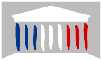
N° 2254
_______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 avril 2005
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION (1)
SUR LES ENJEUX DES ESSAIS ET DE L’UTILISATION DES
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Président
M. Jean-Yves LE DÉAUT,
Rapporteur
M. Christian MÉNARD,
Députés.
——
TOME II
AUDITIONS
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
La mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, est composée de :
M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président ; MM. Philippe FOLLIOT, François GUILLAUME, Vice-présidents ; MM. André CHASSAIGNE, Philippe MARTIN (Gers), Secrétaires ; M. Christian MÉNARD, Rapporteur ; M. Gabriel BIANCHERI, M. Yves CENSI, M. Yves COCHET, M. Pierre COHEN, M. Francis DELATTRE, M. Éric DIARD, M. Gérard DUBRAC, Mme Jacqueline FRAYSSE, M. Louis GISCARD D’ESTAING, M. François GROSDIDIER, M. Louis GUÉDON, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, M. Michel LEJEUNE, Mme Corinne MARCHAL-TARNUS, M. Germinal PEIRO, Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD, M. Christophe PRIOU, M. Jean PRORIOL, M. Jacques REMILLER, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Serge ROQUES, Mme Odile SAUGUES, M. François SAUVADET, M. Jean-Marie SERMIER, M. Philippe TOURTELIER.
TOME SECOND
Volume 1
SOMMAIRE DES AUDITIONS
Les auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des séances tenues par la Mission.
Audition de Mme Muriel MAMBRINI, chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (extrait du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2004) 7
Audition de M. Pierre-Benoît JOLY, directeur du laboratoire de recherche sur les transformations sociales et politiques liées aux vivants (TSV) de l’INRA (extrait du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004) 25
Audition de M. François HERVIEU, chargé d’études à la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales (extrait du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004) 45
Audition du Professeur Roland ROSSET, président de la Commission du génie génétique (extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004) 69
Audition de M. Marc FELLOUS, président de la Commission du génie biomoléculaire et de M. Antoine MESSÉAN, vice-président (extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004 ) 83
Audition du Professeur Jacques TESTART, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), co-organisateur du débat des « 4 Sages » sur les OGM en 2002 (extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004) 103
Audition de M. Frédéric JACQUEMART, spécialiste de biologie médicale, administrateur de France Nature Environnement et membre de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) (extrait du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2004) 125
Audition de M. Pierre-Henri GOUYON, membre du Comité de biovigilance, directeur du laboratoire UPS-CNRS d’écologie, systématique et évolution et professeur à l’université Paris-Sud (extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004) 139
Audition conjointe de M. Martin HIRSCH, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), et de M. Maxime SCHWARTZ, directeur de la programmation de l’Agence (extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004) 151
Audition de Mme Marion GUILLOU, présidente de l’Institut national de recherche agronomique (INRA) (extrait du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2004) 161
Audition conjointe de M. Olivier KELLER, secrétaire national de la Confédération paysanne, M. José BOVÉ, cofondateur, M. Michel DUPONT, animateur de la Confédération paysanne et M. Guy KASTLER, président du Réseau Semences Paysannes (extrait du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2004) 179
Audition de M. François LUCAS, président de la Coordination rurale – Union nationale (extrait du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2004) 199
Audition conjointe de M. Benoît LESAFFRE, directeur général du Centre de coopération internationale en recherche (CIRAD), et de M. Philippe FELDMANN, délégué aux ressources biologiques (extrait du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2004) 205
Audition conjointe de M. Didier MARTEAU, vice-président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et de M. Bernard LAYRE, président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA) (extrait du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2004) 227
Audition de M. Jean BIZET, sénateur, président de la mission d’information sur les OGM constituée dans le cadre de la commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat (extrait du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2004) 241
Audition de M. Arnaud APOTEKER, responsable « campagne OGM » de Greenpeace France (extrait du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2004) 251
Audition de M. Christian BABUSIAUX, ancien président du Conseil national de l'alimentation et coauteur du rapport des « 4 Sages » sur les OGM (extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004 ) 265
Audition de M. Jean-Claude KADER, directeur de recherche et chargé de mission pour la biologie végétale du département des sciences de la vie du Centre national de recherche scientifique (CNRS) (extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004) 275
Audition de M. Philippe KOURILSKY, directeur général de l’Institut Pasteur et professeur au Collège de France (chaire d’immunologie) (extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004) 285
Audition de M. Daniel MARZIN, président de la Commission d’étude de la toxicité (extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004) 295
Table Ronde regroupant des Académies (extrait du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004) 307
Audition conjointe de MM. Georges PELLETIER et Georges FREYSSINET, président et vice-président du directoire de Génoplante (extrait du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004) 335
Audition conjointe de M. Bruno CLÉMENT, directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), M. Victor DEMARIA-PESCE, chargé des relations avec le Parlement à l’INSERM, M. Jean-Antoine LEPESANT, directeur de recherches au Centre national de recherche scientifique (CNRS) (extrait du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004) 351
Audition de M. Gérard PASCAL, ancien président du Comité scientifique directeur de l’Union européenne (extrait du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004) 363
Audition de M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, président du Muséum national d’histoire naturelle, vice-président de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) (extrait du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004) 377
Table ronde regroupant des représentants de semenciers et de producteurs agricoles (extrait du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2005) 387
Table ronde regroupant des associations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs (extrait du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2005) 415
Table ronde regroupant des représentants de groupes agroalimentaires et de grands distributeurs (extrait du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2005) 447
Table ronde regroupant des juristes (extrait du procès-verbal de la séance du 1er février 2005) 477
Table ronde contradictoire sur le thème « Les enjeux sanitaires des OGM » (extrait du procès-verbal de la séance du 2 février 2005) 499
Table ronde contradictoire sur le thème « Les enjeux environnementaux des OGM » (extrait du procès-verbal de la séance du 8 février 2005) 541
Table ronde contradictoire sur le thème « Les enjeux juridiques des OGM » (extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 2005) 575
Table ronde contradictoire sur le thème « Les enjeux économiques des OGM » (extrait du procès-verbal de la séance du 15 février 2005) 607
Table ronde contradictoire sur le thème « OGM / Média et information du public » (extrait du procès-verbal de la séance du 17 février 2005) 643
Audition de M. François d’AUBERT, ministre délégué à la recherche auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2005) 669
Audition de M. Dominique BUSSEREAU, ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité (extrait du procès-verbal de la séance du 22 mars 2005) 683
Audition conjointe de M. Gilles-Éric SÉRALINI, chercheur en biologie moléculaire et membre de la Commission du génie biomoléculaire (CGB), de M. Luc MULTIGNER, épidémiologiste à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et de M. Thierry MERCIER, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (extrait du procès-verbal de la séance du 23 mars 2005) 697
Audition de M. Christian JACOB, ministre délégué aux PME, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation (extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005) 723
Audition de M. Serge LEPELTIER, ministre de l’écologie et du développement durable (extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005) 735
Audition conjointe de Mme Anne-Marie CHÈVRE et de Mme Marianne LEFORT, directrices de recherches à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005) 751
Audition de M. Philippe DOUSTE-BLAZY, ministre des solidarités, de la santé et de la famille (Extrait du procès-verbal de la séance du 30 mars 2005) 771
Glossaire 777
Audition de Mme Muriel MAMBRINI,
chercheur à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves Le DÉAUT
M. le Président : Avant de débuter cette audition, je tiens d’abord à vous informer que nous nous sommes fait, le Rapporteur et moi-même, vos porte-parole devant le Président Jean-Louis Debré. Vous aviez en effet souhaité que le travail de notre mission ne soit pas bâclé, alors que la discussion du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés était initialement annoncée fin octobre. Le Président Debré nous a indiqué que le débat serait reporté au printemps et nous a donc assuré que nous aurions le temps nécessaire pour conduire notre mission. Il nous a également fait savoir qu’il n’était pas opposé à l’élargissement des thèmes de notre mission, et que nous avions entière liberté en la matière.
Je souhaitais, pour notre première réunion, que l’on puisse procéder à une explication de la notion d’OGM avec l’aide d’un chercheur. La présidente de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Mme Marion Guillou, à qui nous nous sommes adressés, a donc chargé Mme Muriel Mambrini, chercheuse au laboratoire de génétique des poissons au centre INRA de Jouy-en-Josas, de réaliser cet exploit.
Mme Mambrini présente sur transparents un exposé sur la transgénèse dont le contenu est repris dans la contribution écrite ci-dessous que Mme Mambrini a remis à la mission
« Cet exposé vise à poser les bases permettant de juger de la faisabilité des techniques actuelles utilisées pour produire les micro-organismes, les plantes et les animaux transgéniques et d’analyser leurs atouts et leurs limites en comparaison des autres techniques d’amélioration des êtres vivants. L’objectif est de fournir les moyens d’identifier la nature des questions qui se posent et se poseront dans le futur.
Après avoir fourni les quelques éléments nécessaires de biologie moléculaire, seront évoqués les moyens naturels de transfert de gènes et décrits les éléments constitutifs du transgène. Nous aurons alors tous les éléments pour analyser les techniques utilisées pour la transformation des organismes et leur évolution pressentie. Enfin, nous comparerons la transgénèse aux autres techniques d’amélioration des organismes exploitées jusqu’alors, sur la base des critères positifs et négatifs associées à chacune d’entre elles.
Eléments de biologie moléculaire
Les protéines, acteurs des fonctions
Les objectifs de la transgénèse sont les suivants :
– ajouter une fonction, par exemple, rendre une plante résistante à un herbicide,
– amplifier une fonction, par exemple, améliorer le potentiel de croissance,
– limiter une fonction, par exemple, limiter les phénomènes de rejet immunitaire,
– marquer les acteurs d’une fonction, par exemple, repérer certaines cellules pour les trier et analyser en détail leurs caractéristiques.
Le mot commun est celui de « fonction ». Les molécules qui œuvrent pour réaliser une fonction au niveau cellulaire sont les protéines (les enzymes, les hormones sont des protéines). Elles sont composées d’un enchaînement d’unités de base, les acides aminés qui sont agencés selon un ordre déterminé. Vingt et un acides aminés différents sont retrouvés dans la nature. L’identité et la fonction d’une protéine sont contenues dans la séquence de leur agencement.
Les acides aminés s’agencent dans l’espace. Ils réalisent des liaisons entre eux permettant à la protéine d’avoir une structure particulière dans les trois dimensions. Changer un seul des acides aminés d’une séquence protéique peut entraîner la perte de sa fonction, également parce qu’elle n’aura plus la même configuration spatiale (exemple d’un anticorps : les « bras » de cette molécule possèdent une séquence et une conformation spécifiques qui lui permettent de se lier avec les protéines étrangères et ainsi de les rendre reconnaissables par l’organisme). Assurer une fonction est donc la capacité de produire des protéines spécifiques et actives, dont la séquence en acides aminés est rigoureusement contrôlée.
Le programme de synthèse des protéines
Si la séquence en acides aminés des protéines est aussi strictement contrôlée, c’est parce que leur production par l’organisme et leur synthèse dépendent d’un programme. Ce programme est contenu dans la molécule d’ADN, dont nous pouvons analyser la structure. En fait cet ADN est simplement constitué de quatre bases, adénine (A), thymine (T), cytosine (C) et guanine (G) portées par des sucres. Comme les acides aminés, ces bases sont capables de réaliser entre elles des liaisons extrêmement spécifiques : A se lie à T et uniquement à T et C à G. Ainsi la molécule d’ADN se présente-t-elle sous la forme d’un double brin – chaque brin étant formé d’un agencement de bases – complémentaire l’un par rapport à l’autre.
Comment passe-t-on de l’ADN formé de quatre bases à une protéine qui peut compter 21 acides aminés différents ? C’est grâce à un code appelé le code génétique. A chaque groupe de trois bases correspond un acide aminé, ce groupe est appelé codon. Toutefois, à un acide aminé peuvent correspondre plusieurs codons, le code génétique est dit « dégénéré ». Il est néanmoins universel car utilisé par l’ensemble des organismes vivants.
L’agencement des bases de l’ADN doit être extrêmement bien gardé et conservé car c’est d’elles que va dépendre le choix des acides aminés qui vont constituer la protéine. La modification d’une seule base peut entraîner l’incorporation d’un autre acide aminé que celui prévu et changer la fonction.
L’ADN sous forme de double brin est une molécule extrêmement stable (par exemple, il est possible de récupérer et d’analyser la séquence d’ADN obtenue sur les vestiges d’organismes disparus). S’il est sous forme simple brin, il est moins stable et cherchera à rétablir la liaison avec une séquence qui lui est complémentaire pour former un double brin. Une autre caractéristique très importante de l’ADN est qu’il est capable de se répliquer strictement à l’identique. C’est un des brins qui sert de matrice à la synthèse de l’autre ; ainsi le programme est-il conservé lorsqu’il est nécessaire de doubler la quantité d’ADN.
La molécule d’ADN d’un individu est unique (par exemple, c’est grâce à elle que l’on peut maintenant identifier des criminels à partir de fragments de tissus). Elle se transmet aux individus qui en sont issus, lesquels héritent de l’intégrité et des particularités de fonctionnement (on retrace ainsi les paternités en analysant les séquences d’ADN). Ce programme est unique pour un individu, et on le retrouve dans toutes ses cellules. Il doit donc comporter toutes les informations nécessaires à la vie de l’individu, à la formation et au fonctionnement des différents tissus si c’est un organisme supérieur.
Ce programme est donc très compacté, le double brin s’enroulant autour de lui-même puis étant compacté dans des protéines. Suivant les organismes, le double brin d’ADN a des conformations différentes et est situé différemment dans la cellule.
Les virus sont constitués d’une information génétique encapsulée dans une membrane leur permettant d’aller d’une cellule à une autre. Ils n’ont pas la compétence de synthétiser leurs protéines et injectent leur information génétique dans une cellule hôte afin qu’elle synthétise pour eux les protéines dont ils ont besoin. Ces protéines permettent l’encapsulation de leur matériel génétique, donc la production de particules virales qui iront infecter d’autres cellules. Certains virus sont capables de faire intégrer leur ADN dans l’ADN de l’hôte afin qu’il y ait une synthèse plus efficace.
Chez les bactéries, la molécule d’ADN est libre dans la cellule. Chez les plantes et les animaux, l’ADN est séparé du reste de la cellule par une membrane, constituant le noyau. L’ADN dans le noyau se présente sous différents aspects. Il peut être sous la forme d’unités séparées où il est extrêmement compacté ; ceci se passe juste avant que la cellule se divise. En effet, avant qu’une cellule se divise, la quantité d’ADN est doublée par duplication, et la même information passe dans chaque cellule fille. Avant la duplication, l’ADN se condense en unités dont les nombres, formes et tailles sont caractéristiques de chaque espèce, ce sont les chromosomes.
Un homme possède 23 paires de chromosomes, les plus connus étant les chromosomes sexuels ainsi que le chromosome 21 qui, lors de cas rares, peut être présent sous forme de triplet provoquant le mongolisme ou « trisomie 21 ». On peut remarquer que chaque chromosome est représenté deux fois ; c’est une caractéristique des organismes autres que les bactéries et les virus. Nos chromosomes proviennent pour moitié de notre père et pour autre moitié de notre mère.
Le programme de synthèse est très conservé, il se transmet à la descendance et il est spécifique d’un individu. Il est identique pour toutes les cellules de l’individu or, les cellules du foie, par exemple, n’ont pas les mêmes fonctions que les cellules du muscle ; le programme étant le même, ces différences s’expliquent par le fait qu’il est « lu » et traduit de manière spécifique suivant les demandes de la cellule.
La séquence d’ADN correspondant au programme d’une protéine spécifique correspond au gène. La « lecture » du gène codant pour une protéine nécessaire à la cellule est un phénomène sous contrôle. Lorsque la cellule a besoin d’une protéine spécifique, elle envoie un signal qui est capté en amont du gène, dans une partie que l’on appelle le promoteur. Le double brin de l’ADN s’ouvre alors dans la partie correspondant au gène et une molécule appelée ARN est synthétisée qui comporte des bases complémentaires de la séquence d’ADN, c’est la phase de transcription. La lecture de la partie de l’ADN correspondant au gène se termine avec un signal appelé « terminateur ». La molécule d’ARN, simple brin, beaucoup plus légère et instable que l’ADN va se déplacer dans la cellule pour que commence la traduction du code en agencement d’acides aminés. Cette petite molécule est en fait un messager, une copie d’une partie du programme central qui sera transféré et décodé par l’usine cellulaire. Une fois le programme traduit, l’ARN est dégradé ; il faudra en transcrire un autre pour que soit produite une autre protéine. Le contrôle des quantités de protéines synthétisées et de la fonction s’effectue donc également au niveau de l’ADN. Lorsqu’il est transcrit, le gène est dit « exprimé ».
Chez les organismes supérieurs, il y a une étape supplémentaire. En fait la molécule d’ADN contient des séquences « utiles » c’est-à-dire qui correspondent à un code permettant l’agencement des acides aminés (les exons), mais ces séquences sont ponctuées de séquences a priori « inutiles » (introns). Chez l’homme, elles représentent une grande majorité de l’ADN. Le gène est donc une succession de ces séquences utiles et inutiles, il est initialement transcrit ainsi puis la machinerie cellulaire élimine ce qui ne correspond pas à des parties comprenant le code qui permettra l’agencement des acides aminés.
Les éléments de base du transgène
La transgénèse est le fait d’intégrer dans le génome d’un individu une séquence d’ADN lui permettant de produire de nouvelles protéines qui confèrent à cet individu de nouvelles fonctions. La séquence d’ADN doit être construite afin de posséder tous les éléments clés permettant la traduction du nouveau code que l’on veut insérer, donc au minimum un promoteur, la séquence correspondant à la protéine que l’on souhaite faire produire (les introns apparaissant a priori inutiles) et un terminateur.
C’est au niveau du promoteur que se trouve le signal de transcription de l’ADN ; certains promoteurs sont activés dans toutes les cellules, d’autres spécifiquement dans un tissu ou à un moment donné d’un processus. Les promoteurs utilisés dans une construction transgénique sont choisis pour contrôler les lieux et les moments d’expression du transgène. (Exemple : la protéine fluorescente verte, est une protéine provenant initialement d’une méduse qui a la particularité d’émettre une lumière verte lorsqu’elle est illuminée par des ultraviolets. Cette protéine est utilisée pour visualiser l’endroit où est exprimé un transgène. Le gène codant pour la protéine fluorescente verte, transféré chez un poisson, et sous contrôle d’un promoteur permettant une expression dans toutes les cellules est retrouvé dans tous les tissus de l’animal, alors que le même gène placé sous le contrôle d’un promoteur spécifique d’un tissu n’est retrouvé que dans ce tissu.)
En ce qui concerne le gène d’intérêt, le code génétique étant universel, a priori, les séquences de n’importe quel organisme peuvent être reconnues par un autre organisme. Ainsi peut-on faire exprimer des gènes bactériens chez les mammifères et inversement. Idem pour les virus. Or les génomes de nombreux organismes sont actuellement en cours de séquençage, ce qui veut dire que la source potentielle de gènes d’intérêt et d’idées de transformations qui peuvent y être associées est en pleine expansion.
Une fois les éléments du transgène choisis et assemblés, il faut trouver un moyen de le transférer dans des cellules qui seront capables de le transcrire et de le traduire. Il est possible de transférer cette petite molécule d’ADN, qui pourra s’exprimer, mais seulement temporairement. Mais si l’objectif est de modifier ou d’améliorer les fonctions d’un organisme, il faut une expression durable du transgène et que cette nouvelle fonction puisse être transmise aux descendants. Pour ce faire, le transgène doit être intégré au génome hôte.
Les transferts naturels d’ADN
Des systèmes de transfert naturels d’ADN existent. Nous avons vu que les virus sont des molécules d’ADN encapsulées n’ayant d’autres moyens d’exprimer leurs gènes qu’en utilisant la machinerie cellulaire d’un hôte. Les virus peuvent ainsi infecter des bactéries, des plantes ou des animaux, mais sont chacun très spécifiques. Pour infecter, ils doivent pouvoir pénétrer dans la cellule hôte et cette étape est très spécifique. Certains virus (rétrovirus) sont, en plus, capables de faire intégrer leur information génétique dans le génome de leur hôte. Cette intégration est permise par l’existence de séquences présentes de part et d’autre de l’ADN viral, qui seront reconnues par le génome hôte, lequel acceptera alors sa césure et l’intégration.
On sait aussi depuis longtemps que les bactéries peuvent échanger de l’ADN, essentiellement sous la forme d’une petite molécule circulaire d’ADN appelée « plasmide », qui est mobile et qui peut passer d’une cellule à une autre. Ces petites molécules permettent de conférer de nouvelles fonctions à la bactérie receveuse, des fonctions avantageuses. Par exemple, les plasmides comportent souvent des gènes de résistance aux antibiotiques. Les plasmides restent souvent libres dans la cellule bactérienne, mais certains ont aussi la capacité de s’intégrer au génome de la cellule hôte. Le passage et l’intégration de plasmide bactérien à la cellule d’un organisme supérieur sont plus rares. Le cas le plus connu est celui d’Agrobacterium tumefaciens, bactérie dont le plasmide est capable d’entrer dans la cellule et le noyau végétal et de s’intégrer à son génome. Ces systèmes sont très spécifiques de certaines populations bactériennes, de même que les possibilités de transfert bactérie/organisme supérieur ne sont possibles que pour un couple d’espèces bien déterminé.
Pour les organismes supérieurs, les échanges d’ADN s’effectuent au moment de la reproduction. Ne peuvent se reproduire et s’échanger l’ADN que des individus interféconds. La limite de ces échanges est donc la barrière d’espèce. Selon la théorie de l’évolution, toutes les espèces dérivent d’un ancêtre et d’un programme commun qui s’est petit à petit modifié. Les grands types de modifications sont les mutations (changement d’une base d’ADN pour une autre), les insertions de séquences entières, les délétions qui sont également des séquences entières. Tous ces éléments sont des facteurs de l’évolution. Des éléments appelés « transposons » sont capables de rendre mobiles des séquences entières d’ADN, de les retirer d’un endroit particulier du génome et de les intégrer à un autre. Le génome humain est rempli de séquences assimilées à des transposons qui sont inactives. On pense que ces transposons ont été des vecteurs importants dans l’évolution des génomes. Des transposons actifs ont été caractérisés chez certains micro-organismes, certaines plantes et insectes. Mais chez les vertébrés, seuls des vestiges ont été identifiés.
La transformation des bactéries
Objectifs des transformations
Les bactéries sont transformées de manière ciblée avec les objectifs suivants :
– Faire fabriquer à la bactérie une protéine d’intérêt en grande quantité, c'est-à-dire l’utiliser comme usine cellulaire. Par exemple, c’est ainsi qu’a pu être produite en grandes quantités l’hormone de croissance humaine. Elle était auparavant extraite d’hypophyses mais la préparation où se trouvait l’hormone purifiée n’était pas toujours exempte d’autres facteurs pouvant se révéler pathogènes. Par ailleurs, les capacités de production étaient limitées par l’abondance de la « matière première ». Dès lors que sont apparues les techniques du génie génétique, il est devenu possible de faire produire cette protéine par des bactéries.
– Améliorer les fermentations des produits alimentaires en modifiant les bactéries afin de les rendre plus résistantes aux pathogènes, qu’elles aient une meilleure croissance, montrent de meilleures capacités d’adaptation.
– De nouvelles applications sont en cours d’étude pour savoir si l’on ne pourrait pas utiliser les bactéries pour produire et véhiculer certains vaccins.
Transformation sans intégration
La première idée pour transformer les bactéries a été d’utiliser leur élément mobile, le plasmide, car on peut facilement le purifier, et y intégrer de nouveaux gènes. Le plasmide transformé est ensuite intégré dans la bactérie et exprime les nouveaux gènes. Il est capable de se répliquer et la bactérie, lorsqu’elle va se diviser, pourra transmettre à ses cellules filles ADN et plasmide. Comme les bactéries ont des capacités de multiplication importantes
– l’Escherichia coli double sa population en 20 minutes –, cette technique permet de produire de grandes quantités de plasmide et, ainsi, de dupliquer le gène ou la séquence d’intérêt que l’on y a intégré. Cette technique est donc utilisée de longue date dans tous les laboratoires de biologie moléculaire qui peuvent ainsi disposer de grandes quantités de la séquence spécifique qu’ils souhaitent étudier.
Après avoir transformé la bactérie, il faut pouvoir sélectionner celles qui comportent effectivement le plasmide. Ce dernier possède en général des gènes de résistance aux antibiotiques, et c’est ce qui est utilisé comme marqueur. Les bactéries ayant intégré le plasmide seront capables de croître dans un milieu comportant de l’antibiotique.
Cette technique permet, certes, d’ajouter une fonction, de faire produire une nouvelle protéine, mais les systèmes plasmidiques sont relativement spécifiques et fonctionnent sur des bactéries qui ont la compétence de l’intégrer ou que l’on modifie pour qu’elles aient cette compétence. Toutes les bactéries ne sont pas compétentes ou ne peuvent être modifiées ainsi. Par ailleurs, le plasmide peut être relativement instable, disparaître ou passer à une autre bactérie compétente sans que l’on en ait le contrôle. Le nombre de plasmides intégrés dans une bactérie est variable, ce qui implique que l’on ne peut contrôler la concentration en protéine que l’on veut faire produire. Il ne s’agit pas d’une modification de l’ADN de la bactérie, ce qui accroît le caractère instable de la transformation. Restent les séquences du marqueur – en général un gène codant pour un antibiotique – qui peut, avec le plasmide, être transféré à d’autres cellules et qui implique que les bactéries devant produire ces protéines devront croître dans un milieu comportant de l’antibiotique pour maintenir le plasmide.
Transformation avec intégration
Certains plasmides sont capables d’intégrer la séquence du gène d’intérêt si ce dernier possède également des séquences homologues à certaines séquences bactériennes. Elles seront reconnues, et la séquence bactérienne du génome hôte sera remplacée par la séquence que l’on souhaite introduire. C’est ainsi que peuvent être introduites des mutations ciblées dans certains gènes. On isole le gène bactérien, on lui introduit la mutation que l’on souhaite, on le place dans un plasmide qui pourra s’intégrer et on transforme la bactérie. Le gène modifié comporte suffisamment de séquences homologues au gène initial pour qu’il soit introduit en ses lieu et place.
L’autre moyen de faire intégrer un nouveau gène est d’utiliser des transposons. Certaines bactéries possèdent des transposons actifs pouvant véhiculer et faire intégrer le gène d’intérêt.
Ces techniques permettent d’ajouter une fonction, de modifier une fonction en pratiquant des mutations ciblées, mais ces systèmes sont relativement spécifiques de certaines espèces bactériennes.
Transformations des plantes et animaux
Objectifs
La suite de l’exposé concerne la transgénèse animale et végétale, les objectifs et les principes des techniques étant comparables, voire identiques.
La transgénèse est pratiquée avec les objectifs suivants :
– Productions pour améliorer les génotypes, accroître leur résistance aux maladies, leur résistance à la sécheresse ou leurs capacités de croissance et également pour créer de nouveaux produits répondant soit à des demandes de santé (vaccination par voie orale), soit à des demandes nutritionnelles (superproduction de vitamine A, vitamine B6, d’acides gras oméga 3).
– Productions pour servir d’usine cellulaire permettant de produire en grande quantité des protéines d’intérêt (production dans le lait ou dans les feuilles).
– Sont également à l’étude de nouvelles applications, comme la production, à partir d’animaux, de tissus transplantables immunocompétents.
Chez ces organismes, le transgène doit être intégré dans une cellule ayant la capacité d’être à l’origine d’un organisme entier.
Il s’agit des cellules sexuelles, ou d’un embryon à son stade le plus précoce, c’est à dire une cellule. Il peut s’agir de cellules d’un tissu déjà différencié auxquelles on donne la possibilité d’être à l’origine d’un organisme entier. Elles existent naturellement chez certains végétaux (bouturage, culture in vitro), mais pas chez les cellules animales. Les équipes travaillent pour arriver à cultiver des cellules ayant ce caractère comme les cellules embryonnaires, ou pouvant aller conquérir les cellules sexuelles, ou encore pour redonner ce potentiel à des cellules adultes. Pour aller de ces cellules à un organisme entier, il faut ensuite soit transférer ces cellules dans un embryon, soit transférer leur noyau, afin qu’il remplace celui d’un embryon à son premier stade de développement.
Quelle que soit l’origine de la cellule à transformer, les techniques peuvent être classées en deux catégories : le transfert direct et le transfert au moyen de vecteur.
• Les techniques :
– La micro-injection. La première technique à avoir été utilisée est la simple injection. Le matériel est relativement simple, il faut une loupe ou un microscope, et un micromanipulateur. La difficulté dépend essentiellement de la taille de la cellule ou de l’œuf. Cette technique est appliquée cellule par cellule, œuf par œuf. La solution contenant la construction transgénique est micro-injectée dans la cellule. Elle est surtout pratiquée sur les embryons, au stade d’une cellule.
– Le bombardement de particules. Les autres techniques permettent des transformations en masse. Il s’agit du bombardement de particules. Le plasmide contenant le transgène est adsorbé sur des microbilles qui sont ensuite bombardées sur les cellules. Ceci permet au plasmide de passer la membrane cellulaire et même la paroi végétale. Cette technique est pratiquée sur des cellules en culture et c’est, en particulier, une des techniques employées pour la transformation des plantes et des ovules.
– L’électroporation et la transfection. Le bombardement pouvant être parfois drastique, il existe des méthodes permettant de passer les membranes cellulaires par perméabilisation : l’application d’un champ électrique (électroporation), la déstabilisation des membranes par l’utilisation d’agent chimique, ou l’utilisation d’agents favorisant la fusion avec les membranes. Ces techniques ont été employées sur des cellules végétales après retrait de leur paroi, sur les cellules en culture, les spermatozoïdes et les ovules.
Les résultats obtenus à ce jour montrent qu’avec ces techniques, le transgène s’intègre, s’exprime et est capable de conférer de nouvelles fonctions et caractéristiques aux individus.
Suivons maintenant ce qui se passe exactement et le devenir du transgène dans le génome hôte. Ces techniques permettent de passer la membrane cellulaire mais pas de transférer le transgène au niveau du noyau. Le transgène peut y parvenir et s’intégrer au génome hôte grâce à des mécanismes cellulaires que l’on ne contrôle pas. En conséquence, toutes les cellules n’effectuent pas cette opération et ne possèdent pas le transgène. On ne contrôle pas le moment de l’intégration, et l’organisme qui se développera à partir des cellules qui auront été transformées ne possédera pas le transgène dans toutes ses cellules. Cet organisme est dit « mosaïque ».
En conséquence, il est nécessaire de réaliser un tri. S’il s’agit de cultures cellulaires on peut utiliser des marqueurs. Ainsi, les gènes de résistance aux antibiotiques ont-ils été couramment utilisés comme marqueur. Les cellules sont cultivées sur un milieu contenant l’antibiotique et si elles peuvent croître c’est qu’elles ont intégré le transgène et son marqueur. Aujourd’hui sont étudiées et utilisées d’autres possibilités de marquage, afin de ne plus transférer de gènes de résistance aux antibiotiques.
Si l’on a transformé des œufs ou des gamètes, le tri s’effectue en analysant la présence du transgène sur les individus issus de ces transformations. Pour qu’il soit transmis, il faut que le transgène soit présent dans les cellules sexuelles. Il sera alors intégré dans les cellules étant à l’origine de l’organisme, mais les cellules sexuelles étant elles-mêmes mosaïques, la transmission du transgène ne sera pas de 50 %, comme attendu, mais inférieure et parfois bien inférieure. Le taux de succès dépend du degré de mosaïcisme de l’animal fondateur, lequel varie suivant les espèces et les conditions de transformation. Par exemple, les souris sont peu mosaïques, le transgène, après transfert, est intégré relativement tôt, pendant le développement, alors que les poissons peuvent être très mosaïques. Il faudra réaliser une nouvelle génération pour avoir un taux de transmission du transgène de 50 % et ainsi avoir une lignée transgénique. Ceci revient à dire que l’investissement permettant de produire une lignée peut être relativement lourd.
Il est possible d’analyser la présence du transgène en purifiant l’ADN de l’hôte, en le coupant, en séparant les fragments et en repérant ensuite les fragments contenant le transgène par hybridation avec l’ADN du transgène que l’on aura au préalable marqué. Lorsque l’on réalise cette étude sur les animaux ou plantes transformées, on constate qu’il existe des fragments de tailles attendues, correspondant à la taille du transgène, mais également d’autres fragments de taille plus importante, qui sont en réalité comme des chaînettes comportant des répétitions de la construction transgénique, appelés « concatémères ». Cela veut dire que le transgène peut être présent en multiples copies. Quel que soit le nombre de copies, il est dans la plupart des cas intégré en un seul site. La multiplication et l’association en chaînettes du transgène s’effectuent donc avant son intégration, qui est dans la majorité des cas un événement unique. On ne sait pas actuellement quels facteurs gouvernent cette intégration, ni si le site d’intégration dans le génome est effectivement aléatoire ou s’il existe des régions privilégiées.
Au bilan, ces techniques permettent de transférer le transgène mais on ne contrôle ni le lieu, ni le moment, ni le nombre de copies du transgène intégré.
Or, le nombre de copies intégrées du transgène influence son expression. On pourrait penser que l’expression est proportionnelle au nombre de copies intégrées, mais ce n’est pas toujours le cas, c’est même rarement le cas. Le génome, lorsqu’il reconnaît des séquences répétées, met en places des systèmes de défense et va inhiber la transcription de ces séquences (on notera que les séquences des virus comportent très souvent des séquences répétées). Par ailleurs, compte tenu du fait que l’ADN va s’apparier à des séquences complémentaires, il se peut qu’il forme des doubles brins avec différentes copies du transgène et forme ainsi des structures compliquées pouvant inhiber l’activation du promoteur et la transcription du transgène.
Ne pas contrôler le site d’intégration du transgène peut avoir des conséquences importantes sur son niveau d’expression. Toutes les régions du génome ne sont pas actives de manière équivalente ; dans certaines régions la transcription est intense, dans d’autres non. Le transgène peut donc subir l’effet de son environnement.
En conséquence, l’expression du transgène est variable et non contrôlée. Afin d’y palier, il est souvent effectué un tri des individus. Ne sont conservés que ceux dont l’événement d’intégration permet la meilleure expression du transgène. Ceci ajoute un coût supplémentaire à la production de lignées transgéniques.
L’autre technique de transformation est l’utilisation de vecteurs, molécules ou structures possédant la capacité de transférer leur ADN à un génome hôte. Ces systèmes, contrairement aux systèmes précédents, sont spécifiques dans la mesure où vecteur et hôte doivent pouvoir se reconnaître mutuellement.
– Agrobacterium tumefaciens : chez les plantes, le vecteur le plus largement utilisé est l’Agrobacterium tumefaciens. Cette bactérie possède un plasmide capable de s’intégrer dans le génome de la plante. On intègre donc le transgène dans le plasmide qui le véhicule ensuite jusqu’au génome hôte. Comme dans le cas d’un transfert direct, il ne se trouve pas dans toutes les cellules, ce qui nécessite de réaliser un tri des cellules transformées. Ensuite le transgène peut être intégré en nombre de copies multiples, le nombre est bien souvent inférieur à ce que l’on peut obtenir avec le transfert direct, mais les dimères sont courants. Enfin, il peut être présent, mais sous forme réarrangée, et parfois on ne retrouve plus la succession promoteur/gène d’intérêt/terminateur initiale, ce qui rend la construction inefficace. Le site d’intégration du transgène n’est pas contrôlé. En conséquence, le transgène a une expression variable et il faut également réaliser le tri d’un événement favorable d’intégration.
– Rétrovirus : les rétrovirus ont le pouvoir naturel d’intégrer leur matériel génétique dans des cellules hôtes. Des vecteurs ont été construits qui conservent les capacités d’intégration du virus, mais où on a remplacé les gènes permettant l’infection par le transgène. Les capacités d’intégration du virus dépendent de son pouvoir infectant. Par ailleurs, la taille de la construction transgénique doit être limitée car ces vecteurs ne peuvent accepter de fragments trop grands. Les rétrovirus sont très spécifiques de leur hôte. Pour certaines espèces il n’existe pas de rétrovirus caractérisés. Des rétrovirus ont été transformés pour perdre leur spécificité d’hôte et sont normalement capables d’infecter n’importe quelle espèce (virus pseudo-typés). Il convient donc de manipuler ces vecteurs, et tout particulièrement ces derniers, avec une très grande prudence. En outre, le moment où l’ADN va s’intégrer n’est pas contrôlé ce qui ne résout pas le problème du mosaïsme.
Les transposons : les transposons ne sont utilisés que chez les espèces où ils sont toujours actifs, nous l’avons vu pour les bactéries, et parmi les animaux, essentiellement chez la drosophile chez qui a été isolé un élément actif. Un transposon comporte des séquences de reconnaissance de sites spécifiques de l’ADN et un gène codant pour une enzyme appelée « transposase » qui permet de scinder l’ADN et d’y intégrer de nouvelles séquences possédant des sites de reconnaissance à leur extrémité. Il s’agit donc d’utiliser cet élément avec un transgène auquel on aura ajouté ces sites. Là encore, la taille du transgène doit être limitée. Chez les vertébrés n’existent que des vestiges. Or des chercheurs ont identifié les raisons pour lesquelles un transposon spécifique était inactif : des mutations accumulées au cours de l’évolution sur le gène avaient inhibé son activité. Ils ont donc modifié progressivement la séquence afin d’inverser les mutations, de réactiver cet élément et de l’utiliser pour accroître l’efficacité d’intégration du transgène.
Au bilan l’utilisation de vecteurs permet de favoriser l’intégration du transgène et ceci en nombre de copies limitées pour Agrobactérium tumefaciens et à une seule copie pour les vecteurs viraux et les transposons. Toutefois, ils ne permettent pas une intégration dans toutes les cellules et n’évitent pas le tri ou la production de générations successives en raison du mosaïsme des fondateurs. Le site d’intégration n’est pas contrôlé. Par ailleurs, seuls les transgènes de taille limitée (4 à 13 000 paires de bases) peuvent être utilisés.
Les recherches sur les techniques sont axées sur l’identification de moyens permettant de transformer les organismes de manière plus contrôlée et plus efficace. On cherche à aller vers une « transgénèse propre », où le transgène pourrait être placé dans un endroit connu du génome et en une seule copie, soit en contrôlant son intégration par des éléments de reconnaissance du génome, soit en triant le « bon » événement d’intégration en transformant des cellules en culture que l’on utilisera ensuite pour donner naissance à un organisme entier (technique utilisée chez la souris de laboratoire mais qui n’a pas encore pu être transférée efficacement à d’autres espèces).
Une autre tendance est de chercher à améliorer les constructions. Les promoteurs peuvent avoir des efficacités différentes. En principe, on peut utiliser les gènes isolés chez d’autres espèces mais, en pratique, ils sont parfois peu efficaces car chaque espèce a une utilisation préférée de certains codons, et aussi parce que ce sont parfois des enchaînements de séquences que l’organisme hôte ne reconnaît pas et dont il va se protéger en inhibant l’expression. Enfin, l’agencement promoteur/gène d’intérêt/terminateur est parfois trop simple pour fonctionner. Il peut manquer des signaux importants et ces introns que l’on pensait « neutres » et sans rôle fonctionnel sont finalement parfois indispensables pour une expression correcte du transgène. Nos connaissances sur l’efficacité de certaines constructions et éléments avancent avec nos connaissances sur le génome. Et chaque nouvelle séquence connue pour modifier ou réguler l’expression est rapidement testée en transgénèse. La tendance est que les constructions transgéniques comportent de plus en plus d’éléments et ont une taille de plus en plus importante.
Comparaison avec les techniques de génétique classique
Depuis longtemps on cherche à améliorer les caractéristiques des espèces produites. Le moyen le plus ancien et le plus classique est la sélection, suivi rapidement par les techniques d’hybridation. Le fait de modifier la séquence du génome est apparu avec la mutagenèse. Toutes ces techniques ont permis la production de nouvelles lignées ou de nouvelles souches utilisées pour la production alimentaire. L’objectif est de comparer leurs possibles et leurs limites à ce que pourrait proposer en principe la transgénèse. La grille de lecture proposée devrait permettre l’analyse comparative de l’intérêt de chaque technique dans un objectif d’amélioration donné.
Le principe de la sélection est d’analyser la variabilité d’un caractère, par exemple la croissance, et de connaître, dans ce caractère, la part attribuable à la génétique et la part attribuable à l’environnement. La part du génétique est évaluée par la transmission du caractère. Les individus les meilleurs sont croisés ensemble, selon des plans permettant de conserver un bon brassage des gènes, et ceci sur plusieurs générations, le gain s’accroissant normalement avec le nombre de générations. Des résultats notables ont été obtenus concernant la croissance, la résistance à certaines maladies, la qualité des productions.
Les atouts de la sélection sont qu’elle est basée sur la fonction que l’on cherche à améliorer, que ceci est réalisé sans aucun a priori sur le/les gènes susceptibles d’en être la cause et que les résultats sont obtenus avec un brassage des gènes en conservant, en principe, une bonne variabilité génétique (limitation/contrôle de la consanguinité).
La sélection a ses limites. Elle ne permet d’améliorer que les caractères pour lesquels on peut mesurer ou identifier, au départ, une bonne variabilité génétique. C’est, par ailleurs, un processus sur le long terme car il faut plusieurs générations de sélection pour obtenir un résultat. Enfin, on ne contrôle pas les autres réponses qui peuvent être associées au caractère (par exemple sélection sur la croissance et engraissement ou affaiblissement vis-à-vis des maladies …).
Le principe est d’associer les compétences de deux espèces pas trop éloignées de manière à ce qu’elles puissent ou que l’on puisse les reproduire ensemble. Par exemple, on peut prendre une espèce de poisson ayant une bonne croissance mais résistant mal à la salinité et une espèce ayant de mauvaises performances de croissance mais capable de croître, même si la salinité est importante. En les croisant, on espère produire une nouvelle espèce qui aura de bonnes qualités de croissance et résistera à la salinité.
La technique a des atouts : étant basée sur la mesure du caractère ou de la fonction, elle peut permettre d’améliorer simultanément deux fonctions, elle est réalisée sans aucun a priori sur le/les gènes qui peuvent en être la cause, les résultats sont obtenus avec un brassage des gènes et conservent, en principe, une bonne variabilité génétique
La technique comporte des limites : l’hypothèse clé est que les caractères seront transmissibles et que l’hybride les aura acquis de manière équilibrée. L’autre hypothèse majeure est que les espèces sont interfécondes de manière naturelle ou provoquée. La fertilité des hybrides est une nécessité si les caractères ne s’expriment pas de manière équilibrée en première génération. La production d’hybrides stériles pose la question de la propriété du matériel génétique initial. A nouveau les réponses autres que celles attendues ne sont pas contrôlées. En outre, en réalisant une hybridation non naturelle, on créé une nouvelle variété ou une nouvelle espèce.
La mutagenèse consiste à faire agir un agent qui produira des cassures dans l’ADN. Ces cassures seront réparées par la cellule, mais parfois avec des bases qui ne sont pas originelles, produisant ainsi une mutation. Un agent mutagène couramment utilisé est le rayonnement ultraviolet. On crée une série de mutations qui sont ensuite analysées en détail : les modifications des caractères ou fonctions des individus issus de la mutagenèse sont analysées et, si possible, corrélées à la partie de l’ADN modifiée. Cette technique a été beaucoup utilisée en recherche fondamentale pour identifier la fonction des gènes. Elle a été appliquée essentiellement pour améliorer certains caractères des micro-organismes des fermentations.
La mesure qui réalisée est basée sur l’analyse des caractères. Les gènes sont ensuite identifiés au cas par cas.
Pour analyser une mutation, il faut pouvoir en mesurer ses effets car on ne peut analyser correctement que les mutations produisant un effet sur les gènes dont on sait mesurer les produits. Par ailleurs, les modifications ne sont pas contrôlées. D’autres mutations peuvent être induites que l’on ne contrôle pas et qui peuvent apparaître silencieuses si nous ne disposons pas des moyens analytiques pour les étudier.
Transgénèse
Face à l’ensemble de ces techniques, il est clair que la transgénèse a comme atout le fait de savoir quelle est la nature de la transformation. L’hypothèse initiale est que l’effet que l’on souhaite produire est lié à l’action d’un seul gène. On a un a priori sur l’effet de ce gène, et on sait a priori quelle est la transformation effectuée. Toutefois, nous l’avons vu, cet atout n’est réel que si l’expression et l’intégration du transgène peuvent être contrôlées. Face à l’hypothèse initiale, il se peut que le caractère que l’on veut améliorer ne dépende pas d’un seul gène et soit la résultante d’actions en synergie de groupes ou de réseaux de gènes. C’est, en fait, bien souvent le cas des caractères de production (tels que la croissance, la résistance à la sécheresse…). La stratégie en transgénèse est alors basée sur la surexpression d’un gène clé, à laquelle l’organisme transgénique devra adapter sa physiologie. Par ailleurs, il existe très certainement d’autres subtilités dans la régulation de l’expression des gènes qui nous sont encore inconnues et qui font que la simple construction promoteur + gène d’intérêt + terminateur ne permettra pas la production d’une protéine efficace.
D’autres aspects doivent sans doute être pris en compte dans l’analyse. Les lignées transgéniques sont uniques, chacune est issue d’un événement d’intégration différent, leur production et leur maintien peuvent nécessiter une étape de croisements d’apparentés, et ainsi introduire de la consanguinité. Par ailleurs la production de ces lignées a un coût important, en outre elles ne doivent pas être reproduites ni disséminées sans contrôle, ce qui suppose qu’elles soient élevées dans des structures spécifiques et/ou vendues stérilisées. Ceci pose également la question de la propriété des lignées.
En conclusion, il est évident que si la question des impacts de la transgénèse doit être évaluée organisme par organisme et objectif par objectif, il n’en est pas moins important de considérer qu’elle a un caractère universel. A priori, dès lors que l’on peut contrôler la production et la reproduction des organismes et que l’on dispose d’outils de génétique, elle peut concerner tous les systèmes de production. D’un point de vue fondamental, c’est un outil unique pour analyser la fonction des gènes et l’utilisation de cet outil rendra possible une meilleure connaissance du génome. Les recherches vont tambour battant et les techniques continuent d’évoluer. Dès lors que le temps du transfert entre le fondamental et l’appliqué se réduit, toutes les techniques émergentes en la matière peuvent être rapidement appliquées. Le principe même de la méthode fait que la frontière entre espèces est dépassée et que la connaissance des effets d’un gène ou des gènes peut se traduire rapidement en objectif d’amélioration. Il faut également analyser les risques, dont certains sont mesurables ou estimables car si l’on connaît la transformation réalisée, d’autres – tel que l’impact sur l’intégrité du génome – ne sont pas mesurables, à l’instar d’autres innovations. La perception de ces risques évolue suivant la nature des bénéfices escomptés.
Face à ces enjeux, les objectifs de recherche sont variés et concernent les biologistes comme les sociologues. Des études sont en cours pour analyser et mettre au point des moyens de contrôle de l’intégration et de l’expression du transgène. La connaissance du fonctionnement du génome et de sa régulation fait également l’objet de recherches intenses. Un grand nombre d’études vise à analyser les impacts afin de mettre en place des moyens de contrôle et d’estimation des coûts en termes d’environnement, de biologie et de qualité des produits. Enfin, des recherches spécifiques sont menées pour évaluer et anticiper la perception des innovations, notamment en terme de génie génétique.
Face aux enjeux que représente ce secteur tant en terme de risques que de bénéfices et compte tenu de la dynamique d’innovation qui l’environne, il semble indispensable de ne négliger aucun des axes de recherche. »
L’exposé de Mme Muriel Mambrini a été suivi d’un échange.
M. Philippe FOLLIOT : Vous affirmez que les micro-organismes OGM constituent depuis longtemps un outil pour la biologie moléculaire. Depuis quand et pour quelles applications ?
Mme Muriel MAMBRINI : Pour l’hormone de croissance, par exemple. Auparavant, on procédait à des injections d’hormone sur des enfants atteints de nanisme, hormone que l’on obtenait à partir de broyats de tissus. Or, le produit obtenu comprenait non seulement l’hormone de croissance qui allait permettre à ces enfants de grandir harmonieusement, mais aussi des substances contaminantes. Désormais, on sait identifier le gène de cette hormone, l’intégrer dans un plasmide et le fabriquer par des bactéries.
M. Philippe FOLLIOT : Il s’agit donc d’un médicament transgénique.
Mme Muriel MAMBRINI : C’est un médicament issu d’une transformation permise par transfert de gène. Les notices pharmaceutiques, elles, font état de « protéines recombinantes ».
M. Louis GUÉDON : Vous nous avez parlé de l’intégration de transgènes dans des cellules de plantes ou d’animaux. Comment contrôle-t-on l’opération ?
Mme Muriel MAMBRINI : Les méthodes pour transférer le transgène sont variées mais, comme nous l’avons vu, elles ne permettent pas, en général, de contrôler l’intégration. C’est la cellule qui décide… En particulier, on ne sait pas pourquoi un gène s’intégrera ou pas. L’intégration est possible pendant une fenêtre de temps, relativement réduite, et variable d’une espèce à une autre.
M. Yves COCHET : On sait que la science progresse par essais et erreurs… Quel pourcentage de réussite avez-vous ?
Mme Muriel MAMBRINI : Tout dépend de l’espèce. Chez le poisson, on enregistre entre 20 et 40 % de succès pour 100 œufs micro-injectés.
M. Louis GUÉDON : Les poissons transgéniques se reproduisent-ils ?
Mme Muriel MAMBRINI : Oui, et ils transmettent le transgène. Au Canada, les saumons transgéniques sont élevés dans un système fermé, confiné, où l’eau est recyclée, de manière à éviter toute fuite vers l’extérieur. Pour éviter que des poissons transgéniques ne s’échappent dans la nature, on peut également les stériliser. Etant donné la forte fécondité de ces espèces et que les souches d’élevages sont interfertiles avec les souches naturelles, la probabilité de dissémination du transgène chez ces espèces est un gros souci.
M. Louis GUÉDON : L’hormone de croissance introduite dans ces poissons est-elle détruite ou assimilée par l’organisme humain ?
Mme Muriel MAMBRINI : Les chances qu’elle soit assimilée ou qu’elle puisse avoir une action dans l’organisme humain sont très faibles.
M. Louis GUÉDON : C’est le fond du problème. Il faut savoir si l’hormone est métabolisée ou assimilée.
Mme Muriel MAMBRINI : Elle ne peut vraisemblablement pas passer la barrière intestinale.
M. Pierre COHEN : Vous nous dites n’avoir aucun contrôle sur l’intégration du transgène. C’est inquiétant…
M. Yves COCHET : Pour le moins... Y a-t-il en particulier des transgènes qui s’expriment sans avoir été intégrés ? Et si oui, dans quel délai ?
Mme Muriel MAMBRINI : Le délai est très variable… Tout dépend de l’objectif de l’opération, de l’espèce et des situations. En la matière, on ne peut procéder qu’au cas par cas. Dans mes recherches, j’ai pu constater que certains transgènes introduits dans un embryon s’exprimaient jusqu’au stade adulte sans pour autant avoir été intégré. Mais il est vrai que l’embryon est un cas très particulier. J’ai du mal à imaginer qu’un transgène mette vingt ou trente ans à s’exprimer s’il n’est pas intégré. S’il est intégré, cela dépend des éléments de contrôle de l’expression, tels que la nature du promoteur, le nombre de copies intégrées et le site d’intégration.
M. le Président : C’est un point qui fait l’objet de trop peu de travaux de recherche. L’intégration d’un transgène peut-elle modifier un métabolisme ?
Mme Muriel MAMBRINI : On ne peut travailler qu’au cas par cas et considérer les effets du produit du transgène, ainsi que les modifications possibles de l’expression des autres gènes. Nous revenons à l’importance du site d’intégration : le transgène a-t-il interrompu un gène, est-il dans une région « neutre » ? De récentes études sur la typologie nucléaire mettent en évidence de plus en plus de régions actives ou non dans le génome. Il faut poursuivre les recherches.
M. Louis GUÉDON : Cela dit, obtiendra-t-on toujours le même OGM en utilisant toujours la même méthode ?
Mme Muriel MAMBRINI : Le produit du transgène sera toujours le même. Seule la quantité produite différera. En matière d’OGM, procéder à une analyse a posteriori et établir un profil de protéines permet d’identifier les impacts potentiels d’une intégration de transgène. Beaucoup de recherches sont conduites dans ce domaine.
Imaginez deux firmes qui produiraient, à partir du même transgène, deux lignées transgéniques. Dans la mesure où l’intégration dans le génome sera différente, la protéine recombinante sera la même, produite en quantités différentes peut-être, mais l’impact sur la production des autres protéines peut être différent.
M. Yves COCHET : Surtout, l’expression du gène peut être différente d’un individu à l’autre. La culture en plein champ de médicaments transgéniques est donc particulièrement dangereuse, dans la mesure où de nombreux végétaux risquent d’être contaminés.
M. le Président : On reparlera de cette question ultérieurement.
M. André CHASSAIGNE : On entend souvent dire que les semences transgéniques ne peuvent pas être réutilisées. Or, votre démonstration démontre plutôt le contraire.
Mme Muriel MAMBRINI : Vous faites sans doute allusion au gène « Terminator ». Produire des semences transgéniques stériles permet de diminuer considérablement le risque environnemental. Cela dit, les hybrides qui sont commercialisés, eux non plus, ne se reproduisent pas.
M. Yves COCHET : L’agriculteur qui devra cultiver des semences transgéniques stériles sera lié par un brevet !
M. le Président : Ce n’est pas nouveau, comme le montre l’hybridation qui a toujours été un phénomène marchand obligeant les agriculteurs à acheter chaque année leurs semences. A l’heure actuelle, très peu d’agriculteurs produisent eux-mêmes leurs semences.
M. Yves COCHET : L’agriculture paysanne le fait. Nous devons absolument auditionner le président de la Fédération française des assureurs pour voir comment assurer le risque de contamination.
M. le Président : Cela est prévu ! Madame Mambrini, nous vous remercions de ces explications.
Audition de M. Pierre-Benoît JOLY,
directeur du laboratoire de recherche sur les transformations sociales
et politiques liées aux vivants (TSV) de l’INRA
(extrait du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Nous accueillons aujourd’hui M. Pierre-Benoît Joly, sociologue et directeur de l'unité TSV de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA).
Après un exposé liminaire, votre audition se poursuivra par les questions des membres de la mission.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je suis très honoré d’intervenir aujourd'hui dans le cadre de cette mission dont nous connaissons tous l'importance. Je ne sais pas si, sur de telles matières techniques, il est d’usage d’auditionner des sociologues, mais je considère révélateur en soi du sujet que vous avez à traiter que l'une des premières interventions soit celle d’un sociologue.
Peut-être escomptez-vous entendre des éléments de sociologie quantitative ou des résultats de sondages. Tel ne sera pas le sens de mon propos qui sera plutôt celui d’un sociologue des sciences et de la sociologie politique. L’axe principal de mon exposé s’attachera aux points posant problème dans le débat public sur les OGM.
A cet égard, nous suivons une règle de méthode qui est l’agnosticisme, c’est-à-dire que nous devons nous intéresser à l’ensemble des positions et des arguments des protagonistes, sans pour autant prendre parti et donner raison à une partie ou à l'autre. En effet, il convient de prendre en compte les positions qui s’expriment dans le débat, la structure du débat, puis d’analyser ces différents éléments. L’impératif que nous nous fixons sur le plan méthodologique est de décrire et d’analyser la façon dont les différents protagonistes s’emparent de ce sujet et interviennent dans la dynamique du débat public.
Mon exposé traitera principalement de trois points. Tout d’abord, à partir d’une comparaison entre la situation européenne et celle des Etats-Unis, je m’intéressai à la question centrale qui est de savoir pourquoi les OGM se sont diffusés aussi rapidement aux Etats-Unis et pourquoi ils posent tant de problèmes en Europe. Je rappelle que les Etats-Unis comptent environ 50 millions d’hectares de cultures d’OGM contre 7 hectares environ en France. Le décalage est donc abyssal. J’essaierai de remettre en cause l’idée reçue selon laquelle les OGM ne posent aucun problème aux Etats-Unis parce que les Américains les auraient acceptés. Je me permettrai de contester cette assertion que Jean-Yves Le Déaut avait reprise dans son rapport
de 1998.
Ensuite, j'en viendrai plus précisément au développement récent du débat public en France. Pour ma part, je considère que nous sommes confrontés à un paradoxe : plus on débat de ce sujet, plus la perplexité de nos concitoyens augmente, alors que le débat devrait éclairer, informer et permettre de dégager l’essence des arguments.
Le dernier point de mon exposé portera sur une expérience de débat sur les essais aux champs, que nous avons conduite à l'INRA pour éclairer la décision de la direction générale.
S’agissant de la comparaison Europe/Etats-Unis, le professeur Tom Hoban de l’université Nord-Caroline a signé un article intitulé « Les Américains ont accepté les biotechnologies agricoles ». Cette acceptation expliquerait les différences importantes dans la dynamique de diffusion des OGM aux Etats-Unis et en Europe.
Sans entrer dans le détail des sondages, cette hypothèse peut être rejetée si l’on se réfère aux arguments suivants. Tout d’abord, la question fondamentale est celle de la définition de l'acceptation. Si par acceptation, on entend un consentement éclairé, cette assertion peut être aussitôt rejetée, puisque les enquêtes d'opinion montrent que le grand public américain est très mal informé sur les OGM. En effet, quand on demande aux consommateurs américains s’ils connaissent, parmi les produits de grande consommation, des aliments contenant des produits issus des biotechnologies modernes – puisque l’expression « OGM » n'est pas officiellement utilisée aux Etats-Unis –, environ 30 à 35 % répondent par l’affirmative, alors qu'ils devraient être 100 %. Quand on leur demande de citer les produits en question, la liste de ceux qu’ils citent spontanément est en grande partie fausse. On constate donc que les consommateurs sont très mal informés et quand on creuse un peu, on s’aperçoit que l’attitude des Américains n’est pas aussi différente qu’on le dit de celle des Français.
Il convient évidemment de rechercher une explication alternative. Après avoir établi une comparaison assez approfondie de la situation américaine, européenne et française, nous avons mis en évidence que le problème public ne se constitue pas du tout de la même façon dans les deux cas.
Je rappellerai très brièvement l’historique du débat sur les OGM. Ce sujet a certes été discuté à l’Assemblée nationale en 1992 dans le cadre de la loi sur la dissémination volontaire des OGM transposant la directive 90/220/CE. Mais jusqu’en 1996, on peut estimer que ce sujet n’a été débattu que dans un cercle très restreint : forums très spécialisés, Commission du génie biomoléculaire (CGB), Direction générale de l’alimentation (DGAL), presse spécialisée, un peu dans les organisations agricoles. Mais il n’y avait pas de débat réel sur les OGM dans les arènes publiques. Par exemple, les journalistes scientifiques des grands organes de presse s’y intéressaient assez peu et quand ils le faisaient, c’était surtout pour relater des nouveautés sur le plan scientifique, avec une attitude relativement positive. Le débat public intervient réellement en 1996 avec la crise de la vache folle, l’arrivée du soja transgénique en provenance des Etats-Unis dans les ports européens. Le quotidien Libération titre, le 1er novembre 1996, « Alerte au soja fou ». Le lien est donc très fort entre la crise de la vache folle et l’arrivée des OGM.
Depuis lors, le débat rebondit avec des thématiques qui prolifèrent. Un premier débat porte sur l’étiquetage, la ségrégation, la traçabilité, puis en 1997/1998, sur la question de l'évaluation des risques, le principe de précaution, la participation des profanes. Dès 1999, le débat s'amplifie avec la question de la dépendance des agriculteurs, du pouvoir de monopole des industries des sciences du vivant, des brevets du vivant, la question des pays en voie de développement. Ces différents points structurent la thématique des OGM, avec, notamment, l'implication de la Confédération paysanne et la campagne contre « la mal bouffe ».
Depuis 1999/2000, le débat se traduit par une contestation très forte du rôle de la recherche, notamment de la recherche publique, et par les interrogations sur la transparence et sur la question des essais au champ.
S’agissant de l’évolution du débat aux Etats-Unis, la différence forte est qu’un débat public important a eu lieu dans les années 80 sur les OGM, débat qui portait sur la façon dont il fallait évaluer les risques des OGM. Entre 1990 et 1998, s’écoule une période très calme correspondant à la phase de très forte diffusion des OGM. Déjà en 1998/99, on compte 20 ou 30 millions d’hectares de cultures OGM. Le décollage de la culture des OGM se situe ainsi dans une apparente absence de débat.
Puis en 1998/2000, le débat refait surface avec la question de l’étiquetage réimportée par Greenpeace aux Etats-Unis, à partir de l’expérience européenne. Greenpeace lance de grandes campagnes contre les entreprises agroalimentaires qui offrent le droit à l’information et au libre choix aux consommateurs européens, mais qui ne le font pas pour les consommateurs américains. En 1999/2000, plusieurs grandes industries de l’agroalimentaire déclarent qu'elles n’utiliseront pas d’OGM dans leurs produits alimentaires. A partir de 2000, on constate un revirement. On aurait pu supposer que la situation basculerait aux Etats-Unis, à l’image de ce qui s’est passé en Europe, mais cela n'a pas été le cas. C’est peut-être un point sur lequel il conviendra de revenir dans la discussion.
Les profils temporels de débat sont certes très différents mais quand on identifie les thèmes traités, on observe que ce sont les mêmes. Le débat sur les OGM comprend trois grandes thématiques :
– la question de l’étiquetage des produits contenant des OGM, question très liée à l’exigence du droit à l’information et à la liberté de choix du consommateur,
– le débat sur les OGM et les choix de développement économique, c’est-à-dire toutes les questions liées à la concentration de l’industrie, à la dépendance des agriculteurs, les enjeux des OGM pour les pays en voie de développement, la question des brevets, etc.
– les controverses sur le choix d’un cadre pour l’évaluation des risques.
Il faut noter qu’en matière d'étiquetage, les mêmes questions sont posées avec des arguments très proches par les groupes exigeant un étiquetage obligatoire des OGM. Mais le traitement de ces questions est tout à fait différent. En Europe, on se situe dans un cadre réglementaire définissant les OGM, sur la base des directives européennes 90/220/CE révisées par la directive 2001/18/CE. La définition du texte est d’ailleurs intéressante par sa référence à des méthodes qui ne sont pas naturelles : un OGM est « un organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ». En fait, il y a un accord très fort de l’ensemble des protagonistes en Europe pour un étiquetage obligatoire des OGM, avec un renforcement du cadre réglementaire.
Aux Etats-Unis, on retrouve des campagnes sur le même thème. Par exemple, « Pure food », un organisme américain très actif dans les campagnes anti-OGM, a diffusé sur son site Internet des photos traitant de la question de l'information. Les premières cibles des anti-OGM concernant l’étiquetage étaient les entreprises d'alimentation pour nourrissons, notamment Gerber, filiale du groupe de biotechnologie végétale et de pharmacie Syngenta-Novartis. La campagne a été très forte, mais avec un résultat tout à fait différent.
Sans entrer dans le détail du débat, un des points discutés a été le précédent de la somatotropine, cette hormone de croissance laitière utilisée aux Etats-Unis mais pas en Europe. L’Etat du Vermont avait introduit, dans sa réglementation, une obligation d’étiquetage du lait produit à partir de vaches traitées avec la somatotropine. Cette réglementation, contestée par les acteurs de la filière de production laitière, a été remise en cause par la cour fédérale. Au final, le Vermont a dû retirer cette réglementation. Ce précédent a donné lieu à un débat juridique très intensif sur ces questions de droit à l'information et d’étiquetage.
Ce sont les mêmes arguments qui sont repris dans le débat sur l’étiquetage des OGM : une logique réglementaire a fait ses preuves et il n’y a pas lieu d’en changer. Elle est fondée sur le consensus scientifique et pas du tout sur la politique. Les consommateurs américains ont accepté les biotechnologies et ceux qui ne les ont pas acceptées peuvent toujours consommer des produits d’agriculture biologique, puisque l’agriculture biologique n’introduit pas les OGM, même aux Etats-Unis, dans ses cahiers des charges.
L'argument fondamental est qu’une réglementation sur l'étiquetage serait sans doute excessive, non justifiée. Elle stigmatiserait mal à propos les OGM parce que non fondée sur des arguments purement scientifiques – ce que les Américains appellent la « sound science », pierre d’angle de toute l’institution réglementaire aux Etats-Unis – et de ce fait, irait à l'encontre de l’intérêt du public. Il est intéressant de voir que c'est l'intérêt du public qui est invoqué pour s’opposer à la réglementation des OGM.
Pour conclure sur cette comparaison, on constate que les Etats-Unis se distinguent très nettement de la France sur un certain nombre de thèmes similaires :
1. Le droit au choix et à l’information du consommateur fait l’objet, en France, d’un consensus très large, mais n’est pas reconnu aux Etats-Unis au titre d'utilité publique.
2. La question de l’absence de bénéfices est systématiquement débattue en France. Les OGM sont souvent considérés comme faisant courir un risque indu car non compensé par des bénéfices pour le consommateur ou l’environnement. Cette question de l’utilité des OGM aux Etats-Unis ne se pose pas du fait que l’agriculture américaine a un projet agro-exportateur et productiviste qui n’est pas remis en cause, alors que le projet productiviste de l'agriculture européenne l’est. C'est bien ce soutien fort pour une agriculture productiviste qui explique que la question de l'utilité ne se pose pas. Le fait que les « farmers » puissent trouver avec les OGM des moyens de production qu’ils estiment plus efficaces est considéré, en soi, comme un argument recevable.
3. En Europe, la question de la réglementation des OGM est structurée par la référence au principe de précaution. Elle comporte un apprentissage de ce qu’est l’incertitude dans l’espace public. L’accent est mis sur les moyens de biovigilance et de suivi, avec une expérimentation et de nouvelles formes d’expertises beaucoup plus ouvertes. C’est un aspect tout à fait nouveau en France, et plus globalement en Europe, alors qu'aux Etats-Unis, il y a plutôt un resserrement des instances et des débats autour de la référence à la « sound science » et de la question de l’indépendance des agences fédérales qui fonderaient leurs décisions sur les seuls arguments scientifiques.
Pour souligner le caractère paradoxal du débat public en France, j’ai dressé une liste rapide des débats et rapports sur les OGM – qui n’inclut ni le second rapport du sénateur Bizet ni le second rapport du député Le Déaut. Aucun sujet n'a fait l’objet d’autant d’attention de la part de différentes instances. Pourtant, lorsqu’on interroge nos concitoyens, on observe une réaction systématique d’incompréhension et de perplexité sur les OGM.
Le débat en France se situe dans des instances structurées, mais closes. De cela, découlent deux grandes faiblesses :
1. Un débat peu relayé par les grands médias comme la télévision,
2. Un débat qui peut donner l'impression d'être très peu lié à la prise de décision.
Ces deux faiblesses sont imbriquées car l’absence d’enjeux peut expliquer le désintérêt des médias.
En revanche, le débat sur la destruction des essais aux champs s'est amplifié depuis l’été 2001, après plusieurs actes de destruction. Cela correspond à une stratégie délibérée de mise en cause de la légitimité des OGM et de judiciarisation du débat. C’est aussi une stratégie assez efficace de captation d’audience via les médias.
Sur ce transparent qui présente des unes du journal Le Monde, il y a une référence assez systématique – ne serait-ce que par les dessins de Plantu ou de Sergueï – aux actions de destruction d’essais. Un des éléments qui enflamme le débat en 2001 est la révélation par l’Agence française de sécurité sanitaire des alimentaires (AFSSA) que les tests effectués sur des semences de maïs montrent que 40 % des échantillons contiennent des traces d’OGM. Puis il y a la déclaration du commissaire Byrne, selon laquelle il faut accepter les OGM parce qu’ils sont là, qu’ils s’imposent et qu’il n’y a pas le choix. C’est un des éléments qui a durci le débat, avec des campagnes très actives de destruction d’essais.
La morphologie elle-même du débat est très intéressante. Dans un premier temps, les essais aux champs suscitent un débat relativement spécialisé qui a lieu dans quelques arènes et qui porte sur des questions importantes, mais très ciblées, du type de la transparence. A partir de 1999/2003, le débat se situe dans ce que les politistes qualifient d’« espace public mosaïques », donc dans différentes arènes, impliquant des acteurs et des enjeux très hétérogènes. Les questions abordent les thèmes très variés : légitimité de la recherche lorsqu'elle est conduite dans l’espace social, responsabilité en cas de problèmes survenant lors de l’essai, contamination et coexistence de différentes formes d’agriculture, organisation de notre système démocratique, rôle de l’élu local par rapport aux administrations centrales dans la gestion de l’autorisation, mise en place et information sur les essais, etc. Il y a une prolifération des thèmes, des acteurs, des lieux de débat et des enjeux.
Il en ressort un débat extrêmement fragmenté et difficile à suivre. L’absence d’un véritable espace de délibération publique explique, en première analyse, cette situation paradoxale : des débats apparemment de plus en plus nombreux mais en même temps une augmentation de la perplexité du citoyen sur la question des OGM.
Un autre facteur est que, comme dans toute controverse sociotechnique, la controverse augmente l’incertitude et l’incertitude renforce la controverse. On a donc une sorte de cercle vicieux ou de spirale vertueuse, selon comment on se place, dont un des risques est d'arriver à une très forte politisation de la science, puisqu’on a une prolifération des énoncés « au nom » de la science. La mobilisation de l’autorité de la science n'est plus l'apanage des industriels ou de l'Etat. Il s’agit d’une ressource utilisée par l'ensemble des protagonistes. C’est un point fondamental dans ce débat. Il est important d’instituer des lieux de débats où l’ensemble des positions peut être pris en compte et discutées. La création des agences est une excellente chose car elle assure une plus grande indépendance de l’expertise tout en donnant les moyens d’une véritable transparence. Mais il nous manque tout de même le lieu de débat sur les enjeux socio-économiques des OGM. C’est une proposition récurrente de différents rapports officiels (par exemple, le fameux « 2ème cercle de l’expertise »). On ne peut que regretter qu’elle soit restée sans effet.
J’introduirai l’expérience conduite à l’INRA par une anecdote. En décembre 1999, le président de LVMH, M. Arnaut, s’arrête sur un titre du Canard enchaîné : « Des bulles transgéniques dans le champagne ». L’hebdomadaire satyrique se réfère à une expérimentation de porte-greffes de vignes transgéniques conduites à Epernay, dans les domaines de leur filiale Moet & Chandon. Aussitôt, il appelle les chercheurs, et l’essai est détruit ipso facto.
Cet essai résultait d'une collaboration entre les chercheurs de Moet &Chandon, l’INRA et le CNRS. La recherche était considérée comme très importante parce qu’on espérait qu’elle pourrait résoudre un certain nombre de problèmes liés à l’utilisation très intensive de produits phytosanitaires sur la vigne et de substituer à ces produits une génétique réputée plus douce. Moins d’une dizaine d'années plus tard, LVMH ne veut pas que son nom soit associé à ce type d’expérience.
Les chercheurs de LVMH se tournent donc vers l'INRA pour que l’institution reprenne ce matériel génétique et continue la recherche. La nouvelle directrice générale, Marion Guillou, nous demande en tant que sociologues de proposer une méthode de concertation sur cette question. Il va de soi que la question ne renvoie pas au seul problème de la prise de décision concernant la mise en place ou non de l’essai. Elle concerne un problème complexe imbriquant des aspects scientifiques, techniques, économiques, symboliques et socioculturels liés au vin. Chacun sait combien le monde du vin est structuré par des représentations s’inscrivant dans une tradition longue et complexe dans la société française.
Nous aurions pu utiliser la méthode de la « conférence citoyenne », utilisée en 1998 sur les OGM, mais nous avons préféré la méthode d’« évaluation technologie interactive » inventée aux Pays-Bas. Au lieu de constituer un groupe de « profanes », comme pour la conférence citoyenne, on constitue un groupe hybride d'une quinzaine de personnes choisies pour la diversité des visions du monde qu’elles représentent. Ce groupe comprend des personnes favorables aux OGM, d’autres hostiles aux OGM, d’autres qui sont neutres. La sélection de ces personnes, après une enquête menée auprès d’une centaine d’individus, s’est faite sur la base d’un certain nombre de critères qui nous semblaient importants pour la structuration de ces visions du monde. Le groupe comprenait six professionnels de la vigne et du vin – des viticulteurs et des techniciens des filières vitivinicoles –, quatre chercheurs de disciplines tout à fait différentes allant de la biologie moléculaire à l'amélioration des plantes en passant par la lutte contre les maladies phytosanitaires, et quatre « citoyens ordinaires ». Ce groupe, pendant six mois, a instruit le problème, délibéré, puis produit un rapport qui a été remis à la direction générale de l'INRA.
Pour nous, ce rapport est tout à fait éclairant. A partir de cette question très précise – « Est-il opportun ou non de faire cette expérimentation aux champs ? » –, le groupe a ouvert la délibération sur des questions extrêmement larges, en insistant beaucoup sur l’importance de la symbolique du vin.
Les membres du groupe se sont posé un grand nombre de questions :
– Comment la recherche définit-elle ses priorités et quelle est la logique d’orientation des choix de recherche ?
– Pourquoi la transgénèse ? Y a-t-il des alternatives à la transgénèse ou bien y a-t-il une mode du « tout OGM » qui fait qu’on ne pose plus la question et que, lorsqu’un problème survient, la seule façon de le résoudre passe par les OGM ?
– En prenant pour cible ce virus du court noué, n’est-on pas sur une course perdue d'avance car on s’intéresse systématiquement aux effets et non aux causes, c’est-à-dire à la nature des systèmes de culture qui provoquent des problèmes phytosanitaires ?
Le groupe nous a très clairement indiqué que les recherches de l’INRA sont peu lisibles. De l’extérieur, on ne comprend pas comment sont définies les priorités, pourquoi le choix a été fait de telle recherche plutôt que de telle autre, etc. Le lien établi entre les moyens investis dans la recherche et les grandes finalités ne ressort pas de façon suffisamment nette.
Par ailleurs, un accord très fort s’est dégagé sur le principe de parcimonie, lié à l’importance de la symbolique du vin. Pour ce groupe, le fait de travailler sur la vigne n’a pas les mêmes implications que de travailler sur le coton ou le colza. Avec la vigne, on se situe tout en haut d'une sorte d’échelle symbolique des plantes. Notre groupe a ajouté une « couche » au principe de parcimonie développé dans le cadre du débat dit des « 4 Sages » de février 2002. Selon ce principe, les expérimentations aux champs étant développées dans un espace social, il convient de ne pas y recourir pour répondre à des questions auxquelles il pourrait être répondu par des manipulations de laboratoire. Notre groupe a considéré que, dans le cadre de ce principe de parcimonie, il ne fallait pas travailler sur un produit tel que la vigne pour produire des connaissances que l’on pourrait produire en utilisant des plantes moins élevées dans l’échelle symbolique.
Sur les quatorze membres du groupe, douze se sont déclarés favorables à l’essai sous des conditions restrictives et deux défavorables, même sous ces conditions. Pour les premiers, la condition essentielle et revendiquée, était que l’accord donne pour la recherche ne puisse être considéré comme une carte blanche pour des autorisations commerciales. Les deux personnes défavorables se sont d’ailleurs opposées à ces essais pour cette raison : elles considéraient que l’INRA n’avait pas la capacité de donner cette garantie.
Le fond de la question débattue par le groupe était, en fait, de savoir s’il pourrait y avoir du vin transgénique à l’échéance concrète d’une vingtaine d’années, alors que la question posée était de savoir si l’on pouvait mener une expérimentation. La délibération s’est bien faite dans ce cadre-ci, mais deux membres du groupe ont considéré que la distinction était quasiment impossible, malgré la bonne volonté et les garanties de l’INRA, et que cet essai serait utilisé comme « cheval de Troie » pour faire entrer les OGM dans la vigne et le vin.
L’institution a donné des garanties et s’est engagée publiquement sur le fait qu'aucun travail visant à la commercialisation ne serait engagé sans consultation des instances professionnelles. Après la remise du rapport du groupe de travail, la direction de l’INRA a décidé de procéder à la demande d’autorisation d’un essai à Colmar. Elle a mis en place un comité local pour discuter le protocole de recherche. Ce comité local comprenait des représentants de différents syndicats agricoles, des représentants de l’interprofession vignes et vins en Alsace, des riverains et des membres d'associations. Les élus locaux étaient invités, mais n'ont pas siégé au comité, ce qui est regrettable.
Environ 50 % des propositions du protocole proviennent des discussions avec le comité, ce qui montre la richesse des discussions entre les membres du comité et les chercheurs. La CGB a ensuite donné un avis favorable. Depuis le mois de mai, nous sommes en attente de la décision du ministère. Les plantations qui auraient dû être faites cet été ou cet automne ne se feront pas, ce qui remet en cause à la fois l’essai lui-même et, plus globalement, cette opération, puisque ce cycle de délibérations publiques autour de cette question est rompu par le silence des ministères compétents. Il est important que je puisse émettre cette critique dans cette enceinte. Il ne s’agit pas de désigner une personne en particulier mais de montrer que le politique a beaucoup de difficultés à organiser une délibération ouverte sur ces questions.
En conclusion, considérer que nos concitoyens sont pour ou contre les OGM est une mauvaise introduction au sujet, comme le démontrent nos nombreux travaux. Considérer qu’une position contre les OGM s’explique par un manque d'information ou d’éducation est également une hypothèse infirmée par de nombreux travaux. Ce n’est pas un manque d’information ou d’éducation qui fait que les OGM constituent une préoccupation essentielle. Certaines oppositions très fortes sont exprimées par différents groupes, pour des raisons liées à la défense de leur identité et de leurs intérêts. Typiquement, la question posée est celle de l'agriculture biologique et des agriculteurs qui veulent faire de la qualité avec des labels non-OGM. L’enjeu de la coexistence des deux systèmes est très fort et présente d’importants problèmes qui ne sont pas réglés.
Comment les régler ? Depuis 2003, il existe des textes européens qui, comme la plupart des textes européens actuels, donnent des objectifs assez précis mais n’indiquent pas comment les atteindre. Il reste un gros travail qui, pour l’essentiel, relève des ministères techniques, mais qui renvoie également à des questions éminemment politiques. Par exemple, la solution allemande consiste à instaurer des distances entre les parcelles OGM et les parcelles non-OGM. Si, dans la réglementation, on introduit une distance de 200 mètres, cela a des implications très fortes, compte tenu de notre organisation parcellaire. Certaines décisions techniques renvoient donc à des questions politiques.
La question de la coexistence est tout à fait importante car, tant qu’elle n’est pas réglée, on ne dispose d’aucun moyen fiable garantissant à nos concitoyens le droit au libre choix et à l'information. La question de la responsabilité est également pendante depuis de nombreuses années et n’est toujours pas réglée. Celle des brevets sur le vivant est aussi très liée à ce débat et n’est pas non plus réglée de façon satisfaisante. Nous sommes actuellement – et heureusement – dans le processus de débat de la directive 98/44/CE, qui aurait dû commencer il y a six ans. Toutes ces questions sont essentielles et le fait qu’elles ne soient pas réglées empêche une évolution satisfaisante du débat public.
En conclusion, je reviens sur la notion d’espace public mosaïques et sur la complexité de l'espace public. Pour avoir une réelle délibération dans l’espace public, la solution est celle d'un débat au Parlement. Les initiatives qui seront prises dans le cadre de cette mission et la perspective de la loi à venir sur les OGM, sont porteuses de nombreux espoirs.
M. le Rapporteur : Je tiens à remercier M. Joly pour son exposé qui nous a présenté clairement une situation qui ne l’est pas.
Dans le cadre de votre exposé, vous avez déjà répondu en partie à un certain nombre de mes questions telles que lien entre les craintes d’une grande partie de la société vis-à-vis des OGM et l’insuffisante information du grand public.
J’en viens à une autre question. La différence d’attitude sur les OGM entre l’Europe et les Etats-Unis pourrait-elle s’expliquer par une acceptation inégale du risque, les sociétés européennes privilégiant la sécurité et le principe de précaution ? Sur ce point, je ne suis pas entièrement d’accord avec la réponse que vous avez donné. Vous avez évoqué l’affaire du sang contaminé en 1991, la crise de la vache folle en 1996. Je ne reviendrai pas sur ces deux événements car tout le monde conviendra qu’ils ont eu une très grande influence sur la suite de la discussion concernant les OGM. La mobilisation du mouvement associatif anti-OGM s’est intensifiée en 1999, des actions spectaculaires ont été menées par la Confédération paysanne puis, par ATTAC. Cette intensification explique-t-elle l'émergence tardive du débat sur les OGM en France, alors que ce débat demeure marginal aux Etats-Unis ?
Autre question : n’existe-t-il pas actuellement une différence de traitement par les médias américains et français du problème OGM, les uns considérant le problème comme circonscrit, les autres au contraire s’appuyant sur le principe de précaution ? Vous avez indiqué que les médias français ne se sont pas tellement emparés de la question des OGM. Or il suffit de lire la presse actuelle pour constater que ce n'est pas le cas. Les dernières actions menées par la Confédération paysanne, comme les destructions de cultures OGM auxquelles on a assisté pendant l’été, semblent avoir eu un effet contre-productif dans l’esprit des Français. Il y a eu aussi la réaction de nombreux chercheurs et de membres de la société civile. Ne pensez-vous pas que la surmédiatisation, dont ces actions de destruction ont fait l'objet, risque de produire un effet contraire à l'objectif recherché ?
Les sociétés européennes sont-elles aussi réceptives à l'argument de la dépendance économique selon lequel les OGM réduiraient les problèmes des pays en voie de développement qu’à l’argument des risques écologiques et sanitaires qui pourraient être liés à l’utilisation des OGM ?
Autre question peu évoquée : comment se déroule le débat sur les OGM en Grande-Bretagne, au Canada et maintenant en Espagne ?
Le problème des OGM semble, en France, dépasser les clivages politiques. En est-il de même aux Etats-Unis ? L'attitude contestataire française actuelle a-t-elle une influence sur l'attitude américaine ? Est-ce qu’aujourd’hui, on se dirige vers une contestation mondiale qui serait uniforme ?
N'y a-t-il pas, en France, une attitude consistant à développer la connaissance des risques potentiels au détriment de la connaissance des bienfaits que pourraient amener les OGM en matière de santé publique, par exemple pour l’hormone de croissance, l’insuline, les vaccins, le traitement des cancers, etc. ? Les cultures OGM ont-elles également fait l’objet d’actions de destruction dans d’autres pays comme les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Espagne ?
Dernière question : une étude a-t-elle été réalisée sur l’origine sociale, politique, professionnelle des personnes contestant les OGM et de celles qui les acceptent ?
M. le Président : Si le rapporteur en est d’accord, nous allons faire un tour de table des questions, puis M. Joly nous présentera une synthèse.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Ma question concerne le fonctionnement de l'INRA par rapport aux OGM. On sait très bien que l'INRA possède des hectares de terrains, notamment à Montpellier, sur lesquels peuvent être menées des expérimentations. Dès lors, quel serait l’intérêt de l’instauration de cette distance de 200 mètres entre les plantations ? A Montpellier, vous avez largement ces 200 mètres, comme je suppose que c’est le cas dans d’autres centres du même type. Auquel cas pourquoi ces expérimentations sont-elles effectuées en plein champ, à côté d’autres cultures ?
Il me semble, en outre, que le problème majeur est que nos concitoyens ont été mis devant le fait accompli et que les élus locaux se révoltent de plus en plus, parce qu'on ne les informe pas des expérimentations en plein champ mises en place sur leur territoire. Au titre du principe de précaution, ils sont en droit de s’interroger sur ce que donneront ces expériences. Je n’aborderai même pas les problèmes liés à la pollinisation, dont on sait bien qu’ils existent. Nous avons déjà eu droit à l'histoire du nuage de Tchernobyl « qui n’a jamais passé la frontière… »
S’agissant des essais sur vignobles, j’aimerais savoir si l’autorisation dont vous avez parlé a été validée pour un essai sur un seul territoire de vignoble.
M. Pierre-Benoît JOLY : Pour répondre tout de suite à votre dernière question, cela concernait cinquante plans sur un terrain INRA à Colmar, en Alsace.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Je conclurai sur cette dernière question. Tous les scientifiques sont-ils d’accord sur ces essais en plein champ ? Je connais déjà la réponse, puisque je connais certains scientifiques, mais j’aimerais que vous le précisiez devant la mission.
M. le Président : Avant de donner la parole à mes collègues pour d’autres questions, je rappelle que M. Pierre-Benoît Joly a été invité par notre mission en tant que sociologue. L’objet de son audition était de dresser le tableau de la situation de manière objective.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je peux répondre à la question de Mme Robin-Rodrigo, mais je ne représente pas l'INRA.
M. François GUILLAUME : Sur ces sujets sensibles, on assiste à la fois à une désinformation et à une politisation véhiculées par la presse. Je prends pour exemple la situation que nous avions connue avec les hormones. L’information, d’ailleurs connue des scientifiques dès le départ, était que les hormones naturelles ne présentaient aucun danger, tandis qu’un certain nombre d’hormones de synthèse devaient être proscrites et d’ailleurs l'étaient…
On peut citer un autre débat, encore vif actuellement, portant sur deux produits utilisés par les agriculteurs, le Régent et le Gaucho. Aujourd’hui, on constate que ces produits ne sont finalement pas responsables de la disparition d'un certain nombre de ruches dans le pays. Moi qui suis agriculteur, j’ai eu un champ de tournesols traités pendant plusieurs années successives au Gaucho. Les ruches qui se trouvaient à proximité n’ont connu aucun problème, même si le miel produit est davantage un miel de transformation que de dégustation.
Aujourd'hui, on constate qu’il n’y a aucun lien entre l’utilisation de ces produits phytosanitaires et la disparition des abeilles. Un seul journal a donné une information convenable sur le sujet, mais elle est restée relativement discrète et n’a été reprise par aucun des autres médias. Dans cet article, il était dit que les apiculteurs étaient productivistes et que, par ailleurs, les souches en provenance des Etats-Unis étaient moins agressives et résistantes, etc. C’est le même problème que l’on rencontre aujourd’hui en France, avec l’information sur les OGM.
Ma question est la suivante : comment dresser un vrai bilan de l’intérêt des OGM ? On sait que la presse, qui vend essentiellement plus de papier que d’information, a des clients en face d’elle et qu'elle doit aller dans leur sens, sinon l’information ne l’intéresse plus. Le premier bilan est une image réelle de la situation. On sait qu’aux Etats-Unis, 80 % du maïs sont issus d’OGM, de même que le coton et on compte sur la planète 70 millions d'hectares de cultures d’OGM.
La deuxième préoccupation est l'intérêt humanitaire et économique des OGM pour les pays en développement qui connaissent des conditions de production très difficiles et aléatoires. Sur chaque hectare de maïs OGM par rapport à un maïs non-OGM, l’agriculteur gagne environ 76 euros l'hectare. Il ne faut donc pas s’étonner de l’ouverture des marchés. Nos semenciers sont dans une situation difficile face à la concurrence. Limagrain est implanté dans d'autres pays du monde où il est possible de développer les OGM sans problème.
Il ne faut pas non plus oublier les bienfaits médicaux à tirer des OGM.
Certes, il existe un problème de biodiversité, mais nous le connaissons déjà avec les croisements. C’est pourquoi des vergers conservatoires ont été mis en place pour protéger les essences premières.
En face des inconvénients présentés, il conviendrait de montrer les avantages car, dans toute découverte, il n'y a pas que des inconvénients. Face à ces difficultés nouvelles, comment faire pour éviter, voire limiter, les incidences négatives du développement des OGM ?
M. André CHASSAIGNE : Je poserai deux questions. Tout d’abord, on ressent une inquiétude très forte dans ce pays qui se traduit notamment par la mise en cause de la recherche. Que pensez–vous de l'impact, dans l’opinion publique, de cette mise en cause alors que la recherche était, jusqu’à présent, un secteur respecté à qui l’on attribuait une éthique très forte ? J’aimerais connaître votre sentiment sur la gravité de cette question.
Par ailleurs, pensez-vous que le débat est véritablement faussé par les « fonds de commerce » politiques qui mettent parfois en exergue des interrogations en décalage avec la réalité ?
M. Pierre COHEN : En prolongement de cette question, vous avez indiqué que le sujet des OGM est celui qui fait le plus l’objet de réflexions et de débats en vase clos. Comme le rappelait Mme Robin-Rodrigo, l'Etat a une certaine part de responsabilités dans cette situation. Alors que des procédures d’autorisation ont été mises en place par les pouvoirs publics pour les expérimentations en plein champ, pourquoi les personnes concernées, notamment les maires, n'ont-elles pas accès à cette information ?
Le deuxième point rejoint le propos de mon collègue Guillaume sur le principe de précaution, mais sous un autre angle. S’il y a un risque, la précaution n'est pas d’arrêter, mais de mettre encore plus de moyens pour déterminer si ce risque est réel ou pas, puis d’entamer un vrai débat pour mettre fin à la confusion qui caractérise le débat. Il s’agit de faire la différence entre les connaissances et l’utilisation d’un certain nombre de ces connaissances pour développer des techniques qui conduiraient à une autre vision économique de la production mais aussi de la façon dont on peut organiser l’alimentation du monde dans les années à venir.
Au-delà, il est également nécessaire d’engager un vrai débat politique et de faire un choix, la question étant de savoir si l’on a assez de connaissances pour le faire. Lorsque je discute avec les chercheurs de l'INRA, ceux que je connais estiment qu’ils ont assez de connaissances et sont sereins.
M. Louis GUÉDON : J'aurais tendance à simplifier le débat : il faut déterminer les avantages et les inconvénients des OGM.
Les avantages qui militent en faveur des OGM sont des rendements très importants, une diminution des coûts de production, la possibilité de nourrir la planète affamée, la résistance des plantes à certaines maladies et donc l’absence de traitements onéreux.
L’inconvénient majeur est le principe de précaution. Comme l’a rappelé M. Guillaume, nous avons connu le veau aux hormones, la vache folle, etc. Nous voulons savoir si, en touchant au vivant par des mutations génétiques, l’OGM va être métabolisé par l’organisme donc détruit, ou bien s’il va agir sur le vivant de celui qui va l’ingérer.
Dans ce débat, quels que soient les aspects sociologiques, l’importance de l’enjeu est telle que la réponse ne sera vraiment donnée que par le débat scientifique et la recherche. Le débat politique doit coller à la recherche et exiger que celle-ci donne des réponses précises, comme nous l’avons vu dans les avancées médicales importantes. Si les grandes épidémies ont été éradiquées dans le monde, c’est parce que la vaccination a été autorisée, mais seulement lorsqu’on a été certain du résultat sur le plan scientifique.
Pour l’anecdote, quand autrefois la vaccine se faisait de bras à bras, je vous rappelle que le collège des Oiseaux et ces demoiselles de la bonne société ont toutes eu la vérole parce que le sergent de la légion, qui était venu avec sa vaccine, était lui-même syphilitique. C’est une bonne histoire que l’on se raconte entre immunologistes, 150 ans plus tard. Pour conclure, quelle est votre position dans ce débat, car n’est-ce pas à la science de donner la réponse devant laquelle nous devons nous incliner.
M. Jean PRORIOL : Je souhaite poser deux questions. Tout d’abord, je suis frappé sur le plan sociologique, pour la frilosité de la communauté scientifique. Vous dites qu'elle a des certitudes mais elle ne les exprime pas et elle refuse quelque peu le débat médiatique. On peut accuser l’Etat, les élus, les multinationales mais, à cet égard, peut-être faut-il remonter à la communauté scientifique qui a aussi des devoirs d’information ? On nous dit qu'elle est plutôt favorable dans son ensemble mais jamais elle ne l'exprime de façon nette et précise, ou pas assez à notre sens, ce qui fausse le débat.
Toujours sur le plan sociologique, en tant qu’élus, nous recevons un certain nombre de lettres ayant pour objet les essais. Avez-vous effectué un recensement de ces documents dont je vous donne un aperçu : « Madame, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je vous invite à prendre, sur un modèle de délibération, des délibérations de votre conseil municipal : Article unique : le conseil invite l’Etat à prendre en compte l’intérêt de la santé et nous demandons au conseil municipal d’interdire tout essai. » Ces courriers sont signés par les « associations partenaires » – les Amis de la Terre France, Greenpeace, Agir, Attac, etc. – mais sont anonymes. Comment analysez-vous cela ? Avez-vous recensé le nombre de délibérations prises et quelle valeur leur accordez-vous ?
M. le Président : Je vais ajouter quelques questions. Pourquoi le débat de 1992 à l'Assemblée nationale, préparé par le rapport Chevalier, s'est-il passé dans l’indifférence générale ? Pourquoi Greenpeace, les Amis de la Terre, France Nature Environnement n'ont-ils pas réagi ? Les seuls à l’avoir fait étaient des scientifiques qui avaient fait circuler une pétition disant que l’on bridait totalement la recherche.
Au niveau sociologique, l’expérimentation en champs ouverts, dans un espace dit public, vous apparaît-elle nécessaire ? Je lie ma question à celle de notre collègue Chassaigne.
Par ailleurs, on voit apparaître aujourd’hui, dans le cahier des charges de l’agriculture biologique, une agriculture non-OGM. Quand cette clause est-elle apparue dans l’agriculture biologique ? Qui a souhaité l'introduire et lier ce label de qualité à l’absence totale d’OGM ?
Vous me citiez tout à l'heure pour dire que l’Amérique n’est pas l’Europe, et vous disiez inversement que l’Europe n’est pas l’Amérique. Vous avez expliqué les différences d’un point de vue sociologique. Je pense qu’en Europe, on assiste à une guerre entre des lobbies industriels d’un côté et des lobbies anti-OGM de l’autre, qui, par idéologie, imposent chaque fois des conditions nouvelles. La bataille d'hier était l'expérimentation en plein champ, celle de demain sera l’étiquetage d'animaux ayant consommé des végétaux fabriqués par des techniques OGM. On me répond que non à Bruxelles, néanmoins je sens venir une nouvelle revendication. Cette longue suite de revendications n’est-elle pas la preuve d'un mouvement très organisé ?
Vous avez indiqué qu’il y avait sans doute un manque d’information et d’éducation. Pour ma part, je pense qu’il s’agit d’un argument de personne éduquée. Comment des évaluations sérieusement effectuées en milieux clos peuvent-elles lutter contre des actions surmédiatisées ?
M. Pierre-Benoît JOLY : Comme me l’a proposé M. le Président, je vais tenter de faire une synthèse. En préliminaire, je peux dire que toutes ces questions me semblent très pertinentes mais très vastes. Si jamais j'omets de répondre à certaines d'entre elles, je me tiens à la disposition de la mission pour lui transmettre un rapport écrit.
Concernant les questions de M. Guillaume qui renvoient à la question du Rapporteur sur des comparaisons internationales, il faut citer l’expérience très intéressante de la Grande-Bretagne qui a organisé un grand débat national sur les OGM. Cette expérience s’est déroulée en 2002, 2003, voire 2004 et s’est traduite par plusieurs rapports faisant le point sur les avantages et les inconvénients des OGM et sur la manière dont on peut mesurer les risques. Le dossier est très fouillé sur le plan scientifique et économique et comporte les résultats d'une expérience très originale, menée en Grande-Bretagne, sur l'effet de la culture d’OGM sur la biodiversité.
Il sera très important pour la mission de prendre connaissance à la fois des rapports et de l’expérience de ce grand débat public, puisque des dizaines de milliers de personnes ont été convoquées pour des débats locaux. Je pourrai vous communiquer le nom de collègues sociologues qui travaillent sur cette expérience et qui pourront vous donner toute l’information pertinente. Sur les sites Internet dont je vous donnerai les noms, vous pouvez récupérer les rapports ainsi qu’une analyse du déroulement de ces débats et de son impact dans l'espace public.
La FAO1 a récemment publié un rapport très intéressant sur les intérêts humanitaires des OGM. Ce rapport conduit à renvoyer dos à dos les pro et les anti. En effet, les OGM, à court terme, ne sont pas la solution pour éradiquer la faim dans le monde car il s’agit d’un problème de répartition de la richesse. Marcel Mazoyer a coutume de dire que, sur les 800 millions d’hommes qui souffrent de la faim, environ 600 millions sont des paysans désargentés. C’est là qu’il faut intervenir et ce problème ne sera pas résolu avec les cultures d’OGM. Ce rapport de la FAO indique aussi que, à vingt ou trente ans, l’utilisation de la biologie et de la génétique moderne, et pas seulement les OGM, apportera une contribution majeure à la production agricole. La génomique comporte en effet des enjeux extrêmement importants.
Vous m'avez également questionné sur la communauté des chercheurs. Je comprends à la fois vos questions et vos inquiétudes. De nombreux chercheurs, très impliqués dans les recherches pointues en biologie moléculaire, ont vu d’un très mauvais œil, dans les années 90, les premières diffusions de cultures d’OGM qu’ils qualifiaient de « brouillons ». Pour eux, ces cultures n’avaient pas d’intérêt économique évident et elles posaient des problèmes qu'on ne savait pas analyser et résoudre. Par exemple, on utilisait alors des gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques qui ont été par la suite interdits en Europe. Il y avait aussi le problème des flux de gènes et la question complexe de la dynamique des agrosystèmes dont les effets secondaires peuvent rendre inefficace un produit très efficace. Quand les promoteurs de la bio-industrie et des OGM ont fait pression, dans les années 80, de nombreux chercheurs ont redouté les effets, dans l’espace public, d’une promotion jugée trop précoce.
Aussi, le débat est historiquement marqué par une certaine suspicion à l’égard des OGM. J’adhère à votre position consistant à essayer de montrer quels sont les vrais enjeux. Ce n'est pas simple car le débat se développe avec sa propre dynamique et il est vrai qu’il y a des « fonds de commerce » installés sur lesquels je n'ai pas de jugement moral. Ils existent et quand je dis que le débat est en fait un « espace public mosaïques » avec des acteurs très hétérogènes défendant des enjeux hétérogènes, c'est une façon un peu plus éthérée de dire qu'il y a des fonds de commerce. Ces derniers continueront car il y a des relais, des habitudes. Je discute beaucoup avec les journalistes scientifiques. Ils sont très inquiets et partagent tout à fait votre critique sur la façon dont les médias traitent le sujet. Les discussions sont très dures au sein de l’association des journalistes scientifiques et il ne leur est pas du tout facile d’instruire ce dossier.
M. le Rapporteur, vous m'avez interrogé sur les influences réciproques entre l’Europe et les Etats-Unis. Pour ma part, le scénario auquel je souscrirais le plus est celui de l’organisation de la coexistence entre deux systèmes qui vivent sur des valeurs et des normes de fonctionnement différentes. Aux Etats-Unis, le choix a été fait de ne pas étiqueter les OGM. Il y a beaucoup de discussions à ce sujet, y compris de nombreux projets de lois d’origine démocrate et républicaine. Je ne sais pas, avec l’évolution de la situation politique des Etats-Unis, si aujourd’hui on va vers un clivage démocrate/républicain sur ces questions. Il est vrai que sur certains sujets, comme le changement climatique et les cellules souches, on peut voir des différences fortes entre les deux partis, et l'administration Bush a montré à plusieurs reprises qu’elle prenait des décisions allant à l’encontre de la communauté scientifique.
M. le Président : Elle a toutefois fait progresser les fonds du NIH2, par exemple.
M. Pierre-Benoît JOLY : Certes, mais c'est autant le fait du Congrès que celui de l'administration. Sans aller plus loin dans ces considérations, il me semble que les clivages politiques autour de la question des OGM ne sont pas très différents. Il y a une forte adhésion à l'utilisation des OGM chez les démocrates comme chez les républicains. La pierre de touche sera donc l'organisation de la coexistence de deux systèmes différents.
L'enjeu se noue autour du protocole de Carthagène, qui est la reconnaissance des positions européennes sur le plan international, c’est-à-dire les moyens d’identification des OGM dans les flux transfrontaliers. Une très large majorité de pays adhère au protocole de Carthagène qui reste à mettre en œuvre. Les Etats-Unis étant opposés à cet instrument, un rapport de force va se nouer. Cette question est actuellement devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des mémorandums sont disponibles.
M. le Président : Dans le cadre de mon rapport sur les biotechnologies, j’ai également abordé ces questions. Aux Etats-Unis, lorsque j'ai posé la question du protocole de Carthagène, il m’a été répondu que le champ d’application de ce protocole était beaucoup plus étroit que le champ visé par l’OMC.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je pourrais vous donner des informations à ce sujet. Le protocole de Carthagène vise les organismes vivants modifiés, soit un champ très large, mais il faudrait savoir précisément quel était le contexte de cette remarque.
Plusieurs questions concernaient les orientations de recherche et le fait qu'il puisse y avoir en Europe un déséquilibre entre les recherches consenties sur la question des risques et la question sur les bienfaits. Je crois qu'il faut sérier les problèmes. Tout d’abord, sur le plan informatif, l’Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire (AFSSA) a produit récemment un document d’expertise collective faisant le point de ces questions, à partir de l'ensemble des connaissances et des positions établies sur ce sujet. En gros, on voit que l’utilisation des OGM présente des avantages potentiels en terme de santé, notamment liés au fait qu’on peut avoir moins de résidus de pesticides ou de mycotoxines. Cela commence à se savoir.
Mais cela ne concerne pas la production de protéines thérapeutiques via les plantes. Sur ce point, la communauté scientifique est au contraire très réservée, et la question a fait l’objet de beaucoup de discussions aux Etats-Unis. A mon avis, il y a plutôt un retour en arrière car si ces protéines thérapeutiques ont un effet très fort, le fait de les disséminer dans l’environnement, sachant comment se croisent les plantes, n'est pas forcément opportun.
M. le Président : Qui faudrait-il interroger sur le sujet des protéines végétales ?
M. Pierre-Benoît JOLY : Le professeur Fellous, président de la CGB, est le mieux à même de vous répondre. Je sais qu’il a exprimé plusieurs fois cette position en indiquant que l’on pouvait gérer les problèmes agroécologiques, mais que diffuser ce genre de gène dans l’environnement pouvait présenter des risques difficilement maîtrisables.
M. le Président : Il avait néanmoins autorisé Meristem Thérapeutics dans le Puy-de-Dôme à cultiver une plante qui produisait de la lipase pancréatique.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je peux vous donner d'autres contacts. La revue Nature a commis plusieurs éditoriaux sur cette question.
S’agissant de l’équilibre entre le travail réalisé sur les risques et celui réalisé sur les bénéfices, je ne porterai aucun jugement de valeur. Je laisse le soin à la présidente de l’INRA, que vous auditionnerez, de vous répondre sur le fond.
Toutefois, du point de vue de la recherche, les questions posées par la controverse ont ouvert de nouveaux chantiers de recherche. La question d'une meilleure connaissance a priori des impacts des innovations agricoles est à poser. De plus en plus, l’agriculture ne sera légitime que si l’on corrige les effets des innovations après les avoir constatés et si tout est fait pour prévoir ces effets et en gérer au mieux les impacts socio-économiques et environnementaux. Il est clair que cela ouvre des champs de recherche très importants sur la modélisation agroécologique. La façon dont les chercheurs travaillent aujourd’hui sur la coexistence avec ce type de modélisation est une question très importante. Nous conduisons à l'INRA l'une des meilleures recherches sur ce point.
L'INRA – très clairement depuis la nomination du président Paillotin – considère qu’en tant qu’organisme de recherche publique, il a pour mission principale de fournir une expertise pour la décision publique. Lorsqu’il peut y avoir conflit d’intérêt entre sa mission d'innovation et sa mission d'expertise publique, c'est la dernière qui est privilégiée. C’est ainsi qu’à partir de 1996/1997, certaines recherches sur des plantes du colza résistant aux herbicides ont été arrêtées car on considérait que, tout en produisant dans le même temps les évaluations sur leurs effets environnementaux, ces recherches étaient contre productives pour l'INRA et pour l’instruction scientifique du dossier OGM.
On m’a demandé pourquoi, si les chercheurs sont tous d’accord, ils ne le font pas plus savoir ? Je peux vous assurer que nombreux ont été les chercheurs qui ont mouillé leur chemise pour aller au débat public. Il faut leur rendre justice car ils l’ont fait courageusement, avec un esprit d’ouverture au dialogue. Nous sommes vraiment très sollicités pour intervenir sur les OGM et si je répondais à toutes les sollicitations, il me faudrait faire une intervention par semaine. Je vais à la Confédération paysanne à Blois, puis j’ai une demande du Centre des jeunes agriculteurs dans la Vienne. Devant ces demandes, les chercheurs n’ont pas compté leur temps.
La question qui peut se poser est celle de l'institution qui ne renvoie pas un message lisible. Il me semble – mais c'est mon avis personnel – que c'est plutôt à l’AFSSA d'organiser ce type d’évaluation et non pas à l'INRA de prendre une position pour ou contre les OGM. D'ailleurs, dans la philosophie européenne sur les OGM, il ne s’agit pas de dire que l’on est pour ou contre, mais d’analyser les OGM au cas par cas et dans une situation donnée. Une variété intéressante aux Etats-Unis peut ne pas l’être en France, la prévalence de la pyrale n’étant pas la même, notre organisation parcellaire étant spécifique, les filières de qualité devant être défendues et l'association entre OGM et qualité pouvant poser problème, par exemple pour des producteurs de foie gras.
Dans le Sud-Ouest, par exemple, avec tous les labels qualité et les enjeux qui y sont liés, l'utilisation des OGM n'est pas évidente pour les producteurs eux-mêmes. C'est un choix économique dont ils doivent connaître toutes les données.
On pourrait aussi discuter de la transparence et du rôle des élus locaux. Nous sommes confrontés à une tradition d’absence de transparence. La notion de transparence commence difficilement à faire son chemin mais dans un contexte de très forte controverse. Les responsables de la DGAL sont, à juste titre, très clairs sur ce point : s’ils indiquent le lieu des essais, ceux-ci seront aussitôt détruits. L'apprentissage de la transparence est donc difficile. Par exemple, les responsables de Biogemma me disent que chaque fois qu’ils implantent un essai, ils organisent maintenant systématiquement des débats locaux, ce qui n’empêche pas les destructions. Passer d’un système relativement fermé et opaque, à un système beaucoup plus ouvert ne se fera pas ipso facto du jour au lendemain. Un certain nombre d’acteurs – on l’a dit – font des OGM leur fonds de commerce et il n’y a aucune raison pour qu’ils s’arrêtent. Il faudrait qu’une autorité reconnue s’exprime sur cette question. Mais cette autorité peut-elle provenir, comme autrefois, du scientifique qui monte à la tribune et impose son point de vue ? Je crois que cela n'a plus cours. Aujourd'hui, il faut des espaces légitimes et crédibles de construction de cette autorité.
C’est pourquoi le rôle de l’AFSSA est très important, car ce type d'agence est à même de produire cette parole avec une certaine autorité. Quant au travail que vous accomplissez, il est essentiel car la représentation nationale doit aussi s’exprimer sur ces questions.
M. le Rapporteur : Existe-t-il une étude sur l’origine sociale et professionnelle des « pour et contre » OGM ?
M. Pierre-Benoît JOLY : Les grands sondages d’opinion donnent des informations sur les personnes qui ont répondu. Il existe aussi des enquêtes plus microsociologiques. Par exemple, un rapport réalisé sur les profils des militants d'ATTAC et de la Confédération qui détruisent les essais, révèle qu’ils sont tout à fait différents. Au sein de la Confédération paysanne, on retrouve des personnes dont certaines ont de très bas revenus. Si l’on se réfère aux déclarations de revenus des paysans de la Confédération paysanne ayant détruit des essais, devant le tribunal, on observe que ceux-ci étaient systématiquement en dessous du SMIC. Une partie du débat se joue donc autour de personnes que l’on pourrait qualifier de « laissés-pour-compte de la modernisation ».
M. le Président : Pourriez-vous nous faire une petite note sur l'étude sociologique concernant les semences biologiques ? Quand vous concluez que ce n’est pas par manque d’éducation et d’information que certains sont contre les OGM, ne pensez-vous pas que cela peut-être dû aussi à une surmédiatisation ? En d’autres termes, la prise de position, aujourd’hui très tranchée, d'un certain nombre de personnes totalement opposé aux OGM, qui refusent l’expérimentation et demandent un étiquetage total, n'est-elle pas le fait, à un moment donné, d'une surmédiatisation d’un sujet qu’ils ne connaissent pas ? C’est une folie de dire que l’on est contre les OGM, il faut les examiner au cas par cas, et peut-être y en a-t-il des bons et des mauvais.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je rappelle que, selon Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas et que John Dewey, en 1927, considérait que, dans une société complexe, l’opinion publique est une notion insaisissable.
En tant que sociologue, je vous recommanderai d’être très attentifs à cette notion problématique et qui donne à voir des choses contradictoires. On fait souvent l’équivalent entre l’opinion publique et les sondages d’opinions, ce qui est, à mon sens, une erreur, un raccourci. On peut ainsi s’étonner de voir que 90 % sont contre les OGM, tout en étant contre José Bové qui détruit les essais.
M. Jean PRORIOL : Ils sont 70 %.
M. Pierre-Benoît JOLY : Certes, on peut avoir 74, 80 ou 85 %, mais cela dépend aussi de la façon dont est posée la question. Il y a plus de sondages d’opinion sur les OGM que de débats sur les OGM.
Vous avez raison de dire que des positions s’expriment et sont reprises dans l’espace public. Pour un certain nombre d’acteurs, il est clair que le sujet OGM est un moyen de faire pression sur d'autres dossiers, mais c’est quelque chose de classique. Par ailleurs, il ne faut pas confondre un sondage d’opinion avec l'opinion au sens « perception » et « attitudes » de nos concitoyens. Tous les travaux que nous avons réalisés à partir des méthodes de « focus group » montrent que le fait de poser la question « pour ou contre » n'est pas pertinent.
S’agissant des relations entre la science et la société, il convient, là aussi, de bien sérier les problèmes. Quand on interroge les citoyens sur leur attitude vis-à-vis de la science, la réponse est très majoritairement positive. Il y a une différence entre l’opinion vis-à-vis de la science et l’opinion vis-à-vis de certaines applications et technologies. On constate une plus grande vigilance vis-à-vis de la science lorsqu’elle s’exprime dans ces domaines. Il faut être très prudent lorsque l’on dit que la population tourne le dos à la science.
S’agissant de l'INRA, et cela répond un peu à vos questions, il y a plusieurs fondamentaux sur lesquels l’institut est conduit à réfléchir. Sa mission première est de produire de la connaissance. Si des expérimentations aux champs pour produire de la connaissance sont nécessaires, il convient d’expliquer pourquoi, même si certains leaders d’opinion sont opposés à cette position. Il faut défendre cette position, mais en l'explicitant dans le débat public. A cet égard, les positions de l’INRA sont très claires : parce que nous sommes un institut de recherche agronomique et que nos recherches n'ont pas vocation à rester dans le milieu confiné des laboratoires, nos recherches ne peuvent pas être pertinentes sans expérimentations au champ. Il convient d’appliquer le principe de parcimonie et de prendre toutes les précautions nécessaires mais, dans de nombreux cas, l’expérimentation s’avère incontournable. Cette position a été réaffirmée publiquement à différentes occasions.
M. le Président : Je vous remercie pour toutes ces informations.
Audition de M. François HERVIEU,
chargé d’études à la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
(extrait du procès-verbal de la séance du 10 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Nous accueillons aujourd’hui M. François Hervieu, chargé d’études à la Direction générale de l’alimentation (DGAL) auprès du ministre de l’agriculture, qui va nous faire une présentation des OGM, sous l’angle juridique, après quoi nous procéderons à l’échange habituel de questions/réponses.
M. François HERVIEU : Je suis ingénieur du génie rural des eaux et forêts et universitaire, titulaire d’un doctorat en sciences de l'université Paris 11. J’exerce actuellement les fonctions de coordinateur national du contrôle et de la biovigilance en matière d’OGM pour le compte du ministère de l’agriculture. Pendant quatre ans, j’ai rempli les fonctions de secrétaire de la Commission du génie biomoléculaire.
J'ai une vision assez générale de la thématique puisque j’étais en poste sur des dossiers relevant de l’évaluation des risques et que j’exerce désormais des missions de gestion du risque, de contrôle et de surveillance biologique du territoire.
Je vous propose de faire un tour d’horizon rapide de la réglementation et d’abord, de reprendre les éléments de contexte historique nécessaires à la compréhension de la législation actuelle.
Je rappellerai quelques dates clés de l'histoire scientifique depuis la découverte de l’ADN et de sa fonction : les premiers OGM ont été obtenus entre 1973 et 1981, en 1973 pour les bactéries, en 1981 pour les animaux et en 1983 pour les plantes.
Au cours de cette évolution scientifique et technique, on constate qu’une partie de la communauté scientifique prend conscience, dès 1975, de l’enjeu de ces technologies. Emerge alors le souci de mettre en place une instance régulatrice au niveau international pour encadrer le développement de technologies, dont l’immense potentiel peut engendrer des actes de malveillance dans le développement de certains types de produits.
Dès le début des années 80, notamment sous l'égide de l'OCDE, se développe une démarche de construction réglementaire, puis l’installation d’une réglementation spécifique des OGM aux Etats-Unis. En France, notre système est un peu hybride puisque les OGM ne font pas l’objet d’un dispositif juridique formel, mais plutôt d’un encadrement à caractère volontaire, avec la création de la Commission du génie génétique, première commission consultative dont la vocation concerne essentiellement les micro-organismes.
Cette démarche sera poursuivie, au niveau national, par la constitution, en 1986, de la Commission du génie biomoléculaire qui va traiter, à la différence de la première commission, de l'impact des OGM sur l'environnement et des risques liés à la dissémination. A la même époque, a lieu la première dissémination volontaire d’OGM en France. Cet exemple français sera largement utilisé, puisque les deux directives adoptées en 1990 s’inspirent des grands principes établis en France. Ces deux directives ont deux vocations distinctes :
– La première concerne l'utilisation des OGM en milieu confiné. Elle n’encadre que les micro-organismes génétiquement modifiés et conduit à l’obtention d'agréments d’utilisation en milieux confinés. La loi française de transposition de la directive a élargi sa portée à l’ensemble des OGM utilisés en milieu confiné.
– La seconde directive cadre, 90/220/CE, concerne la dissémination volontaire dans l'environnement, par opposition à l’utilisation en milieu confiné, et permet l’obtention d’autorisations de disséminations volontaires d’OGM dans l'environnement. Elle ne concerne que les OGM, mais tout type d’OGM et quel que soit le secteur d’activité.
Cette directive générale avait vocation à disparaître pour être progressivement remplacée par d’autres textes sectoriels. En 1993, est adopté un règlement communautaire encadrant la mise sur le marché des médicaments et des médicaments vétérinaires. Ce règlement ne porte que sur le dispositif de mise sur le marché qui est centralisé au sein d’une agence européenne d’évaluation et d’encadrement de la mise sur le marché des médicaments et des médicaments vétérinaires.
Cette démarche de sectorialisation se poursuit avec, en 1997, l’adoption du règlement appelé « Novel food », qui englobe l’ensemble des ingrédients alimentaires et les produits destinés à la consommation humaine, quels qu’ils soient, y compris les OGM. Elle prend en compte tout type de nouvel ingrédient. Est considéré comme « nouvel ingrédient », tout produit n’ayant pas un long historique d’utilisation sûre sur le territoire de l’Union européenne. Cela peut également concerner les fruits exotiques nouvellement introduits sur le territoire de l’Union.
Dès l’origine, avait également été adopté le principe d’un calendrier de révision fixé à dix ans. En conséquence, la directive 90/219/CE est modifiée en 1998 dans le sens d'une simplification des procédures, ce qui conduit à la directive 98/81/CE et, en 1997, est engagé le travail de révision de la directive 90/220/CE qui se traduit par l’adoption, en 2001, de la directive 2001/18/CE. Aucune modification n’est apportée aux principes généraux. L'objectif principal est maintenu d’assurer un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé publique – deux aspects intimement liés – et cet objectif sera conservé dans toutes les législations qui seront adoptées à partir de 1990 jusqu’à nos jours.
Un autre objectif est l’harmonisation des législations au niveau communautaire, dans le cadre du marché intérieur. Le principe général est de subordonner toute utilisation d’OGM, en milieu confiné ou dans le cadre d’une dissémination volontaire dans l’environnement, à une autorisation préalable, laquelle ne peut reposer que sur une évaluation rigoureuse du risque pour la santé publique et l’environnement.
La directive 2001/18/CE n'a pas modifié substantiellement les définitions que proposait déjà la directive 90/220/CE. Il s'agit d'encadrer une certaine catégorie de produits et d'organismes, un « organisme » étant pris comme étant celui qui est capable de se multiplier, de se reproduire et de transférer son patrimoine génétique. Cet organisme est obtenu selon des méthodes très particulières définies par la législation.
La dissémination volontaire, par opposition à l’utilisation en milieu confiné, concerne une introduction intentionnelle dans l'environnement sans mesure de confinement. Des nuances sont possibles mais la différence importante entre les deux concepts est explicite.
La mise sur le marché est définie comme la mise d’un produit à disposition d’un produit, à titre gracieux ou onéreux. La mise à disposition d’organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche sous couvert d’une autorisation délivrée dans le cadre de la partie B de la directive 2001/18/CE ou d’un agrément d’utilisation en milieu confiné en application de la directive 90/219/CE n’est pas considérée comme une mise sur le marché.
Pour l'évaluation des risques, un ensemble de textes et de documents obligatoires est prévu qui, par exemple, imposent aux opérateurs de répondre à un ensemble de questions pour que l’évaluation du risque soit la plus complète et la plus rigoureuse possible.
A cet égard, la directive 2001/18/CE apporte une définition plus précise de ce que l’on entend par « évaluation du risque » en indiquant qu’elle doit concerner des effets directs et indirects, immédiats ou différés, alors qu’auparavant, l’évaluation devait être « complète et rigoureuse ».
S’agissant des techniques conduisant à la création d’OGM au sens de la directive – car certains OGM ne sont pas couverts par la directive – il s’agit de l’ensemble des techniques classées dans la catégorie des techniques du génie génétique : la transgénèse, la fusion de cellules distinctes, éloignées phylogénétiquement et l’introduction d'une particule d’ADN dans une autre cellule.
Sont exclus de cette directive, tous les organismes obtenus par mutagenèse, puisque celle-ci peut survenir naturellement, ainsi que la fusion de cellules correspondant à des cellules relativement proches phylogénétiquement.
En conséquence, la directive 2001/18/CE, comme la directive 90/220/CE, concernent tout type de produit OGM, mais ne couvrent pas les produits dérivés. Par exemple, elles n’ont pas vocation à encadrer la mise sur le marché d’une huile de colza génétiquement modifiée.
Quels sont les apports de la nouvelle directive 2001/18/CE par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur ?
Les objectifs, définis par la directive, sont plus précis et mieux encadrés. Celle-ci présente une formalisation plus claire de l’évaluation du risque, notamment à travers l’ensemble des documents d’accompagnement de la demande d’autorisation de dissémination volontaire. Elle prévoit également une information et une consultation du public, avec des dispositions précises pour chaque type de disséminations envisageables.
La directive 2001/18/CE, à la différence de la directive 90/220/CE, encadre précisément toutes les étapes des procédures d’autorisation y compris celles qui relèvent de la compétence de la Commission en fixant par des délais précis.
La directive impose également une surveillance biologique du territoire, sur initiative française d’ailleurs, car la France avait déjà adopté des dispositions précises en matière de surveillance biologique des effets non intentionnels liés aux OGM, dans la loi d'orientation agricole de 1999.
Elle prévoit – et c'est une prémisse des futures législations – des dispositions précises en matière de traçabilité, d’étiquetage et de seuils de tolérance, ces derniers déclenchant les obligations de traçabilité et d’étiquetage. S’agissant des seuils, il reste toutefois à définir, au niveau communautaire, ceux qu’il faut appliquer aux semences. Le débat n’est donc pas clos.
La directive 2001/18/CE comme la directive 90/220/CE distingue deux types de disséminations volontaires d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement, le premier pour des disséminations à des fins de recherche et de développement (partie B de la directive) et la seconde à des fins de mise sur le marché.
Les deux types de dissémination font l’objet de procédures d’autorisation distinctes.
S’agissant des disséminations à des fins de recherche et de développement la procédure d’autorisation est subsidiarisée et est de la seule compétence de l’Etat membre, concerné par la dissémination en question. Chacun des Etats membres est néanmoins tenu d’informer les autres Etats membres et la Commission des disséminations qui sont autorisés sur leur territoire national.
En ce qui concerne la mise sur le marché d’un OGM, la procédure d’autorisation se déroule en deux temps, le premier comporte une étape d’évaluation initiale des risques conduite par les instances nationales désignées par l’Autorité nationale choisie par le demandeur. Suivant le principe « d’une porte une clé » le demandeur peut déposer une demande d’autorisation dans l’un ou l’autre des 25 Etats-membres pour obtenir une autorisation valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Dans un deuxième temps, les autres Etats membres sont consultés sur la demande et invités à faire part de leurs commentaires ou objection sur les conclusions du demandeur et de l’Etat membre rapporteur sur l’évaluation des risques que peut présenter l’OGM. S’ouvre ainsi la seconde étape de la procédure d’autorisation qui est du niveau communautaire et dans laquelle l’Autorité européenne de sécurité alimentaire est également consultée.
Dans le cadre des mises sur le marché, l’information et la consultation du public sont opérées par la Commission. A cette fin, celle-ci a ouvert un portail électronique à partir duquel le public peut retrouver la liste des dossiers de demande d’autorisation, un résumé de chaque dossier et les conclusions des autorités nationales sur la demande de mise sur le marché. Le rapport d'évaluation est présenté sur ce portail et le public peut faire part de ses commentaires. Il s’agit donc d’une procédure nationale puis communautaire et, en aucun cas, un Etat membre ne peut autoriser une mise sur le marché de façon unilatérale.
Concrètement, pour une dissémination volontaire dans l'environnement, l’opérateur dépose une demande auprès d’un Etat rapporteur. Celle-ci prend la forme d’un dossier complet comportant des aspects administratifs et scientifiques répondant à un ensemble d’exigences définies par la directive. Ce dossier fait l'objet d’un examen préliminaire par l’autorité nationale qui en accuse réception et informe immédiatement les autorités des autres Etats membres ainsi que la Commission du dépôt de ce dossier. Cette autorité nationale engage une procédure d’évaluation du risque, selon les modalités qui lui appartiennent. En effet, il existe un certain niveau de subsidiarité dans la mécanique d’évaluation du risque, ce qui permet à chacun des Etats membres de définir la façon la plus appropriée de mettre en œuvre cette évaluation du risque.
Cette évaluation débouche sur un avis, puis sur un rapport par lequel l’Etat membre prend position sur la demande et transmet ses conclusions au niveau communautaire, que la décision soit favorable ou défavorable. Si elle est favorable, l’Etat membre doit également définir les conditions de mise en marché qu'il estime acceptables.
S’ouvre alors une procédure communautaire relativement longue et encadrée. Il y a d’abord une consultation qui va durer 60 jours, au cours de laquelle, l’Etat membre peut faire part de ses objections et de ses commentaires. Une solution sera recherchée aux problèmes posés, en concertation avec l'opérateur. S’il n’y a pas d'objection, l'Etat membre est habilité à délivrer son autorisation, laquelle acquiert alors une portée communautaire.
Si, au contraire, le dossier fait l’objet d’objections, on entre dans une deuxième phase de concertation plus étroite entre les Etats membres, au cours de laquelle on tente, dans un délai de 45 jours, de résoudre le problème rencontré par cet Etat membre.
Si une solution est trouvée, il y a décision d’autorisation. Sinon, on passe à l’étape de la consultation du comité réglementaire sur la base d’une proposition de décision élaborée par la Commission sur la base notamment des conclusions de l’évaluation des risques de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA), consultée entre-temps. Le comité réglementaire se détermine selon un vote de comitologie type 3, requérant une majorité qualifiée pour ou contre.
En l’absence de solution, on passe à un niveau supérieur de réglementation, avec la consultation du Conseil des ministres de l’environnement, selon un même système de consultation sur la base de comitologie type 3, avec majorité qualifiée pour ou contre.
S’agissant des règles de comitologie, chacun des Etats membres ne dispose pas d’une seule voix mais d’un nombre de voix défini par pondération en fonction de l’importance de l’Etat membre au sein de l’Union européenne (UE). Dans l’UE à 25 membres, la France dispose ainsi de 29 voix.
M. le Président : Au final, chacun se renvoie, quand même, la « patate chaude » qui revient en fait à la Commission.
M. François HERVIEU : Il est vrai que cela ne devrait pas se passer ainsi, mais actuellement, c’est le cas.
M. le Président : Les deux premiers organes consultés ne décident jamais.
M. François HERVIEU : Il y a eu une exception avec le dossier des Pays-Bas sur les œillets génétiquement modifiés, autorisés en 1998, sans consultation du comité réglementaire parce qu’il n’y a pas eu d’objection de la part des Etats membres. En revanche, pour tout produit ayant une conséquence sur l’environnement ou la consommation, il y un passage par toutes les étapes de la procédure.
Il est vrai que si la « patate chaude » reste trop chaude, c'est la Commission qui prend la main, synthétise l’ensemble des éléments et prend une décision, en prenant en compte tous les éléments disponibles, en délivrant une décision d'autorisation ou, le cas échéant, un rejet de la demande.
Nous avons connu un cas de ce type, avec la pomme de terre d’Avebe dont la demande d’autorisation a été rejetée, dans le cadre de ces procédures, en 1998. Cette pomme de terre à composition en amidon modifiée et à vocation industrielle a posé de gros problèmes au comité d’évaluation car le nombre de séquences introduites était trop nombreux. Les experts ayant estimé qu’ils n’étaient pas en mesure d’évaluer complètement le risque, le système a joué son rôle en bloquant la culture de cette pomme de terre.
M. François GUILLAUME : Cette pomme de terre est-elle cultivée ailleurs ?
M. François HERVIEU : Non, c’est un produit purement européen, mais depuis cette pomme de terre développée par la société Avebe, une autre pomme de terre d’un genre similaire a été proposée à la mise sur le marché par la société suédoise Amylogene. Cette pomme de terre Amylogene se distingue de la pomme de terre développée par Avebe par des insertions d’ADN introduites par transgénèse strictement limitées aux séquences génétiques nécessaire pour obtenir les caractéristiques recherchées.
Pour ce qui est de la partie B concernant les essais de recherche et de développement, le dispositif est plus simple, puisqu’il relève du niveau subsidiaire. Les Etats membres mettent en œuvre les procédures qu’ils souhaitent pour autoriser ces essais et ils sont compétents pour l’organisation de l’information et de la consultation du public. Toutefois, ils ont obligation d’informer les autres Etats membres et la Commission sur la nature des dossiers déposés dans l’Etat membre et sur les conclusions de la procédure. Les Etats membres peuvent d’ailleurs faire des commentaires à l’Etat membre concerné. Ces dossiers sont enregistrés, depuis 1990 ou 1992 au niveau communautaire, sur un registre accessible aux autorités nationales.
Ce dispositif d’autorisation est similaire et parallèle à celui des mises sur le marché, mais beaucoup plus simple, puisqu’il n’y a qu’une procédure nationale, avec la consultation d’un comité d’évaluation qui est, en la matière, la CGB. La directive 2001/18/CE n’ayant pas été transposée, l'ensemble du dispositif d’information et de consultation du public est organisé sur une base volontaire par le ministère de l'agriculture, avec l’ouverture d’un portail électronique où sont référencées toutes les informations relatives à ces disséminations.
Dès la décision prise, les sites mentionnés dans le dossier sont confirmés. Etant donné la difficulté de trouver des sites d’implantation, l'opérateur a tendance à donner une liste importante de communes où pourront être implantés les essais. A posteriori, il précise la liste pour indiquer à quels endroits les essais seront effectivement implantés. Ces sites sont notifiés en mairie, sur notre système Internet ainsi qu’à l’ensemble des agents chargés du contrôle.
Faute d’une transposition de la directive 2001/18/CE, l'ensemble du corpus législatif repose sur les actes de transposition des directives 90/220/CE et 90/219/CE, par la loi 1992-654 du 13 juillet 1992 et l'ensemble de ses décrets d'application. Ce dispositif a néanmoins été renforcé par la loi d’orientation agricole de 1999 qui a anticipé un ensemble de dispositions prévues par la directive 2001/18/CE.
En outre, ce dispositif législatif formel a été complété par un ensemble de démarches complémentaires sur une base volontaire, à la demande du ministre chargé de l’agriculture. L’ensemble des OGM concernant aujourd’hui principalement des plantes, il relève de la compétence du ministre de l’agriculture, qui a prévu une démarche d’information préalable des maires, lors de laquelle sont expliqués les tenants et les aboutissants de la demande et le contexte réglementaire dans lequel interviennent ces décisions. Cette procédure d'enquête de terrain vise à renforcer nos informations pour mener à bien les opérations de gestion du risque et pour déterminer si le dossier prend correctement en compte les particularités liées au contexte local.
Une publication de l’ensemble des dossiers est disponible en ligne – dans tous les cas des résumés et des parties non confidentielles du dossier : les avis des commissions consultatives, les décisions qui s’y rapportent et l'ensemble des listings de sites de dissémination. Dès 1999, nous avons mis en œuvre un régime centralisé de l'information, avec un système sécurisé d’enregistrement des localisations des essais, c’est-à-dire les parcelles cadastrales. Cette base de donnée est accessible à l’ensemble des agents habilités et bénéficiant d’un code d’accès personnel des services du ministère de l’agriculture en charge des contrôles.
Depuis la loi d’orientation agricole de 1999, le dispositif de contrôle a été renforcé, notamment à travers une obligation de surveillance biologique des effets non intentionnels de ces disséminations, qu’il s’agisse de mise sur le marché ou de recherche et développement.
Ces contrôles sont effectués par les agents des Directions régionales de l’agriculture et de la forêt, Services régionaux de la protection des végétaux (DRAF – SRPV), qui font parties des services déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, ce ministère étant organisé en une administration centrale, répartie dans plusieurs directions générales et des services déconcentrés en région et département.
Aujourd’hui, 141 agents habilités et assermentés peuvent procéder à des contrôles. Ils sont directement rattachés aux DRAF et travaillent en coordination nationale avec la sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux (SDQPV).
M. Jean PRORIOL : Ce sont des agents discrets !
M. François HERVIEU : On leur reproche effectivement souvent de ne pas donner suffisamment d’informations. Néanmoins ils répondent à chacune des sollicitations.
M. Pierre COHEN : Dans mon département de la Haute-Garonne, la procédure n’a pas été suivie. Il n’y a eu aucune démarche d’information préalable auprès des élus, ni de procédure d'enquête de terrain, ou alors elle a été plus que discrète car ni les citoyens ni les élus n’en ont eu connaissance.
M. François HERVIEU : La démarche d'enquête préalable est une mission technique. Nos agents se rendent sur place et font une analyse technique de terrain, à travers un enregistrement topographique de la géographie, des cultures avoisinantes et de différentes circonstances particulières. Ces actions font chacune l’objet d’un rapport rédigé par l’agent, synthétisé par moi-même et remis au ministre préalablement à la décision.
En 2003 et 2004, ces agents ont rencontré tous les maires concernés. Des rapports ont été rédigés après ces rencontres…
M. Pierre COHEN : Lors de la dernière assemblée générale, les maires des communes de Haute-Garonne concernées par ces essais ont interpellé le préfet car ils ont pris connaissance de ces essais par « La Dépêche du Midi ». Le problème est que l’on parle d’une procédure relativement ouverte, responsable et connue des différents décideurs, qui ne correspond pas à la réalité.
M. François HERVIEU : Je ne peux pas remettre en cause les conclusions d'agents habilités et assermentés. Je reçois des listes sur lesquels figurent des dates de sollicitations téléphoniques
– car certains maires refusent de recevoir nos agents – et des dates de rencontre avec des maires. Pour l'ensemble des sites concernés par des essais au champ en 2004, les maires ont été rencontrés. Vous le contestez, mais je ne peux rien vous dire d’autre.
M. Pierre COHEN : Je voudrais simplement vous entendre confirmer que cela a été fait. Ensuite nous aurons l’occasion de revoir la question avec les maires pour recueillir leur avis.
M. François HERVIEU : Ces actions sont pilotées par des ordres de service, diligentées dans chacune des DRAF concernées par un projet de dissémination. La confusion vient souvent du fait que pour les essais pluriannuels, certains maires supposent que lorsqu’il y a eu essai une année, il se reproduira l’année suivante. Ce n'est pas du tout le cas, notamment pour le maïs, pour lequel il y a rotation des cultures et nécessairement des sites tournants.
Je ne suis pas sur place pour vérifier si l’agent a bien transmis l’information aux élus locaux ou s’il me raconte des histoires dans le rapport qu’il me transmet.
Les opérations de biovigilance sont relativement souples puisqu’elles sont destinées à détecter des effets non intentionnels ou non anticipés par l’évaluation. On peut penser que ces effets ne seront visualisables que lorsqu’il y aura des surfaces significatives de cultures, ce qui est loin d'être le cas en ce qui concerne la partie B, puisqu'en 2004, nous avions 7,2 hectares disséminés sur l’ensemble du territoire national.
M. Francis DELATTRE : Combien en aviez-vous en 2000 ?
M. François HERVIEU : De mémoire, je peux vous donner le chiffre de 1 000 hectares pour 1999, mais ces informations sont publiées annuellement dans le rapport d’activité de la Commission de génie biomoléculaire et je pourrai vous en faire la synthèse.
Je compléterai cette présentation par la réglementation qui va encadrer plus spécifiquement le secteur alimentaire, puisque le règlement 258-97 « Novel food » a été modifié en 2003 par le règlement 18-29 qui en a élargi la portée. Ce règlement retire les éléments qui, dans le règlement 258-97, portaient sur les OGM et les dérivés d’OGM, pour les intégrer dans ce règlement spécifique traitant à la fois de l’alimentation humaine et de l’alimentation pour le bétail.
Par rapport à la directive 2001/18/CE, ce règlement introduit un système centralisé d’évaluation relevant de la compétence de l’autorité européenne. A part cette centralisation des procédures, le dispositif général fonctionne d’une manière à peu près similaire à celui précédemment décrit.
Ce règlement a repris l’ensemble des dispositions relatives à l'étiquetage
– l’étiquetage des ingrédients alimentaires en consommation humaine est obligatoire depuis le 2 septembre 1998, avec un seuil de tolérance défini en 1999 à 1 % – mais a ramené le seuil à 0,9 %. L’évolution majeure est la prise en compte des denrées destinées au bétail et l’adoption d’un dispositif particulier qui est un seuil de tolérance à la présence fortuite pour des OGM non autorisés, mais évalués, c’est-à-dire tous les OGM qui étaient dans le « trou noir » ou les perturbations générées par le moratoire. Ces OGM, qui sont au nombre d’une dizaine, sont en attente de décision depuis 1996/1997 pour les plus anciens. Le législateur européen a estimé nécessaire de fixer un seuil de tolérance particulier qui est de 0,5 %.
Ce nouveau règlement communautaire élargit la portée de l’ensemble des dispositions aux dérivés d’OGM, aux additifs et aux arômes, qui sont donc assujettis aux mêmes dispositions que les ingrédients alimentaires.
Par ailleurs, pour répondre à la demande d'un certain nombre d'Etats membres, un règlement « horizontal » a été adopté concernant la traçabilité qui est considérée comme un élément indispensable à la fiabilité de l’étiquetage. Ce règlement de traçabilité concerne tous les OGM et leurs dérivés lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation humaine ou animale. Il réglemente les documents devant accompagner les transactions de traçabilité et la durée pendant laquelle ces documents doivent être conservés.
Il est important de bien avoir à l’esprit que la directive 2001/18/CE ne se substitue pas à l’ensemble des autres législations. Ainsi, une décision d’autorisation 2001/18/CE ne remplace pas une autre autorisation lorsque le produit considéré est assujetti à une législation particulière.
Si l’on prend le cas des semences, une autorisation 2001/18/CE ne vous autorise pas à commercialiser librement vos semences. Celles-ci doivent répondre à l’ensemble des exigences de la directive semences et, notamment pour ce qui concerne l’inscription au catalogue de ces variétés.
La décision d’autorisation 2001/18/CE donne un droit de culture de l’OGM, mais pas un droit de commercialisation. Un opérateur titulaire d’une autorisation peut cultiver un OGM, une semence, mais sans le commercialiser, parce qu’il n’existe pas de régime général portant sur le droit de cultiver un produit. Au contraire, les directives semences donnent des droits de commercialisation de semences, en encadrant la transaction commerciale de la semence pour assurer, en premier lieu, la loyauté des transactions entre l’obtenteur semencier et l'agriculteur. C'est une notion que l’on ne perçoit pas toujours.
Ainsi, lorsque M. Juppé a autorisé, en 1997, par consentement écrit, le maïs Bt 176, il n’a pas autorisé la commercialisation des semences. Ce n'est que lorsque l’agriculteur accède aux semences par l’acte d’achat qu’il y a possibilité de culture. Sans cette étape, les niveaux de culture restent confidentiels. En 2004, on compte en France environ 17,5 hectares de cultures commerciales d’OGM et 7,2 hectares de cultures correspondant à des actes de décision d’autorisation de type B, c’est-à-dire des essais de recherche et développement. Les deux aspects sont donc présents.
M. le Président : Où sont localisés ces 15,5 hectares de cultures commerciales d’OGM ?
M. François HERVIEU : Ils sont répartis dans le grand Sud-Ouest de la France. Ces cultures sont « commerciales » mais elles correspondent essentiellement à des cultures de démonstration, sur de petites surfaces, ou à des cultures de production semencière destinées à l’export. Il y a aussi un important essai utilisant des variétés autorisées à la mise sur le marché. Arvalis, notamment, a mis en place dans le Sud-Ouest une grande culture pour évaluer les possibilités de coexistence des différents types de culture.
Les trois variétés concernées dérivent de Bt 176, de MON 810 ou de T 25, seules variétés bénéficiant aujourd’hui d’une autorisation communautaire de mise sur le marché à toutes fins, similaire à celle des produits conventionnels. Sur le territoire national, on voit principalement des variétés dérivant de MON 810 et autorisées par consentement écrit de la France en août 1998.
M. Francis DELATTRE : Est-ce sur la base de cette réglementation que l'Espagne cultive ce type de produit ?
M. François HERVIEU : Tout à fait. De mémoire, l’Espagne a inscrit douze variétés de MON 810 utilisées à hauteur de 60 000 hectares, en 2004.
M. le Président : Tout à l'heure, on nous a indiqué que l’INRA avait eu une démarche très innovatrice de discussions, bien en amont de l’autorisation, qu’au final la CGB avait donné l’autorisation de cultiver cinquante pieds de vigne à Colmar, mais que depuis, on attendait une décision de l’administration. Est-ce vrai ?
M. François HERVIEU : Permettez-moi tout d’abord de préciser que la CGB n'a pas donné d'autorisation, mais a émis un avis, ce qui est différent sur le plan juridique. L’autorisation appartient au ministre. Celui-ci doit intégrer un ensemble d'éléments relatifs à la demande : éléments relevant du registre scientifique – d’où l’importance d’une commission consultative – éléments de synthèse issus de la consultation du public et éléments de synthèse provenant de nos services. C’est l’agrégation de tous ces éléments qui conduit à la décision du ministre.
Pour l’essai de Colmar, la décision n'a pas été prise, le ministre estimant que l'ensemble des éléments réunis ne permet pas de prendre une décision aujourd’hui. Mais cela ne signifie pas qu’il refusera la mise en place de cet essai.
M. le Président : Certes, mais la vigne se plante à certaines périodes. On peut parler là, comme au niveau européen, de « patate chaude ».
M. François HERVIEU : Nous attendons la réponse du ministre, mais il faut savoir que ce type de dissémination pose de réelles difficultés dans l’ensemble de l’Union européenne, surtout lorsqu’il s’agit d’espèces emblématiques comme le blé ou la vigne, notamment en France.
Si l’on se fonde sur le cadre juridique en vigueur au niveau national – mais nous sommes alors en infraction avec la législation communautaire – l’absence de décision dans le délai de 90 jours vaut refus. Ce sont les termes de la loi 92-654 : « Une absence de décision dans un délai de 90 jours, à compter de la date de réception et sans autre indication de l’autorité nationale, vaut pour refus. »
Cette disposition sera modifiée par la transposition de la directive 2001/18/CE qui impose que les décisions soient motivées, quel que soit l’avis – favorable ou défavorable – donné à la demande. Il y aura donc une évolution juridique sur ce point. S’agissant du dossier sur la vigne, le ministre n’a pas formellement refusé la demande, même si, selon le cadre juridique en vigueur aujourd’hui, on doit comprendre qu'il y a eu rejet.
Je terminerai cet exposé en parlant du protocole de biosécurité et de la façon dont il est appliqué au niveau européen. Ce protocole est un accord international concernant les échanges internationaux entre pays exportateurs et importateurs, et imposant des consentements préalables – ou, tout au moins, une évaluation préalable – aux premiers mouvements transfrontières de ces OGM.
L'Union européenne a estimé que l'ensemble du dispositif était suffisant pour répondre aux obligations du protocole concernant l’importation des OGM. En revanche, elle a estimé qu’il convenait d’adopter un règlement complémentaire pour encadrer les transactions à l’export, ce qui a été fait avec l'adoption du règlement CE/1946/2003, qui impose aux opérateurs des obligations préalables aux premiers mouvements transfrontières de tout « vrai » OGM, à l’exclusion des produits dérivés qui relèvent d’un autre domaine et attendre un accord explicite de la partie ou de la non partie (au protocole de biosécurité) importatrice avant le premier mouvement transfrontière de l’OGM.
Quant au dispositif de la directive semences, il fait l’objet de dispositions subordonnant la possibilité d’inscrire des variétés au catalogue à une autorisation préalable, soit dans le cadre de la directive 2001/18/CE, soit dans le cadre du règlement « Novel food » ou « Novel food novel feed ».
M. le Président : Merci pour cet exposé qui montre la complexité du système et au cours duquel vous avez pris la peine de nous indiquer les lacunes que la loi devra combler pour se conformer à la législation européenne.
Vous avez indiqué qu'il y avait aujourd’hui obligation de traçabilité pour tous les OGM et pour les dérivés d’OGM. Il en est ainsi, par exemple, de la lécithine extraite d'une plante OGM. Pourquoi alors, sous l'effet d’un certain nombre de pressions et de lobbies, n’a-t-on pas imposé l’étiquetage « OGM » de certains aliments, comme la bière fabriquée avec des enzymes génétiquement modifiés ou d’autres aliments, tels des substituts, des vitamines, du glutamate, qui utilisent des OGM dans leur fabrication ? Il ne s’agit pas, dans mon esprit, de vouloir encore plus de réglementation mais j’observe que, ce faisant, on a une fois encore pointé du doigt les OGM végétaux. La pression a été suffisamment forte à Bruxelles pour que 30 % des aliments que l’on consomme ne soient pas étiquetés « OGM ». Qu’en pensez-vous ?
M. François HERVIEU : Le dispositif communautaire relatif à l’étiquetage est très large mais il ne concerne pas les auxiliaires technologiques comme les enzymes, parce que ces auxiliaires technologiques ne se retrouvent pas dans le produit final et qu’ils ne sont pas assujettis à une obligation d’étiquetage dans le régime général.
Un débat a cours aujourd’hui sur l’ensemble des produits de fermentation et sur la façon dont ils doivent être considérés au regard des obligations d’étiquetage. Par exemple, en ce qui concerne les bières, on peut imaginer que certaines pourront être étiquetées « génétiquement modifiées » dès lors que l’on retrouvera une enzyme génétiquement modifiée dans le produit.
Par ailleurs, il faut rappeler que le déclenchement des obligations d’étiquetage et de traçabilité s’applique à partir d’une présence d’OGM à 0,9 %, et cela ingrédient par ingrédient. La disposition est donc extrêmement large.
M. le Président : Je prends l’exemple de la lécithine, extraite d’une plante génétiquement modifiée et utilisée dans la fabrication du chocolat. On n’y retrouve pas la partie OGM de la plante. Pourquoi alors avoir séparé les auxiliaires technologiques non concernés des ingrédients technologiques dans un cas tout à fait identique ?
M. François HERVIEU : La différence est que vous allez retrouver de la lécithine en tant que telle.
M. le Président : Certes, mais elle n’est pas OGM.
M. François HERVIEU : Non, elle est dérivée d’OGM. C’est comme l’huile issue d’un OGM.
M. le Président : Au niveau du concept, c’est comme le produit qui a été fabriqué avec des éléments OGM. Vous défendez la réglementation, et c’est bien normal, mais je pense qu’il y a là une contradiction.
M. François HERVIEU : Il faut considérer qu’une disposition élargissant ce type d’étiquetage aurait toutes les chances de faire passer toute substance en étiquetage positif.
M. le Président : C’est la bonne solution !
M. François HERVIEU : Il faut rappeler que les mesures prises par les entreprises visent à éviter la moindre trace d’OGM. A titre d’exemple, l'entrée en usine pour des maïs doit respecter un seuil de tolérance de 0,01 %. Pareil pour la semoulerie. A mon avis, une démarche d’élargissement vers un étiquetage systématique entraînerait davantage un ensemble de contentieux entre les opérateurs qu’elle ne résoudrait un problème. Néanmoins, le débat n'est pas clos au niveau communautaire concernant la catégorie de produits que vous venez de mentionner.
M. le Rapporteur : Autre question : pourquoi inclut-on les hybrides dans la définition des OGM, alors que c'est un processus naturel ?
M. François HERVIEU : La législation communautaire traite les OGM au cas par cas, à la différence de la législation nord-américaine dont l’approche est beaucoup plus générale. Dans le droit nord-américain, c'est la caractéristique introduite par la structure d’ADN qui est régulée. Par exemple, une protéine Bt sera évaluée, puis dérégulée pour être introduite dans un ensemble de maïs ou dans n’importe quel autre site.
En Europe, le système de réglementation est le suivant : vous prenez le résultat de l’utilisation de cette séquence introduite dans un génome de maïs. Une fois qu’un OGM avec une identité particulière et donc une localisation définie des insertions des séquences d’ADN étranger dans le génome de l’organisme, cette OGM peut alors être utilisé dans tout programme de sélection et d’obtention variétale sans qu’une autorisation complémentaire soit nécessaire. Cet OGM autorisé peut donc être décliné dans un ensemble de variété différente dès lors que ces variétés sont obtenues par reproduction sexuée ou toute autre méthode traditionnelle de création variétale. Par exemple, dans le cas de MON 810, c’est l’OGM MON 810 qui est autorisé. Mais si l’opérateur le souhaite, il peut obtenir, à partir de cet OGM, 250 variétés de MON 810.
En ce qui concerne l'aspect hybride, la perception européenne est la suivante : si vous prenez un maïs MON 810 et que vous le croisez avec du Bt 176, cela donne un hybride de deux OGM, lequel est considéré comme un nouvel OGM assujetti à nouveau au régime d’autorisation. Mais l'hybride en tant que tel n’est pas réglementé.
M. le Rapporteur : Vous parlez de l’hybridation d’OGM, mais qu’en est-il des hybrides naturels ?
M. François HERVIEU : Les hybrides obtenus par des méthodes traditionnelles de sélection et création variétale ne sont pas assujettis à une autorisation spécifique relevant de la réglementation OGM.
M. le Rapporteur : Autre question : pourquoi le ministère de la santé ne fait-il pas partie des ministères de tutelle du futur conseil des biotechnologies ?
M. François HERVIEU : Je ne peux pas vous répondre sur cet aspect.
M. le Rapporteur : Comment être informé du cas d’un opérateur ayant obtenu une autorisation d’essai OGM qui n’avertirait pas l’administration en cas de changement dans l’appréciation du risque ?
M. François HERVIEU : Dans ce cas, on applique le dispositif de recherche et de constatation des infractions qui est le même que pour tout autre type de problématique. Un tel opérateur prend un gros risque car si l’on découvre et prouve qu’il masque sciemment des informations à l’administration, la procédure pénale s’applique, comme pour toute autre fraude de ce type.
M. Francis DELATTRE : Au titre des règles d'étiquetage et de traçabilité, on doit maintenant indiquer sur le maïs autorisé à la vente pour l’alimentation humaine s’il est d’origine OGM. Mais si le commerçant précise que c’est « avec 50 % de moins de pesticides », considérez-vous qu’il s’agit là d’une publicité ?
M. François HERVIEU : Honnêtement, je ne suis pas dans mon domaine de compétence pour ce type d’allégation.
M. Francis DELATTRE : Ce n’est pas une allégation. L’inscription d’OGM est dissuasive, mais il faudrait que l'Etat, qui doit être objectif, permette de faire état des éventuels avantages des OGM. N'est-ce pas une préoccupation de la direction de l'alimentation ?
M. François HERVIEU : Les dispositions encadrant l’étiquetage sont de la compétence du ministère des finances et de sa direction générale de la concurrence, de la réglementation et de la répression des fraudes (DGCRRF) qui fixe la liste des ingrédients à signaler.
Vous faites allusion à la recherche d’une information objective, claire et précise sur, d'une part, les risques potentiels présentés par ces OGM, d’autre part, leurs bénéfices. C’est ce que nous essayons de faire le mieux possible, à travers les informations que nous donnons sur notre serveur interministériel. Si l’on constate une réduction significative de l’usage des pesticides du fait de ces OGM, on peut effectivement le mentionner. Cela étant, sur la base de 7 ou de 15 hectares, il est difficile de se rendre compte de la réalité des choses.
M. Francis DELATTRE : Certes, mais le maïs que l’on va trouver dans le commerce ne provient pas des cultures françaises – puisqu’elles sont interdites – mais de l’exportation, à commencer par celle l’Espagne. Et cela me permet d’aborder ma deuxième question. Le maïs Bt cultivé en Espagne, autodétruit la pyrale et supporte les glyphosates, ce qui permet une diminution de l’utilisation des herbicides.
M. François HERVIEU : C’est inexact car aucune variété de maïs tolérante au glyphosate n’est autorisée sur le territoire de l’Union européenne.
M. Francis DELATTRE : C’est pourtant ce que m’ont affirmé des responsables espagnols que j’ai rencontrés. Il n’en reste pas moins que le maïs Bt permet d’éviter d’utiliser trois ou quatre herbicides spécialisés, et c’est la raison pour laquelle les Espagnols le cultivent mettant ainsi en concurrence désagréable les professionnels de la salaison.
Comment s’exerce alors la traçabilité entre des porcs espagnols nourris à 20 kilomètres de la frontière française avec du maïs transgénique espagnol et les porcs français vendus par le même commerçant ? Si chaque Etat membre fait à peu près ce qu'il veut, il est bien évident que nous aurons des systèmes qui gêneront nos producteurs, la concurrence, etc.
M. François HERVIEU : En premier lieu, la législation européenne ne s’applique pas aux co-produits animaux nourris avec des OGM, puisque justement cette réglementation fait exclusion de l'application de ces dispositions à cette catégorie de produits. Par conséquent, les porcs nourris avec des OGM ne sont pas assujettis à l’obligation de traçabilité et d’étiquetage.
Sur le plan réglementaire, la transaction commerciale d’un maïs Bt 176 cultivé en Espagne et importé en France, est assujettie à la réglementation européenne qui comprend des mécaniques permettant de détecter les fraudes.
M. Francis DELATTRE : Vous faites référence au maïs qui serait vendu en France, mais s’il arrive sous forme animale, il n’y a aucun contrôle.
M. François HERVIEU : Les Etats membres n’ont pas accepté la proposition du Parlement européen de soumettre les co-produits issus d’animaux nourris avec des OGM à l’obligation de traçabilité et d’étiquetage. Ils ont estimé que les possibilités de contrôle sont absolument impossibles, notamment pour des animaux ayant une durée de vie relativement longue. Par ailleurs, le règlement de traçabilité s’applique à compter d’un seuil de 0,9 % sur la nourriture destinée aux animaux. Cela signifie qu’un porc, qui mange, dans une étape de sa vie, quelques grains de maïs OGM sur 100 % de sa ration de la journée, devrait être assujetti aux dispositions de traçabilité. Objectivement, il est impossible de faire une opération de contrôle sur de tels produits, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un produit importé.
M. Francis DELATTRE : C’est ce que je pense, donc nous sommes d'accord.
Les brevets OGM sur le maïs et le soja sont généralement la propriété des grandes firmes américaines. Mais les brevets sur les céréales à paille sont plutôt celle des firmes françaises. Les retards que nous avons pris ces dix ou quinze dernières années ne nous pénalisent-ils pas ? J'ai en effet rencontré des chercheurs d’Arvalis qui m’ont expliqué que, globalement, la recherche française et les semenciers français étaient très avance. Ils citaient notamment un blé dans lequel on avait transféré un germe de pois permettant une conservation sans insecticide pendant plusieurs mois, alors qu’actuellement, chacun sait que pour conserver les céréales et les protéger contre les charançons et autres insectes, on jette directement les insecticides dans les silos. Avec un brevet français potentiel, on aurait pu réduire considérablement ce genre de situation. Est-il exact que notre recherche était bien en avance sur les céréales à paille et que nos atermoiements suppriment malheureusement cet avantage ?
M. François HERVIEU : Tout à l’heure, nous évoquions la question de l’incidence communautaire du débat d’opinion sur les OGM. On voit bien qu’il y a une évolution très intéressante du nombre de dossiers instruits au niveau français. Nous étions effectivement leader européen en matière de recherche, mais pas sur les céréales à paille, puisque nous n'avons jamais vu d’essais aux champs en matière de céréales à paille en France.
M. Francis DELATTRE : On ne risque pas d’en voir, puisqu’ils sont interdits !
M. François HERVIEU : Deux dossiers ont été déposés en France, l’un en 1997 et l’autre en 1999, qui concernaient du blé. Les essais ne sont pas proposés aujourd’hui en France pour des raisons diverses et variées.
M. Francis DELATTRE : Il faut savoir que les essais sont faits à l'étranger.
M. François HERVIEU : Tout à fait, mais au niveau européen, le nombre d’essais sur ces espèces reste encore très limité. On observe une courbe en cloche à partir de 1997, avec une inversion de la tendance exponentielle entre 1987 et 1997. Nous sommes aujourd’hui dans une situation analogue à celle de 1989/90. Je vous laisserai apprécier le dynamisme de la recherche, en tout cas celle concernant la dissémination qui ne constitue qu'une face de la recherche, tout un ensemble de recherches étant mené en milieu confiné. Ainsi, nous avons une forte activité en matière de séquençage qui débouchera, nous l’espérons, sur des brevets, puisque l'Etat, semble avoir débloqué un budget assez significatif en faveur de Génopole-Génoplant 5, précisément pour favoriser l’accès aux brevets sur ce type de technologie. Mais il est certain qu’en termes d’activités aux champs, nous ne pouvons que constater une situation de régression.
Autre évolution importante : en 1997, il devait y avoir une dizaine d’espèces végétales faisant l’objet d’expérimentations aux champs. Aujourd'hui, nous en avons cinq et, en 2005, nous en aurons trois.
M. André CHASSAIGNE : Concernant les difficultés d’application de la procédure d’autorisation de la dissémination volontaire, je n’ai pas été tout à fait convaincu. Vous avez rappelé la procédure : information des élus, enquête de terrain effectuée par les agents des DRAF, publication du dossier, avis et décision. Cette procédure fait-elle l’objet d’une évaluation, au niveau national ?
Deuxième question : alors que nous avons tous un souci de transparence, vous êtes passé très rapidement sur l’indication du lieu et des entreprises réalisant les 15 hectares de cultures OGM commerciales autorisées en France. J’aimerais savoir ce que recouvrent ces hectares qui ont obtenu une autorisation de mise en marché.
Troisième question : je n'ai pas compris la différence entre les OGM et les dérivés d’OGM. J’y vois presque une contradiction par rapport à l’exposé d’hier. Je ne suis pas un scientifique, mais il me semblait qu’une fois le produit génétiquement modifié, que les dérivés l’étaient également.
M. François HERVIEU : Pour répondre à votre dernière question, le caractère génétiquement modifié ne se réfère nécessairement qu’à une structure génétique particulière qui est l’ADN. Ainsi, lorsqu’on parle d’organisme « génétiquement modifié », cela ne peut concerner que de l’ADN modifiée génétiquement, avec une structure ADN présente ou pas dans la cellule ou le produit.
Par exemple, une tomate peut être un vrai OGM, c'est-à-dire un organisme vivant capable de se multiplier et de se reproduire. A partir de cette tomate, vous pouvez produire des dérivés d’OGM, tels une sauce tomate ou un ketchup, ou des produits encore plus raffinés dans lesquels vous ne trouverez pas du tout de trace d’ADN, tel un jus qui correspondrait essentiellement à une composante eau. Si vous leur appliquez une méthodologie de détection d’analyse par réaction de polymérisation en chaîne (PCR), vous êtes dans l’incapacité de trouver une structure ADN.
L’exemple type souvent cité est le suivant : si vous pressez une graine de colza pour en extraire une huile de haut raffinage, je vous mets au défi de trouver de l’ADN. Pour autant, cette huile est issue d’un produit OGM.
La législation prévoit une obligation d’étiquetage pour répondre aux attentes du consommateur. Toutefois, ces obligations d'étiquetage ne sont pas fondées sur une notion de risque, mais sur la perception que l’on a de l’attente des consommateurs en terme d’information.
Pour ce qui est de la démarche de nos agents sur le terrain, nous avons la charge de vingt-cinq communes en France. Quatre agents sont principalement concernés, puisque ces essais sont menés dans des régions très précises. Je fais toute confiance aux agents travaillant avec nous. On peut toujours aller vérifier ce qu’allègue un agent habilité et assermenté, mais si l’on remet en cause le travail effectué, je ne vois pas comment le système peut fonctionner. Ce qui ressort des rapports écrits, ce ne sont pas des éléments inventés par l'agent.
M. François GUILLAUME : Un dérivé d’OGM ne présente aucun risque pour le consommateur, si toutefois l’OGM en question en présentait un !
M. François HERVIEU : Nous sommes d’accord, puisque la décision d’autorisation est fondée sur une évaluation du risque et qu’en général, la conclusion de l’évaluation du risque est que le produit ne présente pas de risque.
M. François GUILLAUME : On pousse vraiment très loin l’information, car on arrive à un point tel que l’on donne, comme étant une information du consommateur, une fausse information. En effet, on sait que le consommateur va se méfier de tout produit portant mention d’OGM. Même si un produit dérivé des OGM ne présente aucun risque, le consommateur ne le sait pas et va, d’office, le refuser. On aboutit là à un système d'étiquetage très pénalisant.
Je me souviens qu’au début des discussions sur l’étiquetage au Parlement européen, ont eu lieu des discussions homériques sur le risque, justement parce que d'aucuns considéraient – et j’étais de ceux-là – que ce type d'étiquetage ne donnait pas une information objective, mais entraînait généralement soit une adoption, soit plutôt un refus.
Je voulais poser une question sur l'aliment du bétail. Les établissements Glon nous ont adressé une note intéressante démontrant leur très grande difficulté à trouver des produits non-OGM, ce qui pose un problème d'approvisionnement et un problème d’assurance. Vous avez indiqué qu’en ce qui concerne l’aliment du bétail, il y avait une tolérance de 0,5 % pour les OGM non autorisés. Existe-t-il des listes de ces produits ?
M. François HERVIEU : Tout à fait. Un document publié par la Commission dresse la liste des OGM couverts par cette disposition. Il s’agit non seulement des aliments du bétail, mais également de tous les produits couverts par le règlement « novel food novel feed ».
Par exemple, on retrouve le GA 21, un OGM tolérant au glyphosate non autorisé encore aujourd’hui, mais qui a bénéficié de l’ensemble des étapes d’évaluation par les autorités nationales et communautaires, avec la conclusion qu'il ne présentait aucun risque. Il ne reste qu’à prendre la décision. Il y a également le NK 603, un maïs également tolérant aux glyphosates. Toutefois la différence entre les deux, est que pour l’un, le gène introduit vient du maïs, pour l’autre d’une souche bactérienne, ce qui donne lieu à une querelle de brevets entre deux opérateurs. Vous avez aussi un hybride de NK 603 et de MON 810.
Ces OGM ne sont pas autorisés, ils sont pendants et tombent dans la tolérance du seuil de 0,5 %. Pour les autres, c’est le seuil de 0,9 % qui s’applique. Parmi ceux bénéficiant de la tolérance à 0,9 %, vous avez le Bt 176, le MON 810, le Bt 11 et le T 25, soit très peu de produits, plus le soja qui est le plus ancien.
M. le Président : Ceux que vous citez et qui ne sont pas autorisés sont-ils actuellement examinés ?
M. François HERVIEU : Je ne sais pas exactement à quel niveau de procédure ils se trouvent mais je sais qu’ils sont arrivés au niveau communautaire.
M. le Président : La communauté dispose déjà d’un tableau – qui inclut d’ailleurs les dix nouveaux Etats membres – avec des couleurs selon les avis des pays : en vert pour les favorables, en rouge pour les défavorables, en orange pour les abstentions. On voit que ce sont toujours les mêmes pays qui sont favorables et ceux sont défavorables. Les entrants sont plutôt défavorables, sauf deux pays dont la Slovaquie. Au bout du compte, il n’y a aucune majorité dans un sens ou dans l’autre. Par conséquent, en termes de comitologie, la première commission se sépare sur une absence d’accord et il en est de même quand cela passe en conseil des ministres. Ensuite le dossier revient à la Commission qui a déjà autorisé quatre ou cinq produits.
M. François HERVIEU : Les plus récents sont le maïs doux Bt 11, dans le cadre du règlement « nouveaux aliments », et le NK 603. La procédure se poursuit pour un ensemble d’autres dossiers et une liste a été établie de tous les OGM en cours d’instruction au niveau communautaire, à différents niveaux. Le dernier dossier est en phase d’instruction initiale aux Pays-Bas, tandis les autres dossiers datent de 1997, de 2000, de 1998, et de 1996.
Dans l’attente, ces dossiers sont soumis au seuil de 0,5 %, en raison des perturbations rencontrées au niveau communautaire – ce que l’on va appeler le moratoire de fait – et, ce qui est nouveau, d’un contentieux international au niveau de l’OMC. En effet, en l’absence de décision, un certain nombre d’Etats ont décidé de porter l’affaire devant l’instance de règlement des différends. Cette situation résulte de prises de position politiques.
M. Serge ROQUES : Vous avez indiqué que vos agents prenaient toujours contact avec les élus locaux, mais que certains refusent tout contact. Que se passe-t-il alors ? Pouvez-vous continuer votre démarche en l’absence de l’avis du maire ?
M. François HERVIEU : Tout à fait. C’est le ministère de l’agriculture qui a décidé unilatéralement de mettre en place la démarche d’information des élus locaux pour qu'ils soient à même de gérer les éventuelles polémiques. Il ne s'agit pas d’une démarche de consultation formelle destinée à recueillir un accord. Le seul pilote est le ministre de l’agriculture qui, du fait des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, dispose d’une police spéciale d’autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement ou de retrait de ces autorisations.
Cette information est disponible parce que nous avons pleine conscience des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les maires et que nous souhaitons qu’ils soient le mieux informés possible, notamment au regard d’un ensemble de procédures largement méconnues. Nous essayons d'expliquer comment et pourquoi nous effectuons des opérations de contrôle. Il faut savoir que tous les essais sont contrôlés au minimum une fois par an, dans les phases critiques – au moment de la floraison et de la récolte – et qu’en général, ils sont contrôlés entre 2,5 à 3 fois par an. Le dispositif d’encadrement est donc extrêmement important et rigoureux.
La confusion des élus vient souvent du fait qu’on met en ligne des informations génériques indiquant qu’un essai va être mis en place dans telle ou telle commune. Le maire de cette commune ne rencontrera pas nécessairement notre agent parce qu’entre-temps, nous avons appris que l'opérateur se désengageait de ce type d’implantation, après avoir été informé d’une polémique locale. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’envoyer un agent rencontrer le maire, puisque l’essai n’aura pas lieu.
Aujourd’hui, on peut estimer qu’environ 10 % seulement des communes envisagées seront effectivement prises pour un essai. Il y a donc beaucoup de rejets. Je rappelle qu’à ce jour, nous avons des essais dans vingt-cinq communes sur les 36 000 que compte le territoire national, et qu’en 1999, nous en avions environ 300 communes.
M. le Président : Dans les vingt-cinq communes en question, les maires sont-ils favorables à ces essais ?
M. François HERVIEU : Oui. Je peux d’ailleurs vous en donner la liste, ainsi que celle des maires défavorables à ce type d’essai sur le territoire de leur commune. Par exemple, le maire de Bax, qui est totalement contre ces essais, nous a amenés devant la cour d’appel de Bordeaux.
M. François GUILLAUME : Comment cela a-t-il été jugé et quid des décisions prises par les régions ?
M. François HERVIEU : Cela a été apprécié au regard des pouvoirs conférés par le Code des collectivités territoriales. L'interprétation que nous en faisons concernant la compétence des maires, est que le pouvoir de police de ce dernier ne s’applique pas, sauf s'il y a un risque de péril imminent, auquel cas il doit démontrer l'ensemble des éléments justifiant sa position et la nature du péril imminent.
Nous sommes en contentieux dans de nombreuses communes. Nous avons demandé à l’ensemble des préfets de déférer devant les tribunaux administratifs tout arrêté municipal interdisant la culture d’OGM. Jusqu'à présent, aucun de ces maires n'a eu gain de cause devant un tribunal administratif. Dans le cas de Bax, le tribunal administratif de Toulouse a validé la décision d’interdiction, ce qui nous a amené à déférer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux, laquelle a invalidé la position du tribunal administratif de Toulouse.
Donc contrairement à ce qui est dit, aucune décision d’interdiction d’un maire n’a été validée par un tribunal administratif. Des vices de procédure ont fait que les affaires n’ont pas été jugées au fond, notamment pour l'affaire de Mouchan, mais le tribunal administratif de Pau vient de casser l'arrêté du maire. Aujourd’hui, l’interprétation, faite par les services du ministère de l’agriculture, soutenue par les services des affaires juridiques, est validée systématiquement par les tribunaux administratifs, voire par la cour d’appel de Bordeaux.
S’agissant des actions engagées contre les démarches des conseils régionaux, celles-ci ne sont pas recevables, puisque le conseil régional n'a pas de compétence dans ce secteur d’activité au regard du Code des collectivités territoriales. On ne peut pas engager un recours contre une position non génératrice de droit.
M. Francis DELATTRE : Avec le principe de précaution qui permet la saisine directe des tribunaux par tout citoyen, pensez-vous que les essais OGM ont encore une chance de pouvoir se dérouler en France ?
M. François HERVIEU : Honnêtement, il est de plus en plus difficile de mener des essais aux champs en France et je n’ai pas le sentiment que la situation ira en s’améliorant.
M. le Président : Y a-t-il plus d’essais dans d’autres pays européens ?
M. François HERVIEU : Globalement, la situation est similaire dans l’ensemble des Etats de l'Union. A l'exception de l'Espagne, aucun pays ne détonne de manière patente par rapport à l’activité de recherche aux champs.
M. le Président : Combien y a-t-il d’essais en cours actuellement ?
M. François HERVIEU : Je ne peux pas vous répondre car ce chiffre évolue. Le serveur européen n’est pas très bien conçu dans la mesure où il ne permet pas de réaliser une analyse statistique facile, année par année. Il donne une liste couvrant l’ensemble des dix dernières années, mais ne permet pas de déterminer facilement combien d’essais sont effectivement réalisés aux champs. La difficulté est aggravée du fait que certains Etats membres délivrent des décisions d’autorisations pluriannuelles pouvant aller jusqu’à dix ans. Par exemple, il est difficile de déterminer si des décisions délivrées par l’Allemagne, il y a dix ans, sont encore génératrices d’effets en 2004. C’est d’autant plus compliqué que les informations disponibles sur les serveurs allemands sont uniquement en langue allemande.
L'Angleterre a rencontré, il y a cinq ou six ans, exactement les mêmes difficultés que celles de la France actuellement. L’activité de recherche y est très limitée, à l'exception du grand programme d’étude aux champs que j’ai mentionné et qui s’est déroulé au cours des trois dernières années. L'Allemagne a une activité restreinte sur un petit nombre de catégories de produits, notamment du colza, de la betterave et du maïs. Quant à l'Italie, elle mène des essais aux champs pour différentes catégories de produits, mais ce sont souvent des activités de recherche universitaire sur des petites dimensions.
M. le Rapporteur : Quel est pays européen le plus strict en matière de législation ?
M. François HERVIEU : La législation est quasi identique partout, seules les modalités vont changer ainsi que l'appréciation faite au regard des conclusions d’évaluation du risque. A ce titre, on peut estimer que l’Autriche est certainement l’un des pays les plus draconiens. Il n’y a jamais eu le moindre essai aux champs dans ce pays, pas plus que le début du commencement d’une dissémination volontaire d’OGM au titre de la mise sur le marché.
M. le Rapporteur : Quel est le pays le plus souple ?
M. François HERVIEU : On aurait pu dire que c’était l’Espagne mais la position du nouveau gouvernement à l’égard des OGM a inversé la tendance semble-t-il.
Par ailleurs, on parle souvent de l'Italie comment d’un pays hostile aux OGM. Aujourd’hui, on voit se dégager un mouvement d'opposition à l’opposition OGM, la politique en matière d’OGM étant actuellement menée par le ministre de l’agriculture. Cette politique est contestée par le Premier ministre et par le ministre de l’environnement, mais il n’est pas certain que la situation italienne soit pérenne. Nous sommes donc dans une mosaïque assez diversifiée de positions nationales sur ces thématiques.
M. Jean PRORIOL : Peut-on dire que l’Europe, dans ce domaine, se situe vraiment à part ?
M. François HERVIEU : Tout à fait. Je rappellerai, qu’aujourd’hui, les OGM concernent 60 millions d’hectares dans le monde, le leader incontesté étant les Etats-Unis. Mais dans des pays comme l’Argentine, 80 % de la culture du soja est OGM.
On constate aussi une émergence des OGM dans un certain nombre de grands pays agricoles qui vont développer ce type de technologie. C’est vrai pour le Canada et les Etats-Unis, également pour le Brésil puisqu’on estime qu’environ 30 % de la culture de soja y est transgénique notamment, à travers un système de marché de contrebande de la semence.
La Chine a également fait le choix des OGM, notamment pour le coton. En effet, l'intérêt de ce type de technologie est de préserver la santé des applicateurs dont le taux de mortalité est assez significatif à cause des produits phytosanitaires utilisés pour le traitement du coton. Cette technologie a donc un intérêt sanitaire très positif.
Les choix opérés par les producteurs dans les pays tiers, dans certaines filières de production, tiennent aussi largement compte des positions et attentes des pays de l’Union européenne dans la mesure où ils représentent un débouché commercial important qu’ils ne peuvent négliger. Ainsi les choix opérés au Brésil par les producteurs de soja, les producteurs de blé sur le continent Nord-américain, reposent en grande partie sur les attentes des entreprises européennes pour des garanties non-OGM. En conséquence, on peut considérer que le taux d’adoption de ces nouvelles technologies dans certains pays et le développement ou l’émergence de nouveaux types d’OGM sont largement dépendants des choix et attentes des pays et citoyens européens.
Mme Corinne MARCHAL-TARNUS : A combien estimez-vous la durée de validité d’un brevet ?
M. François HERVIEU : Cela va dépendre complètement de la nature du produit. Un produit, qui aura acquis une résistance au glyphosate, aura une durée de vie significativement supérieure à ceux qui auront une résistance aux insectes. Si un produit a une flexibilité et un usage importants, sa couverture par le brevet va ramener énormément de royalties, à la société Monsanto, par exemple.
Si l’on se réfère à un autre aspect, les quinze variétés inscrites au catalogue national et autorisées en 1998 sont aujourd’hui obsolètes. Ainsi, au bout de cinq ou six ans, la variété aura disparu, mais la technologie MON 810 pourra être réintroduite dans des variétés plus récentes. En effet, au-delà de la technologie Bt ou « Roundup Ready », il y a aussi les caractéristiques et le fond génétique de la variété. En conséquence, tout le travail de création et de développement variétal n’est pas anéanti du fait de ce type d’innovation technologique.
M. le Président : Quand il y a eu accord sur un événement, par exemple le MON 810, une nouvelle autorisation est-elle nécessaire si l’on transfère l’événement ?
M. François HERVIEU : Non, une fois que vous avez l'autorisation, vous pouvez utiliser votre organisme suivant toutes les procédures conventionnelles, c’est-à-dire les programmes de sélection, d’amélioration, de transfert, de rétro croisement. Si un opérateur souhaite mettre la technologie Bt 176 d’un produit ancien dans une variété plus moderne, il est habilité à le faire.
M. le Président : A l’exception des produits comportant des gènes de résistance aux antibiotiques et qui vont être interdits ?
M. François HERVIEU : Au regard des gènes antibiotiques, la législation communautaire prévoit effectivement une élimination progressive des gènes de résistance aux antibiotiques qui portent ou sont susceptibles de porter préjudice à la médecine et à la médecine vétérinaire. Ainsi, des gènes qui seraient résistants à l’amycasine ou à des produits antibiotiques très utilisés, seront progressivement éliminés voire interdits, à partir de décembre 2004. Mais le gène de résistance à un antibiotique qui ne répond pas à cette caractéristique ne sera pas interdit.
M. le Rapporteur : Quelle est la définition du « risque faible » dans les essais en milieu confiné ?
M. François HERVIEU : Cet aspect relève de la compétence de la Commission du génie génétique, laquelle est chargée d’assurer le classement de l’OGM dans une classe de risque et de définir, en fonction de cette classe de risque, les conditions de confinement appropriées. Les OGM sont globalement classés en quatre classes de risque : la classe 1 concerne les OGM ne présentant quasiment pas de risque pour la santé publique ou l’environnement, qui ne sont pathogènes ni pour l’homme ni pour l’animal, et la classe 4 concerne des produits hautement pathogènes pour l’homme ou l’animal ou l’environnement.
C’est un peu le même cas de figure pour la dissémination, puisque des contraintes de dissémination vont être imposées sur des OGM plus ou moins caractérisés. Moins l’OGM est caractérisé sur le plan des risques plus les contraintes imposées par la décision d’autorisation sont importantes, avec des isolements reproductifs par une absence de floraison ou une castration des organes de reproduction, pour progressivement, avec l’accroissement des connaissances sur les risques, évoluer vers des conditions de culture qui se rapprocheront de celles appliquées traditionnellement et donc de celles d’une mise sur le marché. Par conséquent, il n’y a pas aujourd’hui de dissémination au champ au titre de la partie B de la directive sans aucune mesure de gestion du risque.
M. le Président : Merci de cet exposé très intéressant.
Audition du Professeur Roland ROSSET,
président de la Commission du génie génétique
(extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004)
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président.
M. François GUILLAUME, Président : J’ai l’honneur de remplacer le Président Le Déaut qui effectue une mission en Hongrie cette semaine. Nous recevons aujourd’hui M. le professeur Roland Rosset, président de la Commission du génie génétique (CGG), que je remercie d’être venu pour nous expliquer le rôle de cette commission ainsi que ses conditions de travail. Je vous propose de vous présenter à l’ensemble des membres de cette mission. Après votre exposé liminaire, nous procéderons à un échange de questions/réponses.
M. Roland ROSSET : Je suis ingénieur agronome de l’Institut national agronomique (INA) Paris. Après un court passage à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) où j’ai travaillé sur les boissons fermentées et la microbiologie, je suis entré au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et je ne suis passé à l’université que plus tard.
Ma spécialité a toujours été la génétique, la génétique bactérienne dans un premier temps, puis la génétique du développement des organismes supérieurs. J’ai fait partie de nombreuses commissions et j’ai présidé le conseil du département des sciences de la vie du CNRS au début des années 90. J’ai donc participé de façon très active à ce que l’on appelle le « gouvernement de la science » au sein de ces instances consultatives.
Depuis maintenant cinq ans, je préside la Commission de génie génétique créée par la loi de 1992 qui a deux fonctions, d’une part, celle d’évaluer les risques liés aux OGM et, d’autre part, celle de prévoir des mesures de confinement préventives de ces risques.
La Commission de génie génétique, contrairement à celle présidée par mon collègue Marc Fellous, est composée uniquement de scientifiques et d’un parlementaire
– M. Le Déaut précédemment et actuellement M. Francis Giraud, sénateur des Bouches-du-Rhône. Ces dix-huit experts scientifiques présentent un large éventail de compétences car nous devons traiter de dossiers relevant à la fois de la microbiologie, de la virologie, des systèmes animaux et des systèmes végétaux. Vu la composition de la commission dont on ne peut étendre le nombre des membres à l’infini, mais qui doit bénéficier d’une expertise indiscutable dans tous ces domaines, je dois dire que si nous disposons bien des compétences nécessaires, il n’y a pas de redondance.
La première mission de la CGG est l’évaluation des risques. L’évaluation du risque consiste à déterminer, en fonction d’un danger avéré ou potentiel, si ce danger va se manifester dans chacune des conditions d’utilisation. C’est un point important et j’en donnerai un exemple : un vecteur viral utilisé en thérapie génique présentera des risques différents, selon les phases de son utilisation. Tant que ce vecteur viral est préparé, cultivé en système bactérien, on peut dire que son risque est faible, mais au moment où on va l’amplifier pour l’utiliser dans un traitement sur animal ou homme, le risque devient plus important et, très souvent, on passe de la classe 1 à la classe 3 des risques. En revanche, lorsque le vecteur viral est prêt et utilisé dans des conditions de dilution plus grande, le risque diminue. Cet exemple montre combien l’évaluation du risque dépend des conditions d’utilisation.
La deuxième mission de la CGG est d’indiquer les mesures à prendre pour éviter que le risque se manifeste. La mesure la plus simple, et toujours utilisée, est le confinement.
Quand on est en présence d’un organisme non pathogène, le confinement est de niveau 1. Il s’agit du confinement le plus courant, le plus simple, celui d’un laboratoire classique. En revanche, lorsque le risque est plus élevé, on passe au niveau 2, 3 ou 4. Le niveau 4 est le plus élevé, un seul laboratoire en France respecte les conditions L4. Il s’agit du laboratoire P4 de Lyon, qui est un bunker en dépression où les personnels travaillent en scaphandre et où sont manipulés non seulement des organismes normalement pathogènes mais également des OGM qui pourraient l’être. Le niveau 3 est assez fréquemment utilisé ; le VIH, par exemple, est un pathogène de classe 3. Les laboratoires de classe 3 sont en dépression et il en existe toute une série en France dans les grands centres scientifiques.
Après avoir classé l’OGM dans une de ces catégories de risques, nous prescrivons des conditions de confinement qui varient en fonction du type d’OGM. Si l’OGM provient d’un micro-organisme qui se répand par voie aérienne, il est clair que les conditions sont différentes de celles d’un OGM de type « prion » qui ne se propage pas par voie aérienne.
Nos délibérations suivent deux procédures différentes.
– la procédure d’avis : les demandeurs, qui peuvent être des industriels ou bien l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation (AFSSA), ou l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé médicament (AFSSAPS) nous saisissent pour obtenir un avis de classement de nos OGM. Après délibération, j’adresse au demandeur un avis indiquant le niveau de risque et le confinement que nous proposons pour l’utilisation de cet OGM. Ainsi, l’AFSSAPS nous demande assez régulièrement des avis de classement pour les essais de thérapie génique.
– la procédure d’agrément, c’est-à-dire l’autorisation accordée à un laboratoire par le ministre de la recherche de manipuler des OGM. L’agrément est donné à un laboratoire pour un projet, un certain type d’utilisation et des procédures précises.
Le point suivant que je souhaitais aborder est celui du champ d’application de nos avis et de nos agréments.
Il y a d’abord la recherche. Pour vous donner une idée de notre travail, depuis le 1er janvier 2003, nous avons accordé 517 agréments et rendu 22 avis. Sur ces 539 actes, 81 répondaient à des demandes formulées par l’industrie, les autres émanaient de laboratoires de recherche publics. Il faut souligner qu’à l’heure actuelle, on ne peut plus faire de recherche biologique sans OGM. C’est pourquoi un de mes soucis a toujours été que les laboratoires de recherche puissent travailler et poursuivre leurs travaux normalement. J’insiste sur ce point parce que je ne voudrais pas que la future loi puisse, à quelque moment que ce soit, interférer avec le fonctionnement de la recherche.
Les projets concernent également la recherche et le développement, en aval, liés à l’utilisation d’OGM à des fins de production. Il faut en effet savoir qu’il existe tout un volet d’OGM dont on entend moins parler dans la presse car ils sont utilisés en milieu confiné. Par exemple, on utilise des fermenteurs de centaines de mètres cubes pour produire des molécules à l’aide d’OGM. Les OGM ont donc déjà pénétré et pénètrent de plus en plus la vie économique et industrielle mais en milieu confiné, c’est-à-dire dans des systèmes d’où ne sort aucune cellule vivante.
Pour ce qui est plus précisément de la production, nous recevons des demandes d’avis et d’agréments de tous les producteurs d’enzymes et de molécules qui sont des entreprises françaises et, souvent, étrangères. Cette démarche est réalisée en collaboration avec le ministère de l’environnement.
Les deux derniers champs de compétence de notre commission concernent les OGM destinés à être disséminés, qui sont ceux qui vous préoccupent le plus.
Les OGM destinés à être disséminés concernent un peu la thérapie génique, la plupart des essais de thérapie génique réalisés à l’aide d’OGM pouvant parfois – je ne dis pas toujours – conduire à une dissémination. La doctrine actuelle qui est de ne pas laisser sortir un malade d’une chambre d’isolement aussi longtemps qu’il peut contribuer à la dissémination d’un OGM est, dans un certain nombre de cas, très difficile à satisfaire. Nous nous interrogeons donc sur le risque que l’on courrait, ou que courrait le malade ou son environnement, si on laissait sortir un malade qui dissémine toujours des OGM. Sur ce point, je me demande si nous ne serons pas amenés à infléchir notre stratégie.
Notre dernier domaine d’intervention porte sur les essais au champ qui concernent essentiellement les végétaux car le problème de la dissémination des animaux ne se pose pas en des termes aussi cruciaux que pour les végétaux dans le cas d’essai au champ.
Je terminerai par plusieurs remarques.
La première est, qu’en règle générale – à quelques exceptions près – seuls les organismes de classe 1 font l’objet d’autorisations de dissémination, puisque la définition de la classe 1 est celle d’un organisme non pathogène ne présentant aucun risque pour l’environnement. On peut estimer qu’un maïs transgénique portant un gène de résistance est de classe 1 car il n’y a pas de pathogénicité avérée, du moins pour celui qui le manipule. J’insiste beaucoup sur ce point : notre classement n’intéresse que le manipulateur et son environnement. Jamais il n’est envisagé de lui faire ingérer ou de lui injecter l’OGM. Nous restons dans le cadre de l’utilisation « manuelle » d’un OGM et de l’environnement du manipulateur. Quand je parle d’un organisme de classe 1 non pathogène, c’est dans les conditions de manipulations normales de laboratoire, ce n’est pas du tout dans le cadre de la consommation ou de l’injection de l’OGM à un homme. Quand on parle de « dissémination », on change complètement de registre, puisqu’on envisage alors l’injection ou l’ingestion et qu’il s’agit d’apprécier les conséquences d’une large diffusion de l’OGM dans la nature.
Ma deuxième remarque porte sur le soin attentif apporté dans nos prescriptions au respect du confinement. Cela implique non seulement des structures de laboratoire ou d’usine convenables – il existe des règles parfaitement codifiées sur ce point –, des manipulations correctes – ce que l’on appelle « les bonnes pratiques de laboratoires » – et surtout, le traitement des déchets car il ne faut pas que les déchets puissent, de quelque manière que ce soit, contribuer à la rupture du confinement. L’ensemble des déchets émis par un laboratoire ou une entreprise doit être inactivé, c’est-à-dire qu’il ne doit plus y avoir d’organismes vivants dans les déchets. Dans les laboratoires, les déchets sont traités comme des déchets hospitaliers, c’est-à-dire stérilisés et incinérés. Dans l’industrie, nous demandons aux industriels de veiller à ce qu’il n’y ait plus de cellules vivantes, ce qui ne pose plus problème, puisque des traitements soit physiques soit chimiques permettent d’atteindre ce but.
C’est un point important. Il y a deux ans, on nous a demandé d’examiner le problème posé par le maintien de l’ADN génomique d’une cellule détruite. Nous avons réuni des spécialistes pour savoir si cet ADN pouvait contribuer à la dissémination. Leur avis a été très clair. Concernant la question de savoir s’il y a risque de dissémination à partir d’un maïs transgénique contenant un gène d’une enzyme de chien, dont l’ADN est mis dans la nature – ce qui est le cas puisque tout le système racinaire du maïs, les feuilles et les tiges, reste dans les champs – les spécialistes nous ont dit que le gène de l’enzyme gastrique de chien existant déjà dans la nature, ce n’est pas la faible contribution de l’OGM qui pourrait participer au risque de dissémination. Pour nous, ce problème a donc été réglé. En revanche, nous demandons qu’aucune cellule vivante ne sorte des installations, laboratoires ou entreprises.
Concernant le fonctionnement de notre commission, il faut savoir que nous examinons entre 250 et 300 dossiers par an, en huit séances, avec deux experts que je nomme sur chaque dossier, en fonction de leurs compétences. Sur la base de leur avis, je rédige soit un avis, soit une note qui servira à l’agrément donné par le ministre de la recherche dans le cas des laboratoires publics ou privés.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous citer des cas dans lesquels l’autorisation, acceptée par vous, n’aurait pas été accordée par le ministère ?
M. Roland ROSSET : Nous nous contentons de donner un avis de classement en indiquant que tel OGM ou que l’utilisation de tel OGM correspond à telle classe et à tel niveau de confinement. Par conséquent, le ministre, en règle systématique – absolue même puisque, en cinq ans, je n’ai pas rencontré de cas de désaccord – retient notre classement et envoie un agrément conforme à notre recommandation. Je n’ai connu qu’un seul problème lié au désaccord entre le ministère de la recherche et un industriel : le ministère voulait marquer son mécontentement vis-à-vis de l’attitude de l’industriel, ce qui s’était traduit par un retard mais pas par un refus.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous donner des exemples d’avis favorables et surtout d’avis défavorables ?
M. Roland ROSSET : Je pense à un cas remontant à quelques années. L’expert avait donné son avis d’expert, puis, dans un second temps, m’avait dit qu’en tant que citoyen et scientifique, il lui semblait que cette expérimentation était inutile, dangereuse. Je ne pouvais pas retenir cette remarque pour la rédaction de mon avis, mais l’expérimentation proposée nous a paru suffisamment contre-nature pour que nous la classions en risque maximal, rendant l’expérimentation infaisable. C’est le seul cas, à ma connaissance, où nous avons adopté une attitude de refus. Il ne nous est pas possible de « refuser », nous sommes obligés de rendre un avis mais si nous « surévaluons » notre classement, il est clair que nous pouvons empêcher la réalisation d’une expérimentation.
M. le Rapporteur : De quelle manipulation génétique s’agissait-il, en l’occurrence ? Quelle manipulation avez-vous refusé ?
M. Roland ROSSET : Nous ne refusons pas vraiment d’expérience, puisque nous nous contentons de donner un classement. En cinq années, jamais nous n’avons refusé d’expérience. Nous avons demandé des compléments d’informations pour encadrer l’expérimentation, mais n’en avons jamais refusé.
M. le Rapporteur : Excusez-moi, mais vous ne répondez pas à ma question. L’expérimentation portait sur quel sujet ?
M. Roland ROSSET : La plupart du temps, cela porte sur l’utilisation d’animaux.
M. le Rapporteur : Sur quel animal précisément ?
M. Roland ROSSET : Il s’agissait de deux essais concernant un traitement sur le chien par injection dans l’œil.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : De quelle bactérie s’agissait-il ?
M. Roland ROSSET : D’un virus. Scientifiquement, cela se justifiait parfaitement, mais nous nous sommes demandés si, réellement, ce type d’expérimentation se justifiait. Mais, je le répète, ce n’est pas notre rôle. Il s’agissait là de réactions personnelles des rapporteurs.
M. le Rapporteur : Le futur conseil des biotechnologies est placé sous la tutelle des ministères de l’environnement, de l’agriculture et de la recherche. Ne pensez-vous pas qu’il pourrait également être placé sous la tutelle du ministère de la santé ?
M. Roland ROSSET : Actuellement, je suis sous la double tutelle des ministères de la recherche et de l’environnement. Cela signifie que pour tous les actes importants, il faut l’accord simultané des deux ministères, ce qui est très lourd. Quand le ministre de la recherche nomme les membres, il faut un décret conjoint du ministre de la recherche et du ministre de l’environnement. C’est extrêmement laborieux et nous y perdons des semaines entières. Je m’interroge donc sur l’utilité de mettre des organismes sous la tutelle de multiples ministères. Mais ce n’est qu’un avis personnel.
M. le Rapporteur : Je comprends, mais pourquoi le ministère de l’environnement et pas celui de la santé ?
M. Roland ROSSET : Nous n’avons jamais affaire au ministère de la santé. Notre interlocuteur est le directeur de l’AFSSAPS. Je ne suis pas en train d’exclure le ministère de la santé mais je préférerais que l’on réduise au contraire le nombre des tutelles tant il est clair que des tutelles multiples posent plus de problèmes qu’elles n’aident à en résoudre.
Puisque vous évoquez la future loi, je souhaiterais soulever deux points.
D’après ce que je connais du texte, le conseil des biotechnologies devrait se composer de scientifiques qui formeront une sous-commission et de ce que l’on appelle « la société civile » qui en formera une autre. Il est prévu que pour qu’il y ait un avis du conseil des biotechnologies, les deux sous-commissions devront se prononcer. Mon inquiétude serait que, par exemple, la section scientifique rende un avis, alors que la section de la société civile refuse de le faire, ce qui bloquerait tout le processus. Dans une telle situation, la recherche serait particulièrement visée. Aussi, je me demandais s’il ne faudrait pas que, pour des projets concernant la recherche, seule, la sous-commission scientifique soit requise pour émettre un avis.
Le deuxième point porte sur l’unicité des dossiers prévue pour l’ensemble des deux sous-commissions. A la lecture d’un dossier, je peux connaître la stratégie de recherche d’un laboratoire ou, très souvent, la stratégie d’une entreprise. Mon inquiétude serait que cette stratégie, qui est un renseignement important, soit trop diffusée au sein d’une large commission. Je souhaiterais donc, personnellement, que le dossier scientifique remis à la commission scientifique pour sa délibération, ne soit pas forcément le dossier soumis à l’ensemble du conseil.
M. le Président : Avant de donner la parole à nos collègues, je vous poserai une question. Quelle est la répartition entre laboratoires privés et publics, des 300 dossiers annuels que vous traitez ? Est-ce la loi de 1992 qui oblige, et dans quelles conditions, ces laboratoires à vous soumettre leurs projets d’expérimentation et de recherche pour que vous puissiez juger du risque de dissémination ?
M. Roland ROSSET : La loi de 1992 prévoit que tous les OGM doivent être déclarés. Je ne pense pas qu’il y ait d’exception, ou cela reste marginal. C’est dans ce cadre que les industriels déposent une demande d’agrément. Actuellement, 15 à 20 % des projets proviennent de l’industrie et le reste émane de laboratoires de recherche publics, ou parapublics comme l’Institut Pasteur ou d’autres structures du même type.
La procédure de déclaration d’agrément est-elle une contrainte pour l’industrie ? Il me semble qu’elle l’est, mais il faut souligner que nous entretenons maintenant un excellent dialogue avec les industriels qui ont très bien compris le système et le font bien fonctionner. Il n’est pas inutile qu’un comité veille au classement car, parfois, nos experts sont en désaccord avec le classement retenu par les industriels eux-mêmes qui peut être inférieur à celui que nous retenons. Je ne suis pas contre le principe de l’allègement, mais il faut, à mon avis, conserver un système de vérification, même a posteriori, afin d’éviter toute dérive dangereuse.
M. François GUILLAUME, Président : Quelle est la législation en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne ? Existe-t-il une recherche d’harmonisation européenne ? Ne se retrouve-t-on pas dans une situation comparable à celle que pose l’instrumentalisation des embryons, possible dans certains pays, interdite dans d’autres ?
M. Roland ROSSET : Nous avons des relations non pas institutionnelles mais personnelles avec les membres d’autres commissions en Europe et il est assez frappant de constater que l’interprétation que nous faisons des directives européennes, anciennes et nouvelles, est étonnement semblable d’un pays à l’autre.
Nous avons, par exemple, à régler le problème de l’autoclonage qui intéresse les industriels, puisqu’un micro-organisme autocloné n’a plus besoin – je ne dis pas qu’il échappe à la réglementation OGM – de mentionner que les produits qui en dérivent sont issus d’OGM. Les industriels en sont donc très demandeurs. Bien que l’autoclonage corresponde scientifiquement à un processus très précis, nous subissons des pressions constantes pour déclarer autoclonés un certain nombre de micro-organismes.
Sur cette question, j’ai pris contact, notamment, avec mes collègues hollandais qui ont les mêmes règles que les nôtres et qui subissent la même pression de la part de leurs industriels. Je pourrais formuler la même réponse sur la thérapie génique pour laquelle les experts étrangers aboutissent au même classement que nous. On constate une certaine homogénéité liée aux directives qui conduisent à des appréciations assez similaires, et même identiques dans nos différents pays.
M. André CHASSAIGNE : Vous avez parlé de 250 à 300 dossiers en six séances, soit une cinquantaine de dossiers par séance présentés par des experts nommés. Qui sont ces experts ? Leur indépendance est-elle garantie par rapport à l’industrie, mais aussi par rapport aux laboratoires publics ?
Les industriels et les laboratoires privés obtiennent des agréments pour des expérimentations. Mais n’y a-t-il pas un risque qu’au bout d’un certain nombre d’années le fruit de leurs expérimentations tombe dans le domaine public et qu’il n’y ait plus de contrôle alors ? Vous avez vous-même évoqué le contrôle a posteriori. Je souhaitais obtenir quelques précisions sur les contrôles et sur l’évaluation, en aval, des décisions.
Vous avez également parlé du maïs transgénique de classe 1, qui ne concerne que le préparateur et son environnement, je souhaiterais que vous nous donniez quelques explications sur le passage éventuel de ce maïs transgénique dans la consommation. Qui donne un avis dans ce cas ?
M. Roland ROSSET : En ce qui concerne l’indépendance des experts, il faut d’abord préciser que tous les scientifiques faisant partie de la commission sont des scientifiques qui font de la transgénèse, qui l’ont pratiquée et qui, par conséquent, en connaissent sinon tous les secrets, du moins tous les pièges. La question de l’indépendance a été posée sous deux aspects.
Le premier problème est le cas du scientifique qui, en dehors de son laboratoire, est le conseiller ou bien même participe au développement d’une entreprise. Si je suis confronté à cette situation, j’ai le choix entre deux attitudes. La première est de ne pas confier à cet expert ce qui relève d’entreprises concurrentes ou ayant la même activité, pour respecter la confidentialité. C’est le cas le plus fréquent. Il concerne actuellement deux membres de la commission. La seconde serait de procéder au remplacement de ces experts.
Le second problème tient aux pressions dont les experts peuvent faire l’objet
– et desquelles nous ne sommes jamais à l’abri. Nous sommes, de temps en temps, l’objet d’interventions et c’est l’occasion de distinguer le bon expert du mauvais. Un bon expert est celui qui, non seulement a des compétences, mais qui sait aussi rester indépendant. Je suis émerveillé à chaque séance de l’étendue des connaissances des membres de cette commission ; ce sont d’extraordinaires scientifiques qui connaissent non seulement leur domaine mais tout ce qui s’y rapporte.
Sur le problème de l’indépendance, il y a donc deux aspects, le premier est l’implication directe dans une entreprise travaillant sur ce que l’expert est censé juger, ou dans une activité concurrente. Il me revient alors de veiller à ce que cet expert n’intervienne pas dans ces appréciations. Puis, il y a le problème plus général des pressions extérieures.
Pour ce qui est des contrôles, les agréments sont jusqu’à présent donnés pour cinq ans. Au bout de cinq ans, nous revoyons passer les dossiers, et c’est actuellement le cas. Dans la nouvelle loi, tout ce qui concerne les classes 1 et 2, c’est-à-dire les niveaux de risque les plus bas, fera l’objet d’une simple déclaration. Nous ne reverrons plus ces dossiers. Seuls les agréments correspondant aux classes 3 et 4 seront éventuellement revus au bout de cinq ans. Vous soulevez là un problème important, que j’appelle gentiment la « dérive des projets » dans les laboratoires. On commence par un élément anodin, puis, on en rajoute et il y a dérive. Vous avez raison de poser la question et je n’ai pas de réponse à y apporter. Mais il faudra dans la nouvelle loi que vous prévoyiez le moyen de revoir les avis et agréments donnés.
M. François GUILLAUME, Président : M. Chassaigne demandait également qui nomme les experts. Je suppose que c’est le ministre ?
M. Roland ROSSET : La nomination est faite par les ministres de la recherche et de l’environnement, sur proposition. Quatre sont proposées par le ministre de la recherche, un par le ministre de l’éducation nationale, quatre par le ministre de l’environnement, deux par le ministre de la santé, un par le ministre des armées, un par le ministre de l’intérieur et un par le ministre de l’industrie.
Les industriels souhaiteraient que le ministre de l’industrie s’implique dans ces problèmes d’OGM.
Les ministres de la recherche et de l’environnement sont très présents. Le ministre de la santé l’est aussi parce qu’il est utilisateur. Le ministre de l’intérieur ne s’est pas trop manifesté jusqu’à présent mais demande maintenant à être tenu au courant et pour le ministre de la défense, c’est, en fait, un militaire que je connais bien, qui est un scientifique des laboratoires de l’armée où il s’occupe de bioterrorisme et autres sujets de ce type ; nous avons donc une interface opérationnelle.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Il y a peu de temps, le Parlement, à la demande du Président de la République, a voté une charte de l’environnement qui consacre – même si c’est de façon certainement imparfaite – les principes de précaution, d’information et de réparation. Je voulais connaître votre sentiment sur cette charte.
Par ailleurs, alors que la variole a été complètement éradiquée, une polémique s’engage pour savoir s’il faut conserver l’agent responsable de la variole, parce que des industriels et des scientifiques souhaitent l’utiliser dans les manipulations génétiques à des fins dont aujourd’hui, le grand public, et probablement certains scientifiques, ignorent l’objet. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, si j’ai bien compris, vous êtes réservé sur la possibilité de donner au collège de la société civile les mêmes informations qu’aux scientifiques. Est-ce à dire que ces personnes dont le niveau est pourtant jugé suffisant pour faire partie de cette commission ne sont pas capables de comprendre les enjeux ? Pourquoi semblez-vous ne pas leur faire confiance ? Pensez-vous que les populations et les citoyens sont incapables d’analyser ce qui se fait et d’avoir une opinion ?
M. Roland ROSSET : Pour ce qui est du virus de la variole, comme d’autres, on a publié la séquence nucléotidique complète. Cela signifie qu’un bon chimiste – et ils sont nombreux dans le monde – peut à tout moment reconstruire le virus. Donc, à l’heure actuelle, même si l’on détruit tous les stocks de virus de la variole existants, un mauvais esprit pourrait toujours le refaire. Par ailleurs, j’ai lu, il y a deux jours, dans une base que je consulte périodiquement, qu’aux Etats-Unis, les organismes de recherche envisagent de travailler sur le virus de la variole pour en faire un vecteur.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Oui, mais je vous demande ce que vous en pensez.
M. Roland ROSSET : On peut tout détruire, mais je connais quatre ou cinq personnes en France qui, si elles le voulaient, pourraient reconstituer un virus de la variole. Nous ne l’empêcherons jamais. C’est le drame du génie génétique : cela ne coûte pas cher et, dès lors que l’on dispose du savoir faire, on peut faire beaucoup de choses. C’est vrai aussi en bioterrorisme. Cela dit, je suis opposé à la manipulation du virus de la variole car je pense qu’il existe d’autres virus bien plus intéressants.
En ce qui concerne la mise en place d’un dossier unique, je constate que pour l’examen des dossiers nous demandons très souvent à l’opérateur de nous communiquer des détails sur son OGM. Si nous le voulions, ces précisions nous permettraient de reproduire ce qu’il est en train de faire. Or, il me semble essentiel de protéger les savoir faire industriels. C’est cet aspect du problème que je considère. Ce qui nous intéresse est de savoir comment les personnes sont parvenues au résultat et je voudrais éviter que ce savoir-faire soit divulgué. Actuellement, le dossier qui nous est remis et les informations qu’il renferme ne sont consultés que par les deux rapporteurs et moi-même. Je ne voudrais pas que cela aille au-delà.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Cela signifie qu’il n’y a pas de transparence.
M. Roland ROSSET : Notre classement porte sur le résultat de l’OGM final. Je souhaiterais protéger les moyens par lesquels on parvient à ce résultat.
A propos de la charte de l’environnement, je m’exprimerai sur deux points.
Tout d’abord, je ne suis pas sûr, contrairement à ce que souhaite le Président de la République, que cela doive faire partie de la constitution. Mais je n’exprime là que le point de vue personnel du citoyen que je suis.
Ensuite, je ne sais pas ce qu’est le principe de précaution, même après avoir lu l’épais rapport de M. Kourilsky. Pour ma part, je fais une analyse scientifique des risques qui peut varier dans le temps, en fonction des connaissances scientifiques que nous accumulons. Nous faisons le raisonnement suivant : « Etant donné notre analyse des risques, nous estimons que le risque maximal encouru est celui-là et que, dans ces conditions, les modalités que nous devons utiliser pour manipuler les OGM sont les suivantes… »
Je vais illustrer mes propos. Il existe un virus d’oiseau, qu’on appelle un canarypox, utilisé en vaccination chez l’homme. Il est employé dans des essais de vaccination contre le cancer de la prostate, par exemple. Il est intéressant car il ne se divise pas dans les cellules humaines. Autrement dit, il est analogue au virus que nous utilisons pour nous protéger de la variole. Il y a eu un variant, c’est-à-dire un OGM amélioré de ce canarypox qui, dans deux cas, s’est révélé capable de se diviser en culture de cellules humaines. Il semble que ce sont deux lignées de cellules qui n’ont rien à voir avec des cellules normales. Par conséquent, nous avons considéré que ce variant, cette nouvelle souche que l’on appelle Alvac 2, devait être traité comme s’il se répliquait chez l’homme, en attente d’information plus large. Nous avons donc pris l’évaluation maximale du risque pour décider de notre classement. C’est ainsi que nous évaluons les risques dans le cas des OGM.
Ce que je veux dire est que l’évaluation scientifique tient toujours compte des connaissances au jour d’aujourd’hui. Si demain, des industriels qui utilisent ce vecteur nous montrent qu’il ne se réplique que dans ces deux lignées cellulaires, nous reviendrons à un classement plus bas.
M. Francis DELATTRE : D’abord, je vous rassurerai en vous disant qu’il existe des parlementaires partageant largement votre avis sur le principe de précaution.
Ma question s’inscrit dans la continuité de celle de notre collègue. Les essais confinés, disiez-vous, ne semblent pas poser de grande difficulté au grand public. La difficulté, aujourd’hui, c’est la chaîne alimentaire.
M. Roland ROSSET : Effectivement.
M. Francis DELATTRE : Pour prolonger les questions précédentes, je souhaiterais savoir qui, finalement, donne l’agrément. Vous avez cité plusieurs ministres, sauf celui de l’agriculture et de l’alimentation.
La difficulté actuelle, celle qui explique la mise en place de notre mission, est pourtant le problème des essais au champ sur un certain nombre de végétaux OGM, sur la dangerosité desquels nous aimerions connaître votre avis car nos positions sont très divergentes.
Par exemple, la Commission européenne doit rendre un avis sur un certain nombre de maïs transgéniques qui ont déjà fait l’objet d’une étude et qui ont largement fait le tour des ministères, lesquels se renvoient, si je puis dire, « la patate chaude ». Parmi ces maïs, il en est un résistant aux glyphosates et un permettant d’auto détruire certains insectes dont la pyrale du maïs. Avez-vous eu à connaître de ces deux OGM ? Qu’en pensez-vous ? Il paraît étonnant que le ministre de l’agriculture ne soit pas votre interlocuteur courant.
M. Roland ROSSET : En ce qui concerne l’alimentation, c’est l’AFSSA, en charge de ces dossiers, qui nous demande un classement. Mais il s’agit d’un classement de l’OGM pour un manipulateur courant, non pour un consommateur.
Pour ce qui est des thérapies géniques, c’est l’AFSSAPS qui nous saisit pour avis et cet avis ne porte pas sur l’effet que pourrait avoir l’OGM sur un malade à qui on l’aurait injecté. Pour notre part, tant que nous sommes en confinement, nous évitons précisément d’injecter ou d’ingérer l’OGM. Marc Fellous, Président de la Commission du génie biomoléculaire, dont c’est le centre d’intérêt, vous répondra mieux que moi sur ce point.
Si je prends l’exemple d’un maïs Bt ou d’un maïs résistant aux herbicides, il faut s’interroger sur sa toxicité et, ensuite, sur ses effets à long terme. Ce sont eux qui sont importants car les effets immédiats et à moyen terme sont bien analysés. Les Américains en consomment depuis sept ou huit ans et nous n’avons rien noté jusqu’à présent. Mais vous savez très bien que les effets de certains médicaments ne se sont révélés que sur la génération suivante et sur ces effets-là, il faut bien reconnaître que nous sommes sans information.
Actuellement, on nourrit des animaux de toutes tailles pendant de longues périodes avec ces OGM pour observer d’éventuels effets adverses qui influeraient sur la croissance, la fertilité, ou des aspects de ce type. Mais il est vrai que la panoplie d’essais est assez réduite, puisqu’on est obligé d’attendre.
Si vous me demandez mon avis, je ne pense pas que le risque lié à ces OGM est grand. Pour le dire plus clairement, à la question de savoir si j’en consommerais, ma réponse est affirmative. Mais il s’agit d’une réponse que je fais en tant qu’individu, pas en tant que chercheur. Le problème de la voie alimentaire reste posé.
L’autre point que je veux développer est le fait qu’à l’heure actuelle, les OGM mis sur le marché par les semenciers ne présentent pas grand intérêt pour l’agriculture française, parce que le gain que les agriculteurs peuvent en attendre est mince. En revanche, il existe d’autres OGM, par exemple, de colza ou de betterave, auxquels je suis opposé car le risque de dissémination ou de transmission à des espèces voisines est avéré. En tant qu’ancien agronome, je dirais qu’il ne faut pas courir ce risque. Le maïs n’ayant pas de parent en France, le risque de dissémination est faible.
M. Francis DELATTRE : Concernant le colza, des études poussées sur la dissémination montrent qu’elle est de l’ordre d’une chance pour un million. Cela ne se fait pas comme cela.
M. Roland ROSSET : … et c’est abortif, je suis d’accord.
M. Francis DELATTRE : L’intérêt des OGM n’est pas seulement agricole, il est aussi environnemental. A partir de l’amidon du maïs, par exemple, on peut assez facilement remplacer tous les plastiques de supermarché. On ne peut pas le faire pour l’instant parce que le taux d’amidon n’est pas suffisamment élevé et que cela coûte encore cher. Mais en réduisant les coûts de 30 % – ce qui paraît assez facile, puisqu’on ferait l’économie de trois ou quatre herbicides en utilisant un seul traitement par glyphosate ou Roundup – nous aurions un maïs moins cher, pourvu d’un taux d’amidon plus élevé, et nous pourrions nous lancer dans l’industrie de remplacement des plastiques à partir d’une matière totalement biodégradable. Nous souhaiterions que vous examiniez tous ces effets, car il faut prendre en considération non seulement l’utilisation alimentaire mais aussi l’utilisation industrielle.
M. François GUILLAUME, Président : Nous verrons cela avec M. Fellous.
M. Roland ROSSET : Tout à fait.
M. Michel LEJEUNE : Vous parliez de la toxicité des molécules chimiques pour lesquelles on s’est aperçu qu’elles avaient des effets à long terme. Faites-vous une différence entre la toxicité à long terme d’une molécule chimique sur une descendance et celle des OGM ? Une expérimentation ne pourrait-elle pas être entreprise, par exemple, sur des animaux tels que la souris ou le lapin qui ont une multiplication rapide et sur lesquels on peut étudier les effets d’une éventuelle toxicité sur un certain nombre de générations ?
M. Roland ROSSET : Ces essais ont été réalisés. C’est ce que j’appelle les effets sur la fertilité, sur la descendance. Jusqu’à présent, rien n’a été trouvé. De même, rien n’a été trouvé concernant un éventuel effet allergène. Cela n’exclut pas qu’une fois sur 500 millions, un individu puisse être allergique. Pour le moment, rien n’a été trouvé. C’est tout ce que l’on peut dire. On ne peut pas dire que cela n’existe pas, on peut simplement dire que, pour le moment, cela n’a pas été trouvé.
Mais, si vous le permettez, je voudrais revenir sur un point. Il me semble, en tant que citoyen, qu’il faudrait pouvoir distinguer les végétaux destinés à la nutrition humaine ou animale et les végétaux destinés à une utilisation industrielle.
M. Serge ROQUES : Pouvez-vous nous indiquer le pourcentage d’essais acceptés ou rejetés par votre commission ?
M. Roland ROSSET : Nous ne rejetons pas. Nous attribuons un classement qui rend l’expérience infaisable. Par exemple, les expérimentations classées de niveau 3 requièrent une installation que l’on appelle un P3, si les utilisateurs ne disposent pas d’un P3, ils ne peuvent pas les faire. Par conséquent, nous n’interdisons pas, mais nous demandons des conditions qui ne sont pas forcément remplies par le demandeur. Nous sommes tenus de répondre, nous devons donc donner un classement. Ce classement peut être tel que, finalement, le demandeur ne peut mettre en place l’expérimentation.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Dans ce cas, y a-t-il un contrôle ?
M. Roland ROSSET : La loi de 1992 prévoit un contrôle qui a été mis en place par le ministère de la recherche après les multiples demandes de mon prédécesseur et de moi-même. Des contrôleurs, qui sont des personnes assermentées, en général, détachées de l’université ou des organismes de recherche à temps partiel – un quart temps, généralement – vont vérifier la conformité de la déclaration et de l’utilisation sur tout le territoire.
Cela ne se met en place qu’à l’heure actuelle. Je vous indique qu’au moment du 11 septembre 2001, j’avais envoyé une note au ministre de la recherche en lui indiquant que le système de contrôle n’existait pas. Je n’ai jamais reçu de réponse.
M. Germinal PEIRO : Je souhaiterais avoir une précision : la dissémination des végétaux OGM se fait par pollinisation ?
M. Roland ROSSET : Oui, ou par graine. Le colza, par exemple, a des graines tellement fines qu’elles peuvent se répandre le long des chemins, comme en témoignent les repousses de colza que l’on voit un peu partout en France.
M. Germinal PEIRO : Elle repousse, mais ne contaminera les espèces voisines que par pollinisation ?
M. Roland ROSSET : Tout à fait.
M. Germinal PEIRO : Vous dites traiter quelque 200 dossiers par an, alors que je suis incapable, pour ma part, de citer plus de cinq produits OGM. Alors, sur quoi portent ces dossiers concrètement ?
M. Roland ROSSET : Je vous donnerai un exemple. Dans les laboratoires, toute la recherche actuelle sur le comportement s’effectue sur des animaux qui sont toujours transgéniques. Ces animaux sont des OGM ; en tant que tels, ils doivent être déclarés.
M. Germinal PEIRO : Quel est le but de ces recherches ?
M. Roland ROSSET : L’étude du comportement consiste, par exemple, à regarder si l’accoutumance à une drogue est liée à une certaine forme de gène. On introduit donc ce gène dans le rat pour étudier sa tendance à consommer de l’alcool ou de la drogue.
En biologie du développement – c’est mon domaine – toutes nos expériences sont réalisées avec des animaux transgéniques : des souris transgéniques, des drosophiles transgéniques, des lapins transgéniques. Par exemple, l’un de mes collègues vient de transférer la maladie de la vache folle à un lapin transgénique.
Toute une partie de la recherche est, aujourd’hui, entièrement dépendante de l’utilisation d’OGM.
M. le Rapporteur : Si vous aviez des recommandations à nous soumettre dans le cadre du projet de la future loi, quelles seraient-elles ?
M. Roland ROSSET : Je vous ai déjà indiqué les deux points qui me paraissaient importants. D’une part, j’aimerais réellement que les décisions concernant la recherche soient sauvegardées, c’est-à-dire qu’il y ait sinon une priorité, du moins un souci important de la recherche. D’autre part, je reviens sur le problème des dossiers pour lesquels j’aimerais que l’on distingue ce qui est mis sur la place publique et ce qui relève réellement du secret industriel.
Le troisième point que je n’ai pas abordé a trait au Comité de biovigilance. Il est prévu que ce comité fasse partie de la même instance. Or les deux commissions CGG et CGB font une évaluation a priori, alors que le Comité de biovigilance fait du contrôle a posteriori. Je crains qu’il soit très difficile de faire cohabiter dans une même structure ce qui relève de l’évaluation d’un risque qui se fait en fonction des données dont on dispose, et l’évaluation a posteriori de ce qui s’est passé. Il faudrait réellement que les deux étapes soient clairement distinguées.
M. François GUILLAUME, Président : M. le professeur, je vous remercie de toutes ces informations. Comme je prévois que nous aurons besoin de précisions, la mission se permettra de faire à nouveau appel à vous, si nécessaire. Quelques problèmes se posent de manière très publique alors que, finalement, il semble qu’il y ait un foisonnement, une banalisation des OGM – dans les laboratoires tout du moins – qui est tout à fait étonnante. Elle est source de chances pour l’avenir, mais exige de la précaution.
M. Roland ROSSET : Mon inquiétude est de voir – je dépasse là totalement mon rôle – la façon dont les OGM sont banalisés ailleurs dans le monde, hors de la France. Cette année, la moitié du coton produit en Chine sera transgénique.
M. le Président : Je vous remercie.
Audition de M. Marc FELLOUS,
président de la Commission du génie biomoléculaire
et de M. Antoine MESSÉAN, vice-président
(extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004 )
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président,
puis de M. André CHASSAIGNE, Secrétaire
M. François GUILLAUME, Président : Nous recevons M. Marc Fellous accompagné de M. Antoine Messéan, respectivement président et vice-président de la Commission du génie biomoléculaire, la CGB. Nous souhaitions vous rencontrer pour que vous puissiez nous faire part de vos recommandations. Je rappelle que la CGB a été créée en 1986 et que le premier président en a été le professeur Axel Kahn.
Dans un premier temps, je vous demanderai de nous présenter cette commission, sa composition, les travaux qui l’occupent, la façon dont se font les désignations et les procédures utilisées. Vous pourrez nous dire comment et à qui vous rendez vos avis, s’ils sont toujours suivis et, dans la négative, pour quelles raisons.
M. Marc FELLOUS : Nous sommes vraiment heureux d’être reçus par votre mission pour vous exposer la façon dont nous travaillons et nos propositions pour l’avenir.
Mon exposé se divisera en quatre parties : la mission de la CGB ; notre manière de travailler, d’évaluer les risques pour la santé et l’environnement ; les propositions susceptibles d’améliorer notre travail du fait des limites de notre expertise scientifique ; et les points forts de notre message.
Je suis médecin et mon collègue, M. Antoine Messéan, est ingénieur agronome. Je pense que nos analyses sont complémentaires.
Comme vous l’avez dit, la Commission du génie biomoléculaire a été créée
en 1986. Sa mission est d’évaluer les risques pour la santé publique et l’environnement. Elle est composée de onze experts scientifiques et de sept représentants de la société civile, dont les noms figurent dans le document que je vous ai distribué. Nous avons le plaisir de compter parmi nous un représentant de l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques qui nous est fort utile.
La CGB est une commission indépendante, chargée d’évaluer les risques pour la santé publique et l’environnement de toute dissémination volontaire d’OGM, que ce soit dans le cadre de l’expérimentation au champ ou de la mise sur le marché, quand celle-ci est autorisée. Cette consultation s’opère soit au niveau national, dans le cas de l’expérimentation au champ, soit au niveau communautaire, dans le cas de la mise sur le marché.
J’insisterai d’emblée sur deux points importants. Tout d’abord, la CGB n’a pas pour vocation de faire des analyses sur bénéfices ou des études socio-économiques ou de coexistence. Ensuite, nous transmettons des avis et ce sont les services compétents dont nous dépendons – le ministère de l’agriculture, l’ancien ministère de l’environnement et, indirectement, le ministère de la santé – qui décident. La décision est donc prise à l’échelon politique ; nous n’écrivons que des avis.
Enfin, une dernière mission de la CGB est de répondre à des saisines. Si, par exemple, un travail rendu public sur une question précise émeut la population, nos ministères de tutelle nous saisissent pour mener une réflexion permettant de répondre à cette question pointue.
Il est également important de préciser que nous faisons une analyse au cas par cas. Chaque plante posant un problème différent, on ne peut pas généraliser. Le maïs pose un problème, le colza en posera un différent. Une plante donnée, d’après le transgène considéré, selon, par exemple, qu’il la rendra résistante à un herbicide ou à un insecte, sera différemment analysée.
Autre aspect important : s’agissant d’une expertise scientifique, elle est limitée par l’état des connaissances. C’est une expertise scientifique qui doit être dynamique, en fonction de nos connaissances et de l’expérimentation, qui va, elle-même, nous apporter des connaissances. Il y a donc une obligation de recherche : nous devons en permanence être à l’écoute des évolutions de la recherche, celle de nos chercheurs français comme celle des chercheurs étrangers.
Nos missions sont donc claires, elles ont des limites et nous communiquons nos avis aux ministres de tutelle.
Le deuxième point de mon propos porte sur la manière dont nous travaillons et sur ce qu’il faut entendre par « l’évaluation du risque pour la santé publique et l’environnement ». Il faut distinguer trois types d’évaluation, qui posent des problèmes totalement différents : la première évaluation porte sur l’OGM en milieu confiné, la deuxième concerne cet OGM en expérimentation au champ, la troisième concerne le cas de mise sur le marché.
Vous avez déjà entendu le professeur Roland Rosset, qui est responsable de la partie OGM en milieu confiné. Dans cette analyse, nous intervenons pour faire des expérimentations préalables à toute continuation. Par exemple, le milieu confiné permettra d’étudier si la protéine purifiée produite par la plante est toxique ou non sur des souris ou des rats. Elle nous permettra aussi de faire des tests in vitro sur l’entomofaune3 : celle-ci est-elle spécifique de l’insecte ou pas ? On pourra également étudier la séquence du transgène : s’agit-il d’une séquence dont on connaît le phénomène allergique, des épitopes allergiques ? On peut aussi – c’est la spécialité de mon collègue – faire des simulations in sinco de flux de pollen, en fonction de multiples paramètres dont les résultats en milieu confiné pourront ensuite être comparés avec les résultats au champ.
Les résultats de cette évaluation en milieu confiné – qui conduiront peut-être à stopper un OGM ou, au contraire, justifier sa poursuite –, ne permettent pas de passer tout de suite à la mise sur le marché. Il faut une phase d’expérimentation au champ. Elle est obligatoire dans la mesure où le milieu confiné ne permet pas d’analyser le caractère complexe d’une plante dans son environnement (ensoleillement, température, vents, etc..). C’est un point important dont nous voudrions discuter avec vous.
Par exemple, l’expression de la protéine du transgène dans les différentes parties de la plante donnera des résultats différents, selon que la plante sera dans une serre ou au champ. Nous savons aujourd’hui qu’une même plante, dans des lieux géographiques différents, a des niveaux d’expression différents. Nous sommes obligés de tenir compte de toute la complexité de la biologie d’une plante et du monde vivant. C’est la raison pour laquelle, il nous semble que refuser l’expérimentation au champ est quelque peu illusoire.
Un autre exemple est celui du test de « l’équivalence en substance », très utilisé dans l’analyse d’alimentarité, qui permet, grâce à des outils très subtils, de comparer une plante OGM et la même plante non-OGM jusque dans ses compositions les plus fines. Ces comparaisons n’ont de sens que si la plante pousse dans son milieu naturel et il est impensable d’imaginer procéder autrement.
Toujours dans l’alimentarité, les nouvelles directives imposent de faire des expériences de toxicologie chronique, c’est-à-dire de donner à manger à des rats ou d’autres animaux des quantités données de grains de maïs ou de grains de colza. Il est évident que ces grains doivent être cultivés à grande échelle pour disposer de suffisamment de matériel d’expérimentation et dans des conditions correspondantes à ce qui sera un jour mis sur le marché. Enfin, après des simulations en milieu confiné, il faut bien vérifier que ces simulations théoriques sont valables ou pas.
Le dernier point intéressant est l’effet sur l’entomofaune. Des résultats obtenus par nos collègues anglais, lors d’expérimentations au champ, ont montré qu’en Angleterre, un OGM, le colza tolérant à un herbicide, avait un effet négatif sur certains organismes de la faune. Inversement, le maïs tolérant à un herbicide avait sur eux un effet positif indirect.
Je pourrais citer bien d’autres exemples, démontrant la nécessité de l’expérimentation au champ. C’est la physiologie même de la plante, si je puis dire, qui le nécessite.
La dernière situation dans laquelle nous intervenons se présente si l’expérimentation au champ donne tous les éléments permettant de continuer. Le pétitionnaire demande alors une phase de mise sur le marché qui va poser des problèmes totalement différents de ceux rencontrés lors des phases d’expérimentation car on a alors affaire à des surfaces plus étendues, des durées plus longues – dix ans – et des impacts que nous n’avions pas nécessairement prévus a priori et que l’on va pouvoir vérifier a posteriori. La mise sur le marché va donc nous apporter de nombreuses informations, qu’elles aient été prévues ou pas.
Sur les procédures réglementaires applicables à ces trois types de situation, je me limiterai à rappeler très brièvement que l’expérimentation au champ est une procédure nationale qui implique la CGB. Nous informons nos ministres de tutelle, rédigeons un avis et indiquons si l’expérimentation en cause suscite ou non des objections. La mise sur le marché est une procédure communautaire longue et très complexe dont les modalités sont présentées dans le document qui vous a été remis. C’est vraiment un parcours du combattant. Le diagramme de parcours est le suivant : la France communique à la Communauté européenne. Il y a éventuellement un retour à la France puis, à nouveau, à la Communauté européenne en passant par un très grand nombre de commissions. Il est vraiment important de souligner que nous ne travaillons pas seuls. De nombreuses commissions nationales ou européennes sont impliquées.
Pour la mise sur le marché, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) donne son avis, qui peut être en accord ou non avec le nôtre. Je souligne d’ailleurs qu’au sein de la CGB, en plus des experts scientifiques et des représentants de la société civile, assistent systématiquement à nos réunions un représentant du ministère de la santé, un du ministère de l’environnement ainsi qu’un représentant de l’AFSSA pour assurer un lien entre notre travail et celui des autres commissions.
Pour en terminer sur les procédures, je rappelle que notre manière de travailler a été modifiée par la directive 2001/18/CE sur les points suivants : une réglementation plus rigoureuse, une obligation de surveillance pour la mise sur le marché, une autorisation qui ne peut excéder dix ans ; une obligation de traçabilité, d’étiquetage et de processus d’alerte.
Je passerai maintenant à la pratique de l’évaluation, ses limites et la façon dont nous verrions tout cela évoluer car, en tant que scientifiques, nous ne considérons pas que le système est figé ; il doit évoluer dans la limite, toutefois, de notre savoir, de la complexité des connaissances qui elles-mêmes évoluent avec le temps. J’insisterai donc sur quelques points qui me semblent essentiels de ce point de vue.
Premier point, nous avons précédé la 2001/18/CE en définissant des grilles d’analyse sur lesquelles s’appuient nos experts, que ce soit pour le dossier B traitant de l’expérimentation au champ ou pour le dossier C traitant de la mise sur le marché. Ces grilles sont décrites dans le document distribué. Elles définissent des points que nous pensons nécessaires à notre information pour pouvoir juger, analyser et confronter nos données entre experts.
Les grilles applicables aux dossiers de mise sur le marché comportent des questions plus précises, plus pointues : par exemple, la grille sur l’expression des gènes ou celle portant sur la toxicité de l’OGM, les résultats, l’information suffisante ou insuffisante, les modèles animaux, la pertinence des études… Toute une série d’informations nous permettant de cadrer nos outils d’analyse.
Deuxième point : il faut diversifier les compétences de notre commission pour améliorer notre évaluation des risques sanitaires et environnementaux.
Par exemple, nous voudrions que le nombre d’experts en épidémiologie soit augmenté. Les questions de traçabilité et d’étiquetage relèvent de l’épidémiologie et de l’écotoxicologie. La toxicologie est importante, mais l’écotoxicologie est une association des deux spécificités. Ces spécificités existent en France, quoique peu représentées, et nous souhaiterions qu’elles soient présentes au sein de notre commission. De même, nous voudrions renforcer la présence d’entomologistes ou de généticiens des populations. Nous en avons un pour l’instant, mais je pense que le sujet est suffisamment difficile et complexe pour que leur présence soit accrue.
Troisième point : nous avons amélioré et précisé nos règles de fonctionnement. C’est ce que nous appelons le règlement intérieur, qui figure également dans le document que je vous ai remis. Il concerne la désignation des experts – nous établissons une liste d’experts qui est validée par la commission – et la rédaction des avis – précédemment, nos avis faisaient une à deux pages, aujourd’hui, de cinq à dix.
Le quatrième point concerne l’information du public qui n’était pas assez présente dans notre travail et que nous avons améliorée peu à peu dans le sens de la transparence. Nous avons créé un site Internet où tous nos avis, dès leur validation par la commission, sont mis en ligne. Toute commission fait l’objet d’un procès-verbal, qui est un outil interne de notre commission, que nous validons. Les procès-verbaux comportant certaines données confidentielles ne sont donc pas mis en ligne sur le site Web, mais chacun fait l’objet d’une synthèse comprenant tous les éléments importants, votes compris, que nous rendons accessibles au public.
Vous pouvez comprendre qu’il est toujours difficile d’essayer de bousculer le fonctionnement d’une commission car on se heurte toujours aux mêmes problèmes de moyens. Normalement, nous devrions disposer d’un secrétariat important pour assurer le recensement de tous les articles nouveaux posant problème et la mise à jour du site Web. C’est un travail très lourd qui n’est pas encore fait de façon satisfaisante.
Pour améliorer l’information du public, M. Messéan et moi-même organisons des conférences de presse tous les ans, ou lorsqu’un problème exceptionnel se pose. Lors de la conférence de presse annuelle, nous présentons et distribuons notre rapport d’activité à la presse, spécialisée ou non, et nous répondons aux questions des journalistes, dans les limites de l’expertise. C’est une tâche difficile parce que les problèmes sont complexes.
Par ailleurs, je voudrais vraiment insister sur un point : chaque fois que nous rencontrons un problème difficile, complexe, nous organisons des séminaires pointus de recherche avec tous les membres de la CGB auxquels s’ajoutent des experts externes. Ainsi, en 2000, nous avons tenu un séminaire de trois jours sur la question des gènes de résistance aux antibiotiques, dont les actes ont été publiés sous la forme d’un livre accessible au public.
En 2001, nous nous sommes réunis autour du thème des flux de pollen – quelles sont les distances, quelles sont les manières de limiter ces flux, au cas par cas, plante par plante ? – et nous avons fait des propositions.
En 2002, nous avons tenu au Sénat un important séminaire international sur la difficile question de savoir si nous avons aujourd’hui les outils permettant de mesurer la toxicité d’une plante. En cas de toxicité aiguë, la plante est tout de suite éliminée. Mais quand on donne à manger au bétail, ou peut-être un jour à l’homme, une plante contenant un OGM, savons-nous mesurer ce que j’appellerai la « toxicité chronique », c’est-à-dire la toxicité à très long terme et à faible dose ? Les actes de ce séminaire international sont maintenant accessibles sur notre site.
En 2003, un séminaire a fait le point sur les impacts environnementaux de la culture du colza tolérant à un herbicide.
La semaine dernière, un important séminaire a également eu lieu sur la question de la stabilité de la construction d’un OGM mis sur le marché. Quels sont les moyens de le savoir ? Ce séminaire a été passionnant, comme ils le sont toujours, d’ailleurs. Mais, il faut continuer à faire de la recherche.
Dernier point, il faut que nous améliorions nos liens avec les autres instances. Chacun de nous étant pris dans ses travaux, les liens sont insuffisants. J’ouvre ici une parenthèse pour préciser que notre travail d’expert n’est pas reconnu par les instances pour lesquelles nous travaillons. Je suis universitaire et mon université Paris 7 veut que je fasse mes 189 heures, mais ne reconnaît pas ce travail d’expert. Nous manquons de temps pour aller discuter avec la Commission des toxiques, avec le Comité de biovigilance. Il faut formaliser les relations pour que des liens plus étroits s’instaurent avec ces instances. Je ne parle même pas des instances européennes qui pourtant existent aussi et avec lesquelles il serait également bon d’entretenir des liens, par le biais de réunions, d’informations, par un échange de nos avis ou par la présence d’un représentant de ces commissions à nos réunions.
Tous les points que je viens d’exposer ont fait l’objet d’un document que je pourrai vous laisser et que nous avons envoyé à nos ministres de tutelle en février 2003. L’objectif est de mieux travailler pour être plus à l’abri des critiques. Celles-ci existeront toujours mais, du moins, pouvons-nous les minimiser.
Je terminerai par un vœu. Il nous semble que la future loi de transposition devrait concentrer le travail de notre commission sur l’évaluation scientifique des risques sanitaires et environnementaux. Il est évident que les représentants de la société civile, qui sont minoritaires, n’ont pas toujours leur place dans ce type d’évaluation. Certes, le représentant des parlementaires, le professeur Etienne est un gastro-entérologue qui connaît bien la nutrition, mais peut-être faudrait-il que son avis porte non pas sur la partie scientifique proprement dite mais plutôt sur les questions sociétales qui sont les plus fortes aujourd’hui.
Autant les questions scientifiques sont cernées et reçoivent des réponses – parfois satisfaisantes, parfois peu satisfaisantes –, autant les questions sociétales sont peu abordées. La nouvelle transposition pourrait être l’occasion d’examiner la création de deux cercles différents, l’un scientifique et l’autre consacré aux questions sociétales, économiques, à la question des bénéfices et celle de la coexistence. Pour l’instant, à ma connaissance, il n’existe pas d’espace pour débattre de ces questions.
De même – et c’est un point sur lequel vous nous suivrez certainement –, la structure d’évaluation des risques ne peut pas être la même que celle qui les gère. Il faut séparer les deux fonctions. On ne peut pas être partie prenante dans la gestion si on évalue.
Enfin, du point de vue du chercheur, je voudrais élargir ce dont nous discutons au problème des biotechnologies végétales, car les OGM n’en sont qu’une partie. Ces biotechnologies végétales sont très importantes pour améliorer nos connaissances de la physiologie végétale. Il serait désastreux pour la recherche en agronomie française de ne pas pouvoir bénéficier de cet outil magnifique. Certes, il pose des problèmes, mais il serait dangereux pour les progrès de nos connaissances, de l’agronomie et de la physiologie végétale françaises, de ne pas avoir accès à un tel outil, avec, bien évidemment, les limites que je viens de vous décrire.
(M André Chassaigne remplace M. François Guillaume à la présidence.)
M. André CHASSAIGNE, Président : Je vous remercie, M. Fellous, de cet exposé extrêmement intéressant, comportant non seulement des explications, mais aussi des propositions. Nous allons maintenant passer à des questions qui vous permettront d’apporter des précisions.
M. le Rapporteur : Je vous remercie de la qualité de votre exposé et de toutes les recommandations futures que vous nous avez présentées.
Dans les expérimentations au champ que vous avez déjà réalisées, pouvez-vous nous parler de celles qui vous ont posé des problèmes de dissémination « pathogène » pour les plantes ou les animaux. Cela a-t-il donné lieu à l’arrêt des expérimentations ?
M. Antoine MESSÉAN : Je précise que nous ne sommes pas gestionnaires du risque, puisque le suivi officiel des essais, une fois qu’ils sont en place, est assuré par les services du ministère de l’agriculture. Mais nous bénéficions du retour d’expérience, les comptes rendus d’expérimentation et ceux des services officiels du ministère de l’agriculture nous étant communiqués a posteriori.
A ma connaissance, il n’y a pas eu d’arrêt d’essais pour des raisons d’impacts environnementaux. Tout au plus certains essais ont-ils fait l’objet de procès-verbaux pour non-respect des mesures de précaution de type distance d’isolement. Comme nous l’avons dit, la question de l’impact environnemental est fortement liée à l’échelle à laquelle on travaille.
M. le Rapporteur : Vous n’avez donc jamais connu de problème ?
M. Antoine MESSÉAN : En ce qui concerne les risques environnementaux, il nous arrive souvent d’évoquer la question de la dispersion de pollen et de la coexistence avec les filières classiques, bien que cette dernière ne relève pas de notre mandat, comme M. Fellous l’a précisé.
Ainsi, quand je dis qu’il n’y a pas eu d’arrêt pour des raisons d’impact environnemental, je ne dis pas qu’il n’y a pas eu dispersion de pollen au-delà des distances d’isolement qui font l’objet des préconisations de la CGB. Le raisonnement rationnel concernant les mesures de précaution de type distance d’isolement – ce ne sont pas les seules, mais ce sont celles dont on parle beaucoup – est, en effet, d’adopter des mesures évitant les impacts écologiques durables. On peut en discuter sur un plan scientifique mais, quand nous rendons nos avis, nous considérons que les mesures de précaution préconisées permettent d’éviter un impact négatif au plan écologique. Pour autant, cela ne signifie pas qu’aucun grain de pollen n’ira au-delà des distances d’isolement.
M. le Rapporteur : Pourquoi la CGB n’est-elle pas sous tutelle du ministère de la santé ? Cela vous semblerait-il utile ?
M. Marc FELLOUS : Le ministère de la santé intervient par le biais de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui nous envoie des dossiers de thérapie génique et/ou des dossiers de vaccins. Quand nous rendons un avis – avec des objections ou pas – nous l’envoyons à l’AFSSAPS qui le fait parvenir elle-même au ministère de la santé. Donc, pour ce qui est des expériences de thérapie génique et de vaccins, nous travaillons à guichet unique ; c’est l’AFSSAPS qui nous sert d’intermédiaire auprès du ministère de la santé.
Par ailleurs, je vous ai dit que, même si nous ne dépendons pas du ministère de la santé, le représentant de ce ministère siège dans notre commission. Il fait part à l’AFSSAPS, qui elle-même fait part au ministère de la santé, de tout ce que nous traitons, c’est-à-dire des aliments, de la toxicologie, des vaccins et de la thérapie génique.
M. le Rapporteur : Vous ne voyez donc pas l’utilité pour la CGB d’être placée sous la tutelle du ministère de la Santé ?
M. Marc FELLOUS : Pour l’instant, les choses fonctionnent assez bien.
Il y a deux manières d’améliorer les liens avec les autres commissions ou les autres ministères : soit créer des liens formels, soit demander qu’un représentant de ces ministères et de ces commissions vienne siéger au sein de notre commission. L’important est qu’il y ait une bonne diffusion de l’information et des problèmes que nous rencontrons. D’un point de vue pragmatique, c’est, me semble-t-il, le plus important.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que la CGB et le Comité de biovigilance doivent être fusionnés ? Vous avez déjà répondu en disant que chacun devait avoir sa fonction.
M. Marc FELLOUS : Oui, c’est très important. Je ne sais quel est votre avis mais, à mon sens, celui qui évalue et celui qui gère doivent être distincts. Une commission qui autoriserait et qui, en même temps, surveillerait serait affaiblie.
M. Antoine MESSÉAN : En revanche, il est essentiel que le retour d’expérience se fasse dans de bonnes conditions car on apprend beaucoup du suivi des essais ou de la mise sur le marché, par la mise en situation. Comme le disait M. Fellous, la diversité du vivant et la complexité de l’environnement font que l’on ne peut pas toujours apprécier a priori, en atmosphère confinée ou par des simulations mathématiques, ce qui va se produire. Si l’on observe des choses intéressantes dans le cadre du suivi, il est tout à fait essentiel que cela vienne alimenter les connaissances scientifiques pour l’évaluation a priori. Il faut donc qu’il y ait un lien au travers des connaissances.
M. le Rapporteur : Il m’a été rapporté, M. Fellous, qu’à une époque, vous étiez réticent quant à l’utilisation d’OGM médicaux destinés à la fabrication des protéines thérapeutiques. Pourtant, vous avez donné à Meristem Therapeutics l’autorisation de fabriquer la lipase qui sert à soigner la mucoviscidose.
M. Marc FELLOUS : C’est plus subtil que ça. Comme toujours.
Un précédent ministre de l’agriculture, M. Glavany, avait dit – et cela avait été repris dans les journaux – qu’il y avait de bons et de mauvais OGM. Parmi les bons OGM, il avait cité celui qui produit des médicaments. Je n’étais pas d’accord. Il n’y a pas de bons ou de mauvais OGM. C’est l’utilisation que l’on en fait qui les rend bons ou mauvais.
Pour ma part, un OGM qui a des propriétés médicamenteuses, peut avoir des effets plus néfastes qu’un OGM résistant à un herbicide, s’il est libéré dans la nature. Bon ou mauvais ne veut donc rien dire, ce sont les applications que l’on en fait, qui sont bonnes ou mauvaises.
M. le Rapporteur : Mais, dans le cas de la lipase, vous n’avez vu aucun inconvénient ?
M. Marc FELLOUS : Non, mais il faudrait être plus attentif, plus strict. Il s’agit en l’occurrence d’une lipase produite par le maïs. Le maïs est intéressant, d’une part parce qu’il n’existe pas de maïs naturel dans nos régions – chaque année, le froid le détruit, il ne repousse pas – et, d’autre part, parce qu’on peut isoler de manière pratiquement hermétique – mais jamais totale – un flux de pollen. Donc, pour le dossier Méristem, nous avons été très attentifs à cela.
D’une manière générale, les opposants aux OGM disent oui à la thérapie génique et non aux OGM plantes. Je dois dire, en tant que médecin, qu’une thérapie génique réalisée avec des vecteurs ou des vecteurs rétroviraux qui ont la propriété de se répliquer dans l’homme me semble potentiellement plus dangereuse. A mon avis, il faut faire encore plus attention. Le public intègre à la fois l’aspect risque et l’aspect bénéfice, alors que nous n’intégrons que l’aspect risque.
C’est pour cela qu’il faudrait une structure qui discute de ces aspects, qui explique au public que nous ne sommes pas qualifiés et surtout qui rende le public conscient de la complexité des choses. Certes, tout le monde est d’accord pour soigner un patient atteint d’une maladie génétique mais le risque est parfois bien plus dangereux. D’ailleurs, dans les dossiers de thérapie génique, nous sommes très attentifs aux conditions d’isolement des malades et le représentant du ministère de la santé nous reproche de ralentir les expériences parce que nous appliquons les mêmes critères de risque que pour les plantes OGM. Nous sommes très vigilants car il existe un risque de dissémination du patient dans son entourage quand il rentre chez lui.
Donc, la réponse à votre question est pleine de nuances, comme toujours.
M. Francis DELATTRE : Ma première question porte sur les problèmes de toxicité, concernant notamment le végétal : existe-t-il des études comparatives évaluant leur coût/avantage ?
Par exemple, dans le cas d’un OGM permettant de diminuer les pesticides, comme dans le cas bien connu de la pyrale du maïs, pensez-vous que des études pourraient être faites sur le coût et l’avantage d’un tel OGM ? On sait qu’on retrouve beaucoup de pesticides dans l’eau, puis dans le corps humain et il est scientifiquement démontré qu’il y a parfois cause à effet entre la présence de ces pesticides et la survenance de certains cancers. Or le but de certains OGM est bien de diminuer l’usage des pesticides.
Cela vaut pour les pesticides mais aussi pour certains produits phytosanitaires issus de l’agrochimie avec lesquels on soigne les plantes malades. Si l’on peut renforcer leur résistance aux maladies, on peut aussi diminuer la présence de ces produits phytosanitaires dans les plantes. De telles études comparatives sont-elles possibles ou bien suis-je un grand rêveur ?
Enfin, j’ai été très sensible à votre proposition concernant cet espace où l’on pourrait peser les rapports coûts/avantages des OGM, aborder les problèmes sociétaux, etc. Je vous suis parce que pour l’instant, on entend beaucoup José Bové, mais vous, M. le professeur, on ne vous entend malheureusement pas suffisamment.
M. Marc FELLOUS : Il n’est pas dans la mission de la CGB de passer tous les jours à la télévision. Ma mission est d’être en mesure de donner des avis à nos ministres de tutelle. C’est tout. Elle n’est pas d’informer. La commission donne de l’information sur notre site, qui doit, je l’ai dit, être encore amélioré pour être plus accessible, mais notre travail, notre responsabilité, notre métier n’est pas d’aller critiquer.
M. Francis DELATTRE : Je ne dis pas qu’il faut critiquer, mais qu’il faut participer au débat.
M. Marc FELLOUS : Je suis professeur, je parle à mes étudiants et je m’efforce d’être le plus convaincant possible. Bien que les débats soient toujours houleux, je n’ai jamais refusé une invitation parce que c’est mon métier d’enseigner et de diffuser du savoir.
Vos deux questions sont difficiles.
A la première portant sur la toxicité, je répondrai d’emblée qu’il n’est pas dans notre mission d’évaluer les bénéfices, de dire si en utilisant tel ou tel colza, le paysan emploiera moins d’herbicide ou de pesticide ou si en utilisant un maïs résistant à la sésamie, il utilisera moins d’insecticide, donc, polluera moins les nappes phréatiques.
Pourtant, c’est important. Pour pouvoir défendre les OGM, il faudrait pouvoir dire aux médias qu’effectivement, quand on utilise un maïs résistant à la sésamie, il y a un plus dans la production du maïs, parce que l’on va travailler de manière plus intelligente et plus raisonnée. Mais cela n’est pas dans ma mission.
Maintenant, si vous souhaitez ma réponse de citoyen, je dirai qu’il y a quelques mois, je suis allé en Catalogne espagnole, où j’ai observé ce que font nos collègues espagnols sur le maïs Bt. Nous, nous sommes des experts dans les bureaux. Je dois dire qu’en discutant avec les paysans qui font pousser 50 000 hectares de ce maïs, – en France, nous en avons 50 – vous entendez que ce maïs est formidable parce que le rendement est 30 % plus élevé et qu’ils n’utilisent plus d’insecticide, celui-ci étant dans la plante. Mais il faut dire qu’après un coup de tramontane, le maïs Bt est complètement à terre et qu’on ne peut plus le récupérer.
Les paysans vous disent qu’il n’y a pas à hésiter mais il est vrai qu’en Catalogne espagnole, il y a un problème – dont je n’ai pas parlé et qui montre bien qu’il n’y a de réponse qu’au cas par cas – qui est l’importante infestation de sésamie. Il est évident que si vous êtes dans une région où il n’y a pas d’infestation, le maïs Bt est inutile.
M. Francis DELATTRE : En France, c’est la pyrale qui pose problème.
M. Antoine MESSÉAN : Il est clair que cette question des bénéfices n’est pas dans notre mandat et nous demandons qu’elle soit examinée, mais pas par les mêmes personnes, même si cela relève en partie – et c’est un point difficile – d’une démarche scientifique car il s’agit d’évaluer a priori les bénéfices d’une technologie.
Il faut des scientifiques qui étudient le risque spécifique de l’OGM et éclairent l’homme politique puis, d’autres scientifiques et, plus largement, des acteurs socio-économiques qui donnent un avis. Mais l’évaluation scientifique des bénéfices est un exercice très difficile. On peut, sur un plan microéconomique, dire que quand il y a une attaque forte de pyrale, il y a un intérêt économique, éventuellement environnemental, mais il est très difficile d’intégrer dans l’analyse des bénéfices, les comportements des acteurs. A titre d’exemple, il n’est pas du tout évident que l’on n’utilisera pas la technologie même là où elle n’est pas nécessaire.
De toutes les études a posteriori – y compris de nombreuses études économiques – sur l’expérience des Etats-Unis, il ressort, pour certaines, qu’il y a eu réduction de l’usage de pesticides, pour d’autres c’est l’inverse. En fait, les méthodes d’évaluation ne sont pas les mêmes et les études ne portent pas sur les mêmes plantes, les unes s’intéressant au coton, d’autres au soja. Sur le soja, par exemple, il est dit que la technologie ne présente pas d’intérêt économique mais un intérêt en terme de temps. C’est plus confortable pour les agriculteurs qui, pendant ce temps, peuvent faire autre chose, ce qui est aussi à prendre en compte. Mais il n’en est pas de même pour le coton ou le maïs. Tout cela renvoie à ce que l’on appelle les « impacts indirects ».
Nous avons organisé un séminaire en 2003 sur l’impact environnemental des cultures de colza tolérant à un herbicide à l’occasion duquel nous nous sommes posé cette question des impacts indirects.
Les effets induits en termes de modification des pratiques agricoles, de changement de travail du sol, d’impact sur la biodiversité sont tout à fait essentiels. Cela ressort du rapport que je vous ai distribué. Cela doit être pris en compte mais n’est pas spécifique aux OGM. Toute pratique agricole induit des modifications indirectes qu’il est difficile d’apprécier a priori. Nous avons essayé de le faire pour le colza, mais le suivi a posteriori sera indispensable.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : M. le professeur, sur un certain nombre de points, je suis d’accord avec vous, en particulier, en matière d’évaluation et de gestion du risque car il me semble effectivement indispensable qu’il y ait d’un côté l’évaluation et de l’autre la gestion.
Je vous suis également pour dire que la connaissance de la physiologie végétale passe aujourd’hui par l’accès aux biotechnologies. Tout chercheur digne de ce nom utilise depuis déjà assez longtemps ces méthodes.
En revanche, j’ai plus de difficultés à vous suivre quand vous dites que les plantes ou les organismes génétiquement modifiés n’ont pas d’impact environnemental car, de mon point de vue, ces impacts environnementaux ne peuvent se constater que sur le long terme.
Mon collègue a évoqué les produits phytosanitaires : si l’on prend l’exemple de l’atrazine, quand nous l’avons utilisée, nous ne savions pas qu’elle aurait des conséquences aussi fortes sur la pollution de nos nappes phréatiques, de même pour les chlorofluorocarbones dont on ne savait pas a priori qu’ils auraient un tel impact sur la couche d’ozone.
Un autre sujet m’interpelle. Vous nous avez expliqué que l’on ne pouvait pas passer du milieu confiné à l’autorisation de mise sur le marché sans passer par des essais en plein champ, parce qu’une plante se comporte différemment, qu’elle soit transgénique ou pas, en fonction du lieu où elle est cultivée. Mais alors, on peut considérer que les plantes transgéniques devront être cultivées partout, parce que le climat sera différent d’un lieu à l’autre et que c’est un facteur important. La qualité de la terre doit l’être également, puisque certaines plantes poussent sur certains continents et pas sur d’autres. On sait aussi que certaines sociétés industrielles ont en tête de fabriquer des transgènes susceptibles d’être cultivés là où ils ne pouvaient l’être auparavant. On nous a beaucoup parlé de la faim dans le monde que l’on allait pouvoir résoudre grâce aux OGM, notamment en Afrique, où le blé ne pousse pas aujourd’hui mais où serait utilisée une variété de blé transgénique cultivable dans ces pays. On sait bien que, derrière cet enjeu, les intérêts économiques sont énormes
Comment pouvez-vous, dans votre commission et en tant que scientifiques, vous extraire de ces enjeux qui sont quand même fondamentaux et qui ont une signification humaine et économique importante ?
J’ai lu dans votre rapport qu’au sein de la commission un représentant d’une association de défense de consommateurs était démissionnaire, de même qu’un représentant d’une association de défense de l’environnement, ces sièges n’ayant pas été de nouveau pourvus. J’aimerais connaître les raisons de la démission de ces représentants et celles pour lesquelles ces sièges n’ont pas été pourvus depuis.
M. André CHASSAIGNE, Président : Permettez-moi de donner la parole à M. Pierre Cohen, qui souhaite intervenir avant la réponse.
M. Pierre COHEN : En effet, une de mes questions se rapporte au même thème.
Vous avez insisté par deux fois sur la nécessité de constituer un espace où des débats liés à l’économique et aux bénéfices pourraient avoir lieu. On sent bien que cette question vous préoccupe et je le comprends parce que, dans le débat, surtout quand il devient fort et violent, se crée souvent une confusion entre l’aspect scientifique du risque et un certain nombre d’arguments contradictoires qui peuvent conduire à l’adhésion ou, au contraire, qui font ressortir des enjeux de monopole et de dépendance de l’ensemble des agriculteurs. Par ailleurs, on sent bien qu’il y a, derrière tous ces débats, une évolution de la société sur la façon de produire l’alimentation.
Il me semble que votre rôle est de bien faire la différence. La question est de savoir comment il faut évoluer, quel est l’enjeu, s’il faut des lois pour empêcher les monopoles, les brevets sur le vivant, des lois pour éviter que la société ne se laisse guider par le seul profit. Tout cela relève du débat citoyen et c’est un problème d’information. Pour moi, cet espace de discussion que vous souhaitez, c’est la société correctement informée, alors que vous semblez préconiser un espace plus formel qui se situerait au même niveau que le vôtre, avec des représentants désignés. Est-ce bien cela ?
Ma seconde question reprend aussi les propos de Mme Perrin-Gaillard, mais d’un autre point de vue. Je voudrais que soient bien confirmés les propos de M. Messéan, selon lesquels à un certain moment, les essais en milieu confiné, voire les modèles mathématiques, ne sont plus suffisants pour émettre un avis pertinent.
Quand vous dites que vous avez besoin des retours d’expérience pour savoir réellement ce qui se passe, cela indique-t-il nécessairement d’aller en plein champ ? L’expérimentation en plein champ vous a-t-elle permis de constater des évolutions qui ont contredit ou modifié ce qui se fait en laboratoire ou qui est démontré par modèle mathématique ?
M. Marc FELLOUS : Nous répondrons tous les deux à ces questions qui sont effectivement importantes. Nous sommes des scientifiques, mais aussi des citoyens, à l’écoute de ce qui se passe et parmi les scientifiques certains sont opposés aux OGM. Mais si la communauté n’est pas homogène sur ce point, dans la très grande majorité des cas, l’opposition n’est pas d’ordre scientifique, elle est d’ordre philosophique, elle concerne la relation de l’homme à la nature. En tant que scientifique, j’essaie de comprendre les arguments des opposants. Je reconnais qu’ils sont importants, qu’il faut en tenir compte et y répondre, mais je dis qu’ils ne sont pas d’ordre scientifique et que, dès lors, ils ne sont pas du ressort de la CGB.
Par exemple, il ne nous appartient pas à nous, membres de la CGB de traiter du problème de la faim dans le monde. Il est évident que les réponses sont ailleurs et il suffit d’aller sur le site de la FAO4 pour savoir comment réagit l’Afrique à ces questions. Je visite ce site en tant que citoyen mais pas en tant que président de la CGB. La question de savoir si les Africains ont leur mot à dire ne relève pas de nos responsabilités, mais nous ne pouvons pas rester insensibles à ces oppositions extra-scientifiques.
Sur la question de savoir si, lorsque nous autorisons la mise sur le marché d’un tel OGM, nous sommes sûrs qu’il n’y a pas d’impact sur l’environnement, je vous répondrai, en tant que scientifique, que nous n’avons pas de certitude. Chaque fois que nous avons un doute
– c’est le principe de précaution – nous développons des programmes de recherche, nous nous réunissons et nous réfléchissons. Tout le monde est présent, nous ne sommes pas toujours unanimes, il y a des oppositions.
Nous pouvons dire aujourd’hui, avec les résultats des essais en milieu confiné sur l’entomofaune et ceux des expérimentations au champ, que nous ne détectons pas dans le temps – un ou deux ans – ni d’effets sur l’environnement ou sur l’entomofaune ni de croisements avec des plantes adventices.
C’est la raison pour laquelle dans la nouvelle directive 2001/18/CE de mise sur le marché, un chapitre important est consacré à la mise en place d’une structure de veille. On n’autorise pas sans rien savoir, il faut que le pétitionnaire dise exactement comment il va surveiller par exemple le flux de pollen – il faut qu’il dise précisément dans son cahier des charges avec quel outil il assurera la surveillance – ou bien l’entomofaune.
Notre inquiétude concernant l’environnement est celle de la résistance qui est un problème capital. Si l’on met un insecticide dans un maïs ou un colza, on sait mathématiquement que des insectes seront atteints. Ce que nous demandons, c’est que le pétitionnaire prévoit une « zone refuge » pour minimiser ce risque, c’est-à-dire un milieu, à côté du champ, où vont pousser ces OGM, où des insectes qui n’ont pas ce gène de résistance pourront se développer, persister et éventuellement se croiser avec ceux qui auront ce gène afin de le diluer.
Nous sommes conscients des risques mais nos tests permettent de dire qu’aujourd’hui, en l’état de nos connaissances, ce risque, s’il n’est pas nul, est minime. Il faut donc développer un dispositif d’alerte et de surveillance et dès qu’il se produit quelque chose, pouvoir tout de suite demander l’arrêt de l’expérimentation.
Vous avez également soulevé un deuxième point sur lequel nous sommes bien d’accord. Il n’est pas évident que l’on puisse généraliser au sud de la France l’analyse d’une plante OGM effectuée dans le nord. C’est la raison pour laquelle nous avons parfois une multitude de dossiers dont nous ne comprenons pas toujours le sens. Le pétitionnaire nous envoie plusieurs cultures d’OGM, précisément pour répondre à la question de savoir si, en faisant pousser le maïs dans d’autres régions, même dans un petit pays comme la France, il obtiendra les mêmes résultats en termes de qualité, d’expression du transgène, etc. Il le fait justement parce que les conditions géographiques très variables d’une région à l’autre vont entraîner des expressions différentes. Si l’on ne trouve pas de différence, on dira qu’aujourd’hui, dans les limites de nos connaissances, la géographie n’interfère pas.
S’agissant des représentants de la société civile, il est vrai qu’ils changent souvent. Il faut dire qu’il s’agit d’un travail lourd et prenant que nous accomplissons parce qu’il nous enrichit scientifiquement mais, très souvent, ils n’en voient pas l’intérêt pour leur « promotion » et ils ne se sentent pas très à l’aise au sein de cette commission où ils sont souvent minoritaires.
Nous avons eu la chance d’avoir parmi nous une représentante des consommateurs qui était biologiste et dont les réflexions étaient très intéressantes. C’est important et enrichissant pour une commission qui doit laisser place à la confrontation et au débat d’idées car, je vous l’ai dit, nous avons une vision très dynamique de la recherche. Si quelqu’un nous apporte des informations valides, nous changeons notre manière de travailler.
En 2004, tous les sièges vacants ont à nouveau été pourvus, même si cela a pris du temps, parce que rares sont ceux qui veulent participer à ce débat.
Il est intéressant qu’un représentant des consommateurs puisse s’exprimer, mais nous restons sur notre faim car ce représentant vote contre chacune de nos résolutions sans que nous puissions savoir pourquoi. Il nous dit seulement que son association lui a demandé de voter contre parce qu’elle est opposée aux OGM, ce qui n’est pas très fructueux. Et je comprends à quel point il doit être démotivant d’être dans une position d’opposition systématique. Ces représentants sont minoritaires et sont, de surcroît, dans une situation inconfortable, parce qu’ils votent contre non pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons qui, si elles sont respectables, n’ont pas leur place dans le débat scientifique. C’est la raison pour laquelle nous avons proposé, dès 2003, la création de deux structures parallèles dotées d’autant de pouvoir l’une que l’autre, l’une où l’on discute des arguments scientifiques, l’autre où seraient discutés tous les problèmes économiques, sociétaux, de bénéfice, du tiers-monde, de la faim dans le monde etc. J’imagine que les conclusions d’une telle instance seraient différentes des nôtres et il reviendrait au politique de faire la synthèse. Mais, à mon avis, le politique ne doit pas court-circuiter l’avis du citoyen, des consommateurs ou des économistes.
Je pense que l’on a besoin de science, comme l’a dit Antoine Messéan, non seulement dans notre domaine, mais aussi dans le domaine sociétal. Le consommateur utilisera des arguments scientifiques pour se déterminer et on y gagnera dans un débat qui est aujourd’hui mal engagé.
M. Antoine MESSÉAN : Nous souhaitons en effet un autre cercle formel de débat pour les raisons que nous venons d’indiquer car actuellement nous nous sentons en première ligne, alors que notre mandat est l’évaluation des risques. Nous sentons bien qu’il manque un intermédiaire entre la commission scientifique et le débat sociétal. Cela dit, nous ne nous sommes pas prononcés sur les modalités de fonctionnement de ce cercle car c’est à vous d’en décider.
Il y a un argument supplémentaire en faveur de la création de ce nouvel espace qui est le sentiment – peut-être récent– chez les scientifiques qu’ils ne savent pas tout et qu’ils ne posent pas nécessairement toutes les questions. Or la grille d’analyse a été élaborée par des scientifiques et nous sommes plusieurs à penser que les questions qui proviendraient d’un cercle socio-économique pourraient nous amener à nous interroger sur d’autres questions scientifiques liées à des risques que nous n’aurions pas identifiés parce que l’expert a ses limites, parce que les connaissances évoluent et parce qu’il s’agit d’individus et non de machines.
En ce qui concerne le retour d’expérience, je dirai qu’elle permet d’alimenter la dynamique de la connaissance. Sur le maïs, par exemple, si nous avions demandé il y a dix ans à des scientifiques de dresser l’état de la dispersion de pollen, ils nous auraient dit qu’il se disperse à telle distance mais on n’était pas allé voir si l’on retrouvait du pollen en altitude, alors que nous savons maintenant que c’est un élément à prendre en compte. Nous nous basons sur des connaissances validées, publiées et contrôlées – c’est une règle d’or des scientifiques – mais nous n’avons ainsi accès qu’à ce qui a été étudié. Il y a donc une posture consistant à se dire qu’il y a des choses qui n’ont pas été étudiées.
A titre d’exemple, les chercheurs de l’INRA qui ont commencé à travailler sur le croisement entre le colza et les crucifères adventices pensaient, il y a quinze ans, que ces croisements seraient très difficiles à réaliser. Ils ont produit des hybrides en laboratoire et sont ensuite allés au champ, pour s’apercevoir que c’était aussi facile au champ – avec des taux très faibles. Il y a donc une évolution des connaissances à prendre en compte.
J’ai dit, à propos des essais au champ, qu’étant donné les durées et les surfaces concernées ainsi que les mesures de précaution prises, nous considérions qu’il n’y avait pas de risque environnemental significatif. Mais j’ai dit aussi que toute pratique agricole a toujours des impacts environnementaux. Le simple fait de cultiver, une année donnée, un blé plutôt qu’un colza change, par exemple, toute la communauté microbienne du sol, même si cela n’a peut-être pas d’effet à long terme. Et il y a aussi les effets de masse, c’est pour cela que, pour les essais, on travaille sur des surfaces et des durées réduites.
Sur ce point, notre avis sur le colza est clair. Nous disons qu’aujourd’hui, dans les conditions actuelles de pratique agricole, il nous semble difficile d’envisager une mise sur le marché ; on suggère une « diffusion contrôlée » ou de « diffusion à très petite échelle » car les impacts environnementaux seraient très élevés avec une mise en culture à grande échelle. Dans le cas des essais, il y a des impacts environnementaux limités et, en étudiant cela au cas par cas, nous considérons qu’ils ne sont pas durables. Alors que, dans le cas de culture pour une mise sur le marché, ils pourraient l’être.
Faudrait-il faire des essais au champ partout, dès lors que la nécessité de l’essai au champ est établie ? Nous essayons au fur et à mesure que nous acquérons des connaissances sur la dispersion du pollen, de modéliser les phénomènes et nous disposons, par exemple, de modèles mathématiques simulant la dispersion de gènes de colza et de maïs dans des paysages agricoles. Avec ces modèles mathématiques, nous sommes capables d’estimer de façon assez précise, dans une région donnée, selon la forme des parcelles, le paysage environnant, la date de semis et de précocité des variétés et en formulant des hypothèses de scénario – par exemple, 10 % d’OGM dans cette région – le pourcentage d’OGM que nous allons retrouver dans nos productions non-OGM. Ces études relatives au problème de la coexistence concernent, pour l’instant, le maïs et le colza.
Pour répondre à votre question, dans la gestion des essais il faut appliquer le principe de parcimonie, c’est-à-dire les faire quand et où c’est nécessaire. Les modèles prédictifs disponibles maintenant permettent d’éviter de tester au champ partout et permettent d’identifier a priori, par simulation, les situations les plus à risque ou les plus bénéfiques. C’est alors qu’il faudra peut-être faire un essai pour vérifier s’il y a un problème ou pas.
Nous croyons beaucoup aux modèles mathématiques mais ils ne peuvent intégrer que les connaissances qu’on leur amène. Il faut donc se laisser interpeller par la réalité, bannir les certitudes et recourir à la notion dynamique d’intégration progressive des connaissances. Si nous n’avions que les études en laboratoire ou les modèles – même s’il faut les renforcer car je crois beaucoup aux modèles comme un instrument de rationalisation des essais – j’aurais pu conclure, par exemple, qu’il n’y a pas de risque de dispersion du pollen en altitude, faute d’avoir intégré cette donnée dans mon modèle mathématique. C’est donc bien parce qu’à un moment donné on va vérifier sur place les situations les plus à risques, que l’on peut vérifier la pertinence du modèle. Dans le cas contraire, cela signifie qu’il existe un paramètre que l’on n’avait pas vu. C’est ce qui s’est passé pour le problème de la dispersion du pollen de maïs en altitude.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Mais n’est-il pas alors trop tard puisque vous n’arrêtez l’expérimentation que quand vous vous rendez compte, après contrôle, que l’essai peut comporter des risques scientifiques ? Qu’en est-il alors du principe de précaution puisque, si j’ai bien compris, ces expérimentations en plein champ vous sont indispensables ? Qu’en est-il de la pollinisation, de la santé ? Comment pouvez-vous, d’un point de vue scientifique, nous répondre ?
A l’heure actuelle, vous êtes capable de dire qu’à l’échéance d’un ou deux ans, ces expériences sont suffisantes. Mais, comme le disaient ma collègue et le professeur Rosset, nous n’avons pas encore passé une génération d’hommes pour mesurer quels pourraient être les effets négatifs sur une deuxième génération. Pourriez-vous m’apporter des éléments complémentaires ?
M. Marc FELLOUS : Je découvre depuis une dizaine d’années ces problèmes très intéressants et cela me rappelle ce que je me dis quand je vais soigner un malade. : « Si je le soigne quel sera le bénéfice, si je ne le soigne pas quel est le risque ? »
Je peux pourtant vous affirmer que si demain vous allez voir votre médecin et qu’il vous fait part de ses incertitudes, vous sortirez encore plus malade car vous avez besoin de certitudes. Je fais cette parenthèse parce qu’en tant que médecin, je sais comment il faut parler aux patients. Il ne faut pas leur dire que l’on ne sait pas, ce serait une catastrophe.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Cela ne concerne qu’un individu, alors que nous parlons d’éléments qui concernent des populations entières.
M. Marc FELLOUS : Je reviens à la question de l’arrêt des expérimentations qui soulève le problème capital de l’irréversibilité des éléments avec lesquels on travaille. Tout dépend, en fait, de la plante. Par exemple, pour le pollen de maïs, on sait qu’il va mourir parce que dans nos régions, il n’y a pas de plantes voisines et que, de toute façon, il ne passera pas l’hiver. Mais il en est autrement du colza. C’est la raison pour laquelle, lors du séminaire sur le colza, nous avons recommandé la prudence.
M. Antoine MESSÉAN : Vous parliez d’arrêt des essais. Il est clair que quand on considère qu’il n’y a pas d’objection, c’est qu’il n’y a pas de danger a priori décelable avec les connaissances du moment.
Sur la question de l’alimentation, on va accroître nos connaissances à partir de l’expérimentation, dans le cadre d’essais dont on aura évalué le risque. Dans le risque, plusieurs critères entrent en jeu : il y a ce que l’on appelle l’exposition, c’est-à-dire le mode de diffusion du transgène, et il y a le danger proprement dit, c’est-à-dire l’effet du transgène. Dans le cas très précis que vous évoquiez, c’est-à-dire l’effet du transgène et dans l’hypothèse où une exposition n’aurait pas été intégrée a priori, il n’y avait pas de danger écologique ou sanitaire. Cet élément est bien le résultat de l’analyse.
On peut tout imaginer, mais comment pourrait-on imaginer qu’une protéine, bien connue et étudiée par ailleurs, se révèle dangereuse ? Bien que cette hypothèse soit assez peu probable, il n’empêche que le postulat est qu’il ne faut pas l’écarter. Sur l’exemple précis de dispersion de pollen de maïs, on est bien dans le cas d’essais et d’OGM qui ne présentent pas de danger et qui n’ont pas d’impacts directs. Il n’y a pas non plus de risque de prolifération, puisque ces essais se font sur des durées et des surfaces limitées. En revanche, pour le colza, par exemple, nous savons qu’en cas de culture à grande échelle, il existe des conditions dans lesquelles une prolifération peut se produire, du moins un accroissement des populations de colza dans l’environnement. Est-ce bien ou mal ? Nous disons seulement qu’il y a des impacts environnementaux, qu’ils ne sont pas forcément dangereux, mais qu’il faut en tenir compte. C’est pour cela qu’il faut des conditions de gestion très particulières qui ne sont pas forcément réalisables, économiquement viables ou acceptables, mais ce n’est pas à nous d’en juger.
M. Serge ROQUES : A l’inverse, avez-vous pu démontrer scientifiquement un danger précis des OGM ? Par ailleurs, pensez-vous que les difficultés rencontrées pour la culture des OGM en plein champ peuvent induire un retard dans la recherche scientifique française ?
M. Marc FELLOUS : A votre première question je répondrais non parce que les pétitionnaires ne nous envoient que des dossiers filtrés. Quand ils construisent des OGM, ils font les expérimentations de toxicité, d’avantages en phase confinée, ou bien ils ont réalisé des expérimentations ailleurs, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud ou en Inde et ont pu vérifier que ces essais n’entraînaient pas de risque pour l’environnement ou la santé. Nous disposons donc d’un matériel déjà extrêmement filtré par des tests préalables en milieu confiné et par des tests de mise sur le marché effectués dans d’autres pays.
Mais les OGM que nous avons en culture aujourd’hui sont déjà développés à grande échelle chez nos voisins. Je vous ai parlé de l’Espagne. S’il y avait eu des dangers, je pense que les pétitionnaires auraient vite arrêté le processus car fabriquer un OGM revient cher. La durée de vie d’un OGM n’est en effet que de dix ans et il faut passer ensuite à une nouvelle génération. Les OGM que nous avons ont donc été testés ailleurs depuis de très nombreuses années. En fait, ceux que nous testons en France sont très peu innovants.
Votre question sur le risque d’un retard scientifique de la France est importante et c’est bien ce qui se passe avec la destruction d’essais qui sont précieux. Des expériences importantes du CIRAD5 sur le riz ont été détruites de même que l’expérimentation Aventis de croisement avec le colza ou l’expérimentation de Meristem. Ce sont des années de recherche privée et publique qui se sont envolées. Sans messages forts ni informations convaincantes, il faut, en effet, avoir peur pour la recherche française.
J’ai eu la visite, la semaine dernière, d’un chercheur en biologie végétale du Gabon qui envisage d’introduire certaines de ces méthodologies dans son pays. Si nous n’avons pas le savoir parce que nos recherches sont détruites, il ira s’adresser à des pays concurrents. La France est en avance, c’est un des principaux vendeurs de semences grâce à un savoir-faire traduisant une grande expérience mais cette avance est fragile et il faut continuer à avancer.
En Argentine, j’ai eu l’occasion de voir le soja transgénique qu’on y cultive et j’ai pu constater qu’on y acquiert un savoir-faire extraordinaire que nous sommes en train de ne plus pouvoir développer. Cela me fait peur, mais je parle en tant que scientifique pas en tant que président de la CGB.
Je voudrais cependant tempérer mes propos car je ne suis pas pour le tout OGM. Par exemple, la généralisation du maïs résistant à la sésamie ou à la pyrale serait insensée. Il faut considérer les choses en fonction des besoins et des problèmes. C’est un outil important pour la connaissance et le freiner, comme cela se produit aujourd’hui, est dangereux. Mais la réponse n’est pas uniquement policière, je le regrette d’ailleurs. Il me semble qu’elle devrait partir d’une meilleure information, d’un meilleur débat, pour lequel, nous vous l’avons indiqué, l’opposition est plus d’ordre socio-économique. On dit que les OGM vont placer le paysan sous la dépendance des vendeurs de semences, etc. Ces sont ces éléments qu’il faut examiner et, pour le moment, il y a un vide qui nous gêne.
M. Francis DELATTRE : L’argument de la subordination de l’agriculteur au semencier ne tient plus. Il y a bien eu la tentative dite « Terminator »», mais c’est la seule et cela a fait un tort considérable aux OGM. Par ailleurs, pour les semences fermières, on a tout de même inventé une taxe pour faire payer le droit de reproduire sa propre semence. Nous ne sommes donc pas blanc-bleu, même ici au Parlement, puisque c’est le Parlement qui vote les taxes.
M. le Rapporteur : Je tenais tout d’abord à vous remercier pour la clarté de ces explications.
Il me semble, en effet, que l’ouverture à la société civile est indispensable, sous réserve que les membres de cette commission, que l’on souhaite totalement indépendante, abandonnent leurs a priori. Ayant été chargé d’établir un rapport sur le service de santé des armées, je dois dire que ledit rapport a abouti à une conclusion totalement différente de ce que j’avais imaginé au départ, simplement parce qu’à force de discussions, j’ai abandonné tous mes a priori.
Votre rapport sur la Commission de génie biomoléculaire date de deux ans. Vous avez sans doute fait d’autres préconisations depuis. Pourriez-vous nous les communiquer par écrit ?
M. Marc FELLOUS : Nous pouvons effectivement vous indiquer cela par écrit.
M. le Rapporteur : Je vous en remercie.
M. André CHASSAIGNE, Président : Nous vous proposerons sans doute, si vous en êtes d’accord, de participer à une de nos tables rondes contradictoires tant il nous semble intéressant que la richesse de vos propos puisse être confrontée à d’autres avis.
Audition du Professeur Jacques TESTART,
directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
co-organisateur du débat des « 4 Sages » sur les OGM en 2002
(extrait du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2004)
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président.
M. François GUILLAUME, Président : Le Président de notre mission, M. Le Déaut, est en déplacement en Hongrie et j’ai l’honneur de le remplacer. Nous recevons aujourd’hui M. le Professeur Jacques Testart, directeur de recherche à l’INSERM, co-organisateur du débat des « 4 Sages » sur les OGM qui s’est tenu en 2002.
M. le directeur, après quelques mots d’introduction sur votre parcours, je vous propose de nous livrer vos réflexions sur le sujet qui nous occupe, avant de répondre aux questions posées par M. le Rapporteur, puis par nos collègues.
M. Jacques TESTART : Je vous remercie de me donner la parole devant cette mission.
Pour me présenter brièvement, je dirai que je suis biologiste de la procréation. Je ne suis absolument pas généticien. Mes faits d’armes se sont essentiellement déroulés autour de la fécondation in vitro des bébés-éprouvette. J’ai été amené, avant d’en démissionner, à présider la Commission du développement durable, à l’époque où elle existait et s’intéressait à de nombreux sujets, dont les OGM. J’ai été aussi co-organisateur du débat des « 4 Sages » avec Jean-Yves Le Déaut, Didier Sicard et Christian Babusiaux.
Je m’intéresse beaucoup au thème des OGM, sujet sur lequel je m’emporte très vite. Je vous demanderai d’emblée d’excuser mon énervement, que vous percevrez sûrement.
Je m’emporte d’autant plus qu’il s’agit, à mon sens, d’un débat absurde, ce que j’essayerai de montrer. Je m’emporte parce que le thème des OGM rejoint des sujets qui me glacent et que l’on retrouve dans d’autres thématiques, avec toutefois une forte concentration sur le thème des plantes transgéniques. C’est, pour être bref, le pouvoir des lobbies industriels qui arrivent à faire passer pour vérité ce qui n’est encore que promesse. C’est le déguisement de la croyance par la science – ce que je supporte mal. Ce sont aussi des atteintes graves à la démocratie. Mais ce n’est pas spécifique à la France, cela fait partie de la mondialisation de la technoscience.
Le présent débat me laisse assez perplexe, car j’ai l’impression de revenir dix ans en arrière, comme si les parlementaires ne savaient ce que sont les plantes transgéniques et les problèmes qu’elles posent, alors qu’une masse de documents est parue depuis une dizaine d’années, surtout depuis la Conférence des citoyens de 1998.
Ces documents – qui sont surtout produits par les opposants aux plantes transgéniques – peuvent malgré tout être des documents de qualité. Sur l’histoire de la manipulation du thème des plantes transgéniques par les multinationales, vous avez le livre d’Hervé Kempf, journaliste au Monde. Un livre collectif, sorti l’an dernier sous la direction de Frédéric Prat et regroupant une dizaine d’associations, fait le point sur tous les sujets. Un autre ouvrage de Guy Kastler vient de paraître sur la bibliographie et tout ce que l’on sait sur les rapports entre plantes transgéniques, environnement et santé, sujet de votre mission. D’innombrables articles de presse ont également été publiés sur le sujet. J’en ai commis quelques-uns.
Il n’est sans doute pas inutile de nous entendre car vous avez certainement des questions à poser mais, étant quelque peu provocateur, je donnerai plutôt des éléments qui nous permettent d’aller au vif du sujet.
Je viens de vous citer des publications qui sont rédigées par des personnes que l’on qualifie « d’anti-OGM ». C’est absurde. Personne n’est contre les OGM. Les OGM sont des organismes. Etre pour ou contre n’a aucun sens. C’est contre la dissémination, contre le brevetage, contre des choses de cet ordre que l’on peut s’élever.
Si je n’ai pas nommé d’ouvrages écrits par les « pro-OGM » c’est parce qu’il n’en existe quasiment pas. Il y a bien quelques rares ouvrages – assez lamentables, dois-je dire –, produits, entre autres, par des chercheurs en agronomie, de petits fascicules ressemblant à des ouvrages de croyance où sont racontées des choses qui n’existent pas – nous pourrions les reprendre si vous le souhaitez – et dans lesquels ces chercheurs se font passer pour des individus totalement objectifs, alors qu’ils sont parfois impliqués dans des start-up fabriquant des OGM, ce qui leur retire tout de même une certaine légitimité.
Cette absence d’interlocuteurs dans le débat sur les OGM me frappe. Je le vois bien car, quand quelqu’un ou une association veut organiser dans une région un débat sur ce thème, on m’appelle assez souvent. Je déclare immédiatement que je plaiderai contre la dissémination des plantes transgéniques et l’on me demande alors si je connais quelqu’un qui pourrait me répondre, parce qu’il est difficile d’en trouver.
Ceux qui plaident en faveur des plantes transgéniques se cachent, ils n’apparaissent que seuls. Vous en verrez ici. Ils écrivent aussi dans les journaux, mais refusent absolument la discussion et quand, par exception, ils l’acceptent, ils ne tiennent généralement pas le beau rôle.
Je crois que c’est la démonstration qu’il y a, du côté des pro-OGM, une incapacité d’argumenter. Ils préfèrent soutenir seuls leur argumentation, en racontant : « On va nourrir la planète. On va faire pousser des tomates dans des terrains salés. On va mettre de la vitamine A dans le riz. » Toutes sortes de réalisations qui seraient intéressantes, mais qui sont à l’état de recherche et restent, pour le moment, des promesses.
Il est regrettable que des scientifiques dont, normalement, la fonction est de rechercher des vérités et de les faire connaître, soient aujourd’hui réduits à jouer le rôle d’attachés de presse des industriels pour essayer de faire croire que ce que l’on cherche à obtenir, est déjà obtenu.
Les arguments des pro-OGM portent sur l’acquis, et ce qu’ils répondent est complètement usurpé. Ils portent aussi sur le présent – c’est-à-dire, pour ce qui est de la France, sur les essais de plantes transgéniques – or, ces essais sont dévoyés. Ils portent enfin sur l’avenir, qui est totalement mystifié car, pour les plantes génétiquement modifiées en France, cet avenir est, en fait, le présent en Amérique du Nord.
Je reviens sur ces trois points car les mots que j’emploie sont volontairement violents.
L’acquis, disais-je, est usurpé. Quand un pro-OGM vient pour défendre les OGM, aussi bien dans les articles de presse ou les livres que lors d’interventions radiotélévisées, il parle des micro-organismes que l’on cultive dans les fermenteurs pour produire des substances utiles à la pharmacopée. Ce sont effectivement des OGM, bien que je pense personnellement que l’on ne peut utiliser le mot « organisme » pour qualifier une cellule car un organisme est pluricellulaire. Le fait d’avoir baptisé « OGM » un ensemble dans lequel il y a des organismes et des cellules isolées est un abus de langage qui n’est sans doute pas innocent.
Bref, il traite des succès connus des OGM que personne ne conteste et que personne ne demande d’arrêter. Ce sont les vaccins et la plupart des vaccins sont fabriqués par des OGM. Mais cela n’a rien à voir avec les plantes transgéniques. La confusion est savamment entretenue par les pro-OGM qui ne peuvent citer que ces réussites.
Pourquoi cela n’a-t-il rien à voir ?
Tout d’abord, parce que cela se fait en milieu fermé. Ces micro-organismes, qui peuvent être des bactéries, des cellules animales ou humaines que l’on a modifiées dans le but de leur faire produire certaines substances, sont enfermés et très surveillés. On peut donc penser que, sauf accident – c’est un peu comme le nucléaire –, ils ne devraient pas sortir du laboratoire et n’auraient pas d’effet sur l’environnement ou sur la santé. Etant donné leur utilité, je ne vois pas de raison de s’opposer à ces OGM.
Mais on peut aussi expliquer leur succès autrement : l’objectif est apparemment plus facile à atteindre parce que, du point de vue génétique, il est plus aisé de maîtriser une cellule isolée qu’un organisme pluricellulaire. Ce que l’on sait faire avec des levures ou des cellules, même humaines, en les modifiant, en les cultivant, on ne peut le faire avec la même maîtrise quand on a affaire à des cellules différentes cohabitant dans des organes et dans l’ensemble de l’organisme et qu’il y a des échanges non seulement avec l’environnement mais aussi à l’intérieur de cet organisme complexe. Dans ces cas, la maîtrise est bien moins bonne. C’est une hypothèse que je pose car, pour l’instant, il n’y a pas d’explication à ce phénomène. Je constate simplement qu’il n’existe aucune plante que l’on maîtrise aussi bien qu’une cellule isolée. Cela me paraît d’ailleurs être un sujet de recherche intéressant.
J’ajouterai que ce que l’on peut reprocher aux plantes transgéniques – j’utilise toujours le mot PGM (peut-être un jour parlerons-nous d’AGM, d’animaux génétiquement modifiés, qui sont déjà à l’étude) pour bien les distinguer des OGM industriels fabriqués en milieu confiné et qui sont bien utiles – c’est que, contrairement aux cellules isolées qui n’ont pas d’échange avec l’extérieur, les plantes génétiquement modifiées, par exemple pour fabriquer un insecticide, vont avoir une action sur l’environnement qui est labile. Les bêtes s’habituent très vite à ce genre de produits.
Les cellules cultivées sont stables, n’ont pas de rapport avec l’extérieur et elles fournissent un service à l’humanité. Je trouve malhonnête qu’à chaque débat sur les OGM on évoque ces cellules pour montrer les avantages des OGM en laissant croire que c’est la même chose pour un organisme complexe. C’est pourquoi je dis que les acquis sur les plantes transgéniques sont usurpés.
Venons-en au présent. Le présent, en France et très largement en Europe, ce sont essentiellement les essais car, bien qu’il y ait des autorisations de cultures, pour des raisons diverses, il n’y a pas vraiment de cultures d’OGM en dehors des essais. Ces derniers sont supposés apporter des réponses à des questions quasiment fondamentales, sur la dissémination, sur les modifications de l’environnement, éventuellement, sur la toxicité et sur l’innocuité de l’OGM.
Il y a mensonge. Quand nous avions organisé ce fameux débat des « 4 Sages », auquel participait Jean-Yves Le Déaut, nous nous sommes adressés à plusieurs reprises aux responsables des essais de PGM…
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous rappeler comment a fonctionné ce comité des « 4 Sages » ?
M. Jacques TESTART : A l’instigation de cinq ministres, ce débat s’est tenu en février 2002. Les « 4 Sages » en question étaient Jean-Yves Le Déaut, que vous connaissez, Christian Babusiaux du Conseil de l’alimentation, Didier Sicard du Comité national d’éthique et moi-même pour la Commission du développement durable. C’était une initiative très intéressante car, pour la première fois – et la dernière –, nous avons eu un débat contradictoire d’experts. Nous avions réuni une trentaine de personnes : dix pro-OGM, dix anti-OGM et dix universitaires ou autres, sans opinion affirmée, les anti-OGM étaient tout aussi experts que les pro-OGM et les comptes rendus de ce colloque montrent qu’il a été répondu à toutes les questions que l’on continue d’ailleurs de poser aujourd’hui.
Nous avons préparé le débat en réunissant énormément de documents. Mais il nous manquait ceux qui démontrent l’affirmation selon laquelle on ne recourt aux essais au champ qu’après avoir obtenu des résultats scientifiques en milieu confiné, qu’après avoir démontré l’avantage de cette plante et son innocuité et que lorsqu’on ne peut plus avancer sans aller en milieu ouvert.
Nous avons demandé à la Commission du génie génétique et à celle du génie biomoléculaire, ainsi qu’aux ministres concernés, la façon dont sont faites ces expérimentations en milieu confiné. Nous avons écrit plusieurs fois et n’avons jamais obtenu de réponse. Je dois dire que nous étions plusieurs dans cette Commission – au moins trois sur les quatre – à penser qu’en fait, ces expériences n’ont pas vraiment lieu, que les plantes transgéniques sont, bien sûr, isolées par les industriels qui éliminent celles qui ne présentent pas d’intérêt – c’est-à-dire celles qui ont reçu le gène en plusieurs exemplaires et que l’on ne pourra pas bien maîtriser – que ces plantes sont cultivées pour voir si elles poussent à peu près bien et qu’immédiatement après on passe aux essais au champ.
Je ne demande qu’à être démenti mais je constate qu’alors que nous étions investis d’une mission officielle, nous n’avons pas pu obtenir de réponse à la question de savoir ce qui se passe en milieu confiné.
Contrairement à ce qu’on a dit, les essais de Menville qui ont fait l’objet d’arrachages de la part des « faucheurs volontaires » – lesquels sont d’ailleurs en procès à Toulouse – n’avaient pas la recherche pour objectif. Ils étaient destinés à décrire les qualités agronomiques des végétaux concernés, comme on l’exige pour tout végétal dont on demande l’inscription au catalogue des semences. Cette procédure s’applique également aux plantes transgéniques, mais, alors, on appelle cela de la recherche !
Je dirai tout de même que des essais de toxicité des plantes transgéniques dans l’alimentation animale ont été entrepris il y a plus de quatre ans sur deux cents vaches, pour lesquelles on a congelé des échantillons de lait, de viande, d’urine, etc., afin de voir si le fait de les avoir nourri avec du fourrage transgénique – c’était du maïs – pouvait modifier leurs normes biologiques. Ces essais n’ont pas été achevés parce que les crédits ont été épuisés dans la mise au point des techniques d’études et qu’ils n’ont pas été renouvelés malgré la demande appuyée de nombreuses associations. Ces demandes sont même parvenues jusqu’au Parlement. Vous devez donc en avoir entendu parler mais, pour le moment, il n’y a pas eu de réponse. C’est assez troublant parce que c’était une expérience assez rare.
Il est vrai que le système est différent aux Etats-Unis où ce qu’ils appellent « l’équivalent substantiel » suffit à démontrer l’innocuité. Selon ce système, si l’analyse chimique comparée d’un végétal transgénique et du même végétal non transgénique donne des résultats identiques – ce qui est à peu près évident –, on en conclut que ce végétal est le même et qu’il est inutile de rechercher s’il y a une toxicité. J’attire votre attention sur le fait que si l’on avait procédé ainsi on aurait trouvé exactement la même composition chimique dans la viande d’une vache folle et dans celle d’une vache qui ne l’est pas et qu’alors, nous aurions pu consommer du prion.
L’équivalent substantiel n’est donc pas une réponse scientifique à la toxicité éventuelle d’un élément vivant et, heureusement, nous avons, en France, une autre habitude qui est de vérifier, par expérimentation, si un végétal, un animal ou un médicament possède les propriétés que l’on en attend. Je citerai M. Martin Hirsch, le directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), qui, dans une interview, a récemment proposé que soit mise en place, pour les plantes transgéniques, une démarche en palier permettant de passer progressivement du milieu confiné vers l’extérieur, après avoir obtenu des réponses à des questions claires. Il propose le même schéma que celui utilisé pour les médicaments et cela me paraît intéressant. Il s’agirait d’étudier non seulement l’innocuité mais aussi les avantages apportés, parce que personne ne nie le fait qu’il serait légitime, s’il y avait un tout petit risque mais des avantages énormes, de cultiver des PGM.
Pour l’instant, ces végétaux présentent des risques que l’on ne connaît pas bien parce qu’on ne les étudie pas et n’apportent aucun avantage démontré pour les consommateurs. C’est pour cela que je parlais d’un débat absurde : on ne comprend pas pourquoi l’on prendrait le moindre risque à disséminer des végétaux qui ne présentent aucun intérêt mais qui peuvent présenter certains risques.
Maintenant, voyons le futur mystifié. Le futur, c’est ce qui se vit actuellement en Amérique du Nord et s’étend à l’Argentine et à la Chine notamment : on y cultive des plantes transgéniques et certains prétendent ainsi augmenter la productivité du végétal ou encore diminuer les pesticides répandus dans l’environnement. Toutes ces affirmations sont totalement contredites par d’autres études, parmi lesquelles des études universitaires tout à fait sérieuses.
Pour ce qui est, par exemple, des pesticides, les études de M. Ben Brook – qui était membre de l’Académie des sciences américaines et qui est plutôt « pro-OGM » tout en restant un scientifique – ont montré que l’on répand près de deux fois plus de pesticides quand on a affaire à des plantes qui tolèrent un herbicide. Ce sont des faits concrets. Il est d’ailleurs regrettable que l’information vienne des industriels eux-mêmes dont le but est, évidemment, de vendre la semence brevetée.
Je suis frappé et choqué de voir que la croyance a remplacé la science. Bien que tout ce qui se dit de positif sur les plantes transgéniques soit au futur ou au conditionnel, c’est immédiatement repris dans les médias comme étant le présent, voire le passé. « Grâce aux OGM, on va nourrir l’Afrique, on va faire pousser des plantes dans les terrains salés, on va fabriquer des plantes médicaments, … » Alors que pendant longtemps l’homme a cru à des sornettes et a réussi à s’en débarrasser, il ne faudrait pas que de nouvelles sornettes apparaissent, fabriquées par la technoscience.
Je m’en tiens donc à ce que l’on peut constater. Ainsi, je note que ces plantes transgéniques nous sont imposées – pour le moment à titre d’essais, mais ce sont des essais contagieux car, quand on cultive en un lieu, il y a risque de dissémination – sans aucun avantage pour les consommateurs et au mépris de leur avis, puisque toutes les enquêtes d’opinion montrent que les Européens sont en majorité opposés aux plantes transgéniques.
Personnellement, je ne me bats pas trop sur l’argument « sondage » parce que je sais qu’on peut faire dire n’importe quoi à une personne interrogée dans le cadre d’un sondage et je n’admets comme étant l’opinion des consommateurs que celle de consommateurs éclairés. C’est la raison pour laquelle je suis très favorable aux conférences de citoyens. C’est une procédure longue et lourde, qui demande des volontaires – mais il en existe –, qui exige de former complètement, grâce à des informations contradictoires, des personnes au départ « naïves » pour leur permettre de décider en connaissance de cause. Cela n’a rien à voir avec les référendums ou les sondages, dont on se sert quand on a besoin de l’opinion publique pour prendre des décisions. Si on y recourait pour les plantes transgéniques, il faudrait tout arrêter immédiatement.
La Conférence des citoyens de 1998 a demandé, par exemple, la création d’une nouvelle commission, qui serait la fusion des commissions techniques existantes et d’une nouvelle commission issue de la société civile, pour que le regard sur les plantes transgéniques ne soit pas seulement celui de ceux qui les fabriquent ou les vendent. Elle a également demandé qu’aucun essai en milieu ouvert n’ait lieu sans système d’assurance, ce qui n’existe toujours pas, alors que cette demande a été réitérée par le débat des « 4 Sages ».
M. François Ewald, patron d’assurance que nous avions interrogé lors du débat des « 4 Sages » avait écrit un article avec le philosophe Dominique Lecourt pour attaquer ceux qui refusent les plantes transgéniques en arguant du retard que nous allions prendre. Ce supposé retard est un argument récurrent alors que l’on peut tout aussi bien penser que si nous sommes en retard sur quelque chose d’absurde, nous allons peut-être nous retrouver en avance ! Nous avons demandé à M. Ewald pourquoi lui, qui est assureur et favorable aux plantes transgéniques, ne les assurait pas. Sa réponse a été extraordinaire : « un assureur ne peut assurer que les risques qu’il connaît ! »
Je constate que ces débats, qui étaient pourtant d’origine officielle – la Conférence de citoyens se tenait à la demande du Parlement et le débat des « 4 Sages » à l’initiative de cinq ministres –, n’ont encore débouché sur rien. Cela fait six ans et l’on poursuit exactement les mêmes cultures dans l’espace public. Lors du débat des « 4 Sages », un philosophe, M. Tibon-Cornillot, était venu expliquer que pour la première fois, « la paillasse du laboratoire s’était élargie à l’espace public ».
Je pense, pour ma part, que l’on peut faire ces essais en milieu confiné, contrairement à ce que prétendent les personnes qui travaillent sur les plantes transgéniques.
Parlons de la procédure de consultation des citoyens : le ministère de l’agriculture consulte les citoyens par Internet sur d’éventuelles autorisations de nouveaux essais de plantes transgéniques. C’est une procédure quasi clandestine car personne n’est au courant, sauf les militants qui sont évidemment vigilants. Je ne me réfère donc pas à cette procédure pour affirmer que les Français sont contre les essais au champ – même si chaque consultation récolte plus de 90 % de réponses négatives – car de telles procédures ne démontrent rien. Je note d’ailleurs que la dernière de ces enquêtes s’est déroulée entre le 23 juillet et le 8 août 2004, moment très favorable, s’il en est, pour interroger les Français !
M. le Rapporteur : La réponse négative a été donnée par Internet ?
M. Jacques TESTART : Oui, c’est une sorte d’appel. On demande l’opinion des citoyens par Internet et, à l’appui, le dossier très savant de la CGB est même mis en ligne.
Trois enquêtes de ce type ont eu lieu : deux en 2003, une en 2004. Chaque fois, le ministre de l’agriculture a fait connaître les résultats, sans honte, annonçant que 90 % de ceux qui ont répondu sont défavorables à ces essais et il a conclu : « En conséquence, j’ai décidé d’autoriser les essais. » Là, on touche le fond. C’est vraiment se moquer du monde !
Il m’est souvent demandé – car je me permets de faire des conférences sur les plantes transgéniques, sujet que je trouve extraordinaire et qui me permet de m’énerver un peu ! – comment j’explique que ces cultures augmentent puisqu’elles ne servent vraiment à rien. C’est une bonne question car les cultures augmentent sans aucun doute : en Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Canada, en Argentine, au Brésil où il y a des cultures clandestines et la Chine s’y est mise aussi.
Tout d’abord, je rappellerai que les multinationales de l’industrie chimique, à l’origine – Dupont de Nemours, Monsanto – ont acheté les semenciers, ce qui leur permet d’obtenir les meilleures semences, avant même qu’elles deviennent transgéniques. On prétend qu’en les rendant transgéniques on obtient les plantes les plus performantes, mais si on ne les rendait pas transgéniques, on aurait le même résultat. Pour m’être intéressé aux essais publiés par Monsanto ou par l’Académie des sciences américaine, j’ai pu constater que, souvent, la variété non transgénique comparée à la variété transgénique n’est pas de même nature, ce qui est totalement contraire à tout protocole scientifique, mais on parvient ainsi à montrer un avantage temporaire.
C’est le premier élément de réponse : ces industries qui sont moins d’une dizaine et de moins en moins nombreuses au fil des concentrations, disposent des meilleures semences et peuvent les rendre transgéniques.
Deuxième élément de réponse : le marketing extraordinaire pratiqué dans ces pays où des publicités massives et des cadeaux d’initiation sont destinés aux agriculteurs pour les pousser à se lancer dans ce type de culture. J’ai dit ces « agriculteurs » et pas ces « paysans », ce qui n’est pas tout à fait innocent parce que les plantes transgéniques sont toujours destinées à des cultures de grandes surfaces, bénéficiant de gros moyens. C’est bien pour cela que ces nouvelles technologies sont lancées en Amérique du Nord, en Chine et en Argentine, qui disposent d’immenses surfaces.
Il y a un troisième élément de réponse : ce que j’appelle la « mystification », non seulement à cause de la publicité souvent mensongère des industriels auprès des gros agriculteurs qui acceptent de cultiver ces plantes parce qu’ils ont un esprit moderne et qu’elles sont présentées comme un progrès, mais aussi parce que quand ils ont essayé, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Comme vous le savez, on a démontré que ces plantes transgéniques se propagent soit par repousses, soit par le pollen, soit par les chaussures qui colportent des déchets végétaux.
Il y a d’ailleurs des procès en Amérique du Nord – au Canada notamment – où un gros agriculteur qui faisait du bio, nommé Percy Schmeiser, est en procès avec Monsanto depuis plusieurs années. Régulièrement, il perd, va en appel, pour perdre à nouveau, parce que la police privée de Monsanto a trouvé dans son champ des plantes transgéniques appartenant à Monsanto. Ces semences étant brevetées, il a été condamné pour vol de semences. Lui proteste en disant que ces semences ont contaminé son champ et qu’il n’en est pas responsable.
Je ne sais pas ce qu’il en est vraiment, mais il est certain qu’une fois qu’on a cultivé des plantes transgéniques, ces semences se répandent. Il est même des végétaux, comme le colza, pour lesquels il faut compter dix ans de repousse, or personne ne peut contrôler les terrains pendant dix ans. Je pense que, même en France, où les essais sont bien contrôlés, ils ne s’exercent pas durant dix ans, tout au plus pendant un an après la culture. Il y a donc des possibilités de contaminations diverses qui font qu’il est très difficile de revenir en arrière quand on a commencé à faire du transgénique.
Dernier élément de réponse : le seul avantage que l’on peut trouver aux plantes transgéniques – il ne concerne que les agriculteurs et, bien sûr, les industriels qui vendent ces plantes, et il est temporaire – c’est l’économie de main-d’œuvre. Quand une plante fabrique son insecticide, vous n’avez pas besoin d’acheter des produits et de payer quelqu’un pour répandre l’insecticide dans le champ. C’est un fait. De même, quand une plante tolère les herbicides, au lieu de passer de l’herbicide trois ou quatre fois pendant la culture, ce qui représente beaucoup de main-d’œuvre, vous pouvez le passer une seule fois en grande quantité et on en met d’ailleurs bien plus que dans les conditions habituelles.
Tout cela a une signification sur le plan symbolique. Le paysan s’est toujours battu contre l’hostilité de l’environnement. Il a toujours recherché à avoir de l’eau, à éviter les insectes parasites mais dans une sorte de pacte avec la nature. Il sait bien qu’il n’est pas plus fort que la nature et il s’accommode des petits méfaits du milieu naturel parce qu’en même temps, il en tire des bienfaits.
La démarche transgénique est radicalement différente : il s’agit d’éradiquer, de tuer tous les parasites et, comme on s’est aperçu que c’est absurde, on a même créé aux Etats-Unis des surfaces réservées autour des plantes transgéniques pour que les petites bêtes puissent se reproduire dans des végétaux non transgéniques et éviter ainsi qu’il y ait trop de mutations qu’on ne pourrait plus combattre. On prétend maîtriser la chose génétique et les plantes transgéniques, mais on s’aperçoit, à tous niveaux, que l’on ne maîtrise rien.
On a dû vous décrire la façon dont sont fabriquées les plantes transgéniques : c’est un bombardement de gènes complètement aléatoire. On ne sait pas combien de gènes pénètrent dans combien de cellules ni sur quels chromosomes ils vont aller se mettre. On ne sait rien, on constate après. On vérifie que la plante est bien devenue transgénique au moyen de marqueurs telle que la résistance à un antibiotique et l’on regarde si elle pousse normalement, si elle présente des caractéristiques normales ou intéressantes. Mais ce n’est pas de la science, ce sont des essais hasardeux.
Une étude réalisée en Afrique du Sud a montré que le coton transgénique utilisé pour combattre le parasite d’origine américain existant aussi chez eux, n’a pas permis de combattre d’autres parasites qui, une fois disparue la fameuse pyrale, sont venus se régaler à sa place. Au bout d’un temps, la pyrale a muté, les autres parasites se sont multipliés et tous les insecticides connus sont maintenant inefficaces pour assurer la salubrité de la culture.
J’ai sans doute été un peu provocateur mais je suis maintenant prêt à tenter de répondre à vos questions.
M. François GUILLAUME, Président : Je vous remercie de votre style très direct. Je trouve toutefois, si vous me permettez cette réflexion, que vous n’êtes pas très aimable vis-à-vis de vos collègues scientifiques qui ont d’autres points de vue que vous et parmi lesquels il y a un certain nombre de personnes de grande qualité. Mais le progrès de la science naît aussi de ces oppositions qui permettent aux uns et aux autres de réagir face à des affirmations qu’ils estiment non fondées. C’est au travers de ce débat que l’on finit par trouver la voie du progrès.
Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas faucheur mais je suis agriculteur, cela tombe bien ! Et j’ai entendu pendant toute ma vie d’agriculteur les réactions de ceux qui, comme vous, sont opposés à tout progrès.
A l’origine, des techniques telle que l’insémination artificielle – et vous êtes expert en la matière – ont suscité des protestations ; de même pour l’emploi des désherbants. S’il est vrai que ces techniques ont eu un certain nombre d’effets négatifs, ceux-ci ont permis d’approfondir ces techniques et d’en améliorer la maîtrise. Cela fait partie de la loi de la vie. C’est un combat permanent. Le combat des espèces l’est aussi.
L’agriculteur que je suis voulait tout de même vous poser une question de fond : je n’arrive pas à comprendre que les agriculteurs américains paient des semences OGM plus cher sans en espérer une certaine rentabilité. Or si l’on compare les prix de revient du maïs OGM ou non-OGM, on note une différence d’une centaine d’euros l’hectare, ce qui n’est pas négligeable. Il y a au travers de tout cela un problème commercial que personne n’ignore.
De plus, la vitesse à laquelle se répandent les OGM sur les territoires américain, chinois ou argentin fait que certains aliments ou certaines matières premières destinées à l’alimentation du bétail seront bientôt en totalité OGM. Je pense notamment au soja. Or nous avons un déficit considérable en protéines qui nous oblige à importer. Nos producteurs d’aliments du bétail sont en grande difficulté parce qu’ils redoutent que leurs produits ne soient plus commercialisables à cause des peurs que l’on développe dans la population face à l’utilisation de ces OGM. Que faire ?
Par ailleurs, les intervenants que nous avons auditionnés hier, notamment le professeur Fellous qui nous a indiqué qu’il y avait des travaux en laboratoire – et il me paraît excessif de mettre en cause le travail des scientifiques dans les laboratoires, comme vous l’avez fait – ont également dit qu’il est absolument indispensable de faire des essais en milieu ouvert.
Nous nous posons ces questions parce que nous sommes face à un problème à la fois scientifique, économique et commercial auquel il faut apporter une réponse.
Je suis pour l’information des citoyens, mais on connaît le résultat d’un sondage qui demanderait aux Français s’ils sont pour ou contre les OGM. Autrefois, les Gaulois avaient peur que le ciel ne leur tombe sur la tête ; aujourd’hui, les Français ont peur d’être empoisonnés, alors que jamais ils n’ont eu une nourriture aussi sécurisée. Ce n’est donc pas en organisant ce genre de débats que l’on éclairera les Français sur l’intérêt ou non des OGM.
M. Jacques TESTART : Vous confondez les conférences de citoyens et les sondages. Je suis opposé au sondage ou au référendum. Le référendum est valable pour une question politique large. Par exemple, on peut demander aux Corses s’ils souhaitent être Français ou pas. Ils n’ont pas besoin d’aller à l’école pour savoir répondre.
Mais quand on a affaire à une question aussi complexe que les plantes transgéniques, sur laquelle les scientifiques, eux-mêmes, n’ont pas de réponse très claire, il faut absolument informer les gens de façon contradictoire et cela n’a rien à voir avec un sondage ou un référendum. C’est la conférence de citoyens, dont j’ai parlé, une procédure très lourde, qui n’a été utilisée que deux fois en France, la première pour les plantes transgéniques et la seconde pour le changement climatique, cette dernière étant organisée par la Commission du développement durable. Il s’agit de procédures tout à fait extraordinaires.
Je conviens avec vous que le sondage est une manipulation très facile de l’opinion et d’ailleurs je ne m’y réfère jamais, contrairement à certaines personnes opposées comme moi aux OGM. J’ai dit très brièvement – en précisant que je n’y attachais pas d’importance – que les trois-quarts des Européens sont contre la consommation de plantes transgéniques. Mais je conviens que cela n’a pas de sens, car on pourrait les retourner très rapidement.
M. le Rapporteur : Quand les résultats des sondages vous conviennent, vous les utilisez tout de même : vous avez ainsi parlé des 90 % de personnes défavorables aux OGM.
M. Jacques TESTART : C’est que je me suis mal fait comprendre. Je disais que, pour moi, ces résultats n’avaient pas de sens, mais que ceux qui font ces sondages leur donnent un sens. Quand le ministre de l’agriculture veut interroger la population par Internet, on peut penser que c’est pour avoir une information sur l’opinion publique. A mon avis, l’information ainsi récoltée n’a pas de sens, d’autant que ce sont les militants qui répondent parce qu’ils sont les seuls à connaître l’existence de la procédure. Et elle a encore moins de sens dès lors que le ministre de l’agriculture qui a décidé de procéder ainsi ne respecte pas la règle du jeu qu’il a lui-même lancé.
De manière générale, le pouvoir se sert des sondages quand ils confortent ce qu’il veut faire. Dans le cas contraire, il n’y recourt pas. Personnellement, je pense que les sondages sont peut-être un moyen de mesurer l’état d’aliénation d’une opinion publique mais certainement pas une façon de mesurer son état d’ouverture. Donc, sur ce point, je suis clair.
Vous me dites que M. Fellous – que je connais bien – vous a parlé de la nécessité des recherches et vous me demandez ce qu’il faut faire Je vous réponds qu’il faut faire de la recherche sur les plantes transgéniques mais qu’elle doit d’abord se faire dans les laboratoires et éventuellement dans des serres. Tant que l’on ne saura pas mettre un gène à l’endroit où l’on veut le mettre, il est absolument prématuré de parler de « maîtrise du vivant ». C’est vrai aussi bien pour les thérapies géniques que pour les plantes ou les animaux transgéniques. Il reste donc du travail à faire en milieu confiné et pour ce qui est, plus précisément, des plantes il faut arriver à démontrer qu’elles présentent un avantage et des inconvénients que l’on peut maîtriser ou qui seraient limités par rapport aux avantages. Tout cela peut se réaliser en milieu confiné.
Je ne comprends pas comment nous pouvons fabriquer des porte-avions nucléaires et ne pas avoir les moyens de fabriquer des serres de grandes tailles dans lesquelles on pourrait faire varier le climat. On est tout de même capables de faire varier la température de moins 50°C à plus 70°C, de faire du vent, de créer de la sécheresse, de l’humidité, d’introduire des parasites. On pouvait déjà le faire il y a cinquante ans.
Quand on veut passer à l’extérieur, c’est que l’on veut apprécier la rentabilité d’un système au niveau des exploitations, donc, au niveau de la commercialisation. Cela n’a rien à voir avec la recherche. Personnellement, je ne suis pas opposé à la recherche sur les plantes transgéniques. Je dis seulement que, pour le moment, aucune variété transgénique n’a démontré un avantage qui permettrait de la mettre dehors et qu’on met les plantes transgéniques dehors de façon prématurée.
M. le Rapporteur : Je comprends, M. le professeur, que vous êtes tout à fait favorable aux essais en milieu confiné. Mais, rappelez-vous ce qu’il en a été pour le nucléaire. Grâce aux essais nucléaires réalisés sur le terrain, dans les îles Mururoa, on s’est aperçu qu’on pouvait travailler en laboratoire, mais, sans ces essais sur le terrain, jamais on n’aurait pu le faire en laboratoire.
M. Jacques TESTART : Il ne s’agit pas du tout du même problème.
M. le Rapporteur : Mais cela mérite d’être analysé.
M. Jacques TESTART : Oui, mais pour faire des simulations sur le nucléaire, il a fallu étudier les effets physiques du nucléaire pour pouvoir ensuite les modéliser. Pour ce qui est des plantes transgéniques, on peut faire autrement. Il faut, certes, mettre cet élément biologique en rapport avec d’autres éléments biologiques, c’est-à-dire avec l’environnement, mais cet environnement peut être reconstitué dans un milieu confiné.
M. le Rapporteur : A mon avis, vous n’aurez pas suffisamment de champ expérimental en milieu confiné ou en serre.
M. Jacques TESTART : Tout ce qui se fait au titre des essais de plantes transgéniques pourrait être fait en milieu confiné, par exemple, les essais réalisés actuellement pour étudier comment la plante pousse, quelle est sa production. Ainsi, les essais qui ont été fauchés pouvaient très bien être réalisés en serres. En général, quand on nous dit que des essais ne peuvent se faire dans des serres, c’est qu’il s’agit d’études de dissémination et on nous rétorque : « Comment ? Vous craignez une dissémination dont nous voulons précisément étudier le risque et vous empêchez l’essai ? »
C’est absurde. La dissémination n’a pas de limite et parler de 300, 600 mètres, voire maintenant d’un kilomètre, n’a aucun sens. Le sable du Sahara va jusqu’au Danemark, dès lors on ne voit pas pourquoi le pollen qui est fait pour voyager, contrairement au sable, n’irait pas très loin, d’autant que le pollen peut vivre plusieurs jours et qu’en plusieurs jours, il peut franchir des milliers de kilomètres. De plus, il a été montré que la dissémination la plus importante se fait par les bottes et les camions, plus que par la dissémination du pollen. Donc, il n’est nul besoin d’essais pour démontrer la dissémination. Elle est évidente ! Toute cette pseudo recherche n’est qu’une façon de nous habituer aux plantes transgéniques et répond même, peut-être, à une volonté perverse de disséminer pour rendre inéluctable le fait qu’il faut bien gérer les OGM, car ils seront partout.
M. le Rapporteur : On peut penser que les objectifs des essais de cultures en plein champ sont d’intérêt secondaire. Mais s’il s’avérait un jour que les objectifs soient plus importants, seriez-vous d’accord pour que les expérimentations soient menées en plein champ, d’autant que celles conduites aux Etats-Unis, en Argentine ou ailleurs, nous permettrons, dans quelques années, d’avoir le recul nécessaire pour savoir si la dissémination est dangereuse ou pas ? Seriez-vous d’accord pour que l’on franchisse alors le pas ?
M. Jacques TESTART : C’est comme pour les médicaments. On ne les injecte pas à des malades avant d’avoir vérifié qu’ils ont un effet nouveau, un avantage par rapport à ceux que l’on avait avant et qu’apparemment, ils ne présentent pas de risque. Pourquoi ne pas faire de même pour les plantes transgéniques ? Après avoir fait cette démonstration, on passerait dehors et l’équivalent de l’injection du médicament à un malade serait de faire les essais en milieu ouvert. Mais, en l’occurrence, on a sauté toutes les étapes. Tant que l’on n’a pas d’avantage prouvé, on n’a aucune raison de prendre le moindre risque. J’insiste sur ce point. Et cet avantage peut se démontrer en milieu confiné.
M. le Rapporteur : Si l’objectif était vraiment important, seriez-vous d’accord de prendre ce risque ?
M. Jacques TESTART : Bien sûr, autrement, je serais dans la religion du non-OGM et ce n’est pas du tout mon cas. Je pense simplement qu’il faut appliquer la même règle partout. Il est vrai que les technologies se développant et qu’on pourrait admettre que certains OGM présentent un jour un avantage, mais encore faut-il le démontrer avant de les mettre dans la nature.
M. le Rapporteur : D’un côté, on prône l’information des populations locales, des maires, et de l’autre, on détruit les cultures. Cela ne vous semble-t-il pas paradoxal ?
M. Jacques TESTART : Le paradoxe est davantage que le gouvernement, au lieu d’autoriser les essais et d’informer les maires, ferait mieux d’exiger des essais en milieu confiné, comme cela était demandé par la Conférence de citoyens et par le débat des « 4 Sages ». Chaque fois que s’est tenu un débat informé, on en est arrivé à la même conclusion : les essais doivent être faits en milieu confiné et l’on ne passe dehors qu’une fois que l’on possède les éléments suffisants pour montrer que cela présente de l’intérêt et que ce n’est pas dangereux.
On se trouve donc dans une contradiction : on autorise les essais mais, en même temps, comme il y a une opposition – à mon avis légitime – on est amené à ne pas en informer les maires, ce qui est encore une faute contre la démocratie.
M. Yves COCHET : Votre discours présente plusieurs aspects importants. Même si l’objet de notre mission d’information est limité dans son intitulé, on voit bien qu’à la clé il y a un projet de société. Les questions sont donc de tous ordres, aussi bien scientifiques qu’écologiques, sanitaires, démocratiques, industrielles, commerciales, économiques.
Je vous poserai quatre questions.
Première question : on n’a démontré ni l’innocuité ni la dangerosité des plantes transgéniques ; il y a une incertitude, mais rien n’est démontré. Par contre, les médicaments qui sont, par définition, des poisons dont on sait que l’effet est fonction de la dose, ne présentent-ils pas un risque plus avéré que les transgéniques alimentaires ? Si l’on fait des médicaments transgéniques en plein champ plutôt qu’en laboratoire, cela signifie que, par dissémination, des substances qui peuvent être des poisons iront se répandre et peuvent être à la merci non seulement des animaux mais des enfants, ou des adultes d’ailleurs. Ces médicaments transgéniques cultivés en champ, qui pourraient avantager certains industriels de la pharmacie, parce que la culture en champ coûte sans doute moins cher que la production en laboratoire, ne constituent-ils pas un danger supplémentaire ?
Vous avez évoqué les assurances et M. le Rapporteur ayant eu le bon goût de comparer ces essais aux essais nucléaires – même si la substance elle-même ou les protocoles d’étude scientifique ne sont pas tout à fait comparables –, je suivrai son chemin.
Pour le risque nucléaire, je constate qu’il existe une loi aux Etats-Unis, et même une en France depuis la Convention de Paris et la loi de 1990 qui permettent de mesurer le risque à partir d’une échelle établie par les scientifiques et de l’assurer pour un coût fixé en fonction de la gravité de ce risque. Ainsi, l’Agence internationale de l’énergie atomique, située à Vienne, a déterminé une échelle du risque en sept paliers – Tchernobyl étant au palier 7, Three Mile Island au palier 5. On sait donc évaluer le risque et même le décrire.
Dans cette logique, il est normal que les assureurs demandent aux scientifiques de leur décrire l’échelle du risque lié aux OGM. Mais cela est-il possible ? A ma connaissance
– mais je ne suis pas versé dans les OGM –, la réponse est plutôt négative.
Ma troisième question concerne l’information et la consultation des élus locaux. Je vois aujourd’hui des départements, des villes, des régions entières qui s’autodéclarent « sans OGM ». C’est le cas, notamment, de la région Aquitaine et de la région Poitou-Charentes. Ces prises de position prennent la forme de délibérations qui n’ont pas d’effet juridique mais expriment un vœu. Pourriez-vous nous rappeler ce que proposait le rapport des « 4 Sages » dans ce domaine ?
Enfin, près de 70 millions d’hectares de plantes transgéniques – maïs, soja, coton – sont déjà cultivés dans le monde, en Chine, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud. Dans la mesure où la dissémination est d’une certaine manière irréversible, n’est-il pas déjà trop tard pour s’y opposer ? Et si c’est cas, que peut-on faire ?
M. Germinal PEIRO : On dit que la croyance a remplacé la science, je crois que c’est vrai pour nous tous et, en tout cas, pour les élus. J’en veux pour preuve les résultats d’un tout récent sondage selon lesquels les maires de France se sont majoritairement opposés aux OGM à l’occasion de leur Congrès. Je ne sais selon quels principes ils se sont prononcés : principe de précaution environnemental, scientifique, sanitaire, ou électoral, parce que cela compte aussi dans notre vie d’élu. Après cette remarque, je vous poserai deux questions.
La science de la génétique ne date pas d’aujourd’hui. Depuis des siècles, les hommes ont essayé d’améliorer les races d’animaux et les espèces variétales. Un arbre fruitier obtenu par pollinisation de deux espèces proches ou une race bovine améliorée par croisement produisent-ils des espèces génétiquement modifiées ? Dans ce cas, si l’on s’était posé autant de questions dans le passé, on n’aurait jamais obtenu ce que l’on a aujourd’hui. Les chiens qui se promènent dans la rue et s’accouplent entre eux produisent des bâtards. Ceux-ci sont-ils des êtres génétiquement modifiés ?
Par ailleurs, hormis le risque de dissémination et les problèmes démocratiques et économiques que vous avez exposés, en quoi les OGM vous font-ils peur ?
M. André CHASSAIGNE : Je fais partie, au sein de cette mission, des parlementaires qui n’ont aucune certitude. Mes questions sont donc posées avec la volonté de bien comprendre.
Nous avons auditionné hier des scientifiques que j’ai trouvé extrêmement scrupuleux, faisant montre d’un souci obsessionnel de relever le moindre signe de risque. Il y a donc un décalage avec les propos que vous tenez. Pensez-vous que ces scientifiques de haut niveau, qui me semblent d’une parfaite honnêteté, puissent se tromper ?
Ma seconde question porte sur la proposition faite hier par ces mêmes scientifiques de créer un espace d’évaluation des questions économiques et sociétales. Ils se plaignent que cet espace n’existe pas. Si nous faisions une telle proposition à l’issue de notre mission, comment verriez-vous cet espace ?
M. Philippe TOURTELIER : Pour compléter les questions précédentes, supposons qu’il soit effectivement déjà trop tard. Quels seraient, selon vous, les risques d’un monde avec OGM ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je ne suis pas d’accord avec mon collègue M. Chassaigne sur les scientifiques que nous avons reçus hier car ils ont évité un certain nombre de détails, concernant en particulier les expérimentations.
Je pense comme vous, M. le professeur, qu’une ambiguïté est entretenue par de nombreux chercheurs et hommes et femmes politiques. Nous ne sommes pas contre les OGM, mais nous sommes opposés à la dissémination des organismes génétiquement modifiés et, plus particulièrement, des plantes génétiquement modifiées. Il faut que cela soit clair. Je suis une scientifique, docteur vétérinaire, comme d’autres ici et j’ai fait de la recherche en laboratoire. On ne peut pas nier les progrès qui en ont résulté, notamment en biologie, mais s’agissant des plantes transgéniques nous devons être d’une extrême prudence en raison des risques de dissémination.
Ma première question rejoint celle de M. Tourtelier : ne sommes-nous pas déjà allés trop loin. Et si oui, que peut-on faire ?
Ma seconde question est plus spécifique. Vous nous avez dit que certains chercheurs étaient impliqués dans des start-up dont l’objet était de promouvoir la naissance de certains OGM. Pouvez-vous nous en dire plus ?
M. Philippe MARTIN : J’ai lu que vous disiez qu’entre la science et la loi, il y a un chaînon manquant : le citoyen. C’est une des phrases qui m’a poussé, en tant que président du Conseil général du Gers, à tenter d’organiser un premier référendum départemental citoyen sur la question des OGM. Quelle est, selon vous, la bonne façon pour réintroduire ce chaînon qu’est le citoyen, dont je ressens, dans mon département, qu’il se sent dépossédé de tout pouvoir dans ce domaine ?
M. François GUILLAUME, Président : Pour que nous puissions bien saisir votre pensée, je reviens sur ce que disait M. Peiro.
Les producteurs ont toujours cherché, de façon expérimentale, à améliorer les rendements et la qualité de leurs productions, notamment par hybridation. Je pense, par exemple, aux vergers où l’on a cultivé quelques variétés particulièrement productives au point qu’à une époque on ne trouvait pratiquement plus que des goldens sur les marchés. Dans ce cas aussi, il y a eu dissémination par le pollen et l’on s’est posé la question de la conservation des variétés d’origine pour pouvoir faire d’autres hybrides. C’est ainsi qu’ont été créés des conservatoires arboricoles destinés à protéger les variétés de tout croisement accidentel par pollinisation.
Le problème est un peu le même avec les OGM à cette différence près qu’il y a un saut technologique majeur. On passe des simples soins à la chirurgie, en quelque sorte.
Autant je partage votre souci de préserver la biodiversité, autant je ne vois pas ce qu’il peut y avoir de nocif dans une technique nouvelle, qui donne plus de rusticité, renforce la résistance aux maladies ou la capacité de pomper directement l’azote de l’air, comme le font certaines légumineuses, ce qui dispense d’utiliser des engrais chimiques, une technique qui, finalement, amplifie l’avantage que l’on avait recherché au travers des croisements naturels de végétaux.
M. Jacques TESTART : Les plantes médicaments font partie de l’offensive de séduction de l’industrie pour essayer de réduire l’opposition des Européens aux OGM. Je répondrais que nous n’avons pas besoin de plantes médicamenteuses.
M. le Rapporteur : La lipase ne présente-t-elle pas tout de même un intérêt pour la mucoviscidose ?
M. Jacques TESTART : Oui, mais on peut la fabriquer en fermenteur.
M. le Rapporteur : Pourquoi, dans ce cas, ne l’a-t-on pas fait avant ?
M. Jacques TESTART : Je pense que ceux qui fabriquent la lipase ont un intérêt économique à le faire avec des plantes car il est bien plus facile de semer des graines dans un champ que d’entretenir des fermenteurs en milieu confiné. De toute façon, l’intérêt de la lipase a été énormément grossi. Elle ne guérit pas la mucoviscidose…
M. le Rapporteur : Effectivement, elle ne guérit pas la mucoviscidose, mais vous ne pouvez pas nier l’intérêt de cette expérimentation du point de vue thérapeutique.
M. Jacques TESTART : Je n’en suis pas persuadé. Personne n’a pu dire que l’on ne peut pas fabriquer la même lipase – qui est une lipase de chien – non pas avec des bactéries, puisqu’il a été dit que les bactéries ne peuvent pas fabriquer toutes les protéines, mais avec des cellules animales ou humaines, que l’on cultiverait. En général, on utilise des cellules d’ovaire de hamster et il existe une lignée qui sert aujourd’hui à fabriquer tous les médicaments en fermenteur. Je ne sais pas si l’on a essayé de fabriquer de la lipase, mais je ne vois pas pourquoi on ne réussirait pas à le faire.
C’est simplement une question de compétitivité des techniques. Il est certainement moins cher de le faire avec des tabacs ou des pommes de terre transgéniques que dans des fermenteurs. La question est de savoir si le principe de précaution doit prendre en compte l’économie réalisée par l’industriel quand il fait pousser sa lipase dans la nature ? Tout à l’heure, je parlais de la paillasse du laboratoire qui s’étend dans la nature mais, en l’occurrence, c’est la pharmacie qui s’ouvre dans la nature. C’est une notion tout de même assez étonnante.
M. Louis GUEDON : Le coût de la sécurité sociale mérite tout de même que cet aspect économique soit pris en compte !
M. Jacques TESTART : Je ne dis pas que le coût économique n’est pas à prendre en compte, mais que le principe de précaution doit l’être aussi. Fabriquer des médicaments en milieu ouvert, cela signifie qu’il est inutile d’avoir des tableaux B dans les pharmacies.
M. le Rapporteur : Ce n’est pas en mangeant de la digitale que vous allez vous intoxiquer, c’est en prenant de digitaline. Ce n’est pas en mangeant la belladone que vous allez vous intoxiquer, mais en prenant de l’atropine.
M. Jacques TESTART : Pour en finir avec les plantes médicamenteuses, je répète que l’on peut les fabriquer en fermenteur. On fait aussi des essais pour fabriquer des vaccins avec les bananes. Cela ne marche toujours pas, mais le projet existe. Je suis, pour ma part, certain qu’on peut le faire en fermenteur, certainement à un coût supérieur, mais peut-être faut-il assumer ce coût au nom de la sécurité.
Pour ce qui est des assurances, je pense que l’on ne peut pas construire d’échelle de risque sur des plantes transgéniques, comme on l’a fait pour les risques nucléaires. Le problème est très difficile, les assureurs voulant absolument connaître le risque avant de l’assurer. C’est bien pour cette raison que, pour le moment, on ne peut mettre de plantes transgéniques en dehors du milieu confiné.
A propos de sécurité, je voudrais dire un mot sur l’étiquetage. On en a fait une panacée démocratique : les gens allaient ainsi pouvoir choisir. C’est, en fait, un vrai abus démocratique. Alors que les experts eux-mêmes ne connaissent pas la dangerosité alimentaire d’une plante transgénique, on prétend que les consommateurs disposeraient d’une information suffisante, parce qu’il y aurait écrit sur une étiquette « contient des OGM ». C’est vraiment se moquer du monde !
Plus grave encore, c’est ramener l’éventuelle dangerosité des OGM au seul aspect alimentaire, sans s’occuper de l’environnement et de l’aspect économique. Quand il achètera une boîte de maïs transgénique, le consommateur prendra un risque pour lui et sa famille. Et l’on dit que c’est de la démocratie ! Tout d’abord, il n’est pas informé et, ensuite, en prenant ce risque, c’est-à-dire en consommant cette plante, il en active la production. Donc, il modifie complètement le circuit de culture, de distribution, l’économie agricole, la biodiversité, toutes choses qui ne sont pas sur l’étiquette et qui ne sont donc pas prises en compte.
S’agissant des régions qui se déclarent sans PGM, le débat des « 4 Sages » en avait effectivement parlé mais sans prendre de position parce qu’il n’était pas de notre compétence de réguler cela de façon administrative. On demandait qu’une étude juridique soit faite pour savoir si le trouble à l’ordre public pouvait être revendiqué par le maire pour interdire la culture de plantes transgéniques sur sa commune. Cela n’a pas été fait.
Sur l’irréversibilité, je dirais que le problème est assez dramatique car, effectivement, on ne va pas rattraper les gènes. Je n’ai pas la solution, sauf à répéter que la précaution est indispensable.
Il est vrai que la croyance s’oppose partout à la science mais il est assez dramatique que cela se produise sur le terrain de la science car, jusqu’à présent, la science essayait de se libérer de la croyance. Le débat sur les OGM m’irrite car nous sommes dans quelque chose qui n’est plus scientifique.
L’amélioration traditionnelle à laquelle procèdent les paysans depuis 10 000 ans sur les végétaux ou les animaux existe effectivement mais elle n’a rien à voir avec les OGM. On a parlé des croisements entre chiens, mais il s’agit toujours de la même espèce. On a parlé aussi de l’hybridation de végétaux, mais cela n’a rien à voir ni en ampleur ni en rythme avec ce qu’on fait avec les plantes transgéniques. Avec l’hybridation, on n’a jamais mis un gène de fraise dans un mouton. Actuellement, on fait au contraire des choses complètement folles, par exemple, introduire un gène d’araignée dans des chèvres pour produire de la soie d’araignée. C’est un projet de la société Nexia qui a déjà dix ans et dont on ne cesse de nous dire qu’il va aboutir. Le but est de produire de la soie d’araignée, qui est un textile très intéressant, résistant et élastique, en créant des chèvres transgéniques qui produiraient cette soie dans leur lait. Pourquoi pas ? Mais cela n’a jamais marché et cette société a fini par produire sa soie d’araignée en cultivant des bactéries dans des fermenteurs. Cela signifie qu’elle n’avait pas essayé cette méthode avant, sans doute parce qu’elle plus chère.
On ne peut pas assimiler les techniques transgéniques aux techniques classiques. Il n’y a pas de passage d’un ordre animal à un autre ou d’un végétal à un animal : on a jamais fait cela par la sélection. Puis, il y a le rythme, ce rythme lent du paysan qui regarde si l’expérience marche, si elle s’améliore. Les améliorations variétales se font assez lentement, même avec les sélectionneurs professionnels et elles ne sont pas irréversibles. Avec les plantes transgéniques, c’est le contraire ; en quelques années, on veut changer le monde utile à l’homme, végétal d’abord, animal bientôt.
De quoi faut-il avoir peur, me demande-t-on ? Il faut avoir peur des modifications dont on ne sait pas quels seront les effets et qui seront irréversibles. Pour moi, c’est suffisant mais on peut également craindre un développement des allergies. Personne ne l’a démontré, mais personne non plus n’a démontré le contraire. Nous sommes dans l’incertitude.
En revanche, on a démontré qu’il pouvait y avoir des risques pour la biodiversité, en particulier, celles de la microfaune du sol, qui est fondamentale en agriculture et qui souffre énormément de l’épandage massif de pesticides.
Il y a des scientifiques honnêtes. Se trompent-ils ? C’est une question presque idéologique.
Je connais des scientifiques malhonnêtes. J’en connais qui sont honnêtes et ont un point de vue contraire au mien. Donc, c’est possible, on comprend pourquoi certains sont malhonnêtes. Pour les autres, on peut comprendre aussi qu’il est très difficile pour un scientifique qui travaille sur un sujet de couper la branche sur laquelle il est assis, pas pour des raisons économiques, mais simplement par fierté, pour ne pas avoir à reconnaître qu’il a travaillé inutilement. C’est une explication. Il y a donc certainement des scientifiques honnêtes favorables aux OGM.
La création d’un espace économique sociétal, proposée par la loi, est intéressante. Je voudrais seulement savoir ce que l’on entend par « espace économique et sociétal ». Dans le projet de loi, il est dit, me semble-t-il, que le pouvoir de cette commission sera équivalent à celui de la commission technique. C’est bien. Mais imaginez que l’on désigne comme représentant de la société civile, un philosophe comme Dominique Lecourt, un assureur comme François Ewald et quelques autres que je pourrais citer. Cette commission sera-t-elle représentative de la société ou bien renforcera-t-elle le poids des industriels ? Comment va-t-on la définir ? Va-t-on y mettre les associations, par exemple ?
Vous avez posé une question difficile sur les chercheurs et les start-up. Je ne veux pas citer de noms, mais certains chercheurs connus défendent les OGM en même temps qu’ils défendent leur propre start-up. Peut-on leur en vouloir de créer des start-up ? Hélas, non ! C’est une demande de l’institution publique. Aujourd’hui, vous le savez, à l’INSERM, au CNRS ou à l’INRA, on nous y oblige puisque l’on ne nous accorde de crédits que si nous sommes capables d’en trouver dans l’industrie. On nous demande donc de créer des liaisons privilégiées avec le tissu industriel. On nous oblige à prendre des brevets et à créer des start-up. Il n’est donc pas illégitime pour un chercheur du domaine public d’avoir une start-up. Cela lui donne-t-il pour autant le droit de parler, revêtu de l’objectivité de la science, alors qu’il détient un intérêt personnel dans l’affaire, même si c’est un peu dévié par l’institution publique dans laquelle il travaille ?
Je n’ai pas le temps de vous parler du Téléthon qui occupera bientôt l’actualité. Mais c’est le même problème. Le Téléthon finance aussi des travaux sur les plantes transgéniques. Il y a une mystification exercée par le biais du génome, ce grand livre de la vie, et toutes sortes d’absurdités dont on prend conscience progressivement : l’ADN n’est pas une molécule vivante car il n’y a que des molécules inertes et qu’on ne sait toujours pas définir la vie, que celle-ci est bien plus complexe qu’on ne croyait... Cela répond à cette idée que l’on pourrait avoir la maîtrise de l’ensemble grâce à la génétique. Je ne suis pas opposé à la recherche. Je pense simplement qu’on l’instrumentalise à des fins qui n’ont plus rien à voir avec elle.
A propos des citoyens du Gers, je suis informé de cette volonté de débat. Je ne sais pas quelle forme il revêtira, mais il ne me semble pas que cela puisse prendre la forme d’une conférence de citoyens telle que je la propose, car celle-ci doit être organisée au niveau national, voire multinational.
Avant de démissionner de la Commission du développement durable, j’avais lancé auprès du ministère de l’environnement, un projet visant à organiser trois conférences de citoyens sur le thème des aides à l’agriculture, simultanément en France, dans un pays de l’Est et dans un pays du Sud. Elles auraient porté sur le même sujet, de façon relativement autonome, mais avec un comité de pilotage commun, en faisant le pari que les résultats seraient les mêmes, c’est-à-dire que les citoyens du monde auraient des intérêts communs qu’ils pourraient avoir l’intelligence de découvrir ensemble, à condition de disposer de toute l’information, et que les intérêts ne seraient pas forcément ceux que défendent leurs dirigeants.
Le débat local me semble donc important mais ne peut, à mon sens, prendre une forme aussi lourde que la Conférence de citoyens qui dure près de neuf mois et coûte très cher.
Pour en revenir à la comparaison entre hybrides et plantes transgéniques, je pourrais ajouter que, lorsque le généticien introduit volontairement un gène – avec une certaine maladresse car on ne sait pas le faire bien –, il l’introduit dans le vivant et on s’aperçoit qu’il y a des effets imprévisibles, qu’il s’agisse de l’homme, de l’animal ou des plantes.
Pour ce qui est de l’homme, je rappellerai le cas de l’hôpital Necker où deux enfants ont eu une leucémie après avoir reçu un traitement par thérapie génique, apparemment parce que le transgène est venu activer un oncogène. Cela ne condamne pas, bien sûr, tout ce travail auquel je suis favorable. Quand des enfants vont mourir, on peut tout essayer, mais il en est différemment pour les plantes dont on n’a pas besoin.
Je voudrais citer, à titre d’exemple, un travail de l’INRA concernant des transgènes introduits dans des plantes autorisées pour la culture. Il s’est révélé que sur cinq plantes étudiées, aucune d’entre elles ne possédait le transgène tel qu’il était décrit, ce qui signifie que le gène transmis était instable, contrairement au gène qui arrive naturellement en cas d’hybridation. Il y avait quatre variétés de maïs et une de soja. Toutes avaient des gènes modifiés : soit il manquait des morceaux, soit il y en avait de supplémentaires ; le gène avait donc subi des mutations.
Autrement dit, quand on introduit un gène, on ne sait pas ce que l’on fait et, surtout, la plante que l’on va cultiver à partir d’une autorisation n’est pas celle qui a été autorisée. Il y a donc énormément d’incertitudes.
M. François GUILLAUME, Président : Il en est ainsi de toute avancée scientifique. Mais le problème qui se pose à nous, politiques, n’est pas le même. Nous entendons des scientifiques qui ont des avis différents sur les OGM et nous, qui n’avons pas votre formation scientifique, devons arriver à trancher.
Les nouvelles techniques de production agricole ont toujours été accompagnées, au début, d’un certain nombre d’inconvénients que l’on a réussi à réduire au maximum, l’impératif étant naturellement que les avantages finissent par l’emporter sur les inconvénients. Je crois aussi que l’on avance en marchant et que si l’on s’arrête, cela n’empêche pas les autres de continuer.
M. Gérard DUBRAC : Ce qui fait débat aujourd’hui est la question de savoir comment on doit avancer. Serait-il possible d’envisager une autorisation de mise en expérimentation en différentes phases, comme cela existe pour les médicaments ?
M. le Rapporteur : J’ajouterai une question courte mais qui demanderait une réponse très longue : l’utilisation d’OGM pour l’alimentation animale vous semble-t-elle dangereuse ? Indirectement, je pense au problème de l’étiquetage des aliments issus d’animaux ayant consommé des OGM.
M. Jacques TESTART : Il est effectivement surprenant qu’il n’y ait pas d’obligation d’étiqueter la viande des animaux nourris avec des plantes transgéniques, simplement parce que l’on ne sait pas si cela peut avoir un effet.
Je voudrais citer à nouveau cette expérience, qui n’a pas abouti, sur les deux cents vaches pour dire encore que les essais de ce type sont rares. Certains sont controversés comme celui de M. Puztay, grand patron de la recherche en alimentation animale en Grande-Bretagne, qui, ayant montré que l’intestin des rats était modifié quand il leur donnait à manger des pommes de terre transgéniques, a perdu son emploi et s’est réfugié en Finlande. Certains faits sont étranges et ne semblent pas tout à fait relever de l’ordre scientifique.
Je ne sais si la viande des animaux alimentés par du végétal transgénique est dangereuse mais je pense qu’elle doit être aussi placée sous surveillance. Nous avons l’occasion de finir l’essai des deux cents vaches et je ne comprends pas pourquoi on ne le termine pas.
Je suis tout à fait d’accord avec M. Dubrac concernant une procédure de mise en expérimentation semblable à celle des médicaments. Votre suggestion correspond exactement à ce que je propose, c’est-à-dire des procédures sérieuses, avec des contrôles et de la transparence. Il y a, certes, la limite du brevet et de la propriété industrielle, mais on peut quand même assurer une certaine transparence permettant progressivement d’envisager de sortir du laboratoire, tout comme on envisage d’appliquer un médicament aux populations, seulement après avoir acquis une quasi-certitude d’innocuité et une certitude d’avantage. Pour le moment, on n’a ni l’un ni l’autre.
Je reviens au propos de M. le Président selon lequel on n’aurait jamais rien fait si l’on avait pas décidé d’avancer. Je répondrai que c’est la première fois, à ma connaissance, que l’on dissémine une technologie irréversible sans qu’elle ait encore montré un quelconque avantage.
Pour reprendre l’exemple du nucléaire, je suis antinucléaire mais je considère que le débat sur le nucléaire n’est pas absurde. On a vu récemment dans Le Monde une argumentation des pro-OGM consistant à dire que les anti-OGM sont les mêmes que les antinucléaires. Cela me semble cohérent. C’est parce qu’ils ont une autre notion de la précaution et du rapport de l’individu avec le développement économique.
Néanmoins, le débat sur le nucléaire ne me paraît pas absurde, contrairement au débat sur les OGM. On sait à quoi sert le nucléaire. Personnellement, je pense que les risques à très long terme sont trop importants pour que l’on continue de cette façon, mais il n’est pas absurde de faire ce pari en disant que, pour le moment, l’énergie nucléaire est utile et ne nuit pas aux changements climatiques. On peut prendre des risques mais de façon raisonnable.
Pour les OGM, le débat est absurde, car cette technologie ne présentant aucun intérêt, nous n’avons donc aucune raison de prendre des risques. Je pense comme vous qu’il faut poursuivre les recherches mais en milieu confiné et de façon très contrôlée.
M. François GUILLAUME, Président : M. Testart, nous vous remercions.
Audition de M. Frédéric JACQUEMART,
spécialiste de biologie médicale,
administrateur de France Nature Environnement
et membre de la Commission du génie biomoléculaire (CGB)
(extrait du procès-verbal de la séance du 17 novembre 2004)
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président
M. François GUILLAUME, Président : M. Jacquemart, je vous remercie d’être venu devant notre mission. Nous souhaiterions, dans un premier temps, que vous vous présentiez en rappelant votre parcours et, dans un second temps, que vous nous donniez votre avis de chercheur sur la question qui nous occupe.
M. Frédéric JACQUEMART : Initialement médecin, j’ai suivi une spécialité en biologie médicale complétée par un doctorat ès sciences avec, en parallèle, un cursus en philosophie. Je ne suis entré à l’Institut Pasteur qu’assez tardivement, dans le laboratoire du professeur Antonio Coutimho, en immunologie fondamentale, avec pour but de développer une approche systémique du système immunitaire et du système vivant en général. C’est une voie de recherche qui a été supprimée avec l’avènement de la biologie moléculaire, laquelle a stérilisé toutes les autres voies de recherche.
Il me restait le choix de faire comme tout le monde, de la biologie moléculaire et de la transgénèse ou de m’en aller. Etant parvenu à l’idée qu’il s’agissait d’une voie extrêmement dangereuse – et j’essaierai de vous dire pourquoi –, je suis parti et, depuis 1990, je m’occupe, d’une part, d’associations de réflexion sur la biologie et, d’autre part, d’associations de protection de l’environnement. Je suis, entre autres, président de la Fédération Rhône-alpes de protection de la nature (FRAPNA) pour l’Ardèche et administrateur de France nature environnement (FNE). Je suis donc actuellement un « associatif » à temps complet et c’est à ce titre que je représente la FNE au sein de la Commission du génie biomoléculaire (CGB).
M. le Président : Je vous propose de nous exposer votre point de vue sur les OGM, leur utilisation, les avantages qu’ils présentent et les inconvénients que vous opposeriez à leur utilisation et il serait sans doute également intéressant que vous nous éclaireriez sur les raisons pour lesquelles il semble que d’autres pays soient moins sourcilleux sur leur emploi qu’on ne l’est en France en particulier, et en Europe en général.
M. Frédéric JACQUEMART : La différence d’attitude entre les Etats-Unis et l’Europe est de nature culturelle. Je pense que le mode de réflexion des Etats-Unis relève beaucoup plus d’une logique déductive et technique, le nôtre étant plus sophistiqué et peut-être plus riche sur le plan philosophique. Il me semble que le problème des OGM est généralement mal posé car il est posé dans un contexte que l’on juge immuable et acquis, alors qu’il faudrait vraiment le poser sur le plan contextuel. Il me semble que l’on ne peut pas s’abstenir d’une réflexion générale sur la science qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, et oublier cet élément, pourtant classique en épistémologie, de philosophie des sciences.
Pour prendre une image, la science est un bateau sur l’océan, un bateau absolument superbe, mais qui est porté par un océan d’une autre nature que lui. On l’oublie trop souvent, comme si ce bateau se suffisait à lui-même. Ainsi, l’ensemble des questions que vous m’avez transmises présuppose que l’on n’ira pas chercher en dehors de ce bateau ce qui, pour moi, est une erreur.
Nous disposons de très peu de temps pour un sujet si vaste, aussi vais-je simplement essayer d’ouvrir quelques pistes de réflexion. Ensuite, nous verrons les questions qu’il vous plaira d’aborder.
Ce qui est frappant dans le domaine des OGM c’est cette grande certitude de l’expert scientifique. J’ai été moi-même en position d’expert scientifique et j’ai, moi aussi, vécu des moments d’autosatisfaction vis-à-vis de mes propres certitudes. J’en suis revenu.
Je vais illustrer cette réflexion car elle est essentielle pour répondre à une très importante question que vous avez posée, qui est le rapport bénéfice/risque. Poser la question en ces termes laisse supposer qu’il existe une machine à peser les bénéfices et les risques – ce qui reste à inventer – et, surtout, montre un a priori qui est de penser que les bénéfices et les risques sont comparables. Or ceci n’est pas acquis.
Je voudrais rappeler un événement que j’ai vécu quand j’ai débuté ma « carrière » en tant que microbiologiste à la faculté de médecine. A l’époque, se posait le problème de la résistance aux antibiotiques. On avait encore peu d’antibiotiques mais, déjà, des résistances. Pour résoudre ce problème, on suivait ce raisonnement : on sait que, pour une bactérie, la probabilité d’occurrence d’une résistance à un antibiotique général est de 10-6. Cela peut donc survenir. La solution est donc de prendre deux antibiotiques, augmentant ainsi la probabilité pour qu’une bactérie soit résistante aux deux à 10-12. C’est ce que nous avons fait et… nous avons été submergés de résistances. Tout cela parce que les scientifiques faisaient une proposition implicite – il y a toujours des propositions implicites dans l’interprétation des expériences – qui était que la totalité de l’information génétique se retrouvait au niveau chromosomique. C’est faux, comme vous le savez tous, mais il était à l’époque absolument impensable qu’il puisse en être autrement, notamment qu’il puisse y avoir plusieurs résistances codées en extra-chromosomiques sur un plasmide et qu’en plus, ce plasmide soit à transmission épidémique.
L’important dans l’interprétation de la certitude de l’expert, est de ne pas oublier que, depuis le début de l’histoire des sciences – et de plus en plus puisqu’il y a de plus en plus de productions scientifiques –, nous avons des exemples de cet impensable, de cet indicible au moment t qui se révèle ensuite et que nous occultons dans les interprétations que nous faisons actuellement. Bien entendu, je pourrais citer d’autres exemples.
Je pense ici à la réticence avec laquelle ont été accueillis les travaux de Barbara Mc Climtock dans les années 40, puisqu’il a fallu attendre presque quarante ans pour qu’on reconnaisse l’existence réelle des gènes sauteurs. Cela signifie que, lorsque des expériences parfaitement menées amènent à une conclusion, elles sont refusées parce qu’elles ne correspondent pas à ce que l’on peut appeler « le dogme » ou plutôt l’idée générale qui prévaut à un moment donné. On est très loin de cette science de pure logique déductive qui débobine un savoir forgé de certitudes. Le scientifique est très rationnel quand il rédige son travail et décrit son expérience, mais la part d’irrationnel est peut-être encore plus grande dans le domaine scientifique que dans le domaine courant. Il faut avoir conscience de cet aspect.
Au niveau des OGM, il est clair que l’irrationnel est encore plus présent et, de par mon expérience d’ancien chercheur, je pense que la sensation de puissance que donne la manipulation du vivant y est pour une grande part. Il est clair que l’on a tendance à demander à l’expert la vérité et, qu’en ces temps modernes, l’élu décisionnaire est parfois le simple relais de l’expert. Or l’expert doit être écouté, mais en aucun cas ne doit être décisionnaire, car lui-même est tellement formaté dans son domaine qu’il n’a pas la possibilité, comme quelqu’un d’extérieur, de replacer la problématique dans un contexte plus vaste.
Parmi les exemples imprédictibles, il faut citer l’avènement du prion. On dira que cela n’a rien à voir avec les OGM, mais, au contraire, cela est très profondément lié en ce que l’imprédictible, ce qui n’est même pas questionnable, ne se révèle qu’a posteriori. Un comité de biovigilance, comme celui qu’on a créé, ne peut surveiller que ce qu’il connaît au temps t; et ce n’est pas une garantie suffisante.
Il faut se souvenir que le prion, ou plus exactement la protéine infectieuse dépourvue d’acide nucléique qui était un élément totalement hétérodoxe, avait été décrit par ALPER en 1967. On l’a un peu oublié.
Dans ces conditions, il est absolument impensable d’arriver à une réelle évaluation des risques puisque, dans le domaine du prévisible, on est loin du quantifiable, mais surtout l’imprédictible n’est même pas énonçable, ni pensable. La question que l’on a tendance à poser est de savoir ce que l’on obtiendra si l’on fait telle chose. A mon sens, cette question n’est pas la bonne. Elle se pose dans des domaines qui sont stables et bien étudiés alors que, dans ce cas précis, on est au début d’un processus d’agression du milieu vivant. La véritable question qu’il faut parvenir à traiter scientifiquement est de savoir quel est le niveau auquel on interfère sur le monde vivant.
Prenons une image : l’écosphère, en écologie, est l’ensemble des êtres vivants connectés les uns aux autres en un gigantesque réseau. Cette écosphère possède une organisation qui nous concerne au premier chef, puisqu’elle qui nous permet de survivre, de nous maintenir en tant qu’espèce sur terre. C’est, me semble-t-il, le premier élément que nous devons essayer d’assurer. La question est de savoir, si avec une technique aussi agressive, puisqu’elle modifie très profondément et d’une façon radicalement nouvelle l’écosphère, on touche à des éléments périphériques de cette écosphère ou, au contraire, si l’on atteint des niveaux profonds de son organisation.
C’est ainsi que je pose la problématique sachant, comme je viens de le dire, qu’il est tout à fait illusoire – surtout dans des domaines d’une telle complexité – d’essayer de savoir qualitativement ce que sont les conséquences de nos actes. L’important est de connaître le degré de risque auquel on s’expose. S’expose-t-on à des risques concernant l’individu ? Auquel cas, on est habitué à le faire car il n’est guère de chose que l’on développe sans risque pour l’individu. Ou bien ces risques concernent-ils l’espèce humaine ? Et, dans ce cas, il est clair que l’on ne peut pas se lancer tant que l’on n’a pas la certitude que ce n’est pas ce risque-là qui est mis en jeu.
Je voudrais apporter une illustration de ce type de questionnement.
Je me suis posé cette question il y a vingt ans quand, au sein de l’Institut Pasteur, on fabriquait déjà des souris transgéniques. C’est très enthousiasmant et cela permet de répondre à des questions auxquelles on ne trouvait pas de réponse par les techniques traditionnelles. Néanmoins, si l’on reprend schématiquement le raisonnement, on peut dire que le code génétique est universel, c’est-à-dire que l’on retrouve toujours la même correspondance entre les triplets et les acides aminés, que ce soit une baleine ou un ver de terre. Le biologiste en déduit qu’une quantité de possibles s’ouvre à lui, mais il ne se demande pas pourquoi les phénomènes naturels s’interdisent ce que le chercheur a envie de s’autoriser. Pourquoi a-t-on mis tant d’obstacles aux communications génétiques dans la nature, puisque tout est profondément restreint ?
Le chimpanzé a 98 % ou 98,5 % d’homologie génétique avec nous, pourtant on ne peut pas faire un petit avec lui et je ne parle pas d’un poisson ou d’une fraise. Les virus, eux aussi, transfèrent des informations génétiques mais elles sont restreintes par les capacités d’adaptation moléculaire. Les bactéries transfèrent des plasmides à partir de pilis qui ont, eux aussi, des adaptations moléculaires précises. Cela ne se fait pas n’importe comment. Le seul élément qui ne semble pas restreint est le transfert d’ADN nu entre bactéries. Je ne pense pas que ce soit un phénomène très fréquent et, de toute façon, la nature nous a habitués à toujours trouver des petites exceptions dans toutes les grandes règles. C’est d’ailleurs le moteur de l’évolution.
On en arrive à cette notion même d’organisation. Qu’est-ce qu’une organisation ? Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question extrêmement difficile. En revanche, il y a des conditions fondamentales, primitives, pour qu’une organisation existe. Si l’on réfléchit un peu, l’organisation va être essentiellement ce qui n’est pas aléatoire. Si je fais un dessin n’importe comment, vous ne reconnaîtrez pas une forme. Si je fais la totalité de ce qui est possible, je ne ferai pas une forme. Si je fabrique tous les mots possibles avec les lettres de l’alphabet, je ne ferai pas un langage. La condition pour qu’une organisation existe – et je peux le démontrer de façon rigoureuse – est que ce qui est organisé est extrêmement rare dans le possible réalisable dans les mêmes termes, c’est-à-dire que si vous parlez de langage, ce sera dans les termes des mots. C’est le primum movens de l’organisation. Personnellement, je ne connais rien de plus basique, de plus primitif à l’organisation.
Or c’est ce principe de restriction que viole l’OGM, c’est-à-dire que dans cette volonté de s’émanciper de toute contrainte qui est un héritage du passé ancien, on ne se demande pas pourquoi ces contraintes existent ni si elles ont un rôle dans la structure du monde vivant. Il s’agit pourtant d’une question essentielle. Cela suffirait déjà, à mon sens, pour que l’on n’aille pas plus loin dans les essais tels qu’ils sont pratiqués et que l’on se demande, très sérieusement, à quel niveau nous allons interagir avec l’écosphère. Car, dans le cas que je donne, qui n’est qu’un élément hypothétique – mais que je n’accepterai pas d’abandonner sans l’étudier, et qui est à l’origine de ma démission de l’Institut Pasteur –, on va beaucoup trop vite en besogne et l’on suit des désirs qui n’ont plus de raison d’être.
L’autre élément qui a été tranché sans être étudié – comme beaucoup d’autres dans le domaine des OGM – est l’historicité. En effet, une protéine, un gène se trouve quelque part, à un moment donné. Il a une histoire, il est arrivé là d’une certaine façon. Il est clair que la pratique de l’OGM abolit complètement toute notion d’historicité.
A quel moment a-t-on montré que cette historicité n’était pas un élément pertinent de l’organisation des systèmes ? Jamais, personne ne s’est posé la question. Or, c’est une question absolument fondamentale. Il est certain que si l’on reste juste dans ce bateau sur l’océan, à se regarder les pieds, on ne voit rien et on risque de recevoir les réponses des systèmes vivants qui, eux, tiendront compte de ces contextes.
Pour étayer cette façon de voir, qui n’est pas très classique dans l’argumentation OGM, je vais me permettre d’insister sur cette notion de « restriction dans le possible réalisable ».
Si je trace une série de caractères A B A B A B A B A, et que je vous demande ce qui suit, je pense que vous direz B, sans aucune hésitation. C’est la base même de tous les QI. Pourtant, si vous considérez maintenant un mécanisme aléatoire, qui donne toutes les chaînes formées de A et de B, la lettre qui suit est à 50 % de chances A et à 50 % de chances B. Or vous n’avez même pas considéré que cela puisse être la lettre A. Cela signifie qu’en voyant une chaîne organisée, vous concluez immédiatement qu’un processus causal l’a créée. Pour qu’il en soit ainsi, il faut, et c’est impératif, que les chaînes organisées soient en nombre extrêmement petit dans l’ensemble des chaînes qui seront construites de la même façon. Plus globalement, ceci est la démonstration du fait que l’organisation nécessite, impérativement, que ce qui est organisé soit extrêmement petit dans l’ensemble du possible réalisable dans les mêmes termes. C’est une démonstration.
Par ailleurs, si l’on considère l’histoire des sciences, il est prouvé que l’évolution de ce que l’on appelle les paradigmes, c’est-à-dire l’ensemble des contextes qui donnent sens à ce que l’on fait, s’inscrit non pas dans une progression agréable à l’œil mais par ruptures successives. On ne passe pas de la physique newtonienne à la physique quantique dans un continuum, mais par fracture. Il en est de même pour l’évolution des espèces et pour l’évolution des sciences et des techniques. On peut très facilement montrer que l’on considère des paramètres qui sont mesurables par des techniques caractéristiques d’une époque, qui évoluent pendant très longtemps, presque parallèlement à l’axe des x, avec une croissance extrêmement lente, et montent vraiment très brutalement . En fait, cela va encore plus vite qu’une exponentielle, c’est une sur-exponentielle ou une hyperbole.
Prenons l’exemple de l’évolution de la taille du silex chez les hommes préhistoriques. On se rend compte que, pendant un million et demi d’années, l’efficacité de la taille ne bouge presque pas et que, brutalement, elle monte d’une manière extrêmement explosive. Maintenant je vais vous demander depuis combien de temps vous avez taillé un silex. C’est un élément très important car, quand on sait très bien faire quelque chose, on fait autre chose, et cela se répète dans toute l’histoire des sciences et des techniques.
Si l’on trace la courbe d’évolutivité des techniques, on constate que, pour les silex, il a fallu un million et demi d’années d’évolution et que, pour ce qui est la technologie de notre époque, c’est-à-dire le traitement de l’information, on retrouve exactement la même courbe en forme d’hyperbole, à cette différence près qu’elle s’échelonne non plus en un million et demi d’années, mais sur quelques dizaines années. L’ensemble des évolutions des techniques, et c’est logique, connaît une même courbe hyperbolique, c’est-à-dire que l’accélération des sciences et des techniques est elle-même hyperbolique.
Cette constatation doit être en toile de fond de toute la réflexion sur les biotechnologies. L’a priori qui consiste à dire qu’il faut toujours faire mieux est valide pendant un temps immense de l’évolution mais il ne l’est plus à partir du moment où la courbe devient explosive. La façon de considérer les choses, les désirs que l’on peut avoir, et le mode de validation de nos actes, diffère radicalement selon la pente de l’évolutivité dans laquelle on se trouve. Actuellement, nous sommes à un moment où tout va extrêmement vite. C’est un élément qui peut se théoriser mais qui se ressent aussi, et on ne prend pas la mesure de cette nouvelle donnée. C’est en cela que le problème des OGM ne doit pas être traité dans un paradigme vieillissant, mais dans une autre perspective de changement de paradigme. C’est ainsi que l’on peut vraiment apprécier ce que l’on fait et décider de ce qu’il faut faire.
Je suis maintenant ouvert à vos questions.
M. le Rapporteur : M. le professeur, vous allez me trouver dur, et je m’en excuse, mais j’ai le sentiment que vous avez une vision structurée, rigide, pessimiste des choses et que vous n’avez pas envie que la science évolue. Je ne sais si c’est le sentiment de cette salle, mais cela n’explique-t-il pas votre retrait de l’Institut Pasteur ?
M. Frédéric JACQUEMART : Cette remarque me déçoit parce que je suis un amoureux de la science et le reste. Je pense que votre erreur consiste à penser qu’il n’y a qu’une seule façon de penser, de la même manière que les gens s’imaginent qu’il n’y a qu’une seule histoire possible de l’humanité. Je pense, comme je l’ai dit précédemment, que l’on a amputé un nombre assez important de domaines de recherche et que l’on a appauvri la pensée scientifique. C’est peut-être ce que vous avez pris pour du pessimisme.
Ce que j’ai suggéré durant cette brève intervention est que l’on développe une pensée systémique, c’est-à-dire une capacité d’approche systémique capable de poser les bonnes questions parce qu’on a développé des techniques extrêmement puissantes pour lesquelles on a oublié de demander le mode d’emploi. Je souhaite un développement différent de la science, pas du tout une négation de la science.
Quant à mon « pessimisme », il est assez incompatible avec mon engagement personnel, puisque je travaille bénévolement, quasiment sept jours sur sept et douze heures par jour, poussé par un profond optimisme, qui s’exprime par le fait que les courbes, dont je parlais, montrent la nécessité d’un changement de paradigme et donnent, au contraire, une ouverture à ceux qui s’imaginent qu’il n’y a pas d’issue. C’est donc un message profondément optimiste, au contraire, mais, en même temps, un message de prudence.
Ai-je répondu à votre question ?
M. le Rapporteur : Imparfaitement. Nous travaillons actuellement sur un sujet qui est, certes, philosophique, et vous avez très bien exprimé cette dimension, mais je souhaiterais connaître, d’un point de vue plus pratique, votre sentiment sur les essais d’OGM en milieu confiné, d’une part, et en milieu ouvert, d’autre part. S’il est possible d’étudier, par exemple, une plante qui nous fabrique un médicament susceptible de guérir le cancer, acceptez-vous l’idée d’essais en milieu ouvert ?
M. Frédéric JACQUEMART : La problématique ne me paraît pas devoir être ainsi posée. Elle se pose, je l’ai dit, dans un contexte bien plus vaste. La fin ne justifie sûrement pas les moyens. Et surtout, est-ce qu’une idée de l’homme dans laquelle la mortalité est une anomalie et qui se heurte à 100 % de contre-exemples peut être maintenue indéfiniment ?
Pendant un million et demi d’années, on a eu des désirs, par exemple de vivre toujours jeune, en bonne santé, d’éradiquer tout ce qui gêne… et de proliférer, bien sûr. Ce sont des désirs validés par l’histoire, mais ils l’ont été dans leur constitution même, c’est-à-dire qu’ils étaient irréalisables et ce caractère irréalisable faisait culturellement partie de ce désir. Maintenant qu’il devient soit réalisable soit approchable, on le prend toujours comme un a priori justificateur.
Vous en donnez vous-même un exemple. Pour vous, il va de soi qu’il faut augmenter les capacités médicales. Je suis ancien médecin et je pense que les médecins sont un peu « formatés » pour trouver une solution à la souffrance des gens. Mais il s’agit là d’une attitude individuelle. Sur le plan collectif, il me semble qu’il faut mener une réflexion sur tous ces a priori qui n’ont plus de sens dans un monde moderne. On ne peut pas vivre dans un monde moderne avec les désirs de l’homme de Neandertal. Quand on n’est plus adapté à son monde, on disparaît. Et nous ne sommes plus adaptés au monde que nous avons créé. Nous avons toute une philosophie à refaire.
Quant aux essais au champ, il est clair que j’y suis opposé pour les raisons que j’ai données. On ne peut pas au nom d’un gain, qu’il s’agisse d’un gain financier ou pratique, mettre en jeu a priori l’existence de l’espèce. De même, pour ce qui est des développements médicaux, on ne peut mettre en jeu l’espèce pour l’individu. Il existe une hiérarchie des valeurs.
M. André CHASSAIGNE : Participez-vous toujours aux réunions de la Commission de génie biomoléculaire ? Quelle appréciation portez-vous sur le fonctionnement de cette commission qui, semble-t-il, a la volonté de prévenir les risques et de rendre des avis précis ?
M. Frédéric JACQUEMART : C’est encore une question très difficile.
Ma première remarque est que cette commission ne s’intéressera pas au bateau dont on parlait, mais à une toute petite partie de son mât. Toutes les décisions préliminaires sont déjà prises et l’on nous demande seulement de regarder si elles sont compatibles avec les règlements et s’il y a un risque visible. Pourtant je ne pense pas qu’une commission puisse travailler beaucoup mieux que celle-ci. A mon avis, elle est nécessaire parce que, si quelqu’un décide de faire un essai au champ, le minimum est que l’on puisse saisir une telle instance. Le problème est que l’on prend ce minimum comme un tout final. A la limite, si l’on continue à penser que c’est bien parce que la CGB l’a dit, je préférerais qu’elle n’existe pas. Mais c’est davantage l’usage de l’outil, plus que l’outil lui-même, que j’aurais à critiquer.
M. Yves COCHET : Tout d’abord, il y a la critique que vous faites de l’évaluation du rapport bénéfices/risques des OGM. Vous nous dites que cette évolution n’a plus de sens compte tenu des éventuels risques sanitaires et environnementaux et même existentiels. Il est vrai que la philosophie des droits s’est en partie imposée, notamment dans les pays à tradition continentale, alors que la philosophie sur laquelle se fonde l’évaluation bénéfice/risque est une philosophie économique, un peu sacrificielle qui consiste à faire, peut-être, le bonheur du plus grand nombre, sachant que l’on sacrifie les autres – quoiqu’en l’occurrence, il s’agit non pas de faire le bonheur du plus grand nombre, mais de tout sacrifier, puisque l’espèce elle-même est en danger. La philosophie des droits dit que, au contraire, le droit à l’existence dans un environnement sain, comme cela figure dans le projet de charte de l’environnement, concerne tout le monde et qu’il ne doit pas y avoir d’exception. Je me demande si cette philosophie n’est pas plus adaptée aux OGM dans la mesure où le risque est, pour le moment, inconnu. En tout état de cause, elle exclut les essais en champ, puisque l’absence de risque n’est pas garantie.
Ne pensez-vous pas que les OGM sont une sorte de projet démiurgique procurant une jouissance neuronale extraordinaire, d’abord au chercheur qui en est l’artisan, puis aux industriels et même à une société qui se croit plus forte que l’écosphère elle-même ?
Je terminerai par deux propos peut-être choquants mais tout à fait publics puisque je les ai déjà écrits : le projet OGM n’est-il pas que l’on veut refaire la nature, comme un personnage politique pourrait vouloir « refaire la société » ? La nature étant polluée, imparfaite, ennuyeuse, salie, elle ne correspond pas au projet que l’on a pour elle, d’où l’idée de la refaire entièrement. Nous sommes tellement forts, nous, l’humanité, maîtres et possesseurs de la nature, que nous allons entièrement la refaire, notamment dans le domaine du vivant. C’est le problème de toutes les biotechnologies dont les OGM sont une application particulièrement inquiétante. D’une certaine manière, ne pensez-vous pas que les OGM sont un projet totalitaire ? Totalisant, c’est sûr, mais aussi totalitaire ?
M. Philippe FOLLIOT : Je vous prie de m’excuser, je ne suis pas du tout scientifique…
M. Frédéric JACQUEMART : Si je puis me permettre, nombre de personnes, comme vient de le faire M. Folliot, s’excusent de ne pas être scientifiques. C’est bien le signe d’un phénomène extraordinaire qui est que la science a confisqué le langage à la population en imposant ses propres limites aux personnes. Lorsque quelqu’un veut s’exprimer en des termes qui ne sont pas scientifiques, il s’en excuse. Cela mérite d’être souligné car on n’a pas le droit de se laisser ainsi confisquer la parole pour la laisser aux technocrates, comme je le disais précédemment. Je vous remercie d’avoir débuté ainsi votre propos, cela m’a permis de le rappeler.
M. Philippe FOLLIOT : Je ne m’excuse donc plus mais, pour autant, je ne suis pas scientifique, c’est un constat !
Je voulais simplement vous demander de réagir à la prise de position suivante. La communauté scientifique d’un pays tel que les Etats-Unis est au moins quantitativement, si ce n’est qualitativement, aussi importante que la nôtre. Or les Américains se sont engagés non plus dans la voie de l’expérimentation mais dans celle de la culture des OGM. D’après vous, pourquoi n’y a-t-il pas eu de réaction de la communauté scientifique aux Etats-Unis pour freiner ou empêcher ce que vous considérez comme un risque important, une erreur ? Non seulement elle a laissé faire les expérimentations, mais ne s’est pas opposée à une utilisation économique et industrielle de ces OGM.
M. François GUILLAUME, Président : Vous êtes resté sur un plan très philosophique. Il faudrait, puisque vous avez une compétence en matière de biologie médicale, que vous nous disiez si vous êtes favorable ou défavorable à la culture d’OGM qui pourrait produire des médicaments, comme cela a déjà été démontré ?
J’ai naturellement trouvé une certaine convergence entre vos propos et ceux de M. Cochet qui appelle à la prudence : ne prenons pas le risque de développer les biotechnologies, parce que l’on risque de jouer aux apprentis sorciers et de tout sacrifier au profit de quelques-uns.
Vous avez expliqué, à raison, qu’il existe une écosphère. Mais celle-ci n’est pas immobile, elle est toujours en pleine évolution. Au cours des millénaires, les espèces se sont modifiées sous l’effet de phénomènes naturels. Certains, comme vous, pensent qu’il n’y a pas eu un continuum mais toute une série de fractures. On peut être d’un avis différent.
Je voulais simplement savoir, au travers de ce constat, si l’on doit ou non interdire à l’homme de modifier éventuellement certaines espèces pour pouvoir répondre à des attentes parfaitement légitimes.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je ne reviendrai pas sur l’aspect philosophique de la question mais je partage en partie votre point de vue et je voudrais revenir sur certains éléments que vous avez évoqués.
Vous disiez que la nature a restreint considérablement les ouvertures diverses entre les espèces. Nous le savons tous et vous avez aussi cité deux exemples. Le premier était celui des plasmides et de la résistance aux antibiotiques. Pendant longtemps, et encore aujourd’hui, on s’est posé la question de savoir comment étaient apparus ces plasmides qui ont si considérablement fait évoluer la science médicale, en particulier, pour les traitements aux antibiotiques. Le second était celui des prions. Faites-vous partie de ces scientifiques qui pensent – ce qui me semble être le minimum au sein d’une commission qui traite de sujets extrêmement importants touchant aux gènes – que l’apparition des prions est directement liée à l’activité humaine ou bien pensez-vous qu’il s’agit uniquement d’une évolution naturelle ?
M. François GUILLAUME, Président : Madame, nous nous écartons de notre sujet.
M. Frédéric JACQUEMART : C’est la question du risque.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : C’est effectivement la question du risque et c’est un point fondamental, M. le Président…
M. Frédéric JACQUEMART : C’est la question du risque et de son évaluation.
M. François GUILLAUME, Président : Ce n’est pas le sujet.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : On parle de génétique, le prion est une protéine toxique …
M. François GUILLAUME, Président : J’ai pour mission de recadrer les débats sur les questions qui nous sont posées. Je voudrais que vous reveniez aux problèmes de biologie médicale, puisque vous êtes particulièrement compétent pour nous dire si nous devons ouvrir la porte aux OGM qui permettent de soigner un certain nombre de maladies ou si nous ne le devons pas à cause de risques dont vous allez nous parler.
M. Gabriel BIANCHERI : Juste une remarque. J’ai l’impression que l’approche de M. Jacquemart est quasi religieuse, pour ne pas dire mystique, et cela me gêne un peu parce que, dès lors, elle ne me paraît pas entièrement rationnelle.
M. Yves COCHET : Il me semble, M. le Président, que vous ne pouvez pas évacuer de la sorte la question de Mme Perrin-Gaillard. Nous sommes en plein dans notre sujet.
M. François GUILLAUME, Président : Je n’ai pas demandé que l’on ne réponde pas à la question, j’ai simplement dit que nous débordions de notre sujet.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je pense, au contraire, que les choses sont liées. C’est précisément parce qu’on ne veut pas aller au-delà du petit problème restreint des OGM qu’on reste sur un débat qui dure maintenant depuis des années.
Par ailleurs, je pense que vous n’avez pas le droit de demander à notre invité s’il est favorable à la culture des OGM médicamenteux en plein champ parce que nous savons très bien que la fabrication de médicaments n’est pas l’objet unique des OGM.
M. François GUILLAUME, Président : J’ai dit que M. Jacquemart était un spécialiste de la biologie médicale et qu’à ce titre, il était important que nous connaissions son point de vue sur l’utilisation d’OGM à des fins médicales. Si n’est pas tout notre sujet, cela en fait partie et sa compétence me permet de le lui demander.
M. Yves COCHET : Telle que votre question a été formulée, elle me semblait signifier, « Voulez-vous qu’on guérisse les gens ou pas ? » Elle semblait quelque peu fermée. Evidemment, tout le monde est favorable à l’idée de guérir les malades, y compris avec les OGM, si cela est possible. Il ne faut donc pas se l’interdire. La question est légitime mais sa formulation était choquante.
M. Gabriel BIANCHERI : Ce n’est pas si simple parce qu’en continuant à vacciner, on peut se demander si l’on préserve l’espèce ou les individus. Faut-il lutter contre la maladie, ou faut-il l’accepter comme une contrainte de la nature et la subir comme une épreuve de la vie ?
M. le Rapporteur : Ne parlons pas de religion.
M. Frédéric JACQUEMART : Je suis obligé de répondre à la remarque sur la démarche religieuse bien que ce ne soit pas strictement mon domaine. Ce qui caractérise la démarche religieuse, c’est qu’elle est dogmatique, c’est-à-dire qu’on dit que la vérité est telle et que l’on adapte les faits à la vérité. J’ai suffisamment fait de philosophie pour vous assurer de la définition du dogme. Mystique, je ne sais pas bien ce que cela veut dire. Il me semble qu’il ne faut pas stériliser la pensée en se cantonnant au logique/déductif. On est très prétentieux dans notre civilisation et, notamment, on s’imagine être rationnel. Si vous êtes si rationnel que cela, je vous engage à vous pencher sur les travaux de neurophysiologie moderne qui montrent que la partie du cerveau qui traite la rationalité n’a aucune influence sur le comportement humain. Ceci vous fera peut-être reconsidérer beaucoup d’éléments. L’irrationnel n’est certainement pas quelque chose que nous visons, mais l’affect couplé à la rationalité est un élément absolument indispensable à la fois du comportement et du raisonnement. Il est vraiment important d’apprécier notre place dans le monde. Sur le religieux, je suis donc vraiment à l’opposé d’une démarche dogmatique et je tenais à m’en expliquer.
Pour réagir à l’intervention de M. Cochet, je pense, qu’effectivement, les biotechnologies sont un projet totalitaire. J’ai écrit à ce sujet qu’il y a, dans la biologie, ce que j’ai appelé l’auto-amplification de l’autosatisfaction. Ce n’est pas une formule, c’est un mouvement fermé d’auto-amplification, c’est-à-dire que l’on simplifie l’objet de recherche, ce qui permet d’avoir des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus satisfaisants. Vous êtes satisfait par votre procédure et donc vous continuez à simplifier. En des termes non scientifiques, on peut prendre l’exemple d’une personne qui gère une forêt ; si vous considérez qu’une forêt est une culture de planches, vous serez beaucoup plus efficace que celui qui tiendra compte de la biodiversité. Vous aurez une satisfaction par rapport à votre objectif simpliste, qui vous engagera à continuer, à produire plus et vous traiterez d’arriéré celui qui ne fera pas comme vous. C’est en cela que les biotechnologies sont impérialistes : dans ce mouvement d’hypersimplisme, elles ont éliminé toutes les alternatives de recherche qui existaient avant elles. Il n’y a pratiquement plus de recherche, par exemple sur la systémique, alors que c’est cette vision systémique qui manque pour arriver à gérer le monde que nous avons construit.
Sur l’exemple des USA, je ne peux pas répondre à une question aussi complexe car je ne dispose pas d’éléments expérimentaux ou sociologiques qui me permettent de comparer les deux systèmes. En revanche, j’ai dit que nous n’avions pas la même culture. Je me souviens très bien qu’à la Sorbonne les étudiants américains s’étonnaient de la manière dont nous étudions la philosophie et la métaphysique. C’est une civilisation basée sur le logique/déductif, les plus grands logiciens sont d’ailleurs anglo-saxons. Je pense que l’on a droit à la différence. Non seulement on y a droit mais c’est même une question de survie.
Quand j’ai quitté l’Institut Pasteur, on me disait qu’il fallait faire de la transgénèse pour ne pas être à la traîne et que l’Institut Pasteur devrait être le premier institut, etc. J’ai répondu qu’on ne le ferait jamais aussi bien qu’eux parce que la transgénèse correspond à leur mode de pensée et qu’il valait mieux développer ce que nous savons faire mieux qu’eux. Résultat : quand un laboratoire de l’Institut Pasteur se libère, il faut des petites annonces pour trouver quelqu’un, alors qu’en 1990, quand je suis parti, on se battait pour venir, et du monde entier. Effectivement, du point de vue concurrentiel, il vaut mieux casser le marché américain et créer le nôtre, plutôt que d’être à la traîne, mais, pour moi, le problème n’est pas là.
Doit-on interdire les OGM et toutes les biotechnologies ? Non. La seule chose qu’il faut interdire ce sont les essais au champ car il y a une urgence en raison des risques énormes, irréversibles qui sont en jeu. Pour le reste, il serait tout à fait absurde de demander au seul pouvoir politique de décider d’une question de société aussi forte. Il faut faire réagir la société et c’est elle qui, par son comportement, réglera ces problèmes. Si la société me donne tort, elle me donnera tort, je ne suis pas porteur de vérité et ce sont des problèmes très complexes.
M. le Rapporteur : Mais alors, qui doit décider in fine ?
M. Frédéric JACQUEMART : Le politique, à mon avis, est là pour capter les émergences sociales et les mettre en forme. Dans un paradigme stable, le politique prend les décisions ; dans un changement de société, il ne peut pas les prendre à la place de la société, sauf à se comporter en dictateur. Mais on peut ne pas être d’accord avec moi.
M. le Rapporteur : En effet, car si le politique ne peut plus décider, cela peut être dangereux.
M. Frédéric JACQUEMART : Cela mériterait une longue discussion…
Pour ce qui est d’une intervention directe sur la thérapie génique, je n’y suis pas favorable. Je pense que nous n’avons pas à prendre cette décision, elle dépasse nos compétences.
En revanche, en ce qui concerne les plantes médicamenteuses que l’on met en plein champ, je vous demande d’imaginer les conséquences de contaminations qui interviendraient à partir de plantes alimentaires dans lesquelles on aurait mis des aligaments ! C’est le contre-exemple absolu de l’intérêt de ce type de démarche, c’est le risque maximal !
Puisque j’ai obtenu l’autorisation de répondre à la question relative l’apparition des prions, je dirai que nous disposons de données suffisamment claires démontrant non seulement que l’apparition du prion n’est pas liée à l’activité humaine, mais qu’il est, très probablement, un élément de la physiologie. Cet élément est même porteur de nouvelles surprises, puisqu’un récent article indique que le prion pourrait être un mode d’incorporation, d’acquisition héréditaire des caractères. Les certitudes en matière de science étant extrêmement relatives, il faut prendre cette information avec prudence, mais il est clair que le prion est un élément qui existe depuis longtemps et qui joue un rôle très important. En fait, on a déclenché un usage qui a créé une pathologie nouvelle et qui aurait pu prendre des proportions considérables.
Je ne suis pas contre la science. Vouloir abandonner la science, même les biotechnologies, serait suicidaire parce qu’il nous faut le maximum d’outils pour arriver à gérer les situations difficiles que nous avons créées.
On m’a parlé de ce que j’appelle le « risque des voitures ». On compare encore un risque individuel à un risque d’espèce. Je parle du risque sur l’espèce humaine et non du risque individuel que l’on court en traversant une rue. Le principe de précaution ne s’applique pas aux personnes qui traversent la rue, il est fonction du niveau de l’enjeu.
M. Gabriel BIANCHERI : Vous dites, avec d’autres, que l’on n’a pas besoin de créer d’autres espèces végétales, alors que l’évolution du monde en fait apparaître de nouvelles tous les ans, peut-être même tous les jours. En conséquence, quel risque prenons-nous en créant de nouvelles espèces s’il en disparaît certaines et que de nouvelles apparaissent sans qu’on s’en doute ? C’est une vraie question de fond.
M. Frédéric JACQUEMART : L’évolution des espèces comporte, certes, des apparitions et des disparitions, mais celles-ci ne sont pas continues. Il y a des crises, l’évolution se fait par rupture. Je rappelle qu’il y a eu cinq grandes extinctions.
M. François GUILLAUME, Président : Il y a eu des fractures, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de continuum.
M. Frédéric JACQUEMART : Actuellement, on estime que l’homme a accéléré la disparition des espèces, d’une façon considérable, au moins de 1 000 fois. La fourchette est de 1 000 à 100 000 fois, parce qu’on ne sait même pas combien d’espèces existent au monde. Or, dans la dynamique des systèmes, la vitesse comme les fréquences sont des éléments pertinents. On a l’habitude de faire du qualitatif, en disant que la vitesse ne change rien. C’est faux : si les choses vont plus vite, cela signifie que l’on a changé la dynamique or, nous sommes dans un monde connecté. Chaque espèce est connectée avec d’autres et des super-connecteurs assurent la pérennité du système au niveau relationnel. Ce sont heureusement des systèmes extrêmement solides mais, en revanche, il n’y a pas de garantie sur la qualité des éléments du système. Il y a une garantie sur son organisation informationnelle, mais on ne sait rien sur sa qualité. Cela signifie que la préservation des éléments du système est la première tâche à réaliser. Or, le mouvement qui consiste, chez l’homme, à créer quelque chose est complètement opposé au système naturel car il remplace une évolution sans intention par un acte intentionnel : on se désigne un but et ensuite on adapte la nature à ce but. On est donc bien dans un mouvement inverse du mouvement naturel.
Cela signifie que si nous voulions tester la compatibilité des résultats de nos actes avec l’ensemble des systèmes naturels, nous n’y parviendrions pas. Il n’y a absolument pas équivalence entre un être artificiel et un être naturel et pour cette raison on se trompe totalement quand on prétend que l’on va augmenter la biodiversité en faisant des OGM. Vous allez peut-être augmenter la diversité biologique, mais pas la biodiversité au sens où elle est impliquée dans une dynamique globale.
M. Gabriel BIANCHERI : Dans un monde qui n’est plus naturel, que peut-on préserver de naturel. Il y a longtemps que l’homme nous a conduits dans une fuite en avant permanente ? Si un jour, on arrête la fuite, j’ai peur que l’espèce disparaisse totalement.
M. Frédéric JACQUEMART : Je suis bien d’accord avec vous. C’est pour cela qu’il faut réagir. La société ressent une crainte vis-à-vis de l’accélération de toutes ces nouveautés et la tendance est de se réfugier dans le passé, de refaire ce qui a fonctionné autrefois, c’est-à-dire de se placer dans une situation où l’on sera encore plus en inadéquation avec le monde moderne. Ma demande est autre et rejoint tout à fait votre préoccupation : c’est de faire en sorte d’être en adéquation avec le monde moderne, et c’est une urgence absolue.
M. Gabriel BIANCHERI : C’est très ambigu et je ne suis pas sûr que nous ayons la même conclusion.
M. Yves COCHET : Si, parce qu’à la limite, on pourrait être tenté de faire des humains transgéniques. C’est la question que l’on a pu poser au Professeur Testart qui a fait les bébés-éprouvette. Si l’on me disait qu’avec du transgénique, ma vie serait allongée de 50 ans, il se pourrait que je sois intéressé. Mais votre réponse, M. Jacquemart, est assez ambiguë. Que veut dire s’adapter à quelque chose que l’on a créé nous-mêmes et dont on ne peut plus s’échapper ? Je pense qu’il faut retrouver les limites et savoir ne pas les dépasser. Or il me semble que, dans le cas des essais au champ d’OGM, nous sommes en train de les dépasser. J’espère que nous pourrons revenir en arrière mais, dans la mesure où l’on compte déjà 70 millions d’hectares de cultures transgéniques dans le monde, n’est-ce pas déjà trop tard ?
M. Frédéric JACQUEMART : Cela ne me gêne pas parce cela ne m’inquiète pas. Peut-être à tort, mais l’élément important à mes yeux est qu’il y a peu de variétés. Si vous reprenez la manière dont je pose le problème, vous comprenez que cela ne va pas d’emblée modifier les choses car nous sommes dans des systèmes connectés très solides. La contamination que vous évoquez n’est pas un élément d’influence proche. Je ne pense donc vraiment pas qu’on ait dépassé le point de non-retour, ce qui ne veut pas dire que le point de non-retour n’existe pas.
Quand je dis m’adapter au monde moderne, cela signifie non pas m’adapter à ce paradigme qui est manifestement finissant, mais changer de paradigme, changer de façon d’être au monde, de façon globale. Mais on ne peut pas tirer un trait sur ce qui a été fait. Le propre des systèmes vivants est d’être des systèmes loin de l’équilibre, donc consommateurs d’énergie. C’est de la thermodynamique des systèmes ouverts où, lorsqu’une bifurcation est prise, on ne revient pas en arrière.
M. Francis DELATTRE : Pourriez-vous nous dire très précisément, quel est le risque concret de la culture du maïs transgénique en plein champ, car on parle de risques sans jamais les nommer ? En outre, on sait que dans le Sud-ouest de la France, on se trouve à quelques kilomètres des maïs transgéniques espagnols autorisés.
Par ailleurs, bien que les notions de coût et d’avantage semblent échapper totalement à votre approche, il me semble qu’à côté des risques, il faut aussi traiter des avantages dont on ne parle pas mais qui existent pourtant – moins d’insecticides et de fongicides dont on connaît très bien l’effet sur nos réserves d’eau et sur notre santé. Est-ce que cette évaluation coût/avantage est stupide ou bien devons-nous essayer de l’étudier au sein de cette commission ?
M. Frédéric JACQUEMART : Vous savez que le maïs ne se croise pas avec les espèces autochtones françaises. Donc, le risque de contamination est limité aux cultures de maïs non transgéniques. Si, hélas, vous voulez légiférer pour autoriser les essais en plein champ, il vous faudra tenir compte des zones biogéographiques, car les distances de sécurité ne seront pas du tout les mêmes dans des zones humides ou des zones sèches, dans des zones ventées et celles qui le sont peu, etc.
M. Francis DELATTRE : On mettra moins d’insecticide.
M. Frédéric JACQUEMART : Les études faites aux Etats-Unis ne montrent pas vraiment une diminution de l’utilisation des pesticides, actuellement.
M. Francis DELATTRE : C’est controversé.
M. Frédéric JACQUEMART : Admettons que ce soit controversé. J’aurais du mal à lever cette controverse car je ne dispose pas des éléments me permettant de dire quelles sont les bonnes études. Je me suis vraiment posé la question et il me semble qu’alors même qu’on est en train de comprendre qu’on est allé trop loin dans l’agriculture intensive, on se trompe de solution en recourant à des méthodes qui relèvent toujours du même système productiviste. Il y aurait pourtant des solutions agronomiques alternatives dont les spécialistes pourraient vous parler mieux que moi, parce que ce n’est pas mon domaine.
M. François GUILLAUME, Président : Nous vous remercions, M. Jacquemart.
Audition de M. Pierre-Henri GOUYON,
membre du Comité de biovigilance, directeur du laboratoire UPS-CNRS d’écologie, systématique et évolution et professeur à l’université Paris-Sud
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Nous accueillons M. Pierre-Henri Gouyon, membre du Comité de biovigilance, directeur du laboratoire UPS-CNRS d’écologie, systématique et évolution, et professeur à l’université Paris-Sud. M. Gouyon abordera surtout les questions relatives à la biovigilance.
M. Pierre-Henri GOUYON : En 1988, lorsque je suis arrivé au laboratoire que je dirige aujourd’hui, j’ai entamé des recherches sur les conséquences de la culture d’OGM. C’était alors un sujet de tout repos car personne ne s’en préoccupait. Si la Commission du génie biomoléculaire existait déjà, ses conférences de presse étaient désertées par les journalistes, et le sont restées jusqu’en 1996, époque où le dossier a émergé. Du point de vue de notre pratique, il y en a eu un « avant » et un « après » 1996.
Avant 1996, nous travaillions tranquillement sur les conséquences potentielles des OGM car notre spécialité scientifique est la génétique de populations, c’est-à-dire l’étude de la transmission des caractères génétiques à l’échelle de toute une population. Nous nous sommes d’abord demandé si les gènes pouvaient s’échapper des champs, et la réponse a rapidement été positive.
Après vous avoir communiqué quelques résultats scientifiques, je vous expliquerai en quoi ils interagissent avec la biovigilance.
Comme c’est souvent le cas en matière de recherche, nous sommes partis d’une mauvaise question : « à quelle distance est-on sûr qu’il n’y aura pas de contamination ? » En fait, il n’y a pas de réponse à cette question car le taux de contamination dépend de l’espèce, bien sûr, mais également de la forme et de la taille du champ – qui déterminent la quantité de pollen et de graines produite. Il faut préciser que les gènes peuvent migrer sous forme de pollen qui vont féconder d’autres graines ailleurs ou de graine ; cela dépend aussi des espèces. Par exemple, les graines de maïs ne migrent pas, en France en tout cas, à l’inverse du colza.
Nous nous sommes ensuite rendu compte qu’il n’existe pas de distance à partir de laquelle on soit sûr que le risque de contamination est nul : on peut simplement calculer un seuil à partir duquel la proportion est faible ou très faible, en fonction de la forme du champ et de son environnement – champs voisins de même espèce, présence de haies. Toutefois, on a pu progressivement démontrer que même si la plupart des graines tombent dans un rayon de dix mètres, le taux de contamination à un kilomètre avoisine toujours un pour mille : les courbes statistiques font ainsi apparaître une « queue de dispersion » très longue. Les graines qui ne tombent pas très près peuvent donc aller très loin, ce qui fut une surprise.
Une contamination d’un pour mille est-elle élevée ? Là encore, tout dépend du gène et de la plante. La graine de colza, par exemple, migre très facilement. Or un champ de colza produit 75 000 graines par mètre carré avec une perte de 10 % à la récolte. Pour cette plante, le taux d’un pour mille signifie donc qu’à partir d’un hectare, des milliers de graines sont contaminées. Si le gène en question est favorisé par l’environnement, il se répandra extrêmement vite : par exemple, si l’on utilise un gène de résistance à un pesticide, celui-ci sera transmis à d’autres plantes par contamination et en cas d’application d’un herbicide, seules pousseront aux alentours les plantes contenant un gène de résistance, que ce soit dans les champs, sur les voies ferrées ou sur les bords de route. Les risques ont donc été évalués au cas par cas.
Mais en étudiant plusieurs plantes à la fois, nous nous sommes aussi aperçus de l’existence d’effets de système. Rendre une espèce résistante à un herbicide n’aura pas le même impact selon que les autres espèces auront ou non la même propriété. Ainsi, si l’on veut désherber le blé et le maïs avec le même herbicide que celui du colza, il faut pouvoir se débarrasser des colzas résistants dans les champs de blé ou de maïs. Or aucun système réglementaire ne prend en compte cette problématique. La Commission du génie biomoléculaire, par exemple, ne peut donner ses autorisations qu’au cas par cas, même si elle réfléchit aux effets de système.
S’agissant du Comité de biovigilance, un Comité « provisoire » de biovigilance a été mis en place en 1998, à peu près au moment de la Conférence des citoyens sur les OGM. Le comité définitif, quoique créé par la loi, n’a jamais été nommé, de sorte que la composition actuelle du Comité ne correspond pas à la loi.
Le comité provisoire, qui était censé travailler sur l’impact des OGM commercialisés, s’est autosaisi de sujets comme la dispersion de gènes à longue distance, mais pas du problème de dispersion à partir des essais. Chaque fois que je l’ai demandé, on m’a rétorqué que ce n’était pas dans ses missions ; cela ferait bien partie de celles du comité créé par la loi, mais celui-ci n’a jamais été installé… Tout cela n’est pas logique car l’impact des essais ne peut être évalué qu’en allant étudier la contamination aux alentours des essais menés il y a quelques années et cela ne peut se faire que si le ministère de l’agriculture en a la volonté réelle, puisque c’est la seule structure qui peut connaître l’implantation précise de tous les essais.
Je trouvais la composition du comité provisoire très bien faite car on y trouvait toutes les tendances : représentants des Verts et de la Confédération paysanne, semenciers, scientifiques de disciplines diverses. Bien qu’appartenant à une même communauté, les chercheurs ont en effet des avis contrastés selon, par exemple, qu’ils sont spécialisés en écologie – ce mot n’étant pas pris dans l’acception militante qu’il a communément – ou en biologie moléculaire végétale. Les premiers travaillent sur des systèmes complexes avec des capacités de prédiction faibles et des interactions imprévisibles, tandis que les seconds ont une vision un peu plus simple du système vivant. Je le dis très clairement, étant moi-même généticien passé à l’écologie.
La composition du comité définitif aurait été beaucoup moins bonne, exceptée la présence d’un parlementaire, puisque la plupart des scientifiques y auraient représenté leur organisme de recherche, au lieu d’être nommés en tant qu’individus, et n’auraient donc pas pu s’exprimer librement.
Le comité provisoire a permis beaucoup de débats, mais son poids est resté très faible car il n’avait le droit de travailler que sur les cultures commerciales, lesquelles ont très rapidement été abandonnées en France.
Le regroupement envisagé du Comité de biovigilance, de la Commission du génie génétique (CGG) et de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) serait une bonne mesure. Il est en effet nécessaire que le Comité de biovigilance travaille main dans la main avec la Commission du génie biomoléculaire pour alerter immédiatement celle-ci des découvertes qui pourraient contrecarrer ses prévisions.
Mais le point essentiel réside dans la composition de l’organisme de regroupement : s’il est essentiellement constitué de biologistes moléculaires avec un écologiste pour faire bonne figure, il ne sera guère crédible car les conséquences en termes d’environnement et de santé publique ne pourront être saisies convenablement.
M. le Président : Je précise que le projet de loi en cours de préparation prévoit bien la fusion de ces trois organismes, mais que notre mission d’information pourra faire des propositions à ce sujet, puisque le texte ne sera proposé qu’après le dépôt de notre rapport.
Par ailleurs, nommer une personnalité qualifiée lui confère certainement de la liberté, mais comment choisir telle personne plutôt que telle autre, sachant qu’il y a des milliers de chercheurs ? Je pense que le fait d’avoir été nommé en fonction de votre appartenance au Centre national de recherche scientifique (CNRS) ne vous oblige aucunement à porter la parole de cet établissement et devrait vous permettre de vous exprimer librement.
M. Pierre-Henri GOUYON : C’est alors un problème de formulation : il ne faut pas dire que tel chercheur « représente » le CNRS, mais qu’il « est désigné » par cet organisme.
M. le Président : Absolument !
M. Pierre-Henri GOUYON : Cela dit, si chaque organisme nomme un seul chercheur, il choisira celui qui représente le mieux la vision qui y est dominante. Mieux vaudrait, pour favoriser le pluralisme, un petit nombre d’organismes désignant chacun plusieurs représentants, plutôt qu’un plus grand nombre d’organismes qui en désigneraient chacun un seul.
La composition de ces comités doit en tout cas être diverse et équitable, y compris pour leur image. Ainsi, le scientifique qui représentait le mieux l’écologie à la Commission du génie biomoléculaire a démissionné il y a deux ou trois ans parce qu’il en avait assez d’être systématiquement mis en minorité.
J’ai été rapporteur du groupe « Recherche et société » aux Assises nationales de la recherche, qui se sont récemment tenues à Grenoble, et nous espérons que sera créé un « Haut Conseil de la science », lequel pourrait réfléchir à la composition de ce comité. La meilleure formule, selon moi, serait qu’une instance générale s’efforce de désigner les meilleurs représentants de la communauté scientifique, plutôt que de demander à chaque organisme de nommer quelqu’un.
Par ailleurs, il est important que la société civile soit représentée. Mais l’expérience montre que, lorsque les discussions deviennent techniques, les représentants de la société civile sont rapidement dépassés et en viennent à ne plus se déplacer. Il faudrait probablement prévoir une structure spécifique pour les échanges techniques et soumettre ses conclusions en séance plénière. Nous évoquions déjà ce problème, avec Christine Noiville, dans le rapport sur le principe de précaution que nous avons remis au Premier ministre Lionel Jospin.
S’agissant de la tutelle du comité, celle-ci est assurée par les ministères de l’agriculture, de la recherche et de l’environnement, et je serais un peu inquiet si l’on y adjoignait celui de la santé, comme l’envisage l’une de vos questions, car cela compliquerait le processus de nomination et laisserait encore moins de place à la représentation des chercheurs étrangers à la biologie moléculaire. Le Comité consultatif national d’éthique n’est-il pas placé directement auprès du Premier ministre ? Il avait été envisagé, sous le gouvernement Juppé, de créer un organisme similaire pour l’environnement, et je pense que le rattachement administratif du futur comité pourrait être envisagé à haut niveau, au lieu de dépendre de plusieurs ministères.
L’une de vos questions écrites était amusante : « Comment expliquez-vous que l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale ne conduise pas d’études concernant les conséquences des OGM sur l’environnement et se déclare non compétente ? » N’appartenant pas à cette agence, je n’ai pas à répondre. Mais mon sentiment, même si j’ai participé avec intérêt à la Conférence des citoyens de 1998, est que la question des OGM n’est pas traitée très sérieusement par l’ensemble des instances de décision, et je regrette qu’elle n’ait jamais donné lieu à un débat parlementaire.
Je voudrais vous donner un exemple. A la fin du XXe siècle, un financement de 10 millions de francs a été dégagé pour des études relatives à l’impact des OGM sur l’environnement. Au vu du faible nombre de laboratoires candidats – ceux qui travaillaient déjà sur le sujet, comme le mien, ont présenté des projets qui ont été retenus mais les autres n’y ont pas prêté attention –, le ministère de la recherche a décidé, l’année suivante, de ne pas reconduire l’opération. Cette année, des crédits sont de nouveau ouverts, mais, pour inciter les laboratoires à changer d’orientation, il aurait fallu, comme pour le SIDA, injecter des sommes élevées et stables d’une année sur l’autre. Lorsque M. François d’Aubert était ministre de la recherche, il m’avait demandé pourquoi les laboratoires étaient si peu intéressés par l’impact des OGM sur l’environnement et il m’avait fait remarquer que les chercheurs devraient s’emparer des questions que se pose la société. Il manque effectivement, en France, une structure chargée d’enregistrer ces questions et de les répercuter dans le milieu de la recherche ; nous en parlons dans le rapport « Recherche et société » qui figure sur le site des « Assises sur la Recherche ».
M. le Président : Je précise, mes chers collègues, que le rapporteur avait fait parvenir une liste de questions écrites à M. Gouyon, qui s’efforce d’y répondre point par point.
Quant à l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE), nous l’avons invitée, mais il nous a été répondu, en substance, qu’elle n’avait pas conduit de sujet sur cette question, ce qui peut paraître étonnant.
M. Gérard DUBRAC : Quelles sont les missions du Comité de biovigilance et comment fonctionne-t-il par rapport aux autres commissions ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Je commencerai par vous dire que, pour la Commission du génie biomoléculaire, il vaut mieux ne pas utiliser le sigle « CGB », réservé à la Confédération générale des betteraviers !
La Commission du génie génétique donne des avis sur ce qu’elle constate dans les laboratoires. La Commission du génie biomoléculaire donne des avis sur la sortie des OGM des laboratoires. Le Comité de biovigilance était chargé, une fois les OGM commercialisés, de surveiller leur impact pour éventuellement rétroagir et demander leur retrait du marché.
Les missions et les nominations du comité temporaire avaient été décidées conjointement par les ministères de l’agriculture et de l’environnement. Mais les missions du comité définitif sont fixées dans la loi – qui, je le répète, est inappliquée –, avec un élargissement aux essais, c’est-à-dire au tableau 2 de la Commission du génie biomoléculaire.
M. le Rapporteur : Si le Comité de biovigilance ne se préoccupe pas de la dispersion à la suite d’essais, qui s’en saisit ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Personne !
M. le Rapporteur. C’est tellement étonnant que je voulais vous l’entendre dire clairement !
M. Pierre-Henri GOUYON : Dans ce dossier, il y a beaucoup de choses hallucinantes, et je suis très heureux que votre mission d’information ait été constituée.
Même si je n’ai jamais été opposé à la technologie OGM, j’ai toujours exprimé des réserves vis-à-vis de certains OGM en passe d’être autorisés. D’ailleurs, nous avons été entendus, puisque, en 1998, la France a posé un moratoire sur le colza et la betterave, avant même le moratoire européen. Je dois cependant vous avouer que ma position s’est durcie à la suite du jugement récent de la Cour suprême canadienne dans l’affaire Percy Schmeiser. Cet agriculteur reproduisait chaque année ses propres variétés de colza. Il n’avait jamais acheté de semences Monsanto, contrairement à beaucoup de producteurs canadiens, mais les enquêteurs de la firme ont prouvé la présence de gènes de résistance au Roundup dans certaines de ses cultures. Bien qu’il ait été reconnu par les avocats de Monsanto que tout ce qui poussait chez lui était arrivé par le vent, Percy Schmeiser a été condamné en dernière instance et n’est plus autorisé à récolter ses colzas, car le droit du brevet prime. Il faut savoir que le contrat de culture Monsanto est léonin : il interdit non seulement de ressemer les graines obtenues mais aussi d’exploiter les repousses spontanées.
M. François GUILLAUME : Dans ce genre de procès, il faut en prendre et en laisser. Personne ici ne peut répondre du sérieux du producteur incriminé, qui a pu récupérer des graines de semences génétiquement modifiées.
M. Pierre-Henri GOUYON : Peut-être, mais il est spécifié dans les attendus du jugement que le fait d’avoir introduit volontairement ou non des graines n’a aucune importance ; les gènes, de toute façon, appartiennent à Monsanto.
M. Francis DELATTRE : C’est au Canada !
M. Pierre-Henri GOUYON : Certes, mais cette affaire montre qu’il est crucial de donner des garanties aux agriculteurs français.
M. le Président : Lundi, l’Assemblée examinera le projet de loi sur la protection des inventions biotechnologiques et il est prévu que le texte européen soit amendé dans ce sens.
M. Pierre-Henri GOUYON : Absolument ! Mais vous savez aussi que les Etats-Unis ont porté plainte contre l’Europe devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à propos des OGM. Concernant le droit des brevets, jusqu’à quel point l’Europe saura-t-elle résister à la pression américaine ? Je serai pleinement rassuré le jour où l’OMC admettra les principes retenus aujourd’hui au niveau européen.
M. le Rapporteur : Comment les essais sont-ils surveillés dans les autres pays, par exemple aux Etats-Unis et au Canada ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Aux Etats-Unis ou au Canada, le problème ne se pose pas, puisqu’il n’y a aucune réglementation spécifique aux OGM, lesquels sont considérés comme des variétés normales. Le Canada est néanmoins un très bon terrain d’expérience. On peut y travailler sur la dispersion à longue distance car il y existe de très grands champs transgéniques. Nous avons effectué des études sur ce point, dont les résultats n’ont pas encore été publiés. En outre, on y a identifié, au bout de trois ans de culture de colza transgénique, des variétés résistant à trois herbicides par croisement entre champs transgéniques. Nos craintes s’en trouvent ainsi confirmées : cette espèce pourrait devenir une mauvaise herbe majeure. Mais travailler avec le Canada est assez difficile car Monsanto, dans ce pays, subventionne presque tous les laboratoires de biologie végétale.
M. le Rapporteur : Vous avez suggéré que l’Etat ne connaîtrait pas précisément la localisation des essais d’OGM.
M. Pierre-Henri GOUYON : Le ministère de l’agriculture les connaît mais leur liste n’est pas rendue publique.
M. le Rapporteur : Depuis deux ans, les maires sont informés.
M. Pierre-Henri GOUYON : C’est vrai, mais, comme je l’ai dit, il serait aussi intéressant de connaître la localisation des essais entrepris il y a dix, cinq ou trois ans. Il faudrait donc écrire à tous les maires de France pour savoir si des essais ont été menés dans leur commune et quels champs sont concernés !
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : A l’époque, les maires n’en savaient rien.
M. François GROSDIDIER : Et le Comité de biovigilance n’est pas informé non plus ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Non.
M. le Président : En 1998, il était permis de penser que la technique des cultures allait se développer. Donc, on a créé le comité de biovigilance pour surveiller les cultures et non les essais, ceux-ci étant traités par une autre commission. Or, aujourd’hui, il n’y a plus que des essais, sur lesquels le Comité de biovigilance n’a pas compétence. Nous devons donc travailler sur ce point et faire des propositions.
Premièrement, l’idée prévue dans l’avant-projet de loi de regrouper le comité et les deux commissions en élargissant le champ des spécialités scientifiques représentées est une bonne idée.
Deuxièmement, il faut définir ce que signifie « société civile » et déterminer qui la représente. Le projet de loi, en l’état, prévoit que la nouvelle instance se réunit dans une configuration unique pour examiner les dossiers au cas par cas. Pierre-Henri Gouyon vient de nous proposer de séparer les discussions techniques – dans lesquelles les représentants des consommateurs ont du mal à faire entendre leur point de vue face aux scientifiques – du rôle de la société civile concernant les grandes orientations. Personnellement, je retiens aussi cette idée.
M. François GUILLAUME : J’y souscris également totalement. Par ailleurs, je voudrais faire deux observations.
Vous avez employé le terme « contamination », que je n’aime pas beaucoup car il est péjoratif et a une connotation animale, voire humaine : on insinue, dans l’esprit du citoyen, une crainte peut-être injustifiée.
Avec la dissémination du colza, la ravenelle, par exemple, plante adventice, risque effectivement de développer une résistance préjudiciable aux autres cultures. Mais je ne comprends pas très bien le processus pour la betterave, dont la production ne nécessite pas de très grandes superficies et qui est généralement localisée : comment la « contamination » intervient-elle dans ce cas ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Les mots, effectivement, ne sont pas innocents et je serais prêt à ne plus parler de « contamination » si l’on en trouvait un autre.
M. François GUILLAUME : Pourquoi pas « dissémination » ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Ce n’est pas pareil : la contamination, intervient au niveau des récepteurs. Attention aux mots ! Souvenez-vous : les initiales OGM, au départ, signifiaient « organismes génétiquement manipulés », et on nous a demandé de dire « organismes génétiquement modifiés » pour faire moins peur ; on l’a fait et ensuite, il nous a été opposé que les plantes avaient de tout temps été modifiées et que nous perdions notre temps !
Concernant le colza, la ravenelle s’hybride effectivement avec le colza, mais celui-ci pose un problème en lui-même. Nous l’étudions depuis longtemps dans une petite commune de la région Centre, Selommes, en liaison avec un organisme professionnel, le Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM), et nous avons découvert des plantes de colza contenant des gènes qui ne sont plus cultivés depuis plus de douze ans. En terme de réversibilité, cela prouve que le colza peut vivre longtemps hors des champs et s’y reproduire. Donc, si l’on donne trop de coups de pouce – résistance à des insectes et à des herbicides –, le colza pourrait se transformer lui-même en une sorte de peste.
Concernant la betterave – dont il faut savoir que les semences sont produites dans le Sud-Ouest de la France, alors que les cultures se font dans le Nord – l’une des mauvaises herbes principales des champs de betteraves est la betterave sauvage, et il s’agit de savoir d’où elle provient. Nous avions posé la question, avec Axel Kahn, dès la création de la Commission du génie biomoléculaire, et les producteurs de semences nous avaient répondu qu’ils contrôlaient dorénavant très bien l’hybridation entre betteraves sauvages et cultivées. Or, autour des champs, on n’a jamais réussi à se débarrasser des betteraves sauvages. Pour produire des hybrides, on emploie des plantes dites « mâles stériles », c’est-à-dire femelles, qui ne produisent pas de pollen – l’appellation peut paraître bizarre, mais il faut savoir qu’en botanique un organisme normal est hermaphrodite. Le problème est que ces mâles stériles sont de redoutables pièges à pollens et que quelques plantes sauvages suffisent pour que leurs gènes soient captés. Un laboratoire de Lille a démontré que les graines récoltées et envoyées dans le Nord pour semis contenaient de tels hybrides : l’agriculteur sème donc en même temps la betterave sauvage – qu’il devra ensuite désherber – et la betterave cultivée. Si l’on insérait dans celle-ci un gène de résistance à un herbicide, vous comprenez que l’on rendrait aussi définitivement résistante la betterave sauvage au bout de deux ou trois générations.
M. Francis DELATTRE : Je voulais dire, à titre préalable, que si l’Assemblée n’a jamais débattu de ces questions, c’est que l’article 34 de la Constitution, qui fixe les compétences du Parlement, ne fait pas encore référence à l’environnement, et quelques-uns d’entre nous se battent pour que cela change. Heureusement, depuis la loi Barnier, nous avons pris l’habitude de nous emparer quand même de ces problèmes.
Vous avez parlé du colza mais le cas du maïs est particulier en ce qui concerne les risques de dissémination, et nous attendons tous une décision de la Commission européenne sur ce point. Pouvez-vous nous en dire un mot ?
Je persiste à penser que c’est surtout la dissémination du colza qui fait débat. L’étude sérieuse remise par M. Marc Fellous il y a une semaine démontre que les risques de dissémination de plantes adventices sont réduits. En quoi est-il alors pénalisant de rendre un colza résistant au glyphosate, herbicide généraliste, qui constitue la base du Roundup et qui appartient au domaine public ? Employer un autre système requiert trois ou quatre traitements, qui coûtent 300 ou 400 francs chacun, et qui augmente la quantité de molécules injectées dans la terre. La politique « Terminator » de Monsanto est certes scandaleuse mais il est d’ores et déjà interdit, en France, de reproduire une plante hybride sans rémunérer le titulaire du brevet. Le colza est certes rendu résistant au glyphosate et il va se propager près des voies ferrées mais ce n’est pas un vrai problème parce qu’un autre désherbant, l’Allié, supprime aisément les variétés susceptibles de se conduire comme des plantes adventices. En quoi la dissémination est-elle « risquée » puisque la semence est plus intéressante et moins coûteuse ? Pourquoi ne pas comparer tous les avantages et tous les inconvénients ? Le débat est insuffisant sur ce point. La culture du colza est importante car c’est la plante la mieux maîtrisée dans la perspective des biocarburants. Pourquoi nos propres producteurs n’auraient pas droit d’utiliser des OGM plus économiques ? Les Brésiliens envahissent notre marché de biocarburants, alors que nous sommes un pays agricole et que nous disposons de la matière première nécessaire !
M. Pierre-Henri GOUYON : En France, le maïs, sauf exception dans le Sud-Ouest, ne pose effectivement pas de problème de dissémination car les grains restent enfermés dans l’épi. Mais ce n’est pas vrai en Amérique Centrale. Or comment pourrait-on, au plan international, autoriser certains maïs en France au motif qu’il n’y a pas de risque de contamination des variétés traditionnelles ou de contamination de la plante sauvage qui sert de réservoir génétique au maïs et interdire les mêmes au Mexique ? Cela me fait penser à ce ministre brésilien qui a indiqué accepter l’inscription de la forêt amazonienne au patrimoine de l’humanité à condition qu’il en soit de même pour la bombe atomique et les puits de pétrole… exprimant ainsi l’idée que tout le monde fait des erreurs.
Il existe effectivement des hybrides de maïs ou de betterave, mais ils ne sont pas brevetés, contrairement à ce que vous affirmez, M. Delattre. Il y a un certificat d’obtention végétale qui permet de réutiliser les ressources génétiques : si jamais votre maïs se croise avec le maïs hybride du voisin, cela ne confère aucun droit à la firme.
M. Francis DELATTRE : Je ne parlais pas du maïs mais du colza.
M. Pierre-Henri GOUYON : Maïs ou colza, c’est pareil.
M. Francis DELATTRE : En outre, le colza hybride est en plein développement : il représente au moins 10 % du total, pour la simple raison qu’il produit davantage.
M. Pierre-Henri GOUYON : Quoi qu’il en soit, ces colzas n’étant pas brevetés, un croisement avec les miens ne confère aucun droit à mon voisin ni à la firme qui les lui a vendus. C’est une différence avec le droit des brevets, tel qu’il s’applique actuellement, et il faut effectivement craindre l’extension de ce droit : les variétés traditionnelles mexicaines, largement contaminées par des transgènes provenant d’OGM d’Amérique du Nord, appartiendraient alors aux firmes qui ont fabriqué ces derniers et il y aurait alors un véritable problème de propriété des ressources génétiques mondiales. C’est un vrai enjeu.
M. le Président : Je précise que nous avons prévu d’organiser une table ronde sur ce thème avec des juristes. Les précautions juridiques que nous introduisons, pour être efficaces, doivent être reconnues par l’OMC.
M. Pierre-Henri GOUYON : Absolument ! Mais je ne pourrais pas vous aider sur cette question car j’ai été débouté comme expert devant l’OMC…
On n’a jamais découvert que deux molécules d’herbicide total, c’est-à-dire venant à bout de toutes les plantes avant l’élaboration d’OGM résistants : le glyphosate, produit actif du fameux Roundup de Monsanto, et le glufosinate, qui entre dans la composition du Liberty et du Basta. Le glyphosate est certes tombé dans le domaine public – c’est-à-dire la molécule – mais pas le Roundup. Or cette molécule n’agit que si elle pénètre dans les plantes, ce qui nécessite des adjuvants, et ceux du Roundup sont nettement plus efficaces que ceux des produits concurrents. Cela signifie qu’en terme de toxicité, ce mécanisme est terrifiant : on diffuse des quantités énormes de molécules dans l’atmosphère, sans avoir les moyens de tester la toxicité produite par leurs interactions.
Pour l’instant, Monsanto impose évidemment aux agriculteurs qui lui achètent des variétés résistantes au glyphosate d’utiliser du Roundup et non pas du glyphosate générique. Mais on constate que les agriculteurs ont tendance à abuser du produit et que la quantité d’herbicide épandu a malheureusement beaucoup moins baissé que ce qui était espéré. Pour que le système fonctionne bien, il conviendrait d’imposer de bonnes pratiques.
Par ailleurs, l’environnement ne peut y gagner que si l’on ne rend pas le blé ou d’autres plantes résistantes au Roundup – même les agriculteurs américains s’y sont opposés. Cela créerait un risque de contamination entre parcelles et même, lors d’une rotation, au sein d’une même parcelle. Et, pendant ce temps, d’autres firmes rendent d’autres plantes résistantes au glufosinate ; cette logique interdirait donc tout recours à un autre herbicide et serait très dangereuse pour l’agriculture. Je répète d’ailleurs que des colzas trirésistants – au glyphosate, au glufosinate et aux oxynils – ont été découverts au Canada.
Une firme a évidemment intérêt à rendre toutes les plantes résistantes à son herbicide pour mieux le vendre, et on ne peut lui reprocher. D’ailleurs, cela s’explique par le fait que les semenciers ont été rachetés par les sociétés d’agrochimie. Les champs se croisant, on finit par fabriquer des plantes qui sont résistantes à tout. C’est un vrai problème et lorsque nous le soulevons, on nous répond toujours que les agriculteurs sont intelligents. Mais les médecins ne le sont pas moins et ils n’ont pas su pour autant gérer les antibiotiques de façon optimale, la pression exercée sur chaque individu faisant perdre de vue l’intérêt collectif. C’est donc à la collectivité de mettre en place des systèmes de gestion globale des herbicides et des plantes transgéniques. Je n’ai rien contre le fait de rendre une espèce résistante à un herbicide spécifique, mais rendre chacune d’entre elles résistante à tous les herbicides me semblerait tout à fait déraisonnable. C’est pourquoi j’avais émis l’idée d’un « permis de mettre des gènes dans les plantes », chaque firme étant alors limitée dans ses acquisitions de semences. Mais, comme je l’ai déjà dit, la Commission du génie biomoléculaire se prononçant au cas par cas, elle ne peut prendre en compte l’effet de système.
M. François GROSDIDIER : Au-delà des cultures et des essais, quelqu’un contrôle-t-il les conséquences des transports ? Ma commune, qui a le privilège d’héberger la plus grosse gare de triage de France, est par conséquent traversée par des convois venant des quatre coins de l’Europe. J’ai observé des brins de colza sidérants, d’une force et d’une dimension extraordinaires, poussant sur du ballast régulièrement désherbé par la SNCF et en bordure de sites industriels connus pour leur pollution très forte. J’en ai envoyé, aujourd’hui même, à un laboratoire. C’est d’autant plus inquiétant que ces trains sillonnent le territoire, traversent des champs et longent des zones habitées. Des précautions particulières sont-elles prises ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Aucune précaution particulière n’est prise pour les transports ferroviaires. Mais nous étudions cette question dans le cadre de l’étude de Selommes sur l’impact des OGM, dont je vous ai parlé. C’est un travail assez difficile à mener car il n’y a pas de découvertes fondamentales à en espérer ; nous l’avons maintenue car elle correspond à une demande de la société, mais elle est constamment sur le fil du rasoir. Dans ce cadre, nous avons aussi abordé l’aspect des transports : d’où vient le colza trouvé au bord d’une route ? Du champ d’à côté ou d’une plante poussée au même endroit l’année précédente ? A moins qu’il ne soit tombé d’un camion ? Nous commençons à obtenir des données sur les proportions de chacune de ces catégories et les camions figurent effectivement parmi les disperseurs de graines, mais il faudrait que nous ayons davantage de moyens pour aller plus loin. Quoi qu’il en soit, je serais content de pouvoir analyser les plantes dont vous parlez.
M. André CHASSAIGNE : Lors des auditions précédentes, nous avons entendu des propos contradictoires à propos des essais de plein champ : certains nous ont dit qu’ils étaient uniquement destinés au processus de commercialisation ; d’autres qu’ils servaient à mesurer la dissémination.
Vous avez appelé de vos vœux une structure qui répondrait aux questions de la société civile. Pouvez-vous donner deux ou trois exemples de sujets qu’elle pourrait aborder ?
Savez-vous, par ailleurs, quelle est la part des semences réutilisées en France d’une année sur l’autre ?
Enfin, la dissémination est-elle plus grave quand on fauche le champ ou quand on laisse les plantes aller jusqu’à maturation ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Je dirai que 99 % des centaines d’essais effectués ces dernières années étaient destinés au développement – c’est-à-dire à la productivité des plantes – et non à la recherche sur les problèmes de dissémination. Hormis les plates-formes que l’INRA partage avec le CETIOM, l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) et l’Institut technique de la betterave (ITB), c’est-à-dire trois essais, et celle de l’Ariège, qui a malheureusement été détruite, il s’agit presque toujours de développement. J’ajoute que les trois essais cités étaient destinés à étudier la dissémination mais qu’il serait intéressant d’étudier cette question à l’occasion d’autres essais dont ce n’est pas le but.
Sur bien des sujets, il est nécessaire que les chercheurs débattent avec la société civile. Par exemple, faut-il organiser des vols spatiaux habités ? Quelles sont les conséquences de la pollution chimique ? S’agissant des conséquences de la culture d’OGM, je n’ai pas le temps ici de dresser la liste des points qui devraient être étudiés mais les questions sont nombreuses.
Enfin, je ne crois pas que les fauchages disséminent grand-chose. Mais j’en profite pour vous dire que vous devriez donner de la publicité à votre mission d’information, car la société civile a l’impression que les pouvoirs publics essaient d’enterrer le dossier. Elle serait sans doute rassurée si elle savait que l’Assemblée nationale y réfléchit.
M. François GUILLAUME : Dès lors, par exemple, que l’on accepte un OGM pour le colza, pourquoi ne pas rendre obligatoire l’introduction du gène « Terminator » correspondant ? Les semences de colza ne sont plus remployées – même celles de blé ne le sont plus guère. Du reste, les appareils ensemencent désormais graine par graine, ce qui ne nécessite qu’un kilo et demi environ de semences par hectare. Enfin, en 2003, dans certaines régions, il pleuvait tous les jours et la récolte commençait à germer à terre ; avec « Terminator », le grain aurait été conservé dans de bonnes conditions.
M. Pierre-Henri GOUYON : Pour le colza, on compte tout de même encore 30 % de semences de ferme, comme le prouve l’examen des génotypes auquel nous procédons dans la région Centre.
Par ailleurs, la technologie « Terminator » n’est absolument pas en mesure de faire ce que vous dites, M. Guillaume, car il faudrait stopper la totalité de la germination et pas seulement la moitié. En outre, faire entrer « Terminator » dans toutes les variétés transgéniques serait trop coûteux et réduirait de beaucoup leur intérêt – de même que des tests toxicologiques de grande ampleur sur les OGM rendraient leur rentabilité insuffisante, eu égard à la durée de vie réduite des variétés botaniques, contrairement à la durée de vie des médicaments.
M. Gérard DUBRAC : Avez-vous une idée du nombre d’OGM actuellement expérimentés ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Je l’ignore, mais vous obtiendrez facilement cette information auprès de la Commission du génie biomoléculaire. En tout cas, même si les OGM sont nombreux et de natures très variables, 95 % de ce qui est disponible sur le marché reste concentré sur les résistances à des insectes ou à des herbicides.
M. le Président : L’année dernière, on dénombrait quelque quarante essais, sur cinq espèces, principalement le maïs et le colza, et ce nombre décroît, pour les raisons qui ont déjà été indiquées.
M. Gouyon, pourrez-vous nous communiquer des réponses écrites sur les points que vous n’avez pu aborder ce soir, concernant en particulier la gouvernance ?
M. Pierre-Henri GOUYON : D’accord.
M. le Président : Par ailleurs, nous avons décidé d’organiser des tables rondes contradictoires ; il serait intéressant que vous y participiez.
M. Pierre-Henri GOUYON : Avec plaisir.
M. le Président : Je vous remercie.
Audition conjointe de
M. Martin HIRSCH, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA),
et de M. Maxime SCHWARTZ, directeur de la programmation de l’Agence
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Martin Hirsch, maître des requêtes au Conseil d’Etat, directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), et à M. Maxime Schwarz, directeur de la programmation des laboratoires de l’agence.
M. Martin HIRSCH : L’AFSSA, créée en application de la loi du 1er juillet 1998 relative à la veille sanitaire et à la surveillance des produits destinés à l’homme, a été spécifiquement chargée d’évaluer les risques alimentaires liés aux OGM et cela, de trois façons.
A la demande des ministères ou de son propre chef, l’agence évalue les risques au cas par cas et rend des avis. Elle tente aussi de tirer des enseignements de ces cas particuliers pour proposer un cadre général d’évolution des lignes directrices de l’évaluation des risques que peuvent présenter les OGM.
L’agence s’est aussi attachée à évaluer les éventuels bénéfices de l’utilisation des OGM. Ce point est d’une importance particulière, car lorsque nous nous sommes engagés dans cette voie, le sujet était occulté, pour des raisons contradictoires : alors que, pour certains, les termes « OGM » et « bénéfices » étaient totalement antinomiques, d’autres posaient comme un postulat d’évidence que leur utilisation aurait de multiples effets bénéfiques, qu’il s’agisse de lutter contre la faim dans le monde, de combattre l’obésité ou de supprimer l’allergénicité des produits naturels. Dans tous les cas, on en restait à des positions de principe. Nous avons donc fait œuvre pionnière en nous penchant sur les méthodes d’évaluation des bénéfices des OGM et en organisant, en décembre 2001, un colloque consacré à cette question. Comme il fallait définir si les bénéfices allégués avaient une existence autre que virtuelle, nous avons prolongé le colloque en étudiant quatre OGM, comme nous l’aurions fait si nous avions évalué le rapport bénéfices/risques d’un médicament. Nous avons présenté ce travail, conduit par Maxime Schwartz, à nos collègues européens, à Berlin, il y a une dizaine de jours.
Enfin, nous nous sommes intéressés à l’isolement des filières, par ricochet en quelque sorte, après la découverte, il y a trois ou quatre ans, de quelques fifrelins d’OGM dans des champs où l’on n’aurait dû trouver que des productions conventionnelles, et après avoir constaté que la séparation entre filière OGM et filière non-OGM était floue.
De ces études, il ressort que l’on peut améliorer les modalités d’évaluation du risque, tout en maintenant un niveau de sécurité satisfaisant, dès lors que les exigences sont bien remplies. A cet égard, on a pu noter que certains dossiers, qui nous ont été présentés pour la première fois, il y a maintenant sept ans, sont encore étonnamment incomplets, comme si les industriels attendaient que notre niveau d’exigence faiblisse… Cette attitude diffère de celle observée pour d’autres produits soumis depuis longtemps à un régime d’autorisation.
M. le Président : Sur quoi les avis rendus par l’agence portent-ils ? Les expérimentations sont-elles concernées ?
M. Martin HIRSCH : Nos avis portent seulement sur les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale.
M. Francis DELATTRE : Mais pas sur l’effet que pourrait avoir pour la santé de l’homme l’ingestion d’animaux de boucherie nourris avec des produits génétiquement modifiés ?
M. Maxime SCHWARTZ : L’agence se prononce sur la pertinence des autorisations de mise sur le marché d’aliments génétiquement modifiés destinés à la consommation animale mais nous ne contrôlons pas les animaux qui ont mangé des OGM. Il n’y a d’ailleurs pas de procédure d’autorisation concernant les produits issus d’animaux eux-mêmes nourris aux OGM.
M. Martin HIRSCH : Les mêmes questions valent pour tout produit destiné à l’alimentation animale : en premier lieu, l’aliment dont la mise sur le marché est demandée peut-il nuire à la performance de croissance de l’animal, ou induire la transmission d’une maladie à d’autres animaux ? Ensuite, la consommation par l’homme d’un animal ainsi alimenté aura-t-il un impact sur la santé humaine ? Le risque est donc évalué, à la fois dans ses effets sur l’animal et dans ses effets sur l’homme. Par ailleurs, des essais sont en cours pour déterminer si des séquences d’acides nucléiques provenant des OGM ingérés sont retrouvées dans le sang et le lait.
J’en reviens à l’agence, qui œuvre dans un environnement national et international complexe. En effet, sur le plan national, la distinction des compétences n’est pas très nette entre l’AFSSA, chargée de l’aspect alimentaire, et la Commission du génie biomoléculaire, dont le champ de compétence non limité recouvre à la fois l’aspect environnemental et l’aspect alimentaire, si bien que nous pouvons être en désaccord – cela s’est parfois produit. Mieux vaudrait rationaliser cet ensemble.
Sur le plan international, la création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) devrait, en toute logique, entraîner la disparition à court terme de l’examen des dossiers d’évaluation à l’échelon national. A ce jour, les agences nationales et l’Autorité européenne mènent des travaux en parallèle et les confrontent in fine pour voir s’il y a accord ou désaccord. De ce fait, il nous est arrivé de constater des différences d’approche dans l’évaluation des risques, soit entre les agences nationales, soit entre l’une d’elles et l’Autorité européenne. On peut espérer que les lignes directrices d’évaluation permettront à terme une convergence des appréciations mais cela ne va pas de soi.
M. François GROSDIDIER : Et que se passe-t-il en cas de désaccord ?
M. Martin HIRSCH : La réglementation européenne prévoit une procédure de conciliation, que je n’ai toutefois jamais vue mise en œuvre, si bien que les avis restent divergents et que les gouvernements ne savent pas à quel avis se fier.
M. le Rapporteur : Comment l’autorité européenne est-elle composée ?
M. Martin HIRSCH : Créée il y a deux ans, elle est dotée d’un conseil d’administration et d’équipes scientifiques permanentes. Elle constitue ses comités scientifiques par appels à candidatures, si bien que nous avons parfois des experts communs.
M. le Président : Quand l’autorité européenne aura atteint son régime de croisière, quel sera le rôle des agences nationales ?
M. Martin HIRSCH : Si l’on ne fait rien, leur rôle disparaîtra car le règlement donne compétence à l’agence européenne et celle-ci, spontanément, ne souhaite pas fonctionner en réseau. Sauf si les Etats membres et la Commission décident que l’Autorité assumera désormais un rôle de tête de réseau et de coordination – comme c’est le cas pour l’évaluation des médicaments, pour laquelle on fait appel à un réseau d’experts nationaux –, les évaluations seront uniquement faites à Parme, où l’agence a son siège. Jamais, en effet, les industriels n’enverront spontanément les dossiers de demandes de mises sur le marché à Paris en même temps qu’à Parme ; de ce fait, l’AFSSA ne pourra plus procéder aux évaluations.
M. le Rapporteur : Vos propos s’appliquent-ils aussi aux autres instances nationales chargées des OGM ?
M. Martin HIRSCH : Je ne suis sûr de ma réponse que pour les risques alimentaires.
M. le Président : Je sais que les instances nationales, que le projet de loi propose de regrouper, resteront compétentes pour tout ce qui concerne les expérimentations. Il y a là une nouvelle répartition des rôles qui doit être explicitée et sur laquelle il faudra que nous donnions notre avis.
M. Maxime SCHWARTZ : J’ai accompagné notre directeur général parce qu’avant d’être directeur de la programmation des laboratoires de l’AFSSA, j’ai présidé son comité « Biotechnologies », chargé de préparer les avis relatifs à la mise sur le marché des OGM.
Je compléterai les propos de Martin Hirsch par quelques précisions concernant nos travaux. Ceux-ci sont publiés et je vous ai apporté les actes du colloque de décembre 2001 relatif à l’évaluation des bénéfices potentiels des OGM, ainsi qu’une copie de l’avis rendu par l’agence en janvier 2002, relatif aux possibilités d’évolution de la réglementation en matière d’évaluation des risques. Ses préconisations ont d’ailleurs été reprises par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et figurent désormais au nombre des lignes directrices d’évaluation qu’elle a publiées. Je vous ai également apporté notre récent rapport sur les bénéfices intitulé « OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer des bénéfices pour la santé ? », publié en français, et, tout récemment, en anglais.
M. le Président : Après avoir évalué le rapport bénéfices/risques de certains OGM, l’AFSSA a donc donné un avis favorable à leur mise sur le marché. Estimez-vous que ces organismes présentent un risque pour la santé humaine ? Estimez-vous que c’est le cas pour certains mais pas pour d’autres ? Avez-vous déterminé quel bénéfice sanitaire on peut attendre des OGM autorisés en France ?
M. Maxime SCHWARTZ : S’agissant des risques : si tous les tests d’évaluation de la toxicité et de l’allergénicité ont été faits – et bien faits – et si leurs résultats sont concluants, nous donnons un avis positif à la mise sur le marché. Nous rendons un avis négatif et nous formulons une demande de complément d’information lorsque nous estimons les tests insuffisants pour que nous puissions nous prononcer valablement sur l’absence de dangerosité. Mais il n’y a pas eu de cas qui nous a fait dire : « cet OGM est dangereux, il ne faut pas le mettre sur le marché ». S’agissant des bénéfices potentiels, nous ne portons pas d’avis puisque les dossiers qui nous sont présentés par les semenciers ne sont pas préparés à cette fin, mais seulement pour démontrer l’absence de risque.
On peut faire état de certains bénéfices. Dans le cas des OGM résistant aux insectes, déjà utilisés en Amérique du Nord depuis un certain temps, deux bénéfices sont allégués. Le premier est un bénéfice pour la santé, résultant de ce que leur emploi réduit la nécessité d’utiliser des insecticides et donc l’exposition du consommateur à ces produits. Le second, moins évident, tient à ce que les plantes attaquées par les insectes sont ensuite plus vulnérables aux moisissures qui, elles-mêmes, produisent des mycotoxines toxiques. L’utilisation de ces OGM, en préservant la plante des insectes, aurait pour effet connexe de diminuer la présence de mycotoxines dans ces plantes. Mais si une moindre exposition aux insecticides et aux mycotoxines est un élément positif avéré, dans un certain nombre de cas au moins, il manque la démonstration que, dans les faits, on a bien des bénéfices significatifs. Par exemple, on manque d’éléments concernant l’effet sur la santé humaine des mycotoxines contenues dans les végétaux. Nous souhaitons donc qu’à l’avenir les industriels qui allèguent de tels bénéfices sanitaires en apportent la preuve scientifique.
M. le Président : En somme, vous considérez que l’utilisation des OGM peut produire des bénéfices, mais que cela reste à démontrer par expérimentations en champs…
M. Maxime SCHWARTZ : Oui, vérifier la baisse de production de mycotoxines par les plantes génétiquement modifiées suppose des expérimentations en plein champ.
M. Martin HIRSCH : Encore faut-il qu’au préalable on se soit posé les bonnes questions. Ainsi, lors du colloque de décembre 2001, l’hypothèse avait été émise que l’on résoudrait peut-être le problème de l’obésité par l’utilisation d’OGM – si, par exemple, on parvenait à obtenir des pommes de terre absorbant moins d’huile lors de la friture. Mais les nutritionnistes ont fait valoir qu’une telle démarche ne présentait aucun intérêt car ce trouble devait être résolu tout autrement : par une alimentation diversifiée, par la pratique sportive… En d’autres termes, si le bénéfice attendu est sans intérêt, on peut éviter de s’interroger sur la nécessité d’essais en plein champ. Il en est autrement lorsqu’il est démontré par une évaluation préalable – si possible indépendante de l’industriel promoteur du projet – que l’on peut en tirer un bénéfice réel.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Vous avez donc déjà donné des avis favorables à l’autorisation de mise sur le marché d’OGM, en fonction des résultats de tests établissant leur innocuité. Mais pensez-vous avoir disposé du recul suffisant pour garantir leur absence de dangerosité à moyen ou long terme – deux ans, une génération ? Le doute était perceptible au cours d’autres auditions.
M. Maxime SCHWARTZ : Les essais sont exclusivement conduits sur des animaux puisque, comme vous le savez, la législation interdit les essais cliniques, sauf lorsque l’on recherche un bénéfice déclaré pour la santé humaine. S’agissant de la recherche de risques dans des OGM fabriqués pour des motifs économiques, les essais sur l’homme sont interdits et, à supposer qu’ils soient autorisés, on ne saurait pas ce qu’il faut chercher. Je rappelle en effet que la transgénèse végétale ne crée rien : les gènes utilisés existent déjà dans les organismes vivants auxquels on est exposé et que, très souvent, l’on mange déjà sous d’autres formes. On ne fait donc rien d’extraordinaire et il n’y a pas de raison, a priori, de voir se manifester un effet très dangereux. C’est pourquoi nous appliquons aux OGM les tests de toxicologie classiques. Au début, nous pratiquions les essais de toxicité aiguë pour lesquels il faut injecter une grande quantité de la nouvelle protéine. Maintenant, nous insistons sur la toxicité chronique, en nourrissant des animaux de laboratoire, pendant 90 jours, de la quantité maximale de la nouvelle protéine – par exemple, la toxine résistante aux insectes. Et comme on peut imaginer que l’introduction d’un gène étranger dans le patrimoine génétique d’un végétal peut avoir des effets inattendus – la plante sécrétera peut-être des produits toxiques nouveaux –, nous testons aussi sur les animaux le produit final. C’est le maximum que nous puissions faire et, malgré ces précautions, nous ne pouvons jurer qu’il n’y aura aucun problème à la deuxième génération. Mais chaque innovation technologique fait courir un risque et, à titre personnel, je considère qu’il y aurait eu bien davantage matière à s’inquiéter des effets chimiques qui peuvent résulter du mode de cuisson tout à fait anormal auquel on procède en utilisant des fours à micro-ondes ; pourtant, l’opinion publique ne s’en est pas émue, car elle a vu un bénéfice immédiat à ce nouvel outil.
En conclusion : non, on ne peut pas affirmer qu’il n’y a aucun risque à long terme, mais les raisons de penser que ces produits sont toxiques sont a priori extrêmement faibles, et tous les tests raisonnables sont pratiqués.
M. le Rapporteur : Quel risque peut-on courir, par exemple, en mangeant des produits issus d’animaux ayant été nourris par des OGM ? On sait que le franchissement de la barrière intestinale est malaisé mais l’ADN de ces protéines parvient tout de même dans le sang.
M. Maxime SCHWARTZ : Oui, comme pour tout ce qui se mange. Mais l’ADN, en lui-même, n’aura pas d’effet sur les individus.
M. le Rapporteur : Quel avantage voyez-vous à l’utilisation du « riz doré », enrichi en fer et en vitamine A ?
M. Maxime SCHWARTZ : C’est un des cas analysés dans notre rapport. Cette plante transgénique a été conçue pour pallier une grave carence vitaminique très répandue au sein des populations des pays en développement : on a inséré toute une série de gènes dans une variété de riz pour lui permettre de produire elle-même un précurseur de la vitamine A, qui se transforme en vitamine A proprement dite après l’ingestion. Les industriels concernés et les détracteurs du produit s’opposent sur la réalité du bénéfice sanitaire induit et particulièrement sur le taux de conversion de la provitamine A : on voit bien que le bénéfice sanitaire ne sera pas le même selon qu’il suffit de manger 600 grammes de riz pour obtenir une complémentation intéressante en vitamine A ou s’il est besoin d’en avaler 4,5 kilos par jour… De plus, l’absorption de la vitamine A diffère selon les aliments ingérés, et il n’existe pas d’étude précise à ce sujet pour le « riz doré ». Une troisième incertitude tient à la résistance de la provitamine A à la cuisson et à la conservation.
En conclusion, l’approche mérite d’être tentée mais l’on ne dispose pas de données suffisantes pour établir l’utilité réelle du produit ; donc, à ce jour, il est aussi absurde de dire que l’on va pallier par ce biais les carences en vitamines A que de dire que cela ne sert à rien. De nouvelles études sont nécessaires pour en savoir plus.
M. le Président : Y a-t-il plus ou moins de mycotoxines dans les productions de l’agriculture biologique, qui n’utilise pas de pesticides ? D’autre part, les détracteurs des OGM disent que le fait d’insérer le gène de production d’une toxine dans une plante – par exemple le Bt pour lutter contre la pyrale du maïs – fait que l’homme est amené à consommer beaucoup plus de toxines qu’il ne le ferait en s’alimentant avec des végétaux naturels. Des études ont-elles été conduites sur les effets de cette ingestion plus forte de toxines ? Quel est le rôle de la commission des toxiques en ce domaine ?
M. Maxime SCHWARTZ : De très nombreux auteurs ont démontré une très forte diminution du taux de fumonisines dans le maïs Bt, qui n’est pas attaqué par les insectes. Ces résultats ont été validés pour un certain nombre de toxines mais ne sont pas totalement extensibles. S’agissant des nouvelles toxines, des essais ont été effectués montrant que des doses élevées de toxines ont pu être données au rat, sans dommage. D’ailleurs, comme je vous l’ai dit, l’agence n’aurait pas émis un avis favorable à la demande d’autorisation de mise sur le marché si les études toxicologiques avaient révélé un problème.
M. Martin HIRSCH : La commission des toxiques, que préside le professeur Daniel Marzin, est chargée d’évaluer les problèmes phytosanitaires. Elle n’a pas compétence en cette matière.
M. le Rapporteur : Donc, aucun essai n’est réalisé sur la présence de mycotoxines dans des productions de l’agriculture biologique ?
M. Martin HIRSCH : On commence à avoir des informations sur les mycotoxines. Ainsi, un numéro récent de la revue UFC-Que choisir a fait état de la présence de toxines cancérigènes dans les céréales du petit-déjeuner.
M. Francis DELATTRE : C’est exact. Et beaucoup !
M. Martin HIRSCH : Beaucoup, on ne le sait pas encore précisément, et de nouvelles études seront menées, avec eux, sur ce point.
M. Gérard DUBRAC : Les mycotoxines ont-elles tué beaucoup de monde ?
M. Martin HIRSCH : Certaines mycotoxines sont incontestablement cancérigènes. Je ne connais pas le nombre de cancers qui leur est attribuable.
M. Francis DELATTRE : L’une des difficultés de l’agriculture biologique est bien le problème des mycotoxines. Par exemple, les céréales, attaquées par les insectes, se trouvent ensuite fusariées, c’est-à-dire abîmées. Si elles sont consommées tout de suite, il n’y a pas grand problème, mais il en va tout autrement si l’on décide de les conserver, car ce sont alors des céréales avariées que l’on stocke. Pour moi, l’avantage des OGM est qu’ils permettent de réduire l’emploi d’insecticides et de pesticides ; d’ailleurs, si l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et la Chine s’y mettent, c’est bien qu’ils y trouvent un avantage – celui de faire l’économie des intrants. Nous devons nous intéresser à cette question de très près pour ne pas nous mettre en difficulté. Quand on veut se débarrasser de la pyrale du maïs, on doit épandre des insecticides trois fois dans l’année. Si l’on utilisait des OGM, on éviterait cela et l’on produirait une agriculture plus biologique. La question doit donc être abordée posément, en mettant l’accent, sans dogmatisme, sur le rapport coûts/avantages.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Dans ce cas, on parle d’économie, et non plus de santé !
M. Francis DELATTRE : Mais si !
M. Martin HIRSCH : A chaque mode de production son mode de maîtrise des risques. Ainsi, il serait faux de dire que des rillettes produites industriellement seraient, par essence, plus sûres que des rillettes de grand-mère : tout dépendra de la manière dont les unes et les autres auront été fabriquées et entreposées. Cela vaut autant pour l’agriculture biologique que pour l’agriculture conventionnelle. L’AFSSA utilise maintenant des méthodes d’évaluation des OGM très sophistiquées, au cas par cas, comme elle le ferait pour tout nouveau produit, fruit exotique importé, ou toute autre innovation alimentaire, et il n’y a pas de raison de penser qu’il faudrait en faire plus. Mais nous avons l’honnêteté de dire les limites de cette évaluation, et de ne jamais prétendre pouvoir prédire ce qui se passera dans une ou deux générations.
L’interrogation qui, à mon sens, suscite trop peu de réflexion est celle relative aux conséquences de la diffusion très rapide et à très grande échelle d’une innovation, quelle qu’elle soit, OGM ou non. Prenons l’exemple de l’huître triploïde : s’il n’y a plus d’huître que celle-là, et si un virus l’attaque, le risque est très élevé que le cheptel disparaisse. De même, s’il apparaît soudain que le patrimoine génétique du taureau Jupiter, qui a eu 150 000 descendants, présente une anomalie génétique, la diffusion de cette anomalie sera très rapide et très large. On évalue mal les effets de l’uniformisation des produits alimentaires. La nouveauté, ce n’est pas la technique diététique, c’est la rapidité et l’ampleur de la diffusion des innovations, et il faudrait s’interroger davantage sur le rythme de franchissement des étapes depuis la découverte en laboratoire. Une anomalie sur un produit diffusé à un cinquième de la population mondiale pourrait entraîner d’importants déséquilibres.
M. le Président : De multiples études bénéfices/risques ont été conduites partout dans le monde mais, exception faite du coton, pour lequel il est établi que l’emploi d’OGM diminue effectivement la quantité d’insecticides utilisés, on n’a toujours pas de réponse claire sur le point de savoir si la culture d’autres plantes génétiquement modifiées induit une moindre utilisation de pesticides. Comment expliquer cela ?
M. Maxime SCHWARTZ : Les études américaines portant sur le coton Bt ont montré qu’il entraîne une forte diminution de l’utilisation de pesticides. La différence est beaucoup plus marginale pour le maïs Bt, parce que les agriculteurs américains utilisent peu de pesticides pour traiter le maïs ; mais ce n’est pas forcément le cas ailleurs.
M. Martin HIRSCH : Je rappelle que l’on est incapable de connaître le tonnage de pesticides utilisé en France, sauf à convaincre les fabricants de nous communiquer le volume de leurs ventes : quatre ans après la décision de le créer, l’Observatoire des résidus de pesticides n’existe toujours pas, faute de texte, faute de moyens, mais pas faute de groupes de pression… ce qui est absolument anormal. De surcroît, les produits phytosanitaires étant toujours plus puissants, on ne pourrait déterminer avec certitude si un tonnage moindre au fil des ans ne s’explique pas par la puissance décuplée des produits utilisés. En bref, s’agissant des produits phytosanitaires, dont on dit pourtant qu’ils peuvent présenter un risque sanitaire pour les exploitants agricoles, pour les consommateurs et pour les salariés des fabricants, on ne sait ni d’où l’on part ni où l’on va, faute d’outils de mesures et de données… C’est à se demander si les enseignements d’un certain passé ont été tirés.
M. le Président : A supposer que les conditions de culture idéales soient réunies, entre l’utilisation de pesticides et des OGM, que choisiriez-vous ?
M. Maxime SCHWARTZ : A titre personnel, je choisirais les OGM, car je tiens pour hautement probable que l’exposition aux pesticides n’est pas très bonne pour l’homme et pour l’environnement alors qu’en revanche, de ce que je connais, je ne vois pas d’arguments démontrant un risque induit par les OGM. C’est pourquoi je préférerais manger des OGM que des produits traités par pesticides.
M. Francis DELATTRE : Ah ! Je ne suis plus tout seul !
M. Martin HIRSCH : Je pense que ce sera fromage et dessert ! Je crains, en effet, que ce choix-là ne nous soit pas offert. Si, pour rendre un végétal résistant à tout, il faut insérer 25 gènes différents dans son patrimoine génétique, on obtiendra des résistances croisées. Il faudra, de toute façon, continuer d’utiliser, aussi, des produits phytosanitaires.
M. Louis GUÉDON : Quels sont les effets du métabolisme de dégradation des OGM ingérés ?
M. Maxime SCHWARTZ : Les protéines insérées dans les plantes transgéniques sont identiques aux autres, elles n’ont pas de propriétés particulières et se dégradent comme les autres.
M. Louis GUÉDON : Leur ingestion ne présente donc pas de risques pour l’être humain ?
M. Maxime SCHWARTZ : Nous n’avons pas mis en évidence de risques pour la santé animale. Mais, a priori, ce ne sont pas des protéines à risque.
M. Louis GUÉDON : Qu’advient-il si ces protéines passent la barrière intestinale ?
M. Maxime SCHWARTZ : Très peu de protéines passent la barrière intestinale. Dans les organismes animaux, ces protéines sont détruites comme les autres. Le risque est donc a priori très faible, et tout est fait pour mesurer s’il existe ou non.
M. le Président : Le prion n’est-il pas une protéine ? Or, le prion est passé…
M. Maxime SCHWARTZ : Il ne passe pas forcément : il a pour effet de modifier la conformation des cellules intestinales.
M. Martin HIRSCH : La crise due au prion a montré la difficulté de mettre au point un système de surveillance efficace pour un risque nouveau car, pour chaque cas d’ESB détecté chez l’animal, on passait à côté de milliers d’autres cas, faute de système de surveillance…Cela incite à quelque modestie et surtout à se féliciter que la barrière d’espèce soit un peu élevée. On estime en effet à quelque 30 000 le nombre de bovins infectés, qui sont passés dans la chaîne alimentaire à l’époque où la détection n’était pas faite, et peu de nos concitoyens semblent avoir été infectés.
M. le Rapporteur : Les Américains ont-ils admis le principe de l’utilisation des OGM une fois pour toutes, ou des avis sont-ils toujours obligatoires préalablement à la mise d’une nouvelle protéine sur le marché ?
M. Martin HIRSCH : Les OGM pouvant être mis sur le marché aux Etats-Unis sans le feu vert de la FDA6, ils n’ont pas tous été évalués au préalable.
M. Francis DELATTRE : Et les Américains en mangent depuis neuf ou dix ans !
M. le Président : De nombreux OGM sont déjà utilisés de par le monde, pour la plupart dans l’alimentation des animaux. Dans quels types d’aliments destinés à l’homme en trouve-t-on, et où ? Et ces produits, qui devraient alors être étiquetés, conformément à la réglementation européenne, sont-ils importés en France ?
M. Martin HIRSCH : S’agissant de l’étiquetage, je suis persuadé que le seuil de 0,9 % ne tiendra pas longtemps, car on s’aperçoit déjà qu’on est incapable de le vérifier matrice alimentaire par matrice alimentaire. Aussi est-il très probable que dans un, deux ou trois ans, on s’apercevra que les aliments en contiennent, en fait, 1,5 %, 2 % ou 3 %... A ce moment-là, il est possible que l’on crie au scandale et que l’on demande de redescendre au seuil de 0,9 %. Mais les fabricants expliqueront que cela coûtera une fortune, parce qu’il faut séparer les filières, laisseront entendre que les consommateurs n’accepteront jamais une hausse des prix de grande ampleur… et l’on acceptera que le seuil passe à 3 %, en expliquant : « Vous en avez mangé et vous n’en êtes pas morts »… Cette fiction a de grande chance de se réaliser : il faut avoir conscience que c’est le seuil qui fait franchir la porte.
M. Maxime SCHWARTZ : Pour ce qui est de l’alimentation humaine, le maïs génétiquement modifié a été formellement accepté par l’Union européenne, mais il y a aussi des OGM dans l’huile de colza, le soja et les amidons.
M. le Président : Mais les fabricants n’en veulent pas pour l’alimentation humaine ?
M. Maxime SCHWARTZ : Ils n’en veulent pas en France, en raison des réactions que cela suscite. Mais, aux Etats-Unis, on en mange ! Si l’on s’en tient au rapport risque/bénéfice, il faut dire à la fois qu’aucun problème de santé n’a pu, jusqu’à présent, être attribué à la consommation d’OGM, et que l’on ne sait pas quels risques chercher, puisqu’ils sont, à ce jour, totalement hypothétiques. On est donc dans le domaine de la précaution. En revanche, la recherche des bénéfices éventuels est plus facile et on pourrait essayer de faire une évaluation quantitative des bénéfices.
M. le Président : Messieurs, je vous remercie et je propose que l’AFSSA soit représentée à l’une des tables rondes contradictoires que nous avons prévu d’organiser dans le cadre de nos travaux.
Audition de Mme Marion GUILLOU,
présidente de l’Institut national de recherche agronomique (INRA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Nous remercions Mme Marion Guillou d’être venue, accompagnée de M. Guy Riba et de M. Patrick Flammarion, devant la mission d'information sur les conséquences environnementales et sanitaires des autorisations d'essais d'organismes génétiquement modifiés. Je précise que notre champ d’investigation sera peut-être prochainement élargi, comme nous l’avons suggéré hier au Président de l’Assemblée nationale, aux conséquences économiques et juridiques des essais et de l’utilisation des OGM.
Ces premières « auditions privées » ont pour but de nous aider à nous approprier le sujet en entendant toute une série de responsables d’institutions et d’organismes ; c’est ce titre que nous vous avons demandé, Mme la présidente, de venir répondre à nos questions.
Mme Marion GUILLOU : Les organismes génétiquement modifiés répondent à une définition réglementaire très précise, fruit de longues négociations au niveau communautaire. Les OGM sont d’abord pour nous un outil de recherche. Nos laboratoires les utilisent très largement pour comprendre la fonction des gènes en les éteignant ou, à l’inverse, en les surexprimant afin de découvrir quel gène ou quel ensemble de gènes est à l’origine de telle fonction dans un environnement donné. Toutes ces manipulations aboutissent à la création de plantes, de microbes et parfois même d’animaux expérimentaux.
Cela se traduit par de très nombreux essais d’abord en laboratoire, après autorisation du ministère de la recherche sur avis de la commission du génie génétique, à laquelle les chercheurs adressent les demandes d’autorisation. Pour les plantes, si la dimension de l’essai s’élargit, nous passons aux essais en serres, de taille croissante. Enfin, dans quelques cas, peu nombreux mais parfois utiles, nous passons aux essais en champ.
Nous défendons la possibilité d’expérimenter en champ les plantes génétiquement modifiées, dans le respect du principe de parcimonie, autrement dit, sous réserve d’avoir préalablement déterminé les effets prévisibles en laboratoire et en serre, les questions à explorer et les précautions à prendre. C’est ce que nous avons fait pour le projet d’essai en champ du plant de vigne génétiquement modifié qui, finalement, ne nous a pas été autorisé, mais qui se présentait sous la forme de cinquante bois de vigne génétiquement modifiés au milieu de 1 500 pieds non génétiquement modifiés. Les conditions scientifiques arrêtées par les chercheurs avaient été renforcées par une série de précautions très strictes, à la demande du voisinage, entendu dans le cadre d’un comité de suivi local. Autrement dit, tout en étant prêts à répondre aux légitimes inquiétudes de la société, nous devons rester en mesure de procéder à des essais en champ, faute de quoi nous serons incapables de nous prononcer dans des enceintes internationales sur l’intérêt et les conditions des expérimentations et autorisations d’OGM. Interdire les essais en champ des OGM en France revient à donner le monopole de la connaissance à d’autres, qui sont loin de se les interdire – on compte plus de 65 millions d’hectares d’OGM dans le monde ! – et à nous priver de toute capacité d’expertise sur le plan international. Or il est du rôle d’un organisme public de recherche d’appuyer les pouvoirs publics et de leur donner les moyens de participer aux discussions internationales.
L’INRA applique très scrupuleusement le principe de parcimonie : nous n’avons actuellement qu’un seul essai en plein champ – en fait deux, mais sur la même espèce et au même endroit – sur peuplier à Orléans, en terre depuis une dizaine d’années. Il faut du temps pour voir les propriétés d’un arbre s’exprimer… Ce peuplier a été génétiquement modifié afin de faciliter l’extraction de la lignine et de réduire l’utilisation de produits chimiques dans le processus de transformation du bois en pâte à papier.
Je voudrais insister sur le fait que les OGM – plantes, microbes ou animaux pour ce qui concerne l’INRA – sont un outil de recherche extrêmement courant dans nombre de laboratoires pour des expérimentations à finalité agronomique ou médicale, mais également pour des travaux de recherche fondamentale. En serres ou en animaleries, les essais, moins nombreux, sont également soumis à autorisation. En champ, ils sont très peu fréquents, mais il est indispensable de les maintenir dans des cas très particuliers et pour répondre à des questions bien précises.
Les OGM jouent également un rôle évident dans l’innovation. Une innovation peut être définie comme un objet social dont l’existence suppose une autorisation et dont le but final est la mise en marché.
L’autorisation est un processus en plusieurs phases, dont la première est la phase d’évaluation préalable des risques alimentaires – qui relève de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) – et environnementaux – laquelle relève de la Commission du génie biomoléculaire. Vient alors la phase de la décision éventuelle, prise à l’échelon national s’il s’agit d’un essai, à l’échelon communautaire dans le cas d’une mise sur le marché. Une fois la décision acquise, les OGM doivent répondre à une troisième exigence spécifique : ils sont soumis à un suivi de biovigilance dont le but est d’observer les éventuels phénomènes survenant lors de la culture et qui n’auraient pas été anticipés au moment des phases d’évaluation et d’autorisation. Se pose enfin la question, qui ne concerne en rien l’INRA, de savoir si le marché est ou non demandeur de l’OGM en question.
L’INRA est appelé à intervenir à plusieurs titres, ne serait-ce qu’en tant qu’employeur de chercheurs : un tiers des experts individuels mobilisés par l’AFSSA sont des scientifiques de l’INRA. Nos chercheurs participent très largement à nombre d’organismes, commissions et comités d’évaluation nationaux, européens et internationaux, dans lesquels on s’attache à respecter les trois principes de l’expertise, laquelle doit être pluridisciplinaire, contradictoire et transparente.
Nos chercheurs, dans le cadre de ces instances, et non l’Institut en tant que tel, participent ainsi largement à l’évaluation des risques, par le biais d’études au cas par cas portant sur les risques environnementaux et alimentaires. Mais il paraît de plus en plus difficile de procéder à une évaluation digne de ce nom – quel que soit son objet, du reste, OGM, médicament ou produit phytosanitaire – en ne regardant que la partie risques et non la partie bénéfices. Un risque en soi, si minime soit-il, ne sera jamais accepté si le produit évalué ne fait pas apparaître un bénéfice avéré. Il serait utile d’indiquer explicitement, dans le dispositif communautaire, comme dans le dispositif national, que l’évaluation doit réellement porter sur le couple « risque/bénéfice », c’est-à-dire apprécier le risque comparé avec le bénéfice avéré de l’objet évalué.
L’approche systémique ne doit pas non plus être ignorée. Il faut se demander quelles conséquences entraînera, dans un système de culture donné, l’introduction d’une plante génétiquement modifiée, non pas en tant que telle, mais au regard du système de culture considéré et des surfaces plantées – en termes, par exemple, de résistance ou de tolérance ? Ainsi, une plantation génétiquement modifiée à 100 % pour résister à la pyrale n’induira-t-elle pas de nouvelles résistances chez le ravageur ? Ne faut-il pas, dès le stade de l’autorisation, prévoir des recommandations et des limites de mise en culture ?
Parallèlement à ce rôle d’évaluation, l’INRA conduit bon nombre de travaux de recherche visant à mettre au point des méthodes de sélection ou à améliorer la connaissance des gènes et de leur expression – ce que l’on appelle la génomique et la post-génomique. Nous travaillons en ce moment sur des alternatives aux techniques de génie génétique afin que la France ne soit pas totalement dépassée dans ce domaine. Nos équipes de sociologues s’attachent également à étudier les demandes et les réactions de notre société à ces innovations radicales. Nous avons, par exemple, conduit une étude sociologique de ce genre à propos du porte-greffe de vigne résistant au court noué, afin de répondre aux préoccupations, exprimées par un groupe ouvert, en entourant la mise en place de l’expérimentation en cause des précautions adéquates.
Enfin, nos économistes mènent des recherches sur les structures des entreprises, sur le droit de la propriété intellectuelle et ses différentes pratiques, sur la circulation de la connaissance ou encore sur la répartition de la plus-value dans les filières, sans oublier d’autres études sur l’environnement et l’agronomie – flux de gènes entre cultures, architecture d’implantation des cultures et effet sur les transferts de gène – qui ne sont pas limitées aux seuls OGM. Les résultats de toutes ces expériences sont à votre disposition. Précisons que ces travaux sont souvent menés à l’échelon communautaire.
Il est à noter qu’un de nos chercheurs participe au réseau européen chargé de mettre au point des méthodes de détection des OGM dans les différents supports et coordonne le réseau français correspondant. Nous vous communiquerons les coordonnées des équipes concernées qui pourront venir devant vous ou vous remettre une contribution écrite.
Comme tout sujet scientifique, mais celui-là est particulièrement révélateur, les OGM sont sources de tensions à reconnaître et à instruire.
Première tension : entre le public et le privé. L’INRA, organisme public de recherche, a entre autres missions celle de l’appui à l’expertise publique, mais également celle de contribuer à l’innovation par le biais de contrats de recherche avec des opérateurs industriels et professionnels. Comment concilier la participation à l’expertise publique et les contrats avec des entreprises privées ? Précisons que bon nombre de semenciers français sont sous statut coopératif, comme c’est le cas de Limagrain, par exemple.
Lorsqu’on est membre d’une communauté de 11 000 personnes, il n’est pas surprenant d’avoir deux métiers. Reste à organiser cette cohabitation, à l’expliciter, à en reconnaître les contraintes et les difficultés afin d’éviter les conflits d’intérêts et les contestations.
Deuxième tension : entre l’expert et le demandeur. Nos spécialistes participent aux comités d’expertise et d’évaluation ; or il peut arriver que les mêmes, ou plus souvent leurs collègues, sollicitent des autorisations d’expérimentation en laboratoire, en serre ou en champ… Cette contradiction existe dans tous les domaines, mais les OGM, du fait de leur caractère paroxystique, la mettent d’autant plus en lumière.
Troisième tension : sur la répartition des moyens. Comment arbitrer de manière à peu près équilibrée entre la « biologie moderne à haut débit » la génomique, la post-génomique, très coûteuses et la biologie classique, les sciences intégratives et la physiologie ? Nous avons choisi de continuer dans les deux voies, ce qui suppose une grande exigence dans les choix.
Dernière tension : entre les différents types d’agriculture. Agriculture biologique : lutte intégrée, agriculture raisonnée ; agriculture classique : autant de modèles techniques, économiques, sociaux différents sur lesquels un institut de recherche agronomique se doit de travailler.
Toutes ces tensions se retrouvent pour chaque innovation, mais elles s’expriment de manière exacerbée avec les OGM. Elles exigent de notre part un effort de précaution sur le plan déontologique comme sur celui de notre organisation interne. A cette fin, toute une série de processus ont été mis en place, ou sont en passe de l’être, par l’INRA.
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a déjà eu l’occasion de débattre de la propriété intellectuelle, des brevets, des certificats d’obtention végétale, des limites et des avantages des brevets dans le domaine des biotechnologies, autant de sujets qui, dès lors que l’on parle du vivant, exigent une explicitation a priori. Le droit est finalement venu rejoindre la position défendue par l’INRA, qui s’était interdit de breveter des séquences brutes de gènes, considérant que le seul fait de réussir à les lire n’était pas un acte d’invention. Les offices de brevets ont finalement fait marche arrière et nous avons pu expliciter nos positions en la matière (limites de l’utilisation des brevets et autres systèmes de protection, politique de licence et de diffusion…). A noter que, dans le programme Génoplante, nos partenaires professionnels ont accepté sans trop de difficultés le principe de licences gratuites ou à prix très avantageux pour les agricultures dites pauvres. Nous avons bien entendu prévu une série de critères propres à éviter les détournements et notamment une définition des agricultures pauvres, grâce au concours du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD). Une charte de la propriété intellectuelle a pu ainsi être adoptée, fruit d’un long travail commencé au niveau de notre comité d’éthique, puis dans le cadre du conseil scientifique et au sein de l’institut lui-même, jusqu’à son adoption par le conseil d’administration il y a un an.
Dans le même esprit, l’élaboration d’une charte de partenariat est en cours. Le but est de savoir comment choisir ses interlocuteurs, selon quelles modalités de financement, avec quel partage des résultats, etc. Là encore, ce long processus d’explicitation, sur des questions peu évidentes, a commencé par un avis du comité d’éthique.
Une réflexion sur l’expertise a été également lancée. Nos experts, à titre individuel, étaient évidemment tenus au respect des règles déontologiques des agences dans lesquelles ils sont amenés à travailler. La question restait posée au niveau de l’institut lui-même, qui peut tout à la fois être demandeur d’autorisation et partie prenante à l’expertise.
Notre comité d’éthique s’est également penché sur les questions que les plantes génétiquement modifiées pouvaient poser à un organisme de recherche tel que l’INRA par la rupture qu’ils introduisaient, par leurs effets intrinsèques et extrinsèques, attendus et non attendus, connus et non connu, évalués a priori ou non, etc. Le Comité d’éthique et de précaution pour les applications de la recherche agronomique (COMEPRA) a finalement conclu, dans ses recommandations à l’institut, que nous devions poursuivre des recherches sur les OGM, mais à condition d’en arrêter précisément les thèmes et les objectifs. Rappelons que ce comité d’éthique est composé de personnalités externes à l’INRA, philosophes, économistes et autres, qui ont produit en deux ans sur le sujet un travail très original et approfondi.
M. le Président : Certains d’entre nous en ont eu connaissance, mais il serait bon de le faire connaître à tous nos collègues.
Mme Marion GUILLOU : Bien volontiers. Le texte n’est pas toujours facile à lire, mais c’est une approche des OGM très novatrice, ni pour ni contre, qui s’attache à montrer à quel point cette innovation impose de nouvelles démarches, et à proposer des pistes originales.
L’arbitrage sur la répartition des moyens financiers, évoquée plus haut, s’appuie souvent sur la réflexion conduite par notre conseil scientifique. La question des différents types d’agriculture relève plutôt de la compétence de notre conseil d’administration.
Le contenu de la charte de propriété intellectuelle de l’INRA est évidemment public. Tous ces documents sont consultables sur Internet. Je vous recommande en particulier de lire attentivement l’avis du comité d’éthique et de précaution de l’INRA sur les OGM, que nous avons rendu public le 21 octobre dernier. Diffusez-le, discutez-en et faites-en le meilleur usage. Je rappelle que c’est un avis totalement indépendant, qui a même choqué plusieurs de nos scientifiques. Nous tiendrons sur ce sujet un colloque interne associant toutes nos instances – comité technique paritaire, conseil scientifique, conseil d’administration et chercheurs – le 9 décembre prochain. Cette discussion sera le point de départ d’un travail qui se conclura d’ici à quelques mois par une décision du conseil d’administration sur ce que fera l’INRA dans le domaine des OGM et dans celui des techniques alternatives au génie génétique.
M. le Président : Vous nous avez parlé des travaux de l’INRA sur les plantes transgéniques mais pas des autres secteurs d’expérimentation. L’INRA travaille-t-il sur les animaux transgéniques, sur les micro-organismes génétiquement modifiés, et dans quels secteurs ?
Vous avez, tout en insistant sur le respect du principe de parcimonie, défendu avec une certaine solennité la nécessité pour la recherche de mener, après les essais en laboratoire et en serre, des expérimentations en plein champ. Or nous avons entendu dire hier que la plupart des demandes d’autorisations déposées auprès de la CGB ne concernaient pas des expérimentations, mais bien des essais de développement pour le compte d’entreprises. Partagez-vous cet avis ?
Enfin, votre essai en plein champ détruit en Ariège visait précisément à étudier les effets de la transgénèse sur l’environnement. Pourquoi ne l’avez-vous pas repris ?
Mme Marion GUILLOU : Guy Riba, qui vient d’être nommé directeur général délégué de l’INRA, n’a pas pour autant oublié tout ce qu’il sait sur les plantes… Il complétera mes propos.
Je me suis effectivement laissé entraîner en ne vous parlant que des plantes… Nous menons effectivement des recherches en laboratoire sur les microbes et les animaux, qu’il s’agisse des techniques de transgénèse sur les oiseaux et les poissons, de mise au point d’animaux transgéniques à des fins de recherche fondamentale en physiologie et physiopathologie, de la « souris rapide » – génétiquement modifiée pour servir de test aux prions ovin, bovin et humain –, des animaux génétiquement modifiés servant de modèles pour les recherches sur les maladies humaines – surdité, mucoviscidose, artériosclérose, fertilité – ou encore de la production, par le biais du lait, de protéines d’intérêt médical ou vétérinaire, de l’éventuelle transplantation d’organes – à la demande de l’INSERM – ou des études sur les résistances à certaines maladies essentielles dans le secteur de l’élevage. Nous pouvons vous transmettre une liste détaillant les expériences, les animaux et les objectifs. Cela dit, il n’est pas question, pour l’instant, que ces animaux aillent ailleurs que dans le laboratoire… Précisons que, souvent, ces laboratoires n’appartiennent pas à l’INRA, mais à des sociétés de biotechnologie auxquelles nous avons cédé la licence du procédé en question.
Nous menons également des travaux sur des microbes génétiquement modifiés, soit pour en comprendre le fonctionnement, soit pour leur conférer une propriété particulière.
M. le Président : Pourrions-nous avoir la liste complète de toutes ces manipulations et de leurs objectifs ? Il n’y a plus qu’un seul essai en champ sur le peuplier et on ne parle que de cela… Il serait bon de les faire figurer en annexe de notre rapport.
Mme Marion GUILLOU : En tant que présidente d’un organisme publique de recherche, je crois indispensable de préserver la possibilité en France de réaliser des essais en champ. L’INRA n’en a plus qu’un, ou plus exactement deux, puisqu’il y a deux objectifs de recherche sur la même espèce et sur des parcelles adjacentes, à Orléans. Le jour où les organismes publics français de recherche n’auront plus le droit de faire des essais en champ, il ne sera plus question d’ouvrir la bouche dans les instances internationales… Notre crédibilité sera proportionnelle au nombre d’essais pratiqués ! Ce serait grave pour la voix de la France.
M. Guy RIBA : D’ores et déjà, sans même être interdits d’essais en champ, nos chercheurs ne sont guère enclins à en faire… Pourquoi n’avoir pas remis en place l’essai de colza détruit dans l’Ariège ? Tout simplement parce que nos chercheurs ne le veulent pas. Parce que ceux-là mêmes qui l’ont détruit étaient ceux qui avaient soulevé la question des OGM en 1995. A cette époque, ils nous avaient aidés en nous obligeant à nous poser des questions qui jusqu’alors ne nous paraissaient pas prioritaires. Entre 1996 et 2000, la contestation des OGM a joué un rôle moteur et mobilisateur : on a compté jusqu’à 150 essais d’OGM en France. C’est alors que ceux-là mêmes qui nous avaient posé les questions se sont mis à nous empêcher d’y répondre en détruisant les champs et les essais de modélisation ! Pour étudier, par exemple, les flux de pollinisation et de contamination dans les maïs, il suffit d’utiliser des maïs bleus, qui existent naturellement. Mais dans d’autres cas, on a besoin d’OGM.
Le cas de la vigne de Colmar est particulièrement révélateur. Jamais essai n’avait été si soigneusement préparé et concerté. Que pouvait-on faire de plus pour éviter tout risque ? Il s’agissait d’un porte-greffe, c’est-à-dire d’une plante sans feuilles, sans fleurs, sans pollen, cultivée sur une surface pas plus grande que la moitié de cette salle, bâchée de surcroît ! Non seulement tout a été arrêté, mais nous nous retrouvons définitivement sans possibilité de recommencer. Le résultat est que cet essai n’aura plus jamais lieu en Europe, et que le chercheur qui le dirigeait a trouvé un poste de professeur à l’université de Cornell et ira refaire l’essai aux Etats-Unis !
Pour le colza, nous avions besoin d’espace et de temps à un certain stade de notre expérimentation. Il s’agissait, en l’occurrence, de vérifier s’il s’hybridait avec des crucifères sauvages. Nous avons découvert en serre que c’était le cas. Restait à déterminer l’ampleur que pourrait prendre le phénomène dans la nature. En attendant, le comité de biovigilance ne peut se référer qu’à des essais de très petite taille pour répondre à des questions tout à fait pertinentes, mais qui exigeraient des essais à plus grande échelle. On est en train de rendre le système de recherche complètement absurde.
Etre pour les essais ne veut pas dire que l’on est pour la culture des OGM. Il faut séparer le débat sur les cultures et le débat sur les essais. Les essais, parce qu’ils servent à produire des connaissances, sont un bien public. Il serait, du reste, utile d’exiger que tous les résultats soient rendus publics, ce qui n’est pas le cas actuellement. Mais en les interdisant, on franchit la ligne jaune.
M. le Président : A-t-on pu mesurer les conséquences de cette situation sur le nombre de jeunes qui choisissent les filières de biologie végétale et de chercheurs qui s’engagent dans ces filières à l’INRA ou dans les universités ?
Mme Marion GUILLOU : La corrélation n’est pas évidente et supposerait des entretiens approfondis. A croire un rapport de l’Académie des Sciences, le nombre de bacheliers scientifiques continuerait globalement à augmenter. Celui des inscriptions en filières courtes
– IUT, BTS – s’accroît régulièrement, celui des classes préparatoires en grandes écoles reste constant, mais celui des inscriptions en facs de science a chuté de 24 %, alors qu’il est en pleine croissance pour les filières économiques et commerciales… Cela répond seulement pour partie à votre question.
M. Pierre COHEN : Ce n’est pas aussi évident…
Mme Marion GUILLOU : En effet, et c’est pourquoi je n’en dis pas plus. Les paramètres sont très nombreux. Le nombre des inscriptions en biologie végétale serait aussi un élément objectif. Il serait en diminution. Mais il faudrait interroger les étudiants pour savoir pourquoi ils n’ont pas choisi cette filière. Reste que, du fait de la violence ambiante, des arrachages, des menaces sur les personnes, etc., nos chercheurs se détournent du génie génétique. Rares sont à l’INRA les chercheurs végétalistes disposés à travailler sur les OGM ! C’est compréhensible : nos scientifiques sont poussés par le plaisir intellectuel, le désir d’être utile au développement et à la diffusion des connaissances, ce ne sont pas des combattants… Bon nombre de nos seniors ont préféré abandonner.
M. Guy RIBA : Du côté des scientifiques, la corrélation n’est effectivement pas évidente. Mais du côté du secteur privé, c’est parfaitement clair : pratiquement toutes les entreprises ont préféré s’installer ailleurs. Pour être parfaitement honnête, le phénomène n’est pas propre à la France : il sévit avec la même intensité en Angleterre, par exemple. Les entreprises semencières françaises et anglaises ont toutes, sans exception, mis en place des unités expérimentales et des laboratoires de recherche aux Etats-Unis. Le débat autour des OGM a clairement mis un point d’arrêt au développement de la recherche privée dans ce domaine.
M. le Rapporteur : Vos propos sont très intéressants. Nous avons eu durant un temps l’impression que les Français étaient pratiquement tous anti-OGM, faute de voir les pro-OGM et les chercheurs s’exprimer sur le sujet… Est-ce vous qui vous êtes mal exprimés, ou bien les médias ont-ils insuffisamment rapporté vos positions ?
M. Guy RIBA : Depuis le temps que l’on nous reproche de mal communiquer, je ne sais plus ce qu’il faut dire ni comment le dire ! Nous sommes désavantagés par un déséquilibre sémantique évident : lorsqu’on est contre quelque chose, il suffit d’un quart de seconde pour dire non. Mais comment expliquer, non pas que l’on est pour à 100 %, mais que c’est compliqué, parfois oui, parfois non, que la problématique des essais est différente de la problématique des cultures, etc., durant les dix secondes qu’on vous accorde au journal télévisé ?
Mme Marion GUILLOU : Après la destruction des caféiers du CIRAD en Guyane, nous avons publié un communiqué de presse avec le CIRAD, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Centre national de recherche scientifique (CNRS). En avez-vous entendu parler ? Non. Ou bien nous sommes mauvais, ou bien nous ne sommes pas repris…
M. le Rapporteur : Y aurait-il un manque d’objectivité dans les médias ?
Mme Marion GUILLOU : Pas à proprement parler. Disons que ce n’est pas assez spectaculaire…
M. Louis GUÉDON : Vous ne créez pas l’événement…
M. Guy RIBA : Exactement. Sauf le jour où les chercheurs descendent dans la rue.
M. le Rapporteur : Est-il arrivé qu’un essai de l’INRA n’ait pas été autorisé par la Commission de génie biomoléculaire ?
M. Guy RIBA : Cela nous est arrivé pour un prunier résistant à la sharka. Nous avions trouvé, en cherchant dans nos ressources génétiques – la France a une politique remarquable dans ce domaine – des variétés ancestrales résistantes pour l’abricotier, mais pas pour le prunier. Faute de pouvoir trouver un produit capable de détruire le virus, nous n’avions pas d’autre solution que de mettre au point un prunier transgénique, en collaboration avec les Américains. Mais la CGB a refusé notre demande d’autorisation d’essai en champ – non sans raison, d’ailleurs, puisque nous avions nous-mêmes démontré la difficulté à limiter le flux du pollen. L’INRA a aussitôt dénoncé sa contribution aux programmes européens dans lesquels il était partie prenante et en a prévenu tous ses partenaires, notamment d’Europe de l’Est. Aucun essai n’a donc été conduit en France, ni en Pologne, ni en Hongrie. Aux Etats-Unis, en revanche, la variété est d’ores et déjà brevetée…
Nous analysons également la pertinence de nos propres essais, et ce dès le stade du laboratoire, au vu de critères économiques, environnementaux et agronomiques. Ainsi, nous avons stoppé les essais sur une variété de pomme de terre transgénique mise au point par une de nos équipes en Bretagne : elle était résistante, mais à un seul virus, de sorte que l’agriculteur était toujours obligé de traiter ses pommes de terre contre les pucerons, vecteurs de propagation des autres virus. La variété transgénique n’apportait donc aucun progrès. Nous avons fait de même pour les recherches sur un colza capable de produire de l’acide palmitique, estimant qu’un organisme public n’avait pas à s’impliquer dans une recherche qui, outre son caractère non prioritaire, serait contraire aux intérêts des pays en voie de développement, où l’huile de palme constitue une source de revenus très importante.
M. le Rapporteur : Avez-vous élaboré un cahier des charges indiquant notamment les distances à respecter entre les cultures ?
Mme Marion GUILLOU : La CGB a publié des normes très précises sur les distances d’isolement, directement tirées des travaux des organismes de recherche. Elle impose de surcroît la mise en place de plants non génétiquement modifiés autour des plantations génétiquement modifiées, afin qu’ils jouent le rôle de pièges à pollen : c’est ce que nous avions prévu pour notre essai de vigne, qui nous a été finalement refusé. Pour chaque essai, les conditions agronomiques à respecter dépendent totalement des taux de croisement tolérables pour les cultures voisines.
M. Guy RIBA : Les normes d’isolement mises en place pour un essai sont particulièrement drastiques et il ne tient qu’à vous d’ailleurs d’être encore plus exigeants sur l’évaluation des informations. Il faut donc continuer dans ce sens pour réduire les risques au maximum mais il ne faudrait pas en conclure qu’il sera facile d’isoler une production commerciale. Ce sera possible car les agriculteurs sont déjà capables de produire des variétés différentes en garantissant un taux minimum de mélange. Mais il s’agit alors de productions d’excellente qualité et à très haute valeur ajoutée. Autrement dit, les agriculteurs acceptent la contrainte parce qu’ils y trouvent un intérêt direct lié à la plus-value de la production. Mais qu’en sera-t-il avec les OGM ? Ces conditions de culture ont un coût. De celui qui veut produire des OGM et de celui qui n’en veut pas, qui acceptera la contrainte ? Techniquement, c’est possible mais économiquement, ce sera plus difficile…
M. le Rapporteur : Les séquences génétiques sont-elles toujours brevetées aux Etats-Unis ?
Mme Marion GUILLOU : Leur jurisprudence serait, paraît-il, en train d’évoluer. Vous devriez poser la question à l’Office européen des brevets ou à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). L’Office européen est déjà revenu en arrière et les autres pays du monde commencent à changer leur pratique.
M. Guy RIBA : On peut breveter une séquence dont on a démontré une fonction que l’on revendique pour une application. Si vous avez la même séquence et la même fonction, mais pour une autre application, tant mieux pour vous…
Mme Marion GUILLOU : C’est le principe que l’INRA s’est imposé, mais pas celui retenu par l’Office européen des brevets, qui retient le principe d’une séquence et d’une fonction utilisables dans toutes les applications. Nous ne nous sommes imposé que le triptyque séquence(s) – fonction – application.
M. Guy RIBA : Il faut combattre le droit de dominance, trop fortement reconnu, notamment en droit américain.
M. le Président : Vous dites que l’essai de vigne viro-résistante vous a été refusé, alors qu’on nous a pourtant dit que le ministre de l’agriculture n’avait pas encore pris de décision…
Mme Marion GUILLOU : Sa lettre date du 22 novembre. L’essai n’a pas été interdit mais, très précisément, il n’a pas été « accepté », ce qui nous interdit effectivement de le faire puisque nos essais sont soumis à autorisation expresse.
M. le Président : Il s’agissait bien des porte-greffe que vous évoquiez tout à l’heure : cinquante plants entourés de plants non modifiés, sans possibilité de contamination, discussion préalable avec le voisinage, etc. Et tout cela vous a été refusé ?
M. Guy RIBA : Oui. Deux ans de travail !
Mme Marion GUILLOU : Cela n’a pas été « autorisé ».
M. Guy RIBA : Cela a causé un réel traumatisme parmi les chercheurs. Il suffit de lire leurs forums de discussion…
M. le Président : Pouvez-nous nous en faire parvenir des extraits ? La mission serait intéressée à les connaître.
M. Didier GROSDIDIER : Avec l’autorisation de leurs auteurs ?
Mme Marion GUILLOU : Les forums sont régis par des règles d’utilisation très strictes. Mais nous pouvons leur transmettre votre requête.
M. Guy RIBA : Nous pouvons suggérer aux participants qui le souhaitent d’en envoyer copie à la mission.
M. Pierre COHEN : Vous avez clairement expliqué que, sans autorisations d’essais en plein champ, la recherche sera stoppée et la France, puis l’Europe, seront écartés. Vous avez longuement parlé des plantes génétiquement modifiées, mais très peu des animaux. La principale motivation, dans le domaine des plantes, semble d’ordre économique et s’apparente, qu’on le veuille ou non, à une course aux rendements. Cela peut expliquer la réticence du public à accepter les risques liés à des opérations de nature mercantile. En revanche, pour ce qui touche aux animaux génétiquement modifiés utilisés en laboratoire, vous avez pu citer en quelques secondes une liste impressionnante d’expérimentations dont les retombées seront à l’évidence très positives pour les populations… La mise au point de plantes génétiquement modifiées est-elle donc à ce point dictée par une logique économique de rendement, ou peut-elle répondre à d’autres soucis d’intérêt plus général ?
Mme Marion GUILLOU : A l’évidence oui, et c’est bien la raison pour laquelle il faut exiger pour les OGM une évaluation « risque/bénéfice ». Imaginez que l’on examine les médicaments au regard du seul risque : aucun ne serait autorisé, car même l’aspirine est potentiellement porteuse d’effets secondaires ! Les risques doivent évidemment être identifiés, sans oublier la biovigilance pour détecter ceux qui ne l’auraient pas encore été au moment de la mise en place des cultures. Mais ils doivent être appréciés à l’aune du bénéfice, faute de quoi aucun risque ne pourrait être considéré comme « acceptable ».
On comprend dès lors la difficulté qu’il y a à défendre cette position dans un débat. Je ne suis ni pour ni contre les OGM. Je suis contre le fait qu’on leur ferme la porte. Affirmer que l’on n’aura jamais besoin d’une si puissante technique me paraît bien prétentieux. Toute la question est de savoir ce que l’on veut en faire. Etre pour ou contre un OGM résistant à la pyrale, on peut en discuter. Mais on ne peut pas être pour ou contre un OGM dans l’absolu.
Pour ce qui concerne l’INRA, on peut identifier des sujets d’intérêt, parmi lesquels, en premier lieu, la résistance aux parasites. La vigne résistante au court noué en est un exemple typique. Lorsqu’on n’a pas trouvé de variabilité génétique naturelle de résistance à un virus, la voie du génie génétique apparaît comme une évidence, et de nature à contribuer au bien public. Elle fait partie de la palette des techniques que nous entendons proposer à la société. D’où la nécessité, j’y insiste, d’introduire dans les réglementations française et communautaire la notion de rapport risque/bénéfice.
M. Guy RIBA : Existera-t-il des OGM améliorant les rendements ? Jamais. Les déterminants du rendement sont trop compliqués pour que l’on y parvienne avec les OGM. Aucun programme, pas même aux Etats-Unis, ne se fixe, d’ailleurs, comme objectif d’améliorer les rendements.
M. Pierre COHEN : C’est pourtant toujours ce genre d’objectif que l’on fait valoir…
M. Guy RIBA : Entendons-nous sur ce que signifie le mot « rendement » : jamais un OGM ne fera doubler le nombre des épis de maïs !
Marion Guillou a parlé du rapport risque/bénéfice. Avantages, inconvénients, auxquels j’ajoute une troisième notion : celle du comparatif.
Un hectare de vigne coûte entre 1 500 et 2 000 euros d’application de pesticides. La question n’est pas celle de savoir si je veux des vignes transgéniques résistantes à tel parasite, mais la suivante : si un jour cette vigne existe et me supprime 2 000 euros de frais de pesticides à l’hectare, la préférerai-je à l’actuelle vigne ? Je ne préjuge pas de la réponse. Mais c’est ainsi qu’il faut poser la question, avec les risques, les avantages et la comparaison par rapport à l’existant.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Ce sont d’abord les problèmes de dissémination qui nous préoccupent. Tout le monde peut admettre que les OGM puissent présenter des avantages mais on se heurtera toujours aux mêmes difficultés tant que l’on n’aura pas résolu la question de la dissémination. Je fais partie de ceux qui attendent des preuves scientifiques claires avant de laisser planter dans la nature des organismes génétiquement modifiés « sans aucun risque ». Or nous n’avons, sur le long terme, aucune certitude à cet égard.
Vous nous avez affirmé que les essais en plein champ étaient indispensables mais des chercheurs ont soutenu, ici même, que certaines techniques permettaient de s’en passer, grâce à des serres « grandeur nature », dans lesquelles on recréait les conditions de climat, de dissémination de pollen, dans la plus totale rigueur scientifique.
Mme Marion GUILLOU : Il faut de vraiment grandes serres…
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Certainement, mais on nous a assuré que c’était possible.
Vous avez souhaité une approche systémique et je suis bien d’accord, mais si vous la souhaitez, c’est que, pour l’heure, elle n’existe pas. Tant que nous ne l’aurons pas, nous n’aurons jamais de certitudes sur le long terme ni d’évaluation exacte du rapport risque/bénéfice.
M. Riba a lui-même reconnu, en parlant du prunier, que l’on ne savait pas limiter les flux de pollen. On ne le sait pas davantage pour le maïs…
M. Louis GUÉDON : Cela n’a rien à voir !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : C’est très variable, je vous l’accorde, mais quelle que soit la plante, le pollen a vocation à se disséminer. Sur de plus ou moins longues distances, plus ou moins rapidement, je vous l’accorde aussi. Mais tout cela peut se calculer en serre. J’aimerais avoir de plus amples informations sur ce sujet.
M. François GUILLAUME : Je comprends et partage l’exaspération des chercheurs dont on a détruit les essais. Communiquer sur le sujet n’est pas facile mais à côté des journalistes « classiques » qui répercutent plus ou moins bien l’information, il existe des journalistes scientifiques. Êtes-vous en relation avec eux ? Pouvez-vous leur faire passer votre message ? Celui-ci n’est-il pas trop compliqué ? Le sujet est, il est vrai, complexe et votre prudence vous honore, mais elle n’en constitue pas moins une brèche dans laquelle les anti-OGM systématiques ne manquent pas de s’engouffrer.
Vous penchez-vous, en travaillant sur la transgénèse, sur les problèmes liés aux exigences en eau des plantes, à la salinité des sols, à la protection des graines face aux ravageurs durant le stockage, cause de la disparition de 25 % de la production mondiale de céréales ? Etudiez-vous également la faculté à capter directement l’azote de l’air, à l’instar des légumineuses, ce qui réduit d’autant les apports d’engrais et les pollutions induites ?
On parle effectivement peu de la transgénèse des animaux, mais elle me paraît plus porteuse de dangers et de dérives que la transgénèse végétale. Les pays étrangers moins réticents que nous sont-ils plus en avance dans ce domaine ? Pour ce qui est du secteur végétal, tous tenons encore la comparaison face aux Etats-Unis. Qu’en est-il pour le secteur animal ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Aucun élu de la nation, qu’il soit de droite ou de gauche, n’aurait à l’idée de brider des essais scientifiques. Pour autant, il est du devoir de tout élu, mais également de tout citoyen, de s’assurer que les recommandations et précautions qui les entourent sont suffisantes. Or, au sein même de la communauté scientifique, nous entendons des avis totalement contradictoires. Hier encore, un membre du Comité de biovigilance nous a fait part de ses interrogations, alors qu’il était au départ totalement favorable aux essais d’OGM : « nous étions incapables », disait-il, « de déterminer scientifiquement les dangers liés à la pollinisation. »
L’INRA ne manque pas de grands terrains. Pourquoi ne mène-t-il pas ces expérimentations sur ses propres parcelles ? Pourquoi les avoir implantés dans le Gers, par exemple ? La vigueur des réactions de la population et des élus tient précisément au manque de communication et d’explications, autrement dit, bien souvent, au manque de transparence. Il y a encore deux ans, on ne prenait même pas la peine de prévenir le maire… On imagine l’effet d’une telle nouvelle sur des gens peu au fait de ces questions : nous-mêmes ne le sommes pas totalement puisque nous sommes là à écouter vos explications. Les Français ont déjà été traumatisés par l’affaire de la vache folle. Les deux sujets n’ont certes rien à voir, mais il est logique que le citoyen moyen se sente interpellé.
Je ne cautionne pas les arrachages, mais j’aimerais une réponse claire : pouvez-vous nous garantir que le principe de précaution est réellement appliqué et que vous maîtrisez totalement les risques liés à la pollinisation ?
M. François GROSDIDIER : Je reste un peu sur ma faim pour ce qui touche au risque de dissémination : on nous a dit que l’essentiel tombait tout près, mais que le peu qui restait allait très loin, avec au surplus des capacités de résistance… Tout cela n’est pas de nature à nous rassurer, même si nous sommes unanimes, a priori, pour souhaiter la poursuite des recherches et condamner l’obscurantisme et l’hostilité. Reste que les risques de dissémination d’OGM à l’occasion d’essais ne sont jamais totalement écartés et suscitent toujours autant d’inquiétude, y compris parmi d’éminents botanistes.
J’ai entendu votre proposition de rendre systématiquement publics les résultats de ces recherches. Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais cette publicité n’ira-t-elle pas à l’encontre du principe du secret industriel ? Quoi qu’il en soit, il est souhaitable d’avancer dans cette voie. Mais l’idée est-elle réellement applicable ?
M. Francis DELATTRE : Je vous interrogerai sur le maïs, pour lequel nous attendons une décision de la Commission européenne. J’ai entendu avec effarement plusieurs scientifiques affirmer que les avantages du maïs génétiquement modifié en terme de moindre dispersion d’insecticides n’étaient pas démontrés : nous pensions naïvement qu’un gène destructeur de la pyrale, principal ravageur du maïs en France, permettrait de réduire les pesticides que nous finissons tôt ou tard par retrouver dans notre eau ou dans notre assiette… Le gain n’aurait pas été seulement économique, mais également sanitaire : le lien entre plusieurs cancers et certains résidus présents dans nos aliments a été clairement démontré.
L’argument de la dissémination est de plus en plus souvent brandi. Pouvez-vous nous confirmer que, dans le cas du maïs, la dissémination sur des adventices est impossible dans la mesure où il n’existe pas de plante voisine du maïs en Europe ?
Croyez-vous à l’apparition, à terme, d’une double filière de production, avec OGM et sans OGM ?
Les Américains, et particulièrement l’emblématique firme Monsanto, s’attirent désormais toutes les foudres des bien-pensants. Mais alors que, dans le domaine des céréales, la France était bien plus en avance que les firmes américaines, notre incapacité à nous décider n’a-t-elle pas conduit à totalement entraver la recherche française et son utilisation par le secteur productif ? Nos recherches sur le blé, par exemple, quoique embryonnaires, n’étaient-elles pas prometteuses tant sur le plan économique que sur le plan sanitaire ?
Mme Marion GUILLOU : Vos questions appelleraient des réponses précises ; nous sommes prêts à revenir devant vous ou à vous donner les coordonnées de nos équipes, qui pourront vous livrer des informations plus complètes par écrit.
Les essais en champ sont-ils vraiment indispensables ? Tout dépend de la question posée. Si nous n’en avons plus qu’un, c’est sans doute que nous n’avons plus beaucoup de chercheurs disposés à s’y risquer, mais également parce que nous disposons d’autres moyens pour répondre à bon nombre de questions. En revanche, s’il s’agit de savoir, grâce à un système de surveillance à une échelle suffisante, quels effets non attendus peut avoir l’implantation d’OGM en champ sur l’environnement, je ne saurai pas vous répondre si je n’ai pas fait d’essais en champ… Comment faire autrement pour observer des effets non prévus ? Aucun scientifique ne se risquera à affirmer qu’il a tout prévu, listé toutes les questions et obtenu toutes les réponses. C’est ainsi, du reste, que nous procédons pour les semences classiques : seul les essais en champ permettent de s’assurer que toutes les questions ont été abordées. Les interdire en France ou en Europe pour les OGM revient à nous priver de tout moyen de répondre aux questions non identifiées au départ et qui n’apparaîtront qu’au stade de la mise en culture. Ou alors, nous demanderons hypocritement à nos collègues hongrois, polonais, espagnols – on est carrément passé au stade de la culture pour le maïs en Espagne – ou canadiens d’y répondre.
Nous pourrions, me direz-vous, autoriser les cultures et nous en remettre à la biovigilance en cas d’effets imprévus… Nous préférons nous en assurer à l’avance sur des parcelles surveillées.
Peut-on construire de grandes serres qui récréeraient la nature ? On sait évidemment simuler le vent, le soleil, les alternances d’éclairage, etc. Mais quelle serait la dimension pertinente pour observer ce qui se produirait dans une mosaïque de cultures ? Une simulation en serre aurait-elle un sens ?
M. François GROSDIDIER : Cette question a-t-elle déjà été étudiée ?
Mme Marion GUILLOU : Tout dépend de la question posée et des moyens que vous entendez y consacrer. S’il s’agit de savoir ce que donne un flux d’OGM dans le paysage, compte tenu de tout ce qui y passe, oiseaux, abeilles, etc., je ne peux pas répondre avec une serre. Prétendre tout résoudre a priori n’est pas raisonnable. Et attendre la mise en culture pour voir ce qui se passera, ce n’est pas la démarche que nous avons choisie.
Bon nombre d’études sur les flux de pollen peuvent être conduites, sans qu’il soit besoin d’essais OGM en champ : grâce à des outils tels que les maïs bleus, nous avons déjà obtenu des réponses à pas mal de questions : nous savons ce qui se passe en fonction du vent, de la pluie, du poids du pollen, de la nature du croisement, de la présence de plantes sauvages voisines, etc. Mais il en reste auxquelles nous n’avons toujours pas de réponses. Au vu des données récoltées, multinationales et multilocales, nous savons ce qu’il en est pour quelques espèces. Pour le prunier, nous avons dû renoncer. Pour certaines espèces, nous savons que nous ne pouvons pas répondre. Pour d’autres, nous n’avons pas encore de résultat. Nous pourrons vous donner un bilan de ce qui a été fait dans ce domaine, en France et ailleurs.
Ne confondons pas danger commercial et danger environnemental. Si un pour mille de maïs OGM va à plus de 400 mètres, est-ce un danger environnemental ? Non. Mais c’est un risque économique pour les producteurs voisins qui se sont engagés à produire un maïs 0 % OGM et qui pourraient se trouver pris en défaut. Les croisements incontrôlés, c’est un risque environnemental. La présence d’OGM résiduels chez un opérateur qui a pris des engagements contraires, c’est un risque économique contre lequel il est normal de vouloir se prémunir pour éviter toute mauvaise surprise commerciale ou accusation de fraude.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : C’est très important.
M. le Président : Une table ronde économique est prévue, à condition que le Président de l’Assemblée nationale accepte l’élargissement du champ d’investigation de la mission. Il y serait, à ce que je crois savoir, plutôt favorable.
Nous pourrons inviter Guy Riba à l’une de nos tables rondes contradictoires, ce qui permettra de préciser certaines questions.
Mme Marion GUILLOU : Nous sommes par principe ouverts à toutes les questions.
Vous sentez bien, en nous entendant, que nous sommes incapables de vous répondre en quelques secondes… Nous ne vous répondrons jamais par oui ou par non, mais que c’est au cas par cas, qu’il faut un examen préalable, etc. C’est de l’anticommunication par essence ! Mais si la science se permet de s’affranchir de ce genre de message, nous ne saurons plus où nous en sommes. Il en résulte que notre communication sur de tels sujets n’est pas des plus efficaces, je le reconnais. J’ai déjà débattu avec José Bové. Il est des moments où nous pouvons discuter. Mais à la question : « Y a-t-il zéro risque ? », je ne peux pas lui répondre oui. Je dis qu’il y a des risques contrôlables, qu’il y a ceux que l’on peut diminuer, qu’il y a ceux que l’on peut ou non accepter au regard de tel ou tel bénéfice, mais pas qu’il y a zéro risque.
M. Louis GUÉDON : Votre exemple de l’aspirine était parfait : il y a toujours un risque à en prendre. Le risque zéro n’existe pas.
Mme Marion GUILLOU : Ce qui explique notre faiblesse dans ce genre de communication rapide. Mais nous ne pouvons pour autant laisser la déontologie de côté.
Enfin, que les essais aient lieu sur nos terrains ou pas, on les détruit. Dans le Gers, il ne s’agissait pas d’un essai INRA. Mais les essais INRA sont faits sur des terrains INRA, et cela ne change rien.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : C’est à cause du manque de transparence, ou de la proximité d’autres terrains privés…
Mme Marion GUILLOU : Non. A Toulouse, c’est une serre que les « Ravageurs de la nuit »
– personne ne sait qui c’est – ont saccagée. On a détruit des essais à Rennes, alors que nous avions organisé des débats et largement expliqué les objectifs de nos recherches. C’était sur un terrain INRA, toutes les précautions de distance avaient été respectées…
M. Guy RIBA : Et alors que nous avions longtemps à l’avance consulté les agriculteurs mitoyens et les élus locaux !
Mme Marion GUILLOU : Nous sommes résolus à poursuivre dans la transparence, avec des comités de suivi, des règles de distance, etc. Un jour viendra où les gens admettront que les avantages de ces essais justifient qu’on les poursuive en France… Mais nous n’en sommes pas là.
M. Gérard DUBRAC : En fait, vos essais en milieu naturel n’ont pas pour but de connaître les effets non attendus qui font toujours peur au grand public, mais de rechercher des effets attendus que vous voulez vérifier. Pourquoi ces choses ne sont-elles pas expliquées ?
Mme Marion GUILLOU : Elles le sont.
M. Guy RIBA : L’essai détruit en Ariège est l’exemple type d’une implantation destinée à mesurer les flux !
M. Gérard DUBRAC : Expliquez-le au grand public…
Mme Marion GUILLOU : Sans aller jusqu’à aller l’expliquer à l’ensemble de la population, nous décrivons, sitôt que nous demandons l’autorisation, l’objectif de l’essai. Tout est détaillé, essai par essai, sur le site Internet de l’INRA. Je ne prétends pas que notre vocabulaire soit des plus compréhensibles, mais tous nos essais sont systématiquement accompagnés d’une description précise de leur objectif. Au-delà, comment pourrons-nous mettre en place des systèmes de vigilance sans essais grandeur nature ?
M. Francis DELATTRE : Le maïs transgénique présente-t-il, oui ou non, des avantages sur le plan économique ?
Mme Marion GUILLOU : Je vous donnerai les adresses Internet des sites sur lesquels vous pourrez retrouver tous les résultats. Nous avons une étude comparative entre maïs non-OGM et maïs OGM cultivés aux Etats-Unis de 1996 à 2002, plus une extrapolation sur 2003.
M. Francis DELATTRE : Et en France ?
Mme Marion GUILLOU : Comment voulez-vous que nous ayons le recul nécessaire ?
M. Guy RIBA : Nous ne pouvons pas faire d’essais !
Mme Marion GUILLOU : Il s’agit d’une étude de l’USDA7, apparemment très bien faite. Le résultat est négatif pour ce qui est de la résistance aux herbicides : après avoir baissé, la consommation d’herbicides a remonté et en vient même à dépasser le niveau antérieur. Il est en revanche positif pour ce qui est des OGM-Bt, puisque l’utilisation de maïs Bt a permis de réduire les traitements phytosanitaires.
M. le Président : Et il semblerait que l’augmentation de la consommation d’herbicides serait liée au fait que des agriculteurs, qui ne les utilisaient pas jusqu’alors, se sont mis à traiter.
Pouvez-vous nous communiquer des fiches sur l’essai de l’Ariège ainsi que sur celui du caféier de Guyane ?
Mme Marion GUILLOU : C’est un essai réalisé par le CIRAD, sur la résistance aux parasites du café.
M. le Président : Nous le demanderons au CIRAD.
Madame, Monsieur, nous vous remercions.
Audition conjointe de
M. Olivier KELLER, secrétaire national de la Confédération paysanne,
M. José BOVÉ, cofondateur,
M. Michel DUPONT, animateur de la Confédération paysanne
et M. Guy KASTLER, président du Réseau Semences Paysannes
(extrait du procès-verbal de la séance du 24 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Messieurs, nous vous remercions d’être venus devant la mission d'information sur les conséquences environnementales et sanitaires des autorisations d'essais d'organismes génétiquement modifiés. Je précise que nous avons unanimement suggéré hier au Président de l’Assemblée nationale d’élargir notre champ d’investigations aux conséquences économiques et juridiques des essais d’OGM. Cet élargissement sera très bientôt discuté en Conférence des Présidents.
Ces premières « auditions privées » ont pour but d’entendre les responsables institutionnels d’instituts de recherche, d’organisations professionnelles agricoles et d’autres organismes privés et publics français, avant d’entamer une série de tables rondes dont certaines contradictoires, ouvertes à la presse et au public, autour de thèmes précis, tels que les enjeux sanitaires, environnementaux, juridiques…
Nous nous rendrons aux Etats-Unis, mais également en Afrique du Sud et en Espagne afin d’apprécier la situation dans les autres pays.
M. Olivier KELLER : Un peu d’histoire pour commencer. Dès 1996, la Confédération paysanne a organisé un débat interne sur les OGM. Les actions engagées dès 1997, faute de voir la question posée sur la place publique, et les procès qui ont suivi, ont permis à bon nombre de citoyens de s’approprier le sujet. Peut-être est-ce également ce qui explique notre présence ici…
Les positions de la Confédération paysanne sont assez simples : nous avons vocation à défendre les paysans, et le propre d’un paysan est de pouvoir ressemer une partie de sa récolte. Notre vision n’est pas seulement nationale, mais européenne et internationale, partant du fait que 55 % des actifs de cette planète ont une activité liée à l’agriculture. Ajoutons qu’à notre sens la notion de brevet, dans le droit français et le droit européen, ne s’étendait pas jusqu’à maintenant au domaine du vivant et se limitait aux matières amorphes, transformées ou non. Or on s’emploie petit à petit à nous faire croire que le vivant est une marchandise comme une autre.
Il n’y a pas à nos yeux de seuil de coexistence possible entre les OGM et les cultures traditionnelles, sans même parler des produits de qualité ou de l’agriculture bio, par le seul fait que le dépassement de la barrière du genre n’est pas acceptable en tant que tel.
M. Guy KASTLER : Membre de la Confédération paysanne et chargé du dossier OGM, je suis, par ailleurs, président du réseau « Semences paysannes », regroupant des paysans qui non seulement ressèment leur récolte, mais s’acharnent à sélectionner eux-mêmes, faute de pouvoir trouver auprès des semenciers des variétés adaptées à une culture à faible niveau d’intrants, autrement dit exemptes de ces pesticides de plus en plus critiqués par les consommateurs comme par les professionnels de la santé.
Ce choix, plus lié au sujet qui nous occupe aujourd’hui qu’il n’y paraît, est devenu totalement illégal depuis l’instauration du catalogue et des certificats d’obtention végétale qui éliminent toute variété non stable et non homogène. Or nos variétés ne sont précisément ni stables ni homogènes, puisqu’elles doivent précisément évoluer en fonction des terroirs – sans parler des coûts d’inscription que seul un gros semencier peut se permettre.
Avant même que n’arrivent les OGM, les paysans avaient déjà perdu le droit de choisir leur mode de culture et leur système agraire. Pourtant, la liberté économique, la liberté d’entreprendre est un principe fondateur de la République. Les lois semencières viennent à en priver le paysan qui, faute de pouvoir choisir le mode de sélection de ses semences, ne peut choisir le type d’agriculture qu’il entend pratiquer, biologique ou autre.
Nous recevons régulièrement la visite d’agents de la répression des fraudes qui veulent nous empêcher de travailler. Nous sommes des citoyens et nous revendiquons le droit de travailler dans la légalité, car c’est le seul moyen d’offrir au consommateur une nourriture irréprochable sur le plan tant nutritionnel que sanitaire. La qualité sanitaire des produits pose de nombreux problèmes avec les nouvelles variétés vendues par les semenciers et se détériorera davantage encore avec les OGM.
On parle souvent des problèmes de la coexistence entre l’agriculture biologique et les cultures transgéniques et je suis moi-même producteur biologique. Mais le problème ne se limite pas au bio, ni aux AOC ou aux parcs naturels. Plus de 50 % des paysans, y compris dans les grandes cultures céréalières, ressèment leur récolte. Avec les OGM, le risque de contamination deviendra tel que l’usage de ce droit deviendra très rapidement impossible, tout simplement parce que nous serons devenus les principaux multiplicateurs d’OGM… Et lorsque notre récolte est issue de trois ou quatre générations de sélections d’une variété locale sur la même ferme, c’est tout un patrimoine génétique, cette biodiversité que nous nous devons de transmettre à nos enfants, qui sera définitivement détruit. Le problème de la coexistence avec l’agriculture transgénique ne se pose donc pas seulement pour le bio, mais pour l’ensemble de l’agriculture.
Nos amis italiens ont fait preuve en 2001 d’un grand sens de l’intuition lorsqu’ils ont inscrit dans leur loi semencière, parmi les motifs – sanitaires, environnementaux – au nom desquels un Etat peut interdire sur son territoire des variétés transgéniques pourtant autorisées par la réglementation européenne, la protection des systèmes agraires. La Communauté n’a pas remis en cause cette exigence supplémentaire. Je vous recommande vivement de faire reconnaître, dans le cadre de vos travaux législatifs, la liberté d’entreprise qui nous est due, et donc notre droit de défendre notre système agraire.
M. Michel DUPONT : Je suis animateur de la Confédération paysanne, chargé du dossier OGM et ancien producteur agricole. Nous sommes heureux que votre mission ait proposé d’étendre son champ d’intervention aux aspects économiques ; elle pourra ainsi mesurer l’impact qu’aurait une généralisation des cultures OGM sur l’économie agricole et agroalimentaire française et européenne. Il serait intéressant pour vous de connaître la position des semouliers, par exemple, très liés au maïs et aux autres céréales, de vous rendre compte des difficultés que rencontre la mise en place d’une double filière, OGM et non-OGM, et du risque économique que représenterait la perte de marchés très importants. Dans des filières comme la viande, par exemple, l’inquiétude est grande : on sait les quantités de viande française vendues en Italie. Sachant les positions qui sont de plus en plus défendues dans ce pays, tout porte à croire que la demande des consommateurs s’en ressentira et que la perte d’attractivité de notre viande du fait de la présence d’OGM aura de lourdes conséquences.
Sur le plan sanitaire, il serait également intéressant que vous envisagiez de proposer le lancement d’études toxicologiques de longue durée, au cas par cas, parce que les OGM ont des effets sur la santé qui ne sont pas pris en compte. Les modalités d’instruction des dossiers d’autorisation sont trop réductrices. Nous avons publié un petit livre consacré aux aspects de sécurité et de santé, dans lequel sont reprises les conclusions de certains chercheurs, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, alors qu’elles pourraient très utilement nourrir le débat.
M. José BOVÉ : Les OGM sont-ils une nécessité ou, à l’inverse, un obstacle au développement de l’agriculture et à l’alimentation des habitants de cette planète ? A l’évidence, ce débat dépasse le cadre du seul territoire français : il se pose à l’échelle l’ensemble des pays et des continents.
A nos yeux, le développement des OGM s’inscrit dans une logique d’agriculture industrielle et aucunement dans une logique d’agriculture au service de l’alimentation des individus. La majorité des OGM produits – 80 à 90 % – sont destinés à l’alimentation animale, participant d’une logique d’industrialisation et d’artificialisation de l’agriculture propre aux pays industrialisés.
Sur cette planète, on l’a dit, 55 % des actifs sont des paysans. Mais sur ces 55 %, 28 millions ont un tracteur, 250 millions un animal de trait et 1 300 millions n’ont que des outils à main ! La forme d’agriculture induite par les OGM ne convient évidemment qu’à la première catégorie, autrement dit à une infime minorité. Il n’est que de regarder les belles cartes brandies par les firmes dans le but de faire croire que les OGM se seraient massivement diffusés : on y voit les Etats-Unis, le Canada, l’Argentine, certains vont même jusqu’à y ajouter la Chine… A les entendre, les OGM domineraient la planète et nous mènerions un combat d’arrière-garde. Mais si l’on considère les surfaces agricoles avouées par ces mêmes firmes, on s’aperçoit qu’elles ne représentent que 0,6 % des terres cultivées… On est donc très loin d’une agriculture dominante ! Et si nous nous engageons dans ce débat d’une manière aussi forte, c’est que rien n’est inéluctable en la matière.
A quoi donc servent ces OGM et à qui rendent-ils service ?
Le paysan n’y a visiblement pas d’intérêt : les semences sont plus chères et les cultures exigent davantage de pesticides. Les derniers chiffres de l’administration américaine
– vous les verrez de vous-mêmes sur place – font état d’une utilisation de pesticides en augmentation de 20 à 40 % selon qu’il s’agit de soja, de maïs ou de coton.
Le consommateur n’y a pas davantage d’intérêt. Aucun OGM n’est de nature à améliorer un jour l’alimentation ou la qualité des produits, contrairement à ce que l’on se plaît à nous répéter, d’autant que 99 % des OGM appellent l’emploi de pesticides.
Dans ce cas, à qui donc rendent-ils service ? La réponse est pour nous évidente : à quelques firmes qui, grâce aux brevets, se retrouvent propriétaires des semences des paysans. Et par le jeu très pervers des pollutions génétiques – pas seulement par les transferts de pollen, mais également à l’occasion des transports et des stockages – le processus aboutit inéluctablement à enfermer les paysans et les consommateurs dans le système OGM.
Puisque vous allez aux Etats-Unis, faites donc un saut au Mexique. Les Mexicains viennent d’interdire l’entrée de maïs en grains sur leur territoire. Tout le maïs doit être concassé, car ils ont découvert que les maïs américains génétiquement modifiés importés dans le cadre de l’ALENA8 non seulement détruisaient la capacité économique des paysans à gérer leur propre production, mais venaient polluer les variétés locales de ce bassin historique d’où proviennent tous les maïs du monde ! C’est là un des aspects les plus dangereux, particulièrement pour les pays du Sud : l’impossibilité pour les paysans, à terme, d’utiliser leurs propres semences.
A ce propos, si vous allez en Afrique du Sud, je vous suggère de faire également un petit détour par la Zambie, gros producteur de maïs. Les Zambiens ont refusé voici deux ans l’aide alimentaire proposée dans le cadre de l’US Aid car celle-ci était composée de maïs transgénique. Ils ne voulaient pas que leur agriculture soit contaminée.
Ces exemples montrent que le discours selon lequel les OGM permettront de lutter contre la faim dans le monde n’a pas de sens. Ce qui est évident en revanche, c’est la volonté des transnationales de les imposer par le biais du commerce et de l’aide alimentaire, et de montrer leur puissance. A preuve, la façon dont Monsanto, pour ne citer qu’elle, s’implante progressivement dans les institutions politiques de certains pays – le président du Nicaragua est l’ancien président de Monsanto pour l’Amérique centrale – ou dans les instances internationales : le secrétaire général adjoint de l’OMC est l’ancien avocat international de Monsanto !
Face à cette situation, il est de la responsabilité des élus français et européens d’affirmer des choix politiques, pour nos territoires, mais également pour l’ensemble des paysans du monde. Au moment où l’Europe s’emploie à mettre en place de nouveaux accords régionaux, notamment avec l’Afrique de l’Ouest, il serait intéressant que la France et l’Europe prennent des positions qui aillent dans le sens de la préservation des agricultures paysannes de ces pays. De la pérennité de ces systèmes agraires dépend le maintien de la majorité des paysans de la planète là où ils sont. C’est dans ce sens que le Mali vient de décréter un moratoire, alors même que Monsanto et l’administration américaine multiplient les pressions, notamment sur le Burkina Faso.
Il n’est pas trop tard. Ce débat vient à point nommé. Encore faut-il faire preuve de cohérence et nous mettre en capacité de réagir.
M. le Président : Vous avez mis l’accent sur les aspects économiques, ce qui va dans le sens de ce que nous avons demandé hier, à l’unanimité, au Président de l’Assemblée nationale. Certaines de nos questions pourront vous paraître des pièges ; mais il se trouve que, juste avant vous, Mme Marion Guillou, présidente de l’Institut national de recherche agronomique (INRA), et M. Guy Riba ont défendu avec force et passion les expérimentations en plein champ, dans le respect évidemment des principes de parcimonie, de précaution et de transparence. Parlant des essais détruits, ils ont eu cette phrase : « Ils nous empêchent de répondre aux questions qu’eux-mêmes posent dans le débat public ». Que répondez-vous à cela ?
M. Olivier KELLER : Partant du principe que le brevet du vivant n’est pas possible, nous pensons que ces expérimentations n’ont pas lieu d’être. En admettant même qu’elles puissent exister, elles doivent être effectuées en milieu clos. Encore faut-il que cette recherche soit totalement indépendante et non menée dans le cadre de partenariats qui aboutissent à créer des liens de dépendance économique entre la recherche nationale et les firmes intéressées. Et cela supposerait une contre-expertise, par des laboratoires réellement indépendants, ainsi qu’une parfaite lisibilité des objectifs.
M. Guy KASTLER : Nous avons déjà – malheureusement – un champ d’expérimentation de centaines de milliers d’hectares dans d’autres continents que le nôtre, qui non seulement permet de disposer de premiers éléments de réponse, mais qui est également porteur d’autres interrogations auxquelles il faut répondre mais auxquelles il est tout à fait possible de répondre en milieu confiné. Les problèmes de dissémination ont déjà été mis en évidence par nombre d’études : des graminées qui migrent jusqu’à 21 kilomètres, des pollens de maïs encore fertiles que l’on retrouve à 1 800 mètres d’altitude… Et Arvalis continue de faire des expériences pour savoir s’il peut aller d’un champ à l’autre ! L’Association générale des producteurs de maïs (AGPM), elle-même, se reconnaît incapable de respecter le seuil de contamination de 0,9 %
– alors que le seuil légal de détection est de 0,1 % !
M. le Président : Faut-il à votre avis l’abaisser encore ?
M. Guy KASTLER : Si les capacités de détection s’améliorent, oui. Je garantis ma production sans OGM. La répression des fraudes est formelle : ou bien il y a des OGM, ou bien il n’y en a pas. Si je ne peux pas garantir qu’il y a moins de 0,1 % d’OGM dans mon produit, je n’ai pas le droit d’écrire « sans OGM » sur l’étiquette, sous peine d’amende.
De son propre aveu, l’AGPM est incapable de maîtriser les risques de contamination au niveau de la filière – transformation et semences – en dessous de 0,9 %, du fait des excès auxquels ont donné lieu les variétés d’ores et déjà autorisées en France. Ne reste que la solution de créer des régions spécialisées… Et ce sont les piliers du lobby pro-OGM en France qui le disent !
Au-delà, sans même parler d’environnement, mais tout simplement en terme de santé, on se rend bien compte que bon nombre de problèmes se posent, et pas seulement du fait des transferts de gènes, dont la possibilité a été démontrée sur des souris dès 1997 : en comparaison d’animaux nourris avec une protéine produite par une plante classique, les bêtes nourries avec la même protéine, produite par la même variété, mais génétiquement modifiée, présentent des problèmes de santé ! Autrement dit, la même substance, selon qu’elle sera produite par un OGM ou par une variété classique, causera ou non des dégâts sur les animaux.
M. le Rapporteur : Quels types de dégâts ?
M. Guy KASTLER : Des dégâts sur le système digestif, comme l’ont montré plusieurs scientifiques. De même chez les insectes : pourquoi la mortalité de la chrysoperla augmente-t-elle lorsqu’elle mange des insectes qui se sont nourris de maïs transgénique Bt au lieu de maïs traditionnel traité au Bt ?
Autres questions non résolues : celles qui sont liées à l’instabilité des constructions transgéniques. Sur la même variété transgénique brevetée, des chercheurs ont trouvé, à un an d’intervalle, des constructions génétiques différentes de la construction publiée… La variété transgénique vendue devrait logiquement correspondre à celle qui est inscrite dans le brevet ou dans le catalogue officiel ! Deux équipes de chercheurs, l’une française et l’autre belge, ont séquencé la même variété : ils n’ont pas trouvé la même chose ! Si, comme le prétendent certaines firmes, cela s’explique par le fait que ce qui est inscrit dans les registres ne correspond pas à la réalité, c’est qu’il faut se poser la question de la pertinence de l’expertise… Autant de questions fondamentales, dont les conséquences sur la santé humaine sont extrêmement graves et auxquelles il est parfaitement possible de répondre en laboratoire, sans essais en milieu ouvert. Ce serait faire prendre un risque énorme à la population comme à l’environnement.
M. le Président : A croire ce que nous a dit l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), les gènes et les séquences en question sont tirés de produits naturels, contrairement à ce qui se fait pour les produits chimiques. Et M. Schwartz nous a déclaré hier préférer de loin utiliser des produits naturels issus d’organismes génétiquement modifiés plutôt que des produits d’origine chimique.
M. Guy KASTLER : C’est faux. Ces gènes ne sont pas naturels. La toxine du Bt, par exemple, est, nous dit-on, produite par un gène d’une bactérie du sol, que l’on a introduit dans la plante afin qu’elle produise la même toxine. Le problème est que la bactérie et la plante n’ont pas la même construction génétique, du seul fait que l’on n’insère que les gènes qui s’expriment. Or l’essentiel du génome est constitué de gènes muets. Mais s’ils sont muets, ils n’en ont pas moins une utilité que l’on ne connaît pas. En tout état de cause, ce n’est pas la construction transgénique naturelle qui a été insérée et, en fin de compte, la protéine produite n’est pas la même.
En tant que législateurs, vous avez à vous prononcer au vu d’expertises ; or toutes les analyses sont réalisées par électrophorèse. On verra si le gène recherché est présent ou non, mais pas s’il y a eu d’autres perturbations ailleurs. Seul un séquençage complet permet de s’en apercevoir. La directive européenne 2001/18/CE exige dorénavant un minimum de séquençage pour vérifier si rien n’a changé dans les bordures, mais non pas un séquençage de l’ensemble de la construction transgénique. En l’état actuel des dossiers d’autorisation présentés à la Commission du génie biomoléculaire (CGB), on est incapable de dire si les constructions transgéniques proposées sont stables ou non.
M. le Président : Je partage vos propos sur les gènes muets. J’en avais moi-même fait état dans mon rapport de 1998, alors qu’ils passaient totalement inaperçus. Il n’empêche que la méthode de sélection classique, y compris avec des semences, pose exactement le même problème. La création de façon aléatoire d’une nouvelle espèce de semence ne permet pas de savoir quel rôle vont jouer les gènes muets.
M. Guy KASTLER : A ceci près qu’il s’agit vraiment de produits naturels !
M. le Président : La question que vous posez est juste, mais elle n’est pas spécifique aux OGM : elle se pose pour toute modification d’une semence.
M. Guy KASTLER : Quand je sélectionne moi-même ma semence, je laisse agir les lois élémentaires du vivant. Et la première d’entre elle, c’est la différenciation et la course vers la complexité. Aller vers la réduction de la complexité, c’est aller à la mort !
Pour préserver la diversité, la nature a mis en place une protection naturelle : la barrière des espèces, que les créateurs de constructions transgéniques transgressent délibérément. La barrière des espèces, c’est le système immunitaire du génome, qui permet de réguler son évolution – car il arrive effectivement au génome d’évoluer naturellement.
De surcroît, qu’utilise-t-on dans une construction transgénique ? Les organismes vivants les plus capables de transférer les gènes, autrement dit ni des animaux ni des plantes, mais des bactéries qui, faute de reproduction sexuée, ne peuvent évoluer que par mutation génétique ou transfert de gènes horizontal. Plus efficaces encore, les virus, capables d’entrer dans les cellules et particulièrement, dans le domaine agricole, le fameux 35 S CaMV, du virus de la mosaïque du chou-fleur, qui possède une extraordinaire capacité de transfert horizontal.
Sur les milliers d’expériences en thérapie génique, dont la plupart sont d’ailleurs illégales, l’une d’elle a réussi, et c’est heureux, sur une dizaine d’enfants-bulles. Un seul est décédé d’une leucémie, par la suite. Pourquoi ? Parce le vecteur viral de la construction transgénique est allé faire des réarrangements à d’autres endroits du chromosome…
Nous ne voulons pas jouer aux apprentis sorciers dans nos champs en générant des instabilités génétiques systématiques là où la nature a précisément mis des barrières entre les espèces pour permettre au monde vivant d’évoluer. Sans différenciation, pas d’évolution : il ne peut y avoir d’échanges entre deux organismes vivants absolument identiques. C’est cette loi élémentaire que les promoteurs de la transgénèse s’emploient à perturber sur des milliers d’hectares.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas de solution. Que les chercheurs cherchent ; mais qu’ils commencent par le faire en laboratoire avant de prendre le risque de contaminer mon champ !
M. José BOVÉ : Il y a quelques années, l’INRA et le CETIOM9 avaient décidé d’expérimenter en plein champ des colzas transgéniques pour vérifier le taux de croisement avec la ravenelle, une crucifère de la même famille.
M. le Président : Et ces essais ont été détruits…
M. José BOVÉ : Par nous, entre autres. Deux fois : à Foix et à Gaudiès.
M. Francis DELATTRE : Comme cela, on ne peut pas vérifier…
M. José BOVÉ : Ces expérimentations étaient absurdes. Les risques de croisement avaient déjà été prouvés en milieu confiné. Avait-on besoin de savoir s’ils sont de 1 % ou de 10 % ? On fait des essais de crash avec les voitures : on sait que si l’on percute un obstacle à grande vitesse, il y aura du dégât. Va-t-on refaire l’essai dans une cour d’école pour savoir combien il y aura de morts à 50 ou à 100 à l’heure ? Au surplus, était-on obligé de calculer ce risque en se servant d’un colza génétiquement modifié ? Pourquoi ne pas avoir utilisé un gène marqueur qui n’aurait posé aucun problème environnemental ?
En fait, ce que l’on présentait comme une expérience scientifique cachait, comme au moins 85 % des essais à l’époque, Jean Glavany lui-même l’avait clairement admis en 2002, un essai à caractère économique. Tous les dossiers qui passaient devant la CGB ne visaient qu’un objectif : la reconnaissance. L’essai de Menville, détruit par les « faucheurs volontaires » le 25 juillet 2004, était le résultat d’un partenariat GEVES10-Pioneer. Or le GEVES, organisme d’Etat, avait délégué la mission d’expertise à Pioneer ! On ne peut être en même temps expert et partie. Tout cela sera plaidé devant les tribunaux en temps utile. Nous ne savons pas encore si nous serons 250 accusés ou seulement neuf.
Autrement dit, le système ne fonctionne pas correctement. Quelle réalité se cache derrière ces essais ? Pourquoi les firmes poussent-elles aussi fort à leur mise en place ? Pour inscrire le plus vite possible la semence au catalogue. En attendant, les résultats des essais en laboratoire, et particulièrement les données toxicologiques, ne sont jamais publiés. C’est pourtant indispensable. Cette manière de procéder est totalement anti-scientifique.
M. le Rapporteur : Imaginons qu’une nouvelle thérapie anticancéreuse soit mise au point, qui fasse appel à des cultures génétiquement modifiées. Après tests en milieu confiné, il devient nécessaire de passer en essai en champ pour s’assurer de leur totale innocuité. Quelle serait votre réaction ?
M. Guy KASTLER : Pour commencer, on peut très bien produire ce genre de médicament en laboratoire, sur substrat génétiquement modifié, comme l’ont montré les essais effectués par Meristem Therapeutics. Il n’y a pas besoin d’aller en champ, et encore moins en milieu ouvert, même s’il faut utiliser le maïs. Une serre ferait l’affaire.
A chaque fois que vous mettrez une molécule thérapeutique dans une plante cultivée en milieu ouvert, vous prendrez le risque, qui reposera finalement sur le politique qui l’aura autorisée, de voir le médicament en question se retrouver dans l’assiette du consommateur. Les médicaments sont faits pour être dans l’armoire à pharmacie, pas pour être mangés tous les jours… C’est la dose qui fait le poison et les effets peuvent être très lents, parfois même attendre la deuxième génération : on l’a déjà vu avec les PCB11. Oserez-vous prendre une telle décision ?
M. le Rapporteur : En fait, vous recherchez un risque zéro.
M. Guy KASTLER : Non. S’il existe un autre moyen, pourquoi prendre ce risque, sinon pour satisfaire un mercantilisme de bas étage ?
M. François GROSDIDIER : Dans le domaine thérapeutique, l’intérêt peut être autre que de bas étage.
M. Guy KASTLER : On peut produire la même molécule en laboratoire.
M. le Rapporteur : Pas toujours. Et il peut se poser une question de coût de production.
M. José BOVÉ : Allez voir par vous-mêmes ce qui s’est passé dans l’Ohio. La firme Prodigen avait installé une production en champ de maïs transgénique modifié pour produire des molécules pharmaceutiques. Or celui-ci a contaminé plus de 500 tonnes de soja destiné à la consommation humaine. Pas par le pollen, mais par le biais des transports, etc. La situation est devenue à ce point alarmante que les fabricants d’OGM alimentaires eux-mêmes ont réclamé l’interdiction des cultures d’OGM médicamenteux en plein champ ! Cela a fait l’objet d’un article très sérieux du Wall Street Journal… On s’inquiète à raison des problèmes posés par la présence des OGM alimentaires aux côtés des autres formes de culture, mais avec les OGM médicamenteux les conséquences d’éventuels transferts seront beaucoup plus graves : ce sera une affaire de santé publique.
Pour une firme, il est évidemment beaucoup plus rentable de produire une molécule en champ plutôt qu’en construisant une usine coûteuse. Mais la mise en place d’une nouvelle technologie suppose de prévoir un minimum de garde-fous et de connaître précisément son impact sur le plan social, sur les individus, sur l’organisation de la société, sur les générations futures, sur l’environnement… C’est tous ces points qu’il faut aborder avant de savoir si, oui ou non, telle technologie est acceptable pour la société. La question n’est pas de savoir si, scientifiquement, la chose est possible, mais bien de savoir si, socialement, environnementalement, on est en droit de le faire. Et c’est le rôle du politique que de tracer ce cadre.
M. le Rapporteur : Autrement dit, vous refuseriez toute expérimentation en champ, même si cette technologie constituait un extraordinaire progrès ?
M. José BOVÉ : Nous ne sommes pas dans cette situation. Une telle question est dangereuse. C’est comme si vous me demandiez de faire sauter une bombe atomique, pour m’assurer qu’elle fonctionne, au motif que je pourrais un jour être en guerre avec mon voisin ! Il faut d’abord utiliser toutes les autres techniques avant éventuellement de se demander si on peut le faire
– mais après un débat public, organisé tant avec les politiques qu’avec la société civile, pour déterminer dans quelles mesures et dans quelles conditions.
M. le Rapporteur : Ne pensez-vous pas qu’il serait utile de mettre en place deux commissions, la première composée uniquement de scientifiques chargés d’évaluer les risques liés aux OGM, la seconde majoritairement issue de la société civile pour rapporter ces risques aux avantages attendus ?
M. José BOVÉ : Tous les types et niveaux d’expertise doivent être mis en commun. C’est du reste la raison d’être des commissions existantes du génie biomoléculaire et du génie génétique. Malheureusement, la théorie ne se retrouve pas dans la réalité, dans la mesure où les promoteurs des essais ne sont pas obligés de montrer les résultats – notamment en toxicologie – de ce qui s’est préalablement fait en laboratoire. Il faudrait d’abord revoir ce que l’on met derrière le mot « expertise ». Ensuite, tous les impacts – économiques, environnementaux, sociétaux – doivent être évalués, en positif et en négatif. C’est seulement à partir de là, et au cas par cas, que les gens pourront se déterminer. Malheureusement, nous en sommes loin. Seule une expertise d’ensemble dira si l’activité en question est profitable pour la société, pour l’économie, pour l’environnement et pour la qualité des produits. Ajoutons que la logique du brevet, en elle-même, pose un problème fondamental. Le débat, y compris sur le plan scientifique, restera faussé tant que les règles de la propriété intellectuelle telles que définies par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) s’appliqueront au vivant.
M. le Rapporteur : N’est-il pas paradoxal de prôner d’un côté le droit à une meilleure information et, de l’autre, de détruire les champs d’expérimentation ? Ne nous retrouvons-nous pas aux meilleurs temps de l’Inquisition ?
M. Olivier KELLER : Le débat, au niveau parlementaire, ne fait que commencer aujourd’hui. Si l’on s’est résolu à consulter les populations, les maires, les collectivités, c’est avant tout par dépit. Et le dernier sondage montre que 73 % des maires ne veulent pas d’OGM sur leur territoire…
M. le Président : Je ne peux pas laisser dire que le débat n’a pas eu lieu. Vous reprochez aux règles actuelles de ne pas vous convenir ; c’est le résultat d’une transposition de directives de 1990, laquelle s’est effectuée dans l’indifférence générale. Personne n’a rien dit, ni Greenpeace, ni la Confédération paysanne. J’étais déjà député à l’époque et nous nous sentions bien seuls ! Et nous serons tout aussi seuls lundi prochain, lorsque l’Assemblée examinera précisément la question du droit des brevets ! Et pourtant, ce texte traite de plusieurs des questions que José Bové vient d’évoquer.
Le débat a commencé en 1996. Vous avez largement participé à la conférence des citoyens que nous avons organisée en 1998 et qui a permis de diffuser l’information parmi la population. Mais comment prouver que tel essai est dangereux et démentir les affirmations de certains économistes si vous refusez toute forme d’expérimentation ? Le meilleur moyen de combattre les OGM n’est-il pas après tout de refuser que l’on en parle et de médiatiser au maximum les incidents ? Bref, n’y a-t-il pas un peu de tactique derrière tout cela ?
M. José BOVÉ : Les préalables indispensables à la connaissance ne sont pas réunis. Les résultats des expériences en laboratoire ne sont toujours pas rendus publics, qu’il s’agisse des aspects toxicologiques ou bien le problème de la stabilité est bien réel et dans ce cas, de la stabilité ou de l’instabilité des constructions génétiques. La CGB a pourtant planché deux jours durant, la semaine dernière, sur la question de l’instabilité ! C’est dire à quel point c’est devenu un problème central. De deux choses l’une : ou bien le problème de la stabilité est bien réel et dans ce cas, les brevets ne servent à rien, ou bien ils ont un sens, auquel cas la construction brevetée n’est pas conforme au cahier des charges des semences… Il y a des problèmes juridiques à la clé. Tant que nous n’aurons pas une position politique et un cadre législatif clair, il faut impérativement un moratoire sur les essais et les cultures en plein champ. N’oublions pas qu’il existe déjà des variétés d’OGM autorisées, que l’AGPM pourra parfaitement vendre aux agriculteurs qui le souhaitent, sans aucun cadre réglementaire pour déterminer notamment les responsabilités en cas de pollution. Il n’est qu’à voir ce qui s’est passé à Sigalens, en Gironde : l’AGPM avait installé un essai d’un hectare et demi de maïs OGM au milieu de dix hectares non-OGM. « Tout va très bien », avait-elle proclamé dans Sud-Ouest et Le Figaro. Mais sans en informer les habitants de la commune ni les agriculteurs voisins, puisque c’était dans un cadre économique non soumis à information… En cas de croisement, tant pis pour le voisin qui fait du bio ou de l’AOC !
Cette situation est d’autant plus dangereuse que la question de la responsabilité n’est pas non plus tranchée. Allez-vous auditionner les compagnies d’assurance ?
M. le Président : Bien sûr.
M. José BOVÉ : A la question : « Êtes-vous prêt à m’assurer contre un risque de pollution génétique de mon voisin ? », Groupama-Aveyron nous a répondu par courrier : « Nous ne pouvons pas vous assurer, parce que ce risque n’est pas aléatoire. » Autrement dit, le risque est certain, mais pas quantifiable… Aucune assurance n’accepte de se mouiller dans ces conditions.
Cela pose un problème de fond sur le plan de la responsabilité juridique. Si les promoteurs d’OGM ne sont pas responsables et si ces OGM sont mis en culture sans un cadre pour traiter de la responsabilité, qui sera responsable en cas de pollution ? Les élus de la République qui auront laissé faire, et nous retrouverons le débat bien connu : responsable/coupable… Comment sera-t-il tranché ?
Vous avez aujourd’hui une lourde responsabilité. Et si vous ne l’assumez pas, c’est vous qui serez accusés demain d’avoir été les promoteurs de cette situation. Y compris dans l’intérêt des partisans des OGM, pour défendre ceux qui veulent les mettre en place, il vous appartient de fixer un cadre, le plus clair et le plus restrictif possible.
M. Pierre COHEN : Je croyais que l’on n’avait pas le droit de produire des OGM en France et que la tolérance s’arrêtait aux recherches en laboratoire et aux essais en champ, eux-mêmes soumis à autorisation. A croire José Bové, tout un chacun aurait le droit en produire librement, dès lors que la semence est dans le catalogue. C’est pour moi une réelle surprise.
Marion Guillou nous a fait part de la vive inquiétude des chercheurs. Ils affirment qu’il n’est pas possible d’aller plus loin dans la connaissance scientifique du problème sans essais en champ, alors que vous soutenez qu’il existe suffisamment de moyens en amont pour s’en passer ! Qu’il faille poser des préalables, nous en sommes tous d’accord. Mais quels doivent être ces préalables au-delà de ce qui est déjà requis ? Qu’il faille lancer le débat, c’est évident : Marion Guillou et Guy Riba ont très honnêtement reconnu le rôle moteur que vous avez joué à cet égard en 1996. Je n’irai pas jusqu’à poser la question sous l’angle sociétal, comme l’a fait le rapporteur mais n’y a-t-il pas un réel danger, en décourageant les chercheurs – car ils sont découragés – de nous couper d’une connaissance qui pourrait permettre à la France et à l’Europe de se prévaloir de leur capacité d’expertise pour peser dans les instances mondiales ?
« Nous avons suffisamment d’informations ailleurs », avez-vous dit. En tant que scientifique, je ne peux me satisfaire de tels arguments. Le chercheur a toujours intérêt à avoir sa recherche propre, ne serait-ce que pour combattre de ce l’on veut combattre à l’extérieur. Se servir de la connaissance que les autres veulent bien vous donner, c’est inévitablement courir le risque d’être manipulé.
M. André CHASSAIGNE : José Bové a parlé des conséquences de l’utilisation des OGM sur l’alimentation mondiale. En fait, l’arme alimentaire est d’ores et déjà utilisée par les cinq grands groupes qui dominent le monde, avec une force d’appropriation énorme et tout un arsenal de techniques d’avant-garde. Mais doit-on pour autant mélanger le combat, à mes yeux légitime, contre le capitalisme alimentaire et la question de la recherche sur les OGM ? Avec ou sans OGM, la question de l’arme alimentaire ne se pose-t-elle pas en fait dans les mêmes termes ? Ce rapprochement n’est-il pas quelque peu artificiel ?
D’un autre côté, les pays en voie de développement sont, chacun le sait, dans une situation critique sur le plan alimentaire. On nous a parlé hier, par exemple, d’un « riz doré » transgénique enrichi en provitamine A qui permettrait de lutter contre les famines et les carences vitaminiques. Est-ce une bonne chose de bloquer ce type de recherche ?
On nous promet également des riz qui pourraient être produits en économisant 41 % d’eau et qui pourraient constituer une réponse au réchauffement climatique. On sait que des pays entiers qui autrefois avaient des cultures vivrières ne sont plus en mesure aujourd’hui de produire leurs propres vivres, du fait du réchauffement climatique. Si la transgénique permettait de leur donner les moyens de subvenir à leurs propres besoins, cela ne mériterait-il pas d’être pris en compte ? Votre attitude n’est-elle pas en contradiction avec certaines des positions que vous défendez ?
M. Guy KASTLER : Il n’est pas normal qu’un paysan conteste un chercheur. Guy Riba était partie civile au procès de Foix. C’est un homme parfaitement honnête avec qui on peut discuter. Lorsque nous lui avons demandé s’il savait qu’il y avait des ruches à moins de deux kilomètres de l’essai en cause, il a répondu qu’il n’était pas au courant… Cela signifie que l’interpellation des chercheurs par la société civile est indispensable. Nous connaissons le terrain et nous sommes en droit de leur poser des questions.
A côté de l’expertise officielle, on trouve quantité de chercheurs de la recherche publique – dont certains ont été licenciés – et de chercheurs indépendants. Jusqu’à la semaine dernière, avec le séminaire de la CGB, l’expertise officielle ne parlait pas de l’instabilité génétique. Il suffit de lancer un moteur de recherche pour savoir que tout le monde est au courant depuis des années… Grâce à l’Internet notamment, la société civile a accès à toutes ces recherches. Certes, elles ne sont pas estampillées « Académie des sciences », mais ce que dit l’Académie des sciences sur les OGM, je préfère ne pas le commenter… En tant que citoyen lambda, en tant que paysan, j’ai accès à d’autres informations scientifiques et je suis en droit de poser des questions auxquelles les chercheurs doivent répondre. Le problème aujourd’hui n’est pas de faire des essais en milieu ouvert, mais de répondre à nos questions de fond. Dans le secteur de l’amélioration végétale, on n’embauche quasiment plus que des biologistes moléculaires depuis vingt ans. Faisons-les travailler sur des questions de fond et non sur des brevets !
Vous avez évoqué le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection des inventions biotechnologiques. Lisez le texte de l’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il est proposé de le modifier : « La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé… » Et l’article L. 613-2-3 : « La protection conférée par un brevet… s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. » Autrement dit, la semence du paysan qui ressème sa récolte sera elle-même protégée ! Et si ma récolte est contaminée, appartiendra-t-elle à celui qui l’aura contaminée ? Voilà les dispositions adoptées par le Sénat que l’on vous demande de voter !
Au surplus, qui dit brevet dit protection du secret industriel. Faire connaître l’intégralité de la construction transgénique brevetée revient à livrer son secret industriel. De fait, les constructions transgéniques des variétés brevetées ne figurent jamais intégralement dans les répertoires officiels, ce qui pose un problème de loyauté commerciale, mais surtout interdit toute expertise indépendante puisque seuls les experts officiels – et encore ! – les experts de la CGB n’ont pas les séquençages complets. Ils ne sauront donc pas si des gènes baladeurs sont allés se fixer ailleurs. Et un laboratoire indépendant ne pourra rien chercher, puisqu’il n’aura pas la construction originelle. Le système du brevet revient à confisquer définitivement toute possibilité d’expertise indépendante et, du même coup, toute possibilité de contestation par la société civile. Vous aurez définitivement escamoté tout débat scientifique réel sur l’instabilité génétique et les risques qui en découlent.
M. José BOVÉ : L’Organisation mondiale de la santé elle-même s’est inquiétée du risque de voir développer une variole génétiquement modifiée, alors même que cette maladie a été totalement éradiquée de la planète. Et tout cela pour étudier le potentiel de la variole comme arme de destruction massive ! Cela rejoint ce qui a été dit sur les plantes médicamenteuses. Il y a là des bombes à retardement. Nous n’avons jamais remis en question la transgénèse en tant qu’outil de recherche, mais seulement son utilisation pour un produit fini.
Le « riz doré » a été l’occasion d’une véritable escroquerie qui n’est du reste pas le fait des chercheurs. Il suffit de demander quelle quantité de « riz doré » il faut ingurgiter chaque jour pour tirer le bénéfice attendu de cette modification génétique : autour d’un kilo de riz sec par jour !
M. Francis DELATTRE : Les chiffres que l’on nous a donnés hier sont nettement inférieurs : entre trois et six cents grammes.
M. José BOVÉ : Je vous mets au défi de manger trois cents grammes de riz sec – avant cuisson – par jour !
M. Guy KASTLER : Les carottes, c’est mieux !
M. José BOVÉ : Les paysans du Tiers-Monde ont déjà été privés de leurs moyens de production du fait de la logique des cultures industrielles, des lois de l’OMC et du dumping des Etats-Unis et de l’Europe. Maintenant, on veut leur donner du « riz doré » pour compenser ce qu’ils ne peuvent plus produire par notre faute… Même chose pour l’histoire des ailes de poulets, que l’on fait manger aux Africains, ce qui a détruit en quelques années tout l’élevage de l’Afrique de l’Ouest ! Nous sommes tombés dans un système absurde, cinglé, invraisemblable !
M. le Rapporteur : Et si l’on trouve un jour une variété de « riz doré » acceptable ?
M. José BOVÉ : On invoque aussi la consommation d’eau. Limagrain travaille sur un maïs qui consommerait moins d’eau. Les Africains savent que cela existe depuis toujours : cela s’appelle le sorgho. Pourquoi ne pas travailler à l’amélioration du sorgho ? Un des « faucheurs volontaires » est chercheur au CIRAD12. On lui a demandé d’améliorer le rendement du sorgho. Il a trouvé un sorgho parfait. Malheureusement, il mettait trois fois plus de temps à cuire
– autrement dit, il fallait trois fois plus de bois. Cela n’avait aucun sens ! C’est à toutes ces questions qu’il faut faire attention au moment d’expertiser un produit fini.
Ce dont ont besoin la majorité des paysans de cette planète, c’est d’avoir la capacité de nourrir leur famille à partir de leur propre production, de leurs propres semences, de leurs propres modes agraires – qu’il faut préserver. Il faut donc mettre des freins à la logique du dumping qui ne cessent de s’étendre. On compte plus de 150 000 variétés de riz différentes dans le monde. La logique d’une firme comme Monsanto est de lancer une production de masse sur quatre ou cinq variétés de riz transgénique pour obtenir un maximum de retour sur investissement. Or, dans le champ du paysan, les semences se reproduisent sexuellement, donc gratuitement. Et cela, un marchand ne peut pas le supporter.
M. Francis DELATTRE : Je conçois parfaitement qu’un paysan soit libre de ressemer ses propres graines. Mais vous-même posez le problème de la dissémination ; le gène dit « Terminator » qui a provoqué, à juste titre, un véritable scandale, avait précisément pour but d’éviter la dissémination… Parlant du colza transgénique, vous affirmez que le risque de contamination a été démontré en laboratoire, ce qui est vrai. Mais l’essai en plein champ a précisément l’intérêt de s’assurer du risque non plus théorique, mais réel, et les études, conduites, elles aussi par des gens sérieux, montrent que la dissémination est très relative.
Du reste, quel problème poserait la présence de ce colza modifié pour résister aux herbicides ? Son principal intérêt est de permettre à l’agriculteur de recourir à un herbicide généraliste, le glyphosate, tombé dans le domaine public, et donc beaucoup moins cher que les désherbants sélectifs classiques qu’il faut passer à trois ou quatre reprises. Soit un coût de 50 francs à l’hectare au lieu de 900 à 1 000 francs avec un colza traditionnel – mes références sont antérieures à l’avènement de l’euro.
L’intérêt des OGM n’est pas tant d’améliorer les rendements que de réduire les coûts de production. S’y ajoute un intérêt sanitaire, puisque le maïs génétiquement modifié, par exemple, détruit lui-même la pyrale et la chrysomèle. Or si votre argument sur le franchissement de la barrière des espèces ne m’a pas convaincu, il est une chose dont je suis certain, c’est que l’accumulation des pesticides dans l’eau et l’alimentation est cause de bon nombre de cancers. J’en viens à penser que la réconciliation de l’agriculture et de la société passera par les OGM et que vous devriez en être les premiers supporters !
Le problème des semences se pose d’ores et déjà avec les hybrides. L’amélioration des rendements depuis cinquante ans est due, pour une large part, à la recherche variétale. Le créateur d’une nouvelle variété est donc légitimement fondé à espérer un retour sur investissement, faute de quoi personne ne se consacrerait à l’amélioration variétale.
Nous sommes, par exemple, particulièrement intéressés à la production de biocarburants. Or nous avons besoin d’améliorer le rendement du colza en biocarburant pour que cette filière devienne compétitive, sous peine de voir notre marché envahi par la concurrence, notamment du Brésil.
M. Philippe FOLLIOT : Je rends tout d’abord hommage à votre détermination. J’ai du reste suivi avec intérêt le combat qu’avait mené en son temps José Bové contre la taxation du roquefort par les Américains…
Si les OGM amènent à se poser des questions, il est d’autres sujets d’ordre environnemental sur lesquels nous avons d’ores et déjà beaucoup plus de certitudes : les gaz à effet de serre, le bromure de méthyle, l’utilisation des pesticides, etc.
Je me félicite de votre présence ici. Toute conviction mérite d’être défendue et chacun a le droit d’en exprimer, d’autant que je n’ai aucun a priori pour ou contre les OGM. Mais, en tant que parlementaire, l’idée de désobéissance civique me choque profondément. Je ne saurais partager ces méthodes, si légitime que soit la cause défendue. Nous avons connu les commandos anti-avortement qui venaient jusque dans les hôpitaux agresser les médecins ou les jeunes femmes !
Sur le fond, vous avez déclaré avoir une vision non pas nationale, mais bien européenne, voire mondiale. Nul ne peut vous reprocher la constance de vos positions européennes mais irez-vous faucher volontairement en Espagne, où les cultures d’OGM couvrent déjà 70 000 hectares ?
M. José BOVÉ : C’est prévu pour l’été prochain !
M. Philippe FOLLIOT : Mais surtout, qu’entendez-vous faire pour que ce problème soit abordé à l’échelle continentale ? On ne résoudra rien par des dispositions prises seulement en France, sans garde-fous dans les pays voisins. Que la France prenne la tête de combats hautement symboliques, comme elle l’a fait pour l’Irak, je n’ai rien contre mais si nous sommes les seuls à nous imposer des contraintes, ne craignez-vous pas que, loin de régler le problème, nous n’aboutissions qu’à nous pénaliser nous-mêmes ?
M. François GROSDIDIER : Si votre action a eu le mérite, il y a quelques années, de médiatiser le problème des OGM, on a plutôt l’impression désormais que, plus on en parle, plus la confusion s’accroît. En vous écoutant, j’ai cru un moment que le présupposé l’emportait sur les considérations techniques…
Pourquoi opposer systématiquement l’agriculture industrielle et l’agriculture qui sert à l’alimentation ? Le carburant mis à part, la finalité première de l’agriculture reste de produire des aliments, directement ou par le biais de la production d’herbivores. Cette dialectique ne me paraît pas de nature à éclaircir le débat, alors précisément qu’ici notre rôle consiste à nous forger la meilleure opinion possible en toute honnêteté intellectuelle.
Je vous ai entendu dire que la recherche n’était finalement pas nécessaire dans la mesure où elle ne répondait qu’à un seul objectif, la brevetabilité du vivant. Mais pour un établissement public, la première finalité de la recherche, ce n’est pas le brevet, c’est de trouver les bonnes réponses, en termes de sécurité sanitaire, à apporter aux populations. Par ailleurs, je croyais – mais peut-être me trompais-je – que le vivant n’était pas brevetable en France ni en Europe.
M. Guy KASTLER : C’est prévu dans le projet de loi.
M. François GROSDIDIER : Autrement dit, pour l’heure il ne l’est pas. En revanche, les recherches sont indispensables.
Vous mettez fortement en cause l’indépendance de l’INRA. Certes, l’INRA est lié par des conventions avec des opérateurs privés. Mais, outre le fait qu’il s’est doté d’un comité d’éthique et que ces questions sont largement débattues au sein de ses différentes instances, il me semble que l’INRA évite soigneusement de mélanger les intérêts publics et privés.
La question se pose alors de savoir si l’INRA est effectivement à même de nous donner des réponses capables de nous éclairer au regard de l’intérêt public ou bien si nous devons considérer ces résultats comme intrinsèquement viciés et nous mettre en quête d’une autre instance d’expertise réellement indépendante. Au-delà du procès d’intention, avez-vous des éléments précis qui pourraient nous faire douter de son indépendance ? Progressivement, votre action en est venue à dissuader, à croire les chercheurs, toute recherche publique dans le domaine des OGM. Pour ma part, je préfère m’en remettre aux résultats des expérimentations menées par l’INRA en France plutôt qu’à ceux que nous fournirait la recherche privée américaine.
Vous mésestimez totalement les avantages que présenteraient les OGM en terme de moindre utilisation des pesticides. L’enjeu de santé publique est suffisamment important pour prendre la peine, qu’il s’agisse des OGM ou de l’agriculture traditionnelle, de faire un honnête bilan coût/avantages…
Enfin, prétendre que les OGM n’auraient aucun intérêt économique pour le paysan n’a pas de sens. Si tel était le cas, le problème serait d’ores et déjà réglé ! Dans une économie de marché, un acteur économique n’est jamais obligé de faire un geste dont il ne tire aucun avantage. Les OGM présentent forcément un intérêt économique pour celui qui l’achète, sinon, il n’en achètera pas. Reste maintenant à savoir s’ils ont un intérêt public.
M. le Président : Nous pourrons inviter la Confédération paysanne à participer à nos tables rondes contradictoires où les avis pourront se confronter.
M. Guy KASTLER : La liberté économique de l’agriculteur a précisément disparu depuis l’avènement des hybrides, puisqu’il lui est interdit de faire ses propres semences. Il existe du maïs bio en France, mais il est tout simplement illégal, parce qu’une variété « population »
– c’est-à-dire une variété non hybride permettant, contrairement aux hybrides, de ressemer le grain récolté et d’avoir ensuite une belle récolte – ne peut pas être inscrite au catalogue. Or il nous faut précisément, en bio, des variétés naturelles, diversifiées et capables d’évoluer pour nous passer d’intrants chimiques et nous adapter aux changements climatiques. Les hybrides ont été mis en place justement pour entraver la liberté économique par le fait qu’ils ne peuvent pas être ressemés. Et c’est l’INRA qui les a introduits et qui a mis en place la réglementation catalogue ! Il faut modifier cette législation.
Pour ce qui est des rejets de pesticides, un champ de maïs Bt produit au minimum dix mille fois plus de toxine Bt qu’un agriculteur qui traite intensivement ! Les consommations d’insecticides et de désherbants avaient effectivement diminué aux Etats-Unis. Mais au bout de quelques années, elles sont remontées au niveau du début. Et la quantité de toxine libérée dans l’environnement ne cesse d’augmenter, puisqu’elle est désormais produite par la plante. Quant à manger du maïs Bt, je vous en laisse la responsabilité… Demandez à la chrysoperla ce qui lui arrive !
Quant au maïs « Terminator », il a lui aussi la faculté d’aller contaminer par son pollen le maïs du voisin et le rendre infertile. On prétend mener actuellement des recherches sur des plantes capables de produire des lipases gastriques. Une lipase est une enzyme qui détruit les lipides, y compris les lipides des graines au moment de la germination… Autrement dit, les tests sur les plantes à lipases sont en fait des tests « Terminator » ! Et il n’y en a pas qu’aux Etats-Unis, mais également en France…
Une étude sur les sojas résistants aux désherbants a mis en évidence une baisse de la résistance au Fusarium – un champignon qui se fixe sur les racines et rend la récolte toxique – et une baisse de la capacité de la plante à mobiliser elle-même l’azote – ce qui oblige à augmenter les apports d’azote.
Nous nous posons des questions de recherche fondamentale mais la recherche fondamentale n’est pas financée par les firmes. Un chercheur INRA est habillé par l’INRA, on lui paie son stylo, mais même pas son essence ! Pour financer ses recherches, il va devoir passer des contrats, faire de la recherche appliquée et déposer des brevets. Mais il n’a pas intérêt à publier ses résultats de recherche fondamentale, ni à en faire la publicité, au risque de remettre ses brevets en question.
M. Olivier KELLER : Nous connaissons au Canada mille agriculteurs biologiques qui ne peuvent plus produire de bio à cause du colza. Une étude réalisée dans le cadre de l’ALENA a montré que 0,7 % des maïs autochtones mexicains étaient pollués à cause des plantations transgéniques ! Quel droit à exister reste-t-il pour ceux qui ne veulent pas aller dans ce sens ? Quel espace leur reste-t-il pour s’exprimer ? L’implantation des OGM, sur le plan économique, comme sur le plan environnemental, procède d’une logique totalitaire.
M. José BOVÉ : Lors d’un procès à Auch pour un fauchage de champ, Monsanto, partie civile, était venu à la barre expliquer que, grâce au maïs Roundup Ready, on utilisait moins d’herbicide et que c’était un formidable progrès. Le président du tribunal, homme de bon sens car ancien président du tribunal de commerce, lui a aussitôt répondu : « Vous êtes une firme commerciale, pas une organisation philanthropique. Pourquoi nous faire toute cette propagande en expliquant que votre maïs permettra d’utiliser moins d’un produit que vous vendez également ? Cela n’a aucun sens économique ! » Le représentant de Monsanto a reconnu que le but était de vendre la plante et le traitement qui allait avec, et surtout pas d’acheter le produit de traitement du voisin, qui ne serait plus compatible avec ce maïs génétiquement modifié… Il y a là une cohérence économique évidente.
M. François GROSDIDIER : Ce raisonnement ne vaut qu’un temps. Ce que Monsanto ne fait pas, un concurrent le fera. Tant qu’on n’est pas en situation de monopole…
M. José BOVÉ : Précisément : on assiste à une concentration drastique des détenteurs des variétés végétales sur la planète. C’est un véritable problème de fond auquel les politiques doivent être sensibles. Lorsque quatre ou cinq firmes privées internationales contrôleront toutes les semences, que pourra-t-on faire ? Monsanto détient déjà plus de 60 % des variétés de maïs de la planète. Nous sommes déjà dans une situation de monopole, et celui-ci est encore plus accentué dans les OGM.
Dès lors qu’un OGM fabrique un produit toxique, insecticide ou herbicide, pourquoi n’applique-t-on pas une logique d’autorisation de mise sur le marché ? Compte tenu des risques de toxicité notamment, il est invraisemblable de rester dans le flou de l’OMC et de sa définition des « produits équivalents ». C’est au nom de ce principe que l’on a tenté de faire entrer le bœuf aux hormones en Europe en alléguant qu’il était équivalent au bœuf à l’herbe... Heureusement, l’Europe a su résister. Pour les OGM, c’est la même chose. Ce ne sont pas des produits équivalents.
Plus on avance, plus c’est confus, dites-vous. Je le constate moi aussi chaque jour : les problèmes posés, particulièrement sur le plan scientifique, sont de plus en plus complexes. Et si la complexité augmente, il faut prendre du temps pour réfléchir au lieu d’avancer à l’aveuglette en transformant le champ du paysan en paillasse de laboratoire. C’est un vrai débat, un débat sérieux, fondamental. Cet été encore, les chercheurs de l’équipe de Jacques Monod, qui avait reçu le prix Nobel en 1965, nous confessaient qu’ils avaient à l’époque une vision restrictive de la biologie moléculaire et qu’il leur fallait aujourd’hui revisiter la totalité de leurs travaux. Tout simplement parce que le vivant, ce n’est pas mécanique. Voilà un vrai débat de recherche fondamentale sur lequel il est nécessaire d’avancer, et plus vite qu’on ne le fait aujourd’hui.
On nous demande ce que nous proposons au niveau européen. Nous ne sommes pas des politiques, ne mélangeons pas les rôles. Il est vrai qu’un débat s’impose au niveau européen, à voir la distance qui sépare l’Espagne – favorable, jusqu’au changement de majorité – de l’Autriche – totalement réfractaire aux OGM – ou de l’Italie, plutôt opposée. Il semblerait que les ministres espagnols de l’agriculture et de l’environnement veuillent remettre le sujet sur la table, tout comme les organisations de consommateurs et d’agriculteurs. Et à vingt-cinq, il faudra avancer encore davantage et ce sera très compliqué.
Nous avons déjà parlé de l’indépendance de l’INRA. Se pose particulièrement la question de sa participation à Génoplante dont le but déclaré est de déposer des brevets. Et lorsqu’un des partenaires de Génoplante s’est retrouvé absorbé par une entreprise qui n’était plus française, il a fallu changer au plus vite les statuts de Génoplante pour éviter qu’une firme étrangère ne s’en retrouve actionnaire principal de cet organisme mixte public/privé… Participer à la course aux brevets, c’est prendre le risque de perdre son indépendance. On a admis pour le nucléaire le principe de laboratoires indépendants – voyez la CRIIRAD. Il serait cohérent de faire de même pour les OGM. Cela fait partie du jeu démocratique. Il faudrait que des laboratoires indépendants puissent refaire ce qui a été fait par des laboratoires de firmes privées.
Enfin, si nous avons fait acte de désobéissance civique, c’est parce que la mise en place des OGM, telle qu’elle s’est effectuée jusqu’à présent, va à l’encontre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui, par extension et jurisprudence, dispose que chacun a droit à en environnement sain pour lui-même et pour sa famille. La prolifération des OGM va à l’encontre de ce droit. Par ailleurs, nous avons clairement assumé nos actes, à visage découvert, en arguant de l’état de nécessité, lequel, face à un risque grave et imminent, autorise un individu à agir, au besoin en dehors de la loi. Cela dit, nous avons toujours assumé les conséquences de nos actes et nous n’avons jamais fait usage de violence à l’encontre des personnes. C’est pourquoi je ne peux accepter la comparaison avec les commandos anti-avortement qui s’en prenaient physiquement à des personnes et ont attenté à leur liberté de penser au motif qu’elles ne partageaient pas leurs convictions religieuses et philosophiques. Nous n’avons rien à voir avec ce genre d’individus, nous l’avons de nouveau montré à l’occasion du débat sur le voile et la laïcité. Il est du reste heureux que cette discussion arrive le jour anniversaire de la loi Veil, dont on ne peut que féliciter le Parlement de l’avoir adoptée.
M. le Rapporteur : Je vous remercie pour la qualité de ces échanges qui se seront déroulés dans un climat de respect mutuel.
Audition de M. François LUCAS,
président de la Coordination rurale – Union nationale
(extrait du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Je vous informe que notre mission d’information s’intitule désormais « mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés ». La Conférence des Présidents a accédé à la demande que nous avions faite au Président Debré d’élargir notre champ de compétence.
Nous accueillons M. François Lucas, président de la Coordination rurale - Union nationale.
M. François LUCAS : Avant d’en venir aux questions assez exhaustives qui m’ont été adressées, j’exposerai les raisons pour lesquelles la société en est arrivée à s’interroger sur les organismes génétiquement modifiés, qui nous sont familiers depuis près d’une dizaine d’années.
Tout part d’une ambiguïté. Les semenciers promoteurs des OGM, au départ, laissaient entendre que cette technologie produisait des semences ordinaires, seulement pourvues d’un petit « plus ». Mais la Coordination rurale et les agriculteurs, après information sur cette technique, ont considéré qu’une semence manipulée en insérant dans des cellules des gènes étrangers à l’espèce dont elles étaient extraites n’avait plus grand-chose à voir avec un produit que l’on puisse qualifier d’« authentique ». Pour nous, un maïs, un soja ou un riz génétiquement modifié n’est plus un maïs, un soja ni un riz. La production d’OGM a pourtant été présentée comme une simple variante de la sélection, et certains ont été jusqu’à affirmer que cette pratique datait des origines de la génétique, voire de celles de l’agriculture ! C’est ainsi que, vers 1995, des parcelles d’essais ont été ouvertes pour le maïs, et plusieurs années ont passé avant que soient prises des précautions sérieuses, tant autour de ces essais qu’en matière d’information et de suivi, notamment dans la loi d’orientation agricole de 1999. Les inquiétudes suscitées par ces créations – ou ces créatures – chez certains scientifiques, ainsi que chez les agriculteurs, chez les consommateurs et dans la société tout entière, n’ont cependant jamais été levées. Ainsi les essais en plein champ sont-ils très souvent détruits, l’opinion publique étant, vis-à-vis de ces actions, partagée entre l’approbation au titre du principe de précaution et le malaise face au mépris affiché pour la légalité.
Outre les problèmes d’ordre agricole, plusieurs questions restent sans réponse de la part des autorités scientifiques. L’innocuité des organismes génétiquement modifiés dans la chaîne alimentaire n’a pas été démontrée. L’instabilité de ces plantes dans l’environnement a été prouvée, leur séquence génétique n’étant pas toujours conforme à celle déclarée par leurs inventeurs. Les aliments issus des manipulations génétiques n’ont pas été expérimentés sur des animaux de laboratoire.
Certains points particuliers éveillent pourtant une suspicion de risque, comme, par exemple, les effets des plantes OGM résistantes aux herbicides totaux, lesquels ne sont pas homologués pour entrer dans la chaîne alimentaire. Lorsque du maïs tolérant au Roundup est consommé, que deviennent les molécules de glyphosate ? De même, les effets dans l’alimentation du gène Bt – Bacillus thurigiensis – sécrété par certains maïs OGM font-ils l’objet de recherches ? Et quelles sont les conséquences annexes sur l’équilibre naturel général lorsqu’une plante acquiert la faculté de résister à tel insecte, tel lépidoptère ou tel herbicide ? La nature se réorganise en donnant naissance à des plantes, à des insectes ou à des champignons résistants, et cet aspect n’a guère été étudié. Si la technologie des OGM est vulgarisée, on pourra se retrouver avec une infinité de plantes génétiquement manipulées. Comment se comporteront ces cocktails de gènes libérés dans la nature ? Comment les organismes de contrôle pourront-ils en dresser l’inventaire ? Enfin, certaines manipulations génétiques semblent allergènes et je ne crois pas que cela ait fait l’objet de recherches poussées.
Il convient de répondre à toutes ces questions avant de manipuler le fraisier, le peuplier, le noisetier, la vigne, le maïs ou le blé, et avant d’autoriser les essais en plein champ, sans quoi l’on risque de laisser libre cours à une dissémination irresponsable.
Notre syndicat est opposé aux essais en plein champ car le risque de dissémination est parfaitement avéré. Des distances de sécurité de quelques dizaines ou même centaines de mètres sont inacceptables : songez que certains vents, en Charente, charrient des sables provenant du Sahara et qu’il existe d’autres vecteurs potentiels, comme le gibier ou les abeilles. Il y a quatre ans, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté sur la présence d’OGM dans des semences de maïs, et en a relevé des traces dans 40 % des lots analysés. En outre, quand les semenciers prétendent qu’ils ne peuvent se passer des essais en plein champ, ils oublient de dire que le comportement des variétés concernées est connu, puisque l’on se contente de greffer sur des plantes standard un gène possédant un caractère particulier supplémentaire. Du reste, les essais sont conduits sur de très faibles volumes, pendant un ou deux ans, et dans un lieu donné, ce qui ne permet pas de tirer des conclusions générales sur le comportement de la variété. Des scientifiques disent qu’il est parfaitement possible de reproduire en laboratoire les conditions variables que rencontreront ces variétés sur le terrain, à l’instar de ce qui se fait pour les essais nucléaires, même si cela coûte plus cher. Nous sommes donc partisans de l’expérimentation en atmosphère contrôlée, qu’il s’agisse d’OGM à des fins alimentaires ou médicamenteuses – comme en 1983 ou 1984, lorsque furent cultivés sous serre des plans de tabac génétiquement modifié pour produire une protéine médicamenteuse qui coûtait très cher à reproduire en chimie de synthèse.
M. le Président : Vous venez de prononcer un plaidoyer en faveur d’expérimentations en milieu confiné, contrairement à l’INRA, qui les juge insuffisantes. Mais quel intérêt voyez-vous à la poursuite d’expérimentations, même en milieu confiné, si vous êtes opposé à la culture en plein champ ?
M. François LUCAS : Notre position n’est pas binaire : nous ne sommes ni pour ni contre les OGM, nous estimons simplement que leur culture en plein champ, en l’absence de certitudes scientifiques, ne doit pas être vulgarisée, et nous demandons que plusieurs questions importantes fassent l’objet de recherches indépendantes approfondies. Il est scandaleux, à cet égard, que les dix dernières années aient été perdues à essayer de faire passer les OGM en force.
M. le Président : Mais à quoi servirait-il de cultiver quelques plants sous serre quand 70 millions d’hectares sont déjà exploités dans le monde ? Estimez-vous que le gouvernement devrait se battre pour faire interdire la culture des OGM dans tous les pays ?
M. François LUCAS : Ce serait un beau combat, mais je doute qu’il soit gagnable. Par contre, il faut dresser une barrière continentale pour que l’Europe ne mette pas le doigt dans l’engrenage. Ce n’est pas parce que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud ont pris la responsabilité de cultiver des OGM que nous devons nous aligner sur elles. C’est une question de souveraineté, mais aussi de sécurité alimentaire. N’oublions pas, notamment, que depuis 1997, certains maïs du Sud-ouest de la France sont valorisés par le marché espagnol parce qu’ils sont non-OGM.
M. le Président : Pourquoi l’application sur un OGM d’un herbicide total comme le Roundup différerait-elle son utilisation dans un champ classique ? Par ailleurs, ne pensez-vous pas que l’utilisation des pesticides et des fongicides constitue actuellement l’un des problèmes principaux en matière de sécurité alimentaire ?
M. François LUCAS : Un herbicide total étant censé détruire toutes les plantes qu’il touche, il ne fait pas l’objet de recherches dans la chaîne alimentaire. Mais, dès lors que survivent des plantes sur lesquelles il a été pulvérisé, je m’étonne que son devenir ne soit pas étudié dans la plante qui a survécu.
M. le Président : De toute façon, il est présent dans le sol et par conséquent dans les repousses. C’est pour cela qu’on le retrouve d’ailleurs.
M. François LUCAS : Mais le glyphosate est actif uniquement par contact avec les feuilles. Quoique Monsanto ait longtemps présenté le Roundup comme l’herbicide « écologique » par excellence, absent dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, il convient de se montrer réservé car on trouve désormais des résidus de glyphosate dans les eaux.
Contrairement à ce que disent les promoteurs des OGM, ceux-ci ne dispenseront pas du recours aux herbicides. Ils déplaceront simplement l’usage vers d’autres matières actives. J’aurai cependant l’honnêteté de dire que je ne partage pas le jugement des détracteurs des OGM traités au Roundup qui prétendent qu’on utilise finalement plus d’herbicide qu’avant : ceux-ci requièrent effectivement des quantités importantes de produit, en deux ou trois passages, mais les herbicides sélectifs sont beaucoup plus nocifs pour l’environnement. Car il ne faut pas simplement s’attacher au poids total d’herbicide mais aussi à la nature de la matière active. Il est parfois moins nocif d’employer une plus grande quantité de matière moins nocive qu’une plus petite très nocive. Quoi qu’il en soit, si des plantes deviennent résistantes au glyphosate, on aura fait une fois le tour du cercle vicieux et on sera revenu à la case départ. On a déjà connu, par le passé, des herbicides miracles, l’atrazine et la simazine, qui ne laissaient debout que le maïs, mais, d’année en année, des mauvaises herbes résistantes sont apparues, au point que ces deux produits, devenus inefficaces, ont été interdits. Je vous donne un avis de praticien : faune, flore ou champignons, la chimie n’est jamais parvenue à venir définitivement à bout d’un problème. En médecine, le cas des antibiotiques est similaire.
M. le Rapporteur : S’agissant des expérimentations en plein champ, ne menez-vous pas un combat d’arrière-garde, sachant que l’Espagne se lance dans des cultures qui seront sources de dissémination ? Par ailleurs, selon les conclusions du « projet Bright », mené en Angleterre durant quatre ans, le colza et la betterave génétiquement modifiés préserveraient la biodiversité, et les écologistes préconisent maintenant des études en plein champ.
M. François LUCAS : La préservation de l’authenticité naturelle, à mon sens, n’est pas un combat d’arrière-garde. Un homme a créé l’agriculture, un jour, il y a 13 000 ans, en semant une graine, mais cela ne justifie pas que l’on redéfinisse les règles de la nature et que l’on transfère les caractères d’un animal à un végétal sans se poser de questions. Il est de surcroît inacceptable, par principe comme par souci de protéger les générations futures et la planète, de l’imposer à ceux qui n’ont rien demandé. Que les Espagnols avancent rapidement ne constitue pas une raison suffisante pour s’incliner et pour s’exposer à tous les dangers – je note d’ailleurs qu’aucune compagnie d’assurances au monde ne consent à couvrir les risques encourus par les créateurs d’OGM. On réinventera la nature en créant de nouvelles espèces à l’infini, par combinaisons : quel progrès pour la biodiversité ! Plus sérieusement, il est à craindre que les semenciers, par le biais du brevetage, ne s’emparent de la maîtrise de la biodiversité.
M. le Rapporteur : L’information que donne la presse sur les OGM vous paraît-elle objective ?
M. François LUCAS : La presse présente malheureusement le problème de façon binaire : elle est soit pour, soit contre les OGM. Le sujet est relativement difficile à comprendre pour le non-initié mais les médias n’ont guère accompli d’efforts de vulgarisation.
M. André CHASSAIGNE : Dans son communiqué, votre organisation « demande que des moyens importants soient consacrés aux OGM par la recherche publique afin de disposer d’informations fiables qui soient diffusées en toute transparence et hors de la pression des organisations économiques ». Mais la plupart des chercheurs nous confient qu’ils doivent sortir du milieu confiné pour mener leurs travaux, et nombre d’entre eux sont découragés par les fauchages et abandonnent la recherche. Qu’en pensez-vous ? Quelle est votre position sur ces fauchages ?
M. François LUCAS : Nous nous opposons aux essais en plein air parce que les conséquences de la dissémination restent mal connues. Mais peut-être, dans l’avenir, s’avéreront-elles dénuées de danger. Avant de se décourager, pourquoi la communauté scientifique ne nous donne-t-elle pas les réponses à nos questions ? J’appelle de mes vœux un effort considérable en faveur de la recherche indépendante, c’est-à-dire surtout publique. Le monde scientifique nous semble globalement indépendant, hormis les spécialistes des biotechnologies, très souvent contraints de s’impliquer dans des programmes privés.
La Coordination rurale n’a jamais participé à des fauchages et sa position sur le sujet est très réservée : nous ne jugeons pas les faucheurs mais nous observons, en ce qui concerne le maïs, qu’ils ont toujours agi après la floraison, c’est-à-dire après la dissémination du pollen… A chacun ses responsabilités : nous pointons les problèmes ; que ceux qui autorisent les essais en assument les conséquences.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Je ne considère pas que votre combat est rétrograde, d’autant que vous affichez une position très mesurée, fondée sur le principe de précaution : la science, en termes économiques, environnementaux et sanitaires, ne nous apporte pas suffisamment de garanties. Des expériences ont-elles été menées dans votre région ? Par des semenciers ou par des chercheurs ? Toujours dans votre région, y a-t-il eu des arrachages ? Quelles conclusions la Coordination rurale a-t-elle tirées de tout cela ?
M. François LUCAS : L’INRA n’est pas intervenu dans ma région, mais des essais y ont été conduits par des semenciers. Lors des derniers, qui ont eu lieu en 1999 à Longré en Charente, la Coordination rurale, avec d’autres organisations, y compris des associations de consommateurs, a créé un collectif intitulé « OGM, nous voulons savoir ». A l’époque, il n’y avait aucune transparence, mais nous avons rencontré le prestataire de services du semencier et obtenu le dossier du ministère de l’agriculture. Il y était question de tests sur le comportement d’un maïs Bt face à la chrysomèle, lépidoptère d’Europe centrale, alors inconnu en France, et qui s’attaque aux racines des maïs. J’ai été un peu surpris par cette anomalie, mais on m’a répondu que c’était une erreur de « copier/coller », et notre collectif de bénévoles n’a pas enquêté davantage… Si cela vous intéresse, sachez que je détiens certainement encore le dossier dans mes archives.
M. le Président : Il serait en effet intéressant de demander au responsable de ces essais pourquoi il s’intéressait à la chrysomèle, qui était alors absente de France, contrairement à la sésamie. Je vous saurais gré de bien vouloir nous faire parvenir le dossier.
M. Francis DELATTRE : Les essais conduits sur le maïs Bt que la Commission européenne s’apprête à homologuer portaient bien sur la sésamie et la pyrale, et c’est à cause de la chrysomèle que le dernier agriculteur de ma circonscription, située à proximité de l’aéroport de Roissy, se voit interdire de produire du maïs depuis deux ou trois ans. Mais en quoi la dissémination est-elle si redoutable pour notre maïs ? En France, il n’existe guère de flore qui ressemble au maïs ; nous ne sommes pas au Mexique. Enfin, le glyphosate, entré dans le domaine public, est un herbicide généraliste au coût raisonnable, même s’il faut y ajouter certains adjuvants. Au lieu d’opter pour le modèle culturel consistant à utiliser trois ou quatre herbicides différents, coûteux et plus nocifs pour la santé que le glyphosate, n’est-il pas autrement intéressant, d’un point de vue économique, de produire du maïs génétiquement modifié ? L’intérêt ne réside pas dans l’amélioration des rendements, mais plutôt dans la diminution des coûts de production.
M. François LUCAS : J’ai cru comprendre que votre mission d’information ne s’intéressait pas seulement au maïs mais aux OGM en général. Le seul inconvénient de la dissémination du pollen du maïs, c’est que des agriculteurs peuvent produire malgré eux un maïs inconnu. En ce qui me concerne, je ne pratique pas l’agriculture biologique, mais j’ai choisi jusqu’à présent de ne pas cultiver d’OGM et je refuse qu’on puisse en trouver des traces dans ma production. Or l’enquête de la DGCCRF que j’ai évoquée démontre qu’il y a bien eu dissémination. Et les conséquences de la dissémination de gènes de colza seraient bien plus graves : s’il se croisait avec des ravenelles résistantes à l’herbicide total, ce serait une catastrophe pour les agriculteurs, voire pour la société.
M. Francis DELATTRE : Il suffirait d’employer un autre désherbant que le généraliste – il en existe déjà dans le commerce. Du reste, une étude de l’INRA a établi que la dissémination était possible mais très peu rare.
M. François LUCAS : Je ne suis pas chercheur à l’INRA mais agriculteur et fils d’agriculteur, et il m’a été donné de constater que la nature se réorganisait en permanence : on ne règle jamais un problème, on ne fait que le déplacer. A l’horizon de dix, vingt ou cinquante ans, le transfert à une plante indésirable d’un gène résistant au glyphosate constituerait un gros problème pour l’agriculture. La médecine humaine, avec les maladies nosocomiales et la résistance aux antibiotiques, paie très cher pour savoir que la nature n’est pas maîtrisable. En tant qu’agriculteur, mon intérêt économique est une chose, mais je suis aussi sensible au devenir de mon exploitation et à son transfert aux générations futures. C’est pourquoi il peut être préférable, pour l’instant, de continuer à employer des herbicides plus coûteux.
M. Louis GUÉDON : La résistance aux antibiotiques était connue dès leur découverte, il y a cinquante ans. Si les utilisateurs ont développé des résistances, c’est par un mauvais usage, à l’encontre des recommandations expresses des scientifiques. Or, en l’occurrence, les scientifiques travaillent sur les OGM et nous en parlent, tandis que les utilisateurs s’en méfient.
M. Pierre COHEN : Vous affirmez qu’il existe des risques tant qu’on ne maîtrise pas tout. Mais sous quelles conditions accepteriez-vous que l’on passe des essais en milieu confiné aux essais en plein champ ?
M. François LUCAS : La réponse incombe aux scientifiques. On a observé que les événements annoncés par les obtenteurs n’apparaissaient pas dans certains produits issus de plantes génétiquement modifiées, ce qui tend à démontrer que ces événements sont instables – à moins que les obtenteurs ne rendent pas publics les bons résultats. Les biologistes n’auraient pas besoin de suivre des cycles complets de reproduction pour obtenir des réponses rapides à cette question. De même, pourquoi n’avoir jamais soumis des rats de laboratoire à une alimentation issue de maïs résistant à herbicide par modification génétique ?
M. le Président : Cela vient d’être fait sur des rats de 90 jours, avec, d’ailleurs, des interprétations divergentes de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence européenne, car les comportements anormaux constatés ont été imputés par les uns à l’âge avancé des rats et par les autres à leur alimentation. Cette étude est décrite dans le dernier numéro de la revue de l’AFSSA.
M. François LUCAS : Elle a porté sur le dernier maïs présenté à la Commission européenne, le ZT-603, et non sur le Bt-11, qui est résistant à la pyrale. Quoi qu’il en soit, cela devrait faire partie du cahier des charges des semenciers.
M. le Président : L’AFSSA n’étant compétente que pour les autorisations de mise sur le marché, elle peut exclusivement tester des aliments susceptibles d’être consommés. Faute de cultures d’OGM destinées à l’alimentation, il ne peut pas y avoir d’essais. Or je note que vous proposez d’étendre les expériences sur les rats à des produits cultivés en champ ouvert.
M. François LUCAS : L’expérimentation des produits sur des rats de laboratoire devrait intervenir avant même l’exploitation en champ ouvert : il conviendrait qu’elle fasse partie du cahier des charges imposé aux semenciers pour l’homologation des semences modifiées issues de plantes cultivées sous serre.
M. le Président : Nous interrogerons à ce propos le représentant de la Commission des toxiques, que nous recevrons le mardi 14 décembre.
Monsieur Lucas, je vous remercie.
Audition conjointe de
M. Benoît LESAFFRE, directeur général du Centre de coopération internationale en recherche (CIRAD),
et de M. Philippe FELDMANN, délégué aux ressources biologiques
(extrait du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2004)
Présidence de M. Jean Yves LE DÉAUT, Président.
M. le Président : Messieurs, je vous remercie d’être venus devant notre mission dont le nouvel intitulé, depuis la Conférence des présidents de ce matin, est « Mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés ». Le Président Debré est convenu avec nous de l’intérêt d’élargir notre champ d’investigations à des domaines qui devraient vous intéresser, puisque votre institut se consacre à la recherche finalisée pour le développement, ce qui vous amène à nouer des rapports étroits avec les pays du Sud. Comment la problématique OGM est-elle étudiée au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ? Quels ennuis avez-vous pu connaître ? Quelle est votre position sur ce sujet ?
M. Benoît LESAFFRE : M. Feldmann qui est délégué aux ressources biologiques à la direction scientifique du CIRAD et moi-même avons préparé à votre intention une série de documents ainsi qu’un CD-ROM rassemblant toutes les informations présentées sur notre site Internet et qui décrivent l’ensemble de nos travaux dans le domaine des OGM. Nous avons toujours veillé à assurer le maximum d’informations sur ce que nous faisions, et c’est d’ailleurs peut-être ce qui a facilité la destruction de nos caféiers de Guyane…
M. le Président : Nous en avons entendu parler…
M. Benoît LESAFFRE : La mission du CIRAD, organisme de recherche finalisée pour le développement, est de contribuer au développement durable des régions tropicales et subtropicales, pour ce qui touche aux systèmes agricoles et agroalimentaires et aux filières de production agricole, mais également, et de plus en plus, aux acteurs et aux territoires eux-mêmes, en travaillant sur les questions rurales et environnementales. Notre approche est résolument intégrée et multidisciplinaire : sciences de la vie, sciences humaines et sociales, sciences pour l’ingénieur. Nos équipes de recherche ne sont pas organisées autour de disciplines comme au Centre national de recherche scientifique (CNRS) et dans les universités, mais autour de questions de recherche, en suivant trois axes : la production, la conservation et la transformation des produits, qui tiennent une large place dans la problématique de l’alimentation des pays du Sud ; la gestion des ressources naturelles et des milieux ; les organisations et les sociétés, car un système de production agricole dépend de la société et du contexte socio-économique.
Notre mandat au service du développement des pays du Sud et de l’outre-mer français, comme indiqué dans notre décret constitutif, se décompose en cinq points : recherche et expérimentations, appui aux institutions de recherche étrangère, information scientifique et technique, formation de Français et d’étrangers – nous avons en permanence 300 doctorants dans notre établissement ; enfin, nous contribuons à l’élaboration de la politique nationale et à l’analyse de la conjoncture scientifique internationale.
Pour mener à bien sa mission, le CIRAD dispose d’installations scientifiques importantes dans l’ensemble des départements d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, installations dont le rayonnement régional et international va croissant. Nous avons deux directions régionales en métropole, cinq dans l’outre-mer français, ainsi qu’une en Amérique latine et centrale et cinq en Afrique. A cela s’ajoutent des missions régulières en régions tropicales ou subtropicales à la demande des gouvernements, d’organisations multilatérales ou de nos partenaires.
Le CIRAD compte 1 850 agents dont 850 scientifiques – 530 en métropole et 320 hors métropole. Son budget opérationnel est de 160 millions d’euros dont 30 % en ressources propres. Il est à noter que les financements d’origine contractuelle proviennent de fonds nationaux et internationaux, privés et publics, et surtout européens. Le statut du CIRAD, établissement industriel public et commercial, est très différent de celui des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et sa part de ressources contractuelles est nettement supérieure. Cette caractéristique est certes une source de fragilité budgétaire mais elle renforce notre ancrage sur le terrain, dans la mesure où elle nous oblige à présenter des projets en partenariat répondant à des questions concrètes.
Remarquons enfin que, pour les pays du Sud, la question mise en avant depuis la convention internationale de 1992 sur la biodiversité est celle de la préservation des ressources génétiques, question plus générale et autrement plus importante à nos yeux que celle des technologies particulières de modification génétique.
M. Philippe FELDMANN : Le développement des pays du Sud, encore très dépendant des ressources agricoles et forestières, implique une gestion durable de leurs ressources naturelles, qu’il faut en premier lieu caractériser et analyser avant de développer de nouvelles variétés de plantes ou races d’animaux. Mais bien d’autres valorisations sont possibles.
Le CIRAD est logiquement conduit à étudier l’éventuel intérêt des techniques de la transgénèse pour les pays en voie de développement qui, très souvent, ont besoin d’augmenter leur production alimentaire tout en préservant leurs ressources naturelles, autrement dit leur environnement.
Les biotechnologies contribuent tout d’abord à l’amélioration des connaissances. La biologie moléculaire est d’abord un outil d’analyse, de diagnostic, d’identification et de caractérisation, et la génomique un outil particulièrement performant pour comprendre le fonctionnement du génome.
Les biotechnologies contribuent ensuite à l’amélioration, quantitative et qualitative, de la production, mais aussi de la santé animale et végétale. Elles peuvent enfin être utilisées à des fins de préservation, de réhabilitation de l’environnement – bioremédiation, dépollution –, ou encore pour reconstituer des milieux perturbés par les activités humaines.
Les biotechnologies ont encore un potentiel de développement très important dans les pays du Sud. Leurs applications – parmi lesquelles les OGM – soulèvent cependant des interrogations, auxquelles vient s’ajouter le débat de fond sur leurs impacts ainsi que sur l’identification et le partage des enjeux. Ce dernier aspect est particulièrement important au regard de notre rôle de collaboration avec les pays du Sud. Le but n’est pas de leur transférer les techniques du Nord mais d’arrêter des objectifs partagés, en adéquation avec leurs besoins. L’évaluation des impacts des OGM et le partage des objectifs et des enjeux sont à nos yeux deux questions prioritaires qui se posent à toute société face à toute innovation.
Les recherches du CIRAD utilisant la transgénèse ou les OGM ont d’abord pour objectif d’approfondir la connaissance du fonctionnement génétique des espèces tropicales afin de gérer plus efficacement les ressources biologiques. Les biotechnologies sont appliquées sur environ 25 espèces, très souvent pour des analyses de diversité ou encore pour mettre au point des méthodes de sélection par l’utilisation de gènes marqueurs. Pour ce qui est des OGM proprement dits, nous sommes d’ores et déjà parvenus à des réalisations significatives, qu’il s’agisse de la création de mutants d’insertion de riz – en collaboration avec d’autres partenaires publics et privés dans le cadre de Génoplante – afin de déterminer la fonction de chacun des gènes du riz ; de l’étude des gènes impliqués dans l’élaboration de la fibre chez le cotonnier afin de mettre au point des variétés mieux adaptées et de meilleure qualité ; ou encore d’analyses physiologiques sur l’hévéa afin de mieux comprendre les phénomènes déterminant la qualité du latex.
Nos recherches ont également pour but d’étudier l’application de la transgénèse aux productions du Sud lorsque l’intérêt le justifie, en travaillant sur divers procédés de transferts de gènes, en comparant les avantages des plantes transgéniques et les risques économiques, écologiques et sociaux que pourrait entraîner leur développement, en examinant enfin leur impact sur les milieux et leur intégration dans les systèmes de production. Parallèlement, et conformément à sa mission, le CIRAD contribue aussi par son action de formation à renforcer la capacité d’expertise des pays du Sud afin que ceux-ci puissent décider en toute connaissance de cause de la politique à adopter en la matière.
Nous travaillons également, en particulier sur le riz, à l’amélioration des techniques de transformation génétique en supprimant les gènes dits intermédiaires, pour éliminer, par exemple, une résistance aux antibiotiques, ou pour jouer sur la localisation du gène afin d’éviter qu’il ne s’exprime dans le pollen, les graines ou toute partie vouée à être consommée, ou encore pour développer l’inductibilité, c’est-à-dire faire en sorte que le gène – la production de toxine, par exemple – ne s’exprime qu’en cas de stress – en l’occurrence l’attaque d’insectes.
Autre objectif de nos recherches : maîtriser l’impact des plantes transformées sur l’environnement. C’était le but de notre essai de caféiers en Guyane, destiné à tester les flux de gènes et les impacts sur les abeilles, ou encore de nos essais en cours en Chine et en Afrique du Sud sur le cotonnier, destinés à tester les effets sur les insectes cibles et non-cibles et à vérifier l’intérêt économique des variétés transgéniques.
Un domaine moins connu, enfin, est celui des maladies animales tropicales, telles que la peste des petits ruminants ou la peste bovine, pour lesquelles nous avons pu mettre au point des tests de diagnostic et des vaccins dits recombinants grâce aux techniques de transgénèse.
Deux types d’essais sont entrepris par le CIRAD. Les essais en enceintes confinées, soumis au contrôle de la Commission du génie génétique (CGG), ont été pour la plupart menés en métropole sur le riz, le caféier, le cotonnier, l’hévéa, ou encore sur le bananier, en collaboration avec l’université belge, jusqu’en 2003. Les essais dits de dissémination, c’est-à-dire en champ, sont quant à eux soumis à l’autorisation de la Commission du génie biomoléculaire (CGB). Ce fut le cas d’un essai de cotonnier à Montpellier, stoppé en 2000, ou de l’essai de caféier en Guyane, détruit par des inconnus le 29 août dernier, et dont nous n’avons pu sauver que quelques plants remis en enceinte confinée. Nous participons également en Colombie, dans le cadre de Génoplante, à un essai de multiplication de semences des mutants d’insertion de riz, pour lequel nous avons demandé, sans y avoir été tenus, l’avis de la CGB en plus de celui de la commission locale de biosécurité. Nous n’entendions pas mettre en place une expérimentation sans respecter pour le moins les réglementations applicables en France.
La demande des pays en voie de développement est très forte. Leur besoin d’augmenter leur production agricole va de pair avec la nécessité de l’adapter aux contraintes du milieu tropical, beaucoup plus élevées que celles des zones tempérées. Nous intervenons beaucoup dans le domaine de la formation afin de renforcer les capacités dans tous les domaines, biologiques, juridiques et réglementaires, ou encore liés à la biosécurité, conformément à la convention de Carthagène. Le CIRAD joue également un grand rôle d’expertise.
M. le Président : C’est à la suite de la destruction de votre essai de riz qu’a eu lieu le procès de Montpellier. Ne s’agissait-il pas pourtant d’un essai en milieu confiné ? Quelles justifications ont été avancées, dans la mesure où seuls les essais en champ étaient condamnés ? La présidente de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Mme Marion Guillou, nous a déjà parlé de votre essai de caféiers. Pourquoi l’a-t-on détruit ?
Enfin, peut-on estimer la part globale des pertes de production dans les milieux tropicaux en l’absence de traitements ?
M. Philippe FELDMANN : L’essai de Montpellier, qui portait sur des riz transgéniques en serre confinée de type S2, située sur le campus du CIRAD, a été détruit en juin 1999, à l’occasion du tour d’Europe effectué par une « caravane paysanne » à laquelle participaient des paysans indiens. Une partie de ces plants aurait dû être replantée en champ au Centre français du riz, en bordure de la Camargue, quelques mois plus tard. Toutes les informations relatives à cet épisode ont été rassemblées dans notre CD-ROM. Nous n’y rapportons que des éléments factuels, sans prises de position autres que celles exprimées au cours de la procédure judiciaire. Il est à noter qu’aucune plainte n’avait été déposée par le CIRAD nominativement contre José Bové, René Riesel et Dominique Soullier, qui n’avaient pas été identifiés au moment des faits, mais seulement plus tard, lors de l’enquête de gendarmerie, au vu des cassettes des journaux télévisés.
L’enjeu du procès de Montpellier était avant tout de défendre la recherche publique. Les deux expérimentations détruites avaient été réalisées sur financements publics européens dans le but de répondre à la problématique de la lutte contre les insectes, mais également aux questions posées par les gènes inductibles afin d’éviter toute conséquence sur les insectes pollinisateurs en jouant sur la localisation du gène dans certains tissus.
Les arguments avancés par les promoteurs de cette destruction reposent d’abord sur une certaine conception du principe de précaution – nous avons repris certains rapports émanant, entre autres, de l’Assemblée nationale pour la définition du principe de précaution. Or non seulement nous respections la réglementation, mais encore nos travaux visaient précisément à développer des méthodes et des techniques destinées à répondre à certaines interrogations. Il arrive un moment où, pour évaluer un impact, la recherche ne peut se contenter de simulations en enceinte confinée et doit se poursuivre dans les conditions réelles de développement des plantes.
Beaucoup en viennent à croire qu’un être vivant ne serait finalement qu’un ensemble de gènes qui pourraient tout définir. Si tel était le cas, une plante, incapable de se déplacer, disparaîtrait sitôt que l’environnement auquel elle est adaptée évoluerait. L’expression d’une plante dépend certes de facteurs génétiques, mais aussi de l’influence de son environnement – eau, luminosité, etc. Une plante est d’abord le résultat d’une interaction entre le génotype et l’environnement. Certains gènes, dans un contexte donné, vont s’exprimer d’une certaine façon, mais donneront autre chose dans un autre contexte. La partie génétique et la partie environnementale ne viennent qu’après. Imaginer que l’on puisse se contenter d’expérimentations sans reproduire les conditions d’environnement finales revient à s’exposer à des risques très importants que l’on n’aura pu évaluer.
Notre essai de caféiers était destiné en premier lieu à vérifier l’efficacité d’une transformation génétique destinée à lutter contre la chenille de la mineuse des feuilles, qui pose de gros problèmes, au Brésil notamment. La localisation en Guyane permettait de conjuguer les conditions tropicales et le sérieux des mesures de contrôle et de protection propres à un pays développé, en particulier dans une zone où le caféier n’existe pas à l’état sauvage. Les jardins les plus proches étaient distants de plusieurs dizaines de kilomètres de l’expérimentation, elle-même située en pleine forêt tropicale. Les risques de dissémination étaient donc nuls.
Le deuxième objectif était d’évaluer les flux de gènes en installant des plantes pièges à pollen dans des coupes en forêt parfois longues de plus d’un kilomètre pour favoriser le transfert des gènes, ainsi que des ruchers dont le miel était analysé à chaque récolte, avant d’être systématiquement détruit.
Cet essai était prévu sur cinq ans, le caféier mettant trois ans à fleurir. Il a été détruit la quatrième année… Nous n’avons que des résultats préliminaires en termes de flux de gènes. Nous avons pu en apprendre davantage sur l’expression des transgènes dans les feuilles et les différents tissus. Nous verrons, au terme de l’analyse des résultats sur les flux de gènes, si un nouvel essai peut être envisagé. Encore faudrait-il identifier les causes et les motivations de la destruction du premier, pour lequel nous n’avons eu ni revendication ni témoin : il était situé en pleine forêt, à 60 kilomètres de Kourou et 40 kilomètres de Sinnamary…
M. Benoît LESAFFRE : Vous trouverez une description très précise de cet essai dans le CD-ROM qui reprend le contenu de notre site Internet. Non seulement il avait été approuvé par la CGB mais, du fait qu’il était situé dans un milieu naturel où le caféier n’existe pas à l’état sauvage, le risque de contamination était totalement nul.
M. Philippe FELDMANN : Plus précisément, il s’agit de risque de contamination en termes de flux de gènes par le pollen, puisqu’il n’existe pas de plante apparentée en Guyane. Ce n’est pas le cas en Afrique, par exemple, où d’autres questions se posent, qui nécessiteront d’autres expérimentations. Cela n’exclut pas la possibilité d’une dissémination par les graines, mais celles du caféier ont cette caractéristique de n’avoir aucune « dormance » : elles germent le jour où elles tombent. Ne restaient que les souches ; l’essai a été totalement labouré et les restes brûlés et détruits sous contrôle des services de protection des végétaux qui reviendront s’assurer régulièrement de l’absence de toute repousse.
M. Benoît LESAFFRE : Précisons qu’il n’a jamais été question de commercialiser quoi que ce soit. Il s’agissait bien d’un essai de recherche, financé sur fonds publics.
M. Philippe FELDMANN : Peut-on limiter les pertes de production dans les milieux tropicaux ? Nous disposons de tout un arsenal chimique, variétal, biologique, cultural, pour lutter contre les parasites et les maladies. Les OGM ne sont qu’une solution parmi d’autres. Seule la mise en œuvre de moyens intégrés permet de répondre à des contraintes qu’il faut définir au cas par cas, selon les endroits et les productions. On estime que les pertes de semences liées aux insectes sont de 30 à 50 % en zone tropicale. Cela dit, ce discours doit être relativisé dans la mesure où le développement de la plante en l’absence d’insectes peut favoriser indirectement l’apparition d’autres facteurs pathogènes – les champignons, par exemple. Certains équilibres se sont créés, et mieux vaut bien préciser ce dont on parle avant d’avancer une solution. Reste que le cotonnier est un exemple particulièrement intéressant : c’est, de loin, la plante la plus consommatrice d’insecticides, lesquels, de tous les produits chimiques utilisés en agriculture, sont par essence les plus dangereux pour l’homme et pour les animaux. Le cotonnier est une plante très sensible à de nombreuses attaques d’insectes, car ses résistances naturelles sont très réduites. Les techniques classiques d’amélioration génétique ne pouvant, dès lors, donner de grands résultats, la mise au point de plantes transgéniques apparaît potentiellement comme une solution à même de réduire l’utilisation de certains insecticides, sous réserve de ce que j’ai dit plus haut : lutter de façon trop privilégiée contre un insecte dominant revient à favoriser les autres… Il faut adopter des approches plus globales associant l’utilisation de plants transgéniques à d’autres méthodes culturales, ne serait-ce que pour éviter le phénomène classique d’apparition de résistances.
Vous trouverez à ce propos, dans le CD-ROM, un petit « quiz » que la Confédération paysanne avait qualifié de « simpliste », alors que nous-mêmes avons parfois eu du mal à y répondre ! Force est de reconnaître que certaines questions très simples, voire simplistes, appellent des réponses autrement moins évidentes. Cela montre que l’état de notre information ne nous permet pas de répondre à nombre d’interrogations pourtant simples que suscitent les OGM et la transgénèse. Ce questionnaire pédagogique se révèle bien plus utile que nous ne l’imaginions, ne serait-ce que pour introduire un débat ou une conférence. La question des principales raisons des pertes de production dans les pays du Sud y est posée. Vérifiez par vous-mêmes…
M. le Rapporteur : Certains pays du Sud ont-ils refusé les expérimentations en plein champ ? Vous a-t-on demandé d’arrêter certaines expérimentations ? Pour quelles raisons ? Quels incidents avez-vous connu en dehors de ces deux épisodes ?
M. Philippe FELDMANN : Plusieurs pays refusent les OGM et certains ont été jusqu’à refuser l’aide alimentaire américaine pour éviter tout risque d’introduction de maïs transgénique. D’autres, pris entre la crainte du risque et l’urgence d’une situation de famine, ont trouvé un compromis en acceptant l’aide alimentaire sous forme de maïs broyé pour empêcher toute germination.
Jamais nous n’avons entrepris d’expérimentations en champ dans d’autres pays que la France, si ce n’est en Colombie, dans un centre de recherche agronomique international et dans de parfaites conditions de contrôle. Nous travaillons en partenariat avec ces pays pour répondre à des questions de développement. Si la solution transgénique apparaît comme la seule possible, nous aurons un débat qui aboutira peut-être à une proposition. Mais d’ores et déjà, nous sommes confrontés à une très forte demande de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, soumis à de fortes pressions des Etats-Unis qui n’hésitent pas à financer les expertises – je vous laisse imaginer avec quels types d’experts – et désireux de disposer, grâce à notre appui, d’une réelle capacité d’expertise indépendante. Le problème pour nous est de savoir si, compte tenu de nos possibilités budgétaires et des conditions dans lesquelles nous menons nos expérimentations, nous serons capables de répondre à cette demande.
M. le Rapporteur : Quelles difficultés – ou facilités – rencontrez-vous en matière de brevets ? Et sur le plan des assurances ? J’imagine que vous n’en avez aucune…
M. Philippe FELDMANN : Nous avons produit, dans le cadre de Génoplante, plus de 50 000 lignées d’insertion de riz pour tenter de cibler tous les gènes potentiels afin d’identifier chaque gène et sa fonction. Cela suppose évidemment de faire des essais en champ, en Colombie. Génoplante est un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant des entités tant privées que publiques, à des fins de valorisation. En donnant le moyen de contrôler le libre accès à certaines innovations, le brevet permet de se préserver la possibilité d’octroyer librement des licences et de développer au besoin des plantes transgéniques ou autres. Une clause a été introduite à notre initiative, dès la constitution du GIS Génoplante : cette « clause CIRAD » prévoit la possibilité d’un libre accès pour les petits paysans du Sud aux résultats obtenus, quand bien même ceux-ci auront été brevetés.
M. Benoît LESAFFRE : Cette clause a été reprise dans notre charte de propriété intellectuelle. Nous estimons qu’il est de notre mandat de donner à la paysannerie du Sud un libre accès à toutes les semences – OGM ou non – sur lesquelles nous travaillons. Il est à noter que nous avons 25 variétés non-OGM améliorées grâce à des techniques de sélection variétale assistée par génie génétique. Grâce aux travaux sur le génome, nous pouvons repérer, par des gènes marqueurs, les sites de résistance à un agresseur, par exemple, et cibler les croisements en conséquence.
M. le Rapporteur : Où en êtes-vous en matière de recherche animale ? Envisagez-vous des applications à la santé humaine – vaccins ou autres – à moyen terme ?
M. Philippe FELDMANN : Nous avons développé plusieurs vaccins recombinants, c’est-à-dire produits par des micro-organismes génétiquement modifiés, à l’exemple du vaccin contre l’hépatite B qui fut le premier du genre. Nous travaillons exclusivement dans le domaine de la santé animale. Mais ces recherches peuvent utilement servir à développer des techniques et méthodes applicables à la santé humaine.
M. Benoît LESAFFRE : Auquel cas le relais est pris par l’INSERM et surtout par l’Institut Pasteur, qui s’occupe notamment du volet « homme » des maladies vectorielles émergentes.
M. Philippe FELDMANN : Ces vaccins sont conçus de façon à éviter tout risque d’intégration de gène par l’organisme humain. Le vaccin recombinant a l’avantage de permettre une traçabilité et de savoir si les anticorps présents dans l’individu proviennent du vaccin ou d’une exposition à la maladie. Ainsi on n’abat que l’animal véritablement infecté. Quand on sait le nombre d’animaux qu’il a fallu tuer lors de la dernière épidémie en Grande-Bretagne, on mesure tout l’intérêt qu’aurait présenté un vaccin recombinant.
M. Gabriel BIANCHERI : La vaccination est un grand débat… J’ai pour ma part tendance à confondre brevet et séquençage des gènes. Ce que nous craignons aussi, c’est le monopole. Comment l’éviter ?
M. Philippe FELDMANN : La position française, unanimement partagée par les organismes de recherche, est de s’opposer à la brevetabilité du séquençage de gènes.
M. le Président : Nous avons adopté hier après-midi le projet de loi relatif aux inventions biotechnologiques. La position française est de refuser de breveter les gènes en tant que tels – ce que les Américains ont fait dans un premier temps –, mais seulement un gène dont on connaît la fonction, autrement dit son application directe.
M. Gabriel BIANCHERI : Mais d’autres que nous peuvent avoir une position différente et nous créer des problèmes…
M. Philippe FELDMANN : Effectivement, si l’on considère, comme l’ont fait dans un premier temps les Etats-Unis, que l’utilisation des techniques OGM permet de breveter une plante, il devient possible de bloquer l’innovation à ce stade. Jusqu’à présent, le privilège de l’obtenteur permettait à tout un chacun de se servir de n’importe quelle variété pour en fabriquer une nouvelle par croisement. Cela n’est plus possible avec une variété brevetée. Une bonne partie de la communauté internationale, à commencer par les obtenteurs de semences, est opposée au principe de la plante brevetée, sauf à y réintroduire le privilège de l’obtenteur.
M. le Président : Le texte du Sénat a été adopté conforme hier. Le privilège du sélectionneur, introduit à l’initiative du sénateur Bizet, permet de concilier le droit des brevets et le droit du certificat d’obtention végétale, qui depuis 1961 autorise tout un chacun à améliorer une plante, fût-elle élaborée par quelqu’un d’autre.
M. Philippe FELDMANN : Le problème est que toute une série de méthodes – et pas seulement des gènes – font déjà l’objet de brevets croisés alors qu’elles sont indispensables pour réaliser une construction génétique. Une étude a été confiée par le ministère de la recherche à l’INRA et au CIRAD pour trouver un dispositif d’échange et d’utilisation permettant de poursuivre une innovation sans être bloqué par ces brevets très complexes.
M. Benoît LESAFFRE : Force a été de constater que, même regroupée, la recherche française, tout comme du reste les universités américaines, avait du mal à valoriser ses brevets, contrairement aux multinationales. Nous vous avons remis, entre autres documents, le rapport réalisé par le groupe de travail à partir de la question suivante : comment mutualiser les brevets de la recherche publique française, voire européenne, afin de créer une sorte de « pool » et de nous donner une capacité à les défendre collectivement ? A elle seule, notre recherche publique est incapable de produire et de valoriser des brevets dans le domaine de la génomique végétale.
M. le Président : On ne trouve que l’Institut Pasteur dans les cinquante premiers organismes du monde… Même le CNRS n’y est pas.
M. Benoît LESAFFRE : En biologie végétale, c’est pire encore. Même les universités américaines sont confrontées à ce problème. Nous vous avons remis le rapport complet, plus une note de deux pages en anglais résumant la position des universités américaines.
M. Francis DELATTRE : Nous n’avons pas toujours été à la traîne… Cette situation ne date que de dix ans.
M. Gabriel BIANCHERI : Je reviens sur les vaccins recombinants. Dans quel délai serions-nous capables de produire des dizaines de milliers de doses de vaccin contre la fièvre aphteuse ?
M. Philippe FELDMANN : Je ne suis pas compétent pour vous répondre sur la fièvre aphteuse. Je l’ai seulement prise en exemple pour montrer l’utilité de ces vaccins. Aurions-nous besoins de tuer tant d’animaux si nous avions pu distinguer ceux qui avaient été vaccinés des autres séropositifs ?
M. Francis DELATTRE : Pour les pays du Sud, le soja constitue à n’en pas douter la source de protéines la plus intéressante. Avez-vous engagé des études dans ce domaine ? En France, la culture du soja se heurte au rythme de nos saisons : il nous faudrait au même moment l’humidité de mars et la chaleur de juin… Mais la technique du marquage permettrait-elle de mettre au point des variétés capables d’éliminer les pyrales, entre autres, sans avoir à créer un OGM proprement dit ?
M. Philippe FELDMANN : Le soja est effectivement une source très importante de protéines, utilisée pour l’essentiel sous forme de tourteaux destinés à l’alimentation du bétail. Les Etats-Unis en sont le premier et principal producteur.
M. Francis DELATTRE : Ils en ont pratiquement le monopole.
M. Philippe FELDMANN : Le Brésil et l’Argentine sont également deux gros producteurs de soja. L’Argentine produit beaucoup de soja transgénique et le Brésil a été contraint de l’autoriser, dans la mesure où les producteurs n’hésitaient pas à aller en Argentine acheter des semences de soja argentin, beaucoup plus facile à cultiver. Malheureusement, nous n’avons pas les moyens d’entreprendre des recherches d’envergure sur le soja, alors que la recherche américaine, et même brésilienne, y consacre des sommes plusieurs centaines de fois supérieures, et nous préférons travailler sur d’autres espèces moins étudiées par nos concurrents ou encore étudier les implications économiques de l’introduction du soja transgénique.
M. Benoît LESAFFRE : Le soja ne faisait pas partie des sujets à aborder en priorité au moment de la création du CIRAD. Depuis, la recherche internationale sur cette plante a tellement avancé que nous y lancer aujourd’hui n’aurait guère de sens et exigerait des moyens budgétaires hors de proportion.
M. Philippe FELDMANN : M. Delattre voulait également savoir si, par l’identification des gènes de résistance à la pyrale, nous pourrions développer des variétés non transgéniques plus résistantes. Plusieurs travaux sont déjà en cours pour parvenir à cet objectif par d’autres moyens, génétiques ou biologiques. Pour le cotonnier, il n’existe pas de solution satisfaisante, hormis la voie transgénique. Mais pour d’autres espèces, nous ne manquons pas de moyens d’action.
M. François GUILLAUME : La voie transgénique permettrait sûrement de réduire la dépendance alimentaire des pays du Sud, mais la solution à un problème aussi complexe ne saurait se limiter à l’addition de plantes transgéniques. Quelle est votre stratégie de recherche en la matière ? Ne vaudrait-il pas mieux commencer par des plantes non susceptibles de créer des problèmes de dissémination mais apportant un service évident – résistance à la sécheresse, réduction de l’aridité ou de la salinité des sols, etc. –, sans chercher à résoudre d’emblée toutes les difficultés – lutte contre les insectes et autres – qui se présentent ?
M. Philippe FELDMANN : Je pourrais répondre, de façon provocatrice, que « Terminator » est un excellent moyen d’éviter la dissémination… Par ailleurs, nombre de plantes ne produisent pas de graines ou de pollen viables, ce qui évite tout risque de dissémination. La grande peur suscitée par « Terminator » tient au fait qu’il supprime toute production de semences viables sur des plantes qui ne peuvent précisément être multipliées qu’en ressemant, ce qui conduit, de fait, le paysan à racheter systématiquement des semences. Cela dit, la technologie « Terminator » n’est qu’un brevet qui n’a jamais été mis en œuvre jusqu’à présent, déposé par Delta & Pine Land et racheté, depuis, par Monsanto. L’idée sous-jacente était certainement d’obliger le producteur à acheter des semences mais c’est déjà le cas pour tous les maïs hybrides dont les graines produites sont inutilisables en tant que semences.
Autrement dit, les techniques propres à éviter la dissémination existent potentiellement d’ores et déjà, reste à vérifier si elles n’ont pas d’effets néfastes sur le plan économique. Le meilleur exemple se retrouve avec les plantes qui ne fleurissent pas, comme certains tubercules ou encore certaines variétés de canne à sucre, ce qui évite tout flux de gènes. Une modification transgénique sur ces espèces ne présenterait donc aucun risque à cet égard.
Les travaux que nous avons menés sur le riz, dont certains ont été détruits, visaient quant à eux à empêcher l’expression du gène dans le pollen, celle-ci n’apparaissant qu’en cas d’attaque d’insectes et à un niveau correspondant aux besoins pour éviter toute production excessive de toxines. A supposer que le gène arrive sur un autre riz, le risque en cas d’ingestion par d’autres animaux serait considérablement réduit et ne tiendrait qu’à l’avantage sélectif dont bénéficierait la nouvelle variété en cas d’attaque massive d’insectes, par exemple. Dès lors, on entrevoit des solutions envisageables, sur lesquelles nous n’avons pas encore mobilisé en France assez de moyens et de compétences, en matière de génétique des populations notamment : il suffirait de faire en sorte que, sitôt qu’il migre d’un endroit à un autre, le transgène confère un désavantage sélectif à l’hybride qui se crée ailleurs. Autrement dit, l’important n’est pas que le pollen aille à quinze, vingt ou même cinq cents kilomètres, mais de savoir s’il est fécondant, s’il s’intégrera dans une variété similaire ou une espèce sauvage apparentée, et surtout s’il conférera aux générations suivantes un avantage sélectif permettant aux populations de s’étendre. Mais si le gène confère un désavantage sélectif, les générations ultérieures disparaîtront petit à petit en application des lois naturelles de l’évolution, sans qu’il soit besoin mettre au point des mécanismes de type « Terminator ». Cette réflexion, autrement plus large qu’une petite étude d’impact des flux de gènes, doit être développée avec le concours des meilleures compétences nationales et internationales.
M. Gabriel BIANCHERI : Et cela exigera des essais en plein champ…
M. Benoît LESAFFRE : Pour ce qui est de la résistance à la sécheresse ou à la salinité, nous ne travaillons pas sur la création d’OGM, mais sur les mécanismes de régulation naturellement présents dans la plante, que nous nous attachons à identifier et à développer par sélection végétale, assistée par marqueurs génétiques.
M. Philippe FELDMANN : Une thèse sera soutenue la semaine prochaine, qui fera le bilan de nos recherches sur le riz, où nous avons utilisé les OGM pour identifier les gènes et comprendre les mécanismes qui confèrent une tolérance à la salinité et à la sécheresse. Nous sommes parvenus à décrypter les gènes les plus importants et la façon dont, au niveau des racines, fonctionnaient les variétés les plus résistantes. Partant de là, nous déterminerons les critères de sélection à utiliser pour améliorer les variétés classiques.
M. François GUILLAUME : N’avez-vous jamais envisagé de prendre le gène d’une plante naturellement résistante à la sécheresse pour l’introduire dans le riz ?
M. Philippe FELDMANN : Tout peut être envisagé mais la tolérance à la sécheresse est un mécanisme extrêmement complexe, associant toute une série de fonctions, qu’il faudra décrypter au préalable avant d’espérer qu’un transgène puisse, pour certaines espèces, apporter un progrès significatif.
M. Serge ROQUES : Les expérimentations en plein champ sont incontournables si nous voulons rassurer les populations face aux craintes que suscitent les OGM. Mais peut-on les rassurer en se privant d’essais grandeur nature ?
M. Philippe FELDMANN : Le problème tient d’abord au manque de confiance de la société vis-à-vis des scientifiques comme des politiques. Une révolution technologique de cette ampleur pose forcément des questions éthiques très lourdes. Comment faire pour aboutir à des innovations sans impacts négatifs et pour amener la société à s’approprier réellement le sujet ? L’arrêt des expérimentations au champ pourra-t-il calmer le jeu ? Avec cinquante hectares en tout et pour tout en France, cela n’aura pas de répercussions gigantesques… Ce pourrait être une opération de communication relativement aisée, mais ce n’est pas ainsi que nous disposerons d’éléments objectifs et indépendants pour répondre aux inquiétudes de la société. Nous n’y parviendrons jamais sans nous mettre dans des conditions réelles de risque. Le but n’est évidemment pas de prendre des risques inacceptables et c’est la raison d’être de commissions telles que la CGG et de la CGB. Peut-être a-t-on des doutes sur la manière dont elles fonctionnent et dont leurs recommandations sont appliquées. C’est sans doute là-dessus qu’il faudrait travailler pour que le public se sente vraiment associé à leurs décisions.
M. Benoît LESAFFRE : Nous sommes en fait très proches des recommandations du rapport des « 4 Sages », que l’on pourrait résumer ainsi : oui aux essais en champ, à condition d’avoir auparavant procédé à tous les essais et modélisations possibles en laboratoire, afin que le test soit parfaitement calibré.
Qu’appelle-t-on « expertise indépendante » ? Cela a été tout l’objet du débat au Parlement sur la sécurité sanitaire. Sur qui s’appuyer pour évaluer le risque ? Quelle séparation doit-on instaurer entre l’évaluation et la gestion ? Nous pensons quant à nous que notre système d’évaluation et de gestion du risque doit progresser.
M. Serge ROQUES : Ne peut-on déjà s’appuyer sur les expérimentations en champ réalisées à l’étranger pour rassurer les populations ?
M. Philippe FELDMANN : Avec plus de 70 millions d’hectares cultivés dans le monde, dont certains depuis très longtemps, nous commençons à disposer d’un certain nombre d’éléments qui, s’ils excluent la perspective d’une catastrophe d’envergure, n’en amènent pas moins à se poser certaines questions et, notamment, à se demander si toutes les précautions sont prises. Plusieurs études relativement avancées ont été conduites, y compris en France, sur les conditions dans lesquelles les OGM se sont développés aux Etats-Unis. Un séminaire est prévu le 8 décembre prochain pour tirer les conclusions d’une étude réalisée à la demande du ministère de la recherche, dont un volet, réalisé par une équipe de l’INRA, est spécifiquement consacré aux effets économiques du développement des OGM aux Etats-Unis.
M. le Président : Vos détracteurs affirment que les essais sont, en fait, des expérimentations pour le compte de semenciers. Nous avons bien compris que ce n’était pas le cas de votre essai de caféiers en Guyane, pourtant détruit par des anonymes. Et vos adversaires ajoutent qu’aucune de vos expérimentations ne traite de questions en rapport avec les besoins des pays du Sud. Là encore, vous démontrez le contraire puisque c’est la raison d’être de votre organisme. Mais pensez-vous que les OGM pourraient régler, dans l’absolu, des problèmes de production agricole dans les pays du Sud et réduire, par ricochet, la déforestation liée à l’augmentation des populations ainsi que les pollutions causées par les traitements destinés à lutter contre les agents pathogènes responsables des pertes de récoltes ?
M. Benoît LESAFFRE : Il est difficile de donner une réponse générale…
M. le Président : Le problème est que nous sommes au Parlement. Si vous voulez que nos collègues puisent rendre un avis éclairé, il faut nous donner le vôtre…
M. Benoît LESAFFRE : Jacques Diouf, directeur général de la FAO13, a dit récemment : « Aujourd’hui, nous n’avons pas besoin des OGM pour nourrir la planète ; demain peut-être. »
M. Francis DELATTRE : Il a été chez les jésuites !
M. Benoît LESAFFRE : On ne peut répondre à une telle question par oui ou par non. Deux écoles s’affrontent. Il y a ceux qui pensent que toutes les réponses aux problèmes de développement du Sud sont d’ordre technologique – OGM et autres – et qu’en augmentant la productivité de plantes ou d’espèces animales, on aura résolu le problème de la faim dans le monde. Encore faut-il des systèmes de culture adaptés, une juste rémunération des agriculteurs, des circuits de distribution efficaces – 30 à 50 % de la production agricole se perdent, dans les silos ou faute de circuits de distribution. Un des grands points faibles du Sud tient au manque d’organisations paysannes. Sans coopératives, à qui doit s’adresser l’agriculteur pour acheter des semences ? Les OGM ne résoudront pas le problème de la faim dans le monde. Mais s’interdire le recours à des technologies innovantes à même de répondre un jour à des questions auxquelles les technologies d’aujourd’hui ne répondent pas, c’est se fermer l’avenir. C’est ainsi qu’il faut poser le problème. Les recherches du CIRAD portent sur l’ensemble des systèmes agricoles et pas simplement sur la variété végétale ou l’espèce animale en tant que telles.
M. le Président : Je connais les réponses, mais nous avons affaire à un monde binaire et à des détracteurs qui utilisent des mots simples. Or les idées simples appellent souvent des réponses compliquées. Votre raisonnement est parfait pour un esprit cartésien, mais jamais vous ne parviendrez ainsi à faire mesurer l’intérêt que ces techniques pourraient présenter pour l’agriculture des pays du Sud.
M. Benoît LESAFFRE : Le coton est un exemple typique de ce sur quoi nous pouvons répondre : oui, l’introduction du gène Bt dans le coton permet d’éviter bon nombre de traitements phytosanitaires dont on connaît les effets particulièrement dangereux tant sur l’environnement que sur l’alimentation.
M. le Président : C’était précisément ma troisième question. Tout le monde s’accorde à reconnaître que, pour le coton, le besoin en produits phytosanitaires est réduit, les techniques culturales sont plus faciles, l’agriculteur enfin y trouve avantage.
M. Francis DELATTRE : Et la santé humaine également !
M. Philippe FELDMANN : Aucun chercheur n’affirmera jamais avoir trouvé la solution à tout…
M. le Président : Je le sais, je l’ai été !
M. Philippe FELDMANN : Si bien que, face avec un adversaire convaincu de détenir la vérité et utilisant un discours bien élaboré, la situation n’est pas à notre avantage : les chercheurs ne sont pas de grands communicateurs – mais certains finissent par le devenir ! Comme toute innovation, les OGM peuvent effectivement contribuer à résoudre les problèmes d’alimentation et de développement dans le Sud, Encore faut-il, comme avec n’importe quelle technique, évaluer leurs avantages, leurs inconvénients et leur impact.
La polémique autour des OGM aura au moins eu un mérite : on se préoccupe beaucoup plus qu’auparavant des conséquences économiques des innovations. Les questions que l’on se pose sur les OGM, on se les posera bientôt sur autre chose. Autrement dit, on a ouvert la boîte de Pandore. Jamais, jusqu’à présent, on n’avait parlé des espèces envahissantes, qui sont devenues un problème majeur dans le monde, et pas seulement dans le Sud. Les Etats-Unis ont chiffré à 1 000 milliards de dollars les conséquences économiques de l’introduction d’espèces exotiques sur leur sol ! Et l’Inde en est au même point…
Mais il y a plus important encore. Dès lors qu’il s’agit de santé publique, les vaccins recombinants ne gênent pas trop : les pauvres enfants leucémiques sauvés, nonobstant quelques « petites » erreurs typiques des risques liés aux OGM, on les accepte… Mais n’est-ce précisément pas là que les risques potentiels sont les plus importants, du fait même que c’est sur l’espèce humaine que l’on travaille ? Depuis la maladie de la vache folle, la fièvre aphteuse et autres catastrophes sanitaires d’envergure, la société a perdu confiance. Les OGM ont fait tomber des tabous, à commencer par celui de la barrière des espèces. Et le poisson dans les fraises, en termes de communication, c’est extraordinaire pour amener à se poser des questions sur les innovations… Il faudra se les poser pour les OGM, mais pour bien d’autres également. Reste qu’il ne faudrait pas que toutes ces inquiétudes, pour légitimes qu’elles soient, en viennent à bloquer toute innovation. Il va falloir parvenir à les gérer.
M. Benoît LESAFFRE : Il y a quarante ans, on a parlé de « révolution verte ». Les nouvelles variétés, non-OGM, mises en place à cette époque, grosses consommatrices d’engrais et de traitements phytosanitaires, ont considérablement perturbé l’équilibre des ressources naturelles et aggravé les pollutions. On a compris, depuis, que l’innovation n’avait de sens que si elle était étudiée et réfléchie au regard de son impact sur le milieu. OGM ou non, une innovation non intégrée dans le système de production et introduite sans étude d’impact aura fatalement des effets négatifs.
M. François GUILLAUME : Il arrive un moment où les politiques, éclairés par les scientifiques, doivent décider. Dès lors que les avantages paraissent l’emporter sur les inconvénients, il faut bien finir par prendre des décisions. Sinon, on trouvera toujours, étude après étude, des raisons supplémentaires pour ne pas avancer, cependant que le coût de la recherche deviendra exorbitant.
Les OGM sont-ils indispensables pour améliorer l’alimentation mondiale ? Il n’est en tout cas plus supportable de voir 800 millions de personnes mourir de faim pendant que d’autres gèlent leurs terres, remplissent les poubelles et deviennent obèses ! Sans doute les OGM sont-ils indispensables, mais cela ne suffira pas. On trouvera toujours des solutions aux problèmes techniques. Il suffit de voir les progrès de productivité que nous avons réalisés dans les pays tempérés, pour peu qu’on ne se mette pas à détruire toutes les recherches… Le problème principal est celui de la distribution des richesses. Peut-être devrons-nous donner, gratuitement, nos semences OGM aux pays du Sud mais il faudra également organiser le commerce des produits agricoles afin de protéger leurs productions de la concurrence des pays du Nord. Et cela, on sait le faire : créer, par exemple, un marché commun des pays d’Afrique protégé par une barrière douanière, comme nous l’avons fait en 1960. Et si le prélèvement douanier permet de subventionner les exportations des pays en voie de développement, ce sera tant mieux et le problème sera quasiment réglé !
Ne nous ingénions pas à multiplier les obstacles. Certains n’hésiteront pas à se servir de l’argument de l’organisation de la production pour interdire les OGM. Je suis d’accord avec notre président sur la nécessité d’un message clair : les OGM, cela ne suffira pas mais, de toute façon, il en faudra.
M. Benoît LESAFFRE : Nos économistes et ceux de l’INRA avaient dû répondre à la même question au Sénat, à propos de la réforme de la politique agricole commune (PAC). La première façon d’aider les pays du Sud à développer leur agriculture, c’est de leur permettre de produire sur place et de bénéficier d’un minimum de protection à l’échelle régionale. Le marché international n’en serait aucunement perturbé, sinon à la marge. Ne nous interdisons pas la technologie des OGM, mais ne réduisons pas la question de l’amélioration de la situation alimentaire de ces pays à celle d’une technologie particulière. Je reconnais que c’est un peu jésuite…
M. le Président : Quel est l’état d’esprit des chercheurs du CIRAD ? Lorsque je suis allé à Montpellier, je les ai sentis assez remontés… Notre retard dans le domaine de la biologie végétale est-il réel ? Est-il lié à cette polémique autour des OGM ?
M. Benoît LESAFFRE : La succession de pétitions et contre-pétitions montre que le monde des chercheurs est lui aussi partagé. Les biologistes sont plutôt partisans de la poursuite des essais en champ et ceux qui ont vu leurs travaux détruits en ont été particulièrement perturbés. En revanche, les chercheurs en sciences humaines et sociales sont plus portés à s’interroger sur l’acceptabilité des OGM par la société et à condamner les expérimentations en champ. Les deux populations apparaissaient assez nettement sur les listes des pétitionnaires.
Cette divergence entre les points de vue n’est pas inintéressante pour un petit établissement comme le nôtre, lorsqu’il s’agit de donner notre position. Nous essayons de tenir les deux bouts : nous affirmons haut et fort la nécessité de conserver une réelle capacité scientifique dans ce domaine, qui passe par la maîtrise du génie génétique, mais nous affirmons également le besoin d’aller le plus loin possible dans la compréhension des réactions et des peurs de la société face à l’innovation. Cette tension au sein d’un organisme de recherche est positive – dès lors, évidemment, qu’elle n’est pas stérile. Loin de m’en inquiéter, je suis plutôt satisfait de ce débat interne.
M. le Président : Lorsque j’étais allé à Montpellier, je n’avais vu que la première catégorie, celle qui criait contre la destruction des essais, pas la seconde.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Vous n’aviez vu que les biologistes…
M. Benoît LESAFFRE : Ils ne diront jamais qu’ils soutiennent les destructeurs, mais qu’ils comprennent leurs arguments…
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Ce sont des chercheurs !
M. le Président : Je faisais partie des « 4 Sages ». Nous avions rendu un rapport très modéré. Mais une mission parlementaire se doit de pousser les arguments à bout. Pourquoi cette deuxième catégorie n’est-elle pas présente ?
M. Philippe FELDMANN : Nous parlons de personnes qui conduisent des actions de recherche dans un domaine où les sciences humaines et sociales sont peu représentées.
M. le Président : Combien avez-vous de chercheurs en sciences humaines et sociales ?
M. Philippe FELDMANN : Environ 130. Sur 850, cela fait beaucoup. Surtout comparés aux quatre qui travaillent directement sur les OGM…
M. le Président : Et sur la génomique ?
M. Philippe FELDMANN : Sur les 120 chercheurs qui travaillent sur l’amélioration des plantes, soixante s’occupent de génomique. Il y a dix ans, les quatre-cinquièmes travaillaient sur les sélections. Progressivement, les technologies biomoléculaires ont pris la plus grande place. Ceux, en tout cas, qui étaient impliqués dans les essais détruits ont subi un réel traumatisme.
M. Benoît LESAFFRE : Ceux-là étaient réellement traumatisés et ont vigoureusement réagi contre les destructions. Mais ceux qui relèvent davantage du champ des sciences sociales sont plutôt portés à écouter les questions posées et à les trouver légitimes.
M. Philippe FELDMANN : Bien que rien n’ait jamais été caché, c’est seulement en juin 1999 que la communauté du CIRAD a brutalement découvert que nous travaillions sur les OGM. Il s’en est suivi un débat intense. Nous avons mis en place un forum électronique ouvert à tous les personnels, des chercheurs aux ouvriers agricoles. Les positions ont été parfois très tranchées, mais tout le monde a été satisfait de voir que ces questions pouvaient être discutées. Reste que, pour ceux qui ont rejoint le CIRAD avec l’idée d’aider au développement des petites paysanneries du Sud, le message de la Confédération paysanne, dont ils se croyaient finalement assez proches, a été totalement déstabilisateur. Ils n’ont pas compris et pour eux, ce syndicat paysan se trompait de cible. Du reste, un des responsables de la Confédération l’a lui-même écrit.
Ce à quoi est venu s’ajouter un phénomène d’autocensure au niveau tant des politiques que des bailleurs de fonds et des responsables de recherches qui, compte tenu du climat ambiant, ont préféré ne pas développer de travaux sur des sujets « politiquement incorrects » par crainte de provoquer des incidents.
M. le Président : Autrement dit, la recherche s’est censurée elle-même.
M. Philippe FELDMANN : De fait. Le sixième PCRD14 a connu un véritable effondrement des financements destinés à la génétique et à la génomique, en relation directe avec les réactions apparues en France et ailleurs. La crainte d’avoir à gérer de tels phénomènes s’est traduite par de réelles difficultés dans la mobilisation des moyens. Nous avions, au CIRAD, diagnostiqué de gros besoins en matière d’évaluation des impacts et nous n’avons pas réussi à mobiliser les financements suffisants.
M. François GUILLAUME : Certaines craintes étaient parfaitement légitimes et honnêtes, mais ne sous-estimons pas les campagnes de désinformation et les cabales conduites par des organismes spécialisés qui ont fait de l’opposition aux OGM une véritable religion. Ne tombons pas dans leur piège : il faut répondre au besoin d’information de la société, sans pour autant oublier que nous avons à faire face à un combat de fond mené avec des moyens financiers considérables par des gens qui y ont tout intérêt.
M. Benoît LESAFFRE : Le mot d’autocensure est peut-être par trop simpliste. La destruction de notre serre de riz a traumatisé les chercheurs, mais également toutes leurs équipes. Notre essai sur le caféier était unique au monde. Il n’est pas sûr que ces gens soient prêts à redéposer un dossier si c’est pour travailler pendant deux ans à refaire un essai appelé à être détruit trois ans plus tard… Osons le dire : la perte de confiance est telle que ces recherches ne sont plus vraiment possibles au CIRAD si elles ne sont pas restimulées par des décisions venues de l’extérieur, de nature politique et sociétale.
M. le Rapporteur : Est-il possible de connaître les domaines et les fonctions de ceux qui ont signé pour ou contre les essais OGM ?
M. le Président : Et le nombre des pour et des contre ?
M. Philippe FELDMANN : La pétition critique vis-à-vis des essais OGM rassemblait, au-delà des chercheurs en sciences humaines et sociales, des agronomes généralistes appartenant à une génération plus ancienne que la communauté des généticiens ou biotechnologistes, plutôt signataires de la contre-pétition.
M. le Rapporteur : Pouvons-nous en avoir la liste ? Précisons que ce ne sont pas les noms qui nous intéressent.
M. Benoît LESAFFRE : Très honnêtement, ce n’est pas possible. Après avoir procédé à cette analyse rapide, à la louche, nous n’avons pas conservé les fichiers. Pour partagée qu’elle soit, une telle appréciation serait difficile à restituer dans un rapport.
M. Philippe FELDMANN : Il est en tout cas à noter que les signataires de la contre-pétition étaient, pour ce qui concerne le CIRAD, plus nombreux que les signataires de la pétition contre les essais OGM.
M. Benoît LESAFFRE : La pétition des opposants aux essais rassemblait beaucoup plus de gens du CNRS et de l’université que de représentants du champ INRA-CIRAD. Les chercheurs plus proches de la recherche agronomique étaient généralement plus disposés à soutenir les expérimentations sur les OGM.
M. Philippe FELDMANN : Trois conseils régionaux ont voté des motions s’opposant à toute expérimentation.
M. le Rapporteur : Beaucoup plus !
M. Philippe FELDMANN : Les motions les plus fortes ont été votées par les conseils régionaux d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes et de Languedoc-Roussillon…
M. le Rapporteur : Et de Bretagne.
M. Philippe FELDMANN : Or ces trois régions comptent beaucoup de chercheurs dans ce domaine. Cela a créé un réel traumatisme. Il y a trois semaines, à Lyon, lors de la conclusion du colloque du Bureau des ressources génétiques, le représentant du conseil régional s’est fait proprement huer par la communauté des chercheurs.
« Je traquerai jusqu’au bout les expérimentations », a-t-il prévenu, ajoutant que sa position n’était pas d’ordre scientifique, mais bien politique. Le conseil régional de Languedoc-Roussillon a également une position très arrêtée à cet égard, suscitant une très vive réaction des chercheurs de la région, qui ont parlé d’un coup de poignard dans le dos.
M. le Rapporteur : Dans ma région, la Bretagne, les conseillers régionaux ont pris position contre les essais, alors même que le Conseil économique et social, pourtant de même sensibilité politique, a clairement dit qu’ils faisaient fausse route.
M. Philippe FELDMANN : Cela a eu un énorme impact sur les chercheurs.
M. Benoît LESAFFRE : Imaginez ce qu’il en est en Languedoc-Roussillon : la base principale du CIRAD est à Montpellier, toute la génomique y est organisée en campus inter organismes associant les instituts de recherches, l’université, etc., sans oublier Agropolis… On imagine l’émoi qu’a suscité la position du conseil régional !
M. le Rapporteur : Une étude anglaise a démontré que le colza et la betterave génétiquement modifiés préservaient la biodiversité. Le plus amusant est que les associations écologistes contestent la représentativité des essais réalisés dans des stations de recherche et non dans des exploitations agricoles… Autrement dit, elles réclament des expérimentations en plein champ !
M. Benoît LESAFFRE : Nous avons un exemple comparable avec le papayer. A Hawaï, la culture du papayer, particulièrement sensible à une maladie virale, avait été totalement arrêtée. Les Hawaïens ont donc développé des variétés transgéniques résistantes au virus. Depuis, 40 000 hectares de papayers transgéniques ont été cultivés en remplacement de la canne à sucre. De surcroît, la pression virale est devenue si faible qu’il redevient possible de cultiver du papayer biologique, ce qui était infaisable avant l’introduction du papayer transgénique. Cet exemple n’est pas généralisable, mais il montre que, dans certains cas, les organismes génétiquement modifiés sont un réel progrès.
M. Serge ROQUES : Est-ce trop simplifier que de dire que les chercheurs favorables aux essais le sont pour des raisons scientifiques et ceux qui y sont opposés, pour des raisons d’ordre sociétal ?
M. Philippe FELDMANN : Effectivement, et c’est moins l’argument du risque inconsidéré que celui de l’absence de débat que les chercheurs opposés aux essais mettent au premier rang. La perspective d’une possible privatisation du vivant est également avancée, de même que les conséquences socio-économiques d’un monopole des semences. Mais tout cela relève davantage d’une analyse socio-économique que d’une étude biologique au sens plein du terme. Eux-mêmes reconnaissent ne pas encore disposer tous les éléments pour pousser davantage l’analyse.
M. Benoît LESAFFRE : La question de la propriété des semences OGM reste une préoccupation majeure et il faudra vraiment se la poser.
M. le Rapporteur : La Confédération paysanne a rappelé devant nous son hostilité aux études sur le vivant. Or j’ai appris qu’une expérimentation, à la demande de la filière laitière, était en cours sur le sang des vaches engraissées aux OGM et non plus seulement sur le lait. Et la Confédération paysanne se félicite de cet essai !
M. Gabriel BIANCHERI : Cela se comprend.
M. Philippe FELDMANN : La Confédération paysanne s’oppose au fait que l’on ne déclare pas OGM des animaux nourris aux OGM. Si des expérimentations permettaient de conclure à la présence d’OGM dans ces animaux, cela conforterait leur position.
M. Gabriel BIANCHERI : Ils approuvent celle-là parce qu’ils espèrent que les résultats confirmeront leurs thèses.
M. Philippe FELDMANN : Ils soutiennent que les expériences menées sur le lait auraient montré des modifications liées aux OGM mais qu’elles auraient été interrompues et le lait en question congelé et caché quelque part…
M. Gabriel BIANCHERI : Au tout début de la prophylaxie de la fièvre aphteuse, on nous demandait souvent de ne pas vacciner telle vache, nommément désignée, afin que les enfants puissent continuer d’avoir un lait « sain »… C’est dire combien le message a été dur à faire passer !
M. le Président : A-t-on formellement montré que le coton transgénique insecticide et herbicide présentait un avantage, premièrement sur le plan des rendements, deuxièmement sur le plan de la consommation de pesticides, troisièmement sur le plan économique ?
M. Philippe FELDMANN : En termes de rendement, les expérimentations montrent un progrès relatif. Hormis le cas d’infestation par les insectes cibles, l’avantage n’est pas avéré. La consommation d’insecticide spécifique aux insectes cibles diminue mais elle peut parfois augmenter pour les autres insectes dans la mesure où la disparition d’une espèce dominante peut favoriser la prolifération d’autres espèces. Mais globalement, l’utilisation des insecticides est réduite. Une étude réalisée en Inde par Monsanto fait même état de résultats incroyables, que les anti-OGM contestent. Quoi qu’il en soit, sur le coton nous disposons désormais de données chiffrées, en Afrique du Sud notamment, qui démontrent l’intérêt économique d’une variété transgénique produite par Monsanto par rapport à la même variété non transgénique, les économies réalisées compensant largement le surcoût lié à la cherté de la semence.
Pour le soja, autre exemple, l’utilisation aux Etats-Unis de variétés transgéniques résistantes aux herbicides facilite tellement la culture que les pratiques culturales s’en trouvent profondément modifiées. Pourtant, l’ensemble « soja transgénique plus herbicide spécifique » coûte beaucoup plus cher que l’ensemble « semences classiques et herbicides classiques ». Mais la diminution de la charge de travail est également un élément à prendre en considération, indépendamment des coûts économiques. Nous aurons des éléments plus précis à l’occasion du colloque qui se tiendra les 8 et 9 décembre prochains à l’INRA.
M. le Président : Sur quel sujet portent les travaux du CIRAD en Afrique du Sud ?
M. Philippe FELDMANN : Nous étudions les avantages et inconvénients du cotonnier transgénique, en termes d’impact économique comme de lutte contre les insectes.
M. Benoît LESAFFRE : En partenariat avec l’université de Pretoria.
M. le Président : En dehors du Brésil et de l’Argentine, dans quels pays du Sud se développent principalement les cultures d’OGM ?
M. Benoît LESAFFRE : Une soixantaine de pays cultivent des OGM. A croire un document datant de 2003, les surfaces dépassent 50 000 hectares dans 21 pays.
M. Philippe FELDMANN : Les Etats-Unis, l’Argentine, le Canada, le Brésil et la Chine sont aux premières places. Après l’Afrique du Sud viennent l’Uruguay, l’Inde, l’Australie, la Roumanie, le Mexique, le Honduras, l’Espagne, la Colombie, la Bulgarie, les Philippines et l’Indonésie. D’autres pays sont venus, depuis, s’ajouter à cette liste.
M. Benoît LESAFFRE : Cette statistique a été réalisée au niveau international en 2003.
M. le Président : Les pays voisins de l’Afrique du Sud cultivent-ils des OGM ?
M. Philippe FELDMANN : Non.
M. le Président : Il y en aurait au Burkina Faso…
M. Philippe FELDMANN : En effet. Pas des cultures commerciales mais des essais dans le but de mettre au point une réglementation en la matière. Les Etats-Unis exercent une très forte pression.
M. le Président : Monsanto dit travailler au Kenya…
M. Benoît LESAFFRE : Ce ne peut être qu’à un stade d’essais. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du Burkina Faso m’a lui-même demandé l’appui de la recherche française sur le plan tant scientifique que juridique. J’ai relayé sa demande auprès de nos tutelles mais nous ne sommes pas en situation de répondre à l’ensemble de la demande des pays de la zone francophone. Nous n’avons que quatre chercheurs spécialisés dans les OGM…
M. Philippe FELDMANN : Tous ces pays sont l’objet de fortes pressions de l’US AID, derrière lesquels on trouve Monsanto et autres, pour mettre en place une réglementation leur permettant d’y commercialiser leurs semences.
M. le Rapporteur : Y mène-t-on des recherches que l’on ne peut pas faire en France ?
M. Philippe FELDMANN : Certains pays ont une réglementation beaucoup moins contraignante. Mais le CIRAD s’est fixé pour règle de ne mener des expérimentations dans un pays étranger que si celui-ci le demande et en s’imposant des obligations au moins comparables à celles de la France. C’est ce que nous avons fait en Colombie et nous avons même demandé l’avis de la CGB, laquelle en a été très surprise…
M. Benoît LESAFFRE : La Colombie nous offre des conditions tropicales. La réglementation française permet les essais en champ, même si la société n’y est pas prête. Mais nous tenons à ce que nos expériences sur le riz en Colombie soient conformes aux règles édictées par notre propre pays. Nous nous interdisons de faire ailleurs ce que nous ne pourrions plus faire en France.
M. Francis DELATTRE : Le soja transgénique, avez-vous dit, autorise des itinéraires culturaux simplifiés sans labours. Peut-on dire que les OGM limiteraient ipso facto les rejets de CO2 dans l’atmosphère ?
M. Philippe FELDMANN : Le « minimum tilsage », comme l’appellent les Anglo-Saxons ou « semis direct », se développe beaucoup au Brésil. Des recherches sont en cours pour vérifier si les émissions de carbone en sont significativement réduites. La question est de savoir si cette pratique peut être généralisée. Ce n’est pas forcément la panacée.
M. Francis DELATTRE : On pratique de plus en plus d’itinéraires simplifiés en France…
M. Benoît LESAFFRE : On arrive rapidement à certaines limites, sans compter certains phénomènes d’irréversibilité auxquels il faut prendre garde.
Pour terminer, vous nous avez demandé dans votre questionnaire ce que nous pensions du projet de regroupement des commissions du génie génétique, du génie biomoléculaire et du Comité de biovigilance. Le débat sur la sécurité sanitaire a mis en évidence la nécessité de disposer d’un système d’évaluation des risques clair et transparent, de même que d’un système de décision et de gestion tout aussi clair et transparent. Or la « séparabilité » entre la Direction générale de l’alimentation (DGAL) et la CGB ne nous a pas paru toujours évidente, notamment lors de l’affaire des caféiers. Du reste, le rapport des « 4 Sages »…
M. le Président : Autrement dit, la CGB n’est pas indépendante du ministère de l’agriculture…
M. Benoît LESAFFRE : Je n’ai pas dit cela…
M. le Président : Vous-même reconnaissez être un peu jésuite !
M. Benoît LESAFFRE : La CGB fait plutôt bien son travail. Je trouve seulement que l’articulation entre les rôles de la CGB et la DGAL mériterait d’être clarifiée et simplifiée. L’idée, avancée dans le rapport des « 4 Sages », d’une commission d’experts scientifiques et d’une autre instance réservée au débat sociétal et politique a au moins le mérite de la clarté. Pourquoi ne pas évaluer le risque et le bénéfice dans le même endroit ?
M. le Président : Mais dans l’hypothèse où nous aurions deux instances, la commission dite de la société civile devrait-elle examiner chaque dossier au cas par cas ou donner de grandes orientations ?
M. Benoît LESAFFRE : Mon expérience, y compris au sein du ministère de l’environnement, me conduirait à privilégier la deuxième variante.
M. le Président : Moi aussi. Même si ce n’est pas forcément celle qui était dans les tuyaux à un moment donné…
M. Benoît LESAFFRE : Quoi qu’il en soit, il me paraît nécessaire de clarifier le rôle des commissions d’expertise. On ne saurait les accuser de n’être pas indépendantes, mais le système manque de clarté.
M. le Président : Messieurs, nous vous remercions. Nous avons battu des records de durée, mais cet échange était très intéressant.
M. le Rapporteur : Passionnant même !
Audition conjointe de
M. Didier MARTEAU, vice-président de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
et de M. Bernard LAYRE, président du Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Rapporteur : Mes chers collègues, notre Président Jean-Yves Le Déaut, nous rejoindra dans quelques instants. Nous remercions MM. Didier Marteau et Bernard Layre de leur présence ce matin. Avant d’en venir aux questions, je propose qu’ils nous présentent brièvement leur approche d’ensemble sur la question des OGM.
M. Didier MARTEAU : Je me félicite qu’une mission d’information ait été créée au sein de l’Assemblée nationale pour aborder un sujet que je connais assez bien, pour y avoir travaillé dans le cadre du Conseil national de l’alimentation et du Conseil national de la consommation, ainsi que de la Conférence de citoyens organisée en 1998 et présidée par M. Le Déaut. Depuis, on a malheureusement plutôt reculé : il est devenu difficile de parler objectivement des OGM, tant le débat est devenu polémique.
Peut-être d’ailleurs serait-il bon d’éviter l’expression OGM et de parler plutôt des biotechnologies car une image négative est systématiquement associée au terme OGM.
M. Bernard LAYRE : Je me réjouis à mon tour que les parlementaires aient décidé de prendre à bras-le-corps le sujet des OGM. On en était venu à douter de la volonté des pouvoirs publics d’intervenir en la matière. Nous souhaitons que votre mission parvienne à dépassionner ce débat et à y introduire l’objectivité qui lui fait défaut.
Bien que votre questionnaire pose les bonnes questions, peut-être manque-t-il celle de savoir si les OGM peuvent être acceptés par l’opinion publique. Car des maladresses ont été commises aussi bien par les syndicats, les professionnels des filières, les établissements semenciers, que par les pouvoirs publics. Il est d’autant plus important de maîtriser la communication que certains mots font peur.
C’est le progrès de l’expertise scientifique qui fera avancer le débat. Si nos campagnes ont évolué sur le plan économique, social ou technique, elles le doivent au progrès et aux chercheurs qui ont pu travailler librement. Les jeunes agriculteurs défendent la liberté de la recherche, qu’il s’agisse non seulement des travaux en laboratoire mais aussi des expérimentations en plein champ, dès lors que l’expertise scientifique les estime indispensables. Or, la très grande majorité les chercheurs de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) déclarent les expérimentations en plein champ nécessaires pour évaluer l’impact sanitaire, environnemental et agronomique des OGM.
Un autre sujet qui me tient à cœur est celui de la brevetabilité du vivant. Il est essentiel d’éviter qu’une firme conserve la maîtrise d’un génome qui lui rapporte des royalties pendant plus de vingt ans et lui permet de maintenir un certain nombre d’acteurs économiques dans la dépendance.
Beaucoup ont tendance à opposer OGM et agriculture biologique. J’estime pour ma part que c’est une démarche idéologique consistant à noircir les OGM tout en idéalisant l’agriculture biologique. Celle-ci a pu évoluer et devenir rentable, tout au long des cinquante dernières années, grâce à la sélection génétique.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous du projet de regroupement de la Commission du génie génétique (CGG), de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) et du Comité de biovigilance au sein d’un Conseil des biotechnologies ? Et quelle serait, selon vous, la composition la plus pertinente pour ce nouvel organisme ?
M. Didier MARTEAU : J’ai eu la chance de suivre les travaux de la Commission du génie biomoléculaire et en tant qu’utilisateur, je ne m’y retrouve pas. Les débats sont trop scientifiques. Par ailleurs, ces trois commissions ne permettent pas d’avoir une vision globale du problème. La Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole (FNSEA) est plutôt favorable à un système organisé autour de deux structures, l’une qui serait chargée de donner des avis scientifiques, l’autre qui serait chargée d’exprimer un point de vue d’ensemble.
M. Bernard LAYRE : Pour ma part, je ne suis pas sûr qu’il soit opportun de regrouper les organismes car il est utile de conserver une confrontation entre leurs différents points de vue. C’est ensuite au pouvoir politique de chapeauter ces différentes commissions au moyen d’une instance ayant une approche plus globale.
Mais je constate que l’on commence par une question portant sur les outils. Il me semble qu’il faudrait plutôt mener d’abord une réflexion sur les objectifs que l’on se fixe, et surtout se donner les moyens d’améliorer les conditions du débat afin que les citoyens soient informés de manière objective. On sait par exemple que le débat a connu un tournant lorsque José Bové a été l’invité de l’émission « 100 minutes pour convaincre ». C’est à partir de là que la confrontation des points de vue s’est affirmée, ce qui est une bonne chose.
M. le Rapporteur : Je précise, à cet égard, que notre mission d’information organisera des tables rondes contradictoires qui seront ouvertes aux médias et au public.
M. André CHASSAIGNE : Avez-vous le sentiment que les scientifiques sont objectifs sur cette question ?
M. Didier MARTEAU : Les scientifiques sont indépendants, c’est un fait, mais ils ont des avis très tranchés et parfois tellement contradictoires que l’on peut en arriver à douter de leur objectivité. C’est un vrai problème pour notre agriculture. Alors qu’elle a longtemps évolué dans un contexte serein, précisément parce que l’expertise scientifique lui donnait des points de repères, le climat s’est progressivement détérioré et un certain discrédit a frappé aussi bien les scientifiques que les responsables politiques et les professionnels. Après l’affaire du sang contaminé, il y a eu la maladie de la vache folle et la crise a été aggravée par des mesures qui n’étaient peut-être pas en rapport avec le nombre de décès relativement faible constaté. Toute l’alimentation est ensuite devenue un problème.
M. Bernard LAYRE : En tant qu’administrateur d’une coopérative impliquée dans les biotechnologies, je pense qu’il faut pouvoir compter sur des organismes neutres, sous tutelle des pouvoirs publics et n’ayant pas d’intérêts privés à défendre. Même si les chercheurs de certaines entreprises ont compris qu’il fallait assurer une meilleure transparence dans les dossiers, les enjeux économiques sont tels que je fais davantage confiance aux organismes publics.
M. le Président : Le futur Conseil des biotechnologies devrait être placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, du ministère de la recherche et du ministère de l’environnement. Que pensez-vous de cette triple tutelle ? Faut-il y ajouter celle du ministère de la santé ?
M. Didier MARTEAU : Non. Ce serait rendre le dispositif encore plus complexe, sans bénéfice évident.
M. le Président : Si nous vous posons cette question, c’est parce que les compétences de la CGB ne se limitent pas aux végétaux. Elles incluent les essais de thérapie génique, dont il nous paraît évident qu’ils relèvent du ministère de la santé. C’est d’ailleurs pourquoi le président de la CGB a toujours été un médecin.
M. Didier MARTEAU : Votre point de vue est tout à fait cohérent. Je dis simplement que la tutelle d’un quatrième ministère rendrait le dispositif plus complexe. Notre crainte est que le système soit paralysé.
M. Bernard LAYRE : S’agissant d’un sujet aussi délicat que celui des OGM, je comprends que l’on souhaite prendre un maximum de précautions. Mais je vous répondrai par une autre question : sachant qu’un médicament sur deux est issu du génie génétique, le ministère de l’agriculture exerce-t-il une tutelle dans ce domaine ? Je partage le point de vue exprimé par M. Marteau. On a quelque difficulté à comprendre la multiplication des tutelles dans un système qui est déjà très encadré.
M. le Président : Que pensez-vous précisément des procédures administratives de contrôle et d’évaluation des essais d’OGM ? Certains estiment qu’elles sont trop complexes et trop lourdes, notamment pour le développement de la science. Partagez-vous ce point de vue ?
M. Bernard LAYRE : Comme je le disais à l’instant, le sujet est tellement sensible que l’on a voulu multiplier les précautions. Il est donc logique que l’on ait mis en place un encadrement de la recherche assez lourd. C’était nécessaire pour crédibiliser le dispositif, même si le système peut paraître extrêmement lourd.
M. Didier MARTEAU : De manière générale, on est beaucoup plus exigeant en France que dans les autres pays, y compris européens. L’obtention d’une variété OGM prend à peu près deux fois plus de temps qu’aux Etats-Unis. S’agissant des essais, le système est très lourd et très coûteux. Ajoutez à cela qu’ils sont détruits dans une proportion comprise entre 60 et 70 %.
M. le Président : La question n° 4 du questionnaire qui vous a été remis est la suivante : « Pour assurer la coexistence de filières agricoles avec et sans OGM, serait-il utile de fixer une distance minimale pour limiter les risques de dispersion d’OGM d’un champ d’essai à un autre champ, par exemple d’agriculture biologique ? » Cette question est à rapprocher de la question n° 14 : « Est-il possible de mener une recherche sur les OGM sans recourir à des essais en plein champ ? N’est-il pas paradoxal de détruire des champs d’essais, alors que ceux-ci ont pour objectif d’étudier les risques potentiels que la culture d’OGM peut entraîner et que ceux-là mêmes qui détruisent ces champs souhaitent une meilleure information sur les risques de ces essais ? »
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je compléterai la question. Vous avez dit qu’il n’y avait pas lieu d’opposer les OGM à la culture biologique. Sur quelle base vous appuyez-vous pour dire que les essais d’OGM en plein champ n’ont aucune influence sur la culture biologique ?
M. Bernard LAYRE : Jusqu’à présent, c’est la sélection génétique – la sélection des hybrides selon le terme des années 50 – qui a permis de faire évoluer notre agriculture. Les scientifiques estiment que la nouvelle sélection génétique permettra d’apporter une réponse aux enjeux de demain, qu’il s’agisse de l’alimentation ou de l’énergie, et que cela passe par les nouvelles biotechnologies, en particulier les OGM. La position traditionnelle du CNJA était que la sélection génétique devait être encouragée parce qu’elle bénéficie à tous, et à toutes les productions. Mais la désinformation et l’information partielle répandue par les médias ont eu pour résultat que l’opinion publique a tendance à idéaliser la culture biologique et à diaboliser les OGM. Les producteurs en viennent même à douter que les OGM soient demain un facteur de progrès. Nous prenons acte de cette situation, et nous sommes favorables à la coexistence de trois filières : la filière bio, la filière OGM et la filière non-OGM.
J’ajoute une précision : les OGM sont présents, en plus ou moins grande quantité, dans 70 % de notre alimentation. La lécithine de soja et l’amidon de maïs sont des additifs que l’on retrouve dans une majorité de produits alimentaires.
M. Didier MARTEAU : Il y a aussi toutes les levures, ainsi que bon nombre de médicaments.
Pour ma part, j’ai toujours prôné le respect du choix des utilisateurs, qu’il s’agisse des consommateurs ou des agriculteurs. C’est pourquoi j’ai toujours défendu la coexistence de filières séparées, contre ceux qui préconisent la banalisation des OGM en mélangeant les cultures OGM et non-OGM.
Le seuil à partir duquel la présence d’OGM doit être mentionnée sur l’emballage des produits est aujourd’hui de 0,9 % – et de 0,1 % pour les produits biologiques –, alors qu’il était de 3 % il y a quelques années. Mais il faut savoir que plus le taux est bas, plus l’application de la règle est coûteuse. Par ailleurs, si l’on abaisse encore ce seuil, la solution de facilité sera d’indiquer systématiquement la présence d’OGM, quel que soit le taux, afin d’éviter le risque de se voir reprocher un niveau d’information insuffisant. Ainsi, les consommateurs – mais aussi les transporteurs, les intermédiaires, les associations – ne pourront plus faire la différence entre produits OGM et non-OGM. Je souscris tout à fait à l’idée de distinguer trois filières mais je me demande s’il n’est pas suicidaire pour l’agriculture biologique de viser un taux de 0 % d’OGM.
M. le Rapporteur : Est-ce à dire que vous êtes opposé à la mention des OGM dans l’étiquetage des produits utilisés pour l’alimentation des animaux ?
M. Didier MARTEAU : C’est beaucoup plus compliqué que cela. Prenons le cas d’une vache qui a consommé des produits OGM et qui a ensuite allaité un veau. Devra-t-on mentionner que ce veau a bu du lait produit par une vache qui a consommé des OGM ? Autre exemple : une vache a vécu dix ans et a consommé des OGM pendant quinze jours ; doit-on le mentionner ? Et si oui, à partir de quelle quantité d’OGM consommés ? Cette question de l’étiquetage est d’une extrême complexité, et je vous mets en garde contre des règles trop rigides en la matière.
M. André CHASSAIGNE : Vous avez dit que l’évolution variétale bénéficie à toutes les productions. Est-ce à dire, par exemple, qu’il pourrait y avoir un jour une production bio à partir de semences issues de manipulations génétiques ?
Vous insistez aussi beaucoup sur la coexistence de trois filières. Mais comment cela peut-il se traduire dans l’organisation du territoire agricole ? Y aura-t-il des zones de production bio, des zones de production OGM et des zones de production non-OGM ? Si oui, de quelle taille seraient-elles ? Et comment les différencier ? Cette notion de coexistence des filières n’est-elle pas contradictoire ?
M. Bernard LAYRE : Des contradictions, il y en a eu beaucoup dans toute cette affaire ! Et d’abord en raison du manque de courage politique au niveau de l’Union européenne : n’est-il pas contradictoire d’interdire la production OGM tout en en autorisant les importations ?
Ensuite, il faut différencier le court terme et le long terme. Je n’ai pas de réponse toute faite au sujet de la production bio. Je sais simplement qu’elle a bénéficié de sélections génétiques, qu’elles aient résulté ou non de l’intervention de l’homme. Il y a toujours eu des croisements d’hybrides.
M. André CHASSAIGNE : Les manipulations génétiques et les croisements hybrides sont des choses différentes…
M. Bernard LAYRE : A mes yeux, non. C’est l’évolution variétale, dans laquelle l’homme est toujours intervenu.
Je peux vous faire part de mon expérience de producteur de maïs semence. Nos productions sont faites dans des îlots protégés par arrêté ministériel avec des zones d’isolement, où toutes sortes de cultures coexistent sauf du maïs, afin d’éviter la dissémination du pollen et d’obtenir les variétés les plus pures. Ces îlots peuvent aller jusqu’à 2000 hectares. La coexistence des filières se pratique ainsi sur le terrain depuis plus de trente ans.
M. le Président : Quel est votre taux de tolérance en matière de contamination ?
M. Bernard LAYRE : Il est interdit de dépasser 1 %. Mais les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. On distingue notamment les semences autofécondées et les semences dites « aberrantes ». Je n’entre pas dans le détail, mais sachez que ce chiffre n’est pas représentatif d’une réalité beaucoup plus complexe.
M. le Président : Sur les semences bio, y a-t-il une tolérance de norme AB de 5 % ?
M. Didier MARTEAU : Les agriculteurs bio se sont imposés eux-mêmes des normes dans leurs cahiers des charges, en l’absence de réglementation concernant la présence d’OGM dans les cultures bio. Pour l’ensemble des cultures, la tolérance qu’ils se sont fixée en terme de pureté variétale, est généralement de 5 % mais sur les OGM, ils se sont imposé le taux de 0 ou 0,1 %. C’est plus sévère que les normes existant dans d’autres pays européens : l’Autriche est à 0,5 % par exemple, et la Suisse à 1 %. Ce manque de coordination pose d’ailleurs un problème de distorsion de concurrence.
Mme Odile SAUGUES : La norme « Ecocert » correspond-t-elle au cahier des charges auquel vous faites référence ?
M. Didier MARTEAU : Oui, ce cahier des charges fixe le taux d’OGM à 0,1 %. En termes de pureté variétale, le taux est généralement de 5 %. Je serai plus prudent concernant le taux des produits bio importés.
M. le Président : Qui a fixé ce taux de 0,1 % ?
M. Didier MARTEAU : Je préférerais que vous leur posiez la question, mais il me semble qu’il n’y a toujours pas de réglementation européenne sur ce point.
M. le Président : En effet.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Je rappelle que les représentants de la Confédération paysanne nous ont bien confirmé que la norme des 0,1 % leur est opposable et que si la proportion d’OGM est supérieure à 0,1 %, les agriculteurs ne sont plus considérés comme agriculteurs bio, ce qui est extrêmement grave pour eux.
Vous nous avez dit que la coexistence entre cultures OGM et cultures non-OGM est tout à fait possible, bien que des chercheurs nous aient dit le contraire car la pollinisation peut parfois s’étendre jusqu’à 25 kilomètres, et plus, des lieux d’expérimentation en plein champ. Dans ces conditions, comment la différenciation des cultures est-elle possible et quelles sont les distances nécessaires ?
M. Didier MARTEAU : Il faut distinguer selon les cultures. S’agissant du blé qui se reproduit par autofécondation, le problème de la pollinisation ne se pose pas. S’agissant du maïs, la pollinisation existe, mais il s’agit d’un pollen lourd. Nous le savons grâce à l’expérience des différents producteurs de semences. Quant à la repousse, elle est stérile.
Le problème est plus compliqué s’agissant du colza, puisqu’au risque de dissémination s’ajoute celui de la repousse non stérile qui peut s’étendre sur plusieurs années et qui est donc plus grave. Il faut en outre distinguer entre le colza oléique et le colza double zéro. Les distances de dissémination du pollen ont été étudiées pour la France, notamment grâce aux études de l’INRA. Pour le colza, par exemple, la pureté variétale exige une distance de 700/800 mètres. Pour le tournesol, la distance est de 300/400 mètres.
Par quels moyens peut-on réduire les distances ? Le premier moyen est la barrière de protection à l’intérieur du champ, qui est de l’ordre de dix, vingt ou trente rangs. Une variété « tampon » en bordure de champ freine la dissémination des OGM.
M. Bernard LAYRE : Des études précises ont été conduites par l’Association générale des producteurs de maïs (APGM), qui montrent que si la pollinisation peut être importante à une distance de quelques mètres, elle devient très faible à partir de quelques centaines de mètres. On a retrouvé des pollens marqués à près de 50 kilomètres, mais en quantités infimes.
Je voulais également préciser que la norme de 0,1 % que les agriculteurs bio se sont fixée pour les OGM est plus stricte que celle qu’ils ont retenue pour les pesticides. Ils s’autorisent 9 ppm de produits phytosanitaires dans les produits biologiques, ce qui est énorme, du moins par rapport à la norme fixée pour les OGM. La différence est très importante, elle résulte d’une situation d’urgence qui s’est peut-être traduite par une trop grande précipitation.
M. Didier MARTEAU : Je voudrais lever tout malentendu. Dire que la coexistence des cultures est possible ne signifie pas l’on peut parvenir à une étanchéité complète. On retrouvera toujours des traces.
M. François GUILLAUME : Il faut aussi souligner que la présence de pollen ne signifie pas forcément qu’il y aura pollinisation.
M. Didier MARTEAU : Cette remarque est importante. On sait que l’une de nos craintes majeures est qu’un croisement se fasse entre les variétés cultivées et les variétés sauvages, en particulier crucifères comme la ravenelle. Or, ce croisement est exceptionnel parce qu’il n’est pas naturel. Cela dit, il est toujours possible.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Notre mission d’information a pour objectif de nous permettre d’éclairer nos concitoyens sur les risques. Je suis tout à fait favorable aux expérimentations en plein champ, à condition que toutes les précautions soient prises. Tant que les scientifiques ne seront pas d’accord sur l’estimation des risques, je continuerai à poser des questions.
M. Gabriel BIANCHERI : Je souligne que nous avons pour les OGM des exigences que nous n’avons même pas pour les médicaments en ce qui concerne les effets paradoxaux. Les quatre-cinquièmes d’entre eux ne seraient pas mis sur le marché si les mêmes exigences leur étaient appliquées.
M. Bernard LAYRE : Sans vouloir être provocateur, je remarque aussi qu’il y a longtemps que nous ne roulerions plus en voiture si le niveau de tolérance par rapport aux accidents était aussi bas que celui qu’on applique aux OGM.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Dans cette logique, autant mettre fin à cette mission d’information…
M. François GUILLAUME : Il est une question à laquelle personne n’a répondu depuis que les travaux de notre mission ont commencé. On nous dit : OGM égal danger. Mais de quel danger s’agit-il ? Le risque de porter atteinte à la biodiversité existe, mais il est relativement limité. Et surtout, le problème n’est pas différent de celui qui se posait avec les hybrides. Il y a simplement un saut technologique majeur qui permet de modifier la plante pour obtenir des résultats que l’on obtenait auparavant avec les hybrides.
M. le Président : Avec cette différence majeure qu’un gène peut venir d’une autre espèce, y compris bactérienne. Le franchissement d’une barrière d’espèces est donc possible et c’est un vrai problème. Cela dit, le président de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) estime qu’il n’y aucun danger avéré à l’heure actuelle, et affirme que, s’il avait à choisir entre les OGM et les pesticides, il choisirait les OGM sans hésiter.
M. Didier MARTEAU : C’est là un point très important car les risques des autres produits ne doivent pas être négligés. Même les agriculteurs bio utilisent du soufre pour soigner leurs cultures le plus naturellement possible, mais les quantités utilisées deviennent dangereuses au-delà d’un certain seuil. On sait que des agriculteurs ont été victimes d’accidents. Si l’on peut créer une résistance naturelle aux insectes et aux maladies, ce serait un bien pour les agriculteurs – qui sont quand même les plus exposés – comme pour les consommateurs. Sans parler du gain économique qu’on pourrait en tirer car la culture des OGM se développe à l’étranger, notamment chez nos voisins espagnols.
M. Pierre COHEN : La peur de la dissémination pèse fortement sur le débat autour des OGM. Il semblerait, d’après ce que vous nous dites, que l’isolement soit facilement maîtrisable si l’on respecte certaines distances connues. Serait-il possible d’obtenir des chiffres précis sur le risque de dissémination qui nous permettrait d’objectiviser le risque ?
M. Bernard LAYRE : Je n’ai pas de chiffres. Mais techniquement, nous avons les moyens de réaliser les études nécessaires. Par ailleurs, j’ai oublié de préciser que les tests effectués sur les OGM coûtent vingt fois plus cher que pour d’autres produits.
A quelques jours du Téléthon, il serait également bon de se souvenir que personne ne s’est jamais élevé contre le développement du génie génétique sur l’homme, alors que de très fortes résistances – véhiculées par une mauvaise communication – se manifestent contre les plantes OGM. On sait, par ailleurs, qu’il va falloir doubler la production alimentaire dans les quinze ans à venir, et ce sur une même surface, de même qu’il nous faudra développer des sources d’énergie renouvelable. Peut-on, dans ces conditions, s’offrir le luxe de ne pas développer la recherche en biotechnologies ?
M. Didier MARTEAU : Nous disposons de deux études majeures : celle de l’INRA, conduite par M. Valceschini ; et celle de l’APGM sur les protections. S’agissant de ces dernières, j’ai déjà évoqué les distances de sécurité à l’intérieur du champ. La deuxième technique utilisée est le décalage de semis pour éviter des disséminations simultanées de pollen, même si, dans certains cas, ces techniques sont inutiles car un même champ peut accueillir des cultures différentes.
M. le Président : La FNSEA et le CNJA sont-ils favorables aux expérimentations en plein champ, et si oui, pourquoi ?
M. Bernard LAYRE : Nous y sommes favorables, parce que les experts nous disent qu’il n’est pas possible, dans un milieu confiné, d’évaluer toutes les conséquences des cultures d’OGM. Ces expériences sont nécessaires, dès lors que toutes les précautions sont prises.
M. Didier MARTEAU : Notre position est la même. Il faut se donner les moyens de répondre de manière précise à toutes les questions qui sont légitimement posées. Il est tout de même sidérant que ceux-là mêmes qui posent ces questions détruisent les essais qui ont pour but d’y répondre.
M. Bernard LAYRE : Alors que certaines plantes peuvent contribuer à améliorer les conditions environnementales, ceux qui se disent attachés à la protection de l’environnement ne veulent pas que l’on se donne les moyens de savoir comment y parvenir. Il y a là quelque chose d’assez incompréhensible.
Je voudrais répondre, M. le Président, à la question n° 5 du questionnaire : « Jugez-vous pertinente la définition d’un seuil de teneur en OGM au-delà duquel la présence d’OGM dans un produit alimentaire devrait être signalée au consommateur ? » Ma réponse est oui, au nom de la transparence qui est indispensable.
M. le Président : Si vous êtes favorables à l’expérimentation en plein champ, cela signifie-t-il que vous êtes également favorables, le cas échéant, à la mise en culture ultérieure ?
M. Bernard LAYRE : Bien sûr. Comment peut-on être favorable aux expérimentations en plein champ et ne pas être favorable à la mise en culture si ces expérimentations concluent à l’innocuité de cette culture pour la santé humaine, pour l’environnement et pour les sols eux-mêmes ? Il ne faut pas négliger les problèmes agronomiques, comme cela a été le cas avec les boues d’épuration
M. Didier MARTEAU : Je ne suis pas favorable, pour l’instant, à la production en plein champ, car trop de questions restent encore sans réponse et donc sans réglementation, notamment en matière de responsabilité. Par ailleurs, les conditions du marché ne nous permettent pas de nous engager dans de telles productions.
M. Bernard LAYRE : Je souscris tout à fait à ce que dit M. Marteau, et qui n’est pas contradictoire avec ce que je viens de dire.
M. Pierre COHEN : Je suis heureux de cette réponse, car notre mission d’information n’a pas encore entendu, du moins de la part d’acteurs du monde agricole, de propos aussi nettement favorables aux expérimentations en plein champ.
M. Didier MARTEAU : Mais soit dit en passant, nous n’aurons bientôt plus à nous poser la question ! Alors que la recherche française était en pointe il y a quelques années, les grands groupes quittent notre pays. Ils ne veulent plus entendre parler d’essais en France. Je ne sais pas si les essais couvriront, l’année prochaine, une surface totale supérieure à cinq hectares, autrement dit rien.
M. Pierre COHEN : Si l’on peut être favorable aux essais en plein champ sans être obligatoirement favorable, pour l’instant, à la production en plein champ, c’est pour les raisons que vous avez exposées, mais aussi parce que notre pays a intérêt à développer les études scientifiques s’il veut pouvoir prendre la parole dans l’arène internationale. C’est ce que nous ont dit les représentants de l’INRA.
M. François GUILLAUME : Si nous procédons à des expérimentations en plein champ, c’est bien pour savoir quels sont les inconvénients et les avantages des OGM. Il me paraît évident que si ceux-ci l’emportent, la conclusion à en tirer est l’autorisation de produire. Qu’ensuite, certains agriculteurs souhaitent ne pas s’engager dans la production d’OGM pour des raisons qui tiennent aux conditions du marché ou au souci de leur image, c’est leur droit. Les expérimentations ne doivent pas avoir pour but essentiel de nous permettre de participer aux colloques internationaux !
M. André CHASSAIGNE : Dans ce débat précis, il faut noter que depuis le début de nos auditions, on nous dit que les expérimentations doivent être justifiées par une utilisation future. La question du passage à la production ne devrait donc pas se poser.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Il y a cinquante ans, les chercheurs nous disaient que l’expérimentation sur les animaux vivants était indispensable, et que la recherche in vitro ne suffisait pas. Or, grâce à l’augmentation des crédits et à la manifestation d’une volonté politique, certains problèmes ont pu être résolus sans recourir à l’expérimentation sur les animaux. De la même manière, je suis convaincue que si nous faisons les efforts nécessaires, les modélisations en milieu confiné nous permettront d’avancer sans avoir systématiquement besoin de procéder à des essais en plein champ.
M. Bernard LAYRE : N’étant que le président du CNJA, je ne me permettrai pas de donner un avis scientifique. J’observe seulement que la majorité des chercheurs que j’ai rencontrés affirment que les travaux en milieu confiné ne leur permettent pas d’évaluer les conséquences d’une culture d’OGM.
Pour répondre à M. Guillaume, je pense qu’il ne suffit pas que les avantages l’emportent sur les inconvénients. Compte tenu de la sensibilité politique du sujet, pour que la production d’OGM soit possible, il me semble que c’est véritablement son innocuité qui doit être établie.
M. Didier MARTEAU : Je pense m’être mal exprimé. J’exclus la production d’OGM dans l’immédiat. Mais au-delà de 2005, je n’exclus nullement que l’on passe au stade de la production si les expérimentations montrent que c’est possible. D’autant que le risque zéro n’existant pas, il sera plus intéressant de faire de l’OGM et de réduire les traitements. Au demeurant, je rappelle que douze variétés de maïs OGM sont actuellement autorisées. Rien n’interdit à un agriculteur d’aller acheter des semences en Belgique ou en Espagne.
M. le Président : Il s’agit de variétés autorisées avant le moratoire de 1998.
M. Didier MARTEAU : Tout à fait et le paradoxe est que certaines variétés sont autorisées à l’importation mais ne peuvent pas être cultivées.
M. Francis DELATTRE : L’affichage « OGM » sur un produit donné revient pratiquement à le condamner à l’échec commercial. Il me semblerait donc honnête que l’on puisse mentionner également les avantages d’un produit OGM. S’agissant du maïs, par exemple, un affichage « OGM : deux fois moins de pesticides » devrait être autorisé. Pensez-vous que cela entrerait dans le cadre d’une politique de traçabilité honnête ?
M. Didier MARTEAU : Nous sommes plutôt opposés aux mentions du type « sans OGM », « sans boues » ou « sans pesticides ». La liste des produits concernés serait infinie et, en tout état de cause, cela ne valorise pas un produit.
M. Francis DELATTRE : Je pense que si des messages positifs ne figurent pas sur l’emballage, il y a peu de chances que les ventes décollent.
M. Didier MARTEAU : Ce n’est pas sûr. Les enquêtes montrent que les consommateurs qui s’aperçoivent, après être sortis du magasin, que le produit acheté contenait des OGM décident quand même de le garder.
M. le Président : Cela rejoint ce que vous avez dit tout à l’heure sur le fait que les OGM entrent, en fait, dans la composition de 70 % des produits alimentaires. Il faut souligner que, dans ce dossier, les dirigeants politiques, qu’ils soient de droite ou de gauche, n’ont pas été courageux. Ils n’ont pas su analyser en détail un problème, certes compliqué, ni fixer, à partir de là, des orientations claires. On est donc dans une réalité pleine de contradictions.
M. Bernard LAYRE : Il faut aussi savoir où positionner le curseur entre les pratiques qui relèvent de l’information des consommateurs et celles qui relèvent du marketing, peut-être moins objectives.
M. Francis DELATTRE : Sur les bouteilles d’eau minérale, la composition du produit apparaît. Pourquoi la même chose ne serait-elle pas possible pour les produits OGM ?
M. Bernard LAYRE : La plupart des consommateurs n’ont pas de référence. Le simple mot « phytosanitaires » provoque de vives réactions. Les informations qu’il convient de porter à la connaissance des consommateurs doivent avoir un sens pour eux.
M. Francis DELATTRE : C’est ce que l’on disait il y a dix ans et, aujourd’hui, on mentionne les conservateurs sur les emballages. Une information objective, me semble-t-il, suppose que l’on fasse apparaître les éléments entrant dans la composition du produit.
M. Bernard LAYRE : Une enquête menée auprès des consommateurs a fait apparaître, en 2002, que 10 % d’entre eux seulement lisent la composition des produits qu’ils achètent, et que 2 % comprennent effectivement ce qu’ils lisent. Je ne suis pas sûr que le fait de détailler plus avant la composition des produits soit d’une grande utilité.
M. Gabriel BIANCHERI : Il faut être conscient qu’il existe des mots clés. « OGM » en est un, qui n’attire guère. « Pesticides » en est un autre, qui fait peur également. Une meilleure information sur ces mots clés ferait avancer les choses.
M. le Président : A votre avis, que peut-on espérer des OGM ? Et quel bénéfice les agriculteurs peuvent-ils en tirer ? Peuvent-ils notamment contribuer à diminuer l’utilisation de pesticides, d’insecticides et de fongicides ?
M. Didier MARTEAU : Du point de vue de la communication, mieux vaut éviter le mot « pesticides ». Je préfère parler de produits phytosanitaires ou de médicaments des plantes.
Sur le fond, je rappelle que l’Europe importe environ 75 % de ses protéines. Le génie biomoléculaire nous permettra peut-être de répondre à nos besoins en la matière, notamment avec le soja.
En outre, les produits susceptibles de se substituer au pétrole constituent un marché énorme, sur lequel nous devons être compétitifs. Dans les vingt-cinq ans qui viennent, on va demander aux agriculteurs d’utiliser la moitié de la surface agricole pour des cultures non alimentaires, tout en nourrissant une population mondiale qui pourrait passer de 6 à 7 milliards d’habitants et à 9 milliards en 2050.
Enfin, on peut espérer que les biotechnologies répondent à certaines exigences alimentaires d’ordre qualitatif, par exemple l’abaissement du taux de cholestérol.
M. le Président : C’est ce que l’on disait il y a six ans. Mais je ne connais pas d’expériences dans ce domaine.
M. Didier MARTEAU : Des expériences sont menées, mais leurs résultats ne sont pas connus. Quoi qu’il en soit, ce sont des objectifs intéressants, le premier étant de répondre à la demande européenne plutôt que d’importer. C’est ce que je dis à ceux qui détruisent les essais : ils feraient mieux d’aller arrêter les bateaux !
M. le Président : Que pensez-vous précisément de la démarche de ceux qui détruisent les essais ?
M. Didier MARTEAU : Ils cultivent l’obscurantisme et la peur. En France, on préfère ne pas savoir et il est plus populaire de tenir un discours de refus catégorique. Je ne suis pas un « pro-OGM », je souhaite simplement que la recherche avance, dans l’intérêt des consommateurs comme des paysans. Le risque zéro n’existe pas. Ce qui compte, c’est que nous soyons en mesure d’évaluer les avantages et les inconvénients des OGM, du point de vue de la qualité des produits comme de la compétitivité de notre agriculture. Car si nous ne nous donnons pas les moyens de rester dans la course, l’agriculture française sera sinistrée comme le textile. Des règles infiniment plus strictes que celles appliquées dans les autres pays risquent d’aboutir à ce résultat. Déjà, la production française de viande blanche est en train de disparaître au profit du Brésil et de la Pologne. La tomate risque de subir le même sort.
M. Bernard LAYRE : A chaque fois que je regarde le journal télévisé, je constate moi aussi que l’on cultive la peur.
Quant à la question des bénéfices que l’on peut attendre des OGM pour l’agriculteur, le premier concerne la santé. Beaucoup d’agriculteurs souffrent d’avoir utilisé certains produits qui ont été mal évalués à une certaine époque.
D’autre part, nous n’avons pas évoqué le problème essentiel de la brevetabilité du vivant. Les réglementations appliquées aux Etats-Unis et en Europe sont très diverses. A nos yeux, il faut breveter les applications d’un gène, et non pas le gène lui-même.
M. le Président : C’est ce que prévoit la loi qui vient d’être adoptée lundi dernier, 29 novembre 2004..
M. Bernard LAYRE : C’est une très bonne chose. Actuellement, les coopératives subissent une concurrence déloyale de la part de certains établissements privés qui nouent des liens au niveau international. Il faut aussi avancer en matière de certificats d’obtention végétale. Il faut que votre mission travaille sur ce sujet.
M. le Président : Avant de vous poser les dernières questions, je voudrais vous signaler que notre mission d’information organisera des tables rondes sur divers sujets, y compris les problèmes juridiques, auxquelles participeront des acteurs très différents. Vous pourrez revenir à certaines d’entre elles.
M. le Rapporteur : Je vais me faire l’avocat du diable. En adoptant les OGM, ne craignez-vous pas d’être les otages d’un oligopole mondial ?
M. Didier MARTEAU : Cette question est essentielle, d’autant plus que le nombre des grands groupes va encore se réduire. Monsanto est à vendre.
Nous pensons qu’il faut d’abord préférer la certification à la brevetabilité. Les agriculteurs doivent également avoir la possibilité de choisir leur culture. S’agissant de la protection, la stérilité peut être une réponse aux risques de croisement et j’ai attiré l’attention de l’INRA sur ce point. Le « Terminator » n’est pas une folie, contrairement à ce que disent certains. Je précise que c’est là ma position personnelle, et non pas celle de la FNSEA.
M. Bernard LAYRE : S’agissant du problème de la dépendance des paysans à l’égard des semenciers, il faut expliquer que sur les variétés non-OGM en sélection d’hybrides, plusieurs entreprises ont leurs variétés croisées avec des souches différentes. C’est cela qui permet de mettre les entreprises en concurrence et d’éviter une trop forte dépendance. Au contraire, lorsqu’on découvre la fonction d’un gène, celle-ci est unique. Par contre, les applications de cette fonction peuvent être multiples et c’est à travers ces applications que la concurrence peut jouer pour éviter d’enfermer les agriculteurs dans une dépendance. C’est pourquoi j’insiste à nouveau sur l’importance de modifier les dispositions légales relatives à la brevetabilité.
M. le Rapporteur : N’y a-t-il vraiment aucun risque que le gène de stérilité soit disséminé sur d’autres plants ?
M. Didier MARTEAU : Non. Ce gène meurt. Mais les scientifiques de l’INRA seraient plus qualifiés que moi pour vous répondre. En ce qui concerne le colza, c’est la repousse qui pose le plus problème, en particulier en raison des risques de dissémination croisée avec les plantes crucifères.
M. Bernard LAYRE : Il faut aussi préciser que le phénomène d’hétérosis – c’est-à-dire la capacité à repousser partiellement avec la même productivité – caractérise certaines plantes et pas d’autres. C’est une donnée à prendre en compte.
M. Gabriel BIANCHERI : La stérilisation ne crée-t-elle pas aussi une forme de dépendance ?
M. Didier MARTEAU : Je ne dis pas que c’est la formule idéale. Mais à partir du moment où l’agriculteur est bien informé, il fait des choix qu’il assume.
M. le Président : M. Marteau, M. Layre, nous vous remercions.
Audition de M. Jean BIZET, sénateur,
président de la mission d’information sur les OGM constituée dans le cadre de la commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat
(extrait du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2004)
Présidence de M. Christian MÉNARD, Rapporteur
M. Christian MÉNARD, Président : Mes chers collègues, nous remercions le sénateur Bizet d’avoir bien voulu répondre à notre invitation. M. Bizet, vous avez été le président de la mission d’information sur les OGM constituée dans le cadre de la commission des Affaires économiques et du Plan du Sénat, mission dont les travaux ont débouché en 2003 sur un rapport particulièrement exhaustif sur ce sujet15. C’est donc avec beaucoup d’attention que les membres de notre mission d’information sont prêts à vous écouter.
M. Jean BIZET : Mesdames, Messieurs les députés, je vous félicite d’avoir créé cette mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés. Ce dossier est devenu depuis quelques années un véritable sujet de société. Puisque vous avez évoqué le rapport de notre propre mission d’information, je veux rendre hommage à notre rapporteur, Jean-Marc Pastor. Tout en ayant des sensibilités politiques différentes, nous n’avons eu aucun problème à nous retrouver, et ce rapport a été adopté à l’unanimité des groupes politiques du Sénat.
J’aborderai successivement les réalités économiques, environnementales et sociologiques, avant de conclure brièvement.
S’agissant des réalités économiques, nous devons d’abord constater, que cela nous plaise ou non, que les cultures d’OGM occupent environ 65 millions d’hectares dans le monde, essentiellement au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine et en Chine. Cela représente plus de deux fois la surface agricole utile française, sur laquelle les expérimentations occupent un peu moins de 20 hectares…
Deuxième réalité économique : la brevetabilité est incontournable. Elle relève notamment du traité ADPIC16. Tout pays qui n’aura pas breveté se trouvera à l’écart de cette nouveauté. Je rappelle cependant qu’il n’y a pas de brevetabilité du vivant – les espèces animales ou végétales ne sont pas brevetables – et que ce qui est brevetable, c’est le couple gène/fonction.
Une entreprise ayant déposé un brevet a donc plus d’avenir qu’une autre. C’est un fait. Je me réjouis que le Sénat ait adopté, il y a à peu près un mois, le projet de loi portant transposition de la directive communautaire 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998. Nous y avons ajouté un amendement, adopté par l’Assemblée nationale, tendant à introduire ce qu’on appelle l’exception du sélectionneur, de façon à permettre aux semenciers européens, et notamment français, de travailler sur un substrat végétal, sans être obligés de demander une autorisation à une multinationale, étant entendu que la brevetabilité commence là où s’opère la commercialisation.
Troisième réalité, également incontournable : la mondialisation des échanges. Le Canada, le Brésil, l’Argentine et les Etats-Unis ont saisi l’organe de règlement des différends au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un panel s’est constitué, a décidé de recourir à une expertise scientifique à la demande de l’Union européenne, et a sollicité pour cela cinq experts anglo-saxons. Leurs réponses sont attendues pour le 17 décembre 2004 et le rapport définitif du panel pour le 24 juin 2005. Dans l’hypothèse où l’Union européenne serait condamnée, on sait déjà que les Etats-Unis ont fixé à 4 milliards de dollars la somme qu’elle devrait verser pour entrave à la liberté du commerce. Il serait regrettable que ce conflit interfère avec les travaux du Parlement français sur la transposition de la directive 2001/18/CE. Donner l’impression de légiférer sous pression de l’OMC, et, plus précisément, sous pression américaine, serait du plus mauvais effet.
J’ajoute que depuis les accords de Blairhouse, soit depuis 1992, nos importations de protéine végétale couvrent 75 % de nos besoins. Nous ne pouvons d’ailleurs faire autrement si nous voulons nourrir nos animaux.
Quatrième réalité économique : même après l’accord-cadre du 1er août 2004 qui a « relancé » le cycle de Doha, l’alimentation reste pour les Etats-Unis une arme vis-à-vis des pays en voie de développement. Ainsi, en 2003, la marge brute du coton OGM par rapport au coton traditionnel a été de + 74 % en Inde. Pour les Etats-Unis, avec 43 millions d’hectares cultivés en 2003, la production d’OGM a augmenté de 2,4 millions de tonnes, générant un bénéfice de 1,9 milliard de dollars supplémentaires et une diminution de l’utilisation de produits phytosanitaires à hauteur de 20 900 tonnes. Ces chiffres émanent de la dernière lettre d’information de Monsanto.
J’en viens maintenant aux réalités environnementales. Il faut se souvenir que les progrès qu’a accomplis notre agriculture sont essentiellement dus à l’utilisation des intrants, pour laquelle nous sommes, après les Etats-Unis, le deuxième pays au monde. Mais nous sommes aujourd’hui au sommet de la courbe de Gauss, et il est strictement impossible, en termes de production, que nous allions au-delà. Il faut tenir compte de cette réalité.
Deuxième réalité environnementale : nous devrons être de plus en plus attentifs, dans les années qui viennent, à la gestion de la ressource en eau.
Troisième point : la notion de développement durable est incontournable. Jean-Marc Pastor et moi-même avons rappelé, dans notre rapport, que le « World Wide Fund » (WWF) a mis au point un indicateur visant à mesurer la pression que l’homme exerce sur la nature, son « empreinte écologique ». Celle-ci équivaut à la quantité de terre productive ou d’espace marin nécessaire à la consommation d’une population donnée et à l’absorption des déchets ainsi produits. Notre planète compte 6 milliards d’habitants et dispose de 11,4 milliards d’hectares terrestres et marins, soit une biocapacité de 1,9 hectare par habitant et une empreinte écologique de 2,28 hectares par habitant. Dans son rapport « Planète vivante 2002 », le WWF a fait apparaître que l’empreinte écologique de l’Européen de l’Ouest était, en 1999, de 4,97 hectares, celle de l’Américain de 9,7 hectares, celle de l’Africain de 1,36 hectare. S’agissant du sort des générations futures, on ne peut pas lire ces chiffres sans être interpellé. Je ne dis surtout pas que les biotechnologies sont la réponse à tout, mais il me semble difficile de les rejeter si l’on veut répondre aux enjeux du développement durable.
Parmi les réalités sociologiques, la première est que l’acceptation sociétale n’est pas au rendez-vous. Une grande majorité de nos concitoyens sont opposés aux OGM. C’est une chose qui leur fait peur, à tort ou à raison, peut-être à cause d’un défaut d’explication, peut-être parce qu’ils ne veulent pas entendre, peut-être aussi parce que nous sommes un pays riche : le problème des Indiens ou des Chinois, étant d’abord de manger, leur approche du problème est forcément différente.
Deuxième réalité sociologique : bon nombre de nos concitoyens ont encore un pied dans le XIXe siècle. Dans une « société d’inquiétude », pour reprendre l’expression d’Alain Touraine, l’alimentation est considérée comme un repère, elle renvoie à nos racines. Dans un pays de culture latine, il est très difficile d’aborder le sujet de façon rationnelle, sans passion.
La troisième réalité sociologique est la difficulté du débat démocratique. Après la Conférence des citoyens organisée par Jean-Yves Le Déaut en 1998, et après plusieurs débats au Conseil économique et social, on s’aperçoit qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’aborder le sujet sous l’angle exclusif de l’information. Il me semble que nous avons atteint un stade où, le passionnel l’ayant emporté sur le rationnel, il faut que le Parlement se saisisse de cette question et que la décision politique soit prise.
Enfin, toujours dans le domaine des réalités sociologiques, je suis extrêmement inquiet pour l’Etat de droit au regard de ce qui s’est passé cet été après les actions des « faucheurs volontaires ». Les actes que certains qualifient de « désobéissance civile » relèvent plutôt, à mes yeux, du vandalisme. Quand on porte atteinte au bien d’autrui, on doit s’attendre à en répondre devant la justice de son pays. Même sur un sujet délicat et conflictuel, l’Etat de droit doit être respecté.
Je voudrais insister, pour conclure, sur cinq points.
Tout d’abord, les groupes politiques du Sénat ont adopté le rapport de notre mission d’information à l’unanimité. Il faut s’en réjouir.
Deuxièmement, il me semble, je le répète, que nous sommes arrivés au terme du débat démocratique. Nous en sommes à un point où le passionnel l’a emporté. Il faut maintenant un débat politique et il est urgent qu’une décision politique soit prise. Pendant que nous tergiversons, d’autres pays, notamment la Chine, brevètent. A force d’attendre, nous faisons courir à nos agriculteurs le risque de devenir des ouvriers à façon de certaines multinationales. Alors que nous étions il y a quelques années les leaders en Europe, nous sommes maintenant derrière les Allemands et les Anglais.
Je souligne, troisièmement, la nécessité d’une législation adaptée. Le projet de loi transposant dans notre droit la directive 98/44/CE a été adopté par le Sénat à l’unanimité, moins l’abstention du groupe communiste. Comme je l’ai dit, nous avons amendé ce texte pour y introduire l’exception du sélectionneur, afin que nos semenciers soient dans une position plus confortable dans leurs négociations avec le détenteur du brevet sur le couple gène/fonction. Les Allemands ont adopté la même approche, et les autres pays de l’Union européenne devraient nous suivre. Par contre, la transposition de la directive 2001/18/CE reste à faire. On notera que le seuil de 0,9 % retenu pour l’étiquetage est le résultat d’un consensus politique et n’a aucune signification d’ordre scientifique. Les quinze ministres de l’agriculture européens ont mis 72 heures pour se mettre d’accord sur ce chiffre. Evidemment, le fait qu’il n’ait aucune signification scientifique n’est pas facile à faire comprendre à nos concitoyens. Certains pensent qu’ils sont sauvés au-dessous de 0,9 % et condamnés au-delà. La vérité est que le « mauvais OGM » est celui qui n’est pas mis sur le marché. Par ailleurs, la difficile question de la coexistence entre les cultures doit être réglée, de même que celle de l’assurance car elle a un impact économique important.
Quatrièmement, il me semble que nous n’avons pas pris conscience de notre fragilité en matière de recherche-développement. Nous ne répondrons aux enjeux du développement durable que par un saut technologique. Il est totalement illusoire d’y répondre par une stratégie de décroissance. Pourquoi les Etats-Unis n’ont-ils pas ratifié le protocole de Kyoto ? Pas du tout parce qu’ils sont opposés à ses objectifs, mais parce qu’ils ont fait le choix d’investir massivement dans la recherche-développement. Et lorsqu’ils auront trouvé des solutions, ils adopteront une démarche beaucoup plus coercitive que le protocole de Kyoto, et nous imposeront une évolution économique que nous aurons beaucoup de mal à suivre, si ce n’est en payant des « royalties ». Songez qu’en 2002, leurs dépenses de recherche-développement ont été de 38 % supérieures à celles de l’Union européenne, que le budget du « National Institute of Health »17 est 57 fois plus élevé que celui de l’INSERM, et qu’alors que six médicaments sur dix sont, de près ou de loin, issus des biotechnologies, sept sur dix sont d’origine américaine. Je rappelle que nous étions leaders sur les produits pharmaceutiques en 1960. Il faudrait donc faire un investissement massif dans la recherche.
Comment réagissons-nous ? Je vous donnerai l’exemple de Meristem Therapeutics, émanation de Limagrain, propriété des agriculteurs français qui était jusqu’à une date récente leader mondial de la recherche sur une variété de maïs transgénique susceptible d’entrer dans la production d’une lipase gastrique, une enzyme permettant de soulager les enfants atteints de mucoviscidose. L’an dernier, son président m’a appris qu’un fonds de pension retirait sa participation en raison des messages négatifs émanant de la société française à l’adresse des biotechnologies.
Enfin, je voudrais souligner que, depuis cinquante ans, l’agriculture a toujours été au rendez-vous de la modernité. J’aborde la question des biotechnologies en considérant qu’elles s’inscrivent dans le droit-fil de l’évolution de la sélection variétale. Les rendements moyens sont passés de 20 quintaux à l’hectare à 100 quintaux, grâce à l’hybridation. Les journaux de l’époque expliquaient que les oies gavées avec du maïs hybride allaient devenir aveugles… En ce début de XXIe siècle, c’est une autre modernité qui est devant nous, à l’écart de laquelle l’agriculture ne peut rester. Nous n’avons pas le droit de laisser nos agriculteurs subir une distorsion de concurrence par rapport aux agriculteurs d’outre-atlantique. Cela n’exclut pas l’existence d’une pluralité de pratiques agricoles, selon le choix des agriculteurs ou selon les régions, car le maïs Bt est inutile dans la Manche où la pyrale n’existe pas. De même, l’agriculture biologique est une « niche » intéressante, d’ailleurs davantage pour les transformateurs et les distributeurs que pour l’agriculteur lui-même.
Le professeur Bernard Chevassus-au-Louis, ancien Directeur scientifique de l’INRA, nous a commenté la découverte du « vrai-faux » OGM canola. Les chercheurs canadiens avaient mis en culture des milliers de cellules de canola. S’étant aperçus de l’existence d’une mutation qui avait donné naissance à une cellule résistance au Roundup, ils se sont demandés comment ils devaient classer cette plante. Cette mutation n’étant pas le produit d’une intervention humaine – les chercheurs n’avaient fait que la constater – devait-on la considérer comme un OGM ? A cette occasion, le professeur Bernard Chevassus-au-Louis s’est posé la question de savoir si les OGM ne seraient pas, au bout du compte, un simple passage obligé.
Aussi, veillons à ne pas fragiliser nos chercheurs qui doivent pouvoir continuent à décrypter le génome, animal ou végétal. Peut-être pourra-t-on bientôt utiliser une transgénèse excluant toute intervention d’éléments étrangers. On va dans ce sens, puisque la Commission du génie biomoléculaire refuse désormais de valider toute construction génétique faisant appel à un marqueur antibiotique, parce que cela perturbe nos concitoyens et que les progrès de la science ont fait qu’il est possible de s’en dispenser. Pourtant, quand on l’utilisait, le risque d’une contamination générant une résistance à un antibiotique avait été estimé à 10-17, c’est-à-dire pas loin de zéro.
M. Christian MÉNARD, Président : Merci, mon cher collègue, pour votre exposé. Vous avez évoqué la transposition de la directive 2001/18/CE. L’Assemblée nationale pourra s’y atteler au printemps prochain, après le dépôt de nos conclusions.
La mission d’information que vous avez présidée a remis un rapport en 2003. Quels sont les éléments que vous ajouteriez ou retrancheriez aujourd’hui ?
M. Jean BIZET : Ce rapport n’a pas pris une ride, puisque depuis sa rédaction, la seule évolution, et je le regrette, a été la transposition de la directive 98/44/CE.
M. Christian MÉNARD, Président : Pensez-vous, comme beaucoup de détracteurs des OGM, que ceux qui sont actuellement mis sur le marché n’ont pratiquement aucun intérêt économique, humanitaire ou sanitaire ?
M. Jean BIZET : Il est vrai que nos concitoyens ne voient pas, dans leur assiette, l’intérêt des cultures OGM. Celles-ci peuvent pourtant permettre de diminuer l’utilisation de produits phytosanitaires.
M. Christian MÉNARD, Président : Il est question de regrouper la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance au sein d’un Comité des biotechnologies. Qu’en pensez-vous ? Par ailleurs, ce conseil devrait être placé sous la tutelle des ministères de l’agriculture, de la recherche et de l’environnement. Pensez-vous qu’il faudrait y ajouter celle du ministère de la santé ?
M. Jean BIZET : Je suis d’accord pour regrouper les trois instances au sein d’un même conseil et également pour placer ce conseil sous la tutelle du ministère de la santé.
M. Christian MÉNARD, Président : Sur ce dernier point, certaines des personnes que nous avons auditionnées ont estimé que ce serait une lourdeur administrative de plus.
M. Jean BIZET : Je pense qu’il vaut mieux, vis-à-vis de nos concitoyens, s’entourer d’un maximum de précautions.
M. Michel LEJEUNE : Comment évaluez-vous, d’un point de vue scientifique, le rapport entre les risques et les avantages des OGM ?
M. Jean BIZET : Jusqu’à présent, aucune étude n’a pu démontrer le moindre risque, la moindre pathologie spécifique en rapport avec la consommation d’OGM. Les tests effectués sur des animaux de laboratoire, que ce soit à 28 jours ou à 90 jours, n’ont par permis de conclure à l’existence de risques et on a maintenant une preuve « grandeur nature » avec les 280 millions d’Américains qui mangent des OGM depuis une dizaine d’années.
Les risques qui ont été repérés sont essentiellement d’ordre allergique et les substrats concernés sont désormais totalement écartés.
Cela dit, encore une fois, le débat n’est plus d’ordre rationnel. Je rappelle les propos de Pascal Lamy : « Les Etats-Unis considèrent que les OGM ne sont pas dangereux jusqu’à preuve du contraire, l’Union européenne estime qu’ils sont dangereux jusqu’à preuve du contraire. »
Quant aux risques environnementaux – pollinisation, repousse, résistance aux phytosanitaires –, ce sont les mêmes que pour les variétés classiques. Les agriculteurs savent qu’ils sont obligés de permuter leurs traitements en raison des risques de résistance.
En ce qui concerne les avantages, je reconnais qu’ils ne sont pas évidents, du moins s’agissant des OGM de première génération. Des rendements un peu meilleurs, un peu plus d’économies, un peu moins d’intrants. Mais il s’agit plus à mes yeux d’une question de principe. Si nous restons à l’écart de cette modernité, notre position va s’en trouver fragilisée.
M. Francis DELATTRE : Ne pensez-vous pas que ceux qui luttent le plus contre les OGM défendent en fait les intérêts des groupes agrochimiques ? D’après l’état actuel de nos connaissances, les OGM peuvent en effet diminuer de manière significative l’utilisation des intrants, qu’il s’agisse d’insecticides, de pesticides ou de fongicides, et sont la seule alternative disponible.
Par ailleurs, vous avez très justement souligné que la sélection variétale avait permis depuis cinquante ans d’importants progrès en productivité. Mais les détracteurs des OGM disent que l’on a fait évoluer les variétés en fonction également de leurs capacités à assimiler les nouveaux intrants. Et il est vrai que les fameux « packages » de Monsanto associant certaines variétés à certains produits phytosanitaires ont été une véritable aubaine pour les détracteurs des OGM. Les groupes agrochimiques européens, qui à un certain moment étaient à vendre, se sont d’ailleurs aperçus qu’ils pouvaient encore trouver un marché et ils ont finalement acheté les semenciers, y compris les semenciers français.
M. Jean BIZET : En effet, on peut dire que, d’une certaine façon, José Bové fait le jeu des multinationales américaines. Celles-ci n’ont pas particulièrement besoin de procéder à des expériences en France : elles ont 43 millions d’hectares à leur disposition de l’autre côté de l’Atlantique et on leur achète déjà 75 % de nos protéines ! Ce sont nos chercheurs et nos entreprises qui sont fragilisés par les destructions. On en vient presque à se demander si José Bové n’est pas un agent double !
Pour ce qui est des groupes chimiques, ils ont besoin d’acheter des semenciers. On ne peut pas se lancer dans les biotechnologies si l’on n’a pas un substrat. Or les semenciers français sont parmi les plus performants au monde. Le risque existe effectivement qu’ils soient achetés par des multinationales extra-européennes. Il faut préserver des entreprises comme Limagrain, malheureusement le dégât est déjà en partie fait.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Quelle différence faites-vous entre les essais en plein champ et la culture en plein champ ? Si l’on peut considérer que la recherche est indispensable, on n’est pas pour autant obligé d’accepter des cultures tous azimuts. Et n’y a-t-il pas des enjeux économiques pour un certain nombre d’entreprises multinationales ?
Par ailleurs, on s’est aperçu que les nitrosamines, qu’on ne connaissait pas il y a une quarantaine d’années, et qui proviennent directement d’une fabrication in vivo dans notre alimentation, étaient presque toutes cancérigènes. Il faut donc être très prudent. On sait aussi que les cancers, ou du moins certains d’entre eux, sont provoqués par une somme de facteurs internes et externes. Pensez-vous que les études toxicologiques, à 28 jours ou 90 jours, sont suffisantes ? Avant de se lancer dans la culture et la consommation d’OGM par les animaux et par les hommes, ne devrait-on pas développer des recherches à plus long terme ?
Pour ce qui est de la biodiversité, sur quels éléments vous fondez-vous pour affirmer que la dissémination des plantes génétiquement modifiées n’aura pas d’impact à long terme sur la biodiversité ?
Vous nous avez parlé d’une économie de 20 900 tonnes de produits phytosanitaires aux Etats-Unis. Ce chiffre peut tout vouloir dire. J’aimerais avoir des détails sur la lettre d’information de Monsanto que vous avez citée.
M. Jean BIZET : Je vous la laisserai à disposition.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Enfin, comment expliquez-vous que les assureurs refusent d’assurer les cultures OGM ?
M. Jean BIZET : Quand nous interrogeons les chercheurs, ils nous disent tous qu’à un certain moment, ils ont besoin de procéder à des expériences en plein champ car, même dans de très grandes serres, le biotope n’est pas entièrement identique à ce qu’il est dans la nature. Dans la mesure où toutes les précautions sont prises – castration, distances, décalage des semis –, où les protocoles sont validés par la Commission du génie biomoléculaire, où les ministères de l’agriculture et de l’environnement ont donné leur avis, je ne vois pas ce qui s’oppose aux expérimentations en plein champ. Même si, parmi les « faucheurs volontaires », il y a sûrement des personnes intellectuellement honnêtes, il est dommage que ces essais ne puissent être conduits jusqu’à leur terme, ce qui empêche que des réponses soient apportées aux questions légitimes qui se posent.
S’agissant de la toxicologie, aucun effet négatif n’a été prouvé sur les court et moyen termes. Sur le long terme, on n’a pas de réponse. Mais quelle expérience peut-on mener, en grandeur nature, au-delà de dix ans ? On peut seulement constater que les consommateurs américains consomment des OGM depuis plus de dix ans sans que des dominantes pathologiques soient apparues. M. Gérard Pascal, de l’INRA et de l’AFSSA, inverse le problème : a-t-on jamais procédé à des études aussi poussées pour déterminer le niveau de toxicité éventuelle de la salade, des tomates ou des pommes de terre ? Quand vous croisez deux variétés hybrides, vous réalisez un brassage de milliards de gènes, sans savoir quelles positions ils vont occuper. Quand vous effectuez une transgénèse, vous placez un gène codant pour une protéine donnée. C’est simplement un repositionnement de gène et une addition d’acides aminés. Je ne vois pas où est le problème, puisque l’on ne se pose pas autant de questions dans le cas d’une hybridation classique.
Pour ce qui est des tests de toxicité, tous les toxicologues – et je leur fais confiance – disent que les tests à 28 jours sont suffisants. Des tests à 90 jours ont fait apparaître que des rats étaient atteints d’une maladie dégénérative, ce qui a fait dire aux détracteurs des OGM que l’on avait découvert un effet toxique. En réalité, on avait simplement affaire à une pathologie de fin de vie.
Nous devons être très attentifs à la biodiversité, même si les 6 milliards d’hommes qui vivent sur Terre se nourrissent essentiellement avec une dizaine de céréales. Les biotechnologies ne doivent pas pour autant être synonymes d’uniformisation du vivant.
En ce qui concerne l’assurance, il est vrai que les assureurs ne sont guère enthousiastes. La raison en est l’absence de dispositions législatives, à laquelle la transposition de la directive 2001/18/CE devra remédier. Celle-ci répond à deux problèmes. Le premier est le seuil d’acceptation de la présence fortuite d’OGM dans les cultures biologiques. Si les agriculteurs biologiques veulent le zéro absolu pour les OGM, ils se condamneront eux-mêmes à mort, alors qu’ils admettent des tolérances pour d’autres produits. Les agriculteurs biologiques suisses acceptent un taux de 0,5 %. Le second problème est, précisément, celui de l’assurance. Il n’a pas de solution à ce jour, et il ne sera pas facile d’en trouver une. On peut imaginer que les producteurs d’OGM vont éditer un cahier des charges. Pour l’agriculteur qui respectera ce cahier des charges, il n’y aura pas de problème de responsabilité. Mais si un agriculteur biologique voisin voit ses cultures contaminées, des procès sans limite sont prévisibles.
M. Christian MÉNARD, Président : Sur le plan mondial, avez-vous connaissance de tentatives de solution ?
M. Jean BIZET : Non, mais je crois savoir que l’Allemagne est en train de travailler sur la question.
J’ajoute, de mémoire, que chaque fois qu’il y a eu un problème de contamination fortuite aux Etats-Unis, les entreprises ont payé. Cela dit, le fameux agriculteur canadien qui, lors du procès qui l’a opposé à Monsanto, a prétendu n’avoir jamais réutilisé ses semences, a constaté, comme par hasard, une repousse. Mais on sait très bien pourquoi il y a eu repousse.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Que pensez-vous de la question du franchissement de la barrière d’espèce ? D’autre part, vous ne m’avez pas répondu au sujet des facteurs internes et externes de certains cancers.
M. Jean BIZET : Je ne vous ai pas répondu parce que je ne pense pas être le plus qualifié pour vous répondre sur ce point.
En ce qui concerne la barrière d’espèce, vous savez comme moi qu’il y a unicité du code de la matière vivante. Dans une cellule animale ou végétale, le même gène code pour la même protéine et il y a des mutations dans la nature, même si elles sont rares. Les questions qu’on se pose sont plus existentielles qu’autre chose. Et dans le tractus digestif, les différentes variétés de protéines consommées ne sont plus, assez rapidement, qu’une addition d’acides aminés. Je préférerais toutefois que vous posiez ces questions à des scientifiques de haut niveau, mais je considère qu’il n’y pas vraiment de problème, d’autant que les marqueurs antibiotiques ont été exclus des transgénèses. A partir de là, je ne vois pas la différence entre un hybride et une variété transgénique. Dans le premier cas, il y a brassage de milliards de gènes et dans le second, un seul gène – ou tout au plus une série de gènes – est introduit. La question est de vérifier en aval si le gène d’intérêt produit bien la protéine qu’on souhaite.
Mais on ne convaincra jamais complètement tout le monde. Quand Parmentier a introduit la pomme de terre en France, manger un tubercule était considéré comme une aberration. La famine a contribué à l’acceptation de ce nouvel aliment.
M. Christian MÉNARD, Président : Merci beaucoup, mon cher collègue, pour votre contribution à nos travaux. Je remarque qu’il n’y a pas eu beaucoup d’évolutions depuis le dépôt de votre rapport il y a un an.
M. Jean BIZET : En effet. A ceci près, cependant, que la législation allemande semble avoir évolué. J’ajoute que l’Allemagne, alors qu’elle était, il y a cinq ou six ans, en troisième position dans le domaine des biotechnologies, est aujourd’hui en tête.
M. Christian MÉNARD, Président : Je vous remercie.
Audition de M. Arnaud APOTEKER,
responsable « campagne OGM » de Greenpeace France
(extrait du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2004)
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président
M. le Rapporteur : Monsieur Apoteker, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation. Responsable de la campagne OGM de Greenpeace France, ancien membre de la Commission française du développement durable, membre du Comité provisoire de biovigilance sur les variétés de maïs génétiquement modifiés, vous êtes depuis 1999 administrateur d’Inf’OGM.
M. Arnaud APOTEKER : Je vous remercie de me permettre de m’exprimer en tant que responsable de la campagne que mène Greenpeace sur les OGM depuis 1996, date à laquelle l’Union européenne a commencé à ouvrir ses marchés aux sojas génétiquement modifiés des Etats-Unis. Dès le début des années 90, Greenpeace s’est intéressée à la problématique des OGM : une première campagne de sensibilisation avait été organisée sans grand succès en 1992, lors du débat sur la transposition de la directive 90/220/CE, remplacée depuis par la directive 2001/18/CE.
La position de Greenpeace a souvent donné lieu à des confusions et à des malentendus. Pour résumer, Greenpeace s’oppose à la dissémination dans l’environnement des organismes génétiquement modifiés, qu’elle juge porteuse de contaminations génétiques irréversibles et automultiplicatrices. Pour autant, nous ne sommes opposés ni à la génomique, ni à la science de la génétique, ni à la biologie moléculaire, ni même à la transgénèse, dès lors que ses applications sont réalisées en milieu confiné. Pour une association de protection de l’environnement comme la nôtre, la question n’est pas de savoir si l’on est pour ou contre les OGM, mais si l’on est pour ou contre leur dissémination dans la nature. Nous sommes parfaitement conscients de l’intérêt que peuvent présenter pour la santé, par exemple, des bactéries génétiquement modifiées pour fabriquer de l’insuline, de l’interféron ou de l’hormone de croissance. Mais ces organismes doivent rester dans les laboratoires, dans les incubateurs, et surtout ne jamais être développés à l’air libre.
Cette position ne découle pas d’une croyance ou d’une idéologie en tant que telle. Elle repose sur la crainte des impacts écologiques négatifs et irréversibles que pourrait provoquer la dissémination des OGM. Pour sophistiquée qu’elle soit, la technologie du génie génétique n’en reste pas moins fondée sur une science sinon obsolète, en tout cas dépassée : la découverte de la structure en double hélice de l’ADN remonte aux années cinquante. Or non seulement l’ADN n’explique pas tout, mais l’idée univoque selon laquelle tel gène serait, par un mécanisme constant, responsable de la fabrication de telle protéine est erronée. Les découvertes les plus récentes ont montré que la mécanique génétique était autrement plus complexe : un gène peut avoir plusieurs fonctions, dont chacune dépend de l’environnement génétique et cellulaire, dans le cadre d’une rétroaction permanente. Le génome apparaît ainsi comme un ensemble très compliqué et dynamique dans lequel le moindre élément, jusqu’à la forme même de l’hélice d’ADN et à la position qu’y occupe le gène, peut avoir des conséquences extrêmement importantes.
Ajoutons que la technologie elle-même reste rudimentaire et peu précise : on ne sait en fait jamais exactement où l’on insère le gène, ce qui interdit d’éliminer par avance les effets imprévus et les interactions susceptibles de perturber le fonctionnement des autres gènes présents. Si le génie génétique semble fonctionner pour des modifications simples, il n’en ira pas de même avec des créations plus complexes, lorsqu’il s’agira, par exemple, de créer des plantes résistant à la sécheresse ou aux milieux salins.
De surcroît, le comportement de ces nouveaux organismes, qui n’ont, par définition, pas pu évoluer avec leur écosystème, est pour l’heure imprévisible. Ils seront fatalement à l’origine d’une contamination, d’une pollution génétique – à l’instar des pollutions chimiques ou radioactives de l’ère industrielle – en passant dans des variétés apparentées, voire dans des espèces affines. C’est précisément en raison de cette impossibilité de contenir ces gènes dans la plante génétiquement modifiée et de leur capacité à se répandre de proche en proche dans l’environnement que nous parlons de pollution, d’une pollution d’organismes vivants qui plus est, donc irréversible parce qu’automultiplicatrice. Fermer une usine chimique entraîne de fait une diminution de la pollution à plus ou moins long terme. De même pour une pollution radioactive, bien qu’à un rythme infiniment plus lent, dès lors que sa source a été stoppée. Inversement, l’arrêt de la culture d’une variété génétiquement modifiée n’empêchera en rien la contamination génétique de se poursuivre en s’amplifiant au fil des générations.
Ce n’est peut-être pas grave, me dira-t-on. Le problème est que nous n’avons aucun moyen d’évaluer les conséquences à long terme de cette contamination génétique. Mais d’ores et déjà, on voit poindre les effets négatifs sur l’environnement des premières cultures transgéniques – effets du reste prévisibles et dénoncés par notre association et par d’autres dès les années 90, comme l’apparition de résistances aux herbicides par des mauvaises herbes, qui obligent à recourir à des doses plus fortes ou à des mélanges plus toxiques. On peut également craindre l’apparition d’insectes résistant aux toxines produites par les plantes génétiquement modifiées telles que le maïs, le coton ou le riz Bt, ou bien, les prédateurs cibles ayant été éliminés, la pullulation de prédateurs secondaires, qui obligera peut-être à revenir aux insecticides classiques, ou encore la disparition d’insectes utiles – on ne s’est penché que sur le cas du monarque aux Etats-Unis, mais tout porte à croire qu’il en sera de même pour les papillons européens si le maïs Bt est cultivé à grande échelle en France.
M. le Rapporteur : A ma connaissance, les effets du Bt sur le papillon monarque n’ont jamais été prouvés.
M. Arnaud APOTEKER : Je n’apporte pas d’affirmations, seulement des éléments. La toxicité du pollen de maïs Bt sur le monarque ayant été montrée en laboratoire, tout porte à croire que les cultures de Bt auront des conséquences potentiellement néfastes sur le monarque en champ. On peut également relever que le distributeur Novatis, devenu entre-temps Syngenta, a décidé de ne pas demander le réenregistrement aux Etats-Unis du maïs Bt 176, qui est précisément celui avec lequel avait été menée la première étude sur le monarque. Sans nécessairement y voir un lien direct de cause à effet, la coïncidence peut étonner. Le gouvernement espagnol lui-même a refusé de renouveler l’autorisation du Bt 176. Nombre d’éléments récents, que je vous communiquerai, montrent l’impact potentiellement dangereux du pollen de maïs, et vraisemblablement d’autres cultures Bt, sur des insectes utiles.
Au-delà des effets directs, le risque d’effets en cascade, jamais étudiés ni même mentionnés dans les études, est très probable à long terme. L’apparition de variétés autochtones résistantes aux herbicides et ayant de ce fait acquis un potentiel invasif plus élevé, ou l’éradication totale d’un insecte, utile ou nuisible, peuvent avoir des conséquences en chaîne non négligeables sur l’écosystème, dont les prémices sont d’ores et déjà perceptibles aux Etats-Unis, au Canada ou en Argentine.
Bien des inconnues subsistent également pour ce qui est des effets à long terme sur la santé. Bon nombre de ces plantes génétiquement modifiées sont gorgées de pesticides qu’elles ont synthétisés. Si le Bacillus thurigensis est couramment utilisé à l’état naturel par les agriculteurs biologiques pour ses propriétés insecticides, le gène Bt introduit par transgénèse ne produit pas exactement le même insecticide que la bactérie.
Enfin, les plantes génétiquement modifiées testées ou mises sur le marché ont été adaptées pour une agriculture productiviste, intensive et sur de grandes surfaces, ce qui, à court ou moyen terme, rendra très vraisemblablement impossible tout autre choix que les OGM pour les agriculteurs comme pour les consommateurs, en raison précisément des contaminations par échange de pollen, mais également par les manutentions de semences ou les mélanges dans les silos. Le scandale du maïs StarLink aux Etats-Unis a montré que la séparation entre cultures transgéniques et cultures conventionnelles est extrêmement difficile à appliquer. Dès lors, toute possibilité de choix de vivre sans OGM, pour l’agriculteur comme pour le consommateur, est illusoire. La réglementation elle-même que peine à bâtir l’Europe en matière d’étiquetage, par exemple, obligatoire au-dessus d’un seuil de 0,90 %, deviendra très rapidement impossible à mettre en œuvre dans le cadre d’une généralisation de la culture transgénique.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu’il faille interdire définitivement les expérimentations d’OGM en champ, quand bien même il s’agirait de mettre au point des molécules thérapeutiques extrêmement attendues – la lipase, par exemple, utilisée contre la mucoviscidose ? La production en milieu confiné étant très compliquée et coûteuse, la culture en champ ne serait-elle pas la solution ? Vous y opposeriez-vous totalement ?
M. Arnaud APOTEKER : Je n’aime pas utiliser les mots « totalement » ou « définitivement » pour parler d’une science encore rudimentaire et en pleine évolution. On ne peut préjuger de l’avenir. Cela dit, je crois pour ma part possible de produire la lipase gastrique dans des conditions relativement économiques en incubateurs, par le biais de levures ou de cellules de plante plutôt que par des bactéries. Encore faudrait-il que la recherche publique ou privée y voie une priorité. Le coût doit être apprécié à l’aune du risque. Il me paraît irresponsable de faire fabriquer des médicaments par des plantes à l’air libre, à plus forte raison par des plantes à vocation originellement alimentaire, car l’on risque de voir des substances médicamenteuses se disséminer et se retrouver en bout de course dans nos assiettes. Le danger est encore plus grand qu’avec les autres substances.
M. le Rapporteur : Avez-vous eu vent du rapport Brigth qui vient de sortir et tend à prouver l’innocuité du colza et de la betterave transgéniques pour la biodiversité ?
M. Arnaud APOTEKER : Non, car ce rapport doit être tout récent.
M. le Rapporteur : Il est curieux que les écologistes contestent l’expérimentation dans la mesure où elle a eu lieu en centre de recherche et non en plein champ…
M. Arnaud APOTEKER : Les écologistes eux-mêmes doivent regarder les choses en face : il est clair que les essais en serre ne donneront jamais les mêmes informations que les essais en plein champ, de même que les essais en plein champ ne permettront pas d’évaluer les risques liés aux cultures à grande échelle, quelle que soit la taille des parcelles expérimentales, du fait qu’elles ne seront jamais contrôlées et surveillées aussi attentivement qu’une expérimentation, fût-elle grandeur nature. A refuser les essais en champ, bon nombre d’écologistes se retrouvent effectivement pris dans une contradiction. Mais le même problème se pose lors du passage des expérimentations en plein champ à la réalité agricole. Si je suis pour ma part opposé aux essais en plein champ, c’est parce que je suis persuadé, en raison même de notre méconnaissance des interactions et du fait de l’imprévisibilité du comportement de l’organisme lui-même une fois introduit dans la nature, que le génie génétique et la transgénèse ne sont pas l’avenir de l’agriculture. Vouloir créer des OGM à usage agricole, c’est à mes yeux s’engager sur une fausse voie.
M. le Rapporteur : Ne craignez-vous pas d’être ainsi accusé d’obscurantisme, le jour où les Européens, totalement débordés, se retrouveront tributaires des Américains dans ce domaine ?
M. Arnaud APOTEKER : Très franchement, non. Les cyniques vous diront que l’argument pourra être resservi à chaque fois que l’Europe refusera quelque chose qui se fait ailleurs… On n’a pas à accepter n'importe quelle technologie au motif qu’elle est pratiquée ailleurs. Au surplus, il est parfaitement légitime, y compris sur le plan politique, de défendre la volonté de la France et de l’Europe de préserver une agriculture conforme au désir des citoyens et des consommateurs. Je suis persuadé qu’une intensification à l’américaine n’est pas la voie de l’avenir pour l’agriculture européenne. Nous n’avons pas le même écosystème, ni les mêmes surfaces, ni la même vision du monde, avec des zones totalement protégées et d’autres où l’on peut faire n’importe quoi. Nous avons le droit de défendre une agriculture conforme à nos vœux, une agriculture de qualité qui n’aurait pas besoin du génie génétique. Prenons garde à ce que les grandes compagnies semencières d’outre-atlantique n’en viennent à accaparer les ressources génétiques disponibles dans l’Union européenne. La sélection variétale classique est tout à fait à même de répondre au défi d’une agriculture de qualité pour l’Union européenne.
M. Michel LEJEUNE : A ceci près que l’Europe importe 70 % de ses protéines des Etats-Unis… Vous vous dites d’accord pour l’expérimentation, mais opposé à l’application. Dans ces conditions, quel est l’intérêt de la recherche ? Par ailleurs, êtes-vous certain que les cas de résistance aux herbicides et insecticides qui apparaissent çà et là sont bien dus aux OGM et non à l’usage trop répété de produits classiques ? On trouve ainsi de plus en plus de bactéries résistantes aux antibiotiques ; pourquoi n’en irait-il pas de même avec le glyphosate ?
Vous semblez in fine vous satisfaire du taux de 0,9 % en dessous duquel on tolérerait la présence d’OGM dans l’alimentation. Cette démarche vous paraît-elle scientifique ? Si les OGM sont aussi toxiques que vous le dites, peut-on admettre d’en trouver ne serait-ce que 0,9 % ? Et s’ils ne le sont pas, pourquoi se limiter à 0,9 % ?
M. Arnaud APOTEKER : Je n’ignore pas que nous importons 70 % de nos protéines des Etats-Unis, même s’il ne faut pas y voir une règle. Nous avons eu tort de nous mettre dans cette situation de dépendance, mais ce n’est pas moi qui mène les négociations… L’Union européenne doit à mon avis retrouver la maîtrise de sa production de protéines végétales ; notre autonomie de choix en dépend. Il est du devoir de nos dirigeants d’essayer de revenir sur cette dépendance imposée, quitte à l’échanger contre autre chose.
M. Michel LEJEUNE : C’est également du devoir de nos producteurs…
M. Arnaud APOTEKER : Bien sûr. Mais le débat sur la politique agricole commune, les aides à la production et la fixation des prix mondiaux est extrêmement complexe et dépasse ma compétence. Reste qu’il faut également prendre cet aspect en compte si nous voulons déterminer nous-même le modèle d’agriculture que nous souhaitons pour l’Union européenne.
Si je suis d’accord pour les expérimentations en milieu confiné, mais opposé aux essais en champ, c’est surtout parce que je crois que ces plantes ne devraient jamais être commercialisées. Cette position peut effectivement vous paraître paradoxale, mais elle découle de mon attachement à la liberté de la recherche : en tant que responsable d’une association de défense de l’environnement, je ne me sens pas le droit de condamner une recherche en milieu confiné dès lors qu’elle n’a pas de conséquences dommageables sur le plan environnemental. Mais comme l’on ne connaît jamais à l’avance le résultat d’une recherche, il me paraît très dangereux d’autoriser ces essais en milieu ouvert. Cela dit, je trouve effectivement un peu dommage de jeter autant d’argent par les fenêtres pour des travaux qui n’ont pas vocation à être commercialisés… En tant que contribuable, je préférerais que mes impôts financent un autre type de recherche. Et je reste farouchement opposé à toute idée de commercialisation.
Les cas de résistance au glyphosate sont-ils réellement liés à l’utilisation des OGM ? Je ne suis pas un spécialiste des mécanismes qui régissent les échanges de gènes mais aucun document scientifique ne l’a encore prouvé. Quoique, pour ce qui est des repousses de colza, la cause est très certainement à rechercher de ce côté-là… Mais en fin de compte, que la résistance soit directement liée à une contamination génétique ou que la cause tienne à l’utilisation abusive ou répétitive du même produit – ce que l’OGM tend précisément à permettre –, le résultat est le même : on voit apparaître des mauvaises herbes. On ne connaissait avant 1995 qu’un seul exemple de résistance au glyphosate, lié à une utilisation abusive, en Australie. Si désormais les agriculteurs n’utilisent plus que du glyphosate, les nouvelles variétés « Roundup Ready » évitant l’épandage d’herbicides sélectifs, on verra fatalement les phénomènes de résistance se multiplier, même si ce n’est pas par un mécanisme génétique.
Je ne me satisfais évidemment pas du seuil de 0,9 % d’OGM, au-dessus duquel la réglementation européenne impose dorénavant un étiquetage. A l’origine, il devait être de 1 % et, très franchement, je ne vois pas vraiment de différence. Nous en avons débattu au sein des associations écologistes. Certains estimaient qu’accepter l’étiquetage, c’était accepter les OGM. Pour moi, c’est se rendre compte que les OGM sont, qu’on le veuille ou non, déjà cultivés. En 1996, lorsque l’Europe a autorisé les premières importations de soja génétiquement modifié, il n’y avait aucun étiquetage, donc aucun moyen pour le consommateur et pour le citoyen de faire valoir ses préférences en matière d’alimentation. Dès lors que les OGM sont cultivés à grande échelle en divers lieux de la planète, le consommateur doit être en mesure de dire qu’il n’en veut pas. La fixation du seuil ne dépend pas uniquement de considérations scientifiques, mais plutôt de critères technico-scientifico-économiques et politiques… Imposer l’étiquetage à la moindre trace d’OGM répondrait certes totalement au souhait du consommateur, mais reviendrait en fait à lui ôter toute possibilité de choix, pour la simple raison que c’est devenu tout bonnement impossible. C’est précisément là que résiste le caractère « totalitaire » de l’agriculture OGM. Le taux de 0,9 %, pour insatisfaisant qu’il soit, a au moins le mérite d’éviter les dérives que l’on a relevées au Japon, par exemple, où le taux de 5 % permettait à tout un chacun de « refourguer » de l’OGM sans le dire.
M. Michel LEJEUNE : Certains cas de résistance spontanée, à l’instar de ce qui se produit avec les antibiotiques, n’ont strictement rien à voir avec les OGM. Les résistances apparaissent par un phénomène très naturel. Soit ils sont dangereux ou toxiques, soit ils ne le sont pas. Et s’ils le sont, la dangerosité commence à la première trace, pas à 0,9 % !
M. Arnaud APOTEKER : C’est précisément parce que la lutte contre les agents pathogènes, et notamment contre les mauvaises herbes, devient plus difficile qu’il nous faut chercher des méthodes propres à ralentir l’apparition des résistances. Or la création d’OGM tolérants à un produit particulier ne peut qu’accélérer ce phénomène. Et s’il n’est pas encore avéré que la résistance aux mauvaises herbes puisse provenir d’un transfert de gènes, force est d’admettre, on le voit au Canada, que le colza a une propension certaine à la repousse à long terme et au croisement avec des plantes très apparentées qui deviennent également résistantes à des herbicides. Reste à savoir si la repousse de colza résistante est une mauvaise herbe ou pas… Tout dépend de ce que l’on fait après. Si c’est du blé que l’on cultive, c’en sera une.
M. Michel LEJEUNE : Cela peut être un engrais vert, une fois retourné.
M. Arnaud APOTEKER : Mais pas lorsqu’il pousse en même temps que le blé !
L’opposition de Greenpeace aux organismes génétiquement modifiés n’est pas motivée par la crainte d’un risque sanitaire. La fixation du seuil à 0,9 % n’est pas liée à la toxicité des produits, mais à des considérations d’ordre économique. Le but est de donner le choix au consommateur qui, avant même de craindre pour sa santé, doit être en mesure de donner un signal aux producteurs en faisant clairement savoir qu’il refuse ces produits. Dès lors que les importations ont été autorisées, seul le consommateur peut faire reculer cette menace écologique, car le risque est bien plus grand encore pour l’environnement que pour la santé, même si des inconnues demeurent sur ce plan : si le danger n’est pas prouvé, l’absence de danger ne l’est pas davantage.
M. Pierre COHEN : Autrement dit, c’est le risque de l’inconnu, plutôt que le danger sanitaire, que vous mettez en avant pour vous opposer aux expérimentations en plein champ, sans parler de la production. Mais les observations faites en milieu confiné ne vous amèneront-elles pas – et si oui, à quelles conditions – à revoir votre position, ne serait-ce que pour permettre d’améliorer notre niveau de connaissance ? Comment nous prévaloir d’une expérience en la matière dans des instances internationales, face à des pays où les OGM sont cultivés sur des milliers d’hectares et dont, par la force des choses, nous nous retrouverons tributaires si nous ne procédons pas à des essais en plein champ ?
M. Arnaud APOTEKER : J’ai en tête le rapport de la CGB sur le colza, plante éminemment emblématique par son pouvoir de dissémination : la seule façon de savoir s’il y a un risque irréversible de contamination génétique, c’est de le prendre, disait-elle en substance, en faisant des essais en champ pour vérifier l’existence d’une dissémination automultiplicatrice et irréversible… Pour moi, les terres agricoles et l’environnement ne sont pas un gigantesque laboratoire. On ne peut se permettre d’y courir un risque au motif que l’on veut savoir s’il existe réellement. Les essais en champ ressemblent fort, de ce point de vue, à une épine dans le pied. Mais l’avenir nous montrera que les plantes transgéniques ne fonctionnent finalement pas, simplement du fait que les caractères qui nous intéressent sont très complexes à mettre en œuvre. Si la résistance à un herbicide ou à un insecte est chose relativement aisée parce que cela implique peu de gènes, il n’en sera pas de même lorsque l’on voudra s’attaquer à des caractères plus sophistiqués. Le dogme de la biologie moléculaire montrera alors ses failles, qui tiennent à l’extraordinaire complexité du réseau d’actions et d’interactions entre les gènes eux-mêmes et entre les gènes et leur environnement. De fait, la majorité des expérimentations en plein champ n’apportent, aujourd’hui, aucune réponse à ces questions. Il s’agit en réalité d’opérations de précommercialisation, destinées à s’assurer que la variété testée est stable et homogène et à mesurer ses caractéristiques conventionnelles avant de la mettre sur le marché. Cette procédure s’applique à toutes les plantes, OGM ou pas. Pour ce qui est des préoccupations de recherche fondamentale, les essais en milieu confiné, auxquels je ne suis pas opposé, même si en tant que citoyen, j’estime qu’il ne s’agit pas d’une priorité, permettent déjà d’apporter bon nombre de réponses, notamment sur le plan de la cartographie du génome, en utilisant des gènes marqueurs. L’amélioration variétale conventionnelle en serait grandement accélérée.
M. François GUILLAUME, Président : Autrement dit, vous espérez que ces travaux déboucheront un jour sur une production. Sinon, à quoi serviraient-ils ?
M. Arnaud APOTEKER : Le terme « essai » prête à confusion. Je suis favorable à des recherches expérimentales en milieu confiné. Le but est de savoir comment s’opère une transformation génétique et de se servir de ces résultats pour faire de l’amélioration variétale par mutagenèse et de la sélection par marqueurs, sans pour autant chercher à introduire dans un organisme des gènes d’une autre espèce. Il s’agit d’« expériences » et non d’essais visant à comprendre de façon beaucoup plus fine les mécanismes entre les génomes, le milieu cellulaire et l’environnement ; comprendre comment un caractère désiré peut être repéré sur la carte du génome et comment on peut, lors d’améliorations variétales classifiées, repérer les mécanismes de transmission du gène.
M. Germinal PEIRO : Les partisans des OGM ne manquent pas d’arguments intéressants : la mise au point d’une plante résistante à un insecte a de quoi séduire sur le plan économique comme sur le plan politique, car elle devrait coûter moins cher à produire et contribuer à l’alimentation des populations pauvres. N’y trouvez-vous réellement aucun intérêt sur quelque plan que ce soit ?
M. Arnaud APOTEKER : Il ne faut jamais dire jamais… Mais il faut toujours se méfier de la séduction – on tombe souvent de haut – et se pencher attentivement sur les effets à plus long terme. La plante génétiquement modifiée insecticide, c’est effectivement séduisant. On en parlait déjà lorsque j’étais étudiant, et cela avait même de quoi séduire l’apprenti écologiste que j’étais… Mais on s’aperçoit finalement que c’est beaucoup moins séduisant pour bien des raisons, que certains considéreront comme des fantasmes mais que d’autres jugeront bien réelles.
Pour commencer, les effets sur la santé humaine de l’insecticide produits par ces plantes, faute d’avoir été testés, restent inconnus. Et des essais à long terme réellement satisfaisants coûteraient bien trop cher. Dix ans d’essais, cela peut se concevoir pour un médicament, pas pour une semence appelée à se démoder au bout de cinq ans.
Ensuite, le maïs Bt résiste à la pyrale, mais pas aux autres parasites. Il n’empêchera donc pas l’utilisation d’insecticides. En revanche, il risquera de provoquer des phénomènes de résistance chez les insectes, tout comme les insecticides chimiques, à ceci près que l’on n’épand pas les insecticides chimiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre pendant toute une saison… Or les insectes seront au contact avec le Bt durant tout le temps que le maïs sera cultivé.
Une plante génétiquement modifiée pourrait effectivement coûter moins cher à produire. Encore faudrait-il, là encore, se poser la question du court terme et du long terme, des royalties à verser aux compagnies semencières, et du coût, en terme de dépendance, de cette apparente économie pour l’agriculteur. Par ailleurs, on observe, en Argentine par exemple, que l’utilisation des herbicides a effectivement diminué durant les deux ans qui ont suivi l’introduction du soja « Roundup Ready », pour augmenter de nouveau à partir de la troisième année, tant et si bien que les bénéfices engrangés disparaissent au moment précisément où les cours baissent… L’« or vert », comme certains se plaisaient à le décrire, prend soudain des allures moins paradisiaques !
M. le Rapporteur : Les Américains, bien qu’ils aient dix ans de recul, continuent à planter des OGM… Est-ce à dire qu’ils n’y trouvent pas un intérêt ?
M. Arnaud APOTEKER : Pour certains agriculteurs, c’est probable, d’autant que les OGM paraissent mieux adaptés à un certain type d’agriculture propre aux Etats-Unis. Mais n’oublions pas qu’il est très difficile de revenir en arrière une fois que l’on a commencé à utiliser des plantes génétiquement modifiées, ne serait-ce qu’en raison de la pression des entreprises : Monsanto n’hésite pas à envoyer des détectives sur vos champs pour vérifier que vous n’avez pas réutilisé de semences sans payer de royalties. Certains agriculteurs ont même été condamnés parce que leur champ avait été contaminé par des OGM brevetés Monsanto ! Du reste, bon nombre de fermiers américains, pris par la nécessité de préserver un équilibre financier très précaire, craignent d’entrer en conflit avec ces grandes compagnies. Enfin, dix ans de recul, c’est encore bien faible pour mesurer des impacts écologiques. Il est heureux qu’aucune catastrophe ne se soit encore produite. Je suis persuadé que l’intérêt qu’avaient suscité les OGM aux Etats-Unis se tassera à brève échéance.
M. Gabriel BIANCHERI : On peut évaluer les risques de dissémination et, partant, prendre les précautions en conséquence. Pour ce qui est des insecticides, je doute qu’un produit chimique largué manu militari soit moins dangereux qu’une toxine produite par un végétal…
A vous entendre, nous n'aurions pas besoin des plantes génétiquement modifiées. Mais d’autres nous ont affirmé le contraire, en citant le cas du coton ou d’un papayer génétiquement modifié qui a même permis, à Hawaï, de redémarrer concomitamment la production de papayes biologiques ! A supposer que nos cultures puissent se passer d’OGM, devons-nous pour autant les interdire aux pays du Sud ? Finalement, les écologistes ne sont-ils pas devenus, par leurs actions, les meilleurs alliés de Monsanto ?
M. Arnaud APOTEKER : Ce sont précisément les précautions qui font toute la différence entre les essais, très encadrés, et la réalité agricole. Et pourtant, des essais de colza génétique ont déjà provoqué des croisements avec de la moutarde et autres plantes sauvages. Comment contrôlera-t-on ces disséminations de pollen sur des cultures à grande échelle ? Aux Etats-Unis même, plusieurs produits alimentaires ont été retirés des rayons parce que contaminés par le maïs StarLink destiné à l’alimentation animale, pourtant cultivé sur une surface relativement faible. Et les effets de cette contamination se sont poursuivis pendant quatre ans !
M. le Président : Pouvez-vous nous donner des éléments plus précis à l’appui de vos affirmations ? Et pas seulement des écrits de Greenpeace !
M. Arnaud APOTEKER : Tout à fait, je vous ai apporté un dossier. A noter que, dans ses écrits, Greenpeace cite toujours ses références. Vous y trouverez de nombreux exemples de contamination génétique. Je n’ai pas eu le temps de préparer un argumentaire scientifique à proprement parler, mais je suis prêt à vous communiquer toutes mes références. La mésaventure du maïs StarLink a fait perdre à Aventis entre 100 millions et un milliard de dollars, selon les sources… Plus récemment, on a dû vider des silos de soja américain et jeter leur contenu après y avoir trouvé des repousses d’un maïs génétiquement modifié pour produire des médicaments, si bien que l’industrie agroalimentaire américaine a réclamé l’interdiction des cultures de maïs à fins médicamenteuse dans la Corn Belt ! De son côté, l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) soutient que la coexistence est possible : cela peut se concevoir à partir du moment où l’on retirerait de fait toute possibilité de choix au consommateur en portant le seuil « non-OGM » de 0,9 % à 5 ou 10 %. La documentation que je vous ai apportée montre clairement que tout contrôle est impossible. Je ne connais pas Hawaï, mais je sais en revanche que des papayers thaïlandais ont été contaminés par les plants génétiquement modifiés d’un centre de recherche gouvernemental situé à proximité, et qu’il a fallu tous les détruire !
M. Gabriel BIANCHERI : De quel type de contamination s’agissait-il ?
M. Arnaud APOTEKER : D’une contamination génétique.
Je n’ai jamais prétendu que les insecticides synthétisés par les plantes seraient plus dangereux que les insecticides chimiques. Ils devraient même être beaucoup moins nocifs, puisqu’ils sont autorisés, sous leur forme naturelle, dans les cahiers des charges de l’agriculture biologique. A ceci près qu’ils n’ont pas la même structure et que leurs effets à long terme ne sont pas, et pour cause, connus. Je maintiens en tout cas que des phénomènes de résistances pourraient se produire plus rapidement dans la mesure où ces insecticides ne sont pas épandus au coup par coup, mais présents en permanence.
Si nous étions les meilleurs alliés de Monsanto, ce serait vraiment à notre corps défendant…
M. Gabriel BIANCHERI : Mais pour le coton ? On nous a expliqué que c’était une plante si sensible qu’elle en devenait très difficile à cultiver dans conditions normales et que les OGM représentaient une véritable chance pour les pays concernés. Je ne sais si c’est vrai ou faux, mais j’ai tendance à croire ce que me disent les intervenants…
M. Arnaud APOTEKER : Mais moi, visiblement, vous ne me croyez pas !
M. Gabriel BIANCHERI : Je suis prêt à vous croire lorsque vous dites que nous pourrions nous passer d’OGM en France. Encore faudrait-il que les autres cessent d’en cultiver, faute de quoi nous nous retrouverons totalement prisonniers. Mais dans les pays du Sud, sans le coton génétiquement modifié, il n’y aura plus de coton, nous dit-on. Peuvent-ils s’offrir les mêmes exigences et le même cheminement intellectuel qu’un pays riche comme le nôtre ?
M. Arnaud APOTEKER : Les différents cotons transgéniques doivent représenter 10 % des cultures dans le monde et 25 % aux Etats-Unis. Le non-OGM reste donc très majoritairement cultivé... Ce qui m’inquiète le plus dans vos propos, c’est l’impuissance dans laquelle se trouveraient la France et l’Union européenne face à ce qui se fait à l’extérieur. Je crois la France et l’Europe suffisamment fortes pour décider de la direction de leur agriculture.
Si le coton est effectivement la plante qui consomme le plus d’insecticide, c’est parce que l’on en a fait une monoculture intensive dans des régions qui ne s’y prêtaient pas forcément. Il faudrait plutôt développer des modes d’agriculture biologiques afin que le coton cesse de devenir le centre d’attraction de tous les ravageurs… Bon nombre d’agriculteurs et de coopératives ont d’ores et déjà développé des méthodes culturales, certes moins productives, mais moins gourmandes en intrants chimiques. C’est cette direction qu’il faut privilégier.
M. Gabriel BIANCHERI : La plupart des céréales produites dans le monde sont sensibles aux charançons, dont une espèce en particulier serait responsable de la perte de millions de tonnes. Plusieurs moyens de lutte peuvent être employés : les insecticides classiques, mais également des techniques de froid, beaucoup plus coûteuses. La situation actuelle est la suivante : les pays les plus riches recourent au froid, le plus cher ; ceux qui ont quelques moyens utilisent, à leurs risques et périls, les insecticides à des doses de plus en plus élevées ; enfin, ceux qui n’ont pas les moyens se retrouvent à subir la totalité des pertes, et par voie de conséquence à souffrir de toutes les carences alimentaires !
L’introduction d’un gène du pois cassé serait, paraît-il, un moyen de lutter efficacement contre le charançon. Non seulement il permettrait de réaliser des économies, mais il ne présenterait aucun risque de dissémination. Et les pays les plus défavorisés pourraient ainsi protéger leurs céréales alimentaires. Ne serait-il pas dommage de passer à côté d’une telle opportunité ?
M. Arnaud APOTEKER : Je ne connais pas ce dossier, mais c’est typiquement le cas où il faut savoir regarder plus loin que le mode d’emploi et les conditions d’utilisation.
M. Gabriel BIANCHERI : Je l’ai lu dans Le Point...
M. Arnaud APOTEKER : Ce dont je suis sûr, c’est que ce n’est pas près d’arriver sur le marché ! On sait ce qui sera produit d’ici à cinq ans : pour l’essentiel, des Bt et des plantes tolérantes aux herbicides. Mais prenons garde à la séduction. Essayons de regarder à moyen terme. J’ai une grande confiance dans l’intelligence humaine et je sais qu’un problème donné n’appelle pas forcément une solution unique, en l’occurrence celle que propose une multinationale. Il peut y en avoir des tas, qui mériteraient de se voir consacrer des moyens de recherche. Malheureusement, la génétique et la biologie moléculaire sont à la mode depuis vingt ou trente ans, si bien que nous n’avons plus de chercheurs dans des domaines plus larges, plus heuristiques, qui pourraient appréhender plus globalement les interactions entre les organismes et leurs écosystèmes, jouer sur les relations proie/prédateur et autres, et proposer au bout du compte d’autres choix que les produits chimiques et les OGM. Je crois possible de développer une recherche capable de nous amener à une agriculture de qualité et conforme aux désirs de nos concitoyens.
Des promesses séduisantes, j’en ai entendu depuis que je suis étudiant. Combien de fois a-t-on parlé de plantes résistant à la sécheresse, à la salinité, etc. ! Hormis quelques annonces, jamais nous n’avons vu rien de concret depuis trente ans.
M. Michel LEJEUNE : Je reviens à vos papayers de Thaïlande. Les agriculteurs voisins, avez-vous dit, ont été obligés de détruire leurs plantations. Comment s’étaient-ils aperçus que leurs papayers avaient été contaminés ?
M. Arnaud APOTEKER : C’est nous qui avons fait les analyses… Sachant que le papayer se contamine aisément, nous pensions bien en trouver la preuve sur les plantations voisines des essais.
M. Gabriel BIANCHERI : Autrement dit, personne n’est venu vous voir en vous disant : « Mon papayer pousse mieux, ce n’est pas normal ! »
M. le Rapporteur : Vous êtes pires que Monsanto au Canada !
M. Arnaud APOTEKER : Je n’étais pas en Thaïlande. Nous savions que cette station expérimentale testait des papayers transgéniques et nous soupçonnions une contamination génétique. Les destructions ont été ordonnées par le gouvernement thaïlandais sitôt que nous avons communiqué sur le sujet. Les agriculteurs ne l’avaient pas demandé. Ils ont, je suppose, été indemnisés. Nous nous efforçons de travailler en collaboration avec les agriculteurs.
M. François GUILLAUME, Président : Mais manifestement pas avec l’AGPM !
M. Arnaud APOTEKER : Nous nous rencontrons de temps en temps. Mais nous avons, il est vrai, une vision de l’agriculture très différente.
M. Pierre COHEN : Je suis sensible à votre argument du risque lié à l’inconnu. Mais il est possible de fabriquer des OGM ne présentant aucun risque sanitaire. A supposer qu’un phénomène de dissémination massive se produise, où serait le problème, hormis les considérations d’ordre économique et politique liées au brevet et à la propriété intellectuelle ?
M. Arnaud APOTEKER : C’est précisément le type de question à laquelle on ne peut répondre de façon générale et qui appelle, les autorités réglementaires elles-mêmes le demandent, des études au cas par cas. Ce qui n’évitera pas pour autant les interactions : le cas par cas ne permet pas d’étudier les effets cumulatifs ou interactifs provoqués par la dissémination simultanée de plusieurs OGM dans les écosystèmes. Je crois impossible de garantir à l’avance une totale absence de danger sanitaire. Ce ne serait qu’une illusion. On peut juger le risque minime – on l’a fait avec les OGM autorisés –, mais personne ne peut prévoir les effets à long terme ni a fortiori les effets transgénérationnels. Au demeurant, et pour ce qui nous concerne, ce sont les impacts écologiques qui nous préoccupent en premier lieu, impacts sur lesquels il n’est pas davantage possible de s’engager. L’état de nos connaissances sur les interactions entre les différentes espèces et les écosystèmes est si faible que nous sommes incapables de prévoir les effets écologiques à long terme d’une contamination. Les variétés locales mexicaines ont d’ores et déjà été partiellement contaminées par des transgènes de maïs nord-américain, alors même que la culture du maïs génétiquement modifié est interdite au Mexique. Quelles en seront les conséquences à long terme ? Verra-t-on disparaître certains insectes, et du coup leurs prédateurs ? Verra-t-on apparaître certaines espèces invasives, devenues plus résistantes aux parasites, et, en sens inverse, disparaître les anciennes variétés ? On n’en sait rien. On n’a même pas idée de la méthodologie à utiliser pour les mesurer.
M. François GUILLAUME, Président : Le risque est le même avec le résultat de croisements naturels, dont le pollen se dissémine exactement de la même façon…
M. Arnaud APOTEKER : Non, il n’est pas le même.
M. François GUILLAUME, Président : …et d’aucuns pourraient se dire qu’après tout, vu ses piètres qualités intrinsèques, le maïs mexicain a tout intérêt à être contaminé par le maïs américain !
Vous parlez du refus du citoyen de consommer des OGM. Les réactions de prudence ou de suspicion sont bien normales, mais certains se sont employés, par leurs déclarations, à les exacerber. Au demeurant, ce « droit de refus », sur un plan commercial, n’est pas conforme aux règles de l’OMC. L’Europe en sait quelque chose, puisqu’elle est condamnée à payer des compensations aux Etats-Unis pour avoir refusé la présence de viande hormonée
– aux hormones naturelles, sans danger – sur ses étals… Si nous sommes obligés de passer sous les mêmes fourches caudines pour le soja, la sanction financière promet d’être terrible.
Je crois votre organisation et ses semblables plus portées à exciter la peur du citoyen qu’à rechercher la vérité. En refusant les essais en plein champ, vous refusez l’accès à la connaissance et, du même coup, vous avivez une inquiétude naturelle qui a tôt fait de se muer en opposition systématique. J’en viens à avoir le sentiment que vous déniez à la science le droit de prendre part à la lutte, constante et naturelle, entre les espèces afin d’en tirer le meilleur parti au profit de l’homme. L’apparition de résistances est un phénomène constant et naturel, qui nous oblige à une recherche permanente. Renonce-t-on aux antibiotiques sous prétexte que leur utilisation accroît les résistances ? Quelque chose m’échappe dans cette logique qui vous conduit à nier le principe même de la lutte pour la vie.
M. Arnaud APOTEKER : Plus que des questions, ce sont là des accusations qui renvoient à une conception radicalement différente de l’avenir de l’agriculture. On peut effectivement craindre que les Américains ne nous traînent en justice devant l’OMC si nous n’acceptons plus leur soja génétiquement modifié ; on peut accepter de consommer n’importe quelle cochonnerie pour s’éviter des ennuis commerciaux !
M. François GUILLAUME, Président : Il n’est pas dit que ce soient des cochonneries…
M. Arnaud APOTEKER : Les risques liés à l’amélioration conventionnelle ne sont pas du tout du même ordre. La transgénèse consiste à introduire assez brutalement, au moyen d’une bactérie ou d’un canon à gènes, un élément pris à n’importe quel organisme dans le génome d’un autre, situé on ne sait trop où dans un ensemble jusqu’alors en équilibre. Un croisement classique est un mélange à parts égales dans lequel les gènes s’assemblent de façon « naturelle » en combinant les caractéristiques des géniteurs.
L’idée selon laquelle la contamination génétique du maïs mexicain ne serait pas une si mauvaise chose renvoie elle aussi à cette vision fondamentalement différente. J’ai entendu les spécialistes qui négociaient le protocole de Carthagène affirmer, à l’époque, que la contamination génétique, c’était de la blague… Il n’était pas question d’imaginer le maïs mexicain des montagnes d’Oaxaca contaminé, même en cultivant du maïs transgénique au Mexique. Les mêmes, aujourd’hui, admettent qu’ils le savaient depuis le début, mais que, finalement, ce n’est pas grave ! En fait, personne ne sait ce qui se passera réellement à long terme alors que nous sommes engagés dans un processus irréversible.
M. François GUILLAUME, Président : Non seulement on utilise sciemment le mot de « contamination », péjorativement connoté, au lieu de celui de « dissémination », mais on mélange à dessein le cas du colza, dont le pollen peut effectivement se promener relativement loin, et celui d’autres espèces, et particulièrement du maïs, dont on sait pertinemment que le pollen est beaucoup plus lourd ! Comprenez dans ces conditions que je me méfie de tout…
M. Arnaud APOTEKER : Moi aussi, y compris des OGM !
M. François GUILLAUME, Président : …surtout lorsque j’entends parler d’une « contamination » survenue à point nommé dans un champ mexicain, comme par hasard, et qui vient opportunément conforter la thèse d’un danger généralisé !
M. Arnaud APOTEKER : Peut-être avez-vous suivi de près cette affaire : le chercheur qui l’a dénoncée le premier a failli être renvoyé de l’université de Berkeley et s’est vu attaquer sur l’Internet par tout l’establishment des biotechnologies jusqu’à ce que le gouvernement mexicain confirme la réalité de sa découverte ; l’origine de cette contamination – en l’occurrence, un maïs américain – a été établie depuis par un rapport de l’ALENA (accord de libre-échange de l’Atlantique Nord). Tous ces exemples montrent, c’est que cette contamination est impossible à éviter. Elle viendra tantôt du pollen – ce qui n’était du reste pas le cas dans cette affaire –, tantôt des pratiques agricoles, tantôt du stockage en silos, mais elle finira par arriver.
Partant de là, on peut effectivement décider que l’on acceptera dorénavant les OGM et que tout sera transgénique… Ce serait à mon avis courir un risque majeur pour l’avenir. Vous affirmez que les hormones sont sans danger ; je ne le savais pas…
M. François GUILLAUME, Président : Je parlais des hormones naturelles.
M. Arnaud APOTEKER : Tout est une question de dose, dirait Paracelse !
Je m’inscris en faux contre votre accusation de refus de l’accès à la connaissance. Nous en avons précisément beaucoup à acquérir avant de chercher à disséminer des OGM. Nous pouvons faire appel à la génétique, à la biologie moléculaire, aux techniques cartographiques, aux sélections par marqueurs, etc., sans recourir à la transgénèse. Notre connaissance trop partielle des mécanismes génétiques nous conduit à prendre des risques incalculables – au sens propre – sur le long terme. Je réclame un plus grand accès à la connaissance, mais aussi à celle du fonctionnement du génome, des organismes dans les écosystèmes, des relations entre les espèces, pour arriver à une agriculture qui soit à l’opposé de cette vision réductrice, héritée de la chimie, selon laquelle tout insecticide chimique peut être remplacé par son équivalent génétique.
Enfin, la grande différence entre les antibiotiques et les OGM, c’est que les antibiotiques sauvent des vies, ce qui n’est pas le cas du maïs Bt ou du soja Roundup Ready, destinés à 80 % à nourrir, non les habitants des régions pauvres, mais les animaux des pays riches, et que je crois inutiles et même néfastes.
M. le Rapporteur : Etes-vous partisan de l’étiquetage des animaux nourris aux OGM ?
M. Arnaud APOTEKER : Nous sommes totalement favorables à cet étiquetage, non pour des raisons sanitaires – nous ne savons pas s’il y a un risque à consommer des animaux ayant eux-mêmes mangé des produits génétiquement modifiés –, mais parce que c’est un moyen pour le consommateur de faire savoir qu’il ne veut pas voir cultiver des OGM dans son environnement. Nous lançons précisément une pétition en faveur de cet étiquetage, que d’ailleurs les défenseurs des OGM peuvent eux aussi réclamer, en vertu du droit démocratique à l’information. Les industries agroalimentaires elles-mêmes y sont favorables.
M. le Président : Nous vous remercions de cet échange.
M. Arnaud APOTEKER : Et moi de votre attention.
Audition de M. Christian BABUSIAUX,
ancien président du Conseil national de l'alimentation
et coauteur du rapport des « 4 Sages » sur les OGM
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004 )
Présidence de M. François GUILLAUME, Vice-président
M. François GUILLAUME, Président : Nous accueillons aujourd’hui M. Christian Babusiaux, actuellement magistrat à la Cour des Comptes, mais qui a présidé le Conseil national de l’alimentation et qui fut l’un des coauteurs du rapport des « 4 Sages » sur les OGM.
M. Christian BABUSIAUX : Je ne suis pas un spécialiste des OGM mais j’ai eu à en connaître sous quatre prismes différents. Tout d’abord, en tant que directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), j’ai été confronté au problème du contrôle des semences et des produits alimentaires et de la détection des traces éventuelles d’OGM, ainsi qu’aux questions d’étiquetage. Ensuite, j’ai retrouvé ce sujet en qualité de président du Conseil national de l’alimentation (CNA), chargé d’organiser la concertation entre l’ensemble des filières de l’agroalimentaire et les consommateurs, sous la tutelle des ministères de l’agriculture, de la santé et de la consommation. C’est dans ce cadre que j’ai contribué, en 2001, à un avis sur l’étiquetage des OGM et que j’ai coprésidé en 2002, avec Jean-Yves Le Déaut pour l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, Didier Sicard pour le Comité national d'éthique et Jacques Testart pour la Commission française du développement durable, un débat public national et rédigé avec eux le rapport dit des « 4 Sages ». Enfin, c’est comme président de l’Institut national de la consommation, jusqu’au mois dernier, que j’ai retrouvé ce thème sous l’angle de sa perception par les consommateurs.
Je ferai trois remarques préalables sur ce dossier.
La première porte sur le côté passionnel du débat. Si les polémiques sur l’alimentation ont été nombreuses ces dernières années, aucune n’a atteint un tel degré de passion, une telle charge émotionnelle dans presque tous les pays d’Europe. La méfiance et l’hostilité persistent aujourd’hui dans 70 % de l’opinion publique. Le fait même que rien n’ait vraiment changé depuis le débat public d’il y a deux ans invite à la réflexion car il n’est pas bon pour la démocratie qu’un tel conflit se prolonge plusieurs années. Cela donne aux citoyens le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. En outre, une grande partie des élus locaux, mais aussi nationaux, n’a pas encore pu se prononcer, dans la mesure où la directive communautaire n’a pas encore été transposée et où le débat parlementaire souhaité par les « 4 Sages » n’a pas encore eu lieu.
Ce qui est également frappant, c’est la persistance de l’obscurité du débat et de l’insuffisance des connaissances scientifiques et économiques.
Enfin, une troisième remarque concerne la mauvaise organisation de l’évaluation économique et scientifique des OGM qui, en empêchant l’objectivation, alimente les tensions.
Posé dès 2001-2002, ce diagnostic demeure largement actuel, ne serait-ce que parce que les propositions faites en mars 2002 dans le rapport des « 4 Sages » n’ont pas eu de suite. Or, ce blocage est préjudiciable au bon exercice de la démocratie sur un problème ressenti comme important par nos concitoyens.
Deux aspects me semblent devoir être tout particulièrement étudiés : l’évaluation scientifique et l’enjeu économique.
L’évaluation scientifique et technique est au cœur du débat. Dans les domaines qui touchent à la santé et à l’environnement, aucune décision objective et incontestée ne peut être prise si elle ne repose pas sur une expertise préalable. Cela est vrai pour tout produit nouveau. Force est de constater l’insuffisante organisation, pour ne pas dire le grand désordre, de l’évaluation des OGM avant et pendant leur expérimentation. Ainsi, quatre instances scientifiques interviennent : la Commission de génie génétique (CGG), la Commission du génie biomoléculaire (CGB), le Comité – toujours provisoire – de biovigilance et le Comité des biotechnologies de l’Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire (AFSSA). Le législateur avait cherché, en adoptant la loi de 1998 sur la sécurité sanitaire, à organiser, à contrôler et à rendre cohérente l’expertise dans tous les domaines concernés. Pourtant, alors même qu’il s’agit d’un sujet très sensible, la dispersion persiste et elle est même plus grande qu’elle ne l’était dans l’alimentation avant 1998.
Le législateur avait aussi posé le principe du rattachement de l’expertise aux agences de sécurité sanitaire de l’alimentation et de l’environnement, afin de garantir une indépendance essentielle à la crédibilité de l’évaluation. Or l’on constate que le Comité de biovigilance est toujours rattaché au ministère de l’agriculture. Si l’on comprend bien l’intérêt que cela présente pour ce dernier, mieux vaudrait, pour que le ministre puisse prendre une décision éclairée, que l’expertise soit confiée à une instance indépendante.
Un autre problème tient à la composition des instances : la CGB mêle des personnes d’origines très différentes, des scientifiques et des représentants de la société civile, entre lesquels le dialogue est impossible. D’ailleurs le représentant d’une association de consommateurs a renoncé à y siéger. Le rapport des « 4 Sages » a préconisé la coexistence, comme cela se fait dans bien d’autres domaines, de deux instances différentes, l’une scientifique, l’autre socio-économique. Pourtant, le projet actuel de transposition de la directive européenne ne prévoit qu’une instance, composée de deux sous-comités.
La façon dont les disciplines sont représentées au sein de la CGB n’est pas non plus satisfaisante. Ainsi, il n’y a qu’un seul toxicologue, ce qui exclut tout débat contradictoire sur cette discipline. Par ailleurs, le Comité de biovigilance reste hélas provisoire, alors que nous avions demandé, dès 2002, qu’il devienne définitif. Et comme le choix avait été fait d’inclure la réforme des instances d’évaluation dans le projet de transposition de la directive, cette réforme se trouve bloquée, comme le reste. Il pourrait y avoir une réforme des instances indépendamment du projet de loi de transposition.
L’articulation entre les instances est également source de difficultés : alors que la CGB conduit une évaluation provisoire, avant les essais en champ, le Comité provisoire de biovigilance suit les essais. On est donc loin de la logique d’aller-retour qui voudrait que les essais alimentent l’évaluation tandis que cette dernière aboutirait à des conseils sur la façon de surveiller les essais. Certes, certains membres sont communs aux deux organismes, mais on a quand même l’impression d’un bricolage institutionnel ne permettent pas un fonctionnement « huilé » des institutions.
Les modes de fonctionnement font également problème.
En premier lieu, le délai de 90 jours entre le dépôt de la demande d’expérimentation en champ et la décision du ministre semble trop bref : comment les membres de la CGB pourraient-ils assimiler, critiquer, vérifier les 3 dossiers, de 500 à 600 pages chacun, qu’ils doivent examiner chaque quinzaine ? La légitime volonté des industriels d’aboutir très vite ne doit pas réduire la vigilance : on l’a bien vu, dans un autre domaine, à propos des médicaments car ce problème ne se limite pas aux OGM. Je précise que ce délai de 90 jours comprend non seulement l’avis de la CGB mais également une consultation préalable à la décision du ministre.
Je regrette par ailleurs que seul le président ait communication du dossier complet, tandis que les autres membres de la CGB, pourtant tenus au secret de leurs délibérations, soient tenus à l’écart des informations relevant du secret industriel. Cela est unique dans les instances d’évaluation.
En outre, il est fort rare que la commission, sensible au coût que cela représenterait pour les industriels, demande un complément d’expertise. Pourtant, si l’OGM apporte vraiment un progrès économique très important, une dépense d’étude de plus n’est qu’une charge limitée. A l’inverse, si l’on est à 100 000 euros près, c’est qu’il n’y a pas un intérêt fondamental à bouleverser les techniques agricoles.
M. le Rapporteur : Le délai peut-il être prolongé ?
M. Christian BABUSIAUX : C’est arrivé mais c’est rare, car il y a un problème de mise en culture : les industriels déposent souvent les dossiers très tard et le ministre sait qu’un retard empêcherait les semailles. Il est donc pratiquement obligé de se prononcer en l’état du dossier. Il faudrait fixer une date limite raisonnable pour le dépôt des dossiers.
Le dernier problème est celui de la teneur des avis. S’il y a progrès depuis deux ans dans la mesure où ils sont désormais publiés, ils demeurent trop succincts. Certes, la CGB fait un travail très louable, mais sa position est difficile et il faudra bien revenir un jour sur ces questions.
Ce problème de l’évaluation est tout à fait majeur et ne se limite pas aux OGM.
J’en viens à la faiblesse de la connaissance économique qui pose deux questions.
Les études par type d’OGM paraissent extrêmement fragmentaires et fragiles. Par exemple aux Etats-Unis, les industriels comparent le coût et le rendement des semailles de produits génétiquement modifiés et le traitement par herbicides et pesticides, ne prenant pas en compte le fait que les attaques combattues chimiquement ne se produisent pas nécessairement tous les ans mais plutôt tous les trois ou quatre ans. L’étude serait donc plus rigoureuse si l’on prenait en compte le rythme réel d’utilisation des pesticides.
Il n’y a pas, par ailleurs, de véritable centralisation des résultats des études économiques : alors que des essais ont été menés à grande échelle dans le monde pour certaines cultures, seul le cas du coton semble clair à ce jour.
Au niveau plus global, deux éléments doivent être analysés dans le cadre d’une évaluation économique préalable.
Il faut d’abord s’interroger sur l’intérêt global des OGM pour l’agriculture européenne. Certes, ils peuvent apporter un gain immédiat en termes de confort de culture, mais qu’en est-il pour l’image de l’agriculture ? Certains estiment que dans la compétition économique avec les Etats-Unis, l’Europe aurait intérêt, notamment vis-à-vis des consommateurs, à jouer résolument la carte des cultures sans OGM. Il est difficile de savoir où se trouve la vérité, puisqu’il n’y a jamais eu d’évaluation globale du rapport coûts/bénéfices dans ce domaine. On n’a pas non plus mesuré le préjudice que peuvent subir les autres modes de production, notamment biologiques, avec le risque de contamination entre les différents types de semence.
Le rapport des « 4 Sages » a insisté sur la nécessité d’une instance chargée, au moins temporairement, d’évaluer l’intérêt économique des OGM, sur la base d’une méthodologie explicite, publiée et soumise à contradiction, car seule l’objectivation des débats permettra de sortir de la polémique. Certes, l’information a été améliorée depuis le rapport de 2002, notamment avec la publication des avis de la CGB, l’information des maires sur les lieux d’expérimentation ; certes, on a mis en place l’espacement des cultures, et le suivi a progressé, mais beaucoup reste encore à faire.
M. François GUILLAUME, Président : Merci d’avoir traité des méthodes d’organisation, que nous n’avions pas encore examinées aussi précisément et qui sont pourtant très importantes. Des procédures existent déjà pour d’autres produits, mais des failles sont apparues dans leur application aux OGM.
M. le Rapporteur : Je vous remercie également pour cet exposé très clair. Nous nous posions nous-mêmes un certain nombre des questions que vous avez abordées, s’agissant notamment de l’articulation entre les quatre organismes. Pouvez-vous nous parler des relations du Conseil national de l’alimentation avec l’AFSSA, ainsi qu’avec les autres organismes européens ?
M. Christian BABUSIAUX : Le CNA et l’AFSSA se situent sur deux plans différents : la seconde est une agence d’évaluation scientifique et technique, alors que le premier est une expression de la société civile, qui tente de dégager un consensus entre les acteurs et de procéder à une expertise socio-économique et non pas scientifique. En matière d’alimentation, il y a donc bien deux instances distinctes, autonomes, indépendantes, chargées chacune d’un rôle particulier et clairement défini. Cela n’existe ni pour l’environnement ni pour les OGM, pour lesquels le CNA n’a pas vraiment compétence, puisque les OGM sont à la fois une question d’environnement et d’alimentation et que l’ensemble de la filière OGM n’y est pas représenté.
M. le Rapporteur : Avez-vous le sentiment que l’information de la population et des maires sur les expérimentations est complète et objective ? Et que pensez-vous de l’information donnée par les médias ?
M. Christian BABUSIAUX : Informer le public me semble tout à fait fondamental. Bien sûr, il peut y avoir des réticences à indiquer les lieux d’expérimentation, car cela peut attirer l’attention des faucheurs et provoquer des incidents. Mais aux yeux d’une opinion aussi éclairée que l’opinion française, donner l’impression que l’on cache quelque chose est toujours contre-productif. D’ailleurs, s’il peut y avoir une certaine sympathie pour les faucheurs, je ne suis pas convaincu que l’opinion soit majoritairement du côté de ceux qui provoquent des incidents violents.
J’ajoute que l’opinion est plus rationnelle qu’on ne le dit souvent, et qu’elle peut avoir l’impression légitime que l’expertise n’est pas très bien organisée, qu’il y a un certain brouhaha, que le Comité des biotechnologies de l’AFSSA et la CGB n’ont pas toujours des positions identiques. Cela montre qu’il faut donner des explications, tenir un langage clair. Tel ne peut être le cas si les instances ne sont pas bien organisées. L’opinion est plutôt méfiante vis-à-vis des décideurs politiques, d’où l’intérêt d’instances d’évaluation organisées et indépendantes, qui donnent l’impression d’un discours cohérent avant que le ministre exerce sa responsabilité et décide.
M. François GUILLAUME, Président : Vous parlez de dispersion, vous estimez que la CGB travaillant a priori et le Comité de biovigilance a posteriori, il faut aménager des allers-retours entre les deux. Vous souhaitez donc que l’on réfléchisse à une autre articulation. Si l’on peut admettre le principe d’une séparation entre les représentants de la société civile et les scientifiques, ne pensez-vous pas que le fait de confier des dossiers à une commission dont les membres n’auront qu’une connaissance scientifique limitée pourrait conduire à ce qu’on fasse usage d’arguments pseudo scientifiques pour dénigrer les OGM ? Je vois mal, en outre, comment ces deux instances s’articuleraient, car la société civile fait plutôt confiance aux scientifiques, qui disposent des éléments de connaissance nécessaires, tandis que les autres se fondent sur des appréciations subjectives, psychologiques ou affectives.
Vous dites également qu’il faut informer les consommateurs. Bien sûr, mais comment ? L’honnêteté scientifique consiste sans doute à dire que vérité aujourd’hui peut être erreur demain. Mais cette prudence est mise au débit des scientifiques, et l’on se dit qu’il faut tout de même que la recherche serve à quelque chose et qu’à un moment donné des décisions soient prises. Sinon, à quoi bon dépenser tout cet argent ?
M. Christian BABUSIAUX : L’articulation entre les instances est délicate. Dans mon esprit, l’instance qui représenterait les aspects économiques ne devrait pas être un mini-parlement, regroupant des gens dont nul ne saurait quelle est la représentativité, et dont l’analyse risquerait d’être subjective et arbitraire.
Ce qui manque, c’est une objectivation économique. Ce sujet pourrait être traité comme n’importe quel autre sujet économique : combien ça coûte ? Combien et à qui cela rapporte ? Avec une méthodologie adaptée, on pourrait se pencher sur les aspects agronomiques, en déduire des éléments concernant les coûts et la commercialisation pour apprécier s’il est économiquement sensé d’avoir ou non recours aux OGM.
Il ne faut pas que cette instance économique soit saisie du même dossier que les scientifiques. En l’état actuel, le projet de transposition n’est pas satisfaisant sur ce point, puisqu’il prévoit que les deux sous-groupes de la même instance seraient saisis simultanément du même dossier. Mieux vaudrait que l’instance économique intervienne une fois que l’étude scientifique et technique aura été menée.
Tel est le cas pour le médicament, même si la procédure n’est pas non plus parfaite : la commission d’autorisation de mise sur le marché fait d’abord une analyse des aspects scientifiques, notamment toxicologiques, puis la commission de transparence étudie le rapport coût/avantages pour l’assurance maladie, enfin le comité économique des produits de santé fixe le prix. C’est cette sorte de chaîne logique qu’il faut organiser pour les OGM.
S’agissant de l’information des élus, l’avis d’une commission scientifique s’apparente souvent à un balancement des plus circonspects, dont il faut faire une lecture à plusieurs niveaux, mais ce n’est pas une raison pour ne pas informer les élus et le public. Celui-ci est capable d’appréhender beaucoup plus de choses qu’on ne le pense, les mutations extraordinaires de la consommation et des modes de vie au cours des dernières années le montrent bien. Sur un sujet comme les OGM, il faut donc faire le pari de l’intelligence collective de la France.
M. Pierre COHEN : Je partage votre point de vue sur l’information. Plus encore que le nucléaire ou le sang contaminé, les OGM me semblent symboliques de la nécessaire perméabilité entre société et science, appelée incontestablement à évoluer.
Il me semble qu’on a voulu mélanger la société civile et les scientifiques par souci de cloisonner les différentes phases d’évolution des OGM – laboratoires, plein champ, production. Pour votre part, vous préconisez deux instances distinctes et je le comprends.
Je vous suis moins quand vous mettez l’accent sur l’évaluation économique. Je ne connais aucune recherche qui soit soumise à une telle évaluation. A l’appui des OGM, on met souvent en avant les améliorations sanitaires et la réduction des inégalités dans le monde, alors que ce sont surtout des bénéfices économiques que l’on escompte, ce qui explique l’importance attachée à la question des brevets. Pour autant, ces aspects ne doivent pas devenir essentiels pour la recherche. C’est pourquoi, sans être hostile à l’analyse des aspects économiques, je ne souhaite pas que ce soit au sein d’une instance chargée d’orienter la décision finale.
M. André CHASSAIGNE : Je suis hostile à l’idée d’une recherche strictement utilitariste et je refuse moi aussi que la recherche sur les OGM se fonde sur leur seule utilité socio-économique. C’est un problème de fond.
Par ailleurs, il me semble que créer deux structures chargées de l’évaluation poserait le problème de ces allers-retours indispensables à la validation. Je m’entretenais hier avec un ingénieur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), qui me disait que si l’utilisation des OGM ne posait pas de problème immédiat, il pourrait y en avoir ensuite en raison de l’accumulation des manipulations génétiques. Or c’est un domaine qui ne fait pour l’instant l’objet d’aucun suivi à long terme, ce qui me paraît inquiétant. Quelle instance pourrait-elle être chargée de ce suivi à long terme ?
M. Gérard DUBRAC : Ne devrait-il pas y avoir, au sein du comité scientifique, une sorte d’autorisation de mise en expérience ? En effet, le risque de laisser des apprentis sorciers tout essayer en matière de modification du génome me paraît plus grand que le risque économique. L’intervention d’une très haute autorité serait donc rassurante.
M. François GUILLAUME, Président : A un moment, il y a inévitablement conflit entre la liberté totale de la recherche et les interdits.
M. Christian BABUSIAUX : La particularité des OGM tient à la phase d’expérimentation en champ, bien différente de celle qui se déroule en laboratoire. D’abord parce que la liberté des chercheurs se heurte à celle des propriétaires des champs voisins, qui veulent faire de l’agriculture biologique ou traditionnelle. La science investit donc effectivement le champ social. Par ailleurs, on n’est pas, à la différence de ce qui se passe dans le médicament, dans un domaine de chimie fine. Le degré de précision de la technique n’est pas tel que l’on puisse être sûr de ce qu’on expérimente. Si le dossier remis à la CGB explique comment on va modifier le génome, on n’est jamais certain que dans le processus expérimental ou de production ce qui va être semé soit conforme à 100 % à ce qu’on a voulu obtenir. Des précautions s’imposent donc.
M. François GUILLAUME, Président : Mais tout le monde contamine tout le monde, ne serait-ce que quand deux arboriculteurs voisins cultivent deux espèces différentes…
M. Christian BABUSIAUX : C’est vrai, mais on ne peut assimiler les phénomènes de croisement aux modifications génétiques. Les industriels et les scientifiques ont beau argumenter sur ce thème, l’opinion, qui est très pragmatique, ne comprend pas qu’une technique dont on lui dit qu’elle est semblable à un simple croisement puisse être en même temps celle qui est révolutionnaire et permettra de nourrir toutes les populations affamées… Il faut donc avoir le courage de dire que c’est nouveau. Et il faut également que le suivi et l’évaluation soient liés pour permettre les comparaisons nécessaires entre le dossier examiné a priori et ce qu’on a trouvé sur le terrain, y compris, comme l’a souhaité M. Chassaigne, sur le long terme.
J’en viens à l’évaluation économique. Je ne pense pas qu’elle doive être menée au cas par cas, préalablement à chaque expérimentation ponctuelle. Mais on pourrait avoir des gens indépendants et une méthodologie qui permettraient de centraliser les études menées dans le monde, de vérifier leur fiabilité, de les synthétiser, de les analyser. Cela éclairerait aussi davantage la décision du ou des ministre(s). Il ne s’agit évidemment que d’éclairer la décision politique, pas de décider. Il ne s’agit pas non plus de minorer l’importance de l’évaluation scientifique menée par ailleurs, mais de compléter l’information du décideur et de l’opinion.
M. le Rapporteur : Ne conviendrait-il pas d’associer le ministère de la santé à celui de l’agriculture ?
M. Christian BABUSIAUX : Il faudrait certainement associer le ministère de la santé. Cela renforcerait le caractère incontestable de la décision. Mais j’insisterai moins sur la tutelle des ministères que sur le fait de confier l’expertise à une agence.
M. Jean-Marie SERMIER : On voit bien l’utilité d’une autorité indépendante qui couvrirait l’ensemble des protocoles de recherche, mais dans la mesure où les expérimentations en plein champ font courir un risque de dissémination bien au-delà du territoire national, ne devrait-on pas placer ce débat dans un cadre européen, voire mondial ? Car si nous adoptons plutôt des règles très strictes, il ne faudrait pas que des pays dotés de règles différentes nous pénalisent sur le plan économique comme sur le plan environnemental.
M. Christian BABUSIAUX : Il vaut mieux effectivement que ce soit dans un cadre plus large, notamment européen, comme le sont les autorisations de mise en culture. Mais il y a, au niveau européen aussi, une certaine confusion, notamment entre les responsabilités de la Commission et celles du Conseil. On a vu que dans un certain nombre de cas, le Conseil des ministres s’est arrangé pour ne pas prendre la décision lui-même et la faire prendre par la Commission. Les instances d’évaluation gagneraient aussi à être organisées et améliorées.
M. André CHASSAIGNE : Dans la mesure où le brevetage est centré sur une invention précise, ne pourrait-il pas limiter l’accumulation de manipulations successives ?
M. François GUILLAUME, Président : En effet, quand on introduit un gène, on peut espérer qu’il n’y aura pas de dégâts collatéraux, mais si on les combine, on est moins sûr que cela n’aura pas d’incidences négatives sur la santé de l’homme. Si personne ne conteste qu’une modification des plantes peut apporter des qualités supplémentaires, on peut quand même se demander qui fera, en aval, la synthèse des expertises scientifiques, économiques, sociétales et commerciales.
Il y a 70 millions d’hectares d’OGM dans le monde, et les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont telles qu’un pays doit faire la preuve qu’un aliment peut être dangereux pour refuser aux autres la possibilité de l’exporter sur son propre territoire. Aujourd’hui nous devons verser 100 millions de dollars de compensations pour avoir interdit les hormones de croissance. Si nous devons faire de même pour le soja, le maïs et le coton, cela risque de coûter très cher ! Avant que le politique décide, il faut bien qu’il soit éclairé.
M. Christian BABUSIAUX : Je ne me suis pas penché sur la question des brevets et je n’ai donc pas d’avis à ce propos, mais il est vrai que les modifications successives seront un sujet de débat. Cela étant, on retrouve là ce qui se fait pour le médicament : l’autorisation de mise sur le marché (AMM) est fondée sur l’analyse des effets d’un produit et non pas de plusieurs, alors que le cumul est fréquent, notamment chez les personnes âgées.
S’agissant de la décision, je pense qu’il faut que le ministre dispose à la fois d’une évaluation scientifique et technique et d’une évaluation économique pour qu’il puisse prendre sa décision. Si un risque scientifique apparaît pour la faune ou la flore, il est vraisemblable qu’il ne donnera pas l’autorisation. Dans le cas contraire, il prendra en considération l’aspect économique et rendra sans doute une décision positive. Pour l’instant, si les avis de la CGB et du Comité des biotechnologies de l’AFSSA ne sont pas totalement convergents, il peut se trouver embarrassé. Une réorganisation serait donc nécessaire.
M. Pierre COHEN : L’instance représentant la société civile serait-elle destinée uniquement à l’évaluation économique et vouée à produire des études de marché, ou aurait-elle vocation à traiter aussi des questions de société ?
M. Christian BABUSIAUX : Une évaluation socio-économique est possible sur un grand nombre de sujets. Nous parvenions ainsi, au CNA, à faire l’unanimité entre consommateurs, distributeurs et producteurs sur des questions d’alimentation. En matière d’OGM, je ne suis pas convaincu que ce soit possible, au moins dans l’immédiat, car les affrontements et la passion sont trop forts.
Ce qui est important, c’est que même le sociétal soit objectivé, afin que l’on ne se prononce plus sur la base d’opinions et que le sujet cesse d’empoisonner l’atmosphère. Une instance spécifique à la société civile pourrait analyser les comportements des consommateurs et des acheteurs, mais il ne faudrait pas qu’elle se transforme en structure quasi politique.
M. Pierre COHEN : Une telle instance est nécessaire car on imagine la réaction de l’opinion si le choix était fait uniquement sur des bases scientifiques et économiques…
M. le Rapporteur : Ne pensez-vous pas qu’en insistant sur le scientifique et l’économique on risque de privilégier les études a priori sur la surveillance a posteriori ?
M. Christian BABUSIAUX : Au contraire, un certain nombre de tests ne peuvent être demandés quand on passe du laboratoire au champ. Il faut, par exemple, parfois attendre un an pour disposer de quantités suffisantes pour mener des études de toxicologie sur le gros bétail. Il faudrait donc, compte tenu des particularités du sujet, que la structure unique soit chargée à la fois des évaluations a priori et du suivi au bout d’un an et à plus long terme, et qu’elle puisse demander des tests complémentaires.
M. le Rapporteur : Est-il bon d’assurer l’étiquetage et la traçabilité ? Que pensez-vous du seuil de 0,9 % ? Enfin, vous êtes-vous intéressé aux assurances ?
M. Christian BABUSIAUX : Le seuil a été initialement fixé à 1 % parce que ce taux correspondait à la capacité de détection de la DGCCRF. Aujourd’hui, on fait un geste politique en l’abaissant à 0,9 %, mais on peut scientifiquement détecter à 0,1 % de sorte que l’opinion ne comprend plus… Je pense donc qu’il faut faire un effort de transparence et laisser le consommateur choisir. Il n’est pas hostile, par principe, aux OGM mais veut savoir ce qu’on lui donne à manger.
A la différence de François Ewald, je doute de l’efficacité d’un système d’assurance, dans la mesure où il imposerait de déterminer l’origine du dommage. Si cela demeure possible en Europe, où les plantations d’OGM sont encore rares, on voit mal, dans des pays comme les Etats-Unis ou le Brésil, comment identifier la parcelle dont vient la contamination…
M. le Rapporteur : Il faudra pourtant bien songer à un tel système…
M. Christian BABUSIAUX : C’est une question importante et qui mérite effectivement réflexion, mais il sera, je le répète, difficile de déterminer avec certitude l’auteur du dommage et je crois donc qu’on ne peut pas tout miser sur la mise en place d’un système d’assurance.
M. le Président : Je vous remercie pour toutes les informations que vous nous avez données. Vous avez ouvert un chapitre que nous n’avions pas encore examiné. Or ces éléments de procédure paraissent essentiels, en particulier pour rassurer le consommateur.
Audition de M. Jean-Claude KADER,
directeur de recherche et chargé de mission pour la biologie végétale
du département des sciences de la vie du Centre national de recherche scientifique (CNRS)
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2004)
Présidence de M. André CHASSAIGNE, Secrétaire
M. André CHASSAIGNE, Président : Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Claude Kader, directeur de recherche et chargé de mission pour la biologie végétale du département des sciences de la vie du Centre national de recherche scientifique (CNRS).
M. Jean-Claude KADER : Je vous remercie de m’avoir permis de m’exprimer devant cette mission. Il est toujours intéressant pour un chercheur de dialoguer avec les citoyens ou leurs représentants. En tant que chargé de mission pour la biologie au sein du département des sciences de la vie du CNRS qui est un établissement public scientifique et technique (EPST), je gère les laboratoires liés à l’établissement, les pôles les plus importants étant situés en Alsace, en Rhône-Alpes et dans le Midi-Pyrénées, à Montpellier et Toulouse. Je précise que je m’exprimerai au nom du CNRS lorsque l’organisme aura clairement établi une politique et en tant qu’expert scientifique dans le cas contraire.
La mission première du département des sciences de la vie, qui représente 20 % des activités du CNRS, est de faire progresser, dans l’interdisciplinarité, les connaissances fondamentales sur les mécanismes du vivant, en coopération avec nos collègues d’Europe et du monde. Sa mission seconde est de valoriser ces connaissances en contribuant à répondre aux besoins en matière sanitaire et environnementale et en participant à la création d’entreprises. Au sein du CNRS, la recherche sur la biologie végétale s’appuie sur 23 unités : trois centres propres, dix-neuf unités mixtes de recherche constituées avec des partenaires publics – Université, Institut national de la recherche agronomique (INRA), Commissariat à l’énergie atomique (CEA), Ecole normale supérieure (ENS), Institut de recherche pour le développement (IRD)… – et un partenariat avec l’industriel Bayer Cropscience qui a repris Rhône-Poulenc. Cette mixité nous permet de partager nos missions avec nos partenaires.
Les laboratoires ont pour plante modèle l’Arabidopsis thaliana ou arabette des dames, qui n’a aucune utilité agronomique ni économique – c’est une mauvaise herbe ! – mais qui est étudiée par tous les biologistes du monde en raison de la petite taille de son génome
– 28 000 gènes – entièrement séquencé, de la brièveté de son cycle de vie et du fait qu’elle a de nombreux mutants. Grâce à cette plante fétiche, nous pouvons étudier, en petites enceintes confinées, la reproduction, la photosynthèse, les mécanismes de protection contre les pathogènes, l’adaptation aux contraintes de l’environnement et les processus de symbiose des végétaux.
Par ailleurs, un programme national de génomique végétale, dit Génoplante, a été lancé en 1999, conformément aux recommandations du rapport Le Déaut. Son financement, mixte, émane du ministère de la recherche et d’organismes publics de recherche d’une part, de semenciers et de sociétés privées telles que Limagrain, Bioplante et Bayer Cropscience d’autre part. Cette collaboration a permis de soutenir de nombreux projets de recherche, tant sur des plantes modèles comme l’Arabidopsis thaliana que sur des plantes cultivées : riz, maïs, colza… Génoplante a donné à la France une visibilité internationale en matière de recherche sur la génomique végétale et permis des coopérations renforcées, notamment avec des laboratoires allemands et espagnols – ce qui développe la recherche européenne en génomique végétale –, tout en protégeant la propriété intellectuelle, grâce à la création d’une filiale spécifique. Aussi les chercheurs du CNRS souhaitent-ils la prolongation jusqu’en 2010 de ce programme – qui s’achève cette année – car celui-ci leur permet de mieux comprendre comment fonctionnent les gènes, en utilisant des OGM de recherche en enceintes confinées.
Conscients qu’il fallait tenir le plus grand compte des conséquences de l’utilisation des OGM sur l’environnement, le ministère de la recherche et le CNRS ont également lancé en 2001 le programme « Impact des biotechnologies sur les agrosystèmes », l’objectif étant d’étudier les flux et déploiements des transgènes dans l’environnement et, notamment, dans les micro-organismes du sol ou les insectes… Un colloque consacré à son bilan, théoriquement définitif, s’est ouvert hier en présence du ministre, mais les chercheurs espèrent que le programme sera poursuivi.
En conclusion, le département des sciences de la vie, en coopération avec différents départements du CNRS – sciences de l’univers, sciences sociales et humaines – et avec d’autres organismes, est résolument engagé dans des programmes de recherche en biologie végétale imposant l’étude d’OGM en enceintes confinées. Ces projets, évalués par le Comité national de la recherche scientifique, sont réalisés en toute transparence et dans le strict respect de la législation. Nous défendons farouchement l’usage des OGM dans la recherche, indispensable au progrès de la connaissance des mécanismes fondamentaux de la physiologie des plantes et au maintien de la compétitivité nationale. Le CNRS, qui n’a pas vocation à réaliser des essais en plein champ, souhaite toutefois participer à l’évaluation des risques qui interpellent les citoyens et les chercheurs. Les perspectives ouvertes par ces biotechnologies sont fascinantes car les enjeux sont illimités : adaptation des plantes au manque d’eau ou à une température plus élevée, résistance aux pathogènes – insectes, virus, champignons, phytoremédiation (c’est-à-dire l’élimination des polluants) – production de composés utiles, tels les médicaments…
Nous en sommes pour l’instant au stade de la recherche fondamentale, mais le moment viendra où l’INRA devra valider, par des essais en plein champ, les résultats obtenus par le CNRS. C’est pourquoi nous nous sommes, par solidarité, associés à la lettre de protestation des organismes de recherche publiée après les destructions d’essais d’OGM en plein champ. Dans le même temps, tous les chercheurs du CNRS sont prêts à participer à l’information des citoyens sur cet important dossier.
M. le Rapporteur : Vous avez précisé que le CNRS fait ses expérimentations sur les OGM en enceintes confinées uniquement, mais vous avez indiqué que vous étiez prêt à participer à l’évaluation a posteriori des essais en plein champ. J’aimerais que vous nous donniez votre avis sur les essais en champ des plantes génétiquement modifiées permettant, par exemple, de fabriquer de la lipase gastrique.
M. Jean-Claude KADER : A titre personnel, je pense qu’il faut épuiser toutes les possibilités d’essais offertes en milieu confiné, qui sont nombreuses, et, puisque nous ne disposons pas du recul nécessaire, ne procéder aux essais en champ qu’avec parcimonie. Mais cela conduit à débattre de la qualité des enceintes confinées répondant aux normes européennes, ce qui a donné lieu à de longues discussions au sein du CNRS.
Si je m’exprime maintenant au nom du CNRS, je souligne que nous espérons mettre au point des plantes qui, parce qu’elles donneront des médicaments, produiront un bénéfice pour le citoyen. Voilà ce sur quoi il faut davantage faire porter la recherche, et qui n’est sans doute pas assez expliqué. A Rouen, une équipe se consacre à l’expression de protéines à intérêt thérapeutique dans les plantes, mais elle en est au stade de la recherche fondamentale. On a pu constater que l’expression du gène n’est pas suffisante et qu’il peut y avoir des réactions de rejet rendant ces plantes inutilisables à l’homme.
Pour résumer, la recherche tendant à la production de médicaments dans les plantes est un projet tout à fait utile, mais, à titre personnel, je dirai : ne nous précipitons pas pour procéder à des essais en plein champ avant d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les enceintes confinées.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que la production de « riz doré » puisse avoir des conséquences bénéfiques dans les pays en développement ?
M. Jean-Claude KADER : Le dossier est passionnant et l’idée généreuse, puisqu’il s’agit, en produisant un riz enrichi en provitamine A, de combler l’une des carences dont souffrent des millions d’individus. C’est ce type de plantes qu’il faut développer mais, pour l’instant en tout cas, la concentration du principe actif dans le « riz doré » demeure insuffisante pour présenter un réel bénéfice sanitaire.
M. le Rapporteur : Les laboratoires de biologie végétale du CNRS travaillent, nous avez-vous dit, en collaboration avec des firmes privées. Dans ce dispositif, leur indépendance est-elle garantie ?
M. Jean-Claude KADER : Il est vrai que certains chercheurs du secteur public n’ont pas manifesté un enthousiasme excessif, lors du lancement de Génoplante, pour cette alliance public-privé. On leur a expliqué que le programme est très bordé : le pilotage scientifique n’est pas entre les mains du secteur privé, nous pouvons choisir nos programmes et les évaluations ont toujours lieu paritairement. De plus, nous exigeons que nos résultats soient publiés assez vite, ce qui a été fait. C’est dans ce cadre que des équipes du CNRS et de l’INRA ont pu mener à bien des programmes de recherche générique fondamentaux avec l’appui du secteur privé et, notamment, de leurs plates-formes technologiques. Le lancement de Génoplante a aussi institué une coordination entre secteur public et secteur privé, dont les modalités vont évoluer.
M. le Rapporteur : Comment les projets de recherche sont-ils définis ? Un de vos partenaires privés se met-il en relation avec vous pour vous indiquer ce qu’il entend voir traiter ?
M. Jean-Claude KADER : Génoplante lance des appels d’offres publics très larges, après quoi les comités thématiques sélectionnent les projets, et les entreprises privées peuvent décider d’en financer certains en majeure partie. A aucun moment on ne peut contraindre une équipe du CNRS – dont l’activité est régulièrement évaluée et contrôlée par le Comité national scientifique – à travailler sur un programme donné.
M. Philippe TOURTELIER : Vous avez indiqué que les enceintes confinées permettent des observations et des expérimentations dans d’excellentes conditions. Au cours de précédentes auditions, il nous a été dit que lorsque des essais de culture d’OGM sont conduits en milieu naturel, on ne peut éviter la contamination, puisqu’il y a diffusion des gènes par les vêtements, les chaussures… Dans ces conditions, le débat sur le bien-fondé des essais en plein champ a-t-il seulement lieu d’être ? Pourquoi ne pas s’en tenir, pour trancher, aux conclusions scientifiques des essais conduits en enceintes confinées – quitte à agrandir les serres –, puis aux conclusions d’un débat social sur le rapport risques/bénéfices, sans passer par l’étape des essais en champ ?
M. Jean-Claude KADER : Il existe des limites à l’expérimentation en enceinte confinée, où l’on ne peut reproduire les conditions du milieu naturel que dans une certaine mesure. C’est pourquoi, le moment venu – mais je ne peux définir quand –, des essais en champs seront indispensables. Les chercheurs du CNRS s’accordent pour considérer que les risques présentés par les plantes transgéniques doivent être examinés au cas par cas, les risques présentés n’étant pas les mêmes selon qu’il s’agit, par exemple, de colza ou de maïs. A cet égard, les conclusions du colloque consacré à l’impact des OGM qui s’est ouvert hier ont offert quelques surprises. Ainsi, une étude a montré que les grains de pollen de maïs, que l’on pensait beaucoup plus fragiles que ceux du colza, sont assez résistants pour se transporter à des distances jusqu’alors insoupçonnées. Voilà pourquoi le credo du CNRS a toujours été que les essais en plein champ ne devaient être réalisés qu’avec parcimonie et en choisissant bien la plante. Les chercheurs savaient dès l’origine que les essais en champ avec du colza transgénique seraient source de nombreuses difficultés – mais la recherche ne doit pas s’interrompre. Ainsi, pour minimiser les risques, on sait qu’il y a la solution d’utiliser les variétés de colza cleistogames, qui ne libèrent pas leur pollen. De même, il faut s’interroger sur la présence d’espèces apparentées, en raison du risque de croisements. En France, ce serait catastrophique pour le colza, mais heureusement pas pour le maïs, pour lequel le risque de croisements est inexistant. En bref, il faut continuer la recherche et donc, nous donner plus de moyens d’investigation, comme le disent beaucoup de scientifiques !
M. Philippe TOURTELIER : Pensez-vous que le moment était venu de réaliser les essais en plein champ qui ont été détruits ?
M. Jean-Claude KADER : Nous n’avons pas analysé les essais en question, mais nous avons tenu à manifester notre solidarité de chercheurs.
M. André CHASSAIGNE, Président : Vous avez fait allusion à des débats, au sein du CNRS, sur la qualité des enceintes confinées. Cela signifie-t-il que vous manquez de moyens pour aller au bout de vos recherches en serres et que, de ce fait, le passage aux essais en plein champ se fait trop rapidement, pour des raisons de coût ?
M. Jean-Claude KADER : Absolument pas. Ce n’est pas parce qu’on n’a pas les moyens d’entretenir les serres ou de les mettre aux normes européennes qu’on fera des essais en plein champ. Mais il est vrai que, faute de moyens, il est parfois difficile d’obtenir des serres assez grandes. Il en existe deux types : les serres S2, pour les plantes transgéniques habituelles, qui ne présentent pas de danger parce qu’il n’y a pas eu transformation virale, et les serres S3, consacrées aux expériences tendant à étudier les virus des plantes – et les 23 laboratoires que je contrôle travaillent, comme il se doit, dans le strict respect des normes.
M. André CHASSAIGNE, Président : A supposer que vous disposiez de serres gigantesques et plus performantes, pourrait-on éviter les essais en plein champ ? Ou considérez-vous que, de toute façon, on ne peut reproduire en enceintes confinées l’ensemble des conditions naturelles
– vent, hygrométrie, chaleur… ?
M. Jean-Claude KADER : On peut très facilement valider en laboratoire la fonction fondamentale d’un gène et, pour cela, les essais en plein champ sont rigoureusement inutiles. Il n’y a d’ailleurs aucune demande en ce sens. En revanche, les limites technologiques de l’expérimentation en enceintes confinées sont réelles, sans parler du coût très important des serres. Si l’on veut se rapprocher des conditions réelles de production, l’expérimentation en champ est nécessaire.
M. André CHASSAIGNE, Président : N’est-ce pas jouer les apprentis sorciers que de manipuler et recombiner les 28 000 gènes d’Arabidopsis thaliana ? N’est-ce pas fabriquer des bombes à retardement ? Pouvez-vous mesurer le danger des manipulations génétiques auxquelles vous vous livrez ? Certains disent qu’il existe une incertitude grave, d’autres que la part d’incertitude n’excède pas celle qui est attachée à toute science, mais qu’il n’y a pas de risque important. Qu’en pensez-vous ?
M. Jean-Claude KADER : Pour ce qui est des recherches conduites par le CNRS – uniquement en enceintes confinées, je le répète –, dès lors que l’on autoclave terreau et plantes, il n’y a aucun risque pour l’humanité.
En tant qu’expert, je note que les premières plantes transgéniques datent de 1983 ; je serais donc tenté de dire qu’on sait très bien ce qu’on fait quand on manipule une plante et, du point de vue génétique, je ne vois pas de grand risque. Les surprises peuvent venir de ce que, lorsqu’on touche une étape du métabolisme d’une plante, celle-ci s’adapte pour rétablir l’équilibre, et cette réaction peut avoir des conséquences biochimiques inattendues, si bien que le résultat obtenu n’est pas toujours celui qui était recherché. Cela ne signifie pas que les expérimentations ne servent à rien : ainsi, pour concurrencer l’huile de palme, une équipe américaine a introduit un acide gras particulier dans le colza, et elle a bel et bien obtenu une huile de colza enrichi de cet acide gras spécifique.
M. Philippe TOURTELIER : Ainsi, lorsque l’on cultive un OGM en milieu naturel, on n’est jamais à l’abri d’une surprise biochimique ?
M. Jean-Claude KADER : Les travaux en enceinte confinée permettent de valider la transformation. Que cette transformation évolue encore en champ, où les conditions ne sont pas identiques, c’est possible.
M. Gérard DUBRAC : Qu’en est-il des croisements éventuels de différents OGM ?
M. Jean-Claude KADER : Cela doit être examiné au cas par cas. Par exemple, ce qui est très dangereux s’il s’agit du colza – dispersion importante du pollen et croisement avec des espèces apparentes – l’est beaucoup moins avec le maïs.
M. Gérard DUBRAC : On peut envisager que, génétiquement modifiées, des plantes deviennent résistantes à tous les herbicides. La prudence ne commande-t-elle pas de ne permettre l’expérimentation que si l’on a l’antidote ?
M. Jean-Claude KADER : Dans le programme Génoplante, la mesure de l’impact des OGM impose des essais en plein champ, mais ces essais ne sont pas faits avec des OGM : s’agissant, par exemple du colza, ces expérimentations tendent à apporter des éléments de réponse sur les distances de croisements avec des variétés ayant des compositions différentes en huile.
M. Gérard DUBRAC : Mais tout étant maintenant planétaire, un OGM « américain » ne peut-il croiser un OGM « européen » pour donner un OGM « africain » dont on ne pourra plus se débarrasser ?
M. Jean-Claude KADER : Tout dépend des plantes considérées. Le colza peut se croiser avec tout crucifère, le maïs uniquement avec la téosinte, qui ne pousse qu’au Mexique. Voilà pourquoi il faut étudier chaque végétal au cas par cas, toujours améliorer la plante et favoriser l’utilisation de variétés qui s’autopollinisent pour éviter la dispersion du pollen. Tout cela nécessite beaucoup de recherche.
M. le Rapporteur : Avez-vous travaillé à des échanges entre espèces, tendant par exemple à injecter un gène animal dans un végétal ?
M. Jean-Claude KADER : Un laboratoire de Rouen le fait à titre expérimental, en utilisant une protéine équivalente de l’albumine humaine. Mais il s’agit de recherche fondamentale visant à comprendre le mécanisme du transport du sucre dans une cellule végétale ; on est très loin de la production. Dans un petit nombre de cas, on étudie effectivement le transfert de gènes d’autres espèces.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous du système de protection intellectuelle ?
M. Jean-Claude KADER : Le CNRS favorise la protection intellectuelle et le dépôt de brevets, sous certaines conditions. Il faut notamment qu’il s’agisse d’applications qui apportent quelque chose de neuf, d’intéressant et d’assez ciblé car nous ne voulons pas bloquer le progrès scientifique. Ainsi, par exemple, nous brevetons les procédés permettant d’améliorer une plante.
M. le Rapporteur : Le système gène-fonction vous paraît-il acceptable ?
M. Jean-Claude KADER : Nous protégeons les procédés d’amélioration, c’est-à-dire les inventions, plutôt qu’un gène particulier. Il nous paraît important que le CNRS puisse recueillir le fruit de ses inventions mais le coût de la protection est tel que nous ne le faisons pas systématiquement.
M. André CHASSAIGNE, Président : Ne risque-t-on pas de voir se créer des monopoles ? Si un laboratoire privé brevète ses combinaisons génétiques, quelle possibilité d’intervention future sur les semences brevetées sera laissée, par exemple, aux agriculteurs et autres semenciers ?
M. Jean-Claude KADER : Plus la part du secteur public dans la protection est importante, mieux c’est : ainsi, il serait formidable que le « riz doré » ne soit breveté que par le secteur public. Tous les chercheurs ont envie d’offrir au public les progrès scientifiques ! Au sein de Génoplante, le CNRS a son mot à dire et, le moment venu, nous pourrons céder des licences, à titre plus ou moins gratuit, à ceux qui nous conviennent, par exemple au Centre international de recherche et d’aide au développement (CIRAD) ou à l’IRD, organismes de recherche agronomique en faveur du développement.
M. le Rapporteur : Dans le cadre de Génoplante, qui est propriétaire des brevets ?
M. Jean-Claude KADER : Sa filiale de protection intellectuelle Génoplante-Valor, dont chaque organisme public et privé associé de Génoplante est partie prenante à hauteur de ses investissements. Si, comme nous l’espérons, Génoplante est prolongé jusqu’en 2010, notre part sera plus importante.
M. le Rapporteur : La société privée a-t-elle le moyen de bloquer le brevet ?
M. Jean-Claude KADER : Non. C’était l’une des préoccupations exprimées par les chercheurs lors de la création de Génoplante, et nous avons su persuader nos partenaires que la France, deuxième pays semencier au monde, souhaitait que secteur public et secteur privé travaillent main dans la main. Au comité stratégique de Génoplante, où siègent les semenciers, tout le monde tient à peu près le même langage et, en tant que chercheur, je suis rassuré par ce dispositif.
M. Gérard DUBRAC : Les caractères des OGM sont-ils récessifs ou dominants ?
M. Jean-Claude KADER : C’est une question de génétique à laquelle je ne peux répondre précisément en tant qu’expert, mais dont je sais qu’elle préoccupe mes collègues de l’INRA. Le CNRS, qui étudie la transmission des OGM dans l’air ou vers la flore bactérienne du sol, n’a pas cette expertise.
M. Gérard DUBRAC : Cela me semble essentiel. Que se passerait-il si un esprit malfaisant mettait au point un OGM au caractère dominant qui anéantirait les végétaux naturels ? C’est d’autant plus effrayant qu’une fois dans la nature, les OGM se multiplieront. Si l’on avait la certitude que les plantes transgéniques ont un caractère récessif, il n’y aurait plus de risque.
M. Jean-Claude KADER : Les généticiens recherchent les conséquences des croisements entre plantes transgéniques et plantes « normales », mais cela ne peut être fait qu’à une petite échelle. Cette préoccupation n’est peut-être pas encore suffisamment prise en compte. Sur cette question, je raisonne davantage en citoyen qu’en expert.
M. Germinal PEIRO : Outre qu’ils dénoncent le danger de la dissémination des OGM – qu’ils estiment planétaire –, les opposants en récusent l’utilité, faisant valoir que, depuis dix ans qu’ils sont cultivés à grande échelle aux Etats-Unis, aucune preuve n’a été faite que les choses se soient améliorées. Ainsi les économies en herbicides sont annulées en quelques années et le bienfait sanitaire attendu de la moindre utilisation d’herbicides a son revers, la plante transgénique elle-même distillant son herbicide à longueur d’année, si bien que l’on en retrouve dans la chaîne alimentaire. Ils pensent donc que l’intérêt pour les OGM va s’amenuiser. Pour ce qui vous concerne, connaissez-vous des cas – indépendamment de ce qui a trait à la recherche médicamenteuse – où la modification génétique de plantes a eu des résultats manifestement positifs à grande échelle ?
M. Jean-Claude KADER : Aux Etats-Unis, des millions d’hectares de végétaux transgéniques ont été plantés, très souvent pour améliorer la résistance des plantes aux insectes. Pour l’instant, agriculteurs et industriels en tirent donc plus avantage que les citoyens. Il n’empêche que l’on constate une extension considérable des surfaces cultivées en OGM, aux Etats-Unis bien sûr, mais aussi en Amérique latine et en Chine. On peut, en effet, attribuer cette tendance, qui s’affirme, à l’agressivité commerciale des semenciers et au désir des agriculteurs de cultiver des plantes plus résistantes. C’est aussi le cas au Canada, où l’on n’hésite pas à cultiver du colza transgénique, en dépit des risques de dissémination. Dans un tel contexte de développement des cultures OGM, il nous appartient d’expliquer notre différence d’approche et de résister, mais ce n’est pas facile.
Les autres utilisations d’OGM sont moins développées, mais le soja américain va être amélioré pour fournir une huile plus résistante à l’oxydation, et le coton a été rendu résistant à des insecticides. Autrement dit, des considérations économiques vont indéniablement conduire à l’augmentation des surfaces cultivées en OGM dans le monde, ce qui est dérangeant quand on connaît les préoccupations qui s’expriment en France et en Europe. Toutefois, hier, lors du colloque, j’ai entendu dire que le Canada commence à réfléchir… Ce doit être par contamination européenne…
M. Germinal PEIRO : Les productions agricoles contiennent des pesticides dont on retrouve trace dans l’alimentation humaine et animale. L’utilisation d’OGM a-t-elle amélioré la qualité alimentaire, et donc sanitaire, des végétaux modifiés ?
M. Jean-Claude KADER : La réponse à cette question est davantage du ressort de l’INRA que de celui du CNRS mais, à ma connaissance, il n’y a eu ni amélioration ni aggravation. De plus amples recherches sont nécessaires sur ce point.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous du gène stérile « Terminator » ? Cultivé, peut-il stériliser d’autres espèces de végétaux ?
M. Jean-Claude KADER : Je n’ai pas de réponse institutionnelle à donner sur ce point. Mais, puisque vous m’interrogez à ce sujet, je tiens à dire, à titre personnel, qu’en ma qualité de chercheur en biologie végétale, je ne peux cautionner des stratégies telles que celle qui a conduit à la commercialisation de ce gène. Si l’on m’avait demandé mon avis sur le lancement du premier maïs transgénique résistant à la pyrale et contenant un gène de résistance à un antibiotique, j’aurais dit : « Ne faites pas ça ! » Mais personne ne nous a demandé notre avis, et nous subissons maintenant les conséquences de tout cela, puisque le financement de la recherche en biologie végétale a beaucoup diminué, au niveau européen, ces dernières années … En fait, nous sommes punis, alors que nous ne sommes en rien responsables de la stratégie de gens irresponsables.
Sur le plan technique, il y a effectivement stérilisation mais c’est déjà le cas avec les semences hybrides qui ne peuvent pas être ressemées, ce qui oblige l’agriculteur à racheter des semences nouvelles chaque année. On est dans le même processus d’asservissement. Mais, en même temps, c’est une technique qui peut empêcher la dissémination, puisque la plante ne peut plus germer.
M. le Rapporteur : Cette stérilité peut-elle être transmise à d’autres plantes non transgéniques ?
M. Jean-Claude KADER : Je ne le pense pas.
M. le Président : Comment mesure-t-on la contamination, par dissémination, d’un champ voisin ?
M. Jean-Claude KADER : Outre l’observation à l’œil nu, on peut utiliser des marqueurs moléculaires. Ainsi, l’acide gras contenu dans le colza étant soupçonné d’être mauvais pour la santé, on a élaboré un colza qui n’en contient pas, et il est assez facile de comparer la teneur en huile d’un champ de colza et d’un autre. Les outils permettant d’apprécier la contamination biochimique et moléculaire des cultures sont accessibles, sans difficultés méthodologiques majeures, notamment aux généticiens de l’INRA qui étudient cette question.
M. le Président : Je vous remercie vivement des explications que vous nous avez apportées.
Audition de M. Philippe KOURILSKY,
directeur général de l’Institut Pasteur et professeur au Collège de France (chaire d’immunologie)
(extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : M. Philippe Kourilsky, directeur général de l’Institut Pasteur et professeur au Collège de France, est souvent mis à contribution par l’Assemblée nationale, et je le remercie d’être venu une nouvelle fois répondre à nos questions. Je rappelle aux membres de notre mission qu’il a rendu au Premier ministre, avec Mme Geneviève Viney, un rapport remarqué sur le principe de précaution.
M. Philippe KOURILSKY : Ayant une formation de biologiste et ayant beaucoup pratiqué la génétique moléculaire, je ne suis pas un spécialiste des plantes, mais les OGM recouvrent d’autres domaines d’application : ceux des bactéries et des divers mécanismes de production de produits destinés à la santé, comme les vaccins.
La question des OGM m’a toujours intéressé car j’ai participé, en 1975, à la Conférence d’Asilomar, première réunion internationale ayant traité des risques associés aux bactéries génétiquement modifiées – alors qualifiées de génétiquement « manipulées ». L’exposition publique de la problématique, à l’époque, m’a beaucoup frappé car il s’agissait du premier grand débat lié à la biologie. J’ai pu ensuite observer que la polémique qui touchait aux objets génétiquement modifiés à destination de produits de santé s’éteignait à mesure que celle relative aux plantes se développait, les interrogations se déplaçant de la santé vers l’environnement. Mes opinions sont bien connues et j’en ferai état avec simplicité, sans détours.
Les risques associés aux OGM étant potentiels, et non pas démontrés ni avérés, ils relèvent donc du principe de précaution – encore qu’il faille s’entendre sur la notion de « risque avéré » qui suppose elle-même une définition de la réalité et de la gravité des risques.
La polémique entourant les OGM est assez localisée : elle est beaucoup moins vive aux Etats-Unis et encore moins en Asie, où les expérimentations et les cultures d’OGM à ciel ouvert atteignent des surfaces considérables dans de nombreux pays. Quant à l’attitude d’opposition que l’on prête parfois à la Chine, il convient de l’interpréter en grande partie comme un moyen d’ériger de temps en temps des barrières protectionnistes. La spécificité européenne est liée à une certaine conception de la nature, de l’écologie et du pouvoir de l’homme sur son environnement.
Au-delà, la génétique, du point de vue de la psychologie collective, pose un problème complexe. C’est une science relativement récente – l’ADN n’a été découvert qu’il y a 50 ans –, enseignée dans les écoles depuis seulement une vingtaine d’années, et le public ne l’a pas intégrée : récemment encore, la majorité de l’opinion publique pensait qu’une tomate normale ne comprenait pas de gènes, plusieurs enquêtes l’ont montré ! Il faut dire que la génétique provoque un sentiment d’inconfort dans la mesure où c’est une science de l’aléatoire. Chacune des divisions cellulaires affectant notre corps – et il s’en produit plusieurs millions chaque jour – se traduit, en moyenne, par plusieurs mutations chromosomiques, l’accumulation de ces dernières déclenchant des phénomènes de vieillissement et des cancers ; c’est difficile à faire comprendre, voire à faire accepter et à vivre. De même, on a observé qu’un gène de résistance à un antibiotique inséré dans un maïs transgénique pouvait se transférer à la plante voisine, appartenant éventuellement à une autre espèce ; on peut certainement en déduire qu’il en est de même de tous les autres gènes, et cette notion de flux des gènes se révèle assez inconfortable, l’instabilité du monde étant toujours source d’inquiétude. Cela contribue sûrement au rejet des OGM par une partie de la population française et européenne.
Cela dit, nous marchons un peu sur la tête, et les séries de dispositifs français et communautaires deviennent handicapantes, peut-être même désastreuses. Les réglementations sont en effet très lourdes, souvent dissuasives, à tel point que, dans plusieurs cas, nous avons tué une partie de la recherche et handicapé une partie de l’avenir. Je donnerai deux exemples.
Premièrement, l’Institut Pasteur s’efforce de développer un vaccin contre le SIDA aussi adapté que possible aux besoins des pays du Tiers-Monde, c’est-à-dire facile à produire, pas cher et ne comportant pas trop d’exigences concernant la chaîne du froid. Notre candidat est un recombinant obtenu à partir du virus de la rougeole – que l’on sait parfaitement maîtrisé – par l’introduction de gènes du SIDA dans le gène du virus de la rougeole, afin de développer des anticorps. Les résultats de cette recherche chez le singe sont très encourageants mais, s’agissant d’un OGM, son passage aux essais cliniques est soumis à une réglementation particulière comportant notamment une évaluation de son impact sur l’environnement : si l’on impose de faire les essais cliniques dans des chambres confinées, je pense que ces essais soit n’auront pas lieu, soit seront faits ailleurs, car ce serait trop cher et trop contraignant de les faire en France. Mettre dans le même panier les vaccins vivants et les plantes transgéniques pose tout de même un problème.
Deuxièmement, les nombreuses auditions auxquelles nous avions procédé, il y a quatre ans, avec Mme Geneviève Viney, avaient mis en évidence la quasi-disparition, en France comme en Europe, de la recherche sur les plantes transgéniques. Les chercheurs s’autocensurent car leurs travaux n’ont pratiquement aucune chance de déboucher sur des essais en champ, où ceux-ci sont détruits, et ils n’ont plus envie de travailler dans un domaine stigmatisé par une partie des médias et par certains mouvements bien connus. Ainsi, le nombre de start-up et d’entreprises biotechnologiques créées dans le domaine de la transgénèse végétale est ridiculement faible en France et en Europe.
Quel est l’avenir de cette technologie, et notamment de ses applications végétales ? Les brevets étant concentrés aux Etats-Unis et en Asie, notre recherche, si elle reste si peu agressive, n’aura guère de chances d’obtenir des produits efficaces. Un jour, je n’en doute pas, apparaîtront des OGM de deuxième génération, appliqués notamment à l’optimisation sanitaire des produits alimentaires ; les consommateurs en voudront et nous devrons payer le prix de notre faute historique. Je trouve tout à fait paradoxal que l’Europe et la France, qui ont fondé une partie de leur développement sur la qualité de l’agriculture, se privent ainsi d’un progrès technologique majeur : nous nous tirons une balle dans le pied. Créer des filières agricoles nouvelles, c’est bien, mais il est au moins naïf, sinon erroné, d’imaginer que l’agriculture biologique nous protégera. La situation est désastreuse.
Dans le domaine de la santé, au contraire, nous avançons convenablement, les craintes étant désormais transférées sur l’environnement. Il n’en demeure pas moins que les industries de la biologie continuent à délocaliser une grande partie de leurs laboratoires de recherche notamment vers les Etats-Unis et maintenant vers l’Asie. Les contraintes réglementaires pesant sur les OGM n’expliquent certes pas ce phénomène à elles seules, mais elles en constituent l’une des causes non seulement dans le domaine végétal mais aussi dans d’autres domaines comme dans celui de la santé.
Je suis heureux que les plus hautes autorités de l’Etat et la représentation nationale se saisissent du problème, car il n’est jamais trop tard pour intervenir. Il faut prendre conscience des enjeux en cause.
La France, de surcroît, est encline à exporter ses idées, ses normes et ses réglementations. Je trouve personnellement scandaleux de pousser les pays en développement, contre leur intérêt, à adopter les contraintes que nous nous imposons sur les OGM. Quelles règles éthiques, et même morales, nous autorisent à agir de la sorte ? Même si, à l’instar du bioterrorisme, un mauvais usage peut être fait de cette technologie, il me semble malsain d’avoir jeté sur elle un tel discrédit, car elle n’a jamais rien produit de dangereux et elle recèle des bénéfices potentiels.
M. le Président : Vous avez dit que le problème relevait du principe de précaution dans la mesure où les OGM, depuis 1975, n’avaient jamais eu le moindre effet néfaste avéré. Mais un tel constat suffit-il pour, finalement, s’abstenir de développer une technique ? Dans ces conditions, comment pourrait-on jamais développer une technique nouvelle ?
M. Philippe KOURILSKY : S’il se transforme en principe d’abstention, le principe de précaution constitue effectivement un danger objectif car il freine toutes les formes d’innovation. Mais c’est une mauvaise utilisation du principe de précaution. A cet égard, on enregistre depuis peu, dans l’opinion publique, une remarquable évolution de la perception du principe de précaution, qui, en quelques années, est devenu si populaire qu’il s’est étendu à toutes les problématiques. L’invocation systématique du principe de précaution m’apparaît comme une quête insensée du risque zéro et reflète, selon moi, un déplacement du curseur de la conscience collective à la conscience individuelle, en tout cas dans le domaine de la santé – mais ce sont là des interprétations personnelles que nul n’est tenu de partager. Quoi qu’il en soit, je répète que le principe de précaution, mal compris et mal utilisé, constitue un frein majeur à l’innovation.
M. le Rapporteur : Je partage votre vision très pessimiste à propos de la recherche. Mais jugez-vous le problème irrémédiable, ou espérez-vous que, si les essais en champ reprennent, la recherche française pourra redémarrer ?
M. Philippe KOURILSKY : Rien n’est irrémédiable : si des signaux clairs étaient donnés, la recherche redémarrerait. Il conviendrait cependant de bien distinguer les OGM de deuxième et troisième générations de ceux de première génération. Ceux-ci n’avaient effectivement rien de tentant : les images d’Epinal qui s’en dégageaient étaient, d’un côté, la « malbouffe » et, de l’autre, les profits colossaux des grands industriels. Mais on ne parle plus de la même chose : les produits deviennent sophistiqués et rationnels, et méritent de nouvelles lettres de noblesse. Peut-être faudrait-il trouver d’autres termes pour distinguer ces nouveaux OGM de ceux de la première génération.
M. le Rapporteur : Le risque allergénique vous paraît-il plus grand avec les plantes traditionnelles qu’avec celles issues des OGM ?
M. Philippe KOURILSKY : Le risque est faible dans les deux cas mais il est beaucoup plus aisé de rechercher la présence de facteurs allergéniques dans une plante dont on connaît précisément les caractéristiques que dans un hybride issu d’un « cocktail » difficile à caractériser. En outre, la technologie génétique peut servir à détoxifier des produits. Cela dit, eu égard à mon parcours et à mes fonctions, je suis beaucoup plus préoccupé par les problèmes de santé humaine que par ceux concernant l’environnement au sens strict. C’est pourquoi les phénomènes d’allergie, même s’ils ne sont pas négligeables en termes de santé mondiale, me préoccupent moins que le retard de distribution du vaccin contre le rotavirus, qui cause 500 000 décès d’enfants par an.
M. le Rapporteur : On a beaucoup parlé de la fabrication par des plantes génétiquement modifiées de la lipase gastrique destinée au traitement de la mucoviscidose. D’autres expérimentations du même type sur les plantes sont-elles en cours ?
M. Philippe KOURILSKY : Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais la fabrication de masse de produits divers, et en particulier de médicaments, à partir des plantes recèle un intérêt évident. On sera peut-être content, un jour, de maîtriser cette technologie pour produire des anticorps massivement et rapidement, y compris – même si c’est un peu provocateur – dans l’éventualité d’attentats bioterroristes. Reste que ces OGM sont ceux qui requièrent le contrôle le plus pointilleux, car il est hors de question, par exemple, qu’une plante productrice d’insuline se dissémine dans la nature.
M. Pierre COHEN : Le principe de précaution est tout de même lié à la succession de catastrophes dues à la mauvaise utilisation de technologies. Sa valeur n’est pas uniquement négative : il ne s’agit pas de freiner l’innovation mais, avant de se lancer dans des recherches, de se donner le droit d’évaluer leurs conséquences. Le débat reste donc ouvert.
Peut-on prendre le risque de modifier l’environnement dans un sens qui le rendrait nocif pour la santé de l’humanité ?
Enfin, pourquoi jouer les apprentis sorciers en n’approfondissant pas davantage les recherches en milieu confiné sur les OGM et en se lançant dans les essais en plein champs, à meilleur coût, alors que, dans des domaines comme le nucléaire militaire, on s’est donné tous les moyens nécessaires pour parvenir à maîtriser les technologies par le biais de la simulation ?
M. Philippe KOURILSKY : Je ne suis pas hostile au principe de précaution, dont l’intérêt est capital, mais simplement à sa version abstentionniste ; il convient d’ajuster les moyens de l’action aux enjeux et aux risques. Or le risque potentiel n’entre pas dans la même catégorie selon qu’il est mortel pour l’humanité tout entière ou qu’il est mineur, contrôlable et qu’il frappe une population limitée. C’est à cause d’interprétations catastrophistes des OGM, selon lesquelles la planète et l’humanité courent un danger, que certains groupes se croient autorisés à enfreindre la loi. Ils vont même jusqu’à contester la démocratie en estimant que les systèmes de représentation populaire se montrent incapables de contrôler la technoscience et que la désobéissance civile devient un devoir. Il y a tout un discours pseudo philosophique sur les dangers de la technoscience non maîtrisable. Permettez-moi de continuer à penser que le risque posé par le maïs transgénique n’est pas aussi grave que la mort de 500 000 enfants chaque année à cause du rotavirus !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Tout le monde espère en effet que ces enfants vivront. Il n’en est pas moins vrai que le problème des OGM est extrêmement compliqué.
La recherche mérite, certes, d’exister mais, pour ma part, je suis très préoccupée par le problème de la dissémination. Vous vous êtes alarmé des obstacles que l’on met au développement du vaccin contre le SIDA élaboré à partir du virus de la rougeole, mais chaque cas d’organisme génétiquement modifié, producteur ou non de médicament, est spécifique. Pour les médicaments, si le virus du SIDA est parfaitement connu, il peut y avoir d’autres manipulations plus problématiques et dont on peut craindre que les essais cliniques n’entraînent une dissémination sur des êtres humains. Quant aux plantes productrices de médicaments, vous avez, vous-même, estimé qu’elles doivent être élevées en milieu confiné.
Plus globalement, vous avez dit que s’il s’avère que les OGM sont bénéfiques, nous devrons en payer le prix. Mais s’il s’avère qu’ils ont des inconvénients majeurs, ne devrons-nous pas aussi en payer le prix ? Or pouvez-vous nous garantir qu’aucune plante génétiquement modifiée n’aura d’inconvénients ?
L’accumulation de mutations dans l’organisme entraîne l’apparition de cancers. La modification d’organismes, dès lors qu’elle fait évoluer les gènes, ne risque-t-elle pas d’accroître le risque de cancer ? A qui en reviendrait la responsabilité ? Comment expliquez-vous qu’aucune compagnie d’assurances n’accepte de couvrir les producteurs de plantes transgéniques ?
M. Philippe KOURILSKY : Il y a quelques années, le dossier d’un autre candidat vaccin contre le SIDA a été bloqué un an à cause de la Commission du génie génétique, pour finalement obtenir le feu vert. Est-ce bien raisonnable, alors qu’une épidémie galopante sévit sur la planète ? Pour ces problèmes de santé publique aigus, des procédures d’urgence sont indispensables : quinze jours auraient dû suffire. C’est une question de morale !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Maintenant que les essais cliniques ont eu lieu, pourquoi ce vaccin n’est-il pas encore sur le marché ?
M. Philippe KOURILSKY : Un vaccin se développe en dix ou quinze ans. J’ignore si celui-ci sera efficace, mais il est dommage qu’un an ait été perdu pour conduire la première phase d’instruction du médicament.
Pour certaines plantes transgéniques, un confinement strict s’impose en effet, et c’est le procédé « Terminator » qui devrait alors être appliqué parce qu’il permet le confinement des cultures en stérilisant les semences. Or celui-ci est malheureusement discrédité à cause de la mauvaise presse qui lui a été réservée. Ce n’est pourtant pas la technologie elle-même qui est condamnable mais les conséquences économiques et sociologiques, pour les agriculteurs, de l’usage qui en a été fait, ou peut en être fait.
Pour en revenir au principe de précaution, toute la problématique du concept vient de ce qu’il est impossible de démontrer qu’il n’existe aucun risque ; on peut seulement formuler des hypothèses et leur affecter des coefficients de probabilité. Même si les Américains consomment des OGM depuis fort longtemps, j’ignore si l’on obtiendra un jour la preuve de leur absolue innocuité.
On nous demande maintenant de démontrer que des milliers d’individus, soumis à des paramètres génétiques et environnementaux variés, sont en sécurité : c’est impossible. Autrement dit, les questions posées sont arrivées à un tel degré de finesse qu’il est devenu impossible d’y répondre de façon univoque parce que les paramètres sont trop nombreux. Il faut prendre conscience que la science contemporaine est fondée sur l’incertitude ; elle travaille sur des bases plus probabilistes que déterministes. La statistique n’a jamais démontré, par exemple, qu’il existait une corrélation entre la vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaques, mais elle ne peut pas non plus démontrer que le risque est nul : elle établit simplement une probabilité maximum. De même, en ce qui concerne les OGM, on ne pourra guère aller au-delà de ce que l’on connaît aujourd’hui. De façon générale, cette incertitude est d’ailleurs devenue un problème de société crucial.
M. François GUILLAUME : On éprouve toujours une grande satisfaction à entendre ainsi confirmer ses convictions personnelles.
S’agissant des dangers potentiels attachés aux OGM, a-t-on constaté, au-delà du problème de la biodiversité, que l’utilisation des OGM avait des conséquences sanitaires ? Quelle différence la transgénèse présente-t-elle, à cet égard, avec la technique ancienne de l’hybridation ? Par ailleurs, il semble, comme vous l’avez dit, que la transgénèse simple soit un peu dépassée, mais n’y a-t-il pas lieu de s’inquiéter désormais des interactions susceptibles d’intervenir entre plusieurs transgénèses opérées sur une même plante ? De même, y a-t-il une raison quelconque de craindre un risque d’allergies liées aux OGM ?
Je voudrais aussi abonder dans votre sens à propos du procédé « Terminator », en ajoutant qu’il peut, même en agriculture, présenter un intérêt. L’année de sa dénonciation a été marquée par une forte pluviométrie pendant la moisson ; sur une bonne partie du territoire français, les céréales étaient couchées et se sont naturellement mises à germer. Avec un OGM « Terminator », la germination aurait été arrêtée, ce qui aurait permis de protéger la qualité de la production.
M. Philippe KOURILSKY : Je n’ai pas connaissance de problèmes sanitaires apparus à cause de la technologie OGM, mais on découvrira probablement un jour ou l’autre que quelque chose est lié à la consommation d’OGM, même si on ne sait pas encore quoi car on a toujours des surprises en matière d’alimentation. Songez qu’après la réunification allemande, la qualité de l’air s’est nettement améliorée en dix ans, mais que, dans le même temps, les cas d’asthme et de maladies allergiques ont étonnamment doublé dans une ville d’Allemagne de l’Est. On ne sait toujours pas pourquoi mais l’une des hypothèses est le remplacement, dans l’alimentation, de la margarine par le beurre.
Il faut savoir que les plantes génétiquement modifiées sont obtenues à partir de variétés possédant 30 000 gènes, auxquelles on supprime ou on ajoute un seul ou un petit nombre de gène(s). Lorsqu’on pratique une délétion, le risque est donc, a priori, particulièrement faible et facile à évaluer : un allégement réglementaire en matière d’ablation génétique nous simplifierait donc un peu la vie. Et même une addition génétique ne constitue qu’un ajout mineur à un ensemble déjà extraordinairement complexe de sorte qu’il ne faut en craindre aucun danger majeur, au moins en matière de santé.
Cela étant, il n’est pas exclu que les OGM, à l’avenir, aient des effets comportementaux, à l’instar de l’abus d’édulcorants, qui ont provoqué, aux Etats-Unis, un doublement des cas d’obésité en incitant à l’augmentation de la consommation alimentaire.
S’agissant de la biodiversité, je dirai qu’on en a presque fait une religion. En éradiquant le virus de la variole, on a bien porté atteinte à la biodiversité ! Et on ferait de même si l’on venait à bout du virus du SIDA ! Le problème relève moins de l’impact des OGM en lui-même que de leur usage, c’est-à-dire, en fait, de la sociologie, notamment agricole. La culture du maïs à grande échelle, qu’il soit transgénique ou non, a les mêmes effets en termes de biodiversité.
A propos de « Terminator », je ne puis qu’approuver M. Guillaume.
Nous avions proposé, avec Mme Viney, que le principe de précaution soit appliqué dans le cadre d’une procédure, d’un bon cahier des charges, afin que la question des risques ne bloque pas éternellement l’action. Les uns et les autres doivent faire valoir les avantages et inconvénients, puis procéder à une transaction entre l’incertitude et la rigueur des procédures, avec une prise de risques résiduelle. Il convient également de reconsidérer les paramètres économiques du système car, quand le risque est insignifiant, il n’est pas raisonnable d’imposer un cahier des charges trop onéreux. Cette piste procédurale est la voie à suivre pour progresser.
M. François GROSDIDIER : Je suis davantage convaincu par ces dernières réflexions que par les précédentes. Je vous ai en effet trouvé un peu méprisant envers le principe de précaution. La circonscription dont je suis l’élu appartient à une région sidérurgique où l’amiante fait des ravages, alors que des signaux d’alarme avaient été tirés il y a plusieurs décennies. Si le principe de précaution avait été appliqué, un très grand nombre de cancers mortels auraient été évités. Pour le risque minier aussi – certes moins grave car il ne touche que le patrimoine –, qui fut jugé aléatoire mais est maintenant avéré, on a choisi de ne pas bloquer l’activité économique, et, en fin de compte, l’indemnisation est très nettement inférieure au préjudice réel.
Après de tels désastres, nous ne devons pas exposer les populations à un risque qui peut se révéler démesuré, mais trop tard. Un botaniste éminent comme Jean-Marie Pelt tire la sonnette d’alarme à propos de la chute de la fertilité de certaines espèces, et nous avons déjà parlé de l’incidence de la consommation d’OGM sur la santé des rats. Or vos objections sont le plus souvent d’ordre économique. Alors que personne ne peut aujourd’hui écarter le risque de dissémination, on nous oppose que de très grandes serres reconstituant les conditions de l’exploitation en plein champ sont irréalisables pour des raisons économiques et non techniques. En mutualisant les moyens à l’échelle européenne, ne pourrait-on pas procéder à des recherches moins coûteuses que le viaduc de Millau ?
A l’issue de cette audition, je ne suis pas moins convaincu du risque des OGM et si je peux quelque part me féliciter que des activités nocives pour la santé de mes concitoyens soient délocalisées – comme celles qui recourent à l’amiante –, je regrette que le risque ait été transporté ailleurs et le fait que d’autres pays conservent ces pratiques ne suffit pas à les légitimer.
Au-delà des arguments de droite ou de gauche – je pense aux contraintes fiscales ou à l’absence de financement public de la recherche –, on peut parvenir à un assez large consensus quand la santé publique est en jeu et prendre des précautions pour protéger la population contre les risques inhérents aux OGM.
Toutefois, je vous suis lorsque vous dites que la recherche et l’activité économique ne doivent pas se voir entravées par des lenteurs administratives. Je retiens donc votre dernière proposition concernant les modalités d’applications du principe de précaution. Comment notre mission d’information pourrait-elle faire avancer cette idée de cahier des charges ?
M. Philippe KOURILSKY : Je voudrais d’abord lever un malentendu : je n’ai aucun mépris pour le principe de précaution. Il n’en reste pas moins que cette notion est complexe.
A propos de l’amiante, je distinguerai deux phases : quand sont apparus des signaux d’alerte significatifs et crédibles, il aurait fallu appliquer le principe de précaution mais on ne l’a pas fait ; lorsque ces signaux ont été scientifiquement avérés, on est entré dans le domaine de la prévention. Dans cette affaire, il y a par conséquent eu deux faillites, la plus grave étant celle de la prévention. Pour élaborer un cahier des charges, en matière d’alimentation, le problème est le même : il consiste d’abord à déterminer la base sur laquelle les signaux d’alerte doivent être définis ; on est alors dans le domaine de la précaution. Mais lorsque les signaux d’alerte sont avérés, on entre dans le domaine de la prévention. S’agissant des OGM, je ne vois aucun signe d’alerte.
Je me référai, par ailleurs à la loi Barnier qui fait déjà appel aux concepts de proportionnalité et de réversibilité : l’enjeu est de progresser avec suffisamment de souplesse pour être capable soit d’accroître le niveau de sécurité, soit de réduire les contraintes injustifiées.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Quand toute la production sera génétiquement modifiée, ce ne sera plus possible.
M. Philippe KOURILSKY : L’irréversibilité, qui fait partie des hypothèses catastrophistes, est illégitime dans bien des situations. Pourquoi les OGM envahiraient-ils le monde ? Darwin n’a jamais dit cela ! Les OGM résistants à tel herbicide ne le feront que si le monde entier est arrosé de cet herbicide !
M. François GROSDIDIER : Une espèce ne revient jamais en arrière.
M. Philippe KOURILSKY : Bien sûr que si ! L’instabilité que j’ai évoquée est également constatée en matière de systèmes écologiques. Ceux-ci dérivent à une vitesse surprenante, comme le vérifient les études de l’écologie scientifique.
Quoi qu’il en soit, l’enjeu est d’être capable de suivre la situation et de s’y adapter avec réalisme. Les systèmes publics se caractérisent malheureusement par des temps de latence et de réaction difficilement compatibles avec la réversibilité, et les réglementations se superposent plus souvent qu’elles ne s’annulent. Le principe de précaution, inscrit dans la loi, est extraordinairement difficile à respecter et doit faire l’objet d’une véritable réflexion de la part du législateur.
M. Pierre COHEN : Vous avez affirmé que les anti-OGM avaient gagné la partie en exploitant deux caricatures : la « malbouffe » et la productivité à tout prix. L’ensemble des personnes que nous avons entendues a tout de même reconnu que 90 % des essais en plein champ et des demandes d’expérimentation, en France, étaient motivés par la rentabilité. Vous mettez en avant l’intérêt des OGM pour la santé. Mais pourquoi n’y a-t-il pas davantage de recherches tendant à vérifier que les OGM sont susceptibles de résoudre des problèmes sanitaires ou celui de la faim dans le monde ? Cela signifie-t-il qu’il n’y a aucun besoin de recherche, ou bien que les chercheurs éprouvent des scrupules à s’y investir ?
M. Philippe KOURILSKY : Nous vivons dans un système économique libéral et la rentabilité fait partie de notre horizon, y compris dans le domaine de la santé – c’est d’ailleurs pourquoi certains vaccins ne sont pas distribués dans les pays en développement. On se heurte donc au problème de la rentabilité dès lors qu’on quitte le champ de la recherche académique, et on ne le résout qu’en mettant sur le marché un produit qui apporte un progrès attendu par le consommateur. Ainsi, je ne doute pas que celui-ci acceptera et même désirera un aliment faible en cholestérol. Or tous les brevets sont développés à l’étranger : quand ces produits de qualité arriveront sur le marché, il faudra payer la facture.
Quand les essais en plein champ, et même en serre, du CIRAD sont détruits par des groupes activistes, croyez-vous que cela encourage les chercheurs ? Non, cela les incite à l’autocensure. S’agissant du CIRAD, cette action a été d’autant plus criminelle contre l’esprit, et en tout cas plus absurde, que les recherches consistaient à tester des systèmes plus sûrs.
Enfin, j’oserai conclure par une remarque un peu provocante. Si l’on part du principe que les OGM n’entraînent pas de risque particulier pour l’alimentation – tests à l’appui –, la différenciation des filières alimentaires ne relève plus de la sécurité mais exactement de la même logique que le choix, éminemment respectable, de manger casher ou non : on flirte avec le religieux. S’agissant de la représentation que l’on se fait des choses, que l’on ne fasse pas porter le chapeau à la sécurité alimentaire ! On a le droit de choisir ce qu’on mange et donc de revendiquer des filières alimentaires différentes mais j’estime, pour ma part, que l’argent consacré à cette différenciation serait mieux employé s’il était investi dans d’autres segments de l’activité humaine, et je serais curieux de savoir si l’opinion publique est consciente de son coût et volontaire pour l’endosser.
M. le Président : Je vous remercie vivement pour votre exposé.
Je signale que l’AFSSA nous a répondu très clairement à propos des tests sur les reins de vieux rats de 90 jours : les désordres histologiques découverts, d’un point de vue probabiliste, ne sont pas forcément liés aux OGM et peuvent résulter du vieillissement car un rat de 90 jours est un vieux rat.
Audition de M. Daniel MARZIN,
président de la Commission d’étude de la toxicité
(extrait du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Je souhaite la bienvenue à M. Daniel Marzin, président de la Commission d’étude de la toxicité, dite « Commission des toxiques ». Nous souhaitons savoir si, bien qu’elle ne soit pas directement concernée, la commission est consultée au cours du processus administratif de délivrance des autorisations de mise sur le marché d’OGM et, si c’est le cas, selon quelles modalités. Par ailleurs, la commission étudie-t-elle la modification par la transgénèse du métabolisme des végétaux pour qu’ils puissent produire des toxiques ? Si tel est le cas, étudie-t-elle aussi les gènes permettant de fabriquer ces toxiques ?
M. Daniel MARZIN : Je suis professeur de toxicologie à la faculté de pharmacie de l’Université de Lille et chef du laboratoire de l’Institut Pasteur de Lille de recherche en toxicologie, plus particulièrement orienté de la mutagenèse et de la cancérogenèse. Assisté par le docteur Rémi Maximilien du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), toxicologue, et par le docteur Eric Thybaud de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), écotoxicologue, vice-présidents, je préside, depuis 2001, la Commission d’étude de la toxicité du ministère de l’agriculture, constituée d’une quarantaine de membres nommés pour trois ans – sur appels d’offres après examen des candidatures – par un comité de scientifiques indépendants. Des experts extérieurs participent aux groupes de travail, car l’évaluation des risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires requiert la contribution de spécialistes de très nombreuses disciplines. La commission est assistée par des représentants des ministères de la santé, de l’environnement et de l’industrie et d’autres institutions telles que la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Mutualité sociale agricole (MSA), l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement (AFSSE), et par le directeur de la structure scientifique mixte Institut national de la recherche agronomique (INRA)/Direction de l’alimentation du ministère de l’agriculture (DGAL).
Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CE, l’industrie phytopharmaceutique soumet à la Commission des toxiques, aux fins d’évaluation du risque pour l’homme et pour l’environnement, les dossiers relatifs aux matières actives d’une part, aux préparations phytopharmaceutiques d’autre part. Les évaluations sont conduites en fonction de six axes de recherche pour tous les produits : risques physico-chimiques ; méthodes analytiques ; risque pour l’homme ; résidus dans les aliments ; comportement dans l’environnement ; risque écotoxicologique.
Pour les matières actives, l’autorisation de mise sur le marché est donnée par l’ensemble des pays de l’Union européenne, après que chaque pays a voté sur un document rédigé par un pays rapporteur, aidé d’un pays co-rapporteur. Si l’accord se fait, chaque pays peut ensuite donner des autorisations de mise sur le marché de préparations contenant ces substances.
En France, elles sont données par la DGAL, sur avis de la Commission des toxiques. Ses avis sont souvent suivis, mais ce n’est pas toujours le cas. Parfois, bien que la commission ait signalé l’absence de risque, des interrogations sur l’efficacité d’une substance
– ce dont elle n’a pas à juger, puisqu’elle n’évalue que la sécurité – poussent le ministère à ne pas autoriser la mise d’un produit sur le marché. On peut aussi concevoir que, même si un produit donné ne présente pas de risque particulier, la qualité des eaux, ou l’état de l’opinion publique par exemple, puisse conduire à la même décision.
Il n’en va pas de même dans la situation inverse, et il est arrivé que la Commission des toxiques entre en conflit avec le ministère à propos du maintien sur le marché de produits qui présentent un danger réel pour la santé publique. C’est le cas, en particulier, du Paraquat, qui cause de si graves brûlures aux ouvriers agricoles que des greffes de peau ont été nécessaires pour réparer les lésions ; de plus, lorsqu’il est utilisé, comme c’est trop souvent le cas, par des candidats au suicide, il leur vaut de mourir, au mieux, de brûlures du système digestif, au pire de détresse respiratoire après une agonie atroce. Malgré cela, et bien que la Commission des toxiques en ait demandé le retrait, non seulement ce produit continue d’être commercialisé en France, mais les représentants français ont voté contre son interdiction au niveau européen.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Comment ont-ils justifié leur position ?
M. Daniel MARZIN : Demandez-le au ministre de l’agriculture qui a donné la consigne de vote à ses représentants – qui ne sont pas des scientifiques – sans nous faire part de ses arguments…
M. le Président : Depuis quand le danger du Paraquat est-il avéré ?
M. Daniel MARZIN : Depuis très longtemps. Pour les substances actives présentes sur le marché avant l’application de la directive 91/414/CE – son entrée en vigueur date de 1994 – les industriels ont dû déposer des dossiers d’évaluation, qui ont été traités en fonction de critères d’urgence. Le Paraquat figurait sur la première liste, car sa dangerosité, connue, est très documentée : on lui a attribué de 2 500 à 3 000 morts par suicide chaque année, rien qu’au Japon ! L’un des problèmes tient à ce qu’il est principalement utilisé pour traiter les bananeraies aux Antilles, où il n’y a ni médecine sociale agricole ni centre antipoison, et donc aucune statistique sur les accidents dont il est la cause. Bien entendu, la société Syngenta, qui le fabrique, explique qu’il n’y a aucun problème, puisque l’épandage se fait avec un pulvérisateur à dos, une combinaison de protection étanche, des gants et des bottes… ce qui, étant donné la chaleur tropicale, laisse pour le moins dubitatif. Je continue de me battre à ce sujet avec le ministère de l’agriculture. Nous avons assisté, au niveau européen, à des revirements étonnants : ainsi les représentants de la Belgique qui, un lundi, faisaient savoir qu’ils se prononceraient pour l’interdiction du Paraquat, et qui votaient contre le vendredi… Entre-temps, Syngenta avait fait valoir au ministère belge de l’agriculture que l’emploi de ses salariés en Belgique serait sérieusement menacé par une interdiction…
En France, ce produit est utilisé pour la vigne et la luzerne mais ne pose pas trop de problème parce que la pulvérisation se fait sur tracteur. Mais la médecine sociale agricole nous rapporte quelques cas, limités, de brûlures graves.
Pour tenter, au moins, de réduire le risque d’utilisation du Paraquat par les personnalités suicidaires, mes prédécesseurs avaient imposé que le produit contienne à la fois un répulsif odorant, un émétique, un colorant et un épaississant. Malgré cela, on comptabilise encore chaque année en France plusieurs dizaines de suicides par ingestion d’un produit qui condamne à une mort effroyable par étouffement, les poumons des malheureux étant réduits à la consistance du polystyrène expansé !
Je suis un peu sorti du sujet mais cette question me tient à cœur.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Cela en valait la peine !
M. Daniel MARZIN : J’en reviens aux activités de la Commission des toxiques, qui étudie chaque année quelque 1 200 dossiers portant soit sur des substances actives, soit sur des préparations les contenant, soit sur des modifications d’usage, soit sur des demandes d’expérimentations pour les produits ou les préparations nouvelles. Elle participe aux réunions d’évaluation communautaires et rédige des documents d’aide à l’évaluation du risque. La France, à sa demande, a été chargée des propositions de révision de la directive 91/414/CE pour le chapitre « risques pour l’homme ».
J’en viens au rôle de la Commission des toxiques dans les études d’impact des OGM. A l’initiative du professeur Marc Fellous, président de la Commission du génie biomoléculaire, s’est tenue au Sénat, il y a deux ans, une réunion commune aux deux commissions, à laquelle des scientifiques venus d’autres pays ont participé. Elle était consacrée aux relations entre pesticides et OGM et, à la suite de cette réunion, nous sommes convenus de constituer un groupe de travail commun sur les résidus, ce qui a été fait en septembre dernier.
Deux problèmes se posent. Le premier est celui des plantes transgéniques transfectées par un gène produisant une protéine pesticide ; le second est celui des plantes transgéniques qui acquièrent un gène de résistance à un pesticide.
Pour le premier cas, l’exemple classique est celui de Bacillus thurengiensis, bactérie qui existe dans tous les sols européens et qui constitue quelque 10 % de la flore connue du sol. Cette bactérie, de divers types, contient une protéine qui, lorsqu’elle est consommée par certains insectes, en tue les larves. C’est un bio-pesticide largement utilisé, en vente dans les jardineries et recommandé par les agriculteurs « bio ». Autant dire que la transfection par cette protéine ne présente pas pour l’homme un risque supérieur à celui que présente la consommation quotidienne de Bacillus thurengiensis « naturel » dans nos aliments. Les problèmes qui peuvent se poser sont le risque de dérégulation de gènes réprimés et le risque pour l’environnement : ainsi, un colza Bt pourrait par croisement féconder des ravenelles, qui deviendraient à leur tour toxiques pour les insectes. Certes, comme il n’existe pas de colza Bt en France, le risque direct est relativement faible, mais il peut y avoir, par pollinisation croisée, transmission aux plantes sauvages, et le risque est plus que théorique, puisqu’on trouve du colza Bt ailleurs dans le monde qui pourrait être importé chez nous.
M. le Rapporteur : A-t-on constaté des effets toxicologiques induits par le colza Bt là où il en est cultivé, au Canada par exemple ?
M. Daniel MARZIN : Pas à ma connaissance, mais la Commission des toxiques n’a pas connaissance des dossiers concernant les OGM : cela ne fait pas partie de ses missions.
J’en reviens à la nécessité d’évaluer le risque de dérégulation de gènes réprimés
– et donc de surproduction de leur produit – que peut faire courir l’insertion d’un gène. Prenons l’exemple de la pomme de terre qui, comme la tomate, produit, dans certaines circonstances, de la solanine, laquelle cause des troubles digestifs – c’est pourquoi, comme chacun le sait, il ne faut pas manger de pommes de terre verdies. La dérégulation du gène de la production de solanine pourrait conduire à une production continue de cette toxine, ce qui rendrait le légume impropre à la consommation. Il est donc nécessaire, lorsque l’on sait qu’une plante produit une toxine, de s’interroger sur le risque de la surexposition du gène et donc de la surproduction de toxine.
Pour autant, ce risque est-il spécifique aux OGM ? Lors de la réunion organisée au Sénat, le cas d’un céleri américain, particulièrement toxique, obtenu par croisements et sélection naturelle a été évoqué. Dès lors, ne doit-on pas s’interroger sur les risques potentiels de recombinaisons génétiques conduisant à une surexpression de gènes que peuvent présenter toutes les nouvelles variétés de plantes non-OGM comme on s’interroge sur les risques éventuels des OGM ? Pour cela, botanistes et toxicologues doivent conduire des évaluations conjointes.
M. le Président : Y a-t-il d’autres exemples que celui de cette variété de céleri ?
M. Daniel MARZIN : Je n’en connais pas.
M. le Président : Quels sont les risques comparés de transmission à la faune d’OGM et de pesticides ?
M. Daniel MARZIN : J’aborderai la question des pesticides un peu plus tard. Pour la faune, le risque des OGM, par rapport aux pesticides, tient à la rémanence. Lorsque l’on traite un végétal, le produit chimique utilisé détruira le prédateur visé – champignon, insecte ou mauvaise herbe – puis il sera éliminé. Mais lorsqu’un gène produit une protéine, celle-ci est en permanence dans la plante. Cela étant, à l’inverse des insecticides qui, en général, tuent tous les insectes, la protéine Bt est sélective : elle présente un risque pour les mouches mais pas pour les abeilles. Autrement dit, on a, d’un côté, rémanence et sélectivité, de l’autre un spectre très large mais une activité ponctuelle.
Aujourd’hui, l’idée fait son chemin d’une agriculture raisonnée, qui suppose que l’on utilise un pesticide uniquement lorsque le besoin s’en fait sentir, comme le faisaient nos anciens, qui prenaient soin de planter un rosier devant chaque rang de vigne pour être avertis précocement des attaques de mildiou. L’utilisation de plantes transgéniques va à l’encontre de la théorie de l’agriculture raisonnée, puisque le gène pesticide est inséré que l’agresseur soit présent ou non. Il en est de même du traitement des semences par enrobage, pratique qui se répand de plus en plus : la substance active passe dans la plante et exerce son action toxique pendant une bonne partie de la saison, qu’il y ait ou non pucerons ou champignons. Par son effet rémanent, qui s’ajoute à la pratique du « Je tape tous azimuts », cette pratique va encore plus à l’inverse de la conception de l’agriculture raisonnée. Qui n’a entendu parler des effets du Régent et du Gaucho ? Le Comité scientifique et technique des troubles des abeilles, que je préside, va publier un rapport à ce sujet après la réunion de son comité de pilotage le 21 décembre prochain.
La rémanence ne doit pas conduire à condamner systématiquement les OGM, mais à choisir de ne les utiliser que dans les cas où la fréquence d’apparition d’un prédateur le justifie – mettons quatre années sur cinq. Là comme ailleurs, il faut évaluer en permanence le rapport bénéfices/risques… comme lorsque l’on traverse la rue !
M. le Rapporteur : Précisément, y a-t-il un plus grand intérêt à utiliser des OGM contenant un gène de résistance aux pesticides que des pesticides en traitement ?
M. Daniel MARZIN : Je me refuse à répondre de manière générale : il faut étudier, au cas par cas, les avantages et les inconvénients. Prenons le Bt : c’est formidable, mais il suffit que le récepteur de l’insecte mute, et tous les insectes de la région deviendront résistants ! On l’a vu avec les pulvérisations de Bt contre la chenille processionnaire : la mutation spontanée du récepteur a eu pour conséquence que l’efficacité, réelle la première année, l’a été moins la deuxième et plus du tout la troisième… Autant dire que les OGM spécifiques relèvent d’une vision de court terme, car le revers de la médaille, c’est le développement très rapide de la résistance des prédateurs.
M. le Rapporteur : Les toxicologues sont-ils suffisamment consultés sur les OGM ?
M. Daniel MARZIN : Il y a des toxicologues au sein de la CGB. La difficulté tient au nombre très limité de toxicologues en France : c’est une espèce en voie d’extinction, car le ministère de la recherche ne distribue chaque année que quatre ou cinq bourses de thèse pour cette discipline. D’ailleurs, un seul laboratoire – INSERM18 et CNRS19 confondus – comporte le terme « toxicologie » dans son titre.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Vous avez évoqué le risque de surexpression de gènes. Les cahiers des charges comportent-ils des tests sur ce problème de toxicité et si oui, ceux-ci doivent-ils être obligatoirement faits en plein champ ou bien peut-on s’en tenir à des expérimentations en milieu confiné ?
M. Daniel MARZIN : Je n’appartiens pas à la CGB, mais je pense qu’à un moment donné on ne peut plus s’en tenir à des observations dans un univers parfaitement clos, car on risque de passer à côté de l’expression d’un gène. Ni l’exposition solaire vraie – par exemple, lorsque seule l’action du soleil permet de synthétiser la solanine – ni la pluie ne peuvent être imitées en serre. C’est bien pourquoi, lorsqu’il s’agit, par exemple, de définir des limites maximales de résidus, nous demandons que les études soient réalisées en plein champ, tant en Europe du Nord qu’en Europe du Sud, et pendant deux années au moins pour que les variations climatiques ne jouent pas. En effet, tout phénotype ne s’exprime qu’en réaction ou en accord avec l’environnement.
Le phénotype est à la rencontre d’un patrimoine génétique et d’un environnement. Si le patrimoine n’est étudié que dans un environnement clos, on néglige toute une partie de l’environnement et donc, en partie, l’expression de certains gènes.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais qu’en est-il du risque de dissémination des gènes lors des expérimentations en plein champ ? Quelles en seraient les conséquences pour la biodiversité ?
M. Daniel MARZIN : Cela pose certainement des problèmes de biodiversité, car on peut conférer à une plante sauvage inséminée par croisement avec le pollen d’une plante transgénique des propriétés de résistance particulières lui permettant de se développer au détriment de son environnement. Il faut donc procéder par étapes, et c’est là que les botanistes peuvent nous aider.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais il n’y en a plus !
M. Daniel MARZIN : C’est également une espèce en voie de disparition, c’est vrai ; en revanche, nous avons des biologistes moléculaires à foison !
M. le Président : Vous avez dit qu’il convenait d’étudier chaque cas, sans rejeter cette technologie par principe. Et, à propos de la mutation des récepteurs, des agronomes nous ont indiqué que la question ne se poserait pas si l’on constituait des « zones refuges » sans OGM autour des champs cultivés en plantes génétiquement modifiées (PGM) ; qu’en pensez-vous ?
M. Daniel MARZIN : C’est possible, mais je n’ai pas de connaissances dans ce domaine.
M. le Président : S’agissant de la biodiversité, on nous a aussi expliqué qu’il n’y a possibilité de gène de résistance que s’il existe une pression de sélection du pesticide ou de l’insecticide, et qu’il disparaît quand on ne cultive plus le produit concerné. Qu’en pensez-vous ?
M. Daniel MARZIN : Ce n’est pas mon domaine de compétence. Mais si ceux qui vous ont dit cela ont publié les données chiffrées sur lesquelles ils appuient leur démonstration dans des journaux scientifiques internationaux à comité de lecture, on doit les croire.
M. André CHASSAIGNE : Pour certains, la recherche française souffrirait de l’expatriation de chercheurs découragés, notamment par l’arrachage des plantes qui servaient à leurs essais. Votre approche est différente : pour vous, le gros problème est plutôt l’insuffisance du nombre de chercheurs, singulièrement en toxicologie. Selon vous, les réponses aux questions en suspens seraient-elles plus sûres si la recherche avait plus de moyens ?
M. Daniel MARZIN : L’évaluation des risques doit être pluridisciplinaire pour être complète. Et comme nous sommes, en tout, quarante professeurs de toxicologie en France, nous nous retrouvons toujours les mêmes dans les commissions d’évaluation. J’ajoute que le travail d’évaluation n’emporte aucune reconnaissance – c’est même plutôt l’inverse : notre progression dans la carrière universitaire est pénalisée par ces activités annexes, qui nous font « perdre notre temps »…
M. le Président : Autrement dit, le Conseil national des universités (CNU) ne considère pas le travail d’expertise réalisé pour la collectivité par le président de la Commission française des toxiques comme suffisamment important pour lui valoir la classe exceptionnelle.
M. Daniel MARZIN : En effet. Il faut dire que la toxicologie est considérée comme une discipline mineure, si bien qu’au cours des cinq années du mandat du CNU, aucun professeur de toxicologie n’a été nommé à la classe exceptionnelle, alors qu’il y avait de 3 à 5 postes par an, non plus, d’ailleurs, qu’aucun clinicien ou galéniste. Aussi, pour attirer des chercheurs vers l’évaluation, serait-il souhaitable de créer une nouvelle voie de promotion interne : les ministères fourniraient des postes et le conseil scientifique des instances chargées de l’évaluation conféreraient la classe exceptionnelle après délibération. Cela se conçoit très bien, à la fois parce que nous rendons service à l’Etat et parce que ce travail enrichit notre enseignement.
M. André CHASSAIGNE : Pour connaître la réponse scientifique à la question : « Quelles sont les conséquences des OGM sur la santé ? », faudrait-il davantage de chercheurs et en particulier de toxicologues ? Peut-on affirmer que, faute de scientifiques en nombre suffisant dans certains domaines, la recherche française n’est pas en mesure de valider la réponse à cette interrogation ?
M. le Rapporteur : Pour compléter cette question, estimez-vous qu’une place devrait être faite à la toxicologie au sein du futur Conseil des biotechnologies ?
M. Daniel MARZIN : J’ai été très étonné de constater, lors de la réunion organisée au Sénat, que ces produits donnent lieu à des études nutritionnelles, mais à aucune véritable étude toxicologique : on administre un produit à une vache et on observe si elle continue d’avoir une croissance normale, mais il ne m’est pas apparu que l’on soumette l’animal à des examens biochimiques ou hématologiques pour savoir si cette ingestion a des conséquences toxiques. On ne se préoccupe pas non plus, à ma connaissance, de l’impact du produit sur le cycle reproductif – fertilité, conséquences sur le fœtus, sur la gestation... Pourtant, on dispose d’études toxicologiques de ce type pour les produits chimiques et même pour les cosmétiques, et il ne me paraîtrait pas anormal que l’on s’intéresse à la toxicité éventuelle des OGM en tenant compte de ces paramètres.
M. le Président : Combien de toxicologues la CGB compte-t-elle ? Quelle place la toxicologie devrait-elle avoir dans la future commission nationale ?
M. Daniel MARZIN : A ma connaissance, la CGB ne compte aucun professeur de toxicologie. Dans le futur Conseil des biotechnologies, la venue d’un toxicologue serait nécessaire pour définir les effets toxiques à rechercher et les études qui devraient être exigées des industriels. Après quoi se posera la question de savoir quels toxicologues procéderont à ces évaluations car la toxicologie est protéiforme et complexe.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Vous considérez donc qu’il conviendrait de réaliser des études de toxicologie sanguine sur les animaux amenés à manger un maïs qui produit un pesticide ?
M. Daniel MARZIN : Oui, ainsi que des examens histopathologiques sur les prélèvements. C’est l’avis d’un toxicologue, mais il doit être conforté par d’autres avis.
M. le Président : Pour ce qui est des autorisations de mises sur le marché (AMM) européennes, c’est fait, mais pour les expérimentations, l’avis des toxicologues autres que ceux qui siègent à la CGB n’est pas pris. D’autre part, si l’on demande que des essais soient conduits sur les animaux, et dans la mesure où le risque de surexpression de gènes peut intervenir non seulement avec les OGM, mais également de façon aléatoire sur des variétés issues de croisements naturels, ne faudrait-il pas, dans ce cas, faire ces tests sur toutes les nouvelles variétés de plantes, OGM ou pas ?
M. Daniel MARZIN : Des études de toxicologie seraient inutiles pour le blé ou le maïs, qui ne produisent pas de toxines, mais seraient, effectivement, nécessaires pour d’autres végétaux tels que la tomate ou la pomme de terre, même sans OGM. Voilà en quoi l’aide des botanistes est nécessaire.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Quels sont, selon vous, les effets sanitaires des OGM qui produisent des pesticides ?
M. Daniel MARZIN : Aujourd’hui, nous avons des pesticides de structure protéique qui, une fois ingérés, ont le même devenir qu’un beefsteak, c’est-à-dire qu’ils se transforment en acides aminés. Le risque pour l’homme est donc très limité, et il serait très simple de l’étudier en procédant par étapes : études in vitro de digestibilité, puis études sur animaux pour observer si de petits peptides ne sont pas absorbés, puis essais sur des volontaires sains, à toutes petites doses, après avis d’un comité d’éthique. Mais je ne connais pas, à ce jour, d’exemples de plantes produisant des molécules organiques non protéiques. Mais on ne peut pas l’exclure.
M. André CHASSAIGNE : Pensez-vous que, compte tenu du principe de précaution, la pomme de terre serait proposée à la consommation de nos jours ? Sur un autre plan, pensez-vous qu’une plante génétiquement modifiée peut entraîner une toxicité « à retardement » – à l’horizon d’une ou deux décennies – pour l’homme et pour l’environnement ?
M. Daniel MARZIN : On mettrait très certainement la pomme de terre sur le marché mais en se posant sans doute davantage de questions qu’on ne l’a fait à l’époque de son introduction en Europe. Cela dit, l’expérience montre que l’on ne s’interroge pas assez, par exemple, sur les risques allergéniques que peut entraîner l’introduction d’espèces nouvelles sur un continent. Autrement dit, on se pose des questions sur les OGM que l’on ne se pose pas pour les plantes naturelles proposées à la consommation sur de nouveaux marchés. Il en est ainsi du kiwi, qui constitue désormais l’une des premières causes d’allergie en France. Il est vrai que ce n’est pas le cas au sein de la population néo-zélandaise, mais l’immunologie est une science complexe et ils n’ont pas le même patrimoine génétique que nous.
Sur le fond, la notion de principe de précaution est mal utilisée, galvaudée. Beaucoup considèrent que cela signifie : « On arrête tout ». Or, ce dont il s’agit, c’est de donner une réponse graduée en fonction des dangers évalués, réponse qui peut amener à arrêter provisoirement tout en se donnant les moyens d’une nouvelle évaluation. Voilà ce qu’est le principe de précaution !
Pour ce qui est des risques « à retardement », je n’en vois pas pour l’homme si les protéines absorbées se transforment en acides aminés. Pour l’environnement, on peut imaginer qu’une éventuelle transmission à d’autres espèces pourrait conduire à la pérennisation de certains caractères, mais c’est à d’autres que moi de vous apporter des réponses plus précises sur ce point.
J’en viens à la nécessité d’étudier les problèmes métaboliques que peut poser l’introduction, dans une plante, d’un gène de résistance à un pesticide. Les études disponibles concernent surtout le glufosinate et le glyphosate, c'est-à-dire des herbicides.
Pour cela, il faut déterminer si la transgénèse induit la formation de produits de dégradation – les métabolites – du pesticide considéré ; si c’est le cas, il faut définir si ces métabolites sont connus et s’ils ont été évalués sur le plan toxicologique. Ce n’est pas tout : il faut aussi mesurer si les quantités de métabolites produites sont supérieures à celles trouvées dans les plantes non-OGM traitées avec le pesticide et, si c’est le cas, déterminer si ce niveau d’exposition présente un risque.
Ces études qui sont nécessaires pour fixer les limites maximales de résidus acceptables dans l’eau, et surtout dans les aliments ne sont pas réalisées à l’heure actuelle, alors que le problème a été pointé. Ainsi, un herbicide tel que le glufosinate pose le pire problème toxicologique qui soit, car il existe une plante OGM ainsi transfectée qui produit un métabolite inconnu dans la plante d’origine. Au sein du groupe « résidus », nous nous efforçons de sensibiliser la CGB à cette question, sans guère de succès pour l’instant et, à ce jour, les études de métabolisme sur les OGM résistants aux pesticides ne sont toujours pas faites.
On nous dit aujourd’hui que l’introduction du gène de résistance au pesticide va réduire l’utilisation des pesticides mais on peut imaginer qu’une plante deviendra tellement résistante qu’on pourra augmenter les doses de pesticide, sans nuire à cette plante, alors que toutes les autres, autour, seront détruites. Dans ce cas, il faudra faire une évaluation du risque que présente une exposition plus forte, tant pour les applicateurs, les personnes vivant dans l’environnement et les ouvriers au champ que pour les consommateurs exposés à des métabolites inconnus ou à doses plus fortes – et aussi pour l’environnement par les dérives de pulvérisation et également par les métabolites inconnus.
En conclusion, l’évaluation des risques toxicologiques pour l’homme et pour l’environnement est nécessaire. Des liens sont indispensables et devraient être obligatoires entre la CGB et la Commission des toxiques. L’évaluation des risques suppose évidemment des toxicologues, qui ont eux-mêmes besoin de formation et de reconnaissance.
M. le Président : S’agissant des expérimentations pour lesquelles la CGB conservera sa compétence, on pourra faire des propositions. Mais les autorisations de mise sur le marché de produits alimentaires – de quelque pays qu’ils viennent, européen ou autre – étant maintenant de la compétence de l’Autorité européenne, estimez-vous suffisantes les analyses toxicologiques faites au niveau européen dans ce domaine ? C’est un sujet majeur.
M. Daniel MARZIN : Je ne peux répondre à cette question. Mais l’idée que la délivrance des autorisations de mise sur le marché soit de compétence uniquement européenne me gêne, car l’évaluation des risques doit être faite en fonction des habitudes alimentaires nationales. Ainsi, en matière de pesticides, si l’évaluation des matières actives est de compétence européenne, celle des pratiques agricoles est du ressort des Etats. On voit bien l’anomalie qu’il y aurait à ce que les Finlandais portent une appréciation sur la culture des oliviers. De même, s’agissant des OGM, on doit pouvoir analyser, par exemple, les risques spécifiques que court un gros mangeur de polenta, car la consommation de quantités notables d’un produit donné peut poser problème.
M. le Président : Pour l’instant, l’AFSSA fait encore ces études, mais son président que nous avons reçu se demande comment l’articulation va se faire avec l’agence européenne et a posé, comme vous le faites, le problème des comportements alimentaires, alors même que les autorisations qu’elle délivrera seraient applicables sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Il ressort de vos propos que les études toxicologiques, pourtant indispensables, ont été laissées pour compte, et l’on mesure le travail qui reste à accomplir. Serait-ce qu’animés par le souci de rentabilité, les semenciers ont choisi de sacrifier ces études parce qu’elles leur coûteraient trop cher ? Vous posez de vrais problèmes, qui en rappellent d’autres, et cette absence d’études est très inquiétante.
M. Daniel MARZIN : Mon opinion est que, ramené au coût des essais en champ, celui des études toxicologiques est relativement modeste : que représentent 3 millions d’euros dans le coût du développement d’une nouvelle plante transgénique ? Cette abstention s’explique peut-être par une autre motivation : la peur que, si l’on trouvait quelque chose de dangereux, cela ne freine le développement d’un produit dans lequel on a beaucoup investi. Les considérations relatives à la rentabilité seraient donc plutôt liées aux conséquences éventuelles des études qu’à leur coût.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Nous avons reçu bon nombre de scientifiques, et je m’étonne que personne n’ait fait référence à des études toxicologiques. Comment cela s’explique-t-il ?
M. Daniel MARZIN : Je l’ignore.
M. le Président : Il faudra recommander que des toxicologues siègent au sein du Comité des biotechnologies. Je pense pouvoir résumer votre opinion de la manière suivante : d’accord pour des études au cas par cas ; en matière d’OGM, pas de croyance « religieuse », mais nécessité absolue d’évaluation pluridisciplinaire ; s’agissant des autorisations de mise sur le marché, ne pas perdre toute compétence au bénéfice de l’Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments.
La question se pose maintenant de savoir comment intégrer la toxicologie dans le processus d’examen des expérimentations, sachant que certains ne veulent aucune expérimentation en champ... ou ne veulent carrément aucun OGM…
M. Daniel MARZIN : Le fait est, pourtant, qu’il faut, à un moment, intégrer tout l’environnement, climatique en particulier, et donc passer aux essais en plein champ. L’Autorité européenne étant appelée à travailler sur la réglementation, elle devra être particulièrement attentive à la définition des études obligatoires ; sinon, les industriels brandiront le cahier des charges pour refuser de procéder à certaines analyses au motif qu’elles n’y figurent pas et qu’on n’a donc pas le droit de leur demander de les réaliser. La volonté politique d’imposer des études minimums au niveau européen est donc indispensable. Les parlements nationaux, le Parlement européen et la Commission auront donc un rôle éminent à jouer pour orienter les textes réglementaires, sans toutefois hypertrophier le système, ce qui suppose une réflexion pluridisciplinaire sur le type d’études, à la fois souhaitables et interprétables, pour aboutir aux textes les plus applicables et donc les plus réalistes possible.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je ne partage pas l’avis selon lequel les essais en plein champ sont absolument nécessaires. Rappelons-nous : il fut un temps où l’on ne jurait que par l’expérimentation animale ; c’est l’action de petits groupes, persuadés qu’il n’était pas nécessaire d’en faire autant, qui a conduit à l’augmentation des analyses in vitro. De même, je suis convaincue qu’il est possible de limiter les essais en plein champ. Plus encore : c’est un discours castrateur pour la recherche que d’affirmer que ces essais sont de toute façon nécessaires.
M. Daniel MARZIN : Nos opinions ne sont pas antagonistes.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Tout dépend de la manière dont on interprète la déclaration : « Il n’y a pas d’autre solution que les essais en plein champ ». Pour moi, il existe des solutions alternatives.
M. Daniel MARZIN : Posons, alors, la question sous une autre forme : quelles études supplémentaires devraient être faites in vitro pour limiter les essais en champ ? Et nous aurons alors la même altitude …
M. André CHASSAIGNE : Vous nous avez exposé que bien des études ne sont pas faites, dont les études toxicologiques. Dans ces conditions, les essais en plein champ doivent-ils être autorisés, ou comprenez-vous les faucheurs qui estiment que, faute de précautions suffisantes en amont, il existe un risque réel ?
M. Daniel MARZIN : Cela doit s’évaluer au cas par cas. Autant il serait stupide de « flinguer » un maïs Bt, autant il serait anormal de procéder à des expérimentations, alors que l’on n’a pas de données suffisantes sur un maïs qui serait résistant à un pesticide dont on ne connaît pas le métabolisme dans la plante transfectée.
M. André CHASSAIGNE : Et comment le citoyen peut-il s’y retrouver ?
M. Daniel MARZIN : Je ne pense pas qu’il faille l’introduire dans ce débat.
M. le Président : Parlant des destructions qui ont eu lieu, M. François Kourilsky a évoqué des « atteintes très fortes à la démocratie ».
M. Daniel MARZIN : Je maintiens qu’il faut agir au cas par cas et dépassionner un débat qui fait la part belle aux intégristes de tous bords, en expliquant à la fois toutes les précautions prises et l’intérêt des recherches conduites. Ainsi, on nous explique que, demain, aucun agriculteur ne pourra utiliser, ni même produire, d’autres semences que celles de la société Monsanto. Mais pourquoi ne pas expliquer aussi que les agriculteurs sont déjà dépendants des producteurs de semences pour la plupart des cultures – tournesol, maïs, betteraves… –, car s’ils les produisaient eux-mêmes à partir d’hybrides, ils se retrouveraient avec des petits gros et des grands maigres, ce qui leur poserait quelques problèmes, au moins agronomiques ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Je pense que le principe de précaution commande que toutes les études d’évaluation des risques indispensables aient été faites avant que l’on se lance dans des expérimentations en plein champ.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Vous dites tenir pour une ineptie le fait d’arracher des cultures de maïs Bt, dont vous considérez qu’il est sans risque pour l’homme. Mais ne nous avez-vous pas parlé, aussi, du risque de dérégulation de gènes d’une part, de risque de passage de gènes aux espèces sauvages ou aux insectes d’autre part – risques qui, vous nous l’avez dit, n’ont pas été étudiés ?
M. Daniel MARZIN : Je n’ai pas cité l’exemple du maïs par hasard et pour les raisons que je vous ai exposées, je n’aurais pas pris celui du colza. Mais le risque de surexpression de gènes toxiques est nul pour le maïs, puisqu’il ne contient aucune toxine connue, le maïs Bt est également inactif pour les insectes utiles et il ne présente aucun risque pour l’environnement puisqu’il ne peut pas se croiser avec d’autres espèces en France. Encore une fois, il faut procéder au cas par cas, après que, par le dialogue, les scientifiques ont défini le risque ou l’absence de risque.
M. le Président : C’est d’ailleurs ce qui m’a conduit à demander, en 1998, un moratoire pour le colza et, il y a deux ans, l’autorisation des essais en champ au cas par cas, avec parcimonie et dans la transparence. Mais, aujourd’hui, des activistes des deux bords ne veulent pas discuter ou portent le débat, dans l’irrationnel et le tactique, sur de faux sujets – cela vaut d’ailleurs aussi pour le traitement des déchets nucléaires.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Il n’empêche que les auditions ont mis au jour de considérables carences dans la recherche en amont, et qu’elles doivent être exprimées clairement.
M. le Président : Il s’agit d’expérimenter, et je trouve aberrant de demander que ces expérimentations se fassent dans des conditions de sécurité bien plus drastiques que pour les produits OGM que l’on retrouve, par exemple, dans les céréales du petit-déjeuner.
Je vous remercie, M. Marzin, d’être venu nous exposer certaines lacunes dans les expérimentations, qui perdurent depuis 1998, ainsi que les difficultés de certaines disciplines qui ne doivent pas disparaître, notamment en allergologie et toxicologie. Nous en tiendrons compte dans nos réflexions sur la future organisation de la Commission des biotechnologies.
M. Daniel MARZIN : J’insiste sur l’extrême danger qu’il y aurait à dissocier recherche de l’impact des OGM sur l’environnement et recherche de leur impact sur l’homme. Car si l’on met un produit dans la terre, il donnera un métabolite qui se retrouvera dans l’eau que l’homme va boire. Si vous dissociez les évaluations, le risque ne sera pas détecté. L’intérêt de la Commission des toxiques est d’avoir ce double angle de vue.
Table Ronde regroupant des Académies
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2004)
– Académie d’agriculture : M. Jean-Claude MOUNOLOU, vice-président
– Académie des sciences : M. Roland DOUCE, professeur à l’Institut de biologie structurelle et M. Christian DUMAS, spécialiste de biologie végétale
– Académie nationale de médecine et Académie vétérinaire : M. Alain RERAT, co-auteur de l’ouvrage « OGM et santé »
– Académie des technologies : M. Pierre FEILLET, directeur de recherche émérite de l’INRA, directeur du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Recherche - industrie alimentaire »
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président,
puis de M. François GUILLAUME, Vice-président
M. le Président : Nous ouvrons aujourd’hui la première séance d’audition publique de cette mission, créée le 5 octobre dernier, et dont la Conférence des Présidents vient d’accepter, à notre demande, d’élargir le champ de compétence qui traite désormais non plus seulement des conséquences environnementales et sanitaires des autorisations, mais de l’ensemble des enjeux des essais et de l’utilisation des OGM. Je rappelle que cette mission, comme les précédentes sur les signes religieux à l’école, l’accompagnement de fin de vie et le financement de l’assurance-maladie, a été créée à l’initiative du Président Jean-Louis Debré, qui souhaite que l’Assemblée nationale se prononce sur les grands problèmes de société.
Cette mission pluraliste comprend des représentants de tous les groupes politiques et, conformément au vœu du Président, la présidence a été confiée à un député de l’opposition et le rapport à un député de la majorité.
Je rappelle également qu’en 1998 un travail avait déjà été effectué, à mon initiative, sur ce sujet, pour l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et qu’à cette occasion, a été organisée la première conférence de citoyens sur les OGM.
Nous avons décidé à l’unanimité de commencer par un certain nombre d’auditions privées, non par goût du secret, mais pour bien nous approprier ce sujet complexe, en écoutant notamment des chercheurs et des représentants des institutions directement compétentes. Nous entamons aujourd’hui une première série d’auditions publiques qui nous permettront d’entendre toutes les parties prenantes. Nous commençons aujourd’hui avec les représentants des académies, que je remercie d’avoir accepté notre invitation.
Ces premières tables rondes seront suivies d’une autre série organisée sur des thèmes précis et dont les débats seront contradictoires.
Nous nous rendrons par ailleurs dans deux régions françaises, puis à Bruxelles, en Espagne, aux Etats-Unis, et en Afrique du Sud.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : Nos exposés doivent-ils ne concerner que les plantes, ou bien également les micro-organismes et les animaux. L’Académie d’agriculture que je représente constate, en effet, que les sensibilités, les connaissances et les enjeux économiques et sociaux ne sont pas les mêmes dans chacun de ces trois compartiments.
M. le Président : Le sujet qu’il nous est demandé de traiter est général, vous pouvez donc aborder tous les types d’OGM. Si le temps nous fait défaut, je vous propose de nous faire parvenir les compléments écrits nécessaires.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : Depuis longtemps, notre académie a une attitude originale, grâce à sa structure qui réunit des hommes et des femmes ayant des formations et des professions diverses, tant dans le domaine public que privé. Nous balayons tout le spectre de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement, depuis les molécules jusqu’au revenu des agriculteurs et nous nous occupons aussi du bien-être des animaux.
L’Académie s’est donc intéressée aux OGM depuis de nombreuses années, et son secrétaire perpétuel dressera dans son prochain rapport annuel la liste de ses activités en la matière. Après de nombreux groupes de réflexion et de multiples séances, nous avons envoyé le 10 mars dernier au ministre de l’agriculture un message sur le moratoire concernant les plantes transgéniques à destination alimentaire. En précisant ainsi l’objet, nous laissions entendre implicitement que les problèmes se présentaient de manière différente dans d’autres domaines et que les mesures à prendre pouvaient l’être aussi.
L’attitude de l’Académie est la résultante d’opinions parfois personnelles, parfois structurées par l’origine professionnelle de ses membres. Il n’y a donc pas une règle unique de l’Académie, mais un effort de compréhension réciproque, de recueil de l’information et de transmission de nos réflexions. Je vous renvoie au dossier que nous avons constitué à ce propos, et que vous trouverez sur notre site Internet.
Dans le cas des plantes génétiquement modifiées, nous devons tout d’abord préserver les outils de concertation sociale et de défense de notre patrimoine économique, ainsi que la position de notre pays qui s’exprime à travers le certificat d’obtention végétal. Cet outil, qu’il serait souhaitable d’étendre au niveau européen, est une façon intelligente de traiter la question de la brevetabilité du vivant sans tomber dans le piège de l’ambiguïté : on peut breveter une séquence de nucléotides, alors qu’il est très difficile de breveter le concept formel de gène, opérationnel à un moment donné de l’histoire des sciences.
Ce qui fait souvent défaut dans le débat de société sur les OGM, c’est une réflexion sur les bases économiques des utilisations ou des non-utilisations possibles d’OGM. Ainsi, on fait très souvent abstraction des investissements nécessaires selon qu’on choisit ou non les OGM. On fait aussi abstraction des perspectives économiques : dans quel type d’agriculture serons-nous ? Que dira la nouvelle politique agricole commune (PAC) ? Comment traiterons-nous la question du commerce des produits alimentaires dans cinq ans ?
Pour revenir au champ de l’objet biologique, la position de l’Académie d’agriculture est claire : le vivant change en permanence, à des rythmes parfois plus rapides, parfois plus lents que ceux qu’aime la société. Par conséquent, il faut des règles qui séparent les filières, qui définissent des traçabilités, des outils qui permettent d’évaluer les résultats et de reconsidérer ces règles. Pour cela, le pouvoir est entre les mains des pouvoirs publics, parmi lesquels, le Parlement.
M. Roland DOUCE : Je rejoins tout à fait les observations qui viennent d’être faites. La position de l’Académie des sciences est claire. Les progrès considérables enregistrés dans la connaissance des gènes impliqués dans le métabolisme, la croissance, le développement, les réponses adaptatives aux contraintes physico-chimiques de l’environnement et la pathologie des plantes, ouvrent la possibilité d’une introduction raisonnée et prudente, au cas par cas, des plantes génétiquement modifiées dans l’agriculture, sous l’égide de la Commission du génie génétique (CGG), de la Commission du génie biomoléculaire (CGB), du Comité de biovigilance et de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), qui sont autant de garde-fous, mais dont il nous semble qu’ils devraient être regroupés au sein d’un seul Comité des biotechnologies, placé sous la responsabilité du Premier ministre.
En d’autres termes, l’Académie des sciences ne s’est pas prononcée pour l’introduction de toutes les plantes génétiquement modifiées. Elle considère que l’acceptabilité de ces plantes passe impérativement par un critère d’utilité. C’est le rapport risques/utilité qui fera pencher la balance. Toute généralisation sur les risques ou avantages potentiels de ces plantes est impossible et l’examen au cas par cas s’impose.
Notre deuxième recommandation porte sur la prise en compte des incertitudes et de l’indépendance des chercheurs. J’ai été moi-même amèrement critiqué parce que je dirigeais une unité mixte Rhône-Poulenc/CNRS20 et je suis ainsi apparu dans une certaine presse comme « vendu » aux industriels. C’est complètement faux !
Etant donné que les plantes transgéniques constituent potentiellement un atout considérable pour l’agriculture, pour le monde industriel et pour la santé, l’Académie des sciences recommande d’autoriser et de développer des recherches visant à accroître les connaissances indispensables à l’évaluation raisonnée des risques potentiels, tout en garantissant l’indépendance des chercheurs et des organismes publics face aux impératifs économiques et aux pressions diverses. La même prudence devrait valoir pour l’introduction de n’importe quelle variété produite par des procédés traditionnels.
La troisième recommandation a trait au rôle indispensable de la recherche fondamentale. Afin d’identifier des gènes cibles et d’innover dans des applications potentielles, l’Académie des sciences recommande de poursuivre et d’amplifier, via certaines actions incitatives comme Génoplante, des recherches de premier plan visant à comprendre le métabolisme, le développement et la résistance au stress des plantes supérieures. L’action incitative « Génoplante », lancée il y a quelques années, fut un réel succès.
La dernière recommandation porte sur les cultures expérimentales de plantes génétiquement modifiées et là, on peut se fâcher… L’Académie des sciences considère qu’il faut impérativement préserver l’intégrité de ces cultures, car c’est le seul moyen dont on dispose pour déterminer l’innocuité et l’utilité de ces plantes.
Telles sont donc les recommandations, nuancées, de l’Académie : introduction prudente, raisonnée, au cas par cas.
M. Christian DUMAS : Je m’exprime au nom de l’Académie des sciences et je partage ce qui vient d’être dit. En tant que spécialiste de la reproduction et du développement des plantes par la voie classique, j’ajouterai que, si l’on veut faire de la recherche biovégétale, il faut absolument utiliser les outils de la génétique, afin de tenter d’associer une fonction aux gènes impliqués. Dans l’esprit d’un grand nombre de personnes, il y a une confusion entre la technique
– l’utilisation du transfert de gènes – et la science – la recherche fondamentale. C’est ce qui a conduit à un blocage dans les médias et chez les « anti-OGM ». Les conséquences en sont désastreuses. Ainsi, sous l’égide de Philippe Busquin, commissaire européen à la recherche, un groupe d’études a montré que les retards législatifs ont entraîné l’arrêt total des recherches en génomique végétale soutenues par l’Europe dans le cadre du sixième Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de démonstration (PCRDT). Il a fallu que les scientifiques de toute l’Europe montent au créneau pour tenter de convaincre la Commission et nos propres politiques, afin que le septième PCRDT soutienne ces recherches.
La production et l’exportation de semences sont des richesses importantes pour notre pays et nous sommes en concurrence directe avec les Etats-Unis, où la législation est différente. Or ce blocage entraîne un retard de la France et de l’Europe. A qui cela profite-t-il ?
M. Alain RERAT : Je représente ici l’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie. L’Académie vétérinaire a participé à une journée que j’avais organisée il y a quatre ans sur ce thème, mais elle ne m’a communiqué aucun avis et je ne puis donc donner ici son opinion.
L'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie ont suscité, il y a trois ans, la formation d'un groupe de travail destiné à dresser un bilan entre avantages et inconvénients de l'utilisation des OGM, sous ses aspects nutritionnels et médicamenteux, en relation avec la santé de l'homme, car il est évident que l’alimentation peut faire le lit de la pathologie et que la thérapeutique est très importante. Ce groupe avait aussi vocation à informer l'ensemble des académiciens de ces deux académies de ses débats et conclusions, pour les soumettre à leurs observations et prononcer des recommandations. Il visait enfin à transmettre aux pouvoirs publics ces recommandations, approuvées par les membres des deux académies, et à publier les rapports ayant permis de les établir.
J’insisterai ici sur les deux points importants pour nos académies : l’alimentation et la thérapeutique.
L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est l'un des moyens envisagés pour faire face à l'augmentation de la production alimentaire mondiale, rendue nécessaire par l'accroissement démographique, et freinée par la stagnation des surfaces agricoles utiles en raison de l'urbanisation et de la dégradation des sols. On estime que, d'ici 2050, la production agricole devrait s'accroître de 2 % par an, soit un doublement en cinquante ans, sur un contingent insuffisant de surfaces arables disponibles, avec les ressources génétiques agricoles actuelles et les techniques même les plus sophistiquées.
Au plan quantitatif, l'utilisation d'OGM devrait permettre, d'une part d'accroître le rendement et la durabilité des cultures grâce à une meilleure gestion des terres et à une réduction des pertes, qui peuvent actuellement atteindre 50 % entre la production et la consommation à cause des prédateurs et des mauvaises herbes ; d'autre part d'envisager l'utilisation de surfaces agricoles, actuellement non disponibles, en raison de leur salinité ou de conditions climatiques défavorables. Ces progrès, permis par l'utilisation du génie génétique pourraient rendre disponibles, des masses alimentaires plus importantes et réduire ainsi les conséquences de l'accès aléatoire aux aliments, notamment dans les pays en développement où prévaut une malnutrition protéino-calorique.
Au plan qualitatif, le progrès alimentaire que l'on peut espérer de l'utilisation d'OGM porte sur la composition chimique des aliments et vise à corriger des carences spécifiques – vitamines A, E, fer et autres nutriments essentiels – ou à rétablir un équilibre entre nutriments plus favorable à la santé, notamment dans les régions favorisées où l’on observe des déséquilibres par pléthore, ou à faire disparaître des substances anti-nutritionnelles, toxiques ou allergéniques présentes dans certains produits végétaux.
Face à ces progrès potentiels, dont certains sont déjà concrétisés, on évoque avant tout le risque toxique ou allergénique lié aux protéines nouvelles issues du processus de transgénèse, mais ce risque apparaît également avec les méthodes génétiques classiques. Un deuxième risque est celui de la persistance potentielle de produits dérivés de pesticides dans les plantes rendues tolérantes aux pesticides, mais cette éventualité est prévenue, en principe, par les examens préalables de la Commission des toxiques, qui fait un travail efficace. En raison du risque potentiel de toxicité ou d'allergénicité de la protéine néoformée, l'autorisation de commercialisation des OGM en alimentation ne saurait être accordée sans une évaluation au cas par cas par des systèmes permanents d'évaluation et de biovigilance. La traçabilité devrait être aussi assurée par un système d'allergovigilance.
En matière de thérapeutique, l'utilisation du génie génétique est justifiée par les dangers que présentent les protéines d'extraction, telles que l’hormone de croissance, et par l'impossibilité pour la chimie de synthèse de mettre au point certaines macromolécules à usage thérapeutique. Le génie génétique permet en effet d'envisager des stratégies pour obtenir de grandes quantités de ces substances, en qualité satisfaisante, et pour répondre au large éventail des besoins. Les méthodes utilisées en milieu confiné sur cultures cellulaires, ou en milieu ouvert avec des plantes et des animaux transgéniques ont été analysées, ainsi que les risques présentés par les produits obtenus et les critères utilisés dans leur évaluation, qui sont les mêmes que pour une autorisation de mise sur le marché (AMM). Il existe actuellement, en thérapeutique, près de 80 protéines recombinantes de toutes natures, dont certaines ont permis de progresser notablement dans le traitement de maladies considérées, jusqu'alors, comme incurables, ou de maladies orphelines. Je n’évoquerai pas ici la thérapie génique, discipline en plein développement qui a fait l’objet d’autres séances de l’Académie de médecine et qui a un bel avenir devant elle.
A la suite de ces travaux, l'Académie nationale de médecine et l'Académie nationale de pharmacie ont émis un certain nombre de recommandations, d'ordre général ou plus focalisées sur l'alimentation et la thérapeutique.
D’un point de vue général, nous recommandons tout d’abord la reconnaissance par les pouvoirs publics du potentiel que représentent les OGM en matière d'alimentation et de santé. Nous préconisons ensuite la poursuite et l’intensification des recherches sur le génie génétique et ses applications, avec création de comités interdisciplinaires d'experts scientifiques et socio-économiques. Nous souhaitons également une communication vers le grand public par un discours scientifique clair et objectif. Un organisme public ayant les compétences et l'autorité morale nécessaires pourrait y être dédié. Enfin, il faudrait aller vers une coordination européenne, voire mondiale, du développement éventuel des OGM, en particulier en vue d’une harmonisation des réglementations.
Pour l'alimentation humaine et animale, nous recommandons un choix coordonné des domaines de recherches par les meilleurs experts, nommés par les pouvoirs publics, et l’élaboration, au cas par cas, d'un cahier des charges. Il convient aussi de définir de façon très stricte les conditions de recherche – nécessité des recherches en milieu ouvert, isolement sévère et protection des cultures expérimentales. Les dispositions législatives et réglementaires préconisées par la Commission européenne et leurs conséquences en termes d'innovation et de recherche devront par ailleurs être évaluées. Il faudra également améliorer les performances des méthodes de contrôle et de traçabilité. Nous préconisons la création d'un Observatoire public et permanent des OGM permettant l’observation a priori avant autorisation, la vigilance a posteriori après mise sur le marché, et l’évaluation régulière des expérimentations et cultures autorisées. Autre recommandation : la création d'un système d'allergovigilance pour tous les aliments nouveaux, OGM ou pas.
Les recommandations à visée thérapeutique sont moins nombreuses : extension de la recherche fondamentale à d'autres molécules que les protéines, établissement d'une réglementation internationale concernant les brevets, actualisation permanente des règles de sécurité, pharmacovigilance à l'instar des autres médicaments.
M. Pierre FEILLET : L’Académie de technologie n’a pas de position institutionnelle sur les OGM et n’a pas rédigé de rapport spécifique à leur propos. Pour autant, depuis deux ans, nous nous interrogeons sur l’impact des nouvelles technologies sur la qualité de notre alimentation. Nous avons déjà commis un rapport sur la filière laitière, un travail se termine sur les filières céréalière et oléagineuse, un troisième se poursuit sur les autres grands secteurs alimentaires. En ces occasions, nous avons croisé le problème des OGM.
Si l’Académie de technologie s’intéresse à ces questions, c’est qu’elles sont au cœur des relations qui vont s’établir entre science, technologie et société. Nous entendons donc prendre en compte les problèmes éthiques, juridiques, sociaux, et la question générale de l’acceptabilité.
Nous parlons ici d’une technologie « de rupture » car elle permet, à la différence des techniques classiques, d’aller chercher des gènes dans toutes les espèces existantes : jusqu’à l’apparition des OGM, on n’était pas capable d’insérer le gène d’un animal ou d’un micro-organisme dans une plante. Cette rupture nécessite une réflexion spécifique sur l’utilisation de cette technique et sur son impact sur la société. Si elle n’a jamais posé de problème en matière de santé, les choses sont bien différentes quand il s’agit d’alimentation et d’agriculture. Peut-être cela tient-il à une approche trop scientiste, dans laquelle on cherche à convaincre du bien ou du mal fondé d’une technologie sans prendre en compte tous ses impacts sociétaux. Par exemple, imagine-t-on convaincre des religieux musulmans qu’il faut manger de la viande de porc simplement en leur disant de ne pas s’inquiéter, en leur certifiant qu’elle est bonne pour la santé, qu’elle contient autant de protéines et de minéraux que le bœuf ? Non, parce que le problème se situe ailleurs.
De même, limiter la relation entre l’homme et son alimentation à un débat technique n’est pas satisfaisant. Il faut donc créer une grille de réflexion qui permette, pour toute nouvelle technologie, de mesurer son impact sur la nature, sur la santé, sur l’économie, sur l’emploi, sur l’agriculture, sur le maintien des activités semencières en France,… Nous avons besoin pour cela d’un lieu de réflexion où seraient présents les associations de consommateurs, les agriculteurs, les industriels, les scientifiques. Est-il toutefois besoin de le créer, puisqu’il existe déjà, sous la forme du Conseil national de l’alimentation, qui dépend du ministère de l’agriculture, et auquel on pourrait demander de regarder le problème des OGM sur un plan beaucoup plus large que celui de la science, incluant leurs impacts ?
Prenons un autre exemple : on nous dit que les téléphones mobiles auraient, par les ondes émises, des effets dommageables sur l’activité cérébrale, et on continue à mener des études à ce propos. Mais s’il s’agissait d’un sandwich, il aurait été interdit depuis longtemps, car tout ce qui touche à l’alimentation pose des questions particulières. Il est autorisé parce que l’avantage lié à cette nouvelle technologie est tel que le discours alarmiste ne passe pas. On raconte aussi cette histoire : un groupe de savants et d’inventeurs annonce aux gouvernants du monde qu’ils viennent de faire « une découverte formidable, qui permet à chacun de se déplacer rapidement là où il le veut, mais qui présente l’inconvénient de provoquer un million de morts par an »… Bien sûr, les dirigeants s’écrient « Pas question ! » Ils viennent de refuser l’automobile… On est dans ce débat, celui de la relation de la science, de la technologie et de la société et nous, nous préconisons qu’il soit approfondi au sein d’une instance neutre, où chacun serait représenté et qui pourrait être le CNA.
J’observe enfin que nous mangeons des OGM quand nous nous déplaçons et même en France, puisqu’il y a dans plusieurs fromages des enzymes obtenues par des micro-organismes génétiquement modifiés, mais cela n’a pas alerté les foules.
M. le Président : Nous aborderons lors de notre déplacement à Bruxelles, le 13 janvier, ces questions de définition : la lécithine qu’on met dans le chocolat, extraite du soja, va être classée OGM et devra être étiquetée si elle dépasse un certain seuil, alors que les enzymes ne sont pas considérées comme des OGM. Deux choses produites de la même manière, l’une à partir de plantes génétiquement modifiées, l’autre à partir de bactéries génétiquement modifiées, ne se voient pas imposer la même obligation d’étiquetage. Et quand on dit que c’est aberrant à la direction concernée, la réponse est « oui, mais c’est la réglementation »…
Vous avez eu tous les cinq des positions nuancées, vous n’avez pas prétendu que les OGM allaient tous nous sauver, vous avez dit qu’il fallait étudier au cas par cas, que vous étiez pour l’expérimentation, qui permet de mesurer les risques, qu’il fallait évaluer le rapport risques/avantages... Néanmoins, quand les rapports de l’Académie des sciences d’une part et des Académies de médecine et de pharmacie d’autre part, sont sortis il y a deux ans, un certain nombre d’associations et même de nos collègues ont dit que si vous concluiez à l’absence de risque pour la santé et pour l’environnement, c’était parce que vous aviez des liens étroits avec les lobbies et les grands groupes industriels... Je vous poserai donc deux questions politiques destinées à crever les abcès : vos conclusions étaient-elles moins nuancées que votre discours d’aujourd’hui ? Peut-on à la fois s’inscrire dans le cadre d’un partenariat public/privé et être très indépendant dans un rapport d’académie.
M. Roland DOUCE : Il est vrai que notre rapport a été très mal interprété. Alors que nous n’étions pas d’accord pour introduire toutes les plantes génétiquement modifiées, que nous maintenions le cas par cas, j’ai été victime d’attaques personnelles inadmissibles, qui m’ont fortement surpris. J’ai été cloué au pilori pour la simple raison que j’avais dirigé, à la demande des pouvoirs publics, l’unité mixte dont je vous ai parlé ; on a aussi dit que j’étais, en tant que membre de l’Académie des sciences des Etats-Unis, le fer de lance du Président américain dans sa volonté d’introduire les OGM en France. Cela a suscité une violence incroyable : lettres anonymes, sites Internet diaboliques… Mon honneur a été bafoué, j’ai eu du mal à surmonter cette détresse, et aujourd’hui encore je suis las de cette question. Heureusement que je dirigeais à l’époque l’Institut de biologie structurale de Grenoble, dont les 200 chercheurs ont signé une pétition pour me remonter le moral, car j’étais au creux de la vague et prêt à quitter la France.
Peut-être des chercheurs blanchis sous le harnais avaient-ils utilisé des expressions un peu dures, mais les conclusions générales du rapport, dont je vous ai fait part tout à l’heure, étaient nuancées.
J’ai aussi été surpris d’apprendre que, sous la pression de quelques députés, l’Assemblée nationale avait décidé de lancer une commission d’enquête. Cela a fait énormément de mal aux disciplines comme aux rédacteurs de ce rapport.
M. le Président : L’Assemblée n’a pas « décidé » : tout député a le droit de proposer la création d’une commission d’enquête, mais ce processus n’a pas abouti.
M. Roland DOUCE : La chose a traîné dans la presse et ça, c’est terrible !
M. le Président : Vous n’y êtes pas habitués… Mais c’est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons, à l’occasion de cette mission, dédramatiser ces débats en ouvrant nos auditions aux citoyens et à la presse.
M. Alain RERAT : J’ai moi aussi été incriminé, mais de manière moins brutale. J’ai surtout été étonné de découvrir des éléments de mon curriculum vitae que j’ignorais : j’ai ainsi appris, alors que j’ai passé ma vie à l’INRA, que j’appartenais au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)… J’ai aussi appris que mon thème de recherche était la défense de l’agriculture durable par les OGM, alors que j’ai travaillé toute ma vie en production animale, en nutrition animale et humaine, et en physiologie digestive et chirurgie expérimentale sur modèles animaux… Tout ceci est absurde et inadmissible dans un pays démocratique.
M. Pierre FEILLET : La vraie question n’est-elle pas : est-il possible que la recherche publique travaille sans collaborer avec la recherche industrielle ? D’ailleurs à un moment, l’AFSSA a considéré que, par principe, toute participation des industriels était de nature à perturber les réflexions de ses groupes de travail. Mais il ne faudrait quand même pas que toutes ces attaques amènent à considérer que, dès qu’un chercheur, un laboratoire ou un organisme a établi des liens de recherche contractuels avec le monde de l’industrie, de l’agriculture ou des semenciers, tout ce qu’il va faire est prédéterminé par les intérêts de celui qui finance.
J’appartenais à l’INRA. Si l’on veut qu’un organisme de recherche finalisée mène des travaux utiles, il faut pour le moins qu’il sache à quoi ils vont servir. Pour cela, il n’y a pas de meilleur moyen que de travailler avec ceux qui vont bénéficier de ces études. Pour un chercheur, le fait d’être en collaboration avec une entreprise privée apporte une vision de l’impact potentiel de ses recherches, des rapports science/société que j’évoquais tout à l’heure, vision infiniment plus large que celle du chercheur académique qui n’est jamais sorti de son laboratoire.
Je m’inscris donc totalement en faux contre l’idée que le fait de travailler en collaboration avec le récepteur de ses travaux soit nuisible à la société. Il faut, au contraire, l’encourager. C’est dans les années 80, au moment où Jean-Pierre Chevènement a lancé de grandes réflexions sur la science, qu’a été un peu débloqué le débat idéologique sur la relation de la science avec la société. Il ne faudrait pas qu’une discussion ponctuelle comme celle sur les OGM amène à remettre en cause cette avancée !
M. le Rapporteur : M. Mounolou a parlé de l’indépendance des chercheurs, qui est en effet essentielle, mais peut-on être vraiment indépendant et travailler dans le privé, par exemple chez Génoplante ?
M. Jean-Claude MOUNOLOU : En tant qu’individu/citoyen, je ne trouve pas acceptables les attaques diffamatoires ad hominem, et je pense que la réponse à celles dont a été victime Roland Douce passe par la justice de mon pays.
Sur la question de l’indépendance, l’opinion de mes confrères de l’Académie d’agriculture est qu’il s’agit d’une notion relative, que l’on peut aborder au moyen de l’outil que sont les lois de la République – le pourquoi du système dans lequel nous vivons –, ainsi que sous l’angle des objectifs que nous proposons pour nos agriculteurs, pour les consommateurs et pour la société dans son ensemble. Ensuite, nous avons à faire un effort de confrontation et nous plaidons pour qu’à tout moment, dans le dialogue entre les partenaires privés et publics, les agriculteurs et les consommateurs, les scientifiques et les investisseurs, soit analysée cette notion d’indépendance. Toujours nous devrons nous reposer cette question, toujours nous serons en retard, il faut donc nous habituer à la traiter sans relâche.
M. Roland DOUCE : Notre rapport est tombé à un très mauvais moment, celui du procès des « Douze de Valence » et de José Bové, ce qui a accru l’excitation, les militants anti-OGM s’imaginant, à tort, qu’il était destiné à les stigmatiser.
S’agissant de l’indépendance des scientifiques, la paranoïa n’est pas bonne conseillère car elle creuse le fossé d’incompréhension entre le monde académique et les industriels.
M. Pierre COHEN : Au-delà du cas des personnes, pour lesquelles la justice tranchera si elles se sentent humiliées, on ne peut nier qu’il y a débat sur l’influence de leur environnement de travail sur le positionnement des experts. On ne peut faire semblant de croire en la neutralité de laboratoires qui travaillent avec des filières industrielles et, à un moment donné, il est donc bien nécessaire de recourir à plusieurs expertises pour avoir des avis différents. S’il y avait autre chose dans les carrières des scientifiques que les publications et la valorisation, si la société était capable de valoriser les recherches scientifiques et les hommes de science dans le débat citoyen, ces derniers pourraient sans doute sortir de l’enfermement dans leurs relations avec leurs objets de connaissance et avec le monde de l’industrie. Tel n’est pas le cas ! La future loi sur la recherche nous donnera peut-être l’occasion de travailler à nouveau sur ces sujets.
Par ailleurs, la notion d’utilité peut renvoyer à l’économie, à la société, à la santé. Pouvez-vous, M. Douce, préciser vos idées à ce propos ?
Vous avez pour votre part, M. Feillet, donné l’exemple de la viande de porc. Mais, dans la restauration, on offre la possibilité de ne pas manger de porc. Pour les OGM, le problème est moins de laisser ceux qui en ont envie en manger que de faire en sorte que ceux qui ne le veulent pas n’y soient pas contraints. Serons-nous capables d’empêcher que tout devienne OGM ? Aucun d’entre vous n’a répondu à cette question ni évoqué le passage de la recherche confinée à l’expérimentation en plein champ, qui pose le problème de la maîtrise et de la prudence. Avez-vous un avis sur le sujet ?
M. François GUILLAUME : De ce que nous venons d’entendre se dégagent nettement, pour la première fois, les objectifs visés par les OGM et ce qu’on en attend : augmentation du volume de la production mondiale, hausse des rendements, amélioration de la qualité des produits, protection contre certaines maladies cryptogamiques affectant la qualité des produits, réduction des intrants, etc.
Ceux qui sont plutôt défavorables aux OGM ou qui sont excessivement prudents disent qu’il faut des recherches. Mais on a l’impression qu’en demander sans cesse de nouvelles, comme d’ailleurs vouloir en rester aux expérimentations en milieu confiné sans jamais passer en plein champ, revient en fait à ne jamais prendre de décision. A quel moment va-t-on se dire que, même s’il reste quelques petits inconvénients, il faut quand même décider et utiliser les OGM, comme l’ont fait, notamment, les Etats-Unis et la Chine ? On ne fait pas des recherches pour le plaisir, mais pour aboutir à des résultats, y compris économiques.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mme Robin-Rodrigo et moi-même avons été signataires, avec deux collègues, de la demande de création d’une commission d’enquête sur les OGM. Bien sûr, nous sommes totalement hostiles à certains propos diffamatoires qui ont pu être tenus, mais je rappelle que nous sommes en démocratie et que chaque parlementaire a le droit de demander à ce qu’on enquête quand il y a des points qui ne sont pas clairs.
Il est vrai que le rapport est mal tombé, au moment du procès de Valence, mais ce que nous avons entendu était un peu laconique et on peut comprendre que certains députés se soient posés des questions. D’ailleurs, j’en veux un peu à nos collègues qui ont refusé que l’on traite immédiatement ce problème, car cela aurait sans doute évité les développements diffamatoires ultérieurs, qui ont mis certains dans des difficultés inacceptables. Quand il y a des doutes, notre devoir est d’y répondre. Nous-mêmes, parce que nous avions rédigé cette proposition, avons été destinataires de propos peu amènes. Pourtant, l’intérêt de tous est d’avancer là où il y a des zones d’ombre.
Je voulais faire cette mise au point vis-à-vis des scientifiques, mais aussi des parlementaires…
M. Roland DOUCE : Elle me satisfait pleinement !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Nous étions prêts à modifier le nom de la commission d’enquête, mais nous nous sommes heurtés à une fin de non-recevoir : il ne fallait pas en parler ! Cela a encore accru notre malaise.
J’en viens au fond. Les problèmes de dissémination me préoccupent particulièrement, notamment parce qu’il y a des choses que les chercheurs ignorent encore et parce que la recherche – qui ne dispose certes pas des budgets suffisants pour avancer – n’est pas très claire sur un certain nombre de sujets. Nous avons reçu hier le président de la Commission des toxiques, qui a fait un exposé extrêmement clair, auquel j’adhère largement, et qui nous a expliqué que nous n’étions pas encore allés suffisamment loin en la matière. Quel est votre point de vue ?
L’un d’entre vous a dit par ailleurs que ces technologies permettaient d’envisager désormais la rupture de la barrière des espèces, ce qui n’est pas neutre aux yeux de nos concitoyens et à nos propres yeux, et qu’il conviendrait d’expliquer davantage, car on ne sait pas ce que pourront donner les OGM après plusieurs générations. N’est-ce pas jouer aux apprentis sorciers ?
J’aimerais aussi savoir ce que vous pensez de la charte de l’environnement et du principe de précaution, qui n’ont pas encore été intégrés à la Constitution.
Enfin, que pensez-vous du fait qu’aucune assurance ne souhaite couvrir les productions d’OGM et comment voyez-vous la législation très stricte qui vient d’être adoptée en Allemagne ?
M. André CHASSAIGNE : Nous travaillons dans cette mission, depuis un mois et demi, avec la volonté de comprendre, sans a priori, la problématique des OGM. Au fur et à mesure des auditions, nous nous sommes rendu compte que les débats étaient très passionnés, avec des gens qui croient chacun détenir une vérité définitive.
Je souhaite revenir sur le lien entre recherche fondamentale et recherche appliquée. De plus en plus, nous dit-on, la recherche sur les OGM devrait être systématiquement liée à des objectifs économiques ainsi qu’à l’utilisation possible de ces OGM. Mais ne pensez-vous pas que cette approche peut entraver la recherche fondamentale ?
M. Rerat a recommandé l’isolement sévère des cultures expérimentales et leur protection, mais est-ce compatible avec la culture en plein champ ? On ne peut se contenter d’affirmations, il faut être sûr des applications sur le terrain !
J’en viens aux moyens de la recherche. Tout le monde dit qu’il faut davantage de recherche, davantage de précautions. Or, dans nos auditions, nous constatons que des scientifiques estiment qu’ils ne disposent pas de moyens suffisants ou qu’ils ne sont pas assez nombreux, en particulier en toxicologie. Pour développer la traçabilité, l’allergovigilance, il faut des scientifiques et des crédits !
Enfin, on fait souvent un lien entre les OGM et les technologies classiques. N’avez-vous pas le sentiment que l’accent mis sur les premiers, dans une logique de rupture, conduit à délaisser les recherches sur les variétés, qui pourraient, pourtant, aussi apporter des réponses ?
M. Jacques REMILLER : On voit bien que tout tourne autour de la dissémination. Avant même Valence, le tout premier procès a eu lieu à Vienne, dont je suis le maire. C’était celui des « Trois de Saint-Georges », et l’audience en appel aura bientôt lieu à Grenoble. On l’a vu, le débat judiciaire s’est transformé en débat scientifique. Si l’expérience en vase clos est acceptée par tous, pourriez-vous préciser votre point de vue sur les expériences en plein champ ?
Par ailleurs, quel rôle voyez-vous jouer à l’Observatoire permanent des OGM dont vous avez parlé ?
M. le Rapporteur : J’aimerais savoir dans quelle mesure le recours aux OGM peut modifier les relations entre les semenciers et les producteurs agricoles. N’y a-t-il pas une dérive qui tend à rendre les seconds totalement dépendants des premiers ?
Par ailleurs, j’aimerais que M. Mounolou nous précise ce qu’est exactement le certificat d’obtention végétal et nous dise comment il pourrait être étendu au niveau européen.
Chacun semble d’accord pour regrouper les commissions du génie génétique, du génie biomoléculaire et de pharmacovigilance, ce qui serait une bonne chose. Ce futur Comité des biotechnologies devrait être sous la tutelle de plusieurs ministères : agriculture, environnement, recherche. Ne conviendrait-il pas d’y ajouter le ministère de la santé ? Il serait bon par ailleurs, cela a été dit, que la signature revienne in fine au Premier ministre.
Enfin, on a évoqué hier la procédure, pour constater qu’il faut parfois des mois, même en cas d’urgence, pour qu’un vaccin aboutisse. Ne pensez-vous pas que, dans certaines circonstances, le délai devrait être raccourci ?
M. Pierre FEILLET : Je vais essayer de répondre à l’ensemble des questions concernant le principe de précaution, la nécessité des recherches et la toxicologie.
Le principe de précaution est un principe à caractère politique, dont l’application est motivée par l’absence de connaissances scientifiques suffisantes. Pour éviter que ne se maintienne indéfiniment une situation dans laquelle aucune décision n’est jamais prise, il conviendrait que l’autorité politique, à chaque fois qu’elle invoque le principe de précaution, dégage systématiquement et obligatoirement les crédits nécessaires à la réalisation d’un programme de recherche visant à lever l’incertitude scientifique qui a conduit à invoquer ce principe. Hélas, ce n’est pas toujours le cas.
M. le Président : Plusieurs des personnalités que nous avons entendues, dont Philippe Kourilsky, directeur général de l’Institut Pasteur affirment que la recherche sur les points d’incertitude concernant les OGM a sans doute atteint sa limite. Souscrivez-vous à ce point de vue, et si oui, quelle décision vous semble la meilleure ?
M. Pierre FEILLET : C’était justement le deuxième point que je souhaitais aborder. On n’arrivera jamais à démontrer de manière absolue et définitive qu’un risque n’existe pas. On peut démontrer la présence d’un danger, jamais l’absence d’un risque. Il faut bien s’arrêter à un moment donné. Ma conviction est que tous les travaux effectués par nos collègues biologistes moléculaires et par les toxicologues ont atteint un seuil indépassable, sauf peut-être sur un point, qui est l’expression éventuelle de gènes silencieux. C’est là une question à laquelle la recherche fondamentale n’a pas encore répondu et qui m’inquiète plus que celles relatives à l’allergie et à la toxicité. Mis à part ce point précis, je crois en effet que les recherches supplémentaires que l’on pourrait mener ne peuvent pas nous donner beaucoup plus d’éclairages que ceux dont nous disposons aujourd’hui. Nous en sommes arrivés au point où une décision politique doit être prise. Encore une fois, il faut savoir s’arrêter. Je précise que si la pomme de terre était soumise aux règles européennes du Novel Food, elle ne serait pas autorisée.
M. le Président : M. Daniel Marzin nous a dit hier qu’en son âme et conscience il pensait qu’on l’autoriserait, à certaines conditions.
M. Pierre FEILLET : C’est cela : « à condition que… ». Il reste que, si je démontrais qu’un OGM introduit de la solanine dans une variété qui normalement n’en contient pas, je vous garantis qu’il serait interdit. Or l’expérience a montré, que même si la pomme de terre peut en contenir, sa culture nous a apporté des bénéfices bien supérieurs à ses dangers potentiels. S’agissant des OGM, ce ne sont pas des recherches, même extrêmement pointues, qui prouveront l’absence d’effets négatifs. C’est l’expérience de dizaines d’années de cultures sur plusieurs millions d’hectares qui conduira à penser que l’on peut les cultiver.
Troisième point, la toxicologie. Il faut savoir que la toxicologie française est sinistrée.
M. le Président : Vous n’êtes pas le premier à nous le dire, et nous le dirons dans notre rapport.
M. Pierre FEILLET : Les ministères de l’agriculture et de la recherche avaient demandé, il y a dizaine d’années, au professeur Jean-François Narbonne de rédiger un rapport sur ce sujet. Ce rapport était clair. Il n’a rien changé, et les grands groupes industriels français se tournent aujourd’hui vers la toxicologie étrangère. L’heure n’est pas très éloignée où il n’y aura plus en France de véritable toxicologue de l’alimentation.
M. Alain RERAT : Les aliments que nous mangeons aujourd’hui sont le produit de techniques très lentes de sélection et de croisement qui se sont progressivement améliorées sur une période de plusieurs siècles. Dans l’Antiquité, un épi de blé donnait trois grains de blé. Au Moyen Age, il en donnait six. Actuellement, il en donne cinquante. Il ne faudrait donc pas diaboliser les exigences de rentabilité et de rendement. Ce sont elles qui nous permettent de consommer des aliments de qualité et à bon marché. Il ne faut pas l’oublier
L’alimentation est quelque chose de sacré. Cela pose des problèmes. L’Académie de médecine et l’Académie d’agriculture ont récemment organisé une journée sur l’œuf de consommation. Le public accepte très bien des œufs enrichis en oméga-3 par l’alimentation de la poule. Mais si c’est un aliment OGM qui est enrichi en oméga-3, le même public criera « Horreur ! ». Il y a une barrière à faire tomber.
M. le Président : Je voudrais rappeler qu’il existe deux types d’autorisations. Celles qui concernent les expérimentations sont décidées au niveau national et relèvent de la Commission du génie biomoléculaire. Elles n’exigent pas d’études de toxicologie. La Commission des toxiques ne s’occupe que des produits phytosanitaires, elle ne s’occupe pas des OGM. Pour ce qui est des autorisations de mise sur le marché, des études toxicologiques sont menées par l’AFSSA, et maintenant par l’Agence européenne de sécurité des aliments. On ne sait d’ailleurs pas encore très bien comment ces deux structures ont coordonné leurs activités.
Pensez-vous que les études toxicologiques sont suffisantes en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché ou les exportations ?
M. Roland DOUCE : S’agissant des OGM, les études toxicologiques peuvent viser soit le transgène, qui est un acide nucléique, soit la protéine nouvelle apparue. Dans le premier cas, les nucléases puissantes du tractus intestinal tronçonneront le transgène et les risques d’insertion dans le génome humain sont nuls. Dans le second cas, les choses sont beaucoup plus compliquées. On doit impérativement se poser les questions suivantes. La protéine surexprimée est-elle toxique ? Cela serait, par exemple, le cas si l’on surexprimait dans une plante cultivée le gène codant pour la ricine du Ricin, un toxique puissant qui bloque la synthèse des protéines. Si la réponse est oui, qu’est-ce qui lui confère sa toxicité ? La protéine exprimée a-t-elle des propriétés allergènes ? etc. Ce sont là des questions auxquelles il est facile de répondre et il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre une toxicologie lourde. En fait, il faut analyser chaque OGM au cas par cas.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Pourquoi ces études ne sont-elles pas faites ?
M. Roland DOUCE : Elles seront faites. Mais actuellement, seuls deux types d’OGM sont commercialisés.
M. le Président : Et quid du gène Bt ?
M. Roland DOUCE : Le gène Bt produit une protéine, une toxine qui se comporte comme un « tueur des chenilles ». Je pense que, dans ce cas, nous devons faire des essais supplémentaires pour savoir si cette protéine est sans effet sur le bétail ou sur l’homme. Je crois que ces essais n’ont pas été faits.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Pourquoi ?
M. Christian DUMAS : L’utilisation du Bt est connue depuis trente ans en application externe sur les cultures, y compris en agriculture biologique.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Si certains végétaux développent des résistances aux pesticides, l’avantage des OGM semble peu évident car on est alors de nouveau obligé d’utiliser des pesticides. Qu’en pensez-vous ?
M. Christian DUMAS : Depuis que l’industrie chimique utilise des molécules pesticides, les agriculteurs savent qu’il convient d’effectuer des rotations ménageant des zones refuges. Le phénomène dit de co-évolution est connu et géré depuis longtemps.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : L’une des personnalités que nous avons entendues nous a appris que, sur 43 millions d’hectares de cultures d’OGM aux Etats-Unis, la quantité d’insecticides utilisés n’a diminué que de 20 000 tonnes. Le bénéfice est-il clairement établi ?
M. André CHASSAIGNE : Le fait que les études toxicologiques soient insuffisamment développées n’arrange-t-il pas les industriels, dans la mesure où ces études peuvent constituer un frein au développement d’un produit ? D’autre part, les habitudes alimentaires diffèrent d’un pays à l’autre. Or la toxicité varie selon le volume consommé. N’est-ce pas là une autre raison pour laquelle les études toxicologiques sont indispensables ?
M. François GUILLAUME : Il faut rappeler que la résistance est quelque chose de tout à fait naturel. Un OGM destiné à tuer la pyrale peut fort bien s’avérer inefficace au bout d’un certain temps, comme on a pu le constater pour la ravenelle et les chardons. On constate un phénomène de résistance analogue en ce qui concerne les antibiotiques.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : La position partagée par mes collègues de l’Académie d’agriculture est la suivante.
Mme Perrin-Gaillard a demandé pourquoi certaines recherches n’ont pas été faites, alors qu’elles sont techniquement possibles. Mais il faut aussi se demander comment faire en sorte qu’elles le soient. Il me semble qu’il appartient au ministère de la recherche de lancer un programme de recherche, ainsi qu’une procédure d’appel d’offres national, voire européen. C’est une démarche politique répondant à un souci de citoyens.
Pour ce qui est de la résistance, nous rejoignons tout à fait la position de M. Guillaume. Au cours de sa vie, un agriculteur voit le panorama biologique évoluer en permanence autour de lui. Cela a toujours été ainsi, et il est peu probable qu’il en aille autrement dans l’avenir, du moins pas dans celui que connaîtront les générations proches de nous. Par conséquent, la question est de savoir quelles pratiques il convient d’adopter. Toutes sortes de propositions ont été faites : agriculture raisonnée, agriculture pensée, agriculture biologique. Les pratiques existent donc, et il s’agit de savoir quels agriculteurs ont les moyens de les mettre en œuvre dans le respect des impératifs territoriaux qui leur seront imposés. Quelles barrières, quelles haies va-t-on leur imposer ? Voilà la question. La coexistence de filières OGM et non-OGM est possible. Le moratoire qui a été appliqué visait à stimuler des recherches sur la diffusion des gènes. Elles ont été menées et leurs conclusions rendues publiques. Nous savons donc comment faire techniquement pour gérer les risques que nous pourrions prendre. Il ne s’agit plus de faire d’autres recherches. Il s’agit de prendre des décisions à partir de celles qui ont été menées et de répondre à des questions pratiques : avec quel argent les agriculteurs vont-ils adopter les meilleures pratiques ? Dans quelles conditions ? Avec quelle politique nationale ? Quelle vision avons-nous de la politique agricole et environnementale ? Quand nous aurons une idée générale de la ligne politique adoptée, nous serons bien mieux placés pour refuser ou accepter la culture de tel ou tel OGM. C’est ainsi qu’il faut utiliser le principe de précaution.
M. Pierre FEILLET : Je voudrais nuancer quelque peu ce qui a pu être dit au sujet de la toxicologie. On est aujourd’hui capable de détecter des protéines allergéniques, comme on est capable de rechercher la ricine. Par contre, on ne sait pas encore identifier une toxicité dont l’origine serait inconnue. Si, suite à une transformation génétique, il se produit la synthèse d’un constituant dont on n’avait pas présagé qu’il puisse être présent, on ignore quelle molécule est en cause. Comment savoir si la substance produit ou non des effets en alimentation s’il est nécessaire, pour le savoir, d’en faire manger une tonne par jour à des rats ? Il y a un réel problème méthodologique. Comment savoir si une substance ne pose pas de problème alimentaire si j’ignore quelle molécule est en cause ?
Cela dit, il ne semble pas que ce problème soit spécifique aux OGM. Il se pose pour tout type de recomposition génétique. On pose, depuis que les OGM existent, une question qui se posait avant même la découverte des lois de Mendel, lorsque les frères Vilmorin réalisaient les premiers essais de sélection variétale dans les années 1740. Je n’ai jamais rencontré de problème de toxicité à l’occasion des recompositions de gènes classiques et je ne vois pas pourquoi il en serait différemment avec les OGM. Personne ne m’a prouvé scientifiquement que les OGM posaient un problème spécifique.
M. Alain RERAT : Je souscris pleinement à ce que vient de dire M. Feillet.
J’ajoute que le grand problème de la toxicologie est celui des études à long terme. Il est possible de faire des études à court terme, à trois mois, mais c’est beaucoup plus difficile à long terme. La toxicologie devrait être intensifiée. Mais ce problème ne concerne pas uniquement les OGM.
M. Pierre COHEN : Vous avez dit tout à l’heure, M. Mounolou, que les connaissances actuelles permettent la coexistence d’une filière OGM et d’une filière non-OGM, et qu’il suffit que des décisions politiques soient prises. Or, jusqu’à présent, je n’ai entendu que des propos allant dans le sens contraire. Même la FNSEA affirme qu’il y a encore des incertitudes et qu’on n’est pas encore capable de maîtriser cette coexistence. Si vous avez la solution, je crois qu’il n’est plus utile que je participe aux travaux de cette mission…
M. Christian DUMAS : Le maïs se reproduit par le pollen, qui peut être disséminé par le vent. Deux filières de maïs, OGM et non-OGM, peuvent-elles coexister ? Depuis très longtemps, les instituts techniques, pour mettre sur le marché une nouvelle variété, subissent des tests d’homologation, qui sont conduits par un organisme indépendant – avec une sorte de quarantaine, en milieux différents et en plein champ – sur une durée de deux ans. A l’issue de ces deux ans, il doit être démontré que la variété nouvelle satisfait à deux exigences. Elle doit être « DHS », c’est-à-dire « distincte, homogène et stable », et elle doit avoir une « VAT », une « valeur agronomique et technologique », satisfaisante pour être inscrite au catalogue des semences. Ce système extrêmement contraignant n’existe pas aux Etats-Unis. Les industriels producteurs de semences sont obligés de respecter un taux de certification très élevé. En général, ils arrivent à des taux meilleurs que les seuils de certification demandés. Pour qu’il y ait coexistence des filières, il faut que les taux de certification soient compatibles avec les normes. Actuellement, les instituts techniques, après avoir effectué des essais, affirment qu’il existe des normes compatibles pour les deux filières.
M. le Président : Quelles normes ?
M. Christian DUMAS : Dans beaucoup de pays, c’est 5 %. En France, c’est 1 %, et l’on parle actuellement de 0,9 %.
M. le Président : Le taux de 0,9 % est le taux de la directive européenne mais certains demandent des normes plus basses pour les semences.
M. Christian DUMAS : Des normes plus basses sont irréalisables.
M. le Président : Cela signifie donc qu’avec des seuils, on peut faire coexister des filières, sous réserve de respecter certaines distances pour éviter une dissémination qui dépasserait les seuils tolérés.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Si la coexistence des filières est possible, comment se fait-il qu’il y ait eu pollinisation lors des expériences faites en plein champ, alors que toutes les précautions avaient été prises ? Comment se fait-il que l’on n’ait pas pris toutes les mesures qui auraient évité que l’agriculture biologique soit entachée comme elle l’a été ?
M. Philippe MARTIN : Ce que vous nous avez dit signifie-t-il que des essais d’OGM en plein champ peuvent parfaitement coexister avec des cultures biologiques situées juste à côté, sans que celles-ci courent le moindre risque d’être déclassées du fait de l’existence de traces, comme cela vient de se passer dans le Gers dont je préside le conseil général ? L’organisme Ecocert a déclassé des productions biologiques au motif qu’elles contenaient des traces.
M. Christian DUMAS : Vous avez prononcé le mot « trace ». J’ai prononcé, quant à moi, le mot seuil. Ces deux notions renvoient à des valeurs totalement différentes.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : C’est l’expression « juste à côté » qui est le lieu de notre divergence, alors que nous convergeons dans nos objectifs. M. Dumas a parlé de seuil, ce qui concerne aussi bien la présence d’informations génétiques issues d’un OGM dans une culture biologique que la mise en œuvre des pratiques et des contraintes de gestion du territoire que les agriculteurs ont à respecter. En d’autres termes, nous, la société française, pouvons décider de fixer certains seuils et de mettre en œuvre deux filières séparées en imposant des contraintes techniques et financières supplémentaires à nos agriculteurs. Si je cultive des tomates à côté d’un agriculteur qui cultive d’autres tomates, il s’ensuivra des résultats très inattendus, pour lui comme pour moi. Il n’y a là rien de nouveau, et rien de spécifique aux OGM. Toute la question est de savoir quels sont les objectifs d’organisation et de gestion du territoire agricole que nous voulons nous donner, quels sont les agriculteurs que nous voulons. L’organisation des deux filières n’est pas un problème biologique, c’est un problème de politique agricole et de gestion du territoire. Les deux communautés existent au sein de l’académie, elles se parlent mais il faut s’organiser et l’organisation n’est plus un problème biologique, c’est un problème de gestion politique.
M. Pierre FEILLET : L’agriculture biologique se définit par le respect de certaines règles de bonnes pratiques. Actuellement, lorsqu’une production biologique est contaminée par des pesticides appliqués dans un champ voisin, elle reste biologique, dès lors que l’agriculteur a respecté les bonnes pratiques. Si demain la France est couverte de cultures OGM, il est certain que l’on retrouvera des traces dans les productions biologiques, tout comme actuellement, on trouve des traces de pesticides. La question est de savoir s’il faut, pour cette raison, refuser la culture d’OGM ou s’il faut admettre qu’une production peut rester biologique, même si elle est très légèrement contaminée. Le simple fait que l’on retrouve des traces suffit-il pour que l’agriculture biologique ne soit plus considérée comme telle ? Il faut peut-être faire évoluer les définitions des caractères, dès lors que la santé des consommateurs n’est pas en cause.
M. le Président : Nous interrogerons sur ce point des représentants de l’agriculture biologique. Il est impossible de définir comme culture non-OGM une culture où ne se retrouve aucune trace. Il y aura toujours des traces, même à des dizaines de kilomètres. La question des seuils fait l’objet d’un compromis au niveau européen mais l’agriculture biologique souhaite que ces seuils baissent. Si tel est le cas, l’agriculture biologique sera-t-elle compatible avec les OGM ? C’est là une question importante, que nous aborderons à l’occasion de tables rondes contradictoires.
M. Christian DUMAS : Je voudrais aborder le thème de l’utilité des OGM.
Aujourd’hui, une douzaine de plantes nourrissent la planète. Trois d’entre elles, le blé, le riz et le maïs, représentent 60 % de l’alimentation mondiale, avec 600 millions de tonnes par an. Deux sur trois, le riz et le maïs, ont des besoins en eau extrêmement importants.
D’autre part, la première révolution verte, dans les années 70, a permis à 1 milliard d’habitants d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, notamment grâce au blé et au maïs. Elle a mis en œuvre les outils de la génétique classique qui ont permis d’améliorer la qualité des semences. Depuis une vingtaine d’années, nous assistons à une autre révolution, doublement verte, celle des biotechnologies. Que peut-on en attendre ? On connaît aujourd’hui la totalité du génome de certaines plantes, comme le maïs et le riz, et bientôt le colza. On connaît également un certain nombre de marqueurs, qui permettront notamment une sélection beaucoup plus efficace que la sélection empirique. Ce sont les connaissances de la génétique qui permettent cette amélioration, indépendamment des OGM.
Pour ce qui est des OGM, peut-on raisonnablement envisager que l’agriculture de demain puisse s’en passer ? Aujourd’hui, 36 millions d’hectares dans le monde sont des sols salés, sur lesquels on ne peut pratiquement rien cultiver, et 30 à 40 % de la surface du globe est aride ou semi-aride. Les surfaces cultivées sont extrêmement restreintes, et les mégalopoles en réduisent encore la dimension. Deux objectifs vont devoir être atteints : augmenter la production ; améliorer la qualité des aliments. Les OGM vont pouvoir nous y aider. On sait en effet que les caractères de résistance à la sécheresse et au sel sont très complexes. Ils impliquent des dizaines de gènes. Il y a toujours en amont des gènes maîtres, que l’on commence à connaître, notamment ceux qui permettent de résister à la sécheresse et au sel. Certains de ceux que l’on connaît se trouvent dans des bactéries, notamment thermophiles. On va donc transférer des gènes de bactérie dans une plante et cela fait peur. Mais il faut savoir que le séquençage a montré qu’une centaine de gènes présents dans l’arabette, l’espèce végétale sans doute la mieux connue, étaient homologues à des gènes humains. Parmi eux, le gène BRCA 1, qui peut être à l’origine du cancer du sein, est plus homologue entre la femme et l’arabette qu’entre l’homme et la souris. Il y a des gènes communs entre la levure et la plante et entre la levure et l’homme.
Le transfert horizontal inquiète beaucoup, car il peut être à l’origine de la transgression de la barrière des espèces. Mais cette transgression a toujours existé. C’est un mécanisme de l’évolution. Toutes les espèces vivantes dérivent d’un groupe de bactéries qui a échangé environ 25 % de ses gènes par transfert horizontal avec un autre groupe de bactéries primitives. Il a été montré récemment qu’il existait 4 000 plantes parasitées par d’autres plantes. Il y a donc des échanges de gènes entre plantes parasites et plantes parasitées et les recherches doivent se poursuivre.
Le colza OGM a fait l’objet de polémiques, notamment en raison des croisements avec la ravenelle. Mais ce n’est pas un phénomène nouveau. Chaque fois qu’un croisement est possible entre une espèce cultivée et des adventices sauvages – c’est-à-dire des mauvaises herbes qui en sont de proches cousines – le croisement se fait. Pourquoi ? Parce que l’on a affaire, en définitive, à la même espèce, l’espèce cultivée n’étant que le résultat d’une évolution, souvent produite par la sélection de l’homme.
M. Francis DELATTRE : Pouvez-vous nous confirmer que le principal intérêt des OGM n’est pas dans l’amélioration des rendements mais dans la diminution des intrants, essentiellement herbicides et insecticides ? Si les agriculteurs américains choisissent des cultures OGM, c’est bien pour cette raison.
M. Christian DUMAS : Les seules données que nous avons à notre disposition sont celles qui nous sont fournies par l’industrie. On peut s’interroger sur leur objectivité, même si elles sont parfaitement bien établies. Mais il est plus que vraisemblable que les OGM permettent une diminution des intrants.
Certaines plantes nécessitent une très grande quantité de traitements. C’est notamment le cas du coton. Alors que les Indiens étaient farouchement opposés aux OGM, le gouvernement indien a autorisé le coton OGM parce qu’il évite aux agriculteurs d’avoir recours à des pesticides.
M. Francis DELATTRE : La pyrale exige trois pulvérisations. Est-il d’ores et déjà possible d’affirmer que le maïs OGM permettra de s’en passer ? Il est important de le savoir. Car la seule chance de survie commerciale d’un maïs OGM réside dans la mise en évidence de ses avantages, parmi lesquels la diminution des intrants.
M. Christian DUMAS : En Europe, la surface cultivée moyenne est de 18 hectares. Aux Etats-Unis, elle avoisine les 80 ou 90 hectares. L’échelle d’expérimentation n’est pas la même. Les seules données objectives intéressantes concernent les grandes surfaces, où l’on constate, effectivement, une diminution des intrants.
M. Pierre FEILLET : Les avantages et inconvénients des OGM peuvent être de trois ordres : amélioration de la productivité ou des caractéristiques des produits agricoles ; impact ou absence d’impact sur l’environnement ; impact ou absence d’impact sur la consommation et le consommateur. Pour le consommateur, l’avantage n’est pas évident.
M. François GUILLAUME : Il y a le prix.
M. Pierre FEILLET : Je ne sais pas. Le prix du blé représente 4 % du prix de la baguette. Je ne suis pas sûr que l’incidence des OGM sur les prix soit considérable. De même, pour ce qui est de la qualité de l’aliment, je ne suis pas sûr que les OGM présentent un avantage direct, identifiable et clair. Par exemple, si la vitamine A est un avantage, il faudrait, pour en bénéficier, manger une telle quantité de riz que ce n’est pas possible. Et c’est d’ailleurs là le principal problème : les consommateurs et les citoyens ne voient pas l’avantage qu’ils peuvent retirer des OGM. Dès lors, se disent-ils, pourquoi courir un risque, fût-il quasiment nul, s’il n’y aucun avantage ?
M. Francis DELATTRE : La diminution des insecticides est un avantage !
M. Pierre FEILLET : Je me place du point de vue du consommateur. Je ne parle pas de l’environnement.
M. François GUILLAUME : Je suis en désaccord sur plusieurs points.
Premièrement, il ne faut pas seulement penser aux consommateurs, mais aussi aux hommes et aux femmes qui ne peuvent pas consommer, et à qui les OGM peuvent apporter beaucoup par l’augmentation des rendements ou la production dans les terrains salés.
Deuxièmement, s’agissant des prix, la remarque de M. Feillet vaut pour les produits transformés, par pour les fruits et légumes, par exemple.
Troisièmement, il y a de grands avantages à attendre en ce qui concerne la qualité des aliments, sans quoi je ne vois d’ailleurs pas pourquoi on ferait des recherches en la matière. Si, par le passé, on avait suivi le raisonnement de M. Feillet, on n’aurait pas eu recours à l’insémination artificielle, qui repose sur des techniques finalement très onéreuses. Or, grâce à elle, le cheptel d’aujourd’hui est nettement meilleur que celui d’hier.
M. Christian DUMAS : Nous n’avons pas encore abordé la question de fond, celle de la réglementation. Nous sommes tous partisans du certificat d’obtention variétale (COV), qui permet, depuis 1961, de créer d’autres variétés à partir d’une variété nouvelle, sans avoir à verser de droits à celui qui l’a créée. Cela permet d’autoriser les semences fermes. Ce COV est un paradoxe juridique qui permet au créateur de tirer profit de sa création tout en évitant de bloquer les choses pour le reste de l’humanité. Or, la nouvelle réglementation a combiné ce COV avec le brevet, ce qui aboutit à un blocage total. Si vous modifiez légèrement un génome, vous entrez dans le système du brevet. J’y insiste : même si des problèmes scientifiques se posent, le problème de fond est d’ordre juridique. Une entreprise qui greffe un gène gagne très facilement tous ses procès en cas de dissémination.
M. le Président : Je vais vous répondre sur ce point. En 1991, les OGM n’intéressaient personne à l’Assemblée nationale. Au début de la semaine dernière, la transposition de la directive de 1998 a été adoptée. Premièrement, la contamination accidentelle ne peut pas donner lieu à un procès analogue à celui qui a eu lieu au Canada. L’article 15 du code de la propriété intellectuelle l’interdit. Deuxièmement, nous nous sommes battus pour maintenir le certificat d’obtention variétale. Vous n’avez donc pas à utiliser le brevet pour travailler sur une espèce nouvelle. C’est important, car le but d’un certain nombre de grandes sociétés est, dans le domaine informatique, de s’approprier le logiciel, et, dans le domaine des sciences de la vie, de s’approprier le vivant. Nous devons donc être très vigilants. Il me semble que la transposition que nous avons adoptée permet d’éviter cela. La jurisprudence le dira. Mais j’ai demandé, au nom de mon groupe, que cette directive fasse l’objet d’un travail an niveau européen pour traiter de ces questions.
M. Germinal PEIRO : Je veux souligner qu’il est tout à fait naturel que ce débat préoccupe énormément notre société. Si l’utilisation des OGM dans la recherche thérapeutique ne pose aucun problème pour nos concitoyens, c’est tout le secteur de l’alimentation qui suscite des interrogations. Quoi de plus normal ? L’alimentation, c’est ce qui met en jeu notre processus vital. Si l’on mangeait les téléphones portables, on ne les produirait pas comme on le fait aujourd’hui, car on se préoccuperait beaucoup plus de leurs incidences. De même, si on mangeait des voitures, l’on produirait des voitures beaucoup plus sûres. Bref, ce qui est directement vital appelle de notre part une très grande vigilance.
S’il y a suspicion, c’est parce que, bien qu’il y ait eu d’énormes progrès dans les mesures visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments, l’opinion a le sentiment que l’alimentation s’est dégradée parce qu’elle s’est artificialisée et parce que le goût et la composition chimique posent problème. C’est pourquoi elle n’a pas confiance dans les méthodes culturales ou les méthodes d’élevage actuelles, d’autant plus que certaines ont produit des effets dramatiques, je pense en particulier à la vache folle. Elle n’a pas non plus confiance dans l’industrie, dont les motivations lui paraissent essentiellement dictées par le profit.
Les citoyens pourraient accepter certains inconvénients s’ils percevaient clairement les avantages des OGM. Pour ma part, je rêve que des techniques nouvelles permettent de nourrir la planète et de produire une alimentation plus saine. Mais honnêtement, c’est là une perspective que je ne vois pas se dessiner.
M. Alain RERAT : L’opinion n’est pas suffisamment consciente que de meilleurs aliments sont aujourd’hui à la portée du plus grand nombre, quoi qu’on en dise. Pour l’essentiel, les grandes intoxications alimentaires sont derrière nous, même si l’on sait qu’elles ne disparaîtront jamais entièrement. Quant à la qualité gustative, les panels de dégustateurs ne font apparaître aucune espèce de dégradation de l’alimentation. Il faut résister à ce matraquage médiatique autour du thème de la fameuse « malbouffe » dont tout le monde nous parle mais dont personne n’a jamais apporté le moindre début de preuve. Je ne nie pas qu’il y ait ici ou là ce que l’on peut appeler des « bavures », mais il reste que la qualité de l’alimentation est aujourd’hui bien meilleure qu’il y a cinquante ans. Et du point de vue sanitaire, elle est cent fois meilleure. Cela ne souffre aucune discussion.
Je voudrais revenir aux propos de M. Feillet. Il nous faut distinguer les produits manufacturés de ceux qui ne le sont pas. Dans les pays développés, les OGM peuvent nous permettre de mettre à la disposition du consommateur des fruits et légumes de meilleure qualité.
En ce qui concerne le tiers-monde, je rappelle que 800 millions de personnes souffrent de dénutrition, que 130 millions de personnes souffrent de carence en vitamine A, parmi lesquels 500 000 enfants sont victimes chaque année d’une cécité complète ou partielle, et que 2 milliards d’individus souffrent de carence en fer. Une telle situation mérite que l’on considère des voies nouvelles, qui sont très intéressantes. Personne n’a jamais dit que le « riz doré » était capable, à lui seul, de couvrir les besoins des personnes carencées en vitamine A. C’est néanmoins une piste que l’on peut explorer.
S’agissant de la production alimentaire elle-même, elle peut être augmentée dans le tiers-monde, par des moyens que j’ai évoqués dans mon propos liminaire, ainsi que M. Dumas à l’instant.
M. le Président : Nous n’avons pas épuisé le sujet, mais il nous reste encore à traiter de deux grands thèmes : les essais en plein champ et la réglementation relative aux expérimentations et aux autorisations de mise sur le marché.
En quoi l’expérimentation en plein champ vous apparaît-elle nécessaire après un travail mené en laboratoire puis en serre ?
M. Roland DOUCE : L’expérimentation en plein champ est une étape absolument incontournable pour juger de l’innocuité ou de l’utilité d’une plante transgénique.
M. Christian DUMAS : L’expérimentation en plein champ est absolument indispensable, parce que l’on n’est pas capable, même au moyen de phytotrons – les cellules qui permettent de mimer en partie le climat – d’étudier le comportement d’une plante.
Ensuite, le « plein champ » ne signifie pas simplement le plein air : il implique la possibilité d’étudier les interactions avec les micro-organismes du sol et avec les autres plantes, qui ne peuvent pas faire l’objet d’expérimentations en serre.
M. Alain RERAT : Il existe actuellement des voies de production de molécules thérapeutiques en plein champ. Elles ne sont pas seulement expérimentées, elles sont aussi développées. C’est là quelque chose de vital. Bientôt, il sera possible de produire des médicaments grâce aux plantes et aux animaux. Cela nécessitera absolument le développement en plein champ qui permettra de produire en masse et à moindre coût.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : La position de l’Académie d’agriculture est la suivante. Ces objets vivants que nous cultivons sont souvent imparfaits et parfois peu reproductibles. L’expérimentation en plein champ offre à l’agriculteur la possibilité de mettre à l’épreuve les pratiques culturales, ce qu’il n’est pas possible de faire dans un autre contexte.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Le directeur général de l’Institut Pasteur, M. Philippe Kourilsky, nous a expliqué hier que, s’il était indispensable, dans certains cas, de procéder à des expérimentations en plein champ, il était nécessaire de le faire en milieu confiné pour les plantes médicamenteuses. Qu’en pensez-vous ?
M. Alain RERAT : En ce qui concerne les produits thérapeutiques, le milieu confiné, ce sont les bio-réacteurs, c’est-à-dire les cellules. Le milieu ouvert, ce sont les plantes et les animaux. D’après ce que les spécialistes ont expliqué à l’Académie de médecine, il sera nécessaire de procéder à des expérimentations en milieu ouvert, dans des conditions très contrôlées.
M. le Rapporteur : Oui, c’est d’ailleurs ce qu’a dit M. Kourilsky.
M. Roland DOUCE : Il ne faut pas confondre les plantes à usage alimentaire avec celles qui produisent des molécules nouvelles à des fins pharmaceutiques ou médicales. Ces deux groupes d’OGM sont bien distincts.
M. Pierre FEILLET : Le génie génétique est un ensemble de techniques qui permettent d’établir un catalogue mondial des gènes et de créer un OGM à travers un processus de sélection. Je dis bien : à travers un processus de sélection. On injecte un gène dans une plante réceptrice, après quoi on procède à des améliorations et des croisements, tout comme on le fait dans la sélection classique : on vérifie que la nouvelle variété a une valeur supérieure, qu’elle est stable, qu’elle résiste à des maladies, qu’elle a telle ou telle attitude selon le climat. C’est exactement ce que l’on fait avant d’inscrire une nouvelle variété destinée à la culture traditionnelle. Et cela ne peut pas se faire dans une serre. Avec les OGM, c’est le point de départ qui est nouveau, mais le long processus de sélection est le même. Il serait tout de même pour le moins paradoxal qu’en écartant l’expérimentation en plein champ, l’on se montre moins exigeant pour cette technique nouvelle que pour les techniques traditionnelles.
M. Christian DUMAS : Nous avons abordé ce problème lors des assises régionales de la recherche qui se sont tenues récemment en Rhône-Alpes. Les responsables politiques affirmaient leur volonté de soutenir la recherche. Je les ai remerciés pour ce message tout à fait sympathique, mais le refus des essais en champ et l’amalgame entre les OGM et la recherche privent les scientifiques de tout soutien dans cette région.
Pour revenir à votre question, il existe une entreprise qui a innové en développant la fabrication par transgénèse de molécules à valeur thérapeutique. Ces essais ont été vandalisés, ce qui est tout à fait anormal. Cette innovation était par ailleurs source de création d’emplois. Il y a un moyen d’éviter les risques : la castration du maïs.
Mme Odile SAUGUES : Je crois savoir que l’on a détruit, au moins partiellement, certains essais visant à produire des molécules destinées à soulager certaines maladies emblématiques, en particulier la mucoviscidose. On a alors joué sur cette corde sensible en laissant penser que les auteurs de cette destruction étaient des criminels en puissance. Or M. Rerat vient de nous dire que la recherche thérapeutique se faisait en milieu fermé. Je ne comprends plus très bien.
M. Alain RERAT : J’ai dû mal m’exprimer. Il y a deux manières de conduire les recherches thérapeutiques, puis de produire des plantes médicamenteuses : en milieu confiné – les bioréacteurs – et en milieu ouvert, sur plantes ou sur animaux. Lorsque des essais se font en milieu ouvert, on ne peut pas accepter qu’ils soient détruits.
M. le Président : Lorsqu’un gène humain ou animal peut aboutir à des applications thérapeutiques, prend-on ou non le risque d’une dissémination dans la nature de gènes qui n’ont rien à voir avec le règne végétal ? Nous n’aborderons pas cette question aujourd’hui, mais elle sera posée lors de notre table ronde contradictoire sur les enjeux environnementaux.
Il reste que l’expérimentation en plein champ conduite dans le Puy-de-Dôme par l’entreprise Meristem Therapeutics a été vandalisée, et que la question du vandalisme doit être posée. Nous la poserons d’ailleurs aux auteurs de ces actes. En Guyane, l’INRA et le CIRAD ont conduit une expérimentation sur le caféier qui devait se dérouler sur cinq ans. Elle avait obtenu toutes les autorisations nécessaires et ne posait aucun problème puisqu’il n’y avait pas de caféier dans cette zone. Elle a également été vandalisée, alors que l’essai était déjà très avancé. Cela pose le problème de l’impact d’un certain nombre de groupes sur la recherche.
M. Philippe MARTIN : Le département dont je préside le conseil général a été le théâtre, en septembre dernier, d’une tentative d’arrachage, qui n’a pas été jusqu’à son terme. Etant opposé à ces actes de vandalisme, j’ai envisagé la tenue d’un référendum départemental sur cette question. Une enquête sur 500 personnes, récemment publiée par un quotidien régional, fait apparaître que 77 % des Gersois souhaitent être consultés, et que 72 % sont opposés aux essais en plein champ dans leur département.
Dans le face-à-face entre les scientifiques et les politiques, quelle est selon vous la place du citoyen ? Et compte tenu de la technicité du sujet, vous paraît-il nécessaire que les citoyens soient, à un moment où à un autre, éclairés et consultés sur l’avenir de leur territoire ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Pourquoi, s’agissant des molécules médicamenteuses, doit-on obligatoirement passer par une plante ? N’est-il pas possible de faire en sorte que, dans ce domaine-là, la recherche passe par les bactéries ? Vous allez sans doute me répondre que c’est impossible. Mais ce qui est impossible aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain. Il serait souhaitable qu’on arrive à faire en sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir recours aux essais en plein champ.
M. Alain RERAT : Vous avez raison sur le principe. Mais, premièrement, les essais en bio-réacteurs sont très coûteux.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : C’est donc une question de prix !
M. Alain RERAT : Pas seulement. Parce que, deuxièmement, ces méthodes ne permettent pas de produire des grandes masses. C’est pour cela qu’ont été lancées des recherches sur des plantes ou sur des animaux.
Pour répondre à la question du Président sur la dissémination, le risque est réduit par le fait que l’on préfère s’en tenir à la feuille plutôt que d’aller jusqu’à la graine, pour éviter le risque de reproduction. Cela dit, la technique n’est pas complètement au point.
M. Christian DUMAS : S’agissant de la question de M. Martin, je pense effectivement que le citoyen a parfaitement sa place dans le débat sur les OGM. Je veux cependant préciser qu’il doit y prendre part en étant informé. Or, actuellement, il est essentiellement « informé » par la télévision, et n’entend guère que le discours des groupes anti-OGM et alter-mondialistes. Il nage dans la confusion la plus totale. En 1997, on autorise le maïs OGM en France et, une semaine plus tard, le citoyen constate qu’un moratoire a été décidé pour évaluer les risques et qu’il n’est pas levé au bout d’un an, sans qu’on lui ait donné d’explication sur les raisons pour lesquelles il ne l’est pas : la conclusion qu’il en tire tout naturellement est qu’un danger existe. A partir de là, il n’est pas étonnant que la grande majorité de la population soit opposée aux OGM, tout en ignorant de quoi il s’agit. Le débat citoyen est donc absolument indispensable, mais à condition qu’il soit éclairé par un niveau d’information suffisant. Avec le CNRS, j’ai eu l’occasion de faire un sondage à Annecy. A la question « Etes-vous pour ou contre les OGM ? », 70 % ont répondu qu’ils étaient contre. A la question « Pouvez-vous définir ce qu’est un OGM ? », la même proportion était incapable de le faire.
M. Pierre FEILLET : J’ai eu l’occasion de lancer deux débats en région sous la forme de ce que j’ai appelé un « procès de l’alimentation ». On pose une question, par exemple : les aliments biologiques sont-ils meilleurs pour la santé ? On fait voter la salle, après quoi un avocat de l’accusation et un avocat de la défense s’expriment. Après quelques questions supplémentaires, on procède à un nouveau vote. C’est un système très efficace. Il est important de trouver des moyens concrets d’organiser l’éducation du public. Car cela n’a pas beaucoup de sens de consulter une population sur des questions sur lesquelles elle n’a pas de connaissances. Mais il est vrai que les scientifiques ne savent pas communiquer.
M. Roland DOUCE : Je suis moi aussi favorable à une participation du citoyen au débat, dès lors qu’il est bien informé. Lors d’une conférence-débat qui s’est tenue dans une petite ville, un opposant aux OGM se lève : « M. Douce, on en a marre, vous nous faites bouffer des gènes ! » Je lui ai dit qu’en mangeant un gramme d’épinards, il avalait 30 milliards de gènes. Il ne m’a répondu que d’un mot : « Ah ! ».
M. Alain RERAT : A mon avis, il faudrait que soit mis sur pied un centre d’information indépendant, qui puisse rectifier les mauvaises informations lancées dans les médias.
M. le Président : Je voudrais dire à Philippe Martin que je partage ce qui a été dit : oui à un référendum, à condition qu’il soit précédé d’une très bonne information. La conférence de citoyens qui a eu lieu en 1998 a été exemplaire à cet égard. Elle a montré que les positions prises par des gens bien informés sont très éloignées des positions extrêmes que l’on peut prendre dans un sens ou dans l’autre.
M. François GUILLAUME remplace M. Jean-Yves LE DÉAUT à la présidence.
M. le Rapporteur : Mme Perrin-Gaillard a dit que ce qui n’était pas possible aujourd’hui pouvait l’être demain. Dans cet ordre d’idées, il me semble que nous avons trop tendance à fixer notre attention sur les OGM de première génération, en oubliant ceux de deuxième ou troisième génération.
Je voudrais aussi revenir à la question que j’ai posée tout à l’heure. Dans quelle mesure, d’après vous, le recours aux OGM peut-il modifier les relations entre les producteurs et les semenciers ? Ceux-là ne risquent-ils pas un jour d’être les prisonniers de ceux-ci ?
M. Christian DUMAS : La dépendance que vous évoquez existe depuis le début du XXe siècle. Mais il est clair que si l’on couple le certificat d’obtention variétale et le brevet, la dépendance deviendra insupportable.
M. le Rapporteur : Il est question de regrouper la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance. Qu’en pensez-vous ? D’autre part, le futur Conseil des biotechnologies devrait être placé sous la tutelle des ministères de l’agriculture, de la recherche et de l’environnement. Pensez-vous qu’il faudrait y ajouter celle du ministère de la santé ?
M. Roland DOUCE : Il me semble impératif de regrouper la Commission du génie génétique, la Commission du génie biomoléculaire et le Comité de biovigilance, ainsi que l’AFSSA. Cela permettrait de coordonner les efforts de diverses instances qui ont des sensibilités complémentaires. Par contre, la tutelle conjointe de plusieurs ministères serait absolument ingérable. Cette instance unique doit être sous l’autorité du Premier ministre.
M. Pierre FEILLET : Les compétences de l’AFSSA dépassent très largement les OGM. Que des membres de l’AFSSA siègent au sein de ce Conseil serait une bonne chose, mais je ne pense pas qu’une fusion de ces deux instances serait souhaitable.
M. Roland DOUCE : C’est bien ce que je voulais dire.
M. Alain RERAT : Je pense que les trois commissions actuelles ont des compétences très différentes. Il me semble qu’il ne faudrait pas les regrouper, mais plutôt les coordonner au moyen d’un conseil dont le champ de compétences propre serait les OGM.
M. Jean-Claude MOUNOLOU : La position de l’Académie d’agriculture rejoint celle de M. Rerat.
D’autre part, elle ne voit pas la nécessité, sauf si une intention politique déterminée s’exprime explicitement, de subordonner une commission de type scientifique à une commission composée majoritairement de représentants de la société civile et chargée d’évaluer et de comparer ces risques par rapport aux avantages attendus des OGM. On constate en effet un déplacement de valeurs – la connaissance, l’innovation, le développement, le symbole – qui rend difficilement concevable de soumettre une commission scientifique à une tutelle qui sera toujours a posteriori, parce que l’on prendrait alors le risque de ne jamais avoir de réponse aux questions posées.
M. Germinal PEIRO : Quel est votre point de vue sur la stérilisation des semences ?
M. Christian DUMAS : Cette question a pris un tour très polémique après que le groupe Monsanto a mis au point des semences qu’il a maladroitement appelées « Terminator ». L’avantage, c’est l’absence de dissémination. L’inconvénient, c’est le fait de monopoliser une variété améliorée, qui a pour effet l’assujettissement total des producteurs à l’industrie semencière.
M. François GUILLAUME, Président : La question peut être largement débattue, car on peut aussi considérer que le créateur d’une semence doit pouvoir protéger sa recherche, en tirer profit pour faire d’autres recherches.
Il se trouve que l’année où cette polémique a eu lieu sur ce produit a été extrêmement pluvieuse dans le nord de la France, avec des récoltes très belles mais complètement couchées. S’il s’était agi de semences « Terminator », cela aurait eu l’avantage de protéger le blé, qui n’aurait pas germé.
M. le Rapporteur : M. Rerat, vous avez parlé d’un centre d’information indépendant. De qui dépendrait-il, selon vous ?
M. Alain RERAT : J’avoue que notre réflexion n’a pas été aussi loin. L’important est de s’assurer qu’une information correcte soit faite, suivie d’une communication convenable. Car la communication est essentielle. Nous le voyons à l’Académie de médecine, qui pendant des années n’a jamais été entendue, et qui se fait entendre depuis qu’elle a un chargé de presse car la communication est un métier.
M. Christian DUMAS : Dans les universités, il existe depuis maintenant plus de dix ans des centres de communication de la recherche scientifique et technologique qui fonctionnent sur la base de cahiers des charges. Ce réseau peut être utilisé.
M. François GUILLAUME, Président : Le problème de la communication est manifeste. Nous pouvons constater qu’une seule journaliste assiste ce matin à une table ronde qui réunit pourtant des personnes particulièrement compétentes.
Il est vrai que les chercheurs ne communiquent pas bien. D’une certaine façon, c’est tout à leur honneur. Ils sont prudents, car ils savent que les résultats de leurs recherches n’ont pas la certitude que certains souhaiteraient. C’est pourquoi ils apparaissent parfois hésitants, ce qui renforce encore la crainte de ceux qui les écoutent. Mais il serait bon qu’un centre fasse le lien entre les chercheurs et les journalistes. Il pourrait rectifier un certain nombre d’erreurs grossières en recourant à un droit de réponse.
M. Pierre FEILLET : Je réfléchis, avec le conseil général de la Drôme, sur la création éventuelle d’une Cité de l’alimentation, qui inclurait une instance chargée de la communication non pas vers les citoyens, mais vers les relais d’opinion : les médecins, les diététiciens, les enseignants et les médias.
M. le Rapporteur : Sans oublier les élus !
M. Pierre FEILLET : Absolument. D’autre part, il me semble qu’il ne serait pas bienvenu de se spécialiser dans la communication relative aux biotechnologies et aux OGM. C’est l’alimentation en général qui devrait faire l’objet de cet effort de communication. Il faudrait un lieu d’information validée – c’est important – sur l’alimentation et cette information devrait être ciblée sur les relais d’opinion.
J’ajoute que le Conseil national de l’alimentation est bien placé pour faire ce travail. Attention à la multiplication des commissions ! C’est d’ailleurs pourquoi, pour revenir à une question précédente, je suis très réticent à l’idée de créer une commission chargée de superviser les trois commissions existantes.
Enfin, il me semble important de distinguer clairement les instances qui sont chargées de traiter les problèmes scientifiques et celles qui traitent des problèmes de société.
M. Alain RERAT : Je ne pense pas qu’il serait opportun de créer un lieu de communication sur l’alimentation en général. Un centre d’information et de communication spécifiquement dédié aux OGM serait le bienvenu, animé par des professionnels. D’autres centres devraient d’ailleurs se consacrer à la communication sur les autres problèmes relatifs à l’alimentation.
M. François GUILLAUME, Président : Messieurs, nous vous remercions infiniment. Cette matinée a été très enrichissante, grâce à vous. Nous aurons sans doute l’occasion de vous revoir à l’occasion des autres tables rondes dont le Président Jean-Yves Le Déaut a parlé tout à l’heure.
Audition conjointe de
MM. Georges PELLETIER et Georges FREYSSINET,
président et vice-président du directoire de Génoplante
(extrait du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Messieurs, nous vous remercions d’être venus à cette audition privée dont le but est de nous aider à nous forger une opinion, d’autant que le champ d’investigation de notre mission d’information a été élargi aux enjeux des essais et à l’utilisation des organismes génétiquement modifiés.
M. Georges PELLETIER : Génoplante, dont la présidente est Mme Marion Guillou, présidente-directrice générale de l’INRA, est un grand programme fédérateur de génomique végétale créé en 1999 pour cinq ans – mais nous ferons en sorte qu’il perdure encore plusieurs années – qui associe en France la recherche publique – INRA21, CIRAD22, IRD23, CNRS24 – et les principales sociétés privées impliquées dans l'amélioration et la protection des cultures – Biogemma, Bayer Cropscience, Bioplante. Son objectif est exclusivement l’acquisition de connaissances et non la fabrication de produits. Les éventuelles applications qui pourraient en être issues, sous forme de nouvelles variétés végétales, resteront l’affaire de chacun des partenaires. Le financement de Génoplante se compose des moyens apportés par les parties prenantes et de subventions des ministères de la recherche et de l’agriculture. En cinq ans, l’activité de Génoplante a représenté grosso modo un effort de 200 millions d’euros, soit 40 millions en moyenne par an, dont 40 % ont été apportés par les instituts de recherche publics, 40 % par les privés et 20 %, sous forme de subventions, par les ministères. En vitesse de croisière, une centaine de projets de recherche auront été conduits, mobilisant l’équivalent de 400 chercheurs, ingénieurs et techniciens.
La conjugaison des moyens publics et privés aura permis d’atteindre une masse critique suffisante, à laquelle aucun des partenaires n’aurait pu prétendre à lui seul, mais également de rassembler, autour d’un projet commun d’accélération des connaissances en biologie végétale, une communauté scientifique par trop dispersée.
Les espèces végétales étudiées sont de deux types : les espèces modèles
– Arabidopsis, une petite crucifère, et le riz pour les graminées – et cinq espèces de grande culture pour notre pays : le maïs, le blé, le colza, le tournesol et le pois, chacune ayant donné lieu à plusieurs sous-programmes visant à acquérir des données et des outils, ainsi qu’à retrouver les gènes impliqués dans la qualité des plantes, leur résistance aux maladies et leurs caractéristiques agronomiques.
L’analyse des gènes des espèces modèles a nécessité la création de plantes transgéniques et la constitution de collections de mutants d’insertion, fabriqués en insérant un fragment d’ADN dans le génome, la mutation ainsi créée devenant repérable grâce à l’ADN introduit. Mais si Arabidopsis peut facilement être multipliée en serre, il n’en est pas de même pour les mutants d’insertion du riz produits dans les laboratoires de Montpellier, dont la multiplication est effectuée dans un centre international en Colombie.
M. le Président : Quel type de marqueur utilisez-vous ?
M. Georges PELLETIER : Dans les deux cas, c’est une résistance à un herbicide ou un antibiotique qui nous permet de sélectionner les cellules et les plantes transformées, mais également, puisque nous connaissons la séquence du gène en question, de repérer la localisation de l’insertion dans le génome au fur et à mesure des hybridations. Nous avons pu constituer des collections rassemblant 60 000 lignées indépendantes dans le cas d’Arabidopsis et, pour l’instant, 25 000 dans celui du riz. Parallèlement, nous avons développé l’isolement systématique du cycle d’insertion, c’est-à-dire de la courte séquence qui correspond à la « bordure » de l’insertion. C’est ainsi qu’ont pu être alimentées, grâce à ces travaux mais aussi aux recherches similaires menées par d’autres laboratoires, des bases de données mondiales qui représentent, pour Arabidopsis, des collections de 500 000 à 600 000 insertions – l’insertion du même gène étant déclinée en plusieurs localisations –, ce qui correspond largement à la saturation du génome. Les chercheurs ont ainsi à leur disposition, via l’Internet, tous les outils souhaitables pour analyser le génome, relativement petit, d’Arabidopsis.
M. le Président : Certains nous ont affirmé que la transgénèse pouvait s’exprimer différemment selon la localisation de l’insertion. L’avez-vous vérifié dans vos mutants où le même gène a été inséré, mais à des endroits différents du chromosome ?
M. Georges PELLETIER : Prenons le cas où nous insérons un fragment d’ADN contenant un gène de résistance à tel herbicide. Nos plantes sont toutes sélectionnées de la même façon, en semant les graines obtenues sur un milieu traité à l’herbicide en question. Seules s’y développeront les plantes résistantes. L’expression du gène de résistance introduit a été, par le fait, uniformisée, puisque seuls auront été récupérés les sujets dans lequel il se sera suffisamment exprimé. Mais certaines insertions ne s’expriment pas, parce que localisées dans des zones d’hétérochromatine : le gène est alors dit « muet ».
M. François GUILLAUME : Peut-être vos techniques d’insertion dans le génome ne permettent-elles pas forcément une localisation aussi précise que le suggère le président…
M. Georges FREYSSINET : L’insertion n’est pas localisée a priori, mais a posteriori : une fois qu’elle y est, elle ne bouge plus.
M. François GUILLAUME : Mais quel que soit l’endroit où elle tombe, l’effet est-il le même ?
M. Georges PELLETIER : Non. Dans la grande majorité des cas, le gène s’exprime. Mais il peut arriver que l’insertion soit incomplète ou arrive dans une partie du génome non exprimée. Auquel cas le gène est muet – et pour nous invisible.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Ne sont finalement sélectionnées que les plantes dans lesquelles s’exprime cette résistance. Mais recherchez-vous d’autres caractéristiques qui auraient pu également être véhiculées par ce gène ? Avez-vous réussi à localiser précisément l’endroit où il doit s’insérer pour s’exprimer ?
M. Georges PELLETIER : Oui : l’insertion est localisée à la base près dans le génome.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais est-ce toujours la même localisation qui donne le même résultat ?
M. Georges PELLETIER : Non. On tire au hasard sur le génome ; cela s’insère où cela veut. C’est après que l’on repère où c’est tombé…
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais sur les plantes devenues résistantes, l’insertion s’est-elle produite au même endroit ?
M. Georges PELLETIER : Non. Mais il y a bien sûr des localisations préférentielles, plutôt au début qu’à la fin des gènes, etc. Tout cela est publié. Nous arrivons finalement à un niveau de précision absolue par rapport à la séquence du génome lui-même.
M. le Rapporteur : Mais cette localisation reste-t-elle inchangée au fur et à mesure des filiations ?
M. Georges FREYSSINET : Une fois inséré, le gène se comporte tout à fait normalement et occupe une place stable de génération en génération, sous réserve, bien sûr, des recombinaisons naturelles susceptibles de se produire dans toute reproduction sexuée.
M. le Rapporteur : N’est-il pas plus « fragile » ?
M. Georges FREYSSINET : Non, et son hérédité est parfaitement prévisible.
M. Georges PELLETIER : Cette insertion ne représente qu’une déformation minime du génome, de l’ordre de quelques parts pour un million.
M. Georges FREYSSINET : Ces collections de mutants ciblés n’ont d’autre but que d’étudier la fonction des génomes. En aucun cas ces mutants ne sont destinés à la commercialisation.
M. Georges PELLETIER : Le but est d’empêcher, par l’insertion de ce morceau d’ADN, un gène résident de s’exprimer. Si, par exemple, on s’aperçoit que la plante ne produit pas de pollen, on en déduira que ce gène intervient dans la formation du pollen et on poussera l’analyse jusqu’à connaître précisément la fonction biochimique et la nature de la protéine correspondante. C’est ainsi que travaillent désormais tous les laboratoires, grâce à ce matériel mis à la disposition des chercheurs sous forme de lignées parfaitement répertoriées.
C’est donc essentiellement dans ce cadre que Génoplante produit des OGM.
Dans d’autres cas, l’approche peut être en quelque sorte inverse : ayant déjà une idée assez précise de la fonction d’un gène, on va expérimenter une modification du gène pour savoir dans quelle mesure on modifie la fonction. Cette démarche vaut surtout pour les espèces cultivées. Ainsi, deux de nos programmes font appel à des maïs transformés, le premier portant sur la digestibilité des maïs d’ensilage, que l’on cherche à améliorer par modification de la composition des parois cellulaires, et le deuxième sur une meilleure utilisation de l’azote du sol en surexprimant l’enzyme glutamine synthétase qui permet de faire entrer l’atome d’azote dans le circuit des acides aminés. Ces deux programmes ont nécessité la création de plants génétiquement modifiés qui ont fait l’objet d’essais au champ – et connu les difficultés que l’on sait.
M. le Président : Où ?
M. Georges PELLETIER : L’essai « azote » était installé à Marsat, dans le Puy-de-Dôme.
M. Georges FREYSSINET : L’objectif, au moment de la création de Génoplante, était de contrebalancer la toute-puissance de l’Amérique du Nord en développant un portefeuille de brevets afin de disposer de gènes en toute propriété, mais également de moyens d’échange pour mieux négocier. Génoplante permettait de garantir tout à la fois la protection de la propriété intellectuelle et la diffusion des résultats scientifiques grâce à une participation élevée des organismes publics de recherche. A cette fin a été créée la structure Génoplante-Valor, dépositaire de la propriété industrielle développée dans l’ensemble de la communauté Génoplante ; parallèlement, un conseil de la propriété industrielle, qui regroupe les partenaires, publics et privés, détermine les domaines appelant un effort de protection.
Il existe trois façons de se protéger. La première consiste à ne rien dire : aussi avons-nous la possibilité de constituer des dossiers techniques secrets. La deuxième consiste à déposer des brevets. Une trentaine aura été déposée à la fin de la phase 1999-2004, qui concerne surtout la partie « valorisation ». La troisième, particulièrement valable pour la partie bioinformatique, consiste à faire usage de droits d’auteurs.
Une fois la protection assurée, la valorisation des résultats est assurée soit directement par les partenaires privés de Génoplante, Bayer CropScience, Biogemma et Bioplante, soit par cession de licences à des tiers, à des conditions variables selon qu’il s’agit d’universitaires ou de structures privées.
M. Georges PELLETIER : Nous vous avons distribué trois documents : la plaquette de présentation de Génoplante, un communiqué de presse rédigé à l’occasion du séminaire qui s’est tenu à Lyon en septembre dernier, et la liste des nouveaux projets prévus pour la période 2004-2005.
M. le Président : En tant que responsables d’un partenariat public/privé, vous avez une vue globale du développement des filières recherche comme des filières agro-industrielles. La controverse autour des OGM, qui sévit en Europe depuis 1998, a-t-elle nui, selon vous, au développement de la biologie végétale en France et, par contrecoup, à notre agriculture ?
D’autre part, certains affirment que les OGM procèdent d’un modèle agricole qu’ils récusent fondamentalement. D’autres estiment que notre modèle d’agriculture intégrera tôt ou tard cette technologie et que nous prenons un retard irrattrapable. Est-ce votre avis ?
M. Georges PELLETIER : Du retard, nous en avons assurément…
M. le Président : Pourquoi ?
M. Georges PELLETIER : Avant les années 90, on effectuait plus d’essais en France qu’aux Etats-Unis. Cette année, on en compte mille chez les Américains contre dix chez nous – essais franco-français, s’entend, les autres sont conduits par Pioneer et Monsanto. Pourquoi ? Parce qu’un frein a délibérément été mis à cette voie de la biotechnologie.
Situé plus en amont, le programme Génoplante n’est pas directement touché. Mais, à terme, comment pourra-t-on exploiter les résultats de la génomique en faisant totalement l’impasse sur les OGM, pour des raisons idéologiques, sinon religieuses ? Quatre cents essais de recherche au sens strict sont menés en champ chaque année aux Etats-Unis, contre quatre en France…
M. François GUILLAUME : Craignez-vous que ce blocage vis-à-vis des OGM n’en vienne à remettre en cause la participation à Génoplante des partenaires privés, qui pourraient rechigner à mettre de l’argent dans une affaire dont ils n’auraient guère à espérer de retombées économiques et commerciales ?
M. Georges FREYSSINET : Vous avez absolument raison. On ne fait pas de la recherche pour la recherche, mais pour répondre à des objectifs de marché. Et si le marché n’existe plus, on ira là où le marché est demandeur. Si, par une décision politique, on décidait que l’agriculture française devait en rester à son niveau de 2004, nous en resterions là et nous irions faire de l’amélioration ailleurs. Mais il faudra bien améliorer la productivité de notre agriculture si nous voulons continuer à vivre comme aujourd’hui. Et si Bayer a décidé de cesser sa participation dans Génoplante pour 2004-2010, ou du moins de la réduire, c’est principalement lié au fait que l’on ne peut pas développer d’OGM en Europe. S’il faut faire des essais en plein champ, on le fait dans son propre marché, pas dans celui d’un autre… Dans le cadre même de Biogemma, les pressions se multiplient pour ne pas pousser plus loin les recherches dans le domaine des OGM. On assiste incontestablement à une baisse de l’activité dans ce domaine par rapport aux autres pays, les Etats-Unis évidemment, mais également la Chine et l’Inde où, sur le coton et le riz, les recherches en génomique se développent considérablement, qu’elles donnent lieu à des applications OGM, lorsque c’est la seule solution possible, ou non. Il arrive fréquemment, dans le domaine des micro-organismes par exemple, qu’après avoir, pour des raisons de commodité, travaillé sur des OGM, on préfère au stade de la valorisation industrielle répéter ce que l’on a trouvé sous une forme non-OGM. C’est un peu moins aisé dans le domaine du végétal.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu’il sera un jour possible de faire produire des médicaments par des plantes dont on aurait stoppé les fonctions de pollinisation ? Le coût de revient de ce genre de production est-il plus intéressant que celui des processus en milieu confiné faisant appel aux levures ou aux bactéries ?
M. Georges FREYSSINET : Les plantes permettent d’ores et déjà de produire des médicaments : le Taxol en est un exemple. Partant de là, on peut songer à faire travailler le gène en question ; l’économie qui en résultera dépendra de la difficulté à faire produire la protéine par des bactéries ou des levures. Le végétal permet de s’exonérer de coûts industriels parfois considérables : non seulement l’investissement industriel est beaucoup plus léger, mais les coûts de fonctionnement eux-mêmes sont limités. L’opération est donc économiquement rentable.
M. le Rapporteur : Mais l’expérimentation en plein champ est-elle nécessaire ?
M. Georges FREYSSINET : Elle est à l’évidence indispensable pour 99,9 % des produits que vous voulez sortir du végétal… Si vous travaillez sur des tomates appelées à être cultivées en serre, l’expérimentation en serre suffira. En revanche, vous observerez que le maïs en serre et le maïs en champ n’ont pas la même allure… Le maïs étant appelé à être cultivé en plein champ, il faut impérativement des essais en champ pour tester les rendements comme la résistance à la sécheresse ou aux insectes. S’est-on déjà contenté d’essais en soufflerie avant de faire voler un avion rempli de passagers ? Nous avons besoin d’essais en champ – naturellement avec toutes les précautions qui s’imposent – ne serait-ce que pour nous assurer de la validité commerciale du produit.
M. le Rapporteur : Qui, au sein de Génoplante, décide des essais ?
M. Georges PELLETIER : Les acteurs du programme de recherche eux-mêmes, qu’ils soient publics ou privés. C’est en général la petite équipe de chercheurs qui décide de l’opportunité de l’essai. Se pose alors le problème de sa réalisation : j’appartiens à un institut public qui a quelque difficulté à les réaliser dans ses propres domaines. Aussi préférons-nous le plus souvent les faire chez nos partenaires privés.
M. le Président : Décryptez votre réponse…
M. Georges PELLETIER : Il est des centres de recherche INRA dans lesquels il vaut mieux ne pas faire d’essais OGM… Lusignan, par exemple.
M. le Président : Et pourquoi ?
M. Georges PELLETIER : Parce qu’ils seraient aussitôt détruits !
M. le Président : Ce n’est pas parce que des chercheurs y seraient opposés ?
M. Georges PELLETIER : Il y en a. Et aussi des chefs de domaine qui ne veulent pas avoir d’ennuis.
M. le Président : La région Poitou-Charentes est donc une zone sans OGM…
M. Georges PELLETIER : C’est pourquoi les essais de Génoplante sont surtout conduits dans les domaines de nos partenaires privés.
M. le Rapporteur : Vous avez des partenaires allemands. Envisagez-vous d’autres partenariats étrangers, voire avec les Américains ?
M. Georges PELLETIER : Pour le moment, nous restons très européens. Nous avons commencé avec les Allemands : c’était très facile, ils étaient en phase avec nous, ils avaient développé un programme de génomique végétale, le programme GABI, en même temps que nous. Plus récemment, nous avons développé des programmes tripartites avec l’Allemagne et l’Espagne : vous les retrouverez sous l’appellation TRIL. Après nous être mis d’accord sur un montant global d’investissements, nous procédons à des appels d’offres internationaux et nous soumettons les projets à un panel d’experts pour les sélectionner. Sur quarante, huit en moyenne sont retenus, pour une durée de deux ou trois ans.
Au niveau européen, dans le cadre de l’action ERA-NET, un réseau européen, ERA-PG, European research area plant genomics25, dirigé par des collègues néerlandais, s’est mis en place dans le but de fédérer les projets nationaux, dans le même esprit que nos TRIL, avec des équipes travaillant ensemble sur des projets préalablement sélectionnés par un panel de chercheurs. La Commission voit donc d’un très bon œil ces initiatives. Il est à noter qu’avec certains pays il est très difficile de monter des projets de génomique végétale ; d’autres, en revanche, ont une très ancienne tradition d’amélioration variétale et il est beaucoup plus facile de mettre en place des projets multilatéraux avec eux.
M. le Rapporteur : Comment se répartiront, entre public et privé, les licences que vous avez déposées ?
M. Georges PELLETIER : Tout dépend des investissements des uns et des autres dans le projet qui a donné lieu à la prise de propriété industrielle… C’est réparti au prorata. Selon que les investissements auront été financés à 50/50 ou à 90/10, le produit sera partagé à 50/50 ou à 90/10.
M. André CHASSAIGNE : Vous dites qu’il n’y aurait que quatre essais en champ en France ; un document que j’ai lu faisait état de 42 parcelles…
M. Georges PELLETIER : J’ai parlé de quatre essais franco-français ; trente-six sont menés par Pioneer et Monsanto.
M. le Président : En fait, il s’agit seulement de cinq ou six essais, reproduits sur des parcelles situées en différents endroits.
M. Georges FREYSSINET : Ajoutons que bon nombre d’essais aux Etats-Unis ont été « dérégulés » et viennent en plus des 400 dont nous parlions, qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation. Les tests de résistance du maïs aux herbicides, par exemple, ne sont plus soumis à autorisation.
M. André CHASSAIGNE : Un « fauchage » a été organisé à Marsat. De quel type d’essais s’agissait-il ? L’essai plein champ était-il indispensable ? Quelles en seront les conséquences pour la recherche ? Cette affaire a beaucoup fait couler d’encre et de salive dans ma région.
M. Georges PELLETIER : Cet essai, autorisé par la CGB en 2003, devait initialement être implanté à Blagnac. Le maire de Blagnac l’ayant fortement déconseillé, nous y avons renoncé et l’avons mis en place en 2004 à Marsat.
Cet essai consistait à planter, à côté de maïs témoins, un maïs dans lequel avait été surexprimé le gène de la glutamine synthétase afin de mieux utiliser l’azote minéral – autrement dit d’économiser l’engrais azoté. Les résultats des essais en serre n’ayant pas été très clairs, nous avons procédé à un essai au champ. Les maïs témoins et transgéniques avaient été castrés, donc incapables de polliniser, et entourés d’une bordure de maïs normaux pour la fécondation. C’est ainsi que la CGB nous avait demandé, par souci de précaution, de procéder, encore que l’on peut se demander quel risque aurait fait courir un gène de glutamine synthétase de maïs… dans le maïs ! Et toutes ces précautions n’ont pas empêché qu’il soit détruit.
Pourquoi un essai en champ ? Tout simplement parce que le système racinaire du maïs a du mal à se mettre normalement en place dans une structure de serre. L’équipe de chercheurs a de nouveau présenté une demande d’autorisation à la CGB en espérant que, pour cette troisième fois, il pourra être réalisé quelque part…
M. Georges FREYSSINET : L’essai n’avait pas pu être fait en 2003. En 2004, il a été détruit. Nous avons déjà perdu deux ans. Tout porte à croire que nos concurrents, qui travaillent également sur l’assimilation de l’azote, n’ont pas perdu leur temps, eux. Pourrons-nous rattraper ce retard ? Sans compter les effets sur la motivation des chercheurs… Seront-ils disposés à recommencer sur le même sujet ?
M. André CHASSAIGNE : Y avait-il un risque de dissémination de pollen au-delà de la bordure de maïs normaux ?
M. Georges PELLETIER : Aucun, puisque tous les maïs témoins et transgéniques étaient castrés : on avait coupé la fleur mâle. Les maïs de bordure jouaient le rôle de mâle. Tout était parfaitement maîtrisé.
M. le Président : Le promoteur venait-il d’une espèce différente ?
M. Georges PELLETIER : Oui. Nous avions utilisé une partie de séquence d’un virus. Nous n’avions pas pris le classique virus 35 S, peu efficace sur les monocotylédones, mais son équivalent, un virus de la papaye. Comme avec le 35 S, cette séquence virale est capable de permettre l’expression d’un gène dans presque toutes les cellules d’une céréale.
M. le Président : J’ai cru lire que certains redoutaient que l’introduction d’un promoteur viral dans une plante n’en vienne à réveiller certaines séquences virales éventuellement intégrées dans la plante…
M. Georges PELLETIER : Aucun test expérimental ne permet de confirmer la thèse de rétrotransposons, effectivement présents dans les plantes et réveillés par des facteurs extérieurs.
M. le Président : Mais en imaginant que ce promoteur passe juste avant le transposon ?
M. Georges PELLETIER : C’est un peu ce qui se passe dans les maïs dits « Mutator », couramment utilisés par les sélectionneurs. Ce sont des variétés de maïs qui mutent à tout bout de champ… Nous aurions créé l’équivalent du « Mutator », utilisé dans toutes les stations d’amélioration du maïs du monde…
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Votre réponse me donne à penser qu’aucune recherche n’est menée sur cette problématique. Est-elle envisagée ou pas ? A-t-on mis en place des protocoles de recherche – fondamentale en l’occurrence – pour approfondir cette question ? Les essais en serre, avez-vous dit, n’étaient « pas très clairs ». Qu’est-ce que cela signifie ?
M. Georges PELLETIER : Que les mesures d’azote et de rendement n’étaient pas probantes.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : On peut admettre que le maïs, a fortiori castré, est la plante idéale pour éviter toute diffusion de gènes. Mais pour d’autres espèces, la diffusion de gènes fait-elle l’objet, en serre comme en champ, de protocoles précis ?
M. Georges FREYSSINET : Pour ce qui est des séquences virales, aucun mécanisme de rétrovirus n’est capable de « ressortir » d’une plante en refabriquant des virus à partir de l’ADN végétal, comme cela peut se produire chez l’animal. Au demeurant, une plante est, dans 80 % des cas, naturellement infectée par un virus : si vous mangez du chou-fleur, vous avez de bonnes chances de manger le virus de la mosaïque du chou-fleur ; de même pour le tabac. Ces virus naturellement présents dans la plante ne vont pas se promener ni s’insérer dans vos gènes. Ils resteront là et se contenteront de se reproduire en tant que virus.
Certaines technologies consistent à n’insérer qu’un promoteur pour « allumer » un gène. Dans le cas de l’essai de Marsat, c’est un gène qui contenait tout à la fois le promoteur et la séquence de glutamine synthétase que nous avons insérée. Nous procédons au préalable à un minimum d’études au niveau moléculaire pour vérifier combien il y a d’insertions, où est le point d’insertion, etc., et à des expérimentations pour s’assurer que les gènes s’expriment bien et que la plante se comporte bien comme un maïs normal. Mais on peut imaginer, à partir d’un promoteur viral, créer, en y mettant les moyens, une collection de 600 000 ou 700 000 mutants. On trouvera bien un cas où le promoteur se sera inséré devant un gène qui donnera à ce maïs mutant un caractère tout à fait particulier.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Cela peut donc arriver…
M. Georges FREYSSINET : Oui. D’où la nécessité d’études préalables pour s’assurer que les plantes ont un comportement normal avant de passer à l’étape suivante.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Et sur les résultats « pas très clairs » de vos essais en serre ?
M. Georges FREYSSINET : C’est l’exemple type des limites de l’efficacité des essais en serre. La majorité des serres dans lesquelles sont autorisés les essais d’OGM ne sont pas des serres en pleine terre ; il faut y cultiver en pots. Le système racinaire du maïs ne s’y développe pas comme en plein champ. On peut récolter de premières indications, mais en aucun cas des résultats significatifs qui préjugent de ce qui se passera au champ. Même dans le cas de la résistance aux herbicides, il nous est arrivé, chez Rhône-Poulenc, de voir des plantes résister parfaitement en serre et se comporter de manière décevante en champ.
M. François GUILLAUME : D’autant que les conditions en champ ne sont jamais les mêmes et évoluent d’une saison à l’autre, voire d’une année à l’autre.
M. Georges FREYSSINET : Tout à fait, et c’est impossible à reproduire en serre.
M. François GUILLAUME : C’est bien pourquoi il faut multiplier les essais pour tester dans des conditions différentes avant de porter un jugement définitif.
Soit dit en passant, nous avons un problème de terminologie et donc de communication : parler d’introduire des virus dans les plantes provoque immanquablement une réaction immédiate de rejet.
M. le Président : Quelle justification les « faucheurs » avancent-ils pour la destruction de l’essai de Marsat, où toutes les précautions possibles semblaient pourtant avoir été prises ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Il n’y avait effectivement aucun risque de dissémination.
M. Georges PELLETIER : Ils s’en fichent : ils arrachent parce qu’ils sont contre les OGM, point à la ligne !
M. Georges FREYSSINET : Je n’ai vraiment pas l’impression qu’ils fassent de l’arrachage discriminatif : précaution ou pas, on arrache quand même. Il est même fréquent qu’ils se trompent et qu’ils détruisent des essais conventionnels… Je ne crois pas qu’il y ait derrière tout cela une analyse rationnelle : on détruit un essai OGM, c’est tout.
M. le Rapporteur : Connaissez-vous les gens qui ont fauché cet essai ?
M. André CHASSAIGNE : Oui, puisqu’ils sont passés devant le tribunal la semaine dernière. Mais le procès a été reporté.
M. le Président : Le procureur avait requis contre quelques uns des faucheurs seulement, mais les participants ont tous demandé à être mis en cause.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Dans certains pays, on voit des palmiers et même des champs de tournesol sous serre… Pourquoi ne peut-on pas en faire autant chez nous ?
M. Georges PELLETIER : J’ai moi-même un palmier dans mon appartement…
M. Georges FREYSSINET : Les Allemands ont construit près de Berlin une immense serre, type Center Parc, dans laquelle ils ont installé des palmiers. Demandez-leur combien de fois ils sont obligés de les changer et de les faire tourner !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : La durée de vie du maïs est bien plus courte…
M. Georges FREYSSINET : Lorsqu’on développe un OGM, on commence par des essais en laboratoire, pour étudier tant la partie moléculaire que les caractéristiques biochimiques, puis on passe en serre, c’est-à-dire en pots, où on observe la plante et où l’on récolte de premières informations. C’est seulement après qu’on passe au champ pour voir comment la plante se comporte. Soit elle présente un intérêt, et on peut alors passer à l’étape suivante, celle de la commercialisation, soit elle n’en présente aucun et on arrête. Mais comment se passer de cette phase intermédiaire ? On est bien obligé de tester une voiture sur circuit avant de la confier au conducteur lambda…
M. le Président : Le rapport que nous avions produit avec MM. Babusiaux, Sicard et Testart, reconnaissait, dans le respect des principes de parcimonie, de précaution et de transparence, la nécessité des essais en champ. Je ne comprends pas pourquoi certains soutiennent désormais, par idéologie, qu’il n’en faut pas. L’essai en champ est la suite obligatoire de l’expérimentation en serre, en respectant évidemment le principe de parcimonie. Dans le cas de Marsat, le problème de la dissémination était parfaitement traité. Or le recours aux serres n’a qu’une justification : éviter la dissémination. Et des essais en serres sur sols normaux n’interdisent pas les possibles disséminations par les réseaux hydrologiques. Il faut donc planter en pots.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Pourquoi en pots ?
M. Georges FREYSSINET : Parce qu’avec une plante en pleine terre, même sous serre, vous n’êtes plus en condition confinée. Ou alors, il faudrait prévoir deux mètres de terre, à récupérer par la suite – pour en faire quoi ? Sans oublier qu’un maïs en serre ne se développe pas de la même manière qu’à l’air libre.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : D’autres plantes le peuvent.
M. Georges FREYSSINET : C’est ce que je vous ai dit tout à l’heure : pour la tomate commerciale de serre, il n’y a pas besoin d’essais en champ, parce que ses conditions normales de production, c’est la serre.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Pouvez-vous me certifier que les essais en plein champ n’ont jamais posé de problème aux plantations voisines ? Certains essais, avec l’accord des autorités compétentes, permettaient une pollinisation. Estimez-vous qu’il n’y a jamais eu quelque danger que ce soit ?
M. Georges PELLETIER : Je ne saurais vous répondre, faute de les avoir tous visités. Mais je fais confiance à la Commission du génie biomoléculaire et à ses prescriptions, et au promoteur de l’essai qui est censé suivre les directives de la CGB.
M. Georges FREYSSINET : Y a-t-il eu à ce jour un seul accident du fait des OGM ?
M. Georges PELLETIER : A supposer qu’un grain de pollen s’échappe, où serait le danger ? Quelle quantité de graines en résulterait-il dans un champ voisin ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais pour un producteur bio ?
M. Georges PELLETIER : C’est tout le problème de la coexistence. Les possibilités de croisements restent dans la norme des taux légaux de contamination. Toutes les expériences montrent que quelques rangs de maïs permettent d’éviter que le maïs A ne vienne polliniser le maïs B à un taux supérieur à 0,9 %. Dans le cas du bio, le problème est très simple : si on pose le principe du 0 %, il est impossible d’avoir une seule plante transgénique sur la terre. Tout simplement parce qu’une abeille aura toujours la possibilité théorique de prendre un avion ou un TGV. Et c’est absurde.
M. Germinal PEIRO : La société s’interroge et le commun des mortels – dont je fais partie – reste dubitatif. Dans une récente émission de télévision sur l’Inde, plusieurs minutes ont été consacrées au coton génétiquement modifié et aux difficultés des paysans, obligés malgré tout de traiter de plus en plus, et acculés à la ruine, voire au suicide. Par rapport à vos trois objectifs initiaux – améliorer la connaissance et l’analyse des génomes végétaux, apporter des réponses positives sur le plan de la qualité de l’alimentation et préserver l’environnement –, estimez-vous, au bout de cinq ans, avoir obtenu des résultats probants et réellement prometteurs ? Etes-vous en mesure d’annoncer à la société que, dans tel ou tel cas, les OGM fonctionnent bien et apportent une réelle amélioration ?
M. Georges FREYSSINET : A votre première question, la réponse est clairement oui. La création de Génoplante remonte à 1999 ; sachant qu’il faut dix ans pour produire une nouvelle variété, OGM ou non-OGM, les connaissances techniques obtenues en cinq ans nous permettent d’ores et déjà de faire de l’amélioration mieux ciblée.
S’agissant maintenant des avantages et bénéfices apportés par certains OGM, Georges Pelletier va vous donner des chiffres qui montrent ce qu’il en est réellement dans les pays où ils sont cultivés.
M. Georges PELLETIER : Je me fonde sur le rapport publié par la FAO26 et intitulé : « La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture en 2003-2004 ». Le coton est, dans le monde, la plante qui consomme le plus d’insecticides : 25 % du tonnage mondial. Les études sur le coton Bt menées en Chine et aux Etats-Unis font état d’une réduction de 50 % des épandages d’insecticide – sachant qu’il faut continuer à traiter pour les insectes insensibles à la toxine Bt. Les cas d’intoxication des paysans sont passés de 20 % à 6 %. Non seulement les traitements chimiques sont relativement agressifs, mais ils développent chez les insectes des phénomènes classiques de résistance.
M. le Rapporteur : Ces études sont-elles réellement indépendantes ?
M. Georges PELLETIER : Le rapport fait état de différentes études réalisées par des personnalités dont le nom est cité.
M. le Président : L’AFSSA a elle-même reconnu que les avantages, s’ils restent flous pour d’autres plantes, sont parfaitement avérés pour le coton. Cette émission sur l’Inde…
M. Georges PELLETIER : L’Inde avait déjà connu, il y a trente ans, de sérieuses difficultés pour améliorer ses productions végétales et céréalières.
M. le Rapporteur : Comprenez que vos sources soient pour nous très importantes. Le représentant de Greenpeace nous a également sorti ses statistiques… Qui dit vrai ? Nous avons besoin d’études totalement objectives.
M. le Président : Nous les confronterons de façon contradictoire lors des tables rondes : vous viendrez avec des chiffres, et Greenpeace avec les siens.
M. Georges PELLETIER : Le rapport de la FAO est disponible sur Internet. Une trentaine de pages traitent des plantes transgéniques et de la biotechnologie, assorties de toutes les références bibliographiques.
Ce rapport fait également état de données chiffrées montrant, toujours pour le coton, comment se répartissent les bénéfices obtenus grâce aux OGM aux Etats-Unis. Les sociétés semencières récupèrent environ 35 % des gains, le consommateur 19 % en termes de baisse des prix et l’agriculteur 46 %. C’est lui le premier bénéficiaire. Sur le soja Roundup Ready, qui autorise à se passer de labours et qui permettra probablement à l’Amérique du Sud de devenir le premier producteur du monde, le principal bénéficiaire est le consommateur qui profite de la baisse des cours ; l’industrie semencière récupère toujours 35 % et l’agriculteur, qui est pourtant le vecteur essentiel du développement du soja génétiquement modifié, seulement 13 %.
En 1840, une épidémie de mildiou avait détruit les récoltes de pomme de terre en Irlande. Pour l’instant, on a toujours traité le mildiou de la pomme de terre par la chimie. Il existe pourtant des gènes de résistance au mildiou dans des espèces proches, comme le Solanum bulbocastanum, que l’on pourrait introduire, grâce à la technique OGM, dans la pomme de terre, plutôt que de faire appel à la chimie. Or cette solution n’est pas utilisée, même pas aux Etats-Unis. Demandez-vous pourquoi…
M. le Président : Parce que les industriels de la chimie y sont hostiles ?
M. Georges PELLETIER : Non. Je crois tout simplement que l’on craint les réactions négatives du consommateur.
M. Georges FREYSSINET : Essayez de commercialiser une tomate résistante aux virus…
M. François GUILLAUME : Nous avons un énorme problème de communication. Chacun discute de tout dans ce pays sans rien connaître, ne serait-ce que des choses élémentaires. On nous parle des dangers des OGM. Lesquels ? Personne n’a jamais pu les établir. On dit seulement : il y a des dangers, alors arrêtons…
Danger pour la biodiversité ? Mais la biodiversité a déjà été sérieusement entamée par la sélection expérimentale à laquelle on procède depuis des décennies. Ainsi, dans les vergers – et Dieu sait si cela pollinise ! –, on a tellement sélectionné la Golden que l’on s’est finalement résolu à mettre en place des vergers conservatoires pour préserver nos ressources génétiques.
Les OGM n’empêchent pas de poursuivre les traitements, nous dit-on. C’est oublier que, pour faire venir une plante, il faut des anticryptogamiques, des herbicides, des insecticides, et qu’un OGM résistant à tel agent pathogène n’en continue pas moins à exiger des traitements pour les autres infestations. Toutes ces évidences devraient être rappelées, faute de quoi la peur s’installe, et d’abord par ignorance. Et certains refusent de s’informer, ou bien rejettent l’information obtenue pour des raisons moins avouables que celles que l’on peut communément avancer.
L’Union européenne a-t-elle lancé des programmes sur OGM qu’elle finance ? Les nouvelles interdictions décidées par certains pays, l’Allemagne notamment, n’inciteront-elles pas la Commission à refuser tout financement de ces recherches ?
M. Georges PELLETIER : C’est déjà malheureusement le cas. Dans le cinquième PCRD27, il était difficile de proposer un projet de recherche de biotechnologie végétale : le mot OGM était déjà devenu tabou. C’est devenu encore plus grave dans le sixième PCRD, au point que la communauté scientifique végétale a eu l’impression qu’il n’y avait plus de place pour elle en Europe. Les programmes de génomique végétale qui ne sont pas directement des programmes de biotechnologie – Génoplante, GABI et autres – permettent de survivre, car l’Union européenne semble disposée à les soutenir – encore que ce soient les Etats qui en supportent directement le coût. Mais il n’est pas sûr qu’elle continue à nous suivre. Quant à subventionner des recherches sur les OGM, c’est tout simplement exclu.
M. André CHASSAIGNE : Si l’on fait des essais en plein champ, c’est bien parce que le produit est destiné à être inscrit au catalogue et commercialisé. Et derrière tout cela se pose le problème de l’organisation économique. Le développement du coton génétiquement modifié, au-delà des appréciations contradictoires qu’il suscite, aura de terribles conséquences, à n’en pas douter, pour les pays en voie de développement directement confrontés à la concurrence de ces nouvelles productions. C’est d’abord cet aspect essentiel que mettent en avant les partisans des fauchages.
M. Georges PELLETIER : L’objectif de l’essai de Marsat était bien de planter un maïs en champ pour examiner sa physiologie en conditions normales, point. Naturellement, s’il apparaissait que la surexposition du gène en question a des effets très positifs en termes d’économie d’engrais azotés, je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette chance. Mais il faudrait alors réaliser d’autres types d’essais, totalement différents, à fins de certification et de commercialisation d’une nouvelle variété végétale.
M. Georges FREYSSINET : On ne fera un produit commercial que si l’on est certain que cela fonctionne au champ.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Quelle est la différence entre ces deux types d’essais, dans les analyses et dans les protocoles ?
M. Georges PELLETIER : Pour être commercialisée, toute variété doit subir une série de tests, afin notamment de prouver son homogénéité, sa nouveauté par rapport aux variétés existantes et la stabilité de ces nouveaux caractères. Toute nouvelle variété doit passer par ce crible d’essais de certification réalisés par des organismes officiels, le GEVES28 en particulier.
M. André CHASSAIGNE : Pardonnez-moi une question bête : quel intérêt y a-t-il à limiter l’utilisation d’engrais azotés ? S’agit-il seulement d’un problème de coût ou y a-t-il un enjeu environnemental ?
M. Georges FREYSSINET et M. Georges PELLETIER : Les deux !
M. François GUILLAUME : Il y a un critère simple : si la plante ne présente aucun intérêt économique, soyez sûr que l’agriculteur n’achètera pas les semences !
M. le Président : Une bonne partie des engrais azotés n’est pas assimilée par la plante et s’accumule dans les nappes phréatiques qu’ils contribuent, pour une part, à polluer. De gros efforts ont déjà été entrepris en agriculture classique pour réduire les épandages. Le rêve du biotechnologiste était de parvenir à fixer l’azote de l’air pour s’en servir comme engrais. C’était l’utopie des années 80, lorsque l’on a découvert le gène de la nitrogène-réductase. Malheureusement, on s’est aperçu, depuis, que la chaîne était autrement plus compliquée et qu’il fallait, non pas un, mais dix-sept gènes. Cela dit, toute technique permettant de diminuer l’utilisation des intrants est bonne pour l’environnement.
J’ai toujours été mesuré dans les conclusions de mes rapports, mais il est une chose que je ne peux personnellement accepter. Je m’efforce de faire en sorte que chacun s’exprime, mais je ne peux comprendre que, d’un côté, on demande, et très légitimement, aux scientifiques de répondre à des questions de plus en plus compliquées et que, de l’autre, une partie de notre opinion refuse qu’on y réponde et aille détruire des plantes. C’est le seul point sur lequel je resterai en désaccord total.
Le citoyen n’est pas un scientifique. Il se pose peut-être des questions bêtes ; reste qu’elles méritent réponse. Mais tant que certains, soit par idéologie, soit par stratégie
– parce qu’ils veulent vendre, et j’aimerais à ce propos que nous puissions visiter Monsanto pour comprendre sa philosophie –, feront tout pour qu’on n’y réponde pas, jamais notre société ne pourra régler ce problème.
Vous avez parlé d’une réunion à Lyon. On nous a dit qu’elle aurait été houleuse, notamment pour un représentant du conseil régional…
M. Georges FREYSSINET : Cela ne doit pas être la nôtre… M. Queyranne s’y était fait représenter par son adjoint, mais jamais celui-ci ne s’est fait chahuter.
M. Georges PELLETIER : Ce congrès européen, Plant GEMs – Genomics European Meetings –, se tient tous les ans : la première année à Berlin, l’an dernier à York, cette année à Lyon et l’année prochaine aux Pays-Bas.
M. François GUILLAUME : Précisons que la recherche n’a pas renoncé à obtenir une plante qui, à l’exemple du pois, puisse grâce aux nodules présents dans ses racines, fixer l’azote de l’air.
M. le Président : Ou comme la luzerne et toutes les légumineuses. Mais c’est plus compliqué qu’il n’y paraît.
M. Georges PELLETIER : En effet. Mais des chercheurs travaillent toujours sur cet objectif.
M. le Président : Messieurs, nous vous remercions.
Audition conjointe de
M. Bruno CLÉMENT, directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM),
M. Victor DEMARIA-PESCE, chargé des relations avec le Parlement à l’INSERM,
M. Jean-Antoine LEPESANT, directeur de recherches au Centre national de recherche scientifique (CNRS)
(extrait du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Après nous être beaucoup intéressés au thème des plantes transgéniques, qui est au cœur de l’actualité, nous souhaitons, à l’occasion de cette audition, examiner les questions liées à la recherche biomédicale et aux animaux transgéniques. En quoi la transgénèse est-elle utile dans les secteurs des biotechnologies et de la pharmacie ? A quel niveau se situe la recherche française ? La controverse sur les végétaux génétiquement modifiés nuit-elle à la recherche dans d’autres domaines ?
Nous accueillons M. Victor Demaria-Pesce, qui est chargé, à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), des relations avec le Parlement, et que nous rencontrons souvent dans le cadre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ainsi que MM. Bruno Clément et Jean-Antoine Lepesant.
M. Victor DEMARIA-PESCE : Nous allons présenter l’organisation générale de l’INSERM puis développer deux aspects spécifiques concernant les OGM : la recherche biomédicale sur les animaux transgéniques et la valorisation des médicaments.
Je suis chercheur à l’INSERM, chargé, au sein de la direction de l’établissement, des relations avec le Parlement.
M. Jean-Antoine LEPESANT : Je suis directeur de recherches au Centre national de recherche scientifique (CNRS), directeur de l’Institut Jacques Monod et directeur d’un Institut fédératif de recherche (IFR) commun à Paris VII, à l’INSERM et au CNRS.
M. Bruno CLÉMENT : Je suis directeur de recherches à l’INSERM. Je dirige, à Rennes, un groupe qui travaille sur le cancer du foie et je suis par ailleurs chef de mission auprès du directeur général de l’INSERM ainsi que directeur scientifique d’INSERM-Transfert.
M. Victor DEMARIA-PESCE : L’INSERM, établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), est le seul organisme public entièrement consacré à la recherche biomédicale et à la santé. Il assure le continuum entre recherche fondamentale, recherche clinique, recherche thérapeutique et valorisation. Il compte 366 laboratoires, 2 000 chercheurs, 13 000 collaborateurs – 85 % de ses laboratoires sont implantés dans des centres hospitaliers universitaires (CHU) – et 21 centres d’investigation clinique. Son budget s’élève à 508 millions d’euros.
A propos des OGM, deux points me semblent importants. Premièrement, nous avons adopté une démarche qualité, autour de deux pôles : vérification des bonnes pratiques de laboratoire et accompagnement pour la certification ISO ; contrôle draconien de tous les essais cliniques pour faire respecter les normes et bonnes pratiques cliniques. Deuxièmement, nous disposons d’un comité d’éthique, compétent sur l’ensemble de nos activités de recherche, ainsi que d’une mission éthique, chargée de coordonner notre action avec celle des autres organismes de recherche français et européens.
M. Jean-Antoine LEPESANT : Mon domaine de recherches est la génétique moléculaire du développement, et l’organisme modèle sur lequel travaille mon équipe est la mouche drosophile.
Les animaux transgéniques sont utilisés pour la recherche biomédicale et pour l’étude des pathologies. Ils résultent de l’insertion dans leur patrimoine génétique de fragments d’ADN exogènes, provenant soit de leur propre patrimoine génétique, soit de celui d’autres organismes vivants. Les animaux modèles sont ceux sur lesquels les expérimentations de types génétique, moléculaire et cellulaire peuvent être menées et combinées, jusqu’à devenir des références pour l’étude des processus biologiques. Il s’agit de la souris, mais aussi du crapaud xénope, de la mouche drosophile et du vers nématode, voire du moustique ou du rat. Les animaux domestiques, pour leur part, ne peuvent être considérés comme des modèles de référence.
Les techniques de transgénèse animale sont maintenant standardisées dans le monde entier. Si des améliorations et des sophistications sont apportées régulièrement, ces techniques restent fondées sur des innovations méthodologiques mises au point dans les années 80. Elles ont permis d’introduire des modifications très ciblées de patrimoines génétiques connus, et elles complètent les techniques génétiques classiques – et ne s’y substituant pas – en multipliant la puissance d’investigation : on peut ajouter un gène, le détruire, le remplacer par un autre et même franchir les barrières d’espèces. Ce sont en outre des techniques relativement faciles à mettre en œuvre, quoique coûteuses.
La transgénèse est devenue un outil indispensable en recherche fondamentale biomédicale et en biotechnologie. Etudier une mouche aide à expliquer les processus vitaux intervenant dans nos propres cellules, fondamentalement identiques à celles de l’insecte. A cette occasion, s’est en effet affirmé le principe de l’unicité du vivant. C’est utile pour comprendre le développement des embryons, des organes ou du cerveau, mais aussi le comportement, la mémoire et le vieillissement.
Par ailleurs, nous disposons ainsi de modèles animaux pour étudier les pathologies humaines, et ce domaine connaît une grande expansion : un ou plusieurs aspects d’une maladie sont reproduits sur un animal pour en étudier les processus moléculaires et cellulaires et envisager ainsi des thérapies. Des équipes françaises, en particulier à l’INSERM, ont ainsi obtenu de bons résultats sur ce créneau, concernant le diabète, les maladies auto-immunes, les maladies dégénératives, notamment du système nerveux, la listériose ou la spondylarthrite ankylosante. Et la mise au point de ces modèles animaux permet, en retour, de comprendre les processus biologiques fondamentaux eux-mêmes. La pathologie humaine constitue en effet un réservoir extraordinaire d’altérations génétiques, dans la mesure où nous sommes tous porteurs, à l’état hétérozygote, de multiples mutations : songez qu’un Français sur trente est porteur du gène muté de la mucoviscidose et que plus de 3 000 maladies humaines sont génétiquement identifiées ! Grâce à ces modèles, des vaccins et médicaments nouveaux sont mis au point, avec de grosses retombées économiques et biotechnologiques.
Ces recherches sont étroitement encadrées par la réglementation. Les expériences sont soumises à l’approbation de comités ad hoc – notamment des comités d’éthique ou la Commission du génie génétique et le Comité ERMES – et le traitement de l’animal fait l’objet de protocoles stricts. Le confinement des animaux transgéniques est très sévère, d’autant qu’il est indispensable à la bonne marche des recherches. Un effort considérable est consacré à la formation des personnels.
Ces recherches nécessitent des investissements considérables, un personnel qualifié, un matériel sophistiqué et des installations adaptées – animaleries à haut degré de confinement et laboratoires de transgénèse. Les EPST et les universités ont recensé les plates-formes existantes dans un fascicule qui vous a été remis. L’effort doit être soutenu pour que la France continue d’occuper une place honorable dans ce domaine.
M. Bruno CLÉMENT : Les animaux génétiquement modifiés sont cruciaux pour concevoir de nouveaux traitements. J’aborderai trois points : les nouveaux médicaments, les xénogreffes et les perspectives pour la recherche publique.
Les grandes sociétés pharmaceutiques ont fondé leur croissance sur les molécules chimiques à large spectre traitant les grandes maladies. Ce modèle économique est pour l’instant très porteur, puisque le marché qu’il cible a atteint 500 milliards de dollars en 2003, chaque blockbuster rapportant plus d’un milliard de dollars par an. Il est toutefois déstabilisé par les médicaments biologiques issus des procédés biotechnologiques, qui génèrent des produits thérapeutiques à partir du vivant – de protéines recombinantes, d’anticorps monoclonaux, de vaccins ou de cellules. Ils proviennent majoritairement d’organismes génétiquement modifiés : animaux, cellules, bactéries, voire plantes. Le secteur croît à un rythme très rapide – deux fois plus élevé que les médicaments traditionnels. Il représente environ 8 % du marché, soit 155 médicaments, dont certains ont acquis le fameux statut de blockbuster, par exemple les interférons, les facteurs de coagulation, l’hormone de croissance et l’insuline qui est le plus ancien médicament issu de la transgénèse. Ces produits présentent l’intérêt d’être très ciblés sur tel ou tel sous-groupe de maladie, ce qui, par rapport aux médicaments chimiques, améliore l’effet thérapeutique et facilite le contrôle des effets toxiques.
L’intérêt des médicaments biologiques est également qu’ils sont adaptés aux traitements cibles de pathologies qui se manifestent à l’occasion d’une maladie, comme le cancer, par exemple, ou les maladies cardio-vasculaires. Ainsi, l’herceptine est un anticorps monoclonal issu de la thérapie génique, ciblé sur un défaut précis qui frappe 20 à 30 % des victimes de cancer du sein et que l’on arrive à détecter grâce à la surexpression d’un gène de susceptibilité. Ce médicament, contrairement au taxotère ou au taxol, n’est pas adapté à toute la gamme des cancers du sein – ce n’est donc pas un blockbuster – mais il est efficace et moins toxique pour les malades concernées. Les anticorps monoclonaux peuvent donc être définis comme des protéines qui repèrent un déterminant sur une cellule ou une protéine malade en vue de mener une action très précise contre elle. Leur marché est en croissance de quelque 60 % depuis 1997, et 200 d’entre eux sont actuellement en phase de développement clinique.
Les techniques de transplantation d’organe se sont améliorées et les greffons sont de mieux en mieux tolérés par les patients, mais nous sommes confrontés à une pénurie d’organes sains. C’est pourquoi des équipes travaillent sur la possibilité de transplanter des organes d’animaux. Pour contourner le problème majeur que constitue le rejet aigu par notre système immunitaire, il faut transformer l’organe de façon à ce qu’il ne soit plus identifié comme étranger. Les animaux sur lesquels portent les recherches sont généralement des porcs, que l’on cherche à « humaniser » – le terme est très mauvais, mais la presse l’utilise souvent – afin de prélever le foie, les reins ou encore des cellules, notamment pancréatiques. Ce sujet ouvre des perspectives thérapeutiques et éthiques passionnantes.
Lorsqu’un processus moléculaire cible a été identifié pour guérir une maladie, beaucoup de temps, d’argent et de recherches sont encore nécessaires pour prouver que cette cible est pertinente et aboutisse à un médicament. Je confirme l’importance cruciale que revêtent les modèles cellulaires lors de cette phase-clé de la preuve du concept, les modèles animaux permettant de mimer le mieux possible la pathologie ciblée. Or la recherche publique détient les outils et le savoir-faire pour créer ces animaux et organismes.
L’évolution de l’industrie pharmaceutique du chimique vers le biologique constitue une chance pour la recherche publique française et européenne. Celle-ci se trouve en effet à l’origine de la plupart des innovations en la matière. Elle est de surcroît en mesure de proposer une expertise globale – concernant la préparation du médicament, mais aussi les patients, les modèles et les ressources biologiques –, qui intéressera l’industrie pharmaceutique. Enfin, les entreprises biotechnologiques innovantes, vecteurs du transfert technologique entre recherche académique et recherche industrielle, sont le plus souvent issues des organismes de recherche.
L’impact des organismes génétiquement modifiés sur la découverte de nouveaux médicaments est donc considérable : on ne peut plus imaginer de traitement futur sans recours aux OGM, à un stade ou à un autre. Et les applications sont parfois surprenantes, à l’instar de l’utilisation de plants de tabac pour produire des molécules thérapeutiques.
M. le Président : Merci, messieurs, pour ces deux exposés. Nous en venons maintenant aux questions.
M. le Rapporteur : Un vaccin recombinant contre la rage a permis d’éradiquer la maladie. Mais une dispersion a-t-elle été constatée et suivie ? Des effets ont-ils été enregistrés sur l’écosystème ?
M. Bruno CLÉMENT : Aucun effet secondaire, à ma connaissance, n’a été enregistré. Je vois d’ailleurs mal par quel processus l’écosystème aurait pu être affecté. Dès lors que le support du vaccin n’est pas un être vivant mais un virus inactivé, l’entité biologique ne peut se disséminer.
M. le Rapporteur : Au cours de vos recherches, avez-vous rencontré des difficultés financières ? Et des difficultés en ce qui concerne la concurrence, les brevets et la dispersion des organismes ?
M. Jean-Antoine LEPESANT : Les investissements consentis en équipements, en fonctionnement et en salaires sont considérables, mais restent en deçà de ce qui serait nécessaire pour que la France soit compétitive. Les animaleries doivent respecter des normes de confort de plus en plus strictes – par exemple un nombre limite de souris par cage –, définies au niveau européen, et qui nécessitent de nouveaux investissements, de même que le recrutement et la formation de personnel statutaire, car il est très inconfortable de travailler avec des agents précaires, susceptibles de nous quitter du jour au lendemain. Tous les plateaux techniques français travaillant sur l’animalerie et la transgénèse expriment les mêmes demandes : des postes et des moyens. D’autres pays, comme le Japon ou les Etats-Unis, savent se donner les moyens.
Pour éviter la dispersion, les animaux transgéniques doivent être manipulés derrière un sas. Mais de toute façon nos drosophiles sont toutes aveugles, vivent à peine quelques heures en dehors d’un tube et sont, pour la plupart, dépourvues d’ailes. Quant aux souris, elles sont knock-out, c’est-à-dire si malades qu’il faut prendre beaucoup de précautions pour les élever en laboratoire. Je n’affirmerai pas qu’aucune souris ne s’échappe, mais les souris sauvages posent davantage de soucis au campus de Jussieu ! Il est peu probable, au demeurant, que nos souris puissent se reproduire à l’extérieur.
M. le Rapporteur : L’INSERM crée-t-il aussi des races comme les saumons transgéniques ?
M. Bruno CLÉMENT : C’est plutôt du ressort de l’IFREMER29.
M. Jean-Antoine LEPESANT : La majorité des laboratoires de l’INSERM n’ont pas pour préoccupation de découvrir des animaux transgéniques intéressants du point de vue économique, même si certains résultats sont valorisés pour produire des médicaments ou à des fins de recherche, publique ou privée. La valorisation économique des organismes transgéniques obtenus fait en revanche partie des missions de l’IFREMER et de l’INRA.
M. le Rapporteur : Quelles difficultés rencontrez-vous lorsque vous établissez les autorisations de mise sur le marché (AMM) ?
M. Bruno CLÉMENT : L’un des défis consiste à réduire la durée de mise au point des médicaments, pour des raisons économiques mais aussi de santé publique. Nous n’avons pas pour mission de négocier les AMM mais, après avoir identifié une cible, d’amener le produit au plus près de l’essai préclinique, c’est-à-dire du stade de médicament candidat. Rien n’étant prévu à cet effet parmi les subventions nationales, cela suscite de vraies difficultés de financement, d’autant que l’industrie, méfiante, temporise avant d’investir. Restent les contrats de collaboration, qui sont toutefois notoirement insuffisants pour faire la preuve du concept parce qu’il faut des animaux et des essais lourds et coûteux. Notre retard doit être comblé en affectant à cet objet une part du financement de l’Etat afin d’identifier les projets susceptibles d’aller jusqu’au bout. Il faut définir le stade où s’arrête la mission de la recherche publique dans ce continuum de dix ans entre la paillasse et le malade.
M. François GUILLAUME : Les industriels sont rarement prêts à financer la recherche dès son origine mais, s’il y a une espérance de production, le laboratoire public enregistre-t-il un retour financier ?
M. Bruno CLÉMENT : S’il détient le brevet de l’invention – et non pas de la découverte, il faut bien distinguer les deux –, le retour sera réel, éventuellement très élevé. Les revenus de brevets que perçoivent les universités américaines suivent ainsi une courbe exponentielle : 54 millions de dollars par an pour l’université de Californie, même 129 millions pour l’université de Columbia ! Ces résultats sont dus à la politique très ambitieuse de protection menée depuis dix ans. Si l’Europe ne réagit pas rapidement, elle sera perdante non seulement financièrement, mais aussi en termes de défense de la découverte et de protection sociale car ces médicaments seront vendus à prix d’or.
M. Germinal PEIRO : Si le grand public connaissait mieux la recherche sur les OGM destinées à la création de médicaments, il n’aurait peut-être pas la même perception.
L’un des buts des recherches sur les OGM végétaux est de contribuer à résoudre les problèmes alimentaires et environnementaux mondiaux. Une partie de la recherche sur les animaux est-elle animée par ces mêmes objectifs – la taille des animaux, leur qualité gustative ?
M. Jean-Antoine LEPESANT : Je ne pense pas que ce soit la finalité actuelle des recherches actuelles. Il s’agit plutôt de donner à des animaux tel ou tel caractère génétique de l’homme pour procéder à des recherches thérapeutiques. La transgénèse présente un intérêt pour produire des protéines en masse et à moindre coût. En revanche, l’INRA s’est toujours illustrée en améliorant la production de lait des vaches par des méthodes plus classiques : la sélection du cheptel a encore de beaux jours devant elle. Il faut essayer de répondre à l’espoir de mieux alimenter l’humanité avec des plantes transgéniques, requérant moins d’engrais, accumulant davantage de protéines ou poussant sur des sols ou à des latitudes où l’irrigation est difficile. Pour les animaux, personnellement, je suis plus sceptique.
M. Victor DEMARIA-PESCE : L’INRA, il y a une vingtaine d’années, avait isolé une souche de cailles consommant un minimum d’oxygène afin de l’exporter au Pérou. En tant que chercheur de l’INSERM, j’avais employé cette souche pour étudier les mécanismes de consommation de l’oxygène et cela avait abouti à un usage thérapeutique, notamment en médecine hyperbare, pour les protocoles des accidents de plongée.
M. Jean-Antoine LEPESANT : L’aquaculture se développe quand même grâce à la sélection génétique mais aussi à la transgénèse, en particulier pour les saumons, qui peuvent rapidement atteindre des tailles gigantesques. Il faut cependant se montrer extrêmement prudent avec ce genre d’expérimentations, tout comme avec les plantes, car le volume de biomasse est élevé et l’environnement peut être facilement perturbé.
M. Bruno CLÉMENT : M. Peiro a employé un mot très important : « perception » par le public. Ce phénomène constitue un verrou dans la relation entre recherche et société. Les chercheurs se sentent un peu fautifs et accomplissent aujourd’hui un effort d’explication. Dans le domaine de la santé, nous sommes assez chanceux car les OGM ne suscitent guère de polémique, si ce n’est l’affaire Meristem Therapeutics. Cette entreprise, installée à Clermont-Ferrand, a mis au point des protéines avec un certain succès. Mais tout a basculé quand elle est parvenue à produire des molécules de médicaments en champ, à partir de maïs, puis de tabac : les médias s’en sont mêlés et plusieurs événements déplorables sont survenus.
M. le Président : C’est tout le problème de l’acceptabilité par le grand public. Pour les médicaments, c’est différent, car il y a un bénéfice avéré et les consommateurs sont prêts à prendre des risques pour se soigner. Hormis l’aquaculture, eu égard aux faibles flux vers l’environnement, le risque de contamination par les animaux transgéniques est faible. S’agissant des plantes, au contraire, le bénéfice n’est pas immédiatement perceptible, l’objectif étant généralement de réduire le coût de production, sans que cela se répercute sur le prix de vente, tandis que des risques de modification globale de l’environnement existent.
Avec le recul, estimez-vous que les biotechnologies, en matière de santé, ont connu des ratés ? S’il n’y en pas eu, je ne vois pas pourquoi il y en aurait davantage avec les plantes. S’il y en a eu, le contrôle qui s’exerce aujourd’hui sur les modèles expérimentaux est plus vigilant. Quoi qu’il en soit, sur les modèles animaux, des problèmes vous ont-ils alertés ? Pour caricaturer, avez-vous produit des « monstres » ?
M. Jean-Antoine LEPESANT : Je me souviens de la frénésie qui, en 1974, s’est emparée du grand public à propos des manipulations génétiques. Or aucun monstre n’a jamais été et ne sera jamais produit. Les organismes obtenus sont généralement un peu plus fragiles, en tout cas pas plus compétitifs que les autres dans la nature.
Le problème relève, en fait, de la perception de ce qui est « génétique » et surtout « génétiquement modifié ». C’est pourquoi je préfère employer le mot « transgénique ». Il faut commencer par éduquer le grand public car la génétique envahira de plus en plus la société : depuis 2002, on teste sur tous les enfants la présence du gène de la mucoviscidose et la plupart des mères ne le savent sans doute pas.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Les barrières d’espèces sont maintenant franchies, ce qui confère tout leur intérêt à ces manipulations. Mais n’est-il pas normal que cela provoque l’angoisse du grand public ? On ignore ce qui peut survenir, d’autant que les manipulations génétiques n’en sont qu’à leur début. Quel regard portez-vous sur ce problème ?
Avez-vous constaté, d’autre part, que vos recherches entraînent la répression ou l’activation d’autres gènes, et dans quelles proportions ?
Que pensez-vous, par ailleurs, du principe de précaution, introduit dans la Charte de l’environnement, laquelle doit un jour être adossée à la Constitution ?
Enfin, on sait produire les médicaments en laboratoire à partir d’autres organismes que des plantes. Eu égard aux garanties de confinement offertes par les animaux transgéniques, ne pensez-vous pas qu’il serait sage, hors de toute considération financière, de renoncer à cultiver en plein champ les plantes génétiquement modifiées en vue de produire des médicaments ?
M. André CHASSAIGNE : Quel est le degré d’intervention des divers comités d’éthique que vous avez évoqués ? N’existe-t-il aucun risque de dérapage des recherches ?
En novembre 2004, José Bové, dans une interview, a fait référence à l’INSERM à propos de l’arrachage, jamais revendiqué, du champ situé près d’Issoire dont il a été question tout à l’heure : « Ces essais n’étaient pas véritablement thérapeutiques et derrière cette apparence se préfigurait autre chose. J’en suis persuadé, notamment après en avoir débattu avec des chercheurs de l’INSERM. Il existe des techniques beaucoup plus simples et plus efficaces, par fermentateurs, en particulier, pour produire des médicaments. Une histoire similaire s’est produite aux Etats-Unis avec des cultures soit disant thérapeutiques et il a fallu les arrêter, puis détruire les cultures voisines de maïs. »
Quand le brevetage intervient-il ? Au stade du médicament, ou lors d’une phase antérieure ? Une fois le brevetage enregistré, sa gestion avec l’entreprise pharmaceutique est-elle purement financière ou laisse-t-elle une place à l’approche éthique, en particulier au profit des pays en développement ?
M. Jean-Antoine LEPESANT : Il est impossible de mesurer les conséquences à long terme de certaines expériences. Les modifications génétiques auxquelles nous procédons sont toutefois assez limitées : insérer un gène humain ou un fragment de gène humain dans un vers nématode ne rendra pas celui-ci plus humain pour autant. A cet égard, les xénogreffes suscitent quand même une certaine méfiance, comme en témoigne un avis du Comité d’éthique, les porcs possédant des virus au sein de leur patrimoine génétique qui pourraient infecter les humains – quoiqu’on n’en ait pas encore trouvé qui soient actifs. Il faut donc poursuivre les recherches. Quoi qu’il en soit, ce franchissement de la barrière d’espèces ne crée aucun problème d’un point de vue philosophique ou éthique.
M. le Président : La barrière d’espèces est déjà franchie car l’homme a des gènes en commun avec certaines levures ou bactéries !
M. Jean-Antoine LEPESANT : Avec la levure, nous avons un ancêtre commun, mais on ignore en revanche comment des gènes de bactéries ont pu entrer dans le génome humain, il y a probablement quelques dizaines ou centaines de millions d’années. Des échanges génétiques entre espèces se produisent tous les jours dans la nature, portant sur de grands morceaux de patrimoine génétique, et nous le constatons mais sommes incapables de reproduire ce phénomène.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais les chercheurs réfléchissent-ils aux problèmes soulevés par le franchissement de la barrière d’espèces ? La question n’est pas incongrue !
M. Jean-Antoine LEPESANT : Les protocoles sont soumis à des comités qui conduisent une réflexion d’ordre scientifique et éthique pour savoir s’il faut poursuivre ces expériences ou non. Les chercheurs sont responsables et disposent d’un cadre, même si celui-ci est peu contraignant, pour porter un regard critique sur les projets et pour estimer s’ils sont potentiellement dangereux, en particulier lorsque ces projets supposent la manipulation d’un génome de virus ou des expérimentations sur l’animal qui introduisent une maladie dans celui-ci.
Les sciences, elles aussi, sont sujettes aux modes, et on a beaucoup fantasmé sur la perspective de moissonneuses produisant en masse un facteur de coagulation – ce qui, cela dit, reste une réalité potentielle. Mais le développement de plantes transgéniques cultivables suppose des investissements colossaux, sans commune mesure avec le coût d’une animalerie de souris, pourtant déjà considérable – et, une fois les investissements réalisés, l’objectif est évidemment de pouvoir les cultiver à grande échelle.
M. le Président : Combien y a-t-il d’expériences de médicaments produits à partir de plantes ?
M. Bruno CLÉMENT : Aucun de ces produits, à ma connaissance, n’est encore sur le marché ; nous sommes encore dans le domaine expérimental.
M. le Président : La mission aimerait savoir combien d’expériences sont en cours.
M. Bruno CLÉMENT : La plupart des protéines recombinantes sont produites à partir de levures, de bactéries, voire de cellules humaines ou simiesques, ce qui pose deux problèmes : un risque de contamination par d’autres éléments biologiques provenant de ces organismes relativement proches de nous ; des difficultés de purification après production par l’entité biologique. Un autre procédé consiste à introduire un gène humain dans une plante qui va produire une protéine humaine. Passer par des plantes devrait comporter moins de risques. Ainsi, Meristem Therapeutics, à partir des travaux d’un chercheur de l’INSERM, a utilisé du maïs, puis du tabac pour produire de l’hémoglobine – dont on ignore encore si elle est fonctionnelle – et ce type de procédé a également été employé pour obtenir de la lipase gastrique pour la mucoviscidose et du collagène utilisé comme produit cicatrisant pour les pansements.
Cette année, Meristem Therapeutics lance deux programmes principaux. Le premier concerne la production de lipase gastrique à partir de maïs transgénique pour une étude clinique de phase III du traitement de la mucoviscidose. A raison d’environ 1 kilo de protéine recombinante par hectare de maïs, cet essai nécessite d’ensemencer 21 hectares en plein champ pour produire 50 lots de médicament. Le deuxième projet est plus modeste mais tout aussi important pour la recherche. Il concerne la production de deux anticorps monoclonaux pour le traitement des cancers dont les effets biologiques ont été montrés in vitro. Un hectare et demi de champ sera utilisé pour cet essai de médicament recombinant sur des modèles précliniques. A ma connaissance, ce sont les seuls essais en plein champ prévus en 2005 en France, et probablement en Europe.
Si M. Bové est entré en scène, c’est que Limagrain a pris une participation dans la société. Il n’en reste pas moins que cet arrachage, qui relève du droit commun, pose un vrai problème, car les recherches ont reçu l’agrément des comités et elles sont encadrées et extrêmement bien protégées. On peut craindre aujourd’hui que Meristem Therapeutics aille procéder à ses cultures ailleurs, si les essais prévus cette année ne peuvent pas être réalisés.
M. le Président : Ce n’est plus une crainte : la société sera probablement bientôt reprise par des capitaux étrangers.
M. Bruno CLÉMENT : Je vais être un peu provocateur ! Les désordres écologiques majeurs provoqués par l’introduction, dans les années 50, du maïs en Bretagne ont-ils été mesurés par un quelconque comité ? Il serait encore temps ! S’agissant des OGM, nous nous imposons des contraintes fortes en matière de contrôle et de suivi, et il le faut, mais nous ne pouvons pas faire autrement que passer par la culture en champ.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Un de vos collègues nous a dit qu’il n’était pas forcément indiqué de produire des plantes médicamenteuses en plein champ et qu’une technologie existait pour effectuer les recherches en laboratoire, mais que c’était plus cher.
M. Jean-Antoine LEPESANT : Toute polémique est nuisible à la recherche, et l’attitude de M. Bové, qui consiste à intenter des procès d’intention, est répréhensible en elle-même. Les chercheurs ne sont pas les êtres irresponsables et coupés du monde dont la caricature est souvent esquissée ; ce sont des citoyens comme les autres, et ils ont besoin de calme et de sérénité. J’estime que la transgénèse doit être appliquée, mais, de la même façon, je ne vois pas pourquoi on négligerait de rechercher une alternative à la plante pour obtenir telle ou telle protéine. Il faut chercher !
M. le Président : Dès lors que le principe de précaution est respecté, il n’y aucune raison de ne pas procéder aux expérimentations. Or, dans le cas de Meristem Therapeutics, les protéines étaient extraites de la feuille, ce qui permettait de détruire les cultures avant même la floraison, c’est-à-dire préalablement à l’apparition de la moindre graine ! De même, en Guyane, les flux de pollen de café étaient étudiés, et l’expérimentation n’en a pas moins été réduite à néant, pour des motifs purement idéologiques. Quand on empêche l’expérimentation, cela signifie que l’on refuse d’entendre les réponses !
La recherche doit être encadrée – peut-être la Commission du génie génétique fonctionne-t-elle mal – mais cela ne justifie pas les positions irrationnelles sur l’expérimentation en plein champ, que pratiquement tout le monde s’accorde à juger nécessaire, même s’il faut évidemment que les conditions soient draconiennes. Je vois cependant se profiler un nouveau sujet d’inquiétude parmi la population : l’animal qui a mangé des plantes génétiquement modifiées n’est-il pas dangereux ? Ne faut-il pas l’étiqueter ? Notre mission aura beau faire état de ses convictions, si le grand public n’a pas confiance, il ne sera même pas nécessaire de conduire d’expérimentations car il n’y aura pas de marché.
M. Gabriel BIANCHERI : Quand on parle économie, il n’est pas seulement question de rentabilité mais aussi de coût du produit fini, afin de le rendre plus accessible.
M. Bruno CLÉMENT : Au sujet des brevets, les organismes publics s’interrogent effectivement maintenant sur le meilleur moment pour breveter. Pour que les commissions d’évaluation des brevets donnent leur accord, il faut lier le gène à une fonction et, si possible, à une modification de celle-ci : la preuve de l’activité biologique du gène ou de son intérêt comme outil de diagnostic doit être apportée. Il ne faut pas tout breveter car cela coûte cher et il ne faut pas non plus breveter trop tôt, car la durée de validité de la protection est limitée à vingt ans. Il n’existe donc pas de règle mais seulement des cas particuliers, en fonction de l’intérêt de la fonction brevetée.
M. Jean-Antoine LEPESANT : L’INSERM et le CNRS disposent de services très compétents pour aider les chercheurs sur ce sujet, mais déposer un brevet ne fait pas encore partie de la culture de la recherche française.
M. Bruno CLÉMENT : Un brevet n’est pas figé ; c’est la déclaration publique d’une invention.
M. le Président : La mission devra aborder un autre problème, de nature technique : celui de la compatibilité entre le domaine végétal, le certificat d’obtention et le droit de brevets. La directive a été transposée, mais, au nom de mon groupe, j’ai demandé sa renégociation.
M. André CHASSAIGNE : Quelles sont les modalités financières du dépôt de brevet ?
M. Bruno CLÉMENT : Tout dépend du niveau de protection. S’il est déposé auprès de l’Office européen des brevets, et surtout si son champ d’application est étendu à des pays comme les Etats-Unis ou le Japon, il coûte très cher. Il convient donc de développer des services de valorisation compétents pour évaluer la prise de risques pesant sur l’Etat. On se heurte cependant à un gros problème culturel : la protection de la découverte n’est pas encore passée dans les mœurs des chercheurs publics.
M. le Président : Les Européens déposent moins de 20 % de leurs brevets aux Etats-Unis quand plus de la moitié des brevets de l’Office européen sont le fait des Américains.
M. Bruno CLÉMENT : Mais breveter ne signifie pas licencier et valoriser. Le Japon, par exemple, brevète systématiquement mais ne licencie guère ; son investissement n’est donc pas forcément très rentable. L’Europe doit breveter davantage, mais avec discernement.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous de l’initiative américaine PIPRA30 ? Par quels moyens peut-on valoriser la recherche publique ?
M. Bruno CLÉMENT : PIPRA, je crois, est une réunion d’institutions agricoles présentée sous un angle humanitaire afin de regrouper des brevets. L’expérience me paraît intéressante, même si je dispose de peu d’informations.
M. Jean-Antoine LEPESANT : C’est une initiative du milieu académique.
M. le Rapporteur : L’absorption d’OGM est-elle nocive pour la santé humaine et peut-elle aboutir à une modification du code génétique ?
M. Jean-Antoine LEPESANT : Il n’y a aucun risque, en tout cas pas avec les OGM produits actuellement.
M. Bruno CLÉMENT : Nous mangeons déjà de nombreux produits OGM. Des interrogations demeurent toutefois à propos des allergies : il existe peut-être un risque d’induire une réaction immunitaire de type allergique, mais celui-ci n’est pas avéré.
M. Jean-Antoine LEPESANT : Des éléments génétiques non conventionnels comme les prions, qui ne sont pas produits par le génie génétique, provoquent des modifications génétiques. Quoi qu’il en soit, je pense que l’on peut manger du maïs Bt à volonté sans aucune inquiétude.
M. Bruno CLÉMENT : Plus de la moitié du riz produit en Chine est génétiquement modifié.
M. le Président : En 1998, lorsque j’ai écrit mon premier rapport au sujet des OGM, on ne parlait que de santé. Aujourd’hui, les témoins, y compris ceux à charge, n’emploient plus cet argument, mais on en a trouvé d’autres !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Le métabolisme de la protéine du maïs Bt dans l’organisme a-t-il été étudié ? N’y a-t-il aucun risque de toxicité ? Personne n’en sait rien.
M. Bruno CLÉMENT : L’expérience toxicologique la plus vaste qui soit a été menée, puisque des animaux se nourrissent de ces maïs dans plusieurs pays.
M. Jean-Antoine LEPESANT : Il arrive que l’être humain vive des expériences génétiques sans le savoir : du vaccin antipolio contaminé par du SV40, virus cancérigène dans certaines conditions, a été administré à des millions de personnes.
M. le Président : Nous sommes d’accord pour dire qu’il faut continuer la recherche pour répondre à toutes les questions soulevées. La science et l’innovation sont une suite ininterrompue de questions.
Monsieur Clément, vous qui êtes spécialiste du cancer du foie, avez-vous travaillé sur les mycotoxines ? Des systèmes de culture favorisant l’élévation des mycotoxines comme l’aflatoxine ne sont-ils pas dangereux ?
M. Bruno CLÉMENT : L’aflatoxine est une source connue du cancer du foie. Cet agent toxique puissant provoque des lésions de l’ADN et son exposition prolongée induit des transformations cellulaires. Utiliser des cultures dans lesquelles la présence de mycotoxines serait réduite par modification génétique constituerait un progrès certain et réduirait l’incidence des cancers primitifs du foie, en particulier dans les pays émergents.
M. Jean-Antoine LEPESANT : L’industrie agroalimentaire est aussi directement responsable de cancers du foie survenus en Afrique à cause de la consommation d’arachide.
M. le Président : Messieurs, je vous remercie.
Audition de M. Gérard PASCAL,
ancien président du Comité scientifique directeur de l’Union européenne
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mes chers collègues, nous avons l’honneur de recevoir M. Gérard Pascal, ancien président du Comité scientifique directeur de l’Union européenne. Il a longtemps représenté la France à Bruxelles, où il a pu suivre l’élaboration des directives successives sur les questions de sécurité sanitaire des aliments, l’évolution des mentalités et des idées, ainsi que les arbitrages qui ont été faits. Nous pourrons ainsi l’interroger sur les problèmes actuels de sécurité sanitaire, sur le lien entre réglementation et sécurité sanitaire, sur la façon dont se font les règlements. Même si notre mission s’est davantage penchée, comme je l’ai dit hier, sur les questions d’environnement que sur celles de santé, ces dernières n’en sont pas moins présentes.
M. Gérard PASCAL : Quelques mots de présentation pour commencer. Ingénieur biochimiste de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon, je suis entré au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) dès ma sortie de l’école en 1964 où j’ai travaillé pendant trois ans sur la synthèse organique de molécules marquées. J’ai ensuite été recruté par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et mis à la disposition du Centre national de recherche scientifique (CNRS) pour étudier la nutrition, qu’on n’étudiait alors ni à l’université ni dans les écoles d’ingénieur. Pendant six ans, j’ai fait des études toxicologiques sur les additifs alimentaires antioxydants et des études nutritionnelles sur la synthèse des lipides à partir des glucides. En 1973, j’ai réintégré l’INRA, où j’ai constitué une équipe afin de continuer à travailler dans le même domaine, et nous sommes arrivés à des résultats qui ont mis en évidence le caractère indispensable des acides gras de la série « n-3 » – dont on parle beaucoup en ce moment, ce qui tend à montrer qu’il faut une vingtaine d’années pour que le marketing s’empare des résultats de la recherche...
Puis l’INRA, qui commençait alors à prendre le virage de l’agriculture productiviste vers une agriculture plus soucieuse des attentes des consommateurs, m’a demandé de diriger un département des sciences de la consommation. J’ai dirigé cette structure une dizaine d’années, jusqu’à ce qu’en 1989 je convainque l’INRA de créer un département de nutrition humaine. Il y a eu ensuite un entracte durant lequel j’ai dirigé une sorte de bureau d’études du CNRS, le CNERNA31, qui associait des représentants de l’administration, de l’industrie et de la communauté scientifique, en vue de proposer des lignes directrices – qui se sont souvent transformées en réglementations – et des recommandations à la population en matière d’apports nutritionnels. En 1998, l’INRA m’a rappelé pour être directeur scientifique en charge de la nutrition humaine et de la sécurité des aliments – poste auquel j’ai achevé ma carrière, puisque j’ai fait valoir mes droits à la retraite au début de cette année.
Parallèlement, j’ai exercé des activités d’expertise, depuis la fin des années 70, au Conseil supérieur d’hygiène publique de France, dont j’ai présidé un groupe d’experts sur les additifs alimentaires, puis la section « Nutrition et Alimentation » jusqu’en 1992, date à laquelle j’ai été nommé à Bruxelles au Comité scientifique de l’alimentation humaine, comité dont j’ai été élu président en 1993, puis en 1995. Lorsqu’est survenue la crise de la vache folle, j’ai fait partie pendant un an d’un comité scientifique multidisciplinaire sur l’ESB. C’est à ce moment que la Commission européenne a réorganisé ses comités scientifiques, puis a créé un Comité scientifique directeur, dont j’ai assumé la présidence jusqu’à la création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en avril 2003. Nous avons eu naturellement à faire face aux problèmes liés à l’ESB, à la vache folle, à la maladie de Creutzfeld-Jacob et à ses variantes, mais aussi à proposer des lignes directrices pour l’évaluation de la sécurité sanitaire des OGM. C’est d’ailleurs dans le cadre du Comité scientifique de l’alimentation humaine que je me suis penché pour la première fois sur la question des OGM, fin 1996, à propos du maïs Ciba, et en particulier de l’évaluation des risques liés à la présence d’un gène de résistance aux antibiotiques, à l’ampicilline, en l’occurrence.
J’ai été nommé à la Commission du génie biomoléculaire (CGB) dès sa création en 1986. Je ne connaissais rien au génie génétique et à la transformation des plantes, mais les initiateurs de la CGB se sont dit, dès ce moment-là, qu’il faudrait tôt ou tard faire des évaluations de la sécurité sanitaire des OGM, et comme j’étais membre du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, ils ont pensé que je pouvais faire le lien entre les deux. C’est ce que j’ai fait dès que sont arrivées les demandes d’expérimentation, puis d’autorisation de mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées. Bien que la réglementation ne l’impose pas, nous avions décidé qu’il était important d’informer le Conseil supérieur d’hygiène publique de France de ce qui se faisait à la CGB. Ensuite les choses sont devenues plus formelles, et j’ai trouvé inconfortable d’avoir cette double casquette, de rapporter les mêmes dossiers devant deux instances.
C’est à partir de là que j’ai été impliqué, sur le plan international, dans les réflexions menées au sein d’instances telles que l’OCDE. En 1996, j’ai organisé et coprésidé à Aussois, au centre de formation du CNRS, avec un collègue de l’American Food and Drugs Administration32, un atelier sur les méthodes d’évaluation des risques toxiques et nutritionnels des plantes génétiquement modifiées (PGM), faisant suite à un travail entrepris dès 1989 par l’OCDE33. Donc, quand j’entends dire que la réflexion sur ces sujets est toute récente, je réponds que cela fait plus de quinze ans ! Il y a eu notamment des consultations FAO34-OMS35 à Copenhague, et d’autres dès le début des années 90, par exemple à Jouy-en-Josas sur la transgénèse chez le poisson.
Quel a été mon cheminement intellectuel au cours de ces quinze années de réflexion collective, où j’ai eu à examiner beaucoup de dossiers de plantes transgéniques, notamment en vue d’autorisation de mise sur le marché ? J’avoue qu’au début j’ai été très impressionné par les propositions des industries américaines des biotechnologies, qui avaient publié un document assez volumineux proposant toute une méthodologie d’évaluation de la sécurité sanitaire des OGM. Pour quelqu’un qui n’était pas très averti, c’était assez convaincant. Mais ensuite ce document a été discuté, à l’OCDE, dans les consultations FAO-OMS, au Conseil supérieur d’hygiène publique de France, et nous avons trouvé un certain nombre de failles...
M. le Président : Pouvez-vous préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce qu’est le Conseil supérieur d’hygiène publique de France et ce qui le différencie d’autres organismes ?
M. Gérard PASCAL : Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France est une vieille dame, née dans les années 1840, et qui comprenait plusieurs sections : une section des eaux, une section des maladies contagieuses, etc. Certaines de ses sections ont été fondues dans l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) lorsque celle-ci a été créée, notamment sa section de l’alimentation et de la nutrition et une partie de sa section des eaux. La section de l’alimentation donnait aux pouvoirs publics des avis sur certains risques sanitaires liés à l’alimentation, mais pas sur tous, et pas, en particulier, sur les plantes transgéniques – d’ailleurs l’AFSSA n’est pas chargée d’évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires. Il existait aussi une Commission interministérielle de l’alimentation animale – qui n’est pas sans lien avec l’alimentation humaine – ainsi qu’une Commission des produits diététiques.
Lorsque la loi du 1er juillet 1998 sur la sécurité sanitaire est entrée en vigueur, tout cela a intégré l’AFSSA, de façon à rendre plus lisible le dispositif national de sécurité sanitaire des aliments. Au passage, comme j’avais fait certaines propositions d’amélioration du dispositif, on m’a demandé d’assumer la présidence du conseil scientifique de l’AFSSA lors de sa création. J’ai fait un mandat, mais je n’ai pas souhaité poursuivre, pour des raisons que je pourrais vous expliquer.
Sur les OGM, ma position a évolué au fil de mes discussions avec mes collègues, ainsi que de l’examen des dossiers que j’ai eu à connaître, en particulier de mon expérience de toxicologue sur les additifs alimentaires et contaminants – y compris dans le cadre de l’OMS, où je suis toujours expert, et où j’ai examiné des substances qui, a priori, n’ont pas d’effets biologiques, mais technologiques. On peut faire le parallèle avec les OGM, qui ne sont pas non plus conçues, a priori, pour avoir de tels effets, à la différence des molécules phytosanitaires destinées à tuer des végétaux, des insectes ou des pestes en général, ou encore des molécules d’intérêt pharmacologique, qui ont un effet sur l’organisme. Si la méthodologie dont nous disposons pour juger les risques de ces molécules pharmaceutiques ou phytosanitaires, auxquelles l’homme n’est que relativement peu exposé, permet d’évaluer le risque, il n’en va pas de même pour ces produits qui n’ont pas en principe d’effets biologiques et dont on ne peut pas forcer la dose lors des expérimentations : les méthodes ne sont pas assez sensibles pour mettre en évidence des effets discrets. Mais cela ne veut pas dire que ces effets discrets, s’il y en a, ne puissent pas avoir de conséquences à long terme.
Donc, dès le départ, j’étais réticent envers l’expérimentation animale, notamment de longue durée, que je considérais comme un gaspillage de temps et d’argent, et comme un sacrifice inutile d’animaux. Je n’y étais pas favorable, sauf pour évaluer les risques liés aux protéines dont l’expression est recherchée par ceux qui ont conçu l’OGM ou aux protéines codées par des gènes marqueurs, qu’il s’agisse de gènes de résistance aux antibiotiques ou aux herbicides. Lorsqu’on travaille sur la plante entière pour évaluer les risques non attendus, non intentionnels, et les risques pléiotropes, c’est-à-dire liés à la perturbation de l’expression du génome par l’introduction d’un élément à un endroit non choisi, les méthodes de la toxicologie traditionnelle ne conviennent pas.
Et si l’on persiste à utiliser ces méthodes traditionnelles, on s’expose à des difficultés comme celles que je viens de rencontrer avec le maïs MON 863 de Monsanto, difficultés liées à l’interprétation par différents comités d’experts de résultats ambigus. C’était la première fois, sur tous les dossiers toxicologiques que j’ai eu à étudier, que je n’étais pas satisfait de ce que je trouvais dans le dossier. Il faut dire que j’avais eu le temps d’entrer dans le détail de ses 4 000 pages, et que je n’y avais pas trouvé les mêmes choses que dans le résumé en 50 pages dont beaucoup de rapporteurs ont tendance à se contenter... J’ai donc jugé qu’il fallait un complément d’information. Le comité de l’AFSSA, qui suit ces questions d’OGM, n’a pas été du même avis et s’est déclaré satisfait, le panel de l’Autorité européenne aussi. J’ai eu avec mes collègues de Bruxelles des discussions informelles qui n’ont pas permis de rapprocher les points de vue, et la CGB, après de nombreux échanges et la consultation d’experts indépendants, a considéré qu’il n’y avait certes pas de risque avéré de toxicité, mais qu’on ne pouvait pas l’écarter a priori d’un revers de la main.
Certains adversaires des OGM demandent qu’on fasse des expérimentations à deux ans, mais je ne connais personne parmi eux qui ait la moindre idée, contrairement à moi, de ce que représente une expérimentation toxicologique et cancérologique à deux ans : cela veut dire forcer les doses et aussi de sacrifier des milliers d’animaux, sans même être certain qu’il en sortira quelque chose. Mais la recherche est sur de nouvelles pistes pour mettre au point des méthodes plus sensibles d’évaluation de la sécurité sanitaire, non seulement des OGM, mais des aliments en général, les OGM ne présentant pas de caractères particuliers de ce point de vue.
M. le Président : Si l’on ne fait pas d’essais sur les animaux, par quoi remplacer les études de toxicité discrète ? Faudra-t-il s’en passer ? D’autre part, des représentants de l’INSERM36 nous ont dit hier que les meilleures expériences toxicologiques sont celles des pays où l’on consomme des OGM depuis longtemps, hommes et animaux confondus. Est-ce qu’on a fait des recherches approfondies sur ces pays ?
M. Gérard PASCAL : Certaines populations consomment effectivement des OGM depuis longtemps, notamment en Amérique du Nord, mais il n’y a pas d’étude épidémiologique possible, car il n’y a pas de traçabilité : on ne sait pas qui a mangé des OGM et qui n’en a pas mangé. Evidemment, si c’étaient des poisons violents, cela se saurait, mais il peut y avoir des effets discrets, sur lesquels aucune étude épidémiologique n’est possible.
M. le Président : Pourtant, les études statistiques d’épidémiologie montrent que dans certaines régions du monde, certains types de cancers n’existent pas, et les nutritionnistes essaient de relier ces phénomènes à des changements d’habitudes alimentaires.
M. Gérard PASCAL : On sait naturellement définir des types alimentaires, mais la difficulté tient au fait qu’on n’a pas les moyens de savoir qui a consommé des OGM ! L’affaire de la vache folle a montré qu’on n’arrivait pas à tracer l’alimentation animale, même en Europe où l’on a pourtant fait beaucoup d’efforts, à la demande du Comité scientifique de l’alimentation.
M. le Rapporteur : En somme, vous recherchez le risque zéro ?
M. Gérard PASCAL : Pas du tout, je ne crois pas avoir dit ça ! Ce que recherchent les scientifiques, ce n’est pas le risque zéro, auquel personne ne croit : c’est d’améliorer la méthodologie d’évaluation du risque sanitaire, car cela répond à une attente légitime du consommateur. Or, aucun des aliments actuels, à part les aliments irradiés ou éventuellement ceux réchauffés au micro-ondes, n’a fait l’objet d’évaluations sanitaires ou toxicologiques. On les considère comme sûrs parce qu’ils sont consommés de façon traditionnelle, d’ailleurs pas forcément depuis longtemps. Si l’on avait évalué le potentiel allergène du litchi, du kiwi ou des nouveaux fruits exotiques qu’on ne cesse de nous proposer sur les marchés, je ne suis pas sûr qu’on les aurait autorisés... Mais on ne les a pas évalués.
M. François GUILLAUME : On sait qu’il y a des recompositions naturelles de gènes. Qu’est-ce qui vous fait supposer qu’il y a toxicité dans les recompositions artificielles ?
M. Gérard PASCAL : Même dans les recompositions naturelles, il se passe des choses pas forcément recommandables. Les sélections dites classiques se font par des méthodes parfois brutales, il y a des plantes qu’on élimine parce qu’elles ont une drôle d’allure. Cela peut arriver dans n’importe quelle sélection végétale, quand on fait des mutations par irradiation ou par composés mutagènes violents. L’approche est exactement la même. Il y a des filtres successifs. Personne n’a jamais démontré l’existence d’effets pléiotropes, mais on ne peut pas les exclure en théorie. On connaît l’endroit où l’on introduit la nouvelle construction génétique mais on ne la choisit pas. Cela dit, il s’agit le plus souvent d’un endroit non dangereux.
M. le Président : Ceci est un point très important : depuis 1988 on est capable de le savoir.
M. Gérard PASCAL : Oui, et l’on sait que le risque varie selon l’endroit d’introduction. L’effet pléiotrope est théoriquement possible, même s’il n’a jamais été mis en évidence, mais on ne peut pas l’éliminer systématiquement. C’est la même chose pour l’expérimentation animale. J’y suis personnellement opposé, sauf pour les gènes d’intérêt marqueur, parce que je suis persuadé que cela ne donnera jamais rien. Mais la communauté scientifique a admis, en Europe en tout cas, qu’il fallait en faire. En France, il y a eu toute une bagarre sur la question des 28 jours ou des 90 jours. J’ai plaidé pour 28 jours, parce que c’était un moindre mal, et aussi parce que cette durée suffit à mettre en évidence d’éventuels effets toxiques.
C’est ce qu’a montré l’expérience de 1996 sur le colza GT 73, alors soumis pour mise sur le marché à la CGB, laquelle travaillait en liaison avec le Conseil supérieur d’hygiène publique de France. C’était moi qui rapportais le dossier, et il y avait manifestement une plus forte toxicité hépatique et rénale chez les rats du lot nourri aux OGM que chez ceux du lot témoin. Mais l’explication pouvait résider dans les teneurs plus élevées en glucosinolates en raison des méthodes de sélection utilisées aux Etats-Unis, et c’est pourquoi la CGB a demandé à Monsanto de refaire une expérimentation sur 400 rats, en veillant à ce que les teneurs en glucosinolate soient les mêmes dans les deux lots. La différence a disparu, ce qui prouvait que le biais était bien là.
On n’évoque presque jamais cette expérimentation. Il n’y a que deux lignes sur plusieurs milliers de pages, dans le dossier d’accompagnement déposé par Monsanto quand il a représenté le colza GT 73. Mon interprétation personnelle est que Monsanto n’a pas voulu reconnaître qu’il a cédé à un comité d’experts en refaisant une expérimentation, et que les adversaires des OGM ne veulent pas reconnaître qu’il suffit de 28 jours pour mettre en évidence les effets toxiques. Mais ce qu’on recherche, ce ne sont pas ces types d’effets toxiques, car l’éleveur les verra très vite, et la sélection sera abandonnée. Quant au risque d’effet pléiotrope, je ne peux pas l’éliminer totalement.
M. François GUILLAUME : Des risques, il y en a partout. Je le comprends parfaitement, mais ce que cherchent à démontrer les anti-OGM, c’est qu’il n’y a aucun risque dans le système traditionnel et qu’il y en a une multitude dans le système OGM.
M. Gérard PASCAL : Pour l’instant je vous donne ma position en tant que scientifique, en essayant de ne pas la mélanger avec ma position en tant que citoyen, qui n’est pas forcément la même...
Ma mission de scientifique est d’éclairer les décideurs en leur permettant de juger des différents niveaux de risque. Si vous me demandez de classer le risque d’effet pléiotrope sur l’échelle des risques, je vous dirai qu’il est tout en bas de l’échelle. Bernard Chevassus-au-Louis a proposé que l’application du principe de précaution soit fonction de la plausibilité des hypothèses. Cette plausibilité du risque est, selon moi, tout en bas de l’échelle pour les OGM, elle est nettement au-dessus pour la vache folle, et encore au-dessus pour les déséquilibres nutritionnels. Mais il y a beaucoup d’autres éléments à prendre en compte que le jugement scientifique.
M. le Président : Si une telle échelle des risques existait, et pouvait être définie de façon contradictoire par un groupe d’experts scientifiques, cela changerait beaucoup de choses pour les décideurs, qui s’apercevraient ainsi qu’on a surévalué le problème des OGM par rapport à celui des déséquilibres nutritionnels.
M. Gérard PASCAL : Le principe de précaution existe aussi pour les scientifiques : j’aurais tendance à appeler cela « ouvrir son parapluie »... Il faut tout de même, à un moment, prendre des risques. Souvenez-vous de la polémique entre la France et l’Union européenne à propos de la levée de l’embargo sur la viande britannique : à ce moment-là, j’ai pris un risque personnel en essayant de situer le niveau de risque pour aider les décideurs. Il n’y a pas beaucoup de scientifiques qui sont prêts à prendre un tel risque, d’autant que beaucoup gèrent leur carrière à partir de positions de principe, du type « pour » ou « contre »...
M. Gérard DUBRAC : Quelle était la particularité du colza GT 73 ? Et qu’est-il devenu après l’expérimentation ? A-t-il été commercialisé ? Est-il répandu ?
M. Gérard PASCAL : Il me semble que sa particularité était sa résistance au glyphosate. L’expérimentation a conclu à l’absence de toxicité démontrée, le biais tenant, comme je l’ai dit, aux méthodes de sélection utilisées, puisque Monsanto n’avait pas pris garde au croisement de populations à teneurs différentes en glucosinolate. Le dossier a été présenté à nouveau, et il se trouve actuellement dans les circuits de décision européens. Je ne sais pas si la Commission a déjà rendu sa décision, mais si elle l’a fait, c’est tout récemment.
M. André CHASSAIGNE : Vous dites que les OGM n’ont pas, a priori, d’effets biologiques et ne présentent pas de spécificité en termes de risque sanitaire. Mais, si vous ne pouvez évaluer le risque, comment pouvez-vous dire qu’il se situe en bas de l’échelle ? D’autre part, vous avez dit que votre réflexion a évolué. Quelle était donc votre position au départ, et quelle est-elle à l’arrivée ?
M. Gérard PASCAL : Si je place le risque, compte tenu des expérimentations faites, tout en bas de l’échelle, c’est parce qu’il n’y a pas démonstration d’effets toxiques sensibles. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il n’y a pas d’effets toxiques discrets, mais le même problème se pose, j’y insiste, pour tous les aliments, issus d’OGM ou non.
M. le Président : C’est un point très important.
M. Gérard DUBRAC : Absolument.
M. Gérard PASCAL : Il se trouve que j’ai fait dépenser beaucoup d’argent à l’INRA pour des études dont la finalité est de mieux comprendre les relations entre alimentation et santé. Si l’on savait déjà tout sur ce plan pour les aliments courants, j’aurais été à l’origine d’un gaspillage de fonds publics, et cela m’ennuierait beaucoup...
Sur le second point, j’ai dit que j’avais été très séduit par le dossier déposé par les industriels américains des biotechnologies. Mais dans un deuxième temps, j’ai été convaincu que, pour l’allergie par exemple, ce qui était proposé ne permettait pas de prévoir le risque allergène chez l’homme dans 100 % des cas et, surtout, qu’il était dangereux d’aller « pêcher » des gènes dans des sources connues comme allergènes pour l’homme. A cela, les Américains répondaient : « pas de problème, il suffit de démontrer que le gène codant pour une protéine ne code pas pour la protéine allergène de la source ». C’est inexact : toutes les sources allergènes contiennent plusieurs protéines allergènes, jusqu’à une douzaine dans le cas du soja, par exemple. Quand les Japonais ont fait du riz hypoallergénique, ils ont éliminé une ou deux protéines, mais il en restait d’autres. C’est pourquoi il faut éviter de prendre le risque inconsidéré d’aller chercher des gènes dans une source connue comme allergène. On cite toujours la noix du Brésil, où l’on a été chercher un gène codant pour l’albumine 2S, dont les Américains ignoraient à l’époque que c’était la protéine la plus allergène. S’il a fallu deux ans pour publier les résultats de la réunion d’Aussois, c’est parce que l’accord de toutes les parties prenantes était requis, et qu’on a dû se battre sur chaque mot du rapport à propos de ces questions d’allergies.
M. le Rapporteur : Considérez-vous qu’il faille, dans certains cas au moins, dépasser les essais en milieu confiné ?
M. Gérard PASCAL : Bien sûr. Le « riz doré », pour prendre ce seul exemple, est un travail de laboratoire remarquable et qui a un intérêt nutritionnel majeur. Pour l’instant, il ne répond pas au problème de la carence en vitamine A, compte tenu du faible niveau d’expression du bétacarotène. Mais il est en cours d’expérimentation sur le terrain, en vue d’arriver à introduire, dans des variétés à la fois cultivables et acceptables par les populations, la construction génétique mise au point en laboratoire.
M. le Président : Où ces expérimentations ont-elles lieu ?
M. Gérard PASCAL : Aux Philippines, je crois. Le résultat n’est toujours pas sur le marché, car les choses ne sont pas simples. En tout cas, le laboratoire ne suffit pas, il faut sortir sur le terrain.
M. le Rapporteur : Des bactéries présentes dans un aliment issu d’OGM et devenues résistantes à des traitements sanitaires peuvent-elles franchir la barrière intestinale humaine et se maintenir de façon dangereuse dans le corps humain ?
M. Gérard PASCAL : La condition préalable est que le gène de résistance présent dans la plante se transmette à un micro-organisme du sol ou de l’intestin d’un animal ou d’un homme et puisse s’y exprimer. C’est théoriquement possible, même si la probabilité est extrêmement faible. C’est justement pour tenter de l’évaluer que j’avais organisé en 1996, avec mon collègue président du Comité scientifique de l’alimentation animale, à Bruxelles, une réunion de scientifiques venus d’un peu partout, y compris des Etats-Unis. Nous sommes arrivés à la conclusion que la possibilité existait, mais que la probabilité était inférieure à 10–17, soit un événement sur plus de cent millions de milliards.
M. François GUILLAUME : On peut considérer que c’est un risque acceptable...
M. Gérard PASCAL : Il s’agissait, en l’occurrence, du gène de résistance à l’ampicilline, et l’on se focalisait principalement sur ce qui se passe dans le tube digestif de l’homme. Les conclusions des experts étaient que c’était possible mais que, malheureusement, dans la situation actuelle, ce ne serait qu’une goutte d’eau dans la mer, car la moitié de la population a dans son côlon des micro-organismes porteurs de gènes de résistance à l’ampicilline, et que demain les porteurs ne seront pas forcément les mêmes... Cela ne veut pas dire qu’il faille forcément continuer. Certains adversaires de la présence de gènes résistants, comme Pascal Courvalin, ont fini par dire que ce n’était pas « élégant ». J’admets que si l’on peut s’en passer, cela vaut mieux, mais le risque est infinitésimal, alors que la résistance aux antibiotiques constitue, elle, un risque majeur.
M. le Rapporteur : Peut-on prévoir les éventuels risques allergènes des plantes génétiquement modifiées, et la recherche française a-t-elle les moyens humains et financiers d’effectuer les recherches nécessaires ?
M. Gérard PASCAL : Aucun modèle ne permet de prévoir à coup sûr le risque allergène d’un aliment pour l’homme. Les chercheurs travaillent sur des modèles animaux depuis des années, mais sans être encore parvenus à une sécurité absolue. Dans le cadre des consultations FAO-OMS, les Américains ont réussi à convaincre une partie des participants de l’intérêt de la méthode consistant à rechercher des analogies de séquences d’acides aminés entre les protéines nouvelles produites par les PGM, d’une part, et les quelque 700 séquences connues comme allergènes chez l’homme. On examine des alignements de 8 acides aminés, et s’il n’y a pas d’analogie on en conclut que le risque n’est pas important. Cela ne tient pas, car si la chaîne des protéines se replie, il peut y avoir des acides aminés qui se touchent et vont créer un site allergène. Comment prévoir cela ?
Sur le deuxième point, il y a en France, dans les centres hospitaliers universitaires (CHU), à l’INSERM, à l’INRA, des équipes qui travaillent à améliorer l’évaluation du risque allergène, y compris aussi dans des projets européens.
M. le Président : Les choses se présentent de la même façon pour tous les nouveaux aliments.
M. Gérard PASCAL : Tout à fait.
M. le Président : Et c’est pourquoi il faut développer l’allergovigilance. Quand on consomme un nouveau produit venu du bout du monde, il y a un risque allergène. Le docteur Denise-Anne Moneret-Vautrin a montré comment le sésame, mélangé à certaines nouvelles variétés de pain a provoqué des allergies mortelles.
M. Gérard PASCAL : Il faut dire que Mme Moneret-Vautrin, qui dirige le meilleur service d’allergologie alimentaire de France, a connaissance de tous les cas qui se présentent. Le risque existe donc, mais cela ne veut pas dire qu’il soit très fréquent. Reste qu’on ne peut pas l’écarter.
M. François GUILLAUME : Peut-être sommes-nous de moins en moins bien immunisés parce que nous consommons de plus en plus d’aliments quasiment stérilisés. Vous avez dit que vous étiez réservé sur les transgénèses qui permettent d’aller chercher un gène d’un produit allergène pour le mettre sur un produit consommé. Etes-vous également réservé sur les transgénèse d’une même plante ?
M. Gérard PASCAL : Cela paraît moins risqué, le risque n’étant de toute façon pas important. Modifier le gène de la plante pour un ou deux acides aminés seulement peut lui permettre, en changeant le site d’une enzyme, d’acquérir une nouvelle propriété. Plusieurs cas nous ont été proposés. Quand c’est possible, c’est vraiment quelque chose de très séduisant pour un chercheur, et le risque doit être infinitésimal.
M. François GUILLAUME : Pourquoi, aux Etats-Unis, qui sont pourtant très favorables aux OGM entend-on actuellement des critiques selon lesquelles la Food and Drugs Administration est soumise aux lobbies industriels ? C’est pourtant une administration très sévère. Qu’en pensez-vous ?
M. Gérard PASCAL : Je me garderai de me prononcer sur les critiques adressées actuellement à la Food and Drugs Administration... Je dirai seulement que l’approche anglo-saxonne du risque est différente de la nôtre. Je l’ai observé à Bruxelles, et pas seulement à propos des OGM : schématiquement, l’approche des Européens du Nord consiste à dire : « Démontrez-moi qu’il y a un risque et je prendrai des mesures », et celle des Européens du Sud : « Démontrez-moi qu’il n’y a pas de risque ». Mais je suis incapable de démontrer qu’il n’y a pas de risque. Je peux seulement dire, peut-être, que le risque est inférieur à un seuil donné.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Pourquoi l’expérimentation du « riz doré » aux Philippines en est-elle toujours à l’état d’expérimentation ?
Par ailleurs, vous avez dit tout à l’heure que les méthodes de la toxicologie traditionnelle n’étaient pas appropriées à l’évaluation des risques, qu’il s’agisse des OGM ou des aliments en général, mais vous avez dit ensuite qu’il y avait de nouvelles pistes. J’aimerais savoir en quoi elles consistent. J’aimerais aussi savoir si nous avons, en France, suffisamment de toxicologues formés à ce nouveau type de recherches, et si nous avons les financements suffisants.
M. Gérard PASCAL : Cela fait plusieurs mois que je n’ai plus suivi la question du « riz doré ». Peut-être y a-t-il de nouveaux résultats sur le terrain, mais au début de 2004 il n’y avait toujours pas de « riz doré » cultivable à grande échelle et produisant du bétacarotène comme celui produit par Ingo Potrykus dans son laboratoire Ce que j’imagine, c’est que la nouvelle construction génétique n’est pas facile à introduire – à moins que l’on ne soit en train d’essayer de l’améliorer. Actuellement, la quantité de bétacarotène produite par le riz du laboratoire est insuffisante pour permettre une application nutritionnelle, à moins d’en consommer un kilo par jour. Greenpeace a prétendu qu’il fallait trente kilos. C’est évidemment faux, mais c’est tout de même nettement plus de 200 grammes. L’AFSSA a publié un document sur ce point.
M. Gérard DUBRAC : Cela peut signifier qu’il y a une différence entre la variété de laboratoire et la variété cultivée en milieu naturel.
M. Gérard PASCAL : Oui, la variété utilisée en laboratoire n’est pas utilisable sur le terrain. L’expérimentation est en cours depuis des années, et les moyens ne manquent pas : c’est la Fondation Rockefeller qui finance le projet.
M. le Rapporteur : C’est important, car cela plaiderait pour les essais en champ.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Cela peut aussi signifier que le « riz doré » n’apporte rien...
M. Gérard PASCAL : Il ne faut pas oublier que la carence en vitamine A est un vrai fléau, causant de la cécité de centaines de milliers de personnes dans le monde. Et le « riz doré » pourrait être une solution... Les adversaires des OGM disent qu’il y en a d’autres, mais on ne les voit pas venir.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Si, depuis le temps qu’on en parle, le « riz doré » n’est toujours pas cultivé à grande échelle, c’est peut-être parce la réalité n’est pas à la hauteur, des espoirs, malgré l’expérimentation en plein champ.
M. Gérard DUBRAC : Tout de même, si une expérimentation grandeur nature a été lancée, c’est parce que les recherches en laboratoire ont donné des résultats tangibles et intéressants, et qu’on a voulu les reproduire. C’est peut-être l’occasion de faire la preuve qu’il y a une différence entre le milieu confiné et le milieu naturel.
M. Gérard PASCAL : Intéressants mais insuffisants, et donc à améliorer...
Les nouvelles pistes, les nouvelles méthodes auxquelles j’ai fait allusion se fondent sur les progrès fulgurants de la biologie, notamment de la génomique et de la post-génomique. J’ai apporté deux de mes articles, l’un, en cours de publication par l’INRA, rend compte d’un colloque organisé il y a deux ans par la Commission du génie biomoléculaire et la Commission des toxiques en agriculture, l’autre, publié il y a un an, porte sur les perspectives nutritionnelles des OGM en alimentation humaine, sur ce qui est déjà sur le marché ou est en passe d’y être. La conclusion est qu’à ce jour il n’y a pas grand-chose...
M. le Président : Ce sera très intéressant pour le rapport.
M. Gérard PASCAL : Je voudrais parler des progrès de la génomique et de la post-génomique, progrès qui reposent sur deux approches convergentes.
La première approche est l’utilisation des « puces ADN ». On sait maintenant que la consommation d’un aliment est susceptible de modifier l’expression du génome – ou du moins d’un certain nombre de gènes. Reste à interpréter les millions de données. Il y a vingt ans, les biologistes moléculaires nous riaient au nez quand nous autres, nutritionnistes, émettions cette hypothèse, mais ils ont bien dû se rendre à l’évidence ! On peut ainsi comparer la plante parentale et la plante transgénique. On dispose également, désormais, de puces protéiques, où les ARN37 codent les protéines.
La deuxième approche est de type physico-chimique. Notre organisme produit des dérivés, notamment l’urine ou le sang, qui définissent un profil susceptible de se modifier selon l’alimentation ou selon le traitement subi. On a commencé à utiliser cette méthode en double aveugle sur des bovins pour trier, à partir des urines, sur profil analytique en spectrométrie de masse et en RMN38, des animaux en deux groupes : mâles et femelles, ou traités aux hormones et non traités. En recoupant les deux, on espère mettre en évidence des effets, et de fait on a déjà des résultats. L’INRA travaille actuellement sur une pomme de terre transgénique, qui n’est évidemment qu’un outil de laboratoire, sans aucune fin de commercialisation. Il s’agit de tester la pomme de terre témoin et la pomme de terre transgénique sur des animaux et d’observer les variations dans l’expression d’un certain nombre de gènes. Maintenant, sur l’interprétation des effets, est-ce qu’on reste dans les limites de la régulation physiologique, c’est-à-dire de ce qui permet heureusement à notre organisme de s’adapter, ou est-ce qu’on entre dans le domaine de la toxicologie ou de la pathologie ? C’est là que nutrition et toxicologie se recoupent, et j’ai essayé de réunir les chercheurs des deux disciplines à l’INRA. Je ne garantis pas que cela marchera, et si c’est le cas, le procédé ne sera pas standardisé avant cinq ou dix ans. Pourtant il faut s’engager dans cette voie, car c’est une perspective immense, enthousiasmante, qui s’ouvre à la recherche, et qui répond en même temps à une attente légitime du consommateur et du citoyen.
S’agissant des moyens humains en toxicologie, tout dépend de ce qu’on appelle toxicologue. J’étais responsable d’un DEA national de toxicologie alimentaire. J’avais très peu d’étudiants, l’approche était théorique, fondamentale, de très très haut niveau, mais complètement déconnectée de la réalité de la toxicologie réglementaire classique traditionnelle qui n’intéresse pas les chercheurs... En France, en Italie, en Espagne, nous avons une grande différence d’approche par rapport à des pays comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou le Danemark, plus pragmatiques, où les mêmes personnes font parallèlement de la recherche fondamentale d’une part, de l’expertise toxicologique et de l’évaluation d’autre part. Certains ont dit que l’INRA a fait couler la toxicologie française. Pour ma part, j’ai aidé des équipes de l’INSERM, du CNRS à monter des projets, des programmes ont été lancés, mais parmi ceux qui répondent aux appels de candidatures des comités européens, il y a 10 Britanniques ou Hollandais pour un Français : c’est une réalité dont nous devons être conscients.
M. André CHASSAIGNE : D’un côté vous dites que les OGM n’offrent guère de nouvelles perspectives nutritionnelles, et de l’autre que l’alimentation peut avoir une influence sur le génome. Dans ces conditions, le principe de précaution ne devrait-il pas nous conduire à cesser toute alimentation à base d’OGM dans l’attente de ces fameux résultats que vous nous présentez comme si enthousiasmants pour les chercheurs ?
M. Gérard PASCAL : A ce compte-là, il faudrait cesser de s’alimenter tout court... J’ai dit, mais peut-être pas assez clairement, qu’on ne sait pas plus de choses sur les aliments classiques que sur les OGM. Les pessimistes disent que l’alimentation nous tue, et de fait nous allons tous mourir un jour, et les optimistes disent que l’espérance de vie s’accroît grâce à l’alimentation. Je suis plutôt dans le camp des optimistes, mais, je le répète, c’est la même chose pour les aliments courants et pour les PGM.
M. le Président : Les seuils européens actuels correspondent-ils à des exigences de sécurité alimentaire, ou sont-ils le fruit de compromis politiques ? Et, dans le premier cas, faut-il arriver à des seuils plus bas encore que ceux admis pour l’agriculture biologique ou pour les semences ?
Par ailleurs, la réglementation européenne veut que tout produit à base d’OGM soit étiqueté comme tel, même si le composant considéré ne contient plus un début de commencement de trace d’OGM, comme la lécithine qui entre dans la composition du chocolat. Est-ce bien justifié, quand d’un autre côté on nous dit que les enzymes extraites de levures OGM utilisées par l’industrie agroalimentaire ne sont pas étiquetées OGM ? Quand j’ai demandé pourquoi à Bruxelles, on m’a répondu qu’il faudrait alors étiqueter un tiers des produits alimentaires en France !
M. Gérard PASCAL : Les seuils ne sont absolument pas fondés sur des risques sanitaires, que l’on est bien incapable d’évaluer quantitativement. Ils sont le résultat de négociations politiques, dans lesquelles les scientifiques tels que moi ne sont nullement partie prenante. Les sélectionneurs disent que tout, en fin de compte, dépend des espèces, que le niveau de pureté garanti par les semenciers est fonction de l’espèce. Ce que la Commission du génie biomoléculaire a proposé pour les distances d’éloignement découle de l’expérience des semenciers traditionnels, qui savent bien quel niveau de pureté on peut obtenir avec telle ou telle espèce. C’est cela qui me paraît raisonnable, plutôt que de fixer, comme pour les pesticides dans les aliments pour enfants, un taux unique qui est trop élevé pour certaines molécules et trop bas pour d’autres, et qui n’a aucune autre justification que politique et administrative. Cela permet d’édicter une règle, c’est tout.
Il est parfaitement exact aussi que les enzymes provenant d’OGM sont utilisées dans l’industrie alimentaire depuis quinze ans au moins, et que jamais elles n’ont été étiquetées. Je me souviens de la première discussion à ce sujet au sein du Conseil supérieur d’hygiène publique de France : c’était sur la chymosine produite par des levures, des champignons microscopiques ou des bactéries. Depuis, on s’est aperçu que c’était finalement une bonne chose, car la présure extraite de la caillette du veau – veau qui en fait est souvent de la vieille vache – faisait courir un vrai risque d’ESB, et que la chymosine recombinée était préférable à cette présure. Mais on sait aussi qu’il y a des bagarres entre les différents lobbies, entre les éleveurs et les fabricants d’enzymes, et que ça donne lieu à des négociations politiques qui ne reposent sur rien de scientifique.
Je me suis battu dès le départ pour qu’il y ait un étiquetage, pour qu’un jour on puisse faire de l’allergovigilance sur les OGM. On m’a ri au nez, on m’a dit que ce n’était pas possible, que c’était trop compliqué. J’espère qu’on y arrivera, et pas seulement pour les OGM, mais pour l’alimentation en général. C’est en cours, grâce à l’énergie de Mme Moneret-Vautrin, qui l’a fait sans attendre l’appui des pouvoirs publics. J’espère que ceux-ci vont s’y rallier, mais comment faire de l’allergovigilance s’il n’y a pas de traçabilité ? Cela dit, étant donné les quantités, il restera sur les enzymes des fragments d’ADN non codants. Je suis certain que, les méthodes de détection s’améliorant, on trouvera de tout dans tout, des prions dans le lait ou la viande, des résidus de pesticides, ce qui ne voudra pas dire qu’il y a des risques.
M. le Président : Faut-il, selon vous, réglementer des produits comme la lécithine ?
M. Gérard PASCAL : S’il y a des citoyens qui, pour des raisons politiques, sociales ou éthiques, ne veulent pas de produits issus d’OGM, c’est une question qui mérite discussion avec tous les partenaires de la chaîne alimentaire.
M. Pierre COHEN : Si j’entends bien ce que vous dites, on est en bas de l’échelle du risque et on ne peut pas se passer d’essais en champ. Mais on sent que vous aviez beaucoup d’enthousiasme au début et que maintenant vous avez beaucoup de doutes. On sent que vous avez plus de passion pour les nouvelles voies que pour les OGM. Vous dites qu’il n’y a pas de raison a priori de ne pas continuer, mais on sent bien – vous me direz si je me trompe – qu’il y a quelque chose qui vous gêne, compte tenu de ce que vous avez vécu en exerçant vos responsabilités successives. Je pose la question au citoyen que vous êtes : qu’est-ce qui fait qu’il vaut mieux, selon vous, explorer d’autres voies que celle des OGM ?
M. Gérard PASCAL : Vous avez assez bien perçu la difficulté, qui est d’allier le point de vue du scientifique et celui du citoyen. Les OGM posent de multiples problèmes, mais, à mon avis, ce ne sont pas en priorité des problèmes de sécurité sanitaire. Les problèmes d’environnement, pour autant que je puisse en juger, sont déjà plus criants, tout en restant gérables. Ce que je reproche aux adversaires des OGM, c’est de mélanger les genres. Je comprends parfaitement qu’on soit contre les OGM, compte tenu des applications proposées, des relations entre firmes de biotechnologie et agriculteurs, entre pays du Nord et du Sud. Ce sont de vraies questions, mais qui s’adressent au citoyen, pas au scientifique. Ce que je n’accepte pas, c’est que, pour éviter d’avoir à mettre en avant des arguments politiques, on joue sur la peur de la population. Le débat serait plus clair si l’on séparait bien les aspects de la question. Si je milite, je le fais en dehors de mes activités d’expertise ou de recherche. Les amalgames empêchent le vrai débat scientifique.
M. François GUILLAUME : Pourquoi, à votre avis, n’y a-t-il pas de projets européens de recherche sur les OGM, alors que l’Europe produit et consomme des OGM ?
M. Gérard PASCAL : Dans le cinquième programme-cadre dont certains projets sont en cours d’achèvement, la direction générale de la recherche a investi 80 millions d’euros. Je ne connais pas le total pour le sixième programme-cadre, qui a démarré voici plus d’un an, mais je fais partie du comité de pilotage d’un des principaux projets, « Safe food »39, qui vise justement à évaluer la méthodologie, et qui bénéficie de 14,4 millions d’euros. Je suis moins informé sur ce qui est fait dans le domaine de l’environnement mais l’effort accompli en faveur de la sécurité sanitaire et de la traçabilité est très important.
M. le Président : Vous avez dit, dans votre propos liminaire, que vous n’aviez pas souhaité conserver la présidence du conseil scientifique de l’AFSSA. Pourquoi ?
Deuxième question : pensez-vous que la Commission des toxiques en agriculture doive s’inscrire, elle aussi, dans le projet de fusion de la Commission du génie biomoléculaire, de la Commission du génie génétique et du Comité de biovigilance ? Enfin, que va devenir l’AFSSA avec la création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ?
M. Gérard PASCAL : J’ai quitté la présidence du comité scientifique de l’AFSSA parce que les choses avaient mal commencé dès le début. Le comité scientifique ne s’était pas exprimé sur la levée de l’embargo, c’est le comité Dormont qui, bien qu’extérieur à l’AFSSA, a inspiré l’avis négatif du gouvernement français et l’AFSSA était contre la levée de l’embargo. De son côté, le comité directeur de Bruxelles, que je présidais aussi, a donné un avis contraire à l’avis français, et Martin Hirsch m’en a voulu. Après avoir été traité de « patriote français » par les tabloïds britanniques la veille de la réunion, j’ai été qualifié de traître à la patrie par les journaux français à mon retour de Bruxelles... L’AFSSA a voulu apparaître comme le chevalier blanc, seul protecteur du consommateur français contre tous ces agriculteurs qui font n’importe quoi, contre tous ces industriels qui sont des empoisonneurs, contre tous ces chercheurs vendus aux intérêts économiques... J’exagère un peu, bien sûr, mais cela donnait le sentiment que le mal était partout, que tout était dangereux.
Comme je n’ai pas pu, en tant que président du comité scientifique, modifier cette attitude, j’ai préféré ne pas rester. Je continue de travailler comme expert « de base » dans un comité, je reste membre du conseil d’administration, mais si je ne peux plus avoir d’influence en quoi que ce soit sur la politique de l’agence, je me retirerai sur la pointe des pieds. Les positions du type « Démontrez-moi qu’il n’y a pas de risque » sont impossibles à faire passer auprès des chercheurs des autres pays, sans parler de la difficulté qu’il y a à traduire en anglais des avis comportant jusqu’à cinquante considérants !
Pour ces raisons, le lien risque d’être difficile entre l’AFSSA et l’Autorité européenne, mais il faut rester optimiste. Il faudrait que les agences nationales se voient confier la préparation des dossiers en fonction de leurs compétences, car les projets de rapports ont, en général, une forte influence sur la décision finale, mais l’arbitrage, à un moment ou à un autre, incombera à l’Autorité européenne.
Evidemment, il n’est jamais facile de s’en remettre à une instance située « ailleurs », mais cette instance devrait normalement être plus indépendante que les agences nationales, lesquelles sont toutes placées sous la tutelle d’un ministère. Je me suis beaucoup battu pour que l’Autorité ne dépende plus de la Commission, et soit située au cœur du triangle Conseil-Commission-Parlement. Cela dit, les choses ne seront pas simples, car les Etats membres, qui déjà ont le dernier mot en matière de règlements et de directives, feront tout pour ficeler les choses au niveau du conseil d’administration, en y nommant ceux qui continuent d’exercer d’importantes responsabilités nationales, ainsi qu’au Forum consultatif, constitué de représentants des agences nationales.
Il faudrait donner plus d’autonomie et d’indépendance aux comités d’experts. A cet égard, il faut savoir qu’en France, les avis des comités d’experts ne sont pas publiés, contrairement à ce qui se passe à Bruxelles, seuls les avis de l’AFSSA le sont. Ce n’est pas neutre du point de vue de la transparence. En matière de séparation de la gestion du risque et de son évaluation, il y a bel et bien un problème français, qui tient à la rédaction de la loi du 1er juillet 1998 et du décret créant l’AFSSA.
S’agissant du projet de regroupement, je comprends que l’on veuille réunir la Commission du génie génétique et la Commission du génie biomoléculaire, qui interviennent toutes deux dans le domaine scientifique. Quant au Comité de biovigilance, je ne connais pas bien sa mission, mais il me paraît être davantage une instance de consultation, de concertation entre les différents partenaires, qu’une instance scientifique. Il n’est pas bon de mélanger les genres. En outre, si je comprends bien, sa mission serait limitée à l’environnement, ce qui pose la question du sanitaire ? Sur le plan sanitaire, je crois qu’il faut regrouper la Commission des toxiques et l’AFSSA. L’idée a été envisagée lors de la discussion de la loi de 1998, mais certains ont voulu défendre leur pré carré. Cela ne me paraît plus tenable, et sur ce point les adversaires des OGM ont raison d’être très critiques. J’ai écrit dans mon article que c’était la querelle des anciens et des modernes. Certains pensent que les méthodes traditionnelles peuvent répondre à toutes les questions. Pas moi.
M. le Président : Je vous remercie, et vous propose, si vos engagements le permettent, de participer, le 2 février prochain, à notre table ronde contradictoire sur les enjeux sanitaires des OGM.
M. Gérard PASCAL : J’accepte volontiers votre invitation.
Audition de M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS,
président du Muséum national d’histoire naturelle,
vice-président de la Commission du génie biomoléculaire (CGB)
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 décembre 2004)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Monsieur Chevassus-au-Louis, nous vous remercions d’avoir accepté de répondre à l’invitation de notre mission. Vous êtes aujourd’hui président du Muséum national d’histoire naturelle et vice-président de la Commission du génie biomoléculaire (CGB), après avoir présidé aux destinées de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Vous vous êtes beaucoup intéressé à la question des OGM et avez été auditionné chaque fois que le Parlement s’est penché sur le sujet, notamment à l’occasion de la conférence de citoyens de 1998. C’est donc avec beaucoup d’intérêt que nous vous écoutons.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Le groupe de concertation du Commissariat général du Plan avait rédigé un rapport en 2001, sur les conclusions duquel je me propose de faire le point, en examinant notamment dans quelle mesure elles ont été confortées depuis trois ans ou méritent, au contraire, d’être révisées.
Je précise que je parle ici essentiellement des OGM utilisés dans l’agriculture et destinés à l’alimentation.
Le groupe de concertation avait cru pouvoir dégager trois enseignements. Le premier était que les questions suscitées par les OGM n’étaient pas liées à leurs propriétés intrinsèques, autrement dit, que l’amélioration des conditions techniques d’utilisation des OGM n’était sans doute pas une piste très fructueuse. Le deuxième était que le débat s’expliquait en grande partie par le fait que les OGM étaient devenus un « totem fédérateur », c’est-à-dire qu’ils regroupaient, en les portant au plan symbolique, des questions très différentes. Le troisième était que la crise des OGM n’était pas conjoncturelle : elle était une première illustration des nouvelles conditions dans lesquelles s’inscrivent les innovations durables de notre société, et devait être ainsi l’occasion d’inventer de nouvelles procédures d’innovation applicables dans d’autres domaines. Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Sur le premier point, notre analyse s’est trouvée largement confortée par l’évolution que l’on constate depuis trois ans. L’espace du refus, ou du moins l’espace du débat, s’est étendu à d’autres objets : les hybrides F1, les hybrides conventionnels, les polyploïdes, et même la sélection conventionnelle. Il serait donc naïf d’imaginer qu’un jour, des « OGM parfaits » pourraient avoir des caractéristiques intrinsèques susceptibles de les exonérer des différentes critiques qui leur sont adressées.
Deuxièmement, nous avions estimé que les OGM apparaissaient comme le symbole d’un mode de production agricole productiviste et mondialisé, que certains considèrent comme néfaste ; comme le symbole d’une dépendance croissante des agriculteurs, dans un contexte marqué par des concentrations industrielles en amont ou en aval de leur activité ; comme le symbole d’un nouveau mode d’appropriation du vivant ; comme le symbole, enfin, d’un mode d’innovation que l’on peut considérer comme technocratique, imposé et insuffisamment débattu au sein de la société. Sur ces différents aspects, comment les choses ont-elles évolué depuis trois ans ?
On peut dire que des progrès ont été faits dans le domaine de l’information du citoyen. L’idée que le consommateur a le droit de savoir et le droit de choisir s’est imposée et a abouti à une obligation d’étiquetage, à la définition de seuils. On a également progressé en éliminant le risque juridique de dissémination involontaire. Contrairement à ce qui a pu se produire en Amérique du Nord, un agriculteur français dont les semences auraient été contaminées par des plantes OGM ne pourrait être poursuivi pour recel de semences. Par contre, on n’a pas beaucoup avancé sur la question du mode d’appropriation. On pourrait certes se demander pourquoi l’appropriation du vivant par brevet devrait être écartée, alors qu’on considère la protection par brevet comme légitime quand il s’agit de molécules chimiques ou de produits pharmaceutiques. Il reste que c’est une réalité : les Français considèrent que le vivant n’est pas justiciable du même mode d’appropriation que l’inerte. Il faut trouver un outil juridique qui permette de protéger le travail de recherche tout en tenant compte de cette conception du vivant. Il y a là un chantier juridique qui n’a pas beaucoup avancé. De même, on n’a guère progressé du point de vue de l’image des OGM comme outil du productivisme et de la mondialisation. Cette image est due au fait que les grands groupes mondiaux se concentrent sur les OGM et vont évidemment continuer à le faire dans les années qui viennent. Seule une politique publique s’intéressant à des plantes orphelines pourrait atténuer cette image. Le projet de l’INRA sur le porte-greffe de la vigne était un bon exemple montrant que la recherche sur les OGM pouvait s’attaquer à des questions dont les grands groupes se désintéressent. Mais l’expérience n’a pas pu être conduite jusqu’au bout, alors que peu d’expériences du même genre existent, et il ne faut pas attendre des grands obtenteurs privés qu’ils s’y intéressent de près : 50 % du chiffre d’affaires des semenciers se fait sur le maïs.
Au total, on n’a pas vraiment déshabillé le totem, de sorte que des gens continuent à danser autour de lui, n’en ayant pas trouvé d’autres aussi intéressants, même si le Gaucho a été, récemment, un autre totem, qui a d’ailleurs fait l’objet de débats très similaires.
La troisième conclusion du groupe de concertation était qu’il fallait réfléchir aux nouvelles conditions d’une innovation appropriée, c’est-à-dire à la fois conforme à son objectif et acceptée. Nous avions en particulier insisté sur le fait que nous étions dans une situation d’incertitude scientifique durable, et que l’espoir de démontrer un risque zéro était une utopie. Depuis, beaucoup d’appels d’offres ont été lancés. Les instituts techniques, le Centre national de recherche scientifique (CNRS), l’INRA ont travaillé. Le bilan de ces travaux ne fait que conforter ma position : il est illusoire que les scientifiques mettent fin au débat en démontrant le risque zéro.
C’est pourquoi nous avions proposé de compléter l’évaluation du risque par le développement des outils de biovigilance. Les choses avancent sur ce point. Les ministères de l’agriculture et de l’environnement réfléchissent aux moyens d’organiser une surveillance biologique du territoire. Cela ne sera pas facile, mais le mouvement est amorcé.
Nous avions également proposé de documenter les bénéfices. Il faut aller de l’avant, mais avec réalisme. Il faut évaluer les bénéfices de manière scientifique, aussi rigoureusement que l’on mesure les risques. Mais ne croyons pas qu’une évaluation des bénéfices sera moins conflictuelle qu’une évaluation des risques. La balance entre risques et bénéfices fera toujours l’objet d’un débat.
Reste enfin la fameuse question des risques sériels, qui se manifestent avec une longue latence, et à un moment où il est difficile d’identifier les responsables. Quoi qu’on pense de la probabilité de tels risques, la question de la prise en charge des dommages éventuels se pose, et demeure comme une épée de Damoclès. On n’a guère progressé dans ce domaine.
La conclusion de cet exposé introductif est la même que celle du rapport du Commissariat du Plan de 2001. D’une part, il ne faut pas surestimer l’intérêt à court terme des OGM. Pour ce qui est de leur utilité, nous avons le temps d’y réfléchir, car la compétitivité des agriculteurs français dépend de toute une série de facteurs qui ne relèvent pas tous, tant s’en faut, de la performance technique. Je pense par exemple au cours du dollar. Mais d’autre part, il ne faut pas non plus sous-estimer les enjeux à long terme. Si la France veut continuer à produire une partie importante de son alimentation, et si elle veut le faire selon un modèle agricole et alimentaire qui lui soit propre, elle ne pourra pas ignorer les biotechnologies, qui, d’ici vingt ans, seront un outil majeur de la sélection variétale. A l’heure où les vrais/faux OGM se développent, c’est-à-dire des méthodes qui n’entrent pas dans le cadre juridique des OGM mais qui en ont les propriétés, il faut se préparer à mettre en place des conditions d’innovation concernant l’ensemble des obtentions destinées à l’agriculture et l’alimentation, quel que soit leur mode de production.
M. le Rapporteur : Pensez-vous que les Européens, et notamment les Français, ont un retard irrémédiable par rapport aux Américains ? Est-il encore temps de renverser la vapeur ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Il faut distinguer les aspects scientifiques des autres aspects, en particulier juridiques.
Sur le plan scientifique, je pense que les OGM de demain vont essentiellement puiser dans les recherches fondamentales d’aujourd’hui. Il ne me semble pas que la France et l’Europe soient en train de prendre un retard préoccupant, à condition, bien sûr, que l’on puisse tester un certain nombre d’hypothèses et de créations. Cela pose le problème des brevets. Sur ce point, la France et l’Europe risquent de prendre un retard important en raison du verrouillage de leurs propres innovations par les brevets déposés ailleurs. Ce mode de protection de l’innovation peut donc constituer un handicap sérieux.
M. le Président : Beaucoup de personnes que nous avons auditionnées nous ont dit que les controverses sur les OGM avaient eu un effet négatif sur l’attrait des métiers de la recherche pour les jeunes. Qu’en pensez-vous ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : On ne saurait nier, en effet, que beaucoup de scientifiques, jeunes ou moins jeunes, ont été déstabilisés par un débat au cours duquel ils ont eu le sentiment que leur légitimité était contestée ; je parle non seulement des juniors mais également des seniors. Mais je ne crois pas vraiment à une fracture entre le monde de la science et la société.
M. le Rapporteur : Ne pensez-vous pas qu’il serait utile de créer un centre d’information sur les OGM, sous le contrôle de l’Etat, destiné à divulguer une information neutre et objective ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Faites une recherche sur l’Internet, via Google par exemple : en tapant « OGM », vous serez renvoyé à environ 700 000 pages francophones. Et un certain nombre de sites publics français sont assez bien documentés.
M. le Rapporteur : Certes, mais le problème est que les chercheurs sont souvent de piètres communicateurs.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Il me semble que différents ministères
– consommation, recherche, agriculture – ont fait un effort d’information louable, notamment sur l’Internet.
M. le Rapporteur : Il n’empêche qu’actuellement, la population ne reçoit pas une information objective, et notamment pas à travers les médias. Ceux-ci ne devraient-ils pas pouvoir s’appuyer sur des données précises ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : J’ai vécu la crise de la vache folle, au cours de laquelle il était difficile aux journalistes de donner une information précise. En ce qui concerne les OGM, un journaliste qui veut faire un travail sérieux dispose déjà de beaucoup d’outils.
M. le Rapporteur : On n’a pas l’impression, cependant, que l’information donnée par les médias soit totalement objective.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Sur un sujet polémique, une personne qui prétend à l’objectivité a peu de chances d’être reconnue comme telle. Une équipe de télévision est venue me voir en me disant qu’elle voulait faire une « émission objective ». Elle n’a pas été considérée comme telle par ceux qui ont constaté qu’elle n’allait pas dans leur sens. De même, le rapport du Commissariat du Plan se voulait objectif : il n’a pas été considéré comme tel.
M. le Président : Vous avez dit tout à l’heure qu’il importait de pouvoir procéder à des tests sur les innovations. L’expérimentation en plein champ est-elle nécessaire ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Sur ce sujet, des personnes intellectuellement honnêtes font preuve d’une certaine incompréhension. Beaucoup ont du mal à admettre qu’au XXIe siècle il soit encore nécessaire, pour savoir si une plante a un intérêt agronomique, de la planter en plein champ et d’observer son comportement. Ils pensent très sincèrement que c’est une ineptie et soupçonnent les chercheurs de vouloir imposer les OGM. Si des simulations informatiques sont utilisées dans d’autres domaines de la recherche, ils ne voient pas pourquoi il n’en serait pas de même dans la recherche agronomique. La réalité de l’agriculture, et même du jardinage, n’est pas forcément connue de tous.
La vérité est que les expérimentations en plein champ sont indispensables. Par exemple, les essais multilocaux sur les plantes résistantes aux herbicides donnent des résultats différents selon les pratiques agricoles ou les climats, or rien n’est pire que d’avoir une résistance approximative Je serais extrêmement critique si quelqu’un demandait l’autorisation de cultiver une plante OGM sans avoir procédé à des essais agronomiques. Il serait hors de question que la CGB donne un avis favorable à la culture d’une plante OGM qui n’aurait fait l’objet que d’expériences en serre.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Si nos concitoyens sont inquiets, tout en étant favorables à la recherche, c’est en raison d’une information insuffisante, voire d’une désinformation sur les OGM. Le problème des essais en plein champ, c’est la pollinisation. Les agriculteurs biologiques se posent à ce sujet de multiples questions.
Quels progrès ont été faits ces dernières années, qui pourraient apporter une réponse aux interrogations des détracteurs des OGM ? Quelle certitude a-t-on en ce qui concerne l’impact sur l’environnement ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Pour ce qui est de la dissémination à quelques dizaines ou centaines de mètres, les courbes de dispersion sont bien connues, au moins pour les plantes les plus classiques, maïs, colza, etc. En ce qui concerne, par contre, la dissémination à longue distance, on peut simplement constater que le risque zéro n’existe pas.
Les recherches, notamment celles menées au moyen du logiciel GENESYS, ont montré que le taux de contamination d’un ensemble de parcelles varie fortement en fonction des pratiques agricoles. La solution ne sera pas technique : elle est à rechercher du côté des pratiques.
Cela m’amène à la question du taux de dissémination que l’on est prêt à tolérer pour les produits non-OGM. Comme je l’ai dit en d’autres occasions, en particulier au Conseil national de la consommation, il n’existe aucune base objective permettant de fixer un taux de tolérance de présence fortuite d’OGM. Dès lors qu’un OGM est autorisé, ce n’est pas aux scientifiques de dire dans quelles proportions on peut accepter qu’il soit présent dans une production non-OGM. C’est un peu comme si l’on demandait combien de gouttes de vin de Bordeaux on peut tolérer dans un vin de Bourgogne du fait du mauvais rinçage des cuves. Aucune réponse ne serait plus légitime qu’une autre. Tout ce que les scientifiques peuvent évaluer, c’est ce que coûtera le contrôle en fonction du taux que l’on aura fixé. Plus le taux sera bas, plus le contrôle sera coûteux, et plus on risque d’éliminer les petits producteurs semenciers, qui ne sont pas forcément capables de répondre à des exigences fortes. C’est un phénomène classique : l’escalade dans les normes exigées, et elles le sont souvent par les citoyens, contribue à la concentration industrielle d’un secteur donné. C’est un effet pervers qu’il faut avoir présent à l’esprit.
M. François GUILLAUME : C’est très important !
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : J’y insiste : aucune donnée scientifique ne peut justifier un taux de tolérance donné. Si le taux de 0,9 % a été retenu, c’est uniquement parce que nous comptons dans un système décimal : le chiffre de 1 % est apparu trop important, et les responsables politiques se sont dit qu’il fallait fixer le seuil à un peu moins de 1 %, donc à 0,9 %. D’autre part, ce chiffre n’a rien à voir avec un risque de toxicité. Je ne connais aucun produit dans lequel on tolérerait la présence d’un composant considéré comme dangereux à hauteur de 0,9 % !
Il faut ajouter que l’agriculture biologique est passée d’un seul coup d’une obligation de moyens –« nous certifions que nous n’utilisons pas de semences OGM » – à une obligation de résultat – « il n’y a aucune trace d’OGM dans nos produits ». Or il est impossible techniquement de répondre à une obligation de résultat quand il est question d’atteindre un taux zéro. Une bière étiquetée « sans alcool » est une bière qui contient moins de 1 % d’alcool
– comme le précise d’ailleurs l’étiquette –, mais non pas 0 %. De même, un pain « sans sel » ne se définit par une absence totale de sel.
L’agriculture biologique – qui représente à peu près 3 % de l’agriculture nationale – avait envisagé de se protéger en garantissant un rayon de 5 kms environ autour des parcelles biologiques. Les statistiques ont montré qu’une telle mesure interdirait toute culture d’OGM sur l’ensemble du territoire.
M. Pierre COHEN : Vous n’êtes pas très inquiet quant à l’éventualité d’un retard important du point de vue scientifique. J’observe néanmoins qu’un certain nombre de jeunes chercheurs se détournent du champ de recherche des OGM.
D’autre part, je voudrais revenir à la question de la propriété intellectuelle. Selon vous, si nous risquons de prendre un retard important, c’est d’abord en raison des brevets. Est-ce notre système qui doit être remis en cause, ou bien plutôt le système en vigueur dans d’autres pays ? Ne serions-nous pas fondés à adopter une attitude offensive dans ce domaine ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Il est possible que vous ayez entendu des personnes plus inquiètes que moi quant au risque d’un retard scientifique important. Il vous appartient de faire la synthèse des avis que vous recueillez.
En ce qui concerne la question de la propriété, nous pouvons en effet être offensifs. Mais pour cela, il ne faut pas exagérer le questionnement éthique sur le brevetage du vivant. Je crois peu à la portée de ce questionnement, même si l’on peut y faire référence. Un certain nombre d’économistes soulignent que trop de protection tue l’innovation, et que des systèmes de protection plus ouverts que celui du brevet, comme le certificat d’obtention végétal, sont préférables, même d’un point de vue strictement économique. C’est, d’ailleurs, cette logique qui se développe pour les logiciels libres en informatique.
M. le Rapporteur : Le certificat d’obtention végétale est-il uniquement français et européen, ou est-il international ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : De mémoire, la convention de Paris a dû être signée par une soixantaine de pays, donc par des pays non européens. L’idée est qu’il faut inventer des formes de propriété intellectuelle qui ne verrouillent pas l’accès à l’innovation. Certains affirment que le brevet est le dernier avatar de la production de produits manufacturés. Dans la même logique, si nous voulons protéger des innovations fondées essentiellement sur de l’information et de la connaissance – et c’est bien ce que sont, au départ, la création variétale adaptée aux besoins de demain –, il faut défendre au niveau mondial une forme de propriété intellectuelle plus ouverte. Le combat ne me semble pas perdu.
M. Pierre COHEN : Je suis totalement opposé à la notion de brevet du vivant, qui peut donner lieu à bien des dérives.
Vous pensez qu’il faut s’orienter vers une forme de propriété qui s’apparente plutôt à la notion de droit d’auteur. En informatique, c’est la notion de « logiciel libre » qui s’en approche le plus. Comment voyez-vous les choses dans le domaine du vivant ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Il faut d’abord éviter que se développent des stratégies de protection par des moyens techniques, telles que ces semences qu’il n’est pas possible de semer une deuxième fois. Ces stratégies risquent d’être coûteuses et inappropriées, notamment quand elles nuisent à la diversité. Ainsi, en Afrique, l’introduction de semences verrouillées empêche la poursuite des échanges entre semences et variétés de pays, alors que c’est un élément important de conservation de la biodiversité.
Le système de protection juridique le plus adapté est déjà en germe dans le certificat d’obtention végétale. Une semence ayant été créée, elle est protégée comme un droit d’auteur : il est interdit de la plagier. Mais il n’est pas interdit, à partir de cette création, de procéder à une innovation, laquelle peut, à son tour, être le point de départ d’une autre innovation. Ce système concilie la nécessité de protéger les inventions et de rémunérer leurs inventeurs et celle de permettre au plus grand nombre possible d’acteurs de participer au jeu de l’innovation. C’est un système de progrès par émulation.
M. le Président : Le Parlement a récemment adopté une loi aux termes de laquelle il apparaît, bien que d’une manière insuffisamment claire selon moi, qu’il n’y a pas de brevetabilité du vivant. On n’a pas le droit de breveter un gène en tant que tel mais on peut breveter un couple gène/fonction. Nous sommes en litige avec les Américains, car ceux-ci considèrent que la découverte de la fonction d’un gène implique un droit dérivé sur d’autres fonctions que ce gène pourrait avoir.
Nous avons associé le système du certificat d’obtention végétale et celui du brevet. C’est pourquoi je pense que la législation n’est pas très claire. Il faudrait, à mon avis, travailler à nouveau sur ce sujet au niveau européen. Car le certificat d’obtention végétale était un très bon système : il n’interdisait pas la recherche. Il faut clairement affirmer que le droit de propriété ne saurait être le droit de freiner l’innovation.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : J’ajoute qu’il ne faut pas croire que l’on aura accès, d’une part, à une variété incluant le gène en question, et d’autre part à la même variété sans le gène. Très rapidement, les fonds génétiques n’incorporant pas ce gène ne seront plus accessibles, à moins de retourner aux ressources génétiques initiales, ce qui revient à repartir du point où l’on était il y a quarante ans. En clair, les fonds génétiques performants, dès lors qu’ils incluront un gène breveté, seront de facto inaccessibles. Le blocage de l’innovation par ce système de verrouillage est une réalité.
Mme PERRIN-GAILLARD : Je voudrais revenir à la question des essais en plein champ. Tout d’abord, les objectifs poursuivis peuvent être très différents. Il peut s’agir de produire un insecticide, de produire un médicament, ou de produire une protéine quelconque susceptible d’améliorer la santé humaine. Selon les cas, les conséquences peuvent être totalement différentes. Ne pensez-vous pas que le public devrait être informé sur les objectifs poursuivis ?
Par ailleurs, il y a des décennies, des chercheurs très sûrs d’eux nous disaient qu’on ne pourrait jamais se passer de l’expérimentation animale. Or, les progrès technologiques ont permis de s’en passer dans certains cas, et même dans la majorité des cas. De façon analogue, n’est-il pas envisageable de mettre au point, au moins pour certaines molécules, des méthodes de recherche autres que l’expérimentation en plein champ ?
Enfin, en tant que président du Muséum d’histoire naturelle, vous constatez la réduction de la biodiversité. Ne pensez-vous pas que les plantes génétiquement modifiées peuvent présenter un danger de ce point de vue ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Je crois comme vous qu’il est bon de sortir des débats de portée générale, et de raisonner concrètement sur des cas précis. Cela dit, il ne faut pas croire que les questions précises peuvent facilement recevoir des réponses tranchées et définitives. Par exemple, les champs de maïs ne sont pas, actuellement, des modèles de biodiversité, et ce pour une raison simple : le maïs est une plante tropicale peu compétitive par rapport à la flore de nos régions, de sorte que sans herbicides il est tout simplement impossible de la cultiver. La question qu’il faut se poser est de savoir si le maïs actuellement cultivé est plus satisfaisant que telle variété de maïs OGM. La réponse est moins évidente qu’on pourrait le croire. Il n’y a pas lieu de diaboliser a priori le maïs OGM. Inversement, il est très possible que certains insecticides chimiques aient un impact moins nocif sur l’environnement que certaines variétés OGM. Les chimistes sont aussi astucieux que les biologistes. Il y a une sorte de « match » qui fait que, dans certains cas, la solution OGM est préférable à celle du produit phytosanitaire et des cas où c’est l’inverse.
De même, certains risques supposés des OGM peuvent aussi bien se manifester dans l’hybridation classique. On dit toujours qu’un gène introduit dans un génome peut s’exprimer de manière très inattendue. Or, à partir de deux espèces de pomme de terre, on peut créer, par des moyens conventionnels, un hybride contenant un gène qui s’exprime par un produit toxique, alors qu’il ne s’exprimait dans aucune des deux espèces de départ.
J’ajoute qu’il est indispensable de mettre au point des instruments de mesure de la biodiversité. Des recherches sont faites dans ce sens, mais elles sont notoirement insuffisantes dans notre pays.
M. le Rapporteur : Peut-on dire que les risques sont moindres avec une variété OGM de laquelle on a ôté un gène qu’avec une variété à laquelle on a au contraire ajouté un gène ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Là encore, il n’y a pas de réponse tranchée. Prenons le cas d’un gène qui est récepteur à un virus. Si on l’ôte, le virus ne trouve pas de quoi s’accrocher sur la surface de la cellule. On a ainsi créé une plante résistante à ce virus. Il est possible que, par dissémination, les plantes voisines deviennent toutes résistantes au même virus. Le modèle de dissémination sera à peu près le même que pour un gène qu’on aura ajouté, sous réserve de savoir s’il s’agit d’un gène récessif ou dominant.
M. le Président : Vous avez parlé tout à l’heure des « vrais/faux » OGM. Comment les définissez-vous ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Une plante est inscrite au catalogue européen. On fait un tapis cellulaire à grande échelle, sur lequel on applique un herbicide. Et on constate l’apparition de cellules. A partir de ces cellules, on peut régénérer une plante entière. On obtient ainsi une plante résistant à un herbicide total. Légalement, cette plante est conventionnelle : elle peut être inscrite au catalogue européen sans nécessiter une autorisation de la CGB. Cela revient à faire une sélection de mutants spontanés.
M. le Président : Je reviens un instant à la question des seuils. Je voudrais savoir quand le « zéro OGM » a été ajouté au cahier des charges de l’agriculture biologique. Et pensez-vous que cela s’impose ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Au tout début, la question de la compatibilité entre les OGM et l’agriculture biologique était posée de manière ouverte. Aux Etats-Unis, il était même question que l’agriculture biologique puisse utiliser des OGM, justement pour réduire les quantités de certains intrants. Je ne sais pas au juste quand a eu lieu le basculement. Je sais que la question était déjà chaudement débattue à l’époque où le Commissariat du Plan s’est penché sur les OGM.
Cela dit, l’agriculture biologique n’est qu’un exemple du processus de segmentation par lequel nous voyons naître une agriculture plurielle, avec, entre autres, l’agriculture raisonnée, l’agriculture de précision, etc. Cela pose, me semble-t-il, la question de la distinction entre ce que la puissance publique doit garantir à ces différentes formes d’agriculture et ce qu’elles doivent prendre elles-mêmes en charge. Par exemple, l’Etat peut décider de garantir que les filières qui se revendiquent comme non-OGM ne subiront pas une contamination supérieure à 0,9 %. A partir de là, les agriculteurs peuvent aller plus loin s’ils le souhaitent, en prenant l’engagement de vendre des produits contenant, par exemple, moins de 0,1 % d’OGM, notamment s’ils pensent tirer profit de ce label. Dans ce cas, je pense qu’il leur appartient de se donner les moyens de satisfaire les exigences supplémentaires qu’ils s’imposent à eux-mêmes. Il ne faudrait pas que l’Etat soit mis dans la situation d’avoir à garantir le respect d’engagements qui ont été pris unilatéralement, sans concertation, par des acteurs privés.
M. le Président : Monsieur Chevassus-au-Louis, nous vous remercions de l’éclairage que vous nous avez apporté. Nous aurons sans doute l’occasion de vous entendre à nouveau dans le cadre des tables rondes que nous organiserons prochainement.
Table ronde regroupant des représentants
de semenciers et de producteurs agricoles
(extrait du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2005)
• Confédération française des semenciers (CFS)
• Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS)
• Union des Industries de la Protection des Plantes (UIPP)
La CFS, le GNIS et l’UIPP constituent une plateforme représentée par
M. Philippe GRACIEN, directeur général du GNIS
• Association générale des producteurs de maïs (AGPM), représentée par M. Bernard DELSUC, vice-président
• Institut technique de la betterave industrielle (ITB), représenté par M. Marc RICHARD-MOLARD, directeur technique
• Monsanto Agriculture France SAS, représentée par M. Stéphane PASTEAU, directeur scientifique chargé des relations institutionnelles et industrielles
• La Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux (FOP), représentée par M. Xavier BEULIN, président
• Limagrain, représentée par M. Daniel CHÉRON, directeur général adjoint de Limagrain et président du comité exécutif de Biogemma
• Pioneer / DuPont, représentée par Mme Maddy CAMBOLIVE, chargée des affaires juridiques européennes pour les OGM
• Coop. de France, représentée par M. Christian PEES, vice-président de Coop. de France et président d’Euralis
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence. Cette table ronde, ouverte à la presse, a pour but d’interroger les semenciers et les producteurs agricoles en abordant successivement plusieurs thèmes : l’évaluation des risques et avantages des OGM ainsi que la réglementation et les procédures de contrôle.
Durant les mois de novembre et décembre, la mission a procédé à une série d’auditions privées qui nous ont permis d’entendre nombre de personnalités d’origine très diverses. Aujourd’hui commence un cycle de tables rondes rassemblant les représentants des divers secteurs, dont le vôtre, concernés par les OGM. Viendra ensuite, une nouvelle série de tables rondes organisées suivant le principe des expertises publiques et contradictoires sur des thèmes spécifiques.
M. Philippe GRACIEN : Je représente ici trois organisations du secteur d’activité des semences et de la protection des plantes : la Confédération française des semenciers (CFS), qui regroupe l’ensemble des fédérations syndicales des entreprises semencières françaises, le Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS), qui réunit tous les acteurs économiques du secteur – entreprises, agriculteurs multiplicateurs et utilisateurs et l’Union des industries de la protection des plantes (UIPP), chambre syndicale des fabricants de produits de protection des plantes.
Le dossier des biotechnologies végétales est fondamental pour un secteur comme le nôtre, qui repose sur l’innovation. Le secteur français des semences – un des plus performants au monde – pèse 1,9 milliard d’euros de chiffres d’affaires, dont un tiers est réalisé à l’export, dégageant un excédent commercial structurel de 230 millions d’euros. La France est le deuxième producteur semencier au monde et le premier producteur européen. Soixante-cinq groupes ou entreprises s’y consacrent à la sélection des plantes. La recherche représente une part fondamentale de leur activité et plus de 10 % en moyenne de leur chiffre d’affaires. Le secteur production rassemble quant à lui 200 entreprises qui travaillent avec 26 000 agriculteurs multiplicateurs. Au total, ce secteur activité emploie directement 8 600 personnes, dont 2 000 dans la recherche.
Nous avons relevé avec satisfaction que votre mission d’information avait pour objet de préparer la transposition en droit français de la directive 2001/18/CE. Nous attendons beaucoup de vos travaux en espérant qu’ils permettront de mettre en place un cadre de travail propice au développement des biotechnologies. Les multiples travaux et missions d’information parlementaires engagées – ainsi le rapport dit des « 4 Sages », dont vous faisiez partie, M. le Président – n’avaient jusqu’à présent jamais abouti, malgré la qualité de leurs recommandations, à des décisions concrètes. Souhaitons qu’il en aille différemment cette fois-ci. L’avenir de la recherche française en dépend.
La France et l’Europe se sont d’ores et déjà dotées d’une réglementation très complète, et parfaitement légitime, en matière de mise sur le marché des plantes génétiquement modifiées, que le Gouvernement s’apprête à compléter par le texte actuellement en préparation. Souhaitons seulement que ces conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de l’évaluation préalable ou des conditions de mise en œuvre de l’expertise publique, permettent de rassurer l’opinion publique, sans pour autant pénaliser à l’excès ou décourager les entreprises dans le développement de leurs produits, très attendus par l’agriculture française et européenne. Chacun s’accorde sur le fait que le développement des OGM doit respecter la liberté de choix du consommateur. Encore faut-il créer au préalable les conditions de la liberté de choix du producteur agricole, si l’on veut que le consommateur soit en mesure de choisir librement entre différents produits.
N’oublions pas, enfin, que les biotechnologies végétales ne se limitent pas au maïs, même si cette plante est seule, pour l’instant, à bénéficier d’autorisations en Europe. Elles englobent l’ensemble des recherches sur l’ensemble des plantes, parmi lesquelles on trouve nombre de projets bien avancés et de réalisations concrètes déterminantes pour l’avenir de l’agriculture française, notamment pour ce qui touche à la betterave et au colza.
M. Bernard DELSUC : Je suis également, et surtout, agriculteur. Je produis, dans mon exploitation de Gaillac, du maïs – et singulièrement du maïs de semence. J’ai ainsi pu, au fil des années, suivre la profonde évolution de notre agriculture, qui a reposé sur quatre éléments fondamentaux : l’agronomie, la mécanisation, la maîtrise de la chimie pour la protection des plantes et la fertilisation, et la génétique, qui nous auront permis de progresser sur le plan tant des volumes que de la qualité et des conditions de production, et donc de répondre à la demande de la société : améliorer l’acte de production.
Or deux, au moins, de ces éléments sont aujourd’hui fortement discutés, pour ne pas dire remis en cause : la protection des plantes par la chimie et la génétique. Si le rôle prioritaire de l’agriculture devait être ramené au simple entretien des paysages et non plus à l’acte de production, cela pourrait se concevoir et l’on pourrait chercher à moins les utiliser. Mais si tel n’est pas le cas, la recherche génétique doit, à l’évidence, se poursuivre afin de nous permettre de progresser en trouvant des solutions qui n’existent pas encore : ainsi en est-il pour Diabrotica, un parasite du maïs, récemment arrivé en France, et contre lequel nous n’avons pas d’autre moyen de lutte que les biotechnologies. On sait également que certains OGM permettent de réduire fortement le recours à la phytopharmacie et, par là même, de répondre à une autre demande forte de la société.
Les biotechnologies sont donc un élément déterminant pour l’avenir du paysage agricole français. Il faut, bien évidemment, s’attacher à répondre au mieux aux demandes de la société, pourvu qu’elles soient raisonnables. L’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) travaille à satisfaire les exigences du consommateur et à lui donner le choix entre les produits génétiquement modifiés et les produits traditionnels en cherchant, dans un cas comme dans l’autre, les méthodes les plus efficaces. A cet égard, la transgénèse apparaît comme un outil indispensable si nous voulons maintenir une agriculture performante et compétitive par rapport à nos concurrents.
M. Marc RICHARD-MOLARD : Je représente ici la filière de la betterave à sucre, qui emploie 50 000 personnes en France et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 3 milliards d’euros. Nous sommes une filière très performante. La betterave française est de loin la plante la plus efficace au monde. Ce résultat a été acquis par des progrès techniques liés à l’amélioration génétique des variétés cultivées. La réforme de l’Organisation commune du marché du sucre (OCM), qui se mettra en place l’année prochaine, s’est fixé pour objectif une baisse de 33 % du prix du sucre et une réduction des volumes. Face à ce défi, nous avons un besoin impératif de gains de productivité et nous comptions – à l’imparfait – sur les OGM pour réaliser les progrès indispensables. Or plusieurs projets fort intéressants sur le plan de la résistance au Roundup ou à certaines maladies virales ou cryptogamiques, et donc sur celui de la préservation de l’environnement, ou encore sur le plan physiologique, comme la mise au point d’une betterave d’hiver, sont désormais en panne. Le sucre étant une simple commodité, sans image de terroir, aucun des arguments « risques » communément avancés n’est pertinent pour la culture betteravière. Le blocage total que nous subissons tient moins à la réglementation qu’à la diabolisation des OGM qui sévit dans les médias comme dans l’esprit des consommateurs. Aussi les professionnels s’emploient-ils à empêcher qu’aucune betterave génétiquement modifiée n’arrive dans une sucrerie et chaque producteur s’engage, au moment de la signature de son contrat, à ne cultiver aucun OGM. De ce fait, aucun essai n’est possible, malgré la législation… Nous sommes en train de vivre en échec monumental dans la gestion de cette technologie, aux antipodes du succès de l’Airbus 380.
M. Stéphane PASTEAU : Il y a sept ans, je participais, ici même, à la première Conférence citoyenne sur les OGM, sous votre présidence, M. Le Déaut… Depuis, de nombreux rapports ont été élaborés, qui chaque fois ont été pour toutes les parties prenantes l’occasion de s’exprimer largement sur les enjeux des OGM. Or pendant ce temps, les surfaces consacrées aux essais en champ sont passées, en France, de 85 hectares en 1999 à 7,2 hectares en 2004, autrement dit à 0,0003 % de la surface agricole utile, dont la moitié ont été détruits ! Et M. Gaymard, ministre de l’agriculture, se réjouissait voilà quelque mois qu’il n’ait pas un centimètre carré d’OGM cultivé en France à titre commercial…
Tel est le contexte dans lequel nous sommes amenés aujourd’hui à échanger avec vous. On pourrait en déduire avec ironie que plus on parle des OGM, moins on en fait ! Pendant ce temps, dans le reste du monde, de plus en plus de pays adoptent cette technologie sur des surfaces de plus en plus étendues. C’est de cette autre réalité que je voudrais témoigner, la société Monsanto étant pionnière dans le développement et la commercialisation de ces produits.
En 2004, plus de 80 millions d’hectares d’OGM auront été cultivés dans dix-sept pays, soit 20 % de plus que l’année précédente. Huit millions et demi d’agriculteurs, dont 80 % vivent dans l’hémisphère Sud, ont adopté cette forme d’agriculture – notons que, pour la première fois, la progression aura été cette année plus élevée dans les pays du Sud que dans les pays riches. Si les Etats-Unis représentent encore 57 % du total des surfaces cultivées, l’Argentine, le Canada, le Brésil, la Chine, le Paraguay, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Espagne, les Philippines, l’Uruguay, la Roumanie, et d’autres encore, se sont engagés dans cette voie technologique. 56 % du soja cultivé dans le monde est génétiquement modifié, de même que 28 % du coton, 19 % du colza et 14 % du maïs.
Les raisons de ce succès varient selon les zones de productions, les types de culture et les modes agricoles. Dans certains cas, l’agriculteur bénéficiera d’un gain de rendement, dans d’autres, il maîtrisera autrement l’emploi de phytosanitaires, utilisera différemment son temps de travail ou encore adoptera des techniques culturales simplifiées. Dans tous les cas, on ne passe pas de zéro à 80 millions d’hectares en dix ans, sans que l’agriculteur et l’agriculture y trouvent un intérêt. C’est là une réalité qu’il est impossible d’ignorer.
Face à cette réalité internationale, on ne peut se contenter d’aborder le sujet de façon étroite, en cantonnant le débat à la recherche qu’il s’agirait de sauver face à l’activisme de certains opposants, ou à la question de savoir si et comment on va planter 5 ou 7 hectares d’essais en France cette année… La question est bien celle de la culture d’OGM en France et des conditions dans lesquelles les agriculteurs français pourront exercer leur choix, tout en respectant celui de leurs voisins. Les OGM resteront en France une abstraction tant qu’ils ne demeureront qu’un sujet de débat et nous ne pourrons que tourner en rond à essayer d’apporter des réponses théoriques aux questions légitimes qui se posent. Une nouvelle approche, plus pragmatique, plus concrète, semble indispensable est celle d’une introduction progressive et maîtrisée de la culture des OGM en France. Elle seule permettra d’illustrer, sur le terrain, l’intérêt de cette technologie pour l’agriculture française ou de tester l’efficacité des règles de coexistence, en conditions réelles. Si nous considérons que l’exemple de ce qui se fait ailleurs n’est pas transposable chez nous, faisons notre propre expérience.
Dans cette perspective, je ne peux que souhaiter que cette nouvelle mission d’information soit conclusive et contribue à mettre en place les conditions à même de permettre à une culture maîtrisée d’OGM de démarrer en France, dès cette saison.
M. Xavier BEULIN : Je représente toute la filière française des huiles et protéines végétales, qu’il s’agisse de la production, des première et deuxième transformations, ou de la mise en marché, à travers quelques marques comme Lesieur et Puget. Je me focaliserai sur le cas du soja qui fait figure de pionnier en matière de transformation génétique et de mise en marché.
L’Europe reste fortement dépendante et importatrice de protéines végétales et les Etats-Unis, l’Argentine et le Brésil sont ses principaux fournisseurs, à 64 % sous forme de soja. Or 86 % des surfaces plantées en soja aux Etats-Unis sont OGM, pratiquement 100 % en Argentine, et le Brésil, depuis deux ans, a renoncé à son statut de non-OGM et commencé à développer des surfaces cultivées en transgénique. En France, la production d’oléo-protéagineux occupe environ 150 000 producteurs sur 2 600 000 hectares, avec une particularité : nous sommes, depuis 1960, totalement connectés au marché mondial, sans aucune protection d’aucune sorte face aux importations de soja. Notre situation est donc particulièrement fragile. Si nous avons pu bénéficier de quelques soutiens particuliers entre 1992 et 2000, nous sommes soumis, depuis la mise en place d’Agenda 2000, au régime général applicable aux grandes cultures en France et en Europe. Autant dire que les applications de la génomique, et particulièrement la transgénèse, sont devenues pour nous un élément fondamental. A cet égard, quatre questions nous paraissent devoir être posées.
Premièrement, il devient urgent de privilégier le moyen et long terme par rapport au court terme. Notre pays a été marqué, depuis 1998, par une série de campagnes très opportunes ou opportunistes dont il faut désormais sortir.
Deuxièmement, beaucoup a été dit sur la dépendance ou l’indépendance des producteurs. Mais la seule chose que nous devrions craindre sur ce plan, c’est de ne plus avoir affaire qu’à deux ou trois consortiums internationaux qui détiendraient tout à la fois les technologies et les germplasmes. La France était, jusqu’alors, un des pays les plus performants en termes de potentiel génétique ; or celui-ci s’est malheureusement quelque peu fait piller grâce aux moyens exceptionnels dégagés par les biotechnologies, à mesure que les sociétés familiales qui le détenaient ont été rachetées par les grands groupes.
Troisièmement, si l’on se focalise beaucoup sur les OGM, toute la partie génomique et post-génomique reste pour nous essentielle, y compris dans la recherche des variétés conventionnelles et traditionnelles, et les progrès réalisés dans le domaine des plantes génétiquement modifiées nous rendront également performants dans celui des plantes traditionnelles. Cet aspect est également déterminant pour nos semenciers.
Quatrièmement, n’oublions pas que le recours aux OGM, du fait que ceux-ci diminuent les coûts d’intrants, se traduit pour nos concurrents américains, argentins et canadiens par un avantage en termes de compétitivité que l’on peut estimer à 100, voire 120 euros par hectare. A lui seul, ce point mérite d’être pris en compte. A cela vient s’ajouter la dimension qualitative, à l’heure où l’on rend le consommateur très sensible aux caractéristiques des corps gras, comme la teneur en oméga-3, oméga-6, etc. : on est en train, dit-on, de mettre au point aux Etats-Unis un soja dont l’huile aurait des qualités nutritionnelles équivalentes à celles des huiles de graines produites en Europe. Si ce projet devient réalité, nul doute que la grande distribution n’hésitera pas à faire volte-face et nous réclamera immédiatement d’en faire autant ; à ceci près que nous aurons pris dix ans de retard. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.
M. Daniel CHÉRON : Limagrain est une coopérative qui se situe aujourd’hui au quatrième rang mondial, derrière Monsanto, DuPont-Pioneer et Syngenta. Nous sommes spécialisés dans les semences de grandes cultures, mais également dans les semences de potagères, secteur, lui aussi, concerné potentiellement par les OGM. La recherche représente 13 % de notre chiffre d’affaire professionnel, soit un ratio comparable à celui de l’industrie pharmaceutique. Nous y consacrons 80 millions d’euros et y occupons environ 800 personnes. Avec Euralis, RAGT, Sofiprotéol et Unigrains, nous avons rassemblé les partenaires du monde agricole pour construire, avec Biogemma, une structure compétitive par rapport aux trois géants que j’ai cités plus haut. Biogemma représente 120 personnes travaillant dans le domaine des biotechnologies et un budget de 18 millions d’euros.
Ensemble, nous avons également compris qu’il fallait investir dans la recherche génomique en amont. Aussi, avec les instituts de recherche publics – INRA, CNRS, CIRAD et IRD40 –, avons-nous parallèlement construit Génoplante, dotée d’un budget de 200 millions sur cinq ans, afin de contrer les investissements de nos concurrents américains qui, dans ce domaine, nous distançaient peu à peu.
La génomique est le point de départ de notre raisonnement scientifique. Nous avons besoin de comprendre à quoi servent les gènes dans les plantes et la génomique dans la relation entre gènes et fonctions. La transgénèse nous sert d’outil pour vérifier si la fonction identifiée en laboratoire est bien celle que l’on retrouve au champ. Une fois gène et fonction identifiés, la transgénèse peut permettre de donner, via le gène, la fonction souhaitée à la plante si celle-ci ne la possède pas. Empêcher les essais en champ, c’est remettre en cause non seulement les OGM en France et en Europe, mais également notre métier de semencier et nous faire perdre pied par rapport à nos concurrents.
Limagrain se retrouve aujourd’hui dans une situation paradoxale : tout notre effort de recherche est en Europe, essentiellement en France, alors que notre marché est américain. Non seulement nous ne pouvons, faute de marché, valoriser nos travaux en Europe
– et encore nous détruit-on nos essais –, mais nous sommes obligés, pour rester présents aux Etats-Unis, de négocier auprès de nos propres concurrents l’accès à leurs technologies et de leur payer des royalties ! Nous versons ainsi plus de 20 millions de dollars à un seul de nos compétiteurs pour mettre sur le marché quelques gènes incontournables pour rester présents, à comparer aux 18 millions d’euros que Biogemma investit chaque année… De fait, les semenciers français se retrouvent à payer deux fois la recherche, une première fois par leurs travaux, la deuxième sous forme de royalties !
Dès lors, la tentation devient forte de tout laisser tomber en France et de transférer purement et simplement nos laboratoires aux Etats-Unis. Mais nous ne répondrions peut-être plus tout à fait à l’attente de nos actionnaires, autrement dit de nos agriculteurs, qui espèrent nous voir, par nos recherches, contribuer à améliorer leur avenir.
Mme Maddy CAMBOLIVE : Créée en 1926 aux Etats-Unis, aujourd'hui leader mondial dans les semences, Pioneer développe, produit et vend une gamme complète de semences dans soixante-dix pays. Pioneer commercialise en France du maïs, du tournesol et du colza, et y emploie 270 personnes, plus de nombreux saisonniers. Nos activités de recherche y sont menées dans quatre stations de sélection, tandis que deux usines assurent la production, le conditionnement et la logistique pour des semences vendues en France et à l’exportation. Choisie voilà une trentaine d’années comme base de développement en Europe, la France bénéficie de la structure de recherche la plus importante. Pioneer fait appel à toutes les technologies, y compris celles de la transgénèse dont l’utilité n’est plus à démontrer.
Depuis quinze ans, la France, avec l’Europe, avait entrepris de mettre en œuvre des législations sur les OGM et des biotechnologies pour aider au développement de cette innovation, stratégie qui, de conseil en conseil, avait été acceptée et soutenue. En 1999, elle avait demandé un renforcement de la législation adoptée au début des années 90 pour encadrer au maximum la mise en marché des OGM. Or, que je sache, encadrer ne signifie pas empêcher.
Nous attendons toujours la concrétisation du processus déjà mis en place. La réglementation européenne est claire, encore faudrait-il, pour permettre une mise sur le marché, pouvoir tester en conditions réelles les variétés issues de la recherche, quels que soient leurs modes d’obtention. Sur les plus de 2 000 essais programmés par Pioneer cette année en France, les OGM se réduisaient à un programme microscopique qu’il nous a fallu encore diviser par trois compte tenu des problèmes locaux d’implantation qu’il posait ; et sur les cinq champs expérimentaux finalement retenus, quatre ont été détruits, un seul essai est finalement exploitable ! Voilà la réalité des essais d’OGM en France aujourd’hui et de nos possibilités d’exploiter les résultats de nos recherches, en dépit des grandes déclarations sur la nécessité de soutenir la compétitivité française par l’innovation technique. Il est grand temps d’aligner les actes sur les discours et de nous donner les moyens d’agir. Pour l’heure, il est impossible de donner le choix aux agriculteurs français.
M. Christian PEES : Coop. de France rassemble 3 000 coopératives représentant environ 60 % de la production agricole collectée et 40 % de la transformation, soit 3 500 entreprises, 150 000 emplois directs et 300 0000 exploitations.
Face à la problématique OGM, nos entreprises sont aujourd’hui en état de schizophrénie avancée, totalement écartelées entre le court terme et le long terme. Pour l’heure, nous devons faire face tout à la fois aux exigences de nos clients, industriels ou distributeurs, qui réclament du non-OGM, mais également à la concurrence de poulets ou de porcs nourris à moindre coût – au soja génétiquement modifié importé ou au maïs génétiquement modifié d’Espagne – et qui entrent librement sur notre territoire. Il se pose donc déjà un problème d’équité au sein de l’Union européenne. A plus long terme, c’est la perspective de marchés totalement ouverts dans une économie totalement mondialisée qui se dessine de plus en plus inéluctablement. A privilégier le court terme, c’est bien notre tombe que nous creusons consciencieusement…
Le risque pour notre recherche devient majeur : c’est toute notre génétique qui est en danger. Sur un plan strictement économique, non seulement nous nous mettons dans l’incapacité d’exporter dans des conditions compétitives dans la mesure où nos concurrents ont accès à des outils qui réduisent leurs coûts, mais nous sommes également agressés sur nos marchés intérieurs dans la mesure où le consommateur, à défaut de n’acheter que ce qu’il aime, finit toujours par aimer ce qu’il achète, en fonction évidemment de son pouvoir d’achat. A délibérément ignorer l’intégration de ces nouvelles technologies, nous générons une agriculture résiduelle qui ne produira finalement plus qu’un paradoxe sous la forme de produits de terroir réservés à une « niche », cependant que notre pays deviendra totalement dépendant de produits de grande consommation fabriqués ailleurs, grâce à une technologie que nous nous serons interdite sur notre propre territoire. Ajoutons que ces nouvelles technologies présentent, sur le plan de la préservation de l’environnement comme sur celui des pratiques agricoles, des intérêts évidents, que nous nous employons également à passer par pertes et profits. Sans oublier les effets en termes de déprise rurale : nous sommes bel et bien en train de détricoter le maillage de nos territoires.
En conclusion, nous en avons assez de ne pas avancer sur ce sujet. Nous avons besoin de visibilité et de clarté et nous ne doutons pas que cette nouvelle mission parlementaire portera ses fruits, que notre pays aura une vision claire de cette affaire et que nos entreprises pourront, enfin, arrêter leur stratégie en fonction de vos décisions.
M. le Président : Je vous remercie d’avoir respecté vos temps de parole. Nous allons maintenant vous poser nos questions, thème par thème, en commençant par celui du risque sanitaire et environnemental. Votre discours, nonobstant certaines variations, va dans le même sens que celui de l’Académie ou des chercheurs. Celui des citoyens ou des associations est également univoque, mais dans un sens radicalement inverse. Autrement dit, il y a un divorce que nous devons nous employer à décortiquer. Essayons de faire en sorte que cette audition publique soit la plus interactive possible.
M. le Rapporteur : Ma première question porte sur le risque de dissémination. Le gène « Terminator », dit-on, serait, pour certaines entreprises, une manière détournée de se constituer des monopoles. Mais ne serait-ce pas aussi un moyen d’éviter toute dissémination accidentelle ?
M. Daniel CHÉRON : Vous posez en fait le problème de la brevetabilité du vivant par le biais des OGM. Un gène et sa fonction sont brevetables, tant aux Etats-Unis qu’en Europe. Mais brevetabilité du gène ne signifie pas pour autant brevetabilité de la variété. Les Américains considèrent qu’une variété peut être brevetée, ce qui interdit, de fait, à tout sélectionneur de l’utiliser. En Europe, le certificat d’obtention végétale (COV), tout en protégeant évidemment la variété mise sur le marché, permet toutefois à la communauté scientifique de l’utiliser à des fins de recherche pour élargir la variabilité génétique et créer de nouvelles variétés. Cette distinction est très importante et la plupart des semenciers français militent pour que le système du COV soit étendu au niveau mondial. Il serait très dangereux que toutes les variétés contenant des gènes soient brevetées, à tel point qu’une seule entreprise pourrait, à la limite, disposer de toute la nature et être la seule à pouvoir l’utiliser pour sa recherche. Le problème n’est donc pas de savoir si « Terminator » est ou non la bonne solution, mais de mettre en place des règles du jeu capables de garantir à l’ensemble de la communauté scientifique l’accès à la variabilité génétique, ce à quoi le mécanisme du COV répond parfaitement.
M. Jean-Marie SERMIER : Vous avez été plusieurs à dénoncer, chiffres à l’appui, l’écart qui se creusait entre l’agriculture française et celles qui recourent aux OGM. Mais peut-être un moyen de réduire le divorce dont parlait le président Le Déaut serait-il de « positiver » davantage et, au lieu de parler de « marge à l’hectare », de montrer précisément que les OGM peuvent permettre de renoncer à certaines molécules dangereuses et de réduire certaines pollutions des nappes phréatiques – sujets auxquels les Français attachent beaucoup d’importance.
M. le Président : Autrement dit, le recours à la génétique réduit-il le recours à la chimie et, partant, l’utilisation de produits phytosanitaires dangereux ?
M. Daniel CHÉRON : Que l’on s’en réjouisse ou non, le marché américain reste, pour ce qui touche aux OGM, le meilleur champ d’expérimentation sur lequel nous puissions nous fonder. Or une étude américaine très détaillée apporte plusieurs réponses précises à votre question. Ainsi, l’utilisation du soja résistant au Roundup permet, sur un an, une réduction de 10 000 tonnes d’herbicides, soit un gain annuel de 1,2 milliard de dollars pour les agriculteurs. Pour le maïs Bt résistant à la pyrale, l’économie en pesticides représente, toujours aux Etats-Unis, 258 millions de dollars. Nous tenons à votre disposition cette étude très complète et objective, réalisée non par les seuls semenciers privés, mais également avec des universitaires et des scientifiques parfaitement indépendants. Une autre étude, chinoise celle-là, montre que la culture de coton transgénique s’est en outre traduite par une notable amélioration de l’état de santé des agriculteurs chinois, jusque-là contraints de traiter massivement le coton traditionnel dans des conditions sanitaires déplorables.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Loin de moi l’idée de contester vos chiffres, mais à chaque fois que nous posons la question de la réduction des épandages d’intrants et de pesticides, on nous répond en millions de dollars et milliers de tonnes aux Etats-Unis, or j’aimerais savoir ce qu’il en est précisément à l’hectare et, le cas échéant, dans d’autres pays, sachant que les données peuvent considérablement varier en fonction des sols et des climats.
M. le Président : L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) nous a remis une étude sur quatre cas. Dans celui des plantes résistantes aux insectes, et particulièrement du coton, les résultats sont très nettement positifs. Dans celui des plantes résistantes aux herbicides, ils sont beaucoup plus mitigés. Sont également analysés les cas du « riz doré » et de certains micro-organismes industriels. Je vous invite à consulter cette étude sur le site de l’AFSSA.
M. Christian PEES : N’oublions pas non plus que l’utilisation des plantes génétiquement modifiées tend également à simplifier les pratiques culturales, donc à réduire le nombre de passages de tracteurs… Autant d’économies de fioul qui, rapportées au nombre d’hectares, représentent un gisement considérable.
M. le Rapporteur : Où en sont les projets OGM dans le domaine des biocarburants, d’autant plus intéressant qu’ils n’y présenteraient aucun danger pour l’alimentation, hormis peut-être certains risques de dissémination qui pourraient même ne pas exister ?
M. Xavier BEULIN : Vous avez raison de souligner l’absence de risque alimentaire, quoiqu’il ne faille pas oublier l’utilisation des sous-produits, tourteaux et autres, souvent destinés à la consommation animale. En fait, alimentaire ou non alimentaire, la problématique de fond est rigoureusement la même. Sur le plan économique, la déclaration du Premier ministre était parfaitement explicite : si le Gouvernement est prêt à soutenir le développement des biocarburants par des dispositifs fiscaux, ces mécanismes pourront disparaître très rapidement à mesure que la filière deviendra compétitive. Or le coût de la matière première est un élément fondamental de cette compétitivité.
M. Pierre COHEN : Nous avons bien entendu votre « ras-le-bol » unanime. Mais quelles que soient vos certitudes, nombreux sont ceux qui continuent à douter. En tant que semenciers, vous ne pouvez qu’être sensibles aux évolutions du monde agricole. Or bien des agriculteurs craignent que l’utilisation des OGM ne se traduise par une généralisation des OGM, une uniformisation de la production agricole mondiale, sans aucune possibilité de choisir un autre mode de culture
– l’agriculture biologique, par exemple. Avez-vous conscience de ce risque ? Il est tout de même permis de concevoir qu’il y ait plusieurs modes d’exploitation agricole… Se pose également la question de la propriété de la variété, sur laquelle vous-mêmes reconnaissez n’avoir aucune garantie. Etes-vous réellement en mesure de participer au débat, autrement qu’en avançant des considérations de productivité ? Si tel n’était pas le cas, cette affaire – et du coup votre ras-le-bol – risquerait de durer encore longtemps…
M. Bernard DELSUC : Nous avons mis en avant d’autres arguments que celui de la productivité. J’ai moi-même parlé des attentes des consommateurs sur le plan de la qualité des produits, de même que Xavier Beulin qui a cité l’exemple de nouvelles huiles riches en oméga 3 et 6. La réduction des besoins en phytopharmacie est également un élément très intéressant : le but n’est pas d’améliorer la productivité, mais d’adopter des pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement. Le souci de la productivité ne peut évidemment être ignoré, mais il s’inscrit dans une préoccupation beaucoup plus générale.
M. le Président : Certaines techniques, nous dit-on, permettent de diminuer le nombre d’épandages. Or des produits comme le Paraquat représentent un réel danger pour l’agriculteur. Mais avez-vous des chiffres précis montrant que le nombre d’épandages baisse ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Et pendant combien de temps ?
M. le Président : Bonne question ! L’utilisation de certains gènes ne risque-t-elle pas de donner lieu à des résistances qui obligeront à revenir aux traitements chimiques ?
M. Bernard DELSUC : A l’évidence, le nombre des épandages baisse dans la mesure où l’utilisation d’un gène de résistance à l’herbicide permet de se limiter à un seul passage au lieu de trois pour lutter efficacement contre la prolifération des adventices. N’oublions toutefois pas que le nombre des épandages augmente, par ailleurs, non pas du fait OGM, mais à cause de la nouvelle réglementation sur l’utilisation des pesticides qui, en interdisant notamment les mélanges, nous oblige à passer désormais trois fois à quarante-huit heures d’intervalle là où, jusqu’à présent, nous épandions trois produits en une seule fois. Autrement dit, les épandages diminuent d’un côté, mais ils augmentent de l’autre.
M. Marc RICHARD-MOLARD : Les nombreuses expérimentations que nous avons menées dans le domaine de la betterave et du désherbage ont montré qu’il était possible de réduire fortement le nombre d’applications – de cinq à deux, avec une efficacité accrue. Sur le plan de la toxicité, le bilan de l’utilisation du Roundup est positif lorsqu’on le compare avec les molécules classiques, et il en est de même sur le plan environnemental – quoiqu’il faille être plus nuancé dans la mesure où le glyphosate est lui aussi capable d’atteindre les nappes phréatiques, d’où la nécessité de mettre en place une gestion par bassin de production. Quoi qu’il en soit, la mise à disposition d’un outil complémentaire se traduit toujours par une utilisation améliorée du côté de l’agriculteur.
M. Daniel CHÉRON : Je suis toujours étonné lorsque j’entends parler des « effets négatifs » des produits de protection des plantes. Ils répondent naturellement à un objectif de maximisation du rendement agronomique, mais également à un impératif de qualité. On vante souvent la qualité des productions biologiques mais le développement de productions de blé bio dans le Puy-de-Dôme a provoqué la réapparition d’une maladie oubliée depuis cinquante ans : la carie du blé qui rend le blé tout simplement mortel pour le consommateur… Les produits de traitement n’ont donc pas que des inconvénients, y compris sur le plan de la qualité sanitaire, pour le consommateur, et l’utilisation des OGM participe également du souci d’améliorer la qualité des aliments.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je repose ma question : vous avez parlé de 50 000 tonnes de pesticides économisés grâce à l’utilisation du soja transgénique aux Etats-Unis. Le chiffre est impressionnant, mais pour combien d’hectares ?
M. Daniel CHÉRON : Sachant que l’on compte plus de 20 millions d’hectares de soja aux Etats-Unis, dont 80 % cultivés en soja résistant au Roundup, cela nous donne au minimum 16 millions d’hectares.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Avez-vous étudié les conséquences de la diffusion du maïs Bt sur le plan de la diversité biologique ? Cette question vous intéresse-t-elle seulement ?
Mme Maddy CAMBOLIVE : Qu’entendez-vous par « diversité biologique » ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Je songe en particulier à l’entomofaune, sachant que certaines espèces d’insectes peuvent disparaître et d’autres, à l’inverse, devenir progressivement résistantes et proliférer. Des études ont-elles été conduites sur ce sujet, dans le cadre de vos travaux, aux Etats-Unis ou ailleurs ?
Mme Maddy CAMBOLIVE : La législation régissant les mises sur le marché impose un encadrement et un suivi des cultures, y compris pour ce qui touche à la potentialité d’un risque de résistance des insectes au gène en question. Pour l’heure, on n’a jamais constaté, dans aucune culture, de phénomène de résistance à la protéine Bt : l’insecte cible est systématiquement détruit. La faune avoisinante est également surveillée : l’Union européenne a récemment imposé un suivi de l’entomofaune aux alentours des parcelles de maïs Bt. Aucun changement n’a été relevé.
M. le Président : J’avais lu dans la presse qu’aucune étude d’impact n’avait été réalisée en Espagne. Est-ce vrai ou faux ?
M. Stéphane PASTEAU : C’est faux, puisque la réglementation européenne nous impose de mettre en place un plan de bio-surveillance. C’est ce que nous faisons en Espagne, comme nous le ferions en France si nous devions y développer cette technologie.
M. le Président : Nous pourrons prochainement le vérifier sur place.
M. le Rapporteur : Mais avez-vous réagi à ces fausses informations ?
Mme Maddy CAMBOLIVE : Non.
M. le Président : Il y en avait pourtant une page complète !
M. Stéphane PASTEAU : Peut-être l’avons-nous laissée passer au milieu du flot… La technologie Bt ayant l’avantage d’être relativement ciblée, l’agriculteur ne l’utilise que sur un maïs ou dans une zone où la pression des insectes l’aurait amené à recourir à des insecticides chimiques à spectre nettement plus large que la protéine Bt, laquelle agit seulement sur des familles très spécifiques, sans autre impact sur l’entomofaune. Par ailleurs, comme cela se fait aux Etats-Unis, la mise en culture de ces produits s’accompagne de stratégies destinées à maîtriser au mieux une possible apparition de résistances. Ces stratégies obligent notamment les agriculteurs, contrôles à l’appui, à ménager des « zones refuges » cultivées en variétés conventionnelles, dont les surfaces sont révisées chaque année et adaptées en fonction des évolutions observées dans les diverses populations d’insectes.
M. Philippe TOURTELIER : M. Delsuc rappelait tout à l’heure que l’agriculture avait évolué grâce à l’agronomie, à la mécanisation, à la chimie et à la génétique. Député breton, j’ai pu constater que la mécanisation avait entraîné l’abattage des talus et que l’érosion, alliée à la chimie, était à l’origine du problème de l’eau en Bretagne… Je ne peux être que très circonspect vis-à-vis de la génétique. Nos agriculteurs ont déjà été trompés, au point que certains se retrouvent aujourd’hui mis au ban de la société. Je n’entends pas qu’ils vivent une deuxième fois ce genre de mésaventure.
Adoptons la seule grille de raisonnement possible, celle du développement durable. La situation de l’agriculture bretonne est, de ce point de vue, proprement catastrophique. Sur le plan économique, l’avenir, du fait de la réforme de la politique agricole commune (PAC), est des plus incertains. Sur le plan social, les jeunes ont le plus grand mal à s’installer. Sur le plan écologique, je viens de vous rappeler l’état des choses.
De votre côté, mesdames et messieurs les industriels, où en est votre réflexion ? Pour ce qui est des considérations économiques et de ce qui touche à la compétitivité, vous êtes effectivement dans les starting-blocks. Mais vous ne pouvez pas nous demander de légiférer dans votre sens, sans vous interroger sur les avantages et risques écologiques et sanitaires, mais surtout sur les conséquences au niveau social du modèle d’agriculture que vous proposez, en France et dans le reste du monde. Vous citez la Chine, mais de quel type d’exploitation parlez-vous ? Votre vision de l’agriculture ne dissimule-t-elle pas une vision purement industrielle ? Auquel cas, n’aurions-nous pas intérêt, dans l’analyse, à séparer les deux ?
M. Xavier BEULIN : Placer le débat sous l’angle du développement durable me paraît effectivement le bon moyen de poser le problème. Mais la durabilité s’exprime à travers plusieurs dimensions : économique, sociale, environnementale, territoriale. Nous avons naturellement parlé de productivité, mais également de qualité et d’environnement, autant de réponses qui, pour insuffisantes qu’elles vous paraissent, témoignent de l’ampleur du travail d’étude que nous avons dû conduire – au prix parfois des pires difficultés, lorsqu’il s’est agi des expérimentations en champ.
M. Cohen a posé tout à l’heure une question de fond. A l’évidence, l’agriculture française a tout intérêt à préserver la diversité – agriculture traditionnelle, agriculture biologique, labels, appellations d’origine contrôlée (AOC), etc. Mais on fera d’autant mieux de l’agriculture biologique et des AOC que l’on aura parallèlement préservé un secteur traditionnel capable de gagner sa vie. Imaginez ce que deviendraient nos labels et nos AOC si, au lieu de se partager ces marchés entre 20 % de producteurs, il fallait se les partager entre 40, 50 ou 60 %… Ce serait intenable pour ceux qui en vivent aujourd’hui.
Enfin, n’oublions pas que l’agriculture biologique utilise, elle-même, des semences qui, pour la plupart, ont derrière elles un demi-siècle, voire un siècle de recherche génétique sans que personne n’y trouve à redire… La question est aujourd’hui de savoir si l’amélioration de ces plantes, par voie génétique ou transgénèse, est compatible ou non avec l’exercice de l’agriculture biologique. Sans doute cette question est-elle un peu taboue, mais je tiens à la poser devant la mission parlementaire. Nous sommes tous d’accord ici sur la nécessité de respecter un cahier des charges à même de préserver toutes les pratiques agricoles, dont celle de l’agriculture biologique. Mais il faut nous poser la question de ce que j’appelle l’accès au matériel génétique, quel que soit le mode d’agriculture. Elle me paraît au cœur de la problématique que nous vivons aujourd’hui.
M. le Rapporteur : L’Allemagne vient d’imposer un taux de 0 % d’OGM pour les cultures traditionnelles. Cela ne revient-il pas à interdire carrément les OGM en Allemagne ?
M. Christian PEES et M. Xavier BEULIN : Vous avez vous-même répondu à votre question…
M. le Rapporteur : La coexistence entre les cultures traditionnelles, biologiques et OGM vous paraît-elle possible ? Une réglementation vous semble-t-elle envisageable ?
M. Christian PEES : Cela nous paraît parfaitement possible dans la mesure où elle existe ailleurs : aux Etats-Unis ou en Espagne on voit coexister, sur la même exploitation, des parcelles cultivées en bio et d’autres en OGM.
M. le Président : Avec le même cahier des charges ?
M. Christian PEES : Non, les seuils diffèrent selon les situations et les pays. Plus ils tendront vers zéro, moins la coexistence sera possible. En Europe, la Suisse s’est fixé un taux maximum de 3 % pour garantir la pureté de ses productions bio. Le zéro est impossible à atteindre.
M. Germinal PEIRO : Les OGM sont généralement présentés comme quelque chose de nocif et c’est bien la raison pour laquelle le grand public les refuse, les considérant comme une sorte de poison. Or les scientifiques ne mettent pas suffisamment en évidence leurs avantages, y compris sur le plan sanitaire. Est-ce parce qu’ils n’existent pas ou parce que vous n’y insistez pas suffisamment ? Sitôt qu’il connaîtra les mérites de vos nouvelles huiles face aux maladies cardiovasculaires, le grand public changera certainement d’avis. Mais pour l’heure, vous n’êtes pas parvenus à mettre en évidence les effets positifs des OGM sur le plan de la santé, de la qualité et de la protection de l’environnement.
M. le Président : Une des conclusions les plus inattendues de l’étude de l’AFSSA était que les produits génétiquement modifiés, étant moins attaqués par les insectes, offrent moins de portes d’entrée aux agents viraux et cryptogamiques et contiennent moins de mycotoxines. Or celles-ci sont connues pour favoriser les cancers. Il en est ainsi de l’aflatoxine produite par Aspergillus niger, qui cause de nombreux cancers du foie dans les zones africaines productrices d’arachide, mais que l’on retrouve également dans les céréales. Personne n’a jamais parlé de cet exemple pourtant très intéressant…
Lorsque les arguments ne tiennent pas, le débat public s’effondre. Pour l’heure, ballottée entre les certitudes des uns et des autres, l’opinion publique ne comprend plus. Si nous réussissons, au cours des tables rondes contradictoires, à ce que soient échangés des arguments valables, notre mission d’information aura au moins gagné une partie de la partie.
M. Christian PEES : Nous n’avons pas, je le reconnais, apporté la démonstration absolue des bienfaits des OGM. Cela dit, nous n’en sommes qu’aux prémices d’une évolution scientifique : si l’on avait fait une enquête d’opinion sur l’intérêt de la première draisienne comparée à un cabriolet tirée par six chevaux fringants, tout porte à croire que la réponse aurait été négative… Cela dit, alors qu’on pouvait s’interroger il y a trois ou quatre ans sur l’intérêt réel des OGM de première génération, nous disposons dorénavant de produits bien concrets, capables d’influer directement sur la vie des consommateurs et, partant, de susciter leur intérêt. Le débat souhaité par le Président Le Déaut est effectivement majeur mais il faut se donner le temps de bien l’expertiser, avant d’apporter une démonstration évidente.
M. Stéphane PASTEAU : L’approche « bénéfice » est difficile car elle exige une réponse au cas par cas. Mais nous avons désormais dix ans de cultures derrière nous, et nous disposons d’une masse énorme de données. Le bénéfice sanitaire est avéré dans certains cas, et dans d’autres non. Les nombreuses études menées par les Etats-Unis montrent que le maïs Bt apporte un net « plus » pour ce qui est de certaines mycotoxines, mais pas pour d’autres. Il en est de même pour le coton Bt, on l’a déjà dit, qui améliore grandement la situation sanitaire des agriculteurs chinois dans la mesure où ils étaient auparavant contraints de traiter le coton dans des conditions de sécurité sans rapport avec les nôtres. En France, nous manquons, et pour cause, de données, mais on peut très bien imaginer que l’utilisation du maïs Bt y aura des effets d’autant plus intéressants sur les taux de mycotoxines que la nouvelle réglementation européenne imposera très bientôt des seuils beaucoup plus sévères qui pourraient mettre en difficulté certains bassins de production.
M. Philippe MARTIN : Je suis impressionné par l’unanimité des semenciers et je doute que nous puissions les faire changer d’avis… Nous nous demandions hier pourquoi ce débat, qui aurait dû rester scientifique, devenait souvent idéologique. Sans doute l’absence de concertation préalable et d’assentiment de la société aura-t-elle nui à la cause que vous défendez. Dans le Gers, dont je préside le conseil général, une écrasante majorité de citoyens et d’agriculteurs sont résolument opposés aux expérimentations – mais je suis tout aussi opposé aux stratégies d’arrachage.
On ne peut pas confisquer le débat en le réduisant à une discussion entre experts ; le développement durable suppose précisément que la société tout entière s’approprie ces questions. La demande d’information est très forte, particulièrement chez les jeunes. Le président parlait des certitudes des uns et des autres. J’ai plutôt l’impression que ce qui domine dans cette affaire, ce sont les incertitudes des Français…
M. Pees souhaitait que notre pays ait une vision plus claire du problème à l’issue de nos travaux. A-t-il le sentiment qu’un dialogue circonscrit à des scientifiques et à des législateurs permettra réellement aux Français d’y voir clair ? Ne pense-t-il pas plutôt que, du fait du contexte mondial, ce débat n’est plus qu’un combat d’arrière-garde, perdu d’avance par la partie adverse ? Croit-il enfin qu’il pourra jouir de la même liberté d’action lorsque la charte de l’environnement aura pris valeur constitutionnelle, et singulièrement son article 5 qui prévoit que : « lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution, à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin d'éviter la réalisation du dommage ainsi qu'à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques encourus » ?
M. Xavier BEULIN : Rappelons d’abord qu’il y aura sans doute eu cent fois plus de débats que d’hectares d’expérimentations en France… Les jeunes et les enfants sont à n’en pas douter un public cible intéressant et auquel nous devons des explications. C’est à leur adresse que sera rééditée cette petite publication, préfacée par Mme Claudie Haigneré, alors ministre de la recherche, et déjà tirée à plus dizaines de milliers d’exemplaires. Cette brochure sert de support pédagogique pour expliquer ce que sont les OGM, à quoi ils servent, quels sont les risques, etc.
M. le Président : Qui l’a rédigée ?
M. Xavier BEULIN : Un groupe de scientifiques qui ont travaillé en partenariat sur ces questions, et auxquels nous sommes associés pour financer la réalisation et la diffusion de ce document.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : En toute indépendance…
M. Xavier BEULIN : En toute indépendance.
M. le Président : Le GNIS ou les organisations de producteurs ont-ils participé à sa rédaction ?
M. Xavier BEULIN : Pour partie, et sous l’autorité d’un comité de rédaction composé de scientifiques. Notre participation a été essentiellement financière.
M. Christian PEES : Je ne suis pas compétent en tout, et si, sur certaines questions, je peux être interpellé en tant que citoyen, je serai bien en peine d’apporter une réponse. Il y a des limites à l’ouverture totale du débat. S’il tourne à la discussion « Café du Commerce », je ne vois pas ce qu’il apportera. Je me souviens d’un sondage, il y a plus de vingt-cinq ans, en pleine crise pétrolière, qui avait rendu furieuse mon professeur de philosophie : on avait demandé aux citoyens parisiens s’il fallait raser Notre-Dame sous laquelle, disait-on, on venait de trouver du pétrole, et ceux-ci, à 80 %, en étaient d’accord… Il y a des experts scientifiques pour donner des indications, et des élus pour prendre des décisions claires, en vertu du pouvoir qui leur est délégué. Que la population soit consultée, qu’il faille prendre la température de l’opinion, j’en conviens mais je crois modérément au processus du référendum pour arbitrer le fait OGM. Je crois en revanche à l’animation du débat : il faut aller au contact de la population, en particulier auprès des jeunes, des écoles, etc., pour informer et expliquer. Nous avons des outils pour cela.
Plusieurs d’entre vous semblent penser que nous sommes venus unanimes dans l’idée de vous « bourrer le crâne ». Comprenez bien que notre position n’a rien de global, qu’elle dépend des situations et des événements. Le représentant de Monsanto, lui-même, l’a dit : ce n’est ni tout blanc, ni tout noir. Nous observons certains bénéfices sur tels produits, pas sur tels autres. L’évaluation doit se faire cas par cas.
M. Philippe MARTIN : Et sur le combat d’arrière-garde ?
M. Christian PEES : Je ne suis pas dans cette posture. Il faut évidemment savoir se mettre en perspective et considérer ce qui se fait au niveau de la planète. Mais ce débat n’a à mes yeux rien de ringard. Il doit être mené.
M. Daniel CHÉRON : Ce débat dépasse la pure science. Observez comment sont perçus, d’un côté les OGM, de l’autre côté les fromages au lait cru en Europe et aux Etats-Unis : la perception du risque est totalement inverse et dépend largement de facteurs culturels.
M. le Président : Cela rejoint les constatations d’un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui posait la question : « Les avantages des biotechnologies sont-ils plus importants que les risques ? » Le plus grand nombre de « oui » était relevé au Chili, – 72 % contre 17 % de non –, devant les Etats-Unis – 66 % contre 27 % ; du côté de l’Europe, les « oui » et les « non » s’équilibraient en Espagne – 39 % de oui contre 36 % de non – et la France se retrouvait lanterne rouge mondiale, avec seulement 22 % de « oui » contre 54 % de non.
M. Daniel CHÉRON : La transgénèse n’est qu’un outil : comme pour toute technologie, c’est seulement ce qu’on en fait qui peut être condamnable. C’est donc au cas par cas qu’il faut vérifier si ce que l’on met sur le marché respecte le cahier des charges défini par la société. La transgénèse n’est que le résultat d’une meilleure connaissance du fonctionnement du génome des plantes, laquelle vient quelque peu bousculer la compréhension que le citoyen lambda avait de la vie, par exemple lorsqu’il découvre que 70 % des gènes du maïs sont identiques à ceux que l’on retrouve dans l’homme… Galilée aussi avait présenté une vision différente du monde et il a fallu un peu de temps pour qu’elle soit admise. Il en est de même pour la transgénèse et je suis sûr que, dans dix ou vingt ans, on rira des peurs qu’elle suscite aujourd’hui. C’est un processus irréversible, non du fait de l’action continue des forces multinationales, mais tout simplement parce que cela résulte d’une progression des connaissances.
Avons-nous suffisamment informé et communiqué ? Probablement pas, même si nous n’avons pas ménagé nos efforts de pédagogie. Ainsi, à chaque fois que nous mettons en place un essai OGM dans une commune, nous demandons systématiquement au maire s’il veut que nous organisions une réunion publique pour nous en expliquer. C’est ce que j’ai fait à Clermont-Ferrand. Nous sommes également présents au Salon de l’agriculture. Nous avons créé le comité Cultura où les anti-OGM et les pro-OGM défendent et expliquent, chaque année, leurs positions dans le cadre d’un débat contradictoire. On ne peut pas dire que nous n’ayons rien fait.
M. le Rapporteur : L’information nous pose un problème dans la mesure où les adversaires, comme les partisans, des OGM citent tellement de sources qu’on ne sait plus sur quel pied danser. La mission réfléchit à la création d’un outil d’information objectif et neutre, animé par des scientifiques de toutes obédiences et destiné à informer la population en toute impartialité. Qu’en pensez-vous ?
M. Daniel CHÉRON : Nous sommes dans un débat très émotionnel et toute mesure de nature à l’apaiser sera bienvenue. Actuellement, chaque partie envoie ses arguments à la figure de l’autre, sans jamais parvenir à la faire changer d’avis. Chacun reste campé sur ses positions et, moi le premier, je sors finalement assez frustré de ce genre d’échange. Apporter un peu d’apaisement en faisant appel à des gens placés au-dessus de la mêlée me paraît une bonne initiative.
M. le Président : Au sein de cette mission en tout cas, alors que nous sommes loin de partager les mêmes idées sur la transgénèse et l’utilisation des OGM, tout le monde s’accorde sur le fait que le débat a évolué, même s’il voit toujours s’affronter les certitudes des uns et autres. Ainsi, les risques sanitaires, systématiquement mis en avant en 1998, sont devenus un sujet subsidiaire, alors que de nouvelles questions sont apparues, dont la dernière en date est celle de l’étiquetage des œufs et viandes d’animaux ayant eux-mêmes consommé des OGM. Et ces questions d’ordre réglementaires n’ont pas pour but de régler un problème, mais seulement de multiplier les contraintes supplémentaires.
Mme Odile SAUGUES : La démarche d’information en relation avec les maires suivie par M. Chéron me paraît assez logique, mais, de l’autre côté, M. Pees estime qu’il y a des limites à l’ouverture totale du débat… Quant à son exemple de la draisienne, c’est prendre nos concitoyens pour des sots et leurs élus pour des benêts : il n’est qu’à voir ce qui s’est passé pour l’amiante ! Si vous pensez que vos interlocuteurs ne sont pas de bon niveau, il faut développer l’information. Tant que vous croirez que ce débat ne peut pas être mené avec tout le monde, vous ne sortirez pas du problème et les peurs resteront.
M. Daniel CHÉRON : Je n’ai pas dit que j’étais contre ces réunions, mais seulement que j’en sortais toujours un peu frustré par la manière dont elles se concluaient.
Mme Odile SAUGUES : J’ai seulement rapproché vos propos de ceux de M. Pees.
M. Christian PEES : Je suis parfaitement d’accord pour initier le débat ; en revanche, et c’est un avis rigoureusement personnel, je ne crois pas qu’un tel sujet puisse être arbitré par référendum et j’en appelle à la responsabilité des scientifiques et des politiques.
M. le Président : En 1998, j’ai organisé la première conférence citoyenne sur les OGM, contre l’avis de bon nombre de mes collègues qui estimaient que le Parlement n’avait pas à aller devant les citoyens pour répondre à leurs questions. Quatorze personnes ont été choisies, qui se sont formées pendant six mois, et ce sont elles qui ont posé les questions aux experts. Ces personnes se sont appropriées le sujet et leur rapport était loin des positions extrêmes que l’on entendait à cette époque. En revenant vers de simples citoyens, nous avions fait avancer le débat.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Ce n’est pas que le débat soit circonscrit aux législateurs et aux scientifiques, c’est tout simplement qu’il est devenu médiatique.
M. Gabriel BIANCHERI : Exact !
M. le Président : Le gagnant est celui qui s’est assuré l’accès à la radio et surtout à la télévision par des événements soigneusement organisés. D’où ces énormes différences de perception entre les divers pays du monde.
M. Xavier BEULIN : Les enjeux sanitaires, avez-vous dit, sont progressivement évacués. Cette évolution est lourde de conséquences, et d’abord pour les importations de produits OGM qu’elle aboutit inévitablement à légitimer. Si nous insistons tant aujourd’hui sur la question des capacités de production en Europe, c’est bien parce qu’elle est devenue la seule question résiduelle.
M. Philippe MARTIN : Le principe de précaution prendra bientôt force constitutionnelle. En sera-t-il de même dans d’autres pays ? Y voyez-vous un obstacle à vos recherches ?
M. Xavier BEULIN : A l’évidence, si l’on applique stricto sensu le principe de précaution dans la réglementation française et européenne, nous n’aurons pas avancé sur le sujet dans cinq ans. Il faut reposer le problème dans sa globalité. La réponse n’est pas du tout la même suivant que l’on se place du point de vue du consommateur ou du point de vue du citoyen. Pour le premier, au nom de quoi empêcherait-on le consommateur d’avoir accès à des productions nationales et européennes, au vu de ce qu’est la consommation aujourd’hui et de ce qu’elle sera demain ? Pour le second, certaines questions ne se posent-elles pas encore, qui méritent d’être traitées en priorité ? Nous n’avancerons pas tant que nous ne reprendrons pas le sujet dans son ensemble.
M. Bernard DELSUC : Le principe de précaution ne pose qu’un problème, celui de sa définition. S’entourer de toutes les précautions sur un sujet donné en fonction de la connaissance scientifique du moment paraît tout à fait raisonnable. Encore ce moment ne doit-il pas devenir infini, auquel cas on ne peut plus avancer. Si l’on avait opposé le principe de précaution à l’introduction de la pomme de terre en France, nous n’aurions toujours pas de pomme de terre… Sans définition précise, le principe de précaution, dont bon nombre se servent comme d’un bouclier, nous mènera dans l’impasse.
M. Philippe MARTIN : Mais le texte de loi le définit très précisément. Le jour où cet article sera définitivement adopté, n’importe quel citoyen pourra vous opposer le caractère incertain de la recherche scientifique.
M. Pierre COHEN : Nous nous posons des problèmes qui devraient être dépassés… Le fait que, dans une démocratie représentative, la décision nous appartienne n’interdit pas pour autant la démocratie participative et les référendums, à l’évidence indispensables pour améliorer l’état de connaissance des citoyens. Ainsi, pour les risques industriels, le mouvement associatif a désormais acquis des compétences reconnues, parfois plus grandes que celles des techniciens des sociétés et des administrations. On a toujours intérêt à la transparence.
Il est des points sur lesquels, petit à petit, il nous doit être possible de tous tomber d’accord, même dans le cadre du débat public, à commencer par le fait que les OGM ne sont pas un enjeu philosophique, mais un simple procédé qu’il faut apprécier comme tel, n’en déplaisent à ceux qui cherchent à le diaboliser. Dans l’autre sens, pouvons-nous ici nous accorder sur le fait que les OGM ne constituent pas une réponse idéale et que la décision ne peut se prendre qu’au cas par cas ? Reconnaissons enfin que, à côté de l’enjeu scientifique qui pourrait m’amener, pour ce qui me concerne, à accepter, sous certaines conditions, les essais en champ, il y a également tout ce qui touche à vos propres intérêts, c’est-à-dire un enjeu économique au sens sociétal du terme, celui-là même que les citoyens ont du mal à accepter. La spécificité culturelle vaut également pour la gastronomie et les choix alimentaires, et l’argument selon lequel cela se fait ailleurs n’est pas nécessairement de nature à les persuader. Pensez-vous être à même de les convaincre de votre désir de préserver la diversité ? J’ai cru un moment comprendre que vous y réfléchissiez, mais je n’ai entendu aucune argumentation le garantissant.
M. Philippe GRACIEN : La définition du principe de précaution qui sera soumise au vote du Congrès diffère très peu de celle de 1992, autrement dit de la loi Barnier. Le problème se pose moins dans la définition que dans l’application qui en découlera, d’autant que le texte parle de « mesures provisoires et proportionnées ».
M. Stéphane PASTEAU : Nul doute que des mesures non proportionnées nous interdiraient de développer nos travaux, tout comme elles vous empêcheraient d’utiliser votre téléphone portable… Le principe de précaution est, depuis dix ans, au cœur de la réglementation européenne. Tout le monde s’accorde à reconnaître que notre réglementation est la plus stricte d’Europe ; elle fait passer les produits un par un – c’est effectivement indispensable – par un processus d’évaluation très long et complexe, en suivant une approche précisément fondée sur le principe de précaution. L’adoption d’un texte constitutionnel ne changera pas fondamentalement les choses.
M. André CHASSAIGNE : Vos exposés vont dans le même sens et c’est légitime. Mais on a vraiment l’impression, à vous entendre, que vous êtes dans les starting-blocks, prêts à démarrer sitôt que la réglementation française et européenne aura suffisamment évolué pour vous permettre d’atteindre vos objectifs… Reste qu’en vous voyant ainsi danser autour du totem pro-OGM, comme d’autres dansent autour du totem anti-OGM, on peut se poser quelques questions qui ne peuvent, et c’est normal, être la préoccupation première de vos sociétés qui s’intéressent d’abord aux rendements et à la compétitivité. Certes, M. Chéron lui-même a reconnu que tout n’est pas tout blanc ni tout noir. Mais j’aimerais y mettre un peu de rouge et développer une approche plus politique en posant la question de la dépendance.
On ne peut à mon sens réfléchir aux conséquences de l’utilisation des OGM sans poser la question de l’organisation de notre agriculture et de l’organisation du monde. L’un ne va pas sans l’autre. Ce n’est évidemment pas votre vocation dans la mesure où votre objectif premier reste logiquement, pour les coopératives, l’intérêt de vos adhérents et, pour les sociétés privées, celui de vos actionnaires. Le reste relève davantage de l’habillage pour faire passer la pilule…
Pour ce qui est de la recherche, sachons également garder les pieds sur terre et, face aux divers arguments, observer une certaine distance : les producteurs de lait de ma circonscription m’ont récemment expliqué que, après avoir passé des années à mettre au point des races laitières produisant les laits les plus riches possible, on avait fait machine arrière, et que les nouvelles recherches visaient désormais à limiter le taux de matière grasse…
Ma première question porte sur le risque de dépendance, déjà évoqué à propos de la brevetabilité du gène et de la variété. L’approche des Etats-Unis sur ce point est, vous l’avez rappelé, totalement différente de l’approche européenne, voire française depuis que la loi du 8 décembre 2004 a permis de conforter les protections apportées par le mécanisme dit du privilège de l’obtenteur. Mais quelle garantie avons-nous, connaissant le poids des grands groupes multinationaux, que la réglementation au niveau mondial, loin de généraliser l’approche française, ira précisément dans le sens défendu par les Etats-Unis ? Et le problème de la dépendance se pose pour les agriculteurs, mais également pour les pays en voie de développement. Non seulement les grands groupes pourraient ainsi s’accaparer la totalité des ressources végétales, mais en outre les agriculteurs, par le fait qu’ils se retrouveraient contraints de leur acheter à la fois la semence et les traitements spécifiques associés, tomberaient totalement sous leur coupe. Par le biais des OGM, les multinationales auraient la totale mainmise sur l’ensemble de la chaîne de production agricole.
Pour les pays en voie de développement, le développement des OGM est présenté comme une solution miracle. Or bon nombre d’exemples montrent que l’application sur le terrain ne donne pas toujours les résultats escomptés.
M. Daniel CHÉRON : Le fait qu’un agriculteur puisse dépendre demain d’un outil tel que la transgénèse ne me choque pas outre mesure. Vous-même pouvez être dépendant de votre téléphone portable ou de votre voiture pour vous déplacer… Se pose en revanche le problème lié à la propriété intellectuelle de la découverte scientifique qui a donné lieu à cet outil, en l’occurrence la relation gène/fonction, effectivement brevetable. Laisser totalement la main à quelques opérateurs mondiaux nous placerait – c’est vrai – sous la dépendance de deux ou trois monopoles en termes de propriété intellectuelle, et il n’est pas souhaitable que les agriculteurs français ou européens soient contraints de reverser une partie importante de leur valeur ajoutée à quelques opérateurs. Pour contrer ce danger, vous avez un rôle à jouer en faisant en sorte que la France et l’Europe disposent toujours de structures de recherche capables de rivaliser avec les grandes sociétés multinationales. Pour l’heure, en additionnant les budgets des instituts de recherche publics et des rares organisations privées qui restent en France, on arrive à des montants inférieurs à ceux de certaines multinationales. Si telle est votre inquiétude, je la partage.
M. le Président : Mais l’agriculteur ne risque-t-il pas d’être totalement dominé par un grand groupe agrochimique comme Monsanto ou Pioneer dans la mesure où celui-ci sera propriétaire tout à la fois de la semence et du produit de traitement associé ?
M. Stéphane PASTEAU : La question du choix de l’agriculteur ne se pose pas tout à fait dans ces termes. Aux Etats-Unis, l’agriculteur s’adresse à un semencier conventionnel ou OGM pour acheter sa semence puis, dans un certain nombre de cas, les produits phytosanitaires qu’il peut utiliser avec. Mais l’industrie de la semence, même si l’on y trouve quelques gros acteurs, est un milieu encore relativement peu consolidé. Les structures semencières s’y comptent par centaines.
M. le Président : Mais il se consolidera si les OGM se développent.
M. Stéphane PASTEAU : Dans un OGM, il y a deux choses : la plante et le transgène que vous y avez introduit. La société Monsanto a une stratégie de licencing très large et ouvre les transgènes qu’elle a développés – une tolérance au glyphosate, par exemple – à la quasi-totalité des semenciers présents sur le marché qui, s’ils le souhaitent, les intègrent dans leurs germplasmes et développent des variétés commerciales.
M. le Président : Encore faut-il en avoir les moyens… Cela coûte cher.
M. Stéphane PASTEAU : Cela coûte ce que cela coûte. Je n’entrerai pas dans le détail des accords… De ce fait, la quasi-totalité des semenciers de soja américains, par exemple, a accès à la technologie Monsanto et a intégré la tolérance au glyphosate dans leurs variétés. De ce fait, l’agriculteur a accès à toutes les variétés dont il a l’habitude, et qui intègrent ou non la technologie en question. Et la réglementation permet à n’importe quelle société arrivant sur le marché d’homologuer une spécialité à base de glyphosate pour traiter une variété achetée ailleurs. Autrement dit, un agriculteur peut parfaitement acheter chez un semencier X une semence intégrant la technologie de tolérance au glyphosate de Monsanto et qu’il désherbera avec une spécialité à base de glyphosate vendue par Syngenta. Rien ne permet de penser qu’il n’en sera pas de même en Europe. Nous avons, du reste, d’ores et déjà passé des accords à cet effet avec la très grande majorité des semenciers européens.
M. le Président : Mais si tout est concentré autour de quatre grands groupes mondiaux
– Syngenta, Bayer, Monsanto et DuPont-Pioneer – et que le transgénique se développe dans d’autres domaines que la tolérance au glyphosate, l’agriculteur aura de moins en moins le choix, tant pour la semence que pour les produits phytosanitaires associés.
M. André CHASSAIGNE : Encore cette possibilité de choix ne vaut-elle que pour ceux qui passent marché. Mais ceux qui refusent les OGM et qui sont à côté ne l’ont plus. Chacun connaît la mésaventure de ce producteur canadien dont le colza avait été contaminé par du colza génétiquement modifié, qui s’est vu traîné en justice par Monsanto et condamné… A-t-il eu le choix ?
M. le Président : Vous parlez de l’affaire Percy Schmeiser.
M. Stéphane PASTEAU : Je vous invite à examiner en détail les décisions de justice en question. M. Schmeiser a perdu tous les recours qu’il a successivement intentés auprès des trois instances de la justice canadienne. La contamination dont il se disait victime concernait plus de 95 % de ce qu’il avait mis dans ses champs… Partout on a conclu qu’il ne pouvait, avec un tel taux, s’agir d’une simple contamination, mais bien plutôt d’une fraude, ce qui lui a valu d’être condamné. Je peux vous envoyer le détail des trois jugements en question, parfaitement concordants sur ce point. M. Schmeiser a, depuis, entrepris de partir en croisade contre nous ; c’est un autre problème. Il suffit de mettre en perspective la situation de cet agriculteur, et peut-être de quelques dizaines d’autres, avec celle des quelques 300 000 agriculteurs nord-américains qui utilisent notre technologie, sans pour autant avoir connu les problèmes de M. Percy Schmeiser… Comme sur Internet, il est possible de pirater nos technologies et de chercher à en profiter sans bourse délier. Il était de notre devoir de réagir, ne serait-ce que vis-à-vis de ces 300 000 agriculteurs qui s’en servent légalement.
M. André CHASSAIGNE : Mais s’il s’agit vraiment d’une contamination ?
M. Stéphane PASTEAU : Il nous est arrivé de devoir faire face à quelques problèmes de flux de pollen ou d’adventices, auquel cas nous avons travaillé avec les agriculteurs pour les résoudre, sans pour autant les traîner devant le tribunal. Ils n’y étaient pour rien et nous devions tout faire pour les aider. Dans le cas que vous citez, il ne s’agissait pas d’une contamination, mais de banditisme pur et simple.
M. le Président : Vous voudrez bien faire parvenir à la mission le texte du jugement, et notamment les éléments montant que 95 % des cultures en question étaient génétiquement modifiées, auquel cas il ne pouvait évidemment s’agir d’une contamination.
M. Stéphane PASTEAU : Bien volontiers.
M. le Rapporteur : Mais pourquoi n’avez-vous pas réagi, alors que tous les anti-OGM se plaisent à nous servir cet argument ?
M. Stéphane PASTEAU : C’est comme pour « Terminator » : beaucoup sont persuadés que cette technologie est développée par Monsanto, alors que notre société n’y est pour rien…
M. le Rapporteur : C’est précisément votre absence de réaction qui m’inquiète, alors même que la vérité est clairement établie.
M. Stéphane PASTEAU : Chaque fois que cette affaire est venue dans les médias, nous avons demandé un droit de réponse et systématiquement transmis les informations que je viens d’évoquer.
M. le Rapporteur : Est-ce à dire que les médias n’auraient pas fait leur travail ?
M. Stéphane PASTEAU : Ils l’ont fait dans certains cas. Dans d’autres, nous avons eu plus de mal à faire passer le message, tant et si bien que les fausses informations sont devenues vérités révélées…
M. le Président : M. Chassaigne a reposé la question de la brevetabilité du vivant. La loi du 8 décembre 2004, bien qu’elle représente une avancée, souffre de plusieurs imperfections. Premièrement, les liens entre COV, propriété et brevetabilité du gène sont mal établis. Il s’ensuivra un nid de procédures dont nous ne nous sortirons pas. Le principe du certificat d’obtention végétale doit donc clairement s’imposer au niveau international. Deuxièmement, la partie relative à la recherche reste faible : il doit être possible d’utiliser à des fins de recherche toute construction génétique ayant fait l’objet d’un COV. Mais les groupes que vous représentez en sont-ils d’accord ? Si tel n’était pas le cas, il deviendrait possible, pour peu que l’on soit propriétaire de certaines avancées technologiques, de bloquer toute recherche. Troisièmement, si le texte exclut la brevetabilité du gène en tant que tel – il doit être associé à une fonction –, se pose le problème des gènes ayant plusieurs fonctions. Il doit être bien précisé que le brevet de tel gène associé à telle fonction ne vaut pas pour celles qui pourraient être ultérieurement découvertes. Quatrièmement, le système de licences suppose, on l’a dit, qu’il n’y ait pas de positions dominantes, surtout lorsqu’il s’agit de technologies majeures, faute de quoi, cela devient rapidement un combat de David contre Goliath devant les tribunaux.
C’est seulement à ces conditions que le dossier des OGM pourra avancer. Bon nombre d’entre nous sont prêts à reconnaître que certains des « dangers » avancés doivent être relativisés. Mais les questions liées à l’organisation économique continuent de nous inquiéter. J’ai demandé à cet effet une révision de la directive européenne de 1998. Qu’en pensez-vous ?
M. Stéphane PASTEAU : Vous abordez une problématique très large et très complexe. Je vois toutefois une limite à votre raisonnement : dans une économie de marché, il me paraît difficile de rendre obligatoire l’ouverture de licences… Ce n’est pas aussi simple. S’agissant du COV et de l’accès aux variétés à des fins de recherche, il est clair que la réglementation américaine ne saurait s’appliquer sur le territoire français. Il y est parfaitement possible d’utiliser des découvertes brevetées par d’autres, dès lors qu’il s’agit d’un programme de recherche. Le problème se posera lorsqu’il s’agira de commercialiser le produit de votre programme de sélection végétale. Mais, pour l’heure, les réglementations française et européenne sont claires à cet égard.
M. le Président : Supposez qu’en effectuant des recherches à partir d’un produit ou d’une technologie brevetés, vous en découvriez un beaucoup plus performant. En bloquant la vente de la licence de produit initial, on pourra empêcher le développement du nouveau produit.
M. Stéphane PASTEAU : Ce n’est pas si simple…
M. le Président : C’est pourtant exactement ce que l’on voit dans le monde informatique. Ce sont des sujets très techniques, mais sur lesquels il faut avancer.
M. Stéphane PASTEAU : La transposition de la directive est certainement insatisfaisante sur ce point. Mais est-ce le moment et l’endroit d’en débattre sur le fond ? Quoi qu’il en soit, nous vous communiquerons nos positions sur cette affaire.
M. le Président : La partie réglementaire a beaucoup évolué. Des règles communes ont été fixées pour ce qui touche à l’information du public, par le biais de l’étiquetage, de la traçabilité et de la définition de seuils. La fixation d’un seuil européen de 0,9 % vous satisfait-elle ? Certains opposants aux OGM, notamment les agriculteurs biologiques, réclament un taux plus faible. D’autres exigent l’étiquetage des œufs et des viandes d’animaux ayant consommé des OGM. Pensez-vous que ces seuils soient de nature à permettre la coexistence entre les agricultures traditionnelle, biologique et transgénique ?
M. le Rapporteur : A quel niveau devrait-on, selon vous, fixer le taux maximum de présence accidentelle d’OGM dans les semences ?
M. Daniel CHÉRON : L’étiquetage « OGM » est désormais obligatoire sur les produits alimentaires de grande distribution passé un taux désormais fixé à 0,9 %. La question est maintenant de mettre en place les mécanismes appropriés au niveau des semences. Les semenciers, après avoir défendu l’idée, à leurs yeux plus réaliste, d’un taux de 3 %, ont finalement accepté l’idée d’un taux de 1 %, politiquement plus acceptable, et qui est finalement descendu à 0,9 %. Mais Bruxelles parle maintenant de 0,5 % et la commission de l’environnement du Parlement européen de 0,3 %… Quel que soit le seuil finalement retenu, il faudra bien vivre avec, mais se pose alors le problème du coût de la gestion la coexistence des cultures, qui augmente de façon exponentielle à mesure que le seuil de tolérance diminue. Je veux bien laver plus blanc que blanc, mais à quel prix ? C’est ce message qu’il faut faire passer.
M. le Rapporteur : Mais jusqu’où peut-on techniquement descendre ?
M. Daniel CHÉRON : Avec des isolements de dix kilomètres, très près de zéro… En tant que producteurs de semences, nous avons l’habitude de gérer des flux de pollen entre mâles et femelles : nous savons, par expérience, que nous avons du mal à maîtriser la pureté au-delà de 99 %. Passé ce niveau, les distances d’isolement deviennent ingérables et les coûts, par voie de conséquence, prohibitifs. Le taux de 1 % représente d’ores et déjà un défi.
M. le Président : Quelle est aujourd’hui la tolérance réglementairement admise ?
M. Philippe GRACIEN : Tout dépend du type de plante et de sa biologie. Pour les plantes autogames comme le blé, les seuils sont relativement bas dans la mesure où les organes mâles et femelles sont au même endroit, et le taux d’impuretés est limité à 0,3 %. Dans le cas d’une plante allogame comme le maïs, la réglementation ne prévoit pas de seuil, mais seulement des obligations de moyens pour parvenir au taux le plus bas possible. Fort de cinquante ans d’expérience, les producteurs de maïs savent qu’il est difficile de descendre au-dessous de 1 % d’impureté sans se heurter à des coûts de production exorbitants.
M. Christian PEES : Encore s’agit-il de semences, autrement dit d’un produit pour lequel le respect de ce taux de 1 % détermine la valeur ajoutée du produit. Pour une céréale de base, cette valeur ajoutée n’existe pas et le coût du respect de ce seuil devient rapidement prohibitif. Une étude de l’INRA fixait le seuil de neutralité aux alentours de 3 %.
M. le Président : Autrement dit, le respect d’un taux de 3 % ne provoque pas de surcoûts.
M. Christian PEES : En effet.
M. le Président : Plusieurs personnalités auditionnées nous ont indiqué que le problème des flux de pollen ne devait pas faire oublier les autres contaminations tout au long de la chaîne, de la production jusqu’au produit fini, encore plus importantes. Ainsi, pour le colza, 10 % des graines se perdent tout au long de la chaîne. Beaucoup estiment que les seuils actuels ne sont pas réalistes et que vous les avez acceptés dans le seul but de mieux prouver qu’ils ne pourront pas être tenus. Est-ce vraiment le cas ? Si oui, quelles sont les possibilités de contester les fondements juridiques d’une réglementation dont il est établi qu’elle ne peut être respectée ?
M. Philippe GRACIEN : La production de semences et celles de produits de consommation
– ainsi votre exemple du colza – renvoient à deux problématiques bien différentes. Loin de chercher à faire une démonstration par l’absurde, les professionnels ont toujours proposé des seuils pragmatiques. Ce sont les politiques et les administrations, tant français que bruxelloise, qui nous ont petit à petit amenés à accepter – mais avions-nous le choix ? – les seuils actuels, dont certains sont à l’évidence irréalistes. Mais un seuil n’a pas vocation à rester gravé dans le marbre, et ceux qui sont, pour l’instant, fixés peuvent se concevoir dans un contexte marqué par un très faible développement des OGM. Si la part de ceux-ci devait s’accroître, nul doute que ces taux deviendraient économiquement inapplicables et qu’il faudrait les réviser.
M. le Président : Quels sont les seuils adoptés par les pays qui se sont dotés d’une réglementation ?
M. Daniel CHÉRON : Le Japon a retenu 5 % et la Suisse 3 %. Il n’existe pas de réglementation aux Etats-Unis, mais les observations a posteriori auxquelles nous procédons régulièrement montrent un taux d’impureté de l’ordre de 1 %, sur des parcelles autrement plus grandes, il est vrai, que celles que l’on trouve en Europe. Autrement dit, nous ne pourrons jamais le tenir le jour où les OGM deviendront une réalité en France.
M. le Rapporteur : Souscrivez-vous des polices d’assurance contre ce genre de risque ?
M. Daniel CHÉRON : Pour souscrire une police d’assurance, encore faut-il une règle du jeu claire, autrement dit une réglementation qui n’existe pas aux Etats-Unis. Lors de l’accident du maïs Starlink, dans lequel un élément qui n’aurait dû se trouver que dans l’alimentation animale s’est retrouvé dans des produits destinés à la consommation humaine, le préjudice, compte tenu de son ampleur, a été directement pris en charge par le gouvernement américain. Dès lors que des seuils sont appliqués, il doit être possible de définir, moyennant un peu de recul, des mécanismes assurantiels assez clairs pour se prémunir des risques de présence fortuite d’OGM, tout au moins pour ceux qui auront été identifiés au moment de l’homologation de l’événement. Pour les risques non identifiés, il serait logique que l’indemnisation relève d’un fonds d’Etat, dans la mesure où l’autorisation de mise en marché relève des autorités publiques, Commission du génie biomoléculaire (CGB) et autres.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu’un regroupement des commissions du génie génétique, du génie biomoléculaire et du comité de vigilance soit une bonne chose ?
Mme Maddy CAMBOLIVE : Ces instances ont chacune leur finalité propre et il me paraît de bonne méthode de séparer l’évaluation a priori du produit – qui relève de la CGB et de la Commission du génie génétique (CGG) – et la gestion de son suivi, qui est de la compétence du comité de biovigilance. On peut comprendre l’idée d’un regroupement, encore faut-il ne pas se tromper sur les buts poursuivis par chacun de ces organismes.
M. André CHASSAIGNE : On nous a souvent affirmé que ces trois organismes comptaient dans leurs membres des représentants des semenciers qui se retrouvaient dès lors juge et partie et pouvaient peser sur les décisions dans un sens conforme à leurs intérêts. Ne serait-il pas plus sain que vous ne soyez pas représentés dans ces instances ?
On nous a également dit que vos demandes d’autorisation de cultures en plein champ n’ont pas pour but d’évaluer l’impact des OGM sur l’environnement – et particulièrement le risque de dispersion – mais bien de mesurer les performances de vos produits en conditions réelles avant de les mettre au catalogue.
Mme Maddy CAMBOLIVE : La CGB, la CGG et le Comité de biovigilance sont majoritairement constitués de scientifiques indépendants, mais il a été décidé, dans un souci d’ouverture, d’y faire siéger un représentant de la société civile, un représentant des syndicats et un représentant des organisations professionnelles du secteur des semences. Un sur vingt membres…
M. André CHASSAIGNE : Vous n’entretenez pas de liens particuliers avec les scientifiques qui y siègent ?
M. Stéphane PASTEAU : Pas plus que certains n’entretiennent de liens avec des groupes anti-OGM parfaitement référencés !
M. Philippe GRACIEN : Si les OGM sont appelés à se développer en France et à coexister avec les cultures traditionnelles, nul doute qu’il sera très difficile de respecter les seuils excessivement bas envisagés par certains à la Commission européenne, sauf à rendre la production française de semences trop chère pour être compétitive, voire tout bonnement impossible. En cinquante ans, la France s’est organisée au point de devenir un des premiers producteurs de maïs semence, dont la qualité est mondialement reconnue. Cela représente environ 50 000 hectares, 15 000 exploitations agricoles, souvent de petite taille et situées dans des régions spécialisées – principalement le Sud-Ouest, la Limagne et la vallée de la Loire. Ajoutons que cette spécialisation, par les revenus qu’elle procure à l’exploitation, contribue puissamment au maintien de l’activité agricole dans ces territoires. C’est toute la politique en la matière qui serait mise en péril.
M. André CHASSAIGNE : Les demandes d’autorisation de culture en plein champ répondent-elles à un besoin d’évaluation, ou s’agit-il seulement de la phase ultime avant la mise au catalogue ?
M. le Président : Et pourquoi persister à demander des autorisations, dans la mesure où vos essais sont systématiquement détruits ?
Mme Maddy CAMBOLIVE : Les essais ne sont pas tous menés à des fins de recherche. Certains l’ont été pour étudier les flux de pollen et, tout récemment encore, les problèmes de coexistence, comme le programme d’Arvalis sur la coexistence des maïs Bt et non Bt. Les essais de nos sociétés ont quant à eux pour but d’évaluer les variétés. La CGB nous impose des conditions très strictes d’isolement : les maïs sont systématiquement castrés, ce qui interdit les études de flux.
M. Marc RICHARD-MOLARD : Les filières maïs, oléagineux et sucre ont mis en place une plate-forme d’expérimentation spécifiquement destinée à étudier l’impact, la gestion et les conséquences des flux de pollen. Il est à noter que, pour la filière betterave, ces expérimentations ont coûté beaucoup plus cher que l’analyse des performances des variétés. Les industriels n’y ont pas participé, ce qui garantissait leur indépendance.
M. le Président : De 120 autorisations en 1997, soit 400 parcelles cultivées, on est tombé à moins de 10 autorisations en 2004 et 46 parcelles cultivées, dont 26 ont été détruites et quatre essais arrêtés… Au total, seize essais seulement ont été maintenus.
M. Gérard DUBRAC : Le débat sur les seuils paraît surréaliste. Si le but est seulement de satisfaire l’opinion publique, on peut les fixer au gré du vent, sans se soucier de la recherche ni de la commercialisation, rendues par le fait impossible. De deux choses l’une : ou bien les OGM sont toxiques, auquel cas il faut le dire et il n’est pas question d’en accepter ne serait-ce que 0,1 %, ou bien le seuil est destiné à garantir la coexistence des plantes naturelles et des plantes modifiées, auquel cas il faudrait également étudier l’impact de la plante naturelle sur la plante génétiquement modifiée… Après tout, il n’y a pas 100 % d’OGM dans un champ OGM ! Si l’on accepte 3 % de plantes naturelles dans la plante OGM, acceptons 3 % dans l’autre sens, au lieu de chercher à diaboliser l’une ou l’autre.
Observons ce qui se passe dans l’industrie pharmaceutique : on ne fait pas de sondages réguliers pour savoir quelle recherche l’on va mener en matière de santé… Créons une haute autorité à l’abri de tout soupçon, en regroupant au besoin les trois organismes de contrôle, avec un mécanisme d’autorisation de mise en culture et de mise en recherche comparable à celui de l’autorisation de mise en marché. On sait que certaines recherches peuvent être très dangereuses, même en milieu confiné, et qu’il ne faut pas s’y risquer. Mettons en place une haute autorité bien conçue pour en décider en bonne intelligence, et laissons travailler les professionnels. Sinon, nous courrons inéluctablement à notre perte.
M. Bernard DELSUC : Rappelons que, d’ores et déjà, quinze variétés de maïs sont légalement autorisées et que rien ne m’empêche, en l’état actuel de la loi, de les cultiver demain sur mon exploitation, sans même avoir à demander une autorisation ! Pourquoi ne le faisons-nous pas ? Parce que, pour l’instant, nos clients ne veulent pas d’OGM dans leurs produits. Autrement dit, parce que nous n’avons pas la clientèle.
Faute de pouvoir être menés en France, les essais se font ailleurs, en Amérique du Nord notamment, ce qui pose, aussi, le problème de la dépendance de l’agriculteur. Celui-ci dépend déjà de ses fournisseurs pour les semences hybrides, à ceci près que l’offre est tellement vaste qu’il peut choisir en fonction de ses intérêts. Mais si, pour les OGM, nous nous retrouvons demain dans la situation du secteur de l’informatique vis-à-vis de Microsoft, la dépendance des agriculteurs sera totale. Ce n’est donc pas en limitant et en détruisant les essais en Europe que l’on réglera le problème. On aura, tout au contraire, favorisé la concentration et aggravé la dépendance des agriculteurs, à l’inverse du but recherché par les adversaires des OGM.
M. le Président : Seule l’expérimentation est effectivement soumise à une autorisation nationale, délivrée par la CGG si elle est menée en milieu confiné, par la CGB si c’est en milieu ouvert. Le Comité de biovigilance mis en place par la loi d’orientation agricole de 1999 est, quant à lui, chargé du suivi des essais.
Pour les autorisations de mise sur le marché, la responsabilité est exclusivement européenne. Les autorisations de mise en marché sont instruites et délivrées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui s’installera bientôt à Parme. Se pose à ce propos le problème de la coordination entre l’action des agences nationales, AFSSA et Commission des toxiques, et le travail conduit au niveau européen. On peut, du reste, se demander comment, alors que l’on débat des avantages comparés des produits chimiques et de la génétique, on peut laisser à deux commissions séparées le soin d’instruire les dossiers… Ces questions de gouvernance sont majeures et notre mission se doit d’y réfléchir.
M. Philippe GRACIEN : Effectivement, plus que le fonctionnement actuel de ces commissions, c’est plutôt leur fonctionnement futur qui nous préoccupe… Il faut espérer que le travail de votre mission donnera lieu à des propositions concrètes en la matière, d’autant que certains projets gouvernementaux, au moment de la transposition de la directive 2001/18/CE, avaient de quoi nous inquiéter : on y parlait de double expertise préalable, d’abord au sein d’un comité scientifique interdisciplinaire, ce qui paraît normal, puis au sein d’une instance représentative de l’ensemble de la société, ce qui est moins évident… Cela supposerait à tout le moins de prévoir une bonne articulation entre les deux instances, et surtout de savoir qui décidera in fine pour éviter les blocages. On dit que le diable se cache dans les détails… Une expertise sociétale ne pourrait se concevoir qu’au cas par cas, en présence d’une innovation fondamentale, par exemple, mais en aucun cas sur l’ensemble des dossiers, sauf à totalement bloquer la machine.
M. le Rapporteur : Quel est votre sentiment sur le fait que certains produits dérivés d’OGM, sans pour autant en contenir, pourraient être soumis à déclaration ?
M. Daniel CHÉRON : Sans doute faites-vous allusion à certaines huiles extraites de plantes génétiquement modifiées, mais qui ne contiendraient pas d’ADN, ce qui rendrait de fait tout contrôle a posteriori impossible.
M. le Rapporteur : Exactement.
M. Daniel CHÉRON : Cette affaire mérite effectivement d’être clarifiée. Il serait paradoxal que des sociétés étrangères puissent commercialiser chez nous des huiles dont il serait impossible de prouver l’origine OGM, alors que la même huile fabriquée par une société française serait systématiquement estampillée OGM par le jeu normal de nos mécanismes de traçabilité ! Les règles du jeu doivent être les mêmes : dès lors qu’il n’est pas possible de trouver des traces d’ADN modifié dans la protéine en question, il n’y a pas lieu d’étiqueter.
M. le Président : La position de Bruxelles est difficilement compréhensible. Ainsi la chymosine, enzyme utilisée dans l´industrie fromagère pour coaguler le lait, et qui était autrefois extraite de la caillette de veau, est désormais fabriquée par des micro-organismes génétiquement modifiés, sans qu’aucun étiquetage « OGM » ne soit imposé sur les fromages. Mais s’il s’agit, pour le chocolat, de lécithine extraite de soja génétiquement modifié, l’étiquetage est obligatoire, quand bien même on ne détecte pas la moindre trace d’ADN !
M. Daniel CHÉRON : Et seulement si le fromage est produit en France…
M. le Président : En effet. Ce sont là des distorsions sur lesquelles notre mission demandera des explications à Bruxelles. Ou bien on n’étiquette pas, ou bien on étiquette dans les deux cas, ce qui reviendrait à étiqueter « OGM » les deux tiers des produits agroalimentaires consommés aujourd’hui.
M. Stéphane PASTEAU : Le fromage échappe à l’obligation d’étiquetage, mais pas la chymosine dans la mesure où elle est dérivée d’un organisme génétiquement modifié… Ce n’est pas à proprement parler un ingrédient du fromage.
M. le Président : N’empêche qu’elle y reste… Ces différences de traitement sont difficiles à comprendre. Certaines pressions ont amené Bruxelles à renoncer à publier une liste de produits exempts d’étiquetage. Mais dès lors qu’un produit ne contient pas d’ADN, il n’y a aucune raison d’imposer l’étiquetage « OGM », surtout si, pour d’autres, on ne l’exige pas.
M. Marc RICHARD-MOLARD : Je vous suggère d’ajouter le sucre à votre liste… Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour rechercher des traces d’ADN recombinant dans le sucre provenant de plantes génétiquement modifiées et le résultat a toujours été négatif. Il n’y a aucune raison pour que le sucre soit étiqueté « OGM ».
M. le Président : Mesdames, messieurs, je crois que nous avons fait le tour de tous les thèmes. Nous vous remercions de votre participation. Vos discours, tout comme ceux des chercheurs, étaient assez unanimes mais il était important pour nous de les connaître. A compter du 2 février commenceront les tables rondes contradictoires et publiques. Vous aurez tout lieu de vous exprimer, notamment sur l’affaire Percy Schmeiser et autres.
Table ronde regroupant des associations
de défense de l’environnement et de protection des consommateurs
(extrait du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2005)
Ø Les Associations de défense de l’environnement
• France nature environnement (FNE), représentée par M. Lilian LE GOFF, médecin
• Les amis de la Terre, représentée par M. Jordi ROSSINYOL, membre du groupe de travail sur les OGM
• Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens (ATTAC), représentée par M. Dominique MOURLANE, membre du Conseil d'administration et animateur de la commission nationale OGM d'Attac France
• OGM-dangers, représentée par M. Hervé LE MEUR, président
Ø Les Associations de protection des consommateurs
• Inf’OGM, représentée par M. Eric MEUNIER
• UFC (Union fédérale des consommateurs)-Que Choisir, représentée par Mme Hélène MORAUT-PESTANES, chargée de mission agriculture et alimentation
• 60 millions de consommateurs, représenté par Mme Marie-Jeanne HUSSET, directrice de la rédaction
• Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV), représentée par M. Olivier ANDRAULT, directeur scientifique
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie d’avoir accepté de participer à cette table ronde, ouverte à la presse. Il s’agit aujourd’hui de connaître la position des associations de défense de l’environnement et de protection des consommateurs sur la question des enjeux des essais et de l’utilisation des OGM.
Comme cela vous a été indiqué, je propose à chacun de présenter un propos liminaire de trois minutes pour exposer les grandes lignes de la position de l’organisme qu’il représente, après quoi nous ouvrirons le débat sur les questions qui nous intéressent et dont vous avez eu communication.
M. Lilian LE GOFF : Médecin à Lorient, j’anime la mission « biotechnologies » dans le cadre de la fédération France Nature Environnement (FNE) qui regroupe la grande majorité des associations de défense de l’environnement en France.
France Nature Environnement s’est toujours montrée réservée à l’égard des applications trop rapides des innovations biotechnologiques, qui sont souvent faites sans évaluation préalable du rapport risques/avantages et reposent sur une conception réductionniste du vivant. Le principe du retour sur investissement semble largement l’emporter sur celui du principe de précaution, d’autant que les recherches appliquées en question ne répondaient à aucune demande des agriculteurs ni des consommateurs, ni même des responsables politiques, très tôt mis devant le fait accompli.
Même si les enjeux sanitaires et environnementaux sont importants, le problème fondamental est tout à la fois éthique et socio-économique depuis que le législateur a autorisé le brevetage du génome des espèces manipulées. Il a ainsi ouvert la voie aux monopoles sur des marchés agroalimentaires captifs, au lieu de considérer le génome comme un bien inaliénable du patrimoine commun de l’humanité. Ce problème éthique aurait, pour le moins, dû faire l’objet d’un débat au niveau des parlements nationaux et européen.
Sur le plan de l’environnement – et par voie de conséquence de la santé, les deux domaines étant liés –, les risques dénoncés dès 1996 sont désormais bel et bien avérés, notamment le risque de dissémination des transgènes par les pollens. Celui-ci est particulièrement lourd de conséquence pour la biodiversité et l’environnement, mais également pour les agriculteurs qui ne peuvent s’appuyer sur aucun système de responsabilité pour se faire indemniser. En effet, bien que l’Europe ait mis en demeure les Etats membres d’introduire progressivement dans leur réglementation le principe de responsabilité et de dédommagement, la France n’en a encore rien fait, ce qui rend impensable toute levée du moratoire.
La biodiversité court un très grave danger, et pour plusieurs raisons. Les OGM ne pourront qu’accentuer le caractère industriel de l’agriculture intensive et ses atteintes à la biodiversité, d’autant que, loin de réduire les pollutions par les pesticides, comme le prétendent leurs promoteurs, les OGM ne feront que l’aggraver. Viendra s’ajouter le problème, moins évoqué mais fondamental, des « compétitions envahissantes » liées à l’introduction dans le biotope d’espèces très bien adaptées, sans prédateurs ni mécanismes de régulation. On l’a vu sur le continent américain avec la libération accidentelle d’abeilles tueuses, ou en mer Méditerranée avec Caulerpa taxifolia. Encore ne s’agissait-il que d’accidents ; avec les OGM, c’est délibérément que l’on s’apprête à introduire des espèces artificiellement dotées d’avantages compétitifs. Ce danger a déjà été évoqué à Nairobi, en 2000, lors de la convention internationale sur la biodiversité.
Nous aborderons plus loin tous les aspects sanitaires ainsi que le problème fondamental de la liberté de choisir son alimentation avec tout ce qui en découle sur le plan de la traçabilité et de l’information du consommateur.
M. Jordi ROSSINYOL : Les Amis de la Terre œuvrent, bien au-delà de la protection de l’environnement, pour l’établissement de sociétés durables au Nord comme au Sud. Notre longue expérience nous a permis de nous forger une opinion que l’on peut décliner selon trois axes : incertitudes flagrantes quant aux effets des OGM sur la santé humaine, risques majeurs pour l’environnement, menace d’hégémonie sur les agricultures conventionnelle et biologique.
Sur le plan de la santé, il est impossible d’occulter les incertitudes scientifiques liées aux OGM en l’absence d’étude épidémiologique dans les pays qui les cultivent ou les commercialisent couramment. Les quelques essais réalisés en laboratoire sur des animaux ne sont pas sans lacunes, rapidement balayées par les autorités censées en juger. Cela aussi ne peut qu’inciter à la plus extrême prudence, d’autant que plusieurs études indépendantes ont rendu des conclusions plus qu’inquiétantes.
M. le Président : Qu’appelez-vous « études indépendantes » ?
M. Jordi ROSSINYOL : Les études non financées par les lobbies agricoles ou les grosses sociétés agro-biotechnologiques.
M. le Président : L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) est-il à vos yeux indépendant ?
M. Jordi ROSSINYOL : Tout le monde connaît ses positions dans ce domaine… Il serait innocent de l’affirmer.
M. le Rapporteur : Ils ont tout de même le droit d’avoir des positions !
M. Jordi ROSSINYOL : Naturellement, et on les connaît.
M. François GUILLAUME : Les Amis de la Terre sont indépendants, eux !
M. Jordi ROSSINYOL : Tout à fait. Si vous trouvez chez nous des financements de grands groupes, je vous invite à nous les montrer.
Ces études indépendantes ont mis en avant l’instabilité des constructions génétiques, un accroissement de la mortalité des animaux ou encore des impacts délétères sur la faune. Je peux vous indiquer le nom des personnes et des organismes qui les ont conduites.
Dans le domaine environnemental, au-delà des effets sur la biodiversité liés à l’apparition de super-adventices, les OGM peuvent avoir des impacts intraspécifiques ou interspécifiques qui peuvent aller jusqu’à perturber totalement le fonctionnement de l’écosystème. De surcroît, indépendamment des transferts de gènes, les OGM peuvent représenter une menace directe en se comportant, eux-mêmes, comme des adventices ressurgissant année après année.
Quant à l’idée que cette technologie pourrait limiter les épandages d’insecticides, de nombreuses recherches ont prouvé le contraire.
M. le Rapporteur : Pourriez-vous nous faire parvenir leurs conclusions ?
M. Jordi ROSSINYOL : Volontiers.
Sur le plan agricole et économique enfin, les OGM sont souvent présentés par leurs promoteurs comme une solution au problème de la faim dans le monde. Rien de probant ne permet de l’affirmer, alors même que des études, notamment au Kenya, ont montré que des méthodes plus conventionnelles étaient beaucoup plus efficaces et infiniment moins coûteuses.
Partant de ces trois constatations, les Amis de la Terre réclament une plus grande transparence de la part des autorités et des groupes agro-industriels, la possibilité pour les consommateurs de choisir librement entre produits OGM et non-OGM, ce qui suppose, comme l’Europe l’a déjà demandé, la mise en place, en France, d’une législation et de règles de coexistence propres à garantir tout à la fois l’avenir des filières conventionnelles et biologiques et le droit à une alimentation sans OGM. Cela suppose la possibilité pour les collectivités locales et régionales de créer des zones sans OGM, l’interdiction de toute culture OGM à proximité des zones sensibles ou protégées et la définition d’un régime de responsabilité des différents acteurs en cas de dommage sur la santé et l’environnement suivant le principe pollueur/payeur. Nous demandons, enfin, que notre participation écrite soit incluse dans votre rapport final.
M. Dominique MOURLANE : Je commencerai, comme vous nous l’avez demandé, par une présentation d’ATTAC, suivie d’une déclaration de principe.
L’Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens, créée en 1998, compte aujourd’hui 30 000 adhérents avec 250 comités locaux en France et 56 ATTAC à travers le monde. Nos principales campagnes portent sur les taxes globales, les paradis fiscaux, la dette et l’Accord général sur le commerce et les services (AGCS). Cette année est une période particulière, puisque toutes nos forces sont lancées dans le combat contre le projet de traité européen nommé « Constitution européenne », qui justifie d’autant plus l’existence de la commission OGM au sein d’ATTAC, tant la volonté productiviste agricole de ce projet européen est évidente. Nous avons décidé de nous saisir de la question des OGM sous l’angle non pas environnemental, mais économique et juridique, et nous vous promettons de réelles surprises cette année.
Cela dit, au nom de la commission OGM et d’ATTAC, je souhaite faire une déclaration à l’adresse du Président de la mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, qui prendra probablement plus de trois minutes.
M. Le Déaut, la démagogie est une arme aisée que, manifestement, vous savez utiliser au service de quelques entreprises agro-semencières. Vos propos parus dans le n° 9 de Plantes transgéniques de janvier 2005 ne sont pas dignes d’un responsable politique à la tête d’une mission parlementaire chargée de réfléchir aux enjeux des essais et de l’utilisation des OGM.
Vous vous faites le haut-parleur de quelques semenciers en vous rendant coupable des mêmes abus que ceux que vous reprochez à vos soi-disant adversaires. Vous n’êtes pourtant pas sans connaître les arguments développés dans le rapport des « 4 Sages »… Nous aimerions que vous sachiez vous reporter aux conclusions de ce rapport. Si telle devait être votre intention, nous serions les premiers à vous emboîter le pas.
M. François GROSDIDIER : M. le Président, nous ne sommes pas dans cette mission pour entendre cela !
M. le Président : Je conçois que vous vous en offusquiez, mais la démocratie nous commande de le laisser parler, d’autant que le Président est en cause.
Mme Odile SAUGUES : Les auditions sont faites pour entendre nos invités !
M. François GROSDIDIER : Nous les avons invités pour parler d’OGM…
M. le Président : M. Grosdidier, c’est moi qui préside. Je laisse M. Mourlane poursuivre, d’autant que, si je l’en empêchais, je serais à coup sûr accusé de tous les maux… Je l’enjoins simplement à respecter la règle du jeu et les trois minutes imparties.
M. Dominique MOURLANE : Malheureusement, dans votre dernière production, M. Le Déaut – mais vous êtes coutumier du fait – vous mettez à bas tous les travaux auxquels vous aviez précédemment participé.
Vous regrettez que le débat soit inexistant, mais vous omettez de signaler que votre parti, lorsqu’il était aux affaires, s’est bien gardé de l’engager, contrairement à ce qui s’est passé en Angleterre, par exemple.
De quoi avez-vous peur, M. le député, pour ainsi montrer du doigt certains présidents de région ou de département qui ont eu le courage de prendre des motions anti-OGM ? Cette stigmatisation s’apparente à une véritable pression assortie d’un manque flagrant d’arguments. Compte tenu de la place que vous occupez dans cette mission, c’est déloyal, pour ne pas dire plus.
Au-delà de la polémique, venons-en au fond du dossier.
Vous êtes un expert dans l’art du glissement sémantique : considérer les transferts de gênes naturels comme identiques aux chimères génétiques nous laisse songeurs… Vous assimilez l’introduction d’un pesticide dans une construction génétique à l’évolution des espèces. Cela n’a rien de scientifique. Il y a là un pas que l’homme a franchi et que vous accompagnez sans précaution. Vous n’êtes pas sans savoir que le terme OGM est impropre pour qualifier la transgénèse. Notre combat n’est pas de nous opposer aux transferts de gênes qui existent depuis la nuit des temps, mais simplement de ne pas accepter des techniques qui n’ont toujours pas fait leurs preuves et qui, bien au contraire, montrent nombre d’inconvénients au fur et à mesure de leur exploitation.
Vous citez pêle-mêle « les moyens d’évaluer les impacts des OGM sur l’environnement et la santé ou sur les performances agronomiques » en souhaitant réaliser des essais en plein champ, alors que tous les essais en laboratoires n’ont pas été effectués ou poussés jusqu’à leurs termes, en particulier en ce qui concerne la toxicologie.
Vous n’êtes pas sans connaître, la chose ayant été dénoncée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), la baisse des budgets affectés aux recherches toxicologiques, le manque de spécialistes en toxicologie constaté en France, l’absence de lieux de formation adéquats, alors que les impacts sur l’environnement sont de plus en plus inquiétants.
Nous connaissons les risques de la diffusion des OGM pour l’environnement ; les rapports des semenciers, eux-mêmes, sont formels sur ce point. L’accroissement des performances agronomiques liées aux OGM lors des trois premières années, suivi d’une diminution dans les années qui suivent est un phénomène également connu. Quant aux rares analyses portant sur la santé, elles ont été soit décriées, soit interdites à la publication, quand leurs budgets n’ont pas été carrément supprimés, comme ce fut le cas en Indre-et-Loire avec ces prélèvements sanguins sur des bovins nourris aux tourteaux – toujours congelés – de soja génétiquement modifié. Les mêmes méthodes avaient déjà été utilisées dans l’affaire de l’amiante. D’un côté « on » fait valoir des avantages économiques incontournables que présente cette technique pour notre société, et de l’autre « on » tait soigneusement ses inconvénients.
En ce qui concerne la santé animale et la santé humaine, il n’y aura jamais assez d’études. S’il advenait, par hasard, quelque scandale lié aux OGM, nous saurions vous rappeler votre responsabilité, comme aux membres de l’Académie des sciences qui, voilà deux ans, ont tenu des propos similaires sans aucun fondement scientifique.
Tout récemment, les médecins anglais ont exprimé leur inquiétude sur les bénéfices réels des OGM et demandé que des recherches approfondies soient engagées sur les effets de leur consommation.
Vous proposez une gouvernance des technologies. C’est bien de cela, entre autres, dont il est question dans le rapport des « 4 Sages », auquel vous avez participé. Qu’en est-il aujourd’hui, et de ce rapport et de la gouvernance ? L’argument selon lequel le débat ne doit porter que sur la gouvernance liée à ces technologies, signifie, sous votre plume, que les OGM sont un fait acquis et qu’ils ne nécessitent aucun débat. Vous êtes en totale contradiction avec le début de votre propos.
M. le Rapporteur : Je suis obligé d’intervenir ! Il n’y aura aucun débat si nous continuons ainsi !
M. François GUILLAUME et M. Jean-Marie SERMIER : Ce n’est pas sérieux !
M. Dominique MOURLANE : Je n’ai pas fini.
M. le Président : Pensez aux autres, M. Mourlane…
M. Dominique MOURLANE : Vous parlez ensuite de compétition économique, de bénéfices pour les consommateurs et les agriculteurs, mais vous ne proposez aucune autre solution de recherche que celles proposées par des entreprises qui n’ont que faire des agriculteurs ni des consommateurs dans leurs pratiques quotidiennes, mais qui y ont de réels intérêts économiques.
M. le Président : M. Mourlane, ceci est une audition, avec des règles du jeu. Il faudra d’abord que je vous réponde et que je m’explique. Nous avons constitué une mission d’information…
M. Dominique MOURLANE : Précisément, et vos collègues doivent savoir ce que vous écrivez par ailleurs.
M. le Président : Ils le savent.
M. Dominique MOURLANE : Je n’en suis pas sûr !
M. le Président : Ce n’est pas vous qui allez les informer…
M. Dominique MOURLANE : Vous nous demandez de venir vous informer, nous le faisons.
M. le Président : Ce genre de méthode ne sert qu’à compliquer le débat. Sachez que nous avons déjà discuté de cette affaire au sein de la mission. Nous aurions déjà dû aborder la phase des questions. Concluez rapidement.
M. Dominique MOURLANE : Donnons à l’Europe la possibilité d’une véritable recherche agronomique qui, tout en laissant une plage de recherche sur les OGM en milieu confiné, privilégierait des études sur les sols, sur la rotation des cultures, sur les cultures associées, moins consommatrices d’énergie, sur des techniques de cultures efficaces et précautionneuses pour les sols et pour la santé.
Donnons à la recherche agronomique publique une véritable chance de se pencher sur l’avenir de notre planète, tout en satisfaisant les besoins de tous, plutôt que de proposer, comme vous le faites, une solution unique, qui n’a d’autre intérêt que celui d’accroître les dividendes de quelques grandes entreprises.
C’est par cette recherche libre, aux antipodes de la compétition économique opposant quelques groupes privés, que nous garantirons tout à la fois l’avenir de la recherche européenne, notre indépendance alimentaire, et que nous contribuerons également à celle des pays du Sud.
Le récent rapport du secrétariat de la Commission de coopération environnementale, qui comprend le Canada, le Mexique et les Etats-Unis, constate l’impossibilité de la coexistence des cultures OGM et non-OGM. L’Europe a donc un réel intérêt, sur le plan économique, à orienter ses recherches dans le sens d’une agriculture sans OGM en mettant en avant des principes de solidarité entre les diverses composantes de la société, mais également avec les populations du Sud.
Votre argumentaire ne repose que sur la domination économique, sans jamais évoquer la notion de solidarité entre les générations, les peuples, les classes. Vos choix technologiques visent non pas à répondre aux aspirations du plus grand nombre mais à assurer la consolidation de quelques capitaux à travers la planète. La compétition économique que vous nous proposez, en faisant fi de notre santé, est néfaste pour l’avenir de la terre, pour les générations futures, pour la solidarité en général. Nous nous battrons pour que la recherche reste à la disposition de l’humain, indépendante de la sphère économique et respectueuse du principe de transparence.
Aussi nous posons-nous la question, M. le député, de votre place à la tête de cette mission et de la manière dont vous avez présenté ce dossier.
M. le Président : Premièrement, j’ai été démocratiquement élu par mes collègues, à l’unanimité des voix. Deuxièmement, l’article que vous citez a été écrit au tout début du mois d’octobre 2004, avant la création de la mission parlementaire. Mes propos ne pouvaient donc l’engager. Troisièmement, la commission des « 4 Sages » avait conclu que les essais en plein champ pouvaient être autorisés à une triple condition : transparence, précaution, parcimonie. Je n’ai rien dit de plus…
M. Dominique MOURLANE : Il était également question de responsabilité !
M. le Président : …quand bien même certains, y compris dans cette enceinte, contestent les expérimentations en plein champ. Je n’ai fait que répéter dans cet article ce que j’avais signé, contrairement à ce que vous prétendez.
Quant aux propos que vous me faites tenir sur la transgénèse, ils relèvent proprement de la caricature. Nous sommes d’accord sur le fait que les techniques de transgénèse utilisées par l’homme sont un procédé infiniment plus rapide que la transgénèse naturelle. Je crois avoir prouvé, au cours de ma carrière scientifique, comme à l’occasion des débats que j’ai présidés en 1998 – et qui m’avaient valu les félicitations des organisations des plus diverses, dont la vôtre, mais également de formations politiques très éloignées de la mienne – que je connais ce dont je parle. Il y a deux chances sur trois pour que le gène que vous trouvez dans une espèce existe ailleurs dans la nature. Ce qui signifie qu’il sera un jour possible, grâce à la recherche, de sélectionner les gènes qui existent ailleurs dans une banque de gènes. Personne ne peut nier cette réalité, pas plus que la possibilité pour des gènes viraux de s’introduire à un moment donné de l’évolution par le biais des oncogènes.
J’ai été le premier à dire que les questions du lieu d’insertion et de l’activation des gènes dormants n’étaient pas résolues à ce jour. Mais le bla-bla-bla de gens qui se plaisent à répéter inlassablement les mêmes arguments, sans jamais les étayer, finit par devenir insupportable. Et si je suis partisan d’encadrer la recherche en lui posant des conditions, je suis en désaccord avec les faucheurs volontaires et leur stratégie globale : empêcher toute avancée dans une technique qui, dans certains cas, peut être utile. La transgénèse n’est pas un produit, mais une technique. On doit pouvoir s’en servir quand c’est bon et ne pas l’utiliser quand cela ne l’est pas.
Enfin, monsieur, tous ceux qui me connaissent, y compris les membres de votre association dans laquelle je compte des proches, loin de tenir des propos aussi outranciers, savent combien je suis attaché à nouer des rapports harmonieux et équilibrés entre les pays du Nord et les pays du Sud, particulièrement sur les questions de brevet du vivant. J’ai passé sept ans en Afrique à me battre sur ces sujets. Vos accusations blessantes prouvent que vous ne vous êtes même pas donné la peine de regarder sur mon site Internet comment j’y développe une pensée, non pour l’imposer, mais seulement pour donner un avis dans le débat. Dans mon propre parti, nous ne sommes pas tous d’accord ; c’est la grandeur d’un parti politique que de permettre la discussion sur de tels sujets. (Mmes et MM. les membres de la mission parlementaire applaudissent.)
M. le Rapporteur : Nous sommes tous solidaires de notre Président.
M. Hervé LE MEUR : Nous sommes une association de citoyens, sans affiliation politique ou religieuse. Si OGM-dangers s’écrit avec un « s », c’est pour rappeler que les OGM sont des objets multiformes qui ne peuvent être réduits aux seuls enjeux alimentaires, environnementaux et parfois économiques.
Giuliano d’Agnolo, directeur d’un laboratoire italien de biologie cellulaire, écrit : « Je ne comprends pas l’inquiétude des consommateurs. Comme s’il existait encore des cultures naturelles. ». Au-delà de la question des risques alimentaires, ce qui m’intéresse, c’est cette conviction – que je ne discuterai même pas – qu’il n’y a pas de cultures naturelles et bientôt plus de nature. Tout cela au profit de la culture, au sens intellectuel du terme… Voilà que notre société, apollinienne au sens de Nietzsche, prétend faire la guerre à la nature par adoration de la Culture, de la Volonté, de l’intellectualité, dans un délire manichéen attentatoire à une humanité par nature complexe et ambivalente. La nature comme irréductible à notre volonté est la seule pierre de touche de notre humanité. Nous en avons donc besoin. Et sans pierre de touche, pas d’or…
Dans une société où, si l’on n’est pas progressiste, on est considéré comme réactionnaire, doit à l’évidence régner la foi dans l’existence d’un sens de l’histoire – à gauche comme à droite : ce que vous appelez le progrès –, une foi qui transparaît à travers les quelques citations qui suivent.
Ainsi celle de Condorcet qui rappelle le fondement historique remontant aux lumières et au positivisme : « La nature n’a marqué aucun terme au développement des facultés humaines ; la perfectibilité de l’homme est réellement infinie », à rapporter à cette déclaration de M. Serge Lepeltier, ministre de l’écologie : « Je suis pour la poursuite des expérimentations d’OGM en plein air, sauf à remettre en cause la poursuite du progrès », ou encore à celle-ci : « Je suis fier et heureux de pouvoir continuer à participer au développement de la science et du progrès », dont l’auteur n’est autre que le célèbre docteur Antinori qui travaille au clonage reproductif humain ! Mais en fait, quelle différence, mis à part le fait que celui-ci n’ait pas reçu l’onction d’un Etat ? Le xxe siècle a bien montré que les Etats n’étaient pas synonymes de Bien. Fussent-ils de droit…
Autre aspect, la volonté démiurgique animant ces chercheurs qui travaillent à make life from scratch – fabriquer la vie à partir de rien – dont on a encore parlé récemment.
Gregory Stock, universitaire américain, favorable aux modifications génétiques de l’humain, affirme : « Si je voulais faire émerger l’amélioration génétique de l’homme par l’homme, je ferais exactement ce qu’il est en train de se passer : je mènerais un large projet international de décodage du génome humain comme le Human Genome Project, auquel la France participe ; je favoriserais les pratiques de fertilisation in vitro et de diagnostic préimplantatoire pour éviter les maladies génétiques et, bien sûr, je développerais aussi les techniques de manipulation du patrimoine génétique des cellules. »
Nous pensons que vous, les politiques, soutenus par des chercheurs qui ne sont, d’ailleurs, pas forcément vendus au grand capital, vous travaillez à préparer l’acceptation d’un monde que pourtant, j’en suis persuadé, vous réprouvez, mais dont vous refusez, pour le progrès, pour la science, pour la France, d’empêcher l’avènement.
Enfin, Peter Sloterdijk, philosophe allemand des biotechnologies – mais François Dagognet ne dit pas autre chose en France – écrit : « Les nouvelles applications de la biologie permettent aux hommes d’agir sur leur vie même, en repoussant, à terme indéfiniment, l’horizon de la mort ».
Nous sommes pour notre part dans le camp de ceux qui acceptent la mort, la maladie, les défauts, et vous, dans celui du progrès, de la croissance, de la perfection, de l’absence de limites. C’est en fait à la lutte de deux mondes que l’on assiste, mais vos sentiments devraient, me semble-t-il, vous conduire à rejoindre le nôtre.
M. Éric MEUNIER : La création d’Inf’OGM en 1999 répondait au besoin de M. et Mme Tout-le-Monde d’aller un peu plus loin dans la compréhension des enjeux et de l’évaluation des OGM, dans un contexte de difficulté d’accès à l’information. Inf’OGM n’a pas de position pour ou contre les OGM. Notre militantisme se borne à garantir la transparence et l’accès à l’information de tous les acteurs de ce débat par le biais d’un bulletin mensuel, d’un site internet et d’une liste de diffusion et en participant à des conférences. Nous nous efforçons de fournir une information critique sur les OGM, qu’il s’agisse des enjeux économiques, de la situation législative, des découvertes scientifiques ou encore des actions citoyennes en France et dans le monde, autant d’éléments auxquels le citoyen n’avait pas accès avant 1999. Nous n’avons, j’y insiste, aucune position militante pour ou contre les OGM, si ce n’est notre souci de défendre le droit à l’information pour tous.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : La mission de l’Union fédérale des consommateurs (UFC) est de défendre, dans le domaine des OGM comme ailleurs, les droits des consommateurs : le droit à la sécurité, autrement dit d’être protégé de la mise en marché de produits dangereux, le droit à l’information, le droit de choisir, le droit de recours en cas de préjudice et le droit de représentations. Une modification de la législation actuelle nous paraît nécessaire pour garantir ces cinq droits fondamentaux.
Sur le plan de la sécurité, le dispositif d’évaluation des OGM mérite d’être rendu plus transparent et plus cohérent avec l’évaluation européenne. Sur le plan de l’information, l’obligation d’étiquetage devrait être étendue aux produits animaux. Pour garantir le droit de choisir, la France doit rapidement adopter, comme d’autres pays l’ont déjà fait, des dispositions propres à garantir la coexistence des filières. Nous avons pris dans ce domaine un retard regrettable. Pour ce qui est du droit de recours et de réparation, la réflexion sur les problèmes de responsabilité liés à la mise en marché et à la dissémination est en cours, mais avance trop lentement à notre goût. S’agissant enfin du droit de représentation, on nous promet depuis des années la mise en place d’un deuxième cercle d’évaluation, ainsi que le préconisait le rapport des « 4 Sages » : nous l’attendons toujours…
Au total, la France nous paraît très en retard sur ses voisins européens pour tout ce qui touche aux OGM. Il faut impérativement accélérer le processus.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Contrairement à mes collègues, je ne représente pas une association, mais le journal de l’Institut national de la consommation, 60 millions de Consommateurs, dont je suis la directrice de rédaction.
Notre principale mission est d’assurer l’information indépendante des consommateurs. C’est ce que nous avons très tôt fait pour les OGM en mettant en avant les droits fondamentaux des consommateurs et, particulièrement, le droit à la sécurité, le droit au choix et donc le droit à une information loyale. Il n’était pas question d’un étiquetage des aliments issus d’OGM en 1996 : beaucoup nous répondaient que c’était impossible… On sait ce qu’il en est.
Parallèlement à notre activité journalistique proprement dite, nous menons des travaux originaux propres à appuyer notre information : ainsi les prélèvements que nous avons effectués sur une série de produits du commerce et dont nous avons publié les analyses en 1998 sous le titre « Nous en mangeons sans le savoir », prouvant que nombre d’aliments contenaient d’ores et déjà des OGM, sans que le consommateur le sache. Dernier en date, le dossier que nous avons publié en janvier 2002 sous le titre « OGM : 103 produits analysés, 36 contaminés ». La réglementation n’étant pas encore effective à cette époque, aucun fabricant n’était naturellement en infraction, mais nous avions mis en avant le problème des seuils et du 0 %, sachant que nos systèmes de détection nous permettaient déjà de descendre à 0,1 % et même à 0,01 %. Etait également posée la question de savoir ce que peut être, dans ces conditions, une filière sans OGM.
L’Europe s’est dotée, depuis, d’une réglementation en matière d’étiquetage probablement la plus sévère du monde, mais non exempte de lacunes. Le seuil de 0,9 % n’a finalement guère de signification, dans la mesure où les capacités de détection permettent d’aller bien au-dessous. Par ailleurs, si le principe de l’étiquetage des produits dérivés est désormais acquis pour les filières végétales, il n’en est pas de même pour les productions animales, alors même que l’éleveur dispose, lui, de toutes les informations.
Se posent enfin les problèmes de l’évaluation et de l’indépendance des experts, sur lesquels nous reviendrons dans le débat.
M. Olivier ANDRAULT : Deuxième association de consommateurs en France, la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV) travaille depuis 52 ans sur tous les sujets liés à la consommation : habitat, crédit, alimentation et santé. Nous nous attachons à prendre en compte les positions des consommateurs telles qu’elles ressortent des nombreux sondages menés en France et en Europe, lesquels montrent régulièrement qu’une majorité de consommateurs – autour de 60 % – est opposée à la présence d’OGM dans l’alimentation. Et si les chiffres s’inversent pour ce qui est des OGM à but thérapeutique, ils sont pratiquement unanimes – 90 à 94 % – à exiger d’être informés.
Compte tenu de ces éléments, la CLCV n’est pas a priori contre les OGM qui, dans certains cas de figure, pourraient présenter un intérêt. Encore faut-il, avant de les cultiver et de les commercialiser – à plus forte raison lorsque c’est à des fins alimentaires – respecter certains préalables : utilité réelle pour le consommateur, absence de tout risque sanitaire et environnemental à court et à long terme, autant de conditions qu’aucun des OGM produits à grande échelle ne remplit jusqu’à présent.
Partageant largement les exigences des deux orateurs précédents, la CLCV demande que les associations de consommateurs soient consultées dans le cadre de l’évaluation des OGM sur les questions sociétales, conformément aux recommandations du rapport des « 4 Sages », mais également le rapport de la mission du Sénat – aussi appelé rapport Bizet. Nous souhaitons que, nonobstant ces aspects sociétaux, l’évaluation soit étendue aux aspects de sécurité environnementale et sanitaire à long terme, qui, pour l’heure, ne sont pas pris en compte. Nous attendons des garanties sur le maintien des filières conventionnelles, sans surcoût pour le consommateur, ce qui implique la mise en place d’un régime de responsabilité au niveau français et la possibilité pour l’agriculteur de s’assurer contre le risque de contamination par des OGM cultivés à proximité. Nous demandons, enfin, qu’une réglementation nationale et, mieux, communautaire précise, au-delà des simples lignes directrices actuellement posées, les conditions de culture des plantes génétiquement modifiées et que l’obligation d’étiquetage soit étendue aux produits issus d’animaux ayant eux-mêmes consommé des OGM.
M. le Président : Rappelons que la transposition des directives de 1991 a bel et bien donné lieu à débat au Parlement – dans l’indifférence générale, certes – et qu’aucune association n’avait alors donné son avis. Depuis 1998, date à laquelle j’avais moi-même avancé des propositions, les choses n’ont guère avancé…
M. Lilian LE GOFF : Je rappelle que la France a été déférée devant la Cour européenne de justice pour n’avoir pas transposé la directive 2001/18/CE.
M. le Président : Je parlais des directives 90/219/CE et 90/220/CE. C’est parce que la transposition de la directive 2001/18/CE a été annoncée par le Gouvernement que le Président de l’Assemblée nationale a souhaité constituer une mission d’information, afin de consulter au préalable l’ensemble des acteurs concernés par ce dossier.
Les conditions mises à la levée du moratoire, lors du débat public au Conseil économique et social, portaient sur l’information du public, sur la traçabilité et sur la question des seuils, trois points aujourd’hui résolus. Or plusieurs d’entre vous réclament désormais la prorogation du moratoire tant que le principe d’assurabilité n’est pas mis en place. S’opposer aux OGM est un droit parfaitement respectable, mais cela doit-il conduire à poser sans cesse de nouvelles exigences sitôt les précédentes satisfaites ?
L’environnement est, pour des raisons très nombreuses et diverses, mis à mal sur notre planète. Pensez-vous réellement que les OGM pourraient représenter un risque encore plus grand, sinon le mal absolu, dans la mesure où l’on réclame à leur endroit des mesures
– étiquetage, seuils de mesure, obligation de résultats – qui jamais n’avaient été exigées pour les insecticides et autres techniques agricoles ? Croyez-vous vraiment qu’on améliorera la situation à cet égard en classant les OGM dans une catégorie spéciale ?
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Nous exigeons également des obligations de résultats pour les pesticides, par exemple, et nous trouvons tout aussi intolérables les dépassements des limites maximales de résidus de pesticides dans les fruits et légumes.
M. le Président : A ceci près qu’il n’y a pas d’obligation d’étiquetage, alors que la réglementation européenne l’impose.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Effectivement. Mais l’obligation de résultat vaut pour les autres domaines.
M. Lilian LE GOFF : La préservation de l’environnement grâce à la réduction des pesticides est un des arguments majeurs des promoteurs des OGM. Mais si ceux-ci peuvent effectivement réduire l’emploi de certains herbicides sélectifs, c’est pour utiliser davantage les herbicides totaux, infiniment plus dommageables, puisqu’ils liquident toutes les espèces végétales, à l’exception de celles qui ont été précisément manipulées pour leur résister. La biodiversité, déjà sérieusement mise à mal, ne sera que plus dégradée par l’emploi systématique de ces biocides.
Qui plus est, se pose pour le consommateur le problème des animaux ayant consommé des végétaux transgéniques. L’alimentation animale étant principalement constituée de soja – pour l’essentiel importé du continent américain –, se pose la question du droit à l’information. Se pose également celle de la sécurité alimentaire et des effets potentiels de l’accumulation, par bioconcentration, des métabolites de dégradation de ces herbicides
– Roundup et autres – dont certaines peuvent être plus toxiques que la molécule-mère elle-même, et dont nombre de publications américaines ont déjà dénoncé les effets cancérigènes et protoxiques. La Direction générale de l’alimentation (DGAL) a systématiquement omis de nous faire connaître les résultats de l’étude des éventuelles traces de métabolites de dégradation, voire d’éléments actifs présents dans les espèces manipulées, ni les effets observés sur les animaux qui les consomment. Malgré nos demandes réitérées, nous n’avons jamais obtenu de réponse.
M. le Président : Lors du débat contradictoire, il faudra nous montrer les articles prouvant la présence de ces métabolites dans les tourteaux à base de soja transgénique par comparaison avec les tourteaux fabriqués avec du soja ordinaire.
M. Lilian LE GOFF : Nous posons seulement la question…
M. le Président : Aucune publication de la FAO41 ne l’a jamais laissé entendre. J’ai l’impression, compte tenu de mon expérience sur ce sujet, que chaque fois qu’un problème est résolu, on trouve toujours une nouvelle question à poser.
M. Lilian LE GOFF : Vous ne pouvez pas répéter cela. C’est faux.
M. le Président : Je vous demande seulement de nous apporter les éléments à l’appui de vos affirmations.
M. Lilian LE GOFF : Je vous apporterai les courriers, mais je ne peux pas apporter de réponse, puisque je n’en ai pas eu à ma question…
M. le Président : Nous vous inviterons aux tables rondes contradictoires et vous y viendrez avec les éléments prouvant que les tourteaux fabriqués à partir de plantes transgéniques présentent, sur le plan des métabolites, une différence avec les tourteaux issus de plantes non transgéniques.
M. Lilian LE GOFF : Ce n’est pas à nous d’apporter la preuve.
M. Jean-Marie SERMIER : Dans ce cas, il ne faut pas l’affirmer !
M. le Président : Comment, dans ces conditions, ferez-vous avancer le débat contradictoire ?
M. Lilian LE GOFF : Vous inversez la charge de la preuve. C’est là un point fondamental qui devrait interpeller tous les parlementaires et le législateur. Ne trouvez-vous pas choquant, lorsque l’on interpelle une autorité compétente en terme de sécurité alimentaire, que celle-ci ne daigne même pas vous répondre ?
M. le Président : Sur ce point précis, vous avez raison. Nous vous inviterons au débat contradictoire. Une étude de l’AFSSA fait état de consommations d’herbicides et d’insecticides en baisse, contrairement à ce que vous affirmez. Il vous faudra produire des documents prouvant que ce qu’elle dit est faux. Je suis prêt à tout entendre, sur tous les sujets, et il m’est arrivé d’être convaincu sur certains points. Encore faut-il, en expertise contradictoire, avancer des arguments, preuves à l’appui.
M. Lilian LE GOFF : Ne déformez pas mes propos : je n’ai pas affirmé qu’il y avait des traces de pesticides dans les OGM que l’on donne aux animaux mais que, compte tenu de la nature même d’un OGM et de l’objectif dans lequel il a été manipulé, il y avait de quoi se poser des questions. Et lorsqu’on les pose aux services compétents, on est en droit d’avoir une réponse.
M. le Président : Je suis d’accord avec vous sur ce point. Mais si l’un d’entre vous pouvait apporter des preuves lors des auditions contradictoires, nous ferions avancer le débat. Si j’affirme à la télévision que tel produit est dangereux, tout citoyen normal en déduira qu’il ne faut pas en manger – a fortiori si je suis médecin… Soyons clairs : je suis partisan d’interdire tout ce qui est dangereux.
M. Lilian LE GOFF : Le principe de précaution voudrait – s’il était appliqué – que, sitôt qu’apparaît un facteur de risque potentiel, on fasse tout pour ne plus y être exposé, et cela vaut particulièrement pour les pollutions par les pesticides. Dans le cas présent, se pose le problème de l’imprégnation de l’environnement par les herbicides totaux et la question de savoir ce que ceux-ci deviennent tout au long de la chaîne alimentaire.
M. le Rapporteur : On a souvent bien du mal à cerner la vérité, chacun citant ses sources, les unes vraies, les autres fausses et même parfois volontairement fausses… Que pensez-vous de la création d’un organisme chargé de diffuser une information totalement objective sur les OGM et contrôlé par les pouvoirs publics ?
M. Lilian LE GOFF : Ce serait tout à fait souhaitable et nous l’avons nous-même appelée de nos vœux. Rien n’existe, en termes de veille sanitaire, pour ce qui touche à l’exposition des filières alimentaires aux OGM. En décembre 2001, lors d’un colloque international organisé à l’Institut Pasteur par l’AFSSA sur le thème des avantages – sans parler des risques… – à attendre des OGM, aucun avantage n’avait été clairement démontré. Tout reposait sur des professions de foi.
En revanche, les risques étaient d’ores et déjà mis en évidence, et particulièrement ceux de dissémination des pollens transgéniques et réactions allergiques chez l’animal, etc. Les allergies sont un phénomène en constante augmentation : plus 10 % par an, selon les allergologues. Tout porte à croire que cette évolution ne s’inversera pas et que les cas d’intolérance alimentaire se multiplieront, dans la mesure où les organismes ne sont pas nécessairement habitués aux propriétés et protéines spécifiques présentes dans les plantes génétiquement modifiées (PGM). Bernard Kouchner avait promis de mettre en place un service de veille sanitaire spécifiquement consacré à l’allergie ; nous l’attendons toujours… Qui plus est, comment pourrait-il fonctionner sans un étiquetage des produits issus d’animaux ayant consommé des OGM, autrement dit sans un mécanisme de traçabilité permettant de mettre clairement en évidence des relations de cause à effet en cas d’allergie ?
M. le Rapporteur : Croyez-vous utile de mettre en place, aux côtés d’une commission purement scientifique chargée d’évaluer les risques, une commission « civile » qui aurait pour mission de comparer ces risques aux avantages attendus ?
M. Lilian LE GOFF : Nous-mêmes l’avions demandé il y a trois ans. Si l’avis des scientifiques est évidemment indispensable, la société civile a également son mot à dire dans le cadre d’une commission « associative » chargée de réfléchir sur le sujet.
M. le Président : Devra-t-elle pour autant analyser le dossier technique au cas par cas ?
M. Lilian LE GOFF : Le but à nos yeux n’est pas de supplanter la Commission du génie biomoléculaire (CGB), mais de réfléchir sur les enjeux de société et aux modifications significatives à apporter, notamment à la législation.
M. le Rapporteur : Comment cette instance devrait-elle à votre avis être composée ?
M. Hervé LE MEUR : L’idée d’une telle instance est dans l’air depuis déjà un certain temps et l’on ne peut que l’approuver. Cela dit, il serait bon que la composition de la commission scientifique soit un peu plus équilibrée dans un sens moins « mono-idéologique », autrement dit centré sur la biologie moléculaire.
M. le Président : Vous voudriez y voir des biologistes, des généticiens… ?
M. Hervé LE MEUR : Et des toxicologues.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Et des allergologues !
M. Lilian LE GOFF : Et des environnementalistes, évidemment.
M. Olivier ANDRAULT : Nous sommes évidemment demandeurs d’un deuxième cercle d’évaluation des OGM, chargé des questions sociétales et de l’évaluation bénéfice/risque. Encore faudra-t-il veiller à ce que la société civile, et singulièrement les principales associations de consommateurs, y soient correctement représentées.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : L’évaluation par ce « deuxième cercle » est du reste demandée dans bon nombre de domaines jusqu’à présent marqués par une prééminence de l’évaluation scientifique et sanitaire, notamment pour ce qui touche à l’alimentation. Rien n’a encore été mis en place en France pour permettre la consultation de toutes les parties intéressées, contrairement à ce qui se fait au plan européen, et cette constatation dépasse largement la seule problématique OGM.
M. Pierre COHEN : Je tiens, en préalable, à dire combien je déplore les propos très durs tenus à l’encontre de Jean-Yves Le Déaut, dont le seul effet a été d’électriser le débat.
Tout le monde s’accorde à reconnaître que nous disposons déjà d’une multitude de commissions à l’évidence trop cloisonnées : une pour l’évaluation des recherches en milieu confiné, une autre pour les recherches en plein champ, une autre pour le suivi des productions, sans parler des instances transversales. Malheureusement, tout cet encadrement apparaît somme toute assez inefficace. L’idée d’améliorer l’information et de faire appel à d’autres compétences part d’une bonne intention, mais avez-vous des propositions concrètes en matière d’évolution des structures ?
Je sens chez vous une certaine tendance à généraliser, alors qu’au fil des auditions, j’en viens à penser que le cas par cas est préférable. Etes-vous réellement convaincus que les OGM sont globalement à jeter ? Ne doit-on pas plutôt les considérer comme une technique, la question restant de savoir, cas par cas, ce que l’on en fait ?
Enfin, même si je persiste à trouver inadmissibles les propos entendus à l’adresse de Jean-Yves Le Déaut, nous sommes plusieurs ici à distinguer de ce débat d’ensemble les questions relatives à la propriété intellectuelle, et particulièrement à nous inquiéter du risque de voir le monde agricole évoluer vers un mode de production unique, à mes yeux inacceptable, conforme aux intérêts financiers des lobbies semenciers. Etes-vous prêts à faire la différence entre ce débat particulier – qui pose notamment les questions de la coexistence des productions et de la liberté de choix du producteur comme du consommateur – et le débat sur nos capacités de recherche dans le domaine des OGM ? Peut-on vraiment dire non à tout, en faisant preuve d’un terrorisme de mauvais aloi qui, parce qu’il interdira de fait les recherches, privera notre pays de la possibilité de parler en toute connaissance de cause de ces sujets au niveau international ?
M. Dominique MOURLANE : Le regroupement des commissions, tel que vous le proposez dans votre questionnaire, me paraît une bonne chose, tout comme la création d’un « deuxième cercle » auquel participeraient les associations de consommateurs, de défenseurs de l’environnement ou représentant la société civile – pour peu qu’on lui donne les moyens de véritablement peser dans le débat.
La question des enjeux agricoles, et singulièrement de l’évolution du modèle de production, est effectivement posée. Ou bien nous nous engageons dans une évolution productiviste à tout crin intégrant la technologie OGM en tant qu’élément moteur, ou bien nous nous donnons les moyens de développer une recherche agronomique tirant parti tout à la fois de compétences ancestrales et des plus récentes études conduites sur les sols, les rotations des cultures, les complémentarités, notamment dans les pays du Sud qui en ont le plus besoin. Ce qui n’interdit pas les recherches sur les OGM en laboratoire…
M. le Président : Jamais en plein champ ?
M. Dominique MOURLANE : On s’est pour l’instant borné en France à reproduire au champ des expériences déjà réalisées dans d’autres pays, sur l’emploi des pesticides notamment.
M. le Président : Préparez-vous au débat contradictoire, car ce n’est pas vrai.
M. Dominique MOURLANE : Quelles ont été les expériences conduites en 2004 ?
M. le Président : L’expérience détruite à Marsat le 14 août 2004 portait sur le stress hydrique et la fixation de l’azote, et n’avait rien à voir avec une précommercialisation. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Et je regrette que l’on ait ainsi visé un authentique essai de recherche alors qu’il existe des essais industriels… C’est à se demander qui choisit les sites à détruire !
M. Dominique MOURLANE : Les expériences en laboratoire n’ont pas été poussées à leur terme. Rien n’a été fait, notamment dans le domaine de la toxicologie.
M. le Président : Et vous vous référiez tout à l’heure au rapport des « 4 Sages », qui autorisait, dans des conditions très précises, les expérimentations en plein champ…
M. Dominique MOURLANE : Je suis parfaitement fidèle à ce que j’ai dit tout à l’heure. C’est vous qui avez pris, dans votre article, quelque distance avec ce rapport.
M. le Président : Je suis pour la parcimonie, la précaution et la transparence.
M. Dominique MOURLANE : Rien ou presque n’a été fait, notamment dans le domaine de la toxicologie, et le peu qui a été fait a été décrié. Allons au terme de ces expériences et nous verrons, ensuite, s’il y a lieu d’aller au champ.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : J’appelle votre attention sur l’impérieuse nécessité d’une parfaite coordination entre l’instance d’évaluation, quelle qu’elle soit, avec le niveau européen et singulièrement l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Comprenez l’embarras des associations de consommateurs à propos du Bt 11, par exemple, sur lequel le niveau européen et le niveau français ont des jugements parfaitement opposés. Ces discordances posent un réel problème pour qui veut informer le consommateur.
M. le Président : Ce point est désormais réglé, puisque c’est désormais l’AESA qui tranche en dernier ressort. Peut-être faudrait-il d’ailleurs prévoir une clause de sauvegarde.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Reste que, dans la pratique, la coordination est loin d’être au point.
M. le Président : Vous avez raison.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Le dernier forum qui a réuni, à Berlin, l’AESA et les agences nationales de sécurité des aliments a mis en évidence de sérieux problèmes, qu’il faut régler au plus vite pour restaurer la confiance des consommateurs.
M. Hervé LE MEUR : Un économiste aurait davantage sa place dans la deuxième instance d’évaluation que dans une commission scientifique du type CGB… Il serait du reste politiquement utile de rappeler aux citoyens que la science n’est pas une vérité divine, mais d’abord un débat.
Affirmer que les OGM ne seraient qu’une technique part de l’idée, à mon avis fausse, qu’une technique est neutre. Moi-même, je ne dis pas tout à fait les mêmes choses selon que je m’exprime oralement ou par écrit… Sans pour autant critiquer l’évaluation des OGM au cas par cas, je ne crois pas que celle-ci suffise. Enfin, il ne s’agit pas de dire non à tout : le problème se pose en termes d’allocation de ressources. La question n’est pas : « Que perdons-nous si nous n’utilisons pas les OGM ? », mais : « Sur tel problème, quelles techniques avons-nous à notre disposition, à quel terme peut-on espérer une solution et à quel coût ? »
M. Olivier ANDRAULT : Nous sommes, quant à nous, favorables à une évaluation au cas par cas de chaque OGM, en appréciant à chaque fois l’ensemble des bénéfices et des risques. On peut trouver que cela fera beaucoup de dossiers à étudier, mais c’est ce que font déjà les actuelles instances d’évaluation.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Si l’information, en France, était ce qu’elle devrait être, nous ne serions pas ici aujourd’hui et les OGM n’auraient pas une image aussi négative pour nos concitoyens. Il faut mettre en place une information réellement à la portée de tous et les scientifiques sont les premiers à reconnaître qu’ils ne sont pas en mesure de garantir l’absence de tout problème à moyen ou long terme.
M. Rossinyol peut-il préciser ce qu’il appelle « l’impact délétère » des OGM sur la faune ? M. Le Goff a, quant à lui, parlé des abeilles tueuses aux Etats-Unis. Pouvez-vous nous faire part des éléments dont vous disposez sur ce sujet ?
M. Jordi ROSSINYOL : L’exemple du papillon monarque a fait grand bruit aux Etats-Unis, et nombre de scientifiques ont remarqué des effets du Bt sur le taux de mortalité des larves comme des adultes. Les risques ont également déjà été dénoncés sur les abeilles, même en France.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Cela n’avait rien à voir avec les OGM !
M. Pierre COHEN : Il s’agissait d’un insecticide !
M. Jordi ROSSINYOL : Je ne parle pas du Gaucho. Un groupement d’apiculteurs s’est constitué pour dénoncer les effets des OGM sur les abeilles.
M. le Président : Avez-vous des publications là-dessus ?
M. Jordi ROSSINYOL : Nous pouvons vous communiquer des informations…
M. le Président : Je parle de publications dans des revues à comité de lecture. On vous fera valoir, lors des débats contradictoires, qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un papillon comme le monarque, très voisin de la sésamie et de la pyrale, soit sensible au Bt.
M. Hervé LE MEUR : En Grande-Bretagne, les études du ministère de l’alimentation et des affaires rurales ont mis en évidence une diminution de la biodiversité, au moins pour le colza et la betterave. Pour le maïs, en revanche, l’effet était apparemment plutôt positif. Mais l’usage de l’atrazine pour ces expériences, alors que cet herbicide a été interdit entre-temps et alors qu’il est extrêmement polluant, permet de questionner le protocole. Une dilution de 0,1 partie par milliard dans l’eau est suffisante pour modifier la « sexuation » des batraciens.
M. le Rapporteur : Une étude42 a récemment montré que les implications de la tolérance génétique à l’herbicide introduite dans le colza ne portaient aucunement atteinte à la biodiversité. Et, à cette occasion, les écologistes ont regretté que cette opération n’ait pas donné lieu à des expérimentations en champ…
M. Hervé LE MEUR : Je reconnais qu’il y a une contradiction entre les deux études. Mais, je l’ai dit, la science n’est pas la vérité descendue du ciel… Il faudrait entrer dans le détail du protocole.
M. le Président : Que la science ne soit pas la vérité, nous en sommes tous d’accord.
M. Hervé LE MEUR : Je doute que le grand public garde la même distance lorsqu’un scientifique parle à la télévision.
M. le Président : Je sais, pour en avoir été un, que le scientifique a plutôt tendance à parler par incertitudes et à se retrancher derrière l’état actuel des connaissances, ce qui n’est pas le cas de certaines personnes lorsqu’elles s’expriment à l’écran !
M. Hervé LE MEUR : Ce n’est pas forcément contradictoire. Je vous renvoie à l’article dans lequel Marie-Angèle Hermitte analyse le comportement du scientifique et celui de l’expert. La démarche et le discours ne sont pas tout à fait les mêmes.
M. le Président : Marie-Angèle Hermitte était membre de mon comité de pilotage et je lui fais totalement confiance.
M. François GROSDIDIER : Le rapporteur et M. Cohen ont déjà posé les questions que je voulais aborder. Reste que j’ai l’impression d’avoir entendu bien des affirmations gratuites. Cette entreprise de diabolisation systématique laisse à penser que le risque potentiel, s’il justifie évidemment l’application du principe de précaution, semble finalement moins grand que toutes les nuisances – avérées celle-là – liées à l’emploi des pesticides. Quant à l’assertion péremptoire selon laquelle l’avantage économique serait nul, j’aimerais qu’elle soit étayée… En attendant, plus le débat avance, moins les risques me paraissent certains et plus l’avantage des OGM en termes d’économies de pesticides me paraît évident. Si tel n’est pas le cas, j’aimerais qu’on me le démontre autrement que par des pirouettes.
Peut-on me montrer, éléments à l’appui, des cas où l’utilisation des OGM ne présente aucun risque et d’autres où il faut la proscrire ? Il faudrait dépasser ces discussions irrationnelles dans lesquelles les jugements en bloc de part et d’autre interdisent à quiconque de se forger une opinion fondée.
M. Lilian LE GOFF : Sur les risques et bénéfices de l’utilisation des OGM en termes d’utilisation de pesticides, nous n’en sommes plus aux hypothèses gratuites. Nous parlons bien de faits, au vu ce qui se passe aux Etats-Unis et au Canada.
La très grande majorité des OGM sont, pour l’instant, des « OGM à pesticide », manipulés pour sécréter des toxines insecticides Bt ou pour concentrer davantage les herbicides totaux, type Roundup, ce que certains scientifiques appellent des « éponges à pesticides ». Il y a tout lieu de craindre les effets de ces OGM en termes de sécurité alimentaire et sur l’environnement car il s’agit d’épandre larga manu le Roundup sur des champs génétiquement manipulés au lieu d’utiliser des herbicides sélectifs. Ainsi, aux Etats-Unis et au Canada, les statistiques montrent une progression des ventes de Roundup et beaucoup d’agriculteurs ont fait confiance au schéma proposé par Monsanto, ce qui n’est pas sans danger sur le plan économique car le gain en termes de rendement n’est pas toujours au rendez-vous.
Bien que les abeilles tueuses n’aient pas été manipulées génétiquement, j’ai pris cet exemple pour montrer le danger environnemental de l’introduction d’une espèce dotée d’avantages compétitifs par rapport aux autres, apparentées ou non. L’abeille africaine introduite dans le biotope brésilien, puis américain, faute de prédateur régulateur, a eu le champ libre. Ce sujet a déjà été évoqué lors de la précédente conférence sur la biodiversité, et il interpelle la recherche – la recherche fondamentale et non la recherche appliquée.
A ce propos, France Nature Environnement n’a jamais été contre les manipulations du génome dans le cadre de la recherche fondamentale. Le problème est que nous sommes passés très rapidement, sans disposer de tous les éléments, à la recherche appliquée.
M. le Président : Etes-vous favorables, dans certains cas, à l’autorisation de recherches en plein champ ?
M. Lilian LE GOFF : Je vous renvoie aux recommandations des « 4 Sages » : si on les appliquait, nous pourrions être rassurés.
Le danger lié à l’introduction d’espèces douées d’avantages compétitifs est très inquiétant. Dès l’an 2000, plusieurs pays, dont la Chine, s’en étaient émus à Nairobi. On pourrait citer une dizaine de cas impressionnants, dont celui du lapin en Australie. Avec les OGM, ce problème, au-delà des seuls aspects économiques, prend une dimension majeure.
M. Jordi ROSSINYOL : En 2001, l’USDA43 a relevé une augmentation – de 3,6 % à 7,1 % – des applications de produits phytosanitaires sur un type de soja transgénique. Une autre étude, sur la période 1996-200444, fait état d’une baisse durant les premières années, suivie d’une augmentation de 11 % les années suivantes. Globalement, l’utilisation des pesticides sur les cultures OGM a augmenté de 50,6 millions de livres au cours des huit dernières années.
M. le Président : Le rapport de la FAO fait, quant à lui, état d’une augmentation de l’utilisation de Roundup, mais d’une diminution pour les herbicides totaux ainsi que d’une réduction du nombre d’épandages. Nous pouvons vous fournir cette étude, ainsi que celle de l’AFSSA. Il faut pouvoir confronter les chiffres, preuves à l’appui. S’agissant des expérimentations, je partage les positions raisonnables qui viennent d’être exposées, aux antipodes de celles prônées par les faucheurs volontaires.
M. Lilian LE GOFF : C’est un autre problème…
M. Jordi ROSSINYOL : N’oublions pas non plus le fait que les Etats-Unis restent le producteur majoritaire d’OGM dans le monde.
M. Jean-Marie SERMIER : J’aimerais que M. Le Goff nous produise les études démontrant que les herbicides totaux sont « infiniment plus dommageables » que les herbicides sélectifs… A quelle molécule pense-il précisément ? Le glyphosate est-il plus ou moins dommageable que l’atrazine, herbicide sélectif utilisé pendant des décennies ?
La caution apportée par des mouvements comme ATTAC aux destructions des essais en plein champ interdit toute recherche française ou européenne. N’est-il pas dangereux de nous en remettre aux essais étrangers, notamment américains ? Ces destructions ne reviennent-elles pas à servir les intérêts américains ? Avez-vous eu connaissance d’actions similaires au Brésil, en Chine ou en Argentine, où les essais en champ abondent ? Si oui, sont-elles également cautionnées par ATTAC ? Enfin, utilisez-vous le téléphone portable ?
M. Hervé LE MEUR : Pour ce qui me concerne, non.
Sur le Roundup, je vous livre d’autant plus volontiers mon sentiment qu’un représentant de Monsanto assiste à cette réunion…
M. le Président : Ces auditions sont publiques. Certains de vos amis y assistent également et ils ont raison. C’est la règle.
M. Hervé LE MEUR : On a tendance à mélanger le Roundup et le glyphosate, son principe actif. C’est oublier que le Roundup contient également des surfactants beaucoup plus toxiques.
M. Jean-Marie SERMIER : Aurons-nous des éléments précis qui le prouvent ?
M. Hervé LE MEUR : Je vous les communiquerai.
S’agissant de la productivité, deux articles ont été publiés en 2003 dans la revue Recherche – je peux vous les communiquer également – sur la question de savoir si les OGM avaient accru la productivité et réduit l’usage des pesticides. Leur conclusion était que, s’il y avait bien un effet, celui-ci ne pouvait qu’être marginal. Il est à noter que le mot « pesticides » désigne deux produits bien différents : les herbicides et les insecticides.
Dans le cas d’une plante modifiée pour émettre un insecticide, la question est de savoir si elle en émet suffisamment pour régler le problème de l’insecte ou pas assez au risque de créer des phénomènes de résistance et, à terme, de devoir utiliser d’autres insecticides plus polluants que le Bt. Peut-être suis-je en train de me répéter,…
M. le Président : C’est une bonne question.
M. Hervé LE MEUR :… mais mieux vaut se répéter que se contredire, disait ma grand-mère !
Dans le cas d’une plante rendue résistante à un herbicide, le problème est de savoir si elle peut se croiser avec une plante sauvage, à plus forte raison si celle-ci a déjà acquis une certaine résistance à l’herbicide en question. Auquel cas, le gène a de bonnes chances de se propager. On a déjà l’exemple d’une résistance à trois herbicides relevée au Canada – n’hésitez pas à me demander mes sources…
La problématique des plantes résistantes aux herbicides est donc, on le voit, très différente de celle des plantes insecticides. Un colza rendu résistant au Roundup me semble une très mauvaise idée, proprement stupide. J’en pense autant de la betterave qui peut se croiser avec énormément d’adventices. Ajoutons que la graine de colza a une grande capacité de rémanence : elle peut survivre dix ans dans la terre.
M. Jean-Marie SERMIER : En effet, et même largement plus.
M. Dominique MOURLANE : Je voudrais faire savoir qu’ATTAC n’a jamais appelé aux fauchages.
M. Jean-Marie SERMIER : Mais elle les cautionne !
M. Dominique MOURLANE : Jamais nous n’avons appelé aux fauchages, même si nous sommes allés soutenir les faucheurs au moment des procès. Certains membres partagent leur position, mais la majorité de notre association est opposée aux fauchages.
M. le Président : Certains de vos membres se servent-ils de vos listes pour faire connaître les lieux de fauchage ?
M. Dominique MOURLANE : En aucune façon. Ce que font les gens en dehors d’ATTAC ne nous regarde pas. Sans doute se servent-ils d’autres réseaux. Par ailleurs, j’avoue utiliser un portable…
M. Lilian LE GOFF : Les herbicides totaux sont-ils plus dommageables que les herbicides sélectifs ? C’est une question de définition : l’herbicide total est en mesure d’éradiquer tous les végétaux…
M. Jean-Marie SERMIER : Le problème est de savoir ce que devient le produit dans le sol, et notamment s’il peut percoler jusqu’à une nappe phréatique. Peu importe qu’il ne détruise qu’un végétal ou la totalité.
M. Lilian LE GOFF : Préserver la biodiversité, cela veut dire préserver le plus d’espèces…
M. Jean-Marie SERMIER : Il faudra que vous m’expliquiez ce qu’est la biodiversité dans un champ de maïs !
M. le Président : C’est globalement ce que nous ont expliqué les chercheurs : pour eux, l’OGM n’a aucune incidence sur la biodiversité tant qu’il s’applique sur des terres cultivées, dans la mesure où aucune culture n’est en soi un bon laboratoire de biodiversité, hormis quelques adventices qui au demeurant disparaîtraient en même temps que les cultures.
M. Lilian LE GOFF : On ne peut prétendre que l’utilisation des pesticides se limite stricto sensu aux seuls champs cultivés.
M. Jean-Marie SERMIER : On ne peut pas vous laisser dire une chose pareille ! C’est le député qui parle, mais également l’agriculteur qui épand en général ses herbicides sur les parties cultivées : c’est une question de bon sens et même d’économie ! Lorsqu’il y a de la biodiversité dans un champ de maïs, il n’y a plus de maïs : les adventices ont tout envahi et la culture n’est même plus récoltable ! Dans un champ de maïs, il n’y a – à 99 % – que du maïs et les produits ne sont épandus que sur le champ. La vidange et le nettoyage des cuves et pulvérisateurs s’effectuent dans des endroits confinés précisément définis par la loi – et, encore plus précisément, dès qu’entreront en vigueur les nouvelles dispositions de la politique agricole commune (PAC).
M. Lilian LE GOFF : Je vous sens obsédé par le maïs et il y a de quoi : les primes de la PAC ont tout fait pour contribuer à son hégémonie et la monoculture intensive du maïs n’est effectivement pas pour favoriser la biodiversité. On pourrait retrouver des productions plus conformes aux impératifs d’indépendance et de saine gestion des deniers publics en réformant ces primes.
M. Jean-Marie SERMIER : Nous sommes d’accord là-dessus.
M. Lilian LE GOFF : Mais il n’y a pas que le maïs : chez les crucifères, les possibilités de transmission des propriétés herbicides par contamination pollinique à des adventices apparentées sont prouvées. Le développement des résistances aux herbicides donne lieu à une « escalade thérapeutique », alors que les OGM sont précisément censés réduire les traitements… Ce phénomène de fuite en avant est tout à fait classique du productivisme agricole qui tend à aggraver les problèmes, faute de les avoir résolus à la source. D’où cette question, fondamentale, qu’il faut systématiquement se poser : cet OGM que l’on nous présente comme indispensable pour réduire l’utilisation des pesticides ou encore la faim dans le monde est-il vraiment la solution ou y a-t-il une alternative ? En réfléchissant bien, on découvre, preuves à l’appui, que les vraies solutions existent. Malheureusement, elles ne sont jamais appliquées car elles ont le défaut rédhibitoire d’être beaucoup plus autonomes et économes, ce qui fait l’affaire de tout le monde, y compris des deniers publics, mais pas du tout celle des filières qui veulent renforcer leur monopole en brevetant le génome.
M. Germinal PEIRO : J’ai connu ATTAC meilleur… Je voudrais dire aussi que l’agression caractérisée contre Jean-Yves Le Déaut m’a paru hors de propos. Jamais, au cours de toutes nos auditions, je n’ai senti chez notre président la moindre volonté d’influencer qui que ce soit.
M. Le Meur, à propos de la science, a parlé de vérité tombée du ciel. Pour ce qui me concerne, je n’entends rien du ciel ni de Dieu. Quel est le motif profond de votre opposition ? Est-ce parce que le principe de précaution est à vos yeux insuffisamment appliqué ? Est-ce parce vous êtes convaincus de la nocivité, à terme, des OGM ? Est-ce parce que vous craignez la domination économique ou alimentaire de tel groupe ou de tel pays sur la planète ? Ou n’est-ce pas, pour quelques-uns d’entre vous, parce que vous refusez le principe même de la modification génétique, à vos yeux artificiel ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Je n’ai pour ma part aucune opposition de principe. Mais pour avoir suivi ces débats depuis fort longtemps, j’ai l’impression que rien n’a progressé depuis sept ou neuf ans.
M. le Président : Vous avez malheureusement raison. Nous faisons tous deux figure d’anciens combattants dans cette affaire…
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Mais cela ne m’étonne finalement pas. Les débats scientifiques sur l’évaluation des risques sont à l’évidence fondamentaux – il est normal de chercher à mettre sur le marché les produits ou techniques les plus sûrs et de se doter des procédures et instances d’évaluation les plus efficaces – mais toujours sans fin. Tout simplement parce que la science progresse. Quand bien même nous aurions aujourd’hui toutes les preuves que les OGM ne présentent aucun danger pour la santé et l’environnement, serions-nous davantage avancés ? Non, car le problème fondamental est ailleurs. M. Le Déaut posait innocemment la question tout à l’heure : pourquoi les OGM ont-ils ce statut alors que, pendant des années, ces braves consommateurs ont tout avalé sans mot dire ? Parce que la science n’est pas la seule à avancer : la société progresse elle aussi.
Dans une démocratie, le premier mot appartient au citoyen ; dans une économie de marché, le dernier mot revient au consommateur. C’est précisément dans cette situation que nous trouvons, et pas seulement avec les OGM.
Au-delà de la seule question de la technique se pose le problème, fondamental, du choix de la société face aux progrès de la science. Dans une démocratie moderne, où les avancées sont liées aux choix scientifiques et technologiques, les citoyens doivent avoir leur mot à dire et indiquer s’ils sont disposés à aller dans la direction qu’on leur trace. La question est donc de savoir si nous avons fait ce qu’il fallait pour que la société puisse se prononcer sur le choix qui nous est proposé à travers les OGM. On peut aussi se demander, question subsidiaire, ce que signifie « un choix de la société française » alors que la France fait partie de l’Europe, et ce que veut dire « le choix de l’Europe » dans une économie mondialisée vers laquelle Brésil, Argentine et Etats-Unis sont déjà bien avancés… Si nous parvenions à discuter de ces questions, plutôt que de nous interroger sur le sort de ce pauvre monarque – même si c’est important –, nous aurions déjà progressé.
Pour le consommateur, se pose évidemment la question du choix de société, mais également – car un mot peut avoir plusieurs sens, et l’information de presse n’est pas la même chose que l’information dans le rayon du magasin – celle de la préservation de sa liberté, fondamentale, d’acheter ou pas, de choisir quand bien même il aura l’assurance de ne courir aucun risque. De ce point de vue, la traçabilité ne se limite pas à permettre au consommateur de savoir d’où vient le produit qu’il achète : elle lui donne aussi un droit de regard sur la manière dont il aura été fabriqué – en Chine par des esclaves ? Selon des techniques OGM ? Et il a tout à fait le droit de payer ses œufs un peu plus cher pour que les poules soient réellement élevées en plein air.
Les chercheurs français pourraient-ils continuer à dire non – ils ne l’ont pas dit, du reste – alors que les autres continuent à chercher ? Encore faut-il savoir de quelle recherche il s’agit. Encore faut-il pouvoir compter sur une recherche réellement indépendante dans ce domaine comme dans d’autres. Le but n’est pas d’opposer le privé au public – comme on le disait il y a deux ans au Conseil économique et social – mais bien de reposer le problème. Et, quoi qu’on ne dise, la véritable indépendance n’est-elle pas celle que peut nous apporter la recherche publique ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Très bien !
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Force est de constater que les consommateurs sont franchement opposés aux OGM dans le domaine alimentaire, mais pas dans celui de la production de médicaments. Ce qui amène à penser que la société et le consommateur ne sont pas fondamentalement opposés à la méthode de production en tant que telle. Mais dans la mesure où, dans le secteur alimentaire, les OGM n’apportent directement rien au consommateur, la réponse de celui-ci, entre le risque potentiel et l’absence d’avantages, est simple et pragmatique : il n’en veut pas. Le jour où notre recherche sera capable de proposer des choses intéressantes pour la société et la santé, cela réglera bon nombre de questions.
M. le Président : Ne pensez-vous pas que le hard discount, qui envahit même les rayons des grandes surfaces classiques, n’est pas un moyen de contourner cette difficulté en offrant des produits OGM à ceux qui n’ont pas beaucoup de moyens, cependant que ceux qui peuvent payer se verront proposer des produits sans OGM ?
M. Éric MEUNIER : Le citoyen éprouve les plus grandes difficultés à accéder à l’information sur les OGM, d’autant qu’il est souvent difficile d’expliquer les aspects scientifiques de la question. De surcroît, les gens que nous rencontrons ont du mal à comprendre à quoi peuvent servir les OGM, si ce n’est à quelques agriculteurs. Et l’idée qu’il faille admettre dans son assiette des OGM sans garantie de sécurité au seul motif qu’il ne faut pas prendre de retard sur la Chine ou les Etats-Unis ne les fera sûrement pas changer d’avis… Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce qu’une majorité de consommateurs soit hostile aux OGM, les uns par la conviction qu’ils ont pu se forger grâce à l’information, les autres par pure incompréhension.
M. Olivier ANDRAULT : Il serait probablement utile de compléter l’application du principe de précaution et d’aller plus avant dans l’étude des éventuels risques environnementaux et sanitaires à long terme. Plus généralement, nous ne faisons aucune fixation sur les OGM : nous voulons seulement assurer la meilleure information aux consommateurs, améliorer leur participation au débat, à l’évaluation des nouvelles techniques et, en fin de compte, à la prise des décisions.
M. André CHASSAIGNE : Croyez bien que cette mission travaille avec la plus grande honnêteté intellectuelle, dans le souci d’écouter et de prendre en compte toutes les aspirations. Nous ne sommes pas comme la grand-mère de M. Le Meur, qui se répète pour ne pas se contredire : jour après jour, nous serions plutôt comme Paul Claudel et nous nous réservons le droit de nous contredire, tout simplement parce que nous nous efforçons d’écouter, d’assimiler et de faire la part des choses.
De nombreux scientifiques, issus particulièrement de la recherche publique, nous ont assuré qu’ils ne passaient aux essais en plein champ qu’après avoir épuisé toutes les simulations en laboratoire et en serre. Et nombre d’entre eux sont totalement démontés de voir leurs cultures ravagées, alors qu’ils touchaient au but après des années de travail, qu’il s’agisse de travaux à but médical, comme ceux de Meristem Therapeutics sur la lipase gastrique, des recherches intéressantes en termes de développement agricole sur les caféiers en Guyane ou encore des études sur le stress hydrique ou la fixation de l’azote. Il s’agissait de personnes totalement sincères, aucunement à la solde du grand capital !
D’un côté, il y a la technique même des OGM, et personne ne semble remettre en cause le bien-fondé des recherches menées sur les manipulations génétiques, hormis peut-être M. Le Meur qui semble bloqué vis-à-vis de certaines évolutions – choix que je respecte totalement…
De l’autre côté, il y a les rapports de forces au niveau mondial, marqués par la domination politique et économique des grands groupes. Mais faut-il pour autant mélanger technique et aspects économiques et s’interdire d’aller plus avant dans la recherche scientifique ?
M. Hervé LE MEUR : A entendre certains, la recherche scientifique publique serait du côté du bien et, du coup, la recherche privée serait implicitement du côté du mal… En fait, les deux sont à peu près pareilles, en particulier lorsqu’elles travaillent à nous faire admettre ces bidouillages et qu’elles conduisent à nous enfermer dans une prison technologique avant d’en jeter la clé ! Les dépendances économiques en sont un exemple. Et pour ce qui est des OGM destinés à produire des médicaments, j’avoue n’avoir pas envie de trouver de l’insecticide dans mes corn flakes, mais encore moins un médicament ! Contrairement à tout le monde ici, je pense que les OGM médicamenteux posent un problème bien différent et devraient susciter une opposition encore plus dure que les OGM agricoles.
Peut-on mêler la technique et les aspects économiques ? Ils le sont de facto ! Comment peut-on nous reprocher de les mêler ?
M. Dominique MOURLANE : Ce qu’il faut séparer, c’est la recherche et la technique, autrement dit, pour rester schématique, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. La recherche est nécessaire à tous les niveaux et personne ne saurait s’opposer à cette démarche. Mais viennent ensuite les applications à destination du commerce et la question du choix de société qui, dans le cas des OGM, nous est imposé. Ce débat, chacun ici le reconnaît, n’a pas eu lieu. Donnons-nous les moyens de le mener, d’informer la population, de lui présenter les arguments contradictoires des uns et des autres. Donnons également les moyens à la recherche de répondre aux interrogations du plus grand nombre en menant les études qui ne l’ont pas encore été ou, lorsqu’elles sont suspectes de parti pris, les contre-expertises nécessaires. C’est précisément ce qui ne se fait pas dans le cas des OGM. Ce que condamne ATTAC, ce n’est pas tant leurs conséquences environnementales, pourtant connues, que le fait hégémonique et le monopole donné, par cette technique, à quelques grandes entreprises. Si les recherches montraient que les OGM puissent bénéficier à l’ensemble de la population et pas seulement à quelques intérêts financiers, pourquoi pas ? Mais pour l’instant, il n’est pas question d’accepter que quelques entreprises du Nord imposent leurs vues à l’ensemble de la population du monde.
M. le Rapporteur : M. Mourlane souhaite que l’on donne les moyens aux chercheurs. Mais, précisément, 95 % d’entre eux ne demandent pas mieux, et notamment qu’on leur laisse mener les expérimentations en plein champ !
Il existe, on le voit, une vision théologique de cette affaire : n’ai-je pas lu dans Inf’OGM que l’archevêque de Bourges, lui-même, estimait qu’il fallait parfois savoir cultiver le risque ?
En tant que médecin, j’ai été très choqué du fauchage de l’essai de Meristem Therapeutics. Puisque vous semblez avoir une approche différente suivant la finalité de la recherche, accepteriez-vous plus facilement la recherche médicale ? La production de lipase présente un réel intérêt dans la lutte contre la mucoviscidose qui devrait conduire à accepter certaines expérimentations, en les entourant évidemment de toutes les précautions.
L’exemple du « riz doré » ne manque pas non plus d’intérêt. Certes, les dosages en provitamine A et en fer devront certainement être améliorés, mais nous n’en sommes qu’à la première génération. Qui nous dit que la prochaine ne sera pas efficace ?
M. Lilian LE GOFF : Le plus choquant, dans l’affaire de la lipase, est cet amalgame entre deux domaines, alors même que nos connaissances sur le fonctionnement du vivant et sur les interactions des gènes sont encore très fragmentaires. Aucun amalgame ne devrait être permis entre le domaine agricole et alimentaire, en milieu ouvert, et les recherches à fins médicales, qui devraient impérativement rester en milieu confiné. Au demeurant, pourquoi demander à des plantes de sécréter des principes médicamenteux, alors qu’on peut le faire par le biais de micro-organismes en milieu confiné ? Les Etats-Unis ont déjà connu des contaminations transgéniques de récoltes alimentaires par des plantes cultivées à des fins médicales. Le consommateur n’apprécierait pas du tout de retrouver des principes médicamenteux dans son assiette…
Ce que nous reprochons en premier lieu aux OGM, en l’état actuel de nos connaissances, c’est leur caractère hégémonique et leur propension à envahir l’environnement par le biais des pollens, mais également des germes présents dans le sol. Ceci pose le problème de la traçabilité, de l’information des consommateurs et de la responsabilité en cas de contamination des cultures non transgéniques, principe de responsabilité qui, pour l’instant, n’est pas défini. D’une manière plus générale, nous ne sommes pas contre la recherche et la connaissance du vivant, bien au contraire, et nous reconnaissons volontiers que les manipulations génétiques sont indispensables pour progresser dans ces domaines. Mais à vouloir avancer trop rapidement, sans maîtriser suffisamment ce que l’on fait, on prend une énorme responsabilité vis-à-vis des générations futures.
Il est à noter que la région Bretagne a pris la décision de signer un accord de partenariat économique avec l’Etat brésilien du Paraná, afin de développer une filière d’importation de soja non transgénique, en attendant que se mette en place une production nationale de protéines végétales sous la forme de légumineuses.
M. le Rapporteur : Le Paraná est aujourd’hui infiltré par la mafia et truffé de cultures OGM…
M. Lilian LE GOFF : Pas du tout. Une délégation du conseil régional s’est rendue sur place…
M. le Président : Un industriel breton, M. Glon, nous a fait parvenir une lettre très intéressante sur ce point.
M. Lilian LE GOFF : Nous le connaissons très bien !
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Glon-Sanders est un grand groupe dans le domaine de l’alimentation animale.
M. le Président : M. Glon affirme que, même en important du Paraná, les contaminations seraient inévitables et qu’il ne pouvait s’engager à garantir l’absence de toute trace d’OGM.
M. Lilian LE GOFF : Ce n’est pas M. Glon, mais le directeur des poulets de Loué…
M. le Président : Je connais tout de même la lettre que j’ai reçue !
M. Lilian LE GOFF : M. Glon n’est pas forcément une référence dans le domaine de la traçabilité…
M. le Rapporteur : Il n’est pas le seul à parler ainsi du Paraná.
M. Lilian LE GOFF : C’est surtout l’Etat du Rio Grande do Sul qui est contaminé par les importations sauvages de productions transgéniques de l’Argentine. Les autorités régionales de Bretagne ont mené leur propre enquête au Paraná pour mettre en place cette filière. Il semblerait que la Basse-Normandie leur emboîte le pas.
M. le Rapporteur : Si le conseil régional de Bretagne s’est effectivement prononcé contre les OGM, le conseil économique et social de cette région a dit le contraire, estimant qu’il allait trop loin. Ils sont pourtant de la même obédience politique…
M. Lilian LE GOFF : Cela prouve en tout cas que les dossiers avancent.
M. le Président : Mme Husset déplorait que les choses n’aient pas avancé depuis sept ans, et je suis bien d’accord avec elle.
M. Lilian LE GOFF : Les élevages ont désormais la possibilité de choisir leurs approvisionnements.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Encore faudrait-il une réglementation sur l’étiquetage.
M. Lilian LE GOFF : Cela renvoie au législateur et je m’étonne que les consommateurs n’aient pas insisté sur ce point. En fait, le droit français entrave l’accès à l’information sur les OGM dans la mesure où les filières d’élevage – les poulets de Loué, entre autres – qui ont mis en place des filières d’approvisionnement garanties non-OGM ne peuvent pas le faire savoir : l’administration le leur interdit.
Mme Hélène MORAUT-PESTANES : Nous avons tous réclamé une extension de l’étiquetage aux produits issus d’animaux…
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Je défends le droit pour les agriculteurs produisant sans OGM de pouvoir le faire savoir. Encore faudrait-il définir ce qu’est le « sans OGM » : le taux zéro n’existe d’ores et déjà plus.
M. Lilian LE GOFF : Cela renvoie au seuil réglementaire de 0,9 %. Ces producteurs ont mis en place des dispositifs de traçabilité très coûteux…
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Dans le but de vendre leurs produits plus cher !
M. Hervé LE MEUR : Dans le cas de la lipase gastrique, la question n’est pas de savoir si les OGM présentent ou non un avantage. C’est celle de l’allocation des ressources, autrement dit de la quantité d’énergie, d’argent, de temps et du nombre de chercheurs que l’on affecte à telle recherche et à telle autre. Il n’y a pas, sur ce point, de contradiction entre les chercheurs et les associations qui souhaitent, précisément, que d’autres recherches soient menées – sans préciser explicitement qu’elles aimeraient y avoir un droit de regard.
Dans un monde où tout se complexifie au point que tout nous échappe, on finit par glisser vers l’hétéronomie, aurait dit Illitch, dans la mesure où, pour décider de ce qu’est notre goût, nous en venons à dépendre, non de notre bon vouloir, mais d’un spécialiste du génie biomoléculaire à Bruxelles… On me pardonnera la brutalité de la formulation, mais on comprendra que la question sous-jacente est éminemment politique. Je regrette, pour ma part, que votre mission en soit restée aux enjeux environnementaux, agricoles et économiques et ne se soit pas penchée sur les autres aspects.
M. le Président : Lesquels ?
M. Hervé LE MEUR : Les enjeux philosophiques notamment : j’ai essayé de ne parler que de cela…
N’y a-t-il donc pas d’alternative ? M. André Pochon nous explique que, finalement, nous n’avons pas autant besoin du soja qu’on le dit, mais que toute une machine – ou un « machin » – a intérêt à la poursuite de la logique des primes, qui est finalement le plus grand danger pour notre agriculture.
A ce propos, permettez-moi de vous montrer un authentique maïs de pays : il n’est pas plus petit qu’un maïs hybride, mais il est aussi rentable et aussi productif, et a même 30 % de protéines en plus à traitement égal ! Pourquoi la recherche publique ne s’y intéresse-t-elle pas ? Les OGM ne sont pas la seule solution.
M. le Président : Nous irons voir ensemble ce maïs de pays que vous dites non hybride… Je peux vous montrer dans mon bureau deux épis, un OGM et un non-OGM : si vous trouvez la différence, vous aurez gagné – c’est comme le maïs de pays !
Pour Mme Husset, le seuil doit être déterminé par les possibilités techniques de détection. Ce point mérite réflexion : s’il est très bas, quid de la coexistence des cultures ? Imposer des seuils très faibles, sans rapport direct avec la dangerosité ni considération de secteurs, rendra les conditions de cultures plus difficiles et induira inévitablement des surcoûts payés au bout du compte par le consommateur. Dans un premier temps, on niera l’évidence, et, dans un deuxième temps, on proposera des produits moins chers étiquetés OGM dans les hards discounts et les rayons spécialisés des grandes surfaces et on aura ce faisant contourné la demande des associations des consommateurs qui refusaient toute idée de surcoût…
Nous sommes évidemment amenés à réfléchir à des questions philosophiques et éthiques, mais également à des sujets techniques. J’aimerais, lors des tables rondes contradictoires, que vous fassiez part de votre position sur le dernier rapport de l’AFSSA, resté plutôt confidentiel, selon lequel les plants OGM contiendraient moins de mycotoxines que les plants non génétiquement modifiés.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : C’est le seul domaine dans lequel les OGM présenteraient un petit avantage.
M. le Président : En effet. Mais pourquoi ne mesurerait-on pas, avec les mêmes seuils, les taux de mycotoxines dans toutes les productions ? Les mycotoxines sont, on le sait, dangereuses et l’on en trouve sans doute davantage dans certains types d’agriculture. Au-delà des obligations de moyens, il faudra bien un jour imposer des obligations de résultat.
On ne peut traiter les problèmes de surproduction des pays du Nord sans parler des pays du Sud. Je suis bien d’accord sur le fait qu’une technique, à elle seule, n’apportera pas la solution. Reste que 5 % seulement des malades du sida sont soignés en Afrique, que personne n’a cherché à y développer les énergies renouvelables dans la mesure où personne chez nous n’y avait intérêt. Va-t-on encore une fois leur refuser l’accès, à titre de complément, à une nouvelle technique ? La situation pourrait être améliorée par la généralisation de la traction animale, mais également en agissant au niveau des semences, pour peu que l’on accepte de s’attaquer aux problèmes de propriété intellectuelle. N’est-ce pas, pour parler philosophie, un réflexe de nanti que de refuser, au motif que nous avons des jachères à gérer, l’idée qu’une technique, quelle qu’elle soit, puisse contribuer à résoudre certains des problèmes des pays du Sud ? Plus d’un milliard de personnes n’y mangent pas à leur faim. Peu d’expériences ont été menées sur le sorgho et le stress hydrique. Et pour ce qui est du riz, les essais du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à Montpellier ont été détruits…
Mme Husset en a appelé à un consensus global réunissant tous les acteurs autour d’un Grenelle sur ce sujet. Encore faut-il que chacun respecte les règles du jeu par la suite : or la réduction du nombre des expérimentations après le rapport des « 4 Sages » n’a pas empêché qu’elles soient pratiquement toutes détruites… Force est de reconnaître à un moment donné que certaines personnes font fi de la démocratie et pensent que c’est leur position personnelle qui sauvera la planète.
J’accepte le débat, M. Le Goff, et vous ne manquez pas d’arguments intéressants. Mais nous n’avancerons dans la voie parlementaire qu’à partir du moment où, une fois le point d’équilibre trouvé, tout le monde le respectera. Et si personne ne le respecte, comme c’est le cas depuis deux ans, on verra deux camps s’affronter : d’un côté ceux qui veulent contourner des positions et des questions légitimes en envahissant le monde et, de l’autre, ceux qui s’attachent, par une réglementation de plus en plus compliquée, confuse et tatillonne, à prouver que toute coexistence est impossible. Cet affrontement sans merci ne contribue évidemment pas à résoudre le problème.
M. Philippe FOLLIOT : L’Assemblée est un haut lieu de la démocratie et vous avez tous pu y exprimer vos opinions avec une conviction qui mérite le respect. Je n’en partage pas moins le jugement de mes collègues sur la façon dont travaille cette mission d’information et dont son président la préside dans un souci d’équilibre et d’impartialité.
La désobéissance civile, dont certains se servent comme d’une arme pour faire valoir leurs opinions, en vient paradoxalement à rendre celles-ci moins respectables. Lorsque les membres de l’Assemblée nationale votent un texte, celui-ci prend force de loi et la loi ne saurait être contournée par des moyens plus ou moins violents.
Je me souviens d’un chercheur, dans l’Ariège, dont l’essai avait été détruit alors qu’il visait précisément à mesurer les effets des OGM sur l’environnement. De tels comportements, qui visent à empêcher tout progrès des connaissances sur un sujet qui précisément nous interpelle – la nocivité ou l’innocuité des OGM – me font penser à ces militants anti-avortement qui allaient dans les maternités agresser les jeunes femmes et les médecins. Il a fallu recourir à des sanctions pénales très fortes pour stopper ce phénomène. Dans ce débat, certes ouvert et passionné, il faudra bien que force revienne finalement à la loi, car c’est la règle du jeu dans toute démocratie.
M. Hervé LE MEUR : Votre parallèle entre les commandos anti-IVG et les faucheurs oublie une réalité : l’immense majorité des citoyens étaient contre les premiers, alors que bon nombre de personnes soutiennent les seconds.
M. le Président : Non seulement la majorité des Français est opposée au fauchage, mais nous n’avons pas encore entendu jusqu’à ce jour une personne qui l’ait assumé publiquement. C’est proprement terrible : des membres de votre association ont nié, devant la mission, avoir participé aux événements de Toulouse, alors qu’en privé ils avouent en avoir été. Mais ils ne l’ont jamais assumé collectivement.
M. Hervé LE MEUR : Nous n’y étions pas et je l’assume.
M. Lilian LE GOFF : Sans doute était-ce à cause de l’aspect pénal…
M. le Président : Il n’est pas question de pénal ici. Du reste, 190 personnes l’ont assumé devant le tribunal. Nous aimerions pouvoir en discuter également ici même. On ne peut avancer qu’en écoutant les arguments des autres, quitte à avoir des opinions différentes. Au-delà des OGM, nous sommes amenés à nous saisir de sujets économiques lourds de conséquences, notamment sur l’emploi, dont nous sommes comptables dans nos circonscriptions. Venez un jour avec moi dans les communes : les gens vous parleront d’abord d’emploi. Les OGM ne sont pas pour eux une préoccupation majeure. Ils s’inquiètent davantage des produits cancérigènes, par exemple. Il va bien falloir aborder globalement cette question, sans chercher à en faire un abcès de fixation comme c’est le cas aujourd’hui. Quant aux questions de propriété intellectuelle et de rapports Nord-Sud, elles sont autrement plus compliquées et dépassent largement le sujet des seuls OGM. Nous ne saurions les traiter dans le cadre de cette mission. En attendant, mon rôle de président se borne à faire en sorte que tous les avis s’expriment et soient, au besoin, relayés par les députés au moment de la discussion du projet de loi.
Vous trouverez également une toute petite partie consacrée aux OGM dans le rapport sur les biotechnologies dont j’ai été chargé, il y a de cela quinze mois, pour le compte de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Dans ce document, que je rendrai jeudi prochain, j’exprime évidemment des convictions ; on ne saurait me le reprocher… Encore faut-il que ces convictions puissent évoluer et être amendées grâce au travail en commun.
Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Table ronde regroupant des représentants
de groupes agroalimentaires et de grands distributeurs
(extrait du procès-verbal de la séance du 26 janvier 2005)
Ø Groupes agroalimentaires
• Nestlé France, représenté par M. Vincent PÉTIARD, directeur du centre de recherche Nestlé Tours (Plant Sciences), membre de l’Académie d’agriculture de France
• Coop. de France, représenté par M. Olivier KRIEGK, directeur scientifique de Terrena
• Unilever, représenté par M. Jean-Denis VOIN, directeur des relations extérieures
Ø Grands distributeurs
• Carrefour, représenté par M. Lionel DESENCÉ, chef de groupe « Dossiers transversaux »
• Auchan, représenté par Mme Béatrice THIRIET, chef de groupe qualité Auchan production
• Les Mousquetaires (Intermarché), représenté par M. Daniel CROCQ, directeur qualité, sécurité, environnement des Mousquetaires, accompagné de M. Olivier TOUZÉ, directeur opérationnel
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Madame, Messieurs, je vous remercie d’être venus nous exposer les positions des groupes agroalimentaires et des grands distributeurs sur les OGM.
Nous vous invitons à commencer par une courte présentation afin de privilégier le débat.
M. Jean-Denis VOIN : Je suis directeur des relations extérieures d’Unilever France. Avec un chiffre d’affaire de 43 milliards d’euros au niveau mondial et de 3,7 milliards en France, dont 2 milliards pour les produits agroalimentaires vendus sous les marques Lipton, Knorr, Fruit d’Or, Boursin, Alsa, Miko, Amora-Maille, etc., le groupe Unilever est un des grands groupes mondiaux de l’agroalimentaire.
Unilever se félicite de la création d’une mission d’information parlementaire consacrée à la problématique des OGM, qui permet d’instaurer un débat démocratique sur un sujet en pleine évolution dans le monde entier. Notre position tient en cinq points.
Premièrement, Unilever soutient une utilisation responsable de la biotechnologie moderne, sous réserve d’un contrôle réglementaire effectif et de la fourniture d’informations indiscutables sur ces techniques qui, en améliorant les cultures, peuvent apporter d’importants bénéfices à l’humanité. Toute application doit être jugée à ses mérites – ainsi la réduction de l’emploi de pesticides est à nos yeux un point particulièrement intéressant.
Deuxièmement, Unilever reconnaît que la position de l’opinion publique à l’égard de la présence d’ingrédients issus d’OGM dans les produits alimentaires est en constante évolution et que l’état d’avancement du débat varie selon les pays.
Troisièmement, Unilever défendra toujours le droit du consommateur à disposer de toute l’information nécessaire pour choisir. Nous soutiendrons toutes les initiatives en la matière : centres d’information des consommateurs avec numéro d’appel gratuit, brochures dans les points de vente, informations relatives aux produits sur l’Internet, étiquetage approprié.
Quatrièmement, force est de constater que les consommateurs européens restent assez réticents à l’utilisation d’OGM ou de leurs dérivés dans les produits alimentaires.
Cinquièmement, Unilever, en réponse à ce comportement, n’utilise aucun OGM ou dérivé dans la formulation de ses produits. S’il devait nous arriver de déroger à cette règle, nous en informerions les consommateurs en étiquetant nos produits, conformément aux règlements européens 1829 et 1830/2003.
La sécurité et la satisfaction des consommateurs sont pour Unilever des principes intangibles. Si les élus renouvellent leur mandat tous les cinq ans, c’est tous les matins qu’un groupe comme le nôtre doit affronter le vote des consommateurs à travers six millions d’actes d’achat quotidiens.
M. Olivier KRIEGK : Directeur scientifique du groupe coopératif Terrena, je représente ici la Fédération des coopératives agricoles françaises. Installé dans l’Ouest de la France, Terrena représente 3 milliards d’euros de chiffres d’affaires, 13 000 salariés, 24 000 agriculteurs sociétaires. Les deux tiers de son activité concernent les productions animales : produits laitiers, viandes bovine et porcine, volaille.
Le soja et le maïs représentent 85 % des plantes génétiquement modifiées dans le monde et servent principalement à l’alimentation animale. Le problème des OGM se pose en Europe surtout pour le soja importé, dont nous sommes très dépendants – 300 000 tonnes par an – dans la mesure où le maïs génétiquement modifié n’y est pratiquement pas cultivé, hormis en Espagne.
La première responsabilité d’une coopérative comme Terrena est de répondre à l’attente de ses sociétaires, propriétaires de l’entreprise, mais également acheteurs de ses produits, en particulier de semences, dont la position peut dépendre de considérations agronomiques – les variétés actuellement autorisées ne présentent finalement guère d’intérêt pour eux, du fait que la pyrale n’existe pas dans l’Ouest de la France, par exemple –, mais également de leur appartenance syndicale.
La deuxième responsabilité d’une entreprise agroalimentaire est de répondre aux attentes des consommateurs. Or leur refus global, qu’il soit motivé ou non, est une réalité dont il nous faut bien tenir compte.
Entre ces deux pôles, nous entretenons évidemment des relations régulières avec la grande distribution, qui met en marché la majorité des produits que nous transformons. Sa demande peut varier du simple respect des obligations réglementaires, en matière d’étiquetage notamment, jusqu’à des exigences beaucoup plus spécifiques : c’est le cas du groupe Carrefour avec lequel nous avons mis en place des filières de productions animales où les animaux sont alimentés sans OGM.
Force est de constater de sérieuses lacunes dans les règlements 1829 et 1830/2003 entrés en application début 2004 : ainsi l’étiquetage est obligatoire sur un aliment du bétail contenant des OGM, mais il ne l’est pas sur les produits laitiers et carnés finaux – carence réglementaire d’autant plus notable que la part des OGM dans l’alimentation animale est, on le sait, très élevée.
Une telle situation est un facteur potentiel de crise médiatique grave pour l’image du secteur de la nutrition animale, laquelle s’était déjà sérieusement dégradée à la suite des épisodes de la vache folle et de la dioxine. Une nouvelle mise en cause de notre métier, du fait d’un déficit d’information entre des produits d’alimentation du bétail étiquetés et des produits finaux qui ne le seront pas, serait extrêmement dangereuse pour nos filières. Aussi avons-nous cherché à prévenir et à anticiper la crise en mettant en place une filière d’importation de tourteaux de soja non génétiquement modifié du Brésil, régie par un cahier des charges très strict, et qui constitue dorénavant la source d’approvisionnement exclusif de nos usines d’aliments du bétail, lesquelles représentent un tonnage mis en marché de 1 400 000 tonnes
par an.
M. Vincent PÉTIARD : Je me dois d’excuser les représentants de l’Association nationale des industries agroalimentaires (ANIA) qui sont, aujourd’hui, retenus à Bruxelles.
Directeur du centre de recherches Nestlé Tours, je me préoccupe plus des aspects techniques que des questions de communication, d’autant que, dès 1979, j’ai eu la chance de participer à la mission « Sciences de la vie et de la société » qui avait remis un rapport bien connu sur les biotechnologies au président Valéry Giscard d’Estaing. J’ai suivi l’évolution des biotechnologies depuis cette époque.
La position de Nestlé France et de Nestlé International est globalement très proche de celle de nos amis d’Unilever : les OGM, au-delà des seules plantes transgéniques, sont un apport technologique dont la société ne pourra pas se priver. Nous estimons que les plantes génétiquement modifiées actuellement mises sur le marché sont tout aussi fiables que leurs contreparties non modifiées. Cela étant, nous adaptons notre stratégie et notre utilisation potentielle d’OGM aux pays dans lesquels nous exerçons notre activité. Pour simplifier, notre position ne sera pas la même selon qu’il s’agit d’aliments pour animaux domestiques aux Etats-Unis ou d’aliments pour enfants en Allemagne ou en France… Autrement dit, nous utilisons des OGM dans les pays où la législation et le consommateur nous y autorisent et nous ne les utilisons pas dans ceux où ni la législation ni le consommateur ne nous le permettent. Cela nous a valu, du reste, quelques désagréments, certains groupes de pression ayant souhaité que Nestlé adopte un moratoire sur l’utilisation d’OGM dans tous ses produits et dans tous les pays, ce à quoi nous nous sommes fermement refusés. De ce fait, nous n’avons pas, en Europe, la même position qu’aux Etats-Unis ou en Chine.
Mme Béatrice THIRIET : Le groupe Auchan représente 300 hypermarchés et 100 supermarchés répartis dans douze pays. En France, ce sont 118 hypermarchés, 279 millions de passages en caisse par an et un chiffre d’affaires de plus de 14 milliards d’euros. Notre position prend en compte trois réalités.
Les consommateurs sont partagés. Une immense majorité – 94 % – préfère consommer des produits sans OGM. Une partie d’entre eux souhaite également des produits issus d’animaux nourris sans OGM. Une autre partie de la population ne se sent pas concernée par le sujet, mais personne ne se dit ouvertement favorable aux OGM en tant que consommateur.
Le monde agricole est tout aussi partagé. Une partie des agriculteurs souhaite pratiquer une agriculture et un élevage sans OGM, une autre est favorable à cette technique.
Les scientifiques eux-mêmes le sont également. Si bon nombre d’entre eux sont favorables aux OGM, ils n’en reconnaissent pas moins que leurs effets, tant sur le plan environnemental que sur le plan sanitaire, sont difficiles à mesurer.
Sur le fond du problème, Auchan, à défaut d’être un spécialiste, s’en tient à une totale neutralité et entend répondre aux aspirations de ses clients comme aux préoccupations d’un monde agricole qu’il sait très sensible et qui n’hésite pas à les exprimer devant nos magasins. Aussi avons-nous décidé de donner le choix à nos clients, en proposant systématiquement une alternative non-OGM. Là où nous avons la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire nos sur propres marques et sur les premiers prix, nous proposons exclusivement des produits sans OGM. De la même façon, nous proposons systématiquement une alternative pour les poissons et les viandes vendues en libre-service.
On peut regretter qu’il soit si difficile de valoriser les efforts des producteurs en communiquant sur le caractère non-OGM, particulièrement pour les produits d’origine animale, puisqu’il est interdit de les étiqueter comme tels. Le consommateur, peu au fait de la réglementation communautaire, n’a malheureusement pas accès à une information complète.
M. Lionel DESENCÉ : Implanté dans 31 pays, le groupe Carrefour réalise un chiffre d’affaires de 70 milliards d’euros dont 40 % réalisés en France. Un consommateur français sur quatre passe par une de nos enseignes pour s’alimenter.
Le groupe Carrefour a toujours été favorable à la transgénèse, pour peu que cette technologie d’avenir soit utilisée de façon raisonnée et responsable. Nous sommes en revanche hostiles aux OGM dits de première génération en raison des risques environnementaux, sanitaires, économiques, juridiques et éthiques dont ils restent porteurs, en raison également de la perception négative qu’en ont les consommateurs. Aussi le groupe Carrefour a-t-il interdit dès 1996 toute présence d’OGM ou de dérivés d’OGM dans les produits dits contrôlés, c’est-à-dire vendus sous sa propre marque. Dès 1998, nous avons lancé avec nos partenaires éleveurs et fabricants d’aliments du bétail une filière de tourteaux de soja non génétiquement modifié à destination des filières animales françaises.
Carrefour entend offrir un choix éclairé au consommateur. Si un produit de marque national devait être étiqueté OGM, nous ne nous opposerions pas à sa commercialisation dans nos enseignes, mais nous proposerions au consommateur un produit à nos marques, exempt d’OGM ou de dérivés.
Cette garantie de choix pour le consommateur, qui est l’esprit même de la réglementation communautaire, n’est pas sans poser de sérieuses difficultés. Sans règles de coexistence strictes entre agricultures conventionnelle, biologique et transgénique, nous aurons du mal à assurer la pérennité des filières conventionnelle et biologique. Il est également essentiel d’instaurer un régime de responsabilité environnementale fondé sur le principe pollueur/payeur. Enfin, alors que nous n’avons pas ménagé depuis quatre ou cinq ans nos efforts avec nos partenaires pour garantir une alimentation animale sans OGM, il nous est impossible de relayer cette information auprès du consommateur final.
M. Daniel CROCQ : Propriétaire et exploitant d’un supermarché dans le Territoire de Belfort, je suis chargé de la direction de la qualité, de la sécurité et de l’environnement au sein du groupe des Mousquetaires. Je suis accompagné de M. Olivier Touzé, permanent du groupe, directeur opérationnel.
Les Mousquetaires est un groupement de commerçants indépendants présent en France, au Portugal, en Pologne, en Belgique et en Espagne. Nous réalisons en France un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros, avec 70 000 collaborateurs dans 2 240 supermarchés et magasins ultradiscount sous l’enseigne Netto.
Nous vous remercions de nous consulter sur les OGM, sujet complexe qui suscite d’autant plus la méfiance de nos clients que nous manquons d’informations précises sur leurs risques pour la santé et l’environnement. Nos clients exigent de plus en plus de transparence et de sincérité, qu’il s’agisse de nos marques propres ou des autres. Nous sommes heureux que cette table ronde nous donne l’occasion de connaître l’avis de nos partenaires, comme celui des autorités.
Dès 1998, nous avons commencé à organiser des commissions internes et à diffuser l’information dans tout notre réseau. Depuis fin 2000, tous nos produits à marque propre n’emploient plus que des ingrédients ou additifs exempts de traces d’ADN génétiquement modifié, et nous informons systématiquement nos clients et les associations de consommateurs de cette position. Quand nos fournisseurs ne peuvent nous garantir des ingrédients exempts d’OGM, nous les remplaçons par d’autres ingrédients. Nous n’excluons pas pour autant de vendre des produits de marques industrielles contenant des OGM, pour peu qu’ils soient conformes à la législation.
Les OGM sont un sujet sur lequel nous restons en état de veille permanente en nous posant encore beaucoup de questions : la pression économique nous permettra-t-elle de continuer à garantir l’absence de tout OGM dans nos marques propres ? Quel est l’avenir des OGM en Europe en termes d’importation et de production ? Comment les consommateurs vont-ils réagir ? On sait que, sur des marchés à niche comme la diététique, ils refusent tout OGM. Comment l’administration entend-elle rassurer le grand public face aux éventuels risques sanitaires ou environnementaux ? Comment réagira-t-elle aux pressions d’associations de consommateurs ou d’écologistes bien décidées à mobiliser nos clients contre les OGM ? Peut-on garantir une alimentation animale exempte d’OGM, compte tenu des volumes disponibles ? Quels sont les avis scientifiques sur le lien entre l’alimentation de l’animal et le produit fini ?
M. le Président : Pour ce qui est de la position des consommateurs, Mme Thiriet a sans doute raison. Pour ce qui est des scientifiques en revanche, pratiquement tous, à quelques exceptions près, sont de l’avis de M. Pétiard et estiment qu’il n’y a aucune différence entre une plante normale et une plante génétiquement modifiée.
Mme Béatrice THIRIET : Leur position, à croire un rapport du Sénat, est que le risque zéro ne peut être garanti à long terme.
M. le Président : Aucun scientifique ne vous dira le contraire. Un chercheur nuancera toujours son propos.
Vous avez tous soulevé la question, majeure, de la communication sur les animaux nourris sans OGM. Bruxelles est fermement opposé à tout étiquetage. Cela dit, aurons-nous suffisamment d’oléoprotéagineux en France ? Combien en importez-vous pour fabriquer les produits finalement mis en consommation ? Nous risquons de nous retrouver totalement dépendants de productions étrangères.
Je note, à l’adresse de M. Kriegk, que le discours de Coop. de France change selon les auditions… Il est vrai que les problématiques ne sont pas les mêmes, selon que l’on se situe dans la production ou dans la transformation et la commercialisation.
M. Olivier KRIEGK : Je ne crois pas qu’il y ait de contradiction avec le point de vue exposé au nom de la production. Terrena n’est pas hostile aux biotechnologies pour défendre la capacité des coopératives semencières à poursuivre leurs travaux, afin de ne pas perdre pied dans la compétition internationale sur le marché des semences. Ce qui ne nous fait pas perdre de vue notre responsabilité vis-à-vis des consommateurs et des citoyens. Le meilleur moyen de concilier les deux points de vue est d’assurer la plus totale transparence dans l’information.
Le problème des oléoprotéagineux n’est pas à proprement parler lié aux OGM. Notre situation de dépendance résulte des évolutions de la politique agricole commune (PAC) depuis 1992 et des accords passés dans le cadre du GATT45, puis de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui limitent la sole réservée aux protéagineux en Europe.
M. le Président : Mais en produirions-nous suffisamment si nous cultivions la totalité de la sole disponible ?
M. Olivier KRIEGK : Clairement non. La sole réservée à ces productions est en constante diminution par le jeu du système d’aides, qui pénalise ces cultures parce que les agriculteurs ont tendance à les délaisser. Cela dit, les nouvelles mesures agro-environnementales visant à développer la biodiversité dans les exploitations devraient inciter à les développer.
M. Jean-Denis VOIN : Sur ce point, je vous communique la position de l’ANIA qui estime qu’il n’existe pas sur le marché mondial de sources d’approvisionnements non-OGM suffisantes pour répondre aux besoins européens avec les garanties nécessaires.
M. le Rapporteur : Quels produits OGM vendez-vous le plus, et sous quelle forme ? D’où proviennent-ils ?
M. Lionel DESENCÉ : Un marché comme le nôtre exige 4,5 millions de tonnes de tourteaux de soja par an. Le Brésil en produit 65 millions de tonnes… Même s’il autorise depuis deux ans – à titre temporaire – la culture du soja génétiquement modifié, il peut à lui seul largement satisfaire les besoins du marché français en nourriture animale sans OGM.
M. le Président : Le pensez-vous réellement ? Non seulement le temporaire tend, année après année, à devenir définitif au Brésil, au point que 30 % de la sole serait OGM, dont 20 % de contrebande, à tel point que, par les diverses contaminations liées aux transports, il est impossible de garantir le produit final sans OGM. A en croire 60 millions de consommateurs, un tiers des distributeurs prétendent que leurs produits sont sans OGM, alors qu’en fait ils en contiendraient.
M. Lionel DESENCÉ : Une association indépendante, Qualimat, effectue des tests systématiques sur nos tourteaux brésiliens et je ne suis pas certain que les contaminations aient pris une telle ampleur. Nos tests font parfois apparaître des contaminations fortuites, de 0 à 10 %, donc en partie étiquetables, mais celles-ci restent relativement faibles. Ces informations sont accessibles à tout un chacun.
La mise en place de cette filière non-OGM a évidemment été très difficile. Un cahier des charges très strict a été mis en place, qui prévoit des obligations de moyens et des obligations de résultat, de la semence au produit final. Ces éléments sont à la disposition des autorités compétentes qui ne manquent pas de les vérifier. Ce souci de garantie optimale se traduit bien évidemment par d’inévitables surcoûts.
M. le Président : A combien revient le tourteau non-OGM par rapport aux tourteaux classiques ?
M. Lionel DESENCÉ : Le surcoût est de l’ordre de 16 euros par tonne en 2004 et devrait diminuer en 2005. Le tourteau de soja coûte en moyenne 200 euros la tonne, mais les cours fluctuent énormément.
M. Vincent PÉTIARD : D’après les semenciers, 75 à 80 % du soja cultivé dans le monde est ou sera transgénique d’ici à 2005. Peut-être faut-il se placer dans une perspective à plus long terme, marquée par la concentration du secteur des semences – Monsanto vient encore de racheter le groupe Seminis. Tout porte à croire qu’à moyen terme, le développement de variétés hautement performantes se focalisera sur des sojas génétiquement modifiés. Or la production finale dépendra des semences mises à disposition.
M. Olivier KRIEGK : Gardons-nous des visions trop simplistes sur la contamination des semences brésiliennes. Le Brésil est devenu un pays industriellement développé et parfaitement capable de mettre en place des dispositifs de ségrégation conformes aux cahiers des charges. Les coopératives brésiliennes sont certainement plus à même de respecter les prescriptions de la directive européenne 178/2002/CE, applicable depuis le 1er janvier 2005, sur la traçabilité que ne le sont les entreprises françaises… Leur efficacité est incontestable. L’approvisionnement de filières non-OGM en Europe ne pose pas un problème technique ou de taux de contamination, mais simplement un problème de marché : le marché français ou européen est-il disposé à payer cette « prime » de 16 euros ?
M. le Président : La difficulté à mettre en place des filières séparées est bien le principal argument avancé par les adversaires des OGM. Quels que soient les efforts de qualité, les contaminations supérieures à 0,9 % seront inévitables si les cultures OGM du Brésil dépassent 30 % de l’ensemble. Ajoutons que le dépôt des amorces n’est toujours pas obligatoire, alors que c’est précisément ce qui permet de détecter un OGM. Il suffira à un semencier un peu malin de changer l’amorce pour passer à travers tous les contrôles.
Mme Béatrice THIRIET : Vous avez raison sur le problème des amorces.
M. Olivier KRIEGK : Je ne puis qu’être également d’accord sur ce point. Mais on ne peut raisonner sur les problèmes de contamination d’une manière globale. Les possibilités de contamination d’une plante autogame comme le soja ou le blé n’ont rien à voir avec celles que peut avoir un maïs ou un colza. Il faut analyser espèce par espèce : dans le cas du soja, objectivement, la ségrégation n’a rien de compliqué.
M. le Rapporteur : Je repose ma question : quels produits OGM vendez-vous le plus, et sous quelle forme ? De quels produits proviennent-ils ?
M. Lionel DESENCÉ : Je laisse à mes collègues industriels le soin de répondre… A ce propos, il serait intéressant de se pencher sur le cas de la lécithine de soja pour le jour où l’on ne trouvera plus de soja non génétiquement modifié… La lécithine de soja entrant dans la composition de 30 à 50 % des produits alimentaires, nous serons tous amenés à les étiqueter OGM… Je serais assez curieux de connaître les sources d’approvisionnement des uns et des autres pour savoir s’ils en trouvent. Si leur lécithine de soja n’est pas génétiquement modifiée, cela signifie que leurs tourteaux de soja ne le sont pas davantage ! Comme la plupart de nos collègues, nous utilisons de la lécithine de soja non génétiquement modifiée, tracée depuis la semence jusqu’au produit fini. Les groupes lécithiniers, Lucas Meyer en tête, ont travaillé très tôt à mettre en place une ségrégation, particulièrement au Brésil.
M. le Président : Je précise que la lécithine est un corps gras extrait du soja et qui sert de base à la fabrication du chocolat. Le procédé industriel est tel que la détection de traces d’OGM y est impossible. Une bataille a eu lieu à Bruxelles pour savoir s’il fallait étiqueter les lécithines OGM, alors qu’il est techniquement impossible de le prouver. Tant et si bien, qu’alors que pour toutes les plantes, l’étiquetage n’est obligatoire qu’à partir d’un seuil de 0,9 %, ce seuil est systématique pour la lécithine, les huiles ou encore le sucre, quand bien même le taux d’OGM y est de 0 %… Ceux qui ont voulu faire de la communication sur le non-OGM se retrouveront bientôt victimes d’un effet boomerang et confrontés à des situations inextricables.
Mme Béatrice THIRIET : L’administration rend impossible toute communication sur le non-OGM. Les contraintes administratives sont telles que nous nous gardons bien de prendre un tel risque.
M. Gérard DUBRAC : J’ai cru comprendre que vous étiez relativement intéressés par les OGM mais que la prudence vous amenait à étiqueter non-OGM… Les mots « information » et « choix » n’ont pas toujours la signification qu’on leur prête. Un étiquetage « non-OGM » est évidemment plus intéressant sur le plan du marketing, mais peut-être moins sur celui de l’information. Pour donner réellement le choix, il faudrait pouvoir présenter au consommateur deux piles de produits, OGM et sans OGM, étiquetés de la même manière. On saurait alors réellement si l’opinion publique est franchement pour ou contre. Pour l’heure, les gens répondent surtout en fonction de leur humeur, au vu d’informations diffuses et souvent mal définies. Il suffit de regarder ce qu’il y a dans les caddies… M. Pétiard est le seul à nous avoir déclaré qu’il commercialisait des OGM, dans d’autres pays tout au moins. Quelle y est l’attitude du consommateur ? Quelles sont les règles d’étiquetage ?
M. le Rapporteur : C’est exactement la question que je voulais poser.
M. Vincent PÉTIARD : Le premier produit OGM alimentaire, étiqueté comme tel, distribué en Europe était un concentré de tomates commercialisé en Angleterre, que le consommateur avait largement accepté à l’époque en raison de son prix. Il s’agissait de tomates du groupe Zeneca. Pour ce qui est de Nestlé, ce sont les aliments pour animaux aux Etats-Unis qui sont le plus concernés. Nous pouvons utiliser des maïs transgéniques, nos produits ne sont pas étiquetés, et cela ne semble pas nous avoir posé de problèmes de parts de marché jusqu’à présent.
Mme Béatrice THIRIET : On ne trouve pratiquement pas de produits étiquetés OGM en France. Nous en avions un ou deux, que Greenpeace a aussitôt « placardés »…
M. Gérard DUBRAC : Précisément : on ne fait de la publicité que sur le « sans OGM ». Comment l’opinion publique peut-elle ne pas être contre, alors que l’on ne lui fait ressortir que les avantages des « sans » et jamais ceux des autres ? On manipule les gens…
Mme Béatrice THIRIET : Compte tenu des contraintes de l’administration, les produits ne sont jamais étiquetés non-OGM. Il n’y a, en fait, aucun changement pour le consommateur.
M. Olivier KRIEGK : Si l’on ne voit pratiquement pas d’étiquetage des produits avec OGM dans les linéaires, c’est parce que l’industrie agroalimentaire, tout en se déclarant théoriquement et scientifiquement favorable aux OGM, refuse obstinément, dans la pratique, d’en acheter. Vous ne trouverez pas un Coca-Cola avec un sirop de glucose OGM… On n’a pas le droit de faire de la publicité sur le non-OGM, mais on ne communique pas davantage sur la présence d’OGM car on n’en trouve pas… A ne pas sortir de ce scénario, on entretient la schizophrénie du citoyen/consommateur : si le citoyen est hostile aux OGM, le consommateur, lui, s’en fiche éperdument.
M. le Rapporteur : Que répondez-vous à ceux qui affirment que les supermarchés prôneront des produits sans OGM tandis que les produits OGM seront réservés au hard discount ?
M. le Président : Est-il exact que, pour résister à la concurrence des hards discounters, certains d’entre vous aménagent des rayons hard discount dans vos propres magasins ?
Mme Béatrice THIRIET : C’est vrai.
M. le Président : Les éleveurs du plateau de Combraille nous ont parlé des contrats qu’ils ont signés avec Carrefour afin que celui-ci puisse vendre dans ses magasins une viande de qualité garantie sans OGM. Mais serez-vous aussi regardants sur ce que vous vendrez dans vos rayons hard discount pour contrer les Lidl, Aldi et autres ? Autrement dit, pour reprendre une phrase entendue en Auvergne, est-il normal de donner du non-OGM aux animaux et de l’OGM aux gens les plus pauvres ?
M. Lionel DESENCÉ : Question particulièrement intéressante… Vous pouvez désormais trouver chez plusieurs distributeurs, dont Carrefour, des viandes issues d’animaux n’ayant jamais été nourris aux OGM, ce dont nous nous sommes assurés par un système de contrats de filière, depuis la semence jusqu’à l’arrivée dans nos linéaires. Mais cette garantie a un coût, du seul fait que la ségrégation en a un. Et sans mesures de coexistence strictes, assurant une véritable ségrégation entre les filières agricoles, l’agriculture transgénique finira tôt ou tard par s’imposer, dans la mesure où les coûts de ségrégation pour l’agriculture conventionnelle seront tels que ses produits ne seront plus accessibles qu’à une élite. Or le principe de base, l’esprit même de la législation communautaire, c’est de garantir le choix au consommateur. Encore faut-il que les coûts économiques soient identiques dans tous les types de production.
M. André CHASSAIGNE : Nous avons entendu le témoignage d’un éleveur de Charolais, dans le Puy-de-Dôme, sur le cahier des charges signé entre Carrefour et une coopérative. Alors que le taux réglementaire de 0,9 % vaut pour le produit qui arrive dans l’assiette du consommateur, vous imposez aux éleveurs de ne pas le dépasser au niveau de l’alimentation du bétail ! C’est proprement les étrangler… Il leur est difficile, sinon impossible, de respecter des prescriptions imposées de façon aussi autoritaire, alors qu’eux-mêmes ont le plus grand mal à contrôler la teneur en OGM de leur aliment du bétail. N’allez-vous pas trop loin dans votre démarche de marketing en leur imposant des contraintes encore plus sévères que ce que prévoit la réglementation ? Par là même, ces éleveurs, qui souhaitent entrer dans cette filière de qualité, se retrouvent confrontés à des problèmes de cohabitation analogues à ceux que connaissent les producteurs bio.
M. François GUILLAUME : D’abord, en ce qui concerne le soja, je suis bien d’accord pour dire que nous sommes largement dépendants des importations pour le soja. Mais le soja OGM pourrait justement nous permettre de développer cette production sur notre territoire, à l’instar de ce qui s’est passé avec le maïs. Par ailleurs, je ne partage pas toutes vos certitudes quant aux garanties que peuvent apporter les producteurs brésiliens. Les analyses ne sont pas aussi systématiques ni précises qu’on veut bien le dire…
Reste que le soja a plusieurs utilisations. Lorsqu’il s’agit des huiles, vous pouvez parfaitement les mettre dans vos linéaires sans devoir les étiqueter, dans la mesure où elles ne contiennent aucune trace d’ADN et par le fait aucune trace d’OGM. S’agissant des tourteaux, peu importe finalement qu’ils soient fabriqués à partir de soja génétiquement modifié ou non, puisque cela n’entraînera aucune interdiction ni aucune conséquence commerciale. Mais êtes-vous favorable à l’étiquetage des viandes et produits issus d’animaux ayant consommé des OGM, en provenance d’Espagne notamment ?
Question encore plus provocatrice : en tant que responsables scientifiques de quelques grandes maisons, vous disposez de laboratoires et de moyens considérables, parfois plus importants que ceux de la recherche publique. Etes-vous favorables à une introduction progressive des OGM, assortie évidemment de toutes les garanties souhaitables, sachant qu’il faudra bien y passer un jour, compte tenu de ce qui se passe dans le reste du monde ? La publicité indirecte que vous faites autour des produits non-OGM, à défaut de pouvoir la faire directement, vous permet de faire à bon compte la promotion de vos marques. Mais ne vous causera-t-elle pas bien des problèmes à l’avenir lorsque le consommateur, habitué à entendre sans cesse « OGM égal danger », s’apercevra qu’il y en a, en fait, dans tous vos rayons parce qu’on ne pourra plus les éviter ? Vous serez les premières victimes de cette contre-publicité.
M. André CHASSAIGNE : Vos filières de qualité, n’est-ce pas finalement : « Cachez ce sein que je ne saurais voir » ?
M. Daniel CROCQ : Le groupe des Mousquetaires a, vis-à-vis des produits vendus dans ses magasins hard discount, rigoureusement la même position que sur les produits vendus dans ses hypermarchés conventionnels.
M. le Président : En matière d’étiquetage, s’entend. Mais ne trouvera-t-on pas bientôt dans les uns, des produits étiquetés, et dans les autres, des produits issus de filières de qualité ?
M. Daniel CROCQ : On ne peut préjuger de l’avenir. Aujourd’hui en tout cas, notre politique est exactement la même pour les produits dits « d’entrée de gamme » dans nos supermarchés.
M. le Président : Vous n’avez aucun produit étiqueté OGM dans vos hard discounts ?
M. Daniel CROCQ : Aucun.
M. Olivier KRIEGK : Les produits « labellisés » sans OGM prendront une valeur ajoutée considérable, du fait des frais découlant de la ségrégation et de la traçabilité, et ce d’autant plus qu’ils seront rares. On imagine dès lors les tentations de fraude, de triche et de contrebande qu’ils susciteront. Nous avons d’ores et déjà des volailles et des canards que nous pourrions étiqueter sans OGM, mais nous préférons ne pas nous y risquer, faute d’être à même de le garantir à 100 %.
M. Pierre COHEN : Mais qu’est-ce qui explique le coût de la qualité non-OGM ?
M. François GUILLAUME : Mon sentiment profond, c’est que la stratégie en la matière est et sera définie par les commerciaux, non par des scientifiques.
M. Lionel DESENCÉ : Plusieurs d’entre vous doutent des capacités scientifiques des Brésiliens. C’est ce que pensaient peu ou prou tous les Français et les Européens. Mais Carrefour est implanté au Brésil depuis maintenant vingt ans et nous nous y sommes rendus à plusieurs reprises. Si l’on prend l’exemple de la problématique de la salmonelle et de son traitement au niveau des stockages portuaires, tous les spécialistes vous diront qu’elle est largement mieux gérée au Brésil qu’en France.
M. Louis GUÉDON : Mais les salmonelles et les protéines n’appellent pas du tout les mêmes méthodes !
M. Lionel DESENCÉ : Je veux seulement dire que les capacités techniques et scientifiques des Brésiliens dépassent largement ce qu’on peut imaginer.
M. le Président : Certes. Mais un industriel breton, M. Glon, qui nous a adressé un courrier, estime que les contaminations tout au long de la chaîne de transport y sont inévitables. A-t-il tort ?
M. Olivier KRIEGK : Pour garantir le respect d’un cahier des charges, il suffit de mettre en place les moyens de contrôle appropriés. Pour le Brésil, nous faisons appel à des organismes indépendants, type Veritas, qui s’assurent du respect des procédures et des cahiers des charges en analysant les échantillons qu’ils prélèvent eux-mêmes tout au long de la chaîne. Sur les 340 000 tonnes que nous avons importées en 2004, 100 % des échantillons présentaient un taux inférieur à 0,1 %, c’est-à-dire au seuil de quantification ! Ce sont là des faits.
M. le Président : Les distributeurs contrôlent-ils tous le taux de mycotoxines des produits qu’ils vendent ?
Mme Béatrice THIRIET, M. Olivier KRIEGK et M. Lionel DESENCÉ : Oui.
M. Jacques REMILLER : Je crains que ma question n’ait perdu tout intérêt… Mme Thiriet a insisté sur les contraintes liées à l’administration. Il arrive parfois qu’elle empiète sur les prérogatives du législateur… Peut-elle nous en donner des exemples précis ?
Mme Béatrice THIRIET : Pour apposer un étiquetage « non-OGM », nous sommes soumis à une série de contraintes que l’administration nous a énumérées par courrier : premièrement, l’interdiction d’utiliser des auxiliaires technologiques issus d’OGM ; deuxièmement, pour chaque ingrédient d’origine animale – lait, œufs, etc. –, la garantie que les animaux ont été nourris sans OGM ; troisièmement, pour chaque ingrédient d’origine végétale, la garantie que ces produits ne sont pas fabriqués à partir de variétés OGM. Autrement dit, l’administration a édicté une réglementation sur l’étiquetage non-OGM, alors que le législateur n’a pas encore pris position là-dessus.
M. le Président : Pouvez-vous nous communiquer ces documents ? De quelle administration émanent-ils ?
Mme Béatrice THIRIET : De la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
M. le Président : Je tombe des nues… Vous ne pouvez plus vendre de fromage, dans ces conditions !
Mme Béatrice THIRIET : Nous ne communiquons pas sur le non-OGM.
M. le Président : Pratiquement tous les fromages français sont fabriqués avec de la chymosine fabriquée à partir d’organismes génétiquement modifiés.
Mme Béatrice THIRIET : Pas tous.
M. le Président : Du reste, depuis l’épisode de la vache folle, je préfère de loin cette chymosine-là à celle que l’on extrayait de la caillette de veau.
Mme Béatrice THIRIET : Si nous respectons ces obligations, la DGCCRF nous autorise à communiquer sur le non-OGM.
M. le Président : Cela n’a jamais été débattu au Parlement !
M. Lionel DESENCÉ : Non, c’est une doctrine administrative.
M. Jacques REMILLER : C’est bien là où je voulais en venir : la décision a été prise sans l’accord du Parlement alors que c’est à nous qu’il revient de faire évoluer la législation.
M. le Président : Nous interrogerons la DGCCRF.
M. Olivier KRIEGK : Mon groupe est clairement favorable à l’étiquetage des produits animaux dans la mesure où c’est une garantie de transparence pour le consommateur.
M. le Président : Entendons-nous bien : vous êtes favorable à l’étiquetage des viandes et des œufs issus d’animaux ayant consommé des OGM. Y compris pour les produits importés ?
M. Olivier KRIEGK : Pareillement.
M. le Président : Veritas a de beaux jours devant lui…
Mme Béatrice THIRIET et M. Olivier KRIEGK : Ce n’est pas nouveau !
M. Olivier KRIEGK : Le consommateur ne se sent pas concerné par la problématique des OGM contrairement au citoyen, d’où l’incohérence du citoyen/consommateur. Pourquoi ? Parce que le consommateur ne voit jamais d’étiquetage OGM sur les linéaires et pas davantage de non-OGM. Le meilleur moyen de dédramatiser cette situation est d’adopter une position non pas scientifique, mais pédagogique afin que le consommateur dédramatise par lui-même.
M. Gérard DUBRAC et M. Gabriel BIANCHERI : Très bien.
M. Daniel CROCQ : La pesanteur de la réglementation sur l’étiquetage dans nos magasins devient excessive. Ainsi, nous sommes toujours tenus d’afficher le prix du lait au litre sur un tableau, alors qu’il est déjà affiché sur les rayons… Un inventaire, suivi d’un toilettage, devient vraiment indispensable.
M. Lionel DESENCÉ : Si les obligations de traçabilité et d’étiquetage s’imposent pour les produits venant du sol de l’Union européenne, elles ne s’appliquent pas aux produits importés. Seules restent les règles que nous imposons nous-mêmes à titre contractuel. Encore faut-il que l’administration soit en mesure de vérifier si nous satisfaisons aux obligations de moyens et de résultat imposés par la réglementation. Quelles obligations dois-je satisfaire et quels documents dois-je produire à la direction des fraudes, lorsqu’un bateau de tourteaux de soja arrive dans un port français ? Sans réponse précise, on risque de créer de graves distorsions de concurrence. Certains travaillent bien, d’autre moins bien. Les premiers considéreront que la traçabilité doit être totale, de la semence jusqu’au produit fini, les seconds se contenteront d’une traçabilité partielle, plus sujette à caution. Quelle différence l’administration fait-t-elle entre les deux ? Pour nous, il est évident que seule la traçabilité complète est à même de garantir qu’un produit est OGM ou 100 % sans OGM.
Plutôt qu’un étiquetage OGM, qui serait de nature à jeter l’opprobre sur les produits en question, il serait plus judicieux de chercher à valoriser les produits issus de l’agriculture conventionnelle. Les producteurs eux-mêmes sont très demandeurs car ils ne comprennent pas que nous ne valorisions pas leurs efforts aux yeux du consommateur final, alors que nous leur imposons des contraintes de production très drastiques et coûteuses.
M. le Rapporteur : Y a-t-il aux Etats-Unis une évolution vers l’étiquetage ?
M. Lionel DESENCÉ : Certains Etats comme le Vermont cherchent à se doter d’une législation en la matière, mais cette évolution ne semble pas générale.
M. Pierre COHEN : La possibilité de choisir est réclamée partout. On peut comprendre que des différences effectives de qualité se traduisent par des surcoûts ou des possibilités accrues de valorisation. Mais il ne devrait pas y avoir a priori de différence en termes de conditions et donc de coûts de production entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture OGM. J’en viens à penser que le surcoût tient avant tout aux tracasseries que l’on s’impose pour prouver quelque chose à des gens qui n’ont rien demandé…
Mme Béatrice THIRIET : C’est vrai.
M. Pierre COHEN : D’où cette situation paradoxale, qui peut expliquer ce grand mouvement anti-OGM : des producteurs qui n’ont rien demandé, qui continuent à faire comme ils en ont l’habitude, sont amenés, à cause de gens qui, eux, ont décidé de changer, à devoir prouver qu’ils ne sont pas comme les autres !
Mme Béatrice THIRIET : C’est exactement cela !
M. Pierre COHEN : Autrement dit, s’il n’y a pas de surcoût au niveau de la production, il n’y a pas de raison qu’il y en ait au niveau de l’achat et donc au niveau du prix de vente…
Mme Béatrice THIRIET : Si, parce qu’il faut justifier le caractère non-OGM.
M. Pierre COHEN : En quoi le fait de justifier appelle-t-il un surcoût de production ? Il faut empêcher les producteurs d’OGM d’aller embêter les autres et ceux-ci n’ont pas à dépenser davantage pour s’en protéger !
M. François GUILLAUME : M. Kriegk pense qu’il faut dédramatiser l’affaire OGM et propose, dans ce but, d’étiqueter les produits issus d’animaux ayant consommé des aliments du bétail fabriqués à partir d’OGM. Auquel cas les choses seront parfaitement claires : compte tenu de la contre-publicité faite autour des OGM – à laquelle vous-mêmes avez contribué pour mieux promouvoir vos produits –, personne ne viendra en acheter dans vos linéaires. Et comme nous serons bien contraints un jour de les utiliser, il faudra bien se résoudre à l’étiquetage, sauf à n’étiqueter que le non-OGM. Ainsi vous pourrez aménager dans vos grandes surfaces un petit coin « non-OGM », à l’image des petits coins « bio » qui existent déjà, qui ne représentent pas grand-chose dans votre chiffre d’affaires, mais qui attirent le chaland. Tout le monde sait que le volume de consommation du bio est limité et que 40 % du lait bio, par exemple, retourne, faute de marché, dans le circuit conventionnel. Est-ce cela que vous voulez ?
M. André CHASSAIGNE : Je n’ai pas été satisfait de votre réponse. La viande de votre fameuse filière qualité Charolais Carrefour n’est pas étiquetée non-OGM. Or vous exigez dans votre cahier des charges que le producteur reste en dessous du taux de 0,9 % d’OGM dans l’aliment du bétail ! Quelles sont alors vos motivations ? Les contraintes administratives ? A l’évidence non. Des incidences sur la qualité du produit, qu’auraient décelées les éminents chercheurs de Carrefour dans le cas où ce seuil serait dépassé ? Non plus. Serait-ce uniquement pour des raisons de marketing ? Auquel cas je ne comprends pas, puisqu’il n’y a pas d’étiquetage…
Au final, les producteurs de races à viande, et particulièrement les éleveurs de Charolais des Combrailles, sont étranglés par des contraintes dont ils ne comprennent pas la raison et qu’ils ont le plus grand mal à satisfaire, particulièrement pour ce qui touche à leurs tourteaux de soja. Il ne faut pas s’étonner, dans ces conditions, qu’ils soient partisans des arrachages, comme cela s’est produit à Marsat. Quelles sont donc les raisons de votre démarche ?
M. le Président : Pour résumer, est-ce vous qui êtes à l’origine de ces contraintes ?
M. Jacques REMILLER : En effet, de deux choses l’une : ou bien c’est l’administration, contre notre gré – auquel cas il nous faut auditionner le ministre !– ou c’est vous qui les avez interprétées pour vous éviter tout souci dans vos magasins.
M. le Président : Vos préoccupations de marketing ne vous ont-elles finalement pas mis dans une situation intenable ?
M. Olivier KRIEGK : Si l’étiquetage des produits issus d’animaux aboutit à la création d’une niche, à l’image de l’agriculture biologique, le problème sera d’une certaine manière réglé. Peut-être est-ce l’objectif visé par certains : introduire une information sur l’alimentation des animaux qui se traduira par une acceptation du grand public. Cela dit, je ne suis pas certain que le segment de marché en question sera aussi restreint que le bio, ne serait-ce que parce que sur les coûts de production du bio sont sans commune mesure. J’ai plutôt tendance à penser que les produits issus d’animaux n’ayant pas consommé d’OGM pourraient représenter une part de marché comparable à celle des produits light, c’est-à-dire de l’ordre de 25 à 30 %.
S’agissant des surcoûts, on a tendance à confondre les incidences économiques directement liées à la transgénèse, qui se traduisent effectivement par des coûts de production moindres, et celles, à mon avis plus importantes, du changement du mode de commercialisation des matières premières agricoles. Traditionnellement, ces matières premières étaient commercialisées suivant le système dit des commodities dans lequel les marchés sont passés sur la base exclusive d’une qualité saine, moyenne et marchande, arbitrée sur des marchés à terme, éventuellement au gré du cours de la devise, l’importateur achetant le « physique » au meilleur prix possible sur le marché mondial.
La problématique OGM a favorisé l’apparition d’un nouveau mode de commercialisation des matières premières, fondée sur une logique de connaissance a priori du fournisseur à travers l’élaboration d’un cahier des charges garantissant, pour ce qui nous concerne, la teneur en protéines, en matière grasse, la qualité intrinsèque du tourteau et la gestion des salmonelles. Cette évolution dans laquelle les commodities laissent peu à peu la place à des marchés de gré à gré a évidemment un surcoût dans la mesure où ceux-ci impliquent cahiers des charges, ségrégation, contrôles, etc. Elle a donc une incidence économique fondamentale et inévitable par le fait qu’elle procède d’une logique de précaution et de sécurité alimentaire.
M. François GUILLAUME : Ne confondez pas le label « produits régionaux » et les produits non-OGM. Les OGM sont une affaire de sécurité alimentaire, les produits régionaux, les labels, font appel à une notion combinant l’origine et la race dans le cadre d’une charte liant le producteur et le transformateur/distributeur. Ce n’est pas du tout la même chose.
M. le Président : On ne peut pas dire que cahier des charges égale sécurité alimentaire. Si l’on tolère un taux de 0,9 %, c’est bien parce que l’administration juge que ce n’est pas dangereux. Si ce devait être une question de sécurité alimentaire, il faudrait exiger 0 %. M. Chevassus-au-Louis, vice-président de la Commission du génie biomoléculaire (CGB), a répété devant notre mission qu’il ne connaissait aucun produit toxique au monde qui serait toléré à 0,9 %. Par conséquent, votre cahier des charges n’obéit pas à un objectif de sécurité alimentaire : affirmer le contraire n’aboutit qu’à faire peur à toute la population, car le taux, dans ce cas, devrait être
de 0 %. Ce taux de 0,9 % n’est autre chose qu’un compromis politique qui génère, vous le reconnaissez tous, des surcoûts. Il faudrait sans doute arriver à 2 ou 3 % pour éviter ces surcoûts, le tout en respectant les cahiers des charges. Mais que signifierait une étiquette « non-OGM » sur un produit s’il y a 3 % d’OGM dedans ? D’où mon allusion aux mycotoxines : s’il est des vrais sujets, sur lesquels il est possible d’avancer collectivement, comme celui des mycotoxines, il en est d’autres qui, jusqu’à preuve du contraire, ne méritent pas qu’on leur porte autant d’intérêt sur le plan de la sécurité du consommateur.
Comme il s’agit bien d’une question de marketing, il faut faire très attention. A titre personnel, je suis très opposé à l’étiquetage, que vous avez proposé, des produits issus d’animaux ayant consommé des OGM. Tout simplement parce que vous ne devenez pas tomate ou mouton lorsque vous mangez de la tomate ou du mouton. L’ADN est détruit, il n’est plus possible de le retrouver. S’il est prouvé que les tourteaux de soja contiennent une substance toxique, il faut purement et simplement les interdire, et non jouer sur des seuils. Faute de quoi, on se retrouve à monter des usines à gaz dont nous avons déjà le plus grand mal à sortir.
M. Olivier KRIEGK : Je préciserai ma position en disant que je ne considère pas pour ma part les OGM comme un problème de sécurité alimentaire. Leur étiquetage est à mes yeux un problème d’ordre sociologique.
M. le Président : Alors, nous sommes d’accord !
M. Olivier KRIEGK : Et je persiste à penser que l’étiquetage peut aider à déminer le terrain.
S’agissant du cahier des charges, je m’inscris en faux contre vos propos car l’industrie des aliments du bétail a été systématiquement mise en cause lors des épisodes des farines animales ou des graisses contaminées par les dioxines. Or c’est précisément son incapacité à tracer l’origine de ses matières premières qui lui a valu toutes les suspicions sur les causes des contaminations croisées. D’où le changement, fondamental de ses modes d’approvisionnement, qui passent désormais par une logique d’achat de gré à gré, de fournisseur à client, et non plus sur les marchés internationaux où quatre opérateurs – les Brésiliens les appellent « ABCD » : ADM, Bunge, Cargill et Dreyfus – accaparent 90 % du commerce international de ces denrées, et ont pour préoccupation première d’entretenir l’opacité sur l’origine de la matière première, afin de ne pas être dérangés dans leur commerce…
M. le Président : Nous sommes d’accord.
M. Vincent PÉTIARD : Le problème de la traçabilité – identity preservation – n’est effectivement pas lié aux OGM. Lorsque nous achetons 2 000 sacs de café en Ethiopie pour Nespresso, cela représente un surcoût significatif par rapport à 10 000 tonnes achetées sur le marché de Londres pour Nescafé, et cela n’a rien à voir avec les OGM. C’est simplement pour avoir la maîtrise de la traçabilité, pour savoir d’où cela vient et pour être sûr du suivi de toute la filière, jusqu’à notre usine. Autant de dépenses supplémentaires que l’on peut vouloir assumer pour certains produits, mais éventuellement pas pour d’autres.
Pour moi, comme pour mes collègues de l’Académie de l’agriculture, une plante génétiquement modifiée ne présente a priori, sur le plan de la sécurité alimentaire, ni plus ni moins de risque qu’une plante issue de sélections traditionnelles. Imposer des contraintes de sécurité alimentaire sur les OGM devrait donc, en toute logique scientifique, conduire à les imposer à tout nouvel hybride de pomme de terre issu de la sélection traditionnelle – ce qui ne serait du reste pas davantage justifié, l’histoire ayant montré que les sélectionneurs ont toujours soigneusement évité qu’une plante toxique n’arrive sur le marché.
M. le Président : Monsieur Desencé, je comprends parfaitement votre souci de traçabilité. Mais je note que pour les produits de l’agriculture biologique avec indication d’origine labellisés « AB », vous tolérez jusqu’à 5 % de contamination, beaucoup plus que pour les OGM. Il y a là une difficulté…
M. Olivier KRIEGK : Ce n’est pas nous qui avons fixé les seuils…
M. Lionel DESENCÉ : Je commencerai par vous lire ce petit texte qui, en tant qu’opérateurs, ne peut pas nous laisser insensibles :
« Face à l'incertitude, d’aucuns tentent de convaincre l'opinion que cette technique (la transgénèse) ne fait que copier la nature ou en accélérer le mouvement spontané, dédouanant ainsi les OGM de risques inédits. Cette position est non seulement indéfendable du fait du manque de recul évoqué, mais elle nuit à la mise en place du dispositif de vigilance nécessaire à la détection des effets, non visés, inconnus ex ante, non testés. »
M. le Président : Qui a écrit cela ?
M. Lionel DESENCÉ : C’est le cinquième avis du COMEPRA46 – INRA47/INSERM48.
M. le Président : Nous avons déjà entendu Marion Guillou, directrice de l’INRA, et Guy Riba qui ne nous ont pas dit cela.
M. le Rapporteur : Pourquoi n’adoptez-vous pas les mêmes normes pour les herbicides et les insecticides ?
M. Lionel DESENCÉ : Nous sommes des opérateurs économiques, non des hommes de science. Nous sommes bien obligés de nous fonder sur les avis des diverses instances scientifiques reconnues, qui ne sont pas aussi unanimes qu’on le prétend. Nous n’avons pas de position sur les effets réels ou supposés des OGM sur la santé humaine. Reste qu’il y a une incertitude et nous devons en tenir compte.
Au demeurant, les OGM présentent d’autres risques avérés ou potentiels : risques pour l’environnement, risques économiques – évidents –, risques juridiques, risques éthiques. Pour nous, le principal risque est que nos clients nous sanctionnent et n’achètent plus dans nos magasins. La perception qu’ils ont des OGM doit inévitablement changer si l’on veut que ceux-ci s’imposent. Sinon, pourquoi nous obstinerions-nous à commercialiser quelque chose dont les consommateurs ne veulent pas ?
Il est à noter que l’on entend souvent parler des risques des OGM, mais jamais de leurs bénéfices pour le consommateur. On les cherche encore, bien que deux rapports aient été commis sur le sujet par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)…
M. le Président : Un des rapports de l’AFSSA relève que les OGM présentent un moindre taux de mycotoxines.
M. Lionel DESENCÉ : C’est un des effets positifs, je le reconnais. Mais je ne suis pas sûr que cet effet secondaire heureux ait été prévu lors du développement de l’OGM en question… Il s’agit d’un effet induit mais pas un objectif initial du développement du produit.
M. le Rapporteur : Je réitère ma question : pourquoi, en termes de marketing, n’êtes-vous pas aussi coercitifs à l’égard des herbicides et des insecticides ?
M. Lionel DESENCÉ : La refonte des dossiers d’homologation, que nous appelons de nos vœux, entraînera prochainement la disparition d’un certain nombre de molécules actives. Il nous appartiendra, alors, de respecter la législation. Dans le cas des OGM, l’esprit de la réglementation communautaire était d’offrir le choix au consommateur, ce qui ne signifie pas qu’il faille lui imposer l’un ou l’autre, mais bien lui offrir deux gammes de produits, OGM et non-OGM, tout aussi compétitives.
Mme Béatrice THIRIET : Nous avons le devoir de bien informer le consommateur. Or celui-ci n’est pas au fait de toutes les subtilités de l’étiquetage : il arrive que l’on nous demande si « amidon modifié » signifie « génétiquement modifié », alors qu’il s’agit d’une transformation chimique… Un affichage « blanc » ou « noir », « OGM » ou « non-OGM » est tout de même plus explicite. J’insiste enfin sur le fait que les contraintes administratives évoquées plus haut concernent le non-OGM, pas l’étiquetage.
M. Daniel CROCQ : L’un d’entre vous se demandait si ce n’était pas la grande distribution qui dictait sa loi aux producteurs… Ce n’est pas elle en tout cas qui a inventé les OGM, mais plutôt les semenciers. Nous en sommes plutôt embarrassés. Nous aurions davantage tendance à nous préoccuper des produits trop riches en graisses ou en sucre, ou encore de la mise sur le marché de certaines boissons alcoolisées qui cherchent à attirer les enfants.
M. le Président : Carrefour est présent dans de nombreux pays. Y appliquez-vous les mêmes règles ? Par exemple, que faites-vous en Argentine ? Y vendez-vous des OGM ?
M. Lionel DESENCÉ : Nous nous appuyons, justement, sur les avancées réalisées au niveau de l’Union européenne pour valoriser auprès des pouvoirs publics de ces pays une législation identique. Nous sommes présents dans 31 pays et l’arsenal juridique et législatif de l’Argentine n’est pas celui de la Chine ou du Brésil. Lorsque la réglementation d’un pays oblige à étiqueter et à informer, il nous est naturellement plus facile de garantir un produit exempt d’OGM au consommateur final.
M. le Président : En Argentine, par exemple, où les cultures OGM sont très nombreuses, vendez-vous des produits contenant des OGM ?
M. Lionel DESENCÉ : J’allais y venir. Avant l’entrée en vigueur des règlements 1829 et 1830/2003, la réglementation communautaire obligeait les distributeurs à délivrer cette information au consommateur final, mais ne l’imposait pas aux opérateurs amont. Et sans traçabilité, nous n’avions aucun moyen de vérifier si l’huile de soja, par exemple, était génétiquement modifiée ou non. Dans son règlement 178/2002, l’Union européenne impose désormais la traçabilité.
La réglementation chinoise impose l’étiquetage des produits : nous y adoptons en conséquence la même démarche que dans les pays de l’Union européenne. L’Argentine pose une série de difficultés : outre le fait que le consommateur argentin n’a pas le même pouvoir d’achat que le consommateur français, nous avons du mal à gérer les approvisionnements. De ce fait, aucun produit Carrefour n’est étiqueté en Argentine. Mais affirmer que la pression de contrôle et les garanties applicables aux produits que nous distribuons sont strictement identiques dans l’Union européenne et en Argentine serait une contre-vérité.
M. le Président : Au-delà de vos périphrases, nous avons bien compris que vos stratégies varient en fonction des réglementations…
M. le Rapporteur : Pensez-vous que ce qui se passe actuellement en France ait une influence dans les autres pays ?
M. Lionel DESENCÉ : Pour ce qui est du soja, les jeux sont faits aux Etats-Unis et en Argentine. Quant aux Brésiliens, ils ont vu leurs exportations de soja vers l’Union européenne fortement progresser. Les débats qui animent en ce moment même le Congrès comme l’exécutif brésilien laissent à penser qu’ils prennent conscience qu’une chance se présente à eux.
M. André CHASSAIGNE : Pour savoir si j’ai bien compris votre argumentation : partant du fait qu’il y a une incertitude, vous ouvrez le parapluie en exigeant le non-OGM dans les filières de qualité Carrefour. Or, cela n’apparaît pas dans l’étiquetage mais si une association de consommateurs vous demande le cahier des charges, vous pourrez démontrer que le seuil de 0,9 % n’a jamais été dépassé.
Mais vous ne vendez pas que cela dans vos rayons boucherie. Autrement dit, votre inquiétude et votre doute ne valent que pour une certaine catégorie de consommateurs, ceux qui ont les moyens d’acheter votre viande de qualité sans OGM. Pour les autres, les conséquences des OGM vous inquiètent beaucoup moins… Je ne suis donc pas du tout convaincu par votre réponse qui, à tous égards, manque de logique : c’est pour une simple raison de marketing que vous imposez toutes ces contraintes, et particulièrement ce taux de 0,9 %, à nos éleveurs.
M. le Président : L’appréciation de M. Chassaigne est rude ! Essayez de nous expliquer. Est-ce vraiment une affaire de marketing ? La complexité de la législation en la matière ne vous semble-t-elle pas devenue excessive ? A lire certains, vous aimeriez que l’on sorte de cette législation trop contraignante… Etes-vous d’accord avec le seuil de 0,9 % ? Seriez-vous favorables à des seuils plus bas pour l’agriculture biologique ? Les cahiers des charges de l’agriculture biologique ne prévoient que des obligations de moyens, sans obligation de résultats. C’est-à-dire qu’il faut avoir cultivé sans produits phytosanitaires mais il n’y a pas d’obligation d’absence de produit phytosanitaire ou de mycotoxines dans le produit fini. Etes-vous partisan de lui imposer une obligation de résultats – absence de produits phytosanitaires et de mycotoxines – et l’exigez-vous déjà dans vos propres cahiers des charges ?
M. Lionel DESENCÉ : Le risque zéro n’existe pas… Si quelqu’un se présente devant vous en vous déclarant être à 100 % certain que tous les produits transformés qu’il commercialise sont 100 % sans OGM, ce ne peut qu’être un menteur. D’où la nécessité de mettre un seuil techniquement applicable et économiquement réalisable. Imposer un seuil à 0 % est le meilleur moyen de ne plus avoir un seul produit étiqueté non-OGM en magasin – et inversement d’être sûr que 100 % des produits seront étiquetés OGM. C’est toute la difficulté que pose l’élaboration de la future directive en matière de taux de présence fortuite d’OGM dans les semences : il va falloir définir un seuil en corrélation avec le taux de 0,9 % arrêté pour les produits finis.
M. le Président : Etes-vous consultés là-dessus ?
M. Lionel DESENCÉ : Pas directement ; au demeurant, ce n’est pas nous qui allons discuter des mesures de ségrégation à prendre pour éviter toute contamination. Ce n’est pas de notre compétence. Mais nous appelons de nos vœux une législation propre à assurer la survie des deux agricultures.
Il est vrai que nous imposons aux filières qualité Carrefour des exigences particulières. Encore faut-il noter que ce que nous exigeons des filières porcines est sans commune mesure avec ce que nous demandons à des filières longues, traditionnellement atomisées comme les filières bovines où la mise en œuvre de telles mesures rencontre de colossales difficultés. Aussi appelons-nous l’ensemble des opérateurs à se mettre au travail pour assurer la coexistence de ces deux agricultures.
M. le Président : Vous n’avez pas répondu à ma question. Avez-vous un cahier des charges avec les producteurs biologiques ? Etes-vous favorable une obligation de résultat ?
M. Lionel DESENCÉ : Lorsque Carrefour s’est lancé dans l’agriculture biologique sous sa propre marque, nous avons effectivement constaté qu’une simple obligation de moyens ne suffisait pas. Aussi avons-nous imposé contractuellement des obligations de résultat.
M. le Président : Est-ce le cas pour tous ?
Mme Béatrice THIRIET : Auchan n’a pas de marque bio.
M. Daniel CROCQ : Nous avons quelques produits bio qui répondent aux exigences de la législation en la matière.
M. Gérard DUBRAC : Si des OGM peuvent passer dans d’autres cultures, l’inverse est évidemment tout aussi vrai. Pourquoi ne pas bâtir les seuils à l’identique en considérant qu’à partir du moment où il pourrait y avoir 3 % de non-OGM dans l’OGM, il pourrait y avoir 3 % d’OGM dans les cultures non-OGM ? Si le consommateur a droit à l’information, encore faut-il qu’elle repose sur quelque chose de logique. Multiplier les contraintes pour prouver qu’un produit n’est pas OGM revient de facto à considérer que tous les autres peuvent être étiquetés OGM… La logique voudrait que l’on autorise le même taux d’impuretés dans les deux types d’agriculture, au lieu de 0,9 % qui ne signifie rien.
M. le Président : La question est donc de savoir si ce seuil de 0,9 % doit être révisé. Par ailleurs, ne serait-il pas plus simple d’harmoniser les taux et de retenir un seuil unique pour toutes les productions, étant entendu que tout ce qui est dangereux doit être interdit ? Y a-t-il des raisons d’être plus sévère avec la « contamination » OGM qu’avec la contamination par d’autres plantes de productions qui sont déjà sous label ?
M. Louis GUÉDON : Je remercie les professionnels de toutes les précisions qu’ils nous ont apportées, mais ne sommes-nous pas en train de dévier de notre mission ? Notre travail ne consiste-t-il pas plutôt à dire si les OGM sont dangereux ou pas et, s’ils le sont, à en tirer les conséquences sur le plan législatif ? Nous sortons du cadre de notre mission d’information.
M. le Président : Notre mission a pour rôle de préparer la transposition de la directive, mais également à préparer l’avis – ou les avis – que pourra donner le Parlement à l’adresse du consommateur. La France n’a pas connu depuis 1998 de débat sur ce sujet, alors que le contexte a depuis énormément évolué.
M. Vincent PÉTIARD : Le premier travail dont j’ai été chargé chez Nestlé, bien avant les OGM, était de déterminer pourquoi des produits surgelés à base de courgettes s’étaient finalement révélés toxiques. La cause tenait en fait à une pollution au niveau de la production des semences desdites courgettes !
Si vous voulez vraiment contrôler le non-OGM au niveau des semenciers, il faut savoir qu’il faudra, dans le cas de la tomate, par exemple, contrôler comment les hybrides sont produits à partir des lignées mères en Inde ou en Chine ! Tout simplement parce que l’on procède par pollinisation manuelle et que les coûts de main-d’œuvre étant rédhibitoires dans nos pays, on fait faire l’opération dans des pays où le coût est moindre. Et, dans certains cas, ce sont les mêmes producteurs semenciers qui, dans les mêmes champs pépinières, produisent pour Seminis et Monsanto ou pour Vilmorin…
Ainsi, nous avons connu une pollution sur un autre produit suisse à base de tomate. C’était un concentré acheté au Portugal. Le fabricant, tout comme l’agriculteur, étaient totalement inconscients de cette pollution car l’hybride de tomate cultivé avait été pollué au niveau de la fabrication de semences en Chine ou en Inde.
Ces deux exemples prouvent la difficulté de l’exercice, mais également le fait que ces questions de sécurité alimentaire peuvent parfaitement se poser de la même façon pour tout produit issu de l’agriculture traditionnelle. Pour avoir, en tant que sélectionneur de métier, beaucoup travaillé sur le café, je puis vous assurer que l’on peut produire au Brésil, par sélection traditionnelle, des cafés qui sont naturellement sans caféine. D’autres, également sans caféine, sont actuellement développés par des firmes de capitaux à risques installées à Hawaï. La position que j’ai constamment défendue, y compris face à Greenpeace, était que nous devrons effectuer les mêmes contrôles sur ces cafés, qu’ils soient issus de croisements avec une espèce sauvage ou de manipulations génétiques. Dans un cas comme dans l’autre, il faudra vérifier si, à la place de la caféine, ils ne contiennent pas un produit aux effets physiologiques indésirables.
Le vrai problème scientifique est là : dès que vous modifiez un patrimoine génétique, vous modifiez dans le produit quelque chose qui peut devenir, selon les cas, toxique ou pas. Mais c’est le résultat qui est en cause. Ce n’est pas la méthode de modification génétique qui induira a priori la toxicité – ou la non-toxicité. Heureusement, j’ai confiance dans les capacités de nos collègues semenciers et de nos instituts de contrôle pour s’assurer de la composition et des qualités des nouvelles variétés avant toute mise en marché.
M. le Président : Voilà qui complique davantage encore le problème…
M. Jean-Louis VOIN : La confusion est grande dans l’esprit des consommateurs. Il est de la responsabilité des opérateurs industriels, comme des pouvoirs publics, de clarifier le débat.
M. le Président : Du fait que vous fabriquez dans les cinq continents, avez-vous cinq politiques de fabrication ?
M. Jean-Louis VOIN : Notre politique en Europe diffère de celle que nous menons dans le reste du monde.
Une très grande majorité de scientifiques, avez-vous dit, estime qu’il n’y pas de différence entre un produit OGM et un produit non-OGM. Reste qu’il va falloir, avec des autorités indépendantes, avancer sur la question de la sécurité alimentaire, qui est pour nous la première priorité. Nous avons besoin d’un éclairage objectif sur la problématique des OGM, ce qui ne nous dispense pas, M. François Guillaume l’a dit, de nous pencher sur le futur : du fait même de la dynamique mondiale, l’Europe devra s’ouvrir aux OGM. Il faut s’y préparer de manière raisonnée avec des éléments propres à rassurer les consommateurs, plutôt qu’en déployant des arsenaux qui ne font qu’accroître la confusion.
M. le Président : L’insertion d’un gène crée évidemment une différence. Mais l’utilisation de la transgénèse, méthode plus rapide, ne change pratiquement rien par rapport aux méthodes de sélection classique. Reste à connaître l’impact de l’insertion. Il n’est pas impossible que les effets varient en fonction du point d’insertion – on en a déjà trouvé cinq pour le riz. Si les méthodes de transgénèse permettaient d’améliorer la précision des insertions, elles donneraient des produits moins risqués que les méthodes traditionnelles, par nature aléatoires.
Par ailleurs, personne n’a insisté sur le fait qu’il existe des méthodes de sélection classiques « forcées » faisant appel à des agents mutagènes ou à l’irradiation, qui n’ont rien de naturel ni de traditionnel. Ce qui signifie que la biovigilance – toxicité, allergénicité, … – doit s’appliquer pour tous les aliments. C’était en tout cas le message de tous les scientifiques, depuis les membres de l’Académie jusqu’au plus petit chercheur en laboratoire. Lorsque nous nous rendons en régions, nous ne nous contentons pas d’aller voir le chef, nous parlons également avec les gens qui travaillent à la paillasse… Nous nous devons de vous rapporter leur message. A force de diaboliser les OGM en les rendant responsables de tous les maux, nous nous mettons dans une situation impossible.
M. Vincent PÉTIARD : Il est clair pour nous qu’une variété issue d’une transgénèse doit avoir un caractère nouveau ; sinon, quel intérêt ? La question de la sécurité se pose pour l’objet ou le résultat de la modification, pas pour la méthode utilisée. Ajoutons qu’à côté de l’irradiation, se développent aux Etats-Unis et ailleurs des techniques dites de tilling (screening moléculaire de mutants) : il ne s’agit plus d’OGM, mais de mutants que l’on screene par séquençage d’ADN à grand débit – autrement dit, on cherche le mutant par rapport à un gène connu d’avance. Or les premiers développements de cette technique échappent totalement à la législation sur les OGM. Et pourtant, cela revient à taper à l’aveugle dans le génome pour n’y prendre que ce qui intéresse, sans se préoccuper de ce qui se passe à côté…
La sécurité se fonde sur l’analyse des premiers produits en champ. Lorsque l’on regarde la descendance d’un croisement de pommes de terre, on trouve des choses passablement farfelues, et tout le métier du sélectionneur consiste précisément à trier, qu’il s’agisse de croisements, des fusions de cellules, d’irradiation ou de transgénèse.
M. le Président : Nous connaissions les vrais/faux passeports, voilà les faux/vrais OGM… Les chercheurs de l’INRA nous ont montré que, du fait de la variabilité des espèces, pratiquement les deux tiers des caractères recherchés pour fabriquer des OGM se retrouvaient d’ores et déjà dans les variétés existantes. Si nous sommes capables, grâce aux techniques que vous venez d’évoquer, d’aller les y chercher, nous aurons fait des OGM, mais sans obligation d’étiquetage puisqu’il n’y aura plus d’amorce, c’est-à-dire qu’il n’y aura plus de transgène. Que voulez-vous que le consommateur y comprenne ?
Mme Béatrice THIRIET : Pourquoi alors avoir fait une législation communautaire ?
M. le Président : Parce que tout le monde n’était pas d’accord. Parce que la perception varie selon les personnes et les pays et parce que le politique doit traiter le risque perçu comme vous le faites en marketing. A ceci près qu’il n’est pas possible de fonder une argumentation politique sur du vent. Il faut donc savoir ce que l’on dit.
Mme Béatrice THIRIET : On n’étiquette pas les médicaments…
M. Gérard DUBRAC : Les médicaments ne sont pas en vente libre.
M. le Président : Une molécule sur 10 000 passe du stade de la paillasse à celui de médicament. Et cela prend douze ans… Faut-il en arriver là pour les médicaments ?
M. Lionel DESENCÉ : Ne nous focalisons pas sur le potentiel risque sanitaire. Parlons plutôt du risque environnemental qui est avéré, du risque juridique pour nos sociétés, du risque éthique. Ceux-là ne sont pas potentiels, mais avérés.
M. le Président : Nous le faisons dans le cadre d’autres auditions. Vous ne vendez pas de l’environnement…
M. Lionel DESENCÉ : C’est mon directeur juridique qui aurait dû venir. Il aurait tenu un discours juridique sur les OGM.
M. le Président : Nous avons, bien sûr, prévu une table ronde sur les risques juridiques.
M. Lionel DESENCÉ : Je souhaite seulement que vous compreniez que les positions adoptées par les distributeurs et les industriels ne se justifient pas uniquement pour des raisons de marketing ou de risques potentiels pour la sécurité des aliments.
M. le Président : Nous organisons mardi prochain une table ronde sur l’assurabilité et les problèmes juridiques. Nous y accueillerons volontiers un responsable d’un de vos groupes. Je regrette à ce propos qu’aucun représentant de la grande distribution n’ait pour l’instant répondu présent pour nos tables rondes contradictoires. L’exercice n’est pas facile, je le reconnais, mais votre absence poserait un réel problème. Une démocratie suppose que les différents acteurs de notre société – et vos chiffres d’affaires prouvent que vous tenez une place majeure dans notre économie – puissent échanger leurs arguments. On ne fait pas que des choses confortables dans la vie…
Mme Béatrice THIRIET : Chaque jour est pour nous un exercice de haute voltige…
M. Olivier KRIEGK : Je reconnais avoir eu un peu de mal à comprendre la question de M. Dubrac, car la réglementation communautaire ne concerne que les produits issus d’OGM tandis que le vide juridique demeure pour ceux qui n’en contiennent pas. Je suis d’accord sur le fait que le seuil de 0,9 % obéit essentiellement à des considérations politiques et qu’il devrait être révisé dans un sens plus pragmatique, en reprenant par exemple les seuils de pureté variétale applicables aux semences, et ce dans le monde entier. Le taux de pureté de 99 % devrait servir de base applicable à tous les produits finis. Cette règle est simple, logique et très ancienne.
Et que l’on ne me dise pas qu’on ne sait pas gérer la cohabitation alors qu’on y réussit fort bien tous les jours, lorsqu’on produit des semences de maïs ou de colza !
M. le Président : Les semences sont souvent cultivées sur des parcelles réduites situées dans des territoires assez protégés – des vallées, par exemple. Elles supposent également des contraintes
– l’arrachage des adventices à la main, par exemple, aux alentours des parcelles – qui engendrent des surcoûts très élevés, difficilement acceptables pour une production traditionnelle. On pourrait évidemment songer à couper la France en morceaux, ce qui poserait immédiatement le problème de la liberté de l’agriculteur dans le choix de ses cultures. Autrement dit, le problème n’est pas simple.
M. Olivier KRIEGK : C’est tout de même faisable.
M. le Président : On sait le faire, c’est évident. Mais à quel coût ?
M. Olivier KRIEGK : Cela dépend des espèces.
M. Vincent PÉTIARD : Il serait navrant que les surcoûts des essais liés à la réglementation en viennent à bloquer le développement d’OGM de deuxième génération qui pourraient présenter un avantage direct pour le consommateur, et surtout pour les pays en voie de développement. La mise en marché d’un seul événement de transgénèse représente pour un semencier entre 10 et 15 millions d’euros de frais d’études. Les plantes résistant à la sécheresse, les plantes à amidon modifié ou à acides gras modifiés sont déjà dans les serres. Mais jamais les semenciers ne les mettront sur le marché s’ils ne peuvent en espérer un retour financier correct. C’est ainsi que l’on trouve, à l’instar des maladies du même nom, des « espèces orphelines », tels ces maniocs résistants aux virus qui intéressent bon nombre de pays africains. Mais qui acceptera, connaissant la réglementation en la matière, d’investir dix à quinze millions pour mettre ces semences à disposition des producteurs du Kenya ou d’ailleurs ? Qu’il faille respecter le principe de précaution, tout le monde en est d’accord. Faut-il pour autant alourdir encore la réglementation et même chercher à l’étendre aux pays en voie de développement ? Les OGM sont à l’évidence une des techniques qui, parmi d’autres, peut aider au développement des pays pauvres. Plusieurs firmes semencières sont d’ores et déjà disposées à leur céder gratuitement des licences et des brevets pour développer des produits spécifiques. Il n’y a donc pas d’obstacle technique. Mais cette possibilité leur est interdite du seul fait de la législation et des coûts de mise sur le marché.
M. le Rapporteur : A vous entendre, le coût des brevets ne serait pas un obstacle ?
M. Vincent PÉTIARD : Non. Dans le cas de ce manioc résistant à un virus, le brevet du gène de résistance a été donné gratuitement à des scientifiques du Kenya, entre autres Mme Florence Wambugu qui a beaucoup travaillé à la promotion des OGM en Afrique.
M. François GUILLAUME : Un des principaux atouts des OGM tient effectivement au fait qu’ils peuvent apporter une réponse à des producteurs confrontés à des situations qui ne leur permettent pas de développer des plantes traditionnelles. Mais cela se heurte à deux obstacles : le premier est le coût des semences, et le meilleur moyen d’aider ces pays serait de les leur donner. Le second, d’ordre psychologique, tient à notre propre hostilité à l’encontre des OGM et explique des réactions d’un Robert Mugabe qui refuse des maïs génétiquement modifiés, alors que la population du Zimbabwe meurt de faim, au motif que les Africains n’ont pas à manger un produit dont les populations les plus riches ne veulent pas. Nous avons une lourde responsabilité en la matière.
M. Lionel DESENCÉ : Nous ne pouvons que souscrire à vos propos, mais nous avons tendance à nous méfier parfois de certains discours, trop angéliques. En 1997, le rapport Bizet avait recensé les essais conduits dans les pays occidentaux et ceux effectués dans le Tiers-Monde : la comparaison est éloquente… Je vous invite également à consulter le site Internet du centre de recherche commune de l'Union européenne (JRC pour Joint research center) sur lequel, conformément à la réglementation communautaire, sont décrits les essais au champ et les caractères modifiés. Dans plus de 90 % des cas, il s’agit de plantes de grande culture aux rendements améliorés. Attention au bénéfice pour le consommateur…
M. le Président : Vous avez raison, à ceci près qu’il n’y avait pratiquement aucun essai en Afrique en 1997, alors que maintenant on y trouve des cultures… La mission se rendra du reste en Afrique du Sud. Il est également exact que la plus grande part des essais porte, pour l’instant, sur des plantes dites à pesticides. Je peux cependant vous assurer que, dans les laboratoires des grands groupes, nombre de projets sont d’ores et déjà prêts, mais on ne les teste pas au champ, l’actuel climat de controverse n’étant pas jugé propice à de tels investissements. On s’est pour l’instant borné à tester au champ les produits qui pouvaient apporter un bénéfice immédiat à celui qui vendait la semence, à la rigueur à celui qui la cultivait, mais aucun avantage pour le consommateur. Et s’il n’y a aucun intérêt, le consommateur n’acceptera jamais de courir le moindre risque, fût-il infime.
M. Vincent PÉTIARD : Si vous voulez savoir ce qui se prépare, ne regardez pas les essais en champ, mais les brevets. Observez attentivement les gènes que les grandes firmes spécialisées se sont attachées à protéger : cela concerne les amidons, les acides gras et autres choses du même genre. Voilà ce qui est dans les tuyaux, voilà ce qui est, pour l’heure, totalement bloqué pour les raisons que j’ai indiquées. On a effectivement retardé l’apparition de bénéfices visibles pour le consommateur.
M. le Président : Pourriez-vous résumer votre position sur l’étiquetage des produits issus d’animaux ? Ne pensez-vous pas que cela compliquera davantage encore le système ? Faudra-t-il prendre en compte le cas d’un animal qui aura mangé des OGM une seule fois dans sa vie, tout simplement parce qu’on se sera trompé de sac ? Faire contrôler une filière de transport par Veritas, c’est possible ; contrôler tous les agriculteurs un par un devient autrement plus compliqué, d’autant que la digestion fera disparaître toute trace d’OGM dans l’animal. Vous vous plaignez des contraintes réglementaires, mais vous vous en imposez d’autres, quand vous n’en réclamez pas de nouvelles…
M. Vincent PÉTIARD : Il est difficile de répondre à cette question car je ne vois pas comment on pourrait gérer un tel problème et prouver que les animaux à l’origine des produits carnés en question n’ont jamais consommé d’OGM. Cela dit, je ne connais pas la position du groupe Nestlé sur cette question.
M. Olivier KRIEGK : Je maintiens que nous sommes partisans d’un étiquetage des produits animaux dans un but pédagogique, afin de montrer que les OGM sont d’ores et déjà entrés dans notre quotidien. La pédagogie est le seul moyen de dédramatiser le débat et de prévenir une crise que tout, pour l’instant, concourt à rendre de plus en plus évidente. Nous savons par expérience qu’il n’y a pas besoin de problème sanitaire pour déclencher une crise médiatique du jour au lendemain. Il est grand temps de déminer le terrain. Sur le plan commercial enfin, si cela doit être un élément de segmentation du marché, il est temps de saisir la perche…
M. le Président : Segmenter le marché sans aucune raison sanitaire ?
M. Olivier KRIEGK : Le métier de tous les jours, dans l’agroalimentaire comme dans la distribution, consiste à différencier son offre par rapport à celle des concurrents : c’est la base du commerce. Au demeurant, aucune raison sanitaire ne justifie une segmentation de marché, puisque tous les produits commercialisés en France et en Europe sont conformes aux normes sanitaires. Les OGM ne sont pas un problème de santé publique, mais s’ils sont un élément de segmentation, il faut saisir l’occasion. Si ce n’est pas le cas, nous le découvrirons en garantissant la transparence.
M. le Président : C’est ce qui s’appelle banaliser… Face à la marée OGM, ne restera que le marché des produits qui pourront prouver qu’ils ne le sont pas, vendus beaucoup plus cher… C’est de la stratégie !
M. Olivier KRIEGK : C’est une stratégie que l’on peut décliner au niveau d’une entreprise comme la nôtre et sur laquelle vous devriez réfléchir : comment protéger l’agriculture européenne dans un contexte de mondialisation du commerce ? Les producteurs de volaille et de porc du Brésil, que je rencontre régulièrement, sont d’ores et déjà parfaitement conformes aux normes sanitaires européennes. Ils se sont organisés pour investir les marchés japonais, asiatiques et européens. Leur surface de stands de viande bovine au dernier Salon international de l’alimentation (SIAL) dépassait celle des stands français… Par quels moyens différencierons-nous notre production face à une telle concurrence ? Je ne dis pas que celui-là soit la panacée, loin s’en faut. Mais il mérite d’être étudié.
M. le Président : Vous ne manquez pas d’arguments…
M. François GUILLAUME : Cela rejoint un discours que nous avons déjà entendu : préservez la production française, faites du non-OGM… et pendant ce temps, on importera de plus en plus.
M. Lionel DESENCÉ : Un étiquetage raisonnable des productions conventionnelles aurait le mérite de ne pas jeter l’opprobre sur les OGM, ce que l’on semble nous reprocher. Au-delà de la nécessité d’informer le consommateur, la valorisation de l’alimentation animale à l’origine d’un produit carné, laitier ou autre commercialisé dans nos enseignes apparaît comme un axe de différenciation tout à fait intéressant. Et cela dépasse largement la seule problématique OGM : il n’est qu’à voir les difficultés auxquelles nous nous heurtons au niveau de la Commission nationale des labels et de certification pour apposer des mentions valorisant l’alimentation animale. Par étiquetage « raisonnable », je veux dire que le but est de mettre en avant ce que l’on sait faire. Et si l’agriculture transgénique est l’avenir, l’agriculture conventionnelle est ce que nous savons le mieux faire pour l’instant. Or nous avons le plus grand mal à la valoriser. C’est notre pire difficulté.
M. le Président : Encore faudra-t-il concrétiser cette politique au niveau des relations entre petits producteurs nationaux et grande distribution – ce que font déjà certains d’entre vous – et se pencher sur la coopération commerciale, sur les prix « nets-nets-nets », accorder des mètres de linéaires aux petits producteurs nationaux, ne pas les déréférencer et respecter les accords signés entre la profession agricole et la grande distribution. Le cahier des charges signé avec les éleveurs de Charolais de notre ami Chassaigne ne sera jamais que la partie émergée de l’iceberg si, dans le même temps, on déréférence nombre de petits producteurs dans tout le pays. Force est de reconnaître, pour le moment, que ce souci de nouer de réels partenariats varie grandement selon les groupes de distribution français.
Mme Béatrice THIRIET : Je rejoins assez le sentiment de mon collègue. J’ajouterai qu’il existe bon nombre de signes de qualité témoignant des efforts des producteurs – label rouge, label biologique –, et autour desquels nous développons des politiques de valorisation et de contractualisation, c’est le cas de nos produits à marques. Il devrait être possible de valoriser un choix de filière, de l’amont jusqu’à l’aval, d’autant que c’est également notre intérêt. Ce dont nous avons besoin, c’est que l’on nous aide à mettre au point des types de messages clairs plutôt que de résoudre le problème de la filière, depuis la graine brésilienne jusqu’au panier du consommateur… En nutrition, il existe ainsi des messages types et nous n’avons le droit de n’utiliser que ceux-là. Sans doute ont-ils le défaut d’uniformiser, mais ils vous épargneront au moins de devoir faire une loi traitant de tout sur un sujet extrêmement compliqué avec, à la clé, des montagnes de papiers.
M. le Président : Par exemple, « viande issue d’un animal qui n’a jamais consommé d’OGM » ?
Mme Béatrice THIRIET : Peut-être faudrait-il au préalable en discuter avec les consommateurs pour savoir ce qu’ils attendent. Leur connaissance de la biologie d’un animal est assez limitée…
M. François GUILLAUME : Avouez que certains messages vous arrangent et d’autres non… Lorsque nous avons demandé que l’appellation « chocolat » soit réservée au chocolat pur, sans huiles végétales, vous êtes tous montés au créneau pour empêcher cela !
Mme Béatrice THIRIET : Pas les distributeurs !
M. Lionel DESENCÉ : Examinez les listes d’ingrédients de nos produits de marque distributeur et vous réviserez votre jugement.
M. le Président : J’avais moi-même proposé deux appellations de qualité : « chocolat pur beurre de cacao » ou « chocolat traditionnel », pour empêcher l’ajout de graisses végétales qui n’avaient rien à voir avec le beurre de cacao. La grande distribution m’avait effectivement suivi. Malheureusement, nous avons été battus au niveau européen par les fabricants qui voulaient produire à moindre coût.
M. Vincent PÉTIARD : Soyons clairs : dans les tablettes de chocolat ou les chocolats de Noël, nous ne mettons que du beurre de cacao. L’ajout d’autres matières grasses végétales nous intéressait pour les chocolats dits de couverture des barres chocolatées, Mars, Lion, Kit-Kat et autres, ou des esquimaux. Elles étaient du reste utilisées depuis très longtemps pour les chocolats de pâtisserie industrielle.
M. André CHASSAIGNE : La porte était déjà entrouverte.
M. Vincent PÉTIARD : Oui, mais cela ne justifiait pas d’en mettre dans le chocolat noir en tablettes.
M. Daniel CROCQ : Trop d’information tue l’information, différencier à l’excès conduit à l’élitisme et donc à offrir des produits pas forcément accessibles à tout le monde, alors qu’une de nos devises est : « apporter du mieux-être au plus grand nombre ». Nous ne sommes donc pas favorables à un tel étiquetage, d’autant qu’il tournera rapidement à l’usine à gaz : s’il faut se préoccuper du veau sous la mère dont la mère aurait mangé des OGM ou des dérivés d’OGM…
M. Jean-Louis VOIN : Unilever n’a pas de position officielle sur cette question. A titre personnel, étiqueter des produits issus d’un animal qui aurait pu être nourri avec des OGM, alors même que les scientifiques affirment que l’ADN transgénique est détruit par la digestion, ne me semble pas aller dans le sens d’une clarification de l’information du consommateur. Aussi resterai-je très circonspect.
M. le Président : Mais si l’on prouvait que les tourteaux de soja transgénique présentent des différences avec les tourteaux classiques du point de vue toxicologique, du fait par exemple de l’accumulation de substances herbicides, le problème prendrait une tout autre tournure. Ce serait une excellente justification. France Nature Environnement évoquait cette hypothèse hier. Encore faudrait-il que ce soit prouvé, ce qui n’a jamais été le cas pour l’instant.
M. François GUILLAUME : Cela nous ramène à la définition des seuils de toxicité qui résultent, on le sait, de décisions politiques. La Commission avait proposé pour les OGM un seuil de 1 %, mais certains pays ont voulu prouver qu’ils étaient plus protecteurs que d’autres et ont fini par obtenir 0,9 %…
M. André CHASSAIGNE : C’est comme la stratégie de la grande distribution…
M. François GUILLAUME : Le problème de la toxicité se pose partout dans le monde, et si l’on énumérait tous les produits un tant soit peu toxiques contenus dans une pomme de terre, on cesserait immédiatement d’en consommer !
M. le Président : M. Parmentier doit se retourner dans sa tombe…
Madame, Messieurs, nous vous remercions de votre participation. Vous voudrez bien pardonner le caractère parfois un peu direct de nos questions, mais il n’est pas toujours facile d’organiser un débat réactif. Chacun a pu s’exprimer et cet échange était très enrichissant. Nous vous invitons à participer à nos tables rondes contradictoires : il est essentiel que tous les avis s’expriment et que l’on puisse répondre immédiatement lorsque l’on n’est pas d’accord. C’est le principe et le but de l’expertise publique et contradictoire. Il arrive même que les avis évoluent : c’est tout l’intérêt de nos auditions.
Table ronde regroupant des juristes
(extrait du procès-verbal de la séance du 1er février 2005)
• Ministère de l’agriculture représenté par Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS, directrice du service des Affaires juridiques et par Mme Isabelle TISON, sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations
• Institut national de la propriété industrielle (INPI), représenté par Mme Martine HIANCE, directrice générale adjointe
• Fédération française des sociétés d’assurance, représentée par M. Claude DELPOUX, directeur des assurances de biens et de responsabilités, M. Guillaume ROSENWALD, directeur des marchés accompagnés de M. Laborde, conseiller parlementaire
• Alain MONOD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
• Limagrain, représentée par M. Jean-Claude GUILLON, directeur de la stratégie
• Pioneer, représentée par M. Jean DONNENWIRTH, responsable Europe propriété industrielle
• M. Philippe KOURILSKY, professeur au Collège de France (chaire d’immunologie), directeur général de l’Institut Pasteur
• Mme Isabelle RAVAIL-DELY, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, membre de la Commission du génie biologique (CGB)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Je vous prie tout d’abord d’excuser le retard d’un certain nombre de nos collègues, qui participent actuellement au scrutin public sur le projet de révision constitutionnelle.
Cette table ronde thématique est la dernière avant que nous en venions, dès demain, aux tables rondes thématiques et contradictoires. Elle est destinée à nous aider à comprendre les problèmes liés à la propriété intellectuelle, au principe de précaution, à l’assurabilité, à la responsabilité en cas de dégâts provoqués par la culture ou la consommation de produits issus de plantes et d’organismes génétiquement modifiés.
Ce débat est important, car il s’agit d’un thème récurrent peu traité jusqu’ici, et une législation claire semble faire défaut, sauf en matière de propriété intellectuelle. Nous serons donc heureux de bénéficier de vos suggestions en la matière.
Mme Martine HIANCE : J’indique tout d’abord que je suis juriste et non pas biologiste – et que j’hésite donc à m’aventurer sur le terrain très délicat des OGM.
Le droit de la propriété industrielle ne connaît pas en tant que tel le concept d’OGM, auquel s’applique donc le droit commun des brevets ou des certificats d’obtention végétale (COV).
Selon le droit des brevets, est brevetable un produit, un procédé ou une application, dès lors qu’il remplit trois conditions : être nouveau, présenter une activité inventive, être susceptible d’application industrielle. La matière biologique est soumise aux mêmes règles et conditions, comme le confirme la loi relative à la protection des inventions biotechnologiques du 8 décembre 2004, qui transpose en droit français la directive communautaire 98/44/CE. En outre, au titre des applications industrielles, on retient traditionnellement les applications dans le domaine de l’agriculture.
Les OGM sont donc brevetables aux conditions générales en tant que produits nouveaux. Les procédés techniques qui leur sont applicables le sont aussi, de même que les applications. Sont ainsi susceptibles d’être brevetés en tant que produits : des gènes modifiés, des vecteurs d’expression, des protéines, des cellules, une plante transgénique. Parmi les procédés brevetables, on trouve des procédés de culture cellulaire, des procédés de purification, des procédés d’expression d’un gène dans une plante. Les principales inventions qu’on rencontre dans l’examen des demandes de brevets concernent des transgènes. Lorsqu’un transgène est nouveau, il est l’objet de l’invention, comme le vecteur d’expression, la cellule hôte et la plante qui incorpore le transgène. Il y a aussi des cas où l’invention porte sur l’insertion d’un transgène connu, l’innovation se situant dans la mise en évidence de l’effet technique d’intérêt qui résulte de cette insertion et de l’expression du transgène. Il existe enfin des demandes portant sur des séquences d’ADN nouvelles, qui consistent en un outil de régulation de l’expression des transgènes – c’est le cas des promoteurs.
La protection par brevet suppose, au moins en Europe, qu’il y ait intervention technique de l’homme : ni une découverte, ni un gène en tant que tel n’est brevetable, ni ce qui ne fait que découler des lois de la nature, comme par exemple les procédés, essentiellement biologiques, d’obtention des animaux et des végétaux consistant intégralement en des phénomènes naturels, tels que le croisement ou la sélection, même si l’homme intervient pour les mettre en présence. Sont également exclus les produits issus exclusivement de tels procédés biologiques.
Autre titre de propriété industrielle, le certificat d’obtention végétale protège les variétés végétales issues de procédés essentiellement biologiques. Mais la variété est différente de ce qui est protégé par un brevet, puisqu’elle est caractérisée par son patrimoine génétique dans son ensemble. C’est l’expression de cet ensemble qui conduit à des caractéristiques phénotypiques propres. La plante transgénique brevetable consiste en un ensemble végétal plus large que la variété, et elle est caractérisée par un seul gène déterminé, dont l’expression confère des caractéristiques nouvelles à la plante.
Les protections par brevet et par COV s’attachent donc, en principe, à des constituants différents de l’OGM : ensemble du génome pour le second, gène particulier pour le premier. Ces deux régimes ont en commun une finalité : assurer, par un droit exclusif négociable, le retour sur investissement d’une recherche de plus en plus coûteuse. Ils comportent des spécificités liées à leur objet, aux critères de protection, aux conditions de délivrance et aux droits conférés.
La brevetabilité suppose que l’invention soit nouvelle, c’est-à-dire qu’elle n’ait jamais été divulguée sous quelque forme que ce soit, qu’il y ait eu une activité inventive – c’est-à-dire que l’objet ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique – et que l’invention soit décrite de manière telle qu’un homme du métier puisse la reproduire. L’examen de la brevetabilité est donc fait sur dossier par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sur la base de la description fournie.
Pour le COV, qui relève du Comité de la protection des obtentions végétales, placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture, l’examen est fait à partir de la mise en culture en champ de l’échantillon de la variété, afin de vérifier que les critères de protection sont bien respectés. Les caractéristiques phénotypiques doivent être distinctes de celles qui sont connues pour les autres variétés, homogènes d’un individu à l’autre, stables d’une génération à l’autre et nouvelles. Ces critères diffèrent de ceux du brevet parce qu’on est en présence, dans un cas, de processus essentiellement biologiques et, dans l’autre, d’une intervention technique de l’homme qui assure en principe l’homogénéité et la stabilité du résultat obtenu.
En ce qui concerne les droits, le brevet confère un droit exclusif de fabriquer, de commercialiser et de vendre l’objet de l’invention. Ce droit s’étend à toute nouvelle invention même brevetable qui perfectionne l’invention antérieure. Le brevet engendre donc une dépendance des inventions de perfectionnement, qui n’auraient pu intervenir sans la première qui a ouvert la voie. Cette dépendance se perpétue tant qu’est en vigueur le brevet sur l’invention dominante.
Pour les COV, il n’y a dans la loi de 1961, toujours en vigueur, aucune dépendance pour les variétés développées à partir de la variété initiale. En revanche, la convention de l’Union pour la protection des obtentions d’origine végétale (UPOV) révisée de 1991 a instauré, pour éviter le pillage auquel donnait lieu le système antérieur, une dépendance au profit de la variété essentiellement dérivée. C’est également le cas dans le règlement communautaire 2100/94 pour la protection des obtentions végétales.
Les effets juridiques de ces deux droits se sont rapprochés, en particulier depuis la loi du 8 décembre 2004 transposant la directive 98/44/CE, puisque tous deux comportent trois exceptions notables à la protection conférée : au profit de la recherche en vue de développer des perfectionnements ; au profit du sélectionneur en vue d’utiliser l’invention ou le COV protégé pour créer, découvrir et développer une nouvelle variété ; au profit de l’agriculteur qui peut utiliser une partie de sa récolte pour réensemencer son champ – c’est ce qu’on appelle les semences de ferme.
Dans les deux cas ont été instaurées, en outre, des licences de dépendance qui permettent d’obtenir une licence d’un brevet pour le titulaire d’un COV qui en serait dépendant
– et inversement – lorsque le second représente un progrès technique et un intérêt économique importants justifiant l’atteinte ainsi portée au droit.
M. Jean DONNENWIRTH : Il me semble qu’on ne peut parler, pour les inventions biotechnologiques, de « droit commun des brevets », compte tenu de toutes les exceptions introduites par la directive 98/44/CE, y compris, vous ne l’avez pas mentionné, au profit des éleveurs. L’exception du sélectionneur est quant à elle une spécificité française, non prévue par la directive. On a donc créé pour les inventions biotechnologiques une sorte de brevet « au rabais ».
Vous avez par ailleurs rappelé que la dernière révision de la convention UPOV datait de 1991. Elle était considérée, alors, comme une avancée majeure pour les obtenteurs qu’elle protégeait, grâce au concept de « variété essentiellement dérivée », du pillage possible par des sociétés biotechnologiques. Il est toutefois regrettable que, quatorze ans plus tard, elle ne soit toujours pas entrée en application en France, où l’on vit encore sous le système de 1978. Alors que notre pays avait été le moteur de la création de l’Union pour la protection des obtentions d’origine végétale, il est désormais en retard.
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : La ratification de la convention UPOV est en cours d’examen interministériel et devrait intervenir assez prochainement.
M. le Président : On peut l’espérer, s’agissant d’un texte de 1991… Cette ratification n’a pas été évoquée lors du débat sur la transposition de la directive.
Pouvez-vous, à partir des dossiers que vous examinez à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), nous donner une idée de l’évolution du nombre de brevets dans le domaine du vivant et des sciences de la vie ?
Mme Martine HIANCE : Mes statistiques ne portent pas sur l’ensemble du domaine du vivant. Il n’y a pas d’entrée « OGM » dans la classification internationale des brevets et il faut croiser un certain nombre d’entrées pour obtenir des chiffres pertinents. Pour les entrées « Génie génétique et plantes », on en est, depuis 2000, entre 14 et 16 brevets français par an, à comparer avec les 2 500 à 3 000 brevets européens, selon les années. Pour ces derniers, on observe une baisse sensible d’activité en ce qui concerne les seules plantes génétiquement modifiées, le nombre de brevets étant tombé de 268 en 2000 à 159 en 2004.
M. le Président : Vous avez évoqué un rapprochement, mais le droit des brevets et celui des COV vous paraissent-ils vraiment compatibles ? En fait, les critères de nouveauté, d’activité inventive, d’application industrielle qui prévalent pour le premier sont-ils compatibles avec le caractère distinct, l’homogénéité, la stabilité requis pour les seconds ?
Mme Martine HIANCE : Il s’agit d’objets différents et on ne protège pas la même chose par brevet et par COV. Il n’est donc pas étonnant qu’en dehors de la nouveauté, les critères soient différents. On ne peut pas comparer les critères de l’invention brevetable et ceux de l’obtention végétale. Si une variété végétale est génétiquement modifiée, elle peut être essentiellement dérivée et doit remplir les conditions du COV, le transgène pouvant, pour sa part, faire l’objet d’un brevet.
M. le Président : Le COV donnait globalement satisfaction pour les végétaux. Si le droit des brevets s’y ajoute, que se passera-t-il quand, dans une variété végétale protégée par la convention UPOV, un inventeur insérera un gène qu’il brevètera en faisant valoir qu’il y a une nouvelle fonction ? N’est-il pas possible qu’au bout du compte le droit des brevets s’impose, puisqu’il suffirait, à qui voudrait protéger une nouvelle variété et interdire qu’elle soit utilisée, de transférer des transgènes différents sur cette variété, de les breveter et de bloquer de facto la convention UPOV ?
Mme Martine HIANCE : Dans ce cas, il y aurait dépendance, le droit du breveté étant dépendant du droit de l’obtenteur et il serait possible de recourir à une licence de dépendance si les conditions étaient réunies.
M. Jean DONNENWIRTH : Si la variété n’est protégée que par le droit français, l’obtenteur n’a pas grand-chose à faire dans un tel cas de figure, puisque la loi n’a pas été mise à jour pour intégrer le concept de « variété essentiellement dérivée » et de dépendance de celle-ci par rapport à la variété utilisée comme base pour insérer le transgène. L’obtenteur ne pourra donc pas s’opposer ensuite à l’exploitation du titulaire du brevet. C’est bien pourquoi ces dispositions ont été introduites en 1991 : les variétés transgéniques n’étaient pas encore sur le marché, mais les obtenteurs les voyaient arriver assez vite et s’inquiétaient de telles situations.
Heureusement, il est possible d’obtenir des COV européens qui, eux, intègrent la notion de « variété essentiellement dérivée » et qui peuvent permettre de lutter sur le territoire français contre l’exploitation par un breveté d’une variété essentiellement dérivée qui n’a de différent que le transgène.
M. le Président : La directive européenne s’impose donc puisque la plupart des demandes de COV sont déposées au niveau européen.
M. Jean-Claude GUILLON : Je m’occupe de la stratégie et de la communication de Limagrain, et j’ai donc à la fois le point de vue d’un groupe coopératif agricole et d’un semencier de dimension internationale, qui doit s’inscrire dans une logique plus large.
Nous avons de la protection une vision simple : il faut protéger sans confisquer. C’est important en matière de vivant et de végétal, car on ne part pas de zéro pour créer une variété végétale : je suis généticien de formation, mais même si on me donne tous les éléments pour reproduire une variété à l’identique à partir d’un matériel génétique donné, je n’y parviendrai pas. On le voit, la reproductibilité de l’invention ne fonctionne pas dans le domaine des variétés végétales et c’est pour cela, parce que les critères de brevetabilité ne fonctionnaient pas, que le droit du COV a été institué.
Je souscris à ce qu’a dit Jean Donnenwirth sur la nécessité de ratifier au plus vite la convention UPOV de 1991. A l’heure actuelle, le système français est à double détente : quand vous voulez commercialiser une variété, il faut obtenir son homologation, procédure distincte de celle de protection. Même si quelqu’un prenait une variété, y introduisait un gène et tentait de se l’approprier, il ne pourrait obtenir l’homologation en France et cela serait sans doute source de contentieux.
L’introduction de l’exception du sélectionneur est un point très satisfaisant de la transposition de la directive 98/44/CE. Une démarche similaire est en cours en Allemagne. Et il faut en effet que cette « exception française » devienne une généralité européenne. C’est un enjeu important car la propriété intellectuelle est au cœur des négociations au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : un certain nombre de pays défendent l’idée d’une généralisation du brevet, tandis que d’autres, notamment l’Europe, souhaitent le maintien du COV. Or on a déjà vu des échanges un peu curieux lors des négociations OMC : il ne faudrait pas qu’on sacrifie le COV pour obtenir l’acceptation des indications géographiques protégées. La vigilance s’impose par conséquent.
M. Jean DONNENWIRTH : La protection doit être en phase avec la technologie. Quand on a introduit, en 1961, l’exception du sélectionneur, il fallait au moins dix ans de labeur hasardeux pour créer une nouvelle variété. Aujourd’hui, les nouveaux outils de marquage moléculaire permettent de réduire considérablement le temps nécessaire et de mieux prévoir le résultat. Mme Hiance a rappelé que les investissements, compte tenu de la concurrence et de la sophistication, sont de plus en plus lourds. Ce qui était bon pour les sélectionneurs il y a quarante ans ne l’est sans doute plus. C’est pourquoi nous pensons que le système de 1961, déjà modifié en 1991 en fonction d’une nouvelle technologie, devrait faire l’objet d’une réflexion, autour des propositions avancées lors de l’intéressant symposium organisé l’année dernière par la Fédération internationale des semences.
M. Jean-Claude GUILLON : Nous ne sommes pas contre l’évolution du droit en fonction des technologies. Nous vivons à la fois ce qui se passe en Europe et aux Etats-Unis, où les variétés sont brevetables. La différence est énorme : aux Etats-Unis, vous ne pouvez pas faire de sélection dans une variété brevetée commercialisée sans une autorisation expresse de l’obtenteur. En Europe, dès qu’une variété est commercialisée, n’importe quel sélectionneur peut chercher à en obtenir une autre, bien évidemment distincte et apportant quelque chose de nouveau. C’est bien ainsi, à partir de cette continuité, que s’est bâti le progrès génétique, pas en séquestrant une propriété pendant vingt ans.
S’il est évidemment nécessaire de rémunérer l’inventeur, il faut aussi, dans un certain nombre de circonstances, préserver l’accès aux variétés. A défaut, on créerait des situations de monopole de fait intolérables. Il faut donc que le législateur cherche un équilibre.
Il y a eu des dérives aux Etats-Unis, où on a le choix entre un brevet et un plant variety protection (une protection de variété végétale) car le brevet se développe, ce qui complique les choses et ne favorise guère la continuité de la création. En disant cela, je ne condamne pas le brevet, je dis simplement qu’il faut poser des garde-fous, comme vous l’avez fait avec la transposition de la directive 98/44/CE.
M. le Rapporteur : L’utilisation des brevets dans le domaine du vivant est coûteuse, incertaine et source de contentieux. Comment faire pour qu’elle ne constitue pas un frein au développement de la recherche ?
M. Jean-Claude GUILLON : La protection des inventions est un puissant outil de motivation à faire de la recherche. C’est la façon dont on la confère – en la bornant dans le temps et dans l’espace – qui peut entraîner des difficultés. Il faut donc des règles qui lui permettent de demeurer un outil de progrès.
M. le rapporteur : Ressentez-vous actuellement une volonté des Etats-Unis d’aller vers un système comme le COV ?
M. Jean DONNENWIRTH : Ils sont membres de l’UPOV…
En Europe, on a décidé que les variétés ne seraient pas brevetables et on retrouve cette interdiction dans la convention européenne du brevet, dans les lois nationales, dans la directive 98/44/CE et dans ses différentes transpositions. Les inventions biotechnologiques sont en revanche brevetables.
Aux Etats-Unis, il existe depuis 1930 une loi sur la protection des variétés, le Plant Patent Act, qui concernait, à l’origine, les arbres fruitiers et toutes les plantes à reproduction asexuée, à l’exception des pommes de terre en raison du passé irlandais. En 1970, a été adopté le Plant Variety Protection Act, qui est une forme de transposition de la convention UPOV de 1961, avec toutefois quelques accommodements, puisque les Etats-Unis n’étaient pas encore membres de l’UPOV, qu’ils ont rejointe dans les années 80. La convention a été révisée en 1991 et la loi américaine, adaptée en 1994, n’exclut pas les variétés du domaine de la brevetabilité : on peut avoir pour une variété un brevet, un COV ou les deux en même temps.
Telle est la situation, qui a été reconnue, en ce qui concerne le brevet, par une décision de la Cour suprême en 2001, dans une affaire qui opposait notre société, Pioneer, à un distributeur qui avait enfreint nos droits sur les brevets. Il contestait la validité de nos brevets sur nos variétés mais la Cour en a reconnu la validité.
M. le Rapporteur : Des brevets ont-ils été cédés à des pays du Tiers-Monde ? Dans ce cas, y en a-t-il eu beaucoup et quels OGM concernaient-ils ?
M. Jean-Claude GUILLON : Il y a dans les statuts de Génoplante une disposition visant à donner des licences gratuites aux agriculteurs relevant de l’agriculture vivrière, selon la définition qu’en donne la FAO49. Mais il faut tenir compte de la situation locale : s’il est normal de donner une licence gratuite à un agriculteur qui vit en autosubsistance, en revanche il n’y a aucune raison de le faire au profit de celui qui exploite 25 000 hectares…
M. Yves COCHET : Il y a des brevets pour lesquels on dépose, sous une forme scientifique ou technologique, exactement ce qu’on veut protéger, et puis il y a la réalité de la semence elle-même. Or nous avons vu, lors d’une audition précédente, que certaines plantes génétiquement modifiées étaient très instables, ce qui fait qu’au moment où l’on veut faire jouer la protection, la réalité biologique n’est plus vraiment celle qui avait été décrite dans le brevet. Peut-on vraiment protéger quelque chose qui n’est pas exactement ce qui est ensuite semé ?
Par ailleurs, un agriculteur biologique canadien s’est trouvé contaminé
– j’emploie le mot à dessein – par des plantes génétiquement modifiées et il a été attaqué par la société qui lui reprochait d’utiliser ses brevets… C’est le monde à l’envers ! Non contentes de vouloir régenter le droit des semences et vendre leurs semences à tous les agriculteurs, les grandes transnationales attaquent leurs victimes en justice. « Protéger sans confisquer », disait M. Jean-Claude Guillon, là c’est l’inverse…
M. le Rapporteur : Dans le cas que vous citez, qui est celui de Percy Schmeiser, quel a été le pourcentage de plantes contaminées ?
M. Yves COCHET : Peu importe ! Lui n’était même pas au courant, c’est parce que la société l’a attaqué qu’il a réagi.
M. le Président : Cette question ayant été évoquée lors d’une précédente audition, nous nous sommes intéressés aux attendus du jugement. Sans me prononcer sur le fond, lorsqu’on arrive à 95 % de contamination, on peut douter que celle-ci soit fortuite, et il pourrait plutôt s’agir d’un accaparement d’une plante génétiquement modifiée qui n’appartenait pas à cet agriculteur…
M. Yves COCHET : En dehors de ce cas précis, il y aura des milliers d’agriculteurs qui ne parviendront pas à protéger leur production bio contre des plantes transgéniques dont ils ne voulaient pas, et qui vont être attaqués pour détournement de brevet par les transnationales !
M. le Président : Pas en droit français ! J’ai posé la question au moment de la transposition de la directive : il faut qu’il y ait volonté de fraude pour qu’on soit condamné. On sort donc du cas de la contamination fortuite.
Mme Martine HIANCE : Il est vrai que ce cas était assez troublant. Nous y avons réfléchi car, lorsqu’il y a fabrication d’objets brevetés, la règle est, en effet, que la bonne foi n’exonère pas de la responsabilité : celui qui commet une contrefaçon par fabrication ne peut donc pas dire qu’il ignorait qu’il y avait un brevet. Mais on ne peut pas parler de mise en fabrication dans le cas d’une dissémination fortuite, et l’agriculteur en question ne saurait être considéré comme « l’auteur » de la contrefaçon.
M. le Président : Nous avons pu penser un moment que le droit canadien différait du nôtre. Cette affaire nous ayant paru emblématique, nous nous sommes procuré les minutes du procès. Elles seront adressées à chacun des membres de la mission, qui pourra se faire une opinion.
M. Jean-Claude GUILLON : C’est de variétés végétales qu’il est ici question. On l’a dit, elles doivent être distinctes, homogènes et stables. Introduire des éléments d’instabilité serait assez curieux, et je vois mal à quel cas M. Cochet faisait référence.
M. Yves COCHET : Je ne parlais pas des variétés, mais des plantes génétiquement modifiées, qui sont de plus en plus instables, ainsi qu’on nous l’a montré lors d’une autre audition. Où va-t-on si la plante semée n’est pas celle pour laquelle on a déposé un brevet ?
Mme Martine HIANCE : En droit des brevets, la description doit être suffisante ou du moins rédigée de façon à ce que, si l’on met en œuvre les moyens de l’invention, l’on obtienne le résultat annoncé. Dans l’hypothèse que vous avancez, le brevet pourrait être annulé pour description insuffisante.
M. Jean DONNENWIRTH : Les revendications du brevet s’appuient sur la description. En matière d’inventions biotechnologiques, comme il est souvent impossible de permettre la reproduction par une simple description écrite, on est amené à déposer un matériel végétal qui représente l’objet de l’invention. Il est clair que si ce qui est exploité n’est plus conforme à ce qui a été déposé, il y a un problème au regard du droit des brevets, qui conduirait à considérer soit que ce qui est exploité n’est plus protégé, soit que le brevet a été décerné sur la base d’une description erronée.
M. le Président : On rejoint le thème abordé tout à l’heure par le rapporteur : celui de la brevetabilité d’un gène pour une fonction. Au début de la brevetabilité du gène aux Etats-Unis, Craig Venter a séquencé des gènes et les a brevetés en tant que tels. Cela a provoqué un tollé au motif qu’il n’y avait pas de propriété inventive, mais seulement la description d’un matériel génétique préexistant et qu’on pourrait ainsi devenir propriétaire de toute la matière génétique de l’humanité. C’est pourquoi on a bien insisté sur l’idée « un gène, une fonction ».
Aujourd’hui, les méthodes de fabrication des plantes transgéniques ne sont pas aussi précises qu’on le dit. Dans une audition antérieure, on nous a décrit cinq points d’insertion différents sur le riz et on n’est absolument pas sûr qu’avec un même gène les propriétés seront les mêmes selon le point qu’on choisira. Dans les années 60, c’est l’idée de l’universalité du code génétique qui prédominait – si l’on avait un gène, on avait une protéine. Aujourd’hui, on s’est aperçu que ce n’est pas du tout cela, que la nature est bien plus compliquée et qu’il y a plusieurs fonctions pour un gène.
Pensez-vous, M. Donnenwirth, vous qui représentez une société américaine, qu’il suffit de breveter un gène pour une fonction pour avoir, au bout du compte, la propriété de toutes les fonctions qu’on pourrait ultérieurement découvrir ?
M. Jean DONNENWIRTH : En effet, le gène est inséré en des endroits différents, en une seule ou en plusieurs copies. Ensuite, on sélectionne parmi les différentes transformations celle qui semble la plus valable. C’est de cette transformation que découlent ensuite toutes les variétés transgéniques qui auront cette propriété. On ne met donc pas sur le marché toutes les transformations testées.
M. le Président : Vous faites une sélection, mais si quelqu’un insère à un autre endroit que vous, considérerez-vous que vous êtes propriétaire du résultat ?
M. Jean DONNENWIRTH : Si le résultat de la transformation avec le même transgène confère à la variété les mêmes propriétés, il n’y a pas de raison que cela échappe au droit de la propriété.
En revanche, si vous n’avez pas revendiqué les différentes fonctions du même gène et que quelqu’un d’autre les découvre, ce dernier pourra les breveter.
M. le Président : C’est une évolution intéressante de la position de la société Pioneer…
M. Jean DONNENWIRTH : Mais il peut y avoir une situation de dépendance à partir du moment où le gène aura été breveté en tant que tel.
M. le Président : En conclusion du débat sur ce premier point, je constate que l’on demande la révision de la directive de 1998, que nous avions mis beaucoup de temps à transcrire. Il faudrait aussi ratifier la convention de 1991, comme l’a souhaité M. Guillon, réfléchir à une harmonisation entre le droit des brevets et le droit des COV, garantir la liberté de la recherche
– on ne peut confisquer pendant 20 ans un certain nombre de critères et de caractères pour empêcher le développement de la connaissance. Enfin, sur l’idée « un gène, plusieurs fonctions », j’ai bien entendu la réponse que vient de faire M. Donnenwirth, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit vraiment celle de la firme qu’il représente.
M. le Président : Nous en venons maintenant au principe de précaution. Je donne la parole à M. Philippe Kourilsky, en sa qualité de coauteur, avec Mme Geneviève Viney, du rapport remis en 2000 au Premier ministre, sur ce sujet.
M. Philippe KOURILSKY : L’historique de ce rapport mérite que l’on s’y arrête. Fin 1997, le cabinet du Premier ministre m’ayant consulté à propos des OGM, j’avais répondu que le problème n’était pas celui des OGM mais celui du principe de précaution. J’avais alors été courtoisement éconduit. Il n’empêche qu’un an plus tard, Mme Viney, juriste, et moi-même avons été priés de rédiger un rapport consacré au principe de précaution, qui a été remis au Premier ministre de l’époque.
Nous avons en premier lieu tenu à expliciter la différence, capitale, entre précaution et prévention : si la prévention renvoie à un risque avéré, la précaution fait référence à un risque potentiel – c’est, pour paraphraser Edgar Morin, « le risque du risque ». Le principe de précaution doit être entendu comme principe d’action et non d’abstention. En d’autres termes, la règle ne doit pas être « Dans le doute, abstiens-toi » mais bien « Dans le doute, équipe-toi pour agir au mieux ».
Nous avons ensuite tenté d’interpréter les raisons du succès fulgurant de cette notion. Que traduit-elle ? Si l’attente sociale est si forte en ce domaine, c’est par réaction à la faillite de la prévention, mais aussi à la dilution des responsabilités dans la gestion des systèmes complexes, dont l’affaire du sang contaminé a donné un exemple. Mais c’est encore l’expression d’un désir accru de participation des citoyens à la prise de décision. Elle reflète également le débat sur la conception de la nature, tel qu’il s’est manifesté à propos des farines animales. Il s’est dit, alors, qu’il n’était « pas naturel » d’alimenter ainsi des herbivores. Mais aurait-on constaté pareille réaction si les farines animales avaient été bien préparées ? Il n’y a dans cette innovation rien de très différent des médicaments, lesquels n’ont vraiment rien de « naturel » non plus.
Comme l’ont souligné de nombreux auteurs, le principe de précaution doit être utilisé avec précaution, car il présente lui-même quelques risques, dont le premier est celui du glissement de sens. Certes, les acteurs sociaux expriment, légitimement, leurs opinions et leurs hypothèses, mais il importe de recadrer le débat pour revenir au réel, au moyen de données chiffrées et de statistiques, sans négliger les considérations économiques car l’étude du rapport coût/bénéfice est essentielle dans l’application du principe de précaution.
Les risques sont aussi d’ordre politique. Le premier est celui qui consisterait à gérer la perception du risque plutôt que le risque proprement dit. Si cette dimension politique du principe de précaution ne peut être négligée, elle ne peut prédominer. Le deuxième est le risque de surestimation du risque : s’il est considéré comme planétaire, certains se sentiront autorisés à appeler à transgresser la loi pour y faire face et l’on voit bien le risque d’atteinte à la démocratie qui peut s’ensuivre.
Un troisième risque tient à ce que le principe de précaution, s’il est appliqué de manière inadéquate par le système judiciaire, peut faire échec à la prévention. Il en est ainsi de la suspension, en 1998, de la recommandation de vaccination contre l’hépatite B en milieu scolaire : or le nombre des porteurs est passé en quelques années de 150 000 à 300 000, évolution qui inquiète fortement les autorités publiques. Dans ce cas, l’application du principe de précaution pourrait bien avoir nui à la prévention. Un tel exemple doit porter à s’interroger sur la manière dont s’organise la hiérarchie entre précaution et prévention, y compris dans les financements publics.
Il convient aussi de souligner le rôle des médias. Ainsi, toujours à propos de l’hépatite B, à chaque fois qu’un producteur de vaccin a été condamné, la presse s’est saisie de la question, un grand journal allant jusqu’à titrer : « Hépatite B : le vaccin condamné ». Comment, alors, s’étonner de la chute de la couverture vaccinale ? Ce qui est en cause ici, c’est l’incompréhension par l’opinion publique du principe de précaution et, plus largement, de celui de la responsabilité sans faute.
Le contexte étant ainsi décrit, notre ligne directrice a été la suivante : « en l’absence de certitude, la précaution consiste à privilégier la rigueur procédurale. » Autrement dit, il existe une incertitude dont on prend acte ; elle n’est acceptable que si les procédures d’analyse et de suivi du risque ont été suivies correctement, par l’application d’un dispositif accepté par tous, en fonction des connaissances scientifiques du moment. Si le contrôle du risque a été ainsi réalisé, l’application du principe de précaution n’est pas fautive.
De ces considérations découlent les « dix commandements de la précaution » qui figurent dans le rapport, et qui sont autant de principes procéduraux tendant à une démarche qualité, puisqu’il s’agit bel et bien de décortiquer les mécanismes de prise de décision pour les expliciter. Nous soulignons, en particulier, que « toute analyse de risque doit comporter une analyse économique qui doit déboucher sur une étude coût/bénéfice préalable à la prise de décision ». Prenons l’exemple du dépistage préalable à la transfusion. Selon un article paru il y a peu dans la littérature scientifique, il est désormais pratiqué par détection de l’ARN50 viral, technique dont le coût est évalué à 1,9 million de dollars par année de vie gagnée. Or, il est généralement admis que si la dépense est supérieure à 50 000 dollars, le rapport coût/efficacité n’est pas considéré comme favorable… S’agissant des OGM, le chiffrage du coût de l’étiquetage est une question peu abordée ; mais qui le paye, et au nom de quoi ? Je ne pense pas que le public soit conscient de ce volet du dossier.
A titre personnel, je suis très sensible à la question de la tolérance : tolérance à l’innovation, et donc tolérance, aussi, aux conséquences de la prise de risque qui lui est inhérente. Dans le même temps, je suis conscient que le monde scientifique n’est pas assez ouvert au dialogue préalable à l’innovation, qui garde de ce fait une dimension implicite occulte, si bien que la prise de décision, qui devrait être partagée, trop souvent ne l’est pas, ce qui réduit la tolérance au risque, pourtant essentielle, qu’il s’agisse des vaccins ou des OGM. Cette tolérance devrait valoir, aussi, en ce qui concerne notre attitude à l’égard des pays en développement, vers lesquels nous prétendons exporter nos normes éthiques, de manière, à mon sens, quelque peu abusive.
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : La notion de principe de précaution, apparue en droit international au cours des années 80, a été transcrite en 1992 dans le Traité de Maastricht et transposée en droit interne en 1995. L’article L. 110-1 du code de l'environnement dispose qu'en vertu de ce principe, « l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ». C’est de ce texte que s’inspire la Charte de l’environnement.
Le principe de précaution, ainsi reconnu au niveau national pour ce qui touche à l’environnement, inspire la jurisprudence pour des domaines plus larges, qu’il s’agisse de la protection de la santé publique ou de la sécurité du consommateur. Si la jurisprudence du Conseil d’Etat ne traite pas le principe de précaution de manière autonome, son respect est fréquemment évoqué dans le cadre de recours, et il influence les modes traditionnels de contrôle. Ainsi, l’application du principe de précaution est prise en compte pour juger que l’administration n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en retirant telle ou telle autorisation. Le Conseil d’Etat n’exige pas que le risque pour la santé publique soit avéré : il suffit que des indices suffisamment concordants militent en faveur de ce risque.
De même, l’effet de la prise en compte du risque potentiel explique la rigueur particulière avec laquelle le respect des procédures d’autorisation en matière d’environnement, de santé publique et de protection du consommateur est vérifié par le Conseil d’Etat. Enfin, la jurisprudence de celui-ci a élargi la notion d’erreur de droit en sanctionnant pour cela les décisions qui n’auraient pas pris en compte l’évaluation de tous les risques dont la juridiction estime qu’ils auraient dû l’être. Ce fut notamment le cas dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir à propos de l’anti-parasitaire Gaucho.
Il n’y a pas, à ce jour, d’application du principe de précaution dans le domaine de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat.
M. le Président : En votre qualité de juriste membre de la Commission du génie biomoléculaire, estimez-vous, Mme Ravail-Dely, que lorsque le principe de précaution sera inscrit dans la Constitution, il faudra le faire jouer pour les OGM ?
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : L’avis général de la CGB rejoint celui qu’a exprimé M. Kourilsky, et selon lequel le principe de précaution doit s’apprécier par le respect des procédures. C’est ainsi qu’il est mis en œuvre par la jurisprudence, notamment communautaire : on examine si les avis scientifiques portés à la connaissance du pouvoir politique sont suffisants et, si celui-ci estime qu’un doute existe, l’application du principe de précaution entraîne la décision de retrait de l’Autorisation de mise sur le marché (AMM).
Cette procédure a été suivie tant pour les médicaments au niveau communautaire que pour l’anti-parasitaire Gaucho au niveau national. Aussi, que le principe de précaution soit inscrit dans la Constitution française ne changerait rien puisque, d’une part, le tribunal de première instance des Communautés européennes considère déjà qu’il s’agit d’un grand principe européen et que, d’autre part, on peut déjà faire valoir que le principe de précaution n’a pas été respecté si les procédures d’évaluation du risque n’ont pas été suivies – par exemple, si la CGB n’a pas eu connaissance de certaines informations ou si de nouvelles données scientifiques établissent la dangerosité d’un OGM ou d’une plante génétiquement modifiée (PGM). On notera que le contentieux communautaire s’est attaché à distinguer le risque sérieux des autres.
M. Yves COCHET : Je ne me risquerai pas à traiter de la différence, d’ordre philosophique, entre ce qui est « naturel » et ce qui ne l’est pas. Sur un autre plan, M. Kourilsky s’est dit favorable à la mesure du rapport coût/bénéfice pour la précaution comme pour la prévention ; encore faudrait-il que le risque soit descriptible et objectivement probabilisable. Or, pour les PGM et les OGM, ce risque relève de l’inconnu scientifique, de cette incertitude que l’on espère voir levée par la recherche. Dans un tout autre domaine, celui du nucléaire, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a établi une échelle du risque, qui comporte sept niveaux. L’accident de Tchernobyl figure au niveau le plus élevé de cette échelle – et il s’est produit. En calculant l’« espérance mathématique » d’une probabilité d’occurrence, on peut obtenir le coût d’un dommage éventuel. Le problème est que, lorsque le coût est fort et la probabilité très faible, le résultat mathématique est très instable. La même chose vaut pour le changement climatique. L’économiste John Maynard Keynes tenait donc, à juste titre, à ce que l’on distingue l’incertitude – ce qu’on ne sait pas, mais qu’on peut parfois mesurer – de l’aléa
– ce qui est intrinsèquement incertain. Or, pour ce qui concerne les OGM, on ne sait, pour le moment, absolument pas décrire les risques environnementaux et sanitaires : il n’y a donc pas d’échelle de risque possible. De ce fait, le principe de précaution s’impose.
Je tiens d’autre part à souligner que, par un subtil changement lexical, la transposition de la notion de principe de précaution a considérablement restreint le champ d’application de ce principe dans le droit français. En effet, la Déclaration de Rio de 1992, signée par la France, et qui fonde la transposition, évoque un « risque grave ou irréversible », tandis que la loi Barnier parle, elle, de « risque grave et irréversible », tout comme le projet de charte de l’environnement. Il en résulte qu’aussi bien Mme Roselyne Bachelot que M. Dominique Perben et M. Serge Lepeltier, successivement interrogés, se sont trouvés incapables de citer un seul cas d’application possible de cette version « faiblarde » de la Déclaration de Rio… Si nous nous dotons d’un très beau principe constitutionnel nouveau mais que, faute de spectre, il est totalement inapplicable, nous pouvons aussi bien deviser du sexe des anges !
Est-ce que le principe de précaution est ou aurait dû être applicable à l’amiante ? Aux éthers de glycol ? Aux OGM ? Aux PGM ? Au nucléaire ? Au Régent ? Au sujet du Régent, il est proprement stupéfiant, au regard du principe de précaution, que l’actuel ministre des finances, dans ses anciennes fonctions de ministre de l’agriculture, ait pu interdire les pulvérisations mais permettre l’écoulement des stocks.
M. le Président : Je serais reconnaissant aux orateurs de limiter leurs interventions à la question des OGM qui nous occupe aujourd’hui. Je tiens toutefois à souligner que le cas de l’amiante et des éthers de glycol est différent de celui des PGM car on a soupçonné, très vite pour l’amiante, assez vite pour les éthers de glycol, que des dommages étaient possibles. Le principe de précaution, s’il avait été celui dont nous parlons aujourd’hui, aurait donc dû s’appliquer. Pour ce qui est des PGM, aucun des scientifiques que nous avons entendus à ce jour ne nous a dit que les contaminations fortuites auraient, pour l’instant, causé des dommages sanitaires. Nous sommes donc dans le « risque du risque » à propos d’une technique agricole nouvelle, dont nous nous demandons s’il y a lieu de lui appliquer le principe de précaution et, s’il lui était appliqué, s’il ne se transformerait pas en « principe d’inaction ». On pourrait formuler la question autrement : dois-je, parce que je n’en ai jamais mangé, ne jamais goûter un kiwi ?
M. Yves COCHET : La comparaison ne vaut pas, car même si vous n’en avez jamais mangé, d’autres en ont mangé avant vous.
M. le Président : Mais les réactions allergiques individuelles sont très différentes selon les populations concernées. Faut-il, donc, s’en tenir au statu quo ?
M. Alain MONOD : En ma qualité d’avocat au Conseil d’Etat, j’ai eu l’occasion d’évoquer le principe de précaution dans différents contentieux. Mais je suis par ailleurs maire d’une petite commune, et je souhaiterais, à ce titre, traiter du niveau de décision pertinent en matière d’autorisations d’expérimentations transgéniques.
Je partage le point de vue exprimé par M. Philippe Kourilsky, selon lequel « en l’absence de certitude, la précaution consiste à privilégier la rigueur procédurale », démarche qui revient à exiger la mise en œuvre des procédures existantes. Bien que, s’agissant des OGM, le Conseil d’Etat, en s’abritant derrière les décisions communautaires, n’ait, à ma connaissance, jamais statué sur le fond, il a fait mention du principe de précaution dans les considérants de la décision qu’il a rendue 1er octobre 2001 à la requête de Greenpeace. Je rappelle que cette requête avait été introduite après que le Gouvernement eut refusé de détruire des cultures de maïs issues de semences traditionnelles, cultures parmi lesquelles les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient décelé des traces de maïs transgénique. Le Conseil d’Etat a considéré que les autorisations de mise sur le marché étaient acquises au niveau communautaire et a relevé que « les associations requérantes n’invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause, au regard du principe de précaution, la validité de la décision favorable de la Commission ou la légalité de l’AMM, et ne font état d’aucun élément scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la décision attaquée et serait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les autorités communautaires et nationales sur les risques liés à ces variétés. »
S’agissant du principe de précaution, à chaque fois qu’il a statué, c’est toujours la méconnaissance de la procédure que le Conseil d’Etat a sanctionnée. Il l’a fait par deux fois à propos du Gaucho, soit que le ministère de l’agriculture n’ait pas pris en compte des éléments figurant au dossier, soit qu’il n’ait tout simplement pas respecté la procédure. L’administration doit être particulièrement vigilante sur ce point.
Il serait aussi utile que, lorsqu’elle dispose d’éléments de nature à justifier ses décisions, elle les verse au débat, ce qui n’est pas toujours le cas. De ce fait, la motivation des décisions demeure quelque peu obscure tant pour les juges que pour les citoyens, qui ont, comme l’a souligné M. Kourilsky à juste titre, d’autant plus de mal à trancher.
J’en viens au niveau pertinent de décision relatif aux expérimentations de ce que le code de l’environnement qualifie de « dissémination volontaire ». Alors que les AMM se font au niveau communautaire, les autorisations d’expérimentations sont délivrées au niveau national. Et lorsque le ministère de l’agriculture donne une autorisation, des boucliers se lèvent de toutes parts. Dans ces conditions, qui doit prendre la décision d’autorisation ou d’interdiction ? On voit des maires prendre des initiatives d’interdiction, et l’on sait que la quasi-totalité des conseils régionaux se sont déclarés hostiles à ces expérimentations. Il y a là une dérive qui doit inciter à la réflexion. En tout cas, le niveau pertinent de l’évaluation du risque n’est pas celui des maires. Mais les malheureux élus subissent de très fortes pressions de l’opinion, ce qui les amène à prendre des arrêtés de police évidemment nuls, en l’état actuel du droit. A l’inverse, certains maires, cherchant le moyen de développer l’activité locale, pourraient être intéressés par des expérimentations sur le territoire communal. Le niveau pertinent de l’évaluation du risque me paraît donc bien être le niveau national, sans oublier toutefois la dimension communautaire.
Mais, dans tous les cas, il faut améliorer l’information de la population sur ces expérimentations, car tout manquement en ce domaine, outre qu’il suscite des peurs, éloigne la communauté scientifique de l’opinion publique, qui devrait être son soutien.
M. Philippe KOURILSKY : Puis-je rappeler à M. Cochet que le pire n’est pas toujours sûr ? Ainsi, contrairement à ce que l’on a cru à l’époque, le fait de traverser des tunnels en train n’a pas eu d’incidence sanitaire connue. De même, la construction des réseaux d’égouts a fait beaucoup plus de bien qu’elle n’a créé de problèmes de santé.
Pour ce qui est de l’amiante, il y a eu deux phases : de précaution d’abord, de prévention ensuite. Et si, comme j’en ai la conviction, la phase de prévention n’a pas été correctement suivie, on sort du cadre de la discussion sur le principe de précaution.
Ensuite, ce n’est pas parce que l’on n’a pas trouvé de risque à une activité humaine que la situation est grave et que l’on va forcément en découvrir de sérieux ! Et, s’agissant des OGM, je ne vois pas la trace d’un epsilon de début de risque sanitaire. Par contre, pour ce qui est du risque environnemental, c’est autre chose.
M. Cochet a insisté, à juste titre, sur le problème capital de la probabilité. C’est une notion très difficile à manipuler car, le nombre de paramètres pris en compte dans la recherche de risque ne cessant de croître, il vient un moment où l’échantillon ne permet plus de construire une corrélation significative. La science ne répondra donc jamais en totalité à la dimension « risque ».
Enfin, je tiens la précaution pour une valeur – au même titre, par exemple, que la fraternité proclamée sur les frontons des bâtiments de la République – et non pour un principe. La précaution, entendue correctement comme étant le partage de l’environnement dans le temps, est un apport fondamental à la conscience collective, mais prétendre lui donner une traduction juridique me semble bien difficile.
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : Je partage ce point de vue. C’est d’ailleurs pourquoi le principe de précaution ne se traduit que par une « atmosphère contentieuse » et non par une prise en compte autonome. S’agissant des « arrêtés OGM », les cours administratives d’appel, et particulièrement celle de Bordeaux, ont jugé les maires incompétents pour prendre de tels arrêtés, dans la ligne de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat. Je ne crois pas que l’inscription du principe de précaution dans la Constitution mettra fin au débat ou qu’elle ajoutera une obligation à celles qui résultent des procédures d’autorisation en vigueur, lesquelles en permettent l’application. L’affaire du Régent en est un exemple : si ce produit a été interdit, c’est qu’il n’a pas été établi qu’il était dénué d’un risque acceptable pour certaines populations d’insectes. Et si, corrélativement à cette interdiction, l’écoulement des stocks a été jugé acceptable, c’est par application du principe d’équilibre inhérent au principe de précaution, et compte tenu de la nature du risque potentiel.
M. Yves COCHET : Curieux raisonnement !
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : Les dispositions particulières me semblent être parmi les dispositions d’application du principe général de précaution, qui peut trouver à s’appliquer directement de manière subsidiaire dans des domaines que nous ne connaîtrions pas et qui ne donneraient lieu à aucune procédure.
M. Jean-Claude GUILLON : L’intérêt d’avoir autorisé l’écoulement des stocks est évident, puisque cela a permis des vérifications sur le terrain. Et qu’a-t-on constaté ? Un taux de mortalité de 0,64 % dans les ruches françaises, taux lui-même dû, pour 80 %, à de mauvaises pratiques apicoles ! Le résultat obtenu est édifiant : les produits phytosanitaires ne sont pas en cause. Mais là où le bât blesse, c’est que la suspension n’est pas levée pour autant. On voit là un effet pervers du principe de précaution.
M. Yves COCHET : A l’avenir, le Conseil constitutionnel pourra être saisi par des associations ou par des particuliers de l’application du principe de précaution. Si l’on considère la précaution comme une « ambiance » ou comme une « valeur » sans force juridique, comment pourra-t-il juger quoi que ce soit ?
M. le Président : C’est bien pourquoi certains d’entre nous, très favorables à l’inscription de la Charte de l’environnement dans la Constitution, considèrent qu’une loi est nécessaire pour définir la notion de « principe de précaution » qui figure à l’article 5. Ne pas l’expliciter revient à laisser aux juges constitutionnels le soin de le faire. Mais on ne va pas faire jouer le principe de précaution s’il n’existe aucune probabilité de dommages
M. Yves COCHET : Donc, le principe de précaution ne s’applique pas aux OGM ?
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : A mon sens, si, bien entendu…
M. Yves COCHET : Ah ! Très bien !
Mme Marie-Françoise GUILHEMSANS : La procédure d’autorisation des OGM en vigueur prend en compte le principe de précaution de la manière suivante : en l’état des connaissances scientifiques à un moment donné, pense-t-on être dans la situation où, en raison du principe de précaution, on doit ne pas accorder une autorisation, ou pense-t-on, au contraire, pouvoir l’accorder ? Autrement dit, dans le cadre des procédures existantes, on prend en compte le principe de précaution, parmi d’autres.
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Oui, le principe de précaution est appliqué aux OGM. La jurisprudence communautaire le dit précisément, en établissant que le principe de précaution s’applique lorsque les autorités publiques politiques se réfèrent à des expertises scientifiques. Pour les OGM, cette expertise scientifique est le fait de la CGB, et je ne peux laisser dire qu’il n’y aurait pas eu évaluation des risques.
M. Yves COCHET : La CGB a-t-elle déjà exprimé un avis défavorable à l’autorisation ?
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Il est arrivé que la CGB demande des compléments d’information, et elle les a toujours eus.
M. Yves COCHET : Mais il n’arrive jamais qu’elle exprime un avis défavorable. De fait, à ce jour, le principe de précaution tient plus d’« ambiance » que d’autre chose.
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : L’avis des scientifiques ne doit pas empêcher le politique de se prononcer, y compris en sens contraire ! Mais si le principe de précaution est inscrit dans la Constitution, il doit être défini, afin que l’accord se fasse sur ce dont on parle et que l’on sache précisément par quelle procédure il se traduit, puisque le respect de cette procédure est le seul élément dont les juges disposeront pour apprécier si le principe de précaution est respecté.
M. Jean-Claude GUILLON : Je tiens à souligner que les industriels sont des professionnels qui s’attachent à présenter à la CGB des dossiers bien construits.
M. Yves COCHET : Il n’empêche que la commission est parfois amenée à leur demander des compléments d’information.
M. Jean-Claude GUILLON : Cela peut se produire mais, en ce cas, les précisions demandées sont toujours apportées. Le dépôt des dossiers relève d’une démarche scientifique responsable : l’industrie a procédé à des évaluations avant de soumettre ses dossiers à la CGB, qu’elle ne considère pas comme une chambre d’enregistrement.
M. le Président : En résumé, comme l’a dit M. Kourilsky, il convient de compenser l’incertitude qui, par définition, entoure l’innovation, au prix de la rigueur procédurale. S’agissant de l’alimentation, on voit bien l’évolution intervenue depuis l’époque où l’on allait chercher ses produits frais, « naturels », à la ferme… A présent, les aliments, recomposés, constituent une somme de produits et il est clair que nous prenons des risques nouveaux à chaque fois que nous modifions nos habitudes. Faut-il, pour autant, tout arrêter au motif que les études manquent
– encore qu’il existe des cohortes gigantesques d’expérimentateurs : tous ceux qui consomment des OGM dans d’autres pays, et les vacanciers finalement… ?
M. Yves COCHET : Et si les effets ne se font sentir que dans trois générations ? C’est le syndrome du sang contaminé !
M. le Président : On peut se faire peur…. On peut aussi proposer un nouveau système d’évaluation du risque si l’on estime que celui qui existe est mauvais, puisque, une fois que l’évaluation a eu lieu, le principe de précaution a joué. Un débat contradictoire aura lieu à ce sujet le 9 février.
M. le Président : Nous en venons à l’assurance et à la responsabilité. Le sujet est d’une grande importance : en effet, beaucoup de nos collègues expliquent qu’il ne faut pas produire d’OGM puisque les compagnies d’assurance ne les assurent pas.
M. Yves COCHET : C’est qu’elles appliquent, elles, le principe de précaution !
M. Claude DELPOUX : Le principe de précaution est une question de procédure : si la procédure a été respectée, l’OGM est autorisé. Ensuite joue la probabilité de dommages, et l’on passe alors à la recherche de responsabilité. Or, de quel arsenal juridique disposons-nous, sinon des règles de responsabilité qui s’appliquent au risque ? Personne, à ce jour, n’a dit que, dans le cadre du « risque du risque », de nouvelles règles se substitueraient aux règles anciennes et que l’on passerait du régime de la responsabilité à celui de la faute. Le principe de précaution correspond à un risque de responsabilité civile pesant sur des individus qui sont impuissants, puisque l’AMM a été donnée. Dans ces conditions, comment une compagnie pourrait-elle assurer un risque non quantifiable et imprévisible ? C’est impossible. A ce jour, alors qu’aucune étude ne montre un seul risque pour la santé humaine, on nous dit : « Assurez, cela nous rassurera » ! Ce n’est ni possible ni sérieux.
S’agissant des OGM, on distingue quatre risques : le risque pour l’écosystème avec le problème de l’incidence sur la biodiversité ; le risque de dissémination par pollinisation, qui est incontrôlable et dont on ne connaît pas les effets ; le risque pour la santé humaine, sur lequel je ne reviendrai pas ; la difficulté de garantir une stricte ségrégation entre cultures OGM et autres cultures, ce qui est impossible en cas d’expérimentations en plein champ ; le risque, enfin, que par réaction passionnelle, on en vienne à interdire les PGM à la vente, ce qui causerait des préjudices immatériels considérables par pertes d’exploitation.
En résumé, les incertitudes sont considérables, les conséquences hypothétiques rigoureusement non quantifiables, et l’environnement juridique de la responsabilité inadapté. La réponse unanime des assureurs est donc : « Non, on ne peut pas couvrir ».
M. Yves COCHET : Voilà une démonstration très satisfaisante !
M. Guillaume ROSENWALD : Une partie des risques qui viennent d’être évoqués peut concerner d’autres cultures que celles des PGM – en particulier le risque environnemental – mais l’on constate que la sensibilité sociale est plus forte lorsqu’il s’agit d’organismes transgéniques.
Nulle part, sur le marché mondial, on ne trouve d’exemple d’assurance de l’un des risques dont M. Delpoux a dressé la liste. Il n’y a pas, à ce jour, de demande d’assurance pour « le risque du risque », puisque là où elles sont commercialisées, les PGM sont autorisées. En revanche, une demande commence d’apparaître au sujet du risque de dissémination. Elle émane des agriculteurs traditionnels ou biologiques, qui souhaitent pouvoir se prévaloir, sans risque juridique, du fait que leurs productions sont exemptes d’OGM. A l’inverse, certains agriculteurs dont les champs sont plantés en PGM craignent des poursuites de la part de leurs voisins. Ils veulent donc se couvrir et, pour cela, savoir où s’arrête leur responsabilité… question à laquelle les assureurs sont incapables de répondre. Peut-être pourrait-on imaginer une obligation de moyens ? Il restera à définir où s’arrête la responsabilité et où commence la force majeure. Et comme il ne saurait être question de placer toutes les productions de PGM sous bulle, l’acceptation d’un certain degré de dissémination, réglementairement quantifié, est nécessaire.
M. Jean-Claude GUILLON : Un débat à ce sujet a eu lieu au sein de la coopération agricole française. Nous considérons que toute variété homologuée par le ministère de l’agriculture est cultivable de plein droit, à condition que le cahier des charges associé à l’autorisation – distances d’isolement, nombre de rangs de bordure – soit respecté. Si une variété homologuée ne peut être cultivée, l’homologation, qui résulte elle-même de l’évaluation du risque, n’a aucun sens. Et, à partir du moment où une variété est homologuée, il y a assurabilité, puisque l’on ne se trouve pas en situation de risque mais d’information : si le seuil autorisé est dépassé, on étiquette pour informer le consommateur. Quant à l’éventuel différentiel de valeurs, il est quantifiable, tout comme la probabilité qu’il advienne. Mais comment pourrait-on assurer un risque s’il n’est pas identifié ?
M. Jean DONNENWIRTH : J’ai interrogé un juriste américain sur la situation aux Etats-Unis dans l’hypothèse de l’assurance contre le risque de pollinisation d’un champ sans OGM par un champ planté en PGM. Selon lui, en l’absence d’une clause d’exclusion particulière précisée dans le contrat de l’agriculteur, l’assurance joue. Des compagnies d’assurance ayant souhaité introduire de telles clauses dans les contrats ou faire payer une prime supplémentaire pour assurer ce risque, des négociations ont été engagées entre les assureurs américains et les associations d’agriculteurs, mais elles n’ont guère progressé.
M. le Président : Comme chacun le sait, le seuil de 0,9 % qui a été fixé correspond à un compromis politique. Il ne signale pas une toxicité.
M. Yves COCHET : Mais s’applique-t-il aussi aux médicaments génétiquement modifiés expérimentés en plein champ ?
M. le Président : C’est un sujet à part que celui des médicaments génétiquement modifiés, et nous l’aborderons ultérieurement. Si un seuil – de compromis, je le répète – a été fixé, c’est parce que le consommateur a le droit d’être informé et de choisir ce qu’il achète. Pour ce qui est de la coexistence des filières, il faudra définir des règles claires. L’agriculture biologique européenne a dit – sans débat – : « Nous ne voulons aucun OGM ». A présent, certains agriculteurs admettent l’idée d’un seuil, mais il varie…Si rien n’est fait, on s’achemine vers une multiplication infinie de procédures. C’est d’ailleurs ce que souhaitent certains, car cela participe d’un système de surchauffe entretenue. Il faudra donc fixer précisément les seuils qui permettent la coexistence des filières, après quoi, je pense qu’il y aura possibilité d’assurance.
M. Jean-Claude GUILLON : Les études scientifiques montrent que le seuil de 0,9 % est déjà très difficile à tenir. Si l’on s’acheminait vers le seuil de 0,1 % souhaité par certains, la production deviendrait économiquement non-viable, étant donné le nombre de rangs d’isolement qui seraient alors nécessaires. Cela irait à l’encontre de l’objectif de coexistence des filières.
M. Claude DELPOUX : Il est exact qu’à partir du moment où des seuils de tolérance sont définis et opposables, certains risques deviennent assurables, puisqu’ils sont quantifiables. Mais qu’une PGM homologuée soit cultivable de plein droit ne change rien à la question de la responsabilité, puisque l’Etat fait assumer le risque par ceux auxquels il donne les autorisations.
M. le Président : Existe-t-il d’autres secteurs que les assurances ne couvrent pas ?
M. Claude DELPOUX : En matière de responsabilité civile, nous n’assurons rien de ce qui a trait au risque de développement. S’agissant des contrats, la tendance est effectivement à l’exclusion, rachetable après négociation. Mais, en France, nous n’en sommes pas là, car des préalables techniques et juridiques doivent être levés : les seuils de tolérance, précisément. Avant toute négociation en vue du rachat d’exclusions, nous devons être certains qu’une production contenant un peu d’OGM ne sera pas subitement estimée dangereuse au titre du principe de précaution et, pour cela, retirée du marché.
M. Jean-Claude GUILLON : Si l’on définit le préjudice subi en cas de franchissement involontaire d’un seuil, le risque devient quantifiable.
M. Jean DONNENWIRTH : La coexistence des filières est possible si le seuil de tolérance est fixé à 0,9 %. Notre inquiétude tient à ce que les agriculteurs biologiques et certains autres veulent s’imposer des normes draconiennes, avec un seuil de tolérance infinitésimal. Si l’on en arrivait là, les distances d’isolement devraient être telles que les cultures en PGM deviendraient impossibles. Une minorité, parce qu’elle souhaite s’imposer une norme d’une particulière sévérité, créerait donc, de fait, une situation ingérable pour tous.
M. Philippe KOURILSKY : Aucune rationalisation ne sera possible aussi longtemps que l’on n’aura pas évacué la question de la dangerosité, qui est un faux problème au niveau alimentaire. On parle de seuil de tolérance en matière d’OGM comme on le fait habituellement à propos des médicaments, alors que la question est d’ordre culturel : manger ou ne pas manger des OGM, c’est comme manger ou ne pas manger casher. Les bouchers casher s’assurent-ils contre le risque de se faire livrer de la viande non casher ? Je ne le crois pas.
M. Guillaume ROSENWALD : Si un seuil général est fixé de manière réglementaire, on peut considérer que, s’il est dépassé, il entraîne un préjudice économique. Par ailleurs, chacun peut décider de fixer un seuil plus bas pour ses propres productions, et il reviendra alors au juge d’apprécier s’il y a préjudice. Et s’il estime qu’il y a préjudice dans ce cas, il lui faudra encore déterminer s’il y a responsabilité de fait ou si elle dépend d’une faute de gestion, et aussi si le respect du cahier des charges exonère de responsabilité. Dans cette hypothèse, l’agriculteur dont le champ a subi une dissémination pourra se retourner contre le « disséminateur » si ce dernier a commis une faute, et faire jouer son assurance dommage – qui le prendra en charge – si ce n’est pas le cas. Encore faut-il placer le curseur – c’est-à-dire le seuil de tolérance – à un niveau économiquement réaliste, sachant que si la responsabilité pèse trop systématiquement sur les producteurs d’OGM, ils redeviendront inassurables en cas de fortes tempêtes, qui sont des facteurs de dommages colossaux.
M. Jean-Claude GUILLON : Les catastrophes naturelles sortant par définition de la norme, on ne peut traiter le cas général en fonction de ces événements rares. Il faudrait situer le débat dans le cadre des recommandations communautaires, dont l’une tend à la création de dispositifs permettant d’éviter les fuites de flux indésirables de pollen. Dans son rapport, M. Martial Saddier soulignait que le seuil de 0,9 % s’appliquait à l’agriculture biologique comme à toute autre agriculture. Sur ces bases, la question doit être : quel cahier des charges réaliste au regard de l’économie de la filière établir pour que les probabilités de flux indésirables soient aussi minimes que possible ? Quant à l’agriculteur qui décide un seuil de tolérance à 0,1 % pour ses productions, il institue de fait une totale incompatibilité entre les deux modes de culture. C’est une démarche d’exclusion, et non de coexistence !
M. Claude DELPOUX : Tout dépend de qui était le premier occupant ! Les choses ne sont pas aussi simples, car les premiers installés, s’ils subissent des nuisances, ont droit à réparation. Certes, il existe un seuil de tolérance, mais si quelqu’un s’en est fixé un autre, plus bas, et qu’il constate que ses productions subissent une dissémination telle que ce seuil est dépassé tout en étant inférieur au seuil légal, il faut en connaître la cause – dysfonctionnement de l’exploitation en PGM de son voisin, dont celui-ci est responsable, ou cas de force majeure, ce qui l’exonère de responsabilité. Tout cela doit être défini en amont plutôt que réglé devant les tribunaux.
M. Jean-Claude GUILLON : Je suis d’accord sur la nécessité d’une définition préalable, mais aucunement sur le reste de l’argumentation. Si un agriculteur biologique choisit pour ses productions un seuil inférieur au seuil légal pour en tirer un bénéfice en termes de marketing, c’est à lui de faire ce qu’il faut pour s’en tenir aux seuils qu’il choisit. Quant à celui qui cultive en respectant les règles pour être en dessous de 0,9 % d’OGM, il ne peut créer de préjudice, puisque c’est le seuil légal !
M. Claude DELPOUX : Si vous me prouvez que la justice ne considérera pas que l’agriculteur « non-OGM » a subi un préjudice, d’accord ! Autant dire que tout cela doit être cadré dans la loi.
M. le Président : Il ressort de ce débat que, d’évidence, si les règles ne sont pas claires, les contentieux seront innombrables. Des lignes directrices doivent donc être définies : lesquelles ?
Nous avons fixé, par compromis politique européen, un seuil de tolérance de 0,9 % qui ne correspond aucunement à un seuil de dangerosité. Ce seuil doit être le même pour tous, car si des PGM sont autorisées, c’est qu’elles ne sont pas dangereuses. Il n’y a donc aucune raison d’autoriser des seuils différents pour les PGM d’une part, pour les autres plantes « extérieures » d’autre part. Les différents seuils de tolérance relatifs à l’agriculture biologique doivent être harmonisés. S’agissant des produits extraits d’une PGM et qui doivent être étiquetés en tant que tels, même s’ils ne comportent plus aucune trace de cet ADN, la législation européenne doit être précisée, car on est là dans le domaine de l’irrationnel. Aujourd’hui, les seuils sont différents selon qu’il s’agit d’AMM – de compétence communautaire – ou d’expérimentations – de compétence nationale. Que se passe-il si, au cours des expérimentations, des OGM contaminent des productions de l’agriculture biologique ? Une clarification est nécessaire en termes d’assurabilité pour permettre la coexistence des filières. A cet égard, l’évolution de la législation allemande – qui a conduit à instaurer un régime de responsabilité sans faute pour les personnes susceptibles d’avoir contaminé des champs parce qu’elles cultivent des OGM dans le périmètre de production d’une agriculture biologique – ne me paraît pas l’exemple à suivre, car c’est faire le lit d’un contentieux considérable.
M. Claude DELPOUX : Et dans ce cas, la contamination est inassurable !
M. le Président : Aussi serait-il très intéressant de connaître la réaction des assureurs allemands à cette évolution.
M. Alain MONOD : Au cas où un dommage apparaîtrait qui ne résulterait ni d’une faute du titulaire de l’autorisation ni de la force majeure, je me demande si la responsabilité de l’Etat ne pourrait pas être mise en cause, au motif que le risque n’aurait pas été correctement évalué au moment de l’instruction de la demande d’AMM par l’administration.
M. le Président : La question s’est en effet déjà posée, notamment pour ce qui est des effondrements miniers.
M. Claude DELPOUX : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le vice étant interne à la chose produite et mise sur le marché, le producteur est responsable, même en cas de risque de développement – ce fut dit, en particulier, en 1995, à propos du sang contaminé. Mais le problème de fond est en effet très important car l’Etat, s’il est mis en cause, ne manquera pas d’expliquer avoir respecté toutes les procédures et n’être donc pas fautif. Pourtant, si un risque de développement finit par advenir, tout ne doit pas être mis à la charge du producteur. Or, à l’heure actuelle, ce qui, en matière de responsabilité, relève de la puissance publique et de l’opérateur privé n’est pas réglé.
M. Jean DONNENWIRTH : J’approuve sans réserve la remarque du Président Jean-Yves Le Déaut selon laquelle des normes et de seuils ayant été définis, il n’y a aucune raison de traiter différemment les OGM. Cela doit valoir notamment pour ce qui est de la pureté variétale car, depuis de nombreuses années les semenciers doivent faire face à la difficile question de la présence fortuite de semences OGM dans des semences conventionnelles. Depuis cinq ans, nous demandons instamment aux autorités européennes de fixer des normes à ce sujet, mais rien n’est fait, si bien que nous sommes ballottés au gré des contrôles, ce qui est source de graves difficultés.
M. le Président : Je vous remercie tous de votre participation à cette intéressante table ronde, qui nous aura permis d’enrichir notre réflexion sur la transposition de la directive 2001/18/CE et qui a aussi ouvert la voie à une réflexion européenne plus générale, notamment en matière d’assurabilité.
Table ronde contradictoire sur le thème
« Les enjeux sanitaires des OGM »
(extrait du procès-verbal de la séance du 2 février 2005)
• Ministère de l’agriculture représenté par Mme Sophie VILLERS, directeur général de l’alimentation
• Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), représentée par M. Maxime SCHWARTZ, directeur de la programmation des laboratoires
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), représenté par M. Bruno CLÉMENT, conseiller auprès du directeur général
• M. Gérard PASCAL, ancien président du Comité scientifique directeur de l’Union européenne
• France nature environnement (FNE), représentée par M. Lilian LE GOFF, médecin
• Professeur Marc FELLOUS, président de la Commission du génie biomoléculaire
• Académie nationale de médecine représentée par Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN, allergologue et membre de l’Académie de médecine
• Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) représentée par M. Patrice DAUCHET, chef de bureau
• Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV), représentée par M. Olivier ANDRAULT, directeur scientifique
• Syngenta Seeds, représenté par M. Philippe GAY, consultant
Présidence de M. Jean-Yves Le DÉAUT, Président
M. le Président : Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à cette première table ronde contradictoire qui fait suite à nos premières auditions privées et à nos cinq tables rondes catégorielles. Le but est de réaliser ce que nous appelons l’expertise publique et contradictoire. Peut-être avons-nous sur le sujet des OGM une opinion préconçue, encore faut-il avoir des arguments à l’appui de ses affirmations. Il est en tout cas impossible d’être neutre, comme le voudraient certains : chacun a un passé, une somme de connaissances acquises, l’expérience de débats déjà anciens.
Le moratoire décidé depuis plusieurs années sur les OGM s’expliquait par la nécessité de mettre en place une législation européenne, en l’occurrence la directive 2001/18/CE, complétée par plusieurs règlements en 2003. Tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus : les assureurs nous ont expliqué hier qu’il n’était pas question pour eux d’assurer contre le risque de contamination fortuite tant que les règles de coexistences des cultures ne seraient pas bien définies au niveau européen.
Après une série de débats particulièrement intéressants, nous abordons la phase finale qui s’achèvera par la rédaction du rapport de M. Christian Ménard, fruit du travail collectif de toute la mission, et dans lequel les groupes politiques pourront exprimer leur position si elle vient à différer de la nôtre. Auparavant, nous nous serons rendus dans trois pays étrangers qui cultivent des OGM : l’Espagne, les Etats-Unis et l’Afrique du Sud. Nous aurons également auditionné les responsables politiques nationaux et les ministres concernés.
La réunion d’aujourd’hui est consacrée aux enjeux sanitaires des OGM. Aussi avons-nous sélectionné deux thèmes : celui des risques et des avantages des OGM sur le plan exclusivement sanitaire, et celui de l’étiquetage et de la traçabilité – intérêt et faisabilité. Je vous invite maintenant à vous présenter le plus brièvement possible, sans chercher à faire part de votre position. Le but est de réserver le plus de temps possible au débat contradictoire.
J’ajoute que nous avons particulièrement veillé à l’équilibre de la composition de nos tables rondes.
M. Maxime SCHWARTZ : Biologiste de formation, j’ai fait l’essentiel de ma carrière à l’Institut Pasteur et je préside le Comité des biotechnologies de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), chargé de donner un avis sur la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés, mais également de mener une réflexion plus en profondeur sur la question. Celle-ci s’est traduite par la publication de deux rapports, le premier en janvier 2002 sur les risques et les évolutions souhaitables de la réglementation en la matière, le second en juillet dernier sur les bénéfices potentiels des OGM pour la santé, que nous préconisons de soumettre à une rigoureuse évaluation avant de les mettre en balance avec des risques qui, pour l’heure, restent totalement hypothétiques.
M. Gérard PASCAL : Directeur de recherches honoraire à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), je suis depuis un peu plus d’un an chargé de mission sur les problèmes d’expertise. Ingénieur biochimiste de formation, j’ai travaillé au Commissariat à l’énergie atomique (CEA), au Centre national de recherche scientifique (CNRS) et à l’INRA où j’ai été directeur scientifique pour la nutrition humaine et la sécurité des aliments jusqu’à la fin 2003. Parallèlement à mes travaux de recherche, j’ai eu une activité d’expertise au sein du Conseil supérieur d’hygiène publique, puis de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) dont je suis membre depuis 1986. A ce titre, j’ai eu à rapporter la partie « évaluation du risque sanitaire » de tous les dossiers de plantes génétiquement modifiées dits « de partie C ».
J’ai également participé à des activités d’expertise à Bruxelles où j’ai présidé le comité scientifique de l’alimentation humaine, puis le comité scientifique directeur qui s’est notamment penché sur les problèmes de la vache folle, mais également sur la méthodologie d’évaluation de la sécurité sanitaire des OGM. Je participe depuis la semaine dernière à un groupe de travail chargé de proposer au panel OGM de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) les futures lignes directrices de la mise en œuvre de l’expérimentation animale sur les OGM. Je suis enfin expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les problèmes de sécurité sanitaire depuis une quinzaine d’années.
Mme Sophie VILLERS : Directrice générale de l’alimentation depuis juste trois mois, je rappellerai que le ministère de l’agriculture, et particulièrement la Direction générale de l’alimentation (DGAL), est chargé de délivrer les autorisations d’essais d’OGM au champ, conformément à la procédure suivie en application de la partie B de la directive 2001/18/CE, ainsi que d’instruire les dossiers de demande de mise sur le marché de plantes génétiquement modifiées – partie C – lorsque ces demandes sont déposées en France ou lors des phases de consultation des Etats membres. Nous avons également pour mission de contrôler, par le biais de nos services régionaux chargés de la protection des végétaux, la conformité des essais d’OGM au champ, et de mettre en place les mécanismes de vérification des taux d’OGM et de l’étiquetage des lots de semences importés.
M. Olivier ANDRAULT : Je suis responsable alimentation de la Confédération de la consommation logement et du cadre de vie (CLCV), deuxième association de consommateurs en France. A ce titre, nous siégeons au Conseil national de l’alimentation, au Conseil national de la consommation et à la Commission du génie biomoléculaire (CGB). Nous avons également participé aux débats au Conseil économique et social sur les essais d’OGM au champ. Auditionnés il y a un an par la mission sénatoriale, nous avons déjà été entendus la semaine dernière par votre mission d’information.
M. Patrice DAUCHET : Je suis chef du bureau C2 de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui travaille sous l’autorité, selon les sujets, du ministre chargé de l’économie ou du ministre chargé de la consommation. La DGCCRF a essentiellement un rôle de régulation des marchés en veillant au respect des réglementations en matière de concurrence et de protection des consommateurs. Notre rôle dans cette affaire est assez analogue à celui de la DGAL : nous participons à l’élaboration et à la gestion de la réglementation – essentiellement communautaire – applicable aux OGM pour ce qui touche à l’information et à la sécurité des consommateurs, ce à quoi s’ajoute notre mission classique de contrôle, via nos directions départementales, de la bonne application, sur le terrain, des dispositions relatives à l’étiquetage et à la traçabilité. Réalisés en collaboration avec la DGAL et les Douanes, nos contrôles portent plus particulièrement sur les semences, mais également sur l’alimentation humaine et l’alimentation animale.
M. Philippe GAY : Ingénieur agronome de formation, docteur ès sciences, j’ai suivi pendant dix-sept ans une carrière universitaire, où je me suis très tôt fait remarquer pour l’attention que je portais aux risques liés à cette technologie. En 1982, comprenant avec le directeur général de Limagrain que la génétique moderne prendrait une place prépondérante dans la création des variétés, je suis entré dans l’industrie. Dix ans après apparaissaient le premier maïs résistant à la pyrale, ainsi que la technique des marqueurs génétiques qui en vient aujourd’hui à supplanter les méthodes de sélection classiques.
Tout à la fois témoin et acteur de l’histoire de la biotechnologie en France, je suis passé de Limagrain à la société CIBA où j’ai eu la paternité du premier maïs transgénique autorisé en France. J’ai à ce titre énormément travaillé avec la CGB entre 1990 et 1996 et nous avons construit ensemble un mode d’évaluation des risques envisageables. La société Syngenta, anciennement Novartis, m’a demandé de la représenter devant vous.
M. Lilian LE GOFF : Médecin de formation, je représente la fédération France Nature Environnement (FNE) qui regroupe la majorité des associations de préservation de l’environnement en France. La FNE est structurée en réseaux avec, notamment, un réseau santé/environnement et un réseau juridique dans le but d’entretenir un partenariat avec les autorités publiques afin de faire respecter le droit à un environnement sain. Dès que le débat OGM a gagné la place publique, en 1996-1997, nous avons mis en évidence le lien étroit entre les risques environnementaux et les risques sanitaires. Nous avons donc très tôt posé des questions, mais rarement obtenu de réponses. Dès lors, se pose le problème de la confiance que le citoyen peut apporter aux instances, a priori neutres, chargées de l’évaluation des risques. Cette table ronde pourrait être l’occasion de la renforcer.
M. Marc FELLOUS : Egalement médecin, je dirige une unité INSERM à l’hôpital Cochin, où ma spécialité est la génétique humaine et plus précisément la génétique de l’infertilité chez l’homme et la femme. Je suis également professeur de génétique à l’Université.
Depuis 1998, je préside la Commission du génie biomoléculaire, chargée de l’évaluation scientifique, avant expérimentation ou mise sur le marché, des différents OGM : plantes, micro-organismes, vaccins, thérapies géniques et animaux. Toute expertise ayant ses limites et ses difficultés, nous avons organisé des séminaires scientifiques fermés sur tous les sujets, et ils sont nombreux, qui nous posaient problème. Il est à noter que la France a toujours fait figure de précurseur en matière d’expertise scientifique. La CGB a été la première instance du genre créée en Europe.
C’est ainsi que nous avons organisé en 2000 deux séminaires, le premier sur la dispersion des gènes de résistance aux antibiotiques, dont les recommandations ont été suivies par la Commission européenne, le second consacré à l’impact du colza sur l’environnement, un autre en 2001 sur les flux de gènes, et en 2002 un colloque sur les évaluations toxicologiques des OGM dont je vous ai apporté les documents et le résumé. Contrairement à ce que certains prétendent, nous ne nous prononçons pas sans connaître, et derrière nos décisions se cache un énorme travail scientifique. En 2004, nous nous sommes penchés sur les impacts de la culture du colza génétiquement modifié et sur le très important problème de la stabilité des OGM.
Il est enfin à noter que, dans le cadre de cet aller et retour permanent entre expertise, recherche et développement, je préside, au ministère de la recherche, une commission consultative également consacrée aux OGM.
M. Bruno CLÉMENT : Biologiste cellulaire et moléculaire de formation, directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), j’interviens en tant que conseiller auprès de son directeur général, M. Christian Bréchot, et en tant que directeur scientifique de sa filiale INSERM-Transfert, chargée de la valorisation et du transfert technologique.
L’Institut national de la santé et de la recherche médicale est par définition concerné par la santé humaine. Nos relations avec les OGM peuvent être identifiées en déclinant nos missions : notre mission de recherche amont, pour laquelle nos laboratoires ne peuvent se passer des OGM sous des formes diverses – bactéries, petits animaux modifiés, etc. ; notre mission de transfert de la connaissance jusqu’au lit du malade, par la création de médicaments ou la détermination de nouvelles cibles thérapeutiques ou diagnostiques, autant de domaines dans lesquels les OGM jouent un rôle fondamental lors de la création de modèles permettant de mimer des maladies réelles ; notre mission, enfin, d’expertise et de relation avec la société. L’INSERM participe, soit en tant que tel, soit en par le biais de ses chercheurs, à de nombreuses instances d’expertise. De ce fait, nous n’avons pas créé de comité d’experts spécifique aux OGM, mais nous avons notre propre comité d’éthique. Nous avons enfin un rôle de registre et de veille sanitaire.
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : Professeur de médecine interne, immunologie clinique et allergologie, j’ai une triple mission d’enseignement, de soins et de recherche. Nous sommes pratiquement la seule équipe en France ciblée sur la recherche en allergologie alimentaire. Nous utilisons également des OGM d’origine bactérienne et nous travaillons sur des allergènes recombinants de certains aliments.
Nous nous intéressons particulièrement à la détection des cas nouveaux d’allergie alimentaire liés à des allergènes inconnus ou exceptionnels. Il y a trois ans, nous avons eu l’opportunité, en liaison avec l’AFSSA, de nous inscrire dans un Programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) consacré aux OGM et nous avons créé les bases d’une future surveillance post-marketing, sous la forme d’un réseau d’allergo-vigilance rassemblant 330 allergologues français et belges, chargé de détecter les cas les plus sévères d’anaphylaxie mais également de lancer régulièrement, en son sein, des études prospectives. Ainsi, une étude est actuellement en cours à la demande de l’AFSSA sur la prévalence de sensibilisation aux pollens et aux graines de deux espèces végétales d’ores et déjà devenues des OGM. Ce travail de base servira de référence pour déterminer si l’arrivée de ces nouvelles variétés entraînera des dérives à terme.
Parallèlement, il est apparu que le contrôle du risque allergénique ne pouvait se satisfaire de la seule comparaison des séquences protéiques des protéines transgéniques avec les allergènes connus et qu’il fallait nous doter de sérothèques. Celle que nous avons constituée en trois ans rassemble déjà plus de 2 000 sérums classifiés et 4 000 non encore classifiés.
Parallèlement, je siège à l’Académie de médecine où je suis le seul allergologue chercheur en activité.
M. le Président : Commençons par le thème des risques sanitaires liés aux OGM. Sont-ils spécifiques à la technique ? Quid des éventuels bénéfices des OGM pour la santé ? Les OGM présentent-ils un risque d’allergies ? Les problèmes sanitaires sont-ils avérés ou n’est-on pas train de chercher le « risque du risque », à entendre le professeur Kourilsky qui nous expliquait hier soir qu’il n’y avait pas le plus petit début de commencement d’epsilon de risque sanitaire ? Que doit-on enfin penser de la fabrication des médicaments par des organismes génétiquement modifiés, plantes ou micro-organismes ?
M. Lilian LE GOFF : Votre première question est fondamentale : les risques sont-ils liés à la méthode ? Sous-entendu : les OGM ne présentent-ils pas d’autres risques que ceux liés à la méthode elle-même ?
En fait, il y a deux catégories de risques, dont les premiers sont inhérents au modèle agricole intensif : l’introduction de pesticides dans la chaîne alimentaire et le transfert ou l’acquisition de résistances aux antibiotiques. Loin de résoudre a priori une partie de ces problèmes, et particulièrement celui des pesticides, les OGM tendent à l’aggraver en accroissant l’utilisation d’herbicides totaux sur des plantes précisément manipulées pour y résister. Or ces produits sont beaucoup plus dangereux dans la mesure où ils sont destinés à détruire toutes les plantes. De surcroît, de nombreuses publications américaines et canadiennes ont mis en avant les effets cancérigènes et reprotoxiques du glyphosate, principale molécule en cause.
M. le Rapporteur : Sur quels éléments de preuve vous fondez-vous pour affirmer que les OGM accroîtraient l’utilisation de pesticides ?
M. Lilian LE GOFF : Depuis la commercialisation des variétés OGM, la vente de Roundup, selon les chiffres mêmes de Monsanto, est en nette augmentation.
M. le Président : Le rapport de la FAO51 fait état d’une augmentation pour le Roundup, mais d’une baisse de la consommation globale d’herbicides et de pesticides ainsi que d’une diminution du nombre d’épandages.
M. Marc FELLOUS : Vous vous en apercevrez par vous-même en Espagne : en Catalogne, où ils font pousser 50 000 hectares de maïs Bt, les paysans m’ont déclaré qu’ils utilisaient désormais cinq fois moins d’insecticides dans la mesure où c’est la plante qui le produit elle-même. Pour ce qui est des herbicides, les chiffres varient en fonction des cas.
M. Gérard PASCAL : Ainsi que l’explique un excellent article de collègues de l’INRA dans la revue « Oléagineux, Corps gras, Lipides », tout dépend des espèces considérées et des conditions climatiques. Au demeurant, le fait que la consommation de Roundup augmente lorsqu’on utilise des plantes qui précisément résistent au Roundup n’a rien d’étonnant.
Cela dit, que peut signifier un raisonnement en tonnage global en termes de risque toxique ? Ce sont des molécules différentes, avec des propriétés différentes. Un travail sérieux d’analyse devrait porter sur l’évolution de l’utilisation de chaque molécule, en mettant en face les risques qu’elle comporte pour l’environnement et la santé. Raisonner en tonnage global n’a vraiment aucun sens pour le toxicologue que je suis.
M. Lilian LE GOFF : La spécificité première du Roundup est de détruire toutes les plantes… Il suffit de traverser nos campagnes en mars/avril, où tous les champs virent au jaune orangé, pour s’en rendre compte. Le but est de faire place nette au détriment de la biodiversité.
M. le Président : Croyez-vous vraiment que les 13 millions d’hectares de cultures intensives que compte la France participent de la biodiversité ?
M. Lilian LE GOFF : Evidemment non. Non seulement l’usage intensif de biocides tue par définition la vie, mais la logique même du productivisme conduit à privilégier certaines espèces comestibles au détriment des autres. Les OGM ne risquent pas d’améliorer la situation sur ce plan, dans la mesure où si l’on s’emploie à multiplier les prises de brevets pour se constituer des monopoles, ce n’est évidemment pas pour favoriser le développement et la commercialisation d’autres espèces. Les OGM ne feront qu’accentuer les tendances naturelles du productivisme.
M. le Président : Les risques environnementaux seront traités dans le cadre d’une autre table ronde. Sur le plan strictement sanitaire, peut-on affirmer que les risques sont supérieurs lorsque l’on cultive des OGM plutôt que des variétés classiques, avec épandages d’insecticides et de pesticides ?
M. Lilian LE GOFF : En l’état actuel des connaissances, on ne peut pas répondre à votre question, et c’est bien tout le problème. Les experts que nous-mêmes interrogeons également avouent ne pas savoir. Il n’est que de lire ce qu’a répondu M. Gérard Pascal en 2004, à propos de l’affaire du MON 863, à la question52 : « Quels sont les effets à long terme des OGM et des nouveaux aliments ? » « Je ne sais pas répondre. Il faut avoir la franchise d’avouer que l’on ne dispose pas des méthodes appropriées. » Tout le problème est là… Manifestement, on va trop vite dans l’application en milieu ouvert.
M. Gérard PASCAL : J’ai oublié de déclarer que je n’avais aucun intérêt commun avec les firmes de biotechnologies et que je n’y ai jamais eu de contrat en tant que chercheur. Je m’estime donc parfaitement indépendant, tant à l’égard de ces firmes qu’à l’égard des associations qui militent dans un sens ou un autre.
Il faut faire attention en reprenant les citations des médias, M. Le Goff. En l’occurrence, je parlais des OGM, mais également de nouveaux aliments pour lesquels nous ne pouvons, et pour cause, nous prévaloir de plusieurs siècles de recul. L’épidémiologie est une science encore récente et les relations entre alimentation et santé ne sont pas parfaitement connues. Cela dit, je confirme que nous n’avons pas aujourd’hui de méthodes suffisamment sensibles pour traiter d’effets de très faible amplitude et qui, à long terme, pourraient avoir des conséquences sur la santé publique. Mais cela vaut pour les OGM comme pour n’importe quel nouvel aliment.
M. le Président : Qu’entendez-vous par « nouvel aliment » ?
M. Gérard PASCAL : On voit par exemple arriver sur le marché de nouvelles noix provenant de pays exotiques, dont personne n’a vérifié si la consommation pouvait exposer à des risques allergiques. Et si l’on s’était interrogé sur les kiwis, on n’aurait pas manqué de soulever des questions du même ordre, comme sur les litchis ou sur toute une série de produits qui ne sont pas des aliments communs pour les populations européennes et pour lesquels le règlement « nouveaux aliments » 258/97 propose toute une série de déterminations toxicologiques et nutritionnelles. Et je suis très surpris que personne ne pose cette question pour l’ensemble de l’alimentation. Nous avons effectivement besoin de nouvelles méthodes, beaucoup plus sensibles, pour mieux garantir la sécurité sanitaire des consommateurs en matière d’alimentation. De nombreux instituts de recherche et universités y travaillent, au niveau national comme au niveau européen, le but étant de développer de nouvelles approches et des méthodes de détection plus fines.
M. Philippe GAY : Personne ne peut dire aujourd’hui si la consommation de pâtes alimentaires allongera ou diminuera votre espérance de vie d’un ou deux ans… Il faut savoir que le risque à long terme ne fait toujours pas l’objet de méthodologies scientifiques appropriées.
98 % de nos cultures sont traitées par des désherbants. L’apparition d’OGM résistants à tel ou tel herbicide total conduit à substituer un herbicide à d’autres herbicides. La question est de savoir si tel ou tel est plus ou moins nocif pour l’environnement. Or l’herbicide total en question, autrement dit le glyphosate, n’est pas actif sur les graines, mais seulement sur la végétation, et permet de ce fait la culture sans labour, ce qui n’est pas sans intérêt pour l’environnement.
M. Le Goff établit une relation de stricte association entre OGM et intensification de l’agriculture. Pour qui fait de la génétique appliquée aux plantes, le fait d’associer une résistance à un insecte ou une maladie au génome d’une plate n’a aucun rapport direct avec une intensification de l’agriculture. Un maïs résistant aux insectes en Afrique du Sud, dans les mains d’un agriculteur peu formé, rendra vingt quintaux à l’hectare là où il n’en récoltait d’habitude que dix ; mais il n’y a aucune intensification là-dedans. Si les OGM ont naturellement leur place dans l’agriculture intensive, ils l’ont tout autant dans l’agriculture non intensive.
M. le Président : Restons-en au sujet de la santé. A croire le rapport de la FAO, il y aurait moins d’épandages. Une diminution des épandages de produits, par essence toxiques, présente-t-elle plus ou moins de danger pour les agriculteurs qui les manipulent ?
M. Philippe GAY : Il est très attristant, surtout pour quelqu’un qui a vendu des pesticides, de lire des rapports parlant de la mortalité liée à l’usage de ces produits par des agriculteurs à faible technicité. Reste que la réduction de cette mortalité grâce à au développement du coton Bt est avérée, à croire la publication de Carl E. Pray et collaborateurs.
M. le Président : Cette assertion est-elle contestée ? Comprenez que, devant cette partie de ping-pong, les parlementaires aient du mal à comprendre. J’ai moi aussi lu cet article. Il semble bien que l’emploi d’insecticides très dangereux provoque de nombreux cas d’intoxication chez des paysans mal équipés. Peut-on soutenir le contraire ?
M. Philippe GAY : Je suis né dans une ferme. J’ai utilisé des insecticides dès l’âge de douze ou treize ans. Je sais par expérience quel peut être le niveau d’exposition de personnes peu formées à l’utilisation de ces produits, ce qui est très probablement le cas dans les pays du Sud. On a tout lieu de croire – hélas ! – les publications de M. Pray.
M. Lilian LE GOFF : Ce débat met en évidence les relations intimes entre les pratiques classiques du productivisme et les OGM qui en sont le prolongement naturel. L’agriculteur est à l’évidence le premier exposé aux dangers des pesticides – sans parler de l’utilisation généralisée des pesticides par les services urbains et les Directions départementales des équipements (DDE). Si les statistiques de la Mutualité sociale agricole (MSA) ne font pas état de la mortalité, les preuves ne manquent pas, en revanche, pour ce qui est des cancers ou des affections reprotoxiques liées aux pesticides.
M. le Président : Mais pas liées aux OGM ! Je repose la question : le remplacement des pesticides, jusqu’alors utilisés dans les pays du Nord comme du Sud, par des herbicides totaux liés à l’utilisation d’une semence OGM se traduit-il, oui ou non, par une augmentation des risques sanitaires ?
M. Lilian LE GOFF : La réponse est oui, et le fait a été prouvé aux dépens des femmes des agriculteurs.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Pourquoi ?
M. Lilian LE GOFF : Dans l’Ontario, plusieurs publications font état d’avortements spontanés beaucoup plus fréquents en relation avec l’utilisation du Roundup, de manière classique ou en association avec des plantes Roundup Ready.
M. Marc FELLOUS : Avez-vous les références ?
M. Lilian LE GOFF : Oui.
M. Marc FELLOUS : Lesquelles ?
M. Lilian LE GOFF : Nous vous les donnerons.
M. Marc FELLOUS : Nous sommes entre scientifiques. Avez-vous des références scientifiques précises établissant le fait qu’il se soit produit plus d’avortements dans le milieu familial de paysans utilisant le Roundup ?
M. Lilian LE GOFF : Il y a des publications…
M. Marc FELLOUS : Donnez-moi une référence !
M. Lilian LE GOFF : Je ne peux pas vous la donner ici…
M. le Rapporteur : C’est important, M. Le Goff. La presse aura tôt fait de répercuter vos propos.
M. Marc FELLOUS : Sur des sujets aussi graves, il faut produire des références scientifiques !
M. Lilian LE GOFF : Vous en avez déjà dans le dossier que j’ai apporté, mais qui ne concernent pas ce problème précis. Nous avons également été informés qu’une étude serait en cours sur des allergies développées par des agriculteurs des Philippines…
M. Marc FELLOUS : Mme Moneret-Vautrin pourra vous répondre !
M. le Président : Précisons les règles du jeu de l’expertise publique et contradictoire : on doit pouvoir produire des articles précis à l’appui de ses accusations ou de sa défense. Nous en avions déjà parlé, M. Le Goff.
M. Lilian LE GOFF : J’en ai apporté tout un paquet !
M. le Président : Plusieurs points suscitent en France de vives controverses : le papillon monarque, les rats à la lectine, l’affaire Percy Schmeiser, etc., sur lesquels sont parus des informations que des publications à comité de lecture sont venues par la suite atténuer, infirmer, démentir. Mais si la presse relaie immédiatement la première information, personne ne cite les démentis… Sur un sujet aussi complexe que celui-ci, il faut impérativement présenter ses arguments et contre-arguments, avec des éléments précis à l’appui.
M. Lilian LE GOFF : Voilà un dossier sur le glyphosate, avec 164 références… Mais nous sommes davantage en situation de poser des questions que d’apporter des preuves, pour la simple raison que lorsque nous demandons des réponses, nous n’en obtenons pas. Ainsi, nous avons interrogé par écrit la DGAL sur le risque de bioconcentration des pesticides susceptibles d’être contenus dans les plantes génétiquement manipulées pour diffuser des insecticides ou concentrer les herbicides totaux, sans jamais obtenir de réponse.
Mme Sophie VILLERS : Votre courrier a dû nous arriver avant que je ne prenne mes fonctions. Cela dit, M. Fellous serait plus à même de répondre scientifiquement à votre question… Les risques pour l’environnement et pour la santé sont évidemment pris en compte dans les avis que nous rendons. On peut évidemment se référer aux études d’autres pays, mais il serait également intéressant de pouvoir évaluer en fonction de notre pratique nationale. Or la France ne compte que dix-sept hectares de maïs génétiquement modifié en culture et seulement sept hectares d’essais sur quarante-huit parcelles… Il est difficile d’avancer sur ce sujet, compte tenu de la difficulté des recherches.
M. Bruno CLÉMENT : Lorsqu’un problème nouveau survient, toute la difficulté est de l’évaluer dans la population. On peut le faire par la méthode rétrospective, dans laquelle l’observation de la cohorte de sujets s’effectue sur la base d’une question posée a posteriori. Malheureusement, ces études posent de gros problèmes d’interprétation. Inversement, dans la méthode a priori, on posera d’abord la question avant de créer une cohorte, c’est-à-dire d’identifier une population que l’on suivra dans le temps. De la qualité de la question de départ dépendra évidemment la qualité de la réponse. L’épidémiologiste doit donc s’efforcer de suivre au fil de l’eau les questions qui apparaissent.
Non seulement le débat qui nous occupe aujourd’hui est d’une extrême complexité du fait du mélange entre OGM, pesticides, etc., mais le risque d’exposition à des produits chimiques varie considérablement selon les sujets. L’INSERM soutient le principe de la constitution de cohortes, à l’image de la cohorte dite Constance, qui consiste en une étude à très long terme sur une très large population représentative de la France sur un certain nombre d’événements susceptibles d’arriver au cours de la vie professionnelle, ou encore de la cohorte qui sera bientôt lancée sur les risques d’exposition aux pesticides sur les cellules germinales. On peut toujours lancer des arguments du type : « Il y en a qui ont dit que… » ; la science, elle, se doit de répondre au vu de critères statistiques rigoureux et sur la base de populations parfaitement identifiées. On peut regretter pour terminer que l’épidémiologie en France ne soit pas suffisamment soutenue par les pouvoirs publics.
M. le Président : C’est la conclusion à laquelle est toujours parvenu l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous l’avons écrit dix fois dans nos rapports… Il faut impérativement créer des réseaux d’épidémiologie performants.
M. Lilian LE GOFF : Je voudrais poser une question aux experts ici présents et qui me paraît fondamentale pour le débat sur les enjeux sanitaires des OGM. On a tendance à considérer que les plantes transgéniques cultivées sont des plantes alimentaires comme les autres. Du fait de la nature même des principes actifs, herbicides ou insecticides, qu’elles contiennent, ne devrait-on pas leur imposer les mêmes procédures de mise en marché que les médicaments ou les produits phytosanitaires ?
M. le Président : Votre question ne concerne en fait que les plantes manipulées pour fabriquer une toxine.
M. Lilian LE GOFF : Ou pour concentrer un herbicide.
M. Pierre COHEN : Cette question est très importante. Les risques que vous évoquez restent, faute d’arguments précis, dans le domaine du potentiel. Je distingue pour ma part deux types d’OGM : premièrement, ceux qui ont été manipulés pour remplacer des pesticides, auquel cas je me demande, comme vous, s’ils ne doivent pas suivre une procédure de validation spécifique, eu égard à leur toxicité, ou pour produire des médicaments, ce qui suppose de porter une attention particulière à la question de la dissémination ; deuxièmement, les plantes génétiquement modifiées pour apporter un gain, améliorer la composition des corps gras, par exemple, et qui, de mon point de vue, sont les seules à pouvoir être considérées comme des aliments classiques sur le plan de l’évaluation et du contrôle. Mais les OGM de la première catégorie doivent-ils être traités comme des aliments classiques et suivre obligatoirement la même procédure ?
M. Gérard PASCAL : Premièrement, et heureusement pour elles et pour nous, les plantes sécrètent naturellement, pour résister aux pestes et aux insectes, de très nombreux insecticides dont certains sont mutagènes, c’est-à-dire potentiellement capables, à très fortes doses, d’attaquer l’ADN.
Deuxièmement, personne n’a, pour l’heure, demandé l’autorisation de traiter le maïs par le Roundup, et pour cause : celui-ci le détruirait ! Le jour où cette autorisation sera demandée, la commission des toxiques sera évidemment interrogée sur les risques liés à la présence dans la plante de résidus de Roundup ou de métabolites issues de sa dégradation. Autrement dit, les instances compétentes apporteront une réponse à ce problème, mais seulement le jour où il sera posé. C’est ce qui s’est fait dans d’autres pays ; les rapports toxicologiques existent, mais ils sont confidentiels. En attendant, nous ne disposons pas des éléments officiels qui permettraient de répondre à la question de M. Le Goff.
M. Pierre COHEN : Mais dans votre exemple, la plante ne produit pas d’herbicide…
M. Gérard PASCAL : Si elle y résiste, c’est bien qu’elle le transforme : et les résidus de la molécule initiale ne peuvent qu’être extrêmement faibles, sinon la plante n’y survivrait pas.
M. Pierre COHEN : Mais quel circuit suivra cette plante alimentaire ?
M. Gérard PASCAL : Le circuit classique régissant l’utilisation de tout pesticide sur une plante.
M. Pierre COHEN : Mais est-ce normal ? Peut-on considérer cette plante comme les autres plantes alimentaires ?
M. Gérard PASCAL : On n’y a pas intégré le pesticide, mais la façon de s’en débarrasser. L’approche toxicologique doit être rigoureusement la même, à ceci près qu’elle ne porte pas sur la même substance.
M. Philippe GAY : Je crois sentir une confusion liée au terme « pesticide ». Une plante génétiquement modifiée Bt, par exemple, produit effectivement une endotoxine Bt mortelle pour les insectes. Mais l’étude toxicologique de cette protéine a déjà été faite, et même si bien faite qu’on l’emploie dans l’agriculture conventionnelle et même biologique…
M. le Président : Ce à quoi vos adversaires répondent qu’il ne s’agit pas du tout des mêmes concentrations.
M. Lilian LE GOFF : Très juste !
M. Philippe GAY : J’ai proposé à la table ronde de l’INRA une série de calculs personnels, qui prouvent que l’on parvient à des concentrations équivalentes, voire inférieures.
M. le Président : Je vous invite à faire avancer le débat sur cette question qui jusqu’à présent faisait l’objet de controverses.
M. Philippe GAY : Mes calculs reprennent les concentrations préconisées par les fabricants d’insecticides à base de Bacillus thurigiensis, d’une part, et les concentrations publiées d’endotoxine de Bacillus thurigiensis présentes dans les plantes transgéniques, d’autre part. Tous ces chiffres sont évidemment publics. Au final, les quantités résiduelles qui persistent dans les sols en fin de saison sont inférieures à dix grammes d’endotoxine par hectare, que l’on ait traité de façon classique avec un insecticide à base de Bt ou que l’on y ait enfoui du maïs transgénique. Je mets ces chiffres à votre disposition, assortis des références aux produits utilisés et aux taux de concentration préconisés.
M. le Président : Au moins aurons-nous une base objective.
M. Marc FELLOUS : Une plante génétiquement modifiée, qu’elle soit résistante à un herbicide ou qu’elle produise un insecticide, est soumise à une évaluation utilisant les techniques classiques de la toxicologie : on prend des animaux, on leur donne à manger la toxine purifiée, on calcule la dose létale 50 et on examine comment la plante parvient à la produire. Les résultats finaux sont dans la norme classique, cent fois inférieurs à la dose létale. C’est ce qu’on appelle l’approche toxicologique aiguë.
Vient ensuite l’approche, beaucoup plus difficile, de tolérance alimentaire : on donne la plante non génétiquement modifiée et la même plante génétiquement modifiée à manger à des animaux tests, souris, poulets, rats, lapins dont on observe le comportement. Nous n’avons jusqu’à présent, avec les outils dont nous disposons, relevé aucune différence dans le métabolisme, la vie ou les anomalies entre les deux populations d’animaux.
S’est toutefois posé un premier problème lorsqu’on nous a demandé de prolonger le test de 28 à 90 jours : or, à 90 jours, le rat vieillit comme nous et se met à développer spontanément des maladies…
M. le Président : Combien de temps vit un rat ?
M. Marc FELLOUS : A peu près deux ans. Mais au bout de 90 jours, 80 % des rats se mettent à développer des maladies et particulièrement des maladies rénales. Il est très difficile de déterminer le taux de maladie spontanée.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Autrement dit, vous n’avez pas pu en identifier la cause.
M. Marc FELLOUS : Non.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Pourtant, à 90 jours, un rat n’est pas bien vieux…
M. Marc FELLOUS : Non, mais c’est l’âge auquel certaines pathologies commencent à apparaître.
Le deuxième problème est que les rats, tout comme les hommes, sont différents les uns des autres. Et l’expérience Monsanto a été réalisée sur 400 rats… Il y a donc une variabilité dans la réponse et il faut une analyse statistique pour établir que la variation est identique dans les deux populations, celle qui a mangé la plante normale et celle qui a mangé la plante transgénique. Les tests réalisés par plusieurs compagnies n’ont pas montré de différence.
M. le Président : Monsieur Fellous, vous venez de nous montrer les limites de l’expérimentation. Vous êtes médecin et président de la CGB. Pensez-vous, en l’état de vos connaissances, que les OGM présentent des « risques sanitaires potentiels » comme il est écrit dans la contribution écrite de la FNE ?
M. Marc FELLOUS : L’expérimentation sur le poulet n’a montré aucune différence. Sur le rat, nous n’avons rien relevé, mais les problèmes que nous avons rencontrés appellent d’autres expérimentations, très longues et très lourdes. Reste à savoir, et c’est tout le problème du scientifique, si le résultat est négatif parce qu’il n’y a rien à voir ou parce qu’on n’a pas suffisamment regardé… Aussi vous ai-je apporté ce dossier qui aborde le problème des limites de l’expérimentation à faibles doses et à long terme.
M. le Président : Ces réserves sont tout à votre honneur. Mais au vu également des expertises internationales, estimez-vous qu’il pourrait y avoir des risques sanitaires probables ou n’avez-vous aucun élément permettant de penser qu’il y en ait ?
M. Marc FELLOUS : En l’état actuel de nos connaissances, en constante évolution – j’ai moi-même beaucoup appris sur la pathologie du rat en discutant avec le professeur Parodi, de Maisons-Alfort –, et sachant que nos conclusions ont été confirmées par l’AFSSA et la Commission européenne, nous ne voyons aucune différence entre la plante normale et son équivalent génétiquement modifié. Cela dit, de nouvelles techniques arrivent sur le marché, qui permettront d’évaluer les « éléments discrets ». Reste que trois commissions indépendantes, dont une européenne, sont parvenues à la même conclusion.
M. Pierre COHEN : La question est de savoir ce que M. Le Goff entend par « risques potentiels » : s’agit-il de risques dont on n’est pas sûr, ou de risques que l’on a commencé à identifier, mais qui exigeraient d’autres recherches ?
M. Marc FELLOUS : En science, on travaille toujours en s’accordant une marge d’incertitude de 1 à 5 %. C’est le principe de Heisenberg : la marge d’erreur zéro n’existe pas.
M. Lilian LE GOFF : Je suis surpris que vous n’ayez constaté aucune différence significative, alors que nous connaissons au moins un dossier emblématique : celui du maïs MON 863, où il a fallu batailler ferme pour avoir accès aux procès-verbaux ultra-confidentiels alors que la transparence devrait être la règle lorsque la santé publique est en cause. Force est de reconnaître qu’il est apparu, à un moment donné en tout cas, des différences significatives, au point que M. Pascal lui-même a pris publiquement position en déclarant qu’il fallait reprendre ce dossier. Et pour cause : les rats présentaient des anomalies au niveau des reins, du pancréas, mais également au niveau des globules blancs, des réticulocytes, etc. Manifestement, cette histoire n’était pas très catholique ! Ce dossier a-t-il été repris ? L’a-t-il été avec le même lot, le même événement génétique ? Il semblerait que ce ne soit pas le cas. Peut-être faut-il aller plus loin que 90 jours, et avec un plus grand nombre d’animaux.
M. le Président : M. Le Goff, vous posez beaucoup de question et c’est très bien. Mais M. Cohen vous a interpellé sur le sens que vous donnez au risque probable.
M. Lilian LE GOFF : Nous retenons la deuxième acception. Dès lors que l’on a affaire à un nouveau procédé qui de surcroît transgresse la barrière des espèces, il y a un risque potentiel à la clé, que nous aimerions appréhender.
M. le Président : Ce n’est pas la définition du mot probable. C’est le risque du risque… Le terme de probabilité renvoie à un risque identifié, dont il faut calculer les chances de survenue.
M. Lilian LE GOFF : Je préférerais le mot « potentiel ».
M. Pierre COHEN : La différence est fondamentale. La sémantique compte…
M. le Président : Je vous rappelle que nous avions discuté pendant deux heures sur le sens du mot « soudain » à l’occasion de la loi « après-mine »…
M. Gérard PASCAL : Jusqu’à ce dossier, j’étais considéré comme un chaud partisan des OGM ; on m’a accusé ensuite d’avoir été acheté par leurs opposants ! Ce dossier faisait effectivement apparaître une série de différences significatives qui posaient question et pouvaient laisser penser à un effet non pas probable, mais bien possible.
M. Gabriel BIANCHERI : C’est très différent.
M. Gérard PASCAL : Au demeurant, l’avis de la CGB ne faisait état d’aucune suspicion de toxicité, mais concluait que le test soulevait plusieurs questions.
Nous avons d’abord vérifié si certains des effets étaient observés sur les deux sexes et s’ils étaient plus marqués en cas de dose accrue ou au fil du temps. Cela nous a permis d’en éliminer plusieurs, visiblement dus au hasard.
Restaient ces anomalies observées sur les reins, tant au niveau de leur poids, sensiblement diminué, qu’à celui de l’observation au microscope. Aussi avons-nous suggéré un examen des coupes histologiques par des experts indépendants afin de savoir s’il s’agissait vraiment d’une anomalie ou d’un événement qui pouvait survenir chez les animaux témoins, mais avec une fréquence un peu différente. Deux experts internationaux en ont été chargés, considérés parmi les plus compétents au monde sur les anomalies du rein du rat… Encore avions-nous pris la pris la précaution de demander une contre-expertise à un expert français ! Et ces trois experts ont conclu à une anomalie classiquement observée chez le rat et particulièrement sur la souche qui avait servi à l’expérimentation.
M. Pierre COHEN : Dans les mêmes proportions ?
M. Gérard PASCAL : Non, on en observait un peu plus dans le lot expérimental – d’où mes questions. Mais il s’agissait d’anomalies de même nature.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Autrement dit, il n’y avait pas, à votre avis, aggravation ?
M. Gérard PASCAL : Il n’y avait pas d’anomalies plus marquées dans un lot que dans l’autre, seulement un pourcentage un peu plus élevé.
M. Lilian LE GOFF : Les experts ont-ils examiné les lames ?
M. Gérard PASCAL : Evidemment : c’est ce que nous leur avions demandé !
M. le Rapporteur : Avez-vous décidé de refaire une deuxième expérimentation ?
M. Gérard PASCAL : Ce n’est pas la CGB qui effectue les tests… De plus, il faut savoir que pratiquement aucun laboratoire public en France n’a d’agrément pour réaliser des études toxicologiques en matière d’alimentation qui soient reconnues au niveau international. Autrement dit, nos expérimentations ne serviront à rien s’il survient un conflit à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
M. le Rapporteur : Une autre expérimentation aurait-elle à votre avis servi à quelque chose ?
M. Gérard PASCAL : Ce n’était pas encore tout à fait terminé : nous n’avions pas encore de réponse sur le poids des reins. On nous a fourni des résultats complémentaires, qui concernaient le même élément de transformation, mais pas exactement la même plante. Cela étant, les animaux en question avaient des reins dont le poids correspondait à ceux des rats nourris au MON 863. Les fourchettes de variation étaient à peu près comparables. Même lorsque les rats sont de souches consanguines, les variations peuvent être très importantes. Quant au nombre d’animaux utilisés, il était deux fois plus élevé que ce que prévoient les normes de l’OCDE… Disons que mes questions ont trouvé réponse à 80 % ; en conséquence de quoi, la CGB s’est rangée aux avis de l’AFSSA et du panel « OGM » de l’Autorité européenne. A la suite de cette affaire, Bruxelles a décidé de mettre en place un groupe de travail afin que nous soyons mieux préparés à l’analyse de ces différences significatives… Ce n’est pas fini.
M. Olivier ANDRAULT : Compte tenu des problèmes que pose le rat de laboratoire sur le plan biologique, mais également de la faible proportion de MON que nous avions pu inclure dans sa ration alimentaire, la question peut être posée de savoir si c’est l’animal idéal pour ce genre d’expertise.
M. Lilian LE GOFF : Il serait pertinent de tester également ces produits sur les animaux d’élevage, bovins ou poulets, qui ont le plus vocation à consommer du maïs Bt ou Roundup Ready.
M. Pierre COHEN : Cela a été fait sur les poulets.
M. Lilian LE GOFF : Des prélèvements ont été faits sur des bovins en Maine-et-Loire, mais on les a mis au frigo sans jamais les avoir analysés…
M. le Rapporteur : Au regard des coûts, peut-on raisonnablement envisager une expérimentation sur des bovins ?
M. Lilian LE GOFF : Il faudrait peut-être s’adresser à Maisons-Alfort. En tout état de cause, il faut que les tests correspondent à la réalité de l’exposition au risque.
M. le Président : Sachant que l’on compte quelque 70 millions d’hectares d’OGM cultivés dans le monde, on doit bien pouvoir y trouver des vaches et autres animaux qui en mangent, particulièrement sous la forme de tourteaux de soja, plutôt que de discuter sur des expérimentations effectuées en France sur de petits nombres d’animaux peut-être même pas adaptés… Avons-nous des publications faisant état de différences significatives ?
M. Lilian LE GOFF : A ma connaissance, non. Il est difficile d’en trouver, dans la mesure où il y a encore moins de traçabilité que chez nous… Et sans traçabilité, on ne peut pas établir de relation de cause à effet.
M. le Président : Il n’y a pas besoin de traçabilité en Argentine : tout est OGM, hormis peut-être quelques agriculteurs biologiques…
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Qui disparaîtront !
M. le Président : Des études ont-elles été réalisées dans ce pays ?
M. Philippe GAY : D’autres études ont été menées, par exemple sur des porcs nourris au maïs Bt, qui semblent en meilleure santé du fait d’un moindre taux de mycotoxines…
M. le Président : Nous aborderons la question des mycotoxines après celle des allergies.
M. Gérard PASCAL : Que le rat comme la souris ne soit pas le bon animal, je n’arrête pas de le dire, mais personne ne m’écoute ! Nous ne progresserons jamais dans le domaine de l’alimentarité des plantes – transgéniques ou non – tant que nous travaillerons avec des méthodes de toxicologie classique sur un animal de laboratoire. C’est un modèle insuffisamment sensible et nous ne trouverons jamais rien, pas plus en 90 jours qu’en deux ans, sinon des effets réellement marqués : ce fut le cas avec le colza GT 73 dont la toxicité a été mise en évidence au bout de 28 jours.
M. le Président : Pourquoi était-il toxique ?
M. Gérard PASCAL : Tout simplement parce que les auteurs de l’étude n’avaient pas pris la précaution d’aligner les teneurs en glucosinolates toxiques naturellement présents dans le colza, mais à des teneurs variables. Celle du lot transgénique était plus marquée.
M. le Président : Ce n’était donc pas dû à la transgénèse.
M. Gérard PASCAL : Non. Les effets sont apparus dès le vingt-huitième jour, mais il s’agissait d’une toxicité marquée et d’une substance connue. Mais des effets de faible amplitude n’apparaîtront pas sur les espèces de laboratoire.
M. le Président : Autrement dit, il ne sert à rien d’allonger la durée des tests.
M. Gérard PASCAL : Les méthodes de toxicologie classiques permettent de mettre en évidence la toxicité de molécules qui, à l’instar des produits phytosanitaires ou des médicaments, sont par essence toxiques ou destinées à produire un effet donné sur les organismes vivants. En revanche, un additif alimentaire ou un aliment, qui ne vise pas à produire une action biologique sur un organisme, exige des méthodes beaucoup plus sensibles, faute de pouvoir augmenter indéfiniment la dose : on ne peut pas nourrir un rat avec seulement des pommes de terre ou du maïs transgénique, encore moins avec du colza : il n’aime pas !
Cela dit, bon nombre d’expérimentations animales ont déjà été menées sur des animaux d’intérêt zootechnique, autrement dit de ferme. Je vous ai apporté un dossier qui comporte notamment un article réalisé en 2004 par deux des meilleurs experts au monde, un Allemand et un Anglais, assorti de 170 références de travaux menés chez le poulet, le porc, la vache laitière, le mouton, etc. Nous avons également en France un expert parfaitement compétent en alimentation animale, M. Aimé Aumaître, dont vous trouverez les articles dans le dossier.
Ces travaux ont notamment mis en évidence la présence de brins d’ADN, y compris transgénique, dans les tissus ou organes de ces animaux. La question du devenir de l’ADN transgénique tout au long de la chaîne alimentaire est fréquemment posée.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO et M. Pierre COHEN : Et quelle est la conclusion ?
M. Gérard PASCAL : Lorsqu’un animal ingère du maïs, on retrouve des fragments d’ADN de maïs dans son tube digestif, de plus en plus petits au fur à mesure de la digestion dans le cas d’un monogastrique, et vraiment minuscules dans le cas d’un ruminant. Reste qu’on en retrouve des traces dans les organes et le sang – jamais dans le lait, mais je ne serais pas surpris qu’on en trouve le jour où nous aurons des méthodes de détection plus sensibles. De la même façon, on trouve – certes beaucoup moins – des traces d’ADN du transgène, et peut-être parviendra-t-on un jour à en déceler dans les muscles et le lait. Mais ce n’est pas pour autant que la vache devient maïs… Ce n’est donc absolument pas un problème de santé publique.
Mon dossier contient également les résultats de tests effectués sur l’homme, où l’on a, de la même façon, suivi le parcours d’un transgène dans le tube digestif – en choisissant, pour faciliter les choses, des sujets ayant subi une résection de l’intestin grêle, devenu, par la force des choses, très court. On y a trouvé des morceaux d’ADN de transgène, mais ils sont incapables de coder quoi que ce soit. Reste que l’on en trouve et que l’on en trouvera de plus en plus souvent. De gros travaux de recherche ont été engagés au niveau européen. Le dossier que je vous ai remis contient les informations les plus récentes.
M. Philippe GAY : La présence de fragments d’ADN alimentaire dans les fluides biologiques a été établie par les travaux de l’équipe de Walter Dorfler à Cologne. Mais si cet ADN pouvait migrer dans les cellules, ce serait un cancérigène du fait que, codant ou non, c’est un agent mutagène. C’est donc que les cellules ont un système de protection remarquable qui empêche l’ADN de les pénétrer. Le fait que l’ADN alimentaire ne soit pas cancérigène prouve a contrario qu’il ne s’intègre pas dans les cellules – qu’il soit génétiquement modifié ou pas.
M. le Président : C’est heureux : sinon, nous serions condamnés à ne plus manger…
M. Pierre COHEN : Votre raisonnement ne me rassure pas…
M. le Président : Cela signifie simplement qu’à chaque fois qu’on mange, on mange de l’ADN.
M. Pierre COHEN : A ceci près qu’il est des produits que nous mangeons depuis très longtemps et dont nous sommes par conséquent certains de l’innocuité. Mais les autres ? Nous n’avons ni les échantillons de population ni le recul suffisant…
M. Philippe GAY : Si l’ADN que l’on mange pouvait s’intégrer dans les chromosomes, il aurait un rôle mutagène. Le fait que nous mangeons de l’ADN depuis des milliers d’années sans en être incommodés prouve que nos cellules en sont protégées.
M. Pierre COHEN : Mais ce nouvel ADN génétiquement modifié n’a-t-il pas plus de chances de « s’accrocher » ?
M. Philippe GAY : Il ne s’agit en l’espèce que de fragments, qui n’ont plus rien à voir avec la fonction.
M. Lilian LE GOFF : J’allais moi-même citer les travaux de Dorfler, lequel a établi que des fragments d’ADN pouvaient aller se retrouver jusque dans les noyaux des leucocytes… Que se passe-t-il en cas d’assimilation de transgènes ? En fait, vous posez le problème de l’adaptation de l’espèce humaine à tel ou tel animal ou végétal que notre organisme a appris au fil des temps à tolérer en tant qu’aliment, par le jeu de notre constitution génétique et de notre tolérance immunitaire.
Tout se passe comme si l’on ne voulait pas vraiment connaître les effets d’une exposition au risque potentiel que constitue l’alimentation d’un animal que nous consommons tous les jours. Deux cents prélèvements avaient été effectués en 1998 dans une ferme expérimentale de Maine-et-Loire, et mis au réfrigérateur sans avoir été analysés, faute de crédits… Les études n’ont depuis jamais été reprises, au motif que la traçabilité permettait désormais au consommateur de savoir ce qu’il mange !
J’en viens au problème des allergies. A-t-on effectué sur le rat des tests spécifiques de tolérance à l’exposition alimentaire, particulièrement au niveau de la muqueuse intestinale, à l’interface entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, qui joue un rôle fondamental dans l’acceptation ou non d’un facteur exogène ? S’est-on également intéressé à d’autres paramètres spécifiques aux réactions allergiques, comme le dosage des immunoglobulines ?
M. le Président : Mme Moneret-Vautrin est déjà venue devant plusieurs commissions pour traiter du thème des allergies. C’est elle qui a rédigé le chapitre consacré à l’allergie dans le rapport « OGM et santé » de l’Académie de médecine. Existe-t-il, en l’état actuel des connaissances, un risque allergique spécifiquement lié aux OGM ? Plus généralement, que faudrait-il faire dans notre pays pour mieux traiter du problème des allergies ?
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : Je commencerai par remarquer que la pulvérisation de bacillus thurigiensis, que jamais personne n’avait contestée, entraîne, par exposition respiratoire, une très nette sensibilisation… Autrement dit, alors que jamais ce phénomène, à ma connaissance, n’a été décrit pour l’insecticide Bt transgénique, la technique traditionnelle provoque bel et bien l’apparition d’un asthme professionnel.
M. le Président : A vous entendre, une technique couramment utilisée par les agriculteurs biologiques est la cause d’une maladie professionnelle.
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : Exactement. Le fait a été établi par les publications de Bernstein en 1999.
De même, la technique, connue des agronomes, qui consiste à accroître la résistance des plantes par des pulvérisations d’acide salicylique et d’oxyde d’éthylène a fait l’objet de remarquables travaux, lesquels ont établi qu’exalter la synthèse de certaines protéines de type PR dans les navets augmentait sensiblement le risque allergique du navet, particulièrement chez les sujets sensibilisés au latex.
Ces deux exemples montrent qu’il ne faut pas rester avec l’idée fixe que les OGM présentent un risque nouveau ; les techniques plus anciennes ou alternatives ont des risques allergiques connus et publiés.
Revenons aux OGM proprement dits, parmi lesquels je distinguerai les OGM dits de première génération, insecticides ou résistants aux herbicides, et ceux de deuxième génération.
S’agissant des OGM de première génération, tout le monde a entendu parler de la fameuse « épidémie » de réactions allergiques au maïs StarLink, dont ont été victimes des sujets ayant consommé des tacos de maïs contaminés par un maïs destiné à l’alimentation animale, lequel contenait une protéine dite Cry9C. Mais si cette affaire a suscité un très vaste mouvement d’opinion, on ne compte finalement que 53 cas référencés, sur lesquels l’analyse attentive n’en retient que 28 – dont aucun cas de réaction sévère ! –, autrement dit un chiffre infinitésimal, rapportés aux millions de consommateurs.
Certes, l’étude sérologique, manquant de rigueur scientifique, n’a pas permis d’exclure totalement le risque d’une allergie. Plus récemment, un test en double aveugle, comparant de la farine de maïs naturel et de la farine transgénique Cry9C, n’a pas davantage donné de résultats concluants, encore que l’on puisse critiquer le fait d’avoir mésestimé le risque d’une influence du process de grillage de la tortilla en ne testant que les farines de maïs crues… Le problème reste donc non résolu et on ne peut toujours pas affirmer ni nier qu’il n’existe aucune possibilité de risque. Voilà les seuls résultats publiés que nous avons pour le moment, alors que cette protéine est utilisée depuis déjà un certain temps.
M. Pierre COHEN : Vous avez parlé de 28 cas, mais sur combien de personnes exposées ?
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : On ne sait évidemment pas combien de personnes ont mangé les tacos en question, ni pendant combien de temps – peut-être deux ans. Reste que 28 personnes sur tout le territoire des Etats-Unis, c’est très peu.
M. Pierre COHEN : On peut imaginer que ce soit par rapport à un million de personnes.
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : Très probablement.
Dans les OGM de deuxième génération, le but est tout à fait différent, puisqu’il s’agira de transférer des protéines d’intérêt – peptides antibactériens, provitamines, éléments hypoallergéniques, vaccins, voire adjuvants améliorant l’immunité intestinale. Nous avons déjà à cet égard un cas princeps extrêmement intéressant sur le plan des connaissances, mais décrit comme un cheval de Troie, dans la mesure où il démontrait que l’insertion dans un soja d’une protéine de la noix du Brésil, qui en est précisément l’allergène majeur, présentait indéniablement un risque certain pour les sujets allergiques à la noix du Brésil. Le soja en question n’a évidemment jamais été commercialisé.
Ce cas aura eu le mérite de permettre de bien étayer les recommandations relatives à l’évaluation des essais OGM, avant même toute demande d’autorisation. Nous disposons heureusement de beaucoup plus de moyens d’identification dans le domaine des allergies alimentaires que les toxicologues, grâce notamment aux études sérologiques et à l’analyse du protéome de la cellule végétale. Pour peu que l’on se soit attaché au départ à détecter toutes les ressemblances avec des allergènes naturels par l’analyse de la séquence protéique, et vérifié dans un second temps qu’un grand ensemble de sérums bien validé ne donnera aucune relation avec cette protéine, il devrait être possible de créer un OGM dont la protéine ne présentera aucune similarité avec les allergènes naturels.
Le premier risque est lié à la dissémination par les pollens, sachant que le fait de se préoccuper en premier lieu des nourritures les plus importantes pour l’humanité – le blé, le riz, le maïs, la pomme de terre – se traduira inévitablement par une multiplication des sources d’exposition. Heureusement, si l’allergologue connaît bien le risque de sensibilisation à certains pollens – les pollens d’arbres ou de certaines graminées notamment –, les cas authentiques d’allergies liées au pollen de maïs ou de riz sont quasiment inconnus, sans doute parce que les pollens des herbacées cultivées sont lourds et ne voyagent pas. Il y a donc peu de risques d’y être exposé. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils n’existent pas : l’exposition à des pollens peut, on le sait, entraîner des allergies alimentaires croisées. Ainsi, une exposition au pollen de bouleau peut entraîner une sensibilisation au pollen de bouleau et, secondairement, une allergie à la pomme, à la noisette, à la pêche, etc. Mais si la protéine transgénique est représentée dans un pollen présentant des caractéristiques anémophiles, le risque devient indiscutablement réel.
Deuxième risque, celui qui serait lié à une altération de l’équilibre des allergènes propres de la plante – on sait que le blé est particulièrement riche en allergènes – dans le sens d’une surexpression ou d’une modification de la structure de ces allergènes telles qu’ils deviendraient encore plus allergéniques. Ce risque, théorique, doit pouvoir être décelé grâce aux sérothèques et aux études du protéome et par conséquent « barré » avant la commercialisation.
Troisième risque, le plus fréquemment agité, celui d’une protéine n’ayant rien de commun avec un allergène naturel et n’ayant rien modifié dans l’équilibre du protéome, mais qui révélerait un potentiel immunogène propre. Tout le problème sera d’étudier ce potentiel par rapport à des allergènes d’immunogénicité connue sur différents modèles animaux.
Certes, toute protéine, au contact de notre système immunitaire, est par définition immunogénique si elle ne fait pas partie du « soi ». La question est de savoir si ce potentiel immunogénique est infinitésimal ou particulièrement élevé. Mais nous disposons, avec les modèles animaux, d’une sorte de « cadre d’immunogénicité ». Nos connaissances des grands allergènes alimentaires devraient nous permettre de déterminer le potentiel d’une protéine transgénique avant commercialisation.
A supposer maintenant que cette protéine, très faiblement immunogénique, ait tout de même sensibilisé quelques individus hautement atopiques, voire davantage, la sensibilisation en soi n’est pas une pathologie – on peut être sensibilisé à des tas de choses et n’en être pas moins en parfaite santé… Il faut qu’il y ait expression de cette sensibilisation ; or l’expression de l’allergie alimentaire renvoie directement à la dose réactogène.
Nous avons désormais des idées très précises sur la quantité minimale réactogène chez une très faible partie de la population allergique à l’arachide, l’allergène réputé le plus dangereux. Il ne reste donc plus qu’à calculer les doses réactogènes que nous risquerions de voir passer en ne mangeant que du maïs OGM. La proportion de protéines transgéniques dans la plante se situant entre 1 et 400 ppm, on aura ingéré, en consommant une portion courante de 100 grammes, entre 1 et 400 microgrammes de cette fameuse protéine transgénique, alors que la dose réactogène de l’arachide ne descend pas en dessous de 500 microgrammes chez les plus sensibles de nos sujets précisément sélectionnés pour leur particulière allergie à ce produit. En fait, deux sujets seulement sur cent avaient réagi entre 500 microgrammes et 1 milligramme. Or jamais une protéine transgénique ne parviendra à mimer un allergène aussi dangereux que l’arachide. Il ressort de ces chiffres que les quantités fournies à l’alimentation paraissent entraîner un risque extrêmement faible.
Cela étant, il faudra une transparence et une surveillance post-marketing, ce qui suppose de disposer de toutes les connaissances nécessaires et particulièrement d’une sérothèque de référence, afin de mieux exploiter que ne l’ont fait les Américains lors de « l’épidémie StarLink », les cas qui se présentent pour en avoir le cœur net. Et si la surveillance post-marketing venait malgré tout à révéler un incident grave, la stratégie à employer serait la même qu’à l’AFSSAPS, où un médicament qui pose un problème est immédiatement retiré.
M. le Président : Ces longues explications ont le mérite d’être parfaitement claires. La détection du risque allergène fait actuellement l’objet d’une bataille au niveau international, l’école américaine estimant que l’on peut déterminer le caractère potentiellement allergène d’un aliment si l’on peut mettre en évidence une séquence de six acides aminés identiques aux épitopes connus, l’absence de cette séquence prouvant a contrario l’absence de caractère allergène, cependant que l’école européenne préconise la constitution, en parallèle, de sérothèques de référence. Les dispositifs que certains veulent imposer au niveau de la FAO vous paraissent-ils suffisants ?
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : N’étant pas biologiste moléculaire, je n’ai pas la compétence pour répondre. Des discussions sont effectivement en cours sur la longueur de l’épitope sur laquelle établir une identité.
M. le Président : Est-ce suffisant ?
Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN : Non, dans la mesure où ce procédé ne permet de détecter que des épitopes séquentiels. Seule la validation par sérums – ou par tests cutanés – permet de déceler d’éventuels anticorps aux épitopes conformationnels.
M. le Président : Venons-en aux bénéfices que pourraient apporter les OGM. L’AFSSA a commis un rapport qui a fait couler beaucoup d’entre, notamment à propos du « riz doré ». Mais un élément est resté confidentiel : l’effet bénéfique des OGM de première génération sur le taux de mycotoxines, moins élevé dans les maïs transgéniques que dans les maïs classiques.
M. Maxime SCHWARTZ : Avant de parler des bénéfices, l’AFSSA a naturellement comme première mission d’évaluer les risques sanitaires des OGM – possibles, comme dans toute innovation technologique, mais certainement pas probables dans la mesure où ils ne sont pas identifiés. Aussi avons-nous proposé des précautions supplémentaires, tant au niveau de la caractérisation, très précise, de la plante transgénique, que des aspects toxicologiques, en demandant un allongement de la durée des tests à 90 jours et en précisant bien que l’étude de toxicité ne devait pas porter sur la seule la toxine, mais bien sur toute la plante, en recherchant d’éventuels effets inattendus liés à l’insertion du gène dans la plante et théoriquement susceptibles d’induire des modifications métaboliques qui pourraient se traduire par des synthèses accrues de composés toxiques ou allergéniques. Nous avons également émis des recommandations sur le nombre d’animaux à utiliser et souligné les précautions à prendre pour obtenir des résultats significatifs.
Les risques n’étant pas identifiés, nous ne sommes pas dans le domaine de l’analyse quantitative, comme c’est le cas lorsque nous nous interrogeons sur les effets de la présence d’une toxine ou d’une bactérie pathogène, mais bien dans celui du principe de précaution.
Au-delà de la recherche du risque, l’AFSSA s’est également interrogée, comme cela se fait avec les médicaments, sur les bénéfices que pourraient apporter les OGM sur la santé, alors même que les OGM présents sur le marché, dits de première génération, n’ont pas été conçus dans ce but, mais avant tout pour répondre aux besoins des agriculteurs et de l’industrie semencière et agrochimique. Reste que, aux dires notamment de leurs promoteurs, les OGM résistant à des insectes ou tolérant à des herbicides présenteraient des avantages pour la santé, ce que nous avons entrepris d’analyser.
Dans le cas des OGM résistant à des insectes, autrement dit possédant dans leur génome un gène produisant une toxine capable de tuer des insectes spécifiques ou leurs larves, deux bénéfices étaient avancés : une moindre exposition du consommateur aux insecticides chimiques et une moindre exposition aux mycotoxines. Le premier peut paraître évident, le second peut-être moins, mais il découle du fait que les piqûres et attaques d’insectes provoquent dans la plante des lésions par lesquelles peuvent entrer des spores de moisissures qui, en se développant, produiront des mycotoxines souvent très dangereuses. Une plante résistant à des insectes sera par le fait moins sensible aux moisissures et contiendra moins de mycotoxines.
Les nombreuses données déjà collectées, particulièrement sur le coton Bt en Chine, font clairement état d’une amélioration de l’état de santé des agriculteurs par comparaison avec ceux qui cultivent le coton classique. La différence est moins évidente aux Etats-Unis dans le cas du maïs, du fait que cette plante exige peu d’insecticides, mais significative pour le coton, qui en réclame beaucoup. Autrement dit, la diminution des épandages d’insecticides par l’utilisation de plantes génétiquement modifiées se traduit certainement par un bénéfice pour l’agriculteur.
Pour ce qui est du consommateur, la question est d’abord de savoir si les insecticides classiquement utilisés peuvent nuire à sa santé. Or si ces produits ont été autorisés sur le marché, c’est bien que les doses prévues ne présentent, en principe, aucun risque. Il faudra des études épidémiologiques très poussées pour déterminer si les insecticides actuels peuvent réellement poser des problèmes de santé chez le consommateur, auquel cas on pourra en déduire que les OGM résistants aux insectes ont de fortes chances de réduire leurs effets nocifs. En attendant, l’incertitude demeure sur ce point.
Sur les mycotoxines, dont beaucoup sont des substances particulièrement dangereuses, les données dont nous disposons montrent clairement que l’on trouve moins de mycotoxines chez les plantes génétiquement modifiées, et des expériences réalisées sur des porcs et des poulets font état d’un meilleur taux de croissance des animaux qui les consomment. Il y a donc un bénéfice potentiel mais, comme dans le cas précédent, nous manquons de travaux épidémiologiques approfondis prouvant que les mycotoxines présentes dans les plantes normales ont des répercussions significatives sur la santé de la population française. Reste que, dans ce cas comme dans le précédent, il s’agit bien de bénéfices potentiels, donc identifiés, qu’il faut maintenant quantifier, alors que les risques liés aux OGM n’ont même pas d’identification précise.
Pour ce qui est maintenant des plantes tolérantes aux herbicides – nous avions pris le cas précis de la betterave résistante au glyphosate –, les choses ne sont pas plus claires. Par rapport aux autres herbicides, le glyphosate, du fait de ses caractéristiques physico-chimiques – faible liposolubilité, faible volatilité – présente un risque plus limité pour l’agriculteur. En revanche sa plus grande solubilité et stabilité en milieu aqueux en font un pesticide susceptible de présenter des inconvénients plus grands sur le plan de l’environnement. Pour le consommateur, faute de donnés épidémiologiques précises sur les conséquences en matière de santé de l’emploi des herbicides en général, nous serions bien en peine de dire exactement les avantages qu’apporterait l’emploi du glyphosate par rapport à celui d’autres herbicides. Dans le cas particulier de la betterave à sucre, aucun des résidus d’herbicides appliqués à la betterave n’a de chance de se retrouver dans le sucre lui-même, compte tenu du processus de purification : il n’y aura donc pas de bénéfice direct à attendre pour le consommateur.
Nous nous sommes également intéressés à un OGM de deuxième génération, le « riz doré » enrichi d’un précurseur de la vitamine A afin d’apporter un complément vitaminique à des populations qui en sont gravement dépourvues. Une énorme polémique s’est fait jour sur la question de savoir si le « riz doré » pouvait réellement apporter un bénéfice en termes de santé publique. Mais, là encore, nous sommes dans l’incertitude scientifique, en particulier pour ce qui touche au taux de conversion de la provitamine A présente dans le riz en vitamine A elle-même. Ce taux, selon les auteurs, varie d’un facteur 3, ce qui conduit au fil des calculs à des différences énormes dans l’appréciation de la quantité de riz à consommer pour espérer un effet significatif. A en croire les évaluations les plus positives, 300 à 600 grammes de riz sec par jour suffiraient pour obtenir un résultat palpable, ce qui reste dans l’ordre de grandeur des quantités de riz ordinairement consommées par les populations concernées. Mais si l’on prend les évaluations les plus négatives, autrement dit le taux de conversion le plus bas, on arrive à des quantités de riz à ingérer de quatre ou cinq kilos par jour… D’autres facteurs prêtent également à interrogation, comme la stabilité de la provitamine A à la cuisson ou l’influence de la teneur en lipides des aliments consommés en même temps que le riz sur l’absorption de cette provitamine A. On peut donc en déduire, non que le « riz doré » soit la solution aux carences en vitamine A, ni davantage que l’idée soit absurde et irréaliste, mais seulement que cette approche ne mérite pas d’être condamnée d’emblée et vaut la peine d’être poursuivie.
En conclusion, on peut dire que les OGM, y compris ceux qui n’ont pas été conçus dans ce but, présentent des bénéfices potentiels pour la santé qui méritent d’être étudiés en détail et d’être mis en balance avec les risques possibles. Les recherches sur les OGM susceptibles d’apporter des bénéfices pour la santé méritent d’être poursuivies. Mais il faudra soumettre les bénéfices en question à une analyse quantitative approfondie et développer une approche bénéfice/risque.
M. Gabriel BIANCHERI : Mais pourquoi le maïs OGM contient-il moins de mycotoxines ?
M. Maxime SCHWARTZ : Du fait qu’un maïs insecticide présente moins de lésions causées par les insectes, les spores des moisissures y entrent moins facilement.
M. le Président : Les taux de mycotoxines aujourd’hui relevés sur nos maïs sont-ils seulement conformes aux normes internationales communément admises, ou nettement en dessous ?
M. Maxime SCHWARTZ : Cela dépend des années et des conditions climatiques.
M. le Président : Quels sont les taux admis par la réglementation internationale ?
M. Gérard PASCAL : J’ai participé aux discussions internationales, dans le cadre de la commission du Codex alimentarius, visant à arrêter un standard pour l’aflatoxine B1 dont les effets cancérogènes sont reconnus.
M. le Président : Et que l’on retrouve dans les cacahuètes.
M. Gérard PASCAL : Dans le maïs également.
Les Américains proposaient en fait de fixer la norme à un niveau tel que, si toute la production de céréales venait à l’atteindre, il s’ensuivrait une augmentation des cancers primitifs du foie dans la population européenne, mais trop faible pour être mise en évidence sur le plan statistique… Force est de reconnaître que nous sommes souvent bien en dessous, mais que, de temps en temps, dans certaines configurations de parcelles et certaines conditions climatiques, on peut approcher le taux limite. L’Europe est avantagée par ses conditions climatiques qui lui permettent d’en rester à des teneurs en aflatoxine B1 beaucoup plus faibles que les Américains. D’où cette bataille entre Européens et Américains, dans laquelle on cherche à utiliser les toxicologues à des fins de lutte commerciale et économique.
M. Philippe GAY : La minoterie est très préoccupée par la présence de vomitoxines et autres toxines produites par des champignons pathogènes. Aussi a-t-elle coutume de mélanger les lots pour abaisser la concentration moyenne à des niveaux reconnus comme étant sans danger. La spécificité de l’aflatoxine aux Etats-Unis est liée aux habitudes d’autoconsommation. Pour peu qu’un agriculteur fasse de l’autoconsommation et qu’un de ses lots soit particulièrement touché, c’est tout son élevage de porcs qui disparaît ou qui présente un problème majeur de fécondité.
M. le Président : M. Le Goff réclamait la semaine dernière l’étiquetage de tous les produits issus d’animaux ayant consommé des OGM. Cette position est également défendue par Greenpeace, M. Apoteker déclarant dans un article du Monde : « L’industrie OGM est chancelante, le coup de grâce serait de lui fermer la filière de l’alimentation animale. »
M. Lilian LE GOFF : Tout à fait.
M. le Président : C’est donc très clairement de la stratégie. Mais y a-t-il entre les tourteaux non-OGM et les tourteaux issus d’OGM une différence qui justifierait cette demande ? Plus encore, que répondez-vous à M. Schwartz lorsqu’il affirme que, en raison probablement d’un taux moins élevé de mycotoxines, les animaux nourris aux tourteaux OGM se portent mieux que les autres ?
M. Lilian LE GOFF : A supposer que l’incidence des OGM sur le taux de mycotoxines soit précisément établie, si l’on évite un risque pour mieux s’exposer à un autre, en l’occurrence une consommation accrue d’insecticides, je ne vois guère l’intérêt pour le consommateur…
M. Maxime SCHWARTZ : A ceci près que l’on sait les mycotoxines toxiques, alors que les multiples études conduites sur la toxine Bt ont démontré son innocuité pour l’homme.
M. Lilian LE GOFF : Tout est question de dose : il reste à prouver que les toxines Bt concentrées sont inoffensives.
M. le Président : Les tourteaux de soja bloqués dans le port de Lorient présentent-ils un taux de toxine plus élevé que les autres ?
M. Lilian LE GOFF : Notre problème à nous, consommateurs, n’est pas d’apporter des preuves…
M. le Président : Vous représentez ici les associations de protection de l’environnement, et M. Andrault les consommateurs.
M. Lilian LE GOFF : Nous sommes également habilités à parler pour la consommation. Lorsque nous leur demandons des preuves, les services habilités ne nous répondent pas. Et lorsque nous obtenons des réponses à nos questions, c’est l’incertitude.
M. le Président : Il ne devrait pas être difficile de mesurer et de vérifier s’il y a des différences significatives en termes de présence de toxine Bt entre des tourteaux de soja classiques et des tourteaux transgéniques.
M. Lilian LE GOFF : Nous avons posé la question à la DGAL depuis plusieurs années, sans jamais obtenir de réponse.
Mme Sophie VILLERS : La réponse vous a été donnée par l’AFSSA : rien ne permet de démontrer que les tourteaux de soja génétiquement modifié aient un taux de toxine supérieur aux autres. Ce serait même potentiellement le contraire.
M. Lilian LE GOFF : Lorsque nous demandons les dosages, on ne nous les communique pas. Et les métabolites ?
Mme Sophie VILLERS : Cela relève des instances scientifiques.
M. le Président : J’ai déjà traité au Parlement d’affaires analogues et notamment de la radioprotection. Les associations auxquelles nous avions alors affaire faisaient état de taux de radioactivité précis car elles avaient des équipes capables de les mesurer. C’est le cas du CRII-GEN53 ou de Greenpeace. Et s’il est établi qu’il y a des différences, nous devons évidemment réagir.
M. Lilian LE GOFF : Indépendamment de la détermination de l’exposition au risque se pose la question du droit fondamental de tout un chacun à être informé sur ce qu’il consomme.
M. le Président : Justement : les mycotoxines, ce n’est pas drôle !
M. Lilian LE GOFF : Sachant que l’opinion publique est à 80 % opposée à l’idée de consommer des OGM, le minimum serait de permettre au consommateur de savoir si ce qu’il mange provient ou pas d’animaux nourris au soja transgénique. C’est le B-A – BA de l’accès à l’information.
M. le Président : M. Apoteker, dont j’apprécie les qualités intellectuelles, écrit dans Le Monde que c’est une affaire de stratégie et que le but est de bloquer la filière. Soit. Mais que ferez-vous dans le cas du veau sous la mère qui aura été par accident nourrie une seule fois aux OGM ? Faudra-t-il étiqueter ? C’est rigoureusement impossible.
M. Lilian LE GOFF : Nos positions sont radicalement opposées…
M. le Président : Je le sais.
M. Lilian LE GOFF : Le minimum que l’on doit au consommateur, c’est de l’informer sur ce qu’il consomme.
M. le Président : Ce n’est pas lui qui consomme, mais l’animal. Et si l’on s’est un jour trompé de sac, faudra-t-il étiqueter ?
M. Lilian LE GOFF : Certains producteurs qui ont le souci de la qualité et de l’information du consommateur ont mis en place des filières d’importation de soja brésilien assorties de mécanismes de traçabilité prouvant l’origine non-OGM.
M. Gabriel BIANCHERI : Il n’est absolument pas certain que ces sojas soient totalement non-OGM !
M. Lilian LE GOFF : L’agriculture biologique est la seule de toutes les productions labellisées à pouvoir garantir la traçabilité de l’alimentation donnée aux animaux.
M. Gabriel BIANCHERI : Là aussi, rien n’est moins sûr !
M. Lilian LE GOFF : Pourquoi l’agriculture conventionnelle ne suivrait-elle pas cette voie ?
M. le Président : Etes-vous d’accord pour faire également connaître le taux de mycotoxines ?
M. Lilian LE GOFF : Evidemment.
M. le Président : Le problème est que, dans l’agriculture biologique,…
M. Lilian LE GOFF : Les contrôles sont faits.
M. le Président : En effet, à ceci près que les cahiers des charges décrivent les obligations de moyens à respecter pour obtenir le label AB, mais ne fixent aucune obligation de résultat en termes de présence d’insecticides, de pesticides ni de mycotoxines. Si l’on fixe un taux de présence maximum d’OGM dans l’agriculture biologique, il doit en être de même pour tous les autres critères.
M. Lilian LE GOFF : Les organes de certification indépendants comme ECOCERT54 cherchent précisément à étendre cette obligation de résultat. Un produit contenant des traces de pesticides ou de mycotoxines n’est pas labellisé AB.
M. Patrice DAUCHET : La DGCCRF comme la DGAL effectuent, pour les mycotoxines notamment, des contrôles très réguliers dans le cadre de plans de surveillance. Reste que les vérifications opérées sur les produits d’origine nationale comme sur les produits importés ont pour but de s’assurer du respect des normes, et non de détecter des différences de teneur entre les produits OGM et les autres.
S’agissant de l’agriculture biologique, il n’existe, dans l’état actuel de la réglementation, aucune obligation de résultat.
M. Lilian LE GOFF : On y tend…
M. le Président : Il en faudrait.
M. Lilian LE GOFF : Tout à fait d’accord.
M. Patrice DAUCHET : Les organismes de certification poussent, il est vrai, à une évolution dans ce sens. Mais ils tolèrent pour l’heure des traces d’aflatoxine ou de pesticides, à des taux certes bien inférieurs aux limites maximales en résidus (LMR) prévues.
M. le Président : Les mesures effectuées montrent-elles des différences significatives en termes de présence de résidus de pesticides entre l’agriculture conventionnelle et l’agriculture biologique ?
M. Patrice DAUCHET : Il est difficile de répondre. Nos contrôles ne peuvent être considérés comme statistiquement significatifs par le fait qu’ils sont ciblés sur les productions à risque. Cela dit, l’utilisation des pesticides dans l’agriculture conventionnelle s’est tellement améliorée que les produits contrôlés présentent fréquemment un taux très bas et parfois totalement nul.
M. Maxime SCHWARTZ : Je reviens aux tourteaux. Tout dépend de la toxine dont il est question. Les tourteaux de soja génétiquement modifié contiendront évidemment plus de toxine Bt que les tourteaux non-OGM, dans des quantités toutefois bien inférieures au maximum admis. Pour ce qui est des mycotoxines, plusieurs études font état de taux significativement plus faibles, notamment de fumonisine B1, dans les plantes OGM par comparaison avec les plantes conventionnelles.
M. Olivier ANDRAULT : Si une majorité des consommateurs européens refuse tout OGM dans son alimentation, un quart environ reste indifférent, alors même que la plupart se déclarent intéressés par les applications biotechnologiques à but thérapeutique. Mais si les risques à court terme font d’ores et déjà l’objet de procédures cadrées au niveau national comme au niveau européen, les incertitudes sur les bénéfices restent trop nombreuses pour que les différents profils de consommateurs puissent choisir en leur âme et conscience. Aussi avons-nous demandé à plusieurs reprises que les procédures d’évaluation des OGM ne se limitent pas aux risques sanitaires et toxicologiques, mais soient élargies afin de devenir une véritable évaluation bénéfice/risque.
M. le Président : Ce sera noté dans nos recommandations.
M. Lilian LE GOFF : J’aimerais que le rapport mentionne également l’existence d’alternatives aux OGM…
M. le Président : Nous en sommes parfaitement d’accord, mais cela relève du débat économique et non du débat sur la santé.
M. Lilian LE GOFF : Un rapport de la FAO a montré que la comparaison entre des lots de bétail nourris aux céréales conventionnelles traitées aux fongicides – pour éviter précisément les mycotoxines – et d’autres lots nourris avec des produits céréaliers bio, donne des résultats très nettement en faveur du bio, d’autant que les traitements fongicides n’éliminent pas toutes les mycotoxines, en particulier celles qui sont liées au stockage.
M. le Président : Cela ne met pas en cause les OGM…
M. Lilian LE GOFF : Non, mais ce sont des alternatives aux OGM et cela doit faire partie du débat. Pourquoi nous exposer à des risques potentiels en contrepartie d’avantages qui restent à prouver, alors que nous disposons déjà de solutions beaucoup plus autonomes et économes ? Les OGM répondent-ils au concept de développement durable ? Celui-ci n’appelle-t-il pas d’autres solutions ?
M. le Président : Cette question, majeure, sera abordée lors de la table ronde économique. Mais il en est une autre, que les chercheurs nous ont tous posée lorsque nous les avons rencontrés sur le terrain : pourquoi nous priver a priori d’une technique qui peut venir en complément des autres ? Et pourquoi les empêche-t-on de chercher, alors que le but de leurs recherches est précisément de répondre aux questions posées par la société ? Peut-on croire des gens qui posent des questions parfaitement légitimes tout en empêchant d’y répondre par la recherche ?
M. Lilian LE GOFF : Nous ne sommes pas irresponsables : nous sommes les premiers à déplorer que l’on aille aussi vite dans les applications de la biotechnologie sans donner à la recherche fondamentale le temps et les moyens de mieux comprendre le fonctionnement et la régulation du vivant et donc de mieux maîtriser ses applications ultérieures, particulièrement en milieu ouvert. Le rapport des « 4 Sages » ne recommandait-il pas de commencer par tirer le meilleur parti des données recueillies en milieu confiné ?
M. le Président : J’en reste persuadé. Nous étions d’accord pour les expérimentations en milieu ouvert à la triple condition de parcimonie, de précaution et de transparence. Mais quand des gens prétendent faire le bonheur de l’humanité en refusant toute expérimentation, nous sommes évidemment en décalage. Parmi les expériences détruites, on compte des essais en serre, des recherches médicamenteuses, des tests de résistance au stress hydrique et de fixation de l’azote ou encore des mesures des flux de transgènes. Sans parler de l’essai sur les caféiers de Guyane, détruit dans des circonstances mystérieuses.
M. Lilian LE GOFF : Le peu de moyens dont dispose la recherche publique indépendante est consacré pour la plus grande part aux biotechnologies, au détriment des disciplines classiques et de la mise au point de solutions alternatives. La lutte intégrée reste le parent pauvre et l’autosuffisance alimentaire une préoccupation secondaire. Nous importons plus de 70 % de protéines végétales pour nourrir les animaux, essentiellement sous forme de soja, ce qui rend le problème du transgénique d’autant plus aigu. Il devient particulièrement urgent de rééquilibrer nos ressources en protéines, et la recherche, fondamentale et appliquée, a son mot à dire. Encore faudrait-il qu’elle ait les moyens.
M. le Président : Vous posez de vraies questions, mais nous ne pouvons les aborder aujourd’hui. On pourrait y ajouter celle, que j’ai évoquée dans mon rapport sur les biotechnologies, de la préservation de notre capacité d’expertise en biologie végétale, toutes disciplines confondues. Marion Guillou, la présidente-directrice de l’INRA, a lancé un cri d’alarme. Notre capacité d’expertise disparaît et nous perdons peu à peu tous nos chercheurs, et ce dans toutes les disciplines. Nous devons nous interroger sur les raisons de ce déclin.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous de la production de médicaments par des plantes génétiquement modifiées ? On nous a beaucoup parlé, en Auvergne, de la lipase qui sert au traitement de la mucoviscidose. Les chercheurs ont été extrêmement choqués par la destruction de leur essai. Quels bénéfices peut-on espérer de ces productions, quels risques faut-il éventuellement redouter ? On nous dit que les coûts de production pourraient être divisés par vingt. Du côté des risques, on peut craindre les effets d’une dissémination et de l’absorption par les animaux, voire par les humains.
M. Olivier ANDRAULT : Tous les sondages montrent que l’attitude des consommateurs à l’égard des OGM est radicalement différente lorsqu’il s’agit de productions à but thérapeutique. Encore faudra-il mettre en place une véritable ségrégation pour éviter tout risque de dissémination, en particulier vers la filière alimentaire. Un accident est déjà survenu aux Etats-Unis, où un maïs génétiquement modifié à usage vétérinaire a contaminé des maïs alimentaires. Sous réserve de dispositions contraignantes propres à éviter de tels accidents, la thématique peut être intéressante.
On peut également se demander s’il est bien pertinent de choisir comme support de ces modifications génétiques des plantes initialement destinées à l’alimentation humaine, au risque d’accroître la confusion entre les filières.
M. Bruno CLÉMENT : Les médicaments biologiques présentent de gros avantages par rapport aux molécules chimiques jusqu’alors utilisées, auxquelles on peut reprocher leur toxicité et leur large spectre, qui provoquent des effets difficiles à maîtriser. Les médicaments biologiques permettent de gagner en efficacité et en prédictibilité tout en limitant les effets indésirables. Après les bactéries, les cellules, voire les petits animaux, l’intérêt s’est porté sur les plantes qui, grâce à l’insertion d’un gène spécifiquement codé pour une protéine humaine, peuvent produire des molécules à visée thérapeutique. Outre le fait que les opérations d’extraction et de purification des molécules ainsi produites sont grandement facilitées, la capacité de production des plantes est sans commune mesure avec celle des bactéries en boîtes de culture où des contaminations sont toujours à craindre.
La production de médicaments biologiques est devenue un enjeu majeur. Depuis l’insuline en 1982, l’efficacité de la production de molécules humaines dites recombinantes a été grandement améliorée. Nous travaillons également sur des facteurs de coagulation, l’hormone de croissance…
M. le Président : Et l’EPO.
M. Bruno CLÉMENT : En effet. L’EPO ne sert pas qu’aux cyclistes… Aujourd’hui, 8 % des médicaments sont en fait d’origine OGM et leur part devrait rapidement atteindre 50 %.
J’ai entendu M. Le Goff parler tout à l’heure d’insertion d’ADN d’OGM dans les cellules. S’il a une technique, je lui propose un poste dans mon laboratoire : il est extrêmement difficile, et même impossible, sans des moyens technologiques très puissants, de faire entrer de l’ADN dans une cellule. Même les virus ont bien du mal : un des plus malins, pourtant spécialement équipé pour ce faire, le virus de l’hépatite B, n’y parvient que sur 0,2 % à 0,5 % des malades infectés.
M. Lilian LE GOFF : Ce n’est pas moi qui ai prétendu qu’il était possible d’insérer des traces d’ADN dans les noyaux des leucocytes, mais M. Dorfler. C’est lui que vous devriez inviter dans votre laboratoire.
M. Bruno CLÉMENT : En effet : mes étudiants apprécieraient…
M. Lilian LE GOFF : Il serait en tout cas intéressant de rencontrer les équipes qui ont levé le lièvre.
M. Bruno CLÉMENT : Il y a une grande différence entre faire entrer de l’ADN dans une cellule, ce que fait très bien un macrophage qui captera tout débris passant à proximité, et intégrer l’ADN et le rendre fonctionnel.
M. Lilian LE GOFF : Rappelons que, tout comme vous, Mmes et MM. les députés, nous sommes là pour poser des questions plutôt que pour apporter des preuves. Et nous aimerions avoir des réponses. Poser les bonnes questions, c’est déjà faire avancer le débat.
M. le Président : Nous, nous essayons surtout de clarifier les choses. Contrairement à ce que certains ont prétendu, nous avons évoqué toutes les questions et permis à tout un chacun de s’exprimer, pour peu qu’il soit représentatif. Les autres associations participeront à la table ronde sur l’environnement.
On songe en Auvergne à cultiver 21 hectares de maïs pour produire de la lipase pancréatique. Cela vous paraît-il justifié ? Pensez-vous qu’il puisse y avoir un risque de contamination ?
M. Gérard PASCAL : La question du risque de contamination vaut pour les plantes génétiquement modifiées à finalité thérapeutiques, mais également pour les plantes génétiquement modifiées aux fins de produire des substances d’intérêt industriel. Mais les techniques de prévention existent d’ores et déjà, lorsqu’il s’agit, par exemple, d’éviter que des colzas enrichis en acide érucique cultivés à des fins énergétiques, ou pour produire des traitements contre certaines maladies neurologiques, ne viennent contaminer des colzas à usage alimentaire. Les semenciers disposent également d’un arsenal de techniques destinées à éviter les mélanges non souhaités. Regardons ce que savent déjà faire les opérateurs agricoles.
M. le Président : D’autant que les flux de gènes sont relativement faciles à maîtriser pour le maïs par comparaison avec le colza.
M. Bruno CLÉMENT : L’intérêt pour le patient serait assez évident, puisque la lipase était jusqu’à présent extraite des porcs. Une autre production envisagée est celle de collagène à partir du tabac. L’avantage serait de disposer, pour les greffes de peau, les colles biologiques, la cicatrisation, d’un collagène « humain » par sa conception, alors que le collagène jusqu’alors utilisé est d’origine bovine. Depuis la vache folle, la production a été stoppée. On a bien essayé de l’extraire du poisson, mais les techniques de purification sont très complexes, sans parler du risque de réactions allergiques. Autant dire que les OGM présentent sur ce plan un réel intérêt pour les patients.
M. Philippe GAY : La Limagne, grande productrice de semences de maïs, a une longue expérience en matière d’isolement des champs. D’autres départements producteurs de semences, comme le Gers, sont également connus pour leur savoir-faire. Cela dit, il faudrait distinguer le cas de la lipase et celui de l’EPO : si manger un épi de maïs à la lipase ne fait guère courir de risques, est-il bien conseillé de manger de l’EPO ? Mieux vaudrait, dans ce cas d’espèce, recourir à la culture sous serre pour éviter tout problème.
M. Olivier ANDRAULT : Faut-il en conséquence adapter les conditions de ségrégation d’une culture OGM en fonction du danger potentiel que représenterait une ingestion accidentelle ?
M. Bruno CLÉMENT : Sans doute.
M. le Président : Dans le cas de molécules médicamenteuses, sûrement. La problématique est totalement différente de celle des productions alimentaires. Viendra ensuite la mise en place du dispositif d’autorisation des cultures et des études.
Venons-en maintenant au problème de l’étiquetage. Le dispositif mis en place au niveau européen, fruit d’un compromis entre Etats membres, a fixé un taux maximum de contamination fortuite de 0,9 % au-dessus duquel l’étiquetage est obligatoire. Les taux applicables aux semences et à l’agriculture biologique sont toujours en discussion. Et quid des contaminations par des expérimentations de produits non encore autorisés sur le marché ?
Le taux de 0,9 % n’est en aucun cas un seuil de dangerosité, l’absence de danger ayant déjà été prouvée par les analyses préalables à la mise en marché. Cela dit, un étiquetage est nécessaire pour respecter le droit du consommateur à être informé. Encore faut-il savoir si le taux tel qu’il a été fixé par la Commission permet au consommateur de savoir réellement ce qu’il consomme.
Mme Sophie VILLERS : Précisons qu’un aliment contenant intentionnellement des OGM, fût-ce 0,1 %, doit systématiquement être étiqueté. Le seuil de 0,9 % ne vaut que pour les « contaminations » accidentelles.
M. le Président : Mêmes les produits extraits d’OGM et qui ne contiennent même plus de traces d’ADN doivent être étiquetés.
Mme Sophie VILLERS : Précisons également que ces « contaminations » doivent être le fait d’OGM ayant fait l’objet d’une autorisation de mise en marché, autrement dit considérés comme ne présentant aucun risque pour la santé humaine.
M. le Président : Et l’expérimentation ?
Mme Sophie VILLERS : Tant qu’il n’y a pas d’autorisation de mise en culture ou d’importation de l’OGM considéré, le seuil est de 0 %.
M. le Président : C’est impossible !
Mme Sophie VILLERS : Puisqu’il n’y a pas d’autorisation…
M. le Président : Mais vous avez autorisé l’expérimentation !
Mme Sophie VILLERS : En cas de contamination par un OGM non autorisé sur le marché destiné à la consommation humaine, le seuil est de 0 %.
M. Philippe GAY : Donc il n’y a pas d’expérimentation.
Mme Sophie VILLERS : En l’état actuel des choses…
M. le Président : Il y a une certaine tolérance.
Mme Sophie VILLERS : Non.
M. Lilian LE GOFF : Nous voilà au cœur du problème. Aucun assureur n’étant disposé à assurer contre le risque de contamination et aucun régime de responsabilité et de réparation n’étant défini par l’Etat, nous nous trouvons devant une carence juridique que les producteurs bio, pour en avoir été les victimes, ont été les premiers à mettre en évidence.
Mme Sophie VILLERS : Si je comprends bien, on nous demande de faire preuve de tolérance, y compris pour les OGM non autorisés…
M. le Président : Nous ne demandons rien : nous constatons seulement que vous n’avez pas réglé le problème des expérimentations, alors que c’est votre ministre qui signe les autorisations. De ce fait, c’est lui qui sera responsable en cas de contaminations fortuites. M. Le Goff a raison : il faut un régime des expérimentations.
M. Patrice DAUCHET : Ces expérimentations sont subordonnées au respect de précautions particulières qui vont bien au-delà de celles qui seraient exigées de cultures commerciales. De fait, les risques de contaminations sont extrêmement limités.
M. le Président : Nous interrogerons M. Messéan, vice-président de la CGB, sur ce sujet lors de la prochaine table ronde. Aucune précaution ne peut garantir la contamination zéro.
M. Gérard PASCAL : Les prescriptions de la CGB ont pour objet de réduire au maximum les contaminations possibles. Si le risque pour le maïs en sera considérablement réduit, pour le colza en revanche on ne parviendra jamais à la contamination zéro, dans la mesure où son pollen peut voyager très loin.
M. Philippe GAY : Zéro, c’est zéro. Autrement dit, c’est l’interdiction de toute expérimentation. C’est extrêmement grave. Une contamination fortuite est par définition… fortuite, donc incompatible avec le risque zéro. Et si les expérimentations sont impossibles en France, elles se feront ailleurs, au grand dam de la science française, particulièrement dans le domaine de la biologie végétale.
M. Lilian LE GOFF : Au-delà du problème de la réglementation se pose celui de la spécificité des semences et du respect de la biodiversité.
M. le Président : Focalisons-nous sur le seul aspect sanitaire.
M. Lilian LE GOFF : J’aime à mettre un détail en perspective… A rester l’œil rivé sur le microscope, il arrive de passer à côté d’éléments importants.
Discuter du taux de contamination fortuite revient, de fait, à normaliser la pollution liée aux pollens transgéniques et donc à porter atteinte à l’intégrité des semences à vocation notamment commerciale et alimentaire. Il ne peut être question de tolérer ces contaminations fortuites, le taux de 0,9 % rendant difficiles le contrôle et le suivi de la dissémination et interdisant la mise en œuvre d’une réelle traçabilité en cas d’incident sanitaire, économique et écologique. Nous partageons pleinement les exigences de transparence, de traçabilité et de qualité que se sont fixées les Etats membres de l’Union pour garantir une agriculture préservant la santé comme l’environnement. Ces exigences doivent s’appliquer dès le stade des semences, ce qui suppose de rendre l’étiquetage obligatoire sitôt dépassé le seuil de détection. Celui-ci est de 0,1 % pour le moment, mais il pourra évoluer à mesure que les techniques se perfectionneront.
M. le Président : Cette interprétation peut avoir deux effets : ou bien elle aboutira à interdire purement et simplement les OGM, ce que souhaitent certains, ou bien elle entraînera leur banalisation totale, dans la mesure où tout sera étiqueté.
M. Lilian LE GOFF : Vous verrez alors les réactions des consommateurs…
M. le Président : Il peut se produire une certaine forme de fatalisme.
M. Lilian LE GOFF : Nous ne parlions que des semences.
M. le Président : Plusieurs personnalités auditionnées ont déjà mis en avant la complexité d’un système où le taux de contamination fortuite varie en fonction des cas – expérimentations, semences, autorisations de mise en marché, productions biologiques –, voire des espèces ! En fin de compte, personne ne comprend plus rien à ce nœud de procédures : pourquoi une substance considérée comme non dangereuse, expertisée, homologuée serait-elle soumise à des taux de contamination différents de ceux que l’on tolère pour des contaminants classiques ? Il existe déjà un taux limite de présence d’espèces contaminantes pour l’agriculture biologique ou pour les semences. On voudrait en créer un nouveau pour des OGM déjà habilités et reconnus non toxiques ! C’est une usine à gaz. Pour ma part, je défendrai devant la mission d’information le principe d’un taux de contamination unique, complété par un dispositif propre aux expérimentations. Il n’y a aucune raison, sauf à interdire explicitement les OGM, de mettre en place un dispositif spécifique, alors même que l’on tolérera la présence d’autres contaminants parfois dangereux dans l’industrie semencière ou l’agriculture biologique.
M. Lilian LE GOFF : On ne peut pas accepter une marge de tolérance trop large : tous les spécialistes s’accordent à reconnaître que, compte tenu du caractère envahissant, hégémonique et irréversible de ces contaminations, jamais un taux de l’ordre de 0,9 % ne permettra de garantir la spécificité des filières de qualité, en particulier biologiques. La moindre suspicion dans l’esprit du consommateur leur ferait courir un risque commercial et économique mortel.
M. le Président : Votre remarque est très juste, mais vous savez fort bien que plus le seuil descendra au-dessous d’un point d’équilibre estimé à 3 %, plus il créera des surcoûts, payés au bout du compte par le consommateur. Les producteurs eux-mêmes nous ont appris qu’un soja importé du Brésil et certifié non contaminé leur coûtait près de 10 % plus cher. Leurs filières se sont engagées par contrat avec les grandes surfaces à livrer des animaux nourris sans OGM, sans même pouvoir les labelliser comme tels, grevant d’autant leurs coûts de production pour des raisons finalement de marketing. Ou bien la grande distribution étranglera le petit producteur, ou bien elle fera payer le consommateur.
M. Lilian LE GOFF : Nous avions décrit dès 1997 les conséquences économiques de la traçabilité. La question est de savoir à qui incombe la charge de la preuve et qui doit supporter les coûts induits par un nouveau procédé. Pourquoi le consommateur devrait-il en assumer les conséquences ?
M. le Président : Le surcoût ne tient pas au procédé, mais à l’autocensure qui pousse à instaurer des seuils de plus en plus contraignants, rendant de plus en plus difficile la coexistence entre les différents types de culture. Pourquoi la norme AB-ECOCERT tolère-t-elle 5 % ?
M. Lilian LE GOFF : Ces 5 % correspondent à des ingrédients qu’il est impossible de produire en bio.
M. Patrice DAUCHET : Effectivement, ce seuil de 5 % est d’un autre type : on admet dans un produit décrit comme issu de l’agriculture biologique la présence de 5 % d’ingrédients non obligatoirement bio, parce que non disponibles en agriculture biologique. Mais cela n’a rien à voir avec le seuil OGM.
M. le Président : On pourrait très bien imaginer que, compte tenu des nécessités liées à la coexistence des cultures, ce taux s’applique également aux OGM. La problématique est de même nature.
M. Patrice DAUCHET : A ceci près que c’est l’agriculture biologique elle-même qui a choisi de s’interdire l’utilisation d’OGM. La réglementation européenne prévoit la possibilité de fixer un seuil OGM spécifique à la bio, mais celui-ci n’a pas encore été déterminé. Aussi, dans l’état actuel de la réglementation communautaire, notre analyse, partagée par la Commission, est-elle qu’un produit bio peut contenir jusqu’à 0,9 % d’OGM.
M. le Président : C’est la première fois que l’on nous donne cette interprétation, effectivement très importante.
M. Olivier ANDRAULT : La possibilité d’un étiquetage « non-OGM » pour les produits des filières animales nous semble tout à fait pertinente. Il n’y a rien de byzantin à s’interroger sur la façon dont cela devrait se traduire dans les conditions d’alimentation de ces animaux : l’absence d’OGM doit-elle être prise dans son sens absolu, sans tolérer le moindre grain ? Y a-t-il des limites de temps ? Des questions du même ordre se posent déjà dans des domaines très divers : ainsi, un produit laitier étiqueté 0 % de matières grasses en contient en fait une certaine quantité, pour des raisons d’ordre technique. De même la présence de certains ingrédients non biologiques dans les produits bio. L’alimentation des animaux est une thématique qui intéresse le consommateur, à telle enseigne que les professionnels fournissent d’ores et déjà, par le biais du certificat de conformité de produit, une information garantie sur l’alimentation des poulets, par exemple. Tout cela participe de l’information du consommateur, et il serait intéressant de continuer d’y travailler en intégrant la problématique OGM.
M. le Président : L’Union européenne a imposé l’étiquetage de tous les produits issus de plantes génétiquement modifiées, quand bien même il est impossible d’y trouver la moindre trace d’ADN. Cette décision, elle aussi politique, vous paraît-elle logique ? Ne conduit-elle pas à donner un avantage compétitif aux pays qui nous vendront les mêmes produits sans s’embarrasser de ces considérations ?
M. Gérard PASCAL : J’ai cru sentir tout au long de ce débat une certaine confusion entre le problème du risque sanitaire – très mineur, à supposer qu’il existe – et la nécessité de l’information du consommateur, pour laquelle, indépendamment des motivations d’ordre sanitaire et de suivi post-marketing, le but est de donner la plus grande liberté dans le choix des produits que l’on entend consommer ou rejeter au nom de considérations politiques, éthiques, voire religieuses – auquel cas le problème n’est plus de savoir si le produit contient des traces d’ADN décelables ou non. Cela n’a rien à voir avec les aspects sanitaires. Pour autant, je conçois que la question puisse se poser.
M. Lilian LE GOFF : C’est un problème fondamentalement éthique, qui se pose déjà à quiconque achète une paire de tennis ou un short de football. Le consommateur exige désormais de connaître les conditions, notamment sur le plan social, dans lesquelles l’objet qu’il achète a été fabriqué ; et si c’est le produit de l’esclavage des enfants, il n’en veut pas. Le consommateur doit être en mesure de refuser un produit issu d’une filière avec laquelle il est fondamentalement en désaccord, que celui-ci contienne des traces protéiques ou pas, et de lui préférer un produit équivalent. Ce droit démocratique à un choix éthique doit lui être reconnu.
M. le Président : Autrement dit, vous êtes d’accord avec M. Pascal : si les risques sanitaires ont été mis en avant, c’était avant tout pour lancer un débat et évaluer l’impact d’une nouvelle technologie sur les modes de production agricole.
M. Lilian LE GOFF : Tant que nous n’avons pas de réponses à nos questions, il n’y a aucune raison de nous engager plus avant.
M. le Président : J’avais organisé les mêmes débats en 1998, lors de la conférence des citoyens. Ils n’avaient pas du tout porté sur les mêmes sujets. Nous avions passé des heures sur les gènes de résistance aux antibiotiques… Aujourd’hui, nous admettons que le risque du risque existe peut-être, mais qu’il n’y a pas de risque avéré dans le domaine sanitaire, aux dires mêmes du fondateur de l’AESA.
M. Lilian LE GOFF : Auquel j’aimerais soumettre une question. Les textes qui régissent la composition des produits se réfèrent à la substance, autrement dit à l’analyse chimique de ses composés. Or l’activité d’une molécule, toxique ou non, dépend non seulement de sa composition chimique, mais aussi de sa conformation spatiale. Ainsi, le prion pathogène ne diffère pas chimiquement du prion physiologique : la seule différence entre les deux réside dans la conformation de la molécule dans l’espace. Quid de cet aspect dans l’appréciation de l’effet biologique, voire toxique des molécules et de l’équivalence entre OGM et non-OGM ? Cette question est totalement éludée. Pour autant, ne vous paraît-elle pas pertinente ?
M. Gérard PASCAL : Certes, mais nous disposons d’ores et déjà de techniques d’analyse qui permettent de distinguer parfaitement les différentes formes d’isomères. Nous ne le faisons pas systématiquement, mais cela renvoie à la question du possible et du probable. Si quelque chose est probable, on ira forcément voir ce qu’il en est… Quoi qu’il en soit, nous ne manquons pas de techniques pour identifier les isomères géométriques, qu’il s’agisse de lipides ou d’acides aminés. Mais on ne mettra pas systématiquement en œuvre les méthodes les plus sophistiquées pour analyser tous les constituants des végétaux, à supposer qu’on les connaisse.
M. le Président : La DGCCRF a-t-elle déjà détecté des fraudes ou des manquements à l’obligation d’étiquetage des OGM ? Nous avons également appris, à notre grande surprise, que la DGCCRF avait édicté toute une série de règles très contraignantes sur l’étiquetage non-OGM, qui n’avaient été discutées nulle part, pas plus au Parlement qu’au niveau européen.
M. Patrice DAUCHET : Notre laboratoire de Strasbourg nous permet d’effectuer bon nombre d’analyses sur les OGM. Depuis 1998 et de manière encore plus formalisée depuis 2001, nous intervenons dans le cadre d’un programme permanent de contrôle des organismes génétiquement modifiés, en coopération avec la DGAL et les douanes, tant sur les semences que sur les produits destinés à l’alimentation animale et humaine.
La DGCCRF travaille plutôt sur les semences d’origine nationale, la DGAL se réservant les semences d’importation. Nos analyses ont fait apparaître des taux très faibles de présence d’OGM, souvent en dessous du taux limite de détection – qui n’est pas de 0,1 % mais de 0,01 %. Les quelques cas de contamination relevés ne dépassent jamais 0,1 % à 0,2 %, ce qui n’a rien de surprenant compte tenu du très faible développement des cultures d’OGM en France.
Dans le domaine de l’alimentation humaine, les résultats non conformes à la réglementation existante sont extrêmement rares. Les quelques résultats démontrant la présence d’organismes génétiquement modifiés n’ont jamais dépassé 0,2 %, très en dessous du seuil de 0,9 %. La situation est un peu plus contrastée pour l’alimentation animale : on rencontre des taux de contamination supérieurs à 1 % sur le soja, ce qui n’étonnera personne compte tenu de nos sources d’approvisionnement.
M. le Président : Que faites-vous dans ce cas ? Mélangez-vous les stocks ?
M. Patrice DAUCHET : Le seuil ne s’applique qu’aux contaminations accidentelles et non aux mélanges volontaires. On n’a pas le droit de faire ce genre de manipulation pour abaisser le taux.
M. le Président : Croyez-vous que personne ne le fasse ?
M. Patrice DAUCHET : Je ne peux vous assurer que cela ne se produit pas… Mais si nous surprenions ce genre de manipulation, nous dresserions immédiatement procès-verbal.
M. le Président : Que devient le lot dont la teneur est supérieure à 1 % ? Est-il détruit ?
M. Patrice DAUCHET : On ne détruit pas un produit pour une infraction à une règle d’étiquetage…
M. le Président : Que deviennent alors ces produits ?
M. Lilian LE GOFF : Ils se retrouvent dans votre assiette !
M. Patrice DAUCHET : S’ils étaient correctement étiquetés, ils s’y retrouveraient tout autant !
M. le Président : Ou dans les mangeoires…
M. Lilian LE GOFF : Depuis les origines, on mélange des importations de soja transgénique à du soja non transgénique. Et faute de traçabilité, les éleveurs ne savaient finalement pas ce qu’ils donnaient à leurs animaux. Ils le sauront désormais, grâce au vote du Parlement européen ; encore faut-il que les filières répercutent l’information au consommateur. Ces importations sont-elles légales ?
M. Patrice DAUCHET : Dès lors qu’il s’agit d’un événement de transformation autorisé en Europe et que le produit est correctement étiqueté, je n’ai aucune raison d’interdire l’importation de soja génétiquement modifié. Si la teneur dépasse 0,9 % et que le lot n’est pas étiqueté, nous dressons procès-verbal pour non-conformité aux obligations d’étiquetage, mais cela n’entraîne pas pour autant la destruction du produit. La remise en conformité peut du reste consister à y adjoindre un étiquetage réglementaire.
M. le Président : Et vos règles sur l’affichage non-OGM ?
M. Patrice DAUCHET : C’est quelque chose que la DGCCRF fait, à tort ou à raison, très régulièrement… Il ne passe pas de jour où les entreprises n’inventent de nouvelles communications à caractère publicitaire vantant telle ou telle propriété ou caractéristique d’un produit ou d’un service. Nous ne pouvons en cette matière qu’appliquer le texte, de portée très générale, relatif à la publicité trompeuse, lequel dispose très simplement qu’une allégation de l’opérateur ne doit pas induire le consommateur en erreur. A partir de cette base et en fonction du cas d’espèce, nous établissons une doctrine administrative précisant les conditions à remplir pour éviter qu’une allégation ne soit de nature à tromper le consommateur. C’est ce que nous avons fait dans le cas des allégations négatives sur les organismes génétiquement modifiés.
M. le Président : Pouvons-nous avoir ce document ?
M. Patrice DAUCHET : Des tas de gens l’ont, et notamment les milieux professionnels…
M. le Président : C’est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé… Et lorsqu’un problème se pose, ce sont les parlementaires qui sont les premiers interpellés ! Nous avons été assez interloqués d’apprendre l’existence de ces règles très précises par la grande distribution. Nous aurions préféré que ce fût par la DGAL ou DGCCRF… N’y voyez aucune attaque contre vos services, qui travaillent fort bien. Mais, d’une manière générale, nous aimerions que les administrations de la République transmettent au Parlement leurs textes d’application, projets de décrets, décrets, arrêtés et circulaires. Cela aussi fait partie de notre pouvoir de contrôle. Beaucoup connaissent déjà ce texte, dites-vous, mais, même si nous devions être les derniers, nous aimerions l’avoir également, ne serait-ce que pour notre rapport…
M. Patrice DAUCHET : Rappelons que l’élaboration de cette doctrine administrative est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Libre au juge de ne pas être d’accord. Précisons enfin que nous ne l’avons pas sortie de notre chapeau, mais qu’elle résulte de longues discussions avec les parties intéressées, au sein notamment du Conseil national de la consommation, où siègent les professionnels comme les associations de consommateurs. L’Association nationale des industries agroalimentaires et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, entre autres, ont insisté pour que ce texte, effectivement sévère, élaboré en 2000, ne soit pas modifié en 2004 – nous avons en tout cas compris, au vu des positions des uns et des autres, qu’il ne fallait surtout pas y toucher !
M. le Rapporteur : Des tribunaux ont-ils eu l’occasion de se prononcer sur cette réglementation ?
M. Patrice DAUCHET : Non.
Mme Sophie VILLERS : La DGAL contrôle pour sa part les semences provenant de pays tiers – autrement dit hors Union européenne – en liaison avec les douanes. Les lots montrant une présence fortuite d’OGM doivent être étiquetés en conséquence. Le taux de lots de semence importés de pays tiers présentant une présence fortuite d’OGM est de l’ordre de 20 à 30 %. Ce n’est pas négligeable, mais nos contrôles sont ciblés sur certaines provenances à risque. Pour autant, le taux de présence fortuite est quasi systématiquement inférieur à 0,1 %. Il est à noter que la présence d’OGM non autorisés va croissant d’année en année, ce qui n’a rien d’illogique compte tenu du développement de ces cultures dans le monde.
M. le Président : La difficile question des amorces vous paraît-elle correctement traitée au niveau international ? L’amorce, qui permet d’insérer le gène, est décrite lors de l’homologation en France. Si le procédé d’amorce n’est pas indiqué, le transgène est indétectable. Pensez-vous que la réglementation internationale soit suffisante sur ce plan ?
Mme Sophie VILLERS : Pour trouver, il faut savoir ce que l’on cherche…
M. le Rapporteur : Quelle proportion d’OGM non autorisés trouvez-vous ?
Mme Sophie VILLERS : Je n’ai pas les chiffres sous les yeux. Ils ne représentent heureusement qu’une petite minorité des 30 % de cas dont je parlais plus haut. Reste que le phénomène existe et va même en croissant.
M. Patrice DAUCHET : Notre laboratoire n’est pas le seul ; les services de contrôle travaillent en réseau. La réglementation européenne, qu’il s’agisse de la directive 2001/18/CE ou du règlement 1829/2003, impose désormais la fourniture systématique de tous les outils analytiques et la validation de la méthode d’analyse par le laboratoire communautaire. Sur les OGM non autorisés en Europe, force est de reconnaître que nos moyens analytiques sont plus limités. Cela dit, le protocole de Carthagène prévoit la création d’une banque de données internationale. A supposer qu’il se mette un jour en place, ce dispositif permettrait aux services de contrôle d’avoir accès à une bonne partie des OGM autorisés sur l’ensemble de la planète.
M. Philippe GAY : Je vous confirme pour terminer la position officielle de l’industrie des semences, exprimée par le GNIS55, la CFS56 et l’UIPP57 qui demandent que le taux de présence fortuite d’OGM dans les semences soit harmonisé avec le taux de présence fortuite retenu dans l’alimentation.
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de cette longue séance qui nous aura permis d’épuiser toutes les questions, à défaut d’avoir trouvé un consensus.
Table ronde contradictoire sur le thème
« Les enjeux environnementaux des OGM »
(extrait du procès-verbal de la séance du 8 février 2005)
• M. Antoine MESSÉAN, vice-président de la Commission du génie biomoléculaire
• M. Pierre-Henri GOUYON, membre de la Commission de biovigilance, directeur du laboratoire UPS-CNRS d’écologie, systématique et évolution et professeur à l’Université Paris-Sud
• M. Jacques TESTART, directeur de recherches à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et co-organisateur du « débat des 4 sages » sur les OGM en 2002
• Confédération paysanne : M. François DUFOUR, membre de la commission OGM
• Jeunes agriculteurs : M. William VILLENEUVE, secrétaire général adjoint
• Greenpeace France : M. Arnaud APOTEKER, responsable « campagne OGM »
• M. Yves CHUPEAU, président du centre de recherche de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) à Versailles-Grignon
• Professeur Louis-Marie HOUDEBINE, chercheur à l’INRA à l’unité biologie, développement et biotechnologies
• M. Alain TOPPAN, directeur de recherches chez Biogemma
• Les amis de la Terre : M. Jordi ROSSINYOL, membre du groupe de travail sur les OGM
• M. Dominique BOURG, philosophe et professeur à l’université de technologie de Troyes
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
puis de M. André CHASSAIGNE, Secrétaire
M. le Président : Mesdames, Messieurs, j’ai plaisir à vous accueillir à cette table ronde.
La transposition de la directive 2001/18/CE devant être discutée au Parlement, le Président Jean-Louis Debré a souhaité que le débat à l’Assemblée nationale soit préparé par une mission d’information représentative de tous les groupes politiques. Son Rapporteur est M. Christian Ménard, député du Finistère. Après une première série d’auditions privées, suivie de tables rondes thématiques, nous sommes passés à l’expertise publique et contradictoire, où les arguments échangés doivent être étayés par des références précises afin que nous puissions nous forger notre propre opinion. Contrairement à ce que certains ont pu prétendre, cette mission aura permis à bon nombre de positions d’évoluer. Mais que nous changions d’avis ou non, l’important est que nous puissions travailler dans la transparence sur ce sujet complexe. C’est pourquoi nos tables rondes sont ouvertes à la presse et au public.
Nous souhaiterions aborder aujourd’hui trois grands thèmes : les essais en plein champ et la coexistence des cultures, l’impact – réel ou non – des OGM sur la biodiversité et l’utilisation de produits chimiques, et la maîtrise du risque d’apparition des résistances indésirables, autant de points sur lesquels les débats continuent, contrairement aux risques sanitaires sur lesquels les controverses semblent moins nombreuses qu’en 1998.
Sitôt les présentations achevées, nous entamerons le premier thème. Le but de cette table ronde est de privilégier un débat réactif.
M. Jacques TESTART : Agronome de formation, j’ai d’abord travaillé à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur la reproduction des vaches et mis au point des méthodes de « mères porteuses » avant l’heure, avant de travailler à l’hôpital à l’élaboration de méthodes de procréation assistée, devenant ainsi l’auteur biologique du premier bébé éprouvette en France. J’ai ainsi été amené à réfléchir aux aspects bioéthiques en défendant toujours la même position : on ne peut, au motif qu’il y a un risque, refuser à des couples l’accès à de nouvelles techniques de procréation. Il faut les informer du risque et les laisser prendre leurs responsabilités. Il en va différemment pour les plantes génétiquement modifiées dans la mesure où elles présentent des risques et ne répondent pas à une demande.
M. François DUFOUR : Paysan de Normandie, où je produis du lait, des pommes à cidre et des poulets de chair élevés en plein air en agriculture biologique, militant de la Confédération paysanne, je me suis demandé ce que les OGM pouvaient apporter de positif, notamment sur le plan de l’environnement. En tant que responsable des commissions « sanitaire » et « pesticides » et porte-parole national, j’ai insisté pour que notre organisation s’assure, au préalable, de la réalité de tous les mérites que l’on entendait prêter aux OGM. Force a été de reconnaître que les OGM ne sont pas une bonne réponse aux besoins de l’agriculture paysanne.
M. William VILLENEUVE : Secrétaire général adjoint des Jeunes agriculteurs où je suis responsable du dossier OGM et biotechnologies, je dirige avec mes parents une exploitation en polyculture – vigne et bovin-viande – dans le Gers.
M. Arnaud APOTEKER : Je suis responsable de la campagne OGM de Greenpeace France. Nous estimons que la contamination génétique qui risque de découler des disséminations d’OGM est irréversible et automultiplicatrice, et que personne n’en connaît aujourd’hui les effets à long terme.
M. Yves CHUPEAU : Chercheur à l’INRA depuis quarante ans, ingénieur agronome de formation, j’ai travaillé durant pratiquement toute ma carrière sur le clonage des cellules végétales, ce qui m’a conduit à m’intéresser dès la fin des années 80 aux aspects réglementaires dans le cadre de la Commission du génie génétique (CGG) et de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) et, plus particulièrement, à la sécurité biologique dans le cas des installations expérimentales. Je maintiens que nos travaux dans le domaine de la génomique des végétaux pourraient permettre, grâce à la création de plantes résistantes aux maladies, de promouvoir une agriculture plus durable.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Egalement à l’INRA depuis bientôt quarante ans, je travaille pour ma part sur les animaux. J’utilise la transgénèse depuis une quinzaine années pour des études à caractère fondamental, mais également pour des applications dans le domaine de la pharmacie et de la médecine. Nous préparons notamment des médicaments issus d’animaux transgéniques en collaboration avec une entreprise créée au sein de mon laboratoire. Je suis également membre de la Commission du génie génétique et de la commission des biotechnologies de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), et je participe depuis quatre ans à un enseignement de bioéthique européen.
M. Alain TOPPAN : Après un parcours universitaire et, entre autres, douze ans passés au Centre national de recherche scientifique (CNRS), j’ai rejoint assez naturellement le privé, puisqu’il s’agissait d’appliquer le projet sur lequel j’avais travaillé en recherche fondamentale. Depuis douze ans, je travaille pour des groupes coopératifs agricoles, autrement dit des agriculteurs. Responsable d’un laboratoire, je m’occupe également des aspects réglementaires et des essais en champ. Mon premier essai de plante transgénique remonte à 1989.
M. Jordi ROSSINYOL : Réseau écologiste fort d’un million de membres dans soixante-dix pays, les Amis de la Terre ont été les premiers à réclamer, dès 1987, un débat public sur les biotechnologies. Notre approche est globale : nous défendons des politiques locales de développement, respectueuses des droits sociaux, une utilisation responsable des ressources naturelles, la transparence et la participation. Les OGM ne peuvent à cet égard que susciter les plus vives préoccupations, particulièrement pour ce qui touche aux aspects sanitaires et environnementaux. S’ils devaient être un jour autorisés, il faudrait à tout le moins les encadrer par des règles législatives très strictes.
M. Pierre-Henri GOUYON : Agronome de formation, j’ai enseigné la génétique et l’amélioration des plantes pendant des années, tout en travaillant dans un laboratoire de recherche sur l’évolution en général. J’ai ainsi découvert que les mécanismes sont un peu les mêmes chez les humains et chez les plantes, ce qui n’est pas sans poser des problèmes philosophiques assez compliqués… Du reste, le DEA de philosophie que j’ai passé m’a permis de comprendre qu’eu égard aux aberrations de l'eugénisme, la communauté scientifique était parfaitement capable, tout en étant convaincue de faire le bien, de commettre d’énormes erreurs. Je suis devenu professeur à l’université de Paris-Sud et à Polytechnique et, en 1988, j’ai démarré un projet de recherche sur les conséquences de la culture des OGM et, depuis, je participe à de nombreuses instances. Je siège toujours au Comité « provisoire » de biovigilance – le comité définitif n’ayant jamais été nommé…
M. Antoine MESSÉAN : Egalement ingénieur agronome, j’ai débuté ma carrière à l’INRA avant de devenir directeur scientifique du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM). De retour à l’INRA, je suis chargé de mettre au point des méthodes d’évaluation des impacts écologiques et économiques des innovations dans l’agriculture. Une technique comme les OGM doit être évaluée dans son contexte d’utilisation, dans le système de culture et en tenant compte des pratiques agricoles. J’ai ainsi développé plusieurs méthodes d’étude de risques en situation et surtout des outils de modélisation visant à prédire le comportement futur des OGM, en fonction des systèmes de culture. Vice-président de la Commission du génie biomoléculaire, je suis également membre du Comité provisoire de biovigilance. J’assure, par ailleurs, la coordination scientifique d’un projet de recherche réunissant 44 partenaires européens dans le but de rassembler toutes les données scientifiques existantes sur les flux de gènes et les impacts écologiques des OGM, et d’évaluer les conséquences des divers scénarios d’introduction des OGM en Europe.
M. Dominique BOURG : Professeur d’université et philosophe, j’ai été amené à me pencher sur le sujet des OGM en participant à la fameuse « bataille de la Villette » et en m’intéressant au principe de précaution dans le cadre de la commission Coppens.
M. le Président : Jacques Testart a dit que les OGM ne répondent pas à une demande. Faut-il alors des OGM ? En quoi cette technique se distingue-t-elle des autres ? En avons-nous plus besoin dans certains secteurs, comme la santé, que dans d’autres ? En quoi la transgénèse dans le domaine de la santé se distingue-t-elle de la transgénèse dans le domaine agricole ?
M. Jacques TESTART : A la différence des plantes génétiquement modifiées, les OGM utiles à la santé sont essentiellement des micro-organismes ou des cellules animales modifiées, cultivés dans des fermenteurs en milieu totalement confiné, très sérieusement surveillés et fonctionnant comme des usines à produire des vaccins, des hormones, etc. Personne à ma connaissance n’a contesté l’usage de ces organismes unicellulaires, et l’on ne peut que regretter l’abus de langage qui conduit à qualifier d’OGM les plantes génétiquement modifiées. Il est beaucoup plus facile de contrôler des cellules isolées, tant sur le plan de la sécurité que sur ceux de l’efficacité, de la reproductibilité, de la stabilité et de la qualité de la production, alors que la maîtrise d’un individu supérieur, plante ou animal, pose beaucoup plus de difficultés. Ajoutons que les bactéries n’ont dans leur génome que des parties codantes et non ce fameux « ADN poubelle », non codant, dont on ignore tout du rôle de régulation, mais qui est certainement à l’origine des phénomènes très troublants observés dans l’évolution des plantes transgéniques, puisque le transgène n’apporte que la partie codante du gène.
M. le Rapporteur : Ne pensez-vous pas tout de même qu’il y aurait intérêt à fabriquer des médicaments comme la lipase par le biais de plantes génétiquement modifiées, beaucoup plus productives ?
M. Jacques TESTART : Tous les médicaments peuvent être produits par des organismes, y compris des cellules végétales, cultivés en fermenteurs. Même si la productivité est moindre, ce qui reste à démontrer, mieux vaut aménager des serres un peu plus grandes que de chercher à installer une pharmacie en plein champ, ouverte à tous les vents.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Tous les experts s’accordent pourtant à reconnaître que, même en cumulant tous les systèmes disponibles, nous risquons une pénurie dans la production de protéines avant la fin de la décennie. Or la cellule CHO, la plus utilisée et la plus performante, n’en produit au mieux qu’un kilo par an… Une production massive exige de faire appel à des organismes entiers, plantes ou animaux. Les animaux ont, sur les plantes, l’avantage de ne présenter aucun risque pour l’environnement et de produire les protéines les mieux conformées. Quoi qu’il en soit, il serait très imprudent de balayer d’un seul coup les OGM au sens large, plantes génétiquement modifiées comprises, en prétendant s’en passer pour la production de médicaments.
M. Alain TOPPAN : Les OGM présentent un intérêt majeur, que l’on a tendance à oublier, comme outils de recherche sur le fonctionnement du génome. Viennent ensuite tous les développements possibles et la nécessité d’expérimenter en champ.
Un colloque organisé en novembre par la CGB a montré que les problèmes de « stabilité » des transgènes au fil des générations tenaient, en fait, à des insuffisances dans la description des insertions. Autrement dit, les informations sur lesquelles s’étaient fondés certains laboratoires n’étaient pas fiables. La stabilité a bien été prouvée pour les transgènes.
M. le Président : Cette question de la stabilité du transgène dans le génome revient souvent. Peut-elle susciter un accord ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Cela m’étonnerait : personne ne peut raisonnablement affirmer que tous les transgènes sont définitivement stables… Il est des cas où ils le sont, et d’autres où ils ne le sont pas. N’oublions pas que la biologie est une science jeune et empirique : contrairement à la physique qui peut théoriser et faire des modèles sur ce qui se passe dans des étoiles que personne n’a jamais visitées, la biologie ne peut avoir d’autres certitudes que celles qu’elle tirera de nombreuses observations d’une même situation. La diversité des situations d’insertion de gènes et la multiplicité des manières de procéder – certains OGM contiennent tout le vecteur, d’autres pas – rendent toute statistique impossible, et prétendre en tirer une loi générale de stabilité des transgènes serait indigne d’un scientifique. Nos capacités de prédiction de ce que pourront donner les transgènes, ne serait-ce qu’à l’échelle moléculaire, sont totalement inexistantes. A l’échelle de la physiologie intégrée des organismes, c’est bien pire. La biologie est tellement obnubilée par l'ADN qu’elle en vient à ignorer ce qui se passe à l’échelle des organismes et à plus forte raison des écosystèmes. Ceux qui prétendent le savoir outrepassent très largement leurs compétences et témoignent de l’irrationnel dont fait preuve la communauté scientifique dans ces débats.
M. Yves CHUPEAU : Même si la biologie n’est pas encore capable de tout prédire, rappelons que le génie génétique n’est que le prolongement de tout un ensemble de techniques utilisées en amélioration des plantes… M. Testart oppose médecine et agronomie : mais le premier gène de résistance à un virus foudroyant – la mosaïque du tabac – a été transféré par croisement dès 1930 et est toujours utilisé ! A défaut de pouvoir tout prédire, nous avons tout de même un certain recul… On amalgame un peu trop facilement résistance aux herbicides et plantes génétiquement modifiées, alors que toute une série de techniques permettent d’ores et déjà d’aller pêcher des gènes natifs de résistance chez des espèces sauvages pour les introduire dans les espèces cultivées. Le génie génétique a l’avantage de permettre un ciblage plus aisé, une fois caractérisé un gène intéressant. Ce fut le cas pour un gène de résistance à une douzaine d’isolats de mildiou, isolé sur un Solanum sauvage au Mexique, cloné et transféré sur des pommes de terre actuellement expérimentées aux Etats-Unis et au Mexique.
M. le Président : La transgénèse est utilisée dans ce cas pour repérer un gène dans une espèce voisine, le tester en champ et parvenir, par des croisements naturels, à créer une espèce résistante à une maladie donnée. C’est ce qui avait été expérimenté à Toulouse. Cela vous paraît-il anormal ou non ?
M. François DUFOUR : Je n’étais pas à Toulouse… Pour le paysan que je suis, ces essais sont de même nature que les millions d’hectares déjà mis en production à des fins économiques à travers le monde. Nous ne pouvons accepter que nos champs deviennent des laboratoires, d’autant que la grande majorité de ces essais portent sur des plantes résistantes à des herbicides. Contrairement à ce que l’on promettait, les plantes génétiquement modifiées actuellement proposées, loin de répondre aux attentes de la société, procèdent d’une logique de marche forcée au rendement qui se traduit par des crises sanitaires et environnementales à répétition.
M. Yves CHUPEAU : Si, par transfert du gène natif d’un Solanum sauvage, on crée une pomme de terre résistante aux divers isolats de mildiou, permettant d’économiser autant de fongicides, interdirez-vous d’expérimenter ces pommes de terre et de les cultiver ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Faut-il le faire en plein champ ?
M. le Président : L’essai de Marsat portait non sur des résistances aux herbicides, mais sur le stress hydrique et l’assimilation de l’azote. On s’était servi de maïs castrés, la fécondation était assurée par des maïs classiques. Tout risque de contamination était exclu. Et pourtant, ce champ a été saccagé… Pourquoi ?
M. Arnaud APOTEKER : Tout risque de contamination n’était pas exclu : les maïs modifiés exsudent des produits par leurs racines, qui peuvent être captés par les bactéries du sol. Aucune analyse n’a jamais été faite sur ce risque.
M. le Président : C’est un peu tiré par les racines…
M. Arnaud APOTEKER : Plusieurs observations permettent de craindre un tel risque.
M. Alain TOPPAN : Affirmer que les essais en champ ne concernent que la tolérance aux herbicides procède soit de la mauvaise lecture, soit de la manipulation. Cessez ce petit jeu ! Toutes les informations sont disponibles sur l’Internet. Notre expérimentation visait effectivement à comprendre comment une plante peut utiliser moins d’eau et moins d’azote. Il s’agissait de gènes végétaux, dont certains provenaient du maïs lui-même. Les maïs castrés étaient contrôlés par les agents de la protection des végétaux. Quant à imaginer que les bactéries du sol allaient récupérer ces gènes de maïs ou de sorgho, alors qu’aucune publication scientifique n’a pu mettre en évidence une telle possibilité de transfert horizontal…
M. Pierre-Henri GOUYON : Cela a été démontré par le laboratoire de Lyon il y a deux ans.
M. Alain TOPPAN : Un transgène présent dans une plante récupéré par une bactérie du sol ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Oui. Ce qui est remarquable, c’est que l’article n’a pas été publié dans Nature… On craignait trop qu’il ne serve encore d’exemple contre les OGM !
M. Alain TOPPAN : A partir d’expérimentations en champ ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Précisément : c’est la première fois que cela est montré en champ.
M. le Président : Ce point technique est important. Où a-t-il été publié ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Dans Applied and Environmental Microbiology, sous la signature de Pascal Simonet.
M. Antoine MESSÉAN : M. Pascal Simonet, qui mène ces travaux depuis une dizaine d’années, en a fait le point lors d’un séminaire en décembre dernier. Il a effectivement fait des prélèvements au champ et identifié un événement de transformation qu’il reste à confirmer. Le rapport scientifique final de cette action incitative financée par le ministère de la recherche est sorti il y a quelques semaines.
M. André CHASSAIGNE : Cet échange démontre à quel point les essais en plein champ sont indispensables si l’on veut une vérification scientifique… Et contrairement à ce qu’affirme M. Dufour, les arrachages ont également porté sur des cultures à but médical, à l’image de l’essai de production de lipase gastrique mené par Meristem Therapeutics, détruit en pleine nuit.
M. François DUFOUR : Je répète que nous ne pouvons accepter de voir nos champs servir de laboratoires. Pour un paysan produisant et vendant sous label des produits garantis sans OGM, le risque est réel de voir demain des consommateurs se retourner contre nous. De telles expérimentations ne peuvent être menées qu’en milieu confiné, interdisant toute possibilité de contamination vers des cultures voisines.
M. Antoine MESSÉAN : Commençons par distinguer les essais, limités dans le temps et dans l’espace, et les cultures destinées à être mises en marché. Je rappelle à ce propos que la CGB ne se prononce pas sur la pertinence d’un essai, mais seulement sur la question de savoir s’il présente un risque pour l’environnement.
L’idée est d’essayer de se passer le plus possible des essais. On peut aller assez loin dans la modélisation en expérimentant en serre ou en travaillant sur certains aspects comme la dissémination de pollen avec du matériel non génétiquement modifié. Mais il est des choses que l’on ne verra qu’au champ ou, inversement, que l’on aura pu reproduire en expérimentation mais que l’on aura du mal à observer en conditions naturelles. On ne peut pas tout à la fois affirmer qu’il pourrait y avoir des comportements différents en conditions réelles et se contenter d’extrapoler à partir de modèles ou d’expérimentations en laboratoire.
Reste à savoir où placer le curseur. Cela exige une analyse au cas par cas. Je ne prétends pas que l’équilibre actuel soit correct, mais la CGB n’a pas à se prononcer là-dessus. La seule question pour nous est de savoir si l’essai proposé peut ou non avoir un impact durable. Nous reviendrons sur les problèmes de coexistence.
M. le Rapporteur : Pouvez-nous nous citer quelques exemples d’expérimentations en champ nécessaires ?
M. Antoine MESSÉAN : J’ai dit que l’on ne pouvait évaluer une technique indépendamment du contexte. Les croisements interspécifiques que l’on peut provoquer en laboratoire ou en serres ne se reproduisent pas nécessairement au champ. Inversement, d’autres croisements s’observent plus facilement au champ qu’en serre. Les mécanismes dans la nature sont beaucoup plus nombreux et diversifiés que ceux que nous connaissons et que nous sommes, de ce fait, capables de reproduire en milieu confiné. Le problème est de trouver le bon équilibre, et celui-ci n’obéit pas seulement à des considérations scientifiques.
M. Jacques TESTART : A chaque fois que l’on parle de plantes génétiquement modifiées, on nous parle de production de médicaments, des plantes qui fixent l’azote de l’air ou qui résistent à la sécheresse. Mais 98 % de ce que l’on cultive actuellement sur 70 millions d’hectares sont des plantes produisant un insecticide ou qui tolèrent un herbicide ! Parlons de ce qui est cultivé aujourd’hui…
M. le Président : A ceci près que nous en sommes au terme des essais d’OGM en France, avec 7,2 hectares en 2004, aux deux tiers détruits, même lorsqu’il ne s’agissait ni d’insecticide ni de résistance aux herbicides.
M. Jacques TESTART : La France n’est pas le monde, et elle ne pèse rien dans le domaine des OGM… On ne nous a pas attendus pour faire des expériences ailleurs. On n’a pas encore vu ces plantes miracles aux Etats-Unis ou ailleurs, alors qu’il n’y a pourtant aucun vilain obscurantiste pour venir les arracher ! Et comme je le dis tous les ans à M. Houdebine, si ses animaux producteurs de protéines utiles à la pharmacopée ne sont toujours pas industrialisés, c’est bien parce que cela ne marche pas suffisamment.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : J’ai passé tout l’après-midi à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) à juger d’un projet…
M. Jacques TESTART : Des projets, il y en a ! Mais des choses concrètes…
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Celui-là en est tout de même au stade de l’autorisation de mise en marché !
M. William VILLENEUVE : Comme l’a dit M. Messéan, il est des choses qu’il faudra bien aller voir dans les champs. Et lorsque les fauchages surviennent après pollinisation, le mal, à supposer qu’il y en ait un, a déjà eu lieu, à ceci près que l’on n’a plus rien à tester… Agriculteur comme M. Dufour, je n’ai pas plus envie que lui de voir ma terre servir de laboratoire. Mais j’ai aussi peur des OGM que des boues d’épuration…
M. Pierre-Henri GOUYON : Là-dessus, nous sommes d’accord.
M. William VILLENEUVE : Dans ce cas, prenons le problème dans son ensemble ! Il faut faire des tests sur l’un comme sur l’autre.
La France n’est peut-être pas le monde mais on importe tous les jours. Veut-on garder les paysans pour demain ? Ou si c’est seulement pour couper les ronces, qu’on nous le dise ! On importe 80 % des protéines végétales…
M. Yves COCHET : Pour nourrir les animaux !
M. Pierre-Henri GOUYON : On ne peut pas accepter cet argument !
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : J’allais poser la même question que M. Chassaigne. A supposer qu’une expérimentation en plein champ soit justifiée, est-il possible d’éviter tout risque de dissémination ? Ne pourrait-on imaginer que ces expérimentations en plein champ puissent être réalisées sur des terrains appartenant à des organismes publics de recherche et clos par tous moyens appropriés ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : A croire M. Messéan, certains essais en plein champ sont inévitables. Mais cet avis ne semble pas partagé par tous les chercheurs. Dans la mesure où ils ont déjà été menés aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et ailleurs, pourquoi faudrait-il les refaire en France, et sous quelles conditions ? Ajoutons que, même s’il ne nous en reste plus que 7,2 hectares, dont la moitié saccagée, beaucoup d’expérimentations ont été faites en France depuis 1987, qui n’ont pas été arrachées. Nous devrions donc avoir quelques références.
M. Pierre-Henri GOUYON : Même si j’ai beaucoup d’amitié pour son président comme pour son vice-président, je persiste à penser que la CGB a sûrement commis quelques erreurs tactiques. Si, au lieu de donner l’impression de vouloir autoriser à tout prix des essais en plein champ, elle avait osé refuser d’emblée certains OGM résistants aux herbicides dont on savait avec certitude qu’ils allaient poser problème, peut-être contesterait-on moins ses avis aujourd’hui. De ce fait, certains essais de maïs castré se mettent à poser des problèmes alors qu’ils ne le devraient pas, tout simplement parce que l’on a peur, en les acceptant, de laisser passer tous les autres. Mieux vaudrait élaborer, dès le départ, un cahier des charges énumérant clairement toutes les expériences qui seront a priori refusées parce que trop risquées. Jamais on n’aurait dû autoriser, par exemple, les essais de colza et de betterave résistant aux herbicides. Toutes les études que la CGB nous avait commandées étaient formelles sur ce point. Cela ne l’a pas empêchée d’autoriser un essai de colza, avant même d’en connaître les conclusions… Cette manière de faire ne favorise pas la confiance dans les institutions, et nous en souffrons tous.
M. Antoine MESSÉAN : Il est des choses que je ne peux pas laisser dire. Pour commencer, ce n’est pas la CGB qui donne les autorisations. Une loi a été votée par le Parlement…
M. le Président : Absolument : c’est le ministre.
M. Antoine MESSÉAN : …aux termes de laquelle le mandat de la CGB se borne à dire si l’essai posera ou non des problèmes pour l’environnement et la santé. Quant à la tolérance aux herbicides, un groupe de travail de la CGB en débattait déjà en 1994. Les risques liés, d’une part, à la généralisation de l’usage de deux herbicides non sélectifs et, d’autre part, à la diffusion du colza tolérant à un herbicide y étaient particulièrement mis en exergue, comme l’atteste la publication du livre de la CGB sur ses dix premières années d’exercice. Cette position de la CGB était d’ailleurs transmise officiellement à la Commission européenne et a donné lieu à la mise en œuvre de la clause de sauvegarde par la France sur la protection et les importations de colza tolérant à un herbicide. Le récent séminaire CGB sur le colza en 2003 et le nouvel avis public rendu en 2004 ont confirmé les risques liés à une commercialisation à grande échelle. Cette affaire est d’ailleurs au cœur du débat actuel au niveau du panel OGM de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et la défense n’est pas évidente. On ne peut donc pas affirmer que la CGB n’a pas alerté et hiérarchisé les risques.
M. le Président : La CGB, comme le rapporteur parlementaire, avaient, dès 1998, demandé le moratoire sur le colza. Ce problème avait bel et bien été traité. Reste celui, évoqué par M. Chassaigne, des essais détruits, alors qu’ils ne devraient pas l’être. C’est différent…
M. Pierre-Henri GOUYON : Ce serait différent si l’autorité compétente – pas la CGB, mais celle qui s’inspire de ses avis – avait décidé que certaines expérimentations ne se feraient pas. Tout le problème est là.
M. le Président : Le problème est également de réformer la CGB.
M. Antoine MESSÉAN : Et de savoir ce que nous allons répondre à l’OMC sur la base d’arguments scientifiques…
M. Pierre-Henri GOUYON : Il est effectivement des choses sur lesquelles il faut passer à des essais en champ, mais également des choses sur lesquelles on pourrait s’arrêter avant. Encore faudrait-il le dire beaucoup plus clairement.
Quant à savoir ce qui se passe exactement en matière d’OGM aux Etats-Unis et au Canada… Non seulement les expérimentations que nous menons en commun avec le Canada sont soumises au secret absolu, mais tous les laboratoires de recherche canadiens sont subventionnés par Monsanto. Ne croyez pas qu’il soit facile d’aller chercher des données au Canada ou aux Etats-Unis ! De surcroît, il n’y existe pas de traçabilité au sens propre du terme, dans la mesure où les OGM n’y sont pas considérés comme des produits particuliers. On nous dit que les OGM n’y posent pas de problème, mais personne n’a les moyens de le vérifier sur place.
M. Arnaud APOTEKER : Pierre-Henri Gouyon a déjà exposé la plupart des éléments que je voulais mentionner…
M. le Président : Est-ce à dire que vous seriez d’accord avec certaines expérimentations en plein champ ?
M. Arnaud APOTEKER : On a besoin d’expérimentation en plein champ lorsque l’on veut commercialiser – je le rejoins sur ce point. Mais comme aucun OGM ne mérite à mes yeux d’être commercialisé, les essais en champ ne présentent aucun intérêt.
M. le Président : Ce n’est pas ce que vient de dire Pierre-Henri Gouyon !
M. Arnaud APOTEKER : Sur les 7 hectares d’essais installés en 2004, combien sont sous l’autorité du GEVES58 qui n’en attend que des données à usage commercial ? Quelles plantes voudrait-on voir commercialisées à l’avenir ? Aucune des plantes conçues pour fixer l’azote ou résister à la sécheresse n’est encore au point. Lorsqu’elles auront atteint ce stade en serre, nous pourrons nous poser la question.
M. Alain TOPPAN : C’est faux. Nous sommes, sur ces plantes, allés au bout de ce que nous pouvions faire en serre. Les mesures de rendement en serre n’ont aucune fiabilité. Il faut maintenant les tester au champ. Affirmer, alors qu’il s’agit de gènes de maïs et de sorgho, que des plants castrés présentent un danger, c’est réinventer la biologie.
M. Arnaud APOTEKER : Les plantes médicaments ne méritent pas davantage d’être testées en plein champ. L’industrie agroalimentaire américaine, elle-même, a demandé l’arrêt des tests sur les plantes comestibles modifiées pour produire des médicaments, et particulièrement l’interdiction du maïs médicament dans le Corn Belt, par peur des contaminations.
M. Antoine MESSÉAN : Mme Perrin-Gaillard parlait-elle des disséminations ou des risques écologiques ?
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Lorsqu’une expérimentation en plein champ est nécessaire, est-il possible de l’assortir de conditions propres à éviter tout problème environnemental ? Peut-on clore les parcelles par des haies, des murs ?
M. Yves COCHET : Et en faire une grande serre !
M. Antoine MESSÉAN : M. Cochet a raison : totalement confiner, cela revient à faire une serre. On peut limiter fortement les risques de dissémination par des barrières physiques, mais on ne parviendra jamais au risque zéro. Même le pollen de maïs est capable de voler très haut. On ne peut pas toujours tout castrer comme certains scientifiques très sérieux l’ont parfois préconisé… Mais on peut gérer a priori les sites de dissémination, essayer de les regrouper tout en veillant aux interactions possibles entre OGM.
Cela dit, le fait que le risque zéro n’existe pas ne signifie pas pour autant que ces essais aient un impact écologique durable. Certes, le pollen de maïs ne s’arrêtera pas au bout de deux ou quatre cents mètres. Quelques grains iront polliniser le champ voisin, mais les plantes ne persisteront pas – dans les conditions prévues par l’expérimentation, s’entend. En revanche, dans le cas du colza, nous savons d’ores et déjà, par extrapolation, compte tenu de la pression de sélection qui peut exister sur certaines de ces plantes, qu’il peut se produire des perturbations dans le cas d’une diffusion commerciale ou à grande échelle. Autrement dit, il faut regarder au cas par cas la combinaison exposition/impact écologique.
M. Yves CHUPEAU : La CGB a été pratiquement la seule instance en Europe à insister sur le cas particulier du colza, outrepassant, de fait, le mandat que lui avait confié la loi. La question est de savoir quelle est la probabilité de transfert d’un gène de résistance à l’herbicide du colza à une crucifère sauvage comme la ravenelle, et c’est précisément ce qu’il est impossible de mesurer en ambiance expérimentale confinée. Si nos connaissances intellectuelles sur la biologie des cruciféracées conduisent à penser qu’il peut se poser un problème à cet égard, personne n’a pu le vérifier et la question reste en suspens. Comme dans tout programme d’amélioration des plantes, les tests ne peuvent qu’être progressifs, du laboratoire à la serre, puis au champ sur des surfaces de plus en plus grandes. N’oublions pas, enfin, que la résistance aux herbicides peut être obtenue par mutagenèse : que se passera-t-il au plan international lorsqu’arriveront ces nouveaux colzas résistants au glyphosate, sur lesquels aucune réglementation ne pourra s’appliquer ?
M. le Président : Expliquez-nous cela…
M. Pierre-Henri GOUYON : Cela va demander un long développement !
M. Yves CHUPEAU : Sur les actuels colzas génétiquement modifiés, la résistance au glyphosate est obtenue par transfert d’un gène de bactéries du sol. Mais on sait désormais quel type de mutation procure la même caractéristique dans le génome du colza ou du maïs. De ce fait, on pourrait fort bien voir arriver une demande de mise sur le marché d’un colza résistant obtenu par mutagenèse. Quand bien même ce ne sera pas un OGM, il faudra bien se poser la même question.
M. le Président : Ce sera un faux-vrai OGM…
M. Yves CHUPEAU : Dans le cas de la résistance aux maladies et particulièrement aux virus, les expérimentations ne peuvent se dérouler que dans la nature. Tout comme nous, les plantes sont porteuses de nombreux virus qui évoluent et interagissent. Pour la vigne par exemple, on ne peut pas expérimenter autrement qu’en conditions naturelles une résistance au virus du court noué, transmis par des nématodes aux racines du porte-greffe. Les conditions de sécurité biologique de ce programme de l’INRA sont parfaitement claires : le but est d’observer le développement de vignes greffées sur des porte-greffe transgéniques dans des sols infestés de nématodes. Le contrôle du développement et éventuellement de la floraison des porte-greffes est parfaitement possible et les conditions de sécurité sont optimales. Et pourtant, nous avons le plus grand mal à reprendre ce programme.
M. le Président : Pourquoi ?
M. Yves CHUPEAU : Je ne sais pas.
M. le Président : Allons ! Marion Guillou nous l’a dit. La CGB a pourtant donné un avis favorable.
M. Yves CHUPEAU : Le ministre n’a pas autorisé l’expérimentation.
M. Yves COCHET : Si la CGB donne effectivement un avis sur les demandes d’expérimentation présentées par les laboratoires privés ou publics, elle laisse au politique le soin de se débrouiller… Et lorsque les positions des ministres sont partagées – j’en ai eu l’expérience –, on invente une commission des Sages pour faire un rapport de plus et surtout pour ne pas avoir à prendre de décision !
Le mot « scientifique » prête à confusion. Si la démarche scientifique suppose un protocole, une rigueur, une méthodologie dans sa mise en œuvre, n’oublions pas qu’il s’agit, en l’occurrence, d’expérimentations dans lesquelles on se retrouve à jouer un peu avec le feu, n’ayant aucune théorie ni connaissance scientifique sur ce qui va se passer. Autrement dit, on appliquera aux essais en plein champ une méthodologie très rigoureuse, type laboratoire, mais sur le résultat, c’est l’inconnue absolue… Voilà pourquoi je distingue la méthode, par essence rigoureuse, et la connaissance a priori, qui peut subir toutes les inflexions possibles.
Nos amis physiciens ont été jusqu’à faire exploser des bombes en plein air pour vérifier la justesse de leurs modèles. Mais au moins avaient-ils depuis Joliot-Curie une théorie, ce qui a permis d’en tirer un tableau général des risques parfaitement planifiés et codifiés dans le cadre de l’AIEA59. Mais, dans le cas des OGM, on s’amuse en plein champ avec des choses dont on ne connaît absolument pas le résultat.
Nos amis assureurs, qui ne sont ni des chercheurs purs, ni des philanthropes, ni des passionnés de l’intérêt général, mais avant tout des gens qui comptent, ne s’y sont pas trompés : il n’était évidemment pas question pour eux d’assurer quoi que ce soit contre un risque que personne ne pouvait décrire, fût-ce a minima. Peut-on raisonnablement croire qu’un essai effectué tel jour dans tel champ donnera le même résultat qu’un essai identique conduit six mois plus tard dans un autre champ ? Non. Tout simplement parce que nous n’avons pas la théorie, les lois, les explications scientifiques qui pourraient nous permettre de généraliser. Peut-on, oui ou non, généraliser un essai ?
M. Jacques TESTART : Yves Cochet a fait allusion aux « 4 Sages », dont je cite la conclusion : « Une obligation d’assurance pour passer du stade des essais confinés à celui des essais en plein champ doit être inscrite dans la loi. » Un débat chasse l’autre, mais nous en sommes toujours au même point !
M. Yves COCHET : Retenez cela, M. le Rapporteur !
M. le Président : Nous avons également dit que nous étions contre les destructions d’essais !
M. Jacques TESTART : On a parlé de dissémination par le pollen – qui peut voler, mais également être transporté par les abeilles et bien d’autres choses –, mais on n’a pas parlé des graines qui peuvent l’être aussi de diverses manières, depuis les chaussures du paysan jusqu’au train. Autrement dit, il n’y a aucun moyen d’empêcher les disséminations et donc de s’assurer contre ce risque. Tant et si bien qu’aux Etats-Unis, les recommandations applicables aux cultures de plantes génétiquement modifiées ne sont même plus respectées, qu’il s’agisse des espaces de séparation, des rotations, des surfaces sans OGM, des décalages des dates de semis ou encore du gyrobroyage des repousses. Tout simplement parce que cela coûte cher.
Ce ne sera pas pareil en France, me dira-t-on. J’ai appris de source sérieuse l’existence des premières cultures commerciales de plantes génétiquement modifiées : dix-sept hectares de maïs Bt 11, variété autorisée en France. Quelle est la juridiction compétente à la matière, sachant que le Comité de biovigilance est toujours provisoire et que nous n’avons encore aucune législation applicable aux cultures et aux disséminations ? Comment peut-on faire semblant de discuter, alors qu’aucun acte ne correspond au discours ?
M. le Président : Où ces dix-sept hectares de Bt 11 sont-ils situés exactement ?
M. Jacques TESTART : L’endroit est tenu secret, pour que personne ne les arrache…
M. le Président : Nous poserons donc la question au ministre. Au demeurant, le maïs Bt 11 étant une variété autorisée, on connaît les seuils de contamination possible.
M. William VILLENEUVE : Tout le monde reconnaît l’intérêt des essais en plein champ, qui appellent évidemment un encadrement très précis. Personne n’a demandé les OGM, nous dit-on. Personne ne demandait les semences hybrides il y a cinquante ans, qui constituent désormais la base de toutes nos semences. Cela avait d’ailleurs provoqué un tollé à l’époque.
M. Francis DELATTRE : On se focalise beaucoup sur les plantes résistantes aux herbicides ou aux insectes. Les essais en plein champ auraient au moins le mérite, au-delà des enseignements scientifiques, de montrer s’ils présentent un réel intérêt économique. Sans être spécialiste, j’aurais tendance à penser qu’une plante capable de détruire, par elle-même, la pyrale du maïs permet d’éviter trois ou quatre pulvérisations d’insecticide classique… J’imagine également que si 70 millions d’hectares sont ensemencés en maïs et soja transgéniques de par le monde, c’est que cela peut avoir un intérêt économique. Mais à chaque fois que je pose la question, on répugne à me répondre. Je suppose qu’il y en a un, car l’intérêt scientifique que pourraient présenter ces sept malheureux hectares, alors que des millions sont cultivés ailleurs me paraît des plus réduits.
Ma deuxième question a trait au colza. Un organisme nous a assuré, ici même, que les risques de proliférations étaient minimes. Quoi qu’il en soit, je m’étonne que l’on se refuse à rapporter les avantages aux inconvénients afin de se déterminer au cas par cas. Un champ de colza subit les infestations de quatre ou cinq plantes différentes, ce qui exige quatre ou cinq traitements différents. Un colza résistant au glyphosate n’a plus besoin que d’un seul traitement. Il y a déjà un avantage en termes de coût : le glyphosate, c’est le Roundup, à peu de choses près.
En admettant même que des contaminations puissent exister sur des plantes voisines comme la ravenelle, en quoi est-ce un drame ? En quoi est-ce une atteinte à la biodiversité ? A supposer qu’elle acquière la qualité d’un colza résistant, la plante resterait destructible par un autre désherbant. C’est là qu’interviennent les intérêts économiques : le glyphosate est dans le domaine public…
M. Pierre-Henri GOUYON : Pas totalement.
M. Francis DELATTRE : Seulement la molécule, pas l’huile qui va avec, je vous l’accorde. Reste qu’un désherbage au glyphosate revient à moins de 10 euros l’hectare au lieu de 120 à 130 euros minimum avec quatre ou cinq désherbants sélectifs. En fait, ce rejet primaire des OGM ne conduit-il pas à favoriser Monsanto et les grands groupes agrochimiques ? Il y a quelques années, ils commençaient à vendre leur chimie pour se recentrer sur la semence ; depuis, le mouvement s’est stoppé, probablement grâce aux campagnes anti-OGM.
Enfin, nous recevons de plus en plus de soja et de maïs génétiquement modifiés. J’en viens à avoir le sentiment que le refus des OGM répond d’abord à un intérêt commercial : afficher un produit sans OGM dans un hypermarché, c’est porteur… Je comprends fort bien qu’un agriculteur s’attache à fournir un produit non susceptible d’être contesté par le consommateur. Mais pendant que nous nous attacherons à préserver un critère de qualité, nous serons envahis de maïs et de soja OGM destinés à nourrir toute l’Europe. Et si le Paraná est le seul Etat du Brésil à refuser les OGM, c’est uniquement dans l’idée de mieux vendre ses productions en Europe.
M. Dominique BOURG : L’oiseau de Minerve ne prenant son vol qu’au crépuscule, je veux déplorer un état de fait : il est finalement très gênant que l’expression « OGM » se soit si largement installée. Les bactéries transgéniques ne posent pas les mêmes problèmes que les plantes transgéniques qui, elles-mêmes, doivent être prises au cas par cas. Tout cela, pour le public, est regroupé sous le vocable OGM, nourrissant une guerre de tranchées qui pourrait, au moins en partie, être dépassée. C’était d’ailleurs le sens du reproche qu’adressait Pierre-Henri Gouyon à la CGB, qui n’a pas voulu distinguer les cas en refusant a priori certains essais dont le résultat était connu d’avance. Inversement, je ne vois pas pourquoi on n’accepterait pas des essais réunissant toutes les conditions de sécurité ou portant sur des plantes présentant un intérêt évident. Reste qu’une dénomination globale ne contribue évidemment pas à clarifier la situation, quand bien même M. Dufour estime qu’un OGM, eu égard aux risques potentiels de dissémination qu’il recèle, reste, sur le plan juridique, un OGM.
Quoi qu’il en soit, la façon dont le problème a été présenté à l’opinion publique créée une barrière artificielle qui nuit à sa faculté de discernement. Une technique, par définition, peut évoluer et autoriser plusieurs applications, et si certaines n’apporteront manifestement aucun bénéfice, si ce n’est pour quelques actionnaires, d’autres peuvent présenter un réel intérêt pour le citoyen. Encore faut-il pouvoir le discerner.
M. le Président : Pensez-vous que cette confusion ait été volontaire ?
M. Dominique BOURG : Pas du tout. La stratégie de départ, du côté de Monsanto et autres, l’était probablement, mais il est dommage que, du côté critique, on ait enfourché le même cheval. Les arguments apparaîtraient beaucoup plus fondés et mieux reçus par une partie de l’opinion si l’on savait opérer certains distinguos, notamment pour ce qui touche aux expérimentations en plein champ.
M. François DUFOUR : Le risque le plus à craindre est celui de l’irréversibilité. Dans leur grande majorité, les expérimentations d’OGM visent à tester une résistance à des produits chimiques, censée résoudre un problème d’environnement. Je ne suis qu’un paysan, mais je fais un peu d’agronomie. Lorsque je me suis installé en 1976, j’ai mis en pratique le modèle que l’on nous avait inculqué : il fallait faire du rendement laitier et, pour cela, nourrir les vaches au maïs et au soja. J’ai très vite compris qu’à faire systématiquement du maïs dans les endroits les plus éloignés de mon exploitation, les sols se compactaient, les rendements baissaient et il fallait de plus en plus de produits de traitement. Mais c’est seulement au bout de dix ans que je me suis posé la seule vraie question : un sol, c’est quoi ? C’est un milieu vivant qui est censé agir, non seulement pour nourrir des plantes, mais pour entretenir, au gré des vents et des microclimats, sa capacité à remplir ses fonctions.
On nous dit qu’aux Etats-Unis, les OGM sont cultivés sur des millions d’hectares, mais qu’on ne sait finalement rien des risques, parce qu’il y a les brevets, Monsanto, etc. Mais si la société américaine, totalement tétanisée, standardisée, est toujours disposée à manger ce qu’on lui donne, notre culture en Europe n’est pas la même : nous, nous voulons savoir… Les paysans ont déjà subi les conséquences de plusieurs crises sanitaires, lorsque le citoyen s’est mis à se méfier de ce qu’il mangeait. Ils ne peuvent accepter qu’on lâche dans la nature des OGM avec tous les risques d’irréversibilité qu’ils comportent. L’enjeu n’est pas seulement environnemental, éthique et culturel. Il est également économique. Nous avons réglé nos problèmes d’insuffisance alimentaire, nous sommes excédentaires et pourtant, nous sommes obligés d’importer des protéines. C’est le résultat de choix politiques : nous produisons ici du blé et du maïs que nous vendons à bas prix sur le marché mondial, et l’on cultive là-bas du soja ou du manioc que nous importons… Et parce que, là-bas, on aura décidé de faire ainsi, il faudrait suivre le mouvement chez nous ? Non ! Si l’Europe revenait à des principes agronomiques sains, avec des rotations de cultures, nous aurions des sols moins compactés, capables de mieux se défendre, de mieux nourrir les plantes. Au contraire, on s’obstine à chercher des systèmes dans une petite boîte pour résoudre le problème d’une agriculture standardisée de monoproduction
– du blé et rien que du blé dans le bassin Parisien, du maïs et rien que du maïs dans le bassin de l’Adour, etc. – et à fabriquer en fin de compte une véritable bombe à retardement. Mon métier de paysan disparaît : je deviens peu à peu une machine seulement bonne à appliquer un système qui finira par nous exploser à la figure. Je n’ai pas envie de jouer à cela, ni de jouer avec l’estomac de gens qui, avant d’être des consommateurs, sont pour moi des citoyens.
M. le Président : Nous avons tous entendu le message que vous venez de nous exposer avec passion : force est de reconnaître que bon nombre d’erreurs ont été commises dans nos sociétés développées. Mais une technique peut-elle être à ce point rédhibitoire qu’il ne faille jamais l’employer ? Ne peut-elle être utilisée, y compris dans un modèle d’agriculture moins intensif ? Les OGM ne sont-ils pas finalement une victime expiatoire bien commode, alors que ce sont nos modèles agricoles qui sont répréhensibles ? En les montrant du doigt, ne cherche-t-on pas à se purifier à bon compte de toutes ces erreurs que vous avez très justement relevées ?
M. François DUFOUR : Les OGM pourraient se concevoir si nous étions dans un contexte de pénurie alimentaire – ce qui n’est pas exclu dans les années à venir…
M. le Président : Mais qui existe ailleurs dans le monde.
M. François DUFOUR : Non. A en croire Action contre la faim, le monde produit plus de calories que n’en ont besoin tous ses habitants. C’est un problème de répartition. Le problème est que l’on utilise des terres à cultures vivrières en Argentine et au Brésil à faire pousser du soja pour nourrir nos cochons. Les OGM que l’on nous a proposés ne servent que des intérêts commerciaux particuliers. On veut construire à toute force une machine à gaz en poussant à tester, en plein champ, des plantes résistantes aux herbicides qui pouvaient fort bien être testées en laboratoire. Ce qui n’exclut pas une recherche financée sur fonds publics et travaillant pour l’intérêt public.
M. André CHASSAIGNE : On peut concevoir, à vous entendre, des expérimentations en plein champ pour peu qu’ils soient motivés et entourés de toutes les précautions nécessaires. Mais si l’on ne va jamais voir ce qui se passe à l’extérieur des parcelles expérimentales, ou si l’on encadre si bien que plus rien ne risque de se produire au-dehors, quelle peut être l’utilité d’essais en plein champ ? Et si d’éventuelles disséminations se produisaient, en quoi auraient-elles un effet irréversible sur les cultures environnantes ?
M. Antoine MESSÉAN : J’ai simplement répondu à une question précise : les essais au champ peuvent-ils être confinés ? Je n’ai pas dit que c’est ce qu’il fallait faire. En tout cas, n’allez pas croire que l’on ne regarde jamais ce qui se passe en dehors des champs d’expérimentation. Non seulement les essais sont sous la surveillance permanente de l’autorité publique, mais les parcelles voisines, dans la plupart des cas, et particulièrement lorsqu’il s’agit de colza, font l’objet d’un suivi sur plusieurs années – jusqu’à neuf ans. Les données ainsi recueillies sont-elles suffisantes ? Sûrement pas. Mais on ne peut pas dire que rien n’est fait.
En fait, l’évaluation est un processus continu et dynamique. Ce n’est pas parce que l’on aura fait tels essais en laboratoire, en serre puis au champ que l’on peut se croire autorisé à faire de même sur des millions d’hectares. Cette manière de procéder est révolue, grâce notamment aux OGM, et il doit en être de même pour toutes les innovations en agriculture.
En tant que chercheur, M. Cochet, je suis le premier à regretter que l’on n’investisse pas assez dans la compréhension des phénomènes. Mais cela ne signifie pas que l’on ne sache rien. Même si l’on ne sait pas tout – on ne saura jamais tout –, le corpus de données dont on dispose d’ores et déjà permet une certaine théorisation. Des modèles de dispersion et de dissémination ont été mis au point par l’équipe de Pierre-Henri Gouyon et l’INRA, y compris un modèle mathématique destiné à prédire le devenir des plants de colza en fonction des parcellaires et des pratiques agricoles, et que nous avons pu confronter aux observations recueillies sur le terrain. Nous disposons déjà d’un premier embryon de théorie même si, j’en suis d’accord, nous n’allons pas encore assez vite dans l’appréciation des risques systémiques. On ne peut, comme le disait M. Dufour, évaluer une technique indépendamment du contexte et les interactions sont extrêmement complexes.
Si nous ne pouvons pas extrapoler ce qui se passe outre-Atlantique, ce n’est pas seulement parce que les Américains et les Canadiens ne nous disent pas tout, mais également parce que nos pratiques agricoles sont très différentes. Pour le colza par exemple, certaines pratiques culturales peuvent multiplier le risque de dissémination par quinze, d’autres les diviser par quarante. Certaines, comme les rotations de culture ou l’entretien des bordures, peuvent avoir, selon les cas, des effets contradictoires et insoupçonnables à long terme. En tout état de cause, l’expérimentation au champ sur un an ne saurait suffire.
Se pose enfin la question des dispositifs de surveillance et de l’observatoire. Qu’est-il prévu pour le Bt 11, puisque la question a été posée par Jacques Testart ? La directive 2001/18/CE oblige le pétitionnaire à soumettre un plan de gestion et un plan de surveillance. Il est urgent de transposer ces dispositions en droit français – ce qui ne signifie pas pour autant que le Comité de biovigilance doive rester provisoire… Si parfaites que soient les théories, le suivi et la biovigilance sont indispensables. Ce concept n’est pas nouveau, il s’applique d’ores et déjà aux médicaments et a été introduit depuis dix ans dans le droit français. Encore faut-il passer aux travaux pratiques, arrêter la méthode, définir les instruments, mettre en place les observatoires capables de mesurer les impacts et d’évaluer les pratiques agricoles. Beaucoup de choses existent d’ores et déjà, mais trop éclatées, trop fragmentées pour être efficaces. Nous réclamons depuis plus de dix ans des dispositifs de biovigilance concrètement opérationnels, assortis de protocoles précis. Nous insistons devant vous pour que tout cela se fasse dès maintenant, conformément à ce que prévoit la directive 2001/18/CE.
M. le Président : Que nous travaillons précisément à transposer, y compris pour ce qui touche à la biovigilance. Au demeurant, des instructions dans ce sens ont déjà été données par les ministères, et certains fonctionnaires sur le terrain s’emploient à les respecter. Nous avons eu droit à une heure d’exposé sur la biovigilance à Toulouse…
M. Pierre-Henri GOUYON : Si certains essais en plein champ entrent réellement dans le cadre d’un programme de recherche, notamment sur les risques, la majorité relève du développement pur et simple. Il est assez pénible d’entendre dire, à chaque essai de développement détruit, que l’on a fichu une recherche en l’air… Il y a là une ambiguïté que la CGB elle-même devrait s’employer à lever par un classement approprié.
M. le Président : L’essai détruit à Marsat correspondait bien à de la recherche.
M. Pierre-Henri GOUYON : Mais le riz du CIRAD était du développement, contrairement à ce que l’on a laissé dire.
M. le Président : Mais il était en serre.
M. Pierre-Henri GOUYON : Il y avait une partie en serre, une partie à l’extérieur.
Alors que notre connaissance des effets environnementaux reste très insuffisance, les investissements de recherche continuent à privilégier l’innovation technologique au niveau strictement moléculaire. A jouer ce jeu-là, à s’obstiner à rendre la communauté scientifique de plus en plus monomaniaque et obsédée par la seule attitude de l'ADN et des protéines qui tournent autour, au point que les comités scientifiques deviennent pratiquement incapables de répondre à une question touchant à l’organisme ou aux populations, il devient impossible d’obtenir un avis réellement circonstancié sur les questions relatives à l’environnement, comme de rassurer la population. Il est urgent d’appeler l’attention du ministère de la recherche sur le manque criant de démarches intégratives dans la recherche française, comme ce débat le montre à l’évidence.
M. le Président : Nous le ferons, soyez-en assuré. Mais à croire le jeune chercheur de Toulouse que nous avons entendu sur place, toute la filière biologie végétale serait sinistrée du fait des controverses liées aux OGM qui, de l’aveu même de certains, n’obéissent souvent qu’à des considérations de stratégie.
M. Philippe MARTIN : Mon département du Gers a connu de très nombreuses expérimentations au champ conduites dans la plus grande opacité, à l’insu des élus comme des citoyens. Or je suis un partisan résolu de la dissémination des informations et la seule contamination qui m’intéresse est celle de la démocratie citoyenne…
M. le Rapporteur : Les élus ont systématiquement été informés.
M. Philippe MARTIN : Je peux vous assurer que les maires du Gers n’ont jamais été informés des expérimentations qui se déroulaient sur le territoire de leurs propres communes.
Du fait de la technicité de ce débat, nous aurons le plus grand mal à réellement insérer le citoyen dans le processus de décision. Les parlementaires eux-mêmes ont le plus grand mal à comprendre ce dont vous leur parlez. Or nos concitoyens ont un colossal appétit d’information et ce n’est pas avec un étiquetage a minima qu’on le satisfera. Existe-t-il seulement une réponse qui lui permettrait de prendre toute sa place, entre le scientifique et le politique ?
M. le Président : Ce sera le thème de la table ronde du 17 février prochain.
M. Philippe MARTIN : Mais il est toujours bon de demander à des scientifiques de s’écarter quelque peu de leur domaine propre pour se poser une question d’ordre plus philosophique : comment intéresser, informer et solliciter l’opinion publique ? Notre collègue rapporteure de la Charte de l’environnement, sur laquelle je m’étais abstenu…
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET : Il fallait voter pour !
M. Philippe MARTIN :… connaît par cœur l’article qui parle du principe de précaution. Je ne comprends toujours pas comment on peut tout à la fois prôner le principe de précaution et défendre les expérimentations au champ. Cela reste pour moi un mystère.
M. Dominique BOURG : Le principe de précaution suppose une analyse des risques au cas par cas. Il ne peut conduire à rejeter définitivement ce genre de protocole.
M. le Président : Toute nouvelle technique contient une part d’incertitude. Philippe Kourilsky parlait du « risque du risque ». Jamais un scientifique ne dira qu’il n’y a aucun risque. Faut-il pour autant s’abstenir de progresser ? C’est toute la question.
M. William VILLENEUVE : Se pose également le problème du seuil : à quoi correspond ce taux de 0,9 % d’OGM par rapport à ceux que l’on retient pour les pesticides ? Et quid de l’enjeu de l’eau ? Si les OGM permettent un jour d’y répondre, pourquoi pas ? Et le consommateur finit par accepter les OGM, comment rattraperons-nous les autres ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Nos laboratoires ne sont pas encore fermés… Ne nous faites pas pleurer !
M. William VILLENEUVE : Serions-nous en surproduction ? Non. Certains pays affament leurs populations paysannes pour mieux exporter leur soja. J’ai connu la sécheresse de 2003 et j’ai vu comment sont montés les cours des céréales pour mes animaux… Sans même parler de l’augmentation de la population mondiale, alors que la sole agricole restera la même. Comment fera-t-on ?
M. le Président : Nous reviendrons sur les seuils dans le cadre du débat économique. Au demeurant, il est établi que ce taux n’a rien à voir avec une quelconque toxicité et qu’il résulte, avant tout, d’une décision politique.
M. William VILLENEUVE : C’était le but de ma question.
M. le Président : La question reste de savoir pourquoi l’agriculture biologique s’est imposé pour les OGM des seuils spécifiques, et si bas qu’ils en viennent à interdire toute cohabitation.
M. Arnaud APOTEKER : La différence, qui vaut également dans l’application du principe de précaution, tient au fait que les OGM sont porteurs de phénomènes – pollutions génétiques, transferts à d’autres cultures, etc. – irréversibles et automultiplicateurs, qui, de proche en proche, contamineront toutes les cultures. Cela n’a rien à voir avec une pollution classique, qui cesse, dès que l’on en a tari la source.
M. le Président : Pour l’heure, il est établi que les techniques de transgénèse n’apportent pas plus d’incertitudes que les techniques classiques de biologie végétale ou d’hybridation. Les problèmes relatifs à l’activation des gènes dormants ou à la précision du point d’insertion se posent également dans toutes les techniques. Pour ce qui est des risques allergiques, le professeur Moneret-Vautrin a reconnu que le problème pouvait se poser, comme il peut survenir avec toutes les techniques utilisées dans le domaine végétal. La table ronde sur les risques sanitaires a conclu que la biovigilance devait dans ce domaine s’exercer à l’égard des OGM comme à l’égard de tous les produits nouveaux et exotiques, et particulièrement des mélanges qui entrent de plus en plus dans nos habitudes de consommation.
M. le Rapporteur : L’étude Bright réalisée en Grande-Bretagne en novembre dernier sur le colza et la betterave transgénique a conclu à leur innocuité sur la biodiversité. Qu’en pensez-vous ?
M. Pierre COHEN : Tout comme on a le droit de vouloir cultiver en bio et en traditionnel, on devrait tout aussi légitimement avoir le droit de cultiver des OGM. Mais peut-on autoriser les productions OGM sans porter atteinte à cette liberté de choix ?
Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET : Ainsi que l’a opportunément rappelé M. Martin, notre travail sur le principe de précaution nous a permis de parvenir à un équilibre dans la rédaction finalement adoptée, qui pourrait servir de point de convergence sur certains sujets. Le principe de précaution impose non seulement de sérier très précisément les cas dans lesquels doit s’appliquer le principe de précaution – « dommages graves et irréversibles mettant directement en jeu la responsabilité des autorités publiques et appelant des mesures conservatoires » –, mais également, et concomitamment, de rechercher les éléments propres à lever tous les doutes. Il faut donc y voir un appel à une recherche de premier rang, dans laquelle on ne passe au stade suivant qu’une fois levées toutes les hypothèques sur le précédent. Peut-être devrions-nous nous inspirer de cette démarche et prendre cette rédaction comme document de référence.
M. Philippe TOURTELIER : L’équilibre de la rédaction n’a toutefois pas suscité le consensus : vous avez retenu « graves et irréversibles » alors que nous proposions « graves ou irréversibles ». Car ce qui est irréversible mais bénin sur le moment peut devenir grave par la suite.
M. Alain TOPPAN : Le problème de la coexistence des filières conventionnelles, bio et OGM est directement lié à la détermination d’un seuil de tolérance, arrêté à 0,9 % au niveau européen sur des critères éminemment politiques. Il appartient aux Etats membres de prendre les dispositions propres à le faire respecter – sous-entendu : pour garantir la coexistence des cultures. Les études menées en France, mais également en vraie grandeur en Espagne, ont permis de montrer qu’une distance de sécurité de 25 mètres suffisait largement pour permettre la coexistence, sur une même zone, de productions de maïs OGM, bio et conventionnel.
M. le Président : Pour le maïs.
M. Alain TOPPAN : En effet. Nous raisonnons bien espèce par espèce.
Venons-en à l’étude Bright. Le gouvernement britannique a décidé, il y a quatre ou cinq ans, de mesurer l’impact sur l’environnement des cultures OGM en partant de trois espèces différentes – colza, maïs et betterave – toutes modifiées pour présenter le même caractère de résistance à un herbicide, ce qui, entre parenthèses, me paraît un peu dommage. Les conclusions, selon les termes mêmes du coordonnateur, peuvent être résumées comme suit : il y a une relation directe entre l’effet de l’herbicide et la présence ou non de microfaune et d’adventices. Autrement dit, l’étude montre l’effet d’un produit et non de la plante elle-même. On aurait obtenu les mêmes résultats avec un arrachage manuel : la disparition des adventices entraîne du même coup celle des insectes qui s’en nourrissaient.
M. le Rapporteur : Il ne s’agit pas de l’étude Bright, mais de celle qui a été conduite juste avant.
M. Antoine MESSÉAN : Effectivement, cette étude « Farm Seale Evaluation », publiée en 2003, a montré que l’atteinte à la biodiversité est directement liée à l’herbicide. L’utilisation de plantes résistantes permettant une utilisation plus efficace de l’herbicide, il subsiste moins de mauvaises herbes dans les champs, donc moins de biomasse et de fleurs en dehors de la période de floraison du colza, donc moins d’insectes. L’étude Bright, qui suit un tout autre protocole et sur un ou deux sites seulement, n’aboutit pas aux mêmes observations. A les lire très rapidement, ou à écouter la BBC, on pourrait en déduire que l’une dit blanc, l’autre noir. Il en va de même avec les études économiques sur la consommation de pesticides, qui montrent tantôt une augmentation, tantôt une diminution. Tout dépend, en fait, des sources et des protocoles, et cela exige une interprétation très précise, aux antipodes des relations qu’en fait la presse.
M. Alain TOPPAN : A ce propos, une étude américaine publiée en octobre 2004 sur l’impact des cultures de plantes génétiquement modifiées au regard de l’utilisation de onze produits différents60 fournit une série de chiffres très précis en termes de revenu net et d’utilisation de pesticides en fonction des cultures. Ce document est disponible sur l’Internet.
M. le Président : Tout le monde n’est manifestement pas d’accord sur ce sujet. Pour certains, les cultures OGM, contrairement à ce qu’affirmaient leurs promoteurs, n’ont entraîné aucune réduction des épandages de pesticides. Une étude de l’AFSSA dit l’inverse, notamment pour le cas du coton, de même qu’une étude de la FAO. Qu’en est-il exactement ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Apparemment, la consommation d’herbicides baisserait dans certains cas, comme le coton, mais pas dans d’autres. Cela dit, peut-on comparer un kilo de Roundup à un kilo d’un autre produit ?
M. le Président : Mais y a-t-il moins d’épandages ?
M. Francis DELATTRE : C’est obligatoire !
M. le Président : M. Delattre, nous ne sommes pas là pour savoir, mais pour écouter.
M. Jacques TESTART : Il a raison, et cela répond à la question posée tout à l’heure : si les cultivateurs américains font des plantes génétiquement modifiées, c’est tout simplement parce qu’il faut moins d’épandages, donc moins de main-d’œuvre : un épandage massif d’herbicide suffit et c’est la plante qui fabrique elle-même l’herbicide… Reste à savoir ce que cela donne. Certaines études disent que l’on met moins d’herbicides, d’autres que l’on en met trois fois plus dans le même épandage pour économiser la main-d’œuvre. Et pour ce qui est de l’insecticide, plusieurs études montrent que les maïs Bt diffusent dans les champs des quantités de toxine infiniment plus grandes que n’en laisseraient les traitements traditionnels. Autrement dit, on n’en met pas, mais il y en a, et beaucoup plus.
M. Francis DELATTRE : C’est bien la première fois que j’entends cela !
M. le Président : On nous a dit exactement le contraire lors de la dernière table ronde !
M. Yves CHUPEAU : L’utilisation de plantes résistantes à l’herbicide permet à l’agriculteur de décider de l’opportunité d’un traitement après le semis, en fonction des infestations. Outre cet élément de souplesse, le nombre d’applications est réduit et surtout, plusieurs produits relativement toxiques utilisés en mélanges, et non sans risques, ont été remplacés par un seul produit, le glyphosate, épandu en un ou deux passages, ce qui évite bien des problèmes, particulièrement dans le cas du soja. Sur le plan des quantités, il faut naturellement plus de Roundup, mais en remplacement de mélanges de produits autrement plus toxiques.
M. Francis DELATTRE : Et bien plus chers.
M. Yves CHUPEAU : Le glyphosate est fabriqué par au moins quarante ou cinquante chimistes dans le monde et son prix ne cesse de baisser.
M. Pierre-Henri GOUYON : Et c’est justement ce qui explique pourquoi ça ne marche pas ! La molécule glyphosate, en elle-même, ne tue pas les plantes, car elle est incapable d’entrer dedans. Il faut des adjuvants, et les meilleurs jamais trouvés sont dans le Roundup. On ne peut donc pas dire que glyphosate et Roundup sont la même chose.
M. Yves CHUPEAU : Le Roundup est effectivement une formulation. Le progrès agronomique est réel, mais le problème est que la culture de soja s’est largement développée, alors les formulations Roundup, ou autre, faisant appel au glyphosate n’ont pas été véritablement réévaluées et adaptées à ces nouvelles utilisations. Mais cela n’a plus rien à voir avec les OGM. Du reste, Syngenta vient de breveter un colza mutant non-OGM résistant au glyphosate… Le problème est celui de la caractéristique de la plante et des modifications des pratiques agricoles qu’elle permet. C’est cela qu’il faudrait réglementer.
S’agissant des insecticides, contrairement à ce qu’affirme Jacques Testart, les quantités de toxine qui restent dans le sol, après récolte, d’un maïs Bt sont dix fois inférieures à celles que laisse un traitement traditionnel par des spores.
M. Jacques TESTART : Et dans la plante ? C’est de cela que je parlais !
M. Yves CHUPEAU : Evidemment ! Mais une fois la plante récoltée, ne restent sur la parcelle que les fanes de feuilles et les racines. Or la protéine a une durée de vie très limitée.
M. François DUFOUR : Mais la plante est consommée par les animaux et indirectement par les humains !
M. Yves CHUPEAU : La plante produit la protéine…
M. Jacques TESTART : Et que devient-elle ?
M. Yves CHUPEAU : Elle est en grande partie réutilisée par la plante et, lorsque les feuilles tombent à l’automne, il ne reste plus rien.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Les études de toxicité montrent que la toxine Bt, extrêmement instable, ne pose strictement aucun problème sanitaire ni allergique, même à des doses très élevées.
M. Jacques TESTART : Ces études sont très contestables61…
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Allons ! Elles sont extrêmement nombreuses et toutes concordantes. Et les résidus de la protéine dans le sol n’ont induit aucun changement dans la faune ou la flore.
M. Yves CHUPEAU : Les spores de bacilles de Thuringe – qui produisent quinze toxines différentes, dont la Bt – sont utilisées en pulvérisation sur l’ensemble du territoire agricole et forestier depuis 1936… La France a ainsi été le premier pays à homologuer un produit de lutte biologique contre les insectes. Des quantités faramineuses de mélanges de toxines ont ainsi été pulvérisées en France, aux Etats-Unis, en Australie et jusque sur la forêt de Bornéo.
M. le Président : C’est une des méthodes utilisées par l’agriculture biologique.
M. Yves CHUPEAU : Jamais toxine n’aura donné lieu à autant d’informations et à si grande échelle.
M. Arnaud APOTEKER : On s’aperçoit que dans les régions où ont été cultivées des plantes tolérantes aux herbicides, non seulement les quantités épandues vont désormais croissant, mais qu’on est obligé d’utiliser des produits plus toxiques, les mauvaises herbes développant de plus en plus de résistances.
M. le Président : Avez-vous des références ?
M. Arnaud APOTEKER : Oui. Charles Benbrook, déjà cité, vient de produire un rapport sur les problèmes liés, notamment, à la culture du soja génétiquement modifié en Argentine.
M. le Président : Nous avons demandé à notre ambassade de nous envoyer un rapport. Observe-t-on un recul des ventes de plantes génétiquement modifiées ?
M. Arnaud APOTEKER : Non. Mais 99 % du soja argentin est OGM et les quantités d’herbicide épandues, après avoir baissé les premières années, vont croissant. Les cultures de soja génétiquement modifié envahissent de nouveaux territoires, en particulier les forêts des Yungas.
Sur la toxine Bt, je suis en total désaccord avec M. Chupeau, dont je serais curieux de voir les références. Si le bacille de Thuringe disparaît effectivement en vingt-quatre heures sous l’action des ultraviolets, je vois mal comment on en retrouverait dans le sol une semaine après… Ajoutons que, du fait que le gène est tronqué, la toxine Bt contenue dans les plantes transgéniques n’est pas exactement identique à la toxine Bt utilisée dans l’agriculture biologique, et n’en a ni la spécificité ni les mêmes effets sur la chaîne alimentaire.
M. le Président : Nous assistons ce soir à un vrai débat, arguments et références à l’appui. Mais que dire de cette feuille distribuée sur les champs d’expérimentation saccagés à Toulouse : « Les OGM résistent aux pesticides ou fabriquent eux-mêmes leurs insecticides et les paysans mettent plus de produits dans les champs… En France, le plus gros consommateur d’insecticides du monde, les spermatozoïdes ont diminué de moitié, des bébés naissent avec des organes génitaux absents ou atrophiés… Risque de catastrophes écologiques irréversibles, disparition d’animaux utiles, contamination des plantes, des animaux d’élevage et, en bout de chaîne, de l’homme… » Et le reste est du même style ! Comment voulez-vous qu’un citoyen ne soit pas tenté d’aller tout détruire ? Comment peut-on descendre à un niveau aussi bas dans la discussion ?
M. Pierre-Henri GOUYON : Il est tout aussi scandaleux de prétendre que l’on va nourrir le Tiers-Monde avec les OGM ! Les deux côtés sont également critiquables !
M. le Président : On ne peut pas exiger le droit l’information et laisser circuler des papiers pareils.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Ce ne sont tout de même pas des scientifiques qui les ont écrits !
M. le Président : Mais ce sont des scientifiques qui nous les ont transmis.
M. François DUFOUR : Reprenez plutôt le rapport de l’Institut français de l’environnement qui montre l’accumulation des pesticides dans l’eau et la catastrophe, prévisible d’ici à dix ans, dans plusieurs régions de France !
M. le Président : Mais nous sommes d’accord !
M. François DUFOUR : Vous nous prenez à témoins avec l’idée de nous mettre dans le même bateau.
M. le Président : Mais non !
M. Arnaud APOTEKER : On peut également citer les affabulations scientistes des promoteurs des OGM dans toutes les revues de vulgarisation !
M. François DUFOUR : Plusieurs associations paysannes d’Argentine et des Etats-Unis nous ont appris que, par le jeu des brevets déposés sur les variétés génétiquement modifiées, les grandes firmes ont mis la main sur la plupart des plantes conventionnelles. Autrement dit, les paysans n’ont même plus la possibilité de revenir à des semences conventionnelles, le patrimoine génétique ayant été confisqué !
M. le Président : Pourriez-vous nous donner le nom de ces organismes, afin que nous puissions les rencontrer lors de notre visite aux Etats-Unis ?
M. François DUFOUR : Bien volontiers.
M. Pierre-Henri GOUYON : Allez voir Percy Schmeiser !
M. le Rapporteur : Nous avons déjà entendu parler de cette affaire. Nous pensions qu’il s’agissait d’une contamination accidentelle. Il apparaît en fait que 90 à 98 % des cultures de Percy Schmeiser étaient génétiquement modifiées !
M. Pierre-Henri GOUYON : Non !
M. le Rapporteur : Nous avons eu le compte rendu du procès !
(M. André CHASSAIGNE remplace M. Jean-Yves LE DÉAUT à la présidence)
M. Pierre-Henri GOUYON : Percy Schmeiser s’était, certainement par provocation, fabriqué un lot de graines récupérées sur des colzas qui poussaient sous un pylône électrique. Si ce lot était contaminé à 98 %, c’est tout simplement qu’il avait l’habitude de désherber l’endroit au Roundup. Et les colzas étaient bien arrivés là tout seuls.
Le colza produit autour de 75 000 graines par mètre carré et l’on en perd environ 10 % à la récolte. On comprend, dès lors, qu’il n’y a pas besoin d’un gros pourcentage de contamination pour donner lieu à des centaines de plantes, puis à des populations entières résistantes au Roundup. Percy Schmeiser n’est jamais allé chercher les gènes de Monsanto ailleurs que chez lui, où ils sont venus tout seuls. Il s’agit bel et bien d’une contamination. Il n’empêche que la Cour suprême du Canada a donné raison à Monsanto et que Percy Schmeiser n’a plus le droit de semer ses graines. Et dans le même temps, un article, un de plus, montrait que l’on trouvait des gènes de variétés transgéniques de maïs américains dans les variétés traditionnelles mexicaines… Même si les firmes semencières nord-américaines n’ont pas encore osé réclamer un droit de propriété sur ces variétés traditionnelles, le droit américain, en l’état actuel des choses, leur en donne la possibilité. Aucune loi ne fixe de pourcentage de gènes brevetés au-dessous duquel on peut semer sans verser de royalties… Personne en France n’est prêt à accepter cette conception américaine du droit des brevets. Mais comment lutter contre cette folie furieuse dont sont également victimes nos collègues d’Argentine ?
Evidemment, M. Delattre, si une plante résistante à un herbicide permettait réellement de désherber plus proprement avec moins de produit, ce serait un progrès écologique. Cela pourrait même arriver un jour, pour peu que l’on gère intelligemment les OGM, comme on a pu le faire dans le domaine de la santé, il fut un temps, avec les antibiotiques. Encore ne faut-il pas faire n’importe quoi, et cela vaut pour les antibiotiques, comme pour les herbicides. M. Chupeau, lui-même, en conviendra avec moi : il est totalement ridicule et scandaleux que chaque firme s’emploie à rendre chaque espèce résistante à son propre herbicide. Si Monsanto parvient à rendre ses blés aussi résistants au Roundup que ses colzas, comment désherberez-vous votre blé contre les repousses de colza ? Et comment empêcherez-vous des colzas résistants aux Roundup, Liberty, Pursuit et autres de se croiser pour donner des colzas tri-résistants ? La chose s’est déjà produite au Canada, démontrée et publiée !
Agir ainsi, c’est aller à l’encontre de l’intérêt de l’agriculture et de l’environnement. Passées quelques années, l’économie réalisée disparaîtra. Or les firmes sont obligées de favoriser le profit immédiat. Il revient donc à l’Etat, aux collectivités, d’empêcher ce qui est rentable à court terme, mais préjudiciable à long terme. Et c’est à nous, scientifiques, de vous prévenir : ne laissez pas les plantes être contaminées par des gènes de résistance à tous les herbicides, faute de quoi tous les avantages liés à l’usage des herbicides disparaîtront.
M. Germinal PEIRO : Sur les risques sanitaires, nous avions du mal à y voir clair. Sur les impacts environnementaux, nous sommes à peu près dans la même situation ! Qu’il s’agisse de la dissémination ou de l’irréversibilité, nous ne parvenons pas à obtenir des scientifiques une réponse claire et à savoir enfin si, oui ou non, les OGM sont tolérables ou acceptables. Et je n’ai toujours pas compris si l’on retrouvait plus ou moins de substances nocives dans le sol en utilisant des OGM plutôt que des traitements chimiques… Aurons-nous un jour une vision claire et pourrons-nous présenter un rapport sérieux dans ces conditions ? Enfin, les scientifiques ont-ils des solutions agronomiques à long terme qui pourraient représenter une alternative ?
M. William VILLENEUVE : Il faut savoir que le colza est un cas très particulier. C’est une des rares plantes capable de produire trois, voire quatre générations de repousses. C’est, du reste, en pensant au colza que l’on a imaginé le gène « Terminator ».
M. Yves CHUPEAU : Ce débat sur les OGM nous « plante » totalement. Le problème désormais posé, c’est celui de savoir quelles pratiques agricoles nous voulons, et pour quels types de cultures. Or depuis vingt ans, voire vingt-cinq ans, nous restons bloqués sur un danger biologique nouveau qui résulterait de l’utilisation du génie génétique tout en continuant à autoriser la commercialisation de certaines plantes comme si de rien n’était ! Comme l’a dit M. Gouyon, on peut, dès à présent, au moins sur le papier, rendre à peu près n’importe quelle plante résistante à n’importe quel produit, ce qui n’est évidemment pas pensable. On parle du colza, mais le blé pose le même problème de pertes de récolte et de repousse. Il est plus que temps de changer de niveau de débat et de se poser la question des pratiques agricoles, et au niveau mondial.
Sur le Bt, je vous laisserai un article chinois paru fin 2003 sur le coton. Sur les parcelles de cotonniers, de superficie très réduite, le nombre de traitements insecticides est passé de vingt à sept. C’est un réel progrès sur le plan sanitaire – les pulvérisations se font à la main –, mais également sur celui de la biodiversité.
Je confesse enfin avoir, il fut un temps, voté contre les premiers dossiers de maïs Bt à la CGB, craignant que la culture à grande échelle de plantes produisant une seule toxine ne favorise l’apparition rapide de phénomènes de résistances. Or, depuis dix ans que ces plantes sont cultivées aux Etats-Unis, force est de reconnaître, au vu des études conduites par les laboratoires et les universités américaines conduites dans les parcelles, mais également sur la flore et la faune alentour, qu’aucun insecte résistant n’est apparu et que la biodiversité n’en a pas souffert, bien au contraire. Les cultures Bt préservent les régulations naturelles beaucoup mieux que les traitements insecticides.
M. André CHASSAIGNE, Président : Pensez-vous que la création de zones refuges puisse à cet égard avoir un effet positif ? L’idée de nouvelles pratiques agricoles a été avancée à plusieurs reprises. Peut-être nous permettra-t-elle de sortir d’échanges dans lesquels le politique a le plus grand mal à se faire une idée, perdu entre des études scientifiques présentées comme imparables, mais aux conclusions parfois radicalement opposées. J’en viens même à me demander si certains d’entre vous ne poussent pas un peu le trait en s’appuyant sur certaines études, à défaut de pouvoir justifier leur propos…
M. Gabriel BIANCHERI et M. Louis GISCARD D'ESTAING : Très juste !
M. Antoine MESSÉAN : Il faut effectivement insister sur les pratiques et chercher à savoir ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas. Je vous ai parlé des disséminations, mais leur impact dépend du système dans lequel on s’insère. Pour ce qui concerne le soja, par exemple, le problème en Argentine n’est pas tant que l’on ait remplacé le soja par du soja OGM, mais bien que l’on ait remplacé la prairie par du soja afin d’exporter vers l’Europe ! Comment voulez-vous prédire ce genre d’interaction ? Nous en sommes difficilement capables aujourd’hui.
Toujours à propos des pratiques agricoles, le soja résistant à l’herbicide permet, certes, de réduire les applications, mais également de passer à la technique du non-travail du sol. Dès lors, l’agriculteur épandra le glyphosate une seule fois sur la culture en place, mais il l’appliquera également avant, au lieu de labourer, pour préparer le semis. Est-ce un bien ? Il faudrait comparer l’impact relatif du glyphosate sur l’environnement, le gain en consommation de fuel, donc en émission de gaz à effet de serre, etc.
S’agissant des zones refuges, une recommandation préconise 20 % pour le coton Bt, mais sans indiquer précisément comment il faudrait les répartir sur le territoire. Or, une publication de santé montre que plutôt que de laisser chaque agriculteur se ménager son 20 %, mieux vaudrait cultiver le coton Bt sur de grandes parcelles et préserver des zones refuges importantes. Tout porte à croire qu’il devrait en être de même avec le maïs.
Compte tenu de la diversité et de l’imprédictibilité des situations et des interactions, la nécessité de dispositifs de suivi et d’observatoires apparaît évidente. Seul un véritable suivi dans le temps permettra une réévaluation permanente et non sur la base de telle petite étude à tel endroit. Mais cela suppose également une gestion dans l’espace, un réel travail de coordination au niveau des territoires, qui n’est pas évident : on en mesure toute la difficulté dans mon exemple des champs de coton… Ce sera en tout cas un véritable challenge, pour les politiques comme pour les scientifiques.
M. Jacques TESTART : Je vous comprends parfaitement, M. le Président : pour un scientifique également, il est très difficile de s’y retrouver entre des articles de presse et des publications scientifiques contradictoires. Mieux vaut en tout cas se référer aux articles scientifiques et non à des propos tenus en l’air dans des congrès. Pour ma part, je peux vous donner les références de tout ce que je vous ai dit aujourd’hui.
A propos des zones refuges, un article publié l’année dernière dans les comptes rendus de l’Académie des sciences américaine62 fait état d’un taux de 45 % de contamination des grains de la zone refuge par le maïs Bt ! Une zone refuge, c’est mieux que rien, mais la question n’est pas là : il s’agit de savoir si l’on accepte les contaminations par les transgènes ou si l’on veut s’en abriter.
M. Alain TOPPAN : Au sujet de la présence de gènes de résistance chez les insectes ravageurs du maïs, je vais vous communiquer deux articles montrant qu’en France, où l’on ne cultive pourtant pas le maïs Bt comme aux Etats-Unis, le taux de présence de ces gènes de résistance est identique. N’oublions pas, enfin, que deux problèmes doivent être pris en compte : celui de l’apparition, non souhaitée, de gènes de résistance, et celui de la gestion, possible ou non, du phénomène.
Enfin, j’aimerais que M. Testart m’explique comment, dès la première année, une plante non transgénique peut devenir transgénique par simple pollinisation…
M. Jacques TESTART : Je suis obligé de quitter la réunion, qui est plus longue que prévu, pour un autre engagement, mais je vous communiquerai l’article.
M. Alain TOPPAN : Si vous mettez côte à côte un maïs transgénique et un maïs non transgénique et qu’il se produit une pollinisation croisée, la plante non transgénique ne peut pas devenir transgénique la première année ! C’est réécrire la biologie !
M. François DUFOUR : Je ne sais pas si je vais réécrire la biologie. En tout cas, je n’ai pas d’intérêts financiers dans un groupe coopératif, même si je suis un fervent défenseur de ma coopérative paysanne…
M. Germinal Peiro a demandé si la recherche avait des solutions alternatives. Dès 1997, la Confédération paysanne avait demandé que des moyens financiers soient dégagés sur la recherche publique pour effectuer un suivi sur des élevages nourris aux plantes transgéniques. Novartis-Syngenta promettant 30 000 hectares de maïs dans l’année qui venait, nous voulions savoir où nous allions et pouvoir mener des études sur les produits issus de ces plantes. Sept ans plus tard, les échantillons sont restés au frigo. Aucun test n’a été effectué. Nous en sommes toujours à nous demander ce qui passe dans le sol. Quant à savoir ce que cela devient dans nos animaux…
Existe-t-il des plantes qui répondraient à nos besoins ? La première question que devrait se poser un paysan est de savoir comment répondre au mieux à la demande de la coopérative ou de la société qui collecte, et comment le sol doit être géré le mieux possible, en bon père de famille, avant de le céder aux générations futures. C’est ainsi que je me suis rendu compte qu’en cultivant toujours du maïs dans les parcelles les plus éloignées de ma ferme – les vaches devant rester à proximité –, les sols se compactaient, les rendements baissaient, et financièrement cela coinçait… Je me suis remis en cause : je ne fais plus de maïs, j’ai réintroduit des prairies avec une graminée et des légumineuses. Si bien que je n’ai plus besoin d’acheter quatorze tonnes d’ammonitrate et que le compostage de mon fumier me suffit.
Depuis que je me suis remis aux rotations de cultures, que je n’aurais jamais dû abandonner, je fais des économies, l’eau de mon puits est redevenue potable, alors que j’étais sur une zone en excédent structurel, mon environnement est redevenu sain. Evidemment, je ne suis pas dans les normes, je ne touche pas les primes de la politique agricole commune (PAC), j’ai l’impression d’être un extraterrestre… On me dit que je suis à côté de la plaque, que le progrès c’est les OGM, qu’il faut revenir à un schéma cohérent… Reste que je vois autour de moi des gens galérer à produire du maïs pour le vendre au prix mondial, à consommer de plus en plus d’énergie alors que je suis passé de 3 000 litres de fuel à seulement 1 100 litres, sans parler de mes économies de vétérinaire, car mes vaches sont bien moins fragiles qu’avant !
Des plantes, il y en a. Le CIRAD s’échine à en rechercher pour les pays du Sud alors qu’on a ce qu’il faut. Si l’on plantait des espèces vivrières correspondant aux besoins et aux habitudes de ces populations au lieu d’y semer du soja pour exporter chez nous et nourrir veaux, vaches, cochons, couvées, les problèmes seraient réglés. Chez nous aussi, on peut produire des protéines azotées, du trèfle, des légumineuses, du soja, du lin, du chanvre, du tournesol. Il est possible de mettre en place un plan protéines en Europe, ce qui permettrait d’en finir avec le tout-blé dans la Beauce et le tout-maïs dans l’Adour, de revenir à la rotation des cultures, de rééquilibrer les sols, de faire des économies d’énergie et de ne plus avoir à chercher la plante capable d’éviter toutes les mauvaises herbes, sans désherbant ! Personne n’est capable de l’inventer. Pourtant, cela fait dix ans que l’on s’arrache les cheveux là-dessus et que l’on veut faire passer les OGM en force. Espérons que nous allons enfin revenir à plus de cohérence.
M. André CHASSAIGNE, Président : Reste que cette agriculture que vous appelez de vos vœux ne semble pas se généraliser au niveau mondial. N’attendez-vous décidément aucun résultat positif des OGM ?
M. François DUFOUR : Lorsque j’ai « désintensifié » mon agriculture, je n’ai même pas eu besoin des nouvelles variétés de blé. Je mélange du blé, de l’orge, un peu d’avoine et du pois fourrager, que je sème ensemble et cela remplace le soja. Je fais même un peu de lupin avec de l’orge, ce qui me rend totalement autonome.
Effectivement, cette agriculture hors des sentiers battus n’est pas reconnue dans le modèle standardisé de l’agriculture mondiale, qui consiste à faire de la monoculture pour remplir de grands silos et exporter. Autrefois, il y avait des bovins, des ovins et des cochons un peu partout, qui apportaient du fumier dans les sols pour nourrir les plantes. Ce n’est pas que je veuille me passer de tout engrais. Je veux simplement des semences résistantes aux facteurs, microclimatiques notamment. J’ai retrouvé d’anciennes variétés de blé des années soixante très productives et résistantes, pour peu que l’on ait un bon assolement et un fumier bien composté, et qui n’ont pas besoin d’être sans cesse sous perfusion de produits chimiques. Mais à chaque fois que j’ai voulu utiliser des variétés modernes, j’ai systématiquement subi des invasions. Cela ne veut pas dire que l’on n’ait pas besoin de recherche. Il n’est qu’à voir le travail que nous faisons à la Confédération paysanne avec le réseau Semences paysannes et d’autres organisations. C’est de cette recherche-là dont nous avons besoin, une recherche publique tournée vers la satisfaction des besoins fondamentaux.
Tout cela, y compris la politique agricole commune, découle évidemment de choix politiques mondiaux. Je ne veux pas dire que tout soit à jeter dans la PAC mais il faut reprendre tout cela, afin de revenir peu à peu à quelque chose de plus cohérent.
M. André CHASSAIGNE, Président : Les chercheurs publics de l’INRA que nous avons rencontrés à Clermont-Ferrand nous ont expliqué que la transgénèse permettait de tirer tout le parti du conservatoire de semences qu’ils avaient constitué pour faire évoluer les variétés actuelles. Il n’y a pas d’opposition à nos yeux entre la préservation des semences anciennes et la mise au point, grâce à la transgénèse, de variétés toujours plus adaptées. Tout cela ne peut reposer, j’en suis bien d’accord, que sur la recherche publique et il faut la doter de moyens en conséquence. Or le responsable de ce programme, sur le point de partir à la retraite, ne sera probablement pas remplacé…
M. William VILLENEUVE : Je ne crois pas qu’il y ait incompatibilité entre les OGM et la rotation des cultures. Le problème est qu’il nous a fallu nous adapter à des politiques agricoles communes successives, et nous en connaissons le bilan. De la même façon, opposer les agricultures et les agriculteurs serait la dernière chose à faire.
Après la crise de l’ESB, on nous a demandé d’assurer la traçabilité de nos viandes. Maintenant que le problème sanitaire s’est envolé, tout le monde a oublié…
M. Germinal PEIRO : On n’oublie pas ! Les collectivités locales, à travers les laboratoires vétérinaires départementaux, paient tous les jours le contrôle de l’ESB sur la viande bovine…
M. William VILLENEUVE : Certes, mais on jette les viandes sous label, faute de trouver preneur chez les consommateurs. On contrôle l’ESB, mais sans se soucier de la provenance des viandes. La traçabilité ne sert plus à rien. Aujourd’hui, les consommateurs ne connaissent pas les OGM et n’en veulent pas. Mais qui vous dit qu’ils n’en voudront pas demain ?
M. Germinal PEIRO : Encore faut-il qu’ils y trouvent un avantage !
M. Arnaud APOTEKER : Ils n’auront pas le choix…
M. William VILLENEUVE : Non. Hier, ils avaient le choix de ne pas aller vers la traçabilité et ils y sont allés.
En conclusion, nous avons besoin d’une recherche en plein champ, entourée de toute la réglementation qui s’impose, si nous voulons que la ferme France existe toujours dans les années à venir.
M. Arnaud APOTEKER : Je reviens à la question posée par M. Peiro. Si une plante génétiquement modifiée pour résister aux herbicides exige moins d’épandages pendant la période de culture, il n’empêche que l’on trouvera désormais de l’herbicide sur la plante elle-même, sans parler des résidus qui subsisteront à l’intérieur : ce n’est pas un hasard si certains pays ont relevé, en la multipliant par dix ou vingt, la limite maximale en résidus (LMR) du Roundup ! Et ces produits ou leurs résidus ont toutes chances de se retrouver dans les produits dérivés – mais évidemment, les analyses n’ont pas été faites…
M. Gabriel BIANCHERI : Votre voisin a dit exactement le contraire !
M. Arnaud APOTEKER : Cela prouve bien qu’il n’existe aucune certitude dans ce domaine. Du soja contenant des résidus d’herbicide, cela n’existait pas avant l’apparition du soja tolérant.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : C’est faux !
M. Yves CHUPEAU : On y trouvait d’autres herbicides !
M. André CHASSAIGNE, Président : Audition après audition, on découvre toujours des choses nouvelles… J’ai appris aujourd’hui que les herbicides se promenaient dans la plante… Allez y comprendre quelque chose ! A moins qu’il ne s’agisse d’une simple affirmation…
M. Arnaud APOTEKER : Nous demandons simplement que des tests soient effectués sur les produits issus d’animaux ayant consommé des OGM pour vérifier s’ils contiennent ou non de l’herbicide. Il serait logique de trouver plus de Roundup dans une plante tolérante au Roundup que dans une plante qui ne l’est pas.
Par ailleurs, tout montre aujourd’hui que l’avènement des OGM rendra la coexistence difficile. Le seul fait de parler de seuil prouve que le consommateur aura le choix entre un petit peu d’OGM ou beaucoup d’OGM…
M. William VILLENEUVE : Mais il a le choix, aujourd’hui !
M. Arnaud APOTEKER : Ce choix ne pourra plus exister. Le seuil de 0,9 % deviendra rapidement intenable et il faudra progressivement l’augmenter, mettant le consommateur devant le fait accompli.
Tout montre également la nécessité, pour prévenir les phénomènes de résistance, de coordonner les cultures OGM sur le territoire, ce qui créera une énorme machine à gaz qui ne fonctionnera jamais. Jamais les essais en plein champ ne permettront de gérer une situation agricole où, précisément, il n’y aura plus de contrôle. Le jour où l’on acceptera les cultures OGM à grande échelle, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Les conséquences, à l’évidence irréversibles, en sont pour l’instant imprévisibles.
M. Yves CHUPEAU : Je ne peux pas laisser passer ce que j’ai entendu sur les herbicides… Les plantes résistantes ne sont traitées qu’une seule fois au glyphosate, et au stade plantule. S’il reste des produits de dégradation dans la plante, ce ne peut qu’être infinitésimal et, en tout cas, beaucoup moins que dans les autres types d’utilisation du glyphosate. Je ne suis pas un ardent défenseur des OGM mais je veux simplement que cette technique soit utilisable lorsqu’il faut l’utiliser. Si M. Dufour a toutes les plantes qu’il lui faut, c’est grâce à cinquante ans de travaux systématiques dans le domaine de l’amélioration des plantes, qui reposent, qu’on le veuille ou non, sur le même principe : que l’on procède par croisement interspécifique, qui fait bouger tous les transposons, ou par transfert de gènes, c’est exactement la même chose. En revanche, on peut aller beaucoup plus vite et, même, revenir à des variétés anciennes.
Je ne prône pas l’utilisation du génie génétique dans toutes les applications ; mais dans le cas notamment de résistances à des maladies, et particulièrement au mildiou de la pomme de terre, je vois difficilement comment on peut le refuser, y compris parmi les agriculteurs biologiques.
M. Louis-Marie HOUDEBINE : Il est vrai que je m’occupe d’animaux et non de plantes, mais je continue à ne pas comprendre comment on peut rejeter par principe la sélection par le génie génétique, après tout le bénéfice que l’on a tiré de la sélection génétique classique… Et pour ce qui est de l’innocuité, lorsqu’on voit à quel point ces produits sont suivis, alors que les produits conventionnels ne le sont pratiquement pas, je ne comprends pas davantage comment ils pourraient entraîner de telles catastrophes ! Quant à se demander s’il reste des résidus d’OGM dans les animaux qui les mangent, la réponse est évidemment non : on a testé dans tous les sens sans jamais rien trouver. Enfin, je ne comprends pas non plus en quoi l’OGM interdirait le retour à des formes traditionnelles de cultures : tout au contraire, j’y vois une remarquable complémentarité. On a tout à gagner à mélanger toutes les techniques. Aucune ne mérite d’être éliminée, et pas davantage de passer en force.
M. Alain TOPPAN : On a souvent mélangé ce soir cultures commerciales et essais en champ, recherche et développement. Je veux insister sur la nécessité incontournable de réaliser des essais au champ, dans des conditions acceptables en termes d’agronomie, mais également en termes de respect de l’autre. Je regrette de n’avoir pas entendu certains condamner explicitement les destructions… On a le droit d’expérimenter, dans un cadre très strict, avec une expertise préalable, des autorisations, un suivi. Les choses doivent être très claires à cet égard. La transposition de la directive mettra désormais l’accent sur l’expertise socio-économique mais celle-ci, pour légitime qu’elle soit, ne peut se concevoir que dans un cadre général et non au cas par cas, pour bloquer projet après projet.
M. Jordi ROSSINYOL : Contrairement à ce qu’a laissé entendre M. Toppan, il y a bien des cas de contamination en Espagne : j’ai ici des articles qui le prouveront.
M. Alain TOPPAN : Je n’ai jamais dit cela.
M. Jordi ROSSINYOL : Quoi qu’en pensent certains, on ne peut pas dire que tout va bien : de lourdes incertitudes demeurent, sur le plan tant sanitaire qu’environnemental. La table ronde sur les enjeux sanitaires a bien montré que nous ne disposions d’aucun modèle expérimental valable : le rat n’apparaît pas adapté et les durées d’expérimentation pas davantage. Elle a également mis en évidence l’absence d’étude épidémiologique à long terme. Du côté des enjeux environnementaux, l’incertitude est encore plus grande, puisque rien, absolument rien ne permet de prouver l’innocuité des OGM.
Peut-on dès lors en déduire que tout va bien et qu’il faut continuer ? Encore faudrait-il au préalable disposer d’un cadre légal très contraignant. Nous réclamons depuis longtemps l’application du principe pollueur/payeur. Du reste, si tout va si bien, comme l’affirment Monsanto et ses chercheurs, pourquoi refusent-ils catégoriquement toute idée de responsabilité en application de ce principe ?
Nous défendons également le droit au choix. Or les contaminations rendront rapidement toute coexistence impossible et réduiront ainsi à néant les possibilités de choix. Je doute que le consommateur l’accepte. Le fait que 70 % des consommateurs européens soient opposés aux OGM le prouve à l’évidence.
Nous demandons par ailleurs la création de zones sans OGM. Certaines régions italiennes ont déjà fait valoir que leurs spécificités agricoles sont telles qu’elles ne pourraient survivre en cas de contamination. En France, 1 500 communes et plusieurs régions ont déjà demandé à devenir des zones sans OGM.
Nous exigeons enfin l’interdiction de toute culture d’OGM près des zones protégées, type Natura 2000. L’Allemagne exceptée, bien peu de pays européens ont pris des dispositions propres à ces territoires. Nous demandons que leur cas soit pris en compte lors de la discussion législative visant à la transposition de la directive.
M. Antoine MESSÉAN : Je signale seulement que mon équipe INRA remettra dans quinze jours un rapport à la Commission européenne sur la question de la coexistence entre filières OGM et non-OGM – y compris pour la production de semences –, dans lequel sont traités les cas du maïs, de la betterave et du colza. La faisabilité et le coût de la coexistence dans différents contextes agricoles y sont analysés en détail. Il ne sera malheureusement officiellement publié qu’en mai. Quoi qu’il en soit, il apporte des éléments de réponses à bon nombre de vos questions sur la coexistence.
M. André CHASSAIGNE, Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de ces échanges dont il nous reste à faire la synthèse.
Table ronde contradictoire sur le thème
« Les enjeux juridiques des OGM »
(extrait du procès-verbal de la séance du 9 février 2005)
• Monsanto Agriculture France SAS : M. Stéphane PASTEAU, directeur scientifique chargé des relations institutionnelles et industrielles
• Mme Corinne LEPAGE, avocate, docteur en droit, ancienne ministre de l’environnement, présidente du Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique (CRII GEN) et de Cap 21
• Ministère de l’agriculture : Mme Isabelle TISON, sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations au service des Affaires juridiques et M. Eric GIRY, chef du bureau de la réglementation alimentaire et des biotechnologies à la Direction générale de l’alimentation (DGAL)
• Mme Anne CHETAILLE, économiste de l’environnement spécialisée dans le suivi des réglementations européennes et internationales sur la biodiversité, le commerce et le développement durable, les droits de propriété intellectuelle et la biodiversité au sein du Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET)
• Mme Isabelle RAVAIL-DELY, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, membre de la Commission du génie biomoléculaire (CGB)
• Limagrain : M. Grégoire-Yves BERTHE, directeur des affaires réglementaires
• M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE, département de biologie végétale à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
• Confédération paysanne : M.Guy KASTLER, président du Réseau semences paysannes
• Fédération française des sociétés d’assurance : M. Claude DELPOUX, directeur des assurances de biens et de responsabilités et M. Guillaume ROSENWALD, directeur des marchés
• Greenpeace Europe : M. Eric GALL, OGM et propriété intellectuelle, conseiller politique
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de participer à notre table ronde. Cette rencontre intervient après plus de trois mois de travaux durant desquels nous avons entendu plus d’une centaine d’experts au cours d’auditions privées, puis de tables rondes regroupant des spécialistes par catégories. Maintenant nous tenons une série de tables rondes thématiques et contradictoires. Les deux premières ont porté sur les enjeux sanitaires et sur les enjeux environnementaux, et les deux dernières se tiendront la semaine prochaine, autour, d’une part, des enjeux économiques et, d’autre part, de l’information du public et des médias.
Notre objectif n’est pas de faire passer les opinions personnelles qui animent fatalement chacun d’entre nous mais, à la demande du Président de l’Assemblée nationale, de préparer le débat sur la transposition de la directive européenne 2001/18/CE en accomplissant un travail de fond qui permettra de renouveler le dialogue entre le politique, le scientifique et le citoyen sur la question des OGM. Une fois ce travail accompli, chacun s’exprimera, avec sa propre sensibilité, dans le cadre du débat législatif. Ainsi, le moratoire sur le colza fut adopté sur proposition de la Conférence citoyenne de 1998, que j’animais, alors que le débat public ne faisait que commencer.
Nous discuterons aujourd’hui de trois thèmes.
Premièrement, la gouvernance des OGM. Quelles procédures doivent être mises en œuvre pour contrôler les OGM ? Le système d’autorisation des expérimentations est-il satisfaisant ?
Deuxièmement, comment assurer une protection équilibrée de la propriété industrielle ? La loi votée récemment par le Parlement sur la protection des inventions biotechnologiques est-elle satisfaisante ? Sinon, pour quelles raisons ? Les parlementaires doivent-ils demander qu’elle soit précisée sur certains points ?
Troisièmement, quel doit être le régime de responsabilité et d’assurance face aux risques potentiels liés aux OGM ? Ce thème figure au centre de la modification récente de la législation allemande.
M. Stéphane PASTEAU : Je suis directeur des relations extérieures de Monsanto Agriculture France. Lors d’une première intervention, il y a quinze jours, j’ai plaidé devant vous pour une introduction progressive et maîtrisée de la culture des OGM en France, en particulier du maïs, afin de tester, en conditions réelles, l’efficacité des règles de coexistence. La culture du maïs OGM dans des conditions satisfaisantes pour tous suppose que deux objectifs soient poursuivis : le dépassement du seuil réglementaire de présence fortuite doit rester exceptionnel ; dans les cas où il ne peut, malgré tout, pas être respecté, l’agriculteur non-OGM ne doit subir aucun préjudice économique. Une approche pragmatique de la gestion du voisinage entre culture OGM et culture non-OGM est possible, et la filière agricole française a la capacité de proposer des solutions réalistes permettant à chacun de choisir son type d’agriculture dans le respect du choix des autres. Le moment est venu pour la France de mener sa propre expérience et de s’en inspirer pour instituer un système pérenne.
Mme Corinne LEPAGE : Je représente le CRII-GEN, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique, association créée en 1998, avec Eric Séralini et Jean-Marie Pelt, et dont le comité scientifique est aujourd’hui extrêmement actif – je vous invite à consulter notre site Internet.
Il me semble aujourd’hui essentiel de réfléchir à l’impact des OGM sur la santé car la problématique, en la matière, est équivalente à celle qui nous interpellait, il y a une dizaine d’années, à propos de l’impact sur l’environnement, relativement bien connu désormais. Il importe que s’exerce la démocratie participative et que s’ouvre une véritable controverse scientifique sur la santé, et par conséquent sur la responsabilité : si les assurances couvraient le risque lié aux OGM, chacun prendrait ses responsabilités. Mais, en l’absence de couverture, le contribuable devra payer la note des problèmes de santé publique qui risquent de survenir dans cinq, dix ou quinze ans, et il sera dur de le lui faire accepter, indépendamment de sa sensibilité à l’égard des OGM.
La controverse scientifique sur l’impact sanitaire des OGM passe par une réflexion sur le secret industriel, car il est actuellement impossible de se procurer les études conduites par Monsanto et autres – Greenpeace a engagé une procédure sur ce point en Suède et le CRII-GEN en fait de même en France. Il est normal que les entreprises défendent leurs brevets et leurs secrets industriels, mais il est inacceptable que des études laissant apparaître, au moins, un débat sur les impacts sanitaires restent couvertes par le secret industriel. Tous les scientifiques doivent alors s’en emparer et en débattre.
M. le Président : Nous reviendrons sur cette question, lorsque nous traiterons de la responsabilité et de l’assurance. Je vous fais toutefois remarquer que votre préoccupation au sujet des impacts sanitaires a été très relativisée par les scientifiques auditionnés.
M. Éric GALL : Je suis conseiller politique pour l’unité européenne de Greenpeace. Nous sommes opposés à la dissémination d’OGM dans l’environnement à cause du risque de contamination génétique irréversible, leurs effets négatifs sur l’environnement étant aujourd’hui avérés. La situation des agriculteurs argentins est catastrophique. Une étude fondée sur les données du département américain de l’agriculture a montré que le développement du soja transgénique, entre 2001 et 2003, avait conduit à accroître l’utilisation d’herbicide de plus de 36 millions de kilogrammes. La contamination des variétés traditionnelles de maïs mexicain est particulièrement inquiétante car elle met en péril ce réservoir de biodiversité. Enfin, plusieurs OGM employés au Canada ont eu des effets inattendus, par exemple une teneur plus élevée en lignine dans les maïs Bt.
Nous nous prêtons de bonne grâce et avec reconnaissance à l’exercice que vous nous proposez, mais je souligne qu’il est toujours important, en préalable, de bien définir les termes du débat, ce que votre mission d’information, à ma connaissance, n’a pas fait. Avant d’autoriser un OGM, il importe de mettre en balance l’intérêt ou l’absence d’intérêt qu’il représente par rapport à des méthodes alternatives.
M. le Président : Rassurez-vous, nous en avons parlé hier.
M. Éric GALL : La législation européenne a fait des progrès, notamment en ce qui concerne la traçabilité et l’étiquetage, mais elle reste incomplète et sa mise en œuvre est inadéquate en matière d’autorisation et d’évaluation scientifique. Celle-ci est superficielle et se fonde sur des données fournies par les compagnies elles-mêmes, et je ne peux qu’appuyer ce qui vient d’être dit sur l’absence de transparence des études qui sont couvertes par le secret industriel.
Mme Isabelle TISON : Je suis sous-directrice du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations, au service des affaires juridiques du ministère de l’agriculture. Nous traitons tout le contentieux du ministère et nous assurons un appui juridique aux directions techniques, notamment à la Direction générale de l’alimentation (DGAL).
M. Éric GIRY : Je suis chef du bureau de la réglementation alimentaire et des biotechnologies, à la DGAL. Celle-ci instruit les demandes d’autorisations d’essais en plein champ, suit les demandes d’autorisations de mise sur le marché, contrôle la conformité des essais, ainsi que le contrôle des importations de semences OGM et assure le secrétariat de la Commission du génie biomoléculaire (CGB).
Mme Anne CHETAILLE : J’exerce la fonction de chargée de mission du pôle « politiques publiques et régulation internationale » du Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET), une ONG de solidarité internationale. Je suis également administratrice de l’association Inf’OGM, au sein de laquelle je suis chargée de la veille juridique. Je m’occupe particulièrement des questions internationales liées à la biosécurité, dans le cadre des négociations sur le Protocole de Carthagène, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du Codex alimentarius. Je mène des actions d’information et de sensibilisation en Afrique francophone et je suis la mise en place de cadres de biosécurité en Afrique de l’Ouest. Enfin, je travaille sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages.
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Magistrate, premier conseiller au tribunal administratif de Paris, je suis membre de la CGB en qualité de juriste. Quoique n’étant pas biologiste, j’ai pu constater la portée des expertises scientifiques dans ce domaine, mais elles restent certainement perfectibles, notamment en ce qui concerne les panels d’experts retenus, même si la CGB fait de plus en plus appel à des experts reconnus internationalement. Pour répondre aux critiques dont fait l’objet la CGB, il y a lieu de distinguer le contrôle, qui relève des scientifiques, de la décision, qui doit rester au pouvoir politique.
M. Grégoire BERTHE : Je travaille pour la coopérative agricole Limagrain, basée en Auvergne. J’ai été sélectionneur de maïs au Brésil, puis en France, en Europe et aux Etats-Unis. Je suis actuellement directeur scientifique et réglementaire de Limagrain. Je me suis un peu impliqué dans les OGM en tant que créateur de variétés, mais aussi parce que je préside la Chambre syndicale des entreprises françaises de semences de maïs, la SEPROMA pour laquelle j’interviens au niveau européen et international. Notre entreprise est très sensible au maintien d’une position compétitive de la France, mais elle est aussi très impliquée dans la recherche d’une réglementation équilibrée.
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Je suis directeur de recherche à l’INRA et adjoint au chef du département de biologie végétale. Je m’occupe, plus particulièrement, de partenariat avec les entreprises et de propriété intellectuelle. A ce titre, je viens de coordonner le dépôt d’un projet d’action européenne sur la mutualisation de la gestion de la propriété intellectuelle des organismes de recherche publique, qui a pour objectifs d’améliorer le transfert de leurs résultats vers les entreprises, et notamment les PME européennes, et de mieux affirmer leur rôle dans la définition d’objectifs d’intérêt général, notamment la responsabilité de l’Europe à l’égard des pays du Tiers-Monde.
M. Guy KASTLER : Je représente la Confédération paysanne et le Réseau semences paysannes, que j’ai l’honneur de présider. Celui-ci regroupe l’ensemble des paysans de France qui ont décidé de reproduire ce que firent des milliers de générations et ce que font encore 90 % de paysans de la planète : employer leurs propres semences. Le problème de la propriété intellectuelle est sans doute important mais les paysans ont aussi des droits, parmi lesquels celui de choisir leur système agraire ainsi que leurs semences et d’échanger ces dernières. L’ensemble des constructions juridiques sur les OGM partent d’un préalable faux : tous les producteurs se situeraient dans un schéma d’agriculture industrielle et achèteraient leurs semences chaque année. Les consommateurs réclament une agriculture moins industrielle, moins abîmée par les pesticides. Ils veulent une agriculture paysanne et rurale. Je voudrais que nous parlions des droits des paysans.
M. Claude DELPOUX : J’exerce la fonction de directeur de l’assurance dommages à la Fédération française des sociétés d’assurances, et je suis accompagné de M. Guillaume Rosenwald, mon adjoint chargé des marchés de l’assurance dommages. La fédération réfléchit évidemment aux problèmes de responsabilité et d’assurabilité. Comme nous l’avons dit lors de la réunion du 1er février dernier, faute de certitudes techniques et d’un encadrement juridique très clair des responsabilités, il est difficile d’envisager, dans l’état actuel des choses, l’assurance des risques liés aux OGM.
M. le Président : Je vous propose maintenant que nous ayons un premier échange à propos de la gouvernance des OGM. Avez-vous des propositions à formuler en ce qui concerne la CGB ? Comment fonctionnerait un système idéal de gouvernance des autorisations d’expérimentations ?
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : La question est délicate et ma réponse ne vous conviendra pas forcément. Il est parfois nécessaire d’approfondir l’expertise mais les demandes allant dans ce sens, jusqu’à présent, ont toujours été satisfaites, cela a été particulièrement le cas pour le colza. Il faut distinguer deux problèmes. S’agissant de la composition interne de la CGB, le panel d’experts devrait sans doute être élargi, afin que l’expertise soit la plus complète possible. Mais surtout, l’indépendance des experts extérieurs à la CGB doit être garantie pour que leur impartialité soit indiscutable. La CGB cherche actuellement à renforcer la seule condition procédurale existante : la déclaration d’intérêts, à laquelle pourrait être adjointe une déclaration d’intérêts intellectuels, sur le modèle de ce qui se fait au niveau européen.
Mme Corinne LEPAGE : N’étant pas membre de la CGB, mon avis sera moins précis, mais je souscris à la distinction opérée entre la composition de cette instance et la procédure suivie.
S’agissant de la composition, je constate que, pendant plusieurs années, la CGB a fonctionné sans représentant des associations de consommateurs et de défense de l’environnement. Peut-être faut-il envisager que ces associations disposent de plusieurs représentants et puissent nommer des titulaires et des suppléants. Ensuite, concernant la possibilité de créer deux commissions, la première purement scientifique et la seconde davantage tournée vers la société civile et l’acceptabilité du risque, je pense qu’une commission unique est plus pertinente car elle permet une interpellation permanente entre les scientifiques et la société. Enfin, il est effectivement fondamental que les conflits d’intérêts soient bien gérés, aussi bien pour ce qui concerne les membres de la CGB que les experts, faute de quoi les consommateurs et les citoyens ne pourront avoir confiance dans ce qu’on leur dit.
S’agissant de la procédure, il faut fixer le profil des experts. Aujourd’hui, ils sont généralement choisis par les demandeurs, ce qui pose tout de même un problème.
M. le Président : Cela se passait-il ainsi lorsque vous étiez ministre, Mme Lepage ?
Mme Corinne LEPAGE : Puisque vous m’y invitez, M. le Président, je vais mettre les pieds dans le plat. Le ministère de l’environnement est censé participer à la gestion des organismes génétiquement modifiés, mais c’est, en fait, le ministère de l’agriculture qui pilote tout – vous noterez que deux de ses représentants sont présents ce matin. Le ministre de l’environnement dispose bien d’un droit d’opposition théorique mais, en deux ans, je n’ai pas vu passer un dossier.
M. le Président : Vous vous êtes tout de même opposée à M. Vasseur !
Mme Corinne LEPAGE : J’ai certes obtenu un moratoire mais il a fallu que je prenne l’initiative, à la suite de débats au sein de l’Union européenne, d’écrire au Premier ministre pour lui exposer le problème.
M. François GUILLAUME : Un débat contradictoire est en effet nécessaire, mais que signifie l’expression « experts indépendants » ? Il serait intéressant de savoir, à cet égard, qui finance le CRII-GEN ou Greenpeace.
M. le Président : La mission d’information n’est pas chargée d’enquêter sur ce point, mon cher collègue.
Mme Corinne LEPAGE : Mais je peux répondre sans problème. Les membres du CRII-GEN sont totalement bénévoles. L’association n’a pas de siège social, elle n’a qu’un site Internet et elle vit avec 150 000 francs par an, correspondant aux contributions reçues lors de conférences en province et aux dons de quelques grandes entreprises comme Carrefour.
M. François GUILLAUME : Ah, vous voyez !
Mme Corinne LEPAGE : Vous laissez entendre que nous serions dépendants de Carrefour ? C’est lamentable !
M. Gérard DUBRAC : Carrefour commercialise pourtant des produits à base d’OGM !
M. le Président : Les auditions se sont jusqu’à présent déroulées dans le calme. Je vous demande, mes chers collègues, de ne pas poser de questions provocatrices et de ne pas formuler d’attaques trop rudes.
Mme Corinne LEPAGE : Je n’ai rien à cacher !
M. le Rapporteur : Je reviens à la composition de la commission. Ne serait-il tout de même pas plus pertinent de prévoir deux instances, la première étant chargée d’évaluer les risques tandis que la seconde serait composée de personnalités de la société civile et, par exemple, de deux scientifiques qui transmettraient l’information scientifique recueillie dans la première instance ?
Mme Corinne LEPAGE : J’ai été très impressionnée par le récent rapport de l’Agence européenne pour l’environnement intitulé : « Signaux précoces, leçons tardives, le principe de précaution, 1896-2009 ». Celui-ci explique ce qui s’est passé chaque fois que la société, au cours du xxe siècle, a été confrontée à des technologies susceptibles de poser problème, comme l’amiante. Dans quatorze cas, la controverse scientifique a eu du mal à naître, puis a été confisquée et faussée. J’en déduis que les choses se seraient passées autrement s’il avait existé une sphère où la société civile aurait pu s’exprimer, et tout le monde en aurait profité, y compris le monde économique, tôt ou tard contraint à se débarrasser au prix fort des technologies dangereuses.
M. le Président : Nous avons déjà eu cette discussion lors d’une précédente table ronde, et M. Kourilsky a estimé que le problème des OGM ne pouvait être comparé à celui de l’amiante. En effet, les risques que comportait cette matière étaient avérés et connus – il ne s’agissait donc pas de précaution mais de prévention –, tandis que, pour les OGM, il n’existe pas de « signal précoce » de risque sanitaire : nous sommes là dans la même situation qu’au début du chemin de fer ou de l’électricité.
Mme Corinne LEPAGE : Mais pourquoi ne pas mettre sur la table les études disponibles portant sur la santé des animaux, par exemple ?
M. François GUILLAUME : Elles ont été contestées, vous le savez parfaitement !
Mme Corinne LEPAGE : Mais par qui, M. Guillaume ?
M. François GUILLAUME : Par les scientifiques eux-mêmes.
M. Éric GALL : Puisque j’ai été interpellé, je précise que Greenpeace est financièrement totalement indépendante : nous ne sommes financés que par les dons des particuliers et nous ne sollicitons ni ne recevons aucune contribution publique ou contribution d’entreprise. Nous totalisons 2,5 millions d’adhérents dans le monde, dont 80 000 en France.
M. le Rapporteur : Mais comment se fait-il que vous donniez l’impression de vous acharner davantage sur la France que sur un pays comme les Etats-Unis ?
M. Éric GALL : C’est complètement faux. Je me rends moi-même au Canada la semaine prochaine pour promouvoir le système européen d’étiquetage et de traçabilité. Nous sommes également très actifs en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, y compris en Chine continentale : en janvier, nous avons organisé une tournée dans la province du Yunnan pour informer les paysans du risque lié à la culture de soja transgénique. Je serais d’ailleurs ravi si les médias rendaient répercutaient mieux ces activités. Il faut dépasser l’idée reçue selon laquelle Greenpeace cible ses attaques sur la France. Les années 80 et l’affaire du Rainbow Warrior sont loin.
M. le Président : Au demeurant, il faut reconnaître que Greenpeace, dans cette affaire, fut la victime…
M. Éric GALL : Pour revenir au débat, l’idée de mener en parallèle une évaluation scientifique et une évaluation de l’intérêt et du risque socio-économiques liés aux OGM au regard des autres méthodes est intéressante. Des représentants de la société civile devraient alors intervenir aux deux niveaux d’expertise. De plus, il faudrait que ceux-ci aient un poids identique et soient reliés par des passerelles.
S’agissant de l’autorisation des OGM, travaillant à Bruxelles, je suis moins familier de la CGB que de la procédure européenne. Celle-ci est ainsi faite qu’il est pratiquement impossible de refuser une autorisation d’OGM, dans la mesure où cela suppose un vote négatif de la majorité qualifiée des Etats membres en Conseil des ministres de l’environnement : même si plus de la moitié des autorités nationales d’évaluation des OGM s’opposent à une autorisation et en dénoncent les risques, il peut donc arriver qu’un organisme soit autorisé si l’AESA, l’Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments, considère qu’il n’y a pas lieu de se préoccuper des divergences scientifiques ou des problèmes pointés. Nous avons en outre constaté que ce nouvel organisme n’apportait absolument aucun progrès par rapport au système antérieur : deux des experts du panel, par exemple, ont participé à des vidéos de promotion d’OGM émanant de l’industrie, et plusieurs autres sont également membres d’agences nationales d’évaluation, ce qui signifie qu’ils sont juges et partie, alors que l’Autorité est censée arbitrer entre les Etats membres.
M. le Président : C’est désormais l’AESA qui est compétente pour les autorisations de mise sur le marché, et le rôle des instances nationales devra être redéfini. Il conviendra sans doute de bâtir un système dans lequel l’instruction des dossiers sera confiée aux agences nationales et la décision à un niveau supranational mais le fonctionnement devra être clarifié. Bien évidemment, il faut que les experts de l’AESA soient variés et indépendants.
M. Éric GALL : Le texte instituant l’AESA, notamment son article 30, lui fait obligation de consulter les agences nationales en cas de divergence des avis scientifiques. Or, en pratique, elle ne le fait pas. Le lien entre les experts de l’AESA et les agences nationales est très ténu.
La nouvelle directive prévoit l’évaluation des impacts à long terme sur l’environnement ainsi que des effets cumulatifs et indirects, mais la façon dont ces exigences juridiques sont interprétées confère toute latitude aux autorités nationales. De l’aveu même des scientifiques, les critères ne sont pas suffisamment clairs et les méthodes d’évaluation laissent par conséquent une trop grande place à la subjectivité. L’expression biologically significant, par exemple, pour désigner la variation constatée entre l’OGM et la variété conventionnelle, ne fait l’objet d’aucune définition scientifique et est laissée à l’appréciation des experts. Or une grande partie de ces derniers partent de l’hypothèse zéro selon laquelle les OGM sont équivalents aux plantes conventionnelles. Il n’y aurait donc pas lieu d’effectuer des recherches supplémentaires en vue de mesurer leurs effets précis sur la faune et la flore. Toutes les exigences relatives à l’expertise devraient être contraignantes et déterminées par le législateur, après discussion avec les experts, au lieu de laisser ces derniers choisir des critères subjectifs.
Enfin, la transparence est un gros problème, la majeure partie des études supposées justifier l’utilisation d’OGM étant classées « business confidential information » (information relevant du secret industriel), en contravention avec la législation européenne.
M. le Rapporteur : Que pensez-vous de la création d’un organisme public qui serait chargé de diffuser de l’information sur les OGM ?
M. Éric GALL : L’information doit être liée aux demandes d’autorisation elles-mêmes. Les études commandées par les compagnies doivent être complètement accessibles au public et à la communauté scientifique. Il ne faut pas que ce soit une information générale.
M. Éric GIRY : Je voudrais préciser que si certains sièges de la Commission du génie biomoléculaire sont restés vides, c’est parce que les représentants des associations de consommateurs et autres ont très rapidement démissionné. Il est en effet assez difficile de trouver sa place dans une instance scientifique quand on ne l’est pas soi-même, de s’astreindre à plus d’une réunion par mois et à la lecture de cas d’une extrême complexité : les dossiers d’autorisation au titre de la partie C (autorisation de mise sur le marché) comportent de 5 000 à 6 000 pages. Voilà pourquoi la séparation entre deux sous-groupes est une idée à étudier.
Je voudrais dire également que tous les membres de la CGB participent à ses travaux à titre bénévole. L’exercice a donc ses limites. Quant aux experts extérieurs, ils ne sont pas désignés par le ministère de l’agriculture ni par le pétitionnaire mais par les membres de la commission eux-mêmes. La directive 2001/18/CE exige des évaluations de plus en plus larges, ce qui requiert le concours de panels d’experts couvrant de plus en plus de problématiques scientifiques.
Enfin, je rappelle que le ministère de l’environnement assure le co-secrétariat de la commission, conformément au décret de 1993 qui a créé la CGB, et que les décisions d’autorisation d’essais sont prises par le ministre de l’agriculture, après accord du ministre de l’environnement – cela a d’ailleurs toujours été le cas.
Mme Corinne LEPAGE : J’ignore comment cela fonctionne aujourd’hui mais, il y a dix ans, le ministre de l’environnement n’avait pas la possibilité d’émettre un avis, seulement une opposition. Quoi qu’il en soit, les moyens des deux ministères ne sont pas identiques et, dans la pratique, c’est le celui de l’agriculture qui fait le travail.
M. le Président : Nous interrogerons M. Serge Lepeltier sur ce problème.
Revenons à la question qui nous préoccupe dans l’immédiat : faut-il scinder l’expertise entre deux commissions ?
Mme Anne CHETAILLE : Sur le principe, nous sommes tous d’accord : l’expertise doit être contradictoire, évolutive en fonction des connaissances scientifiques ou des doutes – y compris de ceux apparaissant après une autorisation – et indépendante. La question de l’indépendance soulève, de façon plus générale, celle de la recherche, de la capacité d’expertise et des formations universitaires privilégiées en France : des disciplines comme l’écologie ou l’épidémiologie sont abandonnées, et le manque de moyens dont elles disposent est sans doute l’une des raisons pour lesquelles seuls les spécialistes en biologie moléculaire sont représentés. La France, à ma connaissance, n’a d’ailleurs toujours pas fourni le fichier d’experts demandé dans le cadre du Protocole de Carthagène.
S’agissant du mode de fonctionnement de la commission, il importe que les chercheurs, les associations et les acteurs économiques siègent dans la même commission, afin que les citoyens puissent avoir connaissance des débats sur les risques, réagir et dresser le bilan des avantages et des risques, que ce soit en matière environnementale, sanitaire ou socio-économique.
Enfin, je préconise que le débat sur l’expertise scientifique préalable aux autorisations d’OGM soit lié à ceux sur les orientations de la recherche en général et sur la participation du citoyen à la programmation de la recherche et à la valorisation des résultats.
M. le Président : Autant le thème « recherche et société » est effectivement crucial, autant il paraît impossible que le citoyen participe à la programmation de la recherche car celle-ci doit être libre. Au contraire, on peut penser que le citoyen puisse participer aux choix des applications.
Mme Anne CHETAILLE : L’implication du citoyen peut effectivement s’entendre à divers degrés et je comprends que la référence à la « programmation » puisse être impropre.
Mme Geneviève PERRIN-GAILARD : Les débats ont monté combien nos concitoyens souhaitaient pouvoir s’appuyer sur une expertise indépendante. Mais le problème des moyens de la recherche publique se pose : les financements de nombre de programmes sont dramatiquement remis en cause et les organismes publics de recherche doivent de plus en plus recourir à des apports privés. Comment faire pour que nos concitoyens n’aient pas l’impression que les chercheurs perdent leur indépendance, dès lors qu’une entreprise fabriquant des OGM participe au financement de tel ou tel organisme public de recherche ?
M. Pierre COHEN : Il est effectivement très difficile d’imaginer une expertise parfaitement indépendante, ne serait-ce que parce qu’aucun individu n’est totalement neutre vis-à-vis des OGM. C’est pourquoi l’on s’achemine de plus en plus vers des expertises contradictoires. Mais, sur les OGM, celles-ci sont-elles de nature à donner une idée correcte de la réalité ? J’en doute si je me réfère à ce que nous constatons au sein de cette mission où il apparaît que les positions sont extrêmement marquées et fermées.
M. Grégoire BERTHE : L’évaluation d’un OGM appelle évidemment une expertise large et contradictoire de ses avantages, mais aussi des bénéfices attendus de la façon dont il est envisagé de le cultiver. Par exemple, lorsqu’une variété résiste à un insecte, on l’introduit dans des champs, on examine comment les insectes se comportent et interagissent sur leur environnement, mais aussi quelles sont les options alternatives. Il est fondamental que la recherche publique intervienne dans ce processus, mais celui-ci doit demeurer totalement indépendant de l’expertise sociétale. Dans un deuxième temps, il revient aux pouvoirs publics de prendre les grandes orientations, mais mélanger les deux démarches revient à diluer la notion d’évaluation scientifique. L’amélioration des plantes est un métier pratiqué par un petit nombre de gens et le panel des experts est limité, mais tout le monde est indépendant sur son créneau, à l’instar de ma société, qui regroupe 600 agriculteurs auvergnats. L’indépendance naît d’une expertise couvrant les différentes facettes du problème.
M. Guy KASTLER : L’absence de représentants de la société civile, des consommateurs et des paysans au stade de l’évaluation a deux conséquences : certaines questions sont toujours éludées et les controverses scientifiques ne sont donc pas abordées. Quelle conséquence aura un OGM ou un essai d’OGM sur la pérennité des systèmes agraires ? Quel effet aura la commercialisation d’une variété transgénique sur la taille des exploitations ?
Si l’indépendance des scientifiques est systématiquement mise en cause, c’est que la CGB souffre de la mainmise d’une catégorie de scientifiques : les spécialistes en biologie moléculaire. La science ne se résume pourtant pas à cette discipline ! Des questions sociologiques, économiques et écologiques doivent être soulevées. Au-delà, c’est la gouvernance de la science qui pose problème, car ces disciplines sont dépourvues d’investissement public et, depuis vingt ans, l’INRA embauche essentiellement des chercheurs en biologie moléculaire.
Voilà pourquoi certains dogmes scientifiques ne sont jamais remis en cause. Ainsi, un document publié à propos d’essais indique qu’un Bt n’a aucune conséquence sur la santé humaine ni l’environnement, alors que ce n’est pas le même type de Bt qui figure dans les plantes transgéniques considérées – il existe en effet 96 insertions possibles de Bt, chacun ayant des actions spécifiques. De même, il est arrivé que soit évaluée une construction transgénique dans une variété autre que celle destinée à la commercialisation. Or on sait très bien que, suivant le contexte génétique, l’OGM n’a pas les mêmes effets. Quant aux conséquences des OGM sur l’environnement et la microbiologie des sols, elles n’ont jamais été étudiées.
Enfin, si tous les membres des commissions sont bénévoles, cela signifie forcément qu’ils ont la possibilité financière d’y siéger, c’est-à-dire qu’ils représentent des lobbies. Si vous voulez que la société civile intervienne, il faut lui en donner les moyens, notamment financiers.
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Je voudrais réagir en rappelant qu’au moins trois départements de l’INRA s’intéressent à la problématique de l’écologie : écologie et physiologie végétale ; milieux naturels, forêt et environnement ; écologie et sociologie rurale qui a beaucoup travaillé sur la relation entre la science et le citoyen.
M. Guy KASTLER : Mais quelles masses financières représentent chacun de ces départements ?
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Je vous invite à vérifier le nombre de chercheurs et de laboratoires qui sont impliqués sur le sujet !
M. Grégoire BERTHE : Une variété de maïs OGM ne peut pas, à elle seule, modifier les modes de culture et prétendre que la production d’OGM se traduit par un recours plus important aux herbicides est une erreur totale ! Quand un agriculteur veut cultiver du colza ou du blé dans son champ, il est bien obligé d’enlever les autres plantes, notamment les mauvaises herbes et cela se fait de différentes façons. Au Brésil, les ouvriers passent leur vie sous le soleil à les arracher à la binette. Ainsi, le fait qu’une variété OGM soit résistante à un insecte ou pas n’aura aucun impact sur le système de culture proprement dit. Mais cela aura, en revanche, un effet sur les revenus à l’hectare de l’agriculteur insuffisamment riche pour acheter des intrants, en lui apportant un peu plus de bien-être. Dans ce sens-là, le recours aux OGM peut effectivement changer le mode de culture.
Le gène du Roundup figure dans plusieurs variétés de plantes, mais vous n’ignorez pas que certaines mauvaises herbes, dans le nord des Etats-Unis, commencent à devenir résistantes. Ce qui est normal : un jour je produis une espèce résistante à un insecte, le lendemain celui-ci évolue et peut manger la plante, ce qui m’oblige à recommencer mon travail d’amélioration et de sélection, et ainsi de suite. Pour les herbicides, il en va de même, car les espèces évoluent au gré des mutations naturelles. Ne mélangeons pas tout et restons concrets.
M. Guy KASTLER : Détruire les mauvaises herbes avec des produits toxiques pour la santé de l’agriculteur et du consommateur ou gérer les mauvaises herbes par d’autres pratiques n’a pas les mêmes conséquences !
M. le Président : Pour l’instant, il est question de la gouvernance souhaitable pour le système de contrôle des OGM. L’introduction d’une autre technique n’a pas forcément pour conséquence de remplacer l’agriculture raisonnée. Les deux méthodes peuvent être complémentaires. Alors pourquoi faudrait-il obligatoirement tout arrêter ?
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Les membres de la CGB sont effectivement tous bénévoles, mais je ne crois pas qu’ils soient pour autant à la solde de quiconque.
Pour ce qui est du problème de la mixité de la Commission entre scientifiques et société civile, je constate que les dossiers scientifiques sont d’une grande complexité et que les nouveaux membres représentant les associations de consommateurs et de protection de l’environnement sont tous des scientifiques – des médecins. Peut-on toujours parler de société civile lorsqu’elle est représentée par des scientifiques ? Le mélange des genres me paraît très délicat. On demande aux scientifiques un avis scientifique. La société civile doit raisonner d’un autre point de vue.
M. Gabriel BIANCHERI : Très bien !
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Faut-il créer un deuxième cercle d’expertise ouvert à la société civile ? Quelle part prendra cette instance à la prise de responsabilité ? Quelle sera sa légitimité, puisque le politique décide de toute façon en dernier ressort ? Si un problème survient, ce sont d’ailleurs les ministres qui voient leur responsabilité mise en jeu.
M. Gabriel BIANCHERI : Très bien !
M. le Président : Il n’en demeure pas moins, comme l’a dit M. Kastler, qu’aucune controverse scientifique ne doit être négligée.
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Jamais vous ne me ferez dire le contraire, mais je ne pense pas que ce soit à la CGB de répondre sur le plan sociopolitique.
Mme Anne CHETAILLE : La question porte en définitive sur les moyens de faire coexister plusieurs types d’agriculture et les moyens de prévenir et de gérer les contaminations.
M. le Président : C’était plutôt le thème de la table ronde d’hier.
Mme Anne CHETAILLE : Mais les enjeux sont aussi réglementaires. La coexistence doit être régulée au niveau des Etats membres de l’Union européenne et, à ce titre, il est important que les règles de coexistence couvrent l’ensemble de la filière, y compris les transports. Qui doit prendre en charge la mise en œuvre de ces mesures ? Il est fondamental d’assurer le libre choix des agriculteurs et de ne pas tout miser sur les OGM.
M. Philippe TOURTELIER : On renvoie le problème aux experts en pensant que leur jugement sera objectif. Or un expert n’est jamais objectif, puisqu’il se réfère à un ensemble de représentations. La société civile, à cet égard, a toute légitimité pour interroger les experts.
Pour nous éclairer et amorcer une analyse plus approfondie, l’INRA dispose-t-il d’un programme de recherche transversal associant les chercheurs en biologie moléculaire, en écologie des milieux naturels et en sociologie des exploitations et qui pourrait éclairer la réflexion du citoyen ?
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Un programme de recherche est d’abord défini dans une discipline, spécialité des personnes qui y travaillent. L’INRA soutient des programmes de recherche transversaux entre disciplines complémentaires et des opérations interdisciplinaires plus larges associant les disciplines techniques et les sciences économiques et sociales ; de telles opérations ont été conduites concernant les OGM.
M. Éric GALL : Il ne s’agit pas de choisir entre utilisation d’herbicides et utilisation d’OGM. L’enjeu consiste à développer des méthodes agricoles respectueuses de l’environnement, sans trop d’intrants. Ainsi, pour lutter contre la pyrale, l’institut d’écologie du Kenya introduit une guêpe qui est le prédateur naturel de ce papillon et cultive une plante qui attire la pyrale hors des champs à protéger. Cette méthode a nécessité beaucoup de recherche agronomique. Ce système, une fois mis en place, est équilibré et s’autorégule, les insectes ne risquant pas de développer une résistance, comme c’est le cas avec les herbicides et les OGM. C’est pourquoi l’indépendance de la recherche publique est si importante.
M. le Président : Peut-on dire parler des OGM en général ? Peut-on tous les classer sous le même vocable ?
M. Éric GALL : Pour le moment, je parle des plantes transgéniques, plus précisément des céréales Bt qui sont censées lutter contre la pyrale, alors qu’il y a d’autres méthodes.
J’en reviens à mon développement. Les chercheurs du secteur public sont malheureusement poussés à entreprendre des partenariats avec les entreprises, et force est de constater que l’intérêt privé ne concourt pas toujours à l’intérêt général. La recherche agronomique doit travailler en priorité sur des méthodes agricoles qui ne sont pas forcément génératrices de profits, mais bénéfiques à la société. C’est pourquoi il est indispensable que la société civile soit impliquée non seulement dans l’expertise socio-économique mais aussi dans l’expertise scientifique et qu’elle puisse poser des questions comme l’impact des OGM sur les insectes pollinisateurs, sur le sol, sur la chaîne alimentaire, qui ne sont pas nécessairement posées dans les instances d’expertises.
M. le Président : Après avoir procédé à toutes ces auditions pendant trois mois, vous imaginez bien que la question des impacts des OGM a été posée. Elle l’a été sur les insectes et elle a même donné lieu à controverse.
M. Éric GALL : Mais de réels efforts ont-ils été accomplis pour tenter d’obtenir des réponses convaincantes ?
M. le Président : L’affaire du monarque, par exemple, a causé un scandale il y a cinq ou six ans, et, depuis, elle a donné lieu à dix publications. Il suffit de lire la revue Nature.
M. Éric GALL : Une étude publiée en août à propos de l’impact à long terme du Monsanto 810 et du Bt 11 sur les larves de monarque met en évidence une mortalité accrue de 20 %. Mais à ma connaissance, en Europe, seules deux études se sont penchées sur le problème.
M. Pierre COHEN : Depuis au moins une bonne quinzaine d’années, les moyens consacrés à la recherche publique sont largement insuffisants, mais l’argent ne règle pas tout. Il faut aussi avoir la volonté de répondre aux questions sociétales. Tout le monde, depuis vingt ans, réclame davantage de pluridisciplinarité, mais, pour obtenir un poste de professeur, il faut être pointu dans un domaine précis et la pluridisciplinarité est peu développée dans la pratique.
M. Stéphane PASTEAU : S’agissant des études sur l’impact des OGM, je suis prêt à me pencher avec M. Gall sur la publication concernant le monarque, papillon d’ailleurs assez peu présent en Europe et, par ailleurs, je note qu’au cours des dix dernières années, plus de 1 500 publications portant sur l’impact des plantes génétiquement modifiées ont été dénombrées. Les études scientifiques sont donc extrêmement nombreuses.
Enfin, sur l’évaluation des OGM, je dirai que leur commercialisation donne déjà lieu à une évaluation multifactorielle approfondie, comme le prévoit la réglementation. Quand une betterave résistante à un herbicide est développée, on nous demande d’examiner, à l’échelle d’un territoire comme la France, les dizaines de pratiques de désherbage utilisées pour cette espèce et de déterminer ce que l’introduction de la nouvelle variété modifierait dans les pratiques. Et, dans les laboratoires, vous verrez des physiologistes, des biochimistes, des biologistes moléculaires, des sélectionneurs, des entomologistes, des agronomes. Il s’agit donc bien d’une approche multifactorielle.
M. Guy KASTLER : Je réagis à ce qui vient d’être dit : aucun des essais accomplis en France jusqu’à ce jour n’a jamais donné lieu à une étude d’impact locale. Par exemple, si une telle étude avait été faite, on n’aurait pas autorisé l’essai de soja transgénique de Foix installé à mois d’un kilomètre d’un rucher. Cela pose la question de la nature et de l’évaluation et de ce que cherche les décideurs. Quelle commande le pouvoir politique passe-t-il en matière d’évaluation ? S’il pose comme préalable l’acceptation du seuil réglementaire de contamination de 0,9 %, qui peut pourtant remettre en cause un système agraire comme celui des semences fermières, la réponse ira évidemment dans le sens d’une technique totalitaire et exclusive des autres systèmes.
M. le Président : Nous parlerons de cela lors de la table ronde consacrée aux enjeux économiques. Nous examinerons notamment le problème des seuils à respecter pour l’agriculture biologique. C’est une vraie question et nous ne nous défaussons pas.
Mme Corinne LEPAGE : Sur les moyens de la recherche, je pense qu’un minimum de crédits devraient être accordés aux recherches sur la santé et sur l’environnement pour contrebalancer ceux dont bénéficient les études destinées à développer des OGM. Je regrette beaucoup que la recherche publique soit totalement défaillante sur des questions que je me pose depuis des années.
Quant à moi, je me réjouis que la société civile soit représentée par des médecins, c’est-à-dire des personnes capables de comprendre la discussion et d’y intervenir. Si le niveau du débat est si bas, en France, par rapport à celui de pays comme l’Allemagne, c’est précisément parce que nous n’avons pas su pousser dans la société civile des scientifiques susceptibles d’émettre des avis dissonants ou n’appartenant pas à la sphère la plus influente. Nous avons besoin de tels aiguillons.
M. le Président : M. Gall a posé une question très intéressante. Au niveau européen, les autorisations interviennent par défaut, puisque certains pays, aussi bien au niveau du Conseil des ministres que de la Commission, rechignent à donner un avis, en Conseil des ministres comme devant la Commission. Les pays qui disent oui aux OGM sont toujours les mêmes, ceux qui disent non sont toujours les mêmes, et un gros marais s’abstient systématiquement. C’est un problème de responsabilité politique car l’abstention revient en fait à un vote positif, qu’il serait parfois politiquement délicat d’exprimer ouvertement.
M. Éric GALL : Inversement, il arrive aussi qu’un pays, sous l’influence de pressions, s’abstienne au lieu de voter contre.
M. le Président : Certainement. Il faut savoir que le système comporte trois niveaux de décision et qu’il existe 150 instances de comitologie.
M. Éric GALL : Exactement. La proposition passe devant le comité réglementaire puis, en l’absence de décision, devant le Conseil des ministres, après quoi la Commission décide et il faut une majorité qualifiée d’Etats-membres pour contrecarrer une proposition de la Commission.
M. Éric GIRY : La règle de comitologie qui a été fixée par le Conseil et le Parlement européen est tout de même très particulière. Si, à l’issue de la procédure, les ministres ne sont pas en mesure de faire ressortir une majorité favorable ou défavorable, le pouvoir de prendre la décision finale échoit à la Commission.
M. le Président : Je demande maintenant à tous de proposer une idée brève pour améliorer la gouvernance, c’est-à-dire l’encadrement des autorisations concernant les OGM, un message, en quelque sorte.
M. Guillaume ROSENWALD : Nous ne disposons pas de beaucoup d’informations. Il faut se doter des moyens d’assurer la réversibilité au cas où la décision prise se révélerait mauvaise quelques années plus tard. Peut-être ce point mérite-t-il d’être approfondi.
M. Guy KASTLER : L’analyse des assureurs est extrêmement claire : le véritable problème est celui de la gouvernance de la recherche. Avant de passer au stade de la gouvernance, il convient de répondre aux questions de fond.
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Faut-il rappeler qu’un chercheur ne peut être expert que s’il est en mesure de faire de la recherche : pour cela, il lui en faut les moyens – et je peux vous dire que certaines équipes commencent à manquer véritablement de moyens pour travailler – et qu’on lui donne le droit de le faire, y compris en parcelle expérimentale ?
M. Grégoire BERTHE : Une bonne gouvernance passe par l’intervention d’un panel d’experts couvrant les différentes disciplines pour évaluer le risque et le bénéfice que représente la plante par rapport à l’existant, en vue de la mettre en culture puis sur le marché. Dans un deuxième temps, une expertise sociétale peut être effectuée, mais je recommande que les deux soient séparées.
Mme Isabelle RAVAIL-DELY : Il conviendrait d’élargir le spectre des membres de l’éventuelle future commission et de s’interroger sur la représentativité d’un autre cercle d’expertise.
Mme Anne CHETAILLE : Il faut élargir le débat à la gouvernance de la recherche et des modèles agricoles. Par ailleurs, le risque doit être évalué a priori et géré a posteriori, d’où l’importance des questions touchant à la commission d’évaluation préalable et à la biovigilance.
M. Éric GIRY : Les Etats membres agissent dans un cadre communautaire très rigoureux, la directive 2001/18/CE définissant plusieurs obligations et les autorisations d’OGM à destination de denrées animales ou alimentaires étant désormais soumise aux dispositions du règlement 1829/2003, d’application directe. Les marges de manœuvre des Etats membres se limitent donc à l’information du public, aux règles de coexistence, à la biovigilance, qui a donné lieu à la loi de 1999 en France, et aux structures d’évaluation. Sur ce point, il y a lieu, effectivement, d’élargir les compétences d’expertise des organismes d’évaluation et la société civile a sûrement un rôle à jouer en amont sur des débats généraux et sur le choix de certains types d’OGM.
M. Éric GALL : L’expertise ne peut être scindée entre, d’un côté, celle des scientifiques purs, censés être détachés de toute autre considération, et, de l’autre, l’approche socio-économique. L’expertise scientifique, elle-même, requiert des représentants de la société civile pour que toutes les questions pertinentes soient abordées. En parallèle, une évaluation de l’intérêt socio-économique de l’OGM serait intéressante, mais la plupart des décisions finales sont effectivement prises au niveau européen par quelques fonctionnaires de la Commission dépourvus de légitimité politique. Il faut par conséquent envisager d’autres systèmes associant les citoyens et les élus. Pourquoi ne pas soumettre les autorisations de mise sur le marché d’OGM au vote du Parlement européen ?
M. le Président : Il ne ferait plus que cela !
M. Éric GALL : Enfin, tant que les problèmes de gouvernance, d’évaluation et de contrôle ne seront pas réglés, toute autorisation de dissémination dans l’environnement sera inacceptable.
Mme Corinne LEPAGE : Il ne faut pas confondre la composition d’une commission et son travail. Si le Parlement estime utile d’organiser une expertise d’ordre sociétal et économique, pourquoi pas ? S’il juge qu’il convient de séparer les deux types d’expertises, très bien, mais cela ne dispense pas la société civile de participer à l’évaluation scientifique, car son intervention constitue un « garde-fou » indispensable pour la transparence et la variété des questions posées. La société civile doit donc être présente dans les deux types d’expertise. Et il faut également un panel beaucoup plus large, à la fois sur le plan des disciplines scientifiques mais également du point de vue du positionnement vis-à-vis de la question posée. Il est vrai que personne n’est vraiment indépendant car nous avons tous notre culture, nos présupposés et notre manière d’être, mais l’indépendance est simplement le fait de ne pas être mandaté par qui que ce soit. Les experts doivent constituer un panel de personnes plus ou moins favorables aux OGM.
M. Stéphane PASTEAU : Nous sommes évidemment favorables à une expertise fondée sur la science dans le cadre d’une approche au cas par cas des bénéfices et des risques des nouveaux produits, des nouvelles technologies et des nouvelles pratiques. Cela permettrait d’accomplir des écobilans pour analyser les apports d’une technologie de type Bt dans la protection contre les insectes versus les phytosanitaires standards et les autres pratiques culturales. Enfin, la fusion de la CGB et de la Commission de biovigilance ne serait pas forcément une bonne chose, car il convient de distinguer évaluation et gestion du risque.
M. Pierre COHEN : Nous avons une idée de la teneur du projet de loi d’orientation et de programmation de la recherche. L’expression « gouvernance de la recherche » n’est-elle pas destinée à nous tromper ? Il ne faudrait pas qu’il s’agisse de prendre des partisans des OGM et des opposants pour faire bonne figure puis de piloter directement, en aval, les travaux de recherche.
M. Guy KASTLER : Quels moyens le politique donne-t-il à la recherche pour que celle-ci réponde à la question préalable de l’irréversibilité dès lors qu’il y a dissémination ? C’est le problème politique qui se pose à la gouvernance de la recherche.
M. le Président : Tous les chercheurs que nous avons auditionnés s’inquiètent non seulement de cette question mais aussi du fait que la biologie végétale, dans notre pays, est sinistrée. Certains affirment même que la controverse a asséché les crédits européens et n’incite pas les jeunes à assumer un engagement dans des disciplines placées en permanence sous le feu des projecteurs. Nous avons aussi la responsabilité collective de défendre un pan de la recherche qui a constitué l’un des piliers de l’économie nationale. Hier, M. François Dufour, de la Confédération paysanne, a plaidé avec beaucoup de cœur sur les techniques agronomiques et sur l’écologie, et nous sommes tous d’accord pour aider ces secteurs à se développer, mais il faut que chacune des parties consente des efforts et écoute les préoccupations des autres.
Je propose que nous regroupions les deuxième et troisième thèmes, c’est-à-dire la couverture du risque et la propriété intellectuelle. La Fédération française des sociétés d’assurances va lancer le débat.
M. Claude DELPOUX : Chaque fois que nous assistons à des débats de ce genre, nous constatons que des doutes scientifiques subsistent. Or les assureurs ont besoin, pour exercer leur métier, d’une bonne connaissance technique des risques qu’il leur est demandé de garantir, afin de dégager des données statistiques et de déterminer des règles de responsabilité civile – même si des produits d’assurance directe pourraient être imaginés pour les personnes exposées aux OGM.
Sur les OGM, la position actuelle des assureurs est connue : ils considèrent que les risques ne sont pas suffisamment cernés pour se prêter à des réponses assurantielles. La problématique du risque de développement est longuement explicitée dans le document de la Fédération intitulé « Livre blanc de l’assurance responsabilité civile ». Si l’on s’en tient aux règles de responsabilité du code civil, tous les acteurs qui font courir un risque lié aux OGM peuvent être jugés responsables, de l’agriculteur au fournisseur, sans oublier la puissance publique. Mais il serait anormal de faire supporter par le contribuable des conséquences que l’on n’aurait pas su prévenir. L’alternative ne se résume pas à assurance ou contribuable. Si la société estime nécessaire de prendre certains risques, elle doit l’assumer, et la puissance publique ne saurait employer l’assurance comme un moyen de se défausser de ses responsabilités.
M. le Rapporteur : Des solutions assurantielles sont-elles en voie d’étude en ce qui concerne les importations de soja transgénique ?
M. Claude DELPOUX : Actuellement, la position générale des assureurs est d’exclure la couverture du risque sur la santé humaine des produits à base d’OGM, considérant qu’il existe un risque de développement. Celui-ci ne peut être évalué statistiquement dans la mesure où les dommages susceptibles de survenir dans l’avenir sont imprévisibles en l’état actuel des connaissances techniques et scientifiques. Telle ou telle société expérimente peut-être des solutions dans un domaine bien déterminé, mais la Fédération et les chambres professionnelles n’en savent pas plus.
M. le Rapporteur : Je crois pourtant savoir que des études sont actuellement menées.
M. Guillaume ROSENWALD : Aucune expérience de couverture du risque fondamental pour la santé humaine n’est menée. Pour envisager un produit d’assurance, il faut pouvoir conceptualiser le risque. Nous réfléchissons au problème mais le niveau d’information dont nous disposons tous ne nous permet pas d’avoir une vision conceptuelle du risque que font peser les produits OGM sur la santé.
Par contre, des réflexions beaucoup plus pratiques sont possibles s’agissant de la dissémination d’OGM dans le champ voisin – en particulier si celui-ci relève de l’agriculture biologique ou de tout autre label de qualité –, des données sur les probabilités de dissémination étant disponibles depuis longtemps. En fonction des protections envisagées, on peut établir des probabilités de dissémination. Mais beaucoup de questions méritent encore une analyse, et le débat de ce matin en a fait apparaître une nouvelle, à laquelle nous n’avions jamais pensé : où s’arrête dans le temps la responsabilité de dissémination ? Si la limite de 0,9 % est applicable à la première récolte, une fois les semences contaminées par des OGM réutilisées une deuxième année puis une troisième, elles risquent de prendre mieux que les autres, et le taux pourrait alors passer à 5 puis à 30 %. La responsabilité du disséminateur doit-elle alors toujours être mise en cause ?
M. Guy KASTLER : Quel est le seuil réaliste ? Et encore faut-il qu’il soit ensuite juridiquement admis par tout le monde et que tel ou tel ne se serve pas d’artifices de droit pour porter préjudice à autrui.
M. le Président : La position des assurances est donc claire : elles n’assurent pas les risques de développement, c’est-à-dire ceux qui sont imprévisibles. En revanche, à partir du moment où les règles de coexistence entre cultures traditionnelle, OGM et biologique sont clairement établies, elles peuvent assurer couvrir le risque de dissémination, sous réserve de tester les impacts de génération en génération.
M. Grégoire BERTHE : La concentration d’une variété OGM à l’intérieur d’une culture peut-elle s’accroître au fil du temps, lorsque les semences sont replantées d’année en année ? Non, c’est biologiquement impossible : en système fermé, rien ne se perd, rien ne se crée ; c’est une loi génétique de base. La concentration en aval, notamment lors du transport des produits, dépend de la gestion de la filière, mais en tout cas, sur un champ donné, la concentration de gènes est constante de génération en génération.
D’un point de vue assurance, il est certain que le soja OGM ne pose aucun problème de santé, puisque des millions de personnes en consomment. Donc, il est parfaitement compréhensible que vous ne puissiez évaluer un risque inexistant.
Sur le problème de la coexistence des cultures et des risques de dissémination, on sait que le pollen de maïs tombe dans les trois mètres avec une probabilité de 99,9 % parce que le grain est gros. De nombreuses expérimentations l’ont prouvé. Par conséquent, si vous séparez deux parcelles de 25 mètres en plaçant quelques rangs de plants non-OGM entre les deux, la probabilité que le taux d’OGM dépasse 0,9 % dans le champ non-OGM est quasi nulle et les assureurs commencent à le comprendre. De surcroît, puisqu’il ne s’agit pas d’un indicateur de risque sanitaire mais d’un outil d’information du consommateur via l’étiquetage, les assureurs devraient être contents : en cas d’événement exceptionnel de pollinisation, la seule conséquence imaginable est que le prix de vente du nouveau maïs fluctue en fonction des différences entre les deux marchés. Ils pourraient donc couvrir ce différentiel de valeur entre maïs standard et maïs OGM, dans un sens comme dans l’autre.
M. Gérard DUBRAC : Disposez-vous d’études sur la dilution de la concentration des variétés ?
M. le Président : Bonne question. Est-il possible que des courbes nous soient communiquées ?
M. Grégoire BERTHE : La référence faite de croisement entre maïs blanc et maïs jaune vient de mon expérience personnelle dans ma pépinière au Brésil, de variétés de maïs que je travaillais. Les différentes variétés, les différents maïs étaient semés les uns à côté des autres et le taux de pénétration des grains jaunes dans les rangs de maïs blanc était donc très facilement repérable. L’observation faite, à l’époque, était que, passé 2 ou 3 rangs, il n’y avait plus de croisement visible par la présence des grains jaunes : tous les grains étaient blancs. La même observation vaut pour les productions de maïs waxy, où l’on détecte facilement par les différences de grains, les croisements par du pollen étranger. Là aussi, la dispersion reste très limitée.
M. Guy KASTLER : Je réfute l’argument selon lequel, en deuxième et troisième générations, le taux d’OGM serait stable : scientifiquement, c’est impossible. Et cela se mesure cas par cas, certaines semences OGM étant moins performantes que les semences traditionnelles, et d’autres davantage.
M. Grégoire BERTHE : Je suis à votre disposition pour vous expliquer comment fonctionnent les mécanismes biologiques.
M. Guillaume ROSENWALD : La dissémination devient assurable, dès lors que certaines règles sont établies, mais le dispositif n’est pas facile à mettre en œuvre car il faut fixer une limite entre ce qui relève de la responsabilité et ce qui relève de la force majeure. Les retombées de pollen dépendent toujours du vent et l’on tombe alors dans le cas de force majeure pour lequel la responsabilité de l’exploitant du champ incriminé n’intervient plus. La question est donc de déterminer où elle s’arrête et comment, dans ce cas, compenser les pertes pécuniaires des victimes.
M. Stéphane PASTEAU : Il faut veiller à ne pas mélanger les concepts. On ne tranche pas la question de la responsabilité en résolvant le problème de l’assurance.
Les assurances exigent que le risque soit quantifiable. Or, sur les aspects sanitaires et environnementaux, il n’existe pas de risque quantifiable spécifique aux biotechnologies. Je souhaite toutefois appeler votre attention sur la dimension du risque économique théorique. Par le passé, un marché avait été trouvé pour une couverture assurantielle des cargos affrétant du grain, en particulier de l’Amérique latine vers l’Europe, car certains opérateurs souhaitaient se couvrir contre un risque très particulier : la découverte, parmi des grains devant impérativement rester non-OGM, de présence fortuite d’OGM à l’arrivée dans un port européen. A ma connaissance, ce produit assurantiel n’existe plus, sans doute parce qu’il ne répond plus à une demande.
M. le Président : On ne peut importer en Europe que des variétés génétiquement modifiées ayant fait l’objet d’une autorisation. Mais d’autres variétés sont cultivées, par exemple aux Etats-Unis, en Argentine ou au Brésil. Ne risquent-elles pas de contaminer la filière, même à taux très faible ? Si cela arrivait, quelle serait notre position ?
M. Stéphane PASTEAU : Il existe, en fait, trois catégories de produits : les produits autorisés en Europe ; les produits évalués scientifiquement mais qui ne sont pas encore autorisés ; les produits non autorisés et non évalués. Les produits autorisés peuvent être importés ; les produits évalués peuvent être trouvés à l’état de traces inférieures à 0,5 %...
M. Éric GALL : C’est une mesure transitoire.
M. Stéphane PASTEAU : … et les autres sont interdits. L’introduction et le développement aux Etats-Unis de produits non encore autorisés en Europe ont fait l’objet d’un traitement particulier, dans le cadre du programme Market Choice, consistant en un système de collecte et de traitement du grain réservé au marché domestique. Les variétés incriminées ne sont pas commercialisées dans un certain nombre de zones de production essentiellement tournées vers l’export, et, dans d’autres endroits où une partie des produits part à l’étranger et l’autre sur le marché domestique, un système de traitement séparé est mis en place, avec des points de collecte identifiés. Ce mécanisme, globalement, ne fonctionne pas trop mal. Je laisserai M. Giry répondre sur l’aspect administratif et les contrôles à l’entrée.
A la ferme, les situations sont très différentes d’un pays à l’autre. En Espagne, par exemple, où aucune règle d’isolement n’est officiellement appliquée – que ce soit en vertu de la loi ou pour répondre à des demandes de la filière de transformation agroalimentaire –, la coexistence se gère naturellement et ne pose pas de soucis particuliers. Il n’existe pas de produits d’assurance, faute de demande. En France, la situation est différente et doit être abordée en trois points. Premièrement, lorsque des parcelles OGM sont implantées, le seuil de 0,9 % doit être respecté, ce qui suppose le respect de bonnes pratiques ; l’interprofession et les pouvoirs publics y ont beaucoup travaillé et des recommandations sont prêtes avec, notamment, des distances d’isolement... Deuxièmement, des contrôles doivent être effectués. Troisièmement, si un agriculteur est malgré tout confronté à un événement de dépassement du seuil, les filières agricoles sont capables de gérer le problème.
Faire coexister des productions différentes – maïs waxy, maïs semence, maïs doux, maïs bio, maïs conventionnel, etc. – n’est pas une nouveauté dans notre pays. Avec les OGM, il suffira d’établir certaines règles. Lorsqu’une présence accidentelle d’OGM provenant d’un autre champ conduira à l’étiquetage inattendu d’une partie de la production d’un agriculteur, il pourra lui être proposé d’échanger ses grains « contaminés », si j’ose dire, contre des grains conventionnels de son voisin, dans le cadre des plans de collecte, de façon à corriger le préjudice. Cette approche très pragmatique est suffisante. Il n’est pas nécessaire de construire a priori un dispositif juridique complexe qui se révélera certainement très mal dimensionné au regard de la problématique de terrain.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous nous donner quelques éclaircissements à propos de l’affaire Percy Schmeiser ? La contamination a-t-elle été accidentelle ou bien M. Schmeiser a-t-il provoqué le problème ?
M. Stéphane PASTEAU : Nous abordons là le problème de la propriété intellectuelle et du droit des sélectionneurs et des industriels à protéger leurs inventions au travers de brevets ou de certificats d’obtention végétale (COV). M. Schmeiser a été condamné par trois fois car le taux de présence d’OGM dans ses produits n’était compatible qu’avec la mise au champ de variétés génétiquement modifiées, alors qu’il avait omis de payer les redevances correspondantes. Cela n’a donc rien à voir avec une présence accidentelle. Il est évident que nous ne poursuivons pas les agriculteurs pour utilisation frauduleuse de notre technologie lorsque repoussent des graines OGM présentes fortuitement.
Mme Corinne LEPAGE : Mais les indemnisez-vous ?
M. Stéphane PASTEAU : Lorsqu’un préjudice nous est indiqué, nous procédons à l’arrachage, mais les demandes sont relativement rares. En tout cas, il ne faut pas confondre la présence fortuite, accidentelle, et la mise en culture volontaire avec les droits y afférents. Chacun a des droits à défendre, les agriculteurs comme les industriels et les sélectionneurs.
M. le Président : Une personne que nous avons auditionnée a pourtant affirmé que Percy Schmeiser n’était pas un « voleur de poules ».
M. Stéphane PASTEAU : Cela va bien au-delà ! Je vous invite à lire les attendus des condamnations qui ont frappé M. Schmeiser, à l’échelle de trois juridictions canadiennes, dont la plus haute de toutes, la Cour suprême. J’en suis navré pour lui, mais cette affaire ne doit pas occulter le fait que, l’an dernier, 300 000 agriculteurs nord-américains ont tiré bénéfice des technologies OGM, sans connaître les mésaventures de M. Schmeiser.
M. le Rapporteur : Combien de poursuites Monsanto a-t-il engagé, en Europe et aux Etats-Unis ?
M. Stéphane PASTEAU : Sur une dizaine d’années, un peu moins d’une centaine d’actions ont été diligentées, et, à ma connaissance, nous n’en avons perdu aucune.
Mme Corinne LEPAGE : Sur cette question de responsabilité, je dirai que si les promoteurs de cette nouvelle technologie ne tentaient pas de se mettre totalement à l’abri de toute responsabilité, la question ne se poserait pas. En l’occurrence, ils n’assument pas leurs responsabilités – ils pourraient le faire, quitte à ce que les assurances acceptent ou non de jouer le jeu – mais chacun sait que, lorsqu’elles refusent d’assurer un risque, c’est un peu comme si elles ouvraient leur parapluie. Ils cherchent simplement à imposer à la société des moyens juridiques pour se décharger sur elle.
Deux aspects doivent être distingués : celui, local, de la contamination et celui, plus global, du risque technologique et sanitaire.
S’agissant de l’aspect local, le système allemand me paraît intéressant dans la mesure où il prévoit des règles de responsabilité sur une base de droit commun. Le législateur devra toutefois se poser la question de la charge de la preuve, car comment l’agriculteur contaminé pourra-t-il démontrer l’origine du problème ?
S’agissant de l’impact de cette nouvelle technologie, on nous parle de risque de développement : le promoteur n’est donc pas responsable et la société se substitue à lui. Pour commencer, je ne suis pas du tout certaine qu’il s’agisse là d’un risque de développement. Si les fabricants d’OGM et les pouvoirs publics acceptaient de mettre en œuvre les recherches demandées par la société civile, l’état des connaissances suffirait sans doute pour démontrer quel type de risque est prévisible. En outre, même si je ne conteste nullement la légitimité de la représentation nationale, il sera très difficile, indépendamment des options que celle-ci prendra, de faire accepter à la population d’assumer une responsabilité sur la question, d’autant que les informations qu’elle attend sont couvertes par le secret industriel. Il existe pourtant bien des précédents de produits dont la dangerosité était avérée mais couverte par le secret industriel : des médicaments, le tabac, voire l’amiante. Les citoyens n’accepteront pas d’être leurs propres assureurs sur le risque OGM, alors que l’accès aux informations leur est refusé. Tout dépend du Gouvernement : décidera-t-il de rendre public tous les éléments du débat ?
Mme Isabelle TISON : En ce qui concerne la charge de la preuve, le ministère de l’agriculture s’est penché sur les possibilités de mise en cause de la responsabilité civile sans faute en cas de dissémination involontaire : responsabilité pour trouble de voisinage, responsabilité du fait du gardien de la chose, responsabilité du fait des produits défectueux. Au terme de notre analyse, nous sommes arrivés à l’idée qu’il serait difficile, dans ce cadre, d’imputer une responsabilité, faute d’établir un lien de causalité patent. Le ministère tâche actuellement de résoudre ce problème. Est-il préférable de laisser les agriculteurs biologiques et OGM se débrouiller, de gérer les problèmes de coexistence par le biais d’accords interprofessionnels ou bien y a-t-il matière à légiférer ou à réglementer en créant, par exemple, des présomptions de responsabilité ? Des groupes de travail y réfléchissent actuellement.
Mme Geneviève PERRIN-GAILARD : Le problème est compliqué mais les assureurs ont manifestement besoin de quantifier le risque sanitaire, le risque environnemental et, le cas échéant, le risque de développement. Bref, ils ouvrent un peu le parapluie et cela ne règle pas le problème.
Il me semble que tant que la recherche n’aura pas accompli de progrès, il sera impossible d’avancer. Je souhaite donc demander aux assureurs sur quels points particuliers ils attendent des éclaircissements.
Compte tenu du secret industriel, certaines expérimentations ne parviennent pas toujours entre les mains des scientifiques ni de la population. M. Pasteau, est-il envisageable qu’elles soient rendues publiques, au moins partiellement ? Il en va de l’intérêt général.
M. Claude DELPOUX : Les assureurs n’ouvrent pas les parapluies sur leurs propres têtes, mais pour abriter celles des assurés ! La fédération n’a pas à se prononcer pour ou contre les OGM, mais seulement sur l’assurabilité du risque, et, pour cela, elle a besoin d’instruments de quantification. Elle interviendra, à condition que les seuils de tolérance soient bien déterminés, réalistes et opposables à tout le monde. En ce qui concerne l’influence des OGM sur la santé, le point d’interrogation est total, puisque les études aboutissent à des résultats contradictoires, par exemple en matière d’allergie.
M. le Président : L’une des meilleures spécialistes françaises en allergologie nous a affirmé ici que les organismes génétiquement modifiés comportaient certes un risque allergénique, mais pas plus que les autres, et en tout cas moins que n’importe quel aliment conventionnel venant d’une autre partie du monde, comme le kiwi. Elle préconise donc simplement des mesures d’allergovigilance et la mise en place de sérums bioréférents, sous le contrôle de l’AFSSA. Il n’y a pas de risque allergique spécifique aux OGM.
M. Claude DELPOUX : Je ne suis pas scientifique et je me borne à répéter ce que je lis sur la question. Au demeurant, on ne peut pas nous dire tout et son contraire : puisque ce risque est écarté, si des problèmes de ce genre apparaissent, c’est bien que les OGM relèvent du risque de développement. Et je répète que les assureurs ne savent pas assurer ce risque.
Quant à la couverture de la dissémination, elle doit être accompagnée de règles juridiques certaines et d’un droit de la responsabilité spécifique. Au contraire, si vous disséminez les responsabilités en établissant des présomptions de responsabilité, les compagnies ne suivront pas et le risque ne sera plus assurable. Il faut, au contraire, canaliser les responsabilités.
M. Stéphane PASTEAU : Je ne puis que rejoindre Mme Perrin-Gaillard sur la nécessité de garantir l’accès à l’information et la transparence. Cela dit, les informations industrielles peuvent être classées en trois catégories : les informations publiques – publiées dans des revues à comité de lecture –, les informations relevant de la propriété intellectuelle – par définition également accessibles à tout le monde puisque le contenu du brevet est publié – et les informations relevant du secret industriel – elles-mêmes accessibles à certaines personnes.
Une entreprise comme Monsanto travaillant dans un environnement extrêmement concurrentiel, vous comprendrez qu’elle ne puisse se permettre de laisser un libre accès à son savoir-faire. Mais toutes les informations relevant du secret industriel figurent dans les dossiers soumis aux expertises, en particulier dans le cadre des demandes de mise sur le marché. Les membres de la CGB peuvent les consulter, de même que les experts de l’Autorité européenne. Doit-on élargir le droit d’accès à ces informations au-delà des cercles d’expertise ? Non, parce que cela ferait tout bonnement disparaître le secret industriel. En renseignant les instances d’expertise, nous estimons avoir atteint le niveau nécessaire de communication.
Mme Anne CHETAILLE : La question de la responsabilité est décidément complexe et il faudra que la Commission se penche dessus, car il y a manifestement un chaînon manquant dans la biosécurité. Il est important de regarder les systèmes de responsabilité en vigueur à l’étranger, en Allemagne et au Danemark mais aussi en Suisse et en Norvège par exemple. Quant au Protocole de Carthagène sur la biosécurité, l’un de ses articles prévoit la mise en place d’un régime de responsabilité spécifique pour les OGM. Des experts juridiques et techniques ont bien brossé les diverses dimensions du problème : évaluation des dommages, imputation de la responsabilité, assurance, seuils, etc.
En ce qui concerne l’évaluation des dommages, il convient de prendre en compte l’impact sur la biodiversité mais également les effets socio-économiques, comme le demandent notamment beaucoup de pays en voie de développement.
En ce qui concerne l’imputation des responsabilités, un système distinguant les différents acteurs est envisageable, de celui qui dépose une demande jusqu’à l’agriculteur lui-même.
En ce qui concerne le seuil, je suis assez prudente : une approche plus qualitative est peut-être plus pertinente qu’une approche quantitative fondée sur la détermination de seuils. C’est la question qui a été posée dans le cadre du Protocole de Carthagène. On peut, par exemple, recourir à la notion de « dommage sérieux ».
En ce qui concerne les assurances, je vous invite à étudier le cas de la Norvège qui prévoit qu’un système de sécurité financière peut être imposé comme condition pour l’approbation d’une dissémination d’OGM dans l’environnement.
Enfin, l’importation des OGM soulève la question des mouvements transfrontaliers et relève du Protocole biosécurité. Un système de traçabilité et d’identification est progressivement mis en place au niveau international, afin de vérifier que les produits importés sont bien autorisés.
M. Éric GALL : Sur le problème de la confidentialité, il est clair que beaucoup d’études sont abusivement classées confidentielles, en particulier celle de Monsanto qui porte sur des rats nourris aux OGM pendant 90 jours. Ni le public ni la communauté scientifique n’y ont accès, alors qu’on a du mal à comprendre pourquoi le secret industriel devrait s’appliquer à ce type d’étude. Nous avons, d’ailleurs, intenté des recours juridiques.
M. le Président : Les études toxicologiques ne devraient effectivement pas rester confidentielles. En tout état de cause, il faut savoir que la validité des études portant sur le rat ont été vivement contestées par des experts comme M. Gérard Pascal. Ce modèle d’étude apparaît, en effet, particulièrement inopportun dans la mesure où les rats, dès l’âge de 30 jours, souffrent de désordres physiologiques qui empêchent de faire la part entre ce qui pourrait résulter des OGM et ce qui est lié au processus naturel de vieillissement.
M. Éric GALL : Il devrait tout de même être possible d’accéder aux protocoles et aux résultats de ces études.
S’agissant du problème des importations, il faut savoir que les Etats-Unis vont jusqu’à envisager d’autoriser une contamination généralisée des produits agricoles par des OGM expérimentaux de type pharmaplantes. Par conséquent, l’Union européenne devrait veiller très attentivement à ce que les OGM non autorisés sur son territoire ne soient pas introduits par le biais des importations et rejeter chaque cargaison contaminée.
Par ailleurs, on sait que les variétés traditionnelles de maïs mexicain ont été contaminées. Le rapport rendu à ce sujet en novembre par la commission de la coopération environnementale de l’ALENA63 confirme que le taux de contamination va jusqu’à 20 %, alors que la culture de maïs transgénique est interdite dans ce pays. Le panel d’experts, composé de représentants américains, canadiens et mexicains du monde industriel et scientifique, est arrivé aux conclusions suivantes : le moratoire sur la culture de maïs doit être maintenu ; la contamination est imputable aux importations ; tous les maïs américains exportés vers le Mexique devraient être désormais étiquetés et moulus. Autre problème : chacun sait que la contamination du colza sera ingérable, et pourtant, la Commission européenne pense à autoriser certains OGM. Les agriculteurs bio canadiens ont intenté un recours contre Monsanto et Bayer car ils ont perdu la totalité du marché du colza à cause des contaminations. Et c’est même le cas pour le maïs : dès lors que des OGM sont cultivés, la contamination ne s’arrête pas à trois mètres : les insectes peuvent porter du pollen et les conditions climatiques ont aussi leur influence.
Sur la responsabilité et la coexistence : rien ne prouve que la coexistence soit possible et l’expérience nord-américaine tend même à démontrer l’inverse. Il est en tout cas absurde et malhonnête de vouloir retenir le taux de 0,9 %, qui déclenche l’étiquetage, comme seuil déterminant le préjudice économique, car il s’agit d’un taux de contamination fortuite – les opérateurs doivent prouver qu’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la contamination – et, de surcroît, il ne concerne que le produit final. Or la contamination peut intervenir à tous les stades de la chaîne de production, dans les semences ou les champs, pendant le transport ou le stockage. Sachant que la plupart des transformateurs de maïs européens demandent aujourd’hui à leurs fournisseurs des grains présentant un taux de contamination inférieur à 0,1 % et qu’un agriculteur peut subir des pertes dès qu’il dépasse ce seuil, le préjudice économique devrait être reconnu dès que des traces d’OGM sont découvertes dans la récolte.
S’agissant de la contamination des semences, il est de notoriété publique que les semenciers français réclament que les semences conventionnelles puissent être commercialisées sans étiquetage ni information, dès lors qu’elles contiennent des OGM mais à un taux inférieur à un certain seuil, par exemple de 0,5 %. Ce serait dramatique car toutes les mesures de gestion des risques, de retrait du marché et de protection des zones géographiques sensibles deviendraient inapplicables. De plus, du point de vue économique, toute la filière agroalimentaire non-OGM devrait supporter les conséquences financières de la contamination, alors même qu’il n’y a pas eu d’information.
Enfin, la loi sur la coexistence qui a été adoptée en Allemagne donne à un agriculteur contaminé la possibilité, sans avoir à fournir de preuve, d’intenter un recours contre n’importe quel collègue de son voisinage cultivant des OGM, quitte à ce que celui-ci se retourne contre la compagnie responsable de la mise de l’OGM sur le marché. Par conséquent, si les OGM venaient à être cultivés en Allemagne – ce que je ne souhaite pas –, le coût de la contamination ne serait pas supporté par les agriculteurs mais par ceux qui sont à l’origine de la contamination.
M. le Président : Ceux qui réclament la réglementation la plus contraignante possible n’ont-ils pas en fait pour stratégie d’empêcher les cultures ? En tout cas, au vu de cette législation, le syndicat des agriculteurs allemands a déclaré que personne ne prendrait le risque de cultiver des OGM.
M. Grégoire BERTHE : Je rappelle que la France a les meilleures semences de maïs au monde mais que celles-ci ne restent pas pour autant parfaitement pures : malgré toutes les précautions, le taux de croisement avec l’extérieur atteint 0,4 à 0,6 %, selon les années. Le milieu étant ouvert, la biologie fait qu’il est impossible de descendre plus bas et il en est ainsi de toutes les productions agricoles. Les seuils proposés aujourd’hui sont trop faibles. Nous demandons qu’ils soient au minimum de 0,9 %, sans quoi il ne nous restera plus qu’à abandonner le maïs ou à importer nos semences de l’étranger, alors que nous produisons les meilleures. Je signale simplement que, depuis cinq ans, en l’absence de réglementation, les semenciers se sont engagés à mobiliser des moyens supérieurs pour mieux contrôler les présences fortuites.
M. Guy KASTLER : Je suis agriculteur biologique et, pour répondre à la demande de mes clients, je dois respecter un seuil nul, pas de 0,9 ou 0,5 %.
M. le Président : Vous n’admettez pas que la réglementation prévoie un seuil de contamination ?
M. Guy KASTLER : Je ne parle pas de la réglementation mais des exigences de mes clients.
M. le Président : Le niveau zéro que vous pratiquez n’a pas été demandé par les clients, il s’agit d’une auto-réglementation, mise en place par l’agriculture biologique.
M. Guy KASTLER : En l’absence de réglementation officielle, l’agriculture biologique se réfère à la demande des clients. Le Danemark, par exemple, a décidé que les agriculteurs biologiques seront indemnisés à partir de 0,1 %, c’est-à-dire le seuil de détection.
La majorité des consommateurs européens demandent à ne pas trouver d’OGM dans leur assiette. Or quel est le cadre juridique ? La loi sur les brevets votée en novembre dernier défend la propriété intellectuelle de ceux qui veulent obliger le paysan à racheter ses semences chaque année. Toutefois, parallèlement, d’autres textes font loi, comme le Protocole sur la biodiversité ou le Traité international sur les ressources phytogénétiques, qui reconnaissent le droit des paysans à ressemer le grain récolté, à échanger leurs semences et à les sélectionner, ainsi que le rôle des paysans dans la conservation de la biodiversité. Et puis, dans un Etat de droit, le citoyen a le droit de choisir sa nourriture. Comment faire pour trancher cette contradiction ?
Quand je pense que le représentant des semenciers ignore comment l’on fait pour sélectionner les semences et croit que le taux d’OGM est stable année après année ! Il méconnaît les lois élémentaires de la sélection naturelle et de la génétique !
M. Grégoire BERTHE : Je vous expliquerai !
M. Guy KASTLER : C’est éventuellement possible en laboratoire, mais certainement pas dans les champs. Les grains obtenus à partir du maïs Bt pourront être ressemés, tandis que les maïs non-Bt ne se défendront pas contre l’insecte et ne seront donc pas ressemés. Dès lors que l’agriculteur ressème sa semence – je pense que cette pratique redeviendra bientôt majoritaire en France –, le seuil peut être accru.
Le problème de la distance – que la limite retenue soit de 3 ou de 25 mètres – ne doit pas être considéré sur une seule récolte. Le risque de développement est avéré, le cas du Mexique le prouve. Une étude sur les betteraves démontre que les contaminations ne sont pas uniquement dues aux pollens mais aussi, pour beaucoup, au transport des graines ou flux de pollen, que ce soit par l’intermédiaire des insectes et d’autres animaux ou bien sous une chaussure, sur les roues d’un tracteur, dans un camion, lors du séchage ou en aval. Un agriculteur bio français a vu son champ de soja contaminé, alors que le voisin le plus proche utilisant l’OGM incriminé vivait aux Etats-Unis.
M. le Président : Je citais ce cas dans mon rapport de 1998.
M. Guy KASTLER : Il peut arriver que dans ma région, il existe une variété locale de colza, et que toutes les cultures soient notoirement contaminées. C’est ce qui s’est passé au Canada dans l’affaire Percy Schmeiser. Si nous, les paysans, ressemons le grain que nous récoltons, nous utilisons, alors, en connaissance de cause, des éléments transgéniques protégés par un brevet – ce qui est interdit par la loi. Alors devons-nous arrêter la production de notre variété locale et participer ainsi à l’érosion continue de la biodiversité ? Songez que 90 % des plantes qui étaient encore cultivées il y a une vingtaine d’années dans les pays riches sont aujourd’hui abandonnées ! Les autorités politiques semblent vouloir faire passer le droit de l’industriel à breveter avant le droit de l’agriculteur à sélectionner et à ressemer. Si ma production est contaminée un jour, la responsabilité pourra en être imputée aux politiques, c’est-à-dire à vous, M. le Président.
La loi de novembre 2004 a été adoptée en application de la directive européenne 98/44/CE, laquelle doit être renégociée puisque les connaissances en matière de génie génétique ont progressé depuis son entrée en vigueur. Allez-vous donner la priorité au droit du semencier ou à celui du paysan ? Tant que vous n’aurez pas tranché, il sera impossible de résoudre le problème de la responsabilité.
M. le Président : J’ai participé au débat sur la loi de novembre 2004. Tout le monde s’est dit favorable à ce que le droit de la propriété des inventions biotechnologiques progresse. En revanche, le texte a maintenu le droit de l’agriculteur, et, par ailleurs le droit du sélectionneur y a même été introduit. Cette loi me paraît cependant insuffisante sur trois points : il faut interdire la brevetabilité du gène, lui-même ; il faut que, sur un gène donné, il soit possible de breveter plusieurs fonctions, car la génétique a montré qu’un gène peut avoir plusieurs fonctions ; la liberté de la recherche doit être garantie, ce qui suppose de concilier le droit des brevets et le droit de certification d’obtention végétale.
J’en reviens au droit des agriculteurs. J’ai grandi dans une petite ferme et je sais qu’aucune méthode ne met à l’abri de la contamination par les variétés d’un voisin. Il est donc exagéré de faire d’une technique une victime expiatoire. Vous avez tout à fait raison sur certains points, mais il ne faut pas noircir la réalité. Et je vous rappelle qu’en 1998, c’est moi qui ai demandé le moratoire sur le colza, avec l’appui du ministère, Mme Lepage s’en souvient. Les politiques assument leurs responsabilités, mais je ne suis pas sûr que ces longs mois d’auditions aient clarifié nos idées.
M. Guy KASTLER : Le problème apparaît dès lors que le champ de mon voisin est protégé par la propriété intellectuelle. Si je sais que mon grain est contaminé et que je le ressème, j’entre dans l’illégalité. Voilà le principe que vous vous apprêtez à voter.
M. le Président : Non ! Un des principes du droit français est que personne ne peut être condamné s’il n’est pas convaincu d’avoir agi volontairement.
M. Guy KASTLER : Je devrai prouver que j’ignorais avoir utilisé un produit breveté, sans quoi je serai condamné pour recel. Il est pourtant crucial de défendre la biodiversité en conservant les variétés locales.
M. le Président : La meilleure manière de défendre la biodiversité est de soutenir les centres de ressources biologiques, conservatoires de la biodiversité. L’individu isolé n’est pas forcément le meilleur artisan de la biodiversité.
M. Guy KASTLER : Le premier défenseur de la biodiversité, c’est le paysan.
M. le Président : Collectivement, avec les centres de ressources biologiques et les chercheurs.
M. Stéphane PASTEAU : La présence fortuite est un fait, dans les filières de production OGM comme dans les autres, et elle est contrôlable. A ma connaissance, les réglementations américaines et européennes interdisent l’utilisation frauduleuse des biotechnologies mais ne sanctionnent pas les présences fortuites. Il incombe aux marchés de spécialité, ou de « niches » comme on dit, de définir leurs objectifs et leurs cahiers des charges, en lien avec la valorisation qu’ils sont capables d’en tirer, sous leur propre responsabilité.
Enfin, j’appelle votre attention sur un chiffre important. Dans le bassin du Sud-Ouest, grande zone de production de maïs, sur 600 000 hectares plantés en 2003 et 2004, les variétés biologiques étaient circonscrites à moins de 200 hectares, soit moins de 0,03 % de terres. Prenons garde d’imposer à plus de 99,9 % de la production des mesures inconsidérément lourdes.
M. le Président : Nous avons compris que dix-sept hectares de maïs autorisés sont cultivés en France. Quelle réglementation s’applique à ces expérimentations ? La biovigilance s’exerce-t-elle ? Celui qui les cultive a-t-il déposé une déclaration et apporté des réponses intéressantes ?
M. Éric GIRY : Environ dix-sept hectares de maïs OGM ont été effectivement plantés l’an dernier en France. Il s’agit, je pense, de Monsanto 810 ou de Bt 176. Ces variétés ayant été autorisées et inscrites au catalogue, dans le cadre de la directive 90/220/CE, avant la mise en œuvre du moratoire de 1999, il est possible d’en planter sans rendre compte à qui que ce soit, mais les agriculteurs et les semenciers en ont informé nos services régionaux. Une fois que la directive 2001/18/CE sera transposée en droit français, une obligation de déclaration sera instituée pour les plantations de maïs OGM autorisés. Pour l’instant, il n’y a pas de base législative pour imposer cette déclaration, mais elles ont quand même été signalées par les semenciers.
M. le Rapporteur : Un effet rétroactif jouera-t-il pour ces dix-sept hectares ?
M. Éric GIRY : Non.
M. le Président : Sont-ils tout de même soumis à l’obligation d’étiquetage.
M. Éric GIRY : Il y a bien sûr obligation d’étiquetage et de traçabilité, puisque la production entre dans la catégorie des « mises sur le marché ». Ces plantations ont, en fait, essentiellement servi à des essais sur la contamination croisée ou les inscriptions variétales.
M. le Président : Il s’agit donc d’essais non soumis à autorisation ?
M. Éric GIRY : Ce ne sont plus des « essais » au sens de la partie B de la directive.
M. le Président : Bien sûr, mais il est aberrant que certaines expérimentations utiles sur le plan scientifique soient détruites à tort, tandis que des essais sont conduits sans qu’on en soit informé.
M. Grégoire BERTHE : Je vous confirme que le catalogue européen autorise dix-sept variétés à la production et que la seule réglementation à suivre concerne la biovigilance.
M. Stéphane PASTEAU : On oublie trop souvent, en effet, que l’agriculteur français a le droit d’exploiter ces deux variétés de maïs, même si la liste des semences autorisées est bloquée depuis 1998.
M. le Président : Je connais la réglementation. Il n’empêche que, dans le contexte actuel, il eût été préférable que la mission d’information soit bien informée, dès le départ, de ces expériences. Cette culture du secret, au bout du compte, se retourne immanquablement contre ceux qui l’entretiennent, comme sur le dossier du nucléaire.
M. Stéphane PASTEAU : Ces cultures sont totalement transparentes. Nous allons même jusqu’à les déclarer, alors que la réglementation ne nous y contraint pas et pourtant, vous n’ignorez pas, M. le Président, le destin que connaissent l’immense majorité des parcelles cultivées dans la transparence…
M. le Président : Le respect mutuel entre les acteurs ne pourra être obtenu, le dialogue ne pourra être instauré tant que le secret dominera. Une meilleure compréhension du sujet passe par davantage de transparence et moins de stratégie de la part de tout le monde.
M. Bernard TEYSSENDIER DE LA SERVE : Je reviens au problème de la propriété intellectuelle. Indépendamment de la complexité du fonctionnement du vivant et de son brevetage, il est assez largement reconnu au niveau international que l’une des causes du caractère oligopolistique de la propriété intellectuelle a été l’absence de politique organisée de la part des organismes publics de recherche. Ceux-ci ont trop facilement concédé la propriété de leurs résultats à leurs partenaires privés ou licencié leurs découvertes de manière exclusive à des partenaires privés.
Des structures répondant à cet enjeu sont déjà sur pied aux Etats-Unis et en Australie, et nous en montons une à notre tour en Europe. Il s’agit d’inciter les organismes publics à déposer des brevets, à se réserver autant que possible la propriété entière des brevets résultant de travaux conduits dans leurs laboratoires, mais à conduire une politique de transferts et de licences pour ouvrir au maximum le jeu de l’innovation et à réserver les licences exclusives à des champs spécifiques de collaboration avec les industriels, en prévoyant des clauses de sauvegarde ou de réserve pour des sujets qui ne concernent pas le marché mais qui concernent, par exemple, des causes humanitaires ou les pays du Tiers-Monde.
Nous essayons de constituer des paniers technologiques en réunissant des brevets ; c’est important car ceux-ci sont par nature dispersés, la recherche publique ayant pour vocation de faire de la connaissance et non pas d’orienter ses programmes de manière cohérente pour un objectif de marché précis. Pour organiser des paniers technologiques cohérents au bénéfice de nos techno-industries, en particulier des petites et moyennes entreprises, il est indispensable que nos dispositifs associent plusieurs organismes et que les pouvoirs publics les soutiennent.
M. Guy KASTLER : S’agissant des variétés de maïs dont la culture est autorisée en France, je voudrais ajouter que si elles n’ont pas été cultivées, c’est que leur commercialisation aurait posé problème et que personne ne leur a proposé de les acheter. La contamination n’est donc pas un risque réglementaire mais un risque économique ! Si ma récolte contient des OGM, le consommateur n’en voudra pas, quelle que soit la réglementation. Les responsables politiques doivent répondre à deux questions. Si, demain, mon champ est contaminé par le champ d’un voisin, devrai-je en apporter la preuve pour me retourner contre lui ? Et, si aucun de mes voisins n’a employé d’OGM, l’obtenteur ne doit-il pas être considéré comme le responsable ? Faute de reconnaissance de ce principe, seul le politique pourra être tenu pour responsable.
M. le Président : En démocratie, si les responsables politiques élaborent la loi, c’est parce qu’ils ont été élus à cet effet. Mais l’on ne peut reprocher au pouvoir exécutif de ne pas prendre de décision, alors que nous sommes dans une situation d’incertitude où seul le risque du risque et les croyances de chacun sont avérés.
Est-il légitime de vouloir imposer des cahiers des charges au-delà de la limite de détection ? Si un OGM est dangereux, le pouvoir politique doit l’interdire totalement – comme Bernard Chevassus-au-Louis nous l’a dit, aucun ingrédient toxique ne peut être toléré à hauteur de 0,9 % dans un aliment. Toutefois, des risques sériels peuvent toujours apparaître, car le rapport entre l’homme et l’aliment évolue très lentement, même si cette échelle de temps est un peu bousculée. On doit donc continuer les recherches mais, pour autant, doit-on céder à l’impérialisme de ceux qui prétendent vouloir faire le bonheur du monde ? Ont-ils le droit d’interdire totalement l’émergence d’une nouvelle technique pour défendre les anciennes ? Ont-ils le droit de poser des questions tout en empêchant les recherches qui apporteraient une capacité d’expertise suffisante pour y répondre ? Chacun des membres de la représentation nationale devra se prononcer en son âme et conscience. Pour ma part, je n’ai pas d’actions chez Monsanto, ni d’ailleurs chez Syngenta, Pioneer ou Bayer mais je pense qu’il faut conserver notre capacité d’expertise et, pour cela, continuer à faire de la recherche sur les OGM.
M. Guy KASTLER : Inversement, avez-vous le droit de laisser certains acteurs économiques interdire aux agriculteurs de cultiver comme ils l’entendent et aux consommateurs de manger ce qu’ils veulent ? Vous me classez parmi ceux qui interdisent, mais je vous signale que le cadre juridique interdit à certains agriculteurs et à certains consommateurs de conserver les aliments endogènes. La loi a été votée, la dictature du brevet sur le vivant s’exerce et nous ne pouvons pas nous défendre.
M. le Président : Je répète que je suis favorable au certificat d’obtention végétale.
Mme Anne CHETAILLE : A laquelle de ses versions ?
M. le Président : Celle de la convention UPOV 91, l’Union pour la protection des obtentions végétales, convention que nous devrons d’ailleurs transposer.
Tous les impérialismes sont néfastes. Si le Parlement n’autorisait à la vente que les aliments ne contenant aucune trace de produits phytosanitaires, l’agriculture biologique ne survivrait pas non plus. L’introduction d’intrants et de produits phytosanitaires doit être restreinte au maximum, et il ne faut recourir aux OGM qu’en cas d’absolue nécessité.
M. Éric GALL : Les OGM ne peuvent être comparés aux produits de l’agriculture biologique ou conventionnelle. C’est bien pourquoi il existe une réglementation européenne spécifique, reconnaissant le principe de précaution et la nécessité d’évaluer le risque, y compris après la mise sur le marché. Grâce à cette réglementation, la traçabilité est assurée et les produits peuvent être retirés en urgence de la vente si des effets inattendus sont constatés. Mais, si l’on autorise un seuil de contamination des semences – et pas seulement du produit fini – c’est-à-dire au premier maillon de la chaîne de production, la traçabilité sera jetée aux orties parce qu’il n’y aura plus d’information. Il est fondamental que les agriculteurs biologiques soient certains de la pureté absolue de leurs semences, ce qui suppose un taux technique de zéro, car qui sera le responsable si la chaîne est contaminée et qu’il n’y a plus d’information ? Le semencier ou l’agriculteur voisin ? En agriculture biologique, ce n’est pas le produit final qui est certifié, mais le processus de production, que ce soit pour les OGM ou les pesticides.
M. le Président : Alors, pourquoi l’agriculture biologique n’aurait-elle d’obligation de résultat qu’en matière d’OGM et pas de produits phytosanitaires ?
M. Éric GALL : La filière a une obligation de résultats vis-à-vis de ses clients.
MM. Philippe FOLLIOT et Gabriel BIANCHERI : Mais pourquoi pas aussi en matière de pesticides et de produits phytosanitaires ?
M. Guy KASTLER : Quand nos produits sont contaminés par des substances phytosanitaires, ils subissent un déclassement. Sachez-le !
M. le Président : Votre organisme de certification, ECOCERT, est très compétent, mais la présence de mycotoxines est acceptée en dessous d’un plafond, alors que ces métabolites sont cancérigènes.
M. Guy KASTLER : Cela n’a rien à voir ! Si mes produits contiennent des traces de mycotoxines, ces substances, contrairement aux OGM, ne se multiplieront jamais dans mon champ. De toute façon, avec le système UPOV et le catalogue, vous nous avez déjà lié pieds et poings, et vous voulez maintenant nous imposer l’étape suivante : vous niez le droit fondamental des paysans à sélectionner et à échanger leurs semences, préférant adopter une législation inique sur les OGM.
M. le Président : En France, le droit de l’agriculteur existe !
M. Guy KASTLER : Pas le droit de l’agriculteur à échanger ses semences ! Nous sommes dans l’illégalité ! C’est le catalogue qui prime ! Le système UPOV !
M. Grégoire BERTHE : Le commerce de semences de ferme est en effet parfaitement illégal.
M. Guy KASTLER : Il ne s’agit pas de commerce mais d’échange avec mes voisins.
Mme Anne CHETAILLE : Il ne faut pas réduire le débat à l’alternative entre agriculture bio et OGM. Entre les deux, il reste une place pour les systèmes agraires conventionnels ou moins intensifs, moins riches en intrants ou en pesticides.
M. Claude DELPOUX : Sur l’assurance, je voudrais dire que, même si une loi disposait que la sécurité financière est garantie, toutes les questions concrètes d’ordre technique ou juridique soulevées ce matin ne seraient pas réglées pour autant. Avant d’étudier les solutions de couverture, il faut, en effet, répondre sur le fond du problème.
M. le Président : La discussion a été très animée mais intéressante. Elle contribuera à nourrir notre analyse. Je vous remercie.
Table ronde contradictoire sur le thème
« Les enjeux économiques des OGM »
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 février 2005)
• France nature environnement (FNE) : M. Lilian LE GOFF, médecin
• Association nationale de l'industrie alimentaire (ANIA) : M. Eric SEYNAVE, président de la commission qualité et administrateur/directeur général de Findus
• Limagrain : M. Daniel CHÉRON, directeur général adjoint
• Confédération paysanne : M. Jean-Pierre LEROY, membre de la commission OGM
• Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD) : M. Jérôme BÉDIER, président
• Monsanto Agriculture France SAS : M. Stéphane PASTEAU, directeur scientifique chargé des relations institutionnelles et industrielles
• Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (FNAB) : M. François CALVET, administrateur pour la région Midi-Pyrénées
• Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) : M. Guy VASSEUR, président de la commission environnement
• Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) : M. Alain WEIL, directeur de l'innovation et de la communication
• Institut national de la recherche agronomique (INRA) : M. Guy RIBA, directeur général délégué
• Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) : M. Gilles HIRZEL, chargé d’information au bureau régional pour l’Europe
• Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole (FNSEA) : M. Didier MARTEAU, vice-président
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président,
puis de M. François GUILLAUME, Vice-président
M. le Président : Mesdames, Messieurs, je déclare ouverte notre quatrième table ronde contradictoire, consacrée aux enjeux économiques des OGM. Plusieurs d’entre vous ont déjà participé à de précédentes auditions et certains étaient venus en 1998 débattre du même thème, dans cette même salle, à l’occasion de la Conférence des citoyens.
Depuis le mois de novembre, notre mission a entendu, à Paris ou en région, plus de cent personnes et organisé des débats thématiques, puis contradictoires associant toutes les parties prenantes. Nous avons déjà pu confronter les avis sur les enjeux sanitaires, les enjeux environnementaux, les enjeux juridiques – propriété intellectuelle, assurabilité, droit des brevets – avant de nous pencher aujourd’hui sur les enjeux économiques des OGM.
Le débat sera organisé autour de deux thèmes : « OGM et développement » et « Comment assurer la compétitivité de l’économie française ». Certains points comme la nécessité des essais ou la coexistence des filières ont déjà été largement abordés.
Le thème « OGM et développement » a déjà suscité nombre de controverses, les uns estimant que les techniques de transgénèse pourraient résoudre une part des difficultés des pays du Sud, les autres rétorquant que si cela était vrai, cela se saurait et que les grands groupes agrochimiques veulent d’abord vendre leurs semences et non faire œuvre de philanthropie. Ce débat s’est déjà largement répandu dans notre pays, au point que des essais sur riz mis au point par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ont été détruits voilà quelques années.
Le thème « Comment assurer la compétitivité de l’économie française » pose la question de l’avenir de notre recherche, en danger selon certains, particulièrement dans le secteur de la biologie végétale, qualifié de sinistré. Deux jeunes chercheurs de Toulouse nous ont expliqué comment le manque de réactivité de la France décourageait bon nombre de jeunes scientifiques brillants qui vont se faire embaucher à l’étranger. Sont également posées les questions du devenir de nos modes de production agricole, de la capacité de notre industrie agroalimentaire à rester au premier rang sans recourir à des techniques déjà utilisées par bon nombre de ses concurrents, de la propriété intellectuelle et du risque de monopole lié au phénomène de concentration du secteur agrochimique où quelques grands groupes se retrouvent dépositaires de la plus grande part des semences et des brevets d’avenir.
M. Lilian LE GOFF : Médecin à Lorient, je suis responsable du dossier Biotechnologies à la fédération France nature environnement (FNE), qui regroupe la majeure partie des associations françaises de défense de l’environnement. Nous avons vocation à entretenir un partenariat avec les autorités publiques, afin de faire respecter et évoluer notre droit à un environnement sain. La brevetabilité du génome, outre les problèmes éthiques qu’elle soulève, a des implications économiques majeures dans la mesure où elle ne peut que renforcer le monopole de quelques grands groupes sur les filières agroalimentaires. Or, quoi qu’en pense le Président Le Déaut, nous maintenons que ce débat n’a encore jamais eu lieu au niveau parlementaire, alors que ce devrait être un préalable à toute discussion sur la transposition ou l’application de la réglementation communautaire.
Avant de promouvoir les produits d’une nouvelle technologie, les décideurs, gestionnaires et responsables devraient se fixer pour règle d’en évaluer les risques et les avantages. A supposer que les OGM aient des avantages sur le plan économique, à qui bénéficient-ils réellement ? L’industrialisation de l’agriculture, dont les OGM ne sont finalement que le dernier avatar, a trop souvent consisté à mutualiser les conséquences des risques au détriment des deniers publics, tout en privatisant les bénéfices. Il existe pourtant des solutions alternatives assurément capables de remédier au problème des pesticides comme à celui de la faim dans le monde, qui mériteraient de se voir consacrer un réel effort de recherche fondamentale et appliquée.
M. Éric SEYNAVE : Directeur général de Findus France, je préside la commission qualité de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA), premier secteur industriel français avec un chiffre d’affaires de 140 milliards d’euros et 11 000 entreprises dont 10 000 PME de moins de 250 salariés réparties sur tout le territoire, qui transforment 70 % de notre production agricole et emploient plus de 450 000 personnes. Nos produits sont commercialisés à l’exportation et sur le territoire, notamment via la grande distribution qui représente à elle seule près de la moitié de notre chiffre d’affaires. Trait d’union entre la production agricole et la grande consommation, les Industries agroalimentaires (IAA) ont évidemment pour premier souci la sécurité et la qualité des produits qu’elles fabriquent. Fruit de 150 ans d’étroite collaboration entre agriculteurs, chercheurs et industriels, le modèle alimentaire français est considéré comme une réussite exemplaire à tous égards.
Même si les OGM concernent en premier lieu l’agriculture, nos intérêts sont profondément mêlés. Aussi, compte tenu du phénomène de mondialisation croissante, particulièrement dans l’alimentation animale, serait-il extrêmement dangereux d’isoler la recherche et les filières françaises. L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a, elle-même, reconnu l’intérêt et la sécurité des OGM. La réglementation en vigueur nous semble raisonnable et elle est scrupuleusement respectée par nos industries. De son côté, le consommateur réclame légitimement une information objective et complète. Notre développement reposant tout à la fois sur les progrès techniques réalisés par les divers acteurs et sur la confiance du consommateur, nous avons tout intérêt à garantir l’information du grand public sur les enjeux réels de l’utilisation des OGM si nous voulons continuer à mettre sur le marché des produits sûrs, bons et accessibles au plus grand nombre.
M. Daniel CHÉRON : Limagrain est une coopérative spécialisée dans les semences de grandes cultures et les semences potagères, quatrième semencier mondial. Limagrain a créé avec d’autres groupes privés et coopératifs une structure commune de recherche en biotechnologie, Biogemma, qui représente 100 personnes. A partir de Biogemma, et en partenariat avec les instituts publics de recherche, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et le CIRAD, nous avons construit une structure de génomique rassemblant 400 personnes et capable de faire jeu égal avec la recherche américaine.
Je suis inquiet à double titre. Premièrement, la destruction quasi systématique de nos essais nous interdit de mener à bien notre travail de chercheurs dans des conditions compétitives par rapport à nos concurrents. Si ce climat délétère persiste, nous serons probablement amenés à nous implanter aux Etats-Unis. Deuxièmement, le monde agricole, lui aussi, est en danger de perdre sa compétitivité, faute de pouvoir utiliser les outils qui sont à sa disposition. Pendant ce temps, les surfaces OGM ont pratiquement doublé au Brésil et en Argentine – passant de 8 millions d’hectares à plus de 20 millions en quelques années –, notamment depuis l’introduction du soja Roundup Ready qui a révolutionné ce type de culture. A croire le représentant d’un grand groupe pétrolier que j’ai rencontré ce matin, l’Europe sera même obligée d’importer du soja pour satisfaire les besoins de la filière biocarburants… La situation m’apparaît donc très préoccupante.
M. Jean-Pierre LEROY : Producteur de maïs sur 65 hectares dans la vallée de la Dordogne, près de l’estuaire, je suis également responsable de la Confédération paysanne en Gironde et en Aquitaine. Déterminés à lutter pour la survie des petits paysans, nous avons tout lieu de penser que cette technologie ne saurait répondre à leurs besoins, non plus qu’à ceux des consommateurs. Bien au contraire, les OGM ne peuvent que mettre en danger notre environnement, mais également nos filières de qualités, nombreuses en Aquitaine, entraînant des pertes de valeur ajoutée qui se traduiraient rapidement par des baisses représentant 10 à 20 % du revenu agricole.
Nous appelons donc à la mise en place d’un important effort de recherche pour soutenir une agriculture qui préserve tout à la fois la santé des gens, le dynamisme de notre économie et la vitalité de nos territoires.
M. Jérôme BÉDIER : Le secteur du commerce souhaite garantir au consommateur le droit à l’information, mais également le droit au choix en défendant la lisibilité des informations ainsi que la traçabilité des produits. Ce débat a commencé dès 1996, lorsqu’il a fallu discuter des modalités d’application de la réglementation européenne en matière d’étiquetage des produits à base d’OGM. La situation est désormais clarifiée, particulièrement depuis l’adoption des derniers règlements.
Une bonne information nous semble de nature à régler l’essentiel du problème de l’acceptation du public, inquiet à l’idée que les OGM puissent entrer dans l’alimentation sans qu’on le sache. Les additifs avaient créé un débat similaire jusqu’à ce qu’une information claire ramène la confiance chez le consommateur.
La traçabilité a été perçue par les Américains comme une mesure punitive à l’encontre des OGM. J’ai eu l’occasion d’expliquer à certains interlocuteurs que cette exigence tend à devenir universelle et à s’appliquer à toutes les filières, OGM compris. Encore faut-il que cette traçabilité soit générale et que son coût ne soit supporté ni par la filière OGM ni par la filière non-OGM sous peine de créer des différentiels de coût qui nuiraient à la compétitivité de l’une ou de l’autre.
Reste le droit au choix. Nos enseignes ont, notamment dans le cadre des marques « distributeur », privilégié un temps les produits sans OGM, afin que leurs clients aient un réel sentiment de choix et non l’impression de n’avoir affaire qu’à des produits issus d’OGM, comme les propos des industriels de marque pouvaient le laisser supposer. Ce débat est toujours ouvert ; certains produits sont désormais vendus avec un étiquetage OGM et leurs ventes ne semblent pas en souffrir outre mesure.
M. Stéphane PASTEAU : Quelques chiffres illustrent le bénéfice des plantes génétiquement modifiées pour l’agriculteur. Plus de 80 millions d’hectares d’OGM auront été cultivés dans 17 pays du monde en 2004, par 8,5 millions d’agriculteurs dont 90 % vivent dans l’hémisphère sud. Si ces cultures rencontrent un tel succès, c’est bien que l’agriculteur y a trouvé son intérêt : nos études aux Etats-Unis font état d’un taux de satisfaction moyen de 95 %. En Chine, la culture de coton Bt, sur des parcelles généralement inférieure à un hectare, génère pour l’agriculteur un bénéfice net supplémentaire de 350 dollars par hectare en moyenne, dû à un gain de rendement moyen de 24 %, à une meilleure qualité de la fibre et à une réduction de 60 à 80 % de l’emploi des insecticides.
Les agriculteurs français pourraient également tirer un avantage économique des plantes transgéniques. Les études prospectives de l’Institut de la betterave chiffrent à 18,5 millions d’euros, dont 12,5 pour les seuls agriculteurs, le bénéfice qu’apporterait l’utilisation de la betterave transgénique. Certes, l’acceptation des OGM ne saurait reposer sur les seules considérations économiques. Mais refuser de les prendre en compte revient à nier les raisons du succès de cette technologie dans les autres parties du monde. La stratégie d’évitement des OGM appliquée en France fait peser une contrainte économique lourde sur les différents maillons de la filière alimentaire, depuis les petits éleveurs chers à M. Chassaigne jusqu’aux géants de l’agroalimentaire, alors même que personne ne semble tirer de bénéfice tangible de cette situation. Pourquoi ne pas offrir une alternative aux agriculteurs qui le souhaitent en leur permettant d’expérimenter sereinement les bénéfices concrets des OGM dans le cadre d’une introduction progressive et maîtrisée ?
M. François CALVET : Agriculteur en Ariège, ingénieur agricole de formation, je représente la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) qui rassemble 12 000 agriculteurs bio en France cultivant un peu moins de 2 % de la surface agricole utilisée (SAU).
Notre position est connue : nous n’acceptons pas de pollution de nos cultures par les OGM. Non seulement le règlement européen qui régit nos productions nous interdit d’utiliser tout matériel provenant de la transgénèse, mais les consommateurs ont clairement fait savoir leur refus des OGM et leur préférence pour les filières traditionnelles. L’introduction des cultures OGM en France ouvrirait la voie aux pollutions dans nos champs, nos lieux de stockage ou encore nos lieux de transformation, mettant directement en péril les productions bio.
La coexistence des cultures n’a aucun sens si elle ne nous permet pas de continuer à fournir des produits réellement sans OGM. Observez attentivement ce bocal : il contient mille grains de maïs dont neuf sont colorés en noir, qui symbolisent la part OGM. Il suffit que j’ajoute un seul grain jaune pour que la part des grains noirs tombe au-dessous de 0,9 %… Allez expliquer au consommateur qu’à un grain près, ou bien mon produit est pollué, ou bien il peut être vendu en bio ! Toute coexistence est impossible, à moins que les producteurs OGM s’engagent à ne pas nous polluer. Tout porte à croire, malheureusement, qu’il n’en sera rien : au Canada, le canola ne peut plus être cultivé en bio, parce qu’il est systématiquement pollué. Au Mexique, on retrouve des pollutions de maïs, alors que les Mexicains ne cultivent officiellement pas d’OGM… La mise en place d’une filière OGM en France et en Europe signifiera la mort de l’agriculture biologique, la fin de tous les signes de qualité, labels et appellations d’origine contrôlées (AOC), fleurons de notre agriculture. S’engager dans cette voie serait un désastre économique dans la mesure où nous perdrions des parts sur nos marchés intérieurs, comme sur les marchés extérieurs. Il est urgent de réorganiser la recherche, afin qu’elle réponde réellement aux demandes de la société : avoir des produits sains, qui protègent notre environnement, nos territoires, nos agriculteurs et nos industriels transformateurs.
M. Guy VASSEUR : Agriculteur et président de la chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, je préside également la commission environnement de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA). L’enjeu des OGM ne se borne pas à la production agricole : il touche aux relations agriculture-consommateur, agriculture-citoyen, mais également aux relations internes, autrement dit à la cohabitation entre les filières dites conventionnelles, bio et, demain, OGM. Or poser la question de l’acceptation par le consommateur, mais également par le citoyen, amène immédiatement à s’interroger sur les avantages ou les inconvénients que les OGM peuvent présenter sur l’environnement.
Face à cet enjeu, les chambres d’agriculture ont clairement pris position pour un développement de la recherche. Notre recherche publique, avec l’INRA notamment, est une chance pour la France, mais également pour l’Europe. Elle seule permettra aux consommateurs, aux citoyens et surtout aux politiques une approche beaucoup plus fiable et crédible. Il faut donc pouvoir expérimenter en milieu confiné, mais également au champ, sous réserve, évidemment, de prendre toutes les précautions qui s’imposent et même de les renforcer au besoin. Tout le monde sait que ce qui est valable en laboratoire ou en milieu confiné ne l’est pas forcément dans le milieu naturel où les conditions sont, par nature, en perpétuel changement. Or cette recherche est en danger, et derrière elle toute l’économie agricole et l’indépendance alimentaire de l’Europe. A rester les mains dans nos poches en regardant faire les Américains, nous nous exposons à un réveil brutal.
M. Alain WEIL : Chargé, entre autres choses, des relations avec les entreprises au sein du CIRAD, le petit frère de l’INRA spécialisé dans l’agronomie tropicale, je m’occupais auparavant de la coordination de notre politique de biotechnologie, ce qui m’a conduit à animer un groupe de travail interinstituts sur la mutualisation des brevets publics en biotechnologie.
« Aujourd’hui, on n’a pas besoin des OGM pour nourrir la planète », disait en substance Jacques Diouf, le directeur général de la FAO64, « mais demain, peut-être, si toutes les conditions sont réunies. » Nous pourrions faire nôtre cette citation où chaque terme a son importance.
C’est potentiellement pour les petits agriculteurs des pays en voie de développement que les techniques de transgénèse pourraient un jour présenter le plus d’intérêt. Sur le papier en tout cas, les techniques liées aux OGM pourraient être mises au service des agriculteurs les plus vulnérables comme de la préservation de la biodiversité en rendant cultivables de vastes superficies sans qu’il soit besoin de déforester. Les cultures OGM se répandent dans les pays en développement au point que les Américains eux-mêmes se demandent si la Chine – et l’Inde – ne les dépasseront pas dans la maîtrise de cette technologie. Au demeurant, les pays en voie de développement seront rapidement tous concernés par les OGM, soit parce qu’ils sont eux-mêmes déjà producteurs, soit parce que leurs positions de marchés pourraient en être totalement déstabilisées.
La demande des pays du Sud porte avant tout sur l’expertise et non sur le développement d’OGM adaptés à leurs besoins. Expertise agronomique et écologique, évidemment, mais également expertise économique et sociale, qui fait appel à bien d’autres compétences que les nôtres. Ajoutons que les pays en développement sont fortement instrumentalisés par les partisans comme par les adversaires des OGM, dans un débat que la prolifération des non-dits contribue à polluer fortement.
Rappelons enfin que les OGM commercialisés aujourd’hui sont le résultat de la recherche d’hier. L’important est de savoir ce qui sortira des laboratoires demain et qui pourrait donner les produits commerciaux d’après-demain. Il faut donc impérativement distinguer entre les OGM d’ores et déjà disponibles et diffusés à grande échelle, et la recherche sur les OGM qui, à mes yeux, participe également du principe de précaution. De surcroît, certains OGM pourraient, dans certaines conditions, présenter un réel intérêt économique et social et nous aurions tort de nous priver de cette possibilité. Là encore, on aura besoin d’une recherche forte pour appuyer la décision.
M. Guy RIBA : A étudier les moyens biologiques de lutte contre les insectes ravageurs sans utiliser de pesticides chimiques, j’ai terminé mon activité en laboratoire en travaillant sur le maïs Bt… Après avoir participé à la conférence des citoyens, j’ai été membre du Comité de biovigilance, puis de la Commission du génie biomoléculaire (CGB).
Il faut privilégier l’action dans le sens d’une agriculture durable, ce qui suppose de diversifier les espèces, les génotypes au sein des espèces, et les systèmes de production. Les OGM ne sont pas la panacée, mais ils ont leur place dans cette démarche et on ne saurait a priori les en exclure. Ils ne peuvent être utilisés librement, au gré des seules lois du marché, et exigent un suivi. Pour autant, leur intérêt doit être exploité lorsqu’ils en présentent un. Et si les études montrent qu’ils n’en présentent pas, il faut les exclure.
Qu’il y ait ou non des cultures OGM en France, il est impératif de constituer et de préserver une compétence nationale sur ce sujet en matière d’expertise, de savoir et d’innovation. Or la ligne blanche a clairement été franchie. Les crédits de recherche alloués aux biotechnologies ont considérablement diminué. Qui plus est, toutes les biotechnologies sont massacrées à cause du débat autour des OGM, à tel point que, même l’amélioration génétique conventionnelle, ne dispose plus des crédits suffisants. Le différentiel avec les autres pays ne cesse de s’aggraver. Le droit à expérimentation, dans le respect de la réglementation et des principes de parcimonie et de transparence, est devenu totalement illusoire. La destruction systématique des essais nous interdit de répondre aux questions, y compris à celles que posent les adversaires des OGM, et pousse nos chercheurs à partir à l’étranger et à abandonner des investigations dans des domaines très divers, qui exigeraient une approche comparée et globale, désormais impossible. Je n’avais jamais imaginé qu’un chercheur dût témoigner à des procès pour mettre des gens en prison mais je n’aime pas davantage qu’un travail de recherche soit détruit.
M. Gilles HIRZEL : Je ne suis pas un spécialiste des OGM. Mes propos s’appuieront sur le rapport de la FAO décrivant la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture en 2003-2004.
La FAO considère que les biotechnologies modernes peuvent contribuer à la sécurité alimentaire mondiale tout en s’inscrivant dans une démarche d’agriculture durable. Les avantages et les potentialités des organismes génétiquement modifiés devraient toujours être considérés dans le contexte le plus large, alors que leurs effets appellent une étude au cas par cas.
Les OGM peuvent-ils répondre aux besoins des plus démunis ? La FAO s’efforce de fournir aux Etats des informations objectives fondées sur des avis scientifiques, d’offrir un forum neutre pour débattre de toutes les questions nouvelles liées à l’utilisation des biotechnologies, et de donner des avis techniques sur les aspects légaux et sanitaires. Nous sommes lourdement engagés dans le renforcement des capacités nationales de prévention des risques et de suivi des effets a posteriori.
Avec le soutien des gouvernements, la FAO apporte son appui actif à l’harmonisation des standards, règles et réglementations aux niveaux international, régional et sous-régional, favorise le dialogue entre les partenaires, les transferts technologiques et les échanges d’informations. Les semences nous apparaissent à cet égard comme le principal véhicule de transfert vers les agriculteurs de la meilleure technologie disponible, OGM compris.
Alors que notre objectif est le renforcement des capacités de décision aux niveaux national, régional et subrégional, force est constater que ni la recherche publique ni la recherche privée au niveau mondial n’ont réellement investi dans les nouvelles technologies génétiques en faveur des cultures dites « orphelines » – mil, sorgho, etc. – ou des cultures vivrières de base des pays les plus pauvres. La FAO tient toutefois à remercier la France pour l’importance qu’elle accorde à la fourniture de graines de qualité aux agriculteurs. Nous travaillons en étroite relation avec notamment le Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) à l’harmonisation des politiques et des réglementations, afin d’améliorer la disponibilité en graines et en plants de qualité au niveau subrégional. La FAO espère sincèrement que cette coopération se poursuivra, afin de répondre aux exigences de la sécurité alimentaire mondiale.
M. Didier MARTEAU : Agriculteur dans l’Aube et responsable du dossier « qualité et sécurité des produits alimentaires » à la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole (FNSEA), je remercie l’Assemblée nationale d’avoir organisé ce « forum » : il vaut mieux échanger que se combattre.
La position de la FNSEA sur les OGM n’a finalement guère changé depuis dix ans, tout simplement parce qu’elle a toujours reposé sur deux principes : le respect du choix du consommateur et le droit pour le producteur de décider librement de faire du conventionnel, du bio, éventuellement de l’OGM, moyennant des règles propres à garantir la coexistence des cultures.
Depuis 2000, il n’y a pratiquement plus de production de maïs transgénique en France, bien que 17 variétés y soient autorisées. Un seuil de présence fortuite a été arrêté à 0,9 % et un dispositif de traçabilité et d’étiquetage a été mis en place pour l’ensemble des produits, OGM compris, qui répond à notre souhait.
Où en est-on aujourd’hui ? Le fait que la production d’OGM augmente tous les jours dans le monde n’est pas en soi gênant. Le problème est qu’il en entre de plus en plus chez nous, au point que nous ne serons bientôt plus capables de trouver des protéines sans OGM, surtout depuis que le Brésil a décidé d’autoriser les cultures génétiquement modifiées. Pratiquement tout le soja sera bientôt OGM ou mélangé OGM.
N’en déplaise à ceux qui contestent la rentabilité des cultures génétiquement modifiées, force est de constater que les surfaces emblavées dans le monde augmentent de 15 à 20 % chaque année. C’est donc bien que le paysan, qui n’est pas fou, y trouve un avantage en termes de coûts de production.
Le comportement du consommateur lui-même est ambigu. Je suis producteur de grandes cultures, mais également de produits fermiers et notamment de cidre AOC. Or force est de constater que ce marché reste une niche et ne se développe pas. Une enquête INRA menée en 2000 montre que les consommateurs refusent à 80 % les produits OGM avant de passer à la caisse, mais ne sont plus que 30 % une fois passée la caisse… Entre le dire et le faire, il y a un grand pas.
Comment dans ces conditions continuer de travailler dans le respect de la liberté de chacun ?
Une chose est sûre : si la France continue à laisser partir sa recherche et à la laisser se concentrer entre les mains de quelques grands groupes, nous courons à la catastrophe. Jusqu’à présent, grâce à une recherche digne de ce nom, nous avions la possibilité de faire des choix, y compris entre OGM et non-OGM, d’autant que l’OGM aide à faire évoluer le non-OGM. Mais aujourd’hui, il y va de notre indépendance.
Ensuite, si nous voulons transposer la directive 2001/18/CE, il va nous falloir avancer sur la question de la coexistence. Soyons clairs : une transposition « à l’allemande » interdit, de fait, toute production d’OGM.
Enfin, la coexistence suppose un encadrement juridique définissant un régime de responsabilité. Il faudra bien répondre à cette question et sortir du flou si nous voulons garantir une réelle possibilité de choix aux agriculteurs. Faute de quoi, au moment où arriveront les OGM de deuxième génération, qui présenteront de réels avantages pour la santé, nous regretterons de nous être privés de nos capacités de recherche.
M. le Président : Merci, ces propos liminaires ont déjà permis de mettre en exergue bon nombre de points très intéressants.
Commençons par le thème « OGM et développement ». Visiblement, vous n’êtes pas d’accord entre vous. Pour M. Leroy ou M. Calvet, l’arrivée des OGM se traduira par une perte de valeur ajoutée des productions et donc par une diminution du résultat brut d’exploitation. Pour d’autres, les paysans ne sont pas fous : s’ils utilisent les OGM, c’est qu’ils y trouvent un intérêt. Le rapport de la FAO fait également état de gains de productivité très importants pour les petits agriculteurs de Chine et d’Inde, alors qu’un récent documentaire télévisé tend à montrer le contraire. La FAO maintient-elle sa position ?
Plusieurs d’entre vous ont fait référence à la satisfaction des besoins alimentaires de la planète. L’augmentation de la productivité agricole après-guerre nous a permis de résoudre ce problème au niveau de notre pays, mais pas au niveau mondial. Ces nouvelles techniques très sophistiquées, avec tous les problèmes de propriété intellectuelles qui s’y rattachent, peuvent-elles y contribuer ? A défaut d’améliorer la productivité, devra-t-on déforester massivement au moment où il faudra nourrir deux milliards d’individus supplémentaires ? Le débat sur les OGM dans les pays riches ne serait-il pas, comme le pense Florence Wambugu, un réflexe de nanti ?
M. Yves COCHET : Sur douze personnes, j’en trouve en gros trois qui sont plutôt contre les OGM et neuf plutôt pour… N’appelons pas cela un débat contradictoire !
M. le Président : M. Cochet, il a été remarqué, lors du débat sur les enjeux environnementaux, que l’on comptait plus de « plutôt contre » que de « plutôt pour »…
M. Lilian LE GOFF : Et lors du débat sur les enjeux sanitaires, c’était l’inverse.
M. le Président : C’est en tout cas la première fois que l’on nous fait reproche sur la manière dont nous avons envoyé nos invitations.
M. Yves COCHET : Je ne conteste pas la manière, mais l’équilibre.
M. le Président : Lorsque j’invite l’INRA, la FAO ou le CIRAD, je n’invite pas des « pour » ou des « contre ». Si vous jugez que l’INRA est plutôt pour, c’est un organisme national de recherche que vous classez. Nous n’avons jamais refusé une association, une organisation syndicale ou un représentant des professions agricoles. Nous en avons même rajouté au dernier moment : les Amis de la Terre et l’administration peuvent en témoigner. Nous n’avons fait preuve d’aucun ostracisme alors que vos propos laissent à penser que nous orienterions le débat en jouant sur la répartition des personnalités invitées. L’INRA, la FAO, la Confédération paysanne et la FNSEA sont invités en tant que tels.
M. Gilles HIRZEL : Bon nombre de pays en voie de développement, faute de disposer du cadre réglementaire et des capacités techniques nécessaires pour évaluer les cultures transgéniques, doivent se contenter, dans le meilleur des cas, d’affirmations scientifiques contradictoires. Aussi la FAO s’emploie-t-elle à rassembler les données scientifiques au niveau planétaire. Par ailleurs, un comité d’éthique a été mis en place au sein du Codex alimentarius, qui traite de l’ensemble des biotechnologies, OGM compris.
M. le Président : Les OGM apportent-ils réellement un bénéfice aux petits agriculteurs, comme l’affirme le rapport ?
M. Lilian LE GOFF : Encore faudrait-il savoir de quelle culture on parle…
M. Gilles HIRZEL : Pour être favorable aux agriculteurs les plus démunis, une technologie doit à notre sens répondre à trois critères : premièrement, pouvoir être utilisée par les petits agriculteurs aussi bien que par les grands exploitants ; deuxièmement, ne pas exiger de gros investissements ; troisièmement, être facile à appliquer. Certains produits de biotechnologie y répondent, d’autres en revanche requièrent un cadre institutionnel complexe et des moyens d’investigation sophistiqués. Mais dans le cas du coton Bt, je ne peux que confirmer les conclusions du rapport écrit de la FAO.
M. Lilian LE GOFF : Mettons les affirmations à l’épreuve des faits. M. Pasteau a fait état des résultats remarquables du coton génétiquement modifié en Chine et en Inde. C’est vrai, tout au moins au début, où tout marche toujours relativement bien. C’est seulement après que se manifestent les réactions de l’environnement aux toxines phytosanitaires diffusées par ces organismes génétiquement modifiés, qui reviennent à reproduire, à une vitesse accélérée, les effets des traitements chimiques intensifs. Au bout d’un certain temps, les agriculteurs se retrouvent à devoir supporter les mêmes dépenses en intrants qu’auparavant. Autrement dit, c’est un retour à la case départ… Je suis très étonné que la FAO affiche de tels résultats pour une seule culture, alors que les Etats-Unis, pourtant pionniers en la matière, ne font pas état de telles performances. Un rapport de la Soil Association65, jamais démenti, montre que, pour ce qui est des productions à visée alimentaire – colza, soja et maïs –, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et comme le dit M. Marteau, les agriculteurs ne sont pas fous : une partie des farmers se désengage des OGM dont la rentabilité apparaît, au final, inférieure à celle des produits classiques, alors que ces semences high-tech coûtent nettement plus cher.
Pour résumer, les résultats aux Etats-Unis ne font pas état de performances économiques mirobolantes au point de faire des OGM une solution d’avenir.
M. le Rapporteur : M. Pasteau, à combien peut-on chiffrer ce désengagement ?
M. Stéphane PASTEAU : Pour ne prendre que l’exemple du soja, cité par M. Le Goff, les surfaces cultivées en OGM sont passées entre 1996 et 2004 de 0 % à 85 % du total, et la courbe continue de monter… Je veux bien que l’on parle de désengagement, mais je ne crois pas que les chiffres plaident en faveur de cette thèse. La croissance mondiale annuelle n’est jamais descendue en dessous de deux chiffres.
M. Lilian LE GOFF : Les chiffres que j’ai ici montrent clairement un infléchissement à partir de 2000.
M. le Président : Globalement, les chiffres montrent incontestablement une augmentation des surfaces cultivées dans le monde, sur un nombre limité de produits. Reste à savoir si les agriculteurs en ont tiré bénéfice.
M. Didier MARTEAU : Plus près de nous, en Espagne, les surfaces sont passées de 32 000 hectares en 2003 à 58 000 en 2004.
L’agriculteur ne recherche pas systématiquement le bénéfice rendement, mais le bénéfice tout court. Payer plus cher mes semences ne me dérange pas si, à la sortie, j’ai moins dépensé en traitements phyto, insecticides ou fongicides – sans compter l’intérêt pour l’environnement.
M. Lilian LE GOFF : Mais ce n’est pas le cas.
M. Didier MARTEAU : N’oublions pas, non plus, que nos productions doivent satisfaire à des normes de plus en plus sévères qui, depuis peu, prennent en compte le taux de mycotoxines. J’aurais dû jeter la moitié de ma récolte de blé si elles s’étaient appliquées il y a trois ans…
M. le Président : Ce sujet a déjà été abordé. Sommes-nous toujours au-dessous des taux maxima admis ou nous arrive-t-il de nous en rapprocher ?
M. Didier MARTEAU : Année après année, on a malheureusement tendance à les baisser… On sait maîtriser le développement des mycotoxines dans les céréales lors du stockage, en abaissant fortement la température, pour peu que les normes d’humidité soient, elles aussi, respectées. Lors de la récolte, en revanche, tout dépend des conditions climatiques. Si la récolte n’est pas bien protégée et qu’il pleut en juin et juillet, les taux peuvent dépasser la norme.
Non seulement le débouché alimentaire au niveau mondial n’est pas près de se tarir, car bon nombre de populations n’ont malheureusement pas encore de quoi se nourrir par eux-mêmes, mais la demande en produits agricoles devient de plus en plus forte du côté du non alimentaire. Enfin, le jour où arriveront les produits de deuxième génération, qui auront clairement un effet positif sur la santé, sur le taux de cholestérol ou les maladies cardiovasculaires, par exemple, le problème des OGM et des biotechnologies ne se posera plus.
M. Germinal PEIRO : L’argument des surfaces en augmentation ne me convainc pas du bien-fondé économique des OGM. On a déjà vu dans l’histoire de l’humanité les hommes s’engager massivement dans des démarches dont les conséquences néfastes se sont avérées par la suite… Si les surfaces cultivées en OGM s’accroissent, ce peut être dû aux pressions des semenciers comme aux effets de mode, et pas nécessairement à des raisons de rentabilité. A qui revient réellement le bénéfice économique de l’opération ? Et pour combien de temps ? Voyez ce qu’aura coûté l’amiante sur le plan sanitaire : toutes les études prouvent que notre pays aurait réalisé d’immenses économies s’il ne l’avait pas utilisé. Enfin, l’argument des besoins mondiaux, dont on nous rebat les oreilles, ne me satisfait pas davantage : si l’on avait réellement besoin de produire davantage, les jachères ne proliféreraient pas en Europe.
M. Daniel CHÉRON : Vous oubliez que l’Europe des quinze importe massivement des protéines, qui représentent l’équivalent de la production de seize millions d’hectares… Le développement des jachères tient essentiellement à une politique de subventions qui désavantage nos territoires par rapport aux Etats-Unis, ce qui nous interdit, par exemple, d’exporter du blé, alors que nous sommes excédentaires. Mais pour ce qui concerne les productions végétales, l’Europe est bel et bien globalement déficitaire.
M. Germinal PEIRO : J’aurais pu prendre l’exemple du lait, que l’on verse au caniveau, sitôt les quotas dépassés…
M. François CALVET : Les agriculteurs bio n’importent pas de soja, puisqu’ils cultivent des légumineuses, l’Europe ayant accepté, notamment, que nos jachères soient plantées en luzerne. Si notre agriculture de pays riches, de gens qui mourront d’un excès de cholestérol, se nourrit de protéines importées d’Amérique du Sud, ce n’est pas une fatalité : cela tient à des choix politiques sur lesquels il doit être possible de revenir. Ne faisons pas pleurer Margot : plutôt que de chercher à nourrir nos vaches et nos cochons à coup de cargos chargés d’OGM, développons en France des alternatives pour produire nos propres protéines – sainfoin, luzerne, etc. Elles peuvent parfaitement pousser ailleurs que dans la pampa argentine ou brésilienne.
M. le Président : Mais quelle est la part de l’agriculture biologique dans la production française ?
M. François CALVET : Nous sommes 12 000 agriculteurs et nous cultivons un peu moins de 2 % de la surface.
M. Didier MARTEAU : 1,7 % exactement…
M. François CALVET : Ne mélangeons pas non plus les problèmes, notamment avec celui de la faim dans le monde. Mme Louise Fresco, sous-directrice générale de la FAO, parlait en mars 2003 de la « fracture moléculaire » qui se creusait entre le Nord et le Sud, en remarquant qu’aucune recherche n’était menée sur les cinq cultures les plus importantes dans les zones semi-tropicales arides : le sorgho, le millet, le pois cajun, le pois chiche et l’arachide. Qu’on le veuille ou non, les OGM ne représentent qu’une proportion ridicule des superficies mondiales : quatre pays seulement en cultivent et 85 % des surfaces plantées en OGM sont concentrées dans la zone américaine.
M. Stéphane PASTEAU : Cela change…
M. François CALVET : Ce sont les chiffres de l’année dernière.
M. le Président : Où classez-vous la FCD ? Depuis que nous avons appris que les grandes surfaces finançaient le CRII-GEN66, nous ne pouvons pas les classer parmi les « pour »…
M. François CALVET : Il est dommage que la Fédération française des assurances ne soit pas parmi nous : ce sont des gens pragmatiques et qui savent calculer. Or les assureurs sont tout à fait disposés à me couvrir pour ma baignoire qui déborde ou pour tout autre risque, sauf les OGM. M. Claude Delpoux l’a encore répété le mois dernier. S’est-on demandé pourquoi ?
M. le Président : Nous l’avons auditionné et il ne nous a pas dit exactement cela.
M. le Rapporteur : Il a simplement dit que l’on pourra parler d’assurance le jour où seront fixés des seuils bien clairs.
M. le Président : S’il ne pouvait être question pour les assureurs de couvrir le risque du risque sur la santé, autrement dit les risques sériels, il en va tout autrement pour le risque de contamination des agricultures biologiques : le jour où seront fixés des seuils parfaitement clairs, les assureurs seront capables de calculer les probabilités de contamination et d’assurer en conséquence.
M. François CALVET : Mais pas la santé des consommateurs…
M. le Président : Non, parce qu’il n’y a pas de risque avéré aujourd’hui. Il n’est que potentiel.
M. Didier MARTEAU : Ajoutons que tout dépend des cultures. Certaines, comme la betterave, ne posent pas de problèmes de repousses ni de pollen. Il sera donc très facile de les assurer.
M. Alain WEIL : Les OGM ont déjà prouvé leur intérêt dans certaines productions tropicales. Ainsi, le verger de papayers d’Hawaï, en passe d’être totalement détruit par un virus, a été préservé grâce à la création de papayers transgéniques résistants. C’est l’exemple le plus probant d’un produit spécifiquement adapté à une utilisation en zone tropicale. Le problème est que pratiquement tous les pays cultivés à grande échelle dans les pays du Sud sont dérivés de produits développés dans les pays du Nord pour répondre à des problèmes de l’agriculture du Nord. Il est illusoire d’espérer une réponse positive tant que l’on ne développera pas des OGM adaptés aux problématiques spécifiques des agricultures du Sud.
M. le Président : Peut-on raisonnablement espérer voir des recherches menées sur les thématiques des pays du Sud, avec tous les financements et l’encadrement supplémentaires qu’imposerait cette nouvelle technique ? On peut en douter à voir ce qui se passe pour le sida, où 5 % seulement des 20 millions de malades ont accès aux nouveaux médicaments.
M. Alain WEIL : A la question de savoir si les conditions de développement de produits potentiellement utiles aux pays du Sud sont actuellement réunies, on ne peut malheureusement que répondre par la négative : tant qu’on ne va pas voir, on est sûr de ne pas trouver. En revanche, les OGM présentent un intérêt potentiel évident, du fait qu’en permettant l’intégration du progrès technique au niveau de la semence, celui-ci peut facilement être mis à disposition de producteurs sans savoir-faire technique ni capacité d’acheter engrais et produits phytosanitaires. On peut donc imaginer a priori des utilisations allant dans le sens de leur intérêt direct.
Quant à la question de la propriété intellectuelle, elle n’est pas liée à l’usage même d’une technique : s’il est effectivement possible d’introduire des gènes de stérilité interdisant à l’agriculteur de ressemer sa récolte, il est tout aussi possible de faire en sorte que le paysan puisse ressemer ses graines hybrides sans perte de qualité.
Enfin, n’oublions pas que les pays en développement devraient, selon les prévisions, compter bientôt 2,5 à 3 milliards d’habitants supplémentaires. Ce n’est pas en exportant à partir de l’Europe que l’on nourrira tous ces gens. Ce n’est ni économiquement tenable ni éthiquement défendable. La question est donc de savoir comment les pays du Sud pourront produire chez eux la nourriture qui leur est indispensable.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Il faut les aider à produire mieux.
M. Alain WEIL : Les OGM pourraient éventuellement contribuer à cette intensification souhaitable des agricultures du Sud. Il serait en tout cas dommage de s’interdire d’explorer cette piste.
M. Lilian LE GOFF : Toute la question est de savoir si le développement de la technologie OGM est compatible avec le développement durable.
M. le Président : Bonne question !
M. François GUILLAUME : Pourquoi pas ?
M. Yves COCHET : Elle ne l’est pas !
M. Lilian LE GOFF : Encore faudrait-il au préalable s’entendre sur la définition. Le développement durable suppose, à mon sens, des méthodes beaucoup plus autonomes et économes en moyens comme en ressources.
M. Guy RIBA : Une chose est certaine : les pratiques agricoles majoritairement développées à cette heure ne sont pas compatibles avec le développement durable.
M. Yves COCHET : C’est vrai.
M. Guy RIBA : La question n’est donc pas de savoir quels sont les avantages et les inconvénients des OGM dans l’absolu, mais de les apprécier par rapport aux pratiques actuelles et d’en faire une comparaison exhaustive sur les plans économique, agronomique et écologique.
M. Lilian LE GOFF : Nous sommes parfaitement d’accord.
M. Guy RIBA : Vous verrez, alors, que certains OGM, dans certaines situations et sous certaines conditions, présentent un réel intérêt. « Pendant combien de temps ? » a demandé M. Peiro. Ce à quoi je réponds : si les Argentins continuent à faire du soja transgénique à tout va, sans contrôle, ils finiront par avoir un problème. La probabilité est faible, certes, mais compte tenu du nombre d’occurrences, il surviendra un jour. Le problème pour moi n’est pas d’interdire les OGM, mais de mettre au point les méthodes de suivi adéquates. Pour cela, il ne faut pas laisser libre jeu aux firmes et aux lois du marché. Ce qui suppose de laisser travailler la recherche publique, afin qu’elle puisse produire des connaissances comme des innovations, des OGM éventuellement, mais surtout des méthodes de suivi.
M. François CALVET : En parlant de pratiques agricoles majoritaires, M. Riba vise l’utilisation des pesticides et des engrais…
M. Yves COCHET : Majoritaires en Europe : le reste du monde pratique majoritairement une agriculture sans pesticides ni engrais. Deux milliards d’individus font de l’agriculture « biologique » sans le savoir…
M. François GUILLAUME : Et meurent de faim !
M. Guy RIBA : Ce n’est pas aussi simple que cela…
M. François CALVET : Les agriculteurs bio demandent que la recherche publique française garde un rôle prééminent. Seule une recherche publique peut travailler dans l’intérêt de tous. La durabilité de l’agriculture suppose de se passer des pesticides et de recourir aux énergies locales. Fort peu de paysans sur cette planète peuvent se faire aider par un tracteur ou une machine. Peut-être meurent-ils de faim…
M. Yves COCHET : Pas pour cette raison.
M. François CALVET : En tout cas, l’agriculture industrielle n’a pas changé la donne pour eux. En revanche, le déséquilibre des grands échanges internationaux, les guerres et le manque d’accès à l’éducation ont eu des conséquences redoutables. La solution est à rechercher dans l’organisation intelligente des gens et non dans l’exacerbation des besoins de chacun. Les OGM apparaissent comme une solution tout à la fois lourde et coûteuse, apanage de quelques grands centres de recherche, alors que de petites structures paysannes peuvent trouver par elles-mêmes des solutions alternatives offrant de réels gains de productivité – on l’a vu avec le riz à Madagascar. L’agriculture biologique s’inscrit dans cette démarche et si nous sommes persuadés qu’elle est l’agriculture de demain, c’est en nous appuyant sur des bases agronomiques certaines. C’est en préservant la fertilité des sols et en y faisant travailler en harmonie les plantes, les animaux et l’homme que nous parviendrons à nourrir les populations. Les OGM ne me paraissent servir qu’à nourrir des vaches trop grosses et des cochons qui polluent nos rivières. Et même si vos betteraves ne polluent pas le voisin, à quoi serviraient-elles ? Nous ne manquons pas de sucre, que je sache. Si la France s’engage dans la voie des OGM, une page sera tournée. Les démarches fondées sur les paysans, les appellations, les terroirs et les savoir-faire ont prouvé leur validité économique : mieux vaut être producteur de comté AOC dans le Doubs qu’éleveur de vaches laitières nourries au soja transgénique dans la Mayenne ou la Sarthe.
M. Daniel CHÉRON : Je suis toujours surpris de voir le débat systématiquement ramené à la question « pour ou contre les OGM ? ». La transgénèse n’est qu’un outil supplémentaire à la disposition des sélectionneurs qui, jusqu’à présent, mélangeait les gènes en aveugle au hasard des croisements. Ils peuvent dorénavant se servir d’un outil plus précis leur permettant d’introduire un gène spécifique dans une variété, qui lui conférera des fonctionnalités supplémentaires.
Une question à l’adresse de M. Le Goff : l’introduction d’un gène de sorgho dans du maïs pour réduire la consommation en eau répond-elle à son sens au concept d’agriculture durable ?
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : M. Riba peut-il m’affirmer qu’il est possible de faire coexister les cultures transgéniques avec les autres formes de culture, biologiques notamment ?
J’ai pris bonne note des espoirs de M. Weil et je suis de ceux qui défendent la recherche publique en souhaitant qu’elle poursuive ses travaux sur les transgènes. Mais pour l’heure, aucune expérience n’est venue prouver la capacité des OGM à enrayer la faim dans le monde. Le CIRAD a-t-il entendu parler des péripéties liées à la culture du coton en Inde ? A en croire une récente émission télévisée, les agriculteurs se suicideraient les uns après les autres, faute d’avoir les moyens d’acheter les pesticides nécessaires…
Je reconnais que l’agriculture OGM se développe de plus en plus dans le monde même si, comme M. Le Goff, je remarque que la progression se ralentit depuis quelques années. Reste qu’en Europe, des pays entiers réagissent : après la France, l’Autriche, l’Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce et l’Allemagne défient Bruxelles et refusent les OGM sur leurs territoires. Les unes après les autres, les grandes régions françaises adhèrent à la Charte des régions européennes sans OGM. Tout simplement parce que la recherche n’est toujours pas en mesure de nous prouver que la coexistence des cultures sera possible.
M. Guy RIBA : Puis-je garantir qu’il est possible de faire cohabiter des cultures transgéniques et des cultures conventionnelles ? Cela dépend des cas. Dans celui de la vigne porte-greffe résistant à des maladies, ma réponse est clairement oui. Dans celui du maïs, cela dépend du seuil économique, dans celui des arbres fruitiers, la réponse est clairement non. Enfin, je trouve parfaitement légitime que des citoyens s’organisent pour refuser les OGM. Encore faut-il disposer des données permettant d’éclairer la décision publique et le citoyen, et donc être en mesure de mener les recherches nécessaires.
M. le Président : Mais peut-on défendre le concept de « région sans OGM », alors que vous-même reconnaissez que la coexistence ne peut se concevoir qu’au cas par cas ? Peut-on interdire purement et simplement une technique dans un endroit donné ?
M. Guy RIBA : Poser la question ainsi revient à dire que l’OGM devient une valeur sociale, auquel cas la réponse ne peut être apportée par la biotechnique. A preuve, on ne nous autorise pas à y répondre par nos expérimentations.
M. Alain WEIL : Si aucune étude convaincante n’apporte la preuve de l’intérêt des OGM, c’est tout simplement qu’ils n’ont pas été développés pour cela, faute de moyens. Des pistes tout à fait intéressantes ont été décelées en laboratoire, encore faudrait-il aller au bout pour voir si les semences en question, au-delà de l’avancée technique, peuvent entraîner un réel progrès économique et social. Ainsi, des plantes résistantes au sel, sans même penser aux conséquences du tsunami, permettraient de rendre utilisables des surfaces considérables. Les petits agriculteurs auraient tout intérêt à disposer de semences plus tolérantes à un retard des pluies – actuellement, un décalage d’une semaine de la saison des pluies peut entraîner la perte de toute la récolte. Si ces deux pistes se concrétisaient, il serait difficile de nier qu’il s’agisse d’un réel progrès. Cela représente certes beaucoup de travail, mais il serait grave de s’interdire a priori d’explorer cette voie.
Par ailleurs, si l’on a effectivement recensé un grand nombre de suicides d’agriculteurs en Inde, ce phénomène est lié à un ensemble de raisons qui n’ont rien à voir avec les OGM et il serait temps d’en finir avec ce genre d’amalgame. Enfin, il me paraît tout à fait légitime que des décisions politiques soient prises pour trancher des choix de société – et l’utilisation des OGM à grande échelle en est un. Reste que si toutes les régions françaises se déclarent opposées à toute expérimentation d’OGM au champ, cela revient à tuer toute possibilité de recherche en France et par le fait toute possibilité d’éclairer la décision publique. Faisons la différence entre la diffusion des OGM à grande échelle et la démarche de recherche, qui suppose des essais à petite échelle.
M. le Rapporteur : A vous entendre, les suicides de paysans indiens ne sont pas liés aux cultures OGM…
M. le Président : Je souhaite que nous puissions visionner le film en question et j’ai demandé à notre ambassade, à New Delhi, de nous envoyer une analyse sur cette question. Sur cette affaire comme sur celles qui sont liées à la propriété intellectuelle, Percy Schmeiser, Pustzai et autres, nous devrions pouvoir, ensemble, aller jusqu’au bout de ces questions. Si nous y parvenons, nous aurons pleinement joué notre rôle.
M. Alain WEIL : Nous avons connu exactement le même problème au moment où la révolution verte a eu pour effet de développer considérablement la production dans certaines régions jusqu’alors déficitaires, mais au prix de l’exclusion de nombreux petits producteurs pénalisés par une technicité insuffisante. Ce à quoi, en Inde, viennent s’ajouter des facteurs extérieurs comme la pratique de l’usure. Incriminer une technique particulière est pour le moins extrêmement réducteur, d’autant que les études sur le sujet sont parfaitement contradictoires – et pour cause : tout dépend de la variété d’OGM, des conditions de culture, des facteurs climatiques, du parasitisme, etc. Il est logique de trouver des résultats très contrastés. En Chine, sur de petites exploitations, les surfaces de coton OGM se développent considérablement dans un contexte de petit paysannat. Faut-il pour autant en tirer des conclusions générales ? Evidemment non. Il faut raisonner au cas par cas.
M. Jean-Pierre LEROY : Imposer brutalement une nouvelle technologie inadaptée, en contradiction avec l’agriculture en place, provoque fatalement des réactions désespérées, à plus forte raison si les promoteurs n’ont d’autre intérêt que leur bénéfice le plus immédiat.
M. Lilian LE GOFF : La décision ne peut être guidée par les seules considérations techniques. Elle doit prendre en compte les aspects sociaux, environnementaux, sanitaires et économiques et s’inscrire dans une démarche de développement durable et de souci des générations futures.
M. Chéron m’a demandé si le fait d’améliorer par transgénèse la capacité d’une plante à résister à la sécheresse relevait du développement durable. Encore faut-il savoir de quoi l’on parle et ce que l’on fait. Est-on en mesure de maîtriser ce que l’on fait avec la transgénèse ? Non. Parce qu’on ne fait pas qu’introduire un gène : on en met d’autres pour que ça prenne, pourrait-on dire, ce qui n’est pas si évident. Or on sait très peu de choses sur les mécanismes d’expression et de régulation des gènes et, notamment, sur leurs interactions. De ce fait, des propriétés inattendues peuvent apparaître, comme l’a montré l’affaire Pustzai. Nous n’avons moralement pas le droit de léguer aux générations futures une sorte de bombe biologique à retardement d’autant plus difficile à désamorcer que nous avons tout misé sur la recherche appliquée au détriment de la recherche fondamentale. Le bon sens populaire voudrait pourtant qu’on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier… Parmi les chercheurs, les toxicologues sont en voie de disparition. Les crédits autrefois dévolus à la toxicologie vont à la biotechnologie. Est-ce raisonnable ?
M. le Président : Ce sujet a déjà été abordé lors d’une précédente table ronde. Nous avons tous reconnu la nécessité de préserver les crédits de ces disciplines anciennes. Ce sera dans le rapport.
M. Lilian LE GOFF : Ajoutons que les OGM accroissent notre dépendance vis-à-vis des herbicides totaux, alors qu’une démarche de développement durable voudrait que l’on soit moins dépendant de la pétrochimie. Nous disposons de suffisamment de ressources dans la biodiversité pour utiliser, par hybridation classique, des gènes de plantes naturellement résistantes à la sécheresse ou à la salinité. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que cela ne contribue pas au renforcement des monopoles que permet, justement, la brevetabilité du vivant.
M. Guy RIBA : Personne ne vous a jamais dit que, seule, la transgénèse résoudra le problème de la tolérance des plantes à la sécheresse. Mais n’allez pas dire que nous ne faisons pas de génétique conventionnelle dans ce but. Nous en faisons, nous avons besoin de génomique pour cela, mais cela prend beaucoup de temps, tout simplement parce que ces caractères sont codés par un nombre incalculable de gènes.
M. Lilian LE GOFF : Quelle est la part des crédits consacrés à la lutte biologique intégrée et celle des crédits accordés à la transgénèse ?
M. Guy RIBA : A l’INRA, l’agriculture biologique mobilise quarante chercheurs, la génomique végétale une centaine et les OGM d’intérêt agronomique zéro…
M. Gabriel BIANCHERI : Et voilà !
M. François GUILLAUME : Bravo !
M. le Président : M. Riba nous transmettra officiellement ces chiffres. Cela confirme les propos que nous ont tenus de jeunes chercheurs, selon lesquels des filières entières sont sinistrées.
M. Guy RIBA : Parfaitement.
M. Daniel CHÉRON : Ajoutons que sur un budget de recherche de 80 millions d’euros, l’INRA n’en a investi que 2 millions dans la transgénèse.
M. le Président : Poser une question tout en refusant de donner les moyens d’y répondre revient à fausser le débat. Ce serait la première fois dans notre histoire scientifique que l’on récuserait totalement une technique. Les philosophes invités à nos tables rondes remarquaient que l’on avait globalisé les OGM, alors qu’il aurait précisément fallu distinguer plusieurs catégories dont certaines n’ont effectivement aucune utilité. Nous aurions été beaucoup plus crédibles. Malheureusement, nous nous sommes enfermés dans un débat camp contre camp dont nous avons le plus grand mal à sortir.
M. Didier MARTEAU : Il est vrai qu’en commençant avec des OGM insecticides ou résistants aux herbicides, cette affaire a été engagée par le mauvais bout… Peut-être en serait-il allé différemment si l’on avait mis en avant la possibilité, par exemple, de cultiver le soja partout en France et de réduire nos importations.
Mme Robin-Rodrigo a posé la question de la coexistence des cultures. Dès à présent, nous cultivons du colza érucique ou du tournesol oléique, qui posent rigoureusement les mêmes problèmes de dissémination et de segmentation. Les productions de semences sont également soumises à des règles bien précises. Ce sont des choses que nous savons d’ores et déjà parfaitement faire. Le problème se situe simplement au niveau du taux de présence fortuite acceptée ou non.
Enfin, si l’on s’inquiète des risques d’une extension des OGM, c’est plutôt la politique de développement du bio à tout prix qui me préoccupe en ce moment. On court à la catastrophe. Le marché n’est pas extensible. Ou bien les prix vont s’effondrer, alors que, jusqu’à présent, les producteurs en vivaient plutôt bien ; ou, à l’inverse, le bio va se banaliser, ce qui ne sera pas mieux pour la rémunération du producteur.
M. François CALVET : Je serais content que le bio se banalise en France… Nous sommes importateurs de produits bio, faute de pouvoir répondre à la demande.
M. François GUILLAUME : Ce n’est pas vrai ! 40 % de la production laitière bio retourne dans le circuit classique !
M. François CALVET : Et les importations de lait bio d’Allemagne ? Quoi qu’il en soit, nos concitoyens ne seraient pas mécontents de trouver de plus en plus de surfaces exemptes de pesticides et d’engrais solubles.
M. Gabriel BIANCHERI : C’est autre chose !
M. Francis DELATTRE : Sont-ils prêts à payer cinq fois plus cher ?
M. le Président : Vous posez une vraie question. Nous y reviendrons plus longuement tout à l’heure.
M. Philippe TOURTELIER : Depuis le début, on mélange deux sujets : l’insuffisance, réelle ou supposée, de la recherche et la généralisation de l’autorisation des cultures OGM.
Certains OGM présenteraient un intérêt, sous certaines conditions. Pour le papayer, par exemple, il n’y avait pas d’alternative. Là est précisément la vraie question : y a-t-il des alternatives aux OGM ? Mais on ne se la pose pas, on autorise…
M. le Président : Où ?
M. Philippe TOURTELIER : Dans les autres pays, s’entend.
Autre argument : si les surfaces augmentent tous les ans, c’est que le paysan y trouve un intérêt. Encore faudrait-il prendre le facteur temps en considération. Député breton, je me souviens avoir entendu les mêmes arguments il y a cinquante ans : il faut nourrir la planète, il faut être moderne, il faut se développer, etc. Cinquante ans après, où en est-on ? Nous avons connu le veau aux hormones, le poulet à la dioxine, la vache folle et j’en passe. En Bretagne, les eaux sont polluées, les plages pleines d’algues vertes, le tourisme en péril. Il faudra cinquante ans pour récupérer les sols. Sans parler des problèmes sociaux : combien de paysans ont disparu ? Du reste, les agriculteurs ne s’y sont pas trompés : s’ils font désormais de l’agriculture « raisonnée », c’est bien que la précédente était une agriculture folle !
Le soja n’est cultivé aux Etats-Unis que depuis huit ou dix ans. C’est très peu au regard du temps que prend la recherche. A-t-on suffisamment de recul pour permettre la généralisation des OGM ? Autant je suis d’accord pour développer la recherche, autant je ne puis accepter la généralisation, sans en connaître les effets sur les trois aspects du développement durable, autrement dit économiques, sociaux et environnementaux.
M. François GUILLAUME : Cessons de mélanger tout à dessein. Ainsi, le coton génétiquement modifié n’a jamais conduit, contrairement à ce que certains prétendent, à développer l’utilisation des produits phytosanitaires ! Une production conventionnelle nécessite l’utilisation de désherbants, d’insecticides, de fongicides. Prenez le cas de la pomme de terre : nous avons connu l’époque où, faute de désherbants et d’insecticides, il fallait arracher les adventices à la main et mobiliser les gamins des écoles pour éliminer les doryphores. Reste le problème des champignons et particulièrement du mildiou, qui exige une succession de traitements à des moments bien précis en fonction des conditions climatiques. Il en est de même pour la vigne. L’agriculture biologique elle-même ne s’interdit pas l’utilisation de certains fongicides. La preuve est faite que le produit vraiment « naturel » ne peut résister aux attaques des pestes et ravageurs. La technologie des OGM, en accélérant la sélection des plantes, participe de la même démarche.
Les avantages financiers des OGM sont incontestables. Faut-il en déduire que les semenciers accaparent tout ? Le bénéfice d’une technique nouvelle se répartit entre les forces du marché : producteurs de semences, acheteurs utilisateurs et consommateurs. En s’organisant, les agriculteurs peuvent limiter le poids des semenciers. Mais si, en refusant toute expérimentation, nous tuons Limagrain, quatrième semencier mondial, premier pour les graines potagères, ce sera tant mieux pour les semenciers américains et tant pis pour le pouvoir économique des paysans.
Parlons des pays en développement. L’agriculture conventionnelle des pays tempérés pourrait-elle répondre au problème de l’alimentation mondiale ? Je n’en suis pas sûr. Après tout, se diront certains, nous sommes bien nourris, veillons à notre petite santé et tant pis pour les autres… Je ne suis pas de cet avis. Si nous mettons au point des OGM spécifiquement adaptés à la sécheresse, à la salinité des sols, etc., à défaut de régler le problème, nous aurons déjà fait de gros progrès, car c’est précisément dans ces pays qu’il faut développer la production. L’intérêt pour leurs agriculteurs serait d’autant plus évident que le progrès technologique réside dans la semence et non dans certains intrants difficiles à importer ou à utiliser.
Se pose évidemment la question du prix de la semence. Si l’on tient réellement à aider les pays en voie de développement, peut-être vaut-il mieux la leur donner plutôt que de distribuer de l’argent, sans être assuré d’en faire profiter leurs populations…
M. Yves COCHET : Allez demander cela à Monsanto…
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Ce n’est pas ce qu’on a fait pour le sida…
M. François GUILLAUME : Ajoutons que certains OGM pourraient éviter la détérioration des stocks de céréales, dont l’ampleur est considérable.
Tâchons de dépasser les passions, relativisons les choses et cherchons à voir ce que peuvent réellement apporter certains OGM aux pays en voie de développement en leur permettant d’intensifier une production agricole dont ils ont le plus grand besoin et de les sortir de leur dépendance vis-à-vis des pays riches.
M. le Président : Gardons-nous de globaliser les problèmes. Tout le monde s’accorde à reconnaître que, grâce à la recherche, la qualité sanitaire des produits s’est considérablement améliorée. Et si des problèmes technologiques, tels que la dioxine ou les farines animales, se sont posés, la recherche en tant que telle n’y est pour rien.
M. Philippe TOURTELIER : Je n’ai pas voulu dire autre chose.
M. le Président : J’entends bien. Mais à force d’entendre lier les deux sujets, le consommateur a l’impression de subir crise sur crise et s’imagine que le chercheur en est systématiquement à l’origine. C’est encore un point que notre mission devra s’attacher à clarifier.
M. Guy RIBA : On n’en sait pas assez, c’est certain. J’ai dit et je répète qu’il est effectivement dangereux de lâcher massivement des cultures OGM sans suivi. Cela ne signifie pas que je sois contre, mais qu’il faut les soumettre à plusieurs conditions. Il faut d’abord être systémique, non réductionniste – autrement dit, raisonner par bassin de production et sur l’ensemble des effets – et comparatif. Cela suppose d’abord de développer l’expérimentation, autrement dit les essais, et la modélisation. Il serait également utile, quoique cette question fasse débat au sein de la communauté des chercheurs, de favoriser des coopérations entre nos équipes de recherche publique et les pays ayant déjà massivement développé des cultures OGM, afin d’en mesurer les avantages et les inconvénients dans un cadre multidisciplinaire, sciences sociales comprises.
Rappelons également que le Comité de biovigilance a été mis en place pour le suivi des cultures et non pour le suivi des essais. Prétendre appliquer à des essais une démarche de biovigilance est une monumentale bêtise : les protocoles des essais ne permettent aucunement de répondre aux questions que vous vous posez dans le cadre de la biovigilance. Reste que celle-ci a prouvé sa pertinence et doit impérativement rester pérenne : je me félicite à cet égard que les services du ministère de l’agriculture, et notamment la protection des végétaux, aient formé un bataillon d’inspecteurs spécialisés.
Mme Robin-Rodrigo a soulevé le problème de la régionalisation. Actuellement, la régionalisation des cultures, à de très rares exceptions, dépend essentiellement des acteurs du marché. Toutefois, si la question est très pertinente, la réponse n’est pas évidente. A supposer qu’une région puisse s’interdire ou s’imposer certaines choses, elle doit se préserver une certaine réactivité pour le cas où le contexte l’amènerait à changer d’avis. Je reconnais que l’échelon territorial n’est pas suffisamment pris en considération, mais je ne sais si cela doit relever de la réglementation ou de la décision politique.
M. Lilian LE GOFF : La région Bretagne a déjà pris une décision politique visant à se ménager une certaine autonomie et, surtout, à garantir sa sécurité alimentaire en mettant en place des filières d’importation de soja non-OGM dans le cadre d’un accord signé avec le Paraná, en attendant de produire, elle-même, ses protéines végétales.
M. Guy RIBA : Les pesticides sont une véritable épée de Damoclès pour la filière viti-vinicole. Chaque hectare de vigne reçoit bon an mal an entre 1800 et 2000 euros de pesticides, AOC compris. Si cette affaire est montée en épingle par la concurrence, une région viticole qui se sera interdit les OGM sera bien coincée par la suite. Trouver une alternative aux pesticides dans la production vinicole n’est pas évident.
M. Francis DELATTRE : Si le Paraná a signé un accord de partenariat, c’est qu’il a bien compris qu’il y avait là une niche intéressante dans la mesure où il peut vendre son soja non-OGM 20 % plus cher. Ce raisonnement est totalement économique et non environnemental.
M. Lilian LE GOFF : Le demandeur était la Bretagne, non le Paraná.
M. Francis DELATTRE : Mais le Paraná a une vision bien différente de celle de la Bretagne.
M. Lilian LE GOFF : Il faudrait savoir ce que l’on entend par « sécurité alimentaire ». Peut-on se croire « au top » simplement parce que l’on a traqué le microbe, en passant sous silence tous les autres facteurs de risque ? Le soja transgénique n’est effectivement pas une solution en soi. La vraie solution consiste à remettre en cause le marché de dupes passé à Blair House, lorsque l’Europe a accepté de limiter sa production de protéines végétales et de devenir dépendante à plus de 70 % d’un soja de plus en plus transgénique.
M. François GUILLAUME : Ne dites pas n’importe quoi ! On peut, certes, faire des protéines à partir de luzerne ou de bien d’autre chose. Malheureusement, il faudrait les subventionner massivement, en attendant que le produit trouve sa rentabilité. Si vous considérez que Bruxelles est disposé à consacrer des sommes considérables à ces protéines, dites-le ! La réalité est malheureusement très différente.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : C’est une question de volonté politique !
M. François GUILLAUME : Les établissements Glon nous ont fait part des énormes difficultés qu’ils rencontraient pour trouver du soja non-OGM. Il leur est impossible de trouver des approvisionnements suffisants et sûrs pour garantir un produit non-OGM à leurs clients.
M. Lilian LE GOFF : M. Glon est une référence parmi tant d’autres… Visiblement, M. Guillaume ne sait pas raisonner en dehors des subventions.
M. Stéphane PASTEAU : Toutes les problématiques ont déjà été évoquées, alors que je comptais m’exprimer sur les avantages que pourraient représenter les biotechnologies pour les pays en voie de développement…
Sur les soixante pays qui travaillent officiellement sur le développement de techniques liées aux biotechnologies, plus de la moitié sont des pays émergents. Et la croissance en termes d’utilisation de ces nouveaux produits est deux fois plus élevée chez les paysans dits du Sud que chez leurs homologues du Nord. Cela dit, pas plus dans ces pays que dans les nôtres, la démarche ne peut évidemment se résumer à la question de savoir si l’on est pour ou contre les biotechnologies. Il faut revenir à une approche au cas par cas. J’ai cité tout à l’heure celui du coton Bt.
Avant que ces technologies n’atteignent le stade de la mise en marché, plusieurs conditions doivent être réunies, à commencer par un préalable évident : l’existence ou le développement d’un cadre réglementaire dont certains pays émergents sont, pour l’heure, totalement dépourvus. Le rôle des institutions nationales et publiques est donc prééminent et celui des sociétés semencières n’est pas pour autant négligeable dans la mesure où un développement trop rapide pourrait, à terme, jouer à leur désavantage.
M. Hirzel a rappelé trois critères que je voudrais développer.
Utilisation possible par les petits comme par les grands : le fait qu’elle soit dans les semences donne à cette technologie un avantage considérable par rapport aux autres, à commencer par le machinisme agricole.
Investissement limité : on a beau jeu d’arguer que les agriculteurs des pays en voie de développement ne peuvent pas acheter les semences transgéniques. Si les petits producteurs de coton d’Inde, de Chine ou d’Afrique du Sud achètent, année après année, nos semences plus cher que les semences conventionnelles, c’est tout simplement parce que le bénéfice financier net à la sortie est supérieur. Un petit producteur africain venu à Paris me confiait un jour : « La première fois que j’ai vu arriver des fermiers blancs pour me vendre ces semences, je me suis demandé, premièrement, ce qu’ils allaient essayer de me refiler, deuxièmement, combien cela allait me coûter ! » Réaction évidente, mais qui doit être replacée dans un contexte général : la seule question qui compte est celle de savoir ce que cela coûte et ce que cela rapporte. C’est le calcul de tout agriculteur.
Facilité d’utilisation : la résistance aux insectes ou aux herbicides en est un exemple. Ce qui n’est, du reste, pas sans inconvénients : on a rappelé les risques liés au développement trop rapide du soja tolérant en Argentine. Des mesures doivent être prises pour éviter la prolifération d’insectes résistants. Or, force est de reconnaître que la biovigilance est moins aisée à mettre en place dans les pays émergents.
Tout cela ne peut cependant faire oublier que l’utilisation des biotechnologies dans les pays en voie de développement doit s’inscrire dans une approche globale intégrant tant la problématique de l’accès aux intrants que les pratiques agricoles, voire financières comme le microcrédit.
Venons-en à ce qui se passe en Europe. Un de vos collègues appelait à prendre des décisions pour savoir si, oui ou non, on ouvrait la porte à la généralisation des biotechnologies. La question ne doit pas être posée ainsi. J’ai dit, et je répète, que l’introduction de cette technologie ne peut qu’être progressive et maîtrisée. Il n’est pas question de recouvrir du jour au lendemain les 3,5 millions d’hectares de maïs français par du maïs OGM. Il s’agit de faire notre expérience de façon contrôlée, en l’assortissant de règles de bonne pratique et de coexistence, et de vérifier si cela peut apporter quelque chose à l’agriculture française telle qu’on voudrait la voir demain. Donnons-nous la chance de pouvoir expérimenter, par nous-mêmes, une introduction progressive et maîtrisée. C’est à cela que vous devez réfléchir.
M. Jean-Pierre LEROY : J’ai expliqué tout à l’heure combien le développement des cultures génétiquement modifiées pouvait être pénalisant en termes de revenu brut agricole, par le fait qu’il provoquerait un nivellement par le bas des productions de secteurs, jusqu’alors référencés comme des filières de qualité et qui sont à la base d’une construction alimentaire exceptionnelle en France, tout en permettant à nombre d’agriculteurs de vivre décemment. Qui plus est, la baisse de qualité irait de pair avec une réduction de la diversité de l’offre au niveau de la production comme au niveau de la transformation, obligeant la clientèle à chercher ailleurs, au détriment de nos parts de marché.
Les grandes régions françaises ne sont pas le Middle West américain. Il n’est pas sûr qu’elles aient à gagner quoi que ce soit à utiliser des semences génétiquement modifiées et à industrialiser davantage encore une agriculture qui repose en premier lieu sur la biodiversité et sur un savoir-faire paysan déjà bien mis à mal depuis cinquante ans. La prétendue révolution verte a conduit les paysans à devenir les sous-traitants de l’agrochimie : en leur vendant un processus de production assorti d’une notice dont ils étaient tenus de respecter scrupuleusement les prescriptions, on les a dépossédés de leur savoir-faire pour le transférer à l’agrochimie. Doit-on aller encore plus loin dans cette évolution par le biais de la transgénèse végétale et, pourquoi pas, animale ? Il est vrai que les appétits des firmes n’ont pas de limites…
Ajoutons que notre agriculture, qui a donné naissance à une gastronomie sans égale, reste riche d’externalités positives. Si 70 millions de touristes viennent en France, ce n’est pas seulement pour contempler nos montagnes et nos châteaux. Ils viennent aussi découvrir un art de vivre aux multiples facettes régionales, qui fait toute la richesse de nos territoires, une valeur ajoutée appelée à s’accroître encore. Je doute que nous la préservions en nous engageant dans un processus d’agriculture industrialisée, et qui plus est sous cette forme.
M. Didier MARTEAU : Comment peut-on faire ainsi l’apologie de ce qui se passait cinquante ans auparavant ? Si nous produisions le lait d’il y a vingt ans, on nous le refuserait systématiquement !
M. Gabriel BIANCHERI : Très juste !
M. Didier MARTEAU : Un boulanger d’aujourd’hui serait incapable de faire du pain avec du blé d’il y a vingt ans !
M. Jean-Pierre LEROY : Ce n’est pas ce que j’ai dit !
M. Didier MARTEAU : En tout cas, c’est ce qu’on entend dire souvent. De surcroît, les normes vont encore se durcir. Mon lait ne doit pas compter plus de tant de cellules, mon blé doit contenir tant de protéines, etc. L’année dernière, il était bon à jeter aux poules, tout simplement parce que la nature avait été bonne et que je n’avais pas voulu épandre davantage d’azote ! Résultat : un blé inexportable. Essayez de vendre des pommes de terre avec une tache ou une forme non conforme aux exigences du consommateur ! Toutes ces obligations, ce n’est pas nous qui nous les imposons. Mais il nous faut bien les respecter et, pour cela, soigner nos plantes. Je ne traite pas par plaisir !
M. le Président : La grande distribution a souvent été citée dans nos auditions. On l’accuse d’être pour quelque chose dans les origines de la controverse sur les OGM, certains acteurs ayant, très tôt, cherché à utiliser le label « sans OGM » à des fins de marketing. Effet boomerang aujourd’hui, puisque, à croire certaines affirmations, des hards discounters appartenant aux mêmes grands groupes de distribution commenceraient à faire une place aux produits OGM… Autrement dit, les gens les plus défavorisés, ceux qui devront se contenter des produits les moins chers, n’auront pas le choix, cependant que, dans les grandes surfaces classiques, même les produits issus d’animaux ayant consommé des OGM devront être étiquetés en conséquence. Enfin, certains éleveurs, dans les Combrailles notamment, se voient imposer par les grands distributeurs des cahiers des charges drastiques sans OGM, en dehors de toute réglementation, qui les obligent à supporter des surcoûts de l’ordre de 15 à 20 %. Que répondez-vous à cela ? Quelle est la position de la grande distribution sur cette question ?
M. Jérôme BÉDIER : Dès 1996, nous avons effectivement décidé qu’aucun produit OGM n’entrerait dans nos magasins sans être étiqueté comme tel, conformément au tout récent règlement européen. C’était l’époque où l’on apprenait par la bande que des cargos chargés de soja transgénique entraient en Europe et aucune des conditions permettant l’application du règlement européen n’était réunie. Dans un contexte difficile – on est allé jusqu’à nous taxer d’obscurantistes –, nous nous sommes battus pour une véritable traçabilité et un étiquetage digne de ce nom, sans lesquels il ne saurait y avoir de confiance. Or la consommation est un métier d’abord fondé sur la confiance.
Pourquoi cette fermeté ? Tout simplement parce que certains acteurs ont volontairement ou involontairement donné l’impression que les solutions ne pouvaient être que tout OGM. A les entendre, la ségrégation était impossible dans les bateaux et le seul étiquetage envisageable restait : « Peut contenir des OGM »… Nous nous sommes battus comme des lions, en particulier face aux fabricants de soja américains. Si nous pensons que les OGM ont leur place, nous tenons à préserver le choix et la diversité. Le problème ne vient pas de la grande distribution, mais de ceux qui, implicitement ou explicitement, ont défendu un modèle tout OGM.
Une fois réglée cette question, il doit être possible d’avancer. Une partie de nos clients aime les produits traditionnels, nous avons donc besoin de filières non-OGM afin que le consommateur puisse choisir.
M. le Président : Y a-t-il des produits OGM dans vos linéaires ?
M. Yves COCHET : Le Nutella !
M. Jérôme BÉDIER : Il suffit de consulter la liste de Greenpeace – ce sont les spécialistes de la question – pour voir qu’il y en a dans tous nos magasins.
M. le Président : Et en même temps, vous imposez aux agriculteurs des Combrailles de ne pas donner d’OGM à leurs vaches…
M. Jérôme BÉDIER : Justement pour préserver la diversité : nous avons des gammes avec OGM et des gammes sans OGM.
M. le Président : A ceci près que l’une coûte plus cher que l’autre.
M. Jérôme BÉDIER : C’est un choix de qualité. On nous a trop souvent accusés de ne vendre que de la laitière pour nous reprocher aujourd’hui d’offrir le choix.
Désormais, M. Pasteau vient de le confirmer, plus personne ne revendique le tout OGM. Reste, et cette réunion le prouve, que nous sommes tous dans le doute le plus complet sur la capacité des institutions françaises et européennes à gérer la mise en place de ces technologies. Jusqu’à présent, la consommatrice moyenne, qui ne connaissait rien aux biotechnologies, croyait pouvoir faire confiance aux institutions en France et en Europe et à leurs experts pour prendre position sur les OGM, mais également sur les contaminations, les problèmes de qualité, etc. Or force est de constater que ces institutions ne parviennent pas à susciter le consensus ni à fonctionner. De notre côté, nous resterons parfaitement légitimistes et nous laisserons faire les procédures publiques. Encore faudra-t-il agir dans un contexte qui garantisse véritablement, comme le client le réclame, le pluralisme de l’offre alimentaire.
M. le Président : Mais est-il vrai que vous imposez aux éleveurs de Clermont-Ferrand un cahier des charges sans OGM et, par le fait, un surcoût dont ils ne tirent aucune contrepartie ?
M. Philippe FOLLIOT : Effectuez-vous des vérifications sur les viandes importées ?
M. Gérard DUBRAC : Bonne question !
M. Francis DELATTRE : Et les 20 % de pesticides en moins dans les OGM, les indique-t-on ?
M. Jérôme BÉDIER : Notre demande répond à une logique : présenter, à côté des autres offres, des productions issues de méthodes traditionnelles. Aussi les cahiers des charges prévoient-ils une alimentation du bétail à l’ancienne, sans OGM. Ce qui suppose de trouver les sources d’alimentation présentant toutes les garanties sur ce plan.
M. le Rapporteur : Mais, comme vous l’a demandé M. Folliot, avez-vous les mêmes exigences pour les viandes importées d’Espagne, par exemple ?
M. Philippe FOLLIOT et M. Gérard DUBRAC : Et d’Argentine !
M. Jérôme BÉDIER : Dans quel magasin avez-vous trouvé de la viande argentine ? Peut-être dans certains produits surgelés, mais certainement pas en viande fraîche. Cela dit, l’exigence est fonction de la stratégie commerciale et n’est pas la même pour une viande non issue de filière traditionnelle.
M. le Rapporteur : Vous noyez le poisson…
M. Gérard DUBRAC : C’est une pirouette !
M. Jérôme BÉDIER : Nous le noyons d’autant moins que c’est nous que Greenpeace a attaqués…
M. le Président : Sur quoi ?
M. Jérôme BÉDIER : A propos de l’étiquetage de la composition de l’aliment du bétail sur nos viandes.
M. le Président : Vous y êtes favorable ?
M. Jérôme BÉDIER : Justement non. Nous leur avons expliqué que ce n’était pas possible. Si nous étions disposés, pour des raisons commerciales, à mettre en place des filières traditionnelles, il n’était pas question de nous lancer dans un système de traçabilité de l’alimentation du bétail. Ils nous en ont du reste voulu et ont organisé une série d’actions dans nos magasins, comme le veut la mode…
M. Yves COCHET : C’est cela ou le fauchage…
M. Jérôme BÉDIER : Il paraît que c’est plus commode que devant les préfectures ! La traçabilité de l’alimentation du bétail est très difficile et très coûteuse. Nous pouvions la réserver à certains produits sélectionnés à des fins commerciales, mais en aucun cas la généraliser.
M. Lilian LE GOFF : Remarquons que les malheureux Argentins, qui avaient le leadership mondial des exportations de viandes, l’ont perdu à cause, précisément, du soja transgénique… Un article de Courrier international dresse à ce propos un état des lieux édifiant.
En amont de la distribution, la traçabilité pose un problème politique fondamental. Si l’expansion des OGM induit des problèmes de traçabilité, la logique ne voudrait-elle pas que le coût en soit supporté par les filières qui en sont à l’origine plutôt que par la collectivité et in fine le consommateur ? Car si les filières non transgéniques se retrouvent à payer un surcoût pour prouver ce qu’elles sont, elles seront fatalement moins compétitives que les filières transgéniques qui, peu à peu, supplanteront les produits conventionnels.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Il faut renverser la charge de la preuve.
M. Lilian LE GOFF : Nous sommes bien d’accord.
M. Éric SEYNAVE : N’oublions pas qu’entre l’agriculture et la distribution, il y a l’agroalimentaire… Trois enjeux sont à mes yeux essentiels : la sécurité alimentaire, les enjeux économiques et l’information du consommateur.
M. le Président : Le troisième sera abordé jeudi.
M. Éric SEYNAVE : Commençons par la sécurité alimentaire. Dieu merci, l’industrie ne se polarise pas sur la seule microbiologie. Tous les éléments – microbiologie, toxicité, nutrition, etc. – sont désormais très bien encadrés et réglementés. Or tous les spécialistes, nutritionnistes, toxicologues, y compris l’AFSSA qui généralement n’est pas des plus tendres, sont tombés d’accord sur le fait que l’OGM ne présente, par lui-même, aucun risque en matière de sécurité alimentaire.
M. Yves COCHET : On ne peut pas dire cela.
M. Éric SEYNAVE : C’est en tout cas l’avis de l’AFSSA, autrement dit de l’agence compétente dans notre pays pour en débattre.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : A l’instant T…
M. Francis DELATTRE : Avis confirmé par l’Autorité européenne !
M. Éric SEYNAVE : Absolument.
M. le Président : C’est effectivement ce que nous a dit l’AFSSA, lors de la table ronde sur les enjeux sanitaires.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Mais elle l’a dit pour l’immédiat.
M. Yves COCHET : Une chose est de dire que les OGM ne posent pas de problèmes sanitaires, autre chose est de le démontrer pour tous les OGM, dans toutes les conditions et dans tous les pays du monde.
M. Gabriel BIANCHERI : Et pourquoi ne pas en démontrer également l’intérêt ?
M. Éric SEYNAVE : Ce débat se voudrait être le plus objectif possible sur un sujet excessivement complexe qui engage l’avenir. Force est, à un moment donné, de faire confiance aux spécialistes et j’ai la naïveté de penser que l’AFSSA a, en la matière, une compétence reconnue.
L’alimentation animale est un débat clé sur lequel l’information n’est pas bonne. Les spécialistes – toujours les mêmes – ont constaté une absolue équivalence entre les produits provenant d’animaux ayant consommé des OGM et ceux provenant d’animaux qui n’en ont jamais mangé. Partant de là, le législateur a jugé inutile d’imposer un étiquetage OGM sur les produits animaux. Il ne faut donc pas laisser certains organismes affirmer que l’on ne respecte pas la législation lorsque l’on n’étiquette pas ni laisser circuler ces listes rouges, vertes ou orange dans la presse. Je suis tout à fait d’accord avec Jérôme Bédier : le consommateur a besoin d’information, il est logique qu’il l’exige et l’industriel responsable se doit de respecter la législation en la matière, comme le font les 11 000 entreprises que nous représentons.
Cela dit, restons prudents. Bien sûr, il faut offrir le choix entre différents modes de production. Mais il serait illusoire de penser que toutes les filières, économiquement parlant, se valent. Garantir une filière protéique sans OGM est effectivement très coûteux et l’on ne saurait porter des accusations à l’encontre d’un transformateur au motif que, utilisant des produits parfaitement équivalents, il ne pratique pas un étiquetage qui n’a du reste rien de légal. Imposer des filières spécifiques entraînerait des surcoûts considérables. Les conséquences seraient dramatiques, d’autant que notre industrie, majoritairement constituée de petites entreprises, est déjà confrontée à une pression sur les prix considérable. On ne peut pas laisser dire et faire n’importe quoi.
M. Daniel CHÉRON : M. Bédier a parlé de la liberté de choix du consommateur et de l’organisation de la coexistence des cultures Je n’ai pas d’opposition de fond sur le concept. Encore faut-il que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Une huile produite en France à partir de colza génétiquement modifié devra être étiquetée. Mais si elle est importée des Etats-Unis, sachant que l’on ne peut y trouver aucune trace d’ADN génétiquement modifié, personne ne pourra obliger la distribution à l’étiqueter « produit génétiquement modifié ». Sur le plan intellectuel, comment celle-ci gère ce problème ? Par ailleurs, les distributeurs s’imposent-ils les mêmes règles à l’étranger qu’en France ? Carrefour s’oblige-t-il aux mêmes exigences de traçabilité à Pékin, ou considère-t-il que le consommateur chinois n’a pas les mêmes exigences que le consommateur français ?
M. Jérôme BÉDIER : Il ne peut y avoir de traçabilité loyale sans réglementation pour l’imposer, afin que tout le monde la paie au même prix. Si aucune réglementation chinoise ne l’impose, il n’y en aura pas. C’est, du reste, la raison pour laquelle nous avons toujours milité en faveur de solutions européennes. Nous rencontrons déjà le même problème que nous rencontrons avec le bio, sur lequel nous sommes plutôt mieux-disants que la moyenne européenne. Face aux Américains, il va nous falloir agir tous ensemble pour les convaincre d’entrer dans une logique de traçabilité et leur faire comprendre qu’elle n’a pas pour but de les empêcher d’exporter. Les grands opérateurs américains savent parfaitement maîtriser la ségrégation des cultures. Voilà les combats qu’il nous faudra mener. Nous ne pouvons en rester à des solutions de réserve d’Indiens.
M. Daniel CHÉRON : Les Américains, qui ne sont pas idiots, ont parfaitement compris qu’en transformant leurs produits agricoles aux Etats-Unis, ils se donneraient des armes de compétitivité extraordinaires par rapport à l’Europe. Nous sommes en train de perdre des pans entiers de l’agroalimentaire français et européen, tout simplement parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes des deux côtés de l’Atlantique… On va dans le mur !
M. Didier MARTEAU : M. Bédier est un bon commercial. S’il me paie une caisse de champagne à chaque fois que je trouverai une viande étrangère dans une grande surface, je vais boire à bon compte…
M. Jérôme BÉDIER : Vous trouverez évidemment de l’agneau.
M. Didier MARTEAU : Même de la viande bovine.
M. Jérôme BÉDIER : Il n’y en a vraiment pas beaucoup.
M. Didier MARTEAU : Mais il y en a. Sans oublier que le secteur de la restauration, hors du foyer, importe massivement. La raison est simple : en France, on ne mange que les meilleurs morceaux, autrement dit seulement 10 à 15 % d’une bête. Nous sommes donc structurellement incapables d’alimenter la totalité du marché.
Sur la traçabilité, on nous en demande de plus en plus mais pour les prix, c’est de moins en moins… Et que voulez-vous contrôler sur les produits d’importation ?
M. Gabriel BIANCHERI : C’est bien ce que dit M. Chéron.
M. Didier MARTEAU : Au demeurant, même sur le marché intérieur, quels contrôles pourra-t-on effectuer, alors que toutes les expériences ont montré que des bêtes nourries pendant trois ans, les unes au maïs d’ensilage OGM, les autres au maïs non-OGM, ne présentent rigoureusement aucune différence en qualité comme en quantité, qu’il s’agisse de la viande ou du lait ? Faudra-t-il étiqueter le veau sous la mère qui aura mangé de l’OGM ? Et pendant combien de temps ? Avec un tel système, tout un chacun pourra un jour se faire coincer. L’alimentation est un métier très difficile. Les aliments ne sont pas les mêmes tout au long de l’année. Il faut faire attention avant de promettre et de se lancer dans ce genre de communication. Pour ma part, je me suis toujours refusé à prendre une telle responsabilité.
M. Lilian LE GOFF : La réglementation européenne imposant l’étiquetage des aliments destinés aux animaux, l’éleveur saura s’il donne du transgénique ou pas à ses bêtes, et dans quelles proportions. Reste à obliger, ensuite, la filière à rendre le même service d’information et de traçabilité au consommateur.
M. le Président : Nous vous avons déjà entendu tenir ces propos, M. Le Goff. Mais peut-être auriez-vous dû vous en abstenir cette fois dans la mesure où M. Apoteker a écrit dans Le Monde que le but était exclusivement stratégique : tuer globalement le système en imposant une réglementation. A tout complexifier par des règles supplémentaires et des seuils divers et variés…
M. Didier MARTEAU : Tout sera marqué et banalisé.
M. Lilian LE GOFF : La traçabilité doit permettre de savoir ce que l’on a fait pour arriver au produit.
M. le Président : Mieux vaut poser les vraies questions, comme l’ont fait mes collègues : si l’on n’a pas besoin d’OGM, comme certains le pensent, le plus simple est de les interdire. Si, comme d’autres, on juge cette technique intéressante, on l’autorise au cas par cas, après analyse par des commissions et par un système de gouvernance dûment accepté. Mais les opposants les plus radicaux veulent mettre en place un filet réglementaire de seuils et d’étiquetage tellement complexe que plus personne ne s’y retrouvera et qu’il en viendra à déstabiliser non pas nos concurrents, mais bien nos propres filières.
M. Bédier, nous confirmez-vous que certains de vos membres financent la CRII-GEN, comme nous l’a dit Mme Lepage ?
M. Jérôme BÉDIER : Dites-moi de qui il s’agit, et je me renseignerai…
M. Guy VASSEUR : Du fait de la nouvelle réglementation sur les produits OGM, les risques de distorsion de concurrence deviendront énormes. Le meilleur moyen de piéger les filières européennes consiste effectivement à mettre en place une réglementation compliquée dont l’application sur les produits importés sera le plus souvent inopérante.
Certains députés se sont laissés aller à des amalgames et des comparaisons qui relevaient plus de la provocation que de la recherche de solutions au problème posé…
M. le Président : M. Tourtelier s’en est expliqué.
M. Guy VASSEUR : Je ne pensais pas à lui, mais à son collègue qui s’est déclaré insensible aux considérations économiques… Est-il aussi insensible qu’il le dit au problème des importations, que nous venons de soulever, ou des filières traditionnelles dont M. Le Goff, lui-même, reconnaît qu’elles risquent de perdre en compétitivité ? Voilà, le véritable problème posé à l’agriculture française.
M. Lilian LE GOFF : C’est évident.
M. Guy VASSEUR : Certes, mais si nous restons les mains dans les poches, sans nous doter des moyens de recherche pour trouver les réponses, notre agriculture ne tardera pas à se retrouver dans une situation des plus difficiles. Les agriculteurs français, constatons-le, ne se sont pas précipités pour produire des OGM.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Ils ne le peuvent pas.
M. Guy VASSEUR : Ils le pourraient.
M. le Président : Dix-sept hectares de maïs ont été cultivés par Arvalis dans les Landes – hors expérimentation.
M. Guy VASSEUR : En effet. Alors que nous pouvions produire des OGM, nous ne l’avons pas fait. Pourquoi ? D’abord parce que nous tenons compte des consommateurs, de l’opinion, de la société. Mais, surtout, parce que nous attendons que la recherche publique nous apporte des réponses dont les politiques ont également besoin, et qui pourraient nous permettre de retrouver notre compétitivité perdue. Sinon, tout porte à croire que les jachères continueront à s’étendre sur le territoire national.
Les régions dont a parlé Mme Robin-Rodrigo ont pris des dispositions non pour empêcher la production d’OGM, mais bien pour interdire purement et simplement la recherche au champ, ce qui est à mes yeux scandaleux. Tout le monde veut bien se mettre d’accord sur la recherche en milieu confiné ; le problème est qu’elle ne peut nous apporter toutes les réponses. Toute l’histoire de la recherche agronomique prouve le caractère indispensable des essais au champ. Les interdire revient à condamner la recherche française et à laisser le champ libre à la recherche étrangère et particulièrement à celle des grandes firmes privées. Et malheureusement, cette approche ne semble pas près de changer : mon propre conseil régional a pris position pour défendre ceux qui détruisaient les essais. C’est proprement inadmissible.
M. le Président : Je n’ai pas eu connaissance de motions soutenant la désobéissance civile…
M. Guy VASSEUR : Je suis membre du conseil régional de la région Centre, qui a décidé de payer un avocat aux personnes qui sont allées détruire les essais. Je tiens le texte à votre disposition.
On ne peut pas se plaindre de rester dans le doute et refuser d’encourager la recherche. Elle ne réglera certes pas tout, mais nous donnera au moins des éléments tangibles pour répondre à la question : faut-il y aller ou pas ? Réduire les apports de produits phytosanitaires aurait à l’évidence un intérêt certain pour l’environnement, quand bien même l’agriculture raisonnée apporte déjà une certaine modération. Les OGM permettraient-ils de faire mieux ? Et qu’en est-il des disséminations et des risques de contamination ? Voilà les réponses que nous attendons de la recherche avant de nous déterminer. Malheureusement, nous avons perdu plus de dix ans. N’oublions pas, non plus, que d’autres générations d’OGM doivent voir le jour. Si leur utilité est prouvée, nous ne devons pas rater le coche. Si tel n’est pas le cas, ce sera au politique de prendre ses responsabilités. Mais une interdiction des OGM ne peut se concevoir qu’au niveau européen et avec une protection des marchés : ce n’est pas gagné…
M. Francis DELATTRE : Force est de constater que la grande distribution s’est offert avec les OGM un magnifique coup de marketing, ce qui, du reste, n’a pas contribué à garantir le sérieux du débat.
M. Jérôme BÉDIER : On ne peut pas concevoir que la grande distribution fasse autre chose que du marketing !
M. Francis DELATTRE : Venons-en aux avantages et aux inconvénients économiques des OGM. Un de nos collègues a parlé du Paraná, qui se fait fort d’être le seul Etat du Brésil à produire du non-OGM. Qu’en dit l’article que j’ai sous les yeux ? « Pas sûr que l’Europe puisse toujours compter sur le Brésil pour se fournir en soja non-OGM, à moins d’y mettre le prix. » L’Etat du Paraná a donc fait réaliser une étude sérieuse sur les coûts et avantages du soja OGM
– ce que nous n’arrivons jamais à faire en France, sauf pour le coton, alors que nous produisons surtout du colza et du maïs… Les conclusions en sont claires : si la semence coûte légèrement plus cher, les dépenses en herbicides chutent nettement : 12,50 euros à l’hectare au lieu de 70. Autrement dit, le soja OGM présente bel et bien un intérêt économique. Et le Paraná d’en tirer la conclusion suivante : d’accord pour un partenariat avec la Bretagne, mais à condition de lui faire payer le soja non-OGM 20 % plus cher…
La suite est des plus simples. Dans un premier temps, le soja non-OGM va entrer en Bretagne et ses éleveurs le paieront 20 % plus cher. Malheureusement, ceux-ci seront rapidement dépassés par la concurrence et le hors-sol breton sera transféré au Brésil, sitôt réglés les problèmes de logistique… On pourra alors faire du tourisme en Bretagne, comme le dit notre collègue : il n’y aura plus d’algues vertes, nous serons devenus une réserve à touristes et tout sera parfait ! Tout le débat économique est là.
Ajoutons que l’avenir de notre agriculture est largement non alimentaire. Et si nous nous sommes intéressés à ce dossier, c’est parce que nous espérions y trouver une alternative à un certain mode de production agricole, notamment grâce aux OGM insecticides. Les OGM résistants à l’herbicide ne sont pas, reconnaissons-le, les plus séduisants dans la mesure où leur intérêt est exclusivement économique – deux passages de glyphosate coûtent cinq à six fois moins cher que quatre ou cinq passages de désherbants sélectifs souvent plus dangereux.
Le plus inquiétant est que toute l’image des biotechnologies a pâti du débat sur les OGM, à tel point que les crédits de recherche connaissent une réduction drastique. Il est plus qu’urgent de dépasser cette controverse, d’autant que de nouvelles techniques permettront, bientôt, le même résultat sans faire appel à la transgénèse. Les biotechnologies apparaissent donc de plus en plus comme la vraie alternative et, particulièrement, pour le non-alimentaire. Ainsi, tous les emballages plastiques de la grande distribution pourraient être remplacés par des emballages d’origine végétale…
M. Jérôme BÉDIER : Nous sommes précisément en train d’en parler avec un de vos collègues.
M. Francis DELATTRE : Je regrette qu’Arvalis n’ait pas été invité. Ce serait le début d’une grande réconciliation entre l’agriculture et l’environnement : maire d’une commune de 35 000 habitants, je sais combien me coûtent vos emballages plastiques… J’y vois pour ma part une fantastique voie d’avenir, à condition de s’y atteler : l’amidon de maïs est encore 20 ou 30 % trop cher pour rivaliser de manière compétitive avec la matière première d’origine pétrolière.
Pourquoi la filière OGM ne pourrait-elle pas coexister avec les autres ? Nous sommes un pays de libertés… Moi aussi, j’adore le Sud-Ouest, je veux préserver nos particularismes mais nous devons aussi donner aux acteurs économiques une chance de survivre. Si nous perdons encore dix ans, que se passera-t-il ? L’agriculture française aura perdu toute compétitivité, comme toute l’agriculture européenne, alors même que l’Europe s’est engagée à ne plus payer de primes… Nous serons bien contraints, que nous le voulions ou non, de sortir des règles du commerce international qui régissent l’agriculture.
M. le Président : Nous inviterons Arvalis en audition privée pour étudier la question de la valorisation non-alimentaire de la production agricole. Ce sera sans doute un des sujets de débat du 7e PCRDT67.
M. Philippe FOLLIOT : On a, en fait, totalement mélangé deux sujets bien différents : celui de la recherche et des essais en plein champs et celui de la mise en culture d’OGM. Or ces deux questions n’appellent pas, de ma part en tout cas, une réponse forcément identique.
S’agissant de la recherche, nous avons, à l’évidence, besoin d’un avis éclairé sur les conséquences que pourrait avoir, pour notre agriculture, une insuffisante maîtrise de cette technologie. Maîtriser ne signifie pas automatiquement utiliser : ainsi, les essais OGM que nous avons visités en Haute-Garonne ont seulement pour objectif de permettre de sélectionner des plantes qui in fine ne seront pas OGM… Quelles seraient les conséquences pour nos filières agricoles, notre économie en général, notre recherche et notre secteur agroalimentaire si nous persistions à ne pas vouloir aller au bout de la démarche expérimentale ?
S’agissant de notre modèle agricole pour l’avenir, je crois au développement des complémentarités. Restons toutefois attentifs, comme nous y a appelés M. Leroy, aux conséquences que pourraient avoir des mises en culture d’OGM sur nos productions de qualité et sur l’activité touristique.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : M. Vasseur a posé la question : faut-il y aller ou pas ? Imaginons que, la recherche ayant pu mener à bien tous ses travaux, l’AFSSA et autres ayant définitivement exclu tout risque sanitaire, social et environnemental, on se lance dans la production d’OGM. Imaginons maintenant que, les années passant, on s’aperçoive qu’aucune coexistence n’est finalement possible, qu’un risque sanitaire se pose, que des conséquences économiques et sociales se font sentir. Sera-t-il possible de revenir en arrière ? Y a-t-il réversibilité ou pas ? Ne risquons-nous pas de nous retrouver impuissants sur une terre uniquement peuplée d’OGM ?
(M. François GUILLAUME remplace M. Jean-Yves LE DÉAUT à la présidence.)
M. Lilian LE GOFF : Pourquoi refuser a priori la coexistence des cultures conventionnelles et des cultures OGM ? Précisément parce que nous avons affaire, par le fait qu’il s’agit de pollens et de plantes, à des contaminations de type hégémonique. L’introduction dans un biotope d’une espèce douée d’un avantage compétitif, sans prédateur ou élément régulateur, aboutit inévitablement à un envahissement. C’est ce qui se produit au Canada avec le colza transgénique, puisqu’il n’y est déjà plus possible de cultiver le colza non transgénique. D’où des conséquences économiques et des procès en cascade. Pouvons-nous nous en laver les mains et laisser aux générations futures le soin de s’en débrouiller ? Au-delà de la menace sur la biodiversité, les jeux seront faits et le champ sera libre pour l’hégémonie économique permise par la brevetabilité du vivant.
Sommes-nous condamnés à cette fuite en avant – une de plus – que nous impose le productivisme ? Non. Nous avons en main des alternatives pour résoudre les problèmes des pesticides, de la faim dans le monde…
M. le Président : Nous avons déjà eu ce débat. N’allons pas le reprendre.
M. Lilian LE GOFF : Tous les orateurs ont pu développer leur argumentation, mais pour moi, ce n’est pas possible ! M. le Rapporteur, je tiens à ce qu’il soit noté dans votre rapport que je n’ai pas pu exposer le moindre développement concernant les alternatives aux OGM, solutions plus autonomes et économiques répondant au développement durable, ce qui est une donnée majeure du débat sur les enjeux économiques des OGM !
M. Didier MARTEAU : On parle beaucoup de jachères, mais on ignore souvent que 70 % des superficies en jachère sont en fait cultivées à des fins non alimentaires : c’est déjà le cas d’un champ de colza sur quatre, et bientôt d’un sur deux.
On parle souvent de l’image de nos belles campagnes. Mais le passage de machines de traitement n’est pas ce qu’il y a de mieux à cet égard… Des plantes développant des résistances naturelles seraient certainement plus à même d’améliorer l’image de notre agriculture.
Une attitude m’agace tout particulièrement. Alors que j’essaie systématiquement de porter le débat sur les aspects scientifiques ou techniques, on le ramène en permanence sur les aspects polémiques et médiatiques. Jamais nous ne pourrons nous en sortir dans ces conditions.
Mais c’est l’avenir qui m’inquiète le plus. D’ici à cinq ou dix ans, que nous le voulions ou non, les OGM seront là. Tout simplement parce qu’on ne peut pas mettre un grillage tout autour de l’Europe. Et ce jour-là, nous serons totalement dépendants pour nos semences, qu’il faudra bien aller chercher ailleurs, cependant que notre agriculture bio sera condamnée à disparaître, puisque nous n’aurons pas pris les mesures techniques qui auraient permis de la préserver. De surcroît, le maintien de taux très bas aura conduit à une banalisation : tout sera étiqueté OGM au point que le consommateur n’aura même plus le choix. Enfin, l’agriculture, c’est comme le textile : on peut délocaliser très vite. C’est ce qu’ont commencé à faire les grands producteurs de volaille en Bretagne. Demain, ce sera le tour des semences et d’autres productions. Il ne nous restera plus que le blé, mais à quel prix et avec combien d’agriculteurs ?
M. Guy RIBA : Séparer, comme le prône M. Folliot, la problématique des essais de la problématique des cultures me paraît une excellente démarche. Ce ne sont pas les mêmes questions et l’on n’y répond pas de la même façon.
Quelles sont les conséquences de l’arrêt des essais ? Je peux en citer deux. En voici une directe : faute de disposer de mesures précises effectuées sur notre territoire, les pouvoirs publics sont totalement dépendants du pétitionnaire de l’OGM dont certaines informations peuvent être fondées, d’autres moins, mais dont aucune en tout état de cause n’a jamais pu être vérifiée sur notre territoire. Or un gène résistant à telle souche au Etats-Unis peut fort bien ne jamais marcher en France. Et si personne ne peut le vérifier, on court à la catastrophe.
Autre conséquence, indirecte, celle-là : à partir d’un père et d’une mère, on a des enfants, puis des centaines de milliers de petits-enfants, parmi lesquels il fallait jusqu’à présent trier manuellement. C’est ce qu’on appelle la génétique à la baguette. Aujourd’hui, aux Etats-Unis, en Australie, les grandes entreprises comme les organismes publics ont mis au point un tout nouveau système fondé sur les biotechnologies avec, notamment, des mesures de l’expression des gènes par les puces et les marqueurs moléculaires. Avec les moyens dont nous disposons, il faudra quatre ans à l’INRA pour rattraper notre retard. Et moins nous aurons de crédits, plus il nous faudra de temps…
J’ai beaucoup apprécié l’intervention de M. Leroy sur la biodiversité. Il a posé une vraie question. Mais la problématique de la biodiversité n’est pas liée aux OGM. Avec douze cépages, on produit aujourd’hui 80 % des vins du monde entier. Et l’ensemble des productions de blé dans le monde n’utilise que 3 % de la variabilité génétique qu’ont utilisée ceux qui ont commencé à cultiver le blé voilà 12 000 ans ! Autrement dit, cela fait déjà un moment que nous sommes dans le mur et les OGM ne contribuent pas forcément à aggraver cette situation.
Enfin, Mme Robin-Rodrigo, si vous considérez que la biodiversité se résume à la liste des espèces qui vivent dans un milieu donné, vous allez également dans le mur. Même sans l’action de l’homme, les espèces évoluent en permanence. L’important est ce qu’on appelle la résilience du milieu, c’est-à-dire sa capacité à retrouver son équilibre initial, après une perturbation. Or cette résilience peut être préservée avec les OGM, à coup sûr dans certains cas, avec quelques doutes dans d’autres. Il n’y a pas de règle générale, d’où la nécessité de sans cesse mesurer et évaluer.
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de ce débat particulièrement riche.
Table ronde contradictoire sur le thème
« OGM / Média et information du public »
(extrait du procès-verbal de la séance du 17 février 2005)
• M. Pierre-Benoît JOLY, directeur de laboratoire de recherche sur les transformations sociales et politiques liées au vivant à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
• M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, président du Muséum d’histoire naturelle
• UFC (Union fédérale des consommateurs) - Que Choisir : Mme Sylvie PRADELLE, vice-présidente nationale
• 60 millions de consommateurs : Mme Marie-Jeanne HUSSET, directrice de la rédaction
• Inf’OGM : M. Frédéric PRAT
• Nestlé France : M. Vincent PÉTIARD, directeur du Centre de recherche Nestlé Tours (Plant Sciences), membre de l’Académie d’agriculture de France
• Mme Sophie LEPAULT, journaliste, réalisatrice audiovisuelle, auteur du livre « Il faut désobéir à Bové » (Editions La Martinière, 2005)
• M. Jean-Marc BIAIS, rédacteur en chef chargé de la rubrique « science / médecine » du journal L’Express
• M. Marc MENNESSIER, journaliste scientifique au Figaro
• Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS, journaliste, fondatrice de la revue « Vivant » et membre du bureau de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information (AJSPI)
• Ministère de l’agriculture : M. Eric GIRY, chef du bureau de la réglementation alimentaire et des biotechnologies à la Direction générale de l’alimentation (DGAL)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président,
puis de M. Christian MÉNARD, Rapporteur
M. le Président : Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence à cette dernière table ronde organisée dans le cadre de notre mission d’information.
Depuis six ans, le débat sur les OGM s’est plutôt enlisé. Même si les questions posées ne sont plus les mêmes qu’en 1998, on a l’impression que les positions des uns et des autres sont plus tranchées qu’elles ne l’étaient à cette époque. Dans cette table ronde, nous allons aborder trois thèmes. Le premier est celui de la contribution des médias à une information complète et raisonnée de la population. Traiter d’un sujet complexe dans un article de journal ou dans une brève séquence télévisée n’est pas chose facile. Le deuxième thème concerne le seuil de 0,9 %. Est-il pertinent pour signaler aux consommateurs la présence d’OGM dans un aliment ? Le troisième thème est celui de la communication institutionnelle et de la transparence.
Je vais tout d’abord demander aux différents participants de présenter brièvement leur point de vue sur le problème de la communication.
M. Pierre-Benoît JOLY : Je voudrais pour ma part mettre l’accent sur la question de l’information dont disposent les médias et sur la manière dont ils construisent l’information scientifique, technique et économique sur les OGM. Cela renvoie aux conditions de l’expertise. Il fut un temps où les experts étaient formels et s’appuyaient sur des certitudes. Aujourd’hui, ils prennent part à des controverses dans un contexte d’incertitude. L’information est donc beaucoup plus complexe. Nous devons mettre en place des dispositifs de communication institutionnelle et travailler sur une vieille idée qui ne se concrétise pas suffisamment, celle du deuxième cercle de l’expertise, qui pourrait prendre la forme d’une commission interministérielle, citoyenne ou socio-économique permettant d’instituer un lieu de débat permanent et transversal.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Je voudrais que soit évoquée dans ce débat la manière dont les opérateurs publics, les organismes de recherche et les ministères, ont abordé la question de la communication. Il me semble qu’ils ont répondu à des questions qui ne se posaient pas et n’ont pas répondu aux questions qui se posaient.
Mme Sylvie PRADELLE : L’UFC-Que Choisir, association indépendante de tout pouvoir politique, syndical ou économique, est également éditeur de presse. La revue Que Choisir suit la question des OGM depuis maintenant dix ans. Nous ne sommes pas opposés aux biotechnologies à condition que les droits fondamentaux des consommateurs soient respectés, qu’il s’agisse du droit à l’information, du droit à la sécurité ou du droit à réparation.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Le magazine 60 millions de consommateurs est le journal édité par l’Institut national de la consommation, organisme public au service de tous les consommateurs et de leurs associations. C’est donc un journal de service public, qui a très tôt informé les consommateurs sur les OGM. Dès 1998, nous avons analysé un certain nombre de produits en démontrant que nous mangions déjà des OGM sans le savoir. Notre ligne est celle de l’information des consommateurs.
M. Frédéric PRAT : Inf’OGM a été créée en 1999, devant le constat d’une déficience de l’information du public. Notre mission principale est celle de l’information, dont nous voulons qu’elle soit équilibrée. Nous tentons également d’inciter les pouvoirs publics à mettre en place une réelle transparence de l’information. L’expression de « communication institutionnelle » ne nous satisfait pas : nous souhaitons aller beaucoup plus loin, vers la participation et la consultation du public. Un débat doit précéder les décisions. Et une large discussion sur les modalités de ce débat doit précéder sa tenue car l’expérience de nombreuses années montre que les débats n’aboutissent pas quand les règles du jeu n’ont pas été définies en commun.
M. Vincent PÉTIARD : Je ne participe pas à cette table ronde en tant que représentant de l’industrie. Vous m’avez invité, M. le Président, parce que j’ai participé au développement des biotechnologies, et pas seulement des OGM, depuis leur origine. J’ai pris part aux premières commissions qui se sont réunies aux Etats-Unis pour discuter du bien-fondé des méthodes de recombinaison génétique. J’ai également participé à l’élaboration du rapport « Sciences de la vie et santé » qui avait été remis au Président Giscard d’Estaing.
Je ne suis pas un spécialiste de la communication. Je peux simplement dire que nous ouvrons très régulièrement les portes de nos laboratoires à des élèves, à des étudiants, à des groupes d’agriculteurs, et que leurs réactions sont toujours pour moi une source d’enrichissements.
Mme Sophie LEPAULT : Je suis journaliste et réalisatrice de documentaires, essentiellement pour Arte. Cette chaîne avait consacré une soirée Thema à la question « Faut-il avoir peur de la science ? », qui comprenait un documentaire sur le clonage et un autre sur les OGM, que j’avais réalisé. La diffusion de cette émission a suscité des polémiques, ainsi que des réactions très violentes, très agressives, parfois même très grossières. Cela m’a donné l’envie de prolonger cette enquête, et m’a conduit à écrire un livre, « Il faut désobéir à Bové ». Contrairement à ce que pourrait suggérer son titre, ce livre n’est nullement militant. J’ai rencontré des personnes qui travaillent sur la transgénèse et j’ai tenté de faire le point des questions qu’elles soulèvent.
M. Jean-Marc BIAIS : Je suis chargé des questions scientifiques à L’Express. C’est en 1998 que j’ai commencé à m’intéresser aux OGM, auxquels j’ai consacré vingt-trois articles à ce jour. Ce sujet fait l’objet d’une approche très unilatérale. Au sein des rédactions, il est d’ailleurs souvent traité par le journaliste spécialisé dans les questions d’environnement, et rarement par le journaliste scientifique. J’ai constaté que le traitement de cette question a évolué, notamment dans la presse écrite. Cela tient au fait que les promoteurs des OGM, qui avaient d’abord adopté une politique de relations publiques agressive – ce qui a contribué à donner au débat une tournure manichéenne –, ont pris conscience de leurs erreurs. Aujourd’hui, le traitement d’ensemble de ce sujet est beaucoup plus équilibré. Il faut également souligner que la presse française s’intéresse de plus en plus au développement des cultures OGM en Europe et dans le monde.
M. Marc MENNESSIER : Je suis le dossier des OGM depuis mon arrivée au service Sciences et Médecine du Figaro en avril 2000. Je me sens surtout concerné par le premier thème que vous avez choisi, celui de la contribution des médias à une information complète et raisonnée de la population. L’information délivrée par les médias depuis une dizaine d’années me semble globalement incomplète et fort peu raisonnée. Elle est même parfois partisane.
Un journaliste qui veut faire son travail correctement doit trier en permanence des informations contradictoires en provenance de deux lobbies que je mets sur le même plan : celui des industriels qui vendent des OGM, et celui des organisations anti-OGM qui vendent des slogans. Des informations sont lancées, qui s’avèrent incomplètes, voire tout simplement erronées, mais seulement un ou deux ans plus tard. Pendant ce temps, l’idée a fait son chemin dans l’opinion.
Trier ces informations demande du temps – qui est la denrée la plus précieuse dans le milieu de la presse, où l’on n’en a jamais beaucoup. Cela demande aussi de l’énergie, s’agissant d’un sujet très complexe. Cela demande, enfin, de la patience : nous assistons à un dialogue de sourds qui, personnellement, m’ennuie de plus en plus.
Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS : Je travaille sur le sujet depuis 1984. A l’époque, l’approche de ces questions était d’ordre technique. Il s’agissait d’expliquer aux lecteurs ce qu’était un gène. La médiatisation du problème a conduit à une interrogation sur les projets, les objectifs, les cadres dans lesquels s’inscrit la culture d’OGM, ainsi que sur les problèmes socio-économiques, qui dépassent largement la compétence des journalistes scientifiques. Beaucoup plus récemment, le débat s’est déplacé dans le champ politique, vers des questions relatives aux valeurs et aux conflits d’intérêts. Le journaliste n’est pas forcément très à l’aise quand il s’agit de s’interroger sur le progrès, l’équilibre entre les bénéfices et les risques, la signification de la notion de maîtrise dans le domaine scientifique. Ces questions ne sont pas simples, et nous obligent à interroger les philosophes, les sociologues, les économistes. J’ai tenté d’y répondre dans un livre, « Des inconnus… dans nos assiettes », publié en 1998, puis dans une série d’articles du Figaro, où j’ai abordé la question de la brevetabilité du vivant, qui me paraît majeure. Le thème de la propriété intellectuelle était au cœur de la lettre que la Confédération paysanne a adressée à Lionel Jospin en juin 2001. Il a été repris dans le discours prononcé par le Président de la République à l’UNESCO68 le 24 janvier dernier, lorsqu’il a souligné que nous ne disposions pas de règles internationales satisfaisantes.
Le débat déborde donc largement la question des OGM. Ceux-ci ne sont qu’un révélateur des problèmes démocratiques auxquels nous sommes confrontés. Ils secouent la démocratie, comme Jean-Jacques Perrier et moi-même l’écrivions en janvier 2002 dans un éditorial de la revue Biofutur. C’est ce qui nous a amenés à créer la revue électronique Vivant, ainsi qu’une structure associative, VivAgora. Après le débat de 1998, la question se pose de savoir si le débat public est en mesure d’aborder les problèmes que soulèvent les nanotechnologies, les neurosciences et les biotechniques.
M. Éric GIRY : La Direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère de l’agriculture est chargée d’instruire les demandes d’autorisation des essais OGM, ainsi que les dossiers d’autorisation de mise sur le marché lorsqu’ils sont déposés en France, ou dans le cadre de la procédure d’objection prévue par la directive 2001/18/CE. Elle est également chargée de contrôler les essais sur le terrain et les importations de semences. Le ministère de l’agriculture assure d’autre part, conjointement avec le ministère de l’environnement, le secrétariat de la Commission du génie biomoléculaire (CGB).
La communication institutionnelle s’inscrit dans un cadre réglementaire strict. Les marges de manœuvre sont assez limitées, notamment en ce qui concerne les conditions d’autorisation. A partir du moment où un OGM a fait l’objet d’une évaluation scientifique positive, il est difficile à un Etat membre de l’Union européenne de refuser la mise sur le marché, puisqu’un refus doit être motivé sur une base scientifique. En ce qui concerne l’information et la consultation du public, la marge de manœuvre est plus grande. Elle devra être utilisée dans le cadre de la transposition de la directive.
Il me semble important de dissocier la notion de transparence de celle de consultation du public. Elles renvoient à des dispositions et à des exigences différentes.
M. le Président : Mesdames, messieurs, je vous remercie de votre brièveté. S’agissant de la contribution des médias à une information complète et raisonnée de la population, je voudrais poser une première question à M. Chevassus-au-Louis : en regroupant sous un seul et même terme, « les OGM », des réalités très différentes, ne commet-on pas déjà une première faute de communication ?
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : C’est en effet une dimension du problème. Le biologiste insistera sur la diversité des méthodes d’obtention et des objectifs : il refusera de placer dans la même catégorie la culture d’une bactérie ou d’un virus visant à éradiquer la rage et celle d’une plante de grande culture. Ceux qui sont opposés ou, au contraire, favorables aux OGM insisteront sur les caractéristiques communes de ces différents organismes, par exemple du point de vue du régime de la propriété intellectuelle. Par conséquent, le choix de regrouper ou non l’ensemble des cultures sous un seul et même terme est déjà un élément de débat.
Et cela est d’autant plus vrai que les OGM sont difficilement appropriables. Tout le monde peut se faire une opinion sur la bicyclette, aussi bien sur sa définition que sur ses usages et son intérêt. Les OGM, eux, sont difficiles à comprendre et leurs usages se déploient dans un monde où tout un chacun n’a pas forcément accès. De sorte que la seule manière de se faire une opinion sur les OGM est d’en débattre.
M. Marc MENNESSIER : L’article qui a véritablement lancé le débat sur les OGM date de 1’automne 1996, au moment des premières importations de soja transgénique en France. Le quotidien Libération a titré : « Alerte au soja fou ». Les articles publiés en pages intérieures étaient équilibrés. Les collègues qui les avaient rédigés étaient atterrés par ce titre qu’ils n’avaient pas choisi, et qui faisait référence à la vache folle, sujet qui venait de plonger l’opinion dans un état de choc. Devant un tel amalgame, comment des lecteurs qui ignorent souvent ce qu’est un gène peuvent-ils aborder sereinement le dossier des OGM ?
Le Figaro a lui aussi commis des bévues. En août 1998, il titrait : « Des patates transgéniques à faire peur ». Là aussi, le contenu de l’article lui-même était équilibré. Mais un titre doit toujours accrocher le lecteur.
Autre exemple : le papillon monarque. Des chenilles de ce papillon avaient été nourries avec des feuilles artificiellement recouvertes de pollen d'une variété de maïs rendu résistant à la pyrale par l'introduction dans son génome d'un gène commandant la production d'un insecticide. Ces fortes doses de pollen sécrétant de l’insecticide Bt avaient entraîné leur mort. Après l’article que la revue Nature a consacré à ce sujet en mai 1999, l’idée que « les OGM menacent d’extinction le papillon monarque » a fait le tour du monde. Le Figaro avait titré : « Les OGM tuent les papillons ». Deux ans après, d’autres études, qui ont, bien sûr, reçu beaucoup moins d’écho, ont montré que dans la nature, les chenilles étaient exposées à des doses mille fois inférieures à celles qui avaient été appliquées en laboratoire. Si le papillon monarque est en voie de disparition, c’est peut-être pour d’autres raisons. On peut d’ailleurs déplorer, soit dit en passant, que la focalisation sur les OGM conduise à méconnaître des facteurs de risques très importants pour cette espèce.
Une autre dérive réside dans l’usage du mot « contamination », qui est très connoté. Mais ce terme étant entré dans les esprits, on continue de l’utiliser, tout en sachant qu’il est impropre. Pensons aussi au terme de « Terminator », ou à celui de « Frankenfood ». Quoi d’étonnant, dans ces conditions, à ce que 70 à 80 % des Français aient peur des OGM ? Au total, je ne pense pas que la presse ait fait son travail de manière raisonnée.
M. Philippe MARTIN : Les OGM ne sont pas le seul sujet sur lequel les grands titres révèlent des informations erronées avant que celles-ci soient démenties dans des articles de quelques lignes. Je me souviens d’un titre, dans un grand quotidien du soir, qui nous « informait » que le parti socialiste était financé par l’argent de la drogue, ce qui fut démenti par la suite.
M. Mennessier nous dit que les industriels vendent des OGM, alors que les associations vendent des slogans. Ce n’est pas tout à fait faux. Dans le département du Gers, où l’on milite en faveur du maintien des salles de cinéma indépendantes pour lutter contre les multiplex, on dit : « Ni MGM69 ni OGM ! ».
Mais n’a-t-il pas fallu, précisément, que les associations vendent des slogans pour que l’on commence à s’intéresser à ceux qui vendent des OGM ? Je suis frappé par la politique du fait accompli à laquelle nous assistons. Malgré les titres qui font peur, le rouleau compresseur des OGM continue d’avancer. Le problème est que nous sommes obligés de conduire a posteriori un débat qui n’a pas eu lieu a priori, sur un sujet qui intéresse énormément les citoyens. Si l’on pense que le sujet est trop compliqué pour que l’on puisse se permettre de donner la parole au citoyen, si l’on pense que le débat doit être réservé aux experts, je préférerais qu’on nous le dise clairement. Je pense pour ma part que si l’on veut éviter que la démocratie participative ou le principe de précaution ne soient que des paroles en l’air, il nous faut effectuer un travail important. La bataille que mènent les opposants aux OGM est globalement inopérante face aux entreprises qui veulent vendre des OGM. Dans mon département du Gers, celles-ci font pression sur les agriculteurs en leur disant qu’elles continueront à leur vendre des semences de maïs classiques à condition qu’ils acceptent de consacrer des parcelles à la culture de maïs transgénique. C’est ce qui me paraît le plus choquant. Le président de notre mission d’information est libre d’exposer sa position dans certaines publications, mais le débat a pris un retard considérable. Je souhaiterais que les participants à cette table ronde nous éclairent sur les moyens de faire en sorte que les citoyens, et notamment les plus jeunes d’entre eux, soient informés et puissent se faire une opinion.
M. Marc MENNESSIER : Dans mon esprit, le métier de journaliste ne consiste pas à relayer des slogans. Si l’opinion doit être alertée, elle doit l’être à partir d’informations validées.
M. le Président : En ce qui concerne la publication à laquelle M. Philippe Martin a fait allusion, je précise que j’ai écrit cet article avant d’être président de notre mission d’information et après une campagne de destruction d’essais qui faisait suite à un tract selon lequel la consommation d’OGM avait pour effet un rétrécissement des testicules ! En tant que scientifique, je ne pouvais pas ne pas réagir. J’ai titré mon article : « OGM : victimes expiatoires ». J’assume ce titre, parce que je pense qu’une technique générale n’a pas à subir les attaques dont elle est victime. Je suis d’autant plus à l’aise pour le dire que celui qui a proposé au ministre le moratoire sur le colza en 1998, c’était moi-même. Cela dit, je reconnais que la publication de cet article, une fois la mission d’information constituée, était maladroite. Néanmoins, nous avons tous une position sur les OGM et nous n’avons pas à la cacher. Si un responsable politique ne veut pas prendre position sur des questions importantes, mieux vaut qu’il ne se présente pas au suffrage de ses concitoyens. L’essentiel est que le débat ait lieu, qu’il soit mené de la manière la plus honnête possible, et que nous nous écoutions les uns les autres. Quand le débat entre le citoyen, l’expert et le politique aura progressé, nous aurons sans doute remporté une victoire collective.
Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS : Je voudrais revenir un instant à la première question posée par M. le Président. Si un OGM est un objet fabriqué par les biotechnologies, il est également une fabrication sociale. Le journaliste se doit de décrire à la fois une production technique par la communauté scientifique et l’élaboration d’une production sociale par l’ensemble de la société, production sociale qu’il nous faut respecter. L’objet social est porteur de diverses inquiétudes : celle qui a trait à la question de la propriété intellectuelle, celle qui a trait à la coexistence des OGM et de l’agriculture biologique. Les slogans traduisent ces inquiétudes. L’appellation « Terminator », inventée par l’ONG ETC Group, a cristallisé une inquiétude réelle, portant sur le problème d’accès aux semences auquel est confronté l’agriculteur dans sa pratique.
Je me demande si c’est un bon angle d’attaque que de poser la question du caractère « raisonné » de l’information. Il convient plutôt de poser la question de la pertinence de l’information, de la hiérarchie des données, qu’elles soient techniques, économiques ou politiques. A cet égard, il n’est pas aisé de définir une hiérarchie au sein de données aussi diverses. Il est important de clarifier les rôles et, par exemple, je ne suis pas sûre que le journaliste puisse avoir un avis autorisé sur une question technique comme celle du seuil. En revanche, il lui appartient de décrypter les conflits d’intérêts. Quant au débat politique, c’est davantage le rôle des politiques de le conduire. Ce n’est pas aux journalistes qu’il appartenait de poser les questions qui ont fait l’objet du débat au Conseil économique et social de février 2002.
M. le Président : Je rappelle que si les « 4 Sages » qui ont conduit ce débat n’ont pas traité des aspects socio-économiques, c’est parce que le Gouvernement leur avait demandé de lui remettre un avis sur le devenir des essais d'OGM en plein champ. Nous avons répondu qu’ils devaient obéir aux trois principes de précaution, de parcimonie et de transparence. Cet avis de synthèse n’a servi à rien.
Lorsque le Président de l’Assemblée nationale a suggéré la constitution de notre mission d’information, elle devait avoir le même objet, dans le cadre de la transposition de la directive. Nous avons tous souhaité élargir le sujet.
M. le Rapporteur : Entre 90 et 95 % des chercheurs français sont favorables aux expérimentations en plein champ, comme nous l’avons constaté lors de nos auditions. Ces chiffres ne sont jamais cités par la presse. Pourquoi ? Est-ce un déficit d’information, ou est-ce que nos chercheurs sont de mauvais communicateurs ?
Mme Sylvie PRADELLE : Les chercheurs sont de meilleurs communicateurs qu’ils ne l’ont été par le passé. Aucune communication n’a précédé le moment où les consommateurs se sont rendu compte que les OGM arrivaient dans leurs assiettes. Ils ont été mis devant le fait accompli. C’est pourquoi les choses se sont très mal engagées. On a constaté un certain manque de transparence, ce qui explique aussi en partie les titres excessifs que l’on a évoqués.
Mme Sophie LEPAULT : J’ai rencontré beaucoup de spécialistes de la transgénèse. Très peu étaient rôdés aux techniques de la communication. Leur tâche n’est pas simple. Expliquer clairement ce que sont les OGM est un véritable exercice de style. Et pourtant, c’est essentiel pour comprendre les enjeux qui y sont associés. Quant au journaliste de la presse quotidienne, il est dans une situation très difficile : il lui faut passer énormément de temps avec eux pour comprendre leurs recherches et les vulgariser. A ce jour, je pense que les trois quarts de la population ne savent toujours pas ce qu’est un OGM. Très peu font la différence entre l’OGM alimentaire et l’OGM thérapeutique. Beaucoup reste à faire dans un domaine où les scientifiques ne peuvent pas faire passer leur message à coups de formules choc comme le font les militants anti-OGM. Il est plus facile pour la presse de reprendre des slogans que de vulgariser un discours scientifique.
M. Vincent PÉTIARD : Il n’y a pas eu de fait accompli de la part des scientifiques ou des semenciers. Considérant que les OGM n’étaient qu’une technique parmi d’autres, ils ont cru naïvement qu’ils pouvaient continuer à suivre leur habitude de communiquer essentiellement en direction des agriculteurs. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’ils se sont aperçus que, contrairement à ce qui se faisait par le passé dans le domaine des semences, cette innovation technologique faisait naître un débat public. C’est là qu’ils ont très mal communiqué.
Par ailleurs, le problème de communication est aggravé par le fait que les scientifiques, quand ils sont honnêtes, ne formulent pas de jugements absolus. Ils n’affirment l’existence ou l’absence de risques que de manière relative, sur la base des expériences qu’ils ont conduites, et disent ce dont ils ne sont pas certains. A partir du moment où la presse exploite les doutes des scientifiques, le débat est biaisé.
S’agissant de la chronologie des événements, il faut rappeler que du concentré de tomate contenant des OGM a été vendu en grande surface au Royaume-Uni dans les années 90 et que le public a réagi très sereinement. C’est seulement par la suite que le débat s’est déplacé du milieu des agriculteurs et des semenciers à celui du grand public. L’acceptation des OGM par les consommateurs a, alors, reculé.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Il faut préciser, pour que l’information soit complète, que ces concentrés de tomate étaient moins chers que les autres.
M. Vincent PÉTIARD : Vous avez raison. Ils étaient 20 % moins chers parce que fabriqués aux Etats-Unis, où le volume d’emballage standard de l’usine qui les fabriquait était plus important qu’en Europe. C’est d’ailleurs probablement leur moindre coût qui a attiré le consommateur.
M. Marc MENNESSIER : Je voudrais répondre à la question posée par M. le Rapporteur. Personnellement, si je n’ai pas informé les lecteurs du Figaro que 90 ou 95 % des chercheurs sont favorables aux expérimentations en plein champ, c’est parce que vous me l’apprenez aujourd’hui. J’aimerais connaître vos sources.
M. le Rapporteur : Ce chiffre de 90 ou 95 % ressort de l’ensemble des auditions auxquelles nous avons procédé. Mais il faut dire que les chercheurs anti-OGM sont d’excellents communicateurs.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Je ne peux pas confirmer ce chiffre, mais je pense qu’il faut distinguer deux choses.
Ce serait tromper le public que de lui laisser croire que les expériences en milieu confiné suffiraient pour évaluer tous les risques. Ce qui est donc certain, c’est que le niveau de sécurité que l’on obtiendrait en ne travaillant qu’en milieu confiné apparaît sans doute totalement insuffisant aux yeux de 100 % des chercheurs.
Autre chose est de savoir combien de chercheurs sont favorables aux expérimentations en plein champ parce qu’ils sont favorables au développement des OGM. Je ne sais pas s’ils représentent 90 ou 50 % des chercheurs.
M. le Président : Il faut en effet distinguer entre les expérimentations de recherche et les expérimentations de développement. Nous avons rencontré les chercheurs dans leurs laboratoires. On ne peut pas contester que les expérimentations de recherche en plein champ soient nécessaires, dans le respect des principes de précaution, de parcimonie et de transparence. Cette idée s’impose, bien qu’elle ne s’impose pas dans le public, faute d’un débat suffisant.
Par exemple, pour répondre à la question de savoir quelle quantité d’eau il faut donner à un maïs ou à une autre plante, il faut passer par l’expérimentation en plein champ pour vérifier si les conditions agronomiques sont satisfaisantes. Une fois qu’on a vérifié que le gène introduit a un intérêt du point de vue du stress hydrique, il faut entre six et huit ans avant d’en arriver au développement. D’ici là, on a toutes les chances de retrouver ce gène dans la grande variété des gènes du maïs. Autrement dit, il sera, un jour, possible d’obtenir la variété recherchée par des méthodes de sélection classique. La transgénèse n’aura été qu’un outil. Il est clair qu’il est difficile de faire comprendre cela au grand public.
M. Jean-Marc BIAIS : Je pense qu’il faut distinguer entre la presse écrite et la presse télévisée. La presse écrite a consacré un grand nombre d’articles aux essais en plein champ et à la nécessité de les mener. Le problème est qu’elle n’a qu’un impact très faible par rapport à la télévision.
M. le Président : Vous avez raison d’insister sur ce point. Mais nous n’avons pas le pouvoir d’imposer à une grande chaîne, qu’elle soit publique ou privée, de diffuser un débat sur un sujet complexe à une heure de grande écoute.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : L’intervention de M. Mennessier appelle quelques remarques. On nous demande souvent comment les médias peuvent contribuer à « une information complète et raisonnée ». J’ai envie de retourner la question. Qu’est-ce qu’une information complète ? Qu’est-ce qu’une information raisonnée ? Quel est le but à atteindre ?
Je voudrais bien savoir sur quoi M. Mennessier se fonde pour dire que la presse n’a pas fait son travail. Il se trouve que je suis journaliste scientifique depuis plus de trente ans. C’est ainsi que j’ai assisté au développement de ce que l’on appelait à l’époque les « aliments transgéniques ». J’ai écrit dans les années 70 un article sur la fixation biologique de l’azote. J’étais moi-même béate d’admiration devant les promesses de la science, et les chercheurs de l’INRA étaient enthousiastes à l’idée de fabriquer, un jour, des céréales qui fixeraient l’azote, car il serait ainsi possible de cultiver des céréales sans engrais, partout dans le monde. A cette époque, nous venions d’assister au développement du nucléaire sans qu’un débat citoyen ait eu lieu sur ce sujet. Il aurait fallu s’assurer que le débat public et citoyen ait lieu sur la révolution des biotechnologies et ses promesses. L’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information n’a pas organisé de débat, au temps où j’en étais la présidente, sur les biotechnologies et les OGM. Ce fut une erreur.
La presse fait bien son travail quand elle contribue au débat public, et c’est ce qu’elle a fait. « Alerte au soja fou » est un excellent titre. Ne faisons pas semblant de découvrir que la presse est aussi une industrie et que les journaux sont faits pour être vendus. Ce titre a marqué un tournant. C’est à ce moment que la presse grand public s’est emparée du sujet.
Il n’y a pas d’un côté les bons journalistes, les journalistes scientifiques, et de l’autre ceux qui ne comprennent rien à rien. Il n’y a pas d’un côté la presse écrite qui informe bien et de l’autre la télévision qui assène des jugements hâtifs. Les choses sont plus compliquées que cela. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas parce que les consommateurs se rebiffent que la presse n’a pas fait son travail.
M. Marc MENNESSIER : « Alerte au soja fou », c’est un bon titre sur la forme. Mais, sur le fond, je sais, par expérience, qu’un journaliste de presse quotidienne a tout intérêt à être présent au moment où, peu avant vingt heures, on donne un titre à son article, s’il veut éviter que son contenu soit dénaturé. Il est bon de susciter le débat, mais je ne pense pas qu’il faille le faire en pratiquant l’amalgame. On ne peut pas impunément associer les OGM à la vache folle.
C’est d’autant plus important que l’investigation n’est pas le fort de la presse française. L’affaire du sang contaminé, par exemple, a été découverte par une journaliste isolée. Et l’on n’a commencé à en parler, en France, qu’à partir du moment où la presse étrangère a repris l’information. Le lendemain de la publication de l’enquête dans L’Evénement du Jeudi, elle n’a fait l’objet que de quelques brèves dans les quotidiens, et la télévision n’en parlait même pas. S’agissant de la vache folle, il a fallu qu’un ministre britannique s’exprime au Parlement pour que la presse française s’y intéresse. Elle s’est rattrapée à l’occasion des OGM, en surfant sur la vague de l’opinion, à un moment où celle-ci était en état de choc après la crise de la vache folle. C’est à ce moment que beaucoup de Français ont découvert que l’agriculture n’était pas l’activité bucolique qu’ils croyaient. C’est dans ce contexte que la presse s’est emparée de la question des OGM en la dramatisant. Cela explique, d’ailleurs, la différence d’approche entre la France et les Etats-Unis, où il n’y a eu ni scandale du sang contaminé ni affaire de la vache folle.
Les OGM, comme toute technique, ont des avantages et des inconvénients. Il convient, me semble-t-il, de les aborder de manière rationnelle.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Après des heures d’audition, la question des OGM m’apparaît de plus en plus complexe. Mais comme tous mes collègues parlementaires, je suis souvent interrogée, lors de réunions publiques, par des personnes qui sont assez sommairement informées. Dans ma circonscription, un site Internet affirme que l’on a injecté des pesticides dans du maïs. Si l’audition d’une centaine de personnes nous suffit à peine pour maîtriser le sujet, vous imaginez que quelques réunions publiques ne risquent guère d’être suffisantes.
M. Mennessier a eu raison d’insister sur l’importance des mots. Le mot « contamination », par exemple, évoque une pathologie. Quand on parle d’« essais », que veut-on dire par là ? S’agit-il d’essais de culture ou s’agit-il d’expérimentations ? Tout le monde, en principe, est favorable aux expérimentations, mais, sur le terrain, elles sont détruites comme si elles constituaient une culture.
Nous avons un grand travail d’information à accomplir, à un moment où la recherche semble stérilisée. Cela pose problème, car un pays qui n’a plus de recherche n’a plus de compétence, donc plus d’expertise, plus de transparence. Comment rétablir notre capacité d’expertise ? Voilà la question. La presse est-elle capable d’aider les citoyens à comprendre, ou pensez-vous que la situation est sans issue ?
M. le Président : Le problème que soulève Mme Perrin-Gaillard est majeur. Il faut être clair sur le but des expérimentations, parce que certains ont procédé à des amalgames dans le cadre d’une véritable bataille rangée entre deux lobbies. Notre rôle est de débloquer la situation.
A la suite de notre voyage à Toulouse, deux jeunes chercheurs viennent de nous écrire deux pages poignantes. Ils avaient publié deux articles dans Science sur le gène de la fixation de l’azote. Ils avaient dû aller aux Pays-Bas pour faire financer la fin de leur recherche. L’un est parti aux Etats-Unis, l’autre est resté en France. Celui-ci sera au chômage le 16 mai prochain, après avoir soutenu sa thèse et accompli des contrats à durée déterminée. Celui-là est aujourd’hui à Madison, à l’université du Wisconsin. Son salaire brut est de 6 000 dollars. Il a reçu 500 000 dollars pour créer son équipe de recherche. Celui qui est resté en France veut bien déposer un brevet, mais ni Biogemma ni l’INRA ne veulent s’engager dans la filière de la biologie végétale, qui est trop risquée en France.
M. Philippe MARTIN : Autorisons tout et arrêtons la mission d’information ! Qu’est-ce que c’est que ce chantage ? Il y a d’un côté les esprits rationnels, favorables à la recherche, et de l’autre les obscurantistes, c’est cela ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : M. le Président, vous venez de procéder à un amalgame. Il me semble qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels les chercheurs sont confrontés à des problèmes, voire à la menace du chômage. C’est toute la recherche française qui est dans cette situation.
M. le Président : Je n’ai fait que redire ce que Mme Perrin-Gaillard a dit, car elle a posé la bonne question. D’autre part, nous avons rencontré ces jeunes chercheurs : il est normal que nous soyons attentifs à ce qu’ils nous disent.
M. Philippe MARTIN : Beaucoup d’autres chercheurs ont les mêmes problèmes.
M. le Président : Toutes les personnes que nous avons auditionnées nous ont dit que la filière biologie végétale est sinistrée. Si vous pensez que ce n’est pas vrai, il faut le dire.
M. Gabriel BIANCHERI : Notre mission d’information a, certes, un but précis, qui n’est pas de traiter du problème de la recherche dans son ensemble. Mais nous nous penchons sur les OGM et nous constatons que la recherche végétale française est sinistrée. Pourquoi ? Tous ceux que nous avons interrogés sur les raisons de cette situation nous disent qu’un véritable terrorisme règne dans notre pays. C’est pour cela qu’il n’y a plus de chercheurs dans ce domaine. On ne peut pas être chercheur quand on voit ses essais détruits et qu’on ne sait pas si l’on pourra aller au bout de ses recherches.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Je confirme qu’il y a un malaise chez les jeunes chercheurs. Mais il nous faut être conscients que deux options très différentes s’offrent à nous.
On peut choisir de poser en principe que toute innovation doit faire l’objet d’un débat tout en revendiquant pour la science un espace d’autonomie restreint. On peut choisir également de décider que l’ensemble du processus de recherche doit être socialisé. Dans ce cas, il faut tout faire pour que les citoyens qui le souhaitent puissent participer à la discussion des décisions qui gouvernent les orientations de recherche.
Ce débat est important, et il divise la communauté scientifique. Certains se placent dans une logique de forteresse assiégée en rêvant de retrouver l’âge d’or où la recherche n’était contestée par personne. D’autres pensent que la recherche est un processus social et y voient une chance pour elle.
M. Frédéric PRAT : Vous avez, M. le Président, posé la question de savoir si le fait même d’employer le terme général d’OGM n’était pas une erreur. Je pense pour ma part qu’il est important de parler des PGM, les plantes génétiquement modifiées. Ce sont les PGM qui intéressent les consommateurs, car ce sont elles qu’ils retrouvent dans leurs assiettes. Ce sont aussi les PGM que l’on retrouve en plein champ. Les OGM thérapeutiques ont une utilité évidente mais ils sont produits en biofermenteurs en milieu confiné. Les PGM, pour l’instant, n’apportent rien au consommateur. Les semenciers promettent de résoudre le problème de la faim dans le monde, mais ce ne sont que des promesses.
Plusieurs intervenants ont souligné l’importance des mots. En effet, ils sont importants. Le mot « terrorisme », par exemple, est un mot fort. Il est scandaleux de l’employer de façon aussi légère en parlant de terrorisme contre la recherche.
Certains ont évoqué l’existence de deux lobbies, en les mettant sur le même plan. Il est vrai qu’il existe un lobby agro-semencier très puissant. Sa puissance n’a rien à voir avec celle du « lobby » environnementaliste. De quels moyens disposons-nous pour diffuser une information indépendante ?
Le rapporteur nous dit que 90 à 95 % des chercheurs sont favorables à l’expérimentation en plein champ. Si l’on demandait aux chercheurs qui travaillent dans l’industrie nucléaire s’ils sont favorables à l’énergie nucléaire, ils répondraient sans doute par l’affirmative. Peut-être que les biologistes de population seraient-ils un peu plus critiques que les biologistes moléculaires.
M. le Rapporteur : Vous ne pouvez pas nier que 90 à 95 % des chercheurs sont favorables à l’expérimentation – je dis bien : l’expérimentation – en plein champ.
M. Frédéric PRAT : Je pose la même question que M. Mennessier : quelles sont vos sources ?
M. le Rapporteur : Mes collègues ont entendu les mêmes avis que moi lors des auditions.
M. le Président : Mme Perrin-Gaillard a bien souligné qu’il fallait distinguer entre les essais visant au développement des cultures et ceux qui ont pour objet la recherche.
M. Frédéric PRAT : Comme vous le voyez, les mots sont effectivement importants. Si des militants anti-OGM disent que l’on « injecte » un pesticide, c’est choquant. Quand des agro-semenciers affirment qu’ils ont mis au point des plantes « résistantes aux insectes », c’est également incorrect. Les plantes en question produisent un pesticide, et ce tout au long de leur cycle. Il s’agit de plantes pesticides, il faut le dire.
On parle de « biotechnologies », les technologies de la vie. Mais on pourrait tout aussi bien, s’agissant de semences stériles, parler de « nécrotechnologies ».
Le mot « retard » est également choquant. Sur qui l’Europe est-elle en train de « prendre du retard » ? Sur les Etats-Unis, qui ne sont pas forcément dans la bonne voie. Prendre du « retard » sur quelqu’un qui n’est pas parti dans la bonne direction n’est pas une mauvaise chose.
On critique l’utilisation du terme « contaminé. Mais, être « contaminé », c’est avoir quelque chose qu’on n’a pas désiré or, des gènes que l’on n’a pas désirés et qui se retrouvent dans nos champs constituent bien une contamination.
Pour répondre à la question de Mme Perrin-Gaillard relative à la recherche, j’insiste sur le fait que nous disposons de budgets limités. Si l’on finance 90 % du travail de recherche en biologie moléculaire, c’est autant d’argent que l’on ne consacrera pas à la recherche en agriculture durable ou en agriculture biologique. Il nous faut donc débattre bien en amont, sur le type de recherche que nous souhaitons. Ce n’est pas le sujet d’aujourd’hui, mais c’est un débat que nous devons avoir. Nous ne sommes pas obligés de foncer dans la mauvaise direction.
M. Gabriel BIANCHERI : Comment peut-on dire que nous fonçons dans une mauvaise direction sans avoir les moyens de juger si le développement des OGM est une bonne ou une mauvaise direction ? Les essais qui nous permettraient d’en juger ne peuvent même pas être menés jusqu’à leur terme !
M. le Président : C’est une vraie question. Si nous allons dans une mauvaise direction, il faut laisser à la recherche les moyens de le prouver. On ne peut pas dire qu’on est contre les OGM et poser des questions à la société tout en interdisant que des réponses soient apportées à ces questions. Marion Guillou, présidente de l'INRA, que notre mission d’information a entendue, nous a dit que la France risquait de perdre sa capacité d’expertise. J’entends fort bien les questions que vous posez, M. Prat. Mais pour y répondre, la recherche est nécessaire.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Ensuite se pose la question de savoir dans quelles conditions se déroulent les expérimentations. C’est une question fondamentale, à laquelle nous devons répondre.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Vous nous avez posé la question de « la contribution des médias à une information complète et raisonnée ». Quel est le sens de cette question ? S’agit-il de savoir comment faire pour que les médias fassent en sorte que l’opinion ne s’oppose pas aux expérimentations en plein champ ? Si tel n’était pas le sens de la question, peut-être serait-il opportun de revenir à notre sujet.
M. le Président : Je ne suis pas responsable de toutes les digressions que peuvent faire les uns ou les autres.
M. Vincent PÉTIARD : S’agissant des expérimentations, il faut distinguer entre la recherche, le développement et la commercialisation. On n’arrivera jamais au stade de la commercialisation de nouvelles variétés sans avoir procédé à des expérimentations.
Pour revenir au problème de la biologie végétale, je rappelle qu’il ne se pose pas qu’en France. Le précédent commissaire européen à la recherche, M. Busquin, a parlé d’un « exode scientifique » frappant l’Europe.
J’ai connu l’époque où la recherche française en biologie végétale était rayonnante. Aujourd’hui, elle n’a plus du tout le même prestige. Dans les congrès internationaux de botanique ou de biologie végétale, quand on trouve un chercheur français, c’est déjà beaucoup.
Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS : La destruction d’essais en plein champ était la seule façon d’exprimer une contestation par rapport à un système agro-économique.
M. Gabriel BIANCHERI : Pardon ?
Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS : Cela a été clairement explicité par la Confédération paysanne dans sa lettre à Lionel Jospin en juin 2001. En février 2002, le débat au Conseil économique et social a permis de répondre à la question de savoir si des essais en plein champ devaient être réalisés. Nous assistons à un dialogue de sourds : des gens contestent en avançant des arguments, et on leur répond en mettant en avant des faits de destruction, qui sont un détail. Les essais sont instrumentalisés. Le fond de la question est ailleurs. Les essais sont détruits parce qu’une partie de la société civile conteste un certain type de développement de notre agriculture. Une « information complète et raisonnée » doit permettre de répondre à cette question-là, qui interroge également le rôle des chercheurs. Pierre-Henri Gouyon – professeur de l’Institut national agronomique Paris-Grignon (INAPG) – a tenté de le faire dans le cadre des Etats généraux de la recherche, en coordonnant le travail qui a abouti au rapport Science et société. Le même Pierre-Henri Gouyon est intervenu dans le procès du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), a été démis de ses fonctions de directeur adjoint du département « Sciences de la vie » du Centre national de recherche scientifique (CNRS), et demande des financements de recherche. Aucun chercheur ni aucun militant n’est opposé à la recherche. Mais on ne peut pas utiliser cet argument pour défendre un certain développement agricole en avançant masqué.
M. François GUILLAUME : Je voudrais qu’on en revienne à notre sujet, qui est de savoir comment développer une information claire et objective permettant au citoyen de faire des choix en toute connaissance de cause.
Un certain nombre de citoyens ne veulent pas de la commercialisation des OGM en France et en Europe. C’est leur droit le plus strict. Mais pour faire avancer leur cause, ils refusent toute expérimentation en plein champ qui pourrait conduire à lever les obstacles à la consommation d’OGM. Et ils nous disent, la main sur le cœur, qu’il faut poursuivre les recherches en milieu confiné, tout en sachant que, sans expérimentations en plein champ, aucun développement ne sera possible.
Je comprends les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes scientifiques ici présents. Leur propre rédaction leur impose parfois les titres de leurs articles et leurs collègues généralistes sont peut-être plus sensibles à la commercialisation de l’information qu’à l’information elle-même. L’emploi de certains mots fausse le débat. On parle par exemple de « contamination » alors qu’il faudrait parler de « dissémination », puisque personne n’a prouvé que les OGM présentaient des inconvénients du point de vue de la santé. En outre, de très grandes réticences se manifestent dans notre pays sur un sujet sensible qui touche à l’alimentation.
Je suis agriculteur. J’ai connu toute l’évolution de l’agriculture depuis l’avant-guerre. Je peux vous dire que les premières inséminations artificielles ont véritablement fait scandale dans le milieu rural. Aujourd’hui, plus personne ne conteste cette technique, qui a d’ailleurs constitué un terrain d’expérimentation pour l’insémination chez l’homme. J’ai aussi connu l’époque ou tel colorant était condamné par je ne sais plus quelle publication de consommateurs. Aujourd’hui, on n’en parle plus.
Ensuite, on a parlé des hormones. Les hormones artificielles posaient en effet certains problèmes, d’autant plus qu’il y avait des fraudes, qui n’étaient pas une pratique générale. On s’en est pourtant servi pour mener une campagne contre les hormones. Aujourd’hui, les Etats-Unis utilisent des hormones naturelles, et l’Europe paie chaque année 5 millions de dollars en compensation de la non-acceptation de ces produits sur son territoire. Si la même procédure devait s’appliquer demain pour le maïs Bt, cela nous coûterait très cher.
En ce qui concerne les farines animales, une commission d’enquête a été constituée au sein de l’Assemblée nationale. Tous les chercheurs nous ont dit qu’il était possible d’utiliser les farines animales issues des déchets d’abattoirs. On continue pourtant à les brûler : cela coûte des milliards qui seraient sans doute plus intelligemment utilisés pour développer des recherches sur le cancer ou le sida.
Autre exemple : le Gaucho. Mes propres parcelles de tournesol étaient traitées au Gaucho il y a quinze ans de cela. Cela n’a jamais posé de problème à l’apiculteur voisin. J’ai quelque raison de contester les critiques qui ont été faites à ce produit, et qui ont causé un préjudice majeur.
En ce qui concerne les OGM, je rappelle que la Commission du génie biomoléculaire a été créée dès 1986.
Je voudrais vous soumettre une proposition. Lorsque des informations erronées sont publiées dans la presse, les pouvoirs publics ne pourraient-ils pas, sans aucunement remettre en cause la liberté de la presse, demander un droit de réponse qui serait exercé par une autorité publique reconnue, par exemple l’Académie des sciences, celle de médecine ou celle de l’agriculture ? Cela permettrait au moins un certain rééquilibrage et pourrait éviter des excès qui causent un grave préjudice à l’activité économique comme à l’activité scientifique, et finalement à l’ensemble de notre pays.
M. Pierre-Benoît JOLY : Cette proposition est séduisante, mais inapplicable. Peut-on exercer un droit de réponse parce qu’un journaliste a parlé de « contamination » au lieu de « dissémination » ?
M. le Rapporteur : Sans parler de droit de réponse, ne serait-il pas opportun que les pouvoirs publics créent un organisme d’information ?
M. Pierre-Benoît JOLY : Prenons la question de savoir si les OGM apportent quelque chose au consommateur. Un rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sur ce sujet a été publié le 23 juillet 2004, dont les journaux ont fait état. Le Figaro a titré : « Les OGM peuvent être bénéfiques pour la santé ». Le compte rendu du Monde a été très différent : « Les avantages des OGM pour le consommateur sont, au mieux, extrêmement limités. (…) Les OGM présentent-ils des avantages pour le consommateur ? Compenseraient-ils les risques que ces organismes leur feraient courir et qui font l’objet d’intenses débats ? L’AFSSA tente de répondre à ces questions dans un rapport intitulé "OGM et alimentation : peut-on identifier et évaluer les bénéfices pour la santé ?", publié vendredi 23 juillet. La réponse est un "oui, peut-être", mais elle est assortie de tant de nuances qu’elle s’apparente à un "presque non, mais il faut continuer les recherches". » On voit que les journaux peuvent rendre compte d’une même information de manière très différente. On est là au cœur du sujet. Le rapport de l’AFSSA ne répondait pas de manière tranchée à la question posée. Il allait globalement dans le sens de l’existence de bénéfices potentiels, tout en soulignant l’absence de risques avérés.
En ce qui concerne les mycotoxines, toute une série de travaux ont permis d’affirmer qu’il n’y avait pas de risque avéré ni de bénéfice avéré. A partir de là, la presse peut interpréter ces travaux de diverses manières, par exemple en soulignant les « incertitudes » scientifiques. Mais ces incertitudes ne signifient pas une absence totale de savoir. Elles reflètent un savoir complexe, dont il est difficile de rendre compte.
M. Marc MENNESSIER : Il y a une quinzaine d’années, j’ai adhéré à une association de journalistes couvrant les questions relatives à l’environnement, association dont le but était clairement militant. Je l’ai quittée parce que j’estimais que c’était contraire à ma déontologie personnelle. Je peux militer, mais en dehors de mon travail. Il y a dans les médias, disons-le, une sympathie pour les thèses de José Bové.
Mme Benoit-Browaeys a parlé à l’instant de la société civile. Je suis toujours un peu gêné d’entendre des gens s’exprimer au nom de la société. Les sondages indiquent, certes, que 70 % des Français refusent les OGM, mais l’expérience montre bien que les sondages ont une valeur relative. Depuis dix ans, avant chaque élection, ils se sont toujours trompés.
M. Gabriel BIANCHERI : Finalement, il n’y a que les députés qui n’ont pas le droit de parler au nom de la société !
M. Marc MENNESSIER : S’agissant des lobbies, il est vrai, comme l’a dit M. Prat, que les groupes industriels disposent de moyens importants. Cela dit, je constate que la lutte contre les OGM est devenue le fond de commerce de certaines associations de défense de l’environnement, notamment de Greenpeace, qui a repris des couleurs en Europe depuis le débat sur les OGM. C’est un fait avéré. Imaginons que les expérimentations aboutissent et montrent que les OGM ne posent pas plus de problèmes qu’une autre technique. Du jour au lendemain, ce fond de commerce disparaîtrait.
Il est vrai que Monsanto et les autres groupes s’efforcent avant tout de vendre leurs produits, mais au moins c’est clair : ils ne s’en cachent pas. Je maintiens que nous devons avoir la même attitude à l’égard de ces deux lobbies antagonistes.
M. Louis GISCARD D'ESTAING : L’information du public est au cœur de nos préoccupations. Il est apparu clairement, au cours de nos travaux, que la schématisation extrême de l’information sur les OGM pose problème. L’amalgame avec le sang contaminé, l’amiante ou la vache folle est troublant.
En tant que législateurs, nous n’avons pas vocation à intervenir dans le travail des rédactions. Mais il me semble qu’il serait bon que notre mission d’information rencontre des responsables du service public audiovisuel, lequel a théoriquement pour fonction de jouer un rôle que d’autres médias ne peuvent pas assumer.
M. le Président : Cela me semble une bonne suggestion, même si je suis très pessimiste sur la possibilité de faire évoluer les choses. La télévision s’intéresse moins aux OGM que la presse écrite. Elle est plus sensible à l’aspect événementiel du sujet, qu’elle ne traite que lorsqu’il lui est possible de diffuser des images.
Je voudrais à présent me tourner vers chacun de nos invités pour lui demander de nous soumettre une proposition pour faire avancer les choses.
M. Éric GIRY : L’administration a un rôle d’information, qu’elle remplit mieux qu’il y a dizaine d’années.
M. le Président : La CGB rend-elle publics ses avis ?
M. Éric GIRY : Les avis, les rapports, les comptes rendus de colloque, les comptes rendus synthétiques de ses réunions sont disponibles sur le site ogm.gouv.fr, site interministériel géré par le service d’information du Gouvernement.
M. Frédéric PRAT : Il a fallu une intervention auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) pour obtenir les rapports de la CGB !
M. Éric GIRY : Tout dépend de quoi l’on parle.
M. Frédéric PRAT : Il s’agit des comptes rendus des commissions de la CGB.
M. Éric GIRY : Les avis de la CGB sont disponibles sur Internet. Certaines études sont confidentielles, ce qui est un autre problème. Les dispositions législatives et réglementaires nous font obligation de respecter le secret industriel, le secret de propriété intellectuelle, ainsi que de ne pas nuire à la concurrence. Entre l’exigence de transparence et le respect de ces dispositions, il y a un équilibre à trouver. Nous n’avons pas de réponse toute faite. La question se pose cas par cas, en fonction des documents demandés.
J’ajoute que l’on nous demande souvent des documents relatifs à l’autorisation de mise sur le marché. Dans ce cas, ce n’est pas l’autorité française qui décide du caractère de confidentialité, mais l’Etat membre qui a reçu le dossier d’origine et la Commission qui nous l’a transmis. Nous ne cherchons pas à cacher certaines informations.
La transparence a progressé par rapport à ce qu’elle était il y a dix ans. Le ministère s’efforce de faire du mieux possible dans le cadre réglementaire actuel.
M. le Président : Je suis d’avis qu’il faut aller au bout de la transparence. Pensez-vous que l’on peut faire mieux ?
M. Éric GIRY : On peut toujours faire mieux. Nous informons, par exemple, les maires. Cette information n’est exigée par aucun texte. C’est une démarche que le ministère de l’agriculture a engagée de lui-même. Il demande à ses agents, lorsqu’ils procèdent aux contrôles préalables à l’autorisation des essais, d’informer systématiquement les maires ou du moins de proposer à ceux-ci une rencontre, qu’ils sont libres de refuser.
M. le Président : On nous dit que cela ne se fait pas.
M. Éric GIRY : Les agents du ministère, qui sont assermentés, nous transmettent les comptes rendus de leurs contacts avec les maires…
M. le Président : M. Martin nous a dit que les choses ne se passaient pas forcément de cette manière.
M. Éric GIRY : Comprenons-nous bien : nous ne rencontrons les maires que lorsqu’une implantation d’essais est envisagée dans l’année en cours sur le territoire de leur commune. En 2004, deux communes du Gers, Solomiac et Vic-Fezensac, ont été concernées. Nos agents ont rencontré les maires de ces deux communes et nous avons le compte rendu de ces rencontres, qui ont eu lieu respectivement le 26 avril et au début du mois de mai. J’ajoute que cette information n’est imposée par aucun texte. Il s’agit d’une initiative de notre ministère.
Pour ce qui est de la consultation du public, outre que l’on peut se poser la question de la représentativité de ceux qui participent à cette consultation, un éventuel refus du public interviendrait dans le cadre d’une procédure bien précise. Aux termes de la directive 2001/18/CE, la procédure doit se faire cas par cas, elle doit passer par une évaluation scientifique. Après que celle-ci a été menée et que l’autorisation a été délivrée, l’Etat membre n’est pas en mesure de s’opposer à la mise sur le marché, sauf s’il met en œuvre une clause de sauvegarde. Mais celle-ci doit s’appuyer sur des éléments scientifiques nouveaux. Voilà le cadre dans lequel nous devons procéder à la consultation du public.
M. Philippe MARTIN : Qu’entend-on par information des maires ? Il s’agit souvent de les informer a posteriori sur les décisions qui ont été prises sans eux et indépendamment de leur position. Vous ne pouvez pas imaginer l’exaspération d’élus qui se sentent dépossédés de ce qui fonde leur engagement, à savoir leur responsabilité vis-à-vis de leurs administrés. Ils sont désespérés et déresponsabilisés. Cette manière de faire est peut-être ce qui montre le plus à quel point ils ont peu de pouvoir.
M. Éric GIRY : L’information des maires n’est qu’une information. Ce n’est pas une consultation, et encore moins la demande d’un avis. S’il en est ainsi, c’est parce que les textes législatifs et réglementaires – et ce n’est pas moi qui les ai rédigés – disposent que la décision d’autorisation est rendue par le ministre de l’agriculture, après accord du ministre de l’environnement. Il faut faire la différence entre la question de la transparence et la question de savoir qui prend la décision. Il est vrai que si un essai a été autorisé sur le territoire d’une commune, le maire n’a pas le choix. Il me semble qu’il est néanmoins utile de l’informer.
M. Philippe MARTIN : On vient simplement constater que le maire n’a strictement aucun pouvoir de s’opposer à l’essai en question.
M. Éric GIRY : Je peux vous répondre, M. Martin, que la plupart des maires que nous avons rencontrés ont été satisfaits de recevoir des informations qu’ils n’avaient pas par ailleurs.
M. le Président : Comme sur le sujet des déchets radioactifs, il est évident que nous ne préconiserons sans doute pas que la décision soit prise au niveau communal.
Mme Dorothée BENOIT-BROWAEYS : Je ne crois pas que les mises en cause mutuelles de journalistes contribuent à une information complète et raisonnée. Il n’y a jamais de neutralité. Quand Hervé Kempf a publié son article « La vache et le politique », il a posé des questions qui ont alimenté le débat.
Le site vivantinfo.com a publié en janvier dernier un article de deux économistes, Egizio Valceschini et Thierry Hommel, qui pose la question de savoir si le cadre juridique actuel se prête au développement des OGM. Leur réponse est que rien n’est moins sûr. La responsabilité environnementale, la coexistence des cultures sont notamment deux problèmes qu’une information complète et raisonnée ne saurait ignorer.
M. Marc MENNESSIER : La proposition de M. Guillaume me paraît difficile à appliquer. Il ne me paraît pas possible d’imposer un droit de réponse à des journaux ou à des chaînes de télévision.
S’agissant des destructions d’essais, je n’ai pas le sentiment que ce soit un détail. Elles sont très importantes, ne serait-ce que parce qu’elles frappent l’imagination. Les médias leur prêtent trop d’attention. Après tout, beaucoup de gens manifestent pour des causes tout aussi nobles.
M. Jean-Marc BIAIS : La proposition de M. Guillaume me paraît également difficilement applicable mais il faut souhaiter que les journalistes soient, avant tout, des journalistes et non plus des militants. Le débat a pris une tournure sectaire qui me semble déplorable.
J’insiste par ailleurs sur le fait que le centre de gravité médiatique n’est plus la presse écrite. C’est la télévision qui peut éclairer le citoyen.
Mme Sophie LEPAULT : Je souscris à ce qui vient d’être dit. Il me semble, avant tout, qu’il faut dépassionner le débat. Le travail d’un journaliste consiste aussi à dépasser le manichéisme. Les chercheurs devraient aussi contribuer à une meilleure vulgarisation, même si je sais que ce n’est pas facile.
M. Vincent PÉTIARD : La première chose à faire serait de poser la bonne question, qui est celle de l’avenir de notre agriculture. Mais je sais que ce n’est pas le débat de ce matin.
Deuxièmement, il conviendrait d’instaurer une communication directe avec le public. Notre laboratoire a reçu une classe de première conduite par son professeur de biologie, accompagné d’un membre de Greenpeace. Le débat a été très sain et très honnête et a intéressé les élèves. En Suisse et aux Etats-Unis, l’école a beaucoup fait pour dépassionner le débat et transmettre un savoir élémentaire sur ce qu’est un gène. L’Education nationale devrait faire des efforts en ce sens.
M. Frédéric PRAT : Je suis tout à fait d’accord avec l’idée d’organiser des débats locaux contradictoires, auxquels Inf’OGM participe.
Cela dit, ils ne remplaceront jamais un grand débat national et une consultation citoyenne sur ce sujet. La France pourrait suivre l’exemple du débat national qui a eu lieu au Royaume-Uni pendant le moratoire. Nous avons saisi la Commission nationale du débat public (CNDP). Son président, Yves Mansillon, nous a répondu que seul un ministère peut saisir la CNDP en vue de l’organisation d’un tel débat sur une question nationale. Le collectif de la consultation des citoyens sur les OGM s’est donné pour mission d’interroger les différents ministères concernés. Le ministre de l’environnement a récemment déclaré qu’il allait saisir la CNDP. Il ne l’a pas fait à ce jour.
En ce qui concerne la transposition de la directive 2001/18/CE, il nous faut utiliser la marge de manœuvre importante qu’elle donne aux Etats membres sur le thème de la consultation des citoyens, tout en utilisant les outils de la convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information et à la participation du public au processus décisionnel en matière d’environnement.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Le premier devoir d’un journaliste est d’éviter la manipulation, qui peut venir de tous les côtés. 60 millions de consommateurs est extrêmement vigilant sur ce point. Mais les journalistes sont un peu comme les hommes politiques, ils ont du mal à pratiquer l’autocritique.
Le centre de gravité des médias s’est effectivement déplacé vers la télévision. Mais les journaux télévisés s’appuient beaucoup sur la presse écrite, dont ils reprennent parfois les titres. J’ajoute qu’il ne faut pas négliger les documentaires et les magazines télévisés, qui peuvent donner le pire et le meilleur.
La proposition de M. Guillaume me semble difficile à mettre en œuvre. Le droit de réponse est extrêmement encadré.
M. le rapporteur a proposé la création d’un organisme chargé de centraliser l’information. Cette proposition me rappelle la Délégation générale à l’information qui, il y a trente ans, avait le même objectif. C’est grâce à elle qu’il n’y a jamais eu de débat public sur le nucléaire en France…
M. le Président : Vous voulez dire que cela ne sert à rien ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Si, cela sert à quelque chose. Cela sert à museler l’information.
Enfin, il me semble choquant que les études et les enquêtes menées par l’administration avec les moyens que lui donnent les deniers publics ne soient pas systématiquement publiées.
Mme Sylvie PRADELLE : Que Choisir a l’habitude de pratiquer une information objective, ce qui fait, d’ailleurs, sa crédibilité. La question qui nous a été posée, celle de savoir comment contribuer à une information complète et raisonnée de la population, sous-entend que si 70 % des consommateurs européens ne veulent pas d’OGM, c’est qu’ils sont mal informés. Or, c’est faux. Les consommateurs sont pragmatiques. Ils ne veulent pas d’OGM parce qu’ils ne présentent aucun avantage pour eux et qu’il existe des risques potentiels.
M. le Président : Vous avez raison sur ce point, mais il reste que la Conférence des citoyens de 1998 a montré que lorsque des citoyens étudient longuement un sujet, ils arrivent à des avis beaucoup plus équilibrés.
Mme Sylvie PRADELLE : Un sondage d’Eurobaromètre a également fait apparaître que plus les consommateurs étaient informés sur les OGM, moins ils en voulaient…
M. le Président : Je ne parle pas de sondages. L’expérience de la Conférence des citoyens de 1998 a montré que les citoyens peuvent s’exprimer avec nuance sur ce débat. Par ailleurs, je pense qu’il serait bon que des débats entre citoyens soient organisés au niveau local et il appartient au Gouvernement de le faire.
M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS : Suivant que l’on considère qu’une chose est précieuse ou néfaste, l’exigence de transparence sera différente. Les bases de données du Muséum national d'histoire naturelle sur les espèces protégées sont en ligne. Vous pouvez savoir s’il y en a dans votre commune. Par contre, vous ne pouvez pas savoir où elles se trouvent. Et tout le monde, y compris les associations écologistes, s’accorde pour dire qu’on ne doit pas diffuser cette information. Je vous invite à méditer cet exemple.
Vous allez avoir à discuter de l’instance nouvelle qui devra travailler sur les essais OGM et sur les autorisations. La question de fond est de savoir si elle a la responsabilité d’organiser le débat public, en disposant de moyens importants, ou si nous allons rester dans une logique où l’évaluation du risque appartient à la puissance publique, laquelle organisera éventuellement l’information. Cette question a été en partie tranchée lorsque le Parlement a décidé de la création de l’AFSSA en 1998, en précisant que ses avis devaient être rendus publics. Je me suis réjoui de cette décision. Par contre, l’AFSSA n’avait pas la mission d’organiser un débat autour de ces avis, et lorsqu’elle a fait des tentatives en ce sens, les choses se sont passées de manière quelque peu conflictuelle. Nos amis britanniques ont procédé différemment en décidant que leur agence de sécurité sanitaire des aliments serait également chargée d’organiser les débats.
M. Pierre-Benoît JOLY : On nous dit que 70 à 80 % des gens ont peur des OGM. Bien sûr, quand les instituts de sondage posent une question fermée, du style « pour ou contre les OGM ? », les gens répondent qu’ils sont contre. Mais toutes les études que nous avons conduites dans le cadre de groupes de discussion démontrent, en réalité, que, contrairement à une idée reçue, les gens ne sont pas opposés aux OGM. Ils ont certes une attitude assez négative, mais ils ont surtout des interrogations. Quand un interlocuteur me parle de peur, je lui demande systématiquement si, lui, a peur. Et bien sûr, lui, n’a pas peur, ce sont toujours les autres qui ont peur.
Dans le domaine de la transparence, beaucoup de progrès ont été faits. Les agences mettent en ligne leurs documents. Ce sont les débats qui sont insuffisants. C’est pourquoi il me semble important de revenir à cette vieille idée d’un second cercle de l’expertise ou d’un comité interministériel. Les instances de discussion font encore défaut.
M. le Président : Il reste un point que nous n’avons pas suffisamment abordé, je veux parler de l’information du consommateur et de la question du seuil. On dit souvent que les gens ne veulent pas avoir d’OGM dans leur assiette sans le savoir. Cette phrase, en tant que telle, a-t-elle une signification ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Le droit à l’information est l’un des droits essentiels du consommateur. En 1996, il n’était pas du tout évident que le consommateur aurait le droit de choisir. Il était important de livrer bataille autour de l’étiquetage. On sait bien que le seuil de 0,9 % a une signification politique et qu’il n’a aucune pertinence scientifique. Il me semble qu’il doit être discuté. Il n’y a aucune raison pour qu’il soit gravé dans le marbre pour l’éternité.
M. le Rapporteur : Pensez-vous qu’il faille tout étiqueter ? Autrement dit, le fait qu’un animal ait absorbé des OGM doit-il apparaître sur l’emballage ? Si un œuf a été pondu par une poule qui a absorbé des OGM, cela doit-il apparaître sur l’emballage ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : La réglementation européenne a adopté le principe de l’étiquetage complet dans la filière végétale, mais pas dans la filière animale. Ce n’est pas logique.
M. le Rapporteur : Ne risque-t-on pas d’assister à une distorsion de concurrence par rapport aux produits américains, qui ne seront pas étiquetés ?
M. Frédéric PRAT : C’est aux services des douanes qu’il appartient d’appliquer la directive européenne relative à la traçabilité. Ils n’ont pas à laisser entrer dans l’Union européenne des produits non tracés, surtout s’ils contiennent des OGM.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : La question se pose dans bien d’autres domaines. Beaucoup de substances, par exemple des colorants ou des additifs, sont interdites dans l’Union européenne et autorisées dans d’autres pays. C’est aux pouvoirs publics qu’il appartient de procéder aux contrôles et d’assurer la traçabilité.
M. Gabriel BIANCHERI : Il n’y aura pas de traçabilité.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Et pourquoi donc ? Il y a dix ans, on nous disait qu’il n’y aurait pas d’étiquetage. La traçabilité parfaite n’existe pas, mais c’est une limite vers laquelle il faut tendre.
M. Gabriel BIANCHERI : Les produits transformés qui seront importés n’auront pas de traçabilité et vous n’aurez aucun moyen de prouver qu’ils ont été fabriqués à partir d’OGM. Ces produits seront vendus et gagneront des parts de marché. Il y aura distorsion de concurrence.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : On disait la même chose il y a quinze ans au sujet du bœuf.
M. Gabriel BIANCHERI : Vous pourrez savoir d’où vient le bœuf, mais vous ne saurez pas forcément ce qu’il aura mangé. D’autre part, où va-t-on placer le curseur ? S’il est arrivé une seule fois à une vache d’absorber un aliment OGM, faudra-t-il l’indiquer sur l’étiquette ? Et si non, à partir de combien de fois faudra-t-il l’indiquer ?
M. le Rapporteur : C’est en effet un problème difficile à résoudre. Cela dit, ne pourrait-on pas envisager un étiquetage volontaire ? Les producteurs seraient libres d’indiquer la présence d’OGM dans les produits qu’ils commercialisent. Dans quelques années, les prix des produits OGM seront beaucoup plus avantageux. C’est peut-être ce qui déterminera le choix des consommateurs.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Nous vivons dans une économie de marché, plus personne ne le conteste. On pourrait laisser au marché le soin de trancher la question de l’étiquetage, mais à condition que le consommateur ait réellement le choix. C’est un débat approfondi qu’il faudrait mener sur ce point.
J’insiste sur le fait que les consommateurs n’ont rien demandé. Ils veulent pouvoir continuer à consommer leurs produits habituels, sans surcoût. Soit dit en passant, si les aliments OGM avaient tant de valeur ajoutée que certains le disent, ce sont eux qui devraient être plus chers.
M. Jean-Marie SERMIER : Dans le microcosme médiatico-démocratique, on se fait plaisir en parlant de la nécessité d’organiser des débats « citoyens ». On a déjà connu cela lors de la mise en place des « Pays ». Des consultations ont été organisées au niveau local, auxquelles participaient trois ou quatre personnes. On sous-estime l’effet que peuvent avoir quelques lignes et un titre dans deux ou trois magazines. L’information se résume bien souvent à cela, et seuls les spécialistes vont plus loin. Quand on parle de débats citoyens, il s’agit en fait de débats entre spécialistes citoyens.
Par ailleurs, l’étiquetage n’a d’intérêt que dans la mesure où il y a un risque.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Non !
M. Jean-Marie SERMIER : Libre à vous de penser le contraire !
Une information objective est nécessaire. Le citoyen doit être réellement informé, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Si une personne est mise en cause, elle dispose d’un droit de réponse. Si une contrevérité est dite, il n’y a pas de droit de réponse. Les journalistes ici présents seraient-ils choqués si l’on renforçait la loi en demandant à la presse d’informer de manière claire et objective, faute de quoi un droit de réponse pourrait être exercé ?
M. Marc MENNESSIER : Je comprends votre préoccupation, mais le droit français est très restrictif. De plus, le droit de réponse dépasse largement le cadre des OGM. Les plaintes en diffamation donnent lieu à des amendes dont les montants représentent un budget considérable dans le compte d’exploitation des journaux. Il est faux de dire qu’il n’y a pas de recours.
M. François GUILLAUME : C’est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Une association peut porter plainte en diffamation, mais quand il s’agit de citoyens qui ont de faibles moyens financiers par rapport à l’organe de presse auquel ils sont confrontés, les choses sont beaucoup plus difficiles. S’agissant du droit de réponse, la plupart des organes de presse manifestent toujours la plus grande réticence et ne l’accordent que quand ils se sentent menacés d’une action en justice. Or la partie adverse renonce souvent à aller au tribunal.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Je ne peux pas vous laisser dire cela, M. Guillaume !
M. François GUILLAUME : J’ai quelques souvenirs du veau aux hormones. Des organisations professionnelles ont souhaité répondre aux critiques de votre journal pour rétablir la vérité. Cela ne leur a pas été possible.
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Quand le droit de réponse est déposé dans sa forme légale, on est obligé de l’accorder.
M. le Rapporteur : Que penseriez-vous d’un étiquetage portant sur les pesticides et les insecticides ?
Mme Marie-Jeanne HUSSET : Je ne peux pas vous répondre immédiatement par oui ou par non. Ce qui est certain, c’est que beaucoup de choses devraient être étiquetées, qui ne le sont pas actuellement. Les consommateurs ne veulent pas seulement connaître la provenance des produits qui leur sont proposés, ils veulent aussi savoir comment ils ont été fabriqués. C’est leur droit, et pas uniquement pour des raisons liées aux risques alimentaires. Ils ont aussi le droit de favoriser, par leurs décisions d’achat, tel ou tel type d’agriculture.
M. Philippe MARTIN : Les interventions de certains de mes collègues montrent que le dossier des OGM a trait à la lutte des classes. Au bout du compte, on pourrait fort bien trouver dans les grandes surfaces des produits OGM pour les pauvres, alors que les riches pourront continuer à consommer des aliments sans OGM. La question essentielle est de savoir comment faire pour que l’information soit aussi équilibrée que possible sur une question aussi compliquée et comment rendre possible le choix.
Pourquoi ai-je lancé l’initiative d’un référendum départemental dans le Gers ? Parce que, tout en étant hostile aux destructions d’essais, je constate qu’il n’y a pas de débat national, ce qui est tout à fait anormal, surtout quand on sait combien il est difficile aux départements d’organiser des débats locaux. Il faut savoir que 14 000 pétitions ont été recueillies dans le Gers, ce qui n’a pas empêché le préfet, M. Jean-Michel Fromion, de faire tout son possible pour entraver cette démarche.
Nos concitoyens demandent à être informés, et il faut bien répondre à cette attente. Un sondage effectué dans le Gers a été publié dans La Dépêche du Midi : 77 % des Gersois souhaitent être consultés ; 72 % d’entre eux sont contre les OGM ; 57 % des agriculteurs gersois sont contre les OGM. Si, comme on nous l’a dit, cela n’a pas de sens de poser aux gens une question fermée parce que le sujet est trop compliqué, il faut bien d’une manière ou d’une autre que le grand public prenne part au débat. Ou alors, disons clairement que ce sujet est tellement compliqué que seuls des gens intelligents, les scientifiques et quelques politiques, peuvent se prononcer.
Notre mission va tourner autour de quelques questions. D’abord, comment établir de manière aussi précise que possible le rapport bénéfices/risques des OGM ? Deuxièmement, quels sont les seuils de tolérance qui permettent la cohabitation de deux cultures dans les territoires ? Troisièmement, quel type d’information veut-on ? L’étiquetage est, de toute façon, microscopique sur les emballages et ne permet pas vraiment d’offrir une liberté de choix aux consommateurs. Voilà pourquoi j’ai engagé dans mon département une démarche qui n’a rien d’électoral et qui vise à attirer le citoyen vers le débat auquel il a droit.
M. le Rapporteur : Le problème du référendum, M. Martin, est que, même s’il s’agit peut-être d’une idée intéressante sur le principe, il n’est pas sûr que les Français soient suffisamment informés pour pouvoir se déterminer.
M. Philippe MARTIN : On va bientôt leur demander de se prononcer sur une Constitution européenne qui compte quelque quatre cents articles !
M. Marc MENNESSIER : La question de M. le Rapporteur sur la mention des pesticides dans l’étiquetage est pertinente. S’il faut mentionner la présence d’OGM, il n’y a pas de raison d’en exclure les pesticides.
Mme Husset a affirmé que les consommateurs n’avaient pas demandé à ce qu’il y ait des OGM dans les produits qui leur sont proposés. Mais on peut en dire autant de beaucoup d’autres produits. Quand les kiwis sont apparus sur le marché français dans les années soixante-dix, personne n’avait rien demandé et, pourtant, le kiwi est un fruit extrêmement allergisant.
M. Gabriel BIANCHERI : Si la pomme de terre était soumise aux mêmes exigences que celles auxquelles on soumet les OGM, elle ne serait pas autorisée en France ni en Europe.
Je voudrais dire à mon collègue Martin, en toute amitié, qu’il devrait relire Marx, car il ne comprend pas la lutte des classes. Demain, ce sont ceux qui auront le moins de moyens financiers qui achèteront les produits OGM, parce qu’ils seront moins chers. Ce sont les plus démunis d’entre nous qui consommeront des OGM, et si les recherches ne sont pas menées, ils le feront sans savoir s’ils sont bons ou mauvais.
M. Frédéric PRAT : Je voudrais informer que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, dans sa résolution n° 1419 du 24 janvier 2005, estime que « l’étiquetage des produits issus d’animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés devrait être rendu obligatoire ». Elle affirme dans la même résolution que « seul un large débat social permettra de prendre des décisions politiques claires ».
Par ailleurs, un réseau d’experts européens financé par l’Union européenne, Entransfood, a récemment pris position en disant qu’il est « important de mettre au point de nouvelles méthodes de participation des acteurs concernés et de consultation du débat public » sur les OGM.
M. le Rapporteur : Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Audition de M. François d’AUBERT,
ministre délégué à la recherche auprès du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(extrait du procès-verbal de la séance du 15 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Monsieur le ministre, nous vous remercions d’avoir bien voulu répondre à notre invitation. Comme vous le savez, la Conférence des Présidents a décidé la création de notre mission d’information le 5 octobre 2004, laquelle a été constituée le 25 octobre. Depuis le début de nos travaux le 9 novembre, nous avons auditionné plus de 100 personnes, effectué plusieurs déplacements en France, dans le Puy-de-Dôme et en Haute-Garonne, et à l’étranger : à Bruxelles, en Espagne, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Nous approchons du terme de nos travaux, qui devraient contribuer utilement à la transposition des directives de 1998 et 2001 sur les OGM annoncée par le Président de la République en janvier dernier, et reportée à la demande du Président Debré pour que l’examen du projet de loi par le Parlement intervienne après les conclusions de notre mission.
Nous souhaitions d’autant plus entendre l’avis du ministre de la recherche qu’il sera sans doute chargé de défendre le projet de transposition devant le Parlement.
M. François d’AUBERT : M. le Président, M. le Rapporteur, mesdames, messieurs les députés, je tiens d’abord à souligner que la création de votre mission d’information a été une excellente initiative. Elle permettra de clarifier les conditions dans lesquelles les directives pourront être transposées, puis appliquées en France. Ce travail est d’autant plus nécessaire que le sujet est polémique, même s’il l’est moins dans les aspects touchant à la recherche que dans ceux touchant aux pratiques agronomiques et agricoles.
L’excellent rapport remis en janvier dernier par votre Président, M. Le Déaut, sur la place des biotechnologies en France et en Europe souligne l'urgence d’imprimer une nouvelle dynamique à un secteur d'activité qui sera sans doute primordial pour notre économie au XXIe siècle. Il souligne avec pertinence la nécessité de mobiliser tous les acteurs – industriels et technologues, chercheurs et universitaires – ayant un rôle à jouer dans le développement de la « bioéconomie », qui doivent mutuellement se renforcer pour accroître le potentiel d'innovation de notre pays.
Je considère la recherche française comme essentielle et stratégique pour le dispositif de développement des biotechnologies en France et en Europe. Mon action et celle de mon ministère ne visent qu'à accroître les capacités de recherche et d'innovation de nos laboratoires pour répondre à cet enjeu. La recherche sur les OGM, en particulier, est primordiale pour le développement des biotechnologies dans les domaines alimentaire et agricole, mais également dans le secteur pharmaceutique. La volonté de mon ministère est : d'accroître les moyens dédiés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine « santé, agriculture, alimentation », de promouvoir le renforcement du soutien européen aux projets de génomique végétale et de biotechnologies au travers du septième PCRD70 et de proposer des mesures législatives visant à clarifier le cadre d'utilisation et de dissémination des OGM et à améliorer la lisibilité des dispositifs d'expertise et d'information du public.
Cette volonté s'inscrit donc en parfaite synergie avec l’action de votre mission d'information sur les enjeux des essais et de l'utilisation des OGM.
Quelle est la situation de la recherche française dans le domaine des OGM ? Il convient d’abord de lever l'ambiguïté qui souvent demeure dans l'esprit de nos concitoyens entre deux types de recherche bien distincts.
La recherche sur les OGM est une recherche fondamentale, conduite dans les laboratoires, sur des paillasses ou avec des ordinateurs, et dont l'objectif est de faire progresser la connaissance des génomes, en particulier des gènes qui gouvernent la physiologie des plantes. Ce faisant, elle crée en permanence des OGM expérimentaux qui permettent d'évaluer la fonction de ces gènes et ne connaissent aucune dissémination. Elle permet d'acquérir des connaissances, afin d’optimiser les méthodes de sélection classiques pour l'amélioration de plantes et une expertise, afin d’évaluer de façon sûre et rigoureuse l'impact sur l'environnement et la santé publique de l'utilisation des OGM, ces deux sujets devant être clairement dissociés.
La recherche visant à la création de nouvelles variétés d'OGM, quant à elle, est essentielle pour le développement des biotechnologies végétales qui sont gage d'avenir pour la compétitivité de notre agriculture. Son but est d’accélérer les procédés d'amélioration des plantes modernes grâce à la création de nouvelles variétés de plantes ou de semences génétiquement modifiées.
Sur le plan international, on peut considérer que la France a pris un certain retard, pénalisant et préjudiciable à nos intérêts, dans la création de nouvelles variétés OGM commerciales, et ce malgré l’efficacité de nos entreprises. En revanche, la recherche en génomique qui, au travers d'un partenariat public/privé exemplaire, soutenu depuis 1999 par le réseau de recherche et d'innovation technologique Génoplante, est l'une des plus compétitives en Europe.
Le réseau Génoplante coordonne l'action d'une communauté de près de 400 chercheurs, avec un budget de l'ordre de 200 millions d'euros sur cinq ans, entre 1999 et 2004, ce qui représente l'opération coordonnée de plus grande envergure réussie jusqu'ici dans les domaines de la recherche agronomique et de l'agro-industrie. Le réseau a, en même temps, employé et formé à ces technologies de pointe environ 120 jeunes chercheurs, parmi lesquels près de 100 ont déjà trouvé un emploi dans le secteur public ou privé.
Je veux également signaler la participation de la France aux grandes opérations internationales de séquençage des génomes d'intérêt majeur, non seulement ceux de la plante modèle Arabidopsis, mais également ceux du riz, de la vigne, ou encore de la tomate, ce qui donne à notre pays une visibilité mondiale.
Les grandes infrastructures de recherche mises en place dans le même temps, les Génopôles, et notamment le Centre national de séquençage et le Centre National de Génotypage d’Evry, sont partenaires de ces grands chantiers sur les génomes. Elles accomplissent un travail internationalement reconnu pour sa grande qualité et son extrême rigueur.
L'effort de recherche de la France dans le domaine des biotechnologies végétales a fait l'objet d'un soutien constant du ministère de la recherche au cours de ces dernières années, à hauteur d'environ 10 millions d’euros par an, au travers du FNS71 et du FRT72, en plus de la contribution propre des organismes publics de recherche, que l’on peut évaluer à environ 18 millions d’euros par an. Cet effort sera soutenu et amplifié dans toutes ses composantes, conformément à notre engagement, au travers des programmes de l'Agence nationale de la recherche, y compris par la mise en place du programme Génoplante 2010, qui succédera au programme actuel. Il n’y a donc pas lieu de craindre un ralentissement du soutien des pouvoirs publics à la recherche sur les OGM, bien au contraire.
Il est vrai, cependant, que du côté des entreprises privées, la calamiteuse campagne anti-OGM, qui a parfois revêtu des formes que l’on peut qualifier de barbares, a suscité un certain découragement. Les betteraviers français par exemple, qui, pour rester compétitifs, ont absolument besoin de créer des plantes OGM résistantes aux maladies, ont pratiquement arrêté leurs investissements dans ces activités. Dans le secteur de la vigne, les expériences en plein champ qui ont été envisagées dans la région de Colmar n’ont pas obtenu d’autorisation. L’un des principaux chercheurs de l’INRA est parti aux Etats-Unis. Nous devons être très attentifs au fait que les crédits et les programmes ne suffisent pas : encore faut-il que les hommes suivent, ce qui suppose que l’on puisse compter sur l’enthousiasme et la passion sans lesquels il n’y a pas de recherche. Si nos chercheurs en biologie végétale, qui sont sans doute parmi les meilleurs du monde, sont découragés, il ne faut pas s’étonner qu’ils aillent s’installer dans des pays plus accueillants.
Nous devons tous être conscients que seules des semences à fort contenu agronomique et technologique permettent aujourd'hui à l'agriculture nationale de rester compétitive face aux productions de masse à faible coût de main-d'œuvre des pays émergents, la Chine, le Brésil, l’Inde. Un article récemment paru dans Libération rapportait même l'éloge des semences OGM de soja par un agronome brésilien : « Avec le soja OGM, on plante et on ramasse la monnaie ». Je ne sais pas si les choses sont aussi simples que cela, mais il est clair que le développement des cultures OGM, notamment le soja, ont accru les revenus de pays qui, il y a quelques années, n’étaient pas dans une situation d’autosuffisance alimentaire. Une filière OGM peut, d’ailleurs, coexister avec une agriculture biologique si l’on veut bien laisser de côté les questions d’ordre idéologique. Je remarque à cet égard que le président Luis Inacio da Silva, qui était d’abord défavorable aux cultures OGM, s’y est rallié depuis quelques mois. Il ne faudrait pas que la France et l'Europe laissent passer, comme si de rien n'était, une véritable révolution agronomique. Les OGM, pourvu qu'ils soient développés et utilisés dans les conditions de sécurité optimales pour la santé humaine et l'environnement, offrent en effet un potentiel considérable pour le développement de l'humanité.
A cet égard, la multiplication des campagnes de dévastation des cultures expérimentales autorisées d'OGM porte un très grave préjudice à la recherche nationale sur les biotechnologies, alors même que cette recherche et les découvertes qui en découlent représentent un intérêt fondamental pour la nation. Ces destructions d'essais au champ, qui sont indispensables pour valider les découvertes dans des conditions réelles de culture, ruinent des années de travail pour des centaines de chercheurs et mettent en péril tout un pan de la recherche française publique et privée, alors même que les conditions de sécurité sanitaire et environnementale des essais sont en France les plus sûres du monde. Rappelons-nous les dévastations inqualifiables qui ont frappé le CIRAD73 en 2003, ravageant non seulement les cultures OGM, mais également les serres et les dispositifs expérimentaux. Les destructions n’ont pas épargné la recherche sur une variété de maïs transgénique susceptible de déboucher sur des applications thérapeutiques dans le traitement de certaines myopathies.
Par ailleurs, des projets d'expérimentation, tels que les essais de vignes transgéniques à Colmar, ne peuvent être mis en place dans des conditions favorables, en dépit d'une concertation avec la profession, le public et le monde socio-économique. Tous ces avatars ont pour effet d'entraîner une réduction progressive des essais menés dans une logique de recherche pure – ils occupent 7 hectares en 2004 en France, contre 85 hectares en 1999 –, et d'encourager nos industriels français à délocaliser leurs essais à l'étranger. Par là même, ils incitent nos jeunes chercheurs à quitter le territoire national.
Interrogés en septembre 2004 par l'institut CSA, les Français se disaient très largement favorables à l'expérimentation des OGM – 67 % – et aux essais en champs – 63 % –, tandis qu'ils désapprouvaient fermement les destructions d'expérimentations – 74 %. Il ne faut pas s’y tromper : nos concitoyens sont, dans leur très grande majorité, favorables à la recherche sur les OGM, tout en demandant que de multiples précautions soient prises. Ils considèrent l'Etat comme une garantie de sécurité en matière d'essais OGM, à travers les contrôles qu’il effectue et les autorisations qu’il délivre. Néanmoins, un effort accru de communication doit être entrepris, afin de présenter devant des audiences aussi larges que possible les multiples enjeux de ces innovations pour le consommateur, pour l'environnement, pour l'agriculture en général et celle des pays en développement en particulier. Les chercheurs des organismes publics doivent être sollicités pour qu'ils expliquent en quoi leurs recherches sont bénéfiques pour le pays.
Je veux marquer devant vous ma détermination à créer les conditions favorables au développement d'une recherche de pointe sur les OGM, en améliorant encore les conditions de transparence et de sûreté dans lesquelles se déroulent les expérimentations sur les OGM, plusieurs étant par ailleurs prévues dans les mois à venir. Ces mesures seront détaillées dans le projet de loi portant transposition des directives 98/81/CE du 26 octobre 1998 et 2001/18/CE du 12 mars 2001. Je précise que l'avant-projet reste bien entendu ouvert aux conclusions de votre mission. Il conviendra également d'assurer une protection active des essais en cas de tentative de destruction et de faire respecter strictement et courageusement la loi et l'ordre public. Il s'agira enfin, comme je l'ai déjà dit, de soutenir par des efforts financiers accrus les recherches fondamentale et partenariale dans ce secteur.
Au niveau européen, notre objectif prioritaire sera de renforcer nos collaborations avec nos partenaires : l’Allemagne, dont le programme GABI, doté de financements publics et privés, présente des priorités agronomiques très complémentaires aux nôtres pour l'orge et la betterave sucrière, et le Royaume-Uni, qui semble avoir concentré l'essentiel de ses moyens en génomique végétale sur Arabidopsis dans le cadre du réseau GARNet, le Genomic Arabidopsis Resource Network.
Une coopération franco-allemande existe depuis 2001 entre les programmes Génoplante et GABI, qui a constitué le socle du réseau ERA-Net créé en 2003, le sixième PCRD n'ayant pas réellement laissé de place aux biotechnologies végétales. Ce réseau, ERA Plant Genomics, a été doté d'un budget de 3 millions d’euros pour faciliter les rencontres et les travaux d'inventaire des programmes nationaux de génomique végétale qui, à travers l'Europe des Quinze, représentaient plus de 100 millions d’euros d'investissements publics et privés. C'est évidemment assez peu quand on pense aux 400 millions de dollars annuels de crédits incitatifs que la NSF74 américaine consacre à la Plant Genomics, ou aux 500 millions de dollars investis annuellement par Monsanto dans la recherche-développement.
Le septième PCRD est donc une occasion unique pour redynamiser la recherche européenne dans ce domaine. Une négociation public/privé est en cours pour proposer la mise en place d'une « Plateforme Technologique en Biotechnologie et Biologie Végétale ».
L’autre grande question qui se pose est celle de la protection intellectuelle. La protection et la valorisation des résultats et des innovations biotechnologiques sont à l'évidence une obligation majeure. Sur ce plan, il semble que l'on soit entré dans une course de vitesse au plan international sur la protection des gènes et de leur système d'expression dans les plantes cultivées. C'est ce défi de la compétitivité que les entrepreneurs privés, Limagrain et Bayer CropScience en tête, ont décidé de relever avec l'aide de la recherche publique. Une société spécifique, Génoplante-Valor, a été créée dans le cadre du programme Génoplante. Elle bénéficie d'une organisation très professionnelle et assure la prise de brevets, la gestion dans le temps du portefeuille de brevets et sa valorisation.
S'agissant des variétés pouvant faire l'objet d'un brevet, la directive 98/44/CE relative aux innovations biotechnologiques prévoit qu'il est possible de produire des semences à partir de variétés de plantes couvertes par un brevet, suivant les mêmes principes que pour les variétés conventionnelles. Ces variétés nouvelles, à condition qu'elles soient stables et homogènes, peuvent donner lieu à la délivrance d'un COV, un certificat d'obtention végétale, et être librement commercialisées. Les contentieux entre des agriculteurs américains ou canadiens et des entreprises semencières, notamment en ce qui concerne l'utilisation de semences fermières obtenues à partir de plantes génétiquement modifiées, correspondent à des situations qui ne sont pas transposables à l'Union européenne. Le Canada envisage d'ailleurs de modifier son droit des brevets pour prendre en compte la question des semences fermières. Le système du certificat d’obtention végétale, dit sui generis, est largement répandu et pourrait être étendu aux pays qui ne disposent pas de législation en la matière. Même si ce dernier point n'est pas du ressort de mon ministère, je peux vous dire que je suis très favorable à ce que la France contribue à le promouvoir au plan international.
En ce qui concerne les innovations en biotechnologie végétale, deux systèmes de propriété intellectuelle sont aujourd’hui juxtaposés. Cette situation nous apparaît préjudiciable en ce qu'elle prête une large part à interprétation en fonction des pratiques des offices nationaux de brevets et des jurisprudences en la matière, et ne garantit pas pour l'avenir l'accès de nos chercheurs et de nos industriels aux ressources génétiques de la biodiversité. C'est pourquoi je porte une grande attention aux conclusions de la mission qui a été confiée conjointement par mon prédécesseur et par le ministre chargé de l'agriculture à M. Alain Weil. L'objectif de cette mission était, je le rappelle, d'étudier dans quelle mesure un système de mutualisation de la propriété intellectuelle publique en biotechnologies à vocation agronomique, s'inspirant de l'initiative américaine PIPRA, pourrait être envisagé, afin de mieux répondre aux besoins de la recherche publique et de l'économie française et européenne. Le rapport du groupe de travail nous a été remis en juin 2004 et se concrétise par un projet de dimension européenne, EPIPAGRI, qui a été soumis à l'approbation de la Commission européenne en février 2005 sous forme d'une Action spécifique de support, ou SSA.
S’agissant du projet de loi en cours de préparation, il vise deux objectifs majeurs. Le premier est d’achever la transposition des deux directives européennes, celle du 26 octobre 1998 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et celle du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'OGM. Le second est d’optimiser et de rendre plus lisible le dispositif d'expertise des OGM, tout en lui confiant un rôle d'orientation des choix du Gouvernement en matière de biotechnologies.
Les textes communautaires adaptent la réglementation européenne à l'évolution des connaissances scientifiques en matière de produits composés en tout ou partie d'OGM et visent à harmoniser les pratiques communautaires avec les pratiques internationales. Parmi les éléments nouveaux que nous proposons, il faut souligner deux points d'évolution notable. D’une part, une obligation d'information et de consultation du public plus large, au niveau national, y compris pour une dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché, dans un délai maximal de trente jours. D’autre part, dans le souci de simplifier les procédures et d'assurer une plus grande cohérence à l'expertise scientifique nationale des produits composés en tout ou partie d'OGM, qu'ils fassent l'objet d'une utilisation confinée, d'une dissémination volontaire ou d'une surveillance, notre projet de loi prévoit la fusion des trois instances consultatives préexistantes – Commission du génie génétique, Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et Comité de biovigilance – au sein d'un ensemble unique, le Conseil des biotechnologies.
Dans l'état actuel de nos réflexions, celui-ci pourrait être rattaché aux ministres chargés de la recherche, de l'agriculture et de l'environnement, et constitué de deux sections. La section scientifique serait composée de personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines se rapportant au génie génétique, aux sciences agronomiques, à la protection de la santé publique et aux sciences appliquées à l'environnement. La section économique et sociale serait composée de représentants de la société civile : représentants d'associations de consommateurs, d'associations de prévention de l'environnement, de personnes malades, de la production industrielle et agricole, de la transformation et de la distribution, personnalités compétentes en sciences humaines et personnalités scientifiques.
Vous l'aurez compris au travers de mon intervention, je considère que la recherche en biotechnologie végétale est un atout stratégique pour notre pays. Je crois fondamentalement en la nécessité de soutenir une recherche de haut niveau, source d'innovation végétale et gage d'une agriculture dynamique et d'un secteur agro-industriel fort et structuré. La recherche en génomique végétale a besoin d'essais au champ pour valider ses découvertes. Ces essais, réalisés dans des conditions de sécurité sanitaire et environnementale exemplaires, doivent pouvoir être menés à bien en toute sérénité dans le cadre strictement défini par la loi.
L'arrêt des recherches en biotechnologie végétale nous placerait, au bout de quelques années, dans une dépendance technologique complète vis-à-vis de l'étranger. La France ne peut accepter de prendre ce risque. Elle doit se mobiliser et amplifier son effort de recherche afin de garder son indépendance et préparer son avenir dans un monde ouvert.
En un mot, plus de recherche sur tous les aspects touchant aux OGM, plus d'information et de transparence, un cadre de travail harmonisé et pacifié, voilà les objectifs du ministère de la recherche.
M. le Président : Merci pour toutes ces précisions. Je note que vous avez répondu à notre attente en soulignant que vous étiez ouvert à l’idée que les conclusions de notre mission d’information puissent contribuer à enrichir le projet de loi que le Gouvernement soumettra prochainement au Parlement.
S’agissant de ce texte, avez-vous une idée de la date à laquelle nous pourrons l’examiner, étant précisé que la mission doit rendre ses conclusions le 15 avril prochain, et confirmez-vous que le ministère chargé de piloter cette transposition sera bien celui de la recherche ?
Par ailleurs, les expérimentations en plein champ ont subi des « avatars », pour reprendre votre expression. Selon vous, les conditions dans lesquelles elles ont été autorisées étaient-elles satisfaisantes ? Les commissions de régulation ont-elles suffisamment bien joué leur rôle pour que nos compatriotes soient rassurés ? Un certain nombre d’entre eux ont pensé que non, puisqu’ils ont été « faucheurs volontaires ».
M. François d’AUBERT : Le Parlement doit suspendre ses travaux durant quinze jours au mois de mai, en raison du référendum. Cela renvoie donc la discussion du projet de loi soit au mois de juin, soit à la rentrée d’octobre, sachant que l’ordre du jour d’une éventuelle session extraordinaire au mois de juillet n’appartient pas au Gouvernement. Quoi qu’il en soit, il me paraît indispensable que le Parlement adopte cette transposition le plus rapidement possible, ainsi que les dispositions complémentaires que j’évoquais concernant la transparence
– obligation d'information et de consultation du public – et la fusion des trois instances consultatives en un Conseil des biotechnologies composé de deux sections.
S’agissant du rôle des commissions de régulation, il est difficile de porter un jugement. Je constate que c’est en 1999 que l’on a mené le plus d’expérimentations en plein champ. Depuis, elles n’ont cessé de décroître, puisque leur surface est passée de 85 à 7 hectares, soit une réduction de plus de 90 %. Une concertation plus large aurait-elle fondamentalement changé la donne ? Je n’en suis pas sûr. La politisation du débat a été telle que la concertation, quelle que soit son ampleur, n’aurait pas pu éviter que de petits groupes très militants procèdent à des destructions d’essais, malgré toutes les précautions dont ceux-ci étaient entourés. A cet égard, j’ai été particulièrement choqué par la destruction d’essais à visée thérapeutique dans la région de Clermont-Ferrand.
M. le Rapporteur : Nous avons entendu, tout au long de nos auditions, beaucoup de chiffres et de données, de l’exactitude desquels nous avons parfois tendance à douter, tant ceux qui les avancent manifestent de passion. Que penseriez-vous de la création d’un organisme qui, placé sous la tutelle des pouvoirs publics, serait chargé de diffuser l’information sur les expérimentations, mais aussi d’authentifier les données scientifiques qui peuvent nous être apportées ?
M. François d’AUBERT : On a besoin d’observatoires dans beaucoup de domaines. On ne se prive d’ailleurs pas d’en créer. Je pense que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques pourrait tenir un tableau de bord concernant les essais réalisés en France ou à l’étranger. Il est vrai que le débat est alimenté par beaucoup d’informations, et que les observations scientifiques doivent être rassemblées et réactualisées en permanence. Les organismes prévus par la loi pourront y pourvoir. En ce qui concerne certaines plantes, l’impact des OGM est d’ailleurs assez bien connu, par exemple pour le soja et le maïs.
M. le Président : L’idée de créer un Conseil des biotechnologies composé de deux sections a déjà été proposée par plusieurs rapports mais la question se pose du fonctionnement de ces deux sections qui, étant composées de manière très différente, pourraient donner deux avis très divergents sur un même sujet. Il me semble que la section scientifique devrait procéder à une évaluation technique, tandis que la section représentant la société civile devrait plutôt se prononcer sur l’opportunité économique et sociale du projet. Dans un second temps, le Conseil se réunirait en session plénière pour donner un avis final, sur lequel le ministre s’appuierait pour prendre sa décision.
M. François d’AUBERT : A priori, nous vous proposerons de prévoir que chacune des deux sections puisse rendre un avis mais un conflit entre les deux sections n’est effectivement pas impossible. Pour l’instant, ce problème n’est pas tranché et les propositions de votre mission d’information sont les bienvenues.
M. le Rapporteur : Pouvez-vous préciser pourquoi le projet d’essai portant sur les plants de vigne transgénique n’a pas reçu d’autorisation ?
M. François d’AUBERT : L’INRA estimait que, compte tenu de l’âge des pieds de vigne, ces essais auraient pu aboutir à la mise au point d’une solution intéressante mais il n’y a pas eu de véritable consensus ni au niveau local, ni parmi les professionnels de la vigne. Toutefois, la décision n’est pas définitive, le ministre de l’agriculture ayant seulement décidé un report de l’autorisation. Il s’agissait d’une décision d’opportunité, liée au contexte général – des destructions avaient déjà eu lieu dans la région – et aux réticences de la profession.
M. le Président : Mme Marion Guillou, présidente de l’INRA, que nous avons auditionnée, a estimé que l’on était arrivé à un consensus au niveau local, qu’il n’y avait pas de danger et que cette expérimentation était importante, mais qu’effectivement l’essai n’avait pas été autorisé en raison du contexte général.
M. François d’AUBERT : J’ajoute que le chercheur de l’INRA qui pilotait le projet, M. Marc Fuchs, l’un des meilleurs spécialistes de la vigne, est parti aux Etats-Unis. Son départ n’est peut-être pas dû au seul fait que cet essai n’a pas été autorisé mais le fait est qu’il a quitté la France.
M. Gérard DUBRAC : Nous avons, à plusieurs reprises, constaté que le grand public s’interroge sur le processus de décision concernant les OGM. Aussi, je m’interroge sur la capacité d’un conseil – dont les compétences s’étendraient à l’ensemble des biotechnologies, de surcroît placé sous la tutelle de plusieurs ministres – à clarifier le mécanisme des décisions dans l’esprit d’un public qui attend des décisions claires et rassurantes.
M. François d’AUBERT : Le problème est celui de la confusion. Alors qu’actuellement, il existe trois instances consultatives pouvant donner une impression de dispersion, un ensemble unique me semble préférable.
La crédibilité de l’ensemble dépendra de la sécurité du système qui est déjà sûr
– même le plus sûr du monde –, mais que nous pouvons rendre encore plus sûr. Le problème est que nous avons affaire à des peurs irrationnelles se nourrissant de la confusion. On mélange les questions relatives à la dissémination et celles concernant la santé. On mélange les OGM à usage agricole et ceux à usage thérapeutique. On mélange les problèmes qui se posent à une agriculture développée et ceux auxquels ont à faire face les pays du tiers-monde. Le travail d’information est immense mais tous les pays sont confrontés à ce type de problèmes éthico-sociétaux. Au Royaume-Uni, par exemple, le problème majeur porte actuellement sur l’expérimentation animale, à laquelle l’opinion publique britannique est très hostile. Des groupes très militants ont recours à une violence extrême et interdisent pratiquement toute expérimentation animale. Il en est de même des nano-sciences.
Pour revenir aux OGM, il faut mettre l’accent sur les espoirs suscités par la thérapie génique, et pour l’agriculture, si je ne me prononce pas sur leur intérêt dans des pays autres que ceux du tiers-monde, pour ces derniers cet intérêt me paraît évident.
M. François GUILLAUME : Vous avez souligné les conséquences désastreuses des destructions d’essais qui entraînent le départ des chercheurs de notre pays – c’est d’ailleurs également vrai en Belgique –, ceux qui ne partent pas risquant par ailleurs de s’orienter vers d’autres thèmes de recherche. Ne faut-il pas craindre également que le Gouvernement ne réduise les crédits destinés aux biotechnologies ? Je constate déjà que personne n’a réclamé la création d’un pôle centré autour des biotechnologies.
Nous avons parfaitement compris que le Gouvernement est favorable à la recherche fondamentale, notamment sur le génome, ainsi qu’aux expérimentations en plein champ et je suis favorable à la fusion des trois instances consultatives en une seule instance. Mais quand celle-ci aura évalué ce que d’autres ont déjà évalué, par exemple la totale innocuité de certains OGM, serez-vous prêt à prendre une décision d’autorisation de production, même si d’autres pays de l’Union européenne ne le font pas ?
M. François d’AUBERT : Au chapitre des inconvénients de la situation actuelle, figurent les problèmes de notre filière semencière – la deuxième au monde – et je note d’ailleurs que ceux qui nous expliquent que les OGM sont aux mains de multinationales diabolisées de l’« agro-business » oublient que Limagrain est une coopérative agricole.
S’agissant des crédits de recherche consacrés aux OGM, nous comptons maintenir, voire amplifier, notre niveau d’engagement budgétaire. L’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ne subira pas de diminution des crédits. Par ailleurs, l’Agence nationale pour la recherche (ANR) peut utiliser deux lignes de crédits : la ligne « Santé, agriculture, alimentation » et celle consacrée à la recherche environnementale. L’effort sera poursuivi.
Les expérimentations peuvent avoir pour finalité la création de nouvelles variétés. Elles peuvent aussi viser à des applications en thérapie génique. S’agissant des nouvelles variétés, je ne peux pas dire si la recherche permettra d’en exploiter utilement en France mais il me semble évident que la recherche sur les OGM peut profiter aux pays les plus pauvres, et donc s’inscrire dans le cadre d’un co-développement piloté par l’Europe. Il faut citer aussi les possibilités d’applications environnementales, par exemple la dépollution des sols.
M. André CHASSAIGNE : Plusieurs personnes auditionnées nous ont dit que la toxicologie française était en souffrance avec, en tout et pour tout, quarante professeurs et que, dans ces conditions, il était impossible de se livrer à une recherche complète, en particulier sur les risques d’évolution du gène, ou encore sur les risques d’allergie.
Vous avez dit, par ailleurs, que la recherche se développe mieux dans le cadre du partenariat public/privé, mais le président du directoire de Génoplante nous a dit que l’objectif de cette recherche est commercial et qu’il s’agit d’améliorer la productivité en agriculture. Ne risque-t-on pas de limiter le champ de la recherche à ce qui est susceptible d’augmenter la productivité, la rentabilité, la compétitivité et, dans ce contexte, la santé publique ne risque-t-elle pas d’être sacrifiée ?
M. François d’AUBERT : Sur le premier point, je ne crois pas qu’il faille installer dans l’esprit de la population l’idée que les OGM sont potentiellement des produits toxiques. Il n’y a pas de raison particulière de les soumettre, en plus de toutes les précautions qui sont prises, à un passage devant des commissions chargées d’évaluer la toxicité.
Nous manquons effectivement de spécialistes en toxicologie, mais aussi de spécialistes en biologie végétale, ce problème concerne tous les domaines de recherche. Comme chacun sait, la recherche est sujette à des phénomènes de mode et si des signaux sont donnés sur l’ampleur de l’effort que nous sommes prêts à consentir, il est probable que la biologie végétale et la toxicologie attireront à nouveau les jeunes chercheurs.
S’agissant des partenariats public/privé, ils sont très équilibrés et ce système mixte intègre beaucoup de recherche fondamentale. On ne peut pas dire que la recherche soit « pilotée par l’aval ». Cela ne correspond d’ailleurs pas à la vocation de l’INRA.
M. le Président : Les OGM sont sans doute les aliments qui ont été le plus étudiés. Mais le passage au crible de la toxicologie est vraiment important parce que certains OGM fabriquent une protéine nouvelle, dont il importe de savoir si elle a des effets toxiques pour l’homme. L’étude toxicologique est également importante dans l’évaluation des gènes de résistance aux herbicides, puisque ceux-ci peuvent avoir des effets toxiques. Mais il est vrai que nous devons éviter d’installer l’idée que les aliments OGM seraient assimilables à des médicaments.
M. François d’AUBERT : Si certaines protéines peuvent être des toxines, c’est une question qu’il faut se poser préalablement à la mise au point d’un OGM – et qui est actuellement posée –, mais on ne peut pas passer tous les produits OGM au crible d’une analyse de toxicité identique à celle conduite pour un médicament en phase 1 ou en phase 2.
En fait, chaque OGM est différent des autres. Certaines variétés sont moins disséminantes que d’autres. Certaines peuvent produire une toxine. Pour les OGM à usage agricole, il importe de veiller à assurer la traçabilité.
M. le Président : Le débat autour des OGM a commencé en 1998. En 1999, beaucoup d’essais étaient en cours, puis le nombre d’expérimentations a chuté, et l’opposition à la recherche en plein champ s’est durcie. Aujourd’hui, selon plusieurs personnes auditionnées, la recherche en biologie végétale est sinistrée.
Deux jeunes chercheurs en thèse à l’INRA de Toulouse n’ont pu achever leur travail de recherche qu’avec le financement d’un laboratoire de l’université de Wageningen aux Pays-Bas, qui leur a été accordé en cinq jours, alors que les financements avaient été refusés en France. Après publication de leur découverte dans la revue Science – l’une des deux plus grandes revues scientifiques mondiales –, l’un d’eux travaille aujourd’hui dans le Wisconsin, où il a pu disposer de 500 000 dollars pour créer une équipe de recherche. L’autre a été engagé par Biogemma dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’achève le 15 mai prochain. Il nous a écrit une lettre émouvante, que nous annexerons à notre rapport. Le 16 mai, ce post-doctorant sera peut-être au chômage, ce qui veut dire que notre recherche se privera peut-être de ses talents.
La situation étant gravissime, ne pensez-vous pas qu’il conviendrait d’élaborer un plan visant à ce que les chercheurs que nous avons formés, qui nous ont coûté entre 150 000 et 200 000 euros, reviennent en France, soit dans la recherche publique ou privée, soit pour créer une entreprise ?
M. François d’AUBERT : La situation de la recherche en biologie végétale me préoccupe beaucoup. Dans tous les pays du monde, la recherche sur les OGM est considérée comme une recherche de pointe, en raison de ses retombées agronomiques immédiates, mais surtout pour les espoirs qu’elle fait naître dans les domaines de la thérapie génique et de la protection de l’environnement. Je comprends qu’un jeune chercheur se sente mal à l’aise dans une ambiance qui n’encourage guère ses recherches. Nous tentons d’enrayer cette tendance, au travers des programmes et des priorités de l’INRA, mais aussi par le biais des priorités retenues pour l’ANR, laquelle finance des projets bien identifiés.
S’agissant des entreprises, votre proposition est intéressante. En matière de biotechnologies, nous devons faire preuve de volontarisme. C’est pourquoi le Gouvernement prépare un plan de relance et de développement des biotechnologies. Les initiatives prises en ce sens ont donné des résultats mitigés en Allemagne, plutôt bons au Royaume-Uni, sans doute parce que le développement de ce secteur implique une entente avec la société. En France, certains équipements pourraient faire l’objet d’une mutualisation. Je pense à des usines biologiques produisant de la matière première, telles que le centre de biotechnologies de Novartis à Huningue.
M. Philippe FOLLIOT : Disposez-vous de chiffres relatifs aux montants des crédits consacrés aux recherches portant sur les conséquences de l’utilisation de pesticides et insecticides dans l’agriculture traditionnelle, tant du point de vue environnemental que pour la santé humaine ?
M. François d’AUBERT : Je pourrai vous communiquer des chiffres précis, que je n’ai pas sous la main.
L’INRA conduit des recherches sur ce thème, de même que le CNRS et l’INSERM, ainsi que les universités. C’est important car on ne découvre les effets toxiques de tel ou tel produit qu’en menant des recherches.
Je voudrais préciser que sur la ligne « Energie et développement durable » du budget de l’ANR, 106 millions d’euros sont engagés, dont 42 millions seront dépensés en 2005. Sur la ligne « Santé, agriculture, alimentation », 200 millions sont engagés, dont 100 millions seront dépensés cette année. Il est évident que la recherche sur les OGM – et donc sur leurs éventuelles conséquences pour l’environnement – aura une place importante dans l’utilisation de ces crédits.
M. André CHASSAIGNE : Il semble que des négociations vont se tenir dans le cadre de l’OMC sur la définition du brevetage. Selon la conception américaine, l’invention de l’utilisation d’un gène devrait donner lieu à un brevetage sur l’ensemble de la chaîne gène/fonction/utilisation, contrairement au système du certificat d’obtention végétale qui ménage une plus grande souplesse dans l’utilisation des résultats de la recherche. Des discussions sont-elles menées au niveau européen, et pensez-vous qu’il sera possible d’avancer vers une conception du brevetage du vivant permettant d’éviter une victoire de l’approche américaine et la domination économique qu’elle entraînerait ?
M. François d’AUBERT : Deux approches différentes existent, qui tiennent à l’origine même de la recherche sur les gènes.
Rappelons tout d’abord que les gènes ne sont pas brevetables. Ce qui l’est, dans certaines conditions, ce sont les fonctions des gènes. A l’époque des toutes premières recherches sur les gènes, aux Etats-Unis, il avait été envisagé qu’un brevet porte sur chaque fonction de chaque gène. Depuis, les choses se sont assouplies. Aujourd’hui, on considère qu’une nouvelle variété a été créée dès l’instant où existe une lignée stable. C’est l’un des grands principes de la propriété intellectuelle et industrielle dans le domaine de la génétique. L’approche américaine tient au mode d’organisation de la recherche aux Etats-Unis : beaucoup de recherches sont menées au sein des entreprises. De plus, celles-ci fréquentent les centres de recherche universitaire, détectent ainsi les brevets et les utilisent. Notre système du certificat d’obtention végétale, est beaucoup plus équilibré et le but est de faire en sorte qu’il puisse coexister au sein de l’OMC.
M. le Président : Je partage totalement votre point de vue. Un rapport a été remis en juin 2004 et le Parlement a adopté le 29 novembre 2004 le projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques portant transposition de la directive de 1998. Malheureusement, les vœux que vous venez d’énoncer n’ont pas été pris en compte dans ce texte. Celui-ci a fait avancer les choses dans certains domaines, notamment en adoptant le principe du privilège du sélectionneur, mais ne nous a pas fait progresser vers la garantie de l’accès de nos chercheurs et de nos industriels aux ressources génétiques, ni vers la reconnaissance internationale du système du certificat d’obtention végétale. Plusieurs personnes que nous avons auditionnées ont insisté sur la nécessité d’être très ferme sur ce dernier point dans les négociations internationales.
Etes-vous favorable à ce que la directive de 1998 soit révisée en ce sens ?
M. François d’AUBERT : Tout à fait. C’est un combat que nous partageons.
M. le Président : Je m’en félicite. J’ajoute que ce chantier est d’autant plus important que nous pourrons ainsi contribuer à dépassionner le débat sur les OGM. Beaucoup de critiques portent, en effet, sur le régime de propriété intellectuelle, certains agriculteurs craignant de se retrouver dans une situation de dépendance totale.
Enfin, M. le ministre, nous souhaiterions que votre cabinet nous fasse parvenir assez rapidement les chiffres concernant les crédits consacrés, au cours des dix dernières années, à la recherche en biologie végétale dans son ensemble, et à celle portant sur les OGM en particulier.
M. François d’AUBERT : J’y veillerai.
M. le Président : Je vous remercie, M. le ministre, de votre contribution aux travaux de notre mission d’information.
Audition de M. Dominique BUSSEREAU,
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité
(extrait du procès-verbal de la séance du 22 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Monsieur le ministre, nous sommes heureux de vous recevoir pour évoquer le difficile sujet des OGM dans le cadre de notre mission parlementaire, créée à l’initiative du président Jean-Louis Debré afin de préparer la transposition de la directive 2001/18/CE. Ancien combattant de ce sujet, j’ai hérité de la présidence de cette mission, en compagnie d’un rapporteur et d’une équipe au sein de laquelle nous avons su travailler en bonne entente. Nous avons déjà organisé plus d’une centaine d’auditions et effectué plusieurs voyages tant en France qu’à l’étranger.
M. Dominique BUSSEREAU : Permettez-moi en premier lieu de vous confirmer ma pleine disponibilité et celle de mes services pour vous permettre de mener à bien la mission d’information sur les enjeux et les utilisations des OGM dont vous êtes chargés.
Je suis accompagné de Mme Catherine Rogy, chargée de ces questions à mon cabinet, et de M. Eric Giry, chef du bureau de la réglementation alimentaire et des biotechnologies à la Direction générale de l’alimentation (DGAL), que vous avez déjà auditionné.
Je tiens tout d’abord à saluer l’intérêt du travail que vous êtes en train de réaliser. A en juger par les premiers éléments dont m’a fait part votre Rapporteur, les travaux de votre mission devraient nous apporter une aide précieuse au moment où nous aurons à prendre des décisions pour améliorer le dispositif existant. Nous partageons totalement votre souci d’une vision objective et constructive et d’une approche des problèmes la plus exhaustive possible.
Le ministère de l’agriculture joue un rôle central tant dans l’élaboration de la réglementation relative aux OGM que dans sa mise en œuvre.
Sur le plan international, nous participons activement à la négociation de la réglementation relative aux échanges internationaux d’OGM, dans le cadre du protocole dit de Carthagène, et à l’accès du public à l’information et à sa participation dans les processus de décision, dans le cadre de la convention d’Arhus.
Au niveau communautaire, le ministère de l’agriculture est l’autorité compétente pour les principaux instruments réglementaires encadrant les OGM, avec le ministère de l’écologie pour la directive 2001/18/CE relative à la dissémination des OGM dans l’environnement, et avec le ministère chargé de la consommation pour le règlement 1829/2003 relatif aux OGM ou leurs dérivés destinés à l’alimentation humaine ou animale. Le suivi de la réglementation communautaire est pour nous primordial, car c’est elle qui trace l’ensemble des conditions de la mise sur le marché de ces produits et de l’information des consommateurs.
Au niveau national, le ministère est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la réglementation sur les plantes génétiquement modifiées. A ce titre, il participe à la transposition, en cours, de la directive 2001/18/CE.
Parallèlement, le ministère est chargé de l’instruction des demandes d’autorisation d’expérimentation de plantes génétiquement modifiées au champ, organise l’information et la consultation du public ; il m’appartient in fine de décider d’autoriser ou non les expérimentations, après accord du ministre chargé de l’environnement.
Le ministère de l’agriculture assure également, avec le ministère de l’écologie, la tutelle de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) ainsi que son secrétariat. Cette commission indépendante constitue un élément important du dispositif d’évaluation des OGM.
En matière de contrôle, les services du ministère vérifient la conformité des essais d’OGM sur le terrain et contrôlent les semences importées.
Enfin, le ministère met en œuvre une surveillance biologique des plantes génétiquement modifiées cultivées, dont le but est de détecter tout effet non intentionnel.
Je voudrais maintenant insister sur quelques éléments qui, de mon point de vue, doivent forger l’approche française dans le cadre communautaire qui s’applique en la matière.
S’agissant tout d’abord de la recherche et du soutien à l’expérimentation, en particulier dans le domaine de l’agronomie, je suis convaincu que ni la France, ni l’Europe ne doivent déserter l’espace expérimental en matière d’OGM. Il est essentiel de conserver, voire de développer une recherche publique de haut niveau et de la doter de tous les moyens qui lui permettront de ne pas laisser le champ libre aux pays tiers.
S’agissant ensuite de la surveillance biologique du territoire, la loi d’orientation agricole, confortée, depuis, par la directive 2001/18/CE, a dès 1999 posé les bases légales pour la mise en place d’un système de surveillance dit de biovigilance permettant de détecter l’apparition de tout effet non intentionnel sur l’environnement lié à la culture de plantes génétiquement modifiées. Seuls ces suivis permettront de pallier le manque de certitudes et de gérer efficacement et de façon proportionnée les éventuels risques. Ce système s’est développé progressivement ces dernières années au point d’être devenu totalement opérationnel, alors même que le développement des cultures non expérimentales de variétés génétiquement modifiées en France se limite à 17,5 hectares de maïs en 2004, à comparer aux presque 3 millions d’hectares de maïs traditionnel, et à nos 33 millions d’hectares de surface agricole utile…
S’agissant enfin du sujet, complexe et éminemment politique, de l’information du public, la législation communautaire impose une consultation et une information du public préalables à toute autorisation d’expérimentation, mais laisse aux Etats membres le choix des modalités. Dans l’attente d’une transposition complète de la directive 2001/18/CE en droit national, la consultation du public est actuellement effectuée sur le site Internet interministériel www.ogm.gouv.fr pendant quinze jours, sans réelle base réglementaire. Une information du public en mairie suite à l’autorisation, au moyen de fiches d’information du public, est en revanche prévue dans la réglementation existante.
Parallèlement, les services du ministère chargé de l’agriculture ont mis en place une démarche d’information des maires concernés par les essais de recherche et de développement sur le territoire de leur commune. Précisons que cette démarche, poursuivie cette année, ne vise pas à recueillir leur avis sur les essais en question, mais à leur délivrer une information encore plus complète et à leur permettre ainsi de répondre, le cas échéant, aux interrogations et questions de leurs administrés. Tout en restant, comme bon nombre d’entre vous, décentralisateur dans l’âme, je considère que la prise de décision vis-à-vis de ces demandes d’autorisation doit rester une prérogative de l’Etat, afin de préserver une cohérence nationale en matière d’innovation.
Concernant les cultures d’OGM autorisés à la mise sur le marché, les Etats membres ont l’obligation de créer des registres accessibles au public mentionnant notamment leur localisation. La directive 2001/18/CE n’étant pas totalement transposée, ces registres n’existent pas. Toutefois, une déclaration des cultures est effectuée sur une base volontaire – il semble que pratiquement tout le monde s’y astreigne – auprès des services de la Protection des végétaux. Les surfaces d’OGM cultivés sont publiées chaque année dans le rapport d’activité de la Commission du génie biomoléculaire.
Sur la coexistence enfin, la Commission a adopté en juin 2003 des lignes directrices en la matière, laissant aux Etats membres le choix des stratégies nationales et des pratiques. Je pense pour ma part qu’il faut privilégier une approche la plus communautaire possible du problème.
En attendant, les services du ministère chargé de l’agriculture travaillent en étroite concertation avec les professionnels des filières concernées, afin de déterminer les modalités nécessaires à une coexistence effective des différents modes d’agriculture garantissant l’absence de tout préjudice économique pour l’une ou l’autre des filières. L’organisation spatiale des cultures et les mécanismes d’indemnisation des agriculteurs sont évidemment deux sujets de premier plan. Pour être applicable et effectif, le dispositif de coexistence doit reposer sur la notion de tolérance de seuils de présence fortuite acceptés par tous.
En résumé, il faut certainement mieux préciser les rôles respectifs de l’Union européenne et de la France et améliorer notre dispositif d’information : ou c’est trop, ou c’est trop peu. Les élus locaux ne disposent souvent que de données assez succinctes, alors même que ceux qui ont la faux à la main savent fort bien chercher et trouver l’information pour servir leurs fins.
M. le Président : Ni la France ni l’Europe ne doivent déserter l’approche expérimentale, avez-vous dit. Or l’expérimentation est de compétence nationale et il semblerait que la question de la contamination n’ait pas été prise en compte. Cette situation qui, pour les expérimentations, s’apparenterait à une approche « zéro contamination », vous paraît-elle possible ou existe-t-il une réglementation en la matière ?
Par ailleurs, nous avons entendu parler d’un essai en champ de cinquante porte-greffes de vigne à Colmar. Bien qu’ayant été entourée de toutes les précautions, qu’elle fait l’objet d’un très large débat public et reçu un avis favorable de la CGB, cette expérimentation de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) n’a jamais reçu l’autorisation du ministère de l’agriculture. Peut-on espérer voir cette situation de flou juridique se débloquer ?
Quid de la campagne d’essais 2005, en attendant la transposition de la directive ? Les dispositions transitoires que vous nous avez exposées pourront-elles s’appliquer dans la mesure où, théoriquement, la directive aurait déjà dû être transposée et appliquée ?
Enfin, un député du Lot nous a appris qu’un site Internet proposait des stages de formation à la désobéissance civile. Quelles mesures envisagez-vous de prendre cette année pour protéger les expérimentations ? Le préfet de la région Auvergne nous a confié qu’il n’avait pu disposer l’année dernière de forces de police suffisantes pour protéger l’expérimentation de Marsat, dont tout le monde reconnaissait l’intérêt, en raison d’autres manifestations concomitantes.
M. Dominique BUSSEREAU : Je laisserai à mes collaborateurs le soin de répondre à vos deux premières questions.
Pour ce qui est des considérations d’ordre public, j’ai remarqué que, durant les années précédentes, les réactions variaient selon les départements et la vigueur des préfets… Aussi ai-je demandé la tenue, dans les jours prochains, d’une réunion interministérielle, afin de mettre au point une doctrine de l’Etat républicain applicable sur tout le territoire national. Je trouverais très choquant qu’on laisse faire à certains endroits ce que l’on empêche dans d’autres. L’attitude de l’Etat doit être la même et appliquée avec les mêmes instructions du nord au sud et de l’est à ouest.
Je n’ai pas entendu parler de cette « école » de désobéissance civile. Comme toutes les formes d’incivisme ou de non-respect de la loi, la désobéissance civile tombe sous le coup de la loi. Il appartient à ceux qui ont connaissance de tels agissements – y compris les élus locaux, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale – de le porter à la connaissance des pouvoirs publics.
S’agissant de la campagne 2005, nous avons été saisis de quatorze demandes d’autorisations d’essais au champ portant toutes sur du maïs. Le calendrier prévisionnel pourrait être le suivant : enquêtes de terrain jusqu’au 30 mars ; du 4 au 18 avril, consultation du public – le communiqué de presse est prêt ; du 19 au 25 avril, bilan de la consultation et propositions de décision ; signature fin avril et envoi des fiches d’information au public début mai. Cela dit, je ne vous apprendrai pas que le maïs se sème généralement fin avril. Une délivrance trop tardive des autorisations compromettrait donc l’existence même de certains essais. Je tiens à ce que la campagne d’essais soit sécurisée et exempte de débordements inacceptables au regard de l’ordre républicain.
M. Éric GIRY : Pour ce qui est des cinquante porte-greffe de vigne, la procédure – évaluation du risque par la CGB, information du maire, consultation du public – a effectivement été menée jusqu’à son terme, mais le ministre de l’agriculture de l’époque, M. Gaymard, compte tenu de la conjoncture qui sévissait alors, marquée par une recrudescence des fauchages, a estimé qu’une autorisation serait inopportune, d’autant que les porte-greffe ne pouvaient être plantés à cette période de l’année. Aussi a-t-il préféré reporter sa décision.
M. François GUILLAUME : Sine die.
M. Éric GIRY : Effectivement.
M. le Président : Une nouvelle demande vous a-t-elle été présentée ?
M. Éric GIRY : Non, mais la demande originelle reste valable, tout comme la procédure conduite.
Mme Catherine ROGY : Les plants de vigne devraient être mis en place avant août.
M. Dominique BUSSEREAU : Etant à proximité d’un terroir AOC75, nous devons solliciter l’avis du centre INRA de Colmar et prévoir une concertation avec le monde vigneron, actuellement en but à de sérieux problèmes. Cette affaire mérite en tout cas d’être regardée de très près.
M. Éric GIRY : La notion de seuils d’étiquetage s’applique aux OGM destinés à la commercialisation. Les essais entrent, quant à eux, dans le cadre de la directive 2001/18/CE autorisant, comme son nom l’indique, la dissémination d’OGM, et non dans celui de la directive 90/219/CE qui traite du confinement. Il peut donc se produire une contamination par pollinisation croisée d’un essai OGM vers les champs situés en périphérie. Les préconisations de la CGB – castration ou ensachage, distances d’isolement de 200 mètres – ont précisément pour but de réduire ce risque au maximum. Il faut noter que non seulement ces distances d’isolement sont très supérieures à celles qui pourraient s’appliquer à des cultures de maïs GM destinées à la commercialisation, mais elles ont systématiquement été multipliées par deux dans la décision d’autorisation finalement rendue par le ministre, gestionnaire du risque. Toutes ces contraintes techniques ne sauraient évidemment garantir qu’aucune contamination ne risquera jamais de se produire mais tout est fait pour la limiter au maximum, sans oublier que les services régionaux de la protection des végétaux s’assureront de leur côté de la conformité du site aux prescriptions ci-dessus, des conditions de déroulement des essais et de la destruction des plantes une fois ceux-ci menés à terme. Parallèlement, le processus de biovigilance mis en place conformément à la loi d’orientation agricole de 1999 permet un suivi et un contrôle a posteriori. Autrement dit, le principe de précaution est appliqué, afin de limiter le risque au maximum.
M. le Président : Autrement dit, vous mettez en place une obligation de moyens, mais pas de résultat.
M. Éric GIRY : En effet. Mais pour l’instant, aucun des contrôles que nous avons effectués n’a fait apparaître d’effets indésirables.
M. le Rapporteur : Les informations sont parfois très contradictoires, chacun brandissant ses sources propres. Aujourd’hui encore, les résultats d’une étude émanant du ministère de l’agriculture anglais mettent en avant un danger pour la biodiversité ; hier, c’était une publication de M. Séralini sur les risques du Roundup sur la santé… Que pensez-vous de la création d’un organisme placé sous la tutelle des pouvoirs publics – ministère de l’agriculture ou autre, ou bien une tutelle interministérielle – et chargé de contrôler et de diffuser l’information sur les OGM ?
M. Dominique BUSSEREAU : La question de l’information qui est un élément de premier plan, surtout dans un sujet où l’irrationnel a une part certaine, a été notablement améliorée ces dernières années. Le site interministériel www.ogm.gouv.fr présente une série de fiches thématiques sur les OGM et une information assez complète sur les expérimentations aux champs avec les dossiers techniques, les avis de la CGB, les décisions prises, les fiches d’information du public et la liste des essais implantés. Pour ce qui est des mises sur le marché, l’information, conformément à la réglementation communautaire, relève de la Commission.
Reste, et les travaux de votre mission d’information tombent très bien, qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire pour informer le public, y compris pour ce qui est des connaissances scientifiques. Les informations détenues par l’INRA, le Centre national de recherche scientifique (CNRS) et autres organismes de recherche doivent être impérativement mises en forme pour devenir accessibles au public. J’ai rarement trouvé d’explications compréhensibles dans les publications pour la jeunesse, qui sont pourtant de bons vecteurs d’information civique.
Faut-il créer un organe d’information du public ? Ce ne pourrait être qu’un organisme interministériel, non exclusivement lié à l’agriculture, ou à la recherche, ou encore à la consommation. Veillons toutefois à ne pas multiplier inutilement le nombre d’instances appelées à intervenir sur les OGM. Si votre rapport contient des propositions susceptibles de contribuer à l’amélioration de l’information du public, je serai preneur et prêt à travailler avec vous, sitôt qu’il sera publié, sur toute mesure concrète propre à développer l’information tant des élus de terrain, souvent assez démunis, que du grand public, souvent dérouté, ou même des agriculteurs, pourtant très professionnalisés et très au fait sur le plan scientifique. La coopération pourrait à cet égard apporter les éléments dont elle dispose, souvent de grande qualité.
M. le Rapporteur : D’après nos informations, les services juridiques du ministère de l’agriculture se pencheraient actuellement sur le problème de la responsabilité en cas de contamination d’OGM. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
M. Dominique BUSSEREAU : Une étude réalisée par un cabinet privé a été rendue en mai 2004, à la demande du service juridique du ministère de l’agriculture, sur l’analyse des responsabilités civiles susceptibles d’être mises en cause du fait de la dissémination d’OGM. La question posée était de savoir s’il était opportun de légiférer, afin de permettre l’indemnisation des agriculteurs « conventionnels » dont les produits auraient été dévalorisés du fait d’une dissémination d’OGM.
En l’état actuel de notre droit, une telle indemnisation ne paraît pas possible, dans des délais raisonnables en tout cas, faute de pouvoir déterminer le responsable de la dissémination. Les Pays-Bas envisagent de créer une sorte de fonds d’indemnisation auquel contribuerait l’ensemble des opérateurs d’une filière donnée, à l’image des fonds de régulation mis en place dans le secteur des fruits et légumes pour gérer les périodes de crise. Je suis tout à fait disposé à poursuivre la réflexion dans ce sens.
Les Allemands ont, quant à eux, fait un choix politique en considérant systématiquement les producteurs d’OGM comme responsables d’une dissémination accidentelle, ce qui ne résout pas pour autant le problème de l’indemnisation. Les autorités allemandes partant du principe qu’il ne doit pas y avoir de présence fortuite d’OGM dans les semences conventionnelles, une telle règle serait difficile à appliquer en France où la coexistence prévaut, et mettrait gravement en cause la compétitivité de notre filière semencière et, partant, son équilibre économique. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas facile, faute de jurisprudence établie.
M. le Président : Les assurances nous ont affirmé qu’elles étaient prêtes à étudier un éventuel système d’indemnisation, à condition que les règles de seuils soient clairement fixées. C’est pour elles un préalable. Nous serons certainement amenés à traiter de cette question.
M. François GROSDIDIER : Le problème de l’information ne se limite pas à celui de l’organisme qui en dispose et la diffuse mais concerne également le contenu lui-même de l’information. Or non seulement l’information est distribuée avec parcimonie – il faut parfois faire appel à la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) –, mais les éléments fournis par la CGB et le ministère de l’agriculture sont souvent très partiels, la protection du secret industriel interdisant de faire connaître au grand public comme aux experts indépendants le résultat des tests fondant la décision… Ce silence alimente évidemment tous les soupçons, particulièrement dans un domaine où l’irrationnel tient une grande place. Jamais on ne parviendra à dissiper les malentendus et à établir la vérité en traitant le problème de l’information sous le seul angle des organismes chargés de la diffuser et non sous l’angle de la nature même des éléments accessibles au grand public.
M. Dominique BUSSEREAU : Votre assemblée peut s’honorer d’avoir créé la CADA, mais le fait de devoir en appeler à elle n’est jamais le signe d’un succès : c’est la preuve d’un refus de l’administration, pour des raisons parfois tout à fait légitimes. Quoi qu’il en soit, notre système d’information actuel ne me satisfait pas. Entre le trop et le trop peu, l’affaire n’est pas simple. Il faut aller plus loin sans pour autant donner le champ libre à des destructions sauvages. Quelle que soit la qualité de nos techniciens, il n’est pas facile de fournir à un maire tous les éléments d’appréciation en une ou deux heures… Je suis prêt à y travailler avec vous, sur la base des conclusions de votre rapport.
M. le Président : Pour ce qui est de la biovigilance, il nous a semblé, à travers nos déplacements, que les prescriptions de la loi d’orientation de 1999 – désormais confortées par la directive 2001/18/CE – sont très inégalement respectées. Qu’en est-il exactement ? Le système doit-il évoluer ? Le comité de biovigilance tel que prévu dans la loi de 1999 vous paraît-il finalement la meilleure solution ?
Par ailleurs, si l’on est tenu de déclarer les expérimentations, on n’est plus obligé de déclarer les cultures, sitôt qu’une plante est autorisée. La biovigilance ne supposerait-elle pas la persistance d’un système de déclaration des cultures OGM, au moins pendant un premier temps ?
M. Dominique BUSSEREAU : La loi d’orientation agricole de 1999 a défini le cadre d’une surveillance biologique du territoire, laquelle s’effectue par le biais des Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF) et des services de la protection des végétaux. Comme le prévoit le Code rural, une surveillance générale peut ainsi s’exercer sur tout type de parcelles, ainsi que des actions de surveillance spécifiques conduites sur des surfaces limitées et pendant des périodes déterminées.
Depuis 2004, les démarches engagées visent prioritairement à la définition et au suivi d’indicateurs biologiques permettant de déceler des évolutions anormales dans l’environnement des parcelles – jusqu’alors, les actions de biovigilance avaient plutôt porté sur l’entomofaune du maïs. Parallèlement, un observatoire de la flore des grandes cultures se met en place. Au total, le dispositif mobilise soixante agents et son fonctionnement coûte environ 600 000 euros par an.
Le comité de biovigilance ne s’est jamais formellement mis en place. Faute d’accord, dit-on, entre les ministères, les discussions se sont prolongées jusqu’au moment où s’est engagée la transposition de la directive qui suppose de réformer toutes les instances consultatives, y compris le comité de biovigilance. Le projet de loi en préparation prévoit la disparition du comité de biovigilance en tant que tel et son intégration au sein d’un Conseil des biotechnologies. Cela dit, son statut provisoire n’a jamais empêché le comité de biovigilance de fonctionner régulièrement, alors même que les surfaces de cultures de plantes génétiquement modifiées au titre de l’expérimentation au champ ou de la mise sur le marché sont restées globalement assez anecdotiques.
Sans attendre la mise en place définitive de la réforme prévue par le projet de loi, je suis très désireux de connaître votre avis sur la manière dont pourrait fonctionner le futur Conseil des biotechnologies appelé à remplacer le comité de biovigilance.
Les cultures autorisées ne font pour l’instant l’objet que d’une déclaration volontaire des producteurs auprès du ministère mais, de l’avis de nos fonctionnaires, les professionnels se plient tous volontiers à cette formalité. De fait, les cultures autorisées sont soumises au même dispositif de contrôle et de vigilance que les essais. Cela dit, le retard pris dans la transposition – phénomène général pour toutes les directives – nous oblige à fonctionner de manière un peu artisanale, conforme à l’esprit de la directive mais sans l’avoir transposée…
M. André CHASSAIGNE : Que pensez-vous des décisions prises par certaines collectivités, communes mais surtout régions, tendant à interdire les OGM sur leur territoire ? Dans quelle mesure ces décisions peuvent-elles être prises en compte ? Ne risquent-elles pas d’interférer sur le développement de certaines actions de recherche ? Par ailleurs, pouvez-vous être plus précis sur les mesures prises en cas d’arrachage ? Des instructions seront données, dites-vous. Lesquelles ?
Enfin, faites-vous une différence entre les cultures OGM à but pharmaceutique
– comme les essais de Meristem Therapeutics en Auvergne – et les cultures OGM à vocation purement agricole ?
M. Dominique BUSSEREAU : J’ai le privilège d’être élu local dans une région dont la présidente a fait voter une mesure de ce genre. L’adoption de telles délibérations ne me paraît pas conforme à l’application des lois de décentralisation qui ne prévoient pas ce type de compétence. Pour l’heure, les tribunaux administratifs sont en plein travail du fait de la prolifération des arrêtés anti-OGM et, dans le Gers, des référendums. Il faut attendre que la jurisprudence soit définitivement stabilisée au niveau du Conseil d’Etat et des cours administratives d’appel.
Assurer la sécurisation des biens, autrement dit des essais, me paraît nécessaire, avec évidemment le doigté que suppose une opération de maintien de l’ordre. Il est en tout cas essentiel que, dans tous les départements, les préfets et les gendarmes placés sous leur autorité agissent de la même manière. D’où mon souhait de voir tous les ministères concernés
– écologie, recherche, agriculture, intérieur, défense, justice – se mettre d’accord avant que ne vienne la saison où sortent les faux, sur la manière d’appliquer la même loi sur l’ensemble du territoire, autrement dit d’empêcher les actions sauvages, de quelque nature qu’elles soient.
S’agissant des expérimentations à visée thérapeutique, ceux qui tenteraient de s’y attaquer, alors qu’elles auront été autorisées, prendraient un risque politique considérable devant l’opinion publique : si l’on peut s’interroger, en tout cas dans nos pays développés, sur l’intérêt pratique d’un maïs résistant, il est difficile de contester le bien fondé d’essais à but pharmaceutique visant à faire progresser la recherche sur certaines maladies graves.
M. le Président : Pensez-vous que, sur un sujet tel que celui de la réglementation, l’abstention de la France à Bruxelles soit la bonne solution ?
Autre sujet très important : l’étiquetage. Les règles arrêtées à Bruxelles sont le fruit d’un compromis. Encore faut-il voir comment fonctionnera ce taux de 0,9 % et clarifier les règles applicables aux contaminations de cultures biologiques, aux autorisations de mise en marché, etc. Par ailleurs, on est obligé d’étiqueter les produits issus de plantes génétiquement modifiées, même si l’on ne peut y trouver le plus petit début de trace d’OGM : c’est le cas des huiles, de la lécithine, du sucre. Les Américains ont prévenu qu’ils nous attaqueraient au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) au motif que, dans le même temps, nous n’hésitons pas à recourir à des enzymes et des ferments extraits de bactéries génétiquement modifiées, mais non étiquetés, pour fabriquer notre pain, notre vin et nos fromages… Autrement dit, l’étiquetage obligatoire des ingrédients s’apparente pour eux à un obstacle non tarifaire et j’ai tendance à partager cet avis. On ne peut pas, par souci de compromis, accepter d’étiqueter OGM un produit qui n’en contient pas et ne pas étiqueter un ferment ou une enzyme extraits d’OGM… La direction générale « santé et protection des consommateurs » de la Commission est clairement responsable de cette confusion qui nous expose à de très fortes attaques des Américains. Auquel cas, deux solutions : ou bien nous étiquetons tout, comme c’est l’avis des Américains, et tous les aliments deviendront brutalement OGM au risque de semer la panique chez nos concitoyens, ou bien nous revenons sur cette obligation d’étiqueter les produits ne contenant pas d’OGM. Qu’en pense le ministre ?
M. Dominique BUSSEREAU : Je pense que vous posez une bonne question, à laquelle je ne peux répondre aussi directement aujourd’hui… Nous sommes actuellement en pleine négociation avec les Américains, sur toute une série de problèmes – indications géographiques, origines, etc. Autant dire que le sujet est grave et appelle une réponse mûrement concertée et réfléchie. Les Américains cherchent à passer rapidement sur les produits agricoles pour en venir le plus vite possible à ce qui les intéresse, c’est-à-dire les services et les produits industriels. Il faut rester très prudents et ne pas se donner des bâtons pour nous faire battre.
Par ailleurs, je voudrais dire que la France s’est rarement abstenue, et qu’elle se prononce au cas par cas, en fonction de ce que nous disent l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et la CGB.
Certains pays votent systématiquement contre : l’Autriche, le Luxembourg, le Danemark, la Grèce. D’autres font du cas par cas, d’autres enfin, comme la Suède, l’Irlande, la Finlande ou les Pays-Bas, ont toujours voté pour. Le nouveau commissaire chargé de ces questions, un Chypriote francophone – et francophile – souhaite que la Commission prenne davantage ses responsabilités en la matière. Bien que souvent partisan de la subsidiarité en matière agricole, je n’en appelle pas moins dans ce domaine à la mise en place d’une vraie législation européenne, avec des règles les plus complètes possible et des marges d’appréciation bien arrêtées par la réglementation.
M. Gérard DUBRAC : Vouloir éduquer toute la nation sur les OGM me paraît relever du vœu pieux sans répondre pour autant à une angoisse régulièrement nourrie par les destructions périodiques des essais en plein champ… Ne faudrait-il pas, à l’instar de ce qui se fait pour les médicaments, réserver au ministère le pouvoir politique et confier les aspects les plus techniques – autorisations de mise sur le marché ou d’expérimentations – à des commissions bien définies et capables de délivrer une estampille incontestable ? L’absence de confiance alimente toutes les craintes.
Nous avons vu aux Etats-Unis que bon nombre de chercheurs avaient bien avancé dans la création de molécules médicamenteuses par des plantes génétiquement modifiées. Un message très clair doit être passé à l’opinion publique : nous n’autoriserons jamais ce genre de choses sur des plantes alimentaires, faute de quoi toutes les dérives seront à craindre. Une position politique très nette à cet égard du Gouvernement serait de nature à rassurer les populations.
M. Dominique BUSSEREAU : Ce débat sévit dans toutes les formations politiques et je l’ai moi-même connu, au sein de la commission des lois, sous toutes les présidences : au nom de la protection du citoyen, faut-il faire prendre les décisions par des autorités indépendantes ou par le pouvoir politique ? Depuis une vingtaine d’années, quelle qu’ait été la couleur des gouvernements successifs, la tendance était à la montée en puissance des hautes autorités indépendantes, type ART76. Cette tendance lourde semble toutefois s’inverser dans le domaine de la santé : pour les maladies appelées à se développer : cancers liés à l’alimentation, affections liées à l’amiante, au mercure ou au plomb, la question est désormais posée de savoir si la décision ne doit pas relever du pouvoir politique, les autorités étant ramenées à un rôle de conseil.
Faut-il une haute autorité, instance d’expertise et de décision, ou plutôt des agences techniques dont les avis seraient portés devant le pouvoir politique, Parlement compris, voire l’opinion, la décision revenant au pouvoir politique en place ? Ce sont là deux conceptions du fonctionnement de notre démocratie. Après avoir connu la grande période des autorités indépendantes, on semble, dans toutes les formations politiques, revenir vers le principe d’une décision prise par le pouvoir politique qui s’appuierait sur l’avis d’instances indépendantes. Ajoutons que, pour les OGM, l’évaluation scientifique pourrait se doubler d’une évaluation socio-économique, le pouvoir politique, français ou européen, prenant ses décisions au vu de ces deux éléments. Quoi qu’il en soit, le débat n’est pas tranché. Votre travail et vos recommandations pourraient nous aider à le faire, tant il est vrai que l’une ou l’autre des deux options peut parfaitement se concevoir dans le cas qui nous occupe – sauf à renoncer à toute subsidiarité et à laisser l’Europe prendre seule la décision…
M. le Président : Jamais les Français n’accepteraient de voir la gestion de la crise confiée à une haute autorité. Une gestion de crise est par définition politique, tout comme la fixation des normes, quand bien même nous aurons toujours besoin d’agences pour préparer le travail.
M. le Rapporteur : Qui décide de la confidentialité de certaines études lorsque la CGB est saisie d’un dossier ? Est-ce la CGB elle-même ?
M. Éric GIRY : Non. La CGB reçoit un dossier dont certaines parties sont confidentielles et d’autres pas. Dans les demandes d’expérimentations comme dans les demandes de mise en marché, la confidentialité est souhaitée par le pétitionnaire et il appartient à l’autorité récipiendaire du dossier de juger du bien-fondé ou non de cette demande. Cette autorité compétente peut être, s’il s’agit d’un essai en France, le ministère de l’agriculture, ou le ministère du pays intéressé s’il s’agit d’un dossier d’autorisation de mise en marché dans un des vingt-cinq Etats membres.
Un contentieux est né entre Mme Lepage, qui a réclamé la diffusion d’une série de dossiers, et le ministère de l’agriculture. Nous les avons diffusés, mais en excluant les parties confidentielles. Le problème est que tous les dossiers en cause, qui nous ont été transmis par la Commission, avaient été déposés dans d’autres pays de l’Union européenne, et qu’il ne nous appartient pas de lever le caractère de confidentialité décidé par un autre Etat membre.
M. le Rapporteur : C’est parfaitement compréhensible. Nous avons eu connaissance en Afrique du Sud d’un différend de ce type opposant une firme et une Organisation non gouvernementale (ONG). Et celle-ci a perdu le procès…
M. Éric GIRY : Je ne sais si nous gagnerons. L’affaire est pendante devant la CADA. En attendant, nous respectons les critères arrêtés par la Commission et l’Etat membre dépositaire.
M. François GROSDIDIER : Même si je comprends parfaitement la logique du système, il n’en reste pas moins que le secret dont on persiste à entourer les résultats de tests effectués sur des rats nourris aux OGM est de nature à entretenir tous les soupçons. Le ministère de l’agriculture se refuse à lever une confidentialité au motif qu’elle a été décidée ailleurs…
M. le Président : Pas dans le cas présent, dans la mesure où une expérimentation suppose obligatoirement une décision française.
M. François GROSDIDIER : Dans ce cas, pourquoi refuse-t-on d’accéder à la demande du CRII-GEN, qui veut connaître les résultats des tests effectués sur les rats nourris aux OGM par Monsanto ? Les dossiers ont été communiqués par la CGB, mais il y manque l’essentiel ! S’agit-il d’un dossier français ou bien le ministère se retranche-t-il derrière une décision prise à l’étranger ?
M. Éric GIRY : Nous sommes dans le cadre de la procédure communautaire que nous sommes tenus de respecter.
M. François GROSDIDIER : Même pour ce qui touche à la communication des informations ? La santé de ces rats nourris aux OGM paraît difficilement relever du secret industriel… Nous nous retrouvons dans une impasse que j’aimerais comprendre.
M. Éric GIRY : Le CRII-GEN devrait s’adresser à l’Etat dépositaire du dossier.
M. François GROSDIDIER : A ceci près que les lois régissant l’accès aux documents administratifs ne sont pas les mêmes partout.
M. Éric GIRY : L’accès du public aux informations est désormais régi par une directive européenne. Quant aux critères de confidentialité, ils sont décrits à l’article 25 de la directive 2001/18/CE qui s’impose à tous.
M. François GROSDIDIER : N’est-ce pas en contradiction avec l’article 8 de la directive, lequel prévoit que si l'autorité compétente vient à disposer d'éléments d'information susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé humaine et l'environnement, elle évalue ces éléments d'information et les rend accessibles au public ? Et quand bien même l’article 25 prévoit que les autorités compétentes doivent respecter le secret industriel, en quoi les résultats de ces tests sur les rats sont-ils couverts par le secret industriel ?
M. Éric GIRY : Il n’y a pas que le secret industriel. C’est un problème d’épaisseur de trait
– importante – entre la légitime et nécessaire transparence dans l’information du public et la protection de la propriété intellectuelle, auquel vient s’ajouter, en application du paragraphe 2 de l’article 25, l’interdiction de nuire à la position concurrentielle.
M. François GROSDIDIER : Croyez-vous vraiment que l’état des organes des rats en question soit de nature à mettre en danger la propriété intellectuelle ou à mettre en péril une position concurrentielle ?
M. Éric GIRY : Nous n’avons pas à en juger. Il faudrait que le CRII-GEN le demande à l’Etat dépositaire et invite celui-ci à demander à Monsanto de revoir sa position. Sur tous les dossiers en cause, un seul est français. Le caractère de confidentialité nous avait été demandé par Syngenta, auquel nous avons redemandé de rejustifier le caractère confidentiel de l’élément dont Mme Lepage souhaitait avoir connaissance.
M. François GROSDIDIER : La décision appartient au ministère, pas au pétitionnaire.
M. Éric GIRY : Certes, mais dans le cadre d’un dialogue. Sur de telles problématiques, il n’existe pas de réponses toutes faites.
M. François GROSDIDIER : Votre réponse aurait-elle été la même si le dossier en question avait été déposé en France ?
M. Éric GIRY : Je ne peux présager de la réponse que nous aurions apportée.
M. le Président : Quel était le pays instructeur ?
M. Éric GIRY : Le dossier MON 863 avait été déposé en Allemagne, me semble-t-il.
M. le Président : Il vaudrait effectivement être le plus clair possible dans l’information du public. Dans cette bataille médiatique permanente, les opposants aux OGM n’hésitent pas à profiter du moindre élément. C’est de bonne guerre… L’objectif du CRII-GEN n’est pas d’apporter une information indépendante mais de s’opposer aux OGM. Cela dit, l’état de santé de rats au bout de 90 jours ne relève à l’évidence pas du secret industriel…
Mme Catherine ROGY : Le problème est qu’on peut faire dire tout et son contraire à ces informations brutes… On peut être évidemment pour la transparence, mais on peut aussi imaginer la panique que l’on peut créer dans le public en parlant d’un problème sur les rats…
M. François GROSDIDIER : C’est d’abord le silence qui crée la panique.
Mme Catherine ROGY : Il faudrait à tout le moins l’assortir de l’avis rendu par la CGB.
M. François GROSDIDIER : La plus anti-OGM des positions est celle consistant à répondre que l’état de santé comparé de ces rats est couvert par le secret industriel !
M. Éric GIRY : Soyons clairs : ces éléments confidentiels sont évidemment portés à la connaissance de tous les experts amenés à faire l’évaluation du risque. L’AFSSA a donné un avis positif sur la mise en marché. Quant à la CGB, elle a agi en toute transparence : après avoir émis des doutes et exigé des informations complémentaires, elle a fait appel à des experts externes internationalement reconnus avant de conclure définitivement en novembre 2004, après évaluation itérative en plusieurs étapes, que le MON 863 ne présentait pas plus de risques qu’un maïs conventionnel. N’oublions pas qu’il s’agit de données brutes, sur lesquelles seuls des experts peuvent se prononcer. Encore faut-il savoir qui se dit expert… Nous avons été jusqu’à faire appel aux spécialistes mondiaux de la physiologie du rein du rat !
M. François GROSDIDIER : Pourquoi le taire ?
M. Éric GIRY : Nous ne l’avons pas tu. Ajoutons que l’AESA elle-même, dans le cadre de son panel, est arrivée aux mêmes conclusions. Autrement dit, trois comités d’experts collégiaux travaillant indépendamment ont rendu des conclusions similaires !
M. François GROSDIDIER : Nous touchons un problème de fond : le pouvoir législatif a délégué à une série d’organismes ou autorités indépendantes le pouvoir de décision dans des domaines d’une certaine technicité.
Mme Catherine ROGY : En l’occurrence, il ne s’agit là que d’un pouvoir d’évaluation.
M. François GROSDIDIER : Sur le plan technique, évidemment. Reste que votre transparence ne vaut qu’entre les initiés chargés du dossier, alors qu’il nous revient de traiter de ce problème devant le public… Information brute ou pas, taire l’état de santé de rats nourris aux OGM pendant 90 jours peut satisfaire des experts ou des hauts fonctionnaires, mais certainement pas l’opinion ni probablement les élus qui ont des comptes à lui rendre. Je maintiens que cette procédure n’est pas de nature à garantir la transparence de l’information du public.
M. le Président : Nous devrions pouvoir donner à la CGB la possibilité de commenter les expertises, à l’exemple de ce qui se passe en matière sûreté nucléaire.
Mme Catherine ROGY : C’est ce que fait l’AFSSA.
M. le Président : Même si c’est le ministre qui prend la décision, la CGB devrait communiquer.
Une polémique vient d’être lancée par le CRII-GEN sur les dangers du Roundup, mettant immédiatement les OGM en cause dans la mesure où c’est le produit qu’on utilise le plus sur les plantes résistantes au glyphosate. Il est heureux que notre mission ait pu immédiatement demander un avis public et contradictoire sur cette question. Sitôt qu’une polémique se déclenche, le Parlement devrait pouvoir organiser systématiquement de telles d’auditions dans le cadre de ses commissions permanentes ou de l’Office des choix scientifiques. Et tous les parlementaires devraient pouvoir venir y poser des questions.
M. Gérard DUBRAC : Très bien.
M. le Président : Cela nous permettrait d’abord de jouer notre rôle de contrôle, mais également de démonter les faux procès ou, à l’inverse, de mettre à jour les vrais problèmes et de proposer des solutions.
Mesdames, messieurs, je vous remercie.
Audition conjointe de
M. Gilles-Éric SÉRALINI, chercheur en biologie moléculaire et membre de la Commission du génie biomoléculaire (CGB),
de M. Luc MULTIGNER, épidémiologiste à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
et de M. Thierry MERCIER, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 23 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Monsieur Séralini, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir car vous êtes depuis longtemps l’un des acteurs du débat sur les OGM. Après vous avoir entendu seul pendant un premier temps sur votre position concernant les OGM, nous inviterons MM. Thierry Mercier et Luc Multigner à débattre avec vous dans le cadre d’une expertise contradictoire sur les dangers du Roundup, couramment utilisé sur bon nombre d’OGM résistants au glyphosate, question traitée dans l’une de vos publications et qui a fait l’objet d’un article récent dans la presse.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : J’aimerais vous entretenir de trois points correspondant à autant de lacunes réglementaires dans l’évaluation des effets des OGM sur l’environnement et la santé : la traçabilité des expérimentations en plein champ, les tests sanitaires effectués sur OGM et l’évaluation des pesticides, particulièrement du Roundup dont nous débattrons de façon contradictoire.
La fabrication d’un OGM se déroule globalement en trois étapes. La première correspond à la modification génétique proprement dite, avec l’introduction d’une construction génétique certes connue, mais au hasard, en plusieurs copies ou en morceaux. A ce stade, l’événement de transformation, c’est-à-dire la façon dont s’est insérée la séquence d’ADN artificiel, n’est pas encore connu. La deuxième étape sera donc celle du tri des OGM obtenus, montrant le caractère agronomique attendu. La troisième sera celle de l’hybridation des meilleurs OGM retenus avec les meilleures variétés cultivées : un OGM est rarement commercialisé sous une seule version. Ces deux dernières étapes correspondent à l’essentiel des expérimentations en plein champ. La part des essais encadrés par des chercheurs pour étudier réellement les risques sur l’environnement et la santé est très faible. C’est seulement à la toute fin, une fois sélectionnées les variétés à commercialiser, que l’on procédera aux premiers essais sanitaires, et non – ou très rarement – dans le cadre des expérimentations dites de « partie B ».
Il n’existe pas de méthode homologuée, fiable et indépendante pour doser les OGM expérimentaux durant ces phases d’essais en plein champ. La firme connaît ce qu’elle a inséré, mais pas la manière dont cela s’est inséré. Elle peut, à la rigueur, le retrouver elle-même, mais pas les laboratoires publics ou indépendants, faute d’avoir accès à une traçabilité. Cinq laboratoires indépendants inscrits dans le réseau européen de dosage des OGM commercialisés nous l’ont confirmé et plusieurs industriels nous ont indiqué qu’il était très difficile de mettre au point une méthode de dosage propre à chaque OGM expérimental.
De ce fait, les pouvoirs publics n’ont pas les moyens de vérifier valablement l’efficacité des mesures d’isolement qu’ils préconisent – distance de séparation, présence d’une barrière de chanvre pour éviter la diffusion du pollen, etc. Aucun prélèvement n’est effectué en dehors du champ, afin de pouvoir doser précisément, selon une méthode homologuée indépendante, l’OGM expérimental et en mesurer la dissémination dans les champs avoisinants pour l’immense majorité des essais. Les méthodes d’isolement restent fondées sur des bases purement théoriques, alors même qu’elles devraient évoluer en fonction de la taille des parcelles, des vents et des variétés elles-mêmes.
Au demeurant, le problème des contaminations des cultures par les OGM expérimentaux dépasse largement la seule question des possibles croisements.
M. le Rapporteur : Mais comment peut-on mettre au point des méthodes d’isolement sans expérimentations ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Elles ont été déduites de certains modèles et de ce que l’on sait de la dissémination du pollen du maïs, par exemple. Rien n’a été fait sur les OGM expérimentaux.
M. le Président : Vos propos ne valent que pour les nouveaux OGM, et non pour ceux qui ont été autorisés sur le marché.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : En effet, je parle bien des OGM expérimentaux.
M. le Président : Bon nombre d’OGM expérimentaux ont les mêmes séquences d’insertion que les OGM commercialisés.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Cela peut arriver comme cela peut ne pas arriver.
M. le Président : Les amorces sont presque toutes les mêmes.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Pas dans les OGM expérimentaux. On n’utilise pratiquement plus les promoteurs du virus de la mosaïque du chou-fleur et l’on trouve beaucoup de séquences nouvelles, beaucoup d’insecticides nouveaux, surtout.
M. le Président : Dans la plupart des essais menés à ce jour, les amorces sont connues et on utilise souvent la même amorce.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Pas du tout. Certaines tolérances au glyphosate, par exemple, ne sont pas identifiables avec les méthodes applicables aux OGM commercialisés, tout simplement parce que l’on n’a pas utilisé les amorces classiques.
M. le Président : Mais les amorces sont décrites.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Pas pour les OGM expérimentaux. C’est justement la raison pour laquelle je dénonce le manque de traçabilité des expérimentations.
Non seulement il reste impossible de prouver, au moins dans plusieurs cas d’OGM expérimentaux, l’absence de diffusion effective, et donc de clore le débat, mais ce manque de traçabilité pose un deuxième problème, majeur, pour ce qui concerne les OGM à visée pharmaceutique – on l’a vu près de Clermont-Ferrand. Lorsqu’une plante a été modifiée pour produire un principe actif, il est impératif de savoir le reconnaître. Le problème s’est déjà posé aux Etats-Unis où du soja normal a été contaminé par un mélange avec un maïs produisant un vaccin porcin, au point que certaines régions ont interdit, depuis, les cultures d’OGM pharmaceutiques. L’utilisation du génie génétique en milieu ouvert oblige à une traçabilité parfaite des OGM pharmaceutiques. Le problème ne se pose évidemment pas en milieu confiné, à ceci près que le coût de construction d’une usine est autrement plus élevé.
M. François GROSDIDIER : Est-ce seulement une question de coût ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est essentiellement une question de coût. Il est parfaitement possible d’utiliser des cellules de plantes cultivées en milieu fermé. On peut parler d’une « externalisation du coût » du confinement vers le risque expérimental…
M. André CHASSAIGNE : N’est-ce pas également une question de volume ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Sans doute, mais cela reste lié à la question du coût.
M. André CHASSAIGNE : Peut-on réellement fabriquer en milieu fermé l’équivalent de ce que l’on produit sur quinze hectares ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On peut optimiser la production avec des incubateurs en continu. L’insuline, par exemple, est entièrement produite en milieu fermé.
M. le Rapporteur : On peut optimiser, mais pas faire exactement la même chose…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On peut faire exactement la même chose, avec des cellules végétales, animales ou encore des levures ou des bactéries, en milieu fermé.
M. le Rapporteur : Peut-on réellement, technologiquement, scientifiquement produire de la même façon en milieu confiné qu’en milieu ouvert et avec la même productivité ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Bien sûr. C’est simplement une question de coût et d’échelle. Cela relève de la concurrence entre les entreprises : pour la lipase gastrique, par exemple, Meristem entend clairement ne travailler que sur le maïs pour valoriser la production de Limagrain. Mais rien n’interdit à une autre entreprise de se servir de levures pour produire de la lipase gastrique, au besoin glycosilée différemment, dans des conditions concurrentielles. Le milieu ouvert pose le problème de la traçabilité du risque environnemental. On pourrait trouver un peu bizarre l’idée de produire un médicament non homologué dans une plante alimentaire en milieu ouvert, compte tenu du risque de diffusion dans l’alimentation : le recours à des maïs stériles n’empêche pas les mélanges.
M. le Rapporteur : Peut-on utiliser des plantes n’entrant pas dans la chaîne alimentaire, comme le tabac et, dans ce cas, quelle serait votre position ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Absolument. Cela s’est déjà fait avec le lin et le chanvre, par exemple. Dans ce cas, ma position dépendra des moyens de confinement mis en place pour éviter tout risque de mélange au cours du stockage, par exemple. Mais plus l’usine utilise de structures totalement dédiées – transport, stockage, etc. –, moins le milieu ouvert est rentable. Les Etats-Unis eux-mêmes se sont bien rendu compte de la difficulté de la chose.
M. le Rapporteur : Mais ils ont décidé de relancer leurs essais cette année…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Comme ils n’ont déjà pas beaucoup de traçabilité sur les OGM agricoles, on imagine le risque que crée l’absence de traçabilité pour les OGM pharmaceutiques.
M. le Rapporteur : Seriez-vous d’accord, sur le principe, si l’on utilisait des plantes n’entrant pas dans la chaîne alimentaire ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Ce serait déjà mieux. Mais cela ne règle pas pour autant tous les problèmes de traçabilité.
Deuxième point présentant des lacunes encore plus sérieuses sur le plan réglementaire : les tests sanitaires effectués sur les OGM d’ores et déjà commercialisés. Avec d’autres personnalités, je réclame depuis longtemps que les OGM destinés à nourrir 450 millions d’Européens de tous âges, malades ou bien portants, soient testés pendant au moins trois mois sur des rats de laboratoire.
Le rat est un modèle mammifère couramment utilisé pour étudier les effets des médicaments et des pesticides. La directive « pesticides » préconise de recourir à deux espèces de rongeurs et à une espèce de non rongeurs mais disposer d’un modèle bien établi ne serait déjà pas si mal.
Malheureusement, les premiers OGM commercialisés ont été soumis, au mieux, à des tests de 28 jours, comme l’a montré un bilan réalisé par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en 2000, tout simplement parce que la réglementation américaine des années quatre-vingt-dix n’en avait pas prévu. Les OGM étaient soumis surtout à des évaluations théoriques, en éprouvette – sur la digestibilité des protéines, par exemple –, et à des tests de toxicité aiguë. Venaient ensuite des tests dits d’alimentarité sur des animaux, afin d’en vérifier les effets sur la production de lait ou la conformation de la carcasse, par exemple, mais sans réellement examiner l’ensemble des données métaboliques comme on le fait pour un pesticide ou un médicament. Je sais par expérience – j’avais commencé ma thèse en étudiant l’effet de doses infimes d’aflatoxines et de cancérogènes chimiques sur des rats – qu’il est possible, au bout de quelques mois, de déceler des effets minimes, mais qui permettront de dépister une cancérogenèse à échéance de dix-huit mois, une réaction immunitaire ou encore un effet sur le système reproducteur.
Non seulement ces tests n’ont jamais été réalisés, mais certains experts s’y opposent encore aujourd’hui, les jugeant non pertinents. Ce n’est pas mon avis. Les déductions théoriques ne sauraient suffire dans le cas d’un produit destiné à la nourriture quotidienne, à plus forte raison lorsque 100 % des OGM commercialisés, à en croire les dernières statistiques de l’ISAAA77, sont destinés à tolérer ou à produire un pesticide, autrement dit des substances potentiellement porteuses d’effets secondaires sur l’organisme. La problématique « herbicide », particulièrement pour ce qui touche au Roundup, apparaît, à cet égard, totalement liée à celle des OGM. On peut, du reste, s’étonner, là encore, d’une stratégie qui, loin d’aider à se débarrasser de l’herbicide ou de ses métabolites, ne fera qu’amplifier les problèmes de résidus dans la chaîne alimentaire.
Or les tests à 90 jours réalisés par quelques sociétés – Monsanto pour l’essentiel et, pour une petite part, Syngenta qui pourtant s’en défend – montrent, de l’aveu même de leurs promoteurs, des résultats significatifs, à tel point que certains pays d’Europe ont réagi en demandant des clarifications et, pour certains, la publication des tests en question. Nous avons ainsi pu analyser plus de 5 000 pages que la CGB a dû envoyer au CRII-GEN, après saisie de la CADA. Mme Lepage a dû vous parler de cette affaire, reprise dans Le Monde d’hier.
La question est maintenant de savoir si ces résultats statistiquement significatifs impliquent ou non l’émergence d’une pathologie. Le minimum de l’honnêteté et de l’exigence scientifique commande de refaire ces tests et de les donner à expertiser à l’ensemble de la communauté scientifique.
On exige d’un scientifique qu’il publie ses travaux. On ne peut donc parler de débat sur les effets sanitaires des OGM si l’on ne publie pas ces tests. C’est à mes yeux un principe essentiel. Or les effets significatifs montrés par ces tests ressemblent fort, à mon avis, à ce que pourraient être les prémices d’effets de pesticides sur la santé. Sont plus particulièrement en cause les maïs Bt 11, NK 603, MON 863, le colza GT 73… Autrement dit, il ne s’agit pas d’un cas isolé. Raison de plus pour refaire ces tests, voire de les prolonger.
Evidemment, les entreprises ne manqueront pas de faire valoir que si on leur en demande trop, leur technologie ne sera plus rentable… Mais dans ces questions de santé publique, on se doit de séparer au maximum l’économie et l’exigence scientifique. On ne peut être sûr que des OGM soient sains si on ne les a pas testés pendant au moins trois mois.
Certains feront valoir que les Américains en mangent sans problème, mais cette réponse ne me paraît pas pertinente dans la mesure où il n’existe pas de traçabilité aux Etats-Unis. Si 56 % du soja et 17 % du maïs sont OGM, c’est bien que les sojas et les maïs ne sont pas encore tous génétiquement modifiés… Autrement dit, les gens en mangent de manière hétérogène, variable, plus ou moins progressive selon les endroits, les cultures et les saisons. S’il est établi que ces OGM ne sont pas un poison à court terme, ne risquent-ils pas, en revanche, de provoquer à termes des diabètes – on a relevé une augmentation du taux de glycémie chez les rats –, des problèmes immunitaires – les rats mâles nourris au MON 863 présentaient des anomalies dans les globules blancs –, voire des intoxications à long terme provoquant des cancers ou des maladies de la reproduction ? Aucune étude épidémiologique ou de toxicologie chronique ne permet de savoir ce qu’il en est réellement aux Etats-Unis. Après dix ou vingt ans d’OGM, je trouve particulièrement choquant que ces tests, les premiers du genre, ne soient pas communiqués de manière transparente et publique.
M. le Président : La question de la relation entre la localisation du point d’insertion de l'ADN artificiel et l’activation des gènes dits « dormants » a été maintes fois évoquée – j’en parlais déjà dans mon rapport de 1998 –, mais elle se pose également dans le cas de croisements classiques. Pourquoi s’inquiéter à propos des OGM de quelque chose dont on ne s’était jusqu’alors jamais soucié lors des croisements et des hybridations ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je n’ai pas vraiment évoqué ce point.
M. le Président : Si. Vous avez dit que l’on ne connaît pas la façon dont s’insère la séquence d’ADN artificiel.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Ce qui impose une traçabilité, comme on l’a fait pour les OGM commerciaux.
M. le Président : On sait maintenant qu’il y a plusieurs points d’insertion, sur lesquels on dispose désormais de plus en plus d’études. Autrement dit, le traitement de cette question a déjà bien avancé.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Pas sur la traçabilité des OGM expérimentaux.
M. le Président : La question est maintenant de savoir si l’on connaît les amorces utilisées dans les OGM expérimentaux ou pas – auquel cas on ne peut effectivement les tester. Or la commission de biovigilance nous a répondu que les amorces étaient testées et que nous étions capables, grâce à ces amorces, de mesurer les flux de gènes lors des expérimentations.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Parce que ces expérimentations portaient sur des OGM commercialisés.
M. le Président : Je ne parle pas des 17 hectares du test Arvalis, dont les amorces étaient connues et testées.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je maintiens que les amorces des OGM expérimentaux ne sont pas disponibles, car si les séquences sont effectivement déclarées au Gouvernement, aucun laboratoire indépendant n’y a accès pour les vérifier.
M. le Président : Les laboratoires d’Etat sont-ils capables de le faire ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : S’ils développent la méthode, ce qui prendra quelques mois.
M. le Président : Nous reposerons la question. Je suis pour ma part partisan d’un dépôt des amorces, afin que des tests puissent être réalisés par les laboratoires publics. Pour l’instant, on nous a toujours affirmé que les amorces étaient connues et que l’on était capable de les doser.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On en est capable, mais on ne l’a jamais fait pour les expérimentations car il faut plusieurs mois de travail. On le fait pour les OGM commercialisés ou en voie de commercialisation, y compris aux Etats-Unis, autrement dit dans les phases ultimes d’expérimentation. Mais dans le cas du maïs de Meristem ou des premiers tris, et particulièrement sur les OGM pharmaceutiques, c’est impossible.
M. le Président : On peut le faire par le biais de la protéine.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Si le principe est scientifiquement acquis, les méthodes n’en ont pas été développées ni standardisées. Cela a pris six mois à un an de travail aux laboratoires du réseau européen pour les OGM commercialisés. Et, en tant que membre de la CGB, je puis vous assurer que nous n’avons jamais analysé de dosages réalisés sur des OGM expérimentaux par le secteur public.
M. le Président : J’en déduis que vous n’êtes pas favorable aux expérimentations en champ…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Sans traçabilité, non.
M. le Président : Mais pour mettre la traçabilité en place, encore faut-il pouvoir la mesurer !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : En tant que scientifique, je ne puis être que pour l’expérimentation. Mais comprenez que ma réponse ne peut qu’être fonction des conditions de cette expérimentation, aujourd’hui non remplies. Et si elles l’étaient, l’affaire ne serait pas rentable, aux dires mêmes des entreprises concernées.
M. le Président : « Je suis favorable à un moratoire de cinq ans sur la commercialisation dans l’alimentation des OGM et des dérivés. Cela permettra d’apporter des réponses plus précises à ces questions », déclariez-vous en 1998.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Nous avons une partie des réponses.
M. le Président : Sept ans plus tard, estimez-vous qu’il faut encore plus de temps ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je confirme ce que j’avais déclaré. Mais si nous avons eu le temps, nous avons manqué d’exigence scientifique – et peut-être politique – en ne réclamant pas ces tests, en ne demandant pas qu’ils soient refaits quand ils posaient problème et en n’exigeant pas de les soumettre à expertise contradictoire. Pendant plus de dix ans, le seul expert extérieur de la commission était en fait choisi par l’entreprise pétitionnaire sur une liste de trois personnes proposées par le Gouvernement… Ce n’est donc plus une question de temps, mais de volonté.
M. le Président : Je suis pour ma part favorable à la déclaration des amorces. Dès lors, il devrait être possible de mettre rapidement les tests en place, d’autant que la plupart des marqueurs sont connus.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Si un client australien, par exemple, nous demande de prouver qu’il n’y a pas de résidus d’OGM dans un de nos grands vins, nous aurons beau lui répondre que c’est scientifiquement impossible, il sera en droit d’exiger le test. Et si nous n’avons pas le test de la vigne transgénique INRA, par exemple, personne ne pourra apporter la réponse.
M. le Président : L’expérience sur la vigne INRA n’a pas été faite.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : La vigne existe, en tout cas.
M. le Président : Mais les expériences n’ont pu être menées.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Peut-être pas cette année ni l’année dernière, mais des essais ont déjà été faits en plein champ, à Colmar, où ils ont été autorisés.
M. le Président : Le ministre vient de nous confirmer que ces essais, qui avaient reçu un avis favorable, n’ont toujours pas été autorisés.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Peut-être votre discussion ne portait-elle que sur les tout derniers essais. Depuis 1998, ils ont été autorisés et faits plusieurs fois, à ma connaissance.
M. André CHASSAIGNE : N’étant pas un scientifique, je voudrais savoir ce que vous entendez exactement par « traçabilité » ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est ce qui permet de suivre précisément l’OGM, par des méthodes scientifiques, de la fourche à la fourchette, afin de savoir si l’on est contaminé ou non, où il se trouve, et de pouvoir le doser.
M. le Président : La séquence génétique est introduite avec une séquence complémentaire d’ADN, dite amorce, qui est une suite de bases connues servant de marqueur. Encore faut-il que cette suite soit déclarée. J’ai pour l’instant toujours entendu dire que les amorces utilisées étaient les mêmes, et qu’il était donc possible de doser et de tracer. M. Séralini affirme que, pour certains OGM récents, on a utilisé de nouvelles amorces.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : De nombreux OGM expérimentaux ne parviennent pas au stade de la commercialisation et leurs séquences sont très différentes de celles des OGM actuellement commercialisés.
M. le Président : Si une expérience porte sur un nouveau procédé et que l’amorce n’a pas été déclarée, il sera impossible de mesurer une éventuelle contamination durant l’expérimentation.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : A plus forte raison s’il s’agit d’un médicament.
M. le Président : Qu’en disent vos collègues de la CGB ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : La CGB est par trop composée de biotechnologistes. Aussi est-elle plus portée à accompagner la réglementation des biotechnologies qu’à en freiner l’application… Aux yeux des industriels, la traçabilité est avant tout un moyen de leur mettre des bâtons dans les roues en interdisant les expérimentations en plein champ. Il arrive que l’on expérimente, pour les trier, 150 organismes génétiquement modifiés en même temps sur le même champ. Entre les séquences tronquées, inversées, répétitives, il est impossible de connaître avec certitude l’événement de transformation.
M. François GUILLAUME : Mais la phase du tri s’effectue en milieu confiné. On n’expérimente au champ que les OGM dont on pressent qu’ils apporteront une réponse positive à la question posée.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je puis vous assurer sur l’honneur que ce n’est pas toujours le cas.
M. le Président : C’est là un aspect nouveau qu’il nous faut examiner.
M. François GROSDIDIER : Je suis heureux que l’on entende enfin M. Séralini…
M. le Président : Le caractère génétique, inséré avec une amorce connue, peut s’installer en plusieurs endroits, parfois imparfaitement, sous forme de séquences tronquées ou, à l’inverse, redondantes. Seule l’expérimentation en plein champ permettra de sélectionner l’OGM le plus intéressant, qu’il sera possible, grâce à l’amorce, de « tracer » afin de déceler d’éventuelles contaminations.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : En effet.
M. le Président : Vous n’allez tout de même pas jusqu’à demander que l’on teste la totalité des possibilités de séquence dans un maïs à un moment donné de l’expérimentation…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Alors, ce moment donné de l’expérimentation devrait être confiné.
M. le Président : Non seulement vous ne pourrez plus sélectionner la plante agronomiquement la meilleure, mais le problème se pose exactement de la même façon dans la sélection classique. Sans parler de la sélection forcée par mutagenèse ou irradiation…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On peut toujours comparer à Tchernobyl !
M. le Président : Reste que ce sont les méthodes utilisées aujourd’hui et que vous ne les soumettez pas aux mêmes contraintes. Cela dit, vous confirmez bien que les séquences amorces sont connues.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Ce problème est particulièrement crucial pour les OGM pharmaceutiques. Personne ne peut dire au moment du tri si le principe actif non exprimé dans certaines conditions ne se diffusera pas dans d’autres. De même pour les OGM de troisième ou quatrième génération, qui produisent des insecticides non caractérisés ou des combinaisons de deux ou trois insecticides et de tolérances à l’herbicide, aux effets sur la santé encore inconnus. Il ne peut être question de les diffuser sans méthode de traçabilité. Que cela nuise ou pas à la rentabilité de la technique de sélection utilisée est un autre problème.
M. le Président : La traçabilité est mesurée grâce aux marqueurs, quand il y en a un, et aux amorces. Et pour ce qui est des OGM de troisième génération, je rassure mes collègues : nous les avons vus aux Etats-Unis, mais personne ne les a encore demandés en France.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Ils font partie des dossiers d’expérimentation en cours.
M. le Président : Pas en France.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je les ai moi-même rapportés !
M. le Président : Pas l’Herculex78, tout de même ! Je repose ma question : les amorces
– connues, s’entend – suffisent-elles pour mesurer la présence d’OGM ? Si l’amorce est nouvelle, vous soulevez un vrai problème.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Les OGM expérimentaux ont par définition des amorces nouvelles.
M. le Président : Pas toujours.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Lorsqu’il s’agit de nouvelles hybridations avec des variétés connues, on a une traçabilité. Mais pour les OGM véritablement nouveaux, il n’y en a aucune. La firme dépose évidemment des séquences à la CGB, mais personne ne développe des méthodes de dosage – il faut compter trois à six mois de travail – et aucun laboratoire indépendant ne peut le faire.
M. le Président : Je persiste à penser, comme cela nous a été dit, que les amorces d’insertion, y compris dans les OGM nouveaux, sont la plupart du temps des amorces connues.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Non, puisqu’elles sont couvertes par le secret industriel.
M. François GUILLAUME : Elles sont dans le dossier déposé à la CGB ! Autrement dit, elles sont connues, même si elles sont confidentielles !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Mais aucun laboratoire indépendant ne peut les avoir pour développer des méthodes de dosage. A qui vous adresserez-vous si votre voisin cultive un OGM médicament et qu’il vient à polluer vos cultures ? Comment mesurerez-vous la contamination possible ?
M. François GUILLAUME : On n’en est pas encore tout à fait là…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Si, depuis 1986 !
M. François GUILLAUME : La combinaison de plusieurs événements peut certes créer des interférences, mais commençons par régler les problèmes des OGM « simples »… Or les OGM qui peuvent ou pourraient être commercialisés dans d’autres pays du monde font l’objet d’un suivi parfaitement clair.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Absolument, et je demande le même suivi pour les expérimentations, notamment lorsqu’il s’agit de principes actifs potentiellement toxiques.
M. le Président : Il est vrai qu’en Chine, les amorces ne sont pas systématiquement déposées. Mais pour les OGM commercialisés ou expérimentés en France ou bien venant des Etats-Unis, il n’existe guère que trois ou quatre groupes d’amorces.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Depuis vingt ans, les OGM commercialisés se résument surtout à deux grandes plantes – le soja et le maïs – et deux caractères – la tolérance à un herbicide et la production d’un insecticide. Nous avons leurs amorces. Mais ce sont des OGM expérimentaux dont je suis venu vous parler.
M. le Président : Lesquels ? On n’a autorisé que des essais de maïs cette année. On a donc les amorces…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Nous n’avons pas les amorces du maïs Meristem. Et ce n’est qu’un cas parmi d’autres.
M. le Président : Je suis assez réservé sur la présence de substances médicamenteuses dans des plantes alimentaires mais nous avons les moyens de tester la lipase.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Sur le plan scientifique, oui. Encore faut-il les développer.
M. le Président : Nous sommes d’accord. Vérifier que nous avons bien la totalité des tests est une bonne suggestion. Cela dit, je maintiens qu’en France nous avons les amorces. Mais nous reposerons la question.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Entendons-nous bien : ces séquences sont bien déclarées à la CGB, mais aucun laboratoire indépendant ne développe les méthodes de dosage comme on le fait pour les OGM commercialisés.
M. le Président : Si l’amorce est la même…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Les amorces ne sont pas les mêmes, dans la plupart des cas tout au moins. Il existe de très nombreux insecticides Bt.
M. le Président : Le gène d’intérêt est évidemment différent. Autre chose est l’amorce complémentaire que l’on greffe en avant. Ce sont ces amorces qu’il faut déposer, afin d’être en mesure de réaliser les tests. Je demanderai à la CGB combien il existe actuellement d’amorces et si l’on est capable de toutes les tester dans des laboratoires classiques.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On en est capable, mais on ne l’a jamais fait. Les méthodes de dosage n’ont pas été développées par la CGB. C’est là qu’est la lacune, alors qu’on aurait pu ainsi vérifier l’efficacité des mesures préconisées.
M. le Président : On nous a montré une étude sur les dispositifs d’isolement du maïs, avec mesure des distances parcourues par le pollen…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On peut évidemment développer des modèles à partir des OGM commercialisés et les appliquer aux expérimentations.
M. André CHASSAIGNE : Nous sommes bien d’accord sur le fait qu’il ne saurait être question de lâcher dans la nature des gènes produisant des principes médicamenteux dangereux.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Et non homologués.
M. André CHASSAIGNE : Nous partageons tous votre souci. Mais n’y a-t-il pas une forme de dramatisation lorsque vous appelez à généraliser cette traçabilité à des OGM à but strictement agricole qui, d’après ce que nous avons entendu lors des auditions ou des visites sur le terrain, ne présentent pas les mêmes risques ?
M. François GUILLAUME : Très juste !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Des OGM agricoles diffusant deux ou trois insecticides, dont un non caractérisé et jamais testé sur cellules humaines, me paraissent poser un problème au moins aussi grave qu’un OGM produisant de la lipase gastrique.
M. le Président : Vous appelez à des tests d’alimentation sur 90 jours en rappelant qu’aucune étude épidémiologique sérieuse, avec des cohortes réellement représentatives, n’a jamais été menée. Gérard Pascal – comme bien d’autres – nous a dit exactement l’inverse, estimant que des tests plus longs ne conduiraient qu’à sacrifier inutilement des animaux, alors que dans bon nombre de pays, les bovins, les porcins et les poules sont depuis longtemps exclusivement nourris aux OGM sans jamais avoir manifesté de signes d’intoxication.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Nous débattons souvent de cette question. Si je souscris à son raisonnement pour ce qui est des risques à court terme – une intoxication aiguë par un insecticide, par exemple –, je ne peux le partager pour les risques à long terme, dont les pesticides sont souvent porteurs. Or ces risques, d’ordre immunitaire, hormonal, cancérogène, etc., ne peuvent être valablement évalués sans au moins une expérimentation animale adéquate. Des normes existent pour mesurer les effets collatéraux des pesticides chimiques ou des médicaments. Pourquoi n’en irait-il pas de même avec les OGM produisant ou tolérant des pesticides ?
M. François GROSDIDIER : A quels obstacles peut bien se heurter la mise en œuvre de cette mesure en toute transparence, alors même qu’elle paraît de nature à rassurer les populations ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : L’enjeu est économiquement majeur, car cela remettrait en cause la commercialisation de la plupart des OGM actuels. Dès 1998, les semenciers avaient prévenu qu’exiger sur les OGM les mêmes tests que sur les pesticides leur enlèverait toute rentabilité. La valeur ajoutée d’une semence est bien plus faible que celle d’un pesticide chimique : non seulement elle est vendue moins cher, mais elle est commercialisée pendant moins longtemps. Le prix de ces tests – les tests de mise en marché sur un médicament peuvent coûter jusqu’à 250 millions d’euros – anéantiraient tout espoir de retour sur investissement.
Des tests sur trois mois ont été pratiqués. S’ils montrent des effets significatifs, pourquoi ne veut-on pas les publier ? Parce que la réaction logique sera de les rendre obligatoires. Philippe Gay et Novartis ont toujours soutenu qu’il y allait de la rentabilité de leurs semences. Peut-être se trompent-ils : si ces tests étaient banalisés, probablement coûteraient-ils moins cher. Quoi qu’il en soit, nous sommes bel et bien en présence de pesticides non testés.
M. le Président : Gérard Pascal et tous les participants à la table ronde sur les enjeux sanitaires ont soutenu que des expériences allongées à 90 jours n’apporteraient aucune information statistique supplémentaire sur la toxicité. A 90 jours, nous ont-ils dit, un rat présente des signes de vieillissement.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Un rat vit deux ans !
M. le Président : …en ce sens qu’il se met à présenter des anomalies.
M. François GROSDIDIER : Si cela ne sert à rien, pourquoi Monsanto fait-il des tests à 90 jours ? Il y a une incohérence !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Rappelons que Gérard Pascal siégeait dans la commission qui a autorisé des OGM, et notamment le Bt 176, sans aucun test à 90 jours… Mais peut-être craint-on de remettre en cause la crédibilité de certains ! Sans entrer dans ces considérations, je maintiens qu’il n’y a aucune raison logique à ne pas effectuer ces tests, obligatoires pour les médicaments et les pesticides chimiques, sur des plantes produisant ou tolérant des pesticides.
M. le Président : Visiblement, vous êtes en désaccord… Gérard Pascal a rappelé qu’il était parfaitement possible de détecter d’éventuels effets toxiques sur les cohortes de porcs exclusivement nourris aux OGM.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Aucune étude épidémiologique provenant des Etats-Unis ne nous est fournie…
M. le Président et M. François GUILLAUME : Et d’Espagne ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI :… ni davantage d’Espagne. Que les animaux ne semblent pas mourir dans les fermes, j’en suis d’accord. Mais quid des effets à moyen et long termes sur les mammifères ?
M. le Président : Je suis d’accord avec M. Grosdidier sur le fait que ces tests doivent être rendus publics. Reste que tous les spécialistes de l’AFSSA, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) et la CGB, dont les avis divergeaient quelque peu au début de cette affaire, se sont accordés pour dire que des tests prolongés à 90 jours ne donnaient pas de résultats pertinents, le rat ayant coutume, à cet âge, de développer des anomalies rénales.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : A trois mois, un rat est encore loin de son espérance de vie…
M. le Président : Mais se met-il, oui ou non, à présenter des anomalies ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : J’ai déjà entendu ces arguments. Dans toute expérience de toxicité, on utilise des groupes témoins. C’est Monsanto, lui-même, qui a fait état de « différences significatives » entre les rats nourris aux OGM et les rats des groupes témoins, pas nous ! Pourquoi chercher après coup à mettre en cause des données purement statistiques ?
M. François GUILLAUME : Il faut demander à Monsanto de communiquer le bilan des tests. Ainsi, nous verrons.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Tout à fait. Ces dossiers sont évalués par une poignée de personnes. Qui a lu les comptes rendus des études toxicologiques menées sur les OGM actuellement commercialisés ? Je vous suggère de les demander : cela économiserait des débats.
M. le Président : Nous les demanderons, comme pour la question des amorces.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Des discussions ont eu lieu à la CGB et à l’AFSSA pour savoir si ces différences, statistiquement significatives, étaient pertinentes en termes de santé, autrement dit si les perturbations relevées étaient susceptibles de s’amplifier ou, à l’inverse, ne signifiaient rien. C’est ce que certains ont répondu, Monsanto arguant que les effets ne sont pas les mêmes chez les mâles et les femelles – argument non valable à mon sens, car un cancérogène donne toujours un effet différent chez les mâles et les femelles –, qu’ils ne sont pas proportionnels à la dose reçue – ce qui est précisément le cas de tous les effets hormonaux –, et qu’enfin la comparaison entre ces vingt rats et un « groupe référent » de 400 ou 4 000 rats montre nettement moins de différences significatives ! Moyen commode de les rendre négligeables !
M. le Président : De l’avis de la présidente de l’AESA, jamais aucun produit ou aliment n’aura fait l’objet d’autant de tests que les produits transgéniques, considérés tantôt comme des poisons, tantôt comme des médicaments.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Jamais les OGM n’ont été traités comme des médicaments, puisque les meilleurs tests n’ont jamais dépassé trois mois. Et ils produisent des insecticides…
M. le Président : Je n’ai fait que vous rapporter ses propos. Nous ferons également état de votre avis, puisqu’il y a manifestement controverse. Et nous redemanderons des explications sur les questions que vous avez posées.
MM. Thierry MERCIER et Luc MULTIGNER sont introduits.
M. le Président : Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir au moment où nous abordons le troisième thème de l’exposé de M. Séralini : les effets du glyphosate sur la santé humaine.
M. Luc MULTIGNER : Docteur en médecine, épidémiologiste à l’unité INSERM79 625 de l’université de Rennes I, je travaille sur la problématique de l’impact de facteurs de l’environnement – pesticides, solvants, etc. – sur la fonction de reproduction et les pathologies associées chez l’homme.
M. Thierry MERCIER : Directeur de recherche à l’INRA, docteur en toxicologie, je suis également directeur de la structure scientifique mixte INRA-DGAL80 chargée d’assurer la coordination des travaux de la commission d’étude de la toxicité.
M. le Président : Le professeur Séralini a conduit des travaux sur les effets de pesticides sur certains types de cellules humaines dont Le Monde a fait état il y a quelques jours. Aussi les membres de notre mission d’information ont-ils souhaité savoir si le Roundup, souvent associé à la culture des OGM, a sur l’organisme un effet différent des autres pesticides. Jusqu’à présent, nous avions toujours entendu dire que le Roundup était plutôt moins dangereux que les herbicides sélectifs. La publication de M. Séralini a soulevé un certain émoi en concluant que le Roundup pourrait affecter certaines cellules spécifiques de l’homme et donc influer sur le fonctionnement endocrinien. De surcroît, à en croire Le Monde, le Roundup serait pire que le seul glyphosate.
M. Séralini commencera par exposer le résultat de ses recherches ; M. Fellous, président de la CGB, et M. Marzin, président de la Commission des toxiques, n’ayant pu se libérer ce soir, ont désigné MM. Luc Multigner et Thierry Mercier pour faire connaître leur position, selon une procédure contradictoire que je souhaite voir systématisée au Parlement, sitôt qu’un sujet suscitera polémique. Il nous sera ainsi possible de nous faire rapidement un avis.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Mon laboratoire travaille depuis plusieurs années sur les effets de certains produits – lindane, bisphénol-A, entre autres, par exemple – sur les cellules humaines. Nous avons voulu savoir ce qu’il advenait du Roundup sur des cellules de placenta humain81, plusieurs études épidémiologiques, controversées, menées en Amérique du Nord suggérant un lien entre des avortements, fausses couches ou naissances prématurées et l’utilisation d’herbicides à base de glyphosate.
Nous avons commencé par utiliser du Roundup à des dilutions de 100 à 1 000, les agriculteurs ou agricultrices étant exposés au produit pur, qu’ils diluent avant épandage. Le Roundup est un des herbicides les plus utilisés dans le monde, et particulièrement avec les trois quarts des OGM tolérants aux herbicides. Aussi son usage est-il en constante progression. Avec doses égales, voire inférieures aux doses « agricoles », en dessous desquelles les propriétés herbicides disparaissent, des manifestations de toxicité sont apparues dans un délai d’une heure à dix-huit heures.
A des concentrations plus faibles, jusqu’à 1 pour 10 000, nous avons détecté des modifications de la synthèse des hormones sexuelles œstrogènes qui jouent un grand rôle dans la différentiation sexuelle, la reproduction ainsi que dans l’apparition de certains cancers. Nous avons examiné les effets perturbateurs endocriniens non pas sur les récepteurs des hormones, comme on le fait souvent, mais sur la synthèse des hormones. Les premiers effets apparaissaient au bout d’une heure.
Ayant ainsi montré, contrairement à ce que laissait entendre une certaine littérature, que le Roundup n’était pas seulement toxique pour les cellules végétales, nous avons entrepris de tester le produit formulé par comparaison avec le glyphosate, son principe actif. Nous avons été surpris de découvrir que la formule Roundup était six à cent fois plus toxique ! Aussi pensons-nous que la réglementation sur les pesticides, notamment pour ce qui touche aux effets hormonaux, devrait prendre en compte non pas la seule molécule, mais la formule avec tous les additifs qui permettent sa pénétration et sa stabilité.
M. François GUILLAUME : Mais quel serait le véhicule de cette éventuelle contamination ? On n’épand pas le Roundup sur la plante en fleurs ou en graines, mais seulement en début de végétation. Qui peut l’ingérer, sinon l’agriculteur qui manipule le produit ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je n’ai pas abordé la question du danger et de l’exposition. Ce n’est qu’une première étude in vitro. Des études épidémiologiques ont déjà été menées sur le glyphosate, mais elles sont controversées. Nous avons de surcroît remarqué que, à dose égale, la toxicité augmentait avec le temps et que se manifestaient des effets génomiques, confirmant les travaux de Robert Bellé à Brest. L’éventuelle bio-accumulation du glyphosate sera modifiée par les produits de formulation. C’est donc bien l’herbicide tout entier qu’il faut évaluer, et non ses composants séparés.
M. le Rapporteur : Les cellules utilisées pour cette expérimentation étaient-elles les plus appropriées ?
M. François GUILLAUME : On nous fait une longue démonstration afin de prouver que le Roundup est toxique… J’aimerais savoir, utilisant régulièrement ce produit, comment cette toxicité peut affecter l’homme dans la mesure où le Roundup est épandu avec des méthodes et à une période interdisant précisément tout empoisonnement de la plante ou de la graine !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est une autre problématique.
M. François GUILLAUME : Je comprends que l’on puisse s’interroger sur les effets de la consommation, directe ou indirecte, de la toxine diffusée par un maïs pour se protéger de la pyrale, mais, dans le cas présent, je n’arrive pas à comprendre. Quel est le but de cette démonstration ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : L’utilisation du Roundup, produit très courant, est encore amplifiée avec les OGM le tolérant. Se pose dès lors le problème de l’exposition de l’agriculteur qui manipule le produit, mais également du consommateur, par les résidus du produit présents dans la plante.
M. François GUILLAUME : C’est ce dernier point que je ne comprends pas.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Nous n’avons pas abordé cette question dans notre étude. Tout le problème sera de connaître l’effet des adjuvants entrant dans la formulation et leur durée de vie. N’oublions pas qu’il peut y avoir deux ou trois épandages sur des OGM tolérants. Si, dans la réglementation actuelle, le glyphosate est étudié, ce n’est pas le cas des résidus présents dans les OGM. La Commission des toxiques devrait s’attacher à combler cette lacune en examinant les effets à moyen et à long terme – tels que ceux décrits dans notre étude – des pesticides présents dans les OGM tolérant un herbicide ou produisant un insecticide. Je le demande depuis 1998.
M. Luc MULTIGNER : Je me bornerai strictement à commenter le travail du professeur Séralini, dont la publication est accessible sur Internet, sans entrer dans le débat sur les OGM.
Quand bien même on dispose, pour certaines substances chimiques, de données toxicologiques ou épidémiologiques établissant leur innocuité, il peut arriver, grâce aux progrès des connaissances, que l’on identifie un danger jamais pris en considération jusqu’alors. Encore faut-il que le danger en question soit évalué de façon rigoureuse, en prenant en compte des expositions vraisemblables, y compris dans les scénarios maximalistes.
La publication du professeur Séralini soulève une série de remarques, consignées dans un texte qui vient de vous être communiqué.
La première remarque porte sur la lignée cellulaire employée, dite JEG-3, issue d’un choriocarcinome, un cancer issu du chorion, très différente du trophoblaste placentaire. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une lignée placentaire. Au surplus, ce choriocarcinome est assez particulier dans la mesure où cette lignée dite pseudo-triploïde présente trois séries de chromosomes, mais un seul chromosome sexuel X. Aussi toute étude sur une lignée cellulaire aussi particulière doit-elle être analysée avec la plus grande prudence, a fortiori si l’on veut en tirer une extrapolation. Des procédures existent pour isoler et étudier des cellules placentaires normales, ce qui aurait donné une expérimentation beaucoup plus parlante.
Les cellules JEG-3 ayant été exposées à ces concentrations de glyphosate
– 7 grammes par litre – similaires à celles utilisées en milieu agricole, des effets néfastes ont été observés à des concentrations dix fois, puis cent fois inférieures. Ce qui supposerait, si l’on fait le calcul, qu’un individu de 70 kg puisse ingérer plus de seize grammes de glyphosate, soit un minimum de 2,3 litres de Roundup !
Curieusement, les auteurs ont cité, pour étayer le risque d’exposition des populations, une étude d’Acquavella réalisée sur un groupe de 48 ouvriers agricoles avec enfants et familles et faisant état de charges maxima corporelles de seulement 4 µg/kg… Il est à noter que la dose journalière admissible de glyphosate recommandée par l’agence américaine de protection de l’environnement est de 2 mg/kg et celle arrêtée par l’Union européenne de 0,3 mg/kg, toutes deux fort éloignées de ces 70 mg/kg – encore me suis-je basé sur le facteur 100 et non sur le facteur 10… Or c’est l’exposition qui détermine la réalité du danger potentiel.
La question de l’impact des expositions au glyphosate sur la grossesse et le développent intra-utérin est soulevée en citant un article publié par le groupe d’Arbuckle au Canada en 1997. Contrairement à ce qu’affirme le professeur Séralini, ces études, pour la plupart réalisées par l’excellente équipe d’épidémiologistes d’Arbuckle dans le cadre d’une vaste cohorte de populations en milieu agricole, ne sont aucunement controversées. Les auteurs de l’article cité notent une augmentation modérée du risque d’accouchements prématurés dans les populations agricoles simultanément exposées à l’atrazine, au glyphosate, aux organophosphorés, au 2,4-DB et aux insecticides.
Dans une publication plus récente, employant un modèle mathématique très intéressant, le même groupe d’épidémiologistes observe que l’exposition pré-conceptionnelle au glyphosate entraîne une augmentation très modérée, à la limite de la signification, du nombre de fausses couches. Comme l’indiquent leurs auteurs dans le titre de leur publication, il s’agit d’une démarche exploratoire, caractéristique de l’épidémiologie où l’on peut, ou bien générer, ou bien tester des hypothèses – dans un domaine aussi complexe que celui des pesticides, on en est encore à la génération d’hypothèses. Les auteurs insistent avec raison sur la nécessité de poursuivre les études afin de préciser les molécules incriminées en utilisant des outils performants pour la mesure des expositions. Tous ces travaux reposent sur des questionnaires très précis sur les produits utilisés. L’épidémiologie moderne s’attache désormais à objectiver les mesures d’exposition par l’emploi, notamment, de marqueurs biologiques validés. La démarche suivie par Arbuckle apparaît à cet égard parfaitement raisonnable et j’y adhère totalement.
Enfin, la notion même de perturbation endocrinienne, extrêmement floue et débattue, donne lieu à des définitions très variables. Celle du Comité de la prévention et de la précaution82, citée dans notre contribution, est en fait issue des différentes définitions établies ces dernières années, une des plus connues ayant été posée par l’atelier européen de Weybridge en 1996, récemment reprise par le programme international des substances chimiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Quoi qu’il en soit, ce questionnement est légitime. Toutefois, la communauté scientifique s’accorde à reconnaître que l’on ne dispose pas de preuves directes et formelles de liens de causalité entre de supposés perturbateurs endocriniens et la survenue d’atteintes chez l’homme. La plus grande prudence est donc de mise, jusque dans la définition du perturbateur endocrinien. La seule interaction, à plus forte raison dans un système in vitro, d’une substance X ou Y avec un récepteur, un enzyme ou un transporteur impliqué dans le système de régulation hormonale n’en fait pas pour autant un perturbateur endocrinien et autorise encore moins à conclure à un effet pathogène sur l’homme ou l’animal, à supposer qu’ils puissent être exposés à des doses suffisantes.
Ce sujet fait l’objet de nombreux travaux toxicologiques et épidémiologiques en France. Ainsi en est-il des études coordonnées par l’INSERM sur trois cohortes de femmes enceintes dans trois régions différentes, destinées à étudier l’impact des expositions aux pesticides et plusieurs autres substances chimiques sur le déroulement de la grossesse, voire sur le développement de l’enfant. Ces cohortes se caractérisent par des mesures objectives d’exposition intégrant l’ensemble des voies d’exposition – urine, sang, etc. –, ce qui permettra ultérieurement d’infirmer ou d’affirmer des hypothèses tendant à établir un lien entre l’exposition à une substance donnée et un effet sanitaire.
M. Thierry MERCIER : Le travail du professeur Séralini doit à l’évidence être pris en compte, mais également recadré dans un contexte précis, défini par des documents guides, comme tous les articles publiés sur le sujet dans les revues internationales.
Pour être mis sur le marché, un pesticide doit respecter les critères de la directive 91/414 accompagnée de nombreux documents guides, où sont précisées les conditions de mises sur le marché et les exigences auxquelles doivent répondre les études effectuées dans les domaines de l’environnement, de la santé humaine, de l’écotoxicologie et de l’identité du produit.
L’année 1993 a marqué le début d’une phase de réévaluation communautaire des pesticides, dont le glyphosate. L’Allemagne, Etat rapporteur, a proposé un projet d’évaluation aux quinze Etats membres qui y ont apporté leurs commentaires et un groupe d’experts été saisi. Il ressort de l’évaluation finale que le glyphosate est bel et bien porteur, à fortes doses, d’effets sur la reproduction. A des doses maternotoxiques, il peut affecter le nombre et le poids des fœtus et entraîner des retards d’ossifications ou des anomalies squelettales et viscérales.
Parallèlement à cette évaluation menée sous l’égide de la direction générale « Santé et protection du consommateur », une deuxième évaluation, à fins de classification du danger, a été menée sous la responsabilité la direction générale « Environnement ». Après consultation de l’ensemble des données disponibles sur le sujet, il a été conclu que le glyphosate pouvait présenter certains dangers, particulièrement pour les yeux. Au vu de ces deux évaluations, le glyphosate a été inscrit sur la liste positive européenne.
Un dossier d’évaluation contient des informations sur l’identité du produit, ses propriétés physico-chimiques, les méthodes d’analyse dans l’eau, l’air, les végétaux, le sol, les aspects toxicologiques, écotoxicologiques et environnementaux. Sont étudiées la molécule proprement dite, le glyphosate, mais également, de façon certes moins exhaustive, la préparation – autrement dit le Roundup. Sont notamment examinées la toxicité aiguë de la préparation ainsi que la quantité de glyphosate susceptible de traverser la peau dans la formulation Roundup, in vivo et in vitro sur des modèles de peau humaine. On peut difficilement être plus proche des conditions réelles... Il est ainsi apparu que la pénétration du glyphosate formulé en Roundup ne dépassait jamais 3 %, quelle que soit la dilution.
Une partie du dossier porte également sur l’évaluation de risques, fondée d’un côté sur des indices de toxicité – la dose journalière admissible, mais également des indices propres à l’opérateur –, de l’autre sur des études d’exposition réalisées sur le terrain avec des agriculteurs, dans des conditions d’utilisation prédéfinies, ou encore sur la base de modélisations elles-mêmes mises au point à partir d’une série d’études de terrain. Entrent en ligne de compte le type de préparation, l’absorption dermale ainsi le matériel utilisé. L’exposition ainsi déterminée est comparée à un indice de danger. Si elle est supérieure à l’indice de danger, on définit un « risque inacceptable » – au regard de la directive et de ses critères et dans des conditions de bonne pratique agricole – ; en aucun cas on ne doit parler de risque d’une manière générale. Pour le glyphosate, l’évaluation a montré que le risque était acceptable.
En résumé, l’évaluation d’une substance suppose de bien distinguer le danger de l’exposition et de procéder à une évaluation du risque comme le demande la directive. Ce cadre d’évaluation très strict n’interdit pas pour autant de prendre en considération les données produites par les chercheurs, qu’il s’agisse de l’article de M. Séralini ou des études sur l’exposition que l’on trouve dans la littérature. Encore faut-il les resituer dans un cadre d’évaluation précis. La procédure communautaire présente à cet égard toutes les garanties de sérieux, interdisant une évaluation à la va-vite. Elle exige beaucoup de temps et un investissement important des experts des Etats-membres. Toute nouvelle donnée doit être utilisée, pour peu qu’elle soit recadrée dans ce contexte.
M. le Président : N’est-il pas inquiétant de voir la grande presse reprendre immédiatement des sujets aussi techniques, dont on ne retiendra que l’existence d’un possible mécanisme de cancérogenèse ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Mon étude ne l’évoque pas.
M. le Président : Reste que la presse en parle.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : L’article faisait allusion à d’autres travaux menés sur le sujet.
M. le Président : Est-ce vous qui avez pris l’initiative de rencontrer le journaliste ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je ne l’ai pas rencontré, c’est lui qui m’a téléphoné et j’ai répondu à ses questions. Je n’ai pas écrit l’article mais je pense que, dans ce genre de dossiers, la plus grande transparence s’impose.
M. le Président : Mais comment a-t-il eu l’information ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Par le service de presse de Environmental Health Perspectives qui a été actif dès le premier jour, je pense.
M. le Président : Nous avons entendu les critiques que soulève votre publication, dont certaines très techniques. Je serais bien en peine, et mes collègues pareillement, de donner mon avis sur la question de savoir si vos cellules embryonnaires JEG-3 constituent réellement une lignée placentaire… Nous avons bien compris en revanche que l’exposition devait être vraisemblable, jusque dans les scénarios maximalistes, et que votre étude prenait en compte des quantités de glyphosate mille fois supérieures à la norme européenne… Contestez-vous cette critique ou reconnaissez-vous avoir employé des doses nettement supérieures aux scénarios les plus maximalistes ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Les doses journalières admissibles sont calculées à partir d’hypothèses de travail qui ne prennent pas forcément en compte les adjuvants au glyphosate, ni le temps d’exposition et les effets à long terme. La formulation influe sur la stabilité, la bioaccumulation et la pénétration du glyphosate, et donc sur ses effets à long terme. Les études en toxicologie sont menées à partir d’hypothèses qui doivent pouvoir évoluer avec le temps, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’étudier les effets à long terme, notamment hormonaux et perturbateurs endocriniens.
Il est trois critiques que j’accepte volontiers. Le problème de la lignée est récurrent à toutes les études faisant appel à des lignées cellulaires issues de cancers, plus commodes à étudier que les cellules placentaires primaires. Cela dit, nos études ont également porté sur des lignées de cellules embryonnaires.
S’agissant des doses, nous avons évidemment travaillé en éprouvettes. Reste qu’elles sont 10 000 fois moins concentrées que le produit manipulé par l’agricultrice avant dilution, et 100 fois moins fortes que l’herbicide épandu. Il aurait effectivement fallu prendre en compte le temps d’exposition et les quantités pénétrant réellement dans le corps. Il peut donc y avoir des différences ; encore mesure-t-on rarement les effets à long terme du produit, glyphosate ou autre, lorsqu’il s’est accumulé dans le corps, atteignant des doses parfois bien différentes de celles auxquelles on peut être ponctuellement exposé.
Enfin, sur le caractère controversé des études épidémiologiques, je n’ai fait que citer la réaction de Monsanto.
L’homologation est un travail long et précis. Malheureusement, elle se limite souvent, pour mesurer les effets hormonaux ou endocriniens, au seul principe actif, sans prendre en compte les molécules en formulation. Ainsi que l’avait souligné le commissaire Byrne lui-même, l’effet des synergisants et des formulations sur les systèmes hormonaux et endocriniens mériterait d’être davantage pris en considération.
M. le Président : Ce sujet n’est pour nous qu’une incidente, les OGM n’étant pas directement en cause. Reste qu’ils ont été très largement cités dans l’article en question, d’où il est aisé de conclure, par contrecoup, qu’il ne faut surtout pas utiliser d’OGM résistants au glyphosate…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je ne suis pas sûr que l’article en question dise cela…
M. le Président : Je cite, à propos de vous : « Membre depuis des années de la CGB, chargée d'instruire les dossiers de demande d'essais en champ, puis de commercialisation des OGM, il ne cesse de réclamer des études plus poussées sur leur impact sanitaire éventuel. »
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est certain.
M. le Président : Cet article du 13 mars dernier va très loin, d’où la réaction de notre mission. Quel est le rôle du CRII-GEN dans la diffusion de cette publication ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : EHP a commencé d’en parler dès le 25 février et le CRII-GEN le 7 mars.
M. le Président : Le problème est que, dans ce domaine comme dans d’autres, l’important n’est plus ce qu’en dit la science, mais ce qu’on dit de la science.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est un problème plus général…
M. le Président : Beaucoup plus général et la mission a dû s’y pencher. La question est de savoir si l’on peut être d’accord ou non avec les scénarios d’exposition utilisés dans la démonstration de M. Séralini. Ce sont tout de même eux qui ont donné lieu à cet article de presse.
M. André CHASSAIGNE : Si nous parvenons à mettre un jour en place une commission de la société civile sur les biotechnologies, il faudra essayer d’y parler de façon moins cryptée… Vous êtes des scientifiques, vous avez une certaine façon de vous exprimer ainsi qu’une éthique qui vous interdit d’exprimer des jugements péremptoires. Je peux le concevoir, cette démarche est certes indispensable, mais un parlementaire non scientifique aurait aimé entendre une conclusion claire et nette, du style : M. Séralini exagère – ou l’inverse… Sans réponse précise, comment pouvons-nous répondre, dans nos circonscriptions, aux jugements à l’emporte-pièce qui s’appuient précisément sur ce type d’article ? Je partirai de cette réunion un peu frustré…
M. Luc MULTIGNER : Je suis quotidiennement confronté à ce problème de communication sur des dossiers très chauds, comme celui des éthers de glycol. Il est essentiel de savoir communiquer avec prudence : dans ce monde où l’on parle sans cesse du principe de précaution, les scientifiques devraient commencer par se l’appliquer à eux-mêmes au moment d’interpréter leurs résultats.
Je ne me permettrai jamais de qualifier publiquement le travail d’un tel à l’aide de quelque adjectif que ce soit. Mais il est beaucoup plus facile de capter l’attention d’un journaliste en lui disant : « J’observe une situation catastrophique » plutôt que : « Je n’observe rien », auquel cas on comprendra : « Tout va très bien, madame la marquise » ou encore : « Circulez, il n’y a rien à voir » !
Entre les interrogations légitimes, auxquelles je consacre toute mon activité d’épidémiologiste à essayer de répondre, et les affirmations qui peuvent dépasser le strict cadre du travail scientifique, il est très difficile de satisfaire votre demande, M. Chassaigne… Cela dit, pour en rester à la seule question des scénarios d’exposition maximaliste, j’ai bien entendu M. Séralini prononcer à plusieurs reprises les mots « dix mille fois », alors que je ne trouve, dans sa publication, que les mots « dix fois » à la page 14, et « cent fois » à la page 16…
M. Gilles-Éric SÉRALINI : J’ai parlé de 0,01 %...
M. Luc MULTIGNER : Je lis la deuxième ligne de votre conclusion : «… from concentrations 100 times lower than the recommended use in agriculture… » Si c’est dix mille fois, il faut le mettre dans le résumé, et en gros !
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Il faut lire tout l’article. Je n’ai pas tout repris dans la conclusion. Les figures montrent que les effets significatifs commencent à 0,01 %, autrement dit avec une dilution d’un pour 10 000.
M. Luc MULTIGNER : Voilà ce que j’aurais mis dans ma conclusion… Mais laissons là ce détail.
Pour répondre à la question de M. Chassaigne, essayons de trouver un exemple simple. Si vous faites incuber des cellules dans une concentration d’alcool comparable à celle d’un bon bordeaux – 130 g/l –, il va se passer plein de choses à l’intérieur de vos pauvres cellules… Boire ce bordeaux – à dose raisonnable s’entend – présente-t-il pour autant un réel danger ? Il y a de la marge entre ce que l’on observe dans une donnée expérimentale et les conclusions que l’on peut en tirer en termes d’exposition au risque ! Que dit-on dans cette expérience, à supposer qu’elle ait été validée ?
M. le Président : M. Séralini, les référés ont-ils validé votre étude ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Elle a été expertisée pour publication.
M. Luc MULTIGNER : Certes. Mais d’autres scientifiques n’auraient pas laissé passer ce que je relevais à l’instant.
M. le Président : Est-ce à dire que vous critiquez les référés ?
M. Luc MULTIGNER : Bien sûr.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Tous les scientifiques le font !
M. Luc MULTIGNER : Nous-mêmes sommes référés. Ce n’est pas parce qu’il est publié qu’un article devient la vérité absolue. M. Séralini observe, dans un module cellulaire dont il convient lui-même du caractère très particulier, des effets qui méritent à son sens d’être explorés ; soit. Mais de là à dire, ou à faire dire, ou à laisser dire dans les médias que les individus sont exposés à un danger, fût-ce à des dilutions de mille ou de dix mille, attention ! Pour mes travaux, qui ont souvent donné lieu à des conférences de presse – la dernière en date fut celle organisée par Human Reproduction à Londres –, la procédure habituelle est la suivante : on me soumet le texte, je donne mon accord et c’est ce texte qui, à la virgule près, est repris dans les médias. Libre à d’autres journalistes d’en écrire ensuite ce qu’ils veulent, mais je me fais un devoir d’intervenir dans la mesure du possible en cas d’interprétation excessive. Pour autant, ne voyez dans ces propos aucune mise en cause de l’expérimentation de M. Séralini en elle-même, à quelques détails techniques près.
M. Thierry MERCIER : Le glyphosate a été évalué au niveau communautaire et ce n’est pas une petite opération. Le rapport, disponible depuis 2002 sur l’Internet, conclut à un risque acceptable pour le glyphosate comme pour le Roundup dans les conditions de pratique agricole recommandée.
M. le Président : A l’issue de vos travaux, M. Séralini, pensez-vous que le risque soit toujours acceptable ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Mon article montre que le Roundup n’a pas, dans ce modèle, le même effet que le glyphosate. C’est donc le produit formulé qui doit être utilisé pour déterminer les effets perturbateurs endocriniens. Ajoutons que les effets se modifient avec le temps. L’évaluation de 2001 repose sur des données dont certaines remontent à trente ans. La science continue à évoluer…
M. le Président : Pensez-vous qu’il faille réanalyser le cas du Roundup ?
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je pense que les analyses ne sont pas suffisantes pour ce qui est des produits formulés et de leurs effets endocriniens.
M. Thierry MERCIER : Je ne suis pas d’accord. Cet article montre des choses intéressantes, mais qu’il faut recadrer dans un contexte. Je n’y vois aucune remise en question des données relatives à l’exposition. Et pour ce qui est de l’identification du danger, les informations apportées par l’étude in vitro ne se retrouvent pas in vivo.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Les effets in vivo ne sont pas toujours mesurés avec le produit formulé, ce qui pose un problème sur le plan de la stabilité du produit et des effets à long terme d’une bioconcentration. Je suis heureux de vous entendre dire que les études in vivo doivent venir compléter les études in vitro : reste que ces dernières peuvent expliquer des mécanismes moléculaires parfois difficilement compréhensibles in vivo. Pensez-vous que des études in vivo sur trois mois soient réellement pertinentes dans le cas de pesticides ?
M. Thierry MERCIER : A côté des tests sur trois mois, on dispose d’études à long terme sur deux espèces, le rat et la souris. Parallèlement, des études à court terme sont effectuées sur le chien, des études de reproduction sur deux générations de rats, des études de kératogénèse sur le rat et le lapin, parfois des études de neurotoxicité fondées sur l’observation du comportement, des études de génotoxicité in vitro et in vivo… Je ne prétends pas que l’on détectera tous les effets – l’immunotoxicité notamment pose de gros problèmes –, en revanche, on recadre ces effets en termes de danger dans une notion d’évaluation du risque où l’exposition est prise en compte.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Je suis parfaitement d’accord avec vous : je voulais souligner la différence par rapport aux OGM, sur lesquels nous nous battons pour avoir des tests à trois mois, alors qu’ils contiennent ou tolèrent des pesticides…
M. le Président : Gérard Pascal et certains experts estiment que ce serait une erreur d’aller à 90 jours. Celui-ci nous a déclaré qu’il y a eu, en France, toute une bagarre sur la question des 28 jours et des 90 jours et qu’il avait plaidé pour les 28 jours parce que cette durée suffit à mettre en évidence d’éventuels effets toxiques.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Alors c’est également une erreur pour les pesticides !
M. Thierry MERCIER : Entre des substances chimiques et des plantes, les situations sont difficilement comparables.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : On ajoute bien des substances chimiques aux aliments des rats. Quelle différence avec une plante contenant un pesticide ?
M. Thierry MERCIER : Un OGM ne contient pas le pesticide, hormis dans le cas du Bt.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Il peut contenir des résidus de Roundup… Et le Bt se retrouve dans 25 % des OGM cultivés dans le monde.
M. Thierry MERCIER : Des études de résidus sont réalisées sur les OGM comme sur les cultures conventionnelles. A la demande de M. Marc Fellous, la CGB et la commission d’étude de la toxicité se sont rapprochées pour examiner le problème du devenir des pesticides dans les OGM. Autrement dit, ce point est à l’ordre du jour.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : C’est ce que nous réclamons depuis 1998 !
M. le Président : Effectivement, je l’avais moi-même demandé dans mon rapport. Certains points n’ont guère évolué. Mais le climat qui règne autour des OGM n’a guère facilité l’expérimentation et le travail scientifique sur ce sujet… Comme je l’ai dit ici même à la Confédération paysanne, certains posent de bonnes questions, mais interdisent d’y répondre.
M. Gilles-Éric SÉRALINI : Il n’y a jamais eu de moratoire sur la recherche.
M. le Président : Empêcher l’expérimentation en plein champ, particulièrement lorsqu’il s’agit de travailler sur le stress hydrique pour détecter des gènes naturels, ce n’est pas ce que j’appelle favoriser la recherche scientifique !
Messieurs, nous vous remercions.
Audition de M. Christian JACOB,
ministre délégué aux PME, au commerce, à l’artisanat, aux professions libérales et à la consommation
(extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Nous vous remercions, Monsieur le ministre, d’avoir trouvé le temps de venir devant notre mission d’information, créée à l’initiative du Président de l’Assemblée nationale dans la perspective de la transposition de la directive européenne. Constituée en octobre 2004, la mission a commencé ses travaux le 9 novembre, procédé à plus de cent auditions et effectué plusieurs déplacements en France et à l’étranger.
M. Christian JACOB : Je suis accompagné de M. Hervé Boullanger, directeur adjoint de mon cabinet, de Mme Guillemette Leneveu, conseiller technique, et de M. Luc Valade, directeur adjoint à la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui pourront vous apporter, sur certains sujets, des précisions supplémentaires. Si d’autres éléments encore s’avéraient nécessaires, nous vous les ferions parvenir par écrit dans les tout prochains jours.
On ressent, d’une façon générale, une demande croissante d’information, et surtout de clarté, de la part des consommateurs. En fait, ils se plaignent rarement de manquer d’information, mais plutôt d’une information claire et accessible – et nous rejoignons là le débat sur l’étiquetage. On s’aperçoit d’ailleurs, s’agissant de la consommation en général, que le prix est un élément important mais qu’il n’est pas le seul : c’est lorsqu’il a confiance dans la transparence et la loyauté de l’information que le consommateur se sent maître de ses choix.
Sur les OGM en particulier, ma conviction est qu’il faut poursuivre la recherche, notamment appliquée, et que celle-ci ne peut se cantonner au laboratoire. J’ai toujours été favorable à la recherche en plein champ, avec, naturellement, toutes les précautions d’usage.
Afin de garantir le libre choix du consommateur, l’étiquetage des ingrédients alimentaires contenant des OGM est en vigueur depuis 1997 dans l’Union européenne et la réglementation a été étendue le 18 avril 2004 aux aliments pour animaux et aux produits élaborés à partir d’OGM, quand bien même le produit fini ne contient pas de traces d’OGM en tant que tel. La traçabilité est ainsi possible tout au long de la filière. La mise sur le marché fait l’objet d’une procédure très sécurisée, dont je suppose qu’elle vous a été exposée très en détail par certaines personnes que vous avez auditionnées. L’Union européenne a mis en place en 1990 un système d’autorisation préalable, qui repose sur une expertise scientifique, d’abord au niveau national – c’est le rôle de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) en France –, puis européen avec l’Agence sanitaire européenne.
Les filières d’alimentation humaine et animale font l’objet de contrôles, et la présence accidentelle d’OGM n’est pas admise au-delà d’un seuil de 0,9 % – qui fait d’ailleurs débat. La DGCCRF enquête régulièrement sur toutes les filières concernées par les OGM, vérifie les moyens mis en œuvre et la bonne information des consommateurs et des utilisateurs.
En conclusion, et sans aborder les aspects sanitaires que vous avez naturellement évoqué avec des personnalités hautement compétentes, je crois que la réglementation actuelle est satisfaisante, en ce qu’elle fixe des obligations précises aux professionnels et offre de fortes garanties aux consommateurs. Cela dit, je suis toujours à la disposition de la représentation nationale pour étudier la façon dont on pourrait l’améliorer encore.
M. le Président : Je vous remercie pour cet exposé et voudrais maintenant recueillir votre sentiment sur plusieurs points.
Nous avons reçu les associations de consommateurs, notamment dans le cadre d’une table ronde contradictoire qui fut plus qu’animée. Le débat a porté en particulier sur le point suivant. Aujourd’hui on n’étiquette les produits OGM ou issus d’OGM que si le taux dépasse 0,9 % – ce qui n’est d’ailleurs pas totalement vrai car on étiquette les produits issus d’OGM, même s’il ne reste plus d’OGM dedans. Or nombre d’associations font valoir que si les produits OGM se retrouvent très peu dans l’alimentation humaine, même aux Etats-Unis, ils le sont bien davantage dans l’alimentation animale, où les agriculteurs sont donc en première ligne pour vérifier si les aliments qu’ils donnent au bétail sont bien étiquetés – et d’ailleurs ils le sont, notamment ceux issus du soja. Seriez-vous favorable à ce qu’on étiquette, comme le demandent ces associations, les produits issus d’animaux ayant eux-mêmes consommé des OGM ? Le débat sur ce point a été très rude, car les autres participants au débat ont assuré que cela était impossible. J’aimerais avoir votre sentiment.
M. Christian JACOB : Le moins que l’on puisse dire est que ce serait très compliqué à mettre en œuvre, et qu’il y aurait en outre un vrai risque de confusion. Prenons par exemple le cas du lait UHT83 : il faudrait vérifier si la vache qui l’a produit a consommé un tourteau de soja ou de colza ou encore du maïs issu d’OGM, et même si ses ascendants en ont consommé… Or, 90 % des vaches laitières sont issues d’inséminations artificielles, avec des souches souvent canadiennes ou américaines. Il est impossible d’assurer une traçabilité sérieuse, surtout dans un circuit sans ADN.
M. le Président : Donc, vous n’y êtes pas favorable ?
M. Christian JACOB : Non, car je ne vois pas comment l’appliquer.
M. le Président : J’en viens à ma deuxième question. Ceux d’entre nous qui ont fait le voyage aux Etats-Unis ont observé que les Américains étaient très offensifs sur la question suivante. Ils considèrent que le choix de l’Union européenne d’étiqueter les produits issus d’OGM, même lorsqu’ils ne comportent plus de traces d’OGM, comme la lécithine, l’huile de colza ou le sucre de canne, constitue une barrière non tarifaire, d’autant que Bruxelles a refusé d’étiqueter, dans les filières du fromage, de la bière ou du pain, des produits fabriqués avec des enzymes extraites de micro-organismes génétiquement modifiés, situation qui est, selon eux, rigoureusement identique. Il s’agit en effet non pas de produits OGM, mais de produits issus d’OGM, comme la chymosine qu’on utilise maintenant comme ferment pour fabriquer le brie de Meaux que vous connaissez bien, et qui est d’ailleurs bien plus sûre, à mon avis, que la chymosine extraite de la caillette du veau qu’on utilisait autrefois. Ils disent que nous ne sommes pas logiques et force est de convenir que c’est un peu vrai. Mon point de vue personnel est qu’il aurait mieux valu ne pas étiqueter, car aujourd’hui les Américains vont nous demander de tout étiqueter, afin de noyer ou de diluer les OGM dans un étiquetage général. Je précise que ceux à qui nous avons eu affaire aux Etats-Unis sont des gens qui comptent, comme Charles Stenholm, ancien président de la commission de l’agriculture de la Chambre des représentants.
M. le Rapporteur : Nous en avons discuté entre nous depuis, et je me suis fait l’avocat du diable en demandant si, en étiquetant tout, nos bières, nos fromages, nous ne ferions pas mieux passer le message aux Français, en leur montrant qu’ils absorbent des OGM depuis plus de dix ans sans le savoir… Cela dit, je suis plutôt de l’avis du Président Le Déaut.
M. Christian JACOB : Dès lors qu’il y a une trace d’OGM clairement identifiée, la transparence s’impose, sans discussion possible. Mais pour les produits issus de produits issus de produits, jusqu’où remonter ? Il y a un moment où les moyens de contrôle pertinents font défaut. Il faut savoir que, pour les semences, la troisième, la quatrième, la cinquième génération sont très proches dans le temps. Comment, dans ces conditions, identifier la source ? Mais peut-être M. Valade nous donnera-t-il un avis de technicien…
M. Luc VALADE : Si l’on a décidé de ne pas étiqueter des produits tels que les enzymes utilisées dans la fabrication du pain, bien qu’ils soient issus d’OGM, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’ingrédients se retrouvant dans le produit fini, mais de simples auxiliaires technologiques, que l’on n’étiquette pas non plus quand ils ont une origine conventionnelle.
M. le Président : Autant il est nécessaire d’étiqueter les produits OGM au nom de la transparence, autant il est justifié de ne pas étiqueter quand on ne trouve pas de traces d’OGM, mais je souligne qu’on ne trouve pas non plus de traces dans la lécithine utilisée en très faible quantité comme auxiliaire technologique. Quand nous recevrons du Brésil de la lécithine ou de l’huile qui ne seront pas étiquetées et sur lesquelles, faute de trace d’ADN, nous n’aurons aucun moyen de contrôle, il y aura distorsion de concurrence au détriment de nos produits qui, eux, seront étiquetés. La bonne solution serait de revenir sur l’étiquetage des produits dans lesquels on ne décèle plus de traces d’OGM, et de revenir à la notion de seuil, plutôt que de se donner de mauvais arguments dans une bataille commerciale qui s’annonce rude. Par ailleurs, au lieu d’avoir plusieurs seuils différents, qui prêtent le flanc à la critique, mieux vaudrait, selon moi, en rester à celui de 0,9 % de présence fortuite qui a, au moins, le mérite d’avoir fait l’objet d’un accord politique au niveau européen, et voir si le seuil est pertinent. Je voudrais avoir votre sentiment sur ce point.
Je précise que les Etats-Unis n’ont pas de seuil mais nous leur en imposons un chez nous. Et nous avons cru comprendre qu’ils vont nous demander d’étiqueter OGM nos fromages et nos bières.
M. François GROSDIDIER : Je ne connais pas bien le droit de la consommation, mais la règle d’étiquetage ne s’impose-t-elle pas de la même façon aux importations et aux productions nationales ?
M. Christian JACOB : Si.
M. François GROSDIDIER : Je ne vois donc pas en quoi l’étiquetage favoriserait les importations par rapport aux productions nationales, d’autant que celles en provenance d’outre-Atlantique sont plus souvent OGM.
Par ailleurs, il ressort de l’audition du professeur Séralini, la semaine dernière, que la recherche est loin d’être transparente : s’agissant par exemple de l’expérience faite par Monsanto sur des rats nourris aux OGM pendant 90 jours, on sait qu’il y a eu des modifications du métabolisme sanguin et d’organes tels que le foie ou les reins, mais les résultats détaillés sont couverts par le secret industriel, alors que seule leur publication, justement, serait de nature à dissiper le doute, et donc à avoir une incidence sur la consommation de produits OGM ou d’animaux nourris aux OGM. Il me semble qu’on a traité un peu à la légère la question de l’étiquetage de l’alimentation animale.
M. Christian JACOB : La question est de savoir jusqu’où l’on doit aller. Pour reprendre l’exemple des vaches laitières, ou faut-il remonter jusqu’aux parents, aux grands-parents des vaches ? C’est très difficile.
M. François GROSDIDIER : Il faut au moins avoir la traçabilité sur l’animal lui-même.
M. Christian JACOB : Mais l’alimentation animale est issue pour 20 % de produits OGM. Et il y a, en outre, un vrai risque de confusion entre les produits OGM et ceux provenant d’animaux ayant consommé soit des produits OGM, soit des produits dans la fabrication desquels entrent des ingrédients susceptibles d’avoir été élaborés à partir d’OGM à un moment ou à un autre…
M. François GROSDIDIER : On peut s’en tenir à l’alimentation de l’animal lui-même, sans remonter jusqu’à ses arrière-grands-parents.
M. Christian JACOB : Mais s’il y a vraiment un risque, pourquoi serait-il diminué parce qu’il vient des arrière-grands-parents ?
M. François GROSDIDIER : Et s’il n’y a pas de risque, pourquoi ne pas publier les tests ?
M. le Président : Il faut qu’ils le soient. C’est d’ailleurs une affaire qu’il nous faut élucider.
Par ailleurs, et c’est une question qui s’adresse au ministre en charge de la consommation, nous avons vu en Espagne que les animaux ayant consommé des OGM – ce qui est le cas de pratiquement tous les porcs et volailles – ne sont pas étiquetés. Or ils sont vendus chez nous, notamment dans le Sud-ouest, tandis que certaines grandes surfaces, Carrefour en particulier, qui commercialisent ces viandes espagnoles aux OGM, imposent parallèlement à des éleveurs français, comme nous l’avons vu en Auvergne, des cahiers des charges très contraignants, avec 10 % de surcoûts non rémunérés, pour proposer au consommateur une filière de qualité, garantie sans OGM. Cela vous paraît-il juste ?
M. Christian JACOB : En d’autres termes, on présente sur le même linéaire, sans identification particulière, des poulets nourris au maïs OGM…
M. le Président : Et inversement, on impose aux éleveurs, dans les filières de qualité, une alimentation sans OGM. On n’écrit pas « garanti sans OGM », mais on s’arrange pour le faire savoir à travers le label de qualité.
M. Christian JACOB : C’est la même situation que pour Monsanto qui fait du maïs OGM et Limagrain, pour prendre la même région, qui n’a pas le droit d’en vendre.
M. le Président : Ni de le cultiver ! Mais c’est pire encore quand il s’agit de deux viandes en concurrence sur le même linéaire. Il est évident que cela peut favoriser les importations.
M. Christian JACOB : Cela met un coût supplémentaire, non rémunéré, à la charge du producteur.
M. André CHASSAIGNE : De plus, si l’on affiche « charolais garanti sans OGM », on donne à penser que l’OGM présente un danger alors que, par ailleurs, on vend sans le dire des poulets nourris aux OGM. Il y a là une forme de tromperie.
M. François GROSDIDIER : Si l’on veut améliorer l’information du consommateur, les produits OGM doivent naturellement être signalés. A contrario, je ne trouve pas qu’il y ait lieu de s’indigner que l’on indique « sans OGM » quand il n’y en a pas, et je trouverais même surprenant qu’on ne le puisse pas, car chacun a le droit de vouloir manger sans OGM, comme de vouloir manger casher ou halal. Ce qui serait choquant, car il y aurait tromperie, serait d’indiquer « sans OGM » quand il y en a. Et si l’on veut éviter que la mention « garanti sans OGM » crée la panique par rapport aux OGM, il n’y a qu’à leur expliquer pourquoi il n’y a pas de risque. En tout cas, il convient d’éviter toute présentation confuse, comme pour les yaourts dits « bio » qui en fait ne le sont pas. Sinon il ne faudra pas s’étonner que l’on puisse confondre produits OGM et produits sans OGM.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Vous avez dit que les consommateurs demandaient une information claire. Il y a bien eu des conférences de citoyens sur les OGM, mais il apparaît aux consommateurs d’aujourd’hui – je le ressens sur le terrain – que l’information est trop complexe et trop difficile d’accès pour être vraiment transparente. Votre ministère est-il prêt à contribuer, au-delà du rapport de notre mission et de la position que prendra le Gouvernement, à une meilleure information des consommateurs ?
Par ailleurs, vous avez dit que vous étiez favorable à la recherche appliquée – et sans doute fondamentale également – dans le domaine des OGM, mais cette recherche apparaît, en France, bien sinistrée. Comment envisagez-vous son avenir ?
M. Christian JACOB : Je suis très conscient des difficultés, mais si l’on veut réduire significativement, dans l’agriculture, l’utilisation de pesticides et la consommation d’eau comme celle d’intrants de toutes sortes, cela passe par la recherche variétale, à laquelle les OGM peuvent faire gagner énormément de temps. On peut notamment développer des variétés résistantes ou capables de capter l’azote. Il y a donc un besoin de recherche, à la fois fondamentale et appliquée, mais surtout de recherche en plein champ, car la recherche en laboratoire a ses limites.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Mais l’opinion publique n’en voulant pas, comment faire ?
M. Christian JACOB : La communication a été mauvaise parce qu’elle a été, surtout, le fait de firmes telles que Monsanto, ce qui a créé une certaine suspicion dans l’opinion publique. Pour lever les tabous, en finir avec les procès d’intention, il faut développer les plateformes d’essais, les faire visiter, expliquer, assurer la plus grande transparence possible. On voit bien, dans la recherche variétale sur les espèces végétales, que l’on pourrait gagner dix, quinze, vingt années grâce à la recherche sur les OGM.
M. André CHASSAIGNE : Nous avons pu constater que les médias se saisissent avec empressement de certaines informations données par quelques scientifiques, alors même qu’elles ne portent que sur une expérience ponctuelle réalisée dans certaines conditions. Il suffit souvent qu’une approche scientifique, et je serais tenté de mettre « scientifique » entre guillemets, soit anti-OGM pour qu’elle soit présentée comme vérité, tandis que des organismes comme l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) ou l’AFSSA font, sur des bases scientifiques exemplaires, des recherches très intéressantes, qui commencent à produire des résultats, mais qui restent confidentielles. Il y a là un vrai problème de communication. Pour que ces recherches se retrouvent sur la place publique, il faut que l’information ne soit plus seulement le fait d’une poignée de scientifiques qui en font un fonds de commerce.
M. Christian JACOB : Je répondrai d’abord à M. Grosdidier. Pour écrire « sans OGM », il faut pouvoir en apporter la démonstration scientifique, ce qui est loin d’être aisé...
Quant au financement des associations de consommateurs, il vise à aider la diffusion des informations aux consommateurs. Reste que ces associations sont extrêmement nombreuses et diverses : on en compte dix-huit référencées, plus toutes celles qui ne le sont pas ! On ne fera pas l’économie d’un débat sur leur financement et sur leur rôle.
M. le Rapporteur : Je lisais ce matin dans Ouest-France un article, en pages nationales, sur l’étude de M. Séralini, et un autre, en pages régionales, qui présentait comme une nouveauté le « riz doré », lequel date déjà d’un certain nombre d’années. Cela montre combien l’information des journalistes, eux-mêmes, est parfois insuffisante… Ne serait-il pas utile que les pouvoirs publics se dotent d’un outil d’information objectif sur les OGM ?
M. Christian JACOB : On a tout à gagner, à moyen et long terme, à favoriser la transparence, car elle évite les soupçons et les procès d’intention. Il faut donc impliquer les associations de consommateurs, diffuser les tests, les résultats d’enquêtes…
M. le Rapporteur : Effectivement, si l’information émane des pouvoirs publics, plutôt que de groupes comme Monsanto, elle sera plus efficace.
M. Christian JACOB : La transparence évite aussi les faux scoops sur certains sujets…
M. le Rapporteur : Je pense à l’étude britannique sur le soja d’hiver, reprise par les médias comme s’il s’agissait d’une grande nouveauté, alors que la même information avait été donnée sur le soja de printemps en 2003, et qu’il n’y a eu aucune évolution entre les deux.
M. François GROSDIDIER : Pour en revenir aux essais en plein champ, l’opinion publique y est majoritairement opposée. La communauté scientifique, elle-même, n’y est pas unanimement favorable – MM. Séralini et Gouyon, par exemple, ont émis, devant nous, des réserves. Mais tous ont dit souhaiter que la recherche ne soit pas freinée, et même les plus opposés aux essais en plein champ ont soutenu que, seuls, des obstacles financiers, et en aucun cas des obstacles scientifiques ou techniques, empêchaient que l’on fasse ces essais dans des conditions de sécurité parfaite évitant toute dissémination et assurant une meilleure traçabilité. S’agissant d’un enjeu de cette importance, la France et l’Union européenne ne pourraient-elle à la fois se réconcilier avec leur opinion publique et regagner du terrain sur les autres pays du monde en finançant de tels essais, dont le coût est très inférieur à celui de telle ou telle grande infrastructure ?
M. Christian JACOB : Je ne suis pas sûr que la difficulté soit essentiellement économique. Notre système d’information est ainsi fait que, si l’on programme un essai en plein champ, le maire de la commune est obligé d’indiquer sur quelle parcelle il aura lieu, ce qui ne manque pas de créer l’événement médiatique... Mais on peut très bien définir des périmètres expérimentaux. En tout état de cause, il y a forcément un moment où la recherche doit se faire en milieu naturel car il y a des éléments qu’on ne peut pas mesurer en milieu confiné. Je trouve seulement dommage qu’on mette l’accent sur les seules mesures de prévention – même si elles sont évidemment nécessaires – et pas sur le risque de handicaper notre recherche par rapport à celle des pays concurrents.
M. le Président : Tous ceux ici qui ont participé au déplacement à Toulouse ont pu constater que le maïs en serre ne se comporte pas du tout comme en plein champ : il recherche la lumière, s’élève jusqu’à trois mètres de hauteur, n’a pas la même rusticité, les mêmes caractères agronomiques. S’agissant, par exemple, de la résistance au stress hydrique, on nous a expliqué qu’il fallait passer par le plein champ, et retrouver ensuite le gène par sélection naturelle et croisements successifs ; en d’autres termes, l’OGM ne sert qu’à un moment donné de l’expérimentation, pour rechercher un gène et vérifier ses caractères agronomiques.
Quant à la transparence, sans doute en faut-il plus encore qu’aujourd’hui, mais pourquoi devrait-elle se limiter aux OGM ? J’observe qu’il n’est pas obligatoire, actuellement, de faire état de l’utilisation de produits phytosanitaires pendant la culture, alors que leurs dangers sont unanimement admis, qu’il s’agisse de l’atrazine ou de la simazine. Pourquoi la polémique porte-t-elle sur les OGM et pas sur tous les sujets concernant notre alimentation ? C’est une vraie question, et une question majeure.
M. le Rapporteur : Vous avez évoqué le taux de 0,9 %. Qu’en pensez-vous ? Et que pensez-vous également du taux de 0,5 % préconisé par certains pour l’étiquetage des semences ?
Quels sont, d’autre part, les produits OGM commercialisés en France ?
M. Christian JACOB : S’agissant des taux, la démarche de la France et de l’Union européenne est de voir à quel niveau l’OGM est décelable de façon certaine. Aux Etats-Unis, il n’y a pas de taux, au Japon il est de 5 %. Nous avons voulu descendre symboliquement sous la barre de 1 %. Je n’ai pas compétence pour dire si ce taux est plus judicieux qu’un autre, je sais seulement que, du point de vue du principe de précaution, nous sommes ceux qui plaçons la barre le plus haut.
M. le Rapporteur : Les Allemands voudraient 0 %.
M. Christian JACOB : C’est quasiment impossible à garantir, surtout sur les produits induits, dans la mesure où il n’y a pas de traces.
M. le Président : Il y a plusieurs réglementations différentes sur le seuil de contamination fortuite. Il est de 0,9 % pour l’autorisation de mise sur le marché, de 0,9 % également pour l’étiquetage des produits issus d’OGM, et sera peut-être de 0,5 % pour les semences – je ne sais pas si la décision est définitivement prise, car certains voudraient un seuil plus élevé pour certaines semences et plus bas pour d’autres. D’aucuns proposent de le fixer à 0,9 % aussi pour l’agriculture biologique, mais les agriculteurs bio demandent qu’il soit fixé plus bas, voire ajusté à la baisse en fonction du degré de précision permis par les techniques de détection. Enfin, pour l’expérimentation, dans la mesure où elle est sujette à autorisation, il n’y a pas de seuil : il serait théoriquement de zéro, car on considère qu’il ne doit pas y avoir de contamination fortuite, mais, dans le même temps, on ne sait pas très bien comment la traiter si elle a lieu … Comment la DGCCRF peut-elle gérer une situation aussi compliquée ?
M. Christian JACOB : La DGCCRF sait tout gérer… Cela dit, si l’on avait un seul taux, ce serait évidemment beaucoup plus rationnel et plus clair pour le consommateur.
Quant aux produits OGM autorisés, ils sont au nombre d’une quinzaine, des oléagineux pour l’essentiel : le maïs doux Bt 11 et NK 603, les ingrédients dérivés du soja Roundup Ready et des maïs Bt 11, Bt 176, MON 810, T 25 et NK 603, ainsi que les huiles dérivées de cinq colzas et de deux cotons. Je vous communiquerai la liste, naturellement.
M. le Président : Sont-ils étiquetés ?
M. Luc VALADE : Les produits étiquetés OGM sont surtout des ingrédients de produits finis. Il n’y a pas, sur la liste, de produits transformés destinés au consommateur humain, mais il peut y en avoir, à cause de certains amidons ou de la lécithine de soja, des dérivés d’OGM.
M. le Président : Il n’y a pas de surgelés OGM ?
M. le Rapporteur : Ni l’équivalent du ketchup OGM que l’on trouve au Royaume-Uni ?
M. Luc VALADE : C’est très rare.
M. le Président : Findus avait commercialisé un poisson surgelé OGM. Est-il toujours en vente ?
M. Luc VALADE : Non. En 1998-1999, les grands groupes qui avaient fait l’option des OGM sont revenus sur cette stratégie et il n’y a pratiquement plus de produits s’affichant OGM. Nous avons de temps en temps, sur les listes d’ingrédients de certains produits, des lécithines ou des amidons à base d’OGM, c’est-à-dire des produits de l’avant-dernière transformation, pas de la dernière transformation.
M. le Rapporteur : Avez-vous les mêmes indications pour les importations ?
M. Luc VALADE : La même réglementation s’applique aux produits importés.
M. le Rapporteur : Mais avez-vous les moyens de le contrôler ?
M. Luc VALADE : C’est effectivement difficile à déceler dans certains produits comme les huiles, mais nous demandons des données documentaires au fabricant ou au distributeur français sur l’origine et l’historique des produits.
M. le Président : Pour tous les produits ?
M. Luc VALADE : Dès lors que l’on veut alléguer l’absence d’OGM, il faut en toutes circonstances le prouver par des bulletins d’analyse ou par une traçabilité documentaire des matières premières utilisées.
M. le Président : Y a-t-il des fraudes ? Avez-vous les moyens de faire les contrôles nécessaires, et si oui, comment ?
M. Luc VALADE : Nous n’avons certainement pas les moyens de tout détecter, mais nous avons les moyens analytiques de détecter tous les OGM qui sont autorisés, dès lors qu’il existe des traces. Nous avons fait l’an dernier 80 prélèvements, très ciblés, et 16 % des produits contenaient des OGM à travers un ingrédient. Il s’agissait de présence fortuite.
M. le Président : Pourrons-nous avoir communication du rapport ?
M. Luc VALADE : Il est en train d’être formalisé.
Nous sommes en difficulté, bien entendu, sur des produits comme la lécithine, dont il n’y a pas de traces. Si un distributeur affirmait que telle lécithine est sans OGM, nous lui demanderions de le démontrer, de retracer l’historique du produit au moyen d’un bulletin d’analyse ou de rapports d’audit émanant de son fournisseur étranger.
M. le Président : Il ne s’agit pas d’étiqueter le « sans-OGM », mais seulement les produits qui dépassent le seuil de 0,9 %.
M. Luc VALADE : Nous avons les moyens analytiques de déceler tous les OGM autorisés en Europe.
M. le Président : Et les OGM expérimentaux ?
M. Luc VALADE : Non. Notre mission se limite au contrôle des produits proposés au consommateur.
M. le Président : J’en viens à un autre sujet. Nous avons été très étonnés d’apprendre qu’une note de la DGCCRF imposait de telles contraintes de fabrication qu’il était techniquement impossible d’étiqueter « non-OGM ». On nous a dit qu’il s’agissait d’une « doctrine administrative » de la DGCCRF comme de tous les distributeurs et, au demeurant, non spécifique aux OGM.
M. Luc VALADE : Il nous arrive de faire de la doctrine administrative, non pas pour doubler les textes, mais à la demande des opérateurs eux-mêmes, qui veulent être éclairés sur les règles de loyauté à respecter, dans la mesure où la notion de « sans OGM » n’est pas réglementée. C’est pourquoi il nous arrive d’écrire qu’il est déloyal d’afficher « sans OGM » lorsqu’un produit n’est pas susceptible d’en comporter.
M. Christian JACOB : Je pense qu’il s’agit de la note d’information n°2004-113 de la DGCCRF, en date du 16 août 2004, relative aux allégations sur l’absence d’OGM et que je vous remets. Le résumé de la note dit ceci : « Pour la filière alimentaire, le règlement (CE) n°1829/2003 instaure une obligation d’étiquetage de la caractéristique OGM, exception faite des cas de présence fortuite inférieure à 0,9 %. En revanche, les dispositions communautaires ne réglementent pas l’utilisation des allégations du type « sans OGM ». La présence note précise les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent alléguer l’absence d’OGM.»
Il n’est donc pas interdit d’étiqueter « non-OGM », mais si on le fait, il faut prouver ce qu’on avance.
M. le Président : La grande distribution nous a dit qu’elle ne voulait pas se lancer dans cette voie.
M. Christian JACOB : Sans doute est-ce parce que la démonstration est très difficile à faire. Et les grands distributeurs le font d’autant moins qu’ils s’exposent, en cas d’inexactitude, à de graves sanctions pénales pour tromperie et publicité mensongère.
M. Luc VALADE : Certains auraient souhaité pouvoir écrire « sans OGM », dès lors que le taux est inférieur au seuil de 0,9 %, c’est-à-dire au seuil d’obligation d’étiquetage.…
M. le Président : Nous avons mieux compris, grâce à vous, ce qu’il en est de la doctrine administrative sur le « sans OGM ». On peut d’ailleurs, là-dessus, avoir la même position que sur l’agriculture biologique : si certains veulent aller plus loin, pourquoi pas, mais à condition qu’ils puissent le démontrer…
Pourrez-vous, j’y insiste, nous communiquer, très rapidement pour notre rapport, la liste complète des produits OGM distribués ainsi que les résultats des enquêtes sur les prélèvements opérés l’an dernier ?
M. Christian JACOB : Bien entendu. Je vous laisserai la liste en partant et vous en ferai parvenir une version plus formelle
M. Luc VALADE : Le résultat des enquêtes vous sera adressé sitôt que le document sera formalisé et aura reçu l’aval du ministre.
M. le Président : Madame, messieurs, nous vous remercions pour cet échange de vues très intéressant et de grande qualité.
Audition de M. Serge LEPELTIER,
ministre de l’écologie et du développement durable
(extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Monsieur le ministre, nous vous remercions d’avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le quatrième membre du Gouvernement, avant M. Douste-Blazy que nous recevrons demain matin et qui clôturera une série d’auditions entamée le 9 novembre 2004. Au total, nous aurons entendu plus de cent personnes dans le cadre d’auditions privées et de tables rondes thématiques puis contradictoires, visité deux régions françaises et effectué trois déplacements à l’étranger, aux Etats-Unis, en Espagne et en Afrique du Sud. Nous avons ainsi pu approfondir la réflexion sur ce sujet difficile mais passionnant.
Une de nos tables rondes contradictoires était évidemment consacrée aux impacts des OGM sur l’environnement qui, avec les risques sanitaires, sont fréquemment évoquées.
M. Serge LEPELTIER : Je tiens au préalable à insister sur l’importance de votre mission. La question des OGM, sérieuse et complexe, trop souvent abordée dans un contexte passionnel et partisan, sous les projecteurs des médias, mérite mieux que des polémiques superficielles et impropres à toute réflexion de fond. Votre mission d’information contribuera à un débat serein et objectif. Vos conclusions guideront utilement l’action des pouvoirs publics. Je me félicite à ce titre que le champ d’origine de votre mission ait été élargi pour y inclure l’utilisation des OGM, ouvrant ainsi l’ensemble des problématiques liées aux organismes génétiquement modifiés.
C’est donc avec beaucoup de satisfaction que j’interviens devant vous aujourd’hui.
Le ministère de l’écologie et du développement durable est fortement impliqué sur le sujet des organismes génétiquement modifiés, tant par conviction que par le rôle qui lui revient en application de la réglementation en vigueur.
Mon action dans ce domaine est guidée par quatre convictions : il ne faut pas limiter par principe et a priori la recherche ; il faut une rigueur sans faille ; il faut faire preuve de transparence ; il faut préserver la liberté de choix des professionnels et des consommateurs.
Ajoutons que mes décisions et plus généralement celles du Gouvernement s’inscrivent dans le cadre d’une approche de précaution : au moindre doute exprimé par nos instances d’expertise, je m’oppose aux autorisations.
L’action du ministère de l’écologie et du développement durable en matière d’OGM se situe tout à la fois aux niveaux international, communautaire et national.
Au niveau international, mon ministère a été désigné point focal national pour l’application de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, et pour l’application du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques.
La convention d’Aarhus comporte un volet OGM que les organisations non gouvernementales et les pays dépourvus de cadre réglementaire applicable aux OGM souhaitent développer et rendre juridiquement contraignant. La France estime pour sa part que cette convention n’est pas le meilleur outil et encourage ces pays à ratifier le protocole de Carthagène dont l’objectif est d’assurer un degré adéquat de protection de l’environnement et de la santé humaine lors des transferts internationaux des OGM et qui nous paraît l’instrument international aujourd’hui le plus adapté. C’est la position que j’ai défendue lors du dernier Conseil « Environnement ». Mon ministère joue un rôle essentiel d’animation interministérielle dans la mise en œuvre de ces deux engagements internationaux dont les implications aux niveaux communautaire et national peuvent être considérables.
Sur le plan communautaire, le ministère de l’écologie intervient, avec les autres départements ministériels concernés, dans chaque dossier de mise sur le marché d’OGM. J’exprime donc ma position sur chaque dossier individuel dans le cadre des consultations interministérielles et sur la base des avis des instances d’expertise compétentes. J’exprime par ailleurs la position de la France lorsque les décisions doivent être examinées au conseil des ministres de l’environnement.
Au niveau national enfin, mon ministère assure le co-secrétariat de la commission du génie génétique et de la commission du génie biomoléculaire, ainsi que la coprésidence du comité provisoire de biovigilance. Je suis par ailleurs consulté avant toute autorisation d’essai au champ, délivrée par le ministre en charge de l’agriculture, après avis de la Commission du génie biomoléculaire (CGB).
Le ministère de l’écologie et du développement durable est donc présent dans toutes les procédures nationales, communautaires et internationales liées aux OGM.
Le cadre réglementaire communautaire et national régissant les OGM a considérablement évolué. L’Union européenne s’est dotée durant ces dernières années d’une législation en matière tant d’utilisation confinée que de dissémination volontaire, de traçabilité et d’étiquetage ou encore de mouvements transfrontières des OGM. Cette réglementation apparaît très aboutie par rapport à ce qui existe dans le reste du monde.
C’est la mise en place de ce nouveau cadre réglementaire qui a amené la Commission européenne à reprendre en 2004 l’instruction des dossiers de demande de mise sur le marché, suspendue depuis 1998.
Afin de rendre pleinement applicable cette réglementation, il revient au Gouvernement de procéder aux évolutions réglementaires et de proposer au Parlement les évolutions législatives nécessaires.
Cela ne signifie pas pour autant que des discussions ne puissent pas se poursuivre au sein des instances communautaires sur l’évolution souhaitable des directives européennes. Mais en attendant, la France a un devoir de transposer les directives européennes existantes.
Parmi ces évolutions nécessaires, j’en mentionnerai une qui me concerne tout particulièrement : le renforcement des procédures d’évaluation du risque sanitaire et environnemental dans le cadre de la dissémination volontaire des OGM dans l’environnement. Sans attendre la modification du droit national, ces évolutions ont d’ores et déjà été intégrées par la Commission du génie biomoléculaire dans son travail d’évaluation des dossiers de demande de mise sur le marché.
D’autres évolutions sont prévues par les directives cadres sur les OGM. Un projet de loi de transposition, porté par mon collègue chargé de la recherche, a été élaboré après de longs mois de concertation entre les ministères concernés.
La France a déjà pris beaucoup de retard dans la transposition de ces directives. Elle fait à ce titre l’objet de deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes datant de novembre 2003 pour manquement en transposition des dispositions des directives relatives à la dissémination volontaire et à l’utilisation confinée des OGM. Vous conviendrez avec moi que cette situation n’est pas satisfaisante. La transposition de ces directives est donc une priorité.
Le Gouvernement considère que le projet de loi qui sera déposé au Parlement devra proposer une réforme des instances nationales d’expertise. Est ainsi prévue la création d’une instance unique et lisible, le Conseil des biotechnologies, qui serait composée de deux sections : une section scientifique, qui remplacera la commission du génie génétique, la commission du génie biomoléculaire et le comité de biovigilance, et une section socio-économique. Chacune de ces sections serait saisie pour avis sur chaque dossier individuel nouveau. J’attacherai pour ma part une importance particulière à la définition des règles de fonctionnement du conseil des biotechnologies, qui devront notamment répondre aux attentes en termes de participation de la société civile.
Dans le cadre de la préparation de ce projet de loi, j’ai fait valoir mon attachement au droit pour les agriculteurs de choisir librement leur mode de production, notamment biologique, et à celui des consommateurs et du public d’être correctement informés.
Le dispositif national d’information du public a déjà connu des améliorations importantes. Un site interministériel sur les OGM, www.ogm.gouv.fr, a été mis en place depuis plus d’un an, qui non seulement offre au public des informations générales et assez complètes sur les organismes génétiquement modifiés, mais lui permet de donner son avis avant toute autorisation d’essai au champ.
Par ailleurs, les décisions d’essais sont prises à l’issue d’un processus d’information et d’entretiens entre les maires des communes concernées et les agents des directions régionales de l’agriculture et de la forêt du ministère chargé de l’agriculture. Avec mon collègue Dominique Bussereau, nous venons justement de rappeler ce dispositif d’information.
Permettez-moi enfin de m’attarder sur une question dont vous connaissez l’importance : la coexistence.
La coexistence des cultures – OGM, conventionnelles et biologiques – suppose d’examiner trois questions fondamentales : la présence fortuite ou techniquement inévitable d’OGM dans les semences ou les aliments ; les conditions techniques de mise en culture des plantes, semences et plants génétiquement modifiés bénéficiant d’une autorisation communautaire – je pense par exemple aux distances entre cultures –; le régime de responsabilité/réparation.
En ce qui concerne la présence fortuite ou techniquement inévitable, la Commission européenne étudie aujourd’hui la définition de seuils dans les semences pour le maïs et le colza. Un premier projet a dû être retiré en raison des profonds désaccords qu’il suscitait au sein même de ses services. Des seuils pour la présence d’OGM dans les aliments ont en revanche été arrêtés dans les règlements européens84 entrés en application il y a un peu moins d’un an.
La définition générale des conditions techniques de mise en culture est abordée dans le projet de loi que le Gouvernement a préparé. Ces conditions seraient définies ensuite au cas par cas par le ministre chargé de l’agriculture, après avoir recueilli mon avis.
S’agissant enfin de la définition d’un régime de responsabilité/réparation, une étude a été commandée à un cabinet juridique par mon collègue en charge de l’agriculture, dont il vous a parlé la semaine dernière.
Ainsi que vous le voyez, un sérieux travail d’adaptation et de modernisation de l’actuel cadre juridique attend le Gouvernement. Soyez certain que vos constats et vos propositions nous seront utiles. Ils enrichiront nos réflexions et nos travaux et éclaireront le débat qui se déroulera au moment de la discussion du projet de loi sur les OGM au Parlement, dont vous mesurez les enjeux.
M. le Président : Votre action, nous avez-vous dit, est guidée par quatre convictions, dont la première est que l’on ne saurait, par principe, limiter la recherche. Est-ce à dire que, après étude au cas par cas et nonobstant le respect des principes de précaution, de parcimonie et de transparence, vous êtes favorable à l’expérimentation en plein champ ?
M. Serge LEPELTIER : Ce type de recherche doit évidemment être examiné au cas par cas et strictement encadré. Reste que le processus, avant commercialisation, ne saurait se limiter au milieu confiné. L’expérimentation au champ est inévitable dans un second temps. Ou alors, cela reviendrait à bloquer toute commercialisation, ce qui serait un autre choix. Je n’ai aucun a priori personnel contre ces recherches. En revanche, au moindre doute émis lors de la procédure par les instances d’expertise, j’émets un avis défavorable.
Cette position, il faut le remarquer, est assez originale en Europe, le plus souvent partagée entre des pays qui votent systématiquement contre ou systématiquement pour. Le Gouvernement français estime, quant à lui, que le sujet est trop important pour ne pas être examiné avec précision. En cas de doute, nous émettons un avis défavorable et, lorsqu’il n’y en a pas, nous émettons un avis favorable. C’est à nos yeux une question de responsabilité.
M. le Président : Reste qu’entre le camp des pour et celui des contre, s’abstenir signifie ne pas prendre ses responsabilités et revient à laisser la Commission décider. Les tableaux des derniers votes de l’Union européenne montrent que bon nombre de dossiers ont fait l’objet de « non-décisions », alors même que le moratoire avait été levé… La levée du moratoire tient-elle au fait que les cinq dernières années auront permis de lever le doute et d’apporter les assurances souhaitables ?
M. Serge LEPELTIER : La France, en tout cas, n’a jamais botté en touche, bien au contraire : du reste, lorsque la France prend position, c’est par essence une décision au plus haut niveau, autrement dit une réelle prise de responsabilité politique. Au surplus, si la Commission se retrouve à devoir prendre position, c’est parce qu’il n’y a pas de majorité « pour », mais également pas davantage de majorité qualifiée « contre ». Peut-être finirait-il par en aller autrement si nous votions systématiquement contre… En votant pour ou contre, au cas par cas, nous prenons totalement notre responsabilité.
Le moratoire visait à donner le temps de répondre à deux questions : la traçabilité et l’étiquetage. Ces deux conditions, posées par la décision de l’époque, elle-même approuvée par le Gouvernement et la ministre concernée de l’époque, ayant été remplies, le moratoire a logiquement été levé.
M. le Président : De nouvelles questions ont été posées, comme celle de l’étiquetage des produits issus d’animaux ayant eux-mêmes consommé des OGM. Est-ce à dire qu’elles ne sont pas majeures ?
M. Serge LEPELTIER : Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit… Le fait que les conditions posées lors du moratoire aient été levées n’interdit pas de nous poser d’autres questions sur l’étiquetage et la traçabilité. Je me suis moi-même procuré des produits étiquetés issus d’OGM pour les examiner et il me semble que les informations pourraient être encore améliorées. Mais c’est une autre question.
M. le Rapporteur : Vous indiquez vous opposer aux expérimentations dès lors qu’elles susciteront le moindre doute. Une récente étude britannique a laissé entendre que le colza d’hiver génétiquement modifié pourrait porter atteinte à la biodiversité. Mais vérification faite, il est apparu que cette nouvelle étude n’apportait rien par rapport à l’analyse réalisée en 2003… Quelle serait votre attitude si ce cas se posait en France ? Appliqueriez-vous à toute force le principe de précaution, au motif qu’il pourrait y avoir une possible atteinte à la biodiversité, ou seriez-vous d’accord pour autoriser de nouvelles expérimentations ?
M. Serge LEPELTIER : En 1999, le gouvernement britannique a décidé de lancer une étude de grande envergure, dite « Farm Scale Evaluations », pour évaluer l’impact sur l’environnement et la biodiversité des cultures de maïs, de colza de printemps, de colza d’hiver et de betterave rendus tolérants à un herbicide. Le dernier volet de l’étude, concernant le colza d’hiver, a été publié le 21 mars dernier. Pour la betterave et le colza de printemps, les résultats montraient une plus grande efficacité des herbicides dans l’élimination des mauvaises herbes dans les champs OGM que dans les cultures conventionnelles, entraînant une perte de biodiversité ; un effet inverse avait en revanche été observé pour le maïs. Le colza d’hiver rendu tolérant au glufosinate ammonium montre des résultats sensiblement identiques à ceux du colza de printemps, avec notamment une moindre affluence des abeilles et des papillons par comparaison avec les cultures conventionnelles.
L’étude conclut que les différences en termes de biodiversité entre cultures OGM et cultures conventionnelles ne sont pas liées aux OGM eux-mêmes qui n’ont aucun effet toxique sur la flore ou la faune avoisinantes, mais aux pratiques agricoles et, plus particulièrement, à l’utilisation différente des herbicides. Ces conclusions rejoignent celles de la CGB, qui recommande une approche globale prenant en considération les caractéristiques de l’herbicide et de son utilisation actuelle et future, ciblant le cas échéant le choix des couples culture/herbicide en fonction des contraintes liées à l’agriculture française, et coordonnant les expertises menées sur les plantes tolérantes à un herbicide et celles conduites sur les herbicides. Ces conclusions doivent être prises en compte dans la réforme des instances prévue dans le projet de loi ou tout au moins dans les relations que le futur Conseil des biotechnologies, et particulièrement sa section scientifique, entretiendra avec les instances d’expertise compétentes en matière d’herbicides.
M. le Rapporteur : Autrement dit, seriez-vous d’accord pour reprendre des expérimentations de ce type en plein champ ?
M. Serge LEPELTIER : On ne peut évidemment se prononcer qu’au cas par cas, au vu d’un dossier précis et après avis des instances d’expertise. Mais on ne saurait s’opposer a priori à une expérimentation.
M. Germinal PEIRO : On ne peut que souscrire aux quatre principes qui fondent votre action, et particulièrement à celui de la liberté du choix du consommateur, ce qui suppose que celui-ci soit correctement informé. Est-ce à dire que vous êtes favorable à un étiquetage complet sur l’ensemble des produits proposés à la vente, qu’il s’agisse d’OGM proprement dits, de préparations à base d’OGM ou de produits issus d’animaux ayant consommé des plantes génétiquement modifiées ?
Nous nous sommes aperçus que l’on était très rigoureux en France pour ce qui touchait à la consommation d’OGM par les animaux. La grande distribution notamment impose aux éleveurs de donner à leurs animaux une alimentation exempte de tout OGM, alors qu’elle importe et vend dans les mêmes magasins de la viande porcine d’Espagne où 40 % des céréales consommées sont génétiquement modifiées ! Entendez-vous agir pour imposer le même étiquetage aux produits d’importation ?
Enfin, pensez-vous que la liberté de choix sera réellement garantie et que l’Europe ne sera pas un jour ou l’autre totalement envahie par les OGM, du fait des disséminations mais également du poids économique des productions des autres continents ? Pourrons-nous longtemps préserver la possibilité de choix des consommateurs européens ?
M. Serge LEPELTIER : Votre première question rejoint celle de la traçabilité. Elle mérite en tout cas d’être étudiée dans tous ses aspects et toutes ses conséquences. Je ne verrais d’abord que des avantages à vérifier, par le biais de tests auprès de la population, comment l’étiquetage est compris, analysé et réellement pris en compte. Pour ce qui est de la traçabilité, le problème est de déterminer si l’animal a mangé des produits contenant des OGM ou non, ce dont nous sommes incapables pour l’instant. Sur le principe en tout cas, tout cela mérite d’être analysé.
L’Europe pourra-t-elle résister? L’expérience acquise lors des Conseils « environnement », mais également dans le cadre de nos diverses instances d’expertise, la CGB, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et la Commission du génie génétique (CGG), me conduit à penser que nos procédures, à plus forte raison si nous savons les rationaliser dans le cadre de la nouvelle structure proposée, nous permettront de résister tant au niveau national qu’au niveau européen, pour peu que nous soyons déterminés à utiliser les outils dont nous disposons. Tel n’est pas le cas au Brésil, par exemple, où, pour en avoir discuté avec mes homologues, j’ai bien senti l’immensité des obstacles d’ordre tant sociologique qu’économique. Un tiers du soja y est d’ores et déjà OGM. L’Europe apparaît à cet égard comme un territoire relativement préservé et nous avons les outils pour faire en sorte qu’il le reste, si nous le souhaitons.
M. François GUILLAUME : Certes, les procédures prévues semblent conformes au souhaitable… Force est tout de même de relever l’ambiguïté de la position de la France, partagée entre les manifestations d’hostilité aux OGM et le point de vue quasi unanime des chercheurs, confortés par les déclarations de trois académies démontrant l’innocuité des OGM. Personne n’a jamais pu mettre en évidence le moindre risque pour la santé. Quant aux risques que pourraient présenter des disséminations fortuites pour la biodiversité, on sait à tout le moins les limiter au maximum.
La position de la France est apparue d’autant plus ambiguë que le précédent ministre de l’agriculture est allé jusqu’à déclarer qu’il était « personnellement » contre les OGM ! J’ai l’impression que l’on retarde en permanence l’heure de la décision en multipliant les modifications de procédures et les nouvelles études, de plus en plus coûteuses, sans chercher à profiter de l’expérience acquise aux Etats-Unis, en Chine ou en Afrique du Sud. Il faudra bien aboutir un jour, faute de quoi nous allons nous heurter à un sérieux problème d’approvisionnement en soja – plusieurs industriels s’en sont déjà fait l’écho –, mais également à un problème commercial : croyez-vous que le commissaire européen chargé de ces questions sera aussi ferme que vous, M. le ministre ? L’interdiction de l’importation en Europe des viandes hormonées – parfaitement naturelles et reconnues sans danger – nous coûte chaque année 100 millions de dollars d’avantages commerciaux concédés aux Etats-Unis… Si l’Europe était pénalisée dans les mêmes conditions pour ce qui est du maïs et du soja, l’addition deviendrait financièrement insupportable. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, prenons les problèmes dans leur réalité et mesurons les obligations auxquelles nous serons obligés de souscrire. Que l’Europe soit libre d’importer ce qu’elle veut et les consommateurs européens de manger ce qu’ils veulent, c’est très bien ; mais pour ce qui est de l’application pratique, c’est une autre histoire !
M. Serge LEPELTIER : Il n’y a pas d’ambiguïté dans la position française : nous n’avons pas de position idéologique et nous regardons au cas par cas. Si la CGB ou l’AFSSA émettent le moindre doute au cours de la procédure, nous votons contre. Lorsqu’il n’y en a aucun, nous votons pour. C’est la position que je prends partout où je suis amené à donner mon avis. Nous ne nous abstenons pas à Bruxelles : nous votons ou bien contre, ou bien pour. Il n’y a là aucune ambiguïté et c’est précisément l’honneur de notre pays de ne pas se réfugier dans une position tranchée a priori.
Quant aux conséquences sur nos relations commerciales avec tel ou tel pays, elles n’ont rien à voir avec le sujet qui nous occupe : les conséquences des OGM sur l’environnement. Les conséquences commerciales sont un autre sujet. Si les OGM posaient réellement un problème environnemental, il ne me viendrait pas à l’idée de ne pas en tenir compte pour des raisons commerciales. L’enjeu est beaucoup trop grave. S’il y a doute, il faut résoudre le problème commercial différemment. C’est en tout cas la position du Gouvernement.
M. François GUILLAUME : Mais en attendant, on ne fait que différer les réponses. Nos voisins espagnols commercialisent les OGM et notre collègue Germinal Peiro en a évoqué les conséquences. Quand prendra-t-on enfin une décision en France, où toutes les instances compétentes se sont déjà prononcées ? Ou c’est oui, ou c’est non, mais ne nous renvoyez pas en permanence à de nouvelles études pour prendre une décision ! Sinon, un jour où l’autre, elle finira par nous être imposée.
M. Serge LEPELTIER : Les décisions sont prises au niveau européen et nous les appliquons.
M. François GROSDIDIER : Ayant beaucoup moins de certitudes que mon collègue, je salue la sagesse et la prudence du Gouvernement français… Mais pourquoi les textes régissant les expertises toxicologiques sur les pesticides contenus dans les OGM sont-ils moins exigeants que les textes applicables aux pesticides chimiques ? Pourquoi notamment n’applique-t-on pas aux OGM les tests d’alimentation sur animaux à 90 jours ? Pourquoi enfin les résultats des seuls tests de ce type, pratiqués par Monsanto, ne sont-ils pas publiés ? On ne saurait prétendre que le secret industriel s’applique à un test comparatif entre deux groupes de rats, le premier nourri aux céréales conventionnelles, le second aux OGM. Ce silence ne peut qu’entretenir le doute et la suspicion. Le ministère de l’agriculture refuse de lever la clause de confidentialité au motif que le dossier a été déposé dans un autre Etat membre. Y a-t-il un moyen d’améliorer la transparence dans ce domaine et d’appliquer aux OGM et aux pesticides chimiques les mêmes procédures d’expertise toxicologique ?
Il y a certes un moment où il faut passer de l’expérimentation en milieu confiné aux essais en plein champ. Les scientifiques ne sont pas, sur cette question, aussi unanimes qu’on le prétend : nous en avons entendu deux, et non des moindres, émettre des réserves sur les essais au champ. Ne pourrait-on songer à accroître les investissements publics pour mettre en place soit des espaces confinés plus vastes, soit des parcelles d’expérimentation plus isolées du reste des cultures, afin que la recherche française et européenne ne prenne pas de retard tout en se donnant davantage de marges de sécurité ?
Comment, enfin, faire en sorte que l’étiquetage des produits issus d’animaux ayant consommé des OGM s’applique à la production nationale comme aux importations afin de ne pas créer de distorsions de concurrence dans les hypermarchés ?
M. Serge LEPELTIER : Nous souhaitons également parvenir à un rapprochement des procédures d’expertise applicables aux OGM et aux pesticides conventionnels. C’est du reste tout l’esprit de la création du Conseil des biotechnologies. Je ne puis en revanche vous répondre sur les tests à 90 jours. Pourquoi pas ? Encore faut-il en mesurer toutes les conséquences. Je ne verrais enfin que des avantages à ce que les résultats des derniers tests Monsanto soient diffusés dans une totale transparence. Certes, il peut parfois se poser des questions de secret de fabrication ; il faudrait savoir ce qu’en pense la CGB, mais je ne vois pas pourquoi elle s’opposerait à la communication de ces résultats.
S’agissant des expérimentations en plein champ, je suis tout à fait favorable à une intensification des investissements de recherche publique. Reste que les essais en champ sont, en l’état actuel des choses, incontournables dans la procédure qui va de l’expérimentation en milieu confiné à la commercialisation : il faudra toujours connaître les conséquences sur l’environnement d’une culture avant de la commercialiser.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : Vous avez, à juste titre, insisté sur la liberté des agriculteurs dans le choix des formes de cultures, ce qui pose le problème de leur coexistence, et particulièrement dans le cas de l’agriculture biologique. Le taux maximum de contaminations fortuites, fixé à 0,9 %, n’empêche pas le risque de pollinisations, y compris à l’occasion des essais en plein champ jusqu’à présent autorisés, surtout lorsqu’il s’agit de colza. Entendez-vous augmenter les distances d’isolement préconisées par la CGB afin d’entourer les essais au champ de toutes les garanties nécessaires ?
Ajoutons que l’information des maires n’est pas aussi parfaite que vous ne le dites. Plusieurs d’entre eux nous ont assuré qu’ils avaient été informés au tout dernier moment de l’organisation d’essais en plein champ juste à côté de productions biologiques soutenues tant par le conseil général de mon département que par la région Midi-Pyrénées. J’aimerais connaître votre avis sur ce problème.
Enfin, si pratiquement tous les scientifiques nous ont assuré que les OGM ne faisaient pas courir de risque pour la santé, il n’en a pas été de même pour la biodiversité. Dès lors, dans quelles conditions peut-on autoriser les essais en plein champ et à plus forte raison la commercialisation ?
M. Serge LEPELTIER : La définition de seuils de présence fortuite et d’un régime de responsabilité dommages est un des éléments majeurs de nature à permettre la coexistence des cultures. C’est également une exigence démocratique : nous devons faire en sorte que quelqu’un qui ne veut pas produire d’OGM n’en ait pas chez lui.
Le ministère de l’écologie a participé à l’élaboration de la contribution française transmise à la Commission en réponse à sa recommandation du 23 juillet 2003 établissant des lignes directrices pour l’élaboration de stratégies nationales de meilleures pratiques visant à la coexistence des cultures. Cette contribution représente une première ébauche de spécifications techniques applicables à la betterave, au maïs et au colza, avec notamment des distances d’isolement calculées en fonction des spécificités biologiques des espèces considérées : mode de reproduction, taux d’allogamie, aptitude à se croiser avec des plantes cultivées ou sauvages, aptitude à se reproduire spontanément. Ces spécifications sont évidemment plus ou moins aisées à mettre en œuvre selon qu’il s’agit d’une plante à forte capacité de dissémination, comme le colza, ou d’une plante plus facilement maîtrisable comme le maïs. Les distances envisagées variaient de 1 000 mètres entre cultures commerciales de semences de betterave, à 50 mètres de bordure à bordure entre un champ OGM et un champ non-OGM de maïs de consommation dans le sens du vent dominant. La définition même des distances d’isolement entre les cultures fait actuellement l’objet d’expérimentations réalisées par les plates-formes d’essais inter-instituts dont il convient d’attendre et d’exploiter les résultats.
La Commission a décidé de laisser les Etats membres définir des conditions techniques nationales, mais ceux-ci ont été nombreux à souhaiter des règles harmonisées au niveau européen. La définition de règles techniques et la question plus générale de la coexistence des cultures sont un enjeu important pour la Commission, mais, en l’état actuel des choses, nous restons dans un cadre plutôt national.
L’information des maires et des collectivités locales est une question à mes yeux essentielle. La procédure d’information est mise en œuvre par des agents du ministère de l’agriculture et je vérifierai avec mon collègue si elle se déroule de façon satisfaisante. Si tel n’est pas le cas, nous prendrons les mesures qui s’imposent.
La superficie totale des essais en champ est passée de 85 hectares en 1999 à 7 hectares aujourd’hui ; cela montre à quel point ils ont été encadrés. Reste qu’ils sont indispensables, ne serait-ce que pour mettre au point des distances d’isolement adaptées.
M. le Président : Vous avez cité deux exemples de distances d’isolement, mais il existe bien d’autres cas de figure. Pouvons-nous avoir communication des résultats de vos travaux ? Une plate-forme technique – Arvalis en l’occurrence – travaille actuellement sur le problème des contaminations avec 17 hectares de maïs dans les Landes. Même si, réglementairement, il n’y avait pas lieu de communiquer sur cette affaire, n’aurait-il pas été préférable que nous le sachions avant ? Je comprends que l’on veuille se protéger contre des destructions, mais n’est-ce pas de nature à conforter, après coup, l’hostilité des gens vis-à-vis des expérimentations – même si, en l’espèce, il s’agissait de variétés autorisées ?
M. Serge LEPELTIER : Je suis pour un maximum de transparence, mais il ne faut pas non plus être suicidaire… On ne peut que regretter que, parce que certains refusent de respecter la loi, on fasse de moins en moins d’essais qui, du coup, n’en sont que plus utiles. Il faut espérer que nous saurons sortir d’une situation où, probablement, tout ne peut pas être dit, et faire preuve à terme de la plus totale transparence sur ces questions.
M. le Président : Et sur les distances d’isolement ?
M. Serge LEPELTIER : Cela relève beaucoup plus du ministère de l’agriculture, mais nous vous donnerons tous les documents en notre disposition.
M. Pierre COHEN : Un des objectifs de notre mission était de permettre la réussite des expérimentations en plein champ en évitant les arrachages et en montrant leur utilité aux populations. Malheureusement, vous les avez replacées dans un triptyque que ne renierait pas François Guillaume, pour lequel la recherche en milieu confiné puis les expérimentations en plein champ ne servent à rien si elles ne débouchent pas sur une production… Je fais quant à moi partie de ceux qui y voient un autre enjeu, phénoménal, celui de la connaissance, qui doit passer avant l’enjeu commercial, cause de tant de dégâts dans le monde de la recherche. Ajoutons que ces expérimentations en grandeur nature vont également dans le sens de ceux qui doutent et s’interrogent sur les conséquences potentielles des OGM en leur fournissant les éléments propres à alimenter le débat avec le reste du monde, et particulièrement les pays qui détiennent cette connaissance. Autrement dit, l’enjeu, pour l’heure, n’est pas de produire – j’y suis pour ma part assez défavorable –, mais de préserver notre savoir, afin de ne pas dépendre de connaissances importées et de résister aux diktats de l’extérieur.
Je vous ai entendu mettre en avant des notions et des conditions très proches de celles que nous défendons. Mais il est inutile de présenter ce triptyque « recherche en milieu confiné - essais au champ - production » comme une fatalité. L’évaluation du rapport bénéfice/risque ne peut se concevoir que si les essais au champ dépassent le seul cadre de l’amélioration à fins de production. Or bon nombre de demandes d’essais en champ se limitent à des améliorations de productivité ou de rentabilité, autant de préoccupations tout à fait compréhensibles mais que ne partageront pas forcément ceux qui sont installés aux alentours… Le message du ministre de l’environnement sera d’autant plus crédible que les expérimentations en plein champ n’y seront pas implicitement présentées comme un préalable à la commercialisation.
M. Serge LEPELTIER : J’ai seulement dit que la commercialisation d’un produit supposait des essais en plein champ, et non que les essais, confinés ou en plein champ, ne pouvaient avoir qu’un but de commercialisation… Je suis parfaitement d’accord avec vous : la finalité de recherche fondamentale est très importante. L’INRA peut à cet égard jouer un rôle de premier plan. Or cet établissement public est aujourd’hui confronté à une situation très préoccupante du fait des difficultés à obtenir les autorisations d’essais et des destructions de ses expérimentations autorisées. Sa présidente directrice générale m’en a encore tout récemment entretenu. Nous devons lui donner les moyens de mener à bien ses missions.
M. le Président : La situation est tellement bloquée qu’il faut au préalable essayer de comprendre pourquoi les gens sont opposés. Un cheminement à pas lents, et prioritairement axé sur la recherche, me paraît une meilleure solution que le passage en force de Monsanto, qui s’est soldé par un échec.
Vous proposez la création d’un Conseil des biotechnologies composé de deux sections, ce qui nous paraît bien venu. Nous préconiserons un rééquilibrage au sein de la section scientifique afin d’y améliorer la part de l’environnement et de l’écologie, comme on nous l’a souvent demandé. Mais la section socio-économique sera-t-elle systématiquement conviée à donner son avis au cas par cas ? Comment une association de consommateurs ou de protection de l’environnement pourra-t-elle à chaque fois avaler un dossier de cinq cents pages pour donner valablement son avis ? Ne vaudrait-il pas mieux qu’elle soit consultée sur les grandes orientations : l’utilité de tel OGM, l’évaluation du bénéfice/risque, la nécessité de l’expérimentation ? Si vous la consultez au cas par cas, ne risquez-vous pas d’être systématiquement confronté à un avis positif de la section scientifique et à un avis négatif de la section socio-économique ? Non seulement vous ne seriez alors pas plus avancé pour exercer votre choix, mais personne ne saurait sur quels critères le Gouvernement aurait pris sa décision et ce serait encore plus mal perçu dans l’opinion. Autrement dit, cette affaire ne serait pas gérable et nous tenions à vous en alerter.
Enfin, si le comité provisoire de biovigilance, appelé à être regroupé au sein du Conseil des biotechnologies, a peu fonctionné, c’est tout simplement parce que la loi d’orientation agricole de 1999 ne traitait que des cultures et non des expérimentations. Ne pensez-vous pas que la biovigilance s’impose également pour les expérimentations ?
M. Serge LEPELTIER : Le Conseil des biotechnologies sera effectivement composé de deux sections pour éviter toute confusion des genres entre l’expertise proprement dite et la discussion, véritable acte de démocratie et de concertation, entre des personnes aux priorités parfois différentes. Trop souvent, les organismes appelés à donner des avis au ministre de l’environnement sont composés d’experts et de personnalités de la société civile ayant des positions quasi systématiques sur les sujets présentés, à tel point qu’il devient impossible de s’appuyer sur une expertise valable. Parfois même, la crédibilité de ces organismes, du fait des personnalités qui les composent, est telle aux yeux de l’opinion qu’il est très difficile pour le ministre de ne pas suivre ce qui pourtant n’est réputé qu’un avis… Autant de raisons pour lesquelles le Gouvernement entend dissocier la partie « expertise » de la partie « consultation de la société civile ». C’est dans cet esprit que j’ai créé un conseil scientifique auprès du conseil national de protection de la nature.
La section socio-économique sera-t-elle pour autant appelée à se prononcer sur chaque dossier ? L’avis de votre mission sera très regardé… On sent bien la difficulté du problème. L’idée selon laquelle la section socio-économique examinerait les dossiers d’OGM par type et non pas un par un mérite d’être examinée de très près. Il faudrait pouvoir poser des règles précises. Elle suscite en tout cas débat.
M. Pierre COHEN : N’y a-t-il pas un risque à demander à la société civile de répondre, sinon de manière idéologique, du moins en prenant des positions plutôt générales, alors que nous nous accordons tous à reconnaître que ces dossiers appellent à être traités au cas par cas et au regard de situations bien particulières ? N’est-ce pas contradictoire ?
M. Serge LEPELTIER : C’est précisément tout le débat, et il est tout à fait légitime. C’est pourquoi il vous faut l’aborder. Votre Président posait le problème sous l’angle de l’efficacité.
M. Pierre COHEN : Je comprends.
M. Serge LEPELTIER : La section socio-économique devra évidemment avoir accès à chaque dossier individuel. La transparence devra être totale.
M. Pierre COHEN : C’est certain.
M. Serge LEPELTIER : Reste à savoir la nature de l’avis qu’elle devra émettre.
M. François GROSDIDIER : Contrairement à la section scientifique, la section socio-économique n’aura pas à juger du risque en lui-même, mais du rapport bénéfice/risque pour la société. L’INRA vient à cet égard de nous communiquer un remarquable travail. Or certaines personnes, de la Confédération paysanne notamment, n’ont eu de cesse de jeter la suspicion sur ses analyses au motif que l’INRA vivait pour une large part de commandes privées, ce qui pouvait créer des collusions d’intérêt… Au-delà des chartes déontologiques, ne faudra-t-il pas prévoir des garanties supplémentaires en soumettant les membres de la future section scientifique à des obligations très strictes et en interdisant à un chercheur public d’expertiser un dossier sur lequel il aurait auparavant eu à travailler dans le cadre d’une commande privée ? Nous nous mettrions ainsi à l’abri de tout soupçon.
M. le Rapporteur : Cela vaut également pour les ONG85 recevant des subsides de certaines sociétés…
M. Serge LEPELTIER : La question des intérêts croisés est également fondamentale et mérite d’être examinée de très près. Les chercheurs étant par nature conduits à mener des recherches et à faire des expertises pour vivre, la question de leur indépendance est posée. Il faut à l’évidence être d’une extrême vigilance sur les intérêts croisés. Il y va du crédit des organismes et des personnalités en cause, même si elles sont le plus souvent d’une scrupuleuse honnêteté.
M. le Président : Il est évidemment nécessaire que les intérêts croisés soient déclarés et qu’une personne ne se retrouve pas juge et partie. Mais il ne faudrait pas pour autant se retrouver dans la situation dont nous avons eu vent ce matin, à propos de Tchernobyl, où une association reprend au mot près un remarquable rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de 2002, en présentant un travail de recherche publique – si souvent contestée –, comme la découverte d’une commission indépendante ! Autant il faut être très strict pour ce qui touche aux intérêts croisés public/privé, autant il faut favoriser le rôle d’expertise de la recherche publique. Les commissions dites indépendantes sont souvent très dépendantes d’intérêts privés.
M. François GUILLAUME : Après avoir reproché par le passé à la recherche publique et aux universités de ne pas entretenir de contacts avec les entreprises et encouragé les contrats de recherche, n’allons pas aujourd’hui leur faire grief des contacts qu’elles ont noués avec le secteur privé !
Lorsque l’on interroge un membre du Gouvernement, c’est pour qu’il nous explique la politique que ce Gouvernement entend suivre sur un point précis, en l’occurrence dans le domaine des OGM. La plupart des chercheurs que nous avons auditionnés y sont favorables. Quelques-uns, certes, ne l’étaient pas – ils n’étaient, du reste, pas toujours très sérieux… Quoi qu’il en soit, après avoir entendu des points de vue différents, arrive un moment où il faut juger, trancher et prendre une position qui, naturellement, ne satisfera pas tout le monde. Aucune position ne sera jamais approuvée à 100 %.
La démarche que vous proposiez dans votre intervention est parfaite. Mais avec une commission à deux sections, dont l’une plus « politique » que l’autre, il sera difficile de trancher, d’autant qu’il faudra tenir compte du « tam-tam médiatique »… Sagement, la France comme l’Europe ont décidé de traiter le problème des OGM au cas par cas. Traitons-le cas par cas au lieu de tout mélanger, d’accumuler les problèmes des OGM médicamenteux, des gènes plus complexes, des plantes qui disséminent plus que d’autres, etc. ! A force de ne rien décider, nous nous retrouverons en arrière et incapables de résister à la concurrence des autres pays, sur le plan tant des semences que des productions agricoles.
Ainsi, le maïs Bt a fait l’objet de toutes les analyses possibles et imaginables. On sait comment son pollen se disperse, on sait que le maïs hybride ne se reproduit pas, on connaît précisément, grâce à nos semenciers, les précautions à prendre pour empêcher les hybridations non désirées. Commençons par une décision sur le maïs Bt ! Après, ce sera le tour du maïs résistant à l’herbicide, etc. ! Mais au lieu de traiter les problèmes les uns après les autres, on donne l’impression de se réfugier derrière le problème général en excipant de la spécificité d’OGM plus délicats pour prolonger les études et ne rien décider !
Je vous invite enfin à faire très attention au problème de la responsabilité, que personne n’avait jusqu’à présent soulevé dans les productions conventionnelles. Prenons l’exemple des vergers, dont le pollen se promène sur des distances considérables. Lorsqu’un verger de Golden pollinise celui du voisin, planté en Belle de Boskoop, il se produit fatalement des hybridations, mais personne n’avait jamais protesté. Le jour où vous soulèverez la question pour les OGM, vous susciterez toute une série de revendications à propos de problèmes qui, auparavant, se réglaient tout seuls… Il en sera de même avec les multiplicateurs de semences, qui jusque-là se pliaient de bonne grâce à des contraintes spécifiques permettant de certifier des semences dont aucun élément étranger ne venait perturber la pureté. Serons-nous capables un jour de procéder OGM après OGM et de prendre ou non une décision de commercialisation ? Autrement dit, puis-je semer du maïs Bt ?
M. le Président : C’est possible depuis 1998 !
M. Serge LEPELTIER : Sont autorisés les Bt 176 et 810…
M. le Président : Sont également autorisés, bien que ne figurant pas au catalogue des semences, le maïs doux Bt 11, le maïs NK 603 – feed and food – et même le colza Gt 173 ! Toutes ces variétés peuvent être cultivées.
Vous avez parlé des seuils de contamination. Rappelons que, pour qu’une contamination soit possible, un agriculteur OGM doit cultiver la même plante qu’un agriculteur biologique voisin. Or, pour des raisons liées aux semences, il existe très peu de cultures de maïs biologique en France. Autrement dit, le problème ne se pose pas. On trouve un peu de colza biologique. En revanche, il faut s’attendre à des demandes de seuils différents, selon qu’il s’agira de présence fortuite d’aliments, ou de présence fortuite de semences, de présence fortuite dans les cultures biologiques. Entendez-vous traiter différemment ces cas de présence fortuite ou bien un seuil unique vous paraît-il la solution la plus simple et la plus sage dans la mesure où aucune considération de danger n’entre en ligne de compte ?
M. Serge LEPELTIER : Aucune position gouvernementale n’a encore été prise et cette question fait l’objet de grandes discussions au niveau européen. Mais pour des raisons de lisibilité, je suis plutôt favorable à un seuil unique.
M. le Président : Voilà qui a le mérite de la clarté !
Ma deuxième question a déjà été posée à Christian Jacob ce matin. Nous avons été plusieurs à nous rendre aux Etats-Unis. Après avoir contesté tant l’étiquetage que les seuils, les Américains acceptent finalement l’idée de les voir appliquer en Europe. A un détail près : ils refusent toujours l’idée d’étiqueter des produits qui, quoique issus de plantes génétiquement modifiées, ne contiennent plus de traces d’OGM : c’est le cas du sucre, de l’huile de colza ou encore de la lécithine de soja. Or le compromis européen prévoit de les étiqueter. Les Américains considèrent qu’il s’agit d’une barrière tarifaire et exigeront en retour l’étiquetage des fromages, de la bière et du pain, au motif que nous utilisons des ferments extraits de bactéries génétiquement modifiées, ce qui est tout à fait exact ! Comment pourrons-nous expliquer cette différence de traitement ? Comment les Européens ont-ils pu se fourvoyer à ce point ? L’argument est des plus sérieux : il y a belle lurette que la chymosine utilisée pour fabriquer le brie de Meaux n’est plus extraite de la caillette de veau, mais fabriquée par une levure génétiquement modifiée !
M. Serge LEPELTIER : Nous avons déjà soulevé ce problème auprès de la Commission européenne.
M. Gabriel BIANCHERI : Il y a un réel danger.
M. le Président : Loin de refuser l’étiquetage, les Américains exigeront de tout étiqueter, pour noyer le sujet OGM.
M. Serge LEPELTIER : Nous avons tout intérêt, dans un objectif de lisibilité, à ce que notre étiquetage soit ciblé. Sinon, il n’aurait plus aucune efficacité. C’est vraiment une question à examiner de très près.
M. le Président : Nous donnerons un avis, mais notre mission n’a évidemment pas le pouvoir d’aller contre une directive européenne.
M. le Rapporteur : Quel est votre sentiment sur les plantes produisant des médicaments ? Faut-il imposer des normes plus sévères aux expérimentations ?
M. Serge LEPELTIER : Il faut, je le répète, étudier au cas par cas. Un objectif de santé publique justifie d’autant plus une approche positive, mais là aussi, il faut exclure tout a priori, dans un sens comme dans l’autre. Raison de plus en tout cas pour ne pas limiter la recherche par principe.
M. le Président : Certains ont prétendu il fut un temps que le ministère de l’environnement n’était jamais consulté et que l’agriculture était le ministère dominant. Est-ce votre impression ?
Par ailleurs, la biovigilance ne devrait-elle pas également s’appliquer aux expérimentations ?
Enfin, l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) n’a pas voulu que nous l’auditionnions, se déclarant incompétente sur le sujet…
M. Serge LEPELTIER : C’est vrai, même si c’est peut-être une anomalie. L’AFSSE est compétente pour ce qui touche aux conséquences sur la santé et non sur l’environnement. Ou alors, il faudrait que les conséquences sur l’environnement aient des répercussions sur la santé. L’agence compétente est l’AFSSA.
Je ne sais ce qui se passait auparavant, mais à l’heure actuelle, le ministère de l’écologie et du développement durable est systématiquement consulté dans toutes les phases de la procédure – si je ne l’étais pas, nul doute que je le ferais savoir… – et son avis est systématiquement suivi lorsqu’un avis conforme est requis.
La biovigilance sera désormais intégrée dans le Conseil des biotechnologies. Je ne vois évidemment que des avantages à un suivi des expérimentations. La transparence ne pourra qu’y gagner.
M. le Président : Le ministère de l’écologie et du développement durable entretient des relations avec les associations de protection de l’environnement, or celles-ci ont sur le dossier OGM un avis assez différent du vôtre, que nous partageons largement. A quoi peut tenir ce décalage ? Que faire pour restaurer la confiance ?
M. Serge LEPELTIER : Votre remarque est très importante et renvoie à la question, hautement politique, du débat. Rien n’est pire qu’un débat dans lequel on réagit par passion ou par peur et non en s’appropriant le sujet. Il est du devoir du Gouvernement comme du Parlement d’adopter une attitude tout à la fois d’ouverture et de pédagogie. Il en va rigoureusement de même pour le nucléaire : loin de chercher à faire l’intérêt du peuple malgré lui, il faut faire en sorte que la population s’approprie ces sujets politiques. Je fais confiance à mes concitoyens : bien informés, ils auront une bonne vision des choses. Contrairement à ce que j’ai entendu tout à l’heure, la France assume totalement sa politique dans le domaine des OGM et c’est tout à son honneur. Du reste, lorsque nous ne le faisons pas, la population elle-même ne s’y retrouve pas.
J’entretiens évidemment des relations privilégiées avec les associations environnementales et elles connaissent parfaitement ma position sur le sujet, au demeurant très ouverte. Certains organismes ont, certes, une position a priori quasiment idéologique, mais beaucoup d’autres s’interrogent, veulent savoir, veulent en discuter. Il est de mon rôle d’en parler avec elle sans tabou. C’est ainsi que l’on fait avancer les choses sur des sujets aussi difficiles que les OGM ou le nucléaire. Sur la question des déchets nucléaires, par exemple, je tiens à ce qu’un grand débat public soit organisé d’ici à la fin de l’année par la Commission nationale du débat public afin que le Gouvernement et le Parlement soient en mesure de décider ensemble d’une position en 2006. Dans un pays où la démocratie participative prend une part très importante, les instances de débat « officielles », Parlement et collectivités locales, bien que majeures et déterminantes, ne suffiront pas à réellement impliquer la population. Le débat public est essentiel.
M. le Président : Monsieur le ministre, nous vous remercions de cet échange fructueux.
Audition conjointe de
Mme Anne-Marie CHÈVRE et de Mme Marianne LEFORT,
directrices de recherches à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA)
(extrait du procès-verbal de la séance du 29 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mesdames, nous vous remercions de venir devant nous ce soir pour nous présenter le rapport réalisé par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) sur les impacts des OGM dans le cadre d’une action incitative du ministère de la recherche, dont nous n’avons eu communication que très tardivement. C’est pourquoi vous vous trouvez parmi les dernières personnes que nous auditionnons, entre le ministre chargé de l’environnement et celui chargé de la santé…
Mme Marianne LEFORT : Directrice de recherches à l’INRA, généticienne de formation, je travaille depuis 1981 au département « génétique et amélioration des plantes ». Mes recherches ont surtout porté sur le colza et le maïs, le phénomène d’hétérosis et la gestion de la diversité génétique. En 1993, j’ai pris la direction du bureau des ressources génétiques, groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant des ministères et des organismes de recherche et chargé de la coordination des actions de gestion et de conservation des ressources génétiques, de la promotion des recherches dans ce domaine et du suivi des négociations internationales touchant aux ressources génétiques. En 2000, je suis devenue chef du département génétique et amélioration des plantes.
En 1999, à la suite de la réflexion mise en place par Claude Allègre, j’ai été sollicitée pour assurer la coordination scientifique du premier appel d’offres sur l’impact des OGM dans le domaine environnemental, socio-économique et alimentaire, sous la présidence de Bernard Chevassus-au-Louis. Un deuxième appel d’offres a été lancé en 2002, sous la même présidence et un troisième appel d’offres en 2004, plus précisément axé sur les aspects environnementaux. La présidence a été reprise par Marc Fellous et la coordination scientifique par Antoine Messéan. Autrement dit, l’action entreprise se poursuivra, et peut-être même s’amplifiera dans les années à venir.
Le ministère a accordé un financement de 1,4 million d’euros en 1999 et de moitié moins en 2002 et 2004. Au total, sous réserve que les engagements 2004 soient respectés en 2005 et en 2006, le soutien du ministère se sera élevé au total à quelque 3 millions d’euros. Parallèlement, le Centre national de recherche scientifique (CNRS) a également lancé des appels d’offres plus ciblés sur les aspects environnementaux et portant sur l’impact des biotechnologies au sens large. C’est dans ce cadre qu’a été soutenu, par exemple, un projet sur les huîtres triploïdes.
Les projets soutenus dans le cadre de ces trois appels d’offres ont porté pour l’essentiel sur les aspects environnementaux – dissémination des gènes, interactions écologiques au sein des agrosystèmes, conception de la gestion durable de systèmes de culture intégrant des OGM –, auxquels 75 à 85 % des financements auront été dédiés. Très peu de projets ayant été soumis sur l’aspect sécurité des aliments – dont fort peu ont été retenus –, nous avons préféré prendre le temps de regrouper tous les résultats des appels d’offres de 1999 et 2002 pour présenter un ensemble suffisamment important de données synthétiques sur les impacts alimentaires. Ces présentations devraient être faites à l’occasion d’un séminaire fin 2005 ou courant 2006. Enfin, les aspects socio-économiques auront représenté un peu moins de 10 % des financements chaque année, mais peu d’équipes se seront finalement mobilisées sur ces questions.
Pour ce qui est des impacts environnementaux, cet appel d’offres, conjugué à celui du CNRS et aux actions préexistantes, nous a permis d’obtenir une série de résultats relativement consolidés et de mobiliser une communauté pluridisciplinaire autour de ces questions. En revanche, l’étude des impacts sur la sécurité alimentaire ou des aspects socio-économiques et juridiques ne paraît guère intéresser les équipes de recherche.
M. le Président : L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) a travaillé sur la sécurité alimentaire ce qui complète vos travaux.
Mme Marianne LEFORT : En effet. Aussi, le problème se pose-t-il surtout pour les aspects socio-économiques et juridiques, qui mobilisent peu de gens. Je le regrette d’autant plus que l’INRA n’est pas le seul concerné, puisqu’il s’agissait d’un appel d’offres national.
S’agissant du transport du pollen, des données significatives ont été obtenues sur la dispersion à courte, moyenne et longue distance, et même un commencement de résultats sur la dispersion à très longue distance, via l’atmosphère, qui nous permettent d’envisager un couplage des modélisations biologiques et physiques. C’est autour de ces nouvelles données que nous souhaiterions voir s’orienter les projets de recherche. Beaucoup de travail, en revanche, reste à faire sur la question de la dispersion des graines, plus complexe à appréhender mais nécessaire à la compréhension globale du phénomène de dispersion des gènes.
Les études menées sur plusieurs complexes d’espèces ont montré que des flux de gènes étaient possibles dans pratiquement tous les cas entre les compartiments cultivés et sauvages d’un écosystème, mais que ces différents compartiments avaient des systèmes d’acceptation, puis d’entretien et de déploiement du gène transféré très variables. Dans de nombreux cas, les occurrences de transfert sont faibles, voire très faibles à l’échelle du champ et de l’année mais on ne saurait pour autant les considérer comme totalement négligeables sur des superficies relativement importantes et durant un grand nombre d’années. Les pressions naturelles et anthropiques, comme la valeur sélective du gène transféré, influent sur la vitesse avec laquelle le transgène s’installe et se répand dans le compartiment non cultivé, selon des processus qui restent à approfondir. Jusqu’à présent, les études ont davantage porté sur la possibilité ou non d’un transfert que sur la dissémination et l’expansion des transgènes dans un compartiment donné. Ces questions devront être abordées au cas par cas, en fonction de la nature du transgène en cause.
Pour ce qui est des impacts sur les organismes non-cibles, les travaux menés sur les cultures Bt ont mis en évidence la fragilité de la stratégie dite des « zones refuges » sur le plan aussi bien économique qu’écologique. De nouvelles recherches sont envisagées, qui feront intervenir, notamment, les communautés dont font partie les insectes considérés, particulièrement les parasitoïdes.
Les travaux d’observation de la flore et des adventices mériteraient d’être prolongés et surtout assurés d’un financement pérenne, dans la mesure où c’est grâce à la mise en place d’observatoires et de développement en parallèle des travaux de modélisation de la dynamique des OGM à l’échelle nationale que l’on pourra mettre au point de nouvelles stratégies applicables aux cultures transgéniques. Il est regrettable qu’aucun observatoire de ce type n’ait été mis en place pour ce qui touche à la faune et à la microfaune.
Le transfert horizontal de gènes de plants de tabac vers des bactéries préalablement adaptées au plan moléculaire a été démontré en conditions in vitro. Il est donc possible qu’un transfert vers les bactéries du sol puisse être réalisé en conditions naturelles dans la mesure où les plantes transgéniques utilisées intègrent des génomes bactériens compatibles avec ceux de la microflore du sol, mais les preuves moléculaires d’un tel transfert restent à confirmer.
Le transfert de bactéries génétiquement modifiées associées à des plantes vers la communauté microbienne rhizosphérique a également été étudié, mais le protocole expérimental retenu n’a pas permis de conclure de façon totalement définitive à l’absence de transfert.
Les études sur la conception et la gestion durable de systèmes de culture intégrant des OGM doivent impérativement être poursuivies en accordant un intérêt particulier à l’articulation entre sciences biologiques et sciences économiques et en mettant résolument l’accent sur une approche de modélisation.
Je ne m’attarderai pas sur le contexte économique, juridique et sociologique, qui n’a fait l’objet que d’études très ponctuelles.
En conclusion, les efforts concertés du ministère de la recherche, de plusieurs établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et d’instituts techniques pour conduire des études sur l’impact des OGM présentent un bilan très positif au regard des moyens engagés. Ils auront notamment permis la fédération d’une communauté de chercheurs motivée et, fait assez nouveau dans ce domaine, largement interdisciplinaire. Les résultats significatifs devraient être de nature à faciliter travail de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) et à renouveler la formulation de certaines problématiques de recherche. Dans quelques cas, les actions menées auront permis le développement de premiers outils de prédiction – pour les flux de gènes intraspécifiques à l’échelle d’un paysage, par exemple –, même si de nombreux résultats appellent encore des approfondissements sur les mécanismes sous-jacents aux divers processus en jeu. Enfin, ces travaux nous auront permis de prendre une place relativement motrice dans de grands projets européens comme SIGMEA86 sur la modélisation des flux de gènes à l’échelle du paysage.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Egalement directrice de recherches, je suis chargée, au sein de l’équipe « colza » du centre de Rennes, des croisements entre espèces. Mobilisée dans le cadre de deux projets européens lancés en 1988 et coordonnés par Plant Genetic System, notre équipe « colza » s’est essentiellement consacrée à l’étude des flux de pollen en collaboration avec les centres INRA de Dijon, de Grignon et de Jouy, l’université d’Orsay et le Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM).
Les travaux sur les flux intraspécifiques – autrement dit, de colza à colza – nous ont conduits à imaginer divers dispositifs pour évaluer les distances de dispersion, qui ont souvent pris la forme d’un petit îlot de transgénique au milieu d’un champ de colza. Nous avons pu ainsi évaluer, avec des valeurs chiffrées, la dispersion par plante et entre plantes, ainsi que la dispersion interparcelles. Complétée par des travaux australiens et canadiens, cette étude fait actuellement l’objet de travaux de modélisation par nos collègues de Grignon et de Jouy.
Les travaux sur les flux interspécifiques, dont j’étais plus particulièrement responsable, ont d’abord consisté à recenser les plantes adventices les plus fréquentes en France qui sont susceptibles de fleurir en même temps que le colza – condition préalable de tout échange. Le colza étant un hybride naturel entre du chou et de la navette, la communauté scientifique nord-européenne s’est immédiatement intéressée à la navette : des travaux canadiens et anglais ont montré que les taux d’hybridation entre ces deux espèces se situaient entre 5 et 10 % en conditions naturelles de plein champ. Mais la présence de navette dans les cultures françaises étant très anecdotique, nous avons préféré retenir la ravenelle, la moutarde des champs et la roquette bâtarde.
La première étape consistait en la production d’hybrides F1, d’abord en serres, en conditions contrôlées et croisements manuels, ensuite en plein champ, sans transgènes mais avec des colzas non producteurs de pollens, et autant de colzas que de ravenelles, afin de recréer des conditions optimales. La ravenelle, adventice présente dans toutes nos zones de culture de colza, est apparue comme l’espèce la plus susceptible de poser problème en France. Dans les conditions optimales décrites ci-dessus, nous avons mesuré qu’il était possible de produire de un à cent hybrides pour cent fleurs – autrement dit une graine par fleur maximum, sachant qu’un plant de colza en intraspécifique produit entre vingt et vingt-cinq graines par fleur.
Nous avons ensuite recréé des conditions proprement agronomiques en installant en 1995-1996 deux cultures de plein champ, avec autorisation de la Commission du génie biomoléculaire (CGB) à Rennes et à Dijon où nous avons mimé le cas d’un agriculteur ayant plus ou moins bien désherbé son champ en repiquant tantôt une ravenelle tous les 20 m², tantôt deux ravenelles par mètre carré dans le champ, et des ravenelles en bordure de champ et de fossé.
Après récolte à la main et tri, nous avons ainsi semé 1,3 hectare de ravenelle d’un côté, 1,5 hectare de colza de l’autre, afin de détecter les hybrides et mesurer le taux d’hybridation. Cet énorme travail dont les résultats ont été publiés en 2000, a permis de montrer que le taux d’hybridation, dans un sens ou dans un autre, se situait entre 10-5 et 10-7.
Nous avons ainsi découvert que les hybrides n’étaient pas tous constitués de la moitié des chromosomes de chaque espèce parentale. Certains avaient gardé le stock diploïde de leurs parents, ce qui modifiait leurs caractéristiques de fertilité. Aussi une bonne part de nos travaux de ces dernières années ont-ils porté sur la mise au point d’outils de détection et de caractérisation de ces événements rares. Ces observations nous ont conduits à nous demander ce qui se passerait en situation réelle, dans un champ infesté de ravenelle, avec un suivi très rigoureux jusqu’à un kilomètre alentour. C’était l’objet de l’essai conduit en Ariège et détruit deux années de suite…
M. le Président : L’expérimentation détruite en Ariège était-elle un essai INRA ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Le responsable de cet essai était le CETIOM. Nous n’en saurons donc pas plus…
Après la production d’hybrides F1, la deuxième étape visait à savoir si le transgène introduit dans le colza était susceptible de s’introduire par recombinaison dans les chromosomes de la ravenelle. Une première approche consiste à mettre l’hybride en présence de ravenelles et à examiner ce qui se passe au fil des générations. Cette approche a priori, même si elle apporte des informations sur les mécanismes génétiques en jeu, reste à trop court terme pour mimer exactement tout ce qui peut se passer en conditions naturelles. Aussi avons-nous parallèlement développé une deuxième approche, a posteriori, dans la mesure où la nature n’a pas attendu les OGM pour autoriser les flux entre espèces, en examinant et en sondant des populations de ravenelle dans des zones historiquement différentes au regard de la culture du colza, afin de déterminer si des flux se sont déjà produits, et lesquels.
L’approche a priori a consisté en l’étude, sur six générations, des évolutions constatées à partir des hybrides produits, toujours en situation optimale – autrement dit en mettant systématiquement autant d’hybrides que de ravenelles comme pollinisateurs. Nous avons ainsi appris, et les études malherbologiques de nos collègues de Dijon l’ont confirmé, que lorsque l’hybride d’origine a le colza pour parent femelle et garde le même cytoplasme au fil des générations, aucun risque n’est à craindre dans la mesure où la plante devient toute blanche du fait d’une incompatibilité entre noyau et le cytoplasme. Il est à noter toutefois que cette déficience chlorophyllienne ne se manifeste pas lorsque le pollen de l’hybride en question féconde une ravenelle, ce qui peut parfaitement arriver en conditions naturelles où toutes les générations se superposent. En revanche, nous n’avons jamais détecté en six générations d’introduction de gènes de colza – en l’occurrence, celui de la résistance à un herbicide que nous avions choisi comme modèle – dans le génome de la ravenelle. On trouve toujours au moins un chromosome additionnel.
Nous partions évidemment avec un seul transgène situé en un seul endroit dans le génome du colza. Aussi avons-nous de nouveau reproduit du matériel végétal en partant, cette fois, d’événements de transformation indépendants, avec des transgènes situés en différents endroits du génome du colza, et en appliquant ou non une pression de sélection, dès la deuxième génération, afin de vérifier si, en fonction de leur position, les gènes du colza pouvaient entrer dans le génome de la ravenelle. Nous devrions pouvoir vous donner d’ici quelques mois les résultats de ces travaux.
M. le Président : Ont-ils été conduits sous serre ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Le matériel est déjà produit. Nous en sommes à la caractérisation moléculaire.
M. le Président : Vos résultats corroborent-ils les données collectées dans les champs canadiens ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : La ravenelle y est surtout présente au Québec où la culture du colza est relativement récente. La grande zone de production reste concentrée dans les Etats du Saskatchewan et de l’Alberta qui, jusqu’à une date très récente, ne connaissaient pas la ravenelle. Les graines collectées sur les ravenelles n’ont donné naissance à aucun hybride. Des essais de croisement entre colza et ravenelle au champ, en récoltant sur ravenelle, ont permis de trouver des hybrides dans une proportion de 10-5 à 10-6, c’est-à-dire comparable à nos chiffres, que corroborent également les résultats australiens.
M. le Président : C’est beaucoup plus faible que les chiffres qu’on avançait initialement.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Parce qu’on travaillait en conditions optimales.
M. le Président : Autrement dit, on a au mieux une chance en moyenne sur un million de tomber sur un hybride.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : En effet.
M. le Président : Sachant que, par la suite, l’hybride disparaît dans la moitié des cas.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : D’après nos évaluations, l’hybride en question fournit au mieux une graine par plante – et non plus par fleur. En revanche, une fois passé ce deuxième goulot d’étranglement, la génération suivante retrouve une fertilité très proche de la ravenelle.
M. François GUILLAUME : Qu’entendez-vous par « une graine par plante » ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : L’hybride colza-ravenelle est très fréquemment stérile, les deux génomes ne se ressemblant pas vraiment. Aussi la production de graine, en situation optimale, ne dépasse-t-elle pas une graine par plante.
M. François GUILLAUME : Disons une graine par pied.
M. le Président : Autrement dit, cela ne ressème pas beaucoup.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Cela dit, comme la ravenelle est très présente dans les champs de colza, ne resteront au bout d’un certain nombre de générations que les hybrides dans la mesure où ils résisteront à l’herbicide. Nous manquons encore de recul dans les données.
L’approche a posteriori consiste à chercher par sondage dans les populations naturelles si des flux n’ont pas déjà eu lieu. Cette idée nous était venue à l’esprit dès le départ, mais elle se heurte à une difficulté : toutes ces espèces ayant un ancêtre commun, on ne sait jamais si le phénomène observé dans une population tient réellement à un flux ou à cet ancêtre commun. Aussi avons-nous entrepris avec nos collèges de Clermont-Ferrand de développer une série de marqueurs moléculaires spécifiques au colza et absents de la ravenelle. Nous en avons mis au point un certain nombre, bien répartis sur le génome du colza, ce qui nous permettra de voir l’effet « position ». Dès ce printemps, nous récolterons les populations de ravenelles en essayant d’avoir un historique le plus précis possible de la culture du colza dans la région.
M. le Président : Pour essayer de retrouver des hybrides ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui et des gènes stabilisés du colza qui seraient passés dans la ravenelle, que nous devrions détecter, grâce aux marqueurs moléculaires. C’est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, mais comme le ministère a lourdement insisté… La zone sondée comprendra notamment la Normandie où, paraît-il, on a beaucoup cultivé le colza à la fin du XIXe siècle.
M. le Président : Ma première impression est que tout ce que nous avons entendu sur l’environnement depuis le début de cette mission procède d’une dramatisation par rapport aux résultats scientifiques que vous venez de nous exposer. On nous a soutenu que le colza créerait des risques terribles…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Je ne parle que du colza.
M. le Président : Les premiers résultats de vos études vous conduisent-ils à penser que la culture du colza transgénique serait techniquement gérable ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Pas en intra-colza.
M. le Président : Autrement dit, pas dans le cas de colzas OGM à côté de colzas conventionnels.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : On sait très bien que le pollen du colza se promène à au moins trois kilomètres et que ses graines peuvent survivre dix ans. Les chiffres publiés l’an dernier au Canada montrent que toutes les variétés commerciales non Roundup ready contiennent du Roundup ready. Il ne faut pas compter sur un seuil zéro…
M. Pierre COHEN : Je comprends. Mais connaît-on toutes les espèces susceptibles d’êtres contaminées par hybridation avec le colza ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Pour la navette, c’est évident. Pour les adventices génétiquement plus éloignés, cela se fera probablement, mais dans des conditions que nous avons encore du mal à évaluer.
M. le Président : Avez-vous essayé avec la moutarde ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui.
M. Pierre COHEN : Mais connaît-on précisément toutes les plantes susceptibles d’être concernées ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Bien sûr. Toutes les adventices du colza sont très précisément connues, y compris par les agriculteurs.
M. François GUILLAUME : Il y a toutes les crucifères…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Nous nous sommes réunis l’an dernier à Rennes avec les Canadiens, les Américains, les Danois, les Anglais, les Allemands, les Suisses, etc., et avons produit un article de synthèse sur la question, comprenant même une répartition par pays.
M. Philippe FOLLIOT : Si je comprends bien, mon canari a peu de chances de se faire engrosser par le chat OGM de ma belle-mère ! Claude Allègre avait utilisé une métaphore similaire pour illustrer à quel point une bonne part de la problématique de la dissémination relevait du fantasme… A entendre vos propos, le risque de transmission d’une espèce à une autre est très faible.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Tout dépend des espèces. Le colza est un hybride entre le chou et la navette. Sur ses 38 chromosomes, vingt sont des chromosomes de la navette. Si l’on insère un transgène, a fortiori sur le génome A – le génome navette – du colza, on le retrouvera en deux générations dans le génome de la navette. Les travaux danois de 1996 l’ont bien montré.
M. André CHASSAIGNE : A entendre certains, un gène de résistance à un herbicide pourrait se promener sur une plante sauvage de la même famille, laquelle se mettrait à proliférer d’autant plus facilement qu’elle résisterait aux herbicides… Que pensez-vous de ce scénario catastrophe que le commun des mortels entend fréquemment et se répète à l’envi ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : J’en pense qu’il suffirait tout simplement d’utiliser un autre herbicide… Si vous appliquez autre chose que du Roundup sur une plante résistante au Roundup, elle est évidemment détruite. C’est une question de gestion agronomique.
M. le Président : Encore ne faut-il pas que se développent d’autres résistances…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : C’est inévitable. Les Canadiens connaissent déjà des phénomènes de résistance au Roundup, aux imidazoles et au Liberty. Les trois gènes de résistance se sont rapidement retrouvés dans la même plante – c’est ce qu’on appelle le « gene stacking87 ».
M. le Président : Mais les OGM n’y sont pour rien.
Mme Marianne LEFORT : Effectivement. La question est de savoir pourquoi on associe immédiatement l’introduction d’un gène de résistance à un herbicide à la technologie OGM.
M. André CHASSAIGNE : Je ne l’associe pas et je suis convaincu par votre réponse. Mais nous nous sommes fréquemment conduits à nous faire l’avocat du diable…
M. Pierre COHEN : Au-delà de l’argument des résistances – puisqu’il suffit apparemment de changer de pesticide – l’argument le plus pertinent reste celui de la préservation de nos modes de production en écartant tout risque de dissémination. Le colza nous a toujours été présenté comme la plante la plus portée à se propager. Mais connaissez-vous vraiment, de manière totalement exhaustive, toutes les plantes que le colza serait susceptible de polliniser, de quelque type qu’elles soient ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui.
M. Pierre COHEN : Je suis surpris. Si c’est oui, comment expliquer tout ce débat autour de la dissémination ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Il tient probablement au fait que l’on ne sait pas très bien ce que deviennent les éventuels hybrides.
M. le Président : Ils connaissent toutes les plantes potentiellement capables de se croiser : la ravenelle, la navette, la moutarde et d’autres crucifères, certaines avec des chances très faibles…
Mme Marianne LEFORT : Il y en a tout un cortège.
M. le Président : Et on les connaît toutes. Le but est de calculer la probabilité pour chacune.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : En nous intéressant d’abord aux plus fréquentes en France – les Canadiens se penchent davantage sur les cas de la navette ou la moutarde brune. L’ensemble de ces travaux est actuellement repris en modélisation ; une série de publications devrait prochainement sortir sur le sujet. Nous regardons également ce que nous pourrions faire en monitoring (surveillance) dans le cadre du dispositif de biovigilance.
M. le Président : Avez-vous des courbes de diffusion de pollen en fonction des distances, dans des conditions modélisées ?
Mme Marianne LEFORT : Elles ont constitué un volet des travaux de l’Action concertée incitative (ACI) « Impact des OGM », mais ne sont pas présentées dans la plaquette résumée qui vous a été distribuée.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Ainsi que dans le rapport de la CGB de l’an dernier. Nous vous mettrons en rapport avec la personne compétente de notre équipe.
M. le Président : Il serait bon de pouvoir montrer dans notre rapport les courbes de dissémination des deux espèces autorisées en France, maïs et colza.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : A ceci près que mon chiffre de 3 kilomètres est tiré d’un article australien paru dans Science en 2002 sur la dissémination du pollen d’une variété de colza – non-OGM – résistante au chlorsulfuron. Du fait de la taille des parcelles australiennes, vous n’y trouverez pas une courbe « propre » de dissémination.
M. le Président : Et les vôtres sont-elles « propres » ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui, mais les conditions d’expérimentation sont beaucoup plus restreintes.
Mme Marianne LEFORT : Ce n’est pas la même échelle.
M. le Président : Mais les résultats sont-ils globalement identiques ?
Mme Marianne LEFORT : Absolument. Mais une variété conventionnelle résistante à un herbicide amènerait à se poser exactement les mêmes questions.
M. le Président : On s’en poserait sans doute moins…
Mme Marianne LEFORT : Sans doute… Les OGM ont déclenché un lot de questions auquel je crois pour ma part important de répondre. Encore faut-il distinguer entre ce qui relève de la technologie OGM proprement dite et les problèmes liés à d’éventuelles disséminations et à leurs conséquences plus larges, y compris sur le plan socio-économique.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Il est d’ailleurs significatif que les Canadiens aient légiféré sur le nouveau caractère conféré et non sur le process. Autrement dit, ils considèrent comme une nouvelle variété de canola une résistance aux imidazoles, au Roundup, au Liberty, etc.
M. le Président : Que la variété soit OGM ou non ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Exactement.
M. le Président et M. Michel LEJEUNE : Très intéressant !
Mme Anne-Marie CHÈVRE : L’impact économique du maïs Bt est exactement du même ordre que l’introduction, dans l’agriculture conventionnelle, d’un gène majeur de résistance à une maladie. Jamais il ne serait en pareil cas venu l’idée d’imaginer des zones refuges – même si c’est certainement une excellente technique.
M. le Rapporteur : Vous avez pourtant parlé de la « fragilité » des zones refuges. Pourquoi ?
Mme Marianne LEFORT : Je ne me suis pas occupé des zones refuges, mais seulement de la coordination de l’appel d’offres… Disons que la stratégie des zones refuges a été déclinée dans toute une série de protocoles expérimentaux : 20 % au moins en zone refuges, située en périphérie du champ, ou bien en placettes à l’échelle d’une région de production, etc. Selon les stratégies retenues, les résultats pouvaient paraître parfois hétérogènes et incohérents. De surcroît, les agriculteurs américains avaient tendance à traiter systématiquement…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Si les zones refuge représentent 20 % des surfaces, ils ont le droit de traiter.
Mme Marianne LEFORT : Certes, mais cela complique d’autant plus les comparaisons et l’évaluation de l’efficacité réelle du dispositif.
M. le Rapporteur : Autrement dit, on n’a peut-être pas intérêt à créer des zones refuges.
Mme Marianne LEFORT : On ne peut être aussi catégoriques. Les zones refuges procèdent d’une logique biologique, en théorie du moins. Reste à définir les modalités optimales de maillage de ces zones à l’échelle d’une région de production, de façon à préciser les modalités de gestion.
M. François GUILLAUME : Surtout lorsque les zones en question sont traitées avec des produits phytosanitaires classiques… La pyrale y mourra tout autant que dans la partie OGM !
Mme Marianne LEFORT : Une partie seulement des expérimentations est de ce type. En tout état de cause, il est difficile d’avoir une vision objective de la stratégie des zones refuges, même avec la diversité de la zone expérimentale américaine.
M. François GUILLAUME : Plus grave encore, si elles sont traitées à l’aide d’insecticides polyvalents, ce sont tous les insectes qui seront détruits, et non le seul insecte spécifiquement visé avec la plante génétiquement modifiée…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Ce à quoi il faut ajouter que les vérifications se bornent à une enquête téléphonique…
M. le Président : Même pas : il suffit de le déclarer au semencier…
M. François GUILLAUME : De toute façon, nous n’aurions pas suffisamment de contrôleurs… Entre les bandes enherbées et les cours d’eau, cela n’en finit plus !
La moutarde et la navette sont certes des adventices, mais la moutarde peut être cultivée en tant qu’engrais vert, par exemple…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : La moutarde blanche, cultivée comme engrais vert, n’a botaniquement rien à voir avec la moutarde des champs, adventice du colza.
M. André CHASSAIGNE : Je ne suis pas un scientifique, mais un littéraire. Aussi avais-je noté une très belle phrase lors d’une entrevue à Washington : « Quelle arrogance de penser que la petite chose mise dans la tomate ait pu changer quelque chose ! » Peut-on croire que l’on changera davantage les choses par la transgénèse que par l’agriculture conventionnelle ? L’accélération permise par cette nouvelle technique peut-elle aboutir à des effets différents de ce qu’aurait produit l’évolution par des moyens conventionnels ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Pour peu qu’on les cherche, on trouve des transferts, y compris entre règnes du vivant, des anciens comme de très récents.
M. le Président : En avez-vous des exemples, virus mis à part ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Grâce aux progrès réalisés dans le séquençage du génome, on a découvert que, dans la même espèce, certains individus auront intégré des gènes chloroplastiques et d’autres pas, ou pas au même endroit. Autrement dit, des mécanismes de transfert continuent à s’opérer, dont on est incapable de dire à quoi ils correspondent.
Mme Marianne LEFORT : On peut ainsi trouver des génomes différents entre les individus au sein d’une même espèce.
M. le Président : Pouvez-vous nous dire, en pourcentage, quelle est la variabilité génétique dans une même espèce – le colza, par exemple ? A côté des gènes qui caractérisent l’espèce, certains autres se sont introduits au fil du temps, dont certains sont restés et d’autres pas.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Cela supposerait un séquençage complet du génome du colza. Nous n’aurons prochainement cette information que sur l’espèce modèle Arabidopsis.
M. le Président : Certains généticiens avancent que le pourcentage de variabilité pourrait être de 0,5 à 1 %.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : De récents travaux de séquençage portant sur 150 ou 250 kilo-paires de bases dans deux variétés de maïs relativement voisines ont montré que là où l’on trouvait dix gènes au milieu de séquences répétées dans une lignée, on n’en trouvait plus que six dans l’autre, au milieu de séquences intercalaires différentes… Et pourtant, les deux lignées avaient la même origine.
M. le Président : C’était à peu près le même maïs… C’est encore pire que ce que je disais.
Mme Marianne LEFORT : Nous découvrons seulement le phénomène de flexibilité et de souplesse du génome à l’intérieur d’une espèce.
M. François GUILLAUME : Phénomène naturel…
Mme Marianne LEFORT : Totalement naturel.
M. le Président : Autrement dit, un gène de plus au milieu de cinq ou six cents différents…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Si cette affaire soulève tant de débats, c’est un peu à cause de la question philosophique qui est derrière : peut-on mettre un gène humain dans le colza ? Cela relève plus du symbole que de la science à proprement parler.
Mme Marianne LEFORT : Il n’y a pas que cela…
M. François GUILLAUME : Il est donc possible, par cette démonstration, de dédiaboliser quelque peu la transgénèse, dans la mesure où des modifications génétiques peuvent s’opérer naturellement.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : On ne peut nier pour autant que, brutalement, délibérément, on introduit des gènes humains, brevetés qui plus est – là est la grande question.
M. le Président : C’est la vraie question.
M. François GUILLAUME : Ne parlons pas de transferts de gènes humains, qui poseraient d’autres problèmes philosophiques. Restons-en aux plantes…
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Dans les OGM d’ores et déjà cultivés, ce ne sont pas des gènes de plantes qui ont été introduits, mais des gènes de bactéries.
M. François GUILLAUME : Vous avez parlé de conservatoires des ressources génétiques.
Mme Marianne LEFORT : C’était l’objet de mon précédent travail.
M. François GUILLAUME : Dans la production fruitière notamment, des vergers conservatoires ont été mis en place, afin d’être toujours en mesure de repartir de la plante originelle. Ne serait-il pas nécessaire d’adopter la même démarche avec les OGM pour préserver les qualités originelles de chaque variété ?
M. André CHASSAIGNE : Le centre INRA de Clermont-Ferrand dispose d’un conservatoire pour le blé. On nous a expliqué qu’il serait ainsi possible d’aller chercher dans les espèces anciennes des gènes susceptibles d’améliorer les espèces actuelles. Ne peut-on mettre cette démarche en avant et montrer que les OGM ne se résument pas seulement à l’introduction de caractères extérieurs ?
Nous avons entendu dire qu’en sept mille ans de domestication, le maïs avait vu le nombre de ses gènes multipliés par deux…
Mme Marianne LEFORT : Il ne s’agit pas forcément du nombre de gènes, mais de la taille du génome. Ce n’est pas la même chose.
M. le Président : Il peut y avoir ou bien des diploïdies, c’est-à-dire des chromosomes multipliés par un chiffre allant de deux à six…
Mme Marianne LEFORT : Ou des séquences répétées, ce qui augmente la taille du génome, mais pas pour autant le nombre de gènes.
M. le Président : Reste qu’il y a six mille ans, le maïs était tout petit et que, peu à peu, il est devenu compact et, par le jeu des hybridations, de plus en plus gros.
Mme Marianne LEFORT : Nous avons des conservatoires de semences de nombreuses espèces cultivées – pas toutes – en France et dans le monde, ainsi que des vergers conservatoires d’essences fruitières ou forestières. Il est essentiel de consacrer les financements nécessaires, afin que nous puissions disposer d’un réservoir de gènes, mais également de connaissances, pour mieux comprendre l’histoire des plantes cultivées et l’effet au cours des âges des pressions anthropiques et naturelles. Mais certains pourraient en venir à penser que, dès lors qu’il est possible de garder la diversité en boîte, on peut se permettre n’importe quoi… Or, rien ne dit qu’une variété ancienne de blé, conservée à l’identique, sera capable de s’adapter et de survivre dans les conditions climatiques du futur. Les techniques de dessiccation permettent de conserver des semences jusqu’à 75 ans, mais ces graines sauront-elles germer ailleurs que dans une boîte de Petri ? Leur génome aura-t-il suffisamment évolué face à la pression environnementale ? La question est en tout cas posée. Le risque est évidemment moindre pour les vergers conservatoires qui restent confrontés aux pressions environnementales.
M. le Président : Vous êtes évidemment de farouches partisanes de l’expérimentation en plein champ.
Mme Marianne LEFORT : Tout à fait !
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Absolument !
M. le Président : Y compris sur des espèces comme le colza ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : On nous demande de fournir des informations et des valeurs chiffrées. On peut faire de la modélisation, mettre en équations mathématiques mais si l’on n’a aucune possibilité de les valider, on se retrouve à dire de grosses bêtises et à prendre des décisions qui ne reposent sur aucun fondement biologique…
M. le Président : Avez-vous eu l’occasion de discuter avec les associations qui étaient à l’origine de la destruction de vos essais ? Pourquoi ne parvenez-vous pas à les justifier comme vous le faites devant nous ce soir ? Pourquoi n’êtes-vous pas entendues ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : J’ai déjà eu le plaisir de discuter avec la Confédération paysanne et autres associations de protection en tous genres, mais également de témoigner au tribunal… Du reste, la Confédération avait fait état des résultats de nos travaux dans son journal Campagne solidaire. Au tribunal, ils ont utilisé nos travaux pour justifier qu’ils n’en voulaient pas ! Du coup, leurs propos sont devenus : « vous, les chercheurs, vous allez faire de la surenchère, vous avez montré qu’il y a des hybrides, que le pollen se dispersait entre champ de colza, cela nous suffit… » Que pouvions-nous leur répondre ? Nous avons arrêté nos expérimentations, c’est tout…
M. le Président : Comment qualifiez-vous cette situation française et européenne ?
Mme Marianne LEFORT : Les OGM sont un faux problème. La question est d’abord politique et économique au sens large : c’est celle de l’avenir de l’agriculture en France et en Europe, liée au rejet d’un certain type de production agricole. Dans un débat rationnel, fondé sur des considérations biologiques, il est toujours possible de s’entendre sur les arguments et de continuer à faire de l’expérimentation ; il en va tout à fait différemment lorsque le débat est irrationnel et met en avant des considérations d’un tout autre ordre, auxquelles nous ne sommes pas armés pour répondre – et qui, au demeurant, ne sont pas du ressort de biologistes. Le jour où les deux sujets auront été séparés, le jour où l’on reconnaîtra, au niveau politique, que la question des OGM a posé le problème de fond de l’avenir de l’agriculture et que c’est à cela qu’il faut s’attaquer, la technologie OGM apparaîtra comme un sujet mineur… Cela dit, la mise sur le marché d’un colza résistant à l’herbicide n’est sûrement pas le meilleur moyen pour discuter l’intérêt de l’expérimentation en champ. Mieux vaudrait, me semble-t-il, essayer de travailler sur un gène transféré qui serait unanimement ressenti comme un bien pour la collectivité.
M. François GUILLAUME : Le fameux « riz doré » vous paraît-il le moyen de faire comprendre à l’opinion publique les améliorations que pourrait apporter la transgénèse ?
Mme Marianne LEFORT : Je suis assez réservée. Pour ce qui est des effets à court terme, je suis d’accord avec vous. Mais est-on sûr que les organismes pourront correctement ingérer et métaboliser ces micronutriments ? Maîtrisera-t-on réellement la gestion de ce type d’innovation sur le long terme ? Ma grande frayeur serait de voir une innovation marquante, OGM ou non, se déployer partout en aggravant l’uniformisation dans des proportions que l’agriculture conventionnelle n’a jamais atteintes. En admettant même que les avantages à court terme d’une telle innovation soient réels, ce qui reste à démonter, c’est l’ensemble du package qui mérite d’être étudié et pas seulement le petit « plus » à un moment donné, même s’il paraît répondre à une attente.
M. François GUILLAUME : C’était le seul exemple qui me venait à l’esprit… Reste que vos propos posent deux problèmes.
Premièrement, le projet de loi en préparation prévoit de regrouper la CGG, la CGB et le comité de biovigilance dans une section scientifique. Mais le futur Conseil des biotechnologies comportera également une section économique et sociale. Comment le ministre pourra-t-il trancher entre un point de vue quasi unanime des scientifiques et une hostilité déclarée de la section socio-économique, sensible aux pressions et manifestations de tous ordres de certains groupes d’action et aux réticences d’une population naturellement méfiante à l’égard de tout ce qu’elle ingère ?
Deuxièmement, comment les scientifiques peuvent-ils faire admettre à l’opinion l’intérêt en même temps que l’innocuité de cette technologie ? Les chercheurs, et c’est tout à leur honneur, ont pour habitude de rester très prudents. Malheureusement, cette prudence a souvent tendance à conforter la méfiance de la population.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Une question de fond est posée sur l’avenir de l’agriculture, sur le développement économique, sur la façon dont cette technologie est reprise en termes de données économiques – ce ne sont pas des chercheurs du public qui commercialisent des OGM… En Afrique du Sud, une dizaine de variétés ont été sélectionnées et adaptées aux conditions locales, mais elles dorment dans les tiroirs. Seules sont cultivées les variétés américaines et australiennes. Autrement dit, la perte de la biodiversité n’est pas due à ce que l’on croit. Elle tient d’abord à un certain mode d’agriculture qui tend à une uniformisation mondiale, laquelle pose un réel problème. Si c’est là-dessus que les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme, il faut les entendre. Ajoutons que le débat autour des OGM a permis de soulever la question de l’alimentaire : ou va-t-on, que veut-on ? Le « riz doré » en est un bon exemple. L’argument fréquemment entendu selon lequel il résoudra le problème de la faim dans le monde est totalement irrecevable.
M. François GUILLAUME : Cela peut aider…
M. le Président : Les petits agriculteurs et les responsables agricoles d’Afrique du Sud nous ont souvent tenu le discours suivant : « Vos problèmes du Nord, vos jachères, vos stocks, votre surproduction, votre nourriture abondante, gardez-les pour vous. Notre problème à nous est différent. Ce n’est pas à vous de nous interdire l’accès à une technologie, en complément des autres. C’est à nous de choisir. » Chez le petit agriculteur – 5 hectares – que nous avons visité, la plantation de coton était très bien tenue. Et même si ses rendements étaient moins importants que sur les parcelles des grands Blancs, il savait qu’il allait gagner de l’argent, même avec un cours en chute libre de 50 %.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Le problème est qu’ils achètent tous leur semence chez Delta & Pine…
M. le Président : Si la France travaillait là-dessus, la situation serait peut-être différente.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Il faudrait pouvoir chiffrer exactement ce que cela donne sur la marge finale, entre le surcoût de la semence et les économies en insecticide.
M. le Président : C’est très variable. Celui que nous avons visité était un très bon producteur. Mais pour ceux qui utilisent mal les OGM, le résultat peut être pire qu’avant.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Encore faudrait-il chiffrer le bilan environnemental. L’environnement reçoit nettement moins d’insecticides, et l’agriculteur aussi…
M. André CHASSAIGNE et M. Gabriel BIANCHERI : C’est ce qu’ils nous ont dit.
M. François GUILLAUME : Le meilleur test pour s’assurer de la réalité de l’avantage économique, c’est l’agriculteur qui le fera. S’il y trouve bénéfice, il achètera des semences génétiquement modifiées. Sinon il n’en prendra pas… Si les OGM rencontrent un tel succès dans les grandes fermes sud-africaines gérées par les Blancs, c’est qu’ils y ont un réel intérêt économique.
M. Gabriel BIANCHERI : On nous a cité un proverbe : « Un homme qui a l’estomac vide n’a qu’un souci ; celui qui a l’estomac plein en a beaucoup »…
Mme Marianne LEFORT et Mme Anne-Marie CHÈVRE : C’est vrai…
M. André CHASSAIGNE : Nonobstant tout ce qu’on peut dire sur l’intérêt immédiat, il est permis d’avoir une approche sur l’évolution du monde. Un avantage immédiat peut effectivement rapidement aboutir à une uniformisation et à une mainmise totale des firmes semencières transnationales. Au-delà de votre démarche scientifique, j’ai trouvé votre approche citoyenne très intéressante. Le problème est moins celui de la cohabitation des OGM et des cultures conventionnelles que celui de la coexistence entre les grandes agricultures productivistes indispensables en termes de survie économique et de compétitivité pour notre pays, et la liberté de tout un chacun, particulièrement dans nos terroirs, à mettre en avant une agriculture paysanne, avec des semences propres et des filières courtes. N’est-ce pas cette coexistence qui pourrait être remise en cause, particulièrement dans notre pays ?
M. Gabriel BIANCHERI : Nous avons rencontré en Afrique du Sud la représentante syndicale de quelque 120 000 petits agriculteurs noirs, qui produisent un peu de tout – maïs, coton, etc. – sur quelques hectares. Elle nous a dit « nous avons commencé à nourrir correctement nos enfants ; avant, nous ne pouvions pas. Et maintenant, je peux m’habiller comme vous. » Autrement dit, dégager un revenu pour être comme les autres… Cela aussi doit être pris en compte.
M. François GUILLAUME : L’uniformisation est effectivement un risque si l’on continue à laisser le champ libre aux grandes sociétés qui dominent le marché en produisant des OGM immédiatement utilisables et rentables à court terme. Pendant ce temps, le secteur semencier français, le deuxième du monde, en est réduit à partir à l’étranger pour développer ses semences… Sans compter que les agriculteurs n’aiment guère n’avoir affaire qu’à une seule société, fût-elle Monsanto ou DuPont. La concurrence qui sévit depuis toujours entre des semenciers qui cherchent à se différencier les uns des autres me paraît le meilleur moyen d’empêcher l’uniformisation que vous redoutez.
Mme Marianne LEFORT : Jusqu’à présent, la coexistence des cultures était assurée et je ne vois pas en quoi l’introduction d’OGM – pour peu, évidemment, que les risques de transfert soient correctement gérés par des mesures agronomiques et des distances d’éloignement adaptées – en changerait radicalement les termes. L’agriculture biologique cherche à prendre davantage de place et c’est tout à fait légitime. Encore faut-il s’organiser en conséquence, notamment sur le plan de la récolte et du stockage, mais c’est un autre problème.
La question de la gestion des innovations ne se limite pas à l’arrivée des OGM ou aux macro-surfaces. Elle se pose très concrètement, par exemple, pour la laitue : le contournement systématique des résistances fait le bonheur des semenciers qui, chaque année, et par des méthodes conventionnelles, vendent une semence avec un gène de résistance nouveau qui cédera au bout d’un an ou deux. A chaque fois qu’il cède, on recommence, et cela rapporte de l’argent à tout le monde… Le problème est que, année après année, nous grillons toutes les cartouches que nous avons à notre disposition. Cet exemple très ponctuel prouve à quel point toute innovation agronomique appelle des modes de gestion adaptés, en vue d’une plus grande durabilité.
M. Gabriel BIANCHERI : Les insecticides chimiques posent le même problème de résistances…
Mme Marianne LEFORT : Tout à fait. Cette exigence de gestion des conséquences à court comme à très long terme vaut dans tous les cas de figure.
M. le Président : En France, les cultures OGM se résument au maïs ou au colza. Existe-t-il beaucoup de maïs bio en France ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui, en maïs doux.
M. le Président : Et du colza biologique ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Quelques-uns essaient, mais c’est quasiment impossible à cultiver si l’on veut récolter quelque chose…
M. le Président : Mais trouve-t-on du maïs bio pour l’alimentation des animaux ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Oui, dans la mesure où les éleveurs bio sont tenus de nourrir leurs animaux en ensilage avec du maïs non-OGM.
M. André CHASSAIGNE : C’est dans leur cahier des charges.
M. Michel LEJEUNE : Ces cultures bio sont-elles au moins sans atrazine ?
M. le Président : Les agriculteurs bio n’ont évidemment pas le droit de l’utiliser. Reste que leur cahier des charges fixe une obligation de moyens, non de résultat. Si l’on trouve un peu d’atrazine, ce n’est pas grave ; l’important est que ce ne soit pas eux qui l’aient mise…
M. François GUILLAUME : L’atrazine est désormais interdite, mais notre collègue n’en a pas moins raison : certains produits phytosanitaires sont autorisés pour l’agriculture biologique
– c’est indiqué sur les sacs. L’agriculture biologique adapte sa charte en fonction de ses contraintes plus que du consommateur – celui-ci fait plutôt figure d’excuse… Un produit bio n’est pas forcément un produit sans engrais ni pesticides.
M. le Président : Nous avons déjà l’expérience de la coexistence entre l’agriculture conventionnelle et les productions semencières. Autrement dit, on sait faire.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : On sait faire, mais on sait également, pour le colza, que des contaminations croisées sont inévitables au niveau de la production, entre les variétés éruciques ou sans érucique. Les coopératives ont dû autoriser un taux de 2 % d’acide érucique.
M. François GUILLAUME : L’acide érucique ayant été soupçonné de provoquer des problèmes cardio-vasculaires, les agriculteurs étaient tenus de laisser leurs champs vierges de colza pendant trois ou quatre ans. Malheureusement, les graines vivent plus longtemps.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Actuellement, les deux filières coexistent.
M. le Président : Autrement dit, on y arrive, à condition de prévoir des seuils.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : C’est effectivement une des principales questions. On peut imposer, sous la pression médiatique, des seuils biologiquement irréalistes.
M. le Président : Le seuil de 0,9 % vous paraît-il réaliste ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : C’est totalement impossible pour le colza.
M. André CHASSAIGNE : C’est ce que retient la Confédération paysanne…
M. le Président : Ils veulent encore moins ! Autrement dit, vous pensez que les seuils sont un moyen de tout bloquer ?
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Evidemment ! Pourquoi croyez-vous qu’ils aient consacré autant d’énergie à la discussion sur les seuils !
M. Gabriel BIANCHERI : C’est de la stratégie.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Effectivement.
M. le Président : Mesdames, quel message aimeriez-vous faire passer en conclusion de cette réunion ?
Mme Marianne LEFORT : J’en ai deux. Premièrement, il est essentiel que nous puissions poursuivre les essais au champ, non pas ponctuellement, mais sur plusieurs années de suite. C’est le seul moyen d’étudier un certain nombre d’effets indirects ou collatéraux, mais également de poursuivre une stratégie de type observatoire. Quelle que soit l’innovation en cause, il est indispensable de disposer de références si l’on veut pouvoir étudier ses impacts. Or une référence n’est pas une image saisie à l’instant T, mais une dynamique d’évolution suivie dans le temps.
Deuxièmement, tout cela a un coût. Les OGM et les impacts environnementaux au sens large sont les parents pauvres dans les arbitrages financiers. On entend beaucoup de principes et d’idées, mais on ne voit pas beaucoup de sous par comparaison avec d’autres domaines… Les ambitions doivent être financées à leurs justes proportions.
Mme Anne-Marie CHÈVRE : Quel que soit le process utilisé, l’important est de savoir quel caractère on veut trouver dans les variétés qui feront l’agriculture de demain, et quel type d’agriculture nous voulons. On n’échappera pas à une réflexion de fond sur ce sujet. Les chercheurs, et particulièrement du secteur public, doivent pouvoir vous proposer une série de caractères qui ne se limitent pas à la résistance au Roundup ; restera à savoir comment ils seront perçus et utilisés.
La question de la gestion des innovations est déterminante. Il existe une multitude de gènes de résistance. L’intérêt du semencier est de vendre le plus de semences possible chaque année, celui de l’agriculteur d’avoir un champ le plus propre possible. Mais le jour arrivera où il faudra passer à une gestion en bien commun, autrement dit, supporter la présence d’un minimum d’agents pathogènes pour faire durer les choses et ne pas casser tout ce que nous avons dans notre boîte à outils. Cette dimension de gestion sociale et politique doit impérativement être prise en compte ; or elle est pour l’instant totalement ignorée.
Les chercheurs sont actuellement peu motivés sur les OGM et on peut les comprendre. Ils sont en revanche très intéressés par la problématique que je viens d’exposer : quels caractères veut-on, dans quelle culture et pour quoi en faire sur le long terme ? Que ce soit par OGM ou par croisements classiques, on veut des résistances durables, des produits de qualité et un minimum d’intrants. La question est de savoir quels moyens on entend se donner pour parvenir à ce résultat.
M. le Président : Mesdames, nous vous remercions.
Audition de M. Philippe DOUSTE-BLAZY,
ministre des solidarités, de la santé et de la famille
(Extrait du procès-verbal de la séance du 30 mars 2005)
Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président
M. le Président : Mes chers collègues, nous sommes heureux d’accueillir ce matin M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Nous avons peu de temps devant nous. Je laisse donc sans plus attendre la parole à M. Douste-Blazy.
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : Je tiens tout d’abord à saluer l'intérêt de votre travail sur les organismes génétiquement modifiés. Il contribue à instaurer un débat serein et objectif, à la hauteur de l'enjeu. Votre mission arrive à un moment où l'actualité sur les OGM est particulièrement riche. La levée du moratoire européen sur les nouveaux OGM, il y a bientôt un an, l'entrée en vigueur de deux règlements européens sur la traçabilité et l'étiquetage, un nouveau projet de loi à venir, mais aussi des opérations d'arrachage d'essais d'OGM témoignent de l'acuité de ce sujet et des vives préoccupations de nos concitoyens. Mon ministère s'est particulièrement investi dans les questions relatives aux médicaments issus du génie génétique et à la protection contre les risques sanitaires que les OGM sont potentiellement susceptibles de faire courir à l'homme.
J’aborderai dans un premier temps la question de la transposition des directives européennes.
L'Europe s'est munie d'une réglementation très aboutie, jugée même comme la plus stricte du monde aujourd'hui, tant pour l'autorisation de nouvelles variétés que pour l'étiquetage des aliments contenant des OGM. C'est la mise en place de ce nouveau cadre réglementaire qui a permis à la Commission européenne de reprendre en 2004 l'instruction des dossiers de demande de mise sur le marché, suspendue depuis 1998.
Il importe que ces directives, que la France a contribué à écrire, soient maintenant rapidement transposées en droit français. C'est pourquoi le Gouvernement prépare actuellement un projet de loi visant à transposer les directives cadres sur les OGM. Ce travail législatif et réglementaire est d'ailleurs d'autant plus nécessaire que la France a été condamnée par deux fois par la Cour de justice des communautés européennes en novembre 2003 pour manquement en transposition des dispositions des directives relatives aux OGM. Cette situation n'est évidemment pas satisfaisante.
Une de ces directives me concerne particulièrement. Il s’agit de celle relative à la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, parce qu'elle traite du renforcement des procédures d'évaluation du risque sanitaire et environnemental. Sans attendre la modification du droit national, ces évolutions ont d'ores et déjà été intégrées par la Commission du génie biomoléculaire (CGB) dans son travail d'évaluation des dossiers de demande de mise sur le marché d’OGM.
J’en viens, en deuxième lieu, aux autorisations d'essais et leurs risques sanitaires.
En matière d'autorisation d'essais d'OGM nous nous devons d'assurer au citoyen un haut niveau de protection sanitaire par une rigueur sans faille dans l'application du principe de précaution. La procédure actuelle, impliquant notamment l'expertise de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), permet de répondre efficacement aux préoccupations de nos concitoyens.
La procédure d'autorisation des OGM est en beaucoup de points analogue à une autorisation de mise sur le marché de médicaments. L'analyse repose sur une approche bénéfice/risques qui est particulièrement adaptée à ce type de décision. Cette méthode repose sur l'analyse de faisceaux de présomptions qui permettent d'évaluer au mieux les risques sanitaires à partir des connaissances disponibles.
Cette approche nécessite un travail de suivi post-autorisation qui prolonge l'analyse bénéfices/risques en intégrant les éléments nouveaux qui peuvent apparaître. Pour renforcer cette mission, le Gouvernement propose, dans son projet de loi sur les OGM qui a été annoncé par le Président de la République, de donner une assise législative à la mission de suivi des essais après les autorisations et de la confier au nouveau Conseil des biotechnologies qui intègre la CGG, la CGB et le Comité de biovigilance. Ce conseil sera le garant du bon déroulement des essais et du suivi des conséquences environnementales à moyen et long terme. Cette instance capitale permettra également d'assurer un retour d'expérience aux scientifiques ayant autorisé les essais.
Dans le domaine des médicaments, les OGM sont également utilisés, en particulier des bactéries pour fabriquer des vaccins ou des thérapeutiques innovantes – cancers du sein et du poumon, mucoviscidose, diabète. Aujourd'hui, un médicament sur six est issu du génie génétique. Ces OGM sont moins connus du public que le maïs transgénique destiné à l'alimentation humaine ou animale. Pourtant les tests génétiques, la production de médicaments ou de vaccins par voie génétique sont devenus indispensables et ont apporté des progrès thérapeutiques considérables. Ils permettent de diminuer les risques médicamenteux en fabriquant des produits d'une qualité et d'une sécurité incomparables. Je prendrai l'exemple de l'hormone de croissance qui est maintenant produite par génie génétique, alors que dans le passé, elle était extraite des hypophyses prélevées sur des cadavres, ce qui a entraîné la transmission malheureuse de la maladie de Creutzfeldt-Jacob.
La compétence en matière de médicaments produits par génie génétique relève de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), qui est chargée de l'évaluation et de la gestion du risque et s'assure de l'absence de risque pour les personnes. Les procédés de fabrication sont particulièrement contrôlés et réalisés en milieu confiné.
S’agissant, en troisième lieu, de l'expertise en matière d'OGM, je rappelle que les décisions des pouvoirs publics reposent sur des avis rendus par la communauté scientifique en matière d'évaluation de risques. Les évaluations sont actuellement effectuées par plusieurs instances au niveau national : la CGB principalement pour les risques environnementaux mais aussi pour la santé publique, l’AFSSA pour l'alimentation humaine et animale, la Commission du génie génétique (CGG) pour les recherches conduites en milieu confiné. Au niveau européen, un règlement de 2003 a conféré également un rôle particulier et pivot à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA).
L'expérience montre que cette multiplicité des instances se traduit souvent par des divergences fortes dans leurs avis. Elle contribue cependant à la transparence de l'expertise, elle la rend plus contradictoire, voire collégiale, et facilite l'expression des avis minoritaires. Si certaines instances sont composées exclusivement de scientifiques – je pense au Comité d'experts spécialisés « biotechnologies » de l'AFSSA, ou encore au comité de l’AESA –, d'autres sont composites, telles que la Commission du génie biomoléculaire, associant des représentants de la société civile – associations de protection de l'environnement et associations de consommateurs – aussi bien que des représentants des industriels, afin que l'ensemble des enjeux puisse être pris en considération.
Cette multiplicité des approches doit être mieux organisée pour être plus opérationnelle. A mon sens, l'analyse des risques sanitaires et environnementaux doit être prioritaire et constituer un prérequis absolu. Ensuite seulement, et dans les seuls cas où les risques sanitaires et environnementaux ont pu être considérés comme négligeables ou infiniment peu probables, les approches économiques et sociétales peuvent trouver leur place et éclairer utilement le gestionnaire du risque.
Afin de renforcer la lisibilité du dispositif d'expertise et de favoriser une meilleure prise en compte de ces attentes, le projet de loi du Gouvernement prévoit d'infléchir la structuration du dispositif national actuel. Il prévoit la création d'un Conseil des biotechnologies, associant dans sa section scientifique, la Commission du génie génétique et la Commission du génie biomoléculaire, et favorisant l'expression du monde socio-économique dans sa seconde section. Enfin, pour favoriser la lisibilité et la cohérence des expertises européenne et nationale en matière d'OGM « alimentaires », j'ai personnellement encouragé l'élaboration de lignes directrices d'évaluation des dossiers OGM pour l'AESA. Celles-ci s'inspirent très largement des lignes directrices auxquelles se réfère l'AFSSA. Le rapprochement des méthodes de travail entre l'AFSSA et l'AESA est souhaitable pour permettre une convergence des méthodes et une intercomparabilité des résultats. Il serait regrettable que l’AFSSA travaille selon certaines méthodes et l’AESA avec d’autres méthodes.
En dernier lieu, je souhaite aborder la question de l'information des citoyens.
Le dispositif national d'information du public a connu un rapide développement, notamment avec la mise en place depuis un an du site interministériel ogm.gouv.fr. Avec ce portail, le public peut accéder à des informations générales, assez bien documentées, et dont, surtout, la fiabilité est bonne. Le Gouvernement soumet à la consultation du public, sur ce site, les projets d'autorisation d'essais au champ.
Pour ce qui concerne son alimentation, le consommateur européen a deux garanties : la variété d'OGM autorisée a subi une batterie de tests très importante et il a toujours le choix de refuser d'acheter des produits alimentaires contenant des OGM. Depuis l'entrée en vigueur récente des deux règlements dits « Traceability » et « Novel Food-Novel Feed »
– nouvelle nourriture-nouvelle alimentation –, le citoyen bénéficie d'une information renforcée sur l’étiquetage des denrées préemballées.
Au-delà de la réglementation, qui est une étape essentielle pour la sécurité sanitaire, le succès ou l'échec des OGM dépendra de l'accueil que les consommateurs feront à ces nouveaux produits.
M. le Président : Merci, M. le ministre, pour toutes ces précisions.
Vous avez dit que vous faisiez confiance aux organismes tels que l’AESA, l’AFSSA, la CGB. Pourtant, notre pays connaît des controverses sur des risques en matière de santé. Pensez-vous que les OGM autorisés présentent des risques, ou faites-vous totalement confiance aux commissions qui ont donné un avis favorable pour leur autorisation ?
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : Notre société est actuellement traversée par des peurs collectives, qu’il est très facile de susciter et d’entretenir. Si les journaux télévisés diffusent deux fois par jour des informations qui font peur, des millions de personnes en concluent immédiatement qu’on leur « cache quelque chose ». Je comprends fort bien ces craintes, et il me semble normal que les citoyens aient des garanties.
Je connais bien l’AFSSA et son directeur actuel, Martin Hirsch. Il serait populiste et démagogique d’affirmer que l’AFSSA n’est pas sérieuse.
J’estime qu’il faut d’abord établir l’absence de risque. Une fois celle-ci établie, il est normal que les consommateurs donnent leur avis et que des discussions contradictoires s’engagent, qu’elles soient d’ordre sociétal ou politique. Mais il me paraît fondamental que le politique prenne en considération, dans un premier temps, l’avis des scientifiques.
M. le Rapporteur : Quel est l’avis du ministère sur les essais en plein champ dont la finalité est la production de médicaments ? Aux Etats-Unis, des erreurs dans la chaîne alimentaire ont pu être constatées. Quelles conditions de sécurité préconisez-vous pour les expérimentations en plein champ, si vous y êtes favorable ?
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : La réglementation est très stricte. Refuser ces essais serait une erreur. J’ai rappelé tout à l’heure les avancées que peuvent apporter les OGM pour la santé publique. A partir de là, je ne vois pas pourquoi on ne procéderait pas à des expérimentations de ce type, à condition qu’elles soient parfaitement encadrées sur le plan scientifique.
Mme Geneviève PERRIN-GAILLARD : Vous avez insisté sur la nécessité de s’assurer que l’utilisation des OGM ne présente pas de risques. Or, nous avons constaté au cours de nos travaux à quel point la recherche dans ce domaine est sinistrée. Les toxicologues ne sont pas en nombre suffisant pour mettre en place de nouvelles méthodes de recherche. Nous n’avons pas d’entomologues. Nous n’avons plus de naturalistes. Il est donc extrêmement difficile de mener à bien les recherches nécessaires. En outre, nos chercheurs s’interrogent sur la question de savoir s’ils peuvent continuer à travailler sur ces thèmes en restant en France. Que pensez-vous de l’état de la recherche dans ce domaine ?
S’agissant de l’information du public, vous avez rappelé l’existence du site ogm.gouv.fr. Outre que tout le monde n’a pas accès à Internet, je constate sur le terrain que les citoyens ne sont pas suffisamment informés. Avez-vous des idées qui nous permettraient d’améliorer le degré d’information de nos concitoyens ?
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : Le niveau de la recherche en France n’est pas nul. Je ne peux pas vous laisser dire cela. Oui, il nous faut plus de chercheurs. Oui, il est nécessaire d’accroître les crédits dont disposent nos établissements publics de recherche, et qui sont d’ailleurs en baisse depuis quinze ans. Mais je pense que le problème est beaucoup plus profond. Il nous faut une culture. Il faut susciter des vocations dès les premières années d’études de médecine ou d’études scientifiques. Nous devrions sans doute mettre plus en avant la recherche publique dans ce secteur.
S’agissant de l’information du public, il est vrai que tout le monde n’a pas accès à Internet. Mais ce qui est important, c’est de ne rien cacher. Car le secret, même s’il ne portait que sur une toute petite partie des informations, alimenterait les peurs collectives. L’essentiel est la transparence.
Mme Chantal ROBIN-RODRIGO : En tant que ministre de la santé, vous êtes garant de la santé de nos concitoyens. Contrairement à ce que vous avez dit, tous les spécialistes ne sont pas d’accord sur l’absence de risques sanitaires, et en particulier sur les OGM allergisants. Deuxièmement, aucune étude n’a été réalisée sur les effets à long terme de la consommation d’OGM. Troisièmement, les interrogations demeurent sur la possibilité de transfert horizontal à la microflore intestinale. Ce sujet a été très peu étudié jusqu’à maintenant.
Pouvez-vous nous rassurer en nous disant que des études complémentaires vont être menées sur ces trois points avant que l’on envisage d’aller au-delà ?
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : Ce qui a pu être dit sur les OGM allergisants contient des erreurs. Je peux vous le dire avec certitude. C’est même le contraire, puisque les OGM permettent d’enlever des gènes allergisants.
Ce n’est pas à moi de délivrer des autorisations en usant de mes pouvoirs de ministre de la santé. Cette époque-là est révolue. S’agissant des risques sanitaires, je n’affirme rien qui ne soit établi par toutes les publications scientifiques de haut niveau, internationalement reconnues. D’autres publications peuvent toujours dire le contraire.
Cela dit, vous avez raison de souligner que l’on a oublié d’insister sur la nécessité d’études épidémiologiques. La même erreur a été commise il y a vingt ans en ce qui concerne les médicaments, puisqu’on avait tendance à considérer comme excellent tout médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM). Mais les procédures actuellement en vigueur pour l’autorisation d’un OGM sont très rigoureuses. Pour autant, affirmer qu’il n’y a absolument aucun problème serait aussi irrationnel que le discours selon lequel les femmes ayant consommé des OGM vont donner naissance à des petits enfants verts.
Nous devons nous appuyer sur des études épidémiologiques très longues pour répondre de manière certaine aux interrogations qui s’expriment. Mais il me semble que le rapport bénéfice/risques est tel que nous pouvons ne pas interdire absolument toute culture d’OGM.
M. François GROSDIDIER : Le futur Conseil des biotechnologies comprendra deux sections, ce qui peut se comprendre. Cela dit, certains reprochent à la CGB actuelle de comprendre un trop grand nombre de biotechniciens, et pas suffisamment de toxicologues ou d’épidémiologistes. Serez-vous vigilant pour que les scientifiques dont la compétence est l’évaluation des risques de santé publique soient majoritaires au sein de la section qui sera chargée d’éclairer l’autre section sur la réalité objective des risques sanitaires ?
Par ailleurs, la directive de 2001 relative aux tests auxquels doivent être soumis les OGM est moins exigeante que la directive de 1991 relative aux pesticides chimiques. Êtes-vous favorables à un renforcement des tests ?
Enfin, quelle est votre position sur la publicité des tests ? Il y a en effet des zones d’ombre qui nourrissent la suspicion. Les résultats des tests sont couverts par le secret industriel, et pas sur décision des autorités françaises. Quand les dossiers sont déposés en Allemagne ou au Royaume-Uni, le ministère allemand ou britannique décide du secret, lequel s’impose ensuite en France.
M. Pierre COHEN : Je ne voudrais pas qu’il y ait de malentendu. Ma collègue Geneviève Perrin-Gaillard a insisté sur le fait que les chercheurs ont tendance à quitter le domaine de recherche qui nous intéresse ici. Elle n’a absolument pas évoqué la question, dont nous pourrions débattre très longuement, des crédits consacrés à la recherche.
M. le ministre, vous avez un avis à donner sur l’autorisation des essais en plein champ. Est-il arrivé que votre ministère ait donné un avis négatif pour des raisons tenant à des risques sanitaires ?
M. Philippe DOUSTE-BLAZY : M. Grosdidier, vous avez raison de souligner que la section scientifique du Conseil des biotechnologies ne saurait être composée exclusivement de chercheurs spécialisés en recherche fondamentale. Il faut à tout prix qu’elle soit en mesure de procéder à l’évaluation des risques et du rapport bénéfice/risques. Des études de ce type n’appartiennent pas encore à la culture de notre pays, contrairement aux pays d’Europe du Nord.
S’agissant de la transposition de la directive, il n’y a aucune raison que nous soyons moins exigeants que nous l’avons été concernant le médicament ou la publicité.
M. Cohen, il est arrivé à l’AFSSA de demander des compléments et, pour ma part, il ne m’est jamais arrivé de ne pas suivre son avis.
M. le Président : Je vous remercie, M. le ministre, de votre contribution aux travaux de notre mission d’information.
ACI Action concertée incitative
ADN Acide désoxyribonucléique
AESA Autorité européenne de sécurité des aliments
AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments
AFSSAPS Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
AFSSE Agence française de sécurité sanitaire environnementale
AGCS Accord général sur le commerce des services
AGPM Association générale des producteurs de maïs
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
ALENA Accord de libre-échange nord-américain
AMM Autorisation de mise sur le marché
ANIA Association nationale de l'industrie alimentaire
ANR Agence nationale pour la recherche
AOC Appellation d’origine contrôlée
APCA Assemblée permanente des chambres d’agriculture
ARN Acide ribonucléique : les acides ribonucléiques sont des outils nécessaires à l’expression de l’information génétique traduite en chaînes d’acides aminés : les protéines.
ART Autorité de régulation des télécommunications
ATTAC Association pour la taxation des transactions pour l’aide aux citoyens
CADA Commission d'accès aux documents administratifs
CEA Commissariat à l’énergie atomique
CETIOM Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains
CFS Confédération française des semenciers
CGB Commission du génie biomoléculaire
CGG Commission du génie génétique
CHU Centre hospitalier universitaire
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
CIUS Conseil international pour la science
CLCV Confédération de la consommation logement et du cadre de vie
CNA Conseil national de l’alimentation
CNDP Commission nationale du débat public
CNERNA Centre national d’études et de recommandations sur la nutrition et l’alimentation
CNRS Centre national de recherche scientifique
COMEPRA Comité d’éthique et de précaution pour les applications de la recherche agronomique
COV Certificat d’obtention végétale
CRII-GEN Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique
DDE Direction départementale de l’équipement
DGAL Direction générale de l’alimentation
DGCCRF Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes
DRAF Direction régionale de l'agriculture et de la forêt
ECOCERT Société de contrôle et de certification, agréée par les pouvoirs publics, chargée de garantir le respect des normes spécifiques à l’agriculture biologique
EPIPAGRI « Towards European Collective Management of Public Intellectual Property for Agricultural Biotechnologies » : Vers une gestion collective européenne de la propriété intellectuelle publique sur les biotechnologies à vocation agronomique
EPST Etablissement public à caractère scientifique et technologique
FAO « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FCD Fédération des entreprises du commerce et de la distribution
FDA « Food and Drug Administration »: Agence fédérale américaine de sécurité des aliments et médicaments
FFSA Fédération française des sociétés d’assurance
FNAB Fédération nationale de l’agriculture biologique
FNE France nature environnement
FNS Fonds national de la science
FNSEA Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole
FOP Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux
FRT Fonds de la recherche technologique
GATT « General Agreement on Tarifs and Trade » : Accord général sur les prix et le commerce
GEVES Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences
GNIS Groupement national interprofessionnel des semences
GRET Groupe de recherche et d’échanges technologiques
IAA Industries agroalimentaires
IFEN Institut français de l’environnement
IFR Institut fédératif de recherche
IFREMER Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
INAPG Institut national agronomique Paris-Grignon
INPI Institut national de la propriété industrielle
INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques
INRA Institut national de la recherche agronomique
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale
IRD Institut de recherche pour le développement
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ISAA « International service for the acquisition of agri-biotech applications »
ITB Institut technique de la betterave industrielle
JRC « Joint research center », Centre de recherche de l’Union européenne
LMR Limite maximale en résidus
MSA Mutualité sociale agricole
NIH « National Institute of Health », Institut national de la santé
NSF « National Science Foundation », Fondation nationale pour la science
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OCM Organisation commune du marché du sucre
OGM Organisme génétiquement modifié
OMC Organisation mondiale du commerce
OMS Organisation mondiale de la santé
ONG Organisation non gouvernementale
PAC Politique agricole commune
PCRDT Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de démonstration
PHRC Programme hospitalier de recherche clinique
PIPRA « Public Intellectual Property Resource for Agriculture » : Centre public de la propriété intellectuelle pour l’agriculture (Etats-Unis)
SAU Surface agricole utilisée
SIAL Salon international de l’alimentation
SIGMEA « Sustainable introduction of GM crops into European Agriculture »: Introduction durable de cultures OGM dans l’agriculture européenne.
SRPV Services régionaux de la protection des végétaux
SDQPV Sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux
UFC Union fédérale des consommateurs
UHT Ultra haute température
UIPP Union des industries de la protection des plantes
UNESCO « United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization » : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
UPOV Union pour la protection des obtentions végétales : convention réunissant 54 pays
USDA « United States Department of Agriculture »: ministère de l’agriculture du gouvernement fédéral des Etats-Unis
----------------
N° 2254 – tome 2 – Rapportsur les enjeux des essais et de l’utilisation des orgnismes génétiquement modifiés : auditions (président : M. jean-Yves Le Déaut – rapporteur M. Chrisitan Ménard)
1 FAO : Food and Agriculture Organization : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
2 NIH : National Institute of Health : Institut national de la santé.
3 Ensemble des insectes présents dans un milieu.
4 « Food and Agriculture Organization », Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
5 Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
6 FDA : « Food and Drug Administration » : Agence fédérale américaine de sécurité des aliments et médicaments
7 USDA : « United States Department of Agriculture » : ministère de l’agriculture du gouvernement fédéral des Etats-Unis
8 ALENA : Accord de libre-échange nord-américain.
9 CETIOM : Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains.
10 GEVES : Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences.
11 PCB ou Polychorobiphényle : Dérivés chlorés regroupant 209 substances apparentées utilisés dans des applications liées aux transformateurs électriques et aux appareils hydrauliques industriels. Ils ont été interdits en 1985.
12 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
13 « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
14 PCRD : Programme cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration
15 Rapport d'information n° 301 du 15 mai 2003
16 ADPIC : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce
17 Institut national de la santé
18 INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
19 CNRS : Centre national de recherche scientifique
20 CNRS : Centre national de recherche scientifique
21 INRA : Institut national de la recherche agronomique
22 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
23 IRD : Institut de recherche pour le développement
24 CNRS : Centre national de recherche scientifique
25 Réseau européen de recherche en génomique végétale
26 « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
27 PCRD : Programme cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration
28 GEVES : Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences
29 IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer.
30 PIPRA : « Public Intellectual Property Resource for Agriculture », Centre public de la propriété intellectuelle en agriculture (Etats-Unis)
31 CNERNA : Centre national d’études et de recommandations sur la nutrition et l’alimentation.
32 « American Food and Drug Administration » : Ministère de l’alimentation et des médicaments.
33 OCDE : Organisation de coopération et de développement économique.
34 FAO : « Food and Agriculture Organization », Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
35 OMS : Organisation mondiale de la santé.
36 INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale.
37 ARN : Acides ribonucléiques : les acides ribonucléiques sont des outils nécessaires à l’expression de l’information génétique traduite en chaînes d’acides aminés : les protéines.
38 RMN : Résonance magnétique nucléaire.
39 « Safe food » : alimentation sûre.
40 INRA : Institut de la recherche agronomique.
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
IRD : Institut de recherche pour le développement.
41 « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
42 Botanical and Rotational Implications of Genetically Modified Herbicide Tolerance
43 USDA : « United States Department of Agriculture », ministère de l’agriculture du gouvernement fédéral des Etats-Unis
44 Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years - Charles M. Benbrook, USDA, 2004.
45 GATT : « General Agreement on Tarifs and Trade » ; Accord général sur les prix et le commerce.
46 COMEPRA : Comité d’éthique et de précaution pour les applications de la recherche agronomique.
47 INRA : Institut national de la recherche agronomique
48 INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
49 FAO : « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Etats-Unis pour l’alimentation et l’agriculture.
50 ARN : Acide ribonucléique : les acides ribonucléiques sont des outils nécessaires à l’expression de l’information génétique traduite en chaînes d’acides aminées : les protéines.
51 « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
52 Cf. Le monde du 23.04.04 « L’expertise confidentielle sur un inquiétant maïs transgénique » - Hervé Kempf
53 CRII-GEN : Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique.
54 ECOCERT : Société de contrôle et de certification, agréée par les pouvoirs publics, chargée de garantir le respect des normes spécifiques à l’agriculture biologique.
55 GNIS : Institut national de la propriété industrielle
56 CFS : Confédération française des semenciers
57 UIPP : Union des industries de la protection des plantes
58 GEVES : Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences
59 AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique.
60 « Genetically Engineered Crops and Pesticide Use in the United States: The First Nine Years », Charles M. Benbrook, BioTech InfoNet, Technical Paper Number 7, October 2004.
61 « Les effets toxiques toxiques du Roundup sur le placenta humain », Richard S. et coll. Environ. Health Perspective, février 2005 (référence communiquée par M. Testart après la réunion).
62 « Contamination of refuges by Bacillus thuringiensis toxin genes from transgenic maize », Charles F. Chilcutt and Bruce E. Tabashnik, PNAS, May 18, 2004, vol. 101, no. 20, 7526-752.
63 ALENA : Accord de libre échange nord-américain
64 « Food and Agriculture Organization » : Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
65 « Seeds of Doubt : North American farmer's experiences of GM crops » ©Soil Association, September 2002.
66 CRII-GEN : Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique
67 PCRDT : Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de démonstration.
68 : « United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization », Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
69 MGM: « Metro Goldwyn Mayer », groupe américain de cinéma.
70 PCRD : Programme-cadre européen de recherche, de développement technologique et de démonstration
71 FNS : Fonds national pour la science
72 FRT : Fonds de la recherche technologique
73 CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
74 NSF : « National Science Foundation », Fondation nationale pour la science
75 AOC : Appellation d’origine contrôlée.
76 ART : Autorité de régulation des télécommunications
77 « International service for the acquisition of agri-biotech applications »
78 Technologie de protection contre les insectes. L’événement Herculex™ protège contre un plus grand nombre d’insectes nuisibles que d’autres maïs Bt (pyrale, noctuelle et noctuelle d’automne).
79 INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
80 DGAL : Direction générale de l’alimentation
81 Sophie Richard, Safa Moslemi, Herbert Sipahutar, Nora Benachour, Gilles-Eric Séralini : « Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase ». Environmental Health Perspectives. doi:10.1289/ehp.7728.
82 « Les perturbateurs endocriniens sont des substances exogènes altérant les fonctions du système endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d’un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations. Un perturbateur endocrinien peut interférer avec la synthèse, le stockage, la libération, la sécrétion, le transport, l’élimination ou l’action des hormones sexuelles. »
83 Ultra haute température
84 Seuil de présence fortuite et inévitable de 0,9% à partir duquel l’étiquetage est obligatoire (0,5% pour les OGM en cours d’instruction).
85 Organisations non gouvernementales
86 « Sustainable introduction of GM crops into European Agriculture » : Introduction durable de cultures OGM dans l’agriculture européenne
87 « Empilage de gènes ».
© Assemblée nationale