TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2011.
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
relatif au contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR)
et le groupe Bernard Tapie
ET PRÉSENTÉ
par M. Jérôme CAHUZAC
Député.
——
AVANT-PROPOS DE M. JÉRÔME CAHUZAC, PRÉSIDENT 7
CONTRIBUTION DES GROUPES 15
A.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE UMP, MEMBRES DE LA COMMISISON DES FINANCES 15
B.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 17
C.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE GDR, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 22
D.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU NOUVEAU CENTRE, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES 26
COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 27
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 9 heures 30 (compte rendu n° 110) : 27
– Communication, ouverte à la presse, de M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 27
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 12 heures (compte rendu n° 111) : 65
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bertrand Schneiter, ancien président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 65
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 14 heures 45 (compte rendu n° 112) : 72
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-François Rocchi, président du Consortium de réalisation (CDR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 72
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 18 heures (compte rendu n° 113) : 115
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation (CDR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 115
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 19 heures (compte rendu n° 114) : 126
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Scemama, président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 126
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 9 heures 30 (compte rendu n° 115) : 135
– Audition, ouverte à la presse, de M. Thomas Clay, doyen de la Faculté de droit de Versailles, titulaire de la chaire du droit de l’arbitrage, sur le droit et la pratique de l’arbitrage 135
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 10 heures 30 (compte rendu n° 116) : 149
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 149
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 15 heures (compte rendu n° 117) : 171
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Tapie, ancien président du groupe Tapie, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 171
Mardi 23 septembre 2008, séance de 15 heures (compte rendu n° 120) 218
– Audition, ouverte à la presse, de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, sur les décisions du Consortium de réalisation (CDR) et de l’Établissement public de financement et de réalisation (EPFR) dans le cadre des procédures liées aux contentieux entre le CDR et le groupe Bernard Tapie 218
Mardi 14 septembre 2010, séance de 16 heures 15 (compte rendu n° 103) 244
– Communication du Président sur les travaux de la Commission relatifs au contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie 244
Mardi 8 février 2011, séance de 16 heures 15 (compte rendu n° 53) 255
– Communication de M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR) 255
ANNEXE 1 : RÉFÉRÉ DE LA COUR DES COMPTES DU 12 NOVEMBRE 2010 CONCERNANT LA DÉFAISANCE DU CRÉDIT LYONNAIS (CDR ET EPFR) ET LA RÉPONSE DU PREMIER MINISTRE 267
ANNEXE 2 : COURRIERS 299
1.– lettre de M. Didier Migaud à M. Éric Woerth, 28 juillet 2009
2.– lettre de M. Didier Migaud à Mme Christine Lagarde et M. Éric Woerth, 24 novembre 2009
3.– lettre de M. Jérôme Cahuzac à Mme Christine Lagarde et M. François Baroin, 10 juin 2010
4.– lettre de M. Jérôme Cahuzac à Mme Christine Lagarde, 9 septembre 2010
5.– lettre de Mme Christine Lagarde à M. Jérôme Cahuzac, 13 septembre 2010
6.– lettre de M. Jérôme Cahuzac à M. Bernard Tapie, 15 septembre 2010
7.– lettre de M. Bernard Tapie à M. Jérôme Cahuzac, 16 septembre 2010
8.– lettre de M. Jérôme Cahuzac à Mme Christine Lagarde, 21 février 2011
9.– lettre de Mme Christine Lagarde à M. Jérôme Cahuzac, 28 février 2011
10.– lettre de M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie à M. Jean Peyrelevade, 17 mars 1999
11.– lettre de M. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie à M. Jean-Arnaud de Lasa, 17 mars 1999
12.– note de Mme Christine Lagarde aux administrateurs représentants de l’État au Conseil d’administration de l’EPFR, 10 octobre 2007
13.– note de Mme Christine Lagarde aux administrateurs représentants de l’État au Conseil d’administration de l’EPFR, 28 juillet 2008
AVANT-PROPOS DE M. JÉRÔME CAHUZAC, PRÉSIDENT
Le 7 juillet 2008, un tribunal arbitral condamnait le consortium de réalisation (CDR), société chargée de la gestion du passif du Crédit Lyonnais, au versement d’une somme de 285 millions d’euros au bénéfice du groupe Bernard Tapie et des époux Tapie, clôturant ainsi un conflit judiciaire qui avait duré près de quinze ans. La ministre de l’Économie décidait de ne pas introduire de recours en annulation.
La commission des Finances ne pouvait se désintéresser des conséquences de cette décision de justice. En effet, aux termes de l’article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, « les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Or cette affaire concerne les finances publiques à un double titre : par la charge élevée que faisait peser cette décision arbitrale sur le budget de l’État et par les questions de méthode posées par la défaisance des entreprises financières en difficulté.
Rappelons que le litige était né à propos des conditions de la cession par une filiale du Crédit Lyonnais, la société de banque occidentale (SDBO), de la société Adidas, détenue par la société Bernard Tapie Finance (SA BTF), en 1993. Cette cession s’inscrivait dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais mis en œuvre par l’État à la suite des pertes exceptionnelles de la banque. Dans ce contexte, une commission d’enquête avait été mise en place à l’Assemblée nationale, sous la présidence de M. Philippe Séguin : son rapport (1), paru le 5 juillet 1994, faisait déjà état de la complexité des relations financières entre la SDBO et le groupe Bernard Tapie.
Le jugement rendu dans cette affaire pèsera in fine sur les finances publiques, puisque l’indemnisation accordée aux mandataires liquidateurs et aux époux Tapie restera à la charge de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR), qui assure la surveillance du CDR et assure le soutien financier de l’État au Crédit Lyonnais.
Cette affaire agit par ailleurs comme un révélateur des deux inconvénients majeurs que présente la mise en place par l’État de structures de cantonnement pour écarter les dangers systémiques liés à des gestions financières imprudentes de la part de certaines grandes sociétés. Cette méthode a en effet conduit d’une part à diluer les responsabilités, la structure de défaisance n’agissant en réalité que pour le compte de l’État qui endosse la responsabilité en dernier ressort. Elle aboutit d’autre part à faire peser sur le contribuable la totalité du risque financier. Or cette charge présente un double inconvénient du point de vue des finances publiques : si son poids sera à l’évidence élevé, sa valeur exacte et même son ordre de grandeur sont affectés d’incertitudes juridiques qui l’entourent d’un halo d’incertitude, parfois de mystère.
C’est pourquoi la commission des Finances a engagé, au cours du mois de septembre 2008, une série d’auditions destinées à éclairer les conditions, les motivations et le bien-fondé du recours à une procédure d’arbitrage, en lieu et place de la justice ordinaire, pour le règlement de ce litige, ainsi qu’à examiner les raisons qui ont présidé au choix de l’État de ne pas former de recours en annulation de la sentence arbitrale, et les éventuelles suites à donner à cette affaire.
Il était naturel que la Commission commence par entendre son propre représentant au conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR), M. Charles de Courson, qui a d’ailleurs rendu compte chaque année devant la Commission de son activité dans le cadre de son mandat d’administrateur. Elle a ensuite poursuivi ses travaux avec l’audition des présidents respectifs du CDR et de l’EPFR, ainsi que de leurs prédécesseurs directs. Elle a également entendu un professeur de droit, spécialiste du droit de l’arbitrage, M. Thomas Clay, ainsi que l’ancien président du Crédit Lyonnais, M. Jean Peyrelevade, qui s’est trouvé à la tête de l’institution du mois de novembre 1993 à la fin de l’année 2003. Il a également semblé indispensable d’entendre M. Bernard Tapie lui-même. Les travaux de la Commission se sont achevés avec l’audition de la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, Mme Christine Lagarde, qui a donné les raisons du choix du Gouvernement de recourir à l’arbitrage afin de régler ce litige et de ne pas former un recours en annulation de la décision du 7 juillet 2008.
Il importe de souligner que c’est en vertu des pouvoirs de contrôle « classiques » qu’elle tient du Règlement de l’Assemblée nationale et de la Constitution que la commission des Finances a mené ses travaux. Il ne s’agit donc ni d’une mission d’information, ni d’une commission d’enquête, et il n’a pas été question de remettre en cause l’autorité de la chose jugée dans cette affaire, le parlement n’étant pas une instance judiciaire, mais simplement de tenter de comprendre les raisons des décisions prises par le gouvernement ainsi que de faire la lumière sur les procédures choisies pour les mettre en œuvre.
Les auditions auxquelles a procédé la Commission devaient permettre :
– de déterminer avec précision le coût pour les finances publiques d’une telle condamnation, par le tribunal arbitral, du CDR et donc in fine, par le biais de l’EPFR, de l’État ;
– et au-delà du cas d’espèce, de tirer des leçons de l’expérience d’un plan de redressement, s’agissant du rôle de l’État, et de l’ampleur de la responsabilité qui lui incombe dans ce type de circonstances.
S’agissant du coût que représente pour l’État la condamnation prononcée par le tribunal arbitral, il atteint 198 millions d’euros hors intérêts, dont 45 millions d’euros au titre du préjudice moral subi par les époux Tapie, acquittés dès le 5 septembre 2008, et financés pour un quart par le recours aux fonds propres du CDR lui-même et pour les trois quarts restants par l’endettement de l’EPFR, donc de l’État, auprès du Crédit Lyonnais. Les frais de liquidation, le calcul des intérêts ainsi que la fiscalité applicable à ces sommes devaient, au total, majorer ce coût, pour un montant qui n’était alors pas disponible.
Le processus arbitral a eu un coût d’un million d’euros, chaque arbitre étant rémunéré à hauteur de 300 000 euros et une somme de 100 000 euros ayant été affectée au fonctionnement du tribunal.
Mon prédécesseur, M. Didier Migaud, a souhaité que le compte rendu des auditions soit publié en un rapport d’information, afin que les pièces du dossier soient mises à la disposition des citoyens et que chacun, dûment informé, puisse se former une opinion.
Les groupes composant l’Assemblée nationale ont, selon l’usage habituel, été invités à apporter chacun une contribution à ce futur rapport. Celui-ci devrait également faire état de trois propositions qui avaient fait l’objet d’un consensus à l’issue des débats de septembre 2008.
Toutefois, le président Migaud, suivi par la Commission, avait souhaité que ce rapport fasse état également des réponses aux questions restant en suspens, concernant notamment le calcul des intérêts sur les sommes incombant à l’État, les frais de liquidation, le traitement fiscal des indemnités versées au Groupe Bernard Tapie ainsi que l’enrichissement supplémentaire de Bernard Tapie une fois ses dettes de toute nature acquittées.
Aujourd’hui, la somme brute due par l’État est connue : compte tenu du montant des intérêts – 99 millions d’euros –, elle s’élève à 384 millions d’euros.
La récupération par le CDR de sa créance sur le groupe Tapie a ramené à près de 300 millions d’euros le versement net au liquidateur du groupe.
Qu’est-il finalement revenu aux époux Tapie ? Sans cet élément conclusif, la charge nette de l’État, donc du contribuable, ne peut être connue.
Lors de son audition par la Commission le 23 septembre 2008, la ministre de l’Économie, avait indiqué – je cite : « J’ignore le montant exact de la fiscalité pesant sur les sommes en question, hors préjudice moral. L’ordre de grandeur dont je dispose est tout à fait estimatif car les arbitres n’ont pas encore statué sur la date à laquelle doit être calculé le traitement fiscal. Mes services m’ont indiqué que, après déduction des impôts et créances détenus par l’État, 30 millions d’euros devront être réglés au bénéfice des époux Tapie ».
Diverses demandes adressées par mon prédécesseur et moi-même à la ministre de l’Économie et au ministre du Budget, les 28 juillet 2009, 24 novembre 2009 et 10 juin 2010, afin d’obtenir des informations destinées à être rendues publiques, sont restées sans réponse.
À partir des documents dont j’ai pu avoir connaissance dans l’exercice des pouvoirs dont je dispose en tant que président de la commission des Finances et que j’ai dû me résoudre à faire valoir, j’ai fait une estimation de l’enrichissement supplémentaire de Bernard Tapie de 200 à 220 millions d’euros. L’estimation faite, selon une autre méthode de calcul, par M. Charles de Courson est de 200 millions d’euros.
Par ailleurs, à partir de bribes d’informations livrées par les uns et les autres, de recoupements et de calculs tenant compte de frais d’avocats, de dettes bancaires, d’arriérés fiscaux d’un groupe qui a repris son activité, la liquidation n’ayant pas été prononcée – l’avocat de M. Bernard Tapie faisant référence aux actifs désormais conservés par une holding qui ne donneraient pas lieu à fiscalisation –, des organes de presse sont parvenus, eux aussi, à une estimation d’environ 200 millions d’euros.
J’ai adressé le 9 septembre 2010 à Mme la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi un courrier aux termes duquel je lui demande de prendre position par rapport à cette estimation. Sa réponse reconnaît implicitement que l’estimation qui peut être faite des sommes revenant in fine aux époux Tapie est différente de celle qu’elle avait donnée en septembre 2008 dans la mesure où, entre-temps, les décisions de mise en liquidation des sociétés du groupe Tapie ont été rétractées. Pour le surplus, la ministre, sans apporter d’éléments de réponse pourtant en sa possession, s’est bornée à renvoyer la représentation nationale à l’autorité judiciaire.
La réponse que m’a faite, pour sa part, M. François Baroin, ministre du Budget et des comptes publics, inclut des informations couvertes par le secret fiscal. Ces réponses furent complètes, circonstanciées et données dans des délais très brefs.
De son côté, M. Bernard Tapie, à qui j’en avais fait la demande, m’a adressé, en même temps qu’à la presse, un courrier qui mentionne, à titre de reliquat disponible pour lui et son épouse, divers montants difficiles à agréger, pouvant représenter 120 millions d’euros, l’indemnité pour préjudice moral de 45 millions d’euros n’étant pas visée en tant que telle. En tout état de cause, le principe édicté pour Bernard Tapie par un des Présidents du CDR, « ni enrichi, ni failli », a été manifestement bafoué.
La Commission a entendu, le 8 février 2011, une communication de M. Charles de Courson sur l’activité de l’EPFR, à partir du référé de la Cour des comptes du 12 novembre 2010 concernant la défaisance du Crédit Lyonnais (annexe 1). Il en ressort notamment que le bilan de l’EPFR retrace, fin 2009, 4,4 milliards d’euros de passif pour 100 millions d’euros d’actifs. M. Charles de Courson note que : « Jusqu’en 2007, l’établissement a reçu une dotation annuelle de l’État permettant de réduire de façon continue les dettes depuis 2003. De nouveaux tirages ont toutefois été nécessaires en 2008 - 154 m€- et 2009 -117 m€- afin de financer, à hauteur de 80 % environ, le coût des affaires dites « Tapie » et il n’y a plus eu de dotations de l’État. […] La Cour, qui n’évoque pas la question de la capacité d’endettement des opérateurs, s’étonne en revanche de l’absence de dotations du budget de l’État à l’EPFR. » J’observe que ces dotations, inscrites chaque année dans le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, ne sont pas versées – le Gouvernement invoquant le taux exceptionnellement bas de cette dette, inférieur au coût de refinancement de l’État –, ce qui revient à reporter le règlement de cette dette à … 2014, date à laquelle devrait intervenir la dissolution de l’EPFR.
Enfin, la Cour des comptes a délibéré, en octobre 2010, un « rapport particulier », transmis aux commissions des Finances en février 2011, sur les comptes et la gestion du CDR pour les exercices 2007 à 2008, consacré pour près de la moitié au dossier Adidas/Tapie.
Je relèverai, parmi les reproches très sévères que la Cour adresse aux gestionnaires de ce dossier, trois critiques essentielles :
1) la validité juridique du recours à l’arbitrage était incertaine. Les précédents invoqués « ne valent pas garantie de légalité » et « aucun d’entre eux n’entrait dans le cadre d’un risque non chiffrable » – contrairement au conflit avec le groupe Tapie. Les clauses compromissoires visées par le protocole d’accord entre l’État et le Crédit lyonnais, ratifié par la loi, visaient des affaires dont ne faisait pas partie ce litige. « Il peut être considéré … qu’a contrario tout autre arbitrage qu’expressément mentionné n’est pas autorisé ». La Cour conclut que « Compte tenu de ces incertitudes, il était nécessaire de s’assurer par toutes les voies appropriées, y compris la consultation du Conseil d’État, que le CDR était habilité à recourir à l’arbitrage pour le compte d’un établissement public ».
On ne peut que s’interroger sur les motivations qui ont conduit le Gouvernement à s’engager dans une voie juridique aussi incertaine dans ses fondements, dessaisissant de fait la justice ordinaire. L’argument avancé est d’avoir pu ainsi écarter les effets de certains éléments constitutifs de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 qui auraient pu conduire la cour de renvoi à condamner l’État plus lourdement encore. Dans ce cas, pourquoi Bernard Tapie a-t-il souhaité écarter la justice ordinaire en sollicitant lui-même avec insistance
– par des demandes de janvier et août 2007 – son dessaisissement par le recours à une procédure arbitrale considérée a priori comme défavorable à ses intérêts ?
Cette interrogation est renforcée par la position constante de l’Agence des participations de l’État (APE), qui veille aux intérêts financiers de l’État et avait, pour sa part, donné, dans plusieurs notes adressées à la ministre de l’Économie, un avis très défavorable à la mise en œuvre d’une procédure arbitrale. Lorsque la sentence sera rendue, elle préconisera, sans être suivie, un recours en annulation.
2) Le compromis d’arbitrage, dont plusieurs conditions, notamment la renonciation à la possibilité d’un appel, présentaient de forts risques pour l’État, a été signé dans une version « différente du texte et des modifications qui ont été approuvés par le conseil d’administration du CDR ». « La rédaction « En leur qualité de liquidateurs des époux Tapie, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation à 50 millions d’euros » a été remplacée par la rédaction suivante : « En leur qualité de liquidateurs des époux Tapie, les parties B limitent le montant de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral à 50 millions d’euros ». « Ce point était pourtant de première importance pour les finances publiques dès lors que l’indemnisation d’un préjudice moral était laissée à la libre appréciation du juge, que la procédure d’arbitrage est confidentielle et échappe ainsi aux comparaisons et que les sommes n’avaient pas à supporter l’impôt. »
L’ajout de l’expression « préjudice moral » est du seul fait du Président du CDR, entre la date d’approbation du compromis d’arbitrage par le conseil d’administration et celle de sa signature avec l’autre partie. Il s’agit d’une modification substantielle des conditions du compromis, dont le texte définitif n’a pas été délibéré par le conseil d’administration du CDR, n’a pas été porté à la connaissance de l’APE non plus qu’à celle de l’EPFR, dans un sens qui se révélera très favorable aux époux Tapie et très coûteux pour les finances publiques : jamais l’indemnisation d’un préjudice moral n’a été fixée à ce niveau là – 45 millions d’euros –, les références devant les juridictions ordinaires étant, au plus, de l’ordre du million d’euros, pour des peines d’emprisonnement très longues relevant de l’erreur judiciaire.
3) Les contentieux Adidas et Tapie n’étaient pas couverts par la garantie du CDR envers le Crédit Lyonnais prévue par le protocole législatif du 5 avril 1995. Une lettre ministérielle du 17 mars 1999 du ministre de l’Économie, prise dans le cadre de la privatisation du Crédit Lyonnais, a étendu la garantie du CDR aux conséquences financières des actions engagées par les mandataires liquidateurs au titre de la cession d’Adidas. Mais la Cour relève « la fragilité juridique de cette lettre, dans un domaine qui requiert des validations législatives ». De plus, « aucune garantie n’avait jamais été prévue, même par lettre ministérielle, pour les autres contentieux impliquant le Crédit Lyonnais, en particulier l’action visant à demander une indemnisation pour le préjudice moral subi par les époux Tapie au titre d’une mise en liquidation judiciaire abusive ». Le Crédit Lyonnais n’étant pas partie prenante à l’arbitrage, « le CDR a accepté d’assumer seul des responsabilités qui incombaient au moins pour partie au Crédit Lyonnais, en dehors du champ de garantie ». Ainsi, « il ressort de la lecture de la sentence que le CDR s’est exposé, en s’engageant seul dans la procédure d’arbitrage, à supporter seul (et sans pouvoir se défendre efficacement) une lourde condamnation (45 m€) au motif d’agissements qui mettaient en cause le Crédit Lyonnais. »
On ne peut que s’interroger sur les raisons qui ont conduit la ministre de l’Économie à s’affranchir d’une habilitation législative au moment où allait se décider le contenu d’un compromis d’arbitrage lourd d’intérêts financiers pour l’État.
*
* *
S’agissant des principaux enseignements à tirer de l’examen de cette affaire, et malgré les divergences de points de vue constatées tout au long des auditions menées par la Commission, il semble que trois propositions puissent faire l’objet d’un commun accord.
1.– Il est apparu indispensable qu’intervienne une clarification des modalités de recours à l’arbitrage par les personnes publiques.
En effet, dans le cas du CDR et de l’EPFR, l’absence d’un texte explicite, d’ordre législatif ou réglementaire, prête en tout état de cause le flanc à la critique. L’incertitude prédomine quant à la possibilité et aux modalités du recours à l’arbitrage d’une structure placée sous la surveillance d’un établissement public.
Afin d’éviter que de telles critiques puissent être formulées à l’encontre d’entités responsables de deniers publics, il conviendrait à l’avenir que des dispositions claires viennent encadrer le recours à la pratique de l’arbitrage. Cet encadrement devra intervenir par voie législative pour les établissements publics administratifs (EPA), et par voie réglementaire pour les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), que ce soit d’ailleurs pour exclure radicalement le recours à l’arbitrage ou pour l’organiser.
2.– Il semble par ailleurs essentiel que soient définis avec plus de rigueur et de clarté les montages juridiques qui président à la mise en place des structures de défaisance.
La Cour des comptes a mis en lumière, dans son rapport public annuel de février 2008, les difficultés liées au cantonnement, dans des structures de défaisance, des actifs compromis, des contentieux et des pertes des sociétés concernées, jugeant ces dispositifs « complexes et déresponsabilisants » (2).
Dans le cas exemplaire qui nous intéresse, il est en effet très difficile de déterminer les compétences et les responsabilités respectives des deux entités que sont d’une part le consortium de réalisation (CDR), structure qui abrite en tant que tel le cantonnement du passif, et d’autre part, l’établissement public de financement et de restructuration (EFPR), chargé de sa surveillance et de la gestion du soutien financier de l’État. Si c’est le CDR qui este en justice, les conséquences des décisions de justice prononcées dans le cadre des contentieux hérités du Crédit Lyonnais sont in fine assumées par l’EPFR qui apporte sa garantie financière, et donc par l’État.
3.– L’opportunité de la création de structures de défaisance doit elle-même être examinée avec la plus grande prudence.
Dans son rapport déjà cité, la Cour des comptes juge que « le choix de cantonner des actifs compromis dans une structure spécifique s’est révélé peu judicieux », dans la mesure où il a conduit l’État à assumer la quasi-totalité des pertes et à déresponsabiliser les sociétés qui ont ainsi pu se défaire de leurs actifs compromis. Certes, des montages juridiques similaires seraient aujourd’hui impossibles à mettre en œuvre, – les normes comptables internationales excluant désormais les mécanismes de déconsolidation des comptes –. Toutefois, celles-ci n’interdisent pas le recours à la défaisance en tant que telle. Ainsi, les États-Unis ont-ils envisagé de recourir à la mise en place d’une structure de cantonnement dans le cadre de la première version du plan de sauvetage annoncé en octobre 2008 par le secrétaire d’État au Trésor Henry Paulson, qui consistait à racheter aux banques leurs actifs « toxiques ». Le « plan Paulson » finalement adopté privilégie a contrario une prise de participation par le Trésor américain dans le capital des institutions financières les plus fragiles, afin d’augmenter ainsi leurs liquidités.
Il est dès lors légitime de s’interroger sur l’opportunité même du cantonnement des actifs compromis dans une structure spécifique. Le contexte de la crise financière des années 90 et le risque systémique que la menace d’un dépôt de bilan du Crédit Lyonnais faisait peser sur la place financière parisienne expliquent la mise en place d’une structure de cantonnement des actifs compromis de la banque. À la lumière de cette expérience, le manque de lisibilité chronique de la gestion de la défaisance du Crédit Lyonnais conduit, pour l’avenir, à recommander la plus grande prudence quant au recours à ce type de montage dans le cadre de plans de redressement ou de sauvetage de sociétés initiés par les pouvoirs publics.
Alors que la récente crise financière a conduit de nombreux États à se porter au secours de sociétés au bord de la faillite, il convient de faire preuve de la plus extrême circonspection vis-à-vis d’un outil qui consiste à cantonner les actifs compromis au détriment de solutions de liquidation ou de recapitalisation des sociétés concernées.
A.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE UMP, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES
La commission des Finances, à l’initiative de son précédent président, a souhaité en 2008 mener une série d’auditions sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Tapie, suite notamment à la décision de recourir à un arbitrage pour mettre un terme à l’ensemble des procédures judiciaires en cours.
Les comptes rendus de ces auditions, menées à l’automne 2008, ont permis de rappeler à tous que l’affaire Adidas/Tapie et ses conséquences financières viennent malheureusement s’inscrire à la liste des nombreux déboires du Crédit Lyonnais des années 1990. L’ensemble de la charge financière en résultant s’ajoute à la charge de la collectivité publique et des contribuables français qui atteint plus de 15 milliards d’euros, selon les estimations de Charles de Courson, Vice-président de la Commission des Finances, de l’Économie générale et du Contrôle budgétaire et représentant de l’Assemblée nationale au sein du conseil d’administration de l’EPFR.
L’objet des travaux de notre Commission n’était pas de revenir sur la responsabilité des fautes commises à l’époque par les dirigeants du Crédit Lyonnais – cela a été jugé – mais d’examiner les modalités de gestion du passif Adidas/Tapie hérité du Crédit Lyonnais par les structures de défaisance, dont l’objet et les règles de gestion sont définis par la loi du 28 novembre 1995 relative à l’action de l'État dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs.
Deux questions ont été plus spécifiquement posées, relativement au choix du recours à l’arbitrage.
La première portait sur l’opportunité d’y recourir au vu de l’état des différentes procédures judiciaires en cours. À cet égard, le rapporteur général, à l’occasion de notre séance du 14 septembre 2010, semble avoir parfaitement résumé l’apport des auditions menées : l’examen détaillé des différents jugements intervenus, et en particulier de la décision de la Cour de cassation, met en évidence le risque qu’il y aurait eu à rouvrir les procédures judiciaires et les grands dangers auxquels le CDR aurait alors été exposé. Les travaux de la Commission ont donc permis de partager et d’éclairer l’analyse ayant conduit l’Établissement public de financement et de restructuration, garant de l’intérêt public, à ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage lorsqu’il a été consulté par le Consortium de réalisation.
La seconde question était relative à la possibilité juridique de recours à l’arbitrage par le CDR, et les conséquences qui auraient pu en être tirées en matière de recours en annulation contre la sentence arbitrale. De solides arguments juridiques ont été exposés lors des auditions à l’appui de la démonstration de la légalité de l’arbitrage. Surtout, le tribunal administratif de Paris a été amené à se prononcer sur la question dans un jugement du 8 octobre 2009 et a confirmé que le recours à l’arbitrage par le CDR ne méconnaissait pas l’article 2060 du code civil. Ce jugement a été confirmé en appel le 31 décembre 2010. Le débat sur la légalité de l’arbitrage engagé dans le cadre du contentieux entre le CDR et le groupe Tapie paraît donc définitivement clos.
Les conséquences financières pour l’EPFR et le CDR du contentieux Adidas/Tapie sont désormais parfaitement connues et retracées dans les rapports de gestion transmis annuellement à la Représentation nationale par l’EPFR, puisque toutes les procédures relatives à ce contentieux ont été définitivement closes le 18 mars 2009, date à laquelle est intervenu le dernier versement du CDR en vertu de sa condamnation par le tribunal arbitral, ainsi que cela a été rappelé par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’industrie, dans son courrier du 13 septembre 2010.
Quant à la question de savoir quelle serait la position financière des personnes morales et physiques constituant le groupe Tapie, telle que posée par l’actuel Président de la commission des Finances, il convient de distinguer trois éléments :
– le montant des condamnations du CDR, en principal et en intérêts : ces montants sont désormais parfaitement connus et rappelés en introduction du présent rapport ;
– le traitement fiscal des personnes physiques et morales suite à cette condamnation : il apparaît que, dans le respect du secret fiscal, le ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État a communiqué au Président de notre Commission toutes les informations dans le cadre des procédures prévues à cet effet ;
– le résultat des contentieux et règlements de passif entre le groupe Tapie et d’autres entités privées : cela ne paraît pas relever du champ du contrôle de l’EPFR et du CDR, qui ne sont en rien concernés.
La mise en place, par la loi du 28 novembre 1995, de la structure de défaisance du Crédit Lyonnais était-elle la meilleure solution possible ? Il ne faudrait pas croire que les pertes finalement supportées par les finances publiques résulteraient de la politique mise en œuvre pour la gestion du passif effarant hérité du Crédit Lyonnais, en occultant la responsabilité, réelle, avérée et entière, de la gestion de cette banque au cours des années 90. La priorité absolue doit être d’éviter d’avoir à être confronté de nouveau à la question de la mise en place ou non d’une structure de défaisance, en prévenant par la régulation des errements tels que ceux qui ont coûté si cher aux finances publiques dans le cas du Crédit Lyonnais.
B.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN ET DIVERS GAUCHE, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES
Le 7 juillet 2008, le Consortium de Réalisation (CDR), structure de cantonnement et de défaisance des actifs et créances compromis du Crédit Lyonnais, est condamné par un tribunal arbitral à verser 285 millions d’euros à Bernard Tapie dont 45 millions d’euros au titre de la réparation d'un préjudice moral. Une procédure d’arbitrage inhabituelle s’agissant d’un organisme chargé de la gestion de fonds publics et une évaluation de la réparation d’un préjudice moral sans rapport avec les montants habituellement décidés par les juridictions compétentes.
Le versement de telles sommes d’argent public ne peut laisser indifférent. Au-delà de l’émotion légitime exprimée par le contribuable, il convient de s’interroger sur les raisons qui ont conduit à de tels choix de la part des pouvoirs publics et pour lesquels il ne semble pas que l’intérêt de l’État ait été réellement pris en compte comme l’ont montré les auditions organisées à l’initiative du président de la commission des finances et le rapport de la Cour des comptes.
Plusieurs questions graves appellent des réponses qui n’ont pas été apportées par le gouvernement.
1°) Pourquoi le CDR société anonyme dont l’unique actionnaire est l'EPFR – établissement public administratif - a-t-il décidé d'abandonner le terrain judiciaire pour confier à trois arbitres le soin de trancher son différend avec le groupe Bernard Tapie Finance ?
Lors de leurs auditions, les anciens et actuels présidents du CDR et de l’EPFR ont souligné les liens étroits entre l’EPFR et le CDR. Or, la ministre de l’économie a indiqué que l’EPFR a pris la décision d’accepter de recourir à l’arbitrage à l’unanimité. Son conseil d’administration étant composé de représentants de l’État, il paraît inconcevable que ces derniers n’aient pas reçu d'instructions.
Pourquoi le gouvernement a-t-il accepté de recourir à cette procédure dans une affaire où la décision de la Cour de cassation d’octobre 2006 montrait que le terrain judiciaire classique pouvait aboutir à une situation moins défavorable aux finances publiques ? En octobre 2006, la Cour de cassation casse en effet l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’elle n’a pas mis en évidence une faute du Crédit Lyonnais et annule l’indemnisation précédemment décidée. Pour quelle raison l’action n’a-t-elle pas été poursuivie sur le terrain judiciaire classique ?
Les auditions ont révélé qu’il existe un doute sur la capacité du CDR de choisir la procédure d’arbitrage, étant donné le « droit de veto » de l'EPFR - établissement public administratif lui-même non habilité à recourir à cette procédure – sur les décisions de son conseil d'administration.
De même, le recours à une procédure d'arbitrage, par nature confidentielle, ne paraît guère adaptée à une situation où des financements publics sont en jeu.
Le rapport de la Cour des comptes mentionne les réserves du directeur général de l’Agence des participations de l’État sur l’accord transactionnel avec les minoritaires du CEDP qui créait un précédent ouvrant la porte à un arbitrage favorable aux époux Tapie.
Il faut enfin rappeler qu’une disposition tendant à étendre la possibilité du recours à l'arbitrage, notamment aux établissements publics administratifs, avait été invalidée, en mars 2007, par le Conseil constitutionnel.
2°) Une version de la convention d’arbitrage peu favorable aux finances de l’État
Le choix des arbitres n’a pas été conforme aux pratiques courantes et le montant des plafonds fixés par la convention d’arbitrage, notamment en ce qui concerne la demande du groupe Bernard Tapie Finance au titre du préjudice moral, sont extrêmement élevés et sans précédents.
Par ailleurs la Cour des comptes souligne que la version signée du compromis d’arbitrage diffère de la version présentée et approuvée par le Conseil d’administration du CDR le 2 octobre 2007 sur un point important concernant la qualification de préjudice moral pour l’intégralité de la demande d’indemnisation de 50 millions d’euros au titre des époux-Tapie. La version votée par le Conseil d’Administration limitait « le montant de l’ensemble de la demande d’indemnisation (des époux-Tapie) à 50 millions d’euros ». Cette limite est affectée au contraire dans le compromis d’arbitrage au seul préjudice moral par l’ajout de ce terme à la phrase précédente : «limitent l’ensemble de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral à 50 millions ». C’était ouvrir la porte à une indemnisation exorbitante.
3°) Pourquoi la ministre de l’économie a-t-elle décidé d’abandonner la voie du recours fin juillet 2008, quelques jours après la décision arbitrale, alors que le délai courrait jusqu’à la mi-août 2008. Pourquoi ont-ils renoncé immédiatement après le rendu de la décision, à former un recours en annulation contre la décision, dont on peut considérer qu’elle s’est avérée être défavorable à l'État ?
Les différentes auditions ont montré que Bernard Tapie, en 1992, vend pour deux raisons. D’une part, il devient ministre et les deux fonctions sont incompatibles. D’autre part, Adidas perd de l’argent. Faute d’acheteur, il risque de faire une mauvaise affaire. Et pourtant, il retire de cette cession 400 millions de francs de l’époque. Réclamer une partie de la plus-value réalisée ultérieurement par la société parait pour le moins étonnant, mais cela a paru insuffisant pour que les pouvoirs publics reviennent sur une décision qui conduit l’État à signer un chèque de plusieurs centaines de millions d’euros.
Le rapport de la Cour note que le CDR s’est prononcé le 28 juillet 2008 contre un recours en annulation par 3 voix contre 2. Le président de l’EPFR qui avait indiqué son intention de s’abstenir, ce qui est la position traditionnelle de l’EPFR, a finalement voté « pour » après « avoir reçu instruction du ministre pendant la séance ». Ce vote n’a donc été acquis que par la voix du président de l’EPFR.
L’avocat du CDR, après s’être déclaré « choqué du montant exorbitant des condamnations prononcées », observe que les motifs de la sentence ne « résisteraient probablement pas à un recours en appel ou en cassation si une telle voie était ouverte puisque c’est un fait, pas plus qu’en 1994 qu’en 1998, la SNC GBT n’a la moindre qualité à demander réparation d’un préjudice dont elle n’a pas personnellement souffert ». En effet, l’actionnaire d’Adidas est la société Bernard Tapie Finance devenue CEDP et propriété du CDR.
L’Agence des participations de l’État, dans sa note au ministre du 22 juillet 2008, remarquait pour sa part « que l’ampleur exceptionnelle de la condamnation, proche du montant maximum des demandes formulées par les parties opposées au CDR dans le cadre des arbitrages, justifie en tout état de cause un recours en annulation ».
4°) Le référé de la Cour des comptes
En février 2011, la Cour des comptes a communiqué à la commission des finances un référé relatif à la défaisance du Crédit Lyonnais (CDR et EPFR).
Il met clairement en évidence les défaillances des pouvoirs publics sur ce dossier.
En premier lieu, il est démontré que depuis 2007, l’État n’assure plus le versement de dotations budgétaires pour alimenter l’EPFR. En conséquence, la dette de l’EPFR a recommencé à croître alors que cette structure a vocation à l’apurer et c'est en 2014 qu'il conviendrait de doter l'EPFR de près de 5 milliards d'euros.
En outre, le champ de la garantie du CDR vis-à-vis du Crédit Lyonnais demeure source de contestations. Selon la Cour des comptes, le CDR s’est substitué à la responsabilité du Crédit Lyonnais dans le dossier « Adidas-Tapie » au-delà de ce qu’autorisait le protocole du 5 avril 1995. Ainsi, le Crédit Lyonnais n’aurait pas dû bénéficier de la garantie du CDR dans le contentieux l’opposant au groupe Bernard Tapie car l’autorisation parlementaire a été outrepassée. Pour éviter cela, un avenant à ce protocole aurait dû être conclu et ratifié en loi de finances conformément à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
La Cour vient confirmer une position issue des auditions. Le pouvoir de décision réparti entre l’État, le CDR et l’EPFR n’a jamais été clairement établi et s’est fait dans la confusion. Cela n’a pas permis de respecter l’autonomie des personnes juridiques décidées par le législateur. À ce titre, la Cour affirme que le président de l’EPFR a participé à des votes du conseil d’administration du CDR alors même que le conseil d’administration de l’EPFR ne s’était pas encore prononcé sur ces mêmes sujets.
Plus grave encore pour les finances publiques, l’EPFR n’aurait pas dû accepter de prendre en charge la totalité des sommes à payer au titre « des risques non chiffrables ». La contribution forfaitaire de 12 millions d’euros avant le prononcé de la sentence aurait dû être réglée par le Crédit Lyonnais.
De même, l’EPFR n’avait pas à assumer financièrement le préjudice moral subi par les époux Tapie en tant que « risque non chiffrable ». En effet, seules les conséquences financières des actions engagées au titre de la cession d’Adidas étaient considérées comme « risques non chiffrables » et pas les autres contentieux de l’affaire. Cela signifie que le règlement par l’EPFR du montant du préjudice moral des époux Tapie fixé par la sentence arbitrale n’avait pas de fondement juridique. De plus, cette extension des garanties aurait dû être autorisée en loi de finances préalablement à l’exécution de la sentence arbitrale.
Le référé de la Cour des comptes rappelle que l’article 2060 du code civil affirme que : « On ne peut compromettre […] sur les contestations intéressant […] les collectivités publiques et les établissements publics ». Le Consortium de réalisation est une filiale à 100 % de l’établissement public de financement et de restructuration. Il faut rappeler que le protocole du 5 avril 1995 conclu entre l’État et le Crédit Lyonnais a été validé par la loi. Il ressort donc que seuls les arbitrages expressément autorisés par la loi ont une base légale. Le CDR n’aurait donc pas dû être autorisé à recourir à la procédure d’arbitrage.
Conclusion:
Les commissaires SRC aux finances considèrent que la décision de recourir à l’arbitrage décidé par la ministre dès septembre 2007 est une faute. La ministre de l’économie a donné instruction en ce sens aux administrateurs nommés par l’État au conseil d’administration de l’EPFR. Ce conseil d’administration a décidé du principe du recours à l’arbitrage et ses représentants au sein du conseil d’administration du CDR, la structure de droit privé portant les actifs du Crédit Lyonnais, ont voté en ce sens, emportant la décision de ce conseil d’administration.
La représentation nationale n’aurait pas dû être tenue à l’écart de cette décision pour des raisons légales. Elle aurait aussi dû être saisie car cela concerne la bonne gestion des finances publiques et le choix du type de justice auquel l’État peut recourir.
Enfin, le fait d’avoir abandonné la voie du recours est une autre faute étant donné les montants considérables de l’indemnisation.
C.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU GROUPE GDR, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES
Les débuts de « l'affaire Tapie », c’est-à-dire les révélations concernant la connivence, voire la consanguinité entre le milieu des affaires et une partie du monde politique remontent aux années 1980. On se souvient que Bernard Tapie a exploité, à partir de la fin des années 1970, un système consistant à racheter à bas prix des entreprises en cessation ou en quasi-cessation de paiement, à les restructurer, à licencier, voire à délocaliser, en obtenant, grâce à la loi, un étalement de leur passif ou leur rachat décoté, puis à les revendre, une fois cela fait, en faisant une plus-value aussi copieuse que possible. Il a ainsi racheté Draguer, Manufrance, la Vie claire, Terraillon, Testut, Wonder, Mazda, Look, Donnay et Adidas en 1990. En appliquant ses méthodes extrêmement brutales, Bernard Tapie est directement responsable de la destruction de plusieurs dizaines de milliers d’emplois. Ceci est évidemment de nature à rendre son enrichissement personnel moralement illégitime ; et ce d’autant plus qu’il a généré, au-delà des drames personnels ainsi provoqués, une dépense très importante pour les finances publiques et, notamment, pour les caisses d’assurance-chômage. Tout au long de ce parcours, il a été financé par la Société de banque occidentale – SDBO –, filiale du Crédit Lyonnais, que le rapporteur de la commission d’enquête parlementaire de 1994 qualifiait de « haut lieu, discret et feutré de la spéculation parisienne ». Tout au long de ce parcours, Bernard Tapie a entretenu des rapports coupables avec les plus hautes sphères du monde politique. Défendu par l’avocat d’affaires Jean-Louis Borloo, Bernard Tapie devient, en 1985, l'associé du député RPR Georges Tranchant, grand spécialiste et pratiquant des paradis fiscaux, dans l'entreprise NAVS. Membre du consortium dirigé par Francis Bouygues pour racheter TF1 dès 1987, Bernard Tapie est élu député pour la première fois en 1989. Figure incontournable du football marseillais, il est tour à tour député, conseiller régional, et conseiller général en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Bénéficiant du soutien du président Mitterrand, il est nommé deux fois ministre en 1992 et conduit la liste des radicaux de gauche aux élections européennes contre la liste dirigée par Michel Rocard. Pour préserver ses intérêts, monsieur Tapie fait évoluer ses « convictions politiques » au gré des alternances électorales. Ainsi, après avoir écopé d’une peine d’inéligibilité, en 1994, à la suite d’un de ses nombreux démêlés avec la justice, Bernard Tapie soutient la liste UMP de Renaud Muselier aux élections régionales de 2004 et apporte son soutien au candidat Nicolas Sarkozy en 2007. La confusion des genres, dont monsieur Tapie est devenu le symbole, est inacceptable dans une démocratie digne de ce nom. Le Parlement doit prendre ses responsabilités pour qu’elle cesse au plus vite.
Sans revenir en détail, ici, ni sur le « contentieux Adidas », ni sur les autres et très nombreuses affaires judiciaires qui ont émaillé la « carrière » de monsieur Tapie, ce dernier réaliserait donc, dans ses démêlés avec le Crédit Lyonnais, un « bonus » ultime d’environ 220 millions d’euros, rejoignant d’un coup la caste très exclusive des premières fortunes de France. Le scandale, évidemment, c’est qu’il s’agit d’une somme totalement illégitime. Pour lui, il a été décidé de suspendre la procédure devant la justice ordinaire de la République, pour recourir à la justice privée des arbitres, au moment précis où la bataille judiciaire tournait à l’avantage de l’État et au désavantage de Bernard Tapie. Qui a pris la décision ? Le chef de l’État lui-même.
C’est en effet après un long combat judiciaire entre le groupe Tapie et le Consortium de réalisation du Crédit Lyonnais, couronné par un arrêt, du 9 octobre 2006, de la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière qui était globalement défavorable aux prétentions du groupe Tapie, qu’il a été décidé du recours à une voie judiciaire d’exception. Un tribunal arbitral a été formé. Celui-ci a rendu, en contradiction avec le contenu de la décision de la Cour de cassation, une sentence d’arbitrage extraordinairement favorable à la famille Tapie. La décision du tribunal arbitral a été avalisée par le Consortium de réalisation (CDR) et l’établissement public de financement et de réalisation (EPFR), grâce à la position des membres désignés par l’État qui ont demandé et reçu des instructions écrites du gouvernement. À la suite de cette sentence, rendue par une justice d’exception totalement contraire aux usages de la République, les pouvoirs publics ont persévéré dans cette voie contraire aux intérêts de la Nation en refusant d’interjeter appel d’une décision manifestement inique.
Cette affaire ne souligne pas seulement l’immoralité profonde de la consanguinité d’un certain monde politique et des milieux d’affaires, mais elle révèle surtout le caractère délétère de ces arrangements éminemment préjudiciables à l’intérêt général et au rapport des citoyens à l’État. Ainsi, une telle affaire porte directement préjudice, aux yeux de nombre de nos concitoyens, à la légitimité des institutions de la République et son dernier rebondissement n’aurait pu mieux tomber pour tous ceux qui n’ont pas voulu croire que le pouvoir actuel, et en premier lieu le président de la République lui-même, entretient un rapport incestueux avec le milieu des affaires. Le dénouement de l’affaire Tapie grâce à l’existence d’un tribunal arbitral et à ses décisions invraisemblablement favorables au couple Tapie, résulte d’un enchaînement très construit de dysfonctionnements, d’irrégularités, du viol de la loi. Sur le fond, en vertu de l’article 2060 du Code civil : « on ne peut compromettre… sur les contestations intéressant les collectivités territoriales ». L’EPFR ne pouvait donc en aucun cas être autorisé à recourir à l’arbitrage. Il est à souligner que cela ne relève pas seulement de l’article 2060 du Code civil ci-dessus cité, mais également de l’article L. 311-6 du Code de la justice administrative.
C’est donc délibérément que des règles élémentaires de droit ont été violées. Mais avoir recours illégalement à un tribunal arbitral ne suffisait pas. Cet acharnement ne peut s’expliquer en dehors de ce qu’il est possible d’apprécier comme le but fixé a priori : déboucher sur une sentence arbitrale avantageant outrageusement le couple Tapie. Ce résultat a été atteint par le viol des règles de prudence, viol des usages (par exemple quant à la constitution du tribunal arbitral), la prise de décisions extérieures au conseil d’administration du CDR (ainsi que l’avait souligné monsieur Patrick Peugeot pour justifier sa décision de démissionner), le refus du président du CDR de prendre en compte les mises en garde du directeur général de l’APE, le viol de la confidentialité et le non-respect de l’étanchéité de l’information des dossiers Tapie et des actionnaires minoritaires, le refus de débattre de la possibilité de faire appel de la sentence arbitrale, l’introduction de l’intégralité (50 millions d’euros) de la demande d’indemnisation des époux Tapie au titre du préjudice moral par ajout dans le compromis à la seule initiative du président du CDR et en dehors de toute consultation de son conseil d’administration… Cette énumération des anomalies n’est pas exhaustive, mais largement suffisante pour convaincre que le président du CDR devait avoir de puissantes raisons de nuire à ce point à l’intérêt public pour toujours aller dans le sens des intérêts des époux Tapie.
On ne peut que s’interroger sur les motivations du président du CDR. A-t-il agi de sa propre initiative ? Pourquoi ? A-t-il agi sur ordre ?
Il est légitime de s’interroger sur le rôle du gouvernement et sur le fonctionnement du ministère et du cabinet du ministre. Se trouve une nouvelle fois posée la question de « l’irresponsabilité » du cabinet qui répond (de préférence oralement) ou renvoie des notes sans y répondre, à la place du ministre. Pourtant, c’est à de très nombreuses reprises que le ministre a été saisi notamment par le directeur général de l’APE qui lui a fait part de sa position afin de rester dans le cadre de la légalité et protéger l’intérêt public. Rien n’y a fait.
À l’évidence, la décision était déjà prise de passer outre tous les obstacles légaux et juridiques (il est d’ailleurs à noter que, sur les questions litigieuses, c’est délibérément que le Conseil d’État n’a pas été saisi pour rendre un avis !). Si les notes adressées au ministre ont été nombreuses et claires, les réponses ont été rares et n’ont tenu aucun compte des avis argumentés et des recommandations formulées.
Ce n’est guère qu’en fin de parcours qu’une expression ministérielle écrite est formulée (semble-t-il à la demande des fonctionnaires représentant l’État) enjoignant aux représentants de l’État de se prononcer en défaveur d’un recours contre la décision arbitrale, décision de recours qui a finalement, semble-t-il, été rejetée grâce au changement de vote du directeur général de l’APE, à la suite des instructions du cabinet du ministre.
Bien d’autres données pourraient être ajoutées qui renforceraient encore notre suspicion quant à la légalité, la transparence et l’intégrité de l’ensemble du processus, depuis la décision de recourir à un tribunal arbitral jusqu’à la décision calamiteuse pour l’intérêt public que celui-ci a prise à la suite des étranges postures du président du CDR et à la position gouvernementale refusant l’introduction d’un recours contre la décision arbitrale.
Ce scandale n’est que la confirmation d’une consanguinité entre le palais de l’Élysée et les représentants du grand capital. Nicolas Sarkozy a incontestablement renforcé ces connivences et porte, par conséquent, une responsabilité très lourde dans l’aggravation de la défiance de nos concitoyens envers l’État. Dans le cas particulier et compte tenu de la propension anticonstitutionnelle du président de la République à intervenir sur tous les dossiers, en particulier les plus sensibles, il n’est pas imaginable que le ministre de l’Économie ait pris des décisions dans ce dossier en dehors des instructions présidentielles. Une question au moins demeure : quelle a été la contrepartie accordée par Bernard Tapie afin de profiter de cette bienveillance coupable du palais présidentiel ? Tant que la vérité n’aura pas été révélée sur ce point, les spéculations sur les secrets dont monsieur Tapie semble être le porteur ne cesseront d’alimenter une suspicion malsaine pour l’avenir de la démocratie dans notre pays.
Si l’affaire Tapie ressemble encore à l’un de ces « petits arrangements entre amis » auxquels le président de la République nous a habitués depuis son élection, elle laissera cependant un goût particulièrement amer. Comment accepter le versement d'une somme de 45 millions d’euros, au titre du seul « préjudice moral », alors que les victimes de l’amiante, par exemple, attendent toujours une indemnisation digne de ce nom ? Rappelons en effet que pour le décès d’un enfant dans un établissement scolaire, lorsque la responsabilité de l’État ou d’une collectivité locale est engagée, le préjudice moral est indemnisé à hauteur de 30 000 euros et le décès d’un ouvrier « amianté » est indemnisé par 45 000 euros, en moyenne, pour sa veuve. Les sommes en jeu sont profondément choquantes et cette affaire révèle, hélas, qu’il existe dans notre pays ce que l’on est obligé d’appeler une justice de classe. En effet, c’est bien de cela qu’il s’agit de plus en plus ouvertement : le pouvoir actuel mène une politique éhontément au service de la caste des privilégiés et de ceux qui ne doivent leur enrichissement – aussi vertigineux qu’illégitime – qu’au travail sous-payé de l’immense majorité et aux arrangements opaques comme ceux du dossier Tapie.
Il est impératif que toute la lumière soit faite à la fois sur la somme exacte qu'empocheront les époux Tapie et sur le rôle que les pouvoirs publics ont joué dans cette affaire. N’oublions pas qu’il s’agit d’un « enrichissement supplémentaire » de la famille Tapie, selon la formule de Charles de Courson, qui a été directement prélevé sur l’argent des contribuables et qui portera préjudice à l’esprit de la démocratie. Il est indispensable de rouvrir le dossier Tapie, que toute la transparence soit faite et que les différentes juridictions compétentes puissent se saisir du dossier et mener les investigations nécessaires sans entraves afin que toutes les étrangetés du dossier soient éclaircies. De manière générale, il est absolument indispensable que l'utilisation des deniers publics fasse l'objet d'une transparence sans faille. Cette même transparence doit s'appliquer aux entreprises dont l'impact sur la vie économique du pays est évident. L'arsenal législatif doit être renforcé pour qu'une réelle étanchéité entre les milieux d'affaires et le monde politique soit assurée. Il faut remettre l'éthique au cœur des décisions politiques. C'est la condition pour reconstruire la confiance entre les citoyens et l'État. Cette confiance est aujourd'hui bafouée par l'affaire Tapie et les arrangements auxquels elle a donné lieu entre M. Tapie et les milieux politiques dirigeants.
D.– CONTRIBUTION DES COMMISSAIRES DU NOUVEAU CENTRE, MEMBRES DE LA COMMISSION DES FINANCES
Le contentieux qui oppose les intérêts de l'État, héritier du Crédit Lyonnais, et le Groupe Bernard Tapie depuis de nombreuses années, pose essentiellement trois problèmes.
Tout d'abord le problème de la gouvernance par l'État d'une question juridique complexe est soulevé. L'absence de continuité dans le combat juridique pour défendre les intérêts de l'État et des contribuables français a nui à l'efficacité de ses actions.
En second lieu, ce dossier traduit une absence de respect des droits du Parlement quant à l'octroi de la garantie de l'État. En effet, l'État a supporté les conséquences financières de ce contentieux sans que le Parlement ait autorisé la garantie de la totalité des sommes en jeu. De plus, l'information du Parlement a été insuffisante.
Enfin, ce dossier montre le danger, tant pour les finances publiques que pour la protection politique des Ministres, d'avoir eu recours à la procédure d'arbitrage, alors même que l'arbitrage est interdit à l'État et à ses établissements publics administratifs en application de l'article 2060 du Code civil. Le recours à l'arbitrage pour une pseudo société commerciale, le CDR, dont les pertes cumulées approchent les 15 milliards d'euros, constitue un moyen de contournement des droits du Parlement. Une clarification législative s'impose sur ce dernier point.
COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE LA COMMISSION
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 9 heures 30 (compte rendu n° 110) :
– Communication, ouverte à la presse, de M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
Le Président Didier Migaud : Mes chers collègues, notre réunion de rentrée est consacrée à de premières auditions relatives à un dossier qui engage l’État et les finances publiques : il s'agit des procédures qui opposent, depuis treize ans le Crédit Lyonnais – pour simplifier –, le consortium de réalisation, ou CDR, et le groupe Bernard Tapie.
Alors qu'une dizaine de procédures étaient en cours et que certaines étaient très avancées puisque la Cour de cassation a eu l'occasion de rendre un arrêt de cassation partielle en assemblée plénière le 9 octobre 2006, il a été décidé, en octobre 2007, par les deux parties, à savoir l'établissement public de financement et de restructuration, dit EPFR, et le CDR, d'une part, le groupe Bernard Tapie, d'autre part, d'avoir recours à une procédure d'arbitrage confiée à une formation de trois arbitres.
Une sentence arbitrale a été rendue le 11 juillet dernier aux termes de laquelle le groupe Bernard Tapie doit recevoir un certain montant, qui va maintenant nous être précisé, au titre de la plus-value qu'il aurait pu réaliser avec la vente d'Adidas, et 45 millions d’euros au titre du préjudice moral.
Deux réunions du tribunal arbitral doivent encore se tenir, ce mois-ci et en novembre, afin de déterminer notamment le montant des intérêts dus sur ces sommes.
Plusieurs questions se posent quant à la procédure choisie, à ses conséquences et à la suite à donner à la décision arbitrale.
À la demande des représentants du groupe Tapie, l'EPFR et le CDR ont en effet accepté le recours à la procédure d’arbitrage. Celle-ci est-elle fondée en droit ? Était-elle opportune ? Quels ont été les termes de la convention d’arbitrage ? Quelle a été exactement la décision arbitrale ? S’il existait des recours contre cette décision, pourquoi un recours n’a-t-il pas été exercé ? Quelles sommes seront dues au groupe Bernard Tapie ? Que devra payer l’État et à quel moment ? Les questions qui se posent sont nombreuses, et il a semblé normal à la commission des finances, dans son rôle de contrôle de l’action publique, de se saisir du dossier.
Un membre de la commission des finances, Charles de Courson, représente l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR. Il a eu plusieurs fois l’occasion de rendre compte devant notre commission, notamment sous la législature précédente, des positions que lui-même pouvait exprimer dans le cadre des procédures en cours. Il était donc légitime que nous puissions l’entendre en premier, en particulier en ce qui concerne la façon dont lui-même a pu prendre connaissance des divers éléments d’information et les positions – à partir du moment où il engageait l’Assemblée nationale – qu'il a prises aux différentes étapes de cette affaire.
Je souhaite que nos travaux puissent contribuer à l’information de tous. À chacun de nous et, au-delà, à chaque citoyen, de se forger une opinion. Tout ce qui a pu être dit et écrit doit être vérifié, car il convient d’être le plus rigoureux possible dans l’analyse des faits.
D’autres auditions sont prévues, à commencer, aujourd'hui, par celles des anciens et actuels présidents de l’EPFR et du CDR. La semaine prochaine, nous entendrons Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, et Bernard Tapie, auditions qui seront vraisemblablement précédées par celle de M. Thomas Clay, doyen de la faculté de droit de Versailles et spécialiste du droit d'arbitrage. Nous apprécierons alors si d’autres auditions sont utiles.
Nous sommes convenus que tous nos travaux seraient ouverts à la presse. Nous travaillons en toute transparence, ainsi que le souhait en a été exprimé collégialement.
M. Charles de Courson : Monsieur le président, mes chers collègues, la présente communication, qui répond à une demande formulée par le bureau de la commission des finances, à l'initiative de son président et de son rapporteur général, le 18 juillet dernier, s'inscrit dans le cadre des comptes rendus annuels de mandat d'administrateur dressés par le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, qui est responsable de la surveillance du consortium de réalisation – CDR –, structure de cantonnement et de défaisance chargée de la gestion du passif du Crédit Lyonnais. L'EPFR gère ainsi le soutien financier apporté par l'État au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de ses actifs et veille au respect des intérêts financiers de l'État en la matière. Cette communication constitue une première contribution, en vue de l'audition par la commission des finances des différents acteurs de cette affaire. Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR exerce en effet son mandat depuis 2002, après avoir déjà assumé un premier mandat d'administrateur entre 1995 et 1997.
Dans le temps qui m’a été imparti, je traiterai de trois questions : fallait-il recourir à l'arbitrage ? Devait-on engager un recours en annulation ? En l’absence de recours, quelles suites peut-on donner à l'affaire ?
S’agissant de la première question, quelle était la situation juridique à la veille de l’arbitrage ?
Les parties en présence étaient l'EPFR et le CDR, d’une part, le groupe Bernard Tapie, d’autre part.
Le consortium de réalisation était à l'origine une société par actions
simplifiée dont l'actionnaire était le Crédit Lyonnais jusqu'en novembre 1998, date à laquelle le CDR a été transformé en société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Le CDR désigne en réalité un groupe de sociétés organisées autour d'une holding, CDR SA, et de plusieurs filiales, dont CDR Participations, anciennement Clinvest, filiale d'investissement du Crédit Lyonnais, et CDR Créances, constitué à partir de la société de banque occidentale, la fameuse SDBO, elle-même filiale du Crédit Lyonnais. C'est le CDR Créances, société anonyme, qui est en l'occurrence la personne morale qui este en justice dans l'affaire Adidas.
En novembre 1998, les titres du CDR sont cédés à l'établissement public de financement et de restructuration, établissement public administratif – EPA – qui a, aux termes de la loi du 28 novembre 1995 qui le crée, pour mission de « gérer le soutien financier apporté par l'État au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de certains de ses actifs » au sein du CDR. Cette loi valide en fait le protocole d'accord signé entre l'État et le Crédit Lyonnais le 5 avril 1995, qui a été approuvé sous conditions par la Commission européenne dans sa décision du 26 juillet 1995. L'établissement est également chargé de veiller « à ce que soient respectés les intérêts financiers de l'État dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais ».
Le conseil d'administration de l'EPFR est composé de cinq membres, dont trois hauts fonctionnaires – l’un représentant la Direction du Trésor, l’autre la Direction du budget, le troisième étant le président, traditionnellement un inspecteur général des finances, nommé en conseil des ministres – et deux parlementaires, votre serviteur, représentant l'Assemblée nationale et Roland du Luart le Sénat.
Le groupe Bernard Tapie, ainsi appelé par facilité de langage, est en fait possédé directement et personnellement par les époux Tapie, et est constitué, pour simplifier, de deux pôles principaux :
D’une part, un pôle patrimonial, avec une holding de tête, la SNC « Financière Immobilière Bernard Tapie » – SNC FIBT –, dont fait par exemple partie la société Alain Colas Tahiti – ACT –, qui gère le Phocéa ;
D’autre part, un pôle industriel, avec pour holding de tête la société en nom collectif « Groupe Bernard Tapie » – SNC GBT –, elle-même propriété à 100 % des époux Tapie, et actionnaire de la société anonyme « Bernard Tapie Finance » – SA BTF –, devenue par la suite la compagnie européenne de distribution et de pesage « CEDP ». C'est BTF qui est devenue l'associée majoritaire de la SARL BTF GmbH ADIDAS.
Le groupe compte également en son sein la SA Bernard Tapie Gestion – SA BTG –, propriété directe des époux Tapie.
Il convient à ce moment de rappeler l’historique de l'affaire.
En juillet 1990, Bernard Tapie a acheté 80 % du capital d'Adidas pour le prix de 243,9 millions d'euros, soit 1,6 milliard de francs. Cette opération a été financée en totalité par un prêt consenti par un pool bancaire, dont 30 % par la société de banque occidentale, SDBO, filiale à l'époque du Crédit Lyonnais. Les prêts consentis pour cette acquisition, à court terme, étaient remboursables en deux échéances, à hauteur de 91,5 millions d'euros, soit 600 millions de francs, en 1991 et de 152,4 millions d'euros, c'est-à-dire un milliard de francs, en 1992.
Dès le départ se posait donc la question du remboursement de la somme de 1,6 milliard de francs, puisque le groupe n’était pas capable en tant que tel de payer une telle somme.
En janvier 1991, la société anonyme « Bernard Tapie Finance » acquiert une participation complémentaire de 15 % dans le capital d'Adidas, pour un montant de 10,2 millions d'euros, grâce au concours bancaire d'une banque allemande, Hypobank.
Ayant fait face à la première échéance grâce à l'intervention de partenaires qui ont pris une participation minoritaire de 45 % dans BTF, la société n'a néanmoins pu honorer totalement la seconde échéance.
Élu entre-temps député des Bouches-du-Rhône en mars 1988, Bernard Tapie est nommé à deux reprises ministre de la ville par décret du 16 avril 1992, puis par décret du 26 décembre 1992 – Pierre Bérégovoy étant à l'époque Premier ministre, et François Mitterrand Président de la République. Il entreprend alors de vendre sa participation dans Adidas, incompatible avec ses fonctions ministérielles.
Après avoir cédé, le 13 août 1991, 20 % d'Adidas à la société britannique Pentland, il convient, en juillet 1992, de vendre le reste de ses titres à ce même groupe, qui renonce toutefois en octobre 1992 au motif que l'audit auquel il avait été procédé avait révélé la mauvaise santé financière d'Adidas. La société Bernard Tapie Finance rachète alors la participation de 20 % de Pentland avec l'aide financière du Crédit Lyonnais, la totalité de la société étant alors valorisée à hauteur de 423,8 millions d'euros, soit 2,78 milliards de francs.
Il est peut-être utile de préciser qu’au même moment, la livre sterling a dévalué. Pentland, qui avait prévu une couverture de change, s’est ainsi retrouvée avec une plus-value de change de l’ordre de 150 ou 200 millions d’euros. Il y avait donc probablement un intérêt financier pour la société britannique à renoncer à l’achat, du fait du profit à réaliser sur sa couverture de change.
À la suite de l'échec de la vente d'Adidas à Pentland, et malgré la cession de certaines de ses participations, dont celle dans TF1, la société Bernard Tapie Finance demeure dans l'incapacité d'honorer la seconde échéance, le solde restant dû s'élevant à 91,5 millions d'euros, soit 600 millions de francs. Un mémorandum est alors signé le 12 décembre 1992, par le groupe Bernard Tapie et la SDBO, en vue de la vente d'Adidas par l'intermédiaire de cette dernière, qui a ainsi repris la totalité des engagements financiers du pool bancaire. Le Crédit Lyonnais se substitue donc à tous les autres banquiers alors qu’un principe ancien en matière bancaire veut que l’on partage le risque. Le produit de la vente doit pour sa part être affecté au remboursement des dettes de BTF et du groupe Tapie.
Le 18 décembre 1992, un mandat irrévocable d'intérêt commun à titre onéreux vient confier à la SDBO la vente de 78 % du capital d'Adidas détenu par BTF, au prix de 317,86 millions d'euros, c'est-à-dire 2,085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, soit un montant quasiment similaire à celui qui a été offert à Pentland, ce qui est assez logique. Le mémorandum prévoyait notamment la fusion des sociétés BTF SA, GBT et FIBT en une entité unique, afin de pouvoir affecter la plus-value dégagée par la société Bernard Tapie Finance – BTF SA – pour la cession d'Adidas au désendettement des autres sociétés du groupe. Cette fusion n'a en réalité jamais pu intervenir en raison de l'opposition manifestée par les actionnaires minoritaires des sociétés concernées, qui ont à juste titre soutenu qu'un délit d'abus de biens sociaux aurait résulté de la couverture des dettes d'un pôle par l'autre. La SDBO disposait donc de deux mois pour conclure la vente de la société, dont la situation se détériorait.
Le 12 février 1993, la vente intervient, au prix convenu, auprès de huit acquéreurs, parmi lesquels la société Clinvest, filiale du Crédit Lyonnais, qui était déjà titulaire de 10 % du capital d'Adidas et en acquiert, dans cette opération, 9,9 % supplémentaires, mais également la société Rice SA constituée par Robert Louis-Dreyfus, qui prend une part de 15 %. Certains acquéreurs ont bénéficié d'un prêt spécifique dit à « recours limité » accordé par le Crédit Lyonnais et prévoyant notamment qu'en cas de revente, la plus-value serait partagée à raison, grosso modo, d'un tiers pour l'emprunteur et de deux tiers pour la banque. En revanche, en cas d'échec de la cession des parts à un prix égal ou supérieur au principal du prêt à l'échéance de ce dernier, le Crédit Lyonnais prenait à sa charge la totalité du risque.
Robert Louis-Dreyfus bénéficie dans le même temps d'une option d'achat de la totalité du capital d'Adidas au prix de 708,9 millions d'euros, soit 4,65 milliards de francs, valable jusqu'au 31 décembre 1994. Le rachat sera finalisé le 22 décembre 1994.
Ainsi, entre l'échec de la vente d'Adidas à la société Pentland en octobre 1992 et la cession réalisée le 12 février 1993 pour 78 % du capital, la société Adidas est passée d'une valorisation totale de 423,8 millions d'euros, soit 2,78 milliards de francs, à 407,5 millions d'euros, soit 2,673 milliards de francs : la valorisation de la société entre 1992 et 1993 ne varie donc que légèrement.
En résumé, le Crédit Lyonnais assumait, dans cette opération, la totalité du risque en cas d'échec et bénéficiait des deux tiers du profit en cas de succès, situation qu’en particulier les anciens banquiers présents au sein de la commission ne pourront que trouver extraordinaire.
Le 13 mars 1994, un protocole d'accord a été signé entre la SDBO, le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie, mettant fin aux relations bancaires des parties et soldant les comptes du groupe Tapie. Le protocole d'accord est assorti d'une condition suspensive, à savoir la production dans un certain délai d'expertises sur le mobilier et les objets d'arts de M. et Mme Tapie. Le 23 novembre 1994, la justice a prononcé la caducité de ce protocole en raison de la non levée de condition suspensive, ce qui a conduit à rendre dès lors exigibles les prêts accordés au groupe Tapie. Par conséquent, le 30 novembre 1994, l'ensemble des sociétés du groupe Bernard Tapie a été placé en redressement judiciaire et a été progressivement mis en liquidation.
À partir de cette date, commence le combat judiciaire.
C'est ainsi que plusieurs décisions de justice sont rendues avant que la Cour d'appel de Paris ne rende plusieurs arrêts : le 23 janvier 1998, le 19 février 1999 – dans lequel elle confirme la caducité du protocole d'accord du 13 mars 1994 pour non levée de la condition suspensive –, le 28 juin 2002, et, enfin, le 30 septembre 2005.
Les arrêts successifs de la Cour d'appel ont d'abord confirmé le sursis à statuer opposé par le tribunal de commerce, mais ont annulé la provision de 91,5 millions d'euros, soit 600 millions de francs, que ce dernier avait accordée. La Cour d'appel a en revanche accordé une nouvelle provision de 6,1 millions d'euros, soit 40 millions de francs, dans l'affaire Alain Colas Tahiti, avant de lever le sursis uniquement sur l'opération de la vente d'Adidas.
À la demande des mandataires liquidateurs, une médiation confiée à Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation, est alors ordonnée par la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 12 novembre 2004. Le principe du recours à une médiation avait été autorisé par la conclusion d'un protocole d'accord auquel le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration s'était d'ailleurs montré défavorable – j’ai toujours demandé à ce qu’on laisse la justice agir.
La médiation se soldera, au bout de cinq mois, par un échec, en raison du refus opposé par Bernard Tapie aux propositions du médiateur, ces dernières le laissant en effet en situation de débiteur net.
Enfin, par un arrêt rendu le 30 septembre 2005, la Cour d'appel de Paris a jugé que la SDBO et le Crédit Lyonnais avaient failli à leurs obligations de mandataires en se portant acquéreurs par personnes interposées des participations qu'ils étaient chargés de vendre, ainsi qu'en manquant de loyauté envers le mandant qu'ils n'avaient pas informé par écrit des négociations en cours avec Robert Louis-Dreyfus et auquel ils n'avaient pas proposé les prêts à recours limité octroyés aux cessionnaires.
La cour a également jugé que cette dernière faute avait fait perdre au groupe Tapie une chance de réaliser le gain dont il aurait bénéficié si, ayant obtenu le financement adéquat, il avait pu vendre directement les participations d'Adidas à Robert Louis-Dreyfus en décembre 1994. Elle a en conséquence condamné le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros, égale au tiers de la différence existant entre le prix qui aurait pu être obtenu en décembre 1994 et celui perçu en février 1993. Cet arrêt a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses critiques,...
M. François Goulard : Surtout compte tenu des circonstances !
M. Charles de Courson : ...au motif qu'il reconnaît implicitement un « droit au prêt »...
M. François Goulard : Alors que personne ne lui aurait prêté !
M. Charles de Courson : ...que la jurisprudence s'est en réalité toujours interdite de reconnaître.
Pour bénéficier de la plus-value, encore aurait-il fallu trouver le financement. Or aucune banque en effet ne voulait prêter au groupe.
Après de longs débats, le conseil d’administration de l’EPFR a fini par décider d’aller en cassation. C'est ainsi que, réunie en assemblée plénière – précision importante sur le plan juridique – le 9 octobre 2006, la Cour de cassation confirme tout d'abord la recevabilité de l'action engagée par les mandataires liquidateurs.
Elle juge, en revanche, que la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais ne peut être engagée au titre de manquements dans l'exécution d'un mandat dont elle n'était pas partie – ce qui revient à dénoncer, en quelque sorte, une erreur de personne dans le jugement de la cour d’appel – tout en réservant le sort d'une action menée sur le terrain délictuel.
Enfin, sur le terrain du manquement à la loyauté qu'avait établi la cour d'appel, estimant que la banque s'était abstenue de proposer au groupe Tapie des financements qu'elle avait octroyés à certains cessionnaires des participations litigieuses, la Cour de cassation juge que « le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire ».
L’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris, bien entendu devant une autre chambre, pouvait-on légalement recourir à l'arbitrage ? Un tel recours m’apparaît d'une légalité très douteuse.
L'ensemble des contentieux liés aux affaires opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais concerne des personnes physiques – les époux Tapie – et des personnes morales de droit privé – les mandataires liquidateurs des sociétés du groupe Bernard Tapie, le Crédit Lyonnais, les sociétés anonymes Consortium de réalisation et CDR Créances. Dès lors, le recours à la procédure d'arbitrage ne semble a priori pas poser de difficulté. L'arbitrage est d'ailleurs le mode de résolution principal, sinon exclusif, des litiges du commerce international et est de plus en plus utilisé en droit interne pour les conflits liés aux relations contractuelles professionnelles.
Il est toutefois légitime de s'interroger plus avant sur les possibilités d'un recours à l'arbitrage pour une structure, le CDR, qui est certes constituée sous la forme d'une société anonyme, mais dont la surveillance et la gestion financière relèvent directement d'un établissement public administratif – l'EPFR. Or, le recours à l'arbitrage a toujours été exclu par principe pour les personnes publiques, ainsi que le précise très nettement, et en des termes particulièrement larges, l'article 2060 du code civil, qui dispose qu'« on ne peut compromettre [...] sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public ». Le Conseil d'État a érigé cette interdiction en principe général du droit dans son avis du 6 mars 1986.
Les seules dérogations qui ont été apportées à cette règle concernent à ce jour les différends des personnes publiques relatifs à la liquidation de leurs dépenses de travaux publics et de fournitures, les litiges nés autour des contrats conclus pour la réalisation d'opérations d'intérêt national entre plusieurs personnes publiques et une entreprise étrangère ou l'obtention par l'État du retour d'un bien culturel.
Par ailleurs, la loi a ponctuellement ouvert la possibilité du recours à l'arbitrage à certains établissements publics industriels et commerciaux – EPIC – ainsi qu'à certains établissements publics à caractère scientifique et technologique. Enfin, il est admis par la jurisprudence qu'une personne publique peut compromettre lorsque des intérêts du commerce international sont en jeu.
Le recours à l'arbitrage des personnes publiques demeure en tout état de cause l'exception. Dès lors, on peut s'interroger sur la légitimité du choix du recours à la procédure d'arbitrage dans le cadre d'un contentieux dont on ne saurait évidemment nier qu'il engage l'État et les finances publiques. À cet égard, on rappellera que la loi du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'État dans les plans de redressement du Crédit Lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, qui porte création de l'établissement public de financement et de restructuration, n'a pas prévu de possibilité dérogatoire pour l'établissement de recourir à l'arbitrage. Si l'article 5 du décret du 22 décembre 1995 portant statuts de l'établissement public de financement et de restructuration indique que les décisions du conseil d'administration de l'EPFR relatives aux « transactions » sont soumises à l'approbation préalable du ministère chargé de l'économie, on ne peut toutefois en conclure que la faculté de recourir à l'arbitrage serait ainsi couverte par cette disposition.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision 2004-506 du 2 décembre 2004, que le principe de l'interdiction pour une personne publique de conclure un compromis d'arbitrage « a valeur législative ». Le recours à l'arbitrage doit donc être prévu par la loi, et l'article L.311-6 du code de justice administrative énumère d'ailleurs de façon limitative les conditions dérogatoires de recours à l'arbitrage pour les personnes publiques.
Cette faculté a, par exemple, été expressément reconnue à Réseau ferré de France – RFF –, tandis que l'article 7 de la loi du 9 juillet 1975 portant dispositions diverses relatives à la réforme de la procédure civile dispose que «des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre ». Un décret est ainsi venu autoriser Charbonnages de France, mais aussi EDF et GDF à recourir à l'arbitrage. Toutefois, l'établissement public de financement et de restructuration est un établissement public administratif – EPA – qui n'est donc pas concerné par la faculté de compromettre offerte à certains établissements publics industriels et commerciaux : seule une loi spéciale aurait pu lui ouvrir la faculté de recourir à l'arbitrage.
Même dans l'hypothèse d’une lecture de l'article 2060 du code de procédure civile selon laquelle le recours à l'arbitrage n'était pas en lui-même illégal, il n'en demeure pas moins que l'on peut s'interroger sur sa pertinence.
Le Président Didier Migaud : Une explication s’impose : d’un côté, vous estimez que le recours à l’arbitrage est d'une légalité très douteuse car il aurait fallu l’autorisation de la loi, mais, de l’autre, vous dites que ce recours ne serait pas en lui-même illégal si l’on s’en tient à une lecture stricte de l'article 2060 du code de procédure civile. Il faut distinguer la légalité de l’opportunité.
M. Nicolas Perruchot : Sans pour autant juger.
Le Président Didier Migaud : J’aurai en effet l’occasion de le rappeler : la commission des Finances n'est pas un tribunal.
M. Charles de Courson : Il faut bien comprendre que l'EPFR, établissement public administratif organe de surveillance du CDR, n'aurait pas pu compromettre directement : l'arbitrage a donc été autorisé par un établissement qui n'aurait pas pu y avoir lui-même recours.
En toute hypothèse, ce sont bien sûr les intérêts de l'État que porte, par personne morale interposée, l'arbitrage litigieux. Le CDR est propriété à 100 % de l’EPFR, lequel est un établissement public administratif. La procédure suivie m’apparaît dans ces conditions comme un détournement du principe de l’interdiction par la loi du recours à l’arbitrage.
Enfin, outre les doutes qui peuvent être émis quant à la possibilité même de recourir à un arbitrage dans ce cadre précis, on ne peut que s'étonner du caractère confidentiel d'une telle procédure, qui concerne des actes privés engageant les deniers publics. Or, avec l'adoption d'une clause de confidentialité, ces actes, qui engagent les finances publiques, sont appelés à échapper à tout contrôle, en particulier à celui émanant de la représentation nationale. Cette situation est clairement contraire à la lettre et à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose, dans son article 15, que « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Les problèmes de communication des informations relatives à la procédure d'arbitrage auxquels le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR s'est heurté pour la préparation du présent document, sont révélateurs de l'interdiction de tout contrôle que toute clause de confidentialité suppose.
Le président la commission des finances a adressé, à la fin du mois de juillet dernier, un courrier aux présidents du CDR et de l'établissement public, afin d'obtenir communication du compromis d'arbitrage. Ce n'est qu'à la veille de la présentation de la présente communication – c'est-à-dire hier après-midi – que le compromis a été transmis au président de la commission ainsi qu'à son rapporteur général. Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR s'est vu, au nom de la clause de confidentialité qui encadre la procédure d'arbitrage, refuser la communication de ce document. Il a néanmoins pu, en tant que membre du conseil d'administration de l'établissement public, consulter sur place, la veille de la présentation de cette communication, une copie de la convention d'arbitrage, l'original demeurant conservé dans un coffre. Il se doit d'ailleurs de souligner que cette copie, d'assez mauvaise qualité, ne permettait malheureusement pas de décrypter les données chiffrées figurant dans les tableaux annexés au compromis.
M. Jean-Pierre Brard : Incroyable !
M. François Goulard : Cela relève du pénal !
M. Charles de Courson : Le fait que les tenants et les aboutissants de la procédure d'arbitrage échappent ainsi au contrôle de la représentation nationale est un élément qui devrait suffire à lui seul pour prouver le caractère illégal du recours à l'arbitrage. Seule une disposition législative expresse, soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, aurait pu permettre d'y recourir. Soulignons en outre que le principe du contrôle de la bonne utilisation des deniers publics a un caractère constitutionnel. En l'espèce, ni la représentation nationale, ni le juge constitutionnel ne peuvent malheureusement veiller au respect de ce principe fondamental.
On le voit, le recours à l'arbitrage dans ce cas précis est clairement contraire aux droits constitutionnels du Parlement en matière de contrôle de la dépense publique.
Le Président Didier Migaud : Si nous avons pu avoir connaissance de la sentence arbitrale d’une manière quelque peu particulière puisqu’il a suffi de se reporter au site Internet d’un hebdomadaire – celui de L’Express en l’occurrence –, il était important pour notre information d’avoir également connaissance de la convention d’arbitrage. Or celle-ci étant soumise à une règle de confidentialité, un membre du conseil d’administration de l’EPFR pouvait la lire, mais non en disposer.
Le secret n’étant cependant opposable ni au président de la commission des finances ni au rapporteur général, M. Jean-François Rocchi, président du consortium de réalisation, nous a remis à tous deux hier, à ma demande, un exemplaire de cette convention d’arbitrage, non sans avoir rappelé que celle-ci était soumise à la règle de confidentialité. Contacté par mes soins, Bernard Tapie m’a alors indiqué souhaiter que tous les documents soient portés à la connaissance de la représentation parlementaire. Dans un courrier, son conseil a en effet précisé qu’« en ma qualité de conseil des mandataires liquidateurs des sociétés du groupe Bernard Tapie et de M. et Mme Tapie, je vous confirme que mes clients lèvent la confidentialité relative à la sentence, au compromis d’arbitrage et, plus généralement, à tout document préparatoire, pièces produites et mémoires que le CDR, ses représentants ou nous-mêmes souhaiteraient porter à votre connaissance. »
Après en avoir informé M. Rocchi, ce dernier m’a indiqué qu’à partir du moment où l’autre partie acceptait de lever la clause de confidentialité, lui-même en était d’accord, et nous sommes convenus avec Gilles Carrez que la convention serait à la disposition de la Commission ce matin.
M. Charles de Courson : Pour en revenir au recours à l’arbitrage, examinons d’abord les arguments en sa faveur.
Créé en avril 1995, le consortium de réalisation, chargé du cantonnement d'une partie des actifs du Crédit Lyonnais, a fermé ses portes le 29 décembre 2006, la gestion des ultimes dossiers en cours étant assumée à partir du 1er janvier 2007 par la Caisse des dépôts et consignations – CDC. La structure juridique du CDR a été conservée, dans la mesure où le consortium est partie à des contentieux qui sont toujours en cours, mais ses activités sur le plan opérationnel ont cessé. Dès lors, se posait la question de la poursuite, en particulier de la relance de la procédure judiciaire autour de l'affaire Tapie, alors même que le CDR n'avait pratiquement plus de services propres.
Deux arguments pouvaient alors militer en faveur de l'arbitrage.
Le premier tenait au fait que treize années de combat judiciaire n'avaient pas permis de trouver de solution définitive, la procédure contentieuse dans l'affaire Tapie remontant à 1995. La longueur jugée excessive de cette procédure explique ainsi l'acceptation par l'État du recours à l'arbitrage pour clore le contentieux. L'arbitrage présente en effet des avantages certains, en raison de sa souplesse, par opposition à la longueur et la lourdeur des procédures de type juridictionnel. En l'occurrence, le compromis d'arbitrage sur lequel s'accorderont les parties le 30 janvier 2008 prévoit que le tribunal arbitral rendra sa sentence « dans un délai de huit semaines à compter du second jour de l'audience des plaidoiries », ce dernier ayant été fixé au 5 juin 2008. La sentence arbitrale devait donc être rendue au plus tard le 31 juillet 2008. La procédure d'arbitrage, ici fixée à six mois, se révèle donc bien plus rapide qu'une instance judiciaire.
Le second argument était que le recours à l'arbitrage présentait l'avantage de régler définitivement l'ensemble des conflits opposant les mandataires liquidateurs et les époux Tapie au CDR et au Crédit Lyonnais. En effet, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2006 renvoie l'affaire en cour d'appel, ce qui revient à relancer la procédure judiciaire. La Cour a tranché par cet arrêt la seule question de la responsabilité contractuelle du Crédit Lyonnais, ce qui signifie qu'un engagement de la responsabilité civile délictuelle de la banque demeurait envisageable.
Surtout, le litige opposant le CDR aux mandataires liquidateurs et aux époux Tapie concerne en réalité une douzaine de procédures : le recours à l'arbitrage, qui permet de couvrir neuf de ces procédures, propose une issue à l'ensemble de ces contentieux. Ainsi, le compromis d'arbitrage signé le 30 janvier 2008 prévoit, d'une part, que chacune des parties renonce irrévocablement au maintien des instances pendantes ainsi qu'à introduire toute nouvelle action autour des faits litigieux, d'autre part, que les parties renoncent à faire appel de la sentence qui sera prononcée par le tribunal. L'arbitrage rend ainsi possible le règlement définitif d'un conflit qui a duré plus de treize ans.
Hors recours à l'arbitrage ou relance du combat judiciaire, la seule voie qui s'ouvrait aux parties pour le règlement du litige aurait été la médiation : or, une telle procédure, initiée à la fin de l'année 2004, s'est soldée, comme il a été indiqué, par un échec à la mi-2005, du fait du refus opposé aux propositions du médiateur Burgelin par les mandataires liquidateurs et les époux Tapie.
Outre la question évoquée précédemment de la légitimité du recours à une procédure d'arbitrage dans le cadre d'un conflit auquel l'État est en réalité partie, plusieurs arguments pouvaient être avancés à l’encontre du recours à une telle procédure.
En premier lieu, il convient de souligner que si l'article 1450 du code de procédure civile dispose que « les parties ont la faculté de compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une autre juridiction », le recours à cette procédure intervient généralement en amont du litige, pour éviter que celui-ci ne soit porté devant les instances juridictionnelles. L'arbitrage n'intervient que rarement à un stade de la procédure où de nombreuses décisions de justice ont été rendues. Il est ainsi tout à fait exceptionnel de recourir à l'arbitrage après cassation et renvoi devant une cour d'appel. Il semblerait même que ce soit un cas unique.
Surtout, il est parfaitement incompréhensible d'avoir recours, comme ici, à un arbitrage « en droit » et non « en amiable composition » alors que la cour d'appel de renvoi aurait également statué en droit. Pourquoi demander à des arbitres de dire le droit après la Cour de cassation et avant les juges de renvoi ? Il ne saurait y avoir plusieurs droits. On aurait compris que l'on sorte de la procédure pour solliciter une décision en équité, mais ce n'est pas la voie qui a été choisie.
En second lieu, et par voie de conséquence, s'engager dans une telle procédure revenait évidemment à s'exposer au risque du réexamen par l'instance arbitrale de points du litige qui ont déjà été tranchés, et qui sont dès lors revêtus de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral est ainsi susceptible d'être amené à interpréter constamment des décisions de justice passées en force de chose jugée.
En troisième lieu, le choix de l'arbitrage, dans ce cas précis, renfermait un risque politique important : en effet, pour s'engager dans une telle procédure, le CDR était tenu de recueillir l'avis de l'EPFR, qui est chargé de veiller aux intérêts financiers de l'État dans ce domaine, et dont trois des cinq membres sont des représentants de l'État, qui dépendent directement du ministre pour toutes les décisions importantes prises par l'établissement public.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure confidentielle, « transactionnelle », et dans laquelle les parties nomment les juges appelés à se prononcer de façon définitive et irrévocable sur le litige, quelle que soit la position du ministre en charge, elle ne pouvait que donner lieu à interprétation. La confidentialité du compromis d'arbitrage se heurte d'ailleurs frontalement, comme on l'a souligné, aux pouvoirs constitutionnels du Parlement en matière de contrôle des finances publiques.
Enfin, le dernier jugement intervenu dans l'affaire, antérieurement au recours à l'arbitrage, était l'arrêt rendu le 9 octobre 2006 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, en faveur du CDR : en effet, en établissant que la responsabilité contractuelle de la SDBO ne pouvait être engagée, pas plus qu'un manquement à la loyauté de la part de la banque ne pouvait être établi, l'arrêt de la Cour conduisait à annuler la condamnation infligée par la cour d'appel de Paris au CDR Créances et au Crédit Lyonnais, soit au versement de la somme de 135 millions d'euros aux mandataires liquidateurs des sociétés de Bernard Tapie.
Si le raisonnement suivi par la Haute juridiction n'excluait pas une recherche de la responsabilité de la SDBO sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, la portée de son jugement invitait indéniablement l'État à poursuivre la procédure judiciaire engagée auprès des juridictions de droit commun. Il faut d'ailleurs souligner que c'est en assemblée plénière que la Cour de cassation a rendu cet arrêt, marquant ainsi sa volonté de lier la cour d'appel de renvoi à son interprétation juridique : en effet, l'article L.131-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que, s'agissant de ses arrêts rendus en assemblée plénière, « la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette Assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci ».
On ne comprend d'ailleurs pas qu'un plaideur se pourvoie en cassation pour ne pas payer une condamnation de 135 millions d'euros, qu'il ait ensuite gain de cause devant la Cour de cassation et qu'il choisisse ensuite de recourir à l'arbitrage. La victoire devant la Cour de cassation justifiait de poursuivre la procédure. Faut-il d'ailleurs souligner combien il est rare d'obtenir ainsi une cassation prononcée par l'assemblée plénière ?
On ne voit donc pas quel intérêt le CDR pouvait avoir à se dépêcher de mettre un terme au litige, alors même qu'il venait d'éviter la condamnation : le temps de la procédure, certes long, jouait évidemment en sa faveur et à l’encontre de Bernard Tapie. Plus encore, à la différence d'un être humain, l'État a la durée pour lui et n'a donc aucune raison d'accélérer le mouvement procédural quand il n'est pas condamné. Ce n'était pas le cas de son adversaire.
Pour sa part, le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR a fait part de ses plus grandes réserves quant à un éventuel recours à l'arbitrage dans l'affaire opposant le CDR aux mandataires liquidateurs et aux époux Tapie, lorsque cette demande a été soumise au conseil d'administration lors de sa réunion du 10 octobre 2007.
Le conseil d'administration de l'établissement public est composé, je le rappelle, de cinq membres – trois représentants de l'État, un représentant de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat. Au cours de la réunion, les trois administrateurs représentant l'État ont indiqué avoir reçu instruction ministérielle de se prononcer en faveur de la proposition : la majorité était donc d'ores et déjà acquise pour autoriser le CDR à recourir à l'arbitrage. Dès lors, seul un encadrement strict du dispositif pouvait être recherché, ce à quoi s'est employé le représentant de l'Assemblée nationale, qui s'est interrogé sur les possibilités de recours qui seraient ouvertes au CDR à l'issue de l'arbitrage, ainsi que sur les moyens de s'assurer que le tribunal arbitral ne remettrait pas en cause l'autorité de la chose jugée qui est attachée à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006.
Par ailleurs, en 1999, le Crédit Lyonnais avait pris l'engagement de prendre à sa charge à hauteur de 12 millions d'euros au maximum, à titre de dédommagement, les conséquences du litige en cas de condamnation du CDR. Cette somme avait été versée par la banque en 2005, lors de la condamnation prononcée par la Cour d'appel ; elle avait été remboursée en 2006 à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Or, le Crédit Lyonnais, qui s'est dit défavorable à un recours à l'arbitrage et qui n’a donc pas signé la convention d’arbitrage, refuse en conséquence catégoriquement d'honorer cet engagement en cas de condamnation du CDR par le tribunal arbitral.
Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR, qui a participé à la réunion par téléphone, a conditionné son vote en faveur de la proposition d'arbitrage à la prise en charge par le Crédit Lyonnais de la contribution forfaitaire en cas de condamnation du CDR. Étant dans l'obligation de participer à une autre réunion, il a alors quitté celle du conseil d'administration de l'établissement public, avant que le vote sur la proposition de recours à l'arbitrage ne soit intervenu.
Le consentement du Crédit Lyonnais à prendre en charge cette contribution forfaitaire n'est pas intervenu, selon les informations communiquées à ce stade. En revanche, « pour éviter [...] un blocage », les liquidateurs du groupe Tapie ont proposé de constituer au profit du CDR « une franchise de paiement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à [son] encontre par la sentence arbitrale, égale au montant de la contribution que [le CDR] est en droit d'obtenir du Crédit Lyonnais, soit 12 millions d'euros » : cet engagement, homologué par le tribunal de commerce, a reçu l'accord du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, sous réserve que le CDR persiste à chercher en premier rang et par tous les moyens l'accord du Crédit Lyonnais pour cette contribution.
La sentence arbitrale étant rendue, fallait-il engager un recours en annulation ?
Par un compromis d'arbitrage, très favorable au groupe Tapie, en date du 30 janvier 2008, les parties étaient donc convenues de recourir à un arbitrage unique pour résoudre, d'une manière globale et définitive, l'ensemble des litiges qui les opposent.
Le tribunal arbitral est composé de M. Pierre Mazeaud, président honoraire du Conseil constitutionnel, de M. Jean-Denis Bredin, avocat au Barreau de Paris, et de M. Pierre Estoup, premier président honoraire de la cour d'appel de Versailles. Les honoraires ont été fixés à un million d'euros, soit 300 000 euros pour chacun des trois arbitres...
M. François Goulard : Où peut-on s’inscrire ?
M. Charles de Courson : ...et 100 000 euros pour couvrir les frais de fonctionnement du tribunal arbitral.
Conformément à l'article 1453 du code de procédure civile et à la jurisprudence, les parties se sont mises d'accord sur la désignation des trois arbitres. On peut à cet égard s'interroger sur l'indépendance et l'impartialité des arbitres désignés par les parties. Si M. Pierre Mazeaud, ancien président du Conseil constitutionnel aujourd'hui âgé de soixante-dix-neuf ans, est à l'abri d'une contestation de son indépendance, tel n'est pas le cas pour M. Jean-Denis Bredin : âgé de soixante-dix-neuf ans, il fut vice-président du Mouvement des radicaux de gauche – MRG –, parti auquel a également appartenu Bernard Tapie. L'ancien avocat fut d'ailleurs arbitre dans la procédure d'arbitrage qui fut conduite au milieu des années 90 dans l'affaire des frégates de Taïwan. Enfin, M. Pierre Estoup, magistrat de quatre-vingt-un ans, est un spécialiste du droit des affaires, puisqu'il est notamment déjà intervenu par le passé en 1997 dans une procédure d'arbitrage, dans l'un des volets de l'affaire Elf, entre le président gabonais Omar Bongo et André Tarallo.
Le compromis d'arbitrage prévoit que le tribunal arbitral statue « en droit », et non par « amiable composition », ce qui signifie que les arbitres ne peuvent pas statuer en se fondant sur des considérations d'équité ou de pragmatisme, mais sont contraints de se limiter à l'application pure des règles de droit. L'arbitrage sera donc rendu dans le plus strict respect des décisions de justice définitives revêtues de l'autorité de la chose jugée. En l'occurrence, le compromis d'arbitrage précise que sont revêtus de l'autorité de la chose jugée l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005.
En outre, le compromis prévoit que l'arbitrage sera conduit conformément aux articles 1460 et suivant du code de procédure civile. Les procédures en instance sont incluses dans le champ de l'arbitrage, les parties s'engageant à se désister des contentieux en cours.
Le compromis fixe ensuite à 295 millions d'euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1994 le plafond des demandes d'indemnisation de M. Tapie et à 50 millions d'euros celui du préjudice moral.
Le montant de 295 millions d'euros a été fixé à partir de la plus-value de 301,4 millions d'euros dégagée par Robert Louis-Dreyfus, correspondant à la différence entre le prix de rachat d'Adidas à la fin de l'année 1994, pour un montant de 708,9 millions d'euros, et la valorisation d'Adidas au moment de la signature du mémorandum, à hauteur de 407,5 millions d'euros : la Cour de cassation ayant rappelé qu'en aucun cas les parties ne pouvaient se prévaloir de la plus-value réalisée, la demande se situe légèrement en deçà.
Quant au plafond fixé en matière de préjudice moral, les époux Tapie avaient souhaité le fixer à hauteur de 100 millions d'euros lors de précédentes requêtes. Le CDR a fait droit à la demande de fixation du plafond à 50 millions d'euros – somme au demeurant extraordinaire –, ayant considéré qu'un tel plafond ne serait jamais atteint, et que l'indemnisation au titre du préjudice moral n'excéderait pas quelques millions d'euros.
Les parties renoncent à la possibilité de faire appel de la sentence et de lancer toute autre procédure. La sentence du tribunal arbitral aura l'autorité de la chose jugée et sera immédiatement exécutoire.
Dès la convention d’arbitrage, les plafonds sont donc fixés beaucoup trop haut.
M. Jerôme Cahuzac : Les époux Tapie ont beaucoup souffert !
M. Charles de Courson : Concernant la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, le tribunal arbitral commence, dans une première partie, par rappeler les prétentions des parties, puis établit un exposé des faits de l'espèce. Ce n'est qu'ensuite qu'il se prononce sur l'ensemble des questions pendantes dans le cadre du contentieux :
Le tribunal arbitral déclare recevable l'action des mandataires liquidateurs et des époux Tapie, en se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006.
Il juge que la banque a manqué à son obligation de loyauté lors de l'exécution du mandat de vente d'Adidas par la SDBO, « en n’informant pas BTF et GBT de la nature réelle des négociations qu'elle menait avec M. Robert Louis-Dreyfus et du montage qu'elle avait conçu et en ne communiquant pas tous les éléments de la transaction alors que ces informations étaient déterminantes du consentement du vendeur ».
Il juge que la banque a violé l'interdiction de se porter contrepartie dans la vente d'Adidas, « en prenant un intérêt dans l'acquisition des actions qu'elle était chargée de vendre [...] contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1596 du code civil », qui précise que les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre.
En conséquence, le tribunal arbitral condamne le CDR à verser 240 millions d'euros hors intérêts à GBT, accordant ainsi 81 % de la somme demandée par les mandataires liquidateurs, ou environ 80 % de la plus-value réalisée lors de la vente d'Adidas en 1994, alors même que la Cour de cassation avait jugé que les parties n'étaient pas recevables à demander la plus-value résultant de la vente dont ils auraient été privés. Cette somme doit être actualisée au taux légal depuis le 30 novembre 1994 et majorée de l'ensemble des frais de liquidation. Il alloue également aux liquidateurs une indemnité de 45 millions d'euros en réparation du préjudice moral, portant la somme totale à 285 millions d'euros. S'agissant de l'indemnisation au titre du préjudice moral, les arbitres octroient donc 90 % du montant, au demeurant exorbitant, initialement demandé.
Enfin, le tribunal arbitral prévoit qu'un éventuel préjudice fiscal pourrait légitimement être intégré au préjudice matériel, s'il apparaissait un écart entre la fiscalité appliquée à la somme allouée et celle qui aurait été applicable en 1995.
On ne peut d'ailleurs que s'étonner d'un tel dispositif, à l'initiative d'un tribunal arbitral, qui n'est pas l'instance compétente pour définir le statut fiscal des sommes à verser. Il semblerait d'ailleurs que le groupe Tapie ait renoncé au bénéfice de ces dispositions dont l'application relève strictement de la compétence de l'administration fiscale.
S'agissant de la question du soutien abusif que la banque aurait apporté à GBT et de la rupture abusive des relations bancaires entre les parties, le tribunal arbitral a rejeté les deux demandes.
La première, qui relève d'une responsabilité quasi-délictuelle, est subsidiaire de la demande formée en matière de responsabilité contractuelle, cette dernière ayant été reconnue par le tribunal.
La seconde, relative à une rupture abusive, ne peut être examinée par le tribunal, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 1999, qui constate la caducité du protocole signé en 1994 entre les parties.
Enfin, s'agissant du contentieux « Alain Colas Tahiti », le tribunal arbitral a rejeté la demande de diminution de la provision allouée aux liquidateurs par l'arrêt de la Cour d'appel du 19 février 1999, au motif qu'il s'agissait d'une demande nouvelle, non prévue au compromis d'arbitrage.
Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR s'est naturellement interrogé sur les conséquences financières pour l'État et pour les époux Tapie de la condamnation prononcée par le tribunal arbitral, sur son coût total pour les finances publiques, mais également sur le montant du bénéfice final réalisé par les époux Tapie après acquittement de l'ensemble de leurs dettes.
Le tableau suivant récapitule les estimations que l'on peut raisonnablement émettre, en retenant une hypothèse basse et une hypothèse haute :
ESTIMATION DES MONTANTS EN JEU ET DU BÉNÉFICE FINAL RÉALISÉ
PAR LES ÉPOUX TAPIE APRÈS SENTENCE ARBITRALE
(en millions d'euros)
Hypothèse basse |
Hypothèse moyenne |
Hypothèse haute | |
Montant de la condamnation |
240 |
240 |
240 |
Actualisation au taux d'intérêt légal |
+ 95 |
+ 105 |
+ 115 |
Frais de liquidation |
+ 8 |
+ 15 |
+ 21 |
Créances de la SDBO |
– 163 |
– 163 |
– 163 |
Actions ex-BTF déjà attribuées à la SDBO |
+ 76 |
+ 76 |
+ 76 |
Créances privées |
– 30 |
– 20 |
– 10 |
Dettes fiscales |
– 33 |
– 31 |
– 30 |
Contribution acceptée par les liquidateurs |
– 12 |
– 12 |
– 12 |
Sous-total |
181 |
210 |
237 |
Imposition sur les sociétés(1) |
– 60 |
– 36 |
– 40 |
Imposition sur les revenus(2) |
– 60 |
– 87 |
– 98 |
Sous-total après imposition |
61 |
87 |
99 |
Indemnité pour préjudice moral |
+ 45 |
+ 45 |
+ 45 |
Total |
106 |
132 |
144 |
On retient un taux de 33,33 % dans l'hypothèse basse et un taux de 17 % dans l'hypothèse haute. Ce taux, plus vraisemblable, a également été retenu dans l'hypothèse moyenne.
On retient l'application du bouclier fiscal, à hauteur de 50 % des revenus.
D'après les informations fournies par le CDR et l'EPFR, les parties auraient trouvé un accord sur l'application à la somme de 240 millions d'euros du taux d'intérêt légal, à hauteur de 105 millions d'euros. En outre, les mandataires liquidateurs et les époux Tapie auraient renoncé au bénéfice de l'éventuel écart de fiscalité entre 1995 et 2008.
Cette somme de 240 millions d’euros, qui figure à la première ligne, doit être majorée du fait de plusieurs éléments.
Le premier à trait à l’actualisation au taux d’intérêt légal, entre novembre 1994 et aujourd'hui. Le montant s’échelonne entre 95 millions d’euros, hypothèse basse retenue par le CDR, et 115 millions d’euros, hypothèse haute, la différence étant due à l’estimation du loyer que Bernard Tapie aurait dû payer s’il n’avait pas bénéficié de l’avantage procuré par l’occupation à titre gratuit de l’hôtel de Cavoye.
M. François Bayrou : Qui a payé les impôts locaux pendant la période ?
M. Charles de Courson : Je reviendrai sur ce point par la suite.
Le deuxième élément concerne l’ensemble des frais de liquidation engagés dans la procédure : le montant pourrait atteindre au total près de 21 millions d'euros, incluant les 8,4 millions d'euros fixés par le tribunal arbitral à la charge du CDR.
Il convient également de tenir compte des créances déclarées. La ligne correspondante, qui est pratiquement illisible dans la photocopie de l’annexe, établit à cet égard de façon certaine la créance totale de la SDBO à l'égard du groupe Tapie à 163 millions d'euros. De même les actions ex-BTF déjà attribuées à la SDBO par une décision de justice, sont évaluées de façon tout aussi certaine à 76 millions, ce qui explique là encore, que le même chiffre figure dans les trois colonnes.
Les créances privées sont estimées à 10 millions d’euros, mais d’autres créanciers privés pouvant se manifester, elles pourraient s’élever jusqu’à 30 millions d’euros.
M. François Goulard : Les créanciers se sont en principe déjà déclarés.
M. Charles de Courson : Non. Permettez-moi cependant de ne pas développer ce point, dans l’intérêt de l’État.
Pour leur part, les dettes fiscales représenteraient entre 30 et 33 millions d’euros. Quant à la contribution acceptée par les liquidateurs, elle s’élève à un montant forfaitaire de 12 millions d’euros.
Une fois les dettes payées, le sous-total s’établirait donc entre 181 et 237 millions d’euros.
Après acquittement de l'imposition sur les sociétés – en supposant une hypothèse basse d'imposition au taux de droit commun de 33,33 % et une hypothèse haute à hauteur de 17 % si l’on considère qu’il s’agit de plus-values – puis de l'imposition sur les revenus à 50 %, dans l'hypothèse de l'application du bouclier fiscal, la somme restante, hors préjudice moral, pourrait s'établir, sur la base d’un montant de la condamnation de 240 millions d’euros, entre 61 millions d'euros et 99 millions d'euros.
En réintégrant les sommes afférentes au préjudice moral, en principe exonérées de tout impôt et de toute cotisation, le bénéfice final pour les époux Tapie serait compris – car il s’agit d’une estimation – entre 106 millions d'euros et 144 millions d'euros, sommes qui sont considérables.
Pour ce qui est de l’État, ce dernier devra verser au groupe Tapie entre 226 et 282 millions d’euros, sachant que le coût net pour l'État, décalé dans le temps du fait des impôts, dépendra du montant dont bénéficiera en net Bernard Tapie, sans oublier les créances privées estimées entre 10 et 30 millions d’euros.
S'agissant de la créance hypothécaire sur l'hôtel de Cavoye – ou plutôt sur 92 % de l’immeuble puisqu’un appartement n’appartient pas à Bernard Tapie –, estimée entre 25 et 30 millions d'euros, elle tomberait dans l'hypothèse où les époux Tapie rembourseraient la totalité de leurs dettes. Cette somme leur reviendrait alors également.
Après fiscalisation – en ne tenant compte que des impôts d'État, soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, l’impôt de solidarité sur la fortune, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale – le coût net pour l’État serait donc compris entre 136 et 154 millions d’euros.
Il convient bien entendu de manier avec la plus grande prudence ces estimations chiffrées : en effet, si le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR a interrogé le ministère chargé des finances sur la fiscalité applicable en la matière, il n'a à ce jour obtenu aucune réponse officielle à ce sujet. Par ailleurs, les estimations concernant certaines créances demeurent incertaines. Il faudrait d'ailleurs, pour être exact, tenir compte également des frais d'avocat engagés par les époux Tapie, ou des clauses d’intéressement, que je n’ai pas à connaître.
Ces estimations permettent toutefois de supposer que le bénéfice réalisé par les époux Tapie du fait de la condamnation prononcée par le tribunal arbitral, pourrait se révéler bien supérieur aux chiffres avancés dans des déclarations imprudentes.
Fallait-il, enfin, introduire un recours en annulation de la sentence arbitrale, extrêmement favorable, ainsi que j’ai essayé de le montrer, aux époux Tapie ?
La sentence arbitrale a été rendue le 7 juillet 2008, et conformément aux dispositions des articles 1479, alinéa 1er, et 515 du code de procédure civile qui en ouvre la faculté à l'arbitre, l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée.
Afin que la sentence puisse être rendue exécutoire, une ordonnance d'exequatur doit être prononcée : elle peut être requise par l'une des parties, et c'est la signification de cette ordonnance qui ouvre les délais d'appel ou de recours. La requête à fin d'exequatur a été présentée par les mandataires liquidateurs et les époux Tapie quelques jours après le prononcé de la sentence.
Dès lors, dans la mesure où les parties s'étaient engagées à ne pas faire appel de la décision rendue par le tribunal arbitral, et aux termes de l'article 1486 du code de procédure civile, un délai d'un mois était ouvert aux parties à partir de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur pour introduire un éventuel recours en annulation de la sentence.
Après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration de l'EPFR, le CDR a renoncé à former un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008. Le vote en défaveur d'un recours en annulation a été acquis à quatre voix contre une – la mienne – au conseil d'administration de l'établissement public, et à trois voix contre deux – en l’occurrence des personnalités qualifiées – au conseil d'administration du CDR. Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'établissement public a toutefois demandé, lors de sa réunion, communication des notes émanant des différents cabinets d'avocats et juristes spécialisés que le CDR a consultés relativement à la question du recours en annulation : sur les quatre contributions, deux se montraient défavorables à un tel recours, tandis que les deux autres s'y déclaraient favorables.
Plusieurs arguments ont été avancés pour justifier cette décision :
En premier lieu, il a été considéré que l'introduction d'un recours en annulation aurait signifié la poursuite d'un combat judiciaire que la procédure d'arbitrage avait précisément pour objectif de clore de façon définitive. La volonté de mettre fin au litige avait ainsi conduit à la conclusion d'un compromis d'arbitrage dans lequel les parties s'engageaient à ne pas faire appel de la décision rendue. En assimilant ainsi le recours en annulation à un appel, les conseils d'administration des deux structures ont donc considéré qu'un tel recours eût été contraire à la volonté des parties d'en finir avec le combat judiciaire. On rappellera néanmoins qu'un recours en annulation ne constitue précisément pas un appel : c'est au contraire une manière de défendre l'ordre public et des principes essentiels.
En second lieu, un recours en annulation contre la sentence arbitrale devait se fonder sur l'un des six cas prévus par l'article 1484 du code de procédure civile.
Seul un recours fondé sur le non-respect de la mission conférée aux arbitres ou sur la violation d'une règle d'ordre public était envisageable, avec toutefois, des chances de succès très limitées.
En effet, c'est sur le terrain de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée que la sentence arbitrale aurait été susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Or, ce type de grief ne peut être soulevé sur le fondement d'une atteinte à une règle d'ordre public : il a en effet été jugé que « la règle de l'autorité de la chose jugée est d'ordre privé et non d'ordre public en droit interne comme en droit international», selon un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 16 février 1995. La méconnaissance de l'autorité de la chose jugée pouvait donc seulement être soulevée sur le fondement du moyen tiré de la méconnaissance par les arbitres de leur mission, dans la mesure où le compromis d'arbitrage précise que les arbitres respecteront l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions de justice déjà rendues.
Concernant les arguments en faveur d'un recours en annulation, si l'absence de convention ne peut aucunement être invoquée, pas plus qu'une composition irrégulière du tribunal ne peut être soutenue ou la violation par le tribunal arbitral du principe du contradictoire être objectée – encore que le respect du principe a été discuté, au motif que certains acteurs majeurs de l'affaire n'auraient pas été auditionnés, argument qui me paraît fragile –, la lecture de la sentence invite cependant à s'interroger, comme on l'a vu, sur le respect par le tribunal arbitral de l'autorité de la chose jugée. Cette exigence avait d'ailleurs été précisée par le compromis d'arbitrage, à la demande expresse de l'EPFR, qui en avait fait une condition à son avis favorable concernant le recours à l'arbitrage.
En effet, l'article 7-1 du compromis d'arbitrage prévoit que « les parties rappellent que le tribunal arbitral sera tenu par l'autorité de la chose jugée des décisions définitives rendues dans les contentieux, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 et les attendus définitifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005, étant expressément rappelé et précisé que les décisions rendues en première instance, et qui ont fait l'objet d'une procédure d'appel dont les instances sont en sursis à statuer, ne sauraient être considérées comme revêtues d'une quelconque autorité de la chose jugée ».
Le tribunal arbitral a-t-il violé l'autorité de la chose jugée, ce qui signifierait qu'il aurait statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ?
S'agissant du périmètre de la recevabilité à agir des liquidateurs de la société en nom collectif Groupe Bernard Tapie, et par voie de conséquence, s'agissant de l'étendue du préjudice dont ces derniers peuvent se prévaloir, l'interprétation donnée par la sentence arbitrale se révèle très éloignée de la lettre des arrêts respectifs de la cour d'appel et de la Cour de cassation.
Il faut tout d'abord rappeler que si, généralement, les motifs d'une décision de justice ne sont pas par eux-mêmes revêtus de l'autorité de la chose jugée, il n'en va pas de même lorsque ces motifs sont le soutien du dispositif. Au surplus, il faut souligner l'autorité particulière qui s'attache aux arrêts rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation : en effet, l'article L. 131-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que, s'agissant de ses arrêts, « la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette Assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci », c'est-à-dire qu'elle doit se conformer à la doctrine juridique qui y est développée.
Voudrait-on nier au tribunal arbitral la qualité de juge de renvoi pour le dégager du respect de l'autorité de la chose jugée des points de droit jugés par la Cour de cassation ? Le compromis d'arbitrage, dans son article 7-1, précise pourtant expressément que le tribunal se conformera à la décision. Le compromis va même plus loin, puisqu'il reconnaît l'autorité de la chose jugée aux « attendus définitifs » de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, c'est-à-dire aux attendus dont la Cour de cassation a approuvé la justesse et la pertinence.
Or, s'agissant de la recevabilité à agir des liquidateurs, la cour d'appel et la Cour de cassation ont nié la possibilité pour les mandataires liquidateurs de « demander la plus-value résultant de la vente dont ils auraient été privés », limitant leur intérêt à agir à la réparation du préjudice personnel subi. En accordant aux liquidateurs 98 % des plus-values dont le groupe Tapie, dans son ensemble, aurait été privé, la sentence arbitrale s'inscrit clairement en porte-à-faux avec les jugements rendus respectivement par la Cour d'appel et la Cour de cassation.
Cet élément est essentiel, car en refusant aux mandataires liquidateurs de revendiquer pour eux-mêmes un préjudice qu'ils n'avaient pas subi en propre et en cantonnant leur droit à agir dans d'étroites limites, le jugement rendu par la Cour de cassation avait logiquement pour conséquence de limiter le montant de l'indemnisation à laquelle les liquidateurs pouvaient prétendre. A contrario, l'élargissement par le tribunal arbitral de l'intérêt à agir des liquidateurs conduit à leur octroyer une indemnisation maximale, égale à la quasi-totalité de la plus-value qu'aurait pu espérer encaisser sa filiale, si le mandat avait été exécuté dans des conditions différentes.
Le moyen tiré du non-respect de la mission confiée aux arbitres, au motif que les arbitres auraient méconnu l'autorité de la chose jugée, pouvait donc paraître fondé et justifier un recours en annulation contre la sentence arbitrale.
Le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR était pour sa part favorable à un recours en annulation à rencontre de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 en raison, d’abord, de l'illégalité du compromis d'arbitrage. Mais c'est avant tout sur le terrain de la violation par la sentence arbitrale de l'autorité de la chose jugée – essentiellement l’arrêt de la Cour de cassation – qu'il considère que le recours aurait pu être formé.
J’en viens aux suites à donner à l'affaire.
Lors des réunions respectives des conseils d'administration du consortium de réalisation et de l'établissement public de financement et de restructuration le 28 juillet dernier, les deux structures ont renoncé à engager un recours en annulation de la sentence d'arbitrage, à trois voix contre deux pour le CDR et à une voix contre quatre pour l'EPFR, ainsi que je l’ai déjà indiqué. Les représentants de l'État au conseil d'administration de l'établissement public ont en effet reçu instruction du ministre des finances de voter en défaveur d'un recours en annulation de la sentence d'arbitrage rendue le 7 juillet 2008.
Dès lors, plusieurs pistes méritent d'être explorées sur les suites à donner à l'affaire, en particulier l’audition non seulement de l’actuelle ministre chargée de l'économie, Mme Christine Lagarde, mais également son prédécesseur, M. Thierry Breton.
Concernant la création, dont l’éventualité a été soulevée par certains collègues, d'une commission d'enquête sur la procédure d'arbitrage conduite dans le cadre de cette affaire, si rien ne s’y oppose en droit, il serait cependant prudent d’attendre la fin des auditions afin de savoir si une telle création présenterait un intérêt.
Le Président Didier Migaud : Une commission d’enquête ne peut être décidée...
M. Charles de Courson : Avant que le garde des sceaux n’exprime un avis.
Le Président Didier Migaud : En effet.
Et uniquement lorsque l’Assemble siège en session ordinaire. Toute décision en la matière ne saurait donc être prise avant le 1er octobre.
M. Charles de Courson : Reste la formation d'un recours de tierce opposition.
En l'absence d'un recours en annulation formé par le CDR dans un délai d'un mois à partir de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur, seule une voie de recours extraordinaire pourrait en l'état être envisagée. Ainsi, l'article 1481, alinéa 2 du code de procédure civile consacre la possibilité pour des tiers de former un recours de tierce opposition à l'encontre d'une sentence arbitrale qui leur porterait préjudice. Cette voie de recours est ouverte à « toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque », selon les termes de l'article 583 du code de procédure civile. Il semblerait donc possible d'envisager un recours qui serait formé devant la cour d'appel de Paris par des contribuables en leur nom propre ou par une association de contribuables.
Ce recours serait recevable dans la mesure où le tiers aurait à la fois un intérêt à agir et où il pourrait se prévaloir de ne pas avoir été représenté devant le tribunal arbitral. L'examen de sa recevabilité aurait d'ailleurs l'avantage de clarifier les rapports juridiques entre l'établissement public de financement et de restructuration et le consortium de réalisation. En effet, si la cour considérait que la sentence arbitrale a été rendue concernant un litige entre deux entités commerciales, les mandataires liquidateurs du groupe Tapie, d'une part, le CDR, de l'autre, elle serait amenée à reconnaître la recevabilité d'un tel recours en tierce opposition, considérant que les contribuables n'ont pas été représentés à l'instance.
En revanche, si elle estimait que le CDR représente en réalité les intérêts de l'État, un tel recours en tierce opposition se révélerait dès lors irrecevable, dans la mesure où l'on jugerait que les tiers ont été représentés au jugement qu'ils attaquent. Il convient enfin de souligner que « la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement», selon les termes de l'article 586 du code de procédure civile.
À l'aune de ces analyses, le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR considère que le fait même, pour le CDR, de recourir à une procédure d'arbitrage était plus que contestable. Il estime en outre qu'un recours en annulation contre la sentence arbitrale eût été légitime et aurait eu des chances raisonnables d'aboutir. Le recours à une justice privée et la confidentialité que cette procédure implique sont en tout état de cause incompatibles avec l'exercice des droits du Parlement en matière de contrôle de la dépense publique. Il importait dès lors que la commission des Finances se saisisse de cette affaire.
Le président Didier Migaud. Je rappelle que la communication de Charles de Courson, que je remercie, n’engage pas la commission des Finances en tant que telle. Cette première audition, qui sera suivie d’autres, était indispensable puisque Charles de Courson représente l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’EPFR.
Sur un plan strictement juridique, nous n’enquêtons, ni ne jugeons – que les choses soient claires – mais les décisions qui ont été prises engagent l’État. Nous sommes donc réunis en raison de notre rôle d’information, de transparence et de contrôle. Le mémoire de Charles de Courson est une contribution utile en ce qu’il soulève des questions que nous devrons poser à ceux dont l’audition est déjà prévue, et éventuellement à d’autres. Il est vraisemblable que nous serons amenés à entendre la ministre chargée du dossier, qui s’est d’ailleurs exprimée. Comme l’on dit, nous allons avancer en marchant, c'est-à-dire en auditionnant l’ensemble des acteurs de la procédure.
M. Jérôme Cahuzac. Au nom de tous mes collègues, je remercie Charles de Courson qui vient de nous donner un nouvel exemple de son attachement au bien public.
S’agissant du raisonnement juridique, de deux choses l’une : ou bien l’autorisation de recourir à cette procédure particulière fut consentie entre deux parties privées – le CDR et les liquidateurs du groupe Tapie – et le recours devant la cour d’appel de Paris d’une tierce partie, c'est-à-dire un contribuable, est parfaitement recevable puisqu’il n’était représenté ni par les liquidateurs du groupe Tapie, ni par le CDR ; ou bien la décision fut prise par les liquidateurs et par l’EPFR, dont M. de Courson a dit qu’il avait un statut d’établissement public administratif – dès lors, l’EPFR, c’est l’État – et, alors la décision contrevient explicitement à l’article 2060 du code civil. Autrement dit, la ministre, en l’autorisant, commet, me semble-t-il, un excès de pouvoir dont l’appréciation revient au Conseil d’État. La décision est alors susceptible d’un autre type de recours : le recours pour excès de pouvoir. Ce raisonnement est-il valable ? Pouvons-nous donc estimer que l’affaire n’est pas close, contrairement à ce que certains pourraient espérer ?
Tout à l’heure, M. de Courson n’a pas voulu être plus précis à propos des créanciers privés au nom des intérêts de l’État. Je peux comprendre ce souci, mais son rapport étant par ailleurs très complet, vous comprendrez que nous soyons un peu frustrés sur ce point, qu’il juge peut-être secondaire. Si tel était le cas, je m’en tiendrais là.
M. Charles de Courson : S’agissant des créances privées, l’ensemble des procédures n’est pas achevé. Il n’est donc pas exclu que, au-delà des 10 millions existants, d’autres créanciers privés se manifestent. Je n’en dirai pas plus, pour ne pas nuire aux intérêts de l’État.
L’État a créé par la loi un établissement public, l’EPFR. Il est propriétaire de 100 % des actions du CDR qui est une société privée. L’État a tous les pouvoirs, mais « les décisions du conseil d’administration de l’EPFR soumises à l’approbation préalable du ministre chargé de l’économie en vertu de l’article 6 de la loi du 28 novembre 1995 susvisée sont : […] celles relatives aux transactions… ». En tout état de cause, la décision du conseil ne pouvait être mise en œuvre par le CDR qu’avec l’accord du ministre. Quelle forme cette autorisation a-t-elle prise ? Chaque fois – lors de la médiation, de l’arbitrage et de la discussion sur le recours en annulation de la sentence arbitrale – j’ai demandé aux trois représentants de l’État s’ils avaient des instructions ministérielles et, si oui, si elles étaient écrites. Ils m’ont répondu : « oui », y compris sur le recours en annulation. Au moment de prendre des décisions très importantes, certains, d’après ce qu’ils m’ont expliqué, ont fait jouer la clause de conscience. Ils ont fait une note au ministre pour lui faire part de ce qu’ils pensaient être conforme à l’intérêt public, mais en lui indiquant qu’ils attendaient ses instructions. Et ils ont appliqué les instructions ministérielles en bons et fidèles serviteurs de l’État. C’est ce qu’ils m’ont dit, il faut leur demander directement, mais ces échanges figurent dans les procès-verbaux que j’ai et qui sont classifiés pour des raisons évidentes. Cela étant, j’ai toujours dit au conseil d’administration que je n’étais pas engagé par la clause de confidentialité puisque je représente le peuple français et que je suis donc responsable devant la seule Assemblée nationale.
Quand on a discuté de la convention d’arbitrage, sachez que je ne l’ai jamais vue. On nous a dit ce qu’il y avait dedans. Je n’en ai pris connaissance qu’hier, par l’intermédiaire d’une photocopie dont les annexes sont difficilement lisibles. La sentence arbitrale ne nous a pas été communiquée, toujours au nom de la confidentialité. J’ai appelé M. Rocchi, le président du CDR, pour lui en demander copie et – c’est tout de même extraordinaire –il m’a répondu que, pour cette raison précisément, il ne pouvait pas me la donner et que l’État se mettrait en mauvaise position s’il me la transmettait. Il a ajouté dans un sourire qu’elle était depuis deux heures sur le site de L’Express. C’est là que je l’ai lue.
On m’a aussi questionné sur la façon dont l’EPFR allait payer les quelque 300 millions d’euros puisque la décision est exécutoire. Lors du dernier conseil d’administration de l’EPFR, on nous a demandé si nous étions d’accord pour tirer sur une vieille ligne auprès du Crédit Lyonnais – qui date de 1995 et qui n’a jamais été utilisée –, à un taux très bas, avec un plafond de 300 millions puisque le détail de la somme n’est pas encore connu. J’ai répondu : « Ah, non, ça, jamais ! ». J’ai toujours dit à la commission des Finances – et nous sommes nombreux dans ce cas – qu’il fallait mettre le holà à l’endettement des faux nez de l’État. J’ai donc demandé au président de l’EPFR d’écrire au ministre pour demander une dotation exceptionnelle sur une ligne « frais de justice ». On ne va pas s’endetter pour payer Tapie !
M. François Bayrou : Finalement, quelle a été la décision prise ?
M. Charles de Courson : Eh bien, on a décidé de s’endetter ! J’ai été mis en minorité, comme l’explique une note de bas de page du rapport.
Quant à la possibilité d’un recours, pour attaquer, il faut un acte. Probablement la décision ministérielle, mais je ne l’ai pas vue.
M. François Bayrou : Mme Lagarde l’a reconnue dans tous les journaux.
M. Jérôme Cahuzac : La décision est de notoriété publique.
M. Charles de Courson : Je peux témoigner et les procès-verbaux sont à votre disposition. À chaque fois, j’ai posé la question.
M. Jérôme Cahuzac : D’après votre analyse, si recours il devait y avoir, la voie du Conseil d’État apparaît la plus raisonnable.
M. Charles de Courson : Quand bien même vous obtiendriez l’annulation pour excès de pouvoir de l’instruction donnée par le ministre, il faudrait bien en mesurer la portée, d’une part, sur la décision de l’EPFR, d’autre part, sur celle du conseil d’administration du CDR. Il faut examiner très attentivement la question.
Il est aussi possible d’attaquer la décision du conseil d’administration d’EPFR qui est secrète, mais, par mon intermédiaire ou celui de mon collègue du Sénat, on a les procès-verbaux avec le texte de la délibération.
Le président Didier Migaud : Il y a des points de droit qui méritent d’être précisés et des questions qui devront être posées à d’autres interlocuteurs que Charles de Courson.
M. François Goulard : Le rapport de Charles de Courson résume autant qu’il peut l’être un dossier extrêmement complexe. Tout est anormal dans ce dossier, et depuis le début. Ce n’est pas une question politicienne dans la mesure où beaucoup de gouvernements sont concernés. En tout cas, on ne peut pas rester dans l’ignorance de ce qui a motivé autant de décisions qui, aujourd’hui, apparaissent profondément anormales. Nous devons aller jusqu’au bout des investigations. Les procédures juridictionnelles sont une chose, mais le Parlement, la commission des Finances, doivent faire la lumière sur cette affaire avec tous les moyens qui sont les nôtres en session ordinaire. Je plaide pour que nous ne nous limitions pas à quelques auditions, et nous devons savoir ce qui a réellement motivé des décisions qui, au vu des éléments en notre possession, apparaissent profondément injustifiées.
M. Jean-Pierre Brard : Excellent !
Le président Didier Migaud : En tout cas, vous pouvez donner acte à la commission des Finances du travail qu’elle entreprend.
M. Jérôme Chartier : J’aimerais que soit organisée, aussi rapidement que possible, l’audition des avocats du groupe Tapie. Nous allons entendre les responsables d’EPFR, du CDR, après Charles de Courson qui a exposé son point de vue personnel. En ce qui me concerne, je ne connais rien à cette affaire et je voudrais pouvoir me faire mon opinion en entendant toutes les parties. Or, il n’est prévu d’auditionner M. Tapie que la semaine prochaine. Ne pourrait-on le recevoir avant, lui ou ses avocats ? Pour se forger une opinion, il faut connaître sa vision des événements : pourquoi a-t-il entamé une procédure ? Pourquoi estime-t-il avoir été lésé ? Il ne faudrait pas que la commission des Finances de l’Assemblée nationale se fasse un avis tout de suite et choisisse d’emblée la voie de la commission d’enquête. Je voudrais pouvoir comprendre un dossier extrêmement compliqué. La Cour de cassation en formation plénière s’est-elle prononcée sur tout ou partie des neuf procédures ? Nous n’en sommes qu’au début des auditions. Il faudrait pouvoir entendre toutes les parties dès le départ. Monsieur le président, vous nous avez transmis la lettre que vous avez reçue de l’avocat du groupe Tapie qui était accompagnée de plusieurs pièces. Serait-il possible d’en obtenir aussi la copie ?
Le président Didier Migaud : Pour que les choses soient claires, il était tout à fait légitime, dans le cadre de la première audition, d’entendre Charles de Courson qui représente l’Assemblée au conseil d’administration de l’EPFR. Nous entendrons aussi ceux qui ont été désignés par l’État pour régler le dossier. J’ai demandé à Bernard Tapie de venir devant la commission des Finances et il a accepté. Il sera là dès la semaine prochaine. Mais nous n’aurons pas terminé notre travail pour autant. Il est hors de question de dire que tout est terminé après le travail de Charles de Courson.
M. Jérôme Chartier : Monsieur le président, nous avons cinq auditions du CDR aujourd'hui ! Et aucune de l’autre partie !
Le président Didier Migaud : Elle sera entendue la semaine prochaine.
En cette affaire, il ne faut pas se précipiter. Faisons notre travail de façon méthodique. Je ferai en sorte que nous entendions tous les points de vue et je préciserai à M. Tapie qu’il peut venir accompagné de qui il veut. Je n’exclus pas non plus que nous demandions à entendre une nouvelle fois une personne que nous aurons déjà auditionnée, compte tenu de ce qui aura été dit entre-temps. N’ayez crainte. Nous commençons tout juste notre travail par une mise à niveau en matière d’information. Le dossier est complexe, et je n’ai pas voulu m’exprimer car, quand on est en responsabilité, il vaut mieux éviter de parler trop vite. Nous nous forgerons une opinion petit à petit, et, par là même, nous aiderons l’opinion publique à en faire autant. Tel est le sens de notre travail.
M. Jérôme Chartier : C’est précisément pour cette raison qu’il m’aurait semblé préférable d’organiser les auditions en pensant à ceux qui prennent connaissance du dossier et qui ont besoin d’avoir dès le départ un spectre des opinions le plus large possible, pour pouvoir poser des questions.
Le président Didier Migaud : C’est ce qui sera fait.
M. Charles de Courson : Ce rapport est un mémoire introductif en vue des auditions. Quelqu’un qui prendrait connaissance du dossier sans rien y connaître serait immédiatement noyé. Il s’agit de sérier les grandes questions, d’essayer d’exposer les points de vue des uns et des autres, avant de vous donner le mien, de façon à éclairer les débats, à vous rendre plus intelligibles les auditions et plus faciles les questions que vous voudrez poser à ceux qui seront reçus, dont j’espère que la liste sera un peu étoffée. Mais nous en discuterons. En deux heures de lecture, vous aurez les points essentiels qui vous permettront de suivre les auditions et de poser des questions.
M. Jérôme Chartier : J’aimerais surtout savoir – et sans doute ai-je insuffisamment lu ce rapport – pourquoi le groupe Tapie a engagé des procédures.
M. Charles de Courson : S’il avait perdu, M. Tapie aurait été définitivement ruiné !
M. Jérôme Chartier : Je ne l’ai vu nulle part !
M. Charles de Courson : C’est pourtant de lecture directe !
Le président Didier Migaud : D’où l’utilité de prendre le temps de lire les rapports !
Une fois de plus, nous engageons ce travail par une communication que Gilles Carrez et moi-même avons demandée à Charles de Courson puisqu’il représente l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’EPFR. Il n’a pas écrit son rapport en notre nom, mais, dans ce document, il plante le décor en fonction de son propre sentiment sur ce dossier. Les auditions vont commencer et la liste n’est pas close. Ce dossier dure depuis suffisamment longtemps pour ne pas avoir la prétention de l’épuiser en une seule journée d’auditions. Je souhaite que la commission des Finances soit en situation d’entendre tous les points de vue.
M. Gaëtan Gorce : La question que nous devons nous poser, c’est non pas de savoir si M. Tapie a été lésé, mais si l’État l’a été ! Nous représentons la nation, et défendons les intérêts du contribuable. Est-ce que les décisions qui ont été prises par ceux qui défendent les intérêts de l’État ont abouti à une situation défavorable au contribuable ? C’est la seule question à laquelle nous avons à répondre.
M. Michel Bouvard : Exactement !
M. Jérôme Chartier : C’est pourquoi il faut entendre tous les points de vue !
M. François Bayrou : Comme on le sent bien, il s’agit d’une affaire très extraordinaire, lourde de conséquences. C’est pourquoi il faut prendre le temps d’établir les faits de façon indiscutable. Je vais reprendre ceux qui commencent à apparaître avant de poser une question au rapporteur dont la communication est tout à fait éclairante.
Comme notre collègue vient de le dire, le sujet n’est pas Bernard Tapie. On pourrait le croire, mais à tort. Des aventures mettant en cause les banques, l’URSSAF, le fisc – vous apprécierez la prudence de mon expression – qui tentent de tirer avantage de situations économiques particulières, il y en a beaucoup. Mais, d’habitude, les protagonistes trouvent l’État en face d’eux. C’est la mission de l’État que de défendre le droit, et le contribuable accessoirement. Dans le cas présent, l’État, le pouvoir politique, a décidé d’abandonner la solidité des positions établies par les décisions juridictionnelles, en particulier celle de la plus haute juridiction française réunie en formation plénière, c'est-à-dire liant la cour d’appel dans son jugement ultérieur sur les points de droit jugés, dont l’essentiel : y avait-il lieu à indemnisation, ou pas ? L’État, donc, a décidé d’abandonner la force de sa position et de s’en remettre à un arbitrage privé dont on verra, à la lecture de la convention d’arbitrage, que son orientation était soigneusement indiquée. Jusqu’au montant des indemnisations qui allaient être accordées ! Voilà ce que la commission des Finances doit examiner. Il est donc en effet très important de prendre le temps, mais le travail qui commence aujourd'hui est très précieux.
L’État a donc décidé que le contribuable paierait à Bernard Tapie une dette dont la Cour de cassation en formation plénière a dit qu’elle n’existait pas, ou qu’elle n’avait pas à être estimée sous cette forme. Je ne sais pas si quelqu’un pourra me donner des exemples, mais je crois que c’est absolument sans précédent. Nous devrons déterminer quel est le mobile de tout cela.
À votre connaissance, Monsieur de Courson, quand cette somme, dont il apparaît, d’après vous et d’après moi, qu’elle est infondée juridiquement, sera-t-elle payée ? Une fois ces 300 millions versés, il n’y aura plus de retour en arrière possible. Que se passerait-il dans le cas, qui est plausible en l’état de la réflexion, où l’on découvrirait que l’indemnisation est juridiquement infondée, et que l’on n’a pas respecté la chose jugée à cause d’une décision politique ? Quand ce versement, cette spoliation de l’État et du contribuable, aura-t-il lieu ? Dès lors, de l’irréversible est en jeu.
Accessoirement, ne pourrait-on pas réfléchir en urgence à une protection de l’État et du contribuable dans la mesure où l’on considérerait qu’il y a au moins un doute sérieux sur la légitimité, voire la légalité, des décisions prises.
Le président Didier Migaud : Tout en n’anticipant pas sur les conclusions qui pourraient être les nôtres…
M. Charles de Courson : S’agissant de la date de versement, il faudrait déjà que le montant de la somme soit connu. Or, je l’explique dans mon rapport – page 20 –, deux audiences sont prévues – l’une en septembre, l’autre en octobre – sur les taux d’intérêt, la différence entre 95 millions et 115 millions provenant de la fameuse hypothèque sur l’hôtel de Cavoye et de la prise en compte, ou non, du loyer gratuit sur toute la durée.
M. François Bayrou : Qui paie les impôts locaux ?
M. Charles de Courson : Il y aurait un pré-accord sur les taux d’intérêt autour de 105 millions, mais c’est plus compliqué pour les frais de liquidation. Le règlement devrait intervenir vraisemblablement avant la fin de l’année.
M. Dominique Baert et M. Jérôme Cahuzac : Pour Noël !
M. Charles de Courson : Dans la convention d’arbitrage, l’État n’a pas abandonné ses positions juridiques. C’est dans la sentence arbitrale. J’avais beaucoup insisté car l’État étant en position de force, il était aberrant de recourir à l’arbitrage. Dans ces conditions, il fallait bétonner et mettre dans la convention d’arbitrage que les arbitres doivent juger en droit. Ma thèse est que la sentence arbitrale ne respecte pas intégralement les décisions de justice. On peut en discuter.
M. François Bayrou : Le résultat est le même !
M. Charles de Courson : Certes, mais l’arbitrage n’a pas fait renoncer l’État à sa position de force.
Qui paie les impôts de l’hôtel de Cavoye ? C’est une question que je me suis posée. Vous le savez peut-être, j’avais déclaré de façon plutôt humoristique que Bernard Tapie était le squatter le plus huppé de Paris. Il m’a attaqué en diffamation, mais s’est désisté la veille de l’audience, à mon grand regret. Mon appartement se trouvant, par le plus grand des hasards, dans le même secteur géographique que l’hôtel de Cavoye, j’ai appliqué la loi qui permet à toute personne domiciliée dans le même secteur fiscal de consulter les informations auprès de l’administration. Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas M. Tapie qui les payait. J’ai posé la question en tant qu’administrateur de l’EPFR et on n’a jamais voulu me répondre. J’ai voulu en avoir le cœur net. Après avoir passé une bonne heure dans les services d’assiette, on a fini par me dire que c’était une société qui payait les impôts. C’est assez curieux.
M. François Goulard : Ce serait l’association des amis de Bernard Tapie.
M. Charles de Courson : Il faut distinguer le foncier bâti et la taxe d’habitation.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Il est tout à fait légitime que nous commencions par entendre notre représentant à l’EPFR Charles de Courson. Mais, comme certains portent déjà des appréciations quasi définitives, je veux, dès à présent, apporter quelques précisions.
Contrairement à ce que dit François Bayrou, la convention d’arbitrage n’est pas en contradiction avec le jugement de la Cour de cassation. Je souhaite d’ailleurs que chacun d’entre nous le lise attentivement. Nous ne pouvons pas, dès la première audition, affirmer des choses qui ne sont pas forcément exactes. Chacun doit se forcer à écouter, à lire l’ensemble des documents avant de proférer des affirmations. Il faut savoir que, dans cette histoire extraordinairement complexe, le problème principal tourne autour de la cession d’Adidas, qui a fait l’objet d’une succession de décisions. L’arrêt de la cour d’appel de Paris a donné droit aux liquidateurs du groupe Tapie, mais la Cour de cassation est revenue en partie sur cette décision, tout en confirmant la recevabilité de l’action engagée par les mandataires liquidateurs. Avec Didier Migaud, nous sommes les seuls ici à avoir fait partie de la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais – il faut lire son rapport – et je me souviens parfaitement que, quand nous avons auditionné le président du Crédit Lyonnais, il a utilisé le mot « portage ». Le Crédit Lyonnais, par le biais de la SDBO, n’est-il pas allé au-delà de son rôle de mandataire pour assurer le portage et bénéficier de l’option d’achat par le groupe Louis-Dreyfus dans les meilleures conditions possibles ? Tout part de là. La question ne peut pas être traitée à la légère. Et, à ce stade, je m’inscris en faux contre le fait de dire que la convention d’arbitrage est en contradiction avec l’arrêt de la Cour de cassation. Chacun doit lire avant de se forger un jugement. Cela étant, nous sommes tout à fait dans notre rôle puisque nous devons savoir si les intérêts de l’État ont été lésés, ou non. L’État est en cause parce que le Crédit Lyonnais était une entreprise publique. L’État est bien à l’origine de ces affaires.
S’agissant de l’EPFR, où l’Assemblée est représentée, il a tenu le 10 octobre 2007 un conseil d’administration très important, au cours duquel a été proposé un avis sur le fait que le CDR engagerait une procédure d’arbitrage. Le conseil d’administration de l’EPFR a donné son accord pour pouvoir mettre fin à un certain nombre de contentieux. Le contexte était parfaitement clair puisque, dans les compétences de l’EPFR, figure notamment la faculté de donner un avis sur la faculté de transiger.
Le président Didier Migaud : Chacun doit faire l’effort de lire l’ensemble des documents, que nous contribuons à mettre sur la table. Je vous ai adressé, dans le courant de l’été, des extraits du rapport de la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais. Nous disposons aujourd'hui de la convention d’arbitrage, de la sentence arbitrale, de la décision de la Cour de cassation et de l’arrêt de la cour d’appel. Il faut en prendre connaissance, mais, avant d’avoir procédé à l’audition de l’ensemble des parties prenantes, personne ne peut se prononcer définitivement. Notre travail consiste à rassembler l’information la plus complète possible.
M. Charles de Courson : Dans le rapport de la commission présidée par M. Séguin, et dont le rapporteur était M. d’Aubert, le président du Crédit Lyonnais de l’époque parle non pas de « portage financier », mais de « portage économique », ce qui est tout à fait différent. Le portage consiste à acquérir des actions et à les détenir un certain temps avant de les revendre. Ce n’est pas ce qui a été fait et c’est pourquoi le président a parlé de « portage économique ».
Le président Didier Migaud : Nous poserons directement la question à M. Peyrelevade puisque nous l’auditionnons la semaine prochaine.
M. François Bayrou : L’argument du rapporteur général est limité à la fois par ce que vient de dire Charles de Courson et par le fait – que tout le monde semble avoir oublié – qu’au moment de la vente d’Adidas, Jean Peyrelevade n’était pas président du Crédit Lyonnais. Il le deviendra plus de six mois après. Il n’est pas partie dans cette opération.
Le président Didier Migaud : Convenons que ce n’est pas la question.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Ce n’est pas une question d’hommes ! Jean Peyrelevade n’a été nommé, si ma mémoire est bonne, qu’au printemps 1993. Mais l’ensemble des décisions de justice, et la Cour de cassation ne les contredit pas, laisse penser que le Crédit Lyonnais a été au-delà de la simple mission de mandataire.
M. François Bayrou : Il n’était pas mandataire !
Le président Didier Migaud : C’est tout le débat !
M. Nicolas Perruchot : Je félicite moi aussi Charles de Courson pour son travail très intéressant. Dans son rapport, il évoque les honoraires, de 1 million d’euros, des trois membres du tribunal arbitral. Qui les a fixés ?
M. Charles de Courson : Ils figuraient dans la convention d’arbitrage : 1 million d’euros correspondant à 100 000 euros de frais et 300 000 euros pour chacun des trois juges arbitres, le financement étant réparti pour moitié entre les parties, ce qui est tout à fait classique. Comme certains collègues ont tiqué, il s’avère, d’après les renseignements que j’ai pris, et compte tenu de la durée – cinq ou six mois –, que c’est bien payé, sans être extravagant.
M. Jérôme Chartier : Ce qu’il faut dire, c’est que ce n’est pas hors norme !
M. Charles de Courson : Et je confirme que les honoraires sont fiscalisés.
M. Nicolas Perruchot : Je trouverais également utile d’ajouter à la liste des personnes auditionnées les ministres des finances qui ont été en charge des décisions. Je regrette pour ma part que nous auditionnions Bernard Tapie dès la semaine prochaine. C’est beaucoup trop tôt. Il devrait vraisemblablement être l’ultime personne auditionnée.
S’agissant de la qualité des documents communiqués, chacun insiste sur la nécessité de faire toute la lumière. Je ne peux qu’être très choqué de constater que le compromis d’arbitrage qui a été transmis à M. de Courson, tardivement en plus, est, au moins dans l’annexe sur l’état synthétique du passif, illisible. Nous allons penser que l’on veut nous cacher quelque chose, ce qui risque d’influencer nos débats.
Le président Didier Migaud : Vous considérez que l’audition de Bernard Tapie vient trop tôt quand M. Chartier la trouve trop tardive. Il faut bien qu’elle ait lieu, et ce sera la semaine prochaine. J’en ai décidé ainsi après avoir consulté plusieurs d’entre vous.
Vous avez la convention d’arbitrage dans les mains. En raison de la clause de confidentialité, les copies ne sont pas obligatoirement excellentes, mais il n’y a aucune difficulté à avoir des informations précises à partir du moment où nous avons les documents et où les parties ont accepté de lever la confidentialité. La transparence existe et vous pourrez interroger M. Rocchi et M. Tapie sur ce document. Certaines des informations que vous avez dans les mains sont inédites, notamment la convention d’arbitrage. Elles contribuent à la transparence, à la qualité de nos travaux et à la compréhension par chacun du sujet.
M. Charles de Courson : Je me suis fait la même réflexion que notre collègue, mais, à la lecture, seul l’état du passif est illisible. Les chiffres les plus importants sont, d’une part, les 163 millions de créances de la SDBO et les 30 millions de créances fiscales. Les autres dettes, environ 10 millions, ne sont pas certaines ou pourraient s’éteindre.
M. Michel Bouvard : L’affaire est complexe et le Parlement dans son ensemble gagnerait à ce que nous évitions de porter des jugements à l’emporte-pièce et de politiser prématurément un dossier même s’il méritait ultérieurement de l’être. Nous devons conduire nos travaux sereinement si nous voulons qu’ils soient crédibles et qu’ils se poursuivent comme ils ont commencé. À cet égard, je remercie Didier Migaud d’avoir pris le soin de consulter l’ensemble des membres du bureau de la commission pour fixer le calendrier des auditions et, avec le rapporteur général, la façon de procéder.
Outre le cas Tapie, le CDR traite vingt-huit dossiers dits majeurs et de l’ordre de 160 dossiers mineurs. Quelle est l’appréciation de notre représentant sur ces autres contentieux ?
Par ailleurs, à côté de la question de savoir si l’État a été lésé ou non, nous devons, dans le cadre de nos travaux, nous interroger sur la qualité de la gestion des établissements de défaisance. Malheureusement, il y a d’autres structures de ce type, pour le Comptoir des entrepreneurs ou le GAN. Nous ne sommes pas non plus à l’abri pour l’avenir, même si l’État a moins de participations. Je m’interroge aussi sur l’accès de la représentation nationale à l’information quand j’observe, dans l’établissement public dont je préside la commission de surveillance, et qui était chargé d’une gestion purement administrative, qu’un censeur était prévu par la convention de 2004, mais que le poste n’a jamais été pourvu.
M. Charles de Courson : Il reste au sein du CDR deux grandes affaires : le dossier Tapie et la queue de la comète Executive Life. On trouve aussi des affaires immobilières de moindre importance. Le dossier Tapie représente un peu moins de 300 millions, Executive Life quelques dizaines de millions d’euros sous réserve que la justice américaine, parfois surprenante, ne prenne pas de décision inattendue. Mais il ne reste plus que des passifs, en dehors d’un hôtel à New York qui est en cours de réalisation. Je vous ferai le point sur le passif net.
M. Philippe Vigier : Je remercie Charles de Courson pour l’excellent travail qu’il a fait à la demande du président de la Commission et du rapporteur général. Comme François Goulard, je ne vois pas comment ne pas aller au bout de cette affaire, et de façon équilibrée en donnant la parole à tous les acteurs qui sont intervenus à un moment ou à un autre.
M. de Courson laissait clairement entendre que la non-transmission de la convention d’arbitrage constituait une véritable entrave à la connaissance du dossier. Je ne vois pas, en dépit de la clause de confidentialité, pourquoi on a tant tardé à nous la communiquer. Vu le mécanisme de décision qui a conduit à la mise en place de ce tribunal arbitral, il fallait vraiment que la convention puisse être communiquée à notre représentant au sein du conseil d’administration de l’EPFR.
L’affaire a démarré, rappelons-le, en 1990. Il est tout de même étonnant qu’une banque ait prêté 1,6 milliard de francs remboursables en deux années seulement. Comment cette opération a-t-elle pu être validée par le Crédit Lyonnais ? Les conditions tranchent avec les montages financiers que l’on rencontre dans le monde économique ou le monde industriel.
Le cas ne risque-t-il pas de faire jurisprudence ? Jusqu’à présent, les établissements publics administratifs étaient a priori exclus de ce type de règlement.
Comment enfin mieux protéger l’État à l’avenir ? J’insiste sur ce point car d’autres affaires que le Crédit Lyonnais ont coûté très cher.
Le président Didier Migaud : Une nouvelle fois, je précise que Charles de Courson a eu connaissance, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration de l’EPFR, de la convention d’arbitrage, sans en avoir possession. Je l’ai demandée, et nous l’avons obtenue avec Gilles Carrez puisque la clause de confidentialité n’est opposable ni au président ni au rapporteur général de la commission des finances alors qu’elle l’est à Charles de Courson. La loi me donne certains pouvoirs ; j’ai fait en sorte de les exercer pour permettre à la commission des Finances de travailler. Le groupe Tapie aussi bien que le président du CDR ont accepté que cette convention d’arbitrage soit sur les tables ce matin. Vous pouvez la lire et poser des questions. Si elle n’est pas assez lisible, nous ferons en sorte qu’elle le soit.
M. Michel Bouvard : Dans le cadre de la modification de la LOLF, nous pourrions voter une mission spécifique à Charles de Courson lui donnant la possibilité d’avoir accès à tous les documents.
Le président Didier Migaud : De toute façon, tous les documents sont sur la table.
M. Charles de Courson : Il est tout de même incroyable de refuser de communiquer à un administrateur une convention sur laquelle on lui demande de se prononcer. Un administrateur est tenu à la clause de confidentialité, mais, en ce qui me concerne, j’ai toujours dit que je ne me sentais pas lié par cette obligation envers les représentants du peuple.
Pourquoi le Crédit Lyonnais a-t-il accepté de prêter 1,6 milliard ? C’est toute la dérive du Crédit Lyonnais et de ses filiales de banques d’affaires. Je crois que le prédécesseur de M. Peyrelevade, M. Haberer, y a vu une bonne affaire et qu’il a cherché à piéger Tapie car il le savait parfaitement incapable de rembourser. Ce ne sont que des hypothèses, mais un banquier normal ne finance pas à 100 % un client incapable de rembourser.
M. François Bayrou : Un mot seulement pour dire qu’il y avait un nantissement sur les actions ! C’est ce gage qui explique la situation à la fin de 1992.
M. Charles de Courson : Entre parenthèses, ils auraient fait jouer le nantissement au lieu de se lancer dans cette procédure, il n’y aurait jamais eu de débat.
M. François Bayrou : Évidemment !
M. Charles de Courson : Il n’y a pas de risque de jurisprudence parce qu’il faut une disposition législative pour qu’une partie publique puisse recourir à l’arbitrage. Le droit est très clair, à mon avis.
Comment mieux protéger l’État ? En ce qui me concerne, je pense que la création de structures de défaisance est une erreur. Vous pourrez poser la question à M. Peyrelevade. En créant de telles structures, on coupe les ponts avec ceux qui ont initié les dossiers devenus pourris et la perte de mémoire est considérable. On embauche des nouveaux qui ne savent rien de ce qui s’est passé. Et vous aboutissez parfois à des catastrophes.
Le président Didier Migaud : C’est encore un autre sujet.
M. Jean-Pierre Brard : Merci à la troïka qui permet de rehausser le rôle du Parlement par de tels travaux.
Ce qui m’intéresse vraiment, c’est la dernière longueur. On sait comment fonctionne actuellement notre État. Parmi les auditions, je souhaite que soit prévue celle du conseiller de l’Élysée qui suit le dossier et de M. Guéant, puisque, à l’évidence, nous sommes devant une affaire qu’on appellera un jour une affaire d’État.
Le Président Didier Migaud : Nous verrons. La ministre représente l’exécutif et l’État. C’est elle qui est en charge du dossier.
——fpfp——
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 12 heures (compte rendu n° 111) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bertrand Schneiter, ancien président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Bertrand Schneiter, ancien président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation – CDR – et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Nous recevons maintenant M. Bertrand Schneiter, qui présida le conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration – EPFR – d’avril 2003 à juillet 2007.
Qu’en était-il, Monsieur Schneiter, des procédures de contentieux entre le Consortium de réalisation – CDR – et le groupe Bernard Tapie durant votre présidence? Que pensez-vous du recours à l’arbitrage et de la sentence rendue ?
M. Bertrand Schneiter, ancien président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration – EPFR – : Sans doute vais-je vous décevoir mais je n’exprimerai aucun point de vue sur les événements survenus après ma présidence. Je rappelle en outre que j’ai déjà eu l’honneur d’être auditionné devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale au début de 2006 et que la Cour des Comptes, après s’être longuement penchée sur la gestion de l’ensemble des défaisances, a reconnu que le conseil de l’EPFR a parfaitement joué son rôle sous ma présidence – je vous prie d’excuser cette petite part d’autosatisfaction !
Pendant cette période, c’est le dossier Executive Life – et non l’affaire Adidas – qui a été au cœur des travaux de l’EPFR : aucune disposition ne limitant en droit la capacité juridique du CDR, ce dernier était en charge de la gestion de cette défaisance. L’EPFR, lui, avait à l’origine un rôle de surveillance avant qu’il ne lui soit demandé de devenir l’actionnaire du CDR, situation guère satisfaisante aux yeux de la Cour des Comptes puisque le pouvoir d’actionnaire ne s’est exercé que sur les décisions d’assemblée générale, les administrateurs du CDR – dont j’étais en tant que représentant de l’EPFR – restant indépendants. Quoi qu’il en soit, le CDR a jugé qu’il ne pouvait prendre certaines décisions de gestion sans interroger l’EPFR. Afin de mieux responsabiliser sa gestion ordinaire, on a estimé qu’il était bon de le décharger du régime des risques non chiffrables, soit du provisionnement des affaires particulièrement incertaines, au bénéfice de l’EPFR. Parmi ces risques, deux ont donc pris de l’ampleur : Executive Life et l’affaire Adidas. Cette dernière a été clarifiée en 1999, à la veille de la privatisation du Crédit Lyonnais : un différend, en effet, opposait le CDR à l’établissement bancaire ; le ministre des finances d’alors a rendu un arbitrage aux termes duquel Executive Life relèverait des risques non chiffrables, le CDR se chargeant de l’affaire Adidas sous réserve, en cas de condamnation, d’un « ticket Crédit Lyonnais » de 12 millions. Le Crédit Lyonnais avait tout intérêt à cette clarification car il n’ignorait pas que ces deux affaires pouvaient connaître des développements… désagréables.
Le président du CDR a considéré l’EPFR comme une manière de garant à première demande. En tant que président de l’EPFR membre du conseil d’administration du CDR, je me suis quant à moi toujours abstenu d’y voter mais l’EPFR a jugé que nous devions répondre aux interrogations du CDR sans jamais lui adresser d’instructions. J’ajoute que je n’ai jamais demandé quelque instruction que ce soit à quelque ministre que ce soit. S’agissant d’Executive Life, j’ai considéré que, le ministre de l’économie étant évidemment responsable des finances publiques et mon budget étant soumis à son approbation, je ne pouvais, par mon vote et en mon âme et conscience, engager des dépenses publiques considérables.
Entre gestion courante de la liquidation et contentieux Adidas, l’affaire qui nous préoccupe aujourd’hui est extrêmement complexe. Sur le premier point, l’EPFR n’a jamais reçu que des informations dont M. de Courson, d’ailleurs, a toujours signalé l’insuffisance. L’EPFR s’est montré perplexe quant à la qualité du suivi et aux avatars juridiques de cette liquidation - son contrôle s’est d’ailleurs révélé très délicat. Chacun le sait : la liquidation était liée à l’issue du contentieux « Adidas », lequel n’en finissait pas. L’EPFR a donc toujours été tributaire des informations du CDR s’agissant en particulier des différentes issues judiciaires possibles, notamment, en ce qui concerne le passage en Cour d’appel de la fin 2004. L’idée d’une médiation a alors été avancée par les actionnaires minoritaires. Était-elle opportune ? Le CDR en a fixé les conditions, très strictes, et l’EPFR les a approuvées. Le médiateur, M. Jean-François Burgelin, a considéré que des fautes non négligeables avaient été commises et qu’il fallait se diriger vers une ligne « ni riche ni failli ». Or, cela n’a pas abouti.
M. Jean-François Goulard : C’est l’autre partie qui a refusé.
M. Bertrand Schneiter : En effet. La Cour d’appel, en 2005, a mal raisonné en essayant en quelque sorte de prendre la suite de la médiation. Son arrêt, d’ailleurs, était susceptible d’être censuré par la Cour de cassation : n’est-il pas extravagant de considérer que l’obligation de loyauté irait jusqu’à prêter à un client des sommes considérables comme si ce dernier n’était pas vendeur mais acheteur ? Le pourvoi allait donc de soi. S’il n’est intervenu que fort tard, c’est que la signification de l’arrêt de la Cour d’appel au CDR par les mandataires liquidateurs n’a été effective que le 18 janvier 2006. Le CDR, lui, a toujours considéré qu’une transaction était possible à tout moment. Le 9 octobre 2006, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt et a confirmé la recevabilité de l’action engagée par les mandataires liquidateurs ; sur le terrain du manquement à la loyauté qu’avait établi la Cour d’appel, estimant que la banque s’était abstenue de proposer au groupe Tapie des financements qu’elle avait octroyés à certains cessionnaires des participations litigieuses, elle a jugé que le banquier est toujours libre de proposer ou de consentir un crédit, de s’en abstenir ou de le refuser. On ne peut néanmoins considérer qu’elle ait interdit toute perspective d’attaque pour les plaignants.
Je précise qu’au printemps 2007, M. Rocchi, président du CDR, a trouvé une solution partielle quant au rôle des actionnaires minoritaires.
J’ajoute que j’ai quitté la présidence de l’EPFR en raison de la limite d’âge mais que je n’ai en aucune façon souhaité mettre un terme à mes fonctions.
Enfin, dans le strict respect des procédures, la recherche d’une solution globale à cette affaire me semble préférable à d’interminables procédures judiciaires, le Parquet Général ayant par ailleurs toujours eu le même point de vue.
Je termine en précisant à M. de Courson, qui a évoqué ce point dans sa communication, que les transactions visées par le décret portant statuts de l’EPFR sont celles conclues par l’EPFR lui-même.
M. Charles de Courson : Le président de l’EPFR peut donc voter comme il l’entend mais il a en l’occurrence toujours voté comme les représentants de l’État. L’un d’entre eux, M. Jean-Yves Leclerq, l’a d’ailleurs attesté lors de la fameuse réunion du 10 octobre 2007. À la question que j’ai souvent posée en tant que représentant de l'Assemblée nationale au conseil d’administration de l’EPFR - « Avez-vous donc des instructions ? » – il m’a toujours été répondu positivement. Le confirmez-vous ?
M. Bertrand Schneiter : J’ai eu l’occasion de le dire : je ne peux prendre une décision dont je sais que le ministre la refusera.
M. Charles de Courson : Vous confirmez donc mes propos.
M. Bertrand Schneiter : Non. En tant qu’ordonnateur de l’EPFR, je ne pouvais que raisonner ainsi. Je le répète : je n’ai jamais demandé d’instructions au cabinet du ministre.
M. Charles de Courson : Aux termes de l’article 5 du décret d’application de la loi portant création de l’EPFR, les décisions du conseil d’administration de l’EPFR soumises à l’approbation préalable du ministre de l’économie sont celles relatives au financement de l’établissement public par recours à l’emprunt, à la mise en place du coupon zéro tel que prévu par le protocole d’accord, au budget, à l’arrêté des comptes, à la cession des participations, à la modification du protocole d’accord, à la modification des conventions de garanties, aux transactions… Vous ne pouviez qu’être tenu par une telle liste ! J’ajoute que vous avez toujours protesté de votre devoir de loyauté à l’endroit du ministre de l’économie.
M. Bertrand Schneiter : Mais je n’ai pas besoin de lui demander ses instructions !
M. Charles de Courson : Je me souviens d’un vote où votre voix a fait basculer la majorité du côté des représentants de l’État.
M. Bertrand Schneiter : Nous représentions tous l’État.
M. Charles de Courson : En l’occurrence, je représentais le pouvoir législatif.
M. Bertrand Schneiter : La responsabilité du président de l’EPFR ne saurait être confondue avec celle du représentant du ministre : je n’avais pas à prendre quelque instruction que ce soit.
Le Président Didier Migaud : Vous avez été en effet désigné par le conseil des ministres et non par le ministre des finances. Comme tel, vous ne sollicitez pas des instructions mais votre vote dépend de l’idée que vous vous faites de l’intérêt de l’État.
M. Charles de Courson : L’EPFR visait donc à surveiller le CDR, celui-ci ayant à plusieurs reprises saisi celui-là, lequel a délibéré. Le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 octobre 2007 relatif au vote sur la convention d’arbitrage dispose que le président met aux voix la non opposition de l’EPFR à l’organisation de l’arbitrage par le CDR sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la réalisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage, ainsi que la rédaction de la lettre au président du CDR en ce sens. Si l’on va au bout de la logique défendue par M. Schneiter, le CDR pourrait faire ce qu’il veut aux frais du contribuable ! Quid, dans ces conditions, des représentants du peuple et du ministre de l’économie ? Une telle façon de faire serait absolument contraire au droit constitutionnel. Les montages réalisés par la Direction du Trésor sont en l’occurrence calamiteux sur le plan démocratique.
Le Président Didier Migaud : Quoi qu’il en soit, l’EPFR a été consulté et a voté.
M. Bertrand Schneiter : Le CDR n’a pas demandé d’instructions : il a fait une proposition et a affirmé que la décision de son conseil d’administration ne serait effective que si l’EPFR ne s’y opposait pas. Des administrateurs indépendants ont pris une décision et l’ont soumise à ceux qu’ils considèrent comme leur garant à la première demande.
Le Président Didier Migaud : In fine, c’est donc l’EPFR qui décide.
M. Jérôme Chartier : C’est radicalement différent !
M. Bertrand Schneiter : Pour utiliser une métaphore, disons que le CDR décide de la forme que peut prendre une serrure et que l’EPFR choisit ou non de tourner la clé.
Le Président Didier Migaud : Le CDR ne pouvait prendre de décision sans l’approbation de l’EPFR.
M. Bertrand Schneiter : Le CDR avait en l’occurrence parfaitement délibéré et avait pris sa décision.
Le Président Didier Migaud : Qu’il n’aurait pas appliquée si…
M. Bertrand Schneiter : La décision prévoyait la non opposition du garant à première demande.
M. Charles de Courson : Cette présentation ne correspond pas à la réalité financière. Le CDR fait état de sa décision à l’EPFR parce que c’est ce dernier qui paie ! Que se passerait-il en cas de refus de paiement ? À cela s’ajoute que le ministre de l’économie a le droit de bloquer le budget de l’EPFR.
M. Jérôme Chartier : Après la présentation de M. de Courson, nous avions le sentiment que le recours à la procédure arbitrale était entaché d’illégalités puis l’on nous assure que ce n’est pas l’EPFR mais le CDR qui a engagé la procédure arbitrale ! La commission des Finances a certes l’habitude d’examiner des montages particuliers mais pourrait-on en l’occurrence disposer du compte rendu de la séance du 10 octobre 2007 ? En outre, serait-il possible d’auditionner les mandataires liquidateurs ? Enfin, pourrions-nous connaître la nature des douze recours entre le CDR et Bernard Tapie ?
Le Président Didier Migaud : Nous allons en effet étudier la possibilité d’auditionner ces mandataires et le CDR pourra sans doute communiquer une note sur les douze contentieux.
M. Bertrand Schneiter : Pour des raisons de procédure, les mandataires liquidateurs ont toujours contesté l’attribution de la gestion de Bernard Tapie Finance – BTF – au CDR, or, si cela avait été exploité, ils auraient pu « reprendre la main » sur BTF, vendeur d’Adidas, et la martingale judiciaire se serait perpétuée.
M. Charles de Courson : Ce sont les 76 millions dont j’ai parlé, une décision de justice définitive ayant attribué ces actions à la société de banque occidentale – SDBO – afin de payer une partie de ses dettes.
J’ajoute que le dernier alinéa de l’article 2 portant création de l’EPFR dispose que ce dernier veille notamment à ce que soient respectés les intérêts financiers de l’État dans le cadre du plan de redressement du Crédit Lyonnais. C’est la raison pour laquelle le CDR le saisissait. Aurait-il voté contre que le CDR n’aurait pas pu agir.
M. Bertrand Schneiter : Il ne l’aurait pas fait.
Le Président Didier Migaud : Il aurait pu le faire en droit mais il ne l’aurait pas fait.
M. Charles de Courson : Nous avions un pouvoir de blocage.
M. Jean-Pierre Brard : Dans le meilleur des cas, nous sommes sous le régime de la codécision ; dans le pire, la décision ultime revenait à l’EPFR.
En outre, M. Schneiter assure ne pas avoir demandé d’instructions au ministre mais, comme la fille de Deng Xiaoping, je gage qu’il sait lire sur les lèvres. Par ailleurs, Monsieur Schneiter, avez-vous reçu des coups de fil… informatifs, bien entendu, en provenance de cabinets ministériels ou de la présidence de la République ?
M. Bernard Schneiter : Outre que je n’avais pas besoin de lire sur les lèvres de qui que ce soit puisque les représentants de l’État au conseil d’administration donnaient explicitement leur avis, je rappelle qu’en tant qu’ordonnateur de l’EPFR, je ne pouvais prendre une décision dont je savais qu’elle serait contrecarrée par le ministre.
M. François Goulard : J’admire un tel sens de la casuistique ! Nous autres, parlementaires, nous avons un esprit plus simple que celui des hauts fonctionnaires et nous comprenons, en dépit de certaines circonlocutions, que vous avez toujours respecté la position de l’État, ce qui est d’ailleurs tout à fait normal.
J’ajoute que les banquiers délèguent très peu les recours à l’arbitrage et aux abandons de garanties : les décisions se prennent en la matière au plus haut niveau et non à celui de l’organe de gestion, si indépendant soit-il. En l’occurrence, il s’agit de l’argent et des décisions de l’État dont il nous appartient de juger de la pertinence. In fine, nous avons à faire à une banque qui se conduit mal en prêtant trop, sans garanties suffisantes ni un réel souci des échéances et qui revend ensuite les actions de la société en « truandant » un peu l’ancien actionnaire. Ce dernier pense quant à lui avoir été lésé mais il aurait été incapable de profiter de circonstances potentiellement favorables puisqu’il se trouvait au bord de la liquidation. Il me semble qu’à terme il doit être possible de parvenir à des solutions de bon sens comme celle du « ni riche ni failli » et de faire en sorte, en particulier, que celui qui n’est pas « blanc bleu » ne s’enrichisse pas à travers cette succession d’affaires. Or, l’arbitrage rendu ne va pas dans ce sens : celui qui est à l’origine de tout et dont personne ne peut dire qu’il est le Français le plus irréprochable s’enrichit notablement ; cela choque l’opinion publique mais également un certain nombre de parlementaires et peut-être, au-delà de tout, le droit lui-même.
Le Président Didier Migaud : Si, dans la première partie de votre intervention, vous avez fait montre d’un remarquable esprit de synthèse, vous avez exprimé dans la seconde un point de vue très personnel !
M. Dominique Baert : La cessation de vos fonctions, Monsieur Schneiter, s’inscrit au sein d’un calendrier précis : la Cour de cassation s’est prononcée en octobre 2006 et l’EPFR a dû prendre une décision quant à l’engagement d’une procédure arbitrale un an plus tard. Auriez-vous donc souhaité prolonger vos fonctions ? Avez-vous eu le sentiment que l’on n’ait rien fait pour qu’il en soit ainsi dans cette période pourtant cruciale – sur un plan financier en particulier – et alors que vous connaissiez fort bien ce dossier ?
M. Bertrand Schneiter : La loi de 1984 a fixé une limite d’âge stricte – 65 ans – pour l’exercice de la présidence d’un établissement public. Je ne pouvais rien faire valoir contre et je n’ai pas eu d’état d’âme particulier.
M. Dominique Baert : Si on vous l’avait proposé, vous seriez resté.
M. Bertrand Schneiter : Je n’ai en tout cas jamais prétendu vouloir quitter mes fonctions et j’étais prêt à continuer à m’occuper de dossiers très intéressants.
Le Président Didier Migaud : Si vous aviez été en poste à ce moment-là, auriez-vous approuvé le recours à l’arbitrage ?
M. Bertrand Schneiter : Je ne répondrai pas précisément à cette question mais je considère néanmoins que l’arbitrage constitue une voie légitime qui n’a rien de choquant. Dès lors que toutes les tentatives de parvenir à une transaction avaient échoué et que les aléas judiciaires se perpétuaient, la possibilité d’y recourir ne devait pas être, me semble-t-il, exclue.
Le Président Didier Migaud : Et sans recevoir d’instructions, vous auriez pu tenir compte de l’avis des représentants de l’État…
M. Jean-Pierre Brard : Même pour le préjudice moral !
M. Bertrand Schneiter : Nous sommes dans La vie rêvée des anges !
Le Président Didier Migaud : Je vous remercie.
——fpfp——
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 14 heures 45 (compte rendu n° 112) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-François Rocchi, président du Consortium de réalisation (CDR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Jean-François Rocchi, président du Consortium de réalisation – CDR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Nous commençons les auditions de l’après-midi par celle de M. Jean-François Rocchi, l’actuel président du Consortium de réalisation – CDR. M. Rocchi ayant entendu une partie des débats de ce matin, je vais lui donner immédiatement la parole afin qu’il nous expose la situation telle qu’il la voit, précise les liens entre le CDR et l’établissement public de financement et de restructuration – EPFR – et le rôle respectif de ces deux organismes, indique l’état des contentieux lorsque s’est posée la question de recourir à l’arbitrage, fournisse les raisons de ce recours à l’arbitrage et son fondement juridique – M. de Courson ayant exprimé des réserves, pour ne pas dire plus, sur cette procédure –, donne son appréciation de la sentence arbitrale rendue et, enfin, précise les raisons d’un non-recours en annulation, sachant que les conseils d’administration à la fois du CDR et de l’EPFR – cela a été rendu public et M. de Courson l’a reprécisé ce matin – n’ont pas été unanimes sur cette question.
M. Jean-François Rocchi : Je vous remercie. Je prends comme une chance l’occasion qui m’est donnée aujourd’hui de m’expliquer – en primeur – sur une affaire complexe qui, même si le dossier Adidas en constitue le volet principal, ne se limite pas à celui-ci mais s’étend à d’autres contentieux comme M. le président l’a rappelé, et sur les choix de gestion qui ont orienté la décision de recourir à un arbitrage. J’ai souhaité, en effet, réserver la primeur de mes déclarations à la représentation nationale. Faute de pouvoir réunir la Commission en plein été, j’ai été entendu par le président de la commission des Finances du Sénat juste à la brisure des vacances et en coordination avec vous, je crois, monsieur le président, sur le calendrier. J’avais souhaité qu’il en soit ainsi. Je suis aujourd’hui à la disposition des commissaires pour répondre sans rétention ni dissimulation à toutes les questions qu’ils voudront bien me poser.
Le dossier étant foisonnant, il me paraît nécessaire, après l’audition de vos travaux de ce matin – sans vouloir laisser penser que vous ne connaissez pas le dossier – de revenir, quitte à paraître un peu insistant, sur quelques points concernant les origines de cette affaire.
Je rappellerai, d’abord, en quelques mots ce qu’est le CDR. M. Charles de Courson, qui représente l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’EPFR et suit le dossier de la défaisance du Crédit Lyonnais, rapporte tous les ans – il l’a fait encore ce matin – sur la gestion du CDR. Je ne vais évidemment pas paraphraser ses propos, mon intention étant de vous dire brièvement où l’on en est.
Le CDR est une société de cantonnement, c’est-à-dire, dans le jargon professionnel, qui est un mauvais franglais, une structure de défaisance. Il a été chargé, en avril 1995, au sein du Crédit Lyonnais – il en était, au départ, une filiale – puis, à partir de novembre 1995, en dehors de celui-ci – après l’intervention d’une loi qui a créé un actionnaire public, l’EPFR, dont l’ancien président, M. Bertrand Schneiter, a été entendu par votre Commission ce matin et dont le nouveau président, M. Bernard Scemama, le sera tout à l’heure – de régler ce que les Anglais appellent la bad bank, c’est-à-dire les dossiers dépréciés, dégradés, « pourris » d’une certaine manière, que cette banque comportait dans son bilan et qui avaient causé, à l’époque, un certain nombre de problèmes. Actionnaire à 100 % du CDR, l’EPFR contrôle et supervise ses activités. Dès l’origine, le CDR a donc reçu la charge de gérer, de céder ou de valoriser s’il le pouvait – mais il ne le pouvait pas toujours – un certain nombre d’actifs douteux, dépréciés, et de faire face – c’est malheureusement le cas dans l’affaire qui nous préoccupe aujourd’hui – aux contentieux multiples et variés qui suivent souvent ce genre de gestion.
À l’origine, il était un véritable monstre. Doté de quelque 25 milliards d’euros d’actifs, en valeurs brutes, il avait à peu près 4 000 lignes de participation et presque autant de contentieux. Cela vous donne une idée de la complexité de la tâche de mes devanciers et de l’énormité du sujet. Aujourd’hui, le sujet s’est substantiellement rétréci. Je ne dirais pas pour autant qu’il ne reste que de petites affaires : certaines sont encore significatives et peuvent poser des problèmes à l’avenir.
Alors que le CDR était l’un des plus gros propriétaires immobiliers de Paris, en héritage du groupe Crédit Lyonnais, il n’a conservé qu’une poignée d’actifs immobiliers ou physiques, dont il ne vaut guère la peine de parler. Cette page est tournée. En revanche, il reste de nombreuses créances attachées à des crédits bancaires ou des concours financiers qui n’ont pas été soldés, créances dont la plupart sont décotées ou dépréciées – 400 millions en valeurs brutes au bilan 2007 –, qui sont génératrices de contentieux – quelque 120. À côté d’une poussière de petits contentieux dont il n’est pas utile de parler maintenant, il en est une dizaine qui valent la peine d’être regardés. Je ne les détaillerai pas, nous y reviendrons peut-être dans le débat. Je citerai simplement ceux que nous avons aux États-Unis, qui ne se limitent pas à la queue de la comète de l’affaire Executive Life mais portent sur la poursuite d’un escroc – autant l’appeler par son nom – qui, après, avoir emprunté de l’argent à toute la place bancaire de Paris, en particulier au Crédit Lyonnais, s’en est servi pour acheter des hôtels. Nous avons transigé sur l’hôtel mais nous avons poursuivi le personnage en responsabilité personnelle. Pour vous montrer que le CDR ne perd pas toujours, j’ai le plaisir de vous annoncer que, depuis lundi, ce personnage et ses complices sont condamnés par la justice américaine en première instance à la somme de 266 millions de dollars à notre profit. Le problème est maintenant d’aller les chercher car vous devinez comme moi que son insolvabilité a dû être scientifiquement programmée.
Bien que structure « en finition », le CDR n’est pas, pour autant, totalement négligeable. Il comporte un certain nombre de dossiers significatifs.
Pour avoir assisté aux auditions de ce matin, il me semble également utile de rappeler – en vous demandant de me pardonner quelques redites – ce qu’était le groupe Tapie à l’origine et au moment où l’affaire s’engage et d’où venaient les contentieux. Il est en effet important de préciser de quoi l’on parle et pourquoi un arbitrage a pu se faire.
De manière très simplifiée, le groupe Tapie était organisé à partir du métier – très particulier – de repreneur d’entreprises. Il a été construit par Bernard Tapie, qui en était le propriétaire à 100 % avec son épouse. La structure de tête, en quelque sorte, était donc M. et Mme Tapie. En dessous, on trouve, propriétés exclusives de M. et Mme Tapie, deux sociétés en nom collectif – SNC –, ce qui n’est pas très habituel. L’une, qui ne nous intéresse pas trop en la circonstance, la FIBT – la Financière immobilière Bernard Tapie – porte les avoirs patrimoniaux, privés en quelque sorte, du couple Tapie : le domicile, le bateau, le mobilier et un certain nombre d’actifs patrimoniaux. La seconde SNC, GBT – Groupe Bernard Tapie –, qui est concernée principalement dans la sentence arbitrale, est une holding industrielle, si ce mot peut être appliqué au sujet, qui regroupe les participations détenues par le groupe Tapie dans un certain nombre de sociétés : La Vie Claire, Terraillon, Testut, Tournus. Tous ces noms sont connus et ont illustré l’histoire financière. À côté, il est une société d’un type un peu particulier, qui nous intéresse directement pour Adidas : la sous-holding qui porte Adidas. Lorsque M. Tapie achète Adidas en 1990, il le fait à travers une société de droit allemand qui est une GmbH, c’est-à-dire une SARL allemande : BTF GmbH. Cette société est rattachée à une structure intermédiaire, Bernard Tapie Finance, société cotée sur la place de Paris – qui n’est donc pas la propriété exclusive du groupe Tapie mais compte des actionnaires minoritaires – qui porte les actifs industriels et, indirectement, Adidas à travers la GmbH.
Quand M. Tapie achète Adidas, la société n’est pas celle que nous connaissons aujourd’hui. Elle est le numéro 3, et non le numéro 1, des articles de sport. Propriété des héritiers du fondateur, M. Dassler, elle est cédée au groupe Tapie dans un état moyen. L’ambition de ce dernier est de la redresser, puis d’essayer d’en tirer de l’argent. Il emprunte de manière très lourde au groupe Crédit Lyonnais, en particulier aux sociétés dont le CDR est l’héritier aujourd’hui, dont la SDBO – la Société de Banque Occidentale – qui est une banque faisant du crédit à l’intérieur du groupe Crédit Lyonnais.
En avril 1992 – je vais, évidemment, à l’essentiel et me limite aux points généraux – M. Tapie est nommé ministre de la Ville. Il indique alors – c’est sa version ; lorsque vous l’entendrez la semaine prochaine, j’imagine qu’il reviendra sur des points de sa biographie que je ne connais pas – qu’il souhaite se dégager le plus possible de ses participations économiques parce qu’il estime que les deux activités doivent être séparées. Sa décision nous paraît un peu « enchanteresse ». La thèse défendue par le CDR devant le tribunal arbitral est que, si cette séparation était demandée, c’est plutôt parce que ses affaires étaient en difficulté et qu’il lui fallait trouver de l’argent pour remettre à flot son groupe. Bien que le tribunal arbitral nous ait donné tort, je tiens à préciser que nous n’avons jamais fait nôtres les thèses de M. Tapie, lequel était pour nous, et est encore techniquement puisque l’arbitrage n’est pas achevé, une partie adverse.
En novembre 1992, le Groupe Bernard Tapie prend l’attache du groupe Crédit Lyonnais et lui indique qu’il souhaite un réaménagement de leurs rapports financiers pour permettre une vente d’Adidas. Entre-temps, l’entreprise Pentland, propriétaire de Reebok et numéro 1 à l’époque du secteur, a pris une participation assez faible dans Adidas et laissé entendre qu’elle pourrait aller jusqu’à en prendre le contrôle majoritaire. Mais l’affaire n’a pas eu lieu pour différentes raisons que je laisse le soin à M. Tapie de préciser, car nous n’en faisons pas la même présentation. Au moment où GBT contacte le groupe Crédit Lyonnais, il n’a pas d’acheteur pour Adidas et demande donc à la banque de lui en trouver un. Cela prend la forme d’accords, conclus au mois de décembre 1992. Ceux-ci sont le nœud de l’affaire car tout provient de là.
Le 10 décembre 1992, est signé ce que l’on appelle le mémorandum, sorte de contrat cadre entre la SDBO – aujourd’hui CDR Créances –, le groupe Bernard Tapie Finance, c’est-à-dire la holding cotée qui porte les participations industrielles, et ce que l’on appellera le groupe Tapie, c’est-à-dire la société GBT au-dessus de BTF. Cet accord prévoit – en simplifiant – le désengagement industriel du groupe Tapie, sa restructuration et son désendettement au moyen d’un levier : la vente programmée d’Adidas, qui est sans doute l’actif le plus valorisé et valorisant de ce groupe.
Pour mettre en exécution ce contrat, qui n’a pas de portée directe mais est simplement un gentlemen’s agreement, sont signés, le 16 décembre 1992, une lettre d’engagement et un mandat. Par la première, les sociétés GBT et BTF s’obligent à vendre Adidas avant le 15 février 1993 à toute société désignée par la SDBO pour la somme – le prix est déjà fixé et est ne varietur – de 2,085 milliards de francs. Pour donner le moyen technique de l’exécution de cette lettre, un mandat, au sens pleinement juridique du mot, consenti par BTF – qui est l’actionnaire direct de la société allemande qui porte Adidas – à la SDBO, confie à cette dernière le soin de solliciter des acheteurs : la banque a toute liberté dans le choix de ces derniers, le prix a été fixé par la fameuse lettre d’engagement, la date butoir est fixée au 15 février 1993.
Que fait la banque ? Elle cherche des acheteurs et exécute son mandat. Le problème est qu’elle ne trouve pas d’acheteur. Peu à peu s’impose l’idée de ce que l’on appelle dans les documents de l’époque un « actionnariat de transition » destiné à remplacer le groupe Tapie dans la propriété d’Adidas en attendant qu’un acheteur final se dégage, le désengagement souhaité par le groupe Tapie risquant de ne pas avoir lieu dans les délais.
Entre alors en scène Robert Louis-Dreyfus, qui est un industriel important et connu. En janvier 1993 – c’est en tout cas ce qu’il a déclaré au procureur général Burgelin lors de la médiation de 2004 –, il indique qu’il pourrait s’intéresser à Adidas et envisager de l’acheter mais demande à voir au préalable ce dont il s’agit : il accepterait d’être le manager de cette entreprise et de prendre une participation modeste de 15 %.
Le tour de table correspondant à l’actionnariat de transition dont je parlais s’esquisse. On y trouve Clinvest, la deuxième société que représente le CDR, une petite banque d’affaires du groupe Crédit Lyonnais – que le CDR maison mère a remplacée –, les AGF, la banque Worms, Mme Beaux en tant que particulier et trois nouveaux venus : la société RICESA de M. Louis-Dreyfus, un fonds de la banque Warburg, qui s’appelle Coatbridge, et un fonds de la Citibank, qui s’appelle Omega détenu par une société appelée Citistar. Comme tous ces investisseurs n’ont pas forcément à l’instant t l’argent nécessaire pour acheter, le groupe Crédit Lyonnais – en l’occurrence, la SDBO – met à leur disposition des crédits sous la forme de ce qu’on appelle des prêts à recours limité, c’est-à-dire des prêts assortis d’une sorte de clause d’intéressement : les partenaires – le prêteur et le prêté – s’entendent sur une clause de partage de la plus-value, du gain de croissance, qui sera dégagée par le bien dont l’achat est financé par le prêt.
Le tour de table se met en place et, le 10 février 1993, la cession d’Adidas intervient. Le même jour, les membres du tour de table consentent à M. Louis-Dreyfus, via sa société, une promesse de vente. Contrairement à ce qui a pu être soutenu, il ne s’agit ni d’un engagement ferme de M. Louis-Dreyfus d’acheter, ni d’un acte de vente. C’est une option d’achat : il a la liberté d’acheter dans un délai qui se termine à la fin de 1994, conformément au souhait qu’il a émis de voir ce que devenait Adidas sous sa direction et s’il y avait des perspectives de croissance et d’enrichissement. Le prix auquel M. Louis-Dreyfus s’engage à acheter s’il lève l’option dans le délai est de 3,7 milliards de francs. Ce chiffre ne vient pas d’une exoplanète : il correspond au business plan de l’entreprise, elle-même sous la gestion du groupe Tapie. M. Louis-Dreyfus prend la direction d’Adidas. Fin 1994, il lève l’option et l’achète.
Entre-temps, s’est déroulé un autre événement : le 13 mars 1994, M. Tapie et son épouse ont signé un protocole d’accord de séparation avec le Crédit Lyonnais maison mère – en fait avec nous puisque le Crédit Lyonnais se porte fort de la SDBO. Ce protocole correspond à la volonté des deux intéressés de mettre fin à la relation de clientèle bancaire. Je pense que M. Tapie détaillera ce point. La SDBO était devenue le banquier majoritaire, pour ne pas dire exclusif, du groupe Tapie. Cette situation n’était pas, j’imagine, très confortable à vivre ni d’un côté, ni de l’autre.
Ce protocole annule le mémorandum et, par là même, un certain nombre d’opérations de restructuration qui n’avaient pas eu lieu. Si les actifs proposés par le groupe Tapie pour désintéresser la banque ne suffisent pas à éteindre les prêts, elle accepte de faire remise du solde des créances à M. et Mme Tapie. Le problème est que le protocole est dénoncé quelques semaines après, le 17 mai 1994, par la banque, qui en notifie la caducité. M. Tapie ayant proposé des biens qu’il avait à sa disposition pour éteindre ses dettes, dont son mobilier, une des conditions du protocole était qu’une expertise des meubles devait être effectuée. Celle-ci n’ayant pas été produite dans les délais, pour des raisons que j’ignore, la banque a utilisé cet argument pour mettre fin au protocole. Il s’ensuivit toute une série de conséquences. Après que le tribunal de Paris eut constaté, au mois de novembre, la caducité du protocole et l’eut confirmée, une procédure de redressement judiciaire fut lancée, suivie assez vite, d’une procédure de liquidation judiciaire. Le groupe Tapie ainsi que M. Tapie personnellement ont été mis en liquidation.
Le CDR étant créé peu de temps après, j’arrive au moment où il commence à s’occuper de l’affaire puisque des contentieux apparaissent. Je vais préciser la genèse de cette affaire car on ne peut pas comprendre l’arbitrage si on ne sait pas quels sont les contentieux dont on parle.
On peut facilement imaginer que M. Tapie et ses avocats – techniquement ses liquidateurs, au sens juridique du mot – ne sont pas satisfaits. Ils lancent toute une série de procès pour, d’abord, faire annuler la déclaration de faillite et la liquidation qui a été prononcée et, ensuite, contester les opérations qui ont été conduites par les banques. Ils contestent, non seulement la rupture des relations de 1994, mais également – c’est finalement l’action principale – les conditions dans lesquelles la sortie d’Adidas du groupe Tapie a été organisée : ils attaquent en justice les banques pour avoir – c’est leur thèse, pas la nôtre – manqué au mandat qui avait été confié à la SDBO et organisé un tour de table qu’ils qualifient d’impur, puisqu’on y trouvait, selon eux, des opérateurs détenus en réalité par le groupe Crédit Lyonnais.
Toute une série de procès débutent alors, qui durent encore aujourd’hui. Aucun d’entre eux, sauf exception rare, n’est éteint en 2007 et 2008 : on en trouve encore une bonne douzaine à des stades inégaux. Certains sont encore en première instance devant des juridictions commerciales ou au tribunal de grande instance, d’autres sont en cours d’appel. Adidas est en retour de la Cour de cassation devant la Cour d’appel de Paris. Ce foisonnement d’affaires sur la table complexifie extraordinairement cette affaire et la fait durer.
Deux étapes importantes concernant Adidas proprement dit doivent être rappelées.
Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 septembre 2005 condamne, de manière un peu spectaculaire pour les commentateurs, les banques, c’est-à-dire le Crédit Lyonnais et ses filiales, à une indemnité au profit des liquidateurs du groupe Tapie. Le fondement de cette condamnation réside dans les prêts à recours limité, ce mécanisme particulier et un peu rare de financement des opérations de rachat d’Adidas qui comportait une clause de partage prévoyant que, au cas où il y aurait une plus-value dégagée sur Adidas, le vendeur, c’est-à-dire les nouveaux acquéreurs, recevrait 30 % de ce surcroît d’enrichissement et la banque, le financier qui porte le risque, 70 %. La thèse défendue par le groupe Tapie devant la Cour d’appel, et sur laquelle la Cour d’appel lui donne raison, est que ces prêts ont été proposés aux intervenants dans le tour de table intermédiaire, mais pas à lui alors qu’ils auraient dû également être mis à sa disposition. Il fait valoir que, faute d’avoir disposé de ces prêts qui lui auraient apporté un surcroît d’oxygène financier, il n’a pas été en mesure de conserver Adidas, de le développer et, ensuite, de le vendre au mieux de ses intérêts.
Tel est le motif précis de la condamnation à une indemnité de 135 millions d’euros, portée ensuite à 145 millions d’euros par la Cour d’appel de Paris.
Le CDR et le Crédit Lyonnais élèvent pourvoi. La Cour de cassation se saisit du dossier et rend, le 9 octobre 2006, en assemblée plénière, un arrêt sur lequel je vais m’arrêter un instant car il en est fait diverses présentations. Je suis heureux que M. Schneiter l’ait commenté avant moi. Je ne pense pas trop me départir de ce qu’il a dit. S’il est indéniable que cet arrêt constitue une victoire momentanée pour le CDR et le Crédit Lyonnais, je vais essayer de vous expliquer, en quelques minutes, qu’il ne pouvait en aucun cas s’agir d’une victoire absolue et intemporelle.
Cette cassation, qui est une cassation partielle – cela figure en toutes lettres sur l’arrêt – ne met pas fin aux procédures pouvant être formées par les liquidateurs dans la mesure où elle confirme la recevabilité de ces derniers à agir, qui avait été reconnue par la Cour d’appel de Paris. Or il ne s’agit pas de n’importe quelle recevabilité. Je vous invite à lire attentivement ces arrêts car ils ont leur importance. On parle d’une matière technique, juridique, compliquée. La Cour d’appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation – il y a unité de jurisprudence – reconnaît la recevabilité des liquidateurs de GBT. Pourquoi de GBT ? Parce que BTF, Bernard Tapie Finance, société cotée, qui était la sous-holding qui détenait indirectement Adidas, n’est plus, à ce moment-là, dans le groupe Tapie. En 1995, le CDR nouvellement créé, a exercé un gage constitué par un nantissement des titres de cette société, si bien que BTF a été ramenée dans le groupe CDR en position de filiale. Cela viendra en diminution d’ailleurs de la dette du groupe Tapie le moment venu. Cela veut dire qu’il ne reste plus dans la liquidation que la structure de tête, c’est-à-dire GBT. Or cette société n’était pas l’actionnaire direct d’Adidas. Le problème était donc de savoir si les liquidateurs de cette société et du groupe Tapie en général étaient ou non recevables, alors qu’ils n’étaient pas les détenteurs directs de l’ancienne participation dans Adidas, à venir rechercher une responsabilité supposée des banques. La réponse apportée par la Cour d’appel de Paris a été qu’ils avaient ce droit, mais pas n’importe quel droit. Ce qu’a dit très précisément la Cour d’appel, et qui a été validé par la Cour de cassation, c’est que les liquidateurs du groupe Tapie avaient le droit d’engager des procédures à condition de prouver que GBT avait un préjudice propre, indépendant de sa qualité d’actionnaire. En effet, bien que ce soit un peu étonnant – je livre cette particularité à la sagacité des membres de la commission des Finances – en droit français, un actionnaire d’une société n’a pas le droit de se plaindre de ce qui se passe dans une filiale ou même du fait qu’une filiale soit lésée ou autre, s’il ne peut prouver un préjudice propre. Il a des droits assez stricts et délimités. Les liquidateurs intervenant au nom d’un actionnaire ne peuvent pas mettre uniquement en avant la qualité d’actionnaire de leur client pour contester une opération qui s’est passée dans la filiale. La Cour d’appel de Paris, suivie par la Cour de cassation, a reconnu aux liquidateurs du groupe Tapie le droit d’agir sur la base de l’exécution du mémorandum signé par GBT, qui donnait à cette société des droits particuliers, indépendants de sa qualité d’actionnaire. Le contrat prévoyait, en effet, que le produit de la vente d’Adidas devait servir principalement, et presque exclusivement, à éteindre les dettes du groupe donc, en particulier, de la tête du groupe. Prétendre que toute recevabilité des liquidateurs était barrée est une erreur technique. Le chemin était certes étroit, mais il existait.
Deuxièmement, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel nous condamnant sur un motif et un seul, très précis. La Cour d’appel avait estimé que nous avions commis une faute en ne proposant pas de mettre à disposition du groupe Tapie les prêts à recours limité. La Cour de cassation qui, en l’espèce, a protégé les intérêts de la place bancaire de Paris, a refusé de reconnaître – il n’aurait plus manqué que cela ! – qu’il y avait une obligation de prêter. Elle a très normalement – et on peut tous s’en réjouir – annulé la partie de l’arrêt de la Cour d’appel qui indiquait clairement à des emprunteurs qu’ils avaient un droit absolu au prêt. Un banquier, d’après la Cour de cassation, a tout à fait le droit, pour des raisons fondées, de refuser un crédit. Comme la Cour d’appel nous a condamnés uniquement sur ce motif, son arrêt a été cassé par la Cour de cassation. Cela ne signifie pas, comme cela a malheureusement été dit ou écrit – ce qui me paraît être une approximation dommageable – que toute condamnation des banques était impossible. La Cour de cassation a écarté la responsabilité du Crédit Lyonnais maison mère dans l’exécution des contrats parce qu’elle estimait qu’il n’était pas signataire des contrats ou le faisait pour un tiers. Mais d’autres voies pouvaient être plaidées – avec succès ou pas, c’est une autre affaire. La Cour de cassation ne fermait pas la porte à une condamnation au titre, par exemple, de la responsabilité civile délictuelle prévue à l’article 1382 du code civil : la responsabilité pour faute indépendante d’un contrat. Par ailleurs, la responsabilité du CDR, c’est-à-dire des filiales du Crédit Lyonnais, SDBO ou Clinvest, pouvait parfaitement être recherchée. En tant que financier, banquier, prêteur, mandataire, il était un peu le Maître Jacques de l’affaire. Le fait de savoir si une juridiction reconnaîtrait ou pas cette responsabilité est une autre affaire. En tout cas, un droit à agir était ouvert aux liquidateurs sur tous les motifs que la Cour de cassation n’avait pas écartés. Deux étaient mis en avant depuis le début de cette affaire : l’exécution du mandat était-elle correcte ou non ? Le banquier avait-il ou non commis un manquement à l’interdiction de se porter contrepartie ? C’est un point important. Si vous demandez à un agent immobilier de mettre en vente un appartement, il n’a pas le droit de l’acheter lui-même et il commet une faute s’il le fait acheter par quelqu’un qu’il contrôle ou qui lui est proche. L’une des questions posées par nos adversaires et qu’il appartenait aux juridictions de trancher, était de savoir si, en composant le tour de table intermédiaire, les banques avaient ou non correctement agi.
Enfin, la Cour de cassation n’était pas une ligne de crête indépassable. Nous aurions souhaité qu’elle le fût. Mais ce n’était pas le cas. Elle avait laissé ouvertes un certain nombre de brèches : une sur la recevabilité, une autre sur les responsabilités qui pouvaient nous être imputées. La cassation n’était que partielle. Elle portait sur un seul motif de responsabilité et non pas, par avance, sur tous les motifs, en tout temps, en tout lieu. Elle n’était pas en acier inoxydable, elle n’était pas incontournable.
Telle est la situation juridique et factuelle fin 2006 à partir de laquelle nous avons agi. À cette cheville de mon exposé, je me dois de vous donner trois précisions utiles.
Premièrement, je reviendrai, après avoir lu des choses malheureusement inexactes, sur les conditions de ma nomination au CDR. J’ai été nommé le 20 décembre 2006 au terme normal du mandat de mon prédécesseur Jean-Pierre Aubert qui parlera dans cette salle dans un instant. Jean-Pierre Aubert était à quatre mois de son départ à la retraite. Il était difficilement envisageable de le prolonger très longtemps. Le mandat du conseil d’administration arrivant à son terme, celui-ci a été renommé et recomposé. Il était normal de nommer un nouveau dirigeant. On m’a proposé ce poste. Il n’échappera à personne que cette nomination prend place alors que M. Breton est ministre de l’économie et des finances, M. Dominique de Villepin, premier ministre et M. Jacques Chirac, président de la République. Je n’ai pas été nommé pendant le mandat de M. Sarkozy. J’ai été nommé à une échéance normale de la vie de cette société. Ce rappel, malheureusement, était nécessaire.
Deuxièmement, je précise que, à partir de maintenant, quand je dirai « la banque », il ne s’agira que du CDR. J’ai parlé du Crédit Lyonnais dans mon rappel historique mais le Crédit Lyonnais maison mère n’est pas partie à l’arbitrage – on pourra dire pourquoi mais je ne vais pas m’attarder là-dessus. Par ailleurs, le CDR a été créé par un protocole signé entre l’État et le Crédit Lyonnais pour protéger les intérêts du Crédit Lyonnais et les défendre. Je ne voudrais pas – je le dis publiquement – que, de près ou de loin, tel ou tel de mes propos puisse être déformé et utilisé contre le CDR et que le Crédit Lyonnais vienne se plaindre de mon comportement ou de mes actes. Il est hors de question que je dise quoi que ce soit sur le Crédit Lyonnais que j’ai la charge de protéger. Donc, quand je dirai la banque, il s’agit, premièrement, de SDBO, la Société de Banque Occidentale, la filiale qui a financé les activités industrielles du groupe Tapie et qui s’appelle aujourd’hui CDR Créances, filiale de premier rang du CDR et, deuxièmement, de Clinvest, banque d’affaires, qui intervenait en haut de bilan et qui s’appelle aujourd’hui CDR maison mère.
Troisièmement – c’est une tautologie mais j’ai tellement l’impression par moments d’être en position de défense que je préfère donner cette précision, quitte à passer pour un balourd – je ne suis pas, pour paraphraser un aphorisme récent et célèbre, un « copain » de M. Tapie. Je suis un haut fonctionnaire, à la carrière sans tache et sélectif dans le choix de ses « copains ». M. Tapie est une partie adverse. Cela signifie que nous ne sommes pas dans le même camp et que, aujourd’hui encore, comme l’arbitrage est toujours en cours, nous sommes des adversaires au sens juridique du mot. Nous ne sommes pas des ennemis. Je n’ai pas de raison particulière de détester M. Tapie mais ni moi-même ni ma société n’avons non plus aucune raison particulière de passer, de près ou de loin, pour ses affidés.
J’arrive maintenant à la genèse de l’arbitrage. Celui-ci n’a pas été demandé par le CDR. Il a été sollicité par les liquidateurs du groupe Tapie, en deux temps.
Premier temps. Fin janvier 2007, je crois – alors que j’avais été nommé le 20 décembre 2006 – je reçois un courrier, dont je suis d’ailleurs assez surpris, des liquidateurs de M. Tapie. Trouvant la procédure trop longue, ils suggèrent un arbitrage. Je me suis contenté d’une réponse purement d’attente, faisant valoir que, venant de prendre mes fonctions, je ne connaissais pas l’affaire, que, la décision devant se prendre au niveau des organes sociaux, on verra bien le moment venu et qu’il était hors de question de répondre sur le fond. Les choses en sont restées là.
Second temps. Le 1er août, une nouvelle sollicitation nous est adressée par les liquidateurs du groupe Tapie, qui nous réinvitent à accepter un dénouement de l’ensemble des contentieux nous opposant – je rappelle qu’il y en a une douzaine avec Adidas – par le biais d’un arbitrage. Nous acceptons d’étudier, dans un premier temps, cette proposition. Pourquoi ? Parce qu’un certain nombre de paramètres techniques – j’insiste sur ce qualificatif ; n’allez pas me faire dire ce que je ne dis pas – ont bougé.
Premier paramètre. Le président de la Cour de cassation a changé. Nous connaissions le point de vue de celui qui avait présidé aux travaux de l’assemblée plénière de 2006. Il était, en revanche, parfaitement oiseux de spéculer sur la position de la Cour de cassation, sous un nouveau premier président. C’est un premier élément de changement technique qu’il nous est apparu important de peser.
Deuxième paramètre : les demandes de l’adversaire ont été sérieusement modifiées, pour ne pas dire bouleversées, en juin 2007. Je rappelle que, au moment où le second courrier nous parvient, nous sommes devant la Cour d’appel de renvoi : la Cour de cassation a renvoyé le dossier à la Cour d’appel de Paris autrement composée. Je ferai à ce sujet une remarque. Ayant une formation juridique, je n’ignore pas la loi. Je sais parfaitement que la Cour de cassation a le droit de renvoyer à la même Cour d’appel, autrement composée. Néanmoins, même si ce n’est pas la même chambre ou les mêmes juges, on ne peut pas ignorer qu’il s’agit de la même juridiction, laquelle, dans notre cas, nous avait condamnés. Or, dans les écritures que les liquidateurs du groupe Tapie produisent devant cette Cour d’appel, en juin 2007, apparaît un fait étrange et nouveau : au lieu de demander, comme ils le faisaient d’habitude, la compensation plus ou moins intégrale de la plus-value qu’ils estimaient « avoir été abusivement captée par la banque », ce qu’ils appellent la « revente au double » – je mets des guillemets ; c’est leur thèse –, ils demandent la compensation du préjudice qu’ils auraient subi par une somme, certes extravagante mais inquiétante, partant de la valeur d’Adidas au moment où les écritures sont produites. L’entreprise ayant, entre-temps, été recédée par M. Louis-Dreyfus à de nouveaux actionnaires, elle est assez prospère et vaut, à ce moment-là, 9 milliards d’euros en capitalisation boursière à la bourse de Francfort. Or le groupe Tapie détenait 78 % dans cette société. Le calcul est simple à faire : il est question de quelque 7 milliards d’euros. Il est évident – ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire ; je ne suis pas en train d’essayer de vous vendre un propos de charlatan – qu’aucune juridiction, Cour d’appel ou autre, n’aurait consenti une telle indemnité. Cela étant, un juge du fond, quand il est saisi, a deux attitudes possibles : soit il part d’un raisonnement et, s’il estime que ce raisonnement conduit à une indemnité, il l’applique, soit il fait l’inverse et part de l’indemnité et trouve ensuite un raisonnement. Personne ne peut dire ce qu’aurait fait une juridiction du fond. C’est un morceau d’histoire qui n’a jamais été écrit et qui ne le sera jamais. Je sais bien – je réponds par avance à un argument que M. le rapporteur ne manquera pas de m’opposer – qu’on ne part pas de la valeur actuelle d’un bien. Tous les juristes le savent et moi le premier. Cette thèse ne pouvait pas prospérer. Mais il suffisait qu’en adossement financier, on nous demande, pour une faute alléguée, de payer une indemnité représentant 5 % de la somme exigée, cela faisait 350 millions d’euros, c’est-à-dire plus que ce que le tribunal arbitral a décidé. Je vois des députés hocher la tête. Mais nous craignions très fortement à l’époque qu’un juge du fond ne nous condamne à une somme potentiellement plus importante que la première fois. Lors du premier jugement, le moteur, si j’ose dire, était bridé. La thèse défendue alors par le groupe Tapie reposant sur les prêts à recours limité, une condamnation ne pouvait excéder 30 % de la plus-value correspondant à la clause de partage. Dès lors que la Cour de cassation avait écarté ce motif, la voie d’autres fautes était accessible – à condition, bien sûr, de les prouver ; encore une fois, nous avons combattu violemment les thèses de notre adversaire – et, là, il n’était plus question des mêmes chiffres. On peut discuter sur le sujet à n’en plus finir. En tout cas, théoriquement, ce calcul était accessible à un juge du fond.
Troisième paramètre : le contentieux concernant Adidas n’était plus seul en cause. Une douzaine d’affaires étaient sur la table. La crainte que nous avions – et c’est la raison pour laquelle nous avions accepté, non pas l’arbitrage, à cette époque, mais l’examen de celui-ci, ce qui n’est pas pareil, je ne suis toujours qu’à la genèse de l’arbitrage – est que, dans l’hypothèse où nous aurions été condamnés dans l’affaire Adidas par la Cour d’appel de renvoi – ce qui ne pouvait être écarté – toute une série d’effets indésirables auraient pu en découler en aval. On pouvait redouter, par exemple, d’être condamné une deuxième fois au titre d’un comblement de passif, c’est-à-dire de payer l’aggravation du passif causé par le consentement de la banque qui finance un peu trop longtemps un client en difficulté.
M. François Goulard : Ce qu’on appelle le soutien abusif !
M. Jean-François Rocchi : Tout à fait. Un des facteurs d’incertitude que nous avons est que le passif tiers n’est pas définitivement établi et que les délais n’ont pas couru. Ils sont toujours accessibles.
La thèse de nos adversaires d’une rupture abusive était également toujours sur la table et pouvait très bien nous valoir une autre condamnation. Toute une série de contentieux subsistaient. Une fois la bataille principale perdue, on pouvait craindre que de nombreuses batailles secondaires surgissent et nous valent condamnations sur condamnations pendant deux, trois, quatre ou cinq ans. Il ne faut pas non plus jouer à se faire peur et tomber dans la caricature. Mais il est clair que, si l’on avait subi des défaites à répétition, l’effet aurait été désastreux et notre position aurait été très affaiblie, y compris dans d’autres procès que nous menons par ailleurs.
Quatrième paramètre : un problème sérieux de délai se posait car cette affaire aurait duré encore beaucoup d’années. L’argument du temps nous est souvent opposé. Ceux qui estiment que l’arbitrage n’aurait jamais dû être organisé, avancent, comme premier argument, que nous aurions dû nous en remettre à la justice officielle, à la justice étatique…
Le Président Didier Migaud : La justice n’est pas étatique. C’est la justice tout court !
M. François Bayrou : La justice n’a rien à voir avec l’État. C’est la justice de la République !
M. Jean-François Rocchi : J’emploie cette expression par opposition à celle de « justice privée » qui a été utilisée. Il est clair que la justice – sans qualificatif – pouvait très bien s’occuper de ces contentieux pendant encore de longues années. L’autre argument avancé par les détracteurs de l’arbitrage est que nous avions le temps pour nous, comme si nous disposions de l’éternité. Le CDR, structure de défaisance, n’est pas une structure éternelle. Elle a une durée de vie limitée à 2014 au plus tard. Mais je doute qu’elle atteigne cette date. Il est assez vraisemblable que les pouvoirs publics demandent un jour à ce que cette affaire s’arrête. Donc, l’argument du temps qui passe n’est pas valide, d’autant que, si nous avions perdu, nous pouvions craindre, je l’ai indiqué, d’être condamnés de manière répétitive. Le temps qui passe n’est plus alors un avantage mais, au contraire, un chemin de croix.
Cinquième paramètre, purement technique mais qui a son importance parce qu’il fait partie du débat actuel : la Cour d’appel de Paris avait décidé – et la Cour de cassation n’a pas cassé cette décision ; c’est, d’ailleurs, pour cela que le tribunal arbitral a, à sa suite, décidé un calcul d’intérêt – que l’indemnité qu’elle avait ordonnée au bénéfice du groupe Tapie devait être actualisée, c’est-à-dire, dans le vocabulaire juridique, produisait des intérêts de retard depuis le début de l’affaire, soit 1994. Sur quatorze ans, cela fait une somme importante. Or cette disposition ne joue malheureusement qu’au seul bénéfice de nos opposants : la loi permet à un liquidateur de faire courir des intérêts mais, pour que les intérêts des créanciers que nous étions courent, il fallait que des conditions bien spécifiques soient remplies, et elles ne l’étaient pas. Aux termes de l’article 55 de la loi sur les procédures collectives qui s’appliquait alors, les crédits représentant nos créances ne pouvaient produire d’intérêts que s’ils étaient supérieurs à un an. Entre 20 et 25 % de nos encours, je crois, de tête, étaient des crédits à moyen et long termes et auraient pu produire intérêt, mais il fallait encore que des procédures biens strictes soient respectées – production du contrat de prêt, indication précise des échéances, tableau d’amortissement, taux – et elles ne l’avaient pas été. Sans que l’on sache trop pourquoi, peut-être parce qu’elle était prise par l’urgence, la banque a produit une créance un peu rapidement en marquant, en face de la rubrique « Intérêts », la mention : « un franc (à parfaire) ». Et personne n’a jamais rectifié. Au bout de dix ans, il y a eu prescription. Voilà pourquoi il n’est plus possible aujourd’hui de demander quelque intérêt de retard que ce soit en notre faveur. Dans un tel contexte, le temps qui passe est un handicap sérieux.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous avons accepté d’étudier la possibilité d’un arbitrage. Nous avons pesé les risques, demandé quelles garanties pouvaient nous être données, examiné l’organisation et les procédures.
Je précise, même si cela peut susciter l’ironie, car c’est une tautologie, que je n’ai pas engagé un arbitrage pour le perdre. J’aurais bien aimé le gagner en totalité et je pensais le gagner. En tout cas, il n’y avait pas un risque de perdre plus grand que selon le cours habituel de la justice.
Nous avons estimé que, si nous avions une possibilité de clôturer définitivement tous les contentieux qui pouvaient se révéler risqués pour nous, nous pouvions étudier la possibilité de procéder de la sorte. En septembre 2007, j’ai demandé, après débat, au conseil d’administration du CDR de m’autoriser à confier à nos avocats un mandat de discussion. Avant de dire oui ou non, il fallait vérifier si les conditions de l’arbitrage nous convenaient.
Avant de poursuivre, je m’arrêterai un instant pour dire ce qu’est un arbitrage et préciser de quel arbitrage on parle dans le cas qui nous occupe. Tout d’abord, un arbitrage n’est pas une transaction. Des possibilités de médiation, de transaction, de conciliation ou d’autres formules conventionnelles non judiciaires avaient été examinées avant que je n’arrive mais elles n’avaient jamais abouti. L’arbitrage est une procédure juridictionnelle qui donne lieu à une sentence, laquelle est une décision judiciaire. Ce n’est pas une complaisance ni un cadeau. L’arbitrage est une procédure strictement encadrée. Certains parlementaires présents dans cette salle sont à l’occasion arbitres. Ils savent ce dont je parle. L’arbitrage est une modalité légale. Il prend appui sur le nouveau code de procédure civile, qui y consacre pas moins de soixante articles. Ce n’est pas une technique improvisée par des parties qui inventent un règlement. Il est encadré, codifié. Les parties doivent, d’abord, définir le cadre procédural, c’est-à-dire qu’elles doivent s’entendre – une négociation est prévue et est obligatoire – sur le cadre de travail. Dès lors qu’on choisit une modalité judiciaire qui n’est pas la voie suivie précédemment, il est indispensable d’établir un règlement de procédure par écrit. Ce règlement de procédure doit suivre le code mais les parties ont la faculté d’écrire, dans le respect de la loi, un certain nombre de dispositions relevant de leur volonté commune : par exemple, les délais ou le choix des arbitres.
Il était donc normal que je demande au conseil d’administration du CDR un mandat de négocier puisque, si certaines modalités étaient prévues, d’autres n’étaient pas strictement écrites, sur lesquelles il fallait délibérer.
Je m’arrête un instant sur l’argument selon lequel ce serait de la justice privée et sur l’accusation selon laquelle nous aurions privatisé la justice. Il est certain qu’un tribunal arbitral n’est pas une juridiction permanente.
M. Jérôme Cahuzac : Ni publique !
M. Jean-François Rocchi : C’est une juridiction composée pour une affaire donnée à un moment donné dans un cadre procédural donné. Pour autant, ce n’est pas une juridiction clandestine ou improvisée, ni un tribunal de rencontre, de hasard ou de complices. Cette procédure dérive de la loi et s’exerce sous le contrôle de la justice. Dans l’affaire qui nous occupe, celle-ci est intervenue deux fois.
Premièrement, le tribunal de commerce de Paris, qui est une juridiction permanente, a homologué le fait pour les liquidateurs de pouvoir signer le compromis. Sans cette autorisation, ces derniers ne pouvaient pas signer le règlement qui organise l’arbitrage. A ce stade, le Parquet est représenté et je crois me souvenir – j’étais présent en tant qu’observateur extérieur car cette procédure regarde simplement le tribunal de commerce et les liquidateurs – que le Parquet a produit des observations. Si ces dernières avaient été négatives, il aurait cru bon, j’imagine, de le faire savoir. La justice a donc validé cette phase.
Deuxièmement, à la fin de l’arbitrage, lorsque la sentence a été prononcée – j’y reviendrai peut-être tout à l’heure parce que cela a des conséquences sur le paiement –, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire. Il s’agissait encore d’une modalité un peu privée. Pour rendre la sentence pleinement applicable et opposable, les liquidateurs ont demandé l’exequatur.
M. François Goulard : C’est une formalité !
M. Jean-François Rocchi : C’est, certes, une formalité, mais au sens plein du mot. Si l’exequatur n’avait pas été donné, la sentence n’aurait pas été exécutoire dans toutes ses dimensions. Or elle l’est parce que le tribunal de grande instance a accordé l’exequatur.
Ce n’est pas une formalité automatique. J’ai relu hier un certain nombre de points de jurisprudence. Des contestations sont parfois formées. Il y a des renvois dans le code de procédure civile sur la façon dont cette décision d’exequatur peut être contestée. C’est bien la preuve qu’elle n’est pas accordée de plein droit, en tout temps, en tout lieu et que le tribunal peut la refuser. Dans le cas qui nous occupe, le tribunal de grande instance est intervenu et l’a accordée.
Il n’y a donc pas lieu de parler de justice privée et de justice non privée. Si le cadre de l’arbitrage est conventionnel, celui-ci ne s’organise pas de manière sauvage.
Il ne faut pas oublier non plus qu’il s’agissait d’un contentieux commercial découlant, d’une part, de la vente d’une entreprise, d’autre part, de la rupture d’une relation de banquier à client.
La discussion autorisée par le conseil d’administration s’est organisée par le biais des avocats.
Nous avons exigé que ce soit un arbitrage en droit, c’est-à-dire appliquant la loi. Il existe également un arbitrage en équité, mais il se situe en dehors du droit.
Nous avons également exigé que le patrimoine juridictionnel de ce dossier – notamment l’arrêt de la Cour de cassation qui nous profitait – soit applicable, c’est-à-dire que nous avons demandé et obtenu de nos adversaires que l’arrêt de la Cour de cassation soit obligatoire pour les arbitres.
Par ailleurs, nous avons demandé que toutes les procédures antérieures – c’était précisément le but de l’arbitrage – s’arrêtent. Ces procédures étaient comme un disque rayé : elles étaient à chaque fois réamorcées et remises sur le plateau de lecture par M. Tapie et ses avocats. Ce n’était pas des procédures que nous avions formées. Sur les douze procédures qui ont été fusionnées dans l’arbitrage, une seule a été faite sur demande du CDR. Elle concernait le bateau car nous cherchions à récupérer de l’argent que nous devait M. Tapie. Tout le reste était actionné par le groupe Tapie. Cela signifie que nous étions à chaque fois en défense et que, à chaque fois, nous pouvions faire l’objet de nouvelles procédures. Il fallait, à un moment donné, sortir de cette situation.
J’ai lu, à ce sujet, dans un journal, un commentaire qui m’a un peu étonné. Il y était écrit en substance : « vous voyez bien que c’est un cadeau à M. Tapie puisque les procès s’arrêtent. » L’une des questions qui ont le plus préoccupé mes administrateurs au moment où l’on discutait de la possibilité de faire un arbitrage, était de savoir si, dans l’hypothèse où nous le gagnions – je rappelle que c’était une hypothèse que nous pouvions sérieusement envisager –, M. Tapie et ses liquidateurs pouvaient revenir par la porte de derrière après avoir été chassés par la porte de devant et rouvrir des procès. C’était ça notre inquiétude. Lorsqu’on obtient, dans le compromis que vous avez sous les yeux, le désistement total et définitif des procès faits par l’adversaire, quel est celui qui renonce le plus : le CDR ou l’adversaire ? C’est l’adversaire par définition. C’était donc une garantie pour nous. Nous voulions être sûrs que M. Tapie et ses avocats ne puissent pas revenir par-derrière si nous gagnions.
Il s’agissait également de faire revenir l’adversaire à des prétentions raisonnables par rapport à sa demande extravagante de 7 milliards d’euros. S’il voulait un arbitrage, il devait accepter de plafonner ses demandes. C’est le B.A.-BA. Tous les spécialistes vous le diront. Aucun arbitrage à partir d’un compromis ne peut s’engager si celui qui introduit l’arbitrage ne chiffre pas sa demande. Cela ne veut pas dire qu’on accepte ce chiffre. Il n’y a pas un consentement par avance à une indemnité contractuelle. Je le précise car il y a des malentendus à ce sujet. Encore une fois, ce n’est pas une transaction. Cela veut dire que le tribunal, dans sa mission, délimitée par les parties, a la charge de dire, en droit, s’il y a ou non des fautes à l’intérieur de ce plafond. Mais il n’est pas obligé de saturer ce dernier. Il peut très bien être à zéro ou à tout autre niveau.
L’ensemble de ces garanties ayant été obtenu, nous avons soumis, début octobre 2007, au conseil d’administration du CDR le projet de règlement. À l'issue des discussions, de nouvelles conditions ont été intégrées. Nous avons souhaité que soient rappelées nos créances afin qu’elles soient étayées et deviennent plus certaines car nous craignions que l’adversaire les conteste. La référence expresse non pas seulement à l’autorité de la chose jugée mais à l’arrêt de la Cour de cassation, dûment daté, a également été rajoutée à notre demande. Comme vous le voyez, le sujet a été longuement débattu et nous avons demandé, négocié et obtenu des garanties procédurales importantes.
Le conseil a délibéré et s’est prononcé par quatre voix sur cinq – donc à une très large majorité – en faveur de la signature du compromis.
Le conseil d’administration de l’EPFR s’est prononcé le 10 octobre. Je n’y reviens pas en détail. Vous avez entendu ce matin son ancien président. L’EPFR est notre actionnaire et se prononce, à la suite du CDR, sur les affaires importantes concernant ce dernier. Il a le pouvoir de l’empêcher d’agir sur ses dossiers puisqu’il apporte une garantie. Il a validé la position du CDR ou, plus précisément, ne s’est pas opposé à la position du CDR, à l’unanimité, c’est-à-dire par cinq voix sur cinq. Cela figure au procès-verbal.
M. Charles de Courson : Je conteste cette affirmation. Comme je suis membre du conseil d’administration de l’EPFR et que je n’étais pas là lors du vote final, celui-ci ne peut pas être unanime. Cela étant dit, cela ne change rien à la décision, le vote ayant été acquis pas quatre voix sur cinq.
M. Jean-François Rocchi : Je dispose d’un procès-verbal qui montre que le vote a été unanime.
J’en viens au déroulement de l’arbitrage.
Dès lors que le tribunal de commerce de Paris a validé par homologation le compromis, le tribunal arbitral commence son travail. Il est composé de trois personnalités choisies d’un commun accord par les parties et leurs avocats, selon le principe même de l’arbitrage. Nous avons souhaité, pour notre part, que le choix se porte sur des personnalités incontestables, c’est-à-dire qu’aucun doute ne puisse être jeté sur leur nature, leur qualification et leur impartialité. Ont été désignés, d’un commun accord, le président sortant du Conseil constitutionnel, une personnalité dont l’indépendance est parfaitement connue - personne ne peut le soupçonner d’être influencé –, un ancien avocat très important du barreau de Paris, compétent dans les matières civiles et commerciales, et un ancien premier président de Cour d’appel qui avait également travaillé sur ces sujets et était, par ailleurs, arbitre dans différents dossiers. Ces personnes avaient toutes de l’expérience, connaissaient les dossiers et le droit. Tout permettait de penser, à commencer par leur âge – sur lequel on a beaucoup ironisé – que plus grand-chose ne pouvait leur être demandé ou proposé pour les séduire. Ils étaient, par définition, de grande indépendance.
Ce tribunal s’installe au mois de janvier, organise sa procédure et conduit celle-ci pendant à peu près un semestre après avoir demandé des mémoires aux parties. Nous avons échangé chacun trois mémoires : un premier mémoire de l’adversaire puisque c’est lui qui introduisait la demande, auquel nous répondons, puis un deuxième et un troisième mémoire de l’adversaire, auxquels nous répondons à chaque fois. Je rappelle qu’il s’agit d’une procédure sérieuse, que nous avons conduite avec l’idée de gagner. Nous n’avons fait aucune concession à l’adversaire et avons produit des écritures fort volumineuses. Notre premier mémoire fait 2 500 pages. Ce n’est pas un travail improvisé sur un coin de table avec une feuille volante. La procédure a été dense et extrêmement fouillée.
Le tribunal arbitral a tenu, début juin, deux audiences classiques comme n’importe quelle autre juridiction, avec des plaidoiries, des questions, des réponses et des productions de pièces. Il a ensuite pris un délai pour la rédaction de sa sentence. Celle-ci nous est parvenue au début du mois de juillet. Il n’y a pas de date précise puisqu’elle nous a été adressée par courrier.
Cette sentence est normalement connue. Je me bornerai à en rappeler les dispositions principales.
Le Président Didier Migaud : Elles sont connues, monsieur le président. Vous pouvez avancer dans l’exposé des faits afin de laisser un peu de place aux questions.
M. Jean-François Rocchi : On les commentera après si vous le voulez.
La sentence prononcée, restait à savoir si le CDR faisait ou non un recours en annulation. L’article 1484 du nouveau code de procédure civile nous permettait de saisir la Cour d’appel de Paris soit sur le motif de la violation de l’ordre public, soit sur celui - puisque les autres motifs n’étaient pas en cause ; le tribunal avait, notamment, correctement composé les motifs de forme – du dépassement par les arbitres de leur mission. Il importait de vérifier si, en prononçant cette condamnation, les arbitres avaient ou non respecté l’arrêt de la Cour de cassation comme ils y étaient tenus par le compromis. La question a été soulevée devant les conseils d’administration qui l’ont étudiée avec méticulosité. Le conseil d’administration du CDR s’est réuni trois fois. Et nous avons consulté plusieurs avocats.
Le sujet étant complexe, je ne peux le détailler en quelques minutes. Les consultations ne nous ont pas donné l’impression de pouvoir parvenir à un consensus. Certains juristes estimaient que nous avions des chances raisonnables ou absolues. D’autres s’en tenaient à des « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». D’autres encore nous disaient que nous n’avions aucune chance. Cette pluralité d’opinions nous a quelque peu embarrassés. La question qui se posait à nous, dès lors, était de savoir si, comme certains nous y incitaient, nous devions et pouvions faire ce que j’appellerai un recours de précaution, ou un recours pour voir, ou un recours au cas où. C’était tentant, et possible. Mais il faut savoir que, si nous l’avions fait, il est assez probable que nous serions allés au-devant d’une nouvelle défaite judiciaire. Nous aurions également eu des phénomènes indésirables à effet immédiat. Les liquidateurs du groupe Tapie nous proposaient des modalités d’exécution de la sentence assez accommodantes pour l’État et le CDR, à savoir un paiement dans un délai différé, sans calcul d’intérêts. Par ailleurs, au moment où la sentence est parue, l’arbitrage n’était pas clos. Il ne l’est d’ailleurs toujours pas. Ce n’est qu’une première sentence, un certain nombre de sujets – fiscaux ou de calcul d’intérêt – ayant été renvoyés à plus tard. La sentence étant revêtue de l’exécution provisoire, les liquidateurs pouvaient nous demander de payer la totalité tout de suite, ce qui nous aurait été extrêmement préjudiciable. Lorsque nous avons évoqué l’éventualité d’un recours, les liquidateurs nous ont menacés de nous appliquer un certain nombre de mauvais traitements. En revanche, si nous y renoncions, ils se sont déclarés prêts à nous faire des concessions. Je ne peux pas en donner le détail car certaines vont peser sur la suite de la procédure et le tribunal arbitral n’en est pas encore saisi officiellement. Je ne veux pas paraître enfreindre la confidentialité de ses travaux. Je me bornerai à indiquer que l’adversaire renoncerait à certaines demandes qu’il avait présentées, ce qui représenterait un avantage économique pour nous. J’ai chiffré la totalité des renonciations des liquidateurs dans cette lettre à 70 millions d’euros.
Compte tenu de l’incertitude juridique d’un côté, et des concessions consenties de l’autre, le conseil d’administration du CDR a estimé, par trois voix sur cinq, qu’il ne pouvait pas faire de recours.
Le débat s’est alors porté devant l’EPFR, dont le conseil d’administration, par quatre voix sur cinq, a validé la position du CDR.
Voilà où nous en sommes.
Bien que j’aie conscience d’avoir déjà parlé trop longtemps, je souhaite m’attarder quelques instants sur un point qui a été soulevé ce matin, à savoir la légalité de la procédure.
Premièrement, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, l’arbitrage dont il est question prend sa racine dans le nouveau code de procédure civile, qui y consacre de longs développements. Ce n’est donc pas une procédure improvisée.
Deuxièmement, le CDR étant une société anonyme, régie par le droit commercial, elle a tout à fait le droit de recourir à l’arbitrage, surtout sur un sujet de matière commerciale. Ce n’est pas d’un usage très courant mais ce n’est pas pour autant rare.
La question soulevée ce matin était de savoir si le CDR, détenu à 100 % par un établissement public administratif, avait le droit d’aller à l’arbitrage ou non. Je rappelle que ce n’est pas l’EPFR qui est partie, c’est le CDR. L’EPFR intervient dans un mécanisme de garantie générale, posée par le protocole de 1995 et mentionnée, d’une certaine manière, dans la loi de 1995 elle-même. Il n’y a pas, à ma connaissance, de principe général et absolu interdisant à une filiale d’un établissement public administratif de se porter à l’arbitrage. D’ailleurs, le CDR a engagé ou a été défendeur dans sept arbitrages depuis sa fondation, dont certains fort lourds. L’un portait sur 1,7 milliard de francs. Ce n’était pas une mince affaire. Si l’on avait décelé une impossibilité pour lui de le faire du fait qu’il est détenu par l’EPFR, je pense que ce point aurait été soulevé bien avant.
Le Président Didier Migaud : Le CDR se porte à l’arbitrage y compris dans les affaires franco-françaises ?
M. Jean-François Rocchi. Oui. Celle que j’ai mentionnée est une affaire purement nationale. Quand il y a des adhérences internationales, on n’est pas complètement certain de la qualification du sujet. Je ne voulais pas mettre cet argument en avant mais, puisque votre question m’y pousse, j’indique qu’il est possible qu’il y ait un arbitrage international, compte tenu du fait qu’on parle d’une société allemande. Dans ce cas-là, un établissement public administratif peut porter un arbitrage.
En 1989, le Conseil d’État a été saisi d’une affaire qui intéressait un contentieux de travaux publics pouvant impliquer la société des autoroutes de la région Rhône-Alpes et la caisse nationale des autoroutes. Cette dernière, qui est un établissement public administratif, n’était pas directement partie mais elle intervenait du fait d’un mécanisme d’adossement financier qui l’impliquait. Le cas est similaire avec celui du CDR. Le Conseil d’État ne s’est pas prononcé directement sur cet argument puisque, selon sa technique jurisprudentielle bien connue, il n’en a pas besoin s’il estime qu’il a un autre moyen d’agir. En revanche, le commissaire du Gouvernement, M. Guillaume, qui, en tant qu’ancien directeur des affaires civiles et du sceau, sait de quoi il parle, a livré, dans ses conclusions, son opinion au Conseil d’État. Il a indiqué que le fait d’interdire de manière absolue, au nom de l’article 2060 du code civil, à une filiale d’une société dépendant d’un établissement public administratif de se porter à l’arbitrage serait « trop vague et extensif ». Il précise que : « le fait de dire qu’une personne publique est intéressée à un arbitrage comme le dit le code, nous aurions tendance à dire que la personne publique est intéressée dans la mesure où elle est partie. » Le CDR est partie, pas l’EPFR.
Tels sont les éléments que je voulais rappeler, monsieur le président. Pardonnez-moi d’avoir été un peu long.
Le Président Didier Migaud : Je souhaite une précision pour compléter ce que nous a dit ce matin l’ancien président de l’EPFR : si le conseil d’administration de l’EPFR avait décidé de s’opposer à la décision d’arbitrage, qu’auriez-vous fait ?
M. Jean-François Rocchi : Rien, puisque l’EPFR a le pouvoir d’empêcher le CDR d’agir.
M. Jean-Pierre Brard : Voilà qui est clair !
M. Charles de Courson : J’ai six questions à vous poser, monsieur le président du CDR, auxquelles je vous demanderais de bien vouloir répondre une par une pour bien les sérier.
Ma première question porte sur les raisons que vous avez données a priori – une autre portera sur l’a posteriori – pour aller à l’arbitrage.
Première raison : laisser la justice se dérouler présentait un risque plus élevé que d’aller à l’arbitrage parce que la maison Tapie et ses liquidateurs avaient porté leurs demandes à 7 milliards d’euros. Mais cela n’avait rien à voir puisque la plus-value dont ils prétendaient avoir été privés concernait la cession d’Adidas à Robert Louis-Dreyfus, les sommes concernées alors étant, je le rappelle, de 301 millions d’euros. Donc cet argument est un sabre de bois.
Deuxième raison : on risquait, en allant devant la Cour d’appel, d’en sortir avec une condamnation pire que la première. Je rappelle que la Cour d’appel avait condamné le CDR à 135 millions d’euros…
M. Jean-François Rocchi : Portés à 145 millions d’euros !
M. Charles de Courson : …portés à 145 millions d’euros. Quel risque y avait-il puisque l’arrêt de la Cour d’appel avait été cassé par la Cour de cassation en assemblée plénière ?
M. Pascal Clément : D’autant que l’arrêt de la Cour de cassation, il faut le rappeler, fixait un plafond de 185 millions d’euros !
M. Charles de Courson : Quand un arrêt de la Cour de cassation est pris en assemblée plénière, la Cour d’appel de renvoi est tenue par le dispositif et par l’exposé des motifs de celui-ci. Donc, ce dernier argument, à mon avis, ne tient pas non plus.
La crainte d’une condamnation pour soutien abusif tient encore moins. Comme je l’ai expliqué ce matin, la quasi-totalité des créances étaient des créances du CDR : 163 millions pour le SDBO et une dizaine de millions de créances privées. La probabilité que l’un d’entre eux s’engageât dans une procédure était très faible.
La quatrième raison que vous avez invoquée est plus subtile : l’éventuelle indemnité porterait intérêt à partir de novembre 1994 alors que, par une faute de l’organisme de défaisance, aucune des dettes ne porterait intérêt. C’est un argument valable, mais il est tout de suite contrecarré par un contre-argument : à savoir que vous plaidez déjà l’échec.
De tous les arguments que vous avez soulevés, il n’y a que la moitié du quatrième qui tienne. Qu’avez-vous à répondre à cette première question ?
M. Jean-François Rocchi : Le CDR a admis – et non proposé – l’arbitrage, non pas parce qu’il estimait courir un risque plus important en laissant filer les choses, mais parce qu’il estimait que le risque encouru était en quelque sorte « neutre ». En effet, le moyen par lequel la Cour de cassation avait écarté la première condamnation était fondé sur le refus d’octroyer des prêts à recours limité – limitant mécaniquement l’indemnité perceptible à 30 %. Mais les autres moyens étaient ouverts et on ne pouvait les connaître par avance. Deux moyens, accessibles à un juge du fond, s’imposèrent néanmoins à notre esprit : l’exécution du mandat et l’interdiction de se porter contrepartie. C’est d’ailleurs ceux que le tribunal arbitral a utilisés pour nous condamner.
J’appelle votre attention sur un point technique, assez défavorable à nos thèses et qui nous a toujours handicapés : la charge de la preuve incombe au mandataire, et non au client, quand bien même il s’agirait d’un industriel entouré de conseils éminents. Or le mandataire, qui était la SDBO, n’avait pas, dans ses archives, de compte rendu de mandat – ce qui est pourtant habituel. Il se trouve que je suis également président d’une autre société nationale, l’Entreprise minière et chimique (les anciennes Potasses d’Alsace) et que je vends mes dernières filiales, qui sont à l’étranger. Pour cela, je me suis adressé à des banques d’affaires. Et il est clair que je ne paie jamais le moindre honoraire à celles-ci si je ne dispose pas d’un compte rendu de mission m’indiquant ce qu’elles ont fait.
En l’occurrence, sans ce document, nous étions en défaut de preuve et il était impossible de faire valoir nos thèses. Dans un tel cas, les thèses de l’adversaire sont reçues en totalité ; c’est ce qui s’est passé.
L’interdiction de se porter contrepartie ne concernait pas tant Clinvest, dont la présence avait déjà été reconnue lors du tour de table précédent par le Groupe Tapie, que le fonds Oméga. Nous avons essayé de démontrer que ce fonds n’était pas notre propriété, mais celle de la banque Citistar, en produisant une attestation. Le problème est qu’Oméga collectait des fonds, dans une proportion de 96 %, de notre part. Voilà pourquoi le tribunal arbitral a considéré que nous étions, à ses yeux, contrepartie, ce qui constituait, pour lui, une deuxième infraction.
Ainsi, au moment où s’engage l’arbitrage, nous n’avions aucune certitude, ni dans un sens, ni dans l’autre, et il était tout à fait admissible de penser que des tribunaux successifs risquaient de nous condamner pour ces motifs, dans la mesure où ils n’avaient pas été tranchés.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Il serait très important que nous éclaircissions la période qui va de décembre 1992 à février 1993, dans la mesure où elle est à l’origine de tout ce qui s’est passé ensuite.
L’arrêt de la Cour de cassation est en apparence favorable, mais il comporte plusieurs dangers : il permet aux liquidateurs de poursuivre leur recours ; il n’invalide la décision de la cour d’appel qu’au titre d’un non consentement de prêts à Bernard Tapie – prêts qui avaient été proposés aux autres parties.
Le Groupe Tapie a signé le 16 décembre 1992 au profit de la SDBO un mandat de vendre à un prix supérieur à 2 milliards de francs ; quelques semaines après, une option unilatérale est ouverte au profit du groupe Robert Louis-Dreyfus, à exercer au plus tard à la fin de l’année 1994, pour 4 milliards de francs. Le double du prix en trois semaines ! Cela paraît incompréhensible. Existe-t-il un compte rendu de ce qu’a fait la banque pendant ce laps de temps ?
Au printemps 1994, sont intervenues : la rupture, la mise en liquidation et la décision, par le Crédit Lyonnais, de recouvrer. Concrètement, qui est majoritaire au titre du portage des actions Adidas ? Celles-ci n’ont pas encore été acquises par le groupe Louis-Dreyfus. Quelle qu’aurait été la cour d’appel saisie, l’appréciation du risque est bien liée à la manière dont ce mandat a été exercé pendant ce laps de temps. Pour apprécier le bien fondé du recours à l’arbitrage, nous avons besoin de savoir ce qui s’est passé.
Nous avons passé beaucoup de temps sur ce qui s’est passé ces six derniers mois Mais j’aimerais que l’on passe aussi du temps sur cette période.
M. Jean-François Rocchi : Je voudrais opérer une rectification de langage : vous parlez de « portage », or c’est le mot qui fâche, et qui est utilisé par nos adversaires. Nous parlons pour notre part d’ « actionnariat de transition ». En mars 1994, il me semble que M. Louis-Dreyfus n’avait pas encore exercé son option et que c’est toujours l’actionnariat de transition qui était en place.
La crainte que nous avions d’être condamnés par la cour d’appel à une somme plus importante était réelle. Si une cour reconnaissait, comme a pu le faire le tribunal arbitral, que nous avions été déloyaux ou contrepartistes, on pouvait redouter que l’on n’accorde à nos adversaires un montant proche de la plus-value, voire pire. En effet, la Cour de cassation autorisait une cour du fond à prononcer en faveur de GBT un préjudice par ricochet, comme l’a reconnu le tribunal arbitral – préjudice qui n’est pas immédiat et qui s’explique par le fait que GBT aurait continué à détenir Adidas pendant plusieurs années. Dans ce cas de figure, on sort de l’épure, et on n’est plus sur les mêmes chiffres. C’était tout à fait possible, du moins en théorie.
M. Charles de Courson : Ma deuxième question concerne la convention d’arbitrage. Il est tout de même extraordinaire qu’on ait fixé un plafond d’indemnisation de 290 millions d’euros soit, à peu de chose près, les 301 millions de la plus-value de Robert Louis-Dreyfus ; et que l’on ait fixé à 50 millions le montant du préjudice moral. Je m’étais interrogé à ce sujet, et l’on m’avait répondu que les 290 millions d’euros étaient un peu en dessous des 301 millions – alors même que la Cour de cassation avait annulé cette partie du jugement de la cour d’appel qui avait retenu 30 % de la plus-value ; et que les 50 millions correspondaient à la moitié de ce que les époux Tapie demandaient. Sauf que la sentence arbitrale a retenu à peu près 80 % de l’indemnisation et 90 % du plafond du préjudice moral. Pourquoi êtes-vous allés aussi haut ? Pourquoi n’êtes-vous pas allés beaucoup plus bas ?
M. Jean-François Rocchi : Quand on signe un compromis, l’entrée en arbitrage postule mécaniquement que la demande de celui qui introduit cet arbitrage soit chiffrée. Il appartenait donc au Groupe Tapie de chiffrer sa demande, sans que cela emporte notre adhésion et sans que cela vaille transaction.
Je remarque que si j’avais accepté un montant fort modeste, on aurait pu légitimement dire que j’étais dans une transaction cachée. Cela n’aurait pas eu de sens : on ne fait pas un arbitrage dont le motif principal porte sur 300 millions pour un enjeu limité à 50 ou 100 millions.
Le montant de l’indemnisation, soit 290 millions, est en effet proche de la conversion en euros de l’écart de plus-value entre le prix de vente à l’actionnariat de transition, d’un côté, et le prix de revente à la société de M. Louis-Dreyfus, de l’autre. C’est tout à fait normal : de tous temps, sauf en juin 2007, la demande de l’adversaire a porté là-dessus. L’arbitrage ne pouvait s’engager que sur la question en débat, à savoir : ce que l’adversaire entend par captation de la plus-value. Le dossier Adidas porte sur un écart de plus-value, et rien d’autre.
M. François Goulard : N’était-il pas possible, sachant que la partie adverse était demanderesse, de répondre que vous étiez prêt à accepter l’arbitrage, à la seule condition qu’elle limite sensiblement ses prétentions ? Une négociation a-t-elle eu lieu sur ces plafonds ?
M. Jean-François Rocchi : Oui, les avocats ont discuté de ces sujets. Sans avoir de détails, je sais que tous les paramètres ont été étudiés. Encore une fois, il n’est pas étrange, dans la mesure où un sujet n’est pas clos, de le mettre sur la table. On ne parlait pas d’autre chose que de cette plus-value.
M. Nicolas Perruchot : La question de mon collègue Goulard ne portait pas sur le fait de savoir s’il y avait eu des échanges entre les avocats, mais si vous-même, c’est-à-dire le CDR, aviez donné des instructions en ce sens. Avez-vous accepté la proposition de M. Tapie sans rien dire ? Ne vous êtes-vous pas dit qu’il conviendrait de revoir la donne ?
M. Pascal Clément : Je me suis un peu intéressé à cette affaire, ayant demandé à l’époque au Parquet de faire appel, tellement la décision de la cour d’appel était étonnante. J’en ai suivi les péripéties et je vous résumerai ici mes incompréhensions.
Vous avez dit qu’on allait changer de Premier président et que vous vous étiez demandé s’il fallait s’adresser à la Cour de cassation. Cela m’a laissé sans voix : c’est à une institution que l’on s’adresse, pas à un juge.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait borné financièrement toute action, qu’il s’agisse de la cour d’appel de renvoi ou du tribunal arbitral, à un montant précis : 185 millions d’euros. Visiblement, le tribunal arbitral a méconnu cette somme.
Enfin, il était possible de former un recours en annulation devant la première chambre de la cour d’appel de Paris. J’étais convaincu que vous le feriez. Vous ne l’avez pas fait et je n’en suis toujours pas revenu. C’est invraisemblable, dans la mesure où l’on ne pouvait pas faire monter la trésorerie de GBT à BTF ; où le mémorandum précisait qu’il fallait fusionner BTF et GBT, ce qui n’a pas été fait ; où le même mémorandum fixait un plafond à 185 millions ; où le tribunal arbitral a méconnu tout cela … Tous les éléments étaient là pour former ce recours.
Toutes les explications qu’on peut apporter sont bien gentilles, mais enfin, cette affaire se solde par 45 millions de dommages intérêts, par une fiscalité dont Bercy ne nous a pas encore donné le montant, et par 200 à 300 millions qui seront versés à M. Tapie. Ce n’est pas mal payé !
M. Jean-Pierre Brard : Des sommes – qu’il s’agisse du préjudice économique ou du préjudice moral – figuraient-elles dans les lettres d’instruction aux représentants de l’État ?
Je remarque que lorsqu’un enfant meurt du fait d’une collectivité ou de l’État, l’indemnité est de 30 000 euros au titre du préjudice moral et qu’elle est de 45 000 euros pour la veuve d’un ouvrier mort de l’amiante. Ce qui signifie que vous avez consenti à M. Tapie l’équivalent de ce qu’on aurait donné pour 1 500 enfants ou pour 1 000 morts de l’amiante ! Comment justifiez-vous de sommes aussi colossales, même si chacun sait que dans la famille Tapie, la morale vaut cher...
M. Jérôme Cahuzac : Outre vous-même, qui présidez le CDR, quels en sont les quatre autres représentants ?
M. Jean-François Rocchi : Trois personnalités indépendantes – M. Patrick Peugeot, un ancien assureur, M. Francis Gavois, ancien président de banque, M. Didier Floquet, le liquidateur de la SOFIRAD –, l’EPFR, en tant que personne morale, étant représenté de façon permanente par son président – actuellement, M. Bernard Scemama.
M. Jérôme Cahuzac : J’ai cru comprendre que des négociations étaient intervenues entre vous et les liquidateurs, qu’un certain nombre d’éléments auraient été apportés, selon vous, en votre faveur, par ces liquidateurs pour prix de votre acceptation de la procédure d’arbitrage. Avez-vous reçu à un moment quelconque des instructions de la ministre concernant ces avantages à obtenir et votre éventuelle acceptation de la procédure arbitrale, dès lors que ces avantages seraient consentis ? Si oui, ces instructions ont-elles été écrites ?
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai reçu aucune instruction de qui que ce soit.
M. Jean-Pierre Brard : Il n’y a pas eu d’échanges téléphoniques ?
M. Jean-François Rocchi : Les instructions ne se donnent pas par téléphone, mais par écrit. Il y a peut-être eu des coups de téléphone, mais il n’y a pas d’instruction téléphonique. Il n’y a eu aucune instruction de qui que ce soit, de quoi que ce soit, où que ce soit. J’y reviendrai si vous le souhaitez, car je n’ai pas peur ; mais pas maintenant, car cela risque d’embrouiller les explications.
Monsieur Brard, je ne connais pas les lettres que la ministre a adressées à ses représentants. Je sais qu’elles existent, qu’elles bénéficient à l’ensemble des acteurs, y compris sans doute à moi-même. Je ne connais pas la lettre munissant d’instructions de vote les fonctionnaires siégeant à l’EPFR. Il faudra la demander à son président. Je ne suis pas membre du conseil de l’EPFR, comme cela m’a été rappelé avec force il y a un instant.
On m’a interrogé sur les montants. Le contentieux principal portant sur une plus-value qui aurait été dissimulée ou captée, il n’était pas insensé de faire travailler une juridiction sur le chiffre correspondant. Par ailleurs, nos adversaires avaient présenté cette demande à plusieurs reprises ; celle-ci était pendante, sous différents aspects, devant la cour d’appel initiale au titre d’Adidas, devant une autre juridiction au titre du soutien abusif, devant une autre encore au titre de la rupture abusive, etc. Certes, on n’a pas à se faire peur en imaginant que tout devra être payé en même temps. Il n’empêche que cette technique répétitive, qui est une spécialité de la partie adverse, est pernicieuse et extrêmement dangereuse et nous a mis dans un état de faiblesse permanente.
M. François Goulard : Qu’il y ait eu des faiblesses du CDR aux droits de SDBO dans la mise en œuvre du mandat, chacun peut l’admettre. En revanche, on peut écarter vos propos sur le soutien abusif ou la rupture abusive.
Le soutien abusif est incontestable ; le Crédit Lyonnais a soutenu abusivement quantité d’entreprises. Mais les conséquences financières sont limitées à d’autres créances et l’on sait très bien que celles-ci sont de peu d’importance.
M. Jean-François Rocchi : Tout s’additionne !
M. François Goulard : Si vous contestez ce que je dis …
M. Jean-François Rocchi : Je ne conteste rien, mais je remarque que le soutien abusif s’additionnait au reste.
M. François Goulard : Quoi qu’il en soit, le soutien abusif ne porte pas sur des volumes comparables.
Par ailleurs, parler de rupture abusive n’est pas sérieux. Qu’un banquier, qui était aussi engagé avec un groupe d’entreprises en aussi mauvaise situation, interrompe, avec un protocole – qui n’a pas été respecté par le créancier – et soit accusé de rupture abusive, on n’a jamais vu cela en droit français.
Mais mettons tout cela de côté et revenons aux sujets sérieux que vous avez très clairement exposés. Il n’est pas nécessaire de noircir le tableau avec des risques qui étaient soit très faibles, soit inexistants.
M. Jean-François Rocchi : Venons-en au préjudice moral, qui est dit tel par opposition au préjudice matériel, je le précise, car des commentaires ont été faits, qui ironisaient sur « la » morale …
Ce préjudice moral a fait partie de tous temps des demandes de nos adversaires. Il a été en particulier évoqué devant la première cour d’appel. Celle-ci, sans que cela ait été cassé par la Cour de cassation, a reconnu ce préjudice moral… pour un euro ! Mais c’est pour cela que nous avons admis que nos adversaires demandent une somme plus forte : nous pensions ne courir aucun risque. Cela avait déjà été tranché par la cour d’appel, non pas en notre faveur, mais en nous assurant un bouclier économique.
Nos adversaires ont demandé 100 millions devant la deuxième cour d’appel. À partir du moment où nous leur avons demandé de diminuer leurs prétentions, ils ont baissé à 50 millions. Nous ne nous attendions pas à une telle condamnation, car tous nos avocats nous avaient expliqué que, dans la mesure où la justice française faisait barrage à de tels montants, leur demande n’était pas menaçante. Nous nous sommes peut-être trompés, mais c’est le raisonnement qui nous a été suggéré. Je ne peux pas dire autre chose.
Le Président Didier Migaud : Les réponses sont claires, même si elles peuvent ne pas satisfaire.
M. Charles de Courson : Monsieur Rocchi, au moment de recourir à l’arbitrage, si vous aviez connu le contenu de la sentence arbitrale, seriez-vous allé en arbitrage ?
M. Jean-François Rocchi : Est-ce une question sérieuse ?
M. Charles de Courson : Elle est extrêmement sérieuse. Vous nous avez expliqué qu’il valait mieux aller en arbitrage que continuer à laisser la justice suivre son cours, parce que ce serait moins cher et que ce serait plus court …
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai pas dit que ce serait moins cher ! Que ce soit plus court, c’est manifeste. On pouvait penser que ce serait moins cher, ou pas plus cher. C’est en tout cas le raisonnement économique que nous avons tenu.
Votre question est tout de même un peu surprenante. Si vous lisez dans l’avenir, c’est très bien. Pas moi. Si nous avions auguré de ce résultat, peut-être n’aurions-nous pas agi ainsi. Mais personne ne pouvait deviner quel en serait le résultat, qui a relevé d’une appréciation souveraine d’un juge du fond. Je rappelle que je n’ai pas fait cet arbitrage pour le perdre.
M. Charles de Courson : Ma quatrième question concerne le recours en annulation, évoqué tout à l’heure par M. le garde des sceaux Clément. Juste avant les vacances, nous nous sommes rendus au conseil d’administration de l’EPFR qui devait trancher cette affaire. Personnellement, je ne suis qu’un modeste magistrat de la Cour des comptes.
Le Président Didier Migaud : Vous êtes député !
M. Charles de Courson : …j’ai alors interrogé M. Rocchi qui était venu répondre à nos questions avant que nous ne votions. Je voulais savoir ce qu’en pensaient les quatre avocats du CDR et j’ai demandé à consulter leurs notes, qui sont dans le dossier.
Je vous cite les conclusions de deux d’entre eux – le second s’étant rallié aux conclusions du premier : « Je considère que le CDR dispose d’un moyen d’annulation qui peut être qualifié de sérieux, et qui pourrait d’autant plus emporter la conviction d’un collège de magistrats que l’on est en présence d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée par la plus haute autorité judiciaire dans cette affaire, atteinte accompagnée au surplus d’appréciations péremptoires, d’erreurs de fait et de droit dont est par ailleurs émaillée la sentence. » Il s’agit donc de la première note, celle des deux avocats qui étaient favorables au recours.
La deuxième note y était hostile : « Un recours en annulation sur le fondement de la violation par le tribunal arbitral de l’ordre public, ou le dépassement par les arbitres des limites de leur mission pourrait théoriquement envisagé, notamment sous l’angle de la violation de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions entendues dans cette affaire
– article 7–1 du compromis d’arbitrage. Cependant, seule une violation flagrante de l’autorité de la chose jugée ou l’inconciliabilité manifeste entre la sentence et les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée pourrait justifier l’annulation de la sentence. Compte tenu des termes de la sentence et sous réserve de l’analyse de nos confrères, qui se focalisera particulièrement sur cette question, les possibilités d’annulation de la sentence arbitrale sur ce fondement nous semblent limitées. »
La troisième note concluait : « Si cette décision n’est pas exempte de critiques possibles, liées à la lecture faite par les arbitres de la décision de la cour d’appel du 30 septembre 2005, pour autant, aucune ne m’apparaît suffisamment fondée pour envisager avec des chances raisonnables de succès un tel recours. Certes, on ne peut nier qu’il existe dans cette affaire, certainement plus que dans une autre, une part d’inconnu difficilement appréhendable. Dans un dossier qui excite à ce point les imaginations et sur lequel chacun projette ses fantasmes, il est impossible d’apprécier le facteur humain et la réaction des magistrats de la cour d’appel de Paris qui serait appelée à en connaître, même dans les limites étroites du recours en annulation. Pour autant, l’orthodoxie juridique commande la plus grande prudence. La personnalité et le prestige des arbitres choisis ne seront pas le moindre des handicaps d’une telle action. »
À la lecture de ces notes, le moins qu’on puisse dire est que l’on peut hésiter. J’avais demandé quelle était la probabilité d’annulation, si l’on allait en annulation : 10, 20, 30, 50, 80 % ? On ne m’avait pas répondu. Je renouvelle donc ma question.
Deux avocats étaient clairement pour le recours, et les deux autres étaient plutôt défavorables. Personnellement, je n’hésitais pas : j’y étais favorable.
M. Jean-François Rocchi : J’aurais préféré qu’il y eût un consensus dans un sens ou dans l’autre. Le moins que l’on puisse dire, et vous n’avez pas cité l’intégralité de la dernière note, c’est que ce consensus faisait défaut. Il y avait donc place à la discussion et au doute.
Cette affaire a été examinée avec la plus grande minutie par le conseil d’administration du CDR, qui lui a consacré trois séances en pleine période de vacances.
La première note que vous avez évoquée et qui nous orientait vers un arbitrage est en réalité une deuxième note du même cabinet. La précédente, qui avait été rédigée quelques jours auparavant, était extrêmement dubitative sur les chances de succès d’un recours. Cela signifie que le même avocat, pourtant très respectable et compétent, et qui continue de nous assister, se trouvait dans une position d’interrogation, au point de douter au bout de quelques jours.
Nous étions donc dans le plus grand embarras pour nous former un sentiment absolu. La partie adverse nous a proposé un certain nombre de concessions, qui ont été acceptées par les deux conseils d’administration.
Ces concessions sont apparues suffisamment importantes – on parle d’un enjeu de 70 millions – pour que les conseils d’administration décident de les empocher. Elles n’étaient pas la condition de l’absence de recours, mais un élément qui venait s’articuler à notre doute. Nous avions alors le choix entre un recours « pour voir » et des concessions dont le montant était certain.
Par ailleurs, un certain nombre d’éléments négatifs risquaient de surgir au cas où ce recours n’aurait pas été suffisamment solide. Voilà pourquoi je ne sais pas vous répondre sur le pourcentage de chances que nous avions ; les avocats en étaient eux-mêmes incapables.
La formule exécutoire sortie de l’exequatur aurait été immédiatement applicable. Il convenait donc de peser les risques et les chances suivant qu’on faisait ou qu’on ne faisait pas ce recours. En ne le faisant pas, on recevait des concessions. Si on le faisait, la partie adverse pouvait mettre en exécution la totalité des sommes et, en particulier, ne pas compenser ces sommes avec les créances que nous détenions sur la liquidation.
Nous avons une créance brute de 163 millions d’euros qui, diminuée de l’apport de BTF qui est maintenant chez nous, donne un solde de 87 millions. Autrement dit, toute somme que l’on paiera à la liquidation devrait être diminuée de 87 millions, dans la mesure où la partie adverse en est d’accord. En cas de recours aléatoire de notre part, celle-ci pouvait nous demander de payer tout de suite la totalité et on aurait vu après pour compenser. Et il aurait pu se passer un an ou deux avant que la liquidation ne soit clôturée.
Nos créances pouvaient donc ne pas être compensées, voire être un peu contestées tant que les recours des tiers n’auraient pas été exercés. Et même, la créance que l’on a exercée sur la société CEDP, l’ancien BTF, de 76 millions, n’était pas si certaine que cela. Je ne dirai pas pourquoi, car cela pourrait aiguiser les appétits de certains contestataires.
Faire un recours que l’on n’était pas sûrs de gagner tout en s’exposant à de tels inconvénients, c'eût été jouer aux dés avec nos intérêts.
M. Charles de Courson : Cinquième question : à quelle date, pour quel montant et avec quel financement le CDR devra-t-il verser les sommes découlant de la sentence arbitrale ?
M. Jean-François Rocchi : Le courrier du 28 juillet 2008, par lequel les liquidateurs de M. Tapie nous proposent des modalités de règlement de la condamnation, prévoit que la partie de la condamnation qui porte sur le principal sera payée en liquide hors intérêts le 5 septembre, c’est-à-dire après-demain. Le reste sera à payer à une date plus lointaine, lorsque le tribunal arbitral aura cessé ses travaux et se sera prononcé sur les éléments à parfaire, en particulier le calcul des intérêts.
M. Charles de Courson : Concrètement ? Il y a deux parties : les 240 millions, d’un côté, et les 45 millions, de l’autre.
M. Jean-François Rocchi : Devront être payés, en brut, le 5 septembre : 240 millions de préjudice économique et 45 millions de préjudice moral, soit 285 millions.
Dans la mesure où la partie adverse accepte que nous contractions cette somme avec les créances que nous détenons sur la liquidation à l’instant « t », il faudra enlever 87 millions – le solde entre 163 et 76 – et payer, en net, 197 millions.
M. Charles de Courson : Comment allez-vous les financer ?
M. Jean-François Rocchi : Une partie sera prise sur nos fonds propres, et l’autre sera couverte par la garantie de l’EPFR, dans une proportion d’environ un quart/trois quarts.
Le Président Didier Migaud : Soit une cinquantaine de millions pour le CDR et environ 150 millions pour l’EPFR.
M. Charles de Courson : Qu’il va financer, je le rappelle, en s’endettant auprès du Crédit Lyonnais.
M. Jean-Pierre Brard : Sans intérêts.
M. Charles de Courson : Sixième question : le recours à l’arbitrage était-il légalement autorisé ?
Le CDR est une société anonyme qui peut parfaitement, en tant que telle, avoir recours à l’arbitrage. Sauf qu’il ne peut le faire que s’il y est autorisé par l’EPFR, donc par la ministre. Or l’EPFR étant un établissement public administratif, il lui est interdit par la loi d’avoir recours à l’arbitrage. N’y a-t-il donc pas eu de détournement de procédure ? Et si tout était nul depuis le début ? Pouvez-vous nous donner votre sentiment ?
Le Président Didier Migaud : Il me semble que M. Rocchi avait commencé à le donner.
M. Pascal Clément : La décision de la cour d’appel avait saisi les observateurs : le montant de l’indemnité était de 185 millions ! La Cour de cassation se prononça très largement au bénéfice du CDR, qui dut se sentir soulagé. La cour d’appel de renvoi fut désignée. Mais au lieu de continuer le processus, comme cela venait à l’idée de tout le monde, en attendant la décision de cette cour d’appel, on l’interrompit et on décida de recourir à un tribunal arbitral.
Un tel recours est tout à fait légal, à n’importe quel moment de la procédure. Pour autant, il est extrêmement choquant, à ce niveau de procédure. On pouvait raisonnablement penser que la cour d’appel de renvoi n’allait pas aller au-delà de ces 185 millions. Or vous avez pris le risque d’aller devant le tribunal arbitral. C’est incompréhensible pour les gens normaux.
Le Président Didier Migaud : Deux questions sont ici soulevées : une question de légalité et une question d’opportunité, sur laquelle M. Rocchi a déjà donné des éléments de réponse.
Il convient d’être précis sur les chiffres : le montant de la condamnation de la cour d’appel n’était pas de 185 millions, mais de 135 millions, qui ont été portés à 145 millions.
M. Jean-François Rocchi : Inutile de refaire le débat d’opportunité, qui nous a déjà occupés une heure et demie. Mais je remarque que la Cour de cassation n’avait pas borné à 145 millions une éventuelle condamnation. Ce n’est écrit nulle part. Dans la mesure où elle avait admis le préjudice par ricochet, il n’y avait plus de plafonnement possible. On parlait en effet d’une situation qui aurait pu perdurer, si Adidas était restée la propriété du Groupe Tapie pendant de longues années.
Le CDR est en effet une société anonyme régie par le droit commercial et par le droit de sociétés. Ces textes permettent tout à fait à une SA de recourir à l’arbitrage, tant interne qu’international.
L’EPFR est incontestablement un établissement public administratif. L’article 2060 du code de procédure civile dispose que : « On ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et, plus généralement, dans toutes les matières intéressant l’ordre public. » L’EPFR peut-il recourir à l’arbitrage pour lui-même ? Pour cela, il faudrait une disposition législative explicite et il serait excessif de vous dire qu’elle existe. En revanche, et c’est la seule question qui vaille d’être examinée, l’EPFR n’étant pas partie à l’arbitrage et n’intervenant que comme garant, est-ce que cette prohibition s’étend au cas de figure que vous vivons ? Nous pensons que non. Pourquoi ?
D’abord, j’ai cité tout à l’heure les conclusions du commissaire du Gouvernement Guillaume relatives à un arrêt du Conseil d’État du 3 mars 1989 « Société des autoroutes de la région Rhône-Alpes ». Ces conclusions ne constituent certes pas une décision de justice, mais elles en sont sous-jacentes. Pour M. Guillaume, « une prohibition qui interdirait à toute société détenue par des liens d’actionnaire à filiale par un établissement public administratif », que celui-ci soit autorisé ou non à compromettre et à aller à l’arbitrage, « serait trop générale et trop restrictive par rapport au droit commun commercial. » Il remarque que « l’article 2060 du code procédure civile indique que l’arbitrage ne peut pas porter sur des sujets qui intéressent les établissements publics ». Et il énonce : « Nous aurions tendance à dire que la personne publique est intéressée dans la mesure où elle est partie. » Or que je sache, l’EPFR n’est pas partie.
M. Charles de Courson : C’est l’avis du commissaire du Gouvernement, et non celui du Conseil d’État…
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai pas dit le contraire.
M. Charles de Courson : Le problème de fond est très simple. Êtes-vous à la tête d’une société anonyme à but lucratif ?
M. Jean-François Rocchi : Je l’espère bien !
M. Charles de Courson : Bien sûr que non !
M. Jean-François Rocchi : Une société de cantonnement est là pour vendre des actifs et gagner des procès quand elle le peut, conformément à ses statuts. Ce n’est pas une œuvre de charité.
M. Charles de Courson : L’objectif du CDR est de limiter le coût, il n’est pas de faire des profits.
M. Jean-François Rocchi : Je vous montrerai les statuts.
M. Charles de Courson : Nous aurons fini à une quinzaine de milliards d’euros ! C’est une société anonyme bien spéciale.
M. Jean-François Rocchi : Le CDR était à l’origine une filiale du Crédit Lyonnais. Au bout de quelques mois, on s’est rendu compte que la construction était un peu baroque et on a demandé au Crédit Lyonnais de faire son ménage. Le CDR a été doté d’un actionnaire public, l’EPFR, établissement public dérogatoire, créé par la loi du 28 novembre 1998, en application de l’article 34 de la Constitution. L’EPFR intervient dans le cadre d’un mécanisme de garantie.
L’article 13 de la loi renvoie au fait que les sociétés de cantonnement bénéficient d’un concours ou d’une garantie financière sous toutes formes, directe ou indirecte, de l’EPFR. Nous avons donc une garantie permanente de la part de notre actionnaire, sur ce dossier comme sur les autres.
Si l’arbitrage était une matière inconnue du CDR parce qu’il a un actionnaire qui est l’EPFR, tous les dirigeants du CDR auraient fauté. J’ai en effet retrouvé sept cas d’arbitrage, qui n’ont jamais été contestés. La Cour des comptes, qui s’est penchée sur cette période, n’a pas contesté le fait que le CDR se soit engagé dans ces arbitrages.
Tout cela n’est peut-être pas la preuve que vous attendiez, mais vous m’accorderez qu’il y a là un faisceau d’indices convergents sur le fait que, de manière habituelle, le CDR peut recourir à l’arbitrage, alors même qu’il est détenu par l’EPFR.
J’ajoute que nous sommes régis par un mécanisme comptable très spécifique qui résulte du protocole d’avril 1995 créant le CDR, signé par l’État et le Crédit Lyonnais et confirmé par la loi de 1998. Ce protocole autorise de manière expresse le recours à l’arbitrage. Et il postule que tous les ans, les comptes de résultats sont ramenés à zéro. S’il y a un profit, celui-ci est remonté par un mécanisme de remontée additionnelle à l’actionnaire – qui s’en sert pour amortir le prêt qu’il a obtenu du Crédit Lyonnais pour financer le système de la défaisance. S’il y a des pertes, celles-ci sont imputées mécaniquement et symétriquement à l’actionnaire. Cela signifie que l’EPFR couvre les conséquences négatives éventuelles d’un arbitrage.
On savait, en 1995, que certains des contrats que portait le CDR en héritage des filiales du Crédit Lyonnais comprenaient des clauses compromissoires et donc la possibilité d’ouvrir des arbitrages. Si on avait voulu l’éviter, on l’aurait fait. Vous pouvez bien imaginer que ce protocole, qui occupe trois bottins, a été étudié de très près par les juristes du Crédit Lyonnais et par les services du Trésor. Et ce qui n’est pas interdit est donc autorisé.
M. Jérôme Chartier : Pourrait-on disposer du règlement de procédure de l’arbitrage ?
Le Président Didier Migaud : Une page suscitait des interrogations. Nous vous l’avons redistribuée, sous la forme la plus claire possible.
M. Jérôme Chartier : Je serais très intéressé par le calendrier précis que vous avez commenté tout à l’heure, entre le 10 décembre 1992 et fin 1994.
J’aimerais connaître les conditions dans lesquelles, le 10 février 1993, a été signée l’option d’achat en faveur de Robert Louis-Dreyfus. Était-elle assortie de clauses, au cas où il aurait renoncé à l’acquisition d’Adidas ? Dans quelles conditions et à partir de quand Robert Louis-Dreyfus est-il devenu responsable d’Adidas ?
Par ailleurs, monsieur le président, j’aimerais disposer des deux arrêts de la cour d’appel et de la cour de cassation.
Le Président Didier Migaud : Si vous ne les avez pas, nous allons vous les procurer.
M. Jérôme Chartier : Monsieur Rocchi, les chiffres plafonds évoqués concernent-ils la totalité des douze procédures ou une seule procédure ?
Par ailleurs, vous avez dit que le règlement arbitral concernait neuf procédures. Il doit donc en rester trois en cours. Quelles sont-elles ?
Le Président Didier Migaud : Si certains ont encore des difficultés de lecture sur la nouvelle page qui vient de vous être distribuée, nous referons le tableau.
M. Jean-François Rocchi : J’ai déjà très abondamment détaillé dans mon exposé introductif la séquence des faits. J’ai démarré par le 10 décembre 1992 : la signature du mémorandum. Puis j’ai évoqué le 16 décembre : la lettre d’engagement et le mandat ; et courant janvier : la présentation de M. Robert Louis-Dreyfus…
M. Jérôme Chartier : Vous n’avez pas de mention précise de la date ?
M. Jean-François Rocchi : Non, cela entrait dans le cadre de discussions. Et puis, je n’étais pas là, il faudra le demander aux acteurs de l’époque.
M. Jérôme Chartier : Cela me rappelle étonnamment des auditions auxquelles nous avons assisté l’an dernier concernant EADS. Une conjonction de circonstances très particulière avait fait que M. Lagardère avait cédé des participations, un mois ou quelques jours avant un dévissage en Bourse. En l’occurrence, je voudrais savoir si c’est un hasard extraordinaire qui a fait qu’il n’y ait pas un mois entre le 16 décembre 1992 et le x janvier 1993, entre d’un côté la lettre d’engagement et le mandat, et de l’autre le moment où Robert Louis-Dreyfus s’est dit très intéressé.
M. Jean-François Rocchi : Je ne peux pas vous donner d’explication. D’abord, je n’en ai pas été le témoin. Ensuite, il n’y a pas beaucoup de pièces qui l’évoquent, en dehors du témoignage de M. Louis-Dreyfus, lequel a varié dans le temps et ne donne d’ailleurs pas de date précise. Enfin, mon rôle n’est pas de paraître critiquer le Crédit Lyonnais, ma maison mère ; par protocole, je dois le défendre. Si ces éléments vont au débit du Crédit Lyonnais, je n’ai pas à les commenter. Je m’exposerais sinon à de lourdes difficultés. Je ne peux donc pas parler de cette période.
Je ne sais qu’une chose, dans la mesure où M. Louis-Dreyfus l’a énoncée lui-même dans une pièce qui a été utilisée dans le cadre de la mission de médiation judiciaire du Procureur général Burgelin. M. Louis-Dreyfus a en effet livré en 2004 un témoignage selon lequel il était parti en vacances à l’occasion des fêtes de Noël, qu’il n’avait accepté de parler de ce dossier qu’au mois de janvier. La date n’était pas précisée, mais il était sous-entendu que c’était après que les papiers avaient été signés. Il voulait dire par là que le Crédit Lyonnais ou ses filiales ne savaient pas qu’il était potentiellement acheteur avant ce mois de janvier.
Je suis obligé de m’abriter derrière cette pièce, qui sert les intérêts des organismes que je représente et que je défends, et de ne rien dire d’autre. À partir de là, vous interrogerez d’autres personnes sur la présentation des faits.
Toutes les procédures ont été fusionnées à l’occasion de l’arbitrage. Le but de l’arbitrage était précisément de procéder à cette fusion pour éteindre les procédures existantes. Pour autant, tout n’était pas arbitrable. Ce fut le cas d’une procédure de banqueroute, qui relève de l’action publique. Vous ne serez donc pas étonné de constater que, parmi ces douze procédures, la banqueroute ne figure pas.
Deux ou trois autres procédures n’y figurent pas non plus. Je crois me souvenir que nos adversaires ont renoncé d’eux-mêmes à certaines, parce qu’ils estimaient qu’elles ne pouvaient pas prospérer. Nous nous sommes également mis d’accord pour écarter un contentieux fort emberlificoté concernant une villa à Marrakech et où personne ne comprenait rien.
Le Président Didier Migaud : L’ensemble des procédures est rappelé dans la convention d’arbitrage.
M. Jérôme Chartier : Il y en a neuf. Il en manque donc trois.
M. Jean-François Rocchi : Sur ces trois autres, nos adversaires se sont désistés. Ces procédures n’existent plus. Mais la banqueroute, ordonnée par le ministère public, subsiste.
M. François Bayrou : La banqueroute est close, par définition, dans la mesure où il est prouvé qu’il y avait une créance.
M. Jean-François Rocchi : Elle n’est pas close. Elle le sera peut-être si, à la fin de la liquidation, celle-ci présente un solde positif. Il est probable qu’il y en ait un. Mais ne me demandez pas de le chiffrer. Je ne connais pas les dettes de M. Tapie.
M. Jérôme Chartier : D’après ce que vous dites, si cette procédure de banqueroute court toujours, il faudra attendre le jugement pour savoir ce qui restera à Bernard Tapie.
M. Jean-François Rocchi : Non. Il faudra attendre que sa liquidation soit close et qu’il ait payé tous ses impôts, y compris sur le revenu et sur la fortune.
Le Président Didier Migaud : Je vous renvoie au contenu du rapport de M. de Courson.
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai pas de chiffres à vous donner parce que je ne connais pas les éléments d’actif et de passif de M. Tapie ; il vous en parlera plus savamment que moi. C’est à ce moment-là que votre question trouvera réponse.
M. Jérôme Cahuzac : Vos explications sont assez convaincantes et l’on vous suit assez aisément jusqu’au mois de janvier 2007. Ensuite, les choses deviennent un peu plus difficiles à admettre.
Je comprends l’intérêt de mes collègues pour la période 1992-1995. Il n’empêche qu’aujourd’hui, ce qui suscite une émotion justifiée, ce sont les 200 millions d’euros que vous allez devoir verser à Bernard Tapie et à son épouse après-demain. Voilà pourquoi je souhaiterais revenir sur l’opportunité et la légalité de la procédure d’arbitrage que vous avez choisie et dont la conséquence se trouve être ce chèque de 200 millions d’euros.
S’agissant de l’opportunité, je souscris aux arguments de l’ancien garde des sceaux. Prétendre que l’assemblée plénière de la Cour de cassation pourrait changer de doctrine au motif que son Premier président en change est pour le moins audacieux et un peu irrespectueux à l’égard des magistrats de la Cour de cassation.
Cette remarque vaut pour la cour d’appel de Paris. En effet, vous nous avez expliqué que, certes, ce ne serait pas la même chambre mais la même juridiction d’appel et vous en avez fait un risque, dans le cas où la procédure judiciaire aurait suivi son cours et un élément en faveur de l’acceptation de la procédure d’arbitrage.
Quant à la valeur estimée aujourd’hui de l’affaire Adidas, elle ne tient pas la route deux secondes. Partir de ce chiffrage n’est pas raisonnable. Je m’étonne même que vous ayez présenté cet argument devant notre Commission.
François Goulard a fait un sort à l’argument relatif au soutien abusif et à la rupture abusive. Je me garderai bien d’y revenir, mais je considère qu’il a parfaitement raison.
Enfin, je ne vois pas quels autres éléments vous pourriez avancer pour fonder votre décision en opportunité.
S’agissant de la légalité, vous indiquez que des précédents existent. Ces précédents sont-ils intervenus dans les mêmes conditions, alors qu’une procédure judiciaire banale était en cours ? Avait-on démarré sur une procédure arbitrale ? Si c’est la première fois qu’une procédure arbitrale intervient alors que des procédures judiciaires sont en cours, vous pouvez plus difficilement vous prévaloir de ces précédents. Au demeurant, le fait qu’il y ait eu des précédents n’est pas un élément très fort en faveur de la légalité de la procédure. Car nul ne peut se prévaloir de ses turpitudes. Mais je vous rassure : je vise le CDR et non vous-même…
Dès lors, monsieur le président Rocchi, j’ai besoin d’une précision de calendrier. Vous avez indiqué, dans le cadre d’une réponse à M. de Courson, que rien n’aurait pu se faire si l’EPFR ne l’avait accepté. Le conseil d’administration de l’EPFR s’est-il réuni, qu’il s’agisse d’adopter la procédure arbitrale ou de refuser le recours, avant ou après le conseil d’administration du CDR ?
M. Jean-François Rocchi : Vous estimez que mes arguments sont frivoles, irresponsables ou insolents…
M. Jérôme Cahuzac : Je n’ai pas dit que vous arguments étaient insolents.
M. Jean-François Rocchi : C’était un peu sous-entendu.
M. Jérôme Cahuzac : Simplement, ce n’était pas convaincant.
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai pas parlé de risques. Pour autant, il y avait des facteurs d’incertitude. La Cour de cassation n’avait pas tout cassé, tant s’en faut, et nous ne pouvions pas savoir si une cour d’appel, même autrement composée, ne nous condamnerait pas sur des motifs toujours accessibles ; ni si la Cour de cassation, quand bien même ç’eût été le même Premier président, aurait ou non adopté la même position. Tout cela ne pouvait pas être connu avec certitude au moment de prendre la décision.
Ensuite, je n’ai pas la connaissance intime de tous les cas de précédents que j’ai évoqués. Je ne suis donc pas capable de vous répondre ex abrupto.
Enfin, le mode de gouvernance, qui est en partie double, fait que l’EPFR n’a pas à approuver, au sens plein du mot, les décisions de sa filiale. Il a à les partager par une non opposition, qui ne peut intervenir, par définition, qu’après que le CDR a délibéré.
Je ferai le parallèle avec une autre affaire, celle de l’hôtel de New York, dont on a parlé. Le droit américain a ceci de surprenant que les juges peuvent ordonner des phases transactionnelles quand bien même on n’aurait pas l’intention de transiger. C’est ce qui s’est passé au printemps de 2007. Nous nous étions fait couvrir par l’EPFR, compte tenu de l’importance des sommes potentiellement en jeu. Nous n’avions pas l’intention de transiger, mais nous redoutions les pressions du juge. Nous avons donc demandé à l’EPFR une sorte de mandat. Il a été saisi de notre position et ne s’y est pas opposé.
Voilà donc comment le système fonctionne : le CDR délibère, puis l’EPFR intervient.
M. Jérôme Cahuzac : L’EPFR avait-il les moyens de vous empêcher et de recourir à cette procédure et de former un recours le cas échéant ?
M. Jean-François Rocchi : Je n’ai pas été informé des propos de M. Schneiter et je ne sais pas s’il a dit l’inverse. Mais, pour ma part, selon l’analyse que je peux faire en tant que président du CDR, si l’EPFR, sur quelque dossier que ce soit, nous disait de manière claire qu’il s’oppose à notre position, je n’irais pas chercher plus loin et le CDR s’arrêterait.
Le Président Didier Migaud : Cela concorde avec ce qui nous a été dit ce matin. Il existe, de la part de l’EPFR, une faculté d’empêcher.
M. Charles de Courson : Les propos du président Rocchi confirment ce que je vous ai dit tout à l’heure, mais ils ne sont pas tout à fait cohérents avec ceux du président Schneiter.
Le Président Didier Migaud : Il n’y a pas d’opposition en tant que telle. Les propos du président Schneiter ont confirmé que si l’EPFR avait la volonté d’empêcher, il pouvait le faire. Ce matin, il a été clair sur ce point.
M. François Goulard : Je voudrais vous poser une question délicate, dans la mesure où elle concerne des personnes choisies comme arbitres.
Si j’ai bien compris, le choix a été fait en commun par les deux parties, alors que dans d’autres procédures arbitrales, chacune des parties choisit d’abord un arbitre, et les deux arbitres choisis se mettent d’accord sur un président. Cette dernière manière de faire me semble plus sécurisante. Autant avoir un arbitre dont la vision des choses est compatible avec la défense de ses propres intérêts. Je dis cela pour avoir été partie dans des arbitrages, en tant que responsable d’entreprise.
On peut supposer néanmoins qu’en l’occurrence, il y avait une certaine répartition des rôles au sein du tribunal arbitral. On imagine qui pouvait être favorable aux thèses des liquidateurs et qui pouvait être plutôt porté à défendre les intérêts de l’État – sans que cela emporte un jugement sur la probité des personnalités en cause.
Je considère que la manière dont vous avez procédé n’était pas la meilleure. De la même façon, le fait d’admettre au cours de la négociation des plafonds qui étaient ceux de la partie adverse n’était pas de nature à défendre au mieux vos intérêts. Il y avait, à l’évidence, une marge de négociation.
Le fait d’avoir choisi des personnalités qui n’étaient pas toutes des spécialistes du monde bancaire, du monde des affaires ou du droit privé n’était sans doute pas la meilleure façon de défendre les intérêts de l’État. Quelles qu’aient été la qualité, la probité et l’intelligence des arbitres, ce choix n’était pas optimal.
M. Jean-François Rocchi : Je ne vais pas discuter, monsieur le député. Vous livrez votre point de vue personnel sur la question de savoir si ce choix était optimal ou pas.
Comme vous l’avez remarqué, les arbitres sont d’une telle personnalité et d’un tel niveau qu’on ne peut pas les soupçonner. De fait, nous cherchions des personnalités de grande envergure et indépendantes.
Il est vrai que la pratique usuelle consiste à faire désigner un arbitre par chacune des parties, puis un surarbitre ou un président, selon des modalités qui peuvent varier. Mais il peut y avoir trois arbitres, cinq arbitres, etc. Tout se voit.
Nous avons recherché une méthode telle qu’on ne puisse pas connoter les arbitres en fonction de l’intérêt de tel ou tel. Vous pensez que tel ou tel pouvait être présumé plus proche de tel ou tel. Personnellement, je n’en sais rien du tout. Après avoir discuté différentes hypothèses, les avocats puis nous-mêmes nous nous sommes accordés sur ces personnes : un président, sur le caractère duquel on peut dire beaucoup de choses, mais qui est extrêmement indépendant et ne s’est jamais prêté à aucune instruction ni soumis à aucune influence ; un haut magistrat, praticien du droit ; un autre professionnel du droit, qui se trouve être un avocat. Ce choix a été prononcé d’un commun accord.
M. François Goulard : Contrairement à ce que je croyais moi-même, le mécanisme décrit comme habituel n’est pas celui de la loi. L’article 1463 du code de procédure civile se contente de disposer : « Le tribunal arbitral est composé d’un seul arbitre, ou de plusieurs, en nombre impair. » C’est tout. Tout le reste résulte d’un accord entre les parties. Et en l’occurrence, rien n’est contestable.
Comme cela a été rappelé utilement à plusieurs reprises, ce n’était pas Bernard Tapie qui était partie à l’arbitrage : c’étaient les liquidateurs.
M. Jean-François Rocchi : C’est plus compliqué. Techniquement, nous avons d’un côté deux organismes qui sont : l’ancien SDBO, CDR Créances ; l’ancien Clinvest, CDR Maison mère. Et de l’autre côté, deux liquidateurs : Me Jean-Claude Pierrel, de la société SELAFA MJA, société d’exercice libéral, et Me Didier Courtoux. Ces liquidateurs assurent la liquidation du Groupe Tapie, à l’exclusion de BTF qui est désormais notre filiale sous le nom de CEDP ; et celle des époux Tapie, qui ont été placés en situation de liquidation personnelle.
Nous ne voulions pas que, sur la base de cette nuance subtile, M. Tapie, pris isolément, revienne par la porte de derrière pour engager de nouvelles procédures et nous avons souhaité qu’il soit signataire des désistements. Nous redoutions qu’il nous réattaque, si nous avions gagné. Parce qu’il était en faillite personnelle et pour pallier cet inconvénient, lui-même et son épouse ont été invités à signer ces désistements. C’était une condition sine qua non. Et c’est ce qu’ils ont fait.
M. François Bayrou : Le sentiment que je souhaite traduire pose une question politique. Les explications que vous nous donnez, convaincantes ou non, reposent sur l’exercice, par vous, de l’autorité que vous exercez au sein de CDR en tant qu’entité responsable, société de droit privé et à but lucratif. Vous êtes censé défendre les intérêts de la société en question. Mais l’élément que l’on n’a pas abordé, c’est qu’en fait il ne s’agit pas des intérêts de CDR, mais de ceux du contribuable, qui va devoir payer, sans échappatoire possible.
La question de savoir si on avait droit à l’arbitrage ou non se trouve en butte à cette constatation : ce sont les finances publiques et le contribuable qui devront répondre de vos décisions. C’est pour moi assez troublant et je voudrais vous interroger sur ce point précis : avez-vous discuté avec l’État de cette décision ? Et quand ?
Par ailleurs, je ne comprends absolument pas le mécanisme qui vous a conduit à la décision que vous avez prise. La cour d’appel donne raison à Tapie et elle fixe un montant d’indemnisation de 135 millions. Le moyen sur lequel la cour d’appel appuie son jugement est cassé, en termes durs, par la Cour de cassation. À ce moment, votre position, c’est-à-dire la position de l’État, était plus forte qu’elle ne l’était auparavant. Or c’est ce moment que vous saisissez pour fixer au double votre plafond d’indemnisation, qui servira de guide à la décision qui sera prise.
À partir d’une position qui aurait dû amoindrir les prétentions des parties adverses, position de la Cour de cassation intervenant en formation plénière, vous acceptez d’envisager le doublement de cette indemnisation. Je voudrais comprendre comment vous êtes parvenus à une décision de cet ordre qui, encore une fois, ne concerne pas le CDR ou vous-même, mais le contribuable français. Écrire un tel montant, de même que les 50 millions de préjudice moral, dans la convention d’arbitrage induisait, d’une certaine manière, la décision des arbitres.
Enfin, j’ai interrogé ce matin M. de Courson sur la date probable où il faudrait acquitter l’indemnisation. Il m’a répondu : Noël !
M. Charles de Courson : J’ai dit que le montant n’était pas définitivement fixé, et que les 197 millions dont on parlait ne constituaient qu’un acompte.
M. François Bayrou : Je veux simplement indiquer qu’après-demain, soit dans quarante-huit heures, l’issue de cette affaire deviendra irréversible. Une fois versées, les sommes seront réparties selon un schéma que j’ignore, mais qui semble évident. Elles serviront à régler des dettes, à régler l’URSSAF, à satisfaire certaines remises à flot de M. Tapie et quelques bénéfices. Dans quarante-huit heures, le contribuable français, qui croyait être encore dans l’attente d’une issue, va découvrir que, par votre décision et celle du Gouvernement qui a assumé cette absence d’appel, l’affaire est définitivement terminée, au prix de presque 300 millions d’euros, une fois soustrait ce que vous doit cette liquidation. À quoi serviront donc les auditions de la semaine prochaine ? Cela justifie les soucis des députés et de la commission des Finances.
Le Président Didier Migaud : Un tel souci est à l’origine de nos travaux, qui durent depuis ce matin. Et cette réunion a l’intérêt de nous apporter certaines précisions.
M. François Bayrou : Mais personne n’avait dit que l’indemnisation serait payée dans les quarante-huit heures !
Le Président Didier Migaud : Nous ne sommes ni des magistrats, ni des enquêteurs. Nous avons pour fonction de faire en sorte que chacun puisse se forger une opinion à partir des décisions qui ont été prises, et de voir s’il existe encore des possibilités d’action – question soulevée par Charles de Courson.
M. François Bayrou. Un mot pour aller dans votre sens, monsieur le président. Nous nous sommes quittés ce matin sur l’idée, exprimée par Charles de Courson, qu’un recours éventuel existait : la tierce opposition. Je pense qu’il en existe un autre : comme il s’agit d’une décision du Gouvernement, celle-ci peut-être déférée au Conseil d’État.
M. Jean-François Rocchi : Ce n’est pas une décision du Gouvernement.
M. François Bayrou : Si. Même si elle n’est pas formelle, c’est une décision du Gouvernement que Mme Lagarde a assumée dans plusieurs interviews.
M. Pascal Clément : C’est une suggestion de Mme Lagarde au CDR. Juridiquement, c’est bien le CDR, et non l’État, qui a pris la décision.
M. François Bayrou : Je ne partage pas cette analyse.
Le Président Didier Migaud : Il existe manifestement des points de vue différents.
M. François Bayrou : Toujours est-il que nous pensions ce matin qu’il existait peut-être, quelque vague ou difficile qu’elle soit, une possibilité de recours. La vérité oblige à dire que les conséquences des décisions prises deviendront irréversibles, pour le contribuable et pour les finances publiques, dans les quarante-huit heures.
Le Président Didier Migaud : La vérité revient à dire qu’il y aura effectivement un versement…
M. Jérôme Cahuzac : En cas de succès d’un éventuel recours, la garantie que Bernard Tapie rendra ces sommes est nulle !
M. Jean-François Rocchi : Par pitié, je ne suis ni Bernard Tapie ni son liquidateur ! Étant donné le tour que prend le débat, je me contente d’expliquer un point très pratique. Chacun a bien compris que toutes les sommes qui seront payées le seront à la liquidation et que celle-ci n’est pas clôturée. Le liquidateur est un officier ministériel. On imagine mal qu’il se mette à déraper et exporte ces fonds. Il appartient au parquet de le contrôler étroitement. La garantie de représentation des fonds tient au simple fait que la liquidation ne peut être clôturée dès lors qu’un un recours des tiers s’engagerait. Commencer immédiatement la mise en distribution serait gravissime et heurterait tous les principes du droit.
Le Président Didier Migaud : En d’autres termes, la somme est versée mais elle n’est pas totalement disponible.
M. François Goulard : La somme versée au titre du préjudice moral n’est pas du ressort du liquidateur…
M. Jean-François Rocchi : Si. Elle l’est dans le cadre de la liquidation personnelle des époux Tapie. Je le répète, ces derniers sont représentés par une société d’exercice libéral, la SELAFA. Ces sommes seront versées à leur liquidateur. Là aussi, c’est après la clôture qu’interviendra la mise en distribution. Il est clair que nous ne versons rien à M. Tapie directement : nous versons aux liquidateurs du groupe dans un premier sens et à ceux des personnes physiques dans un second sens.
Le Rapporteur général : Cela signifie que, si les actifs sont insuffisants, ils peuvent s’imputer sur le montant du préjudice moral.
M. Jean-François Rocchi : C’est exact. Il s’agit d’un cas quelque peu théorique mais prévu tant par le compromis que par la sentence : les sommes qui seraient, le jour venu, mises en distribution et perçues par les époux Tapie serviraient à couvrir les insuffisances d’actifs. Cela dit, ce n’est pas mon affaire mais la leur.
Je ne voudrais pas que ces développements donnent à M. Bayrou l’impression que je me dérobe. Pour ce qui est de la date de paiement, la réponse est simple : si la partie adverse avait voulu percevoir ces sommes le lendemain de l’exequatur qu’elle a obtenu du tribunal de grande instance de Paris le 12 ou le 13 juillet, elle aurait pu le faire. N’étant pas un responsable politique, il m’est interdit de suivre M. Bayrou lorsqu’il tire des conclusions politiques – ce qui est normal pour un élu – de cette date du 5 septembre. Sur le terrain technique, le seul sur lequel je puisse me situer, la formule exécutoire dont cette sentence est revêtue par l’intervention du TGI nous fait obligation de payer à la première demande. Que l’exécution de la sentence vienne un peu plus tôt ou un peu plus tard ne change rien à l’affaire.
Le Rapporteur général : Même en cas de recours en annulation.
M. Jean-François Rocchi : Tout à fait.
Pour ce qui est du montant, j’ose espérer que votre question, monsieur Bayrou, ne tend pas à insinuer qu’il résulte d’une transaction. La signification de l’arrêt de la Cour de cassation est en quelque sorte le nœud gordien de l’affaire. La Cour a sanctionné le choix qu’avait fait la cour d’appel d’indemniser les liquidateurs de M. Tapie – et donc M. Tapie d’une certaine manière – à hauteur de 135 millions d’euros, somme révisée à 145 millions en raison d’un calcul d’intérêts semble-t-il erroné.
C’est cela qui a été cassé. J’ai pris le soin de dire que le montant d’une condamnation qui aurait été prononcée par une nouvelle juridiction du fond, telle, typiquement, la cour de renvoi, était absolument inconnaissable. Rien ne permet d’affirmer, comme certains le font, que ce chiffre est un plafond que la cour d’appel ne pouvait franchir. À partir du moment où l’on met les autres moyens de fond à la disposition d’une cour d’appel, d’une cour de renvoi ou de n’importe quel autre juge pour condamner, le cas échéant – ce n’était pas sûr mais on pouvait le redouter –, le CDR, je serais bien incapable de fixer un chiffre : celui-ci se situe entre zéro et le montant de la plus-value, voire au-delà. La Cour de cassation n’a pas sanctionné, me semble-t-il, le moyen qu’ont développé nos adversaires et sur lequel le tribunal arbitral nous a condamnés, à savoir le préjudice « par ricochet » : GBT, société faîtière – ou peu s’en faut – du groupe Tapie n’est pas payée en tant qu’actionnaire, ni même en exécution directe du contrat, mais par des effets continuateurs du contrat. Le mémorandum postulait le désendettement et visait à des restructurations. M. Pascal Clément a souligné à juste titre que l’exécution en était impossible. Elle l’était d’autant moins que la dénonciation de la relation bancaire en 1994 faisait tomber le mémorandum.
Je me dois toutefois de citer la thèse de l’adversaire qui nous faisait redouter une condamnation : le groupe Bernard Tapie pouvait soutenir que, si tout cela n’était pas arrivé, il aurait pu rester propriétaire d’Adidas pendant quelques années et même jusqu’à aujourd'hui ; il aurait subi de ce fait un préjudice continu, ou « par ricochet ». Cela, la Cour de cassation ne l’a pas démoli : c’était toujours à la portée d’un tribunal.
Je suis donc incapable d’avancer un chiffre. Je n’ai pas subitement multiplié par deux un « plafond absolu » qui n’existait pas !
Votre troisième question, monsieur Bayrou, est en revanche naturelle. C’est bien l’État qui est l’actionnaire final du CDR. Cela dit, la formule « C’est le contribuable qui paie » est un peu forte. Dans la mesure où nous sommes détenus par l’EPFR et garantis par lui à tout moment et sur toutes nos opérations, nos comptes sont toujours soldés à zéro. Tous les bénéfices et toutes les pertes remontent à l’EPFR, c'est-à-dire à l’État. Au demeurant, l’avenant n° 13 au protocole de 1995 mentionne expressément « la responsabilité ultime de l’État dans les opérations du CDR ». Cela apparaît en toutes lettres dans un texte que l’État, signataire de ces instruments, a revendiqué. Comprenez donc que je ne puisse vous suivre dans ce débat. Quoi que l’on fasse – que nous subissions une condamnation judiciaire ou non –, l’État finit par être responsable de nos opérations. C’est le principe même qui a conduit à la constitution du CDR, adossé à l’État en novembre 1995 par l’EPFR. Ce n’est pas une découverte !
Pour ce qui est des contacts que j’aurais pu avoir, je serai franc : vous devinez bien qu’un responsable d’entreprise publique ou un haut fonctionnaire ne vit pas dans une bulle. Il est évident qu’il a des discussions régulières avec certains responsables, à commencer par ceux de son ministère de tutelle, pour rendre compte de ses principales opérations. Plusieurs anciens membres du Gouvernement ici présents savent très bien ce dont je parle. C’est mon conseil d’administration qui a voté. La ministre, comme elle le revendique elle-même, a donné des instructions aux fonctionnaires qui votaient en son nom à l’EPFR. Ce n’est pas tout à fait la même chaîne de commandement. Tout le monde – y compris moi-même, sans doute – en profite, mais ce n’est pas tout à fait la même séquence, les mêmes moments et les mêmes effets.
En tout cas, le fait d’informer régulièrement les autorités de rattachement des principales affaires et de leur déroulement est naturel. Un responsable d’entreprise publique qui ne le ferait pas ne remplirait pas sa mission.
La question ne s’arrête pas à Adidas. Nous traitons aux États-Unis des affaires qui sont la queue de la comète d’Executive Life et qui représentent un enjeu d’un milliard de dollars. Imagine-t-on que je n’en informe pas régulièrement mes autorités de tutelle ? Lorsque, dans le cadre de l’Entreprise minière et chimique, je vends des sociétés au Vietnam ou lorsque je rencontre le premier ministre de ce pays au sujet d’un port en eaux profondes dont les Vietnamiens pourraient faire un enjeu de crispation diplomatique, il est évident et normal que j’en fasse le compte rendu aux autorités de l’État.
M. Michel Bouvard : Je m’interroge sur le lien que la sentence arbitrale établit entre ce que les époux Tapie peuvent toucher au titre du préjudice moral et une éventuelle insuffisance d’actifs. La formulation, page 83, est quelque peu curieuse. Au moment où il discute pour fixer le plafond de ce que peut être le préjudice moral, le liquidateur a-t-il connaissance de l’éventuelle insuffisance d’actifs ?
M. Jean-François Rocchi : Je n’en sais rien.
M. Michel Bouvard : Le préjudice moral est apparu en cours de route et n’a rien à voir avec le contenu du jugement antérieur.
Vous avez évoqué la « queue de la comète » Executive Life ; Charles de Courson a lui aussi rappelé que d’autres contentieux sont en cours. Parmi ceux-ci, vous indiquez qu’il en existe une vingtaine de principaux et cent soixante de moindre importance. Or, si j’ai bien compris, les sommes qu’il faudra sortir vont assécher les disponibilités du CDR. D’une certaine manière, nous sommes confrontés à la suite de l’affaire du Crédit Lyonnais, de la SDBO, de Clinvest, etc., et ces montants vont s’ajouter à ce que le contribuable a déjà dû payer au-delà de la seule affaire Tapie. Peut-on évaluer le risque financier que représentent les autres dossiers contentieux et établir ainsi le total de ce que l’affaire du Crédit Lyonnais aura coûté à la République ?
Ma dernière question concerne le fonctionnement des établissements de défaisance. Considérez-vous que la gouvernance d’un établissement du type de celui que vous présidez est pleinement satisfaisante ?
M. Charles de Courson : Pour en revenir aux chiffres figurant à la page 20 du mémoire, les 197 millions d’euros correspondent aux 240 millions de la condamnation auquel on additionne les 45 millions d’indemnité pour préjudice moral et on soustrait les 163 millions représentant l’essentiel de l’actif net de SDBO – le reste étant compris entre 5 et 10 millions –, avant de majorer à nouveau la somme des 76 millions résultant du jugement du tribunal de commerce. Il restera à payer, probablement avant la fin de l’année (deux réunions sont encore prévues pour fixer le montant des intérêts et des droits), entre 57 et 67 millions. Au total, on aboutit à environ 250 millions, soit le point moyen que je vous ai indiqué. Il s’agit là d’un montant brut dont il faudra retrancher les impôts payés par les sociétés sur lesquelles porte la première partie et le boni de liquidation qui sera soumis à l’impôt sur le revenu.
M. Jean-François Rocchi : Il est évident que le liquidateur connaît le passif de sa liquidation aux éléments constatables aujourd'hui. Pour le reste, sans doute existe-t-il des éléments qui ne sont pas disponibles ou qui sont à venir. Je me garderai bien de répondre à sa place. C’est à lui, ou à M. Tapie, de se prononcer.
Le CDR traite encore environ cent vingt contentieux. Nous nous efforçons de ne pas persister dans l’être et de les éteindre dès que nous le pouvons. Lorsqu’il s’agit de petites sommes et qu’une transaction paraît possible, nous privilégions cette option pour éviter des voies de recours intempestives et longues. Dans tous les cas, il s’agit de décisions du conseil d’administration et non, comme l’a affirmé M. Bayrou, de « mes » décisions. Notre mode de gouvernement n’est pas celui d’une dictature ou d’un proconsulat ! Je suis un mandataire social. À ce titre, la loi me fait obligation de partager des décisions avec le conseil d’administration. Au-delà, notre pratique est très collégiale. Le conseil d’administration se réunit pratiquement tous les mois et demi et examine la quasi-totalité des sujets – à l’exception de sujets très mineurs. En l’occurrence, c’est lui qui a pris la décision à une large majorité (quatre sur cinq), tandis que le conseil d’administration de l’EPFR l’adoptait à l’unanimité. Ces organes de gouvernance ont fonctionné dans des conditions et à des dates normales. La décision n’est pas le fait d’un aventurier isolé.
Sur les cent vingt contentieux, dix ou douze sont significatifs. Le chiffrage suppose une certaine prudence car l’adversaire nous demande parfois des sommes fort importantes. En les additionnant, on aboutit à un risque théorique d’environ 2 milliards d’euros, mais c’est évidemment une somme extravagante qui m’obligerait, faute de trésorerie, à me retourner vers mon actionnaire. Cela dit, je n’exclus pas que tel ou tel de ces procès tourne mal. Par exemple, une entreprise anciennement nationale et désormais privatisée nous demande 120 millions d’euros. Une entreprise italienne réclame pour sa part, dans une affaire concernant des chimiquiers, 100 millions. Nous avons par bonheur gagné jusqu’à présent, mais on ne sait jamais. De même les procès américains, dont le déroulement nous est pour l’instant favorable, pourraient subitement se retourner en notre défaveur.
Du reste – c’est le non-dit d’un de ces dossiers –, un entrepreneur important, qui était un des acteurs du dossier Executive Life, est encore en appel devant la justice américaine – le CDR avait, lui, transigé et se trouve de ce fait à l’abri d’un tel procès – et, contrairement à ce qu’on a affirmé, ce n’est nullement une victoire. Si jamais cet entrepreneur perd, il risque d’avoir à payer cinq fois plus et, si l’on en croit la rumeur, de se retourner contre nous. J’espère que ce ne sera pas le cas mais c’est une hypothèse.
Je ne peux donc répondre précisément à une question aussi large, monsieur Bouvard. Les affaires encore en cours sont bien entendu les plus compliquées. Je le répète, nous gérons la bad bank, c'est-à-dire des dossiers risqués et dépréciés. Mais ce qui nous reste maintenant, c’est véritablement le fond du tonneau, la mélasse…
Je ne saurais juger de la gestion des autres sociétés de défaisance – Comptoir des entrepreneurs et GAN. Pour ce qui est du CDR, la Cour des comptes a publié un rapport contenant un certain nombre de remarques. Je suis bien entendu obligé d’intégrer ces remarques, de les parer et d’y répondre en corrigeant certains aspects. Avant même la remise du rapport, nous avons apporté des réponses. En particulier, nous sommes désormais aidés par la Caisse des dépôts et consignations par le biais d’un contrat d’assistance. Il s’agit d’une simple sous-traitance, le CDR reste une personne morale indépendante et il n’y a pas de confusion des rôles. Mais je suis très satisfait de cette gestion et j’en rends hommage à la CDC et à ses salariés.
M. Michel Bouvard : J’aurais aimé avoir votre sentiment personnel sur le fonctionnement des structures de défaisance.
Le Président Didier Migaud : La Commission aura l’occasion de revenir sur ce sujet, mon cher collègue.
Monsieur Rocchi, je vous remercie pour vos réponses et pour votre disponibilité.
——fpfp——
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 18 heures (compte rendu n° 113) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation (CDR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation – CDR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation – CDR – et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Je remercie M. Jean-Pierre Aubert, ancien président du Consortium de réalisation – CDR –, d’avoir répondu à notre invitation. Je suppose, monsieur le président, que vous avez suivi en partie nos travaux.
M. Jean-Pierre Aubert : Non. C’est contraire à mes principes.
Le Président Didier Migaud : Vous êtes donc vierge par rapport aux propos que l’on a pu tenir auparavant.
Je vous propose d’entrer immédiatement dans le vif du sujet : où le dossier en était-il au moment où vous avez quitté la présidence du CDR ? Quelles observations avez-vous à formuler devant la représentation nationale sur les développements qui ont eu lieu depuis que vous avez quitté cette présidence ?
M. Jean-Pierre Aubert : Le dossier Tapie, sur lequel vous avez souhaité m'entendre, est l'un des principaux contentieux dont le CDR a hérité lorsque le Crédit Lyonnais lui a transféré, fin 1995, les actions de deux de ses filiales, la Société de banque occidentale – SBDO – et sa banque d'affaires Clinvest.
Peu de temps après la création du CDR à la fin de 1995, plusieurs procédures ont été engagées contre lui par les liquidateurs judiciaires du groupe Bernard Tapie : les sociétés du groupe Bernard Tapie et M. et Mme Tapie avaient en effet été déclarés en redressement judiciaire, puis, à l'exception de la société Bernard Tapie Finance, en liquidation judiciaire sous patrimoine commun, entre novembre 1994 et mars 1995.
La plus importante de ces procédures concernait le dossier Adidas. Les liquidateurs judiciaires du groupe Tapie reprochaient essentiellement au Crédit Lyonnais :
– de s'être fait donner mandat par la société Bernard Tapie Finance, en décembre 1992, de vendre sa participation de 78 % dans Adidas au prix de 2,085 milliards de francs, sans lui révéler qu'il avait déjà trouvé un acheteur en la personne de Robert Louis-Dreyfus, à qui il a ensuite consenti une promesse de vente au prix de 4,4 milliards de francs ;
– d’avoir organisé le portage d'Adidas pour son compte par des structures qu'il contrôlait, de février 1993 date de sa vente par la société Bernard Tapie Finance, jusqu'à fin 1994, date de l'acquisition d'Adidas par Robert Louis-Dreyfus ;
– d'avoir été ainsi, à l'insu du groupe Bernard Tapie, la contrepartie de son mandant lorsqu'il a vendu Adidas en février 1993, et d'avoir capté à son seul profit, au détriment de son mandant, une plus-value de 2,3 milliards de francs.
Par ailleurs, les mêmes liquidateurs ont assigné le CDR, d'abord pour soutien abusif du groupe Bernard Tapie par le Crédit Lyonnais et ses filiales, puis pour rupture abusive des concours bancaires consentis au groupe Bernard Tapie.
Voici, en quelques mots, le dossier que j'ai trouvé en arrivant à la présidence du CDR à la fin de 2001. Et je m’en suis saisi très vite en raison de son enjeu financier et de sa forte visibilité.
Dès le milieu de l'année 2002, je suis arrivé à la conclusion que, dans cette affaire d'une grande complexité, le CDR, comme successeur du Crédit Lyonnais et de ses filiales concernées – SDBO, Clinvest –, n'était pas à l'abri d'une condamnation à payer des dommages et intérêts, d'un montant cependant très inférieur à la plus-value dont le groupe Bernard Tapie prétendait avoir été privé.
C'est en partant de cette analyse que j'ai proposé le 5 novembre 2002 au ministre de l'économie et des finances de rechercher, dans le cadre d'une médiation, une solution négociée sur la base d'une clôture pour extinction de passif de la liquidation judiciaire du groupe Bernard Tapie grâce à des abandons de créances du CDR. Cette solution avait l'avantage, pour M. et Mme Tapie, d'éviter la condamnation pour banqueroute dont ils étaient menacés devant le tribunal correctionnel et, pour le CDR, de clôturer rapidement de multiples procédures engagées six ans plus tôt et dont tout laissait à penser qu'elles se prolongeraient encore pendant plusieurs années.
M. Francis Mer m'a fait savoir fin 2002 qu'il préférait que la justice suive son cours.
En septembre 2004, le nouveau ministre de l'économie et des finances m'a demandé de mettre en œuvre une médiation. À l'époque, le conseil d'administration du CDR et moi-même étions réservés sur ce processus qui avait pour inconvénient de dessaisir la cour d'appel quelques jours avant la date fixée pour les plaidoiries : je craignais que ce retrait de dernière minute ne soit perçu par la cour et par les adversaires du CDR comme un formidable aveu de faiblesse. En dépit de cette forte réticence, dont j'ai informé le ministre, le CDR s'est totalement impliqué dans la médiation conduite par M. Burgelin, ancien procureur général à la Cour de cassation, et il a accepté la proposition du médiateur, qui ne lui demandait que l'abandon de ses créances, tandis que les liquidateurs et M. Tapie l'ont rejetée.
Après l'échec de cette médiation, les parties se sont retrouvées devant la cour d'appel de Paris qui, par un arrêt du 30 septembre 2005, a condamné le CDR à verser 135 millions d'euros de dommages et intérêts aux liquidateurs judiciaires du groupe Bernard Tapie.
Après ce rappel, je voudrais indiquer pourquoi le CDR a tenu à se pourvoir en cassation et dans quelle situation il se trouvait après la cassation de la décision par un arrêt du 9 octobre 2006 de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
La défense des finances publiques exigeait le pourvoi en cassation. En effet, il est très vite apparu aux avocats, au président et au conseil d'administration du CDR qu'une cassation totale de l'arrêt était très probable, notamment pour les raisons suivantes :
– la cour d'appel ne pouvait pas légalement retenir à la charge du Crédit Lyonnais une obligation de financement du groupe Tapie pour lui permettre d'attendre une éventuelle levée de l'option accordée à Robert Louis-Dreyfus, alors que le banquier n'est jamais tenu de consentir un nouveau concours à l'un de ses clients ; au reste, un tel financement n'a jamais été demandé par la société Groupe Bernard Tapie Finance : au contraire, les liquidateurs du groupe Tapie reprochent au CDR un soutien abusif du groupe par le Crédit Lyonnais ;
– selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour d'appel ne pouvait pas non plus indemniser la perte d'une chance de plus-value par des dommages et intérêts égaux à 100 % de cette plus-value.
La seule objection de la tutelle du CDR à sa décision de se pourvoir en cassation reposait sur la crainte qu'après cassation, la cour de renvoi ne condamne le CDR aussi lourdement, voire plus lourdement, que la cour d'appel de Paris ne l'avait fait par son arrêt du 30 septembre 2005.
Pour les raisons que je vais indiquer, cette objection ne me paraissait pas pertinente, et je l'ai expliqué au comité des sages que M. Thierry Breton avait réuni pour le conseiller sur un éventuel pourvoi.
Finalement, par un communiqué du 13 janvier 2006, le ministre de l'économie et des finances a fait savoir que les deux représentants de l'État au sein du conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, actionnaire unique du CDR, ne formuleraient pas d'objection à la décision du CDR de se pourvoir en cassation.
L'arrêt de cassation du 9 octobre 2006 conférait au CDR une position solide. L'appréciation du CDR, après consultation de ses avocats, était que l'assemblée plénière de la Cour de cassation avait jugé définitivement que les liquidateurs du groupe Tapie n'étaient pas recevables à demander la remontée de la plus-value éventuellement perdue et qu'il ne leur était pas possible de demander plus que la réparation du préjudice personnel de la société Groupe Bernard Tapie du fait de l'éventuelle inexécution à son détriment, par la SBDO, du mémorandum du 10 décembre 1992.
Les juristes étaient unanimes à dire que, la Cour de cassation ayant statué en assemblée plénière, ce qu'elle avait jugé était définitif et s'imposait à la cour de renvoi. L'unique obligation de la SBDO, seule signataire du mémorandum de 1992 avec les sociétés du groupe Bernard Tapie, était la remontée vers le groupe d'une fraction du prix de vente d'Adidas, fixée à 185 millions de francs. Cette somme ayant été effectivement versée par la SBDO à la société Groupe Bernard Tapie, la SDBO s'était entièrement acquittée de son obligation contractuelle.
Indépendamment de cet aspect juridique, plusieurs considérations laissaient à penser que, quoi que décidât la cour de renvoi sur l'existence d'une faute de la SDBO, les préjudices personnels dont la société Groupe Bernard Tapie et M. et Mme. Tapie pouvaient éventuellement obtenir réparation seraient très inférieurs à la condamnation prononcée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005.
Selon le CDR et ses conseils, la cour de renvoi devait tenir compte de trois facteurs essentiels.
Premièrement, le prix de 2,085 milliards de francs était le bon prix parce que :
– il correspondait au prix auquel le groupe Tapie avait conclu la vente d'Adidas à Pentland – c'est-à-dire Reebok – en juillet 1992 et il était validé par les différentes expertises et les autorités de marché ;
– il était le meilleur prix possible en raison de la perte de plus de 500 millions de francs réalisée par Adidas en 1992 et de la nécessité de recapitaliser la société pour un montant équivalent, conformément aux exigences des banquiers allemands ;
– il permettait au groupe Bernard Tapie, sans avoir mis un franc de fonds propres et sans prendre de risques, de gagner 230,8 millions de francs dans l'opération Adidas.
Deuxièmement, le redressement d’Adidas et la levée par Robert Louis-Dreyfus, fin 1994, de son option d'achat étaient aléatoires.
Troisièmement, la survie du groupe Tapie durant les années 1993 et 1994 était impossible sans l'encaissement du prix de vente de sa participation dans Adidas en février 1993.
Autant dire que la chance perdue d'obtenir un meilleur prix que celui obtenu lors de la vente de février 1993 était proche de zéro et que la société Groupe Bernard Tapie n'avait subi aucun préjudice. Voilà pourquoi j'avais indiqué au conseil d'administration du CDR le 13 décembre 2006, au cours de la dernière séance que j'ai présidée, que le CDR pouvait attendre avec confiance la décision de la cour de renvoi et n'avait rien à demander ou à obtenir de quiconque jusqu'à ce prochain rendez-vous.
Le Président Didier Migaud : Je vous remercie pour ce propos très clair.
L’arrêt de la Cour de cassation n’est pas, comme l’aurait souhaité le CDR, une cassation totale. Le consortium encourait-il un risque en laissant la justice suivre son cours, compte tenu de cet élément ? Ce risque est un des arguments que l’on avance aujourd'hui pour justifier le recours à l’arbitrage.
En novembre 2002, vous avez proposé d’engager une procédure de médiation. Le ministre de l’économie et des finances de l’époque ne l’a pas acceptée. En septembre 2004, le ministre en poste propose une nouvelle médiation que, pour votre part, vous ne souhaitez pas. Pourriez-vous préciser pourquoi ce que vous proposiez en 2002 ne vous paraissait plus souhaitable en 2004 ?
M. Jean-Pierre Aubert : Qu’est-ce que l’annulation, par la Cour de cassation en assemblée plénière, de l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2005 sinon une cassation totale ? Après cette décision, le CDR ne doit pas un euro au liquidateur du groupe Bernard Tapie. J’ignore pourquoi l’on parle de cassation partielle alors qu’il y a eu annulation.
M. François Bayrou : Sur le moyen central de l’arrêt de la cour d’appel ?
M. Jean-Pierre Aubert : Sur le moyen que la cour d’appel a commis dans son arrêt un véritable vice de raisonnement – c’est du moins mon interprétation. Pour tenter de restituer au groupe Bernard Tapie une plus-value perdue, elle est passée par un détour en affirmant que le groupe aurait pu encaisser le prix d’achat payé par Robert Louis-Dreyfus s’il avait obtenu un financement lui permettant d’attendre ces deux ans. Elle a donc condamné le CDR – le Crédit Lyonnais de l’époque – sur le fait que le Crédit Lyonnais n’a pas consenti le concours de 2 milliards de francs qui aurait permis au groupe d’attendre le temps nécessaire.
Or il faut savoir qu’un actionnaire n’est pas recevable à demander réparation du préjudice de la société dont il détient des actions. En l’occurrence, le vendeur n’est pas le groupe Bernard Tapie mais Bernard Tapie Finance, dont le mandataire ad hoc a été déclaré irrecevable par la cour d’appel. Celle-ci a en revanche estimé recevable la plainte de la société Groupe Bernard Tapie au sujet d’une éventuelle inexécution du contrat passé au moment de la vente, c'est-à-dire du mémorandum.
Cela étant, l’inexécution du mémorandum représente au maximum 185 millions de francs, lesquels ont été versés. Pour pouvoir verser tout de même quelque chose au liquidateur, la cour d’appel invoque le défaut de financement ou le non-respect d’une obligation de financement. Ayant été président de banque pendant trente ans, je me souviens de l’émotion que ce sujet a soulevée dans le milieu bancaire : pour la première fois, une cour d’appel affirmait qu’il y avait un droit au crédit. Or, dans le même temps, le Crédit Lyonnais était poursuivi pour soutien abusif. La cour d’appel aurait voulu qu’il consentît un financement supplémentaire d’environ 2 milliards de francs pendant deux ans, en attendant la levée, tout hypothétique, de l’option. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Robert Louis-Dreyfus n’était pas tenu d’acheter. Il détenait une simple option qu’il lui était loisible de lever ou non à la fin du mois de décembre 1994. Financer pendant deux ans le groupe Tapie – qui ne le demandait même pas – en attendant cette éventualité n’était à l’évidence pas raisonnable.
Voilà pourquoi je ne crois pas que l’on puisse parler de cassation partielle. Le vrai sujet, c’était le risque que présentait la cour de renvoi. C’est ce qui a fait beaucoup hésiter au moins trois ministres de l’économie et des finances, dont Thierry Breton qui, avant de donner son feu vert au recours en cassation, se demandait si la cour de renvoi n’allait pas sanctionner le CDR encore plus durement que la cour d’appel. C’était une vraie question. Après y avoir beaucoup travaillé, nous sommes arrivés à la conviction qu’il n’y avait pas de risque : comme l’indique clairement la Cour de cassation, on ne peut indemniser à 100 % un préjudice résultant d’une perte de plus-value.
On a avancé beaucoup de chiffres au sujet de cette perte. La part de Bernard Tapie Finance dans Adidas était de 78 %, de 95 % du capital, soit 2,085 milliards de francs, ce qui correspond à une valorisation de 100 % d’Adidas, en février 1993, de 2,9 milliards de francs. Par ailleurs, les investisseurs dans Adidas ont dû procéder à une augmentation de capital de 517 millions de francs pour compenser les pertes de 1992 – les banques allemandes avaient en effet menacé de suspendre leur concours si l’on ne procédait pas à cette recapitalisation. En conséquence, le prix payé par les investisseurs, incluant le montant de la recapitalisation est de 3,4 milliards de francs. C’est ce montant qu’il convient de comparer au prix d’achat en décembre 1994, soit 4,4 milliards qu’a payé Robert Louis-Dreyfus. La vraie différence ne s’élève donc pas à 2,3 milliards, comme on l’a soutenu, mais à un peu plus d’un milliard de francs. C’était là le préjudice maximum. De plus, tant la cour d’appel que la Cour de cassation affirmaient que la demande du groupe Bernard Tapie relative à la perte de plus-value de sa propre filiale n’était pas recevable. Vraiment, je ne vois pas à quel montant la cour de renvoi aurait pu condamner le CDR : à notre avis, pas grand-chose ! Au demeurant, ce sont les liquidateurs qui ont demandé l’arbitrage.
J’en viens à votre seconde question, monsieur le président. En 2002, peu de dossiers de l’ancien Crédit Lyonnais étaient vraiment « blanc-bleu ». On ne pouvait estimer que le dossier Adidas ne présentait pas de risques : la preuve en est que la cour d’appel a condamné le CDR à 135 millions d’euros – on me l’avait reproché à l’époque –. Mon idée était que l’on pouvait s’épargner plusieurs années de procédure sur la base d’un principe que j’avais appelé « ni riche ni failli ». En d’autres termes, le CDR était prêt à abandonner les créances qu’il savait ne devoir jamais recouvrer et qui étaient provisionnées à 100 %, tandis que M. et Mme Tapie évitaient une comparution devant le tribunal correctionnel pour banqueroute.
C’était un compromis équilibré, celui-là même que l’avocat de M. et Mme Tapie avait demandé, autant qu’il m’en souvienne, quelques années auparavant et que le CDR avait alors refusé. Mais M. Francis Mer a souhaité que la justice suive son cours.
Si, en 2004, j’ai marqué beaucoup de réticence à l’idée d’une médiation, c’est que, comme je l’ai dit au ministre, dessaisir la cour d’appel de Paris à huit jours des plaidoiries constituait un très mauvais signal sur la solidité du dossier. Ce qui était possible à froid me paraissait dangereux à chaud.
M. Charles de Courson : Le président Aubert peut en témoigner, nous avons pratiquement toujours été d’accord pour soutenir une position dure dans cette affaire : la justice jusqu’au bout ! Je ne partage cependant pas tout à fait sa lecture de l’arrêt de la Cour de cassation. Certes, l’arrêt de la cour d’appel est cassé dans son élément essentiel, à savoir la condamnation à 135 millions d’euros portés à 145 millions à la suite d’une erreur – et il est vrai que cet arrêt était, en droit, un scandale : tous les articles de doctrine le disent et soulignent cette création d’un droit au crédit qui consacrait, à moins que l’on n’établisse un régime communiste, la disparition des banques en France ! Hélas, la Cour de cassation a maintenu ouvertes certaines portes, notamment en matière de responsabilité délictuelle.
Quoi qu’il en soit, je partage le sentiment du président Aubert : il n’existait aucun risque d’être condamné à un montant supérieur à 135 millions d’euros.
Le ministre Francis Mer a soutenu lui aussi une position dure. M. Sarkozy, qui lui a succédé, a d’abord hésité mais a autorisé la médiation puisque la possibilité restait ouverte de s’opposer aux conclusions qui en résulteraient. C’est finalement la partie adverse qui les a refusées. Elles étaient, si je puis dire, dans la « ligne Aubert » puisque M. Burgelin proposait 140 millions d’euros, soit aucun bonus pour les époux Tapie. Pour ma part, j’étais contre un tel versement, estimant que M. Tapie voulait un boni de liquidation pour se refaire et que ce n’est pas à cela qu’il fallait employer l’argent du contribuable.
Quant au ministre Thierry Breton, il m’avait indiqué, en réponse à une question orale à l’Assemblée, qu’il était ouvert à un accord. Cependant, après discussion et arbitrage, on a décidé d’aller en cassation. Je ne nie pas avoir eu quelque rôle dans cette affaire, ayant averti le Premier ministre et son entourage qu’il ne fallait surtout pas suivre la position initiale de M. Breton.
M. François Bayrou : C’était une question un peu chaude…
M. Charles de Courson : L’arrêt de la Cour de cassation nous a donné raison et nous a mis dans une situation juridique beaucoup plus forte que si l’on s’en était tenu à l’arrêt de la cour d’appel.
M. Jérôme Cahuzac : Votre exposé, monsieur le président Aubert, était plus concis mais aussi beaucoup plus synthétique et éclairant que ceux que nous avons entendus jusqu’à présent. De façon documentée et clinique, vous faites un sort à la théorie selon laquelle les opérations menées entre 1992 et 1994 auraient spolié Bernard Tapie. Je regrette que mes collègues Gilles Carrez et Jérôme Chartier, qui semblaient vouloir insister sur ce point, n’aient pas été là pour vous entendre car ils auraient bénéficié de toutes les réponses aux questions qu’ils se posaient.
Permettez-moi de revenir sur le rôle des ministres successifs. M. Mer refuse votre proposition de médiation ; M. Sarkozy accepte la médiation que mènera M. Burgelin ; M. Breton n’a pas à se prononcer sur les résultats de cette médiation puisque le refus vient des liquidateurs ; il décide en revanche d’aller en cassation après l’arrêt de la cour d’appel.
Sur ces sujets, et dès lors que de l’argent public est engagé, le président du CDR, société privée, ne prend pas de décision majeure sans l’accord du ministre de l’économie et des finances. Selon vous, le président actuel du CDR a-t-il pu recourir à la procédure arbitrale et renoncer à tout appel une fois la sentence du tribunal arbitral rendue sans l’accord clair et explicite de la ministre de l’économie et des finances ?
M. Jean-Pierre Aubert : Je ne saurais répondre pour mon successeur et ne voudrais surtout pas compliquer les choses. Le CDR, je le répète, est une société de droit privé ayant pour actionnaire unique un établissement public administratif, l’EPFR. Certains dossiers clairement identifiés sont à la charge financière directe de l’EPFR, et non du CDR en première ligne. Le dossier Adidas, tout comme le dossier Executive Life, est de ceux-là. Il était donc normal que le président du CDR, avant de prendre une décision importante sur ces sujets, demandât au président de l’EPFR s’il avait une objection. En 2002, une objection à la médiation a été formulée. En 2004, lorsque l’on a évoqué une nouvelle médiation, les choses ont été un peu plus directes : le CDR pouvait difficilement s’y opposer, mais il a été capable d’imposer ses conditions, dont deux étaient essentielles :
– que la médiation soit conduite par une personnalité incontestable, ce qu’était à l’évidence Jean-François Burgelin, homme d’une formidable trempe et d’une intégrité absolue ;
– que la médiation ne puisse aboutir au versement d’une somme dont une partie aurait pu s’ajouter au patrimoine de M. ou Mme Tapie – c’était une exigence du conseil d’administration du CDR et j’avais dit moi-même au ministre que je ne ferais jamais un chèque, ne serait-ce que d’un euro, si elle n’était pas remplie : il m’avait répondu que personne ne me le demandait.
Certes, la médiation ne me paraissait pas une bonne solution dans la mesure où l’on était à quelques jours des plaidoiries en appel. Je pense que cela a eu un rôle dans la décision ultérieure, mais on peut soutenir le contraire.
Permettez-moi de citer le relevé de décisions du conseil d’administration du 23 septembre 2004 : « Enfin, le conseil demande au président de veiller à ce qu’aucun accord transactionnel ne puisse entraîner, pour le CDR, un paiement en numéraire au bénéfice direct ou indirect des époux Tapie, c'est-à-dire allant au-delà de ce qui pourrait être nécessaire pour solder la liquidation judiciaire compte tenu des actifs dont elle dispose. »
M. Charles de Courson : Quand cette affaire est remontée à l’EPFR – qui a accepté ces conditions –, j’ai voté contre le principe de la médiation de M. Burgelin, étant certain que celle-ci échouerait : dès lors qu’il était certain qu’ils n’auraient pas un sou, les époux Tapie refuseraient. C’est bien ce qui s’est passé. Les plus pervers nous ont même accusés de n’avoir engagé la médiation que pour la faire échouer.
M. Jérôme Cahuzac : Vous ne sauriez, bien entendu, vous exprimer à la place de votre successeur, monsieur le président Aubert. Vous confirmez toutefois que, dans votre pratique, rien d’important ne s’est fait sans l’accord ou le refus explicite du ministre et vous imaginez difficilement qu’il ait pu en être autrement par la suite…
Le Président Didier Migaud : M. Rocchi l’a affirmé lui aussi clairement, mon cher collègue. L’EPFR dispose d’une faculté d’empêcher. Le ministre donne des instructions aux représentants de l’État et le président de l’établissement, pour en revenir au débat sémantique que nous avons eu ce matin avec M. Schneiter, « peut » en tenir compte. Tout le monde reconnaît que cela fonctionne ainsi.
M. François Bayrou : Je veux souligner à mon tour combien concise, claire, explicite et démonstrative a été l’introduction de M. le président Aubert et combien elle nous sera utile pour la suite du débat.
Parmi les nombreuses incohérences de cette affaire, il en est une qui est particulièrement frappante et qui aurait dû inciter le Gouvernement à changer sa position au sujet du recours : la thèse centrale, défendue par les liquidateurs du groupe Bernard Tapie devant la cour d’appel, est que l’on a causé du tort au groupe en ne lui offrant pas la chance de réaliser un profit par le biais d’un prêt qui aurait été consenti aux mêmes conditions que ceux accordés aux autres repreneurs.
Il se trouve que Le Point avait consacré un dossier à Bernard Tapie et m’avait interviewé à ce sujet. Il suffisait de lire, dans le numéro suivant, la réponse de M. Lantourne, avocat de Bernard Tapie, à cette interview. Il y exposait sa ligne juridique : on prétend que c’est en raison de difficultés financières que le groupe a choisi de vendre Adidas mais il n’en est rien ; en réalité, c’est une décision personnelle de Bernard Tapie qui, considérant que la gestion d’une affaire industrielle était incompatible avec l’exercice d’une fonction ministérielle – apparemment, c’était pressé –, a choisi de vendre et a été trahi par son mandataire.
Telle est la version alléguée. Je pense pour ma part que le choix n’existait pas car mon analyse du mandat passé en 1992 avec la SDBO est très différente de ce que l’on peut lire ici ou là : il ne s’agit pas d’un mandat de vente mais de la signature d’une obligation de vendre à tout acheteur désigné par la SDBO et au premier appel, sans que Bernard Tapie et son groupe puissent émettre la moindre réserve. En effet, il existait sur les actions Adidas détenues par Bernard Tapie un nantissement. M. Tapie étant incapable de faire face à son échéance à deux ans, la banque aurait pu, sans dépenser un euro, exercer son gage et se retrouver à la tête d’Adidas. Selon moi, c’est pour permettre à Bernard Tapie, qui allait entrer au Gouvernement, de sauver la face que l’on a organisé une vente au lieu d’exercer le nantissement. Bernard Tapie a lui-même affirmé que cette vente s’était faite à un « bon prix », avec une plus-value de 240 millions de francs.
Il y avait en effet quelque exagération à affirmer que l’arrêt de la cour d’appel et celui de la Cour de cassation faisaient peser des menaces sur le CDR. Ce n’était pas le cas. J’estime donc que l’on a pris une décision à l’encontre des intérêts de l’État et du contribuable.
M. Dominique Baert : Je vous remercie moi aussi, monsieur le président Aubert, pour la concision et la clarté de votre introduction.
Au moment où vous quittez vos fonctions, la Cour de cassation vient de rendre son arrêt. Vous estimez qu’un passage par la cour de renvoi ne peut aboutir à une issue plus défavorable que l’arrêt de la cour appel. Au moment du passage de témoin, avez-vous fait part de votre sentiment à vos autorités de tutelle et à votre successeur ?
Quel jugement, au regard de ce que vous connaissez du dossier, portez-vous sur les montants figurant dans la sentence du tribunal arbitral ?
Enfin, j’aimerais savoir – car je crois à l’honnêteté de votre approche – comment vous jugez l’idée d’une indemnisation de M. Tapie pour préjudice moral.
M. Jean-Pierre Aubert : Ayant eu à présider, au cours de ma carrière, quelques établissements, je me suis fixé pour principe de ne jamais dire un mot sur mes prédécesseurs et sur mes successeurs. Vous pourrez vous reporter aux procès-verbaux des conseils d’administration, notamment celui dont je vous ai lu un extrait : c’était ma dernière intervention devant le CDR.
S’agissant de la sentence du tribunal arbitral, ce n’est pas l’ancien président du CDR mais le citoyen qui s’exprimera. En tant que citoyen, je ne comprends pas cette décision. Il me semble que le protocole d’arbitrage – que je n’ai pu consulter mais dont j’ai beaucoup entendu parler – imposait de respecter la chose jugée. Or la question de la recevabilité était jugée de façon définitive. Je le dis et redis : le groupe Bernard Tapie n’était pas recevable, en tant qu’actionnaire du vendeur d’Adidas – à savoir Bernard Tapie Finance – à réclamer une indemnité compensatoire d’une éventuelle perte de plus-value pour BTF. La cour d’appel l’a affirmé et la Cour de cassation l’a confirmé, conformément à une jurisprudence constante : un actionnaire ne peut intenter une action au nom de la société qu’il détient ; il ne peut le faire que s’il a subi un préjudice propre et personnel. Ce préjudice, pour le groupe Bernard Tapie, c’était l’éventuelle inexécution du mémorandum du 10 décembre 1992, lequel prévoyait que, sur le prix de vente d’Adidas à hauteur de 2,085 milliards de francs, 185 millions devaient remonter dans les caisses du groupe. La SBDO a versé cette somme. Il y a donc bien eu exécution de l’obligation contractuelle. Dès lors, je ne vois pas sur quel fondement la société Bernard Tapie peut invoquer un préjudice résultant de la perte de plus-value par sa filiale.
À la limite, le seul point sur lequel le tribunal arbitral disposait d’une liberté totale de décision était la détermination du préjudice moral. Il aurait pu aussi bien l’estimer à 285 millions d’euros : sur le plan strictement juridique, cela aurait été moins choquant ; sur d’autres plans, chacun est libre de son appréciation.
Le Président Didier Migaud : Merci beaucoup, monsieur le président Aubert.
——fpfp——
Mercredi 3 septembre 2008, séance de 19 heures (compte rendu n° 114) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Scemama, président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR), sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Bernard Scemama, président du conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation – CDR – et le groupe Bernard Tapie
Le Président Didier Migaud : Monsieur Bernard Scemama, vous êtes le président actuel de l’Établissement public de financement et de restructuration, l’EPFR, dont nous parlons depuis ce matin. Je crois d’ailleurs que vous avez écouté nos travaux. Je vous propose, afin d’introduire le débat, que vous nous présentiez en quelques mots la façon dont vous avez été saisi de ce dossier et la façon dont les décisions ont été prises.
M. Bernard Scemama : Je vous remercie de m’inviter à m’exprimer devant vous, ce que je fais très volontiers et très modestement. En effet, contrairement aux personnalités entendues jusqu’à présent aujourd’hui, je suis tout nouveau dans ce dossier : j’ai pris la présidence de l’EPFR il y a moins d’un an, alors que l’arbitrage avait été demandé depuis quelques semaines et qu’il avait déjà fait l’objet de premières discussions.
L’EPFR – je parle sous le contrôle de M. Charles de Courson – se résume à son conseil d’administration. Il ne dispose pas de services pour instruire les dossiers, même si l’Agence des participations de l’État, l’APE, peut apporter son assistance et si une mission de contrôle siège aussi bien à l’EPFR qu’au Consortium de réalisation, le CDR. Ce mode d’organisation procède de la loi du 28 novembre 1995, qui a construit un dispositif à deux étages. L’étage opérationnel, celui de la gestion, est constitué par le CDR, société de cantonnement des actifs du Crédit Lyonnais.
Le Président Didier Migaud. Considérez que, depuis ce matin, nous avons recueilli ces informations.
M. Bernard Scemama. Le second étage, que j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui, est celui de la surveillance de la défaisance : la loi a confié à l’EPFR la mission de soutenir financièrement le CDR et de préserver les intérêts financiers de l’État. Le législateur a donc prévu de façon très claire que l’EPFR n’interviendrait pas directement dans la gestion quotidienne du CDR, cela ne s’est pas démenti depuis que je le préside. Il n’a pas pour rôle de gérer les litiges mais uniquement d’exercer une surveillance. Il ne détient en effet ni majorité au sein du conseil d’administration du CDR ni droit de veto sur les décisions de ce dernier.
Le Président Didier Migaud : Ce n’est pas ce qui nous a été expliqué par l’ensemble des personnes auditionnées avant vous. La décision est certes prise par le CDR mais, si le conseil d’administration de l’EPFR s’y oppose, elle n’est pas suivie d’effets, ce qui revient à une sorte de droit de veto. Votre prédécesseur a expliqué que le rôle de surveillance initialement confié à l’EPFR a évolué au fil du temps, car il est appelé en première garantie et il apparaît légitime qu’il donne son point de vue.
M. Bernard Scemama : Ce n’est pas du tout contradictoire : j’ai simplement voulu dire que l’EPFR ne joue pas de rôle dirigeant au sein du CDR.
Le Président Didier Migaud : Si nous avons tous réagi, c’est que vous avez dénié l’existence d’un droit de veto, en contradiction avec les déclarations de l’ensemble des personnes auditionnées depuis ce matin.
M. Charles de Courson : J’en témoigne !
M. Bernard Scemama : Vous m’avez mal compris. Je parlais du rôle de l’EPFR au sein du CDR.
Comment l’EPFR et le CDR sont-ils intervenus dans la procédure d’arbitrage ? Les mandataires-liquidateurs du Groupe Bernard Tapie ont proposé au CDR, le 1er août 2007, la tenue d’un arbitrage en vue d’éteindre tous les contentieux en cours. Le conseil d’administration du CDR a pris connaissance du courrier des mandataires-liquidateurs lors de sa réunion du 12 septembre – n’ayant alors pas encore pris mes fonctions de président de l’EPFR, je n’y siégeais pas. Il a débattu largement de la proposition lors de ses réunions du 18 septembre – la première à laquelle j’ai participé – et du 2 octobre. L’arbitrage a été accepté en deux temps : d’abord, le conseil d’administration ne s’est pas opposé à ce que le président poursuive le travail dans cette direction ; puis, il s’est prononcé en faveur de cet arbitrage, un administrateur s’abstenant.
C’est alors que le CDR a saisi spontanément l’EPFR afin de s’assurer de l’absence d’objection de sa part, s’agissant d’un contentieux à fort enjeu financier aux conséquences supportées par l’EPFR. J’ai alors réuni mon conseil d’administration – M. de Courson y a participé par téléphone –, lequel n’a pas émis d’objection. Les représentants de l’État ont d’ailleurs très clairement indiqué avoir reçu des instructions ministérielles par lesquelles il leur était enjoint de ne pas s’opposer à un tel arbitrage.
Le conseil d’administration de l’EPFR a ensuite attendu d’obtenir des éléments d’information complémentaires, qui lui sont parvenus il y a peu, en juillet : avec la sentence arbitrale, le ciel lui est tombé sur la tête, pardonnez-moi l’expression. L’avis du CDR à propos de cette sentence arbitrale est intervenu au terme de plusieurs réunions : son conseil d’administration, sur la base d’un dossier très étayé, a refusé de déposer en recours en annulation, considérant que celui-ci n’avait aucune chance d’aboutir et que les inconvénients risquaient de surpasser les avantages. Le président du CDR est venu présenter cette délibération devant le conseil d’administration de l’EPFR, lequel a longuement débattu de la question : après avoir entendu les positions défendues par MM. Charles de Courson et Roland du Luart, examiné l’avis formulé par les administrateurs représentant l’État sur instructions de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, il ne s’est finalement pas opposé à ce que le CDR n’intente pas de recours en annulation.
Tel fut le déroulement des choses. Les uns et les autres peuvent éprouver un sentiment, être animés de convictions, mais il existait un courant très fort, relativement ancien, en faveur d’un arbitrage tendant à clore le dossier Tapie. Ce courant était nourri par la force que l’arrêt rendu par la Cour de cassation semblait donner au CDR. Les avocats du CDR, tous leurs écrits en attestent, étaient persuadés de la solidité de leur position juridique. Le compromis d’arbitrage avait été soigneusement travaillé et les avocats l’ont défendu avec beaucoup de vigueur – je rappelle que les administrateurs du CDR en ont eu communication en séance mais qu’ils n’ont pas pu en conserver d’exemplaire, ce qui les a empêchés de l’étudier en profondeur. Cet arbitrage apparaissait de nature à éteindre toute l’affaire à la fois, en permettant de clore plusieurs dossiers susceptibles d’être défavorables au CDR sur le long terme. C’est ainsi que l’option de l’arbitrage est apparue et s’est renforcée.
Le Président Didier Migaud : Vous affirmez que ce courant en faveur de l’arbitrage était « relativement ancien ».
M. Bernard Scemama : Absolument.
Le Président Didier Migaud : Qu’entendez-vous par là ? Cette opinion ne semble pas partagée par l’ancien président du CDR ; il considère qu’il aurait été possible de laisser libre cours à la justice.
M. Bernard Scemama : Lorsque mon prédécesseur m’a transmis le témoin, l’arbitrage est l’une des premières choses dont il m’a entretenu. Je dois dire que j’ai pris ce dossier par hasard, en été ; l’inspection générale des finances cherchait quelqu’un et il s’est trouvé que j’étais disponible à cet instant…
M. Jérôme Cahuzac : Pas de chance !
M. Bernard Scemama : C’est la vie.
Le Président Didier Migaud : Vous ne nous rassurez pas !
M. Bernard Scemama : Quoi qu’il en soit, même si l’option précise de l’arbitrage n’apparaît pas très clairement dans le dossier, l’idée consistant à trouver une solution non juridictionnelle est ancienne. C’est en tout cas mon sentiment, mais il ne vaut pas plus que cela. Et, quand la décision en faveur de l’arbitrage est intervenue, tout le monde était convaincu que le dossier était suffisamment bordé pour que l’issue soit favorable ou du moins pas trop défavorable au CDR.
M. Charles de Courson : Lorsque le CDR s’est prononcé à propos de l’arbitrage, quel a été votre vote ? Aviez-vous reçu des instructions pour voter dans tel ou tel sens ?
M. Bernard Scemama : Ma réponse sera très simple. La première décision a été prise par consensus : les cinq administrateurs ont donné mandat au président de poursuivre la démarche. La seconde décision a été la plus formalisée. Quoique ne disposant pas de l’historique – c’était quelques jours après mon entrée en fonctions –, au vu de ce que j’avais entendu, en mon âme et conscience, j’ai donné mon accord pour la procédure proposée. Aucun membre du conseil d’administration du CDR n’a d’ailleurs voté contre. Je n’ai reçu aucune instruction.
M. Charles de Courson : Une fois la sentence arbitrale rendue, lorsque le conseil d’administration du CDR s’est prononcé sur l’opportunité d’un recours en annulation, il y a eu trois voix contre et deux voix pour. Dans quel sens avez-vous voté et, là encore, aviez-vous reçu des instructions ?
M. Bernard Scemama : Ma réponse sera tout aussi simple. Lors de cette réunion, j’ai indiqué que je n’envisageais pas de prendre part au vote car je préférais réserver ma position en attendant que l’EPFR se prononce. Au terme de la discussion qui a suivi, j’ai voulu être honnête avec moi-même et ne pas remettre en cause mon vote concernant le choix de l’arbitrage, même si son résultat ne convenait pas, d’autant que je n’étais pas certain qu’un recours en annulation soit susceptible d’aboutir.
Le Président Didier Migaud : En clair, qu’avez-vous fait ?
M. Bernard Scemama : J’y arrive.
Le Président Didier Migaud : Ah !
M. Bernard Scemama : Après avoir hésité, j’ai voté contre le recours en annulation. Je savais que ne pas prendre part au vote ne changerait rien, car un administrateur indépendant s’était déclaré opposé à ce recours et le président, doté d’une voix prépondérante, était du même avis. C’était donc une question d’honnêteté intellectuelle.
M. Charles de Courson : Mais avez-vous reçu des instructions ?
M. Bernard Scemama : Non, mais je connaissais les instructions reçues par les administrateurs représentant l’État.
M. Charles de Courson : Si vous aviez connu à l’avance les conclusions de la sentence arbitrale, auriez-vous voté pour cette procédure ?
M. Bernard Scemama : Il aurait fallu être fou ! Un volet de la sentence me paraît excessif et m’a toujours choqué : celui concernant le préjudice moral. Cela dit, il est toujours difficile de refaire l’histoire. L’arbitrage permettait d’éteindre tous les contentieux et de contrecarrer les exigences extraordinaires de la partie adverse en les ramenant de 7 milliards à un maximum de 300 millions d’euros. Le risque existait car il est impossible de connaître les conclusions d’une procédure judiciaire, comme celles d’une procédure arbitrale. Par conséquent, sous réserve de la clause de préjudice moral, peut-être aurais-je été favorable à l’option de l’arbitrage même si j’avais eu connaissance de la sentence.
M. Charles de Courson : Lorsqu’ils ont été appelés à voter sur l’opportunité d’un recours en annulation, les administrateurs du CDR disposaient-ils des trois notes des avocats ?
M. Bernard Scemama : Oui. Nous ne les avions pas en main mais les avocats nous les ont présentées.
M. Michel Bouvard : Bien que le ciel vous soit « tombé sur la tête » lorsque vous avez pris connaissance de la sentence arbitrale, vous avez admis qu’il n’y avait pas lieu de la remettre en cause, alors qu’au moins deux des avocats consultés par le CDR jugeaient possible d’obtenir son annulation. Jugez-vous votre vote cohérent au regard de votre réaction après avoir appris la sentence ?
Quoique doté d’effectifs administratifs restreints, l’EPFR peut demander assistance à l’APE, vous l’avez dit. Dans ce dossier, à un moment ou un autre, avez-vous sollicité une expertise ou un avis de l’APE concernant le déroulement des procédures ou le risque financier ?
Enfin, comment expliquez-vous que l’EPFR et surtout le CDR aient accepté que le volet du préjudice moral entre dans le cadre de l’arbitrage ? Cela s’est sans doute décidé un peu avant votre arrivée, mais qu’en pensez-vous ?
M. Bernard Scemama : À mon sens, les notes des avocats ne contenaient pas d’éléments permettant de déduire avec certitude que l’annulation était envisageable. Certains avocats prestigieux ont même exprimé des positions différenciées au fil du temps. Du reste, nous nous sommes interrogés sur les conséquences d’une annulation : le CDR s’en sortirait-il mieux ou moins bien ? En ce sens, mon vote a été cohérent.
M. Charles de Courson : Vous me permettrez de ne pas partager votre opinion. Voici ce qu’en a dit le cabinet Célice, Blancpain et Soltner – qui suit l’affaire depuis des années –, appuyé par le cabinet Orrick, Rambaud et Martel : « En conclusion, je considère que le CDR dispose d’un moyen d’annulation qui peut être qualifié de sérieux et qui pourrait d’autant plus emporter la conviction d’un collège de magistrats que l’on est en présence d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée par la plus haute autorité judiciaire dans cette affaire, atteinte accompagnée au surplus d’appréciations péremptoires et d’erreurs de fait et de droit dont est par ailleurs émaillée la sentence. » C’est très dur. Les deux autres notes, qui, en conseil d’administration, nous avaient été présentées comme défavorables à tout recours, ne le sont que modérément. Or, vous l’avez confirmé, ce sont les mêmes notes qui vous avaient été présentées au CDR. J’ajoute que les deux administrateurs venant du monde des affaires ont voté pour le recours tandis que les deux représentants de l’État votaient contre.
M. Michel Bouvard : C’est le président du CDR qui a fait la décision.
M. Charles de Courson : Votre prédécesseur, monsieur Scemama, nous a expliqué qu’il s’abstenait toujours, refusant de préjuger de la position de l’EPFR. Même si le scrutin s’était soldé par deux voix contre deux, la voix du président aurait été prépondérante, mais un partage des voix amène toujours à réfléchir. En tout cas, vous ne pouvez affirmer que la sentence vous est tombée sur la tête car son annulation aurait conduit à ce que la procédure reprenne son cours normal, avec l’espoir d’un meilleur résultat.
M. Bernard Scemama : C’est précisément à propos de cet espoir que je n’ai ni certitude ni conviction.
Lorsque la décision d’arbitrage a été prise, je n’ai pas reçu d’analyse de l’APE.
M. Michel Bouvard : Mais avez-vous sollicité son expertise ou son assistance ? Comprenez que nous nous interrogeons sur le fonctionnement des établissements de défaisance en général. L’APE vous fournit-elle de l’expertise ? Vous arrive-t-il de la solliciter ?
M. Bernard Scemama : Oui, très clairement. J’ai justement demandé à l’APE son appréciation concernant le recours en annulation et nous avons eu une séance de travail à ce propos. Ma conviction s’est forgée ainsi.
M. Charles de Courson : L’APE était plutôt favorable à l’arbitrage ?
M. Bernard Scemama : Non, je parlais du recours en annulation. Lorsque l’option de l’arbitrage a été prise, je n’ai pas pu consulter l’APE car le calendrier était trop serré.
Le Président Didier Migaud : Si je comprends bien, pour forger votre point de vue, ce qui semble ne pas avoir été aisé, vous avez organisé une réunion de travail avec l’APE.
M. Bernard Scemama : C’est tout à fait normal : nous avons examiné les différentes possibilités qui s’offraient à nous.
C’est après le choix de l’arbitrage que nous avons découvert le montant demandé au titre du préjudice moral. En effet, le compromis s’est enrichi dans le temps.
Le Président Didier Migaud : Non ! Ce montant figure dans la convention d’arbitrage.
M. Dominique Baert : Dans le compromis initial.
M. Charles de Courson : J’ai participé par téléphone à la réunion du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre. La convention était sur la table mais personne n’a pu réellement la consulter durant la discussion ; elle n’a été ni laissée aux administrateurs ni annexée au procès-verbal. Cependant, celui-ci fait foi : « M. Rocchi précise également que le montant réclamé par les parties adverses sera plafonné dans le compromis d’arbitrage : 295 millions d’euros pour les liquidateurs du groupe Tapie et 50 millions d’euros au titre d’une demande fondée sur un « préjudice moral » allégué par les époux Tapie. »
M. Jérôme Cahuzac : Je trouve un peu curieuse, monsieur Scemama, votre persistance à vouloir prendre le ciel sur la tête…
Vous pensiez d’abord ne pas prendre part au vote concernant le recours en annulation de la sentence arbitrale, en attendant que l’EPFR émette son avis. Vous avez finalement voté contre ce recours en annulation. Quand avez-vous appris que la ministre avait donné des instructions aux représentants de l’État ? Pouvez-vous m’indiquer si elles étaient écrites ?
M. Bernard Scemama : Je l’ai pratiquement appris durant la séance. Je savais que l’APE avait demandé des instructions au ministre – ce qui est normal dans une telle procédure –, sachant que le conseil d’administration de l’EPFR serait amené à se réunir immédiatement après celui du CDR. Au cours de la séance, l’APE m’a informé que ces instructions étaient intervenues. J’ignore si elles étaient écrites.
M. Dominique Baert : Chacun retiendra que le ciel vous est tombé sur la tête mais maintenant, il va falloir payer, et à très brève échéance, nous venons de l’apprendre. Quand verserez-vous l’argent ? Comment vous financerez-vous ? Disposez-vous de la trésorerie nécessaire ? Sinon, auprès de qui vous approvisionnerez-vous ? À qui remettrez-vous les fonds ?
M. Bernard Scemama : Lorsque l’on est convaincu qu’un dossier est excellent et que rien ne peut arriver mais que la sentence tombe, l’on pense que l’on s’est complètement trompé, que l’affaire a été mal conduite ou que l’on a commis une erreur.
M. Jérôme Cahuzac : Vous avez pourtant répondu à M. de Courson que vous étiez prêt à recommencer.
M. Bernard Scemama : Je répète qu’une procédure judiciaire aurait aussi comporté des risques, la partie adverse réclamant 7 milliards d’euros. En face, une possibilité d’arbitrage existait, sur la base de demandes ramenées d’une certaine façon à la raison, permettant l’extinction de tous les contentieux. L’intérêt de poursuivre une procédure en cours depuis une dizaine d’années sans résultat flagrant faisait question. En répondant ainsi, j’ai seulement voulu illustrer l’extrême difficulté de la situation et le fait que l’issue ne pouvait être connue à l’avance.
La trésorerie actuelle de l’EPFR – 205 millions d’euros, si je ne me trompe – ne lui permet pas de répondre à la fois au paiement des sommes dues à la liquidation Bernard Tapie et aux échéances des emprunts en cours. L’APE a déterminé les meilleures modalités de financement : recourir à un tirage dont dispose l’EPFR auprès du Crédit Lyonnais. Cette option offre plusieurs intérêts. Premièrement, elle sera souple, dans la mesure où la somme pourra être remboursée chaque trimestre, et peu coûteuse, puisque le taux applicable sera celui des emprunts à court terme. Deuxièmement, la mobilisation sera rapide, contrairement à une dotation de l’État, qui aurait supposé une procédure, probablement législative. Troisièmement, elle préservera toutes les possibilités de couverture par l’État. Quatrièmement, elle sera complètement neutre au regard de la dette des administrations publiques, l’APE le confirme.
En tant qu’ordonnateur, l’EPFR écrit au ministre pour lui demander l’autorisation d’emprunter. Une fois son accord reçu, je peux saisir le Crédit Lyonnais pour formaliser l’emprunt. Celui-ci est versé à l’agent comptable de l’EPFR, qui procède ensuite au versement des sommes – logiquement, au profit des liquidateurs du Groupe Bernard Tapie, mais je ne suis pas un spécialiste.
M. Dominique Baert : Quand allez-vous payer et combien ?
M. Bernard Scemama : Le versement devrait avoir lieu le 5 septembre.
M. Jérôme Cahuzac : Vous avez donc déjà demandé à la ministre l’autorisation d’emprunter au Crédit Lyonnais.
M. Bernard Scemama : Bien sûr.
M. Jérôme Cahuzac : À hauteur de quel montant ?
M. Bernard Scemama : De mémoire, il doit s’agir de 153 millions.
M. Dominique Baert : À quel taux rembourserez-vous ?
M. Bernard Scemama. Au taux court terme EONIA, un peu plus de 3 %, c’est-à-dire moins que le taux de la dette.
M. Charles de Courson : Pour être très précis, il s’agit au total d’un acompte de 197 millions. L’EPFR va s’endetter de 152 millions d’euros pour compléter les 45 millions dont dispose le CDR. L’autre solution, que je préconisais, aurait consisté à demander ces 152 millions à la ministre.
Restera ensuite, d’ici à la fin de l’année, la deuxième tranche, qui, à mon avis, devrait atteindre 60 millions environ, sachant que les intérêts et la somme plafonnée ne sont pas pris en compte.
Le Président Didier Migaud : Ne refaisons pas le débat de tout à l’heure.
M. Jérôme Cahuzac : Il faudra donc formuler une nouvelle demande d’endettement à la ministre.
M. Bernard Scemama : À moins qu’une dotation soit accordée.
Le Président Didier Migaud : Compte tenu des raisons que vous avez évoquées, cela semble peu probable.
——fpfp——
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 9 heures 30 (compte rendu n° 115) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Thomas Clay, doyen de la Faculté de droit de Versailles, titulaire de la chaire du droit de l’arbitrage, sur le droit et la pratique de l’arbitrage
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Thomas Clay, doyen de la Faculté de droit de Versailles, titulaire de la chaire du droit de l’arbitrage, sur le droit et la pratique de l’arbitrage.
M. le Président Didier Migaud : Nous poursuivons les auditions qui doivent nous permettre de faire toute la lumière sur les raisons qui ont présidé au choix d’un arbitrage pour régler les litiges opposant le CDR aux liquidateurs du groupe Bernard Tapie et aux époux Tapie. Nous avons souhaité entendre un spécialiste du droit de l’arbitrage et je vais donc demander à M. Thomas Clay, titulaire de la chaire de droit de l’arbitrage à la faculté de droit de Versailles de nous exposer les grandes lignes de ce droit puis de commenter son application dans le cas qui nous occupe.
M. Thomas Clay : C’est un plaisir et un honneur pour moi d’être auditionné par votre Commission à propos d’une affaire qui a porté l’arbitrage à la connaissance du grand public, mais dans une représentation infidèle de ce qu’est cette justice privée. Il ne faut en effet pas croire que tous les arbitrages se déroulent comme celui qui fait l’objet de vos travaux. Dans l’immense majorité des cas, l’arbitrage est une justice qui fonctionne, et qui fonctionne même très bien – c’est pourquoi, d’ailleurs, on en entend peu parler. C’est une justice qui donne toute satisfaction car elle est rapide, confidentielle, adaptée aux affaires et aux usages du monde des affaires. C’est aussi une justice à laquelle les arbitres consacrent tout le temps nécessaire, et qui présente l’avantage pour les parties qu’elles peuvent choisir ceux qui vont les juger. Il ne faudrait donc pas que cette affaire discrédite la pratique de l’arbitrage ; autrement dit, il ne faut pas confondre l’arbitrage en tant que tel et cet arbitrage particulier.
Il ne m’appartient pas de juger l’affaire au fond car je n’ai eu qu’un accès très partiel au dossier et je n’y suis lié en rien, mais il convient de donner un éclairage sur la procédure suivie, qui ne laisse pas d’interroger. Je m’efforcerai donc d’éclairer votre Commission sur le droit et la pratique de l’arbitrage, puis d’éprouver la procédure suivie en l’espèce au regard de ce droit et de ces pratiques avant d’indiquer quels sont les recours possibles à l’égard de la sentence arbitrale rendue le 7 juillet dernier.
L’arbitrage n’est pas une justice exceptionnelle, c’est même la forme originelle de la justice, et il existe depuis quelque 4 000 ans. La seule différence entre l’arbitrage et la justice étatique est que l’on choisit celui qui va rendre la décision à laquelle on accepte par avance de se soumettre.
L’arbitrage n’est pas une justice dérogatoire. Il s’est progressivement imposé comme la justice des affaires, particulièrement en matière internationale, où il est devenu la justice exclusive car nul n’a envie de se retrouver devant la justice de l’autre pays, non par défiance, mais parce que les règles appliquées relèvent d’une autre culture. Le Parlement le sait bien qui, le 17 octobre dernier, a voté la loi permettant l’ouverture d’une annexe du musée du Louvre à Abou Dhabi : ce texte prévoit que tous les conflits seront tranchés par la voie de l’arbitrage. De même que les contractants français ne souhaiteraient pas, en cas de litige, se retrouver devant la justice de l’émirat, de même le contractant américain qui s’implante à Marne-la-Vallée ne souhaite pas se retrouver devant la justice française, si bien que la clause prévoyant le recours à l’arbitrage a été une condition sine qua non de l’implantation d’Eurodisney en France.
Ces deux exemples montrent que l’État peut conclure des conventions d’arbitrage et qu’il est même tenu de le faire lorsqu’il intervient comme opérateur du commerce international. Il n’existe pas d’interdiction de principe du recours à l’arbitrage pour l’État ou les collectivités publiques, mais la question de son recours à l’arbitrage en matière interne se pose peut-être différemment.
L’arbitrage n’est pas non plus une justice occulte ou sulfureuse. Le droit de l’arbitrage repose sur deux séries de normes : normes d’origine nationale et normes d’origine internationale. Pour les normes nationales, c’est le code civil qui autorise l’arbitrage et le code de procédure civile qui l’organise. Ces normes existaient déjà dans le code de procédure civile de 1807, ce qui dit assez la continuité de cette justice.
Pour les normes internationales, la France est liée par une série de conventions qui organisent la reconnaissance des sentences arbitrales dans le pays signataire, souvent encore plus facilement que les décisions de la justice étatique. La plus importante est la Convention de New York signée en 1958 et à laquelle 142 États sont parties.
L’arbitrage n’est donc pas une spécificité française, et c’est un des rares domaines du droit où le droit français rayonne dans le monde entier, au point d’être considéré comme une référence. Ce droit est copié partout, parfois recopié, ce qui fait rayonner la pensée juridique française. Paris est, incontestablement, la capitale mondiale de l’arbitrage, la ville où les plus grands cabinets anglo-saxons ont installé leurs départements spécialisés, celle où se résolvent les plus importants contentieux du commerce international, celle où se concentre le plus grand nombre de spécialistes. Les sentences arbitrales rendues à Paris s’appliquent dans le monde entier de la même manière. Cette prééminence suscite des convoitises, les places de Londres, Genève et Madrid essayant de capter une activité qui a de très importantes retombées économiques. À cet égard, le fait que la sentence rendue ait été immédiatement mise en ligne dessert la réputation de la place de Paris, principal centre d’arbitrage mondial.
L’arbitrage n’est pas davantage une justice illégitime, du moins dans les cas où il a vocation à s’appliquer, c'est-à-dire dans le contentieux des affaires, interne ou international, ou, plus exactement, depuis la réforme que vous avez votée en 2001, dans le contentieux professionnel, commercial et civil.
En conclusion, la justice d’arbitrage n’est ni exceptionnelle, ni occulte, ni dérogatoire, ni spécifiquement française, ni illégitime. Il reste à savoir si, en l’espèce, elle était légitime.
Au moment de commencer vos auditions, vous avez déclaré, Monsieur le Président, que vos travaux ont notamment pour objet de déterminer si le choix de l’arbitrage en l’espèce est, précisément « légitime » et « opportun ». À titre personnel, je répondrai par la négative. Il me semble en effet que le choix de l’arbitrage était, dans ce cas, non pas illégal mais inadapté, pour les raisons suivantes. En premier lieu, il intervient en cours de procédure, après une décision de la formation la plus solennelle de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire, si bien que l’arbitrage semble être une procédure « parachute » alors que c’est une procédure parallèle. Ensuite, le dossier concerne l’argent public ; or l’arbitrage est par nature confidentiel et il m’apparaît que confidentialité et argent public ne font pas bon ménage. Enfin, le dossier a une forte résonance politique, ce qui ne fait pas meilleur ménage avec l’obligation de confidentialité qui caractérise la pratique arbitrale.
L’inadaptation du choix opéré se traduit dans les spécificités de la procédure suivie, spécificités qui surprennent car elles s’écartent sensiblement des canons habituels. Ainsi, le compromis d’arbitrage encadre si singulièrement le pouvoir des arbitres qu’il l’enserre : non seulement les montants donnés forment une sorte de compromis conditionnel mais la capacité d’arbitrage est limitée par l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires préalables. En résumé, ce compromis, dont la rédaction étonne, ressemble beaucoup à une transaction dans laquelle les parties renoncent à des actions pour obtenir une contrepartie, au demeurant déjà plafonnée.
Ensuite, la sentence arbitrale épouse le compromis. En réalité, elle figure déjà dans le compromis ! Que reste-t-il alors du pouvoir des arbitres ?
La troisième singularité tient au quantum des honoraires. En général, il est fixé en tenant compte de plusieurs critères : le montant du litige, sa complexité, sa durée et la notoriété des arbitres. Dans le cas qui nous occupe, la difficulté tient à ce que le montant du litige n’était pas fixé au moment où l’arbitrage a été décidé : parlait-on de 135 millions ou de 400 millions ? Nul ne le sait. Il est donc compliqué de se faire une opinion sur le montant des honoraires versé aux arbitres, mais l’on peut dire en tout cas qu’il s’agit d’un montant très important, que l’on trouve plutôt dans les arbitrages internationaux qui supposent des déplacements, une longue durée et des volumes de mémoires à compulser. Le dossier évoqué en l’espèce a été tranché en moins de six mois, la procédure ayant commencé le 30 janvier et la sentence ayant été rendue le 7 juillet. Il ne m’appartient pas de dire que les honoraires versés étaient illégitimes ou exagérés, mais ils étaient en tout cas importants, et les déclarations faites à la presse par l’un des arbitres jugeant « normal » le montant des honoraires au regard du travail « effrayant » que le dossier avait demandé m’ont semblé indécentes. Je crois savoir que de nombreux magistrats les ont mal perçues.
M. le Président Didier Migaud : Il serait préférable d’en rester à l’essentiel, l’examen du droit.
M. Gérard Bapt : Sans doute, mais ces commentaires sont intéressants.
M. Thomas Clay : Le montant des frais alloués aux arbitres – 100 000 euros en tout– est également inhabituel ; il suppose en général un litige international qui implique des déplacements.
Enfin, la confidentialité de l’arbitrage a été violée, la sentence prononcée étant publiée sur le site Internet d’un hebdomadaire. Ce n’est pas la pratique habituelle en matière d’arbitrage, tant s’en faut.
J’en viens aux possibilités de recours.
L’arbitrage fonctionne en principe sans recours, sauf si les parties ont décidé de faire appel, ce qui est assez rare, si bien que le fait que les parties n’aient pas fait appel en l’espèce n’est pas étonnant. Cependant, le code de procédure civile laisse la possibilité de faire des recours dans les cas les plus graves, si graves qu’il est interdit de renoncer à cette possibilité par anticipation. Cette sécurité est conçue pour protéger l’ordre juridique et les parties de dysfonctionnements éventuels, très rares mais toujours possibles. Le système des recours est organisé différemment selon qu’il s’agit d’un arbitrage interne ou d’un arbitrage international. Qu’en est-il en l’espèce ? Très probablement, on est devant un arbitrage interne, même si une partie du différend porte sur l’acquisition de parts sociales de sociétés immatriculées à l’étranger. La sentence s’étant elle-même rangée sous l’application des articles du code de procédure civile relatifs à l’arbitrage interne, on peut s’en tenir là. En tout état de cause, s’il s’était agi d’un arbitrage international, aucun recours ne serait plus possible à ce jour.
En présence d’un arbitrage interne, quatre recours existent. Je citerai en premier lieu l’appel, auquel les parties ont renoncé. Il y a aussi le recours en annulation ; les parties ne l’ayant pas exercé dans le délai imparti, elles y ont renoncé de fait. Je tiens à ce sujet à apporter une précision à propos du délai. Il faut savoir que le CDR avait jusqu’au 15 août pour prendre la décision qu’il a prise le 28 juillet, car le délai n’est pas de dix jours après la reddition de la sentence, comme on a pu le croire, mais d’un mois après la signification de la sentence qui a obtenu l’exequatur. J’observe à ce sujet que la sentence, rendue le 7 juillet, a obtenu l’exequatur le 12 juillet, ce qui constitue un délai record, considérant en outre que le 12 juillet était un samedi. Elle a été signifiée au CDR le 15 juillet, premier jour ouvrable après le 14 juillet. La raison pour laquelle, dans une affaire de cette importance, la décision a été prise dès le 28 juillet est pour moi mystérieuse. Il y a là une certaine précipitation.
Le ministère des finances avait sollicité l’avis de quatre juristes sur l’opportunité d’un recours. Outre qu’ils ont dû travailler dans l’urgence, aucun n’était un spécialiste de l’arbitrage, alors même que la place de Paris n’en manque pas. Pourquoi donc ? On peut se le demander. Malgré cela, deux des experts consultés, en particulier mon collègue Nicolas Molfessis, avaient estimé que le recours en annulation méritait d’être tenté, jugeant que certains moyens de droit permettaient de le fonder – et il est surprenant de ne pas tenter un recours en annulation quand on est condamné à verser une somme aussi élevée. La volonté d’en finir devait-elle s’imposer à n’importe quel prix ?
De fait, quatre moyens sont possibles, que j’examinerai successivement. Certains ont prétendu que le principe de la contradiction aurait été violé au motif que M. Tapie avait été entendu par les arbitres et non M. Peyrelevade. À mon avis, ce moyen doit être écarté car il ne s’agit pas d’un litige entre les deux hommes ; parce que M. Peyrelevade est un témoin et que le contradictoire ne s’applique pas pour les témoins ; parce qu’il suffisait au CDR de solliciter l’audition de M. Peyrelevade, ce qu’il n’a manifestement pas fait. Il ne peut donc arguer de sa propre impéritie pour fonder un recours.
S’agissant du défaut d’indépendance supposé de certains arbitres, M. de Courson a exposé que le Professeur Jean-Denis Bredin « n’était pas à l’abri d’une contestation de son indépendance ». Or, le Professeur Bredin est un spécialiste internationalement reconnu de l’arbitrage et la pratique qu’il en a le met à l’abri de tout soupçon. De plus, il n’a jamais caché ce qui pourrait lui être reproché, c'est-à-dire d’avoir eu des fonctions politiques dans le passé. L’absence d’indépendance postulant la dissimulation, j’écarte également ce moyen.
S’agissant de la violation de l’autorité de la chose jugée, M. de Courson considère qu’il s’agit du cas le plus sérieux. Je ne partage pas cet avis, mais j’admets que la question est, de toutes, la plus délicate. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui a eu à statuer sur le grief de violation de sa mission par l’arbitre n’a annulé les sentences que pour des violations flagrantes et considérables et je ne pense pas que l’on entre dans ce cas. Par ailleurs, le recours en annulation ne permet pas d’évaluer le bien-jugé ou le mal-jugé d’une sentence arbitrale ; s’il en était ainsi, il s’agirait d’un appel, que les parties ont choisi de ne pas former. J’écarte donc ce moyen aussi.
Le quatrième moyen me semble plus intéressant. Il s’agit de la capacité de compromettre du CDR et, par là, de la validité de la convention d’arbitrage. La question est très délicate, et M. de Courson a dressé un inventaire minutieux de l’état du droit en la matière. Il faudrait mener une investigation sur la nature précise des relations entre l’EPFR et le CDR. En effet, le principe est que les collectivités publiques ne peuvent pas compromettre. Pour autant, il existe de nombreuses exceptions à ce principe : si l’on est en matière internationale, comme je l’ai dit ; si le compromis conclut un contrat de partenariat au sens de l’ordonnance du 17 juin 2004 ; si une loi le prévoit expressément ; si un décret le prévoit pour les EPIC, ce qui, depuis 1972, n’a eu lieu qu’une fois.
En février 2007, le Parlement a voté le principe d’une extension très large du recours à l’arbitrage pour toutes les personnes morales de droit public mais cette réforme, parce qu’elle figurait dans la loi sur la protection juridique des majeurs, a été invalidée par le Conseil constitutionnel le 1er mars 2007 comme étant un cavalier législatif ; il est piquant de se souvenir qui présidait le Conseil constitutionnel à l’époque… Il en résulte que le principe demeure la prohibition mais que ce principe supporte de nombreuses exceptions. Le cas d’espèce entre-t-il dans l’une de ces exceptions ? Avant de répondre, on doit se souvenir que la question avait déjà été posée sous le gouvernement Jospin, dans la même affaire, et que la réponse apportée par les spécialistes alors consultés fut négative.
La loi du 28 novembre 1995 créant l’EPFR énonce qu’il s’agit d’un « établissement public administratif national » doté de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie. Comme il s’agit d’un EPA et non d’un EPIC, le recours à l’arbitrage ne lui est possible que s’il est autorisé par la loi, et la loi de 1995 ne le prévoit pas. Le CDR, qui est une émanation de l’EPFR, a-t-il la capacité de compromettre alors qu’il tient son pouvoir et son existence d’un organisme qui n’a pas cette capacité ? Selon moi la réponse est négative, à la fois parce que le CDR n’a pas d’autonomie et parce qu’un principe général du droit veut que l’on ne puisse transmettre plus de droits qu’on n’en a soi-même. Je conclurai donc sur ce point que, sans doute, le CDR n’avait pas la capacité de compromettre, sous réserve d’une plus ample analyse de l’articulation juridique entre l’EPFR et le CDR. La question, complexe et inédite, méritait d’être posée à la juridiction de contrôle et un recours en annulation aurait pu, à mes yeux, prospérer sur le fondement de l’article 1484 du code de procédure civile.
La tierce opposition constitue une autre possibilité de recours contre une sentence arbitrale. Elle est évoquée dans l’article 1481 du code de procédure pénale. La procédure ne se distingue pas de la tierce opposition contre les décisions judiciaires : il faut que le tiers n’ait été ni partie ni représenté à l’instance arbitrale ; il doit être intéressé par la décision ; l’action peut être intentée pendant trente ans ; si la tierce opposition aboutit, la décision est déclarée inopposable au tiers.
En l’espèce, une association de contribuables pourrait-elle agir ? A priori, rien ne l’empêche, car une telle association serait sans doute considérée comme ayant intérêt à agir, mais à la condition que les contribuables n’aient pas été représentés à l’instance – en d’autres termes, que l’État n’ait pas été partie. La question se pose donc à nouveau de savoir qui est engagé par la convention d’arbitrage, du CDR, société commerciale, ou de l’EPFR, établissement public. En effet, soit le CDR a conclu, la convention d’arbitrage est valable et dans ce cas une tierce opposition est possible pour une association de contribuables ; soit c’est l’EPFR qui a conclu et dans ce cas la convention d’arbitrage n’était sans doute pas valable, ce que le recours en annulation aurait peut-être montré, mais alors la tierce opposition n’est plus possible puisque les contribuables ont été représentés à l’instance par le biais de l’EPFR. Pour contrer une tierce opposition, les parties seraient donc dans la situation paradoxale de devoir défendre l’idée que la convention d’arbitrage n’était pas valable ! On notera que, dans un article publié par Le Monde au mois d’août, le conseil de M. Tapie a déclaré qu’il s’agissait d’un litige commercial, ce qui laisserait ouverte la possibilité d’une tierce opposition.
La dernière modalité de recours possible est le recours en révision, exorbitant du droit commun et très exceptionnel. Il est prévu par l’article 1491 du code de procédure pénale, qui le rend possible si un fait nouveau montre que la sentence n’a pas été rendue dans les conditions où l’on croit qu’elle a été rendue. Quatre conditions sont nécessaires : qu’il n’y ait plus de recours ordinaire possible ; que le fait litigieux soit apparu postérieurement à la forclusion du délai de recours en annulation ; qu’il soit intenté uniquement par les parties à l’instance, pendant un délai de deux mois après la découverte du fait nouveau ; que le fait soit grave - fraude, dissimulation d’une pièce décisive, production d’une pièce fausse ou formulation d’une fausse déclaration. J’insiste sur cette possibilité de recours au cas où un fait nouveau apparaîtrait prochainement.
M. le Président Didier Migaud : Je vous remercie et j’appelle les questions.
M. Charles de Courson : Si, en octobre 2007, vous aviez été membre du conseil d’administration du CDR ou de l’EPFR lorsque la question du recours à l’arbitrage a été débattue, quelle aurait été votre position ?
M. Thomas Clay : J’aurais, j’espère, eu le même avis que celui que j’ai exprimé aujourd’hui ! En tout cas, je n’aurais pas poussé au recours à l’arbitrage en l’absence d’une loi spécifique.
M. le Président Didier Migaud : Vous nous avez expliqué que l’arbitrage n’est pas une justice exceptionnelle, dérogatoire, occulte, sulfureuse ou illégitime et vous nous avez dit aussi qu’en l’espèce le recours à l’arbitrage ne vous apparaissait pas illégal mais inadapté. Mais, évoquant ensuite les moyens de droit possibles pour fonder un recours en annulation, vous avez semblé dire qu’un de ces moyens serait de contester la légalité du recours à l’arbitrage. Voilà qui peut sembler contradictoire. Pourriez-vous préciser votre pensée ?
M. Gilles Carrez, rapporteur général : Ma question s’adresse plutôt à notre collègue Charles de Courson en sa qualité de représentant de notre Assemblée au conseil d’administration de l’EPFR. Le principe général est qu’une collectivité publique n’est pas autorisée à compromettre mais ce principe souffre de nombreuses exceptions, comme le montre par exemple le contrat passé entre l’État et Eurodisney. Cependant, le compte rendu du conseil d’administration de l’EPFR du 10 octobre 2007 ne montre pas que la question de principe ait été abordée. À votre sens, pourquoi ?
M. Charles de Courson : La question a été évoquée en 2004 lors du débat sur la médiation. De mémoire, j’avais alors soulevé la question, demandant si nous entrions bien dans ce champ. Il m’avait été répondu, si je me souviens bien, que les services du Trésor consultés avaient estimé que ce n’était pas exclu.
La contradiction apparente relevée par le Président Migaud dans le propos de M. Clay met en une nouvelle fois en lumière un problème juridique de fond, celui des relations entre le CDR et l’EPFR. En théorie, le CDR est une société anonyme, si ce n’est qu’il ne l’est pas vraiment puisque toute société anonyme a un but lucratif et que le CDR perd de l’argent. D’autre part, le CDR est chapeauté par l’EPFR. Vous avez dit, Monsieur Clay, que la décision de recourir à l’arbitrage présentait, dans ce cas, quelque fragilité, mentionnant en particulier le principe de confidentialité alors que des fonds publics sont en jeu. C’est si vrai que cela a motivé l’intérêt de notre commission.
M. Thomas Clay : Je regrette d’avoir donné l’impression d’une contradiction. La sentence arbitrale a été rendue, elle est donc entrée dans l’ordre juridique français et elle est donc légale. Cependant, l’analyse juridique de sa légalité dépend pour beaucoup, dans le cas qui nous occupe, de l’articulation ou, si vous préférez, du lien hybride, sui generis, qui unit le CDR et l’EPFR. C’est ce qui m’a conduit à dire que le recours à l’arbitrage était légal mais inadapté et que la contestation de sa légalité eût été possible.
M. Charles de Courson : Si, en juillet 2008, vous aviez siégé au conseil d’administration du CDR ou de l’EPFR quand est venue en délibération la question de savoir s’il fallait introduire un recours en annulation de la sentence arbitrale, quelle aurait été votre position ?
M. Thomas Clay : Franchement, quand on est condamné à verser 400 millions, je pense que l’on doit tenter un recours. C’est d’autant plus vrai qu’à mon sens, il y avait au moins un moyen sérieux, fondé sur l’article 1484 du code de procédure pénale, que le recours prospère.
M. Charles de Courson : Existe-t-il d’autres sentences arbitrales ayant fixé une indemnisation de 50 millions du préjudice moral alors même que la Cour d’appel l’avait fixé à 1 franc ?
M. Thomas Clay : Je ne connais pas de précédent, mais tous les arbitrages sont confidentiels.
M. le Président Didier Migaud : Je comprends le besoin de confidentialité au cours de la procédure, mais que cette confidentialité aille jusqu’à couvrir la sentence et au-delà, voilà qui a de quoi surprendre. La confidentialité absolue est-elle une règle consubstantielle à l’arbitrage ?
M. Thomas Clay : Une confidentialité partielle ne peut se concevoir. Cela se peut d’autant moins que la sentence retrace l’ensemble de la procédure. En matière d’arbitrage, la confidentialité est absolue et cette règle a été réitérée par la jurisprudence. De fait, la confidentialité se poursuit au-delà du rendu de la sentence. J’observe que les parties qui choisissent cette forme de justice la choisissent aussi pour cette raison, qui permet d’améliorer les chances de résolution des conflits.
M. Charles de Courson : J’ai cru comprendre qu’il ne vous semblait pas y avoir de contradiction entre la convention d’arbitrage et la sentence, s’agissant du respect de l’autorité de la chose jugée. Pourriez-vous préciser votre pensée à ce sujet ?
M. Thomas Clay : Il est exact qu’il existe un décalage entre le compromis d’arbitrage et la sentence rendue. Toutefois, si ce point avait été évoqué comme moyen d’un recours en annulation, je pense que ce recours n’aurait pas prospéré car il s’agit là d’une question de fond et qu’il n’est pas dans les attributions de la Cour d’appel qui statue en annulation de se prononcer sur le fond.
M. Charles de Courson : Ce qui revient à dire qu’on laisse les arbitres interpréter des décisions de justice, y compris lorsqu’elles émanent de la Cour de cassation réunie en formation plénière !
M. Thomas Clay : Parce que les parties l’ont voulu !
M. Charles de Courson : La décision de recourir à un arbitrage fait suite à une délibération de non opposition du conseil d’administration de l’EPFR. L’eût-il refusé que le recours à l’arbitrage n’aurait pas été possible. Dans ce conseil d’administration, qui compte cinq personnes, siègent deux fonctionnaires représentant l’État qui ont confirmé avoir reçu des instructions du ministre, et un Président nommé en Conseil des ministres qui a dit clairement qu’il n’aurait jamais pris une position contraire à celle du ministre. Dans ces conditions, ne peut-on, pour obtenir l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’EPFR qui ne s’est pas opposé au recours à l’arbitrage, envisager un recours pour excès de pouvoir ?
M. Thomas Clay : La question relève du contentieux administratif qui n’est pas ma spécialité, mais je peux néanmoins vous donner mon sentiment. Pour qu’un tel recours puisse être exercé, trois conditions sont nécessaires, et en premier lieu que le délai pour agir – deux mois à dater de la notification de la décision – soit respecté. Ensuite, selon la nature de la décision – soit c’est une instruction ministérielle…
M. François Bayrou : En l’espèce, c’est une décision du ministre.
M. Thomas Clay : Il s’agit donc d’un acte administratif unilatéral, en principe attaquable devant le tribunal administratif. Si on parle de la délibération du conseil d’administration de l’EPFR, la réponse est la même et cela se plaide devant le Conseil d’État.
Y a-t-il eu des précédents ? À ma connaissance, non, mais il me semble qu’en 2002, un commissaire du Gouvernement a estimé que la décision d’une collectivité publique de recourir à l’arbitrage était attaquable.
Mais demeure la troisième condition, celle de l’intérêt à agir. En la matière, qui aurait intérêt à agir ? L’État ne peut le faire ; restent donc les 361 actionnaires minoritaires du groupe Bernard Tapie, à condition qu’ils puissent démontrer qu’ils ont été lésés, ce qui ne sera pas facile.
M. Charles de Courson : Mais si le recours à l’arbitrage était illégal, les contribuables ont été lésés.
M. le Président Didier Migaud : Un contribuable peut-il, à votre sens, déposer un recours en ce sens devant le tribunal administratif ou le Conseil d’État ?
M. Thomas Clay : Sauf erreur, l’action d’un contribuable ne serait pas recevable car pour agir il devrait démontrer un préjudice direct et certain.
M. Jérôme Cahuzac : Vous considérez que cette sentence arbitrale a terni la réputation de la place de Paris ; pourquoi ? Par ailleurs, la procédure d’arbitrage était-elle légale ex ante ? Enfin, pour qu’un recours puisse être formé, il faudrait donc qu’un contribuable estime ne pas avoir été défendu correctement, ce qui suppose que la convention soit illégale. Cette voie de recours est-elle la seule solution possible ?
M. Thomas Clay : La réputation de la place de Paris en matière d’arbitrage est excellente et elle doit le rester. Or une affaire comme celle-ci donne une vision faussée de l’arbitrage, la première entorse étant la violation de la confidentialité. Je l’ai dit, la concurrence s’avive. Londres et Madrid, notamment, s’intéressent à ce marché et ces deux capitales ont des atouts, linguistiques en particulier, à faire valoir. Nous devons maintenir notre réputation et ne donner prise à aucune attaque.
La question de la légalité ex ante du recours à l’arbitrage est délicate et c’est bien pourquoi un recours en annulation aurait été intéressant, car la Cour se serait prononcée sur le lien juridique unissant le CDR et l’EPFR. Enfin, la tierce opposition est ouverte mais le problème est de savoir quel serait son effet : si la sentence arbitrale était déclarée inopposable aux contribuables qui auraient fait recours, que se passerait-il ?
M. François Bayrou : La loi, nous avez-vous dit, interdit de renoncer par anticipation à la possibilité de faire recours. Pourtant, l’article 8 du compromis arbitral dit que « les parties renoncent à former appel de cette sentence ». Qu’en penser ?
M. Thomas Clay : Les parties peuvent renoncer à former appel mais elles ne peuvent en aucun cas renoncer au recours en annulation. Dans le cas d’espèce, ce que les parties ont décidé, c’est de ne pas attaquer la sentence une fois celle-ci prononcée.
M. Philippe Vigier : Est-il habituel que les sentences arbitrales ne justifient pas le calcul de l’indemnisation octroyée ?
M. Thomas Clay : Il est très difficile de connaître les sentences arbitrales car elles sont confidentielles. Celle-ci ne l’étant pas, il apparaît que la motivation du préjudice moral est particulièrement lapidaire puisqu’elle tient en deux pages dont l’une est consacrée à la recevabilité de l’action en la matière. Une page pour 45 millions d’euros : je reconnais que ce n’est pas ce que j’ai l’habitude de voir…
M. Charles de Courson : Vous avez évoqué une consultation sur l’arbitrage qui aurait été lancée au temps du gouvernement Jospin. Pouvez-vous nous dire plus précisément de quoi il s’agissait ?
M. Thomas Clay : La même question avait été posée : était-il possible de solder l’ensemble des affaires par l’intermédiaire d’un arbitrage ? Des contacts avaient été pris officieusement et les personnes consultées alors avaient répondu par la négative.
M. Charles de Courson : Qui étaient ces personnes ?
M. Thomas Clay : Vous le saurez peut-être plus tard dans le cadre d’une commission d’enquête…
M. Michel Bouvard : A-t-on procédé uniquement par contacts verbaux ou existe-t-il des documents écrits dont nous pourrions demander communication ? L’APE – Agence des participations de l’État – a-t-elle été saisie de ce dossier et s’est-elle prononcée en amont sur l’intérêt d’un arbitrage comme cela été le cas dans la procédure à laquelle nous nous intéressons aujourd’hui ?
M. le Président Didier Migaud : Vous-même, M. le professeur, avez-vous été consulté ?
M. Thomas Clay : Je n’ai pas été consulté à titre personnel et je n’ai donc pas d’élément particulier à vous apporter.
M. Michel Bouvard : Savez-vous si l’APE a été consultée ?
M. Thomas Clay : Je l’ignore.
M. Michel Bouvard : De façon générale, les établissements de défaisance ont-ils eu recours fréquemment à l’arbitrage ?
M. Thomas Clay : Je ne puis vous donner de réponse certaine puisque l’on est dans un domaine où il n’existe pas de statistiques et où l’on ne sait pas très bien quelles sont les parties qui recourent à l’arbitrage. Mais un des responsables du CDR a fait savoir la semaine dernière que lui-même y avait eu recours à plusieurs reprises.
M. François Bayrou : En effet, mais à l’international, pour Executive Life.
M. Charles de Courson : En réponse à la question que nous lui avons posée, le président du CDR a évoqué six ou sept recours à l’arbitrage, mais il faut distinguer ceux qui interviennent dans un cadre international, pour lesquels les dispositions du code civil ne s’appliquent pas, de ceux qui interviennent dans un cadre national.
Je crois savoir que le président Didier Migaud s’est entretenu ce matin avec le président du CDR. Peut-être pourra-t-il nous dire s’il y a eu à chaque fois délibération et autorisation de non opposition. Pour ma part, je n’en ai pas retrouvé trace dans les procès-verbaux.
M. le Président Didier Migaud : Compte tenu des déclarations qu’il avait faites la semaine dernière, j’ai effectivement demandé ce matin à M. Rocchi qu’il me confirme que des procédures de ce type avaient déjà été engagées par le CDR. Dans la note qu’il m’a remise, qui s’inscrit dans le cadre de la confidentialité et dont seul le rapporteur général et moi-même pouvons avoir connaissance, il indique que, en dehors de l’affaire Adidas, sept procédures arbitrales ont été ouvertes après la création du CDR.
M. Charles de Courson : Pouvez-vous nous indiquer si, pour chacune de ces sept procédures, il y a eu une délibération de l’EPFR sur la non-opposition au recours à l’arbitrage ?
M. le Président Didier Migaud : Peut-être le membre de l’EPFR que vous êtes peut-il poser la question à son président… Mais on peut en effet se demander si, à chaque fois, l’EPFR a été consulté par le CDR quant à sa volonté d’empêcher un recours à l’arbitrage.
M. Michel Bouvard : Le recours à l’arbitrage par les établissements de défaisance est un sujet intéressant au regard de la qualité de la gouvernance de ces établissements comme de la défense de l’intérêt des contribuables. Cela mérite donc que le président de la commission des Finances et le rapporteur général puissent, dans le respect des clauses de confidentialité, regarder comment cela a été mis en œuvre dans le passé et avec quelle efficacité. Car au-delà des événements qui nous occupent, l’essentiel est que nous tirions des enseignements pour améliorer la gouvernance publique des établissements de défaisance.
M. le Président Didier Migaud : Nous aurons des échanges avec le rapporteur général et nous tiendrons la commission informée de ce que nous aurons pu faire.
M. François Bayrou : On connaît au moins deux des sept arbitrages auxquels le CDR a eu recours, pour Executive Life et pour un hôtel à New-York. Savez-vous si les cinq autres sont internationaux ou nationaux ?
M. le Président Didier Migaud : Il y a des dossiers franco-français.
M. François Bayrou : Sans homologation de l’EPFR !
M. Jérôme Cahuzac : Pouvez-vous vous nous indiquer, Monsieur le président, si les dossiers franco-français avaient, préalablement au recours à l’arbitrage, fait l’objet d’une procédure judiciaire « classique » ou bien l’affaire Adidas a-t-elle été la première à « bénéficier » d’un arbitrage alors que toutes les juridictions avaient été saisies ?
M. le Président Didier Migaud : Je suis dans la totale incapacité de vous répondre.
M. Jérôme Cahuzac : Le représentant de la commission des finances à l’EPFR peut-il le savoir ?
M. Charles de Courson : Je peux interroger le président de l’EPFR, qui est administrateur du CDR. En ce qui me concerne, je suis administrateur de l’EPFR depuis sept ans, soit plus de la moitié de sa durée d’existence, et, s’il y a eu de fréquents débats sur les trois arbitrages internationaux, je n’ai pas souvenir que nous ayons délibéré pour autoriser le CDR à avoir recours à l’arbitrage pour les quatre contentieux français.
M. Jean-Pierre Brard : Je n’ai pas entendu dire qu’il existe une chambre syndicale des arbitres, pourtant l’une des parties prenantes a dit hier que les honoraires des arbitres étaient tarifés. Est-ce exact ?
M. Thomas Clay : Il n’existe pas de chambre syndicale tout simplement parce que l’arbitrage n’est pas une profession mais une activité que l’on exerce de façon intermittente, en plus de son activité principale.
M. Jean-Pierre Brard : À titre bénévole ?
M. Thomas Clay : Bien souvent, notamment pour des arbitrages professionnels rendus dans des milieux très fermés et corporatistes. C’est tout un volant de l’activité d’arbitrage qui fonctionne tellement bien que l’on n’en entend jamais parler…
S’agissant des honoraires tarifés, dans le cadre d’un arbitrage dit « institutionnel », un centre d’arbitrage, tels la Chambre de commerce internationale ou le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris, publie un barème d’honoraires qui dépend uniquement du montant du litige et qui prévoit des fourchettes assez larges en fonction de sa complexité. Sur le site internet de la Chambre de commerce internationale, un calculateur vous permet, à partir du montant du litige, de connaître le montant des honoraires et des frais. Dans ce cas, le barème est connu et accepté par anticipation par les parties, soit dans la convention inscrite dans le contrat initial, soit, beaucoup plus rarement, dans le compromis d’arbitrage passé postérieurement à la naissance du litige.
Il faut distinguer cet arbitrage de celui qui n’est pas chapeauté par un tel centre, que l’on appelle arbitrage ad hoc, pour lequel les honoraires ne sont absolument pas tarifés et dépendent uniquement d’un accord entre les arbitres et les parties au contentieux. Tel est le cas dans cette affaire.
M. Patrick Lemasle : En l’occurrence, le montant vous paraît-il normal ?
M. Thomas Clay : Il me semble avoir déjà traité ce sujet.
M. le Président Didier Migaud : Monsieur le professeur, je vous remercie.
——fpfp——
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 10 heures 30 (compte rendu n° 116) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Jean Peyrelevade, ancien président du Crédit Lyonnais, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie.
Le président Didier Migaud : Monsieur Jean Peyrelevade, vous avez été président du Crédit Lyonnais, poste auquel vous avez été nommé en novembre 1993. Vous avez donc eu à connaître certains dossiers suscitant quelques interrogations, notamment le dossier Adidas. Je rappelle que vous avez été auditionné, en 1994, à deux reprises par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale qui avait été créée sur le Crédit Lyonnais et que les relations entre la Société de banque occidentale – la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais – et le Groupe Bernard Tapie ne constituaient qu’un volet parmi d’autres de ce dossier.
Nous avons souhaité vous entendre et vous avez vous-même sollicité la commission des Finances pour qu’elle vous auditionne. Je vous propose d’entrer dans le vif du sujet par une déclaration préalable, après quoi nous passerons aux questions.
M. Jean Peyrelevade : Je vous remercie de m’accueillir. Je suis en effet très heureux de m’exprimer devant la représentation nationale. Dans cette affaire, je suis accusé de nombre de méfaits par Bernard Tapie, par ses avocats et même par les arbitres – je considère comme mensongères les attaques formulées par ces derniers, notamment dans la partie de leur sentence consacrée au préjudice moral. Aussi curieux que cela puisse paraître, depuis les auditions de la commission d’enquête de 1994, je n’ai jamais été entendu à propos de cette affaire : mon témoignage n’a jamais été sollicité et je n’ai témoigné devant aucune Cour. C’est donc la première fois que j’ai l’occasion de m’exprimer et je serai aussi exhaustif que vous le souhaiterez.
Pour bien resituer le calendrier, je précise que j’ai été nommé à la tête du Crédit Lyonnais en novembre 1993 alors que la cession d’Adidas date de février 1993 ; je ne porte donc aucune responsabilité dans cette cession mais j’ai un avis sur le sujet, je vous en ferai part dans un instant. À l’autre extrémité de la période me concernant – en juillet 1995, si je me souviens bien –, la Commission de Bruxelles approuve le plan de redressement du Crédit Lyonnais, avec pour condition explicite l’interdiction faite à la banque d’interférer de quelque façon que ce soit dans la gestion du Consortium de réalisation, le CDR ; cette injonction est reprise dans une loi française de novembre 1995. Ainsi, à partir de juillet 1995, le Crédit Lyonnais et son président sont écartés de toute décision ultérieure concernant la gestion du CDR, y compris la gestion des affaires Tapie. Durant ces quatorze ans d’« acharnement » contre M. Bernard Tapie, comme disent certains, je n’ai occupé des responsabilités que pendant dix-huit mois : de novembre 1993 à juillet 1995.
Je ne suis pas partie prenante, ni à titre institutionnel ni à titre personnel. J’ai quitté le Crédit Lyonnais fin 2003. Je n’ai ni archives, ni dossiers, ni avocats. Je m’exprimerai donc en fonction de mes souvenirs, qui sont relativement précis mais peuvent laisser des zones d’imprécision ou d’incertitude. Il se peut par conséquent, ici ou là, que je fasse des erreurs, je m’en excuse par avance.
Ces précautions étant prises, je vais retracer les grandes lignes de mon action sur ce dossier – un dossier parmi plusieurs centaines, hélas.
Lorsque je suis entré en fonction, Adidas était sorti du patrimoine de M. Tapie. Je n’avais donc aucune raison de considérer cette vente imparfaite, d’autant que M. Tapie n’émettait alors aucune protestation. Il existait bien un souci avec Adidas, mais indépendant de M. Tapie, puisqu’il n’en était plus propriétaire. Lors de la vente, en février 1993, le Crédit Lyonnais avait endossé l’intégralité des risques : en cas de défaillance d’Adidas, si le bilan était déposé, il aurait supporté la totalité des pertes, compte tenu des conditions de financement accordées au repreneur, extraordinairement favorables à M. Tapie – je n’ai pas changé d’appréciation à ce propos. En décembre 1992, Adidas était au bord du dépôt de bilan, avec une perte de l’ordre de 150 millions de deutschemarks, si je me souviens bien. Toujours fin 1992, avant la vente, dans un moment de lucidité, Adidas avait été recapitalisé de 500 millions de francs – personne n’en parle jamais –, ce qui a eu pour effet de réduire de manière assez importante les frais financiers payés en 1993. En dépit de cette recapitalisation, du talent de Robert Louis-Dreyfus et du travail qu’il a d’emblée engagé sur le fond, le chiffre d’affaires d’Adidas était encore en recul en 1993 et le résultat était juste à l’équilibre. J’étais donc inquiet et j’ai rencontré Robert Louis-Dreyfus à plusieurs reprises pour essayer de le convaincre de prendre une vraie position d’actionnaire, à ses risques pleins, et de renoncer au moins pour partie à la clause de protection qui lui avait été accordée dans le prêt à recours limité. Mais tout cela, dans mon esprit, était complètement disjoint des affaires Tapie.
Par ailleurs, j’avais en face de moi le groupe Tapie, constitué, je le rappelle, de deux piliers principaux : Groupe Bernard Tapie et Bernard Tapie Finance – GBP et BTF –, qui couvraient la totalité des participations industrielles, avec des noms aussi illustres que Testut, Trayvou, Terraillon ou La Vie claire ; et de l’autre côté la Financière et immobilière Bernard Tapie (FIBT), censée gérer les actifs immobiliers et patrimoniaux de la famille mais chargée en fait d’assurer son train de vie.
En novembre 1993, quand je rejoins le Crédit Lyonnais, le Groupe Bernard Tapie est en cessation de paiement, deux éléments objectifs le prouvent. Premièrement, une échéance envers la SDBO, de l’ordre de 200 millions de francs, doit tomber, je crois, en décembre 1993 ; il est incapable de la rembourser et devient, dans le jargon bancaire – pardonnez le qualificatif, qui n’est que technique –, un « débiteur douteux ». Deuxièmement, certains d’entre vous s’en souviennent certainement, je suis à l’époque en bataille permanente – c’est le monde à l’envers – contre la Commission bancaire, à laquelle j’essaie d’expliquer que les pertes subies par le Crédit Lyonnais dans ses aventures sont largement supérieures aux estimations avancées six mois auparavant par ses inspecteurs. Pour ce qui concerne les comptes Tapie, la Commission bancaire me demande de provisionner 500 millions de francs. À l’époque, comme sur d’autres dossiers, je me trompe par excès d’optimisme : je crois qu’il y a 800 à 900 millions de francs d’actifs et je suis sûr qu’il y a 1,4 à 1,5 milliard de francs de passif vis-à-vis de la SDBO, après remboursement de la dette Adidas. L’une de mes premières décisions, parmi tant d’autres, consiste donc effectivement à provisionner 500 millions de francs au titre de l’exercice 1993.
Au faîte de sa prospérité, en 1989 ou 1990, le Groupe Bernard Tapie a un actif de 800 à 900 millions de francs. Il introduit BTF en bourse après avoir réalisé une plus-value sur la revente de Wonder. Son endettement est modéré : de l’ordre de 200 à 300 millions de francs. C’est donc sans aucun doute un homme d’affaires in bonis. Cependant, il se passe des choses dans le monde et dans sa vie personnelle. Si je me souviens bien, deux années consécutives, en 1991 et 1992, les résultats consolidés de BTF sont négatifs de 300 millions de francs. Ainsi, fin 1992, les actifs nets s’élèvent au mieux à 300 millions de francs, soit une année de pertes. En 1993, toujours d’après mes souvenirs, les pertes s’établissent à 200 millions de francs environ. Fin 1993, quand je rejoins le groupe Crédit Lyonnais, les fonds propres sont donc presque nuls puisque le passif total est de 2 milliards de francs, bien plus que l’actif brut. Les fonds propres représentent un septième du passif en 1992 – ce qui, pour un banquier, est un ratio assez inusité – et approchent de zéro en 1993, après les 200 millions de pertes supplémentaires. Pourtant, les conditions extraordinairement favorables de la vente d’Adidas, en février, ont permis à Bernard Tapie d’encaisser une plus-value comptable de l’ordre de 400 millions de francs, je crois. Sans cette plus-value, le résultat annuel de fin 1993 n’aurait pas été de moins 200 millions mais de moins 600 millions et les fonds propres seraient devenus clairement négatifs courant 1993, ce qui, d’après la législation, aurait nécessité le dépôt de bilan.
Les belles affaires industrielles que j’ai citées étaient dans un état catastrophique et aucune ne gagnait d’argent. M. Bernard Tapie a essayé de les vendre, nous avons fait de même, mais c’était impossible. Il a seulement réussi à vendre – le rapport des experts le relève comme un exploit formidable et la marque de la bonne santé de son groupe – sa participation dans TF1, courant 1992, pour 150 millions de francs environ à ma connaissance, c’est-à-dire une somme minuscule par rapport à l’endettement du groupe. Les pertes industrielles opérationnelles atteignaient de l’ordre de 200 à 250 millions de francs par an. S’y ajoutaient au moins 200 millions d’intérêt, correspondant aux 2 milliards d’endettement – à l’époque, les taux d’intérêt excédaient 10 %, d’autant que Bernard Tapie, toujours en dépassement de crédits, ne se finançait pas de manière structurée mais par augmentation de son découvert, au taux du crédit à court terme. Enfin, l’intéressant rapport d’expertise commandé par Éva Joly établit que le prélèvement annuel de la FIBT sur l’ensemble de la structure pour permettre à M. Tapie de vivre atteignait 40 à 50 millions de francs par an. Bref, l’actif net de la structure était négatif, ses fonds propres officiels comptables fondaient extrêmement vite et elle perdait bon an mal an 500 millions de francs par exercice. Si Bernard Tapie avait gardé Adidas, il aurait automatiquement sombré courant 1993 ; la vente d’Adidas lui a permis de gagner un peu de temps.
La fonction de banquier est celle que j’ai exercée le plus longtemps dans ma carrière professionnelle. Je suis devenu financier assez tard et j’ai commencé par apprendre le métier de banquier commercial, vieux comme l’humanité et assez simple puisqu’il se résume à savoir se faire rembourser un prêt. Quand une structure est incapable de rembourser, faut-il continuer à signer des chèques et à accroître le découvert ou arrêter ? Je n’ai aucun doute : indépendamment de mon caractère, si j’avais continué, j’aurais été coupable de soutien abusif et ma responsabilité aurait pu être mise en cause. De toute façon, dans l’océan de pertes du Crédit Lyonnais, dans l’océan de comportements du même type que je découvrais à propos d’affaires diverses – oubliées parce que les noms sont moins célèbres et moins médiatisés que celui de M. Tapie, mais qui portaient sur des montants souvent supérieurs, je l’ai explicitement reconnu devant la commission d’enquête –, je n’avais qu’une façon de me comporter pour redresser la maison : me montrer professionnel. Dans ma vie professionnelle, j’ai d’ailleurs rarement fait entrer d’autres considérations – si quiconque trouve des contre-exemples, je suis intéressé. J’ai donc décidé de mettre fin à cette situation.
À l’époque, j’ai été suspecté de m’être comporté de manière trop douce, trop accommodante vis-à-vis de M. Tapie – je me suis amusé à collationner les questions de la commission d’enquête de 1994. Aujourd’hui, je constate que la sentence du tribunal arbitral m’accuse d’avoir rompu avec une brutalité extrême. J’ai seulement fait mon devoir : demander le remboursement des crédits de M. Tapie. Ensuite, le dossier, suivant la procédure normale, a été renvoyé devant le tribunal de commerce. Si c’était à refaire, je referai de même, sans état d’âme, sauf que, connaissant l’histoire, j’éviterais peut-être l’accord de mars 1994, que j’ai dénoncé en mai 1994, lorsque j’ai réalisé que M. Tapie avait essayé de nous « rouler dans la farine », pardonnez-moi cette expression un peu familière.
Cette introduction me paraît suffisante.
M. Charles de Courson : D’après les informations que vous avez pu recueillir en entrant dans vos fonctions, en novembre 1993, votre prédécesseur, M. Jean-Yves Haberer, a-t-il reçu des pressions du gouvernement de l’époque pour monter un tour de table financé exclusivement par le Crédit Lyonnais afin de trouver un moyen d’acheter les actions de M. Tapie dans des conditions très favorables aux intérêts de ce dernier ?
M. Jean Peyrelevade : Je ne dispose d’aucun élément me permettant d’affirmer l’existence d’interventions gouvernementales. Comme je l’avais dit à la commission d’enquête, M. Tapie a pu recevoir des marques d’amitié ou d’intérêt de la part du Gouvernement ou de personnalités politiques ; j’en ai reçu moi-même lorsque j’ai commencé à demander le remboursement de ses crédits. Mais je n’ai jamais vu d’instructions et, à ma connaissance, il n’en existe pas trace au dossier. D’après ce que j’ai pu constater, je suspecte que le Crédit Lyonnais de l’époque préférait continuer à financer indéfiniment plutôt que de reconnaître une erreur de jugement, sur ce dossier comme sur d’autres ; je ne suis pas sûr que M. Haberer ait eu besoin d’instructions gouvernementales pour agir de la sorte.
M. Charles de Courson : Selon vous, durant les deux mois qui se sont écoulés entre la rédaction du mémorandum, le 12 décembre 1992, et la vente de la société, le 12 février 1993, la SDBO a-t-elle manqué à son obligation de loyauté envers son mandant ? Les époux Tapie affirment ne pas avoir été tenus au courant de l’évolution du dossier et des négociations avec le repreneur, Robert Louis-Dreyfus. Des comptes rendus oraux ou écrits leur ont-ils été communiqués ?
Le président Didier Migaud : Il est en effet reproché au CDR et à la SDBO de ne jamais avoir rendu compte par écrit de leur mandat.
M. François Bayrou : Je souhaiterais préciser la question. Vous avez fait plusieurs fois allusion aux conditions extraordinairement favorables de la vente de février 1993. D’après vous, quel a été le scénario de la cession ? Comment a-t-elle été conclue ?
M. Jean Peyrelevade : S’agissant de la forme, je n’ai pas trouvé, après mon arrivée, d’écrits informant officiellement le Groupe Bernard Tapie des conditions détaillées de l’exécution du mandat de vente. Si cela est vrai, il s’agit d’une modeste faute technique, dès lors que les intérêts du client ne sont pas altérés. Cela nous renvoie donc au fond. Comme toujours dans cette affaire, les témoignages verbaux vont dans les deux sens. Mes collaborateurs m’ont expliqué à moult reprises que l’entourage de M. Tapie était informé. Quoi qu’il en soit, et c’est l’essentiel, je persiste dans la certitude que cela s’est déroulé dans des conditions extraordinairement favorables pour M. Tapie. Il achète Adidas en 1990 sans engager un franc de fonds propres – il obtient un prêt d’1,6 milliard de la SDBO, remboursable en deux échéances. J’en viens à la sentence mensongère des arbitres, sentence mensongère, j’insiste sur le mot, par incompétence ou par mauvaise foi, je vous laisse le choix.
M. Patrick Lemasle : Peut-être les deux !
M. Jean Peyrelevade : Absolument.
À l’été 1991, si je ne me trompe, M. Tapie est incapable de rembourser la première échéance – et pour cause, Adidas, qui ne possède pas de cash-flow, a fait l’objet d’un leveraged buyout, un LBO. Pour faire face à l’échéance, le capital d’Adidas fait l’objet d’une très grosse augmentation, de l’ordre de 50 millions de deutschemarks, la participation de BTF se diluant de 95 à 55 %. Des acrobaties financières dont je n’ai pas le souvenir exact permettent de lever la somme nécessaire pour rembourser la première échéance. Les nouveaux entrants sont Pentland, à hauteur de 20 %, et des investisseurs qui resteront présents jusqu’au bout : Clinvest, à hauteur de 10 %, Mme Gilberte Beaux, la banque Worms et les AGF. L’ensemble contrôle 45 % de la structure.
Compte tenu des résultats de 1992, il est encore moins possible de rembourser la dette d’acquisition. M. Tapie a signé des accords secrets avec Pentland en faisant entrer cette société dans le capital : il lui accorde un droit de préemption dans l’hypothèse où il vendrait et, surtout, il lui donne un droit d’acquisition de la totalité de ses 55 % s’il était incapable de rembourser sa dette fin 1992. Comme la dette est de 600 ou 700 millions de francs, Pentland a la possibilité d’acquérir 55 % d’Adidas pour ce montant. Les banquiers découvrent fin 1992 que Pentland est le cessionnaire obligé. La négociation s’engage avec cette société. Elle déclare qu’elle achète et procède à un audit. Toutefois, deux ou trois mois après, elle n’est plus acheteuse. Catastrophe ! Bernard Tapie a acheté Adidas pour 700 à 750 millions de dollars, la contre-valeur des 1,6 milliard de francs, en jugeant l’affaire merveilleuse – je ne porte pas de jugement sur ce point – mais l’on oublie de préciser qu’Adidas, compte tenu de sa situation difficile et de la nature de son activité, est très endettée : elle doit 750 millions de deutschemarks en Allemagne, dont quelque 500 millions de deutschemarks de fonds de roulement. Adidas a donc été achetée pour 750 millions de deutschemarks d’acquisition plus 750 millions de deutschemarks de dette, soit 1,5 milliard de deutschemarks. Les banquiers allemands, qui financent le fonds de roulement d’Adidas et constatent que l’entreprise est au bord du dépôt de bilan, refusent de continuer, sauf si elle procède à un changement d’actionnariat, une recapitalisation et – tout le monde l’oublie, à commencer par les arbitres – un changement de management. Pentland, en position de force grâce à la clause de substitution accordée unilatéralement par M. Tapie, refuse l’augmentation de capital. Or, j’ai omis de le préciser, M. Tapie avait aussi accordé à Pentland un droit de blocage. Il a donc fallu faire sortir Pentland et Bernard Tapie pour accroître le capital. Un banquier professionnel, dans cette situation, regarde l’état d’Adidas et du Groupe Bernard Tapie et constate la cessation de paiement généralisée – les gages sur Trayvou, Testut et autres ne valent pas grand-chose. Mais ils considèrent qu’ils ont un nantissement sur Adidas car c’est une marque superbe et ils le mettent en jeu. J’ai déjà présenté ce raisonnement, en 1994, à la commission d’enquête parlementaire.
M. le président Didier Migaud : Il peut être reproché au Crédit Lyonnais et à ses filiales d’avoir engagé des démarches dès fin 1992 alors que la valeur d’Adidas était estimée à un peu plus de 4 milliards.
M. Jean Peyrelevade : C’est inexact. J’y viens ; vous m’avez demandé de reconstituer les faits, je m’y efforce.
Dans la situation où se trouvait Adidas à l’époque, il fallait exercer le nantissement, je n’ai aucun doute ; si j’avais été en fonction à ce moment, j’espère que j’aurais agi ainsi. Pour des raisons qui me dépassent et dont j’ignore si elles tiennent à la personnalité de M. Tapie, à celle de M. Haberer ou aux deux, il est décidé de sauver la face à M. Tapie, je l’ai dit dans les mêmes termes à la commission d’enquête en 1994. Ainsi, au lieu d’exercer le nantissement, on vend au prix exigé par M. Tapie pour rembourser sa dette d’acquisition et réaliser une plus-value supplémentaire de 400 millions de francs. Comme aucun acheteur n’est trouvé – Pentland, qui connaît la société, a renoncé –, un montage très compliqué est élaboré. Clinvest, les AGF, Mme Beaux et la banque Worms restent actionnaires et doublent leurs parts pour passer conjointement à 50 %.
Pour trouver les 50 % restants, une clause est destinée à rassurer les acheteurs potentiels : le prix est élevé mais l’achat n’est pas risqué puisque, si l’histoire tourne mal, la perte pèsera exclusivement sur le Crédit Lyonnais, qui récupérera la propriété d’une entreprise ne valant rien par rapport au prix initial ; par contre, si l’histoire tourne bien, le Crédit Lyonnais, qui prend tous les risques, récupérera les deux tiers de la plus-value et le troisième tiers reviendra aux investisseurs. Sans cette clause, Adidas n’est pas vendable. Robert Louis-Dreyfus, qui possède une réputation justifiée de redresseur d’entreprises, accepte ces conditions, qui ne sont pas désagréables. Deux structures offshore sont aussi trouvées – c’est l’un des points sur lesquels la sentence des arbitres est clairement mensongère puisqu’ils affirment qu’il s’agit de faux nez du Crédit Lyonnais, en s’abstenant de produire les pièces que je me suis de nouveau procuré et qui prouvent le contraire.
Robert Louis-Dreyfus, homme d’affaires et entrepreneur avisé, demande une option d’achat à tout moment, à un prix minimum, opposable à tous les autres actionnaires, qu’il compte exercer si l’affaire tourne très bien, de façon à devenir le vrai patron de l’entreprise. Avec la clause de protection, hormis le Crédit Lyonnais, Clinvest et les AGF, tous les actionnaires sont financés par un prêt à recours limité, ne paieront que 0,5 % de taux d’intérêt mais n’auront droit qu’à un tiers de la plus-value éventuelle. Toutefois, ils peuvent renoncer à tout moment, de leur propre chef, à la clause de protection ; ils bénéficieraient alors de la totalité de la plus-value éventuelle à condition de payer le taux d’intérêt normal. Si la plus-value sur Adidas avait été certaine début 1994, pourquoi aurais-je supplié Robert Louis-Dreyfus de transformer une partie du prêt à recours limité dont il bénéficiait en un vrai prêt bancaire sans clause de protection ? Pourquoi aurais-je renoncé spontanément aux 70 % de la plus-value sur ses parts ? Il aurait fallu être fou. Mme Beaux et la banque Worms sont sortis début 1994 – je crois d’ailleurs me souvenir, sans en être certain, que c’est sur leurs parts, rachetées par Robert Louis-Dreyfus, que celui-ci a renoncé à la clause de protection. Si la plus-value était certaine, pourquoi Mme Beaux, femme d’affaires avisée, et pourquoi la banque Worms, à laquelle il arrive d’avoir des réflexes professionnels, y auraient-elles spontanément renoncé ? Surtout, pourquoi les autres actionnaires, Coatbridge Holdings, Omega Ventures – prétendument contreparties du Crédit Lyonnais – n’auraient-ils pas renoncé à leur protection avant la levée d’option par Robert Louis-Dreyfus pour bénéficier de leurs 70 % de plus-value ? Nul besoin d’être un grand banquier ou un spécialiste des produits dérivés pour faire la différence entre une option et un engagement ferme.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Nous voudrions bien comprendre ce qui s’est passé pendant cette période. En décembre 1992, la SDBO bénéficie d’un mandat du Groupe Bernard Tapie pour vendre Adidas autour de 2 milliards de francs. Deux mois après, mi-février, la même SDBO accepte une option d’achat unilatérale de 4 milliards de francs au bénéfice du groupe Robert Louis-Dreyfus, option qui doit se dénouer fin 1994 au plus tard. Les différents jugements comme la sentence arbitrale se demandent si, pendant le laps de temps précédant l’exercice de l’option d’achat par Robert Louis-Dreyfus, le Crédit Lyonnais, par filiales interposées, n’était pas le véritable acquéreur des actions Adidas. Autrement dit, le simple mandat de vente ne s’est-il pas transformé en contrepartie ? Par conséquent, il est essentiel de savoir si, lors de votre entrée en fonction, vous avez eu connaissance de comptes rendus du mandat de la SDBO démontrant qu’il s’agissait d’un simple mandat de vente. Pour ma part, j’ai un doute. Je rappelle que Didier Migaud et moi faisions partie de la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais.
Le 10 mai 1994, sur ce point précis, vous répondez au rapporteur, M. François d’Aubert : « En ce qui concerne Adidas, je le répète, n’étant pas entré dans le détail, je ne suis pas capable de vous répondre de manière précise. Néanmoins, vous me permettrez de rappeler un souvenir. Vous m’aviez agressé, monsieur d’Aubert, à l’époque où j’étais président de l’UAP, et vous m’aviez accusé de participer à une entreprise inspirée par des raisons politiques. Je vous avais répondu que nous étions en situation de portage pour le compte du Crédit Lyonnais. Cette réalité s’étend, à ma connaissance, à l’ensemble des actionnaires d’Adidas, AGF mis à part. Donc, en fait, c’est le Crédit Lyonnais qui était propriétaire d’Adidas. Il avait racheté Adidas à M. Tapie. Les détails, je ne les connais pas aujourd’hui, mais comme je pense que nous allons vendre mieux que nous avons acheté, cette affaire aura, je l’espère, une heureuse issue. »
Henri Emmanuelli indique alors : « Si le Crédit Lyonnais pense qu’il va revendre Adidas plus cher qu’il ne l’a payé, cela signifie que ce n’est pas une créance douteuse. Je souhaite que l’on parle de nombreux autres dossiers pour lesquels les niveaux d’engagement sont beaucoup plus importants. »
Vous nous donnez le sentiment que le Crédit Lyonnais a été très bien avisé. Sentant que la vente d’Adidas pouvait se dérouler, il a poussé la précaution jusqu’à devenir propriétaire pour s’assurer de réaliser la plus-value. Il faut aller au bout de la séquence, qui ne s’arrête que quand Robert Louis-Dreyfus exerce ses options d’achat à hauteur de 4 milliards de francs.
M. Jean Peyrelevade : Je vais y venir, ne vous inquiétez pas.
Le président Didier Migaud : Il pourrait être utile que vous vous exprimiez à propos du rapport d’expertise réalisé fin 1994 à la demande d’un tribunal de commerce, cité dans la sentence arbitrale, selon lequel la vente d’Adidas a été une très bonne opération pour toutes les parties sauf pour Bernard Tapie, qualifié d’« inventeur de l’affaire ».
M. Philippe Martin : Vous avez dit, monsieur Peyrelevade, que vous aviez sommairement qualifié de portage une opération qui n’était qu’un portage financier et non pas juridique. Quel distinguo opérez-vous entre les deux notions ? Les arbitres, dans leur sentence, reconnaissent clairement l’existence d’un portage.
Mme Arlette Grosskost : Dans le rapport d’expertise, vous expliquez que le rachat controversé par financement bancaire des biens personnels et industriels de M. Bernard Tapie était un sauvetage organisé entièrement financé par le Crédit Lyonnais et que la prise de participation de M. Louis-Dreyfus a été doublée d’une augmentation de la participation du Crédit Lyonnais, à 36 % du capital. Vous motivez cette dernière – il a été rappelé qu’il s’agit d’un portage – par le souci de récupérer un maximum d’argent pour le Crédit Lyonnais.
Vous insistez sur le fait qu’il s’agissait d’une option d’achat mais rien ne nous garantit qu’aucune promesse de vente n’a été formulée, fût-ce verbalement.
M. Michel Bouvard : Quel rôle les sociétés offshore ont-elles joué ? Comment ont-elles été choisies ? Par qui ? À quelle somme s’élèvent les plus-values qu’elles ont enregistrées ? Nous avons eu peu d’informations à ce sujet, y compris lors de la commission d’enquête de 1994.
M. François Goulard : L’arrêt de la Cour de cassation d’octobre 2006 établit qu’il n’y a pas eu portage. La question est donc juridiquement tranchée de manière incontestable. Pour la clarté, les points qui ne font plus débat, comme celui-ci, devraient être laissés de côté.
Le Rapporteur général : Je n’ai pas la même lecture de l’arrêt de la Cour de cassation.
Le président Didier Migaud : Il est vrai que les interprétations divergent.
M. François Goulard : Généralement, les mandats de vente ne comportent pas de prix aussi précis mais un prix plancher, qui peut être éventuellement dépassé. Quant au délai de deux mois incluant la trêve des confiseurs, il me paraît exceptionnellement court pour vendre une entreprise dans les meilleures conditions. Ce mandat de vente était inséparable de l’engagement pris au préalable par Bernard Tapie d’affecter l’intégralité du produit de la cession au remboursement de ses dettes. Quand une banque ne trouve pas d’acheteur, il est assez classique qu’elle essaie de constituer un tour de table pour trouver une solution. S’agissait-il de cela ou bien de vendre une société pour laquelle tout allait bien en s’efforçant de parvenir à la meilleure transaction possible ? Cette question de fond détermine très largement la décision rendue par les arbitres.
Ma deuxième question est beaucoup plus précise et vous n’aurez pas forcément les éléments de réponse. La Commission bancaire, dès 1992, a demandé à la SDBO de constituer 129 millions de provisions sur le Groupe Bernard Tapie. La banque ne l’a pas fait. Quelle argumentation a conduit la SDBO et la maison mère à ne pas tenir compte de ce signal d’alarme inquiétant ?
M. Frédéric Lefebvre : Le portage est clairement reconnu à la page 13 de la décision d’octobre 2006, j’invite tout le monde à la lire.
Monsieur Peyrelevade, à l’époque, vous présidiez l’UAP. Pouvez-vous nous éclairer quant à vos relations d’alors avec le Crédit Lyonnais, à propos d’Executive Life – la question a été jugée et a donné lieu à condamnation – mais aussi d’Adidas ? Au-delà de la question du portage, comme beaucoup de monde, je m’interroge. Les opérations de communication décrites dans la décision arbitrale – mise en scène orchestrée par vos soins lors de la vente de l’hôtel particulier de M. Tapie, visites organisées comme si c’était un zoo – expliquent le montant des dommages et intérêts. Tout cela n’est-il pas dû aux liens que vous entreteniez avec le Crédit Lyonnais lorsque vous présidiez l’UAP ?
M. Jean Peyrelevade : Quand on arrive dans un tel groupe, il faut faire confiance à ceux qui vous expliquent ce qui s’est passé précédemment. Je vous ai décrit les opérations telles que je les ai comprises à la lecture de documents et en entendant les réponses aux questions très précises que j’ai posées à l’auteur du montage, François Gille, un honnête homme. Celui-ci m’a toujours assuré qu’il me disait tout, que personne du Crédit Lyonnais n’était derrière Coatbridge et Omega, qu’il s’agissait d’une option d’achat. Je rappelle que nous vivions dans un climat où il n’était pas certain qu’Adidas s’en sorte. Si vous me reprochez de ne pas savoir ce qui était caché alors que je n’étais pas encore là, je vous réponds que des personnes honnêtes, qui étaient présentes avant moi, assurent que rien n’a été caché.
L’UAP n’était aucunement engagée dans Executive Life, désolé, monsieur Lefebvre. L’UAP n’entretenait pas de relations étroites avec le Crédit Lyonnais puisque son partenaire bancaire, à l’époque, était la BNP, désolé, monsieur Lefebvre – avec René Thomas, un ami personnel, nous avons d’ailleurs échangé des participations.
La dernière fois que j’ai rencontré M. Tapie, c’est quand il est venu me voir à l’UAP. La banque Worms, l’un de ses banquiers importants, sinon le premier, avait initialement été choisie comme chef de file de l’introduction en bourse de BTF. Néanmoins, au dernier moment, il a jugé le prix insuffisant et a déchu la banque Worms au profit du Crédit agricole – amusant, n’est-ce pas. Comme je doutais profondément de la santé industrielle du groupe Tapie, dans lequel la banque Worms avait pris des participations à tous les niveaux, j’ai profité de cette décision pour enjoindre au patron de la banque Worms de sortir de tout le groupe, ce que nous avons commencé à faire. M. Tapie est venu me voir pour me reprocher de compromettre son introduction en bourse. Telle est l’histoire des relations entre M. Tapie et l’UAP.
L’opération Adidas arrive un peu après et je m’aperçois – le pouvoir d’un président est toujours limité – que ma consigne n’a été respectée qu’à 98 %, que nous avons gardé une petite participation quelque part. Quand tout Paris applaudit à l’achat d’Adidas, je dis à mes collaborateurs que le climat d’euphorie générale est le bon moment pour finir de s’en aller. Adidas géré par Bernard Tapie, je n’y crois pas.
C’est alors que M. Haberer m’appelle pour me confier que cela lui rendrait service si nous restions. J’ai donné mon accord, mais à condition que nous ne prenions aucun risque, donc que nous intervenions en portage. Le portage est un terme affreux mis à toutes les sauces. Le portage juridique entraîne un transfert de propriété. Mais lisez la déposition de M. Michel Gallot devant la commission d’enquête parlementaire : il parle de portage par Bernard Tapie de ses actions Adidas. Le portage consiste aussi à porter un actif économiquement ou financièrement. Un, deux ou trois mois après, mes collaborateurs m’ont dit que j’avais satisfaction et je n’ai pas regardé davantage.
Quand la commission d’enquête m’a interrogé, j’ai répondu que cette opération était l’habillage d’une vente forcée et que je trouvais complètement fondée l’hypothèse selon laquelle la SDBO, exerçant son nantissement, aurait récupéré la totalité des actions en renonçant à ses 700 millions de crédits. J’ai donc trouvé – j’avais tort, je ne suis pas juriste – que la question de la propriété d’Adidas était secondaire. Quand je me suis aperçu de son importance, j’ai précisé ma pensée : j’ai écrit en particulier aux experts du tribunal de commerce pour leur préciser que j’avais évoqué le terme de « portage » mais qu’il ne s’agissait pas d’un transfert de propriété. Les nouveaux actionnaires étaient vraiment propriétaires juridiquement – ils avaient d’ailleurs, je le répète, la possibilité de renoncer à tout moment à la clause de protection, de manière à recouvrer la totalité des droits incombant aux propriétaires et à percevoir l’intégralité des plus-values. En parlant de « portage », je voulais simplement dire que, devant une situation difficile, le Crédit Lyonnais avait conservé l’intégralité du risque et avait naturellement trouvé des acheteurs prêts à toucher une partie du profit. C’est la première fois que j’ai l’occasion de le dire.
Quels sont les propriétaires, juridiquement, en dehors de ceux que j’ai déjà cités, qui étaient déjà présents un an auparavant ? Clinvest, les AGF, la banque Worms et Mme Beaux. Les trois nouveaux actionnaires sont Robert Louis-Dreyfus – personne ne le conteste, je crois – et les deux structures étrangères, Omega Ventures et Coatbridge Holdings. Comme j’étais agacé par les soupçons pesant sur le Crédit Lyonnais, accusé d’être derrière ces deux structures spécialisées, j’ai écrit aux présidents des deux maisons mères pour leur demander de me garantir le contraire. À ma grande surprise, ils m’ont répondu et m’ont certifié que le Crédit Lyonnais n’avait aucun intérêt direct ni indirect dans ces structures, ni en tant que société ni du fait de personnes physiques employées au Crédit Lyonnais – car, à l’époque, compte tenu de l’intérêt de l’opération pour tout investisseur, je me méfiais. J’ai bien entendu versé leurs courriers au débat, pensant que l’injonction de ne pas m’occuper des affaires du CDR n’allait pas jusqu’à m’interdire de lui en donner copie. Il se trouve qu’à l’époque, le président de la CitiBank France était un ami personnel. Je trouve étonnant que, à la page 69 de la sentence arbitrale, il ne soit pas question de ces deux structures mais de Citistar, qui n’avait pas le statut d’acheteur. La sentence reproduit intégralement la lettre de couverture signée par M. Claude Jouven, président de CitiBank SA Paris, et non pas de CitiBank SA New York, qu’il font passer pour une « réponse de convenance » : « Cher Jean, ainsi que tu me l’as demandé, je te fais parvenir ci-joint… ». Mais elle n’évoque pas le certificat de fond du 7 juillet 1998, provenant de Londres, dont l’auteur ne s’embarrasse d’aucune formule de politesse, ce qui en dit long sur son absence de complicité : « Suite aux rumeurs qui peuvent circuler concernant l’intervention au début de 1993 de notre groupe dans l’acquisition de la holding contrôlant le groupe Adidas, nous attestons par la présente en tant que de besoin que la société Omega Ventures, support de cette acquisition à hauteur de 19,9 % du capital, a été créée par notre groupe. Déduction faite du paiement au Crédit Lyonnais de la rémunération complémentaire prévue à l’article 5-1 de la convention de prêt à recours limité conclue entre le Crédit Lyonnais et nous-mêmes, les bénéficiaires de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts d’Adidas à la fin de 1994 appartiennent à notre groupe, à l’exclusion de toute personne morale ou physique appartenant au groupe Crédit Lyonnais. » Vous comprenez donc que j’accuse les arbitres d’incompétence ou de mauvaise foi.
Le Rapporteur général : La notion de portage étant extrêmement complexe, nous ne sommes pas qualifiés pour juger. Mais M. Peyrelevade nous dit, le 10 mai 1994, que le Crédit Lyonnais est propriétaire d’Adidas, racheté à M. Tapie.
M. Jean Peyrelevade : Je répète, monsieur Carrez, que j’ai reconnu explicitement avoir commis une erreur de vocabulaire. Je l’ai reconnu très vite puisque j’ai écrit aux experts du tribunal de commerce début 1995, si je me souviens bien. Je leur ai indiqué que je voulais dire que le Crédit Lyonnais avait gardé tous les risques et que j’avais employé le terme « portage » dans sa conception économique et non juridique.
Le président Didier Migaud : Ne polémiquons pas. Nous posons nos questions et M. Peyrelevade répond. Chacun est ensuite en mesure d’apprécier.
M. Jérôme Chartier : L’attestation fournie par la maison mère d’Omega Ventures…
M. Jean Peyrelevade : La maison mère de Coatbridge Holdings m’a aussi répondu dans le même sens.
M. Jérôme Chartier : S’il existait par extraordinaire une convention de portage entre Omega Ventures et n’importe quelle personne morale faisant l’objet d’une clause de confidentialité absolue, pensez-vous qu’une telle attestation aurait pu vous être adressée ? Si elle l’avait fait, aurait-elle respecté la clause de confidentialité ?
M. Charles de Courson : En quoi Citistar, qui, à ma connaissance, n’était pas actionnaire, intervient-elle dans cette affaire ? Pourquoi est-elle évoquée dans la sentence arbitrale ?
M. Jean Peyrelevade : Monsieur Chartier, je n’ai pas de réponse absolue mais la formule « à l’exclusion de toute personne morale ou physique appartenant au groupe Crédit Lyonnais » est très forte. Je le répète, j’ai été surpris que les deux banques me répondent et qu’elles le fassent en des termes aussi tranchés. Je n’imagine pas qu’un président de banque, surtout un Anglo-saxon, puisse s’exprimer ainsi si un montage souterrain dénaturait son affirmation.
Tant que la plus-value n’a pas été réalisée, M. Tapie n’a élevé aucune protestation contre les conditions d’exécution de la vente ; il ne s’est réveillé que début 1995. J’étais extérieur à l’affaire, je n’étais pas partie au débat et je n’ai pas témoigné. C’est en lisant la presse que je me suis peu à peu aperçu que j’étais accusé d’avoir procédé moi-même à l’invention des structures tierces.
M. Michel Bouvard : Lors des débats devant la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais, la question aurait pu vous venir à l’esprit. Pourquoi attendre 1998 pour éclaircir la propriété desdites sociétés, qui constitue un aspect important ?
M. Jean Peyrelevade : Lorsque j’arrive au Crédit Lyonnais, j’ai une multitude de soucis plus compliqués les uns que les autres. L’affaire Adidas sort et je passe devant la commission d’enquête parlementaire. Comme je ne sais pas comment les structures ont été choisies, François Gille m’explique le montage auquel il a procédé et m’affirme qu’il n’y a personne d’autre derrière. Que voulez-vous que je demande de plus ? À l’époque, il n’y a ni procès ni contestation, tout le monde est très content. Je trouve le montage très favorable à M. Tapie mais je veux simplement être sûr. Il me semble que François Gilles n’a pas été appelé à témoigner plus que moi.
Citistar, qui appartient à la mouvance de CitiBank, n’intervient pas entre le Crédit Lyonnais et Coatbridge. Mais le prêt à recours limité inventé par le Crédit Lyonnais était inhabituel pour le droit anglais et la CitiBank. Citistar a donc été interposé entre Omega Ventures et le Crédit Lyonnais de manière à transformer le prêt à recours limité en un objet plus comestible pour les juristes de la City londonienne. Citistar, dans cette affaire, est un pur transmetteur de financement. J’ai malheureusement rencontré Citistar dans une autre affaire du Crédit Lyonnais, que M. Tapie a aussi utilisée dans mes ennuis avec Executive Life : les relations entre le Crédit Lyonnais et François Pinault. Cela n’a donc rien à voir avec Adidas. Il se trouve que mon prédécesseur, pour des raisons comptables, a souhaité ne pas consolider sa participation de 25 % dans la Financière Pinault. J’ajoute que, sur l’affaire Executive Life, il n’y a jamais eu d’arbitrage.
M. le président Didier Migaud : Absolument : c’était une transaction, pas un arbitrage.
M. Jean Peyrelevade : Citistar a porté une partie de la participation du Crédit Lyonnais dans la Financière Pinault. Dans un cas, Citistar est un vrai porteur ; dans l’autre, c’est un transmetteur de financement. Mais les arbitres mélangent les deux et concluent que le Crédit Lyonnais est contrepartie dans l’affaire Adidas.
L’affaire Executive Life m’ayant contraint à améliorer mes connaissances juridiques, j’ajoute que j’ai recueilli des consultations juridiques de la part des plus grandes sommités françaises pour comprendre ce qu’est un portage. Je suis ravi de vous dire qu’un portage, en droit français, est une opération parfaitement licite et légitime. S’il a pour objectif de contourner la loi, il est réputé nul de plein droit. Lorsque j’ai fait part de cette thèse à mes avocats américains, ils m’ont assuré que, dans l’affaire Executive Life, il n’y a pas de délit.
S’agissant des structures offshores, je suppose que les monteurs de l’opération ont demandé à leurs contreparties bancaires habituelles de trouver des investisseurs acceptant d’entrer au capital dans les conditions définies.
M. Michel Bouvard. Quelle a été la rémunération des sociétés offshore ?
M. Jean Peyrelevade : Un tiers de la plus-value sans risque, ce n’est pas désagréable…
Le président Didier Migaud : Le rapport d’expertise publié fin 1994 dont il est fait état à la page 48 de la sentence arbitrale considère que l’opération se révèle positive pour tous les acteurs, à l’exception de Bernard Tapie. En avez-vous eu connaissance ? Que pouvez-vous dire à ce sujet ?
M. Jean Peyrelevade : À l’époque, j’en ai eu connaissance mais je ne l’ai plus. Je me souviens qu’il m’accusait d’avoir en personne défini sinon organisé les portages d’Adidas par le Crédit Lyonnais. J’ai répondu aux experts en question de manière tout à fait officielle. La lettre aurait donc dû également être versée au débat. J’observe que les arbitres se contentent – sans la citer, une fois de plus – de dire que ma réponse aggrave mon cas.
Un peu plus tard, un rapport a été commandé par Éva Joly à un autre expert. Ce rapport est extrêmement fouillé, davantage que celui du tribunal de commerce – il serait intéressant de les comparer. Il reconstitue les comptes de chacune des sociétés du groupe Crédit Lyonnais en remontant à 1989 ou 1990. Société par société, il évalue les dates auxquelles les cessations de paiement sont intervenues : elles sont toutes antérieures à 1993. Après prise en compte du coût de l’argent, il estime la plus-value économique obtenue par Bernard Tapie lors de la revente d’Adidas à quelque 200 millions de francs – soit 400 millions de francs de plus-value comptable si l’on ajoute les intérêts. Compte tenu des risques pris par le Crédit Lyonnais, il conclut que la rémunération de Bernard Tapie est tout à fait satisfaisante.
M. Charles de Courson : Avez-vous eu entre vos mains l’audit de Pentland ?
M. Jean Peyrelevade : Non. J’en connais l’existence mais pas le contenu.
M. Yves Censi : L’exégèse économique et financière admet plusieurs points de vue. Pendant la période considérée, vous reconnaissez ne pas avoir disposé de toutes les informations. Cela n’explique-t-il pas que les arbitres n’aient pas la même appréciation que vous, tout comme, à un moment donné, vous aviez affirmé que le Crédit Lyonnais avait été propriétaire ?
M. Jean Peyrelevade : Désolé, monsieur Censi, mais j’ai répondu explicitement à M. d’Aubert, lors de mon audition devant la commission d’enquête, que je n’avais pas lu les contrats de portage. Quand j’ai vu les remous qui commençaient à naître autour de l’affaire une fois que M. Tapie a décidé que la plus-value lui revenait, j’ai lu les contrats de prêt à recours limité et j’ai interrogé François Gille pour me faire une opinion. Quand je suis arrivé au Crédit Lyonnais, j’ai trouvé tellement de problèmes immédiats à résoudre, j’avais tellement à faire qu’il ne me restait pas de temps pour autopsier le passé.
M. Yves Censi : Votre opinion a évolué.
M. Jean Peyrelevade : Sur un point que je croyais dénué d’importance. Je pensais que la SDBO aurait dû exercer son nantissement. M. Tapie, responsable de la chute d’Adidas, tente de prétendre que la plus-value lui revient ; c’est une première dans l’histoire économique, comme si les responsables de la chute d’Alstom jusqu’au bord du dépôt de bilan revendiquaient le redressement ultérieur. Je me suis donc renseigné et, une fois de plus, je suis pleinement satisfait de ce que j’ai trouvé. Je vous le dis en toute conviction, si les arbitres avaient bien voulu écouter et travailler, ils se seraient rendu compte que le Crédit Lyonnais ne s’est jamais porté contrepartie, qu’il n’y a pas eu portage au sens juridique du terme.
M. Jérôme Cahuzac : Cette audition est cruciale pour apprécier l’opportunité et la légalité de la procédure arbitrale. La personne auditionnée juste avant vous juge cette procédure illégitime et, si elle admet sa légalité ex post, elle conteste vivement sa légalité ex ante. Mais enfin nous sommes en train d’apprécier le fondement de la sentence du collège des trois arbitres. Il ressort de différentes auditions que M. Tapie, en 1992, vend parce qu’il n’a pas d’autre choix : il devient ministre – les deux fonctions sont incompatibles – et Adidas perd de l’argent. Faute d’acheteur, il risque de faire une mauvaise affaire. Et pourtant, il s’en sort bien et retire 400 millions de francs de l’époque, sans jamais s’être rendu en Allemagne, sans jamais avoir visité une usine et sans jamais avoir pris la moindre décision stratégique concernant cette entreprise – en tout cas à ma connaissance. Réclamer une partie de la plus-value réalisée grâce au travail d’autres peut être jugé curieux mais c’est insuffisant pour que les pouvoirs publics reviennent sur une décision qui conduit l’État à signer un chèque de près de 400 millions d’euros.
Au départ, je ne saisissais pas bien pourquoi nos collègues de l’UMP insistaient autant pour comprendre ce qu’ils appellent le « portage ». J’apprécie désormais leurs efforts, qui ont permis de démontrer que les organismes soupçonnés d’être des faux nez, des excroissances ou des pseudopodes du Crédit Lyonnais étaient en réalité indépendants de lui. Nous les remercions car ils offrent aux pouvoirs publics un moyen de recours. L’universitaire que nous venons d’auditionner nous a en effet appris qu’il existe un quatrième motif de recours en révision : l’apparition d’un fait nouveau précédemment dissimulé. La lettre du président de CitiBank, désormais connue, est évidemment à la disposition du CDR, qui ne l’a manifestement pas communiquée aux arbitres. En tout cas, ils ne la citent pas dans la sentence arbitrale, ce qui revient à méconnaître un fait grave, que nous considérons comme nouveau. Cette voie de recours est ouverte et il faut l’explorer de la façon la plus consciencieuse qui soit car 400 millions d’euros sont en jeu, alors que les caisses de l’État sont vides.
Pensez-vous que les arbitres ont eu connaissance de cette lettre ?
M. Jean Peyrelevade : Je pense qu’ils en ont eu connaissance puisqu’ils citent son existence dans leur sentence. Je trouve simplement incroyable qu’ils la considèrent comme une « réponse de convenance » sans même exposer son contenu.
M. Jérôme Cahuzac : Il s’agit donc d’un fait nouveau.
M. Frédéric Lefebvre : M. Peyrelevade émet des accusations assez graves à l’encontre des arbitres. Il a au demeurant fortement critiqué le recours à cette procédure. Je m’étonne donc de son silence et de celui de M. Bayrou ou de M. de Courson, en octobre, lorsque la décision a été prise, et jusqu’au mois de décembre, lorsqu’elle a été homologuée. Monsieur le président de la commission des Finances, à l’époque, avez-vous été saisi par un membre de la commission ? François Bayrou n’en était pas membre puisqu’il a opportunément changé de commission,…
M. François Bayrou : Exprès !
M. Frédéric Lefebvre : …sans doute pour se faire l’avocat de M. Peyrelevade.
M. Dominique Baert : Il n’en a pas besoin !
M. Frédéric Lefebvre : Dans ce dossier, l’accusateur devient accusé. M. Peyrelevade, vice-président du MODEM, incrimine des juges et des arbitres. Ce mélange entre une affaire judiciaire et des responsabilités politiques est-il sain ?
M. Jean Peyrelevade : Si je vous suivais, tant que je suis ancien président du Crédit Lyonnais, c’est-à-dire jusqu’à ma mort, je devrai m’abstenir de tout engagement civique ou politique. Je crois pourtant savoir que certains parlementaires ont des activités dans le milieu des affaires…
Pourquoi ne me suis-je pas exprimé plus tôt ? Je le répète une fois de plus, je n’ai jamais été considéré comme étant partie prenante à cette affaire puisque personne ne me demandait de témoigner. Quand j’ai adhéré au MODEM, pour des motifs strictement citoyens, je n’imaginais pas que l’État se livrerait à une procédure de ce type. Je faisais confiance à la justice et à l’État – pour ce qui concerne le second, je me suis peut-être trompé. Par ailleurs, j’éprouve un grand respect pour les murailles de Chine. En qualité de banquier, j’étais soumis au secret professionnel ; en tant qu’ex-banquier, je considère que j’y suis toujours soumis. Je vous mets au défi, monsieur Lefebvre, de trouver des déclarations spontanées de ma part relatives à d’anciens clients. Je fais deux exceptions : dans l’affaire Executive Life, compte tenu de la manière dont j’ai été défendu par l’État, je me considère relevé de mon devoir de réserve ; dans l’affaire Tapie, je m’exprime pour la première fois et je serais resté silencieux si la représentation nationale ne m’avait pas auditionné, même si j’aurais souffert de laisser se dérouler l’aventure actuelle sans rien dire.
Le président Didier Migaud : Je précise que, lors du lancement de la procédure arbitrale, je n’ai été saisi d’aucune demande de la part de membres de la commission.
M. Charles de Courson : Pourquoi le protocole d’accord du 13 mars 1994, qui met fin aux relations bancaires entre le groupe Crédit Lyonnais et M. Tapie, a-t-il été annulé ?
Qui porte la responsabilité de l’absence de production du rapport d’expertise sur les œuvres d’art et les biens mobiliers des époux Tapie ?
M. Jean Peyrelevade : Je répondrai rapidement car je l’ai déjà expliqué devant la commission d’enquête de 1994. Lorsque je me suis rendu compte de l’état du groupe Tapie, ma réaction spontanée a été de le mettre immédiatement en défaut – de toute façon, depuis décembre, il l’était déjà – et de demander le remboursement des crédits. François Gille m’a recommandé de n’en rien faire. En effet, sur les 800 ou 900 millions de francs d’actifs que nous croyions récupérer, 400 millions étaient constitués d’œuvres d’art, de tableaux et de mobilier, c’est-à-dire de biens insaisissables. Il semblait déjà difficile de vendre correctement des sociétés dans une atmosphère désastreuse de dépôt de bilan. Plutôt que de compter sur des biens mobiliers susceptibles de disparaître, François Gille a préconisé un divorce à l’amiable, permettant de récupérer 400 millions de valeur. Je n’ai pas fait passer mon instinct avant la rationalité et je me suis incliné. Le protocole avec Bernard Tapie a été intégralement négocié par François Gille, lequel a demandé confirmation de l’inventaire du mobilier au moyen de deux expertises extérieures fournies par M. Tapie. Celui-ci n’a pas de chance car, à mes moments perdus, je chine, et la lecture de l’inventaire m’avait profondément troublé : tel tableau était censé être un Rubens, auquel cas il valait 100 millions de francs, ou un Snyders, auquel cas il ne valait plus que 15 à 30 millions de francs, mais une œuvre de l’école de Snyders lui ressemblant beaucoup avait été cédée en salle des ventes de Rennes quelques mois auparavant pour 800 000 francs. Les contre-expertises n’arrivant pas, mon doute se transforme en quasi-certitude. Je dénonce donc le protocole car la fourniture de ces expertises était une condition suspensive. Cette décision bénéficie de l’autorité de la chose jugée car une cour d’appel s’est prononcée.
J’ajoute, monsieur Lefebvre, que je n’ai nullement procédé à des saisies publiques pour faire de la publicité – c’est d’ailleurs un autre point à propos duquel les arbitres habillent la vérité. Nous avons effectué une saisie conservatoire pour être en mesure d’évaluer le mobilier. M. Tapie, prévenu, l’a déménagé au milieu de la nuit, alors que je m’étais entouré de toutes les précautions possibles, avec l’appui du ministre de l’intérieur de l’époque, dont je passe le nom. Voilà ce qui a eu un retentissement médiatique. Ensuite, en juin 1994, le fisc avait effectué une vraie saisie pour purger une addition fiscale qui traînait. Étant en concurrence avec le fisc, pour ne pas nous faire doubler, nous avons dû nous aussi procéder à une saisie. Ayant enfin saisi les objets, j’ai pu les faire évaluer par Christie’s et Sotheby’s – aucune des deux maisons ne sachant que l’autre avait aussi été sollicitée – et les deux estimations convergent : entre 40 et 50 millions de francs, soit 10 % de l’estimation de M. Tapie.
M. Frédéric Lefebvre : Et la campagne de publicité ?
M. Jean Peyrelevade : J’y viens, vous allez voir. J’aime bien mettre les pieds dans le plat, y compris vis-à-vis de moi-même ou des institutions que je dirige. Les résultats 1993-94 du Crédit Lyonnais sont catastrophiques. Nous préparons la publication des résultats du premier semestre, qui sortent en septembre – c’est-à-dire avant le jugement du tribunal de commerce de décembre – et nous décidons d’organiser une campagne de publicité financière agressive : « Pour changer la banque, c’est maintenant ou jamais ». Je rappelle que la publicité financière au moment de la publication des résultats est une obligation. Nous expliquons donc sur quatre colonnes pourquoi les comptes sont mauvais, pourquoi nous allons travailler et pourquoi nous demandons à nos clients de rester. Le texte ne comporte pas un mot sur M. Tapie. Comme le directeur de la communication et moi avons le sens de l’autodérision, nous incluons trois dessins humoristiques, parus antérieurement dans la presse, dans The Economist, aux Guignols de l’info et dans Libération. Autant que je sache, M. Tapie n’avait pas intenté de procès à Libération, le 14 août 1994, quand ce dernier avait été publié une première fois. Le Crédit Lyonnais y est caricaturé : un personnage, qui doit être moi, dit que « Maintenant, plus que la cave et le grenier à nettoyer » ; en bas, les noms « MGM » et « Tapie » sont inscrits sur deux poubelles. C’est l’unique endroit où le nom de M. Tapie apparaît dans notre campagne de communication, mais, c’est un fait, les sociétés de M. Tapie s’appellent Bernard Tapie Finance, Groupe Bernard Tapie, Financière et immobilière Bernard Tapie. Les arbitres parlent de brutalité, de préjudice moral, d’acharnement, mais ils ont oublié que M. Tapie, dans cette affaire, m’a intenté un procès en diffamation, dans lequel il demandait 300 francs de dommages et intérêts pour lui et 100 000 francs pour chacune des trois sociétés portant son nom. Le procès, je crois, a eu lieu en décembre 1994 : M. Tapie a perdu sur le fond, avec des attendus radicaux, que je tiens à votre disposition.
Le président Didier Migaud : « Radicaux » ? Prenez garde aux expressions !
M. Jérôme Chartier : Je désapprouve que de tels dessins aient été utilisés dans une démarche de communication institutionnelle.
M. Michel Sapin : Cela ne vaut pas 45 millions !
M. Jérôme Chartier : Je comprends très bien le sens de l’attestation que vous a fourni la maison mère de la société des Îles Caïmans mais vous reconnaîtrez que cela n’exclut pas le portage indirect.
M. Jean Peyrelevade : Qu’entendez-vous par « portage indirect » ?
M. Jérôme Chartier : Une personne a pu s’interposer pour le compte du Crédit Lyonnais ou d’un autre afin de contracter avec cette banque des Îles Caïmans. La maison mère est alors parfaitement couverte et peut déclarer que personne du Crédit Lyonnais n’est intervenu.
M. Jean Peyrelevade : Je vous ai répondu que cette hypothèse ne repose sur aucun élément de preuve et que la rédaction de mes interlocuteurs britanniques est extrêmement claire.
M. Jérôme Chartier : Claire pour ce qui concerne une intervention directe, j’en conviens. Mais puisque nous ne raisonnons que sur des hypothèses, celle que j’évoque ne peut être rejetée. N’étant pas encore entré au Crédit Lyonnais à cette époque, vous n’avez pu ensuite obtenir que des informations indirectes.
Lorsque le Crédit Lyonnais a racheté Adidas, s’il savait qu’il allait pouvoir vendre la société à un autre groupe pour le double de la somme, estimez-vous que Bernard Tapie est fondé à demander réparation ?
M. Jean Peyrelevade : Je regrette, mais vous vivez dans la poésie, dans un monde virtuel, dans Second Life. Quand je suis arrivé au Crédit Lyonnais, fin 1993, tout l’état-major du Crédit Lyonnais, constitué de collaborateurs travailleurs, honnêtes, consciencieux et rigoureux, éprouvait des inquiétudes au sujet de la situation d’Adidas. L’hypothèse de la plus-value certaine, cette reconstitution historique des arbitres, est une affabulation, une fiction.
M. Charles de Courson : Le Crédit Lyonnais, qui était partie, a refusé de signer la convention d’arbitrage. Savez-vous s’il envisage de poursuivre des actions judiciaires ?
M. Jean Peyrelevade : Je ne dispose pas d’informations particulières mais je doute que le Crédit agricole ait l’intention de poursuivre. Il était opposé à l’idée d’arbitrage et considère que, battu, il n’a plus d’obligations financières. Le Crédit Lyonnais est une vieille et sale affaire – j’en ai personnellement souffert, y compris ce matin –, au point que son nom est oublié au profit de LCL.
Le président Didier Migaud : En définitive, l’affaire Adidas a-t-elle été positive ou négative pour le Crédit Lyonnais ? S’il a gagné, comment l’expliquez-vous ?
Deux décisions de justice invalident, d’une certaine façon, une partie de votre démonstration : un jugement du tribunal de commerce et une décision de la cour d’appel reconnaissant une faute du Crédit Lyonnais. Quelles observations voulez-vous formuler sur ces points précis ?
M. Jean Peyrelevade : Je ne l’ai jamais caché, le Crédit Lyonnais a fini par gagner de l’ordre d’1,5 milliard de francs sur le dossier Adidas, mais après l’arrivée de Robert Louis-Dreyfus. Je suis persuadé que, sans changement de management, Adidas aurait déposé le bilan. Le petit actionnaire qui a racheté des titres Alstom en bourse – ou l’État – en faisant une superbe plus-value doit-il la partager avec le président précédent ?
Je crois en la séparation des pouvoirs, j’éprouve le plus grand respect pour la justice, j’aimerais être sûr qu’elle est toujours respectée dans ce pays, mais elle est faillible, ce qui justifie l’existence des voies de recours. Je ne suis pas juriste mais les décisions de la Cour de cassation, en principe, s’imposent aux autres. En 1985, pour le compte de la France, avec Laurent Fabius, Premier ministre, Michel Giraud, président de la région Île-de-France, et Paul Séramy, sénateur maire de Fontainebleau, j’ai négocié l’arrivée d’Eurodisney à Marne-la-Vallée. Dans le mémorandum, pour la clause de juridiction, Disney a refusé que la justice française soit compétente et a réclamé l’arbitrage. Les autorités françaises ont répondu que, selon les principes fondamentaux du droit public, l’État ne transige pas. Le gouvernement a été contraint de faire passer une loi spéciale tendant à faire accepter l’arbitrage ! Je ne comprends donc pas que cette procédure ait été retenue.
M. François Bayrou : Les liquidateurs du groupe Tapie soutiennent la thèse suivante : Adidas était une affaire formidable ; la vente était volontaire, Bernard Tapie considérant comme inconciliables ses responsabilités ministérielles avec l’animation d’une affaire industrielle ; le Crédit Lyonnais a contourné la vente, racheté en sous-main et organisé le prélèvement de sa plus-value. Le Crédit Lyonnais aurait-il eu le pouvoir, en faisant jouer son nantissement – c’est-à-dire l’hypothèque –, d’acquérir la totalité des actions possédées par Bernard Tapie sans dépenser un franc supplémentaire ? Je connais la réponse mais elle éclairera nombre de ceux qui nous écoutent à la télévision.
M. Jean Peyrelevade : La réponse est évidemment affirmative : vous demandez le remboursement des crédits auxquels vous avez droit ; le débiteur douteux est incapable de rembourser ; vous saisissez le tribunal de commerce et vous faites valoir que votre nantissement vous donne le droit d’acquérir la pleine propriété des actions correspondantes. C’est ce que j’ai expliqué à la commission d’enquête parlementaire dès 1994.
M. François Bayrou : La Cour de cassation établit formellement que la SDBO et le Crédit Lyonnais sont deux personnes morales distinctes.
Mme Arlette Grosskost : SDBO est une filiale du Crédit Lyonnais.
M. François Bayrou : Avec cette vente, au lieu que la SDBO récupère la totalité des actions sans dépenser un franc, Bernard Tapie perçoit une plus-value de l’ordre de 400 millions du point de vue comptable, 230,9 millions de francs en cash. Est-ce exact ?
M. Jean Peyrelevade : Parfaitement. La SDBO a un mandat de vente à un prix fixé ; compte tenu de la situation d’Adidas et du groupe Tapie, c’est en quelque sorte une vente forcée. Les acheteurs sont juridiquement parfaits puisque le Crédit Lyonnais n’est nullement contrepartie juridique ; il s’interdit même de racheter dans l’hypothèse d’une revente ultérieure. Mais les conditions de financement accordées par le Crédit Lyonnais sont telles que leur risque à la baisse disparaît, dans une grande proportion sinon dans sa totalité. Un petit reproche technique peut éventuellement être fait : le détail de ce montage financier n’a pas été communiqué par écrit à Bernard Tapie à titre d’information.
Mme Arlette Grosskost : La SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, détenait le mandat de vente. Pouvez-vous nous rappeler son passif concernant Adidas et le groupe Tapie en général ? Il était évident qu’elle allait recouvrer beaucoup plus facilement un actif net en vendant ses titres au lieu de récupérer le nantissement.
M. François Bayrou : Monsieur Peyrelevade, je voudrais vous interroger – je ne l’ai jamais fait lors de nos nombreuses conversations privées sur le sujet – à propos de la nature du mandat confié par le Groupe Bernard Tapie à SDBO. Deux éléments m’ont frappé. Premièrement, la somme est fixée à l’indicatif : « Le prix sera de 2,85 milliards. » Le Groupe Bernard Tapie n’a aucune latitude ni quant au choix de l’acheteur, ni quant à la date de la vente, qui devra être réalisée avant le 15 février ; cela ressemble furieusement à une obligation de vente plutôt qu’à un mandat.
M. François Goulard : À l’époque des faits, il se trouve que j’étais banquier commercial. Je me souviens que la SDBO avait une réputation épouvantable : elle prêtait à n’importe qui, dans n’importe quelles conditions, mettant en danger sa maison mère. Compte tenu des garanties détenues par la SDBO, notamment le nantissement des titres, il me semble qu’un banquier commercial aurait dû depuis longtemps résilier tous les encours du groupe Tapie. Corroborez-vous mon avis ?
M. Jean Peyrelevade : Tout à fait. D’après la théorie officielle de la SDBO – Michel Gallot l’a répétée devant la commission d’enquête de 1994 –, l’affaire Adidas était superbe et les plus-values à venir permettraient d’effacer complètement les pertes et crédits douteux sur le reste du groupe Tapie. Mais les choses se sont passées différemment car ses autres affaires industrielles se sont avérées invendables. De surcroît, les plus-values qui devaient être affectées à la remise à niveau ont été absorbées par le gouffre des pertes, qui n’arrêtaient pas de se creuser. Au final, M. Tapie a seulement gagné six mois. Mais je rejoins M. Goulard : plus tôt l’on aurait arrêté, mieux l’on se serait porté.
Cette affaire est effectivement l’habillage en mandat de vente d’une sorte de vente forcée, nantissement qu’on n’ose pas appeler par son nom, au bénéfice de M. Tapie, qui récupère une plus-value au passage.
M. le président Didier Migaud : Souhaitez-vous apporter d’autres précisions, monsieur Peyrelevade ?
M. Jean Peyrelevade : Non. J’ai eu la satisfaction de pouvoir enfin m’expliquer.
——fpfp——
Mercredi 10 septembre 2008, séance de 15 heures (compte rendu n° 117) :
– Audition, ouverte à la presse, de M. Bernard Tapie, ancien président du groupe Tapie, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de M. Bernard Tapie, ancien président du groupe Tapie, sur les procédures liées aux contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Mes chers collègues, nous accueillons M. Bernard Tapie dans le cadre des auditions concernant les procédures et plus particulièrement la sentence arbitrale rendue récemment dans les conflits opposant le CDR et le groupe Tapie. Tous les documents nécessaires à la bonne compréhension du dossier ont pu être rendus publics, la clause de confidentialité ayant été levée à la fois par M. Tapie et par le CDR. Nous disposons donc de toutes les informations, en particulier du compromis d’arbitrage et de la sentence arbitrale pour nourrir les questions.
M. Bernard Tapie va s’exprimer en premier, comme il le souhaite, avant que nous ne passions aux questions des uns et des autres.
M. Bernard Tapie : Monsieur le président, je n’ai rien préparé dans la mesure où je souhaite répondre à toutes les questions que votre assemblée veut me poser. Selon une certaine logique, les questions relatives à l’arbitrage doivent venir en premier, parce qu’il me semble que c’est tout de même l’objet principal de cette audition : tout ce qui a conduit à l’arbitrage ; est-ce que c’était juste ou non ? La sentence était-elle fondée ou non ? Fallait-il faire appel ou non ? J’ai entendu très peu de chose parce que je ne voulais pas me laisser influencer. Par ailleurs, le CDR et le Crédit Lyonnais étant du même côté, je ne pouvais que continuer à entendre ce que j’entends depuis quinze ans. Il n’y avait aucune surprise à en attendre. Deuxièmement, si vous le voulez, on parlera d’Adidas depuis l’origine de la prise de contrôle jusqu’à sa vente. Troisièmement, puisque j’ai vu que le vice-président du MoDem avait refait le procès ce matin, on va refaire le procès ! Je suis d’accord, même s’il a déjà été fait plusieurs fois. Quatrièmement, je répondrai à tout ce à quoi je n’aurais pas encore répondu.
M. François Goulard : Monsieur le président, il est relativement inhabituel que la personne que nous entendons fixe l’ordre des questions.
M. Bernard Tapie : J’ai fait des propositions.
Le Président Didier Migaud : Vous n’avez pas besoin de faire cette observation, je suis capable de réagir.
Si j’ai bien compris, M. Tapie se propose de passer le temps nécessaire pour répondre à l’ensemble de vos questions, quel qu’en soit l’ordre. Cela étant, on peut concevoir que, pour aller jusqu’au bout d’une question, comme nous l’avons fait ce matin, l’on essaye d’épuiser un sujet avant de passer à un autre. Il ne m’apparaît pas illogique que l’on puisse parler de l’arbitrage, du dossier Adidas et du reste, mais on peut faire l’inverse si vous le souhaitez.
Comme nous l’avons fait à chacune des auditions, nous allons demander à M. de Courson, qui est libre dans ses questions, de commencer à vous interroger.
M. François Bayrou : Une phrase seulement. M. Tapie vient de dire que Jean Peyrelevade était vice-président du MoDem, ce qui est exact. Il n’a pas été entendu à ce titre, de même que Bernard Tapie n’est pas entendu en tant que vice-président des Radicaux de gauche, ce qu’il a été pendant suffisamment longtemps. Les personnes ont été entendues, et le seront, au titre de leur responsabilité de chef d’entreprise.
M. Bernard Tapie : Je ne pensais pas que cette précision était vexatoire. C’était flatteur, au contraire !
Le Président Didier Migaud : Il est utile de rappeler que nous sommes réunis en commission des Finances de l’Assemblée nationale, qui n’est pas une juridiction, ni un tribunal, ni, a fortiori, un cirque, un ring de boxe ou de catch ! Je souhaite que, jusqu’au bout, nous le démontrions, à travers nos questions et vos réponses. Je rappelle que cette séance est télévisée comme toutes les autres et que nous travaillons sous le regard de l’opinion. Chacun doit en avoir conscience.
M. Charles de Courson : J’ai neuf questions à poser.
Première question : Monsieur Bernard Tapie, alors que vous aviez acquis 78 % d’Adidas en juillet 1990, vous avez entrepris dès le mois d’août 1991 de revendre cette participation à hauteur de 20 % à la société britannique Pentland, laquelle était prête, en 1992, à racheter le reste de vos titres, mais y a finalement renoncé en octobre 1992 en raison, semble-t-il, d’un audit défavorable. Avez-vous eu connaissance de ce rapport ? Et quelle est votre interprétation du renoncement de Pentland à poursuivre l’opération de rachat ?
M. Bernard Tapie : Bien entendu, je suis au courant de l’expertise Pentland, d’autant plus qu’elle m’a été communiquée à l’époque où elle a été faite. Elle était d’ailleurs suffisamment bonne pour que Robert Louis-Dreyfus, à un moment où à un autre des procédures, explique que ce qui l’a décidé, c’est l’expertise qui avait été faite par Pentland.
Pourquoi Pentland n’a-t-elle pas donné suite ? Pentland était la propriété d’un homme qui venait de vendre pour 7 milliards de francs les 70 % du capital de Reebok qu’il détenait. Mais il était surtout propriétaire de toutes les unités de sourcing – des usines de fabrication – de Reebok. Son intention – on ne l’a su qu’après la prise d’option – était en fait de prendre Adidas pour pouvoir garantir le travail de ses sociétés qui fabriquaient les chaussures Reebok en Chine car, en vendant Reebok, il avait perdu la certitude de ses débouchés. Le conseil d’administration d’Adidas, comme la loi allemande l’y obligeait, a soumis le projet aux syndicats. Ils se sont totalement opposés à ce que l’actionnaire principal soit en même temps le sourcer, c’est-à-dire celui qui allait fabriquer les chaussures pour le compte de la société mère.
Le deuxième paramètre, c’est qu’entre-temps les variations de change lui ont été extrêmement favorables et, en moins d’un an, l’acheteur potentiel a fait pratiquement 300 millions de francs de plus-value en récupérant sa mise. C’est la seule raison pour laquelle Pentland n’a pas donné suite. En plus, cela se situe un an avant la cession des actions Adidas par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais.
M. Charles de Courson : Pendant la période allant de juillet 1990 à la fin de 1992, alors que vous avez été nommé ministre dès le mois d’avril de cette année-là, pourriez-vous préciser à la Commission qui gérait la société Adidas, puisque, ce matin, M. Peyrelevade nous a indiqué que la société Adidas était en très grande difficulté sur la période 1992-1993 ? Et quelles ont été les mesures de redressement qui ont été mises en œuvre – par vous ou par d’autres – pendant cette période ?
M. Bernard Tapie : Pardonnez-moi d’être un peu long, mais je vais être obligé de refaire l’histoire d’Adidas à partir du moment où j’en prends le contrôle.
Adidas, c’est 20 milliards de francs de chiffre d’affaires, pratiquement celui de Nike, qui fait entre 1,5 milliard et 2 milliards de bénéfice, tandis qu’Adidas perd entre 1,5 milliard et 2 milliards. Adidas fait son chiffre d’affaires avec 11 000 employés, dont 9 500 en Europe, Nike avec 7 000 employés, dont 6 500 en Asie du Sud-Est.
Sur le plan du marketing pur, le marché est le suivant : 30 % de croissance sur le sportswear, 5 % sur le sport. Adidas fait 75 % de son chiffre d’affaires dans le sport, le reste dans le sportswear ; Nike, c’est l’inverse. Inutile de vous dire qu’à la limite, c’est un des redressements les plus faciles à opérer, à condition de mettre en œuvre trois principes : un, repositionner la marque sur le plan marketing, ce que je fais en débauchant le patron du marketing de Nike, M. Strasser ; deux, je forme un état-major digne de cette maison en débauchant d’Airbus M. Friderichs, qui était l’ancien ministre des Finances allemand, et Mme Gilberte Beaux, qui travaillait avec M. Goldsmith, le premier devenant président du directoire, la seconde présidente du conseil de surveillance ; trois, malheureusement, on procède à une délocalisation. Quand on prend le contrôle d’une affaire qui travaille dans le textile, les temps de réponse se situent entre trois et quatre ans, tous ceux qui ont fait un peu d’industrie le savent. Et c’est sept ans dans l’automobile. La prise de contrôle date de mi-1990 ; les premiers effets bénéfiques des transformations et mesures qui sont prises ne se ressentiront qu’à partir de 1993. Les premières années, au contraire, les charges liées à la restructuration coûtent très cher, notamment le licenciement de près de 4 000 personnes. Le bilan d’Adidas ne deviendra conforme à ce qu’on attendait qu’à partir de 1993, et l’exercice 1994 dégage déjà un bénéfice de 500 millions de deutsche marks.
La question a d’ailleurs été posée à tous moments de la procédure. Je vous lis la synthèse faite dans la sentence arbitrale : « Il résulte en effet des différents témoignages et pièces comptables versées au débat que l’ensemble des mesures prises de 1990 à 1992 a produit ses effets à partir de 1994. […] La présentation des comptes… est tendancieuse car elle met l’accent sur le bilan et le résultat de 1991 et 1992. » Évidemment, quand on fait le bilan l’année qui suit les restructurations, ce n’est pas brillant ! « Aussi est-ce à juste titre que les liquidateurs invoquent le coût de ces restructurations […] Quant aux baisses du chiffre d’affaires,… » Vous verrez dans tous les témoignages – tous – que le redressement a été opéré « aux trois quarts », selon l’expression de M. Galbois, directeur financier d’Adidas mis en place par le Crédit Lyonnais. Ce n’est pas moi qui l’ai engagé ! Il déclare : « …le redressement était assuré aux trois quarts, un quart seulement était dû au nouveau management, comme la mise aux normes comptables internationales nécessaires à l’introduction en bourse. » Autrement dit, toutes les structures qui ont été mises en place l’ont été par Gilberte Beaux, Bob Strasser, et par M. Friderichs.
M. François Goulard : Vous dites que le redressement lancé était quasiment garanti. Manifestement, ce n’était pas l’opinion du banquier, qui s’est inquiété fin 1992. Ce n’était pas non plus l’opinion des acheteurs éventuels puisque, d’après nos informations, alors même que les mesures de restructuration avaient été décidées et le management changé, ils ne se précipitent pas pour acheter une entreprise qui est si bien partie. Il y a sur la place de Paris des gens qui ne sont pas totalement idiots et qui sont capables, quand ils voient qu’une entreprise a pris des mesures de redressement tout à fait décisives, d’anticiper d’un an ou un an et demi. Comment expliquez-vous le décalage entre la présentation que vous faites et la réalité des appréciations des banquiers, qui, à cette époque-là, ne se précipitent pas pour vous prêter, et de la Commission bancaire qui demande au Crédit Lyonnais et à la SDBO de constituer des provisions sur les crédits qui vous sont consentis ? Pourquoi ne trouve-t-on pas pléthore d’acheteurs à un prix somme toute très raisonnable, d’après vos déclarations ?
M. Jérôme Cahuzac : Votre appréciation, monsieur Tapie, tranche un peu avec ce qu’on a entendu jusqu’à présent. Ce matin en particulier, il nous a été dit que les concours des banques allemandes, qui contribuaient au bon fonctionnement d’Adidas et en assuraient la trésorerie, n’acceptent de continuer qu’à la condition que le management soit changé, ce qui me semble contradictoire avec ce qui vient d’être indiqué. Si le nouveau management avait mis l’entreprise sur de bons rails, pourquoi les banques créancières de votre société exigeaient-elles le changement du management ?
M. Bernard Tapie : J’en viens à ce par quoi je voulais terminer. Vous êtes en train d’utiliser les déclarations de M. Peyrelevade pour contester ce que je dis. Mais ça va être comme ça tout le long ! C’est comme ça depuis 1996. Il va de soi qu’à partir du jour où il y a eu contestation entre le Crédit Lyonnais et moi, deux versions se sont opposées. Elles sont simples.
M. François Goulard : La Commission bancaire, ce n’est pas M. Peyrelevade.
Le Président Didier Migaud : Vous ne pouvez pas poser des questions à M. Tapie sans prendre le temps d’écouter ses réponses !
M. Bernard Tapie : Vous assénez des certitudes sous prétexte qu’elles ont été dites par M. Peyrelevade. Que ce soit sur le portage, sur les comptes, la cession d’Adidas, l’absence d’acheteurs, la situation de faillite, le fait qu’Adidas ne valait plus rien, il dit la même chose depuis 1996. C’est ce qui a été dit devant le tribunal de commerce, et ils ont perdu ; devant la cour d’appel, et ils ont perdu ; devant les arbitres, et ils ont perdu. Je veux bien que le seul qui dise la vérité dans ce dossier, ce soit M. Peyrelevade, sauf que tous les magistrats qui ont eu à étudier le dossier – non pas des déclarations, mais des éléments tangibles, prouvés – lui ont donné tort. Voilà ! Moi, je prétends le contraire. Les banques allemandes n’ont jamais dit qu’elles allaient retirer leurs concours si le management n’était pas changé. C’est totalement faux. La banque allemande a exigé soit que l’on vende des filiales, soit que l’on recapitalise. C’est la première voie que nous avons choisie : on a vendu Arena et Le Coq Sportif. Et les banques allemandes ont été satisfaites de la décision qui a été prise. Personne ne s’en est plaint !
L’un de vous a dit que les acheteurs ne se précipitaient pas. On se moque du monde ! Le mandat de vente est donné en décembre 1992, et M. Louis-Dreyfus est trouvé en janvier 1993. On a mis un mois pour solliciter tout Paris et constater que personne ne voulait d’Adidas ! M. Louis-Dreyfus a fait savoir qu’il était intéressé par Adidas depuis septembre. Il l’a dit et il n’a jamais menti. Depuis septembre, des conversations entre ses avocats, ses conseils et les gens de Clinvest – ce n’est ni SDBO, ni le Crédit Lyonnais qui a fait l’opération – étaient en cours et ils ont accepté. Ils ont fait signer le mémorandum qui faisait office de mandat de vente un mois avant…
M. François Goulard : Le mandat de vente, ce n’est pas le mémorandum.
M. Bernard Tapie : Si, si ! Lisez-le. On va prendre le temps qu’il faut. Il est évident qu’aucun des acheteurs potentiels réels – ils sont connus, ils ont fait des déclarations dans les journaux – n’a été approché : Nike a demandé à être reçu, il ne l’a pas été ; Reebok aussi, il ne l’a pas été non plus ; mieux, le directeur général adjoint, M. Iagui, avait fait une proposition en association avec M. Jacobs, le patron des chocolats Suchard, et il n’a pas été reçu. Il est donc totalement faux de dire que personne ne voulait d’Adidas. Après coup, lorsqu’il a bien fallu expliquer toute la gymnastique du portage, de la fausse vente, de la fausse option, etc., il va de soi que les avocats du CDR, qui sont brillants – l’un des meilleurs tandems de Paris –, n’allaient pas dire devant le tribunal de commerce qu’on m’avait fait une entourloupe, qu’on avait profité d’une option que j’avais donnée pour effectuer une vente à soi-même, par l’intermédiaire de sociétés off shore, et prendre son bénéfice ailleurs.
Ils ont joué sur deux points majeurs. L’un avait une réelle consistance en droit et soulevait une réelle interrogation, c’est celui de la recevabilité de la plainte. Tant qu’il n’était pas tranché, aucun des deux camps n’était tranquille. Le second, qui avait son importance aussi, c’était de présenter la mariée dans le pire état possible, pour que, au cas où la plainte serait recevable, l’indemnité soit en rapport.
J’espère que vous êtes conscients que tout ce qu’on raconte n’a aucune incidence sur le portage. Si toute la théorie du Lyonnais développée par M. Aubert et répétée par M. Peyrelevade était vraie, consultez tous les avocats que vous voulez, cela ne change rien. On ne les a pas attaqués pour avoir diffamé ou parce que j’étais mis en faillite. On les a attaqués parce qu’ils avaient un mandat qu’ils n’ont pas respecté, et parce qu’ils avaient été contrepartie, c’est-à-dire pour avoir pris un profit sur une vente qu’ils étaient chargés d’assurer. Le reste, c’est bien pour la presse, mais ça n’a strictement aucun intérêt. Cela ne change rien au fond, en droit. Je veux bien qu’on en parle, si vous pensez avoir une chance d’être bien meilleurs que tous les magistrats qui se sont penchés sur le sujet, en ayant écouté contradictoirement la parole des uns et des autres – les professionnels, ceux du parquet et ceux du siège. Je veux bien que vous vous substituiez à eux parce que M. Peyrelevade a déclaré ceci ou cela. Mais soyons sérieux ! Un procès, ce n’est pas une déclaration faite un matin devant une Commission. Il faut des preuves, des analyses, des expertises, des contre-expertises, un débat contradictoire, des plaidoiries avant de rendre un jugement. Un tribunal, ce n’est pas qu’un échange de points de vue. Pensez-vous un instant que ce que M. Peyrelevade a dit ce matin, et M. Aubert la semaine dernière, n’a pas été dit par les avocats du Lyonnais ? Si quelque chose a été occulté, vous devez évidemment le relever car cela voudrait dire que, peut-être, il y a encore des choses à faire. La justice doit trancher à condition que tout soit sur la table. Mais pas d’après des bavardages. Il faut des preuves, des éléments concrets !
M. Charles de Courson : Troisième question : le 12 décembre 1992, vous avez, monsieur Tapie, signé un mémorandum confiant à la SDBO la vente, au plus tard le 15 février 1993, de la société Adidas pour 317 millions d’euros, soit 2,085 milliards de francs. Ce délai de deux mois est extrêmement bref. Pourquoi une telle précipitation ? M. Peyrelevade nous a indiqué ce matin qu’il s’agissait d’une quasi-vente forcée du fait de la situation financière extrêmement dégradée de vos affaires.
M. Bernard Tapie : On en revient à ce que je viens de dire. J’ai quitté mon groupe sur la recommandation expresse de mon Premier ministre, qui considérait qu’il était incompatible d’être à la tête d’une affaire industrielle et ministre. J’ai eu la vanité de croire à l’époque que c’était bien plus important pour ma vie, pour mon avenir et celui de mes concitoyens, d’être ministre que de rester industriel ; et j’ai franchi le pas. De ce fait, il a fallu régler le problème de la propriété de mes actions dans l’industrie. Un mémorandum a donc été signé, pas seulement avec la SDBO et le Lyonnais, mais aussi avec mes deux actionnaires principaux qui étaient les AGF et le Crédit Lyonnais. On a décidé de transformer l’ensemble de mes actifs industriels en actifs patrimoniaux. À l’époque, BT Finance est en bourse. Quand je quitte BT Finance, sa capitalisation boursière est de 600 millions ou 700 millions de francs. Deux actifs ne sont pas cotés : Adidas et les actions de TF1, que j’ai achetées 100 millions de francs et qui, l’année qui suit ma mise en liquidation, valaient en gros 3 milliards de francs. C’est vous dire à quel point on aurait été en faillite si j’étais resté à la tête de mes affaires. Rien qu’Adidas et TF1 m’auraient largement permis de rembourser le solde des crédits de la banque, qui était de 600 millions de francs en tout.
Il est temps que l’Assemblée nationale sache comment j’ai été mis en liquidation de biens. Ça va l’éclairer sur la situation difficile que l’on me prête. L’épisode des meubles, c’est un scandale de l’avoir raconté comme ce matin. C’est totalement faux ! Il était prévu qu’on devait confirmer l’expertise de la valeur des meubles. L’échéance tombait le 24 mars. Vous savez tous, sans être avocat, que ce qui se jouait conditionnait la survie du groupe. Le 24 mars, la production de la confirmation de la valeur n’est pas fournie. Le 25, tout est lancé : le passif est rendu exigible. Le 25 après-midi, on reçoit la confirmation des valeurs, c’est-à-dire que l’expertise arrive au siège du Lyonnais à ce moment-là. On était en retard de cinq heures ! Vous voyez ce que c’est que la brutalité ! J’étais client depuis dix-sept ans. Dix-sept ans sans un incident ! Un client qui, parce qu’il est ministre, a cédé le contrôle de ses affaires dirigées par l’ancien adjoint de Mme Gilberte Beaux et qui devient président, après avoir été directeur général. Et il oublie, parce que cela n’est pas précisé, qui devait fournir la contre-expertise.
M. Charles de Courson : Vous n’avez pas répondu à ma question, monsieur Tapie.
Vous avez signé ce mémorandum le 12 décembre 1992.
M. Bernard Tapie : Bien sûr !
M. Charles de Courson : Si votre analyse est exacte, selon laquelle vos affaires étaient florissantes dans deux de leurs composantes qui vous permettaient de rembourser toutes les dettes de toutes vos autres activités, pourquoi avez-vous signé ? Et dans un délai aussi bref : deux mois ? Pourquoi ne pas avoir vendu vous-même, comme vous aviez essayé de le faire avec Pentland, puisqu’il y avait pléthore de candidats ?
M. Bernard Tapie : J’ai pris un engagement absolu, solennel et irrévocable de ne plus avoir aucune activité, ni aucune intervention au sein de mon groupe, ni dans les sociétés de mon groupe. L’épisode Pentland se passe quand j’étais dans les affaires.
Le mémorandum dont vous me parlez, n’importe quel juriste le voit, c’est exactement la transformation par un banquier du patrimoine industriel de son client en patrimoine non industriel. Il est tellement peu industriel qu’on précise de monter ensemble une société à capital-risque avec la plus-value qui sera faite. Bien sûr, j’étais d’accord sur le prix puisque c’est celui qui figure dans le mandat de vente. Mais il faut lire les accessoires. Nous allons vous remettre, monsieur de Courson, une note contradictoire avec votre rapport qui est tout à fait conforme à la réalité, à quelques omissions près. On complétera. Il faudra que vous fassiez part à toute l’Assemblée des contreparties de l’abandon de cette plus-value. Autrement dit, si, effectivement, on est à l’agonie et qu’on donne 2 milliards, vous pensez bien que la banque en reste là. Ce n’est pas ce qui s’est passé. Elle dit : « Vous recevrez une rente de 600 000 francs par mois pendant une vingtaine d’années. Vous allez avoir 50 % d’une société de capital-risque qui est entièrement financée par nous. » Autrement dit, pour quelqu’un qui est à l’agonie, et qu’on sauve des eaux, on fait une rente annuelle, on fait cadeau de 50 % des actions d’une société de capital-risque. C.Q.F.D. Franchement, en le lisant, ce mémorandum, on se rend compte qu’il organise la séparation entre une banque et son client qui change de métier. Ce n’est pas du tout un couperet placé sur le cou d’un type à l’agonie.
M. Charles de Courson : Vous ne répondez toujours pas à ma question.
M. Bernard Tapie : Si, je vous ai répondu.
M. Charles de Courson : Pourquoi signez-vous ce mandat ?
M. Bernard Tapie : Le mémorandum n’arrive pas au moment de Pentland. Qu’est-ce que vous racontez ?
M. Charles de Courson : Nous en sommes au 12 décembre 1992, jour où vous signez un mémorandum avec le Crédit Lyonnais que vous chargez de vendre…
M. Bernard Tapie : …toutes les sociétés.
M. Charles de Courson : …votre participation dans Adidas à un prix de 2,085 milliards de francs,…
M. Bernard Tapie : …au moins !
M. Charles de Courson : …c’est-à-dire le prix auquel vous aviez passé un pré-accord avec Pentland, qui ne s’est pas réalisé.
M. Bernard Tapie : Non, non, non !
M. Charles de Courson : Mais si, puisque, à la suite de l’audit, Pentland a renoncé.
M. Bernard Tapie : La base de l’accord Pentland, c’était 3 milliards ; le mémorandum, c’était 75 % égalent 2 milliards.
M. Charles de Courson : Vous avez signé ce mémorandum. Et je n’arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi ne vous occupez-vous pas vous-même, comme pour Pentland, de la vente de votre participation dans Adidas ?
M. Bernard Tapie : Je ne me suis pas plus occupé de la vente à Pentland ! Je n’avais aucune raison de m’en occuper.
M. Charles de Courson : Ce sont vos affaires !
M. Bernard Tapie : Si je l’avais fait, en même temps que j’étais ministre, vous auriez dit : « Mais, comment ? Quel est ce mélange des genres ? » Le Crédit Lyonnais était dans son rôle puisqu’il était mandataire. Ce qui serait intéressant, c’est qu’on vous le donne, ce mémorandum ! Comme ça, vous verrez ce qu’il y a dedans.
Le Président Didier Migaud : On va le distribuer.
M. Bernard Tapie : Le mandat n’était pas seulement limité à Adidas, il concernait toutes les sociétés du groupe.
M. Patrick Lemasle : Vous étiez ministre à l’époque.
M. Bernard Tapie : Mais je ne peux plus parler…
Le Président Didier Migaud : Restons calmes. Certains de nos collègues font remarquer que vous étiez ministre à l’époque.
M. François Goulard : Rassurez-vous, monsieur Tapie, nous essayons seulement de comprendre un dossier complexe. Nous ne faisons pas le travail de la justice. On a lu certains documents, on essaie de s’y retrouver et de savoir si l’État a bien fait d’engager un arbitrage et si les résultats de cet arbitrage sont plutôt protecteurs des intérêts des contribuables. C’est notre travail. La commission des Finances se préoccupe des intérêts de l’État et des contribuables.
M. Bernard Tapie : On en est loin, là !
M. François Goulard : Sans doute, mais il est nécessaire de tout expliquer pour comprendre.
M. Bernard Tapie : Oui, oui…
M. François Goulard : Vous êtes d’accord ?
M. Bernard Tapie : Tout à fait.
M. François Goulard : J’en reviens à la question de Charles de Courson. Vous êtes un homme d’affaires avisé, personne ne peut dire le contraire.
M. Bernard Tapie : Il paraît.
M. François Goulard : Vous n’êtes ni naïf, ni débutant. Vous êtes d’accord pour dire que ce mandat de vente est inhabituel…
M. Bernard Tapie : Ah, non !
M. François Goulard : Mais si. Premièrement, il était inhabituel dans la durée du mandat : deux mois y compris la trêve des confiseurs, c’est extrêmement court. Deuxièmement, vous vous engagez à accepter l’acheteur qui est présenté par la SDBO. Là, je n’arrive pas à comprendre. Quelqu’un d’avisé demanderait à vérifier si c’est dans son intérêt, si le prix proposé lui convient, et les conditions car il n’y a pas que le prix. Pourquoi avoir accepté si vous étiez complètement libre de vos mouvements, s’il n’y avait pas le problème du remboursement des prêts à la SDBO ? Pourquoi un mandat de cette nature, qui ne correspond pas du tout à un mandat classique en pareille matière, et qui était, vu d’aujourd’hui, plutôt contraire à vos intérêts dans la mesure où il valorisait Adidas à 2,08 milliards, contre 3 milliards ?
M. Jérôme Cahuzac : La question de Charles de Courson est importante. Si vos affaires sont florissantes, et si Adidas est une entreprise intéressante pour tout investisseur, comment se fait-il que vous n’ayez pas conclu avec ceux qui se sont présentés ? Votre réponse a été, sans la caricaturer, que, à l’époque, vous étiez en train de changer de métier et que, en tant que ministre, vous ne deviez pas vous en occuper vous-même. C’est une réponse plutôt convaincante car il est difficile de faire plusieurs choses à la fois.
Dans ces conditions, pouvez-vous nous indiquer quand vous avez vendu vous-même votre participation dans TF1 ? Vous en souvenez-vous ?
M. Bernard Tapie : Je vais être précis. C’était en 1991, avant d’être ministre. Et le mémorandum a été conclu après ma nomination en tant que ministre. Et c’est à cause de ça qu’il a vu le jour.
Que les choses soient très claires : si je ne suis pas ministre, Adidas est toujours ma propriété et il vaut 40 milliards de francs. J’aurais vraisemblablement été un peu frustré de ne pas avoir été ministre, mais beaucoup plus heureux dans la vie !
M. Charles de Courson : Vous avez été nommé ministre, une première fois, par un décret d’avril 1992 et le mémorandum a été signé le 12 décembre 1992. Vous aviez déjà été ministre.
M. Bernard Tapie : Je n’ai pas fait le mémorandum avant. Ça va de soi.
M. Charles de Courson : Vous venez de dire l’inverse.
M. Bernard Tapie : Je ne veux pas qu’il y ait d’ombre. Reprenons l’ordre chronologique. On me propose d’être ministre. Je réunis M. Albert et M. Haberer – c’est facile de vérifier, ils sont vivants tous les deux – qui sont chacun président d’une société importante, l’UAP et le Crédit Lyonnais, chacun administrateur de BT Finance et je ne donne pas ma réponse sans les avoir consultés. Je leur ai demandé si c’était une lâcheté de ma part d’accepter et de laisser mon groupe entre les mains d’un président désigné. J’ai commis une faute car, évidemment, quand vous vous adressez à des patrons d’une entreprise nationalisée, ça les intéresse d’avoir un ministre dans leurs relations. Je crois ne pas avoir posé la bonne question. Bref, ils m’ont conseillé d’accepter et je leur ai demandé quoi faire. On a alors décidé avec M. Haberer, et les services de Clinvest, de faire un mémorandum de séparation et d’opérer la conversion dont je vous ai parlé. Quand a-t-on signé le document ? Quand il peut prendre effet sur le principal, qui porte sur trois choses – vous allez retrouver l’origine du découvert de la banque qui n’a rien à voir avec ce qu’on vous a raconté : premièrement, sortir BTF de la bourse – ce dont je n’ai rien à faire – et le financement est assuré ; deuxièmement, obtenir 100 % des actions Adidas, les enfants Dassler en détenant encore 5 % avec les minoritaires de BT Finance, et l’essentiel de la dette due à la SDBO, soit 600 millions de francs, qui, je vous le rappelle, est loin des milliards qui ont été provisionnés le jour du dépôt de bilan, représente la sortie de la bourse et une partie du rachat aux minoritaires. Cette dette est née de cette action-là et c’était obligatoire pour que le mémorandum prenne effet. Vous n’avez qu’à lire.
M. Charles de Courson : Quatrième question : la SDBO, ou le groupe Crédit Lyonnais, vous a-t-elle, au cours des mois de janvier et février 1993, tenu informé, par oral ou par écrit, des recherches ou des éventuelles négociations qu’elle menait pour trouver un acquéreur ? De votre côté, l’avez-vous interrogée quant à l’état d’avancement de ses recherches ? Ignoriez-vous les modalités de l’opération qui avait été conclue avec Robert Louis-Dreyfus, alors même que la presse en faisait état, notamment dans un article publié dans le Nouvel Observateur le 18 février 1993, c’est-à-dire encore dans la période de deux mois ?
M. Bernard Tapie : On est juste après. L’avez-vous, cet article ?
M. Charles de Courson : Certainement.
M. Bernard Tapie : Pourriez-vous le lire pour m’expliquer en quoi j’étais au courant de l’opération de Louis-Dreyfus ?
M. Charles de Courson : On est à l’intérieur du délai. Le mémorandum donnait deux mois. L’article, intitulé « Adidas, sortie sur mesure pour Tapie – Comment le Crédit Lyonnais et les AGF ont pris tous les risques au profit de Robert Louis-Dreyfus et des frères Saatchi » est signé de Thierry Philippon : « Le nouveau président et ses amis, eux, ont obtenu une faveur. Robert Louis-Dreyfus nous a confirmé lundi qu’ils avaient une option d’achat sur les titres détenus par les sociétés publiques à un prix supérieur de 30 % au prix actuel durant les deux prochaines années. S’ils redressent l’affaire, lui et ses associés achèteront les actions Adidas possédées par les nationalisées françaises à un prix supérieur au prix actuel, avec une jolie plus-value en perspective. Et si cela tourne mal ? Les entreprises publiques conserveront leurs actions. Bref, en cas réussite, l’essentiel de la plus-value sera pour les investisseurs privés ; en cas d’échec, les trois sociétés publiques en supporteront les conséquences. » En lisant cela dans la presse, ne vous êtes-vous pas inquiété ?
M. Bernard Tapie : Ou je ne comprends plus le français, et il va falloir que je retourne à l’école, ou alors, si cet article veut dire qu’on a vendu à des sociétés off shore avec une promesse de vente...
M. Charles de Courson : Non.
M. Bernard Tapie : Vous me dites que j’étais au courant. Cet article ne m’a pas choqué. Si un seul député ici présent comprend, à la lecture de cet article, que la totalité du capital d’Adidas a été capté par des sociétés off shore domiciliées aux îles Caïman et qu’elles ont consenti une option d’achat à Robert Louis-Dreyfus à 4,4 milliards, alors, effectivement, j’étais au courant ! Mais je vous retourne votre question. Quand on me sort un papier pareil pour prouver que j’étais au courant, c’est qu’on est à poil, monsieur le député ! L’article du Nouvel Obs dit seulement que M. Louis-Dreyfus a eu une option sur 34 % du capital et qu’il fera d’ailleurs une jolie plus-value. On se moque du monde ! Il aurait mieux valu ne pas le produire ! On peut gloser des années, mais dites-vous bien que les gens qui ont eu à juger cette affaire sont compétents et sans a priori. Et c’est avec des arguments comme ceux-là qu’ils ont fini par se lasser. On me dit que j’étais au courant. Je me demande comment c’était possible. Un peu de bon sens ! Si cette affaire s’était passée comme vous le dites, cela veut dire qu’il y aurait eu au milieu une banque, très intelligente…
M. Charles de Courson : Je vous ai posé une question, monsieur Tapie, et j’attends votre réponse. Étiez-vous informé, ou pas ? Par la presse, ou tout autre moyen.
M. Bernard Tapie : Je vais vous prouver que ce ne pouvait pas être le cas. Il y a au milieu une banque, honnête et intelligente ; et, de chaque côté, il y a deux imbéciles. Le premier imbécile, c’est moi. La banque me dit : « On va vous acheter 2 milliards et, je vous préviens, on donne une option à M. Louis-Dreyfus à 4,4 milliards. » Et je lui réponds : « Bon, eh bien, OK, gardez la différence ! » Je suis vraiment un type à psychanalyser d’urgence. Vous qui me prêtiez tout à l’heure des qualités de bon sens… Il vous semblera peut-être que j’aurais demandé, en cas de levée de l’option, qu’il faudrait m’en rajouter un petit bout. Eh bien, non, je ne dis rien ! Quant à Robert Louis-Dreyfus, c’est encore pire ! Lui, on lui dit : « Voilà, on vous vend une merde 2 milliards, mais si vous êtes bon et que vous la redressez, on vous la vendra 4,4 milliards ! » Et lui de répondre : « C’est une bonne idée. » On se moque du monde ! Il n’y a pas d’un côté deux imbéciles et, au milieu, une banque fabuleuse ! J’ai répondu à votre question.
M. Charles de Courson : Une question complémentaire : vous paraît-il anormal que des prêts à recours limité qui ont été faits par le Crédit Lyonnais au tour de table réuni aient été consentis aux nouveaux acquéreurs d’Adidas ?
M. Bernard Tapie : Oui, sauf si c’est à 0,5 %. Il y a deux solutions : ou bien ce qu’a dit M. Peyrelevade est vrai, et à ce moment-là, vous devez immédiatement déposer plainte pour abus de biens sociaux. Qu’est-ce que c’est que ce président de banque nationalisée qui prête à 0,5 % à des sociétés domiciliées aux îles Caïman qu’il ne connaît pas, et qui accepte de supporter la perte éventuelle et de laisser 30 % en cas de gain ? Je me demande comment vous avez pu ne pas vous saisir de cette question.
M. Charles de Courson : Il s’agit non pas de M. Peyrelevade, mais de M. Haberer.
M. Bernard Tapie : J’ai bien entendu. Mais laissez-moi vous dire qu’entre les principes élaborés et le débouclage effectif, M. Peyrelevade a pris le relais.
M. Charles de Courson : M. Peyrelevade a pris ses fonctions en novembre 1993.
M. Bernard Tapie : Il n’était pas obligé de suivre.
M. Charles de Courson : C’est sous la présidence de M. Haberer que cette opération a été montée. Elle a été dénouée sous le mandat de M. Peyrelevade. Ne peut-on pas dire, en inversant vos propos, que les grands gagnants étaient les actionnaires du tour de table qui se sont fait financer par une banque publique, laquelle prenait tous les risques en cas d’échec, et qui se seraient partagé les bénéfices en cas de succès ?
M. Bernard Tapie : Je suis obligé de tempérer ce que je viens de dire car, comme c’était fait à l’avance, évidemment, ils prenaient zéro risque. Ils n’auraient jamais accepté de financer à 0,5 % une chose dont ils savaient qu’elle ne valait rien du tout. Le risque aurait été bien trop grand. Par conséquent, ils ne prenaient aucun risque. Pour vous le prouver, il faut se poser une question qui est restée sous-jacente : s’agissait-il d’une option ou d’une vente ? L’option n’avait-elle pas pour objectif de dissimuler la vente ? Je n’apporterai pas de preuve de ma version, mais je peux apporter des preuves que la thèse qu’ils avancent ne tient pas.
Premièrement, Robert Louis-Dreyfus est associé à son ancien associé dans Saatchi & Saatchi. Ils ont pris l’engagement de faire moitié-moitié sur toutes leurs opérations, y compris celle-là. Trois mois après l’option, M. Louis-Dreyfus rachète à son associé britannique le bénéfice de l’option au prix final. L’option court toujours et il achète quand même la part de son associé au prix final avec un financement du Lyonnais.
Deuxièmement, s’ils ont financé des sociétés off shore qu’ils ne connaissent pas, on les défère devant le juge d’instruction pour abus de biens sociaux. Je ne peux pas leur faire l’injure de croire qu’ils ont pris un tel risque. Ils ont financé des sociétés derrière lesquelles ils sont. Tous les arguments que j’ai entendus pour dire qu’ils n’étaient pas en cause, y compris la lettre fournie ce matin du patron de la Citibank qui certifie ne pas connaître les sociétés…
M. Charles de Courson : Nous avons une lettre d’accompagnement, mais le document intéressant, c’est la lettre qui a été lue ce matin. Il y a deux fonds off shore concernés : Omega, pour 19,9 % des actions, et le fonds Coatbridge pour 15 %. Les deux banques qui les avaient montés ont écrit que c’étaient elles et leurs filiales qui étaient à l’origine de ces fonds et que le groupe Crédit Lyonnais n’avait rien à voir là-dedans. Quand vous dites que ces fonds off shore étaient pilotés par le Crédit Lyonnais et qu’il y a eu des retours, nous avons reçu ce matin la preuve du contraire.
M. Bernard Tapie : C’était une attestation.
M. Charles de Courson : Une attestation.
M. Bernard Tapie : Oui, c’est ça.
M. Charles de Courson : S’agissant de ces deux fonds – il n’y en a pas d’autre dans les actionnaires –,…
M. Bernard Tapie : Si, vous verrez. On va en parler.
M. Charles de Courson : …il n’y a pas eu de retour au Crédit Lyonnais, d’après les faits recensés.
Dernière question dans ce cadre : le Crédit Lyonnais disposait d’un nantissement des actions Adidas. N’avez-vous pas été étonné que, plutôt que de faire ce montage, il n’ait fait pas jouer ce nantissement ? Comment interprétez-vous cela ?
M. Bernard Tapie : Sur la première question, le fonds construit pas Citycorp est signé Henri Filho, directeur général de Clinvest. Tout ça, ce sont des notes confidentielles que l’on a grâce à Mme Joly ! Formidable. Elle a perquisitionné au siège du Lyonnais. Avant que tout ne brûle. Après, c’était plus difficile de retrouver les pièces. Parmi les pièces récupérées, on a la preuve que tout ce montage est bidon. À propos des fonds construits par Citicorp, M. Filho écrit à M. Haberer : « Ces fonds construits offrent un maximum de discrétion. Il n’y aura pas de lien capitalistique, rassurez-vous, avec le Crédit Lyonnais et AGF. Son financement sera assuré par l’émission d’obligations convertibles de City Star, à un taux symbolique qui seront souscrites par le Crédit Lyonnais et les AGF et dont le produit sera affecté, après au moins deux échelons de protection, à une entité portant les titres BTF Gmbh. Derrière, il y a la note : « part CL dans le fonds général, 92,5 % du fonds lui-même ».
Une parenthèse à propos de l’affaire Executive Life dans laquelle j’ai été cité comme témoin. Je suis allé à Washington de bonne foi, pensant qu’il n’y avait aucun problème. Ils avaient en fait monté un tribunal devant lequel je devais passer comme témoin. Les avocats savent qu’il faut prêter serment et quels sont les enjeux si on ne dit pas tout à fait la vérité. On m’a demandé d’abord de confirmer que City Star faisait partie des sociétés qui ont porté les actions Adidas. Je me suis demandé pourquoi on me posait cette question. On a su par l’avocat de la société Executive Life qu’il s’agissait en fait de la même société que celle qui avait porté les actions City Star. Dans les deux pays, le Crédit Lyonnais déclarait qu’il n’avait rien à voir avec City Star. Pourtant, elle a servi dans les deux cas. City Star était la société centrale, même si elle n’avait pas en tant que telle la majorité du capital.
Ensuite, M. Gille, directeur général du Lyonnais, dont M. Peyrelevade a fait, à juste titre, l’apologie ce matin, avertit, dans une note du 21 janvier 1993 adressée au président de Clinvest, M. Deraison – les documents vous seront remis – : « La participation de la banque dans le groupe Pinault est logée provisoirement dans une structure de portage de Citibank. Pour les États-Unis, c’est une preuve parmi d’autres que la banque a tenté de dissimuler des liens avec l’homme d’affaires. Ce portage n’a pas été déclaré aux autorités américaines. On risque gros. »
M. Charles de Courson : Je connais un peu le sujet Executive Life, mais cet argument ne vaut rien dans ce qui nous occupe parce qu’il concerne une tout autre affaire. On peut en parler puisqu’il y a eu une transaction aux États-Unis. C’est une dénonciation qui a tout révélé, mais je ne vois pas le lien avec l’affaire Adidas.
M. Bernard Tapie : Ils ont pourtant utilisé la même société de portage. Ce doit être un hasard !
M. Charles de Courson : Ce n’est pas parce qu’on a utilisé une société qui, dans une autre affaire, a fait un montage irrégulier, que, dans le cas précis, il l’était aussi. En termes juridiques, cela s’appelle de la confusion. Reprenons le premier argument.
M. Bernard Tapie : Soit. M. Pinault a été interrogé sur la fameuse City Star. Il a répondu : « Ce que le président de la banque, M. Deraison, m’a dit, c’est que City Star était une société qui appartenait au groupe Lyonnais. Il avait besoin de mon agrément pour transférer mes actions Clinvest à toute autre société. À cette occasion, il m’a expliqué que City Star était une société du même groupe que le Lyonnais. » C’est contraire à toutes les déclarations, à la lettre, à la note, à tout ce que vous voulez. Si ce n’était pas le cas, qui pourrait croire que le Lyonnais aurait financé à 0,5 % en ayant la totalité du bénéfice, sauf la commission de maquillage – puisque c’est bien de cela qu’il s’agit ? C’était évident pour tout le monde. En tout cas, cela n’a pas échappé à toutes les juridictions.
M. Charles de Courson : Alors, monsieur Tapie, pourquoi, d’après vous, le Crédit Lyonnais n’a pas fait jouer le nantissement dont il bénéficiait ?
M. Bernard Tapie : Il a fait mieux. Il n’a pas saisi les actions d’Adidas, il s’est fait attribuer les actions de la société mère.
M. Charles de Courson : Pourquoi ?
M. Bernard Tapie : Pour avoir les mêmes avantages. Heureusement que les avocats du Lyonnais étaient meilleurs que les analystes qui disent aujourd'hui que la banque aurait pu saisir les actions ! Si les actions Adidas avaient été saisies en vertu du nantissement, je déposais le bilan le lendemain matin, et tout échappait au Crédit Lyonnais pour passer dans les mains d’un administrateur judiciaire qui aurait ou proposé un plan de continuation, ou vendu aux enchères, ou fait une location-gérance à Robert Louis-Dreyfus. Il n’y avait plus besoin de financer puisque les actions auraient appartenu au syndic. S’ils avaient fait ça, ç’aurait été la pire des folies car les actions Adidas leur échappaient. Je vais même plus loin : c’est la raison d’être de l’option. Ceux qui connaissent un peu le droit des affaires vous diront qu’il faut dix-huit mois pleins entre le moment où vous faites une manipulation douteuse et celui où elle devient définitive sans que le tribunal de commerce puisse revenir en arrière. Si la banque avait fait la vente en direct à Robert Louis-Dreyfus, le tribunal de commerce aurait disposé, dès lors que j’étais mis en liquidation, de la possibilité d’annuler la vente.
Ils ont fait mieux. Les avocats du Lyonnais ont été bien plus intelligents. Ils ont voulu faire d’une pierre deux coups. Et j’en viens à l’essentiel. Le crime était parfait, a dit Me Weil, un des plus grands avocats de la place. On vend Adidas et on lui pique les actions BT Finance, ce qui me privait de toute possibilité d’aller réclamer quoi que ce soit sur Adidas. C’était l’enjeu de la recevabilité. Si mes actions Adidas avaient été mises sous séquestre, j’allais immédiatement chez un syndic qui empêchait la vente. Cela ne veut pas dire qu’ils perdaient le profit du nantissement, mais ils perdaient la totalité de la gestion, en tout cas, la destination finale. Vous pensez bien qu’ils n’allaient pas s’engager là-dedans. Par contre, ils ont voulu rendre irrecevable ma demande à récupérer mon bien. Je rappelle que GBT, ma société personnelle, est propriétaire d’une part importante du capital de BT Finance, elle-même propriétaire d’Adidas. Les seuls à pouvoir se prévaloir d’un droit quelconque sur Adidas, c’est BT Finance. Le jour où on a capté les actions de BT Finance, on a cru définitivement m’empêcher de réclamer quoi que ce soit au titre d’Adidas.
Ils ont même fait une autre opération pour être sûrs de leur coup. Quand on retire un titre de la bourse, il reste toujours quelques dizaines de petits porteurs qui, soit ne sont pas au courant, soit opposent un refus et gardent leurs actions. Le retrait de la cote ne leur ayant pas permis de récupérer 100 % du capital, ils tentent d’obtenir auprès de la COB un retrait obligatoire. La loi dispose que, si vous avez moins de 5 % du capital à l’extérieur, vous pouvez obliger les actionnaires restants à vendre. C’est un expert qui décide du prix. Or, la COB refuse, trouvant la ficelle un peu grosse et comprenant qu’on veut priver de toute possibilité de recours les actionnaires. La cour d’appel confirme. Ils se retrouvent dans l’impossibilité d’aller au bout de leur crime parfait. Les petits porteurs demandent à leurs associés de déposer plainte contre le Crédit Lyonnais pour les avoir spoliés. Comme ce sont les mêmes, évidemment, ils ne le font pas. Le tribunal désigne un administrateur ad hoc qui, devant l’étendue de l’arnaque, demande réparation et assigne le Crédit Lyonnais pour 7 milliards de francs. Pas 300 millions d’euros. C’est à ce moment-là que nous avons attrait à la procédure et que nous allons pouvoir montrer qu’en étant signataire du mandat de vente, on devient par ricochet lié au sort d’Adidas. C’est vrai qu’on a les jetons parce que les arguments contre la recevabilité sont forts. À partir de là, j’ai la chance d’avoir des avocats formidables qui vont démontrer que j’ai raison. La Cour de cassation consacre la recevabilité, comme le mentionne le rapport de M. de Courson. On n’a pas perdu en cassation, c’est même le contraire. Je peux vous garantir, et je parle sous l’œil de mon avocat, qu’en revenant de la Cour de cassation qui n’a invoqué aucun des deux moyens que nous avions soulevés – la contrepartie et le manque de loyauté dans l’exercice du mandat – pour consacrer la recevabilité, nous savons que nous avons gagné. Nous savons que l’on ne pourra plus nous arrêter, sauf à un prix démesuré. Donc, la saisie des actions de BT Finance était bien plus intéressante que le simple fait de récupérer les actions Adidas.
M. Charles de Courson : Pour l’information de la Commission, c’est une ordonnance du juge-commissaire au tribunal de commerce de Paris qui attribue, le 25 octobre 1995, à la SDBO les actions de BT Finance, devenue après son redressement judiciaire la CEDEP, pour une somme de 76,2 millions. C’est donc plus tard.
M. François Goulard : Dès l’origine, vous nous dites que récupérer les titres nantis aurait été, pour le Crédit Lyonnais, une victoire à la Pyrrhus parce que vous auriez déposé le bilan le lendemain. Mais pour quel motif ? Les choses allaient-elles si mal que vous puissiez déposer le bilan ?
M. Bernard Tapie : Pardonnez-moi mais pour actionner un nantissement, il faut forcément que le crédit correspondant ne puisse pas être remboursé !
M. François Goulard : Cela change un peu la présentation que vous avez faite.
M. Bernard Tapie : Pas du tout !
M. François Goulard : Je voudrais comprendre. Vous dites que, si le nantissement avait été exercé, vous auriez déposé le bilan immédiatement. Cela veut dire qu’il n’y avait pas d’alternative aux crédits de la SDBO et du Crédit Lyonnais.
M. Bernard Tapie : Pas du tout !
M. Jérôme Cahuzac : Nous essayons de comprendre pourquoi le Crédit Lyonnais a renoncé aux droits attachés au nantissement qu’il avait. Vous nous dites que vous auriez déposé le bilan, après nous avoir dit que l’entreprise Adidas allait très bien, au point que nous apprenons, et c’est un élément nouveau pour nous, que les repreneurs se bousculaient. Si Adidas va très bien, c’est une raison supplémentaire pour que le Lyonnais fasse jouer son nantissement. Si son but est de vous spolier, puisque telle est la théorie sur laquelle vous prospérez, son intérêt était de récupérer son nantissement sans effort. À propos, pourriez-vous nous confirmer si, oui ou non, vous avez été obligé de recapitaliser Adidas ? Tout à l’heure, vous nous avez expliqué que les banques allemandes avaient demandé la vente de plusieurs sociétés, dont Arena, ou une recapitalisation ? Il nous a semblé que vous aviez recapitalisé, ce qui, d’ailleurs, n’est pas un signe de bonne santé.
M. Frédéric Lefebvre : Concernant le portage, j’ai interrogé M. Peyrelevade ce matin, pour lui demander si, quand il était président de l’UAP, il avait des liens avec vous, avec le Crédit Lyonnais. Déclarant que c’est la première fois qu’il s’exprime sur le sujet, il ajoute qu’il a M. Haberer au téléphone qui explique qu’il veut en sortir, vu la situation catastrophique, et qui lui demande comme un service de rester jusqu’au bout de l’opération. Êtes-vous au courant ? Est-ce que cela vous dit quelque chose ? C’est en tout cas la version qui nous a été donnée ce matin par M. Peyrelevade. Or, cela me semble très important parce que…
Le Président Didier Migaud : C’est autre chose. M. Tapie vous répondra, mais revenons au sujet.
M. Michel Bouvard : Un point important a été abordé, celui de la structuration du capital de la société off shore. Deux hypothèses sont possibles : cette société a un lien capitalistique avec le Crédit Lyonnais, ou elle n’en a pas. Ce matin, on nous a apporté une lettre déclarative niant le lien. À l’instant, M. Tapie nous fournit un autre document, indiquant le contraire. Le sujet mérite d’être approfondi. En fonction de ce qui sera avéré, l’une des deux parties a fourni des informations fausses, à nous et, vraisemblablement, à des tiers. Je souhaiterais arriver, autant que faire se peut, à une clarification sur le capital des sociétés off shore. Rien que le fait que ce soient des sociétés off shore avec lesquelles travaille une banque nationalisée est un point d’interrogation.
M. François Bayrou : Nous en étions, avant les deux dernières questions, à la question de savoir si votre thèse reflétait la réalité. Pour résumer, si j’ai bien compris, selon votre avocat, Bernard Tapie vend ses affaires, non pas parce qu’il a des difficultés économiques, mais parce qu’il veut être ministre. Ses affaires se portent bien et, au fond, le Crédit Lyonnais y voit une bonne affaire. Il organise un montage compliqué pour capter l’entreprise Adidas.
M. Bernard Tapie : C’est la même affaire qu’Executive Life.
M. François Bayrou : Cela n’a rien à voir.
M. Bernard Tapie : C’est la même. Avec les mêmes acteurs.
M. François Bayrou : Vous venez de citer, en en faisant la louange, M. Filho. Voici ce qu’il écrit le 17 novembre 1992, dans une note interne : « Le groupe Bernard Tapie n’a plus désormais les moyens d’assurer normalement le paiement des agios, de telle sorte que l’endettement étant appelé à croître plus vite que la valeur d’Adidas via BTF Gmbh, le groupe se dirige irréversiblement vers l’insolvabilité. » Je conforte même ses propos par une autre note du 24 novembre 1992, citée dans le rapport d’expert : « Aussi M. Tapie réagit-il avec violence et menace, puisqu’il est ruiné, de tout faire sauter en déposant les bilans de BTF, » – c’est exactement ce que vous venez de dire –…
M. Bernard Tapie : Pas la peine d’être violent.
M. Francois Bayrou :…« des sociétés industrielles et d’Adidas ». Ce n’est pas inintéressant dans le contexte de la signature du mémorandum. « Derrière l’outrance, spontanée ou calculée, et la manœuvre d’intimidation, existe une réalité cruelle qui peut le pousser au désespoir et au drame. » Vous aviez usé des talents dramatiques qui sont les vôtres depuis longtemps.
M. Bernard Tapie : Continuez. On ne va pas faire les commentaires.
M. François Bayrou : J’ai le droit de faire des commentaires. Je crois même avoir été élu pour ça !
Le Président Didier Migaud : Continuez.
M. François Bayrou : « Il demande avec agressivité qu’une chance lui soit donnée sous forme d’un montage qui pourrait être celui-ci… » Suit la description du montage.
Je voudrais savoir si vous attribuez ces notes à la malveillance de la SDBO à votre endroit, qui, jusqu’alors, n’avait pas été prouvée, à M. Filho et à son incompétence, ou bien s’il y avait à cette époque des difficultés économiques assez graves pour vous obliger, en effet, à suivre le schéma que l’on vous imposait.
M. Bernard Tapie : À la question de savoir si le Crédit Lyonnais aurait pu capter directement les actions d’Adidas s’il l’avait voulu, je réponds négativement. L’exécution de l’option et du nantissement impliquerait en effet qu’Adidas ait été en difficulté ; or, dans ce cas-là, il aurait fallu procéder à un dépôt de bilan. Je rappelle en outre que c’est de BTF qu’il s’agit, non de GBT. La note interne que vous avez citée, de surcroît, a permis de faire condamner le Crédit Lyonnais en cour d’appel – parfois, à vouloir bien faire, on se tire une balle dans le pied ! – : « Aux motifs que (…) les décisions avaient été prises au sommet par le Crédit Lyonnais : en témoignait la note du 17 novembre 1992 adressée à M. Haberer, alors président du Crédit Lyonnais, relative à la restructuration du capital de BTF GmbH - Adidas - sollicitant son accord pour une opération qui visait à remplacer un risque groupe Tapie par un risque Adidas "qui paraît de bien meilleure qualité", note qui avait été approuvée par M. Haberer et appliquée ; qu’alors Clinvest avait porté sa participation dans Adidas de 10 % à 19,9 % conformément à la décision de M. Haberer qui avait visé une note du 9 décembre 1992 et donné l’autorisation demandée en indiquant : « C’est conforme au schéma imaginé » par la note précédente du 17 novembre 1992 ».
M. François Bayrou : Il s’agit du schéma que je viens d’évoquer.
M. Bernard Tapie : Les juges de la cour d’appel ont eu connaissance de cette note et la conclusion qu’ils en ont tirée crédibilise la note précédente expliquant l’ensemble du montage.
M. Jérôme Cahuzac : Vous faites référence à un arrêt que la Cour de cassation a cassé.
M. François Goulard : Cet arrêt, en effet, n’existe plus.
M. Bernard Tapie : Je fais référence à un document qui a permis à la justice de le casser.
Le Président Didier Migaud : Je rappelle qu’il s’agit d’une cassation partielle.
M. Bernard Tapie : En effet.
J’ajoute que, si les notes ou les informations dont il a été maintes fois question relèvent des débats contradictoires qui ont déjà alimenté les différentes juridictions, il est inutile d’y revenir : les magistrats ont jugé en leur âme et conscience. Le problème, hélas, vient de ce que les membres de la Commission ont été persuadés qu’un document capital avait été dissimulé.
M. François Bayrou : Pas plus que nous ne tenons à défendre une thèse opposée à la vôtre, nous ne sommes ni des experts, ni des juges : nous sommes réunis parce que 400 millions d’euros d’argent public viennent de vous être attribués et que cela suscite un certain nombre de questions pour des parlementaires chargés de défendre le contribuable.
Qu’en est-il, en particulier, de la décision politique visant à recourir à l’arbitrage ?
En outre, pourquoi avez-vous vendu à l’automne 1992 et à un prix que vous avez vous-même fixé une société que vous estimiez être par ailleurs en excellente santé financière ?
Le Président Didier Migaud : Nous n’en sommes pas encore à la question de l’arbitrage.
M. Bernard Tapie : Monsieur Bouvard, votre question, sans être capitale, est néanmoins importante car elle permet de souligner le caractère mafieux du système consistant à utiliser des banques étrangères off shore alors que le portage n’est pas une activité illicite et que le Crédit Lyonnais aurait pu fort bien faire appel à des sociétés ayant pignon sur rue ! Je ne vois non plus pas M. Peyrelevade – car c’est de lui qu’il s’agit…
M. François Bayrou : Non.
M. Bernard Tapie : Si.
M. Jérôme Cahuzac : Non.
M. Bernard Tapie : Je ne vois donc pas non plus M. Peyrelevade se livrer à ce genre d’opération pour des raisons fiscales. Je rappelle, de plus, que les 5 % des actions des enfants Dassler ont été achetés directement par le Crédit Lyonnais dans le cadre d’une société off shore luxembourgeoise alors que rien ne l’y obligeait ; l’ayant droit en était alors le directeur général de Clinvest, M. Filho, et nul n’a jamais pu savoir quel avait été le débouclage de l’opération. Vous n’allez tout de même pas me dire – et M. Peyrelevade, je le répète, était aux commandes – qu’il était obligatoire d’en passer par là !
Quoi qu’il en soit, le problème n’est pas tant, en l’occurrence, qu’un portage ait été réalisé, mais qu’un mandataire ait obtenu un profit.
M. Michel Bouvard : C’est pourquoi il est important d’éclaircir l’actionnariat des sociétés off shore.
M. Bernard Tapie : Évidemment !
Le Président Didier Migaud : Il faut prendre garde aux différentes périodes et bien garder à l’esprit que telle ou telle personne, présente lors de la première phase d’une opération, n’est plus en fonction lors de son débouclage. M. Haberer était en l’occurrence à l’origine de celle qui nous préoccupe, mais il est vrai que M. Peyrelevade a dû lui aussi prendre un certain nombre de décisions.
M. Frédéric Lefebvre : Il était présent, en particulier, lors de la décision du portage.
M. Bernard Tapie : Pas en tant que responsable du Crédit Lyonnais, mais en tant que président de l’UAP.
M. Charles de Courson : Cinquième question : monsieur Tapie, vous avez acquis 80 % d’Adidas en juillet 1990 pour 1,6 milliard ; vous avez ensuite revendu cette participation en février 1993 pour 2,85 milliards de francs, réalisant ainsi une plus-value de 400 à 485 millions.
M. Bernard Tapie : Zéro !
M. Charles de Courson : Or, vous estimez avoir été victime du Crédit Lyonnais, qui a fait bénéficier M. Robert Louis-Dreyfus ainsi que d’autres actionnaires d’une option d’achat de la totalité de la société pour 4,75 milliards en 1994. Dans la mesure où vous auriez été privé de la plus-value que vous auriez pu réaliser si vous aviez vendu directement à la société de M. Louis-Dreyfus, à quelle banque auriez-vous pu vous adresser, compte tenu de votre situation financière, afin qu’elle vous prête les fonds nécessaires ?
M. Bernard Tapie : Le Crédit Lyonnais, je le répète, m’a prêté 250 millions pour acheter Adidas à hauteur de 1,6 milliard, soit moins d’un quart de cette somme – je ne compte pas en effet au nombre de ceux qui ont été financés à 100 %. Par ailleurs, mon groupe BTF valant 500 millions et disposant de surcroît de 75 % d’Adidas, comment n’aurais-je pas pu trouver 600 millions ? Le problème, en fait, n’était pas là ! Pourquoi, en outre, sommes-nous restés dans le cadre d’un crédit à court terme de deux ans ? M. de Courson a lui-même convenu que c’est parce que nous souhaitions en terminer.
M. Charles de Courson : C’est un mode de fonctionnement que vous avez accepté.
M. Bernard Tapie : En effet, mais promesse avait été faite de passer à un crédit à moyen terme.
M. Charles de Courson : Vous disposiez d’un document écrit ?
M. Bernard Tapie : Bien sûr que non ! C’est pour cela que nous n’avons rien dit !
M. Charles de Courson : Pourquoi avez-vous donc signé le mémorandum ?
M. Bernard Tapie : J’ai déjà fait état de mes responsabilités politiques d’alors…
M. François Goulard : Pourquoi avoir donné mandat à la SDBO ? Il s’agit certes d’un prêteur de deniers, mais spécialisé en particulier dans le marché de l’art et qui n’a aucun savoir-faire en matière de vente d’entreprises.
M. Bernard Tapie : J’ai signé avec le groupe Crédit Lyonnais mais le droit ne recoupe pas toujours le fait : tout a été réalisé par Clinvest qui, censément, n’était ni la SDBO, ni le Crédit Lyonnais ! J’étais en outre client de la SDBO depuis dix-sept ans et les négociations ont été menées avec M. Haberer. J’ajoute que le président de la SDBO était directeur général du Crédit Lyonnais : les liens de parenté étaient donc patents.
M. François Hollande – usant de la faculté que l’article 38 du Règlement de l’Assemblée nationale confère aux députés d’assister aux réunions des commissions dont ils ne sont pas membres : MM. Peyrelevade et Tapie développent des thèses opposées, d’où leur contentieux : M. Tapie a fait état du « caractère mafieux » du comportement du Crédit Lyonnais et M. Peyrelevade a quant à lui utilisé le terme « malhonnête » à l’endroit de son contradicteur. La justice s’étant prononcée, j’en viens au seul sujet pertinent pour notre Commission : pour quelle raison une procédure d’arbitrage a-t-elle été engagée ? À quel moment, monsieur Tapie, avez-vous demandé un tel recours ? Est-ce le Crédit Lyonnais qui l’a voulu ?
Le Président Didier Migaud : M. Tapie considérant en outre que les décisions de justice lui avaient été plutôt favorables, pourquoi avoir demandé un arbitrage ?
Avant que M. Tapie ne réponde à cette question, considérez-vous, monsieur de Courson, qu’il a répondu à la vôtre ?
M. Charles de Courson : Sur la forme, assurément ; sur le fond, c’est une autre question, si j’ose dire.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : Je souhaite que M. de Courson continue de poser ses questions dans l’ordre logique qu’il a élaboré de manière à faciliter la compréhension de ce dossier fort complexe.
M. René Couanau : Il ne s’agit pas de refaire un procès mais de comprendre – et M. Tapie en conviendra – que nous sommes mandatés par les électeurs pour poser un certain nombre de questions. Pourquoi, en dépit des décisions de justice, une procédure d’arbitrage a-t-elle été mise en place ? Qu’aviez-vous à craindre d’un procès, monsieur Tapie, si votre dossier était aussi solide que vous le dites ?
M. Charles de Courson : Ma sixième question concerne précisément la procédure d’arbitrage, dont je rappelle qu’elle a été demandée par les mandataires liquidateurs : considériez-vous alors, monsieur Tapie, qu’une sentence arbitrale aurait été plus favorable que la poursuite de la voie juridictionnelle ?
Le Rapporteur général : Cette question est en effet centrale. Selon certains, la sentence arbitrale n’a pas été dans la ligne de la chose jugée par la Cour de cassation. Or, l’arrêt de la Cour de cassation confirme la recevabilité des liquidateurs du groupe Tapie. En outre, il casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris – il n’est pas possible de faire grief au Crédit Lyonnais de ne pas avoir proposé au groupe Tapie les mêmes conditions de financement qu’aux acquéreurs des actions Adidas, soit, les prêts à recours limité. En revanche, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le grief du portage et des contreparties au mandat de vente conféré à la SDBO. Confirmez-vous cette analyse, monsieur Tapie ? Si oui, quel intérêt aviez-vous à la procédure d’arbitrage alors que vous pouviez la perdre et que vous étiez en position de force après l’arrêt de la Cour de cassation ?
M. Bernard Tapie : Il n’y a qu’une seule réponse à l’ensemble de ces questions : mon âge. J’ai soixante-cinq ans et cette affaire dure depuis quinze ans ; selon mes avocats, la procédure aurait pu perdurer encore dix années. Si j’avais eu quarante ans, croyez-moi, j’aurais continué ! Par ailleurs, M. de Courson a déclaré que l’État, lui, avait tout le temps ; outre qu’il a ainsi fait preuve de cynisme à mon endroit, je rappelle que l’Union européenne avait également fait savoir aux deux parties que leur différend durait depuis déjà trop longtemps. J’ajoute que mon gain sera constitué par le solde entre ce que je dois et ce que je reçois. Or, le temps joue en l’occurrence pour moi puisque mes dettes sont figées depuis 1995, à la différence de ce que je dois recevoir. Enfin, je tiens à signaler que la publication des frais d’avocat du CDR ne manquerait pas d’être stupéfiante.
Pour faire un bon accord, il faut être deux, et le CDR, en ce qui le concerne, a voulu échanger une diminution de la durée de ce conflit contre la certitude de la limitation du risque. La vraie question est là : le CDR s’est-il trompé sur l’évaluation du risque qu’il y aurait à poursuivre l’action en justice ? Quant à moi, je n’ai pas l’intention de racheter le Phocéa ou l’Olympique de Marseille et je ne me situe en rien dans une perspective financière : je regrette simplement que les représentants légaux du CDR et de l’EPFR n’aient pas exposé devant la Commission leur véritable motivation.
Pourquoi donc ne pas retourner devant la cour d’appel ? Premier élément : la recevabilité est définitive : il fallait en finir. Deuxième élément : l’annulation de l’attribution, comme l’a dit l’ancien président de l’EPFR, constituait un danger terrible, l’acte d’attribution des actions de BTF ayant été contraire à la loi. Or, si un mandataire ne respecte pas son mandat, la vente qu’il a opérée est nulle et, en cas d’impossibilité d’annulation, l’affaire est payée à sa valeur du jour du jugement. Quelle est la première chose que le Crédit Lyonnais a fait savoir au liquidateur ? Il n’y aura pas d’arbitrage si ce dernier ne renonce pas expressément à la remise en cause de l’attribution. Troisième élément : dans le pire des cas, la banque était certaine de limiter les risques. Entre le moment où l’arbitrage a été décidé et où il a été rendu public, cinq mois se sont écoulés. La rédaction du mémoire d’arbitrage a fait l’objet d’intenses discussions où chacun des camps en présence devait répondre devant des organismes de tutelle. Le Crédit Lyonnais a accepté de recourir à l’arbitrage parce que les obligations qui étaient faites à mon groupe pour que l’arbitrage soit accepté étaient sans commune mesure avec le risque de perdre devant la cour d’appel. De surcroît, je pouvais, moi, réclamer un dû devant cette juridiction et, cette fois, j’aurais eu une valeur de référence : sous la présidence de M. Chirac, M. de Villepin étant Premier ministre et M. Breton ministre des Finances, les actions BTF des petits porteurs ont été rachetées 37 euros, les frais de justice s’élevant à 85 euros par action. Devant la cour d’appel, j’aurais pu arguer avoir 7,5 millions d’actions.
Une procédure est une procédure : un basculement en ma faveur s’est donc produit, mais je rappelle qu’en son commencement, les arbitres avaient plutôt tendance à croire la version de mes adversaires.
Je note, enfin, que les arbitres ont vérifié la faisabilité juridique de cette procédure, laquelle s’est révélée effective puisque cette affaire concernait deux sociétés commerciales. Ils ont ensuite reçu de chacune des parties une suggestion d’arbitrage et la procédure a suivi son cours « en droit ». C’est remarquable : il a suffi que je gagne pour que tout le monde remette en cause le principe de l’arbitrage ! J’ai même entendu dire que cette procédure aurait été « influencée » ; dans Libération, M. François Bayrou a évoqué « le plus gros détournement d’argent public opéré uniquement sur une décision purement politique ».
M. François Bayrou : J’ai parlé de « spoliation ».
M. Bernard Tapie : Or, il n’est absolument pas possible de voir la main du pouvoir dans la décision de recourir à l’arbitrage.
M. Jérôme Cahuzac : Le cas échéant, pourriez-vous dire le contraire ?
M. Bernard Tapie : Oui.
M. François Bayrou : Il y a eu des instructions écrites…
M. Bernard Tapie : S’agissant de ne pas faire de recours en annulation, mais je parle, en l’occurrence, de l’entrée dans la procédure d’arbitrage ! Si l’arbitrage avait été le fait du prince, M. de Courson, qui, depuis tant d’années, me témoigne tant d’affection se serait élevé là contre !
Le Président Didier Migaud : Il n’est pas niable que des instructions ont été données.
M. Charles de Courson : En dehors de votre âge, vous n’avez donné aucun argument expliquant le recours à cette procédure. Pour le reste, vous vous mettez à la place de l’État alors que ce n’est pas la vôtre ! Par ailleurs, vous avez déclaré que le CDR était une société anonyme de droit commun. Or, ce n’est pas le cas car, si une société anonyme vise à faire des bénéfices, le CDR, lui, ne le peut pas.
M. Bernard Tapie : Mais si !
M. Charles de Courson : La loi portant création de l’EPFR a, de plus, conféré à celui-ci des pouvoirs de surveillance sur celui-là, le CDR ne pouvant prendre certaines décisions sans l’accord ou la non-opposition de l’EPFR. Le procès-verbal de la délibération du 10 octobre 2007 sur le recours à l’arbitrage précise que « le président a mis aux voix la non-opposition de l’EPFR à l’organisation de l’arbitrage par le CDR sous la condition d’obtenir l’accord écrit du Crédit Lyonnais sur la prise en charge de la contribution forfaitaire en cas de condamnation avant la régularisation du compromis d’arbitrage et l’engagement de la procédure d’arbitrage ainsi que la rédaction de la lettre au président du CDR en ce sens. Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité des présents ». En ce qui me concerne, j’avais quitté quelques minutes plus tôt le conseil d’administration après avoir considéré que le recours à l’arbitrage était d’une légalité douteuse. Un éminent universitaire a également reconnu qu’il y avait là un vrai problème. Par ailleurs, je n’ai pas fait preuve de cynisme en disant que l’État n’avait pas d’âge : la procédure pouvait encore durer de quatre à six ans, étant entendu que l’arrêt de la Cour de cassation avait confirmé un certain nombre de points de façon définitive. Enfin, le recours à l’arbitrage impliquant toujours des interprétations politiques, il me semblait plus opportun de laisser la justice se prononcer jusqu’à la fin.
J’ajoute, monsieur Tapie, que vous avez eu beaucoup de chance puisque le CDR n’a pas inscrit la partie des dettes portant intérêts.
Pourriez-vous par ailleurs confirmer que le plafond de 290 millions relatifs à l’indemnisation au titre du préjudice économique a bien été choisi à l’aune du montant de la plus-value réalisée par le Crédit Lyonnais lors de la revente d’Adidas ? Le préjudice moral, quant à lui, a été fixé à 50 millions dans la convention d’arbitrage alors que, d’après le CDR, vous aviez d’abord demandé 100 millions, somme qui avait été validée. Qu’en est-il exactement ?
Le Président Didier Migaud : Il convient de distinguer les temps de la décision d’avoir recours à l’arbitrage, de la rédaction du compromis et, enfin, de la sentence arbitrale ainsi que de la décision de réaliser ou non un recours en annulation. Les représentants de l’État, à chacune de ces phases – et c’est légitime –, ont dû recevoir des instructions de leur ministre de tutelle.
M. Frédéric Lefebvre : J’ai eu l’occasion de rappeler ce matin que nul ne s’est manifesté pour critiquer la procédure d’arbitrage lors de sa phase d’élaboration.
M. Charles de Courson : Vous avez dit, monsieur Tapie, qu’aucune instruction n’avait été donnée quant au recours à l’arbitrage. Or, le procès-verbal du 10 octobre 2007 précise que, selon M. Leclercq, représentant du Trésor public, « les administrateurs représentants de l’État ont reçu instruction du ministre de se prononcer en faveur de la proposition soumise pour avis par le CDR en conseil d’administration de l’EPFR ».
M. Jérôme Chartier : Depuis le début du recours, combien y a-t-il eu de tentatives d’arbitrages ou de transactions – à votre initiative, monsieur Tapie, ou à celle du CDR – visant à réduire le temps de la procédure classique ? Pourquoi n’auraient-elles pas été suivies ? Est-ce de votre fait ou de celui du CDR ?
M. Jérôme Cahuzac : Nous avons tous été sensibles, monsieur Tapie, à votre argument concernant votre état-civil, même si, connaissant votre sens de la comédie, nous restons un peu dubitatifs. Quoi qu’il en soit, dans ces conditions, pourquoi avoir refusé les conclusions de la médiation Burgelin, laquelle vous aurait fait gagner du temps ?
Mme Marie-Anne Montchamp : Pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont ont été fixés contradictoirement les montants des plafonds figurant dans le compromis d’arbitrage avec d’une part, les attentes du mandataire et, d’autre part, celles du CDR ?
M. Jean-Pierre Brard : Sauf erreur de ma part, Monsieur Tapie, vous n’aviez pas un sou vaillant lors de l’achat d’Adidas. Existe-t-il de nombreuses banques prêtant de l’argent dans de telles conditions ? De plus, le choix des arbitres résultant d’un commun accord entre les deux parties sur la base de leurs propositions, pouvez-vous nous faire connaître les vôtres ? De surcroît, selon vous, la rémunération des arbitres ferait l’objet d’une grille tarifaire, mais, selon M. Thomas Clay, grand juriste auditionné ce matin par la Commission, un tel arbitrage aurait tout aussi bien pu être réalisé à titre bénévole. Enfin, puisque nous parlons de préjudice moral, je rappelle qu’à la suite du décès accidentel d’un enfant et dès lors que la responsabilité d’une collectivité locale a été engagée, une famille est indemnisée à hauteur de 30 000 euros ; la somme s’élève à 45 000 euros pour une victime de l’amiante. Vous, vous allez recevoir 45 millions. Où se situe votre préjudice moral ? Est-il moral que les Français soient en l’occurrence mis à contribution à hauteur de 11 euros par famille afin de financer ce préjudice ?
M. François Goulard : C’est parce que, selon M. Tapie, les risques de pertes potentielles étaient majeurs que le CDR, donc l’État, aurait eu intérêt à recourir à la procédure d’arbitrage. Or, si tel était le cas, comment expliquer que le CDR ait été en Cour de cassation alors que la cour d’appel vous avait octroyé 135 millions ? En outre, si les informations dont nous disposons sont exactes, c’est vous qui avez pris contact avec le CDR pour aller à l’arbitrage, et non l’inverse. Enfin, une véritable négociation a-t-elle eu lieu avec le CDR quant au montant maximal des sommes pouvant vous revenir au terme de l’arbitrage ?
M. Frédéric Lefebvre : Je note que la procédure d’arbitrage mise en œuvre a été critiquée après que la décision eut été rendue et non dans la phase où cette procédure a été décidée. En outre, j’ai demandé ce matin à M. Peyrelevade si, lorsqu’il était président de l’UAP, il avait été au courant du portage. Il a répondu par l’affirmative alors que M. de Courson prétend le contraire. En 1994, M. Peyrelevade déclarait d’ailleurs à la commission d’enquête : « Je savais, côté UAP, que nous participions au portage parce que j’avais donné des instructions à mes collaborateurs afin que nous ne dépassions pas le stade du portage en termes de prise de risque. » Enfin, M. Peyrelevade a déclaré ce matin que M. Haberer lui avait demandé de rester dans cette opération. Celui qui semble se considérer comme un chevalier blanc me paraît fort présent tout le long de cette affaire, et comme président de l’UAP, et comme président du Crédit Lyonnais.
M. Philippe Vigier : Il est compréhensible que les Français soient choqués par la somme de 50 millions due au titre du préjudice moral. N’aurait-il donc pas été plus élégant de s’en tenir à l’indemnisation due au seul préjudice économique ? Cette somme est d’autant plus choquante que vous avez servi la République au plus haut niveau, monsieur Tapie.
M. David Habib : La somme accordée au titre du préjudice moral est en effet choquante alors que les Français connaissent de grandes difficultés et que des collectivités territoriales n’obtiennent aucune subvention. Nous avons par ailleurs le sentiment qu’en tant que justiciable, vous avez bénéficié d’un certain nombre de faveurs. C’est le dégoût qui l’emporte face à une telle décision arbitrale.
M. Bernard Tapie : Il y a eu deux tentatives de transactions : la première, lorsque M. Fabius était ministre des Finances. Les mêmes avocats et les mêmes acteurs lui ont tenu presque mot pour mot le même discours que lors de l’affaire Executive Life : « Nous ne risquons rien, nous sommes sûrs de nous, nous n’avons fait aucune connerie et il n’y a pas de préjudice. » La facture s’est élevée à un milliard de dollars. La confiance de M. Fabius quant au pronostic très favorable de mon dossier était donc très limitée. À cela s’ajoute que les élections présidentielles ont eu lieu un mois et demi après la décision du ministre des Finances d’avoir recours à l’arbitrage.
Le Président Didier Migaud : La transaction ou l’arbitrage ?
M. Bernard Tapie : La médiation. M. Jean-Pierre Aubert, PDG du CDR, y était lui farouchement opposé.
M. François Bayrou : Il a accepté la médiation plurielle.
M. Bernard Tapie : M. Fabius est parvenu à le convaincre, mais M. Jospin a été battu aux élections.
Le Président Didier Migaud : Il n’y a donc pas eu de transaction.
M. Bernard Tapie : En effet.
La seconde fois, c’est moi qui ai demandé une médiation par l’intermédiaire de M. Hortefeux ; M. Sarkozy, ministre des Finances, en a fait part à M. Aubert, qui a répondu négativement. Un peu plus tard, on m’a fait savoir qu’il n’y avait pas d’hostilité absolue à l’endroit de la médiation à condition de choisir les médiateurs. C’est alors moi qui m’y suis opposé en faisant savoir aux liquidateurs que, dans ces conditions, tout le monde croirait à la combine. J’étais donc favorable à l’arbitrage et défavorable à la médiation.
M. Jérôme Cahuzac : Il s’agit de la médiation Burgelin ?
M. Bernard Tapie. En effet.
M. Jérôme Cahuzac : Combien M. Burgelin vous avait-il proposé ?
M. Bernard Tapie : Rien !
M. Jean-Pierre Brard : Combien de millions ?
M. Bernard Tapie : Rien !
M. Jérôme Cahuzac : Laissez-nous apprécier ce qui, selon vous, correspond à « rien » ! Quel est le chiffre proposé par M. Burgelin ?
M. Bernard Tapie : Il n’y a pas eu de proposition.
M. Jérôme Chartier : Au sujet de cette médiation, une formule est revenue à plusieurs reprises lors des auditions précédentes : « ni riche ni failli ». Est-ce à cela que vous faites allusion ?
M. Bernard Tapie : Non, c’est autre chose.
Si vous me le permettez, monsieur le président, je voudrais terminer ma réponse à M. de Courson. Lorsque l’on est en situation d’obtenir un rapport, le liquidateur est obligé de recueillir mon accord. En d’autres termes, il ne lui faut pas mon accord pour entrer en médiation, mais il le lui faut pour sortir de la médiation. Or je refuse toute proposition. Il est inutile de se raccrocher à ce que M. Burgelin ou M. Ricol auraient écrit dans un rapport.
M. Jérôme Cahuzac : Ce n’est pas un rapport, c’est une médiation.
M. Bernard Tapie : Le rapport du médiateur n’existe pas. Il n’y en a pas. Il y a des suggestions. La vérité est simple : ce n’est qu’à ce moment que j’ai l’occasion de refuser la médiation, et je la refuse. Quant à la formule « pas riche, pas pauvre », elle ne veut rien dire.
La médiation n’existe pas. C’est moi qui ai posé toutes les conditions pour qu’elle n’existe pas. C’est d’ailleurs heureux : vu ce qu’a soulevé l’arbitrage, qu’est-ce que ç’aurait été !
On m’accuse également d’avoir bénéficié d’un régime spécial pour mon hôtel particulier. M. le rapporteur de Courson a même dit que je « squattais ».
M. Jérôme Cahuzac : Et vous l’avez attaqué en diffamation.
M. Bernard Tapie : Non. Je vous souhaite, monsieur Cahuzac, de vous faire insulter un seul jour comme je le suis depuis des années et des années au seul motif qu’il s’agit de moi ! Ni moi ni ma famille ne squattons la maison.
M. Jérôme Cahuzac : Je ne vous ai pas insulté. Ce n’est pas moi qui ai dit cela.
Le Président Didier Migaud : Du calme !
M. Bernard Tapie : Depuis quinze ans, quatre présidents se sont succédé à la tête du tribunal de commerce et on a assisté à deux alternances politiques. Si j’ai réussi à rester dans l’hôtel particulier, vous vous doutez bien que ce n’est pas le fait du prince mais parce que, en droit, je le peux.
Enfin je vais pouvoir m’expliquer. Vous arrêterez de dire que j’ai eu un régime de faveur !
Juste après le prononcé de la liquidation des biens, les liquidateurs, pensant aller dans le sens des conclusions du rapport Péronnet, m’envoient un collège de six experts. Manque de chance, comme ceux-ci ne sont pas aux ordres du juge, ils remettent un rapport dont les conclusions sont à l’opposé. Je vous renvoie au jugement : « Il ressort de ce qui précède que la SDBO a eu un comportement condamnable tel que le définit la jurisprudence en matière de responsabilité bancaire. » Le tribunal de commerce la condamne donc à une provision de 600 millions de francs et demande une expertise pour déterminer le montant réel du préjudice. La banque arrive à faire sauter la provision, mais le jugement n’est en aucun cas annulé.
De nouveau devant le tribunal de commerce, je soutiens l’argumentaire suivant : le Crédit Lyonnais a fait appel ; ma famille a des titres à revendiquer l’occupation de l’hôtel ; je propose que nous en partions dès l’instant où la cour d’appel aura pris position, sans attendre la cassation. Ainsi, si la cour d’appel confirme le jugement, cela m’aura évité de me retrouver à la rue avec toute ma famille ; si elle l’infirme, je partirai dans un délai de huit jours.
Or, à chaque fois que nous nous sommes retrouvés devant la cour d’appel pour trancher, le Crédit Lyonnais, sûr de son fait, a demandé un sursis à statuer. On ne peut en même temps retarder la décision de justice sur les fautes éventuelles et réclamer ma tête parce que j’occupe l’hôtel ! D’autant que les tribunaux successifs et le parquet mettaient comme condition que l’intégralité des frais soit à ma charge. Il n’y avait là aucun passe-droit : c’était la moindre des choses que d’attendre la décision de la cour d’appel. Ce n’était pas un actif qui continuait d’entraîner des pertes.
Au tout début, cependant, il a été envisagé de vendre. Il est inutile de vous rappeler l’épisode : six mille personnes dans la rue pour la visite, plusieurs cars de police… Vu le cirque auquel la vente publique a donné lieu, on n’a pas vu les vrais acheteurs. Aucun acheteur sérieux n’a voulu, après deux jours de visite intensive, entrer dans ce « merdier » dont le Crédit Lyonnais est à l’origine.
Voilà pourquoi, dans un premier temps, l’hôtel n’a pas été vendu. Dans un deuxième temps, tous les juges commissaires et tous les présidents de tribunal qui se sont succédé ont estimé qu’il n’aurait pas été normal de vendre.
Pour ce qui est de la fixation du montant maximum de la demande, il va de soi que je n’ai participé à aucune négociation et que je ne suis pour rien dans les accords qui ont été passés : je n’en avais pas le droit. Je crois néanmoins avoir compris que, concernant le préjudice principal, on a retenu comme butée deux éléments qui nous renvoient à la question de M. Chartier sur le principe « pas riche, pas pauvre ».
Premier élément : à combien fixer le maximum pour que, en fait, il ne me reste pas grand-chose ? Le calcul a été fait à l’envers, en tenant compte du fait que je serais imposé deux fois. J’entends bien les sommes que l’on indique mais on en est très loin – et, entre nous, c’est dommage… Le groupe Bernard Tapie, au moment où il va toucher, sera soumis à l’impôt sur les sociétés, dont on ne pourra même pas déduire le remboursement des dettes, à l’exception des dettes sœurs.
Deuxième élément : puisque l’on est en liquidation, les sociétés seront, conformément à la loi, dissoutes. Il résultera de cette dissolution un boni de liquidation qui sera soumis à une première imposition.
On a en outre déduit les dettes, dont 163 millions pour la banque - retrait de la bourse, rachat aux petits porteurs, etc., mais certainement pas l’achat de mon hôtel particulier - et 250 millions d’euros - ce que nous acceptons de payer - à 300 millions - ce qui est demandé - pour le fisc. Les autres dettes sont comprises entre 15 et 20 millions d’euros : des contentieux étant en cours, on ne connaît pas encore leur montant précis.
Un fois réalisé ce calcul « à l’envers », il reste, en gros, l’indemnisation pour préjudice moral. Il faudra peut-être en déduire mes frais personnels : j’ai eu la chance de trouver des avocats qui ont accepté depuis douze ans pour l’un et onze ans pour l’autre de n’être payés que si je gagne en fin de parcours.
M. de Courson a fait un tableau…
M. Charles de Courson : Un tableau indicatif !
M. Bernard Tapie : Soit, mais il comporte deux éléments contestables.
En premier lieu, je ne vois pas comment vous pouvez établir un pronostic fiscal alors que, franchement, c’est impossible – pas même dans une fourchette. On sait que c’est un complément de prix, que ce sera au moins le complément de prix lié à la plus-value, mais on ne sait pas à quelle époque ce sera raccroché.
On a fait appel à mon sens de la responsabilité. Aux termes de l’arrêt de la cour d’appel, l’éventuelle différence entre l’imposition actuelle et celle que j’aurais dû payer à l’époque est prise en charge par la partie adverse : s’il n’y a pas d’arnaque, c’est bien l’impôt de l’époque que je dois payer. Or j’ai personnellement fait savoir que je refusais que l’État, pour quelque raison que ce soit, paie mes impôts.
M. Charles de Courson : La commission des Finances en a été informée.
M. Bernard Tapie : En second lieu, vous avez indiqué que le CDR a eu la faiblesse de ne pas réclamer d’intérêts sur ses dettes. Les arbitres lui ont néanmoins accordé ces intérêts, mais sur les seuls crédits qui pouvaient être concernés, à savoir les crédits hypothécaires.
M. Charles de Courson : Je ne parlais pas du crédit hypothécaire concernant l’hôtel de Cavoye, où vous avez été logé gratuitement, mais des crédits consentis pas la SDBO. Il aurait fallu inscrire toutes les dettes à moyen et à long terme et on a oublié de le faire.
M. Bernard Tapie : Veuillez m’excuser. Ce n’est pas cela que j’ai compris.
Cela étant, vous avez fait figurer dans votre tableau des sommes très incertaines, d’une part en ce qui concerne les impôts, d’autre part en ce qui concerne l’actualisation. Sans doute avez-vous mal lu l’accord : nous n’avons pas fixé le montant de l’actualisation à 105 millions, nous avons fait passer le plafond de 115 à 105 millions. C’est tout différent car le montant versé pourrait très bien être, par exemple, de 80 millions.
M. Charles de Courson : Je n’ai rien dit d’autre.
M. Bernard Tapie : Un autre chiffre n’a rien à faire dans ce tableau. À l’époque où mes titres BTF ont été attribués à la SBDO, ils ont été expertisés 75 millions d’euros, somme que nous avons portée à l’actif de notre bilan et qui doit être placée en face de dépenses qui ne figurent pas aujourd'hui – et c’est bien normal – dans votre tableau. On ne peut la considérer comme faisant partie du profit que je pourrais tirer de la sentence arbitrale.
M. François Goulard : Il s’agit tout de même de la SDBO.
M. Bernard Tapie : Arrêtez de jouer sur les mots et ayez au moins un peu de bonne foi ! Nous parlons ici des conséquences de cette sentence. Vous n’allez pas y ajouter le prix du bateau que j’ai vendu ou mes cachets d’acteur !
Ce tableau étant censé expliquer aux membres de la commission des Finances combien je gagne du fait l’arbitrage, il faut en retrancher les 75 millions d’euros issus des actions BTF. On retrouve alors la fourchette que j’ai annoncée : entre 25 et 40 millions.
Il y a un autre élément capital. Mon sens civique, auquel on a fait appel, est ce qu’il est mais il existe. Qu’est-ce que cela peut bien faire de savoir combien il me reste si l’on ne met pas en regard ce que j’ai coûté ou rapporté ?
M. Jean-Pierre Brard : Rapporté ?
M. Bernard Tapie : Nous ne croisons apparemment pas les mêmes personnes dans la rue. Vous, vous ne voyez que des gens qui crient au scandale. Mais ne me faites pas ce plan-là ! Je viens du même coin que vous…
M. Jean-Pierre Brard : Il y a longtemps que vous l’avez abandonné.
M. Bernard Tapie : Vous ne pourrez pas me la faire ! J’ai été à l’école à la Courneuve, au lycée à Aubervilliers…
M. Jean-Pierre Brard : Vous l’avez oublié !
M. Bernard Tapie : Pas du tout ! Et ceux que je rencontre ne disent pas ça, je vous le garantis !
Qu’est-ce qui est important ? Imaginons que je gagne un milliard d’euros mais que, parce que j’ai réussi à prendre Adidas au nez et à la barbe de tout le monde, je rapporte au contribuable 20 milliards d’euros : je mérite une médaille ! En revanche, si j’avais coûté un milliard de dollars, comme cela a été le cas du CDR dans l’affaire Executive Life, même s’il ne me restait rien, je serais un citoyen pris en sponsoring par l’État de manière scandaleuse.
Voilà pourquoi je trouve dommage – le mot est faible – qu’on n’ait mentionné à aucun moment ce que j’ai rapporté aux contribuables. Dans sa sentence, le tribunal arbitral regrette, comme toutes les juridictions qui se sont succédé, qu’une banque nationalisée n’ait jamais fourni d’information claire et nette sur le bénéfice qu’elle a tiré de cette opération.
Lors de son audition, M. Jean-Pierre Aubert, homme d’une totale intégrité, a estimé le gain à environ un milliard de francs, dont il a déduit le montant du compte courant qui a été capitalisé. Selon lui, le total ne faisait pas beaucoup. Non seulement je conteste cette estimation mais je remarque que, au moment de l’introduction en bourse, le Crédit Lyonnais se voit verser une prime : 1,2 milliard de franc, selon l’aveu même de M. Peyrelevade dans Le Monde. Nous apprenons par un broker financier que cette prime se monte en réalité à au moins 1,6 milliard. Par sommation interpellative, M. Robert Louis-Dreyfus est interrogé sur l’exactitude de ce chiffre. Celui-ci indique qu’il est tenu au secret mais que le chiffre est beaucoup plus élevé que 1,6 milliard de francs.
Il faut donc retenir un gain d’au moins 1,6 milliard et y ajouter la différence entre le prix de la revente - 4,4 milliards - et celui de l’achat - 2 milliards pour les 75 % que j’ai acquis -. En outre, les 5 % de titres des enfants Dassler ont été achetés sur la base de ce prix de 2 milliards et ils ont été revendus au pis lors de l’introduction en bourse – alors que la capitalisation était de 11 milliards –, au mieux bien après. Car chacun semble oublier que la valeur était de 20 milliards un an après et de 30 milliards deux ans après.
En additionnant tous ces éléments, on est à 4,5 milliards de francs, pas à 500 000 et quelques !
La vraie question, c’est de savoir pourquoi M. Peyrelevade ne peut pas nous donner un chiffre. Même vous, monsieur Bayrou, la réponse va vous choquer : entre l’achat pour 2 milliards, l’introduction en bourse et ce qui s’est passé après, grâce à ce montage, le Crédit Lyonnais n’a pas payé un franc d’impôt. Cette affaire a permis une évasion fiscale de plusieurs centaines de millions d’euros !
Je me suis engagé formellement à donner le chiffre précis de ce qui me restera en fin de compte et je n’ai aucune raison d’en avoir honte. Mais vous devez reconnaître que cela représente, dans l’hypothèse la plus défavorable, moins de 10 % du gain que j’ai fait réaliser à l’État.
M. Brard s’est demandé comment j’ai pu obtenir un prêt. Je crois avoir déjà répondu à cette question. Du reste, sur le 1,6 milliard, le Crédit Lyonnais ne m’a prêté que 250 millions. Je ne fais pas partie de ceux qui ont été financés à 100 % par la banque.
M. Jean-Pierre Brard : Et le reste ?
M. Bernard Tapie : Le reste, ç’a été la vente des titres TF1, l’utilisation d’une partie de mon compte courant, un emprunt auprès des Allemands et des Japonais : il n’y avait même pas d’autre banque française. Il faut donc rester très relatif.
Le Président Didier Migaud : Vous souhaitez que l’on prenne en considération ce que vous avez pu rapporter à l’État. Dans le même temps, vous faites observer que le montage réalisé a permis une évasion fiscale : là, l’État n’a par définition rien touché !
M. Bernard Tapie : Je parle de ce qui a été encaissé.
M. François Goulard : Et les pertes du Crédit Lyonnais depuis ?
M. Bernard Tapie : Franchement, nous n’en sommes plus à l’époque où l’on me rendait responsable de la faillite du Lyonnais ! La Metro Goldwyn Mayer était dans le coup mais à part cela, rappelez-vous, c’était moi : j’étais copain avec Béré, il suffisait que je pousse la porte du Crédit Lyonnais et que je demande un milliard pour qu’on me file un milliard ! Or, dans le même moment, ils savaient que je rapportais ces sommes-là. Ce n’est pas indécent, c’est carrément dégueulasse !
M. Charles de Courson : Je voudrais corriger certaines inexactitudes dans les propos de M. Tapie.
S’agissant de la seule véritable médiation, celle de 2004, on ne peut dire qu’il y a eu des contacts préalables. Je l’explique à la page 9 de mon mémoire : « À la demande des mandataires liquidateurs, une médiation confiée à Jean-François Burgelin, ancien procureur près la Cour de cassation, est alors ordonnée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 12 novembre 2004. Le principe du recours à une médiation avait été autorisé par la conclusion d’un protocole d’accord auquel le représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration – EPFR - s’était d’ailleurs montré défavorable. » J’avais en effet voté contre.
« La médiation se soldera, au bout de cinq mois, par un échec en raison du refus opposé par Bernard Tapie aux propositions du médiateur, ces dernières le laissant en effet en situation de débiteur net. »
M. Bernard Tapie : Je n’ai pas dit le contraire.
M. Charles de Courson : Ces propositions figurent en annexe. Le propre d’une médiation, c’est qu’il faut que les parties acceptent ce que proposent les médiateurs.
Le Président Didier Migaud : M. Tapie a dit qu’il n’avait pas accepté.
M. Charles de Courson : Oui, mais on ne peut nier l’existence de propositions.
En ce qui concerne l’hôtel de Cavoye, j’ai indiqué à plusieurs reprises devant la commission des Finances – les comptes rendus en font foi – que je m’étais étonné, au sein du conseil d’administration, de ce que Bernard Tapie puisse continuer à l’occuper gratuitement alors qu’il avait été mis en liquidation et que l’hôtel faisait partie de la liquidation.
M. Bernard Tapie : C’est la loi.
M. Charles de Courson : J’avais même demandé qui payait la taxe d’habitation et la taxe foncière.
M. Bernard Tapie : Moi.
M. Charles de Courson : Et je suis allé vérifier, en application de la loi, qui payait.
Comme je l’ai dit à la commission des Finances, le CDR avait commis à l’époque une erreur de procédure en oubliant de faire appel d’une décision qui, de ce fait, était devenue définitive.
Vous avez par ailleurs nié avoir engagé une action en diffamation contre moi, monsieur Tapie. Vous l’avez pourtant fait. Mais, la veille du jour prévu pour les auditions devant la Cour, vous vous êtes désisté.
J’en viens au point le plus important. Votre thèse consiste à contester le tableau figurant à la page 20 de mon mémoire. Celui-ci visait à établir une estimation prudente à partir des informations recueillies auprès de l’EPFR et vérifiées avec le président du CDR. Au demeurant, les observations de M. Tapie ne contredisent pas ce que j’affirme sauf en ce qui concerne les actions BTF attribuées, par décision de justice, à la SDBO à hauteur de 76 millions d’euros. Ce transfert est bien destiné à atténuer les 163,2 millions de créances de la SBDO.
M. Bernard Tapie : Cela n’a rien à voir avec la médiation.
M. Charles de Courson : Mais c’est conforme à la sentence arbitrale. Le sous-total donne donc une très bonne estimation du montant avant paiement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. Quant aux sommes payées au titre de l’IR, de l’ISF ou de la CSG, elles bénéficieront du bouclier fiscal. Il reste une incertitude sur le taux appliqué au boni de liquidation. J’ai encadré mon estimation par deux hypothèses : le taux de 17 % appliqué aux plus-values et celui de 33 % dans le cas où l’on considérerait qu’il s’agit d’un revenu de droit commun.
Le total est donc très différent des montants indiqués par M. Tapie. Il reste une variable, c’est le montant des frais d’avocat restant à sa charge et qui viendront en déduction. Il est parfaitement libre de nous le dire ou non.
Cela étant, je maintiens qu’il lui restera plus de 20 à 40 millions d’euros « net net », comme il l’a affirmé dans un communiqué.
M. Yves Censi : Je m’étonne de la différence entre les montants évoqués par M. Tapie et ceux évoqués par M. de Courson. Selon vous, monsieur Tapie, on a effectué un calcul « à rebours ».
M. Bernard Tapie : On en a beaucoup tenu compte. Mme Lagarde elle-même a dit que la plus grande partie de ce qui me serait donné reviendrait à l’État.
M. Yves Censi : Peut-être, mais la sentence arbitrale est censée déterminer ce qui est dû après toute une série de péripéties économiques et commerciales. Alors que le débat, notamment dans les médias, se focalise sur la question du préjudice moral, il serait préférable de s’en tenir à l’aspect purement financier.
M. Jérôme Cahuzac : Pour information, la médiation de M. Burgelin proposait à M. Tapie 140 millions d’euros. On peut estimer que ce n’est « rien ». Ce n’est pas notre avis.
Les calculs que vous avez tenté de faire devant nous, monsieur Tapie, visaient à montrer que, une fois défalqués les dettes, les impôts et le reste, il ne vous restait, de votre point de vue, pas assez. Mais je maintiens que 140 millions d’euros, ce n’est pas rien.
Vous avez également soutenu que le Crédit Lyonnais ne vous a prêté « que » 250 millions de francs. Pourtant, dans le mémorandum dont vous nous avez fait distribuer la copie, les prêts s’élèvent à environ 900 millions de francs.
M. Bernard Tapie : Nous parlons de l’opération Adidas. Je veux bien répondre aux questions mais il y a des limites. On n’est pas au café du commerce !
M. Jérôme Cahuzac : Je comprends que l’évocation de ces sommes vous gêne, mais cela prouve, précisément, que nous ne sommes pas au café du commerce. Le document fait apparaître des prêts avoisinant 900 millions alors que vous avancez le montant de 250 millions. D’où vient l’éventuelle confusion ?
M. Bernard Tapie : Tout simplement de ce que vous n’avez pas écouté !
M. François Bayrou : Pour comprendre, avez-vous dit, il fallait lire ce mémorandum, lequel prévoyait, si je comprends bien, une pension de 600 000 francs par mois.
M. Bernard Tapie : Ce n’est pas dans le mémorandum. C’est la contrepartie que les parties ont acceptée et qui figure dans un document…
M. François Bayrou : Secret ?
M. Bernard Tapie : …qui est le travail préparatoire et signé du mémorandum.
M. François Bayrou : Je le note, comme disaient autrefois les Guignols de l’info.
M. Bernard Tapie : Je vous enverrai ce document dans les quarante-huit heures.
M. François Bayrou : Par ailleurs, vous niez avoir été financé à 100 % pour l’acquisition d’Adidas. Vous affirmez avoir réalisé des actions TF1, etc. Je voudrais, à ce sujet, citer le rapport commandé par Mme Eva Joly.
M. Bernard Tapie : Le rapport Péronnet, donc…
M. François Bayrou : Vous en avez cité beaucoup d’autres. « BTF GmbH ne disposant, pour toute ressource, que de son capital de 0,5 million de deutschemarks, soit 1,7 million de franc, a dû recourir à l’emprunt pour financer l’intégralité de l’acquisition d’Adidas. À cette fin, un crédit de 1,6 milliard de francs a été obtenu le 31 juillet 1990 auprès d’un pool bancaire dont les chefs de file étaient la SDBO… »
M. Bernard Tapie : Pour combien ?
M. François Bayrou : Cinq cents millions de francs, soit 31,25 % du prêt.
M. Bernard Tapie : Ça, c’est le pool français. Soyez précis !
M. François Bayrou : Je le suis. Je vais vous citer l’intégralité de la répartition. « Le montant du crédit permettait de couvrir le prix d’acquisition de 80 % des actions Adidas, les frais d’acquisition ainsi que les six premiers mois d’intérêts. La répartition des engagements au sein du pool s’établissait ainsi : SDBO, 500 millions, soit 31,25 % ; banque du Phénix, 250 millions, 15,63 % ; BNP, 200 millions, 12,5 % ; Bank of Tokyo, 300 millions, 18,75 % ; Long Term Credit Bank, 150 millions, 9,38 % ; Hypobank, 100 millions, 6,25 % ; Bayerische Vereinsbank, 100 millions, 6,25 %. Total : 1,6 milliard pour 100 %. » Je pourrais même vous indiquer le taux d’intérêt.
Au-delà de la rhétorique de M. Tapie, je voulais préciser ces faits.
M. François Goulard : Tout peut en effet s’expliquer si l’on admet la thèse initiale de M. Tapie : la société Adidas était véritablement en redressement, le mandat de vente a été conclu pour lui permettre, alors qu’il était au Gouvernement, de céder son actif dans de bonnes conditions… Or plusieurs éléments infirment cette thèse que les arbitres ne traitent pas véritablement. La justice a très largement examiné les questions subséquentes – le mandat, le portage – mais n’a pas résolu la question de fond : avez-vous, monsieur Tapie, pris librement la décision de vendre cette société, ce qui vous met en position de victime de la non-exécution d’un mandat, ou votre situation vous obligeait-elle de vendre à un banquier, le mémorandum et le mandat étant alors un moyen de vous sauver et de réaliser une plus-value nette de 200 millions de francs alors que la banque aurait pu vous contraindre de tout vendre immédiatement sans rien tirer de cette opération ?
M. Bernard Tapie : C’est comme si l’on revenait au début de l’audition.
M. Jean-Pierre Brard : Eh oui, vous n’avez pas convaincu.
M. Bernard Tapie : Je m’en fous, ce n’est pas vous le juge !
M. Charles de Courson : M. Tapie prend pour argument qu’il a plus rapporté à son banquier qu’il ne lui a coûté. Heureusement ! Sinon, comment vivraient les banques ? De même, un chef d’entreprise peut-il se prévaloir de payer l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu pour justifier une indemnisation ? Cela n’a rien à voir : c’est un argument de tribune !
M. Bernard Tapie : Parce que le reste a quelque chose à voir, sans doute ?
M. Charles de Courson : En outre, vous ne prenez pas en compte les coûts de plusieurs entreprises du groupe Bernard Tapie qui ont déposé leur bilan.
M. Bernard Tapie : Aucune n’a déposé son bilan !
M. Jean-Pierre Brard : Et les licenciements ? Et les gens laissés sur le sable ?
M. Charles de Courson : En effet, qu’en est-il du coût des licenciements ? Vos arguments n’ont rien à voir avec le débat qui occupe la Commission.
M. Bernard Tapie : On en revient au point de départ et à ce que toutes les juridictions ont confirmé.
Aux termes de la condamnation du tribunal de commerce, « il ressort de ce qui précède que la SDBO a eu un comportement condamnable tel que le définit la jurisprudence en matière de responsabilité bancaire ». En appel, l’avocat général affirme : « La responsabilité du Crédit Lyonnais est engagée par manquement à son devoir de loyauté, dès lors qu’il avait l’assurance d’espérer que la participation serait cédée à terme pour plus de 4 milliards de francs. Le silence qu’il a conservé est de nature à avoir privé le vendeur d’une chance sérieuse de gain. Le mandataire n’a pas le droit de se porter contrepartie ni d’acquérir les biens qu’il est chargé de vendre ni, plus généralement, de se comporter déloyalement envers sont mandant. »
Venons-en à l’arrêt de la cour d’appel : « Le caractère de portage ressort au demeurant des propres déclarations de M. Peyrelevade […]. En réalisant une opération de portage, propos qu’il a nuancé ensuite dans une lettre adressée […] à l’expert Tourin, et que le CDR explicite en affirmant que le dirigeant de la banque, qui n’est pas expert en droit mais banquier, a voulu parler d’un portage économique.
« Les nouveaux dirigeants du Crédit Lyonnais – M. Peyrelevade – ont reconnu le portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente direction – M. Haberer –. Avec une constance inexplicable, les dirigeants de la structure de défaisance […], qui n’ont aucune responsabilité dans les agissements répréhensibles antérieurs du Crédit Lyonnais et de ses filiales, et dont le rôle était précisément de défaire ce que les banques avaient mal fait, s’obstinent à défendre des pratiques critiquables, comme à soutenir que la qualification de mandat ne peut être donnée à la mission confiée à la SDBO, l’enjeu de la qualification juridique étant précisément l’interdiction pour le mandataire d’acquérir les titres du mandant. Ils accréditent ainsi la réalité de l’acquisition par personne interposée et portent atteinte à l’image, à la réputation et à la crédibilité d’un établissement financier dont il a pu être dit qu’il peine à reconnaître ses erreurs et à en assumer les conséquences. »
M. Jérôme Cahuzac : Le jugement de la cour d’appel confirme-t-il ou annule-t-il celui du tribunal de commerce ?
M. Bernard Tapie : L’appel de la décision du tribunal de commerce n’a pas été jugé.
« Il apparaît en conséquence, poursuit la cour d’appel, que le groupe Crédit Lyonnais, en se portant contrepartie par personne interposée et en n’informant pas loyalement son client, n’a pas respecté les obligations résultant de son mandat. »
Quelles sont, ensuite, les conclusions de l’avocat général de la Cour de cassation ? « Cette dissimulation préjudiciable à ces sociétés constitue, comme l’ont dit les juges d’appel, une faute énorme par manquement au devoir de loyauté de la part des mandataires. C’est donc le manquement à ce devoir de loyauté qui résulte de la violation caractérisée et intentionnelle de l’obligation d’information qui constitue la faute majeure reprochée au mandataire. Ce qu’il y a lieu de retenir, et qui justifie l’arrêt attaqué, est que l’aboutissement de l’opération de reprise a pour effet de renforcer », etc.
La sentence arbitrale…
M. François Goulard : Si je puis me permettre, vous avez sauté un élément important : l’arrêt de la Cour de cassation.
M. Bernard Tapie : Si la Cour de cassation avait cassé les deux moyens qui viennent d’être évoqués, ce serait une omission coupable. Mais je fais exprès de ne mentionner que la démonstration des fautes qui n’ont pas été cassées. Vous pourrez passer encore des heures à me demander quelle était la valeur d’Adidas, quel était mon endettement, etc., ce n’est pas le sujet !
M. François Goulard : Pour nous, si !
M. Bernard Tapie : Dans ce cas, faites-vous avocat ou changez la loi. La loi répond aux deux questions posées par les liquidateurs et sur lesquelles porte l’arbitrage : la faute dans l’exercice du mandat et le fait que la banque se soit portée contrepartie. Tout le reste, c’est du charabia. Cela ne pèse rien au regard du droit.
M. François Goulard : Je rends hommage à votre compétence en matière juridique acquise au cours de ces années. Bien sûr, pour des raisons de procédure, la Cour de cassation n’a retenu qu’un seul moyen. Ce qui me gêne, c’est que, sur le plan juridique, son arrêt démolit complètement toute la construction de la sentence arbitrale.
M. Bernard Tapie : C’est faux. Donnez-moi un exemple !
M. François Goulard : Le portage, l’interdiction de se porter contrepartie…
Le Président Didier Migaud : Reprenons l’arrêt de la Cour de cassation :
« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
« Casse et annule, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre le CDR créances et le Crédit Lyonnais, l’arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ».
La Cour casse donc sur un moyen et renvoie devant une cour d’appel pour juger les autres moyens.
M. Bernard Tapie : Eh oui ! Comment osez-vous dire qu’elle casse tout, monsieur Goulard ? Où avez-vous vu cela ?
Le Président Didier Migaud : L’objectivité veut que nous lisions les décisions. C’est après que la Cour de cassation les a renvoyées devant la cour d’appel que les deux parties ont décidé de recourir à l’arbitrage.
Le Rapporteur général : Ma seule intervention dans ce débat a été précisément pour rappeler ce qu’est l’arrêt de la Cour de cassation et en quoi la sentence arbitrale est bien dans la ligne de cet arrêt. Je suis heureux que vous repreniez ces éléments, monsieur le président.
Comme cette analyse continue à faire débat – peut-être faudra-t-il que nous fassions procéder à une expertise juridique –, je tiens à préciser que la Cour de cassation confirme la recevabilité des demandes des liquidateurs et casse le jugement de la cour d’appel de Paris sur un point : selon elle, on ne peut faire grief au Crédit Lyonnais de ne pas avoir consenti les mêmes conditions de financement à l’occasion de l’acquisition Adidas, en l’occurrence les prêts à recours limité.
M. Bernard Tapie : Je vous signale que c’est un moyen que nous n’avons pas soutenu.
Le Rapporteur général : En revanche, la Cour de cassation ne se prononce pas sur le grief du portage et des contreparties au mandat de vente confié à la SDBO. Dans le cas de figure d’un renvoi devant la cour d’appel, on aurait pu aboutir à une annulation de l’attribution des actions BTF à la SBDO. Dès lors, on n’aurait plus eu aucune base pour les évaluations. La loi ou la jurisprudence disposent que c’est alors la valorisation de l’entreprise aujourd'hui qui fait foi. C’est un point fondamental : si le CDR a décidé de recourir à la procédure d’arbitrage, c’est très certainement en considération de ce type de risque. Le président Migaud a raison : on ne peut faire dire à l’arrêt de la Cour de cassation ce qu’il ne dit pas.
Le Président Didier Migaud : M. Thomas Clay, que nous avons entendu ce matin et qu’on ne peut suspecter de sympathies particulières, a été clair sur ce sujet.
M. Bernard Tapie : Ces arguments sont d’autant plus incontestables que ce n’est pas la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a statué mais l’assemblée plénière. J’hésite à expliquer pourquoi le Premier président a saisi la Cour dans cette formation à huit jours d’une décision que la chambre commerciale devait prendre. Si chacun faisait son boulot, vous sauriez pourquoi le président Canivet a repris l’affaire.
M. François Bayrou : Pourquoi ?
M. Bernard Tapie : Parce que les avocats du CDR ont eu connaissance, huit jours avant la sentence, du projet de décision. C’est arrivé à l’oreille de nos avocats et, lorsque le président Canivet l’a appris, il a immédiatement dessaisi la chambre commerciale au profit de l’assemblée plénière.
M. François Bayrou : Qu’en concluez-vous ?
M. Bernard Tapie : Qu’il est heureux que cela se soit passé dans ce sens. Si ç’avait été mes avocats qui avaient eu la proposition de jugement entre les mains huit jours avant, on vous aurait entendu – et vous auriez eu raison !
M. Charles de Courson : Avez-vous la preuve de ce que vous avancez ?
M. Bernard Tapie : L’avocat du CDR à la Cour de cassation vous le dira.
Quoi qu’il en soit, cette décision représentait pour nous à la fois un grand risque et un grand poids. La Cour aurait pu estimer que nous n’étions pas pleinement recevables et que nos moyens n’étaient pas forts. Dans ce cas, c’en était fini : il n’y avait plus d’affaire.
M. Charles de Courson : Comme il s’agit d’un arrêt en assemblée plénière, le renvoi ne concerne pas seulement le dispositif final : il porte également sur les argumentaires développés dans le corps de l’arrêt. Or celui-ci rappelle que, selon les avocats de la maison Tapie, l’opération constituait un portage mais que, « attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au groupe Crédit Lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe Tapie le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ».
La Cour n’a donc pas confirmé la thèse des avocats de M. Tapie.
M. Bernard Tapie : Elle ne l’a pas infirmée non plus.
M. Charles de Courson : Elle n’a pas tranché sur l’existence du portage…
M. Bernard Tapie : Bien sûr. Personne ne le nie !
M. Charles de Courson : …mais elle a écarté la thèse de la cour d’appel sur ce point.
M. Bernard Tapie : Elle a écarté les deux thèses.
M. Charles de Courson : Absolument. Dans l’hypothèse d’un renvoi, la cour d’appel aurait dû se prononcer à la fois sur l’attendu et sur le dispositif final.
Le Président Didier Migaud : M. Thomas Clay a considéré ce matin que cette question était délicate et que l’on ne pouvait se faire une opinion définitive en la matière.
M. François Bayrou : M. Jean-Pierre Aubert a soutenu devant la Commission une thèse qui me semble très éclairante. S’il était contre l’arbitrage, c’est qu’il lui semblait qu’il n’existait pas de risque juridique important, surtout après l’arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci a confirmé l’irrecevabilité du vendeur, BTF.
M. Bernard Tapie : Pas du tout ! Ce n’est pas BTF, c’est le mandataire ad hoc pour le compte des petits porteurs !
M. François Bayrou : Je vous rapporte ce que M. Aubert nous a dit.
M. Bernard Tapie : Il a aussi dit qu’il n’y avait pas de risque avec Executive Life…
M. François Bayrou : Peut-être prêterez-vous quand même attention aux propos d’une personne dont vous avez souligné tout à l’heure la parfaite intégrité.
M. Bernard Tapie : Tout à fait.
M. François Bayrou : Selon M. Aubert, seul GBT était recevable. Or, étant actionnaire, le groupe ne peut réclamer dédommagement d’une perte subie par sa filiale.
M. Bernard Tapie : Ridicule !
M. François Bayrou : C’est peut-être ridicule, monsieur. Pour moi, cela mérite que l’on y réfléchisse.
M. Bernard Tapie : Je vais vous répondre.
M. François Bayrou : Je ne sais pas si c’est à vous de le faire : il s’agit là d’une appréciation portée sur la sentence, qui pourrait déterminer un éventuel recours.
M. Aubert a en outre remarqué que l’obligation contractuelle entre GBT et BTF, à savoir la remontée de 185 millions du second vers le premier, a été accomplie.
Le Crédit Lyonnais et la SDBO sont des personnes morales distinctes. Le mandat ayant été confié à la SDBO, ce n’est pas le Crédit Lyonnais qu’il faut mettre en cause.
Enfin, je partage la lecture de François Goulard : la décision de la Cour de cassation affaiblit votre raisonnement juridique. De ce point de vue, la sentence arbitrale mériterait d’être examinée d’un peu plus près.
M. Bernard Tapie : Le maintien des deux autres moyens implique que j’ai le droit de contester l’exécution du mandat et de ses conséquences, sans limitation des demandes que l’on peut formuler.
Par ailleurs, la Cour de cassation fait dire à la cour d’appel ce qu’elle ne dit pas. À aucun moment la cour d’appel n’affirme que le Crédit Lyonnais aurait dû m’accorder un crédit comparable : elle dit seulement qu’il aurait pu le faire, manière humoristique de constater qu’on aurait pu au moins me donner ce que l’on avait donné aux sociétés offshore.
M. François Bayrou : C’est vous qui vouliez vendre pour être ministre !
M. Bernard Tapie : Vous n’allez tout de même pas me rendre responsable de l’arrêt de la cour d’appel sur un moyen que je n’ai pas soulevé !
M. Charles de Courson : Ce que vous dites est juste s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel : « Les mandataires liquidateurs peuvent en revanche, à juste titre, soutenir que les 78 % du capital d’Adidas auraient pu être vendus directement à M. Robert Louis-Dreyfus en décembre 1994, si le groupe Crédit Lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à recours limité au groupe Tapie de sorte que la plus-value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque. » Cela, la Cour de cassation l’a annulé en affirmant qu’il n’existe aucun droit au prêt.
M. Bernard Tapie : Nous sommes d’accord.
Le Président Didier Migaud : Les précédentes auditions ont montré qu’il existe des points de vue différents sur ce sujet. Revenons-en aux questions posées sur les arbitres et sur le préjudice moral.
M. Bernard Tapie : Les deux parties avaient convenu de dresser une liste des arbitres potentiels en retenant des personnes dont la notoriété, l’honorabilité et l’impartialité étaient incontestables. Contester M. Jean-Denis Bredin sous prétexte qu’il a été radical de gauche jusqu’en 1978 est aussi ridicule que de rappeler que M. Pierre Mazeaud est membre de l’UMP. M. Mazeaud a raisonné en son âme et conscience, indépendamment de la politique. M. Bredin, membre de l’Académie française, est un grand humaniste, et il a déjà rendu des arbitrages internationaux.
M. Jean-Pierre Brard : Vous ne répondez pas à la question.
M. Bernard Tapie : La liste comportait une quinzaine de noms. M. Bredin est professeur de droit, M. Mazeaud est ancien président du Conseil constitutionnel. Il fallait un magistrat mais celui-ci ne pouvait être issu de la cour d’appel de Paris, qui avait eu à connaître du dossier, ou de la Cour de cassation, qui venait de rendre un jugement. C’est tout naturellement que le choix s’est porté sur l’ancien président de la deuxième cour d’appel de France, celle de Versailles.
Nos amis les médias ont produit toute une littérature sur la proposition d’arbitrage et sur le nom des arbitres. Or personne n’a soulevé aucune objection !
M. François Bayrou : Nous n’étions même pas au courant !
M. Bernard Tapie : Vous lisez tout de même les journaux, monsieur Bayrou. En plus, une personne que vous connaissez très bien savait parfaitement que l’on se dirigeait vers un arbitrage. Personne ne pouvait l’ignorer. La désignation des arbitres et la détermination des contours, obligations et restrictions ont été largement débattues.
M. François Bayrou : Confidentiellement.
M. Bernard Tapie : Non, c’était dans la presse. Et tout le monde, dans les organes de décision, était au courant des plafonds – c’est d’ailleurs moi qui ai demandé qu’on lève les secrets…
M. Jean-Pierre Brard : Vous n’avez toujours pas répondu à mes questions. Sur les trois arbitres, lequel avez-vous désigné ?
M. Bernard Tapie : Aucun. Il arrive fréquemment que les deux parties choisissent séparément un arbitre chacune et qu’elles se mettent d’accord sur le président, mais ce n’a pas été le cas car il ne fallait pas que tel arbitre se sente le candidat d’une partie. L’accord s’est fait sur les trois noms.
M. Jean-Pierre Brard : Et la rémunération ?
M. Bernard Tapie : Je crois qu’il existe des barèmes fixés par la chambre de commerce afin de tenir compte du temps passé et du nombre de personnes mobilisées. Ce travail implique en effet un nombre impressionnant d’assistants et de démarches payantes, et ce pendant sept ou huit mois. Vous faites un véritable procès d’intention. Je ne vois pas comment les arbitres auraient pu dépasser le montant des honoraires habituellement versés pour de telles prestations.
Le Président Didier Migaud : Et le préjudice moral ?
M. Bernard Tapie. C’est un point capital pour le regard que l’opinion publique porte sur cette affaire. Il faut d’abord préciser que le préjudice remonte à quinze ans et que le montant de l’indemnité est actualisé : l’euro d’aujourd'hui vaut à peu près la moitié de son équivalent d’il y a quinze ans.
M. Jean-Pierre Brard : Un gamin qui meurt aujourd'hui, c’est 30 000 euros.
M. Bernard Tapie : Ce n’est pas moi qui définis ce montant !
Dans le cadre de cet arbitrage, trois hommes ont estimé le préjudice que j’ai subi. Libre à vous de dire que cela ne le vaut pas. Mais, contrairement à vous, les arbitres ont passé trois heures à m’écouter et à me tenir sur le gril pour que je fasse l’inventaire de ce qui s’est passé.
On vient de m’accuser d’être un « favorisé ». Bien entendu, personne n’échappe aux maladies, aux décès, aux divorces et chacun peut faire valoir, à un moment ou à un autre, une forme de détresse qui peut ou non prêter à indemnité. On a chacun sa dose. En ce qui me concerne, les juges ont examiné tout ce qui m’a été fait depuis 1995. Il ne vous aura pas échappé que, jusqu’en 1994, j’étais un honnête homme. Puis ont commencé les inculpations, les perquisitions, etc. Chaque fois que j’apparais – sauf au théâtre, où je n’emmerde personne et où, par conséquent, on m’accepte – je me trouve au cœur d’un débat et d’une médiatisation qui, dans le cas d’espèce, sont insupportables.
M. François Goulard : N’est-ce pas normal pour un homme public ?
M. Bernard Tapie : Si c’est pour des fautes que j’ai commises, c’est la moindre des choses : personne ne m’a obligé à être connu. Mais que l’on continue cette polémique et cette médiatisation outrancière même quand je gagne, c’est totalement irrationnel et injustifié.
J’aurais voulu que ceux qui me contestent vivent un mois seulement l’enfer que j’ai vécu pendant quinze ans. Un enfer où je suis obligé de changer le nom de mes enfants car ils ne peuvent plus aller à l’école sous le nom de Tapie. C’est peut-être de l’humour de mettre sur une poubelle un nom qui n’est pas le vôtre. Mais quand c’est le vôtre et qu’il est porté par vos enfants, par votre femme, par votre famille, cela fait mal. Toutes les inculpations dont j’ai fait l’objet – les faux tableaux, les ventes de meubles… – se sont terminées par des non-lieux mais cela, on ne l’a jamais fait savoir. Quand ma femme passe une journée entière à chialer dans les chiottes parce qu’une multitude de personnes est en train d’ouvrir les placards pour regarder quel dentifrice j’utilise, ce n’est pas normal !
Bien sûr, ce n’est pas Tchernobyl, mais c’est ce que j’ai subi en permanence, à petit feu, de la part d’un coupable qui, en plus, s’est enrichi sur mon dos. C’est pour ces fautes que les arbitres peuvent lui dire de payer. Je n’ai rien à réclamer : j’ai demandé mon dû. Des arbitres largement aussi crédibles et honnêtes que vous ont décidé de me l’accorder.
Un jour, la justice a condamné un journaliste pour avoir traité un homme de « Tapie breton », parce que, selon la justice, mon nom était devenu une injure publique. Sans doute ne mesurez-vous pas l’énormité du problème. C’est comme si je m’appelais « enfoiré », « pourri », « ordure »… Or, même si j’ai fait des fautes – et j’en ai fait –, je ne mérite pas du tout ce traitement, et surtout pas de la part de la banque qui a gagné de l’argent sur mon dos.
Ce que je pense, c’est que vous avez eu beaucoup de chance que les parties aient limité au préalable le montant de la condamnation. Vous m’opposez que l’État n’indemnise pas certaines personnes pour des fautes qu’il a commises. Mais ce n’est pas dans mon cas qu’il faut vous insurger, c’est dans tous les autres cas ! L’État a tous les droits dans ce pays, y compris de foutre un type en taule pendant vingt ans et de l’en ressortir en disant : « On s’excuse et on vous donne 10 000 balles. » Le scandale, c’est que l’État se protège parce que, dans ce pays, il n’a jamais tort ; ce n’est pas quand vous m’indemnisez de ce que vous m’avez volé. Je suis content que des personnes du niveau de M. Mazeaud et de M. Bredin disent non, disent qu’il faut que l’État soit responsable et paie lorsqu’il commet une faute.
Quant à la démagogie qui consiste à demander à combien d’enfants malades correspond l’indemnité… Je ne vous demande pas, monsieur Bayrou,…
M. Jean-Pierre Brard : C’est moi qui avais posé la question.
M. Bernard Tapie : …combien de poliomyélites on aurait pu soigner avec vos frais de campagne présidentielle !
Les arbitres ont donné ce qu’ils ont voulu donner. Ils ont estimé un prix. Ce qui comptera, c’est ce que je ferai de cette somme. Croyez-moi, ce ne sera ni pour racheter le Phocéa ni pour racheter l’Olympique de Marseille. Je ferai ce que me dictera ma conscience.
Le Président Didier Migaud : Merci, monsieur Tapie.
——fpfp——
Mardi 23 septembre 2008, séance de 15 heures (compte rendu n° 120)
– Audition, ouverte à la presse, de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, sur les décisions du Consortium de réalisation (CDR) et de l’Établissement public de financement et de réalisation (EPFR) dans le cadre des procédures liées aux contentieux entre le CDR et le groupe Bernard Tapie
La commission des Finances, de l’économie générale et du Plan a procédé à l’audition de Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, sur les décisions du Consortium de réalisation (CDR) et de l’Établissement public de financement et de réalisation (EPFR) dans le cadre des procédures liées aux contentieux entre le CDR et le groupe Bernard Tapie.
Le Président Didier Migaud : Nous accueillons aujourd'hui Mme Christine Lagarde, ministre de l'Économie, de l'industrie et de l'emploi, afin de l'entendre sur les décisions que le Consortium de réalisation, le CDR, et l'Établissement public de financement et de restructuration, l'EPFR, ont été amenés à prendre dans le cadre des procédures qui opposent, depuis quatorze ans, le CDR au groupe Bernard Tapie.
Nous avons déjà entendu, ces deux dernières semaines, un universitaire spécialiste du droit de l'arbitrage, le représentant de l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'EPFR, Charles de Courson, ainsi que les différents « protagonistes » de ces contentieux.
La commission des Finances s'est donné pour objectif, non de refaire le procès, ce qui n’est pas son rôle, mais de comprendre pourquoi et comment les différents organes dans lesquels l'État a des représentants – c’est-à-dire le CDR, société anonyme, et l'EPFR, établissement public administratif – ont décidé d'abandonner le terrain judiciaire pour confier à trois arbitres le soin de trancher leurs différends avec le groupe Tapie, puis ont renoncé à former un recours en annulation contre une décision qui s'est avérée – du moins peut-on le penser – défavorable à l'État.
Au fil des auditions, il est apparu qu'à la question de l'opportunité d'avoir recours à cette procédure s'ajoutaient des questions de droit complexes, auxquelles il n'a pu être apporté, à ce jour, de réponses tranchées.
Nous souhaitons vous poser, madame la ministre, quatre séries de questions.
Premièrement, le CDR avait-il la capacité de choisir la procédure d’arbitrage, étant donné le « droit de veto » de l'EPFR – établissement public administratif lui-même non habilité à recourir à cette procédure – sur les décisions de son conseil d'administration ? La question a-t-elle été posée ? Si oui, quand et par qui ?
Était-il d’ailleurs pertinent d'avoir recours à une procédure d'arbitrage, par nature confidentielle, alors que des financements publics étaient en jeu ? Si l'on interprète la décision de la Cour de cassation comme favorable à l'État, n’aurait-il pas été plus judicieux de poursuivre l’action sur le terrain judiciaire classique ? Comment la convention d'arbitrage a-t-elle été élaborée? Que penser des plafonds fixés, notamment en ce qui concerne la demande du groupe Tapie au titre du préjudice moral ?
Deuxièmement, doit-on procéder à des modifications législatives afin de clarifier le recours aux procédures d’arbitrage ? Pouvait-on avoir recours à l'arbitrage dans un contentieux « interne », c’est-à-dire franco-français, en cours de procédure ? Qui, du CDR ou de l'EPFR, peut engager l'État dans une procédure d'arbitrage ? N'y a-t-il pas contradiction interne dans la construction juridique qui adosse la structure de défaisance, le CDR, sous forme de société anonyme, à l'EPFR, établissement public administratif ?
Quelles conclusions tirez-vous de cette difficulté juridique ? Une disposition tendant à étendre la possibilité du recours à l'arbitrage, notamment aux établissements publics administratifs, avait été invalidée, en 2007, par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif. Avez-vous l’intention de la reprendre ? Envisagez-vous de demander au Parlement une modification de la législation actuelle sur cette procédure ?
Troisièmement, concernant le renoncement au recours en annulation, pouvez-vous, dans un souci de transparence, nous éclairer sur les avis des cabinets de conseils que vous avez sollicités ? Combien en avez-vous obtenu ? Quelle en était la substance ? Aviez-vous également procédé à des consultations avant de lancer la procédure d’arbitrage ? Suite à ces consultations, quelles instructions avez-vous données aux représentants de l'État ? Étant donné les sommes en jeu, l'État n'avait-il pas intérêt à tenter le recours ?
Enfin, ne devrait-on pas élargir notre réflexion à la nature et à l’activité des structures de défaisance ? Que pensez-vous des structures existantes, de leur action et de leur devenir ? Les États-Unis ont l’intention d’en mettre une en place. Le mode de gouvernance de ces structures vous paraît-il approprié ?
Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi : Le CDR a-t-il la capacité de recourir à un arbitrage afin de résoudre l’ensemble des contentieux ouverts ? C’est bien évidemment la première question que je me suis posée quand il a été question de déférer l’ensemble des instances ouvertes entre le CDR et le groupe Bernard Tapie.
Je précise tout d’abord que je n’ai pas compétence à l’égard du CDR, mais seulement de l’EPFR, qui n’est pas partie à l’arbitrage, le compromis étant signé entre, d’une part, CDR et CDR Créances, d’autre part, l’ensemble des entités dites Bernard Tapie. Il s’agit de sociétés commerciales, s’opposant, depuis douze ans, sur un litige de nature commerciale. Il n’y a donc a priori aucune raison pour qu’un tribunal arbitral ne soit pas compétent.
On peut opposer à ce raisonnement les dispositions de l’article 2060 du code civil, suivant lesquelles on ne peut soumettre à l’arbitrage « les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». On pourrait en conclure que, dans la mesure où l’EPFR est depuis 1998 son actionnaire principal, le CDR ne devrait pas pouvoir entrer en arbitrage et signer un pacte compromissoire.
Je crois qu’au contraire le CDR a la possibilité de le faire, et je vous en donnerai six raisons.
Premièrement, les dispositions de l’article 2060 ne s’appliquent qu’aux arbitrages internes, et non aux arbitrages internationaux. Or, si les deux parties sont de droit français, ce n’est pas leur nationalité qui détermine le caractère interne ou international d’un litige. En revanche, celui-ci porte sur une société de droit allemand détenue par une société allemande, ce qui peut amener à considérer qu’il s’agit d’un arbitrage international.
Deuxièmement, ce n’est pas l’EPFR qui est partie au litige, mais le CDR, société de droit commercial qui a parfaitement capacité pour compromettre et entrer en arbitrage. Un arrêt du Conseil d’État du 3 mars 1989 permet de mieux comprendre la notion de « contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». Dans cet arrêt, le commissaire du Gouvernement interprète de manière restrictive l’article 2060, ce qui paraît logique, sinon aucune affaire commerciale garantie par la Coface ne pourrait faire l’objet d’un compromis d’arbitrage, dans la mesure où, les finances publiques étant concernées, l’État serait intéressé par la contestation via la Coface. En l’espèce, il convient donc de faire une interprétation restrictive de cette disposition.
Le Président Didier Migaud : Sur ce point, un juriste nous a précisé qu’il s’agissait, non de l’avis du Conseil d’État, mais des conclusions du commissaire du Gouvernement.
Mme Christine Lagarde : En effet, mais ces conclusions sont très claires.
Troisièmement, dans un certain nombre de cas, la loi a permis à des établissements publics industriels et commerciaux d’arbitrer. Nous ne nous trouvons donc pas dans le cas de figure où l’État français ne pourrait jamais entrer en arbitrage dès lors que les finances publiques seraient concernées.
D’ailleurs, quatrièmement, le CDR lui-même est déjà entré en arbitrage dans sept instances, dont trois de droit interne, sans que cela fasse l’objet de contestation.
Cinquièmement, un arrêt de la cour d’appel de Paris de 2004 renvoie l’ensemble de l’affaire à la médiation, compte tenu de l’imbrication et de la durée des litiges, des sommes investies et du climat passionné. On peut donc estimer qu’un mode de règlement conventionnel, qu’il s’agisse de médiation ou d’arbitrage, est acceptable.
Enfin, le conseil d’administration du CDR s’est prononcé explicitement en faveur de l’arbitrage, ainsi que, à l’unanimité, celui de l’EPFR.
Il y a donc une série de raisons incitant à déférer à l’arbitrage une affaire qui, au moment où j’en ai été saisie, faisait l’objet d’une procédure depuis 1995, dans laquelle le CDR avait déjà englouti dix millions d’euros d’honoraires, et qui s’ajoutait à une dizaine d’autres procédures pendantes. À l’examen des éléments que je viens de vous communiquer, j’ai estimé que le CDR, qui est seul partie à l’arbitrage, y avait probablement intérêt – j’y reviendrai –, l’EPFR pouvant, comme le prévoit le texte de 1995, donner un avis, mais non, contrairement à ce qu’on a pu dire, exercer un droit de veto. L’arbitrage me paraît donc parfaitement licite.
M. Charles de Courson : Je souhaite répondre à vos six arguments.
Vous affirmez que l’article 2060 du Code civil ne s’applique qu’en droit interne. Or il s’agit incontestablement d’une affaire de droit interne, puisque ce n’est pas la société Adidas, mais le propriétaire de la majorité de son capital qui est partie au conflit.
Vous dites que le CDR est une société anonyme. C’est vrai, mais c’est une société anonyme totalement contraire au droit des sociétés. Alors que l’objet d’une société anonyme est normalement de faire des bénéfices, le CDR n’est pas soumis à cette obligation puisque l’État fait tous les ans des dotations à l’EPFR, qui les rétrocède ensuite au CDR afin d’équilibrer son budget. De surcroît, cette société anonyme ne possède qu’un seul actionnaire, un établissement public administratif.
Vous évoquez l’arrêt du Conseil d’État du 3 mars 1989 ; or ce n’est pas l’arrêt que vous avez cité, mais les conclusions du commissaire du Gouvernement, qui ne font pas partie de l’arrêt, et qui, d’ailleurs, ne sont pas nécessairement suivies. Il n’existe pas de prise de position du Conseil d’État sur cette question. Cependant, tant sa jurisprudence que celle du Conseil Constitutionnel tendent à rappeler que toute autorisation pour l’État ou des établissements publics est de compétence législative. Une base législative est donc nécessaire ; or, en l’espèce, il n’y en a pas.
Vous indiquez que certains établissements publics peuvent recourir à l’arbitrage. En effet : il s’agit des établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, suite à des décisions législatives – ce qui s’est déjà produit à plusieurs reprises, et se reproduira sans doute bientôt puisque je soumettrai à mes collègues un amendement relatif à l’exposition universelle. En 2007, le Conseil constitutionnel a annulé, pour des raisons de forme, une disposition que le Gouvernement aurait pu faire voter sans problème sous forme d’un amendement dans un texte ad hoc, ce qui prouve bien qu’il s’agit d’une compétence législative.
Vous rappelez ensuite que le CDR a déjà eu recours à la procédure d’arbitrage. C’est vrai : d’après son président, M. Rocchi, il y a eu sept autres cas, dont trois de droit international. Il en reste donc quatre de droit interne. Or, j’ai procédé à une vérification sur les procès-verbaux : jamais le conseil d’administration de l’EPFR n’a été saisi d’une demande d’aller en arbitrage.
Enfin, comme je l’ai mentionné dans mon rapport, ce sont les mandataires liquidateurs qui ont sollicité une médiation. Suite à leur demande, celle-ci a été ordonnée par la cour d’appel de Paris, mais les magistrats n’en sont pas les initiateurs.
Vos six arguments tombent donc. Reste un vrai problème de fond qu’à mon avis, seule une juridiction saisie pourrait trancher. Personnellement, je trouve douteuse la légalité de cette autorisation à recourir à l’arbitrage, mais je m’exprime en tant que député, non en tant que magistrat.
M. Gilles Carrez, Rapporteur général : On peut discuter a posteriori des raisons invoquées, mais ce qui me frappe, c’est que la ministre se soit posé la question de la légalité, ce que personne n’avait fait auparavant. Si le problème était si important, il aurait dû émerger en amont ; or on n’en trouve nulle trace, ni dans les débats de l’EPFR, sorte d’intermédiaire entre l’État et le CDR, ni dans les conseils d’administration du CDR. Le débat juridique aurait dû avoir lieu dans ces instances !
M. Charles de Courson : Vous n’avez pas évoqué, madame la ministre, la question de la compatibilité du recours à l’arbitrage avec les droits du Parlement. Un recours à l’arbitrage comporte en effet de manière quasi systématique des clauses de confidentialité, ce qui pose problème s’agissant du droit du Parlement au contrôle des fonds publics. C’est pourquoi le législateur a été prudent et que l’article 2060 du code civil pose une interdiction de principe, sauf dérogation au cas par cas.
Il y a donc aussi un problème de ce point de vue. Je l’ai d’ailleurs vérifié quand j’ai fait, à la demande de la Commission, mon rapport introductif, puisque M. Rocchi, président du CDR, n’a pas pu me transmettre la convention d’arbitrage, en raison d’une clause de confidentialité.
M. Jérôme Cahuzac : Lors des précédentes auditions, les anciens et actuels présidents du CDR et de l’EPFR ont souligné que ce que l’EPFR ne veut pas, le CDR ne le fait pas. Vous indiquez, madame la ministre, que l’EPFR a pris sa décision à l’unanimité. Son conseil d’administration étant composé de représentants de l’État, leur avez-vous donné des instructions écrites – ce qui relativiserait ladite unanimité ?
Par ailleurs, parmi les précédents recours du CDR à la procédure d’arbitrage, y en a-t-il eu d’autres qui ont arrêté des procédures judiciaires pendantes, ou s’agit-il d’une situation inédite ?
M. Jérôme Chartier : Au cours des précédentes auditions, il est apparu que, dès M. Fabius, puis sous la responsabilité de M. Breton, des tentatives de médiation avaient eu lieu. En avez-vous eu connaissance ? En existe-t-il des traces écrites ? Avant de prendre votre décision, avez-vous pris contact avec M. Fabius ou M. Breton pour savoir pourquoi ils avaient voulu engager une médiation ?
M. Jean-Pierre Brard : Madame la ministre, vous avez dit vous être posé la question de la légalité de ce qui a été, en fin de compte, décidé. Il a fallu, à un moment donné, prendre une décision. Chacun sait comment fonctionne notre État actuellement. Qu’est-ce qui, dans les arguments de la présidence de la République, a fait pencher définitivement la balance ?
M. François Bayrou : Lors de son audition, M. Aubert, ancien président du CDR, nous a dit que les dossiers Adidas et Executive Life avaient reçu un traitement juridique particulier et qu’en raison de leur importance et de leurs enjeux en termes de finances publiques, ils avaient été confiés plus directement à la responsabilité de l’EPFR. Qu’en est-il ? Quelle est la nature du lien juridique entre le CDR et l’EPFR ?
M. Jérôme Chartier : Avant de soutenir la procédure d’arbitrage, avez-vous fait procéder à une analyse juridique des risques pour l’État français au cas où la procédure judiciaire aurait été jusqu’à son terme ?
M. Michel Bouvard : Lors de son audition, M. Scemama nous a indiqué que l’Agence des participations de l’État avait été consultée sur la pertinence d’une procédure d’arbitrage. Dans quelles conditions cette consultation eut-elle lieu ? Quel fut l’avis rendu par l’APE ?
Mme Christine Lagarde : Monsieur de Courson, la confidentialité que vous évoquez ne s’est malheureusement pas appliquée en l’espèce, puisque, en quasiment trois jours, ont été successivement diffusés sur Internet le compromis, la sentence et les consultations des avocats. Toutefois, cela ne saurait remettre en cause le principe de confidentialité qui devrait normalement s’appliquer à toutes les opérations d’arbitrage.
Le Président Didier Migaud : Je précise que le compromis a été diffusé devant nous, madame la ministre.
M. Jérôme Cahuzac : Avec l’autorisation des médiateurs !
Mme Christine Lagarde : Par ailleurs, l’État français est l’un des rares à ne pas pratiquer l’arbitrage. Je ne crois pas que le fait que des deniers publics soient en jeu interdise, en soi, le recours à l’arbitrage, qui est une procédure judiciaire inscrite dans la loi.
S’agissant du lien entre le CDR et l’EPFR, je rappelle qu’il n’y a que deux représentants de l’État au conseil d’administration de l’EPFR. Je confirme bien volontiers avoir donné des instructions pour qu’ils soutiennent la décision du CDR d’aller en arbitrage. Je ne m’en suis jamais cachée et j’assume la responsabilité des instructions écrites que j’ai données à cette occasion, sous forme d’abord d’une annotation, puis d’une confirmation d’interprétation concernant le sort particulier réservé à une somme de 12 millions d’euros dans le cadre des relations avec le Crédit Lyonnais. Ce document est à votre disposition.
Le conseil d’administration de l’EPFR comprend deux représentants de l’État, un du Sénat et un de l’Assemblée nationale. Que je sache, sa décision a été prise à l’unanimité. Certes, un de ses membres n’était pas physiquement présent, mais le vote à l’unanimité a été consigné et le procès-verbal approuvé à l’occasion du conseil d’administration suivant. Je n’ai pas donné d’instructions aux cinq administrateurs, n’ayant pas compétence pour le faire, mais aux seuls représentants de l’État, sur la base, d’une part, de la capacité pour agir dans le cadre de l’arbitrage du CDR, d’autre part, de l’intérêt pour l’État d’entrer dans une procédure d’arbitrage, qui me paraissait évident.
Quant aux précédents, monsieur de Courson, il en existe sept, pour partie en droit interne, pour partie en droit international, certains concernant des sommes extrêmement élevées.
Monsieur Chartier, vous avez raison : quand j’ai été saisie du dossier, il m’a été indiqué que, dès l’époque de M. Fabius, des tentatives de médiation avaient eu lieu. Je n’ai pas pris contact avec lui pour en savoir davantage. Peut-être aurais-je dû le faire, mais je ne suis pas sûre que cela aurait éclairé mon appréciation de l’arrêt de la Cour de cassation, survenu ensuite.
J’étais également informée des tentatives de médiation sous Thierry Breton, que je n’ai pas non plus contacté, pouvant aisément imaginer les raisons de leur échec.
Monsieur Brard, lorsque j’ai donné mes instructions, je n’agissais pas moi-même sur instruction, mais sur la base de mon appréciation de la position de l’État eu égard à l’ensemble des procédures et à l’arrêt de la Cour de cassation.
MM. Jérôme Cahuzac et Dominique Baert : Ce n’est guère crédible !
Mme Christine Lagarde : C’est votre appréciation !
Le Président Didier Migaud : Une question avait été posée, une réponse a été apportée…
M. Jean-Pierre Brard : Comme aurait dit Georges Marchais.
Le Président Didier Migaud : Laissez Mme la ministre répondre comme elle l’entend aux questions qui lui ont été posées.
Mme Christine Lagarde : Monsieur Bayrou, je n’ai pas eu à traiter le dossier Executive Life, mais, concernant la présente affaire, c’est probablement en raison de l’importance des sommes en jeu que l’EPFR a été saisi pour avis.
Monsieur Bouvard, l’Agence des participations de l’État est régulièrement consultée sur ce type de dossiers. Elle m’a remis des notes tout au long de cette affaire. Il s’agissait en général d’analyses pertinentes, souvent conservatrices dans l’appréciation du bien-fondé de telle ou telle démarche ; en particulier, elle s’est livrée à une exégèse des consultations juridiques qui ont pu être rendues. J’ai pris connaissance de ses recommandations avec intérêt et les ai comparées avec les autres avis qui m’ont été rendus.
M. Michel Bouvard : Mais au départ, pourquoi l’APE a-t-elle jugé intéressant de s’engager dans une procédure d’arbitrage ? C’est ce que nous a dit M. Scemama lorsque nous l’avons auditionné.
Mme Christine Lagarde : L’APE a fait une analyse des risques pour l’État, en comparant les avantages et les inconvénients des différentes procédures.
M. Charles de Courson : Madame la ministre, permettez-moi d’être en désaccord avec vous sur un certain nombre de points.
Tout d’abord, vous dites publiquement ce que j’avais déjà indiqué à la Commission : des ordres ont été donnés aux deux administrateurs représentant l’État, ce qui est parfaitement normal et prouve que les ministres assument leurs responsabilités. En revanche, vous passez sous silence le troisième homme, le président, qui est nommé en conseil des ministres. Or, les deux présidents de l’EPFR que nous avons auditionnés nous ont confirmé qu’ils s’estimaient liés par les instructions données aux administrateurs représentant l’État. On peut ne pas être d’accord avec cette appréciation, mais elle n’est pas illégitime, dans la mesure où le président peut être relevé de ses fonctions chaque mercredi matin en conseil des ministres.
Ensuite, s’agissant des pouvoirs du conseil d’administration de l’EPFR, l’article 6 de la loi du 28 novembre 1995 dispose qu’« un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent titre, notamment le régime comptable de l'établissement. Il détermine les décisions du conseil d'administration qui, en raison de leur incidence sur l'équilibre financier de l'Établissement public de financement et de restructuration, ne deviennent exécutoires qu'après l'approbation du ministre chargé de l'économie. » Or, selon l’article 5 de ce décret, les décisions du conseil d’administration de l’EPFR soumises à l’approbation préalable du ministre sont, entre autres, celles relatives aux transactions. Cela montre bien, comme nous l’ont d’ailleurs confirmé ses présidents successifs, que quand des sommes importantes sont en jeu, le CDR est tenu de saisir l’EPFR et de suivre ses consignes. Les décisions étant soumises à l’approbation du ministre, il est logique que celui-ci donne des directives aux deux administrateurs et au président. Je peux en témoigner devant la Commission, cela s’est produit à plusieurs reprises.
La décision de l’EPFR n’était donc pas un avis, mais une autorisation. D’ailleurs, le procès-verbal du conseil d’administration du 10 octobre 2007 indique que le président met aux voix « la non-opposition de l’EPFR à l’organisation de l’arbitrage par le CDR », sous certaines conditions.
Mme Christine Lagarde : Il s’agissait bien d’un avis, monsieur de Courson. Ne confondons pas transaction et arbitrage : ce dont vous venez de parler s’applique au régime de transaction, non à l’arbitrage.
M. Charles de Courson : Il s’agit cependant d’une affaire qui coûtera 400 millions d’argent public et aura un impact extrêmement important sur l’équilibre financier du budget qui, je le rappelle, est soumis à autorisation avant de devenir exécutoire.
C’est en fait le montage juridique qui pose problème : interviennent le ministre, un établissement public administratif et une fausse société anonyme possédée à 100 % par un établissement public administratif – soit un double faux nez ! Nous en sommes collectivement responsables, puisque c’est le résultat d’une loi que nous avons votée. Faut-il perpétuer un tel système, qui, en cas d’affaire importante, fait remonter la prise de décision du CDR à l’EPFR, puis de l’EPFR au ministre ?
Enfin, Mme la ministre, il y a une grande différence entre l’arbitrage et la médiation – à laquelle on avait recouru en 2004. La médiation n’engage pas les parties, qui sont libres de l’accepter ou de la refuser ; d’ailleurs, en l’espèce, M. Tapie avait refusé à l’époque ce que lui proposait M. Burgelin.
M. Jérôme Cahuzac : 145 millions !
M. Charles de Courson : Dans l’arbitrage, au contraire, on renonce à tout appel.
Le Rapporteur général : Si Mme la ministre a donné des instructions aux deux administrateurs qui représentent l’État au conseil d’administration de l’EPFR, je suppose qu’elle a également pris connaissance du compte rendu de la séance de l’EPFR qui a approuvé à l’unanimité le recours à l’arbitrage et émis un certain nombre de réserves – notamment à l’initiative de notre collègue Charles de Courson – liées en particulier à un engagement de la responsabilité financière du Crédit Lyonnais. À la lecture du compte rendu de la réunion du 10 octobre 2007, on a le sentiment que Mme la ministre a été confortée dans sa décision de recourir à l’arbitrage. On nourrit aujourd’hui, avec des éléments complètement nouveaux, un débat a posteriori ; il eût mieux valu qu’ils eussent été avancés à l’époque !
M. François Bayrou : J’irai dans le même sens que Charles de Courson : je m’inscris en faux contre vos propos, madame la ministre. Si j’ai bien compris M. Jean-Pierre Aubert, il a déclaré que les dossiers Executive Life et Adidas ont été disjoints de tous les autres dossiers du CDR en raison de l’ampleur du risque et placés sous la responsabilité de l’EPFR. Ce dernier, établissement public administratif et porteur d’une responsabilité particulière, n’était donc pas en situation de recourir à l’arbitrage. Juridiquement, cela change tout.
Pour vous, cette procédure, habituelle dans d’autres pays, serait tout à fait acceptable. Ce n’est pas du tout notre analyse. Thomas Clay, professeur de droit de l’arbitrage, l’a d’ailleurs jugée illégitime lorsque de l’argent public est en jeu mais aussi lorsque des actions judiciaires sont engagées, a fortiori lorsque des jugements ont été rendus, a fortiori lorsque la Cour de cassation, réunie en formation plénière, a rendu son jugement.
Je voudrais vous lire l’avis d’un des conseils que vous avez sollicités, qui a au demeurant conclu dans votre sens, maître Patrice Spinosi : « Or, on ne saurait, en aucune façon, assimiler un tribunal arbitral, quel que soit l’instant de sa saisine, à une juridiction de renvoi. Tout au contraire, le recours à l’arbitrage, en l’espèce, avait précisément pour objet d’éviter la saisine de la cour d’appel de Paris autrement composée, désignée par la Cour de cassation, pour concentrer en une seule action, à l’exclusion de toute autre, les demandes pendantes […]. L’arbitrage, par nature conventionnel et privé, s’écarte de tout système juridictionnel, étatique, public. Le tribunal arbitral n’est pas une juridiction. Il ne dépend pas de l’ordre judiciaire et n’est pas soumis à l’autorité hiérarchique de la Cour de cassation. Il n’est pas saisi par le renvoi ordonné par la Cour de cassation […] » ; le tribunal arbitral est une « instance autonome, indépendante et extrajudiciaire ».
L’État a donc soustrait à la justice de la République une affaire qui engage des centaines de millions d’euros d’argent public. Je ne comprends pas que vous ayez pu conclure à la légitimité de l’arbitrage dans cette affaire.
Le Président Didier Migaud : Deux sujets s’entremêlent : la légalité du recours à l’arbitrage et sa légitimité.
Mais prenons garde aux citations. Retirées de leur contexte, elles changent parfois de signification.
M. Jean-Pierre Brard : Nombre d’entre nous ont siégé ou siègent dans des institutions aux côtés de représentants de l’État. La pratique des instructions écrites n’est pas obligatoire. Pourquoi, en l’occurrence, les hauts fonctionnaires ont-ils tenu à en obtenir ?
Vous affirmez ne pas avoir agi sur instructions. Cela n’exclut pas l’existence de rapports avec l’instance que j’évoquais tout à l’heure implicitement, la Présidence de la République, tout au moins, nécessairement, par l’entremise de vos cabinets. Nous sommes évidemment intéressés par la teneur de ces échanges.
Enfin, je serai très direct mais soyez sûre, madame la ministre, que je ne cherche pas à vous agresser. Nous nous moquons de ce qui se passe à l’étranger. Dans cette affaire d’État, votre psychologie ne vous a-t-elle pas poussé à agir comme si vous traitiez une affaire privée ? Dans une affaire d’État, il faut laisser la justice trancher.
M. Dominique Baert : Votre démonstration est curieuse, madame la ministre. Quand la condamnation tombe, il faut signer le chèque. Or c’est l’EPFR qui est mobilisé pour payer l’essentiel, à hauteur de 150 millions d’euros, alors qu’il ne peut recourir à l’arbitrage. Le CDR n’a-t-il pas procédé au portage de l’arbitrage, ce qui pourrait suffire, me semble-t-il, à le rendre illégal ?
M. Frédéric Lefebvre : M. Carrez a raison : durant la préparation de la procédure d’arbitrage, aucun parlementaire ne s’est ému auprès du président de notre Commission ; comme pas hasard, tout le monde se réveille une fois le jugement rendu. Madame la ministre, un parlementaire vous a-t-il interpellée en amont à propos de la légitimité de cette procédure ?
L’État, sous tous les pouvoirs politiques – sous des ministres de l’Économie comme M. Fabius ou M. Breton –, a essayé de recourir à une médiation pour faire sortir le dossier des tribunaux, tout simplement parce que, dans cette affaire, il ne se sentait pas fort. C’est Bernard Tapie qui a refusé la médiation. Ne peut-on pas en conclure que, pour l’État, l’arbitrage était un bon moyen de s’en sortir, dans une affaire qui risquait de durer et de lui coûter cher ?
M. Jérôme Cahuzac : Et 300 millions d’euros, ce n’est pas cher ?
M. François Goulard : La légalité du recours à l’arbitrage fait l’objet d’un débat juridique difficile à trancher : le CDR étant une société anonyme, l’arbitrage paraît possible ; cependant, l’intention du législateur a été de l’interdire pour l’État et ses pseudopodes. Une seconde question porte sur l’opportunité de ce choix. Laissons de côté ces deux points.
L’État, qui organise la justice, doit en principe considérer qu’elle est bien rendue, même si la partie adverse en profite. Dans une affaire aussi peu banale, qui aurait en tout état de cause été jugée par des juridictions françaises, n’est-il pas contestable que l’État ait choisi une autre voie ?
Le Président Didier Migaud : La possibilité de recourir à l’arbitrage, pour l’État et les établissements publics, suscite toujours des points de vue divergents. L’autre question est celle de la légitimité, de l’opportunité.
Mme Christine Lagarde : Il serait totalement inexact, illusoire et dangereux de laisser accréditer l’idée selon laquelle l’EPFR et le CDR représentent la même cause, le même combat, la même société. Il s’agit de deux entités juridiques parfaitement distinctes et l’autonomie de la personne morale prévaut.
Je rappelle, monsieur Bayrou, que l’EPFR a été saisi non pas pour avis ou pour veto mais dans le cadre d’une non-opposition – Charles de Courson l’a confirmé –, notamment parce que le risque n’était pas chiffrable.
Le code civil autorise le recours à l’arbitrage même lorsque des procédures judiciaires sont déjà engagées, il n’y a pas d’équivoque. Je vérifierai s’il existe des précédents.
M. Jérôme Cahuzac : J’ai posé la même question à M. Jean-François Rocchi il y a quinze jours. Les recherches sont donc toujours en cours ?
Mme Christine Lagarde : En tout cas, le code civil autorise à mettre fin à des procédures judiciaires en cours par le biais d’un compromis d’arbitrage.
M. Jérôme Cahuzac : Mais existe-t-il des précédents ?
M. Patrick Lemasle : Il n’y a pas de précédent mais madame la ministre n’entend pas !
Mme Christine Lagarde : Monsieur Brard, en conscience, je vous assure que je n’ai pas pris ma décision par réflexe de juriste internationale. J’ai donné ces instructions écrites aux deux représentants de l’État au sein de l’EPFR sur le fondement de deux considérations essentielles : la capacité du CDR à entrer en arbitrage et l’opportunité que cela représentait pour la République.
N’ayant pas pour habitude de faire semblant de ne pas voir, il m’arrive très fréquemment de signer, d’annoter, de parapher des notes ou de donner des instructions pour indiquer quelle direction doit être suivie ou quelle décision doit être mise en œuvre.
M. Jérôme Cahuzac : Il y a quinze jours, nous avons demandé au président Rocchi s’il existait un précédent d’arbitrage rendu alors que des procédures judiciaires étaient en cours. Moins d’une dizaine d’affaires étant concernées, je trouve étrange que vous ne puissiez toujours pas nous répondre. Les conclusions de M. de Courson sont claires : il n’existe pas de précédent.
M. Charles de Courson : Je n’ai pas dit cela. Nous avons demandé à M. Rocchi, président du CDR, s’il existait des précédents de recours à l’arbitrage. De mémoire, il nous a répondu qu’il y en a eu sept. Trois d’entre eux concernant des affaires internationales, ils sortent de notre champ. Il reste par conséquent quatre cas en droit interne. Sur ces quatre cas, j’ai fait des recherches et je n’ai pas trouvé trace d’opposition de la part de l’EPFR – je vois du reste M. Rocchi acquiescer. En revanche, je n’ai pas la réponse à la question posée par M. Cahuzac.
M. Jérôme Cahuzac : Si l’EPFR et le CDR n’ont rien à voir l’un avec l’autre, pourquoi le premier – donc les contribuables – paie-t-il suite à une décision prise par le second ?
Mme Christine Lagarde : Je répète que chacune des deux entreprises dispose de sa propre personnalité morale et par conséquent de son autonomie juridique.
Monsieur Lefebvre, aucun parlementaire n’avait attiré mon attention sur la légalité de la procédure d’arbitrage. Je précise que la décision, à l’époque, avait été publiée.
Monsieur Brard, d’autres, avant moi – M. Fabius et M. Breton –, ont essayé de mettre fin à cette procédure. Mon action n’a donc pas procédé d’une inspiration soudaine suscitée par une instruction provenant de je ne sais quel lieu, comme vous semblez le supposer.
M. Jérôme Cahuzac : Avant de prendre votre décision, avez-vous parlé de cette affaire avec le Président de la République ? L’un de vos collaborateurs en a-t-il parlé avec un collaborateur du Président de la République ?
M. Jérôme Chartier : Je souhaiterais que vous reprécisiez quelques points car certains collègues s’égarent.
Confirmez-vous que le CDR est une personne morale de droit privée, que son actionnaire est aujourd’hui l’EPFR et qu’elle en avait un autre avant 1998 ?
Le dossier opposant le CDR à Tapie a-t-il donné lieu à la plus longue de ses procédures ? S’agit-il bien d’un dossier exceptionnel, ce qui expliquerait pourquoi M. Fabius, M. Breton et vous-même avez cherché à y mettre un point final, ne serait-ce que pour échapper à une saisine de la Cour européenne des droits de l’homme dont les conséquences auraient été extrêmement défavorables pour l’État ?
Mme Christine Lagarde : Le CDR est effectivement une société commerciale de droit privé. Avant 1998, elle était filiale du Crédit Lyonnais ; elle est ensuite devenue filiale de l’EPFR.
Je vous confirme que la procédure contre Tapie est bien la plus longue engagée par le CDR, la première décision rendue datant de 1994. Vous avez raison d’évoquer la Cour européenne des droits de l’homme. La France aurait pu être incriminée, tout simplement sur le fondement de la durée de la procédure. En effet, dès lors que des procédures excèdent sept ou huit ans, la Cour condamne couramment des États pour mauvaise gestion de la justice. Cet autre élément m’a paru déterminant pour aller vers l’arbitrage, qui présente l’avantage de la rapidité.
Depuis 1994, les parties étaient saisies d’une furie judiciaire qui les amenait devant toutes les juridictions possibles et imaginables, dans une dizaine de procédures. Le temps jouait clairement contre l’État, je m’en expliquerai dans un instant.
Mme Christine Lagarde : Compte tenu de la durée de ces procédures, la Cour européenne, au regard de sa jurisprudence, aurait très légitimement pu alléguer un abus à l’encontre de BTF – Bernard Tapie Finance – et surtout des époux Tapie. Il ne s’agissait donc aucunement de défiance vis-à-vis de la justice mais de trouver rapidement une solution définitive. De fait, si je me souviens bien, la sentence arbitrale a été rendue dans un délai de seulement six mois après la saisine des trois arbitres.
L’arbitrage permettait de clore l’ensemble des neuf procédures en cours, les deux parties stipulant, dans le compromis, qu’elles acceptaient de se désister et renonçaient à toute instance ou action.
Dans le compromis d’arbitrage, les demandes étaient plafonnées à 295 millions d’euros pour les dommages et intérêts, et à 50 millions d’euros pour le préjudice moral. On peut jaser sur ces montants, mais le plafonnement limitait le risque.
D’autres conditions me paraissaient indispensables pour envisager l’arbitrage et donner des instructions positives aux deux représentants de l’État au sein de l’EPFR : que l’arbitrage soit rendu en droit et non en équité ; que les dispositions du code de procédure civile soient respectées ; que la composition du tribunal soit au-dessus de tout soupçon. Les trois arbitres me semblaient et me semblent toujours répondre aux exigences de compétence requises.
On a beaucoup raconté que le CDR se trouvait en bonne situation puisqu’un arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation avait été rendu en sa faveur, cassant l’arrêt de la cour d’appel de septembre 2005. Il me paraissait au contraire crucial de ne pas en rester à cette décision de la Cour de cassation, même s’il s’agit de la juridiction suprême et si un arrêt rendu en formation plénière revêt des vertus complémentaires. Pourquoi ? Parce que l’arrêt cassé ne l’était que partiellement, laissant ouvert à l’une ou l’autre des parties le moyen de revenir devant la cour d’appel de renvoi en modifiant son argumentation et en révisant ses demandes.
Page 13, l’arrêt de la Cour de cassation est très clair : « Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, etc. ». La Cour de cassation déblayait ainsi le terrain et indiquait la voie à suivre pour une procédure devant la cour de renvoi. Si j’avais été l’avocat de Tapie – ce que je ne suis pas, je le précise à l’intention de ceux qui en douteraient –, j’aurais immédiatement fondé mon action sur ces deux moyens : primo, se porter cessionnaire des parts qu’elle avait mandat de céder constitue une violation des dispositions relatives au mandat contenue dans le code civil et entraîne la nullité ; secundo, le manquement à la loyauté dans les rapports avec le client est évident.
Même si le plafond de 295 millions plus 50 millions d’euros était élevé, faute d’arbitrage, nous risquions d’aboutir à la nullité de l’opération, ce qui aurait remis les parties en l’état. Compte tenu des 7 milliards précédemment demandés devant la cour d’appel de renvoi, le risque excédait largement les 135 millions accordés en 1995, d’autant que, dans une autre partie de son arrêt, la Cour de cassation reconnaît la recevabilité des liquidateurs. Voilà pourquoi, en conscience, j’ai jugé l’arbitrage opportun. Je me trompe peut-être mais personne n’est en mesure de le démontrer aujourd’hui.
M. Jérôme Cahuzac : Je n’ai toujours pas obtenu de réponse à mes questions mais vous n’êtes pas obligée d’y répondre. Avant d’accepter la procédure d’arbitrage, en avez-vous parlé avec le Président de la République ?
Mme Christine Lagarde : Non.
M. Jérôme Cahuzac : L’un de vos collaborateurs en a-t-il parlé avec l’un des collaborateurs du Président de la République ?
Mme Christine Lagarde : Je ne les ai pas interrogés un par un par un ni soumis à la question. À ma connaissance, aucune instruction n’a été donnée.
Le Président Didier Migaud : La réponse de la ministre est claire.
M. Jean-Pierre Balligand : Lorsque l’option de la procédure d’arbitrage a été prise, avez-vous donné une instruction quant à la limite haute de la fourchette ?
Mme Christine Lagarde : Je ne m’immisce pas dans les affaires du CDR mais j’ai donné pour instruction aux représentants de l’État au sein de l’EPFR qu’un plafond soit fixé. Cela me semblait absolument indispensable.
M. Charles de Courson : Votre thèse, déjà développée par le président du CDR, est que le temps ne jouait plus en faveur de l’État. Mais le CDR avait oublié d’inscrire les créances à moyen-long terme.
Le Rapporteur général : C’est malheureusement exact.
M. Charles de Courson : Par conséquent, l’éventuelle condamnation portait intérêt mais pas les dettes.
En outre, au sujet de l’hôtel de Cavoye, il a été oublié de faire appel et M. Tapie en a profité pour demeurer gratuitement dans sa modeste demeure. Des fautes ont donc été commises.
Mme Christine Lagarde : C’était il y a dix ans.
M. Charles de Courson : Pour la première, oui, mais la seconde est plus récente. M. le président du CDR a reconnu ces erreurs ; il n’y est d’ailleurs pour rien puisqu’il n’était pas en poste à l’époque.
Beaucoup de membres de la commission des Finances ont été choqués par le plafonnement à 50 millions de la demande concernant le préjudice moral. Le spécialiste du droit de l’arbitrage que nous avons auditionné nous a indiqué n’avoir jamais vu une condamnation à une telle somme, qu’elle soit prononcée par un tribunal de droit commun ou un tribunal arbitral. Pourquoi avoir accepté un montant aussi élevé ?
Je suis en désaccord absolu avec vous à propos de l’arrêt de la Cour de cassation. Je rappelle qu’il casse celui de la cour d’appel qui accordait une indemnité aux époux Tapie en expliquant qu’ils avaient été privés de plus-value à cause du banquier, qui aurait dû leur accorder un prêt. Je relis le dernier alinéa de la page 13 de l’arrêt de la Cour de cassation « Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au groupe Crédit Lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe Tapie le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires ». Soyons équilibrés, madame la ministre : l’arrêt de la Cour de cassation casse le moyen central de la cour d’appel ; en droit français, il n’y a plus de recours possible.
M. François Goulard : Absolument !
Mme Christine Lagarde : Au contraire, la jurisprudence est constante.
M. Charles de Courson : À propos des deux objections soulevées – le respect de l’obligation de loyauté et l’existence de contreparties –, la Cour de cassation ne se prononce pas et renvoie devant la cour d’appel. Il est donc abusif d’inférer de l’arrêt de la Cour de cassation ce qu’aurait conclu la cour d’appel.
Le Président Didier Migaud : Manifestement, les interprétations divergent.
Le Rapporteur général : J’ai la même analyse que Mme la ministre. La Cour de cassation a confirmé la recevabilité des liquidateurs du groupe Tapie et n’a procédé qu’à une cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de 2005, sur le point concernant les conditions de financement accordées par le Crédit Lyonnais au groupe Tapie pour la reprise d’Adidas, à savoir les prêts à recours limité.
Les auditions ont été très utiles, en particulier celle de Jean Peyrelevade. Auditionné en avril ou mai 1994 par la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais, je m’en souviens très bien, il nous avait dit qu’il y avait portage par le Crédit Lyonnais et que celui-ci était même propriétaire. Or, il y a quinze jours, il a affirmé qu’il s’était trompé et qu’il avait publié un démenti dans la presse. M. Peyrelevade est pourtant un homme avisé et expérimenté, qui connaît parfaitement son métier ; avant de prendre la présidence du Crédit Lyonnais, il avait présidé l’UAP et occupé les fonctions de directeur adjoint du cabinet de Pierre Mauroy. Dès lors que la Cour de cassation rend possible l’utilisation de l’argument selon lequel le mandat confié à la SDBO – la Société de banque occidentale – a été détourné et le Crédit Lyonnais s’est porté contrepartie, les conséquences juridiques peuvent être considérables : le contentieux peut repartir et faire exploser tous les plafonds, puisque le référentiel à considérer serait la valeur actuelle d’Adidas. Les auditions ont confirmé ce risque. C’est pourquoi je comprends mieux aujourd’hui la décision de recourir à l’arbitrage.
Les exégèses interminables de l’arrêt de la Cour de cassation nous conduisent à une impasse. Nous nous faisons plaisir intellectuellement alors que, juridiquement, la sentence arbitrale est définitive. Ces auditions présentent cependant l’intérêt de mettre clairement en évidence la légèreté du comportement du Crédit Lyonnais en 1993-94. Les risques pris dans les dossiers Tapie, Executive Life et autres, au final, auront coûté 10, 12 ou 15 milliards d’euros au contribuable. Cette situation justifie le recours à l’arbitrage pour certaines affaires, notamment pour Executive Life.
M. Jérôme Cahuzac : Nous ne connaîtrons jamais le verdict qu’aurait pu rendre la cour d’appel. Quoi qu’il en soit, si l’arrêt de la Cour de cassation mettait les époux Tapie dans une situation juridique si favorable, pourquoi M. Tapie a-t-il décidé de ne pas laisser se poursuivre le cours normal de la justice ? À supposer que tout puisse arriver, aurait-il fait preuve de grandeur d’âme ou de sens de l’État ?
Connaissez-vous M. Patrick Dils, Mme la ministre ? Condamné pour l’assassinat de deux garçons, resté emprisonné dix ans avant d’être innocenté, l’État lui a accordé une somme d’1 million d’euros pour le préjudice moral. Estimez-vous que les souffrances qu’il a endurées sont cinquante fois inférieures au plafond que vous avez accepté pour les époux Tapie ?
M. Yves Censi : Ne détournez pas le sens de l’expression « préjudice moral » !
M. François Goulard : Les propos du rapporteur général paraissent maladroits : il est de notre devoir d’essayer de comprendre, même si les chances de récupérer quoi que ce soit sont fort minces.
Le Président Didier Migaud : C’est pourquoi nous sommes là !
M. François Goulard : La Cour de cassation n’affirme nullement que les banques ont manqué à leur devoir vis-à-vis du client. Elle se contente de rappeler les faits relevés par la cour d’appel. La raison pour laquelle la cour d’appel a fait droit aux demandes des liquidateurs et des époux Tapie est d’une stupidité rare : les banques seraient obligées de prêter à quiconque envisagerait un achat. À l’époque, tous les professeurs de droit ont estimé cela complètement insensé. La Cour de cassation s’est saisie de ce motif énorme et n’a pas examiné les autres. L’important est qu’il y ait eu cassation et que le liquidateur et M. Tapie n’aient pas obtenu gain de cause. Si l’arrêt de la Cour de cassation avait été si favorable aux Tapie et aux liquidateurs, pourquoi auraient-ils demandé l’arbitrage à l’État ?
Pour que la décision soit prise « en droit et non en équité », il aurait fallu la confier à des juridictions et non à des arbitres. Dans la sentence arbitrale – je l’ai lue du début à la fin –, on se demande où est le droit. Les arbitres donnent l’impression d’avoir épousé la thèse de Tapie dans tout ce qu’elle a de plus absurde et indéfendable, faisant droit à toutes leurs exigences, reconnaissant le bien-fondé de toutes leurs thèses, y compris lorsqu’elles sont grossièrement erronées.
Par exemple, M. Tapie nous a déclaré qu’il avait vendu ses actions parce que, devenu ministre, il ne pouvait pas rester chef d’entreprise. Un fait a échappé à notre sagacité : quand le mandat de vente de ces actions a été donné, M. Tapie n’était pas ministre. C’est un mensonge éhonté de sa part ! Et je pourrai multiplier les exemples !
Ce n’est pas le recours à l’arbitrage qui me choque mais les raisons pour lesquelles on a fait droit à des personnes qui ont grugé des banques publiques, qui se sont montrées incapables de redresser la moindre entreprise et qui se sont rempli les poches aux frais des contribuables, des salariés et des anciens actionnaires. Cette sentence est choquante…
M. Loïc Bouvard : Scandaleuse !
M. François Goulard : … et nos compatriotes méritent des explications.
M. François Bayrou : Pour le citoyen français, il est impossible de comprendre ce que représentent 400 millions d’euros. Aux États-Unis, les sommes que le président de Lehman Brothers, M. Donald Fuld, s’est fait attribuer, suscitent une polémique énorme : depuis cinq ans, il a touché 385 millions de dollars. Or l’argent du contribuable que vous attribuez à Tapie, en un seul jour, par votre décision, équivaut à 558 millions de dollars, soit plus de 50 % en plus.
Franchement, s’agissant d’une convention d’arbitrage aux conséquences aussi lourdes, je n’arrive pas à croire que vous n’ayez pas demandé de précisions sur le montant du plafond. Vous croyant intelligente et compétente, j’imagine que vous l’avez fait. Sinon, cela m’inquiète pour la République. La cour d’appel accordait 135 millions d’euros sur la base d’un moyen qui a disparu, sévèrement cassé par la Cour de cassation. Et voilà que vous fixez un plafond qui dépasse le double de ce montant – 290 millions d’euros –, auquel vous ajoutez de surcroît 50 millions d’euros de préjudice moral, alors que la cour d’appel n’avait pas accordé un euro pour ce motif. Ces plafonds, convenons-en, ressemblent furieusement à un schéma d’accord préétabli.
Le Président Didier Migaud : Votre question ressemble furieusement à celle de M. Cahuzac.
M. Jérôme Chartier : Gilles Carrez a raison : l’affaire est jugée définitivement. Mais cela ne nous interdit pas de chercher à comprendre ce dossier très complexe. À l’issue de cette série d’auditions, nous avons du reste beaucoup appris et nous cernons sans doute mieux les raisons pour lesquelles le recours à l’arbitrage était inéluctable.
Je n’adhère certainement pas au principe selon lequel l’État n’aurait pas d’âge face aux citoyens. Je rejoins une grande part des propos de François Goulard mais le droit français ne permet pas d’amalgamer plusieurs dossiers. Si la personne concernée n’avait pas été Bernard Tapie, les yeux dans les yeux, je ne pense pas que nous aurions organisé ces auditions. Même si, s’agissant de Bernard Tapie, je suis gêné par l’évocation d’un préjudice moral, j’ai malheureusement le sentiment et même la conviction que les faits, sur le fond, plaident plutôt en sa faveur qu’en celle de l’État.
La deuxième série de questions posées par M. le président, à propos des structures de défaisance, est très intéressante. Je souhaiterais que l’on m’explique enfin les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là, que l’on m’explique cette série d’erreurs, à commencer par l’oubli de cocher une case, qui empêche le CDR de réclamer des intérêts. C’est tout simplement « abracadabrantesque » !
Enfin, contrairement à ce prétend François Bayrou, ce n’est pas Mme la ministre qui donne de l’argent à Bernard Tapie mais un tribunal arbitral. Pourquoi le CDR a-t-il finalement décidé de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal arbitral ?
M. Frédéric Lefebvre : Lors de l’installation de cette Commission, le président de la Commission avait précisé que nous n’avions pas à nous substituer aux juges. Cela n’empêche que, pour François Bayrou, les juges d’appel sont des imbéciles et les arbitres, magistrats pourtant incontestés, sont à la fois incompétents et partiaux.
M. Peyrelevade, lors de son audition, a avoué avoir pris part au portage, alors qu’il était président de l’UAP : il avait envisagé de couper les ponts avec M. Tapie – qu’il n’aimait pas, nous l’avons bien compris – mais il a maintenu la participation de l’UAP au portage, à la demande de M. Jean-Yves Haberer, après lui avoir parlé au téléphone. Gilles Carrez a aussi rappelé que M. Peyrelevade avait avoué l’existence du portage et avait même expliqué, à l’époque, comment il s’était déroulé – cela a d’ailleurs sans doute nourri le dossier des avocats de M. Tapie. À ce moment du débat, j’aimerais obtenir un éclaircissement essentiel de la ministre ou de M. Rocchi : matériellement, lors du débouclage de l’opération, qui a signé les chèques aux sociétés offshore des Îles Caïmans ? M. Haberer ou son successeur à la tête du Crédit Lyonnais ? J’imagine que le CDR connaît la réponse.
Mme Christine Lagarde : Cette affaire représente un montant certes important mais sans commune mesure avec les volumes supportés par le CDR pour solder le passif de dossiers divers et variés – dont certains se sont conclus par un arbitrage et d’autres ont donné lieu à des contentieux judiciaires – et de pratiques étonnantes de la part du Crédit Lyonnais : il est question d’environ 14,7 milliards d’euros.
M. Tapie a répondu devant vous à de très nombreuses questions, monsieur Cahuzac. De mémoire, il a justifié par son âge – soixante-cinq ans – la volonté de recourir à l’arbitrage, alors que ses avocats lui promettaient dix ans de procédure. À cet égard, monsieur de Courson, j’ai été extrêmement choqué par un commentaire rédigé sous votre plume, selon lequel l’État serait immunisé contre le passage du temps. Lorsque j’ai donné ces instructions, j’avais précisément ce souci du temps car il m’aurait semblé inconvenant que l’État se trouve condamné par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de son incapacité à rendre le droit dans des délais rapides.
Monsieur Bayrou, lorsque je donne mes instructions, le 10 octobre 2007, avant le conseil d’administration de l’EPFR, les plafonds concernant les dommages et intérêts comme le préjudice moral sont globalement négociés. Je ne me suis pas immiscée dans ces discussions, qui ont été conduites sous l’autorité du CDR. Il restait à arbitrer un ensemble de données : le cantonnement, les délais, l’application du code de procédure civile, la composition du tribunal arbitral et la possibilité de s’écarter d’un certain nombre d’éléments constitutifs de l’arrêt de la Cour de cassation, dont je maintiens qu’ils ouvraient la voie à un quantum bien supérieur devant la cour de renvoi.
Monsieur Lefebvre, j’ignore l’origine des chèques qui ont pu être signés au bénéfice de sociétés situées dans les Îles Caïmans ou tout autre paradis fiscal des Caraïbes. Je suggère que M. Rocchi apporte la réponse, s’il la connaît.
Le Président Didier Migaud : Je vous en prie, monsieur Rocchi.
M. Jean-François Rocchi : Je l’ai expliqué lors de ma propre audition, la partie adverse utilisait contre le CDR l’argument selon lequel la SDBO se serait appuyée sur des sociétés offshore pour loger des fonds, procédant ainsi à du portage. Nous avons contesté cette thèse devant tous les ordres de juridictions, tribunal arbitral inclus. Je suis incapable de dire qui aurait signé ces chèques puisque, même si nous avons été condamnés, nous soutenons pour notre part que c’est faux, que ces fonds n’étaient pas à nous.
M. François Goulard : Très bien !
Mme Christine Lagarde : Une fois la sentence rendue, je me suis évidemment interrogée sur l’opportunité d’exercer le recours en annulation. J’ai considéré que le CDR s’était engagé dans cet arbitrage par souci de rapidité, en particulier au regard du risque de saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. Un recours en annulation aurait allongé la procédure de trois ans au moins, à supposer qu’il puisse aboutir, plus trois ans supplémentaires au moins en cas de pourvoi devant la Cour de cassation. Le risque, pour l’État, n’était pas tant chiffrable que réputationnel.
J’ai également demandé des avis, qui, si je comprends bien, sont tous consultables sur le site de Mediapart. Le premier m’indiquait que le recours n’avait aucune chance d’aboutir. Les deux autres émanaient d’avocats au Conseil d’État. L’un concluait de même dans sa première version mais, par un raisonnement assez compliqué, considérait précautionneusement dans une seconde version qu’un motif de recours était susceptible de prospérer, à condition que la cour d’appel adopte un mode de raisonnement particulier, fondé sur l’article 1484 du code de procédure civile. L’autre ne laissait entrevoir aucun moyen. Tous les avocats consultés ont donc éliminé l’ensemble des motifs de recours, sauf un, retenu par un seul d’entre eux : le non-respect de la mission par les arbitres, en ce qu’il leur était demandé de respecter l’autorité de la chose jugée. Je livre cette consultation à la sagacité des juristes.
Franchement, au regard de l’argument du temps, de mes consultations et des compensations susceptibles d’être obtenues dans le cadre de la sentence arbitrale – en particulier la récupération des créances dues par les époux Tapie et BTF au CDR –, j’ai considéré qu’il était de l’intérêt de l’État de renoncer au recours en annulation.
J’ajoute que le professeur Clay, sans doute un ami des uns ou des autres…
M. François Bayrou : Monsieur le président, la Commission doit noter que cette affirmation, accompagnée d’un geste de la main dans ma direction, est extrêmement choquante. J’affirme avec force que je n’avais jamais rencontré M. Clay avant de le voir ici et que je ne l’ai pas rencontré depuis.
Mme Christine Lagarde : Ma main n’allait pas dans votre direction, soyez-en assuré.
M. René Couanau : L’expression est maladroite, madame la ministre ; nous avons moins d’amis que vous !
Mme Christine Lagarde : Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, monsieur le député. Je ne saurais mettre la compétence de M. Clay en cause et j’aurais plaisir à être son ami aussi.
Le Président Didier Migaud : Convenons que l’expression n’était guère heureuse.
M. Jérôme Chartier : Des expressions malheureuses fusent de part et d’autre ! Plusieurs propos tenus par François Bayrou m’ont choqué !
M. Jean-Pierre Brard : Voilà l’émissaire de l’Élysée !
Le Président Didier Migaud : Allons !
Mme Christine Lagarde : M. Clay indique lui-même qu’un recours en annulation n’aurait aucune chance de prospérer.
M. François Bayrou : Il recommande au contraire le recours en annulation.
M. Jérôme Cahuzac : Absolument !
Mme Christine Lagarde : Je n’étais pas présente lors de son audition.
Le Président Didier Migaud : Voici, pour résumer, ce qu’il avait dit : tierce opposition non ; recours en annulation, peut-être. Chacun peut se référer au compte rendu.
M. Charles de Courson : Je me félicite qu’une ministre vienne expliquer à la commission des Finances que la justice française est sujette à de graves dysfonctionnements et que des contentieux interminables aboutissent à la condamnation de l’État. Seulement, qui porte la responsabilité de l’extrême longueur de l’affaire dont nous parlons ? Bernard Tapie - c’est son droit – a multiplié les contentieux pour faire suspendre les décisions concernant ses autres affaires, au motif qu’elles étaient conditionnées par l’affaire Adidas. Il aurait par conséquent été mal placé pour intenter un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme ; je note d’ailleurs qu’il ne s’y est pas risqué.
Les trois notes distribuées aux membres de la Commission n’ont pas la signification que vous leur prêtez, madame la ministre.
Le cabinet Soltner, appuyé par le cabinet Martel – avocats du CDR, qui suivent l’affaire Tapie depuis des années –, était favorable au recours en annulation : « En conclusion, je considère que le CDR dispose d’un moyen d’annulation qui peut être qualifié de sérieux et qui pourrait d’autant plus emporter la conviction d’un collège de magistrats que l’on est en présence d’une atteinte à l’autorité de la chose jugée par la plus haute autorité judiciaire dans cette affaire, atteinte accompagnée au surplus d’appréciations péremptoires et d’erreurs de fait et de droit dont est par ailleurs émaillée la sentence. » Cette note est tout de même ravageuse !
Les deux autres ne concluent pas à l’absence de chance, c’est plus compliqué. Pour le cabinet Spinosi : « Dans un dossier qui excite à ce point les imaginations et sur lequel chacun projette ses fantasmes, il est impossible d’apprécier le facteur humain et la réaction des magistrats de la cour d’appel de Paris qui seraient appelés à en connaître, même dans les limites étroites du recours en annulation. Pour autant, l’orthodoxie juridique commande la plus grande prudence. La personnalité et le prestige des juges choisis ne sera pas le moindre des handicaps d’une telle action. » Enfin, pour le cabinet August & Debouzy : « Un recours en annulation sur le fondement de la violation par le tribunal arbitral de l’ordre public ou le dépassement par les arbitres de limites de leur mission pourrait théoriquement être envisagé, notamment sous l’angle de la violation par le tribunal de l’autorité de la chose jugé attachée aux décisions rendues dans cette affaire […]. Cependant, seule une violation flagrante de l’autorité de la chose jugée ou l’inconciliabilité manifeste entre la sentence et les décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée pourrait justifier l’annulation de la sentence. Compte tenu des termes de la sentence et sous réserve de l’analyse de nos confrères qui se focalisera particulièrement sur cette question, les possibilités d’annulation de la sentence arbitrale sur ce fondement nous semblent limitées. »
En tout cas, le recours en annulation n’est pas formellement déconseillé. Le principe constitutionnel de précaution aurait commandé d’y aller.
M. Jérôme Cahuzac : Je souscris à l’analyse de Charles de Courson : Bernard Tapie a invoqué le temps, avec des accents d’une sincérité douteuse, alors que c’est lui qui a multiplié les procédures ; il n’eût tenu qu’à lui qu’elles fussent plus courtes. Je trouve cet argument invraisemblable. Au demeurant, prétendre qu’il y en aurait eu pour dix ans de procédure supplémentaires alors qu’une nouvelle cour d’appel aurait été saisie, c’est manifester une bien faible confiance dans la justice. Je peux le comprendre de la part de Bernard Tapie mais, de la vôtre, madame la ministre, c’est surprenant.
Si sa situation était si favorable que vous le dites, son intérêt aurait été de continuer. C’est parce qu’elle ne l’était pas qu’il a changé de procédure, ce que vous avez malheureusement accepté.
Vous avez décidé d’abandonner la voie du recours à la fin de juillet alors que, d’après M. Clay, vous aviez jusqu’à la mi-août. Pourquoi n’avez-vous pas attendu la fin du délai ouvert ? Quinze jours de réflexions supplémentaires n’auraient pas été inutiles car 400 millions d’euros étaient en jeu.
Avez-vous parlé de l’option du recours avec le Président de la République ? Un de vos collaborateurs en a-t-il parlé avec l’un des collaborateurs du Président de la République ?
M. René Couanau : Si je comprends bien, les débiteurs publics sont indirectement financés par un prêt du Crédit Lyonnais – ce qui contribuera encore à faciliter la compréhension du grand public… Il arrivera bien un moment où le Parlement devra intervenir pour procéder à une inscription budgétaire ou pour donner une autorisation au ministère des finances. En l’absence de recours – ce que, pour ma part, je regrette –, il restera au Parlement la possibilité de donner son avis et de ne pas autoriser son versement. Mais je raisonne probablement de manière simpliste, monsieur le président. Avant de verser une indemnité quelconque, n’importe quel maire, président de conseil général ou président de conseil régional doit recueillir l’autorisation de son assemblée délibérative. Le Gouvernement laisserait faire l’arbitrage, n’interviendrait pas dans la fixation du plafond, donnerait instruction de ne pas intenter de recours et procéderait au versement financier à partir du budget de l’État sans que le Parlement puisse intervenir ?
Le Président Didier Migaud : C’est le Parlement qui vote le budget, mon cher collègue. Or le Parlement est composé du Sénat et de l’Assemblée nationale, dont vous êtes membre.
M. René Couanau : C’est la réponse que j’attendais !
M. Jérôme Chartier : Cette réponse est sympathique mais, chacun le sait, dès lors qu’une indemnisation devient définitive par décision de justice, le maire est tenu de l’inscrire au budget, sans quoi elle est mandatée d’office. Je crains que ce ne soit pas discutable.
M. François Goulard : Si, car l’État n’est pas une collectivité locale.
M. Jérôme Chartier : Nous y reviendrons.
L’un des avocats consultés a-t-il envisagé qu’un recours en annulation puisse aboutir à l’aggravation de la sentence arbitrale ?
M. Charles de Courson : Notre collègue Chartier a raison : faute de recours, l’État est tenu de payer. La vraie question, dorénavant, porte sur le financement de la première partie de la somme.
Quel est l’ordre de grandeur de la somme à payer ? Je rappelle que 197 ou 198 millions d’euros ont déjà été versés et que, compte tenu des dettes venant en déduction, d’après mes estimations, il reste quelque 60 millions.
Pourquoi, madame la ministre, avez-vous demandé à l’EPFR de s’endetter, à hauteur de 153 millions – auprès d’ailleurs du Crédit Lyonnais – pour payer cette somme ? J’avais pour ma part défendu une thèse plus conforme à l’orthodoxie financière : que l’État verse une dotation à l’EPFR, ce qui devra inéluctablement être fait un jour.
D’après vos estimations, combien restera-t-il, net d’impôt, c’est-à-dire après paiement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu ? Je précise que le débat ne porte que sur les 240 millions, les 45 millions étant exempts de fiscalité – à moins que nous ne modifiions la législation lors de l’examen de la loi de finances et que nous ne rendions imposables les indemnités pour préjudice moral supérieures à 1 million.
Mme Christine Lagarde : Monsieur Cahuzac, la durée des procédures n’est pas imputable uniquement au CDR ou à Bernard Tapie mais aux deux : des voies d’appel ont été formées par l’une et l’autre des parties, lorsque les décisions leur étaient défavorables.
La décision a été prise avant l’expiration du délai de recours car nous étions en juillet et il fallait pouvoir réunir les administrateurs avant leur départ en vacances.
Monsieur de Courson, voici les conclusions de l’avis de maître Spinosi, émis le 25 juillet : « Au terme de cette analyse, je ne peux être que très réservé quant aux chances de succès d’un recours en annulation, formé à l’encontre de la sentence du 7 juillet dernier, fondé sur la méconnaissance de la chose jugée par le tribunal. »
Quant à M. Thomas Clay, voici ce qu’il a déclaré, devant votre Commission, je crois : « S’agissant de la violation de l’autorité de la chose jugée, M. de Courson considère qu’il s’agit du cas le plus sérieux. Je ne partage pas cet avis, mais j’admets que la question est, de toutes, la plus délicate. La jurisprudence de la cour d’appel de Paris qui a eu à statuer sur le grief de violation de sa mission par l’arbitre n’a annulé les sentences que pour des violations flagrantes et considérables et je ne pense pas que l’on entre dans ce cas. » Je ne disposais pas de l’avis du professeur Clay lorsque j’ai pris ma décision mais je juge utile de le citer.
M. Charles de Courson : Mais M. Clay ajoutait : « Le quatrième moyen me semble plus intéressant. Il s’agit de la capacité de compromettre du CDR et, par là, de la validité de la convention d’arbitrage. » M. Clay n’est du reste pas le seul à considérer ce motif comme sérieux.
Mme Christine Lagarde : Le risque d’aggravation de la décision n’a pas été expressément évoqué dans les avis. Je ne consultais pas sur les avantages et inconvénients des effets d’un recours mais sur ses perspectives de succès.
J’ajoute au passage qu’il est excessivement rare qu’un avocat, aussi talentueux soit-il, émette un avis tout noir ou tout blanc. Il prend toujours de multiples précautions pour se prémunir, surtout dans l’hypothèse où il interviendrait en défense lors du recours.
Hormis le dépôt de bilan, je ne vois pas quelle serait l’alternative à l’emprunt bancaire. Une dotation est certes possible…
M. Charles de Courson : Vous ne m’avez pas compris, madame la ministre. Puisque l’État a accepté la sentence, il faut doter l’EPFR afin que le CDR puisse payer la note.
Mme Christine Lagarde : Traditionnellement, pour se financer, l’EPFR recourt à l’endettement. Je parle sous votre contrôle car vous en êtes administrateur depuis bien longtemps.
M. Charles de Courson : Il faudra bien un jour solder les dettes et en finir avec les structures de cantonnement. Quoi qu’il en soit, j’avais demandé au président de l’EPFR de vous écrire afin de solliciter des dotations pour 2009 et 2010, année où le solde sera vraisemblablement versé aux mandataires judiciaires. S’endetter revient à différer encore la constatation du coût, tendance que j’ai toujours combattue.
Mme Christine Lagarde : De toute façon, comme l’a réclamé la Cour des comptes, les structures de défaisance doivent arriver à leur terme. C’est dans cette perspective qu’il convient en effet de solder rapidement les comptes.
J’ignore le montant exact de la fiscalité pesant sur les sommes en question, hors préjudice moral. L’ordre de grandeur dont je dispose est tout à fait estimatif car les arbitres n’ont pas encore statué sur la date à laquelle doit être calculé le traitement fiscal. Mes services m’ont indiqué que, après déduction des impôts et des créances détenues par l’État, 30 millions d’euros devront être réglés au bénéfice des époux Tapie.
M. Charles de Courson : Page 20 de mon rapport, je donne une estimation de 130 millions d’euros. M. Tapie nous a affirmé qu’il ne lui restera que 20 à 40 millions mais s’est bien gardé de nous en donner le détail car il ne veut pas parler des 76 millions de nantissement des actions de BTF qui viennent en déduction. Madame la ministre, pouvez-vous demander le détail à vos services et nous le communiquer ?
Mme Christine Lagarde : Je vais me rapprocher des services d’Éric Woerth pour obtenir ces informations.
M. Jérôme Cahuzac : En décidant de ne pas faire appel, le CDR a-t-il défendu les intérêts du contribuable, qui paiera in fine cette somme de près de 400 millions d’euros ?
Compte tenu du montant astronomique de la sentence arbitrale, avez-vous parlé avec le Président de la République de votre décision de ne pas faire appel ?
Mme Christine Lagarde : Je vous réponds exactement la même chose que pour le choix de l’arbitrage : non.
M. Jérôme Cahuzac : L’un de vos collaborateurs en a-t-il parlé avec l’un des collaborateurs du Président de la République ?
Mme Christine Lagarde : Je vous réponds comme tout à l’heure : je ne les ai pas soumis à la question. Ils font régulièrement le point avec les autres cabinets, en réunions interministérielles, sous l’autorité du secrétariat général du Gouvernement et du directeur de cabinet du Premier ministre. Si une instruction avait été donnée, elle m’aurait été transmise et je m’en serais émue.
M. Jérôme Cahuzac : Puis-je en déduire que vous n’excluez pas qu’un de vos collaborateurs ait pu en parler avec un des collaborateurs du Président de la République ? Pas moins de 400 millions d’euros, c’est un sujet élyséen.
Mme Christine Lagarde : Compte tenu des 15 milliards d’euros pesant sur les épaules du contribuable français du fait de la gestion exercée par le Crédit Lyonnais dans les années quatre-vingt-dix, au regard du temps passé, des coûts engendrés, des passions animant les uns et les autres, ainsi que du libellé de l’arrêt de la Cour de cassation, je persiste à penser que le choix de l’arbitrage puis la renonciation à exercer un recours en annulation ont été de bonnes décisions.
Le Président Didier Migaud : Madame la ministre, je vous remercie.
——fpfp——
Mardi 14 septembre 2010, séance de 16 heures 15 (compte rendu n° 103)
– Communication du Président sur les travaux de la Commission relatifs au contentieux entre le Consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard Tapie
La Commission entend une communication de M. le président concernant les travaux de la Commission relatifs au contentieux entre le consortium de réalisation (CDR) et le groupe Bernard-Tapie.
M. le président Jérôme Cahuzac. En septembre 2008, la Commission a procédé à huit auditions sur le sujet, la dernière ayant été celle de Mme Christine Lagarde, ministre de l'Économie.
À l'issue de ces auditions, les groupes ont été invités à fournir – et, pour trois d'entre eux, ont fourni – leur contribution aux fins de publication d'un rapport d'information regroupant la communication qu'avait faite Charles de Courson, représentant l'Assemblée nationale au conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration – EPFR –, ainsi que le compte rendu des auditions réalisées.
Mon prédécesseur, suivi par la Commission, avait souhaité que ce rapport fasse également état des réponses aux questions restant en suspens, concernant notamment le calcul des intérêts sur les sommes incombant à l'État, les frais de liquidation et le traitement fiscal des indemnités versées au groupe Bernard-Tapie.
Aujourd'hui, la somme brute due par l'État est connue : compte tenu du montant des intérêts, elle s’élève à 403 millions d’euros. Après déduction d'une franchise de 12 millions d'euros prise en charge par les liquidateurs et de la créance du CDR, pour un montant de 87 millions d'euros, le versement net fait au liquidateur du groupe est de 304 millions d'euros. Sur cette somme doivent s'imputer des frais et dettes diverses.
Au total, qu'est-il revenu aux époux Tapie ? En d’autres termes, quel est le « reliquat disponible » ?
Lors de son audition par la Commission le 23 septembre 2008, la ministre de l'Économie, Mme Christine Lagarde, indiquait : « J'ignore le montant exact de la fiscalité pesant sur les sommes en question, hors préjudice moral. » Je rappelle que les époux Tapie ont reçu au titre du préjudice moral un chèque de 45 millions d’euros, somme jamais atteinte dans notre pays. « L'ordre de grandeur dont je dispose », poursuivait la ministre, « est tout à fait estimatif car les arbitres n'ont pas encore statué sur la date à laquelle doit être calculé le traitement fiscal. Mes services m'ont indiqué que, après déduction des impôts et créances détenus par l'État, 30 millions d'euros devront être réglés au bénéfice des époux Tapie. »
Les diverses demandes adressées par mon prédécesseur – les 28 juillet et 24 novembre 2009 – et moi-même – le 10 juin 2010 – à la ministre de l'Économie et au ministre du Budget, afin d'obtenir des informations destinées à être rendues publiques, sont restées sans réponse.
Récemment, à partir de bribes d'informations livrées par les uns et les autres, de recoupements et de calculs tenant compte de frais d'avocats, de dettes bancaires, d'arriérés fiscaux d'un groupe qui a repris son activité – la liquidation n’ayant pas été prononcée, l'avocat de M. Bernard Tapie faisant référence aux actifs désormais conservés par une holding qui ne donneraient pas lieu à fiscalisation –, un organe de presse est parvenu à une estimation de 210 millions d'euros.
Pour ma part, à partir des informations dont j'ai pu avoir connaissance – et que j’ai dû, pour la plupart d’entre elles, aller consulter moi-même à Bercy –, j’estime le reliquat disponible des époux Tapie à 220 millions d’euros dans une hypothèse basse. La méthode de calcul, consistant à faire masse de l’ensemble des dettes des époux Tapie et ne préjugeant pas de la dette fiscale – ce qui serait contraire au secret fiscal auquel je suis astreint –, est la même que celle de la ministre de l’Économie.
J'ai adressé le 9 septembre 2010 à Mme Lagarde un courrier aux termes duquel je lui demande de prendre enfin position par rapport à cette estimation. Dans sa réponse, qui m'est parvenue ce matin, la ministre reconnaît implicitement que l'estimation qui peut être faite des sommes revenant in fine aux époux Tapie est différente de celle qu'elle avait donnée en septembre 2008 dans la mesure où, entre-temps, les décisions de mise en liquidation des sociétés du groupe Tapie ont été rétractées. Cette explication d'une modification de l'estimation est évidemment recevable mais n'est pas accompagnée d'un nouveau chiffrage.
Je me propose d'écrire ce jour à M. Bernard Tapie pour lui demander de nous faire part, conformément à l'engagement qu'il avait réitéré devant notre Commission le 10 septembre 2008 – « Je me suis engagé formellement à donner le chiffre précis de ce qui me restera en fin de compte et je n'ai aucune raison d'en avoir honte », avait-il déclaré –, des sommes qui restent à sa disposition, après déduction des dettes et frais.
Si la Commission en est d’accord – comme c’est le cas du Bureau, consulté il y a quelques jours –, nous pourrons ensuite procéder à la publication d'un rapport d'information qui reprendrait donc, comme initialement prévu, la communication de Charles de Courson et le compte rendu des auditions de septembre 2008, les propositions de la Commission concernant le recours à l'arbitrage par les personnes publiques, l’opportunité et le fonctionnement des structures de défaisance, auxquels s’ajouteraient le texte des courriers adressés par mon prédécesseur et moi-même aux ministres, le courrier transmis par Mme Lagarde, la réponse de M. Bernard Tapie si celui-ci me la fait parvenir, ainsi que les contributions des groupes, qui devront être actualisées.
Pour ma part, je souhaiterais que cette publication se fasse dans des délais assez brefs. Comme je l’ai indiqué au Bureau, il me semble nécessaire que la commission des Finances clôture cette affaire en publiant son estimation du reliquat disponible. Le reste
– opportunité de la saisine du tribunal arbitral, nature du jugement de ce même tribunal, traitement fiscal ayant pu être réservé aux sommes versées – a déjà fait l’objet de débats, mais je comprendrais que certains souhaitent y revenir, ne serait-ce que pour mémoire.
M. Louis Giscard d'Estaing. Le reliquat en question concerne l’affaire Adidas, laquelle était portée par le Crédit lyonnais. Tous les Français savent que les affaires liées à cet établissement bancaire alors national, à une époque où l’actuelle majorité n’était pas aux affaires, ont coûté 100 milliards de francs au total.
Je trouve extraordinaires ces développements autour du montant qui revient à M. Tapie compte tenu de décisions de justice. Souvenez-vous, mes chers collègues, des circonstances de la procédure : M. Tapie a estimé que le Crédit lyonnais, qui avait porté pour lui les actions Adidas, avait réalisé une plus-value à son détriment. Néanmoins, malgré cette plus-value, la banque s’est retrouvée en quasi-faillite. L’affaire Adidas aura donc été doublement mauvaise pour les contribuables : d’une part, la plus-value n’aura pas permis de renflouer le Crédit lyonnais et, d’autre part, alors que le CDR était chargé de liquider les actifs afin de régler les contentieux, la sentence arbitrale a été rendue au bénéfice de M. Tapie.
Cela dit, si vous voulez relancer le débat sur l’ensemble de l’affaire du Crédit lyonnais, nous sommes à votre disposition.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je l’ai dit lors de la réunion du Bureau, à laquelle vous assistiez, et je le répète : ce dossier a été ouvert par la commission des Finances à l’initiative de mon prédécesseur, et je souhaite le clôturer, ce qui ne peut être fait que si nous avons connaissance du reliquat disponible. J’ai indiqué quelle était mon estimation. Je regrette que Mme Lagarde se refuse à donner la sienne. Dans le courrier qu’elle m’a adressé – et dont je vous communiquerai la copie –, elle suggère que les parlementaires saisissent les juridictions compétentes afin de savoir ce qu’est le reliquat disponible. Mon sentiment, que l’on est libre de ne pas partager, est qu’il n’est pas acceptable qu’un ministre réponde de cette façon aux questions de parlementaires.
M. Henri Emmanuelli. M. Giscard d’Estaing retrace l’affaire du Crédit lyonnais à sa manière. Permettez-moi de rappeler les conclusions de la commission d’enquête parlementaire présidée par Philippe Séguin et dont je faisais partie : in fine, plus que les déboires du Crédit lyonnais, c’est l’idée géniale de créer une structure de défaisance qui a démultiplié les dettes. Les choses étaient plus compliquées qu’on ne le racontait dans les journaux – y compris au sujet de la responsabilité des dirigeants de l’époque et du gouverneur de la Banque de France, sous la tutelle de laquelle le Crédit lyonnais était placé –, à tel point que les membres de cette commission ont été embarrassés pour conclure. Évitons les raccourcis !
Ce qui est choquant, en l’occurrence, c’est que M. Tapie a perdu deux fois devant la justice de ce pays, qu’il est peu probable que le résultat d’une nouvelle décision judiciaire eût été différent et que seule la décision du Gouvernement de recourir à une procédure arbitrale lui a redonné la main. Balayer ces éléments d’un élégant revers de main et les renvoyer à l’affaire du Crédit lyonnais me paraît simpliste.
Pour ma part, je souhaiterais connaître exactement – comme nous en avons le droit – ce que va toucher M. Tapie. C’est en fonction de cette information que je pourrai dire si, à mes yeux, l’affaire est close ou non. Pour l’instant, elle est loin de l’être !
M. Charles de Courson. Dans le cadre du CDR – qui touche à sa fin –, l’affaire Adidas est une affaire parmi d’autres. Je confirme que le coût total pour le contribuable aura été de 15 milliards d’euros.
M. Henri Emmanuelli. Et la défaisance représente les deux tiers de ce montant !
M. Charles de Courson. On connaît maintenant ce qui s’est passé au Crédit lyonnais : une dérive complète – comme si l’établissement n’était plus une banque et confondait subventions et prêts –, des prises de risque ahurissantes, les affaires américaines, les jeux sur les obligations pourries, les magouilles en tous genres avec sociétés écrans aux Bahamas. Certes, la plupart des banques ont joué à ce jeu, mais on a atteint là un niveau incroyable. Y avait-il un État, y avait-il des ministres qui contrôlaient le secteur bancaire ?
M. Henri Emmanuelli. Y avait-il un gouverneur de la Banque de France ?
M. Charles de Courson. Un deuxième point doit nous servir de leçon : ne créons plus jamais de structure de défaisance ! Ç’a été une catastrophe d’isoler les équipes qui avaient géré ces affaires de la structure de défaisance : la coupure a coûté encore plus cher.
Pour en revenir à l’affaire Tapie – quelques centaines de millions d’euros sur les 15 milliards –, je me suis battu pendant des années pour persuader les gouvernants de tenir bon et de laisser la justice faire son œuvre. Alors qu’il y avait une annulation partielle en cassation et un renvoi devant la cour d’appel, au terme d’une procédure de plus de dix ans, une décision politique est intervenue. Mme Lagarde a reconnu ici même qu’elle avait donné consigne aux trois représentants de l’État au conseil d’administration de l’EPFR de ne pas s’opposer à la demande d’arbitrage.
Je suis persuadé qu’il aurait coûté moins cher au contribuable de laisser la procédure aller jusqu’au bout. En outre, au risque de choquer, je pense que le choix des trois juges arbitres a été une catastrophe. Un ancien magistrat, âgé de plus de quatre-vingts ans qui avait été juge arbitre dans des affaires douteuses ; notre estimable collègue, passé par le Conseil constitutionnel, n’avait pas de compétence particulière en droit des affaires et a touché des honoraires fort confortables ; il n’était pas raisonnable non plus de choisir Jean-Denis Bredin alors que celui-ci avait été vice-président d’un parti qui sera présidé plus tard par Bernard Tapie.
Cela étant, la décision arbitrale a été rendue et a force de loi. À titre personnel, je l’ai attaquée, car j’estime que, si cette jurisprudence est établie et si l’on ne met pas le holà à la possibilité d’arbitrer, tous les gouvernements auront recours au procédé consistant à créer deux structures, un établissement public et une filiale sous la forme d’une société de droit privé, et à faire procéder à un arbitrage via cette société privée, puisque l’État lui-même ne peut arbitrer sans loi, c'est-à-dire sans l’autorisation des parlementaires. La réforme promise en la matière est urgente.
J’ai perdu mon recours devant le tribunal administratif de Paris et j’attends la décision de la cour administrative d’appel. Si la première décision était confirmée en appel et en Conseil d’État, cela signifierait qu’il est considéré qu’il n’y a pas eu de détournement de la règle de l’interdiction pour l’État d’avoir recours à l’arbitre. Mais s’il suffit de créer une filiale à 100 % de l’établissement public et administratif, c'est-à-dire une société privée qui, elle, a le droit de recourir à un arbitrage, tous les gouvernements vont réaliser de tels montages pour contourner la contrainte législative. Si la règle existe depuis plus d’un siècle, c’est parce qu’il est extrêmement dangereux de donner la possibilité à un ministre d’arbitrer et de soulever ainsi des soupçons de copinage. Généraliser le droit d’arbitrage serait une catastrophe pour la démocratie.
J’en viens à la question posée par tous les citoyens et qui ne relève pas du secret fiscal : il s’agit de savoir non pas combien les époux Tapie ont touché, mais de combien ils se sont enrichis.
Il y a d’abord le scandale des 45 millions d’euros totalement exonérés que l’on a versés à Bernard Tapie au titre du préjudice moral. Par un amendement hélas repoussé, je vous avais proposé de fixer un seuil à un million au-delà duquel la somme était taxable et cotisable, afin que les arbitres ne se mettent pas, à l’avenir, à transformer des indemnités de droit commun en préjudice moral.
Quand aux 200 et quelques millions d’euros, ils ont été versés à la société en nom collectif Groupe Bernard-Tapie, laquelle a acquitté, semble-t-il, de 20 à 25 millions d’impôt. Cela étant, Bernard Tapie est désormais actionnaire à 100 % de cette société. S’il n’a pas touché directement le montant versé, il s’est néanmoins enrichi à proportion, comme je l’avais souligné dans mon rapport pour la Commission.
Sur le plan fiscal, une société en nom collectif peut opter entre l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés. Il est vraisemblable que Bernard Tapie, apprenant qu’il allait toucher cette somme, a opté pour l’IS. Pour ma part, j’avais fait l’hypothèse de la dissolution de cette société et la distribution du boni de liquidation aux actionnaires, ce qui aurait permis une taxation plus importante. C’est ce qui explique l’écart entre mon estimation nette d’impôts des époux Tapie et la réalité.
J’en viens aux interrogations de la presse au sujet de l’ISF et du bouclier fiscal. Les 45 millions d’euros sont un actif évidemment assujetti à l’ISF. De plus, dans la mesure où Bernard Tapie avait été mis en faillite personnelle, la société dont il était actionnaire ne pouvait être considérée comme un outil de travail. Mais, du fait de l’annulation de différentes décisions de justice, il peut désormais redevenir président-directeur général de GBT et cette société être de nouveau considérée comme un outil de travail exonéré de l’ISF.
Pour ce qui est du bouclier fiscal, le bon sens laisse à penser que Bernard Tapie en bénéficiera.
Lors de l’audition de Mme Lagarde il y a deux ans, j’avais opposé mon estimation de 200 millions d’euros à la sienne, qui n’était que de 30 millions. À ma demande d’explication, elle avait répondu que c’était la somme après impôts et prélèvements – d’ailleurs, Bernard Tapie avait surenchéri devant la presse en affirmant qu’il ne lui resterait que vingt millions d’euros : bref, pas même de quoi vivre ! – et qu’elle adresserait par écrit à la Commission le détail du calcul. Deux ans plus tard, nous attendons toujours !
M. le président Jérôme Cahuzac. Pour leur information, tous les commissaires recevront communication de la lettre que j’ai reçue. Après des développements peu en rapport, de mon point de vue, avec la question du reliquat disponible, les deux dernières phrases sont ainsi rédigées : « Il n’est donc pas de ma compétence de vous fournir les éléments à cet égard. Il vous appartient d’engager, dans le respect des textes en vigueur, les procédures pertinentes afin d’obtenir des juridictions compétentes les informations qui seraient utiles aux travaux de la commission que vous présidez. »
Autrement dit, le ministre à qui nous demandons des comptes nous renvoie à l’ordre judiciaire pour obtenir des éléments qu’habituellement le pouvoir exécutif transmet au Parlement lorsque celui-ci les demande.
M. Charles de Courson. À l’EPFR, le CDR m’a fait une réponse similaire : il pouvait indiquer le montant qu’il avait payé – celui qui figure dans mon rapport –, mais renvoyait ensuite aux administrateurs du groupe, alors en faillite. Il aurait fallu, pour ce faire, que le président de la Commission saisisse le garde des sceaux.
Par ailleurs, le débat ne porte pas sur le secret fiscal : il s’agit de savoir de combien s’est accru le patrimoine des époux Tapie du fait de l’arbitrage. Le Gouvernement a les moyens de faire ce calcul.
M. le président Jérôme Cahuzac. Lorsqu’il était ministre du Budget, M. Éric Woerth avait affirmé ne pouvoir donner d’indications sur le reliquat disponible sans trahir le secret fiscal. Je ne crois pas que cet argument soit recevable. Lors de son audition, Mme Lagarde avait donné un chiffre en faisant masse de l’ensemble des dettes, ce qui ne préjuge pas de la dette fiscale en elle-même. Elle pourrait faire de même aujourd'hui.
En cette période de préparation budgétaire, le calendrier est très chargé et il me paraît compliqué d’organiser une réunion de la Commission dédiée à ce sujet,…
M. Henri Emmanuelli. Nous, nous en demandons une !
M. le président Jérôme Cahuzac. …à moins que le Bureau ne le souhaite, bien entendu. Quoi qu’il en soit, notre Commission aura prochainement l’occasion d’entendre Mme Lagarde sur d’autres sujets et il sera loisible aux parlementaires de l’interroger sur ce point.
M. Pierre-Alain Muet. Je partage entièrement les brillantes analyses de M. de Courson. Il me semble difficile de clore le sujet sans disposer de la réponse de Mme Lagarde, que celle-ci pourrait nous donner au cours d’une audition. La Commission doit avoir l’avis de l’exécutif au sujet d’une affaire où celui-ci a joué un certain rôle !
M. le président Jérôme Cahuzac. Je pourrai réunir le Bureau dans les meilleurs délais afin de décider éventuellement du principe d’une convocation de Mme Lagarde.
M. Olivier Carré. Le chiffre de 210 millions d’euros correspond-il à une estimation ou a-t-il été constaté quelque part ?
M. le président Jérôme Cahuzac. M. de Courson a réalisé en son temps une estimation qui se trouve corroborée par ce que j’ai observé en me rendant sur place pour consulter les pièces afférentes au dossier. Selon moi, l’estimation basse est de 220 millions d’euros.
M. Henri Emmanuelli. C’est la première fois que je vois un ministre refuser ainsi de répondre. Je souhaite que Mme Lagarde soit convoquée pour nous rendre compte de ce qui est bien, in fine, la conséquence de décisions prises par le pouvoir exécutif. Elle ne peut s’en sortir en nous renvoyant devant les juridictions !
M. Alain Rodet. Je me rappelle qu’en 1994, au cours des auditions que notre Commission menait pour examiner cette affaire, nous avions mis en évidence que les créances douteuses contractées par le groupe Hersant avaient eu un fort impact sur la situation du Crédit lyonnais.
M. le président Jérôme Cahuzac. La question à l’ordre du jour est celle du reliquat disponible pour les époux Tapie. Par le passé, de nombreuses auditions nous ont donné l’occasion d’évoquer de façon complète l’affaire du Crédit lyonnais et le coût du CDR. Je ne crois pas utile que nous relancions le débat : chacun s’est fait son jugement, peu susceptible d’être modifié par le jugement des autres.
Pour ce qui est de la question posée par M. Emmanuelli, je me tourne vers le rapporteur général, puisque c’est en concertation avec lui que les travaux sont organisés. Je comprends la demande formulée par notre collègue au regard de la lettre de la ministre. Je ne souhaite pas imposer une convocation à laquelle une forte majorité de commissaires s’opposerait, mais il me semble difficile d’exclure un rendez-vous qui se déroulerait à huis clos et au cours duquel nous demanderions à Mme Lagarde des informations plus affinées et plus raisonnables. Certains d’entre vous, mes chers collègues, s’opposent-ils explicitement à une audition consacrée à ce sujet précis – sachant que le débat sur le Crédit lyonnais et le CDR est purgé et que nous n’avons plus à l’avoir ?
M. Richard Dell'Agnola. C’est tout ou rien !
M. le président Jérôme Cahuzac. La logique du « tout ou rien » est rarement raisonnable et souvent suicidaire !
M. Nicolas Perruchot. L’affaire est importante ; les éléments nouveaux dont nous avons connaissance aujourd'hui le sont également. Il me semble que le Bureau pourrait aussi se pencher sur la possibilité d’auditionner Bernard Tapie : lui, au moins, sait ce qu’il a touché !
M. le président Jérôme Cahuzac. Une précision : j’ai reçu l’accord du Bureau pour interroger M. Tapie par écrit sur ce qu’il estime être l’ « enrichissement supplémentaire », selon la formule de M. de Courson, ou le « reliquat disponible », selon la mienne, résultant de l’arbitrage. S’il nous fournit une réponse suffisamment fondée, est-il indispensable de lui demander de venir devant nous ?
En revanche, l’éventualité d’une convocation de Mme Lagarde repose sur un fait nouveau : l’impossibilité d’obtenir par écrit une estimation chiffrée de sa part ; pis, un refus implicite de communiquer cette estimation et un renvoi vers les instances judiciaires. Je ne crois pas que cette méthode soit acceptable.
Si M. Tapie refusait de répondre, sa convocation deviendrait inévitable, mais, en cas de réponse de sa part, il ne me semble pas indispensable de l’inviter à rééditer l’exercice auquel il s’est livré devant nous.
M. Jean-Pierre Brard. M. de Courson a fait un exposé très clair et très complet. La lettre que la ministre vous a adressée, monsieur le président, constitue une humiliation pour le Parlement. Dans d’autres grands pays – en Grande-Bretagne, par exemple –, le secret fiscal n’est pas opposable aux parlementaires. Il l’est en France, sauf pour le président de la commission des Finances et le rapporteur général du budget.
Il est de salubrité publique de refermer ce dossier rapidement afin de ne pas ajouter à la déliquescence actuelle. C’est pourquoi je ne suis pas favorable à une audition de Bernard Tapie : étant donné ses aptitudes à mentir et à jouer la comédie, il en sortira en héros.
En revanche, le refus de répondre de la ministre constitue un élément nouveau, alors même que les éléments qu’elle devra bien nous fournir un jour sont déjà plus ou moins sur la place publique.
Un ministre doit déférer au Parlement : c’est l’esprit de nos institutions. Je pense donc que Mme Lagarde doit être auditionnée. Renvoyer les parlementaires aux juridictions pour recueillir des informations qu’elle-même doit leur fournir est inadmissible !
M. Richard Dell'Agnola. Je n’étais pas membre de la commission des Finances à l’époque mais, à mon sens, nous devrions rester à équidistance : s’il faut entendre Mme Lagarde, il faut aussi entendre M. Tapie. Et pourquoi pas M. Haberer, d’ailleurs ? Si l’on veut élucider l’affaire, il conviendrait de refaire un point précis.
M. le président Jérôme Cahuzac. Que les choses soient claires : je ne referai pas ce qui a été fait il y a deux ans. Je vous invite à lire le compte rendu des auditions que nous avons menées. Il est inutile de demander aux personnes entendues de revenir nous dire la même chose ! Une nouvelle convocation ne se justifierait que dans l’hypothèse où elle apporterait un élément nouveau. Or la seule information manquante pour la publication du rapport concerne le reliquat disponible. Mme Lagarde refuse de la donner au Parlement. C’est pourquoi une audition de la ministre me semble envisageable.
Concernant M. Tapie, j’ai déjà indiqué que je lui enverrai un courrier. Je propose de n’envisager une convocation que si nous jugeons la réponse insatisfaisante. Mais je juge très prématuré d’envisager aujourd'hui, au nom de je ne sais quel équilibre, de relancer une série d’auditions – à moins que cette perspective ne soit précisément avancée pour empêcher toute audition !
M. Richard Dell'Agnola. Il ne s’agit en aucun cas d’empêcher des auditions !
En tant que président de la commission des Finances, vous avez accès à tous les documents fiscaux. C’est d’ailleurs ce qui vous a permis de fournir votre estimation du reliquat disponible. Personne n’oppose de secret fiscal dans cette affaire. Il faut rester raisonnable !
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je partage la position du Président : nous n’allons pas réitérer les auditions que nous avons menées il y a deux ans.
À l’époque, Charles de Courson m’avait convaincu que le recours à l’arbitrage avait été une erreur. Or, à l’issue de ces auditions, mon sentiment était au contraire que la décision de la Cour de cassation risquait de rouvrir les procédures judiciaires et exposait à de grands dangers.
Alors qu’une échéance importante, la loi de finances pour 2011, attend la Commission, le Bureau a décidé unanimement de passer par une procédure écrite avec la ministre et avec M. Tapie pour clore enfin cette malheureuse affaire. La lettre de la ministre, dont je prends connaissance à l’instant, ne me paraît certes pas satisfaisante. Pour autant, je ne crois pas que cela justifie une audition. La procédure d’arbitrage a eu lieu, les indemnités ont été versées. À ce stade, l’important est que le président et moi-même obtenions des données précises concernant le traitement fiscal et social de ces indemnités. M. de Courson a très bien mis en évidence les problèmes que posent l’appréciation et la définition des biens professionnels, compte tenu du montage en SNC et de la situation de Bernard Tapie.
Je propose donc que nous exigions conjointement de Bercy tous les éléments à ce sujet.
M. le président Jérôme Cahuzac. Ce travail a été fait. J’ai reçu lundi un courrier du ministre du budget et je pensais qu’un double vous en avait été adressé, comme c’est le cas ordinairement. Bien entendu, je vous en donnerai copie dans la journée et vous pourrez prendre connaissance du traitement fiscal dont les avoirs des époux Tapie ont fait l’objet.
Il n’en demeure pas moins que l’enrichissement supplémentaire est selon moi de 220 millions d’euros selon une estimation basse et qu’il est parfaitement regrettable que Mme Lagarde, sollicitée à quatre reprises par deux présidents de la commission des Finances, n’ait pas jugé bon de répondre précisément et ait même opposé une fin de non-recevoir en renvoyant les parlementaires devant les instances judiciaires. Certains peuvent faire semblant de trouver cela normal, mais je suis sûr qu’en leur for intérieur ils ne le jugent pas ainsi.
Comme convenu, j’envoie un courrier à M. Bernard Tapie. Vous aurez communication de sa réponse, comme de la réponse de Mme Lagarde. Nous évoquerons ensuite l’hypothèse de nouvelles auditions.
Les propos que nous venons d’échanger feront l’objet d’un compte rendu qui sera rendu public.
Mardi 8 février 2011, séance de 16 heures 15 (compte rendu n° 53)
– Communication de M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR)
La Commission entend la communication de M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’Établissement public de financement et de restructuration (EPFR).
M. le président Jérôme Cahuzac. Nous allons entendre la communication qu’a souhaité présenter M. Charles de Courson, représentant de l’Assemblée nationale au conseil d’administration de l’établissement public de financement et de restructuration (EPFR) depuis 2002. Ce souhait est légitime : il convient que notre Commission soit régulièrement informée de l’activité de l’établissement public chargé de gérer le soutien de l’État au Crédit Lyonnais dans le cadre du cantonnement de ses actifs mis en place par le protocole de 1995. Je présume que Charles de Courson ne se bornera pas à un compte rendu descriptif des activités de l’EPFR. Il souhaitera sans doute nous informer sur les actions contentieuses qu’il a engagées à titre personnel pour tenter de faire trancher la question de la capacité juridique du consortium de réalisation à compromettre. Chacun se souvient à la suite de nos auditions de la fin 2008 que cette question était un sujet de débat sur l’un des dossiers symboliquement et politiquement les plus lourds du CDR : l’affaire « Adidas–Tapie ».
Il se trouve que nous venons de recevoir le référé de la Cour des comptes que nous attendions, concernant la défaisance du Crédit Lyonnais, référé extrêmement intéressant qui procède à bon nombre de mises au point utiles. La Cour y fait notamment état de ces contentieux, et lève des points que la commission avait mentionnés. Nous attendons pour la semaine prochaine un dernier document de la Cour des comptes : un rapport particulier sur l’EPFR.
La communication de notre collègue nous donnera peut-être l’occasion de procéder
– enfin – à la publication du rapport par lequel notre Commission devait regrouper le compte rendu de ses auditions depuis septembre 2008, accompagné des prises de position des groupes, de nos recommandations de méthode en cas de défaisance et de divers courriers permettant de compléter l’information de nos concitoyens.
Comme je l’ai rappelé au cours de notre réunion du 14 septembre dernier, mon prédécesseur, suivi par notre Commission, avait souhaité que le rapport contienne les réponses aux questions en suspens, en particulier sur les sommes revenant aux époux Tapie. Ce n’est qu’en septembre dernier que nous avons reçu les réponses que nous attendions. Mais la réponse du ministre du Budget, François Baroin, qui précisait le montant de la dette fiscale des époux Tapie, apportant le dernier paramètre de calcul, est couverte naturellement par le secret fiscal. La réponse de Mme Christine Lagarde ne donne aucun élément d’appréciation, renvoyant les parlementaires à la saisine des juridictions compétentes s’ils estiment ses réponses insatisfaisantes.
Nous pourrons sans doute, à brève échéance, prévoir de clore ce cycle de nos travaux et de publier notre rapport d’information.
M. Charles de Courson. Il me semble en effet utile de faire, comme chaque année depuis 7 ou 8 ans, un compte rendu de mon mandat. Le rapport d’activité se divise en trois parties. La première décrit l’organisation du cantonnement des actifs du Crédit lyonnais. La deuxième partie est consacrée à la mission de surveillance de l’EPFR, et la troisième à sa mission de financement. Aujourd’hui, je commenterai également le référé de la Cour qui porte sur six points, ainsi que la réponse du Gouvernement.
Le bilan de l’EPFR est le suivant à fin 2009. À l’actif, il ne reste quasiment rien : les disponibilités, qui s’élevaient à 974 millions d’euros en 2004, sont tombées à 104 millions d’euros à fin 2008, 106 à fin 2009. Il reste 3 millions d’immobilisations et 5 millions de créances en valeur nette comptable. Au passif, il ne reste que des dettes, soit 4,4 milliards d’euros à la fin 2009 correspondant aux différentes tranches de l’emprunt auprès du Crédit Lyonnais encore en vigueur. Je vais me concentrer sur les « risques non chiffrables », qui sont liés à des contentieux dont il est difficile d’évaluer le coût – actions en comblement de passif, en soutien abusif, en responsabilité ou autres – ou à des garanties de passif accordées par le CDR. L’EPFR garantit ces risques à 100 %.
Les dossiers de risques non chiffrables en suspens sont au nombre de cinq.
L’affaire Executive Life, extrêmement complexe, rebondit périodiquement car, outre la transaction pénale effectuée avec le Parquet fédéral de Californie, il reste que de nouveaux intervenants, plusieurs groupements américains, demandent des indemnités importantes, sur la base du bénéfice qu’ils auraient pu réaliser si le Crédit lyonnais n’avait pas fait un montage illégal du point de vue du droit américain.
Cette affaire suit son cours. Il a déjà été déboursé 650 millions de dollars, ce qui doit permettre d’éviter une nouvelle phase, celle du jugement par un tribunal dans sa forme de jury populaire. La situation reste extrêmement difficile.
Le deuxième dossier de risque non chiffrable est celui d’AIG contre le CDR, car en marge de l’affaire Executive Life, se sont développées d’autres actions engagées par AIG venant aux droits de la société SunAmerica, actionnaire minoritaire d’Aurora, nouvelle dénomination d’Executive Life. Là encore, il s’agit de demandes fondées sur un manque à gagner ; et on assiste à maints recours et renvois. La situation est délicate et l’on est tenté de composer, car, compte tenu de la jurisprudence américaine en ce domaine, une condamnation pourrait se traduire par une indemnisation jusqu’à trois fois le profit non réalisé du fait du montage illégal.
Le troisième dossier est celui du groupe Adidas. Le CDR a été condamné par le tribunal arbitral à verser 240 millions d’euros aux mandataires liquidateurs de la SNC GBT, 45 millions d’euros au titre du préjudice moral des époux Tapie, 105 millions d’euros au titre des intérêts légaux sur préjudice matériel, 13 millions enfin au titre des « frais de liquidation » déjà encourus. Le montant de 45 millions d’euros versés aux époux Tapie au titre du préjudice moral est bien une première dans l’histoire des juridictions ! En effet, l’avantage de cette indemnisation, très profitable aux époux Tapie, est qu’elle est exonérée de tout impôt. En outre, les 260 millions d’euros ont été versés à une entreprise du groupe qui portait les titres Adidas, dont Bernard Tapie est propriétaire à 98 %. Après paiement des impôts de l’entreprise, ce dernier a dû conserver environ 170 millions d’euros, qui ne sont pas taxés à l’impôt sur le revenu tant qu’il ne dissout pas l’entreprise. Au total, le patrimoine des époux Tapie a dû s’accroître d’environ 215 millions d’euros.
M. le président Jérôme Cahuzac. C’est de plus une entreprise purement patrimoniale, sans salariés, sans activité économique.
M. Charles de Courson. La question s’est posée de savoir si monsieur Tapie a bénéficié du bouclier fiscal. Le secret fiscal ne permet pas de le savoir, mais en faisant l’hypothèse que monsieur Tapie a été soumis à l’ISF pour un patrimoine d’environ 200 millions d’euros, il a vraisemblablement été bénéficiaire du bouclier fiscal puisqu’en 2009, ce bien ne pouvait être considéré comme un bien professionnel, Monsieur Tapie étant alors interdit.
Ce dossier touche à sa fin et les sommes ont été versées. Une dernière question se pose, qui porte sur la manière dont le CDR a financé ces sommes, lesquelles s’élevaient à 314 millions d’euros nets. Il l’a fait grâce à 44 millions d’euros de disponibilités et surtout 270 millions d’euros qui lui ont été transférés par l’EPFR. Ce dernier a lui-même pu financer cette somme en s’endettant : il y a donc eu une remontée de l’endettement de l’EPFR, liée au paiement de l’affaire Tapie.
Le quatrième risque non chiffrable est relatif au groupe IFI. Significativement moins importante que les trois précédentes, cette affaire est en voie de règlement.
Le rapport de l’EPFR mentionne deux autres risques non chiffrables. Le premier risque concerne l’affaire Fonds Turbo/Auchan, reposant sur un montage réalisé – à la limite de l’abus de droit fiscal – par le Crédit Lyonnais, montage qui vaut au CDR et à la société ARJIL d’être assignés par Auchan. Après avoir été déboutée en première instance, la société Auchan a décidé de faire appel. Le second risque concerne l’affaire SGN, pour de faibles montants.
Les deux principaux risques sont donc Executive Life d’une part et AIG d’autre part. Je rappelle qu’AIG, en faillite, a été renfloué à hauteur de 100 milliards de dollars par le Gouvernement fédéral américain. Mais, globalement, le processus de défaisance tend à s’achever.
Le bilan de l’EPFR retrace 4,4 milliards d’euros de passif, pour seulement 100 millions d’euros d’actif. Le financement de ce passif se fait par le truchement de deux prêts, et bientôt trois. Le premier prêt, dit « tranche 1 », s’élève à 2,64 milliards d’euros. Arrivant à échéance à la fin de l’année 2014, il est faiblement rémunéré, au taux EONIA sans marge. Le deuxième prêt se monte à 1,73 milliard d’euros, au taux EONIA. Le troisième, d’un montant de 1,2 milliard d’euros, n’est que partiellement utilisé. L’EPFR a donc pour seule perspective financière le remboursement de ses emprunts, fin 2014.
Jusqu’en 2007, l’établissement a reçu une dotation annuelle de l’État, permettant de réduire de façon continue les dettes depuis 2003. Deux nouveaux tirages ont toutefois été nécessaires en 2008 – 154 millions d’euros – et 2009 - 117 millions d'euros –, afin de financer, à hauteur de 80 % environ, le coût des affaires dites « Tapie » et il n’y a plus eu de dotations de l’État. Or, en application des dispositions organiques, les opérateurs de l’État à partir de 2011 ne peuvent augmenter leur endettement au-delà d’un an ; je me suis d’ailleurs opposé à ce titre en conseil d’administration à l’augmentation – certes modeste – de l’endettement de l’EPFR.
En principe, la dissolution de l’EPFR devrait intervenir fin 2014. Je suis de longue date partisan d’une dissolution anticipée, l’État reprenant la dette de l’EPFR, après négociation avec le Crédit Lyonnais.
J’en viens maintenant au référé de la Cour des comptes, qui évoque six points.
Le premier point concerne les conditions de financement de l’EPFR, dont je viens de parler longuement. La Cour, qui n’évoque pas la question de la capacité d’endettement des opérateurs, s’étonne en revanche de l’absence de dotations du budget de l’État à l’EPFR.
M. le président Jérôme Cahuzac. Ces dotations sont inscrites chaque année dans le compte d’affectation spéciale Participations financières de l’État, mais elles ne sont pas versées.
M. Charles de Courson. Les Rapporteurs spéciaux demandent d’ailleurs chaque année au Gouvernement de leur indiquer, au moment de l’examen du projet de loi de finances, la répartition prévisionnelle des sommes inscrites sur le CAS. Mais seul le projet de loi de règlement fournit, ex post, des informations valables.
La Cour recommande d’apurer progressivement la dette de l’EPFR, sans attendre l’échéance de 2014. En réponse, le Gouvernement indique que « l’intérêt financier pour l’État de rembourser de manière anticipée l’emprunt contracté par l’EPFR dont l’échéance contractuelle est le 31 décembre 2014, ne paraît pas avéré compte tenu du taux exceptionnellement bas – EONIA sans marge – de cette dette, inférieur au coût de refinancement de l’État ».
Il me semble que la solution que je préconise – à savoir la reprise par l’État de la dette de l’EPFR – répondrait à la fois aux critiques de la Cour et aux remarques du Gouvernement. Une telle reprise de dette appellerait nécessairement une mesure législative, précédée d’une négociation avec le Crédit Lyonnais.
Le deuxième point soulevé par la Cour concerne le champ de la garantie du CDR envers le Crédit Lyonnais. La Cour estime que l’EPFR a excédé l’autorisation de garantie ouverte par le Parlement.
M. le président Jérôme Cahuzac. Il faut en effet deux conditions pour que le CDR soit appelé en garantie du Crédit Lyonnais : une condition de date d’une part, une condition de liste d’autre part. Toute affaire postérieure au 31 décembre 1993 ne peut entraîner l’appel en garantie du CDR ; or, à l’exception de l’affaire Adidas, toutes les affaires Tapie sont postérieures à cette date. Mais l’affaire Adidas ne remplit pas la condition de liste : en effet, une annexe au protocole du 5 avril 1995, approuvée par le Parlement dans la loi du 28 novembre 1995, établit la liste des affaires pouvant entraîner l’appel en garantie du CDR. Or, cette liste ne mentionne pas l’affaire Adidas. La Cour des comptes considère donc que la lettre ministérielle en date du 17 mars 1999 permettant l’appel en garantie du CDR dans les affaires dites « Tapie » a méconnu le champ de l’autorisation donnée par le Parlement.
M. Charles de Courson. Lorsque l’État a organisé la défaisance du Crédit Lyonnais, une contribution forfaitaire de 12 millions d'euros a été demandée à la banque. Lorsqu’a été rendue la décision d’arbitrage, le Crédit Lyonnais a refusé de régler les 12 millions d'euros, n’ayant pas été partie à l’arbitrage – il ne l’avait pas souhaité, pour des raisons d’image. Le CDR a cédé les droits de recouvrement de cette contribution aux liquidateurs du groupe Bernard Tapie. La Cour note qu’« à ce jour ceux-ci n’ont pris aucune initiative pour recouvrer cette créance et n’en ont pas signifié le transport au débiteur ». Ce n’est pas tout à fait exact : les avocats de Bernard Tapie ont indiqué par courrier que celui-ci prenait à sa charge les 12 millions d’euros.
Le Gouvernement indique que « l’EPFR a bien notifié au CDR sa position sur le nécessaire recouvrement de cette franchise dans un courrier du 10 octobre 2007 [et que] le CDR a par ailleurs obtenu in fine une solution équivalant, du point de vue des finances publiques, à celle qui aurait consisté à obtenir que le Crédit Lyonnais s’acquitte auprès du CDR de la franchise en question ».
Bernard Tapie a donc accepté de voir réduite de 12 millions d'euros la somme qui lui a été attribuée par l’arbitrage, afin d’éviter le recours qu’aurait pu intenter le Crédit lyonnais contre cet arbitrage. Si cette opération n’a effectivement pas nui aux intérêts du Trésor public, le problème juridique demeure : l’État pouvait-il, sans solliciter l’autorisation du Parlement, accepter cette « contraction » entre créance et dette sur 12 millions d'euros ?
La Cour des comptes a raison formellement lorsqu’elle dit que l’on ne peut étendre le champ des garanties sans passer par le Parlement mais elle omet de souligner qu’en l’espèce, cela n’a pas eu d’incidence financière pour l’État.
Le troisième point abordé par la Cour des Comptes est le dispositif des risques non chiffrables, c’est-à-dire les risques non évalués. Ceux-ci sont couverts par la garantie à 100 % de l’EPFR, autant dire de l’État. Les critiques de la Cour portent sur la confusion des responsabilités entre les différents niveaux de décision impliqués dans le suivi de la défaisance du Crédit lyonnais. Le Gouvernement considère, quant à lui, que les rôles de chacun sont bien définis par le protocole à chaque étape du processus mais il admet qu’un guide des procédures serait bienvenu et a demandé à la mission de contrôle de le rédiger d’ici à la fin de ce trimestre.
Le quatrième point soulevé par la Cour concerne la prise en charge du risque non chiffrable après l’arbitrage Adidas-Tapie.
Selon la Cour, l’EPFR n’aurait pas dû prendre en charge ce risque. Mais il est l’actionnaire unique du CDR. Il est donc nécessaire de distinguer l’analyse juridique de la situation financière. C’est ainsi que le mécanisme de remontée du résultat du CDR vers l’EPFR rend équivalent pour ce dernier la prise en charge directe ou non d’un risque non chiffrable.
Sur le cinquième point, relatif à la mission de contrôle considérée par la Cour comme peu performante entre 2007 et février 2010, le Gouvernement a précisé, qu’à sa demande, l’EPFR, l’Agence des participations de l’État et la mission de contrôle avaient élaboré un projet de convention définissant précisément la nature des contrôles à effectuer avant la prise en charge par l’EPFR des risques non chiffrables, qui sera prochainement soumis au conseil d’administration de ce dernier.
Reste le dernier point abordé par la Cour, qui intéresse tout particulièrement la commission des Finances, soit la capacité juridique du CDR à compromettre.
En droit français, l’article 2060 du code civil interdit à l’État de compromettre sauf autorisation législative expresse. « On ne peut compromettre sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics ». La Cour des comptes considère qu’il y a eu défaut d’autorisation législative en l’espèce.
Il y a eu 7 arbitrages dans l’histoire du CDR, quatre à l’étranger où l’interdiction de compromettre ne vaut pas. En France, on connaît trois arbitrages qui concernent deux affaires de faible importance et l’affaire Tapie.
Je rappelle que je suis l’auteur d’un recours devant le tribunal administratif de Paris contre les instructions données par la ministre de l’Économie et des finances aux trois représentants de l’État de ne pas s’opposer au recours à l’arbitrage par le CDR dans l’affaire Tapie.
Mon recours vise à attaquer ces instructions ministérielles qui aboutissent à un complet détournement des droits du Parlement et de l’article 2060 du code civil.
Il suffirait donc, pour pouvoir compromettre, de créer un faux nez de l’État sous forme d’établissement public lui-même assorti d’une filiale à 100 % sous forme d’une société privée autorisée, elle, à compromettre.
J’ai été débouté devant le tribunal administratif qui a considéré que les instructions ministérielles ne méconnaissaient par les dispositions de l’article 2060 du code civil. Le tribunal a estimé que le CDR possédait une réelle autonomie en raison de la composition de son conseil d’administration et en se prévalant de certaines conclusions du rapport de la Cour des comptes pour l’année 2008, dont l’interprétation me surprend.
Mon appel devant la Cour administrative d’appel a été rejeté le 31 décembre 2010, pour un motif de forme : mon recours était trop tardif. J’aurais dû le faire dans les deux mois suivant la date des instructions de la ministre. Or, je n’ai eu connaissance de cet acte que lorsque j’ai interrogé la ministre lors de son audition par la commission des Finances.
La cour d’appel ne s’est donc, hélas, pas prononcée sur le fond.
En conclusion, il serait judicieux que les députés proposent un amendement à une loi de finances qui clarifie les conditions du recours à l’arbitrage. Il conviendrait de réaffirmer que l’on ne peut recourir à l’arbitrage, de manière directe ou indirecte, sans une disposition législative.
La représentation nationale ne peut laisser le trou béant en matière de jurisprudence, qui n’a pas été comblé par la décision de la Cour administrative d’appel de Paris. Or, l’encadrement de l’arbitrage prévu par l’article 2060 du code civil est une protection pour l’État et les collectivités publiques.
M. Gilles Carrez, rapporteur général. Je tiens à féliciter Charles de Courson pour sa ténacité et pour la qualité de son travail.
M. Charles de Courson. Merci M. le rapporteur général. Dans cette affaire, le Gouvernement a tort juridiquement et politiquement. Nous devons maintenir en droit français l’interdiction, pour l’État, de recourir à la procédure d’arbitrage, sauf disposition législative. Si le Gouvernement était venu devant le Parlement pour demander l’autorisation de recourir à l’arbitrage, nous aurions eu un vrai débat, clair et transparent. En l’occurrence, ce qui est critiquable du point de vue des droits du Parlement et de la morale publique, c’est l’absence de disposition législative. De ce point de vue, la Cour des comptes a raison.
Hélas, la thèse du tribunal administratif défendant l’autonomie du CDR est risible. Qu’est-ce qu’une société anonyme dont le but est de perdre de l’argent ? C’est contraire au droit des sociétés. Quel est l’objet du CDR ? Perdre 4 ou 5 milliards d’euros ? Il en a perdu 15, ce qui était prévisible. J’ai donc été sidéré par la position du tribunal. Lorsqu’on examine l’utilisation qui est faite du rapport de la Cour des comptes par le tribunal administratif et lorsqu’on compare avec la réalité de ce qu’a écrit la Cour, on est étonné d’une telle thèse.
M. Louis Giscard d’Estaing. Je tiens à remercier Charles de Courson pour l’éclairage qu’il apporte à la représentation nationale et, en particulier aux députés qui, comme moi, n’étaient pas élus au moment où ces faits se sont déroulés.
Je souhaiterais que l’on revienne sur la séquence qui commence avec la cession contestée des parts d’Adidas au Crédit lyonnais qui s’en porte acquéreur puis les revend avec une plus-value, ce qui donne naissance au litige que nous connaissons et qui se poursuit avec la lettre du ministre de l’économie du 17 mars 1999, adressée au président du Crédit lyonnais au moment où l’établissement était sur le point d’être privatisé.
M. Charles de Courson. J’ai participé à cela à l’époque et j’ai d’ailleurs été très critique. M. Edmond Alphandéry, alors ministre des finances était venu expliquer devant l’Assemblée nationale que la privatisation du Crédit lyonnais permettrait d’éponger les dettes. Le Crédit lyonnais a certes été privatisé, mais la différence entre le montant de la recapitalisation de la banque – en plus des 15 milliards d’euros qu’aura coûté la structure de défaisance – et ce que sa vente a rapporté, aboutit à un déficit d’environ 24 milliards d’euros !
La création d’une structure de défaisance a été une erreur. Il aurait été plus judicieux de laisser le Crédit lyonnais gérer ses « actifs pourris », puisque cela relevait de sa responsabilité. Si nous devons être confrontés à l’avenir à une situation de cette nature, il faudra surtout éviter de reproduire un tel mécanisme.
Dans cette affaire, les tiers – principalement d’autres banques – ont été remboursés jusqu’au dernier euro par le contribuable pour une somme de l’ordre de 70 milliards de francs, soit 10 milliards d’euros. C’est d’ailleurs ce qui est en train de se reproduire au niveau international avec les dettes d’État : nous remboursons les acteurs détenteurs d’actifs pourris à des taux d’intérêts très élevés sans aucune contrepartie de leur part à l’effort de redressement.
Nous devrions adopter un amendement qui évite, la prochaine fois qu’un tel cas se reproduira, de renouveler une telle structure. Ce montage a permis de déconsolider la dette du Crédit lyonnais qui risquait la faillite. Par ce mécanisme, on a sorti 150 milliards de francs d’actifs qui ont été garantis par l’État, ce qui a conduit à 15 milliards d’euros de pertes. Sans cela, la banque aurait disparu. Mais la structure a été conservée au moment de la privatisation, faute de quoi le Crédit lyonnais n’aurait pas été privatisable.
M. Louis Giscard d’Estaing. Je souhaiterais revenir sur la lettre du 17 mars 1999 qui aurait abouti à six contentieux. Pourquoi y a-t-il une discussion sur le fait que le résultat de la séquence arbitrale était couvert ou non par cette lettre énumérant les garanties de l’État au Crédit Lyonnais ?
Par ailleurs, la sentence arbitrale prévoit le versement de 45 millions d’euros au titre du préjudice moral. La Cour des comptes indique que cette indemnité visait à réparer le préjudice moral causé par les agissements graves imputés au Crédit lyonnais et à l’une de ses filiales. Pourquoi les frais liés au préjudice moral ont-ils été mis à la charge du CDR et non de la structure juridique LCL qui est la continuatrice du Crédit lyonnais ?
M. Charles de Courson. Lors de la privatisation du Crédit lyonnais, la décision a été prise de purger la banque de tous ses passifs. Tout a donc été « rapatrié » sur le CDR pour permettre la privatisation dans les meilleures conditions possibles. C’est donc l’État qui a tout pris en charge.
Pour ce qui concerne la première question, la Cour des comptes a considéré que la garantie en question n’était pas prévue dans la liste fixée par voie législative et qu’il fallait, par conséquent, retourner devant le Parlement pour compléter cette liste. Les magistrats ont raison en droit. Dans les faits, cela n’aurait rien changé au coût final ; mais au moins aurions-nous eu un débat devant la représentation nationale.
M. le président Jérôme Cahuzac. La représentation nationale a pris connaissance de cette opération a posteriori. Si le Parlement avait été saisi de cette affaire en temps voulu, dans la transparence, elle ne se serait évidemment pas conclue de cette façon. Les parlementaires se seraient interrogés sur les conséquences qu’il y aurait eu à appeler le CDR en garantie. Imagine-t-on une majorité se dégager pour permettre un enrichissement supplémentaire de M. Bernard Tapie de 200 millions d’euros ? Jamais ! Cela ne se serait jamais produit.
Si le parlement n’a pas été consulté comme il aurait dû l’être c’est parce que cette opération, pour être menée à bien, supposait qu’elle soit faite en toute discrétion.
Par ailleurs, considérer la lettre du ministre de l’Économie et des finances comme justifiant l’appel en garantie du CDR ne tient pas. Une lettre ministérielle, quelle que soit la qualité du signataire, n’est pas supérieure à la loi. Il fallait donc clairement aller devant le Parlement. Juridiquement, c’est clair. Politiquement, chacun est libre de juger.
M. Charles de Courson. Je me permets de rappeler que même une lettre illégale peut créer des droits à l’égard de tiers. Cette lettre pouvait donc être utilisée par des tiers.
M. le président Jérôme Cahuzac. Tout cela ne serait pas produit si le Parlement avait été saisi.
M. Charles de Courson. Bien sûr. Mais qui avait intérêt à agir ? Cette notion « d’intérêt à agir », très discutable, est fondamentale en droit français. Ainsi, j’ai été très choqué de constater j’étais pratiquement le seul à avoir été jugé recevable par le tribunal administratif au motif que j’appartenais à la commission des Finances de l’Assemblée nationale ! Y aurait-il donc une inégalité entre députés en fonction de la Commission à laquelle ils appartiennent ? C’est ridicule ! Les recours déposés par des contribuables ont été déclarés irrecevables. C’est incroyable ! On est quand même en démocratie ! Je ne parle là que de la décision sur la recevabilité prise par le tribunal administratif de Paris.
Et la cour administrative d’appel m’a déclaré irrecevable ! Je trouve cela incompréhensible du point de vue démocratique.
M. le président Jérôme Cahuzac. S’il était normal, pour pouvoir privatiser le Crédit lyonnais, de purger tous ses contentieux financiers, personne ne pouvait imaginer à l’époque, pas même les analystes, qu’il pouvait y avoir une quelconque indemnisation de préjudice moral ou, en tous cas, certainement pas à ce niveau-là.
Ce qui aurait été normal, y compris au regard des conditions de privatisation du Crédit lyonnais, c’est que le préjudice moral restât à la charge du Crédit lyonnais. Mais dans une telle hypothèse, nous comprenons que la banque aurait fait appel, faisant capoter la procédure d’arbitrage. Or, l’exécutif ne voulait pas de ce scénario. C’est la raison pour laquelle il fallait rester discret. Voilà pourquoi c’est le CDR qui paie ces fameux 45 millions d’euros de préjudice moral.
M. Jean-Claude Flory. Je souhaiterais saluer le travail passionnant que Charles de Courson a réalisé. Sur le plan quantitatif, je crois qu’avait été évoqué, en 1996, le nombre de 2 600 contentieux. On a ensuite cité le chiffre de 250 à 300 dans les années 2007-2008. Faut-il comprendre que les six ou sept dossiers évoqués sont les derniers ? Est-on en train de solder ce contentieux ?
Je souhaiterais par ailleurs avoir un éclairage sur le volet Executive Life de l’affaire. Le préjudice, résultat d’un montage illégal du Crédit lyonnais, n’est pas chiffrable, mais nous disposons semble-t-il d’un plafond équivalent à trois fois le bénéfice potentiel. Qu’en est-il ?
M. Charles de Courson. Sur le volet Executive Life, un accord est intervenu à hauteur de 600 millions de dollars, alors que le bénéfice est estimé aux alentours d’un milliard de dollars. Pour un plafond potentiel de trois milliards de dollars, le préjudice est donc largement inférieur.
Le nombre de contentieux a considérablement diminué. Je n’ai évoqué devant vous que les principaux dossiers. Il en restait 71 au 31 décembre 2009 ; fin 2010, une cinquantaine d’affaires n’étaient pas encore closes.
M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous remercie pour ces explications et cet échange.
ANNEXE 1 : RÉFÉRÉ DE LA COUR DES COMPTES
DU 12 NOVEMBRE 2010 CONCERNANT LA DÉFAISANCE
DU CRÉDIT LYONNAIS (CDR ET EPFR) ET LA RÉPONSE
DU PREMIER MINISTRE
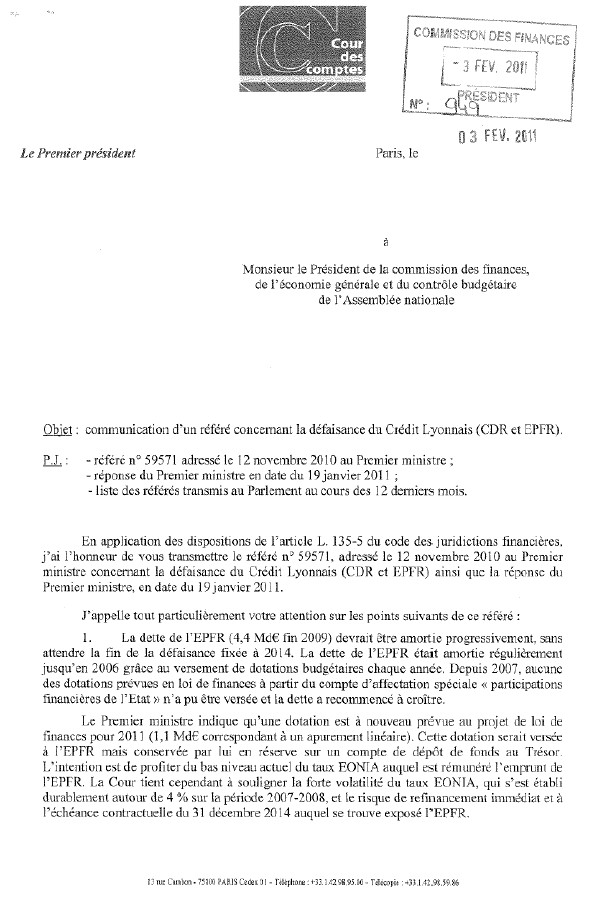
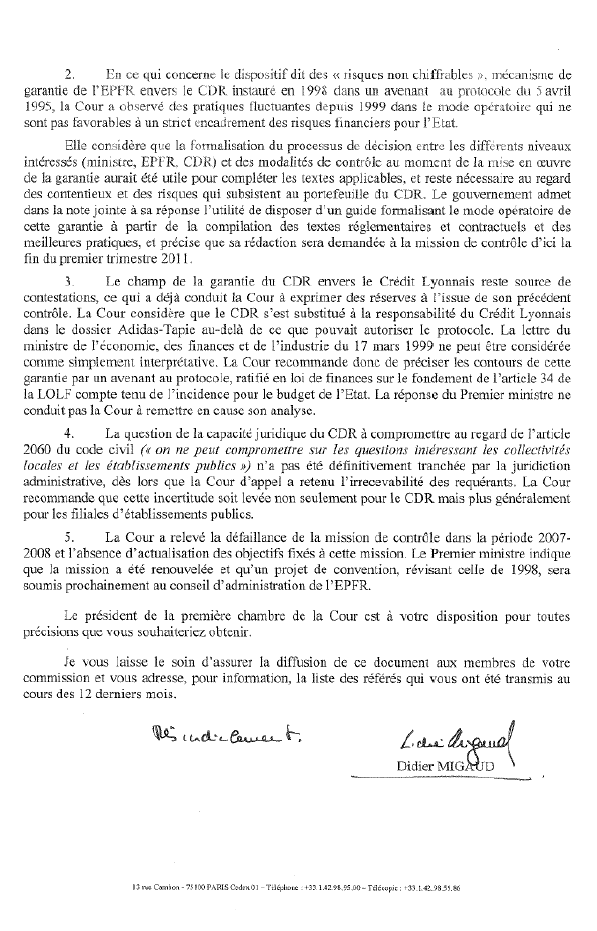
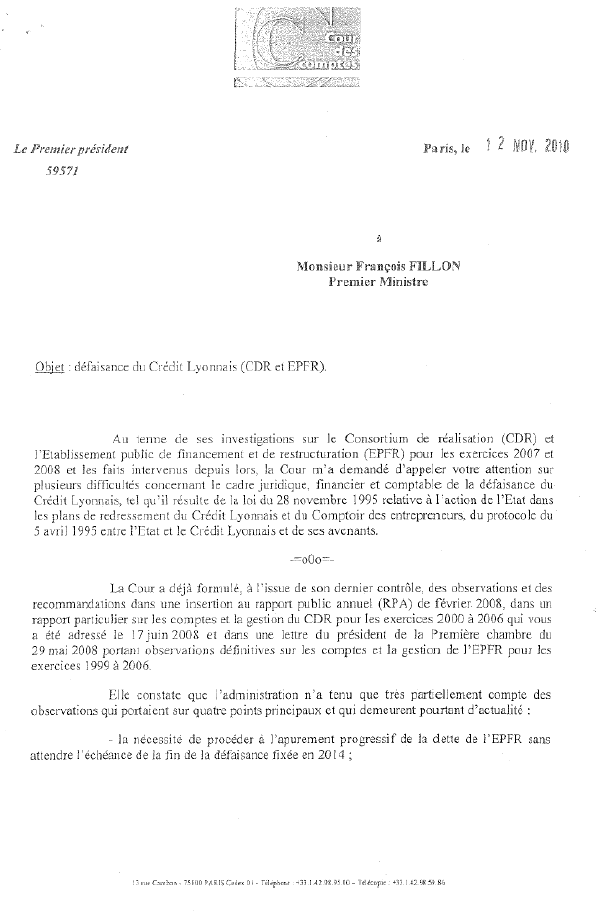
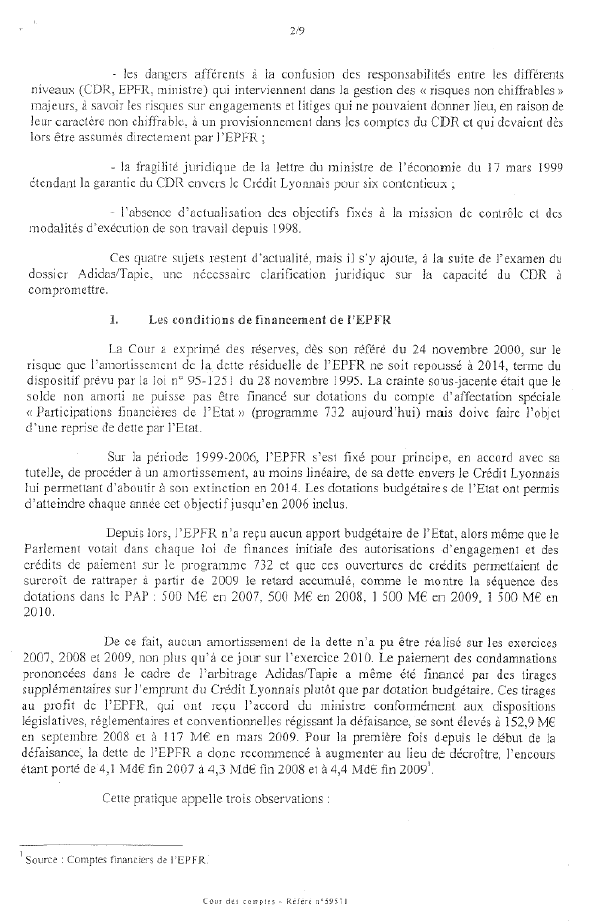
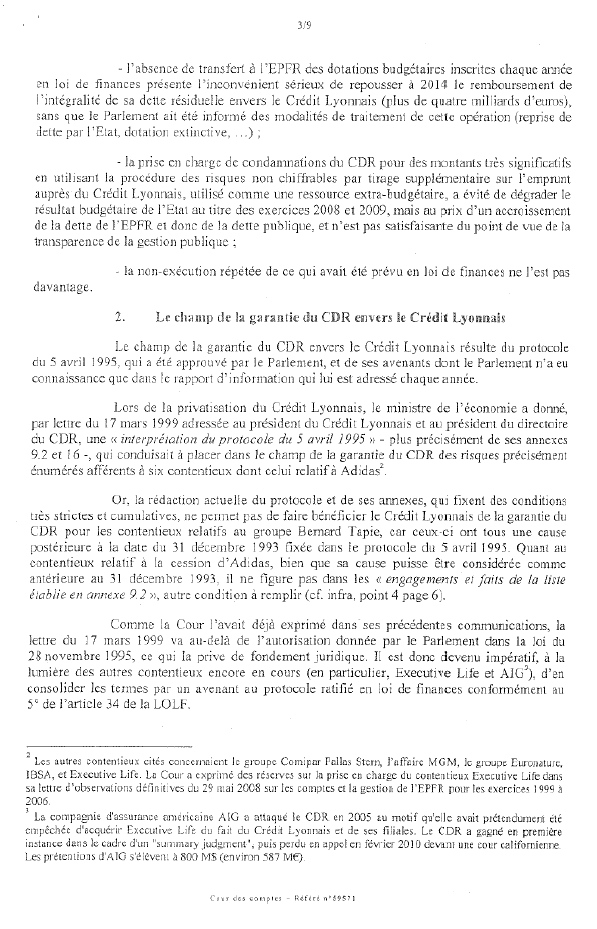
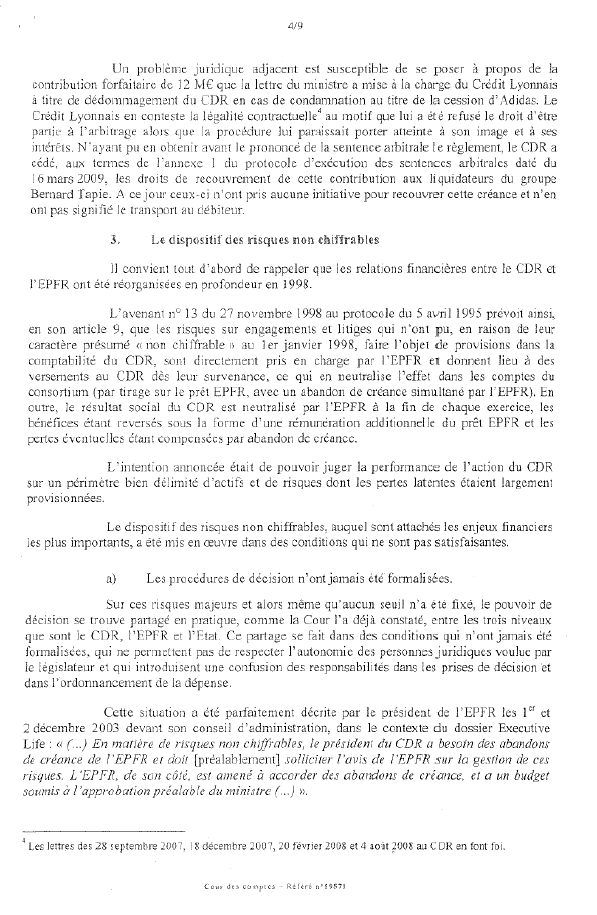
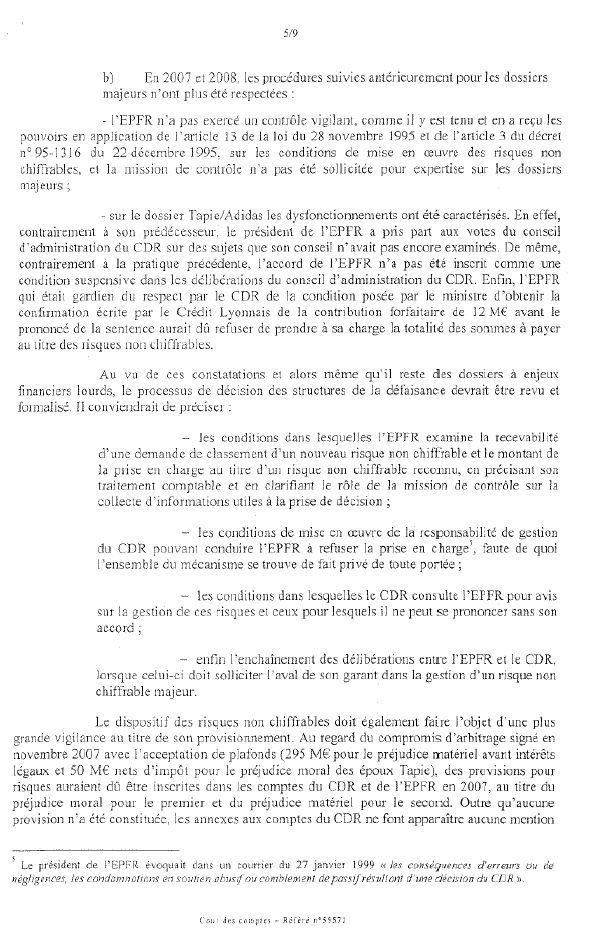
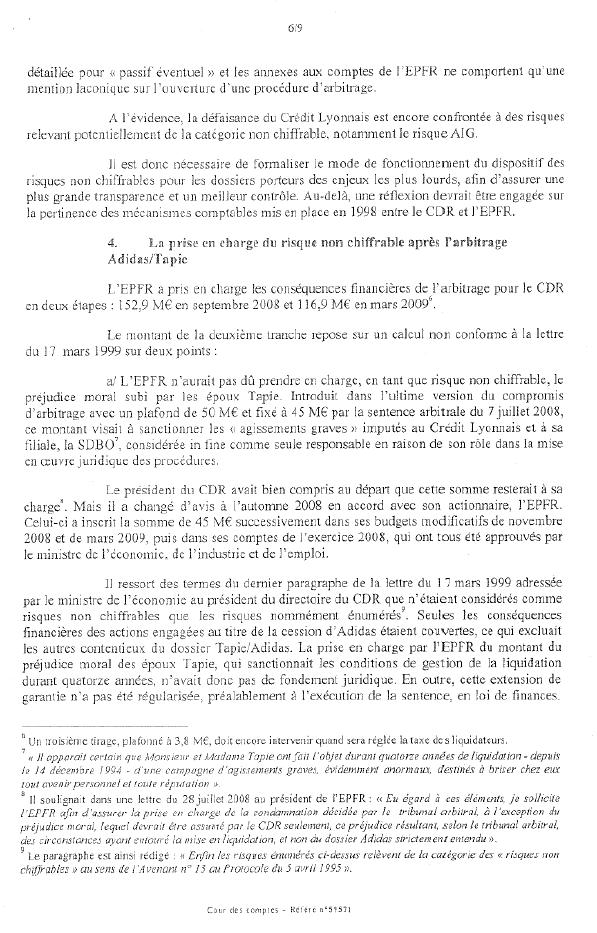
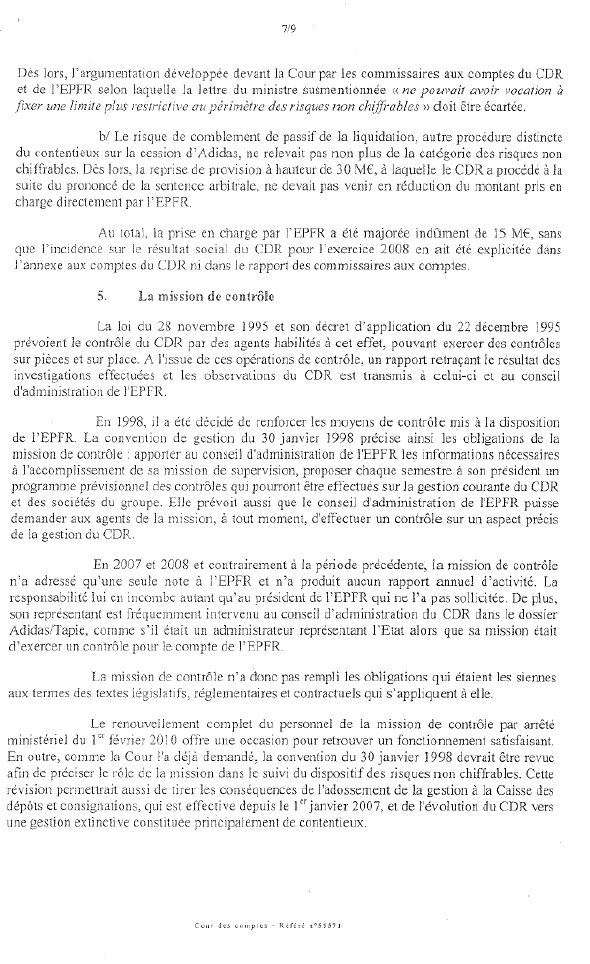
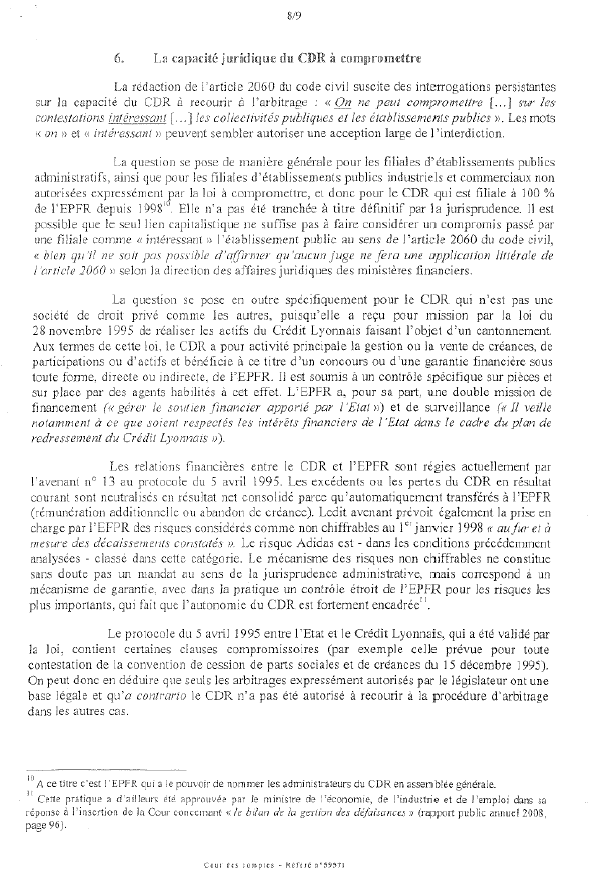
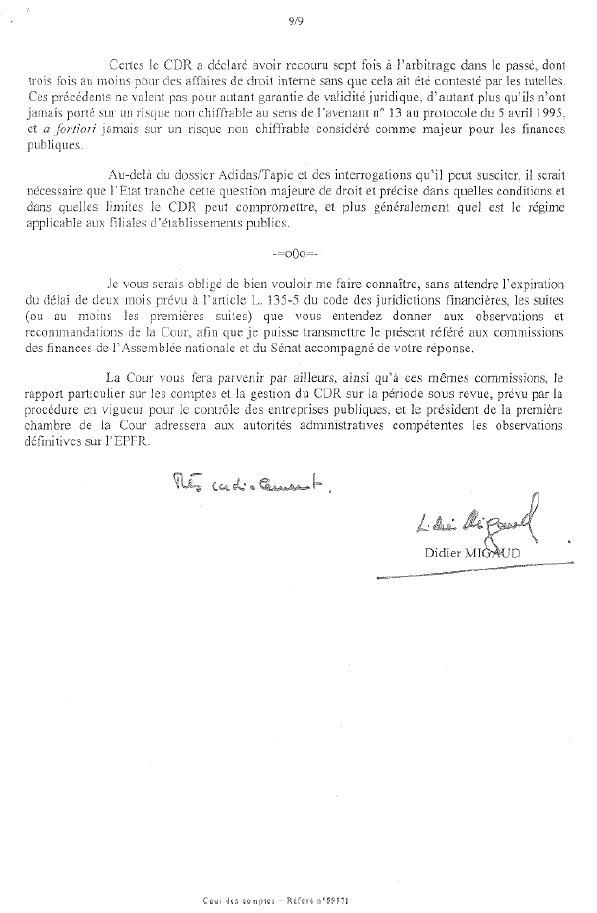
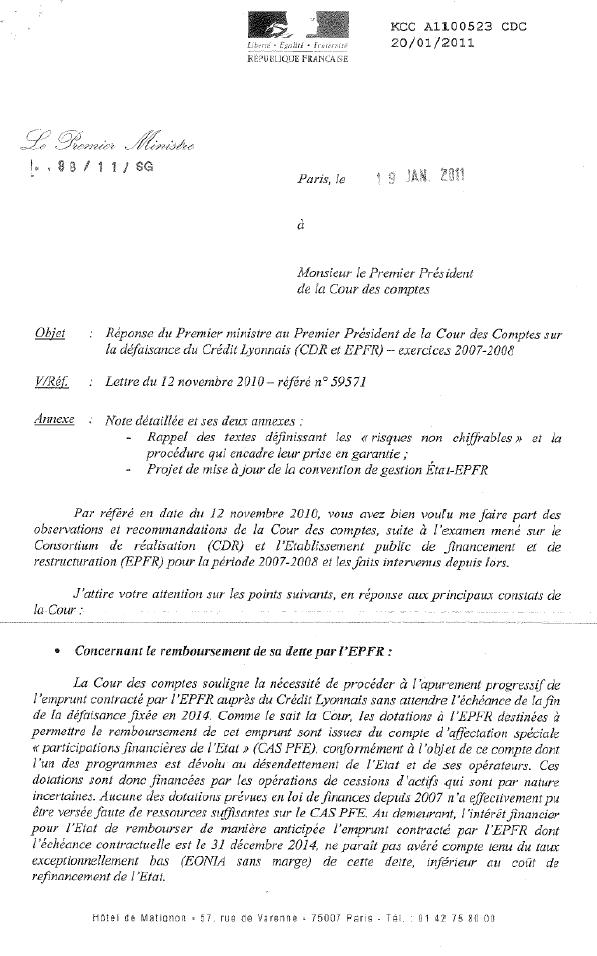
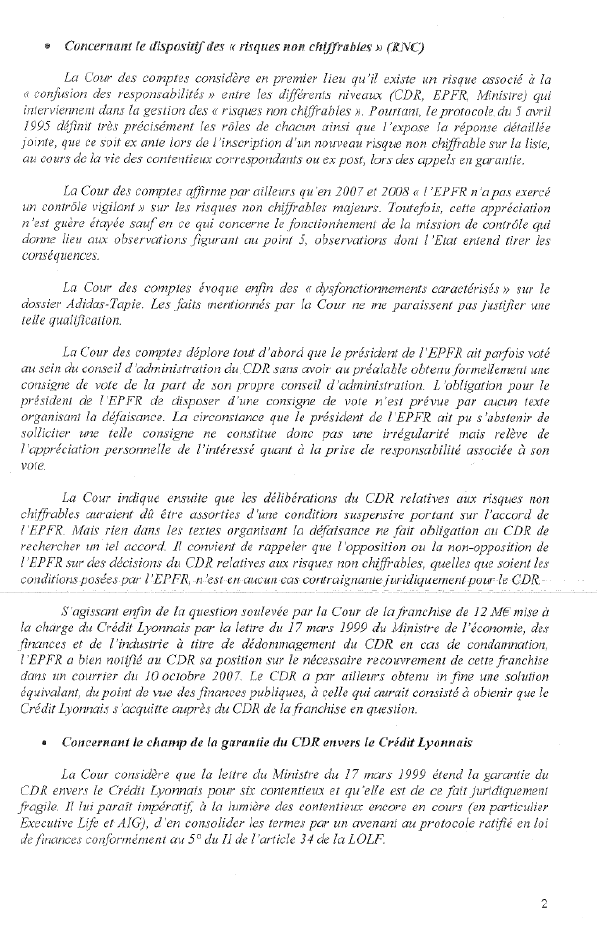
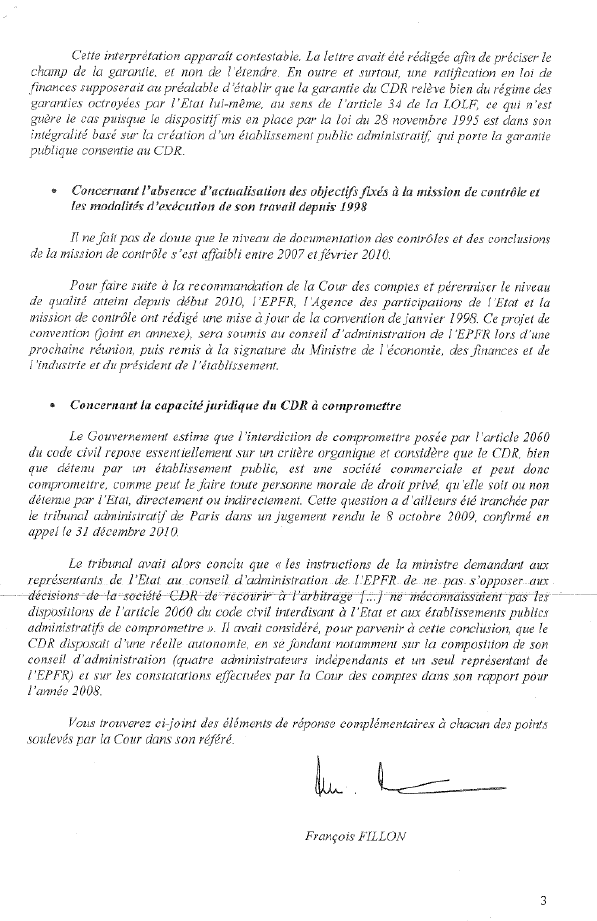
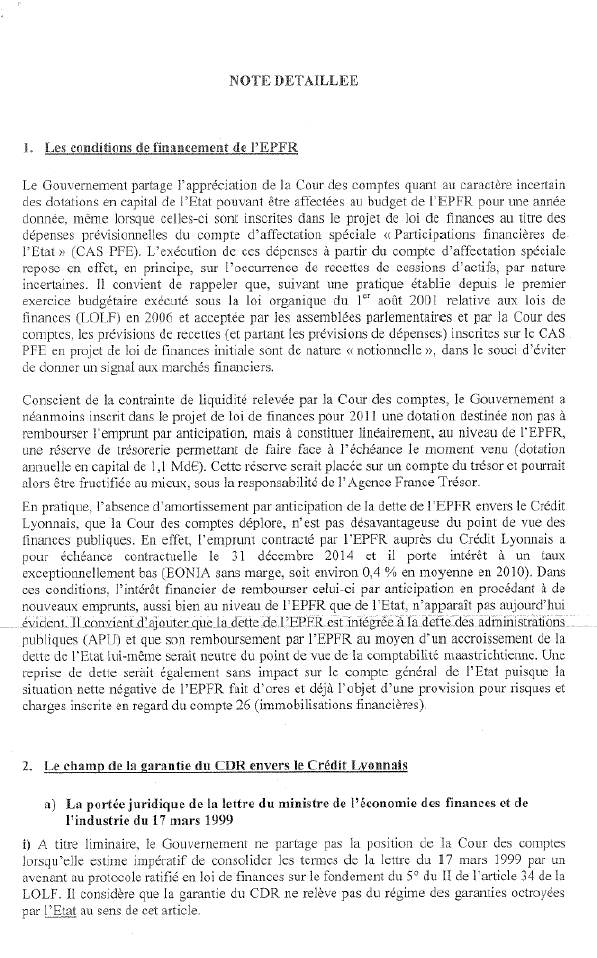
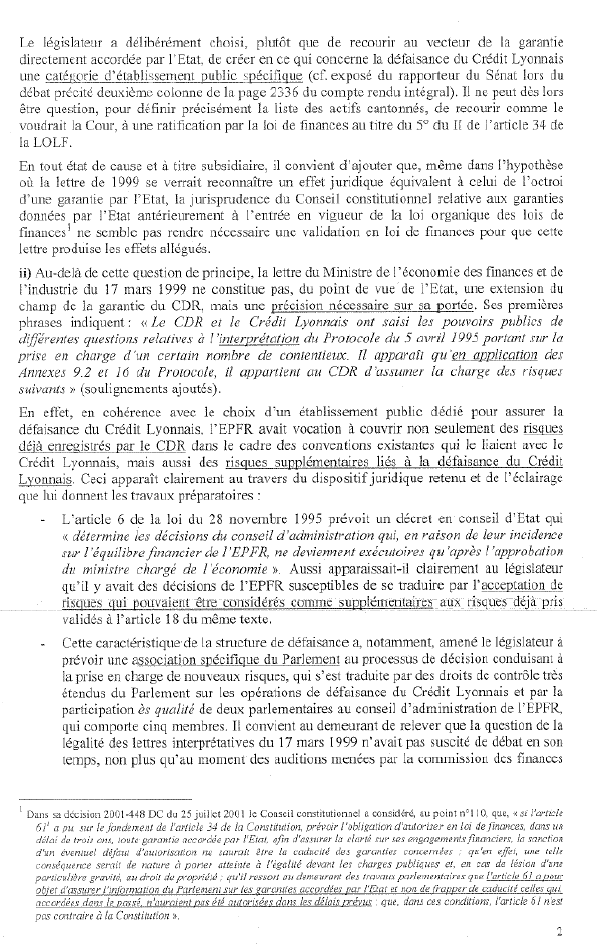
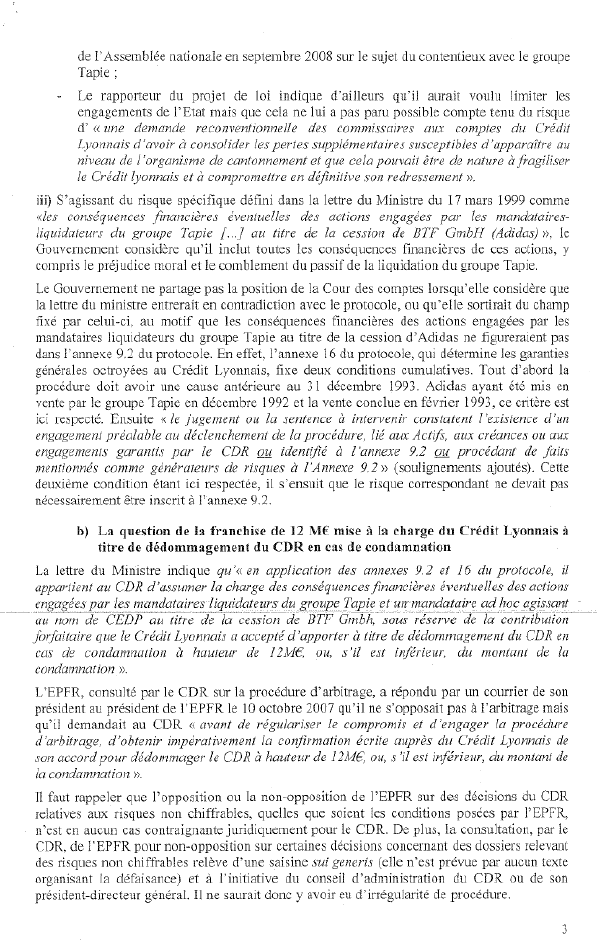
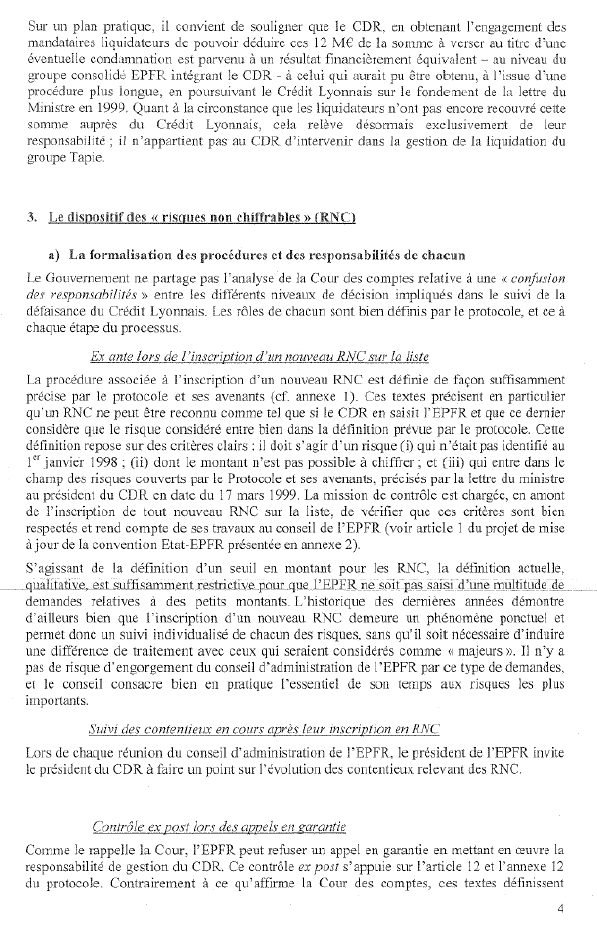
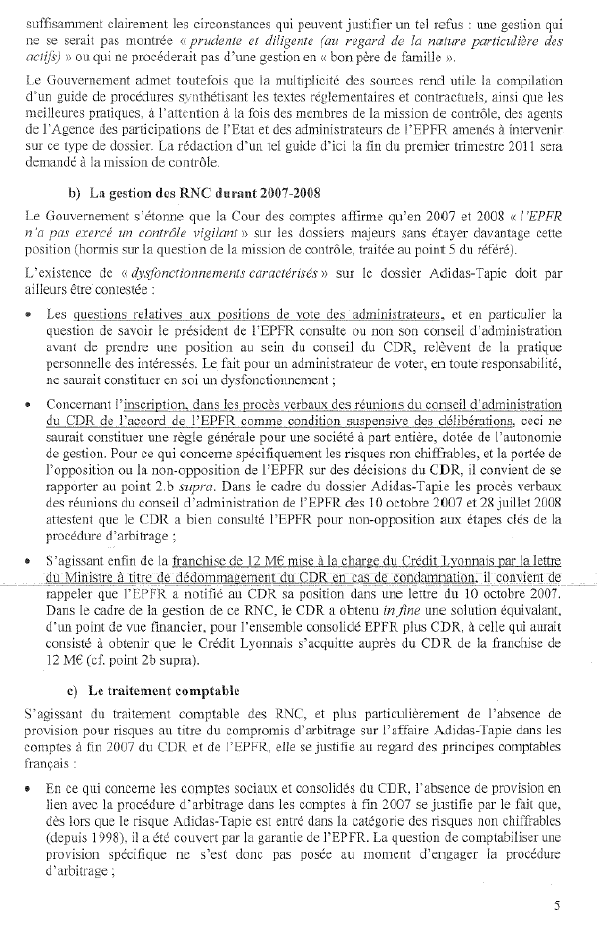
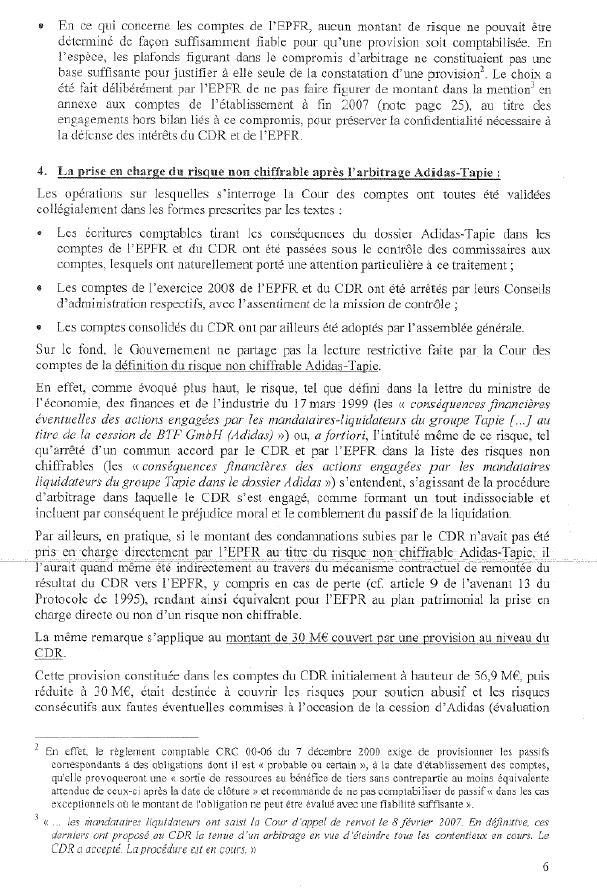
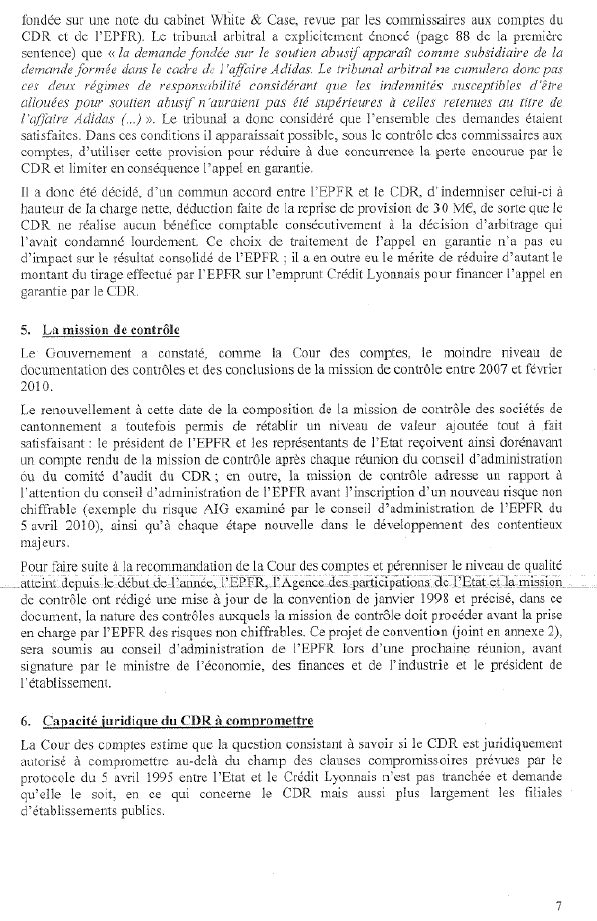
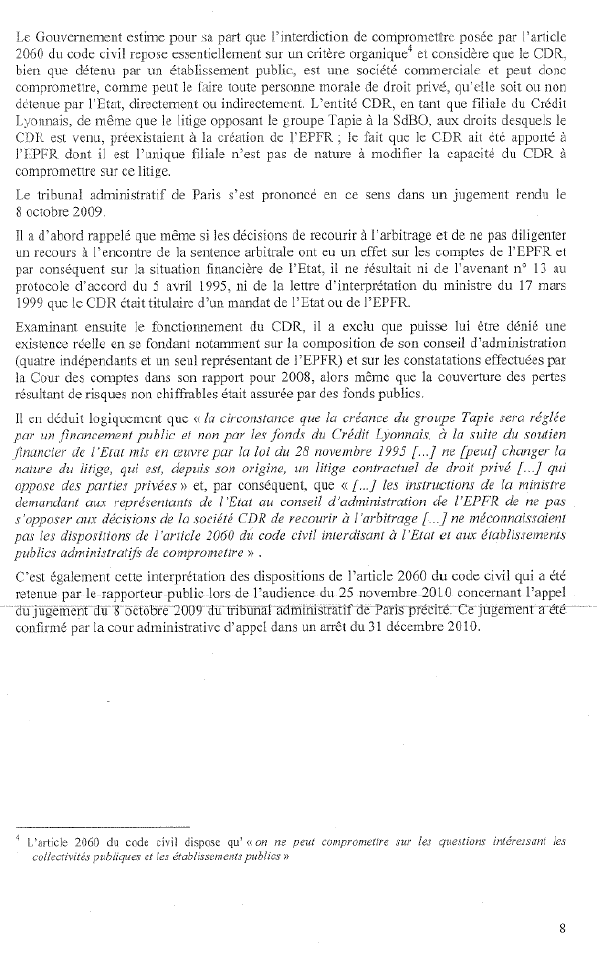
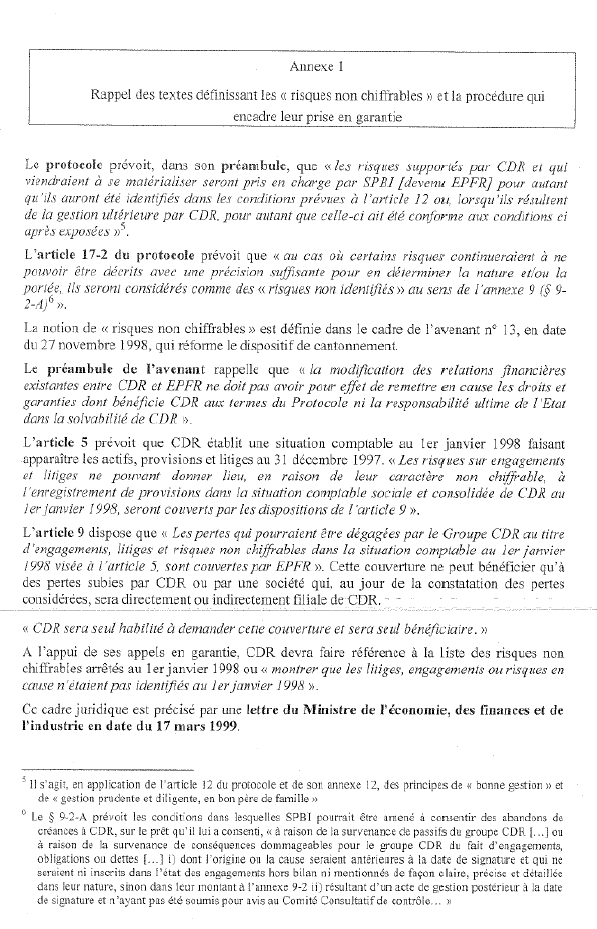
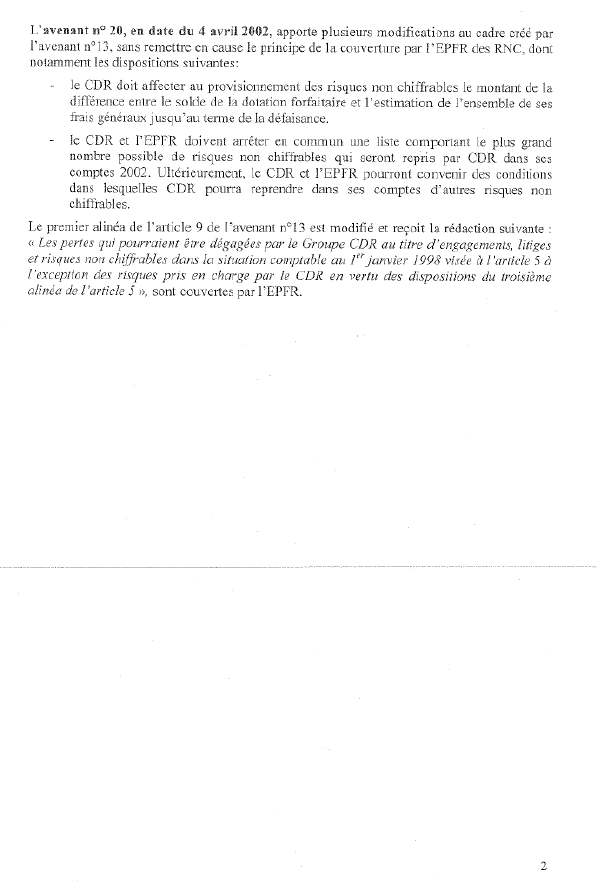
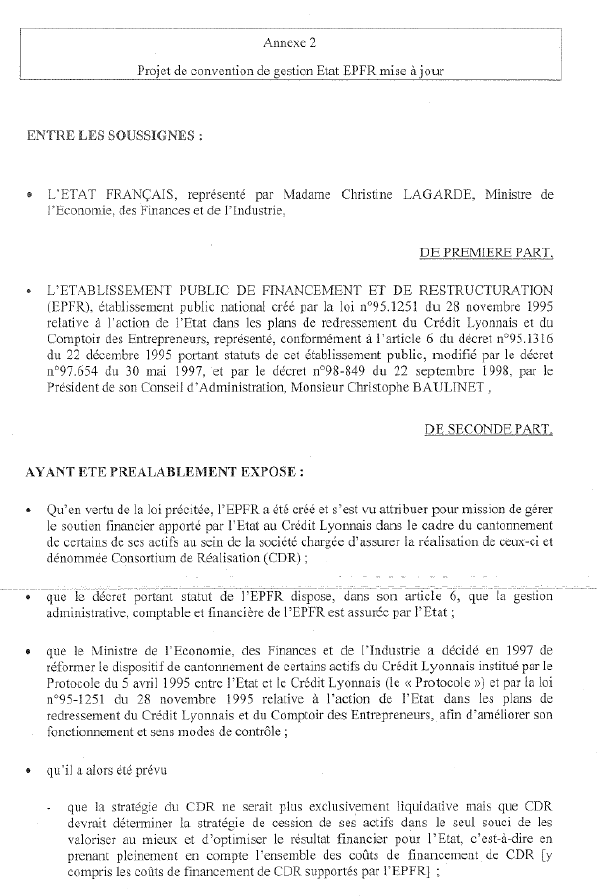
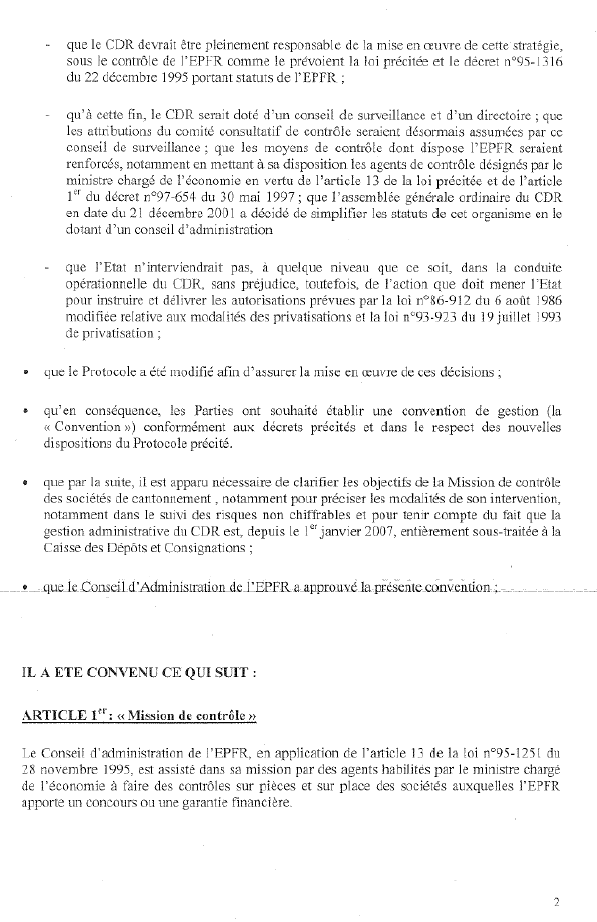
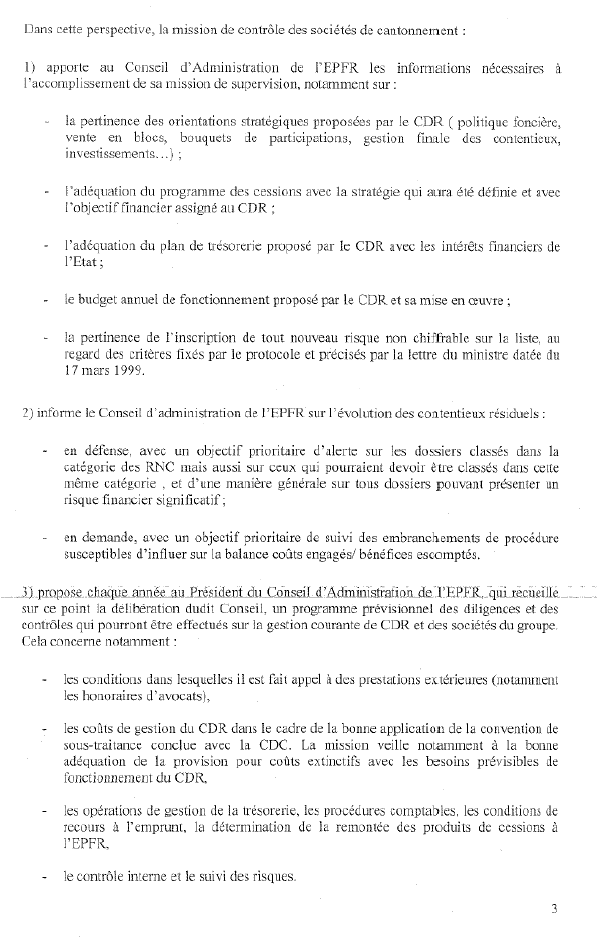
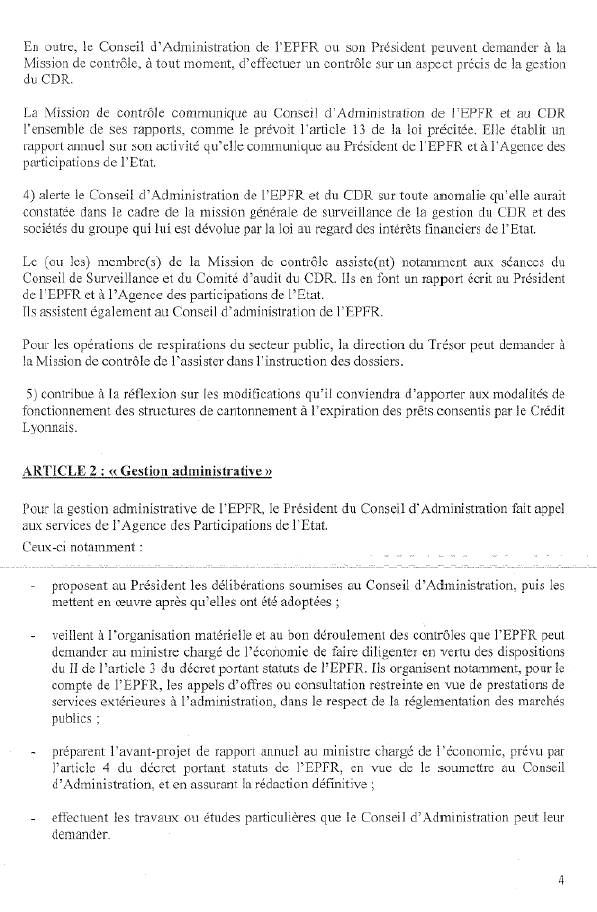
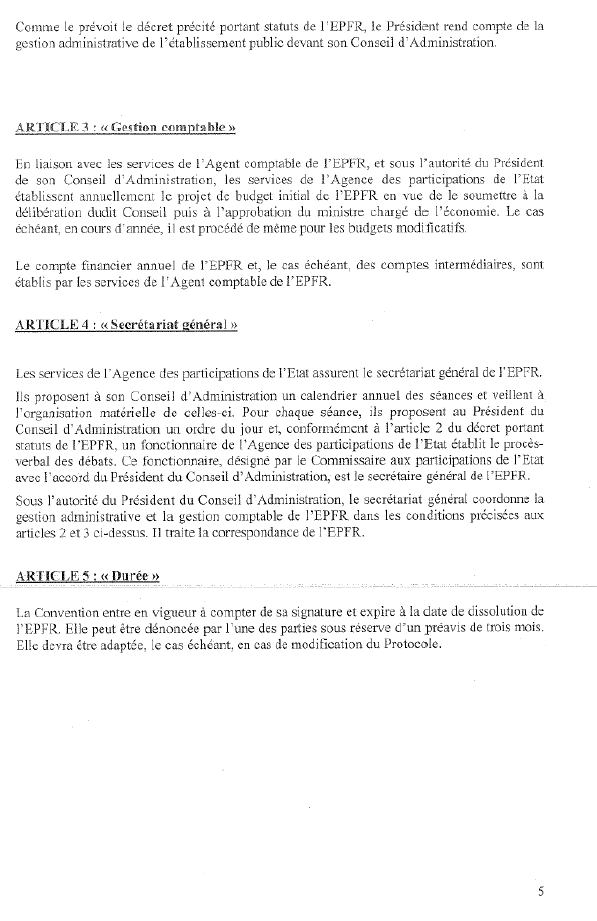
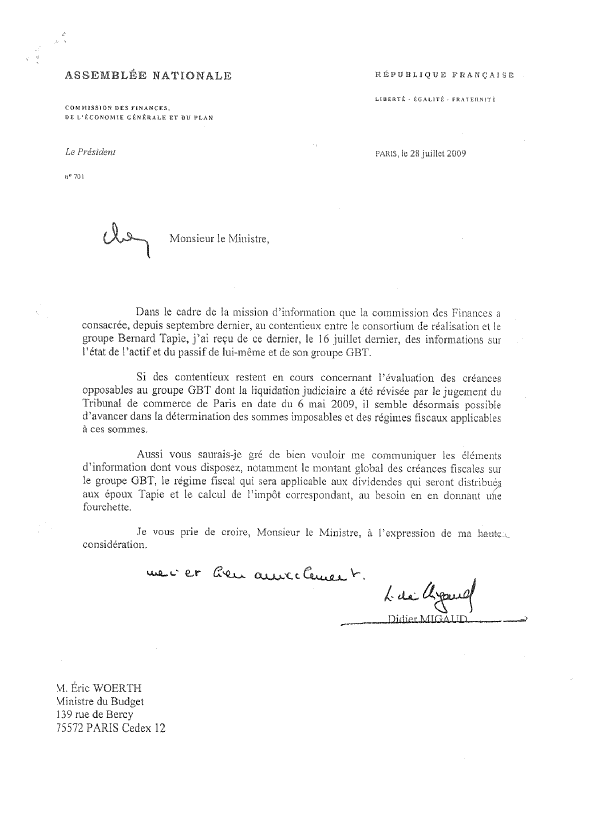
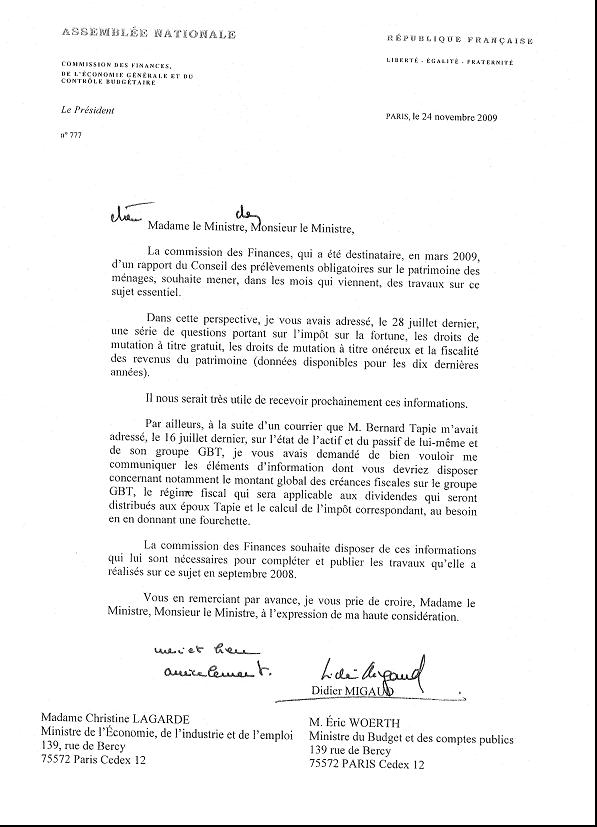
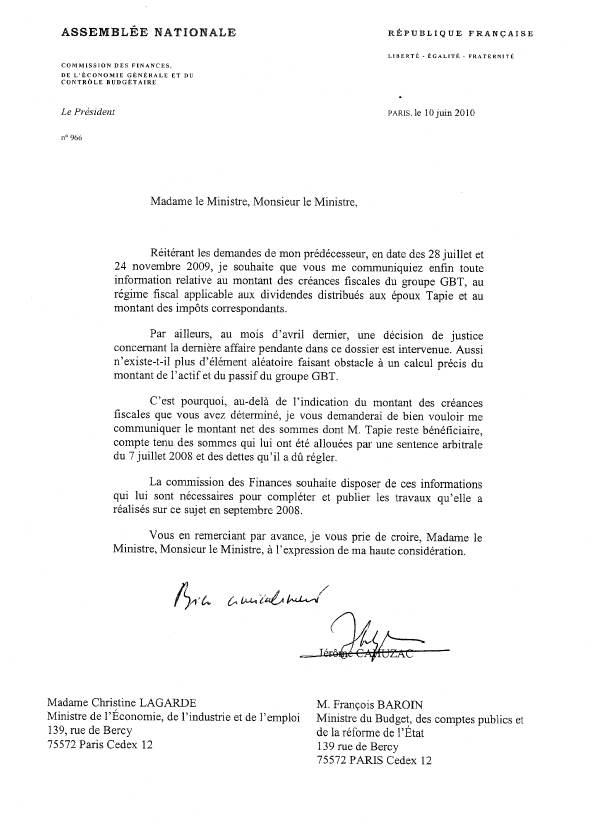
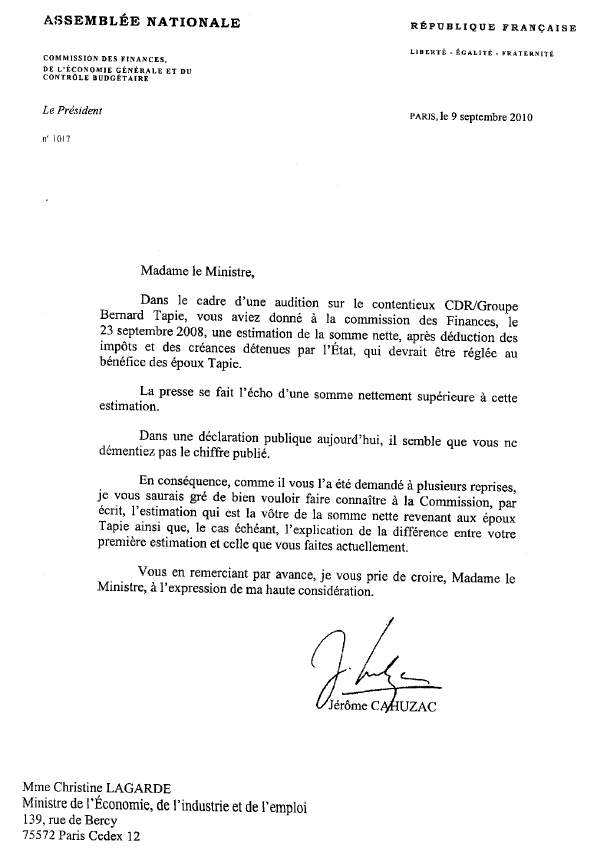
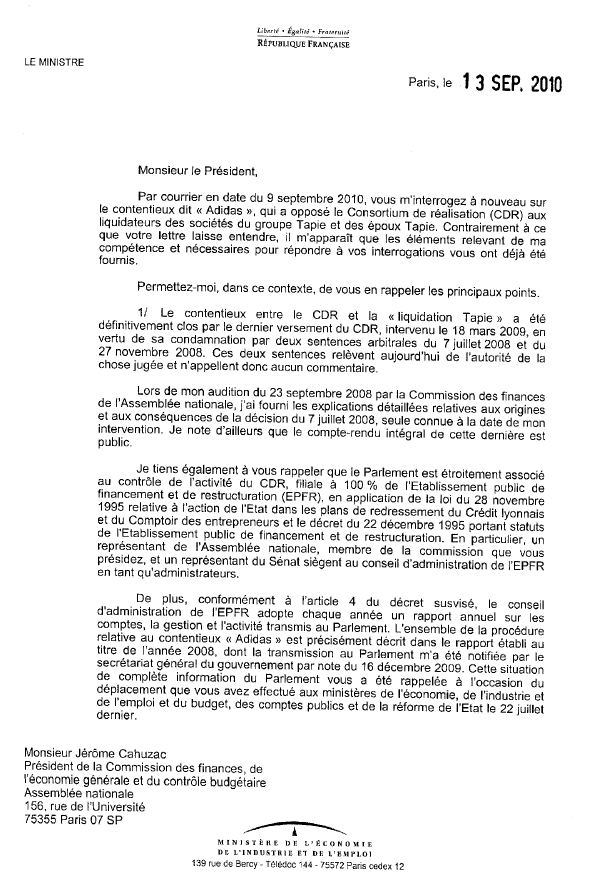
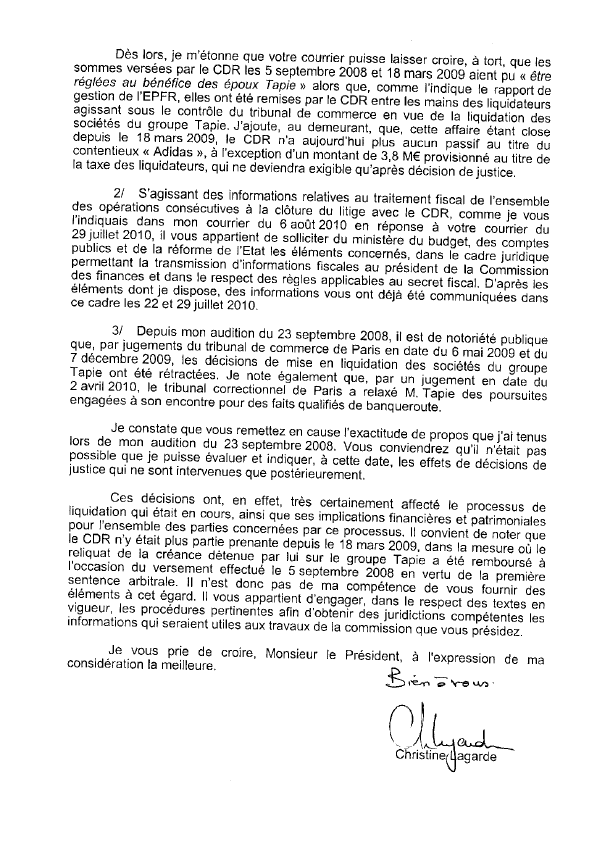
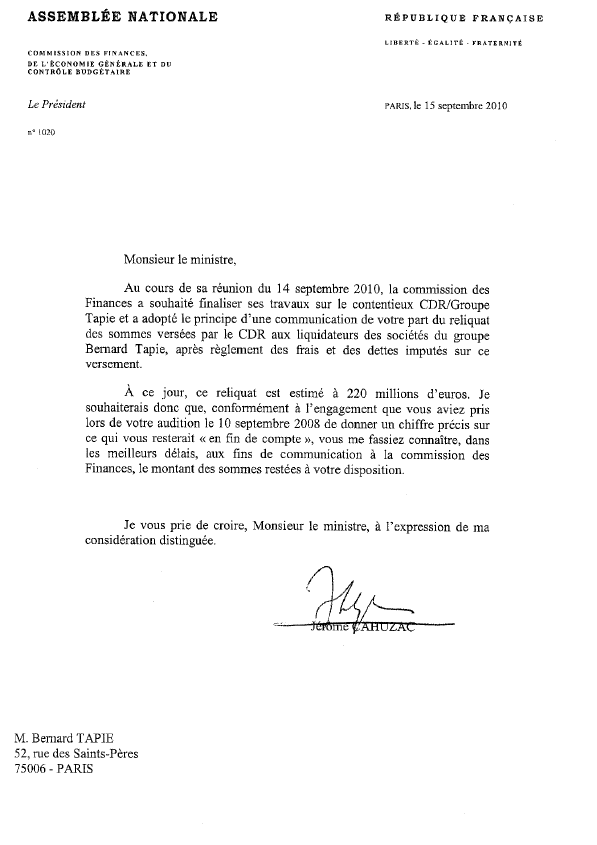
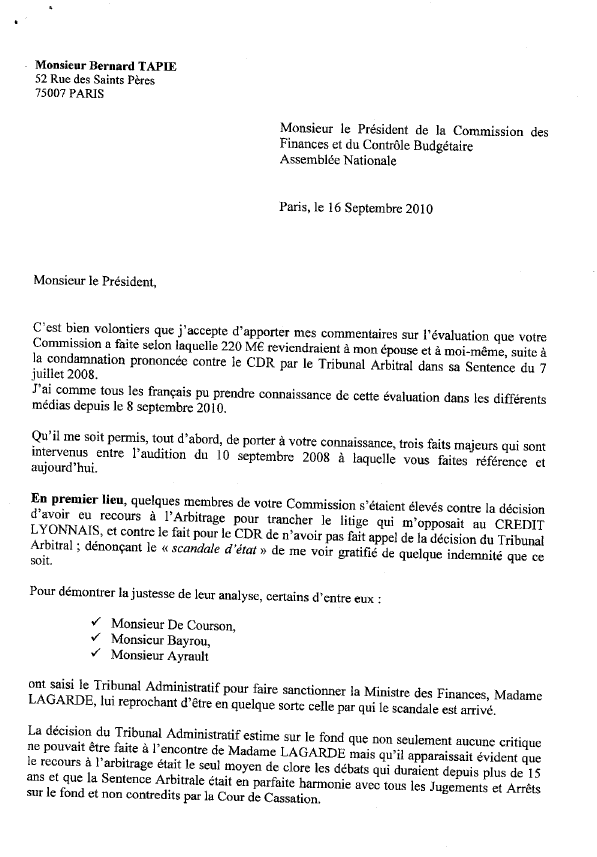
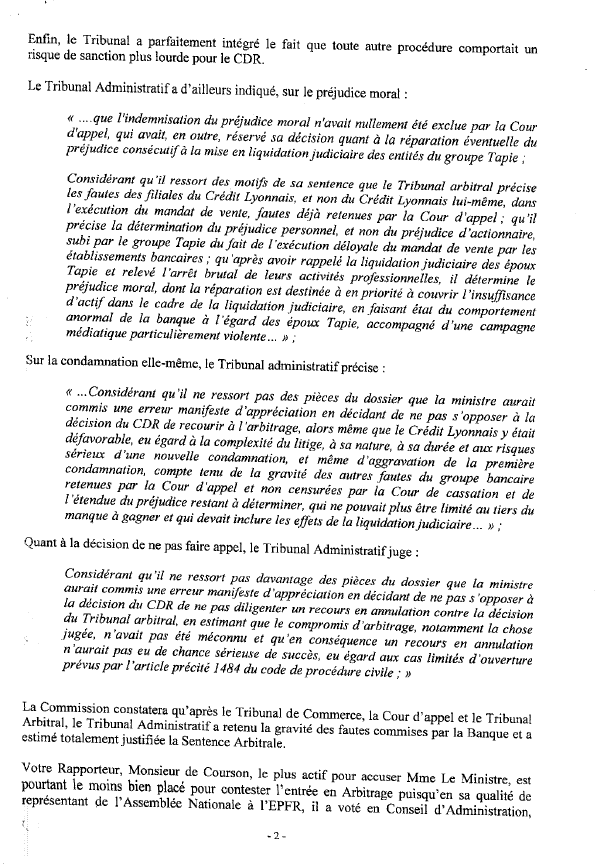
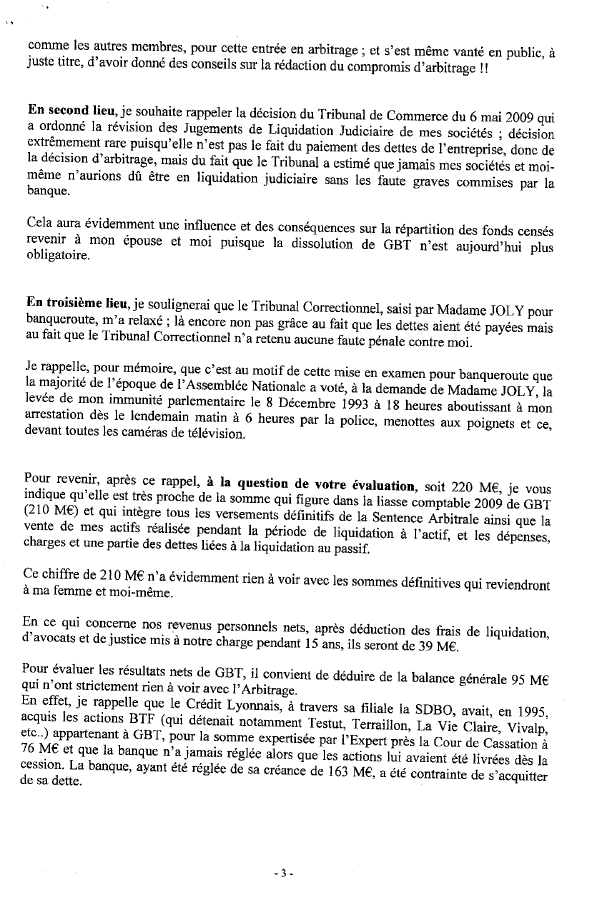

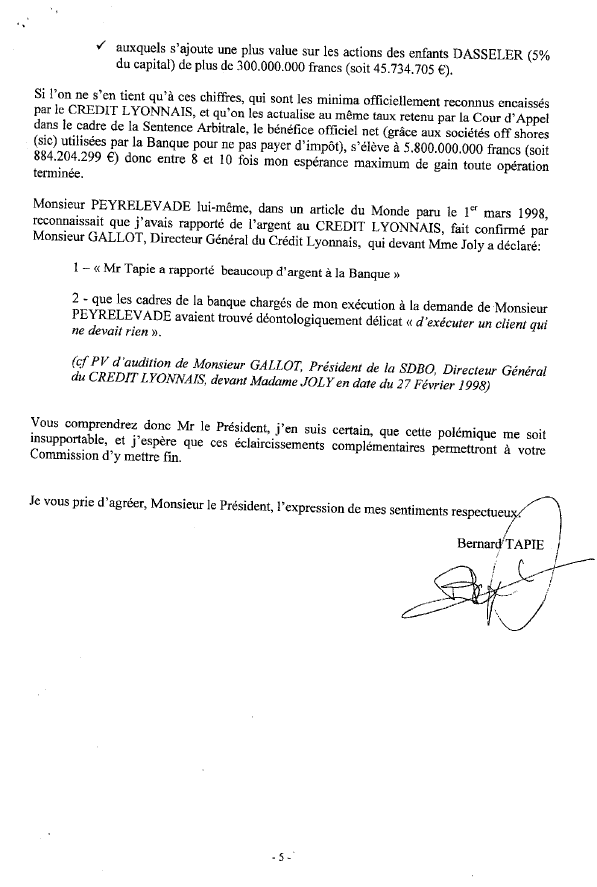
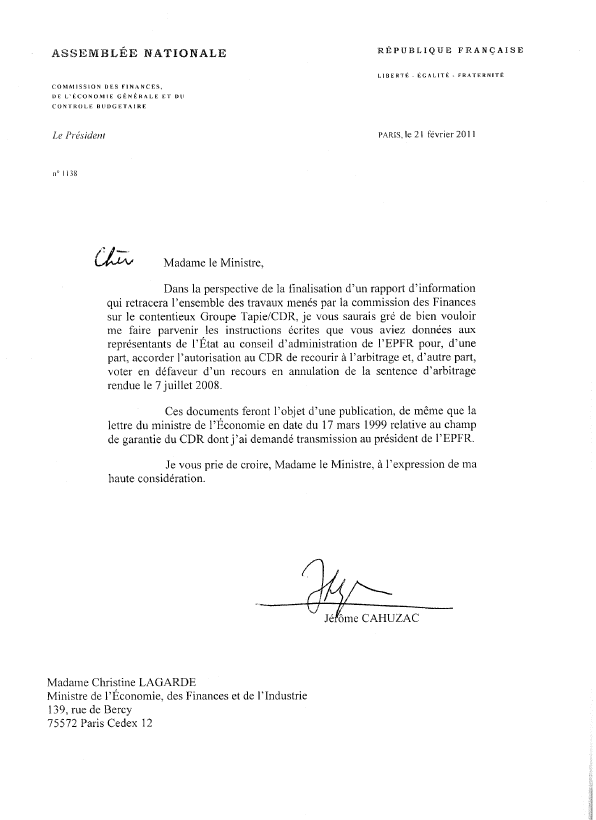
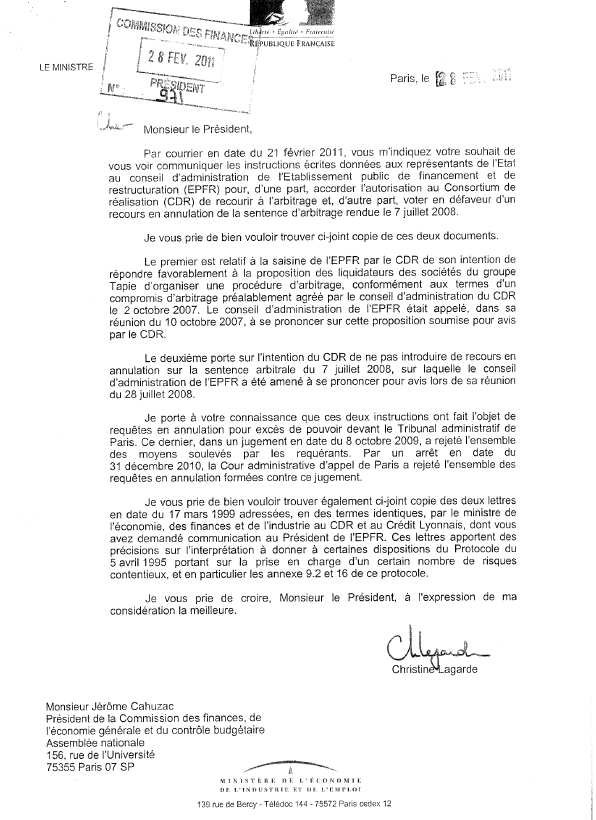
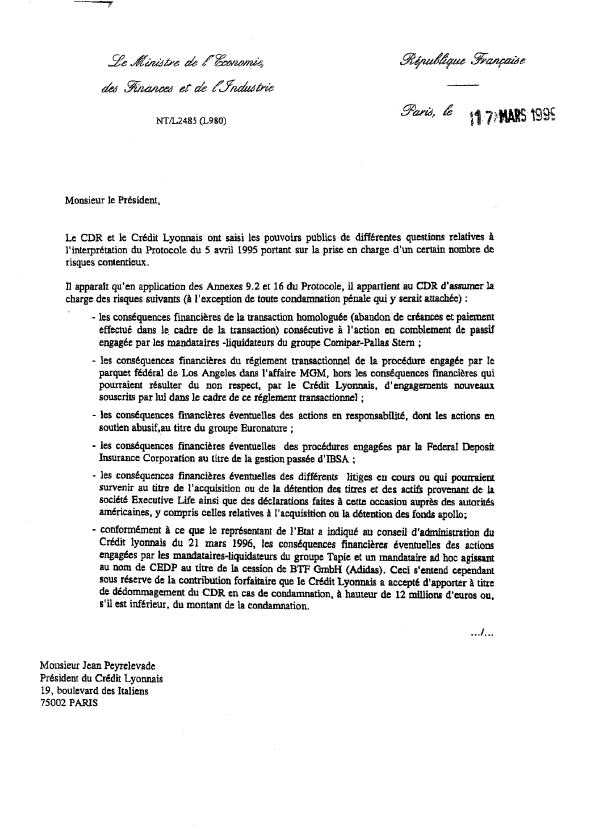
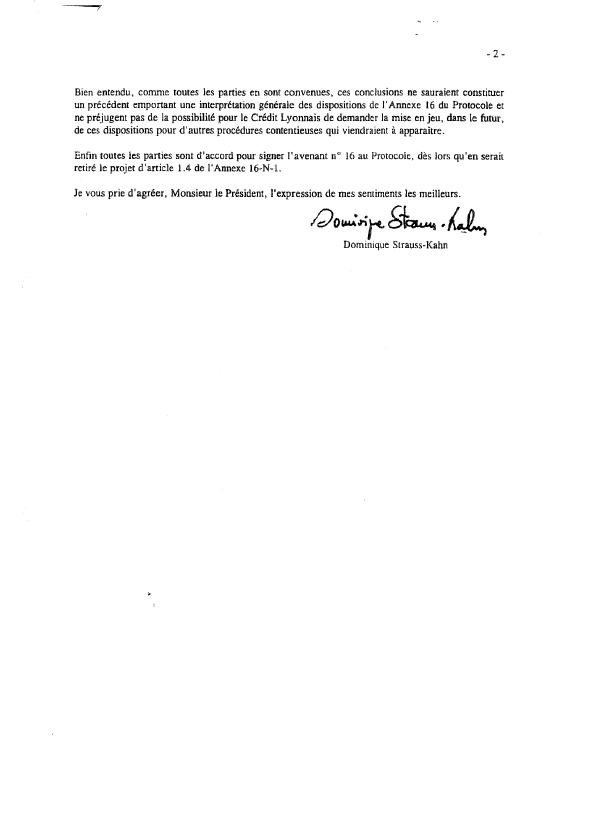
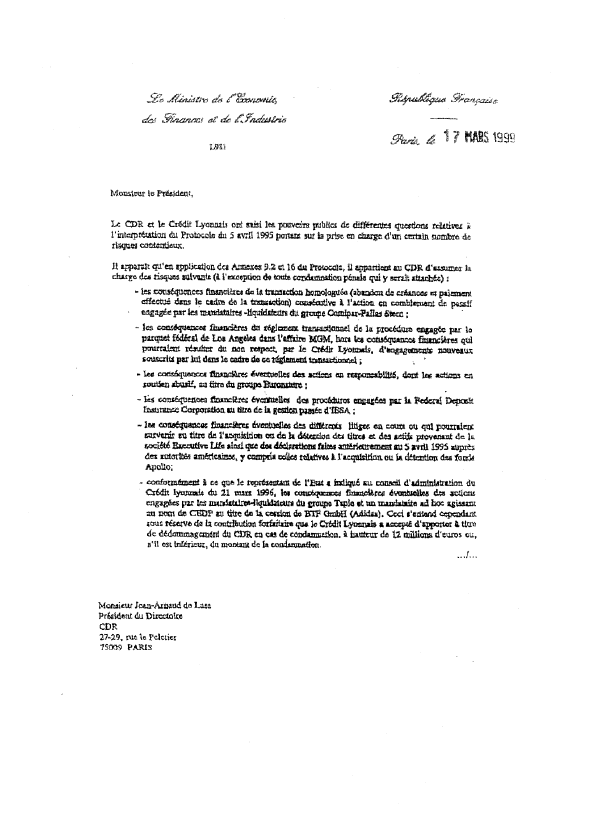
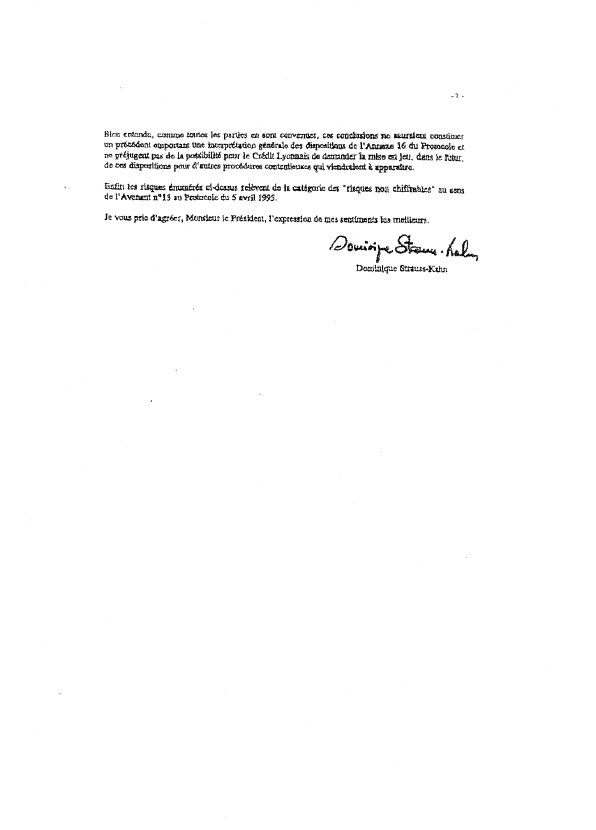
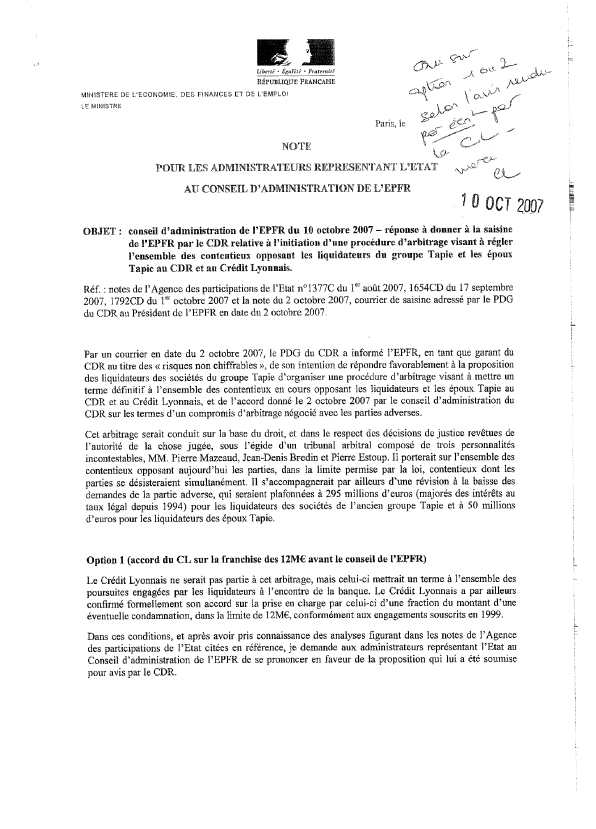
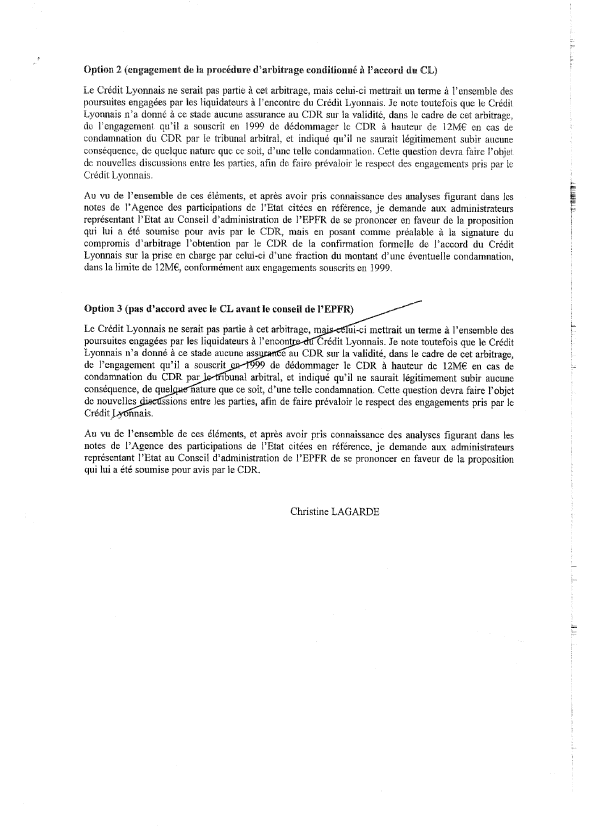
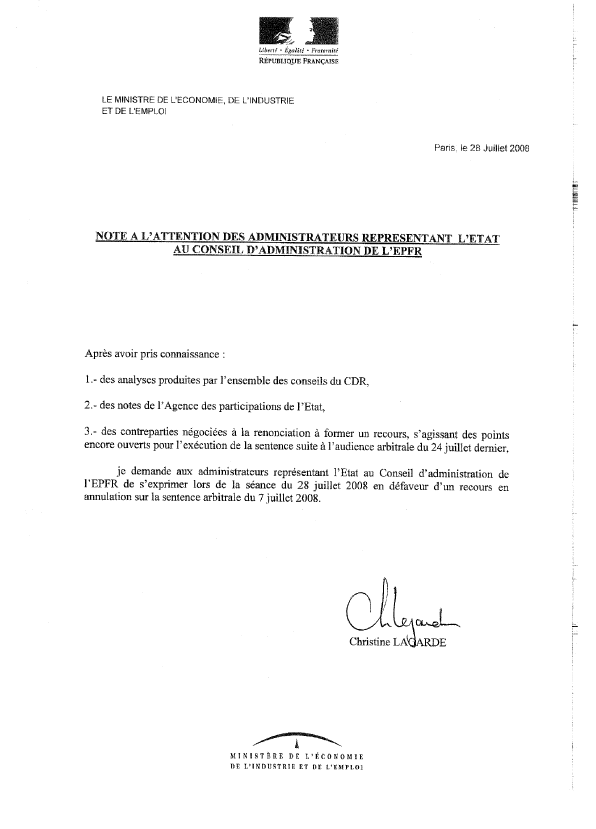
1 () Rapport n°1480 du 5 juillet 1994 de la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais, présenté par M. François d’Aubert.
2 () Rapport public annuel de la Cour des comptes, février 2008, « Le bilan de la gestion des défaisances ».
© Assemblée nationale
