DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),
TOME V
DÉFENSE
Par M. Paul QUILÈS,
Député
Voir le numéro 3363 (annexe n° 9)
INTRODUCTION 5
I – FACE A LA DÉGRADATION CONTINUE DE LA SITUATION INTERNATIONALE, LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ COLLECTIVE EST EN DIFFICULTÉ 7
A – L’AGGRAVATION DES TENSIONS ET DES CRISES INTERNATIONALES : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ COLLECTIVE À LA RECHERCHE D’UN SECOND SOUFFLE 7
1) Irak, Afghanistan, Moyen-Orient, Darfour : les guerres sans fin ? 7
2) Sécurité collective : le retour de l’ONU ? 11
B – PEUT-ON ENCORE SAUVER LE SYSTÈME INTERNATIONAL DE NON-PROLIFÉRATION ? 14
1) La prolifération nucléaire : jusqu’où ? 15
2) Comment relancer le régime de non-prolifération ? 18
II – LA NÉCESSAIRE REMISE À PLAT DE NOTRE POLITIQUE DE DÉFENSE 23
A – EN FINIR AVEC L’INERTIE ET LES NON-CHOIX BUDGÉTAIRES 23
1) Le projet de budget pour 2007 : un effort financier maintenu… 24
2) … mais qui témoigne de l’inertie du budget de la défense 27
B – REDÉFINIR NOTRE POLITIQUE DE DÉFENSE 28
1) Comprendre le nouveau contexte stratégique 29
a) L’influence de la pensée stratégique américaine : la revue de défense quadriennale de 2006 29
b) La prolifération des armes de destruction massive : un problème de long terme 33
c) La nécessité d’une approche globale des questions de sécurité : l’exemple de la sécurité énergétique 34
2) Pour un véritable débat sur les orientations de la politique de défense 36
a) D’une armée d’attente à une armée d’emploi : la question de la projection 36
b) Prévention et protection : quelle place pour la dissuasion ? 39
Mesdames, Messieurs,
C’est dans un contexte international particulièrement préoccupant que nous examinons aujourd’hui les crédits de la mission « défense » inscrits dans le projet de loi de finances pour 2007. Alors qu’un certain nombre de crises persistent et que des conflits s’enracinent, voire s’aggravent – Irak, Liban, Côte d’Ivoire, Afghanistan, Darfour… –, c’est aujourd’hui l’ordre nucléaire instauré en 1968 par le traité de non-prolifération qui est remis en cause, subissant les attaques répétées de l’Iran et de la Corée du Nord.
Dans ce contexte stratégique complexe et troublé, notre politique de défense s’en tient aux objectifs fixés dans la loi de programmation militaire pour les années 2003-2008, dont le projet de budget représente la cinquième annuité, loi elle-même fondée sur le livre blanc sur la défense de 1994 et déclinant les principes inscrits dans le modèle d’armée 2015.
Le contraste entre un monde où les repères stratégiques traditionnels sont profondément remis en cause et l’immobilisme de notre politique de défense, qui se réfère à des objectifs largement considérés comme périmés ne saurait se poursuivre durablement. Au plan intérieur, c’est l’acceptation, par l’opinion publique, des sommes importantes que nous consacrons à notre défense qui est en jeu. Au plan international, c’est notamment la crédibilité de l’engagement des forces françaises sur des théâtres extérieurs qui est en cause, alors qu’il s’agit là d’une mission dont tout donne à penser qu’elle s’inscrit dans la longue durée.
Afin que la France puisse continuer à jouer son rôle dans la résolution des crises internationales, il importe de sortir de cette posture figée et de s’interroger, pour les redéfinir, sur le fonctionnement et les principes de notre politique de défense.
I – FACE A LA DÉGRADATION CONTINUE DE LA SITUATION INTERNATIONALE, LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ COLLECTIVE
EST EN DIFFICULTÉ
Quinze années après la fin de l’ordre bipolaire international, les interrogations sur l’avenir du système de sécurité collective mis en place au lendemain de la seconde guerre mondiale n’en finissent pas de se multiplier. Notamment, la communauté internationale se révèle démunie devant les nouveaux types de conflits qui apparaissent : faute d’en comprendre la nouveauté, elle est en peine pour définir des solutions durables et satisfaisantes. S’il est en effet pour la France une leçon qu’il faut retenir du récent conflit au Liban, c’est celle de la modestie : modestie devant notre capacité collective à anticiper les crises, modestie devant nos limites à en imaginer la nouveauté – en l’occurrence, la guerre entre un État et une organisation non-étatique transnationale –, modestie devant notre aptitude à définir des modes de résolution des crises efficaces dans la durée.
Plus radicalement, c’est aujourd’hui l’ordre nucléaire international qui se trouve contesté. La contestation de cet ordre intrinsèquement inégal, instauré en 1968 dans le traité de non prolifération (TNP), par l’Iran notamment, renvoie à une fracture plus profonde dans un monde où la globalisation, tout en uniformisant les modes de vie, fait paradoxalement ressortir le gouffre qui sépare riches et pauvres. Peut-on mettre fin à cette contestation alors que le promoteur historique de cet ordre nucléaire international, les Etats-Unis, courtise un pays qui a toujours rejeté le TNP et signe avec lui un accord de coopération nucléaire ?
Stabiliser durablement les zones de crise et reconstruire la crédibilité du système de non-prolifération, tels sont aujourd’hui les deux objectifs internationaux prioritaires.
A – L’aggravation des tensions et des crises internationales : le système de sécurité collective à la recherche d’un second souffle
1) Irak, Afghanistan, Moyen-Orient, Darfour : les guerres sans fin ?
L’année 2006 aura été marquée par la dégradation continue des crises préexistantes : au Moyen-Orient, en Afrique ou en Afghanistan, on assiste sur le terrain à une exaspération des tensions. Au regard de l’enjeu pour la stabilité internationale et en termes humanitaires, quatre conflits retiennent l’attention.
• Le 1er mai 2003, le Président George W. Bush a officiellement déclaré l’achèvement des combats en Irak. Aujourd’hui, dans la perspective des élections au Congrès américain à mi-mandat, le débat sur la pérennité de l’engagement des Etats-Unis en Irak fait rage, alors que, petit à petit, le Président américain doit admettre la situation catastrophique qui règne aujourd’hui sur le terrain dans ce pays. C’est ainsi que, au mois d’octobre 2006, pour la première fois, le président des Etats-Unis a établi un parallèle entre la situation en Irak et l’intervention américaine au Vietnam, estimant qu’avec la montée des pertes américaines, les Etats-Unis seraient parvenus au même point qu’après l’offensive du Têt, en 1968, lorsque l’ampleur des combats provoqua le retournement de l’opinion américaine contre la guerre.
De fait, le bilan humain de la guerre en Irak ne cesse de s’alourdir pour les Etats-Unis. En septembre 2006, environ 2 700 soldats américains – soit bientôt autant de victimes que dans les attentats du World Trade Center –, près de 120 soldats britanniques et autant de soldats de pays alliés avaient trouvé la mort en Irak depuis le 20 mars 2003, pour un total d’environ 2900 soldats alliés décédés. Cela en fait la guerre la plus meurtrière pour les États-Unis depuis la guerre du Vietnam. Ceci sans compter les blessés graves : au total, on dénombre 17 469 blessés américains, dont 8 137 assez ou sérieusement blessés étant affligés de handicaps permanents, soit un total d’environ 20 000 soldats mis hors de combat et environ 12 % des effectifs engagés.
Le coût financier de la présence américaine en Irak est lui aussi massif, du fait de l’importance du dispositif américain en Irak. Ainsi, à la mi-2006, 135 000 hommes, soit dix-sept brigades dont six de la garde nationale des Etats-Unis, étaient déployés, dont 50 000 opérationnels, le reste s’occupant de la logistique. Ajoutons que, du fait du système des rotations de troupes, au total, plus d’un demi-million de militaires américains ont, à ce jour, fait un tour de service en Irak. Ces chiffres expliquent l’ampleur du budget consacré par les Etats-Unis à la guerre en Irak, estimé, en octobre 2006, à un total de 320 milliards de dollars depuis le début de la guerre.
Du côté irakien, ce bilan est plus terrible encore, même si, officiellement, le nombre d’Irakiens victimes des violences est inconnu. En octobre 2006, la revue médicale The Lancet estimait le nombre de morts irakiens imputables à la guerre à 655 000. Comparant les taux de mortalité dans les foyers de 1 982 individus en 2006 (certificats de décès à l’appui) aux chiffres officiels de 2003, l’étude montre que la mortalité aurait doublé pendant la guerre, passant de 5,5 à 13,3 pour mille. Cependant, cette étude est très fortement critiquée, même par des organisations opposées à l’intervention américaine en Irak. Il semble plus juste de s’en remettre aux chiffres cités par l’organisation non gouvernementale (ONG) Iraq Body Count, dont l’objet est la création d’une banque de données publique, indépendante et complète des civils morts en Irak, établie sur la base des rapports publiés par les médias. Selon cette ONG, on dénombrerait, côté irakien, plus de 43 000 morts. Pour sa part, le Président Georges Bush a évoqué le nombre de 30 000 morts.
Au-delà de leur caractère incertain, ces chiffres montrent que la situation en Irak échappe désormais largement à tout contrôle. Les Etats-Unis ont à faire à une guerre multiforme, qui combine résistance à l’occupant, terrorisme et lutte entre les composantes sunnites, chiites et kurdes de la population, avec, en toile de fond, le risque de l’éclatement de l’unité de l’Irak.
• L’Afghanistan, second théâtre important d’intervention de troupes internationales, voit également sa situation se dégrader fortement depuis quelques mois. Comme en Irak, c’est une dialectique redoutable qui s’est mise en place entre difficultés, pour les forces armées internationales, à assurer leur mission, et incapacité du gouvernement élu à établir son autorité sur l’ensemble du territoire. De fait, les difficultés actuellement rencontrées par les forces de l’OTAN à étendre leur zone d’action en dehors de Kaboul sont très directement liées au contexte politique afghan qui reste instable, notamment en raison de la recrudescence des attaques de la rébellion dans le Sud et l’Est du pays, et du fait du développement du trafic de drogue. Même le secteur de Kaboul, dont la France assume la responsabilité jusqu’en avril 2007, est un secteur difficile.
Les difficultés qu’éprouve l’OTAN à engager des renforts significatifs sont inquiétantes alors qu’elle vient de prendre la responsabilité de l’ensemble du pays. L’objectif reste cependant de transférer progressivement aux Afghans les tâches de sécurité et c’est pourquoi est maintenu un effort d’instruction intense au profit de l’armée afghane.
Les objectifs politiques affichés paraissent très largement déconnectés de la réalité du terrain. Et cette réalité est aujourd’hui marquée par la résurgence des talibans dans le sud-ouest de l’Afghanistan. Ceux-ci entretiennent des liens étroits avec les forces antiaméricaines en Irak, qui leur font partager leur expérience en matière de guérilla. Qui plus est, l’Afghanistan est redevenu un narco-État, fournissant 90 % de l’approvisionnement mondial d’opium. Ceci faute d’une politique efficace de lutte contre la pauvreté, alors que « depuis que la guerre a commencé, en dehors de Kaboul, rien ou presque n’a avancé, et la population souffre de la guerre et des privations. » (1) Le Times du 18 septembre 2006 indiquait ainsi que « 60 % du pays sont privés d’électricité et 80 % de la population ne disposent pas d’eau potable ».
• Suite aux événements au Liban, le Conseil de sécurité a autorisé, le 11 août 2006, par la Résolution 1701 adoptée à l’unanimité, le renforcement de la FINUL jusqu’à 15 000 hommes. La Résolution 1701 complète le mandat initial de la FINUL délivré par les résolutions 425 et 426 en 1978 (2), au regard de la nouvelle situation dans laquelle elle se trouve. Ce mandat porte sur le contrôle de la cessation des hostilités et le soutien apporté au gouvernement libanais pour le déploiement de son armée, la délivrance de l’aide humanitaire, la mise en place d’une zone exempte d’armes et, éventuellement, la sécurisation des frontières A noter qu’il ne comprend ni le désarmement actif du Hezbollah ni l’action directe vis-à-vis de la population libanaise.
Le déploiement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) renforcée se déroule de façon satisfaisante, sans que l’on puisse se départir d’une certaine prudence. Il faut en effet soutenir la détermination de l’ONU à se faire respecter et ne pas perdre la bataille de la communication. Il n’en reste pas moins que le retrait israélien est effectif et que l’armée libanaise, pour la première fois depuis vingt ans, a pu se déployer jusqu’à la ligne bleue de la frontière avec Israël.
Reste que, outre l’incertitude qui pèse sur la capacité de la nouvelle FINUL à mettre en œuvre sa mission à moyen et long terme, le bilan qui peut être tiré de l’intervention israélienne au Liban à l’été 2006 apparaît d’ores et déjà comme hautement préoccupant. L’absence de stratégie claire d’Israël a conduit au renforcement du prestige du Hezbollah, dont il est à craindre qu’il utilise la FINUL comme un bouclier.
• La situation au Darfour se dégrade de façon préoccupante, dans la quasi-indifférence de l’opinion internationale :
– l’accord de cessez-le-feu humanitaire de N’Djamena (juillet 2004) n’est pas respecté ;
– l’accord de paix d’Abuja conclu le 5 mai 2006 reste pour l’essentiel lettre morte.
Khartoum n’a pas renoncé à l’option militaire, pas plus que certains mouvements rebelles. Ainsi, le gouvernement soudanais a repris début août les hostilités, après avoir acheminé dans le nord et l’ouest Darfour de nombreux renforts (jusqu’a 30 000 hommes). Le Front de rédemption nationale, principal regroupement de mouvements rebelles opposés à Abuja, répond à ces offensives ou les devance, le rapport de force semblant lui être désormais favorable
– victoires d’Um Sidr le 12 septembre et de Tine les 6/7 octobre 2006.
L’aggravation de la situation humanitaire n’a pu qu’en résulter, soulignant l’ampleur de la crise.
Dans cette région de la taille de la France, ce sont près de 10 000 personnes par mois qui périssent. Deux millions de déplacés et 250 000 réfugiés sur le territoire tchadien survivent grâce à l’aide humanitaire, pour autant qu’ils y aient accès, ce qui n’est actuellement pas le cas pour près de 224 000 déplacés. D’autant que les organisations humanitaires présentes sont contraintes de travailler avec l’accord du gouvernement : il est par conséquent difficile dans ces conditions d’agir librement, l’Etat harcelant le personnel humanitaire qu’il soupçonne de divulguer les exactions. Des représentants des organisations humanitaires ont notamment été condamnés à 70 coups de fouets.
La liberté de circulation des journalistes fait également l’objet d’entraves importantes par le gouvernement soudanais. Ainsi en est-il du photographe Brad Clift, ce journaliste américain de Hartford Courant qui a été arrêté pour avoir pris des photos des camps au Darfour.
Trop faible, la mobilisation de la communauté internationale n’a pas pour l’heure permis d’enrayer cette dégradation. La mission de l’Union africaine déployée au Darfour (AMIS, près de 8 000 hommes), aussi déficiente soit-elle, contribue toutefois à assurer un minimum de sécurité. Le conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé le 20 septembre dernier de prolonger la mission jusqu’a fin 2006, avec le souhait affiché de ne pas aller au-delà. L’ampleur de la crise au Darfour impose le déploiement d’une opération de maintien de la paix des Nations unies conformément à la résolution 1706 (31 août 2006) du Conseil de sécurité. Cependant, le gouvernement soudanais oppose un refus persistant au déploiement de cette force mais semble accepter le renforcement de l’AMIS par les Nations unies, tout en exigeant le départ du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour les propos tenus sur les difficultés militaires du camp gouvernemental – départ qu’il a obtenu.
2) Sécurité collective : le retour de l’ONU ?
Trois enseignements majeurs peuvent être tirés des quatre crises décrites ci-dessus.
En premier lieu, elles révèlent que le système international n’a pas encore réussi à tirer les conséquences du constat partout fait depuis la fin de la guerre froide, relatif à l’évolution de la nature des conflits. A cet égard, les événements du Liban incarnent certainement l’illustration paroxystique de ce thème rebattu puisque, dans ce cas de figure, c’est à une organisation non gouvernementale agissant sur le territoire d’un État, disposant d’une armée forte et de soutien extérieurs, que l’État souverain d’Israël s’est attaqué.
Souvenons-nous, lors de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, des savants développements sur les guerres de l’après-guerre froide, qui devaient désormais prendre, disait-on, la forme de guerres éclairs, sous forme de frappes aériennes. Les mêmes constats définitifs furent entendus après l’intervention en Afghanistan.
Or, on le voit aujourd’hui en Irak, l’erreur fondamentale des Etats-Unis est d’avoir cru que le déroulement éclair de la guerre en Afghanistan serait désormais le modèle des futures interventions qui conjuguent avance technologique, effet de surprise et moyens humains fortement resserrés.
Désormais, en effet, la guerre ne s’arrête plus avec la maîtrise du champ de bataille. De même qu’Israël n’a pas su terminer son intervention au Liban, de même les Etats-Unis payent aujourd’hui en Irak un lourd prix à l’omission, dans les plans du Pentagone, des besoins liés à la reconstruction du pays. En réalité, les révélations qui se multiplient sur les préparatifs de l’intervention en Irak témoignent que non seulement les préoccupations liées à la reconstruction et à la stabilisation du pays étaient négligées mais qu’elles étaient ouvertement décriées. Le président Bush, le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld ne cachaient pas leur mépris pour les opérations de stabilisation et de maintien de la paix conduites dans les Balkans. Il apparaît aujourd’hui que, alors que les préparatifs militaires se sont étalés sur dix-huit mois, les consultations sur la reconstruction n’ont commencé qu’un mois avant la date de l’invasion.
Ce constat est d’autant plus préoccupant que – et c’est le deuxième enseignement qu’il faut tirer des quatre crises évoquées – les Etats-Unis détiennent, qu’on le veuille ou non, les clés de la stabilité internationale. A ce titre, la focalisation américaine sur la « guerre contre le terrorisme », au détriment d’une analyse politique de la situation de terrain – en Irak surtout, au Moyen-Orient en général – est lourde de conséquences pour la stabilité internationale. De même, la situation en Afghanistan illustre l’impasse stratégique à laquelle conduit une approche compartimentée de la situation intérieure des pays en crise, avec, d’un côté, la lutte contre le terrorisme, sur laquelle les Etats-Unis auraient la haute main, et, de l’autre, une communauté internationale qui s’efforcerait de stabiliser le pays et d’aider les autorités locales à mettre en œuvre les nécessaires réformes politiques, économiques et sociales. Comme l’a rappelé le général Bruno Cuche, Chef d’état-major de l’armée de terre lors de son audition devant la commission de la défense, le 18 octobre 2006, « le concept de bataille décisive n’est plus aussi pertinent qu’auparavant. C’est désormais sur la phase de stabilisation de l’espace terrestre que se concentre l’effort principal. C’est la manœuvre, à savoir la combinaison des moyens militaires et civils, de l’action politique, diplomatique et militaire, qui permet de neutraliser ou de discréditer les groupes armés et d’offrir des perspectives aux populations. ».
En troisième et dernier lieu, la crise du Liban a de nouveau posé la question du cadre international dans lequel une action d’interposition armée pouvait être efficacement conduite. Les Etats-Unis ont proposé que l’OTAN intervînt, eux-mêmes ne souhaitant pas s’impliquer sur le terrain. Or l’OTAN atteint aujourd’hui la limite de ses capacités, du fait de son intervention en Afghanistan et de l’élargissement de son champ d’action dans ce pays.
A travers ce débat, c’est, plus largement, le problème de l’articulation entre l’action de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne qui revient au premier plan.
Les interventions extérieures de l’ONU, de l’OTAN et de l’Union européenne
L’Organisation des Nations unies conduit actuellement quinze opérations de maintien de la paix et déploie environ 93 000 personnes, chiffre qui devrait fortement s’accroître dans les mois à venir avec le renforcement de la FINUL et du Timor (112 000 personnes selon les prévisions actuelles). L’intervention de l’ONU au Darfour pourrait porter ce chiffre à 140 000.
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord conduit pour sa part cinq opérations, les plus importantes étant celles au Kosovo et en Afghanistan. Elle projette à ce titre environ 27 000 soldats sur des théâtres d’opérations extérieures. La dernière mission déployée est celle concernant l’assistance en matière de transport stratégique auprès de l’Union africaine dans la mission qu’elle mène au Darfour.
Enfin, l’Union européenne conduit douze missions, dont deux opérations militaires, déployant à ce titre environ 8 300 hommes (soldats, policiers, experts civils, juges, etc.). Certaines missions sont menées en étroite coopération avec l’OTAN, d’autres sont menées de manière autonome et l’OTAN est, dans ce cas, simplement tenue informée.
Le débat n’est pas nouveau : il parcourt en filigrane toute l’histoire internationale depuis quinze ans, alors que la chute du mur de Berlin a posé la question du rôle de l’OTAN dans le nouveau contexte stratégique international. Il est revenu brutalement sur le devant de la scène avec l’arrivée au pouvoir de l’administration Bush, du fait de sa méfiance à l’égard du système des Nations unies, symbole d’un multilatéralisme honni chez nombre de « faucons » et de néo-conservateurs américains.
Désireux de contourner une organisation qu’il juge inefficace, les Etats-Unis cherchent à faire évoluer l’Alliance atlantique vers un rôle global de sécurité. La préparation du sommet de l’OTAN à Riga, au mois de novembre 2006, fournit un nouvel exemple de cette démarche constante des Etats-Unis depuis quelques années. Ainsi, en vue de cette réunion de l’Alliance, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont proposé, en mars dernier, la mise en place, pour 2008, d’un partenariat global qui se superposerait aux cadres actuels réunissant les membres, les Alliés, les Partenaires et les pays-contacts autour du Conseil de l’Atlantique. Ce partenariat global permettrait, dans le projet américano-britannique, de créer, d’un côté, un « forum des pourvoyeurs de sécurité » et, de l’autre, un « forum des consommateurs de sécurité ». L’idée serait en quelque sorte, en adjoignant à l’Alliance le Japon, la Corée du Sud et l’Australie notamment, de créer une sorte de « club » des pays riches, qui prendrait en charge les problèmes de sécurité collective, voire traiterait des grands problèmes internationaux.
Dans cet esprit, c’est ainsi que depuis le début de l’année 2006, le sujet de la sécurité énergétique, apparu antérieurement en filigrane, se fait de plus en plus visible à l’OTAN. Sous impulsion américaine, relayée par certains Alliés et partenaires, le secrétaire général de l’OTAN et le SACEUR appuient ce nouveau champ d’intérêt et tentent d’en faire un champ de compétence supplémentaire pour le sommet de l’OTAN à Riga. Toutefois, ce thème ne recueille pas de consensus, pas plus que l’initiative ci-dessus n’a rallié le consensus des Alliés. La France considère qu’il n’y a pas lieu que l’OTAN étende ses compétences dans ce domaine pour lequel d’autres organisations ont un rôle reconnu (G8, Union européenne, Agence Internationale de l’Énergie).
S’agissant du système de sécurité collective, c’est à l’ONU qu’il revient d’en assumer la charge. La question de l’efficacité de l’ONU se pose avec force depuis 2003, l’incapacité du Conseil de sécurité à empêcher l’attaque américaine en Irak laissant présager un affaiblissement durable de son autorité. Trois ans plus tard, force est de constater que les difficultés rencontrées par les Etats-Unis en Irak ont ramené le Conseil de sécurité au centre des affaires internationales, comme en témoignent les négociations sur la Corée du Nord ou le Darfour. Le défi est donc aujourd’hui gigantesque pour l’ONU, puisqu’il s’agit pour elle de garantir le retour américain à la logique multilatérale, en faisant la preuve de sa capacité à mener à bien sa mission. A cette fin, les réformes visant à renforcer l’ONU doivent être poursuivies, seules à même de ramener la confiance des États dans l’organisation.
La réforme clé concerne l’amélioration de la représentativité de l’Organisation, nécessaire pour contrer le sentiment de marginalisation ressenti par certains États, ce qui mine la capacité de l’Organisation à prévenir les conflits. Chacun s’accorde aujourd’hui à reconnaître l’échec des différents projets de réforme du Conseil de sécurité soumis aux États membres depuis deux ans. Pour autant, chacun reste également convaincu de la nécessité de réformer la composition du Conseil, jugée plus cruciale que jamais. Si aucune perspective d’accord n’est perceptible à ce jour, la volonté politique est là, néanmoins, de préserver l’efficacité de l’ONU, ce qui devrait, à moyen terme, permettre à un accord d’émerger.
B – Peut-on encore sauver le système international de non-prolifération ?
Reste que, au-delà même des négociations internationales, au sein de l’ONU, sur la nécessaire réforme de l’Organisation, c’est dans un autre domaine que risque de se jouer la crédibilité du système onusien : les récents développements concernant le développement d’une arme nucléaire en Corée du Nord et en Iran mettent en cause les fondements du système de sécurité collective, qui repose, depuis près de quatre décennies, sur le régime de non-prolifération dont le traité de non-prolifération (TNP), signé en 1968, constitue le socle.
1) La prolifération nucléaire : jusqu’où ?
En janvier 2003, la Corée du Nord a annoncé qu’elle se retirait du TNP et qu’elle entamait des opérations de retraitement de combustible irradié.
Depuis, malgré les négociations multilatérales réunissant en juin 2004 la Corée du Nord, les Etats-Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et la Russie (dites « pourparlers à six »), le dossier nord-coréen n’a que peu progressé. Bien que les discussions aient abouti le 19 septembre 2005 à un premier mandat de négociations sur le règlement de la crise (dénucléarisation de la péninsule, normalisation des relations avec les Etats-Unis, développement des coopérations dans le domaine de l’énergie et des échanges commerciaux, promotion de la paix en Asie du Nord-Est), le processus est bloqué depuis novembre 2005. La Corée du Nord exige au préalable la levée des sanctions adoptées par les Etats-Unis à l’automne 2005 à l’encontre d’entreprises nord-coréennes, dans le cadre de leur politique de lutte contre les financements proliférants (3).
La résolution 1695, en réaction aux essais balistiques nord-coréens du 5 juillet 2006, a permis d’envoyer un message fort à Pyongyang. Adoptée le 15 juillet 2006, elle condamne les essais menés, exige de la Corée du Nord la suspension de son programme balistique et le respect de ses engagements antérieurs en faveur d’un moratoire. Elle demande à tous les États membres d’être vigilants et d’empêcher les transferts de missiles, biens ou technologies liés aux missiles, vers la Corée du Nord et en provenance de celle-ci. La vigilance requise contre l’achat à la Corée du Nord d’articles liés aux missiles s’intègre dans une politique de lutte contre les financements proliférants à laquelle la résolution porte une attention toute particulière. Enfin, le Conseil de sécurité engage Pyongyang à revenir à la table des négociations des pourparlers à six afin de mettre en œuvre au plus vite la déclaration commune du 19 septembre 2005.
Cependant, la décision de la Corée du Nord de faire exploser un engin nucléaire, le 9 octobre 2006, a mis en lumière l’échec total de la communauté internationale à mettre fin au programme nucléaire nord-coréen. Certes, des doutes importants existent quant à la réussite et à la portée de cet essai que les Nord-Coréens qualifient d’« historique ». Ainsi, comme l’a souligné le ministre de la Défense, le 11 octobre 2006, on peut avoir des doutes sur le caractère nucléaire de l’explosion : tous les experts considèrent en effet que, si c’était effectivement un essai nucléaire, il serait « raté », la puissance du test étant « de l’ordre d’une demi-kilotonne ». De même, la Maison Blanche a indiqué également n’avoir pas la confirmation qu’il s’agissait d’un essai nucléaire.
Reste que, intervenant dans le contexte de la crise nucléaire iranienne, elle aussi dans une impasse diplomatique, cette annonce tend à accroître l’image d’un système de non-prolifération moribond et de l’impuissance de la communauté internationale à stopper les démarches proliférantes.
En effet, en dépit des multiples efforts de la troïka européenne, soutenue par les Etats-Unis, l’Iran reste totalement arc-boutée sur sa détermination de poursuivre son programme d’enrichissement de l’uranium. Ainsi, depuis les élections présidentielles iraniennes de juillet 2005 et l’annonce par Téhéran, le 1er août 2005, de son intention de reprendre les activités d’enrichissement de l’uranium, l’Iran n’a cessé de durcir sa position. Téhéran est resté sur cette ligne en dépit des multiples efforts de la communauté internationale, en particulier ceux de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne (EU3) et malgré le transfert du dossier au Conseil de sécurité, le 8 mars 2006 et les nouvelles offres de négociations faites par les EU3, les Etats-Unis, la Chine et la Russie (« EU 3+3 ») avec le soutien du haut représentant de l’Union européenne – offre portant sur un ensemble de coopérations substantielles, notamment dans le nucléaire civil.
Malgré les invitations pressantes des Européens d’apporter une réponse à ces propositions avant le sommet du G8 à Saint-Pétersbourg (15 juillet 2006), les Iraniens ont proposé la date du 22 août, prétextant du besoin de les étudier attentivement. Constatant dans le même temps que l’Iran ne prenait pas les mesures demandées par l’AIEA et poursuivait ses activités, les « EU 3+3 » ont décidé lors d’une réunion ministérielle à Paris, le 12 juillet 2006, de travailler à l’adoption d’une résolution du Conseil de Sécurité sanctionnant l’attitude iranienne.
La résolution 1696, adopté le 31 juillet 2006, rend obligatoire la suspension par l’Iran des activités liées à l’enrichissement et au retraitement de l’uranium, y compris en matière de recherche et développement. Elle endosse l’offre de négociations présentée par les « EU 3+3 ». Elle prévoit, au cas où l’Iran ne se conformerait pas aux termes de cette résolution d’ici au 31 août, que le Conseil de sécurité œuvre en vue de l’adoption de mesures au titre de l’article 41 de la charte des Nations-Unies (sanctions économiques et commerciales, embargo sur les armes, interdictions de déplacement, mesures financières et diplomatiques, …).
L’annonce par l’Iran, le 26 octobre 2006, de la mise en service d’une nouvelle cascade de centrifugeuses, montre que Téhéran n’est pas disposé à céder du terrain.
A l’évidence, aujourd’hui, les deux crises majeures que traversent le régime international de non-prolifération ne peuvent plus être traitées séparément – elles sont d’ailleurs toutes deux sur le bureau du Conseil de sécurité –, en dépit des motivations et de l’histoire différentes des démarches proliférantes de ces deux pays. Il ne fait pas de doute en effet que l’Iran est extrêmement attentif à la manière dont la communauté internationale réagit à l’égard de la Corée du Nord et il n’est certainement pas exagéré de considérer que cette réaction sera déterminante pour l’évolution de l’attitude iranienne.
A cet égard, il est difficile de se défendre d’un certain pessimisme.
Les sanctions décidées par le Conseil de sécurité contre la Corée du Nord sont-elles de nature à faire reculer ce pays ? Je crains qu’il faille répondre par la négative : ces sanctions représentent certes un premier pas mais il est insuffisant. Notamment, il n’est pas certain que la Chine soit disposée à les appliquer strictement ; or toute l’efficacité du dispositif dépend d’elle. Et quand bien même elle appliquerait la résolution, il manque au dispositif retenu la seule sanction efficace contre la Corée du Nord : l’arrêt des exportations pétrolières chinoises, qui serait la seule manière pour la Corée du Nord de comprendre que la Chine tient le sort du régime entre ses mains.
De fait, le raisonnement des dirigeants chinois a changé et ils font désormais de la question nord-coréenne une question d’honneur : l’essai nord-coréen a été pris comme une gifle pour un pays qui se présente comme l’interlocuteur indispensable sur ce dossier depuis deux ans. Reste que, tout mécontents qu’ils soient, les Chinois restent prudents et se trouvent dans un dilemme quant à la définition de l’attitude à adopter. Prendre le risque de faire chuter le régime nord-coréen pourrait avoir d’importantes répercussions intérieures en Chine, notamment dans les régions mitoyennes de la Corée. Quant à l’hypothèse d’une nucléarisation du Japon par réaction à la nucléarisation nord-coréenne, elle ne représente pas un argument pour la Chine ; à ses yeux, le Japon, sous parapluie nucléaire américain et susceptible de se doter en quelques mois de l’arme nucléaire, est déjà une puissance nucléaire. Au vu de ces différents arguments, on peut se demander si, dans une certaine mesure, on ne considère pas, dans une partie des cercles dirigeants chinois, qu’une Corée du nord nucléaire vaudrait mieux qu’une Corée du Nord qui s’effondre. En l’occurrence, il est probable que la choix de la Chine dans cette crise sera… d’éviter d’en faire un, et de laisser faire.
Au total, le scénario le plus probable est celui d’une Corée du Nord nucléaire, « contenue », au sens de la doctrine américaine de containment, restant en dehors de tout système régional ou international. L’effondrement du pays, qu’un certain nombre de chancelleries espéraient pendant la décennie de négociations avec la Corée du Nord, ne doit pas être considéré comme un objectif à court et moyen terme.
Dans le même esprit, les sanctions susceptibles d’être mises en œuvre contre l’Iran sont-elles crédibles pour le régime de Téhéran ? Force est de reconnaître aujourd’hui la menace d’une intervention militaire américaine n’est pas susceptible de faire évoluer le comportement de l’Iran, dans la mesure où il n’y croit pas. Il y a là, à l’évidence, un pari risqué de la part du régime d’Ahmadinejad : dans quelle mesure, en effet, le Président américain acceptera-t-il de conclure sa présidence sur un triple échec en Irak, en Corée du Nord et en Iran, trois pays qu’il avait désignés comme les représentants de l’ « axe du mal » lors de son arrivée à la Maison blanche ?
A dire vrai, la difficulté de la situation actuelle vient du fait que tout ce qui s’est passé au cours des années récentes en matière de prolifération conforte les Iraniens dans leur démarche. Notamment, ils observent ce qui se passe avec l’Inde, puissance régionale à laquelle ils se comparent volontiers : proliférateur sanctionné naguère, ce pays s’apprête aujourd’hui à s’engager dans des coopérations nucléaires avec les Occidentaux. Et si le Pakistan n’est pas engagé dans la même voie, c’est, non pas pour avoir proliféré, mais en raison de l’instabilité et du risque terroriste dans ce pays. Sans doute le raisonnement iranien omet-il un élément essentiel aux yeux de la communauté internationale : ils commettent une erreur d’appréciation, en ce que ni l’Inde ni le Pakistan n’ont violé le TNP, n’en étant pas signataires. Reste que le cas de la Corée du Nord, pays signataire du TNP, ne peut que les conforter dans leur démarche : non seulement ce pays s’est retiré du TNP de manière unilatérale, sans être sanctionné, mais en outre, la soi-disant inacceptable arme nucléaire de la Corée du Nord est en passe de devenir réalité.
2) Comment relancer le régime de non-prolifération ?
A l’évidence, une nucléarisation officielle de la Corée du Nord, puis de l’Iran ferait basculer le monde dans un contexte stratégique radicalement nouveau. Elle créerait notamment un risque élevé de proliférations en chaîne dans un certain nombre de pays, dont la liste peut d’ores et déjà être établie : peuvent être considérés comme de possibles candidats le Japon, Taiwan, l’Arabie saoudite, l’Égypte ou encore le Brésil. Chacun de ces pays obéirait certes à des motivations différentes, au regard du contexte géopolitique régional dans lequel il évolue. A l’évidence, toutefois, au-delà même des rivalités géopolitiques qui pourraient motiver les pays à majorité sunnite, la rhétorique iranienne sur le droit à l’enrichissement et sur le lien entre maîtrise du cycle du combustible et souveraineté nationale fait mouche. Le cas du Brésil mérite notamment un regard attentif : pour ce pays qui ne subit aucune menace directe, la maîtrise de l’intégralité du cycle de l’enrichissement de l’uranium jouerait aussi comme un symbole de souveraineté très puissant.
Face à ce scénario de cauchemar, une question s’impose : que peut-on faire pour sauver le régime de non-prolifération ? Les ambitions nucléaires de l’Iran et de la Corée du Nord posent en effet la question de l’avenir du traité de non-prolifération. Les dispositions de ce traité correspondent-elles encore aux exigences de notre époque ou faut-il lui substituer un nouvel instrument ?
Car celui-ci n’est pas mort à ce stade. Certes, la Corée du Nord n’en est plus membre. N’oublions pas cependant que le TNP reste une norme juridique quasi universelle depuis l’adhésion de Cuba, en 2003 et qu’à ce jour, l’Iran est encore partie au traité.
Toute la difficulté provient de ce que ce traité, dont les imperfections sont connues, est considéré comme non modifiable. Imparfait, il l’est en effet à plusieurs titres : rédaction ambiguë, quasi-impossibilité de modification, inapplication des dispositions relatives au désarmement, insuffisance des contrôles, etc., ce traité court est assurément imprécis. Il souffre également de lacunes, dues à l’évolution du contexte international depuis sa négociation, dans les années 1960. Ainsi, rien n’est prévu dans le traité concernant le risque représenté par l’acquisition d’armes nucléaires par des acteurs non étatiques ou des terroristes. C’est d’ailleurs pour compenser cette lacune que fut adoptée la résolution 1540 du Conseil de sécurité d’avril 2004, dans laquelle le Conseil demande à tous les États de mettre en place des mesures de contrôle intérieures efficaces en vue d’empêcher l’acquisition d’armes de destruction massive par des acteurs non étatiques.
Même si le traité manque de clarté, par exemple sur le problème de l’enrichissement, l’amender reviendrait à ouvrir la boîte de Pandore. Qui plus est, au-delà de la lettre, l’intention des négociateurs était claire sur ce point précis : jamais il n’a été question de reconnaître un droit à l’enrichissement aux signataires du traité.
Les faiblesses intrinsèques du traité apparaissent d’autant plus qu’il est en outre fragilisé par des facteurs externes, tels que le non-respect de l’engagement à une cessation de la course aux armements nucléaires, l’accent mis sur les armes nucléaires dans certaines doctrines de défense ou encore la négociation d’un accord de coopération nucléaire civile entre l’Inde et les Etats-Unis.
A ce stade, cependant, il existe encore une initiative de nature à convaincre les États non dotés de l’arme nucléaire que le régime de non-prolifération est crédible et que l’inégalité fondamentale qu’il instaure vise la sécurité internationale, et non la préservation, par quelques-uns, de leur supériorité stratégique. Celle-ci tient dans un seul mot : désarmement. Le TNP ne pouvant être modifié en lui-même, il faut le compléter par un traité de désarmement complet et progressif, c’est-à-dire tout simplement appliquer les dispositions contenues dans l’article 6.
Une telle initiative permettrait de restaurer l’image du TNP, dont le caractère intrinsèquement inégalitaire est aujourd’hui ressenti comme injuste, précisément parce que les dispositions qui permettaient de faire accepter l’inégalité entre États dotés de l’arme nucléaire et États non dotés de l’arme nucléaire ne sont pas appliquées. Ce qui est en cause, c’est la construction d’« un ordre nucléaire démocratique. Il requiert que les grandes puissances nucléaires se soumettent, elles aussi, à des disciplines nucléaires internationales » (4). L’insuffisante prise en compte du désarmement handicape la position des États dotés de l’armée nucléaire qui cherche aujourd’hui à dissuader par la diplomatie l’Iran de violer définitivement le TNP.
A ce titre, des progrès sont essentiels dans les négociations en cours au sein de la Conférence du désarmement, organe des Nations unies. Or, pour l’heure, « personne ne fait vraiment d’efforts pour aller vers un système différent, un système qui ne soit pas basé sur les armes nucléaires » (5).
Ainsi, du fait d’un désaccord persistant entre ses membres, la Conférence du désarmement n’a pu établir un programme de travail malgré les efforts de la présidence. Dès lors, son activité au cours de l’année 2006, comme depuis neuf ans, a été des plus réduites. Les discussions sur un programme de travail se poursuivent. On notera toutefois qu’à l’initiative de la France, qui reprenait une idée initialement lancée par l’Inde, des travaux informels sur « les nouveaux sujets » ont été amorcés en 2004, en marge de la Conférence du désarmement, pour faire naître un débat et susciter des réflexions sur des enjeux de sécurité internationale qui étaient jusque-là insuffisamment traités dans les enceintes multilatérales. Dans le cadre de ces travaux, des échanges fructueux ont eu lieu sur des questions comme la protection des infrastructures critiques ou le terrorisme nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique.
De même, il faut poursuivre les efforts en vue de rendre applicable le traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE), signé en 1996. Aujourd’hui, 176 Etats membres de l’ONU – sur 194 – l’ont rejoint, 134 États l’ayant ratifié, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni et la Russie. Le nombre des États de cette liste n’ayant ni signé ni ratifié le traité se limite toujours à trois : la Corée du Nord, l’Inde et le Pakistan. La Chine, la Colombie, l’Égypte, l’Indonésie, l’Iran, Israël et les Etats-Unis l’ont signé, mais pas encore ratifié. Or, le TICE n’entrera en vigueur que s’il est ratifié par 44 États clés dont les Etats-Unis.
L’administration Bush a décidé de ne pas soumettre le TICE à la ratification du Sénat américain, ce dernier restant cependant formellement saisi du dossier. Les Etats-Unis déclarent néanmoins vouloir continuer à appliquer le moratoire sur les essais.
La Chine a, pour sa part, annoncé avoir entrepris la procédure de ratification mais fait remarquer que même si celle-ci aboutissait rapidement, le traité n’entrerait pas en vigueur du fait de la position des Etats-Unis. La Chine annonce également respecter le moratoire sur les essais.
De même, une avancée dans la négociation du traité d’interdiction de production des matières fissiles (TIPMF ou cut-off) pourrait contribuer à donner corps aux engagements pris par les Etats nucléaires. Un tel traité constituerait une nouvelle étape, après le TICE, du processus de désarmement nucléaire dans le cadre d’un désarmement général et complet.
Pour l’heure, ce traité reste un simple engagement politique pris lors de la prorogation du Traité de non-prolifération (TNP), en mai 1995. En effet, bien que la Conférence du désarmement ait inscrit cette négociation à son ordre du jour en 1998, elle n’a toutefois pas pu ouvrir officiellement les débats, plusieurs Etats membres liant le démarrage de la négociation sur le TIPMF à la création d’un comité sur le désarmement nucléaire et d’un comité sur la course aux armements dans l’espace.
Le dossier TIPMF pourrait toutefois connaître des développements prochainement. D’une part, les Etats-Unis ont présenté fin mai 2006 un projet de traité que beaucoup d’Etats, dont la France, pourraient accepter bien qu’il ne soit pas vérifiable ; d’autre part, plusieurs Etats, jusque-là hostiles à cette idée, ont annoncé qu’ils étaient prêts à accepter la négociation TIPMF sans la lier à d’autres sujets. La proposition américaine, reçue par beaucoup comme un ultime moyen de revitaliser la Conférence de Désarmement, aurait donc des chances d’aboutir.
En complément de ces démarches au sein de la conférence du désarmement, il faut revaloriser le rôle de l’Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA). Aujourd’hui en effet, pour reprendre les mots du directeur de l’agence, « il y a une contradiction évidente entre la perception du danger et les moyens alloués à l’AIEA. C’est peu dire que la préoccupation internationale ne se traduit pas au niveau financier : notre budget s’élève à seulement 120 millions de dollars. 120 millions de dollars pour rendre la terre entière plus sûre ! » (6).
Dans le même temps, les dispositifs de vérification et de contrôle doivent être renforcés et amplifiés : à ce titre, l’universalisation des protocoles additionnels renforçant le rôle de l’AIEA est indispensable.
II – LA NÉCESSAIRE REMISE À PLAT DE
NOTRE POLITIQUE DE DÉFENSE
« Il n’existera jamais de système parfait pour décrire la menace mais l’insécurité du monde est une réalité taraudante, avec la prolifération, le terrorisme, ainsi que les tensions liées aux approvisionnements énergétiques, à la mondialisation et aux flux migratoires. Le monde étant plus incertain et dangereux, il est nécessaire de se doter de capacités de défense polyvalentes et durables. »
Ce constat établi par le Chef d’État-major des armées devant la commission de la défense, lors de son audition le 10 octobre dernier (7), illustre l’extrême difficulté de la planification des moyens de la politique de défense dans un environnement stratégique aussi complexe que celui dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Dans un tel contexte, il apparaît d’autant plus urgent de remettre à plat notre politique de défense qu’il y a consensus pour reconnaître que non seulement le référentiel que constitue le modèle d’armée 2015 est hors d’atteinte, comme je l’avais montré dans le rapport que j’avais présenté l’an dernier sur la loi de finances pour 2006, mais qu’en outre, il n’est plus adapté. Comment comprendre autrement ces propos du Général Jean-Louis Georgelin, chef d'état-major des armées, pendant la même audition : « Si le modèle d’armée 2015 avait été bâti en 2006, les choix auraient sans doute été différents » ?
Un tel constat ne laisse pas d’inquiéter. En effet, il est généralement expliqué à la représentation nationale que cette construction théorique qu’est la planification militaire effectuée dans le cadre du modèle d’armée 2015 n’est pas figée, mais susceptible d’intégrer, en cours de réalisation, des aménagements permettant à l’édifice de rester en phase avec les évolutions du monde. Cette affirmation est totalement contredite par les propos du chef d’État-major des armées, dans lesquels votre rapporteur voit un plaidoyer pour une remise à plat de notre système de défense.
A – En finir avec l’inertie et les non-choix budgétaires
Les crédits inscrits pour la mission « Défense » dans le projet de loi de finances pour 2007 représentent la cinquième annuité de la loi de programmation militaire 2003-2008. C’est dire qu’ils portent la marque d’une programmation qui ne répond pas aux besoins futurs de notre politique de défense et restent caractérisés par une forte d’inertie et une absence de choix qui risquent d’être lourds de conséquences dans les années à venir.
1) Le projet de budget pour 2007 : un effort financier maintenu…
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances du 1er avril 2001 (LOLF), quatre missions participent désormais à l’effort budgétaire en faveur de la défense et de la sécurité : les missions « défense » et « anciens combattants, mémoire et liens avec la nation », dans leur intégralité ; les missions « sécurité » et « recherche et enseignement supérieur » en partie.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les missions « défense » et « sécurité », qui garantissent la protection et la sécurité des Français, mobilisent près de 92% des crédits de paiement mis à la disposition du ministre de la défense.
les crédits du ministère de la défense
dans le projet de loi de finances pour 2007
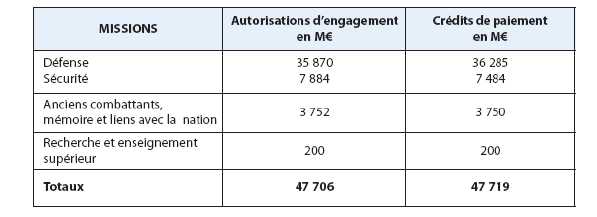
Source : Ministère de la défense, documents budgétaires.
Les crédits mis à la disposition du ministre de la défense s’organisent en quatre missions et neuf programmes. Le ministre de la défense et le ministre délégué aux anciens combattants assument la responsabilité exclusive de deux d’entre elles, les missions « Défense » et « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ».
La mission « défense » regroupe 76 % des crédits mis à la disposition du ministre, soit 35,87 milliards d’euros en autorisations d’engagement (AE) et 36,285 milliards d’euros en crédits de paiement (CP).
Elle s’articule en quatre programmes :
– le programme 178 « préparation et emploi des forces », qui représente la plus grande partie des crédits, soit 20,872 milliards d’euros en AE et 21,04 milliards d’euros pour les CP ;
– le programme 146 « équipement des forces », soit 10,18 milliards d’euros d’AE et 10,41 milliards d’euros en CP ;
– le programme 212 « soutien de la politique de défense », qui pèse pour 3,12 milliards d’euros en AE et 3,17 milliards d’euros en CP ;
– le programme 144 « environnement et prospective de la politique de défense », qui représente 1,7 milliard d’euros en AE et 1,66 milliard d’euros en CP.
Avec un montant de crédits de paiements de 47,7 milliards d’euros, pensions incluses, et de 35,3 milliards d’euros hors pensions, le budget progresse de 0,8 % en volume et de 2,5 % en valeur. Il est conforme à l’annuité théorique actualisée de la loi de programmation militaire 2003-2008.
• Par comparaison avec ses principaux alliés, la France affiche un niveau de dépenses de défense parmi les plus élevés en Europe.
EVOLUTION DES DEPENSES DE DEFENSE (1)
DE LA FRANCE ET DE SES PRINCIPAUX PARTENAIRES DEPUIS 1997
(en parité de pouvoir d'achat (PPA) calculée sur les monnaies nationales courantes)
(en millions d’euros PPA courant part dans le PIB)
Dépenses de défense |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
prévisions | ||||||||||
France (2) |
||||||||||
M€ PPA courants |
25 498 |
24 416 |
24 889 |
24 800 |
24 920 |
25 883 |
27 462 |
29 060 |
28 645 |
29 865 |
part dans le PIB |
2,01% |
1,84% |
1,82% |
1,72% |
1,66% |
1,67% |
1,72% |
1,75% |
1,68% |
1,70% |
Allemagne |
||||||||||
M€ PPA courants |
20 930 |
21 238 |
21 679 |
22 229 |
22 048 |
22 996 |
23 198 |
23 632 |
23 246 |
23 988 |
part dans le PIB |
1,18% |
1,17% |
1,17% |
1,16% |
0,93% |
1,14% |
1,12% |
1,09% |
1,05% |
1,05% |
Royaume-Uni |
||||||||||
M€ PPA courants |
30 587 |
31 216 |
30 816 |
32 237 |
33 392 |
35 151 |
36 027 |
37 063 |
37 938 |
38 466 |
part dans le PIB |
2,52% |
2,48% |
2,36% |
2,34% |
2,32% |
2,27% |
2,26% |
2,20% |
2,18% |
2,13% |
Etats-Unis |
||||||||||
M€ PPA courants |
247 479 |
245 006 |
251 149 |
265 563 |
271 125 |
309 029 |
363 152 |
411 829 |
414 196 |
392 729 |
part dans le PIB |
3,19% |
3,02% |
2,92% |
2,96% |
2,98% |
3,28% |
3,66% |
3,84% |
3,68% |
3,31% |
(1) Dépenses de défense hors pensions, les trois partenaires de la France n'ayant pas de forces de sécurité comptabilisées dans leurs dépenses de défense, la France ne retient que le coefficient d'activité militaire des forces de sécurité, soit 5% des dépenses de la gendarmerie(2) Il s’agit de l’ensemble des crédits votés par le Parlement en cours d’année y compris les pensions (LFI, décrets d’avance, loi de finances rectificative, annulations). (3) Les budgets de défense sont calculés en monnaies courantes (indices nationaux) convertis en euros en utilisant le taux de PPA annuel par rapport à la France (ce taux permet de comparer plusieurs pays se prenant pour référence un Etat et en se basant sur son niveau économique donné par le PIB afin de déterminer le pouvoir d’achat d’un autre Etat par rapport à lui – ce taux est calculé par l’OCDE en fonction des PIB).
Source : Mémorandum statistique de l'OTAN - édition juin 2006
De ces séries, il ressort que, de 1997 à 2002, si la France a réduit son effort de défense en volume (- 4,9%), notamment en 1998 (- 5,1%), en part de la richesse nationale, la France maintient peu ou prou ses dépenses de défense aux alentours de 1,7 % du PIB depuis 2000 – il était de 1,8 % environ en 1998 et 1999.
La France affiche un taux de dépense très supérieur à ceux de l’Allemagne – et de l’Espagne et de l’Italie d’ailleurs – mais inférieur à celui de la Grande-Bretagne et, a fortiori, des Etats-Unis :
– En Allemagne, les restrictions budgétaires imposées ont en effet pour conséquence une déflation de ses dépenses de 2002 à 2006 (- 4,6%).
– Le Royaume-Uni est le pays européen de l’OTAN qui consacre le plus de crédits pour ses dépenses de défense. Ce niveau est dû notamment à l’importance de ses dépenses de fonctionnement (28 milliards d’euros), alors que le volume des dépenses en capital est inférieur à celui de la France, respectivement 10,2 milliards d’euros et 11,4 milliards d’euros.
– Aux Etats-Unis, les années 2002 à 2004 ont été marquées par une augmentation en volume de plus de 40 % de leurs dépenses en structure OTAN, l'accroissement des dépenses américaines sur l’ensemble de la période représentant 37,4 %. Précisons que, pour l’année 2007, le département de la Défense demande au Congrès environ 440 milliards de dollars, soit une augmentation de 7 % par rapport au niveau de financement de l’année fiscale 2006.
• S’agissant des principales caractéristiques du projet de budget, trois points retiennent l’attention.
En premier lieu, en dépit des discours répétés sur la sincérité du projet de budget par rapport à la loi de programmation militaire, la bonne exécution de l’annuité 2007 sera fortement tributaire de l’ouverture dès 2006, en loi de finances rectificative, de crédits permettant de couvrir les besoins de paiement des frégates européennes multimissions (FREMM), à hauteur de 240 millions d’euros, les besoins opérationnels en carburant, à hauteur de 130 millions d’euros, pour assurer les activités de la fin de l’année, ainsi que le reliquat des surcoûts liés aux opérations extérieures (OPEX), à hauteur de 268 millions d’euros. En effet, le surcoût relatif aux OPEX est évalué pour l’année 2006 à 634 millions d’euros, alors que seuls 175 millions d’euros avaient été ouverts à cette fin dans la loi de finances initiale pour 2006.
De ce point de vue, et c’est là le deuxième point saillant qui ressort de ce projet de budget, il faut se réjouir de la poursuite de la budgétisation des OPEX dès le stade de la loi de finances initiale, qui franchit une nouvelle étape, très significative. Le montant total du financement des OPEX en loi de finances initiale progresse à nouveau, en effet, pour atteindre 375 millions d’euros (360 au titre de la mission « défense » et 15 pour la Gendarmerie dans la mission « sécurité »). C’est désormais presque 60 % du surcoût annuel des OPEX qui sera financé dès le vote du budget en 2007.
Enfin, il faut souligner que, si le niveau des crédits de paiement correspondent à la loi de programmation militaire, le niveau des autorisations d’engagement a d’ores et déjà contraint le ministère à prendre quelques mesures de report, notamment à étaler les commandes de l’hélicoptère NH 90 et l’opération « future torpille lourde ». Ce nouvel étalement participe de l’étiolement progressif du modèle d’armée 2015, qui est aujourd’hui de facto inaccessible. Qui plus est, le fait qu’il touche un type de matériels désormais essentiel pour mener les conflits d’aujourd’hui n’est pas anodin et incite à une réflexion de fond sur l’inertie de notre budget de défense.
2) … mais qui témoigne de l’inertie du budget de la défense
De fait, le cas du programme d’hélicoptère NH90 est symptomatique des difficultés que rencontre aujourd’hui le ministère de la défense à arbitrer entre des programmes nécessaires à l’accomplissement de ses missions et des choix d’équipement qui portent la marque du passé. Comme l’a souligné le Chef d’état-major des armées devant la commission de la défense, pour appuyer ses propos sur les choix différents qui seraient faits aujourd’hui dans le cadre du modèle d’armée 2015, « en 1995, dans les maquettes d’armées, l’aviation légère de l’armée de terre a pâti d’arbitrages en faveur des chars Leclerc, des Rafale et des frégates. L’hélicoptère est maintenant considéré comme l’équipement roi sur tous les théâtres d’opérations. Il offre, en effet, la mobilité tactique, même s’il souffre de limitations d’emploi, sauf dans ses versions les plus sophistiquées, mises notamment à la disposition des forces spéciales. (...) Au début des années quatre-vingt, le Tigre, adapté au combat contre les forces du Pacte de Varsovie, était l’appareil le plus intéressant ; en 2006, la priorité va aux hélicoptères de manœuvre et de transport. »
Et le général Jean-Louis Georgelin de poursuivre : « Au-delà du cas des NH 90, les décisions en matière d’équipements militaires procèdent de compromis entre diverses exigences. L’aéromobilité a été difficile à défendre à cause du maintien de programmes de haute intensité très coûteux, de considérations géopolitiques, industrielles, sociales et peut-être par manque d’audace et de clarté des militaires. Ces derniers doivent en permanence se poser la question de l’utilité des dépenses d’équipements afin d’éclairer la représentation nationale. »
Telle est effectivement la question que je pose depuis la mise en œuvre de la présente loi de programmation et que nous imposent les évolutions du contexte stratégique. Elle est également posée par nombre d’experts des questions de défense car « tous les spécialistes du domaine le savent, cet effort [financier de défense], faute de choix, débouche sur une impasse. Dispersion des dépenses, sous-estimation de la professionnalisation et du coût des programmes, décalage entre crédits votés et crédits affectés. Le « modèle d’armée 2015 » apparaît d’ores et déjà hors d’atteinte » (8). De fait, comme je le soulignais l’an dernier, quand bien même le modèle d’armée 2015 deviendrait le modèle d’armée 2020, il faudrait, pour le réaliser, « injecter 70 milliards d’euros supplémentaires, autrement dit de faire passer les crédits d’investissement de 14,7 milliards à 20 milliards par an ! » (9)
A dire vrai, outre qu’une telle augmentation du budget de la défense n’est nullement envisageable, elle serait largement vaine car, ainsi que je l’ai souligné, ce sont les objectifs mêmes du modèle 2015 qu’il faut revoir. Notamment, les formats humains et les choix d’équipement qu’il propose ne sont plus adaptés à la conduite des conflits actuels : « Est-il toujours d’actualité d’envisager le déploiement de 50 000 hommes pour des combats en Europe ? Un parc de 450 avions de combat est-il indispensable alors qu’au Kosovo, au plus fort de la campagne aérienne, nous n’en avons mobilisé qu’une soixantaine ? » (10)
Ces questions ne sont aujourd’hui pas posées au sein de l’appareil gouvernemental, où l’inertie, les non-choix et l’absence de débat prévalent. La manière dont est aujourd’hui traitée la question du second porte-avions est symptomatique de cette incapacité à remettre à plat les choix d’équipement. Alors que ce programme suscite de vifs débats au sein de la communauté militaire, que sa pertinence stratégique est loin d’être prouvée et qu’en termes budgétaires, ce programme entraînerait des sacrifices importants, imposant de renoncer à d’autres programmes, on a le sentiment d’une fuite en avant, visant à donner à ce programme un caractère « irréversible », selon le terme employé par le Ministre de la défense. Pour quel bénéfice politique qui plus est ? S’agit-il de faire un « Saint-Malo opérationnel » ? On voit mal à dire vrai en quoi l’Europe de la défense s’en trouverait renforcée.
B – Redéfinir notre politique de défense
A la lecture des comptes rendus des auditions des différents responsables militaires du ministère de la défense, il me semble que le débat sur les orientations de notre politique de défense est mûr.
L’heure n’est assurément plus aux grandes constructions théoriques, qu’un contexte stratégique en évolution constante condamne désormais rapidement à l’obsolescence. Le Chef d’état-major des armées a eu à cet égard des propos très lucides : « La prochaine loi de programmation militaire, plutôt que d’imaginer un modèle 2025, devrait retenir simplement un objectif de planification exprimé par des capacités et des contrats opérationnels. L’état-major doit être en mesure de s’adresser aux autorités politiques avec courage, ce qu’il fera plus aisément s’il s’appuie sur une réflexion profonde et nourrie, sans chercher à se faire le défenseur corporatiste de situations périmées. »
L’analyse du Chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Stéphane Abrial, fait largement écho à ce constat : ainsi, ce dernier a indiqué que la nécessité d’un nouveau texte fondateur était au cœur d’un débat au sein des armées elles-mêmes. « La plupart des attendus du Livre blanc de 1994, complétés de ceux figurant en préambule de la loi de programmation militaire, sont restés valables, mais il convient de s’interroger sur les missions que la France doit donner à ses armées, afin d’en déduire le format et les structures futurs. » (11).
Le monde politique ne saurait rester en retrait par rapport aux réflexions en cours au sein de l’institution militaire. A ce titre, deux types de réflexions s’imposent : une réflexion de fond sur les conséquences des évolutions stratégiques pour nos choix de format et d’équipement, une réflexion relative à la manière dont est décidée et conduite la politique de défense dans notre pays.
1) Comprendre le nouveau contexte stratégique
Dans le cadre d’une réflexion renouvelée sur les enjeux stratégiques actuels, trois aspects apparaissent essentiels en cette fin d’année 2006 :
– le poids du référentiel stratégique américain ;
– le retour durable des problématiques de prolifération nucléaire ;
– la globalisation des questions de sécurité, à travers l’exemple de la sécurité énergétique.
a) L’influence de la pensée stratégique américaine : la revue de défense quadriennale de 2006
La question du nouvel environnement des politiques de défense s’impose dans tous les États qui aspirent à jouer un rôle sur la scène internationale. Toutes les armées sont aujourd’hui confrontées à cette réflexion sur l’adaptation au nouveau contexte stratégique, à commencer par la plus puissante d’entre elles, celle des Etats-Unis. Or, au mois de mars 2006, les Etats-Unis ont publié la dernière version de leur réflexion stratégique quadriennale, la Quadriennal Defense Review (QDR).
La publication de ce document ne présente, par elle-même, rien d’exceptionnel puisque c’est la cinquième revue de défense menée par les Etats-Unis depuis la fin de l’Union soviétique. Cependant, c’est la première fois que cette revue est présentée en temps de guerre. Tel est en effet ainsi que se vivent les Etats-Unis, comme en témoigne d’ailleurs la QDR, qui est parcourue de bout en bout par la notion de « longue guerre » (Long war), qui remplace désormais le concept de « guerre contre le terrorisme ».
Ce document présente un certain nombre d’éléments de continuité. Ainsi, les Etats-Unis s’en tiennent à l’objectif de sûreté totale par la suprématie militaire globale : ce sont des Etats-Unis interventionnistes qui sont décrits, les concepts d’ingérence et de soutien étant clairement affirmés et résumés à travers l’adage « Help or convince or compel » (« Aider, convaincre ou contraindre »). Par ailleurs, la confiance en la technologie pour apporter la solution aux difficultés reste entière, alors même que l’intervention en Irak montre que toutes les meilleures technologies du monde ne sauraient pallier un plan d’intervention défaillant – en l’occurrence omettant la phase de reconstruction.
Les leçons de l’Irak sont toutefois intégrées. Ainsi, il est indiqué que les forces terrestres vont devoir prendre en compte les activités des forces spéciales (stabilisation, contre-insurrection), ce qui va impliquer une transformation d’unités jusqu’alors principalement, sinon exclusivement, orientées vers la haute intensité.
On remarque également qu’aucun choix n’est véritablement fait entre les menaces : les Etats-Unis doivent être capables de vaincre tout adversaire, du terroriste à la Chine. De nombreux commentateurs reprochent à la QDR cette absence de priorités dans le traitement des menaces, cette absence de choix dans les grands programmes et cette absence de restructuration dans les forces armées. A l’évidence, elles impliqueront à terme un effort budgétaire plus massif encore, d’autant que les grands programmes engagés vont d’ores et déjà requérir une augmentation importante des moyens budgétaires alloués à la défense aux alentours de 2015.
Cependant, de nombreuses options sont prises dans cette QDR, dont les conséquences à terme pourraient se révéler très importantes et qui annoncent des bouleversements majeurs :
– En termes géographiques tout d’abord, la QDR confirme le glissement de l’intérêt américain au-delà de l’Europe. L’accent est mis sur les zones à stabiliser ou potentiellement instables – monde arabe et Asie centrale – et les puissances de demain (Chine, Inde). La réorientation des moyens militaires a commencé, pour répondre à ces nouvelles priorités : accroissement des moyens navals de la côte Ouest au détriment de ceux de la côte Est, renforcement des alliances avec le Japon et l’Australie. On remarquera que l’Afrique est totalement absente de la QDR, alors même que les Américains s’installent à Djibouti, sont présents dans le golfe de Guinée et se soucient du Darfour. Il faut voir dans cette omission l’importante divergence de vues entre Européens et Américains quant aux enjeux de sécurité à long terme (massification des phénomènes migratoires, risques de déstabilisation des États sous l’effet de la pauvreté, risques pandémiques, déséquilibres climatiques).
– Tout aussi important est le passage d’une stratégie de projection de moyens lourds à une stratégie de prévention et de protection. Ainsi, les forces armées américaines ne s’appuieront plus sur des implantations positionnées à l’extérieur du continent américain. La conséquence devrait en être la forte réduction, en Europe comme en Asie, des prépositionnements militaires importants et un repli des forces américaines vers le continent américain dont les conséquences sur la relation transatlantique restent difficiles à mesurer.
– Ce qui ressort enfin, de la QDR c’est le peu de cas fait de l’Alliance atlantique – alliés et partenaires ne sont cités qu’aux pages 8 et 87 du document. La confusion entre l’OTAN, les autres alliés et partenaires est tout à fait explicite à cet égard : l’Alliance atlantique est mise sur le même plan que les alliances bilatérales entre les Etats-Unis et le Japon, l’Australie, la Corée du Sud ou encore l’Inde. Quant à l’Union européenne et la politique européenne de sécurité et de défense, elles ne sont même pas citées.
Si la QDR n’est pas un document de programmation mais doit plutôt être analysée comme une vision et un recueil de souhaits, elle présente cependant l’avantage de donner à lire les vues du Pentagone, non édulcorées et dénuées de toute langue de bois diplomatique. Sans doute le système institutionnel américain implique-t-il, pour que ces vœux soient transformés en actes, force négociations et compromis, au sein de l’exécutif d’abord, puis entre les branches exécutive et législative. Cette revue de défense est néanmoins d’un grand intérêt parce qu’elle sera lue attentivement par tous les acteurs stratégiques, alliés ou ennemis.
Or ce que nous y trouvons, c’est un nombre important de concepts qui sont largement étrangers à notre culture de défense (« longue guerre », approche capacitaire et budgétaire démesurée). Il n’y a là rien de nouveau : bien que nos armées coopèrent efficacement sur le terrain, la culture stratégique américaine et celle de la France sont différentes. Ces différences se retrouvent d’ailleurs sur le terrain, comme le montre par exemple la comparaison très parlante entre le code du soldat français et le credo du soldat américain présenté dans le tableau page suivante.
L’analyse de la pensée stratégique américaine ne vaut pas que par elle-même : du fait du rôle prééminent des Etats-Unis sur la scène internationale et de notre alliance avec ce pays dans l’OTAN, il faut admettre que le débat stratégique américain conditionne partiellement nos propres choix et qu’il serait hasardeux de ne pas l’intégrer dans notre réflexion. Comme le souligne le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), M. Guillaume Schlumberger, « Même si elle n’est pas un des deux alliés privilégiés cités par le texte (le Royaume-Uni et l’Australie), la France sera influencée par les orientations définies par la QDR. Le choix des thèmes que les militaires et plus globalement la communauté de sécurité et de défense vont débattre à l’avenir sera influencé par la revue. Surtout, les choix et les orientations des États-Unis auront un impact majeur sur l’allié qu’est la France (interopérabilité). » (12).
Etats-Unis The Soldier’s creed (Army - Etats-Unis) |
France Code du soldat (Armée de Terre - France) |
Je suis un soldat américain. Je suis un guerrier et je fais partie d’une équipe, je suis au service du peuple des Etats-Unis et je vis selon les valeurs de l’Armée. Je donnerai toujours la priorité à la mission. Je n’accepterai jamais la défaite. Je n’abandonnerai jamais. Je ne quitterai jamais un camarade blessé. Je suis discipliné, physiquement et mentalement dur, entraîné et rompu aux métiers de la guerre. Je contrôle en permanence mes armes, mon équipement et ma personne. Je suis un expert et un professionnel. Je me tiens prêt à attaquer, combattre et détruire les ennemis des Etats-Unis. Je suis gardien de la liberté et du mode de vie américain. Je suis un soldat américain. |
Au service de la France, je lui suis entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. J’accomplis ma mission avec la volonté de gagner et de vaincre et, si nécessaire, au péril de ma vie. Maître de ma force, je respecte l’adversaire et veille à épargner les populations. J’obéis aux ordres dans le respect des lois, des coutumes de la guerre et des conventions internationales. Je fais preuve d’initiative et m’adapte en toutes circonstances. Soldat professionnel, j’entretiens mes capacités intellectuelles et physiques et développe ma compétence et mes forces mentales. Membre d’une équipe solidaire et fraternelle, j’agis avec honneur, franchise et loyauté. Attentif aux autres et déterminé à surmonter les difficultés, j’œuvre pour la cohésion et le dynamisme de mon unité. Je suis ouvert sur le monde et la société et en respecte les différences. Je m’exprime avec réserve pour ne porter atteinte à la neutralité des armées en matière philosophique, politique et religieuse. Fier de mon engagement, je suis toujours et partout un ambassadeur de mon régiment, de l’armée de Terre et de la France. |
Source : Fondation pour la recherche stratégique, « Quadriennal Defense Review : la vision stratégique du Pentagone », Actes de la journée d’études du 13 mars 2006.
Ce constat peut être appliqué à tous les alliés de l’OTAN, d’autant plus que la quasi-totalité de nos partenaires européens ont une vision stratégique largement, sinon exclusivement, façonnée par l’OTAN, elle-même largement influencée sur ce point par les Etats-Unis.
b) La prolifération des armes de destruction massive : un problème de long terme
A l’évidence, la « soif de nucléarisation » (13) que nous observons dans le contexte stratégique actuel correspond à une tendance de long terme. Quels que soient les efforts déployés par ailleurs en matière de désarmement, la réflexion stratégique doit donc prendre en compte les éléments suivants :
– l’acquisition de l’arme nucléaire par l’Iran doit être tenue comme hautement probable. On retiendra à ce propos l’appréciation de John Chipman, Président de l’International Institute for Strategic Studies (IISS) de Londres, qui, lors de la présentation du rapport annuel de l’institut au printemps dernier, rappelait qu’il y avait « un consensus qui émergeait selon lequel une capacité nucléaire iranienne était tout aussi mauvaise qu’inévitable » ;
– les Etats-Unis intègrent désormais la possibilité de l’emploi du nucléaire dans des situations conventionnelles courantes et ne cessent d’accroître le budget de l’administration chargée du nucléaire miliaire (NNSA) ;
moyens dévolus à la National Nuclear Security Administration (NNSA)
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 (requête) | |
En milliards de dollars |
6.830 |
7.595 |
8.217 |
8.929 |
9.298 |
9.105 |
9.316 |
– les Russes annoncent la modernisation de leur arsenal stratégique nucléaire ;
– le budget de la défense chinoise s’est accru massivement entre 2000 et 2006, alors que la Chine s’engage massivement dans un vaste programme de modernisation de ses missiles balistiques, de ses têtes nucléaires et de développement d’une nouvelle génération de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins. Elle devrait posséder le troisième arsenal nucléaire et de missiles balistiques au monde d’ici à 2015, tout en étant numériquement inférieur à celui de la Russie et des Etats-Unis.
– l’exemple nord-coréen montre que la dissuasion joue à plein : comment expliquer autrement la modération américaine face aux provocations répétées de la Corée du Nord, dont il est reconnu aujourd’hui qu’elle possède une arme nucléaire, même rudimentaire ? L’intervention des Etats-Unis contre l’Irak, dépourvu de l’arme nucléaire, renforce a contrario ce constat.
– l’arme nucléaire redevient un outil de prestige, d’indépendance mais aussi d’identité nationale. Comment serait vue aujourd’hui la Corée du Nord sans la bombe, sinon seulement comme une dictature d’un autre âge, à la fois risible et consternante ? De même, l’Iran est considéré comme un pôle de résistance à la puissance américaine, à tel point que, même pour les États à majorité sunnite, pourtant alliés des Américains, une bombe iranienne est préférable à des frappes américaines contre l’Iran.
c) La nécessité d’une approche globale des questions de sécurité : l’exemple de la sécurité énergétique
L’émergence du terrorisme transnational dans le paysage stratégique depuis quelques années a mis en lumière la nécessité d’une approche globale des questions de sécurité : les systèmes de défense ne sauraient ignorer la question du terrorisme ; celle-ci ne se réduit pas pour autant à sa dimension militaire et met en cause la capacité des États à articuler leur outil de défense avec leurs instruments d’intervention diplomatiques, économiques, financiers, etc.
Le retour au premier plan des problèmes énergétiques montre qu’il en va de même dans ce domaine, si ce n’est que, contrairement à ce qui se passe pour le terrorisme, la tendance est, à l’inverse, de minorer la dimension militaire de la sécurité énergétique.
D’ores et déjà pourtant, notre appareil de défense prend en compte l’impératif de la sécurité énergétique, même si le déploiement actuel des moyens de la Défense hors métropole n’a pas explicitement pour objectif la sécurisation des approvisionnements énergétiques, cet objectif s’inscrivant dans le cadre plus général des intérêts stratégiques de la France.
Toutefois, l’étude des besoins capacitaires des armées à l’horizon 2015, s’appuie sur neuf scénarios dont un relatif à la sécurisation des sources et des flux d’approvisionnement énergétique. Pour faire face à cette situation, le ministère de la Défense a trois rôles principaux à remplir :
– Evaluer les risques et les menaces qui pèsent sur notre sécurité d’approvisionnement en hydrocarbures. Le ministère de la défense participe directement et très activement à la collecte du renseignement et à l’analyse des informations collectées sur les questions énergétiques. Les principales zones de production font l’objet d’une attention toute particulière des services du ministère.
– Envisager l’avenir en proposant des solutions de substitution aux hydrocarbures. Face à l’augmentation de la facture énergétique française, les services du ministère de la défense se sont engagés dans la recherche de sources d’économies d’énergie et de nouvelles formes d’énergie, y compris pour la recherche de nouvelles solutions alternatives aux carburants existants.
– Veiller physiquement, au travers de ses moyens militaires, à la protection des voies maritimes, des oléoducs, des infrastructures critiques (ports, raffineries, dépôts de carburant) et des entreprises qui, en France ou ailleurs, permettent d’assurer un approvisionnement sûr et régulier en pétrole ou en gaz de notre pays.
La majorité de nos importations en gaz et en pétrole vient effectivement par la voie maritime. Un quart de l’activité des forces navales françaises est d’ailleurs voué à la sécurisation de ces approvisionnements d’intérêt stratégique.
la marine française et la sécurité énergétique
Entre les détroits d’Ormuz et de Bab el Mandeb, nos forces assurent une présence dissuasive sur la principale artère pétrolière du monde. Ces actions se traduisent par des coopérations de défense avec des Etats du Golfe persique (Arabie saoudite, Qatar, EAU, Koweït) et des exercices militaires bilatéraux. Il existe aussi des accords de défense avec certains de ces pays (EAU, Koweït, Qatar).
La France a aussi une coopération avec l’Egypte (pays hôte de l’oléoduc SUMED par lequel transite chaque année une quantité de pétrole brut équivalente à 1,3 fois la demande annuelle française) au travers d’exercices conjoints (exercice naval bilatéral CLEOPATRE, exercice BRIGHT STAR avec les Etats-Unis). Notre présence à Djibouti, dans le département de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Mayotte, d’où peut s’exercer la surveillance de routes maritimes stratégiques, est également essentiel à la sécurité des voies d’approvisionnement en hydrocarbures.
Au large du Golfe de Guinée, nos moyens militaires déployés dans le cadre des opérations Corymbe et Licorne effectuent des missions de présence auprès des pays riverains et des installations pétrolières off-shore de cette région. Le pré-positionnement de moyens de renseignement et de réaction immédiate à Dakar, au Gabon, au Tchad et en Côte d’Ivoire permet aussi de sécuriser ces grands axes maritimes nécessaires à l’exportation des ressources énergétiques du Golfe de Guinée et du Tchad.
La France soutient également les forces de certains pays producteurs : par la formation de cadres militaires algériens ou la reprise des relations de défense avec la Libye dans des domaines qui touchent la surveillance des frontières et la sécurisation des infrastructures énergétiques libyennes.
Des opérations navales interalliées, entre autres avec les Etats-Unis, sont régulièrement menées dans l’Océan indien.
Enfin, en métropole, nos forces surveillent les flux maritimes côtiers, les grands terminaux d’hydrocarbures (Le Havre, Dunkerque, Fos), les raffineries et les oléoducs stratégiques de l’OTAN qui passent sur notre territoire national.
Or la question de la sécurisation des voies maritimes fait l’objet de développements importants aux Etats-Unis, autant pour des raisons de lutte contre le terrorisme que dans la perspective d’une sécurisation accrue des transferts énergétiques. Via la notion de défense en profondeur du territoire américain, les Etats-Unis mettent aujourd’hui l’accent sur la maîtrise des océans.
Or, comme l’a expliqué l’amiral Alain Oudot de Dainville, Chef d’état-major de la marine, lors de son audition devant la commission de la défense le 18 octobre 2006, « Les restrictions croissantes au principe de la liberté des mers sont un sujet de préoccupation, les textes récents, qu’il s’agisse de la convention et du protocole SUA (Suppression of Unlawful Acts) ou des conventions de Palerme, Bruxelles et Vienne, vont tous dans le sens d’une prise en compte plus large des exigences de sécurité en mer et entraînent des contraintes supplémentaires. Comme la sécurité en mer constitue un élément de vulnérabilité au regard de la croissance considérable du trafic maritime commercial et des flux d’approvisionnement énergétique, ce souci de sécurisation va inévitablement continuer à prendre de l’ampleur. Il reste que les marines militaires anglo-saxonnes feront tout ce qui est en leur pouvoir lors des négociations de textes pour préserver la liberté d’accès des navires militaires. Quant au monde sous-marin, il restera le domaine de la plus grande liberté d’action. » (14).
Il y a là assurément un sujet essentiel pour notre réflexion stratégique.
2) Pour un véritable débat sur les orientations de la politique de défense
Au vu de ces évolutions stratégiques majeures, il est temps de réexaminer à la fois les orientations de notre politique de défense et les choix d’équipement qui en découlent. La question est moins celle du niveau des dépenses que de leur affectation et de leur « euro-compatibilité ». Même si, ne nous en cachons pas, la question des moyens budgétaires ne pourra être éternellement écartée du revers de la main, compte tenu des contraintes budgétaires globales pesant sur la nation et, par ailleurs, de la nécessité de construire l’Europe de la défense.
La question de l’affectation des crédits de défense pose la question du poids respectif des missions de projection, prévention et protection.
a) D’une armée d’attente à une armée d’emploi : la question de la projection
Du temps de la guerre froide, les forces armées étaient dans une posture d’attente ; elles sont désormais dans une posture d’emploi, sur des théâtres complexes, divers et, pour certains, durablement déstabilisés.
Or, force est de reconnaître, avec le Chef d’état-major des armées, que, s’agissant de la situation des troupes françaises à l’étranger, « presque tous les clignotants des opérations extérieures sont à l’orange. Près de 14 000 femmes et hommes sont actuellement engagés en opérations, auxquels il convient d’ajouter les forces de présence et de souveraineté hors de la métropole, soit plus de 35 000 femmes et hommes au total, sans compter les 1 300 personnels déployés sur le territoire national, essentiellement dans le cadre du plan Vigipirate. »
Ces 14 000 hommes et femmes se répartissent entre opérations extérieures sous mandat international et opérations mises en œuvre sur décision nationale :
– Au 30 juin 2006, le nombre de soldats français engagés dans des opérations extérieures sous mandat international était plutôt inférieur à celui des autres années – 12 984 en 2004 et 11 588 en 2005. Toutefois, les évènements qui se déroulent actuellement au Liban vont entraîner une augmentation sensible des effectifs.
Soldats français engagés dans des opérations extérieures
sous mandat international
Pays |
Effectifs (au 1er sept 2006) |
Balkans (Bosnie, Kosovo) |
2 819 |
Afghanistan (Héraclès, Pamir, Epidote) |
1 435 |
Côte-d’Ivoire (LICORNE) |
4 033 |
Côte-d’Ivoire (ONUCI) |
190 |
Liban (FINUL / ONUST)) |
1 370 |
Election CONGO (BENGA) |
1 018 |
Autres missions |
135 |
Total |
11 000 |
– A cela s’ajoutent les forces mises en œuvre sur décision nationale. Il s’agit de forces affectées à une mission hors du territoire français, sur décision nationale et, notamment, de renforts de forces pré-positionnées, pour assurer la sécurité de nos ressortissants, la protection de nos intérêts, le maintien de la paix ou le respect d’accords de défense.
Soldats français engagés dans des opérations extérieures
mises en oeuvre sur décision nationale
Pays |
Effectifs (au 1er sept 2006) |
Tchad (EPERVIER) |
1318 |
RCA (BOALI) |
222 |
Cameroun (ARAMIS) |
50 |
Liban (BALISTE) |
1 614 |
Autres missions |
279 |
Total |
3 483 |
Certes, le niveau de saturation n’est pas encore atteint, mais, comme l’ont souligné le Chef d’état-major des armées, ainsi que le Chef d’état-major de l’armée de terre devant la Commission de la défense, le rythme des missions extérieures est soutenu et éprouvant, engendrant l’usure des soldats et pouvant les amener à quitter prématurément l’institution. Or, ce sont 60 000 militaires qui sont actuellement sollicités chaque année, soit dans le cadre de dispositifs d’alerte très contraignants, ou pour des missions de courte durée outre-mer et à l’étranger, ou pour des opérations extérieures de plus en plus dangereuses.
En effet, sur la plupart des théâtres, la situation politico-militaire tend à se durcir. On a évoqué précédemment les difficultés croissantes rencontrées par les forces alliées engagées en Afghanistan. Le même constat vaut pour la plupart des théâtres sur lesquels des forces françaises sont engagées :
– En Côte-d’Ivoire, la communauté internationale poursuit ses efforts, avec malheureusement peu de succès. La perspective des élections du 31 octobre 2006 n’est plus tenable et de nouvelles décisions devront être prises dans le cadre du comité de paix et de sécurité de l’Union africaine puis du Conseil de sécurité des Nations unies. Une délibération sur un projet de résolution est d’ailleurs actuellement en cours de discussion au sein du Conseil de sécurité. Un processus électoral libre, démocratique et transparent doit être organisé, à partir de listes électorales établies de manière impartiale. Le dispositif Licorne, avec 3 800 hommes en appui de l’ONUCI, poursuit sa mission avec sérieux, détermination et sang-froid, l’opération coûtant en moyenne 200 millions d’euros par an à la France, soit un total cumulé de 755 millions d’euros.
– Au Tchad, en dépit des victoires politiques, diplomatiques et militaires du Président Idriss Déby, la situation n’est pas stabilisée, loin s’en faut. Le dispositif Épervier mobilise de l’ordre d’un millier d’hommes. La résurgence d’éléments rebelles significatifs est toujours possible à l’est et au sud du pays.
– S’agissant du Kosovo, malgré un calme persistant sur le terrain, l’adoption prochaine d’un statut final pour la région est porteuse de risques sérieux de troubles, par impatience ou par refus de la solution qui s’imposera. À titre d’exemple, le pont de Mitrovica, qui avait été rouvert le 25 septembre, a dû être refermé le soir même à la suite d’une altercation. Les déclarations récentes de Martti Ahtisaari, l’envoyé spécial de l’ONU, ne sont guère encourageantes.
En plus de la dimension humaine majeure que recouvre la projection de forces à l’étranger, la question de l’adaptation des matériels à cette fonction ne cesse de se poser. Notamment, la flotte de transport aérien est à bout de souffle et les moyens de transport stratégique manquent pour remplir les contrats opérationnels et les engagements de la France. Dans ce contexte, les informations parues dans la presse sur les retards présumés quant à la livraison de l’A 400M suscitent des inquiétudes.
Cette question de l’adaptation du dimensionnement des forces armées à la mission de projection vaut pour l’ensemble des pays européens. Ainsi, le livre blanc que vient de publier l’Allemagne – le premier depuis douze ans – définit de nouvelles orientations quant à la politique de sécurité de la Bundeswehr hors des frontières du pays. Il prévoit qu’un maximum de 14 000 soldats allemands pourront à l’avenir être affectés à des missions internationales, alors qu’ils sont actuellement un peu plus de 10 000, dont 2 750 en Afghanistan.
Quelques chiffres suffisent à expliquer l’ampleur du défi que doivent relever les pays européens en cette matière, notamment par comparaison avec les Etats-Unis : les capacités militaires dont disposent les États européens représentent seulement le cinquième de celles des Etats-Unis, quand le personnel militaire est, en Europe, de 20 % supérieur au personnel américain. D’où une forte distorsion en matière de projection : les Etats-Unis ayant un ratio d’équipement supérieur, ainsi qu’une meilleure articulation entre le nombre de combattants et le nombre de forces de soutien, sont capables de déployer en Irak, en 2003 et 2004, 115 000 à 140 000 hommes, là où le Royaume-Uni, l’Italie, la Pologne, les Pays-Bas et le Danemark en déployaient au maximum 16 000 sur la durée.
Car c’est bien dans une perspective européenne que nous devrons systématiquement poser la question de l’amélioration de nos capacités de projection, la grande majorité des forces projetées l’étant sous mandat international.
Dans cette mesure, la présidence française de l’Union en 2008 aura le devoir de donner un caractère prioritaire à la relance de l’Europe de la défense. D’autant qu’il y a beaucoup à faire, notamment :
– l’accroissement de l’effort collectif de recherche, alors que l’agence européenne de défense souligne, dans une note du 9 août 2006 relative aux dépenses de recherche et technologie R&T en Europe, qu’avec 1,31 % du total des dépenses de défense dans les 24 membres de l’agence – les vingt-cinq moins le Danemark –, l’Europe ne se donne pas les moyens d’assurer l’avenir de la base industrielle et technologique militaire ;
– l’adoption d’une clause de défense mutuelle, qui soit distincte de l’obligation de solidarité inscrite dans le traité de l’Atlantique nord ;
– la planification commune des objectifs de sécurité, au-delà du livre blanc élaboré sous l’égide de M. Javier Solana ;
– et, surtout, l’harmonisation de la programmation des équipements, en vue de l’acquisition d’une véritable capacité de projection européenne.
b) Prévention et protection : quelle place pour la dissuasion ?
L’accent mis, depuis la chute du mur de Berlin, sur la mission de projection ne saurait conduire à réduire la place qui doit être accordée aux missions de prévention et de protection. Tel est le principal enseignement stratégique que l’on peut tirer du développement du terrorisme international, qui explique d’ailleurs la forte montée en puissance de ces deux missions dans la QDR américaine de 2006.
En France, l’articulation entre projection, prévention et protection pose la question de la part que doit avoir la dissuasion dans notre système de défense. Ou plutôt, « devrait poser », le débat sur la dissuasion étant considéré comme un tabou, du fait d’une curieuse interprétation de la notion de « domaine réservé ». Je ne peux à cet égard qu’approuver les propos de mon collègue, M. Yves Fromion, qui, en réponse à M. René Galy-Dejean, qui faisait observer que le Président de la République étant l’élu du peuple dans son entier, cela justifiait sa prédominance dans le domaine de la défense, a fait observer que « le fait qu’il soit chef des armées n’induit pas que les questions de défense ne puissent être débattues. Il a souligné toute l’ambiguïté des termes de la Constitution et déploré la dérive des institutions de la Ve République en la matière. » (15)
Dans une démocratie vivante, il est pourtant naturel et normal de pouvoir débattre d’une question aussi importante pour la nation que celle de la dissuasion nucléaire. Et aussi coûteuse puisque, en 2007, la France dépensera 3,364 milliards d’euros en autorisations de programme et 3,270 milliards d’euros de crédits de paiement pour financer sa dissuasion nucléaire.
Naturel, normal, le débat est même essentiel lorsque la doctrine française de dissuasion semble subir des infléchissements majeurs. Telle est en effet la question qui se pose après le discours du Président de la République à l’Ile Longue, le 19 janvier 2006 : les précisions qui explicitent le contenu de la doctrine française de dissuasion nucléaire n’en viennent-elles pas à modifier celle-ci ?
Ce discours comporte certes des éléments classiques :
– S’agissant du rôle de la dissuasion, les deux fonctions classiques de garantie fondamentale pour la sécurité de la France et d’outil de notre autonomie d’action sont réaffirmées.
– Le statut de la dissuasion est également réaffirmé : « notre concept d’emploi des armes nucléaires reste bien le même. Il ne saurait, en aucun cas, être question d’utiliser des moyens nucléaires à des fins militaires lors d’un conflit. C’est dans cet esprit que les forces nucléaires sont parfois qualifiées « d’armes de non emploi ». Autrement dit, l’arme nucléaire comme n’est pas, pour la France, une arme du champ de bataille. Le Président de la République l’avait d’ailleurs énoncé dans ces termes le 8 juin 2001, devant l’Institut des Hautes études de Défense Nationale (IHEDN) : « nous avons toujours refusé que l’arme nucléaire puisse être considérée comme une arme de bataille employée dans une stratégie militaire ».
Les aspects les plus ambigus du discours présidentiel concernent l’objectif de la dissuasion. Si, globalement, il reste la protection des intérêts vitaux, on peut cependant s’interroger sur l’éventuelle extension des intérêts vitaux de la France, comme le laisse effectivement penser la précision apportée par le Président de la République le 23 janvier, lors de la conférence de presse conjointe avec le nouveau chancelier allemand (« la définition des intérêts vitaux pour un pays (…) évolue avec le temps »).
La liste des intérêts vitaux n’ayant jamais été exhaustive, le fait d’y ajouter la « garantie de nos approvisionnements stratégiques » et « la défense de pays alliés » marque donc une volonté de préciser la plasticité de cette notion, non d’en définir les contours.
Fallait-il procéder à cette extension, alors même que l’essence de la notion d’« intérêts vitaux » est de rester floue, le fait de définir la notion d’ « intérêts vitaux » étant contraire à l’efficacité de la dissuasion ? Ainsi, comme le rappelle le livre blanc sur la défense de 1994, « il convient d’éviter d’en donner une définition trop précise, afin de préserver la liberté d’appréciation et d’action des autorités de l’État » ; ce document se contentait d’ailleurs de mentionner « l’intégrité du territoire, la protection des populations et le libre exercice de notre souveraineté » comme constituant « le cœur » des intérêts vitaux de la France.
De même, faut-il voir dans la réponse à la question du « qui dissuade-t-on ? » une autre inflexion majeure de la doctrine française ? Si celle-ci reste inchangée dans ses grandes lignes – il s’agit de répondre à « toutes les menaces identifiées », qu’elles émanent d’une « puissance majeure » ou d’une « puissance régionale » –, une précision nouvelle est apportée, qui est loin d’être anodine. Elle réside dans la référence explicite aux « dirigeants d’Etats qui auraient recours à des moyens terroristes contre nous », que le Chef de l’État met sur le même plan que « ceux qui envisageraient d’utiliser, d’une manière ou d’une autre, des armes de destruction massive ».
Certes, la France a toujours affirmé que sa dissuasion visait ceux qui mettaient en cause ses intérêts vitaux, quels que soient les moyens employés, autre manière de dire que la dissuasion nucléaire de la France n’a jamais été destinée à répondre au nucléaire uniquement, mais qu’elle visait à répondre aux menaces de toute nature, dès que sont atteints ses intérêts vitaux. Néanmoins, la référence aux moyens terroristes suscite de fortes réserves, d’autant plus que, au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le Chef de l’État avait souligné que « la dissuasion nucléaire (…) n’est pas destinée à dissuader des terroristes fanatiques ».
Enfin, la référence au lien entre la dissuasion nucléaire et l’intégration européenne pose question.
Certes, le Président de la République avait déjà, dans le passé, établi un lien entre intérêts vitaux et intégration européenne :
– le 8 juin 1996, lors d’un discours devant l’IHEDN, il déclarait: « la dimension européenne apparaît également dans notre dissuasion nucléaire » ; s’agissant de la proposition française de dissuasion concertée, il ajoutait qu’il s’agissait de « tirer toutes les conséquences d’une communauté de destin, d’une imbrication croissante de nos intérêts vitaux » ;
– le 8 juin 2001, devant cette même instance, il rappelait : « notre dissuasion nucléaire doit aussi, c’est le voeu de la France, contribuer à la sécurité de l’Europe. Elle participe ainsi à la capacité globale de dissuasion que peuvent exercer, ensemble, les démocraties réunies par le traité de sécurité collective conclu, il y a plus de cinquante ans, entre l’Europe, les États-Unis et le Canada. En tout état de cause, il revient au Président de la République d’apprécier, dans une situation donnée, l’atteinte qui serait portée à nos intérêts vitaux. Cette appréciation tiendrait compte naturellement de la solidarité croissante des pays de l’Union européenne. »
Le problème vient de ce que, le discours du 19 janvier se situe plutôt en retrait par rapport à ceux de 1996 et 2001, se contentant de rappeler que « nous devrons, le moment venu, nous poser la question d’une défense commune, qui tiendrait compte des forces de dissuasion existantes, dans la perspective d’une Europe forte, responsable de sa sécurité ». Autant dire que c’est une perspective de long terme, et non une initiative de moyen terme, qui est ici envisagée.
Dans le contexte d’une Europe de la défense qui ne parvient pas à émerger, alors qu’un nombre toujours très majoritaire de nos partenaires européens s’en remettent exclusivement à l’OTAN, cette position de retrait, sur un sujet qui plus est délicat, n’était sans doute pas souhaitable.
En parallèle à ces interrogations sur les éventuelles modifications apportées à notre doctrine de dissuasion, l’engagement de la France dans des travaux et des réflexions de l’OTAN sur la défense antimissile stratégique met également en cause le statut de la dissuasion. Comme je l’avais expliqué dans un rapport consacré aux programmes américains de défense antimissile (16), la défense antimissile a toujours été considérée, dans la pensée stratégique française comme sapant la crédibilité de la dissuasion.
En effet, les chefs d’Etat de l’Alliance atlantique ont décidé, lors du sommet de Prague de novembre 2002, d’engager une étude de faisabilité sur les options relatives à la protection des territoires, des populations et des forces contre la menace balistique par un système de défense anti-missiles qui dépendrait de l’OTAN. L’étude a conclu à la faisabilité technique d’un tel système mais des points restent à approfondir. Selon les termes de l’étude, le système américain GBMI et le système européen Exoguard, encore à l’état de projet, pourraient répondre aux besoins si la décision de s’engager dans un programme devait être prise.
Le Président de la République a certes rappelé, en janvier 2006, le cadre dans lequel s’inscrivait la participation française aux réflexions et aux travaux de l’OTAN : la défense anti-missiles ne peut être considérée comme un substitut à la dissuasion, mais peut la compléter en diminuant les vulnérabilités des Etats. Seul un cadre multilatéral est à même d’apporter une vision équilibrée en amont sur la nécessité d’un tel système antimissiles et son architecture, et en aval sur le partage de la décision, sur le choix des systèmes, les modalités de déploiement et les règles d’engagement. Sans préjuger de son engagement final, la France attache la plus grande importance à la cohérence entre les discussions multilatérales de l’OTAN et des négociations bilatérales en cours avec les pays d’Europe centrale et orientale candidats à l’accueil d’un site d’intercepteurs américains.
Il n’en reste pas moins que l’engagement de la France dans une démarche de contre-prolifération – car c’est bien ce que signifie la défense antimissile – mériterait à tout le moins un débat approfondi, plus encore dans le contexte de la crise actuelle du système de non-prolifération.
Des débats difficiles, qui engagent l’avenir de notre politique de défense et la capacité de la France à prendre toute sa part dans la résolution des crises internationales, devront avoir lieu.
A cet égard, le rôle du Parlement dans l’élaboration de la politique de défense et le suivi de sa mise en œuvre, ne peut plus se limiter aux votes d’une loi de programmation militaire tous les cinq ans et d’une loi de finances annuelle.
L’accroissement du rôle du Parlement en matière de défense sera d’autant plus nécessaire que des choix difficiles devront être faits, notamment au regard du coût croissant des programmes militaires.
En outre, la multiplication des missions de projection de nos forces armées sur des théâtres extérieurs, le plus souvent sous mandat international, souligne de manière croissante le décalage existant entre le Parlement français et ses homologues européens. C’est en effet avec étonnement, pour dire le moins, que nos partenaires européens ont pu constater, lors de la crise israélo-libanaise de l’été 2006, que, contrairement à ce qui se passe dans toutes les grandes démocraties, le Parlement français n’a pas eu son mot à dire sur le renforcement massif du contingent français au sein de la FINUL, en dehors d’un échange purement formel au cours d’une séance publique postérieure à l’annonce de la décision de la France.
On déplore souvent les difficultés de construire l’Europe de la défense : commencer par moderniser sur ce point notre pratique parlementaire, d’un autre âge, pour l’aligner sur celle de nos partenaires, serait certainement un signal positif à envoyer à nos partenaires européens avant la Présidence française du Conseil européen de 2008.
Au cours de sa réunion du mardi 31 octobre 2006, la Commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Paul Quilès, les crédits de la mission « Défense » pour 2007.
Un débat a suivi l’exposé du Rapporteur.
Après avoir fait observer qu’il appréciait certains aspects de la démonstration du Rapporteur, mais qu’il n’en tirait pas les mêmes conclusions, M. Jean-Jacques Guillet lui a demandé comment il analysait l’articulation entre notre politique de défense et notre rôle dans l’OTAN.
M. Paul Quilès a rappelé que, si la France était intégrée dans l’OTAN, elle refusait cependant l’évolution des missions de l’Alliance atlantique que les Etats-Unis et le Royaume-Uni souhaitaient confier à l’Alliance.
S’agissant des trois missions attribuées à la politique de défense de la France (projection, prévention, protection), il a estimé qu’il n’était pas possible de définir le format et les équipements des armées sans débat profond sur ces missions.
Concernant la mission de protection, qui inclut notamment la lutte contre le terrorisme, il a rappelé que la France n’en avait pas la même analyse que les Etats-Unis qui, se considérant engagés dans une guerre, s’apprêtent à dépenser 440 milliards de dollars pour 2007 pour leur défense, sans compter que cette notion absorbe leur capacité d’analyse stratégique. A ce sujet, le Rapporteur a expliqué combien était intéressante la lecture de la dernière revue de défense quadriennale américaine, très révélatrice de la vision du système international par le Pentagone. Il a jugé que, les investissements massifs des Etats-Unis en matière de défense pesant sur l’ensemble du système de sécurité, cela justifiait de plus en plus que nous cadrions mieux nos objectifs en matière de défense, dans un cadre européen.
M. Marc Reymann a demandé au Rapporteur comment il expliquait les difficultés de vente du Rafale à l’étranger, alors que l’Eurofighter trouvait des marchés.
M. Paul Quilès, après avoir fait observer que cette question était posée depuis quinze ans, a noté que, quelles que soient les qualités de tel ou tel appareil de combat, le développement des drones risquait, à vingt ou trente ans, de supplanter partiellement les avions de combat.
M. Hervé de Charette a souhaité avoir l’avis du Rapporteur sur la nécessité, pour la France, de disposer d’un second porte-avions.
M. Paul Quilès a rappelé que lorsqu’il avait, en 1985, lancé le porte-avions Charles de Gaulle dans la loi de finances pour 1986, le second était prévu pour 1990. En 2006, ce second porte-avions, qui n’existe toujours pas, est envisagé dans le cadre d’un marché franco-britannique. Le Rapporteur a estimé qu’au-delà de ces aléas, la question était celle de l’utilité d’un second porte-avions aujourd’hui et, surtout, d’ici vingt à trente ans. Il a expliqué avoir toujours considéré que cet aérodrome mobile qu’était en définitive un porte-avions était un outil de gesticulation diplomatique sur les lieux de crise. Or, dans vingt ou trente ans, alors qu’existera probablement une force armée européenne, quels seront les besoins d’équipement correspondant aux missions qui seront assignées à cette force ? Peut-on d’ores et déjà faire figurer le porte-avions au nombre de ces besoins ? Pour cette raison, le Rapporteur a jugé nécessaire de reprendre la réflexion sur le second porte-avions à partir de la question des objectifs. Il a estimé que l’un des arguments présentés en faveur de ce programme, relatif à l’indisponibilité ponctuelle, pour entretien, du porte-avions actuel, n’était pas crédible, les avions pouvant également décoller depuis les bases fixes, à l’instar de la plupart des avions américains lors de l’intervention au Kosovo. Dans ces conditions, M. Paul Quilès, s’est dit d’un avis nuancé sur la construction d’un second porte-avions.
Contrairement aux conclusions du Rapporteur pour avis, la Commission a émis un avis favorable à l’adoption des crédits de la Défense pour 2007.