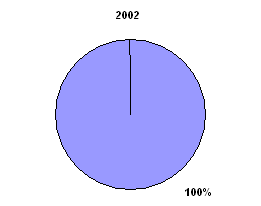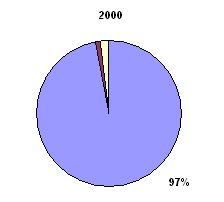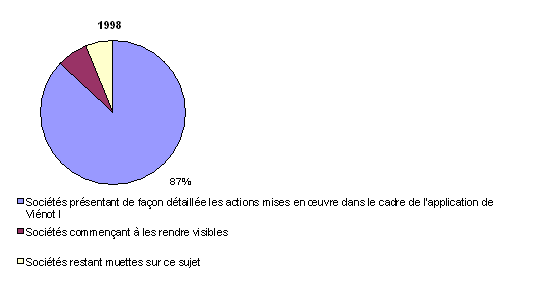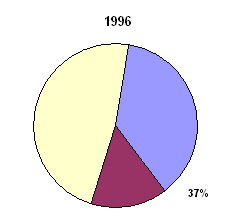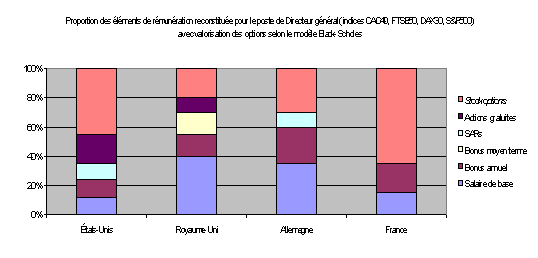N° 1270 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION sur la réforme du droit des sociétés, ET PRÉSENTÉ PAR M. PASCAL CLÉMENT, Député. -- () La composition de cette Mission figure au verso de la présente page. Économie - Finances publiques. La mission d'information sur la réforme du droit des sociétés est composée de : M. Pascal Clément, président ; MM. Jacques-Alain Bénisti, Jérôme Bignon, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Christophe Caresche, Georges Fenech, André Gerin, Philippe Houillon, Michel Hunault, Sébastien Huyghe, Victorin Lurel, Alain Marsaud, Arnaud Montebourg, Xavier de Roux, Mme Ségolène Royal, MM. Rudy Salles, Jean-Pierre Soisson, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. ___________________________________________________ INTRODUCTION 5 I. - LA CRISE DE LA GOUVERNANCE : LA FIN DE L'AUTORÉGULATION 9 A. LA GOUVERNANCE : DU THÈME À LA MODE AU PASSAGE OBLIGÉ 9 1. Une norme universelle 9 a) La mondialisation des règles du jeu 9 b) L'avènement d'une culture de la transparence 11 2. Huit années de gouvernance à la française 11 B. LA CRISE DE CONFIANCE SUR LES MARCHÉS : UN RÉVÉLATEUR DES INSUFFISANCES DE LA GOUVERNANCE 14 1. La crise de confiance actuelle a des causes structurelles, liées aux dérèglements du capitalisme financier 14 2. Les insuffisances de la gouvernance : le cas français 16 II. - MÉTHODOLOGIE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE : POUR UNE LIBERTÉ SURVEILLÉE 21 A. LE LÉGISLATEUR, NOUVEL ACTEUR DE LA GOUVERNANCE POST-ENRON size: 10pt">c) Les débats communautaires 23 2. Les limites de la loi : mondialisation et éthique 24 a) La mondialisation ou la pertinence de l'outil législatif en question 24 b) Décréter la vertu ? L'autre limite de la loi 27 B. L'INDISPENSABLE RÔLE DES AUXILIAIRES DE LA LOI 27 1. Un auxiliaire de droit : le gendarme des marchés financiers, pivot de la bonne gouvernance 28 2. Les auxiliaires de fait : le rôle des actionnaires 29 a) L'actionnaire, grand absent de la gouvernance à la française 29 b) Placer l'actionnaire au cœur de la gouvernance 30 III. - PRINCIPES DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE : TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ 33 A. LA TRANSPARENCE, TOUTE LA TRANSPARENCE 33 1. Dynamiser et responsabiliser le conseil d'administration 34 a) Des administrateurs compétents 34 b) Des administrateurs efficaces 36 2. Le test : les rémunérations 37 a) Vous avez dit transparence ? 37 b) L'envolée des rémunérations : les dirigeants français, « fattest cats » européens ? 39 c) Les stock options : « face je gagne, pile tu perds » (Joseph Stiglitz) 44 3. La transparence à l'extérieur de l'entreprise : le problème des analystes financiers dans les banques 47 B. UNE RESPONSABILITÉ CLARIFIÉE 50 1. La responsabilisation par le risque : transformer le dirigeant en capitaliste L'honnêteté n'est pas spectaculaire ; c'est pourquoi elle n'est pas médiatisée. Il n'empêche que la majorité des gens est honnête. » La Mission fait sien ce constat : le capitalisme français est fondé sur des bases saines. Que des scandales éclaboussent ce système, au point de poser la question de sa pertinence, ne peut dès lors que susciter l'inquiétude. Une inquiétude qui se double de colère quand ces scandales émanent de ceux-là mêmes qui sont supposés défendre et incarner les valeurs du libéralisme. Avec Enron et les nombreuses défaillances d'entreprises qui ont suivi, c'est un capitalisme financier fondé sur une gouvernance trop largement formelle, plus souvent autoproclamée que réellement mise en œuvre, qui a été disqualifié. À l'heure où le Gouvernement s'efforce de promouvoir l'actionnariat populaire, certains comportements, même s'ils ne sont pas sanctionnés par la loi, ne sont pas acceptables. La Mission d'information entend faire une mise au point claire, qui pourrait, si les pratiques ne changent pas, se transformer en avertissement. Autant que les grands scandales, ce sont ces pratiques - politique trop laxiste de rémunération, attributions peu opportunes de stock options, mépris des revendications des actionnaires, comportements autocratiques du management - qui minent le contrat social. Nous vivons actuellement une crise de confiance née de microséismes dont les ondes se sont répercutées sur toute la planète, sur toutes les entreprises. Seule une véritable métamorphose du capitalisme permettra de retrouver le chemin de la confiance. Les voies de la réforme, tous les grands pays libéraux tentent de les esquisser : le Sarbanes Oxley Act de 2002 aux États-Unis, le rapport Higgs au Royaume-Uni, les rapports Bouton et Barbier de la Serre et la loi de sécurité financière en France en 2002-2003 et le plan d'action de la Commission européenne de juin 2003 sont autant de réponses à une crise de confiance mondiale, réponses qui, d'ailleurs, frappent par leur convergence. « Gouvernance : plus de contrôles ou plus d'éthique » (1) Faut-il aller plus loin ? Question effectivement lancinante que celle de savoir jusqu'où le droit doit s'immiscer dans la vie des affaires.En effet, en regard de la remarque de M. Xavier Fontanet, il faut évoquer les déclarations du ministre de l'économie et des finances, en juillet 2002, lors des rencontres de Paris Europlace : « Sachez que la tentation de la réglementation naît toujours de l'absence d'initiative sur le terrain. » Les chefs d'entreprise français peuvent avoir le sentiment qu'une fois encore, le politique n'intervient que pour attenter au principe de la liberté d'entreprise et multiplier les carcans. La Mission tient à dissiper toute interprétation e fondée sur un capitalisme patrimonial dans la très grande majorité des cas : quand le dirigeant de l'entreprise n'est plus celui qui a investi son argent dans la société, quand les actionnaires sont d'influence et de poids divers, qui contrôle, qui décide, qui gagne... ou perd ? Pour prendre une comparaison quelque peu provocante, quand le pilote de l'avion et ses copilotes ne courent pas de risque mortel si l'avion s'écrase - voire seront récompensés quelle que soit l'issue du vol - comment faire en sorte que les passagers, qui, eux, exposent leur vie, aient néanmoins confiance dans le pilotage ? La question centrale est en effet celle de la confiance : si le capitalisme a changé de nature, passant d'une conception patrimoniale à une conception financière, la clé de son bon fonctionnement reste, elle, la confiance. Il est souvent reproché au législateur un interventionnisme excessif et trop rapide. Les travaux de la commission des Lois depuis le mois de juin 2002 témoignent du contraire : - la loi sur le cumul des mandats sociaux du 29 octobre 2002 a été une réponse réaliste aux difficultés rencontrées par les entreprises à la suite du carcan imposé par la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 (nre) en matière de cumul des mandats sociaux ; - avec la loi de sécurité financière du 1er août 2003, un choix délibéré a été fait en faveur d'une approche prudente en matière de gouvernance : le Gouvernement n'a pas souhaité substituer la loi au contrat et le législateur a suivi ce choix. Confiance et cohésion sociale : l'indispensable rôle du Parlement Alors que le retour au calme se profile sur les marchés, la mission d'information sur la réforme du droit des sociétés souhaite dresser le bilan des réformes accomplies, mais également s'interroger sur les avancées supplémentaires susceptibles de contribuer à l'émergence d'une nouvelle gouvernance. Une gouvernance qui place l'éthique et la règle au cœur de ses préoccupations : Enron a, en effet, tué le mythe de l'autorégulation. Dès lors que sont en jeu la confiance dans l'économie libérale et donc, plus radicalement, la cohésion sociale, il est du devoir de la Représentation nationale de faire entendre sa voix propre et d'esquisser les contours d'un contrat renouvelé entre dirigeants de sociétés, actionnaires, salariés, fournisseurs et régulateurs. Contrat qui peut prendre la forme de modifications législatives quand le régulateur suprême qu'est le législateur estime que l'autorégulation n'est plus de mise. Les propositions législatives contenues dans le présent rapport s'inscrivent d'ailleurs en droite ligne des travaux menés par la commission des Lois en matière de droit des sociétés depuis le début de la législature. En effet, les présentes recommandations se veulent, pour celles qui sont législatives, un complément que la Mission juge nécessaire d'apporter à la loi de
align: center">Les quinze propositions de la mission Réhabiliter l'actionnaire → Réhabiliter l'actionnaire Proposition n° 1 : certification par le commissaire aux comptes de la sincérité des informations relatives aux rémunérations individuelles, dans toutes leurs composantes, avec présentation dans les comptes annuels soumis au vote de l'assemblée générale dans le cadre de l'article L. 225-100 du code de commerce. Proposition n° 2 : amélioration de la transparence de la politique de vote des investisseurs institutionnels au sein des sociétés dans lesquels ils investissent. Proposition n° 3 : renforcement du principe déjà inscrit dans la loi de la possibilité pour l'actionnaire de faire valoir l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social en cas de consécration de la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion. Proposition n° 4 : améliorer la qualité et la sincérité de l'information financière fournie par les analystes de banques en inscrivant le principe des « murailles de Chine » dans la loi. → Responsabiliser le conseil d'administration Proposition n° 5 : publication du règlement intérieur du conseil d'administration dans le rapport annuel. Proposition n° 6 : transparence totale des opérations réalisées par les banques représentées au conseil d'administration et des mandats qui leur sont confiés, intégrée dans le règlement intérieur. Proposition n° 7 : instauration de mécanismes de cessions d'actions gratuites, avec obligation de conservation de celles-ci à moyen terme, pour associer les administrateurs dirigeants sociaux à l'évolution de la société. Proposition n° 8 : limitation du nombre d'administrateurs à quatorze maximum. Proposition n° 9 : obligation pour le conseil d'administration de consacrer une séance spécifique à l'examen du projet de nomination de tout administrateur, le cas échéant après réunion du comité des nominations et, le jour de leur désignation, obligation pour les administrateurs pressentis d'assister et de se présenter à l'assemblée générale qui les nomme. → Clarifier les pratiques en matière de rémunérations Proposition n° 13 : interdiction de souscrire des plans en période d'effondrement des cours, placée sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers (amf). Proposition n° 14 : édiction par l'amf d'un formulaire normalisé sur les règles de présentation des rémunérations. Proposition n° 15 : diffusion par l'amf, par exemple sur son site Internet, de tableaux à jour récapitulant les rémunérations des dirigeants de sociétés du sbf 120 avec, en regard, les résultats des années n-1 et n. I. - LA CRISE DE LA GOUVERNANCE : LA FIN DE L'AUTORÉGULATION Enron a sonné le glas de l'autorégulation et, s'il est une certitude dans le paysage encore perturbé des marchés financiers, c'est dans le grand retour des régulations qu'il faut la chercher. Il serait certes illusoire de penser que la restauration de la confiance puisse être décrétée de quelque manière que ce soit, y compris par des lois. À l'inverse néanmoins, quand la confiance, fondement même du système capitaliste, est rompue, l'inaction est inconcevable. La voie est étroite entre ces deux écueils : il convient de placer le curseur au bon endroit entre la tentation d'une sur-réaction réglementaire ou législative et la confiance aveugle dans la capacité du système à s'auto-corriger. Par ailleurs, il ne peut s'agir que d'une œuvre collective, c'est-à-dire émanant, d'une part, de tous les acteurs du marché, dont aucun n'a intérêt à l'atonie du système, moins encore à l'heure de l'éclatement de la bulle Internet, mais aussi, d'autre part, de tous les États. Transnationaux, les problèmes financiers appellent des réponses internationales, qui ne sauraient cependant pallier l'absence d'incitations nationales en faveur de la transparence. A. LA GOUVERNANCE : DU THÈME À LA MODE AU PASSAGE OBLIGÉ a) La mondialisation des règles du jeu La réflexion sur la gouvernance des entreprises initialement limitée au monde anglo-saxon est devenue une norme universelle. Cette évolution n'allait pas de soi. En effet, l'idée même de poser la question de la répartition des pouvoirs au sein de l'entreprise est, à l'origine, intimement liée aux spécificités du capitalisme anglo-saxon : actionnariat dispersé, déconnexion entre un management professionnel et des capitalistes propriétaires de l'entreprise. Elle partait d'une question simple : pour préserver le rôle central de l'actionnaire au cœur du système capitaliste, comment contrôler le management et l'obliger à men
). Fruit de la tradition étatiste, cette spécificité française est renforcée par l'absence de grands investisseurs institutionnels, essentiellement due aux caractéristiques du système des retraites. Si la question de la gouvernance n'est pas un simple phénomène de mode, c'est parce qu'elle pose des questions fondamentales sur le fonctionnement des sociétés, valables aussi bien à New York qu'à Francfort, Tokyo ou Paris. Pour le dire autrement, les réponses peuvent certes varier en fonction des traditions nationales ; il n'en reste pas moins que les questions posées sont universelles. C'est pour cette raison que « ce qui était hier perçu comme de l'impérialisme économique s'impose naturellement aujourd'hui comme la règle normale de fonctionnement des marchés ouverts » (4) De fait, la question fondamentale posée par les théories de la gouvernance a sa pertinence en France, caractérisée par un capitalisme aux traits contradictoires. S'il est toujours vrai que l'actionnariat des sociétés françaises reste relativement concentré, la France est aussi le pays dont l'actionnariat est le plus largement internationalisé. Toute réflexion sur la gouvernance doit donc prendre en compte le fait que la capitalisation boursière de la place de Paris est à 45 % entre les mains d'investisseurs étrangers. « L'intrusion du gouvernement d'entreprise n'est en rien un effet de mode dû au hasard, mais tout simplement la matérialisation d'un profond changement de nature du capitalisme occidental à laquelle la France ne peut échapper. » (5) Pourquoi l'extension internationale des théories de la corporate governance : l'explication de
Marie-Anne Frison-Roche, Le système classique, dans la loi de 1966, consiste à donner le pouvoir à ceux qui prennent des risques. Aujourd'hui, toutefois, la déconnexion entre pouvoir capitalistique et pouvoir décisionnel rend inapplicable un tel mécanisme : dans toutes les sociétés cotées, personne n'est actionnaire majoritaire et ceux qui dirigent n'ont qu'une très faible partie du capital social. Le lien consubstantiel au capitalisme entre pouvoir de décision et risque capitalistique est donc rompu. Dans ces conditions, à qui donner le pouvoir ? Les nouvelles théories de la corporate governance ont adopté, pour résoudre ce problème, une approche « expertale » du droit des sociétés : le pouvoir revient à ceux qui savent, et non à ceux qui risquent. La question pertinente devient alors de savoir comment contrôler « ceux qui savent ». Or, dans la théorie de la corporate governance, le grand problème est celui de la rente informationnelle : pour le dire autrement, comment, si l'on donne le pouvoir à « ceux qui savent », faire en sorte qu'ils utilisent leur savoir au bénéfice des investisseurs ? Par conséquent, la question centrale du droit des sociétés aujourd'hui consiste à distribuer et équilibrer les pouvoirs, à faire en sorte qu'ils soient bien exercés, c'est-à-dire à gérer les conflits d'intérêts dans toutes les sociétés. L'actualité la plus récente l'a rappelé : non seulement les analystes financiers n'ont pas donné leur information aux investisseurs mais ils ont même donné des informations contraires aux investisseurs. Le débat sur la gouvernance est de facto d'intérêt national, sans compter que les entreprises françaises cotées à l'étranger n'ont d'autre choix que de souscrire à des règles de gouvernance. Qui plus est, avec le phénomène récent d'édiction de règles de portée extraterritoriale, explicite ou implicite, par les États-Unis, - la loi Sarbanes Oxley pose la question avec acuité - , les entreprises françaises n'ont d'autre choix que d'adopter un positionnement clair en matière de gouvernance. D'une certaine façon, l'universalité du débat sur la gouvernance est fille de la mondialisation. De surcroît, s'il est vrai que, par comparaison, l'actionnariat des sociétés françaises reste concentré, en tendance, ce phénomène est en recul. En effet, la concentration du capitalisme français tend à se réduire, au profit d'une extension de l'actionnariat individuel. La dérégulation a évidemment facilité cette évolution : alors que, pendant longtemps, il était difficile d'échanger des titres de la société (complexité de valorisation de l'entreprise et coûts de transaction) - l'investisseur s'engageait de ce fait dans la vie de l'entreprise - aujourd'hui, la multiplicité des fusions et acquisitions et le recours croissant au marché ont dilué l'actionnariat. Les investisseurs institutionnels ont, en outre, une stratégie de diversification du risqu
160;Pour des raisons profondément culturelles, la France a pendant longtemps vécu dans le culte du secret. (...) Pour les managers-monarques, le secret était une arme dans l'exercice de leurs fonctions. Familiales, étatiques ou anonymes, les entreprises réglaient leurs petites affaires à l'occasion de réunions de famille plus ou moins sympathiques, dans les couloirs austères des ministères ou dans les salles à manger feutrées des grandes banques parisiennes. » (6) L'expansion de la gouvernance en France est aussi liée aux progrès de la culture de la transparence. Les années 1990 auront été celles de l'avènement de la transparence dans la vie politique ; la décennie 2000 sera celle de la consécration de la transparence dans les grandes entreprises françaises. Ce que le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz appelle le « capitalisme de copinage », dont la France n'avait d'ailleurs certainement pas l'apanage, n'est plus accepté aujourd'hui. 2. Huit années de gouvernance à la française C'est dans les années 1990 que les dirigeants sociaux français entrent dans le débat, jusqu'alors largement anglo-saxon, sur la gouvernance. L'intérêt des dirigeants français pour cette thématique résulte moins d'un enthousiasme pour une notion qui fait sourire - quand elle n'est pas simplement ravalée au rang de « mode venue d'outre-Atlantique » -, que d'un positionnement réactif. La motivation profonde du premier rapport Viénot procède en effet, avant tout, d'une réaction défensive, trois ans après la publication du rapport britannique fondateur en la matière (Cadbury, 1992), qui initia le premier Code of best practices des places européennes. Il n'en reste pas moins que l'acte de naissance de la gouvernance des entreprises se situe en France en juillet 1995, avec la publication du premier rapport Viénot, dit « Viénot I ». De fait, ce rapport fut généralement accueilli avec un enthousiasme modéré par des patrons qui ne voulurent y voir que l'importation forcée d'un concept anglo-saxon, qualifié d'inadapté au marché français. Néanmoins, cette contre-offensive est, sur le fond, assez convaincante en ce qu'elle fait apparaître des propositions et des voies d'évolution qui tranchent singulièrement avec les mœurs du capitalisme français. Réaffirmation claire des missions du conseil, appel à la création des comités spécialisés et à l'émergence d'administrateurs indépendants, remise en cause du principe de croisement des administrateurs, adoption de véritables méthodes de travail du conseil, respect des droits d'information et de contrôle du conseil, rédaction d'une charte fixant les droits et devoirs de l'administrateur..., tous les grands thèmes de la gouvernance sont présents. Manque cependant - mais ce constat vaut pour tous les rapports français, y compris la très récente « compilation » des trois rapports français (7) - une réflexion digne de ce nom sur l'actionnaire
dresser un premier bilan de la gouvernance en France, il est aussi un signal envoyé par les dirigeants sociaux français alors qu'est en préparation à la Chancellerie ce qui deviendra la loi nre du 15 mai 2001. Reste que, au-delà des motivations initiales qui ont conduit le patronat français à s'emparer du thème de la gouvernance, celle-ci s'ancre peu à peu dans le paysage capitalistique français. Et il n'est pas anodin de relever que ce second rapport a pour titre Rapport sur le gouvernement d'entreprise, là où le précédent s'intitulait plus simplement Le conseil d'administration des sociétés cotées. Il ne s'agit plus seulement des réflexions modestes de quelques présidents éclairés adressées à leurs homologues sur le conseil d'administration des sociétés cotées ; il est désormais question de recommandations formalisées par une instance suffisamment légitime pour demander que les sociétés françaises se plient au fameux principe britannique du comply or explain. En bref, si l'idée d'une autorité de marché supervisant la gouvernance est violemment rejetée, en revanche, les sociétés sont fortement incitées à présenter leurs progrès en matière de gouvernance dans le rapport annuel et à expliquer pourquoi, le cas échéant, elles se refusent à faire droit aux recommandations des rapports Viénot I et II. Sur le fond, le rapport se distingue du précédent par l'insistance avec laquelle il demande aux sociétés cotées de fournir une information homogène, lisible et comparable des sociétés cotées sur la rémunération globale de leur équipe de direction, de même que sur la pratique du gouvernement d'entreprise (profil des administrateurs, politique suivie en matière d'administrateurs indépendants, fréquence des réunions du conseil et des comités). S'agissant cependant du droit des actionnaires à connaître la rémunération individuelle des dirigeants, aucune avancée réelle n'est faite : il faut attendre le revirement de position du medef et de l'afep au début de l'année 2000 pour que le sujet progresse, avant d'être finalement consacré par la loi nre. De même, la timidité prime en ce qui concerne ces tares traditionnelles du capitalisme français que sont la consanguinité et la concentration des mandats d'administrateur, ainsi qu'en matière d'évaluation des méthodes de travail du conseil. La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 : - abaissement de 10 à 5 % du seuil de détention du capital ouvrant droit à un certain nombre d'initiatives aux actionnaires minoritaires - dissociation possible des fonctions de président et de directeur général - limitation du cumul des mandats sociaux - tentative de clarification des missions du conseil d'administration - publication de la rémunération individuelle des mandataires sociaux - extension du champ des conventions réglementées - incitation à l'utilisation des nouvelles technologies Pourquoi le rapport Bouton, un peu plus d'un an après la loi nre qui introduit un certain nombre d'éléments de la gouvernance dans la loi ? Il se veut la réponse des dirigeants français à la crise ouverte par les scandales Enron et WorldCom. L'importance accordée à la question de l'audit, de l'information financière et des normes comptables témoigne d'ailleurs de ce contexte spécifique. Il n'en contient pas moins un certain nombre de propositions qui font, au moins sur le papier, de la gouvernance à la française un corpus de règles cohérent et, le plus souvent, convaincant. Ainsi, par exemple, le rapport traite ouvertement de la question de la composition des conseils d'administration en abordant de front le vrai problème : celui de la compétence de ses membres, au-delà de la seule question de l'indépendance. Sans doute est-il évident que les administrateurs sont soucieux de l'intérêt des actionnaires et s'impliquent suffisamment dans la définition de la stratégie et dans les délibérations pour participer effectivement à ses décisions, qui sont collégiales mais, lorsque l'on connaît la pratique d'un certain nombre de conseils, il est des rappels salutaires... En réclamant un véritable droit à l'information des administrateurs, voire à leur formation, le rapport Bouton conforte la toute récente loi nre. Une autre innovation concerne le recours à des procédures d'évaluation, y compris par des organismes externes, du fonctionnement du conseil, dont le principe est d'ailleurs inscrit dans la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Celle-ci constitue la réponse législative à la crise de confiance ouverte par les scandales et dysfonctionnements à répétition de sociétés américaines et européennes. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 - création de l'autorité des marchés financiers - renforcement de l'indépendance des commissaires aux comptes B. LA CRISE DE CONFIANCE SUR LES MARCHÉS : UN RÉVÉLATEUR DES INSUFFISANCES DE LA GOUVERNANCE « Les marchés financiers ne sont plus, et ne seront plus, commandés par l'économie réelle. Ils sont devenus un secteur d'activité à part entière, avec ses acteurs, ses règles, ses fantasmes, son autisme et ses mouvements d'humeur moutonniers. » (9) 1. La crise de confiance actuelle a des causes structurelles, liées aux dérèglements du capitalisme financier La Mission a débuté ses travaux dans un contexte de crise aiguë de la gouvernance, déclenchée par la faillite de l'entreprise américaine Enron. Sans doute, comme la Mission n'a cessé de l'entendre, il y a loin du comportement criminel des dirigeants d'Enron aux jeux comptables poussés à leurs limites ou erreurs stratégiques de certains dirigeants. Dont acte. Mais il serait simpliste de réduire le débat à l'existence d'une ligne de partage entre, d'un côté, des dirigeants américains cupides, et, dans certains cas, malhonnêtes, et, de l'autre, des responsables français au mieux malchanceux, au pire mégalomanes. C'est en effet de part et d'autre de l'Atlantique que le système capitaliste s'est emballé. C'est de part et d'autre de l'Atlantique que des millions de petits actionnaires ont perdu la plus grande partie de leurs économies. C'est de part et d'autre de l'Atlantique qu'en tout état de cause, il y a eu, à la source, un manquement dans le fonctionnement des organes de contrôle. Et, in fine, de part et d'autre de l'Atlantique, la gouvernance telle qu'on la concevait dans les années 1990 n'a pas empêché la dérive : le gigantisme des entreprises, entraînées dans une frénésie de fusions et acquisitions, le gigantisme des rémunérations ont fait dériver le gouvernement des entreprises de la monarchie constitutionnelle - ce qu'il doit être - vers la monarchie absolue. Car la Mission ne considère pas l'affaire Enron et les scandales Vivendi, France Télécom, Ahold... comme le résultat de défaillances ponctuelles ou de l'« ubris » de certains dirigeants. C'est le système dans son ensemble qui a failli. Pour reprendre la distinction établie par Élie Cohen, entre les deux interprétations dominantes - « celle des « bad apples » qui stigmatise les comportements déviants de ceux qui par leurs actes minent
second. Ceci même alors qu'ils sont les propriétaires de l'entreprise et prennent des risques d'autant plus grands que les règles du jeu capitalistique sont aujourd'hui particulièrement complexes et que les montants financiers en jeu sont gigantesques ; - un dirigeant qui assume des responsabilités internes, vis-à-vis des organes de l'entreprise, mais aussi, de plus en plus, externes, vis-à-vis du marché, dualisme qui peut le mettre en situation de conflit d'intérêts - la transparence vers l'extérieur doit-elle être la même qu'en interne ? - et a favorisé les jeux comptables ; - un conseil d'administration censé contrôler un président, alors qu'il dispose d'une masse d'informations bien inférieure, tout en l'aidant dans sa mission de direction ; - des contrôleurs qui interviennent au sein même de l'entreprise - les commissaires aux comptes - et en dehors - analystes et agences de notation, et dont l'opinion peut modifier les conditions d'exercice de la direction de l'entreprise. Des propriétaires qui ne contrôlent pas, des dirigeants qui ne risquent rien en termes financiers, des organes de contrôle dépendants de ceux qu'ils contrôlent pour bien accomplir leur mission et des réceptacles d'informations qui en modifient la teneur par le seul fait d'en donner une analyse critique... Pour que ce capitalisme fonctionne, « il faut que chacun de ces acteurs sache raisonnablement ce qu'il peut attendre des autres, ce qui exclut la généralisation de la tricherie, du mensonge et de l'arbitraire » (11). Ce constat n'a certes rien de nouveau mais, dans un contexte de mondialisation, il prend un relief particulier. Or, c'est le lien entre tous les acteurs qui est aujourd'hui en question. Ce phénomène de crise de confiance est certes classique dans l'histoire du capitalisme. Mais il faut se souvenir qu'à chaque fois le capitalisme ne s'en est sorti qu'en se métamorphosant. Il s'agit là d'une condition sine qua non du retour à la confiance. 2. - Les insuffisances de la gouvernance : le cas français Quel bilan tirer de la gouvernance à la française ? Les progrès sont indéniables : les entreprises françaises ont fait de grands progrès en termes de gouvernance depuis la publication du premier rapport Viénot en 1995. Ce changement ne s'est pas fait sans réticence tant « abandonner l'exercice solitaire, autoritaire et paranoïaque du pouvoir pour lui substituer des pratiques collectives, participatives et schizophréniques n'est jamais, pour l'homme, chose naturelle » (12). Il aura fallu, d'ailleurs, « certaines affaires » pour que de vraies discussions aient lieu dans ce cénacle, en un mot, pour « réveiller les consciences », selon les mots utilisés par M. Jean Peyrelevade lors de son audition devant la Mission. Ainsi, les propositions du rapport Viénot I sont devenues la norme des sociétés du cac 40, comme le montre le sch&
Le bilan est moins facile à dresser s'agissant de la mise en œuvre des recommandations du rapport Viénot II. Si l'on retient comme critères les quatre thèmes les plus emblématiques - séparation des fonctions de président et de directeur général, information sur les rémunérations individuelles des mandataires sociaux, information standardisée et clarifiée sur la pratique du gouvernement d'entreprise et présence forte d'administrateurs indépendants (33 % dans le conseil d'admi-nistration, dans le comité d'audit, dans le comité de nomination et 50 % dans le comité de rémunération) -, elles étaient mises en oeuvre par 60 % des sociétés du cac 40 en 2002 (13) : - 36 % d'entre elles avaient recouru à la séparation des fonctions de président et de directeur général ; - 90 % publiaient une information sur les rémunérations individuelles des mandataires sociaux, proportion dont il faut bien reconnaître qu'elle s'explique surtout par le fait qu'il s'agissait d'une prescription légale depuis l'intervention de la loi nre ; - 92 % produisaient une information standardisée sur la pratique du gouvernement d'entreprise ; - 29 % remplissaient les critères requis en termes d'indépendance des administrateurs. Quant aux prescriptions du rapport Bouton, elles seraient appliquées par 30 % des sociétés du cac 40. Cette évaluation en termes de box ticketing - cette expression imagée désigne le « fait de cocher toutes les cases de la check list du gouvernement d'entreprise sur la forme et non sur le fond » (14) - est-elle suffisante à l'ère de la gouvernance post-Enron ? Si, à l'évidence, une analyse quantitative pouvait paraître satisfaisante avant 2002, il n'en va plus de même aujourd'hui. Pour avoir une approche pertinente de la gouvernance, il faut en analyser non seulement la forme, mais également le fond. Or, cette démarche fait apparaître un bilan plus nuancé. Au titre des avancées, il faut reconnaître que le conseil d'administration français est de plus en plus actif et de plus en plus ouvert.
UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PLUS EN PLUS ACTIF (1995-2002) 2002 2000 1998 1996 1995 Sociétés indiquant le nombre de réunions du conseil) 37 34 29 14 0 Nombre moyen de réunions du conseil 6,9 6,5 5,4 4 3 Selon l'étude du cabinet Korn Ferry, les administrateurs français consacrent entre 40 et 70 heures par an aux travaux du conseil d'administration, selon qu'ils ont ou non un rôle dans un comité, contre 203 heures pour les administrateurs américains des sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur à 20 milliards de dollars. En outre, la composition du conseil se diversifie.
LE PROFIL DES ADMINISTRATEURS FRANÇAIS (1997-2002) 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Âge moyen des administrateurs (en années) 63 63 60 61 67 66 Répartition de l'origine des administrateurs : - Lié à un actionnaire ou un partenaire commercial ou financier (administrateurs dépendants au sens du rapport Viénot) 43 % 46 % 45 % 47 % 45 % 55 % - Représentant du management 20 % 20 % 19 % 17 % 18 % 21 % - Représentant d'une catégorie spécifique d'actionnaires (individuel ou minoritaire) 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % - Représentant des salariés 8 % 7 % 7 % 8 % 8 % 7 % - Administrateurs indépendants 29 % 26 % 28 % 27 % 28 % 16 % Formation des administrateurs : - Diplômés de Polytechnique ou de l'ENA 31 % 32 % 34 % 37 % 37 % 40 % - Provenant d'autres origines 69 % 68 % 66 % 63 % 63 % 60 % Parts des grands corps en % du total des administrateurs français 41 % 42 % 43 % 46 % 45 % 50 % Nationalité des administrateurs : - Français 76 % 78 % 79 % 80 % 83 % 83 % - Étrangers 24 % 22 % 21 % 20 % 17 % 13 % Sexe des administrateurs : - Hommes 93 % 94 % 94 % 95 % 96 % 97 % - Femmes 7 % 6 % 6 % 5 % 4 % 3 % Source : Bertrand Richard et Dominique Miellet, op. cit. Il ressort ainsi du tableau ci-dessus que : - la part des étrangers et des administrateurs indépendants continue de progresser, ce qui accroît la spécificité du conseil d'administration français par rapport à son homologue américain par exemple (moins de 4 % d'étrangers, ce qui laisse rêveur quant à l'existence d'un marché international, sinon des dirigeants, du moins des mandataires sociaux...) ; - la part des grands corps diminue ; - l'administrateur français est, en moyenne plus jeune, que ses homologues anglo-saxons. · Reste que cette évolution est récente et qu'elle est loin d'être achevée. Comme aux États-Unis, la crise récente a révélé les insuffisances de la gouvernance à la française. Les dirigeants d'entreprise eux-mêmes reconnaissent l'existence d'un « problème » du capitalisme français, qu'ils ont attribué à ses « pratiques » (M. Daniel Bouton). Pour Mme Monique Bourven, présidente du conseil des marchés financiers, « le conseil d'administration à la française suit encore un fonctionnement traditionnel ». De fait, les conseils français ont du mal à se réunir pour faire leur autocritique. Comme l'a indiqué le professeur Daigre devant la mission, aujourd'hui, il n'y a pas d'organe de contrôle des dirigeants suffisamment structuré : ceux-ci sont encore trop livrés à eux-mêmes, alors même qu'en raison de l'ampleur de leur tâche, ils souhaiteraient pouvoir disposer de points d'appui critiques. La loi de sécurité financière a sans doute tenté d'apporter une réponse à cette question en obligeant le président du conseil à faire rapport à l'assemblée générale sur les mécanismes de contrôle interne mis en place au sein de la société. Mais n'est-il pas paradoxal de confier à celui sur lequel le contrôle doit porter au premier chef le soin de présenter - de définir aussi sans doute - les mécanismes d'évaluation critique de son action ? Le fait est qu'un certain nombre de conseils d'administration français n'ont pas rempli leur rôle. S'il est facile d'invoquer des traits culturels, comme ont pu le faire des témoins auditionnés par la Mission - « La France a le goût du pouvoir personnel, du chef providentiel » (Professeur Jean-Jacques Daigre), ne faut-il pas également mettre en cause les méthodes de travail des conseils ? Si des dérives ont été possibles en France, c'est aussi parce que certains conseils d'administration n'ont pas fait leur travail, au moment même où la bulle Internet a entraîné le capitalisme financier à des niveaux jamais atteints. En la matière, même aprè
RECRUTEMENT DES DIRIGEANTS (1) Nomination des dirigeants Nomination des Quel est l'acteur clé ? France Royaume-Uni Reste de l'Europe France Royaume-Uni Reste de l'Europe Président 90 % 82 % 54 % 80 % 72 % 54 % Comité de nomination 15 % 48 % 12 % 30 % 47 % 19 % Conseil d'administration 25 % 77 % 20 % 40 % 70 % 27 % Source : Bertrand Richard, Dominique Miellet, op. cit. Question posée : « qui est en charge de la nomination des dirigeants et des administrateurs ? ». Plusieurs réponses étant possibles, le total de réponses est supérieur à 100 %. Comment est-il dès lors envisageable d'aller lui poser les questions qui dérangent ? M. Jean Peyrelevade l'a d'ailleurs très directement reconnu devant la Mission : « in fine, c'est au président qu'il revient de susciter ces discussions ». La question du mode de désignation du conseil d'administration n'est certes pas nouvelle, mais les progrès d'une culture de la transparence la rendent aujourd'hui cruciale. La révérence traditionnelle envers la direction n'est plus acceptable. L'effet de caste n'est plus admis par les actionnaires, à juste titre. Cette insuffisance des conseils n'a pas été compensée par une plus grande vigilance des actionnaires. Certes, le constat est unanime : les assemblées générales qui se sont tenues en 2003 pour examiner les comptes de 2002 ont été beaucoup plus houleuses qu'à l'habitude. Le contexte d'effondrement des cours de la bourse participe sans nul doute de ce climat spécifique au sein des sociétés cotées. Mais il faut également sans doute voir dans ce que d'aucun ont considéré comme une « bronca » (15) le résultat d'une « acclimatation » généralisée des principes de gouvernance. Reste à transformer ces manifestations symboliques en actions constructives : il n'est pas faux de considérer que « le bruit fait par des petites porteurs pèse peu par rapport à l'influence de quelques grands actionnaires ou administrateurs puissants » (16). Le fait même que l'activisme de certaines assemblées générales soit taxé de « fronde des actionnaires » dit assez, a contrario, quelle est la norme. II. - MÉTHODOLOGIE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE : POUR UNE LIBERTÉ SURVEILLÉE L'autorégulation a montré ses limites. Les différents scandales et dysfonctionnements en ont sonné le glas. La nouvelle gouvernance passe par un dosage entre autorégulation et réglementation, avec une mission renforcée de vigilance pour le gendarme boursier. C'est le promoteur de l'autorégulation lui-même, M. Marc Viénot, qui, devant la mission, en a constaté l'acte de décès : « Peut-on continuer dans le système de l'autorégulation ? Aujourd'hui, je crois qu'il faut institutionnaliser le gouvernement d'entreprise. Il faut interposer entre la loi et les entreprises la nouvelle autorité de marché. » A. LE LÉGISLATEUR, NOUVEL ACTEUR DE LA GOUVERNANCE POST-ENRON Autor&eacut
structures : les structures disciplinaires n'ont pas fonctionné, les personnes supposées fiables ont également failli. Dans cette situation où le marché est désormais marqué par l'incertitude et le risque, le droit dispose de cet extraordinaire pouvoir de créer de l'incontestable par sa normativité, donc, en termes économiques, de l'investissement. Dans ce contexte, les marchés n'ont jamais eu autant besoin du droit : ils attendent des termes généraux et ne souhaitent ni l'absence de règles ni l'absence de contraintes. » 1. Du Sarbanes Oxley Act américain à la consultation britannique sur les « Primes à l'échec », en passant par la sécurité financière à la française et les initiatives communautaires La crise du capitalisme financier a sonné le glas de l'autorégulation. Les Etats-Unis, premiers concernés par cette crise, qui a touché un modèle de capitalisme qu'ils ont inventé et propagé, sont les premiers à avoir réagi. Les pays européens ne sont pas en reste, comme le montrent, notamment, les exemples britannique et français (17). Même la Commission européenne a pris position sur le sujet. a) Le Sarbanes Oxley Act ou la révolution du droit américain des sociétés « Le Sarbanes Oxley Act (soa) a été conçu au point culminant d'une ère qui s'est achevée dans la désillusion et s'est traduite par l'effondrement des Bourses et de la confiance à mesure que se multipliaient les preuves des comportements malfaisants des entreprises ». Ces mots de M. William Donaldson, président de la Securities and Exchange Commission (sec), rappellent le contexte tout à fait spécifique dans lequel a été élaborée et votée la loi la plus importante pour les entreprises américaines depuis 1933. En vigueur depuis le 30 juillet 2002, cette loi prise en réaction à l'affaire Enron marque, pour le droit américain, une véritable révolution. La réponse des États-Unis - il est vrai les premiers concernés par les dérives financières - ne s'est pas faite attendre, même si la lutte qui vit triompher les tenants de la régulation fut particulièrement rude. Cette réforme en profondeur du droit américain des sociétés a eu d'autant plus d'impact que les nouvelles règles qu'elle prescrit s'appliquent à tous les émetteurs, américains ou non, dès lors qu'ils choisissent de faire coter leurs titres aux États-Unis. Le sarbanes oxley act du 30 juillet 2002 L'ensemble des dispositions de la loi Sarbanes-Oxley est regroupé dans onze titres. Titre Ier : Institution, missions et règles de fonctionnement du nouveau Public Company Acc
Sanctions de la fraude criminelle en matière commerciale Titre IX : Renforcement des sanctions contre la criminalité en col blanc Titre X : Questions fiscales Titre XI : Sanctions de la fraude commerciale Les sujets traités dans ce que d'aucuns ont vu comme la mise en action du Corporate America sont multiples : transparence comptable, réforme de la profession des auditeurs (commissaires au comptes), et notamment mise en place d'un organe de contrôle des auditeurs, le pcaob, nouvelles règles imposées aux avocats d'affaires, règles de communication financière, création de nouveaux délits boursiers et durcissement des sanctions existantes... Tous les maillons de la chaîne d'information financière sont visés dans ce texte. b) La méthode britannique : des avancées... à petits pas De prime abord, il pourrait sembler paradoxal que le Royaume-Uni, pays libéral par excellence, soit, à bien des égards, le pays le plus avant-gardiste dans le débat sur la bonne gouvernance et, plus particulièrement, les rémunérations. Le paradoxe n'est qu'apparent. C'est bien parce le libéralisme est une valeur fondamentale au Royaume-Uni que les règles y sont les plus élaborées : si ce pays n'a pas connu de dérives comparables à celles qui ont provoqué la crise du capitalisme financier aux États-Unis, c'est sans doute parce que nos voisins d'outre-Manche n'ont jamais oublié que le libéralisme ne fonctionnait que dans un cadre réglementaire précis et efficace... et dans le respect de l'éthique. Pour prendre l'exemple des rémunérations, en juin 2003, le ministère du commerce et de l'industrie a ouvert une consultation sur le thème Reward for failure (des récompenses pour l'échec), dont l'objet est de définir la meilleure voie pour mettre fin aux rémunérations excessives, notamment quand l'entreprise licencie ou voit sa valeur se déprécier en bourse. Cette initiative vient dans la foulée d'une loi adoptée en 2002 prévoyant la publication de la rémunération des dirigeants dans le rapport annuel ainsi qu'un vote consultatif de l'assemblée générale. L'Union européenne veut se fixer des règles en matière de gouvernement d'entreprise. Ainsi, dès le mois de septembre 2001, la Commission avait créé un groupe d'experts sur le droit des sociétés, dont le mandat était initialement limité à la préparation d'une nouvelle proposition de directive sur les offres publiques d'achat et à la définition de nouvelles priorités pour le droit européen des sociétés. Mais, à la suite de l'affaire Enron, la Commission avait décidé de procéder à une analyse, au niveau européen,
où tous les éléments, y compris les programmes de stock options, seraient examinés. Le poids de ces administrateurs devrait être accru dans d'autres domaines, comme le contrôle des audits, les nominations, l'implication éventuelle des salariés. Il se prononce par ailleurs en faveur du renforcement de la transparence par la communication régulière dans la structure de direction et par la description complète des comptes pour toutes les entreprises cotées. Les membres des conseils d'administration seraient légalement et collectivement responsables de la publication des résultats et des communiqués financiers. Depuis lors, le 21 mai 2003, la Commission a communiqué au Conseil et au Parlement européens, un plan d'action intitulé Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer. Parmi les motivations d'un tel plan, la Commission évoque la nécessité de « relever les défis résultant d'événements récents », citant notamment les comportements de dirigeants « mesquins, voraces, voire frauduleux ». Il s'agit aussi pour la Commission d'affirmer la vision européenne du gouvernement d'entreprise, « forgée sur la base des traits culturels et des pratiques des affaires qui lui sont propres ». Cependant, la Commission fait le choix de fixer un cadre général tout en renvoyant aux spécificités nationales. Les quatre axes de la gouvernance à l'européenne selon la commission 1. Une meilleure information sur les pratiques des entreprises. Notamment, le plan considère comme primordial, pour restaurer la confiance du public, « de veiller à ce qu'une information adéquate soit fournie sur la façon dont la société s'est elle-même organisée au plus haut niveau pour mettre en place et appliquer un système de contrôle interne efficace ». Une telle exigence semble traduire le souhait de la Commission de voir publier les règlements intérieurs des sociétés. 2. Le renforcement des droits des actionnaires : il s'agit notamment de favoriser le vote électronique, ce qui, depuis la loi nre, existe en droit français. 3. La réforme du conseil d'administration. La Commission se penche sur la question de la composition du conseil et recommande qu'en cas de conflit d'intérêt réel ou potentiel, seuls votent les administrateurs extérieurs. Selon le rapport du groupe de haut niveau, il faut considérer l'indépendance comme « le fait d'être sans relation avec les opérations de la société, ni avec ses principaux responsables, et de ne tirer aucun avantage de la société que la rémunération, totalement transparente, perçue en tant qu'administrateur extérieur ou que membre du conseil de surveillance ». En matière de rémunération, la Commission considère que quatre éléments essentiels doivent exister : information sur la politique de rémunération dans les comptes
cette matière. a) La mondialisation ou la pertinence de l'outil législatif en question La première de cette limite est liée au contexte de la mondialisation, qui peut faire de la loi un outil, au pire dangereux, au mieux inutile. · Dangereux tout d'abord, dans la mesure où, la loi n'étant pas d'application extraterritoriale, toute contrainte imposée aux entreprises nationales peut porter atteinte à leur compétitivité. Si c'est toujours avec une main tremblante que le législateur doit produire du droit, cette maxime doit être érigée en règle d'or dès lors qu'elle s'applique au droit des sociétés. Ainsi, aux États-Unis mêmes, le Sarbanes Oxley Act fait l'objet de vives critiques de la part de certains praticiens de la vie des affaires, notamment du fait qu'une partie de ses prescriptions est d'application extraterritoriale. En effet, son champ d'application s'étend à toutes les sociétés américaines et étrangères dont les titres sont admis à la cote officielle, mais aussi aux sociétés qui doivent soumettre régulièrement des rapports à la sec, ce qui place, par exemple, une entreprise comme eads, qui possède des actionnaires américains, sous le coup de la nouvelle loi. Selon M. Daniel Hurstel, avocat, « en définitive cependant, peu de sociétés françaises y seront soumises. Leur nombre peut être estimé entre quinze et vingt. » De même, la législation américaine sur la class action est un véritable repoussoir pour certaines entreprises : comme l'a indiqué le président directeur général de Total à la Mission, « nous avons renoncé à certains investissements aux États-Unis en raison de l'insécurité juridique qui y règne », faisant allusion à cette procédure spécifique. · Quant au caractère vain et inefficace de la loi, nul exemple ne l'illustre mieux que celui des agences de notation : alors même qu'il s'agit d'un sujet essentiel, le législateur n'a d'autre choix que de reconnaître son impuissance. Jusqu'à une période récente, les agences de notation étaient, en France, très largement une terra incognita. Ce sont les dysfonctionnements survenus aux Etats-Unis, et notamment le scandale de l'affaire Enron, qui ont conduit le Congrès américain à enquêter sur le sujet, le régulateur américain, la SEC, entrant alors également dans le jeu. Tel est le contexte dans lequel est né le débat, en France. Si l'on s'interroge, en amont, sur les raisons qui ont conduit à cette montée en puissance des agences de notation, il faut revenir au grand mouvement de dérégulation et de désintermédiation survenu au cours de la dernière décennie. En effet, la conjonction entre le développement de la libre circulati
interrogés sur le sujet par la Mission. Ainsi, pour M. Jean Peyrelevade, « les agences de notation (...) ont (...) des responsabilités très importantes dans le fonctionnement global du système. ». Et de rappeler les événements récents lors desquels s'est illustré leur pouvoir : « La dégradation d'une note peut provoquer des désastres : à cause d'une dégradation de notation, Vivendi Universal a frôlé le dépôt de bilan ; France Télécom aurait déposé son bilan si l'État n'en était pas actionnaire majoritaire. » Un autre grand banquier français, M. Michel Pébereau, ne dit pas autre chose : « en ce qui concerne les agences de notation, ce sont des produits du marché. Elles sont nécessaires pour évaluer la solidité, la capacité de remboursement des entités qui émettent sur les marchés : elles assurent l'information des investisseurs qui ne sont pas forcément des professionnels ou qui n'ont pas la capacité d'apprécier la solidité de l'entité avec laquelle ils opèrent, les risques qu'ils prennent en lui faisant crédit. Ces agences répondent donc à un vrai besoin. ». Dans le même temps, chacun est conscient des limites du fonctionnement de ces organismes. Notamment, le fait que les trois grandes agences de notation, qui sont privées, sont financées par les émetteurs qu'elles sont chargées de noter pose un vrai problème de déontologie, particulièrement flagrant à l'heure où, chez tous les acteurs du capitalisme, les régulateurs s'efforcent de réduire les situations porteuses de conflits d'intérêts. Sont également en débat les méthodes de travail des agences : « aujourd'hui, elles prennent prétexte de la protection de leur secret de fabrication pour s'exonérer de tout processus externe d'examen de la qualité de leurs procédures. Les critères de notation changent-ils ? L'entreprise ne le sait qu'une fois notée. Les agences se trompent ? Aucun recours n'est possible car les règles du jeu qui permettraient de mettre en cause leur responsabilité ne sont pas connues. L'exemple de la dégradation soudaine et brutale de la note de la Corée pendant la crise asiatique le montre. », a ainsi rappelé M. Jean Peyrelevade à la Mission. La question du « qui contrôlera les contrôleurs » n'est pas nouvelle. Pour autant, aucune solution satisfaisante n'émerge. Il est révélateur que Mme Monique Bourven, présidente de l'ancien conseil des marchés financiers, reconnaisse devant la mission, s'agissant du financement des agences, « je n'ai pas aujourd'hui de solution à cette question. », constat qui fait écho à celui de M. Jean-François Lepetit, président de l'ex-commission des opérations de bourse : « si les agences de notation disposent d'informations particulières, privilégiées, le régulateur doit s'en occuper. Mais je n'ai pas de solution toute faite. » Dans ces conditions, fait débat l'apparente contradiction entre ce rôle central reconnu par tous et la difficulté à réguler ou réglementer cette activité. Pour autant, le stat
sécurité financière, le législateur a épuisé sa compétence en prévoyant la publication d'un rapport annuel par l'autorité des marchés financiers (amf), relatif au rôle, aux règles déontologiques, à la transparence des méthodes et à l'impact de l'activité des agences de notation. Rappelons qu'alors même que les agences sont, pour les principales d'entre elles, de droit américain, même le législateur américain a dû adopter une position minimaliste en s'en remettant, lui aussi, au régulateur des marchés. Le législateur d'Enron a ainsi enjoint à la sec de s'interroger sur le rôle des agences de notation et leur importance dans le système boursier, les obstacles qu'elles rencontrent dans l'accomplissement de leur rôle, les mesures pouvant améliorer le cheminement de l'information vers le marché en provenance des agences de notation, les barrières à l'entrée sur le marché de la notation financière et les conflits d'intérêts auxquels les agences sont confrontées. L'étape ultérieure ne pourrait qu'être européenne : comme l'a proposé M. Michel Pébereau, « on peut imaginer qu'en Europe d'une part, et aux États-Unis, d'autre part, un organisme indépendant de l'ensemble des acteurs du marché soit mis en place. Pour ce faire, il pourrait être financé par une redevance prélevée sur les agences de notation. » Dans cette attente, la France, comme tous les autres pays, ne peut que s'en remettre aux règles édictées par le régulateur américain, seul organisme susceptible de disposer d'un pouvoir d'influence sur les agences, via l'agrément qu'il leur délivre pour exercer cette activité. b) Décréter la vertu ? L'autre limite de la loi La faillite de la gouvernance des années 1990 est venue rappeler cette évidence : le capitalisme ne saurait fonctionner sans éthique - ce que nous appelons « vertu ». À cet égard, la Mission salue l'attitude de M. Pierre Bilger qui, en rendant les indemnités de départ qu'il avait touchées en quittant Alstom, a mis en pratique un précepte trop souvent vidé de sa substance. C'est également parce qu'elle a jugé illusoire de décréter la vertu que la Mission n'a pas retenu les propositions relatives à l'administrateur indépendant. Non qu'elle ne juge pas cette question cruciale, bien au contraire, comme le prouvent les propositions qu'elle formule dans le présent rapport pour dynamiser et responsabiliser le conseil d'administration. Comme l'a rappelé devant la Mission M. Alain Pietrancosta, le débat anglo-saxon sur l'administrateur indépendant correspond au débat français sur la diversification de la composition du conseil d'administration et des comités créés en son sein. Il faut donc, pour transposer cette notion, non pas inscrire dans la loi l'obligation de présence des administrateurs indépendants dans le conseil d'administration, mais s'interroger sur le rôle assigné à l'administrateur indépendant dans le système anglo-saxon, et dépasser ainsi la seule notion d'administrateur indépendant pour s'attacher aux objectifs poursuivis à travers cette réforme. La forme ne doit
fassent les auxiliaires de la loi, non seulement en épuisant pleinement les compétences que celle-ci leur reconnaît, mais aussi, dans une matière pour laquelle nous privilégions le contrat, en suppléant les silences et les limites de la loi. 1. Un auxiliaire de droit : le gendarme des marchés financiers, pivot de la bonne gouvernance C'est un fait trop souvent oublié que la gouvernance repose sur un système à trois, et non à deux, piliers : l'autorégulation, la loi et, au milieu de ces deux extrêmes, la régulation. Dans ce dernier domaine, l'autorité compétente est le gendarme des marchés financiers. En effet, au-delà de son rôle classique de protectrice des intérêts des épargnants, rappelé par l'article 1er de la loi de sécurité financière, selon lequel « l'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international », cette institution est également désormais le gendarme de la gouvernance. En effet, aux termes de l'article 122 de cette même loi, l'amf établit chaque année un rapport sur la base des informations fournies par les sociétés faisant appel public à l'épargne, relatives aux méthodes qu'elles appliquent pour organiser les travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et aux procédures de contrôle interne qu'elles ont mises en place. Comme l'avait très justement fait remarquer le rapporteur du projet de loi de sécurité financière de la commission des Lois, M. Philippe Houillon, « à travers cette disposition, c'est bien dans un rôle de magistère du gouvernement d'entreprise que le législateur entend consacrer l'amf et c'est là, outre la démarche consistant à donner au marché les instruments de juger de la réalité du gouvernement d'entreprise en France, le second élément innovant dans cet article. Il manque en effet à ce jour un référent fiable et stable de l'évolution réelle du gouvernement d'entreprise. Sans doute les différents rapports publiés sur ce sujet fournissent-ils un indicateur en la matière : en dépit des affirmations de leurs auteurs, le seul fait que trois rapports aient été publiés en sept ans révèle, en creux, les manques et faiblesses persistants. Le regard extérieur, mais informé, de l'amf introduit un nouvel élément dans une équation jusqu'alors tautologique, qui faisait des parties les juges de leur propre action, faute de l'intervention d'un tiers. » (18). Alors que cette nouvelle institution, née de la fusion de la commission des opérations de bourse (cob) et du Conseil des marchés financiers (cmf), vient de se mettre en place, la Mission ré
font-size: 10pt">2. Les auxiliaires de fait : le rôle des actionnaires a) L'actionnaire, grand absent de la gouvernance à la française L'une des principales conclusions de la Mission est que l'actionnaire est le grand absent de la gouvernance à la française. L'actionnaire n'est pourtant pas un objet votant non identifiable mais une réalité importante du corps social. Ainsi, en mai 2002, la France comptait 10 millions d'actionnaires, d'après une enquête réalisée pour le compte de la Banque de France et Euronext. Pour ces particuliers, la durée moyenne de détention des titres est en moyenne de trois ans et demi, contre un an et demi pour les institutionnels français et six mois pour les fonds anglo-saxons. Ce sont au total 22 % des Français âgés de plus de quinze ans qui détiennent des actions ; aux États-Unis, 50 % des ménages sont actionnaires. De tous les dirigeants auditionnés, c'est M. Jean Peyrelevade qui a le plus vivement dénoncé l'insuffisante prise en compte de l'actionnaire dans le système français : « je considère que, pour l'instant, beaucoup de faux pouvoirs, de pouvoirs formels, sont donnés à l'assemblée générale et que l'on évite de traiter des problèmes de fond. L'assemblée générale, qui réunit physiquement les actionnaires, généralement des petits porteurs dont le pouvoir est nul, fournit l'occasion de manifestations médiatiques pseudo-démocratiques. Elle permet certes de faire émerger des problèmes sous-jacents parfois, mais reste imprégnée d'un formalisme inutile, parce que le pouvoir n'est pas là. » À force d'opposer le droit des sociétés et la gouvernance à l'anglo-saxonne, tournés vers la seule maximisation du profit de l'actionnaire (culte de la sharehoder value) et un système français où l'entreprise est conçue comme une entité associant actionnaires, salariés, management, contrôleurs et fournisseurs (banques, par exemple), les évolutions réelles du capitalisme à la française ont été oubliées. Opposer à l'envi le capitalisme européen, « équilibré » pour reprendre le terme utilisé par le rapport de l'Institut Montaigne, au modèle américain de capitalisme actionnarial a, dans une certaine mesure, conduit non seulement les dirigeants, mais également la doctrine, à considérer l'actionnaire comme un acteur de second rang dans l'entreprise. Selon les tenants de cette dichotomie, « l'actionnaire n'existe pas : c'est au mieux un mythe, au pire une illusion. Il est donc vain de faire de son intérêt le critère exclusif de jugement et de comportement des organes sociaux et tout aussi vain de vouloir le placer en clé de voûte du gouvernement d'entreprise. (...) Tous les mêmes administrateurs ont les mêmes intérêts à défendre, ou plutôt, le même intérêt, l'intérêt général de l'entreprise. » (20) Il n'est pas certain que les dirigeants sociaux français aient pris conscience de cette conséquence de l'évolution de l'actionnariat français. Il est, en effet, frappant de constater à quel point l'assemblée générale est absente des rapports Viénot et Bouton, ainsi que de la synthèse qui en a été faite récemment : l'essentiel de la réflexion tourne autour de l'organisation du conseil d'administration. De manière révélatrice, l'actionnaire n'y est envisagé que comme un personnage passif, un réceptacle d'informations auquel sont octroyés des droits, et jamais comme un partenaire doté d'une marge d'initiative. Certes, il est rappelé, à juste titre, que les actionnaires sont titulaires d'un certain nombre de droits légaux, mais la réalité de l'exercice de ces droits, comme leur pratique, sont totalement omises. Chacun sait pourtant que la multiplicité des informations données aux actionnaires n'est pas toujours synonyme de pertinence et de clarté ; à cet égard, il est frappant de constater combien la loi est précise et détaillée s'agissant des pouvoirs des actionnaires, alors qu'elle est très souple et laisse de larges marges d'interprétation dès lors que sont abordés les pouvoirs des dirigeants. Légiférer pour définir précisément, donc pour encadrer, le pouvoir des actionnaires reste considéré comme normal ; légiférer pour encadrer celui du conseil serait contre-productif... b) Placer l'actionnaire au cœur de la gouvernance Faire jouer tout son rôle à l'assemblée générale : le débat n'est pas nouveau, mais la question revient systématiquement en cas de crise. L'entreprise n'est pas une démocratie : l'assemblée générale est là pour donner sa légitimité aux instances de direction, en tant qu'elle rassemble les propriétaires de l'entreprise, mais ce n'est pas elle qui décide des orientations. De ce point de vue, le fonctionnement de l'entreprise s'apparente davantage à un système de monarchie constitutionnelle. À bien des égards, la capacité d'intervention de l'assemblée générale se situe ex post, dans la mise en jeu de la responsabilité civile et pénale des mandataires. Reste qu'en amont, son rôle reste à développer, dans le respect des missions dévolues à chacun des organes de la société. · En conséquence, la principale conclusion de la Mission sur la gouvern
style="text-align: justify">Si placer de l'argent en bourse comporte des risques pour l'actionnaire, ce risque ne doit pas être aggravé par la qualité insuffisante des dispositifs de contrôle mis en œuvre dans les sociétés. La Mission a cependant exclu le principe d'une représentation des petits actionnaires au conseil d'administration. En apparence séduisante dans la mesure où elle pourrait permettre de réconcilier les intérêts du conseil d'administration et ceux de l'assemblée générale, cette piste est porteuse de conséquences négatives pour les actionnaires eux-mêmes, sans améliorer pour autant le fonctionnement du conseil d'administration. Cette « fausse bonne idée » conduirait inéluctablement à une confusion des pouvoirs de direction et de contrôle et serait à ce titre préjudiciable aux actionnaires eux-mêmes, qui ne sont d'ailleurs pas demandeurs d'une telle formule. En revanche, la Mission se prononce en faveur d'un rôle actif de l'actionnaire sur la question des rémunérations. Elle propose ainsi que le commissaire aux comptes certifie la sincérité des informations relatives aux rémunérations individuelles dans toutes leurs composantes, avec présentation dans les comptes annuels soumis au vote de l'assemblée générale dans le cadre de l'article L. 225-100 du code de commerce (proposition n° 1). La Mission n'a pas choisi de reconnaître à l'assemblée générale le droit d'émettre un vote consultatif spécifique sur les rémunérations. Cette proposition, qui est la seule alternative évoquée devant la Mission, stigmatiserait les chefs d'entreprise et risquerait de les conduire à prendre des décisions de délocalisation, évidemment contraires à l'intérêt national. D'aucuns objecteront que la très libérale Grande-Bretagne dispose d'une réglementation obligeant les principaux groupes cotés à Londres à demander l'avis de leurs actionnaires sur la rémunération des dirigeants et qu'elle examine aujourd'hui la pertinence d'une nouvelle intervention du législateur sur le sujet. Aux termes de cette consultation menée sous l'égide du ministère du commerce et de l'industrie, l'objet de la législation serait de permettre aux actionnaires « d'avoir un regard critique, non seulement sur la rémunération des dirigeants mais sur la politique de rémunération de l'entreprise et sur le lien entre rémunération et performance. Au fur et à mesure, nous pensons que la combinaison entre amélioration de la transparence et accroissement de l'activisme permettra de faire en sorte que la rémunération des dirigeants sera plus efficacement reliée à la performance de l'entreprise. Nous pensons également cependant que les actionnaires ont raison de faire part de leurs préoccupations concernant les cas dans lesquels les dirigeants quittent des entreprises en mauvaise situation avec de fortes indemnités. Les " récompenses pour l'échec " attribuées à une petite minorité atteignent l'image et la réputation de l'ensemble du monde des affaires britannique. ». D'ores et déjà, le directeur général du groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline s'est vu refuser par 50,72 % d'actionnaires une révisi
serait-ce que du seul fait d'une presse dont la grille de lecture reste malheureusement trop marquée par des concepts vieux de deux siècles, tels que celui de la lutte des classes. En deuxième lieu, il n'est pas certain, d'un point de vue juridique, que les actionnaires eux-mêmes aient intérêt à une telle mesure : alors même que leur vote ne serait que consultatif, ne seraient-ils pas liés, pour l'avenir, par la seule existence d'un vote, dans l'hypothèse, par exemple, où ils souhaiteraient mettre en cause la rémunération d'un dirigeant sur le fondement de l'incrimination d'abus de bien social ? Enfin, s'agissant par exemple des indemnités d'embauche ou d'arrivée, ou de tout autre élément de la rémunération faisant l'objet d'une convention réglementée régie par l'article L. 225-38, les actionnaires ont d'ores et déjà le pouvoir d'agir en votant contre celle-ci, ce qui entraîne sa nullité de droit. · Valoriser le rôle de l'actionnaire ne signifie pas seulement lui donner de nouveaux pouvoirs : cela implique également qu'il remplisse mieux ses devoirs. Notamment, les investisseurs institutionnels doivent pleinement assumer leur rôle d'actionnaire. Dans la mesure où il n'existe pas de fonds de pension français, notre pays est resté très en retrait sur la réflexion relative à l'implication de cette catégorie d'investisseurs. Or, dans les pays anglo-saxons, ceux-ci sont soumis à des obligations très strictes : aux États-Unis par exemple, la législation sur les fonds de retraites, éclairée par une circulaire du département du Travail en 1994, fait du vote en assemblée générale un élément de la responsabilité fiduciaire du gestionnaire de fonds et lui impose d'intervenir lorsque son action peut raisonnablement accroître la valeur de l'investissement. Par ailleurs, certains investisseurs institutionnels et fonds de pension édictent des codes d'éthique. Ainsi, au Royaume-Uni, l'association nationale des fonds de pension recommande à ses membres de s'abstenir de voter dès lors qu'elle estime que les critères de performance justifiant l'attribution de stock options sont opaques. Dans le même ordre d'idées, et pour en revenir aux rémunérations, cette même association britannique a publié une déclaration précisant que « les conseils d'administration devraient calculer le coût potentiel de résiliation du contrat en termes financiers. Ce calcul doit couvrir l'ensemble des éléments liés au licenciement », déclaration qui s'accompagne d'un guide sur les contrats et les pensions, sources de frais souvent élevés pour les actionnaires. La France s'est, depuis peu, dotée de règles touchant les investisseurs institutionnels : ainsi, en vertu de l'article 66 de la loi de sécurité financière, les règles de bonne conduite édictées par le régulateur des marchés financiers doivent obliger les sociétés de gestion de portefeuille à exercer leurs droits de vote et, sinon, à s'en expliquer. À l'instar de ce qui se pratique dans les fonds d'investissements britanniques, il serait souhaitable que des principes précis soient édictés concernant la politique de vote, tant au regard des rémunérations que de la politique d'attribution de stocks-options ou de la composition du conseil d'administration,
À la transparence, nous adjoignons donc son indispensable corollaire : la responsabilité. A. LA TRANSPARENCE, TOUTE LA TRANSPARENCE Depuis Enron, il est acquis que la transparence ne pouvait être ni un slogan ni une façade. Cela ne signifie pas toute l'information pour tout le monde, cela veut dire la diffusion d'une information hiérarchisée et pertinente pour l'actionnaire individuel, brute et massive pour les investisseurs institutionnels, sincère dans tous les cas de figure. Qu'est-ce que la transparence ? Une définition du professeur Marie-Anne Frison-Roche Le deuxième cœur du droit des sociétés aujourd'hui, en effet, c'est l'information, que l'on appelle « transparence » dans le cadre des marchés financiers. Il faut élaborer des mécanismes permettant de faire en sorte que ceux qui savent, donc les dirigeants, utilisent leurs pouvoirs au profit des actionnaires, c'est-à-dire délivrent une information bien construite, complète et à temps. L'information étant au cœur des principes directeurs du droit des sociétés, il faut également s'interroger sur l'objet de l'information délivrée. L'information est faite, d'une part, pour que ceux qui prennent les décisions les prennent de la façon la plus éclairée possible et, d'autre part, pour que ceux qui sont titulaires du pouvoir de contrôle puissent l'exercer. L'obligation d'information ne saurait, dans ce conditions, se limiter à la communication d'éléments d'information : il s'agit également de rendre compréhensible ce qu'on a communiqué. Or, dans le droit des sociétés classique, cette obligation est assez faible. Il importe par conséquent d'instaurer une obligation, pour les dirigeants, de motiver leurs décisions : les personnes qui ont le pouvoir doivent l'exercer mais doivent également dire pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Ce mécanisme de motivation rendrait compréhensibles leurs décisions. Il ne s'agit donc pas ici de prôner une transparence absolue : en matière financière, trop de transparence tue la transparence et l'impératif de transparence « ne saurait être une nouvelle dictature. Les marchés ont besoin d'une information honnête, pas d'une information totale » (21). Telle est la grande leçon d'Enron : le premier âge de la gouvernance a été trop souvent celui d'une confusion entre éthique et esthétique (22). Sur le papier glacé destiné aux actionnaires, tout était là : des chiffres multiples, des comités spécialisés nombreux, de grands principes de gouvernance. Manquait « simplement », dans les cas qui ont ébranlé la confiance, le sens de l'éthique, cette syntaxe des organes de la gouvernance. 1. Dynamiser et responsabiliser le conseil d'administration 23) ? Cette proposition fait d'ailleurs écho à celle que propose l'Institut Montaigne, selon lequel « une avancée significative pourrait être réalisée en obligeant les sociétés à doter leur Conseil d'administration d'un règlement intérieur adapté (pratique existante mais non généralisée) ». L'annexion du règlement intérieur au rapport annuel complèterait utilement le rapport du Président instauré par l'article 117 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003. En effet, il est désormais fait obligation au président du conseil d'administration de rendre compte dans un rapport joint au rapport annuel « des conditions de préparation et d'organisation des travaux, des procédures de contrôle interne mises en place par la société et des éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ». Certains commentateurs se sont interrogés sur les conditions d'application exactes de cet article 117 de la loi de sécurité financière. Dans le schéma que nous proposons, le règlement intérieur décrirait précisément certes, mais in abstracto, les différents éléments que nous venons de mentionner, tandis que le rapport du président instauré par cet article 117 expliquerait comment ils ont été mis en œuvre in concreto. Nous sommes persuadés que cette double base permettrait d'engager un dialogue constructif entre le conseil et les actionnaires. De fait, comment imaginer qu'une structure aussi complexe que l'entreprise fonctionne sans ce document, qui n'est rien d'autre qu'une charte définissant les fonctions, droits et devoirs de chacun et évite l'arbitraire d'un pouvoir autocratique ? Cela ne signifie pas que la Mission impose aux entreprises de se doter d'un tel outil de travail : aux actionnaires d'en tirer les conséquences en termes de crédibilité de la gouvernance, quand une société refuse de se doter d'un règlement intérieur. La rédaction d'un règlement intérieur du conseil d'administration est une pratique fréquente dans les pays anglo-saxons alors qu'elle reste trop rare en France. Cette spécificité tient largement au fait que disposer d'un tel document revient à encadrer le pouvoir du président. L'intérêt de ce document est de préciser, noir sur blanc, notamment les règles de composition et de fonctionnement des comités spécialisés. Sans doute des règles existent-elles déjà, même si elles ne sont pas écrites. Mais préciser que le président ne peut pas assister ni aux délibérations ni à la décision du comité des rémunérations sur sa rémunération éviterait certaines tentations. Pour l'heure, quand un président devra rendre compte à l'assemblée du fonctionnement du conseil, l'exercice n'est guère encadré. Si le règlement intérieur existait et était publi&eacu
160;cac 40. Il ne semble pourtant pas qu'il s'agisse de la solution miracle. L'existence formelle de ce comité ne garantit pas sur le fond une meilleure transparence dans la détermination des critères définissant les principaux éléments de la rémunération. On peut même parfois avoir le sentiment que l'institution d'un tel comité a quelquefois représenté un moyen pratique de traiter de cette question taboue en comité plus restreint encore que ne l'est le conseil d'administration. De même, l'utilité des comités des nominations est contestable s'ils sont composés d'administrateurs croisés. Pour avoir le sentiment que les comités ont pu être un « faux nez » de la bonne gouvernance, la Mission ne les érige donc pas en « label qualifiant ». Pour autant, dès lors qu'ils existent, il est souhaitable qu'ils fonctionnent sur la base de principes transparents. À ce titre : - il n'est pas souhaitable qu'ils comportent des administrateurs croisés ou circulaires (24) ; - le président du conseil doit s'abstenir de participer aux séances du comité des rémunérations ; - en aucun cas par conséquent, le comité ne devrait être conçu comme un prétexte de défausse par les administrateurs. L'idée n'est pas de traiter en petit comité un sujet tabou - les rémunérations - ou délicat - les nominations d'administrateurs ou les plans de succession : une telle approche conduirait à atteindre le but inverse de celui recherché par la théorie de la gouvernance puisqu'elle reviendrait à faire traiter dans l'opacité d'un comité de trois personnes, sans existence légale rappelons-le, un sujet d'importance majeure, sur lequel le conseil d'administration, sous prétexte de l'existence d'un organe spécialisé en la matière, ne débattrait même pas. Dès lors qu'un règlement intérieur est instauré, la Mission estime en outre nécessaire qu'il inclue une sorte de charte de l'administrateur, dans laquelle figurerait notamment le principe de la transparence totale des opérations réalisées par les banques représentées au conseil et des mandats qui leur sont confiés par celui-ci (proposition n° 6). Cette proposition fait écho aux recommandations d'Aldo Cardoso, président d'Andersen Worldwide, qui prône la mise en place d'une déclaration de conflits d'intérêts par l'administrateur, avec abstention de participation à la délibération ou au moins au vote lorsqu'un tel risque se présente. De fait, pour résoudre les conflits d'intérêts potentiels au sein du conseil, l'approche pertinente se situe, non en termes d'indépendance, mais de conflit d'intérêts, à l'instar de la démarche adoptée par le Deutsche Kodex (25) publié en septembre 2002. Ce document précise que : « Les membres du conseil d'administration ont obligation d'agir dans l'intérêt de la société. Aucun membre du conseil d'
d'administration plus resserré : la Mission propose ainsi de limiter le nombre de ses membres à quatorze (proposition n° 8). La prise de parole s'en trouvera facilitée et la nomination des administrateurs recentrée sur le seul critère de la compétence. · Le débat anglo-saxon sur l'administrateur indépendant correspond au débat français sur la diversification de la composition du conseil d'administration et des comités créés en son sein. Il pose une vraie question, sous la mauvaise forme : comment garantir que le conseil sera composé d'administrateurs suffisamment compétents pour diriger l'entreprise avec le président et suffisamment courageux pour contrôler ce dernier ? Pour reprendre les mots de M. Daniel Bouton, « existe-t-il des règles, une alchimie particulière qui garantisse la meilleure composition possible d'un conseil d'administration ? » Que nul ne s'y trompe : l'idéal n'existe pas en la matière. Reste que quelques principes peuvent être néanmoins posés. Ainsi, en France, ces questions conduisent immédiatement à se pencher sur la question des administrateurs croisés - M. X est administrateur du conseil d'administration de la société de M. Y, lui-même membre du conseil de la société de M. X - et circulaires (26) - M. X est administrateur dans la société de M. Y et dans celle de M. Z et M. Y est administrateur dans la société de M. Z, où il retrouve M. X... . Il serait intéressant d'ailleurs que les organisations patronales réfléchissent sur cette notion d' « administrateur circulaire », qui devrait, à l'avenir, constituer un label aussi disqualifiant que celui d'administrateur croisé. On le voit, la question de la composition du conseil pose encore et toujours la question de la grande concentration des postes d'administrateurs en France. Pour surmonter l'impossibilité de définir l'indépendance, la Mission propose que, d'une part, les modalités de fonctionnement du comité des nominations, qui ne doit pas être présidé par le président du conseil, figurent dans le règlement intérieur ; d'autre part, le conseil d'administration consacre une séance spécifique au choix de tout nouvel administrateur à proposer à l'assemblée générale (proposition n° 9). Cette proposition est, par ailleurs, également de nature à résoudre, plus en amont encore, la question des conflits d'intérêts potentiels évoquée ci-dessus. 2. Le test : les rémunérations L'emballement mondial des rémunérations fut à la fois le symbole et le symptôme de la crise. La manière dont cette question sera désormais envisagée par les chefs d'entreprise sera donc un test. a) Vous avez dit transparence ? La loi
). Au-delà de sa dimension polémique et médiatique, la controverse sur les rémunérations des dirigeants sociaux intéresse la Mission surtout en ce qu'elle révèle les limites des codes de bonne gouvernance. Elle est symptomatique de l'approche largement formaliste du gouvernement d'entreprise qui a prévalu au cours des dernières années : il ne suffit pas de mettre en place un comité des rémunérations ; encore faut-il que, sur le fond, la politique de rémunération dans la société soit cohérente. Pour le dire autrement, les pratiques de bonne gouvernance doivent être autre chose que des mots sur les notices d'information en papier glacé destinées aux actionnaires et au grand public. La controverse sur les rémunérations des dirigeants sociaux montre toutefois que cette réforme, qui est venue bouleverser la culture française, doit s'accompagner de pédagogie : il ne suffit pas de jeter en pâture des rémunérations, généralement élevées ; encore faut-il expliquer ce qu'est la rémunération d'un dirigeant social dans une société où le modèle dominant est le salariat ou le traitement. Le but n'est pas, en effet, de vilipender le fait que les dirigeants de grandes entreprises touchent des rémunérations élevées mais de pointer les dysfonctionnements, c'est-à-dire les écarts entre rémunération et résultat. Le tableau qui suit illustre la complexité de la rémunération d'un dirigeant social, qui comprend théoriquement six niveaux. Là où le salarié n'est rémunéré qu'avec un étage (salaire) ou deux (intéressement) et, plus rarement, trois dans les entreprises où existent des systèmes de participation, de multiples éléments entrent en compte dans la détermination de la rémunération d'un dirigeant de société. Le salaire de base rémunère, en quelque sorte, sa compétence « théorique » c'est-à-dire celle qu'il est réputé avoir à partir de ses expériences professionnelles antérieures ; le bonus est fondé sur sa capacité à atteindre les objectifs annuels, qui peuvent être fort divers ; d'autres éléments servent à rémunérer la performance de l'entreprise à moyen terme ; quant à la spécificité des régimes de retraite et des indemnités de départ, elle reflète largement la précarité de la fonction, le dirigeant étant révocable ad nutum.
Les principaux étages de la structure de rémunération des dirigeants Indemnités de départ Préjudice / perte d'emploi Retraite Rémunération différée Variable long terme Création de valeur durable Variable moyen terme Performance de l'entreprise sur un horizon de 3 / 4 ans Variable court terme Performance annuelle Salaire de base Compétences Source : Ernst & Young Law Toutes les composantes théoriques de la rémunération sont, peu ou prou, prises en compte de la même façon d'un pays à l'autre, comme le montre le tableau suivant.
Les structures de rémunération des dirigeants : comparaison internationale Éléments États-Unis Royaume-Uni Allemagne France Indemnités de départ Golden parachute Golden parachute Golden parachute Golden parachute Retraite Prestations définies Prestations définies Prestations définies Prestations définies Variable long terme Stock options Stock options Stock options Stock options Variable moyen terme Actions gratuites Stock options, Stock options Variable court terme Bonus en numéraire Bonus en numéraire Bonus en numéraire Bonus en numéraire Salaire de base Salaire fixe Salaire fixe Salaire fixe Salaire fixe (1) Stock Appreciation Rights (SARs), qui permettent de recevoir en année n + 3 ou n + 4 une somme en cash égale à l'augmentation de la valeur de l'action sous-jacente en année n. La seule différence notoire concerne la prise en compte de la performance de l'entreprise à moyen terme : si la France l'ignore, les autres pays la rémunèrent par divers mécanismes. b) L'envolée des rémunérations : les dirigeants français, « fattest cats » européens ? Précisons d'emblée que le débat sur les rémunérations n'a rien de franco-français : c'est à dessein que nous nous référons d'ailleurs à l'expression britannique de fat cats, terme maintenant consacré dans les milieux financiers anglo-saxons pour désigner les dirigeants sociaux bénéficiant de salaires particulièrement élevés. Le phénomène est d'ailleurs intéressant en ce qu'il s'agit d'une véritable mondialisation de la contestation : États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse et France, l'exaspération des actionnaires en particulier, de l'opinion publique en général, est tangible. Il faut également ajouter que c'est aux États-Unis que les dérives ont été les plus saisissantes : en dix ans, le salaire moyen du pdg américain est passé de 85 fois le salaire moyen d'un salarié à 500 fois en 2000 ! Pour en revenir aux termes nationaux du débat, les dirigeants français sont-ils les fattest cats en Europe, tels que les a stigmatisés le Financial Times le 23 juin 2003, en rappelant que les dirigeants français étaient les mieux payés d'Europe ? Afin de bien poser les termes du débat, il convient d'en rappeler le contexte général : sur les trois années 2000, 2001 et 2002, 7,1 millions d'actionnaires individuels français ont assisté à l'effondrement de près de 65 % de la valeur moyenne de leurs actions (29). En termes de résultats des principales entreprises françaises, ce sont quelque 20,1 milliards d'euros de pertes qui ont été réalisés en 2002, contre un bénéfice de 1,32 milliard d'euros un an plus tôt. Dans le même temps, les dirigeants des sociétés du cac 40 ont vu leurs émoluments augmenter en moyenne de 36 % en 2000, de 20 % en 2001 et de 13 % en 2002. Selon le journal des finances, le salaire moyen des dirigeants de ces quarante sociétés s'élevait à 2,07 millions d'euros à la fin de l'année 2002. Telles sont également les conclusions de l'institut bruxellois European Corporate Governance Institute, qui estime la rémunération moyenne des dirigeants du cac 40, hors stock options, à 1,84 million d'euros en 2001, contre 1,54 pour les Britanniques, 1,37 millions pour les Néerlandais et un million pour les It
Frappe d'emblée l'imprécision des chiffres existants en la matière. Comment ne pas y voir un fait révélateur des progrès qui restent à faire en termes de transparence ? À cet égard, il est éminemment regrettable que, comme le note le rapport Proxinvest de 2002, 62 % des sociétés du sbf 120 ne communiquent pas la rémunération variable de leurs dirigeants et que 58 % restent muettes sur celle de leur président. Par ailleurs, ni la politique - la philosophie même - des rémunérations pratiquées dans la société ni les critères de fixation du variable ne sont explicités dans la très grande majorité des cas, ce qui nuit également à la clarté des chiffres publiés. Ce flou artistique n'est plus acceptable. C'est pourquoi la Mission propose que l'amf, à l'instar du régulateur américain, édicte un formulaire précis sur les normes de présentation des rémunérations (proposition n° 14) et qu'elle mette en ligne sur son site des tableaux à jour sur les rémunérations des dirigeants de sociétés du sbf 120 avec, en regard, les résultats des années n-1 (pour apprécier l'importance du bonus) et n (proposition n° 15). Le choix du sbf 120 est destiné à permettre des comparaisons internationales plus fiables, le cac 40 étant un échantillon trop restreint par comparaison avec les indices de référence des autres places boursières. Si elles sont imprécises, les données chiffrées en matière de rémunération s'inscrivent toutefois dans la même fourchette, autour de deux millions d'euros annuels pour les dirigeants des sociétés du cac 40, résultat qui place effectivement les dirigeants français dans le peloton de tête, voire au premier rang, des rémunérations patronales européennes. La rémunération des dirigeants sociaux ne doit pas être en elle-même un sujet de contestation : la stabilité du capital a disparu et, dans un contexte de fusion et d'acquisitions permanentes, les dirigeants doivent être à la fois des défenseurs et des attaquants. C'est volontairement que nous employons cette métaphore, dans la mesure où nul ne s'émeut qu'un sportif de haut niveau reçoive de fortes rémunérations. La fragilité des postes est donc réelle : un président de société dont le mandat dure plus de cinq ans est désormais un profil rare. Par ce rappel, la Mission tient à s'inscrire en faux contre tous les discours démagogiques dans un domaine qui s'y prête pourtant : il n'est pas question de favoriser les relents du poujadisme comme de la lutte des classes que certains sont parfois prompts à ranimer. Ainsi en est-il de cette approche extrêmement démagogique qui consiste à rapporter la rémunération d'un grand patron au salaire minimum légal. En revanche, la rapporter à la rémunération moyenne de l'entreprise a un sens microéconomique prouvé par des études sur la cohésion interne au sein de l'entreprise. Là où le bât blesse, c'est lorsque le dirigeant, alignant sa « durée de vie » professionnelle sur le temps d
société de consentir des prêts aux dirigeants et aux administrateurs) limite les risques de dérive - à l'inverse de la réglementation américaine » ; mais il ne plaide pas moins pour « un effort de transparence supplémentaire est, à cet égard, indispensable : prise en compte renforcée des objectifs de long terme de l'entreprise dans la rémunération des dirigeants et limitation des critères liés au cours de bourse ; communication détaillée dans le rapport annuel des critères et principes servant de base au calcul de la rémunération individuelle des dirigeants ». Il conclut ainsi que « les schémas de rémunération des dirigeants peuvent, et doivent, gagner encore en transparence vis-à-vis des actionnaires. » (32) On peut ainsi avoir le sentiment que, si les niveaux atteints par la rémunération des dirigeants sociaux sont déconnectés des risques qu'ils subissent à titre personnel, ils sont curieusement calculés en proportion des risques qu'ils font prendre à la société et, in fine, aux actionnaires. Le marché a certes sanctionné cette confusion entre le temps de bourse et le temps de la vie économique, qui a conduit à une destruction de valeur considérable : le marché des pdg a cessé de s'accroître démesurément avec l'éclatement de la bulle Internet. Reste que, par un effet de cliquet, les résultats sont là. Par ailleurs, si les chiffres précités suscitent des questions, c'est, au-delà des montants atteints, en raison de leur très rapide évolution. Ainsi, selon un cabinet de conseil en rémunérations auditionné par la mission, la rémunération brute des dirigeants-mandataires sociaux des grandes entreprises françaises a plus que doublé depuis sept ans. Les rémunérations totales ont progressé de 10 à 15 % par an au cours des derniers exercices selon l'institut français des administrateurs. (33) De même, la répartition entre les parts variable et brute a été bouleversée au cours des années récentes : d'après M. Thierry de Beyssac, « la partie variable annuelle, c'est-à-dire le bonus annuel des dirigeants, a effectivement augmenté, passant de 15 %-20 % de la rémunération fixe à 50 %, voire 100 %, ce qui est le cas partout en Europe ». « Je considère que les résultats actuels ne sont pas satisfaisants : les dirigeants des sociétés françaises cotées sont trop rémunérés ; contrairement à une idée reçue, il n'existe pas de marché international des dirigeants, mais seulement un marché national. La corrélation entre la qualité de la gestion et la rémunération me paraît peu établie » : ces mots de M. Jean Peyrelevade résument l'état d'esprit de la Mission à l'issue de deux mois d'auditions spécifiquement consacrées à la question spécifique des rémunérations. De même, la Mission souscrit pleinement aux propos de M. Ren&eacut
autorisés des rémunérations en hausse au cours des années récentes, qui les placent aujourd'hui au premier rang en Europe. La Mission reste très sceptique sur l'existence d'un tel marché à l'échelle internationale : convaincante pour les secteurs de pointe, cette théorie est discutable pour les autres cas. Qui plus est, en termes économiques, elle impliquerait, pour justifier l'importante augmentation des rémunérations des dirigeants français en dix ans, une très forte contraction du marché - c'est-à-dire une baisse sensible et brusque du nombre de pdg... - ou une très forte augmentation de leur productivité, ce dont les résultats globaux du cac 40 au cours des années récentes permettent de douter... La Mission a le sentiment que, non seulement la technique comparative à laquelle les sociétés recourent, notamment sur les conseils des sociétés de consultants en rémunération - ce benchmarking mis en avant par tous les dirigeants auditionnés par la Mission - n'a joué qu'à la hausse, mais, plus encore, que les critères choisis pour déterminer la part variable de la rémunération l'ont été davantage en vue de garantir un niveau minimal de rémunération que dans le but de refléter au plus juste la performance des dirigeants. Les dirigeants de sociétés « ont voulu mettre en place un jeu où ils gagnaient à tous les coups » (34). Ce constat sévère est fondé sur des pratiques précises, tenant tout d'abord au choix des critères de rémunération, ensuite à leur trop constante évolutivité. L'exemple caricatural en est sans doute le choix du critère de l'ebitda (35), qui augmente d'autant plus que le groupe s'agrandit. Que ce critère devienne celui du désendettement lorsque la conjoncture se retourne et l'on est tenté d'y voir, dans les deux cas, un choix « pousse-au-crime », non seulement susceptible de conduire à une destruction de valeur pour les actionnaires - en deux exercices, les 25 premières entreprises cotées ont détruit 100 milliards d'euros, en achetant au-dessus de leur valeur - mais également d'influer excessivement sur les choix stratégiques. La Mission a ainsi le sentiment que le mode de rémunération des dirigeants sociaux influence trop souvent la stratégie quand il devrait, à l'inverse, être la résultante de la pertinence de celle-ci. Qui plus est, la modification trop fréquente des critères de détermination de la partie variable semble être une pratique courante, alors qu'elle ne favorise ni les comportements éthiques, ni la transparence à l'égard des actionnaires. Reste à tirer les leçons de cette fuite en avant dont un Jean-Marie Messier n'est en définitive que la figure, minoritaire certes, mais emblématique. Limiter le débat à un oukase, par définition vain, du type « les patrons sont trop payés » est aussi infondé et contre-productif qu'inefficace. Infondé et contre-productif parce que ce serait jeter l'opprobre sur tous, là où il faut mettre fin aux excès ponctuels ; inefficace car c'est au contrat qu'il revient de fixer le niveau des rémunérations des dirigeants sociaux. Les politiqu
la publicité des rémunérations, de façon à ce que la transparence qu'il instaure soit réelle (proposition no 10). Ainsi, les rémunérations doivent être détaillées : partie fixe, critères de détermination et d'évolution de la partie variable, avantages en nature, plans de retraite, état des stock options et, le cas échéant, rappel de tout élément de rémunération inscrit dans des conventions réglementées. Le non-respect de ces dispositions sera sanctionné par la nullité desdites rémunérations. Par cette dernière précision, nous visons notamment les indemnités versées aux dirigeants à l'embauche et au départ, dont la Mission reconnaît l'efficacité, notamment pour des membres de comité exécutif compétents dans un secteur ultra concurrentiel ou en difficulté. Elles ne doivent cependant pas être excessivement déconnectées du salaire annuel. Plus encore, il est inacceptable que l'échec, qui diminue la valeur d'une entreprise et peut menacer le niveau de vie des employés, puisse avoir pour résultat le versement d'importantes rémunérations en faveur des dirigeants sur le départ. Les responsables sociaux, dont la rémunération est déjà fixée à un niveau prenant en compte les risques inhérents à leur fonction, devraient faire la preuve de leur légitimité à occuper une position dirigeante en alignant leurs intérêts financiers sur ceux des actionnaires. Sur ce point, les conseils d'administration, qui, en vertu de l'article L. 225-38 du code de commerce, autorisent au préalable les conventions dans lesquelles figurent généralement ces accords, doivent aussi prendre en considération les importants risques en terme de réputation qu'ils prennent, lorsque sont connues les importantes sommes qu'ils ont versées à des dirigeants défaillants. S'agissant des critères de détermination du variable, la Mission s'en remet, là encore, au contrat et en laisse la définition à l'entière appréciation des dirigeants sociaux. La détermination des critères de la rémunération variable : Dans la plupart des cas, la partie variable est liée au bénéfice de l'entreprise, ce qui est assez normal. Si je simplifie, le bénéfice de l'entreprise est constitué du résultat d'exploitation et d'éléments exceptionnels. Les éléments exceptionnels peuvent donner lieu, soit dans un sens, soit dans l'autre, à des conséquences aberrantes sur la rémunération du dirigeant. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une entreprise cède une année donnée un immeuble ou des participations précédemment sous-évalués, ce qui conduit l'entreprise à réaliser un profit important. Or, la qualité du chef d'entreprise n'y est pas pour grand-chose. De même, en cas de moins-values pour telle ou telle raison ne dépendant pas réellement de l'exploitation propre de l'année, la diminution de la rémunération du dirigeant qui en découle paraît peu justifiée. Aussi, de préférence au bénéfice net, certains comités de rémunération préfèrent retenir la marge opérationnelle ou le résultat d'exploitation qui constitue un agrégat défini plus en amont, mais plus signifiant de la marche réelle de l'entreprise dans l'année considérée. Si la seconde approche est plus juste, elle est plus difficile à comprendre. Personnellement, je suis plutôt favorable au fait d'asseoir la partie variable sur le résultat d'exploitation, mais il faut que, dans l'explicitation de la rémunération que l'on donne au moment du rapport annuel, cela soit bien expliqué afin d'éviter toute confusion. Elle souhaite néanmoins rappeler quelques principes : - ces critères doivent être aussi stables que possible, afin que le variable ne devienne pas de facto un fixe minimal, voire un fixe qui ne dit pas son nom ; - pour la même raison, mais aussi pour refléter au mieux la performance du dirigeant, ils doivent être multiples ; - le critère du cours de bourse est à éviter, comme l'ont d'ailleurs souhaité tous les dirigeants sociaux entendus par la mission d'information ; - le lien entre le fixe et le variable doit être raisonnable. Tous ces principes - indemnités de départ, critères du variable - pourraient utilement figurer dans les documents dans lesquels la société présente ses méthodes de gouvernance, au sein d'une partie qui serait consacrée à la « philosophie » des rémunérations dans la société. Celle-ci pourrait également aborder les principes suivis en matière de stock options. c) Les stock options : « face je gagne, pile tu perds » (Joseph Stiglitz)
de bourse, les principales accusations en matière de rémunérations portent effectivement sur les stock options. Les pratiques relatives aux stock options représentent en effet l'exemple type du dévoiement du système : elles ont conduit, pour les dirigeants, à la disparition de l'idée de risque pourtant inhérente au capitalisme, au moment même où ces risques étaient plus élevés que jamais pour les actionnaires. Comme le note le rapport de Proxinvest de 2002, ce dévoiement conduit purement et simplement à faire des stock options des « bonus contractuels indexés sur le prix de l'action ». De facto, s'attribuer des stock options en période de baisse des cours revient tout simplement à transformer un instrument initialement conçu pour rémunérer, sans certitude aucune, une performance future en un complément assuré de revenu sans lien, ni avec les erreurs du passé, ni même avec les performances à venir. Le système des stock options, en s'éloignant de manière inadmissible de sa philosophie initiale, a atteint ses limites. Celle-ci était pourtant saine, contrairement à ce que peut déclarer M. Jean-Marie Messier. Ainsi, l'usage des options sur titre est un héritage du mouvement de défense de la valeur actionnariale : comme l'explique Joseph Stiglitz, les investisseurs institutionnels américains avaient fait pression, dans les années 1980, pour que les dirigeants d'entreprises repensent leur gestion en fonction de la valeur pour l'actionnaire. Si l'on fait abstraction du court-termisme auquel cette approche a conduit, en elle-même, l'idée d'aligner la situation des dirigeants sur celle des actionnaires, en bref d'en faire des capitalistes soucieux des deniers de la société comme de leur propre patrimoine, est bonne. Les stock options restent un bon outil, dès lors qu'il est utilisé avec pertinence et modération. Dans le secteur des hautes technologies, il est certain qu'elles restent un outil indispensable aux politiques de recrutement et de fidélisation. Le problème vient de ce qu'en période d'euphorie boursière, la valorisation d'un titre a pu se trouver totalement déconnectée des performances propres des dirigeants... et qu'en période d'effondrement des cours, ces mêmes dirigeants n'ont généralement aucun mal à convaincre le comité des rémunérations qu'ils subissent le retournement du marché sans en être responsables et à obtenir une révision à la baisse du prix de leurs options. Fort heureusement, cette technique du repricing n'a pas cours en France. Se pratiquent, en revanche, les mécanismes de couverture mis en place par les banques pour les dirigeants, mécanismes qui, eux aussi, pervertissent la logique du système. De telles pratiques ne sont pas autre chose que ce que Joseph Stiglitz appelle avec justesse le dispositif classique du « face je gagne, pile tu perds ». Dans ces conditions, l'argument des défenseurs des stock options, selon lequel le système fonctionne dans les deux sens - 42 % des plans exerçables émis par les entreprises du cac 40 ne recelaient aucun gain à la fin de 2002 (37) - perd de sa pertinence et relève davantage du raisonnement théorique que de la réalité des pratiques. » De fait, c'est en France que la part des stock options dans la rémunération totale est la plus élevée en Europe et même par rapport aux États-Unis. La surpondération des stock options en France est particulièrement frappante : elle s'explique par le manque d'outil à moyen terme, les options ayant, en France, une double finalité, rémunérer la performance à moyen et à long terme. C'est donc essentiellement pour des raisons fiscales que les dirigeants français apprécient particulièrement cette méthode de rémunération, même si leur régime tend de plus en plus à être aligné sur le régime de droit commun. En moyenne, chaque dirigeant du cac 40 possédait pour 5 millions d'euros d'options en 2001, chiffre qui a baissé à 2,7 millions en 2002. Notons qu'il s'agit là d'une valorisation théorique, fondée sur la méthode Black-Scholes, qui ne dit, par exemple, rien des mécanismes de couverture utilisés par ces dirigeants. Cette gourmandise peut d'ailleurs faire sourire : ce sont généralement les mêmes qui vantent la gouvernance à la française en dénigrant un système américain uniquement fondé sur la création immédiate de valeur pour l'actionnaire (shareholder value) et qui défendent simultanément le système des stock options, précisément créé par les tenants de la shareholder value... Afin de remettre de l'ordre en matière de stock options, la Mission propose de modifier l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur la publicité des rémunérations, afin de rendre obligatoire la présentation, dans le rapport annuel, de la politique et des pratiques en matière de stock options et des conséquences de celles-ci pour les investisseurs (proposition n° 11). Cette proposition est complétée par celle prévoyant l'autorisation des plans de souscription à date fixe, prédéterminée par l'assemblée générale (proposition n° 12), afin d'éviter que certains dirigeants profitent de l'effondrement des cours, comme ce fut le cas en 2001 et 2002, pour acquérir des options qui ne peuvent qu'être valorisées. Dans le même esprit visant à réhabiliter la notion de risque financier pour l'administrateur dirigeant social, la Mission demande que l'amf veille avec une vigilance particulière à mettre en garde les entreprises contre une politique opportuniste de souscription des plans de stock options, qui doit être bannie en période d'effondrement des cours (proposition n° 13). Il est tout à fait regrettable que ce rappel éthique doive être fait : le fait qu'en 2002, 27 dirigeants du cac 40 aient bénéficié de stock options à un niveau comparable à 2001 le rend cependant nécessaire (38). 3. La transparence &agr
placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité doivent être titulaires d'une carte professionnelle lorsqu'elles exercent les fonctions d'analyste financier. Le responsable du contrôle d'investissement - que les prestataires de services d'investissement ont obligation de mettre en place et qui a la charge de contrôler le respect du règlement général du cmf - s'assure que la personne physique « présente l'honorabilité requise » et qu'elle « a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles ». Ajoutons que le responsable du contrôle peut vérifier, auprès du cmf, l'éventuelle existence de sanctions disciplinaires prises à l'encontre du candidat dans les cinq années écoulées. - dans son titre III, le règlement évoque également les règles de bonne conduite applicables aux prestataires habilités et à toutes les personnes agissant sous son autorité, ces règles constituant pour ceux-ci « une obligation professionnelle » (article 3-1-1, arrêté du 18 décembre 2000). Le règlement envisage également le cas de codes de bonnes conduites élaborés par une association professionnelle : ceux-ci sont soumis au cmf qui en vérifie la compatibilité avec les dispositions du règlement général et peut, après avis de l'association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, en recommander l'application à tous les prestataire habilités. - la bonne application des règles de bonne conduite est confiée à un responsable de la fonction déontologique, dénommé « déontologue », que tout prestataire de services d'investissement a l'obligation de désigner. Ce dernier a notamment pour charge d'établir un recueil des dispositions déontologiques à respecter, au nombre desquelles le règlement cite expressément les « procédures connues sous le nom de muraille de Chine », dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles. Elles prévoient notamment « l'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ». - en outre, le règlement interdit aux analystes financiers d'émettre, pour leur compte propre, des ordres sur instruments financiers s'ils « sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier », interdiction qui s'étend « à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter ». La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a repris certains éléments de ce règlement pour les inscrire dans le code monétaire et financier. Art. L. 544-3. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. » Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment : (...) 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 ; 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. Art. L. 621-9. - II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : (...) les personnes (...) produisant et diffusant des analyses financières. (...) Le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire.». Sans doute la loi de sécurité financière a-t-elle permis de grands progrès en la matière, d'autant plus notables qu'ils sont en avance sur les pratiques en vigueur chez nos voisins. Ainsi, le régulateur britannique, la Financial Services Authority (fsa), vient seulement de publier des principes qui, à maints égards, reprennent les principes fixés dans le règlement du cmf : obligation pour les banques publiant de la recherche sur les actions, obligations et produits dérivés d'élaborer et de révéler leurs politiques en matière de gestion des conflits d'intérêt, sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir du caractère « objectif » de la recherche ; non-participation des analystes aux road shows de sociétés que les banques sont sur le point d'introduire en Bourse, interdiction de lier la rémunération d'un analyste aux contrats d'affaires liant la banque à une société, interdiction pour les analystes d'effectuer des transactions sur des titres allant à l'encontre de leurs recommandations. Aux yeux de la Mission, le statut de l'analyste reste pourtant problématique, même après la loi de sécurité financière. La possibilité de conflits d'int&eac
pas intervenir faute de problème est donc paradoxal ! Une telle intervention nous paraît d'autant plus justifiée que la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (dite « directive abus de marché »), l'appelle elle-même de ses vœux : « les États membres s'assurent qu'il existe une réglementation appropriée pour garantir que les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche concernant des instruments financiers ou des émetteurs d'instruments financiers ou les personnes qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinés aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information. Ils portent cette réglementation à la connaissance de la Commission. » Sans doute l'amf, via la mission qui lui est dévolue par la loi de sécurité financière, est-elle appelée à garantir le bon fonctionnement de la profession. Mais la Mission estime que les enjeux en la matière sont de nature législative. C'est pourquoi elle propose de renforcer la loi de sécurité financière en inscrivant dans la loi le principe des « murailles de Chine », au sein des établissements bancaires, entre activités de placement et activités d'analyse financière (proposition n° 4). B. UNE RESPONSABILITÉ CLARIFIÉE La transparence unanimement prônée par les dirigeants sociaux entendus par la mission doit, pour contribuer à la restauration de la confiance, s'ancrer dans la responsabilité. Préférer le contrat à la loi, c'est aussi en accepter pleinement les conséquences en cas de violation de celui-ci. Or, durant ses travaux, la Mission a constaté trois failles majeures dans cet édifice complexe qu'est le système de responsabilité des dirigeants sociaux : - l'insuffisance notoire de la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, soit que leurs rémunérations ne permettent pas de sanctionner une contre-performance notoire, qui laisse l'entreprise dans une situation exsangue, soit qu'en cas de faute caractérisée, le dirigeant n'en subisse pas personnellement les conséquences financières ; - la très grande difficulté à mettre en cause la responsabilité civile d'un dirigeant social en cas de faute de gestion ; - l'excessive pénalisation de la responsabilité des dirigeants sociaux. Sur ce dernier point, tant la loi de sécurité financière du 1er août 2003 que la loi du 2 juillet 20
propriétaires d'une partie importante d'une société, ont, d'une part, une stratégie globale beaucoup plus prudente - sans être pour autant timorée comme le montrent d'illustres exemples français - et, d'autre part, une politique de rémunération modérée. Tel est le modèle vers lequel il faut tendre. Initialement conçues à cette fin, les stock options n'ont pas rempli leur rôle. Comme nous l'avons souligné précédemment, elles sont aujourd'hui utilisées comme un mécanisme hybride destiné à combler un vide dans la structure de rémunération des dirigeants sociaux, contraire à son objectif de garantie d'un alignement de la rémunération des cadres dirigeants sur l'intérêt à long terme des actionnaires. La fiscalité fournit un facteur d'explication à ce dévoiement du rôle des options. Ainsi, le régime fiscal français des stock options conduit les entreprises à mettre en place des plans dont les titres ne peuvent être levés avant quatre ans puisque, dans l'hypothèse d'une levée de cession avant quatre ans, c'est la fiscalité des salaires qui s'applique, ce qui suppose une imposition sur le taux marginal, aujourd'hui à 49,08 %, majorée des cotisations sociales. Au-delà de quatre ans, les taux spécifiques sont de 40 et 50 % (au-delà de 152 500 euros), avec une possibilité de garder les titres pendant deux ans, ce qui diminue les taux, qui s'établissent alors à 26 et 40 %. En conséquence, pour favoriser l'émergence d'un élément de moyen terme de la rémunération, il faudrait adopter des mesures fiscales spécifiques. Par exemple, à l'instar de l'annonce faite par Microsoft, il faut sérieusement étudier l'éventualité de mettre en place des mécanismes d'attribution d'actions gratuites qui présenteraient deux intérêts, comme l'ont rappelé devant la Mission les experts d'Ernst & Young Law : - mesurer la performance de l'entreprise sur une durée de trois à quatre ans, soit en valeur absolue, soit par rapport à un panier de concurrents ; - mettre en place un élément de rémunération déconnecté de l'augmentation du cours de bourse. Cette analyse rejoint les préoccupations de l'ancien président du comité d'éthique du medef, M. René Barbier de la Serre, qui a reconnu l'existence d'un « effet pervers des stock options » : « Ce système pourrait conduire certains dirigeants, mandataires sociaux, à faire prendre davantage de risques à l'entreprise et aux actionnaires qu'il ne conviendrait. Il pourrait y avoir une différenciation de mesure du risque entre le dirigeant particulièrement préoccupé par ses stock options et l'actionnaire qui garderait le souci de l'intérêt propre dans l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, nous recommandons de conduire une réflexion sur cette question. Quand il s'agit des dirigeants, ceux qui sont réellement responsables des décisions, il conviendrait probablement qu'une partie des stock options au moins puis
size: 10pt">2. La responsabilisation par la sanction L'actualité la plus récente conduit à s'interroger sur ce que doit être la responsabilité des dirigeants. Il ne s'agit pas là d'une réflexion spécifiquement française. Pour prendre l'exemple le plus emblématique, les États-Unis, traditionnellement très ouverts à la mise en cause de la responsabilité civile, semblent s'être tournés, avec Sarbanes Oxley, davantage vers la pénalisation, évolution dans laquelle il faut sans doute voir un « effet Enron » temporaire, ainsi qu'une réaction aux excès du système de class action. Les termes du débat sont différents en France, où l'enjeu, dans notre pays qui a développé une culture de la responsabilité pénale, est de rétablir un équilibre entre responsabilité pénale et responsabilité civile des dirigeants sociaux. En la matière, .la situation française se caractérise par un paradoxe : « il existe une contradiction entre la volonté proclamée de trouver des alternatives à la menace pesant sur les dirigeants sociaux et la réduction considérable en droit positif des hypothèses dans lesquelles leur responsabilité civile peut être engagée » (39). · Le droit positif français reconnaît à l'actionnaire deux dispositifs de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant social susceptibles de conduire à l'indemnisation du préjudice subi. En premier lieu, l'actionnaire peut, sur le fondement du régime général défini par l'article 1382 du code civil, demander réparation du préjudice subi devant les juridictions civiles. Hormis une brève allusion à l'article L. 225-252 du code de commerce - « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement » -, l'action individuelle visant à réparer le préjudice subi personnellement par un associé n'est en effet régie par aucun texte spécifique du droit des sociétés. La jurisprudence a toujours néanmoins admis, au moins en théorie, cette action sur le fondement de la responsabilité du droit commun pour faute. En second lieu, le droit des sociétés prévoit un dispositif spécifique de mise en cause de la responsabilité des dirigeants sociaux par la voie de l'action sociale ut singuli. Cette action consiste, pour un ou plusieurs actionnaires, à exercer une action au nom de la société contre les dirigeants : c'est une action qui vise à la réparation du préjudice social et c'est, par conséquent, à la société que sont alloués, le cas échéant, les dommages et intérêts, aux termes de l'article L. 225-252 du code de commerce. Ouverte dans tous les types de sociétés, l'action ut singuli peut être mise en œuvre, soit par l'actionnaire individuel, soit par plusieurs actionnaires groupés, dès lors qu'ils représentent une certaine fraction du capital social (5 % dans les sa, 10 % dans les sarl), soit par une association d'actionnaires r&
faire, elles doivent toutefois avoir été agréées à cette fin, les conditions de l'agrément ayant été définies par la loi de sécurité financière à six mois d'existence et, pendant cette même période, au rassemblement d'au moins deux cents membres cotisant individuellement. L'article L. 452-1 du code monétaire et financier qui définit ce régime précise en outre que leurs dirigeants doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence. · Dans les faits, la mise en cause de la responsabilité civile d'un dirigeant social s'apparente, pour l'actionnaire à un parcours du combattant. « En France, il est aujourd'hui difficile, en pratique, pour un actionnaire de mettre en cause la responsabilité des organes dirigeants : la demande d'enquête de la cob (article L. 621- 9 du code monétaire et financier) est peu utilisée en raison de l'absence d'information sur les suites éventuelles données par la cob, la preuve du préjudice subi reste difficile à apporter devant le tribunal de commerce, enfin le coût et la durée des procédures ainsi que la faiblesse des réparations généralement consenties limitent l'utilisation des procédures civiles et alimentent l'inflation des procédures pénales. » (41) Mme Colette Neuville, présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires (adam), auditionnée par la mission d'information, soulignait, lors d'un colloque organisé le 27 janvier dernier à l'Assemblée nationale, que « le défaut majeur de notre système est que l'on n'arrive pas à mettre en cause les responsabilités. En droit français, la notion de responsabilité est en principe très étendue, mais en fait, elle est nulle. Lorsqu'on engage une action pénale, cela fait beaucoup de bruit, mais l'instruction est longue, l'intérêt s'émousse jusqu'au procès, et la jurisprudence de la Cour de cassation considère de plus en plus que les fautes sont inséparables des fonctions. En outre, la procédure ne prévoit pas de réparations pour les actionnaires floués. Contrairement aux États-Unis, il n'y a pas en France d'instruction civile. » Ces difficultés proviennent notamment du fait que la jurisprudence a interprété les dispositions législatives de manière extrêmement restrictive. En premier lieu, la disposition de l'article L. 225-252 relative au préjudice personnel de l'actionnaire n'est, dans les faits, que très rarement appliquée. Comme l'a montré M. Philippe Houillon, rapporteur sur le projet de loi de sécurité financière (42), en pratique, l'action individuelle intentée en réparation du préjudice personnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil, auquel se réfère l'article L. 225-252 du code de commerce évoqué à l'article précédent, est soumise à de telles conditions de recevabilité qu'elle est peu attrayante aux yeux de l'actionnaire dont le patrimoine person
actions. Dans cette hypothèse, le juge considère en effet que l'actionnaire ne subit pas un préjudice spécial et que le préjudice financier n'est que le corollaire du préjudice subi par la société. L'indemnisation des actionnaires dans le cadre d'une faute de gestion : La Cour de cassation reconnaît certes le bien-fondé des prérogatives individuelles de contrôle de la gestion, en vue de reconstituer un patrimoine social appauvri par la gestion mais elle se refuse à faire droit aux actions individuelles en réparation du préjudice né de la dépréciation du patrimoine de l'actionnaire. À ses yeux en effet, ce préjudice, dans la mesure où il traduit une dévalorisation du capital consécutive aux infractions reprochées aux dirigeants, est de nature exclusivement social, et non subi par les demandeurs à titre individuel, comme l'a répété récemment la chambre criminelle en se prononçant dans le cadre d'un recours formé contre les juridictions pénales (43). Ce faisant, la chambre criminelle a rejoint la jurisprudence formée de longue date par la chambre commerciale qui, à plusieurs reprises, a estimé que « des fautes de gestion ayant contribué à une dépréciation d'une société (...) n'avaient engendré aucun préjudice à caractère personnel au détriment des actionnaires » (44). S'il est vrai que le préjudice subi par les actionnaires est indirect, il paraît toutefois difficile d'affirmer que ceux-ci, au-delà du préjudice social, ne subissent pas un préjudice qui leur est propre, ne serait-ce que « du seul fait du délai courant entre le jour de la décision dommageable et la réparation du dommage social » (45). Si l'on comprend aisément que l'opportunité de reconnaître un droit d'indemnisation propre aux actionnaires fasse débat, eu égard notamment aux dérives américaines en la matière, la thèse défendue par le juge, selon laquelle ce droit ne saurait être satisfait au motif que le préjudice social ne se double pas d'un préjudice propre pour l'actionnaire, n'est tenable que dans un raisonnement limité au droit des sociétés : dans ce cadre en effet, la société fait écran et le préjudice de l'actionnaire, sujet de droit civil, ne peut, de ce fait, être pris en compte. Il n'en reste pas moins qu'au regard du droit général de la responsabilité, outre le préjudice social direct, peut exister un préjudice distinct, subi personnellement par l'actionnaire. Pour ne citer qu'un seul cas, l'actionnaire dont le patrimoine personnel aura été amputé de moitié à la suite d'une dévalorisation des actifs de la société dans laquelle il possède des actions, à la suite d'une faute du dirigeant, subit un préjudice personnel lorsqu'il est, de ce fait, menacé de saisie sur ses biens propres. Pénalisation excessive du droit de la responsabilité sociale, complexité de la procédure visant à faire reconnaître la responsabilité civile d'un dirigeant... Cette situation a une double conséquence : - de manière justifiée, à cause de l'excessive pénalisation du droit des sociétés, le dirigeant d'entrepr
terme est ici entendu dans son sens large et non juridique - d'une telle mesure serait négatif. Certes, la class action américaine n'est sans doute pas le système que d'aucuns se plaisent à caricaturer. Ainsi, elle a été à l'origine de plusieurs réformes sociales d'envergure : l'arrêt Brown v. Board of Education rendu en 1954 par la Cour suprême des États-Unis, qui met fin au système de ségrégation scolaire, est le fruit d'une class action. La class action aux
Etats-unis Héritière du Bill of Peace anglais qui, dès le XVIIe siècle, permet aux requérants multiples, dès lors qu'ils sont unis par une plainte similaire, de présenter un recours commun, la class action est aujourd'hui régie, en droit américain, par l'article 23 de la Federal Rule of Civil Procedure de 1966. Elle se définit comme une action en justice intentée par une personne physique pour elle-même ainsi que pour les autres membres d'un groupe qu'elle définit elle-même. Cette procédure s'exerce dans six domaines privilégiés : le droit de la consommation, le droit de la concurrence, le droit boursier, la responsabilité des produits, la responsabilité civile et les droits civiques. Ce type d'action est soumis à l'existence de conditions préalables et à une procédure visant à en encadrer l'exercice afin d'éviter les abus. Première étape : la recevabilité préalable de la plainte par le juge. Ce dernier vérifie à ce stade que plusieurs conditions sont remplies : le juge contrôle tout d'abord que la class action est, en l'espèce, l'action la plus adaptée par rapport aux procédures de droit commun. Un des éléments d'appréciation en la matière concerne le nombre de victimes présumées : le groupe doit être nombreux ; il doit exister des questions de droit communes aux membres du groupe. Le juge contrôle également que le représentant est à même de représenter, et de bien représenter le groupe en question : le demandeur qui le représente doit établir qu'il va protéger les intérêts de l'ensemble du groupe et démontrer qu'il est capable de conduire l'action jusqu'à son terme, ou d'avoir des chances de la conduire à son terme. En pratique, le juge s'assure notamment que l'avocat qui porte la class action jouit de qualités professionnelles suffisantes et adaptées à ce type de procédure, dans la mesure où c'est à lui qu'incombe la charge de l'ensemble des frais engagés dans la procédure, dans le cadre d'un pacte de quota-litis. On notera qu'à ce stade, le juge ne se prononce pas sur le fond. Deuxième étape : si le recours est jugé recevable, le juge demande qu'un avis de notification soit envoyé à tous les membres du groupe. En cas d'impossibilité (il arrive souvent que l'ensemble des membres ne soient pas identifiés), il ordonne une notification dans les médias. Toute personne n'ayant pas signifié son refus d'être partie à la class action avant une certaine date est considérée comme acceptant d'être représentée (système de l'opt-out). Troisième étape (facultative) : il arrive souvent que le contentieux ne parvienne pas à terme, la plupart des cas faisant l'objet d'une transaction. Dans cette hypothèse, la transaction devra être approuvée par le tribunal qui fixera les frais et honoraires de l'avocat qui seront perçus sur les dommages et intérêts alloués au groupe.13,7 millions de dollars (hors procès cendent Corporation dont le règlement atteint 3,19 milliards de dollars) et, en 2001, à 16 millions de dollars. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont d'autant plus frappants que le Congrès américain a pris en 1995, sans succès, des mesures législatives pour tenter d'enrayer la dérive. Les risques de chantage ne sont pas loin, d'autant que l'annonce d'une class action contre une entreprise se traduit par une baisse soudaine et massive du cours de l'action de la société concernée, aggravant d'autant la dévalorisation du capital social. Sans compter que les spécificités procédurales qui la caractérisent, qui sont le gage de son efficacité, supposeraient le bouleversement de tout notre édifice juridique : la procédure de discovery notamment et, plus largement, le rôle reconnu aux cabinets d'avocats sont étrangers à notre système, voire à notre culture juridique. C'est enfin un système coûteux socialement : les frais engagés par les avocats sont énormes, sans compter les frais de justice et ceux mis à la charge des dirigeants fautifs. Le Québec, qui a introduit une procédure de recours collectif, prévoit un financement alternatif, via un fonds public : il est rien moins que certain que la société française soit prête à assumer le coût de ce type de préjudice... Pour autant, le « statu quo faute de mieux », peu ou prou partagé par presque tous les dirigeants entendus par la Mission n'a rien de satisfaisant, plus encore quand, même parmi les rangs des dirigeants, des voix s'élèvent pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur le sujet. Tel est le cas des membres de l'institut Montaigne, dont les conclusions sur ce point sont particulièrement novatrices et méritent d'être citées in extenso : « l'Institut Montaigne a débattu de la possibilité de rendre plus aisés les recours judiciaires ut singuli exercés par les actionnaires au nom de l'entreprise en permettant a posteriori la prise en charge par l'entreprise des frais de justice supportés par les actionnaires lorsque l'action a amené un bénéfice significatif pour l'entreprise, comme cela est pratiqué aux États-Unis. Ces mécanismes n'ont toutefois pas fait la preuve de leur efficacité. Une telle évolution risque de placer la relation entre le Conseil d'administration et l'Assemblée générale sur un plan conflictuel et pourrait conduire à une multiplication de recours contentieux néfastes à l'entreprise. Pour la même raison, l'Institut Montaigne considère que la mise en place en France d'une procédure équivalente à la class action américaine n'est pas souhaitable aujourd'hui. Il remarque cependant qu'un nombre croissant d'entreprises françaises cotées sur des marchés étrangers sont désormais exposées à ce risque. Cette question difficile dépasse les limites de l'exercice conduit dans le cadre du présent rapport et doit faire l'objet d'une réflexion approfondie sous l'égide des autorités de place et des pouvoirs publics. » Ce statu quo est d'autant moins envisageable que, même lorsque est reconnue la responsabilité du dirigeant, une autre jurisprudence de la Cour de cassation conduit à en reporter le poids sur la société. Mm
171; au lieu d'être considéré comme un complément ou un supplément, le patrimoine social est systématiquement sollicité pour indemniser les parties, en lieu et place du patrimoine personnel es dirigeants » (46). Cette interprétation est sans fondement : « en substituant le patrimoine de la société à celui des dirigeants plutôt qu'en l'y ajoutant pour désintéresser les victimes de leurs fautes, la raison première de l'admission de la responsabilité de la personne morale, qui doit être de donner aux tiers une garantie supplémentaire de ce qu'ils seront indemnisés, semble avoir été quelque peu perdue de vue. »(47) Une telle évolution est liée à la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faute détachable en droit commercial. Ses décisions récentes laissent penser qu'à défaut d'avoir disparu en droit, cette notion a disparu en fait : ainsi, même les fautes intentionnelles du dirigeant ne sont pas considérées comme des fautes détachables par le juge (48) ! Au total, « la faute détachable est une faute introuvable pour la cour de cassation. C'est là une jurisprudence qui va tout simplement contre la loi, à lire l'article L. 225-251 du code de commerce, qui dispose expressément au les dirigeants sont responsables de leurs faute de gestion, violations de la loi ou des statuts. » (49) · À l'heure où l'actionnariat individuel est appelé à se développer massivement, il n'y a de place ni pour les aveux d'impuissance ni pour le statu quo, surtout lorsqu'il est fondé sur une jurisprudence contra legem. C'est pour cette raison que, dès l'examen du projet de loi de sécurité financière, sur proposition de son rapporteur, M. Philippe Houillon, par ailleurs membre de la Mission, la commission des Lois, avait adopté un amendement tendant à modifier la rédaction de l'article L. 225-252 du code de commerce. Il s'agissait de préciser que l'action en responsabilité civile exercée par l'actionnaire individuel avait pour objet de réparer le préjudice propre qu'il avait subi en cas de faute de gestion, préjudice distinct du préjudice social éventuellement réparé dans le cadre de l'action ut singuli. Si M. Philippe Houillon, malgré l'opposition de la commission des Finances de l'Assemblée et celle du Gouvernement, avait réussi à convaincre la majorité de ses collègues, le Sénat avait, par la suite, supprimé cette disposition. La mission d'information sur la réforme du droit des sociétés se prononce à nouveau en faveur du renforcement du principe déjà inscrit dans la loi de la possibilité pour l'actionnaire de faire valoir l'existence d'un préjudice personnel distinct du préjudice social en cas de consécration de la responsabilité des dirigeants pour faute de gestion. Il s'agirait, pour ce faire, de modifier l'article L. 225-252 du code de commerce, ainsi que l'article L. 225
Ainsi, le fait même qu'aujourd'hui, le rôle, les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d'administration fassent l'objet d'un débat ouvert montre à quel point la France de la gouvernance des entreprises n'a, en 2003, plus rien à voir avec celle de l'avant-Viénot. De même, l'engouement médiatique sur la question des rémunérations n'est pas seulement un épiphénomène, mais bien le signe d'une évolution des mœurs sociales, aux deux sens du terme. Pour autant, il est des évolutions qu'il faut favoriser et accélérer, à l'heure où la confiance des Français dans leur entreprise est une nécessité aussi bien économique que sociale. Si nous croyons indéfectiblement à la liberté et au contrat comme mode de régulation de l'entreprise, nous croyons aussi à son indispensable corollaire, la transparence, et au principe de responsabilité qui la sanctionne. Tel est le sens des propositions de la mission. Que ces trois valeurs fondamentales viennent à manquer et le législateur fera à nouveau entendre sa voix. En tout état de cause, il n'y aura pas de rapport « Clément II », mais d'autres propositions de loi si des règles de gouvernance pertinentes ne s'ancrent pas dans le paysage capitaliste français. Le président Pascal Clément a rappelé, en préambule, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 145 du Règlement, « aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information... avant que n'ait été décidée sa publication ». Il a fait observer qu'il avait tenu, par courtoisie, à transmettre à chaque membre de la commission des Lois, avant même la réunion de ce jour, un premier document de travail pouvant servir de base à une discussion plus riche, avant de regretter que les informations contenues dans ce document aient été diffusées dans les médias, qui les avaient présentées de manière erronée comme les conclusions définitives de la Mission. Puis il a présenté les principales conclusions qu'il tirait de l'année de travail de la Mission. Même si, dans notre pays, le capitalisme repose sur des bases saines, la crise de confiance des actionnaires français est profonde. En dépit de l'absence de scandale financier dans l'Hexagone, la crise de confiance résulte notamment de méthodes de gouvernance inadaptées dont les effets ont amplifié la crise économique et boursière : politique laxiste de rémunérations, attributions de stock options dans des conditions contestables, méconnaissance des attentes des actionnaires en terme de clarté et de pertinence de l'information, comportement autocratique du management. Si les contrepouvoirs avaient fonctionné, nul doute que les signaux d'alarme auraient été tirés à temps, évitant des choix stratégiques aberrants et permettant de prendre conscience de la fragilité de la bulle boursière. Dès lors qu'est m
339;ur des problématiques de gouvernance des sociétés cotées. En effet, jusqu'à présent, les différents rapports de place réalisés sur la gouvernance, centrées surtout sur le conseil d'administration, n'ont pas développé de réflexions dignes de ce nom sur le rôle de l'actionnaire. Le système doit fonctionner à l'avenir sur trois piliers : la liberté, la transparence et la responsabilité. C'est ainsi que nous avons décliné des règles de transparence et de responsabilité dont la mise en œuvre nécessitera, dans la plupart des cas, des modifications de nature législative. S'agissant des règles de transparence, l'actionnaire ne peut remplir sa mission de contrôle que s'il est correctement informé. C'est le fondement de la recherche de la transparence, qui ne doit être ni un slogan, ni une fin en soi mais un préalable nécessaire au débat et une aide à la décision. C'est la raison pour laquelle la Mission propose, en premier lieu, de faire certifier par les commissaires aux comptes la sincérité des informations individuelles données en matière de rémunération, de sorte que l'assemblée générale des actionnaires, dans le cadre du vote qu'elle émet sur les comptes annuels, sera libre d'accepter ou de refuser de voter les comptes intégrant ces informations (proposition n° 1). Pour donner un sens à cette proposition nous souhaitons, en améliorant la qualité de l'information relative aux rémunérations, combler une insuffisance de la loi relative aux nouvelles régulations économiques - qui s'est contentée de prescrire une transparence sur le montant global des hautes rémunérations et qui a été largement contournée. Certains ont proposé une alternative en demandant que soit modifié le code de commerce pour obliger l'assemblée générale à émettre un vote spécifique sur les seules rémunérations des dirigeants sociaux ; la Mission n'a pas retenu cette suggestion, qui aurait eu pour effet de stigmatiser les dirigeants, déstabiliser le management des grandes entreprises, allonger les débats dans les assemblées générales sur un sujet, certes important, mais pas essentiel - le montant des stock options accordées ne dépasse que très rarement 3 % de la capitalisation -, au détriment de la présentation et des discussions sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Compte tenu de la sensibilité du capital des sociétés françaises cotées, détenues à 45 % par des intérêts anglo-saxons et à 35 % par quinze familles, le risque de délocalisation des patrimoines et des sièges sociaux est particulièrement élevé. Les rares dérapages qui ont eu lieu sur les rémunérations de certains dirigeants ne doivent pas justifier le départ de tous. La transparence renforcée s'avère la meilleure garantie d'une amélioration de la gouvernance des sociétés cotées françaises. C'est le sens de la proposition consistant à faire ressortir le lien entre performance et rémunération par une distinction des éléments de rémunération entre part fixe, part variable, avantages en nature, plans de retraite, golden hellos et golden parachutes (proposition
cours, comme ce fut le cas en 2001 et 2002, pour acquérir des options qui ne peuvent qu'être valorisées. Le but de cette transparence aura deux conséquences : valoriser le rôle de l'actionnaire et renforcer la responsabilité du conseil d'administration. S'agissant du renforcement de la responsabilité des différents acteurs du marché, une première série de mesures doit porter sur le conseil d'administration. Dès lors que les conseils sauront que des débats approfondis pourront survenir lors des assemblées générales, ils seront incités à mieux organiser leur travail et à être plus attentifs à la qualité du travail, à la compétence et à l'indépendance de leurs membres. À cette fin, nous proposons la publication du règlement intérieur du conseil d'administration dans le rapport annuel (proposition n° 5) et demandons la transparence totale des opérations réalisées par les banques représentées au conseil d'administration et des mandats qui leur sont confiés (proposition n° 6). En effet, dans la mesure où l'on ne peut interdire aux banques de participer aux conseils d'administration de leurs sociétés clientes, les entreprises ayant besoin de leur banque, il faut connaître les mandats conclus au profit des banques représentantes au Conseil. La recherche d'un travail de meilleure qualité nous conduit, par ailleurs, à proposer de limiter à quatorze le nombre maximum d'administrateurs, ce conseil resserré permettant une meilleure prise de parole (proposition n° 8). Parce qu'on peut craindre que le choix des membres du conseil d'administration soit systématiquement fait par le président, entériné par les autres membres du conseil et par l'assemblée générale, la recherche de la compétence et de l'indépendance nous a conduit à suggérer l'obligation pour le conseil de consacrer une séance spécifique à l'examen du projet de nomination de tout administrateur, hors de la présence du président, et le jour de leur désignation, ainsi que l'obligation pour les administrateurs pressentis d'être présents à l'assemblée générale qui les nomme (proposition n° 9). En matière de responsabilité, l'actionnaire français doit, en outre, pouvoir faire reconnaître le préjudice distinct qu'il subit en cas de faute de gestion du dirigeant. Actuellement, si une telle faute est démontrée à l'occasion d'une action initiée par un investisseur, les dommages et intérêts seront versés à l'entreprise. Il est donc proposé de rappeler la possibilité pour l'actionnaire de faire reconnaître par le juge civil, en cas de faute de gestion, l'existence d'un préjudice personnel, distinct du préjudice social, qui devra être réparé par les dirigeants fautifs (proposition n° 3). Il s'agit là d'une reprise de l'amendement que M. Philippe Houillon avait déposé lors de l'examen du projet loi de sécurité financière, amendement que l'Assemblée avait adopté, mais que le Sénat avait repoussé. La troisi
rémunérations des dirigeants de sociétés du SBF 120 (proposition n° 15). Afin d'apprécier la pertinence des différentes composantes de ces rémunérations, nous recommandons à l'amf de présenter, en regard de celles-ci, les résultats des années n-1 et n. La Mission demande également à l'amf de veiller à mettre en garde les entreprises contre une politique opportuniste de souscription des plans de stock options (proposition n° 13). Enfin, alors que l'analyse financière est devenue une source d'informations essentielle pour les actionnaires, la Mission propose de renforcer la loi de sécurité financière du 1er août 2003 en inscrivant dans la loi le principe des « murailles de Chine » au sein des établissements bancaires entre activités de placement et activités d'analyse financière (proposition n° 4). Nous croyons indéfectiblement à la liberté et au contrat comme mode de régulation de l'entreprise, nous croyons aussi à son indispensable corollaire, la transparence, et au principe de responsabilité qui la sanctionne. Que ces trois valeurs fondamentales viennent à manquer et le législateur fera à nouveau entendre sa voix. En tout état de cause, il n'y aura pas de rapport « Clément II », mais d'autres propositions de loi si des règles de gouvernance pertinentes ne s'ancrent pas dans le paysage capitalistique français. M. Robert Pandraud s'est étonné d'avoir entendu certains des membres de la mission s'exprimer sur une station de radio pour évoquer la découverte de faits commis par des dirigeants de société susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales, avant même que cette Mission ait pu rendre ses conclusions et alors que ne circulait qu'un simple document de travail. Il a estimé, en conséquence, que le cadre de la mission d'information avait été dépassé et qu'il aurait été par ailleurs utile d'entendre plus largement des représentants des pouvoirs publics. Il a annoncé qu'il ne voterait pas, pour sa part, en faveur de la publication du rapport. Le président Pascal Clément a démenti avoir subi des pressions et regretté que de fausses informations aient été diffusées, avant de préciser qu'il n'avait jamais reçu de document de nature à permettre la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. De plus, il a indiqué que, si l'un des membres de la Mission possédait des documents de ce type, il ne les avait pas transmis à la Mission, qui ne disposait d'ailleurs pas, contrairement à une commission d'enquête, de moyens d'investigation sur pièces et sur place. Il a précisé qu'il avait accepté d'intégrer dans le cadre de la Mission, sur la suggestion d'Alain Marsaud, la question de la rémunération des dirigeants sociaux, sujet qui faisait partie intégrante de la gouvernance des entreprises. En outre, il a fait observer que plusieurs représentants des pouvoirs publics avaient été entendus, notamment le directeur des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice, la présidente du Conseil des marchés financiers et l
M. Jean-René Fourtou aurait été invité à s'exprimer devant la Mission, sur la réalité des consultations que le président de la Mission aurait menées auprès du Premier ministre et sur le fait que Le Parisien ait appris d' « une personne de l'entourage » du président de la Mission la volonté de cette dernière de proposer que les assemblées générales s'expriment par un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants sociaux. Après avoir estimé que la limite entre mission d'information et commission d'enquête devenait de plus en plus floue, il a demandé que l'affaire « Executive Life » soit examinée par la Mission et que les ministres compétents soient entendus, le président de la Mission s'étant lui-même exprimé en faveur d'une commission d'enquête sur cette question à l'occasion d'un entretien sur LCP-AN. Le président Pascal Clément a précisé que, si le vote consultatif de l'assemblée générale sur les rémunérations des dirigeants avait été proposé par un membre de la Mission, celle-ci n'avait pas retenu une telle suggestion. Il a indiqué qu'il avait eu l'occasion de préciser publiquement qu'après la mise en cause de M. Jean-René Fourtou par M. Jean-Marie Messier à l'occasion de son audition par la Mission, il avait été saisi par le directeur des affaires institutionnelles et européennes de Vivendi et avait proposé au président de cette entreprise, soit de venir répondre devant la Mission, soit de lui transmettre ses observations par écrit, en exercice de son droit de réponse. Il a ajouté qu'à la suite de cette proposition, il avait reçu une lettre signée par le directeur général de Vivendi, lettre qui serait jointe au rapport de la Mission. Par ailleurs, il a fait remarquer que le Président de l'Assemblée nationale avait le premier estimé utile d'examiner l'affaire « Executive Life » et qu'il s'était lui-même contenté à titre personnel de réaffirmer cette utilité, sans pour autant être suivi par la majorité de l'ump et tout en ayant conscience qu'une telle initiative risquait de compromettre les négociations menées entre le Gouvernement et les autorités judiciaires de Californie, au détriment des intérêts du contribuable français. Il a, enfin, estimé normal, le Gouvernement étant maître de l'ordre du jour, d'avoir consulté le Premier ministre, dès lors que les travaux de la Mission pouvaient déboucher sur une proposition de loi. Il a considéré que, si un tel projet devait aboutir, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pourrait être auditionné par la commission des Lois. M. Xavier de Roux a fait observer que l'affaire « Executive Life », liée à des faits s'étant déroulés sous plusieurs gouvernements et venant après les difficultés du Crédit Lyonnais et du Consortium de r&ea
émergé à l'occasion des très nombreuses auditions réalisées, devaient sous-tendre les propositions faites par la Mission pour améliorer la gouvernance des sociétés. Il a regretté que certains aspects techniques de la loi de 1966 sur les sociétés, à l'exemple du régime des augmentations de capital, n'aient pas été traités, ce qui aurait renforcé la légitimité technique de la Mission et, au-delà, de la commission des Lois. Il s'est dit favorable à la philosophie de la proposition n° 1, mais a attiré l'attention sur les conséquences juridiques de la certification des éléments de salaires des dirigeants sociaux par les commissaires aux comptes. Le président Pascal Clément a rappelé qu'au cours des auditions, les représentants des associations d'actionnaires s'étaient montrés extrêmement réticents à l'idée d'être contraints de refuser d'approuver les comptes, dès lors qu'ils exprimeraient des réserves sur les seules rémunérations des dirigeants sociaux. Il a mis en garde contre la stigmatisation démagogique des dirigeants sociaux et de leurs rémunérations et a considéré que la présence de grandes entreprises et de leurs sièges sociaux sur notre territoire était plus importante pour l'intérêt national à long terme que le plaisir que certains ressentaient le temps d'un éphémère feu d'artifice médiatique. M. Arnaud Montebourg a confirmé qu'il s'était attaché, avec son collègue Christophe Caresche, à respecter la procédure, bien que, depuis plusieurs jours, ils soient continuellement contactés par la presse sur le fondement d'informations manifestement incomplètes, voire fausses, et qui exigeaient des réactions des membres de la Mission, de la majorité certes, mais aussi de l'opposition. Il a rappelé que les dossiers de précédents des commissions d'enquête et des missions d'information révélaient qu'il n'était pas rare qu'au cours de leurs travaux, ces institutions aient découvert des faits susceptibles d'être dénoncés sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale et aient décidé, après décision de leur bureau, d'autoriser leur rapporteur ou leur président à effectuer de telles dénonciations. Il a précisé en revanche que, si un membre de la Mission n'avait pas communiqué à celle-ci des informations qu'il possédait, ces dernières n'avaient aucune existence et ne pouvaient donc servir à engager une procédure de dénonciation. Il a demandé des éclaircissements sur le sens de la proposition n° 3, en estimant que la précision qu'elle comportait était d'ores et déjà satisfaite par l'état du droit et semblait se rapprocher de l'amendement déposé par son collègue Philippe Houillon à l'occasion de l'examen du projet de loi de sécurité financière, adopté par l'Assemblée, mais repoussé par le Sénat en deuxième lecture. Enfin, il a jugé que les propositions, n° 2, 4, 5 et 11 étaient satisfaites par la loi du 1er
propositions tout en confondant opinion et information. Il a confirmé que la Mission reprendrait la proposition faite par M. Philippe Houillon au cours de la discussion du projet de loi de sécurité financière, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence, refusant de faire une lecture littérale de l'article L. 225-252 du code de commerce, qui dispose pourtant que « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Après que le président Pascal Clément a rappelé la possibilité qui était ouverte aux membres de la Mission de joindre au rapport les observations de leur groupe, la Mission a adopté le rapport. N° 1270 - Rapport d'information : droit des sociétés 1 () Les Échos, 27 décembre 2002. 2 () Ce rapport clôt la première partie des travaux de la mission, consacrés au gouvernement d'entreprise. 3 () Ce sont même cinq familles qui en détiennent près de 22 %, contre 4,1 % au Royaume-Uni. En la matière, la France détient le record européen de concentration de l'actionnariat (source : Institut Montaigne, Mieux gouverner l'entreprise, mars 2003). 4 () Bertrand Richard, Dominique Miellet, La dynamique du gouvernement d'entreprise, Éditions d'organisation, 2003. 5 () Ibid. 6 () Éric Izraelewicz, « La transparence, une nouvelle dictature ! », Les cahiers Ernst and Young, n° 6, juin 2003. 7 () medef et afep, Principes de gouvernement d'entreprise résultant de la consolidation des rapports conjoints de l'afep et du medef de 1995, 1999 et 2002, octobre 2003. 8 () M. P
'Arial'; font-size: 10pt">12 () Élie Cohen, art.cit. 13 () Évaluation réalisée par Bertrand Richard et Dominique Miellet, op. cit. 14 () Ibid. 15 () Le Monde, 8 mai 2003. 16 () Ibid. 17 () La loi de sécurité financière du 1er août 2003 étant abondamment évoquée tout au long du présent rapport, nous n'en ferons pas une description spécifique dans cette partie. 18 () Avis n° 772 de M. Philippe Houillon, rapporteur au nom de la commission des Lois, 8 avril 2003. 19 () Voir p. 39. 20 () Jean-Michel Darrois, Alain Viandier, « L'intérêt social prime l'intérêt des actionnaires », Les Échos, 27-28 juin 2003. 21 () Éric Izraelewitcz, art. cit. 22 () Nous empruntons cette distinction au même auteur. 23 () Aldo Cardoso, cité par La Tribune, 30 juin 2003. 24 () Cf. définition page suivante. 25 () En Allemagne, un code de gouvernance (Deutsche Kodex), fruit des travaux d'un groupe mis en place par le gouvernement, a été promulgué en septembre 2002. Il contraint les entreprises cotées à prendre position par rapport à ses recommandations. 26 () Nous empruntons cette notion intéressante à Richard Routier (in « De nouvelles pistes pour la gouvernance ? », Bulletin Joly Sociétés, juin 2003, n° 6), qui définit ces administrateurs comme des personnes intervenant « dans des sociétés apparemment sans lien et dans des fonctions a priori différentes » mais sont, par l'exercice de leurs différents mandats, dans une situation de « dépendance plus ou moins réciproque ». 27 () L
_114382" href="#P667_114383">31 () Le Figaro, 21 novembre 2003. 32 () Institut Montaigne, op. cit. 33 () Ibid. 34 () Élie Cohen, cité par Le Monde du 23 mai 2003. 35 () L'ebitda (Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization) représente le résultat opérationnel - solde entre les produits et les charges d'exploitation - avant dépréciation et amortissement. Cette notion est assez proche de l'excédent brut d'exploitation dans les pratiques françaises. 36 () Joseph Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, Fayard, 2003. 37 () Les Échos, 11 février 2003. 38 () Le Monde, 15 juin 2003. 39 () Frédéric Descorps Declère, « Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des dirigeants sociaux », Revue de droit commercial, janvier-mars 2003, n° 1. 40 () Les actionnaires membres doivent justifier d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et détenir ensemble au moins 5 % des droits de vote, chiffre abaissé progressivement lorsque le capital social est supérieur à 750 000 euros, jusqu'à 1 %, pour les sociétés au capital supérieur à 15 millions d'euros. 41 () Institut Montaigne, Mieux gouverner l'entreprise, mars 2003. 42 () Avis n° 772 présenté par M. Philippe Houillon, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, 8 avril 2003. 43 () Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2000. 44 () Bulletin Joly Sociétés, mai 2001, n° 5, Note Jean-François Barbièri, § 126. 45 () D. Schmidt, Les conflits d'intérêts dans la société anonyme, éd. Joly, 1999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||