N° 2714 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2005. RAPPORT D'ACTIVITÉ AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Octobre 2004 - Novembre 2005 FAIT en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ET PRÉSENTÉ PAR Mme Marie-Jo Zimmermann, Députée. -- SOMMAIRE ______ INTRODUCTION 7 PREMIÈRE PARTIE : AGIR POUR LES FEMMES DE L'IMMIGRATION 9 I. DES FEMMES PARFOIS VICTIMES DE DROITS LIMITÉS ET D'UNE VIOLENCE INACCEPTABLE 15 A. LA PRÉVALENCE DU STATUT PERSONNEL MAINTIENT LES FEMMES IMMIGRÉES DANS UNE INFÉRIORITÉ JURIDIQUE AUX CONSÉQUENCES PARFOIS DRAMATIQUES 15 1) Le droit international et les conventions bilatérales maintiennent la femme dans un statut d'infériorité 15 2) Les effets dramatiques du statut personnel en matière de répudiation et de polygamie 17 a) La fin de la reconnaissance de la répudiation : un enjeu fondamental pour les femmes venues par la procédure du regroupement familial 17 b) L'épineux problème de la décohabitation des familles polygames 18 B. UN REPLI IDENTITAIRE SE TRADUISANT PAR UNE VIOLENCE INACCEPTABLE EXERCÉE SUR LES FEMMES 21 1) La permanence de pratiques familiales oppressives intolérables 22 a) Les mutilations génitales féminines 23 b) Les mariages forcés 25 2) La montée des intégrismes entraîne une inquiétante régression de la condition féminine dans les cités 30 C. CONFORTER L'AUTONOMIE JURIDIQUE DE CES FEMMES ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES QU'ELLES SUBISSENT 32 1) Aider ces femmes à conquérir et conforter leur autonomie juridique 32 a) Dénoncer les conventions bilatérales qui méconnaissent le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et limiter la portée de l'application du statut personnel 32 b) Améliorer l'information sur les droits des femmes immigrées 33 2) Lutter contre la violence que ces femmes subissent 37 a) Lutter contre la violence domestique spécifique qui s'exerce sur ces femmes 37 b) Combattre le sexisme dans les cités et réaffirmer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes 41 II. DES FEMMES CONNAISSANT UNE INSERTION DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL MARQUÉE PAR LA PRÉCARITÉ ET CONTRE LAQUELLE IL FAUT LUTTER 43 A. DES FEMMES IMMIGRÉES DE PLUS EN PLUS ACTIVES MAIS PRÉCARISÉES 43 1) Des femmes immigrées de plus en plus actives 43 2) Des travailleuses précarisées 45 a) Des femmes plus sujettes au chômage et à l'emploi précaire 45 b) Une concentration dans certains secteurs 46 B. DE L'ÉCOLE AU TRAVAIL : LA DIFFICILE INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES ISSUES DE L'IMMIGRATION 46 1) Quelle réussite scolaire pour les jeunes filles issues de l'immigration ? 46 a) Des caractéristiques sociales et familiales discriminantes pour les enfants de la « deuxième génération » 46 b) Des jeunes filles qui ne semblent plus croire aux vertus émancipatrices de la réussite scolaire 48 2) Une insertion professionnelle s'apparentant à une course d'obstacles 49 C. LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION ET PERMETTRE AUX FEMMES IMMIGRÉES ET ISSUES DE L'IMMIGRATION DE PRENDRE LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ 50 1) Faut-il améliorer la connaissance statistique sur les discriminations subies par les immigrés et les personnes issues de l'immigration ? 51 2) La maîtrise de la langue française par les femmes immigrées : un enjeu fondamental 53 3) Lutter contre les discriminations à l'embauche 55 a) Améliorer la formation et soutenir les démarches d'insertion professionnelle 55 b) Mettre en place la diversité dans les entreprises en luttant contre les stéréotypes et les idées reçues, et en sanctionnant réellement les discriminations 56 TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 61 RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 63 ANNEXE : PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION 67 DEUXIÈME PARTIE : LE SUIVI DE LA LOI DU 4 JUILLET 2001 RELATIVE À L'IVG ET À LA CONTRACEPTION 173 I. LA LOI DU 4 JUILLET 2001 A PERMIS DES AVANCÉES QUI SE TRADUISENT PAR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 176 A. L'ACCÈS À L'IVG EST OUVERT À UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE FEMMES 176 1) Grâce à l'allongement des délais légaux 176 2) Grâce à une meilleure prise en charge des mineures 177 a) Responsabilité des différents intervenants et respect de la confidentialité 177 b) Prise en charge financière 179 B. L'ACCÈS À L'IVG S'EFFECTUE DANS DE MEILLEURES CONDITIONS 180 1) Du fait de la possibilité d'IVG médicamenteuse en ville 180 2) Une revalorisation du forfait qui facilite l'accès à l'IVG 182 II. MALGRÉ CES AMÉLIORATIONS, DES DIFFICULTÉS NON NÉGLIGEABLES SUBSISTENT 183 A. DES FACTEURS D'ORDRE PRATIQUE RESTREIGNENT L'ACCÈS À L'IVG 183 1) Des délais de prise en charge encore excessifs dans certaines régions et à certaines périodes 183 2) L'accès à l'IVG médicamenteuse en ville est trop limité 185 a) Des textes d'application qui ont tardé à être adoptés 185 b) Un nombre restreint de praticiens habilités à pratiquer l'IVG médicamenteuse 186 B. DES PROBLÈMES D'ORDRE STRUCTUREL RISQUENT ÉGALEMENT DE PESER SUR LES CAPACITÉS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'IVG 187 1) La motivation et la formation des médecins 187 2) Un recueil de données statistiques inadapté 188 III. LE NOMBRE ANNUEL D'IVG SE MAINTIENT A UN NIVEAU ÉLEVÉ, UNE POLITIQUE DE CONTRACEPTION MIEUX CIBLÉE S'AVÈRE INDISPENSABLE 190 A. LE NOMBRE D'IVG SE MAINTIENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ 190 1) En raison de facteurs sociologiques 190 2) Des échecs de contraception encore trop fréquents 191 B. LA NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE DE CONTRACEPTION PLUS EFFICACE 194 1) Renforcer les actions d'information en matière de contraception 194 a) Par des campagnes nationales d'information 194 b) Mieux informer en milieu scolaire 194 2) Assurer une meilleure adéquation de la contraception aux besoins de chaque femme 196 a) Par une prescription davantage personnalisée 196 b) Grâce à des méthodes de contraception variées et évolutives 196 RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 199 ANNEXE : PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION 201 TROISIÈME PARTIE : L'ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION AU COURS DE LA SESSION 2004-2005 227 I. LES RAPPORTS DE LA DÉLÉGATION 229 A. LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2003-2004 ET L'ÉTUDE SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 229 1) Une forte progression du travail à temps partiel 229 2) Les recommandations de la Délégation 229 3) Un sujet de préoccupation pour le Gouvernement 231 B. LE PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 232 1) Le projet de loi relatif à l'égalité salariale 232 2) Les recommandations de la Délégation 233 3) Le texte adopté en première lecture 235 C. LES ACTES DU COLLOQUE : « CINQ ANS APRÈS LA LOI : PARITÉ... MAIS PRESQUE » 236 II. LES AUTRES SUJETS D'INTÉRÊT DE LA DÉLÉGATION 236 A. LE PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE 236 ANNEXE : PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LA DÉLÉGATION 239 B. L'AUDITION DE PERSONNALITÉS 287 III. L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE DE LA DÉLÉGATION 297 A. CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARLEMENTAIRES SUR L'APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT (CIPD) - STRASBOURG, 18 ET 19 OCTOBRE 2004 297 B. CONFÉRENCE DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DES PARLEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT EUROPÉEN - LA HAYE, 4 ET 5 NOVEMBRE 2004 302 C. 49e SESSION DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS UNIES, NEW-YORK, MARS 2005 306 1) La Déclaration adoptée par la Commission de la condition de la femme à l'issue de ses travaux, le 11 mars 2005 307 2) La journée parlementaire organisée par l'Union interparlementaire (UIP) le 3 mars 2005 308 D. CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARLEMENTAIRES DU G8 SUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE : 6 ET 7 JUIN 2005 309 Mesdames, Messieurs, Conformément aux missions que lui a confiées la loi du 12 juillet 1999, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes présente aujourd'hui son cinquième rapport d'activité annuel pour la période octobre 2004-novembre 2005. La première partie de ce rapport rend compte d'une réflexion menée par la Délégation tout au long de l'année 2005 sur le thème des femmes immigrées et issues de l'immigration. Alors que les problèmes de violence dans les banlieues n'avaient pas encore surgis, la Délégation avait choisi ce thème d'étude, consciente de la situation difficile des femmes de l'immigration, mais convaincue qu'elles peuvent être un formidable levier pour améliorer l'intégration de l'ensemble de la population immigrée. Après avoir dressé un constat alarmant de l'ensemble des violences qu'elles subissent - répudiation, polygamie, mariages forcés, mutilations génitales - et des difficultés particulières qu'elles rencontrent pour prendre toute leur place dans la société, notamment en matière professionnelle, il apparaît urgent à la Délégation non seulement de freiner toute tentation de repli communautariste qui conduit à maintenir les femmes dans des coutumes contraires à nos lois et à notre ordre public, mais aussi de lutter contre la double discrimination dont ces femmes sont les victimes. C'est en modifiant certaines de nos dispositions législatives que l'on pourra mettre fin à certaines violences subies par les femmes de l'immigration. C'est en les aidant à mieux connaître notre langue et notre droit qu'on leur permettra de s'affirmer et de conquérir leur autonomie. C'est en s'appuyant sur les femmes de l'immigration, car elles assureront à leurs enfants la transmission des valeurs républicaines qu'elles se seront appropriées, qu'il sera possible d'assurer une meilleure cohésion sociale en France dans le respect de sa diversité. La deuxième partie du rapport est une contribution de Mme Bérengère Poletti, membre de la Délégation, sur le suivi de l'application de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Au vu des difficultés posées par l'application de cette loi, cette mission de suivi a été confiée à la Délégation par M. Jean-Michel Dubernard, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Après avoir rappelé les avancées permises par la loi du 4 juillet 2001 et les obstacles qui demeurent à son application effective, notamment en matière d'IVG médicamenteuse, il apparaît nécessaire à la Délégation, étant donné le maintien à un niveau élevé du nombre d'IVG, de mener une politique de contraception mieux ciblée et plus adaptée. La troisième partie du rapport retrace les travaux de la Délégation au cours de cette période, notamment ceux portant sur la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, sur le projet de loi relatif à l'égalité salariale (rapport n° 2243 du 12 avril 2005), et sur la parité en politique, à l'occasion du colloque organisé pour les dix ans de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et des cinq ans de la loi du 6 juin 2000 (DIAN 40/2005). L'activité internationale de la Délégation est également mentionnée ainsi que les diverses déclarations adoptées au cours des conférences européennes et internationales auxquelles ont participé plusieurs membres de la Délégation. Plus que jamais, la Délégation aux droits des femmes a maintenu sa vigilance dans les domaines essentiels des droits des femmes. C'est un combat qu'il convient de mener en permanence car les régressions sont, malheureusement, toujours possibles, comme ce fut le cas pour la réforme de l'élection des sénateurs. C'est une action qui est menée dans un souci d'information mais aussi de contrôle de l'action gouvernementale, dont le Président Jean-Louis Debré s'est toujours montré l'ardent défenseur. PREMIÈRE PARTIE : ______________ En trente ans, l'immigration en France a profondément changé de nature ; la figure traditionnelle de l'immigré ouvrier et célibataire, venu travailler pour s'enrichir en France avant de retourner au pays, a fait long feu. En effet, si la période des Trente Glorieuses a vu le développement d'une immigration de main d'œuvre essentiellement masculine, la politique de maîtrise de l'immigration engagée depuis 1974, conjuguée à celle du regroupement familial, ont profondément modifié la sociologie de l'immigration. L'immigré, aujourd'hui, est de plus en plus une immigrée. Depuis 1975, alors que le nombre d'hommes immigrés, en constante progression de 1946 à 1975, s'est stabilisé, le nombre de femmes immigrées, lui, n'a cessé de croître, augmentant de 280 000 personnes entre 1982 et 1999. Au 1er janvier 2004, sur les 4,5 millions d'immigrés résidant en France métropolitaine, 50,3 % étaient des femmes. Les femmes représentent donc aujourd'hui une part relativement plus importante de la population immigrée totale. Parallèlement, la part des femmes qui migrent pour raisons économiques a elle aussi augmenté, ce qui explique qu'elles représentent actuellement le tiers des travailleurs immigrés(1). Plus nombreuses, les femmes proviennent aussi d'origines plus lointaines(2). En 1999, les immigrées en provenance d'Italie et d'Espagne ne représentaient plus qu'un sixième du total des immigrées (contre la moitié dans les années 1960), celles en provenance du Maghreb la moitié ; de plus en plus d'immigrées venaient de Turquie, d'Afrique ou d'Asie (notamment de Chine). Toutefois, malgré cette diversification des pays d'origine, la moitié des femmes immigrées en 1999 étaient d'origine européenne. Concernant la pyramide des âges, il apparaît que la majorité des femmes immigrées sont d'âge actif. Les jeunes filles, peu nombreuses au sein de cette population, ne représentaient que 7,5 % de la population immigrée au recensement de 1999, tandis que les deux tiers des femmes immigrées avaient entre 20 et 59 ans (contre la moitié pour les Françaises de naissance), et que les plus de 60 ans représentaient un quart de la population totale, situation comparable à celle des Françaises de naissance. Alors que leur importance numérique s'accroît, les femmes immigrées demeurent, de l'avis du Haut Conseil à l'intégration, victimes d'une longue invisibilité : « malgré un certain nombre d'études et enquêtes administratives existantes, ce sujet est caractérisé par la relative discrétion des sociologues et des juristes - sauf sur des points bien précis, comme la question des répudiations musulmanes - et par le manque d'études monographiques permettant une juste appréciation de la nature et de l'ampleur des problèmes qui se posent »(3). Pour être invisibles, les problèmes des femmes immigrées et issues de l'immigration n'en sont pas moins réels. Au terme de l'audition par la Délégation d'un grand nombre de personnalités issues du monde associatif, universitaire, administratif et institutionnel, il apparaît que leur situation est marquée par une grande fragilité, tant du point de vue juridique qu'économique. Ne connaissant pas les principes fondamentaux de notre République, n'ayant pas la nationalité française ni les droits qui s'y rattachent, les femmes immigrées connaissent de grandes difficultés d'intégration dans la société et spécialement dans le monde du travail. Dans la sphère domestique, elles sont parfois soumises à la permanence de cultures traditionnelles les plaçant en position de mineures, tandis que des préjugés culturalistes diffus tendent à ignorer ou minimiser les discriminations et violences qui leur sont faites. Les femmes issues de l'immigration, de leur côté, peuvent dans certains cas être prises en étau entre des injonctions contradictoires de la part de leurs communautés, se crispant parfois sur leurs cultures traditionnelles et perpétuant sur notre sol des coutumes en contradiction avec nos droits fondamentaux (excision, mariages forcés), et leur propre et légitime désir d'émancipation, se heurtant lui-même à leur difficile insertion dans le marché du travail, et, in fine, dans la société civile. Plus sujettes au chômage et à l'emploi précaire, alors que leurs parcours scolaires sont souvent de qualité, les jeunes filles issues de l'immigration sont souvent cantonnées dans des emplois subalternes du secteur tertiaire. Bien sûr, les parcours de réussite existent. Bien sûr, nombreuses sont les femmes et les filles immigrées et issues de l'immigration qui tirent leur épingle du jeu. Mais force est de constater que la société française, la République, même, ne remplissent pas correctement leurs devoirs à l'égard de la majorité de ces femmes, à savoir celui de leur permettre de vivre pleinement dans notre société, à des fins d'enrichissement mutuel. Femmes et immigrées, elles subissent une double discrimination, à raison de leur origine et de leur sexe. Cette situation est d'autant plus regrettable que les femmes pourraient être un formidable levier des politiques d'intégration des étrangers, politiques qui sont aujourd'hui, malheureusement on le sait, en panne. Forgé au XIXe siècle autour des valeurs universalistes et individualistes nées pendant la Révolution Française et fondé sur une volonté d'intégration, préférée à l'assimilation, ou même à l'insertion, le « creuset français », loin des modèles communautaires, a pour objectif de permettre aux étrangers de devenir partie intégrante de la République et exige qu'ils en respectent règles et valeurs. Il s'agit donc d'un processus qui implique un effort tant de la part des immigrés que de la collectivité nationale. Aujourd'hui, ce processus ne fonctionne plus et la cohésion nationale est en péril. Frappés de plein fouet par la crise que vit notre pays depuis plus de trois décennies, les immigrés sont, plus encore que le reste de la population, victimes de la paupérisation et de la précarité. Plus touchés par le chômage, ils ont actuellement un salaire net moyen de 1 300 euros, contre 1 500 euros pour le reste de la population. Moins souvent propriétaires, ils vivent dans des logements plus petits et plus peuplés que la moyenne, dans des zones généralement mal desservies, cumulant les difficultés, et où la forte concentration de populations immigrées ne permet pas la mixité sociale. A ces conditions socio-économiques difficiles viennent s'ajouter la discrimination dont sont victimes les immigrés, à l'embauche, d'une part, mais aussi dans d'autres domaines de leur vie quotidienne, comme l'accès au logement ou aux loisirs. Sous-représentés dans les instances dirigeantes des partis, des associations, dans la haute fonction publique, dans les postes de direction des entreprises, dans les médias, les immigrés et enfants d'immigrés ont souvent le sentiment d'être laissés de côté par notre société. Or, comme a pu l'écrire M. Jean-Luc Richard dans un ouvrage récent consacré à la place des immigrés dans la société française, « les préjugés des uns et des autres, ainsi que les comportements discriminatoires dont sont victimes un nombre encore trop important des personnes perçues comme issues de l'immigration étrangère compromettent gravement le sentiment d'intégration, le désir de participation à la vie sociale et citoyenne, et nuisent finalement à l'harmonie sociale »(4). Cette situation est d'autant plus durement ressentie qu'elle s'accompagne de la fin, douloureuse, du mythe du retour. Alors que pendant longtemps l'immigration était vécue comme une période transitoire d'enrichissement avant le retour au pays, les immigrés ont fini par prendre peu à peu conscience de leur enracinement en France, notamment lorsqu'ils y ont fondé une famille ou élevé des enfants. De tout cela résulte souvent des crispations identitaires dont les femmes, maillons les plus faibles, sont les premières à faire les frais. Maintenues de par la prévalence du statut personnel dans une infériorité juridique aux conséquences parfois dramatiques, les femmes immigrées ou issues de l'immigration sont trop souvent victimes d'un repli identitaire se traduisant par des violences inacceptables. En outre, alors qu'elles sont de plus en plus actives, leur insertion dans le monde du travail est marquée par une incontestable précarité. Il y a un an, la Délégation, convaincue que l'intégration des femmes immigrées et issues de l'immigration est une des clés de la réussite de l'intégration de l'ensemble des populations immigrées, choisissait de travailler sur les problèmes de ces femmes. Les événements actuels dans les banlieues viennent malheureusement a posteriori justifier la pertinence de ce choix. Certes, les raisons avancées pour expliquer les émeutes actuelles, telles que les apories de la politique de la ville, menant à la ghettoïsation des banlieues, le déclin de l'autorité et notamment de celle de l'Éducation nationale, l'inexorable permanence du chômage, ou encore la fragilisation de la famille, sont indéniables. Il en est une cependant que l'on n'évoque jamais, mais qu'il ne faut pas négliger : celle du manque d'intérêt pour la condition des femmes, notamment immigrées, dans les banlieues. A l'heure où la cohésion nationale est mise en péril, il n'est plus acceptable, non seulement, de ne pas tenir compte de la problématique sexuée de l'immigration, mais en outre, de ne pas s'appuyer sur les femmes, qui peuvent être un véritable atout pour améliorer les conditions d'intégration de l'ensemble de la population immigrée. I. DES FEMMES PARFOIS VICTIMES DE DROITS LIMITÉS ET D'UNE VIOLENCE INACCEPTABLE A. LA PRÉVALENCE DU STATUT PERSONNEL MAINTIENT LES FEMMES IMMIGRÉES DANS UNE INFÉRIORITÉ JURIDIQUE AUX CONSÉQUENCES PARFOIS DRAMATIQUES 1) Le droit international et les conventions bilatérales maintiennent la femme dans un statut d'infériorité On entend par statut personnel toutes les questions de droit concernant directement la personne, comme l'état civil, le mariage, le régime matrimonial, la filiation, ou encore les successions. Dans les pays où l'immigration est constitutive de la Nation, comme aux États-Unis, la question de la permanence d'un statut personnel ne se pose pas et c'est la loi du lieu de résidence qui est appliquée aux étrangers. Cette conception ne prévaut pas en France, où toute personne étrangère est soumise, pour son statut personnel, à la loi du pays dont elle possède la nationalité, comme le prévoit le code civil dans son article 3(5). Ainsi, à chaque fois que des étrangers sont concernés, le juge français applique la loi étrangère, dans le respect toutefois de l'ordre public. Toutefois, la situation juridique est rendue plus complexe non seulement par les exceptions qui ont été instaurées par le législateur lui-même, mais aussi par les conventions bilatérales qui lient la France à de nombreux pays, notamment du Maghreb et d'Afrique. La loi française a prévu des exceptions à l'application du statut personnel. Ainsi, en matière de divorce, l'article 310 du code civil prévoit d'appliquer la loi française lorsque les deux époux étrangers sont domiciliés en France. Il en est de même pour toutes les règles relatives à la protection de l'enfance. Enfin, l'application de la loi étrangère connaît une limite, celle du respect de l'ordre public français. De plus, les conventions bilatérales que la France a signées avec d'autres pays peuvent, d'une part, aller à l'encontre des exceptions précédemment citées, et, d'autre part, être en conflit avec d'autres normes qui devraient pourtant s'appliquer en France. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire exclut ainsi(6) l'application de l'article 310 du code civil et permet donc la reconnaissance implicite en France de la répudiation, qui existe au Maroc, alors même que celle-ci est contraire au protocole additionnel n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conçu à l'origine pour assurer aux personnes se déplaçant d'un pays à l'autre la sécurité juridique par la stabilité des règles les concernant, le statut personnel se révèle ainsi être un frein à l'émancipation des femmes immigrées. Le problème de l'application d'une norme du pays d'origine moins favorable aux femmes se pose surtout pour celles originaires du monde arabo-musulman. Alors que les femmes prennent une place grandissante dans l'économie de ces pays, les législations en vigueur dans certains d'entre eux, inspirées d'une interprétation traditionnelle du droit coranique, continuent à enfermer la femme dans une situation d'infériorité et de dépendance à l'égard de son époux. En matière d'héritage, de mariage, ou même d'intégrité physique, la femme est traitée non comme un sujet mais comme un objet de droit. En Tunisie, la situation de la femme a été nettement améliorée (suppression de la répudiation, possibilité de mariage avec communauté de biens, divorce avec versement de pension alimentaire à la femme), tout comme au Maroc, où la réforme de la Moudawana a nettement amélioré la condition des femmes(7). Mais tel n'est pas le cas partout dans le du monde arabe. Le code de la famille algérien, par exemple, fait de la femme une incapable au sens juridique. Mariée ou non, la femme est une éternelle mineure, placée sous la tutelle d'un homme, mari, père, ou encore frère. Celle-ci n'a pas la capacité de contracter un mariage (c'est un tuteur matrimonial qui le conclut en son nom)(8) ni d'épouser un non musulman(9). En outre, le mari est le « chef de famille », et l'épouse est « tenue de (lui) obéir et de lui accorder des égards » de même qu'elle doit « respecter les parents de son mari et ses proches » (article 39). Alors que la polygamie est légalisée (article 8), l'inégalité de traitement entre l'homme et la femme est particulièrement flagrante en matière de divorce. L'homme peut en effet divorcer du seul fait de sa volonté(10), ce qui revient quasiment à une répudiation, tandis que la femme ne peut demander le divorce que sous certaines conditions limitativement énumérées, comme l'absence de plus d'un an du mari sans excuse valable ou sans pension d'entretien.. Le régime successoral est pour sa part construit sur une inégalité dans le partage, avec une proportion de deux tiers pour les hommes contre un tiers pour les femmes, conformément au droit coranique, qui édicte que la part des hommes est le double de celle des femmes. On voit bien par cet exemple que l'application en France d'une loi étrangère peut maintenir les femmes dans une infériorité juridique archaïque et contraire au principe d'égalité entre les époux en vigueur dans notre pays. 2) Les effets dramatiques du statut personnel en matière de répudiation et de polygamie a) La fin de la reconnaissance de la répudiation : un enjeu fondamental pour les femmes venues par la procédure du regroupement familial Cette infériorité se manifeste tout particulièrement en cas de répudiation. Dans les pays où elle existe, la répudiation est un droit unilatéral de l'époux, qui peut rompre le mariage sans que l'épouse ne puisse s'y opposer. En France, les femmes touchées par une répudiation sont dans la plupart des cas soit des victimes de mariages forcés, soit des femmes d'immigrés de longue date qui refusent de retourner au pays au moment de la retraite de leur mari. Vécue comme un déshonneur par la femme, particulièrement inégalitaire et douloureuse, la répudiation en France est d'autant plus importante qu'elle peut produire des effets sur le titre de séjour de la femme répudiée. En effet, l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les étrangers rentrés régulièrement sur le territoire par la procédure du regroupement familial obtiennent une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable un an et renouvelable. Ce n'est qu'au bout de deux ans de résidence en France qu'ils peuvent solliciter une carte de résident, valable dix ans et renouvelable, si l'étranger qui avait demandé le regroupement familial est lui-même détenteur d'une telle carte. En cas de rupture de la vie commune, la carte de séjour temporaire qui a été remise au conjoint d'un étranger peut, pendant les deux années suivant sa délivrance, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Une femme arrivant par le biais du regroupement familial peut ainsi, durant les deux années qui la séparent de la possibilité d'obtenir ses propres papiers, devenir l'otage de son époux, vivant sous la menace du divorce ou de la répudiation. Certes, l'article L. 431-2, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité de renouveler le titre de séjour de l'épouse lorsque la rupture de la vie conjugale fait suite à des violences ; mais les répudiations ne font pas toutes suites à des violences. De plus, les préfets détiennent, par la voie de circulaires, la possibilité d'user de leur pouvoir d'appréciation pour admettre au séjour, à titre humanitaire, certains étrangers, dont les femmes victimes de répudiations(11). Cette disposition est toutefois d'une relative fragilité, dans la mesure où il ne s'agit pas, pour les femmes répudiées, d'une protection législative. En vertu de l'application du statut personnel, la répudiation a pendant longtemps été reconnue en France, le juge ne contrôlant que le respect des droits de la défense. La doctrine et la jurisprudence opèrent toutefois actuellement un revirement, en faveur d'un durcissement à l'encontre des répudiations. En effet, le statut personnel ne s'applique que tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre public français. Or, la répudiation unilatérale est contraire au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, inscrit tant dans le préambule de la Constitution de 1946(12) que dans la convention européenne des droits de l'Homme(13). La Cour de cassation, qui avait longtemps entériné les répudiations lorsque certaines conditions, comme le dédommagement de l'épouse, étaient remplies, a opéré un renversement de jurisprudence, et paraît vouloir opposer aujourd'hui de façon systématique le principe d'égalité entre époux lorsque les époux concernés vivent en France (14). Il s'agit là d'une évolution protectrice des droits de la femme. Bien que nous n'ayons pas de données chiffrées, les différents témoignages recueillis par la Délégation permettent d'affirmer que la pratique « d'importation » de femmes que l'on répudie au bout d'un délai de deux ans est loin d'être marginale. Or, il n'est pas acceptable que des Français ou des immigrés en situation régulière profitent de la complexité des règles du droit international, et traitent les femmes comme si celles-ci étaient de simples marchandises. b) L'épineux problème de la décohabitation des familles polygames La polygamie se définit comme la coexistence dans le temps et dans l'espace de plusieurs mariages, tous légitimes, entraînant droits et obligations pour les époux, et conférant la qualité d'enfants légitimes aux enfants issus de ces unions. Stricto sensu, la polygamie peut consister tant en une pluralité d'époux (polyandrie), qu'en une pluralité d'épouses (polygynie). Toutefois, la polygamie, dans les pays où elle se pratique, est essentiellement le fait des hommes. La polygamie est reconnue dans la plupart des pays musulmans (Algérie, Libye, Maroc, Arabie Saoudite, Égypte(15)...), à l'exception notable de la Tunisie et de la Turquie, ainsi que dans de nombreux pays d'Afrique (Mali, Mauritanie, Sénégal, Cameroun, Guinée...) et d'Asie (Bangladesh, Birmanie, Pakistan, Laos...), soit au total dans une cinquantaine de pays. Elle va à l'encontre de la monogamie en vigueur dans la plupart des pays occidentaux, reposant sur l'égalité entre les hommes et les femmes. La question de la polygamie a surgi en France dans les années 1970, avec le début du regroupement familial et l'accroissement de l'immigration en provenance d'Afrique. S'il est difficile de connaître le nombre exact de familles polygames, on peut toutefois l'estimer être de l'ordre de 8 000 à 15 000(16), ce qui représente environ 150 000 personnes concernées(17). Largement répandue chez les immigrés originaires du Mali ou de Mauritanie alors même qu'elle est en régression dans ces pays(18), la polygamie est non seulement une atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes, mais en outre un facteur de blocage du processus d'intégration. Les épouses, isolées et dépendantes financièrement, vivent une incessante compétition ; les enfants, souffrant de ces rivalités permanentes ainsi que de la promiscuité dans des logements suroccupés et insalubres(19), sont plus sujets que les autres à l'échec scolaire et à la délinquance ; enfin, les problèmes de voisinage dus au surpeuplement sont légion. Par ailleurs, nombreux sont les observateurs à constater que la polygamie est devenue une réelle source de revenus pour les époux polygames, qui profitent du système d'allocations familiales : au lieu de bénéficier au bien-être des enfants, celles-ci participent d'un enrichissement personnel indu du chef de famille. Pendant longtemps, la polygamie a été reconnue tant par les autorités administratives que par la jurisprudence, en vertu notamment du droit à mener une vie familiale normale(20) et du respect du statut personnel(21). Par la loi du 24 août 1993(22), le législateur a toutefois entendu mettre fin à cette reconnaissance. A l'heure actuelle, une carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie, ni aux conjoints d'un tel ressortissant(23). Hormis la première épouse, les épouses de familles polygames constituées après la loi de 1993 sont en situation irrégulière. Pour les familles polygames admises au séjour avant 1993, seule la première épouse voit sa carte de résident renouvelée(24). L'époux et les autres épouses se voient attribuer une carte de séjour temporaire d'un an. A l'issue de ce délai, si la polygamie a été rompue en droit, une carte de résident peut être délivrée ; si elle a été rompue en fait, le titre d'un an peut être renouvelé ; si le régime matrimonial reste inchangé et que la situation de polygamie demeure, les intéressés ne peuvent plus obtenir de titre de séjour « salarié » ou « travailleur non salarié », mais seulement un titre de séjour temporaire de visiteur. Tous les pays européens ne sont pas confrontés de la même façon à la polygamie, dans la mesure où celle-ci est fonction de la provenance des communautés immigrées. Dans les pays où le problème se pose, des mesures analogues ont cependant été prises. Ainsi, dans les pays nordiques, les législations interdisent de délivrer aux immigrés polygames un permis de résidence, sauf s'ils acceptent de s'établir dans le pays d'accueil avec une seule de leurs épouses(25). L'Allemagne, qui compte une importante communauté turque(26), vient de son côté d'exclure les secondes épouses du bénéfice de la couverture maladie de leurs époux. L'incitation à la sortie de la polygamie est donc forte. Conscients des difficultés matérielles engendrées par la décohabitation, les pouvoirs publics ont mis en place un accompagnement à la démarche d'autonomie des épouses. Une circulaire du ministère de l'intérieur du 19 décembre 2001 invite ainsi les préfets à créer des structures pour favoriser la séparation des épouses entrées en France avant la promulgation de la loi de 1993, dans la mesure où « l'accès au logement séparé s'avère être une condition nécessaire pour une autonomie effective des épouses polygames ». La décohabitation n'est pourtant pas sans poser problème. Les auditions menées par la Délégation ont mis en lumière la précarité de la situation des épouses « décohabitées ». Menacés de perdre leur titre de séjour, les époux polygames mettent à la porte leurs épouses surnuméraires. Or, le plus souvent, celles-ci sont incapables de faire face à la situation. Majoritairement issues du Mali, de Mauritanie, du Sénégal, du Niger, des Comores ou encore de Djibouti ou du Maghreb, ces femmes dans leur grande majorité ne parlent pas ou peu le français, ne connaissent pas leurs droits, et ne maîtrisent pas les réseaux tant administratifs qu'associatifs susceptibles de leur porter secours. Privées d'un statut de résident, elles ne peuvent pas trouver d'emploi. En outre, alors que les structures d'accueil d'urgence sont saturées et les logements sociaux introuvables, les femmes qui ne travaillent pas, mais aussi celles qui ont un métier ne leur procurant pas des revenus suffisants pour pouvoir louer un appartement dans le secteur locatif privé, se retrouvent tout simplement à la rue. La décohabitation n'est pas une solution miraculeuse. Comme l'a précisé Mme Damarys Maa, présidente de l'IFAFE, elle « ne résout pas les problèmes car, même lorsqu'elle semble acquise, l'homme continue de faire le tour des appartements, de faire des enfants à sa femme et de percevoir les allocations familiales. Les femmes ne sont pas plus autonomes qu'elles ne l'étaient précédemment et continuent de dépendre de lui (...). Un divorce à la hâte sollicité par le système de "décohabitation" n'est pas considéré en tant que tel par ces familles, ni en France ni, encore moins, en Afrique »(27). La tolérance de la polygamie, qui a eu cours pendant longtemps, était fondée sur le respect du droit à la différence ; la réalité a toutefois crûment montré que la polygamie était un système d'asservissement des femmes, préjudiciable non seulement à celles-ci mais aussi à leurs enfants. Malheureusement, la lutte contre la polygamie, pour légitime qu'elle soit, se retourne in fine non contre les maris polygames, mais contre leurs épouses, c'est-à-dire contre les victimes mêmes de cette pratique archaïque. Cette situation est d'autant plus préoccupante que de nombreuses « co-épouses » continuent d'arriver chaque année en France, par le biais du certificat d'hébergement ou de manière illégale, pour vivre cloîtrées chez elles et sous l'emprise totale de leur mari. Sans papiers, elles sont contraintes en cas d'absolue nécessité d'utiliser les papiers de la première épouse. Il n'est pas rare ainsi dans les hôpitaux de voir deux accouchements à peu de mois d'intervalle sous un même nom... ce qui n'est pas sans poser problème par la suite en cas de séparation, puisque ces femmes sont dans l'incapacité de prouver qu'elles sont les mères de leurs enfants. B. UN REPLI IDENTITAIRE SE TRADUISANT PAR UNE VIOLENCE INACCEPTABLE EXERCÉE SUR LES FEMMES Les populations immigrées et d'origine immigrée souffrent, on le sait, de leur concentration dans des quartiers périphériques cumulant les difficultés (pas ou peu de transports, habitat de mauvaise qualité construit à la hâte, taux de chômage élevés, absence de perspective de mobilité...) et n'offrant aucune mixité sociale(28). Cette « ghettoïsation » s'explique tant par les politiques de la ville menées jusqu'aux années 1980 que par la création, par les immigrés eux-mêmes, de réseaux de solidarité. Elle est encore plus forte dans les écoles, du fait des taux de natalité plus élevés des populations immigrées, et du départ vers l'enseignement privé des enfants des familles les plus socialement favorisées(29). De fait, de véritables communautés nationales se recréent dans ces quartiers, avec des concentrations d'étrangers telles que l'intégration au reste du corps social est rendue plus difficile. A cela vient s'ajouter une stigmatisation des populations de ces quartiers, lesquelles, malgré les efforts sans cesse renouvelés des politiques d'intégration, peinent à trouver un emploi, et souffrent de l'image que leurs quartiers véhiculent. L'exemple de l'immigration turque, développé par Mme Gaye Petek lors de sa venue devant la Délégation, est à cet égard éclairant : « à partir des années 1980, une prise de conscience a eu lieu chez {les hommes immigrés en situation d'échec}, qui ont préféré rester. C'est ainsi qu'une immigration conçue comme devant être de courte durée s'est transformée en immigration permanente. Mais ces hommes se sont repliés sur eux-mêmes, soit par frilosité, soit par peur de trahir leurs parents, soit par peur que la "moulinette à intégrer" de l'école républicaine ne l'emporte sur l'identité turque. Ils se sont alors organisés en réseaux, créant des journaux turcs, des radios turques, des commerces turcs, multipliant les achats de paraboles et choisissant l'habitat le plus resserré possible, même au sein des HLM, au point que des ghettos se sont constitués. »(30) Tout espoir de retour au pays abandonné, et face au manque de perspective et au sentiment de rejet, les communautés immigrées se sont repliées sur leurs traditions, allant même jusqu'à les réinventer au-delà de ce qui se pratique dans les pays d'origine, ce qui aboutit paradoxalement à ce que le contrôle communautaire soit plus fort en France. Du mal être de l'immigré, mal intégré en France et rejeté dans son pays d'origine, du repli identitaire, mêlant traditions fantasmées et interprétations radicales de l'islam, les jeunes femmes sont les premières à faire les frais. Elles sont les victimes des hommes, jeunes comme vieux, mais aussi parfois des femmes mûres (mères et belles-mères) et de l'ensemble de leur communauté, qui pensent recouvrer une dignité en leur imposant un ordre moral en totale contradiction avec les valeurs d'égalité de la République. Être une jeune fille ou une jeune femme immigrée ou issue de l'immigration, cela signifie risquer d'être confrontée à des mutilations sexuelles ou à un mariage forcé, pratiques familiales archaïques et inacceptables niant aux femmes le droit de disposer de leur corps et de leur vie. Être une fille ou une jeune femme aujourd'hui dans une cité, cela signifie aussi risquer d'être l'objet d'une violence fondée sur une négation de toute possibilité d'émancipation féminine. 1) La permanence de pratiques familiales oppressives intolérables La pression sociale exercée sur les émigrés par la communauté d'origine explique la perpétuation de pratiques traditionnelles telles que les mutilations sexuelles et les mariages forcés. Ces pratiques, d'une violence physique et psychologique inouïe, sont fondées sur l'idée que la jeune fille appartient non seulement à sa famille mais aussi à sa communauté, dont elle doit suivre les règles sans possibilité de se laisser guider par son libre-arbitre. Elles sont la négation même des droits fondamentaux des femmes qu'elles oppriment. Or, comme l'a indiqué à la Délégation Mme Gaye Petek, directrice de l'association ELELE, « le paradoxe est que de multiples associations, dans les pays d'origine, parviennent à faire reculer des pratiques telles que les mariages forcés (...) ou l'excision, alors que des jeunes femmes sont {en France} soumises à ces mêmes pratiques »(31). a) Les mutilations génitales féminines L'excision(32) et l'infibulation sont des mutilations féminines malheureusement encore pratiquées par de nombreuses ethnies en Afrique, ainsi que dans la péninsule arabique, notamment au Yémen et à Oman, et en Indonésie et Malaisie. Pratiques archaïques révélatrices de la méfiance à l'égard de femmes supposées représenter la tentation, l'excision et l'infibulation sont d'une rare violence. Peu importent les souffrances physiques et psychologiques qu'elles génèrent, du moment que la virginité des jeunes filles est assurée : « la manière la plus extrême de garantir la virginité est d'amputer le clitoris, les petites et grandes lèvres de la fille et de racler les parois vaginales avec un objet contondant. Éclat de verre, lame de rasoir ou couteau à éplucher les pommes de terre. Ensuite, les jambes sont attachées ensemble de sorte que les parois vaginales se collent l'une à l'autre. »(33) Ces actes peuvent être pratiqués sur des jeunes femmes, des jeunes filles, ou même des fillettes ou des nourrissons. Ils provoquent une douleur atroce et entraînent de nombreuses séquelles gynécologiques, obstétricales, sexuelles, urologiques, ou psychologiques. Lors de l'excision ou de l'infibulation, pratiquées dans des conditions d'hygiène souvent douteuses, les infections vulvaires, urinaires et gynécologiques peuvent évoluer en septicémies, entraîner une stérilité ou provoquer la mort. Les rapports sexuels sont très douloureux. En outre, les femmes excisées ont des accouchements plus difficiles ; celles infibulées risquent leur vie et celle de leur enfant lors de l'accouchement. Ces graves atteintes à l'intégrité physique de la femme ont bien évidemment d'énormes répercussions psychologiques : anxiété, angoisse ou dépression, pouvant parfois mener au suicide. Les mutilations génitales féminines concernent près du tiers de la population féminine sur le continent africain. Il est difficile de connaître l'ampleur de ces pratiques en France. Selon le GAMS(34), les données relatives aux titres de séjour permettent de considérer qu'il y a en France au moins 20 000 femmes et 10 000 fillettes mutilées ou menacées d'être mutilées ; le groupe estime toutefois que le nombre de fillettes menacées est bien supérieur. Il s'agit de personnes originaires de pays où se pratique l'excision. Les plus nombreuses viennent du Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire et de Mauritanie ; d'autres viennent d'Éthiopie, du Kenya, du Liberia, de Somalie, du Tchad, du Togo,... Les trois quarts vivent en Île-de-France, les autres résidant pour la plupart en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans l'Oise, dans le Rhône ou dans les Bouches-du-Rhône. Contrairement aux idées répandues, il n'existe aucune prescription religieuse des mutilations sexuelles, qui ont d'ailleurs précédé l'apparition des trois grandes religions monothéistes(35). Justifiées en revanche par la coutume, elles s'expliquent en fait par la pression sociale exercée par des communautés malheureusement parfois en retard par rapport à l'évolution des mœurs dans leur pays d'origine(36). En préservant la virginité de la jeune fille, ces pratiques sont perçues comme un moyen de garantir l'honneur de la famille ; en annihilant le désir sexuel féminin, elles préserveraient en outre le mari de tout adultère. Dans l'esprit des mères, principal vecteur de perpétuation de ces mutilations, il s'agit aussi de se conformer à la coutume afin que leurs filles puissent trouver un époux dans leur communauté. Jusqu'en 1983, les affaires d'excision étaient portées devant le tribunal correctionnel, et qualifiées soit de coups et blessures volontaires, soit d'homicide involontaire, ou encore de non assistance à personne en danger. Par un arrêt du 20 août 1983, la Cour de cassation a reconnu que les mutilations sexuelles constituaient des mutilations au sens du code pénal(37). Celles-ci relèvent donc à présent de la cour d'assise : les auteurs de mutilations sexuelles encourent dix ans de prison et 150 000 euros d'amende, peine portée à 20 ans de réclusion criminelle si la mutilation est commise sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur(38). Les parents sont poursuivis pour complicité ; il en est de même si la mutilation a été commise à l'étranger et que la victime est de nationalité française(39). En revanche, pour une excision ou une infibulation pratiquées à l'étranger sur une fillette ou jeune fille n'ayant pas la nationalité française, la loi française ne s'applique malheureusement pas, même si la victime a sa résidence habituelle en France. Enfin, toute personne qui a connaissance d'une menace d'excision ou d'infibulation, en France ou à l'étranger, est tenue de le signaler(40) aux services sociaux ou au Procureur de la République. Les médecins, notamment, sont dégagés de leur obligation de respect du secret médical. Le versement des prestations familiales étant conditionné au passage d'examens médicaux obligatoires, les parents ne pratiquent pas d'excision pendant la petite enfance. Mais dès que le suivi médical est moins poussé, les familles peuvent mutiler leurs filles sans que le personnel de la médecine scolaire ne s'en aperçoive ; comme l'a indiqué à la Délégation Mme Florence Lacaze, responsable de la commission femmes de la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI), « les associations, notamment le GAMS, constatent que les petites filles sont très souvent excisées après l'âge de huit ans, qui correspond à la dernière visite médicale obligatoire »(41). Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, 36 procès pour excision ont eu lieu en France depuis 1979, concernant plus de 80 fillettes dont 4 décédées(42). Alors que jusqu'au début des années 1990, les peines de prison étaient souvent prononcées avec sursis, la justice condamne actuellement sévèrement les exciseuses. En outre, l'OFPRA reconnaît depuis décembre 2001 les personnes menacées d'excision comme un groupe social au sens des accords de Genève. Celles-ci sont donc fondées à demander le statut de réfugié politique, ce qui est une avancée très importante. Parallèlement, de nombreuses actions de prévention ont été engagées par l'État, notamment en partenariat avec plusieurs associations dont le GAMS et la CAMS(43). Depuis que des exciseuses ont été condamnées, il est probable que l'excision ne se pratique plus sur notre territoire. Mais le revers de cette politique nécessaire et plus que justifiée est, malheureusement, que les familles n'ont pas cessé leurs pratiques mais modifié leurs comportements : alors qu'autrefois on se cotisait pour faire venir les exciseuses, ce sont à présent les petites filles et les jeunes filles qui partent au pays pour être mutilées. Le problème de l'excision est donc malheureusement loin d'être résolu, d'autant plus que les signalements ne sont pas toujours suivis d'effets(44). Les mariages forcés sont des mariages arrangés par les familles à l'insu des futurs époux. Bien que les hommes soient parfois aussi mariés contre leur gré, ce sont en général les jeunes filles qui en sont les victimes. Ces mariages contreviennent au principe d'égalité entre époux et à celui du libre consentement au mariage, lequel est inscrit non seulement dans le code civil(45) mais aussi dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948(46). Longtemps considérés comme une pratique à laquelle il ne fallait pas s'opposer sous couvert de respect des différences culturelles, les mariages forcés sont en réalité des actes bafouant, au nom des traditions, le droit élémentaire de disposer de sa vie. Comme les mutilations sexuelles, les mariages forcés correspondent en effet à une conception patrimoniale de la jeune fille, celle-ci étant perçue comme appartenant à sa famille et à sa communauté, et non comme un être libre doté de droits individuels. Cette conception, qui a pu exister en France par le passé, n'est plus en vigueur aujourd'hui dans notre société, qui respecte la liberté de s'unir et de choisir son avenir matrimonial. Le problème des mariages forcés se pose dans les pays où l'immigration en provenance d'Afrique, du Maghreb, de Turquie et d'Asie est importante ; de fait, la structure de l'immigration explique l'existence ou non de mariages forcés dans les pays occidentaux. L'Allemagne et les pays d'Europe de l'Est sont confrontés au problème, comme la Grande-Bretagne, où les mariages forcés concernent à la fois des jeunes filles vivant sur place et mariées de force lors de séjours dans leurs pays d'origine, et des jeunes filles originaires d'Inde, du Pakistan, du Kurdistan, du Yémen ou de Turquie, envoyées par leurs parents au Royaume-Uni pour y épouser un membre de leur communauté. Ces dernières n'ont parfois pas 18 ans, âge légalement requis pour se marier, et sont mariées religieusement à des hommes plus âgés, qui les maintiennent dans leur dépendance(47). Selon le Haut Conseil à l'intégration, plus de 70 000 adolescentes seraient en France concernées par des mariages forcés. Ce chiffre, considérable au regard du nombre de mariages célébrés chaque année(48), a été confirmé par Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, lors de son audition par la Délégation(49). Ces mariages concernent des jeunes filles issues des communautés maghrébines, turques, ou encore africaines ou asiatiques. Il s'agit souvent de mineures, l'âge nubile étant malheureusement encore fixé à 15 ans pour les filles(50), c'est-à-dire à un âge où les adolescentes ne sont pas en mesure de s'opposer à un mariage décidé par leur famille. Les différents acteurs concernés constatent tous une recrudescence des mariages forcés. Les jeunes filles arrivées en France par le biais du regroupement familial sont les premières touchées ; mais le problème se pose aussi pour les jeunes filles de nationalité française mais nées de parents immigrés. Le plus souvent, le mariage est organisé à l'insu de la jeune fille. Celle-ci croit partir en vacances « au pays » ; lorsqu'elle revient - quand elle revient -, elle est l'épouse d'un homme qu'elle n'a pas choisi, et, dans la plupart des cas, qu'elle ne connaît pas. La pratique inverse existe aussi, les mariages forcés concernant alors des jeunes filles que l'on fait venir en France pour qu'elles épousent des hommes plus âgés à qui elles serviront de domestiques. Mme Fadila Bent-Abdesselam, médiatrice juridique de l'association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates (ASFAD), a ainsi souligné la nécessité de « penser aux jeunes femmes (...) vivant dans leur pays d'origine (...) qui sont mariées de force à un cousin binational résidant en France. Elles ne peuvent s'y soustraire, sous peine de voir leur virginité contestée. Elles entrent en France régulièrement, munies d'un visa en tant que conjointes de Français. Mais, une fois arrivées, elles servent de bonnes à tout faire, presque d'esclaves, et sont soumises à des violences sexuelles quotidiennes. Lorsqu'elles commencent à parler de leurs droits, leur époux les rejette. Sans papiers, brisées physiquement et psychologiquement, elles ne sont même pas accueillies dans les foyers et risquent l'expulsion »(51). Comment expliquer ces mariages forcés ? Il semble qu'ils proviennent en premier lieu de la crispation de communautés d'origine mal intégrées à la population française, qui tentent par ce biais d'éviter toute dilution de leur identité. Le mariage endogame est « forcé » pour éviter que des jeunes filles vivant en France, et ayant sous les yeux un modèle matrimonial fondé sur le libre consentement des époux, ne veuillent se soustraire à la tradition. Il arrive ainsi souvent que des mariages forcés soient organisés quand les jeunes filles commencent à fréquenter des garçons hors de leur communauté d'origine. L'exemple donné par Mme Gaye Petek à propos de la communauté turque de France est tout à fait éclairant : « la difficulté la plus redoutable était évidemment de savoir comment demeurer Turc en France. La solution trouvée a été d'insuffler du sang frais, en imposant aux jeunes nés en France le mariage avec des Turcs ou des Turques de Turquie. »(52) Les mariages forcés peuvent aussi correspondre à une marchandisation des jeunes filles. Selon le GAMS, l'union des jeunes filles est parfois monnayée par les familles, celles-ci étant mariées de force à un époux qui obtient ainsi un titre de séjour lui permettant de résider en France. Les filles étant en quelque sorte vendues, il ne s'agit alors ni plus ni moins que d'un viol familial organisé. Quelle qu'en soit la raison, les mariages forcés sont le plus souvent accompagnés de séquestrations et de diverses humiliations ; se concrétisant par des relations sexuelles imposées, niant les droits fondamentaux des femmes mariées de force, ils peuvent être considérés comme une forme moderne d'esclavage. Celles qui veulent rompre ces mariages contractés de force doivent affronter de nombreuses difficultés. Rompre le mariage signifie en effet rompre avec sa famille, et se créer d'énormes difficultés matérielles, spécialement financières, de logement et administratives. Les jeunes filles, lycéennes ou étudiantes, sont particulièrement désarmées ; comment s'opposer à sa famille quand on n'a nulle part où aller et aucun moyen de subvenir à son existence ? Ces difficultés sont encore plus grandes pour les étrangères. Même si celles-ci ne sont pas plus soumises que les autres femmes aux violences domestiques, leur condition est en effet aggravée par leur situation personnelle : la précarité de leur situation juridique, lorsqu'elles n'ont pas de titre de séjour ou que ce titre est de courte durée, est précisément souvent la source de maintes violences, tant physiques que psychologiques. Les maris et belles-familles exercent alors sur elles un véritable chantage aux papiers. En outre, alors que l'isolement et la ghettoïsation rendent particulièrement difficile tout affranchissement de l'oppression familiale, ces femmes craignent souvent de s'adresser aux autorités policières et judiciaires, en qui elles n'ont pas confiance : elles pensent que leur plainte ne sera pas enregistrée et qu'elles risquent l'expulsion. Comme l'a indiqué Mme Gaye Petek, « ce sont elles qui subissent les plus grandes violences, parce qu'elles ne parlent pas français, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir, parce qu'elles n'ont aucune liberté, parce qu'elles n'ont pas de papiers ou seulement des papiers provisoires. Il peut même arriver qu'un mari, lassé de cette femme qui ne lui convient pas, écrive lui-même au préfet pour dire qu'il s'agissait en fait d'un mariage qui lui a été imposé ; le résultat ne se fait pas attendre : ordre de quitter le territoire »(53). Or, retourner au pays est inconcevable, dans la mesure où cela revient pour ces femmes à couvrir leur famille de honte et à signer leur arrêt de mort sociale - voire même, dans certains cas, de mort tout court, d'après Mme Fadila Bent-Abdesselam, de l'ASFAD : « les maris sont Français en France mais Algériens en Algérie (...) ; ils profitent des conventions bilatérales ainsi que du statut des femmes discriminatoire de leur pays d'origine pour y obtenir immédiatement le divorce. Ils ramènent alors souvent du pays une nouvelle épouse, qui subira les mêmes exactions. Les victimes, elles, risquent l'expulsion vers l'Algérie, où, considérées comme le déshonneur de la famille, elles n'échapperont pas à la mort. »(54) L'aide apportée aux victimes de mariages forcés tant par l'État que par les nombreuses associations qui oeuvrent sur le terrain est donc fondamentale. Comme l'a rappelé Mme Joëlle Voisin, chef du service des droits des femmes et de l'égalité, « les victimes de mariages forcés ont la possibilité de bénéficier des dispositifs prévus pour les femmes victimes de violence, notamment les aides financières et les dispositifs d'hébergement. Certaines places leur sont réservées dans des structures d'accueil d'urgence »(55). Le nombre de place est toutefois très limité, et bien inférieur aux besoins réels, tout comme pour les autres besoins d'hébergement d'urgence. Par ailleurs, du fait de la complexité des dispositifs existants, les associations sont un relais crucial pour aider ces femmes à effectuer les démarches nécessaires, notamment auprès des préfectures, pour trouver un logement et des moyens de subsistance. Du point de vue juridique, l'arsenal juridique contre les mariages forcés est actuellement conséquent. D'une part, les règles procédurales du mariage, visent à s'assurer de l'intention réelle du mariage : publications des bans et audition obligatoire des deux futurs époux par un officier de l'état civil(56), possibilité de saisine du Procureur de la République si des indices sérieux permettent de penser que le projet de mariage est dénué d'intentions matrimoniales, consentement donné par les époux, impossibilité de se marier par procuration. D'autre part, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a permis de progresser dans la lutte contre les mariages forcés, dans la mesure où l'officier de l'état civil ou l'autorité consulaire peuvent désormais auditionner séparément les candidats au mariage(57). Si les époux refusent d'être entendus, la transcription du mariage ne peut être effectuée ; le dossier est alors transmis au Parquet, qui peut engager une action en annulation de mariage. Il s'agit là d'une avancée importante. Mais la lutte contre les mariages forcés passe aussi par un travail d'information et de sensibilisation en amont. L'information sur les mariages forcés est donnée sur les plates-formes de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Le nouveau contrat d'accueil et d'intégration (CAI) stipule explicitement l'interdiction en France des mariages forcés. Pour les cas de jeunes filles d'origine étrangère résidant en France et menacées de mariages forcés, les associations tentent, dans la mesure du possible, d'effectuer des médiations avec les familles, et de les convaincre des nombreux inconvénients de ces mariages : interruption des études, grossesses précoces, dépression... Cette tâche est particulièrement difficile, dans la mesure où les parents pensent agir dans l'intérêt de leur fille et ressentent toute incursion dans les affaires de leur famille comme l'effet de comportements racistes et de stigmatisation. Arrivés en France il y a plusieurs décennies, ils vivent en réalité en complet décalage non seulement avec notre société, mais aussi avec celle de leur pays d'origine, qui a depuis beaucoup évolué. Des campagnes de sensibilisation des jeunes filles et des jeunes garçons dans les collèges et lycées, mais aussi des mères dans le cadre des stages d'alphabétisation ou dans les PMI, sont régulièrement organisées. Les jeunes filles sont invitées à la vigilance, par exemple en prévenant des amis si elles craignent d'être emmenées de force à l'étranger, en photocopiant leurs papiers d'identité ou en apprenant par cœur le numéro de leur carte de séjour. 2) La montée des intégrismes entraîne une inquiétante régression de la condition féminine dans les cités Il est difficile de mesurer la réalité des violences faites aux jeunes filles et aux jeunes femmes dans les cités. Il serait réducteur de penser que ces violences ne touchent que les filles et femmes issues de l'immigration, et d'estimer que la vie dans les cités ne se réduit qu'à ces violences. Toutefois, au-delà de la difficulté statistique et du danger de toute généralisation hâtive, il est clair que la condition féminine dans les cités est fragilisée. Comme l'observent l'ensemble des acteurs concernés (police, associations, professeurs, élus locaux,...), l'échec des politiques d'intégration, favorisant la montée des intégrismes religieux et la cristallisation sur certaines aspects des cultures traditionnelles, se traduit malheureusement dans les cités par une tentative d'enfermement des jeunes filles. Dans certaines familles, « la petite fille, jusqu'à un certain âge, est autorisée à voir des copains garçons, à se promener librement ; mais dès qu'elle est pubère, tout cela s'arrête »(58). Les jeunes filles issues de l'immigration maghrébine ou africaine font parfois, à partir de l'adolescence, l'objet d'un contrôle renforcé de la part de leur famille, que ce soit du fait du père, de la mère ou du frère, même plus jeune. La surveillance exercée est rigoureuse ; elle vise au respect d'un ordre moral fondé sur une réinterprétation des traditions, souvent au-delà de ce qui se pratique dans les pays d'origine, et reposant sur le mythe de la virginité(59). « L'honneur de la famille, notion très importante dans ces communautés, repose sur l'honneur de la jeune fille, qui doit rester vierge jusqu'au mariage. »(60) Il s'agit de ne pas risquer d'être stigmatisé par la communauté. Par ricochet, la tentation est forte d'essayer d'imposer cet ordre moral à toutes les filles et femmes vivant dans la cité, qu'elles soient issues de l'immigration ou « Gauloises »(61). Dans les situations les plus tendues, les garçons, chargés de surveiller leurs sœurs, sont éduqués sur la base de l'interdit : pour eux aussi, le sexe est tabou. Garçons et filles ne se connaissent plus, n'apprennent plus à se respecter. Privées des libertés élémentaires d'aller et venir, de se vêtir comme elles le souhaitent, de parler à qui elles le veulent, les jeunes filles, sommées de ne pas « s'occidentaliser », n'ont plus d'autonomie. L'idée sous-jacente est qu'une femme qui revendique les mêmes droits que les hommes est « occidentalisée », c'est-à-dire suspecte de brader sa virginité, couvrant de honte et d'opprobre l'ensemble de sa famille. Cette malheureuse évolution de la condition de la femme dans les cités n'est pas récente, mais remonte à environ une quinzaine d'années. Connu depuis longtemps, le phénomène ne peut plus être passé sous silence. Nous avons tous en mémoire le destin tragique de la petite Sohane, brûlée vive le 4 octobre 2002 dans le local à poubelle d'un immeuble d'une cité de Vitry-sur-Seine, ainsi que la marche des femmes contre les ghettos et pour l'égalité, organisée en 2003 par le collectif « Ni putes, ni soumises ». C'est d'ailleurs, comme l'a souligné Mme Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l'intégration, l'action même de ces femmes qui a fait de leur condition un phénomène d'opinion(62). « Ni putes, ni soumises » : voilà bien là les termes du débat. A l'heure actuelle, pour certaines jeunes filles ou jeunes femmes, le quotidien dans la cité est celui d'une oppression exercée par des garçons s'étant investis de la mission de faire régner un ordre moral fondé sur la soumission des femmes et la négation de leurs droits fondamentaux. Pour être en paix, ces filles sont contraintes de masquer leur féminité : pas de maquillage, pas de robes ni de jupes, ni décolletés ni tenues jugées provocantes. Le voile ou le jogging informe, seuls vêtements leur permettant de circuler dans la cité, ne les préviennent pas contre les insultes ou agressions (sifflets, attouchements...). La cité, les bus, les centres commerciaux, sont devenus des endroits dangereux pour elles, y compris pendant la journée. A l'école, la mixité n'est plus de mise dans les cours de récréation, où filles et garçons ne se mélangent plus. Tout est fait pour imposer aux filles la domination masculine. Dans ce contexte, les jeunes filles ou jeunes femmes n'ont pas le choix : elles se soumettent ou sont punies. Celles qui n'ont pas de frère pour les protéger sont particulièrement en danger. Pour celles qui ne se soumettent pas, les « punitions » sont d'une violence inouïe : passage à tabac, menaces sur la famille, viol collectif ; pour celles qui osent avoir une relation amoureuse qui a été rendue publique, il en est de même. Or, il est alarmant de constater que les adultes peuvent parfois cautionner ces punitions, donnant foi aux rumeurs, propageant les réputations, approuvant le système. Comme l'a indiqué Mme Sihem Habchi, vice-présidente de l'association « Ni putes, ni soumises », après le viol collectif d'une jeune fille de 14 ans, « pour certains habitants de son quartier, la victime était responsable de ce qui lui est arrivé »(63). C. CONFORTER L'AUTONOMIE JURIDIQUE DE CES FEMMES ET LUTTER CONTRE LES VIOLENCES QU'ELLES SUBISSENT 1) Aider ces femmes à conquérir et conforter leur autonomie juridique a) Dénoncer les conventions bilatérales qui méconnaissent le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et limiter la portée de l'application du statut personnel La France a signé avec de nombreux pays des conventions bilatérales qui imposent aux tribunaux français d'appliquer des codes de la famille discriminatoires envers les femmes. Contraires au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, les normes appliquées par les juges français conformément à ces conventions sont en conflit, non seulement avec notre système légal interne, mais encore avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil de l'Europe, dans un rapport récent, a d'ailleurs exhorté les États parties à la convention et ayant signé de tels accords, à la nécessité de les dénoncer. Constatant que « toutes les femmes vivant dans des États membres du Conseil de l'Europe ont droit à l'égalité et à la dignité dans tous les domaines de la vie », l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité les États membres à refuser de reconnaître les codes de la famille étrangers et les lois relatives au statut personnel qui violent les droits des femmes, et à cesser de les appliquer : « certains États (comme la France) ont conclu des traités avec {certains} pays (le Maroc, par exemple) reconnaissant leurs lois relatives au statut personnel. Il est donc possible, pour les femmes marocaines résidant en France, d'être par exemple unilatéralement répudiées par leur mari, ou de se voir supprimer la garde de leur enfant de plus de sept ans. Il va sans dire que ce sont là de très graves violations des droits de ces femmes, et il serait bon que la France ainsi que tous les autres pays qui ont conclu de tels traités, cessent de respecter de manière inappropriée des lois relatives au statut personnel d'autres pays qui violent les droits des femmes, même si cela implique de renégocier des traités d'amitié dans leur ensemble »(64). Il convient de fait de s'interroger sur l'opportunité de dénoncer ces conventions, qui maintiennent dans une insécurité juridique inacceptable, non seulement certaines femmes immigrées, mais encore des jeunes filles ou jeunes femmes qui ne sont pas immigrées mais nées en France de parents étrangers. En effet, comme l'a rappelé le Haut Conseil à l'intégration, « les femmes françaises d'origine maghrébine ignorent souvent que la nationalité marocaine, algérienne ou tunisienne, transmise par le père, ne se perd pas et qu'elles seront donc considérées dans leur pays d'origine comme des ressortissantes soumises à la loi du pays. En tant que Françaises, elles auront la possibilité de demander l'application de la loi française en France. Certaines conventions bilatérales ont cependant établi des dispositions particulières qui excluent le privilège de juridiction, comme la convention franco-marocaine du 10 août 1981 »(65). La Délégation souscrit à la proposition du Haut Conseil à l'intégration, qui estime que les conventions bilatérales en matière de statut personnel pourraient prévoir que la nationalité du pays de résidence l'emporte, dans la mesure où elle est plus favorable aux droits des personnes. De manière générale, il conviendrait de prévoir l'application de la loi du domicile pour les immigrés installés de façon durable en France (par exemple, ceux porteurs de la carte de résident), afin d'éviter que les femmes soient soumises à l'application d'un statut personnel inégalitaire. b) Améliorer l'information sur les droits des femmes immigrées - Améliorer l'information des primo-arrivantes sur leurs droits Lorsqu'elles arrivent en France, les femmes immigrées ignorent souvent que la France n'admet pas certaines pratiques, telles que la polygamie, la répudiation ou les mutilations sexuelles ; parfois, elles ne savent pas non plus que la France reconnaît l'égalité des hommes et des femmes, et n'ont qu'une connaissance imprécise de notre système juridique, culturel et social. L'information sur les droits doit se faire en tout premier lieu dès la délivrance du visa, dans nos ambassades et consulats. Il est donc nécessaire de renforcer la formation du personnel diplomatique sur la question des droits des femmes. Comme l'a indiqué Mme Damarys Maa, présidente d'Initiatives des femmes africaines de France et d'Europe (IFAFE), « si les informations nécessaires étaient données, dès le départ, par le consulat qui délivre le visa, la femme immigrante saurait qu'il existe des associations qui peuvent l'aider et surtout qu'elle jouit de certains droits »(66). Une fois en France, le contrat d'accueil et d'intégration, ainsi que la procédure d'accueil rénovée, constituent un pas important dans l'amélioration de l'information des primo-arrivantes sur leurs droits. Créée par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) est chargée de l'accueil des primo-arrivants et primo-arrivantes(67). A l'issue de la procédure d'obtention de papiers, les immigrés en situation régulière sont accueillis dans les « plates-formes » de l'agence, implantées sur l'ensemble du territoire français. Les immigrés(68) bénéficiaires de titres de séjour de plus de trois mois et qui sont dans un projet d'installation durable, sont invités à signer un contrat d'accueil et d'intégration (CAI)(69). Ce contrat a pour objectif de contractualiser les engagements réciproques du nouvel arrivant et de l'État. Il mentionne le principe d'égalité entre hommes et femmes, celui de l'égal accès à l'éducation des filles et des garçons, le caractère illégal des mariages forcés, ainsi que le respect prévu par la loi de l'intégrité physique et de la monogamie. Sa signature n'est pas obligatoire : depuis son démarrage en juillet 2003, plus de 60 000 contrats ont été signés. Les personnes passant par les plates-formes sont à 55 % des femmes, mais elles ne représentent que 52,5 % des signataires. Les nouveaux arrivants bénéficient d'une réunion d'accueil collectif, ainsi que d'un entretien individuel avec un auditeur social, qui peut être l'occasion d'informer les femmes sur leurs droits spécifiques. Ils sont en outre conviés à deux journées d'information, la journée de formation civique, obligatoire, et la journée d'information sur la vie en France, facultative. Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) est chargé d'organiser la formation civique, obligatoire pour tous les signataires du CAI. D'une durée de six heures, elle se déroule, si possible, dans un délai d'un mois après la séance d'accueil organisée par l'ANAEM. Elle consiste en une présentation des principes et des institutions de la République française. Cette journée se déroule généralement dans le chef lieu du département, dans un local accessible en transports en commun ; elle peut être en principe organisée dans les principales langues des pays d'origine. Le FASILD organise aussi la journée d'information facultative sur la vie en France, qui permet d'informer les immigrés sur les services publics de santé, d'éducation, de logement, de formation et d'emploi. Ces deux journées, et notamment la journée obligatoire de formation civique, constituent une étape indispensable dans l'accueil et l'information des femmes immigrées, notamment car elles y sont destinataires d'une information qui n'est pas contrôlée par leurs maris. Par ailleurs, l'information sur les droits des femmes y est diffusée non seulement en direction de celles-ci, mais aussi des hommes : en tant que pères, frères ou époux, ces derniers doivent être au fait de ce qui se pratique en France, et conscients que notre République reconnaît l'égalité entre les hommes et les femmes, interdit la polygamie, lutte contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles. Le but de cette procédure n'est pas d'imposer une quelconque morale aux immigrés, mais bien de les informer sur l'état du droit en France ; tout comme n'importe quelle personne vivant en France, ils ont obligation de respecter la loi, et c'est à ce titre que l'État les informe de notre législation. En outre, les nouvelles arrivantes se voient, le cas échéant, proposer une formation linguistique adaptée à leurs besoins, organisée par le FASILD. Le suivi des formations civique et linguistique donne lieu à la délivrance d'une attestation, ainsi que, pour la formation linguistique, d'un certificat de validation des compétences acquises. La conjugaison de l'accueil sur des plates-formes et de la possibilité de signer un contrat d'accueil et d'intégration constitue un progrès indéniable. Ce dispositif est toutefois perfectible. En effet, il apparaît que les informations dispensées le sont encore trop souvent en français, ce qui nuit à leur bonne compréhension par le public concerné. Interrogé sur la question lors de son audition devant la Délégation, M. André Nutte, directeur général de l'ANAEM, a souligné la difficulté d'établir une traduction dans toutes les langues, dans la mesure où les plates-formes accueillent près de 145 nationalités. Il a par ailleurs rappelé que, de par le passé colonial de la France et les liens particuliers unissant notre pays et les pays du Maghreb et d'Afrique francophone, nombreux sont les primo-arrivants qui pratiquent notre langue(70). Malgré la distribution de nombreux documents en langues étrangères, concernant des sujets aussi divers que la prévention du cancer du col de l'utérus et l'excision, l'amélioration de l'interprétariat demeure un objectif, dans la mesure où il permet d'assurer une diffusion de l'information la plus large possible. En outre, comme l'a constaté le groupe de travail « Femmes de l'immigration », « s'ajoutent à ces difficultés, les obstructions volontaires ou involontaires qu'occasionnent parfois les maris, pères ou frères »(71)qui accompagnent les femmes sur les plates-formes. Peut-être conviendrait-il de s'interroger sur la nécessité d'obliger les femmes à se rendre seules, éventuellement avec un interprète, aux entretiens individuels organisés dans le cadre de la procédure d'accueil, et à la signature du CAI. La Délégation estime par ailleurs qu'il serait souhaitable que le fonctionnement de la journée d'instruction civique soit amélioré par la constitution de groupes homogènes, tant du point de vue de la langue que de celui du niveau d'éducation. De plus, lors de son audition, Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du FASILD, a estimé qu'il serait nécessaire que la journée d'information « Vivre en France » soit rendue obligatoire(72) ; la Délégation approuve cette proposition, dans la mesure où cela permettrait de compléter l'information des femmes immigrées sur des aspects décisifs pour leur vie quotidienne. La Délégation approuve le projet de réalisation du guide de l'égalité des hommes et femmes de l'immigration, que Mme Catherine Vautrin a demandé au service des droits des femmes de réaliser, afin qu'il soit remis systématiquement sur les plates-formes. Il serait également souhaitable que soit rendue systématique la pratique de certains préfets, qui organisent, selon M. André Nutte, des séances officielles de signature de CAI, ainsi que la diffusion aux communes de la liste des personnes ayant signé un tel contrat. La première mesure aurait pour avantage de souligner par sa solennité l'importance des engagements réciproques de l'État et de l'immigré ; la seconde, quant à elle, permettrait aux municipalités qui le souhaitent de mettre en œuvre des actions ciblées à l'attention des immigrés s'étant engagés dans une démarche volontaire d'intégration. Enfin, il convient de s'interroger sur l'opportunité de rendre obligatoire la signature du contrat d'accueil et d'intégration. Comme l'a indiqué Mme Gaye Petek, « les immigrants doivent être accueillis par des Français et non pas par leur réseau communautaire où les femmes, en particulier, sont immédiatement placées sous la coupe de la famille, dans la norme du groupe, sous la surveillance des imams et des belles-mères »(73). En rendant obligatoire la signature du CAI, l'État se donnerait les moyens d'éviter que les femmes immigrées soient d'emblée intégrées dans des circuits familiaux menant à leur ghettoïsation. - Améliorer l'information à destination des femmes déjà présentes sur le sol français Comme l'a exprimé Mme Catherine Vautrin lors de son audition, « la pleine connaissance de leurs droits par les femmes de l'immigration se heurte non seulement à la barrière de la langue mais aussi à l'enchevêtrement et à la complexité des textes »(74). Les normes applicables aux femmes immigrées sont, on l'a vu, nombreuses et complexes. Ces femmes ignorent souvent qu'elles peuvent dans certains cas faire appliquer la législation française, souvent plus favorable. En matière de divorce, par exemple, nombreuses sont celles qui ne savent pas que, même si elles se sont mariées à l'étranger, elles peuvent saisir la juridiction française, dès lors que le domicile conjugal se situe en France ou que les enfants y ont leur résidence habituelle. Elles laissent ainsi leurs maris saisir les juridictions de leurs pays d'origine, qui appliquent alors un droit qui leur est moins favorable. La question de la diffusion de l'information à destination des femmes déjà présentes sur le sol français est très complexe. D'une part, nombreuses sont les femmes qui vivent dans notre pays depuis des décennies sans maîtriser notre langue, ce qui est inacceptable, la barrière de la langue étant en effet pour ces femmes un obstacle infranchissable dans l'accès à leurs droits. D'autre part, du fait de la multiplicité des acteurs concernés (mairies, préfectures, PMI, associations, FASILD, ...), même les femmes parlant notre langue ne sont pas toujours en mesure d'accéder à leurs droits. Il n'est pas aisé de diffuser de l'information auprès du public spécifique que ces femmes constituent, dans la mesure où elles n'ont en commun que la qualité de femme immigrée. La meilleure façon de s'assurer d'une bonne diffusion des messages à leur encontre est donc que celle-ci soit la plus large possible. Pour les femmes ayant des enfants, les centres de PMI(75) sont un bon lieu de diffusion de l'information ; par la suite, les différentes brochures diffusées dans les mairies, préfectures, centres d'informations, ou encore associations, sont un vecteur de diffusion essentiel. L'amélioration de la formation des professionnels sur les droits des femmes issues de l'immigration est en outre un objectif essentiel. Il ressort en effet clairement des auditions effectuées par la Délégation que les droits de ces femmes ne sont pas toujours connus non seulement des travailleurs sociaux, mais encore parfois des juristes qu'elles rencontrent. Aussi est-il nécessaire d'améliorer la formation juridique des personnes chargées de l'accueil et de l'écoute des femmes immigrées, ainsi que de veiller à une application uniforme de la loi sur l'ensemble du territoire, par une amélioration de la formation juridique des magistrats. Le GAMS, par exemple, mène des actions d'information auprès des élèves de l'École nationale de la magistrature. La Délégation estime que toutes les actions de ce type doivent être encouragées. 2) Lutter contre la violence que ces femmes subissent a) Lutter contre la violence domestique spécifique qui s'exerce sur ces femmes Alors que perdurent dans la société française des préjugés culturalistes admettant comme « coutumes » les violences ou contraintes imposées à certaines femmes au nom de la tradition de leur pays d'origine, la vigilance est plus que jamais de mise. Ces préjugés, fondés sur une approche communautariste de la société qui a d'ores et déjà montré ses limites dans d'autres pays, conduisent en fait à tolérer l'intolérable. « Les Suédois, et notamment les féministes suédoises, ont pris conscience que le relativisme culturel avait conduit à tolérer pour les autres ce qu'on ne tolère pas chez soi. »(76) - Aider les femmes à sortir de la polygamie Du fait de la méconnaissance, par les femmes concernées, du tissu associatif et des différentes administrations, ainsi que de leur incompréhension des mécanismes administratifs et sociaux, du fait encore de leurs difficultés d'orientation et de déplacement (y compris pour des femmes vivant depuis longtemps en France), la décohabitation est, pour les femmes polygames, particulièrement difficile. En outre, leur demander de décohabiter revient à leur demander d'assumer le rôle de chef de famille monoparentale, avec de nombreux enfants à charge et, dans la plupart des cas, aucune ressource. Il est difficile d'envisager de mettre en œuvre une politique de soutien tant que l'ampleur du phénomène de cohabitation polygame n'est pas connu. La Délégation approuve à cet égard la demande d'enquête conjointe commandée à la CNAF et à la MSA. Comme l'a précisé lors de son audition Mme Joëlle Voisin, chef du service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE), « le relogement ne saurait à lui seul apporter la solution au problème de la décohabitation »(77). La politique de relogement doit en effet s'accompagner d'une politique de soutien des femmes, que l'on doit aider à retrouver des repères et à se former afin de trouver un emploi. Par ailleurs, il serait souhaitable de verser à un tuteur extérieur à la famille les prestations familiales, afin d'éviter qu'elle soient détournées de leur objet. Cette mesure apparaît comme le seul moyen de s'assurer que les prestations bénéficient réellement aux enfants. La Délégation souhaite, de plus, que soit mise en œuvre une coopération avec les pays d'origine afin de diffuser l'information sur l'interdiction de la polygamie sur le sol français. Il s'agit d'éviter que des femmes viennent en France sans savoir que la polygamie y est interdite. - Continuer la lutte contre les mutilations sexuelles « Les violences dont sont victimes les femmes issues de l'immigration n'appellent pas une réponse spécifique : ce sont des violences faites aux femmes, qui doivent être traitées comme telles, indépendamment de l'origine des victimes. »(78) Les propos de Mme Sihem Habchi sont particulièrement pertinents en ce qui concerne les mutilations sexuelles, qui ne doivent en aucun cas être l'objet d'une quelconque tolérance culturaliste. La lutte contre les mutilations sexuelles doit ainsi, en premier lieu, passer par un renforcement de la prévention : information des familles au sein des représentations à l'étranger, campagnes à destination des étrangers présents sur notre territoire, réaffirmation de l'interdiction des mutilations sexuelles lors de l'accueil des primo-arrivants. A l'heure actuelle, les mutilations commises à l'étranger sur des fillettes de nationalité française peuvent être sanctionnées (article 113-7 du code pénal). En revanche, la loi française ne s'applique pas pour des mutilations sexuelles commises à l'étranger sur des mineures résidant habituellement en France mais de nationalité étrangère. Or, l'histoire de la lutte contre les mutilations sexuelles a montré que la répression était efficace ; celle-ci doit donc être poursuivie. A cet effet, la loi pourrait être modifiée, pour sanctionner les parents ayant fait procéder à l'étranger à des mutilations sexuelles sur leur enfant mineur étranger mais résidant habituellement en France. Le rôle des médecins dans la prévention et le signalement des mutilations sexuelles doivent être renforcés, tout comme celui du personnel scolaire. Les auditions ont révélé l'importance des visites médicales à l'école, les parents ayant peur que celles-ci permettent de mettre à jour d'éventuelles mutilations sexuelles subies par leurs enfants. A l'heure actuelle, l'article L. 541-1 du code de l'Éducation prévoit que tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de leur sixième année. Il conviendrait d'établir aussi une visite médicale obligatoire au cours de la dernière année de l'école primaire. Les magistrats et les policiers, devraient être eux aussi sensibilisés à ces problèmes. Enfin, le délai de prescription des actes de mutilation sexuelle est actuellement de dix ans. Ils ne sont pas spécifiquement qualifiés d'agressions sexuelles et ne sont pas mentionnés parmi les crimes inscrits à l'article 706-47 du code de la procédure pénale, qui établit une prescription de vingt ans à compter de la majorité de la victime. Or, ces mutilations peuvent être exercées sur des fillettes, voire même sur des nourrissons. Le délai de prescription actuel des mutilations sexuelles est donc tout à fait insuffisant. Comme l'a indiqué à la Délégation Mme Joëlle Voisin, chef du service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE), si les mutilations sexuelles féminines sont déjà pénalement réprimées, l'objectif est de rendre la répression plus effective. Il conviendrait ainsi d'allonger le délai de prescription, en matière d'action publique, à vingt ans et ce à compter de la majorité de la victime(79). - Lutter contre les mariages forcés La lutte contre les mariages forcés peut s'opérer par plusieurs canaux. En premier lieu, les services d'état civil à l'étranger devraient être appelés à la plus grande vigilance, notamment au moment de la transcription du mariage, et régulièrement informés de la faculté qu'ils ont de suspendre cette transcription et d'alerter le procureur de la République en cas de doute sur la réalité du consentement des époux(80). La Délégation adhère à l'opinion de Mme Claudie Lesselier, présidente du Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées (RAJFIRE)(81), qui lui a indiqué qu'il serait utile qu'il y ait, dans chaque consulat, un responsable des mariages forcés, auquel les jeunes filles françaises ou les mineures étrangères résidant habituellement en France, victimes de mariage forcé et de séquestration, pourraient s'adresser en urgence. En outre, l'audition des futurs époux par les agents diplomatiques et consulaires n'est pas systématique, puisque ces agents peuvent juger qu'elle n'est pas nécessaire ou que celle-ci n'est pas effectuée « en cas d'impossibilité ». La Délégation estime primordial que cette audition des futurs époux soit, dans tous les cas, rendue obligatoire, et que les époux soient entendus séparément. Actuellement, seules les jeunes filles de nationalité française sont secourues dans les consulats. Il paraît normal d'étendre ce dispositif aux jeunes mineures étrangères résidant habituellement en France, dont un certain nombre seront automatiquement françaises dès qu'elles atteindront 18 ans, et qui sont amenées à l'étranger par leurs parents pour y être mariées de force. L'harmonisation de l'âge nubile entre les hommes et les femmes serait également une mesure simple et de nature à empêcher un grand nombre de mariages forcés. En effet, établir à 18 ans, et non à 15 ans comme c'est le cas aujourd'hui, l'âge nubile des jeunes filles, leur laisserait le temps d'acquérir la maturité nécessaire pour s'opposer à un mariage imposé par leur famille. Un argument supplémentaire à cette harmonisation réside dans le fait que la différence d'âge nubile entre filles et garçons est contraire au principe d'égalité et qu'elle constitue une discrimination entre filles et garçons. Cette harmonisation est souhaitée par de nombreuses instances, comme le Haut Conseil à l'intégration, ainsi que par les associations concernées. Le Sénat a quant à lui adopté, en première lecture, une proposition de loi modifiant notamment l'article 144 du code civil et portant à 18 ans révolus l'âge du mariage pour les hommes et les femmes(82). D'autre part, il est actuellement envisagé d'instaurer un délit de contrainte au mariage forcé, avec aggravation des peines si la victime est mineure ou vulnérable, ainsi qu'une application de ces incriminations pour un délit commis à l'étranger par une personne étrangère résidant habituellement en France. Les associations ne sont pas toutes favorables à cette pénalisation, au motif qu'elle entraînerait une trop grande pression psychologique pour les jeunes filles. Elles estiment ainsi qu'il vaut mieux utiliser l'arsenal juridique existant : harcèlement, violences, menaces sous conditions et violence constituent déjà des délits, tandis que l'article 146 du code civil prévoit qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Ces arguments ne sauraient être sous-estimés. Toutefois, la pénalisation des mariages forcés aurait une portée symbolique forte, celle de signifier aux familles qu'en France, on ne marie pas les filles sans leur consentement. C'est pourquoi la Délégation se prononce en faveur de cette mesure. De plus, la Délégation souscrit à la proposition du Haut Conseil à l'intégration de modifier le code civil, afin que le ministère public soit habilité à demander l'annulation en justice d'un mariage lorsque le consentement des époux a été obtenu par fraude, violence ou contrainte. Cette disposition permettrait notamment de mettre un terme aux mariages arrangés par les parents contre une compensation financière, puisque ceux-ci seraient contraints d'en rembourser le montant si le mariage était annulé. Il conviendrait en outre de prévoir un dispositif d'accueil pour les jeunes filles ou femmes qui fuient les mariages forcés ; comme nous l'avons exposé précédemment, il leur est en effet très difficile, lorsqu'elles ne disposent d'aucunes ressources, de s'opposer à de tels mariages. Or, les associations auditionnées par la Délégation ont toutes souligné le manque d'hébergement d'urgence à leur intention. Enfin, des campagnes de prévention devraient être régulièrement organisées. Il serait utile de lancer une campagne de communication dans les medias, notamment communautaires, à destination des parents. Des campagnes de prévention pourraient être régulièrement organisées ; à l'école, en direction notamment des 15-18 ans et des professeurs, qui devraient être sensibilisés à identifier les changements de comportement, mais aussi en direction des magistrats et des officiers d'état civil et du grand public. b) Combattre le sexisme dans les cités et réaffirmer le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes Prises en étau entre des traditions familiales perpétuant l'inégalité entre les hommes et les femmes, et leur légitime désir d'émancipation, les jeunes filles vivant dans les cités ont parfois du mal à mener leur vie librement. Cette situation a longtemps été acceptée par les pouvoirs publics, pour des motifs culturalistes, et dans l'espoir d'acheter en retour une certaine paix sociale ; il s'agit là toutefois d'un marché de dupes dont la République risque fort de faire les frais. Comme l'a exprimé Mme Sihem Habchi, vice-présidente de l'association « Ni putes, ni soumises », « l'oppression de la femme par l'homme commence très tôt. C'est en multipliant les concessions que l'on rend possible cette oppression et qu'on lui permet de produire des effets durables »(83). Ne pas transiger sur les principes, c'est permettre que la loi s'applique de la même façon partout sur notre territoire, et donner aux jeunes filles issues de l'immigration la possibilité de vivre comme toutes les jeunes filles de notre pays. Une des principales raisons de la cristallisation sur des traditions revisitées et fantasmées, provient de ce que certains de ces enfants de l'immigration ne se sentent pas Français, et préfèrent se replier sur leurs communautés d'origine. Il est donc important de faire progresser chez ces jeunes leur sentiment d'appartenance à la Nation, et ainsi la conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Comme l'a suggéré lors de son audition Mme Blandine Kriegel, « la panne de l'intégration a sans doute un rapport avec le départ d'enseignement des humanistes classiques »(84). Il faut enseigner à nouveaux les droits de l'homme, l'histoire de la pensée et des idées, non seulement à l'université, mais aussi à l'école, pour que ces connaissances se répandent dans la société. Pour cela, il serait bon que l'Éducation nationale mette en place une journée d'éducation civique réaffirmant les grands principes de notre République (liberté, égalité, fraternité, laïcité, égalité entre les hommes et les femmes, démocratie). Il ne faut pas craindre, en outre, de prôner des valeurs qui peuvent paraître désuètes, comme le respect ou la politesse. Les professeurs doivent en outre être préparés aux problèmes spécifiques des quartiers, afin qu'ils soient en mesure d'appréhender la complexité des enjeux et de proposer des perspectives à des enfants, filles comme garçons, qui ressentent douloureusement un sentiment d'exclusion de la communauté nationale. La formation à l'IUFM pourrait comprendre un stage obligatoire en ZEP. Peut-être faudrait-il cesser aussi d'affecter des professeurs inexpérimentés dans les zones d'éducation prioritaires, notamment en mettant en place des incitations fortes en terme de carrière et de rémunération pour que des professeurs plus expérimentés aient envie d'y être affectés. On pourrait imaginer, par exemple, que les années passées en ZEP compte plus que les autres dans le calcul de la retraite (deux années comptant pour trois). En cas de primo-affectation dans une ZEP, les jeunes professeurs devraient pouvoir bénéficier d'un tutorat de la part de leurs aînés. En outre, il serait sans doute utile de dégager dans l'emploi du temps des professeurs un volume horaire leur permettant de rencontrer les parents, par exemple en organisant des permanences, afin de créer des lieux d'échanges entre parents et enseignants. Il s'agit enfin de faire évoluer les mentalités dans l'ensemble de la société, notamment par le biais d'organisation de campagnes de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'association « Ni putes, ni soumises », vient de publier un guide du respect mutuel, avec le soutien du ministère chargé des droits des femmes. Destiné aux jeunes générations, il a été diffusé à plus de 100 000 exemplaires. La Délégation estime que toutes initiatives de ce type doivent être soutenues, tout comme l'organisation de campagnes d'information à destination des jeunes, afin d'apprendre aux filles et aux garçons à vivre dans le respect réciproque. II. DES FEMMES CONNAISSANT UNE INSERTION DANS LE MARCHÉ DU TRAVAIL MARQUÉE PAR LA PRÉCARITÉ ET CONTRE LAQUELLE IL FAUT LUTTER Alors que les femmes immigrées sont de plus en plus nombreuses, leurs conditions d'accès à l'emploi restent mauvaises. Certes, la situation des femmes immigrées par rapport à l'emploi n'est pas homogène, et dépend de facteurs tels que le niveau d'éducation et l'expérience professionnelle antérieure, ainsi que le pays d'origine. Toutefois, au-delà de la diversité, les femmes immigrées font face à la même double discrimination à l'embauche ; en tant que femmes et en tant qu'immigrées, elles ont une probabilité plus forte d'être au chômage et d'avoir un emploi précaire que leurs homologues masculins et que les autres femmes. Cette situation est d'autant plus dommageable que le travail s'avère facteur d'autonomie et d'intégration, dans la mesure où il leur permet de sortir de l'isolement de la cellule familiale. A. DES FEMMES IMMIGRÉES DE PLUS EN PLUS ACTIVES MAIS PRÉCARISÉES L'accès au travail des femmes de l'immigration est une question d'importance, dans la mesure où celui-ci est une des clés de leur intégration dans la société. Or, travailler lorsqu'on est une femme immigrée ne va pas de soi, pour une multiplicité de raisons : barrière de la langue, problèmes de qualification, discriminations à l'embauche, pression éventuellement exercée par les proches, contraintes de garde d'enfants, ou encore de transport. Malgré ces difficultés, les femmes immigrées sont aujourd'hui de plus en plus actives. Mais les caractéristiques de leur emploi - elles sont plus sujettes au chômage et aux emplois précaires - reflètent leur vulnérabilité. Au bas de l'échelle salariale, les femmes immigrées se trouvent aussi au bas de l'échelle sociale, vivant dans des logements plus petits que la moyenne (et pour un tiers surpeuplés) avec un niveau de vie par ménage inférieur de 26 % à celui des autres ménages. 1) Des femmes immigrées de plus en plus actives Bien qu'elles demeurent minoritaires parmi les actifs immigrés, les femmes immigrées sont de plus en plus nombreuses à travailler ; leur taux d'activité a ainsi connu une progression de 4,7 points entre 1992 et 2002(85). Alors qu'elles ne représentaient en 1990 que 35 % des actifs immigrés, elles en représentent aujourd'hui 41 %. Cette progression explique l'augmentation du nombre d'immigrés actifs depuis 1990. Toutefois, malgré un effet de rattrapage, et contrairement aux hommes, qui connaissent des taux d'activité comparables à ceux des nationaux, les femmes immigrées ont un taux d'activité demeurant nettement inférieur à celui des Françaises. De 15 à 64 ans, elles sont 57,1 % à travailler, contre 63,1 % pour l'ensemble des femmes de cette même tranche d'âge. Taux d'activité par sexe et âge en 1992 et 2002 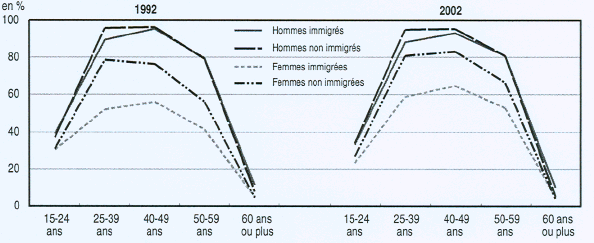 Source : Insee Première, septembre 2005 Cette moyenne cache de fortes disparités, en fonction de l'âge, de la provenance et de la situation professionnelle antérieure. Plus les immigrées sont jeunes, plus elles sont actives, notamment lorsqu'elles proviennent d'Asie du Sud-Est. Le rapport à l'emploi semble de fait fortement conditionné par le pays d'origine. 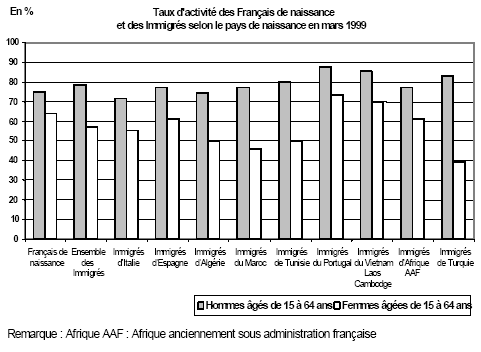 Source : Insee recensement 1999 (Extrait : « Les défis de l'immigration future », Conseil économique et social, 2003) Les femmes turques ont le taux d'activité le plus faible. Viennent ensuite les Algériennes, les Marocaines et les Tunisiennes, puis les Italiennes, qui ont toutes un taux d'activité inférieur à celui des femmes immigrées et des Françaises. Les femmes d'Afrique francophone ont un taux d'activité supérieur à celui de l'ensemble des immigrées, mais inférieur à celui des Françaises. Les Portugaises ont un taux d'activité supérieur aux Françaises et à l'ensemble des immigrées, tout comme les Laotiennes, Cambodgiennes et Vietnamiennes. 2) Des travailleuses précarisées a) Des femmes plus sujettes au chômage et à l'emploi précaire Il est évident que les immigrés ont, de manière générale, plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail que l'ensemble de la population ; ce constat a d'ailleurs été, très récemment encore, corroboré par des données que l'INSEE a rendues publiques(86). Il convient toutefois de souligner qu'au sein même de la population immigrée, les femmes sont les plus fragiles, connaissant des risques de chômage et d'emploi précaire encore plus élevés. Le taux de chômage des femmes immigrées, de l'ordre de 20 %, est près du double de celui des Françaises (environ 11 %). Comme pour le taux d'activité, ce taux moyen masque de fortes disparités en fonction du pays d'origine. Ainsi, les immigrées venues d'Italie, d'Espagne ou du Portugal ont des taux de chômage inférieurs à celui de l'ensemble des immigrées et des Françaises. A l'inverse, les femmes venant du Maghreb, de Turquie ou d'Afrique ont un risque de chômage très élevé, supérieur à celui des Françaises et des immigrées en général. Taux de chômage des Français de naissance et des immigrés selon le pays 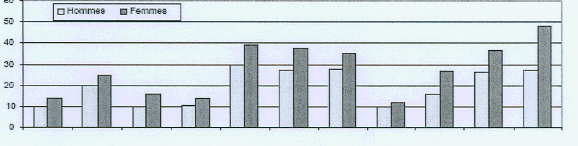 France Ensemble Italie Espagne Algérie Maroc Tunisie Portugal Vietnam Afrique Turquie des immigrés Laos AAF Cambodge Remarque : Afrique AAF : Afrique anciennement sous administration française Source : Insee recensement 1999 En outre, les immigrées sont plus nombreuses que l'ensemble des femmes à occuper un emploi à temps partiel (37 % contre 31 %), ce temps partiel étant majoritairement du temps partiel subi. b) Une concentration dans certains secteurs Malgré une progression de leur niveau d'études, l'emploi des femmes immigrées reste concentré dans des secteurs d'activité précis et concerne essentiellement des fonctions d'exécution. Les femmes immigrées connaissent peu la promotion et la mobilité professionnelle. Seules 8,8 % d'entre elles sont cadres (contre 11 % environ pour les autres femmes). La proportion d'employées parmi les femmes immigrées est la même que la proportion d'employées parmi les Françaises, mais les femmes immigrées travaillent plus sous des statuts précaires (intérim, CDD, emplois aidés dans le secteur public ou privé). En outre, parmi les huit principales professions exercées par les femmes immigrées, sept sont des professions non-qualifiées (contre trois pour les Françaises). Les femmes immigrées travaillent essentiellement dans les services (restauration, tourisme, emplois familiaux...), sur des postes ne nécessitant pas de qualification pointue ni de réelle maîtrise de la langue française (agent d'entretien, garde d'enfants, ménage, gardiennage...). Les métiers familiaux, dits de « services directs aux particuliers », emploient près du quart des femmes immigrées (23 % contre 12 % pour la population féminine totale). Occupant des emplois peu rémunérés et ayant le plus souvent des carrières courtes et entrecoupées de périodes d'inactivité ou de travail non déclaré, les femmes immigrées risquent de ne pas disposer de ressources suffisantes au moment de leur retraite. B. DE L'ÉCOLE AU TRAVAIL : LA DIFFICILE INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES ISSUES DE L'IMMIGRATION 1) Quelle réussite scolaire pour les jeunes filles issues de l'immigration ? a) Des caractéristiques sociales et familiales discriminantes pour les enfants de la « deuxième génération » La France compte 2,35 millions de descendants directs d'immigrés âgés de 0 à 65 ans, soit environ 5 % de la population. Parmi eux, un million ont moins de 17 ans(87). Un sixième des élèves de l'Éducation nationale a un ou deux parents immigrés. La plupart des études menées sur le sujet(88) montrent que les enfants d'immigrés sont particulièrement sujets à l'échec scolaire. Un tiers des enfants dont les deux parents sont immigrés redouble à l'école élémentaire, contre un cinquième quand aucun ou un seul des parents est immigré. Cette tendance perdure tout au long de la scolarité : seul un peu plus du tiers des enfants d'immigrés parvient en seconde générale et technologique sans avoir redoublé, contre la moitié pour les autres élèves ; moins d'un quart des enfants d'immigrés obtient le baccalauréat sans avoir redoublé, contre près du tiers des enfants de familles mixtes ou non-immigrées. Ceci s'explique par un environnement peu propice à la réussite scolaire. Les enfants d'immigrés cumulent les caractéristiques sociales et culturelles liées à l'échec scolaire : concentration géographique en zone d'éducation prioritaire, parents pour la plupart ouvriers ou non-qualifiés et n'ayant pas poursuivi d'études au-delà de l'enseignement primaire, mères peu ou pas insérées professionnellement, logements surpeuplés, difficultés de maîtrise de la langue (les jeunes qui ne parlaient pas le français dans leur famille pendant leur enfance, ou qui n'ont pas appris le français dans leur petite enfance, connaissent plus l'échec scolaire). En outre, faute de soutien de la part de parents qui ne maîtrisent pas le système scolaire, les enfants issus de l'immigration, qu'ils soient ou non de nationalité française, connaissent des difficultés d'orientation. Sauf à avoir des résultats scolaires exemplaires, ils ne sont que rarement, à résultats équivalents, orientés en fonction de leur appétence pour une matière et sont plus souvent orientés vers des filières professionnelles que les autres enfants. Pour ceux allant jusqu'au baccalauréat, et malgré la démocratisation de l'enseignement, la difficulté de mener à bien ses études est encore accrue par la contrainte financière. Alors qu'ils doivent souvent travailler pour pouvoir étudier, ces jeunes ont le sentiment de devoir s'investir doublement pour obtenir des diplômes qui ne leur ouvriront pas, du fait des discriminations qu'ils auront à subir dans leur vie professionnelle, les mêmes portes que les enfants d'origine française. Pourtant, quelques études récentes(89) semblent montrer qu'à conditions sociales et familiales comparables, les enfants d'immigrés ne connaissent pas plus l'échec scolaire que les autres enfants. Cela s'explique notamment, selon l'INSEE, par une plus forte mobilité sociale en bas de l'échelle sociale, ainsi que par des aspirations éducatives plus fortes et des demandes d'orientation plus ambitieuses. Toutefois, ce constat ne doit pas cacher des différences très fortes en fonction du pays d'origine des parents. Les caractéristiques scolaires semblent déterminées par le pays de naissance des parents(90) : les enfants issus de l'immigration d'Afrique du Nord sont plus sujets au redoublement que les autres ; entrés à l'Université, ils sont 46 % à en sortir sans diplôme, contre 29 % pour les jeunes originaires d'Europe du Sud (25 % en moyenne). b) Des jeunes filles qui ne semblent plus croire aux vertus émancipatrices de la réussite scolaire La meilleure réussite scolaire des filles est un phénomène connu, qui existe aussi pour les enfants de l'immigration. Plus performantes que les garçons, les filles redoublent moins et font des études plus longues. Leurs résultats dépendent toutefois de l'origine géographique de leurs parents, qui demeure déterminante. Ainsi, selon une étude menée par Frédéric Lainé et Mahrez Okba, chercheurs à la Dares(91), 27 % des jeunes filles d'origine maghrébine sortent du système scolaire sans diplôme, contre 42 % des jeunes hommes. Mais si la proportion de jeunes femmes d'origine maghrébine atteignant le niveau baccalauréat est plus élevée que celles des garçons, elle reste toutefois bien en deçà de celles des autres filles d'immigrés et des Françaises d'origine. Elles sont, en outre, seulement 20 % à poursuivre des études supérieures, contre 34 % pour les filles originaires d'Europe du Sud et 44 % pour les filles d'origine française. Longtemps présentées comme « les pionnières d'un parcours menant immanquablement à la réussite »(92), les filles issues de l'immigration ont investi l'école comme le lieu de leur réussite et de l'ascension sociale de leurs parents. Réussir à l'école était de plus un moyen de s'émanciper du rôle traditionnel et sexué qui leur était imposé par la permanence des structures familiales traditionnelles. Mais le levier n'a pas fonctionné pleinement. Bien qu'elles aient mieux réussi que les garçons, les jeunes filles de la « seconde génération », ont connu dans les décennies précédentes de réels problèmes d'insertion sur le marché du travail ; à niveaux de qualification équivalents, subissant une double discrimination en tant que femmes et en tant qu'immigrées, elles n'ont pas eu accès aux emplois qu'elles auraient souhaité occuper, et ont connu des taux de chômage supérieurs à la moyenne. Orientées massivement vers les métiers du tertiaire, les jeunes femmes originaires d'Europe du Sud se sont spécialisées dans les métiers du commerce et des services aux particuliers (assistantes maternelles, coiffeuses, femmes de ménage...) ainsi que dans la gestion et dans l'administration. Les jeunes femmes d'origine maghrébine, tout en occupant des emplois dans ces secteurs, se sont orientées aussi vers l'industrie et les métiers manuels. Toutes origines confondues, elles ont souvent été contraintes d'accepter des emplois inférieurs à leurs qualifications pour accéder à une embauche, la plupart du temps sous statut précaire. Prenant acte de ces difficultés, les jeunes filles issues de l'immigration envisagent aujourd'hui l'école et ses vertus émancipatrices et égalisatrices avec plus de recul. Constatant les difficultés d'insertion sur le marché du travail de leurs aînées, qui, elles, avaient beaucoup investi dans leur éducation, ces jeunes filles semblent de moins en moins croire à une quelconque ascension sociale par l'école, et paraissent même capituler. Mettant en œuvre une stratégie d'autolimitation, elles préfèrent s'orienter vers des filières professionnelles moins ambitieuses, mais où elles risquent moins d'échouer : « comme tout a changé, les générations récentes n'ont donc plus autant recours, comme ce fut le cas de leurs aînées, à la réussite scolaire (...). A tort ou à raison, certaines activent d'autres leviers (...) et s'investissent dans d'autres registres (vie familiale, vie amoureuse, mariage, éducation des enfants, activité professionnelle ou associative) au détriment de la réussite scolaire dont certaines ont éprouvé la pénibilité et le faible rendement. »(93) 2) Une insertion professionnelle s'apparentant à une course d'obstacles Comme pour la moyenne des filles, la réussite scolaire n'est pas pour les jeunes filles issues de l'immigration synonyme d'une bonne insertion professionnelle. Le paradoxe n'est qu'apparent, ces jeunes filles souffrant en effet de la conjonction de nombreux handicaps expliquant cette situation : incapacité à mobiliser un réseau de relations au moment de la recherche d'emploi, difficultés à choisir la bonne filière et à financer leurs études, ou encore discriminations ethniques, qui viennent se surajouter aux discriminations sexistes qui les frappent. Rarement inactives, contrairement à leurs mères, les jeunes filles issues de l'immigration connaissent de grandes difficultés d'insertion sur le marché du travail, si bien qu'« au moment où la volonté de travailler est considérée comme une finalité légitime pour filles et garçons, sa réalisation est barrée par des difficultés de tous ordres »(94). Les jeunes femmes issues de l'immigration ont un taux d'emploi moins élevé que celles d'origine française (65,8 % pour les jeunes filles originaires du Maghreb contre 79,5 %)(95). Elles connaissent en outre un déclassement à l'embauche supérieur à celui de leurs homologues masculins et de l'ensemble des jeunes femmes. L'accès au premier emploi se fait dans la grande majorité des cas sous un statut précaire (intérim, CDD ou vacations). Environ 40 % des femmes de l'enseignement supérieur issues de l'immigration accèdent à l'emploi par le temps partiel, contre 22 % pour les Françaises d'origine ; il s'agit bien sûr d'un temps partiel subi. Or, ce déclassement initial a une incidence sur l'ensemble de leur parcours professionnel : il conditionne les opportunités futures et crée, non seulement une frustration par rapport à la sous-utilisation de leurs compétences, mais aussi le sentiment de subir une discrimination. Ces perceptions sont d'autant plus importantes que la succession de « petits boulots » pour financer leurs études sur des postes éprouvants (dans la restauration ou la grande distribution par exemple) donne à ces jeunes filles une image négative du monde de l'entreprise. En outre, celles-ci sont contraintes de cumuler les emplois précaires, la multiplication de contrats à durée déterminée, stages et temps partiels semblant même procéder de la mise en œuvre d'une stratégie d'intégration au marché du travail : « Le fait de multiplier les expériences professionnelles compenserait en quelque sorte l'absence ou la faiblesse du réseau relationnel et permettrait de surmonter les réticences et préjugés des futurs employeurs en faisant la preuve de leur employabilité. »(96) Par ailleurs, les filles issues de l'immigration sont plus touchées par le chômage, que ce soit en comparaison avec les jeunes filles d'origine française ou avec leurs homologues masculins. Parmi elles, ce sont les jeunes filles d'origine maghrébine qui sont les plus menacées : leur taux de chômage est le double de celui des jeunes filles d'origine française et de celles originaires d'Europe du Sud (près de 22 % contre 10 %). Pour celles-ci, comme pour leurs homologues masculins, les différentes formes d'emplois aidés sont alors une voie d'accès à l'emploi cruciale, fournissant environ le tiers des embauches. On comprend un certain découragement. Comme l'a écrit Michèle Tribalat : « La situation sociale des enfants de migrants maghrébins est détestable pour l'ensemble des filles et pour les garçons d'origine algérienne, mauvaise pour les garçons d'origine marocaine ou tunisienne. Il ne s'agit pas là d'un handicap général touchant tous les enfants d'immigrés puisque ceux originaires d'Europe du Sud y échappent. Tout ne s'explique pas par le niveau de formation puisque, à niveau de diplôme équivalent, le surchômage demeure important. »(97) C. LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION ET PERMETTRE AUX FEMMES IMMIGRÉES ET ISSUES DE L'IMMIGRATION DE PRENDRE LEUR PLACE DANS LA SOCIÉTÉ Les discriminations raciales contribuent aux difficultés d'insertion professionnelle des personnes issues de l'immigration. Or, comme l'a rappelé récemment M. Roger Fauroux, dans un rapport remis au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,(98) en dépit d'affirmations volontaristes, la lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances présente toujours des évolutions particulièrement lentes. Cette situation est dommageable non seulement pour les personnes concernées, mais pour l'ensemble de la société. L'intégration économique, pour les immigrés plus encore que pour le reste de la population, est une clé d'intégration sociale ; corrélativement, l'intégration économique des femmes immigrées est un gage d'intégration pour leur famille. Il ne faut en effet pas perdre de vue que le rapport au monde et à la société se construit dès l'enfance. Reprenons ici l'analyse de M. Gérard Noiriel(99) : « la familiarité avec le monde, l'enfant d'immigrant l'acquière tout d'abord au sein de son groupe d'origine (...). Le rôle des femmes - le père étant souvent au-dehors pour son travail - est ici décisif. » Mais il poursuit : « parallèlement, ou plutôt dans un enchevêtrement inextricable, la deuxième génération subit les effets des normes du pays d'accueil ». L'enfant né en France de parents étrangers voit bien, cependant, que les normes de la société d'accueil dévalorisent en permanence sa famille. Conjuguée à une situation économique souvent difficile, cette dévalorisation conduit au sentiment d'être exclu du groupe national dont il fait pourtant partie : « alors que la première génération peut toujours se dire, pour atténuer la souffrance, qu'effectivement le retour "chez soi" est possible, pour la deuxième génération la contradiction est dans les termes, puisque le "chez soi" est en France. » Les femmes immigrées et issues de l'immigration, en tant que femmes et en tant qu'immigrées, souffrent plus encore que les autres du « plafond de verre ». Comment lutter contre cette double discrimination ? 1) Faut-il améliorer la connaissance statistique sur les discriminations subies par les immigrés et les personnes issues de l'immigration ? Actuellement, la mesure de la diversité ethnique se heurte à l'interdiction, récemment encore rappelée par la CNIL(100), d'enregistrer les origines géographiques et nationales des individus ainsi que celles de leurs parents. La loi précise en effet qu'« il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci »(101). Cette interdiction répond au souci d'éviter que des données individuelles relatives aux origines et opinions soient enregistrées et utilisées à des fins discriminatoires. Il est en effet « contraire à la valeur française d'égalité républicaine de considérer une personne à l'aune de ses caractéristiques ethniques »(102). Comme l'a encore récemment rappelé la CNIL, en l'absence d'une définition légale d'indicateurs « ethno-raciaux », les employeurs ne sont donc pas autorisés à recueillir de données relatives à l'origine raciale ou ethnique réelle ou supposée de leurs employés ou candidats à un emploi. Des informations sur l'origine géographique des parents peuvent être collectées, mais uniquement pour les besoins d'une étude particulière. « Il est possible d'étudier la catégorie des femmes d'origine étrangère mais, pour leurs descendantes, qui sont françaises, les chercheurs sont démunis. Alors que la société française est de plus en plus diversifiée, multiculturelle, multiethnique, la conception universaliste abstraite crée un angle mort qui empêche de saisir cette nouvelle configuration. »(103) L'interdiction légale d'enregistrer les origines géographiques et nationales des individus à des fins de consolidation dans une nomenclature standardisée d'usage universel, pour louable qu'elle puisse paraître, semble être précisément aujourd'hui l'obstacle principal à l'amélioration de la connaissance sur les discriminations subies par les immigrés et les personnes issues de l'immigration, et donc à la lutte contre ces discriminations. De fait, cela n'est pas parce que les origines ne sont pas recensées que les discriminations n'existent pas. A l'inverse, l'absence de recensement des données relatives aux origines empêche tant les pouvoirs publics que les chercheurs d'élaborer une analyse fine de la réalité des discriminations. Les auteurs des études statistiques effectuées sur le sujet précisent ainsi souvent la grande difficulté à mener des enquêtes à grande échelle, du fait de l'incomplétude des données recueillies, notamment par l'INSEE. Les employeurs et les décideurs, en l'absence de données chiffrées objectives et incontestables sur les discriminations dans l'entreprise, peuvent quant à eux, parfois même en toute bonne foi, considérer que les personnes immigrées ou issues de l'immigration sont traitées comme les autres dans l'entreprise. A l'heure où la volonté gouvernementale de faire une priorité de la lutte contre les discriminations, notamment par la création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et la désignation d'un ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances, est réelle, il convient sans doute de s'interroger sur l'opportunité de changement des règles relatives à l'enregistrement des données relatives aux origines géographiques et ethniques. Une telle réforme ne fait pas l'unanimité, certains estimant que la prise en compte de l'origine ethnique des individus pourrait aboutir à renforcer les discriminations dont ils sont l'objet, tout en remettant en cause le modèle de l'égalité républicaine et en portant ainsi en germe le risque de dérives communautaristes. Ces arguments ne peuvent être négligés ; de fait, si de telles données étaient collectées, il faudrait s'assurer de leur bonne utilisation. D'autres, à l'inverse, face à l'ampleur du problème de la discrimination à l'embauche, estiment que le pragmatisme s'impose. Le choix qui a été fait pour la parité entre les hommes et les femmes en politique répondait à la même logique. Autoriser la mesure des discriminations dans le monde du travail serait un levier dans la lutte contre ces discriminations, dans la mesure où celle-ci permettrait de mettre un terme à l'invisibilité statistique, qui constitue actuellement véritablement un alibi pour l'inaction. La Commission Fauroux a ainsi proposé d'autoriser le recueil dans les enquêtes du lieu de naissance des parents ou de la nationalité à la naissance. La Délégation, tout en restant prudente sur le sujet, est convaincue que le statu quo n'est pas souhaitable. C'est pourquoi elle estime que la mesure de la diversité doit absolument être mise en œuvre dans l'entreprise, par le biais d'enquêtes sur la diversité reposant sur le volontariat (les salariés étant conviés à renseigner les enquêteurs sur leurs origines). Il faut pouvoir démontrer que les immigrés, et parmi eux plus encore les femmes, ne sont pas présents de la même manière que les autres dans l'entreprise, notamment du point de vue hiérarchique, pour pouvoir lutter contre cette situation. 2) La maîtrise de la langue française par les femmes immigrées : un enjeu fondamental La barrière de la langue a depuis des décennies contraint de nombreuses femmes immigrées à demeurer enclavées dans leur cellule familiale. Ces femmes, dépendantes de traductions effectuées le plus souvent par leur mari, sont dans l'incapacité d'avoir une bonne connaissance de leurs droits. Ne maîtrisant pas notre langue, elles ne sont pas en mesure d'appréhender les circuits administratifs et sociaux susceptibles de leur venir en aide. Lorsqu'elles ont des enfants, la barrière de la langue est aussi un lourd handicap en matière de suivi scolaire ; sans maîtrise du français, elles ont des difficultés non seulement à communiquer avec les enseignants, mais aussi à comprendre comment fonctionne le système et à assurer un quelconque suivi scolaire. En outre, la méconnaissance du français les arrête dans leurs démarches de recherche d'emploi. Pour celles qui travaillent, même si d'autres facteurs rentrent en jeu, les difficultés linguistiques ne sont pas étrangères à leur cantonnement dans des secteurs d'emploi peu qualifiés, comme l'entretien ou la restauration. De fait, un minimum de maîtrise de notre langue est un sésame, non pas suffisant mais néanmoins nécessaire, pour envisager une insertion réussie sur le marché du travail. La maîtrise du français est donc la clé de l'indépendance pour les femmes immigrées, que ce soit du point de vue de la connaissance de leurs droits, de celui de leur indépendance financière ou de leur rôle dans le soutien pédagogique de leurs enfants. C'est ce que la Délégation générale aux langues françaises et aux langues de France (DGLFLF), notamment, a mis en lumière, dans son rapport au Parlement pour 2003 : « une attention particulière doit être portée aux femmes immigrées : ce sont elles qui rencontrent les plus grands obstacles lors de l'insertion professionnelle ; elles éprouvent aussi le plus de difficultés pour accéder à la formation linguistique, en raison de leur situation familiale ou de la pression des traditions culturelles. Enfin, l'évaluation a mis en évidence l'importance primordiale de l'apprentissage de la langue du pays d'accueil pour une intégration réussie.»(104) Prenant acte de ces difficultés, la nouvelle procédure d'accueil des étrangers en France leur propose une formation à la langue française. Gratuite pour les personnes volontaires, le coût étant entièrement pris en charge par l'État, cette formation, d'une durée comprise entre 200 et 500 heures réparties en modules hebdomadaires de 6 à 30 heures, vise à permettre d'atteindre à l'oral un niveau de pratique du français suffisant pour la compréhension des principaux domaines de la vie courante. Organisées par le FASILD dans plusieurs communes de chaque département, ces formations, individualisées et dispensées par des professionnels, sont constituées d'un volume d'heure déterminé à l'issue d'un bilan linguistique individuel. Tous les trois mois, la progression individuelle fait l'objet d'un bilan d'étape. Lorsque l'objectif est atteint, les organismes de formation délivrent une attestation ministérielle de compétences linguistiques (AMCL). Cette formation peut être accompagnée d'un bilan d'orientation pré-professionnelle. Sur les 50 % de primo-arrivants à qui la formation linguistique a été proposée, seuls 54 % la suivent réellement(105). En ce qui concerne les femmes, il est clair que les problèmes de garde d'enfants constituent une des explications de ce manque d'assiduité ; mais il s'explique aussi par l'inadaptation des horaires ou l'incompatibilité avec leur emploi. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a en outre réitéré lors de son audition devant la Délégation(106) son souhait que la délivrance de la carte de résident de dix ans soit soumise à une bonne maîtrise de la langue française. La Délégation soutient cette proposition. Il est impératif d'encourager par tous les moyens l'apprentissage de notre langue. Peut-être serait-il aussi souhaitable, en fonction du niveau des personnes concernées, de rendre la formation linguistique du CAI obligatoire si nécessaire. Dans le même temps, une bonne acculturation passe par une acclimatation progressive. En réalité, pour éviter la déperdition des compétences de ces femmes, il conviendrait aujourd'hui d'encourager par un double mouvement, non seulement l'apprentissage du français, mais aussi l'expression par les femmes immigrées, dans leur langue d'origine, de leurs connaissances et savoir-faire. Reprenons à ce sujet les mots de Nacira Guénif-Souilamas : « avant qu'une femme maîtrise convenablement le français, elle doit avoir la possibilité de transmettre son expérience, son expertise de la vie, avec les ressources qui sont en sa possession, c'est-à-dire avec ses mots à elle. En résumé, il convient d'accepter ce que la femme dit dans sa langue maternelle tout en lui permettant de s'acclimater à l'univers linguistique correspondant à son nouveau contexte de vie. Une telle option implique une plus grande souplesse dans l'acceptation des autres langues dans les lieux symbolisant l'action publique. »(107) 3) Lutter contre les discriminations à l'embauche a) Améliorer la formation et soutenir les démarches d'insertion professionnelle - Soutenir l'insertion professionnelle des femmes immigrées La lutte contre la double discrimination à l'embauche passe en premier lieu par un nécessaire soutien des femmes immigrées dans leur parcours d'insertion professionnelle. La direction de la population et des migrations, en partenariat avec l'ANPE, a ainsi mis en place un programme de partenariat ayant pour objectif d'établir un suivi des primo-arrivantes. La Délégation estime qu'il convient de soutenir toutes initiatives de parrainage ou de soutien des femmes immigrées tant dans le domaine de la recherche d'emploi que dans celui de la création d'entreprise. Fortes de leur diversité et de leur expérience, les femmes immigrées sont parfois porteuses de projets qu'elles ont du mal à concrétiser, du fait des nombreux obstacles qu'elles rencontrent, notamment à cause de leur méconnaissance des dispositifs. La Délégation souhaite que toute initiative visant à leur apporter un soutien soit encouragée. De la même façon, il convient de soutenir tout dispositif visant à améliorer la formation des femmes immigrées. - Améliorer la formation des jeunes filles issues de l'immigration Alors que l'image de la femme immigrée ou d'origine étrangère est le plus souvent dévalorisée, il est essentiel de présenter de façon positive les parcours de réussite. Comme l'a exprimé Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, « mettre en évidence de telles expériences permet aussi d'éviter de tomber systématiquement dans le misérabilisme : il y a des difficultés, mais il y a aussi des réussites de l'immigration, et il faut mettre en avant les possibilités offertes par le modèle républicain »(108). Ces possibilités sont réelles ; nombreuses sont les jeunes filles et femmes étrangères ou d'origine étrangère qui réussissent à mener à bien leur insertion professionnelle, malgré les obstacles qui se trouvent plus encore sur leur route que sur celle de tout un chacun. A l'heure où le Papy Boom s'annonce, il est temps de permettre aux jeunes issus de l'immigration, et parmi eux aux filles, de trouver leur place dans l'entreprise. Pour cela, la diversification des parcours est une donnée essentielle, qui passe sans doute par une amélioration de l'information sur l'orientation à l'école. Alors que leurs parents restent en retrait sur ces questions, par méconnaissance du système scolaire ou parfois aussi de la langue française, il faut aider ces jeunes filles à se mobiliser pour leur futur et à préparer au mieux leur vie professionnelle. L'information sur l'orientation doit être surtout diffusée au collège ; c'est en effet pendant l'adolescence que les jeunes filles doivent commencer à envisager leur futur professionnel ; or, c'est précisément pendant cette période cruciale de construction de soi qu'elles sont le plus confrontées au racisme (qu'elles ressentaient mais ne comprenaient pas réellement quand elles étaient enfants), mais aussi à l'isolement et aux difficultés financières de leurs familles. L'amélioration de la formation passe par deux mouvements complémentaires. Le premier consiste à permettre aux jeunes filles en échec scolaire de ne pas perdre leur temps au collège, mais de se former à un métier. La Délégation estime ainsi nécessaire de revaloriser l'apprentissage, par le biais de campagnes de promotion. Par ailleurs, dans un second mouvement, il est impératif de faire du soutien des élèves les plus assidus à l'école une priorité absolue. Il n'est pas acceptable qu'être une jeune fille issue de l'immigration soit peu ou prou un déterminisme interdisant d'avoir accès aux filières d'études académiques les plus prestigieuses. Les initiatives telles que celles de l'Institut d'Études Politiques de Paris, qui a mis en place un partenariat avec un certain nombre de lycées se situant en ZEP, afin de corriger une inégalité de fait entre leurs élèves et les élèves de quartiers plus favorisés, doivent absolument être encouragées. Il ne s'agit pas là d'une discrimination positive fondée sur l'appartenance ethnique, mais d'une correction d'inégalités structurelles se basant sur des critères sociaux. Comme l'a indiqué à la Délégation Mme Nacira Guénif-Souilamas, « l'idée d'égalité des chances est elle-même contestable car, dans la vie, il ne faut jamais compter sur la chance mais sur la claire réalisation des droits. Il convient plutôt de s'attacher à garantir l'égalité des droits, la chance ne devant intervenir qu'à la marge. L'égalité des chances est une sorte de loto : dans la société, tout le monde tente sa chance et il est anormal que beaucoup de joueurs ne gagnent jamais. D'autant que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations : ceux qui ne peuvent se prévaloir de bons diplômes ne peuvent pas aspirer à entrer dans la catégorie des contribuables qui paient l'impôt de solidarité sur la fortune mais simplement d'avoir une vie digne, de voir reconnaître leurs compétences et de participer à la société »(109). b) Mettre en place la diversité dans les entreprises en luttant contre les stéréotypes et les idées reçues, et en sanctionnant réellement les discriminations Il est clairement ressorti des auditions menées par la Délégation qu'une des difficultés principales dans la lutte pour l'amélioration de la situation des femmes immigrées et issues de l'immigration réside dans leur « invisibilité », celles-ci n'étant pas représentées dans les instances dirigeantes, les syndicats, les associations et les partis. Cette invisibilité explique en partie la permanence de la circulation dans la société d'une image stéréotypée de la femme immigrée. A cet égard, l'État doit mettre en œuvre une politique volontariste permettant de lutter contre les stéréotypes et idées reçues, qui constituent les principaux freins à une réelle diversité dans l'entreprise. Il convient de faire comprendre aux entreprises que la diversité est source d'enrichissement mutuel, et, qu'à l'inverse, se passer de cet enrichissement est un non-sens économique. Pour cela, l'État pourrait en premier lieu faire œuvre de pédagogie en mettant en action dans son propre recrutement une réelle politique de diversité. Sans aller jusqu'à la mise en œuvre stricte d'une politique de quotas basée sur une discrimination positive rigide, tout doit être fait pour que les personnes immigrées ou issues de l'immigration ne soient plus cantonnées aux fonctions subalternes ou d'exécution. Cette politique pourrait s'accompagner d'une campagne de sensibilisation des entreprises au problème de la double discrimination à l'embauche. Au-delà de l'impératif moral et social, et comme l'a justement exprimé M. Louis Schweitzer, président de la HALDE, dans une entretien accordé au journal Les Echos(110), les entreprises ont un intérêt économique à accroître les recrutements de personnes issues de l'immigration ou immigrées. Avec les départs massifs à la retraite des « baby-boomers », celles-ci vont devoir recruter de nombreux salariés ; se priver d'une partie du vivier disponible est un non-sens. En outre, il est indispensable de faire comprendre aux décideurs que la diversité est une source d'enrichissement économique. Pour cela, l'État, qui s'est déjà engagé dans la promotion de la diversité dans l'entreprise (programmes européens Equal/Espere, notamment) doit continuer dans ce sens, spécialement en incitant à l'adoption, au sein des entreprises, de chartes de l'égalité et de la diversité, sur le modèle de celle mise en place par l'Institut Montaigne. Par une telle charte, les entreprises s'engagent, à compétences égales et profils identiques, à favoriser la diversité ethnique dans leur politique de recrutement, de promotion et de salaire, ainsi qu'à former les dirigeants et responsables de ressources humaines aux enjeux de la non-discrimination. Il est tout à fait évident que la situation ne pourra évoluer que si tous les cadres, moyens et supérieurs, sont incités à lutter contre les discriminations. Dans le cadre du projet européen Equal/Espere, l'État et les entreprises ont d'ores et déjà engagé une politique volontariste, fondée sur l'alliance des forces de l'administration et du secteur privé. Des entreprises comme Adecco et Addia tentent aussi de faire évoluer les mentalités sur les questions d'égalité de traitement en matière d'emploi. La Délégation se félicite que le service public de l'emploi travaille également à lutter contre les discriminations, notamment en éditant diverses brochures à destination des managers, brochures constituant autant d'outils de diagnostic et de lutte contre les discriminations. La Délégation souhaite aussi que la négociation sur le sujet, récemment annoncée par les partenaires sociaux, soit réellement organisée. En direction de la population en général, les pouvoirs publics doivent faire œuvre de pédagogie, afin de permettre la diffusion dans les esprits d'une image valorisée de l'immigration : la différence doit être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un atout et non un handicap. Dans le même temps, la lutte contre les discriminations à l'embauche doit être intensifiée. La création de la HALDE est à cet égard une excellente mesure. Depuis son installation en juin 2005, la HALDE a été saisie de près de 900 plaintes, dont 45 % concernent l'emploi. La Délégation espère vivement qu'elle aura les moyens d'exercer sa mission, et se réjouit, à cet égard, de l'annonce, faite par le Premier ministre, de la création d'un pouvoir de sanction propre à cette institution. Ne disposant jusqu'à présent que du pouvoir de saisir un juge, la HALDE gagnerait ainsi beaucoup en autonomie et donc en efficacité. Du point de vue judiciaire, enfin, il faut encourager les magistrats à considérer les discriminations à l'embauche comme des délits aussi importants que les autres. La vigilance tant des pouvoirs publics que des juridictions est impérative. * * * « La situation d'une bonne partie des populations issues de l'immigration la plus récente est (...) plus que préoccupante. Outre qu'elle se traduit par des situations souvent indignes, elle est à l'origine directe ou indirecte de tensions sociales ou raciales graves, lourdes de menaces pour l'avenir. »(111) C'est en ces termes que la Cour des comptes s'exprimait dans un rapport particulier publié en novembre 2004 ; les événements actuels dans les banlieues ne sauraient, malheureusement, la contredire. De fait, un constat s'impose, celui de l'impossibilité de faire l'économie de la mise en œuvre d'une politique volontariste, suivie et engagée, face aux problèmes qu'affrontent les personnes immigrées et issues de l'immigration, et au premier rang d'entre elles, les femmes. Il est vrai que la complexité de ces problèmes peut être un frein à l'action politique, car, dans ce domaine peut-être plus que dans d'autres, nul ne possède malheureusement de solution « toute faite ». Ce serait toutefois une grave erreur de ne rien faire car l'enjeu est d'importance : au-delà de l'avenir de ces femmes, c'est l'avenir de notre société toute entière qui se joue. Le rôle des femmes est, on le sait, fondamental dans l'intégration de leurs enfants ; celles-ci peuvent tout aussi bien émanciper leurs enfants, garçons et filles, qu'être des gardiennes féroces d'une tradition parfois en contradiction avec nos valeurs républicaines. La Délégation est convaincue qu'aider ces femmes à conquérir leur autonomie juridique et financière, ainsi qu'à prendre leur place dans la société, est non seulement un impératif moral, mais en outre une des clés pour régler les problèmes de déshérence dans les quartiers. L'accent doit être impérativement mis sur la socialisation linguistique, car la langue est certes un vecteur de communication, mais surtout d'apprentissage de notre culture. C'est en permettant à ces femmes de comprendre le français et de s'exprimer dans cette même langue qu'on leur donnera les moyens de lutter contre les violences qui leur sont faites, ainsi que de conquérir leur autonomie financière. A cet égard, tout doit être mis en œuvre pour conforter le soutien aux associations, grandes comme petites, nationales ou de quartiers, qui apportent leur aide et leur expertise aux femmes immigrées ou issues de l'immigration. Le travail de ces associations étant crucial, il faut que l'État s'assure qu'elles aient les moyens d'avoir des locaux, des permanents, ainsi que des relais dans les quartiers. L'objectif d'intégration à tout prix, qui a pu prévaloir dans les décennies précédentes, n'est plus réaliste ; la montée du communautarisme, les replis identitaires sont la preuve de l'échec d'une politique rigide d'intégration. Force est de constater qu'il n'est plus possible de demander aux immigrés de faire table rase de leur identité ; leur expérience doit au contraire être considérée comme une richesse, et l'intérêt de tous est de permettre que cette richesse s'exprime. Cela ne signifie pas que nous devions composer avec les communautarismes, contraires à nos traditions et porteurs de menaces pour notre tradition républicaine fondée sur le respect de l'individu, mais que nous devons permettre aux personnes immigrées de se réaliser sans avoir à renoncer à leur histoire, nécessairement consubstantielle de leur identité. A l'inverse, cela implique que ceux-ci renoncent à leurs coutumes se trouvant en contradiction avec nos lois et notre ordre public (polygamie, mutilations sexuelles, mariages forcés), mais aussi fassent l'effort d'apprendre notre langue, notre histoire, et les principes directeurs de notre démocratie. Concernant plus particulièrement les femmes immigrées et issues de l'immigration, les politiques publiques doivent s'attacher à lutter contre la double discrimination qu'elles subissent, afin de leur permettre de vivre en harmonie avec notre société, et, réciproquement, que notre société vive en harmonie avec elles. La Délégation aux droits des femmes s'est réunie, le mardi 29 novembre 2005, sous la présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, pour examiner le présent rapport annuel. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a présenté l'ensemble des recommandations qui ont donné lieu à un large débat. S'agissant du contrat d'accueil et d'intégration qui permettra d'améliorer l'information des femmes immigrées sur leurs droits, Mme Marie-Jo Zimmermann a notamment souligné la nécessité de rendre ce contrat obligatoire et d'organiser une cérémonie en préfecture solennisant la signature de ce contrat. S'agissant de la lutte contre la polygamie, Mme Chantal Brunel a souhaité que soit modifiée la recommandation initiale qui prévoyait de verser directement les prestations familiales aux mères des familles polygames ayant décohabité. Elle a fait valoir que ces femmes étaient la plupart du temps illettrées et ne parlaient pas le français et qu'il leur serait donc difficile de gérer elles-mêmes ces dossiers. Elle a souhaité que les prestations familiales soient versées à un tuteur extérieur à la famille polygame. Mme Marie-Jo Zimmermann ayant approuvé cette modification et souligné que le versement des prestations familiales aux pères maintenait les femmes en situation de dépendance, un débat s'est engagé pour déterminer quel serait dans ce cas le meilleur tuteur. Mme Bérengère Poletti a proposé de confier ce tutorat aux associations figurant sur une liste validée par le ministère concerné, tandis que Mme Chantal Brunel a évoqué la responsabilité des caisses d'allocations familiales et souhaité qu'elles exercent un meilleur contrôle. L'intérêt du tutorat a été souligné par Mme Bérengère Poletti qui a insisté sur la nécessité d'une rééducation des familles. La recommandation n° 11 a donc été modifiée dans le sens proposé. S'agissant des mutilations sexuelles, un débat s'est engagé sur les meilleurs moyens de lutter contre cette forme de violence. Outre les campagnes de prévention et de sensibilisation retenues par la Délégation, et notamment la nécessité d'insister sur l'information délivrée dans le cadre de la procédure du contrat d'accueil et d'intégration relative à l'interdiction de la polygamie et des mutilations sexuelles, un consensus s'est dégagé sur la nécessité de sanctionner les parents pour les mutilations commises à l'étranger sur leurs enfants mineurs résidant habituellement en France. Une recommandation supplémentaire a également été introduite visant à soumettre à une visite médicale obligatoire les enfants au cours de la dernière année d'école primaire, et non pas seulement dans leur sixième année, comme c'est le cas aujourd'hui. S'agissant des mariages forcés, la Délégation a insisté sur la nécessité de rendre obligatoire l'audition séparée des futurs époux par les autorités consulaires de manière à empêcher toute transcription automatique des mariages célébrés à l'étranger. À une question de Mme Chantal Bourragué sur les éventuelles différences de transcriptions de mariage lorsqu'elles concernent, par exemple, des immigrées de l'Union européenne, Mme Marie-Jo Zimmermann lui a indiqué que les règles étaient identiques pour tous les étrangers. S'agissant de la lutte contre le sexisme notamment dans les cités, Mme Marie-Jo Zimmermann a insisté non seulement sur la nécessité de mettre en place dans les IUFM une formation spécifique aux problèmes rencontrés dans les zones d'éducation prioritaires (ZEP), mais aussi d'établir un tutorat pour les primo-affectations des professeurs dans les ZEP, et sur l'importance d'affecter des professeurs expérimentés dans ces zones par une politique réellement incitative. Elle a également rappelé l'importance de soumettre la carte de résident à une bonne maîtrise de la langue française. L'ensemble des recommandations ont été ensuite adoptées par la Délégation compte tenu des observations formulées et des modifications suggérées : Concernant le statut juridique des femmes immigrées : 1. Dénoncer les conventions bilatérales qui méconnaissent le principe d'égalité entre les hommes et les femmes ; 2. Limiter la portée de l'application du statut personnel, notamment en prévoyant que la nationalité du pays de résidence l'emporte lorsqu'elle est plus favorable aux droits des personnes, ou, de manière plus générale, en prévoyant l'application de la loi du domicile pour les immigrés installés de façon durable en France ; Concernant l'amélioration de l'information sur les droits des femmes immigrées et le suivi des ces femmes : 3. Améliorer la formation des personnes en contact avec les femmes immigrées : personnel des ambassades et consulats, travailleurs sociaux, magistrats, policiers ; 4. Favoriser une diffusion dans le plus grand nombre de langues étrangères des informations délivrées lors de l'accueil sur les plates-formes de l'ANAEM et des journées d'information civique ; 5. Insister sur l'interdiction de la polygamie et des mutilations sexuelles lors de l'accueil des primo-arrivants ; 6. Améliorer le fonctionnement de la journée d'instruction civique, par la constitution de groupes homogènes du point de vue de la langue et du niveau de formation ; 7. Rendre obligatoire la signature du contrat d'accueil et d'intégration (CAI) ainsi que le suivi de la journée d'information « Vivre en France » ; 8. Obliger les femmes à se rendre seules, éventuellement avec un interprète, aux différentes étapes de la procédure d'accueil ; 9. Rendre obligatoire une cérémonie en préfecture lors de la signature des contrats d'accueil et d'intégration ; 10. Généraliser la diffusion aux communes des listes des personnes ayant signé les contrats d'accueil et d'intégration ; Concernant la lutte contre la polygamie : 11. Verser les prestations familiales à un tuteur extérieur à la famille ; 12. Favoriser la coopération avec les pays d'origine, afin notamment d'améliorer l'information relative à l'interdiction de la polygamie en France ; Concernant la lutte contre les mutilations sexuelles : 13. Organiser une campagne de prévention à destination des familles en France, et, à l'étranger, aux personnes en demande de visas ; 14. Sensibiliser les médecins, le personnel scolaire, les magistrats et les policiers, sur la question des mutilations sexuelles ; 15. Soumettre à une visite médicale obligatoire les enfants au cours de la dernière année d'école primaire ; 16. Modifier la loi pour permettre de sanctionner les parents pour les mutilations commises à l'étranger sur leurs enfants mineurs étrangers résidant habituellement en France ; 17. Allonger le délai de prescription d'action publique à vingt ans et à compter de la majorité de la victime ; Concernant les mariages forcés : 18. Former et sensibiliser les officiers d'état civil, les magistrats et les policiers à la reconnaissance des mariages forcés ; 19. Rendre obligatoire l'audition séparée des futurs époux par les autorités consulaires lors des mariages célébrés à l'étranger ; 20. Désigner, dans chaque consulat, un responsable des mariages forcés à qui les jeunes filles ou femmes françaises, ou les jeunes filles mineures étrangères résidant habituellement en France, victimes de mariages forcés, pourraient s'adresser ; 21. Harmoniser l'âge nubile des filles et des garçons à 18 ans ; 22. Instaurer un délit de contrainte au mariage ; 23. Modifier le code civil pour permettre que le ministère public soit habilité à demander en justice l'annulation d'un mariage lorsque le consentement d'un époux a été obtenu par fraude, violence ou contrainte ; 24. Prévoir un dispositif d'accueil spécifique pour les jeunes filles et femmes fuyant les mariages forcés ; 25. Organiser des campagnes au sein de l'Éducation nationale, à destination tant des filles que des garçons, dans les medias à destination des parents ; Concernant la lutte contre le sexisme, notamment dans les cités : 26. Rendre obligatoire dans l'enseignement les droits de l'homme, l'histoire de la pensée et des idées ; 27. Mettre en place une journée d'éducation civique à l'école, au collège et au lycée, axée sur les droits de l'homme, sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits de l'enfant ; 28. Former les étudiants et professeurs stagiaires des IUFM aux problèmes spécifiques des zones d'éducation prioritaires (ZEP), notamment en organisant des stages obligatoires en ZEP, et mettre en place un tutorat lors des primo-affectations dans ces zones ; 29. Favoriser l'affectation en ZEP de professeurs expérimentés par une politique réellement incitative en terme de carrière et de rémunération. Les années passées en ZEP pourraient par exemple compter plus que les autres dans le calcul de la retraite (deux années comptant pour trois) ; 30. Organiser des campagnes d'information à destination des jeunes, afin d'apprendre aux filles et aux garçons à vivre dans le respect réciproque ; 31. Organiser des campagnes d'information à destination de l'ensemble de la société, afin de réaffirmer le principe de l'égalité et la nécessité du respect mutuel entre les hommes et les femmes ; Concernant l'apprentissage de la langue française : 32. Soumettre la délivrance de la carte de résident à une bonne maîtrise de la langue française ; 33. Rendre obligatoire la formation à langue française organisée dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. ; Concernant la lutte contre les discriminations dans l'entreprise : 34. Encourager les enquêtes sur la diversité dans l'entreprise, prenant notamment en compte le caractère sexué des discriminations ; 35. Soutenir les femmes immigrées dans leurs parcours d'insertion professionnelle, de formation et de création d'entreprise. 36. Favoriser la diversification des parcours des jeunes filles issues de l'immigration en améliorant l'information sur l'orientation à l'école et en valorisant les parcours de réussite. 37. Mettre en place une réelle diversité dans le recrutement des fonctionnaires, et encourager cette même diversité au sein des entreprises, notamment par l'adoption d'une charte de l'égalité et de la diversité. 38. Valoriser la différence comme facteur d'enrichissement. 39. Conforter le rôle de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), notamment en la dotant d'un pouvoir propre de sanction. 40. Encourager les magistrats à la plus grande vigilance face aux délits de discriminations. Personnalités entendues par la Délégation sur le thème Pages
Audition de Mme Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l'intégration Réunion du mardi 1er février 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Blandine Kriegel, professeur de philosophie politique à l'université de Paris-X-Nanterre, chargée de mission auprès du Président de la République sur les questions de droit civique et d'éthique, présidente du Haut Conseil à l'intégration, d'avoir répondu à l'invitation de la Délégation, qui a choisi comme thème de travail pour 2005 les femmes de l'immigration, et qui ne pouvait mieux commencer ses travaux qu'en entendant celle dont les réflexions et les écrits illustrent toute l'importance du sujet. On y retrouve d'ailleurs très largement les préoccupations que la présidente percevait, lorsqu'elle était enseignante, chez les jeunes filles issues de l'immigration, et dont Fadela Amara lui a fait part au sein de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes. Dans le cadre d'une autre audition, deux avocates de Ni putes ni soumises ont montré qu'en dépit de toutes les bonnes volontés et du travail accompli par le Gouvernement, notamment par Mmes Nicole Ameline et Catherine Vautrin, il reste beaucoup à faire. Le Haut Conseil à l'intégration a rendu deux avis remarqués sur ces questions, le premier sur la promotion sociale des jeunes des quartiers en difficulté, le second, précisément, sur la question des femmes issues de l'immigration. Il est donc intéressant de voir comment on peut faire évoluer les choses sans provoquer de révolution car, au-delà de l'avenir de ces filles et de ces femmes, c'est la réussite de la France qui est en jeu. Mme Blandine Kriegel a souligné que c'est aussi en tant qu'enseignante, à l'université de Lyon-III, qu'elle a commencé à s'intéresser à ce sujet, constatant l'écart des performances entre les garçons et les filles parmi les jeunes « beurs » qui représentaient 15 % de ses élèves. Saisi par le Premier ministre d'une demande d'avis sur les droits civiques des femmes issues de l'immigration, le Haut Conseil a dressé un panorama complet de leur situation, ce qui l'a amené à faire un certain nombre de recommandations, auxquelles il a essayé d'intéresser un certain nombre d'autorités publiques et de ministères, engageant à cette occasion avec Mme Nicole Ameline un partenariat assez fructueux. Pour autant, il reste beaucoup à faire, y compris sans doute sur le plan législatif. Si la situation de ces femmes est devenue un phénomène d'opinion, elles le doivent d'abord à leur propre action, et en particulier à la marche des femmes des cités. Elles ont ainsi mis l'accent sur le fait qu'au cœur de leur condition se trouvait la question de droit, très importante, du conflit entre les lois françaises, qui prévoient une égalité législative, et certaines conventions bilatérales passées avec des pays où les droits des femmes ne sont pas équivalents à ceux des hommes. La nature des conflits varie selon la génération, le pays d'origine, la date d'immigration, et le traitement des phénomènes de société n'est pas le même. Le Haut Conseil s'est intéressé à un certain nombre de sujets sensibles : répudiation, excision, mariage forcé, polygamie, traite. La répudiation revêt une importance particulière dans les conventions bilatérales, en particulier avec le Maroc et avec l'Algérie puisque, même prononcée unilatéralement, elle peut, en raison de la double nationalité, avoir des effets sur le sol français. Selon les associations, 35 000 jeunes filles sont chaque année victimes de l'excision en France. Il ne s'agit pas seulement d'une coutume honteuse, mais d'une pratique qui met en cause l'équilibre psychologique des victimes et qui pose, par ses conséquences physiologiques, notamment au moment de l'accouchement, un véritable problème de santé publique, y compris en termes de coût. Le professeur Roger Henrion l'a bien montré. On compte aussi 35 000 mariages forcés qui, à la différence des mariages blancs, n'étaient pas pris en compte dans le projet de loi sur l'immigration, bien qu'ils constituent une atteinte plus grave aux droits de la personne. Heureusement, les auditions ont conduit la commission à défendre un amendement pour les mettre sur le même plan. Dans le cadre de la réforme du divorce, le Haut Conseil a souhaité que le ministère public puisse demander leur annulation. Il a obtenu que les agents diplomatiques soient sensibilisés à cette question, afin qu'ils puissent alerter les procureurs. La répudiation et le mariage polygamique entraînaient des restrictions à l'entrée et au séjour des étrangers, avec des effets cruels sur les femmes puisque, jusqu'à une date récente, l'acquisition de la carte de résidente et de la nationalité restait liée à la qualité de conjointe. M. François Fillon, alors Ministre des affaires sociales, a accepté que, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, la carte de résident soit remise à titre individuel. S'agissant de la traite et de l'esclavage, il apparaît que si ceux qui font venir les femmes sont visés par la « loi Sarkozy », tel n'est pas le cas de ceux qui les exploitent et les font travailler. A partir de ce constat, le Haut Conseil a fait un certain nombre de recommandations. La première est que les femmes puissent signer individuellement, à leur arrivée en France, le contrat d'accueil et d'intégration. Sur ce point, il a eu entière satisfaction. Il convient par ailleurs que les conventions bilatérales qui méconnaissent le principe d'égalité entre les hommes et les femmes soient dénoncées, or tel n'est pas le cas. On a toutefois vu que, lors de la visite du Président de la République au Maroc, le roi Mohammed VI a annoncé une réforme de la moudawana, c'est-à-dire du code de la famille, tendant à renforcer cette égalité, de façon à rendre la polygamie presque impossible et à améliorer les conditions de transmission de l'héritage. Tout ceci a pu être vérifié à l'occasion d'un grand colloque sur les femmes organisé sur place. Au même moment, le ministre de la justice a pris des décrets d'application de la réforme. Lorsque le Président de la République s'est rendu en Algérie, une femme a pris la parole lors de la réception à l'ambassade pour lui demander son appui en vue d'une réforme analogue du code de la famille. Un projet est aujourd'hui à l'étude devant le Conseil de la révolution. Pour éviter l'application d'un statut personnel inégalitaire, le Haut Conseil avait proposé que la loi du domicile prévale lorsqu'elle est plus favorable aux femmes. Cette évolution est déjà intervenue en Grande-Bretagne et en Belgique, elle est envisagée en Espagne, et la Convention de La Haye a encouragé ce mouvement, qui relève du législateur. L'objectif était de faire des femmes issues de l'immigration un public privilégié de la politique d'intégration. Un certain nombre de femmes remarquables ont d'ailleurs été entendues par le Haut Conseil lors de la préparation de cet avis. La première prise en compte de ses recommandations a donc été l'amendement à la loi sur l'immigration qui a rendu plus difficile le mariage forcé. Les femmes fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, en particulier la Directrice des droits de l'homme, ont été de formidables relais, et les télégrammes diplomatiques qu'elles ont envoyés aux agents consulaires ont rendu plus difficiles les mariages forcés, les consuls exigeant désormais de voir les jeunes femmes avant de transcrire les mariages sur les registres d'état civil. Ce mouvement se heurte toutefois à l'attitude des magistrats, dénoncée à juste titre par les associations, et l'organisation d'une conférence des procureurs généraux sur ce thème serait sans doute utile. Désormais, les consuls reçoivent les futurs mariés séparément, ce qui permet aux jeunes femmes de tenir un discours différent. Certaines leur écrivent aussi pour leur demander leur aide. Mais, lorsqu'ils bloquent la transcription et préviennent les Affaires matrimoniales à Nantes, ils reçoivent un accueil médiocre. Sans doute cela tient-il au fait que l'on a longtemps considéré que cela relevait du caractère privé de la vie du couple, mais il faut désormais que les choses évoluent. C'est pourquoi le Haut Conseil a beaucoup insisté sur la dimension individuelle du parcours d'intégration et de l'entretien. L'expression « mariage forcé » ne figure malheureusement pas dans la loi relative à la maîtrise de l'immigration, qui se contente d'une référence à l'article 146 du code civil qui dispose qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. Pour les mariages en France, l'article 74 de la loi pose le principe de l'audition commune des futurs époux par l'officier d'état-civil avec la possibilité d'une audition séparée. En revanche, pour les mariages à l'étranger, l'article 75 prévoyant l'audition séparée pour la transcription, la sensibilisation des agents consulaires à ce sujet est une belle réussite. Dans les deux cas, l'article 76 permet de recourir au procureur de la République pour s'opposer au mariage en France ou à sa transcription. Cette possibilité existait en réalité depuis 1993 mais n'était jamais utilisée. A l'origine, le texte faisait du fait qu'un des futurs époux ne puisse justifier de la régularité de son séjour en France un indice sérieux de mariage forcé. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel. Or, des auditions ont montré que le mariage forcé pourrait être, par le biais de la compensation financière donné à la famille, un mécanisme d'achat d'un titre de séjour. On pourrait aller plus loin puisque la nouvelle incrimination pénale créée par l'article 31 de la loi ne concerne que les mariages blancs et pas les mariages forcés. Au total, on est encore loin du compte, il faut aller beaucoup plus loin sur ces questions, peut-être en empruntant la voie législative. A Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, qui lui demandait si elle était optimiste, Mme Blandine Kriegel a répondu qu'en dépit du discours des médias sur la « panne » de l'intégration, et grâce aux efforts du Gouvernement depuis trois ans, avec la politique du contrat d'accueil et d'intégration, avec le plan de cohésion sociale, avec toutes les mesures symboliques qui ont été prises - musée de l'immigration, Conseil du culte musulman -, 58 % des Français considèrent aujourd'hui que l'on intègre plutôt convenablement les étrangers. Cela incite d'autant plus à l'optimisme qu'on ne connaît pas en France de violences intercommunautaires comme celles qui secouent actuellement la Grande-Bretagne et que l'insurrection des banlieues, que d'aucuns prophétisaient, n'a pas eu lieu. Et, si tout ne va pas encore pour le mieux, la politique de lutte contre les discriminations, l'engagement de faire quelque chose pour les quartiers, la promotion active sont en train de changer la donne, grâce aussi à l'action des jeunes femmes, qui a été un véritable moteur. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué que, selon Fadela Amara, on ne s'est jamais occupé des mères de celles qui agissent aujourd'hui, qu'on ne leur a pas enseigné les lois françaises, ce qui pose un problème d'identité à leurs enfants. Mme Blandine Kriegel a reconnu qu'il y avait là un problème fondamental : jusqu'au contrat d'accueil et d'intégration, on n'avait jamais enseigné les lois de la République à ceux qui arrivaient et à qui on demandait ensuite de les respecter. Ainsi, on condamne celles qui pratiquent l'excision, mais on ne leur a jamais dit que c'était interdit... Le Haut Conseil a fait un travail important sur ce point en redéfinissant le cahier des charges et en éditant un livret de la formation civique. Désormais, une des premières choses enseignées à ceux qui signent le contrat d'accueil et d'intégration, est le droit des personnes, en particulier l'égalité entre hommes et femmes. Plus fondamentalement, comme on oublie l'air qu'on respire, on considère qu'il va de soi de vivre dans une démocratie, on oublie la chance que l'on a, on oublie que tout cela est fragile, on ne se donne pas la peine de l'enseigner. Qu'elles soient socialistes, conservatrices ou libérales, les idées qui ont dominé l'Europe aux XIXe et XXe siècles ont toutes mis l'accent sur les questions économiques et sociales, tandis que le droit, les institutions politiques passaient au second plan. Ainsi, s'il y a une « instruction civique » dans le primaire et le secondaire, il n'y a pas d'« instruction juridique ». Alors que « nul n'est censé ignorer la loi », on n'enseigne même pas comment rédiger un contrat ou un bail, et il faut faire une licence en droit pour pouvoir en acquérir quelques notions. Si on enseigne aujourd'hui à l'université les droits de l'homme, l'histoire de la pensée et des idées, cela ne s'est pas du tout répandu dans la société. Ainsi, les travailleurs sociaux, même s'ils font de leur mieux, n'ont reçu aucune formation sur les lois de la République. Avant le contrat d'accueil et d'intégration, dans le module de formation « Vivre en France », le premier transparent traitait de l'ANPE, le deuxième des ASSEDIC ! On n'y trouvait que du social, rien sur l'idée de la France ! C'est pourquoi le nouveau livret comporte au moins quelques éléments de la Constitution et des lois que l'État est tenu de faire connaître. Mais, si le contrat d'accueil et d'intégration prévoit 30 heures de formation linguistique, il n'offre que trois heures de formation civique, faute d'enseignants formés aux notions de droit. Comme le préconisait Claude Nicolet dans un rapport à Jean-Pierre Chevènement, il faut enseigner le droit. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que le « rapport Thélot » n'y faisait pas allusion et que cela ne semblait toujours pas prévu dans la grande réforme de l'éducation. Mme Blandine Kriegel l'a déploré, et a souligné que les grands universitaires qui siègent au Haut Conseil sont persuadés que c'est une nécessité. La panne de l'intégration a sans doute un rapport avec le départ d'enseignement des humanistes classiques. Aujourd'hui si les familles françaises qui ont reçu cet enseignement des fondamentaux (la langue, l'histoire) ont été en mesure de pallier ainsi les insuffisances du système, comment les femmes issues de l'immigration le pourraient-elles ? Il y a donc là un vrai frein à l'intégration. Le ministre François Fillon est très sensible à ces questions. A la question de savoir si le Haut Conseil a été auditionné par la « commission Thélot », Blandine Kriegel répond négativement. Dans son avis, le Haut Conseil s'était aperçu qu'en matière d'éducation les collégiens étaient un peu les oubliés des actions visant à l'intégration. Il a salué les expériences menées aussi bien à la RATP qu'à l'UIMM ou à l'Ecole de la seconde chance, qui tendent à ajouter à l'enseignement général des stages professionnels et d'éducation civique. Il faut donc réhabiliter l'enseignement professionnel, avec des passerelles qui mènent jusqu'au métier d'ingénieur. Sur ce sujet un lobbying a été exercé auprès de Jean-Louis Borloo et de François Fillon pour qu'ils généralisent ces expériences, et ils l'ont fait. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a évoqué la promotion des lycées des métiers prônée par M. Jean-Luc Melanchon. Elle s'est par ailleurs interrogée sur le décalage entre le discours tenu par les filles qui se sont mobilisées et qui ont fait le tour de France et la réalité vécue dans les banlieues par les filles issues de l'immigration, qui peinent à sortir d'un contexte familial marqué par l'autorité du père et du fils aîné. Comment peut-on mieux diffuser dans les banlieues tout ce qui est fait pour que les choses avancent ? Mme Blandine Kriegel a vu là un vrai problème. Les jeunes femmes mobilisées sont une élite, de futurs cadres, mais les jeunes lycéennes appellent aussi la République à l'aide, ainsi que le Haut Conseil l'a constaté lors d'une réunion publique à laquelle Jean-Marie Bockel l'avait invité à Mulhouse. La République leur a répondu avec la loi sur le voile, qui fonctionne remarquablement : 49 refus seulement, dont beaucoup en Alsace, où la loi de 1905 ne s'applique pas. On voit là l'efficacité d'une méthode fondée sur la fermeté de la loi, sur le dialogue, sur la compréhension, sur une politique d'ensemble qui fait passer le message que l'on veut vraiment intégrer, s'attaquer aux discriminations et remettre en marche l'ascenseur social. Mme Michèle Tabarot a demandé à Mme Blandine Kriegel son opinion sur la discrimination positive. Mme Blandine Kriegel a rappelé que le Haut Conseil s'y est intéressé très tôt, bien avant la prise de position de Nicolas Sarkozy, ce qui l'a amené, dans le cadre d'une réflexion très approfondie sur l'idée de mettre des quotas dans les grandes écoles, à se pencher sur l'histoire de la discrimination positive. Dans certains pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud ou les États-Unis, qui ont connu une ségrégation en fonction de la caste ou de la race, on a offert des avantages sur la base de quotas ethniques, parce qu'il a paru juste d'offrir une réparation à des groupes qui avaient été discriminés en tant que tels. Or la France, même si elle a un passé colonial, n'a jamais, en dehors de la période pétainiste, inscrit dans le droit métropolitain une quelconque ségrégation sur une base ethnique. Qui plus est, même aux États-Unis, l'affirmative action a été abandonnée en 1978, après que la Cour Suprême a déclaré inconstitutionnels les quotas ethniques qui avaient amené à refuser l'inscription d'Alan Bakke à l'école de médecine alors qu'il avait obtenu de meilleures notes que les membres des minorités concernées, auxquelles 16 % des places étaient réservées. Certains considèrent qu'on applique déjà la discrimination en France, en particulier avec les politiques des ZEP ou de l'aménagement du territoire. Dans ces cas, l'État mène simplement une politique de restauration de l'égalité des chances par des avantages compensateurs, mais pas sur une base ethnique. Faire de la discrimination positive dans les banlieues, ce ne serait pas seulement consacrer de l'argent aux équipements publics, mais réserver à Fatima ou à Malik des postes auxquels on interdirait d'accéder à Nicole et Marcel, même s'ils habitent le même quartier. Personne ne fait cela, pas même Sciences Po, où il existe un tour extérieur destiné aux jeunes défavorisés, et auquel se présentent aussi des Russes ou des Polonais qui habitent en banlieue... Beaucoup jouent sur les mots, mais il ne faut pas confondre action positive et discrimination positive. On a vu aussi dans la parité une application de la discrimination positive. Mais il ne faut pas oublier que ce principe a été inscrit dans la Constitution parce que le Conseil constitutionnel a refusé la logique des quotas. Du coup, les femmes, qui recherchaient quand même plus d'égalité dans l'exercice de la citoyenneté, ont choisi une autre argumentation : dans les pays développés, la citoyenneté est fondée sur les droits de l'humain, or l'humain est homme et femme, la féminité n'est pas une quotité, une proportion de l'humanité, mais une qualité ; elle est aussi universelle que la masculinité. Faire des femmes un quota de l'humanité ou une communauté est absurde ! Aristote a d'ailleurs écrit que le premier attribut « substantiel » de l'humanité, c'est la masculinité ou la féminité. Dans le domaine de l'immigration, il faut faire la différence entre le quanta d'immigration professionnelle au profit des entreprises qui ont besoin de main d'œuvre, comme dans les travaux saisonniers, et le quota de peuplement, qui est une proportion. Transformer les quanta en quotas est impossible dans l'état actuel de notre droit. Sur le plan psychologique aussi, la politique des quotas a des effets nocifs dans la mesure où elle ne fait pas droit à la performance individuelle. Autant il convient de restaurer l'égalité des chances sur la ligne de départ, autant l'obligation de résultat est contraire à la finitude humaine et au fait que tout le monde ne peut pas tout faire en même temps. Même en Inde, comme l'a souligné Amartya Sen de telles politiques ne semblent pas avoir donné les résultats qu'on en attendait Elles semblent bien étrangères à la tradition républicaine française, qui n'a jamais péché sur ce point et qui fait aussi bien avec l'action positive. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a proposé qu'une nouvelle rencontre soit organisée une fois que la Délégation aura achevé ses auditions et avant qu'elle ne remette ses recommandations. S'il apparaissait qu'une loi est nécessaire pour aider les femmes à faire plus encore en faveur de l'intégration, le législateur pourrait sans doute s'appuyer sur les propositions du Haut Conseil. Mme Blandine Kriegel a répondu que la Délégation pouvait compter sur elle et s'est réjouie d'avoir été reçue par des femmes élues de la Nation. Quand on voit ce que les femmes fonctionnaires ont pu faire pour que les choses avancent, on se dit que des femmes parlementaires plus nombreuses pourraient aller encore plus loin. Elle a souhaité que l'on aille plus loin, en particulier sur la question des mariages forcés, car celles qui les subissent vivent des situations terribles et sont tout simplement privées du droit de vivre comme des jeunes filles du XXIe siècle. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est déclarée particulièrement sensible à cette question qu'on ne peut plus ignorer. Il est donc urgent que la Délégation fasse des propositions à ce propos. Il faut aussi tout faire pour aider les femmes algériennes. Audition de Mmes Claudie Lesselier, Anne Nguyen-Dao et Lucia Martini, présidente et membres du RAJFIRE (Réseau pour l'autonomie des femmes immigrées et réfugiées) Réunion du mardi 7 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est réjouie d'accueillir Mmes Claudie Lesselier, Anne Nguyen-Dao et Lucia Martini dans le cadre de la réflexion que la Délégation aux droits des femmes a engagée en vue d'une meilleure intégration des femmes immigrées et issues de l'immigration. Elle a souhaité savoir, parmi les mots « insertion, intégration et assimilation », celui que le RAJFIRE estimait le plus pertinent, et s'il jugeait que de nouvelles mesures législatives et réglementaires étaient nécessaires. Elle a ensuite posé un certain nombre de questions sur les activités de leur association, sur les difficultés d'intégration des femmes immigrées, sur les mariages forcés et sur les situations de violence dont elles sont victimes. Mme Claudie Lesselier a souligné que le RAJFIRE, parce qu'il travaille dans un comité d'action interassociatif, a jugé important de préparer cette réunion avec les trois autres associations membres actifs de ce comité : la CIMADE, qui tient une permanence juridique pour les femmes étrangères victimes de violence, la Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie et la Fédération nationale solidarité femmes, dont le champ d'action est la lutte contre les violences conjugales en général. Leur travail se situe donc à l'intersection des problèmes que peuvent rencontrer les femmes en tant que femmes et en tant qu'étrangères. Le RAJFIRE est une association féministe, qui a une existence légale depuis cinq ans, et qui agit pour les droits des femmes et pour l'égalité, pas seulement en termes d'intégration, d'insertion ou d'assimilation, mais pour l'égalité des femmes entre elles et avec les hommes. L'association mène des actions très concrètes, notamment en tenant, chaque semaine, une permanence d'information et de solidarité destinée à aider des femmes dans leurs démarches et dans leur courrier, ainsi qu'à les accompagner dans les préfectures et auprès des différentes institutions. C'est dans ce cadre qu'elle a été amenée à rencontrer de nombreuses femmes étrangères, arrivées en France soit depuis peu de temps soit depuis plusieurs années, sans titre de séjour ou avec un titre précaire, et qui sont confrontées à des situations juridiques, administratives et sociales difficiles. Ce sont des bénévoles qui assurent ces permanences, en raison de leur engagement féministe et parce qu'elles sont convaincues que ces femmes ont besoin d'informations et de soutien. C'est au moment de l'occupation de l'église Saint-Bernard que les membres de ce qui allait devenir le RAJFIRE sont entrées en contact avec celles qui se nommaient elles-mêmes les « sans-papières », qui leur ont fait part de leurs problèmes familiaux et personnels, ce qui a amené à créer les permanences, puis l'association. Bénéficiant désormais d'une certaine reconnaissance, cette dernière ne se contente plus d'apporter une aide individuelle à ces femmes, elle essaie de développer une analyse des dispositifs législatifs et réglementaires et de faire avancer l'accès aux droits. C'est ce qui l'a conduite à interpeller les députés au moment de l'examen de la loi du 26 novembre 2003 modifiant l'ordonnance de 1945 sur le droit d'asile. Elle a aussi noué des relations avec des acteurs de la vie politique et sociale ainsi qu'avec de nombreuses autres associations, d'où la création de ce comité d'action, qui trouve son origine dans l'appel lancé par le Groupe femmes de Turquie à propos d'une jeune femme, mariée à un Français dans le Jura, qui l'a chassée de son domicile et dénoncée à la préfecture, ce qui a entraîné sa reconduite à la frontière. Le comité est donc voué à lutter contre la double violence que subissent ces femmes qui, en tant que femmes et en tant qu'étrangères, sont soumises à la fois aux violences sexistes, conjugales, parentales, mais aussi aux injustices et aux abus, hélas fréquents, de l'administration et à des dispositions législatives injustes, car trop restrictives. Est-il normal, par exemple, qu'une femme étrangère qui épouse un homme de nationalité française doive attendre plus de deux ans pour obtenir la carte de résident qui lui garantit le droit au séjour en France ? Si le couple se sépare au cours de cette période, la femme perd tout simplement son titre de séjour. Cette dépendance conjugale est choquante. Il faut donc se féliciter que la loi du 26 novembre 2003 ait prévu que, si la séparation est due à la violence conjugale, l'épouse peut tout de même voir renouveler son titre de séjour. Les associations ont aidé de nombreuses femmes à monter des dossiers en ce sens et à obtenir satisfaction. Mais le problème reste entier quand les violences surviennent avant même que la carte soit attribuée car il est alors très difficile de la faire délivrer, en particulier parce que les accords bilatéraux franco-algériens ne le prévoient pas. Il est parfois possible d'obtenir que les préfectures étudient le cas des Algériennes, mais cela n'est nullement obligatoire. La situation n'est pas la même pour les autres pays, notamment du Maghreb et d'Afrique, qui admettent généralement la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile en vigueur depuis le 1er mars 2005. La violence conjugale peut bien sûr être physique et morale, mais elle se manifeste aussi quand l'époux ne tient pas son engagement d'accompagner la femme à la préfecture pour prouver la communauté de vie. Il arrive aussi que de tels abus de pouvoir soient le fait de parents de jeunes filles célibataires. On a vu le cas de parents vivant en France depuis longtemps et faisant repartir leur fille, avant ses 18 ans, dans leur pays d'origine, soit pour la marier de force, soit parce qu'ils craignent qu'elle se marie avec un Français ou qu'elle vive trop librement en France. Ces jeunes filles se trouvent alors bloquées au pays, privées de la possibilité d'étudier ou de travailler. Pour rentrer en France, elles doivent demander un visa dont l'obtention peut prendre des années. À leur retour, elles sont considérées comme primo-arrivantes, contraintes de solliciter un titre de séjour qui peut leur être refusé. Il arrive aussi qu'une femme mariée de force et qui n'a pas réussi à divorcer dans un pays où seul le mari peut demander le divorce, se voie refuser un titre de séjour à son retour en France, au motif qu'elle conserve des attaches familiales - en l'occurrence son mari - dans le pays d'origine... Il y a donc bien, là aussi, double violence : celle des parents, qui contraignent la jeune fille à partir, et celle des institutions françaises, consulat et ministère de l'intérieur, qui l'empêchent de rentrer dans un pays qu'elle estime être le sien. Un livre a été publié à ce propos en 2001 sous le titre Identités volées. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, un groupe de cinq femmes qui ont passé parfois dix ou quinze ans en Algérie et qui sont revenues, se battent pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Elles viennent d'obtenir un rendez-vous à la préfecture et on espère que la réponse sera positive. Mais il faut bien voir que, sans l'aide d'une association, la plupart de ces femmes n'ont aucune chance d'être régularisées, tant les démarches sont complexes. Autre exemple choquant de double violence, celui des victimes de l'esclavage et de la prostitution, qui ne peuvent pas porter plainte en raison des menaces de représailles sur leurs proches et qui subissent des reconduites à la frontière. On observe également des dysfonctionnements dans l'exercice des droits sociaux : s'il existe aujourd'hui, heureusement, des dispositifs légaux et réglementaires qui garantissent les droits des femmes étrangères, on observe, dans la pratique administrative, de grands abus de pouvoir envers celles qui ont bien du mal à se défendre. Ainsi, alors qu'il est possible de régulariser des mineures isolées même si leur passeport a été confisqué ou volé ou s'il est détenu par la police de l'air et des frontières, une jeune femme s'est encore vu refuser il y a deux jours le droit de déposer un dossier en préfecture au motif qu'elle n'avait pas de passeport... Dans les commissariats, les femmes sans titre de séjour sont dissuadées de porter plainte contre des viols ou des violences conjugales, alors qu'aucun texte ne l'interdit : les droits humains fondamentaux que sont la sûreté, le respect de la vie privée et l'intégrité physique ne dépendent bien évidemment pas du droit au séjour ! Les députés devraient se saisir de ces problèmes, comme de l'application et du suivi de la loi. Ainsi, la loi sur la sécurité intérieure a prévu plusieurs dispositifs d'aide aux victimes de la prostitution, mais il est totalement impossible de savoir s'ils sont appliqués et combien de personnes en ont bénéficié. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si le RAJFIRE avait interrogé le ministère de l'intérieur à ce propos. Mme Claudie Lesselier a déclaré qu'au moment de sa nomination, en 2002, M. Nicolas Sarkozy avait reçu de nombreuses associations qui ont été entendues sur un certain nombre de points, en particulier en ce qui concerne la perte de titre de séjour pour les victimes de violence conjugale. Mais, depuis lors, toutes les associations se sont heurtées au refus d'audience de son successeur qui leur demande de s'adresser aux préfectures. C'est pourquoi, dans le document qui a été transmis à la Délégation, le RAJFIRE insiste sur les rapports entre les associations et les institutions, les secondes ayant intérêt à mettre à profit l'expérience de terrain des premières au moment d'échéances importantes. Il faut souligner que la demande de rendez-vous faite en janvier auprès de la préfecture de police de Paris n'a pas davantage été entendue. Sur le droit d'asile, le RAJFIRE a aussi travaillé en réseau avec des associations extrêmement compétentes comme la CIMADE, la commission femmes d'Amnesty International, Femmes de la Terre et la Ligue des droits de l'homme. Il est proposé, d'appliquer, sans la modifier, la convention de Genève sur les réfugiés, car les femmes sont persécutées et soumises à des discriminations légales et officieuses en tant que groupe social. Or, quand leur État ne protège pas les personnes persécutées, elles ont le droit de demander l'asile. Il convient donc non seulement que leurs demandes soient examinées de façon sérieuse, qu'elles fassent l'objet d'une instruction approfondie, mais aussi qu'elles puissent la déposer dans de bonnes conditions, car on sait combien les victimes de traumatismes, en particulier sexuels, ont du mal à parler de violences qui touchent à leur intimité et à leur intégrité. Il est particulièrement choquant que 5 % seulement des femmes qui fuient des menaces familiales, des mutilations sexuelles, un mariage forcé, le viol et les violences liées à la guerre civile, et qui arrivent à la frontière française - c'est-à-dire souvent dans un aéroport parisien - sans passeport ni visa, parviennent à demander l'asile, alors que 40 % des demandes sont satisfaites quand elles parviennent jusqu'à l'OFPRA et à la commission des recours. À l'évidence, il convient que la convention de Genève soit interprétée de façon moins restrictive. Pourquoi la France ne pourrait-elle faire ce que font le Canada et la Grande-Bretagne ? De même, si le HCR prend en compte les questions de genre en matière d'asile, pourquoi l'OFPRA et la commission des recours ne pourraient-ils faire de même ? Si on peut se réjouir de certains aspects positifs des dernières modifications de la loi sur l'asile, notamment du fait que l'OFPRA examine maintenant l'ensemble des demandes, on peut regretter que le texte reste silencieux sur les persécutions sexistes à propos desquelles l'ONU et de nombreuses institutions lancent pourtant un cri d'alarme. Comment imaginer que l'OFPRA et le Parlement français soient les seuls à ignorer la gravité des persécutions dont les femmes sont victimes ? Mme Anne Nguyen-Dao a souligné que la Fédération nationale solidarité femmes est un réseau, issu il y a plus de 25 ans du mouvement féministe, qui regroupe une soixantaine de structures, de taille et d'activité variables, qui s'occupent en particulier d'hébergement et d'accueil de femmes victimes de violences, en particulier conjugales. Environ 40 000 femmes ont recours chaque année aux services du réseau. La Fédération gère également le numéro d'appel Femmes info service, plus connu sous le nom SOS femmes battues. La permanence accueille chaque jour les victimes mais aussi des membres de leur entourage. C'est parce qu'elle a été confrontée à de nombreux cas que la Fédération s'est intéressée à la question des femmes immigrées victimes de la double violence. En effet, ces femmes sont extrêmement dépendantes de leurs maris pour obtenir des papiers, et il est fréquent que ces derniers refusent d'accomplir les démarches et qu'ils détruisent ou confisquent les documents. Mais la situation de ces femmes est vue dans la problématique plus générale des femmes victimes de violence, et le combat pour qu'elles puissent vivre dignement en France s'inscrit dans le mouvement global de la défense des droits des femmes. La proportion d'étrangères parmi les femmes qui contactent les services du réseau est de plus en plus grande, mais on ne peut en conclure qu'il y a plus de femmes étrangères victimes de violence qu'auparavant : le fait qu'elle contactent une association peut aussi être le signe d'une certaine intégration et montrer que l'information qui circule depuis plusieurs années et les campagnes de sensibilisation ont fini par toucher même les femmes les plus isolées. Toujours est-il que, dans certaines régions, ces femmes représentent de 50 à 80 % de celles qui sont accueillies dans les centres d'hébergement. C'est dire l'importance de cette population pour la Fédération. Il faut saluer, comme l'a fait Claudie Lesselier, le fait que la nouvelle loi prenne en compte les violences conjugales pour le renouvellement du titre de séjour. Mais son application est assez variable sur le terrain et il serait souhaitable d'inciter à une harmonisation des pratiques administratives pour que les femmes ne soient pas privées de la possibilité de dénoncer la violence et de se défendre. Celles qui n'ont pas encore de titre de séjour, parce que les violences les ont poussées à quitter le domicile avant sa délivrance, sont particulièrement pénalisées pour déposer plainte et demander le divorce. Certes, la nouvelle loi sur le divorce ouvre la possibilité de demander l'éviction du conjoint, mais elle est d'application récente et on peut se demander si les femmes étrangères parviendront à faire usage de cette possibilité, surtout quand elles ont été obligées de quitter le domicile. Et quand elles ont demandé le divorce et qu'elles se retrouvent sans titre de séjour et en situation précaire, il leur est difficile de suivre les procédures et d'obtenir l'aide juridictionnelle dont elles ont pourtant besoin. S'agissant des difficultés d'intégration, l'association observe qu'elles sont le plus fréquemment liées à la langue, à la qualification professionnelle et au logement, en particulier dans le cas, fréquent, de familles monoparentales. Il est particulièrement regrettable que les femmes qui ont été aidées, qui sont parvenues à sortir du problème de violence conjugale, qui ont recouvré une certaine autonomie, une capacité à travailler, à élever leurs enfants, demeurent confinées dans un système d'aide sociale dont elles pourraient se passer, simplement parce qu'elles ne peuvent trouver de logement. Mme Anne Nguyen-Dao a souligné aussi l'importance du suivi de l'application de la loi. Elle a souhaité que la situation des femmes immigrées soit prise en compte dans la loi-cadre sur la violence conjugale en cours de discussion au Sénat. Il faudrait, en particulier, que la privation de papiers soit reconnue comme une forme de violence : placer une femme en situation irrégulière est un acte violent, l'y maintenir également. La Fédération nationale solidarité femmes s'apprête d'ailleurs à publier un travail de réflexion à propos de cette loi. Elle espère que la disposition relative à la privation de papiers s'appliquera également aux concubins et aux ex-concubins. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé qu'au moment de l'examen de la loi sur le divorce, la chancellerie avait soulevé la complexité du problème des concubins. Mme Anne Nguyen-Dao a insisté, enfin, sur l'importance de la prévention, en particulier à l'école, pour les mariages forcés. L'association a maintenant une connaissance suffisante du phénomène pour pouvoir repérer les moments de l'année où il faut intervenir. Élever l'âge du mariage serait une bonne chose, mais cela ne suffira pas : il faut vraiment développer la prévention en direction des 15-18 ans. Mme Claudie Lesselier a souligné que le problème du mariage forcé se pose aussi pour les jeunes filles de nationalité française. Mais elles sont mieux protégées car elles ont la possibilité de faire appel aux autorités consulaires. Il faut donc que ces dernières délivrent également des laissez-passer et fournissent une aide matérielle aux jeunes filles de nationalité étrangère mais résidant habituellement en France. Quand des situations de ce type se sont produites au Maroc, il a fallu de nombreuses interventions pour que les jeunes filles s'en sortent ; en Algérie les choses sont extrêmement difficiles. On n'a sans doute pas besoin d'une incrimination spécifique pour le mariage forcé car les auteurs et complices peuvent déjà être poursuivis pour viol. Qui plus est, dans la mesure où il ne saurait y avoir de mariage sans consentement, l'annulation devrait pouvoir être obtenue facilement. En région parisienne, outre le Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants, deux associations sont particulièrement actives dans ce domaine : l'association Fatoumata à Paris et Voix de femmes à Cergy. Un rapport récemment publié par Mme Nicole Ameline comporte également un certain nombre de recommandations mais, sur le terrain, on constate que les femmes ont de grandes difficultés à accéder à leurs droits quand elles sont bloquées, sans papiers, dans le pays dont elles ont la nationalité. Lorsqu'il est intervenu en France, le mariage forcé peut davantage faire l'objet d'un recours, mais on ne peut négliger ni la pression sociale et familiale, ni la culpabilisation de la femme. C'est pourquoi il est très important que les femmes puissent, dans leur pays d'origine, recourir de façon rapide et simple à un consulat. Une disposition d'ordre réglementaire pourrait aisément le prévoir. Il faudrait qu'il y ait, dans chaque consulat, un responsable de ces questions, auquel les femmes victimes de mariage forcé et de séquestration pourraient s'adresser en urgence, et qui pourrait aussi leur délivrer un laissez-passer et prendre contact avec la préfecture. Il conviendrait également d'assurer le rapatriement des mineures et de prévoir une aide d'urgence pour les majeures, par exemple sous forme de prêt. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit que cela lui paraissait difficile et compliqué. Mme Claudie Lesselier a répondu qu'un Français agressé à l'étranger recevait une aide du consulat et qu'il ne paraîtrait pas anormal d'étendre ce dispositif aux femmes étrangères qui résident habituellement en France et dont un certain nombre seront automatiquement françaises dès qu'elles atteindront 18 ans. Que les résidents étrangers disposent des mêmes droits sociaux que les Français est quand même la moindre des choses ! S'agissant du statut personnel, le RAFJIRE est bien moins compétent que de nombreuses autres associations dont il faudrait recueillir l'avis : FCI (Femmes contre les intégrismes) et FIJI (Femmes informations juridiques internationales) à Lyon, BRRJI (Bureau régional de ressources juridiques internationales) à Marseille, CICADE (Centre pour l'initiative citoyenne et l'accès au droit des exclus) à Montpellier, FIJI et le BRRJI étant reliés aux CIDF (Centres d'information pour les droits des femmes). Le RAFJIRE est favorable, sans remettre en cause l'article 3 du code civil, à ce qu'une personne puisse, par simple déclaration, demander à se voir appliquer la loi française. Pour les femmes, cela semble difficile parce qu'elles sont soumises à une pression inverse du mari. Qui plus est, le statut personnel est souvent considéré comme un marqueur identitaire auquel il est difficile de renoncer. Si la justice française se déclare généralement compétente, le fait est que, si le mari souhaite recourir à un code national plus discriminatoire à l'égard des femmes, il peut toujours dire qu'il est domicilié à l'étranger, par exemple en Algérie, et engager une procédure de divorce sur la base de la loi algérienne. Dans ce cas, la femme doit se lancer dans une démarche complexe et coûteuse pour obtenir qu'un tribunal français se déclare compétent, refuse d'exécuter la décision algérienne et fasse appliquer la notion de respect de l'ordre public. La question relative aux motivations des migrantes est très vaste. Comme pour tout émigrant, elles reposent sur des problèmes d'emploi et sur le sentiment de ne pas avoir d'avenir dans son propre pays. Mais il y a aussi, les centaines d'entretiens réalisés par l'association le montrent, des itinéraires et des motivations spécifiques aux femmes : fuite devant des oppressions sociales et familiales, devant des menaces, devant des violences et des persécutions, désir de liberté, influence de la diaspora. Tout cela pousse à l'émigration même des femmes instruites, qui ont un emploi, parfois dans la fonction publique, et qui vivent en ville. Mme Claudie Lesselier a souhaité, même si cela traduit de sa part un certain utopisme, que les frontières disparaissent. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné que cela va à l'encontre de la nécessité d'accueillir dignement celles et ceux qui arrivent en France. Mme Claudie Lesselier, a répondu que, sans aller jusque-là, il était éminemment souhaitable que les politiques d'immigration tiennent davantage compte des situations humaines et que plus de moyens soient engagés. Même si les recherches - notamment à Paris-VII, Paris-VIII et à l'École des hautes études en sciences sociales - se développent, on manque encore largement de connaissances, en particulier statistiques, sur les migrantes. Certes, les préfectures ont des chiffres qui permettent de connaître le nombre de personnes, hommes et femmes, par nationalités, qui vivent en France, mais elles ne publient pas de statistiques sexuées sur les flux d'entrées et les divers types de titres de séjour délivrés annuellement. Parmi les effets négatifs de la loi du 26 novembre 2003, figure incontestablement l'allongement de la période au cours de laquelle on ne peut obtenir qu'une carte de séjour temporaire. Comment espérer décrocher un CDI quand on ne peut produire qu'une carte de séjour temporaire, voire un récépissé ? Cette disposition précarise donc des femmes déjà fragiles. Et cela amène à la première question de la présidente sur l'usage des mots intégration et assimilation : comment parler d'intégration quand on n'a pas la possibilité de travailler ? Mme Lucia Martini a insisté sur une précarisation qui peut conduire ces femmes à travailler au noir bien qu'elles soient en France depuis plusieurs années. Alors que leurs compétences et leur expérience pourraient être reconnues dans le cadre de la validation des acquis, ce qui les inciterait à apprendre le français et leur ouvrirait l'accès à des emplois de proximité et à des emplois familiaux, le fait même d'être dans une situation précaire les empêche d'atteindre les 3 000 heures de travail salarié nécessaires à cette validation, qui pourrait pourtant être à la base d'une véritable intégration. Il conviendrait par ailleurs de multiplier, sur le modèle des maisons des femmes, les espaces de rencontres et d'échanges entre les femmes et les associations. Alors qu'il y a de plus en plus de femmes en difficulté, ces espaces sont bien trop peu nombreux et trop mal répartis sur le territoire national. Le besoin est important, chez les femmes victimes de violence et souffrant de syndromes post-traumatiques, d'échanger leurs expériences, mais aussi de trouver un soutien pour leurs relations avec l'administration. Dans la loi-cadre contre les violences conjugales, il serait utile de prendre en compte la question de la traite. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé que cette question avait été traitée dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure. Mme Claudie Lesselier a observé qu'aucun bilan des dispositifs d'aide renforcée n'avait encore été fait et que cette aide était surtout mise en œuvre par les associations, alors que la loi parlait de dispositifs publics. C'est pour cela que le RAJFIRE souhaite qu'un rapport soit rédigé. Aucun bilan n'a été fait non plus de la délivrance d'autorisations provisoires de séjour aux femmes portant plainte contre des proxénètes. On ignore aussi combien de personnes ont porté plainte et combien ont été régularisées dans ce cadre. On sait bien, par ailleurs, qu'un certain nombre de femmes ne peuvent porter plainte en raison des menaces qui pèsent sur leurs familles dans leur pays d'origine. Qui plus est, pour obtenir une régularisation, elles doivent se tourner vers les associations. Pourquoi le service public se défausse-t-il sur ces dernières au lieu de jouer son rôle ? Il conviendrait que dans chaque département un pôle composé de fonctionnaires soit à même de recevoir et d'orienter ces femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'elle s'était inquiétée d'emblée des difficultés d'application de cette loi, pourtant pétrie de bonnes intentions. Ce qui vient d'être dit montre que ses craintes étaient fondées. Tout cela pourrait faire l'objet d'une question écrite. Mme Claudie Lesselier s'est déclarée prête à fournir des informations en vue de la rédaction de questions qui pourraient être adressées aux ministères des affaires étrangères, de la justice, de l'intérieur. On pourrait aussi demander au ministre des affaires sociales pourquoi une mère qui se présente dans une caisse peut se voir refuser les allocations familiales, alors qu'une décision de la Cour de cassation a établi que si les enfants disposent d'un titre de circulation pour étranger mineur, les parents doivent recevoir les allocations. Il est quand même incroyable que l'administration elle-même ne connaisse pas les textes ! La proposition de loi issue du rapport de Christine Lazerges sur l'esclavage moderne s'est perdue dans les sables entre l'Assemblée et le Sénat. Certaines dispositions pourraient toutefois être reprises. Si une femme qui porte plainte a des chances d'obtenir une régularisation, beaucoup ne le font pas, parce que les esclavagistes sont souvent des notables locaux ou des proches et parce qu'elles craignent des représailles sur leurs familles. Il faut donc véritablement insister sur la régularisation car le retour au pays n'est pas envisageable dans la mesure où elles y seraient stigmatisées. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné combien elle était personnellement attachée à l'application de la loi. Il n'y a rien de plus frustrant pour un député que de constater que ce qu'il a voté ne donne pas de résultats et elle souhaite pour sa part qu'avant de légiférer davantage on commence par vérifier si les lois sont appliquées. À l'issue du travail qu'elle a engagé, la Délégation fera un certain nombre de recommandations. Avant leur publication, elles seront transmises aux associations et pourront être améliorées si elles ne sont pas conformes à leurs attentes. Mme Claudie Lesselier a rappelé qu'en juin 2000, à l'occasion d'un colloque organisé à l'Assemblée à propos de la loi Chevènement de mai 1998, un comité de suivi avait alors été créé. On pourrait envisager de faire de même aujourd'hui. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a répondu que cela ferait partie des recommandations de la Délégation. Mme Lucia Martini a insisté sur la nécessité que les victimes de la prostitution soient considérées comme telles non seulement quand elles portent plainte contre les organisateurs de la traite, mais aussi quand elles veulent simplement refaire leur vie. Mme Claudie Lesselier a rappelé qu'en application de loi de 1960, il devrait y avoir dans chaque département un pôle d'aide aux femmes qui veulent abandonner la prostitution. Or, alors que cette dernière s'est développée et qu'elle touche des femmes dans une situation encore plus précaire, les rares pôles qui avaient été créés n'existent plus aujourd'hui. Mme Lucia Martini a souhaité ajouter, parmi les motivations des migrants, le souhait très fort, chez les mères de famille, que leurs filles puissent vivre en liberté. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié les participantes à cette audition, qui enrichira la réflexion de la Délégation sur ces questions. Audition de Mme Gaye Petek, directrice de l'association Réunion du mardi 14 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit son plaisir d'accueillir Mme Gaye Petek, directrice de l'association ELELE - Migrations et cultures en Turquie, dans le cadre de la réflexion que la Délégation aux droits des femmes a engagée en vue d'une meilleure intégration des femmes immigrées et issues de l'immigration. L'association a participé aux travaux du groupe de travail « Femmes de l'immigration » qui a remis le 7 mars dernier un rapport à ce sujet aux ministres de la parité et de la justice. Elle a notamment été associée à la réflexion sur les obstacles culturels à une meilleure intégration des femmes de l'immigration dans la société française. La Délégation entendra donc avec un intérêt particulier Mme Gaye Petek traiter de l'accès des femmes immigrées à leurs droits et la conquête de leur autonomie juridique ; des mariages forcés ; des difficultés rencontrées par les femmes migrantes qui arrivent pour la première fois en France ; de l'insertion professionnelle de ces femmes, souvent peu qualifiées, possédant mal la langue française, et davantage touchées par le chômage que les Françaises. Au préalable, la Délégation aimerait avoir un aperçu de la communauté turque de France, qui semble très soudée, et des activités de l'association ELELE en direction des femmes. Arrivée en France à l'âge de six ans sans parler un mot de français, Mme Gaye Petek se définit elle-même comme un pur produit de l'école républicaine. Membre du Haut Conseil à l'intégration, elle enseigne en faculté la sociologie de l'immigration turque. L'association ELELE, qu'elle a fondée en 1984 et qu'elle dirige depuis, a progressivement été conduite, de par l'évolution sociologique des Turcs de France, à s'intéresser de près au sort des femmes. L'association n'a pas d'antennes régionales, mais elle a formé un réseau de médiateurs. ELELE compte vingt personnes, très orientées vers l'accueil social pour l'accès aux droits et aux devoirs, privilégie par ailleurs la formation des acteurs sociaux et des enseignants (au sein des IUFM) à la culture d'une population plus mal connue que d'autres et qui présente par ailleurs une forte résistance à l'intégration. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si l'association avait abordé la thématique européenne. Mme Gaye Petek a répondu que la question n'a pas été abordée en tant que telle mais qu'elle agite beaucoup les esprits. Les jeunes issus de l'immigration turque ont mal ressenti ce qui s'est exprimé, et elle-même trouve la situation préoccupante. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que les réticences qui se manifestent à l'idée de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne résultent souvent de la perception du sort réservé aux femmes par la communauté turque en France. L'association en parle-t-elle ? Mme Gaye Petek a répondu que les membres de l'association qui abordent, devant des Turcs des deux sexes, la question du statut de la femme rappellent que la législation turque, fondée sur des principes laïcs et un code civil qui remonte à 1926, donne aux femmes turques des droits presque identiques à ceux dont jouissent les femmes en Europe. Le problème, comme toujours, c'est la persistance des traditions. Il y a un fossé profond entre la société rurale anatolienne dont sont issus 95 % des immigrés turcs en France et les quelque 25 % d'habitants des grandes villes de Turquie, bien plus à l'aise à ce sujet. Paradoxalement, le contrôle communautaire est encore plus fort en France. Les familles craignant que les femmes ne soient tentées de transgresser la coutume, il s'ensuit une sorte de panique qui induit elle-même une surprotection, voire une « sur-surveillance » des femmes, phénomènes qui prennent une ampleur démesurée. On peut citer, parmi maints autres exemples, celui d'une jeune fille à peine arrivée de Turquie dans une France qu'elle ne connaissait pas, destinée à vivre chez ses beaux-parents, et à laquelle son jeune époux, qui était allée la chercher à l'aéroport, a tendu un foulard avant qu'ils n'arrivent à destination, en lui disant : « Tu n'es plus en Turquie, tu portes un foulard ». Les contrôles communautaires sont terrifiants et, en réalité, les femmes sont plus libres dans les villages turcs que ne le sont les femmes turques immigrées en France. Décrire cette situation, c'est aussi souligner l'échec des politiques d'intégration menées en France depuis des années, et le manque de souplesse des politiques publiques. Ce qui a manqué et qui continue de manquer, c'est le travail de proximité. Il était très important de mettre au point un contrat d'accueil et d'intégration. Mme Gaye Petek, qui y tenait beaucoup, a plaidé sans relâche en ce sens au sein du Haut Conseil à l'intégration, considérant que les immigrants doivent être accueillis par des Français et non pas par leur réseau communautaire où les femmes, en particulier, sont immédiatement placées sous la coupe de la famille, dans la norme du groupe, sous la surveillance des imams et des belles-mères. S'en tenir à cet accueil-là, c'est accepter que s'instaure d'emblée un circuit d'oppression pour les femmes et les jeunes filles. On considère qu'il y a aujourd'hui 350 000 immigrés turcs en France, mais c'est un minimum car les consulats avancent plutôt le chiffre de 500 000 personnes, binationaux compris. L'immigration turque s'est faite en deux temps. Dans les années 1970, elle fut économique, puis politique à partir de 1980, après un coup d'État militaire. Au début, les immigrants étaient des hommes venus des campagnes dans l'idée d'accumuler un capital et de rentrer au pays fortune faite. Seulement, les choses ne se sont pas passées ainsi et, peu à peu, les femmes sont arrivées, avec les enfants. A partir des années 1980, une prise de conscience a eu lieu chez ces hommes, qui se sont demandé comment rentrer en Turquie en situation d'échec, et qui ont préféré rester. C'est ainsi qu'une immigration conçue comme devant être de courte durée s'est transformée en immigration permanente. Mais ces hommes se sont repliés sur eux-mêmes, soit par frilosité, soit par peur de trahir leurs parents, soit par peur que la « moulinette à intégrer » de l'école républicaine ne l'emporte sur l'identité turque. Ils se sont alors organisés en réseaux, créant des journaux turcs, des radios turques, des commerces turcs, multipliant les achats de paraboles et choisissant l'habitat le plus resserré possible, même au sein des HLM, au point que des ghettos se sont constitués. On trouve ainsi à Mâcon deux classes d'école maternelle intégralement composées d'enfants turcs, ce qui pousse à s'interroger sur la politique suivie par l'Education nationale. Dans le même temps, un tissu associatif s'est créé, qui est composé à 80 % d'associations cultuelles. Voisinent alors une mosquée, un café - pour les hommes... - et une école coranique, autre lieu de contrôle et de normes pour les femmes et les jeunes filles. La difficulté la plus redoutable était évidemment de savoir comment demeurer Turc en France. La solution trouvée a été d'insuffler du sang frais, en imposant aux jeunes nés en France le mariage avec des Turcs ou des Turques de Turquie. Ainsi revigore-t-on l'identité turque tout en gardant la haute main sur les alliances matrimoniales des enfants, ce qui évite qu'ils ne soient tentés par des mariages mixtes. C'est une organisation mûrement réfléchie, et il n'est pas question que les jeunes gens choisissent leur conjoint, tant est forte la peur d'une dilution identitaire. Bien entendu, la pression la plus grande porte sur les femmes et les jeunes filles. Pour dire les choses crûment, les femmes turques de la première génération d'immigrées sont devenues des tortionnaires pour les générations suivantes, qu'il s'agisse de leurs filles ou de leurs brus. La croyance est tenace que, pour une mère, mener trois filles vierges au mariage, c'est la porte ouverte vers le paradis... C'est donc la mission qui leur est impartie. Mais le contrôle familial porte également sur le mariage des fils : en faisant venir une belle-fille qui sera aussi leur esclave, la mère s'assure que son fils n'ira pas folâtrer - ce qui est plus ou moins vrai, car il mène bien souvent une double vie. La situation étant celle qui vient d'être décrite, on comprend que la logique politique ne recoupe pas la réalité. Ainsi, la loi de 2003 relative à la maîtrise de l'immigration a porté à deux ans la durée de vie commune obligatoire avant l'obtention d'un titre de séjour. Ce faisant, le législateur n'a pas réprimé les coupables mais les victimes, ces jeunes femmes qui, n'en pouvant plus de se faire torturer, finissent par s'enfuir de chez elles ; la rupture de la communauté de vie étant alors constatée, la préfecture prend un arrêté de reconduite à la frontière. Le législateur, en considérant que certains s'attachaient à contourner la loi, s'est mépris, car une infime minorité seulement se marie pour obtenir des papiers ; pour la grande majorité, il s'agit d'empêcher l'indépendance des enfants et les mariages mixtes. Mme Bérengère Poletti a observé que ce qui vaut pour la communauté turque ne vaut pas pour toutes les communautés. Mme Gaye Petek a répondu que certaines tractations pouvaient en effet se produire, mais qu'elles sont minoritaires. Elle a ensuite exposé que la situation des femmes de la première génération n'est pas exactement la même que celle des générations suivantes. Peu de violences sont commises à leur encontre, exception faite des cas où le mari ramène son épouse en Turquie puis revient sans elle en France, et garde les enfants. L'association s'attache à régler ces cas très douloureux avec l'aide de l'OMI en faisant rapatrier ces femmes, peu nombreuses dans cette situation. Les vrais problèmes se posent pour les jeunes filles turques issues de l'immigration et mariées de force, et surtout pour les brus arrivées en France en vue de mariages arrangés pour satisfaire les belles-mères. Ce sont elles qui subissent les plus grandes violences, parce qu'elles ne parlent pas français, parce qu'elles n'ont pas le droit de sortir, parce qu'elles n'ont aucune liberté, parce qu'elles n'ont pas de papiers ou seulement des papiers provisoires. Il peut même arriver qu'un mari, lassé de cette femme qui ne lui convient pas, écrive lui-même au préfet pour dire qu'il s'agissait en fait d'un mariage qui lui a été imposé ; le résultat ne se fait pas attendre : ordre de quitter le territoire ! L'association doit alors multiplier les interventions auprès des préfectures et trouver les moyens d'accompagner, d'héberger et de socialiser ces malheureuses. Si elles sont bien accompagnées, ces femmes acquièrent d'ailleurs leur autonomie en un an à dix-huit mois, même si elles ont charge d'enfants. Les jeunes filles turques issues de l'immigration sont moins vulnérables car elles connaissent le français et la société française. Ce dont elles ont besoin, c'est d'un coup de pouce si elles décident de quitter leur famille, pour les aider à surmonter l'idée qu'elles trahissent et une pression psychologique tellement forte qu'elle les conduit à l'autocensure. Sans rien leur cacher de ce que signifie une décision aussi radicale, l'association apporte une aide à ces jeunes filles. Il s'agit de jeunes filles qui ne sont pas autonomes et pour lesquelles on devra, pour éviter des « crimes d'honneur », trouver un hébergement à l'autre bout de la France. Il faut aussi leur faire comprendre que leur rêve d'études supérieures va se heurter très vite au principe de réalité, puisqu'il leur faudra travailler, quitte à reprendre leurs études par la suite. Si elles sont déterminées, l'association les aide à aller au bout de leur projet de départ. Elle propose parfois une médiation, que ces jeunes filles refusent la plupart du temps, craignant que les pressions redoublent, sinon pire. La situation est d'autant plus difficile que les garçons s'opposent très rarement à ces pratiques, qui leur permettent de jouir d'un confort paisible : pour peu qu'ils épousent la femme que leur mère a choisie pour eux, libre à eux de mener une double vie et même d'avoir, ailleurs, une famille illégitime. L'essentiel, c'est que la femme officielle soit turque. Rares sont les fils capables de dire qu'ils veulent mener leur vie comme ils l'entendent et qu'ils ne prendront pas pour épouse la femme que l'on souhaite leur imposer. Dans ce contexte, la seule solution est l'information, qui doit se faire à l'école, car si l'école républicaine est émancipatrice pour les filles, elle ne l'est pas pour les garçons ; il faut donc faire mieux. Les interventions faites par l'association ELELE dans les villes de Seine-Saint-Denis telles que Clichy-sous-Bois ou Montfermeil où la population turque est nombreuse, montrent que c'est une des voies principales permettant de contourner les diktats familiaux. A l'école, où les élèves sont d'origines diverses, des interactions se produisent, telles que des émotions sont verbalisées qui auraient été tues autrement. Ainsi de cet adolescent de seize ans qui, ayant entendu Mme Gaye Petek expliquer les inconvénients qu'il y a à un mariage arrangé avec une jeune fille n'ayant jamais quitté son village turc natal, déclara : « Mais si l'on ne fait pas ça, si je sors avec une des filles qui sont là et que je ne suis pas le premier, où est mon honneur ? ». Ce à quoi un jeune Maghrébin rétorqua que l'on n'était quand même plus au Moyen-Age... Il s'ensuivit une discussion passionnée sur l'amour mais aussi sur le respect, la question étant posée de savoir jusqu'à quel point il faut respecter ses parents si l'on souhaite exister en tant qu'individu. Voilà tout ce dont il faut parler ! Il est temps de comprendre que l'on ne peut faire exactement les mêmes cours au lycée Henri-IV et dans des classes composées à 70 % de jeunes gens issus de l'immigration. Ignorer la réalité ne sert qu'à perpétuer des erreurs dommageables. Il est indispensable d'aborder ces sujets à l'école, car les familles ne vont pas changer très vite, et ce ne sont pas les « prêches laïques » que Gaye Petek fait dans les mosquées modérées qui suffiront à ébranler les consciences masculines dans un avenir proche... Mais elle les fait quand même, toute convaincue qu'elle soit qu'une évolution ne sera possible, s'agissant du mariage forcé, que si l'on se livre à un travail patient d'éducation et de prévention. Actuellement, les jeunes filles françaises issues de l'immigration turque sont, pour 95 % d'entre elles, mariées à des hommes turcs. Le mariage arrangé est donc une stratégie. Parfois, ça marche, bien sûr, comme ça marchait dans la France du XIXe siècle... Mais, dans l'ensemble, cette pratique ne rend pas les gens particulièrement épanouis, qu'il s'agisse des filles ou des garçons, ces garçons qui ne parviennent pas à dire « non » à leur mère, mais qui souffrent de devoir mener une double vie les obligeant à rentrer chez leur épouse quoi qu'il leur en coûte, et qui finissent par passer leur colère sur cette pauvre femme au lieu de s'en prendre à leur mère. Et pendant ce temps, des « crimes d'honneur » continuent d'être commis... Le mariage arrangé tient-il à des raisons religieuses ? Pour partie seulement. Il y a aussi ce que l'on doit qualifier d'interdits féodaux, puisque l'on constate également des mariages forcés chez les Kurdes ou les Turcs alevi, pourtant très ouverts, ainsi que chez les Assyro-Chaldéens chrétiens. L'obligation, dans ces derniers cas, n'est pas d'ordre religieux, mais les mariages doivent se faire à l'intérieur du groupe pour que le lignage ne soit pas interrompu. Revenant sur le contrat d'accueil et d'intégration, Mme Gaye Petek a souligné qu'il s'agit d'une excellente solution pour l'avenir, mais qu'il aurait dû être obligatoire. Elle déplore de ne pas avoir été suivie sur ce point et insiste pour que l'on ne s'endorme pas une fois la disposition adoptée. Le plus important n'est pas que 90 % des immigrants signent le contrat, comme c'est le cas, mais qu'une fois le contrat signé tous participent aux modules de formation et d'apprentissage du français ; or, dans ce domaine, la proportion n'est pas du tout la même. Par ailleurs, le maximum doit être fait pour recevoir les femmes seules, avec un interprète, au lieu qu'elles soient accompagnées d'un mari ou d'un frère dont elles dépendent faute de maîtriser le français. Enfin, il faudrait être certain que ceux qui sont chargés de l'accueil des immigrants sont formés à distinguer la situation d'une Russe qui arrive en France munie d'un diplôme de second cycle d'études supérieures et celle d'une paysanne anatolienne. Or, ce n'est pas si sûr... La journée de formation civique est essentielle, mais encore doit-elle se dérouler dans de bonnes conditions. L'OMI doit donc admettre que, puisque six heures sont jugées nécessaires, elles doivent être intégralement dispensées. Cela signifie la constitution de groupes de niveau si possible homogènes mais surtout parlant la même langue lorsque les personnes sont non francophones, et non pas l'agrégation d'individus parlant des langues différentes dont les interprétations successives s'imputent sur le temps théorique de formation. Poursuivre dans cette voie, c'est le meilleur moyen de tout rater, alors que cette journée donne l'occasion de parler de l'égalité et de la laïcité. On sait d'expérience à quel point le sujet intéresse, mais aussi qu'il demande à être précisément expliqué. La journée sert aussi à donner un aperçu des institutions françaises, et de la protection qu'elles peuvent apporter. Le mariage est, de très loin, le motif de délivrance de carte de séjour le plus fréquent pour les femmes turques, dont 19 % seulement sont actives. Encore celles qui travaillent le font-elles à domicile - principalement pour la confection ou la restauration de type familial -, ce qui rend bien difficile la réponse aux questions de la Délégation qui portent sur leur insertion professionnelle. Rares sont les femmes turques salariées indépendantes. Néanmoins on observe que parmi les « brus » arrivant de Turquie il existe de meilleurs niveaux d'études que chez leurs conjoints « franco-turcs » et que certaines aspirent à parler le français puis à suivre une formation conduisant au travail. Cependant on retrouve les obstacles familiaux liés à la « permission » qui leur est donnée ou non de travailler. Voilà pourquoi l'association ELELE privilégie l'apprentissage du français, puis la formation professionnelle pour celles qui en ont l'envie et la capacité. Les connaissances linguistiques sont capitales. Or, les femmes turques de la première génération d'immigration sont toutes non francophones, même lorsqu'elles sont en France depuis trente ans. Quant aux brus, il est douteux qu'on les laisse libres de se rendre aux cours de français. C'est ce qui explique qu'elles ne signent pas toujours le contrat d'accueil et d'intégration : les maris disent que cela ne leur sert à rien, puisqu'elles restent à la maison. Voilà pourquoi la signature de ce contrat doit être rendue obligatoire. Mme Bérengère Poletti a dit avoir pu constater, dans sa pratique professionnelle, l'extrême réclusion des femmes turques, qui plus est regroupées dans les mêmes quartiers et ne parlant pas français alors même qu'elles vivent en France depuis des années, au point qu'un interprète est nécessaire lors des accouchements... On n'observe pas de tels phénomènes dans d'autres communautés. Mme Gaye Petek a répondu que le repli communautaire et l'enfermement posent problème aux travailleurs sociaux, et souligné qu'au début de l'immigration turque en France, les choses étaient très différentes : les hommes étaient affables, syndiqués, amateurs de rencontres amicales au café, joueurs de PMU... Mais c'était l'époque où ils pensaient leur immigration temporaire, avant que ne les prenne la peur panique de décevoir ceux qui étaient restés au pays. Or, que se passe-t-il à présent ? Ils sont, lorsqu'ils retournent en Turquie, considérés comme plus « ploucs » que quand ils sont partis. Quel échec ! Mme Bérengère Poletti a noté qu'au contraire les femmes qui s'intègrent, s'intègrent parfaitement. Mme Gaye Petek a répondu que cela s'explique fort bien : elles ont pour références les femmes qui, en Turquie, sont ministres, juges à la Cour constitutionnelle, médecins légistes... Mais c'est là un statut reconnu aux femmes des villes. Ainsi, elle-même se sait respectée pour son savoir lorsqu'elle va parler dans les mosquées, mais elle sait aussi que les hommes auxquels elle s'adresse n'aimeraient pas que leur femme ou leur fille lui ressemblent... M. Patrick Delnatte a demandé quelles sont les relations entre les familles et l'école. Mme Gaye Petek a répondu que les familles respectent le savoir qui y est dispensé, mais qu'elles ont peur de sa capacité à intégrer. Il résulte de cette ambivalence, qu'une fois rentrés à la maison, les enfants sont priés de laisser leur cartable fermé - autrement dit, de laisser le contenu de l'enseignement des infidèles aux infidèles. Il y avait, jusqu'à présent, très peu de contacts entre les parents turcs et l'école, mais une évolution récente se fait sentir avec les jeunes mères qui parlent un peu français. Il serait bon d'apprendre à ces jeunes femmes quel peut être leur rôle, et que l'on peut être mère autrement qu'en se limitant à poser des interdits et des autorisations. L'association ELELE a constitué des groupes de formation à la parentalité pour les jeunes mères, et les chefs d'établissement de certaines écoles maternelles où l'association intervient en redemandent car les mères qui y ont eu accès ont radicalement changé de comportement, acceptant désormais de venir à l'école parler de leurs difficultés d'éducatrices. Dans le même temps, le respect pour l'école est réel, et si un enfant turc y fait une bêtise, il sera réprimandé. Pour des raisons aisément compréhensibles, la première génération d'immigrés a éprouvé les plus grandes difficultés à aider ses enfants, qu'elle n'a d'ailleurs pas beaucoup encouragés - et surtout pas les filles... Une enquête a été menée, qui portait sur deux échantillons de parents issus du même village d'Anatolie. Le premier groupe était resté sur place mais transplanté à Istanbul dans le cadre de l'exode rural, le second avait émigré en France. Interrogés sur le point de savoir ce qui, pour eux, était le plus important quand les enfants rentraient de l'école, 81 % des Turcs de France ont répondu qu'il fallait d'abord aider sa mère puis faire les devoirs, 81 % des Turcs restés au pays répondant l'inverse... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a exprimé sa préoccupation. Mme Gaye Petek a souligné qu'il existe, heureusement, des exemples de réussite, tel cet architecte, fils d'ouvrier, qui ressent comme essentiel le fait que sa mère, analphabète, se soit intéressée, tous les soirs, à ce qu'il avait fait à l'école. Mais, dans leur immense majorité, les enfants de l'immigration turque ne partent pas gagnants ; ils pourraient l'être, mais ils doivent y être aidés. Certes, ils démarrent avec un moins grand handicap que les jeunes issus de l'immigration maghrébine, car ils n'ont pas à faire face à des a priori aussi négatifs. En fait, les jeunes gens turcs, et singulièrement les jeunes filles, souffrent de discriminations dues à leurs parents plus qu'à la société. Rares sont les mères qui peuvent dire à leur fille : « Sois autre que moi ». Leur discours est plutôt : « Comment puis-je exister si tu ne me ressembles pas, puisque je n'aurai pas éduqué ma fille à ma ressemblance ? » Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé à quel âge les enfants turcs apprennent le français. Mme Gaye Petek a répondu que l'école étant ressentie comme un passage obligé, les enfants vont à la maternelle. En revanche, on constate une forte résistance aux activités périscolaires, qu'il s'agisse de sorties, de classes de neige ou de classes vertes. Le fait que le conjoint vienne de Turquie sans parler français et qu'il ne l'apprenne pas a pour conséquence que l'on parle turc à la maison, que l'on regarde les programmes de télévision turcs et que l'on n'a pour amis que des Turcs avec lesquels on ne parle pas français, puisque le parent primo-arrivant ne maîtrise pas cette langue. Il ressort d'une enquête menée récemment en Alsace que les jeunes enfants d'origine turque actuellement en maternelle éprouvent plus de difficultés que leur propre parent francophone n'en avaient eu au cours des années 1970... Cela s'explique par la confusion linguistique qui règne à la maison, où l'on parle un mauvais turc et un mauvais français puisqu'un parent a grandi en France et que l'autre est primo-arrivant. Mme Danielle Bousquet a demandé si la classe sociale influe sur le comportement. Mme Gaye Petek a répondu qu'il n'y a guère de différence sociale entre les immigrés à leur arrivée en France, exception faite de ceux qui sont venus comme intellectuels réfugiés, pour poursuivre des études et faire carrière ou encore pour ouvrir un commerce ou un bureau. Les différences s'installent peu à peu, selon l'ampleur de la réussite économique, et la situation d'une famille diffère bien sûr selon qu'elle est affectée par le chômage et la précarité ou que le père réussit comme entrepreneur. Pour autant, il est illusoire de penser que la réussite économique signifie obligatoirement intégration. On dénombre de nombreux Turcs qui travaillent, qui ont acquis la nationalité française, qui ont une grande maison et une grosse voiture, mais qui ne partagent pas le minimum des valeurs communes aux démocrates. Mme Bérengère Poletti a souligné que, lorsqu'un membre de la communauté turque achète une maison, il la choisit toujours dans un quartier dans lequel habitent d'autres Turcs. Mme Gaye Petek a dit qu'il s'agit d'un communautarisme plus nationaliste que religieux. On constate une identification à la nation turque, très différente du ressenti des jeunes gens d'origine maghrébine. Les jeunes issus de l'immigration turque s'identifient à l'extrême droite turque et au panturquisme, mais pas à la religion en cas de fracture identitaire, alors que les jeunes d'origine maghrébine se tournent vers les talibans. A cet égard, le débat sur la place de la Turquie en Europe est redoutable et l'on peut craindre un retour de bâton nationaliste de la part de jeunes gens qui ne cessent de lui demander : « Pourquoi les Français ne nous aiment-ils pas ? » Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a personne pour répondre à ces questions. L'association ELELE est prête à jouer ce rôle, mais toutes les autres sont des associations cultuelles. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné le grand mérite de l'association et de sa directrice mais jugé profondément inquiétante la description de la situation. Mme Gaye Petek a répondu qu'il ne faut pas se voiler la face et que l'évolution perceptible est, en effet, peu encourageante. Il faut agir. Mme Danielle Bousquet a demandé si les enseignants qui ont beaucoup d'élèves turcs ont conscience de cette réalité et si des programmes spécifiques ont été mis au point. Mme Gaye Petek a répondu qu'une prise de conscience se fait dans les classes de non-francophones. Le problème, c'est que les IUFM n'ont pas d'argent à consacrer à de telles formations. De ce fait, tout dépend des individus. Certains enseignants remarquables se documentent, mais il n'y a pas de doctrine globale. Pire : certains enseignants expliquent qu'il leur est interdit de faire référence à la culture d'origine d'un élève. Manifestement, certains messages ne passent pas au sein de l'Education nationale. Mme Danielle Bousquet a observé que la France n'ayant pas pris conscience d'être multiculturelle, on continue à former les enseignants à l'éducation de jeunes Bretons et de jeunes Normands. Mme Gaye Petek a souligné qu'un certain sentiment de culpabilité semble interdire d'aborder les questions qui fâchent, telle celle des mariages forcés. Lorsqu'elle a commencé d'en traiter, il y a une douzaine d'années, elle-même s'est entendu accuser de stigmatiser la communauté turque. L'association ELELE a averti que si la question n'était pas traitée, la presse s'en emparerait, et de manière bien plus violente ; cela n'a pas manqué. Mme Bérengère Poletti a demandé si la situation est la même en Allemagne. Mme Gaye Petek a répondu que l'immigration turque y est plus ancienne de dix ans et que la première vague, venue de l'ouest de la Turquie, était même celle de femmes chefs de famille venues seules, avant leur mari ; ceci a constitué, au fil du temps, une classe moyenne d'origine rurale certes, mais avec des réflexes de classe moyenne. Ensuite sont venus des réfugiés politiques issus du monde urbain et de haut niveau d'éducation, qui ont créé de nombreuses associations similaires à ELELE et proposant des activités culturelles. En Allemagne aussi, les immigrés turcs se marient entre eux, mais 40 % des jeunes se marient entre Turcs d'Allemagne, ce qui est beaucoup plus, et beaucoup mieux, qu'en France. Au sein de l'association ELELE, toutes les catégories sociales se rencontrent, mais c'est un des rares lieux où cela se fait. Pour le reste, il n'y a ni mélange, ni solidarité entre les diverses couches sociales des Turcs de France. Quant aux immigrés turcs qui rentrent en vacances au pays, ils souffrent d'une image bien plus négative qu'en France : la société turque porte sur eux des jugements très durs, estimant qu'ils nuisent à l'image de la Turquie en Europe. De fait, rien ne reflète une Turquie moderne et évoluée dans ces rassemblements de dizaines de femmes voilées... Mais, une fois encore, l'on n'aborde pas comme on le devrait les questions qui fâchent. C'est ainsi qu'au motif qu'elle a participé à la commission Stasi, elle-même est invitée à traiter sans relâche de la laïcité, parce que les Français de souche n'osent pas le faire. Mme Bérengère Poletti a déclaré qu'il règne une grande confusion dans les esprits entre immigration et racisme. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a chaleureusement remercié Mme Gaye Petek, qui a souligné, en conclusion, l'absolue nécessité de l'éducation et de la formation. Audition de Mme Damarys Maa, présidente de la fédération IFAFE (Initiatives des femmes africaines de France et d'Europe) Réunion du mardi 14 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité la bienvenue à Mme Damarys Maa, présidente de la fédération IFAFE, que la Délégation a souhaité entendre dans le cadre de sa réflexion relative à une meilleure intégration des femmes immigrées et issues de l'immigration. L'association a participé aux travaux du groupe de travail « Femmes de l'immigration » qui a remis le 7 mars dernier un rapport à ce sujet aux ministres de la parité et de la justice. Elle a donc été associée à la réflexion sur les difficultés d'intégration des femmes de l'immigration, particulièrement les femmes africaines. La Délégation entendra avec un grand intérêt l'avis de Mme Damarys Maa sur : l'accès des femmes immigrées à leurs droits et la conquête de leur autonomie juridique ; les problèmes particuliers des femmes africaines confrontées aux mariages forcés, à la polygamie, aux répudiations ; le problème des femmes migrantes qui arrivent pour la première fois en France ; l'insertion professionnelle des femmes immigrées, souvent peu qualifiées, possédant mal le français, et davantage touchées par le chômage que les Françaises. Mme Damarys Maa a remercié la Délégation de l'avoir invitée à s'exprimer. Elle en est d'autant plus touchée que les problèmes spécifiques des femmes immigrées n'ont que tardivement commencé d'être pris en considération. Cela fait chaud au cœur de celle qui milite depuis de longues années, si longues qu'elle souhaite prendre sa retraite de militante mais s'inquiète de l'absence de relève. Dans leurs permanences, les associations membres de la fédération IFAFE reçoivent des femmes, africaines ou non, car toutes les femmes peuvent souffrir des mêmes problèmes : une femme battue est une femme battue, quelle que soit son origine. Mais les femmes immigrées souffrent d'une double voire triple discrimination de par leurs origines et de par leurs statuts. IFAFE a été créée en 1993, sous forme d'association loi de 1901. Mme Damarys Maa, qui avait déjà beaucoup milité contre l'apartheid, était à l'époque directrice de son agence de communication par l'événementiel qu'elle avait créée en 1992. Cette année-là, elle a considéré qu'il était temps d'aider les femmes issues de l'immigration qui n'avaient pas eu la chance de parvenir à des postes de responsabilité, en entreprise ou comme indépendantes et, avec des amies dans son cas, elle a décidé d'agir pour aider à l'intégration de la population étrangère en France, pour lutter contre l'image négative des femmes africaines, trop souvent considérées seulement comme l'une des épouses d'un mari polygame, pour combattre le racisme et les discriminations et enfin pour aider au développement des pays d'origine. Mme Damarys Maa, qui est d'origine camerounaise, a souhaité que l'association rassemble des femmes de tout le continent africain, afin de confronter des cultures et des traditions différentes, si bien qu'IFAFE est une Afrique en miniature. En 1996, l'association a décidé qu'il fallait pour être plus visible et plus efficace, se constituer en fédération. Elle comprend 23 associations en France, dont 15 sont présidées par des femmes. IFAFE s'était en effet ouverte aux associations mixtes en 2000. Chacune des associations membres de la fédération IFAFE est une association loi de 1901 autonome, mais toutes ont le même plan d'action. Lorsqu'il n'existe pas d'association locale, les membres de la fédération se rendent sur place pour voir comment apporter une aide aux femmes en difficulté. Abordant la question de la polygamie, Mme Damarys Maa a souligné que les difficultés tiennent au regroupement familial. La polygamie touche majoritairement des femmes africaines musulmanes qui ne parlent pas ou peu le français. Issues du Mali, de Mauritanie, du Sénégal, du Niger, des Comores et de Djibouti mais aussi du Maghreb, elles sont venues rejoindre leur mari, mais c'est lui qui détient le pouvoir, c'est lui qui garde leur passeport et c'est lui qui touche les allocations familiales, car elles n'ont pas de papiers à présenter à l'administration. Ne connaissant pas leurs droits et ne maîtrisant pas le français, elles sont sans moyens d'action. Lorsqu'elles se tournent vers l'association, celle-ci est impuissante, car elle ne peut contraindre un époux à restituer ses papiers à sa femme. La méconnaissance qu'ont les Africaines des circuits administratifs français les empêche d'accéder à leurs droits, ce dont les hommes profitent, allant jusqu'à les séquestrer. Bien souvent, les maris les accompagnent au marché pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec d'autres femmes qui pourraient leur ouvrir les yeux. C'est ainsi que des jeunes femmes arrivées d'une lointaine province malienne se trouvent tout à coup habiter un appartement, devoir utiliser des toilettes, comprendre l'usage de l'électricité et contraindre leurs enfants à se tenir correctement en public comme en Afrique avec des revers tels que certains enfants peuvent menacer leurs mamans de les dénoncer auprès de la DDASS ou des assistantes sociales... Cela n'a rien d'évident, surtout lorsque l'ombre du mari pèse. Si les informations nécessaires étaient données, dès le départ, par le consulat qui délivre le visa, la femme immigrante saurait qu'il existe des associations qui peuvent l'aider et surtout qu'elle jouit de certains droits, mais aussi que l'immigration n'est pas le paradis. En France même, chaque association, chaque service social travaille dans son coin, au mépris d'une transversalité pourtant indispensable. En outre, l'ignorance des cultures des autres conduit à des erreurs psychologiques grossières. Une assistante sociale qui demandera brutalement à une femme dont le mari est polygame : « Pourquoi ne divorcez-vous pas ? » n'obtiendra rien. En revanche, les membres d'IFAFE peuvent expliquer ce qu'est la décohabitation en ménageant les traditions ; si l'on ne procède pas ainsi, on court au blocage. En résumé, le manque de complémentarité ne facilite pas les choses. Et pourtant, ce sont des gens parfois bien maladroits qui demandent aux membres d'IFAFE de prouver leurs compétences... Les mariages polygames entraînent une promiscuité redoutable. Quoi qu'elles en disent, les femmes qui vivent dans cette situation ne peuvent vivre bien, car ce qui se pratique en Afrique n'est pas transposable en France. Où est la grande cour dans laquelle chaque épouse dispose de sa propre case ? En France, les femmes sont contraintes de partager le même appartement, où cohabitent une multitude d'enfants. Le moins que l'on en puisse dire, c'est que ce n'est pas pratique. Comment s'étonner qu'un jour ou l'autre des problèmes surgissent ? En outre, les maris confisquant cartes de séjour et de sécurité sociale, leurs différentes femmes accouchent sous un nom qui n'est pas forcément le leur. Il s'ensuit des épisodes dont on se demande pourquoi les services de maternité ne sont pas surpris. N'est-ce pas un phénomène mystérieux qu'une femme ayant accouché deux mois auparavant vienne accoucher à nouveau ? La loi sur le regroupement familial n'a pas été assortie des mesures permettant aux familles polygames de vivre dans un pays qui interdit la polygamie. Or, le regroupement familial étant acquis, les hommes en ont conclu qu'ils peuvent faire venir leurs épouses. Il en résulte que les enfants vivent dans des foyers surpeuplés où ils n'ont aucun espace. C'est un facteur d'échec scolaire patent ; les enfants sont, d'emblée, victimes de cette promiscuité. Pour chaque femme venue dire sa détresse, les membres d'IFAFE rédigent une fiche expliquant ce qui a motivé sa démarche. Les questions qui permettent sa rédaction montrent que les problèmes s'emboîtent comme des poupées russes. On se rend ainsi compte qu'une femme venue pour un problème de papiers est mariée à un homme polygame, puis que celui-ci la frappe. On découvre aussi que certaines femmes sont en situation irrégulière par simple méconnaissance de la réglementation, ou pour avoir donné foi à des rumeurs. Il arrive que l'association parvienne à rattraper certaines erreurs. Certaines associations membre de la fédération IFAFE dispensent des cours d'alphabétisation sous forme d'ateliers de savoirs de base dans le cadre du co-financement de la politique de la ville (FASILD, sous-préfecture et conseil général). Mais on est une nouvelle fois confronté à des problèmes gigognes, car il est bien difficile d'assister à un cours avec des enfants en bas âge. Il faut donc prévoir des garderies et prévoir aussi, dans ces garderies, des jeux éducatifs pour des enfants qui très souvent ne les ont pas chez eux. Certains enfants très perturbés ont de bonnes raisons de l'être : ils ne voient jamais leur mère, qui part faire le ménage dans des bureaux à cinq heures du matin, reviennent quand ils sont à l'école et repart travailler en fin d'après-midi avant qu'ils aient quitté la classe. Comment s'étonner de l'agressivité de ces enfants-là à l'école ? Ils sont pris en charge, plus ou moins bien, par l'autre épouse ou par les grands frères et grandes sœurs, mais leur mère, absente par force, n'a pas d'autorité sur eux. Mme Danielle Bousquet a demandé quel était le rôle du père, hormis celui de collecteur des allocations familiales. Mme Damarys Maa a fait observer que, dans une famille africaine, le rôle du père n'est pas de s'occuper des enfants et que, par ailleurs, l'éboueur qui rentre chez lui le soir, sa journée accomplie, est épuisé. Il arrive que l'on parvienne à faire comprendre aux parents pourquoi leurs enfants sont perturbés, mais l'association n'a aucun moyen d'action. Or, elle a eu connaissance d'au moins cinq cas de ce genre, à Paris, à Lyon et à Rouen. C'est dire que si l'on creuse, on trouvera de multiples cas similaires, partout, ce qui est très préoccupant ; ne s'agit-il pas des adultes en devenir de la France de demain ? Et la décohabitation ne résout pas les problèmes car, même lorsqu'elle semble acquise, l'homme continue de faire le tour des appartements, de faire des enfants à sa femme et de percevoir les allocations familiales. Les femmes ne sont pas plus autonomes qu'elles ne l'étaient précédemment et continuent de dépendre de lui. Un divorce à la hâte sollicité par le système de « décohabitation » n'est pas considéré en tant que tel par ces familles, ni en France ni, encore moins, en Afrique. M. Patrick Delnatte a dit avoir cru comprendre que la décohabitation entraînait de facto l'attribution des allocations familiales à la mère. Mme Damarys Maa a répondu que la mesure commence seulement d'être appliquée. Abordant la question des mariages forcés, elle a expliqué que la pratique concerne la plupart du temps des femmes musulmanes ne parlant pas ou parlant mal le français. Elle a fait état d'un cas porté tout récemment à sa connaissance, qui témoigne d'une évolution inquiétante. Il s'agit d'une jeune fille renvoyée en Afrique à l'âge de huit ans, que l'on fait revenir à dix-huit ans, alors qu'elle a tout oublié du français, parce qu'elle a un passeport français. Après quoi, on a voulu en quelque sorte vendre ce passeport français à un immigré en situation irrégulière en forçant la jeune fille à l'épouser. Pour elle, l'alternative était la suivante : soit le refus du consentement au moment du mariage, mais les pressions familiales sont énormes, soit la fuite, sachant que son passeport demeure confisqué par la famille. Dans un cas comme celui-là, un nouveau problème se pose : celui de l'hébergement d'urgence. La fédération IFAFE et ses associations membres y sont confrontées de manière permanente et ne peuvent le résoudre. Et pourtant ! Que faire lorsqu'à minuit, des femmes et parfois des enfants se trouvent à la rue et que le 115 ne répond jamais ? Il arrive que les membres de l'association recueillent ces femmes chez eux, mais ce ne peut être une solution. On constate que les services publics, faute de structure adéquate, en viennent à héberger dans l'urgence ces femmes à l'hôtel - où elles n'ont pas le droit de cuisiner, alors qu'elles ont des enfants... Cette politique, qui coûte une fortune, est incohérente. Mieux vaudrait retaper des immeubles ou de vieilles maisons pour reloger ces femmes en difficulté. Les associations européennes sœurs de la fédération IFAFE se sont d'ailleurs dites estomaquées par cette solution hôtelière ; réunies à l'occasion d'une rencontre organisée par la fédération IFAFE et portant sur l'égalité des chances en Europe, et mises au courant de cette pratique, elles ont dit leur admiration pour cette France si riche ! M. Patrick Delnatte a demandé si les femmes dont il est question sont en situation régulière. Mme Damarys Maa a répondu que l'association cherche à aider toutes les femmes en difficulté, qu'elles aient ou non des papiers. Mme Danielle Bousquet a observé que, la politique du Gouvernement tendant à refuser toute régularisation, les problèmes demeureront inextricables. Mme Damarys Maa a souligné que l'absence consternante d'hébergement d'urgence concerne aussi et surtout les femmes en situation régulière. La différence, c'est que celles-là ont droit à des aides, et pas les autres. Il faut aussi parler des mariages voulus, contractés sur Internet par certains Européens en mal d'exotisme ou d'une femme soumise, mais qui la mettent à la porte quand elle ne répond pas au fantasme ou au cliché traditionnel qu'ils se font de la femme africaine. Il arrive également que des femmes s'enfuient car elles sont victimes de violences de la part de leur mari français. Où les loger ? Comment les aider ? On assiste d'autre part à une extension permanente de la prostitution forcée. Les femmes contraintes de s'y soumettre proviennent en majeure partie des pays anglophones d'Afrique de l'Ouest, principalement du Nigeria, du Ghana et de Sierra Leone, exerçant la prostitution dans les camions des trafiquants. La fédération IFAFE a prévu une campagne de sensibilisation l'année prochaine, pour mettre en garde, dans les pays d'origine, contre les mères maquerelles qui ont elles-mêmes vécu cette situation et qui vont « recruter » sur place. Les innocentes appâtées ignorent qu'aussi longtemps qu'elles n'auront pas remboursé leur billet d'avion, elles seront à leur tour contraintes de se prostituer, sous peine de voir leur propre famille menacée. Mme Danielle Bousquet a demandé par quel biais des femmes africaines arrivent en France alors que celui qui les fait venir est déjà marié. Mme Damarys Maa a expliqué qu'elles entrent sur le territoire avec un visa de tourisme. Voilà pourquoi elles ne peuvent obtenir une carte de séjour, voilà pourquoi elles se trouvent toutes en situation irrégulière, certaines disposant cependant d'un titre de séjour temporaire d'un an. Mme Danielle Bousquet a dit connaître de multiples cas de ce genre. Et si l'on parvient à en régler un ou deux avec la préfecture, rien n'est possible pour l'immense majorité des autres. C'est ainsi que des femmes sont contraintes de vivre avec douze euros par jour alors qu'elles ont des enfants scolarisés en France. Souvent, des réseaux de soutien se mettent en place, mais aucune solution n'apparaît : il n'existe pas de solution d'hébergement, il n'y a pas de régularisation possible et elles n'ont pas le droit de travailler, si bien qu'aucun employeur, à supposer qu'il le veuille, ne peut les embaucher. Dans ces conditions, que faire ? Doivent-elles se prostituer ? Cette situation est monstrueuse ; pourtant, elle se répète à l'infini, et des familles entières sont à la rue. C'est l'impasse. On ne peut s'en satisfaire. M. Patrick Delnatte a observé que le problème tient aux conditions de délivrance des visas. Mme Danielle Bousquet a fait valoir que l'on ne peut refuser un visa touristique, et souligné les conséquences de la traite internationale des femmes, qui enrichit bien des truands. Mme Damarys Maa a indiqué que le nouveau contrat d'accueil et d'intégration est une bonne chose, mais que les femmes sont une nouvelle fois pénalisées, leur assistance aux cours de français et de formation civique étant compromise par l'absence de garderies. Voilà pourquoi elles y sont peu nombreuses. Evoquant son parcours personnel, elle s'est désolée que l'on ne parle jamais des cas de réussite professionnelle des femmes issues de l'immigration. C'est toujours une image dévalorisante qui est donnée d'elles, ce qui n'a que des effets négatifs : non seulement les jeunes n'ont pas de modèles, mais ces projections nourrissent le racisme au sein de la population d'accueil. Pourtant, nombreuses sont les femmes d'origine africaine qui sont cadres ou ingénieurs, et nombreuses aussi celles qui ont créé leur commerce. Il est bien dommage que la France ne se rende pas compte de cela et que l'on en reste à des idées toutes faites selon lesquelles les immigrés ne seraient là que pour prendre le travail des autochtones. Par ailleurs, les associations telles qu'IFAFE ne sont pas assez soutenues, et l'action de leurs membres n'est pas reconnue à sa juste valeur. L'action associative est pourtant un formidable vecteur d'intégration et c'est aussi, on le sait, une passerelle vers l'action politique, notamment pour les femmes. Valoriser cette action militante motiverait bien des femmes, encore qu'il soit difficile de demander une telle implication à celles qui vivent dans la précarité. La relève souhaitée au sein d'IFAFE se fait attendre, ce qui est très préoccupant. Il faut dire aussi que les subventions, récentes, ont déjà été dramatiquement réduites, et que le besoin se fait désespérément sentir d'un local, à ce jour introuvable faute de fonds. Le ministère des affaires étrangères devrait pourtant être reconnaissant à une association dont l'action a, entre autre, permis le retour de deux jeunes Françaises d'origine sénégalaise qui avaient été expédiées au Sénégal sous la contrainte de leur famille ! Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué qu'elle appellerait l'attention des services concernés sur cette question. Mme Danielle Bousquet a dit s'inquiéter de l'avenir d'une génération d'enfants qui grandissent dans une société qui les rejette. Mme Damarys Maa a souligné que si tant d'Africains émigrent, c'est que la situation du continent, déjà catastrophique, ne cesse de se dégrader. Il faut en finir avec des programmes de développement concoctés ailleurs et qui ne collent aucunement à la réalité, et leur préférer des projets menés en partenariat après qu'ils auront été élaborés par les populations locales. Mme Danielle Bousquet a observé qu'il est absurde et illusoire de prétendre fermer les frontières, et que l'on n'empêchera jamais de venir des gens déterminés. On ne résoudra rien de cette manière. Mme Damarys Maa a dit le clamer avec d'autres, et souligné à regret n'être pas entendue. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant rappelé que l'UMP vient de tenir une convention sur l'immigration, Mme Damarys Maa a indiqué ne pas avoir été invitée à y assister. Aurait-elle pu y prendre la parole qu'elle aurait dit que l'on ne peut fermer les frontières ; que les immigrants seront de plus en plus nombreux car ils fuient la misère et qu'ils sont prêts à tout pour avoir un sort meilleur, y compris à mourir en cours de route ; qu'il appartient aux pays développés de trouver les moyens de maintenir ces populations désespérées dans leur pays d'origine. Ces moyens existent mais, jusqu'à présent, on a distribué larga manu de l'argent à des dirigeants qui s'en sont servis à des fins personnelles, par exemple pour s'acheter des appartements à Paris ou pour financer les coûteuses études de leurs enfants à l'étranger, pendant que la société civile continuait de souffrir. Que l'on commence donc par la formation et l'information en Afrique, que l'on explique enfin ce qu'est la gestion d'une association et celle des deniers publics ! Les gens ont soif de formation, et particulièrement les femmes, celles grâce à qui l'Afrique n'a pas encore complètement sombré. Mme Danielle Bousquet a souligné qu'il est inacceptable qu'un pays aussi riche que la France laisse à la rue des familles entières. Le besoin d'hébergement d'urgence ne cesse de croître, dans toutes les régions. Il est indispensable d'en tenir compte lors de l'élaboration de la prochaine loi de finances. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a chaleureusement remercié Mme Damarys Maa et souhaité qu'elle ne se décourage pas de poursuivre sa remarquable action militante. Audition de Mme Florence Lacaze, responsable de la commission femmes de la FASTI (Fédération des associations de solidarité aux travailleurs immigrés) Réunion du mercredi 15 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est réjouie d'accueillir Mme Florence Lacaze, responsable de la commission femmes de la Fédération des associations de solidarité aux travailleurs immigrés, dans le cadre de la réflexion que la Délégation aux droits des femmes a entamée en 2005 pour une meilleure intégration des femmes immigrées et issues de l'immigration. Cette Fédération rassemblant de nombreuses associations autonomes, présentes sur tout le territoire, engagées dans un travail quotidien de solidarité avec les personnes immigrées, la Délégation a souhaité que Mme Florence Lacaze commence par décrire l'origine de la Fédération et les activités des associations qui la composent en direction des femmes immigrées, avant de répondre aux questions qui lui ont été adressées en vue de préparer l'audition, qui portent sur quatre thèmes principaux : l'accès des femmes immigrées à leurs droits et la conquête de leur autonomie juridique ; les problèmes particuliers des femmes immigrées confrontées aux mariages forcés, à la polygamie, aux répudiations ; l'insertion professionnelle de ces femmes, souvent peu qualifiées, possédant mal le français, davantage touchées par le chômage que les Françaises ; le problème de l'accueil des femmes migrantes qui arrivent pour la première fois en France, avec le nouveau contrat d'accueil et d'intégration. Mme Florence Lacaze a répondu que la FASTI existe depuis 1966, qu'il a été créé autour des bidonvilles et a suivi ensuite les évolutions de la politique d'immigration, passant d'un public majoritairement masculin, arrivé en quête de travail, à un public de plus en plus varié et de plus en plus précaire. Cela l'a conduit à développer des activités d'alphabétisation et d'accompagnement à l'autonomie, autour du vivre-ensemble, par exemple avec des cours de cuisine, des sorties culturelles et des actions pédagogiques. Les associations tiennent également des permanences juridiques d'accompagnement sur les questions du droit d'asile et des procédures liées aux actes racistes. La Fédération regroupe une centaine d'associations implantées dans les grandes villes, mais aussi ailleurs, comme par exemple à Villefranche-de-Rouergue. Elle est subventionnée par le FASILD, mais les choses sont de plus en plus difficiles. Ainsi, elle n'a reçu aucun financement pour l'organisation récente d'un forum sur la prostitution. Il était pourtant indispensable et il s'est tenu, mais grâce à l'action des militantes. Pour sa part, Mme Florence Lacaze est formatrice en travail social, et n'est pas salariée mais militante d'une association nantaise membre de la FASTI, le GASPROM - Groupement Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré. D'ailleurs, chacune des co-responsables de la commission femmes de la FASTI conserve une pratique de terrain au sein d'une association locale. Cette commission, composée principalement de structures regroupant des femmes issues de l'immigration et des femmes solidaires, a été constituée il y a une dizaine d'années à partir du constat que les femmes venaient vers les associations parce qu'elles vivaient une violence qu'il leur était difficile d'exprimer dans un lieu collectif et mixte. L'accueil qui leur est proposé permet de monter des dossiers, mais aussi de les écouter et de les orienter en cas de nécessité. La commission femmes s'est donc organisée autour de l'autonomie des femmes immigrées, afin qu'elles se ressaisissent de leur histoire et mènent leur propre combat. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé à Mme Florence Lacaze si elle était convaincue qu'il y avait pour les femmes un combat différent de celui des hommes à mener. Mme Florence Lacaze a répondu qu'elle en était persuadée : dans « femmes immigrées », il y a d'abord « femmes », et c'est bien à cela qu'il faut réfléchir en premier lieu. Il y a bien un parcours d'immigration propre aux femmes, lié à leur statut de mère et d'épouse et au fait que la législation les maintient en situation de dépendance. Il y a donc un travail supplémentaire à faire en vue de leur autonomie. Le but de la commission femmes est de leur permettre de se retrouver pour confronter leurs réflexions et leurs expériences sur les discriminations subies. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si les femmes venaient plus facilement qu'il y a quelques années et si la prise de conscience des problèmes était plus forte qu'en 1960. Mme Florence Lacaze a souligné que les difficultés tiennent essentiellement à la politique d'immigration et à la fermeture des frontières : on sait bien que réussir à obtenir un statut légal sur le sol français ou européen oblige à un véritable parcours du combattant et qu'on peut même parler aujourd'hui d'une certaine criminalisation de l'immigration. Les femmes qui viennent sont très impliquées dans ce mouvement ; elles étaient souvent militantes avant de venir ou ont rencontré, dans les associations, des personnes qui leur ont donné envie de lutter. De ce point de vue, il est important de rappeler que la FASTI n'est pas une administration, même s'il est appelé à faire de la domiciliation postale pour les dossiers d'asile, mais bien une fédération d'associations militantes. Et le message qu'il délivre aux femmes est : « vous avez votre histoire, votre lutte, nous sommes solidaires, mais c'est à vous de vous mobiliser pour la porter ». Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a exposé que la présidente d'une association turque, reçue hier par la Délégation, a expliqué constater une radicalisation dans la communauté turque, les femmes étant forcées à venir pour se marier et se trouvant souvent sous la coupe d'une belle-mère qui perpétue, en France, les traditions de l'Anatolie. Ces femmes se rendent-elles auprès des associations de la FASTI ? Mme Florence Lacaze a répondu que oui, et qu'on a bien le sentiment d'un retour au communautarisme, lequel est d'ailleurs souvent en décalage avec l'avancement du pays d'origine vers la modernité. Mais c'est aussi lié à la question de la fermeture des frontières : aujourd'hui le corps des femmes est devenu la seule possibilité pour accéder à un statut légal... C'est particulièrement frappant chez les Turcs : soit on vient épouser une femme française pour obtenir ce statut, soit la femme doit passer par la procréation pour obtenir des papiers. Cette ambiguïté doit conduire à envisager la question des femmes immigrées dans le contexte politique lié à l'immigration. Car il est bien difficile de se saisir de sa lutte, d'être autonome quand on est sans cesse menacée d'expulsion. Les femmes qui viennent voir les associations sont donc extrêmement courageuses. Elles ont des histoires extrêmement lourdes et violentes, comme cette femme congolaise victime de viols à répétition et qui a vu son mari assassiné devant elle. Or, ceux qui les reçoivent sont obligés de redoubler cette violence en leur soutirant leur histoire pour monter le dossier de l'OFPRA : quand on n'a que 21 jours, il est très douloureux de creuser rapidement le parcours d'une femme qui a subi 15 années de viols. Qui plus est, on sait que même une histoire aussi abominable ne suffira pas à lui faire obtenir un statut. Tant que la convention de Genève et les institutions ne reconnaîtront pas les femmes en tant que groupe social discriminé, même celles dont le retour est impossible dans un pays où le viol est une arme de guerre quotidienne ne pourront obtenir de papiers. On les aura donc amenées à raconter leur histoire, on aura redoublé la violence qu'elles ont subie, et elles seront malgré tout expulsées. Tel est le quotidien auxquelles les associations sont confrontées. Alors, parler d'autonomie des femmes, oui, mais dans quel contexte ? Car cela signifie d'abord leur assurer une sécurité de base, c'est-à-dire un hébergement - et ce n'est majoritairement pas le cas -, de quoi manger - et ce n'est pas davantage le cas -, la sécurité de leurs enfants - et ce n'est toujours pas le cas -, une place dans la société - et ce n'est bien sûr pas le cas non plus. Le travail des associations est donc d'abord, avant de parler d'autonomie, de leur assurer cette base, et on voit bien qu'avec la politique actuelle on n'y est pas... Ainsi, la carte de trois mois ne donnera jamais accès à un emploi : deux ans est un minimum. Qui plus est, l'autorisation de travailler dépend d'une décision préfectorale. Il y en a très peu, et il y a donc très peu de possibilités de développer l'autonomie de ces femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a regretté qu'on n'aborde jamais, quand on parle d'immigration, les problèmes particuliers des femmes, que ce soit sous l'angle de leur statut dans leur pays d'origine ou de la façon dont les choses fonctionnent dans le pays d'accueil. Mme Florence Lacaze a souligné qu'il y avait aussi une confusion entre immigration et droit d'asile : quand on parle encore d'« immigrées de la troisième génération », il y a de quoi penser que le travail d'intégration n'est pas bien effectué... Pour sa part, aux logiques d'intégration et d'assimilation, elle préfère celles du métissage et de l'interculturalité, qui sous-entendent que les femmes arrivent avec leur culture et qu'il y a échange, et non pas qu'on les oblige à la laisser à la porte pour entrer dans une culture différente. On pourrait par exemple se rendre compte qu'il est difficile pour une femme qui arrive d'une structure communautaire d'être accueillie en vis-à-vis, toute seule, par exemple lors d'une consultation gynécologique. Si on cherche à accompagner ces femmes, il faut réfléchir à la façon de mieux prendre en compte leur culture. Autre exemple, alors qu'en Occident quand on baisse les yeux c'est qu'on a quelque chose à cacher, en Guinée se regarder les yeux dans les yeux est un geste violent, la marque d'un manque d'éducation. Les membres de la commission femmes sont particulièrement vigilantes à ne pas être elles-mêmes productrices de violence au moment de l'accueil, même si elles y sont parfois contraintes pour monter un dossier. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a déploré qu'on ne prenne jamais en compte la difficulté de la confrontation de la culture de ces femmes à celle du pays d'accueil. Ne serait-il pas plus facile qu'elles soient accueillies par des femmes elles-mêmes issues de l'immigration plutôt que par des Françaises, blanches ? Mme Florence Lacaze a raconté l'histoire d'une femme, en France depuis deux ans, à qui elle a dit, alors qu'elles réfléchissaient ensemble à l'écriture d'un texte militant, qu'elle pouvait utiliser sa propre façon de parler. Elle s'est ainsi sentie, pour la première fois, acceptée telle qu'elle était. Ce qu'il faut, c'est considérer qu'on s'adresse d'abord à des personnes. Ce qui est important, c'est donc la manière dont on accueille ces femmes, pas le fait que celle qui les accueille soit française. D'ailleurs, confier cette tâche uniquement à des femmes issues de l'immigration renforcerait le communautarisme. Cela étant, le métissage des associations est très riche, chacune apporte sa vision différente, on est obligé de se réinterroger sans cesse sur le fonctionnement et c'est ainsi que se construit une identité collective. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité savoir comment les choses se passaient concrètement dans les associations et si elles tenaient des permanences quotidiennes. Mme Florence Lacaze a répondu que le GASPROM tient des permanences quasi quotidiennes, de 18 à 20 heures, qui ne désemplissent pas. Elles ont lieu dans un local du centre-ville de Nantes fourni par la mairie, mais que la préfecture essaie régulièrement de faire fermer. Ainsi, l'association accueille des prostituées, mais elle ne souhaite pas qu'elles soient identifiées en tant que telles mais en tant que femmes. Or la préfecture, qui s'intéressait à ces femmes à des fins de démantèlement de réseaux, a porté plainte contre l'association pour proxénétisme aggravé... Heureusement, la mobilisation des associations nantaises a empêché que cette plainte aboutisse, mais on voit bien là que toute la politique liée à l'immigration tend à l'isolement des personnes immigrées. À l'opposé, les associations essaient de les accompagner, d'obtenir pour elles le maximum de droits, notamment, s'agissant des prostituées, en étant des intermédiaires auprès de Médecins du monde. Dans la permanence du GASPROM, chaque vendredi soir le premier étage est strictement réservé aux femmes qui se retrouvent dans une salle collective, avec les enfants, avec la possibilité de s'isoler quand il faut creuser une histoire difficile, même si l'accueil collectif favorise aussi le soutien des femmes entre elles. En réponse à une question de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, Mme Florence Lacaze a indiqué que les moyens de l'association ne lui permettaient malheureusement pas de se rendre dans les quartiers, où il y a pourtant un important travail à faire. Elle a également souligné que l'association collabore avec le Planning familial, Médecins du monde et SOS femmes, mais pas avec la mairie, avec laquelle elle est parfois obligée de créer un rapport de forces pour aboutir à l'hébergement de familles qui sont à la rue. Évidemment, il est ensuite difficile de travailler ensemble... Il est d'ailleurs de plus en plus difficile de régler le problème de ces familles qui se retrouvent à la rue parce que leurs dossiers sont en attente ou parce qu'elles sont sans papiers. De telles situations sont de plus en plus fréquentes. Quand on voit errer des femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge et qu'on appelle le 115, on voit bien que la priorité est donnée à la population française et qu'ensuite seulement, s'il reste de la place, on accueille les femmes immigrées. Mais quand on est en France depuis une semaine, se trouver séparée de son mari est source d'une grande angoisse. Il est impossible de savoir combien de personnes sont concernées, mais il y en a beaucoup. Alors que Nantes n'est pas une ville de forte immigration, le GASPROM reçoit de 500 à 1 000 lettres par semaine... Revenant sur les subventions du FASILD, Mme Florence Lacaze a indiqué que leur diminution avait amené l'ASTI d'Orléans à interrompre, au prix d'une perte du savoir-faire de l'association, un projet très intéressant d'apprentissage linguistique pour les femmes, bien éloigné de la logique du contrat d'accueil et l'intégration. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente lui ayant demandé si la FASTI bénéficiait de l'écoute du ministère de l'intérieur, Mme Florence Lacaze a répondu que tel n'était absolument pas le cas, le soutien de la Fédération aux idées de libre installation et de libre circulation n'étant guère conforme aux tendances actuelles... Il est toutefois vrai qu'on voit mal comment on pourrait aujourd'hui se passer des activités de terrain des associations de solidarité avec les travailleurs migrants. Mais, si relations il y a, elles sont plutôt avec le ministère des affaires sociales et le service des droits des femmes qu'avec celui de l'intérieur. Il est d'ailleurs anormal de faire systématiquement le lien entre ministère de l'intérieur et immigration, en particulier quand on parle de femmes installées en France depuis des années. Mais c'est bien dans cette logique qu'on s'inscrit quand on affirme que l'immigration est un danger et qu'on associe systématiquement, depuis les attentats du 11 septembre 2001, immigré et terroriste. Pourtant, la tentative de fermeture des frontières liée à tout l'imaginaire qui se développe autour du risque d'invasion est un leurre, puisqu'on sait bien que l'exil a lieu essentiellement vers des pays limitrophes. Avec l'élargissement de l'Europe, la France est encore moins à même de subir une éventuelle explosion de l'immigration. À quoi bon, dès lors, continuer de véhiculer l'idée d'envahissement ? Ceux qui sont déjà installés en France vivent de plus en plus mal cette stigmatisation. Or, la loi du 23 février 2005 en faveur des Français rapatriés va aussi dans ce sens et des relents de colonialisme y apparaissent clairement. On peut aussi s'étonner que le film sur le « vivre en France » diffusé à l'occasion du contrat d'accueil et d'intégration ne soit pas traduit... On voit bien là qu'il est indispensable de se demander à qui on s'adresse et comment on le fait, quel discours on véhicule, comment il est perçu par les populations qui arrivent et par celles qui sont installées, comment éviter un repli communautaire qui découle précisément de tout cela. Si l'autonomie des femmes reste la grande priorité de la FASTI, qui cherche à stimuler leur auto-organisation, la Fédération prend bien soin de ne pas créer un décalage avec les hommes issus des mêmes communautés. Nacira Guénif-Souilamas a beaucoup travaillé sur ce sujet, en particulier dans son livre Les féministes et le garçon arabe. Elle a montré qu'on rendait impossible l'autonomie des femmes en stigmatisant les hommes, en particulier maghrébins, car on les obligeait à se resituer au sein de la communauté. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'il paraissait nécessaire de s'intéresser à la formation, notamment en sociologie et en psychologie, des travailleurs sociaux et de tous ceux qui sont appelés à rencontrer les femmes immigrées. Si on avait eu affaire à des gens bien formés, il paraît évident que le film aurait été traduit... Mme Florence Lacaze a fait observer qu'elle-même travaillait en pédagogie active, c'est-à-dire en partant de l'activité des personnes. Elle a constaté qu'il était très douloureux pour les travailleurs sociaux d'accueillir quelqu'un appelé à raconter l'histoire de sa vie. Leur formation de base les prépare à accueillir des personnes en échec social. Or, la population migrante n'a pas forcément de problèmes d'intégration sociale, ce sont les questions de statut légal qui la mettent dans cette position. Et quand le mal-être des femmes est lié à leurs difficultés à obtenir des papiers, les travailleurs sociaux ne savent pas comment les accompagner, d'autant que l'intégration par le travail est dans ce cas impossible. Ils se rendent compte qu'ils produisent de la violence, mais ils ne savent pas quoi faire d'autre. Par exemple, ils proposent à une femme qui arrive seule avec son enfant de deux ans, et qui va mal parce qu'elle attend des papiers et qu'elle a une histoire difficile, de mettre son enfant à la crèche, mais pour elle c'est inconcevable ! Il est donc indispensable d'améliorer leur formation, pour l'instant très variable. Mais il semble difficile de leur apprendre à accueillir une population qui est là de fait, mais dont ce n'est pas la place. Il y a, chez la population immigrée, une forte demande de travail. Il est fréquent qu'un homme qui arrive avec l'illusion qu'il apportera quelque chose à la France par son travail, sombre dans la dépression devant la réalité. Trois mois après, on le retrouve parmi ceux qui fréquentent la mosquée... C'est donc bien la politique d'immigration qui favorise ce processus. On est dans un double discours : d'un côté on confie l'accompagnement au travailleur social, de l'autre on lui demande, par exemple en matière d'hébergement, de favoriser le public français. Et quand un partenariat se noue entre les ministères de l'intérieur et de l'Education pour aller chercher les enfants sans papiers dans les écoles, comment les enseignants peuvent-ils défendre les valeurs républicaines ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé quelles autres personnes que les travailleurs sociaux pouvaient se charger de cet accompagnement. Mme Florence Lacaze a souhaité que le personnel administratif soit préservé du discours ambiant de méfiance vis-à-vis des étrangers comme de l'idée que les étrangers ne peuvent être assimilés. Cela passe par une formation sur ce qu'est un parcours migratoire, sur le fait qu'on ne naît pas immigré, que l'immigration est un moment de la vie, que personne ne demeure immigré pendant plusieurs générations. Cette formation devrait toucher aussi le personnel de l'ANPE pour éviter la discrimination à l'embauche. Pour cela, des directives ne suffisent pas, il faut aller à la rencontre de ces fonctionnaires et leur expliquer les choses pour faire évoluer les modes de pensée. Il faudrait aussi travailler avec la police sur l'accueil des femmes victimes de violence. Car la fermeture des frontières et la chasse au mariage de complaisance permettent aux hommes d'exercer un chantage par la rétention des papiers. Souvent, des femmes victimes de violences ne peuvent quitter leur conjoint parce qu'elles ne sont pas au bout des deux ans d'obligation de vie commune. Si elles passent outre, elles peuvent être dénoncées : l'homme sera entendu et la femme aura du mal à porter plainte. Toutes les femmes sont confrontées à ce genre de difficultés, à une certaine complaisance vis-à-vis du discours de l'homme, mais les femmes immigrées plus encore. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, lui ayant demandé si elle était optimiste ou pessimiste, Mme Florence Lacaze a répondu qu'elle était extrêmement pessimiste mais qu'elle continuait à lutter ! En effet, on ne peut lâcher des femmes qui ont une telle envie d'avancer, et qui, malgré un parcours de vie aussi difficile, malgré une violence redoublée au moment de l'accueil, continuent à se battre quand même ! On constate quand même quelques évolutions, notamment sur la question de l'excision, même si cette pratique existe toujours. Une voie pour l'éradiquer serait sans doute, au-delà de la formation et de la sensibilisation, de rendre la visite médicale scolaire obligatoire jusqu'à 16 ans et d'y intégrer un examen gynécologique. Car les associations, notamment le GAMS, constatent que les petites filles sont très souvent excisées après l'âge de huit ans, qui correspond à la dernière visite médicale obligatoire. Cet examen devrait être généralisé pour ne pas stigmatiser une fois encore cette population, mais cela présenterait un intérêt général, en particulier dans la problématique du suicide des adolescents, en permettant aux garçons comme aux filles de parler librement à un médecin. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a craint la réaction des parents, même si on peut penser que c'est le fait même de rencontrer un médecin qui est dissuasif et qu'un examen de la vulve ne serait pas forcément nécessaire. Mais le GAMS sera prochainement auditionné et pourra apporter des précisions sur ce point. Mme Florence Lacaze a souhaité aborder également la question de la prostitution à laquelle la FASTI s'est particulièrement intéressée quand on a vu arriver un grand nombre de femmes étrangères sur les trottoirs des villes françaises. Le choix a été fait d'accueillir toutes celles qui voulaient venir, sans les stigmatiser, et de parler avec celles qui le souhaitaient, y compris en les aidant, avec Médecins du monde et avec le Nid, à chercher un hébergement d'urgence. À Nantes, il est possible d'obtenir un accord préfectoral, au cas par cas, pour l'obtention d'une carte de six mois. Si l'État a vraiment une volonté abolitionniste, il doit se pencher très rapidement sur la traite. Or, 80 % des prostituées repérées sont d'origine étrangère. On peut se demander ce que cette proportion a à voir avec l'imaginaire de la clientèle... Cette question renvoie d'ailleurs plus largement à celle de l'image de la femme : il est quand même étonnant qu'il n'y ait pas davantage de mobilisation contre les publicités comme celles qu'on peut voir dans le métro. Ces femmes sont dans une situation de violence extrême, avec des pratiques extrêmement risquées. Certaines, notamment les Guinéennes et les Sierra-léonaises, ont reçu une éducation dans laquelle la femme a pour fierté de ne rien exprimer. Les quarante associations qui ont participé au forum ont toutes souligné que la difficulté de sortir de la prostitution était liée à celle d'obtenir des papiers. Il est donc indispensable que celles qui souhaitent en sortir aient un accès immédiat à des papiers, c'est-à-dire à un statut légal. Pour cela il faut pour l'instant qu'elles dénoncent les proxénètes. Or, cela signifie des violences pour elles et pour leurs familles, et c'est en outre inutile puisque, selon le Syndicat des avocats de France, même la dénonciation a rarement débouché sur l'arrestation de proxénètes. De ce point de vue, il semble que la loi sur la sécurité intérieure ne change pas grand-chose et que la dénonciation reste un marché de dupes. En effet, pour obtenir des papiers définitifs, il faut que la femme prouve sa volonté d'intégration, ce qui suppose qu'elle travaille. Mais elle ne trouvera jamais d'emploi avec une carte de trois ou de six mois. Qui plus est, à Nantes, la seule femme qui a dénoncé son proxénète a été la plus lourdement condamnée... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a vu là une mauvaise application de la loi et a fait part de son intention de saisir M. Jean-Luc Warsmann, qui travaille actuellement sur ce sujet. Mme Florence Lacaze a indiqué que la FASTI s'apprêtait à organiser une campagne de masse sur la prostitution des femmes étrangères en vue d'obtenir un accompagnement à la sortie de la prostitution, sans condition de dénonciation. Il y aura, en particulier, une journée nationale de sensibilisation à ces questions. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Florence Lacaze pour cette audition extrêmement intéressante et pour ces réflexions enrichissantes, qui confirment que le sujet choisi par la Délégation n'est pas facile. Audition de Mme Sihem Habchi, vice-présidente de l'association Réunion du mardi 21 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé que la Délégation aux droits des femmes avait déjà auditionné l'association « Ni putes ni soumises » sur le projet de loi relatif aux propos sexistes et homophobes. À cette occasion, l'association avait évoqué le problème de l'intégration des jeunes filles des cités issues de l'immigration. La Délégation souhaite approfondir ses réflexions sur ce thème, et d'abord par une meilleure connaissance de l'activité de l'association en faveur des jeunes filles issues de l'immigration. Que propose-t-elle pour les aider à conquérir ou conforter leur autonomie juridique et économique ? Comment les aider à lutter contre les violences qu'elles subissent dans la sphère domestique comme dans la cité ? Des jeunes filles d'origine maghrébine ou africaine sont également victimes de mariages forcés. Quels sont les moyens juridiques, tant en France qu'à l'étranger, qu'il faudrait mettre en œuvre pour lutter contre cette pratique ? L'association a-t-elle le sentiment d'un progrès dans la mobilisation de la société française pour l'intégration ? Mme Sihem Habchi a rappelé que l'association « Ni putes ni soumises » était née en 2003, à la suite de la marche des femmes pour l'égalité. Depuis, soixante comités ont été créés dans toute la France, qui effectuent un travail de terrain en direction des femmes, mais aussi de l'ensemble de la population. Ce travail consiste d'abord dans la prise en charge des victimes, en liaison avec les pouvoirs publics et diverses institutions susceptibles de débloquer des situations relatives au mariage forcé, au viol, au viol collectif. Le second aspect de l'activité des comités est un travail de médiatisation, de libération de la parole. Il y a quelques semaines, une jeune fille de 14 ans - qui n'est pas issue de l'immigration - a été victime d'un viol collectif et contrainte à se prostituer. Une quarantaine de personnes ont été interpellées. Pour certains habitants de son quartier, la victime était responsable de ce qui lui est arrivé. Aussi, l'association, outre l'aide directement apportée à la jeune fille, a-t-elle décidé d'organiser une manifestation sur la place publique. Il est important qu'un événement de ce genre fasse l'objet d'un débat, qu'un tel drame ne soit pas entouré de silence, qu'il soit considéré et traité comme un drame public, et non comme l'affaire de la seule victime et de sa famille. Dans les jours qui ont suivi, quatre affaires du même type ont été révélées. Il est important de savoir comment elles ont pu rester ignorées pendant si longtemps, empêchant les comités locaux d'intervenir à temps pour aider les victimes et leurs familles. Il convient de définir des méthodes d'alerte pour que celles-ci puissent avoir suffisamment confiance pour interpeller les pouvoirs publics. « Ni putes ni soumises » est également présente dans les débats qui se tiennent au niveau international sur les violences contre les femmes. L'association a notamment participé à la conférence de Stockholm. Elle a eu à maintes reprises l'occasion de constater que beaucoup d'Européens commencent à mesurer les limites et les dangers du communautarisme. La Suède, par exemple, a été ébranlée par les meurtres de deux jeunes Suédoises d'origine kurde, Pele et Fadime. Cette dernière a été assassinée peu de temps après son intervention devant le Parlement suédois, où elle avait dénoncé les « crimes d'honneur », les mariages forcés et toutes les pratiques archaïques qui étaient tolérées en Suède, du moins dans le cadre domestique. Les Suédois, et notamment les féministes suédoises, ont pris conscience que le relativisme culturel avait conduit à tolérer pour les autres ce qu'on ne tolère pas chez soi. Au nom du respect des autres cultures, on a accepté de traiter avec les leaders religieux, avec les leaders « représentant » les communautés étrangères, auxquels on a reconnu la qualité de responsables habilités à gérer tous les aspects relatifs aux moeurs. C'est ainsi que des pratiques telles que les mariages forcés en sont venues à être tolérées. Dans bien des pays d'Europe, tels que la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou le Royaume-Uni, il est très difficile de s'exprimer sur le problème des mariages forcés ou de la polygamie sans être immédiatement taxé de racisme. Ces questions sont traitées par des organisations de migrants. Autrement dit, la société est complètement communautarisée. Pourtant, l'échec du communautarisme est patent. Au lendemain du meurtre de Theo Van Gogh, seuls les extrémistes, xénophobes et religieux, se sont fait entendre. Dans un tel contexte, le cadre républicain et laïc français peut apparaître comme un modèle pour l'Europe. Les violences dont sont victimes les femmes issues de l'immigration n'appellent pas une réponse spécifique : ce sont des violences faites aux femmes, qui doivent être traitées comme telles, indépendamment de l'origine des victimes. La discrimination positive n'est pas une solution. À cet égard, le glissement du principe d'égalité vers celui d'équité peut donner lieu à un certain nombre de dérives. Les responsables de « Ni putes ni soumises » sont aujourd'hui les premières ambassadrices du principe de laïcité, qui est très mal compris à l'étranger. La loi relative au port de signes religieux, par exemple, a souvent été perçue comme porteuse de discriminations à l'égard de la population musulmane. Il importe de montrer que la laïcité n'est pas seulement un principe de séparation du politique et du religieux, mais qu'elle est aussi un espace d'interaction sociale entre hommes et femmes qui permet de renégocier, au plan social, un pacte laïc. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a invité Mme Sihem Habchi à exposer la position de son association sur les mariages forcés. Mme Sihem Habchi a estimé qu'une nouvelle loi n'était pas forcément nécessaire. Il convient de faire appliquer les textes existants. La notion même de mariage forcé appelle une clarification. Un mariage forcé est l'union d'un homme et d'une femme décidée par les parents ou la famille, sans le consentement de l'une des deux personnes concernées. Il s'agit d'une atteinte au droit le plus élémentaire de l'homme. Ce sont l'échec de la politique d'intégration des immigrés, le chômage, l'émergence des islamistes et la mise en avant du relativisme culturel qui ont contribué à cette montée en puissance des mariages forcés, dont les principales victimes sont les femmes. L'association « Ni putes ni soumises » dénonce depuis longtemps ce phénomène social qui connaît une recrudescence. Mais il faut prendre garde que certains utilisent son combat et créent des amalgames terriblement dangereux. La dénonciation des mariages forcés n'a pas pour but de servir la lutte contre les mariages blancs, lesquels sont consentis, ni la suspicion systématique à l'égard des populations d'origine immigrée. Certains parlent abusivement de « mariages blancs », de « mariages de convenance », de « mariages coutumiers », de « mariages arrangés ». D'autres parlent de « mariages de raison », de « mariages religieux ». Les termes communément employés par certains hommes politiques sont la source d'amalgames graves. Ils prennent prétexte d'une lutte contre les mariages forcés pour élaborer des textes dont la finalité réelle est de lutter contre l'immigration. Là n'est pas le combat de l'association. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné que les responsables politiques désireux de renforcer la lutte contre les mariages forcés étaient avant tout soucieux de venir en aide aux jeunes femmes ou aux jeunes filles concernées, et non de lutter contre l'immigration. Mme Sihem Habchi a insisté sur le fait que les comités locaux de l'association ont signalé que la lutte contre les mariages forcés était l'occasion d'un certain nombre d'amalgames et de dérives. Le législateur doit veiller à éviter les confusions. Lors des débats qui ont eu lieu au Sénat, il a été proposé que « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but de l'obliger à donner son consentement à un mariage » soit « puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Une telle réforme n'est pas forcément pertinente sur le plan juridique. Le harcèlement, la séquestration, les menaces sous condition et les violences constituent déjà des délits. En outre, la jurisprudence a consacré la notion de viol entre époux. La condamnation du mariage forcé existe déjà dans notre code civil, à l'article 146 : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. » Il convient d'utiliser les dispositions existantes et de s'appuyer sur elles pour mettre en place un dispositif efficace. Il arrive que des jeunes femmes françaises parties en vacances dans leur pays d'origine apprennent sur place qu'elles vont être mariées. Dans les cas de ce type, la position de l'association est claire : quand une jeune femme française est victime de quelque violence que ce soit dans un pays étranger, elle a droit à la même protection que n'importe quel citoyen français. Le ministère des affaires étrangères doit jouer pleinement son rôle pour venir en aide à nos concitoyennes. L'association, pour sa part, outre le soutien matériel qu'elle apporte aux jeunes femmes ou jeunes filles concernées, effectue un important travail d'éducation, tant il est vrai que celles-ci ne connaissent pas toujours leurs droits. C'est la raison pour laquelle elle a édité un « Guide du respect ». Malheureusement, les problèmes les plus graves se posent à l'étranger. Or, le paradoxe est que de multiples associations, dans les pays d'origine, parviennent à faire reculer des pratiques telles que les mariages forcés, la polygamie ou l'excision, alors que des jeunes femmes de nationalité française sont soumises à ces mêmes pratiques. Notre pays défend des valeurs universelles tout en se laissant aller à une certaine forme de laxisme dans la défense des droits des femmes. Mme Bérengère Poletti a indiqué que lors d'une précédente audition de la Délégation aux droits des femmes, Mme Gaye Petek, directrice de l'Association ELELE, avait souligné le paradoxe qui veut que la condition de la femme turque progresse globalement alors que des femmes turques vivant en France, ou françaises d'origine turque, subissent des traditions archaïques, en recul dans leur pays d'origine. M. Patrick Delnatte a invité Mme Sihem Habchi à décrire en détail le travail effectué par son association en milieu scolaire. Mme Sihem Habchi a rappelé que son association était fréquemment sollicitée pour intervenir dans les collèges et les lycées sur les violences dont sont victimes les femmes, mais aussi sur les droits qui sont les leurs, ainsi que sur les questions relatives à la sexualité. La mixité est également un axe essentiel de ces interventions, car s'il est vrai que l'école française est mixte, il importe de cultiver cette valeur. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a déploré que l'Education nationale ne joue pas pleinement son rôle. Les droits des femmes devraient être enseignés. Mme Sihem Habchi a dressé un parallèle entre les missions de prévention en matière de sécurité routière, qui peuvent conduire des policiers à intervenir à ce titre dans les établissements scolaires, et le travail d'éducation à la mixité et à l'égalité entre hommes et femmes, qui peut lui aussi justifier que l'Education nationale fasse appel à des intervenants extérieurs. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné que ces interventions extérieures ne dispensaient pas les enseignants de remplir leur mission. Un professeur d'histoire et géographie se doit d'enseigner le programme d'éducation civique dont il est chargé. Mme Sihem Habchi a estimé que tous les problèmes relatifs aux droits des femmes et aux violences qu'elles subissent ne devaient pas nécessairement être abordés dans le cadre de l'enseignement. Il importe de ménager au sein de l'institution scolaire des espaces à l'intérieur desquels certains sujets puissent être abordés. S'agissant de la question des droits, l'une des difficultés est que certains jeunes Français issus de l'immigration ne se sentent pas véritablement français, ce qui les amène à méconnaître leurs droits. La France a tous les moyens nécessaires pour mettre en œuvre des dispositifs susceptibles de faire progresser chez les jeunes la conscience d'être français, et par là même la conscience de leurs droits et de leurs devoirs. M. Patrick Delnatte a fait observer que les enseignants apprécient de pouvoir s'appuyer sur des intervenants extérieurs quand il s'agit de faire progresser les choses sur certains problèmes de société. Le dialogue avec les élèves est parfois plus facile. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a estimé que l'enseignant n'est pas seulement chargé de transmettre un savoir. Il est aussi éducateur. Mme Sihem Habchi a considéré que dans l'esprit de nombre d'enseignants, la formation du futur citoyen ne faisait pas partie de leurs missions essentielles. Mme Bérengère Poletti a souhaité connaître la réaction qui a été celle de l'association « Ni putes ni soumises » devant la réservation de certains créneaux horaires aux femmes dans une piscine de Lille. Mme Sihem Habchi a souligné que cette décision a été ressentie par les membres de l'association comme un choc. Elles ont eu le sentiment d'être « lâchées » par les pouvoirs publics. Cette décision signe une forme de renoncement. Il serait opportun de méditer l'exemple de la Suède, où certaines femmes sont complètement soumises aux règles décidées par leur communauté. Jusqu'à une date récente, le mariage à l'âge de quinze ans était toléré pour les Suédoises issues de l'immigration turque. L'assassinat de Fadime a fait réagir les autorités suédoises. En France, certains dirigeants sont tentés de céder aux pressions qui vont dans le sens du communautarisme. Cette tentation n'est pas non plus étrangère au calcul selon lequel céder aux revendications de certains dirigeants communautaires pourrait avoir pour avantage de conduire à une baisse de la délinquance. Cédons sur ceci, ils nous aideront pour cela. C'est par des marchandages de ce type que l'on vend la République par étages. Mme Bérengère Poletti a estimé qu'à force de renoncer, nous serons un jour au pied du mur. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente a considéré que nous y étions déjà. Mme Sihem Habchi a observé qu'il était important de rester en contact avec les pouvoirs publics, notamment les municipalités, même quand l'association est en désaccord avec les décisions prises. C'est ce travail de terrain qui peut permettre aux responsables de se rendre compte que d'autres types de solution sont possibles. Mme Bérengère Poletti a souhaité savoir si l'association avait pris contact avec la municipalité de Lille lorsque la décision a été prise, et ce qu'il en était ressorti. Mme Sihem Habchi a indiqué qu'un débat avait eu lieu. Elle a souligné que les associations intégristes exercent des pressions sur les pouvoirs publics depuis plusieurs années. Le problème est que ce sont précisément elles que les responsables publics ont choisies pour interlocutrices, ce qui est sans doute dû au fait que les associations citoyennes ont disparu des quartiers populaires. M. Patrick Delnatte a rappelé l'argument mis en avant par la municipalité de Lille pour justifier sa décision : si l'on ne fait pas en sorte que les femmes puissent aller à la piscine, elles resteront recluses et constitueront une génération sacrifiée. Mme Bérengère Poletti a considéré qu'il s'agissait là d'un argument trop facile. Mme Sihem Habchi a jugé que l'argument n'était en effet pas pertinent. Les partisans de la loi relative au respect de la laïcité à l'école n'ont pas reculé. Et les craintes exprimées par les adversaires de cette loi se sont révélées infondées. C'est précisément en ne cédant pas sur le principe de laïcité que l'on peut permettre de construire un espace public où les filles puissent être les égales des garçons. L'oppression de la femme par l'homme commence très tôt. C'est en multipliant les concessions que l'on rend possible cette oppression et qu'on lui permet de produire des effets durables. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué que le journal Le Monde rapportait en ces termes les propos tenus par le ministre de l'intérieur le lundi 20 juin : « Nicolas Sarkozy regrette que les quartiers soient des « déserts spirituels ». Il invite les Eglises à prendre part au débat public. » Mme Sihem Habchi a souligné qu'elle ne pouvait pas porter un jugement sur des propos dont elle n'a pas pris connaissance de manière complète. Il reste que la religion est de l'ordre de l'intimité. Les institutions religieuses font certes partie de la société civile, mais il convient d'éviter la mise en place d'une société communautariste. Le fait religieux peut être fédérateur, comme c'est le cas aux États-Unis, mais la France est fédérée par des valeurs plus universelles. Les Français appartiennent à différentes religions. Cela, en soi, ne pose pas problème. Mais ce qui rassemble les citoyens est ce qu'ils ont en commun. Mme Bérengère Poletti a estimé que l'on pouvait, tout en n'étant pas particulièrement engagé dans la vie religieuse, et tout en adhérant à des valeurs républicaines, reconnaître qu'une société qui évolue sans repères et où aucune culture religieuse n'est transmise subit une certaine désorientation. L'éducation religieuse peut contribuer à transmettre aux jeunes certains repères. La position du ministre de l'intérieur, du moins telle qu'elle est rapportée dans Le Monde, ne relève pas du communautarisme. Mme Sihem Habchi a fait valoir que c'est la citoyenneté républicaine qui permet à chacun de trouver une place dans la société. La religion relève d'une démarche personnelle. Quand la religion est considérée comme ce qui définit l'identité de chacun, l'espace commun aux citoyens est menacé. Selon M. Patrick Delnatte, c'est précisément le fait de renvoyer le religieux à la sphère privée qui conduit au communautarisme. Cette conception contraint l'individu à un repli, en se tournant vers ceux qui partagent les mêmes convictions. La société laïque doit accepter un dialogue avec les religions, lesquelles doivent pouvoir participer au débat public. C'est ainsi que pourra avancer l'idée du vivre-ensemble sur la base de la tolérance et du dialogue. Une séparation totale entre la sphère privée, qui serait celle du religieux, et la sphère publique, d'où il devrait être exclu, mènerait vers le communautarisme. Mme Sihem Habchi a déploré qu'un certain glissement se soit opéré en France de la notion de laïcité vers la notion de tolérance. Tolérer, ce n'est pas vivre avec, c'est vivre à côté. Les responsables religieux font partie intégrante de la société civile et ont parfaitement le droit de participer au débat public. Une chose est d'accepter qu'ils prennent part au débat public, autre chose est d'accepter qu'ils remettent en cause les valeurs fondamentales de la République, et notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. L'intégrisme, qui peut d'ailleurs être également catholique, s'attaque toujours aux droits des femmes et à la mixité. Elle a estimé que les propos de M. Patrick Delnatte relevaient d'une autre conception de la laïcité, dominante dans plusieurs pays européens autres que la France, la « laicité ouverte », dont l'ambition se limite à créer une soupape de sécurité dans les relations entre communautés. Lors d'une conférence internationale qui s'est récemment tenue en Espagne autour du thème du vivre-ensemble, cette expression n'était pas traduite en anglais par living together, mais par coexistence. Le modèle de la coexistence entre plusieurs communautés a conduit à des échecs cuisants. M. Patrick Delnatte a souligné qu'à ses yeux, vivre ensemble signifie bien vivre avec et non vivre à côté. Mme Bérengère Poletti a fait observer que le débat sur la loi relative au respect de la laïcité à l'école, adoptée par le Parlement en 2004, avait été abordé sous l'angle du rapport entre le religieux et la sphère publique, et non sous l'angle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il eût été préférable de défendre ce texte au nom de l'exigence d'éduquer les filles selon les mêmes principes que les garçons. Envisagée de ce point de vue, cette loi eût peut-être été mieux comprise. Mme Sihem Habchi a souligné que l'association « Ni putes ni soumises » n'avait pas dissocié les deux approches. Défendre la laïcité implique de défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Les inégalités sociales sont réelles. Elles entraînent tous les jours des femmes et des hommes hors du champ social et hors de la démocratie. Les politiques de rattrapage sont nécessaires. Mais toute réparation qui ne s'appuie pas sur le principe d'égalité comme moteur entre, à terme, dans une autre logique, celle de l'équité. Or l'égalité n'est point l'équité. Il ne s'agit pas simplement de donner à chacun les moyens d'affronter les difficultés en étant sur la même ligne de départ que les autres, mais de permettre à chacun d'être, tout au long de sa vie, un citoyen à part entière. L'équité est un comportement ou une conduite qui prolonge l'égalité, mais qui ne doit pas se substituer à elle. L'égalité est un principe émancipateur. C'est à la fois l'objectif et le moyen. Tant que l'objectif n'est pas atteint, chaque citoyenne, chaque citoyen a la légitimité de demander tous les moyens pour y parvenir. La condition du communautarisme et de son corollaire, la discrimination positive, nous montre que, sous prétexte de politiques de correction des inégalités, il s'opère un glissement du principe d'égalité vers le principe d'équité. En conséquence, nous glissons fatalement du principe de laïcité vers celui du communautarisme, où la religion devient le dénominateur commun et un facteur mobilisateur. Dans ces conditions, la dynamique sociale se communautarise, et le rapport de forces nécessaire à toute transformation se morcelle. Dès lors, le combat des femmes s'en trouve miné. Dans ce contexte, la notion de mixité n'a pas le même sens pour tout le monde. D'ores et déjà, nous voyons naître et se développer ici et là des courants de pensée, et surtout des comportements, visant à remettre en cause les acquis de la lutte féministe, à tel point que la mixité se réduit en peau de chagrin dans les quartiers défavorisés, révélant ainsi les résistances et les contradictions face à la laïcisation des mœurs qui a transformé notre société. Défendre la mixité revient à défendre et à réaffirmer la laïcité comme vecteur émancipateur. Audition de Mmes Fadila Bent-Abdesselam et Claude Charon, de l'Association de solidarité avec les femmes algériennes démocrates (ASFAD), Isabelle Gillette-Faye et Coumba Touré, du Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS) et Christine Jama, Réunion du mardi du 28 juin 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé le caractère extrêmement sensible des problèmes des femmes de l'immigration. Elle a évoqué son précédent métier d'enseignante et ses classes, dans lesquelles il n'était pas rare que 80 ou 90 % des élèves soient enfants d'immigrés. La Délégation souhaite comprendre les raisons des difficultés d'intégration de ces femmes, persuadée que leur intégration facilitera celle de l'ensemble des populations immigrées. Mme Fadila Bent-Abdesselam s'est inquiétée de savoir si ces auditions auront des effets concrets. Les associations ont trop souvent été impliquées dans des commissions qui n'ont pas abouti à des décisions effectives ; elles ont notamment participé au groupe de travail « femmes de l'immigration » de Mme Nicole Ameline et M. Dominique Perben. Les associations crient au secours : sont-elles entendues ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a assuré, sans pouvoir s'engager à ce que ces auditions soient suivies d'effets, qu'elle savait faire preuve de fermeté quand le besoin s'en faisait sentir et qu'elle donnerait du poids aux recommandations de la Délégation, même s'il ne s'agit pas forcément de prendre des mesures législatives. Sur les sujets de l'égalité professionnelle et du temps partiel, la Délégation a transmis des rapports au Gouvernement ; elle entend en faire de même à propos des femmes de l'immigration. La France, en matière d'immigration, se trouve à un tournant, et les femmes constituent le pivot de la réussite dans le domaine de l'intégration. L'évolution du Maroc ou de la Tunisie, par exemple, montre que les avancées se font par les femmes. Le rapport et les auditions de la Délégation sont médiatisés. Mme Claude Charon ayant fait remarquer que la médiatisation ne faisait pas toujours avancer une cause, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a pris pour exemple la loi relative aux violences faites aux femmes adoptée en Espagne : si les politiques se sont emparés du sujet, c'est après avoir été interpellés par les médias. Mme Isabelle Gillette-Faye a estimé que, dans les pays du Sud, les avancées sont toujours portées par les femmes, tandis que dans les pays d'accueil les populations immigrées se caractérisent par un repli identitaire et une perversion de certaines pratiques traditionnelles, utilisées pour museler les femmes, comme la polygamie ou le mariage forcé. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a évoqué l'audition de Mme Gaye Petek, directrice de l'association ELELE, dont le témoignage sur les mariages forcés dans la communauté turque a stupéfait et éclairé la Délégation. Les femmes ont un rôle à jouer mais il est indispensable que les parlementaires les aident. Mme Fadila Bent-Abdesselam a noté que l'association de Mme Gaye Petek faisait partie du même réseau « Agir avec elles » que l'ASFAD, le GAMS et Voix de femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remarqué que le parlementaire, contrairement au ministre, est élu pour cinq ans et a par conséquent le temps de faire avancer les choses. Mme Isabelle Gillette-Faye a émis le souhait qu'une aide soit apportée aux femmes pour leur donner la possibilité de s'exprimer. L'urgence n'est pas à voter de nouvelles lois mais à faire appliquer les droits des femmes et des enfants en vigueur sur l'ensemble du territoire français : les filles de Marseille ou d'Oyonnax ne sont pas protégées comme celles d'Ile-de-France - on note même des différences entre départements de la région parisienne -, à tel point qu'il faut parfois faire appel à la défenseure des enfants pour vérifier que la loi est respectée. Certains magistrats ignorent que l'excision, en France, est considérée comme un crime. Le GAMS travaille d'ailleurs sur ces thématiques avec l'École nationale de la magistrature. Il éprouve aussi des difficultés à faire entendre à certains conseils généraux qu'ils doivent mettre en place des contrats pour jeune majeur au profit des victimes âgées de dix-huit à vingt-et-un ans. Les associations réclament donc une application uniforme de la loi mais aussi la création d'hébergements d'urgence, adaptés et sécurisés, pour que les femmes puissent se protéger, protéger leurs enfants et bénéficier d'un tremplin. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'étant enquise du rôle joué par les déléguées départementales aux droits de femmes, Mme Isabelle Gillette-Faye a répondu qu'elles étaient les meilleures alliées des associations. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a déploré que leur rôle ait été minoré et a déclaré qu'il fallait donner plus d'impact à leur fonction. Mme Isabelle Gillette-Faye a précisé que le réseau auquel elle appartient travaille avec les déléguées départementales aux droits de femmes comme avec toutes les institutions compétentes et les autres associations. Dans le cas d'une maman qui refuse de retourner dans son pays d'origine car elle craint que ses filles ne soient excisées, la déléguée départementale aux droits de femmes alerte le préfet. L'OFPRA, en 2001, au bout de dix ans de demandes, a accepté de reconnaître les personnes menacées d'excision comme appartenant à un groupe social au sens des accords des Genève. Les choses avancent peu à peu également s'agissant du mariage forcé. Mme Christine Jama a confirmé que les personnes n'étaient pas traitées de manière égale selon leur département de résidence. Par ailleurs, les filles et les jeunes femmes sont victimes du relativisme culturel : trop de professionnels considèrent malheureusement le mariage forcé comme une pratique traditionnelle et non comme une violence appelant une protection, y compris pour les jeunes majeures. Face à ce problème, les structures d'accueil manquent, d'autant que la plupart des victimes ont très peur de parler avant leur majorité car elles savent qu'une dénonciation peut amener à un placement en institution. C'est d'ailleurs pourquoi l'association Voix de femmes désapprouve le projet de pénalisation des parents menaçant leur fille d'un mariage forcé. D'une part, cela aurait pour effet de renforcer la loi du silence. D'autre part, le risque que les parents ne renvoient définitivement leur fille au pays d'origine serait trop important. Une incrimination de délit de contrainte au mariage a été envisagée dans le cadre du groupe « femmes de l'immigration » et reprise par M. Dominique de Villepin, lorsqu'il était ministre de l'intérieur. Mme Claude Greff a jugé que cette mesure partait d'une bonne intention. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que le problème était identique pour la prostitution : dans la pratique, les victimes dénoncent rarement les coupables et, lorsqu'elles le font, elles sont insuffisamment protégées. Mme Fadila Bent-Abdesselam a précisé que le projet prévoit à l'encontre des responsables de mariages forcés, des pénalités de cinq ans de prison et 75 000 euros d'amendes lorsqu'il s'agit de mineures, et de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit de jeunes majeures. Mme Christine Jama a ajouté que Mme Blandine Kriegel, présidente du Haut Conseil à l'intégration, a entendu le réseau Agir avec elles, récemment constitué pour lutter contre les mariages forcés. Ceux-ci ne sont pas forcément en recrudescence importante mais d'aucuns tentent de les légitimer dans le cadre d'un repli identitaire. Mme Claude Charon a signalé que ce phénomène était constaté dans toutes les communautés. Mme Christine Jama a témoigné de l'expérience qu'elle a vécue, durant l'été 2004, au sein de la Caravane des droits de femmes organisée au Maroc : des imams locaux se prononcent contre les mariages forcés alors qu'en France certains de leurs homologues appellent à la violence conjugale ! Certaines familles, voire, mais cela reste rare, des jeunes filles françaises justifient même les mariages forcés comme moyen d'éviter les unions avec des personnes qui ne sont pas de la caste ou de la religion adéquate. Les garçons semblent moins virulents. La sensibilisation en milieu scolaire demeure donc une priorité. Quoi qu'il en soit, un travail de formation s'impose auprès des professionnels, magistrats et avocats, pour les sensibiliser à ce problème. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est inquiétée qu'un système n'existant plus dans les pays d'origine, soit maintenu en France. Mme Coumba Touré a appelé l'attention sur les problèmes auxquels est confrontée une femme qui est « décohabitée » d'une famille polygame. La seconde épouse ne détenant souvent pas de carte de séjour, elle n'est pas reconnue par les autorités et n'a pas accès au travail. Dans ces conditions, quel bailleur lui accordera un logement ? Il arrive même souvent qu'elle ait accouché sous le nom de la première épouse, ce qui lui ôte tout droit aux allocations familiales. Dans la mesure où elle peut difficilement divorcer, elle se retrouve complètement démunie. Mme Isabelle Gillette-Faye a expliqué que c'était l'un des effets pervers de la circulaire : certains préfets ne se contentent pas d'une séparation de corps et n'interviennent que si le divorce a été prononcé officiellement. L'application, là aussi, est différente d'un département à l'autre. Mme Coumba Touré a ajouté que, une fois la « décohabitation » constatée, monsieur obtient une carte de séjour pour l'une de ses femmes : c'est donc lui qui choisit laquelle pourra rester en France. Mme Claude Greff ayant prôné l'interdiction pure et simple de la polygamie, Mme Coumba Touré a acquiescé tout en soulignant que cela ne réglerait pas le problème des femmes déjà sur le territoire français et se retrouvant seules avec plusieurs enfants à élever. Mme Claude Greff ayant alors suggéré qu'un statut leur soit accordé, Mme Coumba Touré a insisté sur la nécessité de leur donner un travail, ces femmes demeurant sur le territoire français avec une carte de visiteur. Mme Isabelle Gillette-Faye a rappelé qu'il est laissé à la libre appréciation de la préfecture d'accorder une carte avec ou sans droit de travail. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a déploré que soit laissée à la rue une femme « décohabitée ». Mme Isabelle Gillette-Faye a précisé qu'elle dépend alors des aides sociales, versées en particulier par les communes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est engagée à interroger le Gouvernement pour obtenir des éclaircissements à propos de la circulaire en question. Mme Isabelle Gillette-Faye a précisé qu'il s'agit d'une circulaire de 2001 de la direction de la population et des migrations, appliquée inégalement selon les départements : dans certains d'entre eux, des pôles associant les bailleurs sociaux et les mairies ont été créés pour la mettre en application. Mais la question des papiers, du statut de ces femmes et de ces enfants, n'a pas été traitée : la circulaire crée des familles monoparentales. Il a bien été proposé de mettre les mamans sous tutelle des allocations familiales mais la caisse nationale d'allocations familiales a refusé, craignant que ce ne soit beaucoup trop lourd à gérer et préférant en laisser la responsabilité au pouvoir judiciaire, au cas par cas. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a envisagé de poser une question écrite sur ce point au ministre des affaires sociales. Mme Christine Jama a demandé que la Délégation, par la même occasion, propose au Gouvernement d'ajouter à l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale un alinéa tendant à élargir le bénéfice de l'aide envers les jeunes majeures de dix-huit à vingt-et-un ans en danger à celles n'ayant pas été suivies lorsqu'elles étaient mineures. Les associations ne demandent pas une inflation législative mais au moins l'application des lois existantes. En cas de mariage forcé, le viol, par exemple, est très rarement reconnu. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant estimé que le viol était extrêmement difficile à prouver, Mme Coumba Touré a rappelé que tout rapport non consenti est un viol. A propos de l'attribution de visas aux femmes qui, trop longtemps retenues dans leur pays d'origine, ont perdu leur droit au séjour en France, Mme Christine Jama a donné l'exemple d'une jeune femme d'origine algérienne mariée, il y a quelques années, à son jeune oncle. Le ministère des affaires étrangères, refusant d'attribuer le visa, avait alors eu la remarque suivante : « Les femmes arabes sont versatiles ; c'est comme les femmes françaises battues, elles retournent toujours vers leur mari. » Une femme violée n'a pas moins mal parce qu'elle est turque, pakistanaise ou tsigane. Bien du travail reste à faire, à l'étranger comme en France. A l'invitation de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, Mme Christine Jama a énuméré les canaux par lesquels les victimes prennent contact avec les associations : la famille, les autres jeunes, les CIDFF (centres d'information sur les droits des femmes et des familles), les missions locales, les assistantes sociales, les éducateurs, les établissements scolaires. Elle a ensuite préconisé la création d'une cellule de veille et d'alerte interministérielle (Affaires étrangères, Intérieur, Justice, Education nationale, etc.) qui pourrait être saisie par tous les professionnels s'inquiétant du non-retour d'une jeune fille. Mme Claude Charon a fait remarquer que l'émotion suscitée par la presse dans un cas comme celui de deux jeunes filles de Montreuil et de Romainville est vite retombée. Mme Isabelle Gillette-Faye a apporté des précisions sur ce dossier. Le procureur de la République de Bobigny s'est saisi de l'affaire, les autorités consulaires françaises se tiennent prêtes à intervenir mais la brigade de protection des mineurs n'a toujours pas localisé les jeunes filles. Heureusement, leur dossier scolaire contient la preuve irréfutable de leur nationalité française. En tout cas, cette médiatisation permet à d'autres jeunes de s'organiser en demandant à leurs copines d'alerter les autorités si elles ne reviennent pas en France après les vacances. Mme Christine Jama s'est inquiétée de la situation de jeunes femmes arrivées en France toutes petites. À dix-huit ou vingt ans, elles obtiennent la carte de séjour de dix ans. Mais si elles sont mariées de force et retenues à l'étranger et qu'elles ne parviennent à s'échapper et à revenir en France qu'au bout de trois ans ou plus, elles perdent tout droit au séjour et se retrouvent dans la situation de primo-arrivantes. Si une cellule de veille existait, il serait plus aisé de prouver qu'elles ont été retenues à l'étranger contre leur gré. Mme Fadila Bent-Abdesselam a raconté que les associations, depuis plusieurs années, interviennent dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les jeunes à la prévention des mariages forcés, ainsi que lors de journées de formation en direction des professionnels sociaux, organisées par les inspections académiques (la DASES) et la Délégation régionale aux droits des femmes. L'ASFAD, qui rencontre également beaucoup de jeunes nées en France, mariées de force et séquestrées, travaille en réseau avec les associations de femmes algériennes pour sauver ces jeunes. Il faut aussi penser aux jeunes femmes de dix-huit à vingt-cinq ans vivant dans leur pays d'origine, en Algérie, par exemple, qui sont mariées de force à un cousin binational résidant en France. Elles ne peuvent s'y soustraire, sous peine de voir leur virginité contestée. Elles entrent en France régulièrement, munies d'un visa en tant que conjointes de Français. Mais, une fois arrivées, elles servent de bonnes à tout faire, presque d'esclaves, et sont soumises à des violences sexuelles quotidiennes. Lorsqu'elles commencent à parler de leurs droits, leur époux les rejette. Sans papiers, brisées physiquement et psychologiquement, elles ne sont même pas accueillies dans les foyers et risquent l'expulsion. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est interrogée sur les moyens de régler les problèmes de ce genre. Mme Fadila Bent-Abdesselam a mis l'accent sur l'énergie des associations, qui prennent tous les jours de tels cas en charge, et a appelé le législateur à l'aide. Mme Christine Jama a prôné l'application de la règle du domicile : toute personne résidant en France a le droit d'exiger l'application de la loi française. Mme Fadila Bent-Abdesselam a ajouté que les maris sont Français en France mais Algériens en Algérie et qu'ils profitent des conventions bilatérales ainsi que du statut des femmes discriminatoire de leur pays d'origine pour y obtenir immédiatement le divorce. Ils ramènent alors souvent du pays une nouvelle épouse, qui subira les mêmes exactions. Les victimes, elles, risquent l'expulsion vers l'Algérie, où, considérées comme le déshonneur de la famille, elles n'échapperont pas à la mort. Mme Claude Charon a dénoncé l'attitude de la France vis-à-vis des conjointes. Mme Fadila Bent-Abdesselam a ensuite évoqué le cas des jeunes femmes qui se voient remettre une première carte de séjour d'un an avec autorisation de travailler : elles préfèrent supporter les violences de leur mari plutôt que de demander le divorce, car elles seraient alors expulsables. Certaines d'entre elles, lorsqu'elles n'en peuvent vraiment plus, s'échappent et se confient à des assistantes sociales, qui les renvoient aux associations, et celles-ci les poussent à déposer plainte. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, en a conclu que, dans tous les cas, l'homme primait sur la femme dans l'attribution des titres de séjour. Mme Claude Charon a abondé dans ce sens en dénonçant le caractère secondaire des conjointes : les choses changeront quand les femmes seront considérées à égalité avec les hommes. Mme Fadila Bent-Abdesselam a observé que Mme Escoffier, ex-conseillère de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, lorsqu'elle avait été saisie d'une dizaine de cas semblables, s'était dite étonnée que cela existe et s'était engagée à agir. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a raconté qu'elle avait récemment reçu une Algérienne vivant dans cette situation : faute de réaction du préfet, elle lui a fait écrire un courrier au procureur de la République. Mme Claude Charon s'est dite lasse de raconter des anecdotes analogues depuis dix ans et d'entendre les pouvoirs publics prétendre qu'ils ne savent pas, qu'ils découvrent le phénomène. Mme Isabelle Gillette-Faye a critiqué la circulaire de Nicolas Sarkozy. D'abord, toutes les femmes ne sont pas informées qu'elles doivent au minimum déposer une main courante lorsqu'elles sont victimes de violences. Ensuite, bien qu'elles soient parfois menacées de mort dans leur pays, elles n'ont pas demandé l'asile politique et ne sont pas protégées, sous prétexte que les violences n'ont pas eu lieu sur le territoire français. Surtout, toutes les générations de migrantes ne sont pas informées sur leurs droits. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a relevé que la jeune fille de l'affaire de la Courneuve s'était présentée au commissariat pour déposer une main courante mais n'avait pas été reçue. Mme Claude Charon s'est prononcée en faveur d'une formation permanente des agents publics. Mme Fadila Bent-Abdesselam a témoigné de ce qu'elle s'est entendue dire par des policiers : ils en ont assez de voir revenir des femmes dès le lendemain de leur dépôt de plainte pour se rétracter. Mme Claude Charon a proposé de communiquer à la Délégation des documents rédigés par l'ASFAD. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué qu'elle poserait des questions écrites au Gouvernement et qu'elle ferait parvenir des recommandations par écrit au Premier ministre ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Mme Christine Jama a insisté sur le risque que constituerait une pénalisation des mariages forcés, laquelle se retournerait contre les victimes. Mme Fadila Bent-Abdesselam a précisé que, pour les mineures, l'Aide sociale à l'enfance porte plainte directement. Mme Claude Charon a confirmé que la pénalisation des parents n'était pas souhaitable. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné que les associations apportent un soutien ponctuel aux jeunes filles mais que ces dernières doivent assumer leurs problèmes au quotidien. C'est pourquoi il convient de diffuser la circulaire dans les établissements de l'Education nationale. Si les mesures prises par la France se traduisaient par le renvoi dans leur pays d'origine de jeunes filles dès leur plus jeune âge, ce serait le plus grave des échecs. Lorsque la Délégation a choisi le thème des femmes de l'immigration, c'était dans la perspective de s'appuyer sur les femmes pour favoriser l'intégration des immigrés en France. Or les auditions conduisent la Délégation vers d'autres pistes et d'autres recommandations. Le fonctionnement des consulats mérite aussi d'être examiné : il faut former leurs agents à distinguer les dérives des véritables situations de détresse. Mme Claude Charon ayant insisté sur le rôle primordial de l'école, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a approuvé, en qualité d'ancienne enseignante, cette remarque : l'école est le lieu où se décide la réussite ou l'échec. L'enseignant délivre un savoir, mais il doit aussi se comporter en éducateur. Mme Isabelle Gillette-Faye s'est demandée pourquoi certains établissements scolaires, de la maternelle au lycée, signalent les disparitions d'enfants tandis que d'autres ne le font pas. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a fait remarquer que le signalement était théoriquement obligatoire. Mme Isabelle Gillette-Faye a cité le cas de quatre enfants de nationalité française bloqués dans leur pays d'origine depuis un an, déscolarisés, les filles étant menacées d'excision, voire de mariage forcé pour l'aînée. Les laissez-passer consulaires sont prêts, la maman a mis de l'argent de côté, en cachette du papa, pour financer la moitié du billet mais le ministère des affaires étrangères refuse de financer le reste. Mme Coumba Touré a déclaré que les associations ne cessaient de se battre mais qu'il fallait aussi que les pouvoirs publics aident les femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant répété que la direction prise par ces auditions la surprenait, Mme Claude Charon a répondu que tout le monde ignorait la réalité du terrain, en particulier les hommes, qui sont majoritaires partout, en particulier à l'Assemblée nationale. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a témoigné de son admiration envers les militantes des associations de défense des femmes. Mme Claude Charon a alerté la Délégation sur la situation des lycéennes majeures sans papiers, qui risquent d'être expulsées cet été. Audition de Mme Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles (CNIDFF), accompagnée de Réunion du mardi 5 juillet 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit son plaisir d'accueillir, dans le cadre de la réflexion engagée par la Délégation sur une meilleure intégration des femmes immigrées ou issues de l'immigration, Mme Annie Guilberteau, directrice générale du Centre national d'information sur les droits des femmes et des familles, qu'accompagnent Mmes Catherine Body et Fersten Djendoubi. Les femmes sont, le plus souvent, les pivots des sociétés et les femmes de l'immigration ont donc un grand rôle à jouer. Pour avoir elle-même, dans ses anciennes fonctions d'enseignante, entretenu des relations suivies avec les parents d'élèves, elle a pu constater que, si les mères veulent l'intégration, elles font tout pour la faire progresser mais que si elles ne la veulent pas, il s'ensuit une coupure définitive avec la société française et un repli vers les traditions. Les auditions successives permettent de mesurer l'ampleur des problèmes, qui s'explique notamment par la diversité des immigrations. De plus, les auteurs de différents rapports se plaignent de ne pas être entendus. La Délégation a donc la responsabilité de dire ce qui est et de contribuer à l'élaboration de lois éventuelles. Mais tout texte sur ce sujet demande à la fois un travail considérable et une grande diplomatie. L'audition qui commence sera donc d'un intérêt particulier. Mme Annie Guilberteau a souligné que les femmes de l'immigration sont omniprésentes dans les permanences des centres d'information sur les droits des femmes. De multiples services et actions existent dans les CIDF pour les approcher. Dans la représentation collective, l'immigré est encore un homme seul, venu travailler en France pour renvoyer de l'argent à sa famille restée au pays. C'était le schéma dans les années 1950-1960, mais depuis la politique de regroupement familial instituée dans les années 1970, la population immigrée s'est fortement féminisée, même si les femmes immigrées ne sont pas toujours visibles. Des premières collectes d'informations réalisées par les plates formes d'accueil et d'intégration, il ressort que 55 % des primo-arrivants recensés sur les plates-formes de l'ANAEM (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) sont des femmes ; or, elles ne sont signataires que de la moitié des quelque 46 000 contrats d'accueil et d'intégration conclus jusqu'à décembre 2004. Il faut s'interroger sur cette déperdition de 5 %. Il n'y a pas une immigration unique mais des immigrations. Chaque femme issue de l'immigration a un parcours spécifique, ses richesses et ses handicaps, ses ressources propres et ses difficultés, si bien qu'il faut trouver des réponses multiples à des problèmes multiples. Il y a toutefois un point commun à toutes celles qui fréquentent nos permanences : elles se trouvent toujours dans des situations où il faut régler plusieurs problèmes en même temps. Problèmes juridiques - titre de séjour, regroupement familial, droit international privé, établissement des droits sociaux, mariage forcé, polygamie - et problèmes sociaux - travail, retraite, assurance, logement - s'entrecroisent, auxquels se greffent d'autres difficultés liées au droit de la nationalité, au surendettement, à la responsabilité parentale... L'allusion est de plus en plus souvent faite, dans les permanences, à ces graves atteintes que sont les mariages forcés et la polygamie, mais l'on constate une prise de conscience qui n'existait pas il y a quinze ans, et les femmes expriment de plus en plus souvent l'idée que ce n'est pas normal. S'agissant de la responsabilité parentale, le CIDF de l'Ardèche a fait des observations particulières : une politique conjointe au sein de l'Education nationale, des élus, des travailleurs sociaux pointant la montée en puissance de l'intégrisme religieux dans certains quartiers, avait demandé à ce que l'on « restaure l'autorité des pères ». Seulement, dans certaines situations, cela s'est traduit par la réinstallation d'une autorité coercitive sur les filles. Mme Annie Guilberteau a souligné que, dans ce contexte, le concept d'autorité parentale a été apprécié exclusivement au regard de références culturelles et en a donc exclu les règles de droit prônées par notre État républicain. En dépit de leur caractère cumulatif, les discriminations faites aux femmes sont souvent minimisées et tendent à être ignorées ou justifiées par la « nature » ou la « culture », qui excuseraient des traitements avilissants inacceptables et inégalitaires. Mais la « culture » doit évoluer vers davantage d'égalité, et aucune différence culturelle ne peut justifier des mutilations sexuelles ou des mariages forcés. Sans reprendre l'ensemble de l'étude consacrée aux « Femmes de l'immigration », à laquelle le CNIDFF a activement participé, Mme Annie Guilberteau a ensuite mis l'accent sur quatre types de difficultés spécifiques pour l'accès à la citoyenneté des femmes issues de l'immigration. Le premier problème tient à la difficulté d'accès aux droits. Cela vaut pour les femmes de l'immigration plus que pour d'autres et c'est sans doute le cas aussi pour les femmes qui vivent dans les campagnes les plus reculées. Les femmes issues de l'immigration ignorent souvent qu'elles peuvent faire appliquer la législation française, qui leur est souvent plus favorable. Ainsi, en matière de divorce, la juridiction française peut être saisie dès lors que le domicile conjugal se situe en France ou que les enfants y ont leur résidence habituelle. Or, de nombreuses femmes ignorent ces dispositions et laissent le mari saisir la juridiction de leur pays d'origine, qui leur sera moins favorable. Il faut donc augmenter le nombre de permanences d'accès aux droits dans les quartiers pour que les femmes issues de l'immigration puissent mieux connaître leurs droits, les faire valoir et gagner en autonomie. Le deuxième problème tient au mal que les femmes éprouvent à faire appliquer leurs droits fondamentaux lorsqu'elles se voient imposer une vie maritale non choisie qui leur vaut de subir la volonté de leur mari, qu'il s'agisse de mariages forcés, de répudiations, de mutilations sexuelles, de polygamie. Mme Annie Guilberteau a souligné la situation particulièrement difficile de certaines femmes arrivées en France par le biais d'agences matrimoniales « spécialisées » mettant en relation des femmes, notamment originaires des pays de l'Est et de Madagascar, avec des ressortissants français, la plupart du temps beaucoup plus âgés qu'elles. Certaines de ces femmes arrivent dans les permanences, totalement déracinées, sans ressources et souvent très isolées. Ces situations sont des « mariages arrangés » sur lesquels il conviendrait que le législateur se penche. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé pourquoi tant de femmes venaient de Madagascar. Mme Annie Guilberteau a répondu qu'elle l'ignorait, mais que plusieurs centres, notamment en Bretagne, en Loire Atlantique et dans le Limousin, font régulièrement état de tels mariages. Il ne s'agit pas à proprement parler de prostitution. Le phénomène a été signalé plusieurs fois aux pouvoirs publics, sans réaction à ce jour. La troisième difficulté à laquelle se heurtent les femmes de l'immigration est de trouver leur place sur le marché du travail, car elles sont victimes d'une double discrimination. A l'école, elles sont orientées vers des filières saturées ; à l'embauche, elles sont cantonnées dans certains secteurs d'activité tels que les services directs aux particuliers, les emplois à temps partiel ou les contrats précaires. Elles souffrent, plus encore que les autres femmes, du « plafond de verre ». Il faut noter que cela vaut aussi pour les femmes de la deuxième, voire de la troisième génération, pour des raisons que l'on ne connaît que trop : nom patronymique à consonance étrangère ou caractéristiques physiques stigmatisantes. Ce problème demeure d'une cruelle actualité. La dernière difficulté, c'est qu'elles ne sont pas reconnues comme individus dans une société qui véhicule des images stéréotypées ou fausses de ce qu'elles sont. Il faut dire qu'elles sont souvent invisibles, puisqu'elles sont peu représentées dans les instances dirigeantes, les syndicats, les partis politiques et les associations, exceptions faites des associations à dominante communautariste. Cela n'est pas le cas pour les jeunes, rassemblées au sein de mouvements tels que « Ni putes ni soumises », mais les femmes reçues dans les permanences du CNIDFF sont âgées de trente-cinq à cinquante ans, et leur situation est différente. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si l'intégration paraît moindre qu'il y a quinze ans. Mme Annie Guilberteau s'est dite incapable d'évaluer si l'intégration est moindre mais pouvoir répondre sans hésiter qu'elle n'est pas plus grande. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit craindre une régression et la radicalisation de la population issue de l'immigration. Mme Annie Guilberteau a indiqué que, sur cette question, les avis sont divers au sein du CNIDFF. Certains centres font effectivement état d'une forme de radicalisation, et de peur chez certaines femmes. Cela a été perçu par le centre de la Drôme qui, à l'occasion de son trentième anniversaire, a organisé une manifestation itinérante sur une trentaine de marchés du département pour évoquer l'égalité entre les hommes et les femmes. Certains propos tenus par des hommes, certes rares, à cette occasion ont été d'une extrême agressivité. Toutefois, certains discours excessifs ont conduit d'autres hommes à se démarquer d'opinions radicales. On peut toujours espérer que le dialogue avec les hommes les plus ouverts permette à d'autres hommes d'évoluer. C'est bien, entre autres, sur les mentalités qu'il nous faut agir. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est dite inquiète de ce qu'elle ressent comme une radicalisation diffuse. Ainsi, certaines jeunes filles qui voulaient participer à la marche organisée par le mouvement « Ni putes ni soumises » ont exprimé la certitude de ne pas y être autorisées par leur père. On sait d'autre part que la communauté turque fait venir des jeunes de Turquie pour leur faire épouser des Turcs de France, dans un climat de radicalisation culturelle qui n'existe pas en Turquie même. Dans ce contexte, comment promouvoir le principe de l'égalité des sexes avec suffisamment de tact pour ne pas donner le sentiment d'une ingérence dans des cultures qui ne sont pas fondées sur les mêmes principes ? Ne peut-on craindre qu'en faire trop ne conduise à un surcroît de radicalisation ? Mme Annie Guilberteau a répondu que le réseau des centres d'information sur les droits des femmes s'interroge également sur ce point. Il faut trouver les mots justes pour donner une représentation réelle de l'égalité et faire que cette valeur soit perçue comme acceptable et donc intégrée. Un grand travail reste à faire à ce sujet. Les CIDF s'y emploient par le biais de supports tels que des jeux, mais il n'est pas simple de traduire de manière aisément intelligible des concepts qui peuvent être interprétés de diverses manières. Que note-t-on d'autre dans les permanences ? En premier lieu l'ignorance de l'existence de lieux d'information. Les permanences pour être très visitées doivent être implantées dans des lieux pertinents. Ceci présente un impact direct sur l'accès aux droits. On note aussi la méconnaissance du maillage associatif et institutionnel, l'incompréhension des mécanismes administratifs et sociaux, la difficulté de s'orienter et de se déplacer dans une ville, même pour les femmes qui vivent en France depuis longtemps, si bien que le périmètre de leurs déplacements demeure limité. A ces difficultés s'ajoutent les souffrances liées à l'exil et au déracinement. On constate également l'incidence des problèmes linguistiques. L'insuffisante maîtrise de la langue constitue un véritable obstacle à l'accès aux droits et à l'insertion. Par ailleurs, lorsque les femmes viennent accompagnées de quelqu'un qui assure la fonction d'interprète, nul ne peut être certain que les informations traduites restituent la réalité du droit français, surtout lorsqu'il s'agit de divorce et d'autorité parentale. On note également les difficultés liées à l'analphabétisme, qui impose une aide à la rédaction d'actes et de contrats. Des juristes sont souvent amenés à orienter les femmes vers des écrivains publics, mais ceux-ci n'ont pas tous une formation adéquate, en particulier juridique. Pour toutes ces raisons, les CIDF ont multiplié des actions spécifiques visant les femmes de l'immigration. Il s'agit en premier lieu d'actions collectives d'accès au droit menées en s'appuyant sur des supports vidéo et des jeux pédagogiques et conçues de telle manière que les populations soient mélangées, ce qui évite la « ghettoïsation » et suscite des solidarités. Le réseau développe aussi des services de proximité pour l'accès aux droits et l'aide aux démarches administratives en privilégiant la complémentarité avec d'autres partenaires. Les centres ont également créé des ateliers thématiques pour aménager des espaces conviviaux où la parole se délie et où les femmes peuvent aborder des sujets de fond tels que la contraception, les mariages arrangés, la parentalité, la violence dans le couple, l'égalité entre hommes et femmes. Enfin, des guides et des brochures d'information sur le droit de la famille pour les étrangers résidant en France ont été publiés et diffusés à l'attention des travailleurs sociaux et des partenaires du réseau, et un service spécialisé en droit international privé a été créé, dont Mme Fersten Djendoubi est la responsable. Mme Fersten Djendoubi a indiqué que le Bureau régional des ressources juridiques internationales (BRRJI) est spécialisé en droit international privé. Ce service, confié au CIDF phocéen, est destiné essentiellement aux CIDF mais également aux professionnels - administrations, travailleurs sociaux, associations -, pour faire que les problèmes spécifiques des femmes de l'immigration soient pris en charge. Dans le cadre de l'activité du BRRJI, Mme Fersten Djendoubi a eu à connaître de la situation des femmes étrangères pour ce qui est de l'application de leurs lois nationales en France, de leur statut personnel, des pratiques traditionnelles telles que les mutilations sexuelles, et aussi de leur situation économique. S'agissant de leur statut et de la citoyenneté, les femmes migrantes expriment souvent le sentiment de n'être pas considérées comme des citoyennes à part entière mais comme des biens appartenant à un homme ou à une communauté. Cela peut s'expliquer par le processus de regroupement familial car si elles sont arrivées par ce biais, elles n'existent pour la France que par rapport à leur lien conjugal ou familial. Leur statut est lié à celui d'un homme ou d'une famille ; elles n'ont pas de statut autonome. Or, les femmes étrangères restant soumises à leur statut personnel, l'application de ce dernier peut avoir de graves conséquences sur leur avenir en France. En effet, en vertu de l'article 3 du code civil français, chaque ressortissant est soumis à sa loi nationale. On comprend que la facilité de dissolution du mariage par répudiation ou par divorce offerte au mari par certaines législations étrangères fragilise la situation administrative des femmes étrangères, qui peuvent se retrouver rapidement en situation irrégulière si le lien conjugal est brisé. Certes, les juridictions françaises manifestent régulièrement leur volonté de protéger les femmes étrangères contre d'éventuels jugements étrangers discriminants mais souvent, cela n'est pas possible. Le droit de séjour est conditionné par les liens familiaux. La fragilité de ce lien rend les femmes immigrées vulnérables, puisqu'elles sont dépendantes de la constance du couple et donc de leur mari. Si la base légale du séjour qu'était le mariage n'existe plus, la femme immigrée se trouve en situation irrégulière. Par peur de perdre le droit de résider en France, certaines sont contraintes de rester avec leur mari, ce qui les expose à un risque supérieur de subir pressions, voire chantage et violences conjugales. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France avait prévu la possibilité de régulariser la situation des femmes étrangères victimes de violences conjugales mais cette disposition n'est utilisée que lors du renouvellement du titre de séjour, et tout dépend de la bonne volonté du préfet. De plus, certaines femmes n'ont pas toujours les moyens de faire valoir les violences qu'elles subissent car elles sont très souvent isolées, surtout les primo-arrivantes, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement des circuits administratifs et qui restent souvent sans titre de séjour, soit par méconnaissance du processus, soit par passivité du conjoint. Certaines femmes immigrées n'ont que très peu accès au monde extérieur. Les primo-arrivantes, ne maîtrisant pas la langue, hésitent à se déplacer seules, et le mari, souvent indisponible, ne les aide pas à découvrir les structures ou les services français. Il faut donc qu'une autre femme ou une assistante sociale consente à pallier l'absence du conjoint pour que ces femmes puissent accéder aux administrations publiques. Le cantonnement géographique dans des cités fortement communautarisées a maintenu les femmes dans un rôle de mère nourricière, mais il les tient également loin des regards et dans l'obligation de taire les éventuelles violences dont elles sont victimes, dans un environnement qui les oblige à respecter et à perpétuer les pratiques traditionnelles que sont l'excision et le mariage forcé, même si elles n'en ont pas la volonté. L'examen de la situation économique des femmes de l'immigration fait ressortir des facteurs pénalisants. On citera en premier lieu la non reconnaissance de leur diplôme étranger et le défaut de prise en compte de l'expérience professionnelle acquise dans le pays d'origine. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a fait observer que cette difficulté vaut pour tout immigré, soulignant que la prudence doit valoir pour toute équivalence de diplôme. La question se pose d'ailleurs dans les mêmes termes pour les Français résidant à l'étranger. Mme Fersten Djendoubi, sans en disconvenir, a indiqué que cette situation est toutefois source de graves difficultés, et cité le cas d'une femme médecin algérienne qui aurait dû reprendre ses études à zéro pour pouvoir exercer en France alors qu'elle n'a rien pour vivre et qu'elle est mère isolée. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a reconnu la réalité du problème. Mme Fersten Djendoubi a indiqué qu'une deuxième difficulté tient à ce que les choix professionnels sont restreints. Les femmes issues de l'immigration font état de leur cantonnement aux services à la personne, qui ne valorisent pas leur expérience passée et qui ne permettent pas d'évolution professionnelle. Les difficultés linguistiques sont un frein et certaines femmes regrettent de s'être mariées trop jeunes pour poursuivre des études. Certaines femmes évoquent également des freins culturels : ainsi de ces femmes de confession musulmane dissuadées d'exercer certaines activités professionnelles. Par exemple, en milieu hospitalier, l'interdit culturel empêche d'approcher les hommes. Ces phénomènes, jusqu'à présent récurrents, tendent à s'accentuer. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a constaté qu'en trente ans, l'action menée n'avait guère eu de résultats. Mme Fersten Djendoubi a répondu que c'est un sentiment général exprimé par les femmes reçues dans les CIDF, lorsqu'on leur demande si elles ont fait état de leurs difficultés. Elles expliquent alors qu'elles ont beau être en France depuis trente ans, personne n'est venu les chercher pour les faire sortir de chez elles, devant leur mari, lequel, dans un tel contexte, n'aurait pu s'opposer à cette démarche. De ce fait, elles sont désormais âgées de soixante ans et elles ne maîtrisent ni la langue française ni l'environnement dans lequel elles vivent depuis des décennies. Toutefois, la récente mobilisation contre les pratiques traditionnelles et particulièrement les mariages forcés a libéré la parole, ce qui constitue un progrès. Le CIDF travaille d'ailleurs avec le mouvement Il faut également souligner la vigilance des pouvoirs publics et des juridictions, qui atténuent les effets des jugements étrangers qui peuvent être discriminants. Ainsi, la Cour de cassation a été amenée à plusieurs reprises, et encore le 17 février 2004, à refuser la reconnaissance en France de jugements de répudiation, qu'elle a jugés contraires au principe d'égalité des époux dans le mariage et ne respectant pas les droits de la défense, une épouse ne pouvant faire valoir ses droits lors d'une répudiation. Cette jurisprudence protectrice des droits des femmes migrantes a permis de pallier les conséquences dramatiques qu'aurait entraînées l'application en France de ces jugements défavorables. Le rappel aux accords bilatéraux et aux règles de compétences juridictionnelles permet aussi d'empêcher l'application en France de tels jugements. Toutefois l'application des accords bilatéraux ne suffit plus à éviter des situations ambivalentes, telles qu'une femme étrangère peut se trouver répudiée dans son pays mais mariée en France, ou divorcée en France et encore mariée dans son pays d'origine. On constate en effet un problème récurrent pour obtenir l'exécution des jugements français de divorce dans le pays d'origine. A cela s'ajoutent la douleur psychologique et le sentiment d'injustice que peuvent éprouver les femmes étrangères face à ce traitement différencié : elles, qui vivent en France depuis des décennies, se voient appliquer la loi de leur pays d'origine, qu'elles ne connaissent pas et qui contient des dispositions contraires au droit de la société dans laquelle elles vivent, qu'il s'agisse de la polygamie ou de la répudiation. Elles souhaitent que les accords bilatéraux soient mieux appliqués afin de permettre l'établissement rapide d'un état civil qui leur permettra de vivre dans la sérénité. Le contexte étant celui qui vient d'être décrit, quelles peuvent être les préconisations ? S'agissant du statut personnel, il faut renforcer l'information et améliorer la diffusion des lois étrangères et des règles du droit international privé. Il faut aussi créer une véritable coopération et une aide mutuelle judiciaire entre la France et les pays d'origine afin d'améliorer l'exécution des jugements français et la prise en compte effective des intérêts des femmes. Pour ce qui est du droit au séjour, il faudrait désigner un réfèrent au sein du bureau des étrangers des préfectures, et le mettre à l'écoute des difficultés particulières des femmes. Il faut aussi mieux tenir compte des violences conjugales dans les causes de la rupture de la vie commune et assurer la régularisation de l'épouse dès son arrivée en France. Il faut enfin mutualiser les moyens des services préfectoraux et des structures traitant du droit des étrangers. Mme Annie Guilberteau a souligné la nécessité d'accroître le nombre des structures d'accès au droit, en veillant à ce que ceux qui les animent soient véritablement qualifiés pour le faire. La complexité des lois et des règlements est telle que ces tâches ne doivent être confiées qu'à des gens qui ont de solides connaissances juridiques. C'est d'ailleurs parce qu'il compte dans son effectif des juristes aguerris que le réseau des CIDF souhaite recentrer une partie de ses activités en faveur de ce public précis ; dans un tel domaine, on ne peut improviser ni, donc, laisser n'importe quelle association se lancer dans de tels services. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a retenu, au nombre des préconisations avancées, celle de créer dans chaque préfecture un lien spécifique obligatoire avec les femmes de l'immigration. Mme Annie Guilberteau a confirmé que cela serait nécessaire. Pourquoi ne parviendrait-on pas à sensibiliser les préfectures aux problèmes spécifiques des femmes de l'immigration comme on a progressivement réussi à sensibiliser commissariats et gendarmeries à la question des violences faites aux femmes ? L'idée est à creuser, car ces femmes, outre qu'elles peuvent être victimes de la violence conjugale « ordinaire », sont aussi victimes de ces délits que sont les mutilations sexuelles et les mariages forcés. Cependant, l'émergence du mouvement « Ni putes ni soumises » a fait que l'on s'est focalisé sur les violences subies par les femmes de certains quartiers. Or, le problème n'existe pas seulement là. Cette focalisation peut avoir un aspect réducteur et porte en germe un risque de stigmatisation de l'agresseur, qui serait de fait un homme arabe ou étranger, quand on sait que la violence faite aux femmes est multiculturelle. Mme Fersten Djendoubi a dit que les préjugés ont la vie dure : ainsi de ces femmes qui, venues porter plainte pour violences conjugales s'entendent dire : « Oui, mais chez vous, c'est comme ça... », alors que la législation des pays d'origine proscrit expressément de tels comportements. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que, là encore, il est bien difficile de savoir jusqu'où peut aller l'ingérence. Mme Fersten Djendoubi a répondu qu'en l'occurrence, la première chose à faire est de rappeler aux individus concernés les dispositions législatives du pays dont ils sont issus. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé qu'en dépit de l'important travail mené par l'État et par les associations depuis des années, la situation actuelle traduit un échec qui exige une réflexion de fond. L'inquiétude de la Délégation grandit à mesure que les auditions se succèdent. Mme Catherine Body a exposé que la principale difficulté dont souffrent les femmes de l'immigration est le manque de reconnaissance en tant qu'individu, dans leur singularité, indépendamment de leur nationalité d'origine. Voilà pourquoi le CIDF de Marseille a organisé, en avril dernier, une action tendant à la visibilité et la reconnaissance, sur le thème « Femmes et migrations ». Il était en effet important de dissocier « femmes de l'immigration » et « femmes des quartiers » en les rendant visibles dans leur diversité et en leur donnant une place valorisante. Cette manifestation a été organisée en coopération avec une vingtaine d'associations et la municipalité et avec le fort soutien de la délégation régionale aux doits des femmes et à l'égalité. La participation d'un service de l'État a, par elle-même, donné un souffle particulier à cet événement et l'a valorisé aux yeux du public. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que la réactivation du réseau des déléguées régionales n'est malheureusement pas dans l'air du temps. Elles devraient pourtant avoir l'oreille du préfet, au lieu que l'indispensable action de terrain qu'elles ont vocation à mener dépende de sa bonne volonté. Mme Annie Guilberteau a insisté sur l'apport des déléguées régionales, souligné leur manque de moyens et précisé que les délégations régionales sont un lien indispensable entre les institutions et les associations représentantes de la société civile. Mme Catherine Body a précisé que les partenariats noués avec des organismes œuvrant dans le domaine de l'immigration ou auprès des femmes dans le cadre de la manifestation « Femmes et migrations » ont déjà modifié les pratiques des professionnels et leur approche du public, ce qui est un progrès en soi. La manifestation, ouverte et intergénérationnelle, a notamment porté sur les relations entre les deux sexes. Elle a permis des échanges multiples, qui ont montré la persistance de difficultés d'identification chez des gens qui ont le sentiment de ne pas être reconnus en tant qu'individus alors qu'ils sont en France depuis longtemps. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si ce phénomène peut expliquer la radicalisation. Mme Catherine Body a répondu que c'est l'une des hypothèses possibles. Si à ce manque de reconnaissance s'associe un cantonnement géographique, le regroupement incite à un repli communautaire et à la résurgence de traditions que des mères présentes en France depuis quarante ans veulent imposer à nouveau à leurs filles. C'est l'un des éléments marquants qu'a fait émerger la manifestation, mais ce n'est pas le seul. En effet, les discriminations raciales et sexistes sont ressenties comme quotidiennes et émanant principalement des pouvoirs publics. Il apparaît donc illusoire, sinon impossible, de dénoncer ces actes en portant plainte devant ceux-là même que l'on accuse de les commettre. Il est d'autre part apparu que de multiples discriminations liées aux représentations culturelles se combinent. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si les services de l'État tiennent compte du travail associatif ainsi mené, et comment la coopération entre toutes les parties concernées devrait s'établir pour conduire à une intégration satisfaisante. Elle a par ailleurs demandé à ses interlocutrices si le terme d'« assimilation » leur paraissait gênant. Mme Catherine Body a répondu que, selon l'étude menée par un chercheur, le seul terme d'«intégration » suffit à « horripiler » celles et ceux qui sont nés et qui ont été scolarisés en France, qui vivent sous la loi française, et qui estiment ne pas avoir à travailler à une intégration qui devrait être acquise. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé qu'il fallait être certain que la loi leur soit connue, ce qui n'est pas toujours le cas. Mme Catherine Body a dit qu'il reste des progrès à faire en matière d'enseignement de l'histoire et du droit. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a convenu que le droit n'est qu'effleuré en section ES, soulignant l'importance du rôle des professeurs d'histoire et de géographie, appelés à enseigner les différentes religions en classe de cinquième, ce qui contribue grandement à une meilleure connaissance réciproque. Mme Fersten Djendoubi a insisté sur la nécessité de distinguer les femmes qui arrivent en France de celles qui y sont nées. Celles-là ont appris l'histoire de France - et elle-même peut témoigner, à titre personnel, de l'horreur que cela représente pour une enfant de s'entendre dire : « Ce ne sont pas tes rois »... Par ailleurs, les immigrants sont arrivés avec des pratiques culturelles mais sans connaissance de la législation de leur pays d'origine ; ils ignorent donc que le principe du consentement des deux époux y figure en toutes lettres. Cette ignorance du droit du pays d'origine a des conséquences problématiques ; il faut leur faire distinguer ce qui relève du culturel et du législatif. Autrement dit, ceux qui, nés et éduqués en France, s'entendent dire des énormités peuvent soit passer outre, soit se sentir mal-aimés et se tourner vers ceux qui les reconnaissent et qui leur donne un statut, sans rien connaître du pays d'origine de leur famille. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que ceux-là ne sont nulle part, ou entre deux chaises, rejetés quand ils rentrent dans le pays d'origine de la famille, cependant qu'en France monte une mayonnaise inquiétante. Il faudrait parvenir à faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mme Annie Guilberteau a observé que pour tout problème se pose la question de l'instrument de mesure. Ainsi, les violences conjugales ont toujours existé mais les plaintes étaient moins nombreuses qu'elles ne le sont maintenant. Cela signifie-t-il que le phénomène a pris de l'ampleur ou que les victimes ont plus de facilité à en parler ? Il en va de même pour les problèmes des femmes issues de l'immigration : il est exact que des courants irréductibles s'efforcent de réimposer des modèles traditionnels mais, dans le même temps, les femmes s'autorisent à en parler plus qu'elles ne l'auraient fait dans le passé. De ce point de vue on peut considérer que de véritables progrès existent. Toutefois, nous observons deux mouvements concomitants qui nécessitent d'être analysés finement. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit partager ce point de vue et déplorer l'absence d'études sociologiques précises à ce sujet, à un moment de tension manifeste. Mme Annie Guilberteau a insisté sur la nécessité de rendre visibles toutes les actions positives et la richesse des apports des femmes de l'immigration, qui sont rarement valorisées. Mme Catherine Body a souligné que les femmes de l'immigration n'ont jamais de mandats électoraux. C'est dire qu'on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer comme citoyennes. Elle a conclu en alertant la Délégation sur la très inquiétante dégradation des relations entre les garçons et les filles issus de l'immigration, liée à la tentation du repli communautaire. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est dite consciente de cette évolution très préoccupante. Elle a remercié Mmes Annie Guilberteau, Catherine Body et Fersten Djendoubi pour leurs propos riches d'enseignements. Audition de Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion Réunion du mardi 11 octobre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Si elle a souhaité qu'elle soit la première invitée de la Délégation en cette rentrée parlementaire, c'est parce que les femmes sont partie prenante dans l'ensemble de ses domaines de compétence, qu'il s'agisse de l'intégration ou de la cohésion sociale. S'agissant de la parité en politique, Mme la ministre s'est exprimée le 6 juin dernier à l'occasion du colloque organisé pour les 10 ans de l'Observatoire de la parité et les 5 ans de la loi sur la parité. La Délégation aura l'occasion de l'entendre à nouveau, peut-être dans un délai assez bref, puisqu'il semble que des textes soient en préparation sur ce sujet. De même, la Délégation serait heureuse de la recevoir au moment de la deuxième lecture du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, afin de lui faire part de ses attentes sur ce texte. Mais c'est aujourd'hui dans le cadre de son thème de travail annuel, celui des femmes de l'immigration que la Délégation souhaite entendre Mme Catherine Vautrin. C'est un sujet difficile et délicat sur lequel la Délégation souhaite faire le point avec la ministre de la situation actuelle et des avancées possibles. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a remercié la présidente pour cet accueil et s'est réjouie de retrouver la Délégation, avec laquelle elle souhaite avancer sur de vrais sujets de société. Car s'il est des sujets à court terme, il en est d'autres, tel celui de la place des femmes dans la société, pour lesquels la réflexion et l'échange doivent précéder la décision. Avant d'en venir au thème de cette audition, la ministre a souhaité insister sur deux points d'actualité. Elle a ainsi rappelé qu'en défendant au Sénat, en juillet dernier, le projet de loi sur l'égalité salariale, elle avait pris des engagements sur des aspects ne figurant pas dans le texte. Le premier est le temps partiel subi, à propos duquel les choses ne sont pas aussi évidentes qu'on le dit parfois. L'enquête qu'elle a demandée à la DARES devrait permettre de savoir exactement de quoi on parle. Le deuxième est celui du désenclavement du travail des femmes, celles-ci étant cantonnées dans onze des quarante familles de métiers. Pour que les choses avancent dans ces deux domaines, elle a tout d'abord demandé à la Délégation aux droits des femmes du Conseil économique et social de lui faire part de ses approches sur le travail à temps partiel en novembre prochain, avant la deuxième lecture du texte. Elle a par ailleurs rencontré ce matin son collègue ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, M. Gérard Larcher, et deux réunions sur ces thèmes sont prévues avec les partenaires sociaux, les 24 et 29 novembre. La ministre a ensuite rappelé qu'elle venait d'être interrogée, lors des questions au Gouvernement, sur la place des femmes en politique. Le sondage publié par Le Parisien montre que les Français souhaitent qu'il y ait plus de femmes dans ce secteur. Elle-même plaide pour la mixité et la complémentarité. En rester à 12,5 % de femmes députées est un vrai échec. Les politiques doivent donner l'exemple, les partis sont prêts à avancer, et il faut vraiment se battre car les élections législatives auront lieu dans dix-neuf mois et les municipales suivront. Il est aussi nécessaire de progresser sur la place des femmes dans la haute fonction publique et elle a fait un certain nombre de propositions au Premier ministre en ce sens. Pour sa part, elle a déjà nommé une femme, Mme Anne-Marie Charvet, à la tête de la Délégation interministérielle à la ville, et elle en a proposé une autre pour prendre la direction du FASILD. Cela lui paraît d'autant plus nécessaire qu'elle a constaté, lors d'une réunion des directeurs régionaux et départementaux de l'équipement, que, sur 150 personnes présentes, il n'y avait pas plus de 20 femmes, y compris les hôtesses d'accueil... Pour en venir aux femmes de l'immigration, cette audition me donne l'occasion de faire le point. Il convient d'abord de rappeler que la moitié des immigrés - 50,3 % exactement - sont des femmes, soit 2,1 millions en 1999. Mais ce chiffre ne tient compte que de celles qui vivent en France et qui sont nées étrangères dans un pays étranger, et non de l'ensemble, bien plus important, des « femmes de l'immigration », qui disposent d'une carte d'identité française depuis longtemps mais continuent à être perçues par l'opinion publique, dans leurs liens de parenté et de culture, comme étant d'origine immigrée. En fait, aujourd'hui un quart des Français ont un de leurs quatre grands-parents d'origine immigrée. La richesse des talents, des compétences de ces femmes peut être un atout fondamental pour la société française, qui ne doit pas se construire sans elles. C'est pourquoi la ministre fait de leur intégration un des axes forts de sa politique. Leur situation se situe d'ailleurs au confluent de ses deux portefeuilles, parité et cohésion sociale, mais elle relève aussi de l'exclusion et de la politique de la ville. Clarifiée par le Haut Conseil à l'intégration, relayée par l'accord cadre signé notamment par le service des droits des femmes et de l'égalité, la politique menée en leur direction passe en particulier par le contrat d'accueil et d'intégration. Aujourd'hui, en matière d'immigration, la France manie deux notions : humanité de l'accueil des nouveaux arrivants et fermeté. À l'évidence, il n'est pas possible de réussir l'intégration si on ne parle pas le français. En signant, dès son arrivée, le contrat d'accueil et d'intégration, la primo-arrivante s'engage à connaître ses droits et devoirs mais aussi à apprendre la langue. Un budget de 60 millions d'euros est consacré chaque année à ces actions. Par ailleurs, l'entretien individuel a été rendu systématique lors de l'accueil sur les plates-formes, les femmes étant informées de leurs droits en tête-à-tête avec un interprète. On sait en effet que le moment de leur arrivée est un des seuls où un tel contact sera possible car, en particulier si elles n'ont pas d'enfants et n'ont donc pas à se rendre aux consultations de PMI, elles risquent d'être ensuite enfermées dans des appartements, où il sera difficile de leur délivrer un message. Bon nombre de femmes, mariées à un cousin, arrivent en France du jour au lendemain, sans en parler la langue. Il faut donc avoir en leur direction une véritable stratégie de formation. La ministre milite ainsi fortement pour que la délivrance d'un titre de séjour de dix ans soit soumise à un test de pratique du français. Elle souhaite également que les centres d'information des droits des femmes (CIDF) soient présents aussi souvent que possible sur les plates-formes, pour accompagner et informer les femmes. La réforme de l'accueil permet ainsi une meilleure information sur l'égalité des droits, ceux femmes étant encore largement bafoués. La ministre est très sensibilisée à la question des violences. La journée contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, permettra de rebondir sur le sujet. Il ne faut jamais oublier que ces violences sont une intolérable négation des droits fondamentaux de la personne, qu'elle soit issue de l'immigration ou française de souche. Le Conseil de l'Europe a adopté mardi dernier une résolution très importante sur les relations entre les femmes et les religions. Il s'est prononcé clairement contre les mariages forcés, les mutilations sexuelles, les violences dont les femmes sont les premières victimes, arguant que « la liberté de religion ne peut pas être acceptée comme un prétexte pour justifier les violations des droits des femmes. » La ministre a souhaité faire part de l'engagement du Gouvernement dans la lutte contre les violences et contre tout ce qui bafoue la place des femmes dans la société En cinquante ans, la population immigrée a connu une importante féminisation puisque, en 1968 la part des femmes dans la population immigrée n'atteignait que 43,9 %. À partir de 1974, à l'immigration de travail a succédé l'immigration du regroupement familial, ce qui explique cette évolution. Mais le fait que les femmes soient arrivées en France plus récemment a des effets sur leur place dans la société, notamment en raison de problèmes de langue. Il est préoccupant qu'une femme de cinquante ans, une fois ses enfants élevés, se retrouve seule dans son quartier, incapable de sortir de chez elle en raison de la barrière de la langue. De ce point de vue l'association de femmes de Vaulx-en-Velin, Cannelle et Piment, a mené une action exemplaire en permettant à des femmes d'origine différente, s'intégrant difficilement et ayant comme seul point commun de ne pas parler français, de mettre en valeur leurs compétences culinaires. Elles ont commencé par cuisiner, les gens sont ensuite venus manger au centre d'action sociale et elles ont vendu leurs produits, avant de constituer une entreprise d'insertion, puis une véritable entreprise qui compte aujourd'hui sept salariés en CDI et qui est devenue un véritable traiteur de l'agglomération lyonnaise. Elle pourrait même aujourd'hui envisager de franchiser dans d'autres quartiers de grandes villes. La ministre leur a fait rencontrer l'ensemble des déléguées aux droits des femmes, car elle croit beaucoup à la mutualisation des expériences. Elle avait aussi fait venir à la même réunion Yasmina Benguigui, cinéaste, qui a beaucoup décrit le fameux « plafond de verre » qui empêche l'évolution professionnelle des femmes. Mettre en évidence de telles expériences permet aussi d'éviter de tomber systématiquement dans le misérabilisme : il y a des difficultés, mais il y a aussi des réussites de l'immigration, et il faut mettre en avant les possibilités offertes par le modèle républicain. Le groupe de travail sur les femmes de l'immigration a bien avancé et ses conclusions ont été rendues le 8 mars dernier. Trois objectifs ont été dégagés : faciliter l'accès aux droits, promouvoir les droits fondamentaux de la personne, garantir aux femmes de l'immigration leur place dans la société. Certaines propositions sont désormais à l'étude. Lors de l'université d'été de Ni putes ni soumises, la ministre a fait part de la détermination du Gouvernement à avancer sur le sujet de l'âge nubile. Il est en effet anormal qu'il demeure de quinze ans pour les jeunes filles et de dix-huit ans pour les jeunes gens. Il est temps de procéder à une harmonisation dont les conséquences seront extrêmement importantes pour les jeunes filles issues de l'immigration. Cette disposition figurera dans le texte sur les violences que le ministre de l'intérieur présentera au printemps. La pleine connaissance de leurs droits par les femmes de l'immigration se heurte non seulement à la barrière de la langue mais aussi à l'enchevêtrement et à la complexité des textes. Il serait donc bon de prévoir un guide à l'attention de celles qui viennent d'arriver. C'est ce qui vient d'être fait, avec le Maroc, pour mettre en application et expliquer la Moudawana. Plus généralement, la ministre a demandé au service des droits des femmes de réaliser un guide de l'égalité des hommes et femmes de l'immigration qui serait remis systématiquement sur les plates-formes. Cela permettrait également de mieux informer sur les mutilations sexuelles. Récemment, à Marseille, un chef d'établissement scolaire a parlé de ces petites maliennes qui, dès l'âge de douze ans, repartent dans leur pays pour y être mutilées et mariées avant de revenir en France. Ces pratiques sont donc extrêmement organisées et il faut se mobiliser car on ne saurait laisser faire cela en France. Autre sujet de mobilisation, les mariages forcés, dont près de 70 000 jeunes femmes seraient victimes sur le territoire français. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a permis de progresser de façon considérable. En effet, les règles procédurales du mariage permettent désormais à l'officier de l'état civil ou à l'autorité consulaire d'auditionner séparément les candidats au mariage. Ce sujet a été abordé récemment lors d'un conseil interministériel à l'immigration où a été rappelée la nécessité de former le personnel consulaire. La ministre a constaté à Rabat le savoir-faire et la délicatesse d'un agent consulaire confronté à la demande d'un homme d'une soixantaine d'années et d'une jeune femme qui ne parlait pas un mot de français... Un autre moyen de lutter contre ce phénomène pourrait être la pénalisation des mariages forcés. L'idée du délit de contrainte à mariage est particulièrement intéressante. Sa création, envisagée également dans le cadre du projet de loi sur les violences, permettrait de condamner les parents ou la famille exerçant une contrainte sur le consentement au mariage. Mais, quelle que soit la répression, elle ne saurait remplacer la prévention. L'information sur les mariages forcés est donnée sur les plates-formes de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et elle figurera dans le guide de l'égalité des femmes et des hommes de l'immigration. Il faut aussi encourager le plus possible les associations, qui font un travail très intéressant. La ministre demandera au FASILD de revenir sur ce sujet. À chaque génération, il faut reprendre les explications et dire clairement ce qui n'est pas normal. L'accompagnement des victimes est un autre aspect de la question. Des expériences sont actuellement menées avec un dispositif de familles d'accueil car il faut non seulement apporter des premières réponses mais aussi aider les jeunes filles à se reconstruire, en particulier quand elles ont aussi été victimes de violences. Des études sont également conduites sur la possibilité pour la femme victimes de violences de rester chez elle : il n'y a aucune raison que ce soit la victime qui soit obligée de partir. Mme Marcelle Ramonet a fait observer que cela ne fonctionnait pas et insisté sur la nécessité de trouver plutôt des hébergements de nuit pour ces femmes. M. Pierre-Christophe Baguet a ajouté qu'il convenait aussi de mieux former les policiers. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a répondu qu'elle savait que les élus locaux étaient régulièrement confrontés à ce problème. C'est la raison pour laquelle ses services travaillent sur le sujet. Elle a aussi rappelé qu'il y a aujourd'hui, tous types d'hébergements d'urgence confondus, 100 000 places pour un coût global d'un milliard. La polygamie est un autre sujet important et difficile à appréhender. Une étude de l'INED et de l'INSEE faisait état en 1993 de 10 000 familles polygames en France. Un sociologue en a recensé 15 000 deux ans plus tard et la presse parle aujourd'hui de 30 000. En tout cas, les témoignages concordent sur le fait que la seconde épouse est rarement acceptée et que les situations conflictuelles sont fréquentes dans la promiscuité et dans une grande souffrance pour les femmes et pour les enfants. Pour avoir eu à gérer cet été, comme plusieurs autres ministres, l'incendie du boulevard Vincent Auriol, Mme Catherine Vautrin a constaté que, lorsqu'il y a cent enfants pour dix familles, la situation n'est pas celle de familles françaises types... Certes, on a réussi à trouver trente-deux appartements, mais les choses sont extrêmement difficiles. Les circulaires du 25 avril 2000 et du 10 juin 2001 sont destinées à encourager les familles à « sortir » de la polygamie. La ministre a par ailleurs l'intention de commander une double enquête à la CNAF et à la MSA, afin d'identifier les situations de polygamie par le repérage des allocataires qui perçoivent une somme particulièrement importante au titre des prestations familiales. Pour s'attaquer au phénomène, il faut en bien connaître l'ampleur. Mme Chantal Brunel, députée, avait proposé d'instaurer une « tutelle aux prestations sociales enfant », mais on peut craindre que son caractère automatique ne stigmatise l'ensemble de ces familles. Mieux vaudrait peut-être que la mère, légitime, naturelle ou adoptive, ait la qualité d'allocataire des prestations, ce qui permettrait un meilleur suivi. Il faudra aussi régler le problème de toutes celles qui arrivent en prétendant être des « grandes sœurs » et qui sont en situation irrégulière. Or il faut que l'allocataire soit en situation régulière. Le Gouvernement est également mobilisé sur la question des familles. Un dispositif expérimental d'aide au retour est actuellement mené, de septembre 2005 à juin 2006, dans vingt-et-un départements, sur une procédure permettant de raccompagner des familles déboutées du droit d'asile. Le Gouvernement a fait de la réduction du délai d'instruction des dossiers de demande d'asile une priorité. Le conseil d'administration de l'OFPRA a établi en juin dernier une première liste de douze pays d'origine sûrs. A la fin de l'année 2005, le délai sera ramené à neuf mois pour le traitement des dossiers par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Commission des recours des réfugiés (CRR), l'objectif étant d'arriver à six mois. Ainsi sera-t-il possible d'organiser le retour avant que ces personnes ne s'installent et ne deviennent parents d'enfants nés en France. Le coût du maintien d'une personne déboutée du droit d'asile en centre de rétention est de 7 000 euros, alors que le dispositif qui permet de raccompagner deux adultes et deux enfants coûte au total 8 000 euros. Qui plus est, cette mesure repose sur un vrai projet qui facilite la réinsertion des personnes dans leur pays d'origine et apporte donc une véritable solution. En juin prochain, au vu des résultats, une généralisation pourra être envisagée. La réussite scolaire est aussi un élément très important. L'école est au cœur du dispositif d'intégration, et les filles réussissent mieux dans leurs études. En outre, les établissements scolaires peuvent aider au repérage des pratiques coutumières. Des actions sont menées dans le cadre de la politique de la ville. Avec les équipes de réussite éducative, pour la première fois on est entré dans une logique d'accompagnement non plus territorial mais individuel. Après l'école, vient théoriquement l'insertion professionnelle. Mais le taux d'activité des femmes immigrées est nettement inférieur à celui des femmes françaises, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Alors que les Portugaises ont le taux d'intégration professionnelle le plus élevé, il est extrêmement faible pour les femmes originaires du Maghreb et de Turquie. En 2002, le taux de chômage des femmes immigrées atteignait 18 %, sans que cela soit lié à un plus faible niveau d'études puisqu'à situation de famille et à niveau scolaire comparables, ces femmes restent moins actives que les Françaises de souche. On touche là à un autre sujet, celui de la discrimination positive et de l'accompagnement en termes d'égalité des chances : comment aider celles qui sont non seulement femmes, mais encore issues de l'immigration, à trouver une activité professionnelle ? Qui, plus est même quand elles trouvent un emploi, elles sont confrontées au « plafond de verre » et exclues des postes de responsabilité. Il faut leur appliquer les dispositions qui ont commencé à être prises pour les femmes en général. Une manifestation importante sera organisée à la fin du mois d'octobre, à l'occasion de l'attribution du label égalité à de nouvelles entreprises. Un travail est également mené avec la CGPME sur la place des femmes dans les petites entreprises, car il est encore plus difficile de faire une place aux femmes quand on n'a un encadrement que de trois ou quatre personnes. Un modèle d'intégration devrait être prêt en janvier 2006. Le récent changement à la tête du MEDEF est par ailleurs de bon augure. La ministre a rencontré à deux reprises Mme Laurence Parisot, qui est si attentive à ce sujet qu'elle a elle-même engagé une démarche « égalité » au sein de l'organisation patronale. L'ensemble de ces projets trouvera une traduction concrète avant la fin de l'année, sous la présidence du Premier ministre, lors de deux comités interministériels, l'un à la ville et l'autre à l'intégration. Un certain nombre de mesures seront annoncées à cette occasion, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les violences, la création du délit de mariage forcé, l'harmonisation de l'âge nubile, l'extension du délai de prescription pour les mutilations sexuelles. Plus généralement, il faut réfléchir ensemble à toutes les actions permettant de mettre en valeur les femmes de l'immigration, leurs parcours de réussites, notamment avec les mesures de parrainage, de tutorat, d'accompagnement dans les parcours professionnels, ainsi qu'avec la présentation des apports spécifiques des femmes par la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Des outils existent, l'opinion publique est mobilisée. Pour rapprocher les politiques de la population il faut désormais agir. La ministre sait pouvoir compter sur la détermination de la Délégation qu'elle remercie de l'accompagner dans son travail quotidien. M. Pierre-Christophe Baguet s'est déclaré impressionné par la forte proportion de mariages forcés, 70 000 mariages forcés représentant près du quart des 300 à 350 000 mariages célébrés chaque année. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a confirmé le chiffre de 60 à 70 000 mariages forcés. M. Martial Saddier a souhaité que le dispositif de labellisation soit étendu aux collectivités territoriales et s'est porté candidat, au nom de sa ville. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a ajouté que le maire de Vienne, M. Jacques Remiller, serait sans doute intéressé également, lui qui mène une forte politique de féminisation au sein de sa collectivité. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a jugé l'idée excellente et s'est déclarée prête à mener une expérimentation avec Bonneville. Ses services prendront contact avec ceux de M. Martial Saddier. Une rencontre pourrait aussi être organisée avec M. Jacques Pélissard, afin d'y associer l'Association des maires de France. Elle a par ailleurs souhaité que la réflexion se poursuive sur la parité dans les exécutifs locaux, car celle-ci ne s'est pas réalisée en dépit de l'obligation d'alterner un homme et une femme dans les scrutins de liste. Mme Bérangère Poletti a remercié la ministre pour son exposé complet. Elle a demandé quand serait disponible l'étude sur le temps partiel car il s'agit d'un enjeu très important pour les femmes, mais aussi, en effet, d'un sujet sur lequel tout ce qui se dit n'est pas forcément juste. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a répondu qu'elle disposait déjà d'une première ébauche. Le nouveau responsable de la DARES étant en place depuis 15 jours, elle lui a demandé de rendre les éléments définitifs sous deux semaines, car il est effectivement indispensable de savoir de quoi on parle vraiment. On peut en particulier s'interroger sur la possibilité de faire évoluer les femmes qui travaillent à temps partiel dans certains types de métier, comme les hôtesses de caisse, vers d'autres métiers plus porteurs. Mme Bérengère Poletti a évoqué le risque pour ces femmes, qui ont choisi le temps partiel pour se consacrer à leur famille, de se retrouver dans une situation très difficile au moment de la retraite si cette famille a éclaté : c'est souvent quand elles sont seules que la misère leur tombe dessus. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'il ne fallait pas minimiser les difficultés des femmes qui travaillent à temps partiel et qui sont le plus souvent sous qualifiées. Peut-être les jeunes filles sont-elles désormais mieux formées, mais c'est la population des 30-50 ans qui pose aujourd'hui problème ; on le voit bien quand on se rend dans une ANPE. Dans tous les contrats qui sont mis en place, des questions se posent pour les femmes. Il faut être capable d'y répondre. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a répondu que la première des choses sur lesquelles il fallait travailler était l'employabilité à vie. Le CDI n'est pas la panacée : quand une entreprise ferme, peu importe le contrat, on se retrouve au chômage. Cela n'a rien d'infâmant, il faut que ce soit l'occasion de rebondir. C'est donc bien la question de la formation des femmes, souvent sous qualifiées, qui est posée. Dans une ville que Mme Bérengère Poletti connaît bien, quand on a fermé le silo de lessive en poudre, 200 femmes qui n'avaient jamais rien fait d'autre que conditionner la lessive se sont retrouvées sans emploi et il a bien fallu les accompagner pour qu'elles en trouvent un autre. Pour aller vers l'employabilité à vie et garantir l'autonomie des femmes, il faut « booster » le droit individuel à la formation. Chez Eurocopter à Marseille, la ministre a rencontré une pilote d'essai, qui est sans doute unique dans son genre, mais aussi une femme de 45-50 ans, qui lui a expliqué qu'elle était employée de bureau et qu'après plus de deux ans au chômage, elle avait appris qu'on recrutait chez Eurocopter, qu'elle s'était présentée, qu'elle avait suivi un contrat de formation et qu'elle était aujourd'hui électricienne et ravie d'avoir un travail et de faire autre chose. Lorsqu'elle était en charge des personnes âgées, la ministre s'est rendue à Châteauroux, ville qui connaît des difficultés liées à la fermeture d'un certain nombre d'entreprises du textile. L'association Familles rurales a mis en place une formation sur les services à la personne et les femmes qui ont pu en bénéficier se sont réjouies d'avoir non seulement un emploi, mais aussi un diplôme. Cela montre bien qu'il y a une volonté de redémarrer, de ne pas rester sur l'échec d'un licenciement et c'est une direction dans laquelle il faut absolument poursuivre. Mme Marcelle Ramonet a souhaité revenir sur la question de la parité. Elle-même a animé hier une réunion de femmes maires dans le Finistère et elle a lu le sondage qui vient d'être publié par Le Parisien, selon lequel 64 % des Français souhaitent qu'il y ait plus de femmes au Parlement. Aujourd'hui, la France se situe de ce point de vue au 21e rang de l'Union européenne et au 65e rang mondial. Il n'y a que 17 % de sénatrices et 12,5 % de députées. Dans les villes de moins de 3 500 habitants, on ne compte que 11 % de femmes maires et on tombe à 6 % pour les villes de plus grande taille. Comment, dans ces conditions, faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes dans les exécutifs ? Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a souligné qu'il s'agissait d'un véritable combat de tous les jours, qui devait être mené par chacun, au sein même des partis politiques. Pour cela, il n'existe pas cinquante outils. On sait bien que les chartes ne servent à rien et que d'autres pistes doivent être explorées. L'une d'entre elles est celle des exécutifs, dont elle a déjà parlé. Une autre est celle du « ticket » suppléant-titulaires, à laquelle elle n'était guère favorable auparavant, parce que les femmes sont en général en option. Mais elle a réalisé qu'en appliquant ce principe, sur la base d'une douzaine de candidats dans chacune des 577 circonscriptions, il y aurait près de 6 000 femmes candidates aux législatives. Même si elles se trouvaient majoritairement en position de suppléantes, on peut penser qu'avoir acquis cette expérience leur permettrait ensuite de se tourner vers autre chose - pourquoi pas vers les cantonales ou les municipales ? Ce système peut donc être un moyen de leur mettre le pied à l'étrier. Il s'agit pour l'instant uniquement d'une idée, sur laquelle aucun arbitrage n'a été rendu et qui nécessiterait une loi organique. Peut-être faudrait-il d'ailleurs étendre cette mesure aux élections cantonales, ce qui éviterait des élections partielles, actuellement fréquentes, et permettrait d'avoir de plus en plus de conseillères générales. Mme Marcelle Ramonet a souhaité des conseils généraux paritaires. M. Martial Saddier a jugé anormal que l'assemblée départementale soit la seule où ce principe ne s'applique pas. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'il n'y avait en Moselle que deux femmes sur les 51 membres du conseil général. Elle a par ailleurs observé que l'application de la mesure proposée par la ministre imposerait sans doute d'introduire une dose de proportionnelle, ce qui ne va pas de soi. Elle-même avait déposé une proposition de loi en ce sens, dès son élection en 1998, mais il semble que le ministère de l'intérieur et que les partis politiques ne soient pas prêts. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a rappelé qu'on avait entendu récemment des propos inacceptables à propos d'une parlementaire, qu'on ne pouvait laisser passer sans réagir. Elle a confirmé qu'elle était favorable à la mixité et la complémentarité, et s'est réjouie que des hommes soient aussi présents à cette réunion. Elle a souhaité un engagement commun dans ce qui est encore une longue marche mais qui doit déboucher au plus vite. M. Martial Saddier a envisagé qu'un grand parti politique fasse de la parité aux conseils généraux un des thèmes de campagne des prochaines élections législatives. Dans ce cas, l'autre grand parti serait bien obligé de lui emboîter le pas et on ne voit pas comment l'assemblée départementale resterait encore longtemps à l'écart de la parité. Il a souhaité revenir par ailleurs sur le contrôle des mariages. Il est impératif de savoir qui exerce ce contrôle. Aujourd'hui, les procureurs sont débordés et, la plupart du temps, ils ne peuvent répondre dans les délais. S'agissant de la pression des familles au sein de la communauté musulmane, on s'aperçoit aujourd'hui que de plus en plus, dans les quartiers, les frères suppléent les parents vieillissants, non pour des questions de religion, mais pour se poser ainsi en caïds. Sans doute conviendrait-il que les ministères fassent de ce problème un axe de travail des équipes de réussites éducatives. M. Martial Saddier s'est également inquiété des effets du ramadan dans les écoles : lundi, il a constaté qu'une petite fille et un petit garçon n'avaient pas avalé leur salive depuis huit heures du matin. D'autres passent toute la journée à l'école sans se nourrir. C'est extrêmement difficile à gérer pour les enseignants et il y a sans doute quelque chose à faire car le conditionnement d'enfants aussi jeunes est inquiétant. Enfin, dans la mesure où on ne peut séparer certains des problèmes que connaît la France de ceux que connaissent les pays, notamment africains, qui alimentent l'immigration, il serait souhaitable que la coopération décentralisée soit davantage tournée vers des actions en direction des femmes de ces pays. Cela paraît indispensable quand on voit qu'au Niger chaque homme a quatre femmes, et chacune d'entre elles huit enfants... La ministre peut-elle aider les communes qui veulent engager de telles actions de coopération et faire comprendre au ministère des affaires étrangères qu'elles sont hautement souhaitables ? Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a remercié M. Martial Saddier pour toutes ces réflexions très intéressantes. Elle est elle-même tout à fait convaincue de la nécessité de la coopération décentralisée car réussir à mener des actions d'éducation en direction des petites filles de ces pays, c'est penser aux générations futures. Elle a l'intention d'aborder ce sujet avec sa collègue en charge de la coopération. Dans ce cadre, il faut absolument travailler avec les élus des communes jumelées. Mme Anne-Marie Comparini a observé que s'il était utile qu'il y ait une loi en faveur de la parité, les femmes se heurtaient bien à un manque de considération au sein des partis où structures de pouvoir comme élites ne veulent pas d'elles à la tête d'une collectivité. Pourtant, le sondage du Parisien montre bien qu'il ne s'agit pas de donner plus de place aux femmes pour se faire plaisir, mais parce qu'elles sont partie prenante de la société et parce que la population voient leur arrivée d'un œil favorable. S'agissant de l'insertion professionnelle des femmes de l'immigration et, plus généralement, des femmes d'origine étrangère, il semblerait intéressant d'entendre le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), qui donne chaque semaine sur l'antenne d'Europe 1 un exemple de discrimination dans l'emploi liée aux origines ethniques. Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a répondu que plus de 600 dossiers relatifs aux discriminations raciales avaient déjà été reçus, ce qui est un chiffre élevé pour une institution de création récente, et que ce nombre devrait croître avec l'installation cette année de trois antennes en métropole et dans les DOM-TOM, l'objectif étant de couvrir à terme l'ensemble des régions. Pour une loi votée en janvier, les résultats sont spectaculaires, un peu comme pour l'Agence nationale de la rénovation urbaine qui, deux ans après sa création, a déjà engagé 14milliards dans 233 quartiers. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme la ministre déléguée, ainsi que tous les participants à cette audition. Audition de Mme Joëlle Voisin, chef du service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE) Réunion du mardi 18 octobre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Joëlle Voisin d'avoir répondu à l'invitation de la Délégation, et rappelé qu'elle avait pris le 23 septembre 2004 la tête du service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE). Ce service, outil extrêmement important du combat pour l'égalité entre les hommes et les femmes, est chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale en la matière. Il anime et coordonne le réseau des déléguées régionales et des chargées de mission départementales aux droits des femmes, dont il faut souligner le rôle déterminant en tant que vecteur privilégié pour diffuser les mesures gouvernementales directement sur le terrain. Il leur faut, pour cela, faire preuve de beaucoup de détermination et de volonté. Elle a donc souhaité savoir quel rôle Mme Joëlle Voisin entendait donner à ces déléguées et comment elle comptait en faire le véritable lien entre le terrain et le ministère. Elle lui a également demandé, au moment où la Délégation achève ses travaux sur son thème de travail annuel, celui des femmes de l'immigration, quelle était sa propre vision de cette question extrêmement délicate. Enfin, en cette période budgétaire, elle a souhaité savoir si elle jugeait les crédits dont dispose son service, adaptés à la nécessité de donner plus de poids à la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mme Joëlle Voisin a remercié la Délégation de lui permettre d'exposer les missions et les activités du service des droits des femmes et de l'égalité. Avant d'essayer d'apporter des éléments de réponse aux questions de Mme la Présidente sur le réseau déconcentré du service et sur l'intégration des femmes de l'immigration, elle a souhaité dresser rapidement le cadre d'intervention, les missions et les moyens du service, ce qui lui permettra également de répondre à la dernière question, sur le budget. La première structure gouvernementale chargée des droits des femmes remonte à 1965, date de la création du Comité du travail féminin, placé sous la tutelle du ministre du travail. Les premières déléguées régionales des droits des femmes ont été nommées en 1974 lorsque Mme Françoise Giroud était secrétaire d'État à la condition féminine. Le service s'est progressivement organisé et professionnalisé, les personnels conservant toutefois de leur militantisme initial un grand sens de l'engagement au profit des femmes. Aujourd'hui placé sous l'autorité de Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, le service est composé d'une administration centrale de 46 agents, organisée en quatre bureaux - deux thématiques, « égalité professionnelle » et « droits personnels et sociaux », et deux transversaux, « ressources humaines - administration générale » et « communication » -, trois missions et un réseau de 173 agents, implantés en 104 points du territoire. Ce réseau donne toute sa légitimité au service, puisqu'il permet de dispenser une politique de l'égalité entre les hommes et les femmes sur l'ensemble du territoire, y compris outre-mer, le service ayant en particulier des correspondantes à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna. La politique de l'égalité est une politique d'intégration systématique de la dimension hommes-femmes dans les politiques publiques, qu'on appelle également gender mainstreaming. Elle repose sur le principe qu'aucune politique n'est neutre au regard de l'égalité. La démarche de l'approche intégrée lancée lors de la conférence mondiale de Pékin en 1995, favorise en effet, par une approche transversale la prise en compte des situations et des besoins respectifs des hommes et des femmes dans l'élaboration, la mise en place, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, sans exclure, bien entendu, des mesures spécifiques en direction de certaines femmes, lorsqu'il faut réduire des inégalités constatées. L'action menée par le service repose ainsi sur une démarche pluriannuelle et interministérielle qui doit permettre de construire progressivement des relations nouvelles avec l'ensemble des administrations, le secteur associatif, et les partenaires sociaux. C'est ainsi qu'ont été signés différents accords avec le FASILD, l'AFPA, l'ANPE, qu'ont été désignés des « correspondants égalité » dans les différents ministères, et qu'a été signée et remise au Premier ministre, le 8 mars 2004, la Charte nationale de l'égalité. L'objectif est de développer des partenariats avec tous ceux qui peuvent contribuer à faire prendre en compte la dimension de l'égalité. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est dite surprise que le « correspondant-égalité » au sein du ministère de l'Éducation nationale n'ait pu être un relais efficace lors de l'examen du projet de loi d'orientation, car l'école est bien le premier lieu où il faut agir. On peut donc parler d'occasion manquée. Mme Joëlle Voisin a répondu que son service s'était beaucoup battu avec ce correspondant pour introduire des éléments sur l'égalité entre les filles et les garçons dans ce projet de loi et que, sans ce combat, la loi aurait peut-être contenu encore moins d'éléments... Par ailleurs, à ceux qui lui disent que, plutôt que d'avoir un service spécifique, il conviendrait de faire intégrer la dimension égalité hommes/femmes par tous les ministères, elle répond qu'il est encore trop tôt pour cela. Assez atypique, le service correspond, dans le cadre de la LOLF, à un programme spécifique, le programme 137 : « Egalité entre les hommes et les femmes ». Les quatre axes politiques du programme sont identiques à ceux de la Charte de l'égalité. Ils correspondent aux quatre objectifs du service : favoriser l'accès des femmes aux responsabilités et à la prise de décision dans les champs politique, associatif et économique ; favoriser l'égalité professionnelle ; favoriser l'accès des femmes aux droits ; faciliter l'articulation des temps de vie. Pour que ces objectifs puissent être atteints, le service dispose d'un budget de 27,44 millions d'euros, dont 17 millions d'euros de crédits d'intervention, qui permettent de subventionner des associations et d'aider certaines entreprises à développer une politique d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et 10,44 millions d'euros qui correspondent aux moyens humains du service et aux crédits de fonctionnement du réseau déconcentré. Même si ces crédits sont très faibles, ils ont un effet de levier important, et permettent d'obtenir des crédits, souvent plus importants, des collectivités territoriales ou d'autres ministères. Ainsi, les conseils généraux s'impliquent souvent en utilisant les outils créés par le service. Les déléguées utilisent ces crédits pour accompagner des partenariats locaux et piloter des actions spécifiques. Elles doivent, en effet, savoir motiver, convaincre les acteurs locaux. Le programme LOLF est le seul, au sein de la mission « Solidarité et intégration » à laquelle il appartient, à intégrer une action correspondant aux moyens du service. C'est extrêmement contraignant, mais aussi extrêmement responsabilisant, et l'on peut espérer que, tout en respectant la fongibilité asymétrique, c'est-à-dire l'impossibilité d'utiliser les crédits d'intervention pour augmenter les moyens en personnel, la LOLF accroîtra à partir de janvier 2006 la souplesse d'utilisation des crédits, par exemple en permettant de recruter un attaché principal sur un poste d'attaché, pourvu que l'on demeure dans les limites de la masse budgétaire attribuée. Les crédits du programme sont répartis pour 78 % entre les délégations régionales, les 22 % restants correspondant à l'action qu'impulse directement le service central pour subventionner notamment les associations spécialisées, au niveau national, dans l'accès aux droits des femmes et la lutte contre les violences. Il s'agit du CNIDFF, dont la subvention pluriannuelle représente à elle seule 31 % des crédits non déconcentrés, et des trois associations qui gèrent des permanences téléphoniques nationales : la Fédération nationale solidarité femmes, le Collectif féministe contre le viol et l'Association contre les violences faites aux femmes au travail. Les quatre objectifs - accès aux responsabilités, égalité professionnelle, accès aux droits et articulation des temps - sont eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels qui varient selon les caractéristiques des régions. Ils ne peuvent être identiques en Auvergne, où il y a 40 % de femmes créatrices d'entreprises alors que la moyenne nationale est inférieure à 30 %, et à la Réunion, où les violences conjugales sont le problème majeur. Des échanges réguliers conduits avec les déléguées régionales dans le cadre d'un dialogue de gestion permettent d'adapter l'enveloppe qui leur est déléguée aux besoins de la région. Les objectifs opérationnels du service correspondent naturellement aux grands axes de la politique conduite par la ministre déléguée. Dans le champ « femmes et emploi », qui figurait parmi les priorités pour 2005, qui se prolongeront en 2006, il est essentiel de lutter contre la précarité du travail et de favoriser le retour à l'emploi de femmes qui ont cessé une activité professionnelle pour élever leurs enfants. Le taux de chômage des femmes reste en effet supérieur de deux points à celui des hommes. En outre, parmi les 3,2 millions de personnes dont le salaire est inférieur au SMIC, on compte 80 % de femmes. Il s'agit de poursuivre le dialogue engagé avec l'ensemble des acteurs, les partenaires sociaux et le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, dont le SDFE assure le secrétariat, et de mener à bien la préparation de la loi sur l'égalité salariale et celle de ses quatre décrets d'application. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé qu'en première lecture du projet de loi relatif à l'égalité salariale entres femmes et les hommes, si le Sénat n'avait pas enlevé les dispositions les plus novatrices, c'est-à-dire les amendements qu'elle avait présenté et fait adopter à l'Assemblée nationale, il aurait été possible d'éviter des faits aussi choquants que les nominations qui viennent d'intervenir au conseil d'administration du CNRS, dont Le Monde de ce soir se fait l'écho. Car c'est aussi là, dans les conseils d'administration des entreprises, qu'est l'enjeu. Mme Joëlle Voisin a ajouté que le service avait pour tâche d'accompagner les entreprises qui se sont engagées pour l'égalité, par le biais de la signature de contrats d'égalité professionnelle ou de contrats de mixité ainsi que par la promotion du label « égalité » décerné aujourd'hui à douze entreprises - douze autres devant signer une convention dans les prochains jours. Le cahier des charges demeure toutefois trop contraignant pour la majorité des PME. En réponse à une question de la Présidente qui lui demandait si le contrat pour la mixité des emplois pouvait être considéré comme l'outil applicable aux petites entreprises, Mme Joëlle Voisin a répondu que tel semblait effectivement être le cas. En effet, le contrat d'égalité professionnelle est surtout collectif, et destiné aux entreprises de taille importante ; elle a cité l'exemple de la société de transport Graveleau, où ce contrat devrait améliorer la situation d'une centaine de femmes. Pour sa part, le contrat de mixité est davantage dirigé vers des actions plus individuelles dans les PME. Il est très intéressant en ce qu'il permet de faire évoluer les mentalités. Le service s'efforce également d'encourager la création ou la reprise d'entreprises par des femmes et de faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Il faut préserver les bons taux de fécondité et d'activité féminine de la France. Promouvoir l'égalité professionnelle relève d'une stratégie de développement et devrait être bénéfique tant aux salariés qu'aux entreprises. Cela suppose de changer progressivement les mentalités, cela dès l'école, et d'attirer les femmes vers des métiers traditionnellement masculins, ceux du bâtiment par exemple. Dans le champ de l'accès aux droits et du respect de la dignité, il s'agit : de développer des mesures spécifiques en faveur des femmes de l'immigration ; de renforcer l'information des femmes dans tous les domaines ; de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité de tous les acteurs concernés - policiers, gendarmes, magistrats, professionnels de santé, travailleurs sociaux. Un plan global, sur trois ans, a été lancé en novembre 2004 à l'occasion de la journée mondiale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Il est évalué en continu. La mobilisation de tous est indispensable pour que, grâce à des réponses diversifiées et complémentaires, les femmes victimes osent dénoncer la maltraitance qu'elles subissent, sans culpabilité, sans craindre de faire vivre à leurs enfants une situation pire encore après la dénonciation. Cela suppose d'améliorer la qualité de l'information des femmes sur leurs droits et d'augmenter les possibilités d'hébergement. C'est un plan intégral, qui concerne de très nombreux ministères et dans lequel le service joue un rôle pilote. A la différence de l'Espagne, la France n'a pas eu besoin d'une loi spécifique, et on peut donc considérer qu'elle est plus en avance par certains aspects. Le service est également très impliqué sur des sujets européens et internationaux. L'égalité entre les hommes et les femmes est en effet partie intégrante de la construction européenne. Depuis le traité de Rome qui, en 1957, consacrait l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, elle est devenue un élément de l'identité européenne. S'agissant du réseau des déléguées régionales et des chargées de mission départementales, et dans la mesure où le service intervient dans des domaines très différents, ses déléguées régionales et ses chargées de mission départementales doivent être régulièrement informées de l'état d'avancement des objectifs nationaux, afin de les relayer efficacement sur le terrain. Leur rôle est difficile, et leur effectif a baissé depuis 2003. Elles agissent, chacune à leur niveau, avec conviction et détermination, mais sont quasiment seules sur le terrain et obligées de se « démultiplier » dans de nombreuses instances. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'elles sont extrêmement courageuses, que leur tâche est difficile mais très importante, et qu'il ne faudrait pas qu'elles aient le sentiment d'être considérées comme quantité négligeable. Or, l'accueil qui leur est trop souvent réservé ne les incite guère à faire remonter les problèmes jusqu'aux préfets, qui se sentent très peu concernés par ces problèmes, à l'exception notable de certains d'entre eux, notamment Mme Bernadette Malgorn. La première déléguée régionale, Mme Marie Judlin, avait eu, il faut s'en souvenir, à gérer le problème des femmes dans une industrie textile en déclin ; on s'aperçoit aujourd'hui qu'elle avait eu raison sur toute la ligne. Mme Joëlle Voisin a indiqué qu'elle faisait de ce réseau un élément fort de son service, qui n'existerait pas sans lui, et qu'elle mettait l'accent sur le soutien qui doit lui être apporté. Le dialogue de gestion est particulièrement fructueux et facilité grâce à la visioconférence, et permet un enrichissement mutuel. Les déléguées et les chargées de mission viennent d'horizons divers, du milieu associatif, d'autres d'administrations, ou de l'entreprise. Elles ont des expériences complémentaires, et leur situation administrative est différente, ainsi que leurs salaires, et leur position dans les préfectures. Les déléguées régionales, que le décret 29 avril 2004 maintient auprès du préfet de région, ont un positionnement plus clair que les chargées de mission départementales, pour lesquelles un tel texte n'existe pas et qui sont parfois intégrées dans des bureaux de la préfecture. C'est pourquoi la ministre déléguée a recommandé, par lettre du 30 novembre 2004, leur positionnement direct auprès des préfets. Les moyens dont elles disposent varient selon les régions et les départements. En effet, certains préfets ont mis des secrétariats à leur disposition et leur fournissent gracieusement bureau et matériel. D'autres demandent systématiquement au service un remboursement des moyens mis à leur disposition. D'autres, enfin, doivent louer elles-mêmes des locaux. Avec l'application de la LOLF on peut craindre que les avantages dont certaines disposent ne se raréfient. Par ailleurs sur les 66 chargées de mission départementales en fonction aujourd'hui, treize sont dans une situation particulière. En effet, huit sont mises à disposition gracieusement par des administrations et le poste budgétaire correspondant n'existe donc pas, deux ont des contrats à temps incomplets, deux sont de catégorie B et une de catégorie C. Leur remplacement, lorsqu'elles partiront à la retraite, sera donc impossible. En résumé, le rôle des chargées de mission et des déléguées est difficile, et elles sont souvent très isolées. Une réflexion est engagée au sein d'un groupe de travail dans lequel les unes et les autres sont représentées, sur les moyens de revoir le fonctionnement du réseau dans un triple objectif : mutualiser leurs compétences ; diminuer leur isolement et renforcer leur soutien ; maintenir un ancrage territorial départemental, voire infra-départemental pour certaines problématiques. Dans la mesure où il paraît difficile d'envisager des créations de postes, une réorganisation interne sera sans doute nécessaire. On peut également espérer que la LOLF permettra, au sein de la masse financière dont dispose le service et dans le respect de la fongibilité asymétrique, de revoir le montant des indemnités de responsabilité des déléguées et des chargées de mission - 274,41 euros par mois pour les premières et 91,46 euros pour les secondes -, qui ne correspondent absolument pas à leur engagement personnel. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a jugé cela hautement souhaitable au regard du rôle capital qu'elles ont à jouer : ce sont elles qui sont sur le terrain et qui peuvent ainsi énoncer des vérités essentielles. On sait bien que, dans une conjoncture difficile, les femmes sont les premières touchées ; il conviendrait donc que le réseau soit conforté. Si, de ce point de vue, les propos de Mme Joëlle Voisin sont rassurants, la Présidente n'aura de cesse de rappeler que, si le Président de la République s'est donné pour objectif l'égalité entre les hommes et les femmes, si le Premier ministre s'est engagé à faire avancer les choses dans son discours de politique générale, si Nicolas Sarkozy a insisté sur la place des femmes, il faut que cela se traduise par des actes, à commencer par un véritable soutien au service des droits des femmes et de l'égalité. Mme Joëlle Voisin a ensuite souhaité décrire les principaux axes d'actions du service en ce qui concerne les femmes de l'immigration. Le service s'efforce tout d'abord de contribuer, aux côtés de la Direction de la population et des migrations (DPM), à l'amélioration de la connaissance de leurs droits. Conscients des difficultés spécifiques de ces femmes, le SDFE, la DPM et le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) ont signé, le 4 décembre 2003, un accord cadre national qui engage un partenariat sur les principaux axes suivants : améliorer la connaissance de la situation des femmes de l'immigration, sensibiliser et former les acteurs associatifs et institutionnels à cette question ; faire évoluer positivement les représentations de ces femmes ; promouvoir l'accès aux droits dès l'accueil ; favoriser l'intégration sociale par l'éducation et par l'amélioration de l'accès à la culture des femmes immigrées et issues de l'immigration ; favoriser leur intégration économique. Cet accord a également vocation a être décliné en régions, et ce thème était d'ailleurs à l'ordre du jour des journées nationales de rencontre du réseau, les 15 et 16 septembre dernier. Il convient de rappeler que les femmes de l'immigration connaissent les mêmes difficultés d'accès aux droits que le reste de la population appartenant aux mêmes catégories socio-professionnelles. Leurs difficultés sont toutefois aggravées par la méconnaissance de la langue française et par l'enchevêtrement résultant de la concurrence des systèmes juridiques différents des pays d'origine et du pays d'accueil en matière de statut personnel. C'est pourquoi ont été mises en place ou envisagées différentes mesures. Pour les primo-arrivantes, le contrat d'accueil et d'intégration, effectif depuis juillet 2003, a trouvé un ancrage législatif avec la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. L'État s'engage à faciliter l'intégration des personnes primo-arrivantes et chaque nouvel arrivant sur le territoire s'engage à respecter les lois de la République, l'égalité entre les hommes et les femmes étant expressément soulignée. Sa signature s'accompagne de formations civiques et, si nécessaire, linguistiques, et fournit une occasion propice pour faire comprendre que les violences telles que les mutilations sexuelles féminines ou les mariages forcés sont prohibées en France. Les coordonnées des Centres d'informations sur les droits des femmes et des familles (CIDF) sont indiquées dans la version actualisée du livret d'accueil. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné que les femmes jouaient un rôle déterminant dans l'intégration et souhaité que l'information sur le nombre de femmes signataires de ces contrats soit largement diffusée. Mme Joëlle Voisin a répondu qu'il y avait eu, en 2004, 37 600 contrats signés sur les 41 000 proposés et que 52,2 % l'avaient été par des femmes. Plus de 92 000 contrats ont été signés entre juillet 2003 et le 31 septembre 2005 dont 52,4 % par des femmes. Elle a ajouté qu'une expérimentation était lancée sur une plate-forme d'accueil de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) afin de tester en matière d'accès aux droits un partenariat actif entre ces plates formes et le réseau des centres d'information des droits des femmes. Cela paraît d'autant plus important qu'il s'agit d'un des seuls moments, avec les consultations de PMI, où on peut délivrer un message à ces femmes. Pour les femmes déjà installées en France, des formations linguistiques sont financées par le FASILD et plusieurs outils sont en cours d'élaboration. Un guide de l'égalité des femmes et des hommes de l'immigration va être élaboré par le service en partenariat avec les associations concernées sur la base des documents déjà existants tels que le guide jaune « Madame, vous avez des droits », réalisé par le CIDF du Rhône et l'association « Femmes contre les intégrismes ». Ce guide aura vocation à combler le besoin d'information juridique, mais également à donner des informations sur le caractère répréhensible de certaines pratiques. Il fournira également des informations très pratiques. Il fera l'objet d'une large diffusion - plates-formes d'accueil, CIDF, associations, consultations de PMI, mairies, etc. - et devrait être traduit l'an prochain en plusieurs langues. En outre, un guide franco-marocain permettra aux femmes marocaines ou franco-marocaines vivant en France de s'approprier la nouvelle moudawana. Il sera publié d'ici la fin de l'année. Pour lutter contre les violences spécifiques que subissent les jeunes filles de l'immigration - mariages forcés, excision, etc. -, le ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité, en lien notamment avec le ministère de l'Intérieur, doit mener des actions spécifiques sur trois champs, prévention, répression et accompagnement. En matière de prévention, le ministère accorde et réitère régulièrement son soutien financier aux associations spécialisées dans la prévention des mariages forcés ou des mutilations sexuelles féminines - ELELE, Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles (GAMS), Association Fatoumata pour l'émancipation des femmes (AFEF). Dans le cadre de l'accompagnement de l'action de l'association « Ni putes, ni soumises », le ministère chargé des droits des femmes a soutenu la conception et la rédaction, par l'association, d'un guide du respect mutuel, dont 100 000 exemplaires ont été diffusés dès fin mars. Destiné aux jeunes générations, il rappelle notamment les principes législatifs concernant les mariages forcés et donne des adresses utiles pour trouver un soutien de proximité. Le ministère a également réédité et diffusé en 2004 les brochures et affiches « Protégeons nos petites filles de l'excision ». Par cette campagne, il s'agit de continuer à sensibiliser les parents vivant déjà en France. Dans le champ de la répression, il est envisagé, contre les mariages forcés, d'instaurer un délit de contrainte au mariage, que sa nature soit civile ou religieuse, qui pourrait être intégré dans le projet de loi sur les violences porté par le ministère de l'Intérieur. Ce projet devrait également prévoir une aggravation des peines si la victime est mineure ou vulnérable ; une application de ces incriminations lorsque le délit sera commis à l'étranger par une personne étrangère résidant habituellement en France ; l'élévation de l'âge minimum du mariage de 15 à 18 ans. Les mutilations sexuelles féminines sont elles déjà pénalement réprimées et l'objectif est donc de rendre la répression plus effective. C'est pourquoi, le projet de loi contre les violences pourrait prévoir d'allonger le délai de prescription, en matière d'action publique, à vingt ans et à compter de la majorité de la victime ; d'introduire la possibilité de poursuivre pour des faits commis à l'étranger lorsque la personne concernée est étrangère mais réside habituellement en France. Sur le champ de l'accompagnement, les victimes de mariages forcés peuvent bénéficier des dispositifs prévus pour les femmes victimes de violence, notamment des aides financières et des dispositifs d'hébergement. Certaines places leur sont réservées dans des structures d'accueil d'urgence. Le sujet des femmes polygames qui décohabitent est extrêmement délicat, car il a d'importantes conséquences humaines qu'on connaît mal. Il relève d'un traitement interministériel. Les circulaires du 25 avril 2000 et du 10 juin 2001 ont encouragé les familles à sortir de la polygamie par la procédure de divorce ou la décohabitation. Le relogement ne saurait à lui seul apporter la solution au problème, et doit s'accompagner d'une politique de soutien des femmes à qui l'on demande d'assumer un rôle de chef de famille monoparentale. Il faudrait aussi envisager, sans proposer des mesures de tutelle aux prestations sociales dont l'objet serait détourné dans ce cas, de verser les prestations familiales directement aux mères, même si elles sont sans doute difficiles à identifier précisément. Il importe donc, d'abord, de connaître l'ampleur du phénomène, et une enquête conjointe a été commandée pour cela à la CNAF et à la MSA. Il y a lieu, parallèlement, de sensibiliser les acteurs de terrain aux problèmes spécifiques de la polygamie. C'est l'objet de la convention entre la DPM et l'Association des femmes africaines du Val-d'Oise. Enfin le Gouvernement a engagé une action décisive dans la lutte contre les discriminations liées au sexe par l'adoption de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. L'insertion des femmes de l'immigration dans la société civile est également très importante. La femme de l'immigration a, pendant des années, été représentée comme l'épouse, à charge de son mari et confinée dans des tâches domestiques, sans participation à la vie publique. Le développement de statistiques sexuées permet depuis quelques années de mieux tracer le portrait des femmes immigrées et de constater qu'elles sont plus de plus en plus actives - 55,6 % contre 64,2 % pour les femmes non immigrées. Leur taux de chômage - 18,8 % est toutefois presque deux fois plus élevé que celui des femmes non immigrées. Elles sont sur-représentées parmi les ouvriers - 14,2 % - et les employés - 8 %. Elles travaillent en majorité dans le secteur tertiaire - services aux personnes, nettoyage, grande distribution. Leur activité est souvent à temps partiel et leur statut précaire. Elles subissent une double discrimination du fait de leur sexe et de leur origine. Plusieurs pistes d'actions de nature différente peuvent être envisagées pour favoriser leur insertion professionnelle. La première est la mobilisation du service public de l'emploi pour la lutte contre le cumul des discriminations. Depuis 2001, plusieurs partenaires institutionnels se sont engagés dans le programme européen ESPERE - Engagement du Service Public de l'Emploi pour Restaurer l'Égalité -, dont l'objectif est d'intégrer la prévention des discriminations directes et indirectes dans les missions du service public pour l'emploi. Ce projet a permis, à partir d'expérimentations menées dans plusieurs régions, de sensibiliser et de former les acteurs de la politique de l'emploi à la discrimination raciale sur le marché du travail. L'année 2005 étant la dernière phase de ce programme, il s'agit désormais de capitaliser les expériences et de modéliser des outils en ce domaine. La seconde est le décloisonnement des métiers. II importe en effet de favoriser la diversité des parcours éducatifs et de formation des jeunes filles d'origine étrangère afin de permettre aux femmes immigrées d'intégrer de nouveaux métiers. Cela implique un travail de sensibilisation des employeurs. Des partenariats ont ainsi été noués avec les entreprises de travail temporaire ADECCO et ADIA afin de favoriser l'accès direct des femmes des quartiers de la politique de la ville, parmi lesquelles beaucoup des femmes immigrées, sur le marché du travail, dans des secteurs porteurs d'emploi auxquels elles accèdent difficilement. La troisième est le développement de la création d'activités. Les femmes immigrées se tournent de plus en plus vers la création d'activités ou d'entreprises pour laquelle elles sont très motivées. Le nombre de femmes parmi ceux qui reprennent ou créent une entreprise est aujourd'hui inférieur à 30 %. Le ministère souhaite développer l'entrepreneuriat féminin. Il y a là, sous réserve d'un accompagnement spécifique, place pour les femmes de l'immigration, notamment dans les secteurs de l'artisanat, du commerce et des services. La quatrième est le développement du parrainage des jeunes femmes vers l'emploi. II s'agit de leur permettre d'accéder à un emploi stable et de s'y maintenir, en les faisant accompagner par des parrains ou marraines bénévoles, en activité ou retraités, ayant la confiance des employeurs et faisant partager aux jeunes parrainées leur expérience, leurs relations et leur connaissance du monde de l'entreprise. D'autres formules encore doivent être inventées pour permettre aux femmes et aux hommes issus de l'immigration de progresser au cours de leur carrière professionnelle au sein des services aux personnes ou au sein de la fonction publique hospitalière. De véritables parcours promotionnels sont désormais possibles, en utilisant les contrats aidés du plan de cohésion sociale, pour intégrer des jeunes dans des emplois du secteur sanitaire, pour les maintenir dans l'emploi, s'ils montrent des compétences, grâce au PACTE, ou pour leur permettre d'accéder à un emploi qualifié par la validation des acquis de l'expérience. Enfin, afin de donner confiance aux jeunes filles, de leur donner des modèles d'identification, il est nécessaire de mettre en valeur celles, parmi les femmes de l'immigration, dont les parcours de vie sont des parcours de réussite. La campagne pour l'égalité entre les hommes et les femmes lancée en mars 2005 par la ministre déléguée à la parité a contribué à véhiculer une image positive des femmes de l'immigration. Il faut enfin insister sur l'importance de l'école et de la réussite scolaire comme vecteur d'intégration. Les établissements scolaires jouent également un rôle primordial dans la prévention des pratiques coutumières que sont les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés. L'école doit être le creuset de l'éducation au respect de l'autre, quel que soit son sexe. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Joëlle Voisin pour cet exposé très complet et d'un optimisme rassurant, en particulier en ce qui concerne le réseau des déléguées aux droits des femmes, et pour avoir apporté à la Délégation un certain nombre d'informations nouvelles sur la politique en direction des femmes de l'immigration, même si toutes les expériences prévues n'ont pas encore été lancées et si tous les guides ne sont pas parus. Audition de Mme Nacira Guénif-Souilamas, sociologue, maître de conférences à l'université Paris-XIII Réunion du mardi 25 octobre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a estimé que, sur la question des femmes immigrées, le regard de la sociologie était susceptible d'ouvrir d'autres horizons que l'approche humanitaire ou militante, et a regretté que cette dimension ne soit pas suffisamment mise en avant. Comment une sociologue voit-elle la situation en matière d'immigration et d'intégration ? Quelles mesures permettraient de lutter plus efficacement contre les discriminations ? Le concept de discrimination positive doit-il être appliqué en France ? Faut-il suivre la proposition de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, de faire voter les immigrés aux élections municipales ? Le droit de vote est-il un facteur d'intégration ? Quel rôle les femmes peuvent-elles jouer dans ce domaine ? Comment faire pour rendre plus harmonieuse la nécessaire vie commune entre les immigrés et les Français ? Mme Nacira Guénif-Souilamas s'est dite à la fois honorée d'être reçue par la Délégation et perplexe quant à la meilleure façon d'aborder la problématique posée afin d'apporter une contribution productive. Le sociologue accumule du savoir à proportion de sa connaissance du terrain. La question des femmes migrantes doit être mise en perspective et s'inscrire dans l'étude de la société dans laquelle elles s'installent. À cet égard, deux risques sont à éviter : réduire les femmes migrantes à leur destin d'immigrées, d'une part, et à leur identité de femmes, d'autre part. Ces deux travers, cumulés, tendent à construire une figure tellement solide qu'elle en devient difficilement sécable et complique la définition d'une politique adaptée. Les femmes migrantes ont accumulé des expériences qui leur donnent des compétences, des savoirs, des savoir-faire. Leur parcours migratoire a aiguisé leur regard sur la société et peut être assimilé à une formation. Pour amplifier cette dynamique, il est essentiel de s'appuyer sur ce qu'elles savent faire et sur ce qu'elles ont déjà compris de la société dans laquelle elles arrivent. Or c'est au contraire une rupture de la dynamique qui se produit, les blocages apparaissant précisément du fait de la rhétorique de l'intégration. L'intégration comme mot d'ordre politique, ou comme objectif institutionnel, propose des normes tellement exorbitantes, avec une exigence de résultats immédiats, que les femmes ne peuvent y accéder. La démarche devrait être menée dans une temporalité spécifique car les rythmes sont différents pour les migrants et pour ceux qui vivent depuis longtemps dans une société. Il conviendrait d'accompagner le processus d'adaptation plutôt que de chercher à imposer aux migrants de renoncer à leur passé et d'endosser immédiatement un nouveau mode de vie, ce qui s'avère impossible car trop déstabilisateur pour les individus comme pour les groupes, sur les plans de la langue, des habitudes ou de la capacité à décoder le mode de fonctionnement de l'espace public. Le nécessaire travail d'accompagnement, de décryptage, d'adaptation, doit être accompli en tenant compte de ce que sont ces femmes, avec leur intelligence de la vie et leur compréhension de la réalité ; il faut les considérer en fonction de ce qu'elles savent déjà faire et non de leurs déficits. Or la notion d'intégration est très souvent traitée en termes de déficit, de difficulté à intérioriser les normes, alors que cet aspect est inhérent à tous les types d'adaptations. Les politiques publiques devraient donc être beaucoup plus proches du terrain et interagir avec leurs destinataires. La question des femmes migrantes est généralement traitée à part de celles des femmes en général et des hommes migrants. Or il existe des intersections entre ces groupes. Même si elles viennent d'un monde qui se caractérise par d'autres codes culturels et un autre univers normatif, elles sont réceptives, en tant que femmes, à ce qui se passe dans la société où elles arrivent, et même parfois très demandeuses. De même, les hommes aspirent parfois à prendre leurs distances par rapport à l'ordre social dont ils sont dépositaires. C'est néanmoins une exigence exorbitante que de demander aux femmes migrantes de rompre avec les règles auxquelles elles étaient habituées - celles-ci pouvant au demeurant être aménagées. Les immigrants sont dépositaires de la possibilité de réformer eux-mêmes leurs pratiques car ils sont déjà engagés dans une dynamique de transformation. L'important est d'accompagner et de prolonger cette dynamique en leur donnant la possibilité de voir en quoi leur vie en France peut offrir des avantages. Cela appelle une politique institutionnelle qui ne sépare les femmes migrantes ni des autres femmes ni des hommes migrants. Des lieux de l'entre-soi sont certes nécessaires pour aborder les questions de l'ordre de l'intime, mais il manque surtout des espaces où s'opéreraient des interactions plus systématiques entre, d'une part, le monde des femmes migrantes et, de l'autre, celui des hommes qui ont vécu la même expérience ou celui des femmes en général. Les femmes migrantes font preuve d'une très forte capacité à progresser individuellement et à se saisir des moyens qui leur sont accordés dès lors que la démarche est égalitaire et réciproque : elles peuvent alors apporter leur contribution et leur savoir-faire pour accélérer le processus et s'approprier les pratiques de la société française. En réponse à Mme Claude Greff, qui se demandait de quels moyens les femmes migrantes disposaient à cet effet, Mme Nacira Guénif-Souilamas a répondu qu'il s'agissait de les amener, pour commencer, à faire part de ce qu'elles savent. Dans un monde administré, ce n'est pas facile, d'autant qu'il tend à tout penser selon son fonctionnement propre, y compris en ce qui concerne la langue usitée. En effet, avant qu'une femme maîtrise convenablement le français, elle doit avoir la possibilité de transmettre son expérience, son expertise de la vie, avec les ressources qui sont en sa possession, c'est-à-dire avec ses mots à elle. En résumé, il convient d'accepter ce que la femme dit dans sa langue maternelle tout en lui permettant de s'acclimater à l'univers linguistique correspondant à son nouveau contexte de vie. Une telle option implique une plus grande souplesse dans l'acceptation des autres langues dans les lieux symbolisant l'action publique. L'immigration n'est pas appelée à décroître : c'est un phénomène structurel et non pas éphémère. Or la population immigrée est composée pour moitié de femmes : la problématique de la dimension sexuée de l'immigration et des réponses à forger va donc perdurer. Se doter d'outils politiques pour accompagner l'immigration dépasse par conséquent l'enjeu de l'intégration : c'est le vivre-ensemble qui est en jeu. La polarité doit être renversée : la vraie question n'est pas l'intégration, mais la juste prise en considération du phénomène migratoire et de ses implications du point de vue de l'organisation de la société. Mme Claude Greff a douté que l'immigration soit vouée à perdurer et s'est interrogée sur les motivations des personnes migrantes. Mme Nacira Guénif-Souilamas a expliqué que la morphologie de l'immigration évoluait mais que les volumes migratoires restaient stables. Des analyses prospectives européennes (OCDE) ou internationales (ONU) l'ont démontré et l'étude de l'histoire de l'immigration en France le confirme : les flux migratoires vers la France, depuis l'entre-deux-guerres, n'ont pas décru ; la proportion d'immigrants arrivant sur le territoire national est stable depuis les années trente. La mobilité, consubstantielle de la modernité, n'a aucune raison de régresser. Ensuite, les motivations des individus sont diverses et leur origine géographique varie dans le temps : ils viennent dorénavant d'Europe centrale, de Chine ou d'autres pays qui ne sont pas d'anciennes colonies françaises. Les contrôles à la frontière sud de l'espace Schengen avec leurs conséquences tragiques et préoccupantes ou les politiques de codéveloppement peuvent limiter les flux en provenance de l'Afrique subsaharienne, mais certainement pas tarir l'immigration dans son ensemble. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant relevé que Mme Nacira Guénif-Souilamas, dans l'un de ses ouvrages, considérait la référence aux spécificités des femmes arabo-musulmanes comme une « source d'enfermement absolu », celle-ci a précisé que des personnes assignées à leur différence et systématiquement appréhendées selon leur origine - c'est-à-dire selon un caractère ethnicisé - ne pouvaient être abordées dans l'espace social qu'à travers cette différence, en contradiction avec l'idée du vivre ensemble. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, en a conclu que l'intégration d'une femme immigrée ne pouvait réussir qu'en procédant avec elle de la même manière qu'avec une femme française. Mme Nacira Guénif-Souilamas a ajouté que les modalités de différenciation devaient venir de la femme elle-même. Une femme peut prendre appui sur ce qu'elle a vécu pour continuer son parcours personnel. En revanche, il est contre-productif de lui demander d'oublier ce qu'elle a été - il est inconcevable de se construire dans l'amnésie - ou au contraire de la ramener constamment à ses origines et à ses différences. Les processus d'ethnicisation opèrent de manière erronée : les personnes sont renvoyées à une origine qu'elles ne revendiquent pas forcément mais qu'elles ne veulent pas pour autant voir disparaître. Pour vivre pleinement son existence de citoyen ou de futur citoyen, il faut être en mesure de tirer profit de toutes les dimensions de son existence. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant émis l'idée que les politiques d'immigration auraient tendance à marginaliser les publics visés, Mme Nacira Guénif-Souilamas a observé que les politiques d'immigration étaient destinées à gérer le trop-plein, ce qui constituait un facteur de marginalisation totale : les personnes considérées comme indésirables sont mal-logées et par conséquent marginalisées. Elle a regretté que les politiques d'immigration ne soient pas conçues dans une perspective de réalisation d'objectifs minimaux traduisant une réelle volonté d'accepter l'autre et de le mettre en position d'agir pour lui-même comme pour la collectivité. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, lui ayant demandé son avis à propos de la discrimination positive, Mme Nacira Guénif-Souilamas a jugé que ce concept était souvent appliqué à l'envers, discrimination négative qui relevait d'une logique d'ethnicisation, dont les femmes discriminées ne prennent souvent pas conscience, car elles sont abreuvées de la rhétorique selon laquelle il est mieux pour elle d'avoir un emploi, même précaire et mal payé, que pas d'emploi du tout. Leur peine s'en trouve peut-être adoucie, mais le problème structurel n'est pas résolu. La plupart des femmes migrantes travaillent dans le secteur des services aux personnes, parfois illégalement : elles sont donc mal payées et en situation de précarité. Et quand bien même elles trouvent un vrai travail, elles restent dans leur immense majorité cantonnées dans les segments les plus fragiles du salariat, celui des travailleurs pauvres, avec un phénomène inquiétant de transmission intergénérationnelle. L'enjeu consiste à rompre ce processus de discrimination des enfants d'immigrants, qui se voient en quelque sorte empêchés d'accéder aux voies de leur réalisation personnelle. Les nombreuses études qualitatives prouvent que le problème se cristallise dans l'accès à l'emploi, mais l'interdiction de dresser des catégories statistiques par ethnies empêche de mesurer l'ampleur du phénomène. Il est possible d'étudier la catégorie des femmes d'origine étrangère mais, pour leurs descendantes, qui sont françaises, les chercheurs sont démunis. Alors que la société française est de plus en plus diversifiée, multiculturelle, multiethnique, la conception universaliste abstraite crée un angle mort qui empêche de saisir cette nouvelle configuration. Mme Nacira Guénif-Souilamas a ensuite mis en cause la pertinence de la discrimination positive, l'expression étant au demeurant impropre puisqu'il conviendrait plutôt de parler d'action positive, traduction d'affirmative action. Cela consiste à aménager à la marge un système structurellement inégalitaire sans le réformer. La politique des zones d'éducations prioritaires (ZEP) a certes produit beaucoup de résultats positifs, mais a souvent été endiguée dans ses effets, d'où les mesures de réajustement mises sur pied avec succès à Sciences-Po. Ce sont donc les structures du système qu'il faut corriger, sauf à considérer que l'égalité entre les personnes doit être garantie par une politique systématique d'action positive, sur une base sociale et non ethnique. Les filles d'ascendance migrante réussissent actuellement un peu mieux que les garçons de même origine et que les filles de même milieu social, mais, par la suite, sur le marché scolaire et sur le marché de l'emploi, elles se heurtent aux effets de l'ethnicisation : elles sont assignées à leurs origines, ce qui suscite un sentiment de rejet. L'idée d'égalité des chances est elle-même contestable car, dans la vie, il ne faut jamais compter sur la chance mais sur la claire réalisation des droits. Il convient plutôt de s'attacher à garantir l'égalité des droits, la chance ne devant intervenir qu'à la marge. L'égalité des chances est une sorte de loto : dans la société, tout le monde tente sa chance et il est anormal que beaucoup de joueurs ne gagnent jamais. D'autant que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations : ceux qui ne peuvent se prévaloir de bons diplômes ne peuvent pas aspirer à entrer dans la catégorie des contribuables qui paient l'impôt de solidarité sur la fortune mais simplement d'avoir une vie digne, de voir reconnaître leurs compétences et de participer à la société. Or ce n'est pas ce que leur offre la perspective hypothétique de l'égalité des chances. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, l'ayant interrogée sur les notions de réussite et d'élitisme, Mme Nacira Guénif-Souilamas a souligné que la pensée française était pétrie par l'idée de mérite et par le clivage fondateur de l'école républicaine entre travail manuel et travail intellectuel. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a confié, à ce propos, qu'elle avait beaucoup apprécié la mise en avant des lycées professionnels par les ministres Jean-Luc Mélenchon et Luc Ferry. Mme Nacira Guénif-Souilamas a indiqué que nombre de ses étudiants avaient vécu des carrières scolaires chaotiques totalement démotivantes, pendant lesquelles leurs facultés intellectuelles n'avaient pas été mobilisées, et qu'il était bien difficile de leur redonner une ambition alors que le système continuait à leur asséner qu'ils n'avaient pas les bonnes compétences ni les bons savoir-faire : c'est ainsi que sont produites les « gueules cassées » du système scolaire. Mme Claude Greff ayant demandé si l'obtention du droit de vote aiderait, selon elle, à intégrer les étrangers, Mme Nacira Guénif-Souilamas a rétorqué que M. Nicolas Sarkozy s'était contenté de ressortir une proposition datant de 1981 et que les polémiques entretenues sur ce sujet étaient éminemment stériles, puisque l'acquisition du droit à participer à la vie politique constituerait un facteur de stabilisation. Dans les familles migrantes, les débats politiques battent leur plein : tout le monde a un avis sur la politique française, y compris les femmes migrantes, qui savent pour qui elles voteraient si elles en avaient le droit. Sur cette question, la France ne pourra donc pas en rester là : plutôt que de considérer cette réforme comme un sacrifice, il serait intéressant de considérer qu'il s'agit d'une opportunité pour construire des dynamiques d'appartenance et enraciner les personnes immigrées, qui ont pour la plupart démontré leur loyauté vis-à-vis de la France. Mme Claude Greff ayant contesté cette analyse, Mme Nacira Guénif-Souilamas a invoqué Emile Durkheim, selon qui la question de l'intégration ne concerne pas les individus mais les systèmes. La puissance publique agit sur la fonctionnalité des systèmes afin d'assurer l'intégration. Ensuite, les individus s'en saisissent ou non, mais le problème n'est pas spécifique aux migrants : énormément d'individus trouvent leur place dans les systèmes sans pour autant participer à la vie civique. On dira des jeunes d'origine immigrée non inscrits sur les listes électorales qu'ils sont en déficit d'intégration, tandis que les autres jeunes du même âge qui sont dans le même cas exprimeraient pour leur part une simple « désaffection » vis-à-vis de la politique. Il serait intéressant d'analyser des phénomènes de même nature avec les mêmes outils plutôt que d'assigner une catégorie à ses différences. Au demeurant, le rapport au politique des jeunes d'origine immigrée est souvent contrarié par les discriminations cumulées et les inégalités structurelles qu'ils subissent au quotidien. Dans ces conditions, l'intégration reste une rhétorique. Mme Claude Greff a jugé qu'une majorité d'immigrés ne veulent pas s'intégrer, qu'ils profitent du système sans travailler ni participer à la vie citoyenne, qu'ils se maintiennent en dehors de la vie nationale, qu'ils n'y mettent pas tout leur cœur, bref, qu'ils préfèrent conserver leur culture d'origine, contrairement aux populations des vagues d'immigration précédentes, notamment les Italiens et les Polonais. Mme Nacira Guénif-Souilamas a concédé que beaucoup de nouveaux arrivants entraient dans une logique assistancielle, mais a rappelé que les immigrés n'avaient jamais été conformes à ce qui était attendu d'eux : les Italiens, les Polonais, les Espagnols comme les Portugais ont été jugés en leur temps inadaptés à leur pays d'accueil. Il convient par ailleurs de prendre en considération les contextes historiques : il est plus compliqué d'arriver dans un pays où le travail est un bien rare que dans un pays bénéficiant du plein-emploi. L'immigration interne du Nordeste vers le sud du Brésil est fondée sur la même idée : la recherche de ressources pour survivre. Du reste, l'entrée de nouveaux usagers dans le système assistanciel est d'une certaine façon une bonne nouvelle : l'État providence, en France, n'a pas complètement disparu. Il n'en demeure pas moins que les immigrants qui entrent sur le marché de l'emploi n'ont guère de marges de manœuvre, hormis le travail au noir, cumulé avec les ressources assistancielles, alors qu'ils arrivaient autrefois avec un contrat de l'employeur en poche. Mme Claude Greff en a déduit que l'immigration pourrait décroître. Mme Nacira Guénif-Souilamas a répondu qu'avec 6 milliards d'êtres humains animés par des dynamiques de mobilité ascendante, les réservoirs d'immigration étaient inépuisables. Et beaucoup de migrations sont aléatoires : les personnes font étape en France, sans avoir l'intention d'y rester - il en a beaucoup été question lors de la fermeture du centre de Sangatte -. Il existe en outre un marché mondialisé de la migration, qui confine parfois à l'esclavagisme et requiert des régulations : les Chinois candidats à la migration plus riches choisissent Vancouver tandis que les plus pauvres échouent à Paris. Soumettre la question de l'immigration à celle de l'intégration revient à inverser l'ordre des causalités, car la migration est un phénomène pérenne alors que les conditions de l'intégration sont adaptables. C'est au demeurant la vocation d'un État démocratique efficace que de se réformer constamment. L'action positive constitue d'une certaine manière une des réponses possibles pour faire une place le plus rapidement possible aux personnes qui s'installent en France. Il importe de renoncer à l'idée selon laquelle les personnes qui ne s'adaptent pas sont celles qui retournent à leur culture. Il n'est pas nécessaire d'abandonner une culture pour une autre car tout le monde, et pas uniquement les immigrés, circule entre des systèmes culturels multiples. Il est d'ailleurs impossible de faire renoncer quelqu'un à son histoire - c'est même contre-indiqué car cela lui ôterait des ressources pour s'adapter. Alors, plutôt que de considérer ces racines culturelles comme des menaces, il conviendrait de prendre appui sur elles et de leur trouver un espace d'expression dans le contexte français. C'est ainsi que la France est devenue un centre de production culturel mondialement reconnu, grâce à la culture syncrétique, hybride, des villes et des banlieues. Ce qui fonctionne dans l'industrie culturelle peut aussi trouver une traduction dans le vivre ensemble. Mme Claude Greff ayant demandé s'il était naturel, chez l'homme, de vivre ensemble, Mme Nacira Guénif-Souilamas a affirmé que ce n'était pas naturel mais culturel, que les sociétés étaient constamment amenées à reconsidérer leurs fondements politiques et symboliques. Ces considérations anthropologiques conduisent à penser qu'il est difficile de faire l'économie d'une réflexion sur la place de l'autre. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'étant enquise si elle était souvent consultée par les politiques, Mme Nacira Guénif-Souilamas a répondu que ses travaux étaient lus mais qu'elle était rarement sollicitée. Mme Claude Greff a déploré que les groupes humains vivent parallèlement et que le fameux vivre-ensemble devienne presque utopique. Mme Nacira Guénif-Souilamas a expliqué que la vie en société était une expérience problématique et que rester dans l'entre-soi, c'est-à-dire sélectionner ses relations sur des bases identitaires, permettait de limiter les incertitudes et les dangers. À cet égard, une figure produit un consensus négatif à la fois symbolique et pratique évident : celle du garçon arabe, qui cristallise un imaginaire et des stéréotypes si particuliers qu'il en devient absolument infréquentable. Mme Claude Greff a indiqué que, dans son entourage, les familles manifestaient davantage d'inquiétudes vis-à-vis des garçons noirs que des garçons arabes. Mme Nacira Guénif-Souilamas a précisé que le garçon arabe était ressenti comme d'autant plus menaçant qu'il entrait sur le marché sexuel et matrimonial et qu'il était donc plus proche, tandis que le garçon noir était supposé être davantage maintenu hors de ce cercle de relations intimes, ce qui rendait moins problématiques les interactions avec les filles et n'alimentait pas autant le sentiment de fascination-répulsion. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est félicitée que la Délégation ait entendu une sociologue pour envisager avec davantage de recul la question. Audition de M. André Nutte, directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) Réunion du mardi 25 octobre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a estimé que la question des femmes immigrées, même si elle ne pouvait être complètement scindée de celle des hommes immigrés, était un peu particulière dans la mesure où la problématique de l'accueil en France se doublait de celle relative à la vie de la famille. L'ANAEM s'efforce de faire passer des messages au cours de journées d'information civique. Comment les personnes accueillies les reçoivent-elles ? Quelles conclusions les organisateurs retirent-ils de ces journées ? Ne voient-ils pas poindre, à cette occasion, les premières difficultés d'intégration ? Après le passage par une plate-forme - dénomination malheureuse car elle évoque les gares de triages -, comment le suivi est-il assuré ? Comment améliorer l'accueil, dans les préfectures, de personnes qui traversent des moments dramatiques ? Le travail des agents des préfectures est admirable mais les préfets, soumis à des obligations de résultats, ne se montrent pas toujours très coopératifs. Comment l'ANAEM pourrait-elle contribuer à améliorer l'accueil et surtout le suivi des étrangers et ainsi désamorcer des situations explosives ? M. André Nutte a indiqué que l'ANAEM avait repris les missions et moyens de l'Office des migrations internationales (OMI), et du Service social d'aide aux émigrants (SSAE). L'Agence, service public de l'accueil, agit donc en première ligne. Elle mène actuellement à bien la fusion entre 650 agents administratifs de culture service public et 360 personnes de culture associative, pour l'essentiel des assistantes sociales, ce qui n'est pas aisé. Il a remis aux membres de la Délégation une note de présentation générale de l'Agence ainsi qu'une carte de ses implantations, également disponibles sur son site Internet. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a approuvé la désignation de Metz comme siège de l'Agence en Lorraine et s'est enquise des motifs de ce choix. M. André Nutte a expliqué qu'une délégation régionale de l'OMI existait jadis à Nancy et fut transférée à Strasbourg compte tenu des flux. Le bureau de Metz a été maintenu et a vu son importance se développer. Transformé en délégation, il vient d'être installé dans de nouveaux locaux. Il a invité la Présidente à venir visiter les nouveaux locaux, situés à proximité de la gare, dès que leur aménagement sera achevé. Puis il a présenté le contrat d'accueil et d'intégration (CAI). Début 2006, si possible, ce contrat sera proposé à tout étranger pénétrant en France muni d'un titre de séjour. La diffusion de ce nouveau produit requerra donc un maillage national. Par-delà la proposition de signature du contrat et des prestations qui lui sont attachées, la formation civique et linguistique, le suivi social et la journée vivre en France, l'ANAEM assure, sur ses plates-formes, un premier contact en proposant du jus de fruit et des petits gâteaux aux usagers, ce qui crée un choc positif, surtout au regard de l'accueil en préfecture. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, ayant demandé dans quelle langue les personnes étaient accueillies, M. André Nutte a répondu que, pour accueillir des usagers de 143 nationalités, les personnels affectés aux plates-formes étaient des auditeurs sociaux, jeunes gens et jeunes filles diplômés de l'enseignement supérieur, qui possédaient tous la pratique d'au moins une seconde langue courante et parmi lesquels certains étaient issus de l'immigration. S'il n'est pas question de discrimination positive, de fait, dans le recrutement, parler arabe, turc, chinois, portugais, espagnol ou tamoul constitue un plus. L'ANAEM a par ailleurs recours à des interprètes qui passent quelques heures dans ses locaux, ainsi qu'à la société ISM Services, spécialisée dans la traduction téléphonique. L'obstacle de la langue est important, mais près de 45 % de la population concernée vient du Maghreb - Maroc, Algérie et Tunisie - et a par conséquent un minimum de connaissances en français, sans oublier les personnes originaires d'Afrique de l'Ouest. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a noté que la France n'était pas seulement un Eldorado mais aussi un État entretenant des relations privilégiées avec beaucoup de pays dans le monde, notamment avec ses anciennes colonies. M. André Nutte a confirmé que l'immigration en France était fléchée et que certains migrants, venant en particulier d'Afrique de l'Ouest, étaient des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, ce qui crée des liens. Dans la même logique, les plombiers polonais n'envahiront jamais la France car ils préféreront s'arrêter en Allemagne. Les plates-formes d'accueil constituent un champ d'observation remarquable. Des comportements peuvent choquer. Des femmes arrivent manifestement apeurées par leur mari et ceux-ci refusent qu'elles soient examinées par un médecin ou exigent d'assister à la visite médicale. Autre réaction classique, le mari, qui parle français, déclare qu'il s'occupera lui-même de la formation linguistique de sa femme. C'est pourquoi il est crucial que le contrat d'accueil et d'intégration soit signé par la femme seule, sans le concours de son mari. Le passage par les services de l'ANAEM est aussi l'occasion d'aborder les problèmes du logement, de l'emploi et de la langue, qui, s'ils ne sont pas résolus, font très rapidement entrer la personne dans la trappe à exclusion. L'Agence joue d'abord un rôle d'éducation en distribuant aux usagers des brochures en plusieurs langues sur le diabète, la drépanocytose - maladie s'attaquant aux os, inguérissable mais soignable, qui frappe les personnes originaires de l'Afrique de l'Ouest -, le cancer du col de l'utérus, les vaccinations, le Sida ou l'excision. Le médecin, au cours de l'examen, parle de la régulation des naissances - certaines femmes, enceintes de cinq ou six mois, n'ont pas encore bénéficié de la moindre visite médicale -, donne des préservatifs et communique des adresses. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a loué, au vu des brochures, le sérieux du travail effectué par l'Agence. M. André Nutte a insisté sur le message essentiel à faire passer en une demi-journée : celui qui ne maîtrise pas la langue française et connaît mal les institutions de la République éprouvera beaucoup de difficultés à s'intégrer et notamment à trouver un emploi stable et déclaré, mais aussi, par exemple pour les mamans, à avoir des échanges avec les autres mamans à la sortie de l'école ; un effort est nécessaire pour acquérir la langue mais il sera payant. Quant aux cas sociaux, ils sont suivis un certain temps par une assistante sociale. En tout cas, cette population écoute les conseils qui lui sont dispensés car elle sait qu'elle obtiendra son titre de séjour. La personne qui vient à la délégation de l'ANAEM de Paris ou de Lille en ressort avec son contrat d'accueil et d'intégration, si elle a souhaité le signer, et son titre de séjour. Tout le monde s'y retrouve, à commencer par la préfecture, qui a moins de flux à gérer. Quant à la délégation de Metz, elle a passé un accord particulier avec la préfecture : ceux qui ont rendu visite à la plate-forme y obtiennent un rendez-vous prioritaire pour aller chercher leur titre de séjour. La journée d'action civique est financée, pilotée et organisée par le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD). L'expérience de la journée d'appel de préparation à la défense incite à opter pour des prétentions raisonnables. Il ne s'agit pas, en une journée, de débattre sur de grandes idées comme l'égalité homme-femme mais de faire rentrer quelques données basiques très précises concernant les droits et les devoirs : le fait, par exemple, que les femmes ont le droit d'obtenir un carnet de chèques sans l'autorisation de leur mari. C'est également l'occasion d'expliquer ce que sont une mairie ou un préfet et d'informer les usagers sur les libertés - liberté du culte, d'expression, syndicale ou politique. Ces personnes ne sont pas forcément en capacité de comprendre comment fonctionnent les institutions - les Français eux-mêmes ne s'y retrouvent pas toujours - mais elles sont accueillies et, si elles désirent en apprendre davantage, elles peuvent participer à une journée Vivre en France, à l'occasion de laquelle elles obtiendront des renseignements sur les allocations familiales, les centres communaux d'action sociale ou l'obligation solaire. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'étant interrogée sur le suivi assuré par l'ANAEM à l'issue de la journée, M. André Nutte a déclaré que chaque centre de formation adressait à l'Agence la liste des présents. Les personnes absentes sont reconvoquées. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a ensuite demandé si les personnes fréquentant les centres étaient averties des interdictions frappant des pratiques comme les mariages forcés, les mutilations ou la polygamie et comment elles réagissaient à ce type d'informations. M. André Nutte a remarqué que cela ne donnait jamais lieu à des débats, que les intervenants n'étaient jamais contredits. En la matière, pour vraiment faire avancer les esprits, il convient cependant de faire jouer le facteur temps et le facteur éducation. Les vagues actuelles d'immigration s'intégreront, comme le firent entre les deux guerres les Polonais et les Italiens dans notre pays. Il n'en demeure pas moins que l'accueil au plus près de l'arrivée en France, assorti d'un suivi, constitue un atout essentiel. Lorsqu'arrive un couple formé par un homme de cinquante-cinq ans et son épouse de vingt-cinq ans au plus et que vous avez la conviction que les époux se connaissent peu, l'enjeu est de parvenir à ce que la jeune femme puisse sortir de chez elle. La journée d'action civique est perfectible mais, du point de vue de la pédagogie, une journée restera toujours une journée. Il n'en demeure pas moins que les participants ont accompli l'effort de se déplacer et reçoivent une attestation. L'accueil dans les préfectures, au bout du compte, est souvent un problème de moyens. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a redit son admiration pour le personnel des préfectures chargé de l'accueil, mais s'est élevée contre les obligations de résultats auxquelles sont soumis les préfets sur d'autres thèmes. Peut-être les plates-formes pourraient-elles embrasser une autre dimension et alléger la tâche des services préfectoraux ? M. André Nutte a fait remarquer qu'à travers le contrat d'accueil et d'intégration, certains préfets, au-delà de leur mission régalienne, avaient saisi le rôle social et d'intégration qu'ils étaient susceptibles de jouer. C'est ainsi qu'ils organisent régulièrement des séances officielles de signature de CAI. De même, l'ANAEM a conclu des accords d'échange d'informations avec certaines municipalités : l'Agence leur communique la liste des personnes qui ont signé un contrat d'accueil et d'intégration après accord des intéressés de façon à ce qu'un contact civique puisse être établi. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a salué ces démarches. M. André Nutte a souligné qu'il serait irréaliste de demander à l'État de supporter tout seul la charge de l'intégration dans sa totalité. Ces populations entrent dans le droit commun : elles forment une catégorie comme une autre, qui doit être éligible à l'ensemble des dispositifs socio-éducatifs et qu'il faut cesser de différencier. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a abondé dans ce sens : dès que quelqu'un obtient son titre de séjour, il acquiert des droits et des devoirs, comme tout le monde. M. André Nutte a conclu sur la nécessité d'apprendre aux personnes immigrées à s'inscrire dans le droit commun. L'État, à cet égard, doit rappeler un certain nombre de normes comme l'interdiction de la polygamie, de l'excision, des mariages blancs ou encore l'obligation scolaire et la liberté des cultes. Il n'est pas choquant qu'une jeune fille passe son baccalauréat ; son destin n'est pas obligatoirement de se marier à dix-sept ans. Il convient, sur tous ces points fondamentaux, de se montrer fermes, intransigeants : être en voie d'intégration ne signifie pas que tout vous est permis. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a résumé ces règles de vie par la formule suivante : « vous êtes chez vous mais en acceptant les règles de votre nouveau chez-vous ». Enfin, elle s'est engagée à répondre à l'invitation de M. André Nutte et à rendre visite à la délégation de Metz dès l'ouverture de ses nouveaux locaux. Audition de Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) Réunion du mardi 8 novembre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité la bienvenue à Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du FASILD et à M. Kaïs Marzouki, directeur de l'action éducative et de la solidarité, en charge des droits des femmes de l'immigration. Mme Hélène Mignon a regretté que les missions du FASILD aient été élargies sans que les financements correspondants aient été obtenus ; cela empêche cet organisme de fonctionner comme précédemment, au détriment des nombreuses associations qui, sur le terrain, reçoivent des populations issues de l'immigration, notamment pour des actions d'alphabétisation. Mme Myriam Bernard a reconnu que le budget du FASILD était utilisé en partie pour la mise en œuvre du contrat d'accueil et d'intégration (CAI), mais a précisé que le Fonds bénéficiait, pour assurer la montée en charge du dispositif, d'abondements de crédits. Dans ce cadre, et en raison de la priorité accordée par l'État à la formation linguistique, le Fonds a été tenu de passer des marchés publics, sur des lots qui, en Île-de-France, sont infradépartementaux. Devant l'importance de la commande, les petites associations ont été amenées à se regrouper. Par ailleurs, un volume annuel de subventions a été maintenu à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui est insuffisant, mais permet de financer des actions d'alphabétisation, essentiellement en direction de femmes qui ne sont pas encore prêtes à s'engager dans le parcours de longue durée qu'impose l'apprentissage du français. Avec des moyens supplémentaires, le Fonds pourrait, dans les quartiers, soutenir davantage d'associations de proximité, qui contribuent à la formation du lien social. Mme Hélène Mignon a souhaité que l'abondement de crédits annoncé vendredi dernier à l'Assemblée nationale par la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité soit utilisé au mieux en faveur des quartiers défavorisés, et regretté que tant de temps ait été perdu. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a précisé que le FASILD, établissement public à caractère administratif fondé en 1958, a pour mission de favoriser, sur l'ensemble du territoire, l'intégration des populations immigrées et de lutter contre les discriminations dont elles peuvent être victimes. Une nouvelle directrice générale vient d'être nommée, Mme Patricia Sitruk, ancienne directrice adjointe du cabinet de Mme Catherine Vautrin. La Délégation souhaite savoir comment le FASILD se situe aujourd'hui par rapport à ses nouveaux partenaires, notamment l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), comment il fonctionne, comment il aide les étrangers à mieux s'intégrer, que ce soit par le biais de l'apprentissage du français ou par celui d'une meilleure connaissance des droits des femmes immigrées, et comment apprécier les résultats obtenus. Mme Myriam Bernard a indiqué que le FASILD était placé sous la tutelle du ministère de la cohésion sociale et du ministère du budget. Son budget 2005 est de 181 millions d'euros, dont 158 millions pour ses interventions et 23 pour son fonctionnement interne. Il emploie 290 agents, répartis entre le siège et 21 directions régionales couvrant l'ensemble du territoire métropolitain. Le Fonds passe notamment des marchés publics dans le domaine de la formation linguistique, et soutient le secteur associatif, soit 6 000 associations, les unes très importantes comme SOS Racisme ou les têtes de réseau associatives, les autres très petites comme les associations de quartier qui mènent des actions de lien social en direction notamment des femmes immigrées. L'apprentissage de la langue est primordial, quand on sait qu'un million de personnes d'origine étrangère, en France, ne maîtrisent pas suffisamment le français pour se débrouiller dans la vie quotidienne et accompagner l'éducation de leurs enfants. Le Fonds consacre environ 60 millions d'euros aux marchés de formation linguistique et 5 millions aux associations de proximité qui assurent une première action de sensibilisation à la langue, mais il est encore, avec 40 000 à 45 000 personnes formées par an, très loin du compte. Il a donc besoin de nouer des partenariats, notamment avec les collectivités territoriales. Il existe plusieurs niveaux d'apprentissage de la langue. Certains, et ce sont les plus nombreux, ont besoin de connaître le français de base pour le pratiquer à l'oral ; d'autres ont besoin du français écrit et d'un niveau oral un peu supérieur. L'enseignement doit donc s'adapter au public, en distinguant notamment entre les publics analphabètes, qui n'ont pas été scolarisés, ou très peu, dans leur pays d'origine, et les autres publics qui apprennent le français comme langue étrangère. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est étonnée de la faiblesse du nombre des personnes formées. Mme Myriam Bernard a expliqué que le FASILD n'était pas le seul intervenant : les communes, par exemple, ont aussi des ateliers de socialisation linguistique. Le FASILD contribue à l'accueil de 108 000 personnes primo-arrivantes par an. Il existe, certes, un organisme d'accueil des étrangers, l'ANAEM , mais le FASILD est également concerné, le législateur en ayant décidé ainsi en 2005 lors de l'examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. L'ANAEM est chargée de l'accueil physique et des premières discussions avec les personnes afin d'évaluer leurs besoins. Le FASILD prend le relais pour assurer les prestations offertes dans le cadre du Contrat d'accueil et d'intégration (CAI), signé aujourd'hui par 92,4 % des intéressés malgré son caractère facultatif. Il a concerné douze départements en 2003, vingt-six en 2004 ; la quasi-totalité du territoire, DOM compris, devrait être couverte début 2006. Au 30 septembre 2005, on comptait 92 000 signataires du contrat ; le nombre de 100 000 devrait être aujourd'hui dépassé. Le FASILD passe des marchés publics pour mettre en place les prestations offertes aux signataires du CAI. Une des prestations que les signataires s'engagent à suivre est la formation civique, qui se déroule sur une journée de huit heures, repas compris. On y enseigne un peu d'histoire de France, des Gaulois au XXIe siècle, en passant par la Révolution française, la colonisation, la décolonisation et la Ve République. On y présente également les valeurs de la République, dont la laïcité, qui est pour certains migrants une véritable découverte. Le concept d'égalité entre hommes et femmes est abordé plusieurs fois au cours de la journée. Mme Claude Greff a demandé à quel moment cette formation avait lieu. Mme Myriam Bernard a répondu que les représentants de l'ANAEM incitaient les intéressés à s'y inscrire le plus vite possible, le FASILD s'engageant à la mettre en œuvre dans les trente jours de la signature du contrat. Cette formation est un succès, dans la mesure où les publics sont très intéressés. En revanche, le taux de présence n'est que de 72 % - aucune sanction n'étant prévue pour absentéisme. Un peu plus de femmes que d'hommes signent le contrat et se présentent à la formation civique, malgré d'éventuels problèmes de transport et de garde d'enfants. Une autre session, complémentaire de la première et très importante pour les femmes, s'intitule : « Vivre en France ». Elle permet de comprendre, en huit heures, comment fonctionnent les services publics. On y indique comment accéder à l'emploi, s'inscrire à l'ANPE, valoriser son expérience ou ses diplômes ; comment trouver un logement ; inscrire les enfants à l'école et s'inscrire à la caisse d'allocations familiales. Malheureusement, cette formation est facultative et n'est prescrite qu'à 18,1 % des personnes intéressées. Le service de l'accueil devrait mieux expliquer aux migrants l'intérêt de cette journée, car le taux de participation n'est que de 57 % sur ces 18,1 % - dont, là encore, une légère majorité de femmes. Mme Claude Greff a dit craindre que le public potentiel ne soit pas suffisamment informé. Mme Myriam Bernard a répondu que chaque personne était reçue par un auditeur social de l'ANAEM, qui évoque cette formation. Peut-être faudrait-il la rendre obligatoire dans le contrat. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a abondé en ce sens. Mme Myriam Bernard s'est dite favorable à ce qu'on institue deux journées obligatoires et consécutives, qui permettraient de faire le lien entre les institutions de la République et les services publics. Mme Claude Greff a demandé si de telles journées n'étaient pas déjà organisées. Mme Myriam Bernard a répondu qu'elles n'étaient budgétées qu'à hauteur de 30 % des signatures du contrat, ce qui est supérieur aux besoins actuels, ce qui est dommage car le public en ressort très satisfait. M. Patrick Delnatte a indiqué qu'il lui semblait qu'on incitait fortement les migrants à suivre ces formations pour obtenir leur titre de séjour. Mme Myriam Bernard a répondu qu'il s'agissait surtout de la carte de résident. La loi de 2003 dispose en effet que, pour obtenir cette carte, il faut faire la preuve, par tous moyens, de son intégration républicaine, et donc de sa connaissance des valeurs de la République et de sa maîtrise de la langue française. Cela dit, le lien entre contrat d'accueil et d'intégration (CAI) et loi de 2003 n'est pas établi clairement. Un décret en Conseil d'État, déjà prêt, devrait le faire. M. Patrick Delnatte a estimé ces formations très utiles pour les primo arrivants, qui ne sont là que depuis quelques mois, mais non pour les personnes qui sont en France depuis trois ou quatre ans. Mme Danielle Bousquet a objecté que celles-ci connaissent sans doute le fonctionnement des services publics, mais moins l'histoire de France ou les principes de la République. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est demandé s'il ne convenait pas de rendre ces formations obligatoires. Mme Myriam Bernard a répondu que la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 disposait simplement qu'il est « proposé » un contrat. Mme Danielle Bousquet a préconisé de modifier cette disposition de la loi. Mme Myriam Bernard a souligné que le FASILD était soumis à de fortes contraintes budgétaires, et qu'il finançait ces formations à hauteur des taux de signature du contrat et des taux attendus de participation. Mme Claude Greff a regretté que des lois allant dans le bon sens voient leur application bloquée pour des raisons financières. Mme Myriam Bernard a précisé que la formation linguistique était la plus coûteuse. Quant à la formation civique, son coût est estimé aujourd'hui à 6,5 millions d'euros pour 100 000 personnes. Si elle était rendue obligatoire, son coût ne dépasserait pas 10 millions d'euros, ce qui n'est pas insupportable pour le budget de l'État. Mme Claude Greff a considéré que les relais du Fonds au sein du monde associatif permettraient de limiter les coûts. Mme Myriam Bernard a répondu que nombre de ceux qui ont répondu aux appels d'offre étaient des associations avec lesquelles le FASILD travaille déjà de longue date, car on ne s'improvise pas du jour au lendemain formateur pour des publics migrants, et que ces associations avaient très bien su s'adapter à la procédure des marchés publics. Il serait souhaitable, en revanche, d'améliorer l'organisation locale autour du service public de l'accueil. Actuellement, chaque direction départementale de l'action sanitaire et sociale élabore, sous l'autorité des préfets, un plan départemental d'accueil prévoyant toutes les modalités de l'accueil des primo-arrivants, ainsi que la mobilisation de l'ensemble des services publics de l'État et des collectivités territoriales. Or ces plans n'ont pas été mis en place partout et, lorsqu'ils l'ont été, on a souvent constaté que l'articulation avec l'ANPE est insuffisamment organisée, que les problèmes de logement ne sont pas assez pris en compte, que l'Education nationale s'investit insuffisamment et que le maillage avec les collectivités locales laisse à désirer. L'accueil des collectivités locales est en effet important ; certaines mairies organisent même des cérémonies républicaines, ce qui est une très bonne chose. M. Patrick Delnatte a souhaité qu'on ne reporte pas pour autant sur le maire les problèmes difficiles qu'entraîne l'accueil des primo-arrivants. Mme Myriam Bernard a souligné qu'il faudrait au moins résoudre certains problèmes de transport et de garde d'enfants pendant ces journées de formation. Mme Claude Greff a demandé des précisions sur les méthodes d'accueil dans les pays voisins de la France. Mme Myriam Bernard a répondu qu'une politique équivalente existait dans la majorité des quinze États européens, mais que les modalités différaient. Elles sont d'ailleurs parfois plus sévères : obligation de formation et prise en charge financière de ladite formation par les intéressés eux-mêmes. Mme Claude Greff a estimé que, pour pouvoir s'installer dans un pays, il fallait en manifester la volonté, accomplir certaines démarches et s'investir personnellement. Mme Myriam Bernard a indiqué que les services juridiques du Sénat ont fait une excellente étude comparée dans cinq ou six États de l'Union européenne, portant essentiellement sur la formation linguistique, et qu'une stagiaire du FASILD a fait une étude comparative sur les structures qui organisent l'accueil dans onze États membres. Il en ressort que la France est plutôt bien placée, mais qu'elle est l'un des pays les moins exigeants sur le plan linguistique : elle se contente d'exiger des primo-arrivants la maîtrise du français parlé, alors que certains pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne ou l'Autriche, requièrent la maîtrise de la langue écrite. Bien que les primo-arrivants soient de plus en plus nombreux à maîtriser le français, l'ANAEM rencontre des problèmes pour assurer l'interprétariat dans les langues rares. Légalement, le CAI doit être présenté à l'intéressé dans une langue qu'il comprend. Or, c'est souvent le mari qui assure cette traduction... L'apprentissage du français constitue une mission prioritaire du FASILD, qui est en train de préparer un contrat d'objectifs et de moyens avec le ministère chargé de la cohésion sociale. Les flux étant très variables d'un département à l'autre, ainsi que le pourcentage de non-francophones, l'exercice est des plus difficiles. Les 45 000 personnes que forme le FASILD chaque année sont, en premier lieu, les signataires du CAI, auxquels il est proposé entre 200 et 500 heures qui peuvent être étalées sur toute la durée du contrat, soit une année, plus, le cas échéant, une année supplémentaire. L'objectif est qu'ils atteignent un niveau de français oral équivalent à celui qui est exigé pour la naturalisation ; c'est ce qu'on appelle le niveau IV du procès-verbal d'assignation linguistique. Il devrait être sanctionné prochainement par un diplôme du ministère de l'éducation nationale. Mme Claude Greff a demandé quels étaient les bénéficiaires des 500 heures de formation. Mme Myriam Bernard a répondu qu'il s'agissait de personnes analphabètes qui signent le contrat. Le chiffre peut paraître élevé, mais en fait, le nombre d'heures varie : l'analphabète se verra proposer 500 heures, la personne qui a déjà le niveau II ou III seulement 200. Mme Claude Greff s'est enquise du coût de la formation. Mme Myriam Bernard a indiqué qu'il était de 5 euros l'heure, et que la durée moyenne de formation était de 380 heures. Mme Danielle Bousquet a rappelé qu'il existait, en permanence, un volant d'un million de personnes potentiellement concernées par l'apprentissage du français, et que toutes ces heures de formation ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport aux besoins. Mme Myriam Bernard a souligné que les rythmes de formation variaient eux aussi. Ils s'adaptent à la vie des intéressés, qui se voient proposer aussi bien des cours du soir que des cours du samedi, des cours de quatre, de six, de douze, de vingt ou de trente heures par semaine. De nombreuses femmes choisissent un rythme de six heures par semaine. Pour un volume de 500 heures, cela demande dix-neuf mois. Mais au Canada, les cursus sont encore plus longs qu'en France... Mme Danielle Bousquet a observé qu'il ne s'agissait pas seulement d'apprendre le français, mais de s'initier à la vie française, car les femmes ne sont pas forcément immergées dans la société. Mme Myriam Bernard a précisé que les personnes étaient encouragées à choisir une formation de 30 heures par semaine, et que les formations étaient assurées par des associations très performantes, qui collaborent de longue date avec le FASILD. Les élèves ne travaillent pas sur Molière, mais sur du concret, sur la vie en France aujourd'hui. Avant même qu'il ne soit question de formation, on évalue sur les plates-formes de l'ANAEM les besoins des primo-arrivants dans le domaine linguistique, et on détermine ensuite le lieu de la formation et son rythme. Seules 25 % de ces personnes sont considérées comme ayant besoin d'apprendre le français oral, les autres ont déjà le niveau IV requis pour la naturalisation. Le pourcentage baisse d'ailleurs régulièrement. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a expliqué que de nombreux primo-arrivants venaient de pays anciennement francophones. Mme Myriam Bernard a indiqué que les langues les plus parlées étaient l'arabe, le russe, le turc, l'anglais, le serbo-croate, le vietnamien, l'espagnol et le portugais, ce qui peut donner une idée de la diversité des langues pratiquées. Par ailleurs, le FASILD prend en charge un second public : des personnes qui se sont fait débouter lors de leur demande de naturalisation pour défaut d'assimilation linguistique, ayant échoué à l'examen du procès verbal d'assimilation linguistique. L'affaire est préoccupante, dans la mesure où elles ont, en moyenne, déjà passé dix-sept ans en France. Ainsi, 3 500 personnes par an se font débouter parce qu'elles ne maîtrisent pas le français oral de base ! M. Patrick Delnatte a considéré que la société n'avait pas à se sentir coupable d'un tel état de fait. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a trouvé inquiétant qu'en dix-sept ans on puisse n'avoir pas acquis une connaissance suffisante du français. Mme Danielle Bousquet a dit y voir le résultat d'une certaine incurie politique et d'un manque de volonté d'intégration qui dure depuis des années. Mme Claude Greff a jugé que l'État n'était pas seul en cause, et qu'il y avait lieu de s'interroger sur l'envie d'intégration des personnes concernées. Mme Myriam Bernard a souligné que certains immigrés savaient très bien se débrouiller tout en ne parlant pas la langue, et que ne pas parler la langue n'était pas nécessairement une preuve de défaut d'intégration. Mme Danielle Bousquet a objecté que, même pour des Français dits « de souche », le fait de ne pas maîtriser la langue française était un signe de non-intégration dans la société. La Bretagne n'a pas beaucoup d'immigrés, mais ils sont nombreux dans certains quartiers, et l'on y rencontre des femmes qui vivent entre elles et ne connaissent que quelques mots de français. Mme Claude Greff en a conclu qu'elles n'étaient pas intégrées, et leurs maris non plus. Mme Danielle Bousquet a objecté que leurs enfants menaient le plus souvent une vie normale et que les filles allaient à l'école. Mme Claude Greff a estimé difficile d'accepter que des personnes qui s'installent dans un pays ne fassent même pas l'effort d'en apprendre la langue. Mme Danielle Bousquet a expliqué que certaines d'entre elles ont longtemps pensé revenir dans leur pays d'origine, mais ne l'ont pas fait, et que l'attachement des femmes à leur culture d'origine peut être lié à la volonté de ne pas se couper de leurs racines. M. Kaïs Marzouki a souligné que les femmes pouvaient être les plus grandes émancipatrices, mais que l'inverse se produisait également. La formation linguistique initiale est importante, mais après cette formation, des « piqûres de rappel » sont nécessaires. Il ne sert pas à grand-chose de donner aux femmes 200, 300, 400 ou 500 heures de formation si elles sont enfermées dans un milieu qui ne parle pas français. La formation professionnelle est également importante, car les femmes qui rejoignent leur mari émigré en France ne travaillent pas. Il y a une action à mener en ce domaine, ainsi que pour lever la précarité juridique dans laquelle elles vivent. Mme Danielle Bousquet a insisté sur le fait que l'intégration des enfants passait également par la manière dont les femmes se comportent. Mme Myriam Bernard a précisé que les personnes qui se voient prescrire un grand nombre d'heures de formation linguistique étaient en majorité des femmes. Si le FASILD forme aussi longtemps qu'il le faut les déboutés de la naturalisation, il forme moins longtemps les autres publics, qui bénéficient de 100 ou de 200 heures selon leur niveau. Certains maîtrisent le français écrit et préparent le diplôme élémentaire ou le diplôme approfondi de langue française. Il y aura bientôt un troisième diplôme, qui sanctionnera une bonne maîtrise du français oral et écrit de base et s'intitulera « diplôme initial de langue française ». L'organisation des cours recherche la plus grande souplesse possible. On essaie de créer des groupes de dix en ville et de cinq en zone rurale. En 2003, 54 % des personnes qui avaient signé le CAI étaient présentes aux formations linguistiques ; en 2004, elles étaient 56 % ; en 2005, on table sur 65 ou 70 %. Ces pourcentages peuvent paraître faibles, mais on s'est aperçu que les personnes « s'y mettent » en fait tardivement et que, parmi toutes celles qui avaient signé un CAI en 2003, 67 % ont fini par suivre une formation linguistique. Les difficultés rencontrées sont les mêmes que pour les autres formations. Elles sont malgré tout accrues dans la mesure où il s'agit de formations longues : problèmes de transport, de garde d'enfants, horaires de travail incompatibles, découragement, isolement dans les zones rurales. Pour compléter cette formation, le FASILD s'adresse aux associations de proximité, auxquelles il verse 5 millions d'euros pour des actions de première sensibilisation au français, destinées pour 80 % à des femmes, dans des ateliers d'alphabétisation de quartier. Ce n'est pas suffisant ; il faudrait que le relais soit pris par les communes et que le FASILD dispose de davantage de moyens pour soutenir le secteur associatif de proximité, qui permet à certaines femmes de commencer à sortir de chez elles, ce qui est très important. Le Fonds soutient également certains organismes qui travaillent sur le droit à la langue ou sur la pédagogie de l'enseignement du français. L'avenir passe par une meilleure articulation avec les collectivités territoriales. Les directions régionales du FASILD sont en train de contractualiser avec les conseils régionaux pour la formation linguistique des 16-26 ans, que le Fonds, actuellement, ne prend pas en charge, sauf lorsqu'ils ont signé un CAI ou ont été déboutés de la naturalisation. Une contractualisation est également envisageable avec les conseils généraux, s'agissant des allocataires du RMI qui auraient besoin d'apprendre la langue. Le FASILD devrait également contractualiser avec le secteur privé, puisque la loi du 4 mai 2004 a consacré dans le code du travail la formation linguistique comme une dimension de la formation professionnelle. Il a déjà signé un premier contrat avec ADIA pour mettre en place un plan de formation linguistique pour les intérimaires, et conclu un accord-cadre avec les professions du bâtiment, qui veulent attirer des femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a fait part du grand intérêt pris par la Délégation au témoignage de Mme Myriam Bernard et lui a proposé de revenir prochainement pour évoquer d'autres sujets qui n'ont pu être abordés aujourd'hui. Audition de M. Louis Schweitzer, président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a entendu M. Louis Schweitzer, président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), accompagné de M. Marc Dubourdieu, directeur général. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a salué le parcours de M. Louis Schweitzer, qui se différencie de certains autres énarques par sa connaissance fine de la société, grâce aux responsabilités qu'il a occupées dans les cabinets ministériels de M. Laurent Fabius puis, entre 1992 et 2005, à la tête de l'entreprise Renault, mais aussi de son implication active dans la vie culturelle et sociale de la France. Il faut en effet bien des qualités techniques et humaines pour animer une instance qui sera appelée à émettre des avis, des recommandations, et peut-être demain à prononcer des sanctions, comme le Premier ministre l'a proposé. La HALDE, créée le 31 décembre 2004, a été installée par le Président de la République le 8 mars 2005. Elle est chargée d'aider les victimes de discriminations, que celles-ci relèvent du racisme, de l'intolérance religieuse, du sexisme, de l'homophobie ou du rejet des handicaps. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a prié M. Louis Schweitzer de présenter la HALDE et de donner son avis sur deux points précis : l'utilité des CV anonymes pour lutter contre la discrimination à l'embauche, au moins dans les grandes entreprises ; le recensement des origines géographiques et nationales des personnes et de leurs parents à des fins de statistiques. M. Louis Schweitzer a rappelé que des directives font obligation aux États membres de l'Union européenne de créer des organismes dédiés à la lutte contre les discriminations et que le Président de la République a fait un bon choix intellectuel en installant une institution unique, compétente pour tous les types de discriminations. Celles-ci comportent en effet des éléments communs : elles procèdent de préjugés et d'un manque de respect de la personne humaine ; elles se traduisent par des actes d'exclusion. Il a ensuite décrit les trois métiers ou activités de la HALDE. Premièrement, la Haute Autorité instruit toutes les réclamations qu'elle reçoit, avec le double souci de répondre au problème concret soulevé par la victime et de s'en inspirer pour lutter plus efficacement contre le phénomène général. L'une des premières réclamations reçues concernait une petite annonce ainsi rédigée : « cherche personne de vingt-cinq à quarante ans ». Cette pratique trop banale en France - et qui n'a pratiquement plus cours dans les pays anglo-saxons - constitue une discrimination juridiquement caractérisée, car la loi l'interdit expressément, et elle est particulièrement insupportable alors que l'âge de départ en retraite a été reporté. La HALDE a donc décidé de transmettre le dossier au parquet, mais également d'alerter les organes de presse, les organisations professionnelles et les associations de ressources humaines. À ce jour, 905 réclamations ont été reçues ; elles sont classées par lieux et par motifs de discrimination. Le lieu de la discrimination est le travail pour 50 % des cas, les services publics pour 20 %, après quoi viennent les services privés, le logement, l'éducation, etc. Le motif de discrimination est l'origine pour 35 % des cas, la santé ou le handicap pour 15 % et le sexe pour 6,4 %, soit seulement cinquante-huit saisines, dont vingt-cinq proviennent d'hommes et trente-trois de femmes, alors que, dans la pratique, les discriminations fondées sur le sexe sont très répandues. Deuxièmement, la HALDE peut se saisir de tout sujet sur lequel elle estime qu'il y lieu d'agir, sur la base d'informations qui lui sont adressées ou qu'elle relève dans un article de presse. Troisièmement, la HALDE joue un rôle de proposition et de recommandation vis-à-vis du Gouvernement et des autorités législatives, au travers notamment de son rapport annuel, qui sera publié en mars ou en avril prochain. Revenant sur le faible nombre de dossiers déposés par des personnes ayant subi une discrimination fondée sur le sexe, M. Louis Schweitzer a indiqué que les saisines par des hommes concernent le plus souvent des avantages liés à la maternité, que la Cour européenne de justice a reconnus comme illégaux car ils sont refusés aux hommes. Un sondage publié par le Figaro Magazine en septembre 2005 est éclairant. Pour 22 % des femmes interrogées, l'égalité entre les hommes et les femmes est à peu près atteinte en France, 76 % estiment qu'il reste beaucoup à faire et 2 % sont sans opinion. Depuis vingt ans, en matière de salaires, 58 % des femmes estiment que les choses n'ont pas vraiment changé, 8 % qu'elles se sont plutôt dégradées et 30 % qu'elles se sont plutôt améliorées. La priorité, pour 66 % des femmes, est d'améliorer la situation en ce qui concerne l'égalité des salaires et, pour 43 % d'entre elles, en ce qui concerne la possibilité de concilier le travail et la vie familiale. Enfin, 12 % des femmes seulement affirment avoir déjà eu le sentiment d'être victimes d'une discrimination dans leur travail en raison de leur sexe et 89 % affirment le contraire. En d'autres termes, les femmes sont traitées de façon illégale mais ne s'en rendent pas compte ou acceptent cette situation. M. Louis Schweitzer, en corollaire, a émis plusieurs remarques. La Haute Autorité est évidemment compétente en matière de harcèlement moral et sexuel. Les femmes sont souvent l'objet d'une double discrimination ; c'est notamment le cas des femmes immigrées. Renault a accompli un gros effort pour accroître le taux de cadres féminins, qui a plus que doublé et atteint désormais 30 %, soit davantage que le taux de féminisation des grandes écoles et universités où l'entreprise recrute. Une étude interne a montré que les femmes, chez Renault, étaient mieux payées que les hommes, mais cela s'explique par le fait que, proportionnellement, elles sont moins nombreuses parmi les ouvriers que parmi les autres catégories de salariés : les statistiques brutes peuvent donc amener à des contrevérités. Pour les ouvriers et les employés, la règle « à travail égal, salaire égal » s'applique sans difficulté. Les femmes cadres, quant à elles, sont moins bien payées que leurs homologues masculins, tout simplement parce qu'elles n'ont pas suivi les mêmes études. Le premier facteur d'inégalité, qui poursuit les salariés pendant toute leur carrière, est donc le cursus d'études. En revanche, les hommes et les femmes qui sortent d'une école donnée perçoivent exactement le même salaire, jusqu'à la naissance des enfants : la rémunération des femmes décroche alors de deux centiles tandis que celle des hommes progresse sensiblement. Ce phénomène s'explique de façon intuitive par la répartition des tâches au sein du couple. L'étude des inégalités de salaires requiert par conséquent d'aller au-delà des chiffres bruts, qui ne sont pas forcément pertinents. Les problèmes sociaux actuels ne seront durablement résolus que si la France démontre de façon convaincante qu'elle combat les discriminations avec détermination et efficacité. Les discriminations à l'encontre de ceux qui accomplissent des efforts pour aller au bout de leurs études décrédibilisent le système d'intégration. Une action de fond doit être conduite pour éviter que ne se reproduisent les événements récents. La technique des CV anonymes n'est opérationnelle que pour les entreprises qui, pour leurs recrutements, possèdent un service central et des services décentralisés, c'est-à-dire les plus grandes. Il faut en effet effacer les données nominatives et identifiantes avant de transmettre à l'échelon recruteur les CV ainsi « anonymés ». Certaines entreprises assurent que cette technique produit des résultats, d'autres la jugent inefficace. Cela ne fait sûrement pas de mal, mais ce n'est pas la panacée. En revanche, il est évident qu'aucun motif légitime ne justifie que les candidats soient invités à joindre une photo à leur CV, car il est interdit de discriminer en fonction de l'âge, du sexe ou de l'apparence physique, autant d'éléments apparaissant sur la photo. Le débat politique sur l'identification des origines dépasse le clivage droite-gauche : faut-il mettre en œuvre des mesures de discrimination positive ou d'action positive ? Le collège de la HALDE n'ayant pas délibéré sur ce point, M. Louis Schweitzer a donné son avis personnel. Dans les entreprises, tout le monde s'oppose à l'extension du système des quotas, actuellement limité aux personnes handicapées. L'existence de discriminations en raison des origines lors du recrutement ne fait aucun doute, comme le démontrent les opérations de « testing » : pour un CV identique, Jean-Marc recevra cinq fois plus de réponses que Mouloud ; de même, Jean-Marc recevra quatre à cinq fois plus de réponses s'il a vingt-cinq ans que s'il en a quarante. La technique du « testing » est validée par les tribunaux : il constitue une preuve admise au pénal permettant non seulement de démontrer l'existence de discriminations mais aussi de les sanctionner. D'aucuns préconisent des comptages selon les origines des salariés pour vérifier que les entreprises sont bien représentatives de la diversité ethnique en opérant des rapprochements statistiques : la doctrine de non-discrimination laisserait la place à une doctrine de recherche de la diversité. M. Louis Schweitzer s'est dit défavorable à cette idée, considérant qu'elle présente plus d'inconvénients que d'avantages. Elle est au demeurant contraire à la tradition en France alors que, dans le monde anglo-saxon, la tradition du comptage est parfaitement établie. En l'état actuel de la loi, la CNIL considère que tout comptage est interdit ; seules sont autorisées les enquêtes statistiques accessibles à l'employeur faisant apparaître la nationalité d'origine ainsi que la nationalité et le lieu de naissance des parents, à l'exclusion de toute autre information. Cela ne constitue pas un obstacle majeur à la lutte contre les discriminations car il existe d'autres moyens. Quoi qu'il en soit, ce débat est susceptible d'être porté devant le législateur. Mme Danielle Bousquet s'est étonnée qu'aussi peu de femmes se tournent vers la HALDE, alors que si la législation établit en droit l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les aspects de la vie, y compris la vie professionnelle, la réalité sociale est tout autre. Dans les faits, y a-t-il matière ou non à revendication ? Les discriminations sont-elles réelles ou pas ? Les inégalités ne sont-elles pas intériorisées ? Chez Renault comme chez Citroën, on observe certes que la progression de carrière est identique à études équivalentes, mais pas nécessairement à poste équivalent. Lorsqu'ils ont des enfants, la carrière des hommes progresse tandis que les femmes voient la leur se ralentir nettement. Mais qu'advient-il plus précisément pour les femmes vivant seules avec des enfants ? M. Louis Schweitzer a indiqué que l'étude menée chez Renault n'avait pas établi de distinction entre les femmes seules et celles vivant avec un compagnon, mais uniquement entre celles ayant des enfants et celles n'en ayant pas. Il a par ailleurs rappelé que le décrochage de salaire était significatif mais pas massif puisqu'il était évalué à deux centiles. Les enfants n'en constituent pas moins un frein à la carrière des femmes, pas à la naissance mais plus tard. En Suède, par exemple, lorsqu'un enfant est malade, il est gardé à la maison tantôt par son père, tantôt par sa mère, et c'est normal. En France, si la femme reste au chevet de son enfant, elle en subit les conséquences ; si c'est l'homme qui s'en charge, on lui demande pourquoi il n'a pas laissé sa compagne le faire. La femme est donc handicapée par le comportement managérial et par le comportement conjugal, qui entrent en résonance. Les causes de l'accélération de la carrière de l'homme après la naissance des enfants sont plus mystérieuses. Mme Danielle Bousquet a répété qu'elle ne s'expliquait pas les raisons pour lesquelles 6 % seulement des réclamations reçues par la HALDE touchaient à la discrimination entre hommes et femmes, dont la moitié seulement émanant de femmes, alors que les inégalités sont si profondes dans les faits. Elle a suggéré que la Haute Autorité se penche sur ce point dans son rapport du printemps 2006. M. Louis Schweitzer a observé qu'un début de changement s'opère dans plusieurs entreprises, mais qu'il n'a pas encore produit tous ses effets et doit vaincre des résistances, au demeurant comparables à celles constatées dans la fonction publique. Le problème est d'autant plus sensible que les carrières se dessinent entre trente et quarante ans, âge de vulnérabilité pour les femmes : l'écart qui se creuse à ce moment-là ne se rattrape pas. Le principe « à travail égal, salaire égal » ne suffit pas à apporter la réponse dans la mesure où deux cadres effectuent rarement un travail strictement identique et où, de toute façon, leurs salaires sont individualisés. Il convient en revanche de s'assurer que les politiques de promotion et de formation ne créent pas les conditions de nouvelles discriminations. M. Patrice Delnatte a regretté que le comptage ethnique, banal dans les pays anglo-saxons, soit interdit en France, la CNIL n'autorisant que les études statistiques « anonymées », alors que les entreprises demandent à avoir davantage les coudées franches. Il s'est enquis des solutions alternatives préconisées par M. Louis Schweitzer en la matière. M. Louis Schweitzer a souligné que le comptage ethnique en vigueur dans le monde anglo-saxon est fondé sur l'auto-déclaration, mais que le recenseur peut remplir le formulaire à la place de l'intéressé si celui-ci ne l'a pas fait. Aux États-Unis, les personnes sont invitées à se déclarer blanches, noires ou métissées mais cette dernière catégorie est très peu utilisée. Dans les entreprises, c'est l'employeur lui-même qui procède à l'identification, ce qui conduit à l'opération statistiquement contestable consistant à comparer deux statistiques d'origine différente. En France, les personnes handicapées peuvent être décomptées dans cette catégorie, si elles le demandent, sous réserve d'une validation médicale et scientifique. Il est cependant frappant que nombre de personnes handicapées ne souhaitent pas être considérées comme telles, craignant sans doute que l'accès à l'emploi ne s'accompagne de l'apparition d'un « plafond de verre » lié à leur handicap. Si le comptage ethnique était la seule solution, peut-être faudrait-il s'y résoudre, mais il existe d'autres moyens de veiller à ce que les processus de recrutement ne soient pas discriminatoires et garantissent la diversité, comme l'« auto-testing », la fin de l'exigence d'une photo sur le CV ou l'ouverture des systèmes de formation à tous les niveaux hiérarchiques. Les études de l'INSEE démontrent que la mobilité sociale des populations migrantes est comparable à celle des « Français de souche » de même milieu social. De même, en Grande-Bretagne, il a été établi que si les Noirs réussissaient moins bien à l'école que les Blancs, à niveau des revenus des parents identiques, leurs résultats étaient meilleurs. M. Patrice Delnatte s'est fait l'écho des maires, qui, d'une façon générale, souhaitent disposer de plus d'informations concernant la population locale. M. Louis Schweitzer ayant demandé ce qu'ils projetaient d'en faire, M. Patrice Delnatte a expliqué que ce serait utile en matière de politique de la ville, afin de renforcer la mixité en empêchant les concentrations trop fortes de populations de même origine. M. Louis Schweitzer a douté qu'un comptage généralisé de la population soit nécessaire dans cette optique et a insisté sur la nécessité de supprimer tout « plafond de verre » pour éviter qu'à partir d'un certain niveau, l'on ne trouve plus que des hommes blancs de plus de cinquante ans. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, l'ayant interrogé sur la quantité de dossiers reçus par la HALDE relevant à la fois de la problématique des discriminations envers les femmes et de celle de l'immigration, M. Louis Schweitzer a répondu que, quatre ans et quatre mois avant la fin de son mandat, il ne pouvait se prononcer définitivement sur l'étendue des multidiscriminations mais qu'il les ressentait intuitivement et que les cas de ce type atteignaient 5 % des dossiers instruits par la Haute Autorité. L'égalité entre les hommes et les femmes est inégalement assurée selon les lieux et les origines ; ce problème appelle des réponses spécifiques car des barrières supplémentaires doivent être franchies. Enfin, il a avancé l'idée que, chez les personnes les moins qualifiées, la discrimination semblait être ressentie comme du harcèlement. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a informé M. Louis Schweitzer que le rapport de la Délégation relatif aux femmes de l'immigration serait parachevé avant deux ou trois semaines et qu'elle serait heureuse de savoir les commentaires qu'il suscite de sa part. Audition de Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du FASILD et de M. Kaïs Marzouki, directeur de l'action éducative et de la solidarité, chargé de la question des femmes immigrées et issues de l'immigration Réunion du mardi 22 novembre 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit son plaisir d'accueillir à nouveau Mme Myriam Bernard, directrice générale adjointe du FASILD, et M. Kaïs Marzouki, directeur de l'action éducative et de la solidarité, chargé de la question des femmes de l'immigration, venus compléter leur propos. M. Kaïs Marzouki a indiqué que les femmes constituent 47 % de la population immigrée, proportion qui augmente régulièrement. Ce sont des adultes jeunes, puisque pour la plupart âgées de vingt à quarante-cinq ans. Comme on le sait, les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage. Or, la situation est plus grave encore pour les femmes étrangères que pour les femmes françaises. Ainsi, une femme immigrée sur quatre est au chômage, contre un homme immigré sur cinq, et le taux de chômage des femmes étrangères originaires de pays non membres de l'Union européenne est trois fois plus élevé que celui des femmes françaises. Enfin, l'emploi à temps partiel concerne 37 % des femmes immigrées contre 31 % de l'ensemble des femmes actives ayant un emploi en France. Il y a donc bien, pour ce qui est de l'emploi, une sorte d'entonnoir : les hommes sont en quelque sorte relativement bien lotis et les femmes souffrent de discrimination, cette discrimination étant plus prégnante pour les femmes originaires des pays de l'Union européenne et plus sévère encore pour les femmes issues de l'immigration extracommunautaire qui sont, et de loin, les plus touchées par le chômage. Dans ce contexte, le FASILD s'attache à promouvoir l'égalité entre les sexes sans distinction d'origine, et toutes ses actions tendent à lever la double discrimination dont sont victimes les femmes immigrées, en raison de leur sexe et de leur origine ethnique. Le FASILD intervient à ce sujet selon plusieurs modalités. Le Fonds conclut des accords cadres avec tous les services publics chargés des questions relatives aux femmes. Un accord a ainsi été signé avec la direction de la population et des migrations et le service des droits des femmes et de l'égalité. Le Fonds s'efforce par ailleurs de susciter un effet de levier par son travail avec les associations. Il intervient au niveau national, en association avec les têtes de réseaux et les fédérations, mais aussi aux niveaux régional, départemental et local, en signant des conventions pluriannuelles d'objectifs dont la durée habituelle est de trois ans et, au cas par cas, des conventions annuelles. Plus largement encore, toutes les actions du FASILD sont conçues de manière transversale, si bien que toutes les conventions mentionnent explicitement que la question de la mixité et de l'égalité entre les hommes et les femmes doit être prise en compte dans toutes les actions qu'il soutient. Voilà pourquoi la direction des études du FASILD a consacré plusieurs travaux à l'amélioration des connaissances sur la situation des femmes de l'immigration. En 2005, M. Le Huu Khoa a traité des « Femmes asiatiques en France : place familiale, placements professionnels, déplacements sociaux ». L'étude dresse un tableau exhaustif des conditions de vie et du poids de l'éducation familiale, religieuse et communautaire sur les trajectoires d'insertion sociale et professionnelle de trois cents femmes asiatiques. Une seconde étude, réalisée sous la direction de M. Altan Gökalp, a traité des « Conjoints de Français originaires de Turquie ». Elle montre le décalage vécu, après leur arrivée en France, par des jeunes femmes qui ont souvent un niveau d'études supérieur à leurs conjoints et qui découvrent à leur arrivée en France des conditions de vie parfois difficiles. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit ressentir les communautés asiatiques comme particulièrement refermées sur elles-mêmes, ce qui n'aide pas à comprendre la situation exacte des femmes en leur sein. Il en va de même pour les communautés d'Afrique noire : on ne sait précisément quel rôle joue chaque femme dans ce qui s'apparente à des tribus au sein desquelles plusieurs épouses cohabitent. Voilà qui complique la tâche du législateur. Mme Myriam Bernard a indiqué que, selon les conclusions de l'étude de M. Le Huu Khoa, les femmes asiatiques bénéficient d'une assez grande intégration professionnelle. Mais si elles apparaissent bien intégrées dans leur milieu, elles semblent aussi plutôt soumises à leur mari et à la communauté étendue et, effectivement, peu connues des services publics. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que, lors de la fête du Têt, le dialogue se noue avec les hommes, mais très rarement avec les femmes. M. Kaïs Marzouki a exposé que la modernité se traduit par la primauté donnée à l'individu sur le groupe. En France, le groupe vient en second, mais ce n'est pas le cas pour les vagues d'immigration récentes, où le poids du groupe demeure très important et où il n'y a pas primauté de l'individu. S'agissant des femmes d'origine maghrébine, il existe un indicateur que les chercheurs utilisent avec réticence et qui est pourtant loin d'être inintéressant : celui des mariages mixtes. Ils sont en effet extrêmement nombreux, et les unissent à des Français de France. Autrement dit, le brassage se fait, comme il s'est fait précédemment avec les vagues d'immigration polonaise, italienne, espagnole ou portugaise. Mais le curseur le plus significatif demeure le degré de primauté accordé à l'individu. Il s'agit là d'un phénomène de long terme, mais il va dans le sens de l'histoire. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est demandé si les communautés asiatiques souhaitent cette évolution. Mme Myriam Bernard a répondu que l'étude ne le montre pas, mais que le phénomène doit être envisagé dans la durée. Pour ce qui est des femmes africaines, le FASILD, loin de nier la polygamie, aide à la décohabitation, source d'autonomie. Là aussi, du temps est nécessaire pour permettre aux nouvelles arrivantes de dépasser les schémas traditionnels. Mais il y a chez les femmes africaines un potentiel d'énergie considérable, comme en témoigne leur activité, remarquable, de chefs d'entreprises. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit n'en pas douter, et s'est félicitée qu'une femme ait remporté l'élection présidentielle au Libéria. Mme Myriam Bernard a souligné que les femmes africaines ont lancé d'innombrables micro-projets dans les quartiers, projets qui demeurent essentiellement portés par elles. Cela étant, les entretiens menés par le FASILD dans ces quartiers ont mis en évidence à quel point l'image des hommes et des pères est dévalorisée. En fait, plus les femmes prennent leur autonomie, et plus ils se réfugient dans la tradition et le repli communautaire. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé les très intéressants propos de Mme Gaye Petek à ce sujet. Elle a d'autre part souligné l'absence des hommes de la prévention des violences urbaines des dernières semaines : on a vu des femmes essayer de reprendre les choses en main, mais les hommes sont apparus comme uniquement spectateurs. D'évidence, les femmes ont un rôle majeur à jouer. M. Kaïs Marzouki a insisté sur l'action menée par le FASILD à propos de la parentalité, précisant qu'il s'agit bien de valoriser le rôle des mères et des pères. Si l'équilibre est difficile à trouver, c'est qu'il faut mener des actions ciblées vers les femmes sans disqualifier les pères. Mme Myriam Bernard a appuyé ce propos, soulignant que lorsque l'image du père est dévalorisée, les enfants ont beaucoup de mal à se construire, faute de repères identitaires satisfaisants. Mme Nathalie Gautier s'est dite à son tour surprise par l'absence des pères pendant les violences urbaines, absents au point de n'exprimer aucune revendication. Elle a ensuite abordé la question des relations entre les familles immigrées et les établissements d'enseignement. Elle s'est dite frappée par l'inquiétude des mères immigrées lorsqu'elles constatent, au collège, que leurs enfants commencent à « décrocher », et ne peuvent établir de liens, sinon superficiels, avec le professeur principal ou avec le CPE. Une demande est formulée qui demeure insatisfaite, et il en résulte une véritable souffrance. Bien souvent, l'équipe enseignante est prête à répondre à la demande mais l'articulation ne se fait pas avec la famille, car le père n'apparaît pas. M. Kaïs Marzouki a indiqué que le FASILD mène une intervention spécifique dans ce domaine, un accord cadre ayant été signé à ce sujet avec l'Education nationale. Il s'agit justement de favoriser le rapprochement entre l'école et les parents - le père et la mère, et non la mère seulement. Mme Myriam Bernard a souligné que, plus largement encore, le FASILD souhaite aider les femmes issues de l'immigration à s'investir davantage dans les instances de l'Education nationale. Mme Claude Greff a observé que la chose ne serait pas simple, puisqu'un problème se pose déjà à ce sujet avec les parents non issus de l'immigration. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit redouter que la génération de ses arrière petits-enfants soit seule à même de régler le problème, tant l'effort à accomplir est de longue haleine. A relire la déclaration du Président de la République, on comprend bien que c'est la question de la diversité culturelle qui se pose et que la France, à ce jour, ne l'assume pas. Mme Claude Greff a renchéri, constatant qu'actuellement la France ne voit pas de quelle richesse cette diversité culturelle est porteuse. Mme Myriam Bernard a indiqué que le FASILD a passé un accord cadre avec France 3 et qu'un autre accord est en cours de réalisation avec France Télévisions. L'objectif est de présenter l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle de manière constructive. La même démarche a été entreprise auprès de TF1 sans résultats probants, cette chaîne considérant avoir fait ce qu'elle devait grâce à des émissions telles que Star Academy. Pourtant, il faut aller bien au-delà et savoir montrer, dans les films produits par la télévision française, des personnages reflétant toute la diversité culturelle du pays. Mme Claude Greff a observé que cette diversité apparaît dans les films américains. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a fait valoir que la même diversité devrait être de règle dans les films français. Mme Claude Greff s'est interrogée sur la nécessité d'une telle démarche. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué avoir eu l'occasion de discuter avec l'acteur Mouss Diouf, qui joue dans le feuilleton télévisé Julie Lescaut. Il lui a fait part de son intention d'abandonner cette production, expliquant en avoir assez d'être « le Noir de service »... L'objectif devrait être de montrer toute la diversité de la population française dans les films proposés aux téléspectateurs. Mme Claude Greff a exposé que, plutôt que d'en passer par les fictions, mieux vaudrait que la diversité culturelle se traduise dans l'effectif des présentateurs et des journalistes. A cet égard, France 3 est sans nul doute en avance sur TF1. Mme Nathalie Gautier a observé que, contrairement à la société américaine, la société française est bloquée en la matière. Il n'est besoin, pour s'en convaincre, que de constater la difficulté que les collégiens de troisième éprouvent à trouver un stage lorsqu'ils sont issus d'une famille immigrée. La responsabilité est générale : la France n'accepte pas son immigration, ni donc la réalité, qui est que la société nationale est devenue multiethnique. Mme Claude Greff s'est dite en désaccord avec cette manière d'envisager les choses. Les enfants issus de l'immigration sont parfaitement acceptés. Ce qui fait barrage, c'est leur comportement, leur manière de s'exprimer et leur tenue vestimentaire, qui ne sont pas dans la norme. Voilà ce qui fait obstacle. Mme Nathalie Gautier a dit ne pas partager ce point de vue, soulignant que la plupart des adolescents et des jeunes gens ont des vêtements hors norme. Mme Claude Greff a insisté et précisé qu'un Français de souche ne sera pas davantage admis dans une entreprise s'il prétend s'y présenter coiffé en « rasta ». Si les immigrés veulent véritablement s'intégrer à la société française, chacun doit y mettre du sien. La France doit considérer la diversité culturelle comme une richesse mais les immigrés doivent, pour leur part, consentir à un effort minimal de comportement, effort qui n'existe pas toujours. M. Kaïs Marzouki a souligné que la France compte 10 % d'habitants d'origine étrangère. Certains économistes considèrent, à juste titre selon lui, que se passer d'un habitant sur dix tient du suicide économique. En poursuivant dans cette voie, la France se ferait harakiri. Quant à l'intégration, elle est en effet à double sens. Il y a, d'une part, les efforts accomplis par l'individu pour s'intégrer, d'autre part, la responsabilité de la société dans les pratiques discriminatoires. Or, elles sont bien réelles ; si elles ne l'étaient pas, le Président de la République n'aurait pas eu à évoquer le « poison » qui mine la société française, et point n'aurait été besoin non plus de créer la HALDE. Une vision équilibrée des choses est nécessaire. Des jeunes de la deuxième ou de la troisième génération sont peut-être débraillés, mais le sont-ils davantage que les autres jeunes Français ? En revanche, n'est-ce pas une anomalie de ne cesser de leur rappeler leurs origines ? Mme Claude Greff a estimé cette analyse tout à fait pertinente, soulignant que la société française, pour s'exonérer d'avoir oublié qu'elle s'enrichissait de la diversité culturelle, a tendance, aujourd'hui, à considérer les fauteurs de troubles comme des victimes. L'équilibre est en effet nécessaire : la société française doit accepter les différences et les immigrés faire des efforts. Le dire, c'est contribuer à une intégration réussie. M. Kaïs Marzouki est revenu aux études conduites sous l'égide du FASILD, indiquant que Mme Marie-Thérèse Lanquetin avait réalisé, en 2002, une étude relative à « La double discrimination à raison du sexe et de la race ou de l'origine ethnique », publiée en 2004. C'est là une des questions les plus complexes qui soient. Comme l'a indiqué Mme Myriam Bernard, le FASILD intervient aussi sur les représentations, par le biais d'un accord cadre avec France Télévisions, dont le président fait preuve d'un fort volontarisme en ce domaine. Mme Claude Greff a indiqué avoir suivi une émission de Star Academy et avoir constaté une volonté sous-jacente de tolérance et de lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. L'évolution est notable, mais elle devrait être encore accentuée. Mme Myriam Bernard a indiqué que le FASILD finance pour partie le feuilleton Plus belle la vie, proposé par France 3 tous les soirs et regardé par cinq millions de téléspectateurs. M. Kaïs Marzouki a indiqué que l'Association des Tunisiens de France a réalisé une exposition sur le thème « Traces, mémoires, histoire des mouvements de femmes de l'immigration », tendant à faire le lien entre l'histoire de ces femmes et la manière dont elles transmettent ce passé à leurs enfants. Dans le cadre du GIP EPRA, le FASILD favorise la production d'émissions radiophoniques qui évoquent la situation des femmes de l'immigration. Le FASILD intervient également auprès de l'Education nationale pour favoriser la formation des adultes qui sont au contact des enfants, afin que les questions liées à l'immigration soient prises en compte et que la parole des femmes de l'immigration soit encouragée. Un autre axe de son intervention concerne l'accès aux droits. A cette fin, le Fonds finance, à hauteur respectable, différentes associations dont les plus connues sont ELELE et Ni putes ni soumises, ainsi que des centres d'information et d'orientation sur les violences faites aux femmes, les mariages forcés et les mariages arrangés. Le FASILD s'attache également à favoriser l'accès à la culture des femmes issues de l'immigration. Dans ce cadre, il soutien notamment le Festival international de films de femmes de Créteil. Son dernier axe d'intervention concerne l'intégration économique des femmes, par le biais d'accords pluriannuels tendant à diversifier leur orientation professionnelle. Dans ce cadre, des pourparlers sont en cours qui tendent à élargir l'accès à des métiers non traditionnellement féminins. Pour conclure, la question des femmes est prise en compte de manière transversale dans toutes les actions du FASILD, et tous les financements qu'il alloue sont orientés dans cette optique. Autrement dit, le FASILD applique une sorte de discrimination positive, puisqu'à choisir entre deux actions, il privilégiera toujours celle qui tient compte des femmes. Actuellement, le Fonds travaille à la création des conditions de l'émergence de la parole des femmes en soutenant des associations de femmes. Mme Claude Greff a demandé si la population dont le FASILD s'occupe était issue de l'immigration régulière. Mme Myriam Bernard a répondu qu'il en était bien ainsi. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Myriam Bernard et M. Kaïs Marzouki. DEUXIÈME PARTIE : __________________ Contribution de Mme Bérengère Poletti, députée, membre de la La loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception venait compléter la loi Veil du 17 janvier 1975 pour tenir compte des évolutions scientifiques et des transformations de société intervenues depuis et également pour tenter de remédier aux dysfonctionnements constatés dans le parcours suivi par les femmes pour accéder à l'IVG. La loi comportait plusieurs dispositions novatrices (allongement des délais légaux, autorisation de l'IVG médicamenteuse en ville, suppression de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures, création d'un cadre légal à la stérilisation dans un but contraceptif...) et des mesures de simplification (comme la suppression de l'obligation d'entretien préalable sauf pour les mineures ou l'intégration des centres autonomes dans les services hospitaliers). Certaines de ces dispositions avaient suscité des réticences importantes (comme l'allongement des délais légaux), d'autres nécessitaient des initiatives diverses et complémentaires pour s'inscrire dans les faits (comme la mise en oeuvre de l'IVG médicamenteuse en ville). C'est pourquoi, le suivi de la loi est très vite apparu comme un élément essentiel de sa réussite. Un groupe national d'appui a été constitué en février 2002, à la demande des parlementaires. Sa présidence a été confiée à Mme Emmanuelle Jeandet-Mengual, membre de l'Inspection générale des Affaires sociales (IGAS). Le groupe d'appui a remis son rapport à la fin de l'année 2002. Il y faisait dix préconisations concrètes. Une commission des suites, destinée à faire le point avec les services de l'état d'avancement des recommandations formulées par le groupe d'appui, s'est réunie en juillet 2004, en présence des différentes directions du ministère de la santé et de la protection sociale. Il est apparu que si des progrès avaient été réalisés dans de nombreux domaines, certains problèmes subsistaient et que des éléments importants étaient difficilement quantifiables, en particulier le parcours administratif et médical des femmes pour accéder à l'IVG. En outre, du fait de retards dans l'adoption des textes, l'IVG médicamenteuse en ville n'avait toujours pas trouvé d'application concrète à l'automne 2004. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a examiné le 22 septembre 2004 une proposition de résolution de Mme Muguette Jacquaint, demandant la constitution d'une commission d'enquête sur l'application de la loi relative à l'IVG et à la contraception. Mme Bérengère Poletti, rapporteure, a estimé préférable à la constitution d'une commission d'enquête, nécessairement ponctuelle, de confier à la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes le suivi de l'application effective de la loi du 4 juillet 2001, afin qu'elle puisse assurer l'information régulière des parlementaires à ce sujet. Cette proposition a été retenue par le Président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean-Michel Dubernard. La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a procédé à plusieurs auditions, afin de faire le point sur l'état d'avancement des différentes dispositions figurant dans la loi du 4 juillet 2001. Elle a ainsi reçu Mme Emmanuelle Jeandet-Mengual, membre de l'Inspection générale des Affaires sociales, présidente du groupe national d'appui à la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception qui a présenté les conclusions de la commission des suites, réunie le 6 juillet 2004 pour examiner le suivi qui avait été assuré aux recommandations figurant dans le rapport du groupe d'appui. La Délégation a également entendu Mme Elisabeth Aubény, gynécologue, présidente de l'Association française pour la Contraception, afin de faire un état des lieux de la pratique de la contraception, en particulier de la contraception d'urgence et d'apprécier les perspectives de l'IVG médicamenteuse en ville. En outre, la Délégation a procédé à l'audition de Mme Nathalie Bajos, chercheur à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), co-auteur d'une étude parue dans le numéro de décembre 2004 dans la revue Population et Société, intitulée «Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ?», dont la presse s'est largement fait l'écho. L'ensemble des renseignements recueillis a permis d'établir un constat détaillé de l'accès à l'IVG et des pratiques de contraception en vigueur quatre ans après l'adoption de la loi du 4 juillet 2001. I. LA LOI DU 4 JUILLET 2001 A PERMIS DES AVANCÉES QUI SE TRADUISENT PAR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES A. L'ACCÈS À L'IVG EST OUVERT À UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE FEMMES 1) Grâce à l'allongement des délais légaux La loi du 4 juillet 2001 a modifié le délai légal de recours à l'avortement qui a été allongé de deux semaines, passant ainsi de dix à douze semaines de grossesse. Une telle disposition ne faisait que rapprocher le délai en vigueur en France de celui de la moyenne européenne qui est actuellement de quatorze semaines. Cet allongement du délai visait à limiter le nombre de femmes contraintes de se rendre à l'étranger (principalement aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne où le délai légal est de vingt-deux semaines de grossesse) car leur prise en charge n'était plus possible en France. Chaque année, 5 000 femmes se trouvaient ainsi hors délai, avec un pourcentage de femmes entre dix et douze semaines de grossesse de l'ordre de 80 %. Outre des difficultés administratives et financières, la nécessité d'aller faire pratiquer une IVG à l'étranger pose des problèmes de suivi médical et psychologique. Lorsqu'elles sont de retour en France, les femmes concernées n'effectuent généralement pas les contrôles médicaux post-IVG nécessaires et hésitent à consulter en cas de complications. De plus, le suivi contraceptif n'est pas assuré et le retentissement psychologique de l'IVG est accentué par le sentiment d'illégalité par rapport aux dispositions en vigueur en France. Néanmoins, l'allongement des délais légaux avait soulevé des réticences de la part des médecins. Certains craignaient de devoir effectuer une intervention médicale plus lourde. D'autres envisageaient de faire jouer la clause de conscience uniquement en ce qui concerne ces deux semaines supplémentaires. C'est pourquoi, le groupe de suivi chargé de rendre compte aux ministres « de l'état des difficultés existantes et de celles que la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 est susceptible de révéler » avait conseillé qu'au moins un établissement par département assure la prise en charge des IVG entre la dixième et la douzième semaine de grossesse. Cette suggestion visait à éviter que des inégalités géographiques choquantes ne se constituent et que certaines femmes soient contraintes de parcourir des distances importantes pour faire pratiquer une IVG entre la dixième et la douzième semaine. Sur ce point, le bilan dressé par la commission des suites montre qu'une régularisation progressive s'opère. Il n'en demeure pas moins que les pratiques sont encore très différentes d'une région à l'autre. La Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques du ministère de la santé (DREES) évalue en 2003 à environ 8 % des IVG déclarées dans les établissements de santé, celles qui ont lieu dans la période des onzième et douzième semaines. La crainte d'une explosion des IVG tardives qui avait été exprimée lors du débat parlementaire ne s'est donc pas trouvée vérifiée. 2) Grâce à une meilleure prise en charge des mineures La deuxième cause du départ de femmes françaises à l'étranger pour faire pratiquer une IVG était liée au problème de l'autorisation parentale, impérative pour les mineures avant l'adoption de la loi du 4 juillet 2001. Cette question était d'autant plus cruciale qu'en ce qui concerne les mineures, plus de la moitié des grossesses conduit à une IVG, ce qui représente 11 000 IVG en 2003 (derniers chiffres recensés) sur un total de 203 000, soit environ 5 % de l'ensemble des IVG. a) Responsabilité des différents intervenants et respect de la confidentialité La loi du 4 juillet 2001, en ouvrant la possibilité aux mineures de faire pratiquer une IVG sans autorisation parentale, avait suscité des inquiétudes chez les médecins, notamment les médecins anesthésistes au sujet de leur responsabilité médicale et un certain nombre d'interrogations quant au rôle de l'adulte référent, chargé d'assister la mineure au cours de ses démarches. En ce qui concerne les médecins anesthésistes, il a été établi que leur responsabilité pénale ne peut être recherchée en cas de complications médicales, au motif que l'intervention a été pratiquée sans autorisation parentale. La Société française d'anesthésie-réanimation a largement relayé cette information auprès de ses adhérents. La prise en charge de ces jeunes filles s'est donc faite plus facilement, à partir du moment où les praticiens ont été rassurés sur ce point. De la même manière, l'adulte référent ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait qu'il accompagne la mineure dans l'ensemble de ses démarches relatives à l'IVG. Il le fait néanmoins à titre individuel et non pas au nom de l'institution à laquelle il appartient, ce qui crée une ambiguïté lorsqu'il s'agit non pas d'un membre de la famille ou de l'entourage mais par exemple d'une assistante sociale ou de l'infirmière scolaire. En effet, cet accompagnement est considéré uniquement comme une démarche individuelle et ne s'inscrit pas dans le cadre de leurs activités professionnelles. A cet égard, on ne peut que déplorer le manque de coordination entre le ministère de la santé et le ministère de l'éducation nationale. En effet, il n'est pas toujours évident de faire admettre aux personnels de l'éducation nationale, qui peuvent être confrontés à des situations de grande détresse et sont parfois le seul recours des jeunes filles concernées, que lorsqu'ils acceptent d'accompagner une élève dans sa démarche d'IVG, il s'agit d'une démarche volontaire et qu'ils le font sous leur responsabilité personnelle. Il est important de veiller à ne pas fragiliser davantage la situation de ces personnels et des jeunes filles qu'ils soutiennent en leur faisant courir le risque que la famille de l'élève soit informée, du fait du signalement des absences de l'élève relatives aux démarches d'IVG. La suppression de l'obligation d'autorisation parentale pour pouvoir faire pratiquer une IVG implique de garantir aux mineures concernées une stricte confidentialité quant à l'accomplissement de toutes les démarches préliminaires et à l'intervention elle-même. Cette exigence s'applique aux personnels sociaux et médicaux, mais elle nécessite également la coopération des établissements scolaires, dans la mesure où ces mineures sont généralement scolarisées et où les démarches relatives à l'IVG sont susceptibles de s'effectuer pendant le temps scolaire. Dans un tel contexte, signaler automatiquement aux parents les absences des élèves lorsqu'elles sont liées à l'IVG, même si le motif de l'absence n'est pas précisé, risque d'aboutir à la révélation de la grossesse et de l'IVG. Or, c'est précisément ce que la jeune fille veut à tout prix éviter lorsqu'elle refuse de solliciter l'autorisation parentale. Il est donc important que le ministère de la santé et celui de l'éducation nationale parviennent à une solution concrète sur ce point, afin d'éviter que les élèves et les personnels concernés ne se trouvent dans une situation inconfortable, voire angoissante dans certains cas. Le groupe de suivi avait préconisé, dans son rapport remis à la fin de l'année 2002, qu'un protocole d'accord soit élaboré entre le ministère de la santé et celui de l'éducation nationale pour proposer des recommandations pratiques aux responsables des établissements scolaires sur ces deux questions du signalement des absences et de la responsabilité individuelle des personnels s'engageant à être l'adulte référent. Jusqu'à présent, le ministère de l'éducation nationale n'a pas donné de signes d'ouverture dans ce domaine et s'en tient à une approche strictement juridique de ces questions. Plusieurs textes d'application ont été nécessaires pour que le principe de la gratuité de l'acte en ce qui concerne les mineures décidant de faire pratiquer une IVG sans autorisation parentale se mette en place sans se heurter à des obstacles administratifs. Le décret n° 2002-799 du 3 mai 2002 a fixé les modalités de prise en charge anonyme et gratuite des IVG pratiquées sur des mineures alors que le consentement parental n'a pas été recueilli. La circulaire CIR-49-2003 du 24 mars 2003 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a explicité ces modalités et précisé les procédures à mettre en œuvre pour préserver l'anonymat des assurées. Il est néanmoins apparu que ces procédures restaient mal connues des professionnels et qu'un certain nombre de dysfonctionnements étaient signalés. Ainsi, des pratiques inappropriées persistaient pour ces actes, notamment le recours à la télétransmission qui n'est pas compatible avec la nécessité de garantir l'anonymat ou à des dispositifs inadaptés comme celui de l'Aide Médicale de l'État (AME). C'est pourquoi le directeur général de la santé a donné instruction aux établissements de santé de procéder à un rappel du dispositif applicable en la matière auprès de l'ensemble des professionnels concernés. Ces instructions figurent dans la circulaire du ministère de la santé DGS/SD 6 D n° 2003-631 du 30 décembre 2003. Il semblerait que cette circulaire ait permis de résoudre les difficultés signalées. B. L'ACCÈS À L'IVG S'EFFECTUE DANS DE MEILLEURES CONDITIONS 1) Du fait de la possibilité d'IVG médicamenteuse en ville Une des principales innovations de la loi du 4 juillet 2001 résidait dans la possibilité de faire réaliser une IVG médicamenteuse en ville, hors établissement de santé, par un médecin habilité. Jusqu'aux années 1980, la seule technique d'IVG était la méthode chirurgicale. A partir de cette période, s'y est ajoutée la technique médicamenteuse par le RU 486 (mifépristone) mais uniquement au sein des établissements de santé. Cette méthode est dorénavant autorisée en France jusqu'à sept semaines de grossesse en établissement de santé et jusqu'à cinq semaines en médecine de ville, d'après les dernières recommandations de l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES). Cette possibilité nouvelle d'IVG médicamenteuse en ville présente un intérêt indéniable. Elle devrait permettre d'augmenter la proportion d'IVG médicamenteuses qui représentaient, déjà en 2003, 38 % des IVG pratiquées en établissements de santé. En effet, trois IVG sur quatre sont réalisées tôt, avant la huitième semaine, et 19 % avant la cinquième semaine. Un pourcentage non négligeable d'IVG pourrait donc entrer dans le cadre de l'IVG médicamenteuse en ville. Si un certain nombre d'IVG médicamenteuses pouvait être pratiqué en ville, cela réduirait les délais d'attente dans les établissements de santé, du moins pour les grossesses peu avancées. Or, le délai de prise en charge dans les établissements de santé reste un problème récurrent dans certaines régions et à certaines périodes (période estivale). De plus, cela permettrait de recourir davantage à la méthode médicamenteuse, celle-ci ne pouvant plus être utilisée dans certains cas, du fait du temps d'attente pour obtenir un rendez-vous dans les établissements de santé. Sur le plan médical, la méthode chirurgicale indispensable pour les grossesses plus avancées s'avère plus lourde, d'autant plus qu'elle nécessite une anesthésie générale. L'IVG médicamenteuse, quant à elle, constitue une méthode sûre puisqu'elle permet d'assurer 96 % de bons résultats avant cinq semaines de grossesse. Elle présente peu de risques de complications, le risque d'infection étant exceptionnel, toujours inférieur à celui des IVG chirurgicales, le risque de perforation nul et le risque de synéchie (adhérence cicatricielle de deux surfaces ulcérées) à terme probablement nul. La réalisation d'une IVG médicamenteuse nécessite cinq consultations médicales dont quatre sont remboursées sur la base d'un forfait. Ce forfait comprend le prix des médicaments utilisés que le médecin doit se procurer lui-même à la pharmacie. Deux consultations préalables sont prévues, suivies de deux consultations pour la prise des médicaments et d'une consultation de contrôle. La première consultation, qui n'est pas incluse dans le forfait, est une consultation d'information, au cours de laquelle la femme effectue sa demande d'IVG. Cette consultation est suivie d'un délai légal de réflexion d'une semaine. Au cours de la deuxième consultation, le médecin doit vérifier la datation de la grossesse (la méthode la plus fiable étant l'échographie), afin de s'assurer qu'une IVG médicamenteuse est bien adaptée. Il procède donc à un examen clinique et interrogatoire. Des examens biologiques sont obligatoires. Le médecin remet à la patiente une fiche de liaison qui sera complétée à chaque consultation, afin que la patiente puisse la communiquer à l'établissement de santé auquel le médecin est rattaché, si des complications survenaient. L'IVG médicamenteuse commence au cours de la troisième consultation. Le médecin donne lui-même à la patiente un comprimé de mifépristone à 200 g (nom commercial Mifégyne), médicament qui arrête la grossesse. Il vérifie qu'elle dispose d'un traitement antalgique et qu'elle est en mesure de se rendre en moins d'une heure dans l'établissement de santé avec lequel il a signé une convention. Au cours de la quatrième consultation qui a lieu 36 à 48 heures après, la patiente est reçue le matin et reçoit deux comprimés de misoprostol à 200 g (nom commercial : Gymiso), médicament qui provoque l'expulsion. Le médecin est tenu de lui faire prendre les comprimés en sa présence. 50 % des femmes expulsent l'embryon en fin de matinée. Le médecin peut prescrire une contraception à commencer le soir même. L'IVG médicamenteuse peut s'accompagner de saignements importants et prolongés qui sont un motif fréquent d'inquiétude et de douleurs plus ou moins fortes mais qui réagissent généralement assez bien aux antalgiques simples. La dernière visite est une visite de contrôle qui doit être effectuée entre quatorze et vingt-et-un jours après l'expulsion. Cette visite permet de vérifier la vacuité utérine à l'aide d'une échographie pelvienne. En dehors des contre-indications médicales à l'IVG médicamenteuse (anémie sévère, antécédents cardio-vasculaires, rhésus négatif...), l'IVG médicamenteuse présente très peu de risques, à condition que toutes les règles soient respectées. Par rapport à la technique chirurgicale, on constate néanmoins un taux d'échec légèrement supérieur (rétention, nécessité d'aspiration) et une durée des saignements plus longue. Bien que l'IVG médicamenteuse représente déjà plus du tiers des IVG pratiquées en établissements de santé, elle tarde à se mettre en place en ville, du fait d'obstacles essentiellement réglementaires, ce qui est dommageable pour les femmes et contraire à l'esprit de la loi. 2) Une revalorisation du forfait qui facilite l'accès à l'IVG L'absence de revalorisation du forfait applicable à l'IVG risquait d'avoir des conséquences néfastes sur la prise en charge de celle-ci par les établissements de santé. Déjà, les cliniques privées, qui assuraient un tiers des IVG, avaient commencé à se désengager de cette activité, en raison de son caractère peu rémunérateur. Or, les hôpitaux publics n'ont pas la capacité d'assurer la totalité des IVG. Ce désengagement de certains établissements de santé est accentué par le caractère peu attractif de cet acte pour les médecins. Ceux-ci considèrent souvent l'IVG comme un acte sans enjeu scientifique particulier et techniquement sans intérêt, ce qui le rend peu gratifiant sur le plan professionnel. En outre, c'est un acte qui humainement peut poser un problème de conscience aux médecins amenés à le pratiquer. Les praticiens hospitaliers ayant généralement une charge de travail trop lourde, ils ont donc tendance à délaisser cette activité. Il faut néanmoins prendre en compte le fait que le nombre d'IVG se maintient à un niveau élevé : le nombre annuel d'IVG qui se situait autour de 180 000 dans les années 1980, a atteint 203 000 en 2003, avec un taux d'IVG stable depuis trente ans, de l'ordre de 14 pour 1 000 femmes. L'IVG est donc devenue un acte médical courant, auquel la France doit être en mesure de faire face, puisqu'elle est un des pays européens où l'on en pratique le plus. La revalorisation du forfait devenait donc cruciale, afin d'éviter que les médecins et les établissements de santé ne se désintéressent de cet acte et pour permettre aux femmes ayant décidé de faire pratiquer une IVG d'y avoir accès dans des délais raisonnables. Les discussions financières ont porté à la fois sur la revalorisation du forfait versé aux établissements de santé, lequel était bloqué depuis treize ans, et sur la fixation du forfait applicable à l'IVG médicamenteuse pratiquée hors établissements de santé. Ces discussions avec les représentants de la profession se sont déroulées dans un contexte général de maîtrise comptable des dépenses de santé. Celui-ci n'a donc pas facilité l'adoption des textes ni au sein du ministère de la santé, ni lors des discussions interministérielles avec le ministère des finances. La pression des associations et des professionnels de santé concernés a néanmoins permis d'obtenir que l'acte soit revalorisé de 30 %.Cette revalorisation a fait l'objet d'un arrêté du ministère de la santé et de la protection sociale en date du 23 juillet 2004, relatif aux forfaits afférents à l'IVG. En ce qui concerne l'IVG médicamenteuse hors établissements de santé, le prix limite du forfait attribué au médecin est fixé à 191,74 euros. Ce montant couvre la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le consentement de la patiente, les deux consultations d'administration de la Myfégine et du Gymiso, ainsi que la consultation de contrôle. Il n'englobe pas la première consultation qui est une consultation d'information au cours de laquelle le médecin remet un dossier-guide à la patiente. Le forfait inclut l'achat des médicaments pour lesquels le médecin doit passer une commande à usage professionnel auprès de la pharmacie d'officine de son choix, afin d'éviter que les patientes puissent détenir un médicament abortif. Cette disposition pose toutefois un certain nombre de difficultés. Cela oblige le médecin à faire l'avance de frais pour les médicaments. En effet, ce n'est que lors de la troisième consultation, celle où commence la prise de médicament, que le médecin établit la facture du forfait. La boite de trois comprimés de Mifégyne est commercialisée au prix de 76,37 euros et celle de deux comprimés de Gymiso au prix de 15,37 euros soit un total de 91,37 euros. La rémunération nette du médecin, une fois défalqué le coût des médicaments, est de 100 euros pour quatre consultations, ce qui compte tenu de la formation requise et du temps passé pourrait décourager les bonnes volontés. Il ne faudrait donc pas que le fait de devoir faire l'avance de frais pour les médicaments dissuade davantage les médecins de participer à la réalisation d'IVG médicamenteuses. La loi du 4 juillet 2001 a permis d'améliorer la prise en charge des femmes ayant décidé de recourir à l'IVG. Toutefois, des obstacles perdurent, risquant de remettre en cause à terme l'accès à l'IVG dans des conditions satisfaisantes. II. MALGRÉ CES AMÉLIORATIONS, DES DIFFICULTÉS NON NÉGLIGEABLES SUBSISTENT A. DES FACTEURS D'ORDRE PRATIQUE RESTREIGNENT L'ACCÈS À L'IVG 1) Des délais de prise en charge encore excessifs dans certaines régions et à certaines périodes Les délais de prise en charge dans les établissements de santé constituaient un des problèmes majeurs liés à l'IVG. En raison de délais de prise en charge trop longs, certaines femmes dépassaient les délais légaux et étaient contraintes de se rendre à l'étranger, dans les pays où les délais légaux sont plus importants (principalement les Pays-Bas et la Grande-Bretagne). De plus, une prise en charge insuffisamment rapide ne permet plus de recourir à l'IVG médicamenteuse qui n'est autorisée que jusqu'à sept semaines de grossesse dans les établissements de santé. La technique chirurgicale reste alors le seul recours. Or, il est important pour les femmes qu'elles puissent choisir la technique d'IVG utilisée. L'allongement du délai légal de dix à douze semaines de grossesse constitue une première réponse à ce problème des délais. Il a d'ailleurs permis de réduire de manière significative le nombre d'IVG pratiquées à l'étranger. Ainsi, depuis que la loi française autorise les IVG entre dix et douze semaines de grossesse, les établissements hollandais disent ne plus recevoir de Françaises se trouvant dans cette période. Ils en accueillent néanmoins toujours au-delà. L'autorisation de l'IVG médicamenteuse hors établissements de santé devrait également aller dans le même sens et permettre de réduire les demandes d'IVG dans les établissements de santé, ainsi que les délais d'attente aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux. Dans ce domaine, on est encore loin du résultat escompté. En effet, l'IVG médicamenteuse en ville a débuté avec beaucoup de retard par rapport à l'adoption de la loi du 4 juillet 2001, les textes d'application ayant été publiés tardivement. Plus grave, ces textes ont défini de manière restrictive les médecins habilités à les pratiquer. L'IVG médicamenteuse en ville risque donc de ne trouver qu'un champ d'application marginal. Les dernières données statistiques dont on dispose au sujet des délais ne permettent que d'évaluer de manière partielle les délais moyens de prise en charge des patientes par les établissements de santé. Les 682 établissements de santé ayant déclaré avoir pratiqué des IVG en 2003 ont été interrogés sur le délai moyen observé entre la date de dépôt de la demande d'IVG et la date de réalisation de celle-ci. Seuls 311 établissements ont fourni une réponse sur ce point et indiqué une durée moyenne d'environ 9 jours (8 jours dans le secteur privé et 9 jours dans le secteur public). 16 % des établissements estiment le délai d'attente à 15 jours et seuls 2 % d'entre eux l'évaluent à trois semaines ou plus. On ignore donc actuellement le délai moyen de prise en charge de plus de la moitié des établissements. De même, il est très difficile de mesurer le temps perdu par les femmes qui sont réorientées vers une autre structure, faute de places disponibles. Or, cela concerne 9,2 % des femmes qui font pratiquer une IVG. Les difficultés d'accès à l'IVG, du fait de l'insuffisance des capacités d'accueil, sont accentuées par l'absence d'accompagnement dans les démarches qui peut rendre l'accès aux soins trop complexe. Parfois, les femmes ne savent pas où s'adresser, ne peuvent obtenir de rendez-vous car les consultations sont complètes et se trouvent renvoyées d'un service à l'autre, perdant ainsi un temps précieux. A cet égard, on constate toujours des disparités régionales et la situation n'a guère évolué depuis le rapport du groupe de suivi. Une plus grande mobilisation des autorités sanitaires et des établissements de santé s'impose pour obtenir des améliorations dans ce domaine. Les problèmes de délai de prise en charge s'accentuent pendant la période estivale, du fait du manque de médecins et de la fermeture de lits. Durant cette période, l'attente peut excéder trois à quatre semaines, ce qui exclut le recours à l'IVG médicamenteuse et risque de placer certaines femmes en situation de dépassement des délais légaux. La parution, tous les ans avant l'été, d'une circulaire conjointe de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et de la Direction générale de la santé, relative à l'organisation et à la prise en charge des IVG dans les établissements de santé publics et privés en période estivale n'a pas eu d'effet significatif sur ces dysfonctionnements. 2) L'accès à l'IVG médicamenteuse en ville est trop limité a) Des textes d'application qui ont tardé à être adoptés L'autorisation de l'IVG médicamenteuse en ville faisait partie des innovations de la loi du 4 juillet 2001 qui avait suscité le moins de débats, contrairement à l'allongement du délai légal et à la suppression de l'obligation d'autorisation parentale pour les mineures. Il est donc d'autant plus surprenant de constater que cette nouvelle disposition est celle qui aura rencontré le plus de difficultés et mis le plus de temps à se mettre en place. Un premier décret n° 2002-796 en date du 3 mai 2002 fixant les conditions de réalisation des IVG hors établissement de santé a été adopté. Il précisait que le médecin effectue ces IVG et assure le suivi de la femme conformément aux recommandations professionnelles validées par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). Or, ces recommandations ont fait l'objet d'une controverse médicale. En effet, certains praticiens considèrent que le dosage de Mifégyne préconisé par l'ANAES est insuffisant et risque de se traduire par une efficacité moindre de l'IVG médicamenteuse, ainsi que par des contractions plus fortes et donc plus douloureuses pour la patiente, puisqu'il faut alors augmenter le dosage du deuxième produit (Gymiso). Il a été finalement décidé de laisser une plus grande marge d'appréciation aux praticiens. Cela a nécessité l'adoption d'un second décret supprimant toute référence explicite aux recommandations de l'ANAES. Ce décret n° 2004-636 n'a été adopté que le 1er juillet 2004. Mais pour que l'IVG médicamenteuse en ville puisse se mettre en place de manière effective, il fallait que les dispositions fixant le montant de prise en charge soient adoptées concomitamment. Cette seconde phase de négociation, cette fois-ci d'ordre financier, a entraîné également du retard dans la parution des textes d'application. Les discussions ont porté sur le montant du forfait, le nombre de consultations incluses dans le forfait et la question de l'achat des médicaments par le médecin. Elles se sont déroulées dans un contexte de limitation de l'évolution des dépenses de santé, ce qui n'a pas facilité l'adoption d'un compromis, d'autant plus que le même arrêté devait fixer la revalorisation du forfait IVG versé aux établissements de santé. L'arrêté du ministère de la santé et de la protection sociale relatif aux forfaits afférents à l'IVG n'a donc été adopté que le 23 juillet 2004. Le montant des forfaits est bien en deçà de ce qui était demandé par les associations et les praticiens. Toutefois, entendue sur ce sujet par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Aubény, gynécologue, présidente de l'Association Française pour la Contraception, a indiqué que la majorité des médecins considère dorénavant qu'ils sont indemnisés correctement. Les obstacles médicaux et financiers à la parution des textes d'application relatifs à l'IVG médicamenteuse en ville étant levés, il a fallu encore attendre qu'un certain nombre de problèmes administratifs et techniques soient résolus. Ce n'est donc que le 26 novembre 2004 que la circulaire d'application permettant la mise en œuvre de l'IVG médicamenteuse en ville a été adoptée. Il s'agit de la circulaire DGS/DHOS/DSS/DREES n° 2004-569 du 26 novembre 2004 relative à l'amélioration des conditions de réalisation des IVG, pratique des IVG en ville et en établissement de santé. Une dernière étape était nécessaire, à savoir l'adoption par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés d'une circulaire adressée aux caisses locales, afin de définir les modalités de remboursement de l'IVG médicamenteuse en ville, ainsi que les procédures à suivre pour assurer l'anonymisation de l'acte. Cette circulaire de la CNAMTS 10/2005 n'a été signée que le 18 janvier 2005. Il aura donc fallu plus de trois ans et demi pour que l'ensemble des textes permettant la réalisation de l'IVG médicamenteuse en ville soit publié. La mise en œuvre de celle-ci a donc pris un retard conséquent. b) Un nombre restreint de praticiens habilités à pratiquer l'IVG médicamenteuse Le nombre de médecins généralistes habilités à pratiquer l'IVG médicamenteuse en ville risque d'être restreint. En effet, les décrets relatifs à l'IVG médicamenteuse ont limité cette possibilité aux médecins de ville justifiant d'une expérience professionnelle adaptée, soit par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie obstétrique, soit par une pratique régulière des IVG médicamenteuses dans un établissement de santé. Cette expérience est attestée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le médecin, quel qu'ait été son statut, pratique ou a pratiqué des IVG. Le directeur délivre l'attestation au vu du justificatif présenté par le responsable médical de cette activité qui certifie ainsi les compétences médicales du médecin pour la pratique des IVG médicamenteuses. Ces conditions limitent de manière significative le nombre de médecins généralistes susceptibles de pratiquer l'IVG médicamenteuse en ville. En effet, seuls les spécialistes gynécologues ou les généralistes ayant déjà une pratique hospitalière de l'IVG médicamenteuse peuvent la pratiquer en ville. Il est vrai que les petits hôpitaux qui n'avaient pas de problèmes de liste d'attente pour les IVG craignaient que la concurrence des médecins de ville ne leur fasse perdre des clientes et n'entraîne des suppressions d'emplois. De même, les obstétriciens, dont certains font beaucoup d'IVG médicamenteuses, sont réticents à se dessaisir de cette compétence et à former les généralistes. Les médecins généralistes ont été surpris et déçus de ces restrictions introduites par les décrets d'application. En effet, l'objectif de la loi était de rendre l'IVG médicamenteuse plus facilement accessible aux patientes et de réduire ainsi les délais d'attente. Certains médecins généralistes y ont vu une marque de défiance par rapport à leurs compétences médicales. Ils s'estiment aptes à dater une grossesse ou à faire face à une hémorragie, d'autant plus que les textes leur font obligation de signer une convention avec un établissement de santé, auprès duquel la patiente peut se rendre en moins d'une heure en cas de complications. Il serait sans doute plus pertinent d'ouvrir la possibilité de pratiquer l'IVG en ville à l'ensemble des médecins généralistes, en la conditionnant à une formation spécifique pour les médecins n'ayant pas d'expérience en matière d'IVG médicamenteuse, formation qui pourrait être assurée par les établissements de santé pratiquant des IVG médicamenteuses. Par ailleurs, il serait également important que le ministère de la santé diffuse une information spécifique à l'intention des médecins au sujet de L'IVG médicamenteuse en ville. En effet, seules les autorités sanitaires ont été destinataires d'une information officielle en provenance du ministère de la santé et de la protection sociale. Jusqu'à présent, l'information des médecins a reposé sur les publications médicales et sur les renseignements que les médecins se communiquaient entre eux. Il est donc important de la rendre plus systématique, le ministère de la santé pouvant en outre avoir un rôle incitatif comme dans les campagnes d'information sur la contraception. Les centres de planification souhaiteraient également pouvoir pratiquer des IVG médicamenteuses, mais ils se heurtent à un problème de conventionnement, le médecin qui réalise l'acte ne pouvant pas actuellement être rémunéré directement. Ces retards et ces restrictions expliquent que le nombre de conventions conclues entre des médecins et des établissements de santé soit actuellement encore très limité. L'IVG médicamenteuse en ville qui constituait une des améliorations prometteuses de la loi du 4 juillet 2004 est donc encore loin d'être répandue. B. DES PROBLÈMES D'ORDRE STRUCTUREL RISQUENT ÉGALEMENT DE PESER SUR LES CAPACITÉS D'ACCUEIL EN MATIÈRE D'IVG 1) La motivation et la formation des médecins Les années à venir risquent de connaître des tensions sur les effectifs de médecins pratiquant des IVG, compte tenu des perspectives démographiques. En effet, le recrutement de personnels médicaux sera rendu plus difficile du fait de la diminution du nombre de spécialistes en gynécologie-obstétrique. En outre, la génération de médecins militants qui a permis la mise en œuvre de la loi Veil sur l'IVG partira bientôt à la retraite. Or, la relève est loin d'être assurée, ce qui se traduira inévitablement par une dégradation des conditions d'accès à l'IVG. Ce constat avait même amené le groupe national d'appui à l'application de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG à préconiser l'extension aux sages-femmes de la possibilité de pratiquer des IVG médicamenteuses, considérant qu'elles ont la compétence technique pour le faire. Toutefois, une telle évolution nécessiterait de modifier la loi. La législation sur l'IVG touchant un domaine propre à susciter les controverses, une telle modification n'aurait rien d'anodin. Il serait sans doute préférable, dans un premier temps, de permettre à un nombre beaucoup plus conséquent de médecins généralistes de pouvoir pratiquer des IVG médicamenteuses, d'autant plus que ce sont les décrets d'application de la loi du 4 juillet 2001 qui ont fixé des conditions restrictives. Ces inquiétudes en matière de démographie médicale sont accentuées par le fait que la loi du 4 juillet 2001 prévoyait le rattachement des centres autonomes, créés au moment de l'adoption de la loi Veil, au sein des services hospitaliers. Le secteur consacré à l'IVG perd ainsi ses ressources propres et des redéploiements de moyens pourraient s'effectuer au détriment de l'IVG qui constitue un acte peu attractif pour les médecins. Pour bien des services, l'IVG est loin de constituer une priorité. Ainsi, l'assistance médicale à la procréation a été largement valorisée, tandis que l'IVG est bien souvent délaissée par les chefs de service et confiée à des médecins au statut professionnel précaire. Cette absence d'intérêt est également perceptible en ce qui concerne la formation des médecins. Au cours des études médicales, un nombre très réduit d'heures de cours, qui plus est facultatives, est consacré à l'avortement et à la contraception. Cette formation insuffisante a pour conséquence qu'un certain nombre de médecins, notamment généralistes, ne joue guère un rôle efficace d'orientation et de conseil. L'information des médecins repose presque uniquement sur l'initiative personnelle et n'est guère relayée ni encouragée par le ministère de la santé pour lequel ils ne constituent pas des interlocuteurs directs. 2) Un recueil de données statistiques inadapté Le système de recueil de données statistiques en matière d'IVG ne permet pas de disposer de données récentes sur le nombre d'IVG pratiquées, ni de mesurer de manière exacte certains critères pourtant essentiels comme les délais d'accès. Les dernières données publiées sont celles fournies en octobre 2005 par la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) du ministère de la santé et de la protection sociale. Or, ces données concernent l'année 2003. Ce décalage dans le temps est préjudiciable à une appréciation exacte de la situation et ne permet pas de mettre en oeuvre des actions efficaces pour résoudre les difficultés constatées. Il existe actuellement trois sources de données statistiques. Il s'agit en premier lieu des bulletins d'IVG que les médecins doivent obligatoirement remplir pour chaque IVG qu'ils pratiquent. Les bulletins ont été simplifiés, le système précédent s'étant avéré lourd, coûteux et mal exploité. Toutefois, ces bulletins dont le questionnaire est simplifié et qui sont identiques pour les déclarations en ville et en établissements de santé, ont été utilisés pour la première fois en 2004 et ne seront donc exploitables qu'en 2005. Ce sont les chercheurs de l'Institut National d'Études Démographiques (INED) et de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) qui sont chargés d'exploiter les données des bulletins de déclaration obligatoire d'IVG que remplissent les médecins. Ces chercheurs déplorent que depuis 1998, faute de saisie par l'administration, les bulletins soient inexploités, s'entassent et que la situation soit assez grave. Ils estiment que le bulletin simplifié ne permettra pas d'analyse précise de la pratique de l'IVG en France. Par ailleurs, il ne constitue pas une source réellement exhaustive puisqu'un pourcentage non négligeable d'IVG, notamment dans le secteur privé, ne donne pas lieu au remplissage du bulletin prévu à cet effet. Les chiffres les plus fiables sont ceux qui résultent des déclarations annuelles des établissements pratiquant des IVG. C'est donc cette source qui sert de référence pour la comptabilisation annuelle des IVG. Ils présentent cependant l'inconvénient de fournir des indications trop globales qui ne permettent pas de procéder à une analyse détaillée de la situation. Des renseignements sont également fournis par les données issues du Programme de Médicalisation des Systèmes d'information (PMSI). Les établissements publics et privés entrant dans le champ PMSI ont, en effet, l'obligation de produire des résumés de sortie standardisés à la fin des hospitalisations en court séjour. Ce codage informatique des actes donne des informations sur les IVG, même s'il ne permet pas de recenser à part les IVG pratiquées pour motif médical. Les données issues de la PSMI fournissent l'âge précis de la patiente lors de l'entrée en séjour, ce qui constitue une donnée précieuse, en particulier pour recenser les IVG chez les mineures. La structure par âge des femmes ayant recours à l'IVG est donc établie à partir de la PMSI. Pour tenir compte de la mise en place de l'IVG médicamenteuse en ville, l'ensemble de ces données est complété par une comptabilisation des ventes de médicaments servant à pratiquer l'IVG médicamenteuse. Les différentes sources existantes ne permettent guère de recueillir des renseignements précis sur la situation individuelle des femmes ayant recours à l'IVG. Ces éléments ne sont saisis qu'au travers d'enquêtes périodiques qui ne peuvent porter que sur un échantillon de femmes, avec tous les risques de distorsion par rapport à la réalité que cela comporte. Cependant, seules ces études de fond, de nature sociologique, permettent de bien appréhender la population des femmes ayant recours à l'IVG. Les associations, telles que le Planning familial peuvent elles aussi transmettre des informations à caractère empirique mais elles sont nécessairement parcellaires, en l'absence d'un système de collecte standardisé. Ce défaut de données complètes et récentes rend difficile et aléatoire la mise en place d'actions efficaces pour améliorer les conditions d'accès à l'IVG, les décideurs ne disposant pas en temps réel de toutes les informations pertinentes. III. LE NOMBRE ANNUEL D'IVG SE MAINTIENT A UN NIVEAU ÉLEVÉ, UNE POLITIQUE DE CONTRACEPTION MIEUX CIBLÉE S'AVÈRE INDISPENSABLE A. LE NOMBRE D'IVG SE MAINTIENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ 1) En raison de facteurs sociologiques Des derniers chiffres connus, à savoir ceux concernant l'année 2003, il ressort que le nombre d'IVG constaté sur une année est pratiquement stable (même si l'on enregistre une légère baisse de 1,6 % en 2003 par rapport à 2002) et relativement élevé si on le compare à celui des autres pays de l'Union européenne. Avant l'entrée dans l'Union européenne des dix nouveaux États membres, la France se situait en deuxième position, après la Suède et juste devant le Royaume-Uni. Seule l'entrée des pays de l'Est, où le nombre d'avortements est élevé, lui a permis de retrouver une position médiane. En France métropolitaine, le nombre d'IVG pratiquées en 2003 s'est élevé à 203 000, soit un taux de 14,1 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. La situation des départements d'outre-mer est particulièrement préoccupante puisque le nombre d'IVG annuel s'élève à 13 500, soit un taux de 28,8 pour 1 000 (le double de celui constaté en France métropolitaine). C'est en Guadeloupe que la situation est la plus alarmante, avec un taux de 41,5 pour 1 000, le nombre annuel d'IVG étant pratiquement équivalent à celui des naissances. Cette situation particulière des départements d'outre-mer nécessiterait des actions spécifiques pour y remédier. En trente ans, le nombre d'IVG est resté pratiquement stable, alors qu'on pouvait escompter que la diffusion de la contraception se traduirait par une diminution de leur nombre. Le recours à l'IVG est très différent selon les tranches d'âge, le taux étant particulièrement élevé dans la tranche de 20-24 ans (26,7 pour 1 000). C'est également parmi les femmes de moins de 25 ans que la fréquence du recours à l'IVG s'est le plus accrue depuis 1990. Près de 90 % des femmes ayant recouru à une IVG en 2003 avaient entre 18 et 39 ans. En France métropolitaine, on constate des disparités régionales importantes, sans lien direct avec les capacités d'accueil dans les établissements puisque neuf femmes sur dix font pratiquer leur IVG dans leur région de résidence. Le recours à l'IVG est particulièrement élevé en Ile-de-France et dans le Sud de la France. C'est également dans ces régions que les établissements privés effectuent une proportion importante d'IVG (la moitié, au lieu d'un tiers en moyenne nationale). Ces chiffres stables recouvrent néanmoins des comportements en évolution. En effet, depuis la loi Veil de 1975, la contraception médicale s'est diffusée de manière massive qu'il s'agisse de la pilule ou du stérilet, méthodes réputées pour leur fiabilité. Le nombre de grossesses non prévues a d'ailleurs fortement diminué. Ainsi, le nombre de grossesses non prévues qui s'élevait à 46 % des grossesses en 1975, n'en représentait plus que 36 % quinze ans plus tard et se situe actuellement à 33 %. Le nombre d'IVG n'en a pas pour autant diminué. En effet, le comportement des femmes confrontées à une grossesse non désirée s'est sensiblement modifié puisqu'elles décident beaucoup plus fréquemment de faire interrompre leur grossesse. Alors que quatre grossesses non prévues sur dix (41 %) se terminaient par une IVG en 1975, c'est le cas de six grossesses sur dix aujourd'hui (62 %). Le phénomène est particulièrement marqué chez les très jeunes femmes. Cette modification des comportements traduit une évolution des mentalités, avec l'émergence de la notion de maternité choisie, mais surtout une prise en compte grandissante par les femmes du contexte dans lequel survient une grossesse non prévue. Ainsi, les femmes décident davantage de recourir à l'IVG lorsque la grossesse peut avoir pour conséquence d'interrompre leurs études ou leur déroulement de carrière ou lorsqu'elles se trouvent dans une situation économique et sociale fragile (mineures, femmes au chômage). Cette attention renforcée au contexte dans lequel survient la grossesse ne correspond pas à une augmentation des comportements individualistes. Elle traduit le désir d'offrir à l'enfant le meilleur environnement possible. L'essor des taux de scolarité et d'activité féminins, de même que la précarité des conditions d'emploi qui touche particulièrement les femmes, rendent plus difficile le choix du moment opportun pour avoir un enfant. Il s'agit davantage, en l'occurrence, de grossesses reportées à une période plus favorable, plutôt que de grossesses refusées. Cette perception accrue de l'importance des conditions d'accueil de l'enfant devrait logiquement avoir pour corollaire une plus grande diffusion de la contraception. Or, celle-ci ne joue pas pleinement le rôle préventif nécessaire. 2) Des échecs de contraception encore trop fréquents Les derniers chiffres connus en matière de situation contraceptive des femmes au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG sont relativement anciens. En effet, ce sont ceux tirés de l'enquête Cocon réalisée en 2000 avec le soutien de l'INSERM. Ils fournissent néanmoins des indications précieuses. Au moment de la conception, près de la moitié des femmes concernées utilisaient une méthode contraceptive réputée fiable (23,1 % la pilule, 7 % le stérilet et 19,3 % le préservatif). Les femmes n'utilisant pas de méthode de contraception ne représentaient que 28,1 % du total et celles employant une méthode naturelle 19,1 %. L'utilisation du préservatif a augmenté, surtout chez les jeunes, du fait des campagnes de prévention menées contre le Sida. En effet, le préservatif étant la seule méthode efficace pour éviter la transmission des infections sexuellement transmissibles, son utilisation est privilégiée, notamment dans les situations de partenaires multiples, de relations occasionnelles ou d'absence de relation stable (en particulier chez les adolescentes). Il n'est pas toujours associé à une méthode contraceptive plus fiable comme la pilule. Or, le préservatif, lorsqu'il est utilisé comme méthode contraceptive, s'avère moins efficace que la pilule et le stérilet, du fait des risques de rupture et de glissement. Il nécessite donc une pédagogie ciblée afin d'être utilisé de manière optimale et une bonne connaissance des possibilités de rattrapage grâce à la contraception d'urgence, ainsi que des modalités pratiques pour accéder à celle-ci. La pilule constitue la méthode de contraception la plus efficace, son taux d'échec étant quasi nul en utilisation optimale. Toutefois, c'est une méthode relativement contraignante, l'oubli d'un ou de plusieurs comprimés compromettant son efficacité. Or, les oublis de pilule sont relativement fréquents et sont à l'origine de près de 20 000 IVG chaque année, soit près de 10 % de la totalité des IVG. L'enquête Coraliance (Contraception Orale & Observance) menée en 2001 sur la contraception orale et son observance a tenté d'évaluer le nombre d'oublis au cours des six derniers mois et le comportement adopté par les femmes lors de ces oublis. 617 gynécologues ont interrogé 3 316 de leurs patientes de plus de 18 ans sous pilule. 92 % des femmes ont déclaré avoir oublié leur pilule entre une à cinq fois au cours des six derniers mois. On n'a pas constaté de disparités géographiques ou familiales. Seul l'âge semble jouer : la tranche d'âge des 30-34 ans est celle qui oublie le plus souvent de prendre régulièrement ses comprimés. La plupart des pilules sont prises pendant trois semaines puis interrompues pendant une semaine. C'est au moment de la reprise du traitement que se situent la majorité des oublis. Or, comme le souligne Mme Elisabeth Aubény, gynécologue et présidente de l'Association Française pour la Contraception, « les premières pilules du cycle sont les plus importantes : l'ovulation pouvant ne pas être inhibée, une grossesse non désirée peut alors survenir. Il en va de même si la femme oublie une ou deux pilules au cours du cycle. Tout oubli supérieur à douze heures quel que soit le moment du cycle et avec n'importe quelle pilule oestroprogestative peut libérer l'ovulation et entraîner une grossesse ». Confrontées à ces oublis les femmes sont souvent désemparées, ce qui induit un risque conséquent de grossesse si aucune méthode ne prend le relais. Or, lorsqu'elles se trouvent dans cette situation, 32 % des femmes ne font rien de particulier et 14 % arrêtent la pilule suite à l'oubli. Un certain nombre de femmes ignorent donc que pour se prémunir alors d'une grossesse non désirée, il faut continuer la pilule là où elle a été arrêtée et recourir en plus au préservatif jusqu'à la fin du cycle. Cette insuffisance d'informations sur la conduite à tenir en cas d'oubli de pilule est aggravée par un recours encore trop limité à la contraception d'urgence. La loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 avait permis la délivrance de la contraception d'urgence à titre gratuit, sans prescription médicale, dans les pharmacies et autorisé, dans les établissements du second degré, les infirmières scolaires à administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures, à titre exceptionnel, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisée. Ces dispositions ont été reprises par la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption de grossesse et à la contraception dont l'article 24 précise que « le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal n'est pas requis pour la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures ». Le dispositif fonctionne bien en milieu scolaire : un protocole national sur la contraception d'urgence en milieu scolaire, détaillant la marche à suivre dans les établissements scolaires, a été annexé au décret du 27 mars 2001. La mise en œuvre de la contraception d'urgence par les infirmières scolaires est donc un succès. En revanche, sa distribution s'effectue de manière inégale dans les pharmacies, malgré la parution du décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence. En effet, les pharmaciens qui sont tenus de donner la contraception d'urgence aux mineures en faisant la demande, ne s'y conforment pas toujours. Cela est dû pour partie à des raisons financières. Toutefois, la situation devrait s'améliorer depuis qu'il n'y a plus de délai de remboursement et que celui-ci intervient sous huit jours. La principale difficulté demeure les réticences d'ordre psychologique. En effet, le décret astreint les pharmaciens à un entretien avec la jeune fille mineure avant de délivrer la contraception d'urgence. Or, le cadre d'une officine de pharmacie n'est pas très propice à un tel entretien. De plus, certains pharmaciens craignent que le recours à la contraception d'urgence n'incite les adolescentes à négliger de prendre une contraception régulière. Cependant, l'Ordre des pharmaciens s'emploie à favoriser l'application des textes en vigueur dans ce domaine. La contraception d'urgence apparaît encore comme insuffisamment utilisée. Cela ne résulte pas d'un manque d'information au sujet des méthodes de rattrapage, mais c'est surtout lié au fait qu'un certain nombre de femmes n'ont pas toujours conscience du risque de grossesse en cas de rapport non protégé. Les connaissances erronées en matière de cycle et de fertilité ont à cet égard des effets désastreux. Ainsi, une étude de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a établi que 86 % des femmes qui viennent demander une IVG connaissent la contraception d'urgence mais que 56 % n'y ont pas eu recours parce qu'elles pensaient ne pas être dans une période à risque. Or, la contraception d'urgence pour être efficace doit être prise dans les douze à soixante-douze heures qui suivent le rapport non protégé. Il est donc indispensable d'améliorer l'information des femmes. B. LA NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE DE CONTRACEPTION PLUS EFFICACE 1) Renforcer les actions d'information en matière de contraception a) Par des campagnes nationales d'information L'information en matière de contraception est un domaine que les pouvoirs publics semblent avoir délaissé depuis quelques années. Il est vrai que la priorité avait été accordée à la lutte contre le sida et que les actions d'information ont essentiellement porté sur ce thème, au détriment souvent de l'information relative à la contraception. L'information repose donc actuellement sur des structures éparses que ce soit le Planning familial, d'autres associations ou bien les professionnels de santé (médecins, infirmières, sages femmes). Le manque d'information constaté, notamment dans la tranche d'âge des femmes de vingt à trente ans où le taux d'IVG est le plus élevé, démontre bien qu'une information plus large et plus systématique que celle qui est dispensée actuellement s'avère nécessaire. Des campagnes nationales d'information sur la contraception étaient menées auparavant à périodicité régulière. La nécessité d'une campagne nationale d'information s'est imposée en 2000. En effet, la dernière campagne de communication publique consacrée exclusivement à la contraception remontait à 1982 ! Compte tenu du contexte de propagation de l'épidémie de sida, depuis 1992, les campagnes d'information initiées par le ministère de la santé étaient davantage orientées vers la prévention du sida et l'usage du préservatif. Or, de fortes inégalités sociales dans l'accès à l'information sur la contraception avaient été constatées. La campagne nationale d'information sur la contraception entreprise en 2000 entendait remédier à ces déficits d'information. Cette initiative a été reconduite en 2001 et en 2002 et a été interrompue depuis. La nécessité d'une nouvelle campagne nationale apparaît avérée et il serait souhaitable qu'une nouvelle campagne nationale, susceptible de toucher un large public, soit rapidement mise en place. b) Mieux informer en milieu scolaire Pour beaucoup d'adolescentes, la sexualité et la contraception demeurent des questions difficiles à aborder en famille. Toutes classes sociales confondues, la sexualité des jeunes reste bien souvent un sujet tabou. La peur du regard des adultes fait que les adolescentes ne sollicitent pas spontanément des informations auprès de leur entourage familial. Elles le font plus volontiers lorsqu'il s'agit de professionnels (médecins, infirmières scolaires, assistantes sociales...). Toutefois, les modalités d'accès à ces professionnels sont disparates et ne permettent pas d'assurer de manière systématique l'information de l'ensemble d'une classe d'âge. Quant aux informations que les adolescents se communiquent entre eux, elles présentent fréquemment un caractère approximatif et peu fiable. On constate que les déficits d'information se manifestent principalement chez les jeunes et qu'il subsiste de fortes inégalités dans l'accès à l'information. L'Éducation nationale a donc un rôle primordial à assurer dans ce domaine. Aux Pays-Bas, l'éducation à la sexualité est très efficace. En France, l'information dispensée aux élèves est encore trop rare et trop théorique. La conséquence en est que les adolescents parviennent difficilement à se réapproprier les connaissances dispensées et à en tirer des renseignements pratiques pour leur vie quotidienne. D'après les textes en vigueur, l'éducation à la sexualité est très peu présente en milieu scolaire. Elle n'est abordée en cycles 1 et 3 du primaire que comme une des fonctions du vivant et dans le cadre d'une approche comparative des modes de reproduction animale. Des séances obligatoires d'éducation à la sexualité ont été instituées par la circulaire n° 98-234 du 19 novembre 1998 relative à l'éducation à la sexualité et la prévention du sida. La durée annuelle minimale prévue n'était cependant que de deux heures. La loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception et la circulaire n° 2003-027 du 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées ont renforcé ce dispositif en rendant obligatoire trois séances chaque année d'éducation à la sexualité, par groupes d'âge homogène. Il est prévu que puissent être associés à ces séances, des personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs. Cette information reste cependant trop théorique et se traduit parfois par des erreurs d'appréciation des situations concrètes, de la part de certaines adolescentes, qui peuvent être lourdes de conséquences. Ainsi, les connaissances en matière de périodes de risques sont très insuffisantes, beaucoup d'adolescentes étant persuadées que l'ovulation a lieu automatiquement le 14e jour du cycle. C'est pourquoi, en cas de rapports non protégés, elles négligent de faire appel à la contraception d'urgence, pensant qu'il n'y a pas de risque de grossesse en dehors de cette période du 14e jour. Lorsqu'elles découvrent leur grossesse, l'IVG devient alors le seul recours possible. C'est ainsi qu'il y a chaque année près de 11 000 IVG dans la tranche d'âge 14-17 ans, ce qui est élevé, compte tenu du traumatisme psychologique que peut représenter l'IVG à cet âge de fragilité. Il est donc indispensable que les manuels scolaires et les professeurs de SVT, lorsqu'ils abordent la question de la reproduction humaine, insistent très clairement sur le fait qu'il n'est pas toujours évident de déterminer avec précision la période de fertilité. En effet, la période de fertilité ne se limite pas au jour de l'ovulation puisque les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours dans les voies génitales féminines. La période de fertilité est donc en principe de plusieurs jours (rarement plus de cinq ou six). De plus, le 14e jour ne constitue que la date théorique de l'ovulation, celle-ci étant susceptible de se produire à tout moment du cycle. L'Association française pour la contraception tente de sensibiliser les professionnels de santé sur cette question, notamment en diffusant des affiches sur le thème « ne comptez pas les jours, comptez sur une contraception efficace ». Il est toutefois évident que de telles actions ne parviennent à toucher qu'un public restreint, alors que le même message diffusé dans les établissements scolaires, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, aurait un impact autrement plus large. 2) Assurer une meilleure adéquation de la contraception aux besoins de chaque femme a) Par une prescription davantage personnalisée L'ensemble des méthodes contraceptives actuellement disponibles est suffisamment étendu pour qu'il soit possible de proposer à chaque femme celle qui paraît la plus adaptée à ses conditions de vie et à son âge. Or, le modèle dominant reste, aujourd'hui encore, celui d'une relation dans laquelle les décisions relèvent pour l'essentiel des professionnels de santé qui se montrent relativement directifs avec leurs patientes, lesquelles bien souvent, faute de connaissances en la matière, ne sont pas toujours en mesure d'exprimer leurs préférences. L'enjeu est pourtant essentiel. En effet, la non-adéquation de la méthode utilisée aux conditions de vie sociales, affectives et sexuelles des femmes risque d'entraîner des échecs de contraception. A cet égard, l'efficacité théorique d'une méthode contraceptive ne permet pas de préjuger seule de son efficacité pratique. C'est le cas notamment de la pilule dont le taux d'échec est quasiment nul en utilisation optimale, mais que des problèmes d'observance peuvent rendre inefficace. Seule une méthode de contraception bien comprise et bien maîtrisée par la femme est garante d'efficacité. C'est pourquoi, les professionnels de santé doivent informer leurs patientes de manière précise sur les taux d'efficacité théorique des méthodes proposées, leurs contraintes, leurs contre-indications, les méthodes de rattrapage éventuelles (en cas d'oubli de pilule ou de rupture de préservatif), ainsi que sur les modalités d'accès à la contraception d'urgence. Afin que la compatibilité avec leur mode de vie soit la meilleure possible, il est indispensable que les femmes soient étroitement associées au choix de leur méthode contraceptive. Cela suppose information, écoute et dialogue. b) Grâce à des méthodes de contraception variées et évolutives La période de fertilité des femmes au cours de leur vie est suffisamment longue pour qu'elles puissent avoir recours successivement à différentes méthodes de contraception, en fonction des changements qui interviennent dans leur mode de vie ou de leur âge. En ce qui concerne les adolescents, l'accent a été mis sur l'importance d'utiliser le préservatif qui constitue la seule protection efficace contre les maladies sexuellement transmissibles, en tout premier lieu le sida. Toutefois, il est loin d'être la méthode de contraception la plus efficace puisque son taux d'échec en usage courant est de 14 %. Il est donc prudent de l'utiliser en association avec un moyen de contraception plus fiable comme la pilule ou les implants. Dans le domaine de la contraception hormonale, on constate que le taux d'échec de la pilule est quasi nul mais que la principale difficulté provient des problèmes d'observance, les oublis compromettant son efficacité. La contraception hormonale ayant fait la preuve de son efficacité, il est toutefois possible d'administrer les oestroprogestatifs, tout comme les progestatifs, sous d'autres formes plus faciles d'utilisation car elles libèrent de l'obligation de prise quotidienne. Ces dispositifs paraissent particulièrement adaptés à la tranche d'âge des femmes de 20 à 30 ans qui considère la pilule davantage comme une contrainte que comme une libération, avec pour conséquence des oublis de pilule fréquents et un taux d'IVG plus élevé que dans les autres tranches d'âge. En matière d'oestroprogestatifs, les deux dispositifs sur le marché en France, en dehors de la pilule, sont les patchs et les anneaux vaginaux. Le patch contraceptif hebdomadaire est disponible depuis janvier 2004 dans les pharmacies. Ce timbre, délivré sur ordonnance, mesure 4,5 cm2 et doit être collé sur le bas de l'abdomen ou sur les fesses (son pourcentage de décollement est inférieur à 2 %). Il délivre à dose continue une combinaison de progestérone et d'oestrogènes pendant une semaine. Le patch doit être changé le même jour de la semaine pendant trois semaines. La quatrième semaine, la femme ne doit pas mettre de timbre. Il faut donc penser à en changer chaque semaine. Néanmoins, les oublis seraient beaucoup moins fréquents qu'avec la pilule. Il est commercialisé en boîte de trois patchs (soit pour un cycle), avec un prix qui varie entre 10 et 16 euros et qui ne fait pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale. On le trouve sur prescription depuis avril 2002 aux États-Unis, où il est devenu la deuxième méthode contraceptive, après la pilule. Depuis avril 2004, les oestroprogestatifs peuvent également être administrés par le biais d'anneaux vaginaux. Ces derniers délivrent régulièrement les hormones contraceptives pendant trois semaines. Au bout de trois semaines, l'anneau est retiré le même jour de la semaine que celui où il a été inséré, ce qui permet de déclencher les règles, et il est remplacé par un nouvel anneau une semaine plus tard. L'anneau mesure 5,4 cm de diamètre et la femme le place elle-même au fond du vagin, autour du col. Dans le cadre d'une étude portant sur plus de 2 300 femmes, l'insertion et le retrait de l'anneau ont été jugés faciles par plus de 95 % des utilisatrices. Ce contraceptif n'est pas remboursé par la sécurité sociale et son coût de revient est d'environ 15 euros par mois. En ce qui concerne les progestatifs, ils peuvent également être administrés sous une autre forme que la pilule, celle des implants qui sont commercialisés en France depuis mai 2001. L'implant se présente sous la forme d'un bâtonnet souple de 4 cm de longueur et 2 mm de diamètre. Il est inséré à la face interne du bras. La pose est rapide (1 mn 30), elle est effectuée sous anesthésie locale par un médecin ou une infirmière préalablement formée. L'implant libère de manière continue et pendant trois ans un progestatif, l'étonogestrel. Ce mode de contraception a fait la preuve de son excellente efficacité. Agissant dès les 24 premières heures qui suivent la pose, l'effet contraceptif est rapidement réversible lorsqu'il est retiré. Il est actuellement commercialisé sous le nom d'Implanon, au prix de 138,15 euros et est remboursé à 65 % par la sécurité sociale. Les dispositifs intra-utérins (stérilet) constituent également une méthode contraceptive très efficace. Toutefois, leur taux d'utilisation est assez faible, les médecins hésitant à les proposer à des femmes nullipares, du fait du risque de maladie inflammatoire pelvienne lié à la pose. Il représente néanmoins une bonne alternative pour les femmes à partir de 35 ans, en raison du risque cardio-vasculaire et cancéreux que fait courir la prise d'oestroprogestatifs à partir de cet âge-là. C'est pourquoi l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation en Santé (ANAES) préconise que ses bonnes pratiques de pose fassent l'objet d'un enseignement, notamment dans le cadre des organisations professionnelles. La stérilisation à visée contraceptive est autorisée depuis la loi du 4 juillet 2001. Elle ne peut néanmoins être pratiquée sur une personne mineure et nécessite un délai de réflexion, du fait de son caractère quasiment irréversible. La loi du 4 juillet 2001 a institué un délai de réflexion de quatre mois après la décision initiale de stérilisation et le recueil du consentement. La signature d'un consentement éclairé est obligatoire. Cette procédure stricte a pour but d'éviter les actes de stérilisation trop hâtifs ou abusifs. 50 000 femmes optent chaque année pour cette solution définitive. Les méthodes contraceptives mises à disposition devraient permettre de proposer des solutions adaptées à chaque situation individuelle. Ce n'est que par une utilisation plus répandue et plus efficace de la contraception que l'on pourra réduire le nombre de grossesses non désirées et infléchir ainsi le taux d'IVG pratiquées chaque année. * * * La Délégation aux droits des femmes s'est réunie, le mardi 29 novembre 2005, sous la présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann. Mme Bérengère Poletti a présenté l'ensemble des recommandations concernant le suivi de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception. La Délégation a adopté l'ensemble des recommandations proposées : 1. Lancer le plus rapidement possible une nouvelle campagne nationale d'information sur la contraception afin de mieux faire connaître la variété des méthodes contraceptives à la disposition des femmes ; renouveler régulièrement de telles campagnes de manière à délivrer des messages actualisés à un public féminin et masculin en constant renouvellement ; 2. Renforcer l'information sur les contraceptifs hormonaux de la troisième génération et favoriser leur diffusion, notamment les implants, les patchs et les anneaux vaginaux, particulièrement adaptés aux besoins de la tranche d'âge des femmes de 20 à 30 ans qui est celle où les oublis de pilule sont les plus fréquents et où le taux d'IVG est le plus élevé ; 3. Faire élaborer par le ministère de la santé des plaquettes informatives, simples, claires sur les différentes méthodes de contraception, les contraceptifs hormonaux de la troisième génération, la conduite à tenir en cas d'oubli de pilule, la contraception d'urgence, l'IVG et l'IVG médicamenteuse ; mettre ces plaquettes à disposition des professionnels de santé concernés (médecins généralistes et gynécologues, infirmières scolaires, centres de planning familial, centres de PMI) pour une large diffusion auprès des femmes ; 4. Faire élaborer par le ministère de la santé un guide du prescripteur en matière de contraception, dans lequel il conviendrait de sensibiliser les médecins à la nécessité d'adapter la contraception proposée au mode de vie et à l'âge des femmes ; 5. Attirer l'attention des professeurs de SVT sur l'importance des informations qu'ils communiquent concernant les périodes de fécondité humaine et s'assurer que les manuels scolaires véhiculent les messages appropriés, notamment que le 14e jour du cycle n'est qu'une date d'ovulation théorique, que l'ovulation peut intervenir à n'importe quel moment du cycle et que la période de fécondité est plus large que la date d'ovulation ; 6. Élargir à l'ensemble des médecins généralistes la possibilité de pratiquer l'IVG médicamenteuse en ville, dès lors qu'ils auraient suivi une formation spécifique ; 7. Activer la mise au point d'un protocole d'accord entre le ministère de la santé et celui de l'Éducation nationale pour assurer aux mineures s'absentant pour des démarches relatives à une IVG la garantie de confidentialité prévue par la loi du 4 juillet 2001. Personnalités entendues par la Délégation sur le suivi de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG et à la contraception Pages
Audition de Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, membre de l'IGAS, présidente du groupe national d'appui à la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 relative Réunion du mardi 7 décembre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé que, lors des débats sur la loi du 4 juillet 2001 modifiant la loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, les parlementaires avaient demandé la création d'un groupe national d'appui, chargé d'évaluer l'application du texte. Cette instance avait été constituée en février 2002 et Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, membre de l'IGAS, en avait été nommée présidente. Son rapport, publié en décembre 2002, avait dressé un tableau très complet des lacunes du dispositif et formulé dix recommandations destinées à une meilleure application de la loi. Par ailleurs, lors de sa séance du 22 septembre dernier, la commission des affaires sociales avait examiné une proposition de résolution de Mme Muguette Jacquaint tendant à la création d'une commission d'enquête sur l'application de la loi relative à l'IVG. Mme Bérengère Poletti, rapporteure, tout en repoussant cette demande, avait souhaité que la Délégation aux doits des femmes informe l'Assemblée nationale de l'application de la législation quant à l'accès effectif à la contraception et à l'IVG. Cette demande avait été approuvée par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, dont le Président, M. Jean-Michel Dubernard, avait adressé au ministre de la santé, le 23 septembre dernier, un courrier demandant que le groupe d'appui poursuive ses travaux, en étroite collaboration avec le Parlement et particulièrement avec la Délégation aux droits des femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann a indiqué que Mme Bérengère Poletti serait chargée du suivi de la loi du 4 juillet 2001 au sein de la Délégation. Elle a ensuite prié Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual de dresser à l'intention de la Délégation un bilan actualisé de l'application de la loi. Mme Bérengère Poletti a précisé que la proposition de Mme Muguette Jacquaint s'expliquait par le constat irréfutable d'importants dysfonctionnements et de blocages incompréhensibles. C'est pourquoi la commission des affaires culturelles, plutôt que de créer une commission d'enquête, ponctuelle, avait préféré une évaluation permanente, confiée à la Délégation. Celle-ci engage aujourd'hui ce travail avec l'audition de la présidente du groupe d'appui. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a observé que le groupe d'appui, en raison du caractère ponctuel de sa mission, ne s'était plus réuni après avoir rendu, en décembre 2002, son rapport au ministre. Cependant, suivant une procédure classique, la chef de l'Inspection générale a voulu, dix-huit mois après la publication du rapport, réunir la commission des suites et faire le point - en présence de représentants des différentes directions du ministère, ainsi que de celui de l'Éducation nationale et d'un membre du cabinet du ministre - de l'application des dix recommandations qu'il contient. La réunion, qui a eu lieu le 6 juillet 2004, a fourni l'occasion de faire un bilan administratif et statistique qui, pour intéressant qu'il soit, ne peut mesurer les difficultés quotidiennes d'accès à l'IVG. On connaît ainsi le nombre d'IVG pratiquées à l'hôpital ou en clinique dans chaque région, et selon quelle technique, mais aucun moyen ne permet de savoir si une femme voulant interrompre sa grossesse s'est heurtée à une porte close un jour donné dans un service hospitalier, si elle a été renvoyée d'hôpital en hôpital, ou si, parce qu'elle a été trop tardivement prise en charge, elle s'est trouvée être hors délais légaux. Les associations telles que le Planning familial transmettent des informations empiriques à ce sujet, mais il n'existe pas de système national de collecte permettant de mesurer ce type de difficultés. La commission des suites a donc proposé d'améliorer le système statistique, mais aussi de mesurer le délai d'accès à l'IVG. Cela commence à être fait, mais il ne s'agit que de moyennes, ce qui sous-entend de grandes distorsions. Autant dire que même les décideurs ne disposent pas de toutes les informations pertinentes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente s'est demandée si les informations relatives à l'IVG ne seraient pas plus faciles à obtenir au niveau départemental. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a estimé que, pour les recueillir, il faudrait lancer des enquêtes. Mieux vaudrait pouvoir compter sur la vigilance constante des ARH et des DRASS, et surtout sur celle des directeurs des établissements de santé et des services d'obstétrique et de gynécologie. La moindre des choses serait qu'ils s'intéressent à l'accès à l'IVG dans leurs services. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente a observé qu'en Lorraine, c'est pour eux une préoccupation constante, parce qu'ils ne parviennent pas à gérer le problème. Mme Bérengère Poletti a souligné que le constat de dysfonctionnements est unanime, et que ces dysfonctionnements ont parfois pour très grave conséquence que les femmes se trouvent hors délais légaux, ce qui les contraint à se rendre à l'étranger. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a indiqué que, de surcroît, pour des raisons médicales, l'IVG médicamenteuse oblige à prendre en charge les femmes dans des délais de réaction plus courts encore. Elle est ensuite revenue sur les circonstances de la création du groupe national d'appui. La constitution de cette instance avait été voulue par Mme Elisabeth Guigou, M. Bernard Kouchner et Mme Nicole Péry pour faire suite aux débats parlementaires relatifs à l'article 8 de la loi du 4 juillet 2001 relative à l'IVG, qui prévoit la réintégration dans le droit commun de l'organisation hospitalière des centres autonomes qui avaient été créés en 1975. A l'époque, de nombreux services hospitaliers étaient opposés à la prise en charge de l'IVG. Les centres autonomes, auxquels participaient des médecins et des équipes militantes, ont permis que les femmes accèdent à l'IVG. Après vingt-cinq ans, il avait paru souhaitable au législateur que ces centres trouvent un statut normal au sein des hôpitaux, et Mme Martine Aubry, ministre à l'époque, avait jugé nécessaire que les chefs de service concernés, quand bien même ils refuseraient, en invoquant la clause de conscience, de pratiquer eux-mêmes des IVG, organisent leur service de façon à les rendre possibles. Mais les médecins des centres autonomes ont craint de voir les moyens qui leur étaient jusqu'alors alloués captés à de toutes autres fins. Ces craintes ayant trouvé un écho au sein du Parlement, les ministres avaient pris l'engagement de créer un groupe de suivi, dont la mission a finalement été élargie, puisqu'il a également été chargé de rendre compte aux ministres « de l'état des difficultés existantes et de celles que la mise en œuvre de la loi du 4 juillet 2001 est susceptible de révéler ». Le groupe s'est réuni sept fois, et il a également procédé à sept réunions d'information et de débats avec les professionnels, notamment là où il avait été fait état de difficultés particulières : en Île-de-France, en Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur... ainsi que dans d'autres régions, en Alsace-Lorraine par exemple. Le groupe d'appui avait accordé une attention particulière à deux sujets qui avaient suscité une polémique : la prise en charge des IVG durant la onzième et la douzième semaines de grossesse, et l'éventualité que, dans des cas exceptionnels, les mineures soient dispensées d'autorisation parentale pour accéder à une IVG, disposition qui préoccupait fortement les professionnels, inquiets à l'idée que leur responsabilité pénale puisse être engagée en cas d'accident. Au terme de ces travaux, le groupe d'appui avait formulé dix recommandations, dont neuf pouvaient être appliquées sans réviser la loi. D'abord, il lui avait paru nécessaire de mesurer, de manière précoce et régulière, le nombre des IVG pratiquées ; les bulletins qui permettent de recueillir les informations sont mal remplis et exploités trop tardivement, ce qui ne permet de disposer des informations qu'après un délai de 3 ou 4 ans. Le groupe avait suggéré de distinguer entre la nécessité de disposer de statistiques simples et rapides qu'on peut obtenir dans le cadre des statistiques d'activité hospitalières classiques, et des études plus approfondies dont la fréquence n'a pas à être annuelle. Par ailleurs, le groupe avait souhaité disposer d'information sur les délais d'accès à l'IVG ; c'est ainsi qu'on dispose depuis cette année d'informations sur le délai moyen d'accès à l'IVG, qui s'établit sur la base de 11 jours environ à partir de données recueillies dans les établissements une semaine donnée dans l'année. En effet, la recommandation sur laquelle le groupe d'appui avait souhaité appeler l'attention particulière des ministres était la réduction des délais d'accès à l'IVG. Or, il apparaît qu'ils sont encore, parfois, de quinze jours, voire de trois semaines dans certaines régions et à certaines périodes de l'année. Il reste donc beaucoup à faire pour remédier à cette situation insatisfaisante. Les autorités sanitaires et les établissements doivent être mobilisés sur ce point. Pour faciliter la prise en charge des IVG durant la onzième et la douzième semaines de grossesse - ce que certains services refusaient de faire - le groupe avait suggéré qu'au moins un établissement par département en soit chargé, évitant ainsi que certaines femmes se trouvent refoulées, à ce stade de leur grossesse, à des centaines de kilomètres de leur lieu de résidence pour subir une IVG une situation profondément choquante -. Sur ce point, le bilan dressé par la commission des suites montre qu'une régularisation progressive s'opère. S'agissant de la prise en charge des mineures, le groupe a reçu l'aide bienvenue de la Société française d'anesthésie-réanimation, qui a largement fait savoir à ses membres que, de par la loi, leur responsabilité pénale n'est pas engagée s'ils pratiquent une IVG sur une mineure dépourvue d'autorisation parentale. Les esprits s'en sont trouvés apaisés et, progressivement, la prise en charge de ces jeunes filles s'est mieux faite. Mme Bérengère Poletti a observé que demeure en suspens le problème posé par le fait que les établissements d'enseignement sont tenus de signaler aux parents l'absence des élèves, quel qu'en soit le motif. Une convention devrait donc être signée à ce sujet entre le ministère de la santé et celui de l'Éducation nationale, ce qui ne sera pas facile. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est demandée comment on pourrait résoudre cette contradiction, puisqu'il en va de la responsabilité des chefs d'établissement. Selon Mme Emanuèle Jeandet-Mengual, la difficulté est réelle. L'Éducation nationale considère également que les médecins, infirmières scolaires, ou tout autre agent, qui acceptent d'être la « personne accompagnante » exigée par la loi dans ce cas le font sous leur responsabilité personnelle. Il est dommage que les deux ministères ne parviennent pas à s'entendre à ce sujet, le ministère de l'Éducation nationale considérant le problème sous son seul aspect juridique, alors qu'il a aussi une dimension sociale. La question a de nouveau été abordée par la commission des suites de l'IGAS ; le ministre de la santé a adressé un courrier à ce sujet au ministre de l'Éducation nationale. Le groupe de suivi avait aussi recommandé de mieux articuler contraception et IVG et, dans un autre domaine, de dégager les conditions satisfaisantes d'une intégration des centres autonomes dans le droit commun hospitalier, en préservant leurs moyens et en évitant qu'ils ne soient « détournés » à d'autres fins. Il avait également suggéré d'inciter les cliniques privées à prendre en charge un plus grand nombre d'IVG, en tout cas à éviter tout désengagement. Le fait que le « forfait IVG » n'ait pas été revalorisé depuis 1991 était très peu incitatif, et le groupe avait donc suggéré l'ouverture de négociations financières à ce sujet. Actuellement, environ les deux tiers des IVG sont pratiqués dans les hôpitaux, qui seraient en grande difficulté si le tiers restant basculait dans leurs services. Cela vaut particulièrement en région parisienne, où la répartition se fait par moitié entre le public et le privé : un reflux vers l'hôpital public y serait ingérable. Le forfait vient d'être revalorisé par le ministre de la santé. Le groupe d'appui avait aussi suggéré d'améliorer l'information des femmes. Une seule de ses recommandations imposait une révision de la loi de 2001 : l'anticipation des effets de la démographie médicale par la révision du rôle des sages-femmes dans la prise en charge des IVG. En effet, la génération militante va partir à la retraite et elle ne sera remplacée ni en nombre ni en ardeur : les jeunes médecins, s'ils n'ont pas de réticences idéologiques, n'ont pas non plus de motivation militante. Le groupe d'appui a dit son inquiétude au ministre et plaidé en faveur de l'élargissement à l'IVG du rôle des sages-femmes, car elles en ont toutes les compétences techniques nécessaires. Mais cela supposerait une modification de la loi, qui dispose que les IVG doivent être pratiquées par un médecin. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, l'a interrogé sur l'absence de motivation des jeunes praticiens. Pour Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, ils trouvent l'acte sans grand intérêt, non gratifiant, et compliqué sur le plan psychologique. De plus, ils sont débordés. Mais plus de 200 000 IVG sont pratiquées chaque année en France - qui est l'un des pays européens où l'on en pratique le plus -. C'est donc un acte très courant, et il faudra faire face. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est demandée si une éducation plus sérieuse à la contraception ne réduirait pas le nombre d'IVG. Pour Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual, les sociologues ont des avis assez partagés à ce sujet. Il n'est pas certain que l'accroissement de la contraception entraînerait automatiquement la chute du nombre des IVG. Ainsi, on aurait pu penser que le développement de la contraception d'urgence réduirait notablement les IVG, mais cela ne semble pas être le cas. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'il faudrait néanmoins insister sur la prévention. Pour Mme Bérengère Poletti, la question est abordée dans les collèges et les lycées, mais il n'y a pas de campagne nationale. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a relevé que, hormis quelques initiatives locales, il n'y a pas de campagne nationale en faveur de la contraception. Il y en a eu une en 2000 et en 2001, après des années de silence ; il n'y en a plus depuis 2001. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité connaître les raisons du plus grand nombre d'IVG en France par rapport aux autres pays européens. Mme Bérengère Poletti a estimé qu'il faudrait comparer les chiffres relevés dans les autres pays européens en les mettant en parallèle avec les politiques menées. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a souligné le nombre important, entre 200 000 et 210 000 par an, d'IVG en France. Depuis l'élargissement, la France est en position médiane, mais elle était auparavant un des pays de l'Union où il s'en pratiquait le plus. C'est pourquoi le groupe d'appui avait recommandé de mieux articuler contraception et IVG, et de mieux informer filles et garçons. Mme Hélène Mignon a indiqué que l'accent avait été mis sur la protection contre le sida, et qu'on avait laissé de côté l'information sur la contraception. De plus, certaines jeunes filles et jeunes femmes considèrent la prise quotidienne d'un contraceptif oral trop contraignante. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a observé qu'il existait d'autres moyens contraceptifs, tels que les patchs ou les implants. Mme Bérengère Poletti a relevé que leur utilisation est encore marginale et que la question du remboursement peut se poser, car les innovations ne sont pas toujours remboursées. Elle a souhaité connaître la répartition des IVG par tranches d'âge. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a indiqué que selon les indications qui figurent dans le numéro d'octobre 2004 de la brochure Etudes et résultats publiée par la DREES, 206 000 IVG ont été recensées en France métropolitaine en 2002, ce qui représente une augmentation de 1,7 % en un an. On comptait 14,3 IVG pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans. Cinq pour cent environ ont été pratiquées sur des adolescentes, quelque 48 % dans la tranche des 18-24 ans, 22 % chez les 25-30 ans, puis le nombre décroît régulièrement. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé la nécessité de mener des campagnes de sensibilisation à la contraception. Mme Héléne Mignon a estimé que toutes ces IVG traduisent aussi les relations à l'intérieur des couples, la fuite de certains hommes quand une grossesse leur est annoncée, ainsi qu'une certaine inconséquence, même chez des jeunes femmes diplômées. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a observé qu'il serait intéressant pour la Délégation d'entendre des sociologues. Mme Bérengère Poletti a souhaité savoir si des discussions avaient été engagées, comme le recommandait le groupe d'appui, avec les représentantes des sages-femmes. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual lui a répondu qu'elles avaient eu lieu avec les représentants des sages-femmes ainsi qu'avec ceux des gynécologues-obstétriciens. Le bilan de la commission des suites montre que la proposition n'a suscité ni enthousiasme ni résistance et que les médecins ne s'opposeraient pas à ce que les compétences des sages-femmes soient étendues aux IVG. Mais il faudrait pour cela réviser la loi, dont chacun sait que ce n'est pas une loi comme une autre, et le ministre n'a pas jugé opportun de le faire. Enfin s'agissant de l'IVG médicamenteuse en ville, le groupe d'appui avait préconisé sa mise en œuvre rapide. Or, la mise en œuvre de cette disposition novatrice de la loi de juillet 2001 a été entravée par une série d'obstacles telle que l'on semble sortir du domaine rationnel. La commission des suites de l'IGAS s'en est étonnée, ce qui a peut-être contribué à la publication, en juillet dernier, de l'arrêté permettant le financement de la mesure. La circulaire d'application qui permettra aux femmes d'être remboursées vient de paraître. Il paraît invraisemblable que trois années et demie se soient écoulées sans que cette disposition soit appliquée, alors qu'elle n'avait suscité aucune opposition lors du vote de la loi et qu'elle devait aussi servir à soulager des plateaux hospitaliers débordés. C'est à la fois incroyable et profondément dommageable pour les femmes. Mme Bérengère Poletti a souligné la nécessité de faire savoir aux médecins libéraux qu'ils doivent se rapprocher de l'hôpital pour établir le protocole à suivre en cas d'incident survenu à cette occasion dans leur cabinet. Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a observé que la circulaire s'adresse aux autorités sanitaires et que rien ne semble spécifiquement prévu pour l'information des médecins de ville. Probablement, en tout cas dans un premier temps, seuls les médecins militants pratiqueront l'IVG médicamenteuse, et non pas la grande majorité des généralistes ou des gynécologues. Pour finir, Mme Emmanuèle Jeandet-Mengual a souhaité attirer l'attention de la Délégation sur la situation de l'IVG dans les DOM, où un nombre très élevé d'IVG est recensé, surtout à la Guadeloupe, où l'on compte presque autant d'interruptions de grossesse que de naissances, avec 41,2 IVG pour 1 000 femmes, contre 14,3 en métropole. Un programme de santé publique spécifique s'impose. En conclusion, des progrès ont eu lieu, mais il faut rester attentif à l'application de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse car, aussitôt que la volonté politique fléchit, la mobilisation administrative marque le pas et les difficultés resurgissent très vite. Si une politique volontariste n'est pas conduite, la régression est certaine. Après avoir observé qu'il en est toujours ainsi lorsqu'il s'agit de femmes, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Jeandet-Mengual pour son exposé d'un grand intérêt. Audition de Mme Elisabeth Aubény, gynécologue, Réunion du mardi 14 décembre 2004 Présidence de Mme Bérengère Poletti, Mme Bérengère Poletti a remercié Mme Elisabeth Aubény d'avoir répondu à l'invitation de la Délégation et a rappelé que la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, qui n'a pas souhaité créer une commission d'enquête sur l'accès effectif à l'IVG et à la contraception, a confié à la Délégation aux droits des femmes la mission d'étudier cette situation. C'est ce que cette dernière a commencé à faire la semaine dernière, en ouvrant une série d'auditions destinées à aborder les questions de contraception et d'IVG, notamment la mise en œuvre de l'IVG médicamenteuse, et à comprendre les raisons pour lesquelles, en dépit de certaines évolutions positives, le nombre des IVG ne décroît pas. Le décret sur l'IVG médicamenteuse vient de paraître, trois ans après le vote de la loi sur l'IVG, et non sans difficultés. Aussi la Délégation souhaite-t-elle savoir comment améliorer l'accès à cette IVG moins traumatisante, comment le travail peut s'organiser avec les médecins de ville, s'ils sont bien informés et si leur intervention est de nature à soulager les hôpitaux avec lesquels ils resteront en relation permanente. Il serait également intéressant de connaître l'appréciation de la présidente de l'A.F.C. sur les nouvelles pilules et sur la contraception d'urgence, notamment l'impact de la clause qui autorise la mise à disposition de cette contraception dans les établissements scolaires. Mme Elisabeth Aubény a d'abord évoqué le thème important de la contraception d'urgence, qui commence à entrer dans les moeurs alors que le vote de cette disposition en 2001 avait été difficile. Les femmes y ont désormais accès directement, sans prescription médicale dans 95 % des cas, et cela n'a pas fait chuter la contraception habituelle. Pour autant, ce ne sont pas celles qui devraient y avoir recours qui s'en servent. Selon une étude de l'INSERM, 86 % des femmes qui viennent demander une IVG connaissaient la contraception d'urgence, mais 56 % n'y ont pas eu recours parce qu'elles ne se croyaient pas « à risque ». Et cette croyance vient tout simplement du fait qu'on leur a appris à l'école qu'elles ne pouvaient ovuler qu'au quatorzième jour du cycle. Or, si cela est vrai en théorie, dans la pratique une femme peut être enceinte à n'importe quel moment du cycle. L'Association Française pour la Contraception a donc pris des contacts avec les professeurs de sciences de la vie et de la terre (SVT) pour en finir avec cette affirmation trop théorique. Il conviendrait donc qu'ils rectifient le contenu de leur enseignement, car leur pouvoir de persuasion sur leurs élèves est considérable. Il serait également important d'insérer un encart à ce propos dans les livres scolaires, mais il semble bien difficile de l'obtenir des éditeurs. Par ailleurs, les médecins hésitent à recommander d'emblée, dès la prescription de la contraception classique, le recours à la contraception d'urgence en cas d'échec de cette contraception classique ou du préservatif, car ils ont le sentiment d'inciter ainsi les femmes à relâcher leur vigilance. Il faut pourtant absolument faire savoir qu'une erreur n'est pas dramatique, qu'on peut la réparer. En revanche, la mise en œuvre de la contraception d'urgence par les infirmières scolaires est un grand succès, et le législateur a fait là une œuvre éminemment utile. La moitié seulement des 15 000 jeunes qui s'informent chaque année ont vraiment besoin de cette contraception, les autres viennent pour parler de leurs problèmes. Bien sûr, la contraception d'urgence a permis d'éviter des grossesses chez les adolescentes, mais elle leur a surtout permis de parler et c'est très important. De ce point de vue, l'augmentation du nombre d'infirmières scolaires est à saluer. On observe aussi que les pharmaciens, qui devraient donner la contraception d'urgence aux mineures, ne le font pas toujours. On peut toutefois penser que les choses vont s'améliorer maintenant qu'ils n'ont plus de délais de remboursement et qu'ils sont remboursés dans les huit jours qui suivent. Une autre difficulté tient au fait qu'on leur demande de parler aux adolescentes, ce qui n'est pas facile. Mais l'Ordre des pharmaciens fait des efforts très importants. Certains ont également des réticences morales, car ils pensent qu'ils incitent ainsi les adolescentes à prendre moins de contraception régulière. Mme Bérengère Poletti a convenu qu'il n'était pas forcément facile d'engager la conversation avec une adolescente, souvent réticente, au milieu d'une pharmacie... Par ailleurs, si la contraception d'urgence n'a pas remplacé la contraception orale, elle n'a pas non plus fait chuter le nombre des IVG ; quelles en sont les explications ? Mme Elisabeth Aubény a insisté sur le fait que beaucoup d'adolescentes prennent des risques, mais ne font rien. Celles qui se montrent responsables et courageuses en venant demander la contraception d'urgence devraient être félicitées. Le développement du recours à la contraception d'urgence tient sans doute à la combinaison de plusieurs facteurs : relâchement dans l'usage des préservatifs contre le sida, augmentation du nombre des incidents dans la prise de la pilule, etc. En Finlande, où l'on dispose de statistiques mises à jour tous les six mois, il est apparu que le nombre des IVG chez les adolescentes reculait. En France, on ne dispose que des chiffres de 2002, soit 18 mois après l'entrée en vigueur de la loi, ce qui est sans doute trop tôt pour observer de vraies tendances. Il semble que les femmes qui ont recours à la contraception d'urgence soient toujours les mêmes, les plus consciencieuses. Il faut donc faire porter l'effort sur les autres, et passer par les médecins, qui devraient faire plus de prévention, et même délivrer des prescriptions de cette contraception d'urgence à l'avance. L'Association Française pour la Contraception intervient partout en France en direction des professionnels, auxquels elle diffuse par exemple des affiches sur le thème « Ne comptez pas les jours, comptez sur une contraception efficace ! », ainsi que des films destinés à faire réagir les élèves au moment où une information sexuelle leur est dispensée. Ces documents ont bénéficié du soutien financier de la Direction générale de la santé, mais pas de celui du Ministère de l'Education nationale... Au congrès des infirmières scolaires et dans les centres de planification, 2 000 cassettes ont été vendues. Mme Danielle Bousquet a souligné que cela faisait fort peu pour 13 000 collèges et lycées... Elle a également observé qu'il ne fallait pas confondre les cours d'anatomie dispensés en SVT et l'éducation sexuelle. Mais, s'il y a un problème pour les cours de SVT, il semble légitime que l'Inspection générale rectifie le contenu des programmes, d'autant qu'il s'agit d'une question de santé publique. Les formateurs des IUFM devraient aussi être mobilisés. Dans le cadre de la formation continue, on pourrait faire passer le message que si, en théorie, l'ovulation intervient le 14e jour, dans la pratique on peut être enceinte à un autre moment. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a considéré que l'amélioration de la formation des professeurs de SVT et l'amélioration des supports pédagogiques pourraient faire partie des recommandations de la Délégation, car, comme souvent, tout part de l'éducation. On sait en outre que les adolescents écoutent plus leurs professeurs que leurs parents et qu'ils se confient davantage aussi aux premiers. Sur les manuels également, il faudrait que l'Inspection générale intervienne, en particulier pour introduire la notion de fertilité dans les programmes de SVT. Elle s'est interrogée par ailleurs sur la possibilité de recommander l'intervention d'un professionnel. Mme Danielle Bousquet a jugé cette proposition incompatible avec l'autonomie des enseignants, réputés seuls détenteurs de la connaissance devant leurs élèves. Se poserait par ailleurs le problème de la rémunération des intervenants. Une telle intervention paraît donc possible dans le cadre de l'éducation sexuelle, grâce au Planning familial et aux associations, mais pas en cours de SVT. Mme Elisabeth Aubény a souhaité que les éducateurs, qui sont de plus en plus formés par l'Éducation nationale, ne se referment pas sur eux-mêmes et qu'ils entendent la parole des professionnels. Malgré toute leur importance, les efforts accomplis à l'école ne suffisent pas. Pour que l'excellente loi sur la contraception donne sa pleine mesure, il faut s'adresser davantage à la classe d'âge dans laquelle on avorte le plus, celle des jeunes femmes de 20 à 30 ans, qui auraient bien besoin que l'on réactive les informations qu'elles ont reçues plus tôt. Or les médecins sont débordés et les jeunes femmes de cette tranche d'âge ne s'adressent pas au Planning familial. Il faudrait donc les toucher notamment par le biais des universités. Mme Bérengère Poletti a considéré que cela relevait de la santé publique, donc des médecins traitants. Mme Elisabeth Aubény a observé que les médecins apprécient que les femmes aient déjà réfléchi à leur contraception quand elles viennent les voir. Il faut donc que l'information ait été donnée avant, ailleurs. En outre, les médecins sont souvent réticents à dire que la pilule n'est pas totalement efficace, alors que 23 % des femmes la prennent mal. Pour que le Planning familial puisse jouer ce rôle d'information, il faudrait qu'il ouvre des antennes dans des lieux publics comme les supermarchés, sur le modèle de ce qu'avaient fait certaines associations sur les plages pour informer sur le sida. Mme Danielle Bousquet a proposé que l'on fasse appel à la médecine du travail, qui pourrait aborder ces questions à l'occasion d'un autre examen. Mme Elisabeth Aubény a trouvé l'idée excellente. Mme Bérengère Poletti a estimé que cela permettrait à ces médecins d'aller plus loin que de poser la question habituelle « Prenez-vous un contraceptif ? » et leur permettrait d'informer sur la fertilité de la femme. Elle a proposé que la Délégation entende, outre un représentant de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, un formateur en IUFM, et un inspecteur du travail. Par ailleurs, elle a souhaité connaître les raisons pour lesquelles l'échec de la contraception entraînait désormais 6 femmes sur 10 à recourir à l'IVG, contre 4 sur 10 auparavant. Mme Elisabeth Aubény a confirmé que, selon l'INSERM, moins de femmes se trouvent enceintes sans l'avoir voulu, mais que, quand elles le sont, elles se font plus souvent avorter, non par égoïsme, mais parce qu'elles ne peuvent garantir le bien-être de l'enfant. On l'a dit, 21,6 % des femmes qui demandent une IVG utilisent la pilule, 12 % le préservatif ; c'est ce qui expliquerait largement le recours à la contraception d'urgence. Elle a souhaité dire également un mot des nouvelles formes de contraception, destinées à durer plus longtemps, comme les anneaux vaginaux qu'on change une fois par mois ou les patchs. Ces contraceptifs libèrent de l'obligation de prise quotidienne, ils coûtent 15 euros par mois, mais ils ne sont pas remboursés, non plus que les futurs contraceptifs à prise semestrielle ou annuelle ou que les pilules que l'on prend tous les jours pour éviter les oublis liés à l'interruption de la prise pendant une semaine. En fait, il ne s'agit pas de nouveaux produits - on continue à mélanger oestrogènes et progestérone - mais de nouvelles formes, plus faciles d'utilisation, dont on peut regretter qu'elles ne soient pas remboursées. Il faut faire attention aux contraceptifs qu'on garde très longtemps, comme les stérilets, car les femmes qui en portent ne vont plus voir leur gynécologue, ne se font plus faire de frottis, ni de mammographie. Il faut expliquer aux femmes que l'absence de surveillance de leur contraceptif ne doit pas empêcher le dépistage. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est demandé si on pourrait envisager de rembourser ces produits et de ne plus rembourser ceux de la génération précédente. Mme Elisabeth Aubény a déclaré que l'efficacité des contraceptifs dépendait des femmes. Il faut donc leur ouvrir toute une gamme de possibilités. Mais on comprendrait mal qu'on pénalise les femmes qui n'ont pas de problème d'oubli avec les pilules actuelles. Certes, les nouveaux produits coûtent 30 % plus cher, mais ce n'est pas une raison suffisante. Ainsi, en Angleterre tous les contraceptifs sont remboursés. En France, parmi les nouveaux contraceptifs, seul le petit bâtonnet d'Implanon est remboursé. Mme Danielle Bousquet a voulu savoir si des arguments sérieux s'opposaient à ce remboursement. Mme Elisabeth Aubény a répondu que les laboratoires qui ont le monopole ne le demandaient tout simplement pas, parce qu'ils pensent que le Gouvernement fixera un prix insuffisant à leurs yeux. S'agissant de l'IVG médicamenteuse, elle a rappelé qu'il a fallu trois ans et demi pour qu'elle entre dans les faits, après une loi, deux décrets, un arrêté et une circulaire. Désormais, les médecins de ville peuvent la pratiquer en ville, après une convention avec un centre référent, qui doit leur proposer des formations. L'accueil a été divers. Si les grands centres universitaires se mobilisent Mme Danielle Bousquet a demandé comment les médecins avaient été informés. Mme Elisabeth Aubény a indiqué que l'information n'avait pas été officielle et avait été diffusée surtout par les publications spécialisées et par le bouche-à-oreille. Elle-même étant gynécologue, elle ignore si tous les généralistes ont été informés, mais elle a constaté que les obstétriciens, dont certains font beaucoup d'IVG médicamenteuses, avaient parfois du mal à « passer la main » aux généralistes et à accepter de les former. C'est pourtant la solution d'avenir, car il y a peu d'obstétriciens. Mme Bérengère Poletti a rappelé que le but de la pratique de l'IVG médicamenteuse par les médecins de ville n'était pas un partage de la clientèle, mais son augmentation, de manière à ce que les femmes recourent moins souvent à l'IVG chirurgicale. Aller voir son médecin traitant est quand même plus facile que se rendre à l'hôpital, et l'on peut penser que les femmes le feront plus tôt. Mme Elisabeth Aubény s'est déclaré persuadée que l'on va recourir à l'IVG médicamenteuse de façon beaucoup plus précoce et que le nombre des IVG chirurgicales va ainsi diminuer. Plus on intervient tôt, plus l'acte est sûr et moins les dégâts physiologiques et psychologiques sont importants. Les médecins de ville ne sont pas très satisfaits de devoir acheter et revendre les médicaments, ainsi que d'être obligé d'administrer le misoprostol dans leur cabinet, car les douleurs, voire l'expulsion, peuvent intervenir dans des délais assez brefs. Alors que le décret laisse le libre choix du dosage de la Mifégyne (qui met fin à la grossesse) et du Gymiso (qui provoque l'expulsion), certains, se fondant sur des études de l'OMS disant que cela serait moins onéreux, font pression sur l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour que l'on modifie l'autorisation de mise sur le marché en diminuant la dose du premier. Mais il faudrait augmenter les doses de misoprostol, ce qui rendrait les contractions d'expulsion beaucoup plus douloureuses. Il faut donc tout faire pour qu'on en reste au texte actuel, surtout au moment où l'IVG médicamenteuse va être réalisée par les médecins de ville. Mme Danielle Bousquet a jugé que cette modification serait d'autant plus regrettable que, hors de l'hôpital, les femmes vont se trouver bien démunies face à la douleur. Mme Elisabeth Aubény a estimé souhaitable d'attendre les observations de la commission de suivi avant toute modification. Il ne faudrait pas non plus que, par souci d'économie, on pousse toutes les femmes à recourir à l'IVG à domicile. On imagine mal, par exemple, qu'une jeune fille qui n'a rien dit à ses parents subisse saignements et douleurs au domicile familial... De même, l'hôpital est préférable au-delà de 49 jours d'aménorrhée, car les saignements sont alors très forts. Le choix doit donc rester ouvert, comme le législateur l'avait souhaité. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a insisté sur le rôle de l'hôpital pour la sécurité des plus jeunes et des plus fragiles. Mme Elisabeth Aubény a indiqué que deux problèmes demeurent non résolus. D'une part, les centres de planification souhaiteraient réaliser des IVG médicamenteuses, mais se heurtent à un problème de conventionnement, le médecin qui signe l'acte n'étant pas rémunéré directement. D'autre part, l'acte n'est pas coté pour les hôpitaux, à la différence des médecins de ville, ce qui les oblige à facturer une hospitalisation fictive étant donné qu'ils doivent garder les femmes durant trois heures. Mme Danielle Bousquet a rappelé que les actes d'IVG étaient très mal indemnisés et souhaité savoir si la revalorisation de 30 % qui est intervenue a satisfait les médecins. Mme Elisabeth Aubény a répondu que dorénavant les médecins étaient indemnisés correctement, et a tenu à en remercier les femmes députées car, sans elles, l'IVG médicamenteuse n'aurait jamais été autorisée. Elle a par ailleurs indiqué que, maintenant que la loi française permet les IVG entre la 12e et la 14e semaine d'aménhorrée, les Hollandais disent ne presque plus recevoir de Françaises se trouvant dans cette période. Ils en reçoivent néanmoins toujours au-delà. On peut toutefois penser que l'IVG médicamenteuse va faire diminuer ce phénomène. Représentant aujourd'hui 30 % du total des IVG, elle favorise la liberté des femmes, qui gèrent elles-mêmes leur IVG, mais aussi leur responsabilité. En effet, il ne faut pas laisser ceux qui s'y opposent dire qu'il est plus facile d'avoir une IVG médicamenteuse - qui dure quand même 48 heures et qui fait que la femme va assister à l'expulsion - que d'avoir une IVG chirurgicale, où la femme est sous anesthésie. Mme Bérengère Poletti a jugé les deux traumatismes différents, mais réels et difficiles à hiérarchiser : dans les deux cas, les femmes sont choquées. Mme Elisabeth Aubény a souligné l'importance pour les femmes de pouvoir choisir la technique d'IVG utilisée. Audition de Mme Nathalie Bajos, chercheure à l'Institut national de la santé et Réunion du mardi 18 janvier 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Dans le cadre de sa mission de suivi de l'application de la législation relative à l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a accueilli Mme Nathalie Bajos, chercheure à l'INSERM dont l'article intitulé « Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-il pas baissé en France depuis 30 ans ? », paru dans Population et sociétés de décembre 2004, est pour le moins troublant. Alors que le législateur de 1974 espérait que la diffusion des moyens contraceptifs entraînerait la diminution progressive du recours à l'avortement, l'article démontre que, trente ans après la promulgation de la loi autorisant l'IVG, sa fréquence, relativement élevée, reste la même, et qu'il continue de s'en pratiquer environ 200 000 chaque année en France. Les modifications apportées par la loi du 4 juillet 2001 n'ont, semble-t-il, pas permis d'amélioration. Dans ces conditions, que faire ? Mme Nathalie Bajos a précisé que cette étude constituait la une synthèse de travaux réalisés par l'équipe qu'elle dirige et qui tendaient, en ce trentième anniversaire de la loi Veil, à alimenter et à éclairer le débat public sur le double paradoxe français : en premier lieu, le taux de recours à l'IVG est resté remarquablement stable en dépit d'une large diffusion de moyens contraceptifs - pilule et stérilet - à l'efficacité théorique très élevée. En second lieu, on dénombre en France, pays qui détient le record du monde des utilisatrices de contraception, encore 30 % de grossesses non prévues qui, pour la majorité, conduisent à des IVG. La seule manière de comprendre la stabilité du recours à l'IVG consiste à décomposer le processus qui y conduit. Il faut d'abord que la femme ait des rapports sexuels sans souhaiter être enceinte ; il faut ensuite qu'elle n'utilise pas de méthode contraceptive ou qu'elle rencontre un échec de contraception ; il faut encore que, face à cette grossesse imprévue, elle choisisse de l'interrompre, et enfin qu'elle accède à temps à l'IVG dans les conditions prévues par la loi. Etant donné cette succession d'événements, il fallait déterminer si la stabilité du nombre d'IVG traduit la stabilité de chaque étape du processus ou si des évolutions contraires se compensent. Qu'en est-il au juste ? La population concernée reste stable, puisque l'âge au premier rapport sexuel a très peu diminué et que la fréquence des rapports sexuels n'a pas varié; l'exposition au risque de grossesse est donc globalement la même. Dans le même temps, la diffusion massive de moyens contraceptifs efficaces a considérablement réduit le nombre des conceptions imprévues. Il en est résulté que la proportion de grossesses non prévues est passée de 46 % en 1975 à 33 % aujourd'hui. Il apparaît de prime abord difficile que la proportion de grossesses non prévues puisse chuter encore beaucoup; cependant, des pistes sont envisageables. On compte donc moins de grossesses imprévues ; mais, lorsqu'elles se produisent, le recours à l'IVG est beaucoup plus fréquent, puisque 60 % de ces grossesses se terminent maintenant par une IVG, contre 40 % en 1975. On voit donc que la stabilité apparente du nombre d'IVG résulte de mouvements contraires : moins de grossesses accidentelles mais, lorsqu'il y en a, une propension plus marquée à les interrompre. Contrairement à une idée reçue, la décision de recourir à l'IVG, dans l'immense majorité des cas, se prend en commun au sein des couples stables. Cependant, en cas de désaccord, la décision d'interrompre la grossesse est très largement corrélée au degré de dépendance sociale et économique de la femme : plus la femme est indépendante, plus son point de vue prévaudra. Plus largement, la qualité de la relation affective pèse fortement sur la décision, et le partenaire d'un soir n'est, le plus souvent, pas même informé de la grossesse. De l'analyse des questionnaires et des entretiens très détaillés menés par l'équipe des chercheurs de l'INSERM, de l'INED et du CNRS, il ressort que les raisons du recours à l'IVG ne sont pas les mêmes selon l'âge des femmes. Si l'on constate un pic des interruptions de grossesse autour de 20-24 ans, l'IVG concerne toutes les femmes en âge de procréer, y compris celles qui sont en fin de vie reproductive. Avec la diffusion de la contraception médicale, les normes sociales de la parentalité se sont modifiées, en ce sens que les femmes se sentent désormais tenues de choisir le meilleur moment pour faire naître un enfant, en prenant en compte le contexte affectif, les carrières des deux partenaires, afin de réunir les conditions les plus favorables à l'accueil et à la prise en charge de cet enfant à naître. Autrement dit, la décision d'avorter renvoie en miroir aux normes sociales de la « bonne parentalité ». Les femmes auront plus souvent recours à l'IVG si la grossesse non prévue se déclare à un « mauvais » moment, ce moment étant apprécié en fonction de raisons qui varient selon l'âge. En particulier, l'engagement scolaire apparaît déterminant pour les très jeunes femmes ; une étudiante de 18 ans décidera de recourir à une IVG car la naissance de l'enfant obérerait ses perspectives de carrière, mais des adolescentes en échec scolaire décideront plus souvent de laisser la grossesse se poursuivre, car une maternité précoce, à leurs yeux, devrait leur permettre d'acquérir un statut social. Ce clivage se retrouve dans de nombreux pays industrialisés. Par ailleurs, les femmes ont des trajectoires affectives et sexuelles plus diversifiées que par le passé, et l'on constate que le « bon » moment pour accueillir un enfant est plus difficile à trouver ; voilà pourquoi la probabilité d'une IVG en cas de grossesse imprévue est plus grande qu'il y a trente ans. Les considérations financières jouent aussi, bien sûr, et le fait qu'une femme ne dispose pas de ressources suffisantes peut la conduire à avoir recours à l'IVG, mais ce n'est pas, loin s'en faut, l'argument premier pour la grande majorité des femmes. C'est bien le contexte affectif et professionnel qui conditionne la décision. C'est pourquoi mieux vaudrait, en matière d'IVG, parler de « situations à risque dans la vie des femmes » que de « femmes à risque ». Certes, il existe des femmes qui, cumulant des difficultés affectives, sociales et économiques particulières, y compris la difficulté d'accès à la contraception, recourent de manière répétée à l'IVG (plus de trois IVG ou deux IVG rapprochées dans le temps), mais elles sont peu nombreuses. Or, près de 40 % des femmes seront confrontées à une interruption de grossesse, et près du double à des grossesses non prévues. Comment expliquer ces échecs contraceptifs ? La stabilité apparente des taux d'IVG masque un phénomène qui pose question en termes de santé publique. En effet, si la moyenne pondérée du taux d'IVG des femmes reste de 14 °/°°, ce taux augmente chez les femmes de moins de 25 ans. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est alarmée de cette évolution. Mme Nathalie Bajos a précisé que cette augmentation apparente pourrait peut-être relever en partie d'enregistrement statistique des IVG par âge chez les plus jeunes. Cependant, un autre facteur joue, celui de l'utilisation sans cesse croissante du préservatif, considéré comme un moyen de protection contre le VIH, et comme une contraception. L'utilisation de plus en plus fréquente du préservatif au premier rapport sexuel a pour conséquence de retarder le recours à la pilule, qui se fait davantage au moment de la stabilisation de la relation. On peut se demander si les grossesses accidentelles ne sont pas plus nombreuses dans cette phase d'utilisation du préservatif, méthode qui dépend de l'accord et de l'expérience du partenaire. On constate que si, en raison de campagnes d'information répétées, les jeunes sont sensibilisés au risque de contamination par le VIH, leurs connaissances en matière de contraception sont très faibles. Il est vrai qu'il n'est pas facile de diffuser un discours portant simultanément sur les préservatifs et sur la pilule, cette dernière ne protégeant pas, comme on le sait, des infections sexuellement transmissibles. De plus, le nombre d'heures consacrées à la sexualité dans les programmes d'enseignement est très réduit, et l'aspect relationnel y est très peu abordé. Ce sujet mériterait réflexion. Un autre facteur clé a été mis en évidence chez les plus jeunes : l'importance de la reconnaissance sociale de leur sexualité. La situation est relativement bonne en France, puisque le taux d'IVG chez les mineures y est un des plus bas des pays industrialisés. Le corollaire est manifeste : plus le discours sur la sexualité et la prévention est axé sur l'interdit, plus le nombre de grossesses non prévues, d'IVG et d'infections par le VIH chez les jeunes augmente. Et ce sont les États-Unis, où l'on préconise l'abstinence, qui détiennent le record des pays industrialisés en ces domaines. La non-acceptation de leur sexualité par le milieu dans lequel ils vivent est l'un des facteurs d'échec de l'accès à la contraception chez les jeunes. Comment une jeune fille qui redoute de se faire réprimander - ou pis encore - pourrait-elle prendre le risque que sa plaquette de pilules soit découverte ? De tels problèmes se posent chez des jeunes filles en difficulté, mais aussi chez des femmes plus âgées qui se sentent coupables, par exemple, d'avoir des aventures extra-conjugales. En bref, accès à la contraception et information sont nécessaires, mais tout ne se résume pas à cela. Quant au sentiment d'ambivalence à l'égard de la grossesse ou au désir de tester sa fertilité, souvent mis en avant, il est loin d'expliquer les 200 000 IVG annuelles et l'ensemble des échecs contraceptifs. Un autre facteur important, est l'inadéquation entre les méthodes contraceptives utilisées et les conditions de vie des femmes auxquelles elles sont prescrites. La très forte médicalisation de la contraception qui prévaut en France fait que la seule absence de contre-indication médicale suffit à ce que la pilule soit prescrite. Or, la contraception orale est très efficace théoriquement, mais une femme dont la vie sexuelle est irrégulière oubliera bien plus souvent de prendre la pilule qu'une autre qui vit en couple stable ; et les oublis sont plus fréquents lorsque le rythme de vie est bouleversé par des tout-petits, ou si la femme travaille selon des horaires irréguliers. Et que dire de la sexualité des adolescentes, caractérisée par des relations de courte durée suivies de périodes sans partenaire ? La pilule n'est pas nécessairement ce qui leur convient le mieux. Quant au stérilet, il reste sous-utilisé pour des raisons qui n'ont pas de fondement épidémiologique, les médecins estimant, à tort, qu'il ne convient qu'aux femmes qui ont eu tous les enfants qu'elles désiraient, alors que la contre-indication scientifiquement reconnue est l'existence d'une infection sexuellement transmissible (IST) au moment de la pose, qui aggraverait le risque de salpingite. A la rigidité actuelle de la prescription contraceptive devrait se substituer un dialogue permettant de prendre en considération le mode de vie de chaque femme, ses réticences éventuelles et ses préférences. Ces résultats ont été pris en compte par l'ANAES dans l'élaboration du guide de bonnes pratiques en matière de contraception diffusé en décembre dernier. Il resterait à revoir la formation des médecins, auxquels ne sont dispensés, au long de leur cursus universitaire, que deux heures de cours relatifs à la contraception, en tout et pour tout..., à l'exception de ceux qui suivent une spécialité en gynécologie, et à qui l'on enseigne qu'un stérilet ne doit pas être posé chez une femme nullipare. Dans ces conditions, comment s'étonner de méconnaissances persistantes ? En conclusion, la contraception chez les jeunes reste problématique car il faut tenir compte, aussi, de la nécessité de la prévention des infections sexuellement transmissibles ; faute de campagnes nationales, les femmes ne sont pas sensibilisées à la contraception ; une plus grande souplesse est nécessaire dans la prescription contraceptive, ce qui suppose d'améliorer la formation des prescripteurs ; enfin, on note des difficultés persistantes d'accès à la filière de prise en charge des IVG. Mme Bérengère Poletti, rapporteure, s'est dite particulièrement frappée par les indications figurant dans l'étude selon lesquelles moins d'un tiers des femmes n'utilisaient pas de contraception au moment de la conception ayant donné lieu à une IVG. Revenant sur l'éducation à la contraception, elle s'est interrogée sur la formation des professeurs de SVT censés l'assurer au sein des établissements d'enseignement. Mme Nathalie Bajos a indiqué que l'étude ne portait pas sur cet aspect de la question, mais elle a souligné que les lacunes de l'éducation à la contraception ne suffisent pas à expliquer la stabilité du nombre des IVG. Ainsi que Mme Bérengère Poletti l'a opportunément rappelé, 28 % seulement des femmes n'utilisaient aucune méthode contraceptive au moment de la conception. Et encore, ce groupe n'est-il pas représentatif de la population française, car il s'agit de femmes en période de transition, soit qu'elles changent de partenaire, soit qu'elles changent de méthode contraceptive. Pour de multiples raisons, il est très difficile de faire un parcours « sans faute » entre 17 et 50 ans ; dans la très grande majorité des cas, on constate une difficulté à gérer la contraception au jour le jour. Mme Bérengère Poletti a observé que bien des grossesses non désirées se produisent après que le médecin a recommandé, pour des raisons qui lui appartiennent, l'arrêt de la contraception orale pendant un ou deux mois. Par ailleurs, la conviction est tenace qu'il ne faut pas poser un stérilet chez une nullipare. Mme Valérie Pecresse a souligné que, l'âge venant, la contraception orale tend à être rejetée, souvent par crainte d'un risque accru de survenue d'un cancer, et que, pour ce qui est de la contraception par stérilet, l'idée est répandue d'un fort taux d'échec chez les femmes « trop fertiles ». Quant à l'augmentation du taux d'IVG chez les jeunes femmes, ne doit-elle pas être corrélée au recul de l'âge de la première maternité ? Autrement dit, les conditions de vie des jeunes ne sont-elles pas perçues comme tellement difficiles qu'ils ne se sentent pas prêts à être parents avant la fin de la vingtaine ? Mme Claude Greff s'est dite favorable à ce que l'éducation sexuelle soit assurée par des professionnels de la santé plutôt que par les professeurs de SVT. Elle a demandé si l'IVG est l'occasion d'une prise de conscience ou si l'on constate des interruptions de grossesse répétées chez les mêmes femmes. Mme Nathalie Bajos a répondu que la contraception orale progresse dans toutes les classes d'âge, y compris chez les jeunes, mais que l'on constate un très fort clivage : pour les femmes les plus âgées, la pilule est symbole de liberté alors qu'elle est davantage synonyme de contrainte pour les plus jeunes. Quant à l'épidémiologie des cancers associés à la contraception orale, elle est compliquée, et les résultats épidémiologiques les plus récents sont présentés dans le rapport de l'ANAES. Mais aucune recherche à ce sujet n'est financée en France... Mme Nathalie Bajos a indiqué à ce propos que, faute de financement public suffisant pour la recherche en santé publique, particulièrement mal lotie, les recherches menées par son équipe sont largement financées par l'industrie pharmaceutique. Mme Valérie Pecresse s'est demandé si le fait que la contraception orale soit perçue comme une contrainte n'expliquait pas les oublis de pilule. Mme Nathalie Bajos a répondu qu'ils sont liés à l'irrégularité de la sexualité et des conditions de vie. Pour ce qui est du stérilet, comme indiqué dans le guide de bonnes pratiques de l'ANAES, rien de scientifique n'étaye les préjugés selon lesquels il ne pourrait être posé à une nullipare par crainte d'une stérilité induite, ou que l'absorption d'anti-inflammatoires en contrecarrerait l'effet contraceptif, ou encore qu'il favoriserait la survenue de grossesses extra-utérines. Comme le montre la littérature épidémiologique mondiale, la contre-indication avérée, c'est une IST au moment de la pose. Le docteur Frédéric de Bels a coordonné l'élaboration du guide de l'ANAES qui présente l'ensemble des contre indications médicales pour les différentes méthodes de contraception. L'enjeu est aussi économique : non seulement certaines pilules sont vendues très cher, mais leur prescription suppose une visite de contrôle tous les six mois. Si le stérilet était proposé aux femmes indemnes d'infection sexuellement transmissible au moment de la pose, indépendamment du nombre d'enfant et de leur âge, sachant que l'efficacité pratique du dispositif est très grande, et supérieure à celle de la pilule, cela pourrait permettre d'éviter des grossesses accidentelles. Répondant à Mme Bérengère Poletti qui a souhaité savoir comment se place la France par rapport aux pays dont on connaît les prescriptions contraceptives, Mme Nathalie Bajos a rappelé que le taux d'utilisation des méthodes médicales réversibles en France, est le plus élevé du monde, tout en mettant en évidence la stabilisation de l'utilisation du stérilet alors que celle de la pilule augmente. On pourrait proposer la pose d'un stérilet en première intention, au même titre que la contraception orale ou d'autres méthodes de contraception encore. A Mme Valérie Pecresse, qui s'est demandé si le progrès ne serait pas dans une contraception plus douce, Mme Nathalie Bajos a répondu par la négative, soulignant que l'important est une plus grande souplesse dans les prescriptions, pour mieux tenir compte des différences de modes de vie entre femmes. Elle a ensuite indiqué que le délai entre l'âge d'entrée dans la sexualité et la première maternité a augmenté de cinq ans depuis 1974 ; ce qui rend compte pour partie de l'augmentation du recours à l'IVG en cas de grossesse non prévue. Mme Valérie Pecresse, approuvée par Mme Claude Greff, a conclu de ces précisions qu'il existe aussi des causes sociales à l'IVG : si les conditions de vie professionnelle et d'accès au logement étaient meilleures, peut-être les femmes accepteraient-elles plus tôt de mener une grossesse imprévue à son terme. Mme Nathalie Bajos a dit douter de la possibilité de revenir à une norme sociale ancienne relative à l'âge moyen à la maternité, tout en soulignant par ailleurs l'importance de la stabilité affective dans la décision d'accepter une naissance. Mme Valérie Pecresse a fait valoir que l'insertion professionnelle la facilite. Mme Nathalie Bajos a indiqué que même le fait d'avoir un travail ne suffit pas à faire accepter une naissance imprévue, car la crainte d'une instabilité professionnelle future joue aussi. Mais des progrès sont possibles en matière d'information sur la contraception, tant au sein de l'Education nationale que par des campagnes nationales ou par l'amélioration de la formation des prescripteurs. Mme Nathalie Bajos a dit s'interroger sur l'opportunité de faire dispenser l'éducation sexuelle par les professeurs de SVT. Le sujet, très vaste, doit conduire à aborder, de manière positive et globale, les enjeux affectifs, le respect de l'autre et le plaisir avant de parler des risques. C'est ce qui se pratique aux Pays-Bas, avec d'excellents résultats. S'en tenir aux seuls aspects biologiques est inefficace, car immédiatement viennent des questions sur la sexualité ; mais les élèves peuvent-ils en parler sans détours avec un professeur qu'ils connaissent ? Mme Valérie Pecresse, revenant sur l'augmentation du nombre des grossesses imprévues auxquelles il est mis fin, a observé que l'IVG était de moins en moins taboue. La tendance à privilégier les conditions de vie s'affirme-t-elle au point que l'on en viendrait à ce que 80 % des grossesses imprévues soient interrompues ? Mme Nathalie Bajos a répondu que la proportion des grossesses imprévues interrompues pourrait se stabiliser, les échecs existeront toujours, et que l'on peut s'attendre à une diminution du taux moyen d'IVG, par l'effet mécanique du vieillissement de la population. Elle a souligné que la décision de recourir à l'IVG reflète les normes sociales relatives aux bonnes conditions de la parentalité, et insisté sur le fait qu'aucune femme ne considère une IVG comme un épisode banal et anodin. Mme Valérie Pecresse s'est demandé si le recours à l'IVG ne traduisait pas la volonté de contrôler entièrement sa vie en toutes circonstances. Mme Nathalie Bajos a répondu que ce sentiment existe en effet, mais elle a souligné la grande différence de trajectoires entre la femme d'il y a plus de trente ans, qui avait un mari pour la vie et ne travaillait pas, et celle d'aujourd'hui, dont le parcours affectif et professionnel est beaucoup plus diversifié. Elle a ensuite rappelé qu'une IVG n'est pas une naissance en moins mais une naissance différée. Quant aux IVG répétées (plus de trois IVG ou deux dans un délai temporel court), elles sont le fait de femmes en très grande difficulté ; pour certaines de ces femmes, la question de la contraception ne se pose même pas. La très grande majorité des autres femmes ayant recouru à l'IVG « feront attention ». Mais un parcours contraceptif « sans faute » est très difficile. Que l'on prenne conscience du nombre de comprimés avalés au cours de la vie reproductive, et l'on comprendra pourquoi 60 % des utilisatrices de pilule ont oublié de la prendre au moins une fois dans l'année... Mme Nathalie Bajos a ensuite réfuté l'opinion avancée par Mme Claude Greff selon laquelle de nombreuses jeunes filles refuseraient de prendre la pilule, lui préférant la contraception d'urgence. Par ailleurs, il ne transparaît dans aucune enquête que l'administration du RU 486, qui est une IVG médicamenteuse, serait devenue une méthode de contraception. Quant à la « pilule du lendemain », elle demeure largement sous-utilisée. Mais serait-elle davantage utilisée qu'il ne faudrait pas en attendre une diminution de plus de 20 % des IVG, car les femmes qui recourent à l'IVG ne sont pas toutes conscientes du risque qu'elles ont pris. Mme Valérie Pecresse a observé que ce serait déjà un progrès sensible mais que, là encore, le manque d'information est patent. Mme Nathalie Bajos a insisté, en conclusion, sur le fait que les IVG pratiquées en France n'ont pas de conséquences sur la santé de femmes : elles n'entraînent plus de décès et aucune étude ne montre qu'elles réduisent la fertilité. Audition de Mme Marie-Josèphe Creps, présidente de l'association Réunion du mardi 25 janvier 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est réjouie d'accueillir Mme Marie-Josèphe Creps, présidente de l'association CLER Amour et Famille, ainsi que Mmes Christine Morel et Christiane Férot, membres de l'association. Cette audition s'inscrit dans le cadre de la mission confiée à la Délégation aux droits des femmes par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Mme Bérengère Poletti, au sein de la Délégation, est plus particulièrement chargée de la mission de suivi de l'application de la loi du 4 juillet 2001, quant à l'accès effectif à la contraception et à l'IVG. CLER Amour et Famille est un mouvement chrétien de réflexion et d'action qui se propose « d'aider toute personne jeune ou adulte, en couple, ou non, croyante ou non, à mieux vivre sa vie sexuelle en vue d'un meilleur épanouissement humain et spirituel ». Cette association, reconnue d'utilité publique, est agréée auprès des ministères des affaires sociales et de la jeunesse et des sports. Son rôle de conseil conjugal et familial est reconnu ainsi que ses activités de formation. Elle est membre du Conseil supérieur de l'information sexuelle. Parmi ses activités extrêmement variées, la Délégation est très intéressée par ses interventions auprès des jeunes et des couples. A une époque où les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés dans la découverte de leur vie sexuelle et affective, quels sont les conseils que le CLER Amour et Famille est amené à leur donner et quel est le cadre de son intervention ? A l'heure où l'institution familiale connaît une profonde mutation, quel type d'aide peut-il apporter aux couples et aux familles en difficultés ? Qu'entend-il par le soutien à la parentalité, qui est une de ses approches des problèmes du couple ou de parents isolés ? Mme Marie-Josèphe Creps s'est félicitée de pouvoir présenter à la Délégation le travail de l'association CLER Amour et Famille, de faire part de son expérience de terrain et de répondre à des questions sur un sujet aussi délicat que la sexualité. Ses trois représentantes sont conseillères conjugales et familiales. Mme Christiane Férot qui a son activité à Cambrai, a été présidente de l'association de 1986 à 1992, a fondé en 1982 le Centre d'information sur les droits des femmes de Cambrai dont elle est toujours membre du conseil d'administration, et a été décorée en 2003 de la Légion d'honneur pour son travail social dans le cadre de l'association ; aujourd'hui, elle reçoit des couples et des personnes seules en conseil conjugal et familial, anime des groupes de jeunes en éducation affective et sexuelle dans des établissements scolaires, et assure des points écoute dans un lycée technologique et professionnel. Mme Christine Morel, qui a son activité en Seine-et-Marne dans le secteur de Marne-la-Vallée, reçoit aussi des couples et des personnes seules en conseil conjugal et familial, se rend dans de nombreux établissements scolaires pour animer des groupes de jeunes en éducation affective et sexuelle, et assure, en lycée et collège à Meaux, un point écoute géré par l'association des parents d'élèves. Mme Marie-Josèphe Creps est elle-même présidente de l'association, ce qui lui laisse peu de temps pour le travail sur le terrain, mais elle a exercé le conseil conjugal et l'éducation affective et sexuelle pendant de nombreuses années en Savoie. Elles ont, toutes trois, assuré des entretiens avant décision d'IVG, entretiens qui ne sont désormais, hélas, plus obligatoire, sauf pour les mineures. L'association CLER Amour et Famille a été créée en juin 1961 afin d'aider les couples en difficulté, notamment pour la régulation des naissances. C'est en 1970 qu'ont commencé les rencontres avec des groupes de jeunes pour l'éducation affective et sexuelle. La demande était déjà très importante et il est difficile, aujourd'hui encore, de répondre favorablement à toutes, avec seulement 930 membres actifs au sein de 90 équipes réparties sur tout le territoire métropolitain et à la Réunion. CLER Amour et Famille est une association centralisée et non une fédération. Ses interventions sont faites principalement par ses membres bénévoles mais aussi par quelques personnes qui travaillent dans des centres de planification. Elle a participé à la création d'associations en Suisse, en Belgique, en Espagne, à l'île Maurice et dans différents pays d'Afrique. En 2003, elle a rencontré 145 000 personnes dont 88 000 jeunes en éducation affective et sexuelle - 9 % en centres de planification -, 14 000 personnes en entretien de conseil, dont 230 en entretien post-IVG, 41 000 personnes en groupe d'information, conférence - 4 % en centre de planification -, 1 200 personnes en entretien pré IVG - 90 % en centre de planification. En 1998, ces entretiens pré-IVG avaient concerné 2 379 personnes et 2 788 en 2000. Mme Christine Morel a présenté les activités de l'association en matière d'éducation affective et sexuelle. Ses membres rencontrent les jeunes à la demande soit des parents, soit de l'établissement ou des professeurs. Ses interventions débutent dès l'école primaire avec un enseignement suivi de questions. Quel que soit l'âge des jeunes, les questions sont le plus souvent écrites afin de conserver un caractère confidentiel. Dans le primaire, l'enseignement porte sur la description et le fonctionnement des organes génitaux masculins et féminins, sur le développement du bébé dans le sein maternel, sur l'accouchement, et se termine par un temps de réflexion sur la relation d'amour entre un homme et une femme. On cherche à ce que les enfants s'émerveillent devant la beauté et la complexité de leur corps. On introduit les notions de respect, de pudeur en vue de prévenir les abus sexuels. Une réunion de parents est systématiquement organisée pour qu'ils sachent ce que l'on va dire à leurs enfants. Beaucoup remercient les intervenants d'avoir pu ouvrir un dialogue avec leurs enfants à la suite de leur passage. Les enseignants signalent également souvent un changement de comportement des enfants : plus grand respect des garçons envers les filles et inversement, moins de mots grossiers à caractère sexuel. En collèges, lycées ou mouvements de jeunes, les bénévoles préfèrent répondre à leurs questions en petits groupes où la parole peut circuler. Garçons et les filles sont séparés en collège car, à cet âge, leurs centres d'intérêts ne sont pas les mêmes. On leur explique que l'amour est l'aboutissement de cinq grands désirs : d'exister, d'être ensemble, de tendresse, sexuel, d'enfant - consciemment ou inconsciemment. Sont aussi introduites les notions de respect de soi, de l'autre, de la vie, de maîtrise de soi, de responsabilité. Avec la responsabilité, on parle de la contraception et de la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Aux plus grands, on montre que l'amour est une lente construction. Il est sentiment, attirance sexuelle, relation et communication entre deux personnes. La relation sexuelle implique maturité, confiance, respect. Elle nécessite maîtrise de soi et attention à l'autre dans sa différence. Après l'intervention, les établissements mettent souvent en place des points écoute qu'ils demandent à l'association de tenir. En ce qui la concerne, Mme Christine Morel intervient une fois par semaine en lycée et en collège à Meaux. Aujourd'hui même, elle a reçu huit jeunes qui lui ont posé beaucoup de questions sur l'amitié. Une fille en avait assez d'être rabaissée par sa mère. La semaine dernière, trois frères et sœurs sont venus lui faire part de leur inquiétude devant le comportement de plus en plus violent de leur père et de ses tendances alcooliques ; ils ont réfléchi ensemble à des solutions que les enfants ont ensuite proposées à leur mère. Mme Christiane Férot a dit que, pour sa part, elle a commencé à rencontrer les jeunes, il y a vingt ans, à la demande d'un directeur qui avait vécu douloureusement le fait qu'une mère, avertie que sa fille était en coma éthylique, ait répondu ne pouvoir se déplacer en raison d'un rendez-vous pour sa chienne chez le vétérinaire... Elle s'est dit que cette jeune fille avait trouvé ce moyen pour appeler au secours et qu'il n'était sans doute pas opportun d'attendre pour lui tendre la main. C'est ainsi qu'elle est passée d'une permanence un midi par semaine à un mi-temps rémunéré dans l'enseignement privé au cours duquel elle a assuré de 450 à 480 entretiens chaque année. Elle travaille en liaison avec les médecins et les infirmières scolaires, ainsi qu'avec les services sociaux. Les jeunes qu'elle reçoit expriment leurs bleus à l'âme et parfois au corps. Elle leur fournit des informations sur la grossesse, la contraception, la toxicomanie. Tout ce qui est lié à leur vie scolaire trouve un écho au point d'écoute. Elle ne participe pas au conseil de classe car c'est un lieu de sanction tandis que l'écoute est dans le registre de la bienveillance et du secret. Elle travaille toutefois avec les enseignants, en toute discrétion. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a considéré que c'était une chance de l'enseignement privé de pouvoir offrir un tel service, que l'Éducation nationale ne saurait financer. Mme Bérengère Poletti s'étant interrogée sur le risque que les intervenantes ne soient démunies face à certaines situations, Mme Christine Morel lui a répondu qu'elles étaient formées et supervisées. Si elles travaillent avec les assistants sociaux, il s'agit surtout d'un travail en écho, qui peut faciliter par exemple la reprise du contact familial et la restructuration d'un jeune, mais c'est bien à lui qu'il appartient de faire des démarches s'il a besoin d'un accompagnement social. A Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, qui pensait que les enseignants étaient enclins à se décharger sur les intervenantes, Mme Christiane Férot a dit qu'il était bon que les jeunes aient le choix de leur référent et que les professeurs disaient souvent ne pas avoir vocation à se transformer en assistant social. Elle a par ailleurs indiqué qu'en matière de contraception les jeunes recevaient une information en groupe, en dehors du cours donné en 4e par les professeurs de SVT - et d'ailleurs plutôt en 3e car c'est une classe charnière où il est bon de retravailler le sujet de l'amour, autour des idées d'attirance, de désir sexuel, de passage à l'acte, de responsabilité de soi, de l'autre et des tiers. Les jeunes comprennent qu'ils sont aptes à transmettre la vie mais pas à l'accompagner car ils n'ont pas eux-mêmes fini de se construire. C'est donc dans le sens de la responsabilité que la contraception est abordée. Pour en parler, on commence par décrire le fonctionnement des organes génitaux de l'homme et de la femme et des signes de fertilité de la femme. Cela intéresse chacun de connaître son corps. Pour certains, même adultes, c'est une réelle découverte. Or, on n'est responsable que lorsque l'on est bien informé. Il est important de savoir aussi que tout homme, toute femme a dans son inconscient un désir d'enfant. C'est ce désir inconscient qui va faire rater la meilleure des contraceptions et qui est par exemple à l'origine de l'oubli de pilule. C'est ce désir d'enfant qui fait qu'une contraception est toujours difficile à mettre en place et peut changer. Prendre conscience de ce désir est important pour s'approprier une méthode et la rendre plus efficace. Mme Bérengère Poletti a demandé ce qui est répondu à ceux qui s'interrogent sur les échecs de la contraception. Mme Christiane Férot a utilisé l'image d'une cocotte-minute : si on colmate la soupape, on ne voit plus la force de la vapeur, mais heureusement que le joint est défectueux et qu'il permet une fuite avant l'explosion... Est-il si surprenant que la contraception échoue quand on se dit « Oh, ça ne fait rien pour une fois, ça n'arrive qu'aux autres » ? Il faut que chacun comprenne qu'on est toujours l'autre de l'autre... Mme Bérengère Poletti a demandé ce qui se passait une fois qu'il y avait eu échec et que la grossesse non désirée intervenait. Mme Christiane Férot a répondu que les jeunes femmes venaient alors avec leurs interrogations, leur colère, leurs peurs, mais pas forcément en refusant l'enfant. Elles viennent surtout pour parler, c'est ensuite qu'elles se rendront au Planning familial, à l'hôpital, ou qu'elles reviendront discuter. De même, lors de l'entretien pré-IVG, on entend ce que la personne vient dire, on répond à ses questions sur la façon dont cette grossesse est survenue, on donne place si possible à la parole du père. Mais, au bout du compte, c'est la femme qui a le pouvoir de mettre cet enfant au monde ou pas. L'entretien post-IVG permet encore de mettre des mots sur les choses, de sortir d'un déni douloureux. Mme Danielle Bousquet a rappelé que, lors d'une audition récente, une gynécologue avait dit que les professeurs de SVT donnaient aux élèves des informations erronées sur la prétendue période de fécondation du 14e jour et que c'était une cause importante d'IVG. Comment le CLER Amour et Famille gère-t-il cela ? Mme Christiane Férot a expliqué que le couple pouvait faire le choix de la méthode naturelle d'observation des cycles et de l'abstinence à certains moments. Cette technique n'est pas à confondre avec la méthode Ogino basée sur un simple calcul de probabilité. Elle repose sur l'observation et l'interprétation de plusieurs signes : température, glaires ou mucus cervical, transformations du col utérin. L'entrée en période fertile est déterminée par l'observation de la glaire et la sortie par la température. Cette période peut être de 8 ou 9 jours, cela varie. Cette méthode est exigeante mais efficace. Le couple qui la choisit doit être stable et motivé. Il apprend à exprimer l'amour par tous les gestes que la vie met à sa disposition ; il accepte des périodes de continence. Mme Christine Morel a ajouté que l'association expliquait bien dans les écoles que cette méthode n'était pas pour les jeunes filles, mais pour des gens plus âgés et plus motivés. Cela étant, en leur expliquant comment fonctionne leur corps merveilleux, on leur donne envie de se connaître, on leur explique à nouveau les cycles, enseignés en 4e, on les incite à observer la glaire, on leur dit que s'il faut jeter à la poubelle la méthode du calendrier, il faut qu'elles prennent l'habitude de marquer leur règles ; qu'elles vivent avec leur corps. Il est également utile de parler aux garçons pour les responsabiliser et les rendre respectueux, mais il vaut mieux les séparer des filles car la maturité et la curiosité ne sont pas les mêmes. Mme Marie-Josèphe Creps a regretté qu'il n'apparaisse dans aucun document officiel que la méthode d'auto-observation est, pour certains couples, une alternative à la contraception. Le CLER Amour et Famille, depuis l'origine, une commission qui travaille sur les signes de fertilité de la femme et sur la façon de les repérer, et les couples qui ont participé à ses travaux tirent une certaine fierté d'avoir contribué au progrès de la science. Mme Christiane Férot a ensuite plaidé pour le rétablissement de l'obligation de l'entretien pré-IVG, au nom du bien de la femme qui est d'autant plus considérée comme une personne qu'elle a réfléchi à sa décision et fait un choix conscient. Confrontée à un problème très douloureux, le fait de pouvoir parler sans être jugée la délivre d'une part d'appréhension. Or l'entretien, depuis qu'il n'est plus obligatoire que pour les mineures, n'est plus systématiquement proposé par le médecin. Mme Christine Morel a ajouté qu'avec la possibilité de prendre le RU 486 seule chez soi, la femme a encore moins de possibilités de parler, les médecins en ayant rarement le temps. Certaines se trouvent ainsi dans une grande solitude. Mme Danielle Bousquet a observé que les médecins étaient normalement tenus de proposer l'entretien et que les femmes en difficulté psychologique pouvaient en profiter. Si on a supprimé l'obligation en 2002, c'est parce que tous les intervenants ont dit qu'elle était un facteur de retard dans l'accès à l'IVG et qu'il était très mal vécu par les femmes de devoir préalablement obtenir un « papier ». C'est donc par respect des femmes que l'entretien n'est plus obligatoire. Mme Marie-Josèphe Creps a relevé que beaucoup de femmes étaient venues contraintes à l'entretien, mais que celui-ci leur avait fait du bien parce qu'elles avaient pu parler des raisons de leur avortement. Mme Bérengère Poletti a noté que, si les représentantes du CLER Amour et Famille semblent avoir à cœur la vraie écoute des personnes, il n'est pas sûr que ce soit le cas de tout le monde : on a signalé des cas où ces entretiens avaient été très déstabilisants pour les femmes. Mme Christine Morel a répondu que les intervenantes du CLER Amour et Famille étaient formées pour faire ce genre d'entretien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Elle a cité le cas d'une femme de ménage qui ne supportait pas l'idée de continuer à travailler pendant sa sixième grossesse. Mais ce couple musulman était écrasé de chagrin à l'idée d'un avortement vécu comme un pêché. Après une heure d'entretien, il est apparu qu'un arrêt de travail par un médecin complaisant pourrait être une solution, et le couple est reparti rayonnant. Peut-on nier dans ce cas l'utilité de l'entretien ? Mme Christiane Férot a ajouté que l'entretien était le lieu pour dire l'affect, le lieu du transfert, le lieu où déposer une histoire de couple qui, sinon, n'aurait aucun écho. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est dite plutôt favorable à l'entretien, à condition qu'il soit fait correctement. Mme Bérengère Poletti a insisté sur le fait qu'il pouvait entraîner un retard, compte tenu de l'engorgement des centres d'orthogénie. Mme Christine Morel a jugé l'argument du retard moins recevable depuis qu'on a augmenté les délais de recours à l'IVG. Mme Danielle Bousquet a rappelé que l'obligation avait non seulement entraîné des retards, mais aussi été le prétexte à des entretiens dissuasifs, et que les auditions avaient montré l'hostilité de tous à l'obligation, au motif que l'on n'a pas à intervenir dans le choix de la femme. Il ne faut pas sous-estimer l'action de ceux qui s'opposent à cette liberté : il y a quelques jours, sur le site du ministère de la santé, si on tapait « IVG », on obtenait la liste des associations qui militent contre... Mme Christiane Férot a observé que l'entretien était aussi le lieu où l'on donnait à la femme des informations sur les aides matérielles dont elle pouvait bénéficier en cas de naissance. Mme Bérengère Poletti a souligné que, lorsque une femme fait la démarche de demander l'IVG à son médecin, sa décision est largement prise et que l'obligation d'entretien peut alors être perçue comme un processus de culpabilisation, une façon de lui demander « mais pourquoi ne voulez-vous pas de cet enfant alors que tout est prévu pour votre confort ? ». Car tout le monde n'a pas la même délicatesse que les intervenantes du CLER Amour et Famille... Peut-être faut-il que les médecins conseillent davantage à celles qui s'interrogent, qui ont besoin de parler, de recourir à l'entretien, mais sans restaurer pour autant l'obligation. Mme Marie-Josèphe Creps a dit que c'était surtout le respect de la personne qui était en jeu : lors de l'entretien, on n'est plus considérée comme une femme qui va avorter mais comme une femme tout court, et on peut en ressortir davantage debout. Mme Christine Morel s'est demandé s'il ne serait pas utile de mener des campagnes en faveur de la contraception, alors que l'on communique presque exclusivement sur le préservatif ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué que ce serait une des premières propositions de la Délégation. Mme Bérengère Poletti a observé qu'il fallait mieux connaître la contraception mais aussi mieux se connaître soi-même. Or les jeunes filles ne notent plus leurs règles. Par ailleurs l'oubli de pilule est une cause importante de grossesse non désirée. Mme Marie-Josèphe Creps a rappelé que l'entretien permettait aussi de parler de contraception, de dire que, contrairement à une idée reçue, le premier rapport pouvait être fécond, que le retrait, le « faire attention », n'étaient pas des méthodes valables. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'il fallait parler de la pilule mais aussi des autres moyens de contraception. Mme Christiane Férot a souhaité qu'on favorise le libre choix, en donnant sa juste place à la méthode d'observation des cycles, qui n'est absolument pas d'arrière-garde. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a conclu cette audition en remerciant les intervenantes du CLER Amour et Famille. TROISIÈME PARTIE : ---------- I. LES RAPPORTS DE LA DÉLÉGATION Au cours de la session 2004-2005, la Délégation aux droits des femmes a adopté deux rapports : - le rapport d'activité (n° 1924) de Mme Marie-Jo Zimmermann présentant le bilan d'activité de la Délégation d'octobre 2003 à juillet 2004, ainsi qu'une étude sur le travail à temps partiel ; - le rapport d'information (n° 2243) de Mme Marie-Jo Zimmermann sur le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, ont été publiés les actes du colloque (DIAN 40/2005) organisé et présidé par Mme Marie-Jo Zimmermann le lundi 6 juin 2005 intitulé : « Cinq ans après la loi : parité... mais presque ». A. LE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2003-2004 ET L'ÉTUDE SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 1) Une forte progression du travail à temps partiel Après une série d'auditions de chercheurs, de syndicalistes, de représentants patronaux et de hauts responsables de l'administration, sur le thème du travail à temps partiel, la Délégation a adopté le 16 novembre 2004 le rapport (n° 1924) de Mme Marie-Jo Zimmermann présentant le bilan d'activité de la Délégation d'octobre 2003 à juillet 2004 ainsi qu'une étude sur le travail à temps partiel. Concernant 30 % des femmes et 5 % des hommes, concentré principalement dans un nombre restreint d'activités peu qualifiées et peu rémunérées, le travail à temps partiel peut conduire à l'émergence de nouvelles poches de pauvreté et d'exclusion, notamment lors de ruptures familiales ou de départ à la retraite. Après une analyse de la forte progression et des caractéristiques du travail à temps partiel - qui concerne principalement les femmes puisqu'elles représentent 80 % des travailleurs à temps partiel -, la Délégation, souhaitant valoriser un travail à temps partiel encore trop souvent contraint et précaire, a formulé des recommandations visant à améliorer les conditions de travail et la protection sociale des travailleurs à temps partiel, notamment en matière de retraite. 2) Les recommandations de la Délégation 1. Le travail à temps partiel, après une forte progression depuis le début des années 90, s'est stabilisé depuis 2001. Fait économique difficilement réversible, il conduit souvent, malgré l'amélioration des conditions de travail apportées par la loi du 19 janvier 2000, de nombreux salariés à temps partiel - essentiellement des femmes - à des situations de précarité. Les pouvoirs publics devraient, d'une part, veiller à la bonne application des dispositions existantes du droit du travail et, d'autre part, dans un souci de meilleure cohésion sociale, apporter aux travailleurs à temps partiel une aide financière en matière de protection sociale. 2. La faiblesse des retraites perçues par les femmes La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu, pour les salariés du secteur privé à temps partiel, la possibilité de cotiser sur un temps plein, avec l'accord de l'employeur. Afin que cette disposition ne reste pas illusoire, il conviendrait que les accords collectifs prévoient la prise en charge par l'employeur des cotisations patronales sur la base du temps plein, lorsque le salarié à temps partiel en fait la demande. Une contribution financière pourrait être apportée par l'État sous forme d'un allégement du supplément des cotisations qui en résulte. 3. L'absence de prise en compte des activités à temps partiel de faible durée par le régime général de sécurité sociale pénalise ces travailleurs, qui, bien qu'ayant cotisé, ne pourront prétendre à l'âge de la retraite qu'au minimum vieillesse. Il serait souhaitable de permettre aux salariés dont l'activité aura été inférieure au seuil de validation des droits à pension, de capitaliser les cotisations versées sur les salaires perçus de façon à pouvoir bénéficier d'une validation des droits correspondants. 4. Dans le secteur privé, les accords de branche pourraient préconiser en faveur des travailleurs à temps partiel, rémunérés au SMIC horaire, une contrepartie sous forme de compensation salariale qui permettrait de valoriser le temps partiel, de fidéliser les salariés et de lutter contre la précarité. 5. De nombreux salariés à temps partiel souhaitent pouvoir travailler à temps plein. La reconnaissance dans l'entreprise ou l'établissement d'une priorité pour l'attribution d'un emploi équivalent à temps plein est une revendication majeure. Cette priorité inscrite dans le code du travail doit être respectée par l'employeur. Elle doit être valable pour une création d'emploi à temps plein, comme pour une libération d'emploi, et réaffirmée dans les accords collectifs de branche ou d'entreprise. 6. Les femmes travaillent de plus en plus longtemps et l'activité à temps partiel n'est souvent qu'une étape dans leur carrière. Pour éviter que les salariés ne restent trop longtemps à temps partiel, ce qui les pénalise fortement dans la constitution de leurs droits à retraite, une offre de réintégration dans un emploi à temps plein devrait leur être proposée, après une période maximum de travail à temps partiel à déterminer. 7. Dans ce but, une meilleure connaissance statistique de la part du temps partiel dans le parcours professionnel des salariés est indispensable et devrait faire l'objet d'enquêtes spécifiques de la part de la DARES et de l'INSEE. 8. Les salariés lors d'une embauche à temps partiel ou lors du passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel doivent être informés des conséquences de ce mode de travail en matière de retraite. 9. Dans certaines activités, comme la grande distribution, les amplitudes d'horaires hebdomadaires devraient être mieux organisées et encadrées, dans le souci du respect de la personne. L'organisation du travail en îlots de caisse, qui donne aux hôtesses de caisse une certaine autonomie dans l'aménagement de leur travail, devrait être favorisée. 10. Dès l'école, une meilleure information des filles sur les carrières et l'organisation du travail dans certaines professions devrait être donnée, l'orientation des filles se faisant encore aujourd'hui principalement vers des carrières très féminisées, filières de services aux personnes ou filières médico-sociales, qui offrent une part importante d'emplois à temps partiel. 11. Au niveau des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, une réflexion en profondeur doit être conduite, sur l'articulation des temps sociaux, l'amélioration du système de garde des enfants, la prise en charge des personnes âgées, la prise en compte du temps global des salariés à temps partiel leur permettant une meilleure organisation du temps de travail et du temps familial. 3) Un sujet de préoccupation pour le Gouvernement Devant l'importance du problème soulevé par le rapport de la Délégation, Mme Nicole Ameline, alors ministre de la parité et de l'égalité professionnelle avait annoncé, le 11 mai 2005, l'organisation d'une conférence sur le travail à temps partiel. Cette conférence n'ayant pu se réunir avant le remaniement ministériel intervenu le 2 juin 2005, Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a indiqué lors des débats sur le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes que « la question du temps partiel est au cœur des préoccupations du Gouvernement et constitue l'un des sujets prioritaires sur lequel (elle) travaille ». Tout en relevant que « la régulation des conditions de travail à temps partiel n'est pas l'objet de ce projet de loi », elle a annoncé qu'elle comptait engager, aux côtés de MM. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et Gérard Larcher, ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes, une consultation approfondie avec les partenaires sociaux sur ce thème. Par ailleurs, elle a confié au Conseil économique et social une mission d'expertise sur ce sujet et demandé à la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) une étude approfondie des caractéristiques du travail à temps partiel. B. LE PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉGALITÉ SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les écarts salariaux entre femmes et hommes demeurent importants en France (25 % d'écart moyen et 5 % d'écart résiduel correspondant à une réelle discrimination) en dépit de l'affirmation du principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes inscrit dans les traités européens, dans de nombreuses directives européennes, ainsi que dans notre droit interne (lois de 1972, 1983 et 2001). Face à la modestie des résultats obtenus en dépit de l'existence de ces textes, le Président de la République a fixé au Gouvernement en janvier 2005 l'objectif d'une suppression d'ici à cinq ans des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 1) Le projet de loi relatif à l'égalité salariale Pour répondre à cette impulsion présidentielle, Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle a présenté le 24 mars 2005 en Conseil des ministres un projet de loi qui définit un objectif de résultat : mettre fin en cinq ans à la discrimination salariale entre hommes et femmes. S'inspirant de l'accord national interprofessionnel signé en mars 2004 par l'ensemble des partenaires sociaux, la méthode choisie consiste à privilégier le dialogue social en invitant les acteurs sociaux à relancer la négociation collective. Les négociations annuelles obligatoires sur les rémunérations devront examiner les moyens d'atteindre l'objectif de suppression des écarts de rémunération. Trois dispositifs figurant dans le projet de loi sont néanmoins fortement incitatifs : - en cas d'absence ou d'échec de négociation de branche, le ministre chargé du travail pourra réunir une commission mixte paritaire afin que s'engage ou se poursuive la négociation ; - une convention de branche ne comportant pas de dispositions relatives à la suppression des écarts salariaux ne pourra pas être étendue ; - les accords salariaux des entreprises ne seront enregistrés, donc validés et opposables aux tiers, que s'ils sont accompagnés d'un procès-verbal d'engagement des négociations. Après un bilan à mi-parcours effectué par une conférence nationale, le projet de loi prévoit la possibilité de présenter un nouveau texte comportant des sanctions financières pour les entreprises récalcitrantes. Plusieurs mesures sont également prévues en faveur de la parentalité, de la formation, et de l'accès aux postes de responsabilités : - progression du salaire de la salariée en congé de maternité incluant non seulement les augmentations collectives mais également la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ; - aide forfaitaire accordée aux entreprises de moins de 50 salariés pour le remplacement des salariées parties en congé de maternité ; - majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation pour le salarié qui engage des frais de garde d'enfant afin de suivre une action de formation ; - représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises publiques. 2) Les recommandations de la Délégation Saisie de ce projet de loi, sur sa demande, par le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, la Délégation a adopté, le 12 avril 2005, le rapport (n° 2243) de Mme Marie-Jo Zimmermann, comportant les recommandations suivantes : 1. La Délégation se félicite de l'objectif fixé par le Président de la République de suppression des écarts salariaux entre les femmes et les hommes d'ici 2010 ; 2. Rappelant que depuis 1972 le principe d'égalité salariale a été introduit dans le code du travail, qu'il a été réaffirmé et précisé, après l'adoption d'une directive européenne en 1976, par les lois du 13 juillet 1983 et du 9 mai 2001, la Délégation approuve ce projet de loi « de la dernière chance » qui oblige les branches et les entreprises à négocier sur la suppression des écarts salariaux lors des négociations annuelles sur les salaires ; 3. Elle souligne cependant l'importance de l'obligation de négocier sur l'égalité professionnelle fixée par la loi du 9 mai 2001 et maintenue par l'actuel projet de loi car l'objectif d'égalité salariale ne peut être véritablement atteint que si l'on prend en compte l'ensemble des inégalités professionnelles qui concernent les femmes ; 4. Elle approuve les références au rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes contenues dans le projet de loi car elle estime que, pour les entreprises de plus de 50 salariés, il est un élément essentiel pour établir un diagnostic fiable de la situation en matière d'égalité professionnelle ; I - Rendre la négociation sur les écarts salariaux plus efficace 5. Si la loi peut inciter fortement à négocier, elle n'intervient pas dans le déroulement des négociations qui sont de la responsabilité des partenaires sociaux. Cependant l'exigence de loyauté et de bonne foi s'impose aux partenaires sociaux dans la négociation, particulièrement à l'employeur. S'agissant des négociations salariales, l'obligation d'engager sérieusement et loyalement des négociations devrait être rappelée, en prenant exemple sur les modalités de la négociation relative au travail de nuit ; 6. Outre son travail de bilan et d'évaluation prévu par le projet de loi, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, par ses recherches et ses études, devrait contribuer à élaborer les outils méthodologiques indispensables pour mesurer les écarts de rémunération et préciser le contenu des indicateurs pertinents, notamment la prise en compte de l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Dès la promulgation de la loi, un groupe de travail constitué au sein de ce Conseil devrait être chargé de cette mission. Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle devrait remettre un rapport d'étape annuel au Parlement ; 7. L'analyse des écarts de rémunération et les comparaisons salariales nécessaires au diagnostic devront notamment : - s'appuyer sur un examen de l'ensemble des éléments de la rémunération : salaire de base, primes, avantages en nature, distribution d'actions ; - prendre en compte non seulement la photographie des salaires à un instant donné, mais aussi les parcours professionnels des hommes et des femmes, sachant que les salaires des femmes plafonnent souvent à un certain coefficient, faute de promotion ; - tenir compte des secteurs d'activité où les salariés sont presque exclusivement des femmes. Des méthodes spécifiques d'évaluation des écarts salariaux devront être mises au point dans ces branches professionnelles ; 8. Les dispositions du projet de loi qui prévoient que le Gouvernement pourra présenter un nouveau texte instituant une contribution financière à la charge des employeurs ne satisfaisant pas à l'obligation d'ouverture de négociations de rattrapage salarial, ne devraient pas figurer dans la loi ; 9. Les inspecteurs du travail devraient être sensibilisés aux problèmes d'égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes ; des modules d'égalité professionnelle devront être inscrits dans la formation initiale et continue des inspecteurs du travail ainsi que des personnels des services chargés des relations du travail ; 10. Le réseau des déléguées régionales et chargées de mission départementales aux droits des femmes doit s'impliquer fortement dans la mise en œuvre de la politique d'égalité professionnelle et salariale. Les missions des déléguées sur le terrain doivent être confortées et élargies, notamment auprès des responsables économiques et des entreprises, et dotées des moyens nécessaires. A cet effet, il convient de les doter d'un statut leur permettant d'avoir cette légitimité. 3) Le texte adopté en première lecture Dans la ligne des recommandations adoptées par la Délégation, Mme Marie-Jo Zimmermann a présenté un première série d'amendements visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des entreprises publiques et privées et à imposer que la proportion de chacun des deux sexes ne puisse y être supérieure à 80 %. Une autre série d'amendements visait à faire respecter sur les listes constituées en vue des élections professionnelles (comités d'entreprises, délégués du personnel, commissions administratives paritaires de la fonction publique) la proportion de femmes et d'hommes de chaque collège électoral ou de chaque corps de fonctionnaires. Ces amendements ont été adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 mai 2005. Au cours de l'examen du texte au Sénat, le 12 juillet 2005, les dispositions concernant les conseils d'administration des entreprises publiques et les élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique ont été adoptées dans le texte de l'Assemblée nationale. En revanche, les dispositions concernant les entreprises privées n'ont pas été retenues par le Sénat. Les amendements adoptés par le Sénat ne sont guère contraignants : ils n'évoquent que la recherche d'une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes (aussi bien pour les conseils d'administration que pour les comités d'entreprise et délégués du personnel) et précisent seulement que « le règlement intérieur du conseil d'administration prévoit les mesures permettant d'atteindre cet objectif ». Le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes devrait être examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat en seconde lecture au mois de décembre prochain. C. LES ACTES DU COLLOQUE : « CINQ ANS APRÈS LA LOI : PARITÉ... MAIS PRESQUE » A l'occasion de l'anniversaire des 10 ans de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes et des 5 ans de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, Mme Marie-Jo Zimmermann, rapporteure générale de l'Observatoire de la parité et présidente de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale a organisé à l'Assemblée nationale, le 6 juin 2005, un colloque intitulé : « Cinq ans après la loi : parité mais presque... ». Rassemblant les précédentes rapporteures générales et les membres actuels de l'Observatoire ainsi que les acteurs et actrices du mouvement paritaire, en présence de Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, ce colloque a permis d'analyser les événements qui ont conduit à la réforme constitutionnelle de juillet 1999 et au vote de la loi du 6 juin 2000 et a tenté de discerner les effets réels de la loi, les obstacles rencontrés et le chemin qui reste à parcourir. Les actes du colloque ont été publiés en juillet 2005 dans la collection DIAN (40/2005). II. LES AUTRES SUJETS D'INTÉRÊT DE LA DÉLÉGATION A. LE PROJET DE LOI RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES PROPOS DISCRIMINATOIRES À CARACTÈRE SEXISTE OU HOMOPHOBE Après la présentation au Conseil des ministres du 23 juin 2004 d'un projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, la Délégation a entrepris dès le début de la session parlementaire 2004-2005 une série d'auditions consacrées à ce thème. Le texte prévoyait que les provocations à caractère sexiste ou homophobe seraient réprimées de la même manière que les provocations racistes ou antisémites. Ainsi, l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne en raison de son sexe ou de son orientation sexuelle était passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende, de même que la diffamation à l'égard de ces personnes. En revanche, seules les injures contre les homosexuels étaient passibles de six mois de prison et de 22 500 euros d'amende. Dans un communiqué de presse du 6 octobre 2004, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente de la Délégation, s'est élevée contre la différence de traitement établie par le texte entre homophobie et sexisme, la pénalisation des injures à raison de l'orientation sexuelle se trouvant renforcée par rapport aux injures à caractère sexiste. Elle considérait que le projet de loi ne constituait qu'un ensemble de dispositions a minima qui n'aidaient pas à l'émergence d'une véritable culture de respect des femmes. Elle se prononçait en faveur d'un projet de loi global sur le respect des femmes qui aurait permis à la fois d'unifier et d'adopter les textes épars de notre législation concernant les discriminations envers les femmes et de promouvoir une action volontaire pour lutter contre les situations inacceptables rencontrées par les femmes. Toutes les associations auditionnées par la Délégation (cf. infra) ont témoigné de leur rejet du projet de loi. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a même demandé le retrait du texte. Le Gouvernement a décidé de retirer le projet de loi et de le reprendre, avec des modifications substantielles, sous forme d'amendements gouvernementaux au projet de loi relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), alors en discussion au Parlement. Les dispositions nouvelles consacrent l'égalité de traitement entre femmes, homosexuels et handicapés. Désormais, les injures et diffamations seront réprimées de la même façon qu'elles soient commises à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou du handicap. Le délit de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap sera puni des mêmes peines qu'en matière de racisme. Toutefois à la différence de la provocation à la discrimination raciale, le texte limite celle en matière d'homophobie, de sexisme et de handicap à des types de discrimination limitativement énumérés aux articles 225-2 et 432-7 du code pénal : refus de fournir un bien ou un service, entrave à l'exercice d'une activité économique, refus d'embauche, sanction ou licenciement, subordination de la fourniture d'un bien ou de l'accès à un emploi à une condition liée au sexe ou à l'orientation sexuelle. Ces dispositions limitatives ont eu pour effet de répondre aux craintes exprimées à la fois par les organisations religieuses et par les professionnels de la presse. Dans un communiqué de presse du 23 novembre 2004, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente de la Délégation, a approuvé le retrait du projet de loi spécifique relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste et homophobe. Elle a considéré que les nouvelles dispositions proposées sous forme d'amendements au projet de loi relatif à la HALDE constituaient une avancée pour les femmes puisqu'elles consacrent l'égalité de traitement entre les femmes et les homosexuels. Elle a rappelé la nécessité d'élaborer un texte global prenant en compte l'ensemble des discriminations à l'égard des femmes. Le « renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe » constitue le titre II (articles 17 bis, ter, quater) de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Personnalités entendues par la Délégation sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe* Pages
* Les auditions des 5 et 12 octobre 2004 ont donné lieu à un compte-rendu intégral. A compter du mois de novembre 2004, toutes les auditions de la Délégation ont été transcrites sous forme de compte-rendu analytique. Audition de Mme Ariane Aubier, présidente de l'association Réunion du mardi 5 octobre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Mme Ariane Aubier, présidente de l'association des Chiennes de Garde, accompagnée de Mme Françoise Rambert et de M. Mathieu Arbogast. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation à cette audition, qui est la première sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Nous tenons à entendre les associations qui, depuis des décennies, défendent les femmes. Sachez d'emblée que ce projet de loi ne me convient pas en l'état. Je suis favorable à un projet de loi global concernant les femmes. Bien entendu, la volonté de condamner les propos à caractère sexiste et homophobe est une bonne intention, mais depuis le temps que l'on débat de la question de la femme, il ne convient pas de faire l'économie d'une grande loi qui mette en avant les problèmes rencontrés par les femmes dans notre société. Les « mesurettes » sont peut-être utiles, mais pas suffisantes ; si l'on veut que la femme puisse être respectée, il convient de lui donner sa place en affirmant que la femme est l'égale de l'homme. Mme Ariane Aubier : Nous nous sommes immédiatement insurgés sur la façon dont a été présenté ce projet de loi qui ne reflète pas ce que nous demandons. Comme vous, nous souhaitons une loi globale qui nous permette d'agir à tous les niveaux et qui soit véritablement une loi contre toutes les violences faites aux femmes. Ce projet nous a néanmoins interpellés, puisqu'il lutte contre les violences verbales sexistes dans l'espace public. Cependant, s'il était voté en l'état, ce texte établirait une hiérarchie entre les insultes à caractère homophobe et les insultes à caractère sexiste, ce qui nous paraît totalement injuste. Je dirais même que ce serait une régression. Une telle loi donnerait le sentiment que les insultes sexistes ne seraient en fait pas très graves, et en tout cas beaucoup moins graves que les insultes homophobes, alors que tout le monde sait aujourd'hui que la violence contre une femme commence par les insultes, et ce à tous les niveaux de la société. La façon dont on perçoit la femme, c'est la façon dont on la traite. Si on les maltraite, si on les discrimine en les rabaissant avec des insultes verbales - aussi bien dans l'espace public que privé - cela veut dire que les femmes valent toujours moins que les hommes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Vous souhaitez donc une loi globale qui unifierait l'ensemble des textes concernant le problème des femmes, qui condamnerait les discriminations faites aux femmes - avec la création d'une Haute Autorité - et qui organiserait des actions tendant au respect de la femme. M. Mathieu Arbogast : En fait, nous nous situons dans un double débat : celui de la lutte contre le sexisme, dans son ensemble, que nous souhaitons voir prise en compte dans une loi-cadre, et un problème de société repris par ce projet de loi présenté par le Gouvernement. Nous sommes évidemment favorables à une grande loi, mais nous avons conscience qu'un problème de pédagogie se pose - auquel nous sommes constamment confrontés - concernant le contenu de notre combat et de nos revendications, ainsi que la légitimité même du combat de nos organisations féministes. Nous souhaitons que les dispositions de ce texte concernant l'homophobie concernent également le sexisme. S'agissant de l'homophobie, ce texte aggrave la portée des injures et de la diffamation ; il prévoit également que les associations puissent se porter partie civile. En fait, toute une partie de ce projet de loi ne concerne que l'homophobie, ce qui crée une discrimination qui n'est pas admissible. Cependant, ce texte prévoit de telles avancées sur l'homophobie qu'il est difficile de dire qu'il ne sert à rien. Nous souhaitons donc que soient amendés les articles 3 et 4 de ce texte, afin qu'il traite sur un pied d'égalité le sexisme et l'homophobie. Mme Ariane Aubier : Ce sont les articles concernant les injures et la diffamation qui font l'objet de circonstances aggravantes, mais uniquement pour l'homophobie. M. Mathieu Arbogast : Ces amendements sont indispensables, car il serait inadmissible que la loi valide une hiérarchie dans les insultes au détriment des femmes. Il s'agirait non seulement d'une discrimination, mais surtout d'une régression et d'une violence à l'égard des femmes. Si ce texte était amendé - dans le sens que nous souhaitons - il aurait la qualité suivante : il nous permettrait enfin d'avoir la législation avec nous, quand nous expliquons que le sexisme est aussi grave que le racisme et l'antisémitisme. Je vous renvoie au numéro du journal Libération du 9 septembre 2004 qui traitait de la violence à l'égard des femmes. Un travail mené à partir des dépêches AFP par les journalistes de Libération démontre qu'entre le 29 juin et le 29 août 2004, 29 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur compagnon. Mme Ariane Aubier : Aucune étude n'a été menée sur la violence conjugale. M. Mathieu Arbogast : Jusqu'à la parution de cet article, nous n'avions qu'une estimation, qui était une extrapolation, du nombre de meurtres : le rapport du Professeur Henrion sur les femmes victimes de violences conjugales, de février 2001. Se fondant sur des chiffres de l'Institut médico-légal de Paris, il avait estimé qu'au moins 72 femmes par an étaient tuées par leur conjoint ou compagnon en France. Mais le journal Libération a démontré cet été, simplement à partir des dépêches AFP, qu'il s'agissait d'une sous-estimation manifeste. Mme Ariane Aubier : Ne sont pas prises en compte les femmes mortes en tombant dans l'escalier ou en se défenestrant, dont nous ne saurons jamais si elles ont été poussées par leur conjoint. M. Mathieu Arbogast : Je vous cite ces chiffres pour vous montrer à quel point il est urgent d'agir et de donner un signe positif. Depuis trente ans, nous sommes constamment renvoyés à la loi très positive de 1972 contre le racisme et l'antisémitisme. Cette loi a eu un impact pédagogique phénoménal et a été un instrument de légitimité, sur lequel les associations qui luttent contre le racisme peuvent s'appuyer sur le terrain, contrairement à nous. Bien évidemment, il n'appartient pas à l'État de tout faire à ce sujet, et il est nécessaire que les associations continuent à avoir une action de terrain, mais nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin d'une légitimité. C'est la raison pour laquelle, si cette loi valide une hiérarchie des insultes au détriment des femmes, elle aurait un impact catastrophique. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Que pensez-vous du fait de traiter dans la même loi l'homophobie et le sexisme ? M. Mathieu Arbogast : Nous pouvons le comprendre, car les médias, par exemple, font souvent l'association, mais il s'agit de deux problèmes différents. Et la réalité est que les mouvements gays, lesbiens, bi, trans et féministes travaillent de plus en plus ensemble, notamment ces derniers temps, avec l'Inter-LGBT (Interassociative lesbienne, gaie, bi et trans), à propos de ce projet de loi. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Comment réagit l'Inter-LGBT à l'égard de ce projet de loi ? M. Patrick Delnatte : Il ne faut pas confondre « orientation sexuelle » et « identité ». Un propos sexiste touche à l'identité de la personne - homme, femme. Il est dangereux de mélanger les deux. M. Mathieu Arbogast : Certaines femmes sont confrontées à un autre problème, celui de la « lesbophobie » : ce n'est ni uniquement en tant que femme, ni uniquement en tant qu'homosexuelle que ces femmes sont discriminées, mais pour ces deux raisons. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas condamner l'association de ces deux problèmes - l'identité et l'orientation sexuelle - au sein d'un même projet de loi. En effet, il n'y a pas que des femmes hétérosexuelles ou des hommes homosexuels. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : En définitive, préféreriez-vous amender ce texte ou vous battre pour obtenir un projet de loi global ? Mme Ariane Aubier : Nous sommes là dans l'urgence, c'est la raison pour laquelle nous sommes montés au créneau. Nous souhaitons amender ce texte, car nous ne voulons pas qu'il passe en l'état. Il s'agirait d'une régression, puisqu'il serait moins grave d'insulter un homosexuel en raison de son orientation sexuelle, qu'une femme en raison de son sexe. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Mais c'est ce qui risque d'arriver. Mme Ariane Aubier : C'est pour cette raison que nous souhaitons amender ce texte. Mais bien évidemment, après avoir obtenu une miette de reconnaissance, nous irons beaucoup plus loin. Mme Danielle Bousquet : Il serait peut-être plus intéressant d'enlever totalement le mot « sexisme » du projet de loi, et de le présenter clairement, tel qu'il a été élaboré à l'origine, comme un texte contre la discrimination homophobe - sans aborder le problème des femmes, qui a été rajouté et donc mal traité. Mme Ariane Aubier : Ce serait tout de même reculer... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Devons-nous amender ce texte ou devons-nous nous battre pour obtenir un vrai texte concernant les femmes ? Mme Danielle Bousquet : Nous sommes tous bien d'accord que ce texte est indispensable pour lutter contre l'homophobie. Mme Ariane Aubier : Mais aussi contre les insultes sexistes. Mme Danielle Bousquet : Nous sommes bien d'accord, mais il devrait s'agir d'un autre texte. Nous l'avons dit, le problème de l'homophobie et celui du sexisme ne sont pas de même nature. Alors ne faudrait-il pas dire oui à ce texte sur l'homophobie et refuser d'y inclure le sexisme, qui y est très mal traité ? Il est inacceptable qu'il soit traité de cette manière : abordons-le autrement, dans un autre projet de loi. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Accepteriez-vous que les parlementaires se battent pour obtenir cet autre projet de loi ? M. Mathieu Arbogast : Selon nous, il serait illisible de demander le retrait des dispositions concernant le sexisme. Ou alors, il conviendrait de scinder le projet en deux. Mme Danielle Bousquet : Imaginez que ce projet de loi soit voté en l'état ; une injure sexiste ne serait rien par rapport à une injure homophobe. Vous dites vous-mêmes qu'il s'agirait d'une régression. Il convient donc de mesurer la dangerosité de ce texte. Je raisonne en termes de stratégie politique pour les femmes, et je pose la question : ne serait-ce pas une erreur d'accepter ce texte en l'état, sachant que nous ne sommes absolument pas sûrs qu'il puisse être amendé ? M. Mathieu Arbogast : On se retrouverait alors complètement piégés. M. Patrick Delnatte : J'ai le sentiment que pour ne pas stigmatiser l'homosexualité, on a rajouté le sexisme, alors qu'il s'agit de deux problèmes bien différents. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je n'ai pas souhaité que la Délégation demande à être saisie de ce texte. Je ne comprends pas que les deux problèmes soient traités dans un même projet, ne serait-ce que par respect des uns et des autres. Mme Danielle Bousquet : On naît petit garçon ou petite fille, c'est le genre humain. Or, la discrimination à l'égard des petites filles a lieu dès la naissance. L'orientation sexuelle, elle, se décide plus tard. On voit donc bien qu'il s'agit de sujets qui ne sont pas de même nature. Le débat est rendu confus par cet amalgame entre les deux situations. Les homosexuels sont une minorité qu'il convient de respecter, alors que les femmes ne sont pas une minorité. On confond tout. Ce texte est dangereux, car il fait un amalgame de deux réalités qui ne sont absolument pas de même nature ; la discrimination n'est donc pas non plus de même nature. Comme vous le dites très justement, il s'agira d'une régression ; non seulement dans le débat, mais également sur le terrain, puisque les insultes homophobes seront davantage sanctionnées que les insultes sexistes. Les discriminations envers les femmes sont des discriminations de genre ; les femmes les subissent depuis qu'elles sont petites filles et tout au long de leur vie. Dans ce projet de loi, le sexisme est minimisé à l'extrême. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Les associations sont-elles prêtes à nous suivre si nous montons au créneau, ou acceptez-vous le projet a minima ? M. Mathieu Arbogast : Non, en l'état, ce projet est inacceptable. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Alors espérez-vous réussir à le faire amender ? M. Mathieu Arbogast : Nos amendements seront présentés, mais seront-ils acceptés ? Nous ne partons pas battus, nous sommes extrêmement actifs. Je ne parle pas simplement des Chiennes de Garde. Nous avons été à l'initiative d'un collectif d'associations qui comprend le Mouvement français pour le planning familial, le Collectif national pour les droits des femmes, Mix-Cité, la Grande Loge féminine de France, etc. M. Patrick Delnatte : Mais ce collectif crée une confusion ; c'est également cela le problème. Mme Ariane Aubier : Toutes les associations féminines et féministes demandent une loi globale. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Alors pourquoi préférez-vous amender ce texte plutôt que de réclamer une loi globale ? Mme Ariane Aubier : Mais nous travaillons depuis des années dans l'optique d'une loi globale ! Mme Mugette Jacquaint : Elles veulent une loi globale qui soit une émanation des propositions de l'ensemble des associations. Car, disons-le, il est rare qu'une loi reprenne leurs propositions. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Tout à fait, et je dois vous dire que votre espoir d'amender ce projet de loi m'inquiète. Car je ne suis pas convaincue que le texte sera amendé. M. Mathieu Arbogast : Nous n'en sommes pas persuadés non plus. Mais nous ne pouvons pas laisser le projet en l'état en disant que nous refusons la partie concernant le sexisme. Au contraire, nous voulons nous en saisir pour en faire un marchepied pour cette loi-cadre dont on commence à parler grâce aux Espagnols ; nous avons dans nos cartons un projet de loi anti-sexiste. M. Ariane Aubier : Réussir à amender ce texte serait une première étape. Car s'il était voté en l'état, ce serait très grave. M. Mathieu Arbogast : Nous savons bien que nous allons avoir du mal à faire passer une loi-cadre ; nous allons avoir besoin d'instruments de légitimité. Or, si nous réussissons à amender le texte du Gouvernement, nous aurons un premier outil pour faire passer l'idée que le racisme et le sexisme sont aussi graves. Mme Ariane Aubier : De toute manière, il faudra voter une loi contre les propos sexistes. Mme Muguette Jacquaint : Il est vrai que les filles sont victimes de racisme et de sexisme. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Donc si nous nous battons pour obtenir une loi globale, vous nous soutiendrez ? Mme Ariane Aubier : Evidemment ! C'est ce que nous demandons depuis des années. Mme Muguette Jacquaint : Si nous réclamons une loi globale, elle doit correspondre aux attentes des femmes et des associations qui les représentent. Nous devons véritablement travailler ensemble. M. Mathieu Arbogast : Dans un premier temps, nous attendons de voir quelle sera l'attitude des parlementaires face aux amendements que nous proposerons sur l'actuel projet de loi ; ce sera un premier signe - ou non - de cette volonté de se battre pour une loi-cadre. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je souhaite vraiment me battre sur ce sujet, car il est inadmissible de faire cet amalgame entre le sexisme et l'homophobie. Ce projet de loi, en l'état, ne respecte ni les uns ni les autres. M. Mathieu Arbogast : Bien identifier la spécificité de chaque discrimination pour la comprendre en tant que telle est très important, mais en même temps, dans notre dispositif national - et en droit international -, un amalgame existe déjà, puisque certaines dispositions concernent les personnes « sans distinction de race, de sexe, de religion ou d'orientation sexuelle ». Alors même s'il peut choquer, il existe déjà en droit national et international, dans des dispositions qui vont dans le bon sens. Mme Danielle Bousquet : Il est vrai que cet amalgame est fait de cette manière. Cependant, dans un certain nombre de documents internationaux et dans le projet de traité constitutionnel, il est question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mme Ariane Aubier : En fin de compte, le mieux serait de ne pas voter ce projet de loi. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Et de persuader le Gouvernement de présenter deux projets de loi. Mme Muguette Jacquaint : S'il doit être adopté, il faut qu'il soit amendé. Mme Ariane Aubier : Bien entendu. Mais s'il n'est pas voté, les associations homosexuelles diront que ce projet de loi en leur faveur n'a pas été adopté à causes des associations féministes. Alors que ce n'est pas du tout la réalité. On nous monte presque les uns contre les autres, alors que nous avons travaillé ensemble. Audition de Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français Réunion du mardi 5 octobre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Nous accueillons maintenant Mme Françoise Laurant, présidente du Mouvement français pour le planning familial, accompagnée de Mmes Maïté Albagly, secrétaire générale, et Fatima Lalem, membre du bureau national. La Délégation a souhaité recevoir les associations afin de connaître leur avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Sachez que je ne suis pas favorable à ce projet de loi - qui ne respecte ni la femme, ni les homosexuels -, mais que je souhaite une loi globale, spécifique, sur les femmes. Cette loi globale unifierait tous les textes qui existent déjà relatifs aux discriminations que subissent les femmes. Le Gouvernement prouverait ainsi sa volonté de lutter contre ce type de discriminations. Car je ne retrouve pas, dans ce projet de loi, des éléments rassurants pour les femmes. Mme Françoise Laurant : Nous aimerions apporter notre expérience sur ce sujet, fondée sur la grande pratique que nous avons auprès des jeunes et des femmes. Tout le monde pense que nos activités sont limitées à la contraception et à l'IVG, ce qui est tout à fait faux ; vous-mêmes, vous commencez à le savoir. Les constantes que nous retrouvons dans nos rapports, individuels ou collectifs d'intervention auprès de groupes de jeunes, de groupes mixtes, de groupes de femmes ou d'hommes, sont les suivantes : le blocage face à une prise de responsabilités et d'initiatives leur permettant de maîtriser leur vie est lié au fait que les femmes vivent dans un contexte où tout ce qui concerne la femme est dévalorisé ; ce sont les rapports de domination de l'homme sur la femme qui sont la référence. Il est donc évident qu'une femme qui n'est pas respectée, qui n'est pas valorisée, a beaucoup de mal, notamment une femme en difficulté, à prendre confiance en elle et à penser que la société est contre cet état de fait, etc. Or, la société ne réagit pas contre cet état de fait. Nous faisons des animations, avec des photos-langages, des jeux de rôles ; vous n'imaginez pas comment les situations sont représentées ! Parfois même, le fait d'être le dominant pose des problèmes à certains jeunes hommes. Nous vivons dans une société, dans laquelle des spécialistes analysent bien les causes de certains problèmes : les échecs contraceptifs sont liés au fait que les femmes ne se sentent pas légitimées à oser penser qu'elles ont le droit à..., que ce qui leur arrive n'est pas normal. Or, il appartient à la société de le leur dire. Notre pays n'engage pas de véritable politique globale sur ce terrain ; il s'agit d'une grosse défaillance. Si nous avions la possibilité, dans nos animations avec les jeunes, de leur citer des lois obligeant à respecter la femme, nous pourrions avancer. A l'heure actuelle, même l'Éducation nationale a intégré que la culture aujourd'hui c'est le stéréotype du garçon qui réussit, de la fille qui doit séduire, etc. Un conseil général a demandé à l'une de nos associations départementales d'intervenir sur le thème de la prévention des comportements violents et des comportements sexistes ; or, tout ce qui concernait le sexisme ordinaire, y compris à l'école, le rectorat nous a demandé de le retirer nous disant : « vous n'y êtes pas, c'est la culture moderne ! Vous êtes ringardes ! » Et ces paroles venaient du conseiller du recteur. En l'absence de toute intervention de la société française - prenons l'exemple espagnol, où toute la société civile travaille avec les politiques à l'élaboration d'une loi anti-sexiste - nous n'avancerons pas. Alors nous vous applaudissons des deux mains si votre intention est de réclamer une loi globale anti-sexiste. Je dis bien globale, touchant toute la société et non pas seulement la presse ; en effet, la première limite de ce projet de loi est qu'il ne vise que la presse. Je tenais également à vous dire que nous avons été peinées que M. Bernard Stasi, qu'il s'agisse des discriminations ou du débat sur la laïcité, ait refusé de nous entendre. Or, nous avons su, par d'autres personnes qui ont été auditionnées et que nous connaissons, que des questions comme celles-ci ont été posées : « Ne pensez-vous pas que les discriminations sexistes, dont la Haute autorité sera chargée, devraient être considérées comme l'une des discriminations ? » Or l'expérience nous prouve que, quand on commence à noyer le sexisme dans un tas d'autres choses, il n'est jamais pris en compte. Or, la loi sur la Haute autorité, chargée de l'ensemble des discriminations est en débat aujourd'hui au Parlement. C'est l'occasion de dire qu'un organisme indépendant - comme le réclame la convention CEDAW - devrait être mis en place pour s'occuper du suivi, de la coordination et des évaluations relatives à la lutte contre le sexisme envers les femmes dans la société. Si une grande loi anti-sexiste de lutte contre la domination du masculin sur le féminin était élaborée, elle montrerait une véritable volonté du Gouvernement de traiter des discriminations sexistes. Or, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le projet de loi, le fait de considérer que le sexisme est aussi grave que l'homophobie, pour l'incitation ou la provocation à la discrimination, est une chose, mais ne pas le dire pour les deux autres éléments du texte - diffamation et injure - est vraiment grave et contre performant. En effet, les jeunes qui regardent les débats à la télévision nous diront : « Alors, en fait, c'est moins grave de traiter une femme de « sale pute », que quelqu'un de « sale pédé » ! Et le jeu aidant, cette idée entrera dans les mœurs. Nous avons donc presque envie de dire, que s'il est impossible de rajouter le mot « sexisme » à côté du mot « homophobie » dans ce projet de loi, alors il vaut mieux l'enlever partout et ne pas traiter du sexisme dans ce texte, et dans le titre. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Dès le début, j'ai été très sceptique quant à ce projet de loi, car ce n'est pas rendre service aux femmes que d'approuver un tel texte. Mme Françoise Laurant : Nous sommes également confrontés aux questions des jeunes sur l'orientation sexuelle. Ils ont besoin de parler seul à seul avec nous sur ces questions, nous sommes donc très attentifs. Car nous savons tous quels dégâts peut produire l'homophobie. Nous ne sommes donc pas contre ce que réclament les mouvements homosexuels. Je me demande si, à l'origine, ce projet de loi ne concernait pas uniquement l'homophobie, et si le Gouvernement n'a pas rajouté un peu d'anti-sexisme... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Si, c'est tout à fait ça. Ils ont rajouté le sexisme pour faire plaisir à tout le monde. Mme Muguette Jacquaint : Et, en définitive, personne n'est content. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : En tant que législateurs, nous sommes responsables du contenu des lois que nous votons et elles doivent satisfaire les personnes concernées. Mme Fatima Lalem : Nous sommes ravies d'apprendre que vous partagez notre ambition d'un grand projet de loi contre le sexisme. Il y a effectivement un problème. Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, a jugé bon d'introduire ce petit additif, qui finalement est totalement contre-productif. Il l'est d'un point de vue pédagogique : comment allons-nous expliquer aux jeunes gens cette hiérarchie dans les insultes ? La loi a une fonction pédagogique extrêmement importante. Il est contre-productif par rapport au travail que nous menons de prévention et de lutte contre les violences sexistes. Nous expliquons aux femmes que nous recevons, victimes de coups, d'insultes, de violences psychologiques, l'ensemble du processus, car les violences ne commencent pas par les coups. Il ne faut absolument pas banaliser la violence verbale et accepter l'inacceptable : les femmes tuées par leur compagnon. Une telle loi ne nous apportera rien quant à notre capacité de pouvoir saisir un juge, nous ne pourrons pas nous constituer partie civile en cas de diffamation. Je ne vois donc pas ce qu'elle apporte sur le plan politique, sur le plan sociétal et sur le plan éducatif. Il s'agit d'un projet qui, en l'état, est totalement contre-productif. S'il existait une proposition allant dans le sens d'un traitement égal, sans hiérarchie, alors nous la considérerions comme un réel progrès. L'idée d'un projet global qui intégrerait l'ensemble de la problématique des discriminations faites aux femmes, quelle que soit leur forme et quel que soit le lieu - la presse, le foyer, à l'école ou au travail - est intéressant ; les femmes devraient pouvoir trouver un traitement égal. Mme Maïté Albagly : J'ai vu hier, à la télévision, une publicité pour une crème qui enlève les bleus - l'on voit une femme battue, avec un cocard. Je suis scandalisée. Nous allons publier un communiqué dès demain, car la banalisation qui existe sur ce sujet dans notre pays est insupportable. Les Espagnols ne se sont pas arrêtés au vote d'une loi anti-sexiste, puisqu'ils continuent avec une loi très intéressante sur l'éducation : éducation à la société, mixité, respect de l'autre, seront les thèmes abordés dans le programme. Il serait dangereux, en France, de traiter ce sujet uniquement dans l'espace public et de laisser de côté le privé. Mme Muguette Jacquaint : Vous préféreriez une loi globale traitant du sexisme. Mais si ce texte devait passer en l'état, quelles propositions d'amendements feriez-vous ? Mme Françoise Laurant : Ce texte est mauvais, car les actes de nature sexistes ne sont condamnés que dans un seul cas, contrairement aux actes et insultes homophobes. Le problème, c'est cette inégalité de traitement. Notre position est claire : si le sexisme n'est pas traité comme l'homophobie, nous préférons qu'on n'en parle pas dans cette loi. Nous utilisons déjà des trésors d'ingéniosité pour persuader les jeunes, les femmes que nous recevons, que la société est contre la violence, contre les inégalités homme/femme. Alors, avec ce projet de loi qui va défrayer la chronique, nous allons avoir encore plus de mal à le leur expliquer Par ailleurs, quand nous parvenons à saisir les tribunaux à propos d'injures dont nous sommes victimes, nous sommes traitées de vieilles ringardes, nous n'avons pas le sens de l'humour !, etc. Vous le savez bien, mesdames les députées, vous êtes vous aussi insultées régulièrement ! Alors, outre la banalisation des insultes sexistes qui sont toujours minimisées, on ne veut surtout pas voir la gravité de leurs effets sur certaines femmes. En les minimisant, on légitime les attitudes des hommes qui battent leurs femmes, qui les insultent ou ne les respectent pas, qui les tuent. Mme Fatima Lalem : Je voudrais reprendre l'exemple cité par des féministes de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) - que vous allez certainement recevoir - et qui était le suivant : pourquoi le chef d'entreprise aurait-il besoin d'inciter à la diffamation et à la discrimination - seul cas prévu dans le projet de loi ? Il lui suffit de discriminer - et il le fait dans la pratique - ; il n'a pas besoin d'aller inciter d'autres personnes à le faire. Alors quand on nous dit que le sexisme est pris en compte dans ce texte, non. Il n'y a que cette provocation à la violence, à la haine et à la discrimination, et ce n'est rien du tout. Mme Danielle Bousquet : Si à côté « d'orientation sexuelle », il était inscrit, à chaque fois, « et sexiste », pensez-vous que l'on arriverait à quelque chose de convenable ? Mme Françoise Laurant : Non, mais le texte n'aurait plus les dangers que je viens d'expliquer. Quand je dis que la société doit afficher ses intentions dans ce domaine, je veux parler, par exemple, de la création d'une Haute autorité, ou d'un organe indépendant contre les discriminations sexistes. On a besoin que la société affirme de façon claire que le sexisme doit être combattu partout et par tout le monde. Mme Danielle Bousquet : Les représentants de l'association que nous avons reçue avant vous jugeaient cette avancée - rajouter le mot sexiste à côté de ceux « d'orientation sexuelle » - comme un progrès. Mme Françoise Laurant : Ce serait un progrès par rapport à la presse, qui a un poids sur l'image de la femme. Mais, je le redis, nous avons besoin que la lutte contre les discriminations sexistes soit affichée. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Ce projet de loi concernait, au départ, les propos homophobes. En rajoutant le mot « sexiste » ici ou là, on minimise le problème de la femme. Ce texte est un texte a minima pour les femmes. Mme Maïté Albagly : Ajoutons que pour les femmes, la discrimination commence avant la naissance. Cette différence est fondamentale. Mme Françoise Laurant : Etant donné la réaction des représentants de la presse et de la publicité, je pense que si l'on rajoutait le mot « sexiste » à côté « d'orientation sexuelle », ça les gênerait tout de même. Alors si cela les gêne, pourquoi ne pas le faire ; mais cela ne répondra pas à la question globale. L'initiative de Mme Nicole Ameline, de missionner l'organisme de vérification de la publicité et d'en faire son partenaire, est intéressante, mais ce serait plus efficace si cette initiative faisait partie d'un ensemble de mesures portant sur les différents aspects de la société. Mme Muguette Jacquaint : Les publicitaires se permettent d'agir ainsi, parce que la question de fond sur les femmes n'est pas réglée. Il y a même un recul depuis de nombreuses années sur cette question. Mme Danielle Bousquet : Il faudrait que tous les partis politiques refusent de voter ce texte si le sexisme n'était pas mis au même rang que l'homophobie ; cela aurait peut-être un certain effet. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Les femmes ne sont pas satisfaites par un tel texte. Ma responsabilité en tant que parlementaire est de tenter de le faire changer pour obtenir ce que les femmes attendent depuis trente ans. Mme Danielle Bousquet : Ce projet de loi aurait pu, dès le début, intégrer le sexisme. S'il a été écrit de cette manière-là, ce n'est pas complètement le fruit du hasard. J'ai donc bien peur que les amendements que nous déposerons ne soient refusés. Audition de Mmes Maya Surduts, porte-parole du Collectif national Réunion du mardi 5 octobre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je souhaite la bienvenue à Mme Maya Surduts, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes, qui est accompagnée de Mme Jocelyne Fildard, déléguée de la Coordination nationale lesbienne de France. Avant tout, sans doute serait-il bon que vous nous rappeliez comment sont nées ces deux organisations que vous représentez aujourd'hui. Mme Maya Surduts : Le Collectif national pour les droits des femmes s'est constitué au mois de janvier 1996, à l'issue d'une manifestation appelée par la CADAC - Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception - le 25 novembre 1995. Des organisations et des partis politiques, des syndicats et des associations avaient participé à l'organisation de cette manifestation qui a réuni trois générations, 40 000 personnes, dont un tiers d'hommes. C'est dans la foulée qu'a donc été créé le Collectif pour les droits des femmes, qui a mené un certain nombre de campagnes sur des thèmes comme la réduction massive du temps de travail, dont j'ai conscience qu'elle n'est pas très à la mode, ou le refus de l'imposition du temps partiel. Mme Marie-Jo Zimmermann : Ce sujet est, en revanche, d'actualité puisqu'il fait l'objet d'un rapport de la Délégation aux droits des femmes, qui sera prochainement examiné. Mme Maya Surduts : Une de nos revendications s'est trouvée satisfaite par « la loi Aubry II » : la suppression des exonérations de charges pour le travail à temps partiel, bien que les modalités des anciens contrats aient été maintenues. Nous avons également mené campagne contre l'extrême droite, lorsqu'elle a passé des alliances avec la droite, pour dénoncer et expliquer ce qu'impliquait pour les femmes une idéologie fascisante. L'année 1997 a été celle des Assises nationales pour les droits des femmes, qui ont mobilisé 2 000 personnes et au cours desquelles ont été définies un certain nombre de priorités, dont la lutte contre l'imposition du temps partiel. En 2000, nous avons organisé une manifestation, estimant que c'est l'une des façons de rendre les femmes visibles et de matérialiser un rapport de force, pour défendre un certain nombre de revendications. Cette action a certainement joué un rôle dans la promulgation de la loi en faveur de l'IVG et de la contraception du 4 juillet 2001, à laquelle nous avons œuvré avec la CADAC, l'Association nationale des centres d'IVG et de contraception ainsi que le Mouvement français pour le planning familial, avec qui nous travaillons de façon privilégiée. Enfin, nous avons tenu de nouvelles Assises en 2002 et nous avons également lancé, il y a un an, une nouvelle campagne sur les violences, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce dernier sujet fait partie de nos préoccupations. La situation est grave et la presse y est apparemment sensibilisée : 29 femmes sont mortes cet été des suites de violences. Aussi, confortées par le fait que le rapport sur les violences faites aux femmes n'a pas donné les résultats escomptés, nous avons décidé d'appeler à une manifestation nationale, samedi 27 novembre, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la violence. Par ailleurs, nous lançons avec le Mouvement français pour le planning familial des réunions unitaires pour préparer une manifestation nationale pour le droit à l'avortement et à la contraception. Elle devrait avoir lieu le 15 janvier prochain, étant précisé que les opposants à la loi s'apprêtent à manifester, quant à eux, le 23 janvier sur le thème : « Trente ans, ça suffit ! ». Avant de terminer il me reste à ajouter que nous sommes, naturellement, partie prenante de la Marche mondiale des femmes. Mme Jocelyne Fildard : J'interviens au titre du Collectif national pour les droits des femmes, mais également au titre de déléguée de la Coordination lesbienne en France, qui regroupe une vingtaine d'associations sur le territoire et un collège de personnes qui, soit sont dans l'impossibilité, pour des raisons géographiques, d'adhérer à une association, soit ne trouvent pas de structures susceptibles de leur correspondre. Il faut savoir que la coordination lesbienne s'est créée sur une discrimination. Ainsi, alors que les groupes féministes ont été associés à la préparation de la conférence de Pékin, les associations lesbiennes en ont été écartées. Mme Marie-Jo Zimmermann : Ce sont pourtant des femmes. Mme Jocelyne Fildard : Bien sûr et c'est pourquoi je vous parlerai de nos luttes spécifiques, qui ont justifié la création de nos associations. Cela étant, nous ne nous enfermons pas dans ces spécificités. En effet, nous faisons partie à la fois du Collectif national pour les droits des femmes, ce qui prouve que nous nous relions totalement au groupe social femmes, et de l'Inter Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Avez-vous souhaité créer votre structure par rapport à l'homosexualité ou pour faire reconnaître votre spécificité ? Mme Jocelyne Fildard : Il est clair que nous souffrons de discriminations spécifiques, puisque les associations de lesbiennes, qui sont pourtant des femmes comme les autres, mises à part les spécificités liées à leur orientation sexuelle, n'ont pas été conviées à la préparation de la conférence de Pékin. Si nous nous sommes constituées en mouvement, c'est pour opposer une force au Gouvernement et aux institutions. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Selon vous, on s'occupe plus des homosexuels que des lesbiennes ? Mme Jocelyne Fildard : Oui et je vous l'expliquerai plus clairement en vous disant pourquoi nous parlons de « lesbophobie ».Vous avez mis le doigt sur un point important que vous ne percevez pas : notre invisibilité. Mme Maya Surduts : On les range dans la catégorie « homo ». Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : On prend donc le terme dans un sens général ? Mme Jocelyne Fildard : Lorsque l'on emploie le terme « homophobie », les lesbiennes sont noyées dans l'universalisme gai, tout comme les femmes sont noyées dans l'universalisme quand on parle des « droits de l'homme ». C'est exactement la même chose. Mme Maya Surduts : En pire. Mme Jocelyne Fildard : Nous nous sommes regroupées, en 1997, en mouvement national. Nous faisons partie du Collectif national pour les droits des femmes. Nous sommes aussi fortement impliquées dans la Marche mondiale des femmes et nous travaillons également avec les gays, notamment au sein de la LGTB où nous commençons seulement à être visibles - on parle maintenant, non plus de Gay pride, mais de Marche des fiertés -, mais après avoir livré, là encore, un rude combat. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Quelle appréciation portez-vous sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe ? Mme Maya Surduts : Nous considérons que le pouvoir a opté en faveur d'un projet de loi qui, en dépit de son titre, donne du sexisme l'impression qu'il est une pièce rajoutée, d'où les réticences que nous éprouvons à son égard. Au départ, il s'agit quand même d'un projet de loi conçu sur le modèle de la loi de 1972 relative au racisme et à l'antisémitisme, complétée en 1992. Nous avons nettement l'impression que ce projet de loi sera voté, alors qu'il ne fait état du sexisme que dans les articles 1 et 2 et qu'il n'en est plus question dans les articles 3 et 4, ce qui ne fait que nous renforcer dans notre conviction qu'il est un peu « bricolé » ; mais je suppose que tout cela a déjà été dit et répété. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Oui, mais la répétition est un outil pédagogique et je peux vous assurer que vous avez été entendue. Mme Maya Surduts : Cette affaire est compliquée car vous n'ignorez rien du sort réservé au projet de loi déposé par Mme Yvette Roudy, à qui nous tenons à rendre hommage, car elle a livré un combat dans une période particulièrement difficile. Ses efforts n'ont même pas abouti à un débat en séance publique, ce qui prouve à quel point ce débat dérange et ce qui illustre bien le fait, même si nous avons pu croire le contraire, qu'il n'y a jamais eu de sociétés matriarcales et que, quel que soit le système économique, nous avons toujours vécu dans des sociétés patriarcales. Cette affaire de la domination des femmes est donc particulièrement difficile à éradiquer et complique singulièrement la lutte contre les discriminations. Nous en sommes réduites à la portion congrue puisque tout ce qui concerne les injures et les diffamations n'est pas retenu, et il est légitime de penser qu'il en est ainsi parce ces aspects sont considérés comme allant de soi. On accepte, en fait, comme étant normal, un certain type de rapports de domination et tout ce qui en découle. Cela explique qu'il soit si difficile de venir à bout, voire de faire reconnaître, même les violences. Si le Gouvernement et les pouvoirs publics ont été conduits à légiférer sur la parité, c'est tout simplement parce que la situation était, en France, particulièrement scandaleuse. Le patriarcat sévit partout dans le monde de façon plus ou moins exacerbée, mais on a le sentiment qu'il existe une spécificité française tout à fait incompréhensible : alors que les femmes représentent, en France, 46 % de la population active, leur niveau d'insertion place notre pays au dernier rang des pays européens, bien loin derrière la Grèce. C'est la raison pour laquelle il a fallu légiférer, avec les résultats que l'on sait. Comme par hasard, le pouvoir est passé aux intercommunalités et la loi sur la parité n'a pas créé les conditions suffisantes pour faire rentrer les femmes dans les instances exécutives qui ont le pouvoir de décision. J'ai bien conscience de répéter des évidences, mais elles montrent à quel point les résistances sont profondes. Je dois avouer que les élections sénatoriales ont, en la matière, marqué une avancée notable. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Seulement dans les départements où s'appliquait la proportionnelle. Au total, les femmes n'occupent que 16,9 % des sièges... Mme Maya Surduts : Je ne considère pas que ce soit miraculeux. Nous avons appris à nous satisfaire de peu, je dirai même du dérisoire. On finit par s'adapter et par accepter des situations qui sont à la limite de l'inacceptable : c'est la réalité et c'est ce à quoi nous sommes conduites. C'est d'ailleurs de ce point de vue que nous considérons qu'en l'état, le projet de loi, est, lui aussi, inacceptable. Il ne répond pas au besoin : il nous faut une loi. A cet égard, il faut rendre hommage au projet de loi que s'apprête à voter le Gouvernement espagnol. Nous en avons eu connaissance et j'ai même participé, ce week-end, dans le cadre de la Marche mondiale, à une réunion où j'ai pu rencontrer des femmes de différentes origines, aussi bien des Basques, que des Catalanes ou des Galiciennes, qui m'ont dit qu'il était prévu de débloquer 60 à 80 millions d'euros, alors que j'avais entendu dire que les moyens ne suivraient pas. Quoi qu'il en soit, les échanges se poursuivront avec les femmes espagnoles et je maintiens que, pour ce qui nous concerne, nous avons besoin d'une loi-cadre qui prenne en compte la complexité de la situation et qui nous permette de faire un bond en avant. Par ailleurs, nous ne sommes pas de celles qui disent se désintéresser du sujet au prétexte que les mesures privilégieraient encore les hommes et la lutte contre l'homophobie - même s'il est vrai qu'il y a eu de sérieuses avancées en la matière - et non pas contre la « lesbophobie ». Nous sommes solidaires des lesbiennes, nous menons des luttes communes, nous les soutenons, mais nous risquons d'être piégées par ce projet de loi. Dans ces conditions, que faire ? C'est la question que nous entendons aborder dans toutes les opérations que nous préparons contre la violence, même si nous n'avons pas encore définitivement arrêté nos modalités d'action : nous hésitons entre la publication d'une pétition ou celle d'un manifeste élaboré à partir de revendications précises. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : La solution du manifeste me paraît plus pertinente. Mme Maya Surduts : Avant de terminer, je rappellerai que la France, qui a ratifié, en 1984, la convention de 1979 pour l'élimination des discriminations faites aux femmes, s'est faite « retoquer » à plusieurs reprises, à l'ONU. C'est grave pour un pays qui se veut être le pays des droits de l'homme : il est peut-être le pays des droits de l'homme, mais pas celui des droits des femmes. Qu'elles soient lesbiennes ou hétérosexuelles, certaines femmes se trouvent encore dans une situation plus difficile que les autres, et à ceux de mes amis qui, notamment au sein de la LGTB, prétendent que de tels propos les insultent, je réponds : « homos ou hétéros, vous êtes des hommes ... ». Les hommes représentent le pouvoir économique, social et nos amies lesbiennes sont encore en plus grande difficulté que nous ne le sommes nous-mêmes. En conclusion, je dirai qu'en l'état, le projet de loi est une discrimination ; c'est encore une violence qui est faite aux femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je suis « montée au créneau » à plusieurs reprises ces deux dernières années et j'entends le faire également à propos de ce projet de loi. Pour obtenir un réel respect des femmes, il nous faut une loi globale, rassemblant tous les textes existants, disséminés de-ci, de-là, et qui mette l'accent sur des actions volontaristes de lutte contre les discriminations. Ce qui me choque dans cette loi, c'est que l'on y ait « rajouté », comme vous l'avez dit, une pincée de sexisme, comme on rajoute une pincée de sel dans une préparation culinaire. Je crois qu'il fallait promulguer une loi contre les propos homophobes ou lesbophobes, mais je considère que c'est desservir aussi bien l'homosexualité que les problèmes des femmes que de les mélanger. Les deux questions sont importantes et doivent être traitées de la même façon. Certaines personnes, de l'Observatoire de la parité notamment, qui ont travaillé à l'élaboration de ce projet de loi, m'ont confié qu'au départ, il ne visait que les propos homophobes. Je me félicite que vous ayez perçu ce défaut du texte à sa lecture, car, aujourd'hui, j'y suis également sensible et je trouve qu'il est extrêmement dommageable pour la femme en général. A mon sens, on ne doit pas faire des petites mesures. Sans être de la même mouvance qu'Yvette Roudy, je lui tire mon chapeau parce que, en travaillant sur ce sujet, elle a montré qu'elle avait de la suite dans les idées, sans doute à une époque encore plus difficile que la nôtre. Même si nous nous heurtons à des réticences, nous n'avons pas, comme a dû le faire Yvette Roudy, à affronter toute la classe politique. On ne peut pas m'accuser de partager ses idées politiques, mais j'ai pour elle beaucoup d'admiration. Elle a ouvert une voie qui, aujourd'hui encore, n'est pas bien comprise par tout le monde. Certains ont été très surpris par mes prises de position, mais, en la matière, je me situe dans la même logique qu'elle. Cela étant, je ne peux pas garantir le résultat, car nous avons vu, lors des élections sénatoriales, que nous étions bien seules à la Délégation à défendre nos positions et à éviter un retour en arrière. Mme Jocelyne Fildard : Je vais évoquer maintenant la spécificité lesbienne, ce qui éclairera nos précédents propos. Si je devais la décrire à l'aide de mots (ou de maux)-clés, je choisirais les suivants : invisibilité, négation, stigmatisation, haine, rejet. Dans la même démarche, si je devais en décrire les conséquences, j'emploierais les termes : autocensure, isolement, mal-être, mépris de soi. Je vous livre une définition de la « lesbophobie » qui a été retenue par la Coordination lesbienne : la « lesbophobie » est une aversion à l'égard des lesbiennes, qui est une forme de rejet de l'autre, comportement qui rejette celles ou ceux qui sont différents(es), comme des sous-êtres humains indignes de vivre. Enfin, qu'est-ce que la « lesbophobie » ? C'est un cumul de discriminations et de violences : le cumul des discriminations d'une part liées au sexisme - comme nous faisons partie du groupe social femmes, nous connaissons toutes les discriminations dont souffrent les femmes -d'autre part, dues à notre « orientation sexuelle », étant précisé que je n'aime pas beaucoup cette formule car, l'hétérosexualité étant également une orientation sexuelle, elle ne singularise pas suffisamment l'homosexualité. Elle n'est pas « parlante ». Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Quelle formule préconisez-vous ? Mme Jocelyne Fildard : L'orientation homosexuelle. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je vois là une forme d'incohérence dans la mesure où vous refusez que l'on parle, vous concernant, d'homophobie. Mme Jocelyne Fildard : Qui entend homophobie pense hommes et rattache donc le terme aux homosexuels et pas aux lesbiennes. S'agissant de « l'orientation homosexuelle », je prends l'adjectif au sens général, par opposition à l'orientation sexuelle qui correspond à l'orientation majoritaire. Les violences que subissent les lesbiennes vont de l'agression verbale au viol punitif en passant par les menaces, le harcèlement, les violences psychologiques et les coups. J'en prendrai deux exemples, dont l'affaire Nicole Abard dont vous avez peut-être entendu parler : il s'agit d'une femme qui, entraînant une équipe de foot féminine dans une municipalité de la région parisienne, s'est vu supprimer ses subventions au motif, déclaré en ces termes par le maire durant une séance du conseil municipal : « Je ne veux pas de brouteuses de gazon dans mon équipe ». Nous en sommes là au stade de l'injure, mais les choses peuvent aller beaucoup plus loin. Nous avons eu à connaître du cas d'une jeune lesbienne qui a été insultée par des voisins, menacée, aspergée de whisky, rouée de coups au point d'avoir des côtes fracturées, avant de subir un viol collectif, ce qui illustre à quelles extrémités peuvent conduire les insultes et je ne parle pas du cas du couple de lesbiennes qu'il nous a fallu cacher pour éviter que leurs parents ne les tuent. Souvent, des clichés caricaturaux nous relèguent à des rôles pervers, largement utilisés dans la pornographie pour alimenter les fantasmes masculins. Si nous parlons de « lesbophobie », c'est parce que nous ne pouvons pas nous reconnaître dans la seule homophobie, puisque, comme nous l'avons vu, la « lesbophobie » est faite à la fois de sexisme et d'homophobie. A l'inverse des gays, la discrimination la plus ravageuse et la plus violente est notre invisibilité tenace. L'étude sur les violences envers les femmes de Mme Nicole Péry, ancienne secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle, qui, à aucun moment, ne mentionne les lesbiennes, en est un exemple frappant. Je peux pourtant vous dire qu'à chaque rencontre j'ai harcelé Mme Nicole Péry et ses collaborateurs pour attirer leur attention sur notre situation, mais rien n'y a fait : nous sommes restées invisibles. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Parce que les problèmes des lesbiennes ne sont pas médiatisés comme ceux des homosexuels. Mme Jocelyne Fildard : C'est bien pourquoi je parle d'invisibilité. Je peux citer un second exemple : alors que nos camarades gays, bien que nous ne soyons pas toujours en bons termes avec eux, font l'effort, le jour de la Marche des fiertés, de nous faire défiler en tête pour que nous soyons visibles, la presse nous ignore. Si j'ai pu me faire entendre auprès des journalistes, c'est parce que j'ai couru après eux, parce que je les ai harcelés : c'est véritablement épuisant. Les conséquences de cette invisibilité sont terribles, d'autant que les lesbiennes, déjà invisibles pour les autres, accentuent elles-mêmes le phénomène en s'autocensurant et en se cachant, de peur d'être mises au ban de la société, d'être injuriées, humiliées, agressées. Toute cette forme de non-existence se traduit par un mal-être qui entraîne souvent une fuite dans la drogue, dans l'alcool ou une auto-négation par le mensonge : le lundi, de retour au travail, au moment où chacun raconte son week-end, les lesbiennes soit parlent « neutre », soit s'inventent un compagnon ou se disent célibataires. Cette situation peut aller jusqu'au suicide non seulement chez les adultes, mais aussi, et c'est un grave problème, chez les jeunes. Imaginez ce qu'on peut ressentir quand, vivant dans une société où le seul référent identitaire est l'hétérosexualité, on se sent lesbienne ou homosexuel. Selon l'étude Daphné, 30 % des suicides sont dus à la « lesbophobie » et à l'homophobie ambiantes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : C'est la découverte de son homosexualité qui pousse parfois le jeune au suicide. Mme Jocelyne Fildard : Ce n'est pas ainsi que je vois les choses : si la « lesbophobie » et l'homophobie étaient absentes de la société, la découverte de l'homosexualité ne poserait pas de problème. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : C'est parce l'homosexualité sera mal accueillie dans la société, que le jeune qui se découvre homosexuel, se sent incapable de tenir le coup et pense au suicide : j'ai eu à connaître de cette situation, dans le passé, avec certains de mes élèves. Mme Jocelyne Fildard : Oui, mais j'ai envie de compléter cette analyse en disant que c'est aussi par rapport à la « lesbophobie » et à l'homophobie ambiantes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Nous sommes d'accord. Mme Maya Surduts : Je crois que l'on mesure mal la souffrance qu'engendre une telle situation. Mme Jocelyne Fildard : Pour en revenir au projet de loi, une fois de plus, nous nous sentons les grandes oubliées. En créant le concept de « lesbophobie », nous n'avions aucune illusion sachant que, dans les textes de loi, on parle « d'orientation sexuelle », mais nous cherchions à « visibiliser » les lesbiennes. Pour nous, il serait important que, dans son énoncé, la loi associe la « lesbophobie » au sexisme et à l'homophobie et que le terme figure dans l'exposé des motifs. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Ce terme existe-t-il ? Mme Jocelyne Fildard : Non, c'est un terme que nous avons créé. Je vais vous faire un petit aveu : l'affaire est partie du Collectif national pour les droits des femmes, le jour où le mot m'est venu à l'esprit, pendant que nous préparions des affiches pour une campagne contre l'extrême droite. Comme je le disais à mes camarades, nous avons une lutte à mener : il faut faire en sorte que le terme « lesbophobie », à l'instar de celui d'homophobie, rentre dans le dictionnaire. Mme Danielle Bousquet : Cela risque de prendre du temps. Or, le texte doit venir en examen à l'Assemblée nationale avant Noël... Mme Jocelyne Fildard : À tout le moins, il faudrait que les lesbiennes y soient mentionnées. Nous voudrions émettre un autre souhait qui dépasse la réalité lesbienne : que soit associée aux termes « orientation sexuelle », l'identité de genre, ce qui permettrait de prendre en compte les transsexuels, qui sont également l'objet de discriminations, mais pas en raison de leur orientation sexuelle. Dans leur cas, c'est une affaire d'identité. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : On ne peut pas mélanger l'orientation et l'identité. Mme Jocelyne Fildard : Mais que va-t-on faire pour eux ? Mme Danielle Bousquet : J'ignore comment procéder : je suis d'accord pour dire qu'il y a de réelles discriminations à leur encontre, mais il n'y a pas de genre pour les transsexuels.. Mme Jocelyne Fildard : Même si je sais qu'il ne faut pas mélanger les choses, j'ai un devoir d'information et c'est pourquoi je tiens à attirer votre attention sur leur situation. Certes, nous sommes, nous, lesbiennes, les grandes oubliées, mais, même si nous souffrons de discriminations et si nous subissons de grandes violences, mieux vaut être lesbienne que transsexuel. Je peux vous dire, en effet, pour en avoir connu quelques-uns et quelques-unes, que leur vie est un enfer. Audition de Mmes Diane Mouratoglou et Samia Meghouche, membres de l'association Réunion du mardi 12 octobre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mmes Diane Mouratoglou et Samia Meghouche, membres de l'association « Ni putes, ni soumises » et avocates. Comme je l'ai dit la semaine dernière aux associations que nous avons auditionnées, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est une loi globale concernant le respect des femmes. Certes, il fallait, aujourd'hui, prendre en compte le problème des propos discriminatoires contre les homosexuels, mais je trouve réducteur la manière dont la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste a été insérée dans ce texte. Je pense que la femme ne sera respectée qu'à partir du moment où l'on considérera le problème dans sa globalité. L'éclairage de votre lecture du projet de loi nous intéresse et nous apportera des arguments supplémentaires dans notre réflexion. Mme Diane Mouratoglou : Vous évoquez un projet de loi global concernant le respect des femmes. L'association « Ni putes, ni soumises » a pour principal objectif de lutter contre la dégradation du statut des femmes qu'elle observe, notamment, dans les quartiers. Elle avance l'idée qu'il ne faut jamais faire de la femme une victime en tant que telle. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je suis d'accord avec vous. Mme Diane Mouratoglou : C'est un vrai problème. Il faut veiller à ce que la femme ne soit pas assimilée à un enfant mineur ou à une victime, qui n'a pas les moyens de se défendre seule, ni de réussir si on ne l'aide pas. Une femme peut réussir ; souvent elle doit travailler dix fois plus qu'un homme, c'est sûr, mais elle le peut. Cela lui demande plus de travail, elle va devoir « jongler » entre toutes ses obligations, parce que c'est encore et toujours la femme qui élève ses enfants. Elle arrivera à un résultat, souvent avec un salaire moins intéressant, mais elle y arrivera. Surtout, et c'est l'idée récurrente, la femme n'est pas une victime. Un projet de loi global sur le respect des femmes est honorable, mais attention à ne pas tomber, dans le schéma : « vous n'êtes pas assez fortes pour vous défendre toutes seules, donc on va légiférer ». Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je suis tout à fait de votre avis. Quand je mets en avant le terme respect, c'est justement pour bien mettre en évidence qu'il faut arrêter de prendre les femmes pour des victimes et qu'au contraire, il faut considérer qu'elles sont des êtres humains comme les hommes. Mme Diane Mouratoglou : Citoyennes à part entière. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Les femmes ont droit au respect. Mme Diane Mouratoglou : Nous ne nous sommes pas encore présentées. Nous sommes toutes les deux avocates et nous travaillons personnellement pour l'association « Ni putes, ni soumises ». A l'origine, j'ai connu l'association à l'occasion d'aide à la rédaction de contrats, parce que j'avais une sympathie pour ce mouvement, sans parfaitement le connaître. Par ailleurs, en tant que femme, en tant que mère, je ne veux pas vivre dans ce monde là et je ne veux pas que mes fils soient élevés dans cet esprit là. Le combat de l'association m'intéressait. Mme Samia Meghouche : Je vais expliquer à quel titre j'interviens bénévolement pour l'association. En ce qui me concerne, je suis contactée lorsque des victimes se présentent à l'association et sont victimes, soit de violence, soit de mariage forcé ou au pire de viol collectif. Dans ce cas, lorsque la victime se rend à l'association, je suis contactée et je la reçois : tout d'abord je la conseille, je peux l'assister ou la représenter ensuite en justice, selon les cas. Mme Diane Mouratoglou : Nous sommes dans ce combat, et en même temps, nous avons souvent des analyses de juriste, puisque c'est notre métier. Lorsque nous en parlons avec Fadela Amara, présidente de l'association, nous arrivons souvent à la conclusion qu'une loi, c'est bien, mais la loi existante, c'est-à-dire les valeurs actuelles qui devraient normalement être celles de la République, ne suffirait-elle pas aujourd'hui à assurer ce respect de la femme ? La République aurait-elle encore besoin de légiférer, parce qu'elle ne n'ose plus affirmer ses valeurs et les défendre bec et ongles, parce qu'elle a peur d'être taxée d'intolérance ? L'arsenal législatif n'existe-t-il pas déjà aujourd'hui ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Si, il existe, mais malheureusement il n'est pas appliqué. Mme Diane Mouratoglou : Pourquoi ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Le premier travail d'un parlementaire est de voter la loi, et le deuxième travail est de voir si elle est appliquée. Si la loi est bonne, elle est appliquée et le maximum est fait pour l'appliquer, sinon il faut l'abroger. Mme Diane Mouratoglou : S'agissant du projet de loi, j'ai déjà été auditionnée par Mme Brigitte Barèges, rapporteure au nom de la commission des lois, sur ce sujet. Je vais vous redire très rapidement ce que j'avais exprimé à l'époque au nom de l'association. Ce projet de loi ne constitue pas une grande avancée, mais cependant, il a le mérite d'exister, d'avoir une valeur déclarative. Au moins, il rappelle que la norme, aujourd'hui, c'est que l'on ne tient pas de propos racistes, antisémites, ni de propos fondés sur une discrimination sexiste ou homophobe. Mme Samia Meghouche : Nous avons remarqué dans l'exposé des motifs que le projet de loi n'allait pas restreindre la liberté de la presse, car il ne permet pas de poursuivre des propos à caractère sexiste comme le seront les propos homophobes. Mme Diane Mouratoglou : Il est écrit que les diffamations et injures sexistes continueront de tomber sous le coup des diffamations et injures de droit commun, afin de permettre de concilier la liberté de la presse et la nécessité de lutter contre des discriminations. On va donc les punir, mais on passe à côté du sexisme, comme si il ne pouvait pas y avoir de diffamation à caractère sexiste. Comme l'a souligné Mme Brigitte Barèges, personne ne comprend la distinction faite entre propos homophobes et propos sexistes. Mon hypothèse - car des rumeurs avaient couru qu'éventuellement la presse aurait fait savoir qu'une telle loi était attentatoire à sa liberté - est que cela résultait d'une espèce de négociation avec la presse. Viser les propos homophobes d'accord, mais les propos sexistes, non, parce que la presse ne pourrait plus rien dire. Tant que l'on vivra dans une société où des millions de personnes entendent les journalistes tenir des propos sexistes aussi idiots que « elle aurait mieux fait de rester chez elle à torcher ses mômes », le Français moyen se dit que, si un journaliste le pense, il peut le penser. Il est dommage que de tels propos soient tenus par des journalistes ayant un niveau élevé d'éducation. Je crois qu'ils n'en sont pas conscients et le pire c'est qu'ils présentent cela comme quelque chose de drôle, mais ce n'est pas drôle, parce qu'il y a des millions de femmes qui se battent pour essayer de travailler. Mme Catherine Génisson : Pourquoi une nouvelle loi ? Un article récent de Libération dénonce le fait que la violence conjugale conduisant au crime n'est pas caractérisée dans le code pénal. Mme Samia Meghouche : Il me semble qu'il y a trop d'infractions. Ce n'est pas forcément opportun d'en créer une nouvelle. L'infraction de meurtre existe. Ensuite, il y a des circonstances aggravantes. Les violences conjugales... Mme Catherine Génisson : Le crime passionnel bénéficie de circonstances atténuantes. Mme Diane Mouratoglou : Souvent, pas officiellement, mais les jurés le perçoivent comme tel en général, c'est vrai. Combien de personnes n'avez vous pas entendues dire, dans le cadre de l'affaire de l'actrice Marie Trintignant tuée par Bertrand Cantat : « Ah ! ce Bertrand Cantat, j'avais de la sympathie pour lui ; elle devait être dingue ». Là n'est pas le problème ; quand bien même elle serait méchante, infidèle et dingue, qu'est ce qui justifierait qu'elle ait reçu des coups qui l'aient conduit à la mort ? C'est de la violence. Mme Samia Meghouche : C'est le système de défense des agresseurs qui, parlant de leur femme ou de leur concubine, invoquent toujours l'hystérie, qui justifierait les coups, pas vraiment volontaires, qu'ils ont pu porter. Mme Diane Mouratoglou : Que dans le cadre d'un procès, les personnes accusées se défendent, c'est de bonne guerre ! Mais que ces idées soient relayées par la presse et que l'on ait des rapports psychologiques disant que la famille Trintignant était elle même oppressive, etc. ! Dans le cadre d'un procès pénal, entre personnes bien informées, qui savent manier ces notions, d'accord, mais que l'on répande ces éléments là, dans le public, c'est un scandale ! Rien ne mérite qu'une personne soit rouée de coups au point d'en mourir. Mme Catherine Génisson : S'agissant de l'affaire du rugbyman qui a tué sa femme, on considère qu'il s'agit d'un meurtre isolé, qui a un minimum de légitimité. Mme Diane Mouratoglou : Il était ivre et « elle en avait rajouté... ». L'article de presse allait même plus loin en évoquant le cas du meurtrier en série Fourniret qui avait eu cette expression : « il y avait des matins, je me levais et je partais à la chasse aux vierges ». C'est un malade, c'est un fou, bien sûr ; mais en allant plus loin, si des hommes se réveillent le matin en se disant : « j'ai envie d'aller à la chasse aux vierges », c'est qu'un certain nombre d'idées qui circulent dans la société sont dangereuses. Mme Catherine Génisson : Tout à l'heure, on parlait de respect, mais le respect c'est d'être traité à égalité. Sur les sujets abordés par le projet de loi, il n'y a même pas de traitement à égalité. Mme Diane Mouratoglou : J'ai craint au début un texte concernant les discriminations contre les femmes. Non, il a bien été écrit : « discriminations à raison du sexe », ce qui peut viser également le sexe masculin ; des hommes peuvent se sentir eux aussi victimes. Le projet de loi a bien respecté l'idée que c'est la discrimination fondée sur le sexe qui est punissable, pas seulement une atteinte portée aux femmes. Mais, ensuite, le texte établit une distinction incompréhensible. Ce texte aura une valeur normative, certes, mais dans la pratique, cela ne changera pas grand chose. S'agissant des femmes vivant dans les cités, elles sauront qu'il existe une loi sur la discrimination, mais en ce qui les concerne, lorsqu'elles se font seulement insulter, elles sont contentes. Les insultes, les propos sexistes, c'est leur lot quotidien. Le curseur est déjà placé plus loin pour ces femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Une loi comme celle-ci ne sert donc à rien pour elles ? Mme Diane Mouratoglou : Si. Son intérêt est sa valeur déclarative. Elle existe. La loi, la République française, combat les propos discriminatoires, toute discrimination fondée sur le sexe, c'est la norme. Maintenant, telle qu'elle est rédigée, elle ne permettra pas de réprimer les diffamations et injures fondées sur le sexe. En pratique, je pense qu'elle peut servir à éviter certains excès commis par les journalistes. Mais, elle ne changera rien à la vie quotidienne des femmes. L'impact pratique est assez faible, a priori. Mme Danielle Bousquet : Les associations qui vous ont précédées la semaine dernière, nous ont dit que cette loi n'était pas vraiment utile, mais qu'elle était en plus dangereuse, dans la mesure où elle établissait une hiérarchie des normes. Je vais utiliser des propos grossiers et vous allez m'en excuser, mais il vaudra mieux dire « sale pute » que « sale pédé ». L'avis des associations était de dire : « Surtout, ne voter pas un texte ainsi rédigé ». Autrement dit, ou bien on écrit sexiste partout ou on ne l'écrit nulle part. La hiérarchie qui est faite est extrêmement dangereuse et ne peut que conforter, auprès des jeunes, l'idée que le sexisme, ce n'est pas grave. Mme Samia Meghouche : Surtout auprès des femmes des quartiers qui ont déjà l'impression que la violence dont elles sont victimes - j'entends la violence verbale, les propos à caractère sexiste - est normale, car elles sont insultées régulièrement par tout le monde. Si le projet de loi établit une différence entre les femmes et les homosexuels, cela voudra dire que les violences verbales dont elles sont victimes ne sont pas si importantes. Au contraire, la République doit leur montrer que ce sont des infractions qui doivent être réprimées, pour qu'elles mêmes parviennent à combattre et à dénoncer ces violences. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Votre intervention conforte ce que je pense depuis le dépôt de ce projet de loi. Je n'ai pas souhaité que la Délégation en soit saisie parce que je considère que l'on ne doit pas mélanger les genres, même si certains considèrent qu'il s'agit d'une avancée. Je pense que ce n'est pas une avancée positive pour les femmes. Mme Diane Mouratoglou : L'exposé des motifs du projet de loi précise : « les diffamations et injures sexistes continueront évidemment de tomber sous le coup des diffamations et injures de droit commun afin de permettre la conciliation entre le principe constitutionnel de la liberté d'expression et les nécessités de la lutte contre les discriminations. » Implicitement, la presse aurait donc le droit de tenir des propos sexistes... Les médias ont sans doute fait valoir le problème des frontières du propos sexiste et la crainte de poursuites judiciaires à raison d'une publicité ou d'un propos de cette nature. Mme Danielle Bousquet : L'homophobie et le sexisme n'ont pas le même statut dans la société. L'homophobie est une chose contre laquelle les personnes qui ont un peu réfléchi s'élèvent. Le sexisme est largement partagé, quels que soient les milieux et ne touche pas aux mêmes ressorts. Le sexisme est parfaitement intégré, de tout temps et dans toutes les civilisations... C'est la raison pour laquelle, la présidente a évoqué une loi globale concernant tous les ressorts du sexisme, en particulier la publicité qui nous montre des images humiliantes et dégradantes des femmes. Je ne souhaite pas que mon petit fils, par exemple, soit élevé dans cette atmosphère. Il ne s'agit pas de pudibonderie, ni de morale, mais de respect des individus. Le texte proposé ne répond pas du tout aux questions fondamentales qui sont posées à notre société. Mme Marie-Jo Zimmermann : Je partage votre inquiétude. Nous qui sommes impliquées dans des métiers comme l'enseignement, la médecine, la petite enfance, nous connaissons les problèmes de l'éducation. En tant que parlementaire, soit en proposant un texte, soit en le votant, nous avons un devoir moral. C'est la raison pour laquelle je continuerai à m'élever contre ce projet de loi. C'est une solution de facilité qui a été choisie, avec une pincée de publicité en ce qui concerne les propos sexistes. Je crois que le respect de la femme est un problème global et si on ne le prend pas en compte, on manque véritablement ce qui doit être à la base de l'éducation. Mme Catherine Génisson : Le texte tel qu'il est présenté actuellement est inacceptable. Mme Danielle Bousquet : Même le titre est inacceptable. Je le rappelle : « La lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe ». Or, les propos à caractère sexiste ne sont mentionnés que dans le titre ! Mme Catherine Génisson : A propos de publicité, par exemple, en ce moment, on voit dans le métro une publicité C & A : « deux pantalons, pour le prix d'un », montrant deux jambes de pantalon d'homme avec une photo de femme, jupe fendue jusqu'aux fesses et une autre photo représentant une jeune fille, jupe plissée relevée... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Il y a pourtant une charte qui a été signée avec le Bureau de vérification de la publicité. Mme Diane Mouratoglou : Un équilibre doit être trouvé entre l'élégance, la séduction, la féminité sur lesquelles il doit être possible de jouer et le respect de la femme. La publicité se sert de l'argument de séduction. Et en soi ce n'est pas anormal. Mme Catherine Génisson : Cela me choque lorsque c'est une image qui dégrade. Il y a toutefois des obstacles à une loi anti-sexiste, notamment le risque de tomber dans la pudibonderie et la moralisation. L'anti-sexisme est considéré comme relevant du domaine privé et non pas du domaine public. Il est toujours considéré quelque part que la femme le fait exprès... ; « si elle ne s'était pas habillée ainsi, cela n'arriverait pas », dit on. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Je voudrais savoir si l'intégration des femmes et des jeunes filles des cités a progressé. Mme Samia Meghouche : Je dirais plutôt qu'il y a aujourd'hui une régression dans l'intégration. Dans les cités habitent des familles d'origine soit maghrébine, soit africaine, dont les traditions, la culture et la religion sont, en général, difficilement conciliables avec les valeurs de la République. Ces familles là ont des difficultés et les jeunes filles de ces familles, nées en France, donc françaises, ont du mal à s'émanciper. Les garçons, pour leur part, perpétuent malheureusement ces traditions qui leur sont favorables. Les jeunes filles se retrouvent sous la pression des parents, des familles, de la cité et également des frères, dont la mission est de préserver l'honneur de la famille, aussi bien par rapport au père qu'aux autres membres de la communauté, et de le faire respecter par leurs sœurs. L'honneur de la famille, notion très importante dans ces communautés, repose sur l'honneur de la jeune fille, qui doit rester vierge jusqu'au mariage. Sur le terrain, je vois des jeunes filles dans des situations de mariage forcé, emmenées dans le pays d'origine pour se marier, parce qu'elles font prendre des risques à l'honneur de leur famille en voulant s'émanciper et nouer des relations extérieures au milieu d'origine. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Quand la jeune fille part au pays, sait-elle que c'est pour un mariage forcé ? Mme Samia Meghouche : En général, non. Il y deux cas. Dans un premier cas, la jeune fille est au courant et elle est « consentante », en se disant que ce sera mieux que de rester enfermée à la maison sans liberté. C'est peut-être un mal pour un bien. Dans un deuxième cas, comme ses parents pressentent qu'elle n'est pas prête à l'accepter, elle n'est pas du tout mise au courant. On lui dit que l'on part en vacances comme chaque année au pays, et là elle se retrouve mariée. Il est courant que l'acte de mariage, dans le pays d'origine, ne soit même pas signé par la jeune fille elle même. Mme Marie-Jo Zimmermann : C'est un mariage par procuration. Mme Samia Meghouche : La jeune fille n'a pas son mot à dire. La liberté de se marier, ou pas, avec la personne de son choix n'existe pas. On ne cherche pas à savoir s'il y a, ou non, consentement. Ensuite, ces jeunes filles reviennent avec des hommes, originaires de ces pays, en possession d'un visa et qui ne sont pas français. La transcription du mariage est faite automatiquement, sans que soient posées des questions. Il faudrait à ce stade, peut-être, poser des barrières, instituer un contrôle, vérifier par des entretiens individuels le consentement de la jeune fille. Mme Marie-Jo Zimmermann : Sera-t-elle capable de dire la vérité ? Mme Samia Meghouche : Lors d'un entretien individuel, je pense que beaucoup d'entre elles, la dirait, ou du moins, la ferait comprendre. Des questions pourraient être posées. Il peut sembler bizarre qu'une jeune fille de 17, 18 ans, née en France, poursuivant ses études, revienne mariée, après un mois passé dans son pays d'origine. Mme Diane Mouratoglou : Notre but est vraiment une mission de protection de la femme. Quand on lutte contre les mariages forcés, il apparaît normal de vérifier la situation d'une jeune fille qui a fait toutes ses études en France, qui habite en France, qui est de nationalité française et qui, après deux mois passés au Maroc, en Algérie ou dans un autre pays, revient avec un mari, lui même en situation irrégulière. Ce n'est pas la situation irrégulière du mari qui nous importe, mais celle de la jeune fille. Or, nous nous heurtons à des associations de protection des droits des étrangers, qui vont critiquer notre intervention comme hostile aux étrangers. Nous essayons de protéger ces jeunes filles en situation d'enfermement vis-à-vis de tout le monde : le père, la mère, les frères, la famille, la cité. Quelle est l'option qui s'offre à elles ? Dire non, mais pour faire quoi ? Elles n'ont pas de travail. Il convient aussi de considérer l'aspect affectif de leur situation, car même si les parents sont un peu durs, ou les frères un peu casse-pieds, elles continuent à les aimer. Le parallèle peut être fait avec les enfants maltraités qui aiment leurs parents. Ces jeunes filles devront se mettre en rupture affective, mais ensuite et pour parler concrètement, il faudra bien qu'elles gagnent leur autonomie. Mme Samia Meghouche : Nous avons des cas concrets à l'association « Ni putes, ni soumises ». Des jeunes filles viennent nous voir juste avant le mariage envisagé, qui est en réalité un rapt, et qu'elles n'acceptent pas, pour demander de l'aide, pour dire qu'elles ne veulent pas partir. S'agissant de mariages célébrés en France, nous devons saisir le Procureur de la République pour empêcher le mariage au niveau de la mairie. Il est des familles qui ne lâchent pas pour autant la jeune fille, qui la recherchent et qui sont prêtes à aller très loin. Or, nous n'avons pas les moyens de protéger ces jeunes filles en détresse. Nous avons récemment accueillie une jeune fille. Elle a été hébergée par un membre de l'association « Ni putes, ni soumises », qui a pris également des risques. Mme Diane Mouratoglou : Il y aurait des moyens matériels à mettre immédiatement en œuvre, mais qui n'existent pas actuellement. Il faudrait qu'on puisse proposer un logement et un travail à la jeune fille, qui a déjà le courage d'accepter la rupture morale et affective, et qui est prête à partir et à subvenir à ses besoins. Ce phénomène toucherait en France entre 50 000 et 70 000 femmes par an, mariages dits « civils », mais aussi mariages « coutumiers », qui existent aussi. Le mariage coutumier concerne surtout certains pays d'Afrique subsaharienne et répond au souci de préserver la virginité de la jeune fille, l'honneur de la famille, pour s'assurer que celle-ci reste bien dans le clan, qu'elle va se marier avec quelqu'un de sa race, de sa religion. On va, le cas échéant, faire venir le jeune homme à la maison et puis, un prêtre, un clerc, un représentant de la religion va célébrer un mariage purement religieux. Ensuite, le jeune homme va prendre possession de la jeune fille. Mais, quand la jeune fille a douze ans, cela s'appelle du viol organisé et sponsorisé par la famille, parce qu'à douze ans, on est une petite fille, même si on est formé et si on a eu ses règles. Le dispositif législatif actuel ne prévoit pas de sanctions extrêmement sévères à l'encontre de la personne qui célèbre ce mariage coutumier, en dehors de toute intervention du maire. Ces situations existent aujourd'hui en France. Mais des éléments statistiques sont très difficiles à réunir. Un projet de loi global sur le statut de la femme pourrait être l'occasion de s'attaquer à ces problèmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Quels ont été les effets de la loi sur le voile, en positif ou en négatif ? Mme Diane Mouratoglou : La position de « Ni putes, ni soumises » sur ce sujet est extrêmement claire. C'est pour cela que Fadela Amara et « Ni putes, ni soumises » sont souvent critiquées, car elles défendent leurs idées de manière très nette et ne transigent pas sur certaines valeurs. L'excision, c'est non. Le voile, c'est non. Le mariage forcé, c'est non. Votre culture, quand elle pratique l'excision, le mariage forcé ou l'interdiction de certains lieux aux jeunes filles, c'est non. En ce qui concerne la loi sur le voile, les médias en ont fait l'affaire du siècle, alors que nous avions déjà une loi. Mme Samia Meghouche : Nous avons eu l'impression que la majorité des jeunes filles musulmanes en France étaient concernées, alors que ce n'était pas le cas. La majorité ne porte pas le voile et en est très contente d'ailleurs. Elles sont musulmanes de par leurs parents, mais la plupart n'ont aucune envie de porter le voile. Ce problème ne concernait qu'une toute petite minorité. Mme Diane Mouratoglou : En ce qui me concerne, j'ai lu certains articles, émanant d'intellectuels, disant qu'il fallait respecter la tolérance et qu'avec cette loi sur le voile, on allait exclure du système scolaire des dizaines de milliers de jeunes femmes. Je crois que le problème en France s'est posé au premier jour pour quatre cents jeunes filles pour l'ensemble de la France ; je pense que c'est peu ; au bout d'une semaine le problème ne se posait déjà plus que pour une douzaine d'entre elles. Si douze jeunes filles sont exclues éventuellement du système scolaire, pour que des milliers d'autres suivent leur scolarité normalement et sereinement, c'est très dommage pour elles... Mais, l'école doit assumer son rôle émancipateur dans le respect de l'égalité des chances. Quelle égalité des chances y a-t-il entre une fille voilée et le reste de ses camarades ? Pense-t-on qu'en arrivant voilée, elle dispose d'une égalité des chances pour faire des études supérieures, occuper des postes importants ? Selon une phrase souvent employée par les membres de l'association « Ni putes, ni soumises » : « la femme voilée aura le poste que sa pudeur impose ». Elle sera manutentionnaire, elle emballera des sacs à l'arrière d'une usine. Elle ne sera même pas caissière, parce que le voile ne passe pas. Elle ne fera pas d'études supérieures et ne sera pas médecin, avocate ou magistrate. L'égalité des chances ne lui est pas assurée. La République aurait commis une faute en laissant passer ce problème de voile. Mme Samia Meghouche : Je pense que cette loi, au contraire, aide vraiment les jeunes filles contraintes de porter le voile et qui, heureusement, sont obligées de le retirer pour aller à l'école et respecter les lois de la République. Dans ce sens, cette loi est salvatrice. Mme Diane Mouratoglou : Des parents qui n'étaient pas forcément excessifs, mais qui se sentaient obligés de faire porter le voile à leurs filles, sont déculpabilisés. Nous sommes une société différente de la société anglaise, fondée sur le communautarisme. En Angleterre, par exemple, j'ai rencontré, récemment, même dans les administrations, des femmes voilées d'origine pakistanaise. Cela ne choque pas là-bas. En France, nous ne sommes pas une société à l'origine de communautarismes. Nous n'en avons pas la tradition, ni la culture. Maintenant, il existe en Angleterre, au delà des communautarismes, une adhésion tacite de chacun à un pacte social. Ce qui est regrettable en France, c'est qu'il n'y a plus d'adhésion forte à ce pacte social. Il y a une perte de confiance dans l'idée collective que nous avons de nos différences, de nos cultures, de nos religions. Nous allons pourtant tous dans le même sens, nous habitons tous le même pays, c'est notre lien transcendant, unique et fondamental ; tout le reste n'est que littérature. La France doit reconstruire cette idée d'adhésion sociale. Mme Samia Meghouche : Je crois que l'Education nationale a un grand rôle à jouer en enseignant aux enfants dès leur plus jeune âge l'éducation civique. L'éducation civique aurait elle été supprimée des programmes ? Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : J'ai enseigné jusqu'en 1998 et j'ai toujours fait mes cours d'instruction civique, qui ont d'ailleurs toujours été au programme. Mais le problème, c'est que les professeurs ont pris l'habitude de ne pas enseigner l'instruction civique pour la raison que cette matière n'était pas sanctionnée par une note à l'examen. C'est cela qui est regrettable. Mme Danielle Bousquet : Tout ce que vous nous dites en ce moment est relativement nouveau historiquement. Il y a quinze ans, vous n'auriez sans doute pas dit cela. Cette violence en direction des jeunes filles me semble relativement nouvelle. Il y a vingt ans, on ne s'occupait pas de cette manière là de la virginité des jeunes filles dans les familles et le voile n'était pas imposé. Comment expliquez-vous la dérive qui a conduit à ce repli identitaire et communautaire, à cette violence en direction des jeunes filles dans les banlieues ? Mme Samia Meghouche : Il y a eu un renversement des valeurs. Le point d'origine en est l'école en raison du grand nombre de jeunes qui se sont retrouvés en échec scolaire. Le problème vient aussi de la formation des professeurs qui, à l'issue d'un concours, sont envoyés dans les quartiers « difficiles ». Ils n'ont jamais enseigné, n'ont aucune formation et ne connaissent pas les problèmes spécifiques de ces quartiers. Comment pourraient-ils aider ces enfants, alors qu'ils ne connaissent pas leurs difficultés et n'ont pas de pédagogie ? Ils en viennent à les laisser de côté. On tente d'orienter ces enfants, on leur propose une formation de serveur... De fils en aiguilles, ils se retrouvent en échec scolaire, et comme on est dans le cercle fermé de la cité, la tentation de l'argent facile, des trafics, les guette. Mme Diane Mouratoglou : Je pense qu'il y a deux choses qui ont joué. La première, c'est plus largement que l'échec scolaire, le manque de perspective. A partir du moment où vous n'avez plus de rêve, vous ne croyez plus en rien, vous ne pensez pas que vous pouvez vous en sortir et tout vous paraît insurmontable. La difficulté c'est que, pour s'en sortir, il faut être encore plus volontaire, intelligent et travailleur, encore plus aidé et soutenu par sa famille qu'un enfant « normal » qui grandit dans un quartier « normal ». Quand le meilleur exemple que vous ayez sous les yeux, c'est le garçon qui a réussi parce qu'il est chef des livreurs au Casino, ce n'est pas excitant. Le manque de perspective engendre un sentiment de rejet : « de toute façon, la société ne nous aime pas et nous ne l'aimons pas non plus ». Pourtant d'énormes efforts ont été faits pour tendre la main ; on a combattu sévèrement le racisme ; des subventions ont été trouvées. De temps en temps, cette population joue aux victimes. Tout le monde n'est pas raciste en France, il convient de ne pas culpabiliser ; il y a beaucoup de personnes de bonne volonté. Le manque de perspective conduit à un manque d'investissement personnel. Deuxièmement, il existe une sorte de sentiment de misérabilisme : « la société ne nous aime pas, pourquoi ferions-nous des efforts ? » Cela s'est doublé à mon avis d'un sentiment de culpabilisation des instances dirigeantes qui n'osaient plus dire les choses franchement. Tout était strictement encadré. Nous avons peut-être manqué de courage, d'affirmation de nos propres idées. Face au Front national, il convenait de ne pas se faire le relais de propos d'extrême droite. Il y a eu aussi peut-être les excès de mai 1968. La liberté était le mot d'ordre. On ne sait plus aujourd'hui ce qu'est la politesse, la tenue, la pudeur et cela engendre des réactions peut-être intégristes. Pendant plusieurs années, au nom de la liberté, dont peut-être certains avaient manqué, il était interdit d'interdire. On n'osait plus dire « non » à l'école, dire : « vous êtes rasé, vous êtes propre, vous n'avez pas de couvre chefs sur la tête, vous n'avez pas une frange qui vous couvre les yeux ». Je pense qu'il ne faut pas craindre de remettre à la mode les valeurs de base de respect, de politesse et d'éducation. Après dix ans de dérive, les enfants, dans les cités, ne savent même plus que l'on ne va pas à l'école en tutoyant son professeur, en étant mal rasé, en ayant des « trucs » sur la tête avec lesquels on ne voit plus les yeux. A l'occasion du débat sur le voile, des journalistes se sont crus autorisés à dire : « Attendez, cette loi, les élèves ne vont rien y comprendre. Sera-t-on autorisé à aller à l'école avec une casquette ? un bandana ? un string ? » La question ne se pose même pas : on ne va pas à l'école avec sa casquette, son bandana et son string. En quoi attente-t-on à la liberté de quelqu'un en lui disant : « Monsieur, vous est êtes en cours avec moi, je ne vois pas vos yeux, tenez vous correctement. » ? Mme Danielle Bousquet : Pourquoi les enfants des banlieues auraient-ils été plus marqués que d'autres ? Pourquoi ces dérives ont-elles conduit ces garçons à être violents vis-à-vis des filles ? Mme Diane Mouratoglou : Quand l'éducation ne se fait plus, certains mythes, comme ceux de la virginité, de la pureté, la remplacent et prennent une importance démesurée et nous en voyons l'aboutissement qui peut aller jusqu'au mariage forcé. La petite fille, jusqu'à un certain âge, est autorisée à voir des copains garçons, à se promener librement, mais dès qu'elle est pubère, tout cela s'arrête, car il y a risque de perte de la virginité ; mais cela veut également dire perte de toutes les libertés : elle ne va plus où elle veut, elle n'est pas autorisée à aller dans les cafés, dans les salles de sport. Il semblerait qu'une grande piscine de la ville de Lille ait pris des mesures afin d'avoir des horaires mixtes. L'association « Ni putes, ni soumises » est opposée à ce genre de choses. Il s'agit d'une première atteinte à la liberté d'aller et venir, d'une atteinte à la liberté de son corps, parce que la jeune fille ne s'habille plus comme elle l'entend. Porter un décolleté sera vu comme malsain, et ce qui peut arriver serait considéré comme mérité. La jeune fille risque gros, soit l'insulte, soit le viol collectif, qui sont devenus normaux, puisqu'on ne connaît plus la femme, qu'on ne la fréquente plus. L'éducation des garçons est également basée sur l'interdit et le sexe est considéré comme tabou. Le garçon et la fille ne se connaissent plus ; ils n'ont pas appris à se respecter, à se connaître et cela laisse libre cours à toutes les explosions. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : La permissivité a provoqué effectivement cette montée de l'intégrisme. Mme Samia Meghouche : L'intégrisme aggrave encore plus les discriminations. De prétendus imams viennent inculquer à des jeunes qui n'ont aucune connaissance de la religion, une interprétation « extrémiste » de la religion conduisant à discriminer les femmes : elles doivent se couvrir pour sortir, cacher les poignets, les cheveux. Il n'y a pas de règles de cette nature dans le Coran, ce ne sont donc que des interprétations que les jeunes vont suivre pour opprimer leur sœur, leur femme... Mme Diane Mouratoglou : Les religieux n'arrivent pas à canaliser ces jeunes, car leurs propos sont ambigus. S'agissant des viols collectifs, ces religieux évidemment vont diront que ce n'est pas bien, car le sexe est considéré comme étant mal ; ils ajouteront que les femmes qui se couvrent méritent le respect, sous entendu pour certains « avec les autres, faites ce que vous voulez... ». Deux faits divers effectivement très durs sont symboliquement révélateurs de ces problèmes de perception et d'inversement des valeurs. Le premier dont nous avons eu connaissance, est l'histoire d'un jeune garçon d'environ 15-16 ans dans une cité. Des garçons d'une cité voisine qu'il connaît un peu de vue mais pas très bien, viennent le chercher et lui disent : « il y a une fille qui tourne à côté ». Le garçon les suit, peut-être pour ne pas se ridiculiser, et se rend compte que c'est sa sœur que l'on est en train de violer. Il retourne chez lui, prend une arme, revient dans la cave, tue sa sœur et ensuite se tue. Mme Samia Meghouche : Elle avait souillé l'honneur de sa famille, même si cela n'était pas de sa faute. Mme Diane Mouratoglou : Le second exemple est l'affaire du viol de la dalle d'Argenteuil, qui a été très médiatisé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu une amourette avec un garçon de la cité. Celui-ci en a parlé à ses copains : elle doit être une fille facile, perdue, etc. ... on va y aller. Elle a été ensuite menée une première fois par d'autres filles, elle a été violée par vingt garçons et elle y est retournée trois fois. On ne parle pas de sexe dans sa famille, on ne va même pas chez le médecin. On ne va pas voir un gynécologue avant d'être marié, on ne prend pas la pilule. Il n'était donc pas possible pour cette jeune fille d'avouer à ses parents qu'elle avait été violée. Elle ne pouvait pas aller voir la police, parce que ses parents l'auraient su et que la honte était présente. Il aura fallu trois viols pour qu'elle se décide. Elle pense que l'honneur de sa famille a été atteint, elle ne pense pas qu'il peut y avoir des criminels. Mme Samia Meghouche : Elle se remet forcément en question parce qu'on lui a toujours appris qu'il fallait baisser la tête, aller à l'école, rentrer chez soi. Et comme elle a flirté avec un garçon, elle l'a un peu cherché. Il faut qu'elle réussisse à dépasser cela, pour aller plus loin et essayer de faire sanctionner ces actes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Quand situez-vous le renversement des valeurs qui est à l'origine de ces comportements ? Mme Diane Mouratoglou : A la fin des années 80. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : On ne touchait pas aux jeunes filles à l'époque. J'ai senti personnellement ce changement avec mes élèves, à la fin des années 80, au début des années 90. Mme Samia Meghouche : Offrir une perspective est un élément important pour montrer à ces jeunes qu'ils peuvent réussir. Il arrive cependant que certains se démarquent parce qu'ils ont plus de volonté, qu'ils sont davantage poussés par les parents, mais c'est une minorité. A ces enfants en difficulté, on ne montre pas ceux qui réussissent et qui arrivent à s'en sortir. Cet état de fait est quelquefois renforcé par les professeurs eux-mêmes qui dévalorisent les enfants en leur disant qu'ils ne sont pas bons élèves, qu'ils ne seront pas capables de suivre, par exemple, une formation de droit. Mme Diane Mouratoglou : Les professeurs peuvent causer des dégâts chez les enfants très jeunes, en leur disant : « tu es nul... » L'enfant intègre ce message qui vient de l'autorité, et lorsqu'on le lui dit depuis qu'il a six ans, il devient effectivement mauvais. Valoriser un enfant, par la parole, ce ne sont pas des moyens qui demandent beaucoup d'argent. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente : Il conviendrait d'affecter dans les ZEP des professeurs qui ont de l'expérience. Certains sont très négatifs. J'ai le souvenir de collègues donnant les appréciations suivantes sur les bulletins : « Tout est nul », « Peut mieux faire ». C'était terrible, alors qu'il y a des possibilités de valoriser l'enfant. Je vous remercie beaucoup de votre intervention extrêmement instructive. Des témoignages comme les vôtres peuvent nous faire avancer. Audition de Mme Marie-Cécile Moreau, juriste Réunion du mercredi 3 novembre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué qu'elle avait souhaité recueillir l'avis de Mme Marie-Cécile Moreau, juriste, présidente de l'association française des femmes de carrières juridiques, sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Mme Marie-Cécile Moreau a fait partie des personnes auditionnées par le groupe de travail interministériel installé auprès de M. Dominique Perben, Garde des Sceaux, à l'occasion de l'élaboration du projet de loi. Son éclairage sur l'historique du texte et sur ses aspects juridiques est donc particulièrement intéressant. Pour sa part, Mme Marie-Jo Zimmermann a réaffirmé son opposition à un texte qui, d'une part, mélange les problématiques homophobes et sexistes, d'autre part, établit une inégalité de traitement en matière de sanction entre les propos homophobes et les propos sexistes. Elle a observé qu'un article du journal Le Figaro, ce mardi 3 novembre, posait la question de l'interprétation par les juges de la notion de sexisme et s'est interrogé sur les problèmes posés par une telle interprétation en matière pénale. Mme Marie-Cécile Moreau a précisé sa participation au groupe de travail de la Chancellerie. Elle a été convoquée et entendue le 12 janvier 2004. Elle a par la suite participé à une réunion plénière, à laquelle étaient convoquées toutes les personnalités entendues et les représentants des ministères intéressés, et au cours de laquelle il a été donné connaissance oralement des propositions que la Chancellerie allait remettre au Premier ministre. Il a également été indiqué que ce seraient les articles 24, 32, 33 et 48 de la loi de 1881 sur la presse qui seraient modifiés. Beaucoup des personnes auditionnées semblaient satisfaites, Mme Marie-Cécile Moreau a relevé la nécessité, en matière pénale, de connaître avec exactitude les termes des modifications proposées. En effet, un texte pénal ne supporte pas d'interprétation de texte. Or, le terme sexisme est imprécis et subjectif et pose donc problème. Mme Marie-Cécile Moreau a observé qu'elle avait fait part de son souhait d'avoir communication du document qui serait transmis au Premier ministre à l'issue de cette réunion, mais elle n'a pas obtenu satisfaction. Ceci précisé, elle est passée à l'exposé des raisons pour lesquelles le projet de loi déposé, la laisse perplexe et dubitative. - En premier lieu, le texte passe à côté de la réalité du sexisme et risque d'accroître les confusions possibles sur cette notion imprécise. Ce mot - d'origine américaine - n'a pas de définition précise en France. Selon le dictionnaire, il s'agit d'une attitude discriminatoire à l'encontre des femmes, mais les chercheurs, les historiens, les philosophes, les juristes, en donnent une définition plus large, qui englobe les institutions et les comportements, par lesquels perdure la domination du masculin sur le féminin. Le projet de loi, au lieu de donner des précisions, accroît encore la confusion en la matière. D'une part, le titre du projet parle de propos discriminatoires à caractère sexiste, alors que le terme sexisme n'est pas repris dans le texte du projet. D'autre part, il s'agirait de propos à caractère sexiste, alors que l'article 1er du texte modifiant l'article 24 de la loi de 1881 renvoie à l'article 23 de cette loi qui est d'une portée plus large : il s'agit des discours, écrits, imprimés, dessins, affiches, moyens de communication audiovisuelle... En outre, l'article 1er du projet rapproche dans une même incrimination la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence, à raison du sexe de la victime ou à raison de son orientation sexuelle, ce qui est un contresens inadmissible. Le texte établit également une différence de traitement entre homophobie et sexisme. Les articles 2 et 3 du projet de loi - qui modifient les articles 32 et 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse - ne visent que les diffamations et injures à raison de l'orientation sexuelle d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il y a donc aggravation de la peine lorsque l'injure ou la diffamation a pour origine l'orientation sexuelle, mais maintien des peines actuelles de droit commun pour les injures et diffamations sexistes. - En deuxième lieu, des instruments juridiques existent déjà dans notre droit pour combattre le sexisme (et l'homophobie) et permettre à la victime d'obtenir des dommages et intérêts devant le juge civil. L'article 16 du code civil - entré en vigueur à la suite de la décision du Conseil constitutionnel de 1994 sur les lois de bioéthique, selon laquelle existe un principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne - précise que : « la loi interdit toute atteinte à la dignité de la personne ». C'est un article à travailler, qui pourrait être un « gisement » de nouvelles propositions. En effet, cette notion permet de distinguer celle des droits de l'homme, dont le fondement est la liberté et la défense de l'individu contre le pouvoir, et celle de dignité de la personne, dont le fondement est l'humanité. Le sexisme n'est pas une question de liberté, c'est une question d'humanité. En la matière, il y a des décisions jurisprudentielles intéressantes, notamment celle prise par le Conseil d'État à l'encontre du maire d'Aix-en-Provence en 1995 à propos du jet de nain. Le jeu consistait à placer un nain - qui était consentant, car cela lui rapportait beaucoup d'argent - sur un trampoline et à le jeter en l'air. La décision d'interdiction a été prise en des termes qui pourraient être appliqués aux femmes victimes de sexisme (« objectivation, animalisation des victimes »). L'article 1382 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » est le fondement, en cas de préjudice, de l'action en réparation qui peut donner lieu à dommages et intérêts. Ce serait un inconvénient d'introduire une incrimination de sexisme dans le code pénal, car il ne serait plus possible d'agir sur le terrain de l'article 1382 du code civil (jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt du 12 juillet 2000). L'article 809 du nouveau code de procédure civile donne tout pouvoir au juge des référés s'il existe un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Celui-ci peut prendre des décisions dans l'urgence. Cela peut le conduire à arrêter un affichage dans des cas suffisamment graves. Comme dans la jurisprudence du jet de nain, la notion d'ordre public inclut celle de respect de la dignité de la personne (cf. C.E., 27 octobre 1995). L'article 31 du nouveau code de procédure civile donne la possibilité à certaines associations de demander réparation pour des actes ayant un caractère sexiste, lorsqu'elles ont dans leur objet statutaire le principe de spécialité pour combattre le sexisme. Beaucoup de textes existent donc en matière civile, qui sont peu ou pas utilisés. - En troisième lieu, le projet de loi modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui est une loi pénale. On peut considérer que la répression et la sanction pénale ne sont pas forcément la meilleure réponse pour parvenir à éradiquer le sexisme. Cela conduit à se faire beaucoup d'ennemis, notamment la presse et les médias. En outre, cela ouvre un débat frontal avec le principe de liberté d'expression. En France, le principe de liberté d'expression est couplé avec un autre principe constitutionnel, selon lequel celui qui en abuse doit répondre de cet abus dans les cas déterminés par la loi (article XI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789). Ce deuxième principe a permis d'amender de manière considérable la loi de 1881. Faut-il cependant rajouter une nouvelle exception - l'incrimination en matière de sexisme - comme il y en a une en matière de racisme depuis 1972 ? Il existe une inconnue : la décision que rendrait le Conseil constitutionnel, s'il était saisi du texte. En effet, il n'a pas été consulté sur la loi sur le racisme. Quelle serait son appréciation vis-à-vis de l'atteinte que le texte porterait à la liberté d'expression pour le sexisme ? Il faudrait pouvoir considérer que la limitation envisagée peut être une exception à la liberté d'expression parce qu'elle est une atteinte trop grave à la dignité de la personne et que traiter une femme comme un objet ou un animal ou tenir des propos extrêmement violents à son encontre, ne peut rester sans aucune sanction. - Enfin, le principe de liberté d'expression est défendu ardemment par la Convention européenne des droits de l'homme. Le deuxième alinéa de l'article 10 précise les conditions et restrictions possibles à celle-ci. Elles doivent résulter d'une loi qui, elle-même, devra respecter des critères que la Cour apprécie avec rigueur : précision, prévisibilité et sécurité juridique. Il existe une inconnue quant à la position de la Cour européenne sur le texte de loi s'il est adopté en l'état. En conclusion, Mme Marie-Cécile Moreau a observé que faire une loi pénale sur une notion aussi mal connue et discutable que le sexisme ne lui paraissait pas répondre aux exigences du droit pénal interne ni du droit issu de la Convention européenne des droits de l'homme. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, lui a demandé comment pouvait s'expliquer la différence de traitement entre homophobie et sexisme s'agissant des injures et de la diffamation. Mme Marie-Cécile Moreau a indiqué qu'à sa connaissance, le projet élaboré par le Garde des Sceaux traitait de la même manière les propos homophobes et sexistes, alors que la première version élaborée par le Premier ministre ne portait plus que sur les propos homophobes, et qu'une nouvelle version avait été rédigée, sous l'impulsion de Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, à la suite des propos tenus par l'imam de Vénissieux à l'encontre des femmes. Le sexisme avait alors été réintroduit à la seule incrimination de l'article 24 (« provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination »). Revenant sur l'idée que la création d'une nouvelle incrimination pénale n'était pas nécessairement la bonne voie pour combattre le sexisme, elle a indiqué qu'elle faisait confiance aux médias, et qu'il faudrait leur offrir le challenge d'aider les femmes. Elle a évoqué le CSA et la mission qui lui a été confiée par la loi de 1986, modifiée en 2000, de veiller à ce que les programmes de radio ou de télévision ne comportent pas de présentation sexiste. Les sanctions du CSA peuvent aller jusqu'à la suspension des émetteurs. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a évoqué le cas de M. José Luis Rodriguez Zapatero, Premier ministre espagnol, interpellé par les médias pour faire adopter une loi contre les violences faites aux femmes. En Espagne, ce sont les médias qui ont fait prendre conscience aux politiques de ce problème majeur. Mme Marie-Cécile Moreau a indiqué que le concours des médias pourrait être demandé en contrepartie de la liberté d'expression dont ils disposent. A son avis, les médias, s'ils entretiennent et véhiculent le sexisme, ne le créent pas. Plutôt que la contrainte de la voie pénale, qui heurte les médias au nom du principe de la liberté d'expression, il faudrait obtenir leur aide, par l'intermédiaire du CSA mais également du BVP, association loi de 1901, qui n'a pas de pouvoir contraignant, mais qui vient de signer une charte de bonne conduite avec Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle. Les médias pourraient contribuer à la mise en application des lois sur l'égalité hommes-femmes, plutôt que de continuer à véhiculer des idées sexistes. Il faut tabler sur leur bonne foi. Mme Marie-Jo Zimmermann a marqué son accord avec l'idée qu'il fallait faire confiance aux médias et a remercié Mme Marie-Cécile Moreau de tous les arguments juridiques présentés à la Délégation sur le projet de loi. Audition de Mme Yvette Roudy, présidente de l'Assemblée Réunion du mercredi 17 novembre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité la bienvenue à Mme Yvette Roudy, présidente fondatrice de l'Assemblée des femmes, ancienne députée du Calvados, ancienne maire de Lisieux, ancienne députée européenne et ancienne ministre des droits de la femme de 1981 à 1986. La Délégation aux droits des femmes a souhaité l'entendre sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoire à caractère sexiste ou homophobe, qui a été présenté en Conseil des ministres le 23 juin dernier, et qui devrait être discuté à l'Assemblée nationale au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Mme Yvette Roudy a été au premier plan du combat des femmes : en matière d'égalité professionnelle, c'est à elle que l'on doit la première loi sur le sujet ; s'agissant de la lutte contre le sexisme, elle a tenté de faire aboutir un projet de loi en ce sens. Vingt ans après, le Gouvernement actuel vient de déposer un projet de loi qui ne peut être approuvé : soit il faut l'amender pour que les propos sexistes soient sanctionnés de la même façon que les propos homophobes, soit il faut réfléchir à une loi globale contre les discriminations et les violences faites aux femmes. Le texte ne répond pas aux difficultés que les femmes peuvent rencontrer et il n'aide pas à l'émergence d'une véritable culture du respect des femmes. Après l'audition de Mme Marie-Cécile Moreau la semaine dernière, Mme Marie-Jo Zimmermann s'est interrogée également sur l'opportunité d'adopter en la matière un texte pénal, qui heurte toujours de manière frontale le principe de liberté d'expression. N'y aurait-il pas lieu de mener une réflexion sur le concept d'atteinte à la dignité de la personne, qui permet des dommages-intérêts au plan civil ? Mme Marie-Jo Zimmermann a souhaité que Mme Yvette Roudy donne son éclairage sur le projet de loi et exprime son opinion sur ce qu'il convient d'en faire : le faire évoluer ou adopter une loi globale sur le respect des femmes. Mme Yvette Roudy a rappelé son expérience dans le combat des femmes, qu'elle continue à mener aujourd'hui au plan associatif. L'Assemblée des femmes, qu'elle préside, créée en 1992 à la suite de la Charte d'Athènes, qui avait fait émerger le terme de parité dans le panorama politique, n'a cessé d'organiser des rencontres, des colloques, des universités d'été et de prendre des initiatives. Elle-même, en marge de cette association, a pris de nombreuses initiatives, notamment en 1996, où, avec l'aide de 10 ministres, 5 de droite, 5 de gauche, elle a tenté de secouer le monde politique dans le domaine de la parité. Des progrès ont été réalisés depuis cette date ; il y a maintenant une loi, - celle du 6 juin 2000 -, qui, si elle n'est pas parfaite, a amélioré la situation pour les scrutins à la proportionnelle ; en revanche, pour les autres scrutins, les partis politiques français ont préféré payer des amendes plutôt que d'entrouvrir la porte aux femmes. Alertée sur le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe, elle a suivi son évolution et essayé d'en comprendre l'historique. Tout a commencé par un fait divers particulièrement violent qui a secoué l'opinion : Sébastien Nouchet a été brûlé vif par des voyous en janvier 2004. Le Garde des Sceaux a immédiatement réagi, la communauté homosexuelle s'est révélée très active et efficace, un projet de loi a été élaboré. Les associations féminines se sont rendues compte que les homosexuels allaient obtenir la protection qu'elles ne cessent de réclamer depuis 25 ans. C'est en effet en 1982 qu'elle-même avait déposé un projet de loi, qui était la mise en œuvre d'une des 110 propositions du Président de la République. Simone de Beauvoir avait demandé un tel texte à la suite de l'acquittement d'un homme qui avait battu sa femme à mort, parce que les jurés avaient considéré que c'était un acte d'amour... Il y a une espèce d'indulgence autour des violences à l'encontre des femmes qui fait partie de notre culture. Un article du projet de loi a été modifié et concerne à la fois les femmes et les homosexuels. Les femmes ont obtenu un petit strapontin, mais on se trouve face à un texte complètement déséquilibré, puisque les homosexuels vont être mieux protégés que les femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué qu'au cours de l'émission télévisée « Mots croisés », à laquelle elle a participé le 8 novembre dernier, M. Pascal Houzelot, président de Pink TV, a fait observer qu'il ne fallait pas séparer la cause des homosexuels et des femmes et que c'est grâce à eux que les femmes obtiendraient une meilleure protection. Mme Yvette Roudy a alors fait remarquer qu'elle avait soutenu les homosexuels lors du vote de la loi sur le PACS, mais qu'elle réfléchirait à deux fois avant de leur apporter son soutien, car ils n'ont pas aidé les femmes sur le projet de loi. Certains homosexuels sont certes un peu gênés que les injures et diffamations voient leurs peines aggravées pour les homosexuels alors qu'elles restent des peines de droit commun pour les femmes. Cela revient à donner autorisation à continuer comme par le passé en matière de violences faites aux femmes. Pour le Gouvernement, il est deux fois plus grave de proférer des insultes homophobes que sexistes, quatre fois plus grave de diffamer un homosexuel qu'une femme. Dans le cas de l'assassinat de Sohane, les criminels peuvent encourir 30 ans de prison, dans le cas de Sébastien Nouchet, c'est la perpétuité. Si une femme de couleur ou de religion juive ou musulmane est agressée, ses avocats auront intérêt à plaider le crime raciste plutôt que le crime sexiste. Le sexisme n'est toujours pas reconnu par la loi. Ce terme ne figure dans le dictionnaire que depuis peu. Elle-même a eu beaucoup de mal à le faire exister dans une proposition de loi. Les progrès vont lentement. Pour Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, ce texte est une grande avancée pour les femmes ; pour Mme Marie-Jo Zimmermann, ce texte est une humiliation pour les femmes. Mme Yvette Roudy a déclaré partager cette dernière opinion. Ce texte reflète la pensée générale de la société dont la culture est imprégnée de machisme. Toutes ces attitudes ont toujours été traitées avec une sorte de dérision, par des moqueries, de sourires. On pense même que les femmes provoqueraient ces attitudes. Certains hommes ont même écrit que la nature particulière des femmes les pousserait à rechercher la souffrance. Ces violences à l'encontre des femmes ont été souvent niées et banalisées ; cela a été également le cas des violences envers les homosexuels. Il a fallu attendre les années 1970 pour que le viol ne soit plus seulement un attentat à la pudeur, mais un crime. Ce conditionnement et cette culture conduisent les femmes elles-mêmes à se considérer d'abord comme responsables de cette violence. A cet égard, Mme Yvette Roudy a cité le remarquable film espagnol « Ne dis rien », où l'on voit le cheminement d'un couple sur la voie de la violence, les efforts du mari, son traitement médical, mais aussi son incompréhension devant la conduite de sa femme. La culture patriarcale qui a longtemps imprégné nos comportements pèse lourdement. Ce n'est que dans les années 70 que l'on a pu remplacer dans nos textes l'autorité paternelle par l'autorité parentale. En ce moment, on assiste à une résurgence des violences dans les banlieues. Notre éducation est en faillite par rapport à certaines populations issues de l'immigration. On n'a pas suffisamment expliqué que notre pays est un État de droit, où existe l'égalité entre hommes et femmes et que certaines coutumes ne doivent pas avoir la primauté sur notre droit. Mme Yvette Roudy a évoqué l'effet pervers du patriarcat bien analysé par Engels. Selon cette culture patriarcale, la différence biologique entre hommes et femmes pourrait justifier les inégalités. On en trouve des exemples dans la littérature du XIXe siècle, dans les fabliaux du Moyen-Age, mais aussi dans « La mégère apprivoisée » de Shakespeare, une femme matée comme un cheval sauvage. Comme disait Simone de Beauvoir avec raison : « On ne naît pas femme, on le devient ». Parmi les discriminations fondées sur le sexe, on peut citer la pratique courante en Chine de noyer les bébés filles, ce qui conduira ce pays à un déséquilibre démographique, ou le problème du voile. Il est un signe d'infériorité accepté par la femme et il représente un cheval de Troie dans notre laïcité : c'est en fait une sorte d'apartheid qui peut conduire à des heures séparées dans les piscines ou des séparations à l'école et dans les lieux publics. La discrimination à l'encontre des femmes est différente de celle à l'encontre des homosexuels, puisque dès la naissance, les filles ont un statut différent, inégal. Aujourd'hui, les femmes de caractère peuvent s'en dégager, d'autant que les lois existent, mais les femmes ne sont pas encore sorties d'affaire, notamment pour les violences au quotidien. Le Premier ministre espagnol, M. José Luis Rodriguez Zapatero, a bien compris le problème. Ce sont des problèmes politiques : les femmes posent des problèmes qui dérangent l'ordre social établi et elles veulent des transformations sociales. On l'a vu au moment des élections américaines, et au moment de l'élargissement de l'Europe, avec le problème posé par la Pologne. Une enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) lancée par Mme Nicole Péry a montré que 4 ou 5 femmes meurent chaque mois de violences conjugales ; la mort de Marie Trintignant a également mis en lumière ce phénomène ; cet été, 29 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Cette violence se retrouve dans tous les milieux sociaux. Beaucoup d'hommes expriment leur embarras devant cette violence ; une grande majorité d'entre eux n'est pas violente ; les hommes violents ne sont pas des malades, il faut donc les sanctionner ; ils bénéficient encore de trop d'indulgence. Le traitement différent des hommes et des femmes dans le projet de loi est le reflet de cette inégalité. On ne peut pas l'accepter. Aussi, faut-il deux lois, car le problème posé n'est pas le même : les femmes ne peuvent échapper à leur statut d'inégalité, alors que les homosexuels le peuvent en cachant leur homosexualité. Les agresseurs sexuels agressent plus faibles qu'eux : M. Michel Fourniret parlant de la « chasse aux vierges » indigne moins que si l'on parlait de chasse aux juifs ou aux homosexuels. C'est une question de démocratie. Il faut dénoncer cette violence sexiste. Le sexisme est une attitude agressive à l'encontre de l'autre sexe, il est la conséquence de la domination masculine sur les femmes. Les hommes doivent mettre fin à ces violences, qu'il faut chercher partout, y compris dans les représentations des images publiques. Il faut une loi spécifique, prendre modèle sur la loi espagnole. Il faut des programmes spécifiques à l'école, des campagnes d'explications et des sanctions. Le texte doit être élaboré après consultation des associations qui ont étudié cette question. Il faut cesser de se dire qu'il y a une double morale sexuelle, permissive pour les uns, répressive pour les autres. Selon l'avis de M. José Luis Rodriguez Zapatero, que Mme Yvette Roudy partage, cela constitue le défi majeur du XXIe siècle. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, revenant sur l'idée qu'on ne peut dissimuler le fait qu'on est une femme, a indiqué qu'il fallait revoir ce projet de loi en urgence. Mme Danielle Bousquet a évoqué l'urgence à faire émerger une discussion sur ce texte, qui va mettre en difficulté toute la classe politique, soit vis-à-vis des homosexuels si on refuse le projet, soit vis-à-vis des femmes si on l'accepte en l'état. Le projet doit être retiré ou réécrit. Ce n'est pas un texte contre le sexisme. En disant que c'est un bon texte, Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, fait considérablement reculer la lutte contre le sexisme. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est déclarée stupéfaite que la ministre ait pu dire qu'il s'agissait d'une avancée pour les femmes. Mme Yvette Roudy a interrogé les parlementaires sur l'action qu'ils entendaient mener contre ce texte. Même si le Gouvernement est maître de l'ordre du jour, les parlementaires peuvent manifester leur opposition à un texte, demander à rencontrer le Premier ministre ou les présidents de groupes parlementaires, voire même démissionner tous ensemble de leur mandat. Le texte ne serait pas acceptable, même si deux amendements rétablissaient le mot « sexe » en cas d'injure et de diffamation. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué qu'elle demanderait un rendez-vous au Premier ministre pour expliquer cette position. Elle a observé qu'à la suite de sa participation à l'émission « Mots croisés », elle avait reçu beaucoup de courriers de femmes lui disant qu'elle avait tout à fait raison. Mme Yvette Roudy a évoqué la phrase scandaleuse de l'exposé des motifs selon laquelle « les diffamations et injures sexistes continueront de tomber sous le coup des diffamations et injures de droit commun ». Les articles 3 et 4 sont une insulte pour les femmes. Il faut le dire au Premier ministre. On piétine la dignité des femmes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé qu'au mois de juin dernier, elle n'avait pas souhaité demander à être saisie du projet parce qu'elle le considérait comme un texte indigne. Après les auditions qu'elle a menées au sein de la Délégation, elle est aujourd'hui plus partagée sur ce point, se demandant s'il ne faudrait pas que la Délégation prenne une position très ferme sur le texte, au moment de la discussion parlementaire. Mme Yvette Roudy a indiqué qu'il faudrait enrichir le projet de loi de 1983 à la lumière de la loi espagnole votée il y a un mois, à l'unanimité, notamment introduire l'obligation, dans les programmes scolaires, d'expliquer les droits des femmes. Mme Danielle Bousquet a observé que la proposition de loi de M. Yvan Lachaud était satisfaisante, mais qu'elle n'abordait pas le domaine de la publicité. Quant à la « loi Zapatero », elle est intéressante, mais elle fait référence à des institutions espagnoles différentes des nôtres. Mme Catherine Génisson a estimé nécessaire que la Délégation soit saisie du projet de loi et a souhaité que le Premier ministre soit averti de la position négative de la Délégation sur ce texte. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a évoqué les autres cas où la Délégation avait exprimé son désaccord : retraites, élections sénatoriales, et où elle n'avait pas été entendue. Elle a indiqué qu'elle solliciterait un entretien du Premier ministre et qu'elle tiendrait une conférence de presse sur le sujet. Audition de Mme Marie-Françoise Blanchet, Grande Maîtresse de la Grande Réunion du mardi 23 novembre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est réjouie d'accueillir Mme Marie-Françoise Blanchet, Grande Maîtresse de la Grande Loge féminine de France, réélue en septembre 2004 pour un second mandat, qui avait pris position dès le mois de mai en faveur d'une loi anti-sexiste et qui s'est exprimée à plusieurs reprises sur le projet relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe. Le Garde des Sceaux vient d'annoncer le retrait du texte et sa reprise, avec des modifications substantielles, sous forme d'amendements du Gouvernement au projet de loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, en discussion aujourd'hui au Sénat. De même qu'elle avait considéré que le texte n'était pas un progrès, mais une insulte pour les femmes, Mme Marie-Jo Zimmermann a estimé que son retrait n'est pas une victoire, à la différence de ce qu'a dit Mme Nicole Ameline, ministre déléguée à la parité et à l'égalité professionnelle, mais une avancée, qui laisse le débat ouvert et montre la nécessité d'une vraie réflexion. Certes, les nouvelles dispositions proposées par le Garde des Sceaux consacrent l'égalité de traitement entre femmes et homosexuels : désormais, les injures et diffamations à raison du sexe seront punies des mêmes peines - aggravées par rapport au droit commun - que les injures et diffamations à raison de l'orientation sexuelle. Pour autant, et c'est le sens du communiqué qu'elle a publié cet après-midi, le problème reste entier et deux priorités demeurent. D'une part, il convient de mieux définir le sexisme, qui ne saurait être confondu avec la discrimination selon le sexe et qui prend un poids particulier quand il conduit vers la pénalisation. Le législateur, s'il laisse aux juges une totale liberté d'appréciation, n'aura pas fait œuvre sérieuse ; sans doute faudrait-il sortir du cadre strictement pénal et approfondir le concept d'atteinte à la dignité de la personne, qui permet des dommages et intérêts au civil. D'autre part, il faudrait élaborer une loi globale, prenant en compte et combattant l'ensemble des discriminations à l'encontre des femmes. Il conviendra notamment d'étudier la loi adoptée en Espagne à l'initiative du Gouvernement de M. José Luís Rodríguez Zapatero et de voir comment l'appliquer en France. C'est la direction dans laquelle souhaite aller la Délégation, convaincue que le projet abandonné ne satisfaisait pas à l'exigence d'une culture paritaire. Dans le même esprit, la Grande Loge féminine a proposé une loi anti-sexiste distincte et prépare un Livre Blanc sur ce sujet. Pour toutes ces raisons, cette audition demeure pleinement d'actualité, en dépit du retrait du texte. Mme Marie-Françoise Blanchet a remercié la Délégation aux droits des femmes d'avoir bien voulu auditionner la Grande Loge Féminine de France. Elle-même porte le titre, féminisé depuis le XVIIIe siècle, de Grande Maîtresse : le respect de la tradition la place donc à la pointe de la modernité... La Grande Loge Féminine de France est une association qui compte 11 300 adhérentes, âgés de vingt-et-un à presque cent ans, de toutes classes sociales, de toutes sensibilités religieuses et politiques. Première obédience maçonnique féminine mondiale - historiquement et quantitativement -, elle compte 360 loges, réparties en France métropolitaine, dans les DOM-TOM ainsi que dans plusieurs pays d'Europe, au Canada, au Venezuela, en Afrique, et jusqu'aux îles Mascareignes... Une loge partenaire a ouvert il y a peu à Jérusalem. C'est donc dans le monde entier, aux côtés des sœurs qui ont pris leur indépendance, que la Grande Loge féminine est attentive aux droits des femmes : on ne peut manifester pour soutenir les femmes afghanes et ignorer ce qui se passe en France dans les banlieues. Le projet de loi relatif à la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe a été publié au moment où la Grande Loge féminine avait déjà lancé un vaste chantier de réflexion en profondeur afin d'élaborer un Livre blanc pour une loi anti-sexiste. En effet, les franc-maçonnes sont animées par des valeurs et des principes fondés sur le respect des autres et de soi-même, sur le désir d'amélioration personnelle et collective, sur I'engagement à œuvrer pour un monde plus juste et plus solidaire. Aussi les franc-maçonnes du XXIe siècle ont-elles vocation à devenir les défricheuses des droits à venir. L'association affirme donc son engagement à contribuer à l'émancipation des femmes, à la reconnaissance et au respect de leurs droits, à l'exercice de leur liberté, à la défense de leur intégrité physique et morale, à l'affirmation de leur dignité. Enfin, les violences faites aux femmes, véritable négation de l'autre fondée sur le genre, incisent à la fois l'ordre symbolique et l'éthique qui rassemblent les franc-maçonnes. Pour toutes ces raisons, la Grande Loge féminine s'est estimée particulièrement légitime pour témoigner, de façon très concrète, de l'expérience que ses membres ont du sexisme « ordinaire » dans leur vie privée, professionnelle et dans l'espace public. Le projet a été annoncé en mai dernier, au moment où les légitimes revendications des homosexuels quant aux discriminations dont ils sont victimes étaient mises sous le feu d'une actualité tragique. La classe politique a semblé soudain prendre conscience de l'urgence à entendre les demandes de cette minorité et à agir pour que cesse l'intolérable. « Ce sera la loi Sébastien Nouchet », a ainsi déclaré le Garde des Sceaux. Pourtant, lorsqu'il s'agit de dignité humaine, la loi doit dépasser le cas individuel et se libérer de l'événement, si tragiques soient-ils, pour atteindre à l'universel. Les femmes, elles, ne demandent pas de « loi Sohane »... Dans le même temps, les discriminations, les atteintes à la dignité, les violences dont sont victimes la moitié de l'humanité, pour la seule raison qu'elles sont femmes, se poursuivent, dans l'indifférence, le mépris goguenard ou la franche hostilité envers les victimes qui osent élever la voix ou envers ceux qui refusent d'être complices. C'est pourquoi la Grande Loge féminine a accueilli avec intérêt ce projet de loi, dont le cadre n'était que l'extension du champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais aussi avec une déception à la mesure des enjeux, ainsi que des attentes dont elle est, avec d'autres, porteuses. Certes, ce projet marque, dans son principe, une avancée, mais son architecture est déséquilibrée, dès lors que la pénalisation des discriminations en raison du sexe est évacuée des articles 2, 3 et 5. Ce silence est, en soi, une prise de position culturelle, juridique, politique. Pourquoi une loi anti-sexiste déchaîne-t-elle un tel rejet, alors que les lois anti-racistes ou anti-homophobes trouvent leur aboutissement ? Comment accepter que le sexisme soit relégué au rang d'incidente de l'homophobie ? « Cachez ce sexisme que nous ne saurions voir », semble-t-on ainsi signifier... L'histoire se répète : la mobilisation de nombreuses associations dans les années 1970 comme les tentatives d'évolution de la législation dans les années 1980, se sont toujours heurtées à des campagnes de dénigrement d'une violence inouïe, comme si tout projet anti-sexiste ranimait dans l'inconscient collectif du mâle dominant la peur de l'émasculation sous les ciseaux d'Anastasie... Ne s'agit-il pas plutôt de protéger la liberté d'une catégorie de population - les hommes - au détriment de l'autre - les femmes - et, plus encore, la liberté mercantile de générer sur leur dos, ou plutôt sur leurs corps sans tête, des gros paquets de publi-dollars ? Ce sont les mêmes qui brandissent l'étendard de la résistance contre le supposé retour de la pudibonderie et de l'« ordre moral ». Alors que l'on n'ose plus avancer ces mauvais arguments pour défendre la liberté d'être homophobe, pour le sexisme, fût-il le plus épais et le plus haineux, on l'ose, sans retenue. Quand le combat des femmes se porte sur le terrain du droit, chasse gardée du dominant, il est perçu comme une menace directe, et le recours contre l'oppression est alors dénoncé comme outil de répression. Quand on dit que l'arsenal législatif actuel est bien suffisant pour punir les délits, on occulte tout bonnement le fait que le passage à l'acte violent s'enracine et se nourrit des propos, des images, des comportements dégradants que la société banalise et, par-là même, légitime. Dès lors, la notion d'interdit - et les peines qui en découlent - deviennent incompréhensibles au coupable : on le voit bien chez les auteurs de viols en réunion. Quand on prétend que la référence faite au sexisme dans les articles 2, 3 et 5 est inopérante ou superfétatoire - on devrait alors s'interroger sur l'impérieuse nécessité de la référence à l'homophobie... -, on feint d'oublier que, dès lors qu'il s'agit de dire le droit, il est impératif de qualifier l'offense afin de pouvoir la poursuivre. Certes, une loi ne fait pas bouger du jour au lendemain les structures mentales, mais elle peut y contribuer, on l'a vu avec les actions pour le respect des places de stationnement pour les personnes handicapées ou avec la politique volontariste de lutte contre la consommation tabagique. La Grande Loge féminine a plaidé devant la commission présidée par M. Bernard Stasi pour la nécessaire force symbolique d'une loi pour le respect de la laïcité et de l'égalité entre hommes et femmes ; cela vaut aussi pour la lutte contre le sexisme. Actuellement, dans un archipel de textes séparés par des océans de vide juridique, trop de domaines ne sont pas couverts, et le projet de loi demeurerait bien réducteur en s'en tenant au contexte de la loi de 1881 et en omettant, par exemple, les insultes proférées dans les lieux publics. Il est vrai que la démarche qui avait conduit à déposer d'abord un projet de loi contre les propos homophobes puis à y ajouter le sexisme n'était pas bonne, et que le risque d'évolution communautariste, en contradiction avec toute l'histoire des droits et de la République, est réel. Par ailleurs, si on lie ces questions à celle de la Haute autorité, encore faut-il savoir quels en seront les pouvoirs et les moyens, qui y sera nommé et par qui. La Grande Loge féminine souhaite donc une véritable loi-cadre anti-sexiste, distincte, qui intègre l'ensemble des dispositifs législatifs existants et introduise les modifications demandées, notamment à la loi sur la liberté de la presse. C'est bien dans cette logique que s'est inscrit le projet présenté par le Premier ministre espagnol. Il convient, a minima, de réintroduire l'expression « en raison du sexe » avant « en raison de l'orientation sexuelle », dans ce qui était les articles 2 (diffamations), 3 (injures) et 5 (article 48-4) du projet, ce qui a une incidence automatique sur l'article 4 et inclut donc la possibilité, fondamentale, de saisir le ministère public. La Grande Loge féminine ne saurait se résoudre ni à une hiérarchisation ni à une confusion des discriminations homophobes et sexistes : elles procèdent des mêmes préconçus, mais les secondes sont transcatégorielles et se cumulent avec toutes les autres. Dans l'esprit des gens, même des femmes, même au sein des loges, on peut parler de discriminations, de lutte contre la violence ou pour la dignité des femmes, mais le mot sexisme fait peur, sans doute parce qu'on craint une dérive « à l'américaine ». Il y a donc un vrai travail de « marketing » à faire pour le remplacer par un autre. Mais il s'agit d'un travail de longue haleine, et c'est pourquoi la Grande Loge féminine ne publiera son livre blanc que fin 2005 ou début 2006, à l'issue des réflexions menées dans toutes ses loges. Il s'agira d'abord de dresser le constat de la façon dont les lois existantes sont ou ne sont pas appliquées, contournées, voire détournées contre les femmes. Des points noirs pourront ainsi être mis en évidence, ce qui débouchera sur des propositions. D'ici-là, la Grande Loge féminine, animée par une réelle volonté politique de faire progresser les droits des femmes, est prête à contribuer à toute réflexion, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Marie-Françoise Blanchet d'avoir demandé à être auditionnée. En fait, elle-même avait d'abord souhaité, dans la mesure où elle ne comprenait pas la discrimination qui était faite entre les homosexuels et les femmes et où elle souhaitait une loi globale, que la Délégation ne soit pas saisie du texte. Mais, au fur et à mesure de l'avancement des auditions, elle l'a estimé nécessaire. Elle a constaté une sensibilité commune avec la Grande Loge et souhaité poursuivre les échanges pendant la période de réflexion des loges, avant une nouvelle audition lorsqu'elle sera achevée. Mme Marie-Françoise Blanchet a rappelé que, si la Grande Loge féminine ne fait pas de politique, le politique est le domaine de tout citoyen et de toute citoyenne. Entendre les homosexuels demander, après le drame vécu par Sébastien Nouchet, une loi pour « les protéger » l'a mise en fureur, car cela conduirait à distinguer les gens selon des catégories, tandis que les femmes, composante transversale, n'auraient pas vocation à être protégées lorsqu'elles n'entrent pas dans une de ces catégories ! Il fallait donc réagir, et soumettre le sujet à la réflexion des 360 loges. Et même si certaines paraissaient un peu frileuses, elles ont été emportées par l'enthousiasme de leurs sœurs étrangères, notamment d'Afrique et d'Europe de l'Est, qui savent toute l'exemplarité de ce qui est fait en France. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a jugé que la France, pays des droits de l'homme, ne devrait pas avoir de problèmes en la matière. Or, on en est bien loin dans la réalité quotidienne... Il faut donc bien commencer par se préoccuper de ce qui se passe à sa porte avant d'en faire un exemple. Mme Marie-Françoise Blanchet a souligné que la France est le dernier pays francophone où l'on parle encore de droits de l'homme et non pas de « droits humains ». Les cinq loges espagnoles sont extrêmement satisfaites de la nouvelle loi, qui va permettre de rompre avec des violences conjugales jusque là abominables. Si les milieux catholiques ont organisé, comme ils l'avaient déjà fait contre le mariage homosexuel, des manifestations de fidèles à la sortie de l'office, au prétexte de défendre la famille, c'est surtout parce qu'en décidant de financer les cultes proportionnellement au nombre de fidèles, le Gouvernement de José Luís Rodríguez Zapatero s'en est pris au porte-monnaie de l'Eglise. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souhaité que la Délégation se rende en Espagne pour rencontrer des parlementaires, mais aussi les médias, car ce sont eux qui ont fait évoluer la politique, en faisant prendre conscience à l'opinion de la nécessité d'une loi antisexiste. Car, à travers les violences, c'est bien de dignité humaine qu'il s'agit. Mme Marie-Françoise Blanchet a aussi pensé qu'il est essentiel que les médias n'occultent pas les violences contre les femmes. Ici, l'agression de Sébastien Nouchet a fait bien plus de bruit que ce que subissent toutes les femmes tuées ou blessées par leur conjoint. Taper sur sa femme fait partie des choses normales ; récemment, un homme accusé d'avoir battu et blessé sa femme a demandé ingénument au juge qui lui faisait la morale : « Mais comment faites-vous donc pour vous faire obéir ? » C'est cette banalisation qu'il faut combattre. Or, elle commence dans les programmes de télévision, qui proposent aux filles comme seul modèle celui de la poupée Barbie chantante de la Star Academy, ou dans les journaux pour adolescentes, même aussi bien-pensants que Julie, qui ne leur parlent que de mode et de maquillage. C'est aussi dans ce conditionnement, qui commence dès l'âge de sept ans, que le sexisme est à l'œuvre. Rien n'a changé depuis les années 1970... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé que les femmes étaient alors plus attentives et plus nombreuses à s'élever contre ce genre de choses. Mme Marie-Françoise Blanchet s'est souvenue qu'à partir du vote de la loi sur l'IVG, quand Simone Veil avait été traitée de manière indigne, puis au moment où Yvette Roudy a tenté de faire passer des textes contre le sexisme, on a assisté à un vaste mouvement destiné à discréditer les femmes et les mouvements féministes. Aujourd'hui encore, quand une femme est partie prenante du monde politique, on la taxe de féminisme. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué que c'est parce qu'elle refuse cette vision qu'elle a déclaré à Libération qu'elle n'était ni féministe ni révolutionnaire, tout en considérant que le projet de loi était une insulte pour les femmes. Mme Marie-Françoise Blanchet a observé que les féministes sont vues comme « dangereuses ». Joue aussi l'image des féministes américaines, à propos desquelles on a inventé le mot terrible de « feminazi ». Ce n'est pas du tout ce vers quoi elle-même veut aller : elle s'affirme féministe, mais elle a très bien vécu sa vie professionnelle dans un univers masculin puisqu'elle était colonelle de l'armée de l'air. C'est là qu'elle a compris qu'il fallait laisser la porte ouverte pour celles qui suivraient, en étant jugée sur ses capacités, en refusant d'être traitée en phénomène, mais aussi de gommer sa féminité. A l'inverse, certaines femmes politiques semblent avoir renoncé à être vues comme des femmes lorsqu'elles sont élues ; c'est dommage, car les hommes ont plus de respect pour celles qui savent rester femmes. Mme Mary Breitenstein, attachée de communication de la Grande Loge féminine, a souligné qu'il est aussi difficile de s'imposer dans l'industrie, où les femmes se font plus rares quand le niveau de responsabilités monte. Dans une société de 15 000 personnes, à sa première réunion des directeurs généraux, elle a été accueillie par quelques sifflets... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a constaté qu'il reste encore beaucoup à faire. Pour autant, il faut prendre son temps, considérer que le retrait de la loi est une avancée, pas une victoire. Lors de sa participation à l'émission « Mots Croisés », Mme Marie-Jo Zimmermann, a expliqué à Pascal Houzelot, président de Pink TV, que, sans nier la nécessité d'une loi contre les propos homophobes, elle s'opposait à un texte commun par crainte d'une véritable régression des droits des femmes : elles sont la moitié de l'humanité, on ne saurait donc les enfermer dans telle ou telle catégorie ! Mme Marie-Françoise Blanchet a fait avec la présidente le constat que l'égalité ne progresse pas et que les choses s'aggravent même dans certains domaines. Ainsi, comment les femmes pourraient-elles s'investir dans la vie associative, syndicale, politique alors qu'elles sont la grande majorité des chefs de familles monoparentales et qu'elles ont bien du mal à faire garder leurs enfants ? Qui plus est, même les textes sur la parité sont détournés, comme on l'a vu avec la multiplication des listes dissidentes, toutes conduites par des hommes, aux élections sénatoriales. Par ailleurs, les hommes membres des commissions d'investitures ont tendance à choisir les femmes qui ne vont pas leur faire d'ombre. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a indiqué que l'Observatoire de la parité va lancer une enquête à mi-mandat sur les conseillères municipales nouvellement élues : alors qu'elles pensaient faire avancer les choses, certaines, dans l'opposition, ont le sentiment de ne faire que de la figuration, tandis que d'autres, dans la majorité, ne sont que des potiches lorsqu'elles ne sont pas adjointes... Il faut analyser précisément leur situation et déterminer si elles continueront à s'investir en politique. L'Observatoire a déjà auditionné tous les dirigeants de partis politiques, et fera de même avec le nouveau président de l'UMP. Au moment des investitures pour les élections législatives, les électeurs devront être informés de ce qu'ils ont dit lors de ces auditions. Chacun doit être conscient qu'on ne saurait à la fois prétendre à un destin national et être le fossoyeur de la parité. Mme Marie-Françoise Blanchet a rappelé qu'à la fin des années 1970, au moment des élections législatives, le journal Elle avait rappelé à ses lectrices le vote de chaque sortant sur les textes relatifs aux femmes... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souligné qu'une vigilance de tous les instants est nécessaire ; on l'a encore vu récemment avec le problème posé par les pensions de réversion. Mme Christiane Taubira s'est réjouie d'avoir entendu aujourd'hui Mme Marie-Françoise Blanchet, qui, lors de leur précédente rencontre à Marseille, n'avait pu développer l'ensemble de son propos sur le statut personnel des citoyens. Mme Marie-Françoise Blanchet lui a répondu que c'est en effet un sujet qu'elle lie habituellement à celui de la laïcité, ce qui permet de sortir plus aisément du système des communautés, dont on voit les effets au Proche-Orient. Là-bas, en effet, il n'y a pas d'état civil et l'on est enregistré comme appartenant à une communauté religieuse. On se marie ensuite religieusement et on meurt dans la religion. Ainsi, au Liban, les droits successoraux varient selon que l'on est sunnite ou chiite. Mme Christiane Taubira s'est déclarée très sensible à la détermination de la Grande Maîtresse quand elle revendique des progrès législatifs, que l'élargissement de l'Europe rend encore plus nécessaires si l'on ne veut pas assister à une véritable régression. En Espagne, les associations ont obtenu que la télévision traite les violences domestiques comme n'importe quel crime. En France, on parle encore de « drames passionnels » pour qualifier les homicides conjugaux. Sur ce sujet, comme sur celui de l'esclavage domestique ou sur celui du divorce, il faut absolument mettre l'accent sur l'accueil et l'accompagnement des victimes, jusqu'ici trop oubliés dans notre arsenal législatif. Mme Marie-Françoise Blanchet a rappelé que les femmes turques ont eu le droit de vote quinze ans avant les Françaises, qu'il y a eu en Espagne une femme pilote de chasse trois ans plus tôt qu'en France. Agit-on davantage quand on est face à l'adversité, tandis qu'ailleurs on ronronne dans un relatif confort ? Se souvient-on où en était l'Espagne il y a trente ans ? Aujourd'hui, la loi est sur le point d'y être adoptée tandis qu'on tergiverse encore en France... Les Espagnoles sont fières d'être ainsi à la pointe du combat. Mme Christiane Taubira a demandé si la Grande Loge féminine s'était penchée sur le futur Traité constitutionnel, notamment sur la nécessité de traiter la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le chapitre des valeurs de l'Union et pas seulement dans celui sur les objectifs. Mme Marie-Françoise Blanchet a répondu que le Comité de liaison international de la maçonnerie féminine avait pris position en mars 2003 pour son inscription dans les valeurs et que le texte finalement adopté le fait figurer à la fois dans les valeurs et dans les objectifs. Pour l'heure, il semble difficile que les Français se prononcent par référendum sur un texte dont ils n'ont jusqu'ici eu connaissance qu'à travers des commentaires de journalistes. La liberté de conscience suppose le libre examen. A défaut, les citoyens pourraient avoir l'impression d'avoir été manipulés. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a conclu cette audition très instructive en remerciant Mme Marie-Françoise Blanchet et en envisageant de reprendre cette discussion lorsque la Grande Loge féminine aura achevé la réflexion qu'elle a engagée. Audition de Mme Françoise Hostalier, Présidente de l'association Action Droits de l'Homme, membre de la Commission nationale consultative Réunion du mardi 25 janvier 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est réjouie d'accueillir Mme Francoise Hostalier, inspecteur général de l'Éducation nationale, ancienne secrétaire d'État à l'enseignement scolaire dans le premier Gouvernement de M. Alain Juppé, ancienne députée du Nord, actuellement conseillère régionale du Nord-Pas-de-CaIais et conseillère municipale de Nieppe dans le département du Nord. C'est en sa qualité de présidente de l'association Action Droits de l'Homme et de membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) que la Délégation aux droits des femmes a souhaité l'entendre. A la CNCDH, elle préside la sous commission chargée des droits de l'enfant, de la femme et de la famille, de l'éducation et de la formation aux droits de l'homme, vaste sujet de réflexion qui l'a conduite à élaborer des rapports sur lesquels il serait intéressant d'avoir de plus amples informations. Après avoir rappelé brièvement le mode de fonctionnement de la Délégation, la Présidente Marie-Jo Zimmermann a jugé utile d'échanger des idées sur les sujets d'intérêt commun à la sous-commission et à la Délégation, afin de déterminer comment leurs travaux pourraient se compléter, voire se conforter. Elle a souhaité en particulier savoir comment l'avis de la CNCDH sur le projet de loi relatif aux propos homophobes et sexistes avait été préparé, et connaître le sentiment de son auteur sur l'évolution ultérieure du texte. Mme Françoise Hostalier a souligné que de nombreux parlementaires ont entendu parler d'Action Droits de l'Homme parce que cette association fait beaucoup de lobbying sur ces sujets. C'est en 1999, au moment de la guerre au Kosovo, qu'un groupe de femmes qui s'étaient déjà mobilisées de 1992 à 1995 au moment de la guerre en Bosnie, puis en 1997 pour soutenir les femmes algériennes victimes des massacres, ont éprouvé la nécessité de se constituer en association pour agir. Action Droits de l'Homme fonctionne essentiellement par réseaux et n'est pas spécialisée dans un pays, mais défend les droits de l'homme, la dignité de la personne et la place des femmes comme projet de société. L'association est très impliquée notamment en Afghanistan où elle avait deux observateurs pour les élections présidentielles du 9 octobre 2004. Dans ce pays qui était encore en guerre il y a trois ans, où les femmes n'avaient pas d'existence et étaient privées de l'accès aux soins, où 80 % d'entre elles sont analphabètes, au minimum 25 % de femmes seront pourtant élues au Parlement lors des élections qui auront lieu à la fin du printemps. Action Droits de l'Homme s'intéresse aussi au Tibet, au Vietnam, à la Tchétchénie, au Soudan, à Cuba, où l'une de ses actions a permis que les 75 dissidents emprisonnés en 2003 soient parrainés par des parlementaires. Elle a aussi aidé à la mobilisation internationale en faveur des femmes menacées de lapidation au Nigeria, mobilisation qui fait désormais hésiter les autorités judiciaires de ce pays à prononcer et à exécuter de tels jugements. L'association essaie de travailler avec le Parlement européen et entretient de bonnes relations avec cette femme remarquable qu'est Emma Bonino, ancienne commissaire européenne. Elle participe à la CNCDH, où elle est représentée par un membre suppléant dans chacune des six sous-commissions, Mme Françoise Hostalier présidant elle-même l'une d'entre elles. Elle n'a pas beaucoup de moyens et fonctionne avec 80 adhérents réguliers, essentiellement par lobbying. La CNCDH, dont le site Internet (www.commission-droits-homme.fr) est très complet, peut soit être saisie par le Premier ministre, soit s'autosaisir afin de vérifier que les textes qui régissent le fonctionnement de l'État sont conformes aux droits de l'homme au sens des instruments juridiques internationaux que la France a ratifiés. Elle travaille aussi sur les problématiques internationales et alerte le Gouvernement en cas de violation des droits de l'homme. Elle assure le suivi des conventions que la France a signées (convention CEDAW, convention des droits de l'enfant, etc.). Ses 120 membres représentent toutes les ONG et structures travaillant sur les droits de l'homme, les syndicats, les obédiences religieuses, sept ministères, le médiateur, etc. Chacun peut assister aux réunions de toutes les sous-commissions qui peuvent intervenir sur tous les thèmes. Ainsi, sur le rapport relatif aux droits de l'homme et à la prison, confié à la sous-commission C, d'autres membres ont estimé que les problèmes des étrangers, des personnes en fin de vie et des mineurs n'étaient pas traités, et un travail transversal a été mené pour compléter le texte. La Commission s'est autosaisie l'an dernier du sujet des mutilations sexuelles féminines. Son rapport très complet n'ayant été suivi d'aucun effet alors qu'il comportait une trentaine de propositions faciles à mettre en œuvre, un nouveau rapport d'étape va être préparé, qui inclura également un travail avec les pays francophones d'Afrique où la CNCDH a des relais. La Commission se propose également de s'autosaisir sur la question des mariages forcés, l'harmonisation à 18 ans de l'âge légal du mariage des hommes et des femmes pouvant être un moyen de les combattre. La Commission n'avait été ni informée ni saisie du projet de loi sur l'homophobie, mais ses sous-commissions A, C et D ont travaillé ensemble et sont arrivées à la conclusion qu'il convenait que le texte soit retiré, ce dont Mme Françoise Hostalier était elle-même convaincue en raison de sa conception universaliste et non communautariste des droits de l'homme, mais aussi des problèmes qu'il posait pour la liberté de la presse. Peut-être faut-il prendre en considération les différences en droit pénal, mais, sur le plan des principes, il faut absolument préserver l'égalité entre les êtres humains, dans ses dimensions de liberté, de dignité et de sécurité. C'est ce que Mme Françoise Hostalier a elle-même expliqué à des représentants, particulièrement pugnaces, d'une association de défense des homosexuels : cela ne la regardait en rien de savoir qu'ils étaient homosexuels car elle ne voyait en eux que des êtres humains ; en revanche, si l'on faisait une loi uniquement pour les protéger, ils apparaîtraient comme membres d'une catégorie à part. S'agissant de la presse, on pouvait craindre que des peines trop fortes empêchent certains sujets de fond d'être traités, y compris avec des exagérations, lesquelles seraient bien moins contrôlables si elles s'exprimaient ailleurs. En outre, Reporters sans frontières redoute qu'il ne soit guère cohérent de recréer une discrimination au moment où un certain nombre de pays, Sénégal en tête, s'inspire de la loi de 1881 pour libéraliser leur législation. La Ligue des droits de l'homme, si elle est d'accord sur la notion d'universalité, considère toutefois qu'il est possible d'élargir les dispositions qui existent déjà en matière de racisme et de xénophobie. L'avis demandant le retrait a toutefois été adopté à une large majorité, la Commission poursuivant son travail. Cet avis n'a pas empêché, pas plus que le lobbying d'Action Droits de l'Homme, le vote d'un texte dont on peut douter qu'il soit applicable, ce qui ne concourra guère à la revalorisation du Parlement. Peut-être certains se sont-ils imaginé qu'avec le vote de ce texte ils échapperaient au débat sur le mariage et l'adoption, mais ils vont au contraire susciter de nouvelles revendications. Sur le mariage, la CNCDH compte, comme elle l'a fait pour l'accompagnement de fin de vie, préparer un rapport, non pour trancher le débat mais pour l'alimenter. A cette fin, Mme Françoise Hostalier a été chargée de travailler sur la thèse opposée au mariage homosexuel, tandis que M. Roger-Vincent Calatayud rapportera celle qui y est favorable. En fait, il semble qu'on ne parle pas de la même chose : certains voient dans le mariage un simple contrat, et dans ce cas il n'y a pas de limite, tandis que d'autres y voient une institution qui est à la base de la société et qu'on ne saurait traiter n'importe comment. Ensuite, la CNCDH travaillera sur le thème de l'homoparentalité, en sachant que deux personnes homosexuelles peuvent bien sûr être considérées comme célibataires et adopter. Ce sont donc des situations particulières qui posent problème, notamment quand le parent dont est issu biologiquement l'enfant disparaît. Pour autant, les régler suppose que soit remis à plat tout le système d'adoption, ce qui serait après tout envisageable, à condition de se caler sur les textes internationaux protecteurs des intérêts des enfants. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a dit qu'elle avait constaté également, en particulier lorsqu'elle a participé à l'émission Mots Croisés, que les homosexuels voient dans les dispositions contre l'homophobie un premier pas vers l'homoparentalité. Mme Françoise Hostalier a souligné que la société avait beaucoup évolué mais qu'on pouvait se demander s'il appartenait au législateur d'anticiper, d'accompagner ou de freiner cette évolution. N'a-t-il pas le devoir de poser des règles ? On sait que la période de l'enfant roi a fait des dégâts et que l'on rencontre aujourd'hui de nombreux jeunes en manque d'autorité et de repères, ce qui peut même en faire des proies pour les sectes. Le premier acte d'amour d'un parent ou d'un enseignant est d'encadrer, de surveiller, de guider. Mme Claude Greff a relevé que l'enfant unique et l'enfant dans une famille recomposée ont du mal à trouver leur place. Mme Françoise Hostalier a indiqué que le rapport sur le mariage sortirait avant l'été. Plus aucun débat sur la famille ne peut désormais s'affranchir d'un traitement du volet mariage, homoparentalité, familles homosexuelles. Mme Danielle Bousquet a observé que cela correspondait simplement à la réalité sociale. Mme Françoise Hostalier s'est demandé à quelle réalité, à combien de personnes, à combien d'enfants cela correspondait. Bien sûr, ce qu'a subi Sébastien Nouchet est horrible, mais fallait-il pour autant voter une loi d'exception ? Doit-on faire une loi parce que des SDF sont régulièrement massacrés ? Pourquoi légiférerait-on sur l'arbre sans voir la forêt de tous ceux qui vivent normalement ? Se rend-on bien compte par ailleurs que si on modifie le code de la famille pour que ces personnes aient les mêmes droits, on va, par un effet domino, bouleverser tout l'équilibre social pour 300 ou 400 cas ? En venant à la place des femmes dans la société française, Mme Françoise Hostalier a fait part de son sentiment d'une régression. Après l'ouverture spectaculaire intervenue il y a 25 ans, on pouvait nourrir l'espoir que les femmes trouveraient toute leur place, et il est vrai que seul aujourd'hui le métier de sous-marinier reste exclusivement masculin. Pour autant, on a l'impression que les techniques actuelles, qui utilisent largement l'informatique, ne font pas l'objet d'une appropriation par les filles, qui utilisent la bureautique, mais pas l'informatique elle-même, et que l'Éducation nationale passe là à côté de sa mission. Or, c'est de la place des filles dans le système scolaire que dépendra celle des femmes dans la société de demain. A l'observation de Mme Bérengère Poletti sur la féminisation croissante de certaines professions comme la magistrature ou la médecine générale, Mme Françoise Hostalier a répondu qu'on pouvait s'inquiéter que ce constat conduise aussi à parler de la paupérisation de ces métiers. Mme Françoise Hostalier a conclu en proposant que de telles rencontres soient renouvelées, sur les thèmes intéressant la Délégation et la CNCDH. Celle-ci vient de s'autosaisir de deux propositions de loi relatives à l'inceste, l'une proposant de le rendre imprescriptible, ce qui semble a priori devoir être réservé aux crimes de masse, l'autre de le faire reconnaître en tant que tel dans le code pénal. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a souscrit à cette proposition de rencontres fréquentes et a remercié Mme Françoise Hostalier. B. L'AUDITION DE PERSONNALITÉS La Délégation a entendu le 7 décembre 2004 le témoignage de Mme Hélène Mignon, députée, coordinatrice du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (AFP) sur les conséquences du VIH/Sida sur les femmes et les orphelins en Afrique. Elle a également auditionné Mme Catherine Chouard, directrice des ressources humaines du groupe Elior et lauréate du trophée « DRH de l'année » pour 2004. Audition de Mme Hélène Mignon, députée, coordinatrice du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.), sur les conséquences du VIH/Sida sur les femmes et les orphelins en Afrique Réunion du mardi 7 décembre 2004 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Hélène Mignon a indiqué qu'elle avait souhaité être entendue par la Délégation pour lui faire part de ses sentiments au retour de la mission qu'elle avait effectuée en Afrique. Elle a rappelé que c'était la troisième fois qu'elle participait à de telles réunions. Au début on y parlait surtout de prévention et de thérapie, mais nos collègues africains se préoccupent désormais beaucoup du sort des orphelins, conscients qu'ils seront bientôt 15 millions, porteurs ou non du VIH. Elle a observé que la France, qui est le deuxième contributeur après les États-Unis au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, dont la création a été décidée au G8 d'Evian et qui se consacre essentiellement au médicament, devrait inciter le Fonds à consacrer une partie de ses ressources à une allocation directement versée aux orphelins. En effet, si au début les familles les ont pris en charge, leur nombre ayant considérablement augmenté et une grande partie de la population active ayant tout simplement disparu, ce sont aujourd'hui les grands-parents qui s'en occupent. Mais ils sont bien trop pauvres pour supporter le coût de la scolarité d'une dizaine de petits-enfants au moins, et on voit apparaître des enfants des rues, phénomène jusqu'ici inconnu en Afrique. Ainsi, alors qu'il y a de moins en moins d'hommes de 25 à 40 ans, ce qui pose de graves problèmes en termes de production, la relève n'est absolument pas assurée puisqu'une bonne partie des enfants développera le sida et que les autres n'auront reçu aucune formation. On le voit, ce n'est pas une question seulement de santé publique, mais aussi de développement économique qui est posée. D'ailleurs, les grandes entreprises européennes implantées en Afrique savent à quel point la population active est décimée. Elles en ont assez de payer les enterrements, mais aussi de perdre de la main-d'œuvre et du savoir-faire. Elles préfèrent donc désormais investir dans la prévention. Aujourd'hui, selon M. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, il faut installer des dispensaires pour distribuer les médicaments génériques et empêcher l'arrêt du traitement dès que l'état de santé s'améliore. Mais au Togo, on reporte les traitements faute de médicaments et on manque même de réactifs pour les tests de séropositivité ! La situation est vraiment catastrophique et on peut même parler de risque d'éradication de la population de certains pays. Selon la ministre de la santé du Togo, les hommes pensent qu'ils guériront s'ils ont des rapports sexuels avec une vierge ; aussi des enseignants demandent-ils aux petites filles de leur apporter leur cahier chez eux et des gamines de six ans sont ainsi contaminées ! Alors que les députés africains insistaient il y a peu sur le poids des traditions pour expliquer les difficultés à parler de ce sujet, ils sont désormais nombreux à avoir eux-mêmes recueilli des orphelins. Le Président de l'Assemblée et le Président de la République du Togo ont eux-mêmes évoqué la mort de leur chauffeur ou de leur garde du corps. On commence donc à parler, des groupes de réflexion voient le jour au sein des Parlements, souvent sous l'impulsion des femmes qui, avec les ONG, se rendent dans la brousse pour expliquer les choses. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a rappelé qu'il y a sept ans déjà, alors qu'elle était encore enseignante, elle craignait que l'épidémie ne prenne une ampleur considérable et que certains pays ne soient ainsi décimés. Aujourd'hui, si les pays occidentaux assument le financement d'une partie des médicaments, les problèmes de leur diffusion et de l'information restent entiers. Mme Bérengère Poletti a observé que même si les génériques se développent, les thérapies demeurent hors de prix, alors qu'elles freinent aussi la propagation de la maladie puisque la quantité de virus diminue dans les sécrétions et dans le sang. Mme Hélène Mignon a indiqué que, faute d'argent, on ne peut guère traiter plus de 10 000 personnes au Togo. Se demandant si les médicaments sont bien pris correctement, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est déclarée pessimiste quant aux effets des actions que nous pouvons mener. Mme Bérengère Poletti a estimé qu'il fallait essayer d'insister sur la prévention et l'information ainsi que sur une évolution culturelle, pour lesquelles les parlementaires peuvent jouer un rôle. C'est difficile, mais sans cela, certains pays vont tout simplement disparaître ! Mme Hélène Mignon a rappelé qu'en Ouganda, là où le virus a été découvert, on est parvenu à ramener le taux de progression de l'épidémie de 18 à 7 %. Mais dans les autres pays, il est au contraire en forte augmentation et on ne dispose pas des ressources nécessaires pour s'occuper des orphelins. C'est d'ailleurs une préoccupation essentielle de la population elle-même. Ainsi, au Burkina, une femme vient tous les six mois dans le dispensaire qui jouxte l'ambassade de France, pour faire un test afin de prévoir l'avenir de ses enfants. Elle n'est pas contaminée, mais elle sait que son mari le sera un jour ou l'autre et qu'elle ne pourra rien lui dire quand il rentrera à la maison, car c'est lui qui fait vivre la famille... Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est déclarée effrayée par la contamination des enfants, car cela signifie soit qu'ils ne procréeront pas, soit qu'ils contamineront à leur tour leur descendance. Dans ces conditions, que faire ? Mme Hélène Mignon a indiqué que, personnellement, elle ne voyait plus l'intérêt d'aller à ces réunions où l'on se contente de dire qu'on ne peut rien faire, alors que les personnes concernées attendent tant de nous. L'idée d'impuissance est affreuse, et même ce que font les ONG ne représente qu'une goutte d'eau. Qui plus est, la situation se dégrade aussi en Chine et en Russie. Quant au Vietnam et au Cambodge, où les campagnards obligés de venir travailler en ville fréquentent les nombreux bordels hérités des Américains avant de rentrer chez eux et de disséminer le virus, la tendance y est désormais la même qu'en Afrique. Dans ces conditions, on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans dix ans 40 millions d'orphelins, dont une bonne partie contaminés. Mme Bérengère Poletti a observé que le fait que 2005 soit déclarée année de la lutte contre le sida aiderait peut-être à communiquer davantage sur ce sujet. Mme Hélène Mignon a indiqué qu'à son retour, elle avait transmis son rapport à MM. Michel Barnier, ministre des Affaires étrangères, et Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, et qu'elle avait informé M. Bruno Bourg-Broc, président délégué de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. A ce jour, elle n'a reçu aucune réponse. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé comment les chefs d'État africains appréhendent ces sujets essentiels. S'en ouvrent-ils par exemple au Président Jacques Chirac ? Mme Hélène Mignon a rappelé que ces problèmes avaient été traités en juillet dernier à Bangkok, mais qu'ils n'ont guère été abordés jusqu'ici dans le cadre de la francophonie. Les choses commencent toutefois à changer sous la pression de la Belgique, de la Suisse et de la France. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a proposé que la Délégation mette l'accent, auprès des ministres des affaires étrangères et de la coopération, sur le compte rendu de la mission de Mme Hélène Mignon et sur le fait que des réponses sont désormais attendues. Mme Hélène Mignon a estimé qu'il faudrait faire remonter les observations jusqu'à l'Elysée. Si la France s'engageait davantage pour la prise en charge des orphelins dans le cadre du Fonds international, les pays concernés seraient enclins à faire de même. Observant que la France est un gros financeur de ce Fonds, Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a estimé que la répartition des financements était également une question très importante. Pour Mme Hélène Mignon, c'est aussi un enjeu pour la présence française dans une région où les futurs cadres vont désormais se former au Canada. S'étant rendue récemment au Nicaragua, pays qui se trouve à la même latitude que le Togo, qui compte le même nombre d'habitants, où la pauvreté est équivalente, mais qui ne subit pas l'épidémie de sida, elle y a constaté une véritable colonisation économique : la résidence du président a été payée par la Thaïlande, les dispensaires sont financés par le Japon, tandis que l'aide européenne est réelle, mais moins voyante. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a observé qu'elle connaissait bien la situation dans ce pays car elle avait souvent l'occasion de rencontrer l'épouse du candidat de l'opposition à la dernière élection présidentielle. Celle-ci lui a indiqué que le souhait que l'Europe intervienne davantage en sa faveur y était largement partagé. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié Mme Hélène Mignon d'avoir fourni ces informations et proposé que toute réponse reçue par l'une ou l'autre d'entre elles soit aussitôt communiquée à l'ensemble des participantes. Audition de Mme Catherine Chouard, directrice des ressources humaines Réunion du mardi 18 janvier 2005 Présidence de Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a accueilli Mme Catherine Chouard, lauréate du Trophée « DRH de l'année » pour 2004 et l'a invité à exposer devant la Délégation son parcours personnel exceptionnel, mais aussi, au moment où le Président de la République a annoncé un projet de loi sur l'égalité salariale, à donner son sentiment sur la manière dont le législateur peut contribuer à faire progresser l'égalité professionnelle dans les entreprises. Mme Catherine Chouard a d'abord décrit son parcours professionnel, quelque peu atypique. Après des études d'économie, elle a trouvé un premier poste dans la fonction publique, à la DDASS de Paris. Puis, ayant réussi le concours d'attaché d'administration centrale, elle a quitté la Ville pour le ministère du Travail et la Délégation à l'emploi, à l'époque des grandes restructurations et des licenciements collectifs notamment dans la sidérurgie. Elle a rejoint ensuite la direction des études et de la recherche nucléaire d'EDF-GDF comme attaché administratif (contrôle de gestion et RH), tout en contribuant à y définir une organisation novatrice de la recherche - par projets et non plus par disciplines. Simultanément, elle a entrepris un DESS de management avancé des ressources humaines, puis intégré la direction du personnel et des relations sociales de l'entreprise. En 1990, elle a rejoint le secteur privé en devenant responsable du personnel chez DHL International, avant d'être nommée, un an plus tard, DRH de l'entreprise - ce qui ne l'a point empêchée, pour remplacer une personne en congé de maternité, d'exercer en même temps, pendant une année, la direction du service « clientèle ». Après avoir suivi, en 1995, un cycle de formation au management général de l'INSEAD, elle a rejoint, sur sollicitation, la société GrandVision pour y créer la fonction de directrice des ressources humaines au moment où le groupe multipliait les acquisitions, en France et à l'international, ce qui l'a conduite à séjourner au Royaume Uni pendant de longues périodes. En 2001, âgée de quarante ans et de nouveau sollicitée pour une création de poste, elle a rejoint Elior pour y exercer la fonction de directrice des ressources humaines groupe. Elior est une société de restauration sous contrat qui opère dans deux secteurs : la restauration collective (Avenance) pour les entreprises, les écoles et les établissements de santé ; la restauration de concession (Eliance) sur les autoroutes (Arche), dans les aéroports et dans les villes (dans des domaines aussi variés que la tour Eiffel, les musées, les gares, les parcs d'exposition...). L'organisation du travail qui, avec une dizaine de conventions collectives différentes, est tout sauf monolithique, et aussi d'une grande complexité. Par exemple, quand l'entreprise gagne un contrat, elle « gagne » aussi l'équipe d'employés correspondante, et les logiques de gestion sont à adapter au cas par cas. Les femmes constituent plus de 60 % d'un effectif de 50 000 collaborateurs, répartis sur 11 500 sites. Mais si le taux de féminisation est plus ou moins le même partout, il n'est pas uniformément réparti, puisque les femmes représentent 80 % des employés mais seulement 25 % de l'encadrement entendu au sens large. Traditionnellement, dans le métier de la restauration, les femmes sont affectées aux préparations froides, la partie « noble » - le chaud - étant le domaine des hommes. D'ailleurs, le vocabulaire traduit la pratique : ainsi de ces femmes dites « étagères » au motif qu'elles sont chargées de les garnir... Considérant que tous les mots comptent, il a été obtenu que, dans la convention collective, soit substitué à ce vocable le terme d'« aide-préparatrice »... qui traduit encore la féminisation de fait de la branche professionnelle. Il est apparu que le groupe éprouvait des difficultés à promouvoir les femmes à la fonction de responsable de secteur. L'analyse a montré que les réticences s'expliquaient tant par des raisons matérielles - nombreux déplacements, obligation de passer du temps dans différents points de vente - que par des raisons psychologiques : souvent, le fait de franchir les étapes du management n'intéresse pas les femmes. La question s'est alors posée de savoir s'il fallait imposer la promotion des femmes en instituant des quotas de responsables femmes par secteur, ou s'il fallait respecter le goût de chacun(e). La réflexion est conduite secteur par secteur, en concertation avec les directions générales de divisions. Dans le même temps, la direction des ressources humaines a poussé les feux de la qualification des femmes en définissant, avec les partenaires sociaux et en partenariat avec une école professionnelle réputée (Ecole Supérieure de Cuisine Française, Grégoire et Ferrandi), des certificats de qualification professionnelle et notamment celui de « chef gérant », reconnu non seulement au sein du groupe mais aussi par le marché. De plus, 250 à 300 femmes reçoivent une formation qualifiante chaque année. Le premier axe de la promotion des femmes est donc de favoriser leur qualification - notamment pour celles dont le niveau initial de formation est faible - afin qu'elles puissent évoluer au même titre que les hommes. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a demandé si l'âge peut constituer un obstacle à la promotion des femmes au sein de l'entreprise et si certaines refusent une formation ou une promotion pour privilégier leur vie familiale. Mme Catherine Chouard a répondu que ce n'est pas le cas dans les métiers de service, où la notion d'âge entre peu en ligne de compte, contrairement à la condition physique, en raison de la pénibilité des tâches. Le deuxième axe de promotion des femmes a pris un aspect plus symbolique. Pour mettre ses chefs à l'honneur, le groupe organise depuis plusieurs années un concours interne de cuisine. Jusque-là n'avaient participé que des hommes mais, lors du dernier concours, l'obligation a été instituée de constituer des binômes, chaque chef étant tenu de faire équipe avec une femme tant pour le choix de la recette que pour sa réalisation. Ainsi a-t-on cassé le mythe du chef qui travaille seul. Les chefs interrogés lors de la finale ont indiqué que la nouvelle organisation du concours avait réduit leur stress, les femmes présentes étant au moins aussi intéressées par le travail des autres équipes que par la concurrence proprement dite, ce qui avait modifié l'ambiance générale. Surtout, on a constaté que, par la suite, les équipes considérées travaillaient différemment. Voilà un exemple des méthodes structurantes que l'on peut mettre au point en jouant sur la logique de projet et le partage d'informations, pour faire évoluer les mentalités et introduire des valeurs féminines dans le management. Comme il a été dit précédemment, certaines difficultés pratiques peuvent être un obstacle à la promotion de femmes et même à leur embauche. C'est particulièrement le cas pour les restaurants d'autoroutes, dont l'accès suppose la disposition d'un véhicule. La direction des ressources humaines a donc mis au point une politique de covoiturage tendant aussi à ce que les salariées soient raccompagnées chez elles quels que soient leurs horaires de travail. Elle a par ailleurs fait évoluer la politique de recrutement en décidant qu'à compétence égale, priorité serait donnée aux femmes. Par ces deux moyens notamment, un terme a été mis à la pénurie chronique de personnel sur ces sites. De plus, il a été décidé de tenir compte des contraintes personnelles, mais aussi des hobbies, dans les plannings des collaborateurs ; de la sorte, les équipes gèrent elles-mêmes les horaires de ceux qui les composent et un mécanisme de solidarité interne s'établit, le tout fluidifiant les rapports au travail. On le voit, les partenaires sociaux - qui sont principalement des hommes... - d'un groupe assez fortement féminisé s'attachent aussi à accompagner le parcours des femmes, y compris celles dont le niveau de qualification initial est faible, pour leur donner une meilleure chance d'évoluer. Mais, comme chacun l'aura compris, des équilibres doivent être trouvés, qui ne dépendent pas seulement de la négociation des accords. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, s'est dite fascinée par ce parcours personnel impressionnant, qui suppose une grande capacité d'adaptation. Mme Catherine Chouard a précisé que cela avait tenu à l'intérêt des projets et des enjeux, ainsi qu'à la personnalité de ceux avec qui elle avait été amenée à travailler. S'agissant du groupe Elior, le défi d'intégration était de taille, car y devenir directrice des ressources humaines signifiait aussi être la seule femme d'un comité exécutif où la moyenne d'âge était de cinquante trois ans et dont les autres membres travaillaient ensemble pour la plupart depuis plus de 10 ans. Quatre ans après la création de la fonction, l'action menée porte ses fruits, et le moment est venu de développer de nouveaux sujets de fond ; c'est d'ailleurs pourquoi elle-même vient de recruter une adjointe chargée de créer une université d'entreprise. Elle se rend par ailleurs régulièrement sur le terrain, et trouve particulièrement touchant de s'entendre dire par des employées, comme il lui est arrivé récemment encore, qu'elles se sentent rassurées de se savoir « représentées » au comité exécutif. Il s'agit d'être aussi vigilant au style de management : l'augmentation du nombre de femmes dans des postes à responsabilités n'est pas forcément le seul critère. Il s'agit aussi de développer des valeurs féminines de management (entraide, participation, persuasion, partage du pouvoir) aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes et d'encourager les femmes à incarner leur différence de style de management. Mme Catherine Chouard a estimé que son passage dans le secteur public lui a inculqué la notion de l'intérêt collectif et l'a poussée à réfléchir plus généralement à l'organisation du travail, en cherchant toujours à faire partager des valeurs. Il est difficile de faire fonctionner des projets en réseaux, mais dès lors que des modèles de communication transversale et de travail en commun sont encouragés, la vision du monde évolue et l'on accepte mieux les autres, tous les autres, qu'il s'agisse de femmes, d'étrangers... Il faut donc s'attacher à faire évoluer les mentalités en montrant en quoi le travail avec des femmes conduit à des évolutions ; par ailleurs, plus universels et moins sexuellement connotés seront les programmes éducatifs, plus la prise de conscience s'accélérera. D'autre part, pourquoi, au terme des formations initiales, continuer de faire passer des examens individuels lorsqu'il s'agit d'accéder à des métiers qui supposent de travailler en commun ? Pourquoi ne pas faire réaliser à quelques étudiants un travail collectif pour les évaluer aussi sur leur capacité d'écoute, de recherche de compromis, de solutions créatives ? Mais on en est encore loin, et on continue de faire porter les examens sur les seuls savoirs, sans tenir compte des comportements et attitudes qui facilitent la vie collective. Pourtant, qui achète un service achète en quelque sorte aussi la personne qui le rend : si le produit est bon mais le vendeur déplaisant, la vente ne se fera pas. Qui dit économie de services dit création de valeur et d'emplois, mais il n'y a pas encore de représentation collective de ce que cela implique en termes d'évolution des comportements. Pourtant, les emplois dans les services sont ouverts au plus grand nombre et c'est un secteur dans lequel l'ascenseur social fonctionne encore bien, puisque la possibilité existe d'une véritable évolution professionnelle. Mais c'est aussi un secteur qui risque de ressentir très fortement les effets des transferts de population induits par l'ouverture de l'Europe. Malgré cela, la réflexion est encore inexistante sur les moyens d'accompagner, sur le plan professionnel, des gens qui, si ce n'est pas fait, se trouveront sans emploi et à la charge de la collectivité. Il faut donc modifier les représentations sociales relatives au secteur des services, qui demeure relativement mal connu et peu attirant par rapport aux standards de la « réussite » sociale, alors que c'est pourtant celui qui salarie le plus grand nombre d'employés et de femmes. Mme Bérengère Poletti a demandé si des salariées manifestent une réticence à l'idée de prendre des responsabilités d'encadrement par manque de confiance en soi. Mme Catherine Chouard a dit avoir constaté de telles réactions, ajoutant qu'un homme à qui l'on propose une promotion répond d'emblée « Je prends ! », alors qu'une femme dira plus volontiers « Il y a dans ce que l'on me demande là des choses que je ne sais pas faire ». Pour surmonter l'obstacle du manque de confiance en soi, la direction des ressources humaines d'Elior a décidé de privilégier la formation sur les sites pendant le temps de travail plutôt que de pourvoir des regroupements régionaux ou nationaux ; non seulement cette facilitation résout les difficultés liées à la garde des enfants et évite que les conjoints qui ne suivent pas de sessions de formation se sentent dévalorisés, mais ces expériences nouvelles sur le site de travail permettent aux intéressées de prendre conscience tout de suite de ce dont elles sont capables. Il est vrai que, souvent, les femmes n'osent pas se lancer ; mais l'on connaît, à l'inverse, des cas de confiance excessive en soi... Dans tous les cas, la lucidité sur ses propres capacités devrait prévaloir, mais parfois l'inhibition est telle qu'en l'absence de sollicitation, il ne vient même pas à l'idée de certaines femmes qu'elles pourraient demander quelque chose. On observe d'ailleurs que moitié plus d'hommes que de femmes demandent une promotion ou une augmentation de salaire. C'est souvent que, se sentant tenues à la parole donnée, elles préfèrent être sollicitées que risquer de ne pouvoir respecter l'engagement pris en demandant une promotion, de par l'évolution ultérieure de leur vie familiale. Les hommes, eux, veulent progresser et se posent moins ce genre de questions. Certaines femmes sont confrontées à des choix personnels déchirants, qui se traduisent par des souffrances et des résignations auxquelles l'entreprise ne peut rien. Mme Bérengère Poletti lui ayant demandé quels étaient à présent ses objectifs, Mme Catherine Chouard a répondu que son premier défi était de replacer l'Homme au cœur de la décision stratégique. Elle a expliqué avoir rejoint le groupe Elior au moment de sa cotation et de son internationalisation, moment où les enjeux économiques primaient, toute l'entreprise étant tendue vers le résultat. Ce défi est de parvenir à ce que le temps consacré aux salariés par le comité exécutif et le comité de direction augmente substantiellement par rapport à celui consacré à l'activité financière. Pour cela, il faut alimenter le débat, présenter des projets misant sur le potentiel des salariés, savoir montrer, preuves en main, le coût d'une intégration ratée ou d'un turnover excessif. Parler dans le registre de ceux qui décident situe la discussion dans la logique interne de l'entreprise. En faisant valoir que, puisqu'une entreprise de services a besoin d'un personnel qualifié et fidèle, tout doit être fait pour parvenir à cette fin, on se fait beaucoup mieux entendre de sa direction générale qu'en se limitant à affirmer que le management doit être féminisé. Autrement dit, il faut, partout où cela est possible, créer le langage commun qui permet de transformer la réalité en l'éclairant par des informations qui n'avaient pas forcément été perçues. Il faut aussi se convaincre de l'utilité de ce Dieu des petits riens cher à la romancière indienne Arundhati Roy, et savoir qu'en changeant de petites choses là où l'on est, on peut parvenir à créer un profond mouvement d'évolution. Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente, a remercié vivement Mme Catherine Chouard et l'a chaleureusement félicité pour un trophée amplement mérité. III. L'ACTIVITÉ INTERNATIONALE DE LA DÉLÉGATION A. CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARLEMENTAIRES SUR L'APPLICATION DU PROGRAMME D'ACTION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA POPULATION ET LE DÉVELOPPEMENT (CIPD) - STRASBOURG, 18 ET 19 OCTOBRE 2004 La Conférence internationale des parlementaires sur l'application du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) s'est réunie au Conseil de l'Europe à Strasbourg, les 18 et 19 octobre 2004, à l'occasion du dixième anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD). Cette deuxième conférence fait suite à celle qui s'est tenue à Ottawa en novembre 2002 et au cours de laquelle fut mis en place un système mondial de surveillance et de suivi pour les parlementaires. Environ 180 parlementaires venus du monde entier ont débattu des progrès accomplis et des mesures à prendre dans les dix prochaines années. La Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale était représentée par Mmes Marie-Jo Zimmermann, présidente, Danielle Bousquet, vice-présidente, Catherine Génisson et Claude Greff. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Mme Marie-Jo Zimmermann a lu la déclaration de M. Xavier Darcos, ministre délégué à la coopération, au développement et à la francophonie. M. Darcos y décrivait le programme d'action de la CIPD comme étant un tournant important dans les politiques démographiques et pour la sensibilisation des opinions publiques aux enjeux du développement. Il y rappelait que si des progrès ne sont pas rapidement enregistrés sur les questions de population, les objectifs du Millénaire pour le développement ne pourraient pas être atteints. Il y saluait l'action du Fonds des Nations unies pour la population et s'engageait à appuyer la promotion des droits des femmes et la prise en compte de l'égalité des sexes, qui sont d'une importance essentielle pour l'instauration d'un développement durable. Mme Marie-Jo Zimmermann a également présidé l'un des huit groupes de discussion de la conférence, celui consacré à la parité des sexes et à l'autonomie des femmes. Une déclaration finale a été adoptée à l'occasion de cette conférence. Déclaration d'engagement de Strasbourg Nous, parlementaires venus du monde entier, nous réunissons à Strasbourg (France) les 18 et 19 octobre 2004 pour réaffirmer et approfondir l'engagement que nous avons pris à Ottawa (Canada) en novembre 2002 de mobiliser les ressources nécessaires et de créer l'environnement politique propice à la réalisation des objectifs du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD). Nous réaffirmons en outre notre engagement en faveur du développement durable et de ses trois piliers : la croissance économique, le progrès social et la protection de l'environnement. Nous affirmons que l'application du Programme d'action de la CIPD et son examen après cinq ans sont essentiels pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Nous approuvons pleinement la déclaration du Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan : « Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en particulier l'élimination de l'extrême pauvreté et de la faim, ne peuvent être atteints à moins d'aborder de front les problèmes de population et de santé génésique. Cela signifie qu'il faut déployer davantage d'efforts pour promouvoir les droits des femmes et investir plus dans l'éducation et la santé, notamment la santé génésique et la planification familiale. » Nous acceptons notre devoir et notre responsabilité de promouvoir et de défendre les droits et la santé de tous les individus en matière sexuelle et génésique, notamment leur droit de décider librement et de manière responsable du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances; de défendre et faire progresser l'égalité et l'équité entre les sexes et la responsabilisation des femmes; et d'éliminer toutes les formes de discrimination, de coercition et de violence contre les femmes. Nous reconnaissons que la décision de défendre ces principes fait toute la différence entre une vie d'espoir et de perspectives et une vie de désespoir et d'affliction ou, pire encore, entre la vie et la mort. Nous acceptons donc notre devoir et notre responsabilité de protéger et de promouvoir ces principes et de faire en sorte qu'ils soient pleinement mis en oeuvre d'ici à 2015. Les problèmes clefs Nous reconnaissons que cet engagement est pris à mi-chemin du Programme d'action de la CIPD, étendu sur 20 ans. Ayant cela à l'esprit, nous reconnaissons que beaucoup de choses importantes ont été accomplies dans les 10 années qui ont suivi l'adoption du Programme d'action de la CIPD au Caire, en 1994, comme le montre particulièrement l'Enquête mondiale conduite par le Fonds national des Nations Unies pour la population (FNUAP) et les examens régionaux par l'ONU des progrès de chaque pays dans l'application du Programme d'action. Mais nous reconnaissons aussi que des problèmes clefs subsistent dans l'application du Programme et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le Développement, notamment les suivants : Chaque minute, une femme meurt du fait des complications liées à la grossesse, toutes sauf un très petit nombre dans les pays en développement, alors que ces complications peuvent presque toujours être évitées. Les complications obstétricales sont la cause majeure de décès chez les femmes en âge de procréer dans les pays en développement. La plupart des pays n'ont pas pour priorité de faire vivre au lieu de laisser mourir; c'est pourquoi le nombre annuel de décès des femmes dans le monde n'a pas changé sensiblement depuis 1994. Un tiers de toutes les femmes enceintes ne reçoivent pas de soins de santé pendant la grossesse; 60 % des accouchements ont lieu hors des centres de santé ; 50 % seulement de toutes les naissances bénéficient de la présence d'accoucheuses qualifiées, mais ce taux varie selon les régions et il est souvent plus bas parmi les plus pauvres des pauvres. Les femmes et les jeunes filles réfugiées, déplacées intérieurement ou victimes de la guerre et les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux risques de santé génésique et à la violence sexuelle. On note certes une sensibilisation croissante à ces problèmes et à la nécessité de les résoudre, notamment par la prévention du sida et le traitement de la violence sexuelle, mais, dans les situations d'urgence et les conflits complexes, les budgets humanitaires prévoient rarement des ressources pour la santé génésique. La pauvreté aggrave considérablement le risque de décès d'une femme durant la grossesse ou l'accouchement. Il est de 1 sur 12 en Afrique de l'Ouest contre 1 sur 2 800 dans les régions développées. La pauvreté ne sera jamais atténuée ni les OMD atteints à moins d'appliquer intégralement le Programme d'action de la CIPD. Dans les pays en développement, environ 200 millions de femmes pauvres manquent de moyens de contraception efficaces. Faire face à ce besoin coûterait environ 3,9 milliards de dollars par an et éviterait 23 millions de naissances non planifiées, 22 millions d'avortements provoqués, 142 000 décès liés à la grossesse, dont 53 000 consécutifs à des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, et 1,4 million de morts infantiles. En l'espace de deux décennies, la pandémie du sida a détruit plus de 20 millions de vies, dont 3 millions en 2003, tandis que la pandémie s'accélère dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, 38 millions de personnes environ sont atteintes du VIH/Sida. Moins de 20 % des personnes les plus exposées à la contamination par le VIH ont accès à une réelle prévention qui, si elle était opérée à très grande échelle, pourrait éviter de 29 à 45 millions de nouvelles contaminations d'ici à 2010. En 2003, on a compté 5 millions de nouvelles contaminations par le VIH. Les femmes représentent plus de la moitié de la totalité des adultes contaminés, et près des trois cinquièmes dans l'Afrique subsaharienne. La moitié des nouvelles contaminations par le VIH touchent les jeunes - quatre contaminations par minute - les jeunes femmes étant particulièrement exposées, surtout en Afrique où leur taux de contamination est deux à trois fois supérieurs à celui des jeunes hommes. Quelque 2,8 milliards de personnes - deux sur cinq - luttent encore pour survivre avec moins de 2 dollars par jour dont 1,2 milliard avec moins de 1 dollar. Plus de la moitié sont des femmes. L'instabilité politique et les conflits armés font obstacle à l'élimination de la pauvreté et au développement durable. Un demi-milliard de personnes vivent dans des pays souffrant de stress hydrique ou de pénurie d'eau, et le captage des eaux souterraines appauvrit les réserves, ce qui a de graves répercussions sur la sécurité alimentaire future ; d'ici à 2025, la population vivant dans ces pays sera, selon les prévisions, cinq à sept fois plus nombreuse. La pollution de l'eau nuit à la santé de 1,2 milliards de personnes et contribue au décès de 15 millions d'enfants de moins de cinq ans. Environ 800 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique et 2 milliards n'ont pas de sécurité alimentaire. Dans quarante-cinq ans, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans aura doublé, passant d'environ une sur dix à une sur cinq. Nombre d'entre elles vivront dans la pauvreté et auront besoin de l'aide publique pour les services sociaux et de santé. Un appel à l'action Nous, parlementaires, nous engageons à prendre les mesures suivantes et appelons les parlementaires du monde entier à faire de même : 1. faire pression sur les Nations Unies pour qu'elles fixent, à l'occasion du bilan quinquennal de la Déclaration du Millénaire, un neuvième objectif du Millénaire en matière de développement, fondé sur le programme d'action de la CIPD, afin de rendre la santé sexuelle et génésique accessible à tous d'ici à 2015 ; 2. faire en sorte d'obtenir que les 0,7 % du PIB qu'il avait été convenu d'affecter à l'aide publique au développement (APD) le soient effectivement et n'épargner aucun effort pour mobiliser les ressources financières nécessaires à l'application du Programme d'action de la CIPD ; 3. faire en sorte d'obtenir que 10 % au moins des budgets nationaux de développement et des budgets d'aide au développement soient consacrés aux programmes de population et de santé génésique ; 4. donner la plus haute priorité dans les budgets nationaux, les approches sectorielles et les stratégies de réduction de la pauvreté à l'élargissement de l'accès à l'ensemble des services et produits en matière de santé génésique et veiller à ce que la santé de la population et la santé génésique soient reflétées de manière visible dans les discussions préparatoires au bilan quinquennal de la Déclaration du Millénaire ainsi que dans les objectifs et indicateurs des OMD ; 5. donner la plus haute priorité aux efforts déployés pour réduire la mortalité et la morbidité maternelles ainsi que les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, conformément aux lignes directrices de l'OMS figurant dans Safe Abortion : Technical and Policy Guidance for Health Systems (2003), car il s'agit d'une question de santé publique et de droits en matière de santé sexuelle et génésique ; 6. renforcer les services de maternité sans risques, notamment la nutrition maternelle et les soins prénataux, la présence d'accoucheuses qualifiées lors des naissances et les soins obstétricaux d'urgence ; 7. prendre des mesures immédiates pour remédier à la pénurie de personnel qualifié dans de nombreux pays, due à une formation insuffisante, aux décès consécutifs au VIH/SIDA et à la fuite du personnel dans les pays développés ; 8. donner la plus haute priorité aux mesures visant à favoriser les partenariats entre le secteur privé, les ONG et les gouvernements afin de produire et fournir des services et produits abordables en matière de santé génésique, notamment pour la planification familiale et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH/SIDA ; 9. encourager de façon prioritaire le partenariat avec les groupes religieux pour la prévention du SIDA, en établissant le dialogue avec eux ; 10. mobiliser des ressources supplémentaires nécessaires pour financer les besoins de produits non satisfaits dans les programmes financés par le FNUAP et la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF) à hauteur d'au moins 150 millions de dollars par an et élaborer une feuille de route pour garantir un financement durable, en reconnaissant les coûts humains et économiques qu'entraînerait l'absence de ces ressources ; 11. renforcer les services de planification familiale afin de permettre aux femmes de différer, espacer et limiter leurs grossesses à leur gré ; 12. sensibiliser les hommes à leur rôle et à leurs responsabilités en matière de santé génésique et aux droits des femmes et des hommes en matière de procréation, afin qu'ils consultent eux-mêmes et encouragent leur partenaire à consulter les services de santé génésique, y compris les services de planification familiale, pour éviter les grossesses non désirées et réduire les risques de transmission de maladies sexuellement transmissibles, notamment du VIH/SIDA ; 13. veiller à ce que les usagers des programmes de santé sexuelle et génésique, notamment les jeunes et les porteurs du VIH/SIDA, soient pleinement associés à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de ces programmes ; 14. mobiliser un soutien en faveur des femmes avant, pendant et après la grossesse et l'accouchement par le biais de campagnes publiques d'éducation sanitaire et grâce à un renforcement des mesures politiques, législatives et réglementaires de nature à promouvoir et à protéger la santé des mères ; 15. amplifier et étendre les activités de prévention du VIH/SIDA et veiller à ce qu'elles soient intégrées aux programmes globaux de santé sexuelle et génésique ; 16. promouvoir des actions coordonnées et cohérentes concernant le VIH/SIDA, fondées sur le principe d'un seul cadre national de lutte contre le SIDA, d'un seul organe multisectoriel et à large assise de coordination de la lutte contre le SIDA, et d'un seul système de suivi et d'évaluation au niveau national reconnu par tous, et rechercher une intégration aussi poussée que possible avec les autres services pertinents de santé sexuelle et génésique ; 17. presser les gouvernements d'accorder la priorité à la recherche sur les vaccins et les antibiotiques et d'augmenter les ressources qui lui sont consacrées ; 18. promulguer et faire appliquer des lois destinées à garantir le respect des droits de l'homme, et notamment les droits sexuels et génésiques, ainsi que la dignité des orphelins du SIDA, des personnes qui vivent avec le SIDA et d'autres groupes vulnérables ; 19. promulguer et faire appliquer des lois et mesures de promotion et de protection des droits fondamentaux des filles et des jeunes femmes, et garantissant l'égalité d'accès des femmes à l'éducation et à la santé, surtout à la santé sexuelle et génésique, ainsi qu'une pleine participation aux opportunités économiques et à la prise de décisions à tous les niveaux ; 20. appliquer intégralement les dispositions du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui protègent les droits des femmes et des filles, des migrants et des réfugiés pendant et après les conflits, et faire appliquer la loi dans toute sa rigueur à l'encontre des personnes coupables de violences ou d'exploitation sexuelles, de la traite d'êtres humains et d'autres crimes similaires ; 21. veiller à ce que les services de santé génésique fassent partie intégrante de l'aide humanitaire et de la transition au lendemain des conflits ; 22. promulguer et faire appliquer des lois qui érigent en infractions punissables les violences domestiques et sexuelles contre les femmes et les filles, notamment les pratiques traditionnelles nuisibles comme la mutilation génitale des filles, et accorder une priorité élevée à l'implication de tous les secteurs de la société, y compris les dirigeants politiques, religieux et culturels, dans les campagnes visant à faire cesser de telles pratiques ; 23. intensifier les efforts visant à assurer un plus large accès à des informations et services de santé génésique adaptés aux jeunes, y compris aux adolescents mariés ou non scolarisés, et dispenser aux adolescents, et surtout aux garçons et aux jeunes hommes, une formation et une éducation à la vie afin de promouvoir les droits des femmes et des filles ; 24. promouvoir et protéger les droits des adolescents, notamment leur droit à des informations et services de santé génésique, et tenter d'éliminer les inégalités dans la manière dont garçons et filles sont traités et appréciés au sein des familles et par la société ; 25. reconnaître que l'accès à une eau propre est un droit fondamental et accorder, dans les stratégies nationales de développement et de lutte contre la pauvreté, une priorité élevée à l'amélioration de la productivité et de la sauvegarde de l'eau, y compris par le passage à des cultures et à des technologies peu gourmandes en eau, et au lancement de programmes de lutte contre la pollution des eaux ; 26. améliorer tout spécialement l'accès des femmes aux ressources agricoles et productives, y compris la terre, les eaux et le crédit, et promouvoir des systèmes équitables et efficaces de distribution et de développement durable ; 27. protéger la santé génésique des femmes, des hommes et des enfants contre les effets des épandages de produits phytosanitaires sur les cultures ; 28. promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et politiques des personnes âgées et leur donner les moyens d'une participation pleine et effective à la vie économique, politique et sociale de leur société. Engagement Nous, parlementaires, nous engageons à prendre ces mesures et à suivre de manière systématique et active les progrès accomplis en la matière. Nous nous engageons en outre à rendre compte régulièrement de ces progrès par l'intermédiaire des groupes parlementaires et à nous rencontrer de nouveau dans deux ans pour évaluer les résultats obtenus. Enfin, nous prenons l'engagement de promouvoir et de protéger pour chacun la pleine jouissance de ses droits humains - notamment sexuels et génésiques - et de ses libertés fondamentales. B. CONFÉRENCE DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DES PARLEMENTS DE L'UNION EUROPÉENNE ET DU PARLEMENT EUROPÉEN - LA HAYE, 4 ET 5 NOVEMBRE 2004 La conférence des commissions pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes des Parlements de l'Union européenne et du Parlement européen s'est réunie à La Haye les 4 et 5 novembre 2004. Cette conférence s'est tenue quelques jours après l'assassinat de metteur en scène néerlandais Théo van Gogh, ardent défenseur de la liberté d'expression, ce qui donnait un relief particulier au thème retenu pour la conférence : l'indépendance économique des femmes, en particulier celle des femmes issues de l'immigration et des minorités ethniques. Mme Danielle Bousquet représentait la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale à cette conférence. La conférence a entendu Son Altesse Royale la princesse Máxima, membre du Comité pour la participation des femmes issues des minorités ethniques, ainsi que des contributions d'experts : - Mme Janneke Plantenga, professeur associé à l'Ecole des études économiques d'Utrecht ; - Mme Lydia la Rivière- Zijdel, présidente du Lobby européen des femmes ; - Mme Erna Hooghiemstra, directrice du Conseil néerlandais des familles ; - Mme Philomena Essed, chercheuse principale à l'Institut pour les études du développement métropolitain et international d'Amsterdam et professeur associé à l'Université de Californie. Des échanges entre les parlementaires des 25 pays de l'Union européenne et du Parlement européen ont permis de mieux cerner les réalités de chacun des pays. En conclusion, la conférence a adopté une déclaration, amendée sur plusieurs points, en particulier à l'initiative de la délégation française. Conclusions de la présidence Observations préliminaires 1. La conférence annuelle des délégués du réseau des commissions parlementaires pour l'égalité des chances des États membres de l'UE et du Parlement européen s'est tenue dans la grande salle de la Chambre des représentants des États-Généraux, à La Haye, le 5 novembre 2004. Des délégués des Parlements nationaux des États membres et des pays candidats et des membres du Parlement européen ont assisté à la conférence. Elle a été présidée par Mme Tineke Lodders et Mme Andrée van Es, alternativement. Dans son discours de bienvenue, la Présidente du Sénat néerlandais, Mme Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, a souligné que certaines questions semblaient quelque peu dépassées en ce qui concerne l'indépendance économique des femmes, mais qu'elles requéraient néanmoins toujours de l'attention. Elle a insisté sur la disparité salariale entre les genres dans l'Union européenne. Ensuite, elle a déclaré que de nouveaux défis sont apparus, comme le retour des femmes à la vie active. Mme Timmerman-Buck a conclu que le but ultime que nous devons nous efforcer d'atteindre est de faire en sorte que l'indépendance économique de toutes les femmes ne soit rien d'autre qu'un choix personnel. 2. D'emblée, deux sujets ont été inscrits à l'ordre du jour : l'indépendance économique des femmes en général et l'indépendance économique et la situation des femmes issues de l'immigration et de minorités ethniques en particulier. Son Altesse Royale la princesse Máxima a prononcé le discours d'ouverture de la conférence, dans lequel elle a déclaré que la diversité doit être prise en compte lorsque l'on parle d'émancipation et de participation. L'émancipation et la participation sont les deux faces d'une même médaille. 3. S'exprimant sur le thème de l'indépendance économique des femmes, Mme Janneke Plantenga, professeur associé à l'Utrecht School of Economics et professeur à l'Université de Groningue, a présenté des données sur plusieurs indicateurs qui, pris conjointement, donnent une bonne idée de la situation socio-économique des femmes (et des hommes) dans les États membres de l'Union européenne. Dans la mesure où l'indépendance économique dépend essentiellement de la répartition équitable du travail rémunéré et non rémunéré, elle a également fourni quelques données sur un sujet de débat aux Pays-Bas, à savoir le « care independence » ou l'indépendance des soins. Mme Lydia la Rivière-Zijdel, présidente du Lobby européen des femmes, a souligné que la féminisation de la pauvreté demeure une réalité dans toute l'Europe. Les États membres de l'Union européenne doivent donner plus de visibilité à la participation des femmes dans l'économie sociale et de solidarité en collectant et en diffusant des informations qualitatives et quantitatives sur le sujet. La valeur ajoutée de la participation des femmes au marché du travail rémunéré a été démontrée dans diverses études. 4. Dans son exposé sur l'indépendance économique des femmes et la situation des femmes issues de l'immigration et de minorités ethniques, Mme Erna Hooghiemstra, directrice du Conseil néerlandais de la famille, a brièvement retracé l'histoire de la migration de femmes néerlandaises issues de divers groupes ethniques. Elle a donné un aperçu de la politique néerlandaise en matière d'émancipation et d'intégration des femmes d'origine étrangère. Elle a accordé une attention particulière à deux passages clés dans la vie des femmes : la création d'une famille et ses effets sur la participation dans la société de femmes ayant un vécu de migrante différent. Mme Philomena Essed, chercheuse à l'Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies à l'Université d'Amsterdam et professeur associé à l'Université de Californie sur les questions des femmes, a souligné qu'il fallait étudier de plus près les conséquences sexospécifiques de l'assimilation et de l'intégration et les entraves que créent les multiples formes de discrimination. L'accent doit surtout être mis sur ce que les femmes (issues des minorités ethniques) peuvent et veulent apporter, sur la manière dont cela peut se faire et sur le type de soutien institutionnel et juridique nécessaire pour réaliser leurs ambitions. Remarques procédurales Les représentants des Parlements nationaux des États membres et des pays candidats et les membres du Parlement européen présents à la 9e conférence du réseau des commissions parlementaires pour l'égalité des chances des femmes et des hommes, réunis à La Haye, 1. conviennent de faire rapport à leurs assemblées respectives sur les progrès réalisés lors de cette réunion et d'inscrire dès que possible à l'ordre du jour parlementaire l'important sujet de l'indépendance économique des femmes et des mesures nécessaires à sa réalisation ; 2. expriment le souhait que cette réunion soit suivie par un rapport de chaque pays sur la mise en œuvre des politiques nationales tendant à l'indépendance économique des femmes sous l'angle des objectifs de Lisbonne ; 3. proposent une nouvelle méthodologie pour la prochaine conférence, à savoir la définition d'un thème spécifique quatre mois avant la conférence, de sorte que chaque pays puisse présenter une contribution écrite sur le sujet retenu, qui sera exposée durant la réunion plénière du réseau ; 4. demandent au président de cette conférence de transmettre les présentes conclusions aux présidents des Parlements nationaux et du Parlement européen ainsi qu'aux présidents de la Commission européenne et du Conseil des ministres. Indépendance économique des femmes Les représentants des Parlements nationaux des États membres et des pays candidats et les membres du Parlement européen présents à la 9e conférence du réseau des commissions parlementaires pour l'égalité des chances des femmes et des hommes, réunis à La Haye, 5. insistent sur le fait que l'inégalité économique est à la base de l'inégalité plus large entre les hommes et les femmes ; 6. prennent note de l'objectif de 60 % d'emploi pour les femmes, qui a été arrêté à Lisbonne comme objectif de la politique de l'Union européenne ; 7. prennent note des objectifs relatifs aux structures d'accueil des enfants fixés dans le programme de Barcelone en 2002, à savoir 33 % de places dans les structures d'accueil pour les enfants de moins de trois ans et 90 % pour les enfants entre trois ans et l'âge où la scolarité devient obligatoire ; 8. sont conscients de la diversité des situations et des conditions dans lesquelles vivent les femmes et reconnaissent que de nombreuses femmes se heurtent à de multiples obstacles sur le chemin de leur autonomie ; 9. considèrent que le genre ne doit pas toujours être considéré isolément, mais doit être vu en relation avec d'autres facteurs structurels comme l'appartenance ethnique et l'âge ; 10. affirment que l'indépendance économique des femmes contribue à la participation au travail dans son ensemble ; 11. appellent les gouvernements de tous les États membres à élaborer une politique globale en faveur de la promotion de l'indépendance économique des femmes selon quatre lignes de force : - politique de l'emploi, - politique salariale, - conciliation de la vie professionnelle et privée, - partage équitable du travail non rémunéré, 12. accueillent favorablement les conclusions du Conseil européen du printemps 2004 qui appellent à l'élaboration de stratégies destinées à accroître la participation nette des femmes et des salariés plus âgés, à encourager l'intégration de la dimension de genre afin de réaliser les objectifs généraux de Lisbonne et d'éliminer les disparités salariales, ainsi qu'à la création d'emploi plus adaptés à la vie de famille afin que davantage de femmes entrent dans la vie active ; 13. appellent les Gouvernements nationaux et les autres parties intéressées à prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre ces conclusions ; 14. appellent les Gouvernements de tous les États membres à poursuivre l'élaboration de nouvelles stratégies afin d'accroître la participation nette des femmes dans la société ; 15. recommandent aux Gouvernements d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures destinées à encourager le travail indépendant et l'entrepreneuriat (social) comme manière efficace d'atteindre l'indépendance économique des femmes ; 16. accueillent favorablement l'idée d'intégrer le travail non rémunéré des femmes à la maison et lié à la vie domestique dans le PIB afin de renforcer l'indépendance économique des femmes ; 17. proposent d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle spécifiques pour les femmes victimes de violence de genre, de manière à leur permettre d'accéder au marché du travail, étant donné que la dépendance économique constitue un handicap pour celles qui souhaitent échapper à ces violences ; 18. formulent le vœu qu'une plus grande attention soit accordée au fait que des améliorations ne seront possibles que si l'émancipation des partenaires est prise en compte et si des solutions adéquates sont trouvées pour concilier travail et vie de famille ; 19. formulent le voeu qu'une plus grande attention soit accordée au partage équitable du travail non rémunéré en fixant, par exemple, des objectifs pour la prise d'un congé parental par les hommes ; 20. sont conscients du fait qu'un des groupes ayant le degré de participation le plus faible dans la société est celui des migrantes et sont d'avis qu'il est capital d'investir dans ces femmes, non seulement en vue de leur émancipation personnelle, mais également pour la prochaine génération de femmes et d'hommes que ces femmes élèvent ; 21. sont conscients du fait qu'un grand nombre de femmes migrantes s'en sortent bien et jouent un rôle important dans la société en tant que modèles, mais rencontrent néanmoins encore des problèmes sur le marché de l'emploi ; 22. appellent les Gouvernements de tous les États membres à prendre les mesures appropriées en matière de politique sociale et d'éducation afin d'offrir aux migrantes et aux femmes issues de minorités ethniques souvent exclues socialement l'occasion d'acquérir les compétences linguistiques et la formation professionnelle nécessaires pour participer et s'intégrer au marché du travail ; 23. accueillent favorablement l'idée de créer un Institut européen du genre et invite la Commission européenne à présenter une proposition détaillée sur ce point. C. 49e SESSION DE LA COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS UNIES, NEW-YORK, MARS 2005 La 49e session de la Commission de la condition de la femme qui s'est tenue à New-York au siège de l'Organisation des Nations-Unies du 28 février au 11 mars 2005, a examiné et évalué la suite donnée à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing ainsi qu'au document de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Cette manifestation a réuni environ 80 ministres, plus de 1 800 délégués gouvernementaux de 165 États membres et plus de 2 600 représentants non gouvernementaux venus de toutes les régions du monde. Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, qui représentait la France à cette session, est intervenue, le 1er mars, au cours du débat général. Associées à la délégation ministérielle, Mmes Danielle Bousquet, vice-présidente, Claude Greff et Bérengère Poletti, membres de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, ont représenté, du 28 février au 3 mars, la Délégation à cette 49e session. Elles ont également participé à la journée parlementaire organisée le 3 mars par l'Union interparlementaire sur le thème « l'après Beijing : vers l'égalité des sexes en politique ». 1) La Déclaration adoptée par la Commission de la condition de la femme à l'issue de ses travaux, le 11 mars 2005 Les représentants à la session plénière ont exposé de façon détaillée les progrès accomplis au cours des dix dernières années en ce qui concerne la condition des femmes. Un consensus s'est dégagé sur l'idée que l'autonomie des femmes représente le moyen le plus efficace pour réaliser le développement et réduire la pauvreté. A un moment où certains pays, notamment les États-Unis, manifestent leur réticence à la réaffirmation des droits contenus dans le plate-forme de Beijing, la ministre Mme Nicole Ameline est venue confirmer l'attachement de la France aux acquis de cette plate-forme, indiquant très nettement qu'il ne saurait y avoir recul en ce domaine. La tentative américaine d'introduire un amendement restrictif sur le droit à l'avortement dans la Déclaration finale a été un échec. La Déclaration finale a réaffirmé sans réserve et sans condition les engagements pris il y a dix ans à Beijing et demandé aux Gouvernements de prendre de nouvelles mesures pour accélérer la mise en œuvre des préconisations issues de la Conférence de Beijing sur les femmes. Déclaration rendue publique par la Commission de la condition de la femme à sa quarante-neuvième session Nous, les représentants des Gouvernements réunis pour la quarante-neuvième session de la Commission de la condition de la femme à New-York à l'occasion du dixième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995, dans le contexte de l'examen des textes issus de la Conférence et de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée « Les femmes en l'an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle », et de la contribution de la Commission à la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale consacrée à l'examen de la Déclaration du Millénaire, qui aura lieu du 14 au 16 septembre 2005, 1. Réaffirmons la Déclaration et le Programme d'action de Beijing adoptés à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale ; 2. Nous félicitons des progrès accomplis jusqu'à présent sur la voie de la réalisation de l'égalité entre les sexes, soulignons que des problèmes et des obstacles continuent d'entraver l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale et, à cet égard, nous engageons à prendre de nouvelles mesures pour assurer leur application intégrale et accélérée ; 3. Soulignons que l'application intégrale et effective de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing est essentielle pour atteindre les objectifs de développement convenus au niveau international, y compris ceux énoncés dans la Déclaration du Millénaire, et insistons sur la nécessité d'assurer l'intégration de la problématique hommes-femmes dans la réunion plénière de haut niveau consacrée à l'examen de la Déclaration du Millénaire ; 4. Reconnaissons que l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing et l'exécution des obligations découlant de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes se renforcent mutuellement dans le but d'atteindre l'égalité entre les sexes et d'assurer la montée en puissance des femmes ; 5. Demandons au système des Nations Unies, aux organisations internationales et régionales, à tous les secteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, ainsi qu'à toutes les femmes et tous les hommes, de s'engager pleinement et d'intensifier leurs contributions à l'application de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing ainsi que des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'Assemblée générale. 2) La journée parlementaire organisée par l'Union interparlementaire (UIP) le 3 mars 2005 A l'occasion de la 49e session de la Commission de la condition de la femme, la réunion organisée par l'UIP visait à permettre aux parlementaires du monde entier d'échanger sur les avancées et les reculs constatés depuis 10 ans, ainsi qu'à contribuer à l'examen et à l'évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d'action de Beijing. Les débats ont porté sur l'amélioration de l'accès des femmes aux Parlements et sur les mécanismes propres à renforcer la capacité des Parlements à atteindre les objectifs de Beijing. La dernière édition de la carte mondiale intitulée : « Les femmes en politique : 2005 » a été publiée à cette occasion et distribuée aux parlementaires. Elle donne des indications sur la participation des femmes aux pouvoirs législatif et exécutif dans les divers pays du monde. Au 1er janvier 2005, la France figure : - au 70e rang mondial pour le pourcentage des femmes dans les Parlements monocaméraux ou dans les Chambres basses (Rwanda : 1er rang, Suède : 2e rang, Belgique : 10e rang, Allemagne : 13e rang) ; - au 32e rang mondial pour le pourcentage des femmes aux postes ministériels (Suède : 1er rang, Espagne : 2e rang, Allemagne : 4e rang). Au 1er janvier 2005, 8 femmes étaient chefs d'État (élues) ou de Gouvernement : Bangladesh, Finlande, Irlande, Lettonie, Mozambique, Nouvelle-Zélande, Philippines, Sri Lanka et 19 femmes étaient présidentes d'une assemblée parlementaire. D. CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PARLEMENTAIRES DU G8 SUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE : 6 ET 7 JUIN 2005 Avant le Sommet des chefs d'État et de Gouvernement du G8, début juillet 2005, une conférence internationale des parlementaires - parlementaires du G8, des pays européens et africains - s'est réunie à Edimbourg, les 6 et 7 juin 2005, sur le thème du développement en Afrique. Cette conférence, à laquelle Mme Danielle Bousquet, vice-présidente de la Délégation, a participé, avait pour objet de mettre au point des recommandations à proposer au Sommet du G8 concernant les besoins en développement de l'Afrique. La déclaration d'Edimbourg a été adoptée le 7 juin 2005. La déclaration d'Edimbourg, le 7 juin 2005 Nous - parlementaires du G8, des pays européens et africains - nous sommes réunis à Edimbourg, en Ecosse, les 6 et 7 juin 2005 à l'occasion de la Conférence internationale 2005 des parlementaires du G8 sur le développement en Afrique. Notre objectif était d'arriver à un accord sur des recommandations concrètes, réalistes et mesurables sur les besoins en développement de l'Afrique, en mettant plus particulièrement l'accent sur le VIH/SIDA, ainsi que sur la santé sexuelle et génésique et les droits en la matière, dans le contexte de l'aide, du commerce, de l'allégement de la dette et la résolution des conflits. L'Afrique a besoin d'une attention urgente. Le nombre de personnes qui y vivent dans des conditions d'extrême pauvreté a presque doublé, passant de 164 millions en 1981 à 314 millions aujourd'hui. En Afrique, la moitié de la population vit avec moins d'un dollar par jour et 40 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. En 2005, trois millions de personnes seront infectées par le VIH et deux autres millions mourront de maladies liées au SIDA. Le VIH/SIDA a renversé la progression en termes de développement, réduisant l'espérance de vie à moins de 40 ans dans neuf pays. Sur la base des estimations actuelles, d'ici 2015, l'Afrique subsaharienne ne pourra réaliser aucun des objectifs du Millénaire pour le développement. Les femmes doivent être au cœur des politiques de développement. Cela signifie qu'il faut leur donner accès à l'éducation, à l'économie, aux ressources, aux instances décisionnelles, à des services de soins de santé complets y compris à la santé génésique ; il faut aussi lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes de progresser et leur assurer une participation égalitaire au niveau politique, économique et social. Face à la complexité et l'importance des défis qu'il doit relever, le continent africain dispose néanmoins d'un énorme potentiel. L'année dernière, les économies africaines ont, par exemple, enregistré leur taux de croissance le plus rapide de ces 30 dernières années. L'Erythrée, le Sénégal et l'Ouganda ont, quant à eux, montré qu'en intensifiant les moyens, il est possible de lutter contre le VIH/SIDA. Les pays africains et leurs partenaires internationaux doivent capitaliser ces progrès. L'heure de l'action politique a sonné. 2005 sera une année décisive pour le développement : il sera ou ne sera pas. La Commission pour l'Afrique, le Sommet du G8 de juillet à Gleneagles et la conférence des Nations Unies de septembre sur les objectifs du Millénaire pour le développement sont autant d'éléments qui attestent du renouveau en termes d'engagement dans la lutte contre la pauvreté et les progrès des services sanitaires de base, et de l'accent particulier mis sur la santé sexuelle et génésique. Nous nous devons de saisir l'opportunité qui nous est donnée d'améliorer la vie des 906 millions d'Africains. POINTS D'ACTION DU G8 Nous lançons un appel aux dirigeants des pays les plus riches qui participent au Sommet du G8 de Gleneagles pour qu'ils entreprennent des actions dans les six domaines suivants : Amélioration de l'aide à l'Afrique, tant en termes de quantité que de qualité Que les pays du G8 fixent immédiatement le calendrier du doublement de l'aide à l'Afrique d'ici 2010 ; Que les pays du G8 fixent des calendriers nationaux en ce qui concerne l'allocation de 0,7 pour cent de leur produit national brut en aide publique au développement (ODA) - comme convenu dans le Consensus de Monterrey - avant 2015 ; Que l'augmentation de l'aide soit indépendante de l'allégement de la dette et de l'aide d'urgence ; Que les pays du G8 améliorent la qualité de l'aide (c'est-à-dire qu'ils la rendent plus prédictible, indépendante, alignée sur les priorités des pays en développement, harmonisée, transparente et responsable) ; Que les pays du G8 agissent en vue de mettre en œuvre la Déclaration de Paris de février 2005 sur l'efficacité de l'aide, qui définit 12 indicateurs de surveillance, de fourniture et de gestion de l'aide ; Que les pays du G8 consacrent 10 pour cent de leur ODA aux programmes consacrés à la population, à la santé sexuelle et génésique et aux droits en la matière ; Que l'aide soit accordée de manière prioritaire à l'autonomisation des femmes et à la promotion de l'égalité des sexes. Il faut développer de meilleurs indicateurs de surveillance de l'amélioration de l'égalité des sexes et les négociations sur l'aide doivent impliquer des femmes ; Renforcement de la capacité de l'Afrique à bénéficier du système du commerce international Que les pays du G8 suppriment les subventions aux exportations agricoles et s'engagent à réduire considérablement les droits de douane sur les produits agricoles ; Que les pays du G8 aident les pays africains à développer leur propre capacité commerciale et à renforcer leurs marchés agricoles domestiques notamment en améliorant leurs infrastructures de transport et de communication ; Que les pays du G8 fassent en sorte que la rencontre ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce de Hong-Kong prévue en décembre soit synonyme de réels progrès au niveau du cycle de Doha pour le développement ; Que les pays du G8 soutiennent les efforts en vue d'une participation pleine et équitable des femmes dans le développement économique, par la mise à leur disposition par exemple de programmes de micro-crédits et leur accès à une formation économique ; Que les pays du G8 soutiennent la lutte contre la pauvreté du NEPAD par l'agriculture et l'utilisation du Programme global de développement de l'agriculture africaine (CAADP) en tant que cadre commun d'assistance au secteur agricole ; Accord sur les moyens d'alléger davantage la dette Que les pays du G8 s'engagent à supprimer la dette insoutenable bilatérale et multilatérale des pays les plus pauvres ; Que les pays du G8 élaborent des mécanismes novateurs pour financer l'allégement de la dette sans générer de nouvelles créances ni déprécier l'ODA existant ; Que les ressources générées par l'annulation de la dette soient équitablement redistribuées et utilisées pour couvrir les besoins des plus marginalisés, surtout ceux des femmes ; Faire des droits des femmes le point de mire de la politique de développement Que les pays du G8 soutiennent les Gouvernements africains pour garantir une participation égalitaire des femmes dans tous les aspects de la vie sociale, politique et économique. Plus particulièrement, des mesures doivent être mises en place pour combler le fossé entre les sexes au niveau des revenus et instaurer une meilleure protection légale et sociale des femmes qui travaillent ; Que les pays du G8 soutiennent les initiatives qui émanent des pays africains pour créer et habiliter un environnement législatif des droits de la femme. Des mesures de protection et de promotion de la santé sexuelle et génésique et des droits en la matière pour diminuer la violence sexiste doivent être incluses dans les politiques nationales et régionales et mises effectivement en œuvre par la législation ; Que les pays du G8 soutiennent les États africains dans leurs efforts pour réaliser immédiatement l'OMD 3, c'est-à-dire l'élimination de la discrimination basée sur le sexe dans l'enseignement primaire et secondaire. Un accent particulier doit être mis sur la rétention des filles dans les écoles et sur l'élimination des barrières socio-économiques qui obligent souvent les filles à quitter l'école ; Aborder les problèmes sanitaires spécifiques des pays africains Que les pays du G8 soutiennent, y compris par le biais d'un financement plus important, la mise en œuvre des "Three Ones" pour améliorer la coordination et l'harmonisation des efforts de lutte contre le VIH/SIDA par le biais d'un continuum complet de prévention, (y compris l'exploration des nouvelles technologies), de traitement et de soins ; Que les pays du G8 renforcent le lien entre la santé sexuelle et génésique et les programmes de défense des droits dans le développement du secteur de la santé, y compris dans le cadre de la prise en charge du VIH/SIDA, de la santé maternelle et de la mortalité des nourrissons et des enfants ; Que les pays du G8 soutiennent les programmes nationaux visant à réduire les stigmates du VIH/SIDA plus particulièrement et sur les thèmes liés à la santé sexuelle et génésique de manière plus générale ; Que les pays du G8 mettent en place des collaborations avec les États africains et les partenaires donateurs pour renforcer les systèmes sanitaires en vue de garantir un accès universel aux services et produits de santé de base, y compris aux services de promotion de la santé maternelle et infantile, de soutenir les efforts de santé génésique et de lutter contre les maladies mortelles comme le VIH, la tuberculose et la malaria; et plus particulièrement, qu'ils prennent des mesures pour aborder les problèmes de ressources humaines et élaborent, entre autres, des stratégies et des actions en faveur du recrutement, de la formation et de la rétention du personnel médical qualifié ; Que les pays du G8 soutiennent l'ajout de l'objectif de l'accès universel à la santé génésique d'ici 2015, dans le cadre de l'OMD 5 - améliorer la santé maternelle - et la mise en place d'indicateurs appropriés par le biais d'un procédé technique pertinent et ne s'arrêtent pas dans le cadre des problèmes sanitaires des femmes à la seule prévention de la mortalité - en reconnaissant son importance dans la promotion de l'égalité des sexes, la lutte contre le VIH/SIDA, la réduction de la mortalité infantile et l'éradication de la pauvreté ; Que les pays du G8 encouragent les efforts soutenus d'interventions effectives dans la lutte contre la malaria, la tuberculose et autres maladies négligées. Renforcement du partenariat avec les initiatives africaines Les Africains doivent diriger les efforts destinés à relever les défis du développement africain en investissant dans leur population, en autonomisant les femmes, en soutenant le développement durable et l'agriculture, en construisant de réelles nations et en mettant en place une bonne gouvernance, en promouvant la paix, la sécurité et le développement du secteur privé. Le G8 et les autres donateurs doivent suivre l'élan africain ; Les pays africains doivent collaborer au renforcement de la participation de la société civile à la vie publique, au dialogue politique et à l'amélioration de la gouvernance et de la responsabilisation. Les leaders du G8 doivent réaffirmer leur soutien aux initiatives africaines telle que l'Union Africaine, au Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) et le Parlement panafricain, de même qu'à la Commission parlementaire panafricaine sur la population et le développement créée récemment ; Les leaders du G8 doivent inciter les Comités de Direction de la Banque mondiale et du FMI à refuser toute politique de réduction de la pauvreté qui n'aurait pas encore été débattue au niveau du Parlement. POINTS D'ACTION PARLEMENTAIRES. En tant que représentants des populations, en tant que législateurs et en tant que dirigeants des Gouvernements, nous nous devons de faire de notre mieux pour soutenir ce programme d'action. En fonction de leur système parlementaire, les parlementaires du G8 et des pays européens devraient : Continuer à demander des comptes aux dirigeants gouvernementaux sur leurs engagements par le biais de sessions parlementaires annuelles spéciales sur l'Afrique, ainsi que sur la santé sexuelle et génésique et les droits en la matière, en commençant par une session de surveillance de la mise en œuvre des recommandations du G8 au début de l'automne 2005. Cette mission implique qu'il faut rappeler aux Gouvernements d'élaborer les mesures concrètes à prendre pour respecter les engagements financiers de Gleneagles et organiser des rencontres internationales telles que la Conférence internationale de Monterrey de 2002 sur le Financement pour le Développement. Ecrire aux chefs d'États et aux ministres en leur détaillant les résultats de cette conférence parlementaire et en les invitant à mettre en œuvre les mesures énumérées dans cette déclaration. Demander à participer aux consultations gouvernementales qui seront organisées dans le cadre de la Conférence mondiale des présidents de Parlement de septembre 2005, le Sommet des Nations unies de septembre 2005 sur les objectifs du millénaire pour le développement, et la session spéciale de l'assemblée générale des Nations unies sur le VIH/SIDA ainsi qu'aux délégations pertinentes. Introduire des résolutions parlementaires réaffirmant le soutien de - et la solidarité avec - la population africaine. Défendre et programmer la santé sexuelle et génésique et les droits en la matière aussi bien sur le plan domestique que sur le plan de nos politiques de développement en utilisant cette déclaration comme point de départ des discussions. Inviter les organisations partenaires à participer à la mobilisation des acteurs concernés, des médias et des représentants de la société civile au niveau des défis à relever dans le cadre du développement de l'Afrique en utilisant cette déclaration comme point de départ des discussions. Rapporter toute action parlementaire entreprise pour soutenir cette déclaration à la Sixième conférence annuelle du Réseau parlementaire sur la Banque mondiale d'octobre 2005 à Helsinki, à la rencontre annuelle du Conseil du Forum parlementaire intereuropéen sur la population et le développement et la Conférence des parlementaires sur la mise en œuvre du programme d'action ICPD, qui se tiendront, quant à elles en 2006. En fonction de leur système parlementaire, les parlementaires des pays africains devraient : Inviter leur Gouvernement à renforcer l'Union Africaine et le NEPAD, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre des mécanismes d'examen par des pairs du NEPAD. Exiger une intervention plus conséquente dans l'élaboration et la mise en œuvre des Stratégies de réduction de la pauvreté. Promouvoir une plus grande responsabilisation et une plus grande transparence au sein des systèmes gouvernementaux. Enfin, nous remercions le Parlement écossais d'avoir accueilli cette conférence et le Forum parlementaire intereuropéen sur la population et le développement, Interact Worldwide, le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et la Banque mondiale d'avoir organisé cette rencontre. ------- N° 2714 - Rapport d'activité de Mme Marie-Jo Zimmermann, au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (octobre 2004 - novembre 2005), en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires 1 () Il existe en effet dans certains pays, comme la Chine ou les Philippines, une véritable stratégie d'immigration économique féminine. Alors que les hommes restent au pays pour assurer par leur salaire la subsistance de la famille, les femmes s'exilent pour trouver un emploi dont le revenu sera essentiellement envoyé au pays. Voir à ce sujet « Les inégalités entre les femmes et les hommes : les facteurs de précarité », rapport remis en mars 2005 à Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, par Mme Françoise Milewski, rédactrice en chef de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). 2 () Les chiffres qui suivent sont issus du rapport « Les défis de l'immigration future », présenté par M. Michel Gevrey au Conseil économique et social, 2003. 3 () Les droits des femmes issues de l'immigration, avis remis au Premier ministre, Haut conseil à l'intégration, 2003. 4 () Les immigrés dans la société française, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation Française, septembre 2005, p. 7. 5 () Article 3, alinéa 3 du code civil : « Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. » La jurisprudence a mis en œuvre la réciprocité pour les étrangers, soumis en France à leurs lois nationales pour ces mêmes questions. 6 () Article 9 : « La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux États dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. » 7 () La réforme mise en œuvre en 2003 par le roi Mohammed VI a permis de réelles avancées, comme la suppression de la notion de tuteur, l'âge nubile fixé à 18 ans pour les jeunes filles, ou encore l'introduction du divorce par consentement mutuel. Toutefois, la répudiation existe encore, même si elle doit être validée devant un tribunal pour être effective, et les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits à héritage que les hommes, et continuent à ne toucher que la moitié de la part des hommes, selon les préceptes de la charia. 8 () Article 11 : « La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents. » 9 () Article 31 : « La musulmane ne peut épouser un non musulman. » 10 () Article 48 : « Le divorce est la dissolution du mariage. Il intervient par la volonté de l'époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l'épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54. » 11 () Voir par exemple la circulaire du 30 octobre 2004 du ministère de l'intérieur. 12 () Article 3 : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. » 13 () Article 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » 14 () Cour de cassation, Civ. I, 17 février 2004, n° 256 et 258. 15 () En Égypte comme en Jordanie, 8 % des hommes ont plus d'une épouse, mais très peu dépassent le chiffre de deux ; en Arabie Saoudite, 70 % des hommes ont une seule femme, 16 % deux, 6 % trois et 2 % quatre (source : Courrier international, 23 septembre 2005). 16 () Lors de son audition le 11 octobre 2005, Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, a souligné cette difficulté à recenser les familles polygames, et indiqué qu'elle avait l'intention de demander une double enquête à la CNAF et à la MSA. 17 () La plupart des familles polygames vivent en région parisienne (Paris, Seine-Saint-Denis, Yvelines, Essonne), mais aussi dans les agglomérations marseillaise et lyonnaise ou en Normandie. 18 () Notamment pour des raisons économiques, la pauvreté ne permettant pas aux hommes d'entretenir plusieurs épouses. 19 () Deux exemples de cohabitation de familles polygames, cités dans un article de l'Express du 15 janvier 2004 : 32 Maliens dans un six pièces à La Courneuve, 15 personnes dans un quatre pièces à Mantes-la-Jolie. 20 () Voir le célèbre arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 1978, GISTI. 21 () Conseil d'État, 11 juillet 1980, Montcho. 22 () Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'accueil et de séjour des étrangers en France. 23 () Article 15 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 24 () Une circulaire du 8 février 1994 a toutefois précisé que les femmes ayant des enfants français ou séjournant en France depuis plus de quinze ans sont inexpulsables. 25 () La polygamie est en outre sanctionnée par une peine d'emprisonnement en Norvège. 26 () Plus de trois millions de personnes. La polygamie est interdite en Turquie, mais elle se pratique, notamment dans les zones rurales. 27 () Audition du 14 juin 2005. 28 () Un immigré sur trois est logé dans le parc HLM, contre un sur six pour la moyenne nationale. La moitié des ménages maghrébins est logé en HLM (source : Les défis de l'immigration future, Conseil économique et social, 2003, p. 127). 29 () Voir à ce sujet Les défis de l'immigration future, Conseil économique et social, 2003. 30 () Audition du 14 juin 2005. 31 () Audition du 14 juin 2005. 32 () L'excision est l'ablation d'une partie ou de la totalité du clitoris et des petites lèvres. Elle se pratique, parfois même de manière illégale, en Afrique (au Bénin, Cameroun, Kenya, Mali, Nigeria, Sénégal, en Côte d'Ivoire, Tanzanie, Guinée, Ouganda, Sierra Léone, au Tchad...), en Indonésie, en Malaisie et au Yémen. L'infibulation est une excision suivie de l'ablation des grandes lèvres dont les deux moignons sont suturés bord à bord, l'ouverture vaginale étant remplacée par un minuscule orifice. Elle est pratiquée à Djibouti, en Egypte, en Ethiopie, au Mali, en Somalie, au Soudan. 33 () Ayaan Hirsi Ali, Insoumise, Robert Laffont, 2005, p. 104. 34 () Groupe femmes pour l'abolition des mutilations sexuelles et autres pratiques affectant la santé des femmes et des enfants. 35 () Il s'agit en fait de pratiques païennes égyptiennes vieilles de plus de 8 000 ans. 36 () En Afrique notamment, de nombreuses campagnes de prévention et de lutte contre les mutilations sexuelles sont aujourd'hui organisées, tandis que plusieurs pays ont adopté des législations les interdisant (Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Mali, Sénégal, Togo...). 37 () Cour de cassation, chambre criminelle, 83-92616. 38 () Respectivement articles 222-9 et 222-10 du code pénal. 39 () Article 113-7 du code pénal : « La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l'infraction. » 40 () Article 223-6, alinéa 1 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. » 41 () Audition du 15 juin 2005. 42 () Voir Commission nationale consultative des droits de l'homme, Étude et propositions sur la pratique des mutilations sexuelles en France, adoptée par l'Assemblée plénière du 30 avril 2004, p. 7. 43 () Commission pour l'abolition des mutilations sexuelles. 44 () Voir notamment le rapport déjà cité de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. 45 () Article 146 du code civil : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. » 46 () Article 16 de la DUDH : « Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. » 47 () Voir notamment à ce sujet Courrier International, 3 mars 2004. 48 () 275 000 en 2003 selon l'INSEE. 49 () Audition du 11 octobre 2005. 50 () Article 144 du code civil : « L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. » 51 () Audition du 28 juin 2005. 52 () Audition du 14 juin 2005. 53 () Audition du 14 juin 2005. 54 () Audition du 21 juin 2005. 55 () Audition du 18 octobre 2005. 56 () Article 63 du code civil. 57 () Article 170, alinéa 4 du code civil : « Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. » 58 () Mme Diane Mouratoglou, avocate et membre de l'association « Ni putes, ni soumises », audition du 12 octobre 2004. 59 () Voir notamment à ce sujet, Insoumise, Ayaan Hirsi Ali, Robert Laffont, 2005, chapitre 8 « La cage aux vierges ». 60 () Mme Samia Meghouche, avocate et membre de l'association « Ni putes, ni soumises », audition du 12 octobre 2004. 61 () Terme utilisé pour désigner les Françaises de souche. 62 () Audition du 1er février 2005. 63 () Audition du 21 juin 2005. 64 () Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour les femmes et les hommes, Femmes et religions en Europe, 22 septembre 2005. 65 () Les droits des femmes issues de l'immigration, avis remis au Premier ministre, Haut Conseil à l'intégration, 2003. 66 () Audition du 14 juin 2005. 67 () L'agence réunit les moyens de l'Office des migrations internationales (OMI), établissement public administratif, et du Service social d'aide aux immigrants (SSAE), association reconnue d'utilité publique. Elle est, selon le décret 2005-381 du 20 avril 2005, chargée sur l'ensemble du territoire du service public de l'accueil des étrangers titulaires pour la première fois d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France. 68 () Sont concernés par le dispositif, les bénéficiaires du regroupement familial, les membres étrangers de familles françaises, les membres de familles de réfugiés, les réfugiés, les titulaires de la carte « vie privée et vie familiale » (dont font partie les étrangers régularisés), les titulaires d'un droit au travail et au séjour d'une durée minimale d'un an renouvelable. Le public potentiellement touché est estimé à 100 000 personnes par an. 69 () Le dispositif est mis en œuvre pour l'instant à titre expérimental dans de nombreux départements, et devrait être national dès janvier 2006. 70 () Il a notamment souligné que 45 % d'entre eux proviennent de Tunisie, d'Algérie, ou du Maroc. 71 () Rapport « Femmes de l'immigration, assurer le plein exercice de la citoyenneté à part entière, à parts égales », remis à Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, le 7 mars 2005. 72 () Audition du 8 novembre 2005. 73 () Audition du 14 juin 2005. 74 () Audition du 11 octobre 2005. 75 () Protection maternelle et infantile. 76 () Mme Sihem Habchi, vice-présidente de l'association « Ni putes, ni soumises », 21 juin 2005. 77 () Audition du 18 octobre 2005. 78 () Mme Sihem Habchi, vice-présidente de l'association « Ni putes, ni soumises », 21 juin 2005. 79 () Cf. à ce sujet l'audition de Mme Joëlle Voisin, 18 octobre 2005. 80 () En vertu notamment de l'article 146 du code civil, stipulant qu'il n'y a pas de mariage sans consentement. 81 () Audition du 7 juin 2005. 82 () Proposition de loi n° 2219 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple, adoptée en première lecture par le Sénat le 29 mars 2005. 83 () Audition du 21 juin 2005. 84 () Audition du 1er février 2005. 85 () Voir à ce sujet INSEE Première, septembre 2005. 86 () Idem. 87 () Voir INSEE Première, septembre 2005. 88 () Voir par exemple à ce sujet, « Des parcours semés d'embûches : l'insertion professionnelle des jeunes d'origine maghrébine en France », Yaël Brinbaum et Patrick Werquin, et « Les trajectoires socioprofessionnelles d'une cohorte de jeunes adultes français d'origine maghrébine », Migrations et Études, mars 2004. 89 () Voir à ce sujet, L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'immigration, Rapport public particulier, Cour des comptes, novembre 2004, ou encore, Les immigrés en France, INSEE, édition 2005. 90 () Voir à ce sujet, « Les jeunes issus de l'immigration, de l'enseignement supérieur au marché du travail », Bref, Céreq, février 2004. 91 () « L'insertion des jeunes issus de l'immigration : de l'école au métier », Net.doc, Céreq, avril 2005. 92 () Nacira Guénif-Souilamas, « Des "beurettes" aux descendantes d'immigrants nord-africains », Grasset, 2000, p. 211. 93 () Nacira Guénif-Souilamas, « Des "beurettes" aux descendantes d'immigrants nord-africains », Grasset, 2000, p. 213. 94 () Nacira Guénif-Souilamas, « Des "beurettes" aux descendantes d'immigrants nord-africains », Grasset, 2000, p. 294. 95 () Voir à ce sujet, « Les inégalités entre les hommes et les femmes », rapport remis à Mme Nicole Ameline, ministre de la parité et de l'égalité professionnelle, mars 2003. 96 () « Les jeunes issus de l'immigration : de l'enseignement supérieur au marché du travail », Bref, Céreq, février 2004. 97 () Michèle Tribalat, « Les populations d'origine étrangère en France », Commentaire n° 109, printemps 2005. 98 () La Lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l'emploi", rapport remis au Premier ministre, 8 septembre 2005. 99 () Gérard Noiriel, « Le creuset français, histoire de l'immigration aux XIXe et XXe siècles », Seuil, 1988, p. 214. 100 () Avis rendu le 5 juillet 2005. 101 () Article 8 de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés ». 102 () La lutte contre les discriminations ethniques dans le domaine de l'emploi, rapport remis par la Commission Fauroux à M. Jean-Louis Borloo, ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, juillet 2005, p. 9. 103 () Nacira Guénif-Souilamas, audition du 25 octobre 2005. 104 () Rapport au Parlement 2003, Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), ministère de la culture. 105 () Cité par le rapport remis à Mme Nicole Ameline du groupe de travail « Femmes et immigration ». 106 () Audition du 11 octobre 2005. 107 () Audition du 25 octobre 2005. 108 () Audition du 11 octobre 2005. 109 () Audition du 25 octobre 2005. 110 () Les Echos, 10 novembre 2005. 111 () L'accueil des immigrants et l'intégration des populations issues de l'intégration, Cour des comptes, rapport public particulier, novembre 2004. |