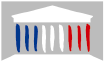 N° 2881 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 février 2006. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION sur l'équilibre territorial des pouvoirs, ET PRÉSENTÉ PAR M. Michel PIRON, Député. -- INTRODUCTION 11 PREMIÈRE PARTIE : LES FORCES EN PRÉSENCE À LA CROISÉE DES CHEMINS 17 CHAPITRE IER : L'AVÈNEMENT D'UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE DE LA RÉPUBLIQUE 17 I. - LA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE DE L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 17 A. LA CRISTALLISATION CONSTITUTIONNELLE 17 1. La dimension européenne de l'autonomie locale 17 2. La nature et la portée de la décentralisation 21 3. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 22 B. LA MULTIPLICITÉ DES ACTEURS 24 1. Les acteurs traditionnels 25 a) Les catégories constitutionnelles 25 b) La diversité des collectivités territoriales 25 2. Les dispositifs intermédiaires : espaces institutionnels et espaces de coordination 26 a) L'intercommunalité 27 b) Les pays 32 3. Le risque croissant de l'illisibilité 34 II. - LA NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES 35 A. LA DIFFICILE CONCILIATION DE PRINCIPES MULTIPLES 35 1. La libre administration et le principe de subsidiarité 35 a) Libre administration et clause générale de compétence 36 b) Principe de subsidiarité et spécialisation 39 2. L'interdiction de la tutelle et la possibilité d'un chef de file 42 a) Le principe d'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre 42 b) La notion de chef de file 43 B. LES TRANSFERTS ENTRE CONFUSION ET INACHÈVEMENT 46 1. L'« acte I » de la décentralisation : entre clause générale de compétence 2. L'« acte II » : la recherche d'une clarification des compétences 48 a) Les objectifs fixés 48 b) La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés C. UN POUVOIR NORMATIF RESTREINT 67 1. Le pouvoir réglementaire 67 a) Un pouvoir réglementaire étique avant 2003 67 b) La reconnaissance constitutionnelle de ce pouvoir 70 2. Une dépendance normative stricte 71 D. L'EXPÉRIMENTATION 72 1. L'expérience des expérimentations 73 2. La consécration constitutionnelle 75 a) De l'expérimentation matérielle à l'expérimentation normative 75 b) Des conditions d'emploi strictement définies 77 CHAPITRE II : LE MALAISE DE L'ÉTAT TERRITORIAL 80 I. - LE RISQUE DE FRAGMENTATION 81 A. L'IMPÉRATIF DE DÉCONCENTRATION 81 1. Le principe d'adaptation 82 2. L'affirmation progressive de l'administration territoriale de l'État 83 a) Les prémices 83 b) Le tournant de 1992 et la relance de 1995 85 c) La déconcentration des moyens 89 B. LA PROFUSION DES CADRES STRATÉGIQUES 91 1. L'élaboration de documents stratégiques : des pte aux pase 92 2. L'exemple des préfectures : de la dno à la lolf 93 a) Les missions traditionnelles des préfectures 93 b) Les objectifs fixés par la directive nationale d'orientation des préfectures 94 c) Les objectifs assignés aux préfectures dans le cadre de la lolf 95 C. L'ÉCLATEMENT DE LA CARTE ADMINISTRATIVE 97 1. Une simplification historique relative sous le sceau de l'autorité 2. Une carte inadaptée 100 a) Un corpus de textes d'organisation générale 100 b) Une inadaptation avérée 101 c) Un paysage d'ensemble contrasté 101 II. - LA RECHERCHE D'UN ÉTAT TERRITORIAL PLUS COHÉRENT 105 A. LA TRANSFORMATION DU POUVOIR PRÉFECTORAL 105 1. Un statut constitutionnel 105 2. De la fonction d'autorité à la mission d'arbitrage 106 a) Le gouverneur 106 b) L'administrateur 107 c) Le partenaire 109 3. Le rôle du sous-préfet en question 115 B. LA CRÉATION DES PÔLES RÉGIONAUX 116 1. La mise en place des pôles 117 2. Le fonctionnement des pôles 120 a) Le pilotage des pôles 120 b) La coordination entre pôles 121 C. LA QUESTION DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE 122 1. Une position remise en cause 122 a) L'exemple des directions départementales des affaires sanitaires et sociales 122 b) L'exemple des directions départementales de l'équipement 123 2. Une tentative de réorganisation 124 a) La phase d'appel à projet 124 b) L'engagement d'une phase expérimentale 125 D. LA LOLF COMME ACCÉLÉRATEUR DE RÉFORME 130 1. Les objectifs et les principes de la lolf 130 a) L'avènement d'un budget d'objectifs 130 b) La promotion de la responsabilité 132 2. Le renforcement du rôle financier du préfet 133 a) Une implication traditionnellement faible dans la discussion budgétaire 133 b) Une implication plus grande dans la territorialisation du budget de l'État 134 3. La construction d'un authentique dialogue de gestion 137 a) Un dialogue de gestion horizontal 137 b) Un dialogue de gestion vertical 138 CHAPITRE III : LA REDÉFINITION DES RAPPORTS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ENTRE TUTELLE ET CONTRACTUALISATION 139 I. - L'INDÉTERMINATION DE LA CLAUSE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE 139 II. - LA TUTELLE FRAGMENTÉE 141 A. LE CONTRÔLE DE LÉGALITÉ 141 1. Une garantie de l'unité de l'État 141 2. Une valeur générale dissuasive 144 3. Une application inégale sur le territoire 146 4. Une réforme en gestation 147 B. LES NORMES TECHNIQUES COMME SUCCÉDANÉS DE LA TUTELLE 150 C. LES REFLUX NORMATIFS 153 IV. - LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONTRACTUALISATION 154 A. LA CAPACITÉ CONTRACTUELLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 154 B. LE MODÈLE DISCUTÉ DES CONTRATS DE PLAN 155 1. Une méthode originale d'administration sujette à critiques 155 2. Des perspectives d'évolution 158 C. LA GÉNÉRALISATION DU MODÈLE CONTRACTUEL 161 1. L'exemple de la politique de la ville 161 2. L'exemple de la sécurité 164 D. DES INCERTITUDES HANDICAPANTES 165 DEUXIÈME PARTIE : VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE TERRITORIAL DES POUVOIRS 169 CHAPITRE IER : LES EXEMPLES ÉTRANGERS 169 I. - UNE DIVERSITÉ EUROPÉENNE DES MODÈLES D'ORGANISATION TERRITORIALE 169 II. - UNE RÉGIONALISATION QUI CONFINE À L'AUTONOMIE : L'ITALIE ET L'ESPAGNE 171 A. LE MODÈLE DE L'ÉTAT RÉGIONALISÉ 171 B. L'ITALIE 172 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités locales 173 a) Un processus qui s'inscrit dans une réforme globale de l'État 173 b) Les révisions constitutionnelles de 1999 et 2001 176 2. La structure et l'organisation des collectivités locales 178 a) Les régions 178 b) Les provinces 181 c) Les communes 183 d) Les villes métropolitaines 186 3. Les compétences des collectivités locales 187 a) Le pouvoir législatif 187 b) Le pouvoir réglementaire 189 c) Les fonctions administratives 189 d) L'articulation des compétences entre collectivités 190 4. Le financement des collectivités locales 191 5 L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État 192 a) L'administration territoriale de l'État 192 b) Le contrôle sur les actes des collectivités locales 193 6. Les perspectives d'évolution : régionalisme ou dévolution ? 195 C. L'ESPAGNE 197 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités territoriales espagnoles 198 2. La structure et l'organisation des collectivités locales 202 a) La structure générale 203 b) Les structures spécifiques supracommunales 210 c) Les structures spécifiques infracommunales 211 3. Les compétences des collectivités locales 212 a) Les principes généraux 212 b) Les matières réservées à l'État 213 c) Les communautés autonomes 214 d) Les provinces 216 e) Les communes et les syndicats de communes 217 f) Les rapports entre collectivités locales 220 4. Le financement des collectivités locales 221 a) Les communautés autonomes 221 b) Les provinces et les communes 226 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État 227 a) L'administration territoriale de l'État 227 b) Le contrôle sur les actes des collectivités locales 229 c) La coopération entre l'État et les communautés autonomes 232 6. Les perspectives d'évolution : vers une stabilisation de la carte des autonomies ? 233 a) La décentralisation comme moteur de la modernisation 233 b) La réforme constitutionnelle 235 c) La modification des statuts des communautés autonomes 236 III. - LE POINT ULTIME DE L'ÉTAT UNITAIRE DÉCENTRALISÉ : LA DÉVOLUTION EN ÉCOSSE 238 A. LE SYSTÈME BRITANNIQUE ENTRE « RECENTRALISATION » ET DÉVOLUTION 238 1. Le régime juridique des collectivités locales 239 a) La souveraineté illimitée de Westminster 239 b) Une « dévolution graduée » et asymétrique 239 c) Le système de gouvernement local 240 2. La structure et l'organisation des collectivités locales 241 3. Les compétences des collectivités locales 247 a) L'avènement d'une compétence générale 247 b) La coopération entre collectivités locales 248 4. Le financement des collectivités locales 249 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État 250 B. L'ÉCOSSE 251 1. Le statut constitutionnel et les compétences de l'Écosse 251 2. L'organisation et les compétences des collectivités locales 254 3. Le financement de l'Écosse et des collectivités locales 256 4. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État 257 IV. - UNE DÉCENTRALISATION RETENUE : LA SUÈDE 258 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités locales 258 2. La structure et l'organisation des collectivités locales 260 a) Les régions 260 b) Les comtés et conseils de comté 262 c) Les communes 263 d) La coopération entre collectivités locales 265 3. Les compétences des collectivités locales 266 a) Les compétences réservées de l'État 266 b) Les compétences des comtés 266 c) Les compétences des communes 267 4. Le financement des collectivités locales 268 a) Les recettes et les dépenses des collectivités locales 268 b) La modification du mécanisme de péréquation 269 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État 271 a) La représentation territoriale de l'État 271 b) Le contrôle exercé par l'État 272 6. Les perspectives d'évolution 275 V. - UNE PRÉGNANCE DE LA RÉGIONALISATION 278 A. DES DÉFAUTS RÉELS 278 B. DES RÉUSSITES INCONTESTABLES 279 CHAPITRE II : LES QUESTIONS POSÉES AU MODÈLE FRANÇAIS 281 I.- RENFORCER LES RESPONSABILITÉS 281 A. AFFERMIR L'ÉTAT TERRITORIAL 282 1. Affirmer le rôle pivot des préfets 283 a) Faire du préfet le chef des services déconcentrés 283 b) Asseoir le rôle du préfet de région 285 2 Développer la mutualisation des moyens 286 a) L'impératif de rationalisation 286 b) Le passage des pôles à l'intégration régionale des services 287 c) L'hypothèque du redéploiement des effectifs et de la réforme de la fonction publique 290 3. Créer des délégations de l'État régionales et de proximité 294 B. CONFORTER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 296 1. Donner un contenu à la notion de chef de file 296 a) Exploiter les voies ouvertes par la Constitution 296 b) Limiter le nombre d'intervenants 297 2. Confirmer le rôle de l'intercommunalité 297 a) Stabiliser sans la cristalliser la définition de l'intérêt communautaire 298 b) Mutualiser les moyens 299 c) S'interroger sur le mode de désignation des élus intercommunaux 299 II. - CHANGER DE MODÈLE DE GOUVERNANCE DES TERRITOIRES ? 300 A. REDESSINER LA CARTE ADMINISTRATIVE ET TERRITORIALE ? 301 1. Dissocier carte administrative et carte locale 302 a) Le mirage du jardin à la française 302 b) La fin du « doublonnement » 303 2. Deux fois moins de régions deux fois plus grandes ? 304 a) Prendre en compte l'interrégionalité ? 304 b) Encourager la constitution de grandes régions ? 306 c) Assurer une meilleure articulation entre départements et régions ? 307 3. Faciliter le rapprochement des communes 308 a) L'éparpillement intangible ? 309 b) La méthode volontariste : pour une fusion imposée ? 310 c) La méthode volontaire : pour un nouveau modèle de communes associées ? 314 4. Diversifier la représentation territoriale de l'État 316 B. RENOUVELER LES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 317 1. Créer des conférences techniques sectorielles 317 2. Fixer un cadre contractuel aux relations entre personnes publiques 318 a) Créer un contrat-cadre public 318 b) Favoriser les relations conventionnelles avec les services de l'État et les organismes ayant une mission de service public 320 3. Encourager les échanges d'expériences 320 4. Poursuivre le développement de l'administration électronique 321 C. PARTAGER LE POUVOIR NORMATIF ? 325 1. Transférer aux régions un véritable pouvoir normatif 325 2. Associer les collectivités territoriales à la politique de simplification 326 EXAMEN EN COMMISSION 329 PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 333 SIGLES ET ACRONYMES 349 MESDAMES, MESSIEURS, Qui gouverne nos territoires ? Cette question − que la commission des Lois qui est aussi la commission de l'administration générale de la République peut légitimement se poser −, apparaît particulièrement opportune à l'heure où sont mis en œuvre d'importants transferts de compétence décidés dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (1), où est entrée en application la loi organique relative aux lois de finances (lolf) (2) pour l'ensemble de ses dispositions, et à l'heure où, parallèlement, l'État réorganise ses structures en région et tente de rationaliser sa présence dans les départements. Dans le même temps, le développement des intercommunalités suscite de nombreuses interrogations, tandis que plane sur l'ensemble de l'action publique une contrainte budgétaire de plus en plus prégnante. La réponse à cette question de la « gouvernance » territoriale (3), évidente il y a trente ans, l'est de moins en moins. La décentralisation oscille entre ferveur et désenchantement. La réforme territoriale de l'État, marquée de plus en plus par une tendance à la régionalisation, s'entrechoque avec la mise en place de la réforme financière et avec la transformation interne de nombreux ministères, en liaison, notamment, avec les récents progrès de la décentralisation. De la concomitance de ces changements naissent de nombreuses inquiétudes et de multiples incertitudes. Les enjeux sont connus. Au plan social, le citoyen, dans sa triple fonction d'électeur, d'usager et d'administré, réclame une plus grande proximité, une qualité et une souplesse des services rendus, ainsi que la garantie de la transparence et de la régularité des procédures. Parallèlement, il déplore l'absence de réponse à l'expression de certains besoins sociaux. Au plan institutionnel, se pose la question de l'articulation des fonctions de l'État avec les nouvelles compétences des collectivités territoriales (4) et avec le développement très important des attributions des instances européennes. Le cadre d'exercice des compétences se transforme rapidement. L'action publique tend à remplacer l'administration publique. Les collectivités publiques interviennent à côté et en continuité avec d'autres acteurs, privés et associatifs, économiques et sociaux. L'autorité publique n'a plus le monopole de la définition de l'agenda public. Cette mutation met radicalement en question deux piliers fondamentaux de la gestion publique traditionnelle : le découpage des organisations administratives, les critères de compétence de leurs agents. Les écueils sont également connus. L'évolution des pouvoirs d'une catégorie de collectivités ne doit pas entraver la liberté des autres. La progression de la décentralisation ne doit pas conduire à un alourdissement des procédures de décision et nuire à la cohérence de l'action politique. Comme le montrent les débats italien et espagnol, à l'étude desquels le rapporteur s'est particulièrement attaché, elle ne doit pas avoir pour effet paradoxal d'affaiblir la protection des droits fondamentaux. Le pluralisme territorial ne doit pas signifier, pour les citoyens, pluralisme des statuts au regard des droits et devoirs civils et sociaux. Il faut se garder des caricatures. Nous ne revenons pas aux féodalités antérieures au XVe siècle. Nous sommes sortis du modèle jacobin gouverné par l'administration centrale parée des vertus de l'omniscience et de l'ubiquité. L'État se réforme sans se transmuter en État fédéral ni même en État régionalisé. Mais le sentiment qui domine, après presque une année de travaux, est celui d'un entre-deux, qui caractérise la nature « semi-centralisée » ou « semi-décentralisée » du système français. La République est unitaire (5), son organisation est décentralisée. Mais, de manière globale, l'État ne se retire pas des territoires et domine l'idée que toute décentralisation doit s'accompagner d'une déconcentration, qui sous-entend un renforcement de l'État territorial. Une collectivité territoriale forte devrait se voir proposer un État territorial fort. La question se pose ainsi de savoir si la France a les moyens de renforcer ses structures administratives déconcentrées et décentralisées à tous les niveaux. Le traditionnel « jardin à la française » qui caractérisait l'État a été profondément modifié par les mouvements de décentralisation récents, à tel point qu'il faut s'interroger sur le rôle et la place de ce dernier dans le nouveau paysage, le « resituer » à l'instar de ce qu'avait ébauché la mission présidée par M. Jean Picq (6). Il s'agit donc, en résumé, de s'interroger sur la réforme et la modernisation de l'État. L'équilibre territorial des pouvoirs doit s'appréhender dans toutes ses dimensions, politique, juridique, et financière. L'équilibre est une problématique classique qui, appliquée au territoire, devient terriblement compliquée compte tenu de la multiplicité des acteurs et des combinaisons possibles : ce peut être à la fois des collectivités territoriales fortes face à un État déconcentré fort ; des collectivités territoriales fortes face à un État central fort ; des collectivités territoriales fortes face à un État déconcentré présent sur ses seules missions essentielles, régaliennes ; des collectivités territoriales fortes face à un État absent ; des collectivités territoriales éparpillées face à un État déconcentré fort ; des collectivités territoriales éparpillées face à un État déconcentré lui-même éparpillé... Chacune des deux parties doit trouver son équilibre interne, avant que ne soit trouvé un équilibre entre elles. Dans ce contexte, il s'avérerait utile de prévoir quels pourraient être les futurs équilibres territoriaux des pouvoirs entre l'État et les collectivités territoriales, mais aussi entre les différents niveaux de collectivités territoriales. Où doit-on placer le curseur de la décision publique ? Contrairement à de très nombreux pays, la France a fait sa décentralisation sans rationaliser sa carte institutionnelle (7). Au contraire, elle a renforcé l'assise d'un nouvel échelon, la région, et a favorisé le développement de structures intermédiaires institutionnelles, les établissements publics de coopération intercommunale (epci), voire des structures intermédiaires de projet, tels que les pays. En résumé, « la déconcentration se cherche toujours » et la « décentralisation s'est perdue dans un dédale inextricable » (8). Le temps est venu de se réinterroger sur cet état de fait, qui, à nos yeux, noie toute avancée et tout progrès dans les sables mouvants de la profusion et de l'émiettement institutionnels, tout en s'écartant des deux fantasmes récurrents que sont l'emboîtement vertical impeccable des structures et un maillage transversal de l'espace en territoires de projet juxtaposés. De quoi est faite la « République des proximités », la « République des territoires »? La décentralisation doit constituer une occasion unique de réformer l'État. Comme le suppose Michel Crozier, « si l'État central ne change pas, la décentralisation perd la plus grande part de sa vertu ». Le premier objet du présent rapport est de présenter une photographie de l'état des forces en présence et de leurs relations mutuelles. Le constat ne saurait être tout à fait positif : les territoires sont morcelés, les institutions chargées de les gouverner prolifèrent, les compétences sont fragmentées. Que trouve-t-on en face ? Un État local, dont l'affaiblissement paraît aujourd'hui évident, suscite à la fois interrogations et inquiétudes, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint. Lui-même se présente comme fragmenté entre autant d'administrations - voire davantage - qu'il existe de politiques publiques. Le développement de la contractualisation, dans de telles conditions, entre tous les acteurs territoriaux ne facilite pas la définition d'un équilibre satisfaisant. Le second objet du présent rapport est, au regard des expériences menées par certains de nos voisins pour concilier différenciation des territoires et unité de l'action publique, de poser les questions qui permettront d'envisager l'évolution de cet équilibre territorial des pouvoirs, aujourd'hui si incertain et lourd de risques de paralysie, et si possible de prévenir ces risques. L'une des questions à résoudre est de savoir comment revenir à une plus grande sécurité juridique. Puisque les débats français sur la décentralisation sont souvent l'occasion de faire référence aux exemples étrangers, en particulier aux pays voisins, soit qu'ils suivent un modèle fédéral, soit qu'ils ont institué une forte autonomie régionale, il est, en effet, paru intéressant de confronter notre modèle à un échantillon de systèmes étrangers qui, sans être trop différents du nôtre − ce qui exclut le modèle fédéral allemand, belge ou autrichien − s'en éloignent suffisamment pour constituer un horizon intéressant. Une tension existe dans tous les pays de l'Union entre la recherche de l'efficacité économique à travers la dimension des collectivités et les impératifs démocratiques. C'est pourquoi, le rapporteur a choisi de s'intéresser à l'Italie, à l'Espagne, à l'Écosse, telle qu'elle trouve sa place au sein du Royaume-Uni, et à la Suède. Le champ très large de ses investigations a incité le rapporteur à exclure de son propos certains domaines spécifiques. Ainsi, les spécificités de l'outre-mer, qui ne sauraient constituer à cette heure un modèle d'évolution pour les territoires métropolitains eux-mêmes, n'ont pas été retenues. Le présent rapport porte sur les structures et les compétences des acteurs territoriaux, mais n'aborde pas la question de la démocratie locale en tant que telle et ne pose donc pas celle du statut de l'élu local, ni celle des rapports entre exécutifs et assemblées délibérantes. Le rapporteur a également été conduit à écarter la question du financement qui, s'il n'est pas sans lien avec la relation que l'État entretient avec les collectivités territoriales, a été largement traitée par une récente commission d'enquête (9). Il s'agit, en définitive, d'éviter le naufrage du « plan Rabourdin » des Employés de Balzac proposant « un nouveau système d'administration », hommage à l'inertie de l'administration traditionnelle. Il s'agit d'examiner les frontières psychologiques de notre droit public en s'interrogeant, notamment, sur la possibilité d'attribuer aux collectivités locales un véritable pouvoir normatif ou bien encore sur la possibilité de se représenter l'intérêt général en dehors du seul État. Au-delà du système légal, il convient d'examiner les procédures techniques du pouvoir qui se trouvent au centre de « l'art de gouverner » (10). Il ressort de ces travaux et des très nombreux entretiens que le rapporteur a menés (11) la conviction que la décentralisation ne doit être plus être octroyée par le centre, mais se construire à partir des territoires eux-mêmes. Il faut admettre la dissociation entre décentralisation et déconcentration et traiter ces deux questions de manière concomitante. L'association de ces deux processus parallèles de transfert du pouvoir du centre vers la périphérie a permis de construire un équilibre instable entre les collectivités territoriales et l'État local, équilibre incarné par la multiplication des techniques contractuelles. En effet, les réformes institutionnelles les plus récentes, parmi lesquelles figurent l'« acte II » de la décentralisation (12) et la lolf, ont provoqué une véritable rupture par rapport aux modèles antérieurs de gestion centralisée du local fondé sur des techniques puissantes de normalisation puis de projet territorial associé à un contrat global. Nous ne sommes plus dans le modèle de la centralisation étatique, de l'uniformité, de la sectorisation − chaque secteur étant pris en charge par un appareil administratif propre, structuré de manière hiérarchique −, et de la normalisation. Nous ne sommes plus tout à fait non plus dans le système dans lequel l'État territorial était en mesure de contracter avec toutes les collectivités territoriales dans tous les secteurs pour « négocier » un partage des compétences. L'élargissement des pouvoirs des collectivités territoriales s'effectue par captation des compétences des services déconcentrés, contribuant à l'affaiblissement et l'allégement de ces derniers, tandis que les administrations centrales, par la définition des programmes et des missions sur le fondement de la lolf, disposent de nouveaux moyens de pilotage de leurs services territoriaux. L'État n'a plus besoin d'être présent partout sur le territoire pour dupliquer ce que font désormais les collectivités territoriales. Parmi les trois scénarios possibles, il conviendra de choisir entre le fil de l'eau qui aboutirait à la construction d'un territoire fait d'archipels isolés, le retour de l'État jacobin accompagné de frileux replis ou la construction d'un espace décentralisé plus lisible assurant une complémentarité entre villes et campagnes et soutenu par un État déconcentré garant de la solidarité et dégagé des tâches de gestion et d'exécution subsidiaires. LES FORCES EN PRÉSENCE À LA CROISÉE DES CHEMINS Que l'on s'intéresse aux collectivités territoriales et à leurs émanations ou à l'État dans sa dimension déconcentrée, un constat s'impose : chacun se trouve au milieu du gué, a le choix entre avancer et reculer, entre l'expansion et la concentration, mais tous n'ont pas les mêmes moyens et ne sont pas soumis aux mêmes contraintes pour réaliser ces choix. Déjà, en 1997, Jean-Benoît Albertini dans son ouvrage sur la déconcentration relevait que « la réforme engagée n'a cependant pas atteint à ce jour un point d'équilibre stable en ce qui concerne le regard que l'État porte sur sa propre organisation territoriale » (13). L'AVÈNEMENT D'UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE L'approfondissement de la décentralisation a exigé une véritable réécriture du droit : l'organisation de l'État est désormais décentralisée. Ce droit valorise le local pour mieux soutenir la nécessité de l'État unitaire. En cela, le processus en cours possède une certaine ambivalence. À ce propos, Maurice Hauriou a pu écrire : « Avec la centralisation, le jardin administratif était tracé à la française et rigoureusement aligné au cordeau, les arbres étaient rognés et taillés. Avec la décentralisation, il faut s'attendre à ce que cette belle ordonnance soit détruite par la spontanéité de la vie. » (14) I. - LA CONSÉCRATION CONSTITUTIONNELLE DE L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES A. LA CRISTALLISATION CONSTITUTIONNELLE 1. La dimension européenne de l'autonomie locale Depuis l'élargissement, l'Union comprend environ 250 régions et 100 000 collectivités locales. Leurs dépenses représentent près de 1 100 milliards d'euros, soit plus 11,2 % du produit intérieur brut européen, masquant de très grandes disparités, le secteur public local variant de 0,8 % du produit intérieur brut à Malte à 30,2 % au Danemark. Le sens actuel de l'histoire est favorable aux autonomies locales. La construction européenne a fortement modifié la perception de l'échelon local par les États et les citoyens ; cette construction repose certes sur les États, mais la politique communautaire exerce également une influence déterminante dans les domaines des marchés publics, des aides économiques ou de l'environnement, autant de secteurs qui intéressent de près l'échelon local. Les collectivités locales ont vu leur existence progressivement reconnue au sein des institutions européennes, en particulier par le biais du comité des régions, institué par le Traité de Maastricht (15)du 7 février 1992. Le principe de subsidiarité y est affirmé comme fondement de la construction européenne. Ce principe ne concerne en théorie que les relations entre la Communauté et les États membres ; cependant, le préambule du Traité, qui affirme qu'est recherchée « une Union dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens » en donne une conception exigeante et très favorable à l'initiative locale, en organisant les compétences selon la proximité des lieux de pouvoir avec les citoyens. La reconnaissance du niveau local par les instances européennes a conduit les acteurs locaux, et principalement régionaux, à être présents à Bruxelles pour mieux s'informer et mieux informer ; presque toutes les régions françaises y disposent désormais de bureaux de représentation permanents. On est encore loin toutefois des États fédérés, qui se voient parfois représenter au sein des instances européennes par l'échelon régional, lorsque la négociation porte sur un domaine qui lui est propre. Les membres du comité des régions considèrent qu'ils sont les mieux à même de connaître les besoins de leurs administrés. Ils construisent un concept d'Europe qui va au-delà de l'intergouvernementalité, fondé sur la subsidiarité et la participation de tous les niveaux de pouvoirs. Le comité se voit à cet effet reconnaître, dans le paragraphe 3 de l'article III-365 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, la possibilité de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'un recours pour la sauvegarde de ses prérogatives. Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité prévoit, en outre, un mécanisme d'alerte précoce ou de veille concernant le principe de subsidiarité : « Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un Parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs ». Le même traité établissant une Constitution pour l'Europe confirme la volonté de corriger la centralisation au niveau européen par plusieurs dispositions. Dans son article I-11, paragraphe 3, il est précisé qu'« en vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union » et que « les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole. » La Commission elle-même, dans son Livre blanc sur la gouvernance européenne de 2001, a entrepris de promouvoir à la demande des acteurs territoriaux « un dialogue permanent et systématique avec les associations de collectivités territoriales (européennes et nationales) sur l'élaboration des politiques ». Elle y voit la possibilité de renforcer le rôle du comité des régions comme interface entre les instances communautaires et les associations et ainsi compenser les défaillances nationales en informant et en écoutant les collectivités par l'intermédiaire de leurs associations avant tout lancement du processus formel de décision. Dans un cercle plus large, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, devancé dès 1957 par la Conférence des pouvoirs locaux et régionaux, est devenu en 1994 un organe consultatif du Conseil de l'Europe. C'est au sein de ce dernier qu'a été élaborée la Charte européenne de l'autonomie locale, qui affirme le principe de l'autonomie locale comme « le droit et la capacité effective des collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques » (16). La France a signé, le 15 octobre 1985, cette charte, entrée en vigueur le 1er septembre 1988, mais ne l'a pas encore ratifiée - un projet de loi autorisant l'approbation de la Charte a été déposé en ce sens à la fin de l'année 2004. Il a été adopté par le Sénat, le 17 janvier 2006, et transmis à l'Assemblée nationale (17). Ce texte de compromis entend faire la synthèse entre des traditions d'autonomie locale différentes, britannique, allemande, française et quelques variantes des pays nordiques, traditions qui pourraient être résumées grossièrement de la manière suivante :
La Charte comporte dix-huit articles qui définissent concrètement ce qu'est l'autonomie locale (articles 2 et 3) et énumèrent les différents moyens pour la rendre effective (articles 4 à 11). L'article 3 définit, dans son premier alinéa, l'autonomie locale comme « le droit », c'est-à-dire un pouvoir accordé par le L'article 4 définit les compétences, l'article 5 la protection des limites territoriales qui ne peuvent être modifiées sans la consultation de la population, l'article 6 l'auto-organisation, ce qui inclut la possession par les collectivités locales de services propres et d'un personnel qualifié régi par un statut qui assure la dépolitisation de l'administration locale. Pour renforcer cette autonomie locale, les élus locaux doivent, en application de l'article 7, bénéficier d'un statut. En vertu de l'article 8, les autorités locales doivent avoir la liberté de faire, ce qui implique que le contrôle exercé sur leurs règles ne peut suivre que des procédures et des cas prévus par la Constitution ou la loi. Il est limité à l'appréciation de la légalité. Les autorités locales, selon l'article 9, doivent également disposer de ressources financières, en vertu de l'exigence de ressources propres, suffisantes et proportionnées aux compétences qui leur sont attribuées ; « une partie au moins des ressources financières des collectivités locales doit provenir de redevances et d'impôts locaux dont elles ont le pouvoir de fixer le taux, dans les limites de la loi ». Selon l'article 10, les autorités locales ont la liberté de créer des associations de défense de leurs intérêts et peuvent aussi coopérer par-delà les frontières nationales. Enfin, selon l'article 11, les collectivités territoriales doivent pouvoir disposer d'un droit de recours juridictionnel pour défendre leur autonomie et faire vérifier que les textes qui les régissent sont bien conformes à la Charte. Sa ratification est tout à fait compatible avec le stade actuel de notre processus de décentralisation. Elle ne peut, dans ce contexte, qu'avoir un impact limité sur le plan interne. Elle peut cependant contribuer à projeter sur le plan international une image actualisée de notre organisation territoriale et afficher l'adhésion à la décentralisation. 2. La nature et la portée de la décentralisation Sous l'empire des dispositions constitutionnelles originelles de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 (18), de 1958 à 1981, les collectivités territoriales ont été soumises à un régime de tutelle. Mais, selon Franco Bassanini, ancien ministre italien de la réforme de l'État, « Pour assurer une bonne gouvernance des sociétés complexes modernes, il faut déléguer de vastes pouvoirs et responsabilités aux gouvernements locaux et régionaux, suivant le principe de subsidiarité, mais cette délégation : doit être précédée de mesures destinées à renforcer la stabilité et l'efficacité des autorités locales ; doit s'accompagner de l'apport des ressources humaines et financières correspondantes ; doit être négociée avec les organismes représentatifs des autorités locales et régionales. » (19) Deux noms, ceux d'Alexis de Tocqueville et de Maurice Hauriou, suffiront à nous convaincre de la nécessité de la décentralisation. Le premier a écrit : « C'est (...) dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institutions communales, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. » (20) Le second, selon la même philosophie, rappelait que « les raisons de la décentralisation ne sont point d'ordre administratif, mais bien d'ordre constitutionnel. S'il ne s'agissait que du point de vue administratif, la centralisation assurerait au pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre et plus économe que la décentralisation. Mais les pays modernes n'ont pas besoin seulement d'une bonne administration, ils ont besoin aussi de liberté politique. » (21) Se situant dans cette logique, dans le prolongement de la loi n°°70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, la loi du 2 mars 1982 : - a reconnu à la région la qualité de collectivité locale à part entière ; - a allégé considérablement les modalités d'exercice du contrôle normatif sur les collectivités territoriales ; - a permis, à droit constitutionnel constant, de mettre fin au dédoublement fonctionnel de l'autorité préfectorale et de transférer au président des conseils généraux et régionaux l'exécutif des collectivités territoriales correspondantes, dès la première réunion de leur assemblée délibérante élue au suffrage universel direct ; - a transféré certaines compétences de l'État aux régions, départements et communes ; - a converti en dotations globales les concours spécifiques attribués aux collectivités territoriales. La décentralisation donne aux citoyens et à leurs représentants de plus grands pouvoirs dans le pouvoir de décision. Dans un système décentralisé, le décideur est mieux informé des besoins des populations et plus impliqué dans leur satisfaction. Inversement, les citoyens connaissent mieux leurs élus et sont mieux à même de les sélectionner. Une organisation décentralisée des pouvoirs permet de répondre de manière idoine à la complexification des besoins sociaux. 3. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 L'ordonnancement de la première étape de la décentralisation par la loi et par ses textes d'application a fait apparaître, à l'épreuve de la pratique, des insuffisances et contradictions, tandis que « le législateur et les autorités compétentes ont parfois hésité à préciser les règles, à dissiper les malentendus, à réprimer les abus » et ne « s'y sont résolus que tardivement, sous le signe de compromis inégalement heureux » (22). La révision du 28 mars 2003 vise ainsi à réformer l'État en France sans le transformer. Relative à « l'organisation décentralisée de la République » et adoptée par le Congrès le 17 mars 2003, elle a été marquée par le souci de reprendre l'architecture des pouvoirs publics afin d'opérer une véritable réforme de l'État en France en dépassant les insuffisances liées au cadre de la décentralisation territoriale défini par la loi du 2 mars 1982. Il s'agit à la fois de développer la démocratie locale, d'amplifier l'autonomie administrative et financière des collectivités territoriales et de prendre en compte la diversité des situations outre-mer. Elle met en place une nouvelle décentralisation permettant de dépasser les limites constitutionnelles imposées à la loi générale du 2 mars 1982. Les juges constitutionnel et administratif pourront déduire de cette consécration constitutionnelle une garantie substantielle de l'autonomie administrative et financière que, par le passé, le principe de libre administration des collectivités territoriales n'aura pas suffisamment préservée. La forme politique de l'État est désormais clarifiée. L'article 1er de la Constitution révisée a ainsi été complété par la phrase suivante : « Son organisation est décentralisée ». Il est conforme à la logique juridique qui veut que, comme les collectivités territoriales qui sont des institutions décentralisées en tant que composantes de l'État qui est le tout, l'État lui-même soit décentralisé sans pour autant remettre en cause son unité ou son indivisibilité. C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel a souligné, dans sa décision de principe n° 84-135 DC du 18 janvier 1985, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales, de valeur constitutionnelle, ne saurait autoriser que les conditions essentielles d'application d'une loi organisant l'exercice d'une liberté publique puissent dépendre de décisions éventuellement divergentes de ces collectivités. Cela a été suffisamment répété, mais il convient ici de le rappeler : l'affirmation du principe d'un nouvel État décentralisé dans la Constitution ne s'inscrit en aucun cas dans le contexte d'un prétendu fédéralisme, même asymétrique, qui conduirait à la disparition de l'État-nation en France, ni dans celui d'un État régionalisé. Si l'équilibre territorial des pouvoirs peut s'en trouver modifié - c'est l'objet de notre réflexion -, il ne s'agit en aucun cas d'une remise en cause de l'État unitaire. Constatons que nous ne sommes pas entrés dans l'ère d'un État qui connaîtrait la juxtaposition de plusieurs systèmes constitutionnels, législatif et juridictionnel, gouvernés par une clause de suprématie de l'État fédéral permettant de faire prévaloir sa souveraineté sur celle des États fédérés. Aucune des collectivités territoriales d'outre-mer ne saurait être raisonnablement regardée, avant comme après la révision de 2003, comme une entité fédérée, y compris la Nouvelle-Calédonie. Force également est de constater que la République française n'est pas devenue non plus un État régionalisé, c'est-à-dire un État dont la décentralisation est exclusivement ou principalement politique et dans lequel les régions sont une catégorie privilégiée de collectivités bénéficiant d'un statut d'autonomie de nature à les rapprocher qualitativement d'entités fédérées. La régionalisation politique, comme en Italie ou en Espagne, se traduirait par la création de collectivités à autonomie politique, dotées de compétences exclusives et d'un véritable pouvoir normatif (23). Notre décentralisation territoriale reste, nonobstant les cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française (24), exclusivement ou principalement administrative et se rapporte à une forme politique d'État décentralisé cherchant à se situer à peu près à mi-chemin entre État centralisé et État régionalisé. Dans la nomenclature fixée au premier alinéa de l'article 72, les régions sont énumérées parmi les autres. Elles figurent à la dernière place des trois catégories constitutionnelles. Le droit à l'expérimentation des collectivités territoriales n'est pas réservé aux seules régions. Il s'y exerce dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les autres collectivités territoriales et leurs groupements. Ni le principe implicite de subsidiarité, ni la notion de collectivité territoriale chef de file ne donnent une place privilégiée aux régions. L'équilibre défini par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 82-137 DC du 25 février 1982 a été préservé : la décentralisation à la française repose sur la conciliation nécessaire entre la libre administration des collectivités territoriales et le contrôle normatif qui incombe à l'autorité administrative déconcentrée, en la personne du représentant de l'État. Ce contrôle normatif est maintenu en l'état. B. LA MULTIPLICITÉ DES ACTEURS La commission présidée par Michel Pébereau rejoint le constat fait par le rapporteur durant toute la durée de sa mission, en particulier au regard des expériences de nos voisins : « Notre appareil administratif est affecté par la prolifération des acteurs et des instruments. Le nombre d'acteurs publics augmente sans cesse dans notre pays. C'est vrai pour les collectivités territoriales. À côté des communes et des départements, on a créé les régions, puis les structures intercommunales, sans parallèlement supprimer d'acteurs. Ainsi, on compte désormais 50 000 acteurs publics indépendants. » (25) On dénombre en France 36 782 communes, 18 504 groupements intercommunaux, 100 départements et 25 régions, tandis qu'en outre, 344 pays ont été créés. Ainsi, se mêlent dans le paysage institutionnel local acteurs traditionnels et nouveaux venus, les uns venant satisfaire les besoins auxquels les autres ne parviennent pas à répondre de manière tout à fait satisfaisante. a) Les catégories constitutionnelles L'article 72, alinéa 1er, de la Constitution, intégralement réécrit en 2003, dispose désormais que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. » Les communes, les départements et les régions sont les trois catégories constitutionnelles les plus simples à définir. Les départements et les régions d'outre-mer sont deux sous-catégories constitutionnelles, soumises au nouveau régime de l'article 73 : il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. L'existence du département et de la région de La Réunion bénéficie d'une garantie constitutionnelle spécifique dès lors qu'est exclue leur transformation en collectivité d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution révisée ou en collectivité territoriale unique à statut propre. Les collectivités d'outre-mer soumises au nouvel article 74 sont celles énumérées à l'article 72-3, alinéa 2, de la Constitution révisée, qui ne sont ni des départements ni des régions d'outre-mer. Ce sont, par conséquent, les deux anciennes collectivités territoriales sui generis de l'ancien article 72, alinéa 1er, de la Constitution, à savoir Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que les deux anciens territoires d'outre-mer, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, mentionnées par l'ancien article 74. La Nouvelle-Calédonie, chacune de ses provinces et la Corse sont des collectivités à statut particulier. La première possède un statut constitutionnel régi par le titre XIII de la Constitution. Les deuxièmes ont un statut organique. La troisième possède un statut ordinaire défini par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 modifiée par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002. b) La diversité des collectivités territoriales La décentralisation a d'abord été assimilée aux communes. Cette constante se vérifie dans toute l'Europe, comme le rapporteur a pu le relever lui-même aussi bien en Italie, en Espagne, qu'en Écosse ou en Suède. L'explication de ce phénomène est bien connue, Tocqueville l'a parfaitement illustrée : elle est liée à la fois au rôle joué par les concentrations urbaines dans la constitution d'une société politique moderne, à l'émancipation de la paysannerie et à l'influence des églises dans l'encadrement des comportements. La France n'échappe pas à ce phénomène de prégnance communale, alors qu'avec ses 36 800 communes, elle regroupe près de la moitié des 73 000 communes européennes, loin devant l'Allemagne qui en regroupe 19 %, et l'Espagne et l'Italie avec 11 % du total. La France possède entre la commune et la région un troisième niveau, le département. Comme dans tous les États où existent trois niveaux subsiste un niveau et un type de collectivité parfois inspiré du département français - province belge, espagnole, italienne. Rien ne distingue ce niveau par nature (sauf dans le cas espagnol, l'élection indirecte de la plupart des députations provinciales) du niveau communal, dont il possède tous les éléments constitutifs : un territoire, une population, l'élection des organes. Deux phénomènes nouveaux contribuent à la complexification du paysage local : l'émergence de la région comme nouveau paradigme de l'organisation territoriale, la montée en puissance des structures intercommunales disposant de ressources propres. L'émergence du phénomène régional est commune à l'ensemble des pays européens, bien que cette réalité recouvre des réalités différentes d'un État à l'autre (26), comme en témoigne l'institution du comité européen des régions par le traité de Maastricht qui n'a pu se faire qu'en s'ouvrant à l'ensemble des collectivités locales. La France, comme tous ces États, n'a pas réussi à trancher entre un modèle qui aurait rapproché cette collectivité intermédiaire - le département - du statut de circonscription déconcentrée de la collectivité régionale et un autre qui aurait affirmé une impossible interférence par rapport aux changements majeurs intervenus dans la structure de l'État central - un transfert de compétence à une collectivité territoriale devant se traduire par un allégement de la présence de l'État dans les territoires. 2. Les dispositifs intermédiaires : espaces institutionnels Avec, d'une part, les pays nés de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (loadt), dite « loi Pasqua » et quasi institutionnalisés par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 (loaddt), dite « loi Voynet », et, d'autre part, les intercommunalités encouragées la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite « loi Chevènement », apparaissent la volonté de mieux organiser le territoire autour des communautés géographiques que l'histoire et l'économie ont façonnées par le renforcement ou la constitution de pays et des agglomérations. La circulaire du Premier ministre du 31 juillet 1998 relative à la préparation des contrats de plan État-régions reconnaît ces territoires en prévoyant que les contrats comprendront un volet territorial constituant le cadre des engagements de l'État et de la région pour les futurs contrats d'agglomération (27) et de pays. Par ces initiatives, le territoire national se reconstruit à partir des territoires et non pas de manière descendante, voire condescendante, à partir de Paris. La recomposition de notre architecture territoriale est sérieusement engagée. À côté de la légitimité apportée par le suffrage universel, sont apparues de nouvelles formes de légitimités fondées sur la capacité que démontrent ces institutions et leurs dirigeants à trouver concrètement à travers leurs politiques des réponses aux problèmes publics. Mais, par ces initiatives aussi, le territoire éclate et, superposant de nouvelles structures aux anciennes, complexifie d'autant la carte administrative. - L'évolution du cadre juridique La loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (atr) a promu des formes nouvelles de coopération institutionnelle, fondées sur des solidarités et la délégation des compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de développement, à l'opposé de la coopération technique incarnée par les syndicats intercommunaux à vocation simple ou multiple. L'institution de deux nouvelles catégories d'epci, les communautés de villes et les communautés de communes, l'abaissement du seuil démographique requis pour la création d'une communauté urbaine, la possibilité d'établir une taxe professionnelle d'agglomération ou une taxe professionnelle de zone (tpz) en étaient l'expression. Puis, une série de textes législatifs a confié aux communautés des compétences significatives pour la vie locale, sans passer préalablement par les communes. Par exemple, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « loi Barnier », dans son article 32, autorise les epci à fiscalité propre à élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels, des paysages et du patrimoine. La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole permet aux communautés de se saisir de la compétence des contrats territoriaux d'exploitation. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (sru) a donné compétence aux agglomérations pour définir la cohérence de la politique urbaine et une stratégie de développement sur le fondement des schémas de cohérence territoriale (scot) appelés à remplacer les schémas directeurs et avec lesquels doivent être compatibles tous les documents sectoriels que sont le plan local d'habitat, la charte d'urbanisme commercial, le plan de déplacements urbains (pdu) ou encore le plan local d'urbanisme (plu) qui a remplacé le plan d'occupation des sols (pos). La loi du 12 juillet 1999, pour sa part, réorganise l'intercommunalité à fiscalité propre sur la base de trois institutions, dont la désignation demeure fondée sur le suffrage indirect : la communauté d'agglomération qu'elle crée, la communauté de communes et la communauté urbaine dont le seuil de création est porté à 500 000 habitants. La principale innovation est la communauté d'agglomération, conçue comme devant former le dispositif de droit commun pour l'organisation des agglomérations, en dehors des plus grandes auxquelles il est proposé de s'organiser en communauté urbaine, et qui est censée tirer sa force de la taxe professionnelle unique (tpu). Une communauté d'agglomération peut être constituée à compter de plus de 50 000 habitants avec au moins une ville-centre de plus de 15 000 habitants ou le chef-lieu du département. L'intercommunalité nouvelle doit permettre une rationalisation de l'espace, non seulement par la réduction du nombre de catégories d'epci − en organisant la disparition des districts, des communautés de villes et syndicats d'agglomération nouvelle (san) (28) − et par le truchement de la mise en œuvre de quatre principes, la continuité territoriale, l'exclusivité, la cohérence et l'existence d'un projet territorial. Le premier principe de continuité territoriale ne s'applique pas aux communautés de communes existantes, ni à celles qui naîtraient de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes − ces anciens epci étant de plein droit transformés en communauté de communes au terme de la période transitoire, si les communes ne sont pas parvenues à s'entendre sur la transformation de leur cadre de coopération. Une commune ne peut appartenir à plus d'un epci à fiscalité propre. Mais, pour les pays « constatés » avant la loi du 25 juin 1999 précitée, la loi tolère la double appartenance si les missions que la commune concernée partage dans le cadre du pays ne recoupent pas celles de l'epci. En revanche, l'appartenance à un syndicat n'exclut pas l'appartenance à une intercommunalité de projet. Plusieurs institutions et procédures nouvelles concrétisent l'idée de projet, en particulier la création par la loi du 25 juin 1999 du contrat d'agglomération prévu qui fait partie du « volet territorial » des nouveaux contrats de plan et qui doit être signé entre l'État et l'epci à tpu d'une agglomération pour la mise en œuvre d'un projet d'agglomération. Ce projet peut couvrir un périmètre plus large que l'epci, en fonction de la composition du conseil de développement de l'agglomération prévu par la loi, tandis que le contrat d'agglomération ne peut être signé que par l'epci à tpu. Le conseil général et le conseil régional peuvent à leur demande être associés par l'epci à l'élaboration de tout projet de développement ou d'aménagement du territoire en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat et de coopération. Pour les communautés d'agglomération, la loi définit, de manière plus extensive qu'auparavant, quatre groupes de compétences qui leur sont transférés de plein droit : en premier lieu, le développement économique ; en deuxième lieu, l'aménagement de l'espace communautaire, y compris les transports urbains et les schémas directeurs − relevons néanmoins que le pos, puis son successeur, le plu, et le permis de construire restent de compétence communale tandis que les communautés urbaines sont elles compétentes en matière de pos-plu ; en troisième lieu, l'équilibre social de l'habitat, y compris le programme local de l'habitat (plh) et le logement social d'intérêt communautaire ; en dernier lieu, la politique de la ville. La loi énumère ensuite cinq compétences parmi lesquelles trois au moins devront être exercées par la communauté : la voirie d'intérêt communautaire ; l'assainissement ; l'eau ; la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, incluant les déchets, la lutte contre les nuisances sonores et la pollution de l'air ; les équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Les compétences des communautés urbaines ont été partiellement redéfinies en 1999. Elles sont ainsi étendues aux équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt communautaire, à la politique du logement d'intérêt communautaire, à la politique de la ville, à la protection et à la mise en valeur de l'environnement, aux lycées et aux collèges. Les autres compétences sont précisées. Ces compétences ne s'imposent qu'à celles qui ont été créées après la loi du 12 juillet 1999. Si la loi ne définit que les compétences obligatoires et, pour les communautés de communes et les communautés urbaines, des compétences optionnelles, cela n'interdit pas aux communes de déléguer d'autres compétences. L'exercice par l'epci des compétences transférées présuppose la reconnaissance de leur intérêt communautaire, dont la définition est une compétence du conseil de la communauté d'agglomération ou du conseil de la communauté urbaine à la majorité des deux tiers de leurs membres, tandis que pour les communautés de communes, il s'agit d'une compétence des conseils municipaux à la majorité requise pour la création de la communauté. La loi de 1999 a maintenu la possibilité de moduler l'exercice des compétences. La réalisation d'équipements d'intérêt commun peut être confiée à une commune avec un financement communautaire assuré par un fonds de concours. En revanche, la délégation conventionnelle de certains équipements, permise pour la communauté urbaine, n'est pas reprise pour les autres intercommunalités. La loi permet à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine d'exercer pour le département tout ou partie des compétences en matière d'aide sociale. Les intercommunalités peuvent participer à un syndicat mixte auquel elles peuvent déléguer certaines de leurs compétences. Enfin, la loi du 12 juillet 1999 anticipe l'évolution des possibilités politiques et l'évolution économique et démographique des institutions. Elle prévoit, en effet, l'extension du périmètre des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, dans un délai de trois ans à compter de sa publication, aux communes dont l'inclusion est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique, ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération en pôle urbain de développement et de la communauté urbaine en métropole régionale. La procédure comporte un projet d'extension arrêté par le préfet après avis de la commission départementale de coopération intercommunale qui est soumis aux conseils municipaux. Le vote du projet à la majorité qualifiée requise pour la création des communautés urbaines ou d'agglomération vaut accord des communes. L'arrêté d'extension pris par le préfet vaut retrait des communes des epci auxquels elles appartenaient. Cette procédure peut être renouvelée tous les douze ans. La loi n° 2002-476 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a clarifié les conditions dans lesquelles doivent être réalisés les transferts de personnels suscités par les créations ou transformations d'epci en application de la loi du 12 juillet 1999 précitée et facilite les transferts partiels de services. Elle prévoit, en outre, la possibilité de mise à disposition d'un service d'un epci au profit d'une commune membre pour l'exercice d'une compétence conjointe. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a renforcé le rôle des epci au plan local en leur donnant, notamment, la possibilité d'exercer certaines autres compétences des départements et des régions. Leur rôle s'est également accru en matière de politique de l'habitat. Par ailleurs, leur organisation interne et leurs relations financières avec leurs communes membres ont été considérablement assouplies. - Un succès quantitatif incontestable Le développement de l'intercommunalité constitue, sans conteste, l'une des nouvelles réalités dans l'équilibre territorial des pouvoirs. Ce développement concerne de manière plus manifeste encore l'intercommunalité à fiscalité propre. Le développement de l'intercommunalité n'est pas nouveau. Entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1999, le nombre de syndicats intercommunaux est passé de 15 940, soit 12 900 syndicats intercommunaux à vocation unique (sivu), 2 290 syndicats intercommunaux à vocations multiples (sivom) et 750 syndicats mixtes, à 18 501, soit 14 885 sivu, 2 165 sivom et 1 451 syndicats mixtes. En 2004, ce sont 64 nouveaux epci qui sont venus s'ajouter aux 2 461 recensés l'année précédente, portant leur effectif total à 2 525 au 1er janvier 2005. Au 1er janvier 2005, 88 % des communes françaises étaient membres d'un epci à fiscalité propre, c'est-à-dire d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération (29), d'une communauté urbaine ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle. Elles regroupaient 84 % de la population totale, soit 54,2 millions d'habitants, contre 16 millions d'habitants en 1993. La couverture du territoire par des structures intercommunales à fiscalité propre est donc en passe d'être achevée. Le nombre de communes concernées par le régime fiscal de la tpu augmente encore ; le nombre d'habitants concernés par ce régime fiscal intégré était de 39,4 millions (30). Au 1er janvier 2006, l'intercommunalité à fiscalité propre, avec un total de 2 572 epci, concernait 89 % des communes et 85 % de la population française. Le succès du dispositif s'explique, il est vrai, par l'existence d'incitations financières, dans un contexte de fragilité structurelle des finances locales, liée à l'épuisement de la fiscalité locale dû à l'obsolescence des bases d'imposition sur les ménages et à la difficulté d'alourdir la pression fiscale, au retard accumulé dans la progression de la dotation globale de fonctionnement (dgf), à l'épuisement des marges d'économie sur les dépenses de fonctionnement et à l'atonie de l'investissement local. Mais ce succès s'explique aussi parce que les esprits ont évolué et parce que les préfets ont été mobilisés par le gouvernement davantage que lors de la réforme de 1992. À des territoires fortement marqués par des pratiques anciennes de coopération tels que la Bretagne ou l'Alsace, dans lesquelles s'est rendu le rapporteur, s'opposent des territoires « anomiques » de ce point de vue, c'est-à-dire sans tradition de regroupement, sans valeurs communes de coopération. La meilleure mise en œuvre de la loi supposait un apprentissage préalable de formes de coopération. L'intercommunalité a permis de limiter la concurrence fiscale entre communes voisines et a permis un développement non négligeable des zones d'activité économique dans la périphérie des grandes villes. L'émergence d'un leadership politique parmi les élus est toujours décisive dans la réussite d'un epci. - Un bilan qualitatif mitigé Dans un rapport récent (31), la Cour des comptes a pointé les difficultés auxquelles se trouve confronté le développement de l'intercommunalité. Quatre problèmes principaux ont ainsi été soulevés : les périmètres ne sont pas pertinents, car les zones trop petites sont nombreuses ; les transferts sont partiels, les compétences n'étant pas toujours bien réparties ; l'interdépendance financière est sous-estimée, les communes et leurs groupements n'ayant pas suffisamment pris en compte leur degré d'interdépendance, faisant parfois courir des risques à plus ou moins long terme aux membres du groupement ou à ce dernier ; enfin, la gouvernance du système est en question, le mode de désignation des délégués communautaires devant être modifié. Après l'échec du processus de fusion de communes initié en 1971, la loi ayant promu un système fondé sur le seul volontariat, de manière inévitable, les périmètres ne sauraient être idéaux. S'agissant du caractère partiel des transferts, peut-être conviendrait-il de prévoir une représentation des epci au sein des commissions locales d'évaluation des transferts de charges dont ils sont aujourd'hui exclus. Par construction, l'intercommunalité à fiscalité propre, par sa complexité et son caractère inachevé, porte en elle le germe des risques de doublons structurels et de superposition des projets. En effet, le mécanisme de flux croisés lié à la mise en place de la tpu peut donner, dans certains cas, l'illusion d'une capacité de financement supplémentaire, alors même que ce « surplus » financier ne découle que la bonification de dgf apportée par le choix d'une intercommunalité à fiscalité propre. Par ailleurs, la progression de l'intercommunalité a conduit à la multiplication des syndicats mixtes, le syndicat retrouvant une nouvelle vocation pour organiser la coopération entre epci à fiscalité propre, dans une forme d'« infradépartementalité », qui se rapproche parfois du pays (voir infra). Il semble souhaitable de ne pas revenir sur l'intercommunalité. Ses acquis sont importants. Les politiques de logement, de développement économique ou d'aménagement de l'espace apparaissent moins pertinentes, voire impossibles, lorsqu'elles sont limitées au territoire d'une seule commune. L'effet dynamique prévisible des dispositions financières et fiscales contient en germe un changement de nature, et non simplement de degré, du pouvoir des établissements intercommunaux : mécanisme différentiel de péréquation entre communes (dotation de solidarité communautaire), extension des compétences (zones d'activités, politique culturelle, environnementale, de transport, d'assainissement), communautarisation du logement et de la politique de la ville. Dans la pratique, l'intégration est d'autant plus forte que l'intercommunalité est plus peuplée. Se pose in fine la question de la nature de l'intercommunalité, incarnation de la politique des moyens ou simple support des moyens de la politique. Plus perturbante et plus indécise que l'intercommunalité, parce que moins déterminée juridiquement, l'expansion des pays tend à rendre floue la correspondance traditionnelle entre territoire et institution. Cette forme de territorialisation des politiques s'inscrit dans une longue suite d'actions en faveur du développement local, qui a commencé dans les années 1950 avec les comités d'expansion, qui s'est poursuivie dans les années 1970 avec la création des premiers pays sous forme associative, avant le développement, dans les années 1980, des comités de bassins de l'emploi initiés par l'État et réunissant élus locaux, entrepreneurs et salariés. Les années 1990 virent la diffusion d'une formule associant un territoire, un ensemble d'acteurs, un projet et un contrat. Ainsi, en vertu de l'article 22 de la loi du 4 février 1995, dite « loi Pasqua », « lorsqu'un territoire présente une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale, la commission départementale de la coopération intercommunale concernée constate qu'il peut former un pays ». Celui-ci, en application de l'article 23, exprime « la communauté d'intérêts économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et l'espace rural » et appelle la définition d'un projet commun de développement. Les pays ont ainsi vocation à devenir une référence de cohérence géographique pour la mise en œuvre des politiques publiques. L'exemple breton, le rapporteur a pu le constater sur pièces et sur place, en donne une brillante illustration, la cohérence entre pays, arrondissements et intercommunalités étant très forte. Mais, sous le régime de la loi de 1995 et de son décret d'application du 19 avril 1995 (32), l'autorité administrative se bornait à publier la liste des pays. Puis, les collectivités territoriales et leurs groupements définissaient, en concertation avec les acteurs concernés, un projet commun de développement. Poussant la logique plus loin, l'article 25 de la loi du 25 juin 1999 précitée a réintroduit le pays dans le cadre institutionnel. Il alourdit la procédure de création : le préfet de région arrête le périmètre d'étude lorsque les communes appartiennent à une seule région, les préfets des régions concernées ensemble dans le cas contraire. Les arrêtés de délimitation du périmètre interviennent au terme d'une procédure très pesante : avis conforme de la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire, avis simple de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées, des préfets des départements et des régions. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas communiqués dans le délai de trois mois. Les entités constituant le pays doivent élaborer, en association avec le ou les départements et la ou les régions concernés, « une charte de pays en prenant en compte les dynamiques locales déjà organisées et porteuses de projets de développement, notamment en matière touristique ». Cette charte est adoptée par les communes ou leurs groupements. Dans chaque pays, un organe est créé, le conseil de développement, composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs, ce conseil étant consulté sur toute question relative à l'aménagement et au développement du pays. Une fois la charte adoptée, le ou les préfets de région arrêtent définitivement le périmètre du pays. Les pays, s'ils ne sont pas organisés dans le cadre d'epci, doivent créer soit des syndicats mixtes, soit des groupements d'intérêt public de développement local exerçant des activités d'études, d'animation et de gestion nécessaires à la mise en œuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d'intérêt collectif prévus par la charte. Outre le fait qu'on peut s'interroger la portée normative de ces dispositions au regard de l'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière, cette quasi-institutionnalisation des pays, encouragée par le volet territorial des contrats de plan État-régions, rend encore plus complexe l'approche des différents échelons territoriaux de projet, voire d'administration. Outre les dangers, en termes d'incohérence et d'inefficacité, que ce foisonnement laisse redouter, la reconnaissance législative d'une capacité contractuelle à des structures qui ne sont pas des niveaux d'administration en tant que tels ne peut que laisser perplexe. Elle contribuera sans doute à diluer et brouiller encore un peu plus le dialogue contractuel entre l'État et les collectivités locales, déjà inévitablement biaisé par une certaine asymétrie des partenaires. 3. Le risque croissant de l'illisibilité Au total, plus de trente types différents d'institutions et de périmètres territoriaux existent entre le niveau national et le niveau local (33). Même si chacune de son côté n'est pas en mesure d'intervenir de façon unilatérale par ses propres moyens, chaque collectivité doit acquérir une capacité qui consiste à organiser la rencontre des acteurs qui peuvent à un titre ou à un autre être parties prenantes dans la résolution de tel ou tel problème. En France, plus qu'ailleurs, tout être persiste dans son être. Comme l'a souligné l'un des responsables d'une grande association d'élus locaux lors de son audition par le rapporteur : « L'expérience des pays illustre parfaitement le problème français ; dès qu'on crée un niveau, on ne peut plus jamais le supprimer. Les pays résultent d'une volonté de construire une politique contractuelle pertinente. Mais, même quand ils ne sont plus nécessaires, les niveaux restent. » De plus, ces espaces intercommunaux et ces pays sont devenus des références dans l'action territoriale des politiques régionales et départementales, les premières ayant tendance à privilégier l'échelon du pays, les secondes l'échelon intercommunal. II. - LA NOUVELLE RÉPARTITION DES COMPÉTENCES Les collectivités territoriales ont développé leurs compétences à la fois sur le fondement de la clause générale de compétence dont elles bénéficient au titre du principe de leur libre administration et sur celui d'une spécialisation définie par le législateur. A. LA DIFFICILE CONCILIATION DE PRINCIPES MULTIPLES À partir de 1981, on assiste à un véritable basculement des conceptions institutionnelles. Le principe de libre administration des collectivités territoriales avait peu donné lieu, avant cette date, à des interventions du Conseil constitutionnel. Depuis lors, plusieurs dizaines de décisions s'y réfèrent et la compréhension de ce principe s'est considérablement enrichie, imposant une conciliation avec d'autres principes. Parmi ces principes, il faut retenir celui d'indivisibilité de la République, celui de continuité de l'État et du service public, celui d'égalité devant le service public (34), tandis que l'exigence du contrôle de légalité a acquis un poids particulier. Le nouvel article 72 de la Constitution, issu de la révision du 28 mars 2005, constitue une nouvelle étape qui oblige à s'interroger sur un nouvel équilibre des principes. Il met fin à l'illusion du « jardin à la française », qui ne traduisait que l'omnipotence de l'État. La subsidiarité, la notion de collectivité chef de file, le droit à l'expérimentation sont autant de manifestations de l'impossibilité d'enfermer les initiatives locales dans une logique étroite de spécialisation. Chaque collectivité locale a désormais, dans le respect des compétences attribuées aux autres collectivités publiques, une vocation générale à assurer la satisfaction de l'intérêt public local et à disposer à cette fin d'attributions réelles. Le texte de la Constitution consacre « une vision à la fois dynamique et réaliste de l'action locale qui tranche avec nos vieilles représentations jacobines de l'administration territoriale » (35). 1. La libre administration et le principe de subsidiarité La Constitution permet aux acteurs territoriaux de s'administrer librement, ce qui leur confère une grande liberté de choix dans leurs actions − liberté matérialisée dans la clause générale de compétence -, et, dans le même temps, impose un principe de répartition des compétences qui, appliqué dans toute sa rigueur, devrait cantonner chaque catégorie de collectivités dans un champ restreint. a) Libre administration et clause générale de compétence En 1946, l'ordre constitutionnel consacre le pouvoir local démocratique, et sa libre administration. En effet, la Constitution de 1946, pour la première fois, pose le principe de la libre administration des collectivités territoriales de la République par des conseils élus au suffrage universel, dont l'organe exécutif est élu par le conseil et confie le « contrôle administratif » de l'exercice de cette liberté au « délégué du Gouvernement » dans le département, le président de la commission de la Constitution déclarant que « nous affirmons le principe des libertés locales pour les collectivités, aussi bien municipales que départementales. Mais, il est bien évident qu'elles s'exercent sous le contrôle administratif et que la représentation de l'intérêt de l'État et la surveillance de l'activité de toutes les collectivités locales subsistent, comme par le passé, de façon que leurs décisions s'exercent dans le cadre national avec un contrôle administratif » (36). La libre administration est alors définie a minima par l'élection des conseils locaux « au suffrage universel » et par le fait que l'exécution des décisions des conseils « est assurée par leur maire ou leur président », tandis que, parallèlement, « la coordination des fonctionnaires de l'État, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales sont assurés, dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres » (37). L'article 89 de la Constitution précisait, en outre, que « des lois organiques étendront les libertés départementales et municipales ; elles pourront prévoir pour certaines grandes villes, des règles de fonctionnement et des structures différentes de celles des petites communes, (des) dispositions spéciales pour certains départements ». Le même article prévoyait que des lois simples détermineraient « les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés ». Le titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958 relatif aux collectivités territoriales consacre un statu quo apparent puisque, aux termes de l'article 72, les collectivités territoriales de la République « s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » (38), tandis que l'article 34 intègre « la libre administration des collectivités locales (de) leurs compétences et (de) leurs ressources » dans le domaine législatif. Si certains, au moment de l'élaboration de la Constitution, ont voulu reprendre certaines autres dispositions présentes dans le texte constitutionnel de 1946 précisant notamment que « la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales » devait se faire « dans le respect des libertés de celles-ci », d'autres, en revanche, à l'instar du commissaire du gouvernement, estimaient que « si on inclut une disposition comme celle-là, le danger est qu'au moment où on le fait on a l'intention extrêmement pure de maintenir cette idée générale de liberté ; mais la conséquence est que, dès que vous voudrez prendre par voie réglementaire une disposition quelconque, même de détail, qui aura donc l'effet le plus léger sur la situation des libertés, mais qui sera obligatoirement et peut-être totalement anachronique, le décret sera annulé par le Conseil d'État et ce sera vraiment un beau désordre. » (39) Ainsi, au moment où la Constitution est adoptée, « la notion de libre administration ne renvoie à aucun type d'organisation identifiable par certains éléments déterminés, mais découle des normes du droit positif français relatives à l'administration locale » (40). Par la suite, à plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel est venu préciser cette notion de libre administration. Ainsi, il a rappelé que, si les collectivités territoriales s'administrent librement, elles doivent le faire « dans les conditions prévues par la loi ». Le législateur peut donc instituer une procédure d'adoption du budget régional sans permettre au conseil de le modifier car « le législateur n'a ni privé l'organe délibérant de la région d'attributions effectives, ni méconnu le principe du consentement des citoyens par leurs représentants aux charges publiques » (41). De la même façon, si, en vertu de la loi, les départements ont compétence pour attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie, allocation d'aide sociale qui répond à une exigence de solidarité nationale, il est loisible au législateur de définir des conditions d'octroi de cette allocation de nature à assurer l'égalité de traitement entre toutes les personnes âgées dépendantes sur l'ensemble du territoire national (42). Le législateur pouvait fixer de telles conditions dès lors qu'il n'a pas méconnu les compétences propres des départements, ni privé d'attribution effective aucun organe départemental. En outre, dans le cas d'une modification ou d'une suppression de ressources fiscales, le Conseil mesure le degré de l'atteinte au principe la libre administration (43). À cette occasion, il a seulement précisé que le législateur ne saurait diminuer les ressources globales des collectivités locales ou réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources « au point d'entraver leur libre administration » (44). Nonobstant un nombre important de saisines invoquant la transgression de ce principe, le juge constitutionnel n'a que très rarement fondé sur lui ses censures. Peuvent être ainsi évoqués seulement quatre cas, dans lesquels, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution : - certaines dispositions qui privaient les collectivités du droit de procéder librement à la nomination de leurs agents, soulignant que la liberté de décision et de gestion des collectivités en matière de personnel était inhérente à la libre administration (45) ; - une disposition limitant les possibilités de prolongation d'une délégation de service public, proclamant le principe de la liberté contractuelle des collectivités (46); - une disposition imposant la publicité des séances des commissions permanentes, « plutôt que de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement » (47) ; - un mécanisme sanctionnant les collectivités qui n'auraient pas respecté les obligations mises à leur charge en matière de logements sociaux (48). En outre, le Conseil a précisé que le principe de libre administration s'appliquait également pour préserver le pouvoir d'une assemblée délibérante d'une collectivité − « les conseils élus » de la Constitution − des empiètements du pouvoir exécutif de cette même collectivité. Ainsi, a-t-il émis une réserve à propos, il est vrai, du cas spécifique de la Polynésie française. Il a relevé que, faute d'être soumise à l'autorisation de l'assemblée de la Polynésie française, la faculté, accordée au président de la Polynésie française de « négocier et de signer des conventions de coopération décentralisée » au nom de la Polynésie française ne saurait porter sur une matière ressortissant à la compétence de ladite assemblée sans méconnaître les prérogatives reconnues aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales (49). La révision constitutionnelle du 28 mars 2003, en proclamant l'organisation décentralisée de la République et en maintenant l'affirmation du principe de libre administration dans la nouvelle rédaction de l'article 72 de la Constitution, marque un retour aux sources de la proclamation de ce principe telle qu'énoncé en 1946 et lui a redonné un contenu. La clause générale de compétence définie par le code général des collectivités territoriales, avatar du principe de libre administration, désigne la « vocation générale dont dispose une collectivité à assumer une compétence en servant l'intérêt public local » (50). Ainsi, les collectivités territoriales ont vocation à se saisir de toute question d'intérêt local, principe consolidé par la jurisprudence administrative (51). Cette notion a été explicitée depuis la révision du 28 mars 2003 dans le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution en vertu duquel « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». La clause générale de compétence permet de faire le lien entre le principe de libre administration et le principe de subsidiarité. b) Principe de subsidiarité et spécialisation D'origine canonique (52), mais surtout communautaire (53), le principe de subsidiarité a été inscrit dans notre Constitution au deuxième alinéa de l'article 72, en vertu duquel « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon ». Mais, tout comme au niveau communautaire, ce principe appliqué à la décentralisation pose plusieurs questions. L'insertion du principe de subsidiarité, d'abord dans le traité sur l'Union européenne puis dans le traité instituant la Communauté européenne, comme principe juridique, malgré son contenu éminemment politique, n'autorise la Communauté à n'intervenir que « si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. » Il a donc été conçu comme une des réponses aux critiques de ce que certains considéraient comme un empiétement progressif et insuffisamment contrôlé des institutions européennes, parfois qualifiées de « centralisatrices », sur les compétences nationales. Règle de répartition des compétences entre Communautés et États membres, le principe de subsidiarité doit sans ambiguïté, dans la Charte européenne de l'autonomie locale du Conseil de l'Europe où il est inscrit à l'article 4-3, profiter en priorité au développement des niveaux infra-étatiques. Or, ce principe traduit en partie le malaise qui existe quant aux objectifs de l'intégration communautaire, malaise qui n'est pas sans évoquer celui qui pourrait naître d'une décentralisation mal acceptée. En effet, depuis le douloureux processus de ratification du traité de Maastricht et l'échec, non moins douloureux, de celui du traité établissant une Constitution pour l'Europe, un double constat conforte la volonté, exprimée dans le préambule du premier traité, d'agir pour une « union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité ». Or, il faut à la fois reconnaître l'existence d'une volonté exprimée par ces derniers d'être plus et mieux associés aux décisions communautaires et admettre le fait que les traités élargissent sans cesse les compétences de l'Union dans des domaines qui touchent directement la vie des citoyens européens. Cependant, l'absence patente d'une répartition claire des compétences entre l'Union européenne et les États membres se traduit, sans coup férir, par trois biais dommageables. En premier lieu, le principe de subsidiarité protège insuffisamment les États membres contre « l'expansionnisme » (54) inhérent aux missions des institutions et organes communautaires ce qui, très logiquement, provoque des réactions nationales d'exaspération. En deuxième lieu, il n'empêche pas les batailles de frontières de se multiplier, ni même la création de redondances, chacun s'estimant compétent pour régler tous les problèmes. En troisième lieu, il fonde un système institutionnel qui se construit au gré de l'actualité ; ce n'est que lorsque le problème se pose que la répartition des compétences apparaît. Ce qui est vrai pour le système décisionnel communautaire, dont l'opacité n'est pas la moindre des qualités, n'est pas totalement faux dans le cas de la décentralisation. La nouvelle rédaction de l'article 72 de notre Constitution transpose ce principe à l'échelon national, les collectivités territoriales se trouvant à cet égard dans la position des États membres par rapport à l'échelon communautaire. Et chaque catégorie de collectivité se trouve elle-même dans cette position par rapport à celle chargée du territoire qui englobe le sien. Pour certains, cette transposition revient à mettre « la charrue avant les bœufs en appliquant aux collectivités territoriales de la République les principes fondamentaux d'une constitution fédérative européenne encore dans les limbes » (55). En fait, pour reprendre cette image bucolique, la charrue existait bien avant son apparition dans la Constitution en 2003. Inscrire le principe de subsidiarité dans notre loi fondamentale revient à donner un fondement à la répartition des compétences entre collectivités telle qu'elle s'est construite au fil de la confrontation du local avec l'évolution des besoins des populations et de la mise en œuvre pragmatique des politiques publiques. Invoquer les blocs de compétences ou, comme Gaston Defferre, les « vocations dominantes » des collectivités, principes inscrits dans la loi ordinaire, ne suffit plus, même si le mythe des blocs des compétences, s'il est de plus en plus dénoncé comme tel, n'est pas tout à fait mort. Ainsi, la commission présidée par Michel Pébereau chargée de se pencher sur la question de la dette pouvait encore regretter que « les niveaux d'administration se multiplient sans rationalisation des compétences de chacun d'entre eux. C'est là la conséquence directe des décisions prises lors de la mise en œuvre la décentralisation. Les lois de décentralisation n'ont en effet pas cherché à donner à chaque catégorie de collectivité des compétences véritablement exclusives. On a fait de même une seconde fois lors de la mise en place des structures intercommunales, puisqu'il n'a pas été exigé des communes qu'elles abandonnent les compétences qu'elles étaient censées transférer. » (56) La nature de la décentralisation, telle que nous l'avons esquissée supra, méritait une inscription constitutionnelle. Qui nierait qu'il ne faut faire ensemble que ce qui ne peut pas être fait seul ou alors ce qui est mieux fait collectivement qu'individuellement ? Le principe permet d'assurer une prise de décision efficace au niveau le plus proche possible des citoyens. Mais ce principe d'attribution ascendante des pouvoirs doit être rendu compatible avec la tradition unitaire de la République française. La subsidiarité est avant tout une culture, c'est un concept dynamique. Le principe de subsidiarité doit agir comme principe rénovateur, permettant un allégement des procédures voire la suppression de certains circuits de décision devenus inadaptés. (57) Le juge constitutionnel devra préciser la portée de ce principe de subsidiarité et veiller à son respect. Sans disposer d'un « pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement » (58), il peut néanmoins vérifier que le législateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation (59). Ainsi, depuis lors, il a relevé qu'il résulte de la généralité des termes retenus par le constituant dans sa définition du principe de subsidiarité que le choix du législateur d'attribuer une compétence à l'État plutôt qu'à une collectivité territoriale ne pourrait être remis en cause, sur le fondement de ce principe, que s'il était manifeste qu'eu égard à ses caractéristiques et aux intérêts concernés, cette compétence pouvait être mieux exercée par une collectivité territoriale. Le Conseil a ainsi admis que, la définition par le préfet des zones de développement de l'éolien prenant en compte les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ainsi que la préservation des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, le législateur n'a pas manifestement méconnu le principe de subsidiarité. Il n'a ni instauré une tutelle de l'État sur les communes ou les régions ni porté atteinte à leur libre administration ou à leur autonomie financière (60). Auparavant, le Conseil constitutionnel avait estimé que le transfert aux départements de la gestion du revenu minimum d'insertion (rmi) ne pouvait être regardé comme contraire aux dispositions insérées dans la Constitution par la révision du 28 mars 2003 relative au principe de subsidiarité (61). 2. L'interdiction de la tutelle et la possibilité d'un chef de file a) Le principe d'absence de tutelle d'une collectivité sur une autre Contrairement à certains de ses voisins tels que la République fédérale d'Allemagne mais à l'instar d'autres comme l'Italie, la France n'a pas souhaité instaurer une hiérarchie entre collectivités territoriales. L'interdiction de la tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre forme ainsi l'un des principes fondamentaux de la décentralisation. Liée à la logique de « blocs de compétences », elle a été inscrite dans le code général des collectivités territoriales en 1982. L'article L. 1111-3 dudit code dispose ainsi que « la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles », tandis que son article L. 1111-4 précise que « les décisions prises par les collectivités locales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité locale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci ». Elle a été consacrée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision relative à la Corse, dans laquelle il a vérifié que les dispositions relatives à l'Assemblée de Corse ne conduisaient pas à placer les communes et les départements sous la tutelle de celle-là. Plus récemment, il a souligné que le fait de confier à la Polynésie française le soin d'autoriser, dans les communes où il n'existe pas de service d'assainissement assuré par la Polynésie française, les communes ou les epci à prescrire certaines mesures d'assainissement, n'avait pas pour effet d'instaurer une tutelle de la Polynésie française sur l'exercice par les communes d'une de leurs compétences (62). La tutelle, définie en droit civil comme l'exigence d'une autorisation ou d'une approbation du tuteur pour que le pupille puisse agir, étendue aux collectivités territoriales, peut prendre des formes multiples, parfois « insidieuses » (63), la collectivité finançant la plus grande part d'un projet pouvant prendre l'ascendant sur les autres. Lors de la révision constitutionnelle de mars 2003, le Sénat a ainsi souhaité que le rôle de chef de file qui pouvait être accordée à une collectivité dans l'organisation d'une action commune ne conduise pas à l'établissement d'une tutelle. - L'affirmation des actions partenariales Le concept de décentralisation par « blocs de compétences » a doucement glissé vers l'obsolescence. Certains secteurs transversaux, tels que l'aménagement du territoire ou la politique de la ville, voire de plus en plus la promotion du développement durable, appellent l'intervention de plusieurs collectivités et rendent, dès lors, indispensable la pratique des financements croisés. Les compétences de chaque niveau de collectivités sont exclusives dans très peu de pays de l'Union européenne. La « cogestion » forme même le cadre le plus courant d'exercice des compétences. Le cas est particulièrement vérifiable aux Pays-Bas. En France, très souvent, est souligné le manque de clarté et de transparence dans la répartition des rôles des différents niveaux de collectivités, par exemple en matière d'aide aux communes. Les « financements croisés », dénoncés comme source de complexité et de confusion, se sont cependant avérés souvent nécessaires, par exemple pour réaliser des équipements dont le coût ne pourrait être assumé par une seule collectivité. Les partenariats créent des tours de table regroupant parfois plus de cinq ou six collectivités publiques. Plus ces dernières saisissent les opportunités institutionnelles ouvertes pour le développement de ces partenariats, plus le système devient illisible et plus la légitimité de ce dernier peine à se consolider. Mais, au-delà des apparences et des financements croisés, certaines expériences montrent qu'il existe une logique d'action et de répartition des rôles qui permet de pallier, dans les faits, le chevauchement apparent des compétences. Par exemple, en Alsace, le rapporteur a pu constater qu'à chaque échelle territoriale correspond de facto un chef de file ou un soutien extérieur principal, comme le montre le tableau ci-après. Dans ce cas, doivent être conciliées la mission générale de soutien aux communes et à leur développement qui incombe traditionnellement aux départements et les interventions spécifiques de nature thématique menées par la région et qui touchent de manière concomitante communes, associations et autres acteurs.
Mais ce type de répartition, s'il permet dans la réalité, de résoudre les questions de chevauchement de compétences, manque de lisibilité et donc de légitimité. L'enchevêtrement des compétences implique en conséquence des procédures de coordination entre collectivités. En accordant à une collectivité la faculté d'organiser les modalités d'une action commune, la reconnaissance de la notion de « chef de file », lors de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, répond ainsi à un impératif pragmatique. - La consécration de la notion de chef de file La notion de collectivité chef de file était déjà présente dans notre droit, sans pour autant être ainsi désignée. Ainsi, la loi du 27 février 2002 précitée, dans son article 102, a confié à la région un rôle dynamique en matière d'aides aux entreprises, en faisant d'elle l'autorité coordinatrice des actions menées en la matière, tandis que les communes, les départements et les groupements sont associés par le truchement de conventions à ces actions (64). Avant l'intervention du législateur de 2002, la loi du 4 février 1995 précitée avait prévu, de manière moins spécifique, dans le II de son article 65, la possibilité de confier à une collectivité un rôle de coordination en énonçant qu'une loi ultérieure définirait « les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assurer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales ». Il était, en outre, précisé que « jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, les collectivités territoriales pourront, par convention, désigner l'une d'entre elles comme chef de file pour l'exercice de ces mêmes compétences. » Cette dernière précision a été censurée par le Conseil constitutionnel (65) qui a jugé qu'en l'espèce le législateur n'avait pas suffisamment défini les pouvoirs et les responsabilités afférents à cette notion : « le législateur ne saurait renvoyer à une convention conclue entre des collectivités territoriales le soin de désigner l'une d'entre elles comme chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant des autres sans définir les pouvoirs et les responsabilités afférents à cette fonction ». Cette notion de chef de file fut réintroduite pour des actions communes menées par la voie conventionnelle par les collectivités et leurs groupements en matière d'aménagement du territoire et de développement économique à l'occasion de l'examen de la loaddt du 25 juin 1999, avant d'être écartée lors de la lecture définitive de ce texte. La double nécessité de clarifier la répartition des compétences entre collectivités territoriales et de permettre la désignation de collectivités chefs de file pour la mise en œuvre de compétences croisées fait l'objet d'un large consensus. La commission pour l'avenir de la décentralisation présidée par Pierre Mauroy proposait ainsi que, lorsqu'une collectivité intervenait dans le cadre du bloc de compétences qui lui a été dévolu par la loi, la collectivité principalement compétente pouvait solliciter des financements d'autres partenaires en tant que chef de file d'un projet (66). Ainsi, le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution, tel qu'issu de la révision du 28 mars 2003, permet de reconnaître à la loi, lorsqu'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités, la possibilité de confier à l'une d'entre elles le soin d'« organiser » les modalités de leur action commune. Il s'agissait d'inscrire dans la Constitution la notion de collectivité « chef de file » (67). Cette possibilité offerte au législateur de désigner un chef de file, comme il l'a déjà fait en 2002 pour les aides directes aux entreprises, doit pouvoir s'étendre non seulement à toutes les collectivités territoriales mais aussi aux établissements qu'elles créent et on peut penser, naturellement, aux epci. À travers la notion de « chef de file », le problème ne serait-il pas - pour éviter la généralisation de l'exercice des compétences « générales » - celui d'une « tutelle » déplacée ou territorialisée ? B. LES TRANSFERTS ENTRE CONFUSION ET INACHÈVEMENT Le débat sur l'équilibre territorial des pouvoirs est obscurci par le manque de visibilité dans le système de vases communicants qui a résulté des transferts successifs de compétences et de moyens de l'État vers les collectivités territoriales. Le constat est connu. Il a été rappelé récemment par la commission présidée par Michel Pébereau, « pour pouvoir porter un jugement sur l'ensemble de ces évolutions, il faudrait savoir si les compétences transférées depuis vingt ans justifient l'accroissement constant des dépenses de fonctionnement et notamment des effectifs. Il serait également intéressant de connaître les économies de dépenses de fonctionnement que la décentralisation a permis de réaliser au niveau des services de l'État. Or, ces informations n'existent pas à un niveau global. Il est probable que certaines des collectivités disposent des informations les concernant dans ce domaine. Mais aucune consolidation des informations individuelles n'est disponible. (...) « Compte tenu de ce manque de données, la Commission ne peut que rester extrêmement prudente dans l'appréciation de l'augmentation des dépenses locales depuis vingt-cinq ans. Elle ne peut que regretter que s'agissant de collectivités représentant désormais 20 % de la dépense publique, il n'existe pas d'information réellement pertinente sur la productivité de leurs services administratifs ou sur l'efficacité de leurs dépenses d'investissement et d'intervention. » (68) 1. L'« acte I » de la décentralisation : entre clause générale Les logiques mises en œuvre depuis 1982 ont favorisé une dilution des responsabilités et auraient fragilisé l'implication des citoyens dans la vie locale (69). Fondée sur le principe de clause générale de compétence, la plupart des textes, adoptés avant ou après les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, vont participer à une répartition des compétences exercées localement qui va s'éloigner peu à peu du « jardin à la française » du temps regretté par certains où l'État faisait tout, partout. En outre, a été définie une logique des « blocs de compétences ». Ainsi, l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 7 janvier 1983, dispose que « la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'État et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions ». Cette logique a conduit à attribuer aux différentes catégories collectivités des domaines de compétences a priori cohérents : - la commune s'est vue attribuer la maîtrise du sol, impliquant l'essentiel des compétences en matière d'urbanisme, et la responsabilité des équipements de proximité ; - le département devait assumer une mission de solidarité et de péréquation, par la gestion des services d'aide sociale et par une redistribution des moyens financiers entre les communes, à l'image des nombreuses collectivités intermédiaires présentes dans les pays voisins (provinces espagnoles ou italiennes, Kreise allemands...) ; - la région a été chargée de conduire la planification, l'aménagement du territoire et l'action économique et de développement, ce qui l'a amené à recevoir la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle. Mais, ce schéma initial des lois de 1983 comportait lui-même de nombreux manques. La délimitation des frontières entre compétences locales et compétences étatiques s'est, dès l'origine, révélée peu linéaire. Les vocations de chaque niveau de collectivités n'ont pas été respectées. L'exemple de l'éducation est particulièrement éclairant. L'État a conservé la définition de la pédagogie, le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels enseignants et techniciens, ouvriers et de service (tos). Les compétences d'investissement ont été réparties entre chaque catégorie de collectivités : la commune a été chargée de l'école primaire, le département du collège, la région du lycée, l'État restant compétent pour l'université. Le même constat pourrait être fait pour le logement ou encore la culture, domaine dans lequel la créativité de chaque niveau de collectivité a trouvé peu de bornes. Dans le domaine de la police, par exemple, les compétences dont disposaient déjà les maires ont été élargies tandis qu'a été créé au profit des présidents de conseil général un nouveau pouvoir de police. Ainsi, le maire s'est vu reconnaître la possibilité de prévenir et de faire cesser les pollutions de toute nature, de déterminer la police des travaux de voirie, la police des ports de plaisance, tandis que le président du conseil général s'est vu attribuer un pouvoir de police dans la gestion du domaine départemental, dans celle des travaux de voirie et les ports départementaux. L'État, pour sa part, n'a pas renoncé à exercer un certain nombre de prérogatives générale ou spéciales. Le préfet peut toujours se substituer en cas de carence aux maires intéressés (70). Dans les communes où est instituée une police d'État, a été maintenue la compétence du préfet pour réprimer les atteintes à la sécurité publique et de veiller au bon ordre, en cas de grand rassemblement. Une complexité identique peut être constatée en matière de police de l'eau, de circulation routière ou encore de police du domaine public maritime. Et le même constat pourrait être présenté dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Par ailleurs, le schéma initial ne fermait pas la porte à l'exercice en commun de compétences partagées, susceptible de faire intervenir différents niveaux de collectivités. En effet, les transferts de compétence n'ont pas été toujours complets. L'État a pu avoir tendance à instrumentaliser l'action des autorités locales, à retenir à son profit les pouvoirs d'impulsion et d'initiative, transférant aux collectivités locales des missions d'exécution et de gestion (71). Sans disposer juridiquement de certaines compétences, ces collectivités sont cependant souvent intervenues financièrement pour soutenir un service qui présentait un intérêt local évident prenant le relais d'un État soumis à une contrainte budgétaire de plus en plus prégnante. Lorsque la loi dispose un transfert de compétence, c'est bien souvent l'aboutissement juridique d'un processus dominé, dans les faits, par l'action des collectivités locales. Les transferts récents en donnent de multiples exemples, tels que le transfert de la gestion de certains monuments historiques, à la mise en valeur desquels les collectivités territoriales apportaient souvent des moyens. La première étape de la décentralisation a ainsi navigué ente le mirage des blocs de compétences et l'écueil de la clause générale des compétences, autant d'illusions que l'« acte II » s'est attaché, en particulier grâce à la constitutionnalisation de la décentralisation, à dissiper. 2. L'« acte II » : la recherche d'une clarification des compétences L'un des objectifs affichés de la révision constitutionnelle de mars 2003 était bien de clarifier les compétences, même si le retour à une logique de spécialisation, largement mythique, s'avère impossible au regard de l'expérience des vingt dernières années, compte tenu de l'impossibilité de donner une définition matérielle stricte aux compétences des collectivités locales assignant à tel territoire telle compétence. Le rapporteur rappelle que cet objectif de clarification avait déjà été fixé par la loi du 4 février 1995 précitée qui, dans son article 65, disposait que : « I.- La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales sera clarifiée dans le cadre d'une loi portant révision de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 83-623 du 22 juillet 1983 complétant la loi précitée. Cette loi interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. « Elle répartira les compétences de manière que chaque catégorie de collectivités territoriales dispose de compétences homogènes. « Cette loi prévoira que tout transfert de compétences est accompagné d'un transfert des personnels et des ressources correspondant. « II.- Elle définira également les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales. « III.- Cette loi déterminera également les conditions dans lesquelles, dans le respect des orientations inscrites aux schémas de services collectifs, une collectivité territoriale pourra, à sa demande, se voir confier une compétence susceptible d'être exercée pour le compte d'une autre collectivité territoriale. » Dans la logique de cet objectif de clarification, depuis la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, la gestion de ces dispositifs se retrouve à la charge exclusive des départements (72). b) La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés Élaborée à la suite des deux lois organiques du 1er août 2003 relatives respectivement au référendum local et à l'expérimentation, et discutée parallèlement à la loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, elle opère de nouveaux et importants transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales et à leurs groupements. En outre, elle comporte des volets relatifs aux transferts de personnels, aux compensations financières, à l'évaluation de l'action publique locale et à la participation des électeurs, ainsi que des aménagements au contrôle de légalité et à l'organisation territoriale de l'État. Enfin, le dernier volet de la loi apporte un certain nombre d'ajustements aux dispositions statutaires et organisationnelles régissant l'intercommunalité.
- Un chantier considérable Si la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 doit faire l'objet d'un rapport spécifique d'application dans le cadre de l'article 86, alinéa 8, du Règlement de l'Assemblée nationale, procédure initiée par notre collègue Jean-Luc Warsmann (73), il convient néanmoins d'en donner quelques éléments afin d'apprécier dans quelle mesure ce texte participe de la modification de l'équilibre territorial des pouvoirs. Ainsi, s'agissant de la mise en œuvre de la loi, 2005 a été une année de transition, riche en discussions entre l'État et les collectivités territoriales. La formation professionnelle a été transférée entièrement aux régions au 1er juillet de même que le Syndicat des transports d'Île-de-France (stif) à la région Île-de-France. La gestion des agents tos, les routes nationales (74), l'inventaire du patrimoine sont transférés aux collectivités concernées le 1er janvier 2006. · Le développement économique La plupart des régions se sont lancées dans la définition d'un schéma régional de développement économique (srde). La Bourgogne a signé son schéma le 17 juin 2005, intégrant une enveloppe de 130 millions d'euros pour l'État, de 200 millions d'euros pour le conseil régional et de 400 millions d'euros pour les banques et autres partenaires, tandis que quinze conventions ont été signées sur cette base entre la région, la Caisse des dépôts et consignations, des banques, des agences de l'eau, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ademe) et l'Agence nationale de valorisation de la recherche (anvar) devenue Oséo (75). Dans ce cadre, la région a demandé la gestion des crédits des aides individuelles aux entreprises, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 13 août 2004, mais aussi l'intégration de tout ou partie de la direction régionale du commerce extérieur (drce), ainsi que, au-delà du cadre législatif actuel, la gestion des aides collectives et du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (fisac). L'Association des régions de France (arf) a pu également relever la nécessité de compléter le dispositif législatif par le transfert des aides collectives, qui concernent un ensemble d'entreprises appartenant à un secteur géographique déterminé, telles que les aides à la recherche ou aux transferts de technologie (76). La Haute-Normandie et la région Poitou-Charentes ont également adopté leur schéma en juin 2005, suivi par le Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes en octobre, par l'Auvergne à la fin de novembre et par les régions Centre, Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Basse-Normandie en décembre 2005. Devraient suivre les régions Limousin, Alsace, Aquitaine, Lorraine et Île-de-France. · La formation professionnelle Dans le domaine de la formation professionnelle, le décret du 5 décembre 2005 (77) permet aux régions de disposer de plus grandes marges de manœuvre dans la gestion de l'indemnité compensatrice forfaitaire d'apprentissage. L'article 13 de la loi organise le transfert aux régions des compétences donnant lieu à l'organisation et au financement par l'État des stages de formation de 1'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (afpa). Le transfert des crédits doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2008. Il peut intervenir avant cette date dans chaque région sous réserve de la conclusion entre l'État, la région et l'afpa d'une convention définissant le schéma régional des formations et le programme régional d'activité de l'association. La région Centre a signé une convention pour un transfert au 1er janvier 2006. Les régions Alsace, Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes devrait signer une convention en 2006 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2007. · La voirie La loi du 13 août 2004 a organisé le transfert aux départements d'une partie de la voirie nationale, tandis que la région est appelée à jouer un rôle de coordination par le biais du schéma régional des infrastructures et des transports. Le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national a fixé les itinéraires qui restent de la compétence de 1'État, alors que les autres routes ont été transférées, par arrêtés préfectoraux, après avis des départements intéressés, dans le domaine public routier départemental, à l'exception du département de la Seine-Saint-Denis. En outre, quatre autres décrets ont été publiés : le décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 portant sur les mutations domaniales liées aux transferts, le décret n° 2005-1628 du 23 décembre 2005 relatif à la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national transféré et portant application de 1'article 26 de la loi du 13 août 2004, le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 relatif à la compensation financière des charges liées aux routes nationales transférées aux départements et aux régions et le décret n° 2005-1690 du 26 décembre 2005 pris pour l'application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales et relatif au transfert des routes nationales dans les départements d'outre-mer. Une circulaire du 6 décembre 2005 adressée aux préfets a précisé les modalités de mise en œuvre des transferts, définissant un calendrier pour les arrêtés préfectoraux constatant le transfert, dans le but d'assurer le transfert de la plus grande partie du réseau au 1er janvier 2006. Elle porte également sur le transfert des services de l'État ainsi que sur les moyens financiers liés au transfert, afin de permettre aux départements d'exercer, dans les meilleures conditions, leurs nouvelles responsabilités. Devront être publiés en 2006 les décrets d'application relatifs aux péages, aux routes à grande circulation et aux enquêtes de circulation. · Les aérodromes et les ports Le transfert des aéroports (78) à l'horizon 2007 a attiré de nombreuses candidatures. Toute collectivité peut demander ce transfert jusqu'au 1er juillet 2006. Si aucune autre demande n'est formulée dans un délai de six mois suivant la première demande, la collectivité pétitionnaire est réputée bénéficiaire du transfert. En cas de pluralité de demandes, une concertation, dont la durée est fixée par le préfet, est organisée en vue d'aboutir à une candidature unique, qui peut prendre la forme d'un syndicat mixte associant les diverses collectivités intéressées. Au 20 décembre 2005, si aucune convention de transfert n'a encore été signée, treize collectivités ou groupements de collectivités ont été désignés comme bénéficiaires, vingt-neuf candidatures formelles ont été enregistrées et quarante-cinq collectivités ou groupements de collectivités ont manifesté leur intérêt pour les plates-formes aéroportuaires par des lettres de leurs exécutifs. S'agissant des candidatures émanant des régions, deux candidatures peuvent déjà être dénombrées, celle de la région Picardie pour l'aéroport de Beauvais, celle de la région Centre pour l'aéroport de Châteauroux-Déols. Le transfert des ports (79) fait l'objet de discussions importantes en régions, départements et intercommunalités. Sept conseils régionaux ont fait part de leurs candidatures pour les ports implantés sur leur territoire. Par exemple, la région Aquitaine est candidate pour le port de Bayonne. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la région est candidate pour le port de Boulogne-sur-Mer et pour celui de Calais, pour lequel est également candidate la communauté d'agglomération de Calais. En Basse-Normandie, le port de Cherbourg est demandé par le conseil régional et le conseil général de la Manche, tandis que le port de Caen Ouistreham est demandé par le conseil régional. En Languedoc-Roussillon, Port-la-Nouvelle fait l'objet de trois demandes concurrentes, par le conseil régional, la commune de Port-la-Nouvelle et la communauté de communes des Corbières-Méditerranée, tandis que le port de Sète Frontignan intéresse la région, le département, les villes de Frontignan et de Sète. · L'action sociale et médico-sociale et la protection de l'enfance Les dispositions de l'article 50 de la loi confiant au conseil général l'initiative, le pilotage et la responsabilité d'arrêter le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale sont entrées en vigueur dès le 1er janvier 2005, sans qu'il soit nécessaire de prendre un décret. Les schémas adoptés avant cette date demeurent en vigueur jusqu'à leur expiration. Par circulaire en date du 21 décembre 2004, il a été rappelé aux préfets qu'il leur appartenait dorénavant de fournir au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma les orientations que le nouveau schéma devrait prendre en compte pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sur un échantillon de quarante-huit départements interrogés au mois de septembre 2005, il ressort que la prise en compte du nouveau cadre législatif s'effectue de manière très progressive : 80 % de ces conseils généraux n'ont pas encore adopté de nouveaux plans dans les conditions définies par la loi du 13 août 2004. De nombreux schémas spécifiques demeurent en cours d'exécution dans les départements et ne viendront à expiration qu'au cours des prochaines années. Les dispositions de l'article 51 attribuant au département l'entière responsabilité pour attribuer des aides aux jeunes en difficulté et mettre en place un nouveau fonds d'aide aux jeunes (faj) sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005 sans décret. D'après le même échantillon de quarante-huit départements interrogés en septembre 2005, la prise en compte du nouveau cadre législatif n'a pas posé de difficultés particulières : 90 % de ces conseils généraux ont déjà mis en place le fonds unique départemental voulu par le législateur. Le transfert à la région de la politique de formation des travailleurs sociaux est effectif depuis le début de l'année 2005, donnant lieu à deux décrets d'application, n° 2005-198 du 22 février 2005 et n° 2005-426 du 4 mars 2005. La loi, dans son article 56, soumet les centres locaux d'information et de coordination (clic), depuis le 1er janvier 2005, au dispositif d'autorisation et de financement prévu par le code de l'action sociale et des familles pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sur l'échantillon de référence des quarante-huit départements interrogés en septembre 2005, 80 % d'entre eux se sont engagés dans la conclusion des conventions prévues par la loi du 13 août 2004. En outre, par circulaire du 21 décembre 2004, il a été demandé aux préfets de veiller à ce que les conseils généraux constituent les nouveaux comités départementaux des retraités et des personnes âgées (coderpa). Dans le domaine de la protection de l'enfance, avant même la date de publication de la loi du 13 août 2004, neuf départements s'étaient déjà portés candidat à une expérimentation de la mise en application des décisions ordonnées par le juge des enfants. Ces candidatures n'ont pas été retenues, la loi ayant précisé que les candidatures sont adressées au garde des sceaux à compter du 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi. Certaines collectivités territoriales ont donc renouvelé leur candidature. · Le logement et l'habitat Une circulaire du 17 janvier 2005 a précisé les modalités de mise en œuvre du dispositif prévoyant la possibilité, pour le préfet de département, de déléguer, au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un epci compétent en matière d'habitat, tout ou partie des réservations de logements sociaux au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées. La circulaire a détaillé les éléments conditionnant l'octroi de la délégation et les modalités afférentes, notamment en proposant une convention-type. Quatorze conventions de transfert ont déjà été signées dans les Hauts-de-Seine et une avec la communauté d'agglomération de Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, quatre communes du département de la Gironde, dont Bordeaux, ont manifesté leur volonté de bénéficier de la délégation du contingent préfectoral. Dans le domaine des aides à la pierre, après qu'une circulaire générale du 23 décembre 2004 a précisé les modalités de mise en œuvre de la réforme de ces aides et proposé des conventions-types de délégation, six décrets ont été publiés : celui relatif au comité régional de l'habitat le 24 mars 2005, celui relatif aux conditions d'octroi des aides par les epci et les départements le 3 avril 2005, celui relatif aux programmes locaux de l'habitat le 6 avril 2005, celui relatif aux conditions d'adaptation des aides de l'État et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (anah) par les epci et les départements le 5 mai 2005, celui relatif aux conditions d'octroi des aides par les epci et les départements dans les départements d'outre-mer le 4 novembre 2005, enfin celui relatif au conseil départemental de l'habitat outre-mer le 31 décembre 2005. En 2006, doivent être publiés les décrets relatifs à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (anru) et à la convention globale de patrimoine. En 2005, seize conventions ont été signées, quatre concernent des départements dont Paris, cinq concernent des communautés urbaines et sept des communautés d'agglomération. Pour l'année 2006, trente-neuf epci ainsi que six départements ont déjà manifesté leur volonté de signer des conventions. Les premières expériences ont montré une accélération des procédures. Le décret relatif au fonds de solidarité pour le logement (fsl) organisant son transfert aux départements a été publié le 4 mars 2005. Afin d'accompagner ce transfert, une circulaire du 26 janvier 2005 a été adressée aux préfets afin de préciser les modalités de mise à disposition des services de l'État pour l'exercice de la compétence. · La santé L'article 71 de la loi du 13 août 2004 assure la « recentralisation » vers l'État des compétences confiées aux départements en 1983 dans le domaine de la lutte contre les grandes maladies, mais les départements qui souhaiteraient poursuivre leurs interventions dans ces domaines peuvent le faire. La mise en œuvre de ce dispositif de recentralisation a été reportée au 1er janvier 2006 dans le cadre de l'article 100 de la loi de finances rectificative pour 2004, pour permettre aux départements de se déterminer, au cours de l'année 2005, sur les compétences qu'ils souhaiteraient continuer à exercer. Quarante-six départements ont conservé la compétence pour le dépistage des cancers, cinquante-huit départements pour la vaccination, cinquante-cinq départements pour la lutte contre la tuberculose et quarante-neuf départements pour la lutte contre les infections sexuellement transmissibles. Mais, seuls huit départements ont souhaité conventionner avec l'État pour la lutte contre la lèpre. Pour les départements où la « recentralisation » interviendra, a été publié le décret n° 2005-1608 du 19 décembre 2005 relatif à l'habilitation des établissements et organismes pour les vaccinations et la lutte contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles. Un décret publié le 30 décembre 2005 détermine la nature des mesures qui pourront être prises pour la lutte contre les moustiques vecteurs de maladies humaines, permettant l'entrée en vigueur effective en 2006 du transfert de compétences aux départements. Les dispositions transférant à la région la compétence pour autoriser/agréer les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et de sages-femmes et, pour les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales, pour agréer leurs directeurs et pour assurer le fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière, sont entrées en vigueur au 1er juillet 2005. Un premier décret d'application n° 2005-723 du 29 juin 2005 a été pris pour définir les conditions dans lesquelles les régions participeront à compter du 1er juillet 2005 au financement du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts publics de formation des auxiliaires médicaux rattachés à des établissements publics de santé. Un deuxième décret, en cours d'examen au Conseil d'État, précisera notamment les conditions d'agrément ou d'autorisation des écoles et instituts de formations par les régions ainsi que les conditions dans lesquelles les régions seront consultées par l'État pour la fixation du nombre d'étudiants admis à entreprendre des études dans les instituts et écoles de formation (quotas). L'article 73 de la loi du 13 août 2004 donne également aux régions la compétence pour l'attribution des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formations autorisés ou agréés. Le décret n° 2005-418 du 3 mai 2005 a défini les règles minimales de taux et de barème des aides que les régions devront verser aux étudiants inscrits dans les écoles et instituts de formation aux professions paramédicales et de sages-femmes. Une circulaire du 4 août 2005, accompagnée d'un modèle-type de convention, a précisé les modalités de mise en place et les moyens à mettre en œuvre permettant aux communes, qui en font la demande, d'exercer la responsabilité de la politique de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans l'habitat, à titre expérimental pour une durée de quatre ans. Seulement sept communes ont présenté leur candidature avant le 31 décembre 2005, à savoir Dunkerque, Valenciennes, Perpignan, Toulon, Bastia, Carcassonne et Paris. · L'éducation et la culture Un décret, en cours d'élaboration au sein du ministère de l'économie et des finances, déterminera les conditions de fixation des tarifs de la restauration scolaire, modifiant le décret du 19 juillet 2000 encadrant les prix de la restauration scolaire. Une circulaire en date du 2 décembre 2005 a précisé les conditions dans lesquelles s'appliquait l'obligation de la participation des communes de résidence aux dépenses des écoles élémentaires privées. Demeurent en suspens le transfert aux régions du financement du fonctionnement et de l'investissement des quatre écoles de la marine marchande, ainsi que la possibilité offerte à un groupement de communes, un epci ou une commune de mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le domaine culturel, deux décrets d'application publiés le 23 juillet 2005 ont porté, d'une part, sur le contrôle scientifique et technique dans le domaine de l'inventaire général du patrimoine culturel, et, d'autre part, sur les conditions requises pour exercer la responsabilité de chef de service chargé des opérations d'inventaire général du patrimoine culturel (80). En outre, une circulaire relative aux modalités de mise en œuvre de ce dispositif a été adressée aux préfets de région et de département le 1er août 2005. En application des dispositions introduites par les articles 95 et 96 de la loi, six conventions de mise à disposition ont été signées en Alsace, Centre, Île-de-France, Limousin, Lorraine et Haute-Normandie. Dans les autres régions, les services régionaux de l'inventaire seront mis à disposition à la suite d'un arrêté interministériel préparé conjointement par le ministère de l'intérieur et par le ministère de la culture. Un décret d'application du 20 juillet 2005 a fixé la liste des monuments historiques proposés au transfert (81). Le projet de liste a été arrêté à la suite des conclusions du rapport de la commission présidée par René Rémond, qui s'est réunie entre juillet et octobre 2003. Cette commission avait retenu la règle d'une affectation locale, la propriété de l'État étant considérée comme l'exception. La propriété de l'État se justifie, selon la commission, pour trois catégories de monuments : les lieux de mémoire nationale, commémoratifs de grandes dates de l'histoire de France, les anciens biens de la couronne, représentatifs de la constitution de l'État national, les archétypes architecturaux dont la qualité exceptionnelle et la valeur pédagogique justifiaient la possession par l'État. À ces trois catégories, la commission « Rémond » a ajouté les sites archéologiques constituant des réserves et les grottes ornées dont la fragilité et la complexité d'exploitation exigent la compétence de l'État. En l'état actuel, sept collectivités territoriales ou groupements ont officiellement transmis leur candidature. Par exemple, le conseil général du Bas-Rhin est candidat pour le transfert du château du Haut-Koenigsbourg, la ville de Nice pour celui du Fort du Mont-Alban, le conseil général du Puy-de-Dôme pour le Temple de Mercure, la communauté de communes du Neuvillois pour le site antique des Tours Mirandes. Sur les cent soixante-seize monuments proposés au transfert, soixante ont fait l'objet, à ce jour, de demande de dossiers d'information par des collectivités territoriales, conformément à la loi et au décret. Le décret d'application du 20 juillet 2005 a déterminé les modalités d'application de l'article 99 de la loi confiant aux régions et, à défaut, aux départements, dans le cadre d'une expérimentation la gestion des crédits affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers protégés n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics. Le décret définit les catégories de professionnels auxquels sera confiée la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration. Tous les décrets permettant l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux enseignements artistiques de la loi n'ont pas encore été publiés. · Le transfert des personnels Le processus de transfert des personnels a pu ainsi aboutir. Tous les textes qui fixent les règles ont été publiés, tous les personnels concernés ont été identifiés. À partir des conventions ou des arrêtés de mise à disposition, les personnels qui se trouvaient dans le champ des transferts ont été identifiés. Le 10 décembre 2004, a été publié le décret relatif à la commission commune entre les conseils supérieurs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale (82). Le 5 janvier 2005, le décret relatif à la convention type et à la mise à disposition des personnels a été publié (83). A pu s'engager toute la négociation sur les conventions dans les trois mois qui ont suivi. Le résultat a été décevant sur les conventions relatives aux tos parce qu'il y avait un discours de positionnement de l'opposition. En cas d'échec, une commission de conciliation devait intervenir. Il a fallu analyser les motifs exacts de l'échec des négociations et, pour chaque arrêté, il a fallu motiver. Le ministre chargé des collectivités locales a souhaité encourager les discussions. Plusieurs réunions de la commission de conciliation ont permis de déboucher sur un accord-cadre entre les associations d'élus et l'État prévoyant que les rectorats proposeraient leur aide aux collectivités locales pendant l'année du transfert. Cet accord a été validé en commission de conciliation et les arrêtés ont été publiés. Le 2 décembre 2005, quatre décrets relatifs aux cadres d'emploi spécifiques pour l'accueil des tos ont été publiés : décrets du 30 novembre 2005 n° 2005-1482 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, n° 2005-1483 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement, n° 2005-1484 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement et n° 2005-1485 portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement. Parallèlement, un décret a été publié le 31 décembre 2005 sur les homologies entre les corps de la fonction publique de l'État et les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale (84). Ce travail a été mené dans le souci d'éviter à la fois les effets d'aubaine et la perte de droits acquis pour les fonctionnaires d'État. Des problèmes dans la fonction publique territoriale ont été identifiés à cette occasion et les textes ont été modifiés pour améliorer la parité entre les deux fonctions publiques. Par exemple, il existait, dans la fonction publique territoriale, des surveillants de travaux qui avaient accès à des concours de catégorie A sans transiter par un poste de technicien. Une facilité identique a été ouverte dans la fonction publique de l'État. Puis, a été publié le décret de détachement sans limitation de durée le 31 décembre 2005 (85). Dès lors, chaque ministère peut publier son décret de transfert ; l'éducation nationale l'a fait. Les 93 000 tos ont été transférés. Les textes concernant le ministère de l'équipement sont en cours de publication. La mise à disposition des personnels de l'équipement va se faire entre le 1er janvier et le 31 mars 2006, pour tous les personnels, ceux qui travaillent pour les routes départementales comme pour les routes nationales. Les arrêtés de mise à disposition pourront être pris en avril prochain. D'audit en contre-audit, de menaces en ultimatum, le montant des compensations financières des nouveaux transferts a été déterminé, en particulier pour le partage du réseau routier, la compensation du revenu minimum d'insertion et les dévolutions de personnels tos. - Une compensation financière garantie À l'appui de ces transferts, des garanties financières ont été inscrites dans notre droit. Le cadre défini par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, par la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales et par la loi du 13 août 2004 qui prévoit une « compensation intégrale, concomitante, contrôlée et respectueuse du principe d'autonomie financière » offre des conditions sans précédent en faveur des collectivités territoriales. Pour le fonctionnement, l'article 119 de la loi du 13 août 2004 précitée prévoit ainsi que « le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées (...) est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences ». Il dispose également que « le droit à compensation des charges d'investissement transférées (...) est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences ». La loi renvoyant à un décret en Conseil d'État, le décret n° 2005-1509 du 6 décembre 2005 prévoit les normes d'actualisation des dépenses et précise également la période de référence à prendre en compte. Le décret définit le taux d'actualisation comme l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tel que constaté à la date des transferts. La période de référence à prendre en compte varie selon les biens transférés : elle est de cinq ans pour le domaine public routier national, de dix ans pour les aérodromes civils, les ports maritimes, les établissements d'enseignement agricole, les établissements à sections binationales ou internationales et les écoles de la marine marchande. Pour l'investissement, l'article 121 de la loi du 13 août 2004 prévoit également un décret d'application. Le décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005 détermine la base d'évaluation de la ressource consacrée par l'État aux routes transférées et la méthode de répartition de cette ressource entre les départements ou éventuellement, dans le cas de l'outre mer, les régions bénéficiaires de ces transferts. La compensation attribuée à chaque département métropolitain est déterminée en fonction de ratios moyens actualisés, calculés sur la base des dépenses effectuées au cours des périodes de référence fixées par l'article 119 de la loi et son décret d'application. Cette méthode est applicable aux charges d'investissement et de fonctionnement respectivement mentionnées au III de l'article 121 et au quatrième alinéa du I de l'article 119 de la loi, soit une période de référence de cinq ans pour les charges d'investissement et de trois ans pour les charges de fonctionnement. Elle permet de prévenir les effets d'aubaine ou d'éviction qui auraient pu résulter d'un recensement analytique des dépenses sur une période trop courte par rapport au cycle de vie des ouvrages routiers. Sur la base des principes précités, les transferts de compétences intervenus en 2005 ont fait l'objet, sur le fondement de l'article 52 de la loi de finances initiale pour 2005, d'une compensation provisionnelle pour un montant de 397,8 millions d'euros de taxe intérieure sur les produits pétroliers (tipp) au profit des régions et de 126,6 millions d'euros de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (tsca) au profit des départements. En 2005, la commission consultative sur l'évaluation des charges (ccec) a approuvé dix arrêtés interministériels fixant le droit définitif à compensation, ce qui a conduit à devoir réajuster ces montants à hauteur de 441,2 millions d'euros pour les régions et 136,7 millions d'euros pour les départements. Pour les départements, les compétences transférées ont porté sur : le faj pour 13,85 millions d'euros ; la mise en œuvre de la politique en faveur des personnes âgées consistant à transférer les crédits de fonctionnement afférents au financement des clic et des coderpa pour un total de 18,26 millions d'euros ; le fsl auquel sont associés les fonds eau-énergie, pour un total de 93,4 millions d'euros ; les conventions de restauration à hauteur de 5,64 millions d'euros ; les crédits d'intervention dédiés à la conservation du patrimoine rural non protégé pour 5,39 millions d'euros. Pour les régions, les compétences transférées ont concerné : le financement des écoles de formation des travailleurs sociaux à hauteur de 134,43 millions d'euros ; les aides aux formations des travailleurs sociaux pour 20,86 millions d'euros ; le financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes pour un total de 441,15 millions d'euros ; les aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes à hauteur de 63,09 millions d'euros ; le financement de l'inventaire général du patrimoine culturel pour 2,25 millions d'euros. Le financement du transfert des lycées et collèges à sections binationales ou internationales et du collège et lycée d'État de Font-Romeu s'est traduit par un abondement de la dotation générale de décentralisation (dgd) aux départements et régions concernés pour un montant respectif de 2,2 millions d'euros et 3,3 millions d'euros. La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 s'est traduite, pour 2006, par l'inscription dans la loi de finances initiale d'une compensation provisionnelle au titre des transferts devant intervenir en 2006 pour un montant de 572,4 millions d'euros de tipp pour les régions et de 110 millions d'euros de tsca pour les départements. Les départements bénéficieront ainsi en 2006 de la pérennisation de la compensation résultant de l'accroissement de la participation des départements au sein du conseil d'administration du stif, du financement des crédits de vacations, des agents contractuels de droit public ainsi que des emplois aidés dans le cadre du transfert des tos des collèges, de la compensation de la suppression de la vignette automobile. Quant aux régions, elles bénéficieront d'une compensation de l'accroissement de la participation de la région Île-de-France au conseil d'administration du stif, l'organisation du réseau des centres d'information sur la validation des acquis de l'expérience, le financement de l'afpa par la seule région Centre, l'extension en année pleine du transfert du financement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes intervenu au 1er juillet 2005 ainsi que le financement des crédits de vacations, des agents contractuels de droit public ainsi que des emplois aidés dans le cadre du transfert des tos des lycées. - Des résultats satisfaisants Au total, soixante-six décrets étaient prévus par la loi dès la promulgation du texte. Au 15 janvier 2006, quarante-huit d'entre eux avaient d'ores et déjà été publiés au Journal officiel, soit un taux de 73 %. S'y ajoutaient cinq textes en cours de contreseing ministériel, deux textes examinés par le Conseil d'État et trois autres décrets finalisés ayant fait l'objet d'accord interministériel, ce qui permet de porter le total à 90 %. Les décrets encore à élaborer concernent notamment la fixation de liste de collectivités autorisées à participer à certaines expérimentations comme celles en matière d'agences régionales d'hospitalisations ou d'insalubrité qui sont en cours de finalisation, mais aussi la décentralisation des écoles de la marine marchande. En analysant l'« acte II » de la décentralisation, il faut bien relever que les difficultés qui demeurent ne sont pas liées directement à cette étape, mais plus sûrement au champ social, qui connaît des mouvements débouchant, en réalité, non sur des compétences transférées mais sur le transfert de droits et de leur gestion. Le processus du 13 août 2004 a été mis en place avec de nombreuses sécurités, sans commune mesure avec ce qui s'était passé en 1982. Reste à savoir combien d'actes compte la pièce de la décentralisation. Il semble bien que l'histoire ne soit pas achevée et qu'un nouvel acte doive être écrit. C. UN POUVOIR NORMATIF RESTREINT « Les compétences (des) autorités décentralisées ne se réduisent pas (...) à la capacité d'effectuer des opérations matérielles, de passer des contrats ou de prendre des décisions individuelles. L'exercice de la compétence transférée réside souvent dans le pouvoir de fixer des règles générales. » (86) La reconnaissance du pouvoir normatif local reste limitée, même si celui-ci a fait l'objet d'une consécration constitutionnelle. a) Un pouvoir réglementaire étique avant 2003 Avant la révision constitutionnelle de mars 2003, le pouvoir réglementaire appartenait au seul Premier ministre en application des articles 21 et 37 de la Constitution (87), sous la réserve des hypothèses du pouvoir réglementaire exercé par le Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution. Les ministres disposaient d'un pouvoir résiduel, limité au seul champ de l'organisation de leurs services (88), de la même façon que les préfets, des directeurs d'établissements publics, certaines autorités administratives indépendantes, certaines personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public comme les ordres professionnels, les fédérations sportives (89) ou les sociétés gérant un service public industriel et commercial. Après la loi de décentralisation de 1982, un débat important s'est engagé pour déterminer si les collectivités locales disposaient ou non d'un pouvoir réglementaire. Pour certains, la libre administration des collectivités territoriales devait permettre à leurs conseils élus de prendre directement des actes de nature réglementaire (90). Pour d'autres, en revanche, le principe de libre administration n'implique que l'existence de conseils élus et le caractère administratif de son régime (91). De manière plus nuancée, on pouvait retenir, à l'instar du Conseil d'État (92), que les compétences réglementaires confiées aux autorités locales s'exerçaient dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par la loi et par les règlements étatiques la mettant en application. Il s'agit alors d'exercer des compétences réglementaires spéciales et non pas d'un pouvoir général permettant d'assurer la mise en œuvre de toute loi intervenant dans le domaine des intérêts de la localité (93). La libre administration ne signifie pas la libre réglementation, la première étant subordonnée à la seconde. Les compétences réglementaires des collectivités ne pouvaient elles-mêmes que résulter d'un pouvoir résiduel et secondaire, lui-même conditionné par les décrets du Premier ministre (94). La plupart des règles relatives à la libre administration des collectivités territoriales, qu'il s'agisse de la répartition des compétences entre l'État et les collectivités (95), de l'imposition à ces dernières d'obligations (96) ou encore de la détermination des principes fondamentaux de la tutelle administrative et du contrôle administratif relèvent du domaine de la loi. Les mesures réglementaires d'application des lois appartiennent au pouvoir réglementaire national (97). Lorsque la loi est insuffisamment précise, mais nécessite un décret d'application, le pouvoir réglementaire d'une collectivité locale est exclu tant que ce décret n'aura pas été pris (98). La collectivité territoriale ne se voit reconnaître un pouvoir réglementaire que si le décret n'était ni prévu par la loi, ni nécessaire (99). Dans sa décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, le Conseil constitutionnel a ainsi considéré que le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales, qui résultait d'une disposition constitutionnelle dépourvue de toute ambiguïté, le deuxième alinéa de l'article 72, était cependant subordonné à ceux du Premier ministre (100) et du Président de la République et saurait être de nature à remettre en cause l'exercice d'une liberté individuelle ou d'un droit fondamental. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent édicter des mesures pour leur organisation, concernant, par exemple l'élaboration du règlement intérieur (101) ou la fixation du nombre des adjoints au maire (102). Elles peuvent également prendre des règlements destinés à l'ensemble de leurs habitants, soit sur habilitation expresse du législateur, à l'exemple de la fixation des règlements locaux d'urbanisme, des taux des quatre principaux impôts locaux ou encore des règlements départementaux d'aide sociale ou encore des pouvoirs de police spéciaux (en matière de ports par exemple), soit pour mettre en place des services publics, soit, enfin, pour régler des situations de fait, notamment en matière de police municipale. b) La reconnaissance constitutionnelle de ce pouvoir Désormais, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 72 de la Constitution, tels que rédigés par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » et « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». Si ce pouvoir ne peut pleinement s'exercer que si le Premier ministre ne met pas le sien en œuvre, il reste secondaire mais n'est plus indirect. Il ne s'agit plus de mesures d'application de la loi mais de mesures d'exécution de celle-ci. Il est possible que les nouvelles dispositions constitutionnelles permettent à « la loi de renvoyer plus systématiquement au pouvoir réglementaire local et non au pouvoir réglementaire national le soin de fixer les modalités d'application de la loi (...) et de lever un doute quant à la capacité de la loi de disposer d'une réelle latitude afin de confier à une catégorie de collectivités locales le soin de prendre les mesures d'application de la loi ». (103) Outre le fait que cette disposition constitutionnelle vient largement consacrer un état du droit, la mise en œuvre de ce pouvoir réglementaire se heurte, elle aussi, à l'éclatement de la carte des collectivités, en particulier à celle de la carte communale et pourrait, dans la pratique, nécessiter de le réserver aux seuls communautés, départements et régions, tant on voit mal 36 800 entités définir des mesures d'exécution de la loi. Par ailleurs, il faut tenir compte du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution qui ouvre aux collectivités territoriales, notamment aux régions, le droit à l'expérimentation pour déroger, « pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences ». In fine, les collectivités territoriales demeurent des entités administratives dont la production administrative est susceptible d'un contrôle normatif qui relève du contentieux administratif, sur déféré de l'autorité administrative habilitée à cette fin. 2. Une dépendance normative stricte Le pouvoir réglementaire local est considéré comme distinct de celui du Premier ministre. Il découle de la seule loi et ne se déduit pas directement de la Constitution comme celui du chef du Gouvernement, qui n'a, par conséquent, pas besoin d'habilitation législative expresse pour s'exercer. En outre, son champ est limité aux compétences des collectivités alors que le Premier ministre possède un champ d'intervention général, comme l'a rappelé le ministre chargé des collectivités locales lors des débats sur la révision constitutionnelle de 2003 (104). La reconnaissance au plus haut niveau du pouvoir réglementaire local ne remet donc nullement en cause les jurisprudences antérieures du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Le pouvoir réglementaire local ne saurait être concurrent de celui du Premier ministre, car il n'est pas de même nature. La capacité normative des collectivités locales reste donc toujours subsidiaire par rapport au pouvoir réglementaire du Premier ministre. Les collectivités territoriales ne sont attributaires que de fragments de divers processus d'exécution des lois et règlements. Au-delà de ces faibles pouvoirs réglementaires, les compétences confiées aux collectivités territoriales sont en réalité dépendante du seul pouvoir normatif de l'État, « maître des normes de satisfaction du bien-être social » (105). Le contenu de ces règles et les modalités de leur application relèvent de son seul pouvoir. Comme le rappelle Pierre-Laurent Frier à propos de la révision constitutionnelle de 2003, « le texte de la révision constitutionnelle confirme le caractère toujours subordonné du pouvoir réglementaire local, attesté par l'alinéa 3 de l'article 72 : c'est à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, qu'il autorise les collectivités locales à déroger provisoirement à telle ou telle disposition du pouvoir réglementaire national. Ainsi, outre les conditions générales fixées par la loi organique, une telle dérogation doit être prévue, à ce stade, par le pouvoir réglementaire national, qui reste seul compétent pour autoriser l'atteinte au bloc des sources réglementaires qui découlent de la multitude des décrets, sans, bien entendu, que la dérogation autorisée puisse porter atteinte aux dispositions de loi d'application générale. On ne saurait mieux montrer, quelques lignes après avoir expressément reconnu le pouvoir réglementaire local, son caractère subordonné : il ne peut agir qu'en respectant la réglementation nationale sauf s'il est autorisé par cette même réglementation à y déroger, et encore de façon très réduite et limitée. » (106) Le pouvoir réglementaire local reste donc résiduel avec un champ d'application restreint et un contenu très encadré. Les lois qui invitent les collectivités à participer à l'administration du territoire dans les conditions posées par l'État central, voire leur imposent de s'y substituer, sont nombreuses. Mais cette intrusion s'arrête aux portes de la norme. Certes, le Premier ministre, lors de son intervention à l'occasion de la première réunion de la Conférence nationale des finances publiques, le 11 janvier 2006, s'est engagé à ne rien entreprendre dans le domaine normatif sans consulter au préalable les collectivités locales : « Les collectivités devront être mieux associées aux décisions qui les concernent : les marges d'initiative et d'action des collectivités locales sur les compétences transférées devront être élargies ; dans les compétences transférées, je suis prêt, comme me l'ont demandé les représentants de l'amf et de l'adf, à un moratoire sur toute nouvelle norme, sauf naturellement en cas d'accord des collectivités concernées. » Mais la consultation n'est pas la production. Ce carcan, révélateur des difficultés du système français à sortir des schémas réels ou rêvés issus de la Révolution, pourrait trouver un peu d'oxygène dans la promotion de l'expérimentation normative, même si le dispositif adopté ne constitue pas en lui-même une nouvelle révolution. L'expérimentation doit d'abord être « un vecteur d'adhésion ». Elle permet de convaincre les collectivités de la pertinence d'une réforme avant d'en tirer une règle générale. Elle est ensuite « un facteur d'efficacité » parce qu'elle permet d'établir des bilans d'étape, de s'assurer que toutes les données ont été prises en compte, d'apporter éventuellement des corrections. Enfin, elle permet « de s'assurer que les nouvelles règles sont bien adaptées aux nouvelles réalités » (107). L'expérimentation, si elle ouvre des possibilités d'initiative inédites aux collectivités territoriales, reste définie par les lois d'un centre qui garde la maîtrise des dérogations aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Fixée dans la Constitution, cette novation s'inscrit néanmoins dans une certaine continuité (108), qui s'était déjà matérialisée dans une proposition de loi constitutionnelle pour la reconnaissance d'un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales, déposée en 2000 par notre collègue Pierre Méhaignerie (109). 1. L'expérience des expérimentations Utilisée au profit de l'État à plusieurs reprises, l'expérimentation constitue une « procédure de mise au point sur un échantillon » qui, s'intégrant à un processus de réforme, en constitue « la première phase opératoire dont la fonction demeure limitée et dont l'objet (...) est de faire l'économie des inconvénients inhérents à l'application immédiate de mesures généralisées » (110). Ainsi, la réforme des services de l'État dans le département fut testée dans plusieurs départements en 1962 avant d'être généralisée, de la même façon que la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information ouvrit plusieurs expérimentations. La préparation de la lolf a également donné lieu à de nombreuses expérimentations (111). Le juge constitutionnel a été amené à encadrer ce type de pratiques. Ainsi, dans sa décision de 1993 relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (112), il reconnaît « qu'il est même loisible au législateur de prévoir la possibilité d'expériences comportant des dérogations (...) de nature à lui permettre d'adopter par la suite, au vu des résultats de celles-ci, des règles nouvelles », mais pose comme condition le caractère explicite de l'expérimentation : « toutefois, il lui incombe alors de définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations, les cas dans lesquels celles-ci peuvent être entreprises ». De surcroît, il établit les conditions relatives à la fin de l'expérience, puisqu'il appartient au législateur de définir précisément « les conditions et les procédures selon lesquelles (les expérimentations) doivent faire l'objet d'une évaluation conduisant à leur maintien, à leur modification, à leur généralisation ou à leur abandon ». En 1994 (113), le Conseil constitutionnel précise la décision de 1993 en rappelant le caractère nécessairement provisoire de l'expérimentation. À propos de la loi du 1er février 1994 qui, dans son article 11, autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel (csa) à délivrer, sans procéder à un appel de candidatures, des autorisations d'émettre à un service de télévision hertzienne pour une durée n'excédant pas six mois, le Conseil juge ce texte conforme à la Constitution au motif que « le législateur a pu estimer que la procédure d'appel à candidatures (...) était inadaptée par sa lourdeur à des expériences occasionnelles ou saisonnières ». Il juge, en outre, qu'« une telle autorisation de caractère temporaire doit être entendue comme ne permettant pas de renouvellement immédiat au regard des règles (...) d'appel à candidatures. Que sous cette réserve d'interprétation, les dispositions de l'article 11 ne méconnaissent aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle ». Par ailleurs, plusieurs expérimentations ont été menées par des collectivités territoriales sans texte. Ainsi a été expérimentée la gestion régionalisée de certaines lignes de chemin de fer. Certaines régions s'étaient engagées, dès les contrats de plan 1984-1989, à prendre à leur charge l'acquisition de certains matériels de chemin de fer de la sncf dans le cadre de conventions passées avec l'accord de l'État. Après l'échec du contrat de plan entre l'État et la sncf, qui prévoyait le transfert de compétences aux régions, la loi portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » disposa que les régions pourraient être « autorités organisatrices des services régionaux de voyageurs » dans le cadre d'une expérimentation. Celle-ci commença en 1997 pour une durée de trois ans. Elle reposait sur quatre principes : la réversibilité, le volontariat, la coopération et la contractualisation. Les résultats de l'expérimentation ont été jugés satisfaisants et la loi dite « sru » du 13 décembre 2000 a étendu le mécanisme à toutes les régions (114). D'autres expérimentations ont été menées sur le fondement de textes précis. Ainsi, la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale disposait, dans son article 38, que « des conventions conclues entre certains départements, des organismes de sécurité sociale et, éventuellement, d'autres collectivités territoriales définissent, dans le cadre d'un cahier des charges établi, au plan national (...) les conditions de la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes ». La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance consacra ce processus. Selon la même logique, la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, dans ses articles 104 et suivants, ouvrait des expérimentations en matière de décentralisation de la gestion portuaire, de la gestion des aérodromes civils, mais aussi en matière de décentralisation culturelle. En matière culturelle, par exemple, la loi instituait, pour une durée de trois ans et dans des conditions définies par conventions, une expérimentation permettant aux collectivités locales d'exercer les compétences de l'État dans les domaines suivants : conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France, instruction des mesures de classement des monuments historiques, inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité. Ce transfert expérimental devait intervenir dans les douze mois de la promulgation de la loi et faire l'objet à son terme d'un rapport au Gouvernement et au Parlement afin d'établir son bilan. Dans cette même matière, le ministère de la culture engagea une autre expérimentation, sans base législative ni réglementaire, mais sur le fondement de protocoles de décentralisation culturelle, lancés en 2000 (115). Aucune collectivité territoriale n'a fait de demande d'expérimentation sur le fondement de la loi du 27 février 2002 précitée. 2. La consécration constitutionnelle a) De l'expérimentation matérielle à l'expérimentation normative Avant la réforme de 2003, si une expérimentation pouvait être menée sans qu'une loi ou un règlement n'intervînt, elle ne pouvait l'être que dans le cadre juridique existant. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 janvier 2002 relative à la Corse (116), avait ainsi censuré la reconnaissance de la possibilité pour la collectivité territoriale de Corse de prendre des mesures relevant du domaine de la loi, parce que la loi déférée était intervenue « dans un domaine qui ne relève que de la Constitution ». Pour déroger à une norme législative ou réglementaire, manquait donc une disposition constitutionnelle. En effet, il convient de distinguer deux types d'expérimentation, les expérimentations-transferts et les expérimentations-dérogations. Dans le premier cas, il s'agit de confier une nouvelle compétence à une collectivité - c'est le modèle retenu dans la loi relative à la démocratie de proximité et consacré dans l'article 37-1 de la Constitution (117) - et, dans le second, de confier à cette collectivité un pouvoir normatif intervenant dans le champ de la loi ou du règlement -c'est le modèle institué par le nouveau quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution (118). L'article 37-l consacre la possibilité pour le Parlement ou le Gouvernement de décider d'expérimentations. Dans ce cadre, il est notamment possible d'expérimenter le transfert aux collectivités territoriales de nouvelles compétences. Ce type d'expérimentations, qui peut être qualifié d'expérimentation-transfert, a connu une nouvelle impulsion grâce à la loi du 13 août 2004 précitée : élaboration d'un schéma régional de développement économique par la région (article 1er), transfert expérimental des aérodromes civils, avant leur transfert définitif au 1er janvier 2007 (article 28), mise en œuvre de la protection judiciaire de la jeunesse (article 59), participation à la réalisation d'équipements sanitaires par les régions (article 70), responsabilité de la politique de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans l'habitat (article 74), création d'établissements publics d'enseignement primaire par les communes ou leurs groupements (article 86), entretien et restauration du patrimoine classé n'appartenant pas à l'État (article 99). Toutes les régions se sont portées candidates pour élaborer le schéma régional de développement économique. Le dispositif relatif à la gestion des fonds structurels européens est actuellement expérimenté par les régions Alsace et Auvergne. En raison des délais restreints de mise en œuvre de l'expérimentation relative aux aérodromes, aucune demande n'a été recensée à ce jour et le nombre de candidatures devrait être limité. Comme on l'a vu, sept communes se sont portées candidates pour exercer la responsabilité de la politique de lutte contre l'insalubrité et le saturnisme dans l'habitat. Cinq régions ont déjà manifesté leur intérêt pour l'expérimentation permettant aux régions de s'investir dans le champ de l'organisation de l'offre de soins (119). Six départements ont transmis leur candidature au garde des sceaux, dont cinq sont recevables (120), pour la mise en œuvre des mesures d'assistance éducative prises pour un mineur par l'autorité judiciaire. En outre, certaines communes du Cher ont exprimé le souhait de mener une expérimentation tendant à créer des établissements publics d'enseignement primaire. Enfin, à la fin du mois de septembre 2005, une seule région semblait intéressée par la possibilité de se voir transférer la gestion des crédits affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers protégés n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics. Alors que ce premier type d'expérimentation, l'expérimentation-transfert, représente, comme on l'a vu, une modalité relativement courante de la décentralisation, le second, l'expérimentation-dérogation, constitue une véritable innovation juridique qui modifie la hiérarchie des normes et nécessite, en conséquence, un encadrement suffisant. C'est pourquoi la loi constitutionnelle de mars 2003 a ouvert, à l'article 72, alinéa 4, de la Constitution, le droit à l'expérimentation locale, à l'initiative des collectivités territoriales. Le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoit également une loi organique. Ce texte a été adopté peu de temps après avec la loi organique du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales. Il s'agit d'ouvrir, à l'échelon décentralisé, des possibilités de déroger aux règles en vigueur. Mais il ne s'agit plus seulement d'éviter les inconvénients liés à la généralisation immédiate d'un dispositif délicat à mettre en œuvre, mais de favoriser, par ce biais, la capacité d'initiative locale (121). À ce jour, aucune demande de collectivités territoriales n'a été recensée. b) Des conditions d'emploi strictement définies Le démarrage de l'expérimentation législative relève du législateur et de lui seul. Il nécessite l'adoption d'une loi d'habilitation L'expérimentation réglementaire est autorisée par le Gouvernement agissant par voie de décret en Conseil d'État. Législateur et Gouvernement gardent la main sur l'opportunité d'une expérimentation. La loi organique pose les conditions d'application de l'expérimentation normative. Le législateur doit en fixer la durée, qui vaut également pour l'expérimentation réglementaire, l'article L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales renvoyant à l'article L.O. 1113-1. Cette durée ne peut excéder cinq ans. Mais le législateur peut très bien décider de fixer une durée inférieure. L'expérience montre qu'une durée de trois années constitue un minimum. Ainsi, l'article L.O. 1113-6 prévoit la possibilité pour le législateur de décider une prolongation de l'expérimentation, qui ne peut excéder trois ans. L'objet de l'expérimentation doit être « limité ». La loi organique ne reprend pas, en revanche, puisqu'elle figure déjà dans l'article 72 de la Constitution, l'exclusion de l'expérimentation lorsque sont en cause « les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti », formulation reprise d'une jurisprudence constitutionnelle désormais bien établie. En vertu de l'article L.O. 1113-1 précité, la loi ou le décret « mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé », c'est-à-dire doit énumérer les dispositions susceptibles de faire l'objet de dérogations. Le même article L.O. 1113-1 dispose, dans son alinéa, que la loi « précise également la nature juridique et les caractéristiques » des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation. Il peut s'agir des collectivités territoriales répondant à des situations particulières telles que des villes dépassant un seuil de population, des communes de montagne, des collectivités situées sur le littoral... Ainsi, l'expérimentation n'est pas ouverte à toutes les collectivités territoriales. En revanche, les epci peuvent bénéficier d'une expérimentation, à l'exclusion des syndicats mixtes. La loi d'habilitation doit également fixer le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions qu'elle a fixées peuvent demander à bénéficier de l'expérimentation. L'article L.O. 1113-2 du code précité définit la procédure à suivre pour la collectivité qui souhaite expérimenter. Celle-ci doit demander, dans le délai fixé, à bénéficier de l'expérimentation mentionnée par la loi, par une « délibération motivée de son assemblée délibérante ». Cette délibération doit être transmise au préfet, qui doit lui-même adresser la demande « accompagnée de ses observations » au ministre chargé des collectivités territoriales. Le contrôle est exercé par le Gouvernement lui-même, l'article L.O. 1113-2 précité disposant que ce dernier « vérifie que les conditions sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation ». Admises à l'expérimentation, les autorités de la collectivité territoriale vont pouvoir édicter des actes dérogatoires à la législation de droit commun, actes qui incluent à la fois les actes de l'assemblée délibérante et les règlements pris par le maire. Elles doivent obligatoirement indiquer la durée de validité des actes. Le caractère exécutoire de ces actes ne dépend pas de la transmission au représentant de l'État, obligatoire, mais de la publication au Journal officiel. Cette procédure est identique à celle prévue pour la Corse à l'article L. 4422-17 du code précité. L'article L.O. 1113-4 du même code prévoit que le représentant de l'État exerce un contrôle sur les actes dérogatoires, qui conservent, en tout état de cause, un caractère administratif. Le représentant de l'État peut exercer un recours contre un acte dérogatoire. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension, à l'image de ce qui existe déjà dans le cadre de l'article L. 2131-6 du code précité pour les actes intervenant en matière d'urbanisme, de marché et de délégation de service public ou dans le cadre de l'article L. 4423-1 dudit code pour certaines délibérations de l'Assemblée de Corse. L'article L.O. 1113-5 organise une évaluation de l'expérimentation, le Gouvernement devant, avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, transmettre au Parlement un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation et qui « expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'État ainsi que leurs incidences financières et fiscales ». Dans le cas d'une expérimentation réglementaire, l'article L.O. 1113-7 dispose qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'évaluation des dispositions prises sur le fondement de l'autorisation, le Gouvernement devant adresser au Parlement un bilan des évaluations auxquelles il aura procédé. La loi organique prévoit trois hypothèses de sortie de l'expérimentation, mais il faut également envisager d'autres situations qui peuvent se présenter. Dans un premier cas, le législateur ou le Gouvernement peut déterminer les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Dans un deuxième cas, peut être décidé « le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ». Dans un troisième cas, l'expérimentation peut être abandonnée, parce que celle-ci n'a pas donné de résultats décisifs. Le législateur a également décidé que le dépôt d'une proposition de loi ou d'un projet de loi ayant l'un de ces trois effets prorogeait l'expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Outre ces cas prévus par la loi, il faut envisager les hypothèses d'un abandon en cours de l'expérimentation par la collectivité bénéficiaire et d'absence de texte déterminant les suites à donner. Reste posée également la question de la publicité de l'abandon de l'expérimentation. Le Conseil constitutionnel a fait le lien entre l'article 37-1 de la Constitution en vertu duquel « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental » et du quatrième alinéa de l'article 72. En effet, il a admis implicitement que cette disposition-ci ne faisait pas obstacle à ce que la loi comporte, sur le fondement de cet article-là, des dispositions à caractère expérimental concernant les collectivités territoriales (122). Par ailleurs, le Conseil recherche si le législateur a défini de façon suffisamment précise l'objet et les conditions des expérimentations en cause (123). Le Conseil a validé la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales. Il a en effet jugé qu'en retenant les modalités prévues aux articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 du code général des collectivités territoriales et, notamment, en liant la compétence du pouvoir réglementaire pour dresser la liste des collectivités territoriales admises à participer à une expérimentation, ainsi qu'en prévoyant, le cas échéant, la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le législateur organique n'est pas resté en deçà de l'habilitation qui lui était conférée par le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et n'en a pas davantage excédé les limites. (124) Certes, le dispositif mis en place en 2003 est très loin de constituer « une voie sans retour, un itinéraire bis qui mène à la destruction de l'unité de la République et des solidarités nationales » ou encore « un outil au service d'une politique de casse et de démantèlement, des services publics en particulier », propos outranciers entendus lors du débat sur la loi organique. Mais, ces dispositions relatives à l'expérimentation intéressent directement l'équilibre territorial des pouvoirs, car elles pourraient porter en germe une nouvelle répartition des compétences. Il n'en reste pas moins qu'en l'état, ce type de solutions « dérivatives » ne saurait installer un nouvel équilibre territorial des pouvoirs pérenne et ne fait que retarder le blocage. En effet, la complexité de notre organisation institutionnelle territoriale est devenue telle que le système pourrait bien devenir autobloquant et les mécanismes qui permettent aujourd'hui d'assurer une certaine fluidité − l'intercommunalité, les pays, l'expérimentation, la contractualisation − risquent fort de n'avoir qu'un effet temporaire. LE MALAISE DE L'ÉTAT TERRITORIAL Dans la conception française, l'État est un sommet, plus qu'un centre : c'est de lui que tout dérive, et c'est vers lui que tout remonte. Les qualificatifs se multiplient pour désigner l'État aujourd'hui : « État stratège » (125), « État creux », « État animateur » (126), « État subsidiaire » (127), « État post-moderne » (128), « État rusé ». Tous disent la mutation de l'institution, sans en définir réellement la nature. Pour reprendre les termes de Paul Ricœur, « le site de l'État n'est plus clair dans la conscience des citoyens ». Avec la décentralisation est demandée aux services de l'État une forme de « loyauté résignée » (129) qui a provoqué ou provoque au sein de l'administration territoriale une sorte de malaise. Mais, nombreux sont les auteurs qui ont montré que l'institutionnalisation des formes de gouvernance polycentrique par le biais du développement de la notion de réseaux, loin de faire disparaître l'État, le conduit à repenser son rapport au territoire et à se reconstruire comme centre, y compris à travers la décentralisation (130). Ainsi, comme le relevait le commissariat général du Plan en janvier 1993 dans son rapport sur L'État stratège (131), l'État conserve trois missions exclusives : l'essentiel des missions régaliennes, la mission de garant de la légalité, celle de garant de la solidarité entre collectivités décentralisées. Dans les autres domaines, l'État ne peut jamais être absent : certaines compétences ne peuvent pas être décentralisées ; lorsque des compétences sont transférées, l'État doit veiller à la cohésion nationale, notamment en édictant des normes qui tracent le cadre dans lequel s'exerce l'autonomie des collectivités décentralisées. Il reste aux commandes en cherchant à se déconcentrer. Mais, la déconcentration continue de se chercher plus de quarante ans après les textes de 1964, plus de vingt ans après les premières lois de décentralisation, plus de dix ans après la charte de la déconcentration, plus d'un an après l'« acte II » de la décentralisation. Reste posée la question de la place de l'État qui, dans un contexte de globalisation, tend à se re-territorialiser. La déconcentration caractérise le processus de transfert, au sein d'une même institution, du pouvoir de décision détenu par les autorités les plus élevées à des autorités moins élevées dans la hiérarchie interne de l'institution. C'est une redistribution du pouvoir de décision dans le sens d'une moindre concentration au sommet. Les attributions de l'institution, en l'espèce l'État, ne sont pas réduites, toutes choses étant égales par ailleurs. Selon l'image quelque peu excessive mais éclairante d'Odilon Barrot, premier vice-président du Conseil d'État sous la IIIe République, à propos des préfets, bénéficiaires traditionnels de la déconcentration, « c'est le même marteau qui frappe ; seulement on en a raccourci le manche ». Au-delà de la formule, le rapporteur ne peut que constater les progrès réalisés en cette matière depuis plus de dix ans. Ces progrès s'inscrivent dans un effort de clarification de la part de l'État qui a cherché à affirmer ses priorités stratégiques à l'échelon territorial en même temps qu'il cherchait, à l'échelon de chaque structure ministérielle, à dresser les grandes lignes de sa réforme. Ce travail s'est accompagné d'une profusion de documents stratégiques dont le lien pourtant réel avec la volonté affichée de déconcentration n'apparaît pas assez clairement. I. - LE RISQUE DE FRAGMENTATION La question même du renforcement de la déconcentration accompagnant celui de la décentralisation est posée. La commission présidée par Michel Pébereau, par exemple, la pose en ces termes : « Quant à la déconcentration, même si elle est tout à fait souhaitable, on peut s'interroger sur les conditions de sa mise en œuvre. Coexistent en effet aujourd'hui dans la plupart des ministères des structures au niveau régional, départemental, voire en deçà (sous-préfectures, subdivisions de l'équipement...), sans que leur nécessité apparaisse aussi clairement que dans le passé, lorsqu'elles permettaient de couvrir un territoire et une population alors largement ruraux. Rien ne permet en outre d'affirmer que la décentralisation vers les collectivités territoriales s'est accompagnée d'une révision systématique à la baisse des moyens des administrations déconcentrées. » (132) Si l'impératif de déconcentration ne fait pas de doute, ce mouvement s'accompagne d'une prolifération des cadres stratégiques et d'un éclatement de la carte administrative qui ont un effet de dilution et d'illisibilité de l'action de l'État. A. L'IMPÉRATIF DE DÉCONCENTRATION La déconcentration est la « politique ayant pour objet d'aménager les rapports entre les administrations centrales et leurs échelons territoriaux dans le sens d'une plus grande délégation de responsabilité consentie à ces derniers » (133). Elle a été pratiquée avant d'être qualifiée, en 1895, date à laquelle est établie la distinction entre déconcentration et décentralisation (134). Progressivement, les avancées de l'autonomie locale ont contribué à donner corps aux notions de niveau local d'administration et d'administration territoriale. Pour s'adapter à la diversité des territoires, l'État a l'obligation de s'adapter. Cette adaptation passe nécessairement par une plus grande déconcentration. La déconcentration n'est plus aujourd'hui pensée comme un substitut à la décentralisation. Au contraire, elle semble désormais indissociable de cette dernière au point d'en devenir, telle la tunique de Nessus de la décentralisation, une composante nécessaire. Au plan social, le citoyen dans ses dimensions d'électeur, d'administré et d'usager, demande de la proximité, de la qualité et de la souplesse, la garantie de la transparence et de la régularité des procédures publiques et déplore l'absence de réponse à l'expression de certains besoins sociaux. L'État, pour rencontrer ces aspirations à une plus grande proximité des lieux de décisions, repense sa propre organisation. Pour répondre à ces attentes, il doit mettre en œuvre le principe d'adaptation, de mutation, caractéristique du service public : « La survie d'un organisme biologique ou social est fonction de sa capacité d'adaptation à son environnement » (135). « Toutes les administrations connaissent le principe d'adaptation ou de mutabilité, véritable " loi " en effet des structures et des services (...). S'adapter ou disparaître n'est pas seulement une loi applicable aux êtres vivants mais aussi aux structures administratives, même si celles-ci montrent une remarquable capacité de résistance. » (136) La circulaire du Premier ministre du 23 février 1989 relative au renouveau du service public constatait ainsi l'idée que la « nécessité d'une adaptation de l'État peut parfois accompagner ou devancer les mutations profondes que connaît la société française a mis du temps à s'imposer » et encourageait à « faire autant en matière de déconcentration que ce qui a été réalisé avec les lois de décentralisation ». La déconcentration est certes un ensemble de mesures techniques visant à améliorer le fonctionnement interne de l'État, mais c'est aussi un véritable projet de société avec ses objectifs propres, ses méthodes nouvelles de management et d'action sur le terrain des fonctionnaires, qui se traduit par une affirmation progressive de l'administration territoriale. 2. L'affirmation progressive de l'administration territoriale de l'État La déconcentration a pour objectif à la fois de rapprocher l'administration des citoyens, de la rendre mieux identifiable en tout point du territoire, plus efficace dans le traitement de leurs demandes, et d'instaurer des rapports plus directs entre l'État et les collectivités territoriales. La première grande période de déconcentration date du début du Second Empire avec le décret du 24 mars 1852 qui met en œuvre la maxime selon laquelle « on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près ». Le pouvoir est partiellement redistribué aux échelons déconcentrés. Le préambule du décret relève l'utilité de déconcentrer face « aux lentes formalités de l'administration centrale » en y substituant « l'action prompte des autorités locales ». Il met en œuvre ce qu'un publiciste décrivait dix ans auparavant : « Une portion de ce qui se fait aujourd'hui sous l'autorisation du ministre pourrait se faire mieux et plus vite sous l'autorisation du préfet. Il ne faut pas, en effet, vouloir régler de loin et par de grands principes les petites affaires qui ne se traitent bien que sur les lieux mêmes, avec promptitude et par de petits moyens employés à propos. » (137) Ce sont les prémices de la déconcentration. Puis, le préfet a vu son autorité sur les moyens matériels et humains s'affirmer très lentement. Après la deuxième guerre mondiale, décentralisation et déconcentration devaient être conçues de conserve. La déconcentration est introduite dans la Constitution qui, dans son article 88, dispose que : « La coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État (est) assurée, dans le cadre départemental, par les délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres ». L'article 89 prévoit que « des lois détermineront également les conditions dans lesquelles fonctionneront les services locaux des administrations centrales, de manière à rapprocher l'administration des administrés ». Ainsi, un projet de création d'une « municipalité départementale » élue fut déposé le 22 mai 1947 et un projet de déconcentration départementale le sera le 6 mars 1948. Mais, les discussions n'aboutirent pas et un décret-loi en date du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets, pris sur le fondement de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, accorda de nouveaux pouvoirs à l'échelon déconcentré, sans pour autant se traduire, dans les faits, par un réel progrès dans ce sens. Les chefs de services conservent un lien fort avec leur administration centrale, par-dessus les préfets. La déconcentration verticale est privilégiée au détriment de la déconcentration horizontale, au profit des préfets. Le premier grand rapport commandé par le gouvernement sous la Cinquième République, en 1959, le rapport « Armand-Rueff », propose de très nombreuses réformes, au premier rang desquelles figure la déconcentration. L'objectif est d'améliorer la coordination de l'action territoriale de l'État et de rationaliser le découpage des services extérieurs. La réforme est expérimentée dans quatre départements pilotes. Deux décrets du 14 mars 1964 relatifs à l'organisation des services de l'État dans les départements et les circonscriptions d'action régionale et à la déconcentration administrative l'entérinent. Ils affirment la prééminence préfectorale dans le cadre départemental. Le préfet, correspondant officiel de tous les ministres, se voit conférer une autorité réelle et directe sur tous les chefs de services dans le département. Il devient ordonnateur secondaire de la plupart des crédits d'intervention de l'État dans le département. Sont créés également les préfets de régions qui succèdent aux préfets coordonnateurs institués par le décret n° 59-171 du 7 janvier 1959 portant harmonisation des circonscriptions administratives de la France métropolitaine en vue de la mise en œuvre des programmes d'action régionale. Ils n'ont qu'une compétence d'attribution pour mettre en œuvre la politique de développement économique et d'aménagement du territoire. Le préfet de région, ainsi, « anime et contrôle en ce domaine l'activité des préfets de département ». La conférence administrative régionale (car), qui remplace la conférence interdépartementale créée par le décret du 7 janvier 1959, est chargée de l'examen de la répartition des crédits de l'État dans chacun des départements de la région, du suivi de la réalisation de la politique économique, de la préparation et de l'exécution régionalisée de la planification nationale. Puis, un premier décret du 14 novembre 1970 (138) porte déconcentration des décisions en matière d'investissements publics. Il transfère aux préfets les pouvoirs de décision pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État lorsqu'ils sont d'intérêt régional, départemental ou communal et il interdit pour l'avenir d'attribuer de tels pouvoirs aux ministres. Un second décret du même jour déconcentre le contrôle financier des dépenses engagées en faveur des trésoriers-payeurs généraux (139). La volonté de déconcentration s'impose comme corollaire de la décentralisation en 1982. Les décrets du 10 mai 1982 confèrent aux préfets un pouvoir de direction sur les services et administrations civiles de l'État (140). Toute correspondance échangée entre les administrations centrales et les services déconcentrés doit être portée à la connaissance du préfet et transmise sous sa signature ou sous couvert. Une circulaire du Premier ministre du 22 décembre 1982 vient apporter des précisions à cette règle (141). Le décret accroît le pouvoir hiérarchique du préfet à l'égard des chefs de services, car il doit proposer leur notation. Le préfet possède depuis 1982 un pouvoir exclusif d'ordonnancement des crédits de l'État, il est l'ordonnateur secondaire de droit commun, sauf pour l'armée. b) Le tournant de 1992 et la relance de 1995 Selon certains auteurs, la loi du 6 février 1992 « semble en effet marquer le passage d'une déconcentration octroyée par les administrations centrales, sectorielle dans son étendue et instrumentale dans sa conception, à une déconcentration assumée conjointement par les différents niveaux d'administration, interministérielle dans son contenu et managériale par sa méthode » (142). - La mise en œuvre de la loi du 6 février 1992 et ses difficultés En apparence, depuis le début des années 1980, l'État se retire des territoires. Les préfets n'exercent plus l'exécutif des départements et des régions et n'assurent plus la tutelle des collectivités territoriales. Nombre des compétences administratives étatiques ont été redistribuées. Les contrôles ne portent plus sur l'opportunité des initiatives locales ; seule la légalité est examinée. Pour contrebalancer les effets de la décentralisation et, suivant une logique de proximité, l'État depuis plus de trente ans cherche à accentuer la déconcentration des décisions. Après les décrets de 1970 précités, l'étape la plus marquante du processus de déconcentration a été franchie avec la loi du 6 février 1992 précitée, complétée par le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration. La car, qui, avant 1992, opérait simplement la répartition des crédits d'équipement délégués au niveau régional, définit désormais les stratégies de l'État dans la région et la programmation des crédits relatifs aux politiques interministérielles. Est mise en place une réunion départementale du collège des chefs de services qui examine les conditions de mise en œuvre des politiques de l'État, traite des conditions d'organisation des services et recherche toute forme d'action commune. Le pouvoir des préfets est renforcé puisqu'il n'est plus question de travailler avec un seul chef de service déconcentré mais avec une multitude d'interlocuteurs. En application de l'article 2 de la loi du 6 février 1992, aux administrations centrales ne doivent revenir que les missions de caractère national ou dont la loi exclut le transfert à un échelon local (143). Le reste relève des services déconcentrés - autrefois appelés services extérieurs -, à l'échelon régional, départemental et des arrondissements. Pour Marceau Long, ancien vice-président du Conseil d'État, le pouvoir naissait concentré, il doit désormais naître déconcentré. La charte de la déconcentration dispose que, pour qu'une administration centrale exerce une compétence, un texte de loi doit en interdire la délégation à un échelon territorial et la compétence doit présenter un caractère national : conception, animation, orientation, évaluation, contrôle, participation à l'élaboration des projets de loi et de décret, préparation et mise en œuvre des décisions du gouvernement, organisation générale des services de l'État, détermination des objectifs de l'action des services déconcentrés. Il a été ainsi décidé de renoncer à une énumération des compétences qui présentent un caractère national au profit d'une approche fonctionnelle de l'activité des administrations centrales : tutelle de certaines sociétés, gestion directe d'investissement d'intérêt national, mise à disposition à l'échelon national de moyens lourds. Pour poursuivre l'effort, le Premier ministre, le 16 septembre 1992, demanda aux ministres de préparer des plans déconcentrés. Seuls les ministères de la culture, de l'intérieur et de l'éducation mirent en place de tels plans. La circulaire du 11 août 1993 prit acte de la déconcentration d'environ 300 mesures dans ces secteurs. Le comité interministériel d'aménagement du territoire (ciater) du 20 septembre 1994 demanda à chaque ministère de réexaminer sa contribution, mais les élections de 1995 interrompirent pour un temps le processus. - La double relance législative et administrative de 1995 Le « rapport Langlais » de 1995 (144) dénonça pourtant les pratiques insidieuses de reconcentration de certaines administrations centrales, tandis que certains services régionaux par leurs compétences de programmation et de financement tendaient à prendre l'ascendant sur les services départementaux. Le renforcement de la cohésion interministérielle autour du préfet n'a pas été suivi d'effets significatifs quant aux transferts de compétences. Le « rapport Langlais » préconisait des fusions de services, des bases de données communes, des guichets uniques ainsi qu'un recours accru aux pôles de compétences. Les difficultés de mise en œuvre des mesures décidées en 1992 ont donc incité le législateur à intervenir de nouveau à l'occasion de la loi du 4 février 1995 précitée imposant que les transferts prévus par l'article 6 de la loi du 6 février 1992 interviennent dans les dix-huit mois. Dans le même délai, sera arrêté un schéma de réorganisation des services de l'État, plan triennal défini à travers une série de séminaires gouvernementaux. La loi du 4 février encourage également les « regroupements fonctionnels » et crée divers fonds financiers dont les crédits étaient en partie mis à la disposition des préfets pour assurer l'effectivité des transferts d'attributions. Elle instituait enfin un comité interministériel pour la réforme de l'État (cire), chargé notamment de faire progresser la déconcentration. La circulaire du 26 juillet 1995 engage la réforme des structures centrales et favorise la délégation des responsabilités au profit des échelons territoriaux. Le séminaire gouvernemental du 14 septembre 1995 prévoit une affectation initiale des hauts fonctionnaires dans les services territoriaux, engage la simplification de l'organisation territoriale au profit des services de proximité, envisage la réduction du nombre des directions centrales des ministères et la déconcentration de la gestion des personnels et crée le fonds pour la réforme de l'État (fre) destiné à aider la réorganisation des administrations. En juillet 1996, est annoncée une baisse des effectifs centraux de 10 % et une réduction de 30 % du nombre des directions centrales ; elles étaient alors 210 (145). Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 a permis la déconcentration des décisions administratives individuelles prise en application de la charte de la déconcentration. Il a été complété par vingt-cinq décrets en date des 19 et 24 décembre 1997 qui ont détaillé les cas où la compétence est maintenue aux ministres, préfets de région, chefs de services déconcentrés ou maire. En résumé, les mesures prises cette année-là devaient permettre le développement de la mobilité géographique des fonctionnaires, l'adaptation des instruments budgétaires, la déconcentration de la gestion des ressources humaines, la simplification et l'adaptation de l'organisation des services déconcentrés de l'État. Parallèlement, le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications impose à ces fonctionnaires, pour devenir sous-directeur, d'exercer pendant deux ans au cours des six premières années de leur carrière une responsabilité dans un service territorial de l'État, d'un établissement public ou dans une collectivité locale. - Le comité interministériel pour la réforme de l'État de 1999 Le cire du 13 juillet 1999 avait inscrit à son ordre du jour la modernisation de l'administration territoriale de l'État. Les travaux menés en 1998 sous l'égide du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation avaient, en effet, confirmé l'actualité des principes de la déconcentration retenus en 1982 et formalisés par la charte de la déconcentration de 1992. La conviction que l'égalité devant le service public doit procurer une égalité de résultat s'est imposée. Elle justifie de donner à l'administration territoriale de l'État davantage de responsabilités de décision et la capacité de s'organiser en fonction des réalités locales. Dans chaque circonscription régionale et départementale, le préfet a été chargé de veiller à ce que les services optimisent leur organisation et leur fonctionnement dans le cadre du projet territorial. Ce projet devait être élaboré à l'horizon 2000 par tous les services déconcentrés et devait préciser, pour chaque département et région, la déclinaison de l'action nationale de l'État en se fondant sur une analyse de la situation et des priorités locales pour en garantir la meilleure efficacité. Élaboré collégialement par les chefs de services déconcentrés, à l'initiative et sous la responsabilité du préfet, le projet territorial avait aussi vocation à servir de cadre aux relations entre les services déconcentrés et les administrations centrales. Il participait donc de la réalisation d'un nouvel équilibre entre fonctionnement ministériel vertical et coordination horizontale des services aux échelons déconcentrés. Le ministère de l'intérieur a lancé, fin 1998, une expérimentation dans six départements - le Cantal, le Doubs, l'Indre-et-Loire, le Lot-et-Garonne, la Meuse et le Val d'Oise - avec le concours de la délégation interministérielle à la réforme de l'État. À partir des résultats, un guide méthodologique a été diffusé à l'ensemble des préfets à la fin de l'année 1999. Dans ce cadre, chaque préfet devait définir l'organisation régionale, départementale et infradépartementale des services des administrations civiles de l'État (à l'exception de ceux de la justice compte tenu de leur spécificité), dans le cadre de directives nationales d'orientation (dno) prises par les ministres intéressés et le ministre chargé de la réforme de l'État, après avis des chefs de service et dans le respect des compétences propres de ces derniers pour l'exercice de certaines de leurs missions. Lorsque plusieurs services concourent à la mise en œuvre d'une même politique, le cire avait acté que préfet pourra également décider d'organiser leur coopération selon l'une des modalités suivantes, après avis des chefs de services sur les objectifs assignés, les moyens à affecter, et les responsabilités imparties. Les différentes formules disponibles proposées étaient : la désignation d'un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action des services (146) ; la constitution d'un pôle de compétence en vue de l'exercice durable d'actions communes ; le regroupement des services sous une même autorité, le délégué interservices, choisi parmi les chefs de services déconcentrés ou les membres du corps préfectoral. Aussi deux décrets du 20 octobre 1999 (147) renforcent le pouvoir d'initiative du préfet pour la coordination des actions de l'État relevant de services différents. Il peut désigner un chef de projet parmi les fonctionnaires d'autorité afin d'animer une politique interservices. Il lui délivre une lettre de mission fixant l'objet, la durée et les moyens. Il peut proposer des fusions de services. Par ailleurs, tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture d'une administration de l'État ou d'un organisme chargé d'une mission de service public donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet à partir d'une étude d'impact. Pour résumer le mouvement qui est intervenu depuis vingt ans, « la diversité des reliefs périphériques s'impose là où le centre était l'unique principe de lecture de l'espace tout entier » (148). Ainsi, « l'État, après avoir connu plusieurs initiatives de réforme aux prolongements incertains, se trouve actuellement engagé dans une évolution touchant à l'organisation et au fonctionnement de son administration territoriale. Ce mouvement de déconcentration, qui vise d'abord à adapter la " morphologie " de l'État à la nouvelle donne locale, rejoint et renouvelle profondément, sans que cela ait peut-être été l'ambition initiale, la préoccupation récurrente de la réforme de l'État en lui conférant une actualité et des effets qu'elle n'avait sans doute jamais connus jusqu'ici. » (149) c) La déconcentration des moyens La déconcentration financière est le corollaire de la déconcentration administrative. Les deux décrets du 13 novembre 1970 précités sur la déconcentration financière et le contrôle financier, confèrent une unité aux trois types de décision qui conduisent à la réalisation d'un équipement : la programmation, l'examen technique et l'engagement financier. Quatre catégories d'investissement sont alors distinguées : d'intérêt national (catégorie I), régional (catégorie II), départemental (catégorie III) ou communal (catégorie IV, supprimée en 1982). Les investissements de « catégorie II » sont individualisés par le préfet de région, les deux dernières catégories par le préfet de département. Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement impose que les administrations centrales doivent déléguer aux préfets de région au moins 75 % des crédits de catégorie II et III. Expérimentée dans quelques départements, la réforme du contrôle financier sera étendue à l'ensemble du territoire par un arrêté du 15 janvier 1973. La mise en œuvre du contrôle incombe au trésorier-payeur général. Le contrôle ne s'applique qu'au stade de l'engagement, non à celui de l'ordonnancement. Une démarche de déconcentration de la gestion des crédits sous la responsabilité de l'autorité locale et de globalisation des crédits est développée à partir de 1985. Le ministère de l'intérieur expérimente les budgets globaux de fonctionnement pour les préfectures, le dispositif est étendu aux autres ministères. La circulaire du 25 janvier 1990 crée les centres de responsabilité dont la mise en place repose sur un contrat de trois ans négocié entre le service extérieur et le ministère de rattachement. Les centres disposent d'un budget global qui doit retracer le coût complet du service, permettre de faire des comparaisons et apprécier les gains de productivité. En échange, les services considérés doivent bénéficier des économies réalisées, démarche que l'on retrouvera au cœur de la lolf. Deux cents centres de responsabilité sont créés fin 1993. Le décret du 4 avril 1991 procédera à la refonte du classement des investissements civils de l'État (150). Mais l'expérience trouve ses limites. La globalisation continue ne s'applique que très progressivement ce qui ne permet pas d'apprécier globalement les efforts de gestion réalisés par les responsables locaux. Ceux de ces derniers qui sont situés à un échelon infra-départemental, tels un sous-préfet ou un ingénieur de l'équipement, ne bénéficient pas de la même autonomie que leurs collègues. Le dialogue de gestion entre centrale et services déconcentrés est quasi inexistant. Les administrations centrales répercutent systématiquement les mesures de régulation qui s'appliquent à elles sur les centres de responsabilité. La réduction progressive des marges de manœuvre déléguées par les ministères et l'absence d'un véritable contrôle de gestion conduisent à reconduire les prévisions de dépenses en fonction de celles constatées l'exercice précédent. La loadt du 4 février 1995 va marquer une nouvelle étape dans la déconcentration des moyens en permettant au préfet de recevoir en délégation la moitié des crédits du Fonds national pour l'aménagement et de développement du territoire (fnadt). Plus tard, sur le fondement des conclusions du cire de juillet 1999, une série d'assouplissements et de simplifications budgétaires et financières a été engagée dès le deuxième semestre de 1999 et devait favoriser le développement d'une gestion plus performante de leurs moyens des services déconcentrés. Ainsi, le nombre de chapitres budgétaires inscrits au projet de loi de finances a été réduit de l'ordre de 15 % par regroupement des crédits de fonctionnement courant des services (151) et par regroupement des chapitres d'intervention (152) autour des grandes politiques publiques. Les crédits de fonctionnement courant non consommés en fin d'année budgétaire ont pu être reportés d'un exercice à l'autre. Comme pour les décisions administratives individuelles, les décisions d'investissement de l'État seront prises à l'échelon déconcentré, le maintien à l'échelon national devenant une exception devant être prévue par décret. Le préfet de région décide de la répartition des enveloppes d'autorisations de programmes, qui lui sont déléguées, entre investissements d'intérêt régional ou départemental, après avis de la car. Le régime des subventions d'investissement accordées par l'État a été modifié pour mieux prendre en compte les conditions de montage des projets et leur déroulement, notamment lorsqu'il est question d'associations. Mais, en définitive, la « déconcentration des crédits, réelle, est difficile à mesurer (...) et leur repérage est un exercice épuisant » (153). On peut néanmoins estimer que, globalement, 60 % des dépenses sont exécutées en administration centrale. Il s'agit bien de passer d'une déconcentration octroyée par les administrations centrales, sectorielle dans son étendue et instrumentale dans sa conception, à une déconcentration assumée conjointement par les différents niveaux d'administration, interministérielle dans son contenu et managériale par sa méthode. Le précédent Premier ministre l'a affirmé, « l'État doit être au service des collectivités » (154) Des efforts importants ont été réalisés ces dernières années pour donner aux différents niveaux de l'État, horizontalement comme verticalement, des orientations stratégiques plus précises. Mais la concentration encore réelle des pouvoirs au centre et l'émiettement des services de l'État sur le territoire, soumis de plus en plus à des contraintes budgétaires, pourraient s'apparenter à une véritable dislocation. Ce système trouve sa légitimité dans l'égalité républicaine, mais crée de nouvelles inégalités. Des efforts substantiels ont été cependant réalisés ces dernières années pour regrouper l'État territorial autour de pôles mieux identifiés et de procédures qui assurent une plus grande unité d'action de ce dernier. B. LA PROFUSION DES CADRES STRATÉGIQUES Depuis une décennie, incité en particulier par les progrès de la décentralisation, l'État territorial est conduit à repenser son action dans des cadres stratégiques mieux définis. Un effort de clarification a été mené pour dresser la liste des priorités de l'État déclinées au niveau local. Dans le même temps, les différentes structures ministérielles ont établi leurs propres priorités. Les deux processus s'articulent harmonieusement dans le meilleur des cas, mais parfois s'entrechoquent et, ce d'autant plus qu'il existe différentes générations de « plans stratégiques » ministériels et territoriaux, accumulation qui tend à rendre les avancées réalisées moins lisibles. pte, paser, pased, dno, smr, lolf, tous ces sigles qui pourraient paraître ésotériques recouvrent une même réalité, la volonté affichée de définir de manière claire les missions qui incombent à l'État. Les préfectures constituent à ce titre un exemple de bonne articulation entre les travaux stratégiques menés au niveau central et la déclinaison territoriale des priorités de l'État. Elles montrent aussi l'importance grandissante des partenariats avec les collectivités territoriales qui, si elles ont besoin de l'État pour fonctionner − la mission de conseil exercée par les préfectures à l'attention des collectivités de petite taille en est l'illustration −, participent également de la mise en œuvre des politiques de l'État − comme le montrent par exemple les politiques de prévention des catastrophes naturelles ou même, de plus en plus, les politiques sociales et de sécurité. 1. L'élaboration de documents stratégiques : des pte aux pase Le cire du 13 juillet 1999 a estimé qu'une démarche tendant à une recomposition fonctionnelle des services déconcentrés de l'État se heurtait à des rigidités statutaires et rencontrait de nombreux obstacles sur le plan structurel. En conséquence, le Gouvernement avait renoncé à cette réorganisation, préférant suivre une voie moins risquée. A ainsi été expérimentée, à partir de 2000, la formule du projet territorial de l'État (pte) dans le département, qui avait pour objet de constituer « une démarche collective associant tous les services déconcentrés de l'État dans le but d'élaborer une stratégie commune et de définir une organisation optimale ». Chaque département a ainsi fixé des priorités d'action pour une durée d'au moins trois ans, déclinées en programmes et mesures assortis d'objectifs chiffrés et d'un calendrier de réalisation, autant de prémices à la mise en œuvre de la lolf. Mais ces projets, s'ils constituaient une expérience intéressante, manquaient de cohérence, en particulier au niveau régional. Prenant le relais des pte, le projet d'action stratégique de l'État (pase), lancé en 2002, matérialise un travail plus abouti de coordination et de mise en cohérence de l'action de l'État. Le projet d'action doit être compatible à la fois avec les orientations nationales de l'administration centrale et les besoins locaux. Il détermine la stratégie de l'État dans chaque région et chaque département. Formalisés par la circulaire du 13 mai 2004 relative à la préparation des projets d'action stratégique de l'État, les paser et les pased fixent ainsi la feuille de route de l'ensemble des services déconcentrés pour trois ans, afin de rendre l'État plus accessible, plus réactif et plus économe. Ces projets se caractérisent par de grandes orientations, déclinées en objectifs et indicateurs de performance. D'une part, le paser stratégique s'appuie sur un diagnostic de territoires, présentant leurs atouts et faiblesses, une identification des attentes des usagers et des partenaires de l'État, une appréciation des forces et faiblesses de l'organisation interne de l'État. D'autre part, pour chaque région, des orientations essentiellement à dimension interministérielle ont été définies. Le développement durable, la cohésion sociale et la sécurité sont les trois grandes préoccupations qui apparaissent communes à toutes les régions. Par exemple, l'État en région Aquitaine privilégie un développement durable reposant sur l'essor des différents modes de transport. Située dans une zone de passage pour les échanges européens avec la péninsule ibérique, l'Aquitaine entend financer des infrastructures de transports et généraliser l'accès ou l'utilisation des réseaux de communication. Quant au thème de la cohésion sociale, il apparaît, par exemple, dans le projet stratégique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Partant du constat que cette région est une terre d'inégalités sociales, l'État propose d'améliorer l'accès à l'emploi en priorité des jeunes qui représentent 13,3 % des demandeurs d'emploi, en luttant contre l'immigration clandestine et l'économie souterraine, en travaillant sur l'accueil et l'intégration de la personne immigrée. Plusieurs paser évoquent enfin les enjeux de la sécurité au sens large : sécurité des personnes, sécurité alimentaire et sanitaire, sécurité civile, sécurité routière, même si cette thématique se retrouve davantage dans les projets départementaux. Une fois les paser définis, chaque préfecture de département a lancé une opération similaire pour définir son propre projet stratégique en accord avec tous les acteurs locaux. Ces projets départementaux, les pased, ne sont pas une déclinaison du paser, mais une adaptation des grandes orientations régionales aux réalités locales. Chaque pased doit être compatible avec le paser. Comme pour ce dernier, l'élaboration du pased a été guidée par trois logiques : une dynamique interministérielle forte associant l'ensemble des services dans le cadre de réunions régulières du collège des chefs de service, une volonté de rédiger un document tourné vers l'action, une démarche évolutive fondée sur des mécanismes de suivi et d'évaluation. 2. L'exemple des préfectures : de la dno à la lolf En deçà de ce cadre qui concerne l'ensemble des services de l'État déconcentrés, les préfectures ont un rôle central à jouer dans la représentation territoriale de l'État. Il convient donc également de mesurer dans quelle mesure les missions des préfectures ont été clarifiées. a) Les missions traditionnelles des préfectures Traditionnellement, les préfectures remplissent cinq missions essentielles. La première est la permanence du fonctionnement des services de l'État et la sécurité, ce qui regroupe le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens, la prévention et le traitement des risques naturels ou technologiques, la gestion des crises et les mesures non militaires de défense. La deuxième mission est la réglementation et la garantie des droits et des libertés des citoyens, ce qui comprend l'organisation des opérations électorales en liaison avec les mairies, le suivi de la citoyenneté et des droits du citoyen, la nationalité, la police administrative, l'environnement et l'urbanisme, les questions d'utilité publique, le droit au séjour des étrangers, la circulation et la sécurité routière et les procédures d'autorisation. La troisième mission est le contrôle des actes des collectivités territoriales. Elle inclut le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des collectivités territoriales, mais aussi le contrôle budgétaire des organismes publics qui exercent une mission d'intérêt général en utilisant les fonds publics ou en percevant des ressources parafiscales. La quatrième mission consiste dans la mise en œuvre et la coordination, à l'échelon local, des politiques du gouvernement, passant par la direction des services de l'État dans le département, dans la région, la mise en cohérence à l'échelon territorial des politiques interministérielles, la connaissance du contexte local, la coordination interministérielle des politiques publiques, au premier rang desquelles se trouvent les politiques de l'emploi, de la cohésion sociale, de l'aménagement du territoire, du développement économique et de l'environnement. La dernière mission couvre la gestion et la répartition des dotations et subventions de l'État à l'échelon local, par le biais de la gestion des enveloppes financières réparties à l'échelon départemental, de l'organisation des actions communes à l'ensemble des services déconcentrés de l'État, telles que la gestion du patrimoine immobilier, le recrutement ou la formation et par le biais de la gestion des frais de fonctionnement de la préfecture. b) Les objectifs fixés par la directive nationale d'orientation Sur le fondement de la circulaire du Premier ministre en date du 8 janvier 2001 sur les directives nationales d'orientation et en intégrant les contraintes de la circulaire du 25 juin 2003 relative aux stratégies ministérielles de réforme (smr), le ministère de l'intérieur a élaboré une dno des préfectures, déclinaison territoriale de la smr et scénario prospectif prenant en compte les mutations de la demande sociale et des technologies, la décentralisation et la réforme de l'État. Les préfectures et sous-préfectures se sont ainsi vues fixer des perspectives pour les dix ans à venir, à l'horizon 2015, et des actions à réaliser dans les trois prochaines années. La dno a été conçue à partir d'un document préparatoire, achevé en juillet 2004, après douze mois d'échanges et de concertation engageant les directions d'administration centrale, les représentants du personnel et les autres ministères concernés. L'analyse du contexte a permis de relever que le « client » de la préfecture est, moins que par le passé, attaché à la ville ou au département où il habite, donc à la préfecture dont il dépend. Il déménage plus souvent. Il se déplace facilement. Il utilise de plus en plus Internet et les automates. Pour autant, les mêmes réponses doivent être offertes à tous. La réforme constitutionnelle introduite par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ont, par ailleurs, assis la prééminence de l'échelon régional déconcentré. Dans ce cadre, les préfectures doivent se recentrer sur leurs missions fondamentales. Le premier axe consiste à rechercher un meilleur service à l'usager, qu'il s'agisse des élus ou des autres citoyens. Il se traduit par le transfert de certaines fonctions de guichet vers des partenaires de plus grande proximité pour les citoyens, la création de services en ligne et la fusion des procédures. Dans le même registre, la dno prévoit la dématérialisation des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et le renforcement de la fonction de conseil. Le deuxième axe d'action fixé aux préfectures concerne la sécurité et la protection des populations. Le premier volet porte sur la prévention du crime et de la délinquance. Le deuxième volet doit faciliter l'anticipation des crises, leur gestion et la correction de leurs conséquences. Ces crises peuvent être multiformes : risques naturels, accidents majeurs, crises sanitaires, épidémies, menaces terroristes... Là encore, le travail de partenariat avec les collectivités territoriales s'avère primordial. En complément, une attention particulière doit être portée à la délivrance des titres aux étrangers. La simplification de l'exercice des compétences d'État et la prise en compte des nouvelles fonctions arbitrales constituent les troisième et quatrième grands axes de la dno. Une réflexion de meilleure répartition des compétences entre services d'État se développera dans le domaine de la politique de la ville, de la prévention de la délinquance et dans ceux dont les contours sont modifiés par le processus de décentralisation. Ainsi, le développement durable, garant d'un équilibre entre la cohésion sociale, le développement économique et la préservation de l'environnement, exige des capacités d'arbitrage qui mobilisent des compétences nouvelles au sein des préfectures. Enfin, la dno fixe un cinquième grand axe d'action aux préfectures : l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui implique l'exercice d'une fonction d'animation et de pilotage, confiée, dans les préfectures de région, au secrétariat général pour les affaires régionales (sgar). L'expertise juridique et la documentation forment un élément essentiel dans le traitement des dossiers, ce qui suppose à la fois des spécialisations techniques et des mises en réseau. La mise en commun de moyens entre préfectures constitue également une des voies à explorer. Un contrôle de qualité doit intervenir en complément du contrôle de gestion. La question se pose de l'articulation de ces objectifs nationaux avec ceux qui ont été fixés par le législateur dans la loi de finances initiale au responsable du programme « Administration territoriale » présenté sur le fondement de la lolf. c) Les objectifs assignés aux préfectures dans le cadre de la lolf Dans le contexte contraint des finances publiques, il est apparu irréaliste de vouloir valoriser toutes les missions des préfectures dans la même mesure. Un tri a ainsi été opéré. Dans le cadre du projet annuel de performances (pap), cinq objectifs ont été ainsi retenus. Le premier est l'amélioration de la prévention dans le domaine de la sécurité civile. Le constat est fait d'importants retards dans la majorité des départements, en liaison avec la multiplication des réglementations dans ce domaine. L'effort doit porter à la fois sur la prévention des risques naturels, la prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (erp) et les risques technologiques. Il s'agit donc à la fois d'augmenter le taux de plans de prévention des risques naturels (pprn) approuvés afin de mesurer la capacité du préfet à faire approuver les pprn prescrits − ces documents élaborés par l'État permettant de réglementer l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis −, d'accroître la périodicité et l'effectivité des visites effectuées par la commission de sécurité dans les erp et, enfin, d'élever le nombre d'exercices de sécurité réalisés pour les installations les plus dangereuses, dites « SEVESO II seuil haut ». Le deuxième objectif assigné au responsable du programme est l'amélioration des conditions de délivrance de titres fiables, ce qui nécessite à la fois de garantir la fiabilité des titres délivrés et de traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Dans cette logique, il est prévu d'élever le nombre de délivrances indues évitées et d'annulations de titres signalées à l'administration centrale et d'accroître la proportion des préfectures qui délivrent dans les délais fixés les cartes grises. Le troisième objectif est la réduction du nombre d'actes non conformes des collectivités territoriales et établissements publics, ce qui passe, en premier lieu, par l'augmentation du taux de contrôle des actes prioritaires que sont les actes de commande publique, les actes de la fonction publique territoriale, les actes d'urbanisme et les décisions de police, en deuxième lieu, par la hausse du taux de déférés « gagnés » par le préfet, et, en troisième lieu, par l'accroissement du taux de saisines de la chambre régionale des comptes jugées recevables. La dématérialisation des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité permettra de supprimer les tâches répétitives de manipulation, d'enregistrement, de classement de documents. La réorientation de moyens vers l'expertise, le conseil, le contrôle ciblé renforcera la sécurité juridique des décisions des collectivités. Cette innovation ouvrira la voie à des outils informatiques polyvalents qui auront un effet d'entraînement sur la production, la validation, la circulation, l'exploitation et l'archivage de tout document échangé entre les préfectures et les collectivités. En complément, le quatrième objectif doit conduire à la modernisation du contrôle de légalité, rendu possible, notamment, par le développement de deux applications informatiques dénommées « Aide au contrôle et à la transmission électronique sécurisée » (actes) et helios, qui permettent la dématérialisation des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Le but est d'accroître progressivement le taux d'actes télétransmis par ces applications. Le cinquième objectif, qui consiste à optimiser l'efficience de la fonction animation, doit conduire à déconcentrer le maximum de moyens dans les préfectures. Enfin, pour bien marquer la volonté du ministère de maîtriser les coûts des préfectures, il est prévu de réduire les coûts d'affranchissement, qui constituent l'un des postes de dépenses de fonctionnement les plus importants de ces services. Le rapporteur a pu le constater lors de ses déplacements en région, la logique interne et cohérente qui préside à l'articulation entre les orientations stratégiques du ministère de l'intérieur et celles assignées aux préfectures, que ce soit dans le cadre de la réforme de l'État au sens large ou dans celui plus restreint de la lolf, n'est pas nécessairement transposable à l'ensemble des ministères et de leurs services déconcentrés. La nécessaire cohérence de l'État territorial appelle donc la promotion d'une force centrifuge, susceptible de donner une définition transversale territoriale de politiques conçues de manière sectorielle au niveau central. Cette force doit être incarnée le préfet. L'exemple des préfectures est probant. Mais on pourrait multiplier les illustrations. Le domaine de la santé bénéficie de ce point de vue d'une créativité qui paraît sans limite, d'autant plus que se mêlent à l'action de l'État celle des acteurs locaux et surtout celle des institutions de sécurité sociale. La simple énonciation des outils de programmation dans ce secteur suffit pour s'en convaincre : programmes régionaux de santé (prs), programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins (praps), schémas régionaux d'organisation sanitaire (sros), schémas régionaux d'éducation pour la santé (sreps), programmes territoriaux de santé, programmes régionaux de l'assurance maladie (pram), programmes régionaux hospitaliers (prh) ou encore plans régionaux de santé publique (prsp). C. L'ÉCLATEMENT DE LA CARTE ADMINISTRATIVE Il existe 22 préfectures de région, auxquelles s'ajoutent 4 préfectures de région outre-mer, 100 préfectures de département, dont 4 outre-mer, et 339 arrondissements, dont 239 sont distincts de l'arrondissement chef-lieu. Mais au-delà de ces structures existe une myriade de découpages qui rendent difficilement lisible la carte administrative française et ce d'autant plus que la synthèse n'est pas toujours réalisée à un échelon bien identifiable. 1. Une simplification historique relative sous le sceau de l'autorité et de l'efficacité L'imbroglio de la carte administrative reste un lieu commun de l'analyse des institutions de l'Ancien Régime. La monarchie a œuvré pour juxtaposer « à la pyramide des vassalités féodales, d'où elle avait tiré son premier principe, l'autorité d'un souverain placé au centre d'une administration plus ou moins centralisée, coiffée par un collège de ministres. Le cœur de ce système, progressivement mis en place depuis la fin du XVe siècle, est constitué par la perception de l'impôt direct, organisée par le Contrôleur général des finances, à l'aide des administrateurs préposés à cette tâche, chacun à l'intérieur de sa généralité : les intendants. » (155) Le développement du pouvoir royal avait, en effet, abouti à un découpage caractérisé par sa complexité et des circonscriptions très diversifiées qui coïncidaient rarement entre elles, que ce soit les généralités et les intendances elles-mêmes subdivisées de manière différente pour les pays d'élection et pour les pays d'État. Les modifications des limites de certaines circonscriptions telles que les provinces étaient si fréquentes qu'elles ne paraissaient même pas invariablement fixées. Leur ressort ne correspondait ni à celui des gouverneurs ni à celui des parlements. Les municipalités constituaient davantage des associations d'habitants que de véritables circonscriptions administratives. La sédimentation institutionnelle voyait s'enchevêtrer anciennes et nouvelles circonscriptions ou autorités. Les cahiers des états généraux ont formulé les vœux de voir se créer des circonscriptions uniformes. Par contraste, la carte administrative adoptée sous la Révolution et gravée dans le marbre par l'administration napoléonienne est donc apparue comme un progrès considérable dans le sens de la simplification, selon une logique d'autorité et d'efficacité. La réforme administrative fait partie des premières réalisations de la Constituante. Le 29 septembre 1789, Jean-Guillaume Thouret donne lecture de son célèbre rapport où les circonscriptions administratives sont découpées de manière géométrique et symétrique. Mirabeau fait valoir le poids de l'histoire. Un projet de compromis est adopté le 14 décembre 1789 avec le décret relatif à la constitution des municipalités. Ainsi, la puissance de l'aspiration populaire au maintien de la cellule communale est telle que le comité constitutionnel dut renoncer à un découpage rationnel et géométrique des cellules communales. Puis, le 22 décembre est adopté le décret relatif aux assemblées primaires et aux assemblées administratives du département, du district et du canton. Le décret du 26 février 1790 viendra, par la suite, préciser le découpage et fixer les chefs-lieux des quatre-vingt-trois départements. En premier lieu, il s'agissait d'assurer la prééminence de l'État. C'est pourquoi la structuration de l'administration territoriale a suivi un mouvement descendant. Le modèle républicain se polarise d'abord autour du département et de la commune (156). Chacune des administrations a ainsi mis en place un dispositif de maillage de l'espace géographique pour projeter son autorité. Ce fut le processus suivi pour le département, invention de la Révolution, créé au premier chef pour affirmer l'unité de l'État, même si, dans un premier temps, l'idée apparut d'accorder des libertés aux administrations locales, dont la gestion devait devenir indépendante du pouvoir central qui restait trop marqué par l'arbitraire du roi et de ses agents. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) impose de manière ferme la logique d'autorité dans la très forte centralisation napoléonienne. Le département est alors une simple circonscription administrative de l'État, un relais du pouvoir hiérarchique exercé par l'administration étatique. Les 44 000 communes, réduites d'autorité à 38 000 en l'an VIII, si elles naissent des anciennes paroisses, deviennent le support de l'administration de l'État. Elles forment alors la dernière circonscription de cet État. Le pouvoir communal décentralisé est alors considéré comme un simple pouvoir délégué de l'État dans une circonscription qu'il a lui-même déterminée. La qualité de circonscription administrative attribuée à la commune apparaît alors plus importante que la personnalité morale qui lui a été accordée (157). En second lieu, l'œuvre révolutionnaire de rationalisation de la carte administrative avait pour objet d'assurer la meilleure organisation de l'administration française, dont les principes ont trouvé leur fondement dans d'anciens textes toujours en vigueur que sont la loi du 22 décembre 1789, la loi du 26 juin 1793, la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800). La simplicité des circonscriptions devait s'opposer à la complexité des structures de l'Ancien Régime, tandis que leur uniformité devait garantir l'égalité entre les administrés, dans un équilibre entre délimitation géométrique et la prise en compte des réalités géographiques et socioculturelles (158). Il reste que l'histoire administrative a enrichi considérablement cette carte qui, par ailleurs, ne semble plus adaptée. L'émergence de l'échelon régional à compter des années 1970, complétée par le maintien, voire le développement, de cartes administratives différenciées selon les ministères mais aussi de cartes spécialisées, telles que les cartes judiciaire ou militaire, a rendu l'ensemble de la représentation territoriale de l'État de moins en moins lisible. En outre, elle conduit les collectivités territoriales à devoir dialoguer avec une multiplicité d'acteurs étatiques qui ne se trouvent pas au même niveau et favorise la mise en concurrence de ces derniers − le directeur régional de l'équipement, voire le préfet, est appelé à déjuger le directeur départemental... Le département fait certes figure de circonscription « de droit commun » ou « type » de « cadre privilégié » ou « principal » de la représentation territoriale de l'État. S'y ajoutent, au-dessus de lui, la région, et, en dessous, les arrondissements. Mais il faut également compter avec les cantons et les communes, le maire agissant comme agent de l'État. Depuis longtemps, il a fallu adapter certaines circonscriptions aux spécificités de leur mission dans un souci de bonne administration, selon une logique fonctionnelle. Chaque type d'action administrative peut justifier l'utilisation de cadres territoriaux différents conduisant à la multiplication des circonscriptions intermédiaires ou même pour certains, qui n'avaient pas vocation à couvrir tout le territoire national, à des découpages privilégiant des localisations périphériques ; il en est ainsi pour les douanes ou les administrations maritimes. D'autres circonscriptions administratives ont un cadre interrégional, interdépartemental ou même infracommunal. Les régions militaires, les circonscriptions militaires de défense ou les zones de défense, les ressorts d'académies, les cours d'appel enrichissent le tableau. Les adaptations des circonscriptions aux contraintes administratives sont manifestes dans les services de police qui n'ont pas de liens nécessaires avec les subdivisions administratives classiques. Elles ont été définies selon les branches spécialisées de la police nationale, police judiciaire, de l'air, ou encore aux frontières, chacune ayant sa propre structure territoriale. a) Un corpus de textes d'organisation générale L'État conserve la maîtrise de la structuration du territoire, que ce soit par la loi ou par décret en Conseil d'État ou même parfois par simple arrêté préfectoral, lorsque, par exemple, il s'agit de modifier les limites des arrondissements (159) ou lorsque la modification de la circonscription communale ne porte pas atteinte aux limites cantonales. Les différents conseils régionaux, généraux, municipaux sont seulement consultés. Seules échappent à ce processus autoritaire la fusion de communes telle qu'issue de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin », et la constitution des « pays » qui ne constituent pas à proprement parler des circonscriptions administratives (160). L'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 qui définit la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales s'applique aux départements, arrondissements, cantons et communes. Le décret n° 59-171 du 7 janvier 1959 et le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 ont procédé à l'harmonisation des circonscriptions administratives de la France métropolitaine en vue de la mise en œuvre des programmes d'action régionale. La loi du 6 février 1992 précitée définit quant à elle les circonscriptions des services civils de l'État. Elle ne retient que les circonscriptions régionales, départementales et d'arrondissements. Mais cette énumération n'est pas exhaustive puisque la loi ne s'applique qu'aux circonscriptions civiles de l'État. Le texte de loi reconnaît la possibilité de dispositions contraires prévues par la loi ou par décret. Ainsi, la circulaire du 26 juillet 1995, relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l'État et des services publics confirme expressément que les services déconcentrés peuvent avoir une compétence nationale. La loi, par ailleurs, exclut a contrario les circonscriptions militaires. Le texte n'apportait pas d'innovation sur ce point, en faisant valoir que les trois catégories de circonscription demeuraient et qu'au regard des dérogations certains cadres territoriaux de l'État, telles les subdivisions de l'équipement, étaient bien des circonscriptions administratives même si elles n'étaient pas classiques. La loi du 4 février 1995 précitée crée un nouveau découpage du territoire, le pays, qui doit exprimer les communautés d'intérêts économiques et sociaux et, le cas échéant, les solidarités entre la ville et l'espace rural. Il ne s'agissait pas de créer une nouvelle circonscription administrative, même si nous avons vu que l'on pouvait légitimement s'interroger sur le flou de cette entité, d'autant que, aux termes de l'article 24 de la loi, il pouvait être tenu compte de l'existence des pays pour la délimitation des arrondissements. Dans une logique de meilleure adaptation des compétences de l'État aux réalités locales et d'un approfondissement parallèle de la décentralisation et de la déconcentration, si la procédure du décret en Conseil d'État pour les décisions de création et de suppression a été maintenue, en revanche, les décisions de modification des limites territoriales ont été déconcentrées par la loi du 13 août 2004 précitée relative aux libertés et responsabilités locales, dans son article 135. Le préfet de région peut désormais, par simple arrêté et après consultation du conseil général, modifier ces limites en fonction de l'évolution de plus en plus rapide des besoins d'administration des territoires. L'échelle de la « gouvernance » territoriale n'est plus celle de la journée de cheval, qui constituait un étalon valable, promu par les physiocrates, dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle. Il nous faut trouver une autre référence de mesure. Quant à la carte des arrondissements, elle ne correspond plus, dans de nombreux départements, aux réalités socio-économiques. Depuis l'an VIII, les départements français sont divisés en arrondissements, qui servent exclusivement de cadre à la déconcentration. L'article 5 du décret du 1er juillet 1992 précité précise qu'il est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État. Le découpage des services territoriaux de l'État correspond aujourd'hui davantage à une logique administrative, chaque ministère parisien s'étant doté d'une représentation locale, qu'à une analyse précise des missions de l'État sur le terrain. c) Un paysage d'ensemble contrasté Dans un souci de lisibilité et de simplification, la loi atr du 6 février 1992 précitée avait posé pour principe, dans son article 4, que « pour exercer leurs missions, les services déconcentrés des administrations civiles de l'État sont, sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'État, organisés dans le cadre des circonscriptions territoriales suivantes : circonscription régionale, circonscription départementale, circonscription d'arrondissement. » Mais, quelques exemples montrent que ce principe ne suffit pas à décréter la simplification et attestent, au contraire, de l'extrême complexité de l'organisation des services déconcentrés, chacun répondant à une histoire et à une logique interne propres, et de la richesse et de la transformation des tâches qui leur sont confiées. L'administration de l'équipement est certainement l'une de celles qui a connu les plus grands bouleversements ces dernières années. Née de la fusion en 1967 des ponts et chaussées et de la construction, cette administration connaît en 1982 le transfert d'une partie de ses compétences et de ses moyens aux collectivités territoriales, tandis que les services extérieurs sont rattachés à un seul ministère. Les directions régionales de l'équipement (dre), elles-mêmes partagées en subdivisions, sont chargées des infrastructures et routes et assurent à ce titre le suivi de l'exécution des contrats de plan, l'assistance technique et le conseil aux collectivités locales. Mais leur activité s'étend également à la construction et au logement, aux transports routiers de personnes et de marchandises, à l'aménagement et à l'urbanisme, aux statistiques et à l'économie du bâtiment. Elles sont également le correspondant du préfet pour certaines attributions spécifiques : parc d'intérêt national des véhicules routiers, parc de ravitaillement d'urgence, défense économique et fonctionnement des réseaux radioélectriques... Les directions départementales de l'équipement (dde) travaillent pour le compte de l'État, des départements et des communes. Une partie importante du service est mise à disposition du conseil général pour l'exécution des décisions en matière d'entretien des voies départementales et de trafic routier (161) et des communes pour l'urbanisme. La dde participe aussi au contrôle a posteriori des actes des collectivités locales en matière d'urbanisme et joue un rôle très actif dans le logement social et l'amélioration de l'habitat, et, jusqu'au transfert prévu par la loi du 13 août 2004, dans le domaine des routes nationales. Elle gère les infrastructures des ports de commerce d'intérêt national et peut intervenir sur les ports de commerce départementaux, les ports de pêche et de plaisance. Elle intervient sur les aérodromes, en particulier pour la maîtrise d'œuvre des opérations. En phase avec l'approfondissement de la décentralisation, les services déconcentrés de l'équipement ont entrepris une profonde réforme qui devrait conduire à créer des directions interrégionales des routes (dir) (162) et à regrouper au niveau régional des fonctions plus nombreuses. Les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ont entrepris en 1984, à la suite de la décentralisation, une réforme importante destinée à renforcer la fonction de synthèse, d'expertise et d'intervention. Ainsi ont été créées les directions régionales de l'agriculture et de la forêt (draf) chargées de l'application de la politique agricole et forestière de développement et d'aménagement rural, de l'enseignement agricole, des statistiques agricoles, de missions juridictionnelles dans le cadre du code forestier. Existent parallèlement, des services techniques spécialisés, tels que le service régional de l'économie agricole, le service régional de la formation et du développement, celui de la forêt et du bois, celui de la protection des végétaux, celui des statistiques agricoles ou encore l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, tandis que, depuis 1992, le service régional des eaux est rattaché à la direction régionale de l'environnement (diren). Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt (ddaf) chapeautent quant à elles le service de l'économie agricole et alimentaire, celui du développement agricole et rural, l'aménagement rural et développement local avec un appui technique aux collectivités locales. Elles s'intéressent aussi au bois et à la forêt, à l'eau et à l'environnement, aux services vétérinaires et aux statistiques agricoles. D'autres services déconcentrés échappent totalement ou partiellement au pouvoir de direction du préfet, à l'exemple du réseau comptable et des services de l'éducation nationale. Le premier, dirigé par le trésorier-payeur général, connaît une mutation profonde liée à la réforme de la comptabilité publique initiée dans le sillage de la mise en œuvre de la lolf. Or, dans l'équilibre territorial des pouvoirs, les trésoreries jouent un rôle non négligeable. Le Trésor public consacre, en effet, 60 % de son activité déconcentrée aux collectivités locales et aux établissements publics locaux. Aux termes des articles 14, 54 et 82 de la loi du 2 mars 1982, les fonctions comptables de ces collectivités sont exercées par un comptable du Trésor. Les fonctions proprement comptables, de contrôle de la recette et de la dépense et de recouvrement des impôts et recettes publiques se doublent d'attributions économiques de plus en plus importantes et qui vont de la régulation de la dépense budgétaire, aux études et avis sur les décisions et propositions relatives aux équipements publics et aux interventions financières de l'État, à l'animation des commissions chargées des restructurations et aux actions en faveur des ménages surendettés, sans compter les fonctions de collecte de l'épargne et d'exécution des opérations de trésorerie pour l'État, les collectivités locales et leurs correspondants. Les seconds, dépendant du ministère chargé de l'éducation nationale, sont organisés selon une carte qui ne correspond pas au schéma administratif classique des régions et des départements. L'inspecteur d'académie se trouve sous la double autorité du préfet du recteur d'académie. Il assure à la fois la direction administrative de l'ensemble des services de l'éducation et la direction pédagogique des établissements de son ressort. Il dispose ainsi de compétences larges en matière d'organisation, de fonctionnement des établissements et de direction des inspecteurs départementaux et contrôle l'inscription obligatoire. Il fixe l'effectif maximum pouvant être accueilli. Il reçoit les dossiers de déclarations d'ouverture des écoles privées, le contrôle de ces établissements étant du ressort du recteur. Il apporte enfin sa contribution à la carte scolaire, au schéma prévisionnel des formations soumis à l'approbation du conseil régional et au programme prévisionnel des investissements des établissements. À ce paysage s'ajoute la création d'agences territoriales qui rend encore plus complexe l'architecture de l'action publique. Il suffit pour s'en convaincre de se concentrer sur le débat bien connu sur la création des agences régionales de l'hospitalisation (arh), présentée en Conseil des ministres le 17 avril 1996 et assurée par l'article 10 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée. Ce mouvement d'éclatement territorial de l'État participe d'un mouvement plus général d'accumulation des structures, que l'on a déjà constaté pour les collectivités territoriales. C'est également vrai pour l'État, à plusieurs titres. Depuis quinze ans, l'État a non seulement décidé d'avoir plus de moyens au niveau local, en renforçant le rôle de ses services déconcentrés, mais il a également confié certaines de ses compétences à des agences, tandis que le nombre de ministères a augmenté, parce qu'on a voulu souligner l'importance de certaines missions. Le plus souvent, toutes ces structures s'additionnent au lieu de se compenser. Les exemples sont nombreux. La création d'un ministère de l'environnement n'a pas conduit à concentrer en son sein la compétence environnementale, que ce soit au niveau central ou au niveau local. En créant des agences, la France a voulu s'inspirer des pratiques étrangères. Mais au lieu, comme dans plusieurs pays étrangers, de supprimer en contrepartie les services qui jusque-là avaient la compétence, nous les avons conservés. Par exemple, les arh se sont par exemple ajoutées aux directions départementales et régionales des affaires sociales. La commission présidée par Michel Pébereau va plus loin : « Les différentes autorités de régulation (Conseil de la concurrence, Autorité de régulation des télécommunications, Commission de régulation de l'électricité et du gaz, Conseil supérieur de l'audiovisuel, ...) se sont également ajoutées aux services correspondants des ministères (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère de la culture...). De la même manière, la création de l'Agence France Trésor pour gérer la dette de l'État n'a pas conduit à centraliser la gestion la dette de l'ensemble des acteurs publics. Réseau Ferré de France (rff), la Caisse d'amortissement de la dette sociale (cades), ou l'unedic, par exemple, empruntent de manière autonome à un taux plus élevé que celui de l'État. Cette situation aboutit donc à un surcoût injustifié qui s'élève à environ une centaine de millions d'euros chaque année, sans compter le coût de fonctionnement des structures. » (163) Malgré les progrès apportés par la déconcentration et le renforcement des structures territoriales de l'État, comme le montre l'exemple de la plupart de nos voisins, il faut se demander si le corollaire de la décentralisation, ce n'est pas autant le retrait de l'État que la déconcentration. La logique fonctionnelle n'est pas la logique territoriale ; la déconcentration pourrait avoir tendance à devenir un « jacobinisme de proximité ». En tout état de cause, des efforts ont été récemment entrepris pour rendre l'État territorial plus cohérent dans sa représentation et dans son action. II. - LA RECHERCHE D'UN ÉTAT TERRITORIAL PLUS COHÉRENT L'État n'est pas resté sans réagir face à l'évolution de ses missions et aux conséquences de l'approfondissement de la décentralisation, comme en témoignent l'adaptation progressive du pouvoir préfectoral et les progrès très importants accomplis depuis 2002 dans le sens d'un État territorial plus cohérent. A. LA TRANSFORMATION DU POUVOIR PRÉFECTORAL Seul corps de l'État dont la mission est constitutionnellement définie, le corps préfectoral est dépositaire de l'autorité de l'État et gardien de l'intérêt public. Il a vocation à incarner la continuité du pouvoir central auprès des collectivités décentralisées. Confrontée, au commencement de la réforme de décentralisation, à une période d'incertitude tenant à l'évolution de son rôle, ainsi qu'au nouveau regard porté sur lui, la fonction préfectorale connaît cependant un nouvel essor grâce à la politique de déconcentration administrative engagée depuis lors. La Constitution du 27 octobre 1946, dans son article 88, donne aux préfets, en tant que « délégués du gouvernement désignés en Conseil des ministres », un statut constitutionnel et précise que « la coordination de l'activité des fonctionnaires de l'État, la représentation des intérêts nationaux et le contrôle administratif des collectivités territoriales, sont assurés dans le cadre départemental ». L'article 72, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction initiale, reprend le principe inscrit dans la Constitution de 1946 et fait du préfet le fléau d'une balance destinée à faire la part de l'intérêt général incarné par l'État et des préoccupations locales, le représentant de l'État régalien et l'instrument de l'État territorial : « Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». En mars 2003, le pouvoir constituant a substitué à la dénomination de « délégué du Gouvernement » celle plus juridique de « représentant de l'État », en précisant que cette autorité, garante de l'organisation décentralisée de la République au niveau déconcentré de l'État unitaire, est le représentant de chacun des membres du Gouvernement. Il s'agit là d'une constitutionnalisation de certains des termes de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif, en particulier, aux pouvoirs du préfet. 2. De la fonction d'autorité à la mission d'arbitrage Fondée sous le Consulat à l'initiative de Napoléon Bonaparte par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), saluée par lui par la formule célèbre « Je veux que les Français datent leur bonheur de ce jour », l'institution préfectorale (164) s'inscrit dans une longue lignée de représentants (165) du pouvoir central, dont une des principales préoccupations fut de contribuer à bâtir et à pérenniser l'unité nationale. La circulaire du 21 ventôse an VIII précisera que les préfets sont « appelés à seconder le gouvernement dans le noble dessein de restituer à la France son antique splendeur ». La fonction de représentation territoriale de l'État apparaît ainsi comme inhérente à l'organisation administrative française, révélant à cet égard l'un des traits de la culture politique nationale depuis la Révolution : l'attachement au principe d'égalité et une inclination centralisatrice. Dans cette construction, le préfet est le gouvernement et l'administration dans le département comme le visage du pouvoir d'État, garant de l'intérêt général. Gouverneur, administrateur, animateur, le préfet a toujours rempli ces trois fonctions, dès 1800 et encore en 2000 (166). Le contenu des fonctions a cependant changé. Incarnation de la continuité du pouvoir d'État, le préfet symbolise et concrétise l'État-puissance publique, mais il est aussi un acteur de la vie sociale dans le département et, de plus en plus, dans la région. La création des préfets par la loi du 28 pluviôse an VIII, renouant avec la tradition des intendants, répondait avant tout au besoin de rétablir l'ordre dans un pays politiquement, économiquement et militairement troublé. C'est dans cette logique qu'est créé un préfet de police à Paris par un arrêté du 12 messidor an VIII (167). Au XIXe siècle, ce rôle de gouverneur l'emporte, au moins jusqu'à l'affermissement du régime républicain. Aujourd'hui, le préfet est encore dans ce rôle dans le domaine du maintien de l'ordre et dans les situations de crise. C'est l'appel aux préfets lancé par Léon Gambetta, le 7 septembre 1870 : « Apportez le sang-froid et la vigueur qui doivent appartenir aux représentants d'un pouvoir décidé à tout pour vaincre l'ennemi. Soutenez tout le monde par votre activité sans limite. Écoutez ceci : toute votre administration se réduit pour le moment à déterminer le grand effort qui doit être tenté par tous les citoyens en vue de sauver la France. » C'est la déclaration du général de Gaulle, le 30 mai 1968, qui invite les préfets « devenus ou redevenus commissaires de la République à maintenir l'ordre, à assurer le ravitaillement de la population et à susciter partout l'action civique ». Dans cette fonction, il est fait « appel au savoir-faire et à l'engagement d'hommes de métier pour surmonter les rigidités, les lourdeurs, le fatras des procédures et faire prévaloir tant bien que mal, si possible sans drames, non sans mérites et quelquefois non sans risque, les exigences du gouvernement du pays » (168). Le décret dit « de décentralisation » du 25 mars 1852 accorde au préfet 112 attributions propres, le décret de 1861 en ajoutera 16, celui de 1888, 22. Le décret du 26 septembre 1853 accorde au préfet le monopole de la délégation de pouvoir ministériel dans les départements, mais le subordonne à la proposition préalable des chefs de service. Les préfets sont établis par Émile Combes et Georges Clemenceau clairement et pour la première fois comme les représentants de tous les ministres et comme les « patrons » des administrations locales de l'État. Après les lois de décentralisation de la Troisième République, le mouvement de déconcentration des pouvoirs de l'État au profit des préfets s'accentue, notamment grâce au décret-loi du 5 novembre 1926 dit « de décentralisation et de déconcentration administratives », qui impose aussi aux chefs de services déconcentrés de fournir au préfet tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission. En 1951, on compte 2 457 attributions préfectorales ne nécessitant pas d'autorisation ministérielle préalable. La Cinquième République accentuera son rôle d'organe déconcentré de l'État, défini par le décret du 14 mars 1964 précité. Comme on l'a vu supra, le préfet, correspondant officiel de tous les ministres, se voit conférer une autorité réelle et directe sur tous les chefs de services dans le département, grâce, notamment, à la généralisation de la règle du « sous couvert ». Il participe à la notation des chefs de service, il préside de droit de toutes les commissions, à l'exception de celles traitant de questions économiques ou fiscales présidées par le trésorier-payeur général. Il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs aux chefs de service, mais reste l'ordonnateur secondaire de la plupart des crédits d'intervention de l'État dans le département. Le ministre de l'intérieur annonce, le 4 mars 1969, que 30 000 nouveaux dossiers seraient directement instruits par les préfets. Les lois de décentralisation parachèvent l'évolution en faisant du préfet du seul représentant de l'État et le représentant du seul État. Il est le chef de l'État territorial, sauf pour la justice, l'armée et l'éducation nationale. Après la loi du 2 mars 1982, qui ne parle plus que de « représentants de l'État dans le département », le décret du 10 mai 1982 donne à ce fonctionnaire le nom de commissaire de la République (169). Le pouvoir de direction du préfet sur les services extérieurs est affirmé par l'article 6 du décret, organisant autour de lui le regroupement de l'ensemble des services territoriaux de l'État. Lorsqu'il a perdu ses compétences d'organe exécutif du conseil général et de tuteur des communes, le préfet est devenu plus qu'hier administrateur en sa qualité de chef des services déconcentrés de l'État, d'autorité de saisine de la juridiction administrative et d'organe de répartition des participations financières de l'État aux collectivités territoriales. Les décrets du 11 juillet 1996, du 15 janvier 1997, du 13 février 1997, du 19 décembre 1997, du 3 juin 1998 et deux décrets du 20 octobre 1999 précités ont renforcé ses pouvoirs déconcentrés. Le décret du 15 janvier 1997 réglemente la déconcentration des décisions administratives individuelles et les deux décrets du 20 octobre 1999 offrent au préfet une grande liberté pour structurer les services déconcentrés de l'État. Le rôle européen joué par le préfet renforce son rôle d'administrateur. Il est devenu « un garant de l'Union européenne » (170), notamment en intégrant la dimension communautaire dans son contrôle de légalité. En effet, en cas de non-respect de cette dimension, seul l'État verrait sa responsabilité engagée. Le préfet se trouve aussi au cœur des dispositifs de demandes de concours financiers et participe à ce titre à l'élaboration des programmes soumis aux autorités communautaires. Selon une circulaire du 17 février 1994, il est responsable de la conception, de la coordination générale et de la mise en œuvre de la politique régionale communautaire. Selon une circulaire du 3 janvier 2000, il est responsable de l'élaboration des programmes de développement économique et social sur son territoire et de la mise en œuvre des décisions communautaires en faveur du développement régional. Le sgar reçoit les orientations de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (datar) − devenue récemment délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (diact) −, pour élaborer les documents uniques de programmation (docup) sous la responsabilité du préfet. De surcroît, le préfet de région donne son impulsion à l'application des programmes communautaires de développement régional. Les décisions de programmation sont prises par lui au sein des comités de programmation. Il a la responsabilité de l'engagement des paiements pour les mesures arrêtées par ce comité. Les fonds sont versés par la Commission européenne à l'Agence comptable centrale du trésor (acct), sont rattachés au ministère concerné (171) ; pour les objectifs dont la gestion est régionalisée, ils sont délégués au préfet de région, qui peut les déléguer au niveau régional ou départemental. Le comité de suivi est coprésidé par le préfet et le président du conseil régional. La nécessité d'une cohérence des actions financées par l'Union européenne renforce l'autorité préfectorale. Mais le transfert de la gestion des fonds régionaux communautaires aux régions autorisé par la loi du 13 août 2004 précitée relative aux libertés et responsabilités locales va placer, de ce point de vue, le préfet dans un rôle de partenaire plus que de prescripteur. Les intendants eux-mêmes jouaient souvent le rôle de « coordinateurs, de médiateurs, de diplomates », plus que celui de représentants inflexibles et omnipotents du pouvoir central. Ils ne sont pas loin en cela du modèle « post-décentralisation ». Le préfet, tout en demeurant l'incarnation de l'État régalien dans le département, s'est vu, en effet, confier de multiples fonctions en partenariat avec les collectivités territoriales et les différents acteurs de la vie sociale. S'est développée ainsi une fonction d'animation dans la mise en œuvre des politiques publiques nationales. En effet, le préfet joue de plus en plus souvent le rôle de chef d'orchestre ou d'animateur des acteurs de la mise en œuvre d'une politique publique. Dans ces domaines, il agit moins par décisions que par négociations. Longtemps dominé par les préoccupations électorales, le préfet est aujourd'hui absorbé par les tâches d'ordre économique, social et d'aménagement du territoire, voire de plus en plus de développement durable. Animateur, il est aussi arbitre des rapports de forces locaux. Comme le relève M. Paul Bernard, « le territoire constitue le lieu géométrique de la décentralisation et de la déconcentration, le point fixe de la répartition des compétences, la raison d'être de toute délégation du pouvoir central à des centres périphériques de décision. La concurrence entre le représentant de l'État et les élus locaux s'atténue forcément, en raison du service attendu par les citoyens habitant sur le territoire national. » (172) Dans l'application des grandes politiques sectorielles de l'État, par exemple en matière d'aménagement du territoire et d'emploi, le préfet se voit reconnaître explicitement, au-delà de la représentation de l'État stricto sensu et des règles de répartition des compétences, une mission générale et permanente d'animation et de mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux autour de questions d'intérêt commun. L'exemple, hier, de la mise en place du service public de l'emploi (spe), structure locale qui a la charge de l'application de la politique de l'emploi conduite par les différents ministères concernés, comme celui, aujourd'hui, des maisons de l'emploi montrent assez le rôle de « catalyseur » joué par le préfet. Dans le développement de l'intercommunalité, les préfets sont aussi appelés à jouer un rôle important. En effet, sous le contrôle des élus locaux, la loi ménage de réels pouvoirs d'intervention au préfet. En effet, l'initiative de la création d'un epci est partagée. Un ou plusieurs conseils municipaux peuvent par leurs délibérations demander la création d'un epci. Le périmètre est arrêté par le préfet dans les deux mois. Il peut aussi prendre l'initiative de la création. En l'espèce, il fixe la liste des communes intéressées, lesquelles sont invitées à se prononcer dans un délai de trois mois ; l'epci est créé sur la base d'une majorité qualifiée des conseils municipaux intéressés. Peuvent être comprises dans le périmètre de l'epci des communes qui ont exprimé leur opposition à sa création. Les préfets ne sont cependant jamais juridiquement tenus de créer un epci. Le préfet se trouve au carrefour de cartes d'action qui demeurent territorialement hétérogènes, ce qui lui confère une place d'influence privilégiée. Le retour de l'État est à géométrie variable, en fonction du contexte local. Ainsi, dans sa fonction d'arbitre entre les divers intérêts locaux, particulièrement sollicitée en matière de coopération intercommunale, le préfet est amené à prendre trois positions différentes. Il peut s'attacher, tout d'abord, à jouer la carte de la stabilité des partenariats, à garantir l'équilibre des rapports de force entre les différentes catégories de collectivité. Le préfet se fait alors facilitateur, il joue sur l'inflexion de l'interprétation des dispositions législatives, selon un mode qui rappelle fortement le cadre canonique du système politico-administratif local des années 1970, cadre qui sert souvent encore de référence à certains préfets de région. Il peut se faire, ensuite, plus entreprenant, dans un contexte de rapports de force conflictuels entre plusieurs collectivités, dans le cas où une collectivité exerce un leadership reconnu, mais dénoncé. Le préfet doit alors entrer dans l'arène politique. Il doit démêler un écheveau complexe de conflits, doit négocier des ralliements pour produire des contreparties politiques, doit jouer sur les registres les plus « autoritaires », et rejeter, par exemple, la mise en place d'un epci à visée uniquement réactive, ou encore fixer un périmètre intercommunal sans consensus politique. Le préfet peut, enfin, être contraint à adopter une attitude plus défensive, dans un contexte marqué par des controverses frontales, l'absence d'expérience de coopération intercommunale et de leadership reconnu ou radicalement conflictuel. Dans ce cadre, il doit se contenter d'empêcher que les relations ne dégénèrent ou ne conduisent à la constitution de projets dont la réalisation compromettra pour l'avenir toute entente possible.
3. Le rôle du sous-préfet en question L'animation figure au cœur des missions du sous-préfet, placé dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Ce sont les « auxiliaires du préfet du département sous l'autorité duquel ils sont placés », ils assurent « l'animation et la coordination des services déconcentrés des administrations », forment une « sorte de conseil pour les maires des petites communes rurales », voire sont leur « collaborateur officieux » (173). Le décret du 1er juillet 1992 précité fait de l'arrondissement le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État. Pris entre l'affaiblissement de l'État central et les thèmes de territorialisation des politiques publiques, de la négociation et de la contractualisation à tous les niveaux territoriaux, de la réorganisation des administrations déconcentrées, le sous-préfet reste cependant, aux yeux de nombreux maires des zones rurales, avant tout la personnification de l'État. Il remplit différents rôles juridiques ou de conseil. Pour les maires des petites communes, le contrôle de légalité est la première raison d'être du sous-préfet. La relation directe avec le sous-préfet est un élément sécurisant, elle constitue le marbre du système. Il contribue aussi à la mise en scène ou au rituel de la République. Il joue un rôle plus latent de médiateur, d'intercesseur, voir de démineur. En effet, parfois, il intervient en cas de « grands projets » portés par les communes ou les intercommunalités. Avec la loadt du 4 février 1995, le sous-préfet se voit reconnaître une mission d'animation et de coordination de la vie administrative locale et devient le maître d'œuvre du développement local. Il peut contribuer à accélérer le traitement des dossiers. Il peut avoir suffisamment d'autorité pour provoquer les réunions nécessaires entre tous les acteurs, rôle de facilitateur que l'on retrouve notamment en Italie. Le sous-préfet peut devenir un « monsieur bons-offices » chargé de gérer les conflits, voire de les régler. C'est de plus en plus fréquent avec l'intercommunalité. Mais certains élus déplorent, en particulier, que le rôle principal des sous-préfectures consiste à envoyer des textes de loi et que la sous-préfecture fasse des réponses générales et ne prenne pas toujours ses responsabilités. D'autres soulignent que le représentant de l'État est un interlocuteur moins important que les assemblées élues, notamment départementales, et la sous-préfecture paraît être souvent contactée après la perception, la dde, voire la ddaf. In fine, le sous-préfet incarne un certain ordre, est la mémoire d'un système et un symbole républicain, mais n'est pas toujours perçu comme un opérateur véritablement dynamique, comme le rapporteur a pu le constater lors de ses déplacements en région. Dans le même temps, la même critique de renouvellement trop fréquent des personnes qui s'adresse au préfet s'adresse au sous-préfet. Il est probable que l'avenir de l'institution sous-préfectorale se joue moins dans la reconstruction de logiques centre-périphérie, qui sont à son origine, que dans sa capacité à s'inscrire dans de nouvelles dynamiques transversales, comme en témoignent les missions transversales confiées de plus en plus à des sous-préfets. Ainsi, dans le Haut-Rhin, les sous-préfets ont été chargés de missions liées à la sécurité routière, à l'environnement, au développement du service public en milieu rural. B. LA CRÉATION DES PÔLES RÉGIONAUX Dans la réforme de 1992, les régions apparaissaient comme des circonscriptions vouées principalement au développement économique et social et à l'aménagement du territoire. Cette réforme poursuit deux objectifs : d'une part, simplifier l'organisation administrative en région en constituant un état-major resserré autour du préfet de région ; d'autre part, conforter l'échelon régional dans l'animation et la coordination des politiques de l'État tout en permettant une rationalisation des moyens utilisés. Dans cette réforme, l'État joue la carte de la régionalisation. La dynamique régionale amorcée en 1972, renforcée en 1986, pourrait trouver dans l'institution des « collectivités chefs de file », des raisons supplémentaires de se développer. Sur le plan régional, de nouvelles prérogatives ont été confiées au préfet de région pour en faire un véritable animateur de l'action des représentants de l'État au niveau régional. Les missions transversales du préfet de région de coordination entre pôles et de mise en cohérence de l'action des échelons administratifs régionaux et départementaux sont renouvelées et renforcées. Les préfets de région assurent désormais trois missions principales : - la conduite des actions de l'État en région ; - l'analyse prospective et l'évaluation des actions de l'État en région ; - la mutualisation des moyens de l'État en région. Le préfet de région, avec l'appui des chefs de pôles et assisté par le sgar, négocie les documents contractuels entre l'État et la région. Il anime et coordonne les politiques contractuelles ou partenariales, régionales ou infra-régionales en liaison avec les préfets de département. Il en assure le suivi budgétaire. Il prend en charge la gestion des fonds structurels européens lorsque celle-ci n'a pas été transférée à une collectivité territoriale. S'agissant de la conduite des moyens de l'État dans la région, le préfet de région se voit assigner une mission essentielle dans le cadre de la mise en œuvre de la lolf (cf. infra sur le nouveau rôle financier du préfet). Le regroupement des services de l'État en neuf pôles régionaux autour du préfet de région contribue à la fois à mutualiser les moyens de l'État et à assurer une meilleure visibilité de son action. Dans la réforme de 1992, les régions apparaissaient comme des circonscriptions vouées principalement au développement économique et social et à l'aménagement du territoire. La réforme fondée sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 poursuit deux objectifs : d'une part, simplifier l'organisation administrative en région en constituant un état-major resserré autour du préfet de région ; d'autre part, conforter l'échelon régional dans l'animation et la coordination des politiques de l'État tout en permettant une rationalisation des moyens utilisés. Ainsi, conformément à l'article 34 du décret du 29 avril 2004 précité et aux dispositions du décret n° 2004-1053 du 5 octobre 2004 relatif aux pôles régionaux de l'État et à l'organisation de l'administration territoriale dans les régions, dispositions précisées par la circulaire du 19 octobre 2004 relative à la réforme de l'administration territoriale de l'État, l'administration de l'État dans la région est, depuis le 1er janvier 2005, organisée en neuf pôles définis de la manière suivante : - Préfecture de région ; - Pôle éducation et formation ; - Pôle gestion publique et développement économique ; - Pôle transport, logement et aménagement (et mer pour les régions littorales) ; - Pôle santé publique et cohésion sociale ; - Pôle environnement et développement durable ; - Pôle économie agricole et monde rural ; - Pôle développement de l'emploi et insertion professionnelle ; - Pôle culture. Ces pôles incluent non seulement les services de l'État proprement dits, mais aussi, et c'est là sans doute l'une des avancées les plus remarquables, les opérateurs publics les plus importants. Par exemple, la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations sont associées au pôle « Gestion publique et développement économique ».
La direction régionale de la jeunesse et des sports est maintenue et continue d'assurer ses fonctions propres. Ce service ainsi que la direction régionale des services pénitentiaires et la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse sont associés, à l'initiative du préfet de région, aux travaux des pôles susceptibles de les concerner. Des expérimentations ont été engagées dans six régions, dans les deux domaines suivants : - l'environnement, avec un rapprochement des directions régionales de la recherche, de l'industrie et de l'environnement (drire) et des diren, dans les régions Aquitaine, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ; - l'emploi et les entreprises avec un rapprochement des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des drire et des services de la trésorerie générale dans les régions Centre et Picardie. Ces expérimentations ont fait l'objet d'une lettre de mission aux préfets intéressés. Elles seront évaluées avant une éventuelle généralisation. Les préfets de région ont proposé un nouvel organigramme du sgar qui a précisé les effectifs et les compétences nécessaires, l'ensemble se réalisant à moyens régionaux constants. Ces propositions de réorganisation ont permis à l'administration centrale d'actualiser l'effectif de référence des chargés de mission, recrutés à un niveau national, en vue de parvenir à un meilleur équilibre entre les ministères. Parallèlement, les ministres principalement concernés devaient présenter des propositions visant à améliorer le recrutement et la gestion de la carrière des chargés de missions. La mise en place des pôles régionaux a été plutôt bien accueillie. 2. Le fonctionnement des pôles Les chefs de pôle sont identifiés à l'article 1er du décret du 5 octobre 2004 précité. Par exemple, pour désigner le chef de pôle « environnement », le préfet de région a organisé les consultations interministérielles nécessaires avant de nommer soit le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit le directeur régional de l'environnement. Pour les régions Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, la mission de chef du pôle « éducation et formation » est exercée de façon collégiale par les recteurs des académies de chacune de ces trois régions. Chaque recteur est chef du pôle pour l'académie qu'il dirige. La mise en cohérence des politiques éducatives à l'échelon régional est assurée par un comité des recteurs des académies de la région. Le préfet de région a adressé aux chefs de pôle, après avoir recueilli leurs propositions, une lettre de mission qui précise les objectifs du pôle, ses conditions de fonctionnement et, le cas échéant, le champ de la délégation de signature accordée. Cette lettre de mission sert de fondement à l'évaluation et à la notation des chefs de pôle, à l'exception de ceux nommés en Conseil des ministres. Elle ne peut porter que sur les missions relevant des compétences des préfets au sens du décret du 29 avril 2004. Le chef de pôle anime et coordonne les services du pôle. Il peut être désigné par le préfet de région en tant qu'ordonnateur secondaire délégué pour tout ou partie des crédits relevant de la compétence du pôle, en lieu et place des chefs de services ordonnateurs secondaires délégués habituels. S'agissant du pôle « gestion publique et développement économique » et eu égard à ses attributions de comptable, le trésorier-payeur général peut proposer la désignation d'un des chefs de services, membre du pôle, placé sous l'autorité du préfet ou d'un fonctionnaire de catégorie A de la trésorerie générale de région. Le chef de pôle est aussi chargé des relations avec les organismes contribuant à la mise en œuvre des politiques de l'État dans la région. Ces organismes sont invités à participer aux instances de coordination que le chef de pôle met en place selon des modalités définies en fonction des spécificités régionales. Quand l'établissement a un champ de compétence interrégional, un correspondant est désigné dans chacune des régions. Pour les établissements publics à caractère national, les ministères chargés de la tutelle s'assurent, en liaison avec les préfets et les chefs de pôles, de la mise en œuvre effective de ces objectifs. b) La coordination entre pôles La problématique interministérielle se pose régulièrement aux services déconcentrés. En 1995, M. Hervé Serieyx dans son rapport sur Un bilan des projets de service dans l'administration (174), projets initiés dans le cadre du renouveau du service public de 1989, relevait ainsi l'urgence et la nécessité susciter des projets de service interministériels au niveau local. La réforme répond à cet impératif. Présidé par le préfet de région, le comité de l'administration régionale (car) se substitue à la car. Il est composé des préfets de département, des chefs de pôles régionaux, du sgar, qui en assure le secrétariat, et du secrétaire général du département chef-lieu de région. Le car, désigné comme le « conseil d'administration » de l'État en région, devient le lieu de délibération collégiale des décisions stratégiques et le cadre dans lequel le préfet de région s'assure de la cohérence de l'action de l'État dans la région et de la mise en œuvre des priorités gouvernementales. Outre la reprise des attributions préalablement exercées par la car en matière de programmation et de suivi budgétaire, le car a vu ses attributions consultatives élargies. Le sgar, sous l'autorité du préfet de région, anime l'action interministérielle et veille à développer la collégialité, tant avec les services régionaux qu'entre les échelons régional et départemental. Cette mission doit désormais être envisagée en intégrant les nouvelles compétences du car, le rôle assumé par les chefs de pôle et les priorités définies par le paser. Ainsi, c'est notamment au sgar qu'il revient de conduire les actions interpôles et d'assurer le pilotage des priorités du paser. Il veille également au contrôle de légalité des actes de la collectivité régionale, ainsi qu'à la coordination locale des politiques destinées à renforcer l'attractivité du territoire français et la compétitivité de notre économie. Il coordonne la réflexion prospective en mobilisant les différents moyens d'études afin que l'État dispose de sa propre capacité d'analyse stratégique du territoire régional. C. LA QUESTION DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE 1. Une position remise en cause Plusieurs services de l'État dans le département, à commencer par les préfectures, doivent affronter plusieurs réformes qui, pour la plupart, vont dans le sens d'une réduction de leurs compétences : décentralisation, régionalisation des moyens et des pouvoirs, rationalisation des effectifs... Ces mouvements sont particulièrement accentués dans deux domaines, le secteur sanitaire et social d'une part, l'équipement d'autre part. a) L'exemple des directions départementales des affaires sanitaires L'exemple des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (ddass) montre combien certains services déconcentrés ont pu connaître une réduction drastique de leurs compétences. Comme l'ont rappelé plusieurs des interlocuteurs rencontrés lors de ses déplacements en région, ces services ont subi un triple choc : celui de la décentralisation des années 1983-1986, celui de la création des arh ensuite, celui enfin des transferts récents des compétences en matière de rmi et de ceux de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales. Ainsi, l'un d'entre eux, directeur départemental adjoint d'une ddass, relevait qu'« en 1984, la première décentralisation a concerné les deux tiers des effectifs des ddass, puis il y a eu les arh. L'institution des maisons du handicap va provoquer de nouveaux changements. Nous sommes un des ministères qui a le plus bougé. » Nombre de ces interlocuteurs ont également souligné combien le rôle des départements n'était pas encore bien assimilé par tous les acteurs, la protection de l'enfance étant toujours considérée, par exemple, comme relevant des services de l'État. Ainsi, l'un des responsables rencontrés par le rapporteur soulignait que « Depuis plusieurs années, il y a un nouveau mode de fonctionnement entre l'échelon régional, qui prend de plus en plus d'importance, et l'échelon départemental qui permet le dialogue dans de bonnes conditions. Le comité technique régional et interdépartemental, de ce point de vue, est utile. Les budgets opérationnels de programme sont régionaux, les unités opérationnelles sont départementales. La relation va se renforcer. La lolf ne vient que consacrer un mode de fonctionnement. (...) La régionalisation est un processus en marche. Je crois que c'est la voie naturelle de l'évolution de l'administration, même s'il faut bien veiller au fait que ce processus n'obère pas la capacité à agir dans la proximité. » Dans le même temps, il appelait à une déconcentration plus forte et à une clarification des compétences avec les départements : « Notre marge d'autonomie est faible. Ainsi, nous sommes encore compétents pour la tarification des établissements médico-sociaux, mais nous avons des enveloppes prédéterminées. La fongibilité va peut-être permettre de faciliter la gestion des personnels. » Or, cet affaiblissement des ddass peut sembler paradoxal à l'heure où le souci de précaution est devenu, dans notre société, quasi pathologique, provoquant une demande d'État toujours plus forte en la matière. b) L'exemple des directions départementales de l'équipement Les mutations opérées par ces services, ces dernières années, sont également très importantes. Un des responsables régionaux de l'équipement dans les Pays de la Loire, rencontré par le rapporteur, décrivait ainsi l'ampleur des changements les plus récents : « Le ministère de l'équipement est concerné par les transferts dans trois champs. Le premier concerne le transfert du fsl au département au 1er janvier 2005. Tous les départements n'étaient pas concernés, certains s'appuyant sur des associations, sur des caisses d'allocations familiales, d'autres sur des cellules formées de personnels État et de personnel départemental. Le transfert a lieu dans ce dernier cas, mais concerne un petit nombre d'emplois. Le deuxième transfert est lié aux routes. Nous sommes en pleine phase de maturation. (...) Nous sommes quasiment d'accord sur les effectifs à transférer (...). Le dernier domaine, qui est moins est avancé, concerne les voies navigables et les aéroports. Il n'y aura pas de transfert d'aéroports dans la région. Pour les voies navigables, des propositions ont été faites. Cela représente quelques dizaines de personnes. La détermination du nombre et l'accord entre les parties sur ce nombre sont acquis. Le processus de gestion devra être monté. Une partie du personnel devra aller sur les nouveaux postes. Nous sommes en train de mettre en place des outils tels qu'une bourse de postes et un pré-positionnement. Nous travaillons sur plus d'un millier de personnes dans la région. « Le département va recevoir toute l'exploitation des routes départementales. La loi de décentralisation a provoqué la fin de la mise à disposition des directions départementales sur les routes départementales et s'accompagne du transfert du personnel qui était chargé des routes nationales. Les personnels des centres d'exploitations des routes départementales seront automatiquement transférés sur les postes. Pour les routes nationales d'intérêt local, des mouvements devront être gérés. Pour l'ingénierie, les personnes transférées vont devoir intégrer les services d'ingénierie. Il y aura des directions interrégionales des routes. » Pour un autre, selon une vision très étatique, voire étatiste, de la situation, « Les dde manquent de cadres, perdent en capacité d'analyse. Or, cette analyse est nécessaire pour savoir ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas l'être. (...) Certains élus (...) ont une vision de court terme. Nous devons être capables de les conseiller sur leurs choix, par exemple lorsqu'il existe des risques d'inondations qui doivent être pris en compte par les schémas de cohérence territoriale. » 2. Une tentative de réorganisation Lors de l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2005, le ministre de l'intérieur avait fait état de l'établissement de différents scénarios de réorganisation des administrations départementales, annonçant une série de discussions interministérielles en vue d'une décision gouvernementale au tout début de l'année 2005. Dans la réforme de 1992, le département était désigné comme l'unité administrative de droit commun, comme l'échelon déconcentré de principe, pour la mise en œuvre des politiques nationales et communautaires. Par une circulaire en date du 16 novembre 2004, le Premier ministre a engagé une réforme de l'administration départementale de l'État. Ce texte vient consacrer une idée directrice : l'administration de l'État n'est pas la même dans chaque département. Il faut rendre possible des adaptations, au cas par cas, de l'organisation des services départementaux de l'État. À l'issue d'une consultation de l'ensemble des préfets de département et en vue de répondre aux trois objectifs de renforcement de l'unité d'action de l'État, de lisibilité pour les usagers et de rationalisation de l'organisation, des projets de réforme de l'administration départementale ont été transmis au ministère de l'intérieur. De nombreuses propositions ont été jugées conformes aux textes en vigueur et peuvent être mises en application. D'autres méritent une analyse complémentaire voire, le cas échéant, une modification des textes en vigueur. C'est pourquoi, par une circulaire en date du 28 juillet 2005 relative à la mise en œuvre des propositions de réforme de l'administration départementale de l'État (rade), le Premier ministre a annoncé qu'elles feraient l'objet de recommandations et d'expérimentations. Les dispositions d'application immédiate s'appuient sur des dispositifs juridiques existants, qu'il s'agisse des pôles de compétences, des missions interservices (mis), des guichets uniques et de toutes les propositions visant à clarifier les modalités d'exercice des missions de l'État dans le département. Ainsi, est encouragée la formule du guichet unique en matière d'ingénierie publique, afin que celles des ddaf et des dde qui ne feraient pas l'objet de fusions puissent coordonner au mieux cette compétence technique proposée aux collectivités territoriales. Les deux tiers des projets ont proposé des mutualisations de moyens, dans le domaine des politiques d'achat par exemple. Les formules des pôles de compétence ou des mis se révèlent particulièrement adaptées à la conduite de politiques transversales exigeant une coopération technique entre les services, telles que les politiques de l'eau, de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité routière ou de la cohésion sociale. De manière prudente, l'expérimentation de délégation interservices (dis) est subordonnée, en revanche, à l'existence d'un consensus local des chefs de service concernés et à l'absence d'un ordonnancement secondaire. Ce type de structure, prévu à l'article 29 du décret du 29 avril 2004, mobilise, pour une mission circonscrite, des compétences ou des éléments de services identifiés au préalable. Elle place ces services, pour l'exercice de cette mission, sous l'autorité fonctionnelle d'un chef de service désigné par le préfet. Pour aller plus loin, des études complémentaires doivent être entreprises. Ainsi, en est-il des dis comportant une délégation d'ordonnancement secondaire et des mutualisations de moyens dans les domaines de l'immobilier, des achats ou de la gestion des personnels. Dans chacun de ces trois domaines, des travaux de concertation ont été entrepris. Plusieurs préfets ont proposé de réformer l'administration selon des modalités d'intégration plus poussée. Des projets de fusion, de rattachement d'une partie de service à un autre ou de réorganisation des services de l'État au sein d'une entité unique ont été élaborés, en particulier entre les dde et les ddaf, entre les inspections du travail au niveau départemental ou encore entre les services départementaux de l'architecture et du patrimoine (sdap) et les dde. En conséquence, une mission a été confiée au comité des secrétaires généraux des ministères pour qu'il procède à une analyse approfondie de ces propositions pour permettre, dans un premier temps, d'en sélectionner un certain nombre à mettre en œuvre à titre expérimental. Des préfets seront auditionnés pour présenter dans le détail leur projet. b) L'engagement d'une phase expérimentale Une circulaire du Premier ministre adressée aux préfets en date du 2 janvier 2006 relative à la mise en œuvre des propositions de réforme de l'administration départementale de l'État est venue confirmer ces orientations. Ainsi, des directions départementales uniques réunissant dde et dda seront créées à titre expérimental dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise. Les préfets des départements concernés recevront des instructions du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable pour préparer ces fusions dans le cadre de la procédure prévue à l'article 25 du décret du 29 avril 2004 précité (175). De surcroît, a été acté le principe d'un rapprochement, à titre expérimental, de la nouvelle direction départementale issue de cette fusion et du sdap dans le département du Val-d'Oise. Ce rapprochement, exclusif de toute fusion, devrait se traduire en particulier par une mutualisation des moyens et des fonctions logistiques. Sera également expérimenté le rapprochement de l'inspection du travail du régime général et de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (itepsa), dès 2006, dans les départements de la Dordogne et du Pas-de-Calais. Elle devrait conduire à la création, au sein des directions départementales du travail et de la formation professionnelle (ddtefp), de sections agricoles regroupant les services départementaux de l'itepsa, sections placées sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture pour l'activité correspondante. Le dispositif sera évalué en 2007 en vue de son adaptation et de son extension éventuelle. De manière plus ambitieuse, sera expérimentée, dans le département du Lot, une réorganisation progressive des services. D'ici à 2009, les services déconcentrés de l'État placés sous l'autorité du préfet ainsi que certaines des directions de la préfecture seront rattachés à trois directions générales de nature opérationnelle et à une direction générale de soutien : la direction générale des territoires, la direction générale des populations, la direction générale de la sécurité, la direction générale des ressources humaines et de la logistique. Le projet d'organisation des services de l'État vise donc à réduire la dispersion des services déconcentrés qui, à l'heure actuelle, sont trente-deux à intervenir à un titre ou à un autre au sein du département.
Par ailleurs, la circulaire prévoit d'encourager la création de six dis dans le domaine de six politiques interministérielles : la police de l'eau, dans le cadre fixé par la circulaire interministérielle du 26 novembre 2004, la prévention des risques naturels telle qu'elle est notamment définie par la circulaire interministérielle du 27 juillet 2005, mais aussi, de manière inédite, la cohésion sociale, la sécurité routière, la communication des services de l'État et la formation et la documentation au sein des services de l'État. En sus d'une politique active destinée à encourager la mobilité des agents, la circulaire prône une mutualisation accrue des moyens. Cette mutualisation doit concerner à la fois l'immobilier, les achats et approvisionnements et la logistique. Par exemple, les projets immobiliers concernant la réorganisation de plusieurs services de l'État en lien avec la réforme de l'administration départementale de l'État seront examinés en 2006 par un groupe d'experts désignés par le comité des secrétaires généraux des ministères. Les projets qui permettront de réduire les dépenses de l'État et d'accroître l'efficacité de son action pourront donner lieu à un retour financier au profit de l'échelon déconcentré. Le service des domaines est érigé en conseil des services de l'État en matière immobilière, conformément aux annonces faites par le ministre chargé des finances lors de la présentation du projet de loi de finances pour 2006, le 29 septembre 2005, et par lettre du 3 octobre 2005. En matière d'achat public, les préfets sont encouragés à optimiser les achats courants de micro-informatique, de véhicules ou encore de fournitures au bon échelon territorial. Devront être privilégiés les marchés nationaux chaque fois que cela est possible. À défaut, une mutualisation aussi large que possible entre les services départementaux devra être organisée. Pour développer l'analyse des coûts et la prise en compte des coûts complets au sein de l'administration, le secours des dispositifs prévus à l'article 17 de la lolf (176) ainsi que la délégation de gestion sont promus. Est créé un réseau de référents qui pourront être des fonctionnaires formés aux questions de logistique ou des contrôleurs de gestion des services déconcentrés, qui exercent une mission plus large de suivi des crédits et de la performance et dont chaque service déconcentré devra se doter avant la fin de l'année 2006. Ce réseau examinera toutes les pistes de mutualisation et diffusera les bonnes pratiques au sein des différents services. Pour les chefs de service qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, à savoir les chefs de juridiction et les chefs des services placés sous l'autorité du garde des sceaux ainsi que les directeurs des services départementaux de l'éducation, le Premier ministre recommande qu'ils soient systématiquement associés aux projets locaux susceptibles de les intéresser. Si les avancées annoncées sont réelles, il reste que, comme le dénonçait déjà le sénateur Michel Mercier, dans son rapport de 2000 sur le bilan de la décentralisation, l'amélioration de la coordination se fait sans véritable réorganisation d'ensemble des services (177). L'expérimentation doit constituer une marche pour la réforme et non seulement une caution. D. LA LOLF COMME ACCÉLÉRATEUR DE RÉFORME Comme le relevait Christian Blanc dans son rapport précité sur L'État stratège, « la déconcentration n'a de portée que si les moyens d'une véritable autonomie de management sont donnés aux services. Ceci suppose que les règles fondamentales de la gestion publique fassent l'objet d'importants aménagements. » La mise en œuvre de la lolf répond à cet impératif, mais les conditions de sa réussite au niveau déconcentré sont loin d'être acquises. Le rapporteur ne peut que constater que cette question a dominé de nombreux entretiens qu'il a eu l'occasion de mener en région. En effet, à l'aube de l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la lolf (178), les interrogations restaient nombreuses sur la capacité de tous les services déconcentrés à s'approprier les outils définis pour décliner à l'échelon local la nouvelle architecture et les nouveaux modes de gestion. 1. Les objectifs et les principes de la lolf a) L'avènement d'un budget d'objectifs La lolf marque le passage d'un budget construit sur la nature des moyens à un budget fondé sur les finalités des actions qu'il finance. Pour atteindre ce but, l'administration en général et le ministère de l'intérieur en particulier se sont engagés, depuis plusieurs années, dans un processus de modification de leur organisation, de leurs procédures, mais aussi de leur mode de pensée. L'enjeu est de diffuser en son sein cette culture du résultat et de la responsabilité si nécessaire à l'amélioration du service public et sur laquelle la très grande majorité des acteurs s'est rassemblée au moment de l'adoption de la lolf. Cette logique d'efficacité trahirait ce qui fait l'essence des finances publiques si elle n'était pas subsumée à l'exigence de meilleur contrôle démocratique du processus d'élaboration et de mise en œuvre du budget de l'État, exigence commandée par l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en vertu duquel « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». Sous l'empire de la lolf, la discussion de chaque loi de finances doit permettre à la fois de mieux analyser les évolutions passées, de donner au Parlement les moyens de prendre la décision la plus conforme possible à la volonté politique qui s'exprimera à travers les débats et d'offrir une plus grande visibilité sur les évolutions qui résulteront de cette décision, créant ainsi au fil des lois de finances successives un chaînage vertueux entre prévision, décision et évaluation. L'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances répartissait les crédits en fonction des structures administratives (ministère de l'intérieur...) et en fonction de la nature des crédits en cause (fonctionnement, intervention, investissement), selon une logique de moyens. Ce n'est qu'à titre informatif que les crédits pouvaient être regroupés par agrégats, qui correspondaient cependant plus à une présentation par structure qu'à une présentation par politique. Sous le régime de l'ordonnance de 1959, la bonne exécution du budget s'analysait de manière comptable sur le fondement d'un simple rapprochement entre les prévisions inscrites dans les lois de finances initiales et les réalisations. La lolf, par la mesure des performances qu'elle impose aux responsables des politiques publiques, donnera un contenu qualitatif à l'analyse de la bonne exécution du budget. Est substitué au triptyque dépenses de fonctionnement − dépenses d'intervention − dépenses d'investissement un triptyque mission − programme − action. La mission regroupe un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie, en l'espèce l'administration générale et territoriale de l'État. Seule une disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission. Elle constitue l'unité de vote des crédits budgétaires. Le programme remplace le chapitre comme unité de spécialité budgétaire. Un programme rassemble les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus, qui font l'objet d'une évaluation. Les actions forment les composantes d'un programme. Dans le cadre de la présentation de la loi de finances en missions et programmes, le contenu des programmes est explicité dans le pap par la présentation des actions qui le composent. Une action doit s'inscrire dans les objectifs du programme ; elle peut viser un public plus restreint que celui du programme ou un mode d'intervention particulier de l'administration. Elle est présentée divisée en titres : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, dépenses d'intervention. Cette répartition par nature de dépenses reste cependant indicative. Une action peut être assortie d'objectifs et d'indicateurs qui lui soient spécifiques parmi ceux qui définissent le programme, mais il ne s'agit pas d'une condition nécessaire ; en revanche, au plan opérationnel et vis-à-vis des opérateurs chargés de sa mise en œuvre, une action doit être déclinée en termes d'objectifs intermédiaires à atteindre. Pour atteindre l'objectif de performance, le législateur organique a prévu de réunir trois éléments : un objectif, permettant aux services de l'État de savoir précisément ce que l'on attend d'eux ; un indicateur, c'est-à-dire un outil de mesure de la satisfaction de cet objectif ; enfin, une cible, qui est la valeur que les services responsables doivent atteindre dans un délai déterminé, compte tenu des moyens dont ils disposent. b) La promotion de la responsabilité Dans le schéma qui prévalait avant la mise en œuvre de la lolf, les ministères étaient le plus souvent organisés au niveau central en direction de missions et directions de moyens. Les services déconcentrés se trouvaient souvent dans la situation d'arbitrer eux-mêmes entre les deux fonctions, sans que des objectifs déclinés au niveau territorial ne leur soient clairement fixés. En poussant cette réflexion jusqu'à son point ultime, la définition des priorités appartenait in fine à chaque agent qui, en fonction des moyens dont il disposait, répondait aux exigences des directives ministérielles. La réforme budgétaire fondée sur la lolf impose désormais aux responsables d'atteindre des objectifs clairement définis, grâce à des marges de gestion plus grandes. Cette nouvelle responsabilité, cette obligation de résultat, ne saurait cependant exclure les catégories de responsabilités existantes, pénales et financières, et, pour les comptables, personnelles et pécuniaires. La responsabilité du management doit compléter la seule question de la régularité. Cette nouvelle responsabilité pèse tout particulièrement sur des agents d'encadrement clairement identifiés : les responsables de programmes, les responsables de bop qui sont la déclinaison fonctionnelle ou territoriale des programmes, et les responsables d'unités opérationnelles (uo) (179). Un dialogue de gestion « en cascade » permet à tous ces acteurs de coordonner leur action. Les ministres gardent leur responsabilité politique sectorielle. Les responsables de programmes acquièrent une visibilité importante, composant autour du ministre l'équipe responsable de la performance et des résultats. Pour la mission qui nous intéresse, le secrétaire général du ministère de l'intérieur, responsable des trois programmes qui la composent, sera en première ligne. Les responsables de bop et d'uo sont désignés sans que leur responsabilité managériale se confonde avec le niveau hiérarchique, l'exercice de leur métier en administration centrale ou en service déconcentré. Au-delà de la nécessité d'agir dans le cadre légal et de respecter les règles de régularité de la dépense publique, la responsabilité managériale se mesurera à l'aune de la bonne gestion financière, de l'atteinte des cibles de résultats et de la garantie de la fiabilité des indicateurs utilisés. La bonne gestion financière, qui s'accompagne de l'allégement des contrôles a priori des engagements, doit empêcher un responsable de programme ou de bop de se trouver dans une situation prématurée de manque de moyens. La responsabilité des résultats est une obligation première des nouveaux responsables. Les objectifs opérationnels des gestionnaires de bop sont fixés par déclinaison des objectifs stratégiques inscrits au pap, soit de manière directe, par simple reprise des objectifs stratégiques, soit de manière indirecte et complémentaire dans le cadre du dialogue de gestion avec le responsable de programme. De la même façon, les objectifs d'uo doivent être définis dans le cadre d'un dialogue de gestion avec les responsables de bop. Dans le cas où les résultats seraient insuffisants, il conviendra de déterminer si cette situation résulte d'un changement de conjoncture, d'une exagération dans la fixation des cibles de résultat, d'un réel manque de moyens, d'une insuffisance ou d'une erreur du responsable. Cet exercice nécessite de mettre en œuvre un système de contrôle gestion idoine accompagné de mécanismes d'audit interne et externe, faisant intervenir en dernière analyse le comité interministériel d'audit des programmes (ciap), installé par le gouvernement le 1er octobre 2002 (180). Au-delà de ces principes, c'est la question de sa déclinaison territoriale qui doit ici nous retenir. 2. Le renforcement du rôle financier du préfet a) Une implication traditionnellement faible dans la discussion budgétaire Traditionnellement, le préfet n'est pas considéré comme une autorité clef du processus budgétaire, même s'il a la charge de la bonne exécution du budget de l'État dans son ressort. Cette vision doit cependant être relativisée. En effet, les préfets sont ordonnateurs secondaires uniques de droit commun des budgets. Par ailleurs, leur rôle dans la programmation territoriale du budget de l'État en liaison avec le développement de la planification et de la contractualisation, s'est renforcé au fil des années. Ainsi, le préfet de région possède une compétence de programmation et de répartition des crédits d'investissements civils déconcentrés de l'État. En outre, il faut rappeler qu'avant 1982, sous l'égide de la datar, les préfets de région pouvaient proposer des redéploiements d'un ministère à l'autre au sein des enveloppes prévisionnelles allouées à leur région. Après cette date, grâce aux contrats de plan entre l'État et les régions, les administrations centrales ont redécouvert la capacité des préfets à mobiliser les différents acteurs locaux sur des enjeux financiers. Mais la part de l'État dans ces enjeux financiers représente une part relativement faible du total de son budget. Une série de pratiques développées sous l'empire de l'ordonnance du 2 janvier 1959 conduisait à limiter les possibilités d'amélioration de la gestion dans les services déconcentrés. La dispersion des chapitres budgétaires, la nécessité de mobiliser de multiples lignes de crédits pour mener à bien une politique, les différences de rythmes dans la délégation de crédits issus de différents ministères, l'appel à des fonds de certains opérateurs de l'État transitant hors du circuit du Trésor compliquaient considérablement la tâche des gestionnaires. La notion de services votés avait fini par se transformer en droits acquis qui, ajoutés à l'absence de marges de manœuvre dans les services déconcentrés, se traduisaient par une absence d'initiative. b) Une implication plus grande dans la territorialisation du budget Le décret du 29 avril 2004 a donné aux préfets un rôle central dans le processus budgétaire au niveau territorial. Ils sont les garants de l'« interministérialité » et doivent faire valoir les priorités de l'action de l'État sur le territoire. Ils doivent valider l'organisation financière des bop déconcentrés et définir ainsi les conditions de la nouvelle gestion publique. Or, 90 % du budget de l'État français est mis en œuvre et dépensé au niveau déconcentré. Le préfet de région intervient dans la procédure budgétaire déconcentrée en amont de la programmation des crédits en proposant, le cas échéant, aux ministres intéressés les éléments d'un programme ou d'une action d'un programme. Au stade de la programmation, il émet notamment un avis sur les projets de budgets des services déconcentrés pour les missions relevant de son autorité. Le sgar prépare ces avis en s'appuyant sur l'expertise des services de la trésorerie. Il veille à une approche transversale des programmes ainsi qu'au respect des priorités de l'action interministérielle définies par le préfet. Le car a repris les attributions préalablement exercées par la car dans ce domaine et pourra, de surcroît, être consulté sur les modalités de mise en œuvre territoriale des programmes tels qu'ils seront définis par la loi de finances à compter du 1er janvier 2006 et sur les propositions du préfet de région ou des chefs de services relatives à la structure des programmes, en particulier lorsque leur mise en œuvre intéresse plusieurs services régionaux. S'agissant des investissements civils, les modalités de consultation du car sont maintenues à titre conservatoire, dans l'attente des modifications qui seront apportées à la distinction entre crédits d'investissements et de fonctionnement après le 1er janvier 2006. Enfin, par souci de simplification, la référence aux échéances du 15 juin et du 30 novembre, qui encadraient la consultation de la car en matière budgétaire, a été supprimée. Le déploiement des nouveaux modes de gestion est donc au cœur des préoccupations des services préfectoraux. S'ils ont bénéficié de l'expérience de la globalisation, les efforts à fournir restent importants. Pour la préparation du projet de loi de finances pour 2006, de nombreuses administrations centrales ont tardé à transmettre les éléments nécessaires au dialogue de gestion avec leurs échelons déconcentrés, ce qui rend la tâche des préfets particulièrement ardue. Cette situation doit être mise en relation avec l'ampleur des bouleversements induits par la mise en œuvre de la lolf. Au fil des années, le dialogue de gestion ne peut que s'enrichir. Ainsi, les relations directes, qui découlent de la mise en œuvre de la lolf, entre les responsables de programmes et les responsables de bop nécessitent une attention permanente pour assurer une mise en œuvre efficiente du dialogue de gestion notamment. En effet, il revient désormais au préfet d'assurer l'analyse stratégique des bop, avec l'appui technique de la trésorerie générale. Dans certaines préfectures, à l'exemple de celle du Languedoc-Roussillon, une réflexion conjointe a été menée par les sgar et les trésoreries générales dès le printemps 2005 afin de définir les circuits de dialogue et d'examen des bop. Le processus arrêté a fait l'objet de débats en pré-car et d'une formalisation au travers d'une note méthodologique adressée aux services, qui doit permettre, d'une part, d'associer le préfet de région le plus en amont possible du dialogue de gestion et ce, dès la communication de la directive relative aux orientations annuelles pour ce qui concerne les bop à enjeux, et, d'autre part, de privilégier des relations itératives entre les responsables de bop et le sgar lors de la construction des bop, afin de faciliter et de fluidifier l'instruction des dossiers, et préparer l'avis du préfet et du contrôleur financier. Le processus arrêté peut comporter, par exemple, les mesures suivantes : - une collaboration étroite entre la trésorerie générale de région et le sgar par un partage intégral de l'information avec l'ouverture d'un espace dédié sur le site extranet de la préfecture de région, également accessible aux responsables de bop et d'uo ainsi qu'aux préfets de département ; - l'élaboration d'un tableau de bord de suivi, partagé par la trésorerie générale et le sgar ; - une articulation avec les préfets de département qui donneront délégation aux responsables d'uo par le biais du site extranet et des pré-car et car ; - une fiche de suivi des bop, conjointe à la trésorerie générale et au sgar, que les responsables de bop doivent renseigner dès l'ouverture du dialogue de gestion, puis compléter jusqu'à la clôture et l'évaluation, et qui sera également mise en place pour les bop départementaux de la région ; - la rédaction d'un schéma d'organisation financière type au niveau régional, ainsi que de modèles d'arrêtés de délégation de signature, sur la base des modèles nationaux ; - le partage avec les responsables de bop des tableaux d'indicateurs de résultat et de performance. Conformément aux recommandations ministérielles, la sélection d'une dizaine ou d'une quinzaine de bop à enjeux a été effectuée. Ils correspondent aux priorités affichées par l'État en région et font l'objet d'un examen plus approfondi, notamment avec le concours des services du trésorier-payeur général en qualité d'expert, et d'une présentation en car, si possible précédée d'un débat en pré-car. Cependant, tous les bop seront transmis par le préfet de région aux responsables de programmes concernés, accompagnés de son avis. Le car en sera systématiquement informé, même a posteriori. Rôle respectif du préfet et du responsable de bop dans l'exécution du bop déconcentré 
 ● délègue Donne Avis sur la répartition définit sa signature son accord des crédits d'ordonnateur Schéma d'organisation financière secondaire
● détermine les crédits les UO 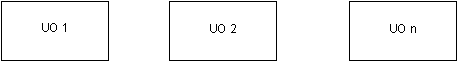 « délégations interservices » - Un élément moteur du développement de la culture de la performance Le préfet de région veille au développement d'une culture du résultat, s'agissant tant du suivi des objectifs des bop que de celui des actions du paser. Pour ce faire, le préfet de région et le car disposent d'un tableau de bord de la mise en œuvre des politiques publiques dans la région. Ce document, combinant des indicateurs physiques et des indicateurs financiers, est établi par le sgar, en liaison avec le trésorier-payeur général de région. Il intègre les éléments fournis par les services à partir des systèmes de contrôle de gestion mis en place dans le cadre de chaque programme ministériel. Sous l'autorité du préfet de région, le sgar est désormais chargé de développer la mise en commun des moyens des services de l'État en région. Il s'agit de généraliser et de poursuivre les initiatives déjà prises en s'appuyant, dans un cadre conventionnel, sur les outils de coopération que sont notamment la délégation interservices et la délégation de gestion. Le périmètre de mutualisation portera, dans l'immédiat, sur les domaines suivants : - l'organisation des concours de recrutement pour les corps d'agents à statut commun ou dont les modalités de recrutement sont proches. Sont concernés à titre principal les catégories B et C de la filière administrative ainsi que les personnels techniques à statut commun ; - l'action sociale, et en particulier les offres de services collectifs (restauration, logement) ainsi que les réseaux de professionnels de soutien (service social, médecins de prévention) ; - la formation interministérielle à travers les délégations interdépartementales à la formation ; - la communication sur les politiques de l'État. Les préfets de régions ont également été chargés d'étudier les modalités d'une optimisation des ressources entre les services déconcentrés de l'État dans les domaines des études, des techniques de l'information et de la communication, de l'expertise juridique, de l'immobilier et de la logistique ainsi que de tout autre thème vous paraissant opportun. L'essentiel du succès de la lolf dépendra donc des pratiques que les préfets développeront. 3. La construction d'un authentique dialogue de gestion Traditionnellement, les pratiques administratives associent insuffisamment les services territoriaux à la préparation des budgets. La mise en œuvre de la lolf est l'occasion de remédier à cette carence. Le dialogue de gestion est un processus d'échanges d'informations et de concertation entre des responsables, centraux et territoriaux, visant des objectifs communs pour atteindre les résultats attendus et améliorer la performance. Pour être constructif, il doit se nourrir des informations du contrôle de gestion. Ces informations concernent tous les éléments relatifs aux actions (financiers, de réalisation, de délai, de suivi...). Ce dialogue peut se dérouler à deux niveaux : vertical entre les services déconcentrés et leur administration centrale et horizontal entre les services déconcentrés et le préfet de région. a) Un dialogue de gestion horizontal Au niveau horizontal, le dialogue doit permettre aux préfets de s'assurer de la cohérence des hypothèses de construction du budget, de la prise en compte de la dimension régionale et territoriale du programme, de son adaptation aux particularités régionales et des projets de territoires ainsi que de sa compatibilité avec le paser, les pased et les actions prioritaires régionales, mais aussi de la cohérence territoriale des actions des services déconcentrés dans un souci de transversalité. Le projet de budget doit prendre en compte les actions incluses dans les contrats de plan, tandis que des moyens spécifiques doivent être mis en œuvre pour suivre les crédits liés à ces mêmes contrats. Doivent être déterminées également la ventilation prévisionnelle des investissements, entre investissements d'intérêt régional et investissements d'intérêt départemental ainsi que l'identification d'indicateurs d'activités spécifiques régionaux. Ainsi, le système d'information à la disposition des préfets doit permettre de territorialiser le budget de l'État, c'est-à-dire d'autoriser les comparaisons d'un territoire à l'autre, d'un service à l'autre. Pour conforter leur rôle interministériel dans le cadre d'un État territorial reconfiguré, des moyens efficaces d'animation des politiques publiques doivent donc être mis à la disposition des préfets de région et de département. b) Un dialogue de gestion vertical Au niveau vertical, en contrepartie de l'autonomie budgétaire accordée, est progressivement mis en place un dispositif de dialogue de gestion entre administration centrale et services déconcentrés, dialogue complété par un contrôle de gestion qui a anticipé le volet performance de la lolf. Selon un schéma idéal, le dialogue doit être conduit par chaque responsable de bop. Il ne doit pas être réservé à un spécialiste, mais doit faire l'objet d'une appropriation par l'ensemble de l'encadrement et des agents des services déconcentrés. Il doit s'articuler autour des grandes missions de ces derniers. Chaque responsable de programme devrait pouvoir « territorialiser » la performance et être en mesure ainsi de proposer à l'ensemble des responsables de bop et d'uo des éléments de comparaison. La remontée des objectifs fixés au plan local vers l'administration centrale doit permettre ensuite de s'assurer que leur moyenne correspond effectivement à l'objectif national, d'entamer un dialogue avec les services qui s'en éloigneraient trop, voire le cas échéant de réviser l'objectif national s'il est jugé inadéquat. Le principe de déconcentration qui fonde l'organisation du contrôle de gestion, doit toutefois être compatible avec le maintien d'une cohérence d'ensemble de l'action des services déconcentrés dans l'exécution des priorités gouvernementales. Les entretiens de gestion conduits au sein de chaque ministère doivent être l'occasion de vérifier que chaque service décline ses priorités dans cette cohérence d'ensemble. Ils devraient mettre en présence, à intervalle régulier, au cours d'une journée l'ensemble de l'encadrement des services et les représentants des directions de l'administration centrale. L'exercice préparé par le service déconcentré qui établit un dossier retraçant l'activité par mission, devrait permettre de faire un état des lieux approfondi dégageant les points forts et les points faibles. Il doit conduire à retenir pour l'avenir des objectifs prioritaires pour l'action externe de la préfecture et pour la gestion interne des moyens. L'entretien de gestion peut permettre de formaliser pour chaque service un document de référence qui fixe des priorités pour l'action externe du service et précise les moyens internes à mettre en œuvre pour les atteindre. La déconcentration peut, à côté d'avantages incontestables tels que la présence, face à l'élu, d'interlocuteurs de même niveau susceptibles d'engager l'État, être aussi une façon d'empêcher le développement de la décentralisation et encourager les dualités de structures administratives sur le terrain. LA REDÉFINITION DES RAPPORTS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : ENTRE TUTELLE ET CONTRACTUALISATION Se pose la question d'un « État rusé » qui se servirait de la décentralisation pour maintenir sa présence et diffuser ses règles dans un territoire dont il conserve la maîtrise. Ainsi, certains auteurs relèvent que « le moyen le plus sûr dont dispose le centre pour penser sa propre " diffusion " sur l'ensemble du territoire, c'est de préserver son monopole du pouvoir normatif initial : par la loi et le décret, il se rend visible à tous comme centre incontesté. Mieux, il condamne ainsi le local à devoir se définir par rapport à lui, qui reste seul investi du pouvoir de s'auto-définir » (181). Les administrations décentralisées sont redoublées par les services territoriaux de l'État qui, placées sous l'autorité du préfet, sont autant de relais périphériques du centre. Le discours sur l'intérêt général reste l'affaire de l'État qui peut continuer de se projeter dans un territoire toujours idéalement unifié et dans lequel il garde l'initiative. I. - L'INDÉTERMINATION DE LA CLAUSE GÉNÉRALE DE COMPÉTENCE Fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, explicitée depuis la révision de mars 2003 dans le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution en vertu duquel « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », la clause générale de compétence désigne la « vocation générale dont dispose une collectivité à assumer une compétence en servant l'intérêt public local » (182). Elle permet aux collectivités territoriales d'avoir des marges de manœuvre au-delà de leurs compétences strictes. Les élus revendiquent de plus en plus la fonction d'intégration des politiques sectorielles. Sur ce fondement, une collectivité locale se considère saisie d'un problème à partir du moment où il émerge sur son ressort territorial. Le processus décentralisateur est caractérisé par une dynamique institutionnelle et un auto-entretien des politiques, selon un « processus incrémental » (183). Mais cette notion est riche d'ambivalence. D'une part, elle constitue la traduction juridique du principe de libre administration des collectivités territoriales, tentées de se saisir des problèmes se posant sur leur territoire. Elle permet de ne pas figer les interventions publiques au regard d'une définition trop précise des problèmes, favorise innovation et respiration, en ne sclérosant pas le champ d'intervention des acteurs locaux. D'autre part, sur ce fondement, l'État peut solliciter les collectivités locales pour financer ses propres politiques et contrôler leur action, favorisant ainsi une coproduction de l'action publique. Par ailleurs, la clause générale de compétence s'avère troublée par une modification importante de son contexte. En effet, comme on l'a vu supra, les epci eux-mêmes interviennent dans des champs de plus en plus larges et stratégiques et la distinction entre « intérêt communal » et « intérêt communautaire » est loin de lever toutes les incertitudes. Parallèlement, certaines collectivités, telles que les départements sur la fonction sociale, sont de plus en plus spécialisées, de manière consciente ou non. De surcroît, l'État, dans un certain nombre de domaines, est conduit à faire supporter par les collectivités locales le financement de ses propres actions, selon le développement de la technique contractuelle. La clause générale de compétence pose ainsi une question non tranchée : celle de la tutelle entre collectivités locales, celle de la mise sur un pied d'égalité des différentes collectivités qui crée les conditions de partenariats multiples. L'approche par « bloc de compétences » a difficilement résisté à la réalité. L'affirmation d'un principe de spécialité, en raison même du principe de libre administration, pose des problèmes juridiques. Une solution intermédiaire a été recherchée dans la notion de « chef de file ». Ainsi, si le principe de libre administration ouvre aux collectivités concernées une grande capacité d'initiative, il opacifie les responsabilités et favorise les transferts de la part de l'État. La redéfinition des problèmes publics et la raréfaction des ressources amènent à multiplier les partenariats. Par ailleurs, il convient de ne pas laisser se développer une forme de spécialisation sous la seule contrainte budgétaire. Il ne faudrait pas déterminer le degré d'autonomie des collectivités territoriales au seul prisme du passage de la tutelle a priori au mécanisme du contrôle de légalité sanctionné par le déféré préfectoral. En effet, l'essentiel demeure : nombre d'actes sont discutés au préalable avec les services du contrôle de légalité, les moyens financiers sont insuffisants, les structures administratives ont atteint une complexité paralysante, l'enchevêtrement des compétences ne s'atténue pas, la plupart des communes doivent encore recourir quasi obligatoirement aux services techniques de l'État, qui édictent ou transposent de plus en plus de normes techniques. Symbole de la prééminence de l'État sur le territoire, le contrôle des collectivités locales trouve son fondement juridique dans la Constitution. Confié au « représentant de l'État », c'est-à-dire le préfet, le contrôle demeure étroitement associé au principe de libre administration des collectivités locales, mais sa pratique marque en elle-même les limites de la décentralisation. 1. Une garantie de l'unité de l'État Les intendants étaient déjà chargés de faire respecter dans leur généralité la loi et la bonne exécution des décisions royales. Même dans les communautés disposant du pouvoir de désigner leurs magistrats formant le corps de ville (maire, échevins), les actes de ces autorités sont soumis à approbation préalable avant de devenir exécutoires. La Constitution de 1946, en même temps qu'elle proclame la libre administration des collectivités locales, dispose que « (...) le contrôle administratif des collectivités territoriales (est assuré), dans le cadre départemental, par des délégués du Gouvernement désignés en Conseil des ministres ». Ce contrôle s'exerce a posteriori et non, comme la tutelle, a priori. Les travaux préparatoires de la Constitution de 1946 montrent que le constituant souhaitait, dès cette époque, supprimer le régime de tutelle et que l'expression de « contrôle administratif » ne visait qu'un contrôle de la légalité assuré par le juge administratif à l'initiative du préfet. Aussi le rapporteur du projet constitutionnel confirme que la « tutelle administrative, qui était une des pièces essentielles de notre droit public, devra céder la place à une conception se rapprochant bien davantage du gouvernement local (...) tel qu'il est pratiqué dans les démocraties anglo-saxonnes » (184). Le préfet devait jouer « le rôle de commissaire du pouvoir central qui lui était dévolu sous le régime de l'an III, c'est-à-dire qu'il sera préposé au respect de la loi et qu'aux côtés des élus départementaux, il jouera un rôle analogue à celui du ministère public au côté des tribunaux judiciaires, il requerra et surveillera l'application de la loi générale ». Mais cette volonté relevait plus alors de l'acte de foi ou de la prophétie que d'une prescription ferme. La disposition restera ainsi pendant plusieurs dizaines d'années synonyme de tutelle. Le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Lors des débats sur la préparation de la Constitution, le député Mignot estimait déjà qu'« aux pouvoirs de tutelle actuels, notamment pour les communes, on peut parfaitement substituer de simples pouvoirs de contrôle », tandis que le commissaire du gouvernement faisait observer « que la véritable limite à la décentralisation ce n'est pas le pouvoir de tutelle, mais l'inexistence d'une réforme de la fiscalité locale » (185). Tout en reconnaissant l'existence de collectivités décentralisées conduites par des assemblées élues, dotées de compétences propres et s'administrant librement, la loi fondamentale pose le principe d'un contrôle à leur égard. En dépit d'une organisation résolument décentralisée, le caractère unitaire et la prééminence de l'État demeurent, précisément parce que ce dernier exerce le contrôle de ces collectivités. L'absence de contrôle conduirait en effet à identifier ces collectivités à de véritables entités fédérées. Le contrôle administratif, évoqué à l'article 2 de la Constitution et dénommé contrôle de légalité, constitue l'une des missions constitutionnelles dévolues au représentant de l'État. Il vise à encadrer juridiquement l'action publique locale en veillant à ce que les décisions administratives et budgétaires prises par les collectivités locales soient conformes à la règle de droit et compatibles avec les intérêts généraux de l'État. En effet, saisi du projet de loi « Defferre » relatif à la décentralisation, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'expliciter les principes du contrôle administratif : « Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 72 de la Constitution que, si la loi peut fixer les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, c'est sous la réserve qu'elle respecte les prérogatives de l'État énoncées à l'alinéa 3 (186) de cet article ; que ces prérogatives ne peuvent être ni restreintes ni privées d'effet, même temporairement ; que l'intervention du législateur est donc subordonnée à la condition que le contrôle administratif prévu par l'article 72 (...) permette d'assurer le respect des lois et, plus généralement, la sauvegarde des intérêts nationaux auxquels, de surcroît, se rattache l'application des engagements internationaux contractés à cette fin. » (187) La finalité du contrôle est par conséquent d'assurer le respect de la loi par les collectivités locales, cette soumission à la règle de droit étant, dans un État unitaire, la condition de l'État de droit au plan local. La conformité juridique des actes se décline sur les plans organique (la forme) et matériel (le fond). Sur le plan organique, l'acte doit être édicté par l'autorité compétente conformément aux procédures en vigueur. Sur le plan matériel, l'ensemble des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires nationales ainsi que le droit communautaire, forment le « bloc de légalité », dont la teneur s'impose aux collectivités locales. Par ailleurs, les actes considérés ne doivent pas être contraires aux intérêts nationaux définis par la politique gouvernementale. Cependant, si le contrôle de conformité à la loi apparaît objectif, le contrôle de conformité aux intérêts nationaux semble bien davantage empreint d'opportunité. Sur quel fondement en effet apprécier la conformité d'un acte à l'intérêt national ? L'interprétation de la notion d'intérêt national n'est pas sans incidence sur la portée du contrôle. La réforme de 1982 a promu une conception restrictive de l'intérêt national, limité à la défense nationale, aux relations extérieures et à la paix sociale, contrairement au régime qui prévalait jusqu'alors. Le dispositif de contrôle institué par la loi du 2 mars 1982 a substitué un contrôle administratif et juridictionnel de légalité a posteriori au contrôle de tutelle a priori, de sorte que le représentant de l'État ne peut plus statuer en opportunité quant à la conformité des actes locaux. Le contrôle se limite désormais à l'appréciation de la seule légalité, à charge pour le juge administratif, saisi par le préfet d'un acte estimé illégal, d'en prononcer le cas échéant l'annulation. Le Conseil constitutionnel a toutefois estimé que ce mode de contrôle était suffisant pour assurer la sauvegarde des intérêts nationaux : « Considérant que (...) le représentant de l'État défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions pris ou passés par les autorités communales, départementales et régionales qu'il estime contraires à la légalité ; que ce contrôle vise l'intégralité des objectifs fixés à l'article 72 de la Constitution » (188). Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose que le caractère exécutoire des actes des collectivités territoriales dépende, dans tous les cas, de leur transmission au représentant de l'État. En effet, il estime que la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789 est satisfaite dès lors que, outre la faculté pour les intéressés de saisir le juge administratif, le représentant de l'État a la possibilité d'exercer un contrôle de légalité, et qu'en conséquence il appartient au législateur de mettre le représentant de l'État en mesure de remplir en toutes circonstances les missions que lui confie le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, grâce notamment à des procédures d'urgence (189). L'innovation majeure de la réforme de 1982 réside dans le caractère immédiatement exécutoire qui est conféré aux actes pris par les autorités décentralisées. Ces actes sont en effet exécutoires de plein droit dès lors qu'ils ont été publiés, s'agissant des actes réglementaires, ou notifiés, s'agissant des décisions individuelles, et pour autant qu'ils ont fait l'objet d'une transmission, mais non plus d'une approbation préalable, au représentant de l'État, auquel il appartient d'en apprécier la légalité. L'accusé de réception des actes par le représentant de l'État ne constitue pas une condition du caractère exécutoire des actes. Classés par catégories de collectivités territoriales, les actes soumis à l'obligation de contrôle sont limitativement énumérés. Aux termes de la circulaire du ministère de l'intérieur du 22 juillet 1982, le législateur a choisi de ne soumettre au contrôle de légalité que les actes considérés comme « les plus importants par leurs conséquences ». Les actes qui ne sont pas légalement soumis à transmission peuvent toutefois être contrôlés dès lors qu'ils sont portés à la connaissance du représentant de l'État. L'autorité préfectorale dispose du pouvoir de faire intervenir le juge, administratif ou financier, pour aboutir à l'annulation, voire à la modification, d'un acte estimé illégal. La portée de cette prérogative varie selon la nature des actes contrôlés. Il convient de distinguer le contrôle des actes budgétaires du contrôle des actes administratifs. Le préfet a compétence liée pour saisir la chambre régionale des comptes, tandis que sa compétence est discrétionnaire pour saisir le tribunal administratif. Concernant le contrôle de légalité des actes administratifs, le préfet, ou d'autres membres du corps préfectoral titulaires d'une délégation de signature (190), dispose, dans le cadre du délai de recours de droit commun de deux mois s'ouvrant à compter de la date de réception de l'acte, de la possibilité de saisir le tribunal administratif. Le juge statue alors au contentieux sur la légalité des actes et en prononce, le cas échéant, l'annulation. 2. Une valeur générale dissuasive L'activité des services affectés au contrôle de légalité n'est pas limitée au seul contrôle a posteriori mais s'exerce largement sous forme de conseil. Très souvent, ce sont les représentants des collectivités qui s'adressent préalablement aux services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour s'assurer de la légalité d'une opération, sans attendre que le préfet leur adresse des remarques sur des décisions déjà prises. En ce sens, ce n'est que lorsque l'on en arrive à la saisine du tribunal administratif que la situation est la plus difficile à admettre, pour le préfet comme pour les élus, mais cette hypothèse reste peu fréquente, car elle est généralement précédée d'une discussion menée en vue de trouver une solution acceptable pour tous. Bien entendu, cette solution est largement favorisée par la menace de l'arme contentieuse dont est assorti le contrôle de légalité. Même lorsque le préfet a formulé une lettre d'observations valant recours gracieux et que la collectivité n'y a pas fait droit, cela ne signifie pas qu'il doive automatiquement déférer l'acte qui a fait l'objet de sa demande. Dès l'origine, les rédacteurs de la loi de 1982 avaient conçu l'exercice du déféré préfectoral comme un recours contentieux ne devant intervenir qu'en dernier lieu, c'est-à-dire en cas d'échec de la procédure informelle de modification, par la collectivité concernée, de l'acte estimé illégal. Les termes de la circulaire du ministère de l'intérieur du 22 juillet 1982 adressée au préfets, commissaires de la République, sont dans la même logique : « (...) je vous demande (...) d'informer systématiquement l'autorité locale concernée avant de saisir le juge administratif lorsqu'un de ces actes vous apparaît entaché d'une illégalité et de lui communiquer toutes précisions utiles lui permettant de rendre légaux les actes concernés. Ce n'est que si l'autorité locale intéressée ne prend pas les mesures nécessaires qu'il vous appartient de saisir le juge administratif et d'informer alors l'autorité locale de cette saisine (...). » La jurisprudence reconnaît ainsi au préfet un large pouvoir d'appréciation, dans le cadre duquel il peut prendre en compte d'autres considérations que la seule légalité pour décider de déférer ou non. À titre d'exemple, il n'est pas forcément souhaitable de déférer un contrat, sachant que son annulation entraînera un droit à indemnisation, parfois important, pour le co-contractant de la collectivité. Dans cette hypothèse, l'appréciation portée par le préfet mettra en balance la gravité de l'irrégularité commise et le coût qu'une annulation pourrait entraîner pour les contribuables locaux, ce coût n'étant à l'évidence pas négligeable en termes d'intérêt général. Dans sa décision du 18 avril 1986 Commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine, le Conseil d'État a ainsi validé l'orientation prise par la circulaire ministérielle de 1982 en jugeant que la notification par le préfet d'observations sur la légalité avait pour effet de proroger le délai du déféré. Le caractère éminemment discrétionnaire du déféré a été consacré par l'arrêt Brasseur du 25 janvier 1991, le Conseil considérant en effet que le refus du représentant de l'État de déférer un acte manifestement illégal, en dépit d'une demande ainsi formulée par un administré, constituait une décision insusceptible de recours. L'arrêt du 28 février 1997 Commune du Port confirme que le déféré constitue une simple « faculté » laissée à la seule appréciation du représentant de l'État, alors même que la loi use du présent de l'indicatif. Enfin, par l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Belcodène du 16 juin 1989, le Conseil d'État reconnaît au préfet la possibilité de se désister d'un déféré devant la juridiction administrative. Il ne faut donc pas négliger, non plus, le caractère pédagogique que peuvent revêtir les lettres d'observations adressées aux exécutifs locaux, lesquelles les informent d'une illégalité constatée et les invitent à ne pas les réitérer. L'assistance à l'élaboration des actes est sollicitée par les exécutifs locaux, notamment dans les collectivités locales qui ne bénéficient pas des moyens juridiques suffisants, ce qui ne manque pas de soulever des objections de principe tenant au respect de l'autonomie de gestion et de la libre administration des collectivités locales. 3. Une application inégale sur le territoire La pratique a montré que le déféré demeure considéré comme une procédure exceptionnelle, manœuvrée avec une grande prudence par les préfets. Les rapports annuels du Gouvernement au Parlement sur le contrôle de légalité font apparaître d'importantes différences d'un département à l'autre, toutes choses étant égale par ailleurs. Le diagnostic établi en 2003 par la mission chargée de l'audit sur le contrôle de légalité est, de ce point de vue, relativement sévère (191). A pu ainsi être évoquée à cet égard la mise en cause de l'égalité des citoyens devant la loi : « Le reproche le plus ferme, qui concerne le contrôle de légalité (...), est celui de l'hétérogénéité. Il est exprimé de façon constante et avec précision par les élus locaux, conscients de ce que la diversité des situations, des enjeux et des rapports à la loi appelle une politique adaptée de contrôle. Mais ils relèvent que dans des départements et des arrondissements voisins, voire des communes toutes proches, la réponse de l'État s'avère parfois radicalement inverse ; de même, quand un des fonctionnaires participant au contrôle, sans doute préfet, secrétaire général ou sous-préfet, mais tout autant agent du service, quitte ses fonctions puis est remplacé par un de ses collègues à la compétence ou aux conceptions différentes. Enfin, ils observent parfois que les grandes collectivités sont " ménagées " par le contrôle ; de même, celles qui, par exemple pour l'instruction des permis de construire, ont fait intervenir un service de l'État. » Lorsque l'inégalité de traitement répond à la diversité des situations locales, elle peut sembler être sans gravité, voire préférable à la recherche systématique d'une égalité de principe. Il ne paraît pas inadapté, dans un contexte de partenariat, d'exercer un contrôle plus souple lorsque les rapports entre le préfet et les élus locaux sont consensuels. Le contrôle est effectivement exercé, mais il n'est pas obligatoirement sanctionné par une procédure contentieuse. À l'inverse, là où les rapports sont plus tendus, où les collectivités s'engagent elles-mêmes dans un rapport de force avec l'État, il n'est pas choquant que le contrôle soit marqué par plus de sévérité. Dans les deux cas, le contrôle est effectivement exercé, mais les conséquences qui s'y attachent diffèrent. Mais cela ne doit pas nous interdire de constater qu'il peut arriver qu'à situation semblable, le contrôle soit exercé de manière différente, ce qui souligne souvent les manques de moyen dont disposent les services du contrôle de légalité. Comme le relevait la mission interministérielle en 2003, rejoignant nombre de constatations relevées par le Conseil d'État dans son Rapport public 1993, « les services qui concourent au contrôle de légalité traitent une grande masse d'actes dans des délais courts et stricts. Ils les traitent de façon diverse, peu coordonnée et avec des moyens obsolètes. (...) En ce qui concerne le contrôle de légalité, le chiffre de huit millions d'actes, généralement cité, pêche par défaut. (...) ce chiffre qui a doublé sur quinze ans, continuera d'augmenter pour trois raisons : le mouvement normal de l'activité locale, le développement de l'intercommunalité, la nouvelle étape de la décentralisation (...). « Cette masse impressionnante d'actes et de documents est, d'une certaine façon, toujours traitée comme elle l'aurait été au début du siècle précédent. (...) La machinerie administrative apparaît, quant à elle, étonnamment éclatée (...) : dans aucun des départements visités, la direction des collectivités locales de la préfecture n'assure la coordination des sous-préfectures ; elle se comporte en sous-préfecture de l'arrondissement, chef-lieu. « Cette machinerie opère, le plus souvent, sans stratégie de contrôle. Cela est vrai d'une stratégie qui serait définie au niveau national. Depuis les circulaires qui ont suivi la mise en place de la décentralisation, la mission n'a pas trouvé d'instruction générale du Gouvernement en ce sens (...). « On retrouve cette absence de stratégie de contrôle dans la plupart des départements. Il semblerait, selon les visites et contacts de la mission, que seulement moins d'un quart des préfets aient défini expressément le cadre d'action des services placés sous leur autorité (...). « Le contrôle mobilise une compétence technique parfois insuffisante. Telle est la deuxième réserve formulée par la plupart des élus rencontrés, et les préfets partagent cet avis. (...) Le phénomène est d'autant plus marqué que les grandes collectivités se sont dotées de services juridiques étoffés ; ce qui ne les conduit pas à mépriser la fonction de conseil des services de l'État mais elles la souhaitent plus élaborée. Grandes et moyennes n'hésitent pas à recourir aux services de spécialistes libéraux quand le sujet est délicat ou important. Les services de l'État ressentent alors souvent une faiblesse relative. « Ces faiblesses techniques appauvrissent le conseil, dissuadent parfois de déférer et donnent, notamment pour les contrats, une allure formelle au contrôle. (...) Le contrôle budgétaire appelle des observations de même ordre. » Cette situation peut provoquer des difficultés au regard de la responsabilité du préfet. Mais il faut faire observer que les devoirs de l'autorité de contrôle sont loin d'être les mêmes que ceux de l'autorité décisionnaire, cette dernière étant tenue le plus souvent à une obligation de résultat, qui engage sa responsabilité plus avant à l'égard des personnes que sa décision pourrait léser. L'autorité de contrôle n'est, quant à elle, soumise qu'à une obligation de moyens. Les enjeux de la réforme du contrôle de légalité sont essentiels. En effet, dans un environnement juridique de plus en plus compliqué et foisonnant, les collectivités territoriales ont de plus en plus besoin de sécurité juridique. Nombreuses sont celles qui attendent du contrôle de légalité une garantie de régularité juridique. Or, il n'est pas rare qu'à l'occasion d'un contrôle d'une chambre régionale des comptes, par exemple, soit contestée une délibération qui avait pourtant passé l'examen du contrôle de légalité. Et il n'est pas besoin d'évoquer les risques de poursuites pénales. Une réforme du contrôle de légalité a été amorcée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorisant la télétransmission des actes, réduisant la liste des actes soumis à l'obligation de transmission et créant pour le préfet un droit à se faire communiquer tout acte non compris dans cette liste. En outre le relèvement à 230 000 euros du seuil des marchés soumis au contrôle, conséquence de la réforme du code des marchés publics, entraîne mécaniquement un allégement des contrôles. La mise en œuvre de ces dispositions est susceptible d'améliorer nettement les conditions matérielles du contrôle, puisque le nombre d'actes arrivant dans les préfectures sera moindre et l'utilisation de supports électroniques (192) permettra un maniement plus aisé. La télétransmission est, sans l'ombre d'un doute, un procédé d'avenir qui mérite que l'on en réaffirme la priorité. Mais, en termes plus qualitatifs, aucune disposition ne permet le ciblage des domaines de contrôle. Cela ne fait toutefois pas obstacle à ce que les préfectures opèrent des choix en fonction des enjeux locaux, de façon à tenir compte de ces enjeux dans les orientations de travail données aux agents et les décisions de les affecter à tel ou tel poste. Il est possible de dissocier le contrôle des moyens humains qui lui sont dévolus, tant la compétence et le nombre des personnes en charge de cette mission influent sur la manière dont elle est accomplie. Le perfectionnement du contrôle de légalité est devenu une priorité. L'action n° 3 du programme budgétaire « Administration territoriale », retraçant notamment l'activité des préfectures chargées de contrôler la légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et de les déférer devant le juge administratif en cas d'irrégularités, en prend acte. L'objectif n° 3 du programme vise à réduire le nombre d'actes non conformes des collectivités territoriales et établissements publics. L'objectif n° 4 prévoit de moderniser le contrôle de légalité. Pour suivre l'évolution des résultats au regard de l'objectif n° 3, trois indicateurs ont été définis. Le premier est le taux de contrôle des actes prioritaires reçus par la préfecture, qui permet de mesurer la capacité du préfet à assumer sa mission de contrôle en fonction d'une stratégie qu'il aura préalablement arrêtée. Une priorité a été accordée aux actes de commande publique, de la fonction publique territoriale, d'urbanisme et aux décisions de police. Le deuxième est le taux de déférés gagnés par le préfet, qui atteint 85 % en 2005. Le troisième est le taux de saisines de la chambre régionale des comptes jugées recevables. Pour mesurer l'évolution des services pour atteindre l'objectif n° 4, un seul indicateur a été retenu : le taux d'actes télétransmis par l'application actes. Ce projet permet la dématérialisation des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. Un prototype a été ouvert en décembre 2003 dans les Yvelines. La plate-forme définitive de réception des actes est en phase de tests. Au premier trimestre 2005, outre les Yvelines, trois autres préfectures, dans le Val-d'Oise, les Alpes-Maritimes et le Rhône, étaient équipées. La coordination des projets doit s'effectuer prioritairement avec le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dont le projet helios couvre le « champ budgétaire » : des complémentarités existent entre les deux projets et des synergies doivent ainsi être recherchées entre les préfectures et le réseau des comptables du Trésor public. Outre la définition de priorités et la télétransmission des actes que les préfectures s'attachent à développer, la spécialisation croissante des agents chargés de cette mission complexe doit renforcer le rôle des préfectures et la coopération interservices. La création de structures d'expertise agissant sur un territoire recouvrant plusieurs préfectures, tel le pôle interrégional d'appui au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire de Lyon revêt tout son sens. Ce pôle, installé en septembre 2002, a pour mission d'aider les préfectures des quatre régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté dans l'exercice des fonctions afférentes au contrôle de légalité. La mise en place d'un tel service permet d'améliorer la réactivité, de rechercher des solutions adaptées aux situations locales et de renforcer la fiabilité juridique des réponses. Le caractère délocalisé du service et son territoire limité à vingt départements semblent avoir permis d'entretenir avec les préfectures une relation de proximité, et de mieux appréhender les contextes et les enjeux qui s'attachaient aux actes ou opérations qui lui étaient soumis. Or, cette connaissance du contexte pourrait plus difficilement être le fait d'un service d'administration centrale. Au-delà de ces questions d'organisation, il faut bien constater que l'initiative du contrôle de légalité est confiée à des autorités directement impliquées dans l'action et la vie locales et qui sont des partenaires privilégiés des collectivités locales. Il peut se trouver en pratique des situations paradoxales dans lesquelles l'émission des actes contrôlés et le contrôle sont juxtaposés. La création d'un organe indépendant de la vie locale pourrait être envisagée à ce titre. Le ministre de l'intérieur a annoncé lors du dernier congrès des maires de France son intention d'ouvrir le chantier de la rénovation du contrôle de légalité. La vitesse de déploiement de l'application informatique qui permet la dématérialisation du contrôle sera doublée et toutes les préfectures y seront raccordées d'ici à la fin de 2006. La modernisation du contrôle passe aussi par la fixation de priorités : « Il faut que nous mettions fin à la fiction du contrôle exhaustif, qui ne recouvre en réalité qu'un contrôle formel et, il faut bien le dire, trop largement orienté vers les questions de personnel ». Chaque préfet devra donc « déterminer les champs de contrôle prioritaires, à la fois thème par thème et, soyons clairs, collectivité par collectivité ». Le ministre veut « mobiliser, dès le stade du conseil, un réseau d'expertise propre à assurer le niveau de sécurité juridique maximal », notamment en matière d'urbanisme et de marchés publics. Le ministre délégué aux collectivités territoriales a eu l'occasion de préciser, à l'occasion de la discussion des crédits de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du projet de finances pour 2006, que : « Pour ce qui est du contrôle de légalité, je partage l'avis formulé sur l'intérêt de développer la fonction de conseil. C'est bien dans cet esprit qu'a été installé à Lyon le pôle interrégional d'aide au contrôle de légalité. « L'importance de ces interventions est certes difficile à mesurer avec précision, car elles peuvent revêtir des formes multiples et interviennent souvent avant la prise d'un acte formel. « Pour ce qui est des actes déjà adoptés, les préfectures sont tenues de comptabiliser ceux qui ont été réformés ou retirés après une lettre d'observation, donc avant tout recours contentieux. Un intervenant a évoqué les chiffres, que j'avais d'ailleurs communiqués à la commission des lois, mais je veux apporter une précision plus récente. S'agissant du contrôle de légalité, en 2004, 8,7 millions d'actes ont été transmis, le nombre de lettres d'observation s'établissait à plus de 100 000 et les recours portés devant le juge administratif s'élevaient à 1 422. « Un " manuel du contrôle de légalité " destiné aux élus et assorti d'un recueil de jurisprudence est en outre en cours d'actualisation. Ce document appréhendera, comme vous le suggérez, l'ensemble des domaines dans lesquels la responsabilité des élus pourrait être mise en cause. Il s'agit d'un sujet essentiel et nous mesurons tous, les uns et les autres, les appréhensions des maires sur ce point. » (193) B. LES NORMES TECHNIQUES COMME SUCCÉDANÉS DE LA TUTELLE Les normes techniques (194) s'appliquent aux collectivités locales en tant que maîtres d'ouvrage lorsqu'elles passent des marchés publics, en tant qu'employeurs ou lorsqu'elles exercent des fonctions de prestataires de services auprès de leurs administrés ou lorsqu'elles agissent en tant qu'acheteurs ou investisseurs. Cette question des normes techniques a pris, ces dernières années, une importance particulière, en raison notamment de la « judiciarisation » de la vie politique locale et à la progressive pénalisation de certains contentieux (195) et des coûts de plus en plus importants que leur application implique (196). D'un côté, le respect d'une norme technique ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité en cas de dommages. De l'autre, le non-respect d'une norme ne suffira pas à engager la responsabilité. Mais, en tout état de cause, la norme peut servir d'indice aux juges afin de vérifier s'il y a eu une imprudence, une négligence ou un comportement fautif. Le champ de ces normes est de plus en plus vaste. Il ne s'agit pas seulement des normes de type privé homologuées par l'Association française de normalisation (afnor), le Comité européen de normalisation (cen) ou encore par l'Organisation internationale de standardisation (iso) (197), mais plus largement des normes techniques réglementaires qui constituent une catégorie de prescriptions techniques ayant un caractère obligatoire parce que reprises dans une loi, un décret ou un arrêté comportant le détail de règles techniques. Les deux ensembles interagissent puisque l'application d'une norme homologuée peut être rendue obligatoire par un arrêté du ministre chargé de l'industrie et le cas échéant des autres ministères intéressés. Une telle possibilité est ouverte lorsque des considérations de santé, de sécurité ou d'autres intérêts publics sont en jeu. S'y ajoutent les normes réglementaires qui peuvent être issues de directives communautaires transposées en droit interne (198). De surcroît, « cette évolution implique que le coût des normes techniques soit susceptible d'entraîner une réduction sensible de leur capacité d'investissement pour d'autres objets. Ce phénomène pourrait comporter une remise en cause de leur pouvoir décisionnel sur leurs investissements, alors même que les lois de décentralisation les ont libérées de la tutelle technique et financière. » (199) L'abandon de la tutelle technique né de la décentralisation apparaît ainsi de plus en plus relatif (200). Le domaine de l'environnement et du développement durable constitue un champ privilégié de réglementations, dans lequel s'accumulent directives et mesures de transposition (201), à tel point que l'utilisation de plus en plus fréquente des normes techniques pour élaborer ou compléter la règle de droit incite certains à se demander si l'on assiste « à une montée du juridique (...) ou si s'opère au contraire celle de l'a-juridique, notamment des normes techniques et scientifiques, ne prenant à travers des règlements, des protocoles, etc., la forme du droit que pour mieux prendre la place de celui-ci » (202). Le rôle de l'État peut apparaître comme essentiel dans la mesure où il pourrait apparaître comme le seul en capacité de coordonner sur des territoires les dynamiques économiques, les demandes sociales et les exigences environnementales (203). Mais, à l'environnement, auquel sa dimension globale confère au régulateur un pouvoir de normalisation sans limite, il faut ajouter les bâtiments et travaux publics, les transports, les équipements pour les crèches, les écoles et le sport, les installations foraines, la sécurité incendie, l'hygiène et la sécurité du travail, les techniques d'organisation et services aux entreprises... L'effet de la norme a un coût marginal croissant. Les communes sont les plus touchées par le poids des normes techniques en raison du vaste champ de leurs prérogatives. Les départements y sont surtout confrontés dans le cadre de la gestion de leurs bâtiments publics, notamment dans le domaine sanitaire et social, voire lorsqu'ils financent des investissements communaux. Les régions sont affectées par ce phénomène au titre de la formation professionnelle et des transports. Ces enjeux sont d'autant plus importants que, outre la question déjà mentionnée de l'importance des coûts de la mise en œuvre des normes techniques par les collectivités locales et des modalités de leur répercussion, se pose la question de la compatibilité du régime de la normalisation avec l'esprit de la décentralisation. En effet, en raison de la complexité de la normalisation, située à la frontière entre le droit et la technique, entre le droit national et le droit européen, les collectivités territoriales éprouvent des difficultés à remplir toutes leurs obligations. Elles participent peu à l'élaboration de ces normes, alors même qu'elles sont les premières à devoir assurer leur exécution, et les reçoivent de plus en plus comme l'expression d'une nouvelle tutelle. Si l'on peut admettre que les collectivités territoriales ne participent qu'à la marge à l'élaboration des normes de type privé, en revanche, il est moins compréhensible qu'elles se voient systématiquement imposer les normes de type réglementaire sans discussion préalable, sans participation à leur élaboration. Elles ne sont que très faiblement représentées au sein de l'afnor, sont absentes du cen. Dans l'élaboration des normes réglementaires, une consultation des élus locaux par le truchement de leurs associations est parfois organisée, mais sans que cette procédure ait acquis un caractère systématique. C'est parfois le cas également à l'échelle communautaire (204), notamment par le biais du comité des régions qui peut être un vecteur des intérêts des collectivités locales, y compris en matière de normes techniques. La principale réserve que soulève la question des normes techniques tient donc à la compatibilité de leur régime avec les lois de décentralisation. L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 2 mars 1982 implique que « seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions : (...) 2° les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions. Ces prescriptions et procédures sont réunies dans un code élaboré à cet effet ». Ce code est toujours attendu. Faute de services techniques étoffés ou de moyens financiers suffisants pour faire appel à des bureaux d'études spécialisés, nombre de collectivités, pour mettre en œuvre les normes prescrites, doivent s'en remettre directement aux services de l'État, en particulier aux dde ou ddaf et aux drire et aux diren. Ainsi, certains services déconcentrés se trouvent à la fois prescripteurs − ils fournissent une interprétation détaillée des normes édictées au niveau communautaire ou national − et conseillers − ils facturent les études permettant d'appliquer les normes prescrites. Le principe de la norme n'est pas contestable. C'est, encore une fois, le placement du curseur qui est en cause : jusqu'où l'État central peut-il imposer une règle ? Aussi utile soit-elle la normalisation ne doit pas empiéter sur les compétences des collectivités locales. Les tentations sont grandes pour les autorités centrales de reprendre la main. Les reflux normatifs ne sont pas rares, tandis que certaines notions, telles que le développement durable, permettent un retour de l'État sur des champs suffisamment larges pour rendre difficiles toute répartition précise des compétences. Aussi peut-on mentionner les textes tendant à freiner l'interventionnisme économique des collectivités territoriales ou bien à en soumettre les modalités à des règles plus contraignantes (loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, loi du 6 février 1992 précitée, loi ordinaire n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques), mais aussi à encadrer, soit par l'énoncé de règles de portée nationale, soit par la mise en place de dispositifs qui ont l'apparence du contrat, à l'exemple des politiques locales d'habitation (loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi Besson »), ou encore à obliger les collectivités à coordonner leurs interventions et à mettre en commun leurs ressources. Certains textes réintroduisent même le préfet en amont d'un certain nombre de décisions relatives aux services publics locaux. Certains textes, enfin, interdisent l'engagement financier des collectivités en faveur d'un certain nombre d'organismes ou de certaines activités. IV. - LE DÉVELOPPEMENT DE LA CONTRACTUALISATION Le développement des conventions entre collectivités publiques constaté ces dernières années ne laisse pas d'étonner. En effet, les fondateurs de la Cinquième République entendaient restaurer l'autorité de l'État, ce qui implique du côté de l'administration un renforcement des pouvoirs et des moyens et donc, a priori, l'utilisation du pouvoir de commandement, de la prérogative de puissance publique et non la recherche du consentement de l'administré. Cependant, devant la complexité des réalités sociales, la logique initiale de spécialisation des compétences par catégories de collectivité a cédé progressivement la place à des rapports de coopération entre les collectivités publiques au sein desquels le contrat, davantage que la loi, sert d'instrument de mise en cohérence de l'action publique. A. LA CAPACITÉ CONTRACTUELLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES Des dispositions générales ont ouvert le champ de la contractualisation entre les collectivités territoriales et l'État et entre collectivités territoriales. Ainsi, l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « les collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles met à disposition d'une autre ses services et ses moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ». Pour les seules régions, le même code, dans son article L. 4111-2, précise qu'elles « peuvent passer des conventions avec l'État, ou avec d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions de leur compétence ». Le Conseil constitutionnel a confirmé ce principe général du droit à la contractualisation ouvert aux collectivités territoriales, à propos de la convention fiscale passée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, en estimant qu'« aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce que l'État passe des conventions avec les diverses collectivités territoriales de la République telles que les communes, les départements, les régions ou les territoires d'outre-mer » (205). Selon la même logique, le Conseil d'État a reconnu la nature contractuelle des contrats de plan passés entre l'État et les régions (206) et a ouvert, en conséquence, la possibilité d'une action en responsabilité contractuelle d'une partie envers l'autre, même si ces contrats n'emportent, par eux-mêmes, « aucune conséquence directe quant à la réalisation effective des actions ou opérations » qu'ils prévoient (207). Au-delà des contrats de plan, se pose la question de la portée juridique et des conséquences réelles des conventions entre collectivités territoriales et entre ces dernières et l'État. Certaines difficultés ont été posées devant la justice. Le Tribunal des conflits a pu ainsi relever que le régime des contrats de plan avait un caractère administratif (208). Mais ces interventions du juge ne suffisent pas à réduire toutes les incertitudes liées à la prolifération de ces conventions. B. LE MODÈLE DISCUTÉ DES CONTRATS DE PLAN La formule des contrats de plan entre l'État et les régions a pendant longtemps constitué la principale formule de contractualisation des relations entre plusieurs personnes morales de droit public. L'accumulation des retards, malgré des efforts récents en matière d'infrastructures (209), tend à remettre en question cet instrument, même si abusus non tollit usum. Leur réforme a été annoncée, laissant une place plus claire aux départements et aux intercommunalités (210). 1. Une méthode originale d'administration sujette à critiques Les contrats de plan, institués par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui dispose que « l'État peut conclure avec les collectivités territoriales, les régions, les entreprises publiques ou privées et éventuellement d'autres personnes morales, des contrats de plan comportant des engagements réciproques des parties », constituent une technique originale de coopération entre l'État et les régions. Disjoints de la planification nationale − le dernier exercice remonte en effet au Xe plan (1989-1993) −, et devenus le principal outil de programmation du développement territorial, ces contrats répondent, pour partie, à la mystique d'un système d'administration concertée. Les régions y ont tiré un sentiment de légitimité, suite aux difficultés qu'elles ont éprouvées pour s'imposer après l'échec de 1969 et la persistance des opinions qui voient dans les régions un risque pour l'État. Les régions y ont également trouvé un pouvoir certain. La procédure leur permet de jouer un rôle de collectivité chef de file à l'égard des autres collectivités dans nombre de projets. Pour sa part, l'État y gagne en capacité d'action. Il y gagne aussi une forme de renouvellement de légitimité, les régions étant l'expression d'une certaine modernité. Le développement de ce type d'instruments s'est fait en résonance avec l'évolution de la politique de l'Union européenne et démontre une nouvelle fois, s'il en était besoin, l'affirmation de la dimension européenne des régions et la dimension de plus en plus régionale des politiques menées par l'Union (211). À cet effet, la durée des contrats actuels a été allongée en cohérence avec la durée de programmation des fonds structurels. Nombre de critiques adressées aux contrats de plan sont également adressées à la décentralisation : finalité moins lisible après vingt ans d'existence, dispersion entre un trop grand nombre d'objectifs, procédure lourde, partenariats compliqués. Le respect des engagements pris par les parties, par l'État en particulier, pose question. L'intérêt général lato sensu peut, en effet, commander des inflexions. La présence même de l'État modifie ou altère le contrat. Les régions quant à elles hésitent à porter le non-respect des engagements devant le juge par crainte des mesures de « rétorsion ». Le juge reste circonspect à l'égard des demandes des régions. Quelques chiffres permettent de donner une mesure de ces difficultés d'application. La quatrième génération des contrats de plan, qui couvre la période 2000-2006 (212), représente un engagement financier de l'État, des collectivités territoriales et de l'Union européenne de 50 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 53 % par rapport à la précédente génération de contrat de plan (213). L'engagement de l'État représente au total 17,7 milliards d'euros, y compris les grands programmes, les contrats spécifiques des territoires d'outre-mer et le financement des avenants marées noires lié à la tempête de 1999 − qui constituent 600 millions d'euros. Fin 2004, l'État a délégué 9,7 milliards d'euros, soit un taux de délégation de 55 %, ce qui représente un retard de 16,7 points par rapport à un taux théorique d'exécution qui est de 71,4 %. Ainsi, l'exécution des contrats de plan, fin 2004, accusait un retard d'une année et demie. Ce retard était variable selon les régions. Le taux de délégation d'autorisations de programme variait de 45 % à La Réunion à 65 % en Champagne-Ardenne. À l'occasion de ses déplacements en Alsace, en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en Picardie (214), le rapporteur a pu relever que tous ses interlocuteurs déploraient l'incapacité de l'État à honorer les engagements pris dans le cadre des contrats de plan, entraînant des retards non négligeables dans la programmation des projets. Si les différences dans l'exécution des contrats entre les régions existent, elles sont doublées de contrastes selon les ministères. Le taux d'exécution des crédits varie ainsi de 33 % pour un volet ferroviaire d'un total de 1 milliard d'euros mis en œuvre par le ministère de l'équipement à 68 % pour les crédits gérés par le ministère chargé de la ville pour une programmation totale de 1,2 milliard d'euros. Le volet routier enregistre lui-même un taux d'exécution qui dépasse à peine les 50 % pour un total programmé de 4 milliards d'euros. Les sources de ces retards sont bien identifiées (215). Certaines sont conjoncturelles. Même si l'État n'est pas plus en retard que sous les précédentes générations de contrats de plan, il connaît des contraintes budgétaires importantes. Il n'est donc pas en capacité de répondre aux ambitions substantielles définies en 2000. Les opérations sont soumises à des délais de réalisation importants, ce qui explique que la plupart n'ont commencé qu'en 2002. Les délégations de crédits ont également fait l'objet de mises en réserve au titre de la régulation budgétaire, touchant en particulier les opérations ferroviaires et routières. D'autres causes de retard sont plus structurelles et posent la question de l'utilisation de l'outil contractuel dans l'équilibre territorial des pouvoirs. Les procédures de contractualisation restent compliquées. Les projets mettent du temps à être définis et mis en œuvre. Les évaluations sont insuffisantes. Une tension peut apparaître parce que les régions sont, en revanche, plus avancées dans leurs projets. Si l'État a exécuté les contrats à 55 %, celui des régions atteint 65,5 % à la fin de 2004. Il faut observer que ce taux comprend des efforts qui n'étaient pas prévus initialement mais aussi des financements de projets complémentaires non prévus par les contrats de plan. Outre les problèmes de retard, le contenu des contrats peut parfois manquer de sélectivité. Selon l'arf, le périmètre trop étendu des contrats résulte de la pression constante des ministères, chacun d'entre eux étant tenté de « sanctuariser » ses crédits dans un contrat de plan, cette tentation étant pourtant souvent récompensée par une illusion (216). L'amélioration de la gestion des contrats de plan apparaît elle aussi comme une nécessité. Sous le régime de l'ordonnance du 2 janvier 1959, chaque contrat touchait une profusion de lignes budgétaires. La rigidité d'emploi des crédits ainsi ventilés était patente. Or, les contrats de plan apparaissent comme un moyen pour mettre en cohérence les projets des nombreux acteurs publics qui interviennent sur un seul et même territoire et accompagner ainsi les progrès de la décentralisation. Un consensus existe pour leur maintien, sous réserve de leur perfectionnement. 2. Des perspectives d'évolution Le Premier ministre a demandé, en 2004, à un certain nombre d'instances de formuler des avis sur l'avenir des contrats de plan (217). Le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (ciadt) de décembre 2003 a ainsi formulé quelques pistes de réformes : resserrer le périmètre de la contractualisation État-régions, réduire la durée des contrats de plan, encadrer davantage les engagements des cocontractants, tant sur le plan financier qu'en termes d'orientations stratégiques, permettre le développement d'une contractualisation séparée entre l'État et des groupes de régions ou des métropoles, et enfin, utiliser les contrats de plan comme des instruments de péréquation entre collectivités territoriales. En effet, comme le soulignait la lettre de mission du Premier ministre aux inspections des finances et de l'administration chargées de préparer la nouvelle génération de contrats de plan, la réforme de la décentralisation intervenue en 2003 implique de « repenser en profondeur les contrats de plan, car elle organise un nouveau partage des compétences entre l'État, les régions, mais aussi les départements ou les villes », en particulier dans les domaines de la formation, des transports (218) et des aides aux entreprises. Si chacun s'accorde pour réformer cet outil, les modalités de réforme restent fortement discutées. Le cadrage lui-même pose question. Qui doit y participer ? L'État seulement ? Les régions et les autres collectivités territoriales ? Quelle doit être la nature du document prospectif ? Le Conseil économique et social préconise l'élaboration d'un schéma national d'aménagement et de développement du territoire (219) à vingt ans, accompagné de schémas régionaux de même durée, schémas que les contrats viendraient décliner. D'autres, à l'image de l'arf demandent que l'État se dote au préalable d'un véritable cadre stratégique avant de proposer aux régions des partenariats matérialisés dans les contrats de plan. D'autres encore insistent sur la nécessité d'élaborer des contrats cohérents avec une politique régionale communautaire en cours de réforme. La durée des contrats elle-même suscite une interrogation. Derrière celle-ci, c'est la stabilité des relations entre partenaires étatiques et territoriaux qui en jeu. Il est proposé soit d'aligner la durée des contrats sur celle des mandats électifs, soit de les asseoir dans une durée plus longue qui permette d'envisager des projets d'envergure, soit de les aligner, comme c'est le cas aujourd'hui, sur la durée de la programmation européenne, tandis que des révisions à mi-parcours sont fréquemment évoquées. Ainsi les durées oscillent entre quatre ou cinq ans (Sénat), six ou sept ans (arf), neuf ans articulés en trois périodes de trois ans (délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire de l'Assemblée nationale), tandis que le Conseil économique et social propose une durée de vingt ans pour les documents prospectifs, de neuf ans pour des contrats d'objectifs et de trois ans pour les contrats de programmation. Dans l'équilibre territorial des pouvoirs, la question de l'exclusivité ou non de la contractualisation entre l'État et les régions et celle, concomitante, de la contractualisation infrarégionale acquièrent une particulière importance. L'organisation d'une articulation entre les différents documents de programmation réalisés à divers échelons territoriaux s'avère, dans ce contexte, primordiale. Il faut évoquer à ce titre les schémas de développement de l'espace communautaire (sdec) (220), les schémas de services collectifs (ssc) (221), les schémas régionaux de développement et d'aménagement du territoire (sradt), les schémas de cohérence territoriale (scot), les projets d'agglomération, les chartes de pays, les directives territoriales d'aménagement (dta) ou encore les schémas de mise en valeur de la mer, les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement de massif (siadm) (222) et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (sdage) (223), sans compter les documents sectoriels à l'image des schémas régionaux d'organisation sociale et médico-sociale, récemment modifiés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il est raisonnable de demander, dans ces conditions, que « les dispositifs contractuels ne soient pas multipliés à l'excès au risque d'une perte sérieuse de lisibilité et de stabilité nécessaire au temps long des processus de développement ». Les finalités mêmes des contrats de plan sont sujettes à discussion et révèlent les difficultés à établir un véritable équilibre territorial des pouvoirs. En simplifiant les positions, certains acteurs souhaitent que les contrats de plan aient une fonction de péréquation renforcée, tandis que d'autres privilégient la qualité des projets mesurée à l'aune des résultats qu'ils peuvent apporter en termes de développement. Ainsi, les premiers « élus donnent le sentiment de ne pas vouloir utiliser ce que la décentralisation leur donne comme pouvoirs, ou, plus exactement, se comportent de manière contradictoire : ils demandent la décentralisation, c'est-à-dire le pouvoir, mais en même temps ils en refusent les conséquences, ils demandent à l'État d'intervenir de manière à ce qu'ils ne peuvent faire soit accompli par l'État, ils refusent la liberté que donne le contrat pour revendiquer l'égalité, qui postule nécessairement une intervention vigoureuse de l'État ayant pour effet de limiter l'autonomie locale » (224). Enfin, se pose la question de la participation des collectivités territoriales autres que les régions aux contrats de plan. Par exemple, comme l'a rappelé au rapporteur le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, « Le contrat de plan en Alsace est signé par le préfet de région, le conseil régional, mais aussi par toutes les autres collectivités, départementales et les grandes agglomérations que sont Strasbourg, Colmar et Mulhouse ». Tous les acteurs locaux souhaitent participer aux contrats de plan. La définition des modalités de leur association à la négociation de la prochaine génération devra être fixée avec précision, sous peine de voir renaître une profusion d'initiatives, source de confusion et de dispersion des moyens. Le problème du chevauchement des compétences dans le domaine du développement économique acquiert alors une acuité particulière. Ainsi, un responsable administratif d'un département important entendu par le rapporteur relevait que « le schéma régional de développement économique est élaboré par la région, mais nous souhaitons pouvoir l'influencer. Le département entend peser. Nous arrivons bientôt au temps des renégociations des contrats de plan et entendons peser sur ces contrats. La mutualisation des moyens à terme n'est pas tout à fait exclue. Nous souhaitons à terme créer un comité de pilotage régional commun. » Le système des contrats de plan a été plutôt inflationniste en raison de la multiplication du nombre des intervenants sur tous les thèmes. Ce constat peut être fait également pour les autres instruments contractuels. C. LA GÉNÉRALISATION DU MODÈLE CONTRACTUEL La formule des contrats de plan entre l'État et les régions a pendant longtemps constitué la principale formule de contractualisation des relations entre plusieurs personnes morales de droit public. L'accumulation des retards, malgré des efforts récents en matière d'infrastructures, tend à remettre en question cet instrument. Comme on l'a vu supra, la réforme des contrats de plan a été annoncée. Le contrat s'introduit au cœur des institutions pour la création de services publics, avec notamment l'ordonnance du 24 avril 1996 (225) qui crée les arh ou la loi du 25 juin 1999 qui crée les groupements d'intérêt public (gip) de développement local (226), ou encore avec la loi du 27 février 2002 précitée qui prévoit des conventions pour organiser des expérimentations. 1. L'exemple de la politique de la ville La politique de la ville, récemment mise en lumière, est un bon exemple de secteur dans lequel l'essor du recours aux contrats a suivi la « complexification » des actions menées. La nature interministérielle de cette politique, la diversité des domaines couverts, de l'éducation à la sécurité, de l'habitat à l'emploi, de la justice à l'équipement, la multiplication des acteurs concernés, dont les collectivités territoriales, en font un lieu privilégié de la construction de liens conventionnels protéiformes. Ainsi, en sus de programmes nationaux, le comité interministériel des villes, créé en 1984 et devenu comité interministériel des villes et du développement social urbain par le décret n° 88-1015 du 25 octobre 1988, développa des programmes territoriaux, sur le fondement de conventions signées à l'échelon des quartiers et de la ville, qu'il s'agisse des contrats de ville, des conventions ville-habitat ou des programmes d'aménagement concerté du territoire (pact). Dans une circulaire du 2 février 1989 relative au développement de la politique contractuelle avec les collectivités locales, le ministre de l'équipement et le délégué interministériel à la ville à l'attention des préfets relevaient que « le cadre contractuel résulte de la nature des problèmes posés, qui nécessitent un traitement global, et de la superposition sur un même territoire de compétences et de responsabilités multiples ». Expérimentés dans treize sites pilotes, les contrats de ville ont été généralisés à compter de 1994 pour mettre en œuvre, pour une durée de cinq ans, des programmes locaux développement et de réhabilitation des quartiers. Cet outil n'a pas permis d'intégrer l'ensemble des dispositifs contractuels en usage dans l'épanouissement foisonnant − nous hésitons à dire « confus » − de la politique de la ville. Son articulation avec d'autres dispositifs tels que les contrats de plan État-région, mais surtout avec les contrats d'agglomération et les contrats de pays n'est pas assurée. La circulaire du Premier ministre du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006 s'était pourtant attachée à faire des contrats de ville « la procédure de contractualisation unique pour la politique de la ville ». La politique de la ville a été profondément modifiée en 2003. En effet, si pendant de nombreuses années, elle a fort utilement contribué à amortir les effets de la crise économique et sociale, elle est désormais passée du stade de la réparation à celui du développement à l'échelle de l'agglomération pour lutter davantage contre les processus de ségrégation. Les 247 contrats de ville 2000-2006, inscrits dans le volet territorial des contrats de plan État-région, sont le support de cette ambition. Dans le cadre de la génération précédente de contrats de plan, seulement 40 % des contrats de ville avaient une assise territoriale intercommunale. De plus, leur mise en œuvre avait révélé le caractère souvent formel de cette intercommunalité. Environ 70 % des nouveaux contrats de ville sont intercommunaux. L'horizon de la politique de la ville est désormais l'agglomération. Nombreux sont, parmi ces contrats de ville, ceux portés directement par des structures intercommunales. Dans certains cas, la préparation du contrat de ville a été l'occasion d'accélérer la mise en place de nouvelles coopérations. Dans le cadre des contrats de plan, la contribution des régions au financement de la politique de la ville est passée de 488 millions d'euros sous le XIe Plan à 777 millions d'euros (227). En outre, les régions consacrent une part non négligeable de leurs crédits de droit commun aux opérations s'inscrivant dans les projets poursuivis par les contrats de ville, concentrant davantage leur intervention sur les sites les plus difficiles, notamment en matière d'investissements, de formation et d'insertion économique. Enfin, plusieurs conseils régionaux se sont engagés aux côtés de l'État. La participation financière des régions à la mise en œuvre de la politique de la ville a été estimée à 140 millions d'euros pour la seule année 2004. Les départements participent également à la mise en œuvre de la politique de la ville pour une contribution estimée à 130 millions d'euros en 2004. Ces fonds servent à la fois au versement de subventions aux maîtres d'ouvrage et au financement d'actions propres dans le champ des compétences départementales ou dans le champ des autres politiques contractuelles auxquelles les départements participent. Le montant de la participation financière des communes et des epci est estimé à 730 millions d'euros pour 2004. Comme on l'a vu pour nombre d'autres politiques, le cadre intercommunal constitue la principale caractéristique de la nouvelle génération de contrats de villes. En raison de l'effet conjugué de l'accroissement de la participation des régions, de l'engagement des départements, du large périmètre d'application des contrats de ville ainsi que de l'intervention des communautés d'agglomération compétentes en matière de politique de la ville et des autres structures de coopération intercommunale, la contribution financière des collectivités locales prend une part de plus en plus importante. L'Union européenne constitue un partenaire financier supplémentaire dans le cadre rénové des fonds structurels, notamment de celui du nouvel Objectif 2, dont bénéficient environ 130 contrats de ville. Elle apporte, en effet, près de 222 millions d'euros (228). Les contrats de ville continuent de coexister avec un ensemble de conventions qui interviennent dans des domaines aussi divers que la santé, la jeunesse et les sports, l'environnement, le désenclavement des quartiers, l'habitat, la culture, l'éducation, la sécurité, l'intégration, l'emploi et le développement économique, mais aussi la lutte contre l'exclusion (229). « Cette politique a constitué l'occasion pour roder, avec la caution du politique, un modèle d'action publique nouveau où la légitimité du service public n'est plus fondée sur la conformité à des normes centrales régissant une profession mais plutôt sur la négociation permanente. » (230) Dans le même temps qu'elle présente un bon exemple de contractualisation des rapports entre l'État et les collectivités territoriales, la politique de la ville, d'une certaine manière, marque aussi l'évolution vers une certaine reconcentration de l'intervention de l'État, comme le montre l'accent qui est mis sur l'action de la nouvelle anru (231), qui centralise les crédits nationaux consacrés à l'aménagement et au logement social que son conseil d'administration affecte de manière discrétionnaire à un nombre de projets de démolition-reconstruction proposés par les maires. Une évolution semblable peut être constatée dans le domaine de la sécurité. A priori, cœur de métier de l'État régalien, la sécurité fait figure, par nature, de domaine de prédilection de l'exercice unilatéral de l'autorité. Pourtant, dans ce secteur, le lien contractuel tend également à se développer. Initiée par deux circulaires du 28 octobre 1997 et du 7 juin 1999, la mise en place des contrats locaux de sécurité (cls) a répondu au constat selon lequel la sécurité « ne peut pas être l'affaire des seuls services de la police et de la gendarmerie nationale » et sa garantie dépend, notamment, de l'exercice par les collectivités territoriales de leurs compétences. Les cls concernent, en général, une commune ou un groupement de communes. Ils comportent deux volets, l'un de prévention de la délinquance et l'autre de définition des conditions d'intervention de la police et de la gendarmerie. Élaborés par le préfet, le procureur de la république et le ou les maires concernés, en association avec le recteur d'académie, ils sont signés par les trois premiers ainsi que, « s'il y a lieu, par le recteur d'académie, le président du conseil régional et le président du conseil général ». Les finalités de ces outils, comme nombre d'outils contractuels faisant appel aux collectivités territoriales, ont été définies par l'État seul et couvrent un champ si divers et si large que la meilleure des volontés ne saurait les satisfaire. En effet, il s'agit de favoriser aussi bien l'apprentissage de la citoyenneté que la promotion d'une solidarité sûreté de voisinage, le soutien aux actions locales de prévention à l'égard des jeunes en voie de marginalisation, la non-discrimination à l'embauche, ou encore la prévention des toxicomanies, des violences urbaines et des phénomènes de bandes, la prévention de la délinquance et de la violence aux abords des établissements scolaires et la prévention de la violence en milieu scolaire... Or, on sait que ce dispositif a souffert de l'insuffisance des diagnostics de sécurité initiaux, du problème de définition du rôle et de la qualification des agents locaux de médiation sociale ou encore du manque de moyens des parquets et des incohérences des cartes judiciaires et de présence de la police et de la gendarmerie. L'État n'a apporté que peu de moyens supplémentaires, décevant l'attente de ses partenaires pour lesquels la signature d'une convention spécifique ne devait pas conduire au simple maintien de l'existant sous une autre forme. Par ailleurs, alors même qu'ils sont compétents dans les domaines de la protection de l'enfance et de la prévention spécialisées, les départements n'ont que très rarement été invités à participer à la négociation de ces contrats lors des premières expériences. Or, il semble admis qu'il faille associer plus étroitement les conseils généraux et notamment leurs services chargés de l'aide sociale à l'enfance et de la prévention spécialisée, ainsi que les conseils régionaux pour ce qui concerne la formation. Au-delà de ces exemples − nous aurions pu évoquer plus avant les contrats de pays (232), les contrats d'agglomération (233) ou encore les contrats de parcs naturels régionaux (234) −, une fois reconnue l'utilité de la procédure contractuelle pour mettre en œuvre des politiques de plus en plus complexes, faisant intervenir des acteurs de plus en plus nombreux, il convient de constater que son développement a provoqué une incertitude juridique croissante qui réinterroge l'équilibre territorial des pouvoirs. D. DES INCERTITUDES HANDICAPANTES D'un côté, la contractualisation peut être assimilée à la fin de la séculaire tradition du secret de la décision, à l'avènement d'une ère de transparence et d'ouverture à la société, à une technique nouvelle d'élaboration de la norme. Il s'agit d'améliorer le service public, par le déblocage d'une situation administrative complexe, grâce à l'intégration de l'ensemble des partenaires concernés par la décision. La contractualisation permet d'allier légitimité managériale et légitimité élective. Elle peut être à la fois le moteur et le reflet d'un renouvellement du droit et de la gestion publics. Mais, d'un autre côté, pour reprendre l'exemple de la politique de la ville, la Cour des comptes, dans son rapport sur la politique de la ville en 2002 (235), estimait que les accords locaux conclus en la matière présentaient parfois un caractère purement formel. Plus généralement, ainsi que le souligne M. Jean-Pierre Gaudin, « lieu après lieu, depuis quelques décennies, le panorama des méthodes des politiques publiques s'est, de fait, modifié progressivement en France (...). De tous côtés, des changements diversifiés semblent aller dans un même sens : la négociation plus explicite de l'action publique et la multiplication des contrats dans les politiques publiques. » (236) Certains, constatant que le contrat devient la plus forme la plus usitée de partenariat estiment, à propos de celui-ci, qu'« il s'agit là d'une notion assez creuse, qui n'a pas (...) de contenu précis sur le plan juridique, mais qui a une valeur symbolique » (237). La banalisation de la contractualisation des rapports entre collectivités, consacrée par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales marque cependant un changement d'orientation stratégique de l'État. La jurisprudence du Conseil d'État a accompagné cette « révolution » (238). Si la logique contractuelle peut se déduire du principe de la libre administration des collectivités territoriales, les modalités de sa mise en œuvre n'apparaissent pas pleinement satisfaisantes. En effet, elle peut contribuer à redistribuer les compétences et à placer certaines collectivités dans une position de quasi-tutelle, asymétrique, tous leurs projets étant soumis à la bonne volonté d'autres. La prolongation unilatérale d'un an de la troisième génération des contrats de plan État-région (239) est, de ce point de vue, emblématique, tandis que, dans le même temps, la part de l'État dans les engagements a diminué, passant de 59,9 % à 55,4 %, puis à 52,1 % du montant total des contrats durant les trois premières générations de contrats pour atteindre 35 % pour la génération en cours d'exécution. Pour reprendre les termes d'un observateur, « la fréquence des violations par l'État des accords qu'il conclut peut donner l'impression que le contrat dispense des espérances sans apporter de garanties » (240). De la même façon, il peut être surprenant de constater que, quelquefois, sur des projets relevant de la compétence de l'État, tels que la construction de routes nationales − avant le transfert opéré par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (241) −, la part d'une région soit appelée avant celle de l'État, ce qui permet à ce dernier d'obtenir des ressources de trésorerie aux dépens de la collectivité territoriale, même si l'on ne peut parler de transferts de financement. Le mécanisme, décrit au rapporteur à plusieurs reprises par ses interlocuteurs lors de ses déplacements, est simple : les conseils régionaux, les conseils généraux et les communes ont assez systématiquement versé leur concours dès l'engagement des opérations, conformément au plan initial, l'État intervenant pour sa part plus tard que prévu ; dans le cas de fonds de concours sur des opérations à maîtrise d'ouvrage de l'État, les fonds sont versés au début de l'opération ; il peut arriver que cette avance soit assez longue en raison de la mise en réserve, c'est-à-dire du « gel », des crédits de l'État. Le constat fait pour les routes vaut également pour les plans universitaires successifs « Université 2000 » et « Université troisième millénaire » (u3m) ou encore pour la sécurité publique, pour lesquels le recours au contrat a permis à l'État de trouver auprès des collectivités locales des financements qu'il était incapable de mobiliser seul. De surcroît, l'État a su démontrer qu'il n'était pas toujours capable de définir au mieux les projets les plus susceptibles de développer un territoire donné. Il a parfois imposé des projets qui ne le méritaient pas nécessairement, s'engageant sur des volumes très importants de crédits, imposant aux collectivités concernées de lever des fonds au-delà du nécessaire. Plus généralement, l'État définit unilatéralement les principes d'intérêt général auxquels devront se conformer les collectivités territoriales, à l'exemple des « noyaux durs » édictés a priori par l'État comme ses priorités pour la troisième génération de contrats de plan 1994-1998, lors du comité interministériel d'aménagement du territoire (ciat) de Mende du 23 juillet 1992. De la même façon, l'État a défini, d'une part, les priorités de la quatrième génération des contrats de plan 2000-2006, lors du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (ciadt) d'Arles en juillet 1999, et, d'autre part, les enveloppes ministérielles et régionales de crédits via les mandats de négociation des préfets, à qui revient la tâche de négocier (242). La profusion des instruments contractuels masque des réalités qui ne correspondent pas toujours à l'idée qu'on peut se faire d'une relation équilibrée entre deux contractants, à tel point qu'apparaît « une sorte de mode contemporaine qui habille du terme " contrat " des procédures de concertation, qui présupposent ou expriment des accords de volontés de la part des personnes publiques, mais qui n'entraînent pour elles aucun effet juridiquement obligatoire qu'on pourrait leur opposer ou dont elles pourraient se prévaloir. (...) Les illustrations actuelles du phénomène ne manquent pas, du " caractère platonique " des contrats de plan État-régions aux très récents contrats locaux de sécurité " » (243). En résumé, « le système de relations contractuelles entre collectivités publiques actuellement en vigueur est, il est vrai, davantage placé sous le signe des rapports de force, et d'une certaine opacité, que sous celui du droit, et de la transparence. Et c'est bien là où le bât blesse, ainsi que l'a fortement relevé le rapport déjà cité du Commissariat du Plan Pour un État stratège garant de l'intérêt général. » (244) Certains vont même jusqu'à considérer que l'essor contractuel marque le passage d'une contrainte imposée (l'acte unilatéral) à une contrainte consentie (le contrat). Il ne signifie pas pour autant un déclin de la tutelle étatique. » (245) En 2000, le rapport de la commission présidée par Pierre Mauroy remet en cause la « systématisation de la procédure contractuelle » car « si la contractualisation est positive, sa systématisation a des effets pervers » (246). In fine, le contrat devient une alternative à la répartition législative des compétences. Si pour l'État, il présente l'avantage de la souplesse, il présente également pour les collectivités territoriales les défauts de la précarité et de l'incertitude. L'insuffisante identification des responsabilités réciproques dans la mise en œuvre du contrat et la lourdeur d'opérations nécessairement conjointes sont des motifs réels de blocage. La multiplication des contrats crée la confusion. De ce panorama général naît le sentiment d'un équilibre territorial des pouvoirs instable ou d'une série d'équilibres successifs, variables et changeants, chacun des acteurs n'étant allé ou ne pouvant pas aller au bout de ses responsabilités, chacun à la recherche d'un dessein que le cadre actuel ne permet pas de réaliser. VERS UN NOUVEL ÉQUILIBRE TERRITORIAL Les exemples étrangers montrent que les enjeux de la décentralisation et de la déconcentration ne doivent pas être le domaine réservé d'un département ministériel et ne sauraient être de simples transferts de compétences ou de fonds à d'autres niveaux administratifs ou aux collectivités territoriales. Il s'agit de donner des pouvoirs et des responsabilités aux citoyens, de trouver un équilibre entre collectivités territoriales et État, mais aussi au sein de l'État territorial et au sein des collectivités territoriales. Aucun modèle européen unique ne permettrait à la France de signer son destin territorial. Néanmoins, cette diversité peut éclairer certaines orientations prises par la déconcentration et la décentralisation dans notre pays et le droit comparé peut offrir, en la matière, des exemples dont il pourrait être utile de s'inspirer ou, au contraire, de s'écarter. Le rapporteur a choisi, pour illustrer cette démarche, d'écarter les États fédéraux proprement dits, pour ne s'attacher qu'à quatre pays qui ont poussé le plus loin possible les expériences de décentralisation dans un État unitaire et qui vivent, en conséquence, au quotidien une « organisation décentralisée » dans un État « un et indivisible » : l'Italie et l'Espagne, l'Écosse au sein du Royaume-Uni et, enfin, la Suède. I. - UNE DIVERSITÉ EUROPÉENNE DES MODÈLES D'ORGANISATION TERRITORIALE Les deux canons constitutionnels que sont les États fédérés, d'une part, et les États unitaires, d'autre part, ne permettent pas en tant que tels de refléter la réalité européenne d'un continuum de régimes d'organisation territoriale qui va de l'État fédéral du type allemand à l'État unitaire du type irlandais, en passant par un entre-deux caractéristique de la situation française ou par des États « régionalisés » du type espagnol. Le paradigme napoléonien de l'État unitaire n'existe plus guère qu'à l'état de souvenir. L'organisation du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suède n'accorde pas de pouvoir législatif propre aux assemblées locales, qui ne possèdent pas non plus de pouvoir réglementaire général. Comme nous le verrons plus avant infra, l'Espagne et l'Italie, sans franchir la frontière fédérale, ont attribué au niveau territorial intermédiaire que constituent les autonomies (en Espagne) et les régions (en Italie) des compétences importantes, un pouvoir législatif et une autonomie financière substantiels. Dans les États fédéraux que sont l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique, les États fédérés déterminent leur propre organisation interne, assurent le contrôle administratif et budgétaire et participent au financement des collectivités territoriales. Ainsi, en Allemagne et en Autriche, les États fédérés partagent des impôts avec l'État fédéral et versent des dotations aux collectivités territoriales, tandis qu'en Belgique, les budgets des communes et des provinces sont financés par des dotations des régions. L'organisation fédérale n'interdit pas l'unité du système juridique. Ainsi, l'Allemagne est dotée d'une très forte unité juridique, liée à la fois à la quasi-absence des particularismes régionaux de la scène politique et de la politique de centralisation de la compétence législative en jeu depuis les années 1950. La nature des régimes d'organisation diverge. C'est le cas également des structures locales. La plupart des États ont une structure homogène sur l'ensemble du territoire. C'est le cas notamment de la France si l'on ne tient pas compte de l'organisation particulière de Paris ou des départements, régions et collectivités d'outre-mer. D'autres États, tels que les États fédéraux et les États « régionalisés », tels que l'Italie ou l'Espagne, ou qui connaissent la dévolution, tels que le Royaume-Uni, possèdent des niveaux de collectivités territoriales non homogènes. Si on fait le choix d'écarter les États fédéraux (247), qui sont d'une essence différente de celle de notre pays, et pour ne s'en tenir qu'à l'Europe des Quinze, que peut-on constater ? En premier lieu, l'Espagne, la France, l'Irlande et l'Italie disposent de trois niveaux de collectivités. En deuxième lieu, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Grèce, le Portugal et le Royaume-Uni possèdent deux niveaux de collectivités. Enfin, la Finlande et le Luxembourg ne comptent qu'un seul échelon local. Dans une perspective dynamique, il faut bien constater la multiplication ces dernières années des révisions constitutionnelles ayant pour objet une plus grande décentralisation. Ainsi, des réformes constitutionnelles ont été menées à bien en Belgique, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Royaume-Uni et plus récemment en France. Ces pays, au même titre que la France, affrontent les mêmes problématiques : tension entre efficacité économique et exigences démocratiques, mondialisation et européanisation, nouveaux modes d'administration publique, montée des régions, abstentionnisme et perte d'intérêt pour la politique en général et la politique locale en particulier, demande de représentation provenant de sections particulières, non élues, de la société. Les cours constitutionnelles ont eu une influence en général favorable à l'unité de l'ensemble et au pouvoir central, sauf en Espagne où la jurisprudence du Tribunal constitutionnel a pu être plus favorable aux autonomies. L'évolution des dispositions constitutionnelles et de la pratique marque une tendance à l'imbrication et à l'interdépendance des compétences. Toutes ces réformes ont été inspirées par la recherche d'une plus grande efficacité des politiques publiques, en favorisant l'émergence de territoires compétitifs au niveau européen. Six niveaux d'analyse permettront de fournir des pistes de réflexion pour l'évolution du système français : le cadre constitutionnel d'abord, l'organisation, les compétences, le financement des collectivités locales ensuite, puis les modalités d'organisation et les compétences des administrations territoriales de l'État, les perspectives d'évolution du système enfin. L'État dispose d'une administration territoriale qui lui est propre pour l'exercice de ses compétences en Italie et en Espagne comme en Grèce, mais cette administration se réduit avec les compétences de l'État. Alors qu'elle a été renforcée en Angleterre, la devolution conduit à sa quasi-disparition en Écosse et au Pays de Galles. En revanche, dans tous les pays, sauf aux Pays-Bas où la fonction de commissaire de la Reine peut être rapprochée de la situation du préfet de département français avant 1982, il y a séparation entre représentant territorial de l'État et exécutifs locaux. Pour mesurer ces évolutions et en tirer des conséquences pour la France, le rapporteur a choisi un échantillon de quatre pays, qui permettent à la fois de se rapprocher et de s'éloigner du modèle français. Trois ont une population qui les rapproche de la France : l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni ; le quatrième, la Suède, dispose d'une population moindre. Deux représentent le modèle continental sud-européen : l'Italie et l'Espagne ; deux représentent le modèle anglo-saxon : le Royaume-Uni et la Suède. Deux ont choisi un État régionalisé, constitué de collectivités relativement autonomes et consacrant institutionnellement les particularismes : l'Italie et l'Espagne ; l'un a choisi un modèle plus radical de décentralisation avec la dévolution : le Royaume-Uni ; un quatrième a opté pour un modèle d'autonomie locale de base forte, sans niveau intermédiaire très marqué : la Suède. Trois ont privilégié une déconcentration géographique : l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni ; l'un a préféré une déconcentration fonctionnelle : la Suède. II. - UNE RÉGIONALISATION QUI CONFINE À L'AUTONOMIE : L'ITALIE ET L'ESPAGNE A. LE MODÈLE DE L'ÉTAT RÉGIONALISÉ L'Italie comme l'Espagne montre l'exemple d'un État qui se « creuse », sinon qui se « vide » par le centre. C'est en Espagne et en Italie que les mesures en faveur des collectivités de niveau régional ont connu la plus grande ampleur, avec l'extension des champs de compétences, l'octroi d'un pouvoir législatif et le renforcement de l'autonomie locale. Les États régionalisés, comme l'Espagne ou l'Italie, reconnaissent ainsi aux régions un pouvoir législatif exclusif dans toutes les matières ne relevant pas expressément de la compétence de l'État. Comme en Allemagne, la plus grande partie des charges administratives est exercée par le niveau régional. Les réformes récentes mises en œuvre dans ces deux pays mettent en lumière qu'il est possible de réunir les conditions d'une autonomie fiscale relative dans un État qui conserve une structure unitaire. Ces exemples permettent de montrer qu'une régionalisation accrue doit se garder de deux écueils : celui de ne pas réclamer du centre le maximum d'éléments de décisions possibles et celui de ne pas s'établir contre les collectivités de niveau « infrarégional ». Dans les deux cas, la principale différence avec le régime français réside dans la différence de nature entre leur troisième niveau de collectivités (regioni en Italie, comunidades autónomas en Espagne) et le nôtre. En premier lieu, la situation de la collectivité territoriale « autonomique » résulte d'un pacte indissociable de la Constitution, lequel détermine dans le texte fondamental lui-même les compétences respectives de l'État central, d'une part, et des collectivités territoriales « autonomiques », de l'autre. En deuxième lieu, ces collectivités possèdent un pouvoir législatif, et pas seulement réglementaire, parfois exclusif, parfois concurrent de celui de l'État central. Ce partage est soumis à la surveillance des cours constitutionnelles et a pour principale conséquence de transformer la nature des rapports entre ces collectivités « autonomiques » et les autres collectivités territoriales. Les premières jouent vis-à-vis des secondes le rôle que l'État joue dans un État unitaire classique. Les régions ont ainsi un pouvoir de coordination des niveaux d'administration locale. En outre, tant l'Espagne que l'Italie s'orientent vers l'établissement d'un pouvoir fiscal régional important, même si l'émergence d'un tel pouvoir reste décevant eu égard aux promesses fixées dans la loi, en raison, peut-être, d'une hésitation des pouvoirs régionaux à assumer la responsabilité fiscale. Le financement des collectivités locales, autres que régionales, est assuré essentiellement par des dotations de l'État. Mais des différences notables demeurent entre les deux pays. Le régionalisme italien est moins accentué qu'en Espagne, en raison du maintien d'un nombre important de compétences de l'État central et en raison des nombreux instruments de centralisation que possède encore son administration. L'Italie est un pays unitaire qui évolue vers un système d'organisation de plus en plus marqué par le rôle des collectivités territoriales, régionales et locales. Dans ce mouvement de polycentrisme territorial, la double faiblesse traditionnelle des provinces et des communes a expliqué la montée des pouvoirs de la région dans un contexte plus large d'affaiblissement de l'État et de transformation, à partir du début des années 1980, du système politique et des partis. Les transferts de compétences pour les régions ont été opérés à législation constante. Il s'agissait de pouvoirs que l'État exerçait de manière centralisée ; la centralisation a ainsi été déplacée au niveau régional. 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités locales Les années qui ont suivi la création de l'État unitaire en 1861, laissant de côté la question de la décentralisation, ont été entièrement consacrées à l'uniformisation du système administratif. Ce n'est qu'en 1946, lors du débat sur la Constitution, que l'idée de la région comme niveau d'administration réapparut. Loin de constituer un troisième niveau d'administration à côté des communes et des provinces, la région demeura très longtemps sans véritable substance. Il fallut attendre les années 1970, puis, de manière plus décisive, les années 1990 pour voir l'échelon régional acquérir un poids politique et administratif réel. a) Un processus qui s'inscrit dans une réforme globale de l'État Jusqu'à la fin des années 1990, les tentatives de modernisation et de réforme du système administratif italien n'avaient donné que de bien modestes résultats. Les défauts de l'organisation administrative italienne avaient été soulignés à maintes reprises : une organisation dominée par une logique de centralisation et d'uniformisation, qui se fragmentait ensuite en d'innombrables exceptions et dérogations ; un rythme de croissance qui était davantage lié à la nécessité de créer de nouveaux emplois qu'à l'exécution des fonctions et au rendement des services, de sorte que le personnel était mal distribué, en excès dans certains lieux et dans certains domaines et insuffisant là où l'on en aurait eu le plus besoin ; des liaisons peu claires, avec des interférences entre la politique et l'administration, entre le centre et la périphérie. Dans un premier temps, l'Italie s'est contentée de mettre en place, à Constitution inchangée, un nouveau système de « fédéralisme administratif » réalisant le transfert de la plupart des fonctions administratives opérationnelles aux régions et aux collectivités locales et l'adaptation des structures administratives de l'État centrales et déconcentrées. (248) La première phase de cette première étape est dominée par des exigences de réduction des coûts des administrations publiques dans le cadre plus général d'une politique d'assainissement financier et par des exigences de redéfinition des règles de transparence et de garantie des droits des citoyens sur le fondement des lois n° 142/90 du 8 juin 1990 et n° 241/90 du 7 août 1990 (249) et du décret n° 29/93 de 1993 (250). C'est toutefois dans cette période qu'est énoncé pour la première fois le principe de distinction entre la sphère politique et l'administration et qu'une convergence commence à se dessiner entre le droit public et le droit privé du travail, ce qui se traduit par la contractualisation, encore partielle, de la réglementation du rapport d'emploi public. Dans la deuxième phase de cette première étape de la réforme de l'État, marquée par les lois n° 59/97 et n° 127/97 de 1997, la loi n° 50/99 de 1999 et les décrets et règlements ultérieurs de mise en application (251), les objectifs qui avaient prévalu jusque-là, à savoir l'assainissement financier et la transparence et la garantie des droits dans le fonctionnement administratif, ont été renforcés par un troisième objectif : transformer et améliorer les administrations publiques, redéfinir leurs missions, les concentrer sur leur cœur de métier, améliorer la qualité des services et des prestations, réduire le poids de la bureaucratie et les coûts de régulation. Pour atteindre cet objectif, un processus de réformes vaste et complexe a été mis en place à partir de quelques directives générales portant sur : - le renforcement et la mise en application de la distinction des rôles et des fonctions entre la politique et l'administration, qui passe par la réorganisation des bureaux opérant directement pour la sphère politique et des structures de l'administration active ; - l'abandon du modèle uniforme au profit de la reconnaissance complète de l'autonomie de structures et d'institutions diverses, telles que les universités, les écoles, les instituts de recherche ou encore les chambres de commerce, et de l'autonomie d'organisation et de gestion des administrations de l'État ; - la délocalisation d'activités marginales et intermédiaires par rapport au service administratif final, pour permettre à l'administration de se concentrer sur la mission exclusive qui lui est propre, selon les principes de subsidiarité, verticale et horizontale ; - la redéfinition des missions du point de vue des résultats ainsi que de la qualité des prestations et des services, impliquant donc l'introduction d'outils et de mécanismes de contrôle des performances et de primes à la productivité, à la professionnalisation et à l'innovation ; - l'allégement des tâches de l'administration centrale, avec le transfert des fonctions administratives aux régions et aux collectivités locales. De façon assez floue au début, puis de manière de plus en plus nette, ce projet de réforme visait le dépassement du modèle fortement étatique, centralisé et bureaucratique caractéristique de la tradition administrative européenne continentale, qui privilégie la spécialité des règles qui régulent l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Des modules de privatisation de type anglo-saxon ont été introduits dans le système. L'élaboration des chartes des services a défini un nouveau modèle d'administration au service des citoyens. La mise en place du processus de contractualisation a tendu à transformer le rapport de travail avec les administrations et à unifier la réglementation des rapports de travail selon le modèle de droit privé, tandis qu'était engagée une forte accélération du processus de redistribution des fonctions et des tâches sur la base des principes de subsidiarité horizontale, par le biais des délocalisations et des privatisations, et verticale, grâce au « fédéralisme administratif ». Le nombre de ministères a été réduit de vingt-deux en 1990 à douze en 2001 (252). La mise en place de paramètres et des mécanismes d'évaluation des performances des administrations et l'introduction de quotes-parts variables pour les redistributions publiques liées aux résultats ont accompagné la séparation rigoureuse entre la politique et l'administration, avec la responsabilisation des cadres de la fonction publique quant aux résultats de l'activité administrative, afin de neutraliser les effets des tendances ou appartenances politiques des cadres supérieurs et moyens de la fonction publique sur leurs perspectives de carrière. Les technologies informatiques dans l'offre des services ont été systématiquement utilisées, permettant une réorganisation des administrations. Dans ce cadre, le système des déclarations d'impôts et le registre des entreprises ont été informatisés. La signature numérique a été introduite. Une carte d'identité électronique a été expérimentée. Parallèlement, les procédures administratives ont été simplifiées, le nombre d'autorisations administratives réduit, la réunion systématique de la législation en textes consolidés engagée, des guichets uniques, par exemple pour la mise en route d'équipements productifs, pour le bâtiment, pour l'automobiliste, pour l'internationalisation des entreprises, créés. Le nombre des certificats exigés des citoyens dans leur démarche a été considérablement réduit. La simplification des processus de décision et du système des responsabilités a été réalisée par le biais du « fédéralisme administratif » et de l'assouplissement des fonctionnements, de façon à rapprocher des citoyens les sièges des décisions publiques et à réduire la pluralité et la confusion des responsabilités. Le système institutionnel administratif a été réorganisé sur la base des principes de subsidiarité et de proximité, en recherchant adéquation, responsabilité, flexibilité, pluralité et diversification des modèles d'organisation, et, par conséquent, l'autonomie des administrations en ce qui concerne l'adoption de modèles liés à leurs missions spécifiques. Dans un second temps, l'Italie, comme de nombreux autres États européens qui sont également des États unitaires, n'a pas hésité à reconnaître dans sa Constitution le principe de la décentralisation. Franco Bassanini, ancien ministre italien de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État dans son pays, a résumé ainsi cet enjeu : « L'organisation de l'État et les performances des administrations deviennent de plus en plus des facteurs compétitifs qui décident de la prospérité d'une nation ». b) Les révisions constitutionnelles de 1999 et 2001 La Constitution du 27 décembre 1947 prévoyait déjà des compétences législatives pour cinq régions à statut spécial, ce régime ayant ensuite été étendu aux quinze autres régions. La loi de révision n° 1 du 22 novembre 1999 a inscrit le résultat de ce long processus dans la Constitution. La loi de révision n° 3 du 18 octobre 2001 est allée beaucoup plus loin, puisqu'elle a abouti à la réécriture complète du titre V de la deuxième partie de la Constitution relatif aux régions, provinces et communes et redéfini du point de vue fonctionnel les relations et le régime des compétences entre l'État et les régions (253). La Constitution dispose désormais, dans son article 5, que « la République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autonomies locales, elle réalise dans les services qui dépendent de l'État, la plus large décentralisation administrative, elle adapte les principes et méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie et de la décentralisation ». Ce principe d'unité et de décentralisation s'accompagne de l'affirmation des principes généraux de solidarité (article 2) et d'égalité (article 3). Le texte constitutionnel précise, dans son article 114, que « la République se compose des communes (comuni), des provinces (province), des villes métropolitaines (città metropolitane), des régions (regioni) et de l'État. Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions sont des collectivités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution. » L'État est désormais traité comme tous les autres niveaux, ce qui constitue un changement très important par rapport à la situation antérieure. Les régions ont une autonomie normative (article 117), d'organisation (article 123) et financière (article 119). L'article 117 organise ainsi une nouvelle répartition des compétences Les provinces et les communes sont définies comme des établissements autonomes ne disposant pas d'un pouvoir législatif mais seulement d'un pouvoir réglementaire pour ce qui concerne leur organisation et l'exercice des compétences qui leur sont attribuées. L'article 118 pose trois principes qui régissent l'exercice des fonctions administratives : la subsidiarité, la différenciation et l'adaptation. Le principe de subsidiarité, au sens de la Charte européenne de l'autonomie locale (254), prévoit que les compétences doivent d'abord être exercées par la commune, puis la province, la région, voire l'État. La subsidiarité est alors considérée comme un principe procédural, qui oblige la loi à suivre une certaine répartition des compétences, en vertu des articles 118 et 120 de la Constitution. Les régions peuvent introduire un recours devant la Cour constitutionnelle contre une loi méconnaissant ce principe, les autres collectivités territoriales ne disposant pas de la même faculté. Le non-respect de la subsidiarité par une loi peut également être invoqué devant le juge constitutionnel par la voie d'une question préjudicielle, lorsque l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée devant les tribunaux ordinaires. Ainsi, en l'absence de réels critères définis par la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui est amenée à trancher d'éventuels recours introduits par les régions. À cet égard, les autres collectivités locales ne peuvent exercer de recours direct auprès de la Cour constitutionnelle, seules des questions préjudicielles dans le cadre d'une exception d'inconstitutionnalité étant prévues. Aucune jurisprudence n'était intervenue à ce sujet. En vertu du principe de différenciation, les collectivités locales d'une même catégorie ne doivent pas nécessairement avoir toutes le même régime. Le troisième principe d'adaptation impose d'adapter l'exercice de compétences de la collectivité territoriale à sa capacité effective à l'exercer. Enfin, l'article 119 consacré à l'autonomie financière dispose que les collectivités doivent bénéficier d'une couverture financière intégrale pour l'ensemble des compétences exercées, l'État exerçant un pouvoir de péréquation entre collectivités ainsi qu'un pouvoir « extraordinaire » lui permettant de distribuer ressources additionnelles et subventions spéciales. En complément des révisions constitutionnelles, un décret législatif n° 267/00 du 18 août 2000 portant Recueil des lois sur les collectivités locales est venu remplacer celui de 1934 et codifier, notamment, les lois n° 142/90 du 8 juin 1990 relative au régime législatif des collectivités locales et n° 81/93 du 25 mars 1993 relative à l'élection directe des maires, présidents de provinces, et présidents de conseils municipaux et provinciaux. Enfin, la révision du titre V a été mise en œuvre par la récente loi-délégation n° 2003/131 du 5 juin 2003 dite « loi La Loggia » qui prévoit qu'un ou plusieurs décrets-délégations reconnaissent les principes fondamentaux dans les matières relevant de la législation concurrente issues des lois en vigueur. Elle constituait le premier essai pour dépasser la paralysie institutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles plusieurs de ses dispositions, tandis qu'aucun décret d'application n'a été pris. 2. La structure et l'organisation des collectivités locales Le pays compte 8 100 comuni, 106 province (255) et 20 regioni, dont 5 à « statut spécial ». Les structures ont peu évolué. En 1950, ces chiffres étaient de 7 781 comuni, 95 province et 19 regioni. Hors dépenses des administrations de sécurité sociale, l'État gère environ 60 % des dépenses publiques, les régions 23 % et les communes et provinces environ 18 %. Les collectivités locales n'ont pas de régime uniforme, à part certains traits communs fixés par l'État, tels que le régime électoral, les règles de fonctionnement de l'organe élu des collectivités et les compétences fondamentales des collectivités locales. Le reste relève soit de la législation régionale, soit de l'autonomie réglementaire des collectivités locales. En raison des nouveaux pouvoirs dévolus aux régions, notamment en termes de différenciation de leurs statuts - une région pouvant ainsi décider de son mode de gouvernement plus ou moins présidentiel -, la distinction opérée par la Constitution de 1947 avec les régions à statut particulier va perdre de sa pertinence, même si elle est toujours reconnue par l'article 116 de la Constitution. Les régions ont été prévues par la Constitution 27 décembre 1947, mais n'ont été mises en place, dans un premier temps, que les régions spéciales, au nombre de cinq aujourd'hui. La mise en place des régions ordinaires n'interviendra ainsi qu'en 1970 avec le vote d'une loi électorale. À partir de là, le processus a connu deux étapes : administrative dans les années 1970 avec deux étapes importantes, 1972 et 1977, politique à partir de 1980, étape motivée plus par une crise partisane que par la recherche d'un nouveau mode d'administration. Depuis 1963, date à laquelle les Abruzzes et le Molise ont été séparés l'un de l'autre, la Constitution, dans son article 131, a arrêté la liste des régions à vingt : Piémont, Val d'Aoste, Lombardie, Trentin-Haut-Adige, Vénétie, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie, Émilie-Romagne, Toscane, Ombrie, Marches, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles, Basilicate, Calabre, Sicile et Sardaigne. L'article 116 de la Constitution précise que cinq régions, à savoir le Frioul-Vénétie Julienne, la Sardaigne, la Sicile, le Trentin-Haut-Adige/Sud Tyrol et le Val d'Aoste, bénéficient de formes et de conditions particulières d'autonomie. Il prévoit également que ces mêmes formes particulières d'autonomie peuvent être attribuées aux autres régions, par une loi nationale, à l'initiative de la région concernée et après avis des collectivités locales, et ce dans le respect du principe d'autonomie financière. Cette autonomie ne s'exerce cependant que dans un certain nombre de matières limitées, telles que la protection de l'environnement et des biens culturels ou encore l'organisation de la justice de paix. La création de ces régions spéciales était alors sans lien avec la recherche de la meilleure organisation du pouvoir. La mise en place de la Sicile et de la Sardaigne devait permettre de faire face au chaos qui régnait alors dans ces régions. La création du Val d'Aoste, du Trentin-Haut-Adige, du Frioul-Vénétie Julienne devait permettre de prendre en considération des populations qui parlaient une autre langue que l'italien, dans un contexte d'affaiblissement de l'État central par rapport aux pays voisins ; le régime d'autonomie était alors fondé par la langue. Plusieurs régions peuvent être fusionnées en une seule ou de nouvelles régions peuvent être créées par loi constitutionnelle, sous réserve de consultation préalable des collectivités locales et régionales des zones concernées. Mais la Constitution, dans son article 132, interdit de créer de nouvelles régions de moins d'un million d'habitants, les régions existantes pouvant néanmoins subsister. La question de la délimitation des régions est politiquement explosive, du fait des propositions de la Ligue du Nord de fusion de différentes régions. Chaque région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en détermine la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement. Chacune possède un conseil régional (consiglio regionale), une commission exécutive (giunta regionale) et son président. Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et les actes administratifs de la région ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux. Le statut est adopté et modifié par le conseil par une loi adoptée à la majorité absolue de ses membres, en deux délibérations successives séparées d'un intervalle d'au moins deux mois. Le statut est soumis à référendum lorsque dans les trois mois qui suivent sa publication un cinquantième des électeurs ou un cinquième des membres du conseil régional en font la demande. Le statut n'est, dans ce cas, promulgué que s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés. En vertu de l'article 122 de la Constitution, complété par la loi n° 165/04 du 2 juillet 2004 (256), le système d'élection et les cas d'inéligibilité et d'incompatibilité du président de la région et des autres membres de la commission exécutive régionale, la giunta regionale, ainsi que des autres conseillers régionaux sont établis par une loi de la région dans les limites des principes fondamentaux posés par une loi de la République qui établit aussi la durée du mandat des organes élus. Le conseil régional, organe délibérant de la région, est ainsi élu au suffrage universel direct au niveau provincial parmi plusieurs listes concurrentes. Les sièges sont attribués selon un système de représentation proportionnelle. Il est tenu compte des bulletins résiduels dans une seconde phase du processus électoral, une circonscription électorale unique leur étant réservée dans la région. Le conseil comprend de trente à quatre-vingts membres (consiglieri regionali), dont le mandat est renouvelé tous les cinq ans. Le conseil régional adopte la législation de la région et prend des décisions administratives dans les domaines qui relèvent de la compétence de la giunta ou de son président. Le conseil régional dépose des propositions de loi au Parlement et fait connaître son avis sur les modifications territoriales envisagées au niveau des régions et provinces. Il approuve le budget régional, les transferts de fonds d'un chapitre à l'autre du budget et le bilan, fixe le montant des impôts régionaux, organise les bureaux et services régionaux, crée et organise les organes régionaux chargés de remplir les fonctions administratives de l'État, approuve les plans généraux de projets de travaux publics, ainsi que l'organisation des services publics régionaux et leur financement. Il peut créer des commissions et en nommer les membres, dans les cas où les régions y sont habilitées par la loi, et approuver toute mesure sur laquelle la loi ou une décision du pouvoir exécutif oblige le conseil à voter. En outre, à la demande du gouvernement, le conseil peut exprimer son avis sur toute question d'intérêt général concernant la région. Le conseil régional peut exprimer la défiance au président de la commission exécutive au moyen d'une motion motivée, signée par un cinquième de ses membres au moins et adoptée par appel nominal à la majorité absolue de ses membres. La commission régionale (giunta regionale), organe exécutif, comprend un président (presidente della giunta regionale) et un nombre de membres et de suppléants variable selon la population de la région. Le président est élu au suffrage universel direct sauf si le statut régional en dispose autrement. Ainsi, si un système présidentiel est préconisé pour les gouvernements régionaux, il n'est pas obligatoire et ce dans le respect du principe d'autonomie statutaire. Dans les faits, il semble que seul le parti de la Refondation communiste s'oppose à la désignation des présidents de région par le suffrage direct et préfèrerait continuer à le voir désigner au sein du conseil régional. Tous les autres partis paraissent avoir été « foudroyés » par les vertus du présidentialisme. Le président nomme et révoque les membres de la commission régionale (assessori). Celle-ci supervise l'exécution des lois et mesures adoptées par le conseil régional, gère les avoirs de la région et contrôle la gestion des services régionaux confiés à des entreprises spéciales. Elle prépare le budget régional et présente le bilan annuel. En outre, elle est habilitée à statuer sur les questions suivantes, dans les limites et selon les procédures prescrites par la loi et par le statut régional : transfert des fonds d'un article à un autre du même chapitre du budget ; projets de travaux publics, dans les limites des plans régionaux de travaux publics ; contrats délivrés par la région ; actif et passif de la région (sous réserve de signaler les mesures prises au conseil à sa prochaine réunion), ainsi que transactions et cas de renonciation. Le président représente la région, signe les lois et règlements et remplit les obligations administratives qui lui incombent pour le compte de l'État selon les instructions du gouvernement central. Auprès des organes délibérant et exécutif, le statut de chaque région organise le conseil des autonomies locales, qui est un organe de consultation pour la région et les collectivités locales prévu par l'article 123 de la Constitution. En Italie, la province constituait le niveau intermédiaire traditionnel, celui de l'unité italienne. Mais elle a souffert du fait de son rôle de relais du pouvoir de la dictature. Le préfet avait fort mauvaise presse, comme en Espagne d'ailleurs. La région avait donc le bénéfice d'une légitimité démocratique, hors de toute rationalité territoriale. Le débat sur la disparition des provinces, très vif jusqu'au début des années 1990, s'est apaisé, des lois récentes leur ayant conféré des compétences nouvelles. Un système de financement fondé sur des ressources propres a été adopté, marquant une véritable renaissance des provinces. Parmi la centaine de provinces, deux bénéficient d'un statut particulier en vertu de l'article 116 de la Constitution, à savoir les provinces de Bolzano et de Trente constitutives de la région du Trentin-Haut-Adige. Leur autonomie particulière, qui les assimile à des régions, les autorise, par exemple, à participer aux décisions destinées à la formation des actes normatifs communautaires dès lors qu'ils interviennent dans des matières qui ressortissent de la compétence des régions (257). Le Val d'Aoste comporte une seule province. En application de l'article 133 de la Constitution, les limites des provinces peuvent être modifiées et de nouvelles provinces peuvent être créées par loi ordinaire sur l'initiative des communes, sous réserve de consultation préalable des collectivités régionales des zones concernées. Des provinces peuvent être détachées d'une région et rattachées à une autre par loi ordinaire, sous réserve de consultation préalable des collectivités locales et régionales des zones concernées. La loi n° 142/90 de 1990 a introduit certains critères, en particulier celui d'un seuil minimal de 200 000 habitants afin d'éviter une prolifération excessive du nombre de provinces (258). Le conseil provincial, organe délibérant de la province, est élu au suffrage universel direct, comprend de vingt-quatre à quarante-cinq membres, dont le mandat est également renouvelé tous les cinq ans. Chaque électeur dispose d'une voix et les sièges sont répartis selon un système de représentation proportionnelle pondérée, qui favorise le parti majoritaire. Tout parti ou coalition de partis qui reçoit plus de 50 % des voix au premier tour se voit attribuer 60 % des sièges, les sièges restants étant attribués à tous les autres partis selon un système proportionnel. Cette prime majoritaire a bouleversé l'équilibre traditionnel des partis qui s'appuyait sur le système proportionnel précédent, en favorisant un regroupement autour de la personne du président. Le conseil provincial peut être dissous en cas de vote de défiance contre le président de la province, exprimé par les deux cinquièmes des conseillers au moins. En tel cas, le Président de la République nomme un commissaire provisoire chargé d'administrer la province en attendant la tenue de nouvelles élections. La commission (giunta provinciale), organe exécutif de la province, se compose du président de la province et d'autres membres. Les membres de la giunta provinciale (assessori) sont nommés par le président de la province, qui en présente la liste au conseil à sa première réunion, ainsi que le programme général du gouvernement provincial. Ils peuvent être choisis parmi les citoyens remplissant les conditions requises pour être élus conseiller. Ils sont en nombre pair. Ce nombre, qui est fixé par le statut de la province, ne peut être supérieur au quart de celui des membres du conseil. La giunta reste en fonction cinq ans, son mandat coïncidant avec celui du président de la province. Elle peut être dissoute pour les mêmes raisons prévues pour la dissolution du conseil, ou bien dans le cas où le président ou plus de la moitié des membres cessent d'exercer leur fonction pour quelque raison que ce soit. Le président peut aussi destituer chaque membre de la giunta à titre individuel. La giunta peut également être dissoute par le Gouvernement. Un assessore ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs. La commission exécutive est l'organe chargé de la supervision politique et administrative et de l'orientation générale. Elle définit les statuts de la province, les statuts des entreprises spéciales, les règlements de la province et l'organisation des bureaux et services de la province, les programmes, prévisions et rapports de planification, la planification budgétaire, les programmes et projets préliminaires concernant les travaux publics, les budgets annuels ou pluriannuels et les modifications qui y sont apportées, les bilans, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, les plans détaillés, les plans de restauration et les programmes d'application pertinents et/ou les dérogations éventuelles, les avis à donner sur les matières précitées. Elle signe les accords entre communes et entre des communes et la province. Elle assure la gestion directe des services publics, la création d'entreprises et institutions spéciales, la concession de services publics, la gestion de la participation de la province dans les sociétés d'économie mixte, ainsi que l'institution et la collecte des impôts, la réglementation générale des redevances perçues pour la jouissance de biens et de services. Elle autorise les dépenses engageant les budgets des exercices futurs, à l'exception de la location de biens immobiliers et de la fourniture continue de biens et services, de même que les achats et les cessions de biens immobiliers, les échanges de ces biens, les adjudications et les concessions qui ne sont pas expressément prescrites par les actes fondamentaux du conseil provincial ou qui n'en constituent pas une exécution, et qui de manière générale n'entrent pas dans le domaine de compétence de la Giunta, du secrétaire ou d'autres fonctionnaires; La giunta provinciale remplit toutes les fonctions administratives que la loi n'attribue pas expressément au conseil et qui n'entrent pas dans les compétences, prévues par la loi ou le statut, du président de la province, des organes gouvernementaux déconcentrés, du secrétaire ou des administrateurs. Elle fait rapport chaque année au conseil sur ses activités, exécute les instructions générales du conseil et lui soumet des propositions. Depuis la loi n° 81/93 du 25 mars 1993 précitée, le président de la province est élu au suffrage universel direct et membre du conseil provincial élu par le même scrutin. Chaque candidat doit appartenir ou être apparenté à un groupe au moins de candidats se présentant aux élections au conseil provincial. Au cas où aucun candidat n'obtient la majorité requise, un deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche suivant, entre les deux candidats qui ont obtenu le nombre le plus élevé de voix au premier tour. Après le deuxième tour, le candidat ayant reçu le plus grand nombre de voix est élu président de la province. Le président de la province nomme les membres de la giunta, qui l'aident à administrer la province, convoque et préside les séances, est chargé de superviser les services et bureaux, ainsi que l'exécution des lois promulguées, propose la candidature des représentants de la province dans les divers bureaux, sociétés et organisations, les nomme et destitue. Dans l'histoire, la commune italienne avait une place relativement faible, contrairement à l'image répandue d'une Italie de la Renaissance composée d'une myriade de municipalités brillantes et puissantes. Depuis la mise en place du régime libéral, le régime des communes est dans la réalité très restrictif. Le secrétaire de mairie jusqu'à récemment était nommé par l'administration. Pendant longtemps, les communes italiennes n'ont pas bénéficié de clause générale de compétence. Elles n'ont acquis une vocation générale que depuis la loi n° 142/90 du 8 juin 1990 précitée. Les élections locales demeurent, de manière significative, qualifiées en italien d'élections administratives. Rome bénéficie, en vertu de l'article 114 de la Constitution, d'un statut particulier organisé par une loi de l'État. Des communes peuvent être créées ou changer de nom et leurs limites peuvent être modifiées par une loi régionale, sous réserve de consultation préalable des collectivités locales des zones concernées. Le renvoi à une norme législative a conduit en pratique à un immobilisme de la carte administrative. Or, près de 4 700 communes, soit près de 60 % du total, ont moins de 3 000 habitants. De nombreux observateurs considèrent que cette catégorie de communes n'a pas les moyens d'assurer les fonctions et les services publics que la loi leur attribue. La loi n° 142/90 de 1990 a créé quelques incitations à la fusion des communes les plus petites en fixant le seul de 10 000 habitants pour la création de communes. Par ailleurs, des communes peuvent être détachées d'une région et rattachées à une autre par loi ordinaire, sous réserve de consultation préalable des collectivités locales et régionales des zones concernées. Le conseil municipal, organisme délibérant, se compose de membres dont le nombre va d'un minimum de douze dans les communes de moins de 3 000 habitants à un maximum de soixante dans les communes de 500 000 habitants au moins. Depuis la loi n° 81/93 de 1993 précitée, dans les communes dont la population est inférieure à 15 000 habitants, deux tiers des sièges sont attribués à la liste majoritaire, le reste étant réparti entre les autres listes en proportion du nombre des voix obtenues par chacune. Dans les communes dont la population est supérieure à 15 000 habitants, la liste ou coalition de listes obtenant 50 % des voix reçoit 60 % des sièges. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le conseil n'est pas présidé par le maire ; il peut être présidé soit par un conseiller représentant le parti ayant obtenu le plus grand nombre de voix, soit par une autre personne élue à cette fin. Ce point est décidé dans le statut de la commune. Le conseil municipal est renouvelé tous les cinq ans. La commission municipale (giunta municipale), organe exécutif de la commune, se compose du maire et du nombre pair de membres prévu par le statut de la commune. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, ces membres sont au minimum de deux et au maximum de six. Dans les communes de plus de 100 000 habitants et dans les chefs-lieux de province, le nombre de membres ne peut être supérieur au quart de celui des membres du conseil. Les membres de la giunta (assessori), parmi lesquels est désigné un maire adjoint, sont nommés par le maire qui en présente la liste au conseil à sa première réunion après les élections, ainsi que le programme général qu'il entend appliquer. Les assessori sont en général membres du conseil. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, les assessori peuvent aussi être choisis parmi les citoyens remplissant les conditions requises pour être élus conseiller. La giunta municipale reste en fonction pendant cinq ans. Un assessore ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs. Le dirigeant politique de la commune est le maire, qui, depuis la loi n° 81/93 de 1993 précitée, est élu au suffrage universel direct sur le même bulletin de vote que le conseil municipal. Le système électoral diffère selon la population de la commune. Dans les communes de plus de 15 000 habitants, l'élection du maire se déroule selon les mêmes modalités que celle du président de la province. Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix au premier tour de scrutin est élu maire. Si plusieurs candidats viennent en tête avec un nombre égal de voix, un deuxième tour de scrutin limité à ces candidats doit avoir lieu le dimanche suivant. Si le résultat est encore égal, le candidat le plus âgé est déclaré élu. La durée du mandat du maire est de cinq ans. Un maire ne peut remplir plus de deux mandats consécutifs. Un troisième mandat consécutif est autorisé si l'un des deux précédents a duré moins de deux ans, six mois et un jour pour n'importe quel motif excepté la démission volontaire. Le maire représente la commune, convoque et préside les réunions du conseil municipal et de la giunta, supervise le fonctionnement des organes et bureaux municipaux, veille à ce que les décisions du conseil soient exécutées, remplit les fonctions qui lui sont assignées par la loi, le statut et les règlements, veille à l'exécution des fonctions de l'État et de la région attribuées ou déléguées à la commune. Le maire fait le serment de respecter la Constitution italienne devant le conseil, à sa première réunion. Conformément à la loi régionale et sur la base du programme présenté par le conseil municipal, le maire est chargé de coordonner l'utilisation des moyens existants de manière à répondre aux besoins des usagers : il coordonne les heures d'ouverture au public des magasins et des services publics. Le maire a aussi la compétence, dans les limites de la législation régionale et des directives fixées par le conseil municipal, de coordonner les heures d'ouverture des branches locales des organismes publics de manière à organiser ceux-ci pour répondre aux besoins des usagers. L'importance de ces compétences, ajoutée à sa désignation au suffrage universel direct, tend à faire des maires des grandes communes des rivaux des présidents de région. En outre, le maire agit en qualité de représentant de l'État dans un certain nombre de fonctions : tenue des registres d'état civil et de population, exécution des tâches qui lui sont déléguées par la loi en matière électorale, inscription des mobilisables et collecte des données statistiques ; exécution des tâches qui lui sont déléguées par la loi en matière d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène ; accomplissement des fonctions que lui confère la loi en matière de police et de sécurité publique ; supervision de toutes les activités concernant la sécurité et l'ordre public, et communication au préfet des mesures qu'il a prises. En tant que représentant de l'État, le maire, par une ordonnance motivée et conformément aux principes généraux de la loi, peut adopter des mesures d'urgence en matière de santé publique et d'hygiène, de construction et de police locale, afin d'écarter et d'éliminer tout grave danger qui menace la sécurité de ses administrés. Pour faire exécuter de telles ordonnances, le maire peut, si la situation l'exige, demander au préfet d'autoriser le soutien des forces armées. Les communes de plus de 100 000 habitants doivent, et les communes dont la population est comprise entre 30 000 et 100 000 habitants peuvent, pousser plus loin la décentralisation en se subdivisant en districts. Le conseil de district est élu au suffrage universel direct selon les règles énoncées dans le statut municipal. Il nomme alors un président choisi parmi ses membres. En Italie, une fraction du corps électoral de la commune peut obtenir l'organisation d'une consultation, sous réserve du respect de critères définis par la loi ou d'une décision de l'instance délibérante locale. Les référendums communaux ont souvent une valeur consultative comme en France. Les règles varient d'une commune à l'autre. Il s'agit d'un nouveau type de collectivité locale, institué par la loi n° 142/90 de 1990 portant réforme des collectivités locales, confirmé par les récentes révisions constitutionnelles. Il aurait dû se substituer à la province dans certaines zones métropolitaines expressément définies, à savoir Turin, Milan, Venise, Gênes, Bologne, Florence, Rome, Bari et Naples. La distinction entre les communes et les villes métropolitaines a soulevé un long débat. Elle demeure cependant à ce jour théorique, aucune ville métropolitaine n'existant pour l'instant. Des projets de transformation de départements en villes métropolitaines ou de regroupements de communes en villes métropolitaines ont été évoqués. Mais, jusqu'à présent, le principe de création d'aires métropolitaines qui serviraient de référence à la gestion urbaine, aux transports, etc., est resté largement virtuel. Sur proposition des collectivités locales concernées, la délimitation des zones appartient aux régions intéressées qui doivent également réorganiser le territoire des communes. La répartition des fonctions entre la ville métropolitaine et les communes membres est établie par le statut de la ville. L'organe délibérant de la ville métropolitaine est le conseil métropolitain. L'organe exécutif de la ville métropolitaine est la giunta metropolitana, qui est régie par les mêmes règles que la giunta provinciale. Le dirigeant politique de la ville métropolitaine est le maire métropolitain, qui est élu selon les mêmes règles que le président de la province. Le maire métropolitain représente l'administration qu'il dirige, nomme les membres de la giunta et la préside. Pour être tout à fait complet, il convient de mentionner la création par la loi n° 1102/71 du 3 décembre 1971 confirmée par la loi n° 142/90 de 1990 précitée de communautés de montagne (comunità montane), qui sont des collectivités locales de plein exercice fondées sur l'association des communes participantes. Ces communautés se voient réserver des fonctions propres, telles que les interventions spéciales pour le développement de zones montagneuses. Elles peuvent également se voir déléguer certaines fonctions des communes et servir de base à la création de nouvelles communes par la fusion des collectivités concernées. 3. Les compétences des collectivités locales La Constitution distingue trois types de fonctions : le pouvoir législatif (articles 117 et 123), le pouvoir réglementaire (article 117) et les fonctions administratives (article 118). C'est en Italie que la législation régionale paraît la plus importante. Pour l'analyse, il convient de distinguer le pouvoir législatif « organique » du pouvoir législatif « ordinaire ». Le pouvoir législatif « organique » appartient pour une part aux régions. En effet, elles peuvent, en vertu de l'article 123 de la Constitution, se doter d'un statut propre, déterminer leur forme de gouvernement, définir les principes fondamentaux d'organisation et de fonctionnement du système politico-administratif régional (259). Le statut réglemente l'exercice du droit d'initiative et du référendum sur les lois et les actes administratifs de la région, ainsi que la publication des lois et des règlements régionaux. Cette forme d'autarcie structurelle et institutionnelle rapprocherait le système italien d'un régime fédéral, si ce n'est que le statut régional doit être en harmonie avec la Constitution. Or, il existe en doctrine et en jurisprudence constitutionnelle un noyau dur de « principes suprêmes » ou « fondamentaux » qui limitent l'action du législateur en matière de révision constitutionnelle, en dehors du droit communautaire. Il s'agit, par exemple, des principes de démocratie représentative, du pluralisme des partis, de protection et de valorisation du rôle des minorités, du respect et de la garantie des droits inviolables. Les statuts régionaux doivent respecter ces principes. Le pouvoir législatif « ordinaire » est partagé entre l'État et les régions selon trois catégories : les compétences exclusives de l'État, les compétences concurrentes et, dans le silence de la Constitution, les compétences « résiduelles » des régions. Les premières, réservées à l'État, sont limitativement énumérées par le texte même de la Constitution. Il s'agit de la politique extérieure et d'immigration, des relations avec les confessions religieuses, de la défense, de la monnaie, du contrôle de l'épargne et des marchés financiers, de la concurrence, de l'organisation fiscale et comptable de l'État, de la péréquation des ressources financières, des organes de l'État et des lois électorales s'y rapportant, de l'organisation administrative de l'État, de l'ordre public, de la nationalité et de l'état civil, des juridictions et des règles de procédure, de la « détermination des niveaux essentiels de prestations relatifs aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur tout le territoire national », des règles générales de l'instruction, de la prévoyance sociale, de la législation électorale des communes, provinces et métropoles, des douanes, des poids, mesures et de la fixation de l'heure, des œuvres intellectuelles et, enfin, de la protection de l'environnement et des biens culturels. Ainsi, les intérêts nationaux sont sauvegardés à travers la législation sur les matières exclusives. Même si l'État n'a pas la compétence de principe, ses compétences concernent des domaines très importants. Les deuxièmes, fort nombreuses, sont partagées entre l'État, qui détermine les principes fondamentaux, et les régions. Elles s'exercent ainsi en matière de relations internationales et de relations avec l'Union européenne des régions, de commerce extérieur, de protection et de sécurité du travail, d'instruction dans le respect de l'autonomie des institutions scolaires et à l'exception de la formation professionnelle, des professions, de recherche scientifique et technologique, de protection de la santé, de denrées alimentaires, de sports, de protection civile, d'aménagement du territoire, de ports et aéroports civils, de grands réseaux de transport et de navigation, de communication, de production, de transport et de distribution nationale de l'énergie. Elles touchent également la prévoyance sociale complémentaire, l'harmonisation des budgets publics, la coordination des finances publiques et de l'impôt, la valorisation des biens culturels et environnementaux et la promotion des activités culturelles, les caisses d'épargne et les établissements de crédits à caractère régional et les établissements de crédits foncier et agricole. Enfin, selon une « clause générale de résidualité », les régions exercent le pouvoir législatif dans toutes les matières non expressément réservées à la compétence législative de l'État, ce qui inclut des secteurs aussi importants que le développement économique ou l'aménagement du territoire. Lorsque la région estime qu'une loi ou un acte ayant valeur de loi de l'État ou d'une autre région empiète sur sa compétence, elle peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l'acte. Ainsi, comme dans la plupart des pays européens, les collectivités de troisième niveau assurent le plus souvent des compétences en matière d'aménagement du territoire, de développement économique, de formation professionnelle, de transports (transports ferroviaires d'intérêt régional notamment). Mais, contrairement aux autres pays européens et à l'instar de l'Espagne uniquement, les régions italiennes disposent de compétence en matière d'éducation et de santé. Les dépenses par habitant des régions italiennes sont ainsi nettement plus élevées que celles des régions françaises, en raison notamment de ces compétences exercées en matière de santé et d'éducation (260). Les régions italiennes se différencient ainsi des collectivités de troisième niveau des autres pays à la fois par l'attribution d'un pouvoir législatif et par l'exercice de compétences plus ou moins vastes, en fonction de leurs particularités géographiques, culturelles ou historiques. Dans les matières concurrentes ou résiduelles, les régions participent aux décisions destinées à la formation des actes normatifs communautaires et pourvoient à la mise en œuvre et à l'exécution des accords internationaux et des actes de l'Union européenne. En cas de carence des régions dans la mise en œuvre de ces dispositions, l'État peut intervenir en substitution. Dans ces mêmes matières, concurrentes ou résiduelles, l'État peut toujours intervenir par des lois précises, lorsque la région n'est pas en mesure de garantir les niveaux essentiels de prestations en matière de droits civiques et sociaux. Cette compétence législative transversale trouve son fondement dans le m) du deuxième alinéa de l'article 117 de la Constitution qui donne compétence à l'État pour « la détermination des niveaux essentiels de prestations relatifs aux droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur tout le territoire national », mais aussi dans les articles 2, 3 et 5 de la Constitution qui affirment les principes de solidarité, d'égalité et d'unité nationale. Dans les matières de compétence législative exclusive de l'État, le pouvoir réglementaire appartient à l'État. Il peut, cependant, par délégation être confié aux régions. Dans toutes les autres matières, y compris dans les matières concurrentes pour lesquelles l'État ne fixe que les principes fondamentaux, le pouvoir réglementaire appartient aux régions. Les provinces, les communes et les métropoles exercent le pouvoir réglementaire pour organiser et exercer les fonctions qui leur sont attribuées. c) Les fonctions administratives L'exercice de ces fonctions est défini par l'article 118 de la Constitution de 1947. Il prévoit que les fonctions administratives sont attribuées aux communes, à moins d'être conférées, pour en assurer un exercice unitaire, aux villes métropolitaines, aux provinces, aux régions ou à l'État, sur le fondement des trois principes de subsidiarité, de différenciation et d'adaptation. Les communes, les villes métropolitaines et les provinces sont titulaires de fonctions administratives propres et de celles qui leur sont conférées par la loi nationale ou régionale. Aux termes de la loi, l'État peut ainsi déléguer aux régions ou aux provinces d'autres fonctions administratives que celles que la Constitution leur attribue directement. Les régions peuvent aussi déléguer des fonctions aux provinces ou aux communes. Il résulte de cette construction que les provinces exercent à titre principal les fonctions d'aménagement du territoire, de défense de l'environnement, de transports et de voirie. Les communes sont chargées de manière spécifique des services à la personne, en matière d'assistance ou de santé par exemple, qui s'ajoutent aux fonctions traditionnelles qu'elles exerçaient traditionnellement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, de création de zones industrielles et commerciales ou encore de foires et marchés. Certaines fonctions que la Constitution attribue à l'État peuvent ainsi être déléguées aux communes. Le maire agit alors en tant que représentant de l'État. C'est le cas, comme on l'a déjà vu, en matière d'état civil, de tenue du registre de la population, des procédures électorales, d'inscription des jeunes mobilisables, de données statistiques. En outre, pour faire face à des dangers immédiats en cas d'urgence, le maire peut prendre des ordonnances en matière de santé publique, de construction et de police locale. d) L'articulation des compétences entre collectivités Il n'existe pas de dispositif clair organisant la coopération entre les différents niveaux de législation. Une partie de la doctrine a appelé de ses vœux la création d'une véritable « chambre des régions », comparable au Bundesrat allemand, réellement différente dans sa composition de la Chambre des députés et représentative des régions, voire le cas échéant des collectivités locales. Sur le modèle de la contractualisation des politiques publiques, des ententes peuvent être conclues entre régions pour un meilleur exercice de leur fonction, y compris lorsque sont déterminés des organes communs. Une loi régionale doit venir ratifier ces ententes. La loi de l'État réglemente les formes de coordination entre l'État et les régions en matière d'immigration, d'ordre public, de sûreté à l'exclusion de la police administrative locale. La loi de l'État réglemente également toute forme d'entente et de coordination en matière de protection des biens culturels. De manière plus générale, les conventions et consortiums, prévus par les articles 30 et 31 du Recueil de 2000, sont des accords qui peuvent être passés entre collectivités de même niveau. Il existe également des accords de type vertical, tels que les conférences de services, encadrés par la loi n° 241/90 de 1990, et les accords de programme, généralisés par la loi n° 142/90. Enfin, les communes peuvent se réunir au sein d'unions (unioni di comuni) sans limite de périmètre ni de fonctions. Les relations entre les différentes collectivités publiques ont été institutionnalisées. Une Conférence État-régions a ainsi été créée en 1988. Une commission parlementaire commune à la Chambre des députés et au Sénat chargée des questions régionales a été mise en place, tandis que se sont multipliés les organes de coopération de nature sectorielle. Le ministère de l'intérieur, pour sa part, entretient de nombreuses relations avec les associations nationales des collectivités locales, que sont l'Association nationale des communes italiennes (anci) et l'Union des provinces italiennes (upi). Enfin, plus récemment, en 1997, une Conférence État-villes-collectivités locales a été créée. Comme en Espagne ou en Écosse, les conflits entre pouvoirs régionaux et pouvoirs locaux, en particulier les grandes communes, ne sont pas absents de la vie locale, ce qui rend particulièrement utile une telle institution. Ces conflits expliquent notamment le peu d'écho qu'a reçu la possibilité de créer des villes métropolitaines. 4. Le financement des collectivités locales L'organisation des finances locales italiennes n'a rien à envier, en termes de complexité, à celle des finances locales françaises. Cette complexité est née, pour l'essentiel, au début des années 1970 lorsque la fiscalité propre des collectivités locales a été abolie. Jusqu'à une période très récente, le financement des collectivités locales résultait, pour l'essentiel, de transferts en provenance de l'État et, dans une moindre mesure, des régions au titre des fonctions déléguées aux provinces et aux communes. Pour rééquilibrer ce régime, dans un premier temps, la loi n° 142/90 de 1990 précitée, si elle n'a pas modifié le système, a établi de manière ferme les principes de l'autonomie fiscale, de garantie par des transferts de l'État du fonctionnement des services locaux indispensables, du caractère certain des ressources, du respect du rapport entre ressources et fonctions administratives. Dans un second temps, l'article 119 de la Constitution consacre, d'une part, l'autonomie financière, singulièrement fiscale, des collectivités territoriales, en disposant que : « Les communes, les provinces, les villes métropolitaines et les régions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et selon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Trésor public rapportables à leur territoire. » Il prévoit, d'autre part, la création par la loi d'un fonds de péréquation et pose le principe d'une aide matérielle et financière de l'État en faveur de collectivités « spécifiques ». La loi de l'État établit un fonds de péréquation, sans obligation d'affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure. Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d'éliminer les déséquilibres économiques et sociaux, de faciliter l'exercice effectif des droits de la personne, ou bien d'assurer l'accomplissement d'autres missions dépassant l'exercice de leurs fonctions normales, l'État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de communes, provinces, villes métropolitaines et régions spécifiques. La nouveauté de ce régime doit être mesurée à l'aune de la situation antérieure. Quasiment tous les impôts perçus par les collectivités avaient été supprimés en 1972. Avait alors été adopté le principe de « finances dérivées » caractérisé par le versement de plus en plus de concours de l'État. De 1989 à 1997, la part relative des recettes fiscales dans les ressources des collectivités territoriales ne s'établissait en moyenne qu'à 20 % tandis que celle des concours de l'État s'élevait à 69 %. Ce mouvement a été inversé dans la décennie 1990. Pour les communes, la création d'un impôt communal sur les immeubles (ici), en 1993, leur a assuré des recettes autonomes représentant environ 30 % de leur budget courant, en moyenne nationale. Depuis le 1er janvier 1999, les communes perçoivent un impôt additionnel sur les revenus à un taux fixe déterminé par l'État et à un taux variable fixé par les communes. Cette dernière réforme est intervenue en conséquence des lois dites « Bassanini » renforçant l'autonomie locale. Les provinces ont bénéficié du transfert d'importants impôts d'État, sur les primes d'assurance automobile et sur l'enregistrement des véhicules, très dynamiques, leur conférant le degré d'autonomie le plus fort des trois niveaux d'administration. Les provinces doivent aussi percevoir une partie de l'impôt sur les revenus pour financer la mise en œuvre des lois « Bassanini ». Pour les régions ordinaires, la loi du 13 mai 1999 a fixé le principe de la suppression des transferts de l'État, toutes les dépenses régionales devant être financées par des ressources régionales, dans le contexte d'une péréquation entre collectivités riches et pauvres. Les régions ont, en conséquence, bénéficié de nouvelles taxes. Afin de remplacer les transferts liés aux dépenses de santé, ont été institués, à compter du 1er janvier 1998, un impôt régional sur les activités productives (irap) (261) et une « taxe additionnelle régionale » à la contribution directe sur le revenu des personnes physiques. Au total, en 1999, la part des recettes fiscales dans les ressources des collectivités territoriales atteignait 47,7 %, la part des concours de l'État régressant à 46,7 %. En 2001, pour les régions ordinaires, la part des transferts courants était tombée à 9,5 % et pour les régions à statut spécial à 10,2 %. En 1999, elle était de 27,1 % pour les provinces et de 26,3 % pour les communes. 5 L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État a) L'administration territoriale de l'État Dans chaque région, l'État est représenté par un commissaire du Gouvernement. Dans chaque province, l'État est représenté par le préfet, que nomme le Conseil des ministres. Le préfet supervise le fonctionnement des services déconcentrés de l'État et coordonne les activités de l'État au niveau provincial. Avant les dernières réformes, la Constitution prévoyait, dans son article 129, un « dédoublement fonctionnel » : les provinces et les communes étaient aussi des « circonscriptions de décentralisation de l'État et de la région ». Comme dans le modèle français, il existait une relation entre les deux formes, décentralisée et déconcentrée, du système administratif. La réforme administrative des années 1998-1999 n'a pas conduit immédiatement à une disparition de l'administration périphérique. Plusieurs compétences ayant été conservées à l'État, ce dernier s'est borné à regrouper les services déconcentrés dans un bureau local du Gouvernement (Ufficio territoriale del Governo). Dans un contexte de réforme globale de l'État, la décentralisation, au profit d'organes élus autonomes, et la déconcentration, en faveur des bureaux locaux de l'administration centrale, ont été conçues, non de façon complémentaire, comme en France, mais de manière concurrente, même si de nombreuses années, la déconcentration a servi de substitut à la décentralisation et a été perçue comme un moyen d'éviter la progression de cette dernière. En Italie, le véritable contrepoids à la décentralisation a été, non la déconcentration, mais la réorganisation du gouvernement central. Pour préparer les administrations centrales à leurs nouvelles missions et responsabilités, il a fallu faire appel à une vaste réforme des ministères, des agences et des organismes publics et procédé à une réforme centrée sur le « cœur du gouvernement ». À la fin des années 1990, l'administration italienne, dans son ensemble, a connu une amélioration globale des services offerts aux citoyens, de la qualité de la régulation ainsi que des coûts et des charges bureaucratiques imposés aux citoyens et aux entreprises : cette amélioration a été confirmée en 2001 par l'Organisation de coopération et de développement économiques (ocde) (262). Pour une population globalement équivalente, l'Italie a deux millions de fonctionnaires. Les dépenses de rémunérations publiques représentent 10,7 % du produit intérieur brut (14,7 % pour la France). L'ampleur et la complexité du processus de réforme commencé en Italie ont également dépendu du choix courageux en faveur de la réforme qu'ont manifesté les principales organisations syndicales, qui ont accepté le défi de l'innovation et de la contractualisation du rapport de travail, de la décentralisation, de l'évaluation des performances et de l'indexation d'une partie des rétributions sur les résultats obtenus du point de vue de la productivité des administrations et de la qualité des services. b) Le contrôle sur les actes des collectivités locales En cas de menace sur l'unité juridique ou l'unité économique du pays, le Gouvernement dispose d'un pouvoir de substitution aux organes des collectivités locales (263). En vertu de l'article 120 de la Constitution, ce pouvoir s'exerce en cas de non-respect des normes et des traités internationaux, des normes communautaires ou en cas de péril grave pour la salubrité et la sécurité publiques, ou lorsque le nécessite la protection de l'unité juridique ou économique. La loi définit les procédures permettant de garantir que les pouvoirs de substitution sont exercés dans le respect du principe de subsidiarité et du principe de coopération loyale. Dans la pratique, ces pouvoirs de substitution sont utilisés avec une extrême réticence. S'agissant de la tutelle d'une collectivité sur une autre, les contrôles externes de l'État ou des régions ont été supprimés. Auparavant, le commissaire du Gouvernement pouvait renvoyer toute loi à la région qui pouvait la modifier en tenant compte de ses observations ou l'adopter sans changement. Le Gouvernement pouvait réitérer ses observations et soulever la question de légalité devant la Cour constitutionnelle ou la question d'opportunité (opportunità) devant le Parlement. Aujourd'hui, seuls subsistent des contrôles exercés par les citoyens devant le juge administratif. Cependant, à l'égard des régions, sur le fondement de l'article 123 de la Constitution, le Gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité relative aux statuts régionaux dans les trente jours qui suivent leur publication. Ce changement « copernicien » trouve son origine dans le texte constitutionnel lui-même. Avant les récentes révisions constitutionnelles, en vertu de l'ancien premier alinéa de l'article 125 de la Constitution, le contrôle de la légalité des actes administratifs de la région était exercé de manière décentralisée par un organe de l'État, dans les formes et les limites établies par les lois de la République. La loi pouvait, dans des cas déterminés, admettre un contrôle d'opportunité dans le seul but de provoquer, par une requête motivée, un nouvel examen de la délibération du conseil régional. Ainsi, sous le régime antérieur, les actes administratifs de la région étaient soumis à un contrôle a priori de légalité et d'opportunité exercé par une commission, organe de l'État, présidée par le commissaire du Gouvernement. Désormais, ce contrôle se fait par voie judiciaire. Pour ce faire, des organes de justice administrative du premier degré sont institués dans la région selon les règles établies par une loi de la République. En application de l'article 127 de la Constitution, le gouvernement peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité dans les soixante jours de la publication d'une loi régionale lorsqu'il estime que cette loi excède la compétence ce la région. Cet article a été mis en œuvre, par exemple, à propos du statut de la Calabre, qui a été annulé par la Cour constitutionnelle dans un arrêt n° 2 du 13 janvier 2004 au motif que le statut violait les règles prévues en cas d'élection directe du président de l'exécutif régional. En effet, le statut calabrais permettait d'indiquer sur le bulletin de vote, en plus du nom du candidat à la présidence de la commission régionale, celui du candidat à la vice-présidence qui, en cas de démission volontaire du président, aurait pu lui succéder sans entraîner une dissolution automatique du conseil régional, en contradiction avec le retour devant les électeurs prévu par la Constitution. S'agissant du contrôle sur les actes administratifs des collectivités locales, l'article 130 de la Constitution, avant sa récente abrogation, disposait qu'il était exercé par un organe de la région et pouvait porter à la fois sur la légalité et sur l'opportunité, sous la forme de renvoi avec demande de seconde délibération, des actes considérés. Puis, la loi n° 142/90 de 1990 a aboli le contrôle d'opportunité, a limité le contrôle de légalité sur un nombre plus limité d'actes et a réorganisé le comité régional de contrôle en instituant une composition moins politisée. L'abrogation de l'article 130 a conduit à transférer le contrôle d'organes externes au profit d'organes internes, tout en maintenant le recours au juge administratif. 6. Les perspectives d'évolution : régionalisme ou dévolution ? Dans sa route vers le pluralisme territorial, l'Italie cherche un équilibre entre principe de l'unité et principes de l'autonomie et de la différenciation. Deux points se dégagent donc de cette restructuration de l'Italie vers le niveau local et régional. Le premier est que la restructuration de l'État est avérée du sud au nord du pays : contrairement à certains clichés, le Sud (Naples, Palerme...) figure lui aussi parmi les avant-gardes de l'Italie des maires et des gouverneurs, faite à la fois de vitalité et de confusion. Mais, et c'est le second point majeur, il est patent que ce processus pourrait aviver les clivages Nord-Sud. Si toute hiérarchie entre collectivités publiques a été abolie sur un plan juridique, l'importance des instruments financiers de l'État place souvent les collectivités locales dans la dépendance de ce dernier. En comparaison, les instruments financiers à la disposition des régions restent relativement limités. Le pouvoir de substitution, s'il constitue de manière formelle un instrument fort de recentralisation, est, en revanche, très peu utilisé. La valorisation des autonomies territoriales et des communautés locales trouve une partie de ses origines, dans le succès, à partir des élections de 1992, du mouvement de protestation porté par la Ligue du Nord, parti anti-système, hostile à la péréquation, favorable à un fédéralisme fiscal compétitif. Les réformes récentes ont tendu à prendre en compte cette volonté d'autonomie plus forte sans pour autant diriger les institutions vers le fédéralisme et en maintenant les principes de solidarité et d'égalité. Malgré ces avancées, l'Italie fonctionne encore sur un modèle ambigu de relations entre le centre et la périphérie. D'une part, se développe une culture régionaliste marquée par la volonté à la fois de se voir transférer les pouvoirs du centre et de maintenir aux régions les fonctions administratives que la Constitution, en vertu du principe de subsidiarité, tendrait à confier aux autres collectivités locales. D'autre part, perdure une culture « localiste » qui se caractérise par le souci de maintenir des relations directes avec l'État central aux fins de se protéger de la volonté régionale d'expansion. Relève sans coup férir de la première tendance le projet de loi constitutionnelle dit « Bossi » du nom de l'ancien ministre des réformes institutionnelles. Sous la pression de sa composante « Ligue du Nord », la coalition au pouvoir réunie autour du parti Forza Italia du Président du Conseil, Silvio Berlusconi, a engagé un processus qui doit mener à un système de dévolution, avec, en ligne de mire avouée, le modèle écossais. Adopté par le Conseil des ministres du 16 septembre 2003, le projet, qui prévoit également le remplacement du Président du Conseil par un Premier ministre désigné en même temps que les députés au suffrage universel qui aurait le pouvoir de nomination et de révocation des ministres et surtout celui de dissolution de la Chambre jusqu'alors attribué au Président de la République, a été adopté par le Sénat le 25 mars 2004. Il a été adopté, fortement remanié, par la Chambre des députés le 15 octobre 2004, avant de l'être de nouveau, en deuxième lecture, par le Sénat le 23 mars 2005 et par la Chambre le 20 octobre 2005. Le Sénat s'est prononcé définitivement, en troisième lecture, le 16 novembre 2005, avec une majorité de 170 voix, 132 voix contre et 3 abstentions. La réforme constitutionnelle, pour être définitive, devra être approuvée par référendum, mais seulement après les élections législatives qui doivent se tenir au printemps 2006, sous réserve d'une dissolution anticipée. En effet, le projet n'ayant pas été approuvé à la majorité des deux tiers des membres du Parlement, un référendum s'avère nécessaire. En application de l'article 138 de la Constitution, « les lois portant révision de la Constitution et les autres lois constitutionnelles sont adoptées par chaque Chambre en deux délibérations successives, séparées d'un intervalle d'au moins trois mois, et à la majorité absolue des membres de chaque Chambre lors de la seconde délibération. Ces mêmes lois sont soumises à référendum lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, demande en est faite par un cinquième des membres d'une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq assemblées régionales. La loi soumise à référendum n'est pas promulguée, si elle n'est pas approuvée à la majorité des suffrages valablement exprimés. Le référendum n'a pas lieu si la loi a été adoptée lors de la seconde délibération par chacune des Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres. » Il convient de relever que le projet de loi constitutionnelle, s'il est adopté définitivement, abrogera cette dernière phrase (264). Le projet, qui comporte cinquante-sept articles et qui modifie cinquante articles de la seconde partie de la Constitution, prévoit de transformer des compétences résiduelles en compétences réservées aux régions. Les dispositions modifiant le titre V de la Constitution accorderaient aux régions un pouvoir accru dans le domaine de la santé et de l'éducation ainsi que le contrôle de la police administrative locale. Un Sénat fédéral de la République, reflétant plus fidèlement les équilibres régionaux, passant de 315 à 252 membres auxquels s'ajouteraient 42 délégués des régions qui siégeraient sans droit de vote, viendrait remplacer l'actuel Sénat. Il ne serait plus compétent que dans les matières de législation concurrente, à l'exclusion des matières relevant uniquement de l'État ou des régions. Il nommerait quatre des quinze membres de la Cour constitutionnelle, tout comme le chef de l'État et la magistrature, tandis que la Chambre des députés n'en nommerait que trois. La Cour constitutionnelle pourra être saisie par les communes et les provinces dès lors qu'elles estiment avoir été lésées. À la demande de l'Alliance nationale, composante de la majorité, l'article 127 de la Constitution serait modifié pour permettre au gouvernement de bloquer une loi régionale si elle s'avérait préjudiciable à l'intérêt national de la République. Le Gouvernement pourrait ainsi, dans les quinze jours de la publication de la loi régionale, inviter la région à supprimer les dispositions préjudiciables. Si la région n'obtempérait pas, le Gouvernement pourrait soumettre la question au Parlement, qui pourrait à la majorité absolue de ses membres, dans les quinze jours, supprimer les dispositions en cause. Le Président de la République promulguerait un décret d'annulation dans les dix jours. Le rapporteur a eu l'occasion de le constater, lors des multiples entretiens qu'il a menés sur place, l'avenir de ce processus de réforme constitutionnel est plus qu'incertain. Nombreux étaient ses interlocuteurs, aussi bien dans la majorité - de manière officieuse - que dans l'opposition - de façon plus explicite -, qui s'accordaient à prédire l'échec du référendum, qui serait demandé sans coup férir par l'opposition, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 138 de la Constitution. Après une période de centralisation autoritaire et en rupture avec l'héritage de l'absolutisme installé par la dynastie des Bourbons à la fin du XVIIIe siècle, la Constitution du 27 décembre 1978 fait de l'Espagne un « État des autonomies » (265), selon un principe qui s'applique à la fois à la création de nouvelles entités territoriales, les communautés autonomes (comunidades autónomas), et à l'instauration d'une garantie institutionnelle pour toutes les entités, ou collectivités, locales (entes locales), qui gèrent leurs intérêts respectifs de façon autonome. L'autonomie des collectivités locales a un caractère plus limité que celle des communautés autonomes, cette dernière étant de nature politique et s'accompagnant d'une capacité législative. Ce régime d'autonomie forte, inspiré du modèle italien, aurait pu conduire à une diversification croissante des situations. Or, tout laisse à penser qu'au contraire, chaque communauté autonome tend à imiter sa voisine et à assurer sur l'ensemble du territoire espagnol une relative homogénéité des règles applicables. 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités territoriales espagnoles La Constitution espagnole du 27 décembre 1978, dans son article 2, proclame que la nation espagnole est indivisible, mais reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions ainsi que la solidarité entre elles. La Constitution consacre son titre VIII à l'organisation territoriale de l'État. Elle dispose, dans son article 137, que « l'État s'organise territorialement en communes, provinces et communautés autonomes qui se constitueront. Toutes ces entités jouissent de l'autonomie pour gérer leurs intérêts respectifs. » L'article 138 précise que « les différences entre les statuts des diverses communautés autonomes ne pourront impliquer, en aucun cas, des privilèges économiques ou sociaux » et pose le principe de la péréquation en disposant que : « L'État garantit l'application effective du principe de solidarité consacré à l'article 2 en veillant à l'établissement d'un équilibre économique approprié et juste entre les différentes parties du territoire espagnol, compte tenu tout particulièrement des circonstances propres à l'insularité ». Ces principaux généraux posés, la Constitution distingue l'administration locale, assurée par les communes et les provinces, et les communautés autonomes. L'article 140 garantit l'autonomie des communes et impose l'élection au suffrage universel direct des conseillers municipaux. L'article 141, dans son troisième paragraphe, permet la création de groupements de communes différents de la province. L'article 141, dans son premier paragraphe, définit la province comme un regroupement de communes et comme une division territoriale de mise en œuvre des politiques de l'État. Les modifications des limites provinciales sont approuvées par le Parlement (Cortes Generales), composé de la Chambre des députés (Congreso de los Diputados) et du Sénat (Senado). Le paragraphe 2 de l'article 141 établit que le gouvernement et l'administration autonome des provinces doivent être assurés par des conseils généraux (diputaciones) ou par d'autres corps à caractère représentatif (corporaciones). En outre, le Tribunal constitutionnel a explicitement étendu à la province le bénéfice de la garantie constitutionnelle de l'autonomie dans sa décision (sentencia) du 28 juillet 1981 qui avait déclaré inconstitutionnelle la plus grande partie de la loi statutaire catalane du 17 décembre 1980 en raison de la suppression des conseils généraux de Catalogne. Les régions, dont la Constitution reconnaît et garantit le droit à l'autonomie sont invitées à se déclarer « communautés autonomes » sur le fondement du premier alinéa de l'article 143 en vertu duquel « en application du droit à l'autonomie reconnu à l'article 2 de la Constitution, les provinces limitrophes ayant des caractéristiques historiques, culturelles et économiques communes, les territoires insulaires et les provinces ayant une entité régionale historique pourront se gouverner eux-mêmes et se constituer en communautés autonomes, conformément aux dispositions du titre VIII et des statuts respectifs ». Ainsi, la carte définitive de l'État espagnol ne figure pas dans le texte de 1978. Elle ne sera que l'aboutissement d'un processus dès lors que les communautés ont été appelées à s'autoconstituer, caractéristique qui ont conduit les observateurs à qualifier la Constitution espagnole de « Constitution accidentelle » (266). Ainsi, ce n'est pas moins de trois régimes d'autonomie qui ont été ouverts par le texte fondamental, permettant, notamment, de concéder aux nationalités dites « historiques » la possibilité d'accélérer l'évolution dans cette voie : - une voie spéciale dite « rapide », prévue à l'article 151, offrant un accès immédiat à un niveau maximum de compétences dans les limites des compétences exclusives de l'État définies par l'article 149 ; cet accès nécessitait deux référendums, l'un d'initiative, le deuxième permettant de ratifier le statut dans chaque province ; seule l'Andalousie suivit cette voie pour obtenir son autonomie en décembre 1981 ; - un régime d'accès progressif à ces mêmes compétences après un délai de cinq ans pour les nationalités autres qu'historiques (régime du 2 de l'article 143) ; ces compétences représentent pour ces communautés à « autonomie progressive » un maximum susceptible d'être élargi lors de la réforme de leurs statuts, qui aurait dû intervenir cinq ans après leur constitution. Ce modèle a permis l'accès à l'autonomie des Asturies et de la Cantabrique (décembre 1981), de La Rioja, de l'Estrémadure et de Murcie (juin 1982), de Valence (juillet 1982), de l'Aragon, des Canaries, de Castille-La Manche (août 1982), des Baléares (février 1982) et de Castille-Leon (février 1983) ; - un régime d'accès immédiat à toutes les compétences non réservées à l'État pour les « nationalités historiques » de l'Espagne en application de la deuxième disposition transitoire (267) ; il s'agit du régime des communautés dites de « pleine autonomie » ; les compétences, définies par l'article 148, constituent pour ces communautés un minimum qui peut être dépassé en s'appuyant sur l'article 150 ; ont suivi cette voie la Catalogne et le Pays basque (décembre 1979), la Galice (avril 1981), ainsi que la Navarre (août 1982), cette dernière bénéficiant, en outre, de la première disposition additionnelle à la Constitution (268). La réforme statutaire en faveur des communautés à « autonomie progressive » n'a jamais eu lieu. Elle a été compensée par le Pacte des autonomies (Pacto autonómico), signé le 28 février 1992 au niveau national entre les deux grandes formations politiques que sont le Parti socialiste ouvrier espagnol (psoe) et le Parti populaire (pp). Ce Pacte élargit les compétences des communautés autonomes, au-delà des matières non réservées à l'État, en regroupant les matières qui font l'objet de délégation en trois catégories : les compétences exclusives déléguées, les compétences déléguées définies par la loi d'exécution, les compétences déléguées d'exécution. Cet élargissement des compétences se fait sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 150 de la Constitution qui autorise l'État à transférer ou à déléguer aux communautés autonomes, au moyen d'une loi organique, les compétences qui relèvent de son propre domaine d'action. C'est sur ce fondement qu'un certain nombre de communautés ont vu leurs statuts modifiés (269). Un deuxième processus de réforme statutaire a été conduit entre 1996 et 1999 (270) et s'est traduit, comme pour le processus de 1992-1994, par un rapprochement significatif des statuts autonomiques, grâce à l'attribution de nouvelles compétences, une rationalisation du fonctionnement des institutions et, parfois, à l'introduction d'un droit de dissolution du parlement régional (271). Dans ce mouvement, les spécificités propres aux communautés « historiques » ont eu tendance à s'estomper, ce qui les a motivées pour demander de nouvelles compétences et revendiquer le « fait différentiel » (272). La procédure de réforme des statuts est incluse dans les statuts eux-mêmes qui ont valeur de loi organique. Les statuts de certaines communautés présentent la particularité d'imposer un référendum : c'est le cas de la Catalogne, du Pays basque, de la Galice et de l'Andalousie. L'initiative de la réforme appartient soit au Gouvernement de la communauté, soit au parlement régional, soit aux Cortes Generales de l'État ; la proposition doit être adoptée par le parlement régional, puis nécessitera l'approbation du Parlement espagnol par le biais d'une loi organique, ce qui implique l'obtention de la majorité absolue des membres des Cortes Generales ; enfin, elle devra être approuvée par référendum. Lorsque la modification ne porte que sur l'organisation des pouvoirs de la communauté, la procédure est simplifiée : le parlement régional élabore le projet ; le Parlement national est consulté ; si, dans un délai de trente jours, aucun organe ne s'y oppose, un référendum est organisé ; in fine, le Parlement national devra approuver la modification par une loi organique. La réforme du statut des autres communautés suit la même voie à l'exception de la phase référendaire. En effet, par parallélisme des formes, les populations de ces communautés n'ayant pas été consultées lors de l'adoption du statut d'autonomie au contraire de celles des communautés précédemment visées, la réforme du statut n'emprunte qu'une voie parlementaire. Le pouvoir législatif des régions autonomes n'est subordonné qu'à la Constitution et le contrôle exercé par l'État est purement juridictionnel. La répartition des compétences est favorable aux communautés qui disposent de toutes les compétences sauf celles attribuées explicitement à l'État. L'article 156 garantit l'autonomie financière des communautés autonomes pour développer et exercer leurs compétences, conformément aux principes de coordination avec les finances de l´État et de solidarité entre tous les Espagnols. Elles peuvent aussi agir comme délégués ou collaborateurs de l'État pour le recouvrement, la gestion et la liquidation de ses ressources fiscales. Le régime constitutionnel des autonomies a été précisé par la loi 7/1985 du 2 avril 1985 relative aux collectivités locales régissant le fondement du régime local (lrbrl) (273), la loi 39/1988 du 28 décembre 1988 régissant les finances locales (lhl) (274) et une série de décrets-lois royaux de 1986 : 382/1986 du 10 février relatif à l'enregistrement des collectivités locales, 781/1986 du 18 avril approuvant le texte remanié des dispositions en vigueur en matière de régime local (trrl) (275), 1372/1986 du 13 juin relatif aux biens des collectivités locales, 1690/1986 du 11 juillet relatif à la population et à la délimitation de ces collectivités et 2568/1986 du 28 novembre relatif à leur organisation, leur fonctionnement et à leur régime juridique. Ces règles ont été déclinées au niveau régional par des lois adoptées par les communautés autonomes. Par exemple, en Andalousie, où le rapporteur s'est rendu, la loi 3/1983 du 1er juin 1983 a fixé l'organisation territoriale de la communauté autonome et les députations sur son territoire ; les lois 3/1988 et 5/1988 du 17 octobre 1988 ont, respectivement, créé le Conseil andalou des communes et fixé les règles relatives à l'initiative législative populaire et à l'initiative des conseils municipaux, tandis que la loi 7/1999 du 29 septembre 1999 a précisé quel était le régime des biens des collectivités locales. Le régime constitutionnel local a également été complété par un accord conclu le 21 avril 1999 par les forces politiques espagnoles et les associations représentatives des collectivités locales. Ce « Pacte local », dénommé « Mesures pour le développement pour le gouvernement local » a abouti à l'adoption de lois organiques ou ordinaires déclinant l'autonomie proclamée par la Constitution. Parmi les lois organiques, la loi LO 7/1999 du 7 avril 1999 a modifié la loi organique relative au Tribunal constitutionnel pour introduire l'action en défense de l'autonomie locale contre les lois et les actes de niveau législatif. La loi organique LO 8/1999 du 21 avril 1999 a modifié la loi organique fixant le régime électoral général pour préciser les conditions de présentation d'une « motion de censure » contre le maire en prévoyant la convocation automatique du conseil municipal en assemblée plénière et introduit la « question de confiance ». La loi organique LO 9/1999, également du 21 avril 1999, a modifié la loi organique relative au droit de réunion et la loi organique LO 10/1999 de la même date a modifié la loi organique relative au droit à l'éducation en organisant la représentation des collectivités locales au sein du conseil scolaire de l'État et a autorisé les autorités locales à coopérer pour la création, la construction et l'entretien des établissements d'enseignement publics et à contrôler l'application du principe de scolarité obligatoire. En juillet 2004, le ministre de l'administration publique (276), compétent pour suivre les affaires autonomiques et locales, a commandé un livre blanc pour la réforme des pouvoirs locaux. Ce livre blanc a été parachevé en juin 2005 (277). À la suite de sa publication, a été rédigé un projet de loi sur le gouvernement et l'administration locale (278), qui devait être déposé au début de l'année 2006. Ce projet de loi, à maints égards novateur, prévoit notamment de renforcer les pouvoirs des autorités locales, en particulier leurs pouvoirs normatifs et de sanction, afin de corriger les difficultés dérivées, entre autres, du principe de réserve de la loi qui limite traditionnellement leur champ d'action. Il promeut également un nouveau modèle d'intercommunalité qui, outre le principe de coopération administrative, défend l'idée d'une coopération et d'une concertation accrue entre les municipalités d'une province, sur le fondement d'une plus grande solidarité, afin d'améliorer l'accès de tous les citoyens à de meilleurs services. Devrait également être mieux assurée la distinction entre les fonctions délibérante et exécutive ainsi que l'équilibre entre majorité et minorité. 2. La structure et l'organisation des collectivités locales Conformément à l'article 137 de la Constitution, il existe trois types de collectivités locales de droit commun : à la base, 8 106 municipios, dont plus de 90 % ont moins de 5 000 habitants ; au niveau intermédiaire, 50 provincias ; à l'échelon régional, 17 comunidades autónomas. S'y ajoutent, au niveau supracommunal, outre 2 zones métropolitaines (Barcelone et Valence) supprimées récemment par des lois communautaires, environ 700 organes de coopération (comarcas (279) et syndicats de communes), et au niveau infracommunal, environ 3 700 collectivités particulières. Seules les communes, les provinces, les îles dans les archipels des Baléares et des Canaries et les communautés autonomes ont un caractère obligatoire. Toutes les autres sont facultatives et sont régies par les lois des communautés autonomes qui doivent définir ceux de leurs pouvoirs qui leur seront applicables, ce qui implique donc un risque de tutelle. - Les communautés autonomes En décembre 1979, commence la création des communautés autonomes quand sont publiés les deux premiers statuts d'autonomie, ceux du Pays Basque et de la Catalogne. Les derniers statuts, ceux d'Estrémadure, des Îles Baléares, de la communauté de Madrid et de la communauté de Castille-Leon, sont publiés en février 1983. Les communautés autonomes sont au nombre de dix-sept. Sept d'entre elles ne possèdent qu'une seule province. Il s'agit des communautés de Navarre, Madrid, La Rioja, Murcie, des Asturies, de Cantabrique et des Îles Baléares. Elles assurent à ce titre les compétences des anciens conseils provinciaux. Il existe deux régimes particuliers d'autonomie, qui ont principalement des incidences fiscales (280) : le régime « foral » qui concerne le Pays basque et la Navarre, qui ont presque toutes les compétences d'un État fédéral, par exemple dans le domaine du logement et de la fiscalité, et le régime commun qui touche les quinze autres communautés qui ont toutes les compétences d'un État fédéré exception faite de certaines matières telles que le recouvrement d'une partie des ressources fiscales et le domaine du logement. La Constitution interdit, par son article 145, la fédération de communautés autonomes. Mais, sur le fondement de l'article 144, pour des raisons d'intérêt national, le Parlement peut autoriser par une loi organique l'adoption ou procéder à l'octroi d'un statut de l'autonomie à des territoires ne faisant pas partie de provinces ou également se substituer à l'initiative des organismes locaux en vue de l'accès à l'autonomie. Ainsi, outre le statut particulier des villes de Ceuta et Melilla (voir infra), a été prévue l'éventuelle intégration de la Navarre dans la communauté autonome du Pays basque sur accord de son parlement obtenu à la majorité absolue et après un référendum approuvé par la majorité des suffrages exprimés en vertu de la quatrième disposition transitoire de la Constitution. Divers statuts d'autonomie ont mis en œuvre en partie ces dispositions. C'est ainsi que les statuts de Cantabrique, de La Rioja, de Murcie, d'Aragon, de Castille-Leon, du Pays basque et d'Andalousie, prévoient les cas de séparation, intégration, en partie ou en totalité, du territoire de la communauté autonome ou d'une autre communauté autonome ou de territoires ne faisant pas partie d'une communauté, le cas échéant, et fixent une procédure prévoyant en règle générale la participation des communes concernées, de la population par voie référendaire et du Parlement au moyen d'une loi organique. L'organe délibérant des communautés autonomes est dénommé soit assemblée, soit parlement. Le nombre de députés ou de membres est calculé en proportion de la population et du territoire de la communauté autonome. Ils sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret, conformément à un système de représentation proportionnelle de la population qui assure la représentation des différentes zones du territoire. L'élection a lieu tous les quatre ans. La circonscription électorale est la province. L'assemblée ou le parlement régional représente politiquement la population de la communauté autonome, exerce le pouvoir législatif, approuve les budgets, oriente et contrôle l'action du gouvernement. Il peut déléguer au conseil de gouvernement le pouvoir législatif. Il fixe et lève les impôts, approuve les accords avec d'autres communautés autonomes conclus par le conseil de gouvernement, élit les sénateurs qui représentent la communauté autonome. Il peut présenter un recours pour inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel et demander au gouvernement de la nation l'adoption de projets de lois ou soumettre des propositions de lois au Parlement en désignant les députés qui se chargeront de la défense de ces textes devant cette assemblée. Il autorise certains crédits et approuve les comptes généraux de la communauté autonome et ses plans économiques. Il peut entamer la procédure de réforme du statut et l'approuver en une première phase. Le conseil de gouvernement assure le pouvoir exécutif de la communauté autonome. Il est composé d'un président et de conseillers dont le nombre en général ne dépasse pas dix. Dans certaines communautés autonomes, il existe des vice-présidents. Le président, élu parmi les conseillers et nommé par le Roi, désigne et révoque librement les conseillers ainsi que, le cas échéant, le vice-président. Le conseil de gouvernement détient les fonctions exécutives et administratives de sorte que chaque conseiller est le supérieur hiérarchique de chacun des départements entrant dans la composition de l'administration autonomique. Le conseil dispose du pouvoir réglementaire et du pouvoir d'initiative législative. Il planifie la politique régionale, peut présenter des recours pour inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel et saisir ce même Tribunal de conflits de compétence avec l'État. Il a le pouvoir de révision par voie administrative avant la voie judiciaire. Il commande la police autonomique, lorsqu'elle existe. Il élabore et exécute le budget de la communauté autonome. Il peut émettre des emprunts publics et réaliser des opérations de crédit. Enfin, il peut ouvrir la procédure de réforme du statut. Le président dirige et coordonne l'action du conseil de gouvernement, assure au plus haut niveau la représentation de la communauté autonome et la représentation ordinaire de l'État au sein de cette communauté. Il est responsable devant l'organe délibérant, qui peut même, au moyen d'une motion de censure, exiger sa démission ainsi que celle des autres membres du conseil. Il peut poser une question de confiance sur un sujet politique revêtant une importance particulière et lancer la procédure de réforme du statut. Par ailleurs, la Constitution prévoit divers mécanismes de participation des citoyens par voie référendaire. C'est le cas pour l'instauration de la communauté autonome proprement dite, comme ce fut le cas de l'Andalousie, ou également pour l'intégration éventuelle de la Navarre à la communauté autonome du Pays basque. De la même manière, il est également prévu un référendum pour la modification des statuts d'autonomie dans les cas du Pays basque, de la Catalogne, de la Galice et de l'Andalousie, dans la mesure où il s'agira d'une réforme de fond et non seulement d'une modification de l'organisation des pouvoirs de la communauté autonome. D'autre part, les statuts de Catalogne, d'Andalousie, de Valence, des Canaries, des Asturies, de Murcie et d'Estrémadure, prévoient la mise en œuvre des règles de niveau étatique en matière de consultations populaires par référendum. Dans ces cas, il appartient à l'État d'autoriser la convocation du référendum tandis qu'il incombe à la communauté autonome de formaliser cette convocation. - Les provinces Il convient de distinguer le régime de droit commun des régimes particuliers (foraux, monoprovinciaux et insulaires). En vertu de l'article 141 de la Constitution, les modifications des limites des provinces doivent être convenues dans le cadre d'une loi organique de l'État approuvée par le Parlement. L'organe délibérant des provinces est le conseil provincial, qui prend la forme soit de conseils généraux (diputaciones), soit de collectivités à caractère représentatif (corporaciones). Tous les conseils provinciaux comprennent un président, des vice-présidents, une commission d'administration, une assemblée plénière, une commission spéciale des comptes et des commissions d'étude, d'information, de consultation et de suivi des affaires, dès lors que la législation sur les communautés autonomes ne prévoit pas d'autre organisation. Le conseil provincial plénier (pleno) est composé de députés, désignés par les conseillers municipaux en leur sein et dont le nombre varie en fonction de la population de la province (281). La commission exécutive ou commission d'administration est quant à elle composée du président et d'un nombre de députés provinciaux ne dépassant pas le tiers du nombre total. Le conseil provincial plénier est chargé de l'organisation de la province, de l'approbation du règlement fiscal, de l'approbation et de la modification des budgets, de l'engagement des dépenses dans les limites de sa compétence et de l'approbation provisoire des comptes, ainsi que de celle des plans provinciaux. Il contrôle et supervise l'action des organes de gouvernement. Il approuve le niveau des effectifs, la liste des postes de travail à pourvoir, le règlement des examens de sélection du personnel et des concours d'admission aux postes vacants, le montant des rémunérations complémentaires des fonctionnaires ainsi que le nombre et le régime du personnel auxiliaire éventuel ainsi que la cessation de service des fonctionnaires et le licenciement du personnel contractuel. Il peut modifier le statut juridique des biens relevant du domaine public et entreprendre l'aliénation du patrimoine. Il peut dénoncer les conflits de compétences avec d'autres organismes locaux et administrations publiques et a le pouvoir d'exercer des poursuites judiciaires et administratives. L'organe exécutif de la province est le président du conseil provincial, assisté de vice-présidents et de la commission d'administration. Il est élu par et parmi les députés et peut être éloigné de son poste au moyen d'une motion de censure constructive, souscrite et votée par la majorité absolue des membres de la corporation, qui doit inclure le nom d'un candidat alternatif. La commission d'administration assiste le président dans l'exercice de ses attributions, exerce les attributions que ce dernier ou le conseil plénier lui délègue. Elle exerce également les attributions que lui fixent les lois. Elle est composée du président et d'un nombre de conseillers inférieur ou égal au tiers du nombre légal de membres du conseil provincial. Les membres de la commission sont librement nommés et révoqués par le président qui en rend compte au conseil provincial. Le président du conseil provincial, responsable politique de la collectivité locale, est président de droit de tous les organes à caractère collégial et se charge de l'exécution de leurs décisions. Il dirige le gouvernement et l'administration de la province, la représente, convoque et préside les sessions plénières et celles de la commission d'administration. Il assure la gestion des services relevant directement de la communauté autonome et dont la gestion ordinaire est confiée par cette dernière à la province. Il engage les dépenses, dans les limites de sa compétence, ordonne les paiements et rend des comptes. Il peut entreprendre des poursuites judiciaires et administratives ayant caractère d'urgence. Il peut passer des contrats en matière de travaux et de services dans la mesure où leur montant ne dépasse pas 5 % des ressources ordinaires du budget, ni 50 % du plafond général applicable aux contrats conclus directement. Il ordonne la publication et l'exécution des décisions du conseil provincial et veille à leur mise en œuvre. À côté de ce régime de droit commun, il convient de distinguer des régimes particuliers : le régime « foral », le régime des communautés autonomes qui ne sont constituées que d'une seule province et le régime insulaire. Ainsi, dans le cas du Pays basque, il existe des territoires historiques, dont les limites territoriales coïncident avec celles de provinces, mais qui sont dotés d'attributions différentes. Trois « provinces » disposent ainsi d'un statut spécial en vertu de l'article 39 de la loi lrbrl précitée : la Biscaye, la Guipúzcoa et l'Alava. Le statut de la communauté autonome du Pays basque de 1979 reprend les règles « forales » historiques de ces trois provinces qu'il considère non pas comme dépendantes de la communauté autonome ou subordonnées à celle-ci, mais comme partie intégrante de son organisation institutionnelle et auxquelles il reconnaît le droit de « conserver ou, si nécessaire, de rétablir et d'actualiser leur organisation et leurs institutions propres d'autogouvernement ». Les organes supérieurs de ces territoires historiques sont les juntes générales et les députations forales présidées et dirigées par le diputado general. Les juntes agissent comme des parlements provinciaux et exercent le pouvoir normatif, approuvent les budgets et les plans et contrôlent l'exécutif. Leurs membres sont dénommés « apoderados » en Biscaye et « procuradores » dans les deux autres territoires. Ils sont élus au suffrage direct à la différence des conseillers provinciaux de droit commun. Les députations « forales » (diputaciones forales) exercent les fonctions exécutives. Les provinces des Asturies, des Baléares, de Cantabrique, de Madrid, de Murcie, de La Rioja et de Navarre se sont transformées en communautés autonomes à part entière. L'entrée en fonction des organes communautaires a entraîné la disparition des conseils provinciaux correspondants. Le rapporteur fait observer que la Navarre dispose d'un régime « foral » particulier. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 141 de la Constitution, dans les archipels, les îles disposent de leur propre administration sous forme de cabildos ou de conseils (consejos). L'île détient tous les pouvoirs administratifs reconnus aux communes et aux provinces par l'article 4 de la loi lrbrl précitée. Les îles Baléares ont ainsi créé trois structures particulières qui réunissent plusieurs communes, trois conseils insulaires (consejo insular) régis par la loi organique du 25 février 1983 : le conseil insulaire de Majorque, le conseil insulaire de Minorque et le conseil insulaire de Ibiza-Formentera. De la même façon, les îles Canaries ont créé deux communautés interinsulaires (mancomunidades) régies par la loi organique du 10 août 1982 : la communauté de Las Palmas qui rassemble les conseils insulaires de Grande Canarie, de Lanzarote, de Fuerteventura et la communauté de Tenerife qui réunit les conseils insulaires de Tenerife, de La Gomera, de La Palma, de El Hierro. Ces deux structures sont de simples organes de représentation sans compétences particulières. Elles se réunissent respectivement sous la présidence du président de l'assemblée (cabildo) de l'île où se trouve la capitale de la communauté. - Les communes et syndicats de communes La compétence de délimitation du territoire des communes appartient aux communautés autonomes sur le fondement du 2 du paragraphe 1 de l'article 148 de la Constitution. Cette compétence peut s'exercer d'office ou à l'initiative des communes elles-mêmes, avec consultation des communes intéressées et en procédant à l'information publique nécessaire. La législation supplétive nationale régit les cas d'intégration, de fusion et de séparation. Peuvent motiver de telles modifications les cas où les communes ne disposent pas séparément des ressources nécessaires pour assurer les services minimums obligatoires, les cas où leurs noyaux urbains se confondent et les cas où il existe des raisons notoires liées à un avantage économique ou administratif. Sur le modèle de l'organisation provinciale, sauf dans le cas des communes qui fonctionnent en régime de « conseil ouvert » (concejos abierto) (282), le conseil municipal (corporación municipal), organe délibérant de la commune, est composé d'un conseil plénier qui rassemble le maire (alcade) et les conseillers (concejales), dont le nombre varie en fonction de la population, et d'une commission d'administration, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, qui réunit le maire et un nombre de conseillers ne dépassant pas le tiers du total. Dans les communes de 100 à 250 habitants, les conseillers sont élus sur des listes ouvertes dans une circonscription électorale correspondant à la circonscription municipale. Dans les communes de plus de 250 habitants, ils sont élus sur des listes bloquées dans une circonscription électorale correspondant à la circonscription municipale, avec attribution de sièges vacants en fonction des coefficients successifs des suffrages obtenus par rapport aux sièges vacants. Les membres des commissions d'administration sont librement désignés par le maire parmi les conseillers. Le conseil municipal plénier contrôle et supervise l'action des organes de gouvernement, prend les décisions relatives à la participation à des organisations supramunicipales, peut entreprendre la modification de la circonscription municipale, créer ou supprimer des sections de commune et des échelons de moindre importance, créer des organes déconcentrés. Il décide de la modification du chef-lieu et du changement de nom et décide de l'adoption du drapeau, de l'enseigne ou du blason de la commune. Il approuve les plans et autres instruments d'aménagement et de gestion prévus par la législation en matière d'urbanisme, le règlement organique et les ordonnances municipales. Il assure la détermination des ressources fiscales de la commune, l'approbation et la modification des budgets, l'engagement des dépenses dans les affaires relevant de sa compétence et l'approbation des comptes, ainsi que des modalités de gestion des services et des dossiers de municipalisation. Il accepte la délégation de compétences effectuée par d'autres administrations publiques. Enfin, il peut dénoncer des conflits de compétences avec d'autres collectivités locales et administrations publiques et prend l'essentiel des décisions dans le recrutement des fonctionnaires municipaux et la gestion des biens de la commune. Le maire, assisté par les adjoints au maire et la commission d'administration (comisión de gobierno), représente l'organe exécutif de la commune. Dans les communes de moins de 100 habitants, il est élu au suffrage direct majoritaire, dans le cadre de la circonscription municipale. Dans les communes qui possèdent entre 100 et 250 habitants, le maire est élu par et parmi les conseillers, à la majorité absolue et, à défaut, avec le plus grand nombre de suffrages obtenus. Dans les communes de plus de 250 habitants, il est élu par les conseillers parmi les têtes de listes, à la majorité absolue et, à défaut, avec le plus grand nombre de votes obtenus. Comme le président du conseil provincial, le maire peut être démis de ses fonctions par une motion de censure constructive. Le maire peut présenter une question de confiance devant le conseil municipal sur un certain nombre de thèmes : budget annuel, règlement interne, ordonnances budgétaires ou approbation de l'emploi des instruments de planification générale du territoire municipal. Trois limites s'imposent à la question de confiance. En premier lieu, l'affaire qu'elle aborde doit avoir déjà été débattue en conseil municipal sans obtenir un vote favorable. En deuxième lieu, le maire ne peut présenter qu'une question de confiance chaque année et pas plus de deux au cours de son mandat. Enfin, il ne peut en présenter pendant la dernière année du mandat du conseil. Si la question est approuvée, l'acte en cause est automatiquement approuvé et le maire est confirmé dans sa charge. Dans le cas contraire, l'acte est repoussé et le maire doit démissionner. La commission d'administration municipale et le maire exercent les mêmes attributions que la commission d'administration provinciale et le président du conseil provincial : direction de l'administration municipale, représentation de la commune, engagement des dépenses dans une certaine mesure, prise d'arrêtés, etc. Le maire dirige les travaux du conseil municipal. Ses pouvoirs, sur ce plan, ont été renforcés par la loi 11/1999. Il est le chef de la police municipale et nomme et sanctionne les fonctionnaires portant des armes. Il peut, comme le président du conseil provincial, entreprendre des poursuites judiciaires et administratives en cas d'urgence. Il peut, en outre, adopter à titre personnel et sous sa responsabilité, en cas de catastrophe ou de désastres publics ou de risque grave, les mesures nécessaires et appropriées en rendant immédiatement compte au conseil plénier et accorder des permis dans les cas prévus par les ordonnances. Une consultation populaire peut être demandée par les habitants et consentie par les maires, avec l'accord de la majorité absolue du conseil municipal plénier et l'autorisation préalable du gouvernement de la nation, pour les affaires de caractère local relevant de la commune proprement dite et qui revêtent une importance particulière pour les intérêts des habitants, exception faite des questions relatives aux finances locales. Ainsi une loi sur l'organisation communale régit les modalités des consultations locales. Les référendums communaux ont souvent une valeur consultative comme en France. Dans le cas de déconcentration territoriale sous forme d'arrondissements ou de districts, il peut être permis aux représentants des associations d'habitants de participer au conseil d'arrondissement, indépendamment du fait qu'il peut être décidé de créer des conseils sectoriels pour canaliser la participation des citoyens et de leurs associations aux affaires municipales. b) Les structures spécifiques supracommunales Les syndicats de communes (mancomunidades de municipios) sont formés par une association volontaire de communes visant à l'exécution en commun de travaux et de services donnés relevant de la compétence des communes concernées. Il s'agit de collectivités locales non territoriales, de caractère institutionnel, dotées de la personnalité et de la capacité juridiques nécessaires pour mener à bien les objectifs spécifiques qui leur sont fixés. Ils n'exercent jamais la totalité des objectifs municipaux. Ils sont régis par leurs statuts, approuvés par les communes concernées, conformément à la procédure arrêtée par les communautés autonomes. Ces statuts doivent définir le ressort territorial de la collectivité, son objet et ses compétences, ses organes de gouvernement et ses ressources économiques, sa durée prévue d'existence et toute autre matière nécessaire à son fonctionnement. Les organes de gouvernement et les administrations du syndicat des communes sont établis librement dans les statuts sans autre règle imposée que celle de la représentation obligatoire au sein de ces organes de toutes les communes syndiquées, dans les conditions et la proportion établies. En règle générale, il est prévu une assemblée, composée de représentants de toutes les communes syndiquées ainsi que d'un président, élu par ladite assemblée. Le syndicat des communes étant un organisme local, lui sont applicables non seulement ses statuts mais à titre supplétif le règlement étatique et autonomique sur le régime local. Il existe aujourd'hui plus 1 000 syndicats de communes. À côté des mancomunidades, il existe, dans certaines communautés autonomes un type particulier de regroupements intercommunaux appelés comarcas et qui sont chargés de la gestion de services. Les communautés autonomes, conformément aux dispositions de leurs statuts respectifs, peuvent créer sur leur territoire des « comarcas » (collectivités supramunicipales) ou d'autres entités qui regroupent diverses communes dont les caractéristiques impliquent des intérêts communs requérant une gestion à part ou réclamant la fourniture des services couvrant la zone en question. La création d'une comarca peut se faire à l'initiative des communes concernées dans la mesure où les deux cinquièmes d'entre elles ne s'y opposent pas et que ces deux cinquièmes représentent la moitié de la population recensée, à l'exception de la Catalogne où cette initiative peut s'imposer d'une manière générale. Les lois des communautés autonomes fixent la circonscription territoriale des comarcas, la composition et le fonctionnement de leurs organes de gouvernement, qui doivent être représentatifs des communes qu'elles regroupent ainsi que les compétences, les pouvoirs et les ressources économiques qui leur sont attribués. Des lois sur les comarcas ont été ainsi établies par les communautés de Catalogne, Aragon, des Asturies et de Castille-Leon, qui reconnaissent aux comarcas le statut de collectivités locales territoriales relevant de communautés autonomes. Dans les Asturies, il existe, en plus, des concejos (conseils). Il existe aujourd'hui 81 comarcas. Les zones métropolitaines (áreas metropolitanas) peuvent être créées et supprimées, au moyen d'une loi, par les communautés autonomes, après consultation de l'administration de l'État ainsi que des communes et des provinces concernées. La Catalogne a ainsi créé en 1987, autour de Barcelone, un organisme métropolitain de transport chargé des services de transport public de passagers ainsi qu'un organisme métropolitain de services hydrauliques et de traitement des résidus chargés de services d'alimentation en eau et de traitement et évacuation des eaux ainsi que du traitement et de l'élimination des résidus. Sur le même modèle ont été créées, en 1986, dans la communauté valencienne, deux zones métropolitaines qui regroupent 44 communes. Par ailleurs, la Constitution, dans son article 141, établit que des groupements de communes différents de ceux de la province peuvent être créés. Elle établit, dans son article 152, qu'au moyen du groupement de communes limitrophes, les statuts pourront établir des circonscriptions territoriales particulières jouissant d'une personnalité juridique totale. Divers statuts ont ainsi prévu l'existence de certains regroupements territoriaux différents de ceux de la province et de la commune ou dotés de certaines particularités. Ces particularités ont été reprises dans leur statut d'autonomie et ont été développées dans le cadre d'une législation autonomique. Conformément à la cinquième disposition transitoire de la Constitution, les villes de Ceuta et Melilla peuvent devenir des communautés autonomes si leurs mairies respectives le décident. Il faut pour cela qu'un accord soit pris par la majorité absolue de leurs membres, outre l'accord de la Chambre des députés. Néanmoins, le législateur a préféré concéder à ces deux villes un statut d'autonomie par la voie de l'article 144 de la Constitution, qui permet à la Chambre des députés, à travers une loi organique, d'autoriser ou d'accorder un statut d'autonomie pour des territoires qui ne sont pas intégrés dans l'organisation provinciale, ceci pour des raisons d'intérêt général. Ainsi chacune des deux villes jouit d'un statut d'autonomie particulier, qui a été approuvé par deux lois organiques du 13 mars 1995, qui fixent un régime organique spécial (assemblée, président et conseil du gouvernement), leurs compétences et leur régime économique et financier. Ce sont bien des communes, mais leur organisation et leurs compétences se rapprochent de celles d'une communauté autonome. Enfin, il y a lieu de souligner le régime spécial accordé par une loi de 1990 de la communauté autonome de Catalogne à la Vallée d'Aran. Dans le cas de Madrid, la possibilité est prévue d'instaurer un régime spécial de la ville de Madrid en sa qualité de capitale de l'État. c) Les structures spécifiques infracommunales Les lois des communautés autonomes régissent le fonctionnement des collectivités locales dont la circonscription territoriale est inférieure au territoire de la commune, en vue de l'administration décentralisée de noyaux de populations séparées, portant les dénominations traditionnelles de caseríos (hameaux), parroquias (paroisses), aldeas (bourgades), ou encore barrios, anteiglesias, consejos, pedanías, ou lugares anejos, etc. Leur création relève indistinctement de l'initiative de la population concernée ou de celle de la commune compétente qui, de toute façon, doit être consultée sur le fondement de l'article 45 de la loi lrbrl. 3. Les compétences des collectivités locales Conformément au principe d'autonomie posé par l'article 137 de la Constitution, la répartition des pouvoirs ne se fait pas de manière verticale, comme c'était le cas avant 1978, mais horizontalement. Comme on l'a vu, la répartition des compétences est édictée dans la Constitution de 1978, au bénéfice de l'État (article 149), des communautés autonomes (articles 137 et 148), de la province et de la commune (articles 137, 140, 141 et 152). Elle prévoit également un système de transferts et de délégations (article 150). Le principe de la répartition des compétences relève de celui du « plus grand intérêt national, régional ou local » correspondant à chacune des administrations publiques et qui donne naissance à des compétences « propres et attribuées », et de nature « exclusive ou partagée ». S'agissant de l'administration locale, la mise en œuvre des principes constitutionnels est prévue par la loi lrbrl précitée qui reconnaît des compétences propres ou attribuées par délégation. Les compétences propres peuvent seulement être fixées par la loi, sont exercées en régime d'autonomie et sous la responsabilité de ces collectivités, étant entendu que leur programmation et leur exécution doivent toujours se faire en accord avec les autres administrations publiques. Les compétences attribuées sont exercées selon les termes de la délégation qui peut prévoir des mécanismes de direction et de contrôle d'opportunité qui, de toute façon, doivent respecter le pouvoir d'auto-organisation des services de la collectivité locale. Pour assurer l'autonomie garantie par la Constitution aux collectivités locales, la législation de l'État, prise sur le fondement du 18 du paragraphe 1 de l'article 149 (283), et des communautés autonomes, qui réglemente les différents secteurs d'intervention publique, selon la répartition constitutionnelle des compétences, doit assurer aux communes, aux provinces et aux îles le droit qui est le leur d'intervenir dans toutes les affaires qui affectent directement la sphère de leurs intérêts, en leur attribuant les compétences pertinentes en fonction de caractéristiques de l'activité publique dont il s'agit et de la capacité de gestion de l'organisme local, conformément aux principes de décentralisation et de rapprochement maximum de la gestion administrative par rapport aux citoyens. Les lois fondamentales de l'État prévues par la Constitution doivent déterminer les compétences qu'elles-mêmes attribuent ou qui, de toute façon, doivent revenir aux organismes locaux dans les domaines qu'ils réglementent. Les organismes locaux autonomes ne poursuivent pas de buts généraux mais bien spécifiques et concrets, même s'ils le font sur un territoire déterminé. Ces buts sont fixés dans leurs lois constitutives ou dans leurs statuts. b) Les matières réservées à l'État La Constitution réserve à l'État dans le 1 de son article 149 un certain nombre de compétences. Il assume, dans ces domaines, le pouvoir législatif, le pouvoir de mettre en œuvre les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir réglementaire et le pouvoir de coordination ou d'ordonnancement. Les matières concernées sont les suivantes : réglementation des conditions fondamentales qui garantissent l'égalité de tous les Espagnols dans l'exercice de leurs droits et dans l'accomplissement des devoirs constitutionnels, nationalité, immigration, émigration, extranéité et droit d'asile, relations internationales, défense, administration de la justice, législation commerciale, pénale, pénitentiaire, propriété intellectuelle et industrielle, commerce extérieur, système monétaire, législation des poids et mesures et détermination de l'heure officielle, bases et coordination de la planification économique, finances de l'État, développement de la recherche, santé, régime juridique des administrations publiques et régime statutaire des fonctionnaires, législation fondamentale sur les contrats administratifs, marine marchande, ports et aéroports importants, chemins de fer et travaux publics interrégionaux, régime des communications, postes et télécommunications, protection du patrimoine culturel, réglementation des titres universitaires et professionnels, convocation des consultations populaires par voie de référendum. Certaines matières sont exercées par l'État sans préjudice des compétences des communautés autonomes. C'est le cas de la législation procédurale, de la Enfin, l'État exerce les compétences qui peuvent être attribuées aux communautés mais qui ne sont pas prises en compte par leurs statuts respectifs. Il supplée, dans tous les cas, le droit des communautés autonomes. Par ailleurs, le rapporteur relève que, selon l'article 131 de la Constitution, il appartient à l'État de planifier l'activité économique générale. Le gouvernement élabore les projets de planification économique conformément aux données prévisionnelles que lui fournissent les communautés autonomes. Mais le 1 de l'article 149, dans son alinéa 13) attribue à l'État la compétence de base et de coordination de la planification générale de l'activité économique, ce qui permet aux communautés autonomes qui ont assumé cette compétence de développer cette législation. Les communautés espagnoles comme les régions françaises et italiennes connaissent une tendance à l'accroissement de leur autonomie. La Constitution réserve plusieurs types de compétences aux communautés autonomes. Le premier type, défini, par l'article 147 de la Constitution, concerne l'attribution de la compétence de leurs compétences inscrite dans leurs statuts. Les communautés sont compétentes pour définir leur propre organisation dans les statuts qui doivent impérativement contenir le nom de la communauté qui correspond le mieux à son identité historique, la délimitation de son territoire, la dénomination, l'organisation et le siège des institutions autonomes mais, surtout, les compétences assumées dans le cadre établi par la Constitution et les bases pour le transfert des services correspondants à ces compétences. La deuxième catégorie de compétences, définies par le 1 de l'article 148 de la Constitution et visées par le 3 de l'article 149, concerne celles dont les communautés peuvent se saisir si elles le souhaitent. Ces compétences, une fois inscrites dans les statuts d'autonomie, reviennent à toutes les communautés autonomes sans distinction : elles peuvent l'être immédiatement dans le cadre de la « procédure rapide » (article 151) ou, dans le cadre de la « procédure lente », après un délai de cinq ans (2 de l'article 148). La Constitution part du principe que toutes les communautés autonomes peuvent assumer à titre exclusif toutes les compétences visées à l'article 148, si leur statut le prévoit. À défaut, c'est l'État qui les assume. Ces compétences sont l'organisation des institutions communautaires, la modification des circonscriptions municipales faisant partie de leur territoire et, d'une manière générale, les fonctions qui incombent à l'administration de l'État sur les organismes locaux et dont le transfert est autorisé par la législation sur le régime local. Il s'agit également de fonctions liées aux infrastructures : aménagement du territoire, urbanisme (284), logement, travaux publics présentant un intérêt pour la communauté autonome sur son propre territoire, réseau ferroviaire et routier dont l'itinéraire s'étend intégralement sur le territoire de la communauté autonome et, dans les mêmes limites, transport effectué par ces moyens ou par câble, ports de refuge, ports de plaisance et aérodromes et, d'une manière générale, ceux qui n'impliquent pas d'activités commerciales. Les communautés autonomes exercent aussi d'importantes compétences en matière économique : agriculture et élevage, forêts et exploitations forestières, gestion en matière de protection de l'environnement, projets, construction et exploitation des installations hydrauliques, des canaux et des systèmes d'irrigation présentant un intérêt pour la communauté autonome, eaux minérales et thermales, pêche en eaux intérieures, pêche de fruits de mer et aquaculture, chasse et pêche en rivière, foires intérieures, encouragement du développement économique de la communauté autonome dans le cadre des objectifs fixés par la politique économique nationale, artisanat. Ces compétences portent enfin sur des matières culturelles et sociales : musées, bibliothèques et conservatoires de musique et patrimoine architectural présentant un intérêt pour la communauté autonome, promotion de la culture, de la recherche, et, le cas échéant, de l'enseignement de la langue de la communauté autonome, promotion et aménagement du tourisme dans le cadre territorial, du sport et de l'utilisation adéquate des loisirs, assistance sociale, santé et hygiène, surveillance et protection de leurs bâtiments et installations. La coordination et les autres compétences en ce qui concerne les polices locales dans les conditions sont établies par une loi organique. Les communautés exercent ainsi, comme leurs homologues italiennes, des compétences spécifiques en matière d'éducation et de santé. Le troisième type de compétences susceptibles d'être exercées par les communautés autonomes est défini par l'article 150 de la Constitution. Il s'agit des compétences entrant dans le champ de compétences de l'État (article 149) que celui-ci décide d'accorder ou de déléguer aux communautés. Cette décision peut prendre deux formes. Selon le 1 de l'article 150, le Parlement peut, dans les matières relevant de la compétence de l'État, attribuer aux communautés autonomes la faculté de définir, en ce qui les concerne, des normes législatives dans le cadre des principes, des bases et des directives fixés par une loi étatique. Cette loi-cadre arrête, sans préjudice de la compétence des tribunaux, les modalités de contrôle qu'exerce le Parlement sur ces normes. Selon le 2 de l'article 150, l'État peut transférer ou déléguer aux communautés autonomes, par une loi organique, des facultés lui appartenant qui, par leur nature même, sont susceptibles d'être transférées ou déléguées. La loi prévoit, dans chaque cas, le transfert correspondant de moyens financiers, ainsi que les formes de contrôle que l'État se réserve. La loi sur le processus autonomique 12/1983 du 14 octobre 1983, dispose, dans son article 2, que les communautés autonomes peuvent solliciter de l'État l'information nécessaire à l'exercice adéquat de leurs compétences. La loi organique sur Tribunal constitutionnel (article 28) et la Constitution (article 162) accordent le droit à la communauté autonome d'interjeter appel pour inconstitutionnalité contre les lois de l'État qui restreignent son autonomie. La loi organique sur le Tribunal constitutionnel habilite les hauts responsables des communautés autonomes à saisir ce tribunal d'un conflit de compétences lorsqu'ils estiment que l'État, par certaines résolutions ou dispositions, restreint l'autonomie de la communauté concernée. Dans la pratique, un premier indicateur des compétences des communautés autonomes réside dans le contenu des lois qu'une communauté a approuvé depuis sa constitution. Par exemple, le Parlement d'Andalousie, dans lequel le rapporteur s'est rendu, a adopté plus de 140 lois au cours de la seule période 1982-1999, les lois à caractère institutionnel, budgétaire et financier représentent plus de 50 % du total. Un deuxième indicateur des compétences des communautés peut être recherché dans la répartition de leurs dépenses : plus de 35 % de leurs dépenses sont ainsi consacrées à la santé, environ 30 % à la culture et à l'éducation et environ 10 % aux travaux publics, à l'urbanisme et aux transports. Le champ de compétences des provinces est difficile à déterminer en raison même de leur histoire. En effet, la Constitution de Cadix de 1812 en avait fait aussi un niveau d'organisation des services de l'État et avait organisé un contrôle des communes par le gouverneur civil placé à la tête de ces services. La création des communautés autonomes a conduit les provinces à assurer la responsabilité des tâches que les communes ne parviennent pas à assumer et à se trouver en situation d'intermédiaire entre les communes et les autres administrations de niveau territorial supérieur. Les compétences propres des provinces sont définies par des lois de l'État et des communautés autonomes. La province, en règle générale, a pour compétence de promouvoir et d'administrer les intérêts particuliers de la province et a pour objectifs propres et spécifiques de garantir les principes de solidarité et d'équilibre intercommunal, dans le cadre de la politique économique et sociale. Dans tous les cas, les provinces assurent la coordination des services municipaux entre eux de manière à garantir la fourniture intégrale et appropriée des services minimums obligatoires, mais aussi l'assistance et la coopération juridique, économique et technique assurée aux communes, notamment à celles dotées d'une moindre capacité économique et de gestion. Elles assurent, enfin, la fourniture de services publics s'étendant à plusieurs communes et, le cas échéant, à plusieurs comarcas. Assurément, les départements français détiennent des responsabilités plus importantes que les provinces espagnoles. Sur le fondement de la loi lrbrl précitée et de la décision du Tribunal constitutionnel en date du 27 mars 1985, les provinces disposent d'un pouvoir réglementaire en ce qui concerne leur fonctionnement interne. Ainsi, l'administration peut prendre librement des normes qui se traduisent par la production de règlement d'organisation ou praeter legem sans qu'il soit besoin d'une habilitation préalable ou d'une couverture légale distincte de celle par laquelle lui a été attribué le pouvoir réglementaire. Les conseils provinciaux peuvent ainsi approuver des ordonnances et des règlements. Le terme d'ordonnance est réservé aux dispositions de caractère général prises par les collectivités locales dans l'exercice de leur pouvoir de police. Les règlements sont réservés aux activités de service public et d'organisation (règlement des différents services, dispositions réglementaires relatives aux fonctionnaires). Ces mesures réglementaires sont soumises à une procédure spécifique qui impose une approbation initiale par le conseil, une information publique et une audition des intéressés pendant un délai minimal de trente jours pour la présentation de réclamations et de suggestions, une réponse à ces réclamations et suggestions, et, enfin, une approbation définitive par le conseil. Ordonnances et règlements sont publiés dans le Bulletin officiel de la province. Les administrations provinciales doivent, dans les conditions prévues dans les statuts d'autonomie, assurer la gestion courante des services propres des communautés autonomes. Les provinces peuvent, en outre, se voir déléguer un certain nombre de compétences, dans les mêmes termes que les communes. Le projet de loi sur le gouvernement et l'administration locale, issu du livre blanc publié en juin 2005, a pour objectif de clarifier les compétences des provinces et des conseils insulaires. Ainsi, ils seront spécifiquement chargés de coordonner les services municipaux, de leur fournir une assistance juridique, économique et technique. Ils pourront déconcentrer leur organisation administrative dans le territoire provincial pour rapprocher leurs services des communes qui disposent de faibles ressources techniques et économiques, à l'image de ce que pratique déjà, par exemple, la province de Séville. e) Les communes et les syndicats de communes Les compétences des communes sont définies par l'article 25 de la loi lrbrl. La commune, aux fins de la gestion de ses intérêts et dans le cadre de ses compétences, peut encourager toute sorte d'activités et fournir tous les services publics qui contribuent à répondre aux besoins et aux aspirations de la collectivité. Elle est plus particulièrement chargée de la sécurité dans les lieux publics, de l'ordonnancement du trafic et des personnes sur les voies publiques, de la protection civile, de la prévention et de l'extinction des incendies. À ce titre et depuis la loi 10/1999, les ordonnances municipales peuvent définir les types d'infraction susceptibles d'être sanctionnés par le maire. La commune assure des fonctions d'aménagement, de gestion, d'exécution en matière d'urbanisme, de promotion et de gestion du logement, des parcs et des jardins, de revêtement des voies publiques urbaines et de conservation des chemins et voies rurales. Elle doit entretenir le patrimoine historique et artistique, garantir la protection de l'environnement, s'occuper des halles, abattoirs, foires, marchés et de la défense des usagers et des consommateurs. Son domaine de compétence s'étend également à la protection de la salubrité publique, à la participation à la gestion des services de premiers soins et de santé, aux cimetières et services funéraires, à la fourniture des services sociaux et à la promotion et réinsertion sociale, ainsi qu'à l'approvisionnement en eau, à l'éclairage public, aux services de nettoyage de la voirie, de ramassage et de traitement des eaux résiduelles. En complément, elle est chargée du transport public de passagers, des activités ou installations culturelles ou sportives, de l'occupation du temps libre et du tourisme. Enfin, elle participe à la programmation de l'enseignement et à la création, la construction et à l'entretien des centres d'enseignement public. Elle intervient dans les organes de gestion de ces centres et participe à la supervision de la scolarité obligatoire. Parmi ces compétences, certaines doivent être obligatoirement assurées par la commune, individuellement ou en associations. Dans toutes les communes, font partie des compétences obligatoires l'éclairage public, les cimetières, le ramassage des résidus, le nettoyage de la voirie, l'approvisionnement des domiciles en eau potable, le système d'égouts, l'accès aux agglomérations, le revêtement des voies publiques et le contrôle des aliments et des boissons. S'y ajoutent dans les communes de plus de 5 000 habitants, la gestion des parcs publics, des bibliothèques publiques, des marchés et du traitement des résidus. Dans les communes de plus de 20 000 habitants, les compétences obligatoires s'étendent à la protection civile, à la fourniture des services sociaux, à la prévention et à l'extinction des incendies, aux installations sportives à usage public et aux abattoirs. Enfin, dans les communes de plus de 50 000 habitants, s'y ajoutent le transport collectif et urbain des passagers et la protection de l'environnement. La difficulté à fournir ces services minimums, reconnue par le législateur, peut être surmontée par le biais de deux mécanismes : le premier permet aux communautés autonomes de dispenser les communes de cette obligation ; le second impose que l'aide des conseils provinciaux aux communes est orientée de préférence vers la fourniture de ces services minimums. Dans la législation en vigueur, celle des communautés autonomes et, à titre supplétif, celle de l'État, même si l'urbanisme relève exclusivement de la compétence des premières, il est expressément prévu une consultation des collectivités locales au cours du processus d'approbation des instruments d'aménagement du territoire lesquels, une fois approuvés, ont une valeur contraignante pour les plans généraux d'aménagement urbain des communes. En outre, il est possible de déléguer aux communes des compétences de l'État et des communautés autonomes, dans des matières qui affectent leurs intérêts particuliers, dans la mesure où l'on améliore ainsi l'efficacité de la gestion publique et où l'on obtient une plus grande participation des citoyens. L'acte ou l'accord de délégation doit déterminer la portée, le contenu, les conditions et la durée de celle-ci ainsi que le contrôle que se réserve l'administration qui délègue et les moyens en personnel, matériels et crédits qui sont transférés. L'administration qui délègue peut diriger et contrôler l'exercice des services délégués, émettre des instructions techniques de caractère général et obtenir à tout moment des informations sur la gestion municipale. Elle peut aussi envoyer des commissaires (comisionados) et adresser des mises en demeure pour obtenir la correction des difficultés constatées. Sur le même fondement que celui applicable aux provinces et sur la base de l'article 137 de la Constitution qui disposent que les collectivités locales « jouissent d'une autonomie pour la gestion de leurs intérêts respectifs », les communes disposent du pouvoir réglementaire, qu'elles exercent également sous formes d'ordonnances et de règlement, tandis que le maire peut prendre des arrêtés (285). Enfin, traditionnellement, les communes ont exercé des fonctions étatiques en matière de recrutement pour le service militaire. Elles doivent également maintenir le régime de délégation de dépôts de détenus à disposition judiciaire dans les communes qui sont le siège des organes de la circonscription judiciaire et qui ne disposent pas d'un établissement pénitentiaire. Elles réalisent des fonctions de secrétariat des tribunaux de paix dans les communes de moins de 7 000 habitants. Les syndicats de communes assurent un certain nombre de services minimums obligatoires, tels que le ramassage et traitement des résidus solides, l'approvisionnement en eau des domiciles, les services sociaux, la prévention et l'extinction des incendies, la gestion des abattoirs, l'entretien de l'éclairage public et des égouts, la protection de l'environnement, le transport collectif urbain, le nettoyage de la voirie, la protection civile, la gestion des installations sportives et le revêtement des chaussées publiques, ainsi que les cimetières, les marchés, l'accès aux agglomérations, le contrôle alimentaire et l'entretien des parcs publics. Au-delà de ces services obligatoires, certains syndicats s'occupent d'éducation et de culture, de tourisme, d'urbanisme, de santé, voire de perception des impôts locaux et d'aide industrielle. Dans le cadre de la politique économique de l'État de soutien aux investissements de travaux et de services des collectivités locales, est prévu un traitement plus favorable des propositions formulées par les syndicats de communes, par rapport à celles formulées par les communes aux fins d'inclusion dans le plan provincial de travaux et de services. Cette mesure constitue une mesure incitative forte à la constitution de syndicats. Le projet de loi sur le gouvernement et l'administration locale, présenté cette année au Parlement, reconnaîtra aux communes une clause de compétence générale. Ainsi, chaque commune, disposera d'une liberté pleine pour exercer son initiative, à condition que la compétence en cause ne soit pas réservée à une autre administration et qu'elle ne soit pas expressément interdite par la loi. En outre, sera définie une liste de matières dans lesquelles les communes exerceront à titre principal leurs compétences et fourniront les services de base, ce qui implique la refonte des articles de la loi 7/1985 du 2 avril 1985. La liste présentée a été approuvée à l'unanimité par le comité exécutif de la Fédération espagnole des communes et provinces. Une seconde liste de compétences sera fixée pour définir les matières dans lesquelles l'État et les communautés autonomes devront garantir l'intervention des communes grâce à l'attribution de pouvoirs de programmation, de réglementation et de gestion. f) Les rapports entre collectivités locales En application de la loi organique 7/1999 précitée, les collectivités locales peuvent saisir le Tribunal constitutionnel lorsqu'elles estiment qu'une loi méconnaît un de leurs droits protégés par la Constitution. Peuvent ainsi faire l'objet d'un recours les normes de l'État ou des communautés autonomes ayant rang de loi qui portent atteinte à l'autonomie locale. Le droit de recours est ouvert à la commune ou la province qui serait l'unique destinataire de la loi considérée, à un nombre de communes équivalant à au moins un septième des communes existant sur le territoire d'application de la disposition considérée et représentant au moins un sixième de la population dudit territoire ou encore à un nombre de provinces équivalant à au moins la moitié des communes existant sur le territoire considéré et représentant au moins la moitié de la population de celui-ci. La décision du Tribunal constitutionnel s'impose à tous les organismes publics. La loi 7/1985 du 2 avril 1985 dite « lrbrl » précitée dispose que « les collectivités locales peuvent constituer des associations, de portée étatique ou autonomique, en vue de la protection de la promotion de leurs intérêts communs, auxquelles est appliquée, à défaut de règle spécifique, la législation de l'État en matière d'associations. Les associations de collectivités locales sont régies par leurs statuts, approuvés par les représentants des organismes associés, lesquels doivent garantir la participation de leurs membres aux tâches associatives ainsi que la représentativité de leurs organes de gouvernement. » Sur ce fondement, outre les syndicats de communes, l'Espagne pratique trois grands types de structures de coopération : les regroupements pour le financement d'un secrétariat et d'un contrôle communs, les consortiums (consorcios) et les associations nationales de collectivités locales. Des regroupements pour le financement d'un secrétariat et d'un contrôle communs peuvent se faire à titre volontaire, à la demande des communes concernées, ou obligatoire, à l'initiative des communautés autonomes. Ils sont régis par le règlement de la communauté autonome. Ils ont le caractère de collectivités locales institutionnelles régies par leurs statuts. Les consortiums sont des associations volontaires des collectivités locales de niveau différent avec d'autres administrations publiques de nature différente, ou avec des organismes privés sans but lucratif. Ils poursuivent des objectifs d'intérêt public complémentaires de ceux des administrations publiques et pourraient être comparés à des gip. Certaines associations de collectivités locales ont une dimension nationale ou autonomique. Elles visent à la protection et à la promotion de leurs intérêts communs. Il s'agit principalement de la Fédération espagnole de communes et provinces (femp), de la Fédération des communes de Catalogne (Federación de Municipios de Cataluña), de la Fédération aragonaise de communes (Federación Aragonesa de Municipios) ou encore, par exemple, de la Fédération galicienne de communes (Federación Gallega de Municipios). Au-delà de ces structures, il existe en Espagne, comme en Italie, une rivalité naissante entre pouvoirs régionaux et pouvoirs locaux, notamment avec les grandes villes. Certes les communes peuvent saisir le Tribunal constitutionnel. Certes les négociations entre association de collectivités locales et pouvoir régional sur des transferts de compétences sont encouragées. Mais la rivalité est telle qu'elle a pu conduire à la suppression des deux zones métropolitaines qui avaient été créées à Barcelone et à Valence. 4. Le financement des collectivités locales La Constitution, dans ses articles 140 et 142, fixe les principes de l'autonomie et de l'autosuffisance financière des collectivités territoriales. Cette dernière est assurée par des impôts propres et une part des impôts de l'État. De plus, le principe de légalité impose que tout nouvel impôt ainsi que les exemptions, bonifications et réductions fiscales doivent être établis par la loi. La loi 39/1988 sur les finances locales précitée définit huit sources de financement : les revenus du patrimoine, les impôts, les parts des impôts d'État, les subventions, les revenus perçus à titre de redevances, le produit des opérations de crédit, celui des amendes et les autres prestations de droit public. Le financement des communautés autonomes est régi par l'article 157 de la Constitution et par la loi organique du 22 décembre 1980 relative au financement des communautés autonomes (Ley Organica de Financiacion de las Comunidades Autonomas ou lofca). La lofca pose le principe d'une égalité de traitement des communautés autonomes dans le domaine financier. La Constitution espagnole reconnaît deux systèmes de financement différents des autonomies. - Le système de droit commun Le premier système est commun à la très grande majorité des communautés autonomes qui sont financées, principalement, par l'intermédiaire de dotations du gouvernement central. Cette règle générale est toutefois adaptée en plusieurs modèles de financement en fonction de critères économiques et politiques. Les communautés autonomes gèrent un tiers des dépenses publiques dans le cadre du processus graduel de décentralisation prévu par la Constitution espagnole. Ce processus graduel a atteint sa phase ultime avec les récents transferts des compétences en matière de santé publique. Cette évolution a également amené les communautés autonomes à peser toujours plus dans la définition et la mise en œuvre de la politique fiscale de l'État. Au titre des ressources des communautés autonomes, la Constitution énumère : les impôts totalement ou partiellement transférés par l'État, les impôts propres, les taxes et contributions spéciales, les transferts du fonds de compensation interterritorial, les ressources du patrimoine, les ressources du secteur privé, le produit des emprunts. Elle reconnaît, en outre, plusieurs principes pour le financement des communautés autonomes qui conditionnent leurs ressources : le principe d'autonomie, le principe de suffisance et le principe de solidarité. Le principe d'autonomie est fixé par l'article 156 en vertu duquel « les communautés autonomes bénéficieront de l'autonomie financière pour le développement et l'exécution de leurs compétences en relation avec les principes de coordination du ministère des finances et de solidarité entre tous les Espagnols ». Par ailleurs, l'article 133 reconnaît aux communautés autonomes la possibilité « d'établir et d'exiger des impôts, en accord avec la Constitution et les lois » avec des limites : les impôts créés ne peuvent frapper des éléments imposables grevés par l'État ; les communautés autonomes peuvent établir et gérer des impôts sur les éléments que la législation locale réserve aux corporations locales ; enfin, si l'État fixe des impôts sur les éléments grevés par les communautés autonomes et que cela entraîne une diminution de leurs ressources, il doit prendre les mesures nécessaires de compensation. Dans les faits, les impôts propres, corollaires du pouvoir normatif des communautés autonomes en la matière, restent limités par le coût politique de la création de nouveaux impôts. Le nombre d'impôts créés par les communautés autonomes est ainsi relativement faible à l'heure actuelle : impôts sur le jeu de Bingo, impôts sur les terres non exploitées, impôts sur les combustibles dérivés du pétrole (Canaries) et les impôts à caractère environnemental. Ils représentent en outre une très faible part des recettes fiscales. L'article 7 de la lofca permet aux communautés autonomes de créer des taxes « pour l'utilisation de son domaine public et pour la prestation de services publics ou la réalisation d'activités du domaine public de sa compétence qui se réfèrent, touchent ou profitent de manière particulière aux usagers passifs » dans certaines circonstances. Le rendement de chaque taxe ne peut dépasser le coût du service. Des contributions spéciales peuvent de surcroît être créées pour « l'obtention par l'usager d'un bénéfice et d'une augmentation de valeur de ses biens comme conséquence de la réalisation de travaux publics ou de l'établissement ou augmentation à son profit de services publics ». Le rendement de ces redevances ne peut pas non plus excéder le coût du bénéfice apporté. L'établissement d'impôts par les communautés autonomes dont les éléments d'imposition relèvent de l'activité économique est soumis à certaines limitations. L'impôt ne doit ni être assis sur des éléments hors du territoire de la communauté autonome concernée ni grever des activités ou des échanges réalisés en dehors du territoire de la communauté autonome, ni limiter la libre circulation des biens et des personnes. Les communautés autonomes peuvent recourir au crédit pour des termes inférieurs à un an pour couvrir des besoins de trésorerie. En revanche, pour des emprunts dont le terme est supérieur à un an, les communautés autonomes sont soumises à certaines limites : les sommes empruntées doivent être exclusivement destinées à des crédits d'investissement ; le montant total des annualités d'amortissement ne doit pas dépasser pas 25 % des recettes courantes de la communauté autonome. Les emprunts ou toute émission de dette ou recours à l'emprunt public à l'étranger sont soumis à une autorisation de l'État. Cette autorisation est justifiée par le respect des critères de convergence européens. La dette publique des communautés autonomes et les titres de valeur à caractère équivalent émis par celles-ci sont soumis aux mêmes conditions que la dette de l'État. L'article 158 de la Constitution garantit un principe de suffisance, c'est-à-dire « un niveau minimum dans la prestation de services fondamentaux sur tout le territoire espagnol ». Ce principe se traduit en matière de ressources pour les communautés autonomes par la participation aux recettes de l'État. Distincte des subventions, il s'agit d'une participation au recouvrement des impôts nationaux qui est reversée aux communautés autonomes en fonction d'un ensemble de critères, incluant, notamment, la population, le potentiel fiscal, le niveau de services sociaux et d'infrastructures. Depuis 1996, le pourcentage de la participation territorialisée de l'impôt sur le revenu, fixé à 15 % puis à 30 %, est venu s'ajouter à la participation aux recettes de l'État. Les impôts transférés constituent la plus importante des ressources des communautés autonomes. Il s'agit principalement de l'impôt sur le revenu dans la limite de 30 % puis de 50 %, de l'impôt sur le patrimoine, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales et les actes juridiques, de l'impôt sur les successions et donations, de l'impôt sur des consommations spécifiques, des taxes sur le jeu. Le principe de solidarité est déterminé par l'article 138 de la Constitution en vertu duquel « l'État garantit la réalisation effective du principe de solidarité (...)veillant à l'établissement d'un équilibre économique adéquat et juste entre les diverses parties du territoire espagnol, en tenant en particulier compte de l'insularité », tandis que, sur le fondement de l'article 158, a été créé un fonds de compensation interterritorial qui vise à corriger les déséquilibres économiques à travers les dépenses d'investissement. En 1980, la lofca a reconnu le rôle de l'État comme garant de l'équilibre économique du territoire espagnol et a confirmé le principe de suffisance de ressources des communautés autonomes pour les compétences transférées. Dans sa version initiale de 1980, elle énumère les ressources d'État susceptibles de cession aux communautés autonomes en excluant l'impôt sur le revenu. Elle détaille également les critères de transferts de ressources financières de l'État vers les communautés autonomes : population, effort fiscal concernant l'impôt sur le revenu, le revenu réel par habitant et d'autres indicateurs du déficit des services sociaux, du manque d'infrastructures et du coût des services. Elle dispose que l'activité financière des communautés autonomes s'exerce en accord avec les principes d'équilibre économique, de solidarité entre les diverses nationalités et régions et de suffisance des ressources, avec en plus l'interdiction des privilèges économiques ou sociaux et de barrières fiscales sur le territoire national. Le fonds de compensation interterritorial est le premier instrument de solidarité qui vise à « corriger les déséquilibres économiques interrégionaux et à rendre effectif le principe de solidarité ». Il est destiné à « des dépenses d'investissement dont les ressources seront distribuées par la Parlement aux communautés autonomes et aux provinces, le cas échéant ». Il est « doté d'un montant qui ne peut être inférieur à 30 % de l'investissement public annuel du projet de loi de finances ». Les critères de distribution sont le niveau de revenu par habitant, le niveau de population émigrée des dix dernières années, le pourcentage de chômeurs par rapport à la population active, la superficie territoriale et l'insularité. L'attribution de la capacité normative aux communautés autonomes dans la part régionale de l'impôt sur le revenu constitue un changement structurel historique dans le système fiscal espagnol et introduit une véritable coresponsabilité fiscale. L'État continue à être le titulaire de l'impôt sur le revenu mais, parallèlement, les communautés autonomes disposent de capacités normatives sur tout ou partie de cet impôt, selon les cas. Cette capacité est transférée par l'État dans les conditions qu'il juge acceptables. Les communautés autonomes peuvent ainsi modifier la part du tarif qui leur revient avec une certaine autonomie, en agissant sur le seuil d'exonération, le barème d'imposition, les déductions et abattements. L'attribution de la capacité normative sur la part régionale de l'impôt sur le revenu n'est pas la seule mesure destinée à élever le niveau de coresponsabilité fiscale dans les communautés autonomes du régime commun. Elles bénéficient également d'une certaine marge de manœuvre en matière d'impôts transférés. Afin d'éviter une « guerre des taux », la capacité normative des finances régionales est limitée à une fourchette de variation de la part régionale de 20 % autour du tarif. Une restriction identique s'applique aux réductions et abattements. Les communautés autonomes peuvent uniquement intervenir dans le domaine des déductions personnelles et familiales, à l'exclusion de celui des activités économiques et celui relatif à la double imposition internationale. Dans cette perspective, la détermination de la résidence fiscale a été rigoureusement définie pour éviter les mouvements artificiels de contribuables vers d'autres communautés autonomes plus favorables en matière d'impôt sur le revenu. Le nouveau cadre financier entré en vigueur en janvier 2002 s'applique à toutes les communautés autonomes, sauf le Pays Basque et la Navarre. La part de reversement de l'impôt sur le revenu est passée de 30 à 33 %, avec une possibilité d'intervention des communautés autonomes sur l'ensemble de cette part. En outre, les communautés autonomes perçoivent 35 % de recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, 40 % des taxes sur les carburants, le tabac et l'alcool et l'intégralité de la taxe sur les immatriculations automobiles et l'électricité. Ces mesures concrétisent la progressive mise en œuvre d'une autonomie financière. Si cette autonomie financière constitue un avantage pour l'ensemble des régions espagnoles, elle laisse toutefois en suspens la question de l'équité entre les communautés autonomes en accentuant les disparités entre les communautés les plus dynamiques économiquement et celles qui pâtissent d'une économie moins florissante. - Le régime foral Le second système concerne les régions du Pays Basque et de la Navarre. Le régime « foral » se décline en effet, au plan financier, dans le concierto económico, forme de pacte historique dont l'origine remonte au Moyen Âge et qui n'avait été supprimé temporairement par Franco que pour la Biscaye et le Guipúzcoa. La communauté de Navarre gère et recouvre la quasi-totalité des impôts de l'État, à l'exception des monopoles fiscaux du tabac et les droits de douane. Dans ce cas, il s'agit d'impôts « concertés », tels que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la valeur ajoutée. En contrepartie, la communauté verse à l'État des sommes globales faisant l'objet d'une actualisation en fonction des données financières du budget général de l'État (« cupo » au Pays Basque, « apport » en Navarre). Les trois provinces basques administrent ces mêmes impôts et versent les sommes globales tant à la communauté qu'à l'État lui-même, au titre de contribution aux charges générales de l'État correspondant aux fonctions qui ne sont assumées ni par la communauté ni par la province concernée. La situation économique du Pays basque est très favorable, mais il ne participe pratiquement pas à la péréquation. Cependant le privilège ainsi accordé a été renouvelé pour quatre ans en 1997, puis de nouveau en 2002. L'Aragon a déjà demandé un mécanisme identique, certains le demandent en Catalogne. L'État accorde aux communautés autonomes des subventions pour frais d'équipement, par le biais d'un fonds de coopération inter-territoriale (fci) et par des accords en matière d'investissement. Certaines subventions sont affectées à des services spécifiques, tels que les transferts dans le domaine de la santé ou le financement de contrats programmes. Certaines communautés autonomes prévoient dans leurs statuts que les subventions accordées par l'État aux organismes locaux transitent par la communauté autonome qui, à son tour, les transfère à la commune ou à la province concernée. b) Les provinces et les communes La Constitution affirme, dans son article 142, que « les entités locales doivent disposer de moyens suffisants pour remplir les missions que la loi attribue à chacune des collectivités ; elles se financent essentiellement avec leurs impôts propres et leurs participations aux impôts de l'État et des communautés autonomes ». Elles ne votent les taux que de leurs impôts propres et non des participations aux impôts de l'État. Les impôts réservés exclusivement aux collectivités locales sont, pour une part, obligatoires (sur les biens immeubles, sur le rendement des activités économiques et sur les véhicules à traction mécanique) et, pour une autre, volontaires (sur les constructions, installations et ouvrages et sur l'accroissement de la valeur des terrains en zone urbaine). Ces impôts sont gérés par les organismes locaux eux-mêmes. Au total, les impôts recouvrés par les organismes locaux représentaient 41 % de leurs recettes en 1997. Contrairement aux communautés autonomes, les collectivités locales ne peuvent imposer de surcharge sur les impôts de l'État. Elles peuvent en revanche, au-delà des deux impôts volontaires déjà mentionnés, créer de nouveaux impôts : taxes pour prestation des services, contributions spéciales pour l'exécution d'ouvrages ou l'extension de services municipaux. Les sommes recouvrées à ces différents titres s'élevaient à 27,7 % des recettes des collectivités locales. Les collectivités locales ont droit à une participation aux impôts recouvrés par l'État, ce qui représentait approximativement 24,5 % de leurs recettes en 1997. Ces impôts étatiques sont l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Une partie des impôts prélevés par les communautés est également reversée aux communes et aux provinces. Les collectivités locales peuvent recevoir des subventions de l'État et des communautés autonomes. Le premier accorde des transferts pour frais de fonctionnement qui représentent 2,5 % des recettes des organismes locaux et pour projets d'investissement. Les secondes accordent des transferts pour des frais de fonctionnement. Certains transferts spécifiques sont destinés à des services particuliers, tels que la sécurité, l'éducation, les services sociaux, l'habitat, l'urbanisme, l'environnement, la culture, le sport et les services économiques. Une seule subvention spécifique est subordonnée à une participation financière. Elle concerne le programme de coopération économique local de l'État dans le cadre duquel celui-ci apporte 25 % des frais d'investissement, les 75 % restant devant être complétés par l'organisme local. Certaines collectivités locales connaissent un régime spécifique de financement. Ainsi, les organismes canariens conservent leur régime particulier de financement conforme au régime économique et fiscal de l'archipel. C'est ainsi que la communauté autonome cède aux îles et ces dernières, à leur tour, aux communes une partie de l'impôt sur l'entrée de marchandises et sur les consommations spécifiques. Les villes de Ceuta et de Melilla bénéficient d'une participation spéciale aux impôts de l'État ainsi que d'une bonification spéciale de 50 % sur les quotes-parts fiscales relevant des impôts municipaux perçus dans les deux villes. Il n'existe pas stricto sensu une péréquation absolue mais la participation aux recettes de l'État remplit en partie cette fonction, étant donné qu'une des variables à prendre en compte (même si ce n'est qu'à concurrence de 10 %) est la richesse ou la pauvreté relative. Ainsi, l'Espagne est un des rares pays avec la France et l'Allemagne à permettre à ses collectivités territoriales de tirer une part substantielle de leurs ressources d'un véritable impôt local. 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État En Espagne, plus que dans les autres pays étudiés par le rapporteur (sauf peut-être en Angleterre), la place de l'État déconcentré reste relativement importante, comme il peut l'être en Allemagne. a) L'administration territoriale de l'État L'administration territoriale actuelle de l'État est héritière de la réforme mise en place, en 1833, grâce à l'élan de Javier de Burgos, ministre du fomento (développement). Est ainsi organisée l'actuelle division de l'Espagne en provinces, sur la base de plusieurs critères, tels que la population ou l'étendue territoriale, mais celui de la tradition historique a été déterminant. Est créé l'organe du subdelegado de fomento, le sudélégué au développement, placé à la tête de chaque province, sur le modèle du préfet français. Mais, à l'image du préfet de la Restauration ou du Second Empire, le subdélégué devient fondamentalement un organe politique. Le décret royal du 28 décembre 1849 crée l'organe du gouverneur civil. Surgissent de nouveaux ministères, ceux-ci créent leurs propres délégués dans les différentes provinces à côté du subdélégué au développement, d'abord, et du gouverneur civil ensuite. Pendant la dictature franquiste, les gouverneurs civils deviennent les chefs provinciaux du parti unique en même temps qu'ils sont les plus hauts responsables du maintien de l'ordre public. Mais, selon un processus classique, on constate l'incapacité du gouverneur à coordonner les services administratifs qui dépendaient de chaque ministère dans les provinces. En 1957, le gouverneur civil est placé à la tête d'une commission de services techniques qui existait auparavant au sein des Diputaciones, mais cette mesure n'a pas été très efficace. La Constitution de 1978, dans son article 141, reconnaît l'existence nécessaire d'une administration périphérique sur le plan provincial « pour l'accomplissement des activités de l'État ». La province constitue une division territoriale générale de l'administration de l'État, et, en tant que telle, est utilisée par cette dernière pour mettre en œuvre certains services de l'administration centrale, tels que le recrutement militaire, la tenue de statistiques, l'organisation des élections générales ou encore la conservation de signaux géodésiques. L'article 154 établit le nouvel organe du délégué du gouvernement chargé de diriger l'administration périphérique de l'État, non plus sur le plan provincial, mais sur le plan de chaque communauté autonome, et de la coordination de l'administration de l'État avec celle de la communauté concernée. Tous les statuts d'autonomie prévoyaient qu'après la constitution des organes de la communauté autonome, on devait créer une commission mixte, comprenant un nombre égal de représentants de l'État et de la communauté autonome La fonction de cette commission mixte consistait à déterminer les biens, services et fonctionnaires que l'État doit transférer à la communauté autonome pour l'exercice de ses compétences. Les accords de la commission mixte ont pris la forme de propositions adressées au gouvernement national qui les a introduits dans l'ordre juridique par le biais d'un décret, appelé « décret de transferts ». Dans les communautés autonomes avec une seule province, le nouveau délégué du gouvernement remplace l'ancien gouverneur civil. En revanche, dans les communautés autonomes intégrées par plusieurs provinces, le délégué du gouvernement coexiste avec les gouverneurs civils de chacune des provinces. La loi 17/83 du 16 novembre 1983 n'avait pas donné au délégué du gouvernement les moyens suffisants pour résoudre les problèmes traditionnels dus au manque de coordination de l'administration périphérique dépendante des ministères sectoriels ni le nouveau problème qui se posait par rapport aux gouverneurs civils, puisqu'il lui manquait une autorité hiérarchique sur eux. En 1995, est engagée une tentative pour adapter l'administration périphérique et placer le délégué du gouvernement au centre de l'administration périphérique de l'État dans les communautés autonomes. Le fait que l'on place le gouverneur civil sous l'autorité du délégué du gouvernement en est un signe évident. Le projet a supprimé les anciennes délégations provinciales de ministères et créé des délégations territoriales du gouvernement. La dissolution des Cortes empêcha la réalisation d'un tel programme. Il a fallu attendre la nouvelle loi 6/97 du 14 avril 1997 d'organisation et de fonctionnement de l'administration générale de l'État (lofage) pour assister à un renforcement des pouvoirs du délégué du gouvernement et au remplacement du gouverneur civil par le subdélégué du gouvernement. Le délégué du gouvernement représente le Gouvernement sur le territoire des communautés autonomes. Il dépend de la présidence du Gouvernement d'un point de vue organique, mais se rattache administrativement au ministère des administrations publiques. Il est l'organe supérieur de l'administration périphérique de l'État sur le territoire de la communauté concernée. Il nomme et coordonne l'action des subdélégués du gouvernement placés dans chaque province. Il est compétent pour suspendre l'exécution des actes dictés par l'administration périphérique de l'État et contestés par un recours administratif. Il est chargé enfin de la coordination de l'administration générale de l'État avec celle de la communauté autonome et les entités locales concernées. Tous les services doivent être intégrés sauf ceux dont le maintien de la dépendance directe des organes centraux affectés est conseillé en raison des particularités de leurs fonctions ou du volume de gestion et au nom de la plus grande efficacité dans leur action. La protection du libre exercice des droits et des libertés et la garantie de la sécurité citoyenne sont assurées par le biais des subdélégués du gouvernement qui dirigent les forces de sécurité de l'État dans la province. L'État peut déléguer la mise en œuvre de certaines de ses politiques aux collectivités locales qui agissent alors en tant qu'administrations déconcentrées. Au-delà de l'adaptation de l'État territorial, se pose la question des modifications de l'État central nécessitées par l'approfondissement des autonomies. En pratique, celui-ci a peu modifié ses structures. En effet, le caractère progressif des autonomies - par exemple, l'enseignement non universitaire a été transféré en Catalogne et au Pays basque en 1980, mais seulement en 1999 dans les Asturies - a empêché les administrations centrales de s'adapter dans toute la mesure souhaitable. b) Le contrôle sur les actes des collectivités locales - Les communautés autonomes Dans le cadre de l'article 150 de la Constitution, le Parlement peut accorder aux communautés dans les matières relevant de la compétence de l'État un pouvoir législatif d'application de normes définies par une loi étatique. Chacune de ces lois prévoit les modalités de contrôle qu'exercera le Parlement sur les normes législatives élaborées par les communautés. Lorsque l'État délègue la mise en œuvre de politiques dont il a la compétence, la loi organique qui organise le transfert définit les formes de contrôle qu'il exerce. Plus largement, lorsque l'intérêt général l'exige, l'État peut promulguer des lois qui établissent les principes nécessaires à l'harmonisation de ces dispositions législatives, même dans des matières relevant de la compétence des communautés. Il n'existe pas de contrôle administratif général sur les actes des communautés autonomes de la part de l'État. Cependant, l'article 3 de la loi relative au processus autonomique prévoit que le Gouvernement doit veiller au respect par les communautés autonomes des règles étatiques applicables et peut formuler les mises en demeure pertinentes. L'article 2 de cette même loi dispose que tant le Gouvernement que le Parlement peut solliciter des communautés autonomes l'information nécessaire sur l'activité de ces communautés, une information qui est acheminée par l'intermédiaire du délégué du Gouvernement. Dans le cas où la communauté autonome agirait à l'encontre des intérêts généraux ou porterait gravement atteinte à la Constitution, le Gouvernement, après une mise en demeure adressée au président de la communauté autonome, peut prendre les mesures nécessaires pour corriger ces situations. Pour s'assurer de l'exécution des mesures prévues, le Gouvernement peut donner des instructions aux autorités des communautés autonomes, dans le cadre de l'article 155 de la Constitution. Le Gouvernement est habilité à contester devant le Tribunal constitutionnel les résolutions et dispositions adoptées par les organes des communautés autonomes sur le fondement du 2 de l'article 161 de la Constitution. Enfin, l'article 153 de la Constitution prévoit une série de contrôles de l'activité des communautés autonomes : par le Tribunal constitutionnel en ce qui concerne la constitutionnalité de leurs dispositions normatives ayant force de loi, par le Gouvernement, après avis du Conseil d'État, en ce qui concerne l'exercice des fonctions déléguées, par la juridiction du contentieux administratif en ce qui concerne l'administration autonome et ses normes réglementaires, et, enfin, par la Cour de comptes en ce qui concerne les matières économiques et budgétaires. Une fois les comptes généraux approuvés par le parlement de la communauté autonome et une fois effectués les contrôles administratifs correspondants, ces comptes sont révisés par la Cour des comptes de l'État. Celle-ci peut néanmoins déléguer l'exercice de certaines de ses fonctions à la cour des comptes régionale, si la communauté autonome en a créé une. La juridiction ordinaire peut également connaître la légalité des actes administratifs et réglementaires des communautés autonomes, étant donné que les organes de l'administration de l'État peuvent attaquer ces actes. - Les collectivités locales Le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, provinces et communes, est exercé par l'administration de l'État, sous la responsabilité du délégué du gouvernement ou du gouverneur civil, et par les communautés autonomes. Dans ce cadre, les collectivités locales sont tenues de faire parvenir aux administrations de l'État et des communautés autonomes, dans un délai de six jours, une copie ou, le cas échéant, un extrait explicite des actes et décisions qu'elles ont pris. Lorsque l'administration de l'État ou des communautés autonomes estime, dans la limite de sa compétence respective, qu'un acte ou une décision d'une quelconque collectivité locale va à l'encontre de l'ordre juridique, elle peut mettre cette collectivité en demeure d'annuler cet acte ou cette décision. La mise en demeure doit être motivée et indiquer la règle que l'on estime enfreinte. Elle doit être formulée dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la communication de la décision. Si une collectivité locale effectue des actes ou prend des décisions qui portent gravement atteinte à l'intérêt général de l'Espagne, le délégué du Gouvernement, après avoir adressé une mise en demeure au président de la collectivité, peut, si aucune suite n'est donnée à cette mise en demeure, suspendre leur exécution et prendre les mesures pertinentes tendant à protéger ledit intérêt. Il devra avoir porté un recours, dans un délai de six jours à partir de la suspension, devant la juridiction administrative. Les collectivités locales sont libres d'accepter ou de rejeter la mise en demeure formulée par l'administration de l'État ou de la communauté autonome, aux fins de modification des décisions prises par ces organismes. Elles sont habilitées, dans tous les cas, à présenter un recours devant la juridiction administrative, contre les actes de l'administration de l'État et des communautés autonomes qui portent atteinte à leur autonomie. De même, les collectivités locales sont habilitées à déposer un recours auprès du Tribunal constitutionnel contre les lois de l'État ou des communautés autonomes qu'elles estiment préjudiciables à l'autonomie locale garantie par la Constitution. Lorsqu'une collectivité locale ne respecte pas les obligations imposées directement par la loi, de telle sorte que l'exercice des compétences de l'administration de l'État ou de la communauté autonome s'en trouve gêné et lorsque la couverture économique nécessaire qui doit se trouver garantie de façon légale ou budgétaire ne l'est pas, l'une ou l'autre, selon leurs compétences respectives, doit rappeler à la collectivité les obligations qu'elle est tenue de respecter en lui accordant à cet effet le délai voulu. Si, une fois écoulé ce délai, à aucun moment inférieur à un mois, la situation de non-respect se maintient, il doit être procédé à l'adoption des mesures nécessaires au respect des obligations en cause aux dépens et en substitution de la collectivité locale (286). Lorsque l'administration de l'État ou des communautés autonomes considère que les actes et décisions des collectivités locales empiètent sur les compétences, gênent leur exercice ou vont au-delà de la compétence de ces collectivités, elle peut introduire un recours contre ces actes, directement, sans besoin d'une mise en demeure préalable, devant la juridiction contentieuse administrative, dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception de la communication de la décision. Dans ce recours, elle peut demander au tribunal la suspension de l'acte ou de la décision attaqué. Au cours du procès, la suspension peut être levée, après avoir entendu l'administration demanderesse, à la demande de la collectivité locale, si cette suspension porte des préjudices à l'intérêt local non justifiés par l'intérêt général ou l'intérêt de la communauté autonome tels qu'ils ont été invoqués dans le recours. L'administration de l'État arrête, à titre général, le plan comptable des collectivités locales. La vérification extérieure des comptes et de la gestion économique des collectivités locales incombe à la Cour des comptes. Dans certains statuts des communautés autonomes, par exemple dans celui de Catalogne, la tutelle financière des collectivités locales appartient à ces communautés. Les comptes annuels sont soumis avant le 1er juin à la connaissance de la commission spéciale des comptes de l'organisme local concerné, laquelle est constituée par des membres des différents groupes politiques composant l'organisme, et sont, par ailleurs, portés à la connaissance publique avant d'être soumis à l'approbation de l'organisme réuni en séance plénière afin que puissent être formulées à leur encontre d'éventuelles réclamations, objections ou observations, ceci sans préjudice d'une éventuelle plainte devant la Cour des comptes pour irrégularités dans la gestion économique et dans les comptes approuvés. Enfin, le Conseil des ministres, de sa propre initiative et après avoir informé le conseil de gouvernement de la communauté autonome concernée ou à la demande de ce dernier et, en tout état de cause, avec l'accord du Sénat, peut, par un décret royal, procéder à la dissolution des organes des collectivités locales dans le cas d'une gestion gravement préjudiciable aux intérêts généraux par suite du non-respect de leurs obligations constitutionnelles. Une fois ladite dissolution décidée, la législation applicable est la législation électorale générale concernant la convocation d'élections partielles et l'administration ordinaire provisoire de la collectivité. c) La coopération entre l'État et les communautés autonomes Les autonomies ont été conçues davantage comme un « droit » des communautés autonomes à développer leurs propres politiques que comme un devoir de participation et de coopération dans un ensemble organisé. Les conférences sectorielles qui se tiennent entre représentants des différents ministères et représentants des communautés, organisés par le ministère de l'administration publique, permettent de régler les questions techniques et d'accueillir l'effort d'adaptation réciproque des partenaires en présence, communautés autonomes et État espagnol (287). Il existe plus de deux cents réunions de ce type par an. Il y a peu, le ministère de l'administration publique a aussi encouragé la création d'une conférence sectorielle des affaires locales comme principal organe chargé de la liaison tripartite entre l'État, les communautés autonomes et les collectivités locales. Ce conseil s'est réuni pour la première fois le 17 janvier 2005. La création de cette instance était primordiale pour développer le gouvernement local avec le consensus des trois niveaux de pouvoirs territoriaux existant en Espagne. Restent les arbitrages politiques. Les conférences des présidents des communautés autonomes pendant longtemps n'ont jamais été réunies. Ce n'est que récemment que le Gouvernement espagnol a favorisé la création de la conférence des présidents qui réunit le Président du Gouvernement de la nation et les présidents de communautés autonomes. Cette instance est nécessaire pour aborder les grandes questions d'intérêt commun, soit parce qu'elles sont intrinsèquement importantes, soit parce qu'elles ne peuvent être traitées toutes seules par le système, incontestablement essentiel, des conférences sectorielles. Ce besoin a déjà été satisfait car deux conférences des présidents ont eu lieu depuis la formation du nouveau gouvernement, après les élections législatives du 13 mars 2004. 6. Les perspectives d'évolution : vers une stabilisation de la carte des autonomies ? La décentralisation espagnole a enregistré de véritables réussites. Elle se trouve aujourd'hui confrontée à trois défis : la réforme constitutionnelle, l'évolution des statuts des communautés autonomes alimentée d'abord par la Catalogne et le Pays basque, et, enfin, la question du financement, qui est liée au deuxième défi, les régions les plus riches souhaitant plus de compétences. a) La décentralisation comme moteur de la modernisation La révolution décentralisatrice, initiée en 1978, ne s'est pas arrêtée depuis. En témoigne la poursuite à un rythme soutenu des transferts de services et de personnels de l'État aux communautés autonomes, transferts parfois opérés par la voie du 2 de l'article 150 de la Constitution (288), qui permet à l'État d'abandonner certaines de ses prérogatives en faveur de telle ou telle communauté autonome nonobstant l'absence d'inscription de ces compétences dans le statut communautaire. Aujourd'hui, les communautés autonomes gèrent deux fois plus de personnel que l'État lui-même (289). Ainsi, l'Espagne constitue un exemple historique du passage réussi d'un État fortement unifié et centralisé à une véritable décentralisation sur le plan politique. Cette transformation a été très rapide et a bénéficié et continue de bénéficier d'un large soutien populaire (290). En raison de ces particularités historiques, les périodes démocratiques en Espagne sont toujours allées de pair avec des évolutions majeures en matière de décentralisation et d'autonomie, non seulement au niveau local mais également sur le plan des nationalités et des régions qui composent le pays. L'avènement des communautés autonomes a été ainsi intimement lié à l'instauration de la démocratie constitutionnelle, les deux mouvements procédant d'une même aspiration à étendre le champ des droits et des libertés. Ce réel succès politique comprend aussi un volet pratique. En effet, la gestion de la plupart des services publics a été progressivement attribuée aux échelons de gouvernement les plus proches des citoyens, ce qui a permis d'améliorer incontestablement la qualité de ces services tout en répondant mieux aux besoins des citoyens et des collectivités territoriales. Comme le montre l'exemple de l'Andalousie, le processus de décentralisation a également contribué directement à l'essor économique du pays, en permettant de mieux valoriser et exploiter les ressources de chaque région, de créer des synergies plus fortes entre les parties prenantes du secteur public et du secteur privé et de concevoir et de mettre en œuvre des politiques de développement régional et local fondées sur une utilisation optimale des ressources de chacun. Les autorités locales et régionales espagnoles ont montré la capacité considérable de modernisation du pays ainsi que sa grande aptitude à intégrer des initiatives sociales et à encourager la participation des citoyens et des institutions dans les affaires d'intérêt général. L'Espagne, en sachant reconnaître sa propre diversité, et en lui accordant des possibilités d'expression et d'institutionnalisation variées, s'est acceptée. Enfin, il convient d'évoquer l'activité législative des communautés. Les lois autonomiques ont naturellement eu tendance à être spécialisées dans certains secteurs jugés prioritaires par les communautés, tels que l'aménagement du territoire, l'urbanisme ou encore les services sociaux. Certaines initiatives régionales ont été plus audacieuses à l'image de la loi catalane de 1998 sur les unions libres ou encore de la loi de Castille-La Manche sur la prévention des mauvais traitements, tandis que d'autres ont servi de modèle aux autres, voire à l'État, à l'exemple de la loi aragonaise de 1997 sur les parcs naturels. Les compétences particulières dont disposent certaines communautés ont été également l'objet d'une activité législative forte, comme dans le domaine linguistique pour la Catalogne ou le Pays basque ou le développement touristique pour les Baléares et les Canaries. La réforme constitutionnelle proposée par le nouveau gouvernement doit prendre en compte dans le texte fondamental cette nouvelle situation et transformer ainsi une « Constitution accidentelle » en Constitution pérenne. b) La réforme constitutionnelle La Constitution a été rédigée à l'origine pour faciliter la transition d'un État fortement centralisé à un État politiquement décentralisé. Le gouvernement emmené par José Luis Zapatero et issu des élections du 14 mars 2004 a estimé, dès son arrivée au pouvoir, qu'elle devait désormais être adaptée à la nouvelle situation : celle d'un État décentralisé bien implanté. Le Gouvernement a donc exprimé le souhait de modifier la Constitution pour y intégrer la catégorie des communautés autonomes qui ont été volontairement créées dans le cadre de la Constitution. Ainsi, le découpage territorial introduit par la Constitution de 1978 pourra être, à son tour, consacré dans son libellé comme l'expression d'un changement fondamental de la structure territoriale de l'État. Mais la question de la révision de l'article 2 de la Constitution et de l'inscription de la carte définitive des autonomies dans le texte de 1978 est une question politique délicate. Certaines communautés se considèrent comme des nations, d'autres comme des régions. Se pose, par exemple, avec acuité la question de la « nation catalane » (291). Le Gouvernement veut trancher le débat et parvenir à une dénomination qui tient compte de la dénomination exacte de chaque communauté autonome. Mais, la réforme constitutionnelle, outre la possibilité de prendre en compte l'évolution de l'Union européenne et de modifier éventuellement la loi salique pour instaurer une égalité entre homme et femme dans la succession royale, a un autre objectif essentiel : transformer le Sénat en une véritable chambre territoriale pour prendre en compte cette situation nouvelle. Actuellement, la plupart des sénateurs espagnols sont encore élus sur une base provinciale plutôt que régionale. Ses fonctions consistent, pour l'essentiel, à dupliquer le travail de la Chambre des députés, sans avoir accès au contrôle de l'exécutif. La réforme qui, comme toute révision de la Constitution, nécessite la tenue d'un référendum et la dissolution du Parlement, a été annoncée pour l'année 2008. En effet, en application de l'article 168 de la Constitution, toute proposition visant à la révision totale de la Constitution ou à une révision partielle du titre préliminaire - qui serait modifié pour citer les communautés autonomes existantes -, du chapitre deux, section première du titre Ier ou du titre II, doit être approuvée, quant au principe, à la majorité des deux tiers des membres de chaque Chambre et l'on doit procéder à la dissolution immédiate des Cortes. Les Chambres élues devront ratifier la décision et procéder à l'étude du nouveau texte constitutionnel qui devra être approuvé par les deux Chambres à la majorité des deux tiers. Après avoir été approuvée par les Cortes Generales, la révision sera soumise à ratification, par voie de référendum. Mais la question catalane, aujourd'hui comme en 1989 lorsque le parlement catalan vota une déclaration relative à l'autodétermination du peuple catalan, plus encore que la question basque, incarnée dans les débats qui font rage aujourd'hui sur la modification du statut de la communauté et la reconnaissance dans le préambule de celui-ci d'une nation catalane, focalise tous les espoirs et toutes les craintes. Elle pose, de manière plus générale, la question de la modification, dans son sillage, du statut des autres communautés (292). c) La modification des statuts des communautés autonomes En Espagne, comme on l'a vu supra, les statuts des collectivités territoriales peuvent être très distincts d'après la Constitution, mais tendent, en réalité, à être de plus en plus similaires... jusqu'à ce qu'une communauté cherche à accroître ses compétences et à se différencier, la prégnance du « fait différentiel », rendant de plus en plus hypothétique l'atteinte de ce que les constitutionnalistes espagnoles appellent le « toit des compétences », le « techo competencial », cible mouvante du droit des autonomies. Les communautés autonomes espagnoles, comme les régions italiennes, se distinguent des collectivités de troisième niveau des autres pays à la fois par l'attribution d'un pouvoir législatif et par l'exercice de compétences plus ou moins vastes, en fonction de leurs particularités géographiques, culturelles ou historiques. Les dépenses par habitant des communautés autonomes sont, par ce même fait, nettement plus fortes que celles des régions françaises (293). Les communautés autonomes « à voie rapide » bénéficient de compétences élargies à la santé, l'éducation et la police notamment. Un processus d'homogénéisation des compétences engagé au début des années 1990 a étendu aux autres communautés autonomes la compétence « éducation » en 2000 et la compétence « santé » en 2002. Les autres compétences devaient l'être au plus tard en 2003. L'arrivée au pouvoir de José Luis Zapatero a donné un nouvel élan à la réforme des statuts communautaires, celui-ci s'étant déclaré, dans son discours d'investiture, prêt à examiner toute proposition de réforme des statuts d'autonomie, à condition que celle-ci respecte la Constitution et soit le fruit d'un consensus politique et social. Dans ce nouveau processus, le « fait différentiel », déjà évoqué, joue à plein. En effet, à l'exception de Madrid, des Asturies et de l'Aragon, ce sont les communautés qui disposent déjà du maximum de compétences qui se sont engagées dans ce nouveau mouvement. Parmi les communautés, il convient de distinguer celles dont l'exécutif s'était déjà engagé dans la voie de la réforme, à l'exemple du Pays basque, celles ayant institué des commissions de réforme, comme la Catalogne, l'Andalousie, Valence, les Canaries et l'Aragon, celles qui n'ont pas encore pris d'initiative réelle telles que la Galice ou encore les communautés de Castille-La Manche et Castille-Leon. Le projet catalan semble le plus abouti. Un texte a ainsi été approuvé le 30 septembre 2005 par près de 90 % des députés du parlement catalan, mentionnant notamment l'existence d'une « nation catalane », revendiquant une indépendance fiscale et la création d'une haute cour de justice régionale. Fin janvier 2006, un projet de compromis a été établi entre le Gouvernement espagnol et la majorité des partis de Catalogne : le terme de « nation » ne serait évoqué que dans le préambule du prochain statut, tandis que, dans le domaine de la fiscalité, l'indépendance fiscale a été remplacée par une augmentation de la part d'impôt sur le revenu qui reste à la communauté de 33 % à 50 % et par une augmentation de la part de taxe sur la valeur ajoutée à 50 % et de la part des droits sur le tabac, les alcools et les carburants à 58 %. Ce projet devait être présenté au Parlement espagnol au mois de février 2006 et continue de susciter une farouche hostilité de la part de l'opposition du Parti populaire, qui dénonce, en effet, un projet centrifuge et désintégrateur. Si le Parlement espagnol l'approuve, le futur statut devra être ratifié par référendum en Catalogne. Un projet de « libre association » avec l'État espagnol avait été approuvé par le parlement du Pays basque fin 2004, mais avait été rejeté, en février 2005, à une très forte majorité par le Parlement espagnol qui avait estimé que le projet n'était pas conforme à la Constitution. Dans la foulée des initiatives catalanes, le Pays basque a relancé l'initiative en publiant, fin octobre 2005, un document programme sur sa pacification et sa normalisation politique, réclamant la possibilité pour les Basques de déterminer eux-mêmes l'étendue de leur autonomie. La multiplicité des possibilités de participation des habitants préservées par la législation espagnole atteste de l'équilibre qui existe dans tous les pays de l'Union entre la recherche de l'efficacité économique à travers la dimension des collectivités et les impératifs démocratiques. Comme en Italie, le concept d'autonomie en Espagne recouvre des situations très différentes. Il peut prendre une couleur politique dans les communautés autonomes qui disposent du pouvoir législatif ou bien une teinte administrative dans les provinces et les communes. Comme l'a reconnu le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 2 février 1981, « l'autonomie est un concept juridique indéterminé qui offre une marge très large d'appréciation », tout en relevant que « la garantie constitutionnelle des autonomies locales ne se limite pas à inclure dans une matière réservée à la loi la détermination du contenu de compétences de ces autonomies... L'autonomie locale doit être comprise comme un droit de la communauté locale à la participation, à travers ses organes propres, au gouvernement et à l'administration des affaires qui la concernent ». À l'image également de l'Italie, l'Espagne présente de nombreux caractères d'un État fédéral, sans pour autant en constituer un à proprement parler. D'un côté, le pays possède un double niveau de pouvoir politique, les compétences des communautés autonomes sont très étendues, le financement est stabilisé et fondé sur les principes de la coresponsaiblité, de la solidarité et la coopération, tandis que le règlement des conflits institutionnels est assuré par une juridiction constitutionnelle. De l'autre, le processus d'« autoconstitution » des communautés prévu par la constitution est éloigné d'un modèle fédéral dans lequel les entités fédérées sont constitutionnellement énumérées et délimitées. De plus, les communautés autonomes ne possèdent de pouvoir judiciaire authentique, ni d'un véritable constituant - les Cortes Generales peuvent faire obstacle à une révision des statuts. Relevons que les tensions entre communautés autonomes et les collectivités locales ne sont pas rares, tandis que le financement des collectivités locales est source de conflit avec l'État. Il existe enfin une certaine concurrence entre législation sectorielle et autonomie locale. L'exemple espagnol montre que des manifestations contradictoires peuvent coexister dans un même État : les institutions et les compétences sont devenues plus homogènes, mais l'autonomie croissante n'a pas, comme le montre la position récente prise par la communauté autonome de Catalogne, désarmé les courants régionalistes. In fine, le problème espagnol, comme à bien des égards le problème italien, réside plus dans l'instabilité constante de son système régional que dans la profondeur de la décentralisation. A contrario, en atteignant le point ultime de la décentralisation dès son entrée dans le système de la dévolution, l'Écosse bénéficie d'un cadre juridique plus stable, même si des ajustements à la marge devront intervenir. III. - LE POINT ULTIME DE L'ÉTAT UNITAIRE DÉCENTRALISÉ : Depuis la fin des années 1990, l'ensemble des pays de la périphérie britannique sont entrés dans une période de questionnement institutionnel. Après une présentation générale de l'organisation locale du Royaume-Uni, le rapporteur s'attardera sur le cas le plus extrême de dévolution, celui de l'Écosse. A. LE SYSTÈME BRITANNIQUE ENTRE « RECENTRALISATION » ET DÉVOLUTION La structure géographique actuelle du Royaume-Uni est le résultat d'une union de quatre nations : l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. En effet, l'Angleterre a incorporé successivement par des Actes d'Union le Pays de Galles en 1536, l'Écosse en 1707 et l'Irlande du Nord en 1800. Ces différentes unions ont conféré au système britannique certaines particularités : il est asymétrique, le système institutionnel local possède une géométrie variable. Chacune des entités qui constituent le Royaume-Uni jouit d'une relation distincte avec le pouvoir central et a hérité de son histoire des éléments particuliers. L'Angleterre et le Pays de Galles partagent le même système juridique, tandis que l'Écosse et l'Irlande du Nord disposent d'un système juridique particulier. 1. Le régime juridique des collectivités locales Le Royaume-Uni ne dispose pas de Constitution écrite. Les principes qui régissent cependant son régime politique accordent une souveraineté illimitée au Parlement du Royaume-Uni (Westminster) qui doit s'accommoder d'une autonomie plus ou moins grande attribuée, par dévolution, aux différentes parties du royaume que sont l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord. a) La souveraineté illimitée de Westminster Le Parlement du Royaume-Uni est le titulaire exclusif de la souveraineté et cette souveraineté est illimitée. Il résulte de ce principe que, même dans des matières dévolues à un parlement « régional », le Parlement britannique peut continuer à légiférer. Par exemple, il put ainsi en 1972 supprimer le Parlement d'Irlande du Nord (Stormont). De la même façon, l'Assemblée d'Irlande du Nord, instituée par le Northern Ireland Act de 1998, a été suspendue par le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord entre février et juin 2000. Le Parlement britannique peut toujours, par une loi ordinaire adoptée à la majorité simple, re-centraliser les pouvoirs qu'il a octroyés aux entités décentralisées. b) Une « dévolution graduée » et asymétrique Comme le rappelle à propos du mot « devolution » M. Gérard Marcou dans son étude récente pour le centre d'étude et de prévision du ministère chargé des libertés locales, « cette notion assez imprécise est apparue à la fin du XIXe siècle avec le mouvement indépendantiste irlandais, auquel on tenta de répondre par un régime d'autonomie interne poussée (Home Rule). La devolution correspond ainsi au transfert de larges pouvoirs à une assemblée politique pour la gestion des affaires intérieures (...). Elle assume et consacre le caractère multinational du Royaume-Uni. » (294) C'est la tradition d'absence de Constitution écrite et la diversité des arrangements administratifs qui ont permis d'adopter une démarche aussi radicale que la « dévolution », inscrite dans le programme du Parti travailliste, qui gagna les élections de 1997 et qui le mit très rapidement en œuvre. Désormais, les gouvernements locaux d'Écosse, du Pays de Galles et d'Irlande du Nord sont régis par des lois de 1998. Le Scotland Act, le Wales Act et le Northern Ireland Act ont tous les trois été présentés devant le Parlement de Westminster en 1998 par le Gouvernement travailliste de l'époque. Ces lois marquent le début du travail législatif réalisé par Westminster dans le cadre des réformes décentralisatrices. Ces différentes lois avaient pour objectif de déterminer les modalités de dévolution ainsi que l'établissement d'organes institutionnels à géométrie variable au sein des trois entités. La dévolution a été poussée très loin en Écosse, elle a été moins substantielle au Pays de Galles, elle a été ralentie de facto en Irlande du Nord en raison de la situation politique. En tout état de cause, ces différentes lois ne sont pas censées affecter la prééminence du Parlement britannique. De plus, elles préservent le système de gouvernement local propre à chacune des entités qui composent le Royaume-Uni. c) Le système de gouvernement local Chacune des entités du Royaume-Uni possède un système de gouvernement local. Les conseils de comtés (county councils) ont été élus, en Angleterre et au Pays de Galles, pour la première fois en 1888. Le gouvernement local (local government) a fait l'objet de nombreuses réformes. Les lois relatives aux gouvernements locaux (Local Government Acts), régissent les principes du gouvernement local et les modalités de transfert et d'exercices des compétences. Une commission, sous la présidence de Lord Redcliffe-Maud, a été créée en 1966, afin d'évaluer l'efficacité de la mise en œuvre, au niveau local, des politiques publiques. Les conclusions de cette commission ont donné lieu au Local Governement Act voté par le Parlement britannique en 1972 et entré en vigueur le 1er avril 1974. Cette commission préconisait un système à un seul niveau d'autorités unitaires pour l'ensemble de l'Angleterre. Elle préconisait également une administration locale démocratique et efficace : « le gouvernement local ne doit pas être vu comme un simple fournisseur de services, il est le moyen par lequel la population peut elle-même déterminer, dans les limites de ce que permettent les politiques nationales et les ressources locales, quel type de services et quel cadre de vie elle préfère ». La commission a formulé trois critiques principales : le trop grand nombre d'unités de commandements sans spécialisation des personnels, la distinction entre county et county borough établissant une dichotomie entre les villes et les campagnes, le décalage entre la réalité géographique et le découpage administratif. Le Local Government Act de 1972 a aboli les structures des gouvernements locaux existantes et a créé un système à deux niveaux de comtés et de districts sur l'ensemble du territoire, et non pas à seul niveau comme cela était préconisé par la commission Maud. Cette loi a introduit la notion d'agence locale (agency), structure qui peut recevoir une délégation de pouvoirs émanant d'une autorité locale si celle-ci estime qu'une telle structure peut être plus efficiente. Certaines compétences ne pouvaient pas leur être attribuées, comme par exemple l'éducation. Cette loi comportait, en outre, des dispositions relatives à la composition et aux noms des comtés, et à la composition des districts, anglais et gallois (295). Les limites des districts non métropolitains n'avaient pas été déterminées. Elles ont été fixées par un « statutory instrument » (296). Le système établi par le Local Government Act n'est pas resté immuable, notamment en raison de la politique centralisatrice conduite par les gouvernements conservateurs entre 1979 et 1997. En effet, en Angleterre, les conseils des comtés métropolitains (the county councils of the metropolitan counties), ainsi que le conseil du Grand Londres (the Greater London Council) ont été abolis par le Gouvernement de Margaret Thatcher en 1986 afin de rétablir le statut des counties boroughs pour les bourgs métropolitains. Les réformes du Gouvernement Thatcher avaient pour objectifs essentiels de réaliser des économies. En outre, le système à deux niveaux du Pays de Galles a été aboli en 1996 et a été remplacé par un seul niveau : les counties, en milieu urbain et les counties boroughs en milieu rural. L'arrivée du Parti travailliste au pouvoir s'est traduite par une série de réforme du gouvernement local. Parallèlement aux lois de dévolution, en 1998, la collectivité du Grand Londres (Greater London Authority) a été remise en place. Une nouvelle loi sur le gouvernement local (Local Government Act) a été promulguée le 28 juillet 2000. Elle a étendu les compétences des collectivités locales britanniques et a prévu la désignation d'exécutifs locaux. Les collectivités ne disposaient que d'une habilitation légale pour régler certaines affaires. L'article 2 de la loi de juillet 2000 a conféré aux conseils élus le pouvoir de prendre toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour concourir au bien-être économique, social ou environnemental de la collectivité. Il ne s'agit plus de compétences d'attribution mais de compétences générales. Cependant, l'article 3 de cette même loi dispose que les autorités locales ne peuvent exciper des dispositions de l'article 2 pour lever des impôts. Cela signifie que l'action des collectivités pour concourir au bien-être des citoyens est limitée aux moyens financiers initiaux. 2. La structure et l'organisation des collectivités locales L'organisation locale du Royaume-Uni présente une certaine complexité en raison d'une forte hétérogénéité. En effet, certaines parties de l'Angleterre ne possèdent qu'un seul niveau de collectivités : les collectivités territoriales uniques (unitary authorities ou unitaries). Le reste du territoire en compte deux : les collectivités territoriales uniques et la région en Écosse et au Pays de Galles, les districts et la région en Irlande du Nord, les districts et les comtés dans certaines zones anglaises. Le paysage s'est compliqué avec l'apparition récente, en Angleterre, de régions. - L'Angleterre · L'apparition hésitante d'un pouvoir régional L'Angleterre compte ainsi huit régions (297) auxquelles s'ajoute la collectivité du Grand Londres (298). Dans leur conformation actuelle, les régions ont d'abord été créées en 1994 sous forme d'échelon déconcentré des administrations centrales par le gouvernement dirigé par John Major. Comme en France, leur carte est largement issue de préoccupations purement administratives, en liaison avec l'organisation de la défense civile durant la seconde guerre mondiale, et a donc fait l'objet, comme en France, de critiques. Elles sont administrées, d'une part, par des agences régionales de développement (299) et, d'autre part, par des assemblées régionales (300), qui désignent en fait les chambres régionales créées par la loi sur les agences de développement régional de 1998 (301). Créées à l'origine pour élaborer une stratégie de développement économique, assurer les fonds structurels européens, attirer les investissements, organiser la concurrence entre agences pour l'utilisation des fonds et la rénovation urbaine, les agences régionales coordonnent, en conséquence, l'utilisation du foncier, ainsi que les politiques de transport, de développement économique, les politiques agricoles, énergétiques et la gestion des déchets. Chargées initialement de porter la parole des intérêts politiques régionaux auprès d'agences de développement motivées par des buts économiques, les assemblées sont devenues progressivement des organes d'impulsion et de consultation, à la fois au niveau national et au niveau européen. Elles sont notamment compétentes pour élaborer les stratégies d'aménagement régional (302), fonction naguère confiée aux comtés. Les membres des agences de développement sont nommés par le gouvernement. Les assemblées régionales sont composées, pour deux tiers, de conseillers désignés par les conseils de district et de comté et par les collectivités territoriales uniques et, pour un tiers, par des représentants des autres groupes d'intérêt régionaux. Le gouvernement de Tony Blair a souhaité promouvoir leur élection au suffrage universel. En 2002, le gouvernement publia ainsi un livre blanc intitulé Your Region, Your Choice - Revitalising the English Regions, destiné à faire des assemblées élues, composées de vingt-cinq membres, les responsables de l'élaboration de stratégies régionales compatibles avec le développement durable, le développement économique, l'aménagement du territoire, des politiques sectorielles performantes dans le domaine de la gestion des déchets, du logement, de la culture et de la biodiversité. Elles auraient été financées par le gouvernement central avec la possibilité de percevoir une partie des taxes locales. La loi relative aux assemblées régionales de 2003 (303), outre qu'elle consacrait le titre donnée jusqu'alors de manière coutumière aux chambres régionales, organisa une procédure de référendum destinée à conduire à l'élection au suffrage universel de ces assemblées. Mais, l'échec sans ambiguïté du référendum organisé, le 4 novembre 2004, dans la région du Nord-Est a marqué un coup d'arrêt du processus. Ainsi ont été reportés les référendums qui devaient se tenir dans la région du Nord-Ouest et dans la région du Yorkshire et Humber. Demeure en effet l'idée que la régionalisation est un processus importé de manière artificielle du continent et se fait, non pas au détriment du pouvoir central, mais à celui des collectivités locales. En revanche, la collectivité du Grand Londres se compose d'un maire (mayor) et d'une assemblée dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Elle compte 33 arrondissements, soit 32 boroughs et la City of London, dont les compétences se situent entre celles d'un district et celles d'un conseil de collectivité territoriale unique (voir infra). · Un gouvernement local à deux niveaux ou un seul niveau Certaines parties du territoire anglais possèdent deux niveaux d'administration locale. À l'échelon intermédiaire, on trouve ainsi 34 conseils de comté (county councils) (304) dont les membres sont élus au suffrage universel direct. Au niveau local, on trouve deux types de collectivités, selon que l'on se trouve en zone urbaine ou en zone rurale : on compte ainsi 36 districts urbains (metropolitan districts) et 238 districts (non metropolitan districts, appelés aussi shire districts) (305). Depuis les années 1990, les autres parties du territoire anglais ne possèdent qu'un seul niveau d'administration locale, dans lequel ont été fusionnés comtés et districts. Elles sont ainsi divisées en 47 collectivités territoriales uniques (unitary authorities) (306). La population de ces collectivités varie entre 35 000 et 1 million d'habitants, mais la plupart compte une population située entre 150 000 et 300 000 habitants. Elles sont administrées par un conseil qui peut prendre le nom de « conseil de comté », de « conseil de bourg métropolitain », de « conseil de bourg », de « conseil de cité », de « conseil de district » ou simplement de « conseil ». Cette multitude d'appellations, si elle peut semer une forme de confusion, recouvre une même réalité et l'appellation n'emporte aucune différence de compétences. Traditionnellement, les conseils des collectivités locales ne connaissent pas la séparation entre exécutif et législatif. Toutes les fonctions sont assurées par le conseil lui-même et sont exercées, en pratique, par des commissions et des sous-commissions. Les leaders locaux peuvent présider plusieurs commissions importantes mais ne disposent pas d'une autorité particulière. La présidence du conseil lui-même est une fonction honorifique sans réel pouvoir. Depuis la loi sur le gouvernement local et le logement de 1989, les commissions doivent refléter la composition politique du conseil, alors qu'auparavant le parti majoritaire au conseil avait tout pouvoir pour prendre le contrôle des commissions. La loi précitée du 28 juillet 2000 sur le gouvernement local a obligé les conseils à constituer un véritable exécutif, sous la forme soit d'un président du conseil assisté d'un bureau, soit d'un « maire » élu directement, soit d'un « maire » et d'un bureau élus par les conseillers, soit encore d'un maire et d'un directeur exécutif du conseil. Seuls les conseils des districts comportant moins de 80 000 habitants peuvent conserver un système de commissions, légèrement modifié par la loi cependant. La plupart des conseils ont choisi la solution d'un président du conseil assisté d'un bureau. Seuls une douzaine de districts ont choisi d'élire directement leur maire. Le nouveau gouvernement issu des élections en 2005 envisage de favoriser l'élection de « maires » dans le cadre de régions plus large, ce qui impliquera une réorganisation des collectivités locales sur la base de circonscriptions plus larges, dotées de pouvoirs plus importants. · La survivance d'un niveau inframunicipal Au niveau inframunicipal, on trouve environ 10 000 paroisses (civil parishes) dont 8 700 sont pourvues d'un conseil. Leur population peut varier de moins de 100 à plus de 70 000 habitants. Lorsqu'une paroisse possède moins de 200 électeurs, le conseil est remplacé par une réunion paroissiale, qui rassemble l'ensemble des électeurs. Les paroisses ont été établies sous leur forme actuelle en 1894, époque à laquelle elles ont été détachées de l'Église d'Angleterre. Elles ne couvrent pas l'ensemble du territoire anglais et demeurent principalement dans les zones rurales et dans les zones urbaines de petite dimension. Elles ont été abolies à Londres en 1965 et dans les zones urbaines principales en 1974. La survivance des paroisses témoigne, comme le maintien de multiples possibilités de participation des habitants préservées par la législation espagnole, de la tension qui existe toujours entre la recherche de l'efficacité économique à travers la dimension des collectivités et les impératifs démocratiques. Parmi les paroisses qui disposent d'un conseil, celui-ci peut prendre l'appellation de « Town Council » ou, de manière plus rare, de « City Council ». Il existe ainsi 400 town councils et 6 city councils. Le titre de ces derniers est accordé seulement par la Couronne, tandis que celui des premiers peut l'être par simple résolution. Le président des conseils des town et des city councils prend généralement le titre de maire. Le gouvernement encourage la création de conseils de paroisses ou de quartier dans les zones qui ne possèdent pas aujourd'hui de telles structures. Le Local Government and Rating Act de 1997 a ainsi créé une procédure qui accorde aux citoyens le droit de demander qu'une nouvelle paroisse soit créée dans les zones qui en sont dépourvues. Si 10 % des électeurs d'une zone signent une pétition en faveur d'une telle création, le conseil de district ou la collectivité territoriale unique doit prendre en compte la demande. La décision finale appartient au bureau du vice-Premier ministre. Les conseils de paroisse sont administrés par des conseillers bénévoles élus tous les quatre ans. L'élection n'a lieu que si le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges. Au total, les collectivités locales anglaises disposent d'un budget de 70 milliards de livres sterling et emploient environ 2 millions d'agents. - Le Pays de Galles Le statut du Pays de Galles établit, non pas une autonomie régionale, mais une forme particulièrement de décentralisation régionale, reposant sur une assemblée régionale et une vingtaine de collectivités locales. Le Pays de Galles possède une assemblée régionale (regional assembly), dénommée Assemblée nationale du Pays de Galles. Selon le Government of Wales Act de 1998, cette assemblée n'exerce aucun pouvoir législatif ni fiscal. Elle peut cependant faire des lois secondaires dans les domaines relevant de la compétence du secrétaire d'État pour le Pays de Galles (logement, développement économique, transport, affaires internes, environnement, culture...). Elle exerce des compétences matérielles étendues associées à un pouvoir réglementaire subordonné important. Constitué au XVIe siècle, de plus en plus complexe, le système local gallois connut une première simplification en 1974 lorsque furent créés 8 conseils de comté et 37 conseils de district. En 1996, intervint une nouvelle réorganisation qui créa un seul niveau de collectivités locales avec 22 collectivités territoriales uniques (unitary authorities), réparties en 10 county boroughs, 9 counties et 3 cities (307), administrées par des conseils, regroupant 1 257 conseillers (councillors). Les conseils sont élus tous les quatre ans. 19 collectivités ont un gouvernement de cabinet dirigé par un leader, tandis que les 3 autres sont conduits par un comité exécutif composé à parité par des membres de la majorité et de l'opposition. Elles disposent ensemble d'un budget de 4 milliards de livres sterling. Elles emploient 150 000 agents. En dessous du niveau des collectivités territoriales uniques, on trouve des conseils communautaires (community councils), qui ont remplacé les paroisses en 1972 et qui disposent des mêmes pouvoirs que les conseils paroissiaux anglais. Un partenariat a été signé entre l'Assemblée nationale du Pays de Galles et le gouvernement local pour mettre en place des procédures de coopération et de consultation. Ainsi a été mis en place un Conseil de partenariat, composé de vingt-six membres, désignés par les autorités locales et chargés de donner leur avis sur les actes de l'Assemblée et de relayer les informations produites par elle. L'Assemblée a adopté, successivement, deux plans stratégiques destinés à promouvoir des politiques communes. En outre, des accords politiques ont été négociés localement entre les conseils et l'Assemblée pour mettre en place des politiques particulières, dont les performances sont mesurées sur le fondement d'indicateurs sur lesquels les deux parties se sont accordées. En outre, une commission présidée par M. Richard a remis au Premier ministre gallois (First Minister) un rapport sur l'évolution du rôle de l'Assemblée, qui pourrait, sur le modèle du Parlement écossais, obtenir des pouvoirs législatifs dans des domaines déjà investis par l'Assemblée, tels que la santé et l'éducation, ce qui ne manquera pas, comme en Écosse, de modifier ses rapports avec les autorités locales. - L'Irlande du Nord Le secrétaire d'État pour l'Irlande du Nord est compétent en matière de maintien de l'ordre public, de gestion du système de sécurité sociale, de politique de sécurité, de justice pénale et d'administration des prisons, de télécommunications, de relations internationales. L'Irlande du Nord est administrée par une assemblée semi-autonome (regional assembly) et un comité exécutif. L'assemblée a la possibilité de légiférer dans le secteur de la justice, du patrimoine, de l'éducation, du logement, de la culture, de la santé et de l'administration locale. Le comité exécutif regroupe dix ministères. Il est dirigé par un Premier ministre (First Minister). Au niveau local, l'Irlande du Nord compte 26 conseils de district (308), rassemblant 582 conseillers. Leurs membres sont élus au suffrage universel direct. Les conseils de district sont responsables notamment du logement, de la prévention sanitaire, de la lutte contre la pollution, de la réglementation de la construction, de la collecte des déchets, de la protection de l'environnement... Ils participent au développement économique, à la sécurité, au développement des sports, au tourisme. Ils peuvent être consultés sur toute autre matière. Ils disposent d'un budget de 360 millions de livres sterling et emploient environ 10 000 agents. Les comtés, comme en Angleterre, sont divisés en paroisses, elles-mêmes divisées en townlands. Les comtés sont aussi divisés en circonscriptions territoriales plus larges appelées baronies, qui sont constituées d'un certain nombre de paroisses ou de parties de paroisses. Mais aussi bien les paroisses que les baronies sont largement obsolètes et ne disposent de réels pouvoirs que dans certaines matières telles que les transactions foncières. Elles ne constituent plus à proprement parler des collectivités locales. - L'Écosse L'Écosse possède 32 autorités unitaires (unitary authorities), rassemblant 1 222 conseillers, disposant d'un budget de 6 milliards de livres sterling, et un Parlement écossais (Scottish Parliament) (309). Dans le passé, les comtés écossais étaient eux aussi divisés en paroisses. Mais celles-ci furent supprimées en 1930. Aujourd'hui, il existe des conseils communautaires, qui ont beaucoup moins de pouvoirs que leurs ancêtres et que les paroisses anglaises ou communautés galloises. Le fonctionnement de ce système est décrit de manière plus précise ci-après. 3. Les compétences des collectivités locales a) L'avènement d'une compétence générale Si l'organisation territoriale a changé fréquemment - en 1888-1890, en 1965-1972, en 1985, en 1995-1996, encore en 1999 -, ces changements se sont également accompagnés de modifications des compétences des collectivités locales. Si, traditionnellement, les collectivités locales au Royaume Uni ne possèdent pas de pouvoir de compétence générale, les réformes récentes ont battu en brèche ce principe, chaque autorité élue se voyant désormais reconnaître la possibilité de prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaire pour concourir au bien-être économique, social ou environnemental de la collectivité dont elle a la charge. Mais cette intervention est limitée par l'enveloppe budgétaire initiale, qui ne peut, en aucun cas, être abondée au prétexte que la collectivité a étendu son champ de compétence. Si les collectivités locales restent responsables d'un grand éventail de services, de plus en plus, elles ne les assurent pas directement mais procèdent par appels d'offres. En effet, depuis les années 1980, le gouvernement britannique a adopté des lois qui ont défini les modalités d'intervention des collectivités territoriales et qui imposent, par exemple, qu'une collectivité soumette à appel d'offres les services de collecte des ordures, de nettoyage des rues, de restauration scolaire, de gestion des équipements de loisirs, tandis que les établissements scolaires doivent gérer directement 85 % des dépenses de la collectivité en matière d'éducation. En tout état de cause, les collectivités sont contraintes dans leurs dépenses par des plafonds imposés par le gouvernement national. Dans les structures à deux niveaux, les comtés sont responsables des plans d'aménagement régional, des transports, des routes, des pompiers, de la police, des services sociaux, de l'éducation primaire et secondaire, des bibliothèques et du traitement des déchets, tandis que les districts sont compétents pour les plans d'occupation des sols, l'entretien de la voirie, le logement, la sécurité sanitaire, l'environnement, les loisirs et la culture, la collecte des déchets, le fonctionnement des marchés et cimetières. Les collectivités unitaires sont responsables de l'ensemble de ces missions, mais quand il s'agit d'un service de réseaux ou de grande échelle, les lois exigent leur participation dans des structures coopératives avec leurs voisins, dans des structures qui ressemblent aux sivom français. Les paroisses en Angleterre ont des compétences en matière de loisirs par le biais de la gestion des parcs et salles de fêtes et rendent un avis facultatif sur les permis de construire. Elles peuvent aussi assurer l'entretien des chemins vicinaux, de l'éclairage public et des cimetières. Depuis 1997, les conseils de paroisse peuvent intervenir dans les transports collectifs, dans la prévention de la délinquance et le financement des schémas de circulation routière. Les plus petits conseils paroissiaux voient leur rôle limité par des faibles ressources et jouent, en conséquence, un rôle secondaire dans l'administration locale, alors que les plus importants peuvent jouer un rôle proche d'un petit conseil de district. b) La coopération entre collectivités locales La forme la plus courante de coopération entre collectivités locales est celle des comités directeurs conjoints (joint boards) et des commissions conjointes (joint committees), les premiers étant imposés par la loi, les secondes étant créées sur une base volontaire. Les comités directeurs sont compétents pour les questions de police et de services d'incendie, pour le transport de passagers (passenger transport authorities) et pour les transports en commun. Les commissions sont compétentes pour l'aide sociale et les routes principales. Quelques-uns de ces organes avaient été créés pour remplacer les missions du conseil de Grand Londres et des autres grandes agglomérations supprimés en 1985. D'autres ont été créés à la suite de la création de nouveaux conseils unitaires en 1996. Ces structures ne sont pas directement élues mais sont composées de conseillers désignés par les conseils participant aux comités ou commissions. En outre, la devolution a donné lieu à la signature de vingt-trois « concordats » et d'un accord entre le gouvernement et les trois pouvoirs régionaux (Memorandum of Understanding), définissant des codes de bonnes pratiques dans les relations entre administrations nationales et régionales. Ces instruments ne sont pas juridiquement contraignants. Mais le Memorandum of Understanding précise que Westminster reste seul souverain et peut légiférer dans les matières transférées tout en s'engageant à ne pas le faire. 4. Le financement des collectivités locales Au Royaume-Uni, chaque collectivité locale est responsable de ses propres dépenses et il lui incombe de déterminer la priorité qu'elle doit porter à ses actions. Pour réaliser cela, les collectivités locales disposent de subventions étatiques, du mécanisme restreint de fiscalité locale et du recours à l'emprunt. L'appareil fiscal britannique est fortement centralisé et caractérisé par la puissance du Trésor. Les différents gouvernements locaux dépendent, pour la majorité de leurs ressources, des transferts accordés par le gouvernement central. Le Trésor verse des subventions par l'intermédiaire des Bureaux territoriaux (Bureau de l'Écosse, Bureau du Pays de Galles, Bureau de l'Irlande du Nord). Ces derniers rendent compte de leurs activités à Westminster. Les vérifications comptables sont faites par les Vérificateurs Généraux, pour l'Écosse et le Pays de Galles, et le Contrôleur Vérificateur général pour l'Irlande du Nord. Les autorités locales n'ont donc pas de réel contrôle sur le volume de leurs dépenses mais une totale autonomie sur la répartition des celles-ci. Ainsi, près de 70 % des dépenses des collectivités locales sont financées par des subventions versées par l'État. L'article 78 du Local Government Finance Act dispose que l'État doit verser aux collectivités locales une dotation d'aide au revenu (Rate Support Grant) qui représente près de 48 % des recettes totales des collectivités locales. Le montant de cette dotation résulte de l'estimation que fait le gouvernement central de l'écart à compenser entre les besoins et les ressources locales. Le montant des dotations attribuées par l'État est calculé sur la base de la formule Barnett (310). Il s'agit d'un mécanisme employé par le Trésor britannique afin de pallier l'augmentation des dépenses résultant des réformes décentralisatrices. Son objectif est d'accorder un montant proche de celui qu'il était, précédemment, aux administrations centrales en charge des affaires dévolues. Le calcul est fait selon le coût des compétences transférées par comparaison avec l'Angleterre. Cette formule ne s'applique qu'aux variations annuelles des budgets et non pas au budget de base. Elle prévoit l'affectation à chaque territoire d'un pourcentage, proportionnel à la population, de l'augmentation des dépenses en Angleterre. Ce mécanisme permet de concourir au principe de péréquation.
L'État prélève un impôt sur la valeur locative des biens immobiliers des entreprises. Il redistribue ce prélèvement aux autorités locales en fonction du nombre d'habitants. La loi sur la fiscalité locale de 1984 a confié au secrétaire d'État compétent le pouvoir de plafonner (capping) l'impôt local. L'impôt local sur les propriétés occupées en tant que logement avait été remplacé par la poll tax (311) tandis que l'impôt foncier avait été maintenu. La poll tax avait été introduite par la loi de 1988 et il appartenait aux autorités locales d'en fixer le montant chaque année. Du fait de son impopularité elle a été partiellement remplacée, en 1993 (312), par un impôt décentralisé, la council tax, qui est la forme principale d'imposition locale directement payée aux autorités locales. En Angleterre et au Pays de Galles il est fait usage de la council tax qui est un impôt sur la valeur marchande des biens immobiliers personnels. Cet impôt foncier assis sur la propriété est fondé sur un système qui classe les propriétés en huit catégories (313). Il permet de financer environ 12 % des dépenses des collectivités locales, notamment les conseils de paroisses. En Écosse et en Irlande du Nord, il s'agit de la poll tax qui est un impôt de capitation dû par toute adulte en fonction de la valeur du logement qu'il occupe. Les recettes des collectivités locales comprennent différentes taxes, redevances et ventes de biens et services liés à l'exercice de leurs compétences et représentent 18 % de leurs montants (314). En outre, le Pays de Galles et l'Écosse ont la possibilité de plafonner la council tax des collectivités locales de leur ressort. Le Parlement écossais à la possibilité d'augmenter ou de réduire, dans une fourchette de 3 %, le taux de base de l'impôt sur le revenu fixé par Westminster (315). Cette opportunité n'a, à ce jour, jamais été utilisée. Plus de 2 millions d'agents travaillent pour le compte des collectivités locales, parmi lesquels 100 000 fonctionnaires territoriaux (council officers). 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État Avant même la dévolution, certaines missions « nationales », comme la construction des autoroutes ou le développement régional., avaient déjà été déconcentrés dans les mains des services ministériels « régionaux », le Scottish Office à Édimboug, le Welsh Office à Cardiff et le Northern Ireland Office à Belfast. Chaque Office est géré par un ministre du gouvernement britannique. Ces quasi-services extérieurs des ministères nationaux à Londres ont perdu de leurs compétences et de leurs moyens, comme on le verra plus loin avec le cas écossais, avec la mise en place de la dévolution. L'Angleterre est la seule « région » à disposer encore d'une administration déconcentrée relativement importante. Si elle n'a jamais eu son propre Office « national » ou ministre spécial, il existe, depuis 1992, dans cette partie du pays neuf « Government Offices in Regions » ou « Regional Offices », transformés par le gouvernement travailliste en English Regional Development Offices, composés de quelques fonctionnaires déconcentrés des ministères, qui ont pour mission de coordonner les politiques de développement régional. Seul parmi les pays européens, le Royaume-Uni, à l'exception de l'Écosse, a opéré a contrario un mouvement de « recentralisation », avec le transfert de nombreuses compétences locales à des organismes publics ou parapublics. Les collectivités territoriales n'y disposent pas d'un pouvoir législatif, à l'exception du Parlement écossais. Elles ne disposent pas non plus d'un pouvoir réglementaire général, sauf au Pays de Galles et en Écosse. En juin 1999, l'Écosse s'est vu octroyer une forte autonomie après trois siècles de gestion directe par Londres. La dévolution constitue une forme de décentralisation politique accentuée. L'Écosse se voit désormais dotée d'un parlement élu, dont les responsabilités toucheront à des secteurs clés, tels que l'éducation, la santé et le logement, les seuls secteurs totalement exclus étant les affaires de défense et la politique extérieure. 1. Le statut constitutionnel et les compétences de l'Écosse L'Écosse a toujours conservé des responsabilités particulières dans trois domaines autour desquels s'est centrée son identité politique durant près de trois siècles : l'Église, l'éducation et la justice (316). Le pays a toujours bénéficié d'une reconnaissance de son statut privilégié au sein de l'ensemble britannique. En témoignait la surreprésentation des Écossais dans l'administration coloniale britannique. Par ailleurs, l'Écosse avait conservé un système d'administration locale, un mouvement syndical distinct, un milieu financier et d'affaires, une presse, un secteur audiovisuel et d'autres organisations et groupes de pression qui ont une orientation spécifiquement écossaise. Des éléments d'autonomie ont été mis en place de loin en loin. Ainsi, furent créés, en 1965, le Conseil de développement des Hautes-Terres et des Îles (317), et, en 1975, l'Agence de développement écossaise (318), tandis que la quasi-totalité de l'Écosse fut classée dès 1967 en « zone de développement ». Comme en France, la planification du développement économique fut à l'origine d'une institutionnalisation d'une collectivité de niveau régional. Mais la centralisation des années 1980 a réveillé les prétentions autonomistes. Comme en Espagne, le débat institutionnel a porté sur l'étendue des changements nécessaire pour contrer l'influence des nationalistes. Ce débat a été particulièrement aigu en Écosse qui accueillait un dixième de la population britannique et disposait d'une économie qui a longtemps accusé un sérieux retard sur celle de l'Angleterre. En 1989, fut créée une Convention constitutionnelle écossaise, regroupant des membres du Parti travailliste, du Parti libéral démocrate, du Parti des verts et de la gauche démocratique, tandis que le Parti national écossais préférait travailler à son propre programme. Le gouvernement travailliste reprit les propositions de la Convention constitutionnelle dans son Livre blanc sur la dévolution, publié en juillet 1997, prévoyant notamment un référendum sur deux questions, la création d'un Parlement écossais et l'attribution à ce Parlement du pouvoir de faire varier l'impôt. Adopté à la suite du double référendum de septembre 1997 sur la création d'un Parlement écossais et sur le pouvoir fiscal du Parlement écossais (319), le Scotland Act qui recueillit l'assentiment royal en novembre 1998 organise la dévolution écossaise. C'est sur ce fondement que le Parlement écossais a été élu en 1999 et renouvelé en mai 2003. Le Scotland Act s'inscrit dans la tradition historique d'une Écosse ayant eu son propre Parlement jusqu'en 1707, date à laquelle celui-ci a été transféré à Londres, par l'Acte d'Union (Union Act). Toutefois il ne s'agit pas d'un retour à la situation antérieure, non seulement parce que le nouveau Parlement ne dispose pas de compétences aussi étendues que celles de son lointain prédécesseur, mais surtout parce qu'il se trouve en position subordonnée par rapport à Londres, le Scotland Act n'ayant pas remis en question l'Acte d'Union. L'équilibre institutionnel entre l'Écosse et le Royaume-Uni est incarné dans une répartition des compétences définie de façon détaillée par une annexe du Scotland Act. Le Parlement britannique de Westminster a conservé des compétences générales en matière de défense, de politique étrangère, d'immigration et de nationalité et de constitution du Royaume Uni. En revanche, les compétences sont partagées en matière d'énergie − le pétrole de la Mer du Nord et l'énergie nucléaire relevant néanmoins du domaine de Londres, ce qui provoque de nombreux débats −, de même en ce qui concerne les transports, la police, les questions économiques et financières, la santé, la législation sur l'emploi et les communications. Les compétences qui reviennent à l'Écosse sont définies de façon résiduelle : le Parlement écossais de Holyrood peut légiférer sur tout ce qui n'est pas expressément réservé à Londres. Dans la pratique, les compétences dévolues portent sur le développement économique, les transports, l'agriculture et la pêche, le logement, les services de santé, l'éducation et la formation, la justice, la culture et le sport, l'environnement et les collectivités locales. La plupart des grandes agences civiles, compétentes en matière de statistiques, d'archives et d'état civil, sont dévolues. Inversement, la dévolution n'interdit pas au Parlement du Royaume-Uni de légiférer sur l'Écosse même dans les matières transférées dans la compétence matérielle du Parlement écossais en vertu de l'article « s. 28 (7) » du Scotland Act de 1998.
Le Parlement de Holyrood est composé de 129 membres élus pour quatre ans, dont 73 élus à la majorité simple et 56 à la représentation proportionnelle, ce qui constitue une originalité par rapport au mode de scrutin en vigueur pour les élections à Westminster. Il dispose d'un véritable pouvoir législatif, à l'intérieur des compétences qui lui ont été dévolues. Il se prononce sur toute question relevant des compétences dévolues. Les décisions prises à Londres et qui sont susceptibles de porter sur des questions en partie dévolues sont soumises à son examen. De même, le Parlement est responsable de la transposition dans l'ordre juridique interne des accords internationaux portant sur des questions dévolues. En outre, il s'estime compétent pour débattre de toute question, même réservée à Londres, dès lors qu'il considère que celle-ci intéresse l'Écosse. À ce titre, plusieurs débats ont eu lieu sur l'Iraq en 2003 ou, en 2004, sur le projet de réorganisation profonde des régiments écossais dans le cadre du plan « Hoon ». Les textes adoptés par le Parlement sous forme de Bills sont transmis au secrétaire d'État à l'Écosse qui vérifie leur conformité aux dispositions du Scotland Act et peut les contester. Ils sont ensuite présentés à la signature de la Reine ; ils deviennent alors des Acts et ont valeur exécutoire. Il n'y a pas eu, à ce jour, de contestation de textes adoptés par le Parlement, les processus de consultation préalable avec les services de la Couronne et au sein du Parti travailliste, en charge des affaires à Londres comme à Édimbourg depuis 1999, ayant un caractère préventif indéniable. La responsabilité de toutes les matières dévolues est passée en 1999 du Scottish Office et des autres ministères britanniques à l'Exécutif écossais (Scottish Executive), le Scotland Act évitant le terme de « gouvernement ». En pratique, les membres de l'Exécutif écossais sont issus du ou des partis ayant une majorité de sièges au Parlement. Après les élections de 2003, le chef du Parti travailliste écossais (Scottish Labour Party) et le chef du Parti libéral démocrate écossais (Scottish Liberal Democrat Party) se sont mis d'accord pour former un gouvernement de coalition. L'Exécutif écossais est dirigé par un First Minister, le terme de Prime Minister étant réservé au Royaume-Uni. C'est lui qui détermine le nombre de ministres écossais et leurs responsabilités ou portefeuilles. Le Lord Advocate et le Solicitor General forment les Law Officers, qui conseillent l'Exécutif écossais sur les questions juridiques et défendent ses intérêts devant les tribunaux. L'Écosse est représentée au Parlement de Westminster par cinquante-neuf députés au lieu de soixante-douze dans le Parlement précédent. Les parlementaires écossais prennent part à l'ensemble des débats à Westminster, même lorsque les questions abordées ne concernent pas spécifiquement l'Écosse. Le vote de parlementaires écossais a permis notamment l'adoption de la loi sur les services de santé. Cette situation dans laquelle les élus travaillistes écossais peuvent être amenés à voter pour une politique que leur parti rejette en Écosse est de plus en plus critiquée. Enfin, l'Écosse est spécifiquement représentée au Parlement Européen par sept parlementaires sur un total de soixante-dix-huit pour le Royaume-Uni. 2. L'organisation et les compétences des collectivités locales L'Écosse a une longue histoire d'administration locale. Des réformes structurelles ont été entreprises en 1929, 1975 et 1995. Avant la dévolution, toutes les instances locales importantes étaient contrôlées par le Scottish Office à Édimbourg. Les responsabilités des collectivités locales étaient généralement définies par des textes de loi dont le contenu était déterminé sur son avis voire directement par lui. Le gouvernement britannique, dans les années 1980, accrut considérablement la mainmise du gouvernement central sur les collectivités locales, qui durent privatiser nombre de leurs activités : immobilier, cantines scolaires, nettoyage des bâtiments publics, projets d'architecture, projets financiers, services du personnel, services juridiques... C'est la mainmise croissante du gouvernement central sur les finances qui a représenté la plus grande force centralisatrice : au milieu des années 1990, les collectivités locales couvraient seulement 15 % de leurs dépenses par des impôts locaux. Le Scottish Office contrôlait de près les rentrées, le niveau des dépenses et même le détail de la gestion financière de certains services publics. Entre 1975 et 1995, le système d'administration locale comptait trois types de conseils élus : des conseils polyvalents « all-purpose » dans les trois communautés des îles de Shetland, Orkney et des îles de l'Ouest, neuf grands et puissants conseils régionaux responsables des « services stratégiques » comme l'éducation, les services sociaux, l'aménagement du territoire et les routes, et les cinquante-trois conseils de districts, responsables des services locaux comme le logement, la collecte des ordures, les bibliothèques, les activités de loisirs et l'aménagement. Dès 1995, l'administration locale écossaise fut réformée par le gouvernement conservateur, dans le sens d'une simplification. Les collectivités locales ou councils ont été réduits de 65 à 32 (320), dont 4 représentent les villes les plus importantes, à savoir Édimbourg, Glasgow, Aberdeen et Dundee. La réforme de 1995 a modifié les attributions des 1 222 conseillers, élus pour quatre ans. Chaque conseil élit un président, dénommé Provost ou Convenor, afin de présider ses séances et représenter le comté. Dans les quatre villes précitées, le président est appelé Lord Provost et cumule ses fonctions avec celle de Lord Lieutenant, c'est-à-dire de représentant de la Couronne. Chaque conseil possède par ailleurs un directeur exécutif, élu en son sein, tandis que certains conseillers disposent également d'une autorité exécutive. Le conseil assure les fonctions exécutive et délibérative. Il n'existe pas de division claire du pouvoir. La supervision de l'approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées, l'évaluation des biens, la protection des enfants maltraités ont été confiées à des corps non élus tandis que de nouvelles fonctions, telles que l'organisation de l'aide à l'enfance et le développement économiques, leur ont été confiées. L'éducation absorbe 40 % de leurs recettes. Avant la dévolution, les councils étaient les seules institutions véritablement représentatives de l'Écosse. Ils ont gardé de cette époque un poids politique incontestable. Toutefois, ces structures ont vieilli et leur efficacité est mise en question. Élus au scrutin majoritaire, les councils sont largement dominés par les Travaillistes. Les collectivités locales jouent cependant aujourd'hui un rôle important, car elles sont chargées de la mise en œuvre des décisions de l'Exécutif écossais. Une commission indépendante, dirigée par un ancien président de conseil régional, Neil McIntosh, a été mise en place en 1998 afin d'optimiser les relations entre collectivités locales et Parlement. Le gouvernement travailliste du Royaume-Uni a souhaité engager deux réformes de gestion : l'élection des maires au suffrage direct, au moins dans les grandes villes, et l'organisation d'une administration locale comprenant un cabinet. Traditionnellement, le processus décisionnel dans les collectivités locales passe par des commissions spécialisées. Dans nombre de conseils écossais, des modifications ont déjà été apportées à ce système pour décentraliser leurs activités grâce à la mise en place de commissions de zones, mieux placées pour prendre les décisions nécessaires localement. La commission « McIntosh » a encouragé cette évolution dans le sens d'une plus grande diversification des modes d'intervention des autorités locales (321). En 2003, la loi sur le gouvernement local en Écosse (322) a reconnu aux autorités locales le pouvoir d'agir dans tous les domaines dès lors que cette action promeut ou améliore le bien-être des citoyens dans leur aire géographique, traduction d'une clause de compétence générale. Cette clause est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Mais avec l'avènement d'un Parlement écossais, comme le rapporteur a pu le constater à l'occasion des entretiens qu'il a eus avec des autorités locales, est montée l'inquiétude d'une centralisation plus proche et donc plus sensible, le pouvoir de Londres étant considéré comme plus lointain et donc moins nocif. Une crainte identique a pu être constatée par le rapporteur parmi les autorités locales italiennes à l'égard des régions ou espagnoles à l'égard des communautés autonomes. 3. Le financement de l'Écosse et des collectivités locales L'Écosse n'a pas de pouvoir en matière fiscale à l'exception de la « tartan tax » (323) qui lui permet de dégager des ressources supplémentaires à l'intérieur d'une marge de 3 %. Le budget est alimenté par un versement global de Londres selon la formule dite « formule Barnett » (Barnett formula) calculée sur la base de la proportion théorique des dépenses de l'Écosse dans le total britannique. L'Exécutif écossais procure une part importante des ressources des collectivités locales. Ainsi, en Écosse, comme en Allemagne et en Belgique, le financement des autorités locales, donc la péréquation, relève des pouvoirs régionaux. Le même débat qu'en Espagne ou en Italie domine la question locale en Écosse. Nombreux sont ceux à souhaiter que les collectivités locales lèvent une plus grande proportion de leurs ressources, grâce, notamment, à la réattribution de la taxe professionnelle, à l'introduction d'une taxe sur le tourisme, d'une taxe à l'achat, de péages sur les routes. 4. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État Pendant longtemps, les affaires de l'Écosse ont été gérées, dans le cadre du système britannique, par le Scottish Office, créé en 1885 et dirigé par le ministre de l'Écosse, le Scottish Secretary of State, lequel était membre du cabinet depuis 1926. L'État britannique n'est presque plus présent en Écosse aujourd'hui. Tout juste a-t-il maintenu une cinquantaine d'agents, regroupés, depuis 1999, au sein du Scotland Office (324), qui fait partie administrativement du ministère des affaires constitutionnelles et qui dépend politiquement du ministre britannique des transports et des affaires écossaises. Le bon fonctionnement de la dévolution repose essentiellement sur une relation de travail harmonieuse avec Londres, relation qui passe par le truchement de deux institutions. La première, déjà évoquée, est le secrétaire d'État à l'Écosse. Voix de l'Écosse dans le cabinet britannique, il a, en outre, pour mission de vérifier la régularité de la législation écossaise au regard du Scotland Act, comme on l'a vu supra. Le poste a toutefois baissé de profil en 2003, avec son rattachement à un ministre déjà titulaire d'un autre portefeuille et la quasi-fermeture de ses bureaux à Édimbourg. La commission ministérielle commune ou Joint Ministerial Committee, joue un rôle essentiel. Elle réunit régulièrement à Londres les représentants des deux administrations pour évoquer des sujets d'intérêt commun. Ces réunions peuvent donner lieu à la signature d'accords informels qualifiés de « concordats » (Memorandums of Understanding) entre l'administration britannique (Whitehall) et les différents services de l'Exécutif écossais. En outre, en vertu du Scotland Act de 1998, en cas de doute sur le partage de compétences entre les institutions britanniques et les institutions écossaises, le Judicial Committee of the Privy Council, qui est l'une des plus hautes juridictions judiciaires britanniques, pouvait être saisi sur tout projet de loi. Les compétences de cette juridiction en matière de dévolution ont été transférées à la nouvelle Cour suprême du Royaume-Uni, créée par la loi sur la réforme constitutionnelle de 2005 (325). Dans les faits, il est très peu fait recours à ces instruments « judiciaires », les conflits étant désamorcés par la négociation de manière préventive au sein des organes administratifs et du parti majoritaire. En l'état actuel des choses, la dévolution a permis, de manière indéniable, une modernisation du pouvoir à Édimbourg et du rapport avec Londres. Aucun des interlocuteurs du rapporteur n'a émis de véritables doutes sur les potentialités du nouveau système et des incontestables progrès dans la vie politique écossaise que les nouvelles institutions ont apportés. Mais il est vrai que la présence d'équipes politiques de même sensibilité dans les deux capitales, comme le rapporteur a pu le constater mutatis mutandis en Andalousie, est un atout essentiel. Elle facilite la concertation permanente. IV. - UNE DÉCENTRALISATION RETENUE : LA SUÈDE Contrairement aux pays étudiés supra, le niveau de population de la Suède, réduite à 9 millions d'habitants, n'est pas comparable à la population française. Cependant, le rapporteur a souhaité apporter un éclairage particulier sur la problématique suédoise, qui, au-delà d'une très intéressante politique d'expérimentation territoriale (326), est caractérisée par une réforme de l'État très avancée - ayant fait le choix d'une déconcentration plus fonctionnelle que géographique -, mais aussi par une décentralisation ancienne quoique plus timide. 1. Le statut constitutionnel et le régime juridique des collectivités locales La Suède est un État unitaire ayant une longue tradition de forte participation des collectivités locales dans les affaires publiques. Le gouvernement local joue un rôle important dans le système de l'État-providence puisqu'il est chargé de fournir nombre de services publics aux citoyens. Ainsi, en Suède, les collectivités locales bénéficient depuis de nombreuses années d'une large autonomie. En effet, dès 1862, les ordonnances sur le gouvernement local organisent cette autonomie, d'une part, en transférant les compétences séculières de l'église luthérienne de Suède aux municipalités, d'autre part, en créant une nouvelle collectivité territoriale de taille intermédiaire, le comté (län). L'autonomie des collectivités locales et régionales en Suède est importante en droit. Elle l'est moins en pratique. Pourtant, l'autonomie du gouvernement local a connu de véritables progrès dans les années 1990, après que le pays a, dès 1989, signé et ratifié la Charte européenne de l'autonomie locale. La Constitution de 1974 prévoit l'existence des collectivités locales ainsi que le droit de lever des impôts pour financer leurs activités. Elle offre ainsi des garanties constitutionnelles aux collectivités locales et régionales, mais ne prévoit cependant pas la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales. Elle en confie le soin au législateur. L'article 1er du chapitre Ier de la Constitution prévoit que les municipalités et conseils de comté jouissent d'un statut spécial et indépendant dans leurs rapports avec l'État parce qu'ils s'acquittent de leurs tâches selon le principe de l'autonomie locale. Il dispose ainsi qu'« en Suède, la souveraineté émane du peuple. La souveraineté nationale suédoise repose sur la liberté d'opinion et sur le suffrage universel et égalitaire. Elle se réalise par un régime constitutionnel représentatif et parlementaire et par une gestion autonome des collectivités territoriales. » L'article 7 précise que « le Royaume comprendra des entités de gestion locale primaires (municipalités) et des conseils de comté. Le pouvoir de décision y sera exercé par des assemblées élues. Les municipalités et les conseils de comté pourront prélever des impôts pour l'exercice de leurs attributions. » En outre, l'article 5 du chapitre VIII dispose que les « principes des modifications de la subdivision du pays en collectivités locales, ainsi que les principes de leur organisation administrative, de leurs modes d'action et de leur fiscalité sont fixés par la loi ». La commission sur la Constitution du Parlement (Riksdag) est chargée d'évaluer la conformité de tout projet de loi avec le principe constitutionnel en question. Les municipalités et les conseils de comté sont régis par la loi de 1991 sur les pouvoirs locaux, entrée en vigueur en 1992. Un premier chapitre définit les municipalités et les conseils de comté et fixe leurs compétences respectives. Le deuxième chapitre concerne les pouvoirs des municipalités et des conseils de comté. Le principe de l'autonomie locale est ainsi repris dans l'article 1er du chapitre II de la loi sur les pouvoirs locaux, intitulé « Pouvoirs généraux » : « Les communes et les comtés gèrent eux-mêmes les affaires d'intérêt général qui sont de leur ressort pour autant qu'elles ne sont pas de la compétence exclusive de l'État, d'une autre collectivité locale ou d'une autre instance ». Les municipalités et les conseils de comté jouissent ainsi d'un pouvoir de décision général pour les questions d'intérêt public qui concernent les circonscriptions où ils sont compétents ou les personnes qui y résident. En fait, c'est la jurisprudence qui détermine s'ils ont le droit d'intervenir dans un domaine donné. Le troisième chapitre de la loi de 1991 porte sur leur organisation, le quatrième sur leurs élus, le cinquième sur les conseils municipaux et le sixième sur les commissions exécutives municipales, ainsi que sur les comités des collectivités locales. Le chapitre VII traite du système de co-décision au sein d'organes réunissant les parties concernées et de la question de la représentation du personnel, tandis que le chapitre VIII porte sur la gestion financière et le chapitre IX sur les contrôles financiers. Le dernier chapitre de la loi est consacré aux examens portant sur la légalité des décisions. La notion de compétence générale des collectivités est inscrite de manière plus explicite dans la législation qu'elle ne l'était auparavant, alors même que ce principe appartient plutôt à la tradition des pays de l'Europe du Sud. Par ailleurs, rien n'interdit à l'État d'attribuer par une loi spécifique des compétences déterminées aux communes et aux comtés. In fine, la plus grande partie des activités locales est désormais régie par de telles lois. 2. La structure et l'organisation des collectivités locales Le pays compte, à la base, seulement 290 municipalités (kommuner) (327) et, à l'échelon intermédiaire, 20 conseils de comtés (landstingen) - 21 si on tient compte du fait que l'île de Gotland est également une commune. Parmi ces 21 comtés, se trouvent 2 régions issues de la fusion de comtés, la région de Scanie (Skåne) et la région de Västra Götland. Un projet pilote, initié par deux lois du 12 décembre 1996 (328), couvrant la période 1997-2002 a organisé la réunion des comtés de Malmöhus et Kristianstad dans une entité unique (329), la Scanie, ainsi que la réunion des comtés de Bohusland et de Västergötland dans une autre entité unique (330), le Västra Götland. Ces deux régions, outre les compétences des comtés, mettent en œuvre le plan de développement régional en lieu et place de l'État central, exercent la responsabilité de la circulation routière, de certaines infrastructures de développement local et soutiennent par des subventions les activités culturelles régionales. Les régions sont gérées par les conseils de comté qui coïncident en général avec les limites des comtés. En 2000, leur évaluation a montré que l'État devrait donner la possibilité au reste de la Suède de choisir de s'emparer des compétences de développement économique. Mais, le gouvernement a sans doute estimé que ces deux régions devenaient trop puissantes. Le Parlement a donc décidé de maintenir l'expérience et de favoriser, par ailleurs, la diffusion des conseils de développement régional. La loi sur les organisations de coopération au sein des comtés (331) a ainsi introduit la possibilité pour les communes d'un comté comme pour un conseil de comté de créer des organismes de coopération qui peuvent assumer les tâches de développement régional normalement réservées aux préfectures. Ainsi, ces dernières années, on a assisté à la création de conseils régionaux de coopération (regionala samverkansorgan) qui sont élus au suffrage indirect et dont les membres sont issus des conseils de comté et municipaux. La moitié des comtés se sont dotés cependant aujourd'hui d'une telle structure. C'est une structure très réduite par rapport aux conseils de comté et aux communes. Elle n'a pas d'activité à destination directe des citoyens. Elle s'occupe de planification et du financement de certaines activités. Par exemple, dans le comté de l'Östergötland, dans lequel s'est rendu le rapporteur, le conseil régional de coopération est un organisme avec une représentation politique structurée comme une municipalité avec une assemblée qui désigne une commission exécutive. Cette assemblée est composée de cinquante-cinq membres. Lorsque le conseil a été créé, ses membres ont déterminé ses activités, qui relevaient soit des missions confiées par l'État aux préfectures et inscrites dans la loi, soit d'une volonté expresse des membres du conseil. Ces missions sont : la programmation du développement régional, la programmation pour la croissance économique, la création d'infrastructures de transport et de communication. Le conseil régional exerce également des activités de formation, d'animation de la vie industrielle et de la vie culturelle. Dans le domaine de l'éducation, l'enseignement à destination des jeunes relève de la commune, l'université de l'État. Le conseil régional souhaite coordonner certaines actions et promouvoir certaines formations, notamment dans certaines professions qualifiées où il existe des pénuries. Le conseil passe des conventions qui permettent par exemple à un jeune, qui ne trouve pas de place pour la formation qu'il souhaite suivre dans sa commune, d'en trouver une dans une autre commune. Dans le domaine industriel, le conseil a créé une structure de conseil et d'appui aux petites et moyennes entreprises. S'y ajoutent des projets pour promouvoir le développement et des entreprises, notamment des entreprises innovantes. Dans le champ des transports et des communications, le plus important est de promouvoir les transports en commun dans le comté. Il s'agit notamment de relier les différentes communes et les deux grands centres urbains. Il s'agit également d'assurer une fluidité des liens avec Stockholm, condition du développement de la région. En matière de culture, le conseil régional finance un orchestre symphonique et des musées. Enfin, il convient de mentionner deux autres activités qui tendent à prendre de l'importance, le développement rural d'une part, qui doit assurer un équilibre entre villes et campagnes, et l'internationalisation d'autre part. Ce sont les municipalités et le conseil de comté qui financent le conseil de développement régional. S'y ajoutent des enveloppes spécifiques du conseil de comté pour les opérations culturelles. Bon nombre de Suédois ne comprennent pas les structures de ces institutions et se demandent qui fait quoi. Il faut se demander aujourd'hui si le conseil de développement régional est une structure passagère ou bien l'amorce d'une nouvelle institution qui s'inscrit dans un processus de plus grande régionalisation. En effet, le débat suédois est concentré aujourd'hui sur les régions, à la fois dans leur dimension géographique et dans leur dimension fonctionnelle. Il reste cependant peu clair. Est parfois appelé région un comté qui a l'intention d'attirer à lui des compétences de l'État, mais sa superficie reste la même. L'expansion des pouvoirs régionaux répond à l'exigence d'accorder un droit de regard plus grand aux citoyens sur les décisions qui les concernent. Mais il existe une autre carte, une carte administrative, pour les routes nationales, pour la perception des impôts, pour les caisses de sécurité sociale. Depuis quinze ans, l'État a déconcentré certains de ses services dans un souci d'efficacité sans pour autant que le périmètre de cette déconcentration corresponde aux limites des municipalités et des comtés. b) Les comtés et conseils de comté Les comtés (län) constituent essentiellement une subdivision administrative du gouvernement central au niveau territorial que l'on pourrait rapprocher de nos départements. Parmi les 21 comtés, 20 sont dotés de conseil (Lanstinget). Dans le comté du Gotland, le rôle de conseil de comté est tenu par le conseil communal. Trois municipalités ne sont cependant pas liées aux conseils de comté (Göteborg, Malmö et Gotland) et il est un comté qui englobe deux conseils de comté. L'organe délibérant du comté est l'assemblée du conseil de comté Le nombre des membres des assemblées est fixé par l'article premier du chapitre V de la loi sur les pouvoirs locaux. Le nombre minimum de ces membres est fonction du nombre d'habitants ayant le droit de vote dans la commune ou au conseil de comté. Ce nombre, toujours impair, ne doit pas être inférieur à 31 membres dans les conseils de comté comptant au plus 140 000 électeurs, à 51 membres dans les conseils de comté comptant de 140 001 à 200 000 électeurs, et à 71 membres dans les conseils de comté comptant plus de 200 000 électeurs. Dans les conseils de comté comptant plus de 300 000 habitants titulaires du droit de vote, le nombre des membres est au moins égal à 101. Le comté le plus important est celui de Stockholm, qui compte 1,8 million d'habitants. Les membres des assemblées, comtales comme municipales, sont élus le même jour à l'occasion des élections locales, qui se tiennent tous les quatre ans en même temps que les élections au Parlement. Les élections locales se déroulent sur la base d'un scrutin de listes qui permet, depuis 1998, à un électeur d'exprimer sa préférence pour un candidat au sein d'une liste. Les taux de participation, s'ils sont en baisse régulière, restent très élevés, entre 78 et 90 %. Le mandat des élus débute le 1er novembre de l'année où se sont tenues les élections. Le pouvoir exécutif appartient à la commission exécutive du conseil de comté (Länsstyrelse), chargée de contrôler l'administration, de surveiller les activités des comités dotés de certains pouvoirs exécutifs que l'assemblée a créés, de préparer le budget, de gérer les biens du conseil de comté. Elle prépare également toutes les décisions de l'assemblée. Les compétences des assemblées couvrent les questions de principe ou d'importance majeure pour la municipalité ou le conseil de comté. Elles décident notamment des objectifs et des grandes orientations pour ses activités, du budget, de la fiscalité et d'autres questions financières importantes, de l'organisation des comités et des procédures en place en leur sein, de l'élection des membres des comités et des comités de rédaction, de l'élection des commissaires aux comptes et de leurs remplaçants, des indemnités de base allouées aux élus et du rapport annuel et du quitus. L'assemblée peut charger un comité de prendre des décisions sur un point ou groupe de points particuliers, en lieu et place du conseil. Les questions énumérées ci-dessus ou qui doivent, légalement ou réglementairement, être tranchées par le conseil ne peuvent cependant être déléguées aux comités. Les commissions exécutives sont nommées par les assemblées, parmi les personnes disposant du droit de vote et de se présenter aux élections. Sous réserve des conditions énoncées dans l'article 2 de la loi sur la représentation proportionnelle, cette élection doit être tenue à la proportionnelle sauf si les partis politiques en décident autrement. Il est extrêmement fréquent que les partis s'entendent sur la répartition des sièges. Le nombre de membres ne peut être inférieur à cinq et s'élève en moyenne entre onze et dix-sept. Les compétences des comités constitués au sein des commissions exécutives couvrent les problèmes de gestion, ainsi que les matières dont ils ont légalement ou réglementairement la charge. Les comités règlent par ailleurs les questions que leur défèrent les assemblées. Ils préparent le travail des assemblées et sont chargés de donner effet aux décisions des conseils. Ils sont responsables devant les assemblées des mesures qu'ils ont prises pour faire assurer l'exécution des tâches que celles-ci leur ont confiées. Le responsable du conseil de comté est le président de la commission exécutive du conseil. Il est nommé par la commission exécutive du conseil de comté. Il n'exerce aucune fonction au nom de l'État. Son pouvoir décisionnel est limité. En effet, les décisions sont pour la plupart prises collectivement par les commissions. Comme a pu le relever le rapporteur, à l'exception du sud de la Suède, l'identité comtale est peu marquée au sein de la population. Le niveau du comté perd donc progressivement de son dynamisme au profit des communes et de l'État. L'organisation des pouvoirs au sein des 290 communes est similaire à celle qui existe au sein des comtés. L'organe délibérant de la municipalité est l'assemblée municipale. Le nombre des membres des assemblées municipales est également fixé par l'article premier du chapitre V de la loi sur les pouvoirs locaux. Le nombre minimum de ces membres est également fonction du nombre d'habitants ayant le droit de vote dans la commune considérée. Ce nombre ne doit pas être inférieur à 31 membres dans les communes ne comptant pas plus de 12 000 électeurs, à 41 membres dans les communes comptant entre 12 001 et 24 000 électeurs, 51 membres dans les communes comptant entre 24 001 et 36 000 électeurs, à 61 membres dans les communes comptant plus de 36 000 électeurs. Dans les municipalités de plus de 300 000, le nombre de membres est supérieur à 101, comme à Stockholm, qui compte 758 000 habitants et Göteborg qui en possède 475 000. Comme pour les élections aux conseils de comtés, les taux de participation, s'ils ont tendance à diminuer, restent très élevés, entre 78 et 90 %. L'organe exécutif est la commission exécutive municipale. Divers comités élaborent des projets de propositions soumis à la décision du conseil municipal et exécutent d'autres tâches dans leurs sphères de compétences respectives. Ils jouissent également, dans certains cas, d'un pouvoir décisionnel. Les commissions exécutives des municipalités et des conseils de comté peuvent décider, au stade préparatoire de leurs travaux, de soumettre une question à référendum. La question de la tenue d'un référendum sur un sujet particulier peut aussi être soulevée dans l'assemblée par au moins cinq pour cent des membres de la commune ou du conseil de comté titulaires du droit de vote. Cette initiative, qui revêt la forme écrite, indique la question posée, le nom, l'adresse et la signature (manuscrite et dactylographiée) de ses promoteurs. Les référendums municipaux sont seulement consultatifs. Ces consultations peuvent même porter sur les questions financières et l'administration de la commune. L'organisation demeure, comme aux Pays-Bas, une compétence du conseil municipal. Le responsable de la municipalité est le président de la commission exécutive municipale. Il est nommé par le conseil municipal. Les présidents des commissions précitées n'exercent pas de fonctions au nom de l'État. Selon une disposition de la loi sur les pouvoirs locaux, les comités doivent s'efforcer de promouvoir des consultations avec les usagers de leurs services. Ils peuvent déléguer la prise de décision à un employé de la commune. Dans ce cas, le comité peut définir les conditions stipulant que les personnes qui utilisent les services du comité doivent avoir la possibilité de présenter des propositions ou de formuler des commentaires avant que la décision ne soit prise. Le comité peut également prescrire qu'un employé ne peut prendre une décision que si celle-ci a été soutenue par des représentants des usagers des services du comité. Par ailleurs, depuis 1980, les communes peuvent mettre en place un système décentralisé de comités ou conseils de district, chacun étant responsable d'un nombre limité de compétences sur une portion limitée du territoire de la commune. d) La coopération entre collectivités locales Selon un phénomène constaté dans tous les pays étudiés par le rapporteur, les besoins de coopération entre collectivités locales de tous les niveaux se font de plus en plus sentir. En Suède, ce besoin existe entre les communes, entre les comtés, mais aussi entre les communes et les comtés. De nombreuses formules sont mises en œuvre. Les collectivités locales disposent d'une grande latitude pour décider par elles-mêmes des modalités de leur coopération. En premier lieu, les municipalités et conseils de comté sont, jusqu'à un certain point, libres de conclure des accords de coopération sans créer d'entreprises ou fédérations en bonne et due forme. Ils sont ainsi libres de contracter sur le fondement d'un contrat de droit commun. En deuxième lieu, communes et conseils de comté peuvent choisir d'aller plus loin en créant des fédérations locales ou régionales de collectivités locales. Celles-ci ont le statut d'autorités officielles. Il est permis à ces fédérations de traiter exactement les mêmes affaires que celles dont une municipalité ou un conseil de comté peut ou doit connaître en vertu de la loi. Les compétences qui leur sont déléguées incluent l'exercice de l'autorité consistant à prendre des décisions qui touchent les droits et obligations des individus et des entreprises intervenant dans le secteur concerné. Ces fédérations sont régies par la loi sur les fédérations de collectivités locales. Plus de quatre-vingts de ces fédérations ont été créées. Elles œuvrent, par exemple, dans l'enseignement secondaire et les services de sauvetage et d'urgence. En troisième lieu, les municipalités et conseils de comté peuvent former un bureau conjoint chargé de gérer des structures telles que des écoles secondaires complémentaires ou des centres de santé. Plus d'une vingtaine de ces structures ont été mises en place. La loi sur les comités conjoints dans le domaine de la santé a favorisé ce mouvement. En quatrième lieu, en vertu de l'article 16 du chapitre III de la loi sur les pouvoirs locaux, les municipalités et conseils de comté sont libres de déléguer à une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, une association enregistrée sous forme de société, une association sans but lucratif, une fondation ou une personne privée la gestion d'une entreprise appartenant à une collectivité locale et dont la gestion n'est soumise à aucune procédure particulière. Cependant, l'exercice de l'autorité ne peut être délégué. Les relations existant entre les associés des entreprises sont similaires à celles qui unissent les propriétaires d'une entreprise privée. Il existe environ 1 600 entreprises ou fondations de ce type. Beaucoup opèrent dans un secteur technique, comme le logement, l'eau et l'électricité. La plupart de ces structures revêtent la forme de sociétés à responsabilité limitée. Les entreprises municipales doivent se conformer à la réglementation de droit commun sur les entreprises, à l'exception du régime de leurs documents qui sont soumis à publicité contrairement à ceux d'une entreprise privée. Enfin, le rapporteur relève que les deux associations représentant les communes et les comtés, l'Association suédoise des autorités locales et la Fédération des conseils des comtés, qui offrent de très nombreux services à leurs adhérents, ont décidé en mai 2003, de se réunir au sein d'une structure unique dénommée Association suédoise des autorités locales et des régions qui doit se mettre en place en 2007. 3. Les compétences des collectivités locales Au-delà des compétences réservées à l'État, les collectivités locales exercent deux types de compétences : des compétences générales attribuées par la loi sur le gouvernement local, des compétences spécialisées déterminées par des lois spécifiques. a) Les compétences réservées de l'État Les administrations centrales sont directement responsables dans les matières suivantes : politique étrangère et défense, sécurité intérieure et ordre public, justice, politique économique, éducation supérieure et recherche, infrastructures de transport de longue distance et communications, politique de l'emploi, politique du logement, politique de redistribution. À ce propos, le rapporteur relève que le gouvernement suédois est historiquement caractérisé par une importante séparation entre pouvoir central (le gouvernement, les ministères et le Parlement) et le pouvoir administratif (les agences). L'administration centrale se compose ainsi d'une dizaine de ministères responsables de l'élaboration des politiques et de quelque 270 agences chargées de la mise en œuvre de programmes et bénéficiant généralement d'une très grande latitude. Les ministères emploient moins de 4 000 personnes (430 personnes au ministère des finances, 380 au ministère de l'industrie), les agences plus de 230 000. La distribution des compétences entre communes et comtés se fait sur le principe selon lequel les tâches qui requièrent une base démographique plus importante pour être correctement effectuées sont confiées aux comtés. Ainsi, les comtés sont principalement compétents en matière de santé - y compris de santé dentaire -, de culture et d'aménagement du territoire. Ils ont la responsabilité générale du système de santé dans leur ressort territorial, tant en matière de prévention qu'en matière de soins. Ils sont chargés de la formation des personnels de santé, à l'exclusion des médecins et des dentistes. Il existe peu d'hôpitaux privés. Ce sont donc les comtés qui sont responsables de l'essentiel des établissements hospitaliers. Ils financent et gèrent également les centres de santé installés dans les districts et ouverts à tous les patients qui n'ont pas besoin d'hospitalisation. Dans le domaine culturel, leur action est surtout dirigée vers les activités musicales et théâtrales. Ils jouent un rôle croissant en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, notamment par le biais des subventions qu'ils versent aux entreprises locales. Leur responsabilité en matière de transports publics régionaux est exercée le plus souvent dans le cadre d'une société commune créée avec les municipalités concernées. c) Les compétences des communes Les attributions des municipalités, qui sont les entités administratives de base aux termes de la loi de 1991, exercent toutes les responsabilités qui ne relèvent pas, sur la base d'un texte spécifique d'une autre entité administrative. Cette compétence générale est fixée la loi sur les pouvoirs locaux. Découle, par exemple, de cette compétence générale la responsabilité communale en matière de voirie urbaine et d'adduction d'eau, de production et de distribution d'énergie ou encore en matière d'affaires culturelles et d'équipements de loisir. C'est également sur ce fondement général que les communes ont exercé, dans les années récentes, une responsabilité de plus en plus grande dans l'accueil des réfugiés en échange d'une compensation spéciale versée par l'État. Mais la compétence des communes peut aussi, comme on l'a vu, être précisée par des lois spéciales. C'est notamment le cas pour les dispositions concernant les responsabilités des municipalités en matière d'enseignement, de services sociaux, de construction et de planification ou d'environnement. Elles assurent aussi sur cette base des responsabilités en matière de protection civile, de prise en charges des personnes âgées et handicapées, de ramassage des ordures. Enfin, les municipalités peuvent offrir un soutien aux entreprises implantées sur son territoire par des aides indirectes, telles que des offres de formation et d'emplois temporaires. Parmi toutes ces responsabilités, les compétences les plus importantes sont sans doute assumées dans le domaine l'enseignement. Près d'1,8 million d'enfants sont pris en charge par les systèmes communaux d'enseignement, qui intègre le cycle préscolaire entre un an et six ans, l'enseignement primaire et secondaire obligatoire pour les enfants âgés entre sept et seize ans, l'enseignement secondaire complémentaire fréquenté par 90 % des adolescents plus âgés, mais aussi les programmes d'éducation des immigrés et les programmes spéciaux d'éducation destinés aux adultes ou aux personnes handicapées. À côté des établissements communaux commencent se développer des établissements privés d'enseignement, agréés par l'État et subventionnés par les communes. Les services sociaux communaux sont particulièrement développés. Ils prennent en charge individus et familles, en particulier les plus vulnérables, pour lesquels ils engagent des programmes de prévention et de traitement des difficultés, offrent une aide sociale et financent des programmes de logements adaptés sur le fondement de la loi relative au soutien et aux services destinés aux personnes souffrant de handicaps.
4. Le financement des collectivités locales a) Les recettes et les dépenses des collectivités locales Les finances locales sont gouvernées par le principe de compensation : si l'État décide d'attribuer de nouvelles compétences aux collectivités locales, il doit leur fournir les moyens financiers nécessaires à la conduite de ces compétences. L'impôt direct local et comtal, recouvré par les agences gouvernementales avant d'être reversé aux collectivités locales, représente environ 70 % des recettes de ces dernières. L'assiette de cet impôt est fixée par la loi et est limitée exclusivement au montant des salaires et des retraites. Si les collectivités locales ont le droit de déterminer elles-mêmes le taux de l'impôt, l'État peut intervenir en fixant un taux maximal, comme ce fut le cas entre 1991 et 1993. La fin de cette limitation, en 1994, a conduit à une explosion de la fiscalité locale jusqu'en 1996. En conséquence, afin de réduire cette pression fiscale, le gouvernement a décidé de réduire ses subventions aux collectivités qui augmentaient leurs impôts. Le taux de l'impôt sur le revenu perçu par les municipalités est en moyenne de 20,8 %, celui des comtés d'environ 10,8 %. Dans la dernière décennie, les taux pratiqués par les différentes collectivités locales ont eu tendance à se rapprocher les uns des autres. La deuxième source de revenus des collectivités locales est constituée par la subvention qui leur est attribuée par l'État. Depuis 1993, cette subvention générale de fonctionnement ne peut représenter que 20 % des revenus de chaque collectivité locale. En pratique, elle atteint environ 20 % des recettes des communes et 10 % de celles des comtés. Les collectivités locales sont libres de les utiliser de la façon qu'elles jugent la plus appropriée. Les dotations sont attribuées aux communes et aux conseils de comté en fonction d'un montant par habitant uniforme. Elles se composent de dotations générales et de dotations spécifiques, dont l'objet est limité. S'ajoutent aux recettes fiscales les charges et redevances dont s'acquittent les utilisateurs des services fournis par les collectivités, les loyers des propriétés municipales et comtales et les revenus des capitaux. En outre, si l'État central n'accorde pas de prêt, il n'existe aucune restriction sur le lieu où les collectivités locales peuvent emprunter des capitaux, ni sur l'identité du prêteur. Elles peuvent ainsi emprunter à l'étranger. Aucune autorisation n'est requise. Les dépenses des collectivités locales représentent environ 21 % du produit national brut du pays, soit environ 66 milliards d'euros, ce qui représente un peu moins que les dépenses de l'État. Ces collectivités emploient 1 million de personnes, soit près de 25 % de la population active. Si on les classe par nature, 57,5 % des dépenses des communes sont constituées des dépenses de personnel (332). Si on les classe par destination, alors ce sont les dépenses d'enseignement qui dominent les dépenses municipales avec 29,8 % du total, suivies des dépenses liées aux soins de longue durée aux personnes âgées (20,1 %), à la petite enfance (12 %) et aux handicapés (9,8 %). Dans les comtés, dominent les dépenses liées au système de santé et au système hospitalier, qui représentent 80 % des dépenses d'exploitation. Les investissements représentent 5,3 % du total des dépenses des collectivités locales et sont en diminution constante depuis le début des années 1970. b) La modification du mécanisme de péréquation Un premier changement de mécanisme de péréquation est intervenu le 1er janvier 1996. Son entrée en vigueur a été étalée sur huit ans. Les municipalités dans lesquelles le revenu imposable par personne est inférieur à la moyenne nationale perçoivent, outre la subvention générale de fonctionnement, une subvention complémentaire, calculée par habitant et dont le montant représente 95 % de la différence entre le revenu imposable moyen suédois et le revenu imposable moyen de la municipalité. En contrepartie, les municipalités dans lesquelles le revenu imposable est supérieur à la moyenne nationale reversent au budget de l'État une somme dont le montant, calculé également par habitant, représente 95 % de la différence entre le revenu imposable moyen de la municipalité et le revenu imposable moyen suédois. La subvention complémentaire aux municipalités les plus défavorisées et la contribution des municipalités les plus riches doivent s'équilibrer. Ce mécanisme de péréquation bénéficie surtout aux communes du Nord, généralement pauvres, au détriment des grandes agglomérations telles que Stockholm. Ainsi, la péréquation horizontale a été réduite. Des subventions gouvernementales sont attribuées à la grande majorité des municipalités et des conseils de comté. Les quelques municipalités dont les recettes sont très élevées doivent pour leur part payer des droits, dont la somme s'élève à quelque 5,5 milliards de couronnes suédoises, alors que les subventions accordées atteignent les 54 milliards d'euros. D'importantes modifications ont été apportées au système de péréquation depuis le 1er janvier 2005. Son objet reste cependant le même, à savoir faire en sorte que les pouvoirs locaux de tout le territoire puissent avoir les mêmes possibilités. Le nouveau système se compose de cinq éléments : péréquation des revenus, péréquation des besoins de dépenses (péréquation des coûts), dotation structurelle, dotation transitoire et dotation ou contribution d'équilibre par habitant. La péréquation du revenu, qui était une péréquation horizontale, est maintenant surtout verticale. Les municipalités et les conseils de comté dont l'assiette fiscale par habitant est inférieure, respectivement à 115 et 110 % de la moyenne nationale, reçoivent une dotation de péréquation de revenu. Lorsqu'elle est supérieure, ils doivent payer une contribution de péréquation de revenu au gouvernement central. Dans la mesure où celle-ci ne couvre qu'une faible partie des dotations de péréquation de revenu, le gouvernement central doit en financer la plus grande partie et il utilise les anciennes dotations générales et dans une certaine mesure les dotations précédemment spécifiques à cette fin. La péréquation des besoins de dépenses ou péréquation des coûts reste horizontale mais certaines modifications lui ont été apportées. Elle a pour fonction d'égaliser les coûts liés aux besoins structurels et les différences de coûts dues, par exemple, aux différences dans la pyramide des âges de la population ou au fait que les autorités locales subissent des coûts supplémentaires dus à l'étendue de leur territoire. Certains éléments de péréquation des coûts ont été éliminés du système horizontal et remplacés par une nouvelle dotation structurelle financée par le gouvernement central. Celle-ci couvre, par exemple, le coût de la promotion du commerce et de l'emploi et les coûts liés à la faible densité de la population. La dotation transitoire vise à atténuer les pertes de revenu subies par certaines collectivités locales du fait des changements dans le système de péréquation. Cette dotation sera éliminée progressivement entre 2005 et 2010. Le total des concours approuvés par le Parlement suédois pour 2005 au titre du nouveau système de péréquation se monte à 55,2 milliards de couronnes suédoises, dont 42,6 milliards pour les municipalités et 12,6 milliards pour les conseils de comté. La contribution d'équilibre par habitant représente la différence entre les crédits votés par le Parlement et le montant net des dotations et contributions de péréquation, de la dotation structurelle et de la dotation transitoire versé aux municipalités et aux conseils de comté, respectivement. Si cette différence est positive, on a alors une dotation d'équilibre par habitant. 5. L'organisation et le rôle de l'administration territoriale de l'État a) La représentation territoriale de l'État Le gouvernement central dispose au niveau territorial d'un organe administratif, chaque comté accueillant un conseil administratif de comté ou préfecture. Cet organe exerce une double responsabilité de planification et d'administration. Il est dirigé par des gouverneurs de comté, appelés aussi préfets, nommés par le Gouvernement. Le ministère de rattachement des préfectures change régulièrement. Ce fut le ministère de la fonction publique ou le ministère de l'intérieur dans le passé, c'est le ministère des finances aujourd'hui, mais nombreux sont ceux qui souhaiteraient, parmi les gouverneurs, être rattachés directement au Premier ministre. La tutelle du ministère des finances permet une maîtrise des dépenses publiques. La préfecture est dirigée par le préfet et par un conseil d'administration de huit personnes désignées, depuis 2003, par le Gouvernement sur une base apolitique. Par exemple, dans le comté de l'Östergötland, où le rapporteur s'est rendu, ce conseil est composé d'un professeur d'université, de deux personnalités politiques, d'un agriculteur, d'un eurodéputé et d'industriels. Il est présidé par le préfet lui-même. Il se réunit quatre fois par an pour prendre des décisions. Y est présenté le bilan des activités de la préfecture et le rapport au Gouvernement y est arrêté. C'est une caisse de résonance pour la direction de la préfecture. Le préfet est assisté d'un secrétaire général et d'un état-major qui assure la publication du rapport annuel, qui examine les projets particuliers et qui comprend le directeur de l'information. Au total, une préfecture comprend quelques centaines de personnes. Dans l'Östergötland, comté qui accueille un demi-million d'habitants, la préfecture compte 220 personnes, dont 60 dans le seul secteur de l'environnement. Elles sont réparties entre neuf directions : économie régionale ; contrôle juridique ; affaires sociales ; agriculture ; questions vétérinaires ; protection de l'environnement ; affaires culturelles ; protection civile ; services d'urgence ; transports, aménagement du territoire ; parité. Par ailleurs, la préfecture dispose de mandats de coordination de la part des agences nationales qui n'ont pas de représentation régionale. Lorsque ces dernières en ont, la préfecture doit coopérer avec elles, à l'exemple de l'Agence nationale des routes ou de l'Agence nationale de l'emploi. La préfecture coopère également beaucoup avec les communes qui ont le monopole, par exemple, des plans d'urbanisme ou des opérations d'aménagement. La direction des affaires sociales, par exemple, exerce la tutelle sur les services sociaux des communes du comté. Ces communes jouissent cependant d'une grande autonomie. Pour exercer une tutelle, la préfecture doit s'appuyer sur une législation particulière. Trois lois particulières permettent ainsi à la direction des affaires sociales d'exercer des missions de contrôle sur les services sociaux, sur les services chargés des personnes handicapées et de la lutte contre l'alcoolisme. Une grande partie du travail des préfectures suédoises repose sur le dialogue. Leur activité de conseil constitue de loin la plus importante. En général, les communes suivent les recommandations qui leur sont faites. En outre, la préfecture est chargée du traitement des demandes et réclamations des citoyens à l'encontre des services rendus par les communes. Cette fonction peut l'amener à exercer des contrôles (voir infra). À côté des préfectures, certaines administrations centrales ont mis en place des « commissions de comté ». Ces organismes s'appuient sur des commissions consultatives composées de non-professionnels. Il existe aussi, à l'échelon local, quelques organismes d'État, tels que les bureaux du Trésor et les services de sécurité sociale. b) Le contrôle exercé par l'État L'État contrôle la façon dont ces tâches sont menées à bien. Le contrôle exercé par l'État comporte deux aspects principaux. D'une part, l'État doit s'assurer que les communes et les conseils de comté s'acquittent des obligations que la loi leur impose. D'autre part, le contrôle exercé par l'État ne peut pas fausser le principe de l'autonomie locale, même si cette dernière n'est jamais absolue, les communes n'étant pas comparables à des entités indépendantes. Aussi le contrôle exercé par l'État doit-il toujours s'inspirer de la recherche d'un équilibre entre ces deux exigences. Le contrôle exercé par l'État peut être un contrôle juridique, financier ou politique. L'État peut exercer un contrôle direct ou un contrôle indirect par le biais de la législation ou en conférant des pouvoirs à cet effet à des autorités publiques, notamment les tribunaux, les autorités centrales et régionales ou les ombudsmans désignés par le Gouvernement. Ce contrôle a pour objet de s'opposer à des décisions des autorités locales qui seraient irrégulières ou illégales/illicites. Dans certains cas, les contrevenants s'exposent au risque de ne pas bénéficier des subventions de l'État ou de faire l'objet d'un contrôle spécial exercé par des organes du gouvernement. Même s'il ne s'agit pas d'un contrôle direct de la légalité, les subventions spécifiques de l'État et les règlements qui les régissent sont un moyen très important mis à la disposition de l'État pour s'assurer que les ressources accordées aux collectivités locales servent à réaliser la politique arrêtée par le gouvernement. Le contrôle de l'État s'exerce par le biais d'un certain nombre d'organes du gouvernement central. Ces organes n'ont pas la même autorité que les tribunaux, qui leur permettrait de se prononcer sur les décisions municipales et, le cas échéant, de les déclarer nulles et non avenues. Ils ont chacun leur manière propre de traiter des irrégularités. Certains s'efforcent de redresser les irrégularités, au besoin en imposant des amendes ; d'autres se contentent d'appeler l'attention du gouvernement sur ces irrégularités ; d'autres encore vont jusqu'à saisir les tribunaux. Mais toutes ces instances pratiquent un contrôle administratif : - Les ombudsmans parlementaires sont compétents pour statuer sur le point de savoir si une décision des collectivités locales viole les droits civils. - Le Chancelier de justice est chargé du contrôle spécial prévu par la Constitution et la loi sur le traitement informatisé des données en ce qui concerne la liberté de la presse et la liberté d'expression. - Les commissions administratives de comté mises en place par l'État sont chargées d'exercer un contrôle pour s'assurer que les communes remplissent leurs obligations telles qu'elles sont énoncées dans des lois spéciales régissant le secteur des activités obligatoires. - Le Comité de l'éducation nationale est responsable de l'accomplissement des objectifs poursuivis par la politique générale en matière d'éducation sur le plan local, en veillant aux adaptations nécessaires à ce niveau. - L'Office national de la santé et du bien-être est responsable de la réalisation au niveau local des objectifs nationaux fixés en matière de politique sociale (y compris le bien-être social, la santé, les soins médicaux et les soins dentaires), en veillant aux adaptations nécessaires. - Le Comité national de l'informatique est responsable des questions concernant le traitement automatique de l'information. La loi impose à certaines de ces instances d'être particulièrement attentives au droit à l'autonomie locale lorsqu'elles exercent un tel contrôle. Souvent, les instances ont le droit de prendre des mesures de contrôle d'office, sans être tributaires d'une plainte. Auparavant, certaines décisions municipales devaient être soumises à une autorité de l'État, qui devait les approuver, cette autorité étant généralement le comité administratif mis en place par l'État au niveau du comté. Ce type de contrôle était prescrit pour des décisions municipales en matière d'emprunts et de règlements locaux. Le contrôle exercé par les préfectures, évoqué plus haut, peut prendre une forme très prescriptive. Cette activité de contrôle est préparée dans le cadre d'une réunion de planification. Elle s'exerce à partir des plaintes et des évolutions constatées depuis le dernier contrôle. La réunion de planification sert également à définir les méthodes à mettre en œuvre. Il s'agit de contrôle de légalité, de qualité, mais pas d'un contrôle financier. Par exemple, dans le contrôle de la prise en charge des personnes âgées, la direction des affaires sociales de la préfecture vérifie que l'individu puisse obtenir tous ses droits. Elle examine les modalités de traitement des dossiers, les dossiers eux-mêmes et tient des entretiens avec le responsable du dossier et les responsables du service. Si des anomalies graves sont détectées, la direction adresse des injonctions, qui peuvent faire l'objet d'appel. Si l'appel n'aboutit pas, la direction peut prendre jusqu'à des mesures administratives. La commune se doit également d'exercer un contrôle interne sur ses services sociaux. Le contrôle judiciaire ne s'exerce jamais d'office et ne peut être déclenché que par une plainte concernant l'application ou l'exécution d'une décision municipale. À cet égard, l'État dépend des initiatives prises par les citoyens, qui seules lui permettent de contrôler l'activité en question. Le contrôle judiciaire représente ainsi en même temps une voie de recours pour les citoyens et un moyen pour l'État de contrôler les collectivités locales. Tous les habitants d'une commune ou les membres d'un conseil de comté peuvent exercer un recours contre les décisions municipales. C'est là un élément essentiel du système suédois d'autonomie locale. Ce type de recours est considéré comme un instrument démocratique permettant aux résidents de faire examiner la légalité d'une décision municipale par les tribunaux administratifs. Les voies de recours locales sont importantes, surtout lorsqu'elles concernent le domaine des activités volontaires des collectivités locales. Cette question est régie par la jurisprudence, et non par une réglementation détaillée. En pratique, certains principes qui limitent l'autorité des collectivités locales se sont dégagés progressivement. La plupart de ces principes, qui sont devenus aux yeux des tribunaux administratifs des pratiques coutumières, sont à présent énoncés dans la loi sur l'administration locale. La plupart des décisions des communes et des conseils de comté peuvent ainsi faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. Dans certains cas, le recours est formé devant un tribunal administratif, dans d'autres devant un tribunal ordinaire, et dans d'autres cas encore devant une juridiction particulière. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire sont précisées dans la loi sur l'administration locale et dans un grand nombre de lois spéciales. Le pouvoir des différents tribunaux à l'égard d'une décision municipale dépend du type de contrôle exercé par les tribunaux. Lorsque seule la légalité est examinée, le tribunal ne peut qu'annuler la décision, sans pouvoir dicter une autre décision. Lorsque le contrôle porte également sur l'opportunité, le tribunal peut dicter une autre décision. Dans certains cas, par exemple dans des actions en dommages et intérêts, le tribunal peut réduire les prétentions du demandeur au montant du dommage qu'il est effectivement en mesure d'établir. Parfois, le tribunal peut imposer une amende en cours de procédure pour sanctionner une désobéissance de la part d'une partie. Dans des cas particuliers, le tribunal a également le droit de suspendre l'exécution d'une décision municipale. Les communes et les conseils de comté sont habilités au même titre que n'importe quelle autre partie comparaissant devant le tribunal à faire appel d'une décision de celui-ci. Les juridictions administratives comprennent les tribunaux administratifs de comté, les cours d'appel et la Cour administrative suprême. Les juridictions ordinaires, civiles et pénales, comprennent les tribunaux de district, les cours d'appel et la Cour suprême. Les tribunaux administratifs examinent la légalité ou tant la légalité que l'opportunité d'une décision. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un contrôle de la légalité par les tribunaux administratifs sont énoncées au chapitre X de la loi sur l'administration locale. Des lois spéciales énoncent les décisions qui peuvent faire l'objet d'un contrôle de l'opportunité ou/et de la légalité devant les tribunaux administratifs. La compétence des tribunaux ordinaires est étendue puisqu'ils peuvent être saisis d'un très grand nombre d'affaires contentieuses impliquant les communes et ceci du fait que les communes et les conseils de comté peuvent être considérés non seulement des autorités publiques, mais également des sujets relevant du droit privé en tant que parties contractantes ou propriétaires de biens. Pour cette raison, les communes peuvent ester en justice comme toute personne ou entité privée. Les demandes d'indemnisation sont considérées comme des affaires civiles. Les tribunaux spéciaux chargés de dire le droit examinent certains problèmes juridiques énoncés dans la loi en conformité avec des procédures spécifiques. Enfin, il faut noter qu'il n'existe pas de cour constitutionnelle en Suède (333). Les tribunaux ont le droit de refuser d'appliquer les lois qu'ils estiment contraires à la Constitution. 6. Les perspectives d'évolution Le gouvernement suédois a constitué un Comité sur les responsabilités du secteur public (Ansvarskommittén) chargé d'examiner la répartition des responsabilités entre les différents niveaux du gouvernement et, ainsi, d'apporter des réponses à certains des défis mentionnés plus haut. Le comité a préparé un rapport intitulé Capacité d'innovation pour un bien-être durable (334), dans lequel il a incité le gouvernement à s'engager à fournir des services publics de haute qualité et équivalents sur tout le territoire par l'intermédiaire d'un système d'administration publique jouissant d'une forte légitimité démocratique et proche des citoyens. Pour ce faire, il a proposé trois stratégies : une stratégie visant, d'une part, à clarifier la répartition des responsabilités entre les divers niveaux du système administratif (où existe une gouvernance à plusieurs niveaux) là où il est impossible ou inapproprié de concentrer la responsabilité à un seul niveau et, d'autre part, à améliorer les capacités d'innovation ; une stratégie de renforcement des capacités d'innovation au niveau local se fondant sur une répartition claire des responsabilités entre les niveaux central et local du gouvernement ; une stratégie de renforcement des capacités d'innovation au niveau central, recouvrant le développement intersectoriel des services du gouvernement central et la gouvernance au niveau national. Le comité a proposé que soient traitées en priorité dans la suite de l'enquête les questions du rôle global des pouvoirs locaux, y compris celles d'une coopération plus importante à leur niveau, de l'élaboration d'un système régional d'administration publique, du cadre de gouvernance et de supervision par le gouvernement central et le Parlement, d'égalisation des prestations de services sociaux et de la réglementation légale des droits des personnes partout dans le pays, mais aussi des conséquences de dispositions opérationnelles alternatives dans le secteur public pour ce qui est des services sociaux intéressés. Le comité a, en outre, entamé une analyse plus approfondie des finances du secteur public à moyen et long termes, notamment dans les municipalités et les conseils de comté. Dans son rapport initial, il a relevé que les tendances qui avaient émergé en Suède à la suite de phénomènes tels que la mondialisation, l'européanisation, les nouvelles formes de croissance économique et d'innovation et les changements dans les besoins et les attentes des citoyens avaient modifié les conditions d'exercice de la démocratie régionale et locale. Il a souligné le renforcement de la tendance à la centralisation et à la réglementation : « la plupart des dix-sept services de secteur public transférés du niveau central au niveau des collectivités (au cours de la période allant de 1970 à 2003) étaient très petits... En outre, il a regretté que le gouvernement central contrôlât les pouvoirs locaux d'autres manières : par le biais de la composition et du montant de ses dotations - pendant les années 1990, la tendance était à l'élimination des dotations spéciales du gouvernement central au profit des dotations générales ; ces dernières années, de nouveaux concours financiers spécifiques ont été introduits ; l'État central contrôle aussi les institutions locales en prenant des dispositions prescrivant que les pouvoirs locaux équilibrent leurs budgets et en établissant des règlements régissant les impôts et les redevances. Le gouvernement central a également « gelé » le barème d'imposition des pouvoirs locaux et il détermine les services pour lesquels des redevances peuvent être imposées. Il décide aussi les redevances maximales des services de prise en charge des enfants et de soins des personnes âgées. En outre, il utilise le mécanisme de coordination financière dans le cadre duquel les pouvoirs locaux et le gouvernement central partagent un budget commun et agit par le biais des plans nationaux d'action qui comportent souvent des concours financiers en vue de la mise en œuvre de ces plans. Il est évident que ces questions sont extrêmement importantes pour la démocratie régionale et locale en Suède. C'est un État unitaire doté d'un fort système d'autonomie locale qui applique nombre des principes de l'autonomie locale inscrits dans la Charte européenne de l'autonomie locale. La Constitution reconnaît le principe de l'autonomie locale ainsi que le droit des collectivités locales de lever des impôts pour remplir leurs fonctions. Conformément au principe de financement, le gouvernement central fournit des ressources appropriées aux pouvoirs locaux si des missions supplémentaires leur sont attribuées. En pratique, les pouvoirs locaux suédois ont joué un rôle important dans le système de protection sociale et jouissent de la haute considération de la population. Mais, la mise en œuvre de ces principes se heurte néanmoins à un certain nombre de problèmes. La Constitution elle-même est ambiguë sur le principe et autorise différentes interprétations, Les deux organes chargés d'examiner la constitutionnalité de la législation, le Conseil sur la législation et le Comité permanent sur la Constitution, ne sont eux-mêmes pas d'accord sur l'interprétation du principe tel qu'il est inscrit dans la Constitution et il existe des désaccords profonds entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux sur la question, désaccords fondés dans une certaine mesure en partie sur des considérations politiques. Mais le rapporteur constate que, dans le cadre des collectivités locales, les conseillers de tous les partis sont unanimes à défendre le principe de l'autonomie locale contre ce qu'ils considèrent être des ingérences du pouvoir central. Au niveau national, l'accent était mis plus sur le principe de l'égalité réalisée par l'uniformité que sur la reconnaissance de l'importance de l'autonomie locale. Se pose néanmoins un autre problème, au niveau local ou régional, celui du croisement entre les politiques sectorielles des agences, qui prennent la forme de tuyaux d'orgues, et la volonté de « territorialiser » les politiques au niveau des communes ou des préfectures. Il existe ainsi des politiques aux objectifs similaires mais aux sources de financement différentes. Dans ce schéma, il peut arriver que personne ne prenne ses responsabilités et veuille faire porter le poids d'une politique sur son voisin. Ce système peut, dans certains domaines, encourager la dilution des responsabilités. La région sous la forme du conseil régional de développement, la préfecture et le conseil de comté peuvent ainsi se faire concurrence. Potentiellement, le grand conflit qui existe entre l'État et les collectivités locales réside dans la confrontation entre l'autonomie de ces dernières et la volonté de l'État d'intervenir dans un domaine financé par elles par le biais de normes précises. Mais, le système suédois fonctionne sur un fort consensus aux niveaux locaux et régionaux. Il est fréquent pour les différents partis de coopérer et former des majorités de gouvernement sans considération des frontières traditionnelles. Plus qu'elles n'apportent de solutions transposables immédiatement, les comparaisons internationales permettent de réinterroger le modèle français d'organisation décentralisée et de dresser une liste de questions qui devront être résolues pour permettre à notre système institutionnel de fonctionner dans de meilleures conditions. V. - UNE PRÉGNANCE DE LA RÉGIONALISATION Si les pays étudiés présentent parfois des inégalités démographiques et géographiques plus marquées qu'en France − l'existence du Mezzogiorno italien suffit à le montrer −, la tendance à la régionalisation y est plus forte, ce qui présente des difficultés réelles mais emporte également des réussites incontestables en phase avec la nécessaire modernisation des structures territoriales. Dans les débats sur la réorganisation territoriale de notre État, à l'exemple de ceux qui ont présidé à l'avènement de l'« acte II » de la décentralisation, les exemples étrangers se trouvent trop souvent idéalisés. Les déplacements effectués par le rapporteur ont permis de relever, non seulement des réussites − au premier rang desquelles se trouve une meilleure adéquation des moyens aux besoins locaux −, mais aussi des faux-semblants. Ainsi, la décentralisation régionale, telle que pratiquée par les pays étudiés, en particulier par l'Italie et l'Espagne, ne signifie pas nécessairement une plus grande décentralisation au niveau communal, comme l'a relevé le Conseil de l'Europe en 1995. La compétence relative à la détermination du régime administratif des collectivités locales est partagée entre le législateur national et le législateur régional. Même si elles puisent leurs compétences dans une histoire très ancienne, les villes ne disposent que très rarement d'une autonomie aussi forte que celle qui existe en France. Les conflits de pouvoirs entre pouvoirs régionaux et pouvoirs urbains affleurent de la même façon que sur notre territoire. L'exemple italien montre que les maires des grandes villes (Naples) sont souvent les rivaux des présidents de région (Campanie) ; la situation n'est pas loin d'être la même en Espagne (exemple de Séville et de la communauté autonome d'Andalousie). Mais là où le système espagnol permet, par la prééminence claire attribuée à tel ou tel niveau de collectivité pour l'exercice d'une compétence - selon un système proche de celui du chef de file -, le système italien, par l'égalité des partenaires qu'il implique, témoigne d'une bien moins grande fluidité et peut conduire à des blocages importants, imposant parfois l'intervention d'une disposition particulière pour désigner un arbitre - dans le cas de grands projets d'infrastructures par exemple. Certes des mécanismes de correction au profit des collectivités locales de premier ou de deuxième niveau ont été souvent établis. Les communes allemandes ou espagnoles peuvent saisir la juridiction constitutionnelle ; les communes italiennes sont représentées auprès des institutions régionales ; les associations de collectivités locales en Écosse et en Suède jouent un rôle très important, comme en Allemagne d'ailleurs ; des négociations entre associations de collectivités locales et pouvoir régional sont fréquentes en Espagne pour la détermination des compétences. Mais, de manière générale, « les institutions régionales tendent à reproduire le schéma constitutionnel de l'État central » (335). Ce constat est encore plus vrai dans les États fédéraux. Ainsi, l'Allemagne vient de connaître une réforme significative. Par exemple, le Land de Bade-Wurtemberg qui compte entre 10,7 millions d'habitants, a été divisé en quatre circonscriptions administratives (Regierungsbezirke) de plusieurs millions d'habitants (336) à la tête desquelles a été placée une forme de « préfet » du Land, le Regierungspräsident, disposant de pouvoirs déconcentrés très importants. Par ailleurs, il serait regrettable de ne pas reconnaître que certains transferts ont un impact sur certains droits fondamentaux, mais ce constat peut être également fait dans le système semi-centralisé français. Il serait également erroné de ne pas relever les difficultés de gouvernabilité qui traversent certains des modèles d'autonomie décentralisée de nos voisins. Ainsi, il n'est pas rare que certains projets ne puissent voir le jour faute d'un arbitre désigné, en particulier lorsque ces projets concernent plusieurs collectivités régionales. Le système italien, tel qu'éprouvé par le rapporteur en Campanie et à Naples, en constitue l'archétype. Dans des cas ultimes, tels que par exemple l'installation d'un incinérateur dans une agglomération, l'autonomie est le synonyme de paralysie. Enfin, l'autonomie financière locale constitue dans tous les pays étudiés un combat de tous les instants. Les dotations de l'État constituent l'essentiel des ressources locales en Suède, en Italie et en Espagne, même si le débat sur l'autonomie fiscale des entités régionales et communautaires prend une ampleur sans précédent et constitue souvent la clef de voûte des relations entre l'État et les autres collectivités. A contrario, les systèmes écossais et gallois donnent un exemple de financement régional des collectivités locales. B. DES RÉUSSITES INCONTESTABLES En tout état de cause, les pays étudiés connaissent un nombre plus réduit, sinon d'échelons territoriaux, du moins d'unités territoriales. Si les interlocuteurs italiens du rapporteur se sont souvent plaints du nombre de communes, celui-ci, avec 8 000 unités, reste bien moindre que celui des communes françaises. L'effort réalisé en Suède est particulièrement significatif, facilité, il est vrai, par une répartition de la population sur le territoire très différente de celle qui existe dans les autres pays. Aucun des pays étudiés n'a réalisé de modification de répartition des compétences sans réforme des structures. L'État dispose d'une administration territoriale pour l'exercice de ses compétences en Italie et en Espagne, mais cette représentation s'avère de plus en plus réduite. Si elle a été accrue en Angleterre, elle est réduite à la portion congrue en Écosse comme au Pays de Galles. Les régions italiennes, espagnoles comme l'Écosse font largement usage de leur pouvoir législatif, ce qui a permis d'incontestables réussites dans la mise à niveau de certains territoires dans l'adaptation et l'amélioration des services. L'Andalousie présente de ce point de vue un modèle de dynamique de rattrapage. Il ne saurait y avoir d'authentique régionalisation sans une véritable latitude normative, seule à même de lier légitimité et responsabilité. L'aménagement et l'urbanisme sont des matières dans lesquelles les régions italiennes, espagnoles ou encore l'Écosse ont développé des compétences très fortes, au détriment − il faut bien le reconnaître − des autres collectivités locales. La question du financement, si elle est exclue du champ du rapport, mérite cependant à ce stade d'être relevée. Elle pose deux problèmes, celui de l'autonomie financière et celui de la péréquation. Dans les pays étudiés, le rapporteur a constaté que le pouvoir fiscal local, à l'origine, est faible ou inexistant. Mais, l'Espagne et l'Italie, comme la Belgique d'ailleurs, s'orientent vers l'établissement d'un pouvoir fiscal régional important. La mise en œuvre d'un tel pouvoir reste en deçà de ce que promet la loi. Les pouvoirs régionaux semblent pour certains hésiter à assumer un réel pouvoir fiscal. Quant à la péréquation, elle est partout admise dans son principe, mais souvent contestée dans ses modalités, dès lors que les montants sont importants et que les payeurs sont identifiés. On retrouve au niveau décentralisé la question du « chèque britannique » familière aux spécialistes du financement de la Communauté européenne. Elle se pose avec acuité en Allemagne. Si le fait d'aller étudier sur place des systèmes décentralisés étrangers a permis de mieux appréhender la réalité des avancées et des manques, cela a également permis au rapporteur de recueillir les avis de nos voisins. Or, en parlant de la France, les observateurs étrangers retiennent souvent trois phénomènes qui ne laissent de les surprendre. En premier lieu, le fonctionnement réel des territoires est non seulement compliqué à comprendre mais la lettre des institutions ne permet pas de décoder la réalité des pratiques − cette remarque pourrait être aussi faite à propos de l'Italie. En deuxième lieu, le débat sur la légitimité des institutions locales peine à surgir et lorsque des mesures sont envisagées qui pourraient y conduire, telles que la simplification de l'architecture institutionnelle, elles tardent à déboucher voire sont immédiatement enterrées, la crainte des obstacles constituant... le premier obstacle. En troisième lieu, le débat semble se cantonner dans un cercle relativement fermé, parfois limité à la seule capitale − ce qui permet de subodorer l'opinion du reste du pays sans s'y confronter. Nous pouvons retenir ces leçons et interroger à leur aune le modèle français. LES QUESTIONS POSÉES AU MODÈLE FRANÇAIS La crédibilité et l'efficience des pouvoirs dépendent d'une architecture des responsabilités et des agencements institutionnels relativement simple et lisible par les acteurs sociaux et économiques. Or, si la complexité de l'organisation territoriale est vérifiée aussi bien en France que dans les pays étudiés, en revanche, en matière de compétences des collectivités territoriales, notamment régionale, la France se présente comme très en retrait par rapport aux exemples étudiés. En France, les collectivités restent privées de la compétence de leurs compétences. Non seulement les administrations décentralisées ne peuvent être productrices de droit, mais elles sont chargées d'assurer la diffusion du droit produit par l'État. Les systèmes de régionalisme « fort » comme ceux de l'Italie ou de l'Espagne ont une propension naturelle à l'unicité qui trouve son fondement dans le principe d'égalité, en vidant le pluralisme des sources de discrimination et d'individualisme anarchique. Le statut des régions peut varier, celui des citoyens doit rester unique. Pour autant, l'autonomie croissante des régions n'a pas désarmé les courants régionalistes. La France est moins décentralisée en termes budgétaires au niveau régional, mais l'est au contraire plus que ses voisins au niveau local des départements, des intercommunalités et des communes. Le système institutionnel territorial, pour trouver son équilibre, doit gagner en légitimité. Pour ce faire, quatre principes semblent devoir être respectés : simplicité de l'offre de dispositifs institutionnels, lisibilité des enjeux, « clarification » des responsabilités, publicité des débats. La mise en œuvre de ces principes exige de répondre au préalable à deux questions : le renforcement des responsabilités de chacun des acteurs et la modification du modèle de gouvernance des territoires. I.- RENFORCER LES RESPONSABILITÉS Pour qu'un équilibre territorial des pouvoirs s'établisse de manière durable, acceptable et efficace, il convient que ses acteurs se trouvent renforcés et puissent être identifiés avec clarté. La légitimité se dissout dans la dilution des responsabilités. Un tel « programme » implique à la fois de recentrer la présence de l'État dans les territoires sur ses missions régaliennes (337) et de clarifier le rôle de chacune des catégories de collectivités territoriales. A. AFFERMIR L'ÉTAT TERRITORIAL La réforme engagée en 1982 et en 1992 n'a pas atteint à ce jour un point d'équilibre stable en ce qui concerne le regard que l'État porte sur sa propre organisation territoriale. Or, selon Michel Crozier, « si l'État central ne change pas, la décentralisation perd la plus grande part de sa vertu ». Sauver l'État territorial nécessite de l'empêcher de se disperser dans des tâches de gestion et des partenariats dans lesquels il se dissout, sans valeur ajoutée pour le pilotage des territoires. Cela nécessite également de modifier les relations entre échelons régional et départemental, entre préfectures et services déconcentrés. Ainsi s'est exprimé un responsable territorial du ministère de l'équipement : « J'ai fait toute ma carrière en direction départementale de l'équipement, en administration centrale et dans les services interrégionaux. C'est ma première expérience au niveau régional. J'ai découvert la question de la gestion entre niveau régional et niveau départemental. On retrouve les difficultés qui existent entre préfet de région et préfets de département. Ce sont des sujets sensibles. Je vais prendre un premier exemple qu'on vient de régler. Depuis une dizaine d'années, le registre des transporteurs de marchandises faisait l'objet d'une gestion régionale. En revanche, pour le registre des transporteurs de voyageurs, c'est le préfet de département qui est compétent. Pourtant, le nombre de sociétés de transports au niveau départemental faisait que le nombre de personnes qui s'en occupaient était faible, souvent un temps partiel. « Il semblait donc mieux d'instruire ces dossiers au niveau régional. Depuis le 1er septembre, c'est ce qu'on fait, mais nous devons transmettre les décisions au préfet de département via le directeur départemental de l'équipement. Il a fallu passer une convention entre le préfet de département et le préfet de région, le premier autorisant les services de ce dernier à instruire les dossiers. Le préfet de département ne peut déléguer sa signature à un service régional ; nous ne faisons pas partie des services départementaux. » Ce type de procédures, coûteux en temps et en moyens, illustre les difficultés que l'État territorial rencontre pour assurer une présence véritablement efficace et proportionnée à ses missions. Pour Jean-Claude Thoenig, « l'État se contente, s'agissant de la déconcentration administrative, de réagir à la dynamique de la décentralisation politique. Il accroche ses services extérieurs - soit 95 % de ses effectifs - à des niches d'activité traditionnelles sans les armer de nouvelles compétences pour affronter les problèmes les plus aigus.... » (338) 1. Affirmer le rôle pivot des préfets Dans l'équilibre territorial des pouvoirs, le préfet intervient à trois niveaux : entre les différents services de l'État d'abord, entre ces derniers et les collectivités territoriales ensuite, entre les collectivités elles-mêmes enfin. Pour qu'il puisse jouer ce rôle d'interface entre politiques sectorielles et politiques territorialisées, il conviendrait à la fois de garantir la place du préfet comme chef des services déconcentrés de l'État et d'accorder une prééminence encore plus forte aux préfets de région, seuls susceptibles d'assurer la synthèse des diverses composantes de l'État à l'échelle d'un territoire pertinent. a) Faire du préfet le chef des services déconcentrés En 1946, le député F. Leenhardt regrettait déjà que « dans les départements on constate que le représentant du pouvoir central, au lieu d'assumer la charge de représenter l'intérêt national et de faire respecter les lois, n'est plus que le représentant d'un seul ministre, le ministre de l'intérieur ». Il estimait alors qu'il convenait « à côté de (la) préoccupation de décentralisation et après l'avoir satisfaite, de poser le principe de la déconcentration administrative » entendu comme un « un principe de saine administration » (339). La capacité d'autonomie de gestion des préfets reste souvent contestée par la dépendance multiple et pesante à l'égard des ministères spécialisés. Les services déconcentrés n'hésitent pas parfois à faire pression sur leurs ministres spécialisés pour dénoncer la dépendance des préfets à l'égard du pouvoir local, de la même façon que les anciens chefs de mission de coopération dénonçaient la trop grande implication de leur ambassadeur dans la vie politique locale. Face aux besoins de réforme, le préfet apparaît souvent comme l'ultime recours, celui par lequel tout doit passer. Ainsi, la Cour des comptes, dans son récent rapport sur l'intercommunalité (340), voit dans le préfet l'instrument de la correction des défauts de croissance des groupements de communes. Si, en l'espèce, l'intervention du législateur peut s'avérer plus adéquate, en raison du besoin de légitimité démocratique que nécessite un tel travail de réajustement de l'intercommunalité, il est significatif que le préfet soit appelé à la rescousse. La commission « Décentralisation » du XIe Plan relevait : « Il est déterminant que face à des élus fortement enracinés et disposant de moyens humains et financiers parfois considérables, le préfet, unique représentant de l'État auprès des collectivités territoriales, puisse définir ou adapter sur place les différentes politiques sectorielles de l'État... Cet État fort et efficace est certainement l'une des conditions nécessaire pour assurer l'équilibre local. » Ce constat permet de mettre en lumière la nécessité de faire du préfet le véritable « patron » de l'État territorial. Or, la pleine efficacité des missions des intendants se heurtait déjà à la difficulté de leur articulation avec les autres représentants du Roi. Le pouvoir de direction du préfet reste relatif et ce d'autant plus qu'un certain nombre de services échappent, de par la Constitution ou la loi, à son autorité. Rappelons que le préfet ne peut intervenir en matière de justice, de défense, de contenu et d'organisation de l'enseignement, d'application de la législation du travail, d'assiette et de contrôle des impôts, d'évaluations domaniales et de statistiques. En outre, certains élus peuvent être tentés de contourner les éventuels arbitrages préfectoraux et de négocier leurs dossiers directement au niveau national. Les administrations centrales peuvent se sentir menacées dans leur rôle traditionnel de direction des services déconcentrés. La collaboration du préfet avec les services déconcentrés, malgré les progrès en cours, reste inégale. Les services techniques jouent un rôle prépondérant. Certains autres font preuve d'un irrédentisme à toute épreuve. Les administrations centrales peuvent tenter de maintenir des liaisons directes avec les services. La règle de la centralisation des correspondances est ainsi contournée par l'habitude ou le recours de plus en plus fréquent à des moyens de communication alternatifs. La pratique des arrêtés-types de délégation de signature au profit les chefs des services déconcentrés limite les marges de manœuvre des préfets, même si certains d'entre eux, comme le rapporteur a pu le constater lors de ses auditions en région, n'hésitent pas à revoir l'ensemble du schéma de délégation. La structuration même de certains services en dit long sur les réticences de certaines administrations centrales à déléguer leur pouvoir. Ainsi, la création des diren a été conçue sur la base d'un simple regroupement de personnels prélevés dans des services déconcentrés existants (341), ce qui crée une certaine fragilité et permet de maintenir le nouvel acteur dans une instabilité relative au profit des services qui se sentent délestés de certaines de leurs compétences. La même remarque pourrait être faite pour les sgar, dont le rapporteur a pu constater la fragilisation en liaison avec la mise en place des programmes de la lolf. Certaines ont pu tenter de ne pas respecter la compétence exclusive du préfet pour conclure toute convention au nom de l'État (ministère de la culture par exemple) ou bien ont défini un contenu-type parfois très détaillé qui prive de toute portée le pouvoir de négociation reconnu au représentant de l'État. Pour asseoir l'autorité du préfet sur les chefs des services déconcentrés, il conviendrait de leur permettre de rester en poste plus longtemps que ce n'est le cas. Nombre des interlocuteurs du rapporteur ont mentionné, certains pour s'en plaindre, d'autres pour s'en réjouir, de la faible durée en moyenne de la mission de chaque préfet (342). Il s'agit de ne pas faire mentir Odilon Barrot : « C'est toujours avec le même arc qu'on vise, mais on utilise plusieurs flèches et les flèches préfectorales sont plus percutantes que les flèches des services extérieurs ». b) Asseoir le rôle du préfet de région Pendant longtemps, le préfet de département est apparu comme le préfet de droit commun. Ainsi, en vertu du décret du 15 janvier 1997 précité, entré en vigueur le 1er janvier 1998, le préfet de département est désigné comme l'autorité de droit commun de la déconcentration des décisions individuelles. Dans les deux décrets du 20 octobre 1999 précités, le département et la région sont désignés comme les échelons de mise en œuvre de droit commun des politiques de l'État. Transparaît un souci de traitement identique des deux circonscriptions, à l'exception des compétences financières. Le préfet de région est, en effet, seul compétent dans le domaine des autorisations de programme relatives aux investissements civils autres que ceux d'intérêt national. La région est désignée comme échelon d'animation et de coordination des politiques de l'État en matière culturelle, environnementale, relatives à la ville et à l'espace rural. Le préfet de région est chargé de la conduite des politiques nationales et communautaires de développement économique et d'aménagement du territoire. Mais le préfet de département garde la main sur les sous-préfets à qui sont confiées de plus en plus des missions transversales. Les préfets de département peuvent aussi constituer des pôles de compétence, dans le domaine de l'eau ou du développement industriel par exemple, préfigurant, à l'instar des rapprochements entre services de l'équipement et de l'agriculture, une future réforme des services déconcentrés. La loi « Voynet » renforce les prérogatives du préfet de département en matière de services publics. Le pte qui devait être élaboré en 2000 devait renforcer l'autonomie et le rôle de coordination des préfets de département. Il reste que, sur certaines compétences, les pouvoirs des préfets de région ont tendu à s'affirmer comme le montre le tableau ci-après :
Mais, les textes de 2004 marquent peut-être un nouveau tournant vers une logique intégrationniste dans laquelle les préfets de département deviendraient les collaborateurs du préfet de région. Il faut bien constater que, dans de nombreux pays, l'État s'est regroupé au niveau régional. Ainsi, en Grèce, seul le niveau régional a été conservé comme seul échelon de pouvoir déconcentré. L'État, dans le département, se limite à un rôle de contrôle. Une évolution semblable a été constatée par le rapporteur en Espagne et en Italie, le délégué du Gouvernement dans les provinces conservant un pouvoir important dans une seule matière, la sécurité, entendue au sens large. L'évolution en cours vers le renforcement du rôle du préfet de région mérite d'être confortée. Le préfet est au cœur de la recherche de l'équilibre entre l'intérêt général d'État et les intérêts généraux territoriaux, comme il est au croisement des recherches du meilleur service public. Il reste sollicité de toutes parts par ses fonctions régaliennes − délivrance de titres, sécurité −, par ses missions d'aménagement, de médiation et de recherche d'une meilleure cohésion sociale et territoriale. 2 Développer la mutualisation des moyens Le diagnostic est connu. Les voies de la réforme le sont également. Mais, comme l'a mis en évidence la commission présidée par Michel Pébereau sur l'endettement public : « Le caractère velléitaire de la démarche de modernisation se retrouve à l'échelon local. Depuis plusieurs années, les outils destinés à permettre aux services de l'État de mieux travailler ensemble à l'échelon local se succèdent (documents stratégiques - projets territoriaux, projets d'action stratégique..., structures de coordination - pôles de compétence interministériels, délégations interministérielles, missions interservices... -). Ces outils constituent souvent un progrès permettant de mieux tenir compte du caractère de plus en plus transversal de certaines politiques publiques (politique de la ville, emploi, environnement...). Mais leur mise en œuvre s'accompagne rarement d'une réorganisation effective. » (343) a) L'impératif de rationalisation L'objectif est de mettre fin à l'émiettement des structures locales de l'État. Il faut parvenir à faciliter l'exercice par le préfet de sa responsabilité de mise en œuvre des politiques interministérielles, créer des regroupements d'administrations locales concourant à la mise en œuvre d'une même politique et donner une configuration solide et stable à l'administration locale de l'État. En application de l'article 28 du décret du 29 avril 2004 précité et pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'État dans la région ou le département, le préfet peut constituer un pôle de compétence dont il désigne le responsable. Des organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au pôle de compétence dans les conditions déterminées conjointement par le préfet et les responsables de ces organismes. Mais il ne faudrait pas se contenter de constituer de simples pôles au niveau régional ou même au niveau départemental. Il conviendrait, d'une part, de « remonter », dans la mesure du possible et surtout du souhaitable, les compétences des services déconcentrés départementaux concernés au niveau régional et, d'autre part, de favoriser l'intégration régionale des services. La création des pôles, si elle constitue une avancée indéniable, pourrait se traduire par la superposition d'une structure supplémentaire qui laisse coexister de nombreux services, sans mutualisation ni intégration. Si les risques de déstabilisation des services ont été évoqués par tous les interlocuteurs du rapporteur à l'occasion de chacun de ses déplacements, il n'en reste pas moins que l'impératif de rationalisation ne saurait par trop attendre les mutualisations indispensables. b) Le passage des pôles à l'intégration régionale des services Jusqu'à aujourd'hui, l'État s'est limité à des rapprochements fonctionnels entre services. La modification des limites territoriales de compétence des différents services pourrait constituer une avancée plus significative. Comme l'a relevé le rapport de la commission « État » du XIe Plan intitulé Pour un État stratège, l'absence de réforme des structures constitue une limite puissante à la déconcentration. - L'affirmation d'une coopération plus grande entre services départementaux et services régionaux Cette intégration doit concerner au premier chef les préfectures. La réforme de 2004 a clairement affirmé la position du préfet de région. Elle nécessite la constitution d'une plus grande synergie entre préfectures de département et préfecture de région. Le remplacement de la car par le car en intégrant les préfets de département dans un état-major régional plus restreint participe de ce mouvement. Cette intégration plus forte doit se faire non pas seulement en amont des décisions mais tout au long du déroulement des politiques publiques. Ainsi, tous les outils dont disposent les préfets de région, à savoir le car, mais aussi les pase et les pôles régionaux favorisent un travail collégial en matière d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. De ce point de vue, le nécessaire besoin de mise en cohérence de l'action de l'État en région passe également par la capacité des services à évaluer les effets des politiques dont ils ont la responsabilité. Les pratiques d'évaluation encore insuffisamment répandues ont pour objet de nourrir les réflexions menées en commun. À titre d'exemple, les dossiers en cours sur le transfert des équipements portuaires et aéroportuaires ont fait l'objet d'un suivi coordonné entre les préfectures de département et la préfecture de région. En effet, la loi de décentralisation fait intervenir parallèlement les préfets de région et de départements dans un même processus. Il est paru important qu'un suivi et qu'une coordination soient assurés par le sgar, afin de garantir une mise en cohérence des interventions des services de l'État dans ces domaines. - Le renforcement des pôles La logique de pôle ne peut constituer qu'une première étape vers la rationalisation de la présence territoriale de l'État. Rappelons-le, la France est le seul pays à cumuler sur un même territoire des services de l'État aussi importants, alors même que, parallèlement, les collectivités territoriales ont renforcé leurs moyens en liaison avec les transferts de compétence et la mise en œuvre de la clause générale de compétence. La mise en place de pôles départementaux peut constituer une première étape intéressante sur le chemin du rassemblement des administrations départementales. Ainsi, l'un des responsables départementaux de l'équipement dans le Bas-Rhin auditionné par le rapporteur a relevé qu'en matière de gestion de l'espace foncier « il y a les services prescripteurs et des services au contact direct des élus qui ont eu des attitudes trop souples. L'arbitrage permanent du préfet est nécessaire. Cette situation n'est pas satisfaisante. Il était donc nécessaire de convenir d'un espace pour nous accorder sur des doctrines, pour les évaluer. « C'est précisément l'objet du pôle " Aménagement de l'espace " qui est aussi une instance de réflexion. Sur certains projets lourds, tels que les schémas de cohérence territoriale, (...), nous avons besoin d'accorder nos violons et d'avoir un suivi permanent. Le pôle possède une instance d'évocation présidée par le préfet qui permet de trancher. La liaison déjà forte avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est très forte pour la gestion de l'espace rural, ainsi qu'avec la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. » Au-delà du simple renforcement des pôles, on peut penser à des rapprochements de services. L'État dispose en la matière d'une expérience avec le rapprochement des dde et des ddaf, expérimenté dans quinze départements, puis généralisée aux cent départements par circulaire au début de 1993. Le bilan de cette expérience a montré la légitimité du rapprochement, accentuée par la mise en place de missions interservices de l'eau (mise). Mais l'absence de finalités précises fixées par les deux ministères quant à l'adaptation au terrain n'a pas permis de poursuivre l'expérience au-delà. - Des délégations interservices à la fusion de services Le recours plus fréquent à la formule de la dis confirmerait la fonction de guichet unique vis-à-vis des usagers et permettrait un pilotage stratégique plus efficace des actions. La formule de la dis peut s'appliquer à toutes les actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'État, à l'exception des actions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, des actions d'inspection de la législation du travail et des actions relatives au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'État et aux modalités d'établissement des statistiques. Sa création est décidée par arrêté du préfet. Son responsable reçoit délégation de signature et exerce une autorité fonctionnelle sur les chefs des services intéressés. L'arrêté doit fixer les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de son action. La décision préfectorale prend effet dès sa publication, quand les ministres ont défini au préalable le cadre des actions pouvant être réalisées par la délégation interservices. Toutefois, dans le cas contraire, cette désignation est subordonnée à l'accord exprès ou tacite dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission par le préfet de la proposition de désignation aux ministres intéressés, et à sa publication. Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré ou un directeur de préfecture. Le budget prévisionnel de la délégation décrit les crédits mis à sa disposition par différents services ou programmes. Le préfet peut désigner le délégué interservices en qualité d'ordonnateur secondaire délégué. La dis peut mobiliser des crédits issus de bop situés à différents niveaux territoriaux (département, région...) dès lors que le préfet a autorité sur le service déconcentré responsable du bop ou de l'uo. Les préfets qui souhaitent mettre en œuvre une dis doivent ainsi, avec les chefs de services concernés, se rapprocher des responsables de bop gérant les crédits correspondant aux différentes catégories de dis dessus. En fonction des enjeux de chaque territoire, ils déterminent ensemble les crédits, en volume et par catégories de titres, devant être affectés à la dis. Mais celle-ci ne permet en aucun cas la fongibilité des crédits provenant des différents bop mobilisés. Pour respecter le principe de spécialité ministérielle, les crédits attribués doivent être isolés au sein de chaque bop dans une uo spécifique. Le délégué interservices choisi par le préfet sera désigné comme responsable unique de ces différentes uo. Les crédits de chacun des bop mobilisés doit faire l'objet d'un engagement coordonné par le délégué interservices, qui doit rendre compte de l'exécution de la dépense et du suivi de la performance au préfet ainsi qu'aux chefs de service et responsables de bop concernés. La mise en place d'une dis constitue, sans conteste, un élément réformateur de l'organisation territoriale des services en anticipant une gestion plus transversale des missions, en renforçant les structures locales et en permettant d'élaborer une position unique des services de l'État sur une question déterminée. Au-delà de la mise en place de dis, qui trouve sa limite dans une unité de façade, pourrait être envisagée de manière plus systématique la création de services supports communs, formes de secrétariat général des services de l'État en régions qui joueraient le rôle de prestataires de services pour l'ensemble des administrations déconcentrées sur un territoire donné. Les fonctions qui pourraient faire l'objet de manière évidente d'un tel regroupement sont la gestion immobilière, les achats et la gestion des ressources humaines. Dans chacun de ces trois domaines, des travaux ont d'ores et déjà été entrepris. Leurs conclusions permettront d'éclairer les voies de progrès susceptibles d'être mises en œuvre à l'échelon du département (344), mais aussi à l'échelon régional. Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en œuvre d'une même politique de l'État, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée. La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services intéressés, sur la base d'une étude d'impact. Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'État, après avis des comités techniques paritaires compétents. Un des interlocuteurs rencontrés par le rapporteur, à l'occasion de ses déplacements dans les régions estimait, par exemple, que « les dde vont se recentrer sur les missions du logement, de la sécurité et de l'aménagement du territoire. Dans ce dernier domaine, l'échelon régional va s'attacher à définir une doctrine en liaison avec la gestion des risques. En Alsace, les directions de l'agriculture sont pilotes dans ce domaine. À terme, une réunion des dde et des ddaf, susceptible d'entraîner celle des dre et des draf, n'est pas inenvisageable ». C'est ce processus qu'il convient d'encourager. La recomposition fonctionnelle ne peut porter que sur des métiers proches et, au-delà, sur des rapports de concertation et de coordination. La fusion ne doit pas être recherchée comme un objectif en soi. Elle doit impliquer de manière indispensable les administrations centrales au plus haut niveau de la hiérarchie. Elle nécessite également et surtout que soit levée l'hypothèque de la réforme de la fonction publique et facilité le redéploiement des effectifs. c) L'hypothèque du redéploiement des effectifs et de la réforme - Le nécessaire redéploiement des effectifs La décentralisation ne doit pas avoir seulement pour effet d'agir sur les effectifs des services déconcentrés de l'État, mais aussi − et peut-être d'abord − au sein des administrations centrales, dont les fonctions doivent être recentrées sur les tâches de conception. Comme l'écrivait, dès 1966, François de Baecque : « pour qu'il y ait déconcentration, il faut aussi que l'administration centrale se modifie. Or, ... il semble qu'on n'ait pas jusqu'à maintenant cherché à réfléchir d'une manière un peu systématique au problème du partage des attributions entre les administrations centrales et celles des services d'exécution,... et puisqu'en France nous partons d'une situation de concentration très marquée, c'est d'abord sur le rôle des administrations centrales elles-mêmes qu'il semble opportun de s'interroger. » (345) François Mitterrand, alors Président de la République, dans son discours de Moulins pour le bicentenaire des départements, le 22 mars 1990, allait dans le même sens : « Il va bien falloir que les administrations centrales se résignent à limiter leurs activités aux missions qui leur sont propres, mission de réglementation, de conception, de coordination et qu'elles délèguent une fois pour toutes la volonté et le pouvoir de régler les dossiers à des services extérieurs renforcés, regroupés sous l'autorité du représentant du gouvernement ». Il est vrai qu'en 2002, l'administration territoriale représentait près de 98 % des emplois civils de la fonction publique de l'État, quand l'administration centrale ne comptait que 35 000 fonctionnaires pour un total de 1,71 million de personnes. Cependant, cette répartition était très inégale selon les ministères. Pour une moyenne nationale de 2 %, la part des effectifs d'administration centrale s'établissait à 24 % au sein du ministère chargé de l'environnement, à près de 18 % au ministère chargé de la santé et des affaires sociales, à 9,7 % au ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, pour atteindre encore 7 % au ministère de la culture et 5 % au ministère des finances. Quant au ministère de l'équipement, des transports et du logement, le ratio est légèrement supérieur, avec 2,5 % des effectifs qui travaillent en administration centrale. En revanche, le ministère de l'intérieur et celui de l'éducation nationale enregistraient des taux plus faibles, respectivement de 1,57 % et 0,33 %, en raison, notamment, du poids des personnels de police et des personnels enseignants. S'il peut ne pas sembler irrationnel qu'un ministère de taille réduite entretienne provisoirement une grosse tête de réseau afin de s'imposer, en revanche, il convient de se demander pourquoi certains ministères semblent avoir conservé au centre une part très importante de leurs effectifs, alors même que leur champ de compétences est parfois décentralisé depuis vingt ans. Dans ces conditions, il paraît légitime que ces ministères redéploient dans les services déconcentrés en voie de restructuration, aux échelons régional et départemental, une partie de leurs effectifs, notamment tous ceux qui sont chargés de tâches de gestion. Ne devraient être conservés au centre que les personnels chargés de la législation et de la réglementation d'une part, de l'évaluation statistique des politiques locales d'autre part, faute de quoi seront maintenus à Paris les moyens de traiter des dossiers qui, en conséquence, remonteront, la décentralisation conduisant alors, paradoxalement, à renforcer les administrations centrales. Cette évolution serait cohérente avec celle de l'organisation des pouvoirs publics qui découle des lois de décentralisation. - La nécessaire fluidité de la fonction publique La commission présidée par Michel Pébereau l'a relevé : « Les décisions politiques qui auraient permis de faciliter la mobilité des agents entre directions et entre ministères n'ont pas été prises. Les fusions de corps restent en effet trop rares (une dizaine par an environ). L'élargissement, au sein d'un même corps, du nombre de fonctions que ses membres peuvent exercer n'a pas non plus été mis en œuvre jusqu'à présent. » (346) De nombreux interlocuteurs du rapporteur, y compris les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, ont souligné le lien nécessaire qui devait exister entre mise en œuvre de la lolf et réforme de la fonction publique. La meilleure allocation des moyens aux besoins implique une certaine souplesse dans le recrutement et la gestion. Or, la déconcentration de la politique de la fonction publique ne se trouve pas dans ses gènes. Pourtant, elle permettrait une meilleure satisfaction des besoins locaux, une plus grande stabilité géographique, une réduction des rotations trop rapides des agents cherchant à rejoindre une affectation conforme à leurs vœux et une réduction des délais de procédure. La juridiction administrative a toujours exprimé sur cette question des positions très réservées. Le Conseil d'État, dans un avis du 1er décembre 1964, estimait que le principe d'égalité imposait que les épreuves écrites soient identiques pour tous les candidats et devaient faire l'objet de l'appréciation d'un jury unique. Dans un avis du 10 mai 1972, il concède que les épreuves écrites peuvent être corrigées par des correcteurs qui ne seraient pas membres du jury, ce dernier opérant une péréquation entre les groupes de correcteurs ; en revanche, les épreuves orales doivent continuer à être appréciées par un jury unique. Le législateur est intervenu pour permettre au jury, si nécessaire, de se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, pour assurer l'égalité de notation des candidats, le jury doit toujours opérer la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs. En outre, la circulaire du 9 avril 1991 relative à la déconcentration des recrutements des fonctionnaires de l'État a prévu l'organisation de concours nationaux au niveau local, les candidats reçus étant affectés dans la région concernée ; l'organisation de concours interministériels par les préfets à la demande des ministères intéressés pour le recrutement des corps de catégorie C a également été ouverte, ainsi que l'organisation de concours communs pour les corps relevant de filières administratives différentes avec une définition commune des modalités de mise en œuvre. Au-delà se pose la question de la déconcentration de la gestion elle-même des fonctionnaires de l'État. Dans ce domaine aussi, la juridiction administrative a dit sa réserve. Ainsi, dans son avis du 7 juin 1990, le Conseil d'État a considéré qu'il ne serait pas raisonnable de déconcentrer les actes de gestion impliquant une appréciation des mérites respectifs des agents d'un corps lorsque l'effectif en cause au niveau local est inférieur à une cinquantaine d'agents, et ce afin de permettre une évaluation équitable. Le Conseil relève, en outre, que le respect de la légalité interdit l'institution, même à titre dérogatoire, de commissions administratives paritaires communes à plusieurs corps. La circulaire du 9 avril 1991 précitée encourage néanmoins la déconcentration des actes de gestion des personnels. L'article 14 de la charte de la déconcentration entérine ce principe en prévoyant que « des décrets en Conseil d'État fixeront, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'État ». Ainsi, de nombreux décrets par ministère permettant la déconcentration vers les représentants locaux du ministre existent. Il faut cependant des arrêtés qui, acte par acte, donnent pouvoir de déconcentration des actes de gestion. Des domaines tels que la formation continue ont connu d'importants progrès. Mais, comme l'a souligné l'ancien directeur général de l'administration et de la fonction publique (dgafp) entendu par le rapporteur, on peut souvent juger de l'appétence d'un ministère à la déconcentration à partir de la déconcentration du pouvoir disciplinaire. C'est dans cette matière que l'on peut voir si le ministère concerné reconnaît à l'échelon déconcentré un certain niveau de responsabilité. Les sanctions sont regroupées dans quatre à cinq groupes. Tous les actes peuvent être pris de manière déconcentrée, sauf les deux premières catégories qui nécessitent la réunion d'une commission administrative paritaire. Les ministères déconcentrent les trois premiers niveaux de sanctions. Qu'ils déconcentrent ou non l'exclusion temporaire pour quinze jours et la mutation d'office est un bon indicateur de déconcentration. Or, les ministères, y compris pour des personnels de catégories B et C, ont un peu avancé en cette matière. L'avis du Conseil d'État précité, qui estime que la rupture d'égalité de traitement entre les agents est avérée si, dans la circonscription considérée, il n'existe pas cinquante personnes au moins d'un même corps, bloque le processus. La question du cloisonnement des corps se pose donc de nouveau. À ce titre, les mesures annoncées par le Premier ministre dans sa circulaire du 2 janvier 2006 relative à la mise en œuvre des propositions de réforme de l'administration départementale de l'État peuvent amorcer la réforme de manière significative, même si le cadre juridique actuel ne suffit plus à assurer la souplesse nécessaire à la fonction publique de l'État, comme l'ont montré les échanges survenus au sein de la commission commune aux conseils supérieurs des fonctions publiques de l'État et territoriale créée pour la mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ainsi, il a été demandé aux préfets de favoriser des parcours professionnels diversifiés entre les différents services départementaux. Dans ce but, en accord avec les chefs de service, devra être préparé un document commun de gestion prévisionnelle des personnels permettant de dessiner l'évolution des besoins quantitatifs et qualitatifs. Les chefs de service devront donc fournir les prévisions de mouvements d'entrée et de sortie au sein des services ainsi que les besoins prévisionnels en fin d'année n, pour évaluer le volume des recrutements offerts aux concours du début de l'année n + 1 et la part des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie du détachement sur la base de fiches de postes. Les départements des régions Lorraine et Champagne-Ardenne devront expérimenter en 2006 une démarche locale visant à organiser des mouvements de personnels entre services, en complément de ceux intervenus au sein des corps de fonctionnaires après consultation des commissions administratives paritaires de mutation. Dans tous les départements et en respectant les principes posés par la lolf, le Premier ministre encourage les préfets à utiliser sans attendre les possibilités qu'offre le décret du 31 mai 1997 relatif à la déconcentration en matière de mise à disposition. Il les invite aussi à mettre en œuvre des mutualisations dans les trois domaines prioritaires pour la gestion des ressources humaines que sont le recrutement et la mobilité, la formation professionnelle et la politique sociale, ce qui implique, notamment, l'organisation de concours communs au niveau départemental ou à l'échelon régional, la mise en place de formations professionnelles interministérielles pour les matières qui ne relèvent pas d'un métier spécifique à un département ministériel. En outre, une plate-forme de suivi et de développement du contingent préfectoral destiné au logement des fonctionnaires sera créée à titre expérimental auprès du préfet de la région Île-de-France dès 2006. 3. Créer des délégations de l'État régionales et de proximité Comme le soulignait M. Jean-Benoît Albertini, en 1997, dans la réforme de l'État manque peut-être une remise en question générale des circonscriptions administratives (347). Or, pour reprendre les propos d'Edmund Burke dans ses Réflexion sur la révolution en France, « un État qui n'a pas les moyens d'effectuer des changements n'a pas les moyens de se maintenir ». La régulation économique est assurée au niveau international et régional, la régulation socio-politique par des institutions de proximité. Les politiques territoriales cassent la « sectorialisation » traditionnelle administrative. Les bassins de vie ne coïncident plus automatiquement avec les cadres administratifs territoriaux classiques des départements, cantons et communes. L'État doit se réorganiser en fonction de ces nouvelles données. - Créer une délégation territoriale au niveau régional En Grèce comme en Italie et en Espagne, le niveau régional paraît destiné principalement à recueillir l'essentiel de l'administration déconcentrée. La création d'une délégation territoriale de l'État au niveau régional permettrait de regrouper certaines fonctions au sein d'une même entité qui pourrait, dans une hypothèse basse, assurer l'accueil dans un seul lieu, et dans une hypothèse haute, intégrer les services déconcentrés de l'État. C'est la question de l'éventuelle mise en commun des moyens de fonctionnement des différents services de l'État, sur le modèle britannique, institué en 1993, regroupant dans huit régions (348) des représentations locales des ministères du commerce et de l'industrie, de l'environnement, de l'emploi et des transports, sous l'autorité d'un directeur régional unique, réunissant entre 200 et 300 fonctionnaires. Dans ce système, chaque ministère contribuait au prorata de ses effectifs. Les directeurs ont été choisis parmi les anciens chefs de bureaux préexistants, chacune des trois autres administrations concernées étant représenté par un sous-directeur. Aujourd'hui, en France, les propositions des ministères s'inscrivent le plus souvent dans une logique de « tuyaux d'orgue ». - Créer une délégation territoriale au niveau infra-départemental L'échelon régional s'affirme, l'échelon départemental se spécialise notamment sur les questions de sécurité. Reste l'échelon de l'arrondissement. Les imperfections de la carte actuelle des sous-préfectures sont une chose entendue. Longtemps condamné à être le « mal aimé de l'administration » (349), image du « vide et de l'ennui », l'arrondissement fait régulièrement partie des victimes putatives ou expiatoires des volontés réformatrices simplificatrices (350). Mais cela ne doit pourtant pas signifier que cet échelon a totalement perdu de son intérêt. En effet, la décentralisation, avec notamment la montée en puissance de l'intercommunalité, a permis une redécouverte de cette circonscription administrative, qui permet de définir, dans la proximité, un optimum de représentation. En instituant, par la loi du 22 décembre 1789, des conseils de district appelés à devenir par la suite les conseils d'arrondissement, la Révolution française avait déjà bien senti la nécessité de trouver un niveau d'administration intermédiaire entre la commune et le département. Il convient aujourd'hui pour ancrer l'État de repositionner ce niveau intermédiaire entre région et commune. Redessinés, les arrondissements pourraient accueillir un bureau territorial de l'État, forme de guichet unique de proximité, en liaison directe avec les délégations de l'État dans la région, à la fois source d'information et point de diffusion des décisions administratives. B. CONFORTER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La déconcentration n'est pas la seule manière possible de désencombrer les structures centrales. Le système bâti sur la notion de délégation et qualifié d'« administration étatique indirecte » peut être la contrepartie de l'absence d'administration d'État au plan local. Les collectivités territoriales, comme en Italie ou en Espagne, par exemple, pourraient très bien, comme le font aujourd'hui par exemple les communes pour l'état civil, conduire des politiques de l'État. Mais, alors, pour conforter le rôle des acteurs locaux, il conviendrait de faire exister la notion de chef de file et de confirmer le rôle de l'intercommunalité. 1. Donner un contenu à la notion de chef de file a) Exploiter les voies ouvertes par la Constitution L'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, dans son deuxième alinéa, disposait ainsi que « les collectivités locales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'un d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et ses moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences » (351). La révision constitutionnelle de 2003 a apporté des nouvelles perspectives en la matière, l'avant-dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoyant que « lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune ». Cette faculté constitutionnelle n'a pas encore été utilisée. Mais, la loi du 13 août 2004, dans son article 1er, en confiant à la région un rôle prépondérant dans le développement économique s'en approche et, dans les faits, les régions tendent à jouer le rôle de chef de file dans ce domaine. Si la diffusion des srde se confirme et fait l'objet d'une généralisation à la fin de l'expérience, il sera temps d'en tirer les conclusions juridiques et de reconnaître par la loi le rôle de chef de file de la région dans l'organisation économique du territoire. Il faut rappeler à cet égard que les discussions qui avaient eu lieu sur le rôle dévolu aux régions dans cette matière, loin de répondre aux changements de majorité dans les régions, puisqu'elles avaient commencé dès la première lecture du projet de loi relatif aux responsabilités locales au Sénat - lecture intervenue avant les élections régionales - reposaient sur le fait que les régions à elles seules n'assurent qu'environ 30 % du financement des aides économiques, les intercommunalités et les communes d'une part, les départements d'autre part en assurant respectivement environ 40 % et 30 %. De la même façon, le rôle dévolu aux départements en matière sociale se rapproche dans les faits de la notion de chef de file, qui, si elle n'est pas juridiquement appliquée, pénètre progressivement les esprits. Elle n'a pas encore donné tous les fruits qu'elle promettait. b) Limiter le nombre d'intervenants De manière expérimentale et afin de tenter de limiter les conséquences de la multiplication des financements croisés, dont on a vu combien ils s'étaient développés au fil de la décentralisation, il pourrait être envisagé de construire des couples d'intervenants, dont seul l'un des partenaires conduirait les opérations à la manière d'un chef de file. Ainsi, dès lors que le nombre total de partenaires à un projet dépasserait trois, serait imposée la constitution d'un couple, permettant ainsi de limiter le nombre d'intervenants directs à deux. Dans ce cadre, pourraient être ainsi systématiquement réunis les communes et les intercommunalités ou bien les intercommunalités et les départements ou encore les départements et les régions. Pour prendre l'exemple de la construction d'un stade susceptible de servir à la fois aux écoles élémentaires de la commune, aux amateurs de sport relevant de l'intercommunalité, mais aussi aux collèges gérés par le département et au lycée suivi par la région, plutôt que d'avoir quatre intervenants pour une seule opération, l'intercommunalité pourrait être désignée chef de file ainsi que la région ou le département. In fine, les opérations seraient menées par seulement deux partenaires, à charge pour les collectivités qui ne seraient pas désignées comme telles de nouer un simple partenariat financier avec le chef de file, sans pour autant s'impliquer nécessairement dans la gestion du projet. Outre l'avantage de la lisibilité, une telle construction permettrait aux collectivités qui ne seraient pas désignées chefs de file de réduire leurs coûts de structure et de gestion. De surcroît, elle permettrait de favoriser les coopérations et l'intégration des territoires. En tout état de cause, la contribution volontaire ne saurait être assimilée à un placement sous tutelle, chaque collectivité ayant à arbitrer entre une intervention directe sur tous sujets, coûteuse en moyens, et un partenariat préservant ses intérêts tout en étant économe de ses ressources. 2. Confirmer le rôle de l'intercommunalité Le succès rencontré par l'intercommunalité dépasse les simples effets d'aubaine et la crise de croissance qu'un tel instrument de coopération territorial né il y a moins de dix ans traverse, ici ou là. Il suscite l'adhésion de nos concitoyens (352). a) Stabiliser sans la cristalliser la définition de l'intérêt communautaire Introduit par la loi du 6 février 1992 précitée, l'intérêt communautaire forme la ligne de partage au sein d'une compétence entre les domaines d'action de la communauté, qui agit dans les domaines d'intérêt communautaire, et ceux de la commune. Les communes conservent la capacité de mener des actions de proximité sur leur territoire. Ce n'est pas l'intérêt commun qui ne concerne qu'une seule commune membre et la communauté. Ce n'est pas non plus l'intérêt intercommunal, entendu comme l'addition des intérêts de chaque commune. La notion d'intérêt communautaire n'a pas la même portée selon les types de communautés : la création de zones industrielles, les actions économiques, le développement urbain, la politique de logement social d'intérêt communautaire sont de la compétence de la communauté d'agglomération ; la totalité de ces compétences sont réputées intégralement d'intérêt communautaire pour les communautés urbaines (353). Les epci doivent strictement s'en tenir à l'exercice des compétences énumérées dans le texte qui les crée. Tribunaux administratifs et Conseil d'État estiment que les difficultés doivent être résolues en faveur des communes qui exercent une compétence générale. Lorsque les statuts utilisent des termes très généraux pour définir une compétence transmise à un epci, le juge écarte l'idée que ce dernier puisse se saisir de celle-ci dans sa globalité. Le Conseil d'État n'accepte pas qu'ils prennent des initiatives allant au-delà du seul intérêt communautaire défini. Or, il faut bien constater que l'institution porteuse du projet existe désormais par elle-même. On voit poindre sous l'établissement public, notamment lorsqu'il s'agit d'une communauté d'agglomération, l'embryon de collectivité territoriale, qui dispose d'un territoire homogène d'un seul tenant et sans enclave, de la tpu, d'une dgf bonifiée et qui peut contractualiser avec l'État. Mais, l'intérêt communautaire fait l'objet de nombreuses incertitudes ainsi que l'a relevé la Cour des comptes dans son rapport précité de novembre 2005. Il serait néanmoins vain de penser que l'intérêt local ou communal peut être défini en droit de manière univoque, applicable à toutes les situations. De très nombreux équipements ou zones sont à la fois d'intérêt communal et d'intérêt communautaire, voire départemental, régional ou national. La solution la plus pragmatique et adaptée consiste à organiser une discussion entre élus communaux (dans les communautés de communes) et entre délégués communautaires (dans les communautés urbaines et d'agglomération), afin de parvenir à définir une liste de ce qui relève de l'un ou l'autre des niveaux. La loi du 13 août 2004 précitée a précisé les délais de définition de l'intérêt communautaire. Ils s'établissent à un an à compter de la publication de la loi pour les epci existants et à deux ans pour les nouveaux transferts de compétences intervenus après cette publication. À défaut de définition dans ces délais, l'intégralité des compétences considérées sont transférées à l'epci. La clarification des intérêts de chacun ne peut que conforter les progrès de lisibilité que doit accomplir l'intercommunalité. Le développement économique, les transports, l'eau et l'assainissement, la voirie, la gestion des déchets, celle des équipements culturels et sportifs, compte tenu de la structure en réseau qui sous-tend ces activités, doivent être privilégiés par l'approche communautaire. La détermination d'un intérêt communautaire change la nature de la coopération intercommunale, qui devient un véritable échelon d'administration. L'intérêt communautaire rapproche la compétence des structures intercommunales de la compétence générale des communes. Les charges de personnel des structures intercommunales sont passées de 1,35 milliard d'euros en 2000 à 2,63 milliards en 2003, soit une augmentation de 30 % par an. Or dans le même temps, les charges de personnel des communes ont également fortement progressé (11,4 %), alors même que les communes ont transféré une partie de leurs compétences aux structures intercommunales, sans en acquérir de nouvelles. Pour éviter un doublement systématique des structures sur le modèle de ce que le rapporteur a pu s'entendre décrire à Strasbourg et pour aller au-delà de la simple possibilité ouverte par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité de mise à disposition d'un service d'un epci au profit d'une commune membre pour l'exercice d'une compétence conjointe, il conviendrait de rapprocher voire d'intégrer les services généraux communaux de la ville-centre et les services intercommunaux de façon à limiter le nombre des doublons administratifs. Les services généraux fonctionnels pourraient être assurés par une seule direction générale : facturations des salaires, des locaux ou des fournitures peuvent être réalisées par un service unique, à charge pour lui de répartir les coûts en fonction des structures utilisatrices. Au rang de la mutualisation des moyens, on pourrait également développer les contrats d'agglomération en favorisant leur dotation. Cet instrument utile de rationalisation des compétences apparaît aujourd'hui insuffisamment développé. c) S'interroger sur le mode de désignation des élus intercommunaux Dans la profusion d'échelons institutionnels et territoriaux, la légitimité découlant d'un mandat politique donné par le suffrage universel demeure plus que jamais une source incontournable. Aujourd'hui, l'organe délibérant de l'epci est élu par les conseils municipaux parmi leurs membres, au scrutin majoritaire à trois tours, sous réserve des dispositions particulières aux syndicats de communes et aux communautés urbaines. La loi a renforcé de manière discrète les pouvoirs de l'exécutif de l'intercommunalité. La liste des matières qui peuvent faire l'objet d'une délégation de la part de l'organe délibérant a ainsi été précisée et allongée. La tendance est à la « mayoralisation » de la fonction d'exécutif de l'intercommunalité. Le nombre et la répartition des sièges peuvent être fixés par accord amiable entre tous les conseils municipaux. Le débat sur la désignation des délégués intercommunaux est récurrent, sinon lancinant. L'effort entrepris pour renforcer et rationaliser l'action publique locale par le truchement de l'intercommunalité mérite, à terme, d'être complété. La décentralisation peut comporter, à l'image de ce que l'on constate à propos de l'État central, des tendances technocratiques, y compris là où les préoccupations managériales sont le plus fortement soulignées. Cela vaut en particulier pour les échelons intercommunaux qui, malgré tous les avantages qu'ils présentent et que le rapporteur s'est attaché à rappeler, constituent souvent des lieux peu lisibles. Si le système de désignation à deux degrés des délégués communautaires peut, dans un premier temps, être analysé comme un levier d'action temporaire au service des représentants politiques, engagés dans un gouvernement de consensus, il convient de reposer la question de leur élection au suffrage universel direct (354). Cette question s'impose d'autant plus que la part de la fiscalité votée par les instances intercommunales progresse rapidement. Ce serait également un moyen de favoriser le débat sur les enjeux intercommunaux lors des élections municipales. Dans un premier temps, il serait possible d'envisager la désignation du seul président de l'intercommunalité au suffrage universel, les délégués restant désignés par les conseils municipaux. Certains candidats aux élections municipales pourraient également être désignés comme ayant vocation à devenir délégués communautaires. Une telle évolution poserait évidemment la question du devenir des communes et celui des cantons, donc des conseils généraux. (355) II. - CHANGER DE MODÈLE DE GOUVERNANCE DES TERRITOIRES ? Le pouvoir territorial est aujourd'hui au milieu du gué. Il mêle comportements traditionnels, tels que l'influence des notables, la complémentarité des rôles entre élus et agents locaux de l'administration et l'imbrication des systèmes de relations nationaux et locaux, et modèles novateurs dans lequel le maire investisseur succède au maire gestionnaire et dans lequel le préfet incitateur et économiste prend le relais du préfet gardien de l'ordre public. Mis en mouvement grâce au déséquilibre initial provoqué par le nouvel agencement des pouvoirs entre les collectivités locales et l'État, le système local évolue donc de manière spontanée autant que régulée, le droit venant, à certaines étapes, prendre acte ou encadrer des dérives possibles. L'objectif est de trouver un équilibre qui permette de donner un minimum de cohérence aux multiples stratégies de réseaux à l'œuvre au niveau local. Il reste difficile de définir ce que sera ou ce que serait l'état stable d'un système politico-administratif local recomposé. L'appareil territorial de l'État n'a plus pour seule fonction d'ajuster à la marge l'application des politiques nationales à travers une négociation avec les acteurs locaux mais de trouver les moyens d'une coordination entre les politiques conduites par les différents acteurs locaux disposant de légitimités souvent concurrentes et de moyens importants. A. REDESSINER LA CARTE ADMINISTRATIVE ET TERRITORIALE ? L'État en France est quasi solidifié. Il ne s'est pas réformé dans ses frontières administratives internes. Les structures se sont empilées, tandis que sont apparues de nouvelles structures, moins institutionnelles que les collectivités territoriales traditionnelles, les pays venant concurrencer les cantons, les communautés d'agglomération venant concurrencer les communes. Il est impossible de ne pas poser la question de la taille critique. (356) Dès 1993, le Conseil d'État relevait dans son étude sur l'ordre juridique et la décentralisation, que « s'agissant du nombre d'échelons de gestion de la vie collective, la décentralisation a vraisemblablement été conduite avec un trop grand nombre de partenaires, et en faisant du département un partenaire à certains égards exagérément privilégié. (...) Une diminution du nombre d'échelons de gestion et une diversification de ceux-ci, laquelle passe peut-être par des ajustements constitutionnels (...) est sans doute nécessaire » (357). Le moyen, pour atteindre un nouvel équilibre territorial des pouvoirs qui soit pérenne, est de trouver des solutions susceptibles de permettre la réorganisation efficace des services publics locaux autour de territoires pertinents, de faire coïncider autant que possible territoire et compétence. Si le rapporteur n'ignore pas les obstacles que pourrait rencontre un tel dessein, il n'en estime aucun dirimant au regard des gains qui résulteraient d'un changement d'organisation territoriale. 1. Dissocier carte administrative et carte locale a) Le mirage du jardin à la française Dans la conception française, les régions, les départements, les communes en métropole comme outre-mer sont donc avant tout des circonscriptions administratives qui pourront, par la formule du dédoublement fonctionnel, servir deux catégories de collectivités : l'État et les collectivités territoriales. Au fil des ans s'est constituée une double administration : historique, formée des administrations centrales, des départements et des communes, et réelle, constituée des services déconcentrés, des régions et des intercommunalités. Les institutions anciennes ont connu de profondes transformations. Pour pallier les carences de l'action publique, les pouvoirs publics suscitent l'émergence de territoires spécifiques dotés d'administration d'exception, à côté ou en parallèle de ceux hérités de la Révolution et de l'Empire. La géographie administrative et politique ne correspond plus aux données de la vie concrète. La constitution juridique du territoire ne répond plus aux besoins de la population. Des circonscriptions périmées sont maintenues artificiellement. À l'inverse on prive d'identité juridique des espaces en formation comme celui de la ville (358). La puissance publique reste cependant attachée aux principes d'administration posés par les états généraux, à savoir la rationalité des limites territoriales, l'abstraction des concepts d'organisation, la symétrie des institutions, l'égalitarisme dans l'action, l'uniformité dans l'application des lois. Le département palliait les limites et les fragmentations du tissu communal en lieu et place des anciennes provinces. L'État a organisé, à côté des administrations traditionnelles, des territoires spécifiques soumis à des régimes particuliers : zones diverses de reconversion, de rénovation, de développement, zones littorales, zones de montage, espaces et sites à préserver, parcs naturels, communautés de communes, communautés d'agglomération, refonte de certains départements, organisation de coopérations transfrontalières, commissariat en charge d'actions spécifiques sur des territoires transversaux... L'émergence de territoires spécifiques dissocie l'assise géographique de la représentation politique de la population. La République devient une mosaïque d'espaces intermédiaires et différenciés sans corps équivalents pour les gouverner. Certains craignent un « polycentrisme improvisé » qui « pourrait inféoder à des intérêts corporatifs et passagers, susciter des autonomies en quête de l'accès direct à un pouvoir européen » (359).
Il faut renoncer clairement à l'illusion d'une administration déconcentrée de l'État dont chaque échelon correspondrait à une catégorie de collectivité territoriale. Ce n'est ni une réalité ni une nécessité. L'État territorial n'a plus les mêmes compétences qu'auparavant. Il n'est plus indispensable qu'il quadrille le territoire de manière aussi fine qu'en 1789 avec son cortège de préfectures et de sous-préfectures, de directions départementales et de subdivisions. b) La fin du « doublonnement » L'article 1er de la loi du 6 février 1992 dispose que « l'administration territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et par les services déconcentrés de l'État ». L'article 4 dispose ensuite que, pour exercer leurs missions, les services déconcentrés sont organisés dans le cadre de circonscriptions régionales, départementales ou d'arrondissements. Cette disposition pose le problème de la dualité d'organisation déconcentrée et décentralisée. Administrations centrales, administrations territoriales de l'État et celles des collectivités locales rivalisent pour « contrôler » les mêmes fragments de territoire et les mêmes populations. Le contournement des procédures contractuelles ne fait qu'aggraver cette confusion. Pour la réduire, certains proposent un bouleversement profond de notre organisation administrative, prenant acte du développement du concept pourtant flou de pays (360) et de l'intercommunalité. Dans ce schéma « idéal », les 3 800 bassins de vie quotidiens seraient incarnés par 3 800 communautés de communes, tandis que les 350 bassins d'emploi deviendraient les réceptacles de 350 pays qui eux-mêmes rassembleraient communautés de communes et communautés d'agglomération, ces dernières, au nombre de 140, constituant un maillage de pôles de développement. Plus raisonnable semble l'idée de découpler la carte administrative de l'État de celle des collectivités locales, idée déjà formulée par Jean Picq notamment (361). Si les collectivités territoriales sont chronologiquement des circonscriptions administratives qui ont ensuite été dotées de la personnalité morale, cela ne signifie pas que l'État doit continuer de dessiner la carte de ses services en fonction de la carte des collectivités locales. 2. Deux fois moins de régions deux fois plus grandes ? Dans son discours fondateur du 24 mars 1968 à Lyon, le général de Gaulle relevait que « l'effort multiséculaire de centralisation ne s'impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui apparaissent comme les ressorts de la puissance économique ». Il faut trouver des circonscriptions pertinentes au regard des mutations du système économique et des enjeux de la construction européenne et parvenir à un allégement du poids résultant, pour les finances publiques et les citoyens, de la multiplication des échelons de gestion. Le débat sur la taille des régions françaises est récurrent. Sans trancher, il convient de présenter un nombre de scénarios susceptibles de parvenir à ces objectifs. a) Prendre en compte l'interrégionalité ? De plus en plus d'administrations de l'État, à l'exemple du ministère de l'équipement, s'organisent à un échelon interrégional. De plus en plus de politiques d'État sont menées à cet échelon, l'exemple ancien des politiques de massif et des politiques de bassin en sont l'illustration. Le rôle renforcé de la zone de défense (362) et la réunion à l'échelon zonal, par un décret du 18 mars 1993 (363), de l'état-major de la sécurité civile, le service zonal des transmissions et le secrétariat général pour l'administration de la police (sgap), vont dans le même sens. Les politiques menées par l'Arc Atlantique donnent un exemple de politique commune entre les collectivités régionales. Cette tendance constitue un indice de l'importance de prendre en compte au bon échelon certaines questions. À de nombreuses reprises, à l'étranger comme en France, les interlocuteurs du rapporteur ont souligné la nécessité d'organiser des réseaux interrégionaux sur certaines questions, celles des grandes infrastructures, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des pôles économiques de compétitivité et des équipements médicaux très spécialisés étant le plus souvent citées. Il faut assurer des arbitrages entre les métropoles, par exemple entre pôles universitaires, pôles de compétitivité ou de santé. Les régions sont aujourd'hui trop petites pour les rendre. La contractualisation à dimension interrégionale apparaît donc comme une réponse privilégiée à cette difficulté, comme l'a montré la mise en place récente des pôles de compétitivité. Elle constitue par ailleurs une condition de la prise en compte de certains programmes par l'Union européenne. La question de l'interrégionalité pose aussi celle de la coopération − ou de la concurrence − entre métropoles régionales, dont le rayonnement dépasse précisément les frontières de la région. Deux types de coopération interrégionale, s'ils sont intéressants de manière ponctuelle, n'ont pas un aspect structurant déterminant. Il s'agit des projets de territoires transrégionaux − un pays constitué entre des territoires appartenant à deux régions différentes − qui forment, en réalité, des projets infrarégionaux, et les projets thématiques de territoires, éventuellement non contigus, concernant par exemple des régions de montagne ou encore des régions viticoles. En revanche, un troisième type de coopération interrégionale permet de révéler de véritables synergies et de donner, par exemple au regroupement de deux régions, un avantage comparatif décisif au meilleur coût pour le citoyen-contribuable. Il faut ranger au titre de ces actions la réalisation d'infrastructures concernant plusieurs régions, les politiques littorales, fluviales ou touristiques, environnementales et économiques, la constitution d'un réseau universitaire, d'un réseau hospitalier ou de cancéropôles. À cet égard, on peut regretter le peu d'engouement que suscitent les missions interministérielles et interrégionales d'aménagement du territoire (miiat) qui ne prennent en compte qu'une partie de ces initiatives interrégionales (364). En tout état de cause, la multiplication des initiatives interrégionales comme la montée en puissances programmes communautaires interreg montre la voie d'un rapprochement entre les régions actuelles qui pose la question de l'élargissement de leur territoire et de leur population. b) Encourager la constitution de grandes régions ? D'un point de vue constitutionnel, le principe de libre administration fait que le législateur ne pourrait modifier les compétences des collectivités territoriales au point de les vider de tout contenu. En dehors de cette limite, le législateur a toute liberté car aucune collectivité territoriale ne peut prétendre détenir « par nature » des compétences à l'encontre de l'État. Ainsi, abstraction faite des aléas électoraux, demeure le sentiment d'une certaine hésitation de l'État sur le rôle qu'il entend faire jouer aux régions. Il semble continuer de leur attribuer des compétences par défaut. Chacun pourtant s'accorde à relever le caractère indispensable des régions − les exemples étrangers étudiés le montrent suffisamment −, mais tous semblent réservés lorsqu'il s'agit de tirer toutes les conséquences de leur existence. Le péché originel des régions est leur caractère administratif. Elles sont nées de la création des vingt-deux régions de programme en 1956 puis des circonscriptions d'action régionale entre 1959-1960. Le législateur, le constituant, le gouvernement continuent d'hésiter quant aux choix à faire, tiraillés entre des tendances ou des orientations en partie contradictoires.
Mais les chiffres présentés, ci-dessus, montrent, outre des disparités très importantes, un chiffre moyen de population par région relativement faible si on le compare notamment avec la situation de nos voisins. Si certaines régions atteignent une taille critique en termes de populations, d'autres ne peuvent que souffrir de leur faible poids démographique. La seule lecture de ce tableau inspire des rapprochements qui, du strict point de vue de l'efficacité des politiques publiques, semblent s'imposer. Dans ce contexte, diminuer le nombre de régions pour en augmenter les capacités ne paraît pas être de mauvaise politique et pourrait permettre un changement d'échelle propre à favoriser des synthèses plus riches entre les différents territoires, mais aussi susceptibles de mieux prendre en compte la dimension internationale de nombreux problèmes. À l'échelle européenne, des régions plus grandes seraient plus visibles et plus efficaces. L'État, dans la tradition française, est suffisamment fort pour ne pas y perdre mais au contraire pour s'enrichir d'un tel processus. c) Assurer une meilleure articulation entre départements et régions ? C'est de la superposition des compétences et des territoires que naît le risque de chevauchement des actions et de confusion des légitimités, tandis que se multiplient les soucis existentiels, chaque échelon revendiquant le droit à s'occuper de tout et ne trouvant de limites que dans la contrainte budgétaire. L'accent mis par de plus en plus de collectivités sur le développement durable (365) des territoires qui leur permet d'investir quasiment tous les champs de l'action publique en constitue une illustration évidente. - « Départementaliser » les régions Une première solution qui apparaît pour améliorer l'articulation entre départements et régions consisterait à faire des conseils régionaux une émanation des conseils généraux, assurant ainsi un lien organique entre les deux. Chaque département pourrait faire valoir ses intérêts au niveau régional, tandis que, sur le modèle intercommunal, une politique de consensus pourrait se dessiner entre délégués des départements émancipés des contraintes départementales. Cette solution aurait cependant pour inconvénient de revenir en arrière sur le fait régional, qui dispose depuis 1986 d'une légitimité démocratique certaine et qui, dans le contexte européen, a pris une importance telle qu'il serait difficilement envisageable de le subordonner à la construction départementale. En outre, elle n'aborderait pas la question de l'adaptation départementale aux évolutions sociales et économiques. - « Régionaliser » les départements Une deuxième solution envisageable reviendrait à faire élire les conseillers régionaux sur une base « départementale » ou plus exactement sur la base d'un regroupement de cantons, qui pourrait prendre la forme d'un arrondissement adapté aux nouvelles réalités territoriales, qui pourrait lui-même, par ailleurs, servir de support à une implantation de l'État rénovée. Chaque conseiller d'arrondissement, au même titre qu'aujourd'hui chaque conseiller général, pourrait être à l'écoute de « son » territoire et relayer ses préoccupations auprès de l'instance régionale, qui assurerait ainsi la synthèse entre proximité et dimension infranationale, pour « penser globalement » et « agir localement ». Dans ce schéma, se poserait naturellement la question du maintien de l'échelon départemental en tant que tel. Là encore, un équilibre territorial des pouvoirs satisfaisant appelle une réponse qui ne saurait être univoque. Certaines régions, dont le territoire est hétérogène ou la population très peu dense, peuvent justifier le maintien d'une collectivité départementale, à l'exemple de la région Languedoc-Roussillon ou encore de la région Auvergne. En revanche, on peut s'interroger sur la pertinence de maintenir des départements au sein de la région Île-de-France ou même, comme cela revient souvent en débat, en Alsace. En tout état de cause, cette question mérite d'être résolue au niveau des régions elles-mêmes et non à partir du centre. En deçà d'une recomposition des collectivités territoriales elles-mêmes, il conviendrait de créer des moyens de faciliter le rapprochement des points de vue. Pour ce faire, la création dans chaque région d'une conférence semestrielle réunissant le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux pourrait constituer un progrès non négligeable. Elle pourrait être chargée, notamment, de donner un avis, qui serait rendu public, sur les grandes politiques menées dans la région ainsi que sur les différents schémas régionaux. Un tel instrument serait d'autant plus utile dans l'hypothèse où des régions plus grandes se seraient constituées. 3. Faciliter le rapprochement des communes Définies en 1789 non pas à partir d'un territoire, comme les départements, mais sur le fondement des communautés d'habitants, les communes forment les « " terminaisons nerveuses " de la nation, véritables êtres collectifs qui la mettent en mouvement, traversent les constitutions et les régimes politiques et font partie de notre patrimoine génétique institutionnel ». C'est cet ancrage qui rend difficile toute réforme en la matière. Comment, cependant, ne pas poser la question du nombre des communes ? La France compte 36 782 communes. En 1968, elle en comptait 37 708, soit grosso modo le même nombre qu'en l'an VIII. 60 % ont moins de 500 habitants, 96,5 % d'entre elles en ont moins de 5 000. De la même façon qu'il ne pourra y avoir de renforcement de notre présence diplomatique et consulaire française sans réforme de la carte de nos ambassades et consulats et qu'il ne pourra y avoir de réforme de la justice sans remaniement profond de la carte judiciaire, il ne saurait y avoir de décentralisation communale réussie sans questionnement de la carte communale. Pour s'interroger ainsi, deux méthodes peuvent être suivies, une méthode abrupte de fusion, telle qu'elle a été pratiquée dans certains pays, en Suède notamment, et la méthode volontaire, qui, devant les échecs du passé ou les incertitudes nées du développement de l'intercommunalité, doit trouver une voie originale. a) L'éparpillement intangible ? La France est caractérisée par un « micro-découpage communal » (366). Environ une commune sur quatre a moins de 200 habitants. Environ une commune sur deux a moins de 400 habitants. Près de 60 % des communes ont moins de 500 habitants pour moins de 10 % de la population. Près de 80 % des communes ont moins de 1 000 habitants accueillant moins de 20 % de la population.
Si raisonner en termes de chiffres ne suffit pas, c'est parce qu'il convient de s'attacher surtout aux services rendus. Or, lorsqu'on définit les compétences des petites communes, celles de moins de 500 habitants par exemple, elles se limitent souvent à la voirie, aux bâtiments et aux affaires sociales entendues au sens strict. Pour assurer au mieux ces missions, il n'est point besoin d'avoir un conseil de onze élus. Un ou deux conseillers municipaux délégués, responsables pour cette zone, pourraient suffire. En revanche, pour que de meilleurs services plus nombreux soient rendus sur une telle commune, il faut bien faire appel à des partenaires extérieurs. Il est plus facile d'obtenir ce résultat lorsqu'on se trouve dans une structure intégrée. L'élargissement de la palette des compétences nécessiterait donc un élargissement du territoire. Si le nombre des communes n'est pas en lui-même la source des difficultés que connaissent les plus petites communes, il constitue au minimum un facteur aggravant de ces difficultés. Pour obtenir un regroupement des communes, deux solutions peuvent être envisagées : une solution autoritaire, telle qu'elle a été pratiquée en Suède, au Royaume-Uni, en Belgique ou en Grèce, et une solution nouvelle, qui consisterait à favoriser l'association pour des communes de petite taille − moins de 500 habitants dans un premier temps par exemple − dans une seule structure, chacune des anciennes communes, constituée d'une communauté d'habitants bien identifiée, pouvant conserver son nom et étant représentée spécifiquement par un ou plusieurs conseillers municipaux. b) La méthode volontariste : pour une fusion imposée ? Certains pays ont engagé une fusion radicale de leurs communes. Ce fut le cas en Belgique, mais aussi en Grèce. Avant la réforme, il existait dans ce dernier pays 5 318 communes et 441 municipalités formées des chefs-lieux des départements et des villes de plus de 10 000 habitants. 85 % des communes avaient moins de 1 000 habitants, 60 % moins de 500 habitants et 38 % moins de 300. Cet éclatement fut analysé comme un véritable obstacle au développement. La population regroupée dans chaque collectivité était restreinte, le manque de ressources criant, le niveau de compétence des ressources humaines en général et de l'encadrement en particulier insuffisant (367). Dans les années 1980, des dispositions sur le regroupement volontaire furent prises, mais n'occasionnèrent que 150 regroupements issus de 134 communes seulement. Pour faire face à cette situation, un ambitieux programme dénommé « Capodistria », du nom du premier gouverneur de l'État hellénique en 1827, fut adopté en février 1997, imposant un regroupement obligatoire fondé sur une planification de l'aménagement du territoire. Le cadre juridique fut défini en 1997, les élections des nouvelles municipalités intervinrent en octobre 1998. Il s'agissait à la fois d'assurer une prestation de services de niveau équivalent pour tous et de créer les conditions de l'autonomie administrative et financière. Le pays passa ainsi de 441 à 899 municipalités et de 5 382 à 135 communes, soit une réduction du nombre total de collectivités de 5 823 à 1 034, pour environ 10,3 millions d'habitants. Les communes et municipalités ont continué d'être compétentes pour l'entretien de l'infrastructure technique des réseaux d'eau potable, d'irrigation et d'évacuation des eaux usées, des routes, des équipements publics et de la mise en œuvre de programmes sportifs et culturels. En Suède, après la seconde guerre mondiale, la croissante très forte a permis une expansion très importante de l'État-providence. Ont alors été décentralisés de nombreux services, tels que l'école et l'assistance sociale, mais les communes étaient trop petites pour les assumer. C'est pourquoi on en a réduit le nombre de manière drastique, passant de plus de 2 500 à moins de 300. Dans un premier temps, le pays est passé par le système de l'agglomération sur une base volontaire. Mais les citoyens restaient attachés à leur petite commune et le processus n'avançait pas. Dans les années 1970, l'État suédois est passé à la fusion. La plus petite commune possède aujourd'hui 2 600 habitants. Parallèlement, s'est développé un système de péréquation qui, à 95 %, instaure un système égalitaire. Mais aujourd'hui, les communes ne veulent plus fusionner. Si on voulait aller plus loin, on se heurterait aux populations. Récemment, deux communes qui ont entre 4 000 et 5 000 habitants ont voulu fusionner. Mais les élus ont abandonné le processus devant le résultat du référendum local, la population refusant, pour l'une des communes à 80 % et pour l'autre à 70 %, la fusion. Dans les deux exemples cités, le Gouvernement et le Parlement se sont rapprochés la population, expliquant par d'importantes campagnes de presse et de télévision, la nécessité du changement, organisant autant de consultations populaires qu'il a été nécessaire.
Ce qui a été possible en Grèce ou en Suède l'est peut-être moins en France. Le traumatisme des débats qui ont conduit à la loi de 1971, traumatisme qui demeure présent dans l'esprit de tous les acteurs et le maintien du compromis trouvé en 1789, accord qui avait conduit au maintien des structures paroissiales, semblent hypothéquer toute tentative de fusion commandée par le centre. En France, en effet, sans qu'il soit besoin de rappeler la seule véritable tentative de regroupement communal autoritaire avec les municipalités de canton de l'an III (368) et en relevant le fait que le statut municipal de 1884 impose l'approbation unanime des conseils municipaux pour mener à bien une fusion, plusieurs tentatives pour diminuer le nombre des communes sont intervenues dans les dernières décennies, avec le succès que l'on sait. La loi du 7 août 1957 prévoyait les premières mesures de regroupements forcés des communes dans les agglomérations (369). Elle a échoué. Les décrets n° 59-189 du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes et n° 64-884 du 27 août 1964 instituant des majorations de subvention en faveur des opérations d'équipement menées par les groupements de communes ou les communes fusionnées précisèrent la procédure de fusion en tentant de la favoriser, tandis que la possibilité de procéder à la fusion autoritaire par décret en Conseil d'État ouverte par l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts urbains fut très peu utilisée (370). Suivit en 1967 le « projet Fouchet » qui fut le premier à envisager de manière effective la fusion de communes. Il s'agissait « d'assouplir les conditions de fusion des communes, en maintenant en exercice les conseillers municipaux des communes fusionnées, jusqu'à la fin du mandat en cours. Enfin, il est prévu de procéder, après le renouvellement municipal de 1971, au rattachement à d'autres collectivités des communes qui, en raison du chiffre infime de leur population, n'ont pas la possibilité de respecter les dispositions du code électoral, aux termes desquelles le nombre de conseillers ne résidant pas dans la commune ne peut excéder le quart des membres du conseil municipal. » (371) Le projet prévoyait ainsi, d'une part, la possibilité d'une fusion initiée par les conseils municipaux, et d'autre part, une fusion imposée. En effet, dans l'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil général aurait été saisi par le préfet d'une proposition de rattachement à une commune voisine de toute commune de moins de 1 000 habitants où le nombre de conseillers non résidents dépasse le quart des membres municipal. À défaut d'avis contraire du conseil général, la fusion aurait été prononcée par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable, la fusion aurait pu être décidée par décret en Conseil d'État. Les événements politiques empêchèrent la discussion du « projet Fouchet ». L'idée de fusion fut reprise dans le « projet Marcellin » du 8 janvier 1969, qui ne fut jamais déposé. Ce projet prévoyait, comme son prédécesseur, une double fusion. Celle-ci pouvait provenir d'une demande, soit du conseil du syndicat communautaire ou d'une communauté urbaine, soit des deux tiers des conseils municipaux. Elle pouvait également intervenir de manière automatique, pour les communes de moins de 100 habitants et les communes ayant un volume faible de ressources. La démission du Président de la République à l'issue du référendum du 27 avril 1969 emporta le projet. Un nouveau projet est déposé après les élections municipales de mars 1971. Le gouvernement avait alors « résolument écarté toute suppression systématique et aveugle des petites communes ». Évoquée lors des débats du projet qui est devenu la loi du 31 décembre 1970 sur les libertés communales, la suppression des 4 000 communes de moins de 100 habitants n'aurait conduit qu'à diminuer le nombre total de communes de moins de 3 000 unités, puisque certaines auraient fusionné entre elles. La réforme est apparue insignifiante. À l'occasion des débats de 1971, fut étudiée la possibilité de supprimer les 11 400 communes de moins de 200 habitants. Cette solution fut également écartée au motif que les petites communes étaient concentrées dans certains départements, en particulier dans l'Est de la France et certaines régions de montagne, ce qui n'aurait abouti, par exemple, qu'à des résultats minimes dans l'Ouest de la France. La loi du 16 juillet 1971 commence par prescrire un examen des caractéristiques de chaque commune afin d'opérer un classement en trois catégories : les communes pouvant assurer elles-mêmes leur développement ; celles appelant une mise en commun des moyens et ressources des communes ; celles devant fusionner. Le Sénat voulut écarter toute solution de contrainte et la loi finale porte les marques de ce blocage. Dans chaque département, le préfet devait dresser un plan de fusions à réaliser, plan qui devait être soumis aux conseils municipaux concernés. En cas d'accord, la fusion était prononcée par arrêté préfectoral. En cas de rejet, le conseil général était saisi et le préfet ne pouvait prononcer la fusion qu'après avis favorable de l'assemblée départementale. La suppression systématique des petites communes fut donc rejetée tandis qu'était promue la voie de l'administration à deux niveaux, grâce au développement de l'intercommunalité, avec le réel succès que l'on connaît. Mais le chemin de l'intercommunalité vers l'intégration reste encore très hypothétique et le maintien d'une double administration semble devoir perdurer. Il serait donc intéressant de trouver une voie médiane qui soit plus efficace que celle conçue en 1971. c) La méthode volontaire : pour un nouveau modèle de communes associées ? Comme on l'a vu, la fusion de communes telle qu'issue par la loi du 16 juillet 1971, dite « loi Marcellin », constitue une voie de rationalisation fondée uniquement sur le volontariat. Sous le régime de cette loi, deux communes limitrophes peuvent ainsi fusionner en une seule commune - c'est la fusion simple - ou bien fusionner en créant une ou plusieurs communes associées, la commune associée conservant son nom et disposant d'un maire délégué - c'est la « fusion association » (372). Dans le régime initial, cette fusion provient soit de l'accord unanime entre conseils municipaux, soit d'une acceptation par référendum communal. La loi du 13 août 2004 précitée, dans son article 123 modifiant l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, a rendu la consultation des électeurs obligatoire. L'État ne maîtrise pas la nouvelle délimitation de la circonscription. Il ne fait que l'officialiser par arrêté préfectoral. Au regard de la virulence de l'opposition rencontrée dans la recherche d'une modification de la carte communale − l'existence de plus de 500 000 élus locaux constituant à la fois une richesse et une force de résistance −, le pouvoir central a préféré perdre la maîtrise de la procédure pour faciliter une amorce de restructuration qu'il souhaitait en tout état de cause. Mais, cette loi, comme sa cousine grecque, n'a pas eu le succès escompté (373). Le rapporteur du projet de loi au Sénat, très sceptique, relevait lui-même qu'il s'agissait « d'un projet de loi important (...) car il peut avoir - je ne dis pas qu'il les aura - des incidences considérables sur les structures communales de l'avenir » (374). Les plans départementaux prévoyaient 3 482 fusions intéressant 9 761 communes. Mais, le nombre réel de fusions a été limité et ne s'est pas traduit par une diminution significative du nombre de communes. Le nombre de fusions fut notable dans les deux années qui ont suivi la loi : 528 fusions en 1972 concernant 1 336 communes, 193 fusions en 1973 concernant 466 communes. Par la suite, ce nombre tomba rapidement : 76 fusions en 1974 pour 154 communes, 9 fusions en 1975 pour 19 communes, 9 fusions en 1976 pour 20 communes, 4 fusions en 1977 concernant 7 communes. À partir de 1978, on peut même relever la permanence des revendications de « défusion » des communes fusionnées montrant les capacités de résistance des communautés d'habitants. Ainsi, fin 1979, 29 communes avaient retrouvé leur autonomie. La loi de 1982 écartera le sujet. Les raisons de l'échec ont été analysées. Dans la recherche d'un nouvel équilibre territorial et dans la recomposition du paysage communal, il convient de veiller à l'équilibre entre centre et villes périphériques, mais aussi entre campagne et ville. Dans ce contexte, redonner du lustre au statut de commune associée permettrait de faciliter les rapprochements et de rationaliser l'espace institutionnel local pour le plus grand bénéfice des populations. Il conviendrait notamment de permettre que la fusion-association puisse être engagée à l'initiative des populations et non plus seulement des conseils municipaux. Il conviendrait également d'encourager la consultation simultanée des populations habitant sur un même territoire susceptible d'être transformé en ensemble de communes associées sur le fondement d'un projet commun. On pourrait aussi très bien imaginer qu'un groupe de communes puisse présenter à leurs habitants différents projets d'association, parmi lesquels ils pourraient choisir le plus pertinent, projet qui s'imposerait s'il était adopté par une majorité des suffrages exprimés dans chacune des communes concernées. L'association pourrait conduire, outre au maintien du nom de la commune associée, à la désignation d'un maire délégué, chaque liste identifiant les candidats qui deviendraient maires délégués des communes associées en cas d'élection. Les dispositifs de conseil et commission consultatifs pourraient être, en outre, allégés. Une convention préalable à l'association signée entre les communes partenaires et décrivant la répartition des services offerts dans chaque commune associée pourrait être soumise à l'approbation de la population, ce qui permettrait de garantir la valeur ajoutée qualitative de l'association. Dans le cas de l'existence préalable d'un epci, l'initiative de la consultation de la population pourrait provenir du conseil intercommunal. Identifiée par un nom distinct, représentée par un élu responsable, valorisée par de nouveaux services, la commune rénovée permettrait de créer des ensembles territoriaux et mieux à même d'assurer un nombre plus grand de compétences, sans pour autant tomber dans le piège de la superposition des structures qui naît de la simple intercommunalité. Se pose inévitablement la question de l'incitation financière. Le dispositif actuel de majoration des subventions d'équipement n'a pas suffi à favoriser la fusion association autant que cela était souhaité. Dès la discussion du projet de loi, plusieurs orateurs relevaient son caractère peu incitatif, même si la majoration de 50 %, pendant cinq ans, de la subvention de l'État pour les équipements collectifs réalisés par la nouvelle commune, dans la limite de 80 % de la dépense subventionnable, apparaissait à bien des égards plus avantageuse que l'incitation inscrite dans le décret du 27 août 1964 destinée à favoriser les fusions (majoration de 10 % à 30 %) ou la constitution de districts urbains ou de syndicats à vocation multiple (majoration de 5 % à 20 %), dispositifs qui n'avaient débouché que sur très peu de réalisations. Un encouragement par le biais de compensation de baisse de la fiscalité pourrait constituer une voie à explorer. De manière plus audacieuse, il pourrait être confié, de manière expérimentale, à une ou plusieurs régions le pouvoir de proposition de réorganisation des territoires communaux, les propositions de la collectivité régionale étant validées ou non par les populations concernées. La région élaborerait en concertation avec les acteurs locaux un plan régional - selon un modèle proche du plan départemental initialement prévu dans le projet de loi qui conduisit à la loi du 16 juillet 1971 -, qui pourrait servir de base à l'organisation d'une série de consultations. Si la fusion n'était pas décidée de manière autoritaire, en revanche, l'élaboration d'un tel plan et la consultation des populations pourraient être rendus obligatoires. 4. Diversifier la représentation territoriale de l'État Trois objectifs peuvent être dégagés de l'histoire administrative française : maintenir l'uniformité administrative, assurer la prééminence de l'État, favoriser l'efficacité de la gestion administrative. Ces objectifs méritent aujourd'hui d'être mis en regard d'autres nécessités : ajustement aux évolutions de la société des missions de l'État, développement des collectivités territoriales, adaptation des services à la diversité des territoires. Pour atteindre ces buts, il convient d'adapter la géographie des implantations de l'État, assurant à la fois des espaces d'arbitrage et de synthèse et des espaces de connaissance des territoires et des évolutions locales. Dans ce contexte, ne faut-il pas s'interroger sur la pertinence d'une organisation identique dans des régions différentes par la taille et les besoins ? On pourrait, par exemple, imaginer une différenciation des structures de l'administration départementale en fonction de critères de taille, de démographie et de dominante urbaine ou rurale du territoire considéré. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposent au gouvernement, lorsqu'il détermine le ressort territorial d'un service administratif, de se référer aux limites des circonscriptions existantes (375). Le principe de division du territoire implique que les limites extérieures de chaque catégorie de circonscriptions coïncident entre elles, dans la mesure « nécessaire à la bonne organisation et au bon fonctionnement des services publics » (376). Le principe d'égalité démographique ne s'applique qu'aux circonscriptions électorales. S'est développé un encadrement juridique, initié par le Conseil d'État, relayé par le Conseil constitutionnel, qui subordonne la légalité et la constitutionnalité des opérations de découpage de la circonscription à des obligations visant à équilibrer les circonscriptions sur le plan démographique et territorial (377). La lisibilité des structures de l'État s'impose moins que celle des services publics. Il faut rappeler, en outre, la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2002 (378), qui a relevé qu'eu égard aux caractéristiques géographiques et économiques de la Corse et au fait qu'aucune des compétences ainsi attribuées n'intéresse les conditions essentielles de mise en œuvre des libertés publiques, les différences de traitement qui pourraient résulter des dispositions de la loi entre les personnes résidant en Corse et celles résidant dans le reste du territoire national ne sont pas constitutives d'une atteinte au principe d'égalité (379). B. RENOUVELER LES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES La mise en œuvre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a montré, en particulier dans le domaine de la fonction publique, que la mise en œuvre de cénacles réunissant de manière régulière et encadrée tous les acteurs, l'État comme les collectivités territoriales, pouvait permettre, outre une meilleure connaissance mutuelle, et peut-être grâce à elle, de prévenir et de résoudre les crises. 1. Créer des conférences techniques sectorielles Par exemple, dans la gestion du rmi, entièrement confiée depuis la loi du 18 décembre 2003 aux départements, il faut instituer une véritable concertation entre le ministre des affaires sociales et les conseils généraux avant toute décision susceptible d'avoir un effet direct ou indirect sur les aides prises en charge par les conseils généraux. Certes, il existe déjà une commission commune entre les conseils supérieurs des fonctions publiques de l'État et territoriale, ainsi qu'un comité des finances locales où les acteurs des deux mondes peuvent se rencontrer. Mais cette démarche qui a fait ses preuves, en particulier dans la mise en œuvre récente de la loi du 13 août 2004, mérite d'être étendue. Ainsi, au-delà de chaque dossier, une conférence sectorielle réunissant chaque ministère et les collectivités territoriales pourrait être institutionnalisée, à l'image de ce qui existe en Espagne entre les représentants des ministères et les représentants des communautés autonomes. Dans ce pays, au total et à tous les niveaux, ce sont plus de quatre cents organismes mixtes qui permettent de négocier les politiques, les projets et les financements et toute loi nouvelle tend à prévoir la création d'un conseil représentatif des communautés autonomes. La décentralisation n'est plus octroyée, elle est négociée, allant à l'encontre de la tendance relevée par MM. François Dupuy et Jean-Claude Thoenig, pour lesquels, en France, la décentralisation y est conçue « non pas comme traduisant le caractère agglomératif (de la société vers l'État) de la constitution politique mais comme un moyen de répandre dans la société les valeurs de l'État démocratique » (380). La dévolution britannique s'est accompagnée également de plusieurs concordats et d'un accord entre le gouvernement britannique et les gouvernements écossais, gallois et nord-irlandais permettant de définir des codes de bonnes pratiques dans les relations entre administrations britanniques et administrations régionales. 2. Fixer un cadre contractuel aux relations entre personnes publiques La contractualisation a rendu de grands services. Elle a « permis de prolonger et de concrétiser l'objectif de flexibilité poursuivi par la décentralisation en organisant le passage de normes et de règles définies par les administrations centrales à des objectifs et des actions négociés localement sur la base de projets élaborés par les collectivités. Les normes et les règles générales n'ont pas disparu, mais leur adaptation a été érigée en règle. On est ainsi passé d'une normalisation assouplie dans l'arrangement implicite à une négociation explicite des normes dans le cadre de projets territoriaux. Ensuite, la systématisation des projets et des contractualisations territoriales a été utilisée pour maîtriser les risques de fragmentation de l'action publique, lesquels n'étaient plus seulement horizontaux (entre secteurs) mais aussi verticaux (entre différents niveaux territoriaux). Enfin, la logique de projet a permis de concilier des finalités techniques − l'intégration dans un sens commun des interventions de multiples acteurs locaux, relevant de divers secteurs − et une ambition plus démocratique, le projet étant supposé faciliter l'association des habitants à la décision publique. » (381) Mais le retour à des contractualisations globales impliquerait que les services territoriaux de l'État retrouvent des compétences et une surface importante pour jouer un rôle actif dans ces contrats. Or, ce retour de l'État territorial paraît difficilement concevable à l'heure actuelle. Il convient donc de trouver des instruments qui assurent un meilleur équilibre entre un partenaire renforcé dans ses pouvoirs − la collectivité territoriale − et un partenaire rassemblé sur ses missions essentielles − l'État local. a) Créer un contrat-cadre public Dans un contexte marqué parfois par une difficulté du système politique et juridique français à penser l'intérêt général hors de l'État et par une tradition d'unilatéralisme étatique, il est remarquable de constater que les relations contractuelles entre État et collectivités territoriales, entre collectivités territoriales entre elles, se sont développées dans des proportions inédites. Dans la régulation territoriale de l'action publique, la convention a succédé à l'acte. Pourtant, comme le montre l'expérience des contrats de plan, le rapport est souvent déséquilibré et le contrat entre collectivités publiques peut parfois masquer un certain retour, s'agissant de l'État, ou l'apparition, s'agissant des relations entre collectivités territoriales, de la tutelle. Comme le relevait le Conseil d'État, dans son étude de 1993, « pour asseoir sur de nouvelles bases la légitimité de l'action publique, faut-il vraisemblablement songer à faire appel non seulement à une nouvelle distribution des rôles, mais à de nouveaux procédés d'articulation entre acteurs publics (...), en rupture avec la logique des blocs de compétences et de la décision unilatérale : l'administration contractuelle, les normes flexibles ouvrant la voie aux arrangements et aux compromis. Encore une telle orientation doit-elle, pour ne pas déboucher sur une impasse, acquérir droit de cité dans les institutions et statut juridique. » (382) Penser que les rapports de force peuvent être éliminés serait faire preuve d'un irénisme fort ignorant de la nature des relations entre collectivités placées en situation de concurrence institutionnelle. C'est pourquoi, plutôt que de nier ces tensions, il importe de recourir aux secours du droit pour les canaliser. Le plus court chemin pour redonner une légitimité aux procédures contractuelles est de dessiner un cadre général qui assure l'égalité entre les partenaires. Ainsi, dans toute procédure, il conviendrait de prévoir que chaque partie puisse voir pris en compte ses besoins et ses attentes ; ainsi encore, dans le cadre des contrats de plan entre l'État et les régions, ces dernières devraient pouvoir inscrire au contrat des thèmes qu'elles auraient choisis. Chaque contrat devrait pouvoir comporter une mention de l'articulation avec des dispositifs antérieurs ou connexes et être précédé automatiquement par une étude d'impact, qui présente, en particulier, son inscription dans les logiques à l'œuvre à l'échelon territorial supérieur. Si mosaïque il doit y avoir − le rapporteur ne peut que constater en la matière l'évolution récente −, elle doit présenter un dessin d'ensemble lisible pour l'ensemble des acteurs publics mais aussi par le citoyen. L'objet de l'étude d'impact est d'évaluer a priori les effets administratifs, juridiques, sociaux, économiques et budgétaires des mesures envisagées et de s'assurer, de manière probante, que la totalité de leurs conséquences a été appréciée préalablement à la conclusion du contrat. Pour reprendre l'exemple des contrats de plan, il paraît souhaitable qu'ils soient conclus au regard d'un « cadre national stratégique » qui devra être soumis aux instances communautaires et respecter les priorités fixées par les chefs d'État et de gouvernement lors des sommets de Lisbonne et de Göteborg. Ces thèmes nationaux peuvent être les infrastructures de réseaux, la recherche et l'enseignement supérieur et la cohésion économique et sociale pour « assurer un développement durable, compenser des inégalités, faire face aux mutations du tissu économique ». Ce rappel permettra de limiter leur objet et de les inscrire dans une logique d'ensemble qui légitime la conclusion même de l'accord. La procédure contractuelle ne doit être utilisée qu'au bénéfice de projets précis, contenant en particulier une programmation, un plan de financement, un échéancier. Toute action prévue par le contrat qui ne serait pas engagée à partir d'un certain délai, fixé contractuellement, devrait disparaître du programme, cet effet pouvant faire l'objet d'une publicité obligatoire. Un rapport régulier d'exécution cosigné par les parties serait rendu public et discuté dans chaque assemblée délibérante des collectivités signataires. Par ailleurs, chaque crédit engagé, dès lors qu'il est lié à l'exécution d'une convention, doit être mentionné comme tel. Une seule collectivité devrait être, le plus souvent possible, désignée maître d'ouvrage. Les pétitions de principe prises sous forme contractuelle ne devraient plus avoir droit de cité. La convention devrait éviter d'être la matérialisation d'effets d'annonce. Plus sonnat quam valet. L'appellation même de contrat devrait être réservée à des documents qui engagent réellement les parties. L'autorité de l'État ne passe plus seulement par la hiérarchie, ni même par des conventions passées tous azimuts avec toutes les collectivités territoriales. Elle doit reposer sur sa capacité à fixer un cadre général au pilotage des stratégies librement développées par les acteurs locaux. b) Favoriser les relations conventionnelles avec les services de l'État et les organismes ayant une mission de service public Attribuer la gestion du rmi aux départements n'a de sens que si ces derniers ont la possibilité de bénéficier des services rendus par les caisses d'allocations familiales (caf) et l'Agence nationale pour l'emploi (anpe). Or, il n'est pas rare que ces différents acteurs ne travaillent pas de manière naturelle les uns avec les autres. L'allocation des moyens financiers n'est pas forcément optimale. C'est pourquoi, dans un cas tel que celui-ci, des conventions de coopération peuvent s'avérer utiles. Ce mécanisme gagnerait à être généralisé, afin que, face à un service public donné, tous les acteurs puissent y contribuer de manière harmonieuse et cohérente, quel que soit leur statut. 3. Encourager les échanges d'expériences Une remarque faite par l'un des responsables territoriaux de l'équipement rencontrés lors d'un des déplacements en région effectué par le rapporteur illustre parfaitement les difficultés et les malentendus qui demeurent entre les deux principaux acteurs de la scène territoriale, l'État et les collectivités territoriales : « Je prendrai pour illustrer ces difficultés l'exemple de nos ingénieurs qui, après un passage dans l'administration territoriale, reviennent dans les services de l'État. Ils sont considérés désormais comme ayant échoué. Nous aurons bientôt de véritables problèmes pour attirer les jeunes diplômés. Il faut favoriser le retour des ingénieurs des travaux publics de l'État qui sont partis dans le privé. Il faut favoriser les allers et retours. » Sur cette base, il conviendrait de développer les échanges, mêmes temporaires, entre administrateurs territoriaux et administrateurs de l'État, et multiplier, en conséquence, les mécanismes de détachement. Au-delà, le passage d'un corps de l'État à un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale et l'inverse doivent être favorisés. De ce point de vue, le travail réalisé dans le cadre de l'élaboration des décrets de transfert des personnels tos et de l'équipement et les efforts d'harmonisation des statuts des corps et des cadres d'emplois correspondants qui en ont résulté constituent une expérience qui mériterait d'être valorisée et étendue. 4. Poursuivre le développement de l'administration électronique Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la seconde moitié des années 1990, a ouvert d'importantes perspectives de réformes. Sans pour autant constituer une panacée universelle comme la présentent souvent ses thuriféraires, l'« administration électronique » ou « l'e-administration » permet de simplifier les démarches des usagers, par exemple en dématérialisant les procédures administratives, mais aussi de rendre plus efficace le fonctionnement de l'administration, notamment par le travail en réseau. À ce titre, comme le montre l'exemple du développement de la télétransmission des actes des collectivités territoriales dans le cadre du contrôle de légalité, elle peut apporter un appui technique à la fluidification des relations avec les services de l'État et supprimer certaines asymétries d'informations. À cet égard, il convient de saluer la publication de l'ordon-nance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 qui jette les bases juridiques et fixe des règles de fonctionnement aux échanges électroniques entre l'administration et les citoyens et entre autorités administratives. Elle s'applique à l'État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif. Ces personnes publiques doivent accuser réception des demandes, déclarations ou productions de documents adressées par un usager par voie électronique avec les mêmes conséquences, en cas de manquement, que celles prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite « loi dcra ». Lorsque l'accusé de réception n'est pas instantané, l'administration doit, en outre, délivrer un accusé d'enregistrement électronique. Le texte donne aussi une base légale à la possibilité pour une administration de transmettre directement à une autre une information personnelle concernant un usager avec son accord ainsi qu'à la création d'un espace de stockage en ligne permettant à chaque usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches. Un référentiel général de sécurité permettra de traiter la signature électronique des actes administratifs. La mise en œuvre du plan stratégique de l'administration électronique (psae), complété par son plan d'action, le projet adele, devrait permettre d'obtenir des services plus nombreux, faciles d'emploi, accessibles à tous et à tout moment, notamment de nouveaux services centrés sur les besoins des usagers grâce à l'intensification de la création de nouveaux services dématérialisés et des services personnalisés, grâce au développement des services offrant la possibilité aux usagers de connaître l'état de leurs dossiers administratifs ou le degré d'avancement de l'instruction d'une demande. Les démarches devront aussi être simplifiées, grâce à la limitation du nombre des informations que l'usager doit saisir et à la transmission des informations entre administrations. L'administration électronique peut permettre également de masquer la complexité institutionnelle par la promotion d'une approche englobant l'ensemble des administrations, qu'il s'agisse de l'État, des collectivités territoriales mais aussi des organismes de la sphère sociale, tant est fréquente l'imbrication des compétences dans ce dernier secteur. Elle doit favoriser une plus grande réactivité de l'administration, par le biais de l'échange des informations entre administrations et avec les usagers dans de meilleures conditions pour répondre plus efficacement à des sollicitations leur parvenant par des voies diverses (courrier, courriel, téléphone, accueil au guichet), avec une réduction des délais de réponse et par une remise à plat et une automatisation des processus de traitement. Cette évolution doit s'accompagner de la création des conditions d'une confiance accrue des citoyens, grâce, en particulier, au renforcement de la sécurité des échanges, ce qui implique une réflexion sur les contraintes d'identification et d'authentification des usagers, sur la sécurisation des systèmes d'information des administrations et sur l'harmonisation de la gestion des droits. Ce progrès ne peut également s'accomplir que grâce à un meilleur contrôle des citoyens sur les données les concernant, ce qui nécessite de développer le dossier électronique personnel pour un libre choix d'usage et d'utilisation, d'assurer un meilleur exercice du droit d'accès des citoyens aux données collectées par l'administration et de prévoir un recours à des outils d'authentification et de signature électronique sous le contrôle des citoyens. Dans ce processus, il convient de ne pas négliger l'amélioration du travail des agents publics, l'automatisation des tâches permettant de dégager de nombreux agents de tâches répétitives et peu valorisantes au profit de missions plus enrichissantes, tandis que la montée en charge de l'utilisation des téléservices favorisera un désengorgement des guichets, à l'image de l'évolution en cours dans les préfectures. La création de sites dédiés aux expérimentations peut favoriser la diffusion des résultats et encourager les vocations des autres collectivités territoriales et contribuer ainsi, de manière décisive, à la mise en place d'un nouvel équilibre qui incite à la généralisation des innovations les plus qualitatives. Certaines communes se sont lancées dans l'information municipale par envoi de messages sur les téléphones portables de leurs concitoyens. Il s'agit d'alerter leurs concitoyens en temps réel en cas d'événements naturels ou bien de les informer des réunions publiques organisées par le conseil municipal ou encore de les avertir de l'arrivée de documents administratifs en mairie. Dans ce cadre, l'administration électronique est un facteur d'égalité de l'accès aux services publics et même de survie des territoires. « On sous-estime encore la portée des enjeux territoriaux de la société de l'information. Pourtant, il ne fait aucun doute que l'accès des ménages, des écoles, des entreprises et des services publics aux réseaux de communication est un facteur de compétitivité et donc de pérennité de l'activité d'un territoire, aussi décisives qu'ont été dans le passé les ressources énergétiques ou les structures de transport. » (383) Les ministres chargés de la réforme de l'État ont présenté un premier bilan le 4 avril 2005 du plan adele, ce qui a été l'occasion de constater l'existence d'une réelle dynamique. Par exemple, plus de 4 millions de foyers fiscaux ont réussi à faire leur télédéclaration fiscale contre 1,2 million l'année précédente. Cette progression est liée à l'équipement progressif des usagers, aux services développés dans le secteur privé et à l'action incitative du gouvernement. Le programme adele doit s'étaler sur quatre ans avec 140 actions. L'objectif reste de donner une visibilité aux différents acteurs : État, personnes physiques et industriels, usagers, mais aussi collectivités locales. Dans le développement de l'administration électronique, il convient d'éviter que les collectivités se voient, en effet, imposer ce que l'État développerait sans elles. Les actions en faveur de l'interopérabilité doivent donc être promues. Pour 90 % des collectivités, il est impossible de développer les infrastructures nécessaires, les compétences, les moyens. Pour pallier cette difficulté, le projet « e-collectivités locales » avec, dans un premier temps, la mise en place d'« e-Bourgogne », doit permettre d'associer l'ensemble des acteurs locaux au développement des outils électroniques. La valeur ajoutée de l'administration électronique est de proposer des services globaux. Lorsqu'on considère un usager, il connaît un événement, par exemple une demande de rmi, un décès, une demande de logement social, un changement d'adresse, une demande de subvention pour une association... Chacun de ces événements concerne plusieurs entités : l'État, la commune, la caisse d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale... Or, aujourd'hui, lorsqu'on raisonne en termes de services traditionnels, on raisonne toujours par institution. Ce mode de raisonnement est adapté lorsque l'évènement ne concerne qu'une seule administration. En revanche, lorsqu'il en concerne plusieurs, il convient de permettre à l'usager d'autoriser la diffusion de l'information à plusieurs acteurs. C'est ce type de service qui a été offert pour le changement d'adresse. Ce régime existe déjà pour les demandes de subventions dans le cadre de la politique de la ville. Un dossier est déposé par l'association, il est transmis à toutes les administrations concernées. Au Québec, deux mois après l'ouverture du service de changement d'adresse, 25 % des changements d'adresse se faisaient par ce biais. La difficulté de passer vers la voie dématérialisée est ressentie comme moins importante que l'amélioration du service rendu. Mais ce type de démarches oblige à mettre des applications nationales en relation avec des milliers de systèmes d'informations locaux, ceux des collectivités locales. Dans des processus tels que celui de la déclaration de changement d'adresse, chaque fois, une personne doit appeler pour vérifier qu'il n'y a pas de déformation des informations transmises d'un service à l'autre. Or, un tel mécanisme est impossible à mettre en œuvre avec des milliers de correspondants. C'est pourquoi dans un système comme celui du changement d'adresse, il faut des grandes plates-formes techniques hébergées par l'État, par exemple à l'éducation nationale, au ministère de l'économie, au ministère de l'intérieur... Du côté des collectivités locales, il faudra quatre ou cinq plates-formes qui proposent des services aux petites collectivités, qui possèdent un ordinateur, une connexion, qui achètent uniquement ces services, de telle sorte que ces petites collectivités puissent dire à leurs administrés qu'elles offrent le même service qu'une très grande collectivité. Une collectivité moyenne pourra, de la même façon, proposer un échange avec une plate-forme comme une grande collectivité. Cette plate-forme technique doit être capable de mettre un service en marque blanche, de telle manière que le responsable politique de la collectivité puisse présenter les services offerts comme ceux qu'ils offrent lui-même, sur son propre site. Il doit pouvoir proposer des téléservices couplés avec l'état civil, avec sa gestion de la cantine, faire la relation avec les autres services de l'État, avec la sphère sociale... Dans ce cas, il n'a aucun investissement à faire, n'achète que du service. Il faut donc susciter une concurrence entre plates-formes permettant aux élus d'avoir une qualité de service idoine et une interconnexion optimale. Beaucoup de services que l'on peut mettre en commun émanent des collectivités locales. L'administration électronique est souvent limitée aux services sur internet. Or, sa définition englobe l'utilisation des technologies de l'information dans les services des administrations. L'effet de levier le plus important se produira au sein même des administrations déconcentrées comme décentralisées, par l'élimination du papier, par la multiplication des échanges d'information... Une nouvelle orientation est en cours d'examen. Avec l'administration électronique, un agent d'accueil peut suffire pour le citoyen, tandis que le dossier peut être à plusieurs centaines de kilomètres. Il s'agit là d'une alternative intéressante au regroupement des services au niveau départemental comme au niveau régional. Il faut renverser la logique. Nous avons besoin de fonctions d'accueil plus fortes, situées dans chaque bassin de vie. Les communautés de communes et d'agglomérations peuvent constituer des échelons pertinents pour fournir des prestations d'accueil... Des guichets d'accueil polyvalents tenus par des agents bien formés qui disposent des outils informatiques qui donnent accès à une batterie de services - téléservices, applications internes de chacune des administrations publiques... - pourraient rendre un meilleur service. Ce qui compte pour le citoyen n'est pas le lieu où est produit le service, mais le lieu où il est rendu. La fluidification des procès ne saurait cependant être qu'un outil. Le contenu même de l'équilibre territorial des pouvoirs ne pourra être modifié et les blocages dépassés que si des marges de manœuvre nouvelles sont offertes aux collectivités territoriales, ce qui pose in fine la question du pouvoir normatif à accorder à celles-ci. C. PARTAGER LE POUVOIR NORMATIF ? La décentralisation s'arrête aux portes du pouvoir normatif. L'émancipation juridique des collectivités locales n'a pas abouti à leur donner une réelle autonomie dans la conception des politiques dont elles ont reçu la charge, conception qui reste centralisée et cloisonnée. Ainsi les compétences sociales attribuées aux départements sont restées régies par des normes nationales au degré de précision redoutable. Les administrations centrales, par le biais des contrats de plan, sont parvenues à imposer leurs choix aux régions tout en obtenant d'elles des financements de plus en plus substantiels. Le principe de subsidiarité, appliqué lato sensu, impliquerait que les normes soient élaborées au plus près des citoyens dès lors qu'elles concernent des mesures qui ne mettent pas en cause l'intérêt national. Or, la tradition française implique que la subsidiarité ne s'applique pas dans un sens ascendant, mais soit octroyée à partir du centre, dans un mouvement descendant, plein de la majesté du pouvoir central. 1. Transférer aux régions un véritable pouvoir normatif Dans les champs transférés, l'État se réserve-t-il le droit de réglementer ? Les collectivités territoriales, et plus particulièrement les régions, pourraient-elles acquérir un pouvoir normatif dans ces champs transférés ? Il est certain que la réponse aux deux questions peut être positive. On pourrait prendre l'exemple du rmi. Si la fixation du montant du rmi était décentralisée, les plus riches pourraient payer un droit qu'ils ne souhaiteraient pas forcément acquitter, tandis que les plus pauvres, sensibilisés aux insuffisances de revenus, n'auraient peut-être pas les moyens de le supporter. La solution est à rechercher dans l'association de la fixation d'un socle national minimal et de sa déclinaison locale librement traduite à la hausse. Ainsi, le sénateur Michel Mercier relève qu'il « est indispensable que les conseils généraux soient associés à toute la politique sociale, et notamment à toutes les mesures réglementaires. Ne serait-ce que pour une raison : d'ici quelques années, même quelques mois, ils en sauront plus que l'État en ce domaine » (384). Durant les débats sur la révision constitutionnelle de 2003, nombreux furent les orateurs à promouvoir l'avènement d'un véritable pouvoir local d'application des lois à l'instar de ce qui existe en Espagne par exemple. La commission des Lois du Sénat voulut ainsi « garantir l'exercice effectif du pouvoir réglementaire des collectivités territoriales (...) en permettant au législateur de confier, dans certains cas, l'application des lois au pouvoir réglementaire à l'exclusion de celui du Premier ministre ». De même, la commission des Lois de l'Assemblée nationale, par la voix de son rapporteur, avait souhaité que le pouvoir réglementaire des collectivités locales puisse intervenir en substitution de celui du Premier ministre et non en subordination. Il ne s'agit pas de revenir à l'époque des arrêts de règlement, qui permettaient aux parlements provinciaux, sous l'Ancien Régime, d'adapter au territoire les édits royaux, voire, en cas d'opposition, de les neutraliser. L'attribution à l'Assemblée de Corse d'un pouvoir de proposition pourrait constituer une voie à approfondir. Dans l'état du droit, le III du nouvel article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales se borne à prévoir la procédure par laquelle la collectivité territoriale de Corse peut présenter des propositions tendant à ce que le législateur modifie la législation applicable à la Corse. Par suite, il ne transfère, par lui-même, à cette collectivité aucune matière relevant du domaine de la loi (385). Cette disposition pourrait être élargie et étendue à d'autres collectivités régionales. 2. Associer les collectivités territoriales à la politique de simplification Sur le fondement de deux lois, les lois n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le législateur a entrepris d'inciter le Gouvernement à prendre des mesures de simplification dans de très nombreux domaines. Cette politique a d'ores et déjà donné lieu à plusieurs dizaines d'ordonnances et un troisième projet de loi de simplification a été annoncé. Mais le processus ainsi engagé a d'abord reposé sur un travail réalisé au sein des ministères. Le droit applicable aux collectivités territoriales, par la multitude et la fréquence des modifications qui lui sont apportées, par l'enrichissement et la complexification continue de leurs activités - il suffit de consulter le code général des collectivités territoriales pour s'en persuader (386) - n'est pas sans refléter la superposition des structures. Sa simplification constitue donc également un impératif. De nombreux exemples cités tout au long du présent rapport montreraient, par ailleurs, une tendance de chaque structure à créer ses propres procédures, qui viennent se surajouter à celles qui existent déjà. Ainsi, dans le seul domaine des formulaires administratifs, il est fréquent que chaque collectivité crée, pour ses propres besoins, des rubriques complémentaires, exige des documents spécifiques. La multitude des acteurs accentue naturellement ce mouvement et rend plus difficile toute coordination. Le conseil d'orientation de la simplification administrative, créé par l'article 1er de la loi du 2 juillet 2003 précitée et encadré par le décret n° 2003-1099 du 20 novembre 2003, comprend certes des élus locaux : un conseiller régional, un conseiller général et un maire, respectivement désignés par le président de l'arf, le président de l'Assemblée des départements de France et le président de l'Association des maires de France. Mais cela ne saurait suffire à associer pleinement les collectivités territoriales à la politique de simplification. Les capteurs de l'application et vérificateurs de l'applicabilité des lois et règlements que constituaient les administrations territoriales de l'État tendent à devenir moins présents. Le raccourcissement des chaînes hiérarchiques et la régionalisation de nombre de services déconcentrés participent de ce mouvement. Les administrations centrales de l'État n'ont plus la même capacité à mesurer le caractère adapté ou non des règles qu'elles édictent, cette capacité étant largement transférée aux collectivités territoriales. Le domaine sanitaire et social en donne un exemple manifeste. Les collectivités territoriales doivent prendre le relais des services déconcentrés dans l'évaluation des réglementations et faire remonter les difficultés liées à leur application. L'État ne saurait suivre, en effet, les différentes expériences de simplification portant sur les relations avec les usagers menées par les collectivités territoriales. Il convient donc d'associer beaucoup plus fortement ces dernières à la politique de simplification du droit et des procédures car, dans la relation toujours mouvante entre le centre et la périphérie, la tension qu'il s'agit de gérer n'est rien moins que l'expression, plus ou moins bien institutionnalisée, de l'exigence démocratiques. Au cours de sa réunion du mercredi 22 février 2006, la Commission a examiné les conclusions de la mission d'information sur l'équilibre territorial des pouvoirs. Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus. Après avoir salué la pertinence et la qualité du travail effectué par le rapporteur, M. Christian Decocq s'est interrogé, du fait de l'évolution de l'intercommunalité, sur la possibilité, à terme, de mettre en place l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires. Il a souligné que l'observation du fonctionnement de la communauté urbaine de Lille, présidée par M. Pierre Mauroy et comprenant non seulement la ville de Lille, mais aussi 85 communes parfois très petites, montrait à la fois l'importance des transferts de compétences effectués au profit de la communauté urbaine, permettant la construction d'ouvrages remarquables notamment en matière de transports collectifs, mais aussi une distance croissante entre la fonction publique de cette communauté et les préoccupations quotidiennes de ses habitants. Il a noté que l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires permettrait certes de remédier à cette distance, mais conduirait également à l'émergence d'une légitimité politique concurrente de celle des maires, dont les pouvoirs s'affaibliraient du même coup. Il s'est interrogé sur les solutions permettant de sortir d'une telle impasse et a ajouté qu'au sein des communautés urbaines, le clivage existant entre les conseillers communautaires maires d'une commune et ceux qui ne le sont pas tend à l'emporter sur le traditionnel clivage entre gauche et droite. M. Bernard Roman s'est félicité qu'un rapport d'information ait été décidé par la Commission sur la question de l'équilibre territorial des pouvoirs et a formulé le souhait qu'il ne reste pas sans suite. Il a remarqué que la décentralisation n'avait débuté en France que depuis vingt-cinq ans, alors qu'elle était plus ancienne dans d'autres pays avec lesquels le rapporteur avait établi des comparaisons. Il a estimé qu'au fil du temps, des avancées ou des erreurs, était révélée l'absence d'un « grand dessein » pour l'organisation territoriale de la République. Il a rappelé qu'au cours des années 1980, la première phase de la décentralisation en avait consacré le principe, tout en mettant fin à la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales et en permettant l'émergence politique de l'échelon régional avant que, de 1992 à 1999, des lois successives, constatant que la France réunissait à elle seule 36 600 communes, soit la moitié de celles de toute l'Union européenne, aient permis la mise en place de véritables intercommunalités, qui couvrent à présent 98 % du territoire national. Il a toutefois estimé que l'« acte II » de la décentralisation, intervenu en 2003 et 2004 à l'initiative de M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre ayant pourtant lui-même présidé un exécutif régional, avait été marqué par une lourde erreur : l'oubli des intercommunalités et le recentrage des compétences de développement, telles que celles relatives aux routes, sur les seuls départements. Il a considéré que les pressions alors exercées en ce sens par le Sénat avaient conduit à dénaturer la décentralisation, conduisant aujourd'hui à une « inorganisation territoriale de la République ». Puis, il a fait valoir que la question fondamentale de l'attribution de compétences exclusives aux différents niveaux de collectivités territoriales, comme celle de la légitimité démocratique de chacun d'entre eux, du fait de règles électorales différentes, n'étaient pas résolues. Il s'est appuyé sur l'exemple des contrats de plan État-régions, permettant de répartir les efforts entre les différents niveaux de collectivités au moyen de nombreux cofinancements, pour suggérer de mettre fin à la confusion en contraignant chaque niveau de collectivités à s'en tenir strictement à ses compétences. Il a noté que cette logique de clarification, ayant par exemple conduit à attribuer aux départements l'ensemble des compétences routières, devait conduire à s'interroger sur la définition, le cas échéant constitutionnellement, de véritables blocs de compétences pour chaque niveau de collectivités. Il a également souhaité une simplification de la carte de l'administration territoriale de la République, tout en soulignant qu'après avoir été personnellement favorable à la suppression des conseils généraux, il lui semblait désormais impossible de faire abstraction de l'échelon départemental, compte tenu de l'importance des compétences transférées aux départements dans le cadre de la loi relative aux libertés et responsabilités locales. S'agissant des intercommunalités, il a souligné que, depuis la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, elles s'étaient considérablement renforcées, leur émergence étant aujourd'hui considérée comme l'évolution la plus marquante survenue dans l'organisation administrative française. Il convient à présent de s'interroger sur le lien entre ces intercommunalités et l'échelon départemental. Enfin, il a fait valoir que le problème des ressources propres des collectivités territoriales n'avait pas été résolu. Il a jugé que le transfert aux collectivités territoriales d'une partie des recettes de la tipp ne leur permettrait pas de disposer de ressources durables et s'apparentait donc à un « faux-semblant ». De même, l'évolution prévisible du nombre d'infirmières prises en charge par ces collectivités, qui ne s'élève actuellement qu'à 10 000 mais devrait atteindre bientôt 30 000, n'a pas été correctement prise en compte par le législateur lorsqu'il a procédé aux transferts de compétences. Après avoir fait part de son grand intérêt pour le rapport, dont l'auteur n'a pu qu'esquisser le contenu, M. Emile Zuccarelli a indiqué avoir beaucoup souffert, en Corse, des « délires et vertiges » auxquels ont donné lieu les manipulations du concept de décentralisation. Il a noté que celui-ci était souvent mal interprété et s'est élevé contre l'idée, parfois défendue, que la déconcentration pourrait constituer un leurre allant à l'encontre de la décentralisation. Il a rappelé que la décentralisation ne saurait conduire à l'exacerbation d'une recherche de « souverainetés locales », mais visait seulement à rapprocher les décisions du citoyen et apparaissait ainsi comme « l'art de gérer les différences dans des structures identiques ». Puis, il a regretté que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 ait conduit à préciser, à l'article 1er de la Constitution, que l'organisation de la République « est décentralisée », un tel adjectif apparaissant comme particulièrement imprécis puisqu'il renvoie à une notion qui n'est nullement définie. Il a par ailleurs jugé « pathétique » la discussion relative à la part de ressources propres des collectivités territoriales, de même que la recherche, depuis Paris, des espaces régionaux les plus pertinents, jugeant absurde toute comparaison entre, par exemple, le Hainaut et la Californie. Rappelant que la République avait, au fil de son histoire, fait évoluer librement l'organisation territoriale de son administration, il a mis en garde contre le défaut français consistant à créer une nouvelle structure dès qu'un problème apparaît, comme en témoigne la création inopportune des « pays », qui ajoute encore à la complexité territoriale française. Il s'est, en outre, interrogé sur l'articulation entre le principe selon lequel il n'existe pas de hiérarchie ou de tutelle entre les différentes collectivités, la définition de blocs de compétences pour chaque niveau de collectivités et la mise en place de collectivités « chefs de file ». Il a enfin fait valoir que la réforme de la décentralisation mise en place au début des années 1980 par le ministre Gaston Deferre avait été positive, parce qu'elle avait été précédée d'un long mûrissement et effectuée sans précipitation. Il a rappelé que cette réforme s'était alors inspirée du principe de « gouvernabilité » pour l'échelon municipal, l'adaptation de la règle de la représentation proportionnelle au sein des conseils régionaux n'empêchant, aujourd'hui, aucune d'entre elle d'être « gouvernable » - à l'exception de la Corse, dont les institutions devraient désormais être rapprochées du droit commun. M. Patrick Delnatte a souhaité connaître la solution préconisée par le rapporteur pour mieux articuler le rôle des départements et des régions. Prenant l'exemple de la région Nord-Pas-de-Calais constituée de deux départements, il a estimé qu'une départementalisation de la région et une régionalisation du département pourraient être une bonne solution, les mêmes élus pouvant siéger en une assemblée régionale et une assemblée départementale. Il a en revanche considéré que, dans les régions les plus grandes, les départements devaient, en raison de leur proximité, conserver toute leur place, les régions ayant une fonction stratégique et de développement. Reprenant la parole, M. Émile Zuccarelli a émis des réserves devant une trop grande différenciation des structures, estimant que, de ce point de vue, la région Île-de-France, par sa dimension, est susceptible de faire l'objet d'une décentralisation poussée, étant précisé que le degré de décentralisation ne doit pas être fonction de l'éloignement géographique. S'agissant de la définition de blocs de compétences, il a considéré que le chef de file doit rester sectoriel, et regretté que la loi du 22 janvier 2002 ait donné à la région Corse un rôle de chef de file général par rapport aux départements. En réponse aux différents intervenants, M. Michel Piron a souhaité apporter les précisions suivantes : - Nombre des interrogations soulevées sont reprises dans le rapport écrit et font l'objet de pistes de réflexion. - La question de la légitimité relative des communes et des intercommunalités, compte tenu de la montée en puissance de ces dernières et, notamment, de la progression de leur intégration fiscale, se pose avec de plus en plus d'acuité. Elle conduit à s'interroger sur la possibilité, à terme, de désigner au suffrage universel direct les membres du conseil intercommunal, ce qui pourrait passer, dans un premier temps, par la désignation directe du seul président du conseil. En tout état de cause, la tension permanente qui existe entre proximité et efficacité fait partie intégrante du jeu démocratique local et en constitue même un ressort essentiel. Le développement indéniable de l'intercommunalité pose, en outre, la question de l'évolution des relations entre les autres structures territoriales. L'attention portée au couple communes-intercommunalité ne doit pas masquer la question du couple départements-région, collectivités dont la complémentarité mériterait d'être recherchée de manière plus approfondie. - De manière plus générale, le manque patent de grand dessein pour l'évolution de l'organisation territoriale de notre pays est souligné à plusieurs reprises dans le rapport écrit. À ce titre, la notion de bloc de compétences constitue sans doute une voie moins productive que la réforme des structures. À la notion de « structures identiques » chargées de gérer les différences évoquées par M. Émile Zuccarelli, il conviendrait de substituer celle de « structures adaptées », tant il paraît obsolète d'appliquer les mêmes structures à des territoires diversifiés. - La généralisation de la contractualisation ne peut faire l'objet d'une adhésion sans retenue et mérite, en effet, d'être critiquée dans ses modalités actuelles. - L'absence de correspondance automatique et nécessaire entre décentralisation et déconcentration mérite d'être affirmée avec force, comme l'illustrent les exemples étrangers, exemples qui montrent également que la question de la coordination entre différents niveaux de collectivités a été résolue par l'acceptation d'une certaine tutelle régionale sectorielle sur les autres niveaux de collectivités. Puis, conformément à l'article 145 du Règlement, la Commission a autorisé le dépôt du rapport de la mission d'information en vue de sa publication. PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR FRANCE · Médiature de la République - M. Bernard Dreyfus, délégué général · Conseil d'État - M. Jean-Ludovic Silicani, conseiller d'État ASSOCIATIONS D'ÉLUS · Association des districts et communautés de France (adcf) - M. Marc Censi, président - M. Jo Spiegel, vice-président - M. Nicolas Portier, délégué - M. Emmanuel Duru, chargé de mission juridique · Association des maires de France - Mme Jacqueline Gourault, sénatrice, vice-présidente - M. Alexandre Touzet, chargé des relations avec les pouvoirs publics ADMINISTRATIONS · Ministère de l'intérieur Inspection générale de l'administration - M. Daniel Limodin, chef du service - M. Pierre duffé, inspecteur général de l'administration Direction générale des collectivités locales - M. Dominique Schmitt, directeur général - M. Daniel Barnier, sous-directeur des compétences et des institutions locales Direction de la modernisation et de l'action territoriale - M. Paul Masseron, directeur · Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction de la réforme budgétaire - M. Franck Mordacq, directeur · Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État - M. Jacky Richard, directeur général de l'administration et de la fonction publique Délégation aux usagers et aux simplifications administratives (dusa) - Mme Monique Liebert-Champagne, déléguée, conseiller d'État - M. Jean-Yves Caullet, chargé de mission Délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'État (dmgpse) - M. François-Daniel Migeon, délégué Agence pour le développement de l'administration électronique (adae) - M. Jacques Sauret, directeur SYNDICATS · Union des fédérations de fonctionnaires unsa - Mme Elisabeth David, secrétaire générale · Union générale des fédérations de fonctionnaires cgt - M. Jean-Marc Canon, secrétaire général - M. Patrick Hallinger, secrétaire national · Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière - M. Gérard Nogues, secrétaire général · Union des fédérations cfdt des fonctions publiques et assimilées - Mme Marie-Claude Kervella, secrétaire générale AUTRES · Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur - M. Bertrand Landrieu, préfet de la région Île-de-France, président - M. Jean-Pierre Lacroix, préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, membre de l'association du corps préfectoral - M. Yannick Imbert, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, membre de l'association du corps préfectoral · Institut de la décentralisation - M. Jean-Pierre Balligand, co-président du conseil d'administration · Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe (grale) - M. Gérard Marcou, directeur ALSACE SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION - M. Jean-Paul Faugère, préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin · Secrétariat général pour les affaires régionales et européennes - M. Franck Robine, secrétaire général - Mme Françoise Klein, secrétaire générale adjointe · Pôle « Éducation et formation » - M. Bernard Izorche, secrétaire général du rectorat · Pôle « Gestion publique et développement économique » - M. Dominique Abraham, trésorier-payeur général de la région Alsace et du Bas-Rhin - M. Jean-Paul Kieffer, contrôleur financier en région · Pôle « Transport, logement, aménagement et mer » - M. Philippe Lalart, directeur régional adjoint de l'équipement · Pôle « Santé publique et cohésion sociale » - M. Alain Rommevaux, directeur régional des affaires sanitaires et sociales · Pôle « Économie agricole et monde rural » - M. Jean-Jacques Ducros, directeur régional et départemental de l'agriculture et de la forêt · Pôle « Environnement et développement durable » - M. Denis Delcour, directeur régional de l'environnement - M. Alain Liger, directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement · Pôle « Culture » - M. François Laquièze, directeur régional des affaires culturelles SERVICES DE L'ÉTAT DANS LES DÉPARTEMENTS · Bas-Rhin - M. Michel Guillot, préfet du Haut-Rhin - M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin - M. Alain Gérard, directeur de cabinet du préfet - Mme Corinne Baechler, directrice des élections, des affaires juridiques et des finances locales - Mme Odile Gatty, directrice de la population et de l'accueil - Mme Annie Bénétreau, chargée de mission lolf à la préfecture - M. Bruno Cinotti, directeur départemental délégué de l'agriculture et de la forêt - M. Rémi Guerrin, directeur départemental des services vétérinaires - M. Yves Gobillon, chef du service de l'eau et des milieux aquatiques de la direction régionale de l'environnement - M. Michel Burtin, chef du service régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - M. Yannick Tomasi, directeur départemental délégué de l'équipement · Haut-Rhin - M. Bernard Roudil, secrétaire général de la préfecture - M. Guy Fischer, chef du bureau du cabinet de la préfecture - Mme Jeannine Grussy, directrice des collectivités locales et de l'environnement - M. Pierre Boltz directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin - M. Jérôme Normand, sous-préfet d'Altkirch - M. Christian Maerten, secrétaire général de la sous-préfecture de Mulhouse - M. Michel Paillisé, sous-préfet de Ribeauvillé - M. Jean-Pierre Balloud, sous-préfet de Thann - M. Jacques Spitz, directeur adjoint départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - M. Patrick L'Hôte, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales - M. Alain Lorriot, directeur départemental de l'équipement - M. Alain Aguilera, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt - M. Jean-Marie Zimmermann, chef des services du Trésor public - M. Bernard Anna, directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - M. Gilles Petreault, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale - M. Éric Queneault, directeur départemental de la jeunesse et des sports CONSEIL RÉGIONAL - M. Adrien Zeller, président du conseil régional - M. François Cavart, directeur général des services adjoint CONSEILS GÉNÉRAUX - M. Roger Maubert, directeur général des services du conseil général du Bas-Rhin - Michel Chaussoy, directeur général adjoint des services du conseil général du Haut-Rhin BRETAGNE SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION · Secrétariat général pour les affaires régionales · Mme Marie-Josèphe Perdereau, secrétaire générale pour les affaires régionales · M. Philippe de Lambert des Granges, adjoint à la secrétaire générale pour les affaires régionales et chargé de mission « pays » · Mme Stéphanie Grayssaguel-Mork, directrice des affaires administratives et budgétaires du secrétariat général pour les affaires régionales · Pôle « Éducation et formation » - Mme Espinette, chargée de mission au rectorat de l'académie de Rennes · Pôle « Gestion publique et développement économique » - M. Stéphane Halbique, adjoint du trésorier-payeur général de la région, chef des services du Trésor public · Pôle « Transport, logement, aménagement et mer » - M. Philippe Suire, chef de la division de l'aménagement et habitat de la direction régionale de l'équipement - M. Perrin, adjoint du directeur régional des affaires maritimes · Pôle « Santé publique et cohésion sociale » - M. Jean-Michel Doki-Thonon, adjoint du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et responsable du pôle « Santé » · Pôle « Économie agricole et monde rural » - M. Charles Zinberg, secrétaire général de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt et du pôle « Agriculture » · Pôle « Environnement et développement durable » - M. Jean-Paul Celet, directeur régional de l'environnement - M. Géry Peaucelle, adjoint du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement · Pôle « Développement de l'emploi et insertion professionnelle » - M. Jean-Claude Challain, directeur régional adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle · Pôle « Culture » - M. Jean-Luc Guinement, adjoint de la directrice régionale des affaires culturelles, directeur de l'administration générale SERVICES DE L'ÉTAT DANS LES DÉPARTEMENTS · Côtes d'Armor - M. Jacques Michelot, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor · Finistère - M. Christian Robbe-Grillet, directeur des affaires interministérielles de la préfecture · Ille-et-Vilaine - M. Bernard Mariotto, directeur des collectivités locales de la préfecture - Mme Pichon, secrétaire générale de l'inspection académique - Mme Colette Perrin, directrice départementale des affaires sanitaires et sociales · Morbihan - M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture CONSEIL RÉGIONAL - M. François-Nicolas Sourdat, directeur de la mission synthèse territoriale, prospective et évaluation - M. Pierre Jolivet, directeur général adjoint, directeur de l'aménagement et des transports CONSEILS GÉNÉRAUX - M. Éric Ardouin, directeur général des services du département d'Ille-et-Vilaine - M. Le Norcy, directeur général de la santé du conseil général du Morbihan SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION - M. Bernard Boucault, préfet de la région des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique · Secrétariat général pour les affaires régionales - M. Yves Colcombet, secrétaire général pour les affaires régionales · Pôle « Gestion publique et développement économique » - M. Jean Bernard-Chatelot, trésorier-payeur général de la région des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique - M. Antoine Albertini, contrôleur financier régional · Pôle « Transport, logement, aménagement et mer » - M. Alain Laville-Fournier, directeur régional adjoint de l'équipement. SERVICES DE L'ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT · Loire-Atlantique - M. Guy Oger, directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle - M. Jean-Louis Durand, directeur adjoint départemental des affaires sanitaires et sociales CONSEIL RÉGIONAL - M. Jacques Auxiette, président - M. Christian Guérin, directeur de l'environnement et des projets de territoire CONSEIL GÉNÉRAL - M. Patrick Mareschal, président PICARDIE SERVICES DE L'ÉTAT DANS LA RÉGION · M. Michel Sappin, préfet de la région Picardie et de la Somme · Secrétariat général pour les affaires régionales - M. Pierre Stussi, secrétaire général pour les affaires régionales - M. Xavier Guérin, chargé de mission - M. Jean-Louis Grenouilloux, chargé de mission · Pôle « Éducation et formation » - Mme Marie-Danièle Campion, recteur de l'académie d'Amiens, chancelier des universités · Pôle « Gestion publique et développement économique » - M. Pierre-Louis Mariel, trésorier-payeur général de la région Picardie · Pôle « Transport, logement, aménagement et mer » - Mme Michèle Joigny, directrice régionale et départementale de l'équipement · Pôle « Santé publique et cohésion sociale » - Mme Flore Thérond-Rivani, directrice régionale des affaires sanitaires et sociales · Pôle « Économie agricole et monde rural » - M. Bernard Senecal, directeur régional de l'agriculture et de la forêt · Pôle « Environnement et développement durable » - M. Laurent Roy, directeur régional de l'environnement · Pôle « Développement de l'emploi et insertion professionnelle » - M. René Viprey, directeur régional délégué du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle · Pôle « Culture » - M. Claude Jean, directeur régional des affaires culturelles CONSEIL RÉGIONAL - M. René Anger, directeur du cabinet du président du conseil régional de Picardie - M. Pierre Guyard, directeur général adjoint des services du conseil régional de Picardie CONSEIL GÉNÉRAL - M. Daniel Dubois, sénateur, président du conseil général de la Somme - M. Robert Alapetite, directeur de cabinet du président du conseil général de la Somme - M. Pierre Ory, directeur général des services du département de la Somme ITALIE ROME · Ambassade de France en Italie - M. Loïc Hennekinne, ambassadeur · Gouvernement - M. Alberto Gagliardi, sous-secrétaire d'État aux affaires régionales · Parlement - M. Carlo Vizzini, sénateur, président de la commission bicamérale pour les questions régionales · Chambre des députés - M. Donato Bruno, Député de Forza Italia et Président de la commission des Affaires constitutionnelles - M. Pietro Fontanini, député de la Lega Nord Federazione Padana et vice-président de la commission des Affaires constitutionnelles - M. Antonio Maccanico, député centriste du groupe « La Margherita » et ancien sous-secrétaire d'État de la Présidence du Conseil - Mme Patriziana Paoletti Tangheroni, députée du groupe Forza Italia, secrétaire de la commission des Affaires constitutionnelles · Sénat - M. Andrea Pastore, Sénateur du groupe UDC - M. Francesco D'Onofrio, sénateur, président du groupe Forza Italia, président de la commission des Affaires constitutionnelles · Autres personnalités - M. Sabino Cassese, professeur de droit administratif près l'Université de Roma La Sapienza CAMPANIE · Consulat général de France à Naples - M. Henri Vignal, consul général · Préfecture (Ufficio Territoriale del Governo) - Mme Fiamma Spena, vice-préfète · Région Campanie - M. Antonio Bassolino, président · Province de Naples - Mme Antonella Basilico, vice-présidente chargée de la culture et de la mer - Mme Giuliana di Fiore, vice-présidente chargée de l'environnement, professeur de droit de l'urbanisme · Mairie de Naples - M. Raffaele Porta, maire adjoint à la décentralisation, aux rapports institutionnels et aux relations internationales · Autres personnalités - M. Alberto Lucarelli, professeur de droit constitutionnel et de droit de la décentralisation à l'Université Federico II de Naples - M. Marelli, président de la Faculté de droit et d'économie - M. Massimo Galluppi, professeur à l'Université Orientale de Naples ESPAGNE MADRID · Ambassade de France en Espagne - M. Claude Blanchemaison, ambassadeur · Congrès des députés - M. Jordi Pedret i Grenzner, député de Barcelone (Groupe socialiste) - Mme Eva Sáenz Royo, députée de Saragosse (Groupe socialiste) - Mme Eva Sáenz de Santamaria, députée de Madrid (Groupe populaire) · Sénat - M. Iñaki Irena Anasagasti Olabeaga, sénateur de Viscaya (Parti nationaliste basque) - Mme Soledad Becerril Bustamante, sénatrice pour Séville, ancienne ministre, ancienne maire de Séville (Groupe populaire) - M. Pere Macias y Arau, sénateur pour la communauté autonome de Catalogne - M. Jorge Villarino Mazzo, letrado des Cortes Generales · Présidence du Gouvernement - M. Santiago Hurtado Iglesias, vocal asesor, département des affaires institutionnelles, cabinet de la Présidence du Gouvernement - M. Fernando Magro Fernández, director, département des affaires institutionnelles, cabinet de la Présidence du Gouvernement - M. José Miguel Vidal Zapatero, asesor, département des affaires institutionnelles, cabinet de la Présidence du Gouvernement - M. Fernando Vallespin Ona, président du Centre des enquêtes sociologiques de la Présidence du Gouvernement · Ministère des administrations publiques - M. Enrique Gómez Campo, directeur général de la coopération autonomique - M. José María Pérez Medina, sous-directeur général des relations de coopération avec les communautés autonomes - M. Pedro Ibáñez Buil, sous-directeur général du régime juridique autonomique · Autres personnalités - M. Gil Carloz Rodriguez Iglesias, professeur de droit public à l'Université de Madrid, ancien président de la Cour de justice des Communautés européennes - M. Luis Palacios Banuelos, professeur de droit public à l'Université du roi Juan Carlos de Madrid - M. José Juan Toharia, professeur de sociologie à l'Université autonome de Madrid, président de Metroscopia, institut de sondages ANDALOUSIE · Consulat général de France à Séville - M. Dominique Pin, consul général · Représentation du Gouvernement espagnol - M. Faustino Valdés Morillo, sous-délégué du Gouvernement à Séville · Parlement de l'Andalousie - M. Gaspar Zarrías Arévalo, député du Parlement andalou, conseiller à la présidence de la Junta · Province de Séville - M. Fernando Rodríguez Villalobos, président de la Diputación · Mairie de Séville - M. Alfredo Sánchez Monteseirín, maire de Séville, ancien président de la Province de Séville - M. Jaime Raynaud, porte-parole du groupe du Parti populaire au conseil municipal de Séville ROYAUME-UNI ÉCOSSE · Consulat général de France à Édimbourg et à Glasgow - M. Pierre-Antoine Berniard, consul général - Mme Valérie Drake, attachée linguistique · Gouvernement du Royaume-Uni - M. Gerald McHugh, Head of Briefing Services, Scotland Office · Exécutif écossais - Mme Margaret Curran, ministre des relations avec le Parlement - M. Robert Dunn, chef du département des services centraux et financiers, division européenne · Parlement écossais - M. George Reid, Président - Mme Margaret Mitchell, députée (Parti écossais conservateur et unioniste) - M. Stewart Stevenson, député (Parti national écossais) - Mme Jean Turner, députée (Indépendante) - M. Bill Thomson, directeur des services législatifs · Municipalité d'Édimbourg - Mme Lesley Hinds, Lord Provost d'Édimbourg · Autres personnalités - Lord Eassie, président de la Law Commission - M. Colin Munro, professeur de l'Université d'Édimbourg - M. Charlie Jeffery, professeur de Science politique, Université d'Édimbourg, responsable du Programme sur la dévolution et des changements constitutionnels du Conseil sur la recherche économique et sociale - Mme Joëlle Godard, Lectrice à la School of Law de l'Université d'Édimbourg SUÈDE STOCKHOLM · Ambassade de France - M. Serge Ségura, premier conseiller - M. Frédéric Kaplan, conseiller économique et commercial - M. Alexandre Defay, conseiller de coopération et d'action culturelle · Riksrevisionen (Office suédois du contrôle de la gestion publique) - Mme Eva Lindblom, directrice - M. Peter Rostedt, conseiller · Ministère de la justice - M. Roger Pettersson, directeur des affaires constitutionnelles · Statskontoret (Agence nationale du management public) - Lars Niklasson, conseiller · Socialstyrelsen (Agence nationale de la santé publique) - Mme Monica Albertsson, direction de la santé et des services médicaux - Mme Lena Mc Elwee, direction des services sociaux · Sveriges Kommuner och Landsting (Association des Communes et Régions de Suède) - Mme Åsa Ehinger Berling, directrice · Préfecture - M. Björn Hedvall, directeur de cabinet du préfet - Mme Anne-Marie Strid-Schultz, directeur-adjoint pour les questions sociales · Conseil de comté de l'Östergötland (Landsting) - M. Tommy Skau, directeur de la santé · Conseil du développement régional (Regionförbundet Östsam) - M. Jan-Erik Lund, directeur de la planification et de l'analyse · Commune de Linköping - Mme Gunilla Wetterling, responsable du Parti des verts au conseil municipal et membre de la commission exécutive municipale
------------ N° 2881 - Rapport d'information déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des lois sur l'équilibre territorial des pouvoirs (M. Michel Piron) 1 () Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 2 () Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 3 () La gouvernance est le nom français donné dès le XIIIe siècle au domaine d'action des autorités municipales des villes du Nord de la France, en Artois et en Flandre et jusqu'à la Révolution aux juridictions des grandes villes de cette région. Il sera repris par la recherche anglo-saxonne et intégré aujourd'hui au vocabulaire français des sciences administratives et politiques. 4 () Depuis la décision du Conseil d'État du 3 juin 1983, Mme Vincent, il est admis que les expressions « collectivités locales » et « collectivités territoriales » ont la même portée juridique et ce d'autant plus que, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, la seconde a été substituée de manière systématique à la première, levant ainsi toute ambiguïté. 5 () Siéyès, le 7 septembre 1789, lors de l'examen de la réforme administrative, pose le principe : « La France n'est pas une collection d'États. Elle est un tout unique, composé de parties intégrantes. » 6 () M. Jean Picq, L'État en France, servir une nation ouverte sur le monde, mission sur les responsabilités et l'organisation de l'État, Paris, mai 1994. 7 () Dans son rapport, la commission pour l'avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy, a maintenu ce principe (Refonder l'action publique locale, rapport au Premier ministre, Paris, La documentation française, Rapports officiels, 2000). 8 () M. Jean-Raphaël Alventosa, « Le nouveau rôle de la Cour des comptes », Revue française de finances publiques, n° 91, septembre 2005, pages 102-103. 9 () MM. Augustin Bonrepaux (président) et Hervé Mariton (rapporteur), Le contribuable se rebiffe, rapport fait au nom de la commission d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale, 3 tomes (rapport, auditions, annexes), Assemblée nationale, XIIe législature, n° 2436, 5 juillet 2005. 10 () Michel Foucault, « La " gouvernementalité " », Dits et écrits, Gallimard, 1994. 11 () Voir liste des auditions en annexe. 12 () Cette expression, qui fait référence à la première vague de décentralisation, recouvre un ensemble de textes incluant la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003) reconnaissant l'organisation décentralisée de la République, suivie de plusieurs lois organiques précisant les modalités de l'expérimentation (n° 2003-704 du 1er août 2003), d'organisation des référendums locaux (n° 2003-705 du 1er août 2003), et de l'autonomie des collectivités territoriales (n° 2004-758 du 29 juillet 2004) et complétée par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 13 () M. Jean-Benoît Albertini, La déconcentration : l'administration territoriale dans la réforme de l'État, Economica, Collectivités territoriales. Droit, 1997, pages 1 et 2. 14 () Maurice Hauriou, note sous l'arrêt du Conseil d'État du 3 mai 1918, Sirey, volume 3, 57. 15 () Articles 263 à 265 du traité instituant la Communauté européenne. Cette instance composée de représentants des régions et des villes, a un caractère consultatif, c'est un lieu de dialogue entre les collectivités locales et l'Union et de prospective. 16 () Le récent projet de loi sur le gouvernement local qui devrait être déposé sur le bureau du Parlement espagnol au début de l'année 2006 inscrira cette définition dans le droit espagnol. 17 () Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 2802, 17 janvier 2006. 18 () « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements et les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Ces collectivités d'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » 19 () MM. François Lacasse et Pierre-Éric Verrier (direction), 30 ans de réforme de l'État, expériences françaises et étrangères stratégies et bilans, Dunod, Management public, 2005, page 71. 20 () Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1835, première partie, chapitre V. 21 () Maurice Hauriou, Précis de droit administratif, Sirey, 12e édition, 1933, page 86. 22 () Conseil d'État, « Décentralisation et ordre juridique » in Rapport public 1993, Paris, Études et documents du Conseil d'État, n° 45, La documentation française, 1994, page 17. 23 () M. Romain Pasquier, La capacité politique des régions, une comparaison France/Espagne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Res Publica, 2004. 24 () Ces collectivités territoriales ont un statut d'autonomie qui est, pour partie, constitutionnellement défini et garanti et dans lequel le principe de spécialité législative est largement dominant, le droit commun est d'application résiduelle, en dehors des matières de souveraineté, et les compétences de l'État sont d'attribution. 25 () M. Michel Pébereau, Rompre avec la facilité de la dette publique, Pour des finances publiques au service de notre croissance économique et de notre cohésion sociale, rapport au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Paris, La documentation française, Rapports officiels, 2005, page 63. 26 () M. Gérard Marcou, Les régions en Europe, entre l'État et les collectivités locales, Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Les travaux du centre d'études et de prévision (cep), n° 6, Éditions SIRP, octobre 2003. 27 () M. Philippe Mejean, « Projets et contrats d'agglomération : problématique et questionnement de l'opération " sites pilotes " conduite dans quatorze agglomérations », in M. Claude Némery (direction), Quelle administration territoriale pour le XXIe siècle en France dans l'Union européenne ?, actes de colloque, Paris, L'Harmattan, Administration et aménagement du territoire, 2001. 28 () En 1999, il existait 305 districts, 5 communautés de villes et 9 syndicats d'agglomération nouvelle. 29 () Il existe aujourd'hui 162 communautés d'agglomération alors que l'objectif initial de la loi de 1999 était d'atteindre une cinquantaine de ces groupements à l'horizon de 2002. 30 () Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale des collectivités locales, Intercommunalité : une dynamique renforcée dans un cadre juridique rénové, bilan au 1er janvier 2005, Ministère de l'intérieur, février 2005. 31 () Cour des comptes, L'intercommunalité en France, rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés, novembre 2005. 32 () Décret n° 95-414 du 19 avril 1995 relatif au comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire et pris pour l'application de l'article 33 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 33 () M. Jean-Claude Thoenig, « Quelle légitimité pour les nouvelles structures territoriales ? », in M. Jean-Claude Némery, 2001, op. cit. 34 () Le Conseil constitutionnel a déjà fait prévaloir le principe d'égalité sur celui de la libre administration des collectivités territoriales dans une décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 sur la loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales. 35 () M. Jean-François Brisson, « Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle des compétences entre l'État et les collectivités locales », Actualité juridique Droit administratif, 2003, page 529. 36 () Journal Officiel Débats Assemblée nationale constituante, séance du 11 septembre 1946, page 3598. Le préambule de la Constitution proclame, par ailleurs, « solennellement les droits et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », principes au titre desquels figurent les « libertés municipales » expressément mentionnées par M. Lionel de Tinguy du Pouet, auteur de l'amendement modifiant le préambule. 37 () Article 88. 38 () Texte initial du deuxième alinéa de l'article 72 ; après la révision du 28 mars 2003, le principe de la libre administration est fixé par le troisième alinéa dudit article dans les termes suivants : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus (...) ». 39 () Comité consultatif constitutionnel, Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, volume 2, 1987, page 258. 40 () M. Michel Tropper, « Libre administration et théorie générale du droit », in La libre administration des collectivités locales, Paris, Economica, 1984, page 55. 41 () Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 sur la loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux. 42 () Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001 sur la loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. 43 () Décisions n° 91-291 DC du 6 mai 1991 sur la loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes et n° 98-405 DC du 29 décembre 1998 sur la loi de finances initiale pour 1999. 44 () Décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 sur la loi de finances rectificative pour 2000. 45 () Décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 sur la loi relative à la fonction publique territoriale. 46 () Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993 sur la loi relative à la prévention de la corruption. 47 () Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 précitée. 48 () Décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 sur la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 49 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 50 () M. Jacques Caillosse, « Comment le " centre " (se) sort-il des politiques de décentralisation ? Éléments de réponse du droit français », Pouvoirs locaux, n°63, 2004, pages 43-53. 51 () Par exemple, Conseil d'État, avis du 14 avril 1983 à propos de la création d'une société d'économie mixte à vocation sucrière par le conseil général de la Martinique : si c'est normalement par voie d'aides directe ou indirectes, et non par voie de participation au capital d'entreprises, qu'il revenait aux départements d'assumer leurs responsabilités économiques, une telle participation peut néanmoins, dans certaines circonstances, être admise. Sur la même base un syndicat à vocation multiple compétent en matière de transports urbains peut contracter avec la sncf pour aménager une nouvelle gare et en préfinançant un emprunt (Conseil d'État, 20 janvier 1989, Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération rouennaise). 52 () Encyclique Quadagesimo anno de 1931 : l'objet naturel de toute intervention en matière sociale est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire ou de les absorber. 53 () Inscrit à l'article 3 B du traité de Maastricht, devenu l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 54 () M. Pierre-Alexis Feral, « Le principe de subsidiarité après la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe », Actualité juridique Droit administratif, 2004, Chroniques, page 2085. 55 () M. Maurice Bourjol, « Vers une prétendue subsidiarité », Actualité juridique Droit administratif, 2003, Chroniques, page 201. 56 () M. Michel Pébereau, op. cit., page 76. 57 () M. Alain Delcamp, « L'Europe et la subsidiarité », in M. Jean-Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 58 () Formule utilisée pour première fois dans la décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse et reprise dans la décision n° 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. 59 () Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982 sur la loi de nationalisation. 60 () Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 sur la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique. 61 () Décision n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003 relative à la loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. 62 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 63 () M. René Garrec, Rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle relatif à l'organisation décentralisée de la République (...) et la proposition de loi constitutionnelle, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales, Sénat, Les rapports du Sénat, session ordinaire de 2002-2003, n° 27, 23 octobre 2002, page 107. 64 () Articles L. 1511-2, article L. 1511-3 L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel, n'ayant pas été saisi de la loi, n'a pas eu à se prononcer sur cette disposition. 65 () Conseil constitutionnel, décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995. 66 () M. Pierre Mauroy, op. cit., page 155. 67 () Dans le but de prévenir toute tutelle d'une collectivité sur une autre qui lui a également fait inscrire dans la Constitution le principe de l'interdiction d'une telle tutelle, le Sénat a substitué au verbe « fixer » le verbe « organiser ». 68 () M. Michel Pébereau, op. cit., pages 59-60. 69 () M. Jean-François Brisson, « Les nouvelles clefs constitutionnelles de répartition matérielle des compétences entre l'État et les collectivités locales », Actualité juridique Droit administratif, 2003, page 529. 70 () Le Conseil constitutionnel a admis un tel pouvoir dès lors que les pouvoirs de sanction et de substitution du préfet sont définis avec précision quant à leur objet et à leur portée (décision n° 2001-452 DC du 6 décembre 2001 sur la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier). 71 () « Le spectre de la recentralisation », Pouvoirs locaux, 1997, III, page 78. 72 () M. Michel Mercier, Le rmi : d'un transfert de gestion à une décentralisation de responsabilité, rapport d'information fait au nom de l'observatoire de la décentralisation, Sénat, Les rapports du Sénat n° 316 (session ordinaire de 2004-2005), 3 mai 2005. 73 () « Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article 145, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois. » 74 () L'État a annoncé, le 18 juillet 2005, qu'il conservera 11 800 kilomètres de routes, tandis que les départements se voient confier la gestion de 18 000 kilomètres. 75 () Le schéma décline 233 propositions au sein des fiches d'action thématiques portant, par exemple, sur le tourisme, le développement à l'international ou encore les reprises-transmissions d'entreprise. 76 () Association des régions de France, Avis sur l'intervention économique des régions et sur les schémas régionaux de développement économiques, 7 juillet 2005. 77 () Décret n° 2005-1502 du 5 décembre 2005 relatif au régime de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail. 78 () 151 aéroports sont susceptibles d'être transférés. 79 () 23 ports d'intérêt national sont transférables, représentant 25 % du trafic de marchandises et 80 % du trafic de passagers. En 1983, 304 ports de plaisance ont été transférés aux départements et 228 ports de plaisance aux communes. 80 () Décrets n° 2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'État en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel et n° 2005-834 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux services chargés des opérations d'inventaire général du patrimoine culturel. 81 () Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales. 82 () Décret n° 2004-1349 du 9 décembre 2004 portant création de la commission commune de suivi des transferts de personnels entre l'État et les collectivités territoriales. 83 () Décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 portant approbation de la convention type prévue par l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 84 () Décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 85 () Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'État en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 86 () M. Jean-Éric Schoettl, « Le Conseil constitutionnel et la Corse », Actualité juridique Droit administratif, 2002, page 100. 87 () Article 21 : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. » 88 () Conseil d'État, 7 février 1936, Jamart. 89 () M. Denis Merville, Rapport d'information de déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des finances, de l'économie générale et du plan en conclusion des travaux d'une mission d'évaluation et de contrôle sur les normes édictées par les fédérations et les ligues sportives, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 2295, 10 mai 2005. 90 () M. François Luchaire, « Les fondements constitutionnels de la décentralisation », Revue du droit public, 1982, page 1543. 91 () M. Jean-Marie Auby, « Le pouvoir réglementaire des autorités des collectivités locales », Actualité juridique Droit administratif, 1984, pages 468 et suivantes. 92 () Conseil d'État, « Décentralisation et ordre juridique », op. cit. 93 () MM. Jean-Marie Auby, Constantinos Bacoyannis, Maurice Bourjol, Jean-Claude Douence, Louis Favoreu et Olivier Schrameck, Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, Economica-Presses universitaires d'Aix-Marseille (PUAM), 1993. 94 () Conseil d'État, 10 juin 1988, Département de l'Orne ; 27 décembre 1992, Fédération interco cfdt et autres ; avis du 20 mars 1992, Préfet du Calvados. 95 () Conseil constitutionnel, décision n° 67-49 L du 12 décembre 1967 sur la loi du 10 juillet 1967 sur la nature juridique de certaines dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : « le transfert de compétence d'une collectivité locale à l'État est une opération qui met en cause les principes fondamentaux ci-dessus énoncés et qui, par suite, relève du domaine de la loi ». 96 () Le principe d'une participation des collectivités territoriales aux dépenses de l'État doit être fixé par la loi (Conseil constitutionnel, décision n° 71-70 L du 23 avril 1971), de la même façon que les règles de vote des budgets locaux (décision n° 75-84 L du 19 novembre 1975), les règles constituant le statut du personnel des collectivités territoriales (décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984) et l'obligation de motiver certaines décisions (décision n° 88-154 L du 10 mars 1988). 97 () Conseil constitutionnel, décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 sur la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement, dite « loi Besson » : « il appartient au législateur de déterminer les cas dans lesquels le droit de préemption est susceptible ou non d'être exercé ainsi que les catégories de personnes et notamment les collectivités territoriales qui peuvent être titulaires de l'exercice de ce droit ; qu'en revanche, la fixation des modalités de mise en œuvre des principes posés par la loi relève de la compétence du pouvoir réglementaire. » 98 () Conseil d'État, avis, 20 mars 1992, Préfet du Calvados. Nonobstant le fait que la loi a expressément prévu que les assemblées délibérantes des collectivités locales fixeraient le régime indemnitaire de leurs agents dans les limites de ceux dont bénéficient les agents de l'État, il a été jugé que la loi n'était pas suffisamment précise pour être appliquée avant l'intervention d'un décret en Conseil d'État. 99 () Conseil d'État, 2 décembre 1994, Commune de Cuers : « les dispositions de la loi qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction sont applicables sans que l'édiction par les autorités de l'État d'un texte réglementaire, qu'elles ne prévoient d'ailleurs pas, soit nécessaire ». 100 () Le Conseil d'État, dans sa décision du 1er avril 1996, Département de la Loire, avait déjà eu l'occasion de relever que la compétence du département pour organiser et gérer les services de la protection maternelle et infantile, prévue par la loi, n'est pas exclusive du pouvoir réglementaire du Premier ministre pour édicter les normes applicables à ces services. 101 () Articles L. 2121-8, L. 3121-8 et L. 4132-6 du code général des collectivités territoriales. 102 () Article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. 103 () M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, Journal officiel Débat Assemblée nationale, deuxième séance du 22 novembre 2002, page 5615. 104 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 30 octobre 2002, et Journal officiel Débats Assemblée nationale, deuxième séance du 22 novembre 2002. 105 () M. François Lefebvre, « La notion de chef de file dans la législation sur l'aménagement du territoire », in « La décentralisation en France et en Europe » (dossier), Territoires 2020, n° 8, juillet 2003, page 31. 106 () M. Pierre-Laurent Frier, « Le pouvoir réglementaire local, force de frappe ou puissance symbolique ? », Actualité juridique Droit administratif, n° 11, 24 mars 2003, page 559. 107 () Michel Piron, Rapport sur le projet de loi organique relatif à l'expérimentation par les collectivités territoriales, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 955, 18 juin 2003. 108 () M. Jean-Marie Pontier, « L'expérimentation et les collectivités locales », Revue administrative, n° 320, mars-avril 2001, pages 169. 109 () M. Pierre Méhaignerie, Proposition de loi constitutionnelle tendant à introduire dans la Constitution un droit à l'expérimentation pour les collectivités locales, Assemblée nationale, XIe législature, n° 2278, 24 mars 2000. 110 () M. Jean Boulouis, « Note sur l'utilisation de la " méthode expérimentale " en matière de réformes », Mélanges Trotabas, Paris, LGDJ 1970, page 29. 111 () Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, direction de la réforme budgétaire, Expérimentations 2004, bilan et premiers enseignements, avril 2005. 112 () Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993. 113 () Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994. 114 () Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Centre d'études et de prospective, Les collectivités locales et l'expérimentation : perspectives nationales et européennes, Paris, La documentation française, 2004. 115 () M. Jean-Marie Pontier, « Transferts de compétences et décentralisation dans le domaine du patrimoine », Actualité juridique Droit administratif, 2002, page 794. 116 () Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002. 117 () « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » 118 () « Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. » 119 () Poitou-Charentes, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Guadeloupe et Bourgogne. 120 () Aisne, Indre-et-Loire, Loiret, Rhône et Haute-Corse. 121 () C'est une démarche similaire qui a été adoptée par le Gouvernement dans le lancement de la réforme de l'administration départementale de l'État (rade) (cf. notamment la circulaire du 28 juillet 2005 relative à la mise en œuvre des propositions). 122 () Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 sur la loi relative aux libertés et responsabilités locales (considérants 8 à 14). 123 () À propos, par exemple, des possibilités offertes aux régions qui en feraient la demande de participer, à titre expérimental, au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires ou encore à propos et à celles qui auront élaboré un « schéma régional de développement économique » de disposer, par délégation de l'État, de crédits correspondant à certaines des aides antérieurement attribuées par ce dernier aux entreprises (décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 sur la loi relative aux libertés et responsabilités locales, considérants 12 à 14). 124 () Décision n° 2003-478 DC du 30 juillet 2003. 125 () M. Christian Blanc, Commission de préparation du XIe Plan « État, administration et services publics de l'an 2000 », Pour un État stratège, garant de l'intérêt général, Paris, La documentation française, 1993. 126 () MM. Jacques Donzelot et Philippe Estèbe, L'État animateur, Paris, Éditions Esprit, 1994. 127 () Mme Géraldine Chavrier, « L'expérimentation locale : vers un État subsidiaire ? », intervention au colloque du grale, Réforme de la décentralisation, réforme de l'État, Assemblée nationale, 22 janvier 2004. 128 () M. Jacques Chevallier, L'État post-moderne, LGDJ, 2004. 129 () M. Jean-.Émile Vié, Les sept plaies de la décentralisation, Economica, 1986. 130 () M. Jean-François Brisson, « La France est une République indivisible... son organisation est décentralisée », Revue du droit public, 2003 (n° 1), pages 111 à 114 ; M. Mathieu Doat, « Vers une conception a-centralisée de l'organisation de la France », Revue du droit public, 2003 (n° 1), pages 115 à 117 ; M. Jacques Caillosse, op. cit., 2004, pages 43 à 53. 131 () M. Christian Blanc, op. cit. 132 () M. Michel Pébereau, op. cit., page 64. 133 () M. Jean-Benoît Albertini, op. cit. 134 () M. Léon Aucoc, Introduction à l'étude du droit administratif, Première conférence faite à l'École des Ponts et Chaussées, Paris, Imprimerie Dupont P., 1895. 135 () M. André Barilari, La modernisation de l'administration, Paris, LGDJ, 1994, page 11. 136 () M. Jean-Marie Pontier, « La décentralisation et le temps », Revue du droit public, 1991, page 1232. 137 () Cornemin sous le pseudonyme de Timon, De la décentralisation, Paris 1842. 138 () Décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'État en matière d'investissements publics (abrogé par le décret n° 2002-955 du 4 juillet 2002). 139 () Décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'État effectuées au plan local. 140 () Décrets n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements et n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de régions et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les régions et aux décisions de l'État en matière d'investissement public. 141 () Circulaire du 22 décembre 1982 relative aux correspondances échangées entre les administrations centrales et leurs échelons territoriaux. 142 () M. Jean-Benoît Albertini, op. cit., pages 1 et 2. 143 () Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 97-180 L du 21 janvier 1997 a estimé que l'article 2 de la loi du 6 février 1992 qui posait ce principe avait un caractère réglementaire. Cet article a été abrogé par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 portant modification du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration. 144 () M. Jean-Louis Langlais, Éléments d'enquête sur la déconcentration, rapport au ministre de la réforme de l'État, Paris, La documentation française, 1995. 145 () Il y aurait aujourd'hui entre 170 (M. Jean-Ludovic Silicani, La rémunération au mérite des directeurs d'administration centrale : mobiliser les directeurs pour conduire le changement, Rapport au Premier ministre, février 2004, page 7) et 185 directeurs d'administration centrale (ministère de la fonction publique, Rapport annuel fonction publique : faits et chiffres 2004, novembre 2005, page 94). 146 () La circulaire du 21 janvier 1993 fixant l'application de la charte de la déconcentration prévoyait déjà que le préfet pouvait instituer des chefs de projet, des pôles de compétence ou déterminer d'autorité les moyens affectés à des actions communes après consultation des chefs de service concernés. 147 () Décrets du 20 octobre 1999 n° 99-895 modifiant le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements et n° 99-896 modifiant le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public. 148 () M. Jacques Caillosse, op. cit., 2004, page 49. 149 () M. Jean-Benoît Albertini, op. cit., page 3. 150 () Décret n° 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'État ou avec une subvention de l'État. 151 () Titre III du budget de l'État, selon la nomenclature définie sous le régime de l'ordonnance du 2 janvier 1959. 152 () Titres IV des crédits d'intervention et VI des crédits d'investissement. 153 () M. Jean-Raphaël Alventosa, op. cit., page 102. 154 () Entretien publié dans La Gazette des communes, 15 novembre 2004, pages 12 à 14. 155 () M. François Furet, La révolution 1770-1880, Hachette, 1988. 156 () M. Pierre Sadran, Le système administratif français, Paris, Montchrestien, 2e édition, 1997. 157 () M. Roland Debbasch, Le principe révolutionnaire d'unité et d'indivisibilité de la République, Paris, Economica, 1988, page 77. 158 () M. Gilles-J. Guglielmi, La notion d'administration publique dans la théorie juridique française, de la Révolution à l'arrêt Cadot (1789-1889), Paris, LGDJ, 1991, page 58. 159 () Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 135). 160 () La possibilité de découper et de créer des « pays » ne revient pas à l'État mais est « constatée » par la commission départementale de la coopération intercommunale composée d'élus locaux (article 22 de la loi du 4 février 1995). 161 () La loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services organise un régime de mise à disposition plus pérenne des services du parc technique au profit du conseil général avec l'ouverture de la possibilité pour les conseils généraux de demander à exercer l'autorité fonctionnelle directe sur les parties de services intervenant pour le compte du département. 162 () Onze dir vont être créées, chargées de l'entretien et de l'exploitation des 11 800 kilomètres de routes nationales et d'autoroutes non concédées restant sous la responsabilité directe de l'État. Elles comprendront chacune des services de gestion de la route, eux-mêmes organisés en subdivisions et en centres d'entretien et d'intervention. En outre, pour piloter les nouveaux projets, seront mis en place vingt et un services régionaux de maîtrise d'ouvrage. 163 () M. Michel Pébereau, op. cit., page 64. 164 () Le terme de préfet fut choisi par le consul Lebrun en référence aux termes antiques évoquant la gloire de Rome. Chateaubriand, dans ses Mémoires d'outre-tombe, précisera : « La République romaine établie sous le Directoire, si ridicule qu'elle ait été avec ses deux consuls et ses licteurs (méchants facchini pris parmi la populace), n'a pas laissé que d'innover heureusement dans les lois civiles ; c'est des préfectures, imaginées par cette République romaine que Bonaparte a emprunté l'institution de ses préfets. » 165 () Missi dominici carolingiens, maîtres des requêtes, commissaires départis du Conseil du Roi, les intendants de justice, police, finances, relayés dans leur généralité par des subdélégués, envoyés en mission de la Convention, commissaires du Directoire. 166 () M. François Borella (direction), Le préfet 1800-2000, gouverneur, administrateur, animateur, Actes du colloque organisé les 30-31 mars 2000 à la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy par le Groupe de recherche et d'études politiques en association avec la préfecture de Meurthe-et-Moselle, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, Droit, politique et société, 2000. 167 () C'est la même idée qui présida à la création de préfets délégués à la sécurité en 1972 dans les grandes métropoles régionales ainsi qu'en Corse, préfets qui seront remplacés en 1993 par des préfets adjoints délégués à la sécurité, placés sous l'autorité des préfets de région. 168 () M. François Borella, « Deux siècles d'institution préfectorale », in Le préfet 1800-2000 précité, page 32. 169 () Le préfet retrouvera son identité séculaire avec le décret n° 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet. 170 () Mme Alexandra Moes-Tosello, « Le préfet et les fonds structurels communautaires » in M. François Borella, op. cit., 2000. 171 () Le ministère chargé de l'agriculture pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (feoga), celui de l'intérieur pour le Fonds européen de développement régional (feder) et celui chargé de l'emploi pour le Fonds social européen (fse). 172 () M. Paul Bernard, « Le territoire, une idée neuve pour la science administrative » in M. Jean-Jacques Gleizal (direction), Le retour des préfets ?, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1995. 173 () Mmes Dominique Andolfatto, Fabienne Greffet et Laura Nakic, « Le sous-préfet et les maires ruraux », in M. François Borella, op. cit., 2000. 174 () L'État dans tous ses projets, pour un service public de mouvement, Paris, La documentation française, janvier 1995. 175 () « Lorsque plusieurs services ou parties de services déconcentrés concourent à la mise en œuvre d'une même politique de l'État, leur fusion, totale ou partielle, peut être opérée. La fusion est proposée par le préfet ou l'un des ministres dont relèvent les services ou parties de services intéressés, sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée. Elle est décidée par décret pris sur rapport des ministres intéressés et des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la réforme de l'État, après avis des comités techniques paritaires compétents. » 176 () Le rétablissement de crédit permet à un service de prendre en charge financièrement la réalisation d'une prestation pour le compte des autres et d'en obtenir ensuite le remboursement. Elle s'applique à toutes les opérations : fonctionnement, personnel, investissement. La cession sur provisions également prévue à l'article 17 constitue une modalité particulière de la procédure de rétablissement de crédits. Alors que dans le cadre de la procédure normale les crédits sont rétablis chez le service créancier ex post par l'encaissement des recettes auprès du service débiteur, la technique des provisions évite le préfinancement de la dépense initiale par le service prestataire. 177 () M. Michel Mercier, Pour une République territoriale : l'unité dans la diversité, Rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information chargée de dresser le bilan de la décentralisation et de proposer les améliorations de nature à faciliter l'exercice des compétences locales, tome I, Sénat, Les rapports du Sénat, session ordinaire de 1999-2000, n° 447, 28 juin 2000, page 115. 178 () La loi de finances pour 2006 est la première à être élaborée entièrement sur le fondement de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. 179 () Partie de programme, le bop se décompose en unités opérationnelles de gestion afin de permettre la mise en œuvre d'opérations et l'utilisation des crédits au plus près du terrain ainsi qu'une responsabilisation de l'ensemble des acteurs. L'articulation programme bop-uo dépend de chaque programme/ministère. 180 () Cf. circulaire du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 4 juillet 2003 relative aux missions et modalités de fonctionnement du comité interministériel d'audit des programmes. 181 () M. Jacques Caillosse, op. cit., 2004, page 50. 182 () Ibid., pages 43-53. 183 () M. Jean-Claude Thoenig in MM. Guy Gilbert et Alain Delcamp (direction), La décentralisation dix ans après, LGDJ, Décentralisation et développement local, page 94. 184 () Intervention de M. Arrès-Lapoque, Journal Officiel Débats Assemblée nationale constituante, séance du 17 avril 1946, page 1915. 185 () Comité consultatif constitutionnel, Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la Constitution du 4 octobre 1958, volume 2, 1987, page 443. 186 () Alinéa abrogé par la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, mais qui en conserve la teneur. 187 () Conseil constitutionnel, décision n° 82-137 DC du 25 février 1982 relative aux lois de décentralisation, cinquième considérant. 188 () Conseil constitutionnel, décision n° 82-137 DC du 25 février 1982 relative aux lois de décentralisation, quatrième considérant. 189 () Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 190 () Conseil d'État, 15 octobre 1999, Commune de Savigny-le-Temple. 191 () Inspection générale de l'administration, inspection générale des affaires sociales, inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, inspection générale des finances, inspection générale de l'équipement, inspection générale de l'environnement et inspection générale de l'agriculture, Rapport sur l'audit du contrôle de légalité, du contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution, juillet 2003. 192 () La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans son article 139, a ainsi facilité la transmission par voie électronique des actes. 193 () Journal Officiel Débats Assemblée nationale, deuxième séance du jeudi 3 novembre 2005, pages 6242-6243. Voir également la circulaire du 17 janvier 2006 adressée aux préfets par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités locales relative à la modernisation du contrôle de légalité. 194 () Au sens strict, la normalisation, aux termes de l'article 1er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, se définit comme le processus qui « a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant des produits, biens, services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux ». 195 () M. Christian Huglo, « Les délits liés au manque de précaution : risques et environnement », Les petites affiches, 5 février 1995, pages 22 à 27. 196 () Inspection générale de l'administration, Les conséquences des normes techniques pour les collectivités locales, Ministère de l'intérieur, 2000. 197 () Pour une définition, voir M. Franck Gambelli, « Définitions et typologies des normes techniques », Les petites affiches, n° 18, 11 février 1998. 198 () MM. Pierre Roussel et Claude Chaussoy, « La normalisation européenne et les collectivités locales », Actualité juridique Droit administratif, 1991, pages 876 à 882. 199 () Mme Olivia Tambou, « Les collectivités locales face aux normes techniques », Actualité juridique Droit administratif, 2000, Chroniques, page 205. 200 () M. Fernand Bouyssou, « Le retour des tutelles techniques », Revue française de droit administratif, 1999, pages 590 à 594. 201 () Exemple de la de la directive sur l'eau potable 98/83 du Conseil de l'Union européenne du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, qui nécessite pour sa mise en œuvre une norme permettant de mesurer les dix microgrammes de plomb par litre. 202 () Mme Marie-Anne Frison-Roche, « Le contrat et la responsabilité : consentements, pouvoirs et régulation économique », Revue trimestrielle de droit civil, 1998, page 43. 203 () Voir, par exemple, l'application de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, dite « directive plans programmes ». 204 () Exemple de l'adoption des réglementations techniques relatives aux boues d'épuration et aux stations d'incinération (directive européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires). 205 () Décision n° 83-160 du 16 juillet 1983. 206 () Conseil d'État, assemblée, 8 janvier 1988, Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire contre communauté urbaine de Strasbourg. 207 () Conseil d'État, 25 octobre 1996, Association Estuaire Écologie. 208 () Tribunal des conflits, 21 mars 1983, Union des assurances de Paris. 209 () 300 millions d'euros d'autorisations de programme et 150 millions de crédits de paiement ont été inscrits à ce titre dans la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004. 210 () Voir, à ce propos, le rapport de la délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire fait par nos collègues MM. Louis Giscard d'Estaing et Jacques Le Nay sur La réforme des contrats de plan État-régions, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 1836, 12 octobre 2004. 211 () M. Henri Oberdoff, « La montée en puissance européenne de l'acteur régional », in « La décentralisation en France et en Europe » (dossier), Territoires 2020, n° 8, juillet 2003, pages 21 à 26. 212 () La première génération de contrats de plan a couvert la période quinquennale de 1984 à 1988, la deuxième celle de 1989 à 1993, la troisième génération qui devait s'appliquer aux années 1994 à 1998 a été unilatéralement prolongée par l'État et s'est achevée en 1999. 213 () Voir bilan de la troisième génération de contrats de plan fait par la Cour des Comptes dans son rapport public 1998. 214 () Fin 2004, les taux d'exécution des contrats pour la partie État y atteignaient respectivement 56 %, 55 %, 53 % et 52 %. 215 () MM. Augustin Bonrepaux et Louis Giscard d'Estaing, Rapport d'information déposé par la commission des Finances sur l'exécution des contrats de plan État-régions et la programmation des fonds structurels européens, Assemblée nationale, XIIe législature, n° 2421, 29 juin 2005. 216 () La Cour des comptes, dans son Rapport sur l'exécution des lois de finances en vue du règlement du budget de l'exercice 2004, rapport sur les résultats et la gestion budgétaires, relève ainsi que « la régulation imposée en 2004 a également pesé sur les volets routiers des contrats de plan État-région, financés sur le budget transports et sécurité routière. La mise en réserve en cours d'année de montants significatifs d'autorisations de programme a entraîné une diminution du taux d'utilisation des AP, passé de 99 % en 2003 à 58 % en 2004. » 217 () Voir, notamment, Inspection générale de l'administration et Inspection générale des finances, Rapport à Monsieur le Premier ministre sur l'avenir des contrats de plan État-région, mars 2005 et Francis Vandeweeghe (Conseil économique et social, section des économies régionales et de l'aménagement du territoire), Décentralisation, nouvelle politique et avenir des contrats de plan État-régions, Conseil économique et social, Avis et rapports, 2004. 218 () Régis Lambert, « L'expérience de la régionalisation ferroviaire du point de vue de la sncf », in M. Jean-M. Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 219 () La loi du 25 juin 1999 précitée a supprimé le schéma national d'aménagement et de développement du territoire (snadt), document de synthèse des divers schémas sectoriels d'aménagement du territoire, qui aurait dû être adopté par la voie législative. 220 () Approuvé au Conseil informel des ministres responsables de l'aménagement du territoire à Potsdam en mai 1999. Il constitue un cadre d'orientation politique destiné à améliorer la coopération des politiques sectorielles communautaires ayant un impact significatif sur le territoire. Il s'agit d'un document de nature intergouvernementale, indicatif et non contraignant en accord avec le principe de subsidiarité. 221 () Prévus par l'article 2 et définis aux articles 10 à 21-1 de la loi du 4 février 1995 précitée, telle que modifiée par la loi 25 juin 1999, ces schémas sont destinés à mettre en œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire (renforcement des pôles de développement à vocation européenne, développement local, organisation d'agglomérations...). L'ordonnance n° 2005-654 du 8 juin 2005 relative à l'allégement des procédures d'adoption et de révision des schémas de services collectifs rappelle que ces schémas « offrent un cadre aux différents exercices de contractualisation, par exemple, à l'occasion de la renégociation des contrats de plan ». 222 () Dispositif créé par l'article 8 de la loi du 4 février 1995, modifiée par l'article 179 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux Les politiques concernant les massifs de montagne s'étendant sur plusieurs régions sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du massif. Il est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Il peut donner lieu à des déclinaisons thématiques. 223 () Document de planification, créé par l'article 3 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, élaboré à l'échelle d'un bassin hydrographique. Il définit les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation sur l'eau. La prochaine mise à jour, qui devrait intervenir en 2009, définira également les objectifs à atteindre en 2015. Il est destiné à être révisé périodiquement afin de s'inscrire dans une démarche dynamique. Depuis avril 2004, le contenu des sdage est fixé à l'article L. 212-1 du code de l'environnement. 224 () M. Jean-Marie Pontier, « L'avenir des contrats de plan État-régions », Revue administrative, n° 347, 2005, pages 510 à 520. 225 () Ordonnance du 24 avril 1996. 226 () Loi du 25 juin 1999. 227 () Selon l'État récapitulatif de l'effort financier consacré à la politique de la ville et du développement social urbain annexé au projet de loi de finances pour 2006, les crédits d'État inscrits pour la programmation 2000-2006 et consacrés à la politique de la ville s'élèvent à 1,6 milliard d'euros. 228 () Programmes régionaux objectif 1, objectif 2 et objectif 3, et trois programmes d'initiative communautaire (pic), urban II, equal et interreg. 229 () Conventions prévues par l'article 156 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, codifié à l'article L. 145-3 du code de l'action sociale et des familles : « La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination (...). » 230 () MM. Dominique Dammame et Bruno Jobert, « La politique de la ville ou l'injonction contradictoire en politique », Revue française de science politique, 45-1, 1995. 231 () Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 232 () Article 22 de la loi du 4 février 1995 précitée. 233 () Article 23 de la loi du 4 février 1995 précitée. 234 () Article L. 333-1 du code de l'environnement (ancien article L 244-1 du code rural modifié par l'article 29 de la loi du 25 juin 1999 précitée). 235 () Cour des comptes, La politique de la ville, rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés, février 2002. 236 () M. Jean-Pierre Gaudin, Gouverner par contrat, Paris, Presses de Sciences Po, 1999. Voir également MM. Jean-Pierre Gaudin et Jérôme Dubois, « L'action publique par convention », Les cahiers de la décentralisation, n° 3, février 2000. 237 () M. Renaud Denoix de Saint Marc, « La question de l'administration contractuelle », Actualité juridique Droit administratif, 2003, Chroniques, page 970. 238 () Conclusions de M. Jacques-Henri Stahl sous Conseil d'État, 25 octobre 1996, Association « Estuaire Écologie », in Revue française de droit administratif, 1997, page 399. 239 () Prévu à la fin de 1998 le terme des contrats a été finalement fixé au 31 décembre 1999, mesure arrêtée en 1996 (circulaire du 19 septembre 1996 adressée aux préfets de région par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration) et confirmée par le comité interministériel d'aménagement du territoire du 15 décembre 1997. 240 () M. Laurent Richer, « La contractualisation comme technique de gestion des affaires publiques », Actualité juridique Droit administratif, 2003, Chroniques, page 973. 241 () Article 18. 242 () Voir également la circulaire du 31 juillet 1998 du Premier ministre relative à l'élaboration des contrats de plan État-régions pour la période 2000-2006. 243 () M. Jacques Moreau, « Les matières contractuelles », Actualité juridique Droit administratif, 20 octobre 1998, page 747. 244 () Conseil d'État, op. cit., 1994, page 97. 245 () MM. Gérard Marcou, François Rangeon et Jean-Louis Thiébault, « Le Gouvernement des villes et les relations contractuelles entre collectivités publiques » in Le gouvernement des villes, Descartes et cie, 1997. 246 () M. Pierre Mauroy, op. cit., page 58. 247 () L'Allemagne, qui comprend seize Länder, est organisée en deux niveaux de collectivités territoriales. Trois villes possèdent un double statut d'État fédéré et de commune. L'Autriche, qui comprend neuf États fédérés, possède un seul niveau de collectivité territoriale. La capitale, Vienne, constitue à la fois un État fédéré et une commune. La Belgique, devenue État fédéral en 1993, est doté de deux catégories d'États fédérés, les communautés et les régions. Elle a conservé ses deux niveaux de collectivités territoriales. 248 () M. Alberto Lucarelli, Percorsi del regionalismo italiano, Milan, Giuffrè Editore, 2004. 249 () Loi n° 241/90 du 7 août 1990 modifiée par la loi n° 15/05 du 11 février 2005 relative aux nouvelles règles en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs. 250 () Décret législatif n° 29/93 du 3 février 1993 de rationalisation de l'organisation des administrations publiques et de révision du pouvoir disciplinaire dans les administrations publiques, abrogé et remplacé par le décret législatif n° 165/01 du 30 mars 2001. 251 () Loi n° 59/97 du 15 mars 1997 autorisant le gouvernement à transférer des fonctions et compétences aux régions, provinces et communes et relative à la réforme de l'administration publique et à la simplification des procédures administratives, loi n° 127/97 du 15 mai 1997 portant mesures urgentes d'assouplissement de l'activité administrative et des procédures de décision et de contrôle, loi n° 50/1999 du 8 mars 1999 dite « loi de simplification 1998 », décrets législatifs nos 112/98 du 31 mars 1998 relatif à l'attribution de fonctions et de tâches administrées de l'État aux régions et aux organismes locaux, 300/99 et 303/99 du 30 juillet 1999 portant réforme de l'organisation du gouvernement et relatif à l'organisation de la présidence du Conseil. 252 () Le gouvernement de M. Silvio Berlusconi a augmenté de nouveau le nombre de ministères à quatorze. 253 () Réforme précisée par la loi n° 131/03 du 5 juin 2003 portant dispositions pour l'adaptation de l'organisation de la République à la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001. 254 () Article 4, alinéa 3. 255 () Les lois nos 146, 147 et 148 du 11 juin 2004 ont créé les dernières provinces de MonzaBrianza, de Fermo et de Barletta-Andria-Trani 256 () Loi « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 ». 257 () Article 117 de la Constitution. 258 () Cette disposition a cependant permis la constitution immédiate de huit nouvelles provinces. 259 () Le statut est adopté et modifié par le conseil régional par une loi adoptée à la majorité absolue de ses membres, en deux délibérations successives séparées d'un intervalle d'au moins deux mois. Le visa du commissaire du Gouvernement n'est pas requis pour cette loi. Le Gouvernement de la République peut saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalité relative aux statuts régionaux dans les trente jours qui suivent leur publication. Le statut est soumis à référendum lorsque dans les trois mois qui suivent sa publication un cinquantième des électeurs ou un cinquième des membres du conseil régional en font la demande. Le statut soumis au référendum n'est pas promulgué s'il n'est pas approuvé à la majorité des suffrages valablement exprimés. 260 () 1 650 euros par habitant au lieu de 206 euros en France, en 2001, selon M. Gérard Marcou (op. cit., octobre 2003, page 11). Ce même observateur averti note que l'extension des compétences régionales en matière scolaire aboutit à des différences de traitement très sensibles des établissements privés et de leurs élèves par rapport à l'enseignement public selon les régions, de même que dans le domaine de l'action sociale en faveur des personnes âgées (id. page 16). 261 () Proportionnel à la valeur ajoutée, cet impôt dont le taux n'est que de 4,5 % a un très fort rendement. 262 () ocde, Italy-Regulatory Review, mars 2001. 263 () Ce régime de substitution ne doit pas être confondu avec la possibilité offerte à l'État, sur le fondement du m) du deuxième alinéa de l'article 117 de la Constitution, d'intervenir par la loi, dans le détail, dans des matières concurrentes ou résiduelles des régions, lorsque celles-ci ne sont pas en mesure de garantir les niveaux essentiels de prestations en matière de droits civiques et sociaux. 264 () Article 52. 265 () Cette évolution reprend un fil de l'histoire apparu à la fin des années 1860, dans la lignée du romantisme culturel et littéraire, qui a vu émerger des composantes régionalistes dans diverses zones du territoire espagnole, en particulier en Catalogne, au Pays basque, en Galice et, dans une mesure moindre, dans la communauté valencienne. De littéraire le mouvement est devenu politique, réclamant un changement dans la structure de l'État, avant d'être interrompu par la guerre civile. 266 () M. Pedro Cruz Villalón, « La constitución accidental », in La democracia constitucional. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Rubio Llorente, Madrid, Centro de estudios politicos y constitucionales, 2002, page 1171. 267 () Dès l'adoption de la Constitution, la revendication démocratique et la revendication autonomiste ont été immédiatement, et continuent de l'être, associées au Pays basque et en Catalogne, deux régions qui avaient de manière brève bénéficié d'un statut d'autonomie sous la IIe République, avant que le coup d'État franquiste n'y mette fin. 268 () « La Constitution protège et respecte les droits historiques des territoires jouissant de fueros. La mise à jour générale du régime de fueros sera menée à bien, s'il y a lieu, dans le cadre de la Constitution et des statuts d'autonomie. » 269 () Exemple de la réforme du statut de Valence, le 24 mars 1994. 270 () Réforme des statuts de l'Aragon et des Canaries, le 31 décembre 1996, de Castille-La Manche en 1997, de Murcie, de la Cantabrique et de Castille-Leon en 1999. 271 () M. Franck Moderne, « L'état des autonomies dans l'" État des autonomies " », Revue française de droit constitutionnel, 1990, n° 2, page 206. 272 () Hecho differential. 273 () Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. 274 () Ley reguladora de las Haciendas Locales. 275 () Texto Refundido de la Legislación de Régimen Local. 276 () Ministerio de Administraciones Públicas. 277 () Libro blanco para la reforma del Gobierno local en España. 278 () Ley del Gobierno y la Administración Local. 279 () En Catalogne (37), Castille-Leon (1) et Pays basque (7). 280 () Voir infra 4). 281 () Il s'échelonne de 25 pour les provinces de moins de 500 000 habitants, à 27 pour celles de 500 000 à 1 million d'habitants, 31 pour les provinces entre 1 et 3,5 millions d'habitants et 51 pour les provinces de plus de 3,5 millions d'habitants. 282 () Cette forme d'organisation, à laquelle fait référence l'article 140 de la Constitution, est considérée comme une forme de démocratie directe, héritée des communes espagnoles médiévales. Seules les communes de moins de cent habitants connaissent ce type d'organisation. 283 () En vertu de cet alinéa, l'État jouit d'une compétence exclusive dans la définition des bases du régime juridique des administrations publiques, y compris des administrations locales, ce qui inclut « Les fondements du régime juridique des administrations publiques et du régime statutaire de leurs fonctionnaires qui, dans tous les cas, garantiront aux administrés un traitement commun devant elles ; la procédure administrative commune, sans préjudice des spécialités découlant de l'organisation propre des Communautés autonomes ; la législation sur l'expropriation obligatoire ; la législation fondamentale sur les contrats et les concessions administratives et le système de responsabilité de toutes les administrations publiques. » 284 () La législation en matière d'urbanisme établit que les directives arrêtées dans le cadre des plans autonomiques sont subordonnées aux dispositions d'un plan national étatique. 285 () Le Tribunal constitutionnel dans une décision du 16 novembre 1981 reconnaîtra lui-même que « les intérêts respectifs sont un concept indéterminé et ouvert qui a pour fonction d'orienter le législateur pour doter les communes des pouvoirs ou des compétences nécessaires à leur gestion ». 286 () Le Tribunal constitutionnel dans sa décision 159/2001du 5 juillet 2001 a considéré que ce pouvoir de substitution devait s'interpréter de façon très restrictive et comme une exception. 287 () M. Desiderio Fernández Manjón, La colaboración en el Estado compuesto asimétrico. El caso de España, Oñati, Instituto Vasco de Administración Pública (ivap), 2001. 288 () « L'État pourra transférer ou déléguer aux Communautés autonomes, par une loi organique, des facultés lui appartenant qui, par leur nature même, sont susceptibles d'être transférées ou déléguées. La loi prévoira, dans chaque cas, le transfert correspondant de moyens financiers, ainsi que les formes de contrôle que l'État se réservera. » 289 () 1 763 décrets royaux de transferts auront été pris. Au total, sur la période 1978-2002, près de 0,8 million de postes de fonctionnaires ont été transférés, principalement dans le domaine de l'éducation (350 000) et de la santé (320 000). Les communautés autonomes emploient aujourd'hui plus de 1,16 million de fonctionnaires. Sur 100 agents publics en 2004, 23 travaillent pour l'État, 50 pour les communautés autonomes, 23 pour les administrations locales et 4 pour les universités. 290 () C'est ce qu'a confirmé au rapporteur le président du Centro de Investigationes Sociológicas, organisme qui dépend de la présidence du Gouvernement et qui est chargé de réaliser des enquêtes et des sondages pour le compte de celui-ci. Les citoyens éprouvent une grande satisfaction à l'égard de l'État autonomique. Les gouvernements régionaux disposent d'une bonne lisibilité. Les citoyens en ont une vision positive. 291 () La Catalogne accueille 7 millions des 44 millions d'Espagnols. 292 () M. Javier Pérez Royo, Una Anomalìa española. La aversiòn a la reforma constitucional, Claves, 2003. 293 () 2 117 euros par habitant en Espagne au lieu de 206 euros en France, en 2001, selon M. Gérard Marcou, dans son étude précitée réalisée pour le centre d'études et de prévision du ministère chargé des libertés locales. 294 () Les régions en Europe, entre l'État et les collectivités locales, étude réalisée pour le centre d'études et de prévision du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, octobre 2003, page 20. 295 () Depuis 1899, l'Angleterre seule était divisée au niveau des districts entre des districts ruraux, des districts urbains, des bourgs municipaux, des bourgs de comté et des bourgs métropolitains. 296 () Acte statutaire : il s'agit d'une législation déléguée, ou secondaire. C'est un acte rédigé par un ministre du gouvernement qui exerce des pouvoirs législatifs temporaires en vertu d'une loi du Parlement. Ces actes peuvent être subordonnés à l'approbation du Parlement pour entrer en vigueur. Il s'agit d'une procédure législative accélérée et simplifiée. 297 () South East, South West, West Midlands, North West, North East, Yorkshire and the Humber, East Midlands, East of England. 298 () Greater London Authority (gla). La collectivité du Grand Londres fut mise en place pour la première fois en 1965 par le London Government Act de 1963. Le Conseil du Grand Londres (Greater London Council - glc) fut supprimé en 1986, avant d'être rétabli sous la forme de l'Autorité du Grand Londres en 1998. 299 () Regional Development Agency ou rda. 300 () Regional Assembly. 301 () Regional Development Agencies Act. 302 () Regional Spatial Strategy. 303 () Regional Assemblies (Preparations) Act. 304 () Six comtés métropolitains avaient été créés en 1974. Ils étaient eux-mêmes divisés en plusieurs districts métropolitains. Ils ont été supprimés en 1986 et leurs fonctions ont été dévolues aux districts ou prises en charge par des structures de coopération. Depuis 1995, les villes de Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham et Sheffield se sont unies au sein du Groupe des Villes Centres (Core Cities Group). Cette association ne confère pas aux villes concernées un statut différent de celui des autres villes, mais apparaît comme un moyen de reconnaissance de leur rôle comme capitales régionales. 305 () Les districts peuvent prendre le nom de « cities », « boroughs », « royal boroughs », « metropolitan boroughs » ou simplement de « districts ». Par exemple, beaucoup de districts ont le statut de borough, ce qui signifie que le conseil local est appelé conseil de borough au lieu de conseil de district, ce qui leur donne le droit de nommer un maire. D'autres districts, comme celui d'Oxford ou d'Exeter ont le statut de city, mais cela ne leur donne aucun autre droit que d'appeler leur conseil city council. 306 () Conformément à la réforme des structures locales opérée par la commission du gouvernement local mise en place sur le fondement de la loi sur le gouvernement local de 1992, les comtés d'Avon, de Cleveland, de Humberside, leurs districts ainsi que le district de la Cité de York ont été supprimés et remplacés par 13 collectivités territoriales uniques, qui sont entrées en vigueur en avril 1996. En 1997, 13 nouvelles collectivités territoriales uniques ont été mises en place et 19 en 1998, faisant un total de 45 collectivités territoriales uniques auxquels s'ajoutent Londres et l'île de Wight qui dispose d'un tel statut depuis 1995. 307 () Les appellations peuvent être différentes, mais les compétences sont les mêmes. 308 () Elle possédait avant la réforme neuf conseils régionaux. 309 () Elle possédait avant la réforme neuf conseils de circonscription. 310 () Mécanisme conçu à la fin des années 1970 par M. Joel Barnett, alors directeur général du Trésor. 311 () Impôt portant sur les personnes et non pas la propriété. 312 () Loi de financement des gouvernements locaux. 313 () Classement en huit catégories de la lettre A à H en fonction de la valeur en capitale du bien foncier. 314 () Gérard Marcou, Rapport sur le respect des engagements souscrits par les États membres, Conseil de l'Europe, 2001. 315 () Scotland Act de 1998, article s. 73. 316 () M. L. Paterson, The autonomy of Modern Scotland, Édimbourg, Edinburgh University Press, 1994. 317 () Highlands and Islands Development Board. 318 () Scottish Development Agency. 319 () Questions qui recueillirent respectivement 74 % et 63 % de « oui ». 320 () La réforme de 1975 avait réduit le nombre de corps élus de 430 à 65. 321 () Commission on Local Government and the Scottish Parliament-the McIntosh report. 322 () Local Government in Scotland Act. 323 () Expression à l'origine utilisée de manière relativement péjorative par le Parti conservateur. 324 () Après la dévolution, la plupart des fonctionnaires du Scottish Office sont devenus fonctionnaires de l'Exécutif écossais (Scottish Executive). 325 () An Act to make provision for modifying the office of Lord Chancellor, and to make provision relating to the functions of that office ; to establish a Supreme Court of the United Kingdom, and to abolish the appellate jurisdiction of the House of Lords ; to make provision about the jurisdiction of the Judicial Committee of the Privy Council and the judicial functions of the President of the Council; to make other provision about the judiciary, their appointment and discipline; and for connected purposes ou Constitutional Reform Act 2005 Chapter 4. 326 () M. Gérard Marcou, « L'expérimentation locale en Suède », in Ministère de l'intérieur, Centre d'études et de prospective, 2004, op. cit., pages 49 et suivantes. 327 () Le nombre des communes a été progressivement réduit par la loi : il est passé de 2 500 avant 1952 à 1 037, puis à environ 290 en 1971, et ce pour tenir compte de la nécessité de concentrer les capacités financières et techniques et rendre possible pour chacune l'exercice des compétences dévolues par l'État. Par ailleurs, depuis la séparation de l'Église de Suède et de l'État, le 1er janvier 2000, les paroisses ont perdu toute fonction administrative. 328 () Loi 1996 :1414 sur l'expérimentation d'une répartition modifie de la responsabilité régionale et 1996 :1415 sur l'expérimentation d'une union régionale dans le comté de Kalmar et le comté de Scanie. 329 () 1er janvier 1997. 330 () 1er janvier 1999. 331 () Loi 2002 : 34 du 7 février 2002. 332 () Chiffres 2003 : Svenska Kommunförbundet et Landstings Förbundet, The financial situation of Swedish municipalities and county councils, novembre 2004. 333 () La question de la nécessité d'une telle cour fait actuellement l'objet d'une enquête gouvernementale sur la Constitution dont les résultats seront connus en décembre 2008. 334 () Utvecklingskraft för hållbar välfärd, Stockholm: Official Government Reports - SOU, 2003. 335 () M. Gérard Marcou, « Les régions entre l'État et les collectivités locales dans les États fédéraux ou à autonomies régionales : décentralisation ou centralisation ? » in « La décentralisation en France et en Europe » (dossier), Territoires 2020, n° 8, juillet 2003, page 14. 336 () 2,7 millions pour Karlsruhe, 3,9 millions pour Stuttgart, 1,8 million pour Tübingen et 2,2 millions pour Fribourg. 337 () M. Jean-Marie Pontier, « La notion de compétences régaliennes dans la problématique de la répartition des compétences entre les collectivités publiques », Revue du droit public, 2003, page 193. 338 () M. Jean-Claude Thoenig, « Réforme de l'administration et réforme de l'État », Revue politique et parlementaire, n° 982, mars-avril 1996. 339 () Journal Officiel Débats Assemblée nationale constituante, séance du 16 avril 1946, page 1918. 340 () Cour des comptes, L'intercommunalité en France, rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et des organismes intéressés, novembre 2005. 341 () Décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement (diren). 342 () La durée du séjour des préfets atteint en moyenne trente mois. 343 () M. Michel Pébereau, op. cit., page 75. 344 () Circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2006 relative à la mise en œuvre des propositions de réforme de l'administration départementale de l'État. 345 () M. François de Baecque, « Pour une politique cohérente de déconcentration », Revue française de science politique, 1967, n° 5. 346 () M. Michel Pébereau, op. cit., page 76. 347 () M. Jean-Benoît Albertini, op. cit. 348 () Préfiguration des Regional Development Agencies créées en 1998. 349 () Gaston Deferre, entretien le 23 mai 1985, repris dans Pouvoirs locaux, mars 1992, n° 13. 350 () En 1902, la Chambre des députés vote le principe de la suppression de l'arrondissement et la loi du 10 septembre 1926 en supprime 106. 351 () Article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales. 352 () Selon un sondage réalisé en octobre 2005 à l'occasion de la convention nationale de l'Association des communautés de France, 87 % des Français vivant dans une intercommunalité estiment que « c'est une bonne chose pour leur commune ». 353 () M. Hervé Groud, « L'intérêt communautaire au lendemain de la loi Chevènement », Actualité juridique Droit administratif, 2000, pages 967 à 976 ; « La notion d'intérêt communautaire. Éléments de recherches », in M. Jean-Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 354 () Mme Cécile Jebeili, « L'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct : l'intercommunalité entre fiction et réalité », Collectivités territoriales - Intercommunalités - Revue mensuelle LexisNexis JurisClasseur, janvier 2006, pages 4 à 8. 355 () M. René Dosière, « Développement urbain et solidarité fiscale », in M. Jean-Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 356 () À la sortie de la seconde guerre mondiale, Michel Debré dans La mort de l'État républicain, Département et décentralisation, prône la création de quarante-sept grands départements, tandis que l'économiste François Perroux envisage la création d'une dizaine de grandes régions. 357 () Conseil d'État, « Décentralisation et ordre juridique » in op. cit, 1994, page 19. 358 () M. Jacques Caillosse, « La ville sans droit », Pouvoirs locaux, juin 1995, pages 112. 359 () M. François Lefebvre, « L'émergence des territoires spécifiques », in M. Jean-Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 360 () M. Alain Faure, « Vers une République régionale », Pouvoirs locaux, septembre 1995, pages 25 et suivantes. 361 () M. Jean Picq, L'État en France, servir une nation ouverte sur le monde, mission sur les responsabilités et l'organisation de l'État, Paris, mai 1994. 362 () Le préfet de zone est le préfet du chef-lieu de la zone. Dans les domaines de la préparation et la mise en œuvre des mesures non militaires de sauvegarde des populations, il dirige l'action des préfets de région et de département. Il peut, en cas de difficulté, obtenir par lettre du Premier ministre autorité hiérarchique sur les autres préfets en fonction dans les départements concernés et sur l'ensemble des moyens de police nationale, pouvoir de réquisitionner des forces armées, de même que les services, les personnes et les biens. 363 () Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense. 364 () M. Francis Vandeweeghe, Conseil économique et social, section des économies régionales et de l'aménagement du territoire, Décentralisation, nouvelle politique et avenir des contrats de plan État-régions, Conseil économique et social, Avis et rapports, 2004, page 34. 365 () La définition même du développement durable ouvre la voie à toutes les politiques publiques ; ainsi, selon le « rapport Brundtland » présenté par la commission mondiale sur l'environnement et le développement à l'assemblée générale des Nations unies, le développement durable est « un type de développement qui permet de satisfaire les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs » (cité par Mme Michèle Cascalès, « Le concept de développement durable », in M. Jean-Claude Némery (direction) 2001, op. cit. 366 () Mme Annie Gruber, « La coopération locale à l'heure de l'Union européenne : les nouvelles formes de regroupements des collectivités décentralisées », Les petites affiches, 28 janvier et 2 février 1994, nos 12 et 14. 367 () M. Georges Stephanides, « La réforme des collectivités en Grèce " Capodistria " », in M. Jean-Claude Némery (direction), 2001, op. cit. 368 () M. Jean Morange, « Les municipalités de canton », in MM. Jean-Pierre Machelon et François Monnier, Les communes et le pouvoir, histoire politique des communes françaises de 1789 à nos jours, Paris, Presses universitaires de France, 2002, pages 135 à 143 ; M. Pierre Villard, Histoire des institutions publiques de la France de 1789 à nos jours, Paris, Dalloz, Mémento, 2004, page 28. 369 () Loi n° 57-908 du 7 août 1957 favorisant la construction de logements et les équipements collectifs. 370 () Entre 1959 et 1970, seules 350 fusions intervinrent. 371 () Projet de loi tendant à améliorer le fonctionnement des institutions communales, Journal officiel Documents parlementaires, Assemblée nationale, deuxième session ordinaire 1967-1968, annexe n° 8121. 372 () À noter qu'une procédure de fusion d'epci a été instituée par la loi 13 août 2004 précitée. Elle permet le regroupement en seul epci à fiscalité propre de plusieurs epci préexistants, dès lors que l'un d'entre eux au moins dispose d'une fiscalité propre. L'epci issu de la fusion est substitué pour l'ensemble des compétences qu'il exerce aux epci préexistants dans l'ensemble de leurs droits et obligations. 373 () MM. Francis Doublet, Laurent Fabius et Jean de Kervasdoué et Mme Myriem Mazodier, « La loi et le changement social : la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes », Revue française de sociologie, XVII-3, septembre 1976, pages 423 à 450. Les auteurs évoquent le flou des objectifs de la loi, la faiblesse des incitations, le fait que les préfets et les élus locaux se sont entendus de manière implicite pour ne pas recourir au référendum, pour court-circuiter les corps techniques. 374 () Journal officiel Débats Sénat, séance du 15 juin 1971, page 875. 375 () Voir, par exemple, Conseil d'État, 31 juillet 1992, Ordre des avocats au barreau du Val-d'Oise. 376 () Conseil d'État, Assemblée. 18 novembre 1977, Commune de Fontenay-sous-Bois et autres. 377 () M. Bernard Maligner, « Le découpage des circonscriptions électorales devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État », Droit administratif, avril 1992. 378 () Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse. 379 () M. François Luchaire, « Un Janus constitutionnel, l'égalité », Revue du droit public, 1986, pages 1229 et suivantes. 380 () MM. François Dupuy et Jean-Claude Thoenig, L'administration en miettes, Paris, Fayard, 1985. 381 () M. Renaud Epstein, « Gouverner à distance. Quand l'État se retire des territoires », Esprit, novembre 2005, page 103. 382 () Conseil d'État, « Décentralisation et ordre juridique », op. cit., 1994, page 18. 383 () M. Bruno Cassette, Le développement numérique des territoires, Paris, datar, La documentation française, 2002, page 9. 384 () « Entretien avec M. Michel Mercier, sénateur du Rhône », Revue Lamy des collectivités territoriales, juillet-août 2005, n° 4, page 45. 385 () Décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002 sur la loi relative à la Corse, considérants 17 et 18. 386 () Un des interlocuteurs du rapporteur, membre du Conseil d'État, allait jusqu'à estimer que « la décentralisation est un modèle de l'anti-qualité réglementaire. Le code général des collectivités territoriales est un des codes les plus mal écrits, il est sédimenté. » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
