 N°3061 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2006. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur L'enseignement des disciplines scientifiques ET PRÉSENTÉ par M. Jean-Marie ROLLAND, Député. ___ INTRODUCTION 9 I.- LA DÉSAFFECTION DES JEUNES POUR LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES : UN PROBLÈME MONDIAL 11 A. L'ÉDUCATION SCIENTIFIQUE DANS LE MONDE PRÉSENTE DE NOMBREUSES CONSTANTES 12 1. Un désenchantement général vis-à-vis de la science 12 2. Une sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques 14 3. Un enseignement trop académique 18 B. L'ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE 20 1. La désaffection est très nette pour les études universitaires en physique-chimie et en mathématiques 21 2. La désaffection pour les filières scientifiques est assez largement une question de genre 25 C. LES LEÇONS DES ENQUÊTES INTERNATIONALES SUR LES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DE QUINZE ANS 28 II.- L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DES MATHÉMATIQUES NE DOIT PAS ÊTRE RÉDUIT À SA SEULE EFFICACITÉ SÉLECTIVE 33 A. POUR ÊTRE PLUS FORMATEUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES DEVRAIT ÊTRE MOINS SÉLECTIF 33 1. Les mathématiques au sommet de la hiérarchie scolaire 33 2. Quelles mathématiques à l'école primaire ? 35 B. L'IMPORTANCE DE L'ACQUISITION D'UNE CULTURE SCIENTIFIQUE 37 1. Apprendre avec les musées scientifiques 37 2. Apprendre la science par les médias 41 3. Apprendre la science à travers l'histoire des découvertes et la vie des grands chercheurs 43 C. LA CULTURE SCIENTIFIQUE PARTICIPE À LA CONSTRUCTION DE LA DÉMOCRATIE 44 III.- LA RÉNOVATION DE L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES SCIENTIFIQUES PASSE PAR L'INNOVATION 47 A. LES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES PORTEUSES D'AVENIR 48 1. L'expérience de La main à la pâte 48 2. L'expérimentation en mathématiques 52 3. Les bons choix en matière d'informatique 55 4. L'enseignement pluridisciplinaire des sciences au collège, l'exemple du Québec 57 5. L'évaluation sans disqualification 60 B. LA CRÉATION D'UNE VÉRITABLE FILIÈRE SCIENTIFIQUE AU LYCÉE 62 1. Créer une option sciences en classe de seconde 62 2. Instaurer un véritable baccalauréat scientifique 63 IV.- LA FORMATION ET LA MOTIVATION DES ENSEIGNANTS : UN ENJEU NATIONAL 66 A. LA SITUATION ACTUELLE EST TRÈS INSATISFAISANTE 67 1. Des professeurs des écoles sous-formés en science 67 2. Des enseignants du secondaire enfermés dans leur discipline 68 3. Un déficit général de formation continue 69 B. LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES (IUFM) DOIVENT PROFONDÉMENT ÉVOLUER 71 1. Un cahier des charges très attendu 71 2. Améliorer la préparation des enseignants du secondaire 73 3. Rendre plus attractif le métier d'enseignant dans le second degré 73 SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 77 TRAVAUX DE LA COMMISSION 81 ANNEXES 85 Annexe 1 : Composition de la mission 85 Annexe 2 : Liste des personnes auditionnées à l'assemblée nationale 87 Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées lors des déplacements 91 Annexe 4 : Les évaluations nationales en 2005 en mathématiques en CE2 et en 6ème 95 Annexe 5 : Exemples d'exercices de mathématiques dans les évaluations Pisa 2003 99 Annexe 6 : Classement des pays sur les quatre domaines évalués par Pisa 2003 105 Annexe 7 : Présentation de l'association maths en jeans (méthode d'apprentissage des théories mathématiques en jumelant des établissements pour une approche nouvelle des savoirs) 107 Annexe 8 : Présentation de l'association animath 109 Annexe 9 : Comptes rendus des auditions 111 Réunion du 29 novembre 2005 : - audition de Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques, - audition de Mme Marie Reynier, directrice générale de l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), présidente de la commission Amont de la Conférence des Grandes écoles 117 - audition de M. Dominique Perrin, directeur de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE), de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). 121 Réunion du 6 décembre 2005 : - audition de M. Christian Margaria, directeur de l'Institut national des télécommunications, président de la Conférence des grandes écoles 127 - audition de M. Yves Malier, professeur d'université, membre de l'Académie des technologies, ancien directeur de l'Ecole normale de Cachan 129 - audition de M. Elie de Saint-Jores, chef de service formation initiale au sein de la direction de la formation du MEDEF 132 - audition de Mme Geneviève Berger, chercheure en biophysique, ancienne directrice du CNRS 134 - audition de M. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint de la direction Réunion du 13 décembre 2005 : - audition de Mme Claudine Peretti, directrice de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 139 - audition de M. Norberto Bottani, directeur du service de la recherche - audition de M. Laurent Lafforgue, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques (IHES), membre de l'Académie des sciences, médaille Fields 2002 143 - audition de M. Michel Lagües, directeur de l'espace sciences à l'ESPCI - audition de M. Thierry Aubin, professeur à l'université Pierre et Marie Curie membre de l'Académie des sciences, section mathématiques. . 148 Réunion du 20 décembre 2005 : - audition de M. Jean-François Bach, professeur à l'université René Descartes, membre de l'Académie des sciences, section biologie humaine et sciences médicales 151 - audition de M. Georges Charpak, professeur émérite à l'École de physique et chimie industrielles et physicien à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, membre de l'Institut de France 156 - audition de M. Pierre Léna, professeur à l'université Denis Diderot, membre de l'Académie des sciences, section sciences de l'univers Réunion du 17 janvier 2006 : - audition de M. Anders Hingel, direction de l'éducation de - audition de M. Pascal Huguet, directeur de recherche au laboratoire - audition de M. Edouard Brezin, président de l'Académie des sciences et M. Yves Quéré, membre de l'Académie des sciences, Réunion du 31 janvier 2006 : - audition de M. Xavier Clément, directeur de la communication et porte-parole du CEA, M. Jean-Pierre Vigouroux, chef de la cellule des affaires publiques, chargé des relations avec le Parlement 185 - audition de M. Christian Orange, professeur des universités en sciences de l'éducation (didactique des sciences), agrégé des Sciences de la vie et de la terre, formateur à l'IUFM des Pays de la Loire 188 - audition de M. Jean-Pierre Demailly, professeur à l'université de Grenoble I, Institut Fourier, président du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes (GRIP), et de M. Michel Delord, vice-président du GRIP, enseignant de collège en mathématiques 191 - audition de M. Antoine Petit, directeur interrégional Sud-Ouest du CNRS Réunion du 7 février 2006 : - audition de M. Marc Peyrade, directeur de l'Ecole nationale - audition de M. Michel Kasser, directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques 205 - audition de M. Christian Loarer, inspecteur général du primaire, auteur d'un rapport sur la rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école 206 - audition de M. Jean-Jacques Dupin, professeur des universités en physique à l'IUFM d'Aix-Marseille, ancien vice-président de la Conférence des directeurs d'IUFM, chercheur en didactique des sciences 209 Réunion du 21 février 2006 : - audition de M. Philippe Meirieu, directeur de l'IUFM de Lyon 211 - audition de M. François Perret, doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale et M. Claude Boichot, inspecteur général secteur physique chimie au lycée et post bac (CPGE, IUT, STS) 215 - audition de M. Rémi Brissiaud, chercheur en didactique des mathématiques, enseignant à l'IUFM de Versailles, auteur d'ouvrages sur les mathématiques en primaire 219 Réunion du 28 février 2006 : Table ronde des enseignants 221 - M. Michel Frechet et M. Bruno Descroix, membres de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP) - M. Jean-Charles Jacquemin, président de l'union des professeurs de physique et de chimie (UdPPC), et Mme Marie-Françoise Karatchentzeff, membre de l'association - M. Jean-Michel Schmitt, président de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI) - M. Yohan Yebbou, président et M. Bruno Jeauffroy, secrétaire général, de l'union des professeurs de spéciales (UPS) classes préparatoires aux grandes écoles - Mme Eliane Vernet et M. Jean Ulysse, de l'association des professeurs de biologie et géologie (APBG) Réunion du 7 mars 2006 : - audition de M. Christian Forestier, membre du Haut conseil de l'éducation, - audition de M. Gilles de Robien ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche 245 - audition de M. Jean-Pierre Kahane, professeur émérite de mathématiques, membre de l'Académie des sciences, président de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques 256 - audition de M. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale et de la recherche, ancien président du Conseil national des programmes, président du Conseil d'analyse de la société 261 Réunion du 14 mars 2006 : - audition de M. Farid Hamana, secrétaire général de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), et M. Gilbert Lambrecht, chargé de mission à la FCPE 265 - audition de M. Roland Debbasch, directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 270 - audition de M. Jean-Marc Monteil, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 274 - audition de M. Christian Brechot, directeur général de l'INSERM 279 - audition de Mlle Eva Dumontet, secrétaire nationale à la presse, et de Mlle Floréale Mangin, secrétaire nationale aux questions de société de l'Union nationale lycéenne (UNL) 283 Une grande partie du paradoxe de la technologie moderne est qu'elle s'utilise bien plus facilement qu'elle ne s'explique et que d'une certaine façon elle se retourne contre la science qui l'a rendue possible. Dès l'instant où nous pouvons utiliser une télécommande nous n'avons plus vraiment besoin de comprendre le fonctionnement de l'appareil. La science et la technologie modernes ont quelque chose de magique et cet aspect risque d'ouvrir la porte à des croyances irrationnelles. Comment peut-on faire la différence entre la réalité et la magie lorsque les réalisations de la science dépassent l'imaginaire ? À l'autre bout du problème se trouve la science qui ne fait plus rêver, dont l'image sociale est ternie et qui est souvent mise au banc des accusés. Pourtant la science est au cœur de la bataille mondiale de l'intelligence et la force d'une nation ou d'une région se mesure souvent en nombre d'innovateurs, de chercheurs et de brevets déposés. Alors, pourquoi seulement 7 % des anciens élèves de l'École polytechnique se tournent-ils vers la recherche ? Cette vaste interrogation de l'homme moderne face à la science, si elle ne contient pas toutes les préoccupations qui ont conduit à la constitution de la mission d'information sur l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire, n'en a pas moins constitué une toile de fond permanente. Une précision tout d'abord mérite d'être apportée, de quelle science faut-il parler ? Les mathématiques sont bien entendu une science qui vit sur sa réputation d'excellence pédagogique un peu ternie par son côté « potion amère ». S'y ajoutent les sciences expérimentales et d'observation ou sciences de la nature (biologie, physique, chimie, géologie, astronomie), qui sont expérimentées partout sauf à l'école ou si peu. Mais il ne faut pas oublier la technologie, qui devrait entretenir avec toutes les sciences un rapport étroit, mais a longtemps été reléguée au rang de travaux manuels et consiste trop souvent aujourd'hui à savoir allumer un ordinateur. Un autre aspect de l'interrogation est de savoir pourquoi, si la science permet à l'homme de devenir « un inventeur de phénomènes », selon les termes de Claude Bernard, son enseignement n'est bien souvent que le « téléchargement de données abstraites » pour reprendre une expression entendue au Québec. Tout au long des six mois qui ont suivi sa création par la commission des affaires culturelles familiales et sociales, le 8 novembre 2005, la mission d'information sur l'enseignement des disciplines scientifiques a examiné les différentes facettes du problème. Elle a procédé à l'audition de cinquante-six personnes à l'Assemblée nationale, toutes concernées à des titres divers par l'enseignement des sciences. Académiciens, pédagogues, enseignants, directeurs d'instituts de formation des maîtres (IUFM), élèves, parents d'élèves, chercheurs, inspecteurs généraux et directeurs d'administration de l'éducation nationale, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale et un ancien ministre, ont fait part de leurs inquiétudes, ou de leur enthousiasme mais aussi de leurs attentes et de leurs propositions. Elle s'est également déplacée sur le terrain, dans un lycée parisien puis dans une classe de cours préparatoire de Clichy-sous-Bois, pour recueillir un maximum d'informations sur des expériences pédagogiques innovantes. Le rôle des musées des sciences dans la diffusion de la culture scientifique était également au centre des interrogations et la mission s'est ainsi rendue au Palais de la Découverte et à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris ainsi qu'au Vaisseau à Strasbourg. Enfin intrigués autant qu'intéressés par les excellents résultats des élèves en Finlande, au Canada et, dans une moindre mesure, en Suède lors des évaluations internationales de compétences qui tendent à se multiplier, certains membres de la mission se sont rendus dans ces trois pays afin de comparer les méthodes, la philosophie et l'efficacité de ces différents systèmes éducatifs avec ce qui se passe en France. Sans prétendre apporter des solutions clés en main aux très nombreux problèmes posés, la mission s'est tout d'abord efforcée de faire le point, dans le monde et en France, sur l'inquiétant problème de la désaffection des jeunes pour les études scientifiques. Il était ensuite indispensable de s'interroger sur les contenus, les méthodes mais aussi le rôle et la place dans le système scolaire des disciplines scientifiques. Quant aux moyens de réconcilier les jeunes - et notamment les jeunes filles - et les sciences, ils dépassent largement les questions purement scolaires même s'il conviendrait d'abord de réconcilier les professeurs avec eux-mêmes. Le poids des stéréotypes et des représentations négatives de la science, un système éducatif trop élitiste et un rapport décourageant entre le long effort à fournir pour faire des études scientifiques et les faibles espoirs de débouchés contribuent largement à figer la situation. Mais la mission a observé, tant en France qu'à l'étranger, un tel enthousiasme à enseigner, une telle curiosité et une telle soif d'apprendre, dès lors que l'on sort des modes traditionnels de transmission des savoirs qu'elle considère que le levier du changement réside dans ces laboratoires pédagogiques qui tendent à se multiplier bien plus que dans une énième révision des programmes ou des horaires. I.- LA DÉSAFFECTION DES JEUNES POUR LES ÉTUDES SCIENTIFIQUES : UN PROBLÈME MONDIAL Depuis plus de dix ans, la situation est préoccupante en France comme dans la plupart des pays occidentaux. De nombreux rapports ont tenté d'analyser et de comprendre le manque d'intérêt des jeunes pour les carrières scientifiques. La communauté scientifique s'est pourtant fortement mobilisée depuis plusieurs années multipliant les initiatives, en direction des établissements d'enseignement notamment pour populariser les sciences. Malgré tous ces efforts, la courbe des effectifs étudiants a poursuivi sa décroissance à l'exception toutefois des filières de la santé. De nombreux interlocuteurs de la mission ont affirmé que ce problème est très largement répandu dans le monde, y compris dans les pays qui consacrent une part importante de leur produit national à la recherche et au développement. De surcroît le problème semble naître très en amont. Dans un rapport présenté à la Commission européenne le 2 avril 2004(1), M. José Mariano Gago, ancien ministre portugais de la science et de la technologie et président de « Initiative for science in Europe », cite une enquête européenne qui montre que, à la fin du primaire la moitié des enfants disent déjà que la science et la technologie ne sont pas pour eux. À la fin du collège, ils sont 90 %. Une étude menée en Norvège donne des résultats similaires. On peut donc dire que l'enseignement des sciences au primaire et au collège décourage, voire dégoûte les enfants : c'est dommage pour eux et c'est grave pour l'Europe. Si la crise est globale elle est hétérogène touchant davantage certains pays développés que les pays émergents. Alors que la France dénombre 5,7 chercheurs pour 1000 habitants, on en recense 9,14 au Japon et 8,08 aux Etats-Unis. Mais c'est dans les pays émergents, comme en Inde avec 400 000 ingénieurs formés chaque année ou en Chine, que les sciences affichent la meilleure santé. Afin d'approfondir quelque peu cette analyse, la mission s'est déplacée en Finlande en Suède et au Canada dans le but également de s'informer sur les méthodes d'enseignement et leur efficacité. Le présent rapport reviendra sur les enseignements que l'on peut tirer de ces exemples étrangers mais on peut dire dès à présent que le Québec et la Suède connaissent la même désertion que la France et que si la Finlande, pays de l'Union européenne comptant le plus grand nombre de chercheurs et de personnels travaillant dans la recherche-développement (R&D) par rapport à l'emploi total, est épargnée c'est en partie grâce à un enseignement qui associe qualité, équité et efficience. A. L'ÉDUCATION SCIENTIFIQUE DANS LE MONDE PRÉSENTE DE NOMBREUSES CONSTANTES 1. Un désenchantement général vis-à-vis de la science À l'heure où les sciences et les technologies connaissent des avancées sans précédent, les jeunes boudent les filières scientifiques dans l'enseignement secondaire et supérieur. On y aborde des sujets ennuyeux et trop abstraits, jugent-ils. Le président de la Royal Society alertait voici peu les députés britanniques sur la baisse alarmante du nombre d'élèves passant les épreuves de mathématiques, de physique et de chimie à la fin des études secondaires, et optant pour ces matières à l'université. Cette désaffection s'observe dans les pays industrialisés et même dans certains pays en développement. Ce désintérêt s'il est assez récent est vraiment général. Selon l'OCDE, le nombre de scientifiques et d'ingénieurs diplômés s'amenuise au moment même où avancées scientifiques et innovations technologiques sont réclamées de toutes parts. Aux États-unis, pays moteur du développement mondial, on constate de plus en plus que les étudiants d'origine asiatique sont majoritaires dans les amphithéâtres et les laboratoires des universités. Ce pays s'inquiète de voir stagner ou régresser les résultats de ses élèves par rapport à Singapour ou à la Finlande, par exemple dans le cadre des Olympiades scientifiques internationales. En Allemagne, les effectifs d'étudiants en chimie se sont tellement amenuisés que dans l'une des chaires de chimie organique les plus prestigieuses, à l'université de Karlsruhe, le dernier titulaire de la chaire ne sera pas remplacé. Dans ce pays entre 1990 et 1995, le nombre d'étudiants en physique a été divisé par trois, passant dans plusieurs universités sous la barre des dix étudiants. Au Canada, des moyens considérables sont mis en jeu par la Fondation canadienne pour l'innovation et les chaires canadiennes de recherche pour faire revenir les universitaires actuellement en poste aux Etat-Unis et attirer les scientifiques étrangers. Au Québec, les universités s'efforcent d'attirer des étudiants et des enseignants étrangers en accordant par exemple à ces derniers une dispense d'impôts pendant cinq ans. Étrange paradoxe, si l'on pense qu'aucune période de l'histoire n'a été plus imprégnée que le XXè siècle par les sciences de la terre et les sciences du vivant, ni plus tributaire d'elles. Le problème concerne toute la société. Les patrons d'entreprises s'inquiètent de ne pas trouver de main-d'œuvre qualifiée dans les domaines scientifique et technologique. Dans de nombreux pays les universités et les centres de recherche sont inquiets face aux évolutions démographiques et au risque de ne pas pouvoir remplacer la génération de chercheurs et d'enseignants qui va partir à la retraite au cours des prochaines années. Une véritable compétition internationale, dans laquelle la France n'est pas la mieux placée, se déchaîne pour attirer les cerveaux. Mais pourquoi les jeunes se détournent-ils des sciences en classe? Le bulletin « Education aujourd'hui » d'octobre-décembre 2004 de l'UNESCO aborde cette problématique présentée comme universelle. Selon Svein Sjøberg, professeur en pédagogie des sciences à l'université d'Oslo et co-auteur d'un ouvrage sur les innovations dans l'enseignement des sciences et de la technologie, les chercheurs et les ingénieurs ne sont plus, dans l'esprit des gens, ces héros qui faisaient de grandes découvertes, luttaient contre l'obscurantisme et amélioraient la vie quotidienne par leurs découvertes. Selon ce chercheur cette image appartient à l'histoire, du moins dans les pays les plus développés. De nouvelles stars occupent le devant de la scène - footballeurs, acteurs et chanteurs célébrissimes et richissimes - « le chercheur en blouse blanche dans son laboratoire, mal payé et travaillant dur, n'est plus un modèle pour bon nombre de jeunes d'aujourd'hui. » Élèves et étudiants tendent donc à s'orienter vers des disciplines qu'ils considèrent comme moins exigeantes. Nyiira Zerubabel, secrétaire exécutif du Conseil national ougandais pour la science et la technologie, prédit un sombre avenir aux sciences dans son pays: « Dans une société dominée par le consumérisme, les jeunes privilégient d'autres formations, comme l'économie ou le commerce, moins difficiles et plus prometteuses en termes de salaire ». Les scientifiques et la science se sont peu à peu coupés de leurs contemporains, faute d'avoir conduit une réflexion suffisamment approfondie sur les implications philosophiques, éthiques, voire métaphysiques, des découvertes et des théories scientifiques. Cette absence de réflexion et de débat au sein de la communauté scientifique et des sociétés, par exemple sur l'hypothèse d'un principe créateur de l'univers, a sans doute facilité l'irruption aux Etats-Unis du mouvement dit du « dessein intelligent » qui fait l'objet d'un intense développement médiatique. Ce mouvement compte en son sein de nombreux créationnistes qui nient une partie des fondements de la science et particulièrement l'existence d'un ancêtre commun à toutes les principales formes de vie sur terre. Il revendique, en conséquence, la modification des programmes scolaires. Le retour des superstitions, la recherche d'explications simples et rassurantes face à la complexité du monde sont le pendant du recul de la force explicative de la science et de l'adhésion collective à ses travaux. La crise des vocations scientifiques chez les jeunes n'est certainement pas sans lien avec les critiques parfois radicales dont la science est l'objet et contre lesquelles elle se défend mal. On peut voir aussi dans cette situation le résultat d'un enseignement des sciences par disciplines complètement cloisonnées et déconnectées de toute approche philosophique ou éclairée par les sciences humaines. Dans ces conditions nos contemporains ont du mal à accepter l'idée que la vérité existe mais qu'elle n'est pas intangible et qu'elle évolue. Cette perte d'influence et de crédibilité de la science au niveau mondial ne doit pas toutefois conduire à écarter les facteurs socio-économiques et les politiques propres à chaque pays. En plein marasme économique le Japon a continué à financer à un niveau élevé l'enseignement supérieur et la recherche, alors que l'Union européenne accuse un sérieux retard dans ces domaines. Toutefois, il faut préciser que le Japon n'échappe pas au problème de la désaffection du public et des jeunes pour la science. Très préoccupées par cette perspective incompatible avec la reprise économique, les autorités japonaises ont mis en place dès 1995 un vaste programme, Public understanding of science and technology (PUST), pour promouvoir la science et les études scientifiques. 2. Une sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques Ce problème est au moins aussi universel que le scepticisme vis-à-vis des progrès apportés par la science. En France, il a été mis en lumière par deux enquêtes récentes commanditées par la mission pour la place des femmes au CNRS, dirigée par Mme Geneviève Hatet-Najar, dont l'objectif est de promouvoir la place des femmes dans cet organisme. Le constat est sans appel : la part des femmes dans le corps des chercheurs stagne aujourd'hui autour de 30 % et, comme cela a été confirmé à la mission par tous les directeurs des différents organismes de recherche, la représentation des femmes s'effondre à mesure que l'on grimpe dans la hiérarchie. Ces enquêtes(2) s'efforcent d'expliquer la persistance de ce « plafond de verre » qui bloque la progression des femmes. Personne ne sera surpris d'apprendre que les capacités intellectuelles et professionnelles ne sont pas en cause. Parmi les explications proposées, on retiendra que les femmes passent spontanément plus de temps que les hommes, et ce au détriment de leur carrière, à l'organisation et à la vie collective des laboratoires. L'une des enquêtrices, Mme Catherine Marry, sociologue, constate avec un brin d'ironie que « les succès professionnels plus fréquents des chercheurs masculins sont liés à leur plus grande capacité à déléguer à d'autres _ le plus souvent des femmes _ les soucis d'intendances dans la sphère domestique mais aussi dans la sphère professionnelle ». Ces constats rejoignent ceux qui ressortent d'une expérience réalisée en Colombie-Britannique (Canada), destinée à promouvoir l'égalité des sexes dans une classe de sciences(3). L'équipe qui a réalisé cette étude a notamment observé que les filles se distinguent dans une sorte de compétence sociale qui consiste à organiser et à diriger le groupe en vue de la réalisation d'un projet collectif pendant que les garçons s'emparent de la compétence scientifique et technique pour infléchir le contenu du projet. Mme Geneviève Berger, ancienne directrice du CNRS, a confirmé ces analyses devant la mission, considérant toutefois que de grandes améliorations ont eu lieu. Si le CNRS compte 50 % de femmes dans ses effectifs totaux, il y a beaucoup plus de chercheurs hommes que de chercheurs femmes alors que l'on trouve plus de femmes chez les techniciens et administratifs et le système pyramidal aboutit au niveau de la direction à un nombre très réduit de femmes. Ses explications rejoignent celles évoquées précédemment : faute de temps, les femmes sont moins présentes dans les réseaux et dans les commissions à prédominance masculine ; la science n'est pas présentée comme un métier féminin et elle a un déficit d'image en direction des femmes. L'environnement scolaire et familial est souvent peu favorable à l'accès des filles aux filières scientifiques. Il leur est souvent suggéré de préférer les métiers du droit ou de la santé. Les femmes sont moins attachées à la notion de pouvoir et de management. Dans un secteur généralement plus recherché par les femmes, celui de la santé et de la médecine, M. Christian Bréchot, directeur général de l'INSERM, constate que, sur les 2000 chercheurs que compte son organisme, la moitié sont des femmes mais qu'il y a beaucoup moins de femmes directrices de recherche que de femmes chargées de recherche, il ajoute : « Alors qu'à mon arrivée à la direction de l'INSERM, il y a cinq ans, je n'étais pas du tout convaincu du bien-fondé d'une action en faveur de la parité, je suis maintenant persuadé qu'elle est indispensable ». Au Canada, on est très préoccupé par cette question et de nombreuses actions visent à démythifier les sciences et à combattre les préjugés qui éloignent ou détournent les jeunes filles des carrières scientifiques et technologiques. Ainsi, le ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation du Québec, participe financièrement à diverses actions visant à rapprocher les filles et les sciences, sous la forme d'ateliers d'expérimentation, de conférences ou de groupes de travail et de discussions. La mission a été très intéressée par les nombreuses initiatives qui fleurissent au Canada dans cette direction. On citera par exemple « Les scientifines », association qui s'adresse aux jeunes filles de milieux défavorisés de certains quartiers de Montréal pour susciter chez elles un intérêt pour les sciences et les nouvelles technologies et les aider dans l'apprentissage de ces matières afin de prévenir le risque de décrochage scolaire et d'encourager la poursuite des études. Les animatrices de cette association, que la mission a rencontrées, font le constat qu'il faut déconditionner les filles et les rassurer pour développer leurs compétences en sciences car, spontanément, elles ne s'affrontent pas à un problème si elles ne sont pas sûres d'avoir la réponse. Les thèmes étudiés sont inspirés par le vécu des élèves (Halloween et les chauves-souris) ou l'actualité (les ouragans, le réchauffement de la planète). Ici les sciences sont utilisées comme outil d'intégration sociale. Au Québec, des actions interministérielles ont été mises en œuvre au cours de la dernière décennie sur le thème du soutien à la progression des Québécoises dans les sciences et l'innovation technologique. Un bilan de ces actions sur la période 1993-2003 a été publié en décembre 2004(4). La principale conclusion est que malgré une certaine avancée des femmes en formation, en emploi, en culture et en loisirs scientifiques et techniques, la progression est très lente dans les domaines professionnels liés aux sciences dures et aux technologies de l'informatique. Dans ce dernier secteur, le bilan note une baisse de l'effectif féminin entre 1992 et 2002, la représentation féminine étant passée de 25 % à 11 % au cours de cette période. Mme Louise Lafortune, professeur au département des sciences de l'éducation de l'université du Québec a, étudié dans de nombreux ouvrages(5) la situation des femmes notamment face à l'apprentissage des mathématiques et aux croyances et préjugés véhiculés par la famille, l'école et la société qui les détournent des études scientifiques. Au Québec comme en France, les performances scolaires des filles y compris en sciences et en mathématiques sont équivalentes voire supérieures à celles des garçons et pourtant elles choisissent beaucoup moins souvent que les garçons d'étudier et de faire carrière dans les domaines scientifiques, particulièrement les sciences appliquées, l'ingénierie et l'informatique. Ces constats font écho à ceux exprimés par de nombreux interlocuteurs de la mission en France, notamment Mme Marie Reynier, directrice générale de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM). Elle a constaté à l'occasion d'enquêtes réalisées parmi les étudiants que l'image de l'école qu'elle dirige est très liée à celle de l'usine, ce qui n'attire guère les filles... En outre, de nombreux pères, qui ont connu les restructurations dans leur vie professionnelle pensent que leurs filles supporteraient mal d'être bousculées de la sorte. Dans les pays scandinaves, les choix d'orientation des étudiants sont également très sexués. La sous-représentation des femmes est très nette en physique, en informatique et dans certains secteurs technologiques. En revanche, elles sont très présentes dans les études de médecine, de pharmacie et certains secteurs de la biologie. Relancer l'intérêt pour les études scientifiques suppose donc de s'attaquer à l'image stéréotypée des rôles masculins et féminins. Les professions scientifiques sont celles qui souffrent le plus de ces idées toutes faites et encourager les vocations féminines passe donc aussi par le combat contre ces représentations. C'est ce que fait aussi, à un autre bout de la planète, l'association pour la formation des femmes aux mathématiques et aux sciences en Afrique (FEMSA). Cette ONG africaine, soutenue par l'UNESCO se propose d'améliorer la participation et les résultats des filles dans les matières scientifiques et technologiques, pour le primaire comme le secondaire. Elle a créé des centres nationaux qui contribuent au renforcement des capacités du corps enseignant et offrent un espace de réflexion aux scientifiques femmes. Elle organise également des clubs et des stages pour les filles, des concours et des expositions. Des études menées par la FEMSA ont montré que les filles s'approprient mieux les connaissances scientifiques lorsque l'enseignement est concret. Un bilan du programme de la FEMSA en Tanzanie a révélé qu'en cinq ans, le nombre de filles du secondaire inscrites dans les matières scientifiques a beaucoup augmenté. Mais il reste encore beaucoup à faire. Si l'Union européenne veut porter d'ici à 2010 les dépenses de recherche et de développement à 3 % de son PIB, il lui faudra recruter environ 700 000 chercheurs et pour cela réconcilier les femmes et les sciences. Aux Etats-Unis, la National Science Foundation estime que les emplois de chercheurs et d'ingénieurs augmenteront trois fois plus vite entre 2000 et 2010 que l'offre nationale d'emplois. D'où viendront ces scientifiques ? La population féminine offre un réservoir de compétences en grande partie inutilisé. Un chercheur français, M. Pascal Huguet, directeur de recherche au laboratoire de psychologie cognitive de l'université d'Aix-Marseille a éclairé la mission d'information sur certaines raisons de ce rejet apparent des filles pour les mathématiques et les sciences dures. Il a présenté plusieurs expériences réalisées dans des classes qui contredisent certains stéréotypes sociaux, en particulier celui selon lequel les femmes seraient intrinsèquement inférieures dans la pensée logico-mathématique. La première expérience porte sur 54 garçons élèves de 6ème/5ème dont 26 « bons élèves » et 28 « mauvais élèves ». Elle utilise un test de reproduction de mémoire d'une figure sans signification particulière, adaptée de la figure complexe de Rey(6). On explique à un premier groupe qu'il s'agit d'évaluer les compétences en géométrie et à l'autre les compétences en dessin. Les résultats montrent bien un écart important entre les bons élèves et ceux qui sont en échec lorsque l'épreuve est intitulée « construction d'images en géométrie », alors qu'il n'y a pas de différence lorsqu'elle est présentée comme une évaluation en dessin. Une seconde expérience complète la première. Cette fois on prend 40 élèves de 6ème/5ème, des deux sexes, tous en réussite en géométrie, avec au moins 14/20 au deuxième trimestre, juste avant l'étude. On applique la même procédure mais en remplaçant la condition dessin par une condition plus explicitement ludique : « Jeu de mémoire». Dans la condition géométrique, les résultats des garçons sont meilleurs, tandis que dans la condition dessin, les filles l'emportent très largement. Le chercheur en déduit que pour réussir en mathématiques et plus généralement en sciences, les filles du secondaire mais aussi du primaire doivent faire face à un obstacle, ancré dans le stéréotype de genre, auquel ne sont pas confrontés les garçons. Les enfants connaissent très tôt ces stéréotypes et il y a donc sans doute un travail important à faire dans l'environnement scolaire pour les faire tomber. Des expériences de même nature ont été réalisées aux Etats-Unis dans le cadre de l'organisation de l'épreuve de mathématiques du test très difficile d'entrée à l'université. Dans un cas on dit aux femmes que l'on constate habituellement, dans les résultats, des différences de sexe mais sans préciser lesquelles, dans l'autre on leur dit qu'on ne constate habituellement aucune différence. On observe alors une très forte infériorité des femmes dans le premier cas et une égalité des résultats dans le second. 3. Un enseignement trop académique Le manque d'intérêt pour les sciences se retrouve à l'échelon des gouvernants. « Nombreux sont les ministres de l'Éducation qui ne disposent pas des informations concernant les innovations dans le domaine de l'enseignement des sciences », souligne Wataru Iwamoto, directeur de la division de l'enseignement secondaire, technique et professionnel de l'UNESCO. Il en résulte que beaucoup de pays n'ont tout simplement pas de politique en matière d'enseignement scientifique. Au-delà des diversités des politiques propres à chaque pays, on observe une grande convergence des situations qui résultent très souvent de l'épuisement d'un modèle scolaire souvent hérité du XIXè siècle. Les systèmes scolaires sont partout confrontés aux conséquences de la massification scolaire souvent mal anticipée et conduisant à des réformes d'ajustement sans vision globale. La difficile prise en compte de l'hétérogénéité des élèves par l'école mais aussi le divorce croissant entre l'idéal de progrès et d'égalité par l'éducation et sa traduction dans les faits, entraînent partout le désarroi des principaux acteurs, enseignants, élèves et parents. Dans tous les pays, la conduite par le haut des systèmes éducatifs est remise en cause et la mission a pu constater que l'un des principaux facteurs d'évolution réside dans l'émergence d'une responsabilité et d'une autonomie plus grandes données aux établissements, tout en évitant comme le soulignent les Finlandais de mettre en concurrence ces établissements. La crise des sciences ne se limite pas au problème des scientifiques sous-payés et mal-aimés. Les méthodes d'enseignement des sciences constituent une des principales explications mises en avant, notamment par les élèves eux-mêmes, pour expliquer la désaffection. On peut citer ici quelques réflexions édifiantes de deux jeunes lycéennes reçues par la mission. La première, élève de seconde, a déclaré à propos de la physique: « Pour vous donner un exemple, on nous a rendu ce matin un contrôle auquel j'ai eu 6 sur 20. On nous avait demandé de calculer la masse de l'atome et de dire le nombre de protons, mais on ne sait rien de ce qu'est un atome ». Elle ajoute un peu plus loin qu'elle préférerait passer des heures à manipuler plutôt qu'à faire des calculs de puissances. La seconde est élève de première littéraire et ce qu'elle dit corrobore tout ce que la mission a entendu en France et à l'étranger : « J'aimais bien les mathématiques et les sciences mais quand nous avons commencé à apprendre la physique et la chimie, et alors que le collège était équipé de grandes tables de travaux pratiques, nous n'avons eu qu'une ou deux séances dans l'année ; tout le reste a été fait sous forme de cours théoriques. Au collège, j'arrivais encore à comprendre mais, au lycée, il n'y a plus eu que des cours théoriques, sans travaux pratiques du tout ; on n'y comprenait rien. Pourtant, ça m'intéressait, j'ai fait des efforts, mais j'ai eu trois professeurs différents et plutôt que d'expliquer les choses, ils les ont compliquées ». Les sciences souffrent ainsi d'être perçues comme abstraites. « Quand j'étais enfant, j'adorais les sciences car nous faisions des expériences en classe, nous partions en expédition pour étudier la nature », se souvient Orlando Hall-Rose, chef de la section pour l'éducation scientifique et technologique de l'UNESCO, cité dans le bulletin de l'UNESCO précédemment évoqué. Maintenant c'est très livresque. Par ailleurs, l'empressement des jeunes à utiliser les technologies nouvelles ne suscite pas chez eux l'envie d'étudier les disciplines à l'origine de ces technologies, précise Svein Sjøberg. Ainsi, les pays qui rencontrent le plus de difficultés à recruter dans les filières scientifiques et technologiques sont précisément ceux où les étudiants font grand usage du téléphone portable, de l'ordinateur et de l'Internet. Mme Marie Reynier a confirmé cette opinion en disant que, pour intéresser les jeunes dès l'enfance, il ne faut pas leur donner à étudier un téléphone portable mais des objets qu'ils ne manipulent pas habituellement. Il lui semble donc qu'il faudrait se tourner vers les nanotechnologies, l'infiniment petit, la conquête spatiale, la domotique. L'objet quotidien n'est pas, pour les jeunes, objet de curiosité scientifique. Cette impopularité est souvent imputée, dans les différents pays, aux insuffisances des programmes et des manuels qui conduisent à un apprentissage purement mécanique, sans permettre une réelle compréhension des notions utilisées. L'enseignement dans le secondaire prend trop souvent la forme de cours magistraux, avec peu de travaux pratiques. Quand des expériences sont réalisées en classe, c'est généralement par l'enseignant, les élèves étant réduits au rôle de spectateurs. L'acquisition d'une démarche intellectuelle proprement scientifique est abandonnée au profit de l'apprentissage de définitions et de procédés standards. Beaucoup de gens pensent que les vraies sciences n'existent que dans des laboratoires équipés de matériel de pointe extrêmement coûteux, et non dans les choses ordinaires de la vie quotidienne, estime ainsi Joseph P. O'Connor, co-auteur, avec Svein Sjøberg de l'ouvrage précité. Si l'on veut que l'enseignement scientifique et technologique réponde aux besoins des jeunes, il importe de savoir ce qui les intéresse. Une étude de l'UNESCO portant sur 10 000 collégiens de 13 ans, habitant dans 21 pays du Nord et du Sud, a montré que garçons et filles aiment des thèmes tels que la vie sur d'autres planètes, les ordinateurs, les dinosaures, les tremblements de terre et les volcans. Ils sont par contre moins curieux de sujets quotidiens et proches d'eux comme les plantes, la transformation des denrées alimentaires, les détergents et le savon. Ce constat va à l'encontre de l'idée selon laquelle les jeunes préféreraient les sujets concrets. La même étude révèle que les enfants des pays en développement s'intéressent à tout, sans doute parce qu'ils perçoivent l'éducation comme un luxe et un privilège. Susciter l'enthousiasme des jeunes enfants pour les sciences demande un effort de la part des enseignants, généralement mal formés, et qui souvent n'ont eux-mêmes pas étudié ni apprécié ces matières lorsqu'ils étaient sur les bancs de l'école. Dans leur classe, les professeurs se trouvent face à des élèves qui connaissent parfois mieux qu'eux les technologies de l'information et de la communication, tout en n'ayant aucune idée des lois de la physique qui les régissent et en n'ayant aucune envie de les connaître. Dans le monde entier, des pays comme le Portugal, la Namibie, le Nigeria, la Malaisie et d'autres encore, tentent d'améliorer l'enseignement scientifique et technologique à tous les niveaux, notamment par la formation des professeurs et la définition des programmes. L'Association chinoise pour la science et la technologie propose ainsi des formations et des échanges qui bénéficient à 4,3 millions de personnes. En Malaisie, plus de 6 000 éducateurs ont reçu une formation assurée par le centre régional pour l'enseignement des sciences et des mathématiques. Enfin une enquête internationale baptisée ROSE (Redevance of Science Education) qui effectue un travail comparatif sur les attitudes, les intérêts et les perceptions de la science et des technologies chez les jeunes de 15 ans, créée à l'initiative de la Norvège et auquel 40 pays ont participé, révèle que les jeunes interrogés se disent convaincus de l'intérêt des sciences pour la société. Cela ne les empêche pas d'affirmer simultanément leur désintérêt pour l'enseignement des sciences qui ne développe pas, disent-ils, leur sens critique et ne leur apporte rien d'utile au quotidien. En France la situation est un peu paradoxale. D'une part la désaffection vis-à-vis des études scientifiques est moins marquée que dans certains pays voisins où l'importation de main-d'œuvre de très haut niveau venant de pays lointains semble devenir une nécessité. Mais, par ailleurs, de nombreux économistes(7) considèrent que le manque inquiétant de dynamisme des exportations françaises s'explique, en partie, par des déficiences qualitatives des produits français, inadaptés à la demande et souffrant d'un grave déficit d'innovation. Ce dernier point est incontestablement le résultat de la très faible part de la recherche et développement dans les investissements des entreprises et notamment des PME, ce qui se répercute évidemment sur la faible attirance des jeunes pour ce type d'activité. 1. La désaffection est très nette pour les études universitaires en physique-chimie et en mathématiques Un constat s'est imposé à la mission, les grandes écoles d'ingénieurs qui produisent l'élite scientifique et les grands organismes publics de recherche ne souffrent, dans l'immédiat, d'aucune pénurie de recrutement. En revanche, on constate une diminution importante des effectifs étudiants dans des disciplines comme la physique et la chimie dans les cursus non sélectifs (licence et ancienne maîtrise) de l'enseignement universitaire, particulièrement dans les universités récentes, petites et isolées, souvent associées à un environnement économique de petites et moyennes entreprises qui ne recrutent pas d'ingénieurs ou de chercheurs. La faiblesse du secteur recherche et développement des entreprises et la question des débouchés scientifiques, notamment dans le secteur privé, est donc directement liée à la désertion des filières scientifiques universitaires. Un rapport de M. Guy Ourisson, ancien président de l'Académie des sciences(8), fait une présentation très complète de cette situation. Selon ce rapport, même si une diminution majeure des effectifs n'est avérée que dans quelques-uns des secteurs de l'enseignement supérieur, on ne doit pas la laisser s'accentuer par nonchalance. Les prévisions de départs à la retraite de scientifiques et d'ingénieurs, dans l'enseignement et dans les organismes publics de recherche, montrent que les besoins de recrutement de haut niveau vont être considérables dans les années qui viennent. Toujours selon ce rapport, les enseignements scientifiques et techniques, malgré des réformes répétées, restent souvent un pensum pour les élèves. Les universités scientifiques ont perdu de 20 à 40 % d'étudiants en dix ans et la France a perdu 37 % de diplômés en sciences physiques depuis 1995 et 18 % en mathématiques depuis 1998. En revanche, il y a peu de problèmes pour les grandes écoles et les classes préparatoires ; ces dernières ont vu leurs effectifs croître de 10 % en 5 ans. Les bancs des facultés de médecine ne sont pas non plus désertés, malgré la sélection imposée par le numerus clausus. Le rapport de M. Guy Ourisson, susvisé, souligne que cette baisse des effectifs a permis à certaines universités de mieux encadrer leurs étudiants de premier cycle et de mettre en œuvre des pédagogies plus efficaces. Malheureusement ces améliorations parfois spectaculaires sont très peu répercutées sur les professeurs des lycées et les conseillers d'orientation, qui continuent à prôner la voie des classes préparatoires. En amont de cette désaffection des sciences à l'université, le nombre de bacheliers scientifiques est en léger recul. Ce recul s'accompagne d'une augmentation spectaculaire des baccalauréats professionnels, ce qui reflète la faible démocratisation du système éducatif français. En effet, dans les filières professionnelles, les élèves sont majoritairement issus de classes défavorisées, comme le souligne M. Christian Forestier membre du Haut Conseil de l'éducation. De surcroît, ainsi que l'a rappelé M. Jean-Marc Monteil, directeur de l'enseignement supérieur, le niveau et la formation des titulaires d'un bac professionnel leur enlèvent tout espoir de réussite à l'université, bien que certains tentent tout de même leur chance faute d'avoir été admis dans une préparation au BTS qui devrait être leur débouché naturel. Si les plus défavorisés ne vont pas vers le baccalauréat scientifique et a fortiori vers les études scientifiques longues, les filles non plus. Elles sont sous-représentées (moins de 25 %) dans les écoles d'ingénieurs comme dans les filières universitaires des sciences de l'ingénieur et les départements secondaires des IUT et des sections de techniciens supérieurs (STS). Comme dans le reste du monde, l'image sociale des sciences attire moins les bons élèves qu'il y a quinze ou vingt ans. La science ne fait plus rêver ; tous les interlocuteurs de la mission l'ont répété : les icônes populaires ne sont plus Marie Curie ou Einstein. La perte de confiance dans la science mais aussi le développement de comportements anti-scientifiques et de rejet par l'opinion publique sont toutefois moins marqués en France(9) que dans certains autres pays. En France, l'opinion publique se considère comme insuffisamment informée mais intéressée. Cependant, il est incontestable que la croyance dans un lien indéfectible entre progrès scientifique et progrès humain s'est effondrée. Les découvertes scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine des biotechnologies et des communications, continuent au même rythme que dans la seconde moitié du XXè siècle mais le sentiment qu'elles améliorent la vie des gens et les protègent de la nature et des catastrophes recule. Autrefois, les héros étaient des ingénieurs et des physiciens et les élèves brillants se projetaient sur ces modèles. Aujourd'hui, cette image a changé et les jeunes ont d'autres modèles ; ils se soucient plus de leur épanouissement personnel et sont plus profondément attachés à la recherche de sens. Aujourd'hui, la science semble trouver sa légitimité dans le fait qu'elle sert les besoins de l'économie et les arguments en sa faveur sont trop souvent associés à l'accroissement de la compétitivité économique industrielle dans une économie de marché mondialisée. Pour beaucoup, la neutralité et l'indépendance des chercheurs entièrement tournés vers la compréhension du monde sont remises en cause. Cette évolution est particulièrement sensible dans le domaine de la physique et de la chimie très souvent associées aux grandes catastrophes industrielles récentes. La plupart de ces catastrophes sont en effet imputables à l'industrie chimique (raffineries Elf à Feyzin en 1966, usine Icmesa à Seveso en Italie en 1976, usine Sandoz à Bâle en 1986, filiale d'Union Carbide à Bhopal en Inde en 1994, usine AZF à Toulouse en 2001, Pétrochima à Harbin en Chine en 2005....). Mal aimée la discipline doit soigner son image et démontrer qu'elle peut être mise davantage au service de la santé et de l'environnement. Face à ce constat, M. Christian Bréchot, directeur général de l'INSERM, a indiqué à la mission qu'il n'a jamais senti de perte d'enthousiasme de la part des lycéens pour la carrière scientifique dans la cinquantaine d'établissements où il est intervenu pour organiser, dans le cadre du réseau « INSERM jeunes », des animations autour de la science. « C'est lorsque se pose la question de l'entrée à l'université que nous les perdons » a-t-il déclaré, car intervient le principe de réalité. L'enseignement de la science doit certainement être amélioré, qu'il s'agisse de la compétence des enseignants ou des méthodes pédagogiques, qui devraient être beaucoup plus ludiques, mais le défaut d'attrait pour les carrières se manifeste plus en aval dans le cursus. Non seulement on propose aux élèves des filières aux perspectives floues, mais il faut être héroïque pour s'y engager puisque, outre que l'on explique mal aux élèves ce qui va se passer, les carrières de chercheur sont des carrières difficiles, avec une sélection importante, pour une rémunération de base qui n'est pas attractive. Ce qui fait défaut, c'est un parcours clairement défini dès la terminale, quand les orientations se font. Mais cette absence d'informations s'explique par le fait que l'on ne sait pas quoi dire, si bien que l'on donne pour conseil aux lycéens de passer par une grande école, ce qui leur permettra de tout faire... y compris de la science ! Il y a beaucoup à faire pour améliorer l'information sur les carrières scientifiques et leur donner davantage de lisibilité a conclu M. Bréchot. Ce qui manque donc profondément dans le système scolaire français, c'est la lisibilité des carrières scientifiques. Pour beaucoup de jeune un chercheur est condamné à un parcours d'errance pour un salaire de misère. Par ailleurs, la représentation sociale du chercheur « apprenti sorcier » contribue à la désaffection constatée. Dans un rapport remis en 2002 au ministre de l'éducation nationale(10), M. Maurice Porchet, professeur de biologie à l'Université de Lille I, constate que les bacheliers scientifiques recherchent en priorité les filières professionnalisantes, à effectifs réduits et bien encadrées. Cette offre de formation est abondante en institut universitaire de technologie (IUT), section de technicien supérieur (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et les diplômes d'études universitaires générales (DEUG) scientifiques résistent mal à cette concurrence car leur image persiste à évoquer l'anonymat, les amphis surchargés et l'absence de lisibilité professionnelle. L'auteur du rapport apporte une autre explication à la baisse relative (par rapport à l'augmentation du nombre de bacheliers) des choix d'études supérieures scientifiques. Depuis une décennie, notamment depuis la fusion des séries C, D et E, la filière S s'est « normalisée » c'est-à-dire qu'elle s'est féminisée et démocratisée. Mais les choix d'études supérieures s'effectuent d'abord en fonction de déterminants sociaux qui n'ont pas évolué à la même vitesse que la hausse du taux de scolarisation. En raison des habitudes sociales actuelles, les filles, les élèves d'origine modeste et les élèves « moyens » ont une propension moindre à opter pour les études scientifiques longues. Auditionnée par la mission, Mme Claudine Peretti, directrice de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a complété ces informations par les observations suivantes. Les disciplines de sciences physique et chimie se sont progressivement dévalorisées et d'autres disciplines, telles les sciences de l'ingénieur, ont pris le pas sur ces matières traditionnelles. Il faut cependant noter, selon Mme Peretti, qu'il n'y a pour l'instant aucune pénurie de candidats pour les concours de recrutement pour l'enseignement et la recherche dans ces disciplines. C'est la même chose en sciences de la vie où on trouve 60 candidats qualifiés pour un poste. C'est l'image de ces disciplines qui est moins valorisée qu'avant, probablement parce qu'elles ne correspondent plus à la structure du marché de l'emploi. Mme Peretti a indiqué également qu'une enquête en cours semble démontrer que les sciences-physiques ne sont pas aimées des élèves et que même les enseignants ont une image dévalorisée de leur discipline. La désaffection trouve sa racine dans le second degré où les sciences physiques ne sont plus valorisées y compris bien souvent par les chefs d'établissement. On constate en effet qu'en cinq ans le nombre de candidats au CAPES est tombé de 9 à 3,5 pour un poste en physique-chimie et de 7 à 4,5 en mathématiques. De surcroît, la mission a pu constater que les notes obtenues en mathématiques par les candidats révèlent une préoccupante faiblesse du niveau. Au CAPES externe de mathématiques de 2005, la barre d'admissibilité aux deux épreuves de mathématiques a été fixée par le jury à 6,2/20. 2. La désaffection pour les filières scientifiques est assez largement une question de genre La quête de sens et la recherche d'une activité en accord avec les valeurs, l'identité et la vie personnelles, sont particulièrement marquées chez les filles. Souvent plus brillantes que les garçons, elles sont prêtes à travailler durement à condition de savoir pourquoi. Dans un article publié en 2005(11) dans la revue du centre régional de document pédagogique (CRDP) de Haute-Normandie, Mme Faouzia Kalali, maître de conférences en didactique des sciences à l'IUFM de Rouen, fait le point sur les résultats scolaires et l'orientation des filles. Si à l'entrée en sixième les effectifs de filles et de garçons sont sensiblement les mêmes, on retrouve en fin de collège une plus faible proportion de garçons. Dans l'académie de Rouen, 62,9 % de filles contre 53,6 % de garçons accèdent à la seconde générale. À 15 ans, 10 % des filles sont en difficulté contre 20,5 % chez les garçons. Elles sont moins nombreuses à redoubler (16,3 %) que les garçons (17,9 %). Au lycée, elles obtiennent un meilleur taux de passage en première générale mais elles s'orientent de manière équivalente entre les trois filières S, ES ou L alors que les garçons choisissent massivement la filière S. La disparité est encore plus grande dans la filière sciences et techniques industrielles (STI). Dans la série S, les filles sont 11 % à choisir la spécialité sciences de l'ingénieur, 40 % les mathématiques, 44,2 % la physique-chimie et 57,6 % les sciences de la vie et de la terre, ainsi que cela ressort du graphe ci-après. Proportion de filles par spécialité parmi les candidats au baccalauréat S (en %) 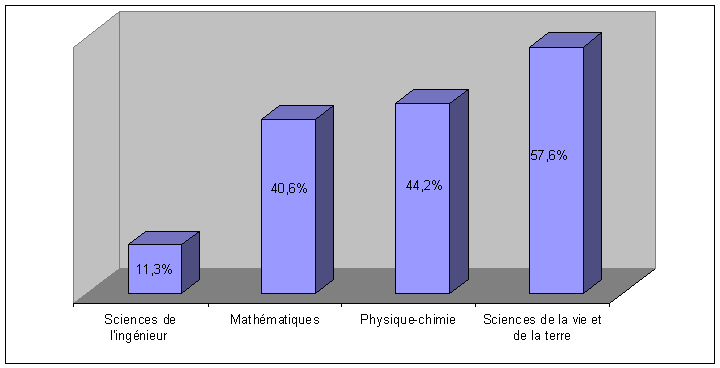 Source : direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) L'auteur de l'étude indique que pour expliquer la faible représentation des filles dans les sections scientifiques, on ne peut pas mettre en évidence un quelconque décrochage en sciences durant la seconde puisqu'au contraire leur niveau s'améliore d'après les données nationales. D'ailleurs, dans la série scientifique elles obtiennent un taux de réussite au bac de 84,2 % contre 79,8 % pour les garçons (toutes séries confondues, le taux de réussite des filles au bac atteint 76 % contre 64 % pour les garçons). La raison de la sous-représentation des filles dans les filières scientifiques doit être recherchée dans les décisions des conseils de classe qui à niveau équivalent orientent prioritairement les garçons vers ces filières. Les choses se dégradent après le baccalauréat puisque si l'on trouve encore environ 43 % de filles en terminale S, elles ne sont plus que 38,9 % en DEUG scientifique et environ 24 % dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). À l'université, si la part des filles reste constante du premier au second cycle, elle chute fortement au moment du passage en troisième cycle alors que la part des garçons augmente à ce niveau après un détour par les grandes écoles. Ces données font apparaître clairement que, de l'entrée en seconde aux troisièmes cycles, se produit une diminution progressive des filles dans les filières scientifiques alors que leurs résultats sont meilleurs que ceux des garçons. On les retrouve en nombre de plus en plus faible dans les filières d'excellence conduisant aux carrières les plus recherchées. M. François Cardi, professeur de sociologie à l'université d'Evry, observe que les réactions d'auto-limitation et d'auto-élimination dans la compétition avec les garçons reviennent très fréquemment dans les discours des filles et dans les résultats de recherche en sociologie de l'éducation. Il fait observer également la très faible part des femmes parmi les ingénieurs et les cadres techniques des entreprises, de l'ordre de 12 % dans ces deux catégories et de 7,6 % chez les agents de maîtrise. Les femmes ressentent donc ces professions comme leur étant fermées et les jeunes filles anticipent cette fermeture dans leurs choix d'orientation scolaire. Selon M. Cardi, les causes de cette auto-élimination sont bien connues : éducation aux rôles sexués dès la petite enfance dans la famille, à l'école et au sein des groupes de pairs, sexisme encore présent dans les manuels scolaires, rapports pédagogiques sexués, partage inégal des activités domestiques, rôle de l'orientation scolaire dans le choix des filières et des professions, discriminations à l'embauche, inégalité des salaires et du rendement des diplômes. Le chercheur s'interroge alors sur les raisons de la réussite exceptionnelle de certaines femmes dans les métiers scientifiques : s'agit-il de période historique particulièrement favorable ou de facteurs familiaux (on sait que la présence de femmes titulaires de hauts diplômes scientifiques favorise la carrière scientifique des filles dans la famille) où bien est-ce le fait d'une exception qui confirme la règle ? Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques, membre de l'association Femmes et sciences, complète cet éclairage. Elle indique tout d'abord que lorsque la mixité a été instaurée à l'École normale supérieure au début des années 1980, cela a eu comme effet paradoxal de conduire à ce qu'il n'y ait plus de fille en mathématiques et en physique ni à Ulm ni à Saint-Cloud, probablement parce que la domination masculine était trop forte dans ces matières. De nombreuses filles considèrent encore à la fin du secondaire qu'elles ne sont pas faites pour faire des mathématiques. Cette image est encore largement véhiculée, y compris par les médias. Mme Chauveau précise qu'elle a ainsi entendu M. Martin Winckler se demander, dans une chronique à la radio, si le cerveau avait un sexe et constater que les filles n'étaient pas faites pour faire des mathématiques. De même, a-t-elle indiqué, un récent article du journal Phosphore démontrait que les filles acceptent de faire des maths quand « on leur tient la main » alors que les garçons sont motivés par un éclair de génie... « Moi, je dis à mes élèves que c'est une matière difficile pour tout le monde ! », a-t-elle indiqué. M. Christian Margaria, directeur de l'Institut national des télécommunications, a également évoqué ce problème. Il estime que ce qui détourne les filles de la science, c'est l'absence de modèle féminin proche de leur âge car les jeunes chercheuses ou ingénieures n'ont pas assez de temps pour s'impliquer dans des expériences comme les « projets scientifiques parrainés » avec les lycéens. Il en conclut qu'une telle implication, tout en restant volontaire, ne devrait pas être bénévole, mais être prise en compte dans les obligations générales des jeunes professionnels. C. LES LEÇONS DES ENQUÊTES INTERNATIONALES SUR LES COMPÉTENCES DES ÉLÈVES DE QUINZE ANS Différents programmes internationaux tentent d'estimer régulièrement le niveau des élèves dans une cinquantaine de pays. Il est en effet de plus en plus admis dans la plupart des pays que les systèmes d'éducation constituent des voies menant au développement économique. Cette évolution, à laquelle s'ajoutent les dépenses publiques considérables dévolues à l'éducation, a intensifié la demande des gouvernements et de l'opinion publique en faveur d'une plus grande transparence et d'un examen plus attentif de la qualité de l'éducation. On peut citer tout d'abord l'enquête TIMSS (troisième étude internationale sur les mathématiques et sur les sciences 1994-1995) de l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire (IEA), qui concerne 40 pays et 300 000 élèves de 13 ans et qui intègre la comparaison des compétences avec les programmes enseignés et les manuels scolaires. La France a très peu participé à cette enquête et les élèves français n'ont été sollicités que sur le volet connaissances. Parmi les élèves de la huitièmeannée d'études (classe de cinquième), les quatre pays qui ont obtenu les meilleurs résultats en mathématiques sont tous asiatiques : Singapour, la République de Corée, le Japon et Hong-Kong. Singapour, la République de Corée et le Japon obtiennent également les meilleurs résultats en sciences. En revanche, de nombreux pays occidentaux, qui ont une longue tradition d'éducation, ont eu des résultats relativement décevants. Par exemple, la Suède, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la Norvège, le Danemark, les Etats-Unis et l'Écosse se situent dans la moitié inférieure des notes en mathématiques, tandis que les notes obtenues par la Suisse, la France, le Danemark et l'Écosse les placent dans la moitié inférieure en sciences. Le programme PISA (programme international pour le suivi des acquis des élèves), piloté par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), n'évalue pas les systèmes scolaires mais mesure le capital humain et la culture scientifique et mathématique des futurs citoyens. Ce programme s'efforce toutefois d'obtenir des renseignements sur la capacité des écoles à transmettre des connaissances et un bagage scientifique. L'enquête PISA 2003 a privilégié les mathématiques pour lesquelles les tests portaient sur quatre matières : algèbre, géométrie, arithmétique et calculs de probabilité. Des tests en sciences concernant des problèmes d'actualité ont également été organisés ainsi qu'un quatrième volet concernant la résolution de problèmes, considéré comme une extension des mathématiques, de la lecture et des sciences. L'OCDE n'a qu'un rôle de gestionnaire dans les enquêtes PISA. Les tests et le déroulement des épreuves relèvent de la compétence des Etats participants qui font des propositions d'exercices. Une équipe de spécialistes retient les questions les plus universelles et les plus détachées d'un contexte. En 2003, 41 pays ont participé à l'enquête à raison de 5 000 à 10 000 élèves de quinze ans par pays. Les écoles dans lesquelles se déroulent les tests sont choisies au hasard. Les tests sont corrigés par une équipe internationale de spécialistes. On trouvera en annexe du rapport des exemples de sujets de mathématiques proposés lors de l'enquête 2003. Dans son avis sur « La France et les évaluations internationales des acquis des élèves »(12), le Haut Conseil de l'évaluation de l'école constatait que la France a participé à nombre de ces enquêtes mais a joué un faible rôle dans leur développement et n'a pas pris la mesure des enjeux et de l'intérêt qui s'y attachent. Le Haut conseil ajoutait que les responsables politiques et éducatifs n'ont pas pris conscience des enjeux de ces enquêtes sur le plan scientifique, comme sur celui du pilotage du système éducatif. De façon générale, les travaux d'évaluation (nationale ou internationale) du système éducatif français ne sont pas suffisamment utilisés pour son orientation. Une note de la Direction de l'évaluation et de la prospective (DEP) du ministère de l'éducation nationale de décembre 2004 présente les résultats de l'enquête PISA 2003 pour la France. Il en ressort que la France se place entre la onzième et la quinzième place dans les quatre matières évaluées en mathématiques et se maintient au niveau de la moyenne OCDE en ce qui concerne la compréhension de l'écrit. Dans l'ensemble des matières, la France est légèrement au-dessus de la moyenne mais c'est en sciences que les élèves français obtiennent les moins bons résultats (10 sur 20). Pour chaque évaluation (culture mathématique, compréhension de l'écrit, culture scientifique et résolution de problèmes) la moyenne internationale a été fixée à 500 points et les deux tiers des élèves de tous les pays sont placés entre les scores de 400 et 600. Chaque pays se place sur l'échelle générale selon son score moyen comme l'indique le graphique qui figure en annexe du présent rapport. En culture mathématique, point majeur de l'évaluation 2003, la France obtient un score de 511 points ce qui la situe juste au-dessus de la moyenne. C'est en résolution des problèmes qu'elle affiche les meilleures performances avec 519 points, tandis qu'en compréhension de l'écrit son score reste au niveau de la moyenne comme lors de l'enquête précédente de 2000. La DEP fait observer que des écarts de score très importants sont observés entre les élèves français qui à quinze ans sont en classe de troisième (donc en retard) et ceux qui sont en seconde générale et technologique. Cette distorsion est moins sensible dans la majorité des autres pays qui ne pratiquent pas le redoublement. De même, Mme Claudine Peretti, directrice de la DEP, a observé devant la mission que les élèves français n'ont pas de cours de probabilités avant la classe de seconde ; il est donc normal qu'ils échouent au test de probabilités de l'enquête PISA. M. Andreas Schleicher, coordinateur de l'enquête PISA à l'OCDE, fait pour sa part observer que si l'on mesure la situation de la France par rapport à la moyenne de l'ensemble des pays participant à l'enquête PISA, cette position est bonne. Mais si on compare la situation de la France avec les meilleures nations, l'écart est grand. Vu sa place politique et économique, la France devrait selon M. Schleicher se comparer aux nations qui obtiennent les meilleurs résultats comme le Finlande, le Canada, le Japon et la Corée. Il observe que ces pays ont une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire. La France contrôle beaucoup ce que les enseignants font en terme de contenu mais ne travaille pas autant sur les compétences-clés qui font qu'un individu va réussir sa vie. M. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint de la direction de l'éducation de l'OCDE, a déclaré devant la mission que le système éducatif français sous-estime trois des principaux objectifs de l'enseignement des sciences : le plaisir de la découverte ; l'augmentation des capacités à apprendre, à trouver des informations et à les gérer ; la capacité à développer une raison critique permettant un jugement sur les grands problèmes scientifiques du moment. Il n'est pas nécessaire de tout connaître mais il faut se demander quel genre de citoyen on veut former. En France, l'objectif obsessionnel des professeurs est de faire les programmes et tant pis pour ceux qui ne suivent pas. Si l'objectif devient l'acquisition d'un socle commun par tous les élèves, la problématique est renversée. C'est ce qui se passe dans les systèmes canadiens et finlandais. Déjà en tête du classement de l'enquête PISA 2000 qui avait essentiellement porté sur la maîtrise de la lecture, la Finlande confirme ses bons résultats en la matière tout en améliorant ses performances en mathématiques et en sciences. Les nombreux échanges, l'observation du fonctionnement des écoles et les entretiens avec un grand nombre de spécialistes de l'éducation auxquels la mission a procédé lors de son déplacement dans ce pays permettent d'apporter quelques explications à ces succès. L'élève finlandais a un rôle actif, il participe à la construction de son savoir, il apprend à travailler en équipe et à prendre des responsabilités au sein de l'école ; en cas de difficulté, il fait l'objet d'une remédiation très précoce et aucun élève ne redouble ni n'est exclu du cursus scolaire général avant seize ans. Les établissements sont dotés d'une large autonomie sous la tutelle des communes et les proviseurs sont nommés par un conseil de surveillance de l'école. Mais le point culminant du système est la qualité des enseignants. Ils bénéficient d'une longue formation qui débute dès l'entrée à l'université et qui réserve une large place à la pédagogie et à la compréhension du rôle de l'environnement des élèves sur leur capacité d'apprentissage. Ils bénéficient d'une image très positive dans le pays qui développe par ailleurs une véritable culture de l'éducation. Pour attirer des hommes vers le métier d'enseignant, notamment dans le primaire, la formation comporte un nombre important d'heures en technologie et en sciences. Les enseignants sont des fonctionnaires de la commune mais les chefs d'établissement peuvent recruter directement 10 % de leur effectif parmi des non-titulaires. À côté de la Finlande, à l'extrémité supérieure de l'échelle de compétences en mathématiques on trouve des élèves de la Belgique, de la Corée et du Japon, dont un pourcentage non négligeable d'élèves (8 à 9 %) sont parvenus à exécuter des tâches très complexes correspondant au niveau 6, le plus élevé de l'échelle de compétences. En bas de l'échelle, plus d'un quart des élèves n'ont pas dépassé le niveau 1, aux États-Unis, en Italie et au Portugal, ce qui a aussi été le cas de plus d'un tiers d'entre eux en Grèce et de plus de la moitié au Mexique et en Turquie. Au-delà de ces classements, des informations qualitatives sur les systèmes éducatifs ressortent de l'enquête PISA. En effet, l'OCDE procède parallèlement aux tests à des enquêtes contextuelles qui intègrent les relations avec les professeurs, la motivation et l'ambiance générale à l'école. Ces résultats révèlent par exemple que les élèves tout comme les écoles réussissent mieux dans un contexte caractérisé par de fortes ambitions scolaires, des règles disciplinaires constructives, des relations étroites entre enseignants et élèves, une disposition de ces derniers à s'investir et, de leur part, un intérêt dénué d'anxiété pour les mathématiques. Dans la plupart des pays qui ont obtenu de bons résultats, les collectivités locales et les écoles disposent d'une certaine autonomie dans la définition du contenu de l'enseignement, de l'utilisation des ressources et parfois du recrutement des enseignants. Les experts de l'OCDE insistent également sur le fait que les pays qui ont les meilleurs résultats pratiquent généralement une politique de classes hétérogènes et ne se livrent pas à une orientation scolaire trop précoce. L'enquête révèle également qu'en moyenne les filles ont de meilleurs résultats que les garçons dans le domaine de la lecture. En revanche, les écarts entre les sexes tendent à être faibles en mathématiques mais, dans la plupart des pays, les garçons sont plus nombreux parmi les élèves les plus performants. Cependant, les unes et les autres sont généralement représentées de façon égale parmi les élèves peu performants. Fait plus préoccupant selon l'OCDE, les filles déclarent systématiquement éprouver moins d'intérêt pour les mathématiques, y trouver moins de plaisir et se sentir moins sûres d'elles et plus anxieuses face à cette matière. Tous élèves confondus, les jeunes Français apparaissent plus anxieux que les autres à l'égard des mathématiques, et leur sentiment d'appartenance à leur école est un des plus faible. On peut donc considérer que la France est globalement dans la moyenne et dans la norme en ce qui concerne les résultats des élèves. Mais l'enseignement scientifique français semble plus livresque, plus théorique que dans la plupart des autres pays. S'agissant des évaluations nationales réalisées sur les élèves de CE2 et de sixième, on trouvera en annexe, le bilan qui a été établi par la DEP pour l'année 2005 dans les différents champs des programmes de mathématiques. Cette situation ne correspond certainement pas au naufrage de l'enseignement évoqué par M. Laurent Lafforgue membre de l'Académie des sciences et titulaire de la médaille Fields 2002, mais elle conduit à s'interroger sur les méthodes d'enseignement des mathématiques et des sciences en France. Par ailleurs, M. Laurent Lafforgue est terriblement critique par rapport aux évaluations internationales. Selon lui, les tests sont très frustres et sommaires afin de pouvoir être appliqués dans tous les pays. Les résultats de ces enquêtes et leur utilisation poussent les systèmes éducatifs vers un enseignement basique, universel et superficiel. Par exemple, le genre de question posée par les tests PISA est : Pierre habite à 5 km de l'école, Paul habite à 3 km, à quelle distance Pierre et Paul habitent-ils l'un de l'autre ? La réponse attendue par PISA est 2, ce qui n'est pas correct. On trouvera en annexe au présent rapport d'autres exemples d'exercices de mathématiques proposés dans le cadre des évaluations PISA. Selon le mathématicien français, la hiérarchie des résultats obtenus par les pays aux tests PISA de mathématiques ne correspond pas à la valeur des mathématiciens de ces pays. Par exemple, un tiers des chercheurs en mathématiques dans le monde sont russes alors que les élèves russes obtiennent des résultats médiocres dans les tests internationaux et que les meilleurs manuels du secondaire en maths sont des manuels russes. Toujours selon lui, les pays du nord de l'Europe qui à l'inverse obtiennent de très bons résultats ne sont pas des modèles car ils ont un système d'éducation « totalitaire » dans lequel il ne s'agit pas de transmettre des savoirs mais des compétences et des sentiments bien-pensants. M. Christian Forestier, membre du Haut conseil de l'éducation, a livré également à la mission son analyse des résultats de l'enquête PISA et des résultats des élèves français. Il rappelle que les jeunes Français sont, dans l'ensemble, notés 12 sur 20. Mais, si l'on distinguait les populations considérées, on se rendrait compte que les jeunes de quinze ans qui sont en classe de seconde seraient notés 18 ou 19 et surpasseraient tout le monde, mais que ceux qui sont en troisième parce qu'ils ont redoublé et dérapé n'auraient que 6, et seraient au niveau de la Turquie. Notre système est donc schizophrénique, en ce qu'il a pour effet qu'un enfant sur deux lui est bien adapté et réussit bien, mais qu'un enfant sur deux regimbe et ne réussit pas bien. II.- L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES ET DES MATHÉMATIQUES NE DOIT PAS ÊTRE RÉDUIT À SA SEULE EFFICACITÉ SÉLECTIVE L'enseignement des « vieilles » disciplines scientifiques (physique, chimie, biologie) et plus encore des mathématiques est exagérément piloté par les épreuves du baccalauréat, voire par celles des concours de l'agrégation ou de l'entrée dans les écoles d'ingénieurs. Il en résulte un enseignement fondé sur la mémorisation de données et l'assimilation de procédures abstraites. Rappelons ce qui a été indiqué à la mission par plusieurs interlocuteurs : on peut réussir l'agrégation de physique sans avoir jamais mis les pieds dans un laboratoire ! Paradoxalement, ainsi que cela est souvent souligné par les scientifiques eux-mêmes, cette dictature des programmes ne permet pas aux enseignants de transmettre une compréhension profonde des concepts de base et encore moins de commenter l'actualité scientifique. Les programmes sont conçus du haut vers le bas en privilégiant dès le primaire les moyens de faire émerger une élite à la fin du parcours et en délaissant beaucoup trop l'importance d'un minimum de culture scientifique dans l'apprentissage de la vie en société. A. POUR ÊTRE PLUS FORMATEUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES DEVRAIT ÊTRE MOINS SÉLECTIF 1. Les mathématiques au sommet de la hiérarchie scolaire Toutes les enquêtes démontrent que les mathématiques sont associées à l'excellence scolaire. C'est une tradition historique française qui permet à la France de se positionner parmi les meilleures nations dans les compétitions internationales en mathématiques mais contribue largement à l'auto-élimination des élèves qui ne se perçoivent pas comme excellents dans cette matière. Dès le primaire, les disciplines nobles, celles du « haut du bulletin », le français et surtout les mathématiques jouent un rôle déterminant dans l'évaluation, le classement et la sélection des élèves. Cette hiérarchie des disciplines et des savoirs, inculquée très tôt aux élèves, entretenue jalousement par les professeurs qui les enseignent et dont la raison d'être est la sélection vers la voie royale à savoir le bac S, ne peut avoir d'autre effet que la dévalorisation des autres matières : les sciences bien sûr mais que dire de la technologie ou des activités manuelles... La dévalorisation des élèves peu attirés par les exercices purement abstraits en découle tout naturellement. M. Philippe Meirieu, directeur de l'IUFM de Lyon, considère qu'aussi longtemps que les trois disciplines spéculatives (mathématiques, français, langue vivante) détermineront exclusivement l'avenir des élèves, l'orientation vers les filières professionnelles continuera de se faire par défaut, sans que l'on tienne compte des capacités des élèves en technologie ou en sciences de la vie et de la terre (SVT) par exemple. La perversion du système s'aggrave encore lorsque l'on sait que la filière S n'a pas pour vocation de sélectionner les futurs scientifiques pour lesquels la rigueur des mathématiques pourrait se justifier, mais de filtrer une élite qui se réserve tous les choix possibles et qui pour une grande majorité tournera le dos aux études scientifiques. Cette situation apparaît encore plus curieuse si l'on se demande, comme l'a fait un interlocuteur de la mission, si l'on fait vraiment des sciences dans les classes préparatoires scientifiques. Tout le long de ce parcours entonnoir qui doit conduire au bac S on aura perdu des élèves motivés par les sciences mais découragés par le poids des mathématiques et l'approche trop abstraite qui est la marque de fabrique de l'excellence scolaire. De surcroît, comment espérer réconcilier des jeunes avec les sciences physiques et même les sciences du vivant alors que tout au long du parcours scolaire elles passent pour des disciplines de second rang. Au risque bien réel de décourager les élèves, le système français privilégie à outrance l'abstrait et l'enseignement hypothético-déductif par opposition au concret et à l'enseignement inductif. C'est par un changement des représentations des matières élitistes et des autres, chez les enseignants, chez les parents et chez les élèves, particulièrement les filles, que l'on pourra faire évoluer les choses. Cette situation a été résumée par M. Gilbert Lambrecht, chargé de mission à la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) lorsqu'il a déclaré à la mission : entre l'école primaire qui est polyvalente et le supérieur qui le devient, il y a un tunnel dans lequel les disciplines s'affrontent pour s'imposer, par l'abstraction, dans une véritable hiérarchie. C'est donc le niveau en mathématiques qui conduit l'élève à se sentir capable ou non d'entreprendre des études scientifiques longues. Comme il a déjà été dit, ce mécanisme de sélection scolaire défavorise considérablement les filles qui manquent de confiance en elles et se dévalorisent systématiquement dans l'évaluation de leurs capacités. Lorsqu'elles se situent au-dessus de la moyenne en mathématiques, les filles en déduisent à 46 % qu'elles ne sont pas capables de se diriger vers une filière scientifique alors que les garçons ayant le même niveau ne sont que 16 % à s'en déclarer incapables. Tout au long de la scolarité et à quelques exceptions près sur lesquelles on reviendra, les mathématiques sont enseignées, à dessein, de façon abstraite et théorique parce que cette méthode est traditionnellement la voie de l'élite. Pas de questionnement, pas d'expérimentation mais l'assimilation douloureuse d'un programme qui comporte les pré-requis des classes préparatoires. Le résultat est que les mathématiques sont jugées sans aucun intérêt par une large fraction d'élèves y compris les bons élèves, alors qu'elles constituent un outil essentiel pour toutes les autres sciences, ce qui est largement ignoré dans les cours. 2. Quelles mathématiques à l'école primaire ? La mission considérait comme une évidence le fait qu'entre six et onze ans les jeunes élèves doivent apprendre assez tôt à maîtriser les quatre opérations, être entraînés au calcul mental et familiarisés avec les mesures et les ordres de grandeur. Les programmes d'enseignement de l'école primaire, adoptés par un arrêté du 25 janvier 2002, semblent aller dans ce sens. L'un des objectifs en mathématiques pour le cycle II (grande section de maternelle, CP, CE1) consiste, « en proposant une étude structurée des nombres, des formes, des grandeurs et de leur mesure de marquer l'entrée véritable des élèves dans l'univers des mathématiques ». Au cycle III (trois dernières années de l'école élémentaire), la résolution des problèmes est au centre des mathématiques et les connaissances doivent porter sur « les nombres entiers et décimaux, le calcul portant sur ces nombres, les techniques opératoires, l'approche des fractions, la mesure de quelques grandeurs, des notions d'espace et de géométrie (...) » Très chargés et très complexes (en Finlande les programmes scolaires comptent quelques pages, contre quelques centaines en France), ces programmes ne semblaient pas a priori être de nature à former des analphabètes en mathématiques et la mission ne s'attendait pas à voir se déchirer sur ce point les représentants des différentes chapelles qui agitent l'éducation nationale. La querelle se cristallise en particulier sur l'apprentissage de la division et des fractions. Elle est qualifiée d'idéologique par les protagonistes eux-mêmes, qui se sont affrontés au moment de l'élaboration des programmes de 2002 et qui continuent de le faire. Peu soucieuse de prendre parti dans ces querelles byzantines, la mission y voit surtout la place démesurée des programmes qui occultent les bonnes et les mauvaises pratiques professionnelles pour les enseigner. Quelques exemples suffiront à montrer que ces oppositions farouches ne se justifient pas vraiment et que le curseur devrait se situer à mi-chemin entre une énumération de connaissances à acquérir et la recherche d'une bonne compréhension de la part des élèves. Très hostile aux programmes actuels, M. Michel Delord, vice-président du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes (GRIP) et enseignant en mathématiques, a expliqué à la mission sa conception de l'enseignement de la division. Il faut, selon lui, apprendre très tôt la division à la main, dès le CP alors que seule la technique opératoire de l'addition est exigée par le programme, à la fin du cycle II. Selon M. Delord, la maîtrise de la division est la meilleure preuve de la maîtrise des trois autres opérations et que la division sans poser les soustractions, spécificité française, est un des meilleurs exercices de base du calcul mental et de plus, la connaissance de l'algorithme de la division est la seule manière de faire la différence entre les nombres décimaux, rationnels et irrationnels, qui est une base de l'algèbre, et que ne permet pas la calculette. Est-il vraiment impossible de concilier ces exigences en matière de connaissances avec la démarche plus pédagogique de M. Roland Charnay, professeur agrégé de mathématiques, membre du groupe d'experts sur les programmes de l'école primaire, responsable de la commission mathématique, et considéré comme le père des programmes actuels. Dans un entretien qu'il a accordé au Syndicat national unitaire des instituteurs professeurs des écoles et Pegc (SNUipp) le 25 novembre 2004, M. Roland Charnay déclare, notamment, qu'un des buts principaux de l'école est que les élèves acquièrent des connaissances, mais ces connaissances n'ont de valeur et de validité que si elles sont utilisables par les élèves. Or, en mathématiques, l'utilisation des connaissances se manifeste à travers la résolution de problèmes et, pour qu'un élève investisse ses connaissances dans la résolution de problèmes, il faut que les connaissances aient pris du sens au moment de leur apprentissage, c'est-à-dire que l'élève soit en capacité de relier certaines catégories de problèmes avec certaines catégories de connaissances. Autrement dit l'apprentissage du mode opératoire de la division ne peut se faire mécaniquement sans que l'élève ait compris à quoi elle sert. La mission déplore ce faux débat entre savoirs et compétences même si il y a eu pendant des années une certaine dérive pédagogique trop axée sur les mécanismes intellectuels de l'apprentissage. Il n'y a pas de compétences sans savoirs et un empilement de savoirs sans liens entre eux et sans réflexion paraît bien peu formateur. M. Rémi Brissiaud, chercheur en didactique des mathématiques et formateur à l'IUFM de Versailles, a éclairé un peu ce débat en rappelant que l'Éducation nationale est coutumière des bouleversements en matière de programmes. Si à l'école de Jules Ferry on apprenait à lire, écrire et compter dès les premières classes, au cours de la période 1970-1985 les jeunes enfants ne comptaient plus en base 10 et aujourd'hui on assiste à un nouveau mouvement de balancier puisque les enfants apprennent à compter dès les petites sections de maternelle ce qui, selon M. Rémi Brissiaud, est prématuré. Tout en regrettant que les psychologues n'aient pas été associés à l'élaboration des programmes, il propose une sorte de synthèse des diverses positions. Selon lui, il est souhaitable d'enseigner la multiplication en CE1 et la division en CE2. Il ne faut pas trop retarder le moment où l'on aborde ces notions car si le temps d'apprentissage est trop court, ce sont ceux qui apprennent le plus vite qui s'en sortent le mieux. Il faut trouver un juste équilibre pour faire aussi la part à l'enseignement qui essaie de faire comprendre au plus grand nombre d'élèves la raison d'être des concepts arithmétiques, pourquoi les hommes les ont inventés, en quoi ils sont des outils pour affronter la réalité. Il ne faut pas revenir à ce qu'on faisait avant, quand on apprenait par cœur, car seul un petit nombre élèves étaient alors en mesure de s'interroger par eux-mêmes sur le pourquoi des choses. Les lacunes en mathématiques constatées plus tard chez les étudiants et souvent dénoncées devant la mission - « ils ne savent pas appliquer la règle de trois » - résultent, sans doute, à la fois d'un manque de connaissances de base et d'un manque de compréhension des concepts arithmétiques. La formation des enseignants, sur laquelle le présent rapport reviendra, est probablement plus déterminante pour améliorer l'efficacité du système scolaire que les querelles sur les programmes. La tendance - signalée par des inspecteurs généraux - des enseignants du premier degré à s'accommoder dans les matières scientifiques d'un faible niveau d'exigence paraît plus grave que le fait que la division à deux chiffres à décimale ne figure pas au programme de l'école primaire, lequel ne prévoit que la division des nombres entiers. B. L'IMPORTANCE DE L'ACQUISITION D'UNE CULTURE SCIENTIFIQUE Au-delà du problème du renouvellement de la génération des chercheurs, ingénieurs et enseignants qui va quitter la vie active au cours des prochaines années et de l'importance des sciences et des techniques pour le développement économique d'un pays, la mission s'est interrogée sur la part que doivent prendre les sciences dans la culture d'un citoyen du XXIè siècle. Quel patrimoine scientifique souhaite-t-on transmettre aux générations futures et comment ? L'enseignement scientifique peut contribuer à la réussite de chaque citoyen dans sa vie professionnelle et personnelle et pour cela l'école et son enseignement trop magistral ne suffit pas. D'autres sources de formation et d'information en direction du public scolaire et non scolaire existent et doivent être encouragées et multipliées. Elles contribuent non seulement à irradier la culture scientifique dans le pays mais aussi à dynamiser l'enseignement traditionnel. 1. Apprendre avec les musées scientifiques L'éducation non formelle, en particulier par les musées scientifiques, doit être l'occasion pour chacun de développer son esprit scientifique et de prolonger sa formation au-delà des portes de l'école. Débarrassés des contraintes disciplinaires et de l'obsession des notes, les jeunes peuvent dans un environnement stimulant, en prise avec les questions scientifiques d'actualité laisser libre cours à une forme de réflexion personnelle tout en restant dans une démarche de découverte et d'apprentissage. À une époque où chacun devra poursuivre toute sa vie sa formation et faire preuve de créativité, quels que soient son métier et sa place dans la société, il est essentiel d'être mis en situation d'apprendre à apprendre et d'apprendre à comprendre. Ces musées ne doivent pas être des « musées mémoires » mais des « musées idées » qui organisent une mise en spectacle de la science indispensable pour attirer le plus grand nombre. Pour autant, les visiteurs sont confrontés à des informations scientifiques et techniques organisées et ils sont invités à attribuer un sens à ce qu'ils voient, touchent ou entendent. Pour les jeunes publics, un accompagnement, une médiation, est indispensable faute de quoi aucune appropriation des connaissances et des observations ne pourrait se faire. Par rapport à l'école, ce qui est séduisant c'est la liberté de mouvement et de manipulation, l'interactivité avec les machines mises à disposition et l'éveil à l'expérimentation. C'est un phénomène qui se développe à travers le monde, les musées les plus célèbres étant l'Exploratorium de San Francisco et le Centre des sciences de l'Ontario ouverts l'un et l'autre en 1969. La France est également à la pointe de cette dynamique avec la Cité des sciences et de l'industrie qui fête ses vingt ans, le Palais de la découverte qui a fait œuvre de précurseur et, dernier né, le Vaisseau à Strasbourg. La mission s'est rendue dans ces trois lieux de découverte et d'innovation pédagogique, facteurs déterminants du développement de la culture scientifique. · Le Vaisseau Créé à l'initiative du conseil général du Bas-Rhin, le Vaisseau a ouvert ses portes le 22 février 2005 et au bout de six mois il avait déjà accueilli 90 000 visiteurs, dont 18 000 élèves accompagnés par leurs enseignants. Il est conçu comme un outil pédagogique au service des enseignants, des éducateurs, des parents et bien sûr des jeunes de la maternelle au lycée, des offres spécifiques d'expositions et d'animations étant prévues pour quatre tranches d'âges différentes. Le musée peut accueillir 85 000 élèves par an, en préparant à l'avance leur visite avec les enseignants. Sa devise est « la science en s'amusant » et la règle de base est qu' « il est interdit de ne pas toucher ». Situé au cœur de l'Europe le Vaisseau attire un grand nombre de jeunes allemands dont les attentes et les réactions contribuent à enrichir la réflexion du comité scientifique et pédagogique du musée. Il présente quatre expositions permanentes thématiques « le monde et moi », dont l'objet est d'approcher la complexité de l'être humain ; « découvrir les animaux », qui se présente comme une enquête sur le vivant ; « je fabrique », qui porte sur la conception et les techniques de construction; « les secrets de l'image » sur la composition, la transformation et la diffusion de l'image. Deux expositions temporaires sont proposées chaque année, celle qui s'est achevée le 19 mars dernier portait sur les phénomènes physiques (les ondes, la lumière, les forces, l'optique, l'énergie...). Outre le rôle pédagogique, l'équipe dirigeante exprime l'ambition de susciter des vocations scientifiques et techniques en ne limitant pas la science à un ensemble de connaissances sur des phénomènes mais en la présentant comme un talent, une habileté à faire quelque chose. · Le Palais de la découverte Le Palais de la découverte a été longtemps le fleuron de la muséologie scientifique française. Lors de son ouverture au public en 1937 il faisait vraiment figure de précurseur et a accompagné le grand élan impulsé à la recherche française au milieu de XXè siècle. Peu à peu, la vétusté des équipements et une conception de la science qui privilégiait peut-être un peu trop la recherche fondamentale lui ont fait perdre de son influence. Il est aujourd'hui en pleine rénovation tant en ce qui concerne les bâtiments que les projets. Sa mission reste de diffuser la culture scientifique et de la faire partager. Pour initier à la pensée scientifique, les manifestations visent à faire comprendre la part déterminante que les découvertes jouent dans l'évolution des civilisations. L'objectif aujourd'hui est de réaliser des expositions aussi vivantes que possible dans lesquelles sont rejouées de façon spectaculaire les grandes découvertes. L'un des apports pédagogiques essentiel du Palais de la découverte est l'importance de la médiation : des chercheurs ou des étudiants en sciences sont présents sur les différents sites pour accompagner ou éclairer la démarche des visiteurs, présenter certaines expériences ou faire des exposés. Une interaction permanente doit exister entre la découverte ludique d'un phénomène et la complexité de la pensée scientifique. Ce musée se conçoit comme un lien permanent et indispensable entre le monde scientifique et le monde pédagogique. Actuellement deux expositions phares sont présentées : l'une sur la lumière et l'autre sur les dinosaures. Les projets à l'étude portent sur la terre et l'univers, la matière et l'énergie, les mathématiques et le vivant, avec une idée directrice, l'abolition du découpage des disciplines scientifiques et une approche toujours transversale des phénomènes. Le Palais de la découverte accueille chaque année 650 000 visiteurs dont 20 % de groupes scolaires et ce malgré les importants travaux en cours. · La Cité des sciences et de l'industrie La Cité des sciences et de l'industrie se situe à une autre échelle. Ouverte en 1986, avec pour mission de rendre accessible à tous les publics le développement des sciences, des techniques et du savoir-faire industriel, elle est devenue le quatrième musée de France par sa fréquentation avec près de trois millions de visiteurs par an. Les jeunes et les groupes scolaires représentent 16 % de ces visiteurs. Elle occupe une surface de 10 000 m2. La Cité est également en rénovation et ses responsables doivent fournir un effort permanent pour s'adapter non seulement à l'évolution incessante des sciences et des techniques mais aussi à celle de l'attente du public qui souhaite de plus en plus en plus que l'on traite les questions scientifiques comme des questions de société. Le projet pédagogique de la Cité, lieu de médiation des connaissances, est évidemment basé sur l'interactivité mais la réflexion a progressé sur le thème de la transmission des connaissances et aujourd'hui l'objectif est d'apprendre au visiteur à produire ses propres connaissances et à communiquer au sein du groupe ou avec les autres visiteurs sur les résultats obtenus. Pour apprivoiser les sciences, formule fétiche de la Cité, ses animateurs considèrent qu'il ne faut pas hésiter à convoquer l'émotion des visiteurs avec l'exposition temporaire « Trésors du Titanic » ou le rêve avec le planétarium en cours de réaménagement. À l'avenir la Cité envisage de privilégier les expositions temporaires en phase avec les grandes préoccupations du moment. Actuellement une exposition est consacrée à la grippe aviaire et une autre intitulée « Questions de sciences » montre comment les scientifiques posent des problèmes et élaborent des solutions, par exemple sur la place que l'homme s'est attribuée dans l'univers au fil du temps ou l'évolution de la description du système solaire. L'exposition vedette est actuellement Starwars qui utilise la science fiction et le mythe de la Force pour faire de la science pure. Au cours de l'entretien qui s'est déroulé à l'issue de la visite de la Cité des sciences, notamment avec M. Joël de Rosnay, conseiller du président du musée, les membres de la mission se sont inquiétés de l'inégalité territoriale qui existe inévitablement entre Paris et la province face à ces réalisations muséologiques exemplaires. M. Guillaume Boudy, directeur général, et M. Jean-Marie Sani, directeur des publics, ont alors détaillé la politique régionale mise en place par le musée au moyen d'expositions itinérantes, les « inventomobiles » sortes de caissons d'expérimentation légers et peu encombrants qui peuvent circuler à travers toute la France et aussi grâce à la richesse du site Internet de la Cité. Sous l'impulsion de la Cité des sciences, 200 « centres de sciences » ont été ouverts dans toute la France. Au cours de cet entretien les interlocuteurs de la mission ont également évoqué la place importante réservée à la formation des enseignants, en lien notamment avec l'IUFM de Versailles. Cette formation porte sur les contenus et les pratiques éducatives qui peuvent être suscités par la visite de la Cité, avec l'idée que tout peut être réutilisé en classe. La démarche mise en avant est de partir du contexte et du vécu des élèves pour les faire cheminer vers l'abstraction. L'ambition affichée est de toucher toute la communauté enseignante et de multiplier à leur intention les outils pédagogiques tels que DVD, expo-dossiers ... Il ne doit pas y avoir opposition mais complémentarité entre l'accès ludique au savoir et la diffusion du savoir. L'apport du musée est également de montrer la puissance de la communication et de l'échange d'informations et d'explications entre les apprenants dans la démarche d'apprentissage. Certes les enseignants engagés dans toutes ces opérations de projet « hors l'école » sont encore un petit nombre, mais ils sont très actifs et leurs élèves tournent, ce qui au bout du compte donne une chance non négligeable à chaque jeune d'être touché par cette démarche. Le budget annuel de la Cité des sciences est de 120 millions d'euros alors que ceux du Vaisseau et du Palais de la découverte sont respectivement de 17,4 et 18 millions d'euros. Sans faire de surenchère, la mission considère que de réels efforts doivent être faits pour que de telles entreprises, devenues le principal vecteur de diffusion de la culture scientifique, puissent se développer et se multiplier. 2. Apprendre la science par les médias De nombreuses enquêtes révèlent beaucoup d'ignorance de confusion et d'approximation dans l'opinion publique à propos des grandes questions scientifiques. Un sondage publié en 1985 dans Sciences et Avenir montrait qu'un Français sur quatre croit encore que le soleil tourne autour de la terre. Une enquête de la SOFRES, parue dans le journal l'Express en 1989, fait apparaître que les croyances au paranormal, à l'astrologie, à la numérologie ou à la voyance prolifèrent tant chez les diplômés que chez les non diplômés. Une autre enquête réalisée par la SOFRES entre le 15 et le 17 novembre 2000 révèle un réel pessimisme quand aux retombées du progrès scientifique et technologique. Si 67 % des personnes interrogées considèrent que ce progrès a contribué, en vingt ans, à une amélioration des conditions de vie, seuls 42 % des sondés estiment que cette influence positive se poursuivra dans les vingt prochaines années, soit moins d'une personne sur deux. Enfin un sondage eurobaromètre réalisé en décembre 2001 à la demande de la Commission européenne révèle que seulement la moitié des personnes interrogées (50,4 %) estiment que les bienfaits de la science sont plus importants que les effets nuisibles qu'elle pourrait avoir. Le public français comme le public européen s'estime insuffisamment informé sur les questions scientifiques alors qu'il existe une curiosité latente non satisfaite et source de frustrations. Or l'information de l'opinion est en grande partie assurée par les médias, (audiovisuels, presse écrite et de plus en plus l'Internet) et il faut déplorer une grande indigence de l'information diffusée sur les questions scientifiques par les grands médias. M. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale, a, par exemple, fait observer à la mission à propos du débat sur les OGM, que depuis quinze ans la presse file les mêmes métaphores, celles de Frankenstein et de l'apprenti sorcier, deux mythes de la dépossession, qui rencontrent un écho d'autant plus grand que la mondialisation libérale effraye. Et c'est ainsi que le petit grain de maïs fait peur. Il y a là un nœud de peur qui dissuade très efficacement les jeunes gens de s'engager dans les carrières scientifiques, par ailleurs peu attrayantes parce que très difficiles et peu lucratives. S'agissant d'Internet c'est à l'inverse le déferlement d'informations souvent difficiles à trier, hiérarchiser, voir authentifier, qu'il faut craindre. Un rapport d'information du Sénat en date du 10 juillet 2003(13), met particulièrement en évidence le faible impact des émissions scientifiques à la télévision notamment à cause de leurs horaires de diffusion. Le rapport indique que les directives inscrites dans les cahiers des charges des chaînes publiques ne sont assorties d'aucun quota, d'aucune obligation minimale quantifiée, contrairement à ce qui prévaut pour le spectacle vivant et pour les émissions à caractère musical. Par ailleurs, les différentes disciplines ne sont pas également représentées sur les grandes chaînes généralistes ; la médecine et la santé font l'objet d'un traitement généralement privilégié ; l'histoire, l'archéologie et l'espace qui se prêtent à l'illustration par l'image et stimulent l'imagination ne sont pas mal traitées. Mais les sciences abstraites, les nouvelles techniques et les métiers qui s'y rattachent sont très souvent délaissés. Notons que l'économie en tant que discipline scientifique semble paradoxalement une des disciplines les plus négligées, alors qu'elle concerne directement la vie de tous. Il faut déplorer également, avec les auteurs du rapport susvisé, que pour beaucoup de programmes le mince vernis scientifique ne soit que l'alibi fragile d'un projet qui ne vise que le divertissement et le sensationnel. Pourtant le succès remporté par quelques très bonnes émissions telles que « L'Odyssée de l'espèce », qui retraçait en 90 minutes les origines et l'évolution de l'homme, avec l'appui du paléontologue Yves Coppens, devrait tracer la voie. La BBC, pour sa part, diffuse beaucoup plus de bonnes émissions scientifiques qui mettent souvent en scène la vie des grands hommes de sciences. Quant aux actions de culture scientifique et technique, telle que la Fête de la science, elles sont surtout remarquées parce que tellement rares. La mission s'associe totalement à l'une des recommandations qui figure dans le rapport des sénateurs et qui n'a reçu aucun écho. Les auteurs du rapport demandaient au ministère de la culture de « considérer les sciences et leur histoire comme une des composantes à part entière de la culture au sens large, en y intégrant sa dimension technique et industrielle ». Ils l'invitaient, en conséquence, à s'investir davantage à l'avenir dans un domaine qui relève de ses attributions et à intégrer la diffusion de la culture scientifique et technique dans les actions qu'il conduit, à l'échelon national comme à l'échelon régional. Il existe incontestablement des problèmes de communication entre la science et la société mais les scientifiques doivent admettre que ce n'est pas un problème à sens unique et qu'ils ont une part de responsabilité dans cette situation. La crise de recrutement que traversent la science et la technologie dans de nombreux pays exige de la part des chercheurs et des scientifiques une sorte d'autocritique qui devrait les conduire à mieux tenir compte des inquiétudes et interrogations de leurs concitoyens et à prendre l'habitude de communiquer sur leurs activités, sans attendre qu'un sujet brûlant ou une catastrophe les mettent sous le feu des projecteurs. 3. Apprendre la science à travers l'histoire des découvertes et la vie des grands chercheurs Georges Canguilhem, philosophe spécialiste de l'histoire des sciences, a écrit pour le regretter, que la façon actuelle d'enseigner les sciences consiste à identifier la science avec ses résultats et les résultats avec leur énoncé pédagogique du moment. Nul n'imaginerait enseigner l'art, les lettres ou la philosophie sans les rattacher à leur histoire et à leur contexte. Seules les sciences sont extraites de ce qui les a rendues possibles ou les a fait reculer et leur donne leur sens. Seules les sciences sont enseignées autrement que comme une culture. Il est curieux de constater que l'enseignement des sciences est, comme on l'a vu, universellement vécu comme ennuyeux alors que l'histoire des sciences et des découvertes constitue une aventure où se mêlent, passions, débats vifs, exercice de l'esprit critique, espoirs, découragements et rebondissements. Pourquoi donc ne pas profiter de cette ouverture plus attrayante vers le monde complexe de la pensée scientifique ? Enseigner l'histoire des travaux scientifiques majeurs, de Galilée à Einstein en passant par Newton et Darwin, c'est montrer qu'ils n'ont réussi à percer l'essence de tel ou tel niveau de réalité qu'en rompant avec les apparences illusoires de l'expérience immédiate et c'est évidemment très formateur. La mise en histoire de la science la rend plus attractive et plus accessible, et de montrer que derrière chaque découverte se profile une rupture avec l'expérience empirique et les représentations a priori que nous avons du monde permet de lever le voile sur la pensée scientifique et d'encourager à l'effort. La restitution de l'histoire des disciplines scientifiques est fondamentale pour aider les élèves et les autres à comprendre que ce qui fait progresser la science et la compréhension du monde c'est le questionnement. La démarche des grands savants montre que ce qui a fait basculer leurs travaux c'est qu'ils ont su poser les bonnes questions et que, bien souvent, c'est la réponse qui permet de savoir si la question était riche et constructive. Les sciences ne commencent pas avec l'observation mais avec l'interrogation sur l'observation ; le fait scientifique nécessite une construction intellectuelle et c'est cette aventure intellectuelle qui mérite d'être racontée par le biais de l'histoire et de la vie des principaux acteurs. L'exercice de la pensée critique à travers la pratique des sciences ne va pas de soi et la confrontation à des sujets aussi complexes que l'astrophysique ou la cosmologie qui passionnent le public se fait au moyen d'ouvrages de vulgarisation qui peuvent être remarquables mais ne permettent pas d'accéder à la réalité de la démarche scientifique. En revanche l'histoire d'une découverte permet beaucoup plus facilement de se familiariser avec cette démarche. Nul besoin d'alourdir les programmes pour cela, il suffit d'incorporer à chaque étape de l'enseignement, une ouverture, un questionnement, sur l'histoire de la connaissance de l'objet étudié. Cette méthode que plusieurs interlocuteurs de la mission ont appelée de leurs vœux suppose évidemment une formation adaptée des enseignants, qui eux-mêmes ont été privés tout au long de leurs études de ce travail de réflexion. C. LA CULTURE SCIENTIFIQUE PARTICIPE À LA CONSTRUCTION DE LA DÉMOCRATIE Les sciences aident à rester dans la compétition mondiale mais elles sont plus que cela, pour M. Édouard Brezin, président de l'Académie des sciences, puisqu'elles transforment notre vision du monde. La découverte de la double hélice d'ADN, par exemple, a transformé notre façon d'appréhender le vivant. Pour Mme Marie Reynier, directrice de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), la science dit que l'homme n'est pas grand-chose dans un monde d'incertitudes. Elle est inconfortable mais cet inconfort doit être valorisé car c'est lui qui élève l'être humain. Ces réflexions illustrent le lien entre le progrès scientifique et la démocratie fondée sur la participation des citoyens au débat et sur l'autonomie de jugement. Science et démocratie reposent sur la pédagogie du débat et du dialogue. L'enseignement scientifique et technologique est plus nécessaire que jamais pour déchiffrer le monde. Les citoyens ont besoin de maîtriser un minimum de connaissances scientifiques et techniques pour comprendre l'univers qui les entoure, l'évolution du climat, la pollution, les organismes génétiquement modifiés, la pénurie d'eau et la biodiversité, par exemple. L'école doit fournir aux futurs adultes la capacité à développer une raison critique permettant un jugement sur les grands problèmes scientifiques du moment. Comme l'a indiqué M. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint de la direction de l'éducation de L'OCDE, une meilleure connaissance d'un problème rend les citoyens plus responsables, par exemple en ce qui concerne le bon usage des médicaments. De plus, l'enseignement des sciences forme au débat, à l'acceptation du doute, à la remise en question de dogmes, au respect de l'autre, à la rigueur de l'expression. L'un des problèmes majeurs de notre époque est de comprendre un monde en constante évolution et d'y trouver sa place. La science est un facteur de socialisation très puissant. Elle n'est pas seulement affaire de savoirs académiques et disciplinaires. Si la science cesse d'être à l'écoute des problèmes de la société, elle se condamne à un déclin certain. Elle doit être au service des hommes et des femmes et ses enjeux doivent être accessibles à chacun d'eux. La science actuelle est de plus en plus complexe à enseigner et si elle doit légitimement exiger des efforts de la part des élèves, y compris de ceux qui ne feront pas d'études scientifiques, elle doit également s'efforcer de faire rêver et donner confiance dans l'avenir à travers l'aventure collective qu'elle représente. Mais pour y parvenir la science ne doit pas être enseignée comme un dogme, car alors loin de susciter le débat et le sens critique elle laisserait le champ libre au retour des superstitions et des fanatismes les plus régressifs. III.- LA RÉNOVATION DE L'ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES SCIENTIFIQUES PASSE PAR L'INNOVATION Deux moments semblent déterminants pour sensibiliser les élèves à la démarche scientifique et pour les motiver afin qu'ils fournissent l'effort requis pour ces apprentissages : - tout d'abord à l'école élémentaire, car c'est à ce moment que la curiosité des enfants est la plus vive et la plus spontanée ; le goût des sciences acquis à cet âge est destiné à durer ; - ensuite à quinze ans, car c'est le moment où l'intérêt pour les sciences est au plus bas alors que se profilent les choix fondamentaux d'orientation, souvent sans retour possible. Tous les efforts des enseignants et des pédagogues doivent donc se concentrer sur ces deux étapes pour élargir le vivier des futurs scientifiques. La mission a constaté sur cette question essentielle de l'innovation en matière pédagogique, qu'elle dépend évidemment du dynamisme, de l'audace et du talent des enseignants qui s'y aventurent, mais elle dépend aussi du soutien des chefs d'établissement et de la conscience qu'ils peuvent avoir de leur rôle de manageur. Toutes les expériences, le plus souvent enthousiasmantes et en tout cas convaincantes, viennent de la base de la communauté éducative, souvent avec le soutien des universitaires et des chercheurs. L'administration de l'éducation nationale se contente d'observer ces initiatives, il est vrai sans y faire obstacle, mais sans non plus les relayer ou les promouvoir. C'est ce qu'a déclaré un enseignant lors de la table ronde des associations d'enseignants des disciplines scientifiques organisée par la mission le 28 février 2006. Il évoquait une initiative des enseignants en Seine-Saint-Denis consistant à faire séjourner quelques jours des élèves de seconde et de première dans des laboratoires de recherche et il a indiqué que ces enseignants se sont sentis très seuls, les inspecteurs étant débordés par les nécessités de la gestion de l'urgence. On peut regretter également que l'éducation nationale ne juge pas utile d'évaluer l'impact sur le niveau des élèves de ces méthodes innovantes et de ces formes différentes de confrontation à la science. Toutefois, la mission s'interroge : faut-il institutionnaliser toutes ces expériences au risque de les asphyxier ou les laisser évoluer librement au risque d'en priver une grande majorité d'élèves ? En Suède, le programme NTA (Natural sciences and technology for all) qui a débuté en 1997 propose aux élèves une approche empirique de la science et offre aux enseignants quatorze thèmes de travail avec du matériel et une formation adaptée. Ce programme comparable à l'expérience de La main à la pâte, évoquée ci-après, a été initié par l'Académie des sciences suédoise et relayé par les municipalités. Aujourd'hui il touche 54 municipalités et 60 établissements scolaires, mais il reste fondé sur la base du volontariat des établissements et des enseignants. Une évaluation de ce travail a été réalisée en juin 2003 par plusieurs chercheurs du département de science de l'éducation de l'Université de Linköping. En Finlande, le programme LUMA (Joint national action) a été lancé par le gouvernement en 1995 et renouvelé en 1999 avec l'objectif majeur d'élever le niveau des connaissances en mathématiques et en sciences, à tous les niveaux d'enseignement, par l'expérimentation et une approche pluridisciplinaire. Le ministère de l'éducation, les autorités locales, l'Académie de Finlande, les institutions éducatives et les universités sont associés au programme, avec le soutien des entreprises qui fournissent du matériel et l'aide de leurs salariés. Ce programme qui concerne actuellement 78 communes et 270 établissements est évalué chaque année. En France de nombreuses expériences se développent avec bien sûr La main à la pâte à l'école primaire mais aussi des démarches innovantes pour l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée. La rénovation de l'enseignement des sciences ne passe pas exclusivement par les méthodes d'apprentissage mais aussi par le bon usage de l'informatique, par la rupture avec le cloisonnement disciplinaire et une transformation du mode d'évaluation des élèves. A. LES INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES PORTEUSES D'AVENIR 1. L'expérience de La main à la pâte Plusieurs interlocuteurs ont présenté à la mission cette expérience originale née en 1995 dans les écoles d'un quartier déshérité de Chicago et à deux reprises, dans une école du Québec et dans une autre de Clichy-Sous-Bois, certains membres de la mission ont pu vérifier son efficacité et l'extrême professionnalisme des enseignants qui la pratiquent. En 1996, par divers biais, plusieurs académiciens ont constaté que l'enseignement de la science avait pratiquement disparu de l'école primaire française. Il fallait réagir et M. Georges Charpak, prix Nobel de physique en 1992, a lancé l'opération La main à la pâte qui vise à promouvoir au sein de l'école primaire une démarche d'investigation scientifique. Cette démarche pédagogique a pour objectif l'appropriation progressive par les élèves, de concepts scientifiques et techniques opératoires, accompagnée d'une amélioration de l'expression écrite et orale. Elle prend pour point de départ l'observation, par les enfants, d'un objet ou d'un phénomène du monde réel, proche et sensible, sur lequel ils sont invités à réaliser des expériences. Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, et construisent leurs connaissances. Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquences en vue d'une progression des apprentissages. Les enfants doivent tenir un cahier d'expériences dans lequel ils consignent leurs observations et leurs raisonnements avec leurs propres mots. L'Académie des sciences s'est engagée à accompagner les enseignants volontaires par toutes sortes de moyens. Du matériel pédagogique imaginé par les concepteurs du projet et spécifique à chaque module est mis à la disposition des enseignants. Un site Internet est destiné à les aider à mettre en place un enseignement des sciences de qualité à l'école primaire et assure la communication entre les enseignants et un réseau de consultants. Ce réseau de chercheurs ou d'ingénieurs volontaires apporte dans des délais très brefs, chacun dans son domaine de compétences, les réponses aux questions d'ordre scientifique que se posent les enseignants dans la préparation ou la réalisation d'une activité. Il y a 320 000 professeurs des écoles en France et le site reçoit 250 000 requêtes par mois depuis huit ans, ce qui traduit l'ampleur des besoins. Un ouvrage collectif récent(14) fait le récit de cette aventure dans laquelle les scientifiques jouent le rôle « d'accoucheurs d'idées et d'éveilleurs de sens ». Cette expérience se développe dans le monde entier, sous des formes diverses mais en respectant toujours les principes de base rappelés ci-après. Les dix principes de La Main à la pâte 1 - Les enfants observent un objet ou un phénomène du monde réel, proche et sensible, et font des expérimentations sur celui-ci. 2 - Au cours de leurs investigations, les enfants argumentent et raisonnent, mettent en commun et discutent leurs idées et leurs résultats, construisent leurs connaissances, une activité purement manuelle ne suffisant pas. 3 - Les activités proposées aux élèves par le maître sont organisées en séquences en vue d'une progression des apprentissages. Elles relèvent des programmes et laissent une large part à l'autonomie des élèves. 4 - Un volume minimal de deux heures par semaine est consacré à un même thème pendant plusieurs semaines. Une continuité des activités et des méthodes pédagogiques est assurée sur l'ensemble de la scolarité. 5 - Les enfants tiennent chacun un cahier d'expériences avec leurs mots à eux. 6 - L'objectif majeur est une appropriation progressive par les élèves de concepts scientifiques et de techniques opératoires, accompagnée d'une consolidation de l'expression écrite et orale. 7 - Les familles et/ou le quartier sont sollicités pour le travail réalisé en classe. 8 - Localement, des partenaires scientifiques (universités, grandes écoles) accompagnent le travail de la classe en mettant leurs compétences à disposition. 9 - Localement, les IUFM mettent leur expérience pédagogique et didactique au service de l'enseignant. 10 - L'enseignant peut obtenir auprès du site Internet des modules à mettre en œuvre, des idées d'activités, des réponses à ses questions. Il peut aussi participer à un travail coopératif en dialoguant avec des collègues, des formateurs et des scientifiques. M. Georges Charpak a décrit à la mission l'enthousiasme - qu'elle a d'ailleurs constaté par elle-même - , le plaisir et le sérieux avec lequel les jeunes élèves s'emparent des problèmes qui leur sont posés et a souligné la synergie qui se produit entre enseignants, chercheurs et autres accompagnateurs. Il a cité, par exemple, la dizaine d'élèves de l'École polytechnique qui font leur service civique dans le cadre de La main à la pâte et sont particulièrement bien accueillis dans les classes. La Vice-présidente de l'Académie chinoise des sciences, qui a visité en sa compagnie une école à Troyes, a dit au Prix Nobel français qu'elle venait de voir le plus bel exemple d'apprentissage scientifique et, a-t-elle fini par ajouter, démocratique... Plusieurs regrets sont généralement exprimés s'agissant de l'évolution de cette expérience en France, qui selon certains s'essoufflerait un peu après dix ans de grande activité : - Le premier regret est l'absence d'évaluation de ces activités d'éveil et d'investigation sur la motivation et les résultats des élèves. L'Inspection générale de l'éducation nationale a toujours affirmé son soutien à la mise en place de ces activités. Dans un rapport en date du 22 mars 2001(15), M. Jean-Pierre Sarmant, inspecteur général, parle même de révolution pédagogique et fait diverses propositions dont certaines seront reprises dans le plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école primaire lancé en 2002 et dont on a d'ailleurs du mal à percevoir les effets. Mais l'administration reste globalement spectatrice de ces expériences : aucun plan global d'évaluation n'a été réalisé et aucune incitation spécifique n'est entreprise en direction des écoles et des professeurs. Interrogés par la mission, M. François Perret, doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale, et M. Claude Boichot, inspecteur général ont déclaré que l'inspection générale est totalement en phase avec les positions de l'Académie des sciences et avec l'expérience de La main à la pâte. Mais, selon eux, trop peu d'établissements sont équipés en locaux et matériels qui permettent l'expérimentation et, pour l'instant, il n'est pas possible de généraliser ce dispositif innovant. Par ailleurs, l'obligation de parcourir l'ensemble du programme ferait obstacle à ce qu'on consacre trop de temps aux méthodes expérimentales. Enfin, il faut que les maîtres soient bien formés pour être capables de décortiquer et d'expliquer ce que font les élèves, et cela pose la question de l'enseignement dispensé dans les IUFM à des étudiants plutôt d'origine littéraire. - La mission a compris que malgré les louanges, les blocages sont sérieux et c'est le second regret qui peut être exprimé : le faible nombre d'élèves bénéficiant de ces activités d'investigation scientifiques. En 1995, selon les estimations de la direction de l'enseignement scolaire du ministère, à peine 3 % des classes de l'école primaire pratiquaient un enseignement des sciences malgré son caractère obligatoire dans les programmes. Aujourd'hui, selon Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, l'un des principaux promoteurs de l'opération, la proportion d'enfants étudiant la science à l'école primaire, notamment grâce aux activités de La main à la pâte, serait d'environ 30 %, ce qui reste bien trop faible. - Un autre regret concerne l'extrême difficulté à introduire La main à la pâte au collège. Selon M. Pierre Léna, l'organisation du travail au collège et la réticence des enseignants expliquent cette difficulté et les élèves de sixième, qui reçoivent un enseignement hebdomadaire d'une heure trente dans chacune des disciplines scientifiques au programme, sont incapables d'établir une unité entre ces enseignements et leur curiosité s'effondre. Quant aux professeurs, tenus d'assurer 18 heures d'enseignement hebdomadaire par unités d'une heure trente également, ils voient quelque 360 élèves différents chaque semaine qu'ils sont incapables de connaître et auxquels ils sont encore plus incapables d'appliquer une méthode d'investigation. Le résultat est que les collégiens acquièrent des connaissances éparses dont ils ne comprennent pas à quoi elles mènent et qu'ils ont des sciences une perception complètement fausse. Pourtant des expériences touchant une cinquantaine de collèges en zone d'éducation prioritaire (ZEP) devraient démarrer à la prochaine rentrée. Il s'agirait d'aider les enseignants de plusieurs disciplines scientifiques, y compris en mathématiques, à conduire des activités d'expérimentation sur un thème transversal. - Enfin, mais le présent rapport reviendra sur ce problème, les animateurs de La main à la pâte constatent que rien n'a changé en ce qui concerne la formation des maîtres dans le domaine des sciences et cela est présenté comme un grave échec. Pourtant, le coût de ces opérations serait extrêmement faible : d'après M. Pierre Léna, le matériel est, très souvent, déjà dans les circonscriptions et, même quand il faut l'acquérir, son prix est d'un ou deux euros par enfant, alors qu'on a dépensé dix, si ce n'est cent fois plus, pour l'équipement informatique des écoles. La mission considère que la démarche d'investigation a une vertu éducative sans pareil et qu'il faut donc étendre l'expérience de la main à la pâte, sous des formes qui peuvent varier, à toutes les classes du primaire et au collège. Cela suppose des classes allégées, une formation spécifique des enseignants et la motivation des directeurs d'école et des principaux de collège, mais ces efforts paraissent assez mineurs face à l'enjeu considérable qui consiste à redonner toute sa place à la science à l'école et dans la société. La mission considère donc que l'école primaire ne doit pas être uniquement centrée sur les apprentissages de base « lire, écrire, compter » car une telle école se priverait des outils d'éveil indispensables pour accompagner ces apprentissages. Il ne doit pas y avoir de barrière rigide entre la maîtrise formelle de la langue et du calcul et les autres apprentissages culturels. C'est le grand apport des initiatives comme La main à la pâte. On manipule mais c'est une manipulation scientifique, pas du bricolage ni du jardinage qui relèvent d'une autre approche du réel. Il faut décrire une situation, formuler une question et mettre en mot la manipulation. On apprend à lire, à s'exprimer oralement et par écrit sur des sujets motivants et vécus. 2. L'expérimentation en mathématiques Interrogé par la mission sur l'enseignement des mathématiques, M. Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, a estimé que c'est un débat difficile et que La main à la pâte cherche à mobiliser ce qui est nécessaire dans les champs mathématiques pour développer les investigations scientifiques conduites en classe. Mais de nombreux mathématiciens français, dont l'excellence reconnue internationalement est incontestable, voient cela comme une menace car, pour eux, les mathématiques existent indépendamment de tout rapport au monde réel et supposent donc une formation au raisonnement indépendante de tout ce qui peut être application. M. Brézin considère, pour sa part, que c'est en reliant les mathématiques à des situations réelles qu'on intéresse les élèves. M. Yves Quéré, également membre de l'Académie des sciences et cofondateur de La main à la pâte a expliqué comment dans le cadre des actions qu'elle organise, on peut faire mesurer par les enfants le rayon de la terre grâce à la méthode d'Ératosthène(16). La mission a découvert qu'en effet il est possible d'enseigner les mathématiques à partir de situations concrètes, sans faire l'économie du sens, et si cela demande du temps c'est sans doute la voie à suivre. Ces démarches d'investigation en mathématiques peuvent prendre plusieurs formes mais toutes cherchent à dépasser l'opposition traditionnelle entre les sciences expérimentales qui se caractérisent par l'expérience, l'observation, le caractère concret et la démarche inductive d'une part et les mathématiques basées sur la démonstration abstraite et la construction formelle à partir d'axiomes d'autre part. Les professeurs de mathématiques et les chercheurs qui sont à l'origine de ces expériences cherchent également à faire apparaître les rapports des mathématiques avec les autres sciences et avec le reste du monde. Un colloque développant ces thèmes s'est tenu à Saint-Etienne le 28 septembre 2005(17) dans le cadre du projet européen Scienceduc financé par la Commission européenne dont l'un des objectifs est la dissémination de bonnes pratiques d'enseignement des sciences à l'école primaire. Pour les intervenants, un enseignement rénové des mathématiques à l'école primaire doit s'inspirer de l'action de La main à la pâte afin de trouver une juste articulation entre expérimentation, mesure et outils mathématiques. · ANIMATH Au cours de ce colloque, M. Martin Andler, professeur de mathématiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin et président d'ANIMATH(18), a apporté un éclairage intéressant sur l'activité mathématique. Il explique que très schématiquement, les mathématiques à tous les niveaux consistent en 45 % d'observation, 45 % de démarche expérimentale et 10 % de démonstration. C'est à peu près l'équilibre qu'il y a dans l'activité d'un mathématicien chercheur qui travaille sur un problème donné. Il passe beaucoup de temps à se familiariser avec une situation, à jouer avec les objets mathématiques. Évidemment, la situation est déterminée par des objets mathématiques (nombres, figures), qui sont des objets abstraits mais ils peuvent acquérir une réalité qui fait que l'on peut les observer. On peut procéder à des expérimentations puis, une fois qu'on a compris que quelque chose a des chances d'être vrai, on peut éventuellement passer à la phase de démonstration. Elle peut durer plusieurs années : on essaye, on « rate », on n'y arrive pas. Pourquoi n'y arrive-t-on pas ? Parce qu'on doit revenir constamment aux phases précédentes d'observation, et finalement on découvre comment écrire une démonstration. Dans l'enseignement traditionnel, toute cette phase disparaît complètement, et pourtant on dit : les mathématiques, c'est la démonstration. C'est évidemment faux dans les mathématiques telles qu'elles sont faites par les mathématiciens chercheurs, ainsi que pour la grande quantité d'activités mathématiques qui sont faites par des gens qui ne sont pas des mathématiciens professionnels (physiciens, ingénieurs, économistes ou autres). Alors pourquoi ne pas essayer de rapprocher l'enseignement à l'école de la démarche mathématique réelle qui a l'air de passionner les chercheurs ? · MATh.en.JEANS C'est ce que Mme Véronique Chauveau tente de faire avec l'association MATh.en.JEANS qui vise à faire découvrir les mathématiques de l'intérieur aux élèves et dont le slogan est : « Ne subissez plus les maths, vivez-les ! ». Cette initiative se développe au collège et au lycée. Malheureusement à Paris un seul établissement s'est risqué dans l'aventure, le lycée Camille Sée dans lequel la mission s'est rendue, à l'invitation de Mme Chauveau, professeur de mathématiques, pour assister à un atelier qui se déroule en dehors des heures de cours avec des élèves volontaires pas nécessairement bons en maths. La formule est la suivante : un chercheur donne des sujets ouverts à deux groupes d'élèves volontaires de deux établissements différents. Les élèves se retrouvent autour de ces sujets, sans que leur professeur qui encadre tous les ateliers ait la solution. Ils travaillent pendant plusieurs mois, un après midi par semaine en se concertant d'un établissement à l'autre, ce qui est très déstabilisant mais très formateur car cela leur montre que le raisonnement mathématique se construit par essais et erreurs. Au bout de la démarche et de l'année scolaire a lieu un congrès de recherche au cours duquel les élèves présentent leurs résultats. Cette enseignante affirme que donner ainsi le goût de chercher est un acquis formidable pour la formation des élèves. Mais, ajoute-t-elle on ne peut pas faire des mathématiques à 100 km/h, sauf à travailler pour une élite et à inciter les autres à prendre des cours particuliers, ce qui, selon ses termes, « est absolument scandaleux ». Si l'on veut un bon niveau, il faut laisser aux élèves le temps de s'approprier le programme. Les ateliers de MATh.en.JEANS doivent trouver localement leur mode de fonctionnement pour faire vivre leur activité dans le cadre d'une classe ou d'un club en s'appuyant sur l'aide des collectivités territoriales, le soutien de l'éducation nationale (inspection académique, rectorat), et en développant des partenariats avec les universités ou les organismes de recherche. On trouvera en annexe une présentation détaillée de l'action de cette association. · Les laboratoires de mathématiques Une autre forme originale d'enseignement des mathématiques a été présentée à la mission par M. Jean Pierre Kahane, président de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques. Il propose la création de laboratoires de mathématiques. L'idée n'est pas nouvelle mais a du mal à s'imposer en raison de la résistance de nombreux enseignants pour lesquels les mathématiques sont une science qu'on pratique dans sa tête, à la rigueur avec des outils, mais pour laquelle il n'est nul besoin d'un laboratoire. À l'inverse, pour M. Kahane, dans ces laboratoires, il faut du bois, du fil, et même un préparateur qui pourrait être un menuisier, mais également du matériel informatique. Selon M. Kahane, le mouvement démarre grâce à la volonté de certains professeurs et chefs d'établissement et l'enthousiasme des élèves. Les premières expériences au lycée technique de Massy Palaiseau, au lycée professionnel Louis Blériot de Besançon et dans plusieurs établissements de Montpellier sont très favorables. Il s'agit de donner aux mathématiques une couleur expérimentale : on cherche, on explore, on construit des exemples et des contre-exemples, on formule et on teste des hypothèses. C'est cette activité que tous les mathématiciens professionnels connaissent. Il faut donner aux élèves les instruments nécessaires pour mener des expérimentations numériques et graphiques totalement nouvelles pour eux. C'est stimulant pour les élèves mais aussi pour l'enseignant, qui aborde d'une nouvelle façon de nouveaux sujets. · Maths sans Frontières La mission a retrouvé cette démarche au cours de son déplacement à Strasbourg où elle a rencontré des enseignants d'une autre association « Maths sans frontières », qui organise des compétitions de mathématiques entre des classes de troisième et de seconde de différents pays. La classe entière participe à la compétition, ce qui développe le goût du travail en équipe et l'entraide entre les élèves. Les épreuves sont conçues par des enseignants des différents pays qui se réunissent chaque année en assemblée générale, laquelle devient un lieu d'échange international sur l'enseignement des mathématiques et les problèmes rencontrés par les élèves. Le choix des sujets qui se veulent ludiques, attrayants, drôles et donnant l'envie de chercher est un moment essentiel. Au cours des trois dernières années, plus de 120 000 élèves d'Allemagne, d'Italie, de Pologne de Hongrie et de France ont participé à ces compétitions. Des prix conséquents fournis par des entreprises locales sont remis aux classes gagnantes. 3. Les bons choix en matière d'informatique Avec son humour décapant, M. Georges Charpak a déclaré à la mission : « Un stylo à bille ne fera pas de vous un poète. De même, l'informatique n'est qu'un outil. Je n'en fais pas un ennemi, mais je ne m'en sers qu'à mon corps défendant car je hais tout appareil dans lequel il y a plus de trois boutons ». De son côté, M. Édouard Brézin considère que l'Internet est un moyen extraordinaire d'accéder à l'information mais il faut prendre garde à ne pas tout mélanger car, faute de contrôle, car on peut trouver n'importe quoi. S'il est bon de savoir se servir d'un micro-ordinateur, il ne paraît pas souhaitable d'encourager à l'excès le recours à l'informatique dans la formation scientifique. Par ailleurs, pour beaucoup d'interlocuteurs, si un enseignement est en crise c'est bien celui de la technologie qui selon les programmes du collège devrait porter sur les « produits techniques », ce qui est assez vague et se résume assez souvent à la manipulation sans objectif précis d'ordinateurs. Mais le reproche majeur porte sur le fait que la technologie est totalement découplée de l'enseignement des sciences, ce qui selon M. Jean-François Bach, professeur à l'université René Descartes, membre de l'Académie des sciences, est une erreur conceptuelle. En effet, pourquoi distinguer à l'école science et technologie alors que cette distinction est totalement obsolète dans les développements actuels de la recherche scientifique. Il faut sans doute voir dans cette erreur les séquelles d'un système bâti sur le principe de la hiérarchie entre les disciplines conceptuelles et abstraites très valorisées et les travaux manuels très peu valorisés scolairement. De plus, l'enseignement de la technologie et donc des technologies de l'information et de la communication disparaît des enseignements communs à l'arrivée en classe de seconde générale. Des cours d'informatique sont proposés uniquement dans le cadre des enseignements de détermination. En première et en terminale S, ils disparaissent complètement. La mission a constaté des divergences d'appréciation sur la place qui doit revenir à l'apprentissage de l'informatique. L'Académie des sciences, dans un avis rendu le 6 juillet 2004(19) considère que l'enseignement de l'informatique ne doit pas être celui de la "science informatique". La création et la mise en œuvre du Brevet Informatique et Internet(20), et les moyens afférents, représentent un premier pas significatif et important. Il faut conduire les élèves à utiliser, pratiquement dans toutes les matières, les outils informatiques aussi bien que les outils traditionnels. À côté des papier et stylo, ils tiendront des cahiers électroniques, remettront des devoirs électroniques et consulteront des bases de données électroniques, pour une partie de leur temps. La puissance et la sophistication des ordinateurs et de leurs logiciels appropriés font que leur bon usage nécessite un long apprentissage qui se poursuivra tout le temps du collège, mais simplement en les utilisant et non sous forme de cours ou de travaux dirigés d'informatique. À l'inverse, M. Antoine Petit, directeur interrégional du CNRS a déclaré à la mission que selon les prévisions du ministère de l'emploi des États-Unis, les cinq métiers dans lesquels la progression devrait être la plus forte d'ici 2010 sont tous liés aux sciences et technologies de l'informatique et des communications (STIC). Face à ces enjeux, la place de l'informatique dans l'enseignement primaire et secondaire paraît très insuffisante. Il faut offrir plus d'options informatiques au lycée et faire en sorte que l'informatique soit considérée comme une véritable discipline, en mettant un terme à la confusion avec l'alphabétisation informatique - ce que les Anglo-saxons appellent computer literacy - et avec l'utilisation « presse-bouton » des outils. Cela suppose, tout simplement, des professeurs formés et des horaires réservés. Dans une étude associée aux évaluations PISA 2003, l'OCDE considère que les élèves qui maîtrisent l'informatique obtiennent de meilleurs scores à l'école, notamment en mathématiques. Ce jugement est toutefois à nuancer puisque l'enquête précise que les élèves qui obtiennent les meilleurs résultats sont ceux qui font un usage modéré de l'ordinateur. La mission ne juge pas nécessaire d'introduire dans les programmes un enseignement spécifique en informatique pour apprendre à programmer par exemple. En revanche, l'intégration de l'outil informatique aux enseignements de sciences, avec des objectifs pédagogiques précis encadrés par des enseignants bien formés, est totalement indispensable. 4. L'enseignement pluridisciplinaire des sciences au collège, l'exemple du Québec Le passage brutal d'un enseignement bien encadré par un seul maître qui connaît tous les élèves à une sorte de supermarché scolaire comprenant autant d'enseignants que de disciplines est bien souvent déstabilisant pour les jeunes élèves qui arrivent en sixième. Mais cette situation, dénoncée par de nombreux pédagogues, est exacerbée avec les disciplines scientifiques enseignées en sixième (4 h de mathématiques, 1 h 30 de sciences de la vie et de la terre et 1 h 30 de technologie) auxquelles s'ajoute en cinquième 1 h 30 de physique et chimie. À un âge où il serait nécessaire que l'élève découvre, guidé par un professeur, la continuité entre mathématiques, sciences expérimentales et technologies, il est néfaste que se déroulent en parallèle et avec des professeurs différents des programmes qui s'ignorent. L'élève n'a ainsi aucune chance de découvrir que la majorité des problèmes scientifiques se situent et se résolvent aux interfaces de chacune des disciplines enseignées. Outre l'ennui généré par des enseignements cloisonnés et sortis de tout contexte, cette fragmentation s'oppose à la perception par les élèves de l'existence de champs professionnels tels que l'énergie, la chimie et l'environnement, le traitement de l'information et les réseaux, la physique et la climatologie, la géographie et les statistiques... La diversification nécessaire de l'apprentissage des sciences doit se faire progressivement et pas avant la classe de quatrième afin de rendre palpable l'unité du monde scientifique. Consciente que la polyvalence et même la bivalence des enseignants au collège se heurtent à une forte hostilité de leur part, comme ils l'ont exprimé lors de la table ronde du 28 février 2006, la mission considère qu'il faut former et inciter les enseignants de sciences à travailler dans un cadre pluridisciplinaire. Un argument a été évoqué au cours de cette table ronde et il faut le prendre en compte. Les enseignants craignent que la bivalence ne conduise à un enseignement au rabais. M. Jean-Charles Jacquemin a expliqué que les futurs professeurs de physique et de chimie sont des physiciens et des chimistes passionnés, qui renoncent de fait à l'ambition d'être chercheurs pour enseigner la discipline qu'ils aiment. Si on leur dit qu'ils sont destinés à enseigner toute leur vie à des classes de sixième et de cinquième, on peut s'attendre à une chute brutale des vocations. De son côté M. Bruno Jeauffroy, enseignant en physique en classe préparatoire, a estimé que le niveau des candidats au dernier CAPES était déjà juste alors qu'il porte sur une discipline. Qu'en serait-il s'ils devaient en maîtriser deux ! Chaque enseignant peut rester maître de sa spécialité mais, s'il a acquis une bonne formation dans une discipline voisine, les cours peuvent néanmoins être élaborés en commun à partir de thèmes transversaux qui se prêtent à des approches croisées : l'eau, l'énergie, l'électricité, les plantes, la santé.... Les séances d'expérimentation, qui doivent être obligatoires au collège, se prêtent particulièrement bien à l'intervention de plusieurs enseignants sur un thème commun. À partir de la classe de quatrième, les enseignements diversifiés peuvent devenir bénéfiques à condition que soit maintenus un recours systématique à l'observation et à l'expérimentation et une liaison étroite entre les disciplines grâce à la définition de thèmes de convergences tels qu'ils sont évoqués dans un rapport établi par le groupe de relecture des programmes du collège remis au ministre de l'éducation nationale en 2004, sous la présidence de M. Jean-François Bach. Les thèmes de convergences proposés sont : les énergies, l'environnement, la météorologie et la climatologie, le mode de pensée statistique dans le regard scientifique sur le monde, l'éducation à la sécurité et l'éducation à la santé. Les jeunes ont une attirance naturelle pour le vivant et ont conscience des enjeux scientifiques pour l'humanité : la réalité d'une pratique expérimentale dès le collège axée sur des préoccupations sociétales devrait accroître leurs choix scientifiques ultérieurs. Cette rénovation en profondeur de l'enseignement des sciences est réclamée de manière pressante par l'Académie des sciences et par l'Académie des technologies qui ont rendu des avis convergents sur ces questions(21). À l'évidence des enseignements interdisciplinaires basés sur l'expérimentation demandent du temps et rendent inévitable un allègement substantiel des programmes. M. Jean-François Bach, membre de l'Académie des sciences, l'a clairement signifié à la mission. Le travers français qui consiste à ajouter des strates sans jamais en retrancher fait que les programmes sont un peu lourds. C'est grave car on aboutit à un enseignement superficiel où, pire encore, à ce que des pans entiers du programme ne soient pas enseignés. Cette manière de procéder est inconcevable. Selon lui, les programmes devraient être allégés, mais l'on n'y parvient pas parce que l'on se heurte à des réactions corporatistes. Il faudra pourtant faire un effort en ce sens tout en modernisant les programmes car, en voulant tout embrasser, on met tout au même niveau. Et comme les programmes actuels n'ont pas d'ossature, on n'insiste pas sur ce qui est véritablement important. Faute de hiérarchie dans ce qui est enseigné, les enfants terminent leur scolarité en ignorant des sujets qu'ils ne devraient pas ignorer. La province du Québec a fait le même constat et a entrepris une réforme profonde de l'enseignement des sciences (à l'exception des mathématiques) dans le primaire et le secondaire qui a été présentée avec enthousiasme, à la mission, par ses promoteurs du ministère de l'éducation du loisir et du sport. Le point de départ de la réforme au Québec a été le constat en 1997 que les élèves retenaient peu de choses de leurs enseignements en science, avaient souvent une conception erronée des problèmes et considéraient ces enseignements comme très élitiste. Les principes directeurs de la réforme reposent sur l'acquisition de compétences transversales (et l'abandon des objectifs fixés par matière), des situations d'apprentissage ouvertes, contextualisées, en lien avec le quotidien des élèves et la disparition des barrières disciplinaires y compris entre sciences et technologies. Les apprentissages ne sont plus centrés sur les contenus mais sur la capacité à résoudre des problèmes au moyen de connaissances puisées dans tous les domaines. La réforme a introduit à tous les niveaux scolaires des cours intégrés de sciences et de technologie qui doivent mettre l'accent sur l'application des sciences et la culture scientifique. En primaire, où très peu d'heures sont consacrées à l'apprentissage des sciences, le ministère envisage d'introduire un examen à la fin de ce cycle avec des épreuves de sciences afin de contraindre les enseignants à faire travailler leurs élèves dans ces matières. Les deux leviers de l'organisation de cette réforme, qui en est au tout début de sa mise en place, sont une réduction drastique des programmes et une réforme de la formation des enseignants. Les contenus des enseignements ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à s'intégrer dans des thèmes transversaux et les programmes du premier cycle du secondaire sont ainsi passés de 300 concepts (par exemple la cellule est un concept dans le système québécois) à 80 pour libérer du temps pour l'acquisition des compétences. Dans le second cycle, on est passé de 600 concepts à une centaine. Comme l'ont indiqué les interlocuteurs de la mission, le deuil de tous ces concepts a été douloureux mais le monde change très vite et il est devenu impossible de faire absorber aux élèves les sommes de connaissances produites d'années en années. L'essentiel pour les responsables du système éducatif québécois est que les élèves sachent réfléchir, communiquer et résoudre des problèmes en maintenant de très bonnes bases en mathématiques. Notons que le Québec a obtenu les meilleurs résultats du Canada aux évaluations PISA 2003 en mathématiques. La réforme de la formation des enseignants n'est pas achevée : elle repose sur une orientation vers la profession d'enseignant dès l'entrée à l'université(22) et la préparation d'une maîtrise d'enseignement en sciences. L'accès à la polyvalence des enseignants de sciences en activité ne pourra se faire que par la formation continue, qui va être considérablement développée sans toutefois devenir obligatoire. 5. L'évaluation sans disqualification M. André Antibi, agrégé de mathématiques, professeur à l'université Paul Sabatier de Toulouse, dénonce - notamment dans son livre « La constante macabre »(23) - le système de notation comme le dysfonctionnement le plus important de notre système éducatif. Il explique que sous la pression de la société les enseignants, souvent inconsciemment, jouent un rôle de sélectionneurs et sont ainsi à l'origine de l'échec scolaire artificiel d'une certaine proportion d'élèves : il qualifie ce phénomène de "constante macabre". Cette constante c'est le pourcentage constant d'élèves qui doivent se trouver en situation d'échec pour que le système soit crédible. Cela ne se joue pas à l'unité près mais correspond, grosso modo, à la règle des trois tiers : un tiers d'élèves en échec, un tiers d'élèves moyens, un tiers de bons. Inconsciemment ou non, un enseignant fait en sorte que les résultats de sa classe soient répartis ainsi, avec une moyenne générale avoisinant les 10-11. L'auteur relève également qu'en dessin, en musique, cette constante n'existe pas, parce que l'on estime que ces matières ne servent à rien. En lycée professionnel ou en classe d'ingénieurs, elle est également absente parce que la sélection s'est faite avant. Les objectifs de l'évaluation individuelle des élèves doivent être revus et précisés. M. Claude Thélot, conseiller maître à la Cour des Comptes et ancien président de la Commission du débat national sur l'avenir de l'école, a avancé des propositions qui tendraient à évaluer davantage la progression d'un élève plutôt que son niveau brut. La note, dans les matières classantes, a en France une valeur hautement symbolique contre laquelle il sera difficile d'aller même si elle est terriblement réductrice et souvent fatale ; mais pour l'éducation nationale la note crédibilise tout le système. Ne faudrait-il pas, si l'objectif de l'école est de former et non de trier, introduire dans l'évaluation individuelle des élèves la dimension de progression des acquis. Il faut passer de « l'évaluation sanction » ou récompense à « l'évaluation bilan » qui met en lumières les difficultés mais aussi les atouts et dont l'objectif principal est de motiver les élèves et de les aider à aborder les étapes suivantes. Les pays visités par la mission ont une politique beaucoup plus souple sur ces questions. · L'exemple de la Finlande En Finlande, où les méthodes pédagogiques privilégient chez les élèves la capacité à travailler en équipe, à prendre des responsabilités et à apprendre à apprendre, la note classement perd beaucoup de son intérêt. L'évaluation est un outil qui permet de mesurer l'engagement de l'élève, l'image qu'il a de ses facultés d'apprentissage et ses perspectives d'évolution. L'évaluation est très large, il n'y a pas de note de 0 à 20 mais les enseignants formulent des appréciations qualitatives et il n'y a pas de classement des élèves. La détection des difficultés ne se fait pas à travers les notes mais grâce à la présence d'enseignants spécialisés dans les classes. Chaque cohorte d'élèves suit une scolarité unique et commune pendant neuf ans, de 7 à 15 ans sans redoublement et sans orientation précoce, le rôle classant des notes est donc inutile. À 16 ans, 55 % des élèves entrent au lycée, 37 % en formation professionnelle, 2 % font une année supplémentaire et 6 % abandonnent les études. Notons par ailleurs qu'il existe une sélection assez rigoureuse à l'entrée à l'université. Sans forcément faire de lien avec ce qui précède, la mission a été étonnée d'apprendre qu'en Finlande les inspecteurs de l'éducation nationale n'existent plus depuis quinze ans, que les directeurs d'établissements contrôlent la qualité des enseignements et que les problèmes ou les incidents sont réglés au niveau de la province (il en existe quatre). Enfin un système d'évaluation national a lieu chaque année en mathématiques et en finnois sur un échantillon de 15 % d'élèves par établissement. · L'exemple du Canada Dans l'ensemble du Canada, à l'école primaire aucune note n'est attribuée aux élèves, les enseignants leur fixent des objectifs et s'ils ne sont pas atteints un programme de soutien est mis en place. Au Québec, dans le secondaire, depuis la mise en place de la réforme, on évalue des niveaux de compétences sur une échelle de compétences préétablie. · L'exemple de la Norvège Enfin, on peut signaler une expérience intéressante d'auto-évaluation des élèves en mathématiques, conduite en Norvège et présentée dans la revue internationale d'éducation précédemment citée. Cette initiative s'applique aux élèves de niveau 9 (15 ans) qui doivent passer un examen final et pour qui les mathématiques apparaissaient souvent comme une matière repoussoir. L'objectif est de stimuler et de développer la capacité des élèves à évaluer leurs propres connaissances, à mesurer la réalité de leurs progrès et à planifier leurs efforts futurs. Selon l'article qui relate cette expérience, ces activités permettent aux enseignants de mieux comprendre le processus d'apprentissage, les attitudes des élèves vis-à-vis de leur discipline et d'avoir une meilleure connaissance de l'impact de travail futur. Au bout de quelque temps, les élèves furent même entraînés à confectionner eux-mêmes certains de leurs tests en mathématiques. B. LA CRÉATION D'UNE VÉRITABLE FILIÈRE SCIENTIFIQUE AU LYCÉE 1. Créer une option sciences en classe de seconde C'est à l'issue de la classe de seconde que les lycéens font le choix d'une série. Cette étape est donc décisive pour l'orientation vers la série S puis vers l'enseignement supérieur scientifique. Pour choisir les sciences à bon escient, les élèves doivent être en mesure de percevoir l'intérêt de la voie scientifique, de comprendre l'esprit de la filière qu'ils choisiront et, pour cela, de s'essayer aux démarches qui lui sont spécifiques. La seconde est bien une classe de détermination puisqu'elle offre aux élèves, à côté des enseignements communs, deux enseignements qui doivent les aider dans les choix à venir. Or les enseignements de détermination actuellement offerts en seconde portent sur les sciences économiques, les langues vivantes ou anciennes, les arts, l'initiation aux sciences de l'ingénieur, les mesures physiques ou la biologie de laboratoire. Ces derniers enseignements à caractère technique ou technologique sont destinés à susciter des projets d'orientation vers les voies technologique et scientifique (BLP, ISI, MPI, PCL(24)). Mais curieusement on ne trouve pas d'enseignement associé à la culture scientifique au sens large, qui permettrait de percevoir la science dans sa globalité, de s'initier à la construction d'un savoir scientifique à travers la démarche expérimentale, ce qui devrait motiver les élèves - en particulier des filles -, pour faire le choix d'une voie générale scientifique. Car si l'enseignement dispensé en seconde dans les disciplines scientifiques s'efforce de donner à chaque lycéen un bagage scientifique minimum, il n'est pas suffisamment tourné, faute de temps, vers un enseignement rénové des sciences qui viendrait utilement prolonger les démarches pluridisciplinaires impulsées au collège. C'est pourquoi la mission s'associe à la proposition du groupe ActionSciences, qui regroupe quinze associations et sociétés savantes d'enseignants et de chercheurs, de créer un enseignement de détermination en seconde intitulé : « Démarches et culture scientifiques ». Il s'agirait d'un enseignement de détermination pluridisciplinaire, impliquant les divers professeurs de sciences, et s'appuyant sur les connaissances des élèves sans apport théorique spécifique, de façon à ne pas pénaliser ceux qui choisiront de se diriger vers la série S sans avoir pris cette option. Cet enseignement de détermination ne serait donc pas requis pour le passage en première S. Il serait axé sur la recherche, l'expérimentation, la lecture et la production de textes scientifiques, composantes essentielles de la démarche mathématique comme des sciences expérimentales et viserait d'abord à promouvoir une image des sciences dynamique et motivante. Le collectif ActionSciences indique que cet enseignement a déjà été expérimenté avec succès dans plusieurs établissements et que les réactions très favorables des élèves qui s'y pressent montrent qu'il répond manifestement à une attente. Cet enseignement devrait également faciliter le saut difficile entre la classe de seconde et la classe de première S car les élèves auraient appris l'autonomie et le plaisir de chercher. 2. Instaurer un véritable baccalauréat scientifique Avant la session de 1995 le baccalauréat scientifique comprenait les séries C (mathématiques et sciences physiques), D (mathématiques et sciences de la nature) et E (mathématiques et techniques), qui ont ensuite été réunies en une seule section S. Le baccalauréat S se divise lui-même en deux voies principales : sciences de la vie et de la terre (SVT), qui comporte au choix trois enseignements de spécialité (mathématiques, physique-Chimie et SVT), et sciences de l'Ingénieur (SI). Le choix d'orientation de cette dernière voie se fait dès l'entrée en première car les sciences de l'ingénieur y prennent la place des SVT et il est conditionné par le choix de l'option ISI (initiation aux sciences de l'ingénieur) en classe de seconde. Cette voie est très faiblement féminisée. L'objectif de la rénovation pédagogique de 1995 était de démocratiser la voie scientifique et d'harmoniser les enseignements fondamentaux pour tous les futurs scientifiques. La modification des baccalauréats s'est accompagnée de changements de volumes horaires en mathématiques, en physique-chimie et en SVT tels qu'ils apparaissent dans le tableau ci-dessous. Ces horaires n'incluent pas les enseignements de spécialité pour lesquels il faut ajouter 2 heures pour la matière choisie. Évolution des horaires en mathématiques, physique-chimie et SVT depuis 1982
Le résultat n'est pas ce qui était attendu. On constate, en effet, depuis la fusion des séries, une baisse importante et continue du choix de la spécialité « mathématiques », chez les garçons comme chez les filles (de l'ordre de 30 %), une augmentation presque parallèle du choix de la spécialité physique-chimie, essentiellement due aux filles et une quasi-stabilité du choix de la spécialité SVT. C'est ainsi qu'en 2004, 29 % des bacheliers scientifiques ont eu 7,5 heures de mathématiques hebdomadaires, les 71 % restants n'ayant eu que 5,5 heures. Donc non seulement le nombre de ces bacheliers a baissé, mais leur formation a considérablement évolué. Le problème est que pendant un nombre réduit d'heures il faut absorber un programme qui lui n'a pas diminué, ce qui se fait nécessairement au détriment des élèves les plus lents et au détriment de la qualité de l'enseignement. L'aboutissement de ces modifications est que la filière S est bien devenue la filière d'excellence, véritable choix stratégique pour les meilleurs élèves et les mieux informés, mais pas la meilleure préparation possible à des études scientifiques ultérieures. En 1995, 79 % des bacheliers scientifiques optaient pour des études scientifiques ou technologiques. En 2000, ils n'étaient plus que 68 %. Lors de la dernière rentrée 2000 places de classes préparatoires scientifiques n'ont pas été pourvues. Comme l'indique Mme Véronique Chauveau, il est frappant de constater qu'il est aujourd'hui possible, par le jeu des coefficients, d'obtenir le bac S avec une mauvaise note en mathématiques et des notes simplement moyennes dans les autres matières scientifiques. La filière S est celle qui compte le plus grand nombre de matières enseignées en terminale. Il faut rétablir un rééquilibrage entre les matières scientifiques et non scientifiques. La mission s'est procuré les notes moyennes en mathématiques au Bac S. Dans toutes les académies et pour les trois dernières sessions, la moyenne est toujours inférieure à 10 et les écarts types entre les notes sont de l'ordre de 5 points. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'exception des meilleurs élèves qui intègrent les classes préparatoires scientifiques (16,5 % des bacheliers scientifiques), les étudiants en DEUG scientifique ou en IUT éprouvent des difficultés en mathématiques. Les enseignants font observer, de surcroît, que si l'élève ne peut acquérir une certaine masse critique de connaissances et des bases solides, il y a moins de chance qu'il acquiert le goût des mathématiques. La mission considère qu'il faut recentrer la filière S sur les enseignements scientifiques et moderniser ces enseignements afin d'y attirer essentiellement les élèves ayant le projet de faire des études scientifiques et les y préparer au mieux. En allégeant les programmes dans les matières non scientifiques, du temps serait libéré pour développer des activités transversales pluridisciplinaires mais aussi pour augmenter les travaux pratiques et les séances d'expérimentation qui initient à la recherche scientifique. Il faudrait également, afin de redonner tout son poids à ce recentrage, introduire des épreuves d'évaluation des capacités expérimentales en SVT et en physique-chimie et même en mathématiques au baccalauréat. Comme l'a indiqué M. Bruno Descroix, membre de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, lors de la table ronde des enseignants, l'appétit pour les sciences existe. Il a cité l'exemple d'un projet d'école ouverte pendant les vacances pour faire des maths, qui a recueilli 130 inscriptions et a dû refuser des élèves. Ce qui empêche cet appétit de se développer, c'est le fait que les élèves croulent sous le travail dans les classes de premières et terminales scientifiques. Par ailleurs il faut regretter le manque de lien avec l'université, ce qui prive d'informations utiles non seulement les élèves mais aussi les professeurs. On peut raisonnablement considérer que la réorientation de la filière scientifique, qui ne serait plus la filière royale la plus recherchée mais la filière qui exige un véritable goût pour les sciences, contribuera à revaloriser les autres filières et notamment le baccalauréat littéraire. IV.- LA FORMATION ET LA MOTIVATION DES ENSEIGNANTS : Le rôle des enseignants est absolument déterminant, tant pour la motivation des élèves que pour leur réussite scolaire. Ici aussi le problème est universel, comme le souligne l'UNESCO : la pénurie de professeurs atteint un niveau sans précédent dans les pays du Nord comme du Sud. Cette profession, devenue à la fois plus exigeante et moins rémunératrice, a cessé d'attirer les plus doués. Alors que les experts réaffirment que les enseignants sont la clé de voûte d'une éducation de qualité, statuts, conditions de travail, perspectives de carrière et formations régressent avec constance. Cette donnée a été confirmée par tous les interlocuteurs finlandais de la mission qui expliquent les bonnes performances de leur système éducatif par le très bon niveau des enseignants qui optent dès l'entrée à l'université, après une épreuve de sélection, pour ce métier et s'y préparent pendant cinq ans avec en fin de cursus la délivrance d'un diplôme universitaire de deuxième cycle (master). Les enseignants jouissent d'un réel prestige dans ce pays, ce qui les place en situation favorable face aux élèves. De plus, leur formation intègre largement la dimension pédagogique et psychologique, la capacité à gérer des conflits en classe et le rapport aux parents. De son côté, M. Claude Boichot, inspecteur général de l'éducation nationale, a indiqué devant la mission : « Si nous avions le choix entre des programmes idéaux animés par des maîtres moyens et des programmes moyens animés par des maîtres idéaux, il est clair que nous opterions pour la deuxième solution ». Malheureusement tout le monde déplore aujourd'hui en France, non seulement des carences graves dans la formation initiale et la quasi-absence de formation continue pour tous les enseignants, mais aussi et peut-être surtout, une dévalorisation du métier et un déficit d'image sociale. Est-ce que la perte d'autorité dont souffrent nombre d'enseignants ne pourrait pas en partie s'expliquer par le manque de reconnaissance de la société à leur égard ? S'il faut apporter des remèdes à la démotivation des élèves c'est d'abord à la formation des enseignants qu'il faut s'attaquer. Toute solution passe par la formation des professeurs et rien ne se fera sans eux. A. LA SITUATION ACTUELLE EST TRÈS INSATISFAISANTE 1. Des professeurs des écoles sous-formés en science Les inspecteurs généraux du primaire, les chercheurs impliqués dans les actions de La main à la pâte comme les formateurs en IUFM, ont tous déploré la carence des professeurs des écoles dans les matières scientifiques et pour nombre d'entre eux, majoritairement des femmes, une sorte d'appréhension vis-à-vis de ces disciplines, remontant à leur propre scolarité. Il en résulte, dans une proportion importante d'écoles, la quasi-disparition des sciences, matières dans lesquelles les maîtres sont très rarement inspectés et le plus souvent, sauf pour ceux qui ont fait appel à La main à la pâte, un enseignement purement livresque. Les maîtres se sentent mal à l'aise avec la science et se considèrent mal formés ? ce qui est évidemment le cas pour les deux tiers d'entre eux qui ont passé un baccalauréat littéraire et n'ont plus fait de mathématiques ni de sciences depuis la fin de la classe de première. La situation actuelle, datant de la réorganisation des IUFM en 2000, est totalement insatisfaisante puisqu'elle limite la formation en sciences de la nature et en technologie à quelques dizaines d'heures sur deux années. Enseigner de façon intéressante et faire travailler les élèves pour l'apprentissage des mathématiques et des sciences demandent un grand professionnalisme. En effet, comme l'a indiqué M. Christian Orange, professeur d'université en sciences de l'éducation, si l'on se contentait il y a trente ans de faire lire des pages de manuel, il faut aujourd'hui mettre les élèves devant des expériences, susciter un échange d'idées et développer la pensée critique : c'est bien plus compliqué et cela implique une capacité à prendre en compte la pensée des élèves et les difficultés qu'ils rencontrent. C'est un travail passionnant et difficile et il y a quand même une contradiction entre une formation réduite et l'exigence de capacités professionnelles de ce niveau. En 2002, un plan de rénovation de l'enseignement des sciences à l'école primaire, adossé à de nouveaux programmes, a été mis en place mais dans le même temps les heures de formation consacrées aux sciences dans les IUFM diminuaient encore. Les programmes ne peuvent pas changer le comportement des professeurs, souvent aux prises avec des difficultés pour l'apprentissage de la lecture, et du calcul et qui n'ont pas perçu l'apport déterminant que pourrait représenter pour la progression générale des élèves une ouverture sur le monde de la science par l'expérimentation. Cette situation a été confirmée par M. Philippe Meirieu, directeur de l'IUFM de Lyon. Il considère qu'en mathématiques on est parvenu à stabiliser les connaissances à un niveau nécessaire mais pas suffisant. En revanche, les heures de formation aux disciplines expérimentales sont très nettement insuffisantes. L'horaire total de formation est de 400 heures, auxquelles s'ajoutent 50 heures pour les options, et le minimum obligatoire est, légitimement, de 100 heures en français et en mathématiques : ce qui reste pour l'ensemble des disciplines expérimentales est donc très faible. Avec un volume horaire de 20 heures ou 24 heures, au mieux 36 heures en sciences, puisque chaque IUFM dispose d'une marge d'appréciation, on ne peut faire qu'une toute petite initiation, qui ne permet en aucun cas de donner à la fois des connaissances et les éléments de base de l'enseignement de la biologie, de la géologie, des sciences physiques et de la chimie. De ce fait, les enseignants du premier degré n'auront que très rarement des lacunes en mathématiques mais des lacunes réelles en sciences expérimentales et en technologie. Alors que ce sont précisément les matières qui peuvent donner le goût des études scientifiques aux élèves. Il est notoire que les pratiques expérimentales sont plutôt en baisse dans les écoles ; lorsqu'elles demeurent, elles sont le fait d'enseignants marginaux et novateurs qui en ont le goût, mais elles ne sont pas systématisées. 2. Des enseignants du secondaire enfermés dans leur discipline Comme l'a exprimé M. Michel Lagües, directeur de l'espace sciences à l'École supérieure de physique et de chimie industrielles, l'un des obstacles majeurs à l'introduction des actions de La main à la pâte au collège est l'hyperspécialisation des enseignants et le tronçonnage des enseignements scientifiques. À aucun moment, ni dans le cadre de leurs études universitaires (elles-mêmes compartimentées en disciplines), ni au cours de la formation professionnelle à l'IUFM, ils n'ont appris à participer à un travail collectif et à une approche transversale des matières. Cette approche segmentée aboutit à se priver de la richesse pédagogique de tous les questionnements sur la science qui pourraient passionner les élèves, telles que les conditions de l'apparition de la vie sur la terre ou la question de savoir si nos sens sont fiables. Plus généralement l'histoire des idées scientifiques est en grande partie délaissée parce que les enseignants ne sont pas familiarisés avec cette approche de la science. Par ailleurs, aujourd'hui en France on peut être agrégé de mathématiques ou de physique sans savoir conduire une expérience. Or le problème essentiel est la motivation des élèves. Ils n'apprennent rien si on n'arrive pas à les accrocher en partant de leurs interrogations et en développant une pédagogie de résolution de problèmes concrets, par exemple comment faire voler un objet, ce qui débouche sur des questions de physique de technologie et de biologie. Il faut laisser les élèves interroger le monde et la science (le clonage, le big bang, le trou noir...) et il faut leur répondre en faisant preuve de beaucoup d'innovations pédagogiques. Tout cela demande encore une fois un gros travail en direction des enseignants car aujourd'hui le bon professeur est celui qui n'entend que les questions auxquelles il peut répondre c'est-à-dire celles qui sont dans le programme. Cette démarche exige une remise en cause des enseignants dans leur façon de travailler et dans leur rapport à leur propre discipline. Selon M. Michel Lagües, les enseignants du primaire qui n'ont pas de formation scientifique sont prêts à se lancer dans de nouvelles pratiques tout en conservant leur responsabilité de dirigeant de la classe. Ce n'est pas le cas au collège, où les professeurs de sciences sont sur la défensive et développent de nombreux blocages. C'est dommage car les enfants arrivent au collège avec un grand appétit d'apprendre et ils sont vite déçus. Le seul moyen serait de faire travailler les enseignants ensemble toutes disciplines confondues en privilégiant la méthode, l'esprit critique, la formation d'hypothèses, la confrontation des résultats sur la transmission des connaissances et la confrontation des conclusions au savoir établi. Le propre d'un chercheur c'est de se tromper mais c'est beaucoup plus difficile pour un enseignant. De même, l'usage des technologies de l'informatique et d'Internet ne doit pas être au centre de la démarche, c'est un outil qui nécessite que les enseignants soient formés autrement et développent une autre vision de leur métier. 3. Un déficit général de formation continue Citons un exemple à peine caricatural. Le volume de connaissances en biologie et en sciences de l'univers double tous les cinq ans : or, selon M. Jean Ulysse, membre de l'association des professeurs de biologie et de géologie, ces disciplines ont disparu des IUFM au cours de la dernière décennie. Son association organise des sessions de formation qui réunissent à chaque fois près de 750 professeurs, qui se déplacent à leur frais sans aucune prise en compte de cet effort volontaire ni même aucune assurance en cas d'accident. C'est dire l'énorme besoin de formation. Les chiffres sont particulièrement préoccupants : 50 % des enseignants ne font jamais de formation continue et, sur le total des 800 000 journées de formation, les sciences ne représentent que 2 %. En clair, comme l'a indiqué M. Pierre Léna, cela signifie qu'il faut cinquante ans pour faire passer tout le monde une fois. C'est évidemment un défaut majeur pour des disciplines qui changent très vite. M. Michel Fréchet, membre de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, a renchéri en disant que son association a organisé une session de formation à Caen, à laquelle ont participé 800 professeurs, sur leur temps de vacances. La presse, sollicitée, n'a pas répondu à l'invitation, mais le journal Libération a jugé plus utile de consacrer une demi-page à une conférence sur les OVNI qui se tenait dans le même temps. Selon les enseignants réunis par la mission, les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques (IREM), qui fonctionnent bien et font de la formation, seraient en danger faute de moyens financiers suffisants. Rendre obligatoire la formation continue des enseignants, qui pourrait être organisée en partie par les associations de professeurs et les sociétés savantes, et valoriser professionnellement cette formation a fait l'objet de l'approbation unanime des enseignants entendus par la mission. S'agissant des professeurs des écoles, le problème est tout aussi crucial. M. Christian Loarer, inspecteur général de l'enseignement primaire, fait état dans un rapport au ministre de l'éducation nationale d'octobre 2005(25), du recul en sciences de l'approche interdisciplinaire et de la démarche d'investigation. Il constate également chez les maîtres un manque de rigueur. Tout se passe, est-il écrit dans le rapport, comme si les enseignants étaient déstabilisés dans leur culture professionnelle par certaines méthodes mal assimilées, notamment pour tout ce qui tourne autour des activités d'éveil. Nombre d'enseignants semblent avoir abandonné leur rôle traditionnel de porteurs de connaissances et de valeurs pour leurs élèves vis-à-vis desquels ils semblent s'accommoder d'un faible niveau d'exigences. Il est clair que ces constats résultent de la difficulté à progresser et à s'adapter faute de formation continue et de formation didactique adaptées aux problèmes rencontrés. Il faut mettre en place à côté des stages de formation, des actions d'accompagnement dans les écoles afin d'aider les professeurs des écoles à surmonter leurs difficultés dans l'enseignement des sciences et il faut faire circuler les bonnes pratiques. Ils n'ont pour la plupart d'entre eux pas de formation scientifique mais ils peuvent parfaitement conduire des activités scientifiques avec leurs élèves, en utilisant notamment toutes les informations qui sont à leur disposition sur Internet ou celles communiquées par le ministère. C'est ce que M. Loarer a exprimé devant la mission en considérant que les professeurs des écoles demandent qu'on leur montre ce que signifie concrètement une démarche d'investigation et comment la conduire et ils demandent surtout de quelle façon il faut répartir au niveau des classes les programmes qui sont organisés par cycle de façon à aboutir à la fin du CM2 à un savoir structuré : faut-il favoriser la répétition, classe après classe, ou étaler l'enseignement sur la durée du cycle ? Il y a à tous les niveaux de notre système éducatif une forte demande et un impérieux besoin de formation continue des enseignants auxquels il faut répondre d'urgence. B. LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAÎTRES (IUFM) DOIVENT PROFONDÉMENT ÉVOLUER Créés par la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, les IUFM ont plusieurs missions. Ils sont tout d'abord chargés de la formation initiale de tous les enseignants du premier et du second degré, des conseillers principaux d'éducation, des instituteurs spécialisés de l'adaptation et de l'intégration scolaire (AIS) et, depuis 1993, des enseignants du second degré des établissements privés sous contrat ; ils assurent la mise en œuvre de la formation continue des enseignants ; enfin, ils contribuent à la recherche en éducation en partenariat avec les universités, l'Institut national de la recherche pédagogique (INRP), les grandes écoles et les grands établissements de recherche. Initialement établissements publics à caractère administratif, ils doivent désormais être intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés depuis la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. 1. Un cahier des charges très attendu La loi d'orientation du 23 avril 2005 prévoit la réorganisation du fonctionnement des IUFM. Avec la perspective du renouvellement de 150 000 enseignants entre 2007 et 2011, la rénovation en profondeur de la formation, tant dans les contenus que dans les méthodes est une occasion qu'il faut exploiter. La loi a prévu l'élaboration d'un cahier des charges retraçant les exigences posées par l'Etat pour la formation des maîtres. Le contenu de ce cahier des charges doit être fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis de Haut Conseil de l'éducation. Dans le cadre de l'examen, par la commission des affaires culturelles familiales et sociales, du rapport(26) de M. Frédéric Reiss sur l'application de la loi d'orientation, le 21 mars dernier, le ministre de l'éducation nationale, M. Gilles de Robien, a eu l'occasion d'expliquer pourquoi le décret très attendu instituant le cahier des charges n'était pas encore publié. Le ministre a déclaré que ce document est préparé par un collège de 22 experts chargé de définir la formation que devront recevoir l'ensemble des personnels enseignants formés en IUFM, c'est-à-dire les professeurs des premier et second degrés, les professeurs-documentalistes et les conseillers principaux d'éducation. Ce document comporte aussi des indications sur les compétences qui devront être acquises à la fin de la formation initiale et sur la manière dont les établissements accueillant les professeurs-stagiaires devront s'impliquer dans la formation de ces futurs professeurs. Ce cahier des charges a été soumis aux organisations syndicales et devrait être prochainement présenté au Haut Conseil de l'éducation. Selon le ministre, le cahier des charges définitif devrait être prêt à la fin du printemps. Les contenus disciplinaires et pédagogiques que les IUFM devront mettre en œuvre pour former les futurs enseignants auront un impact certain sur les nouvelles compétences de ces derniers. À ce titre, on peut regretter que rien ne soit prévu pour allonger la durée de formation, après le concours : elle dure environ sept mois ce qui est jugé trop court par tous les observateurs. L'Académie des sciences a insisté sur l'impérieuse nécessité de renforcer, dans le cahier des charges, les heures de formation en sciences des futurs professeurs des écoles. Cet enseignement scientifique devrait être compris entre 60 et 80 heures pour l'ensemble de la formation. Mais pour les scientifiques, la question n'est pas seulement quantitative, la formation doit établir des liens entre la science, l'histoire des sciences, l'apprentissage du français et l'expérimentation, autrement dit atténuer sinon supprimer les barrières entre les disciplines. Elle doit aller au-delà des stricts contenus enseignés à l'école primaire, pour donner une vision plus authentique et plus globale de la science, de ses méthodes, de son histoire. Une distinction trop poussée entre les diverses disciplines scientifiques n'est pas souhaitable non plus, ce qui implique une coordination entre les différents formateurs des IUFM. Une véritable pédagogie d'investigation doit être appliquée à l'IUFM. Enfin, les membres de l'académie considèrent que les scientifiques présents dans les laboratoires universitaires et acteurs d'une science vivante doivent être bien davantage associés à cette formation. M. Pierre Léna a exprimé la crainte, partagée par ses confrères de l'Académie des sciences, que le cahier des charges national se limite à donner de grandes orientations très vagues et qu'ensuite les universités, dont les IUFM dépendent, fassent les choses dans le désordre. S'agissant toujours de la formation des professeurs des écoles, l'académie s'est prononcée en faveur de la généralisation de la licence pluridisciplinaire qui pourrait devenir le mode d'accès privilégié à l'entrée en IUFM. L'ensemble de la formation devrait être validé par un master professionnel d'enseignement général, diplôme universitaire qui validerait la solidité des notions acquises et préserverait la possibilité de mobilité des enseignants notamment dans l'espace européen. Des dispositions analogues pourraient être appliquées aux titulaires du CAPES (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré) et du CAPET (certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique). Il faudrait identifier avec les nouveaux dispositifs LMD (licence, master, doctorat) dès l'entrée à l'université des parcours qui anticiperaient le futur métier d'enseignant. La France est un des rares pays qui ne professionnalisent pas d'entrée la filière de l'enseignement. Les contenus disciplinaires devraient également être pensés en fonction du futur métier. Cette évolution est amorcée avec l'apparition des licences pluridisciplinaires. 2. Améliorer la préparation des enseignants du secondaire Les IUFM ont également pour mission de préparer aux concours du CAPES et du CAPET et d'assurer une année de formation professionnelle aux lauréats de ces concours ainsi qu'à ceux de l'agrégation. L'évolution souhaitable, au collège et au lycée, d'un enseignement des sciences pluridisciplinaire et structuré autour de l'expérimentation et de l'investigation scientifique doit s'accompagner de modifications significatives de la formation des enseignants. Pour atténuer l'actuel excès de spécialisation, il est proposé d'introduire au programme du CAPES de physique-chimie une épreuve garantissant un niveau minimum de connaissances en sciences de la vie et de la terre et inversement. Par ailleurs, ces concours ainsi que la formation qui leur fait suite doivent garantir que le futur enseignant a une solide culture scientifique et une vision dynamique de la science et des relations interdisciplinaires. Au cours de l'année de formation professionnelle, les enseignants stagiaires doivent apprendre à mettre en œuvre la démarche d'investigation dans la classe. Ils doivent également être formés au bon usage des technologies de l'informatique et de la communication à l'appui de l'enseignement. Atténuer les barrières disciplinaires, favoriser la démarche expérimentale et d'investigation, veiller à la culture générale des enseignants, leur donner les bases d'un perfectionnement ultérieur doivent devenir les objectifs majeurs des IUFM. 3. Rendre plus attractif le métier d'enseignant dans le second degré M. Philippe Meirieu a attiré l'attention de la mission sur la désaffection significative pour l'enseignement des sciences dans le second degré. Selon lui, non seulement le nombre de candidats aux concours de recrutement baisse très fortement mais les désistements ne cessent d'augmenter parmi les étudiants inscrits en préparation au concours. Cela signifie qu'ils ont plusieurs stratégies professionnelles et que le concours de recrutement de l'Éducation nationale vient en second, sinon en dernier. Il y a donc un effritement significatif du nombre des candidats. M. Meirieu n'a pas exprimé la même inquiétude pour le premier degré, puisque des candidats titulaires de diplômes qui pourraient leur permettre d'enseigner dans les collèges et les lycées choisissent l'enseignement en primaire, tant ils redoutent une première affectation dans un collège difficile. Les cellules d'orientation des universités indiquent que le métier d'enseignant du second degré est de moins en moins attractif, singulièrement pour les disciplines scientifiques, car elles exigent un très haut niveau de qualification et de longues études qui font espérer un niveau de vie que l'enseignement ne paraît pas pouvoir offrir. M. Meirieu considère qu'il y a un retournement dans la perception qu'ont les étudiants de l'enseignement, à présent considéré comme un métier difficile et qui peut conduire à un déracinement, à des confrontations et à des problèmes humains difficiles. Tout au long de ses six mois de travail, la mission a fait deux constats essentiels : les jeunes, y compris les bacheliers scientifiques se détournent des filières scientifiques universitaires et les bacheliers d'origine modeste ajoutent à cela un besoin de sécurité qui les fait s'orienter de préférence vers les filières professionnelles courtes (IUT, BTS). Quant aux jeunes filles, elles réagissent de la même façon avec un rejet exacerbé pour les sciences physiques et les mathématiques. Il est bien évident que cette situation va conduire tout droit à l'assèchement du vivier de recrutement des enseignants en sciences et en mathématiques et à un fort risque de pénurie, qui se traduira notamment par une baisse significative du niveau. La situation n'est pas encore catastrophique parce qu'en période de chômage les jeunes recherchent la sécurité dans la fonction publique ; cependant, comme indiqué précédemment, en cinq ans le nombre de candidats aux CAPES de physique-chimie et de mathématiques a diminué significativement. Il est urgent de trouver des solutions et d'envoyer aux jeunes des messages forts. Les formations pluridisciplinaires ont beaucoup plus de succès auprès des étudiants que les études en sciences dures. Développer les licences pluridisciplinaires, afin de conduire à un enseignement moins monolithique et plus proche des réalités sociétales, est donc une première solution qui a été précédemment formulée. Mais la mission considère qu'il faut être plus volontariste et se rallie à une proposition formulée par l'Académie des sciences, consistant à réintroduire sous une forme aménagée les anciennes IPES (indemnités de préparation à l'enseignement secondaire). Il s'agirait de mettre en place une politique de prérecrutement qui jouerait le rôle d'ascenseur social pour toute une population d'étudiants qui n'ose pas entreprendre des études longues. En contrepartie d'une rémunération, qui devrait être supérieure au niveau le plus élevé des bourses actuelles, accordée aux lauréats d'un préconcours qui pourrait se situer à la fin de la première année du premier cycle universitaire, les bénéficiaires s'engageraient à passer les concours d'accès à l'enseignement secondaire et en cas de succès à servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. Enfin, un système préférentiel de bourses attribuées aux étudiants qui s'engagent dans un premier cycle universitaire scientifique devrait être envisagé afin d'attirer les étudiants de condition modeste effrayés par des études longues et aléatoires. * * * En conclusion, il faut insister sur trois points qui contribuent particulièrement à disqualifier les études scientifiques dans notre pays. Tout d'abord les mathématiques et les sciences exactes jouent un rôle d'outil de sélection dans notre système éducatif. Ce champ de connaissances est investi d'une charge émotionnelle importante et regardé, particulièrement par les filles, comme un enseignement d'élite inaccessible si l'on est simplement moyen. Soit on fait des sciences à un niveau très élevé, soit on n'en fait pas et ce dernier choix est fait par un nombre grandissant d'élèves. Cette situation est corroborée par les résultats obtenus dans les évaluations internationales. Le niveau en mathématiques de l'ensemble des élèves du secondaire français n'est pas supérieur à celui des étudiants des pays comparables. En revanche, un petit noyau d'élèves a des résultats très supérieurs à la moyenne. En second lieu, les filières scientifiques universitaires pêchent par leur manque absolu de lisibilité. Elles ne peuvent être associées à aucun devenir professionnel perceptible et motivant alors que, de surcroît, elles sont perçues comme arides et sans lien avec les interrogations sur le monde. Dans un univers instable et insécurisant, il faut être particulièrement courageux, voire héroïque, pour s'aventurer dans ce labyrinthe. Enfin, il faut anticiper la pénurie probable d'ici quelques années de candidats aux concours de recrutement d'enseignants du secondaire dans les disciplines scientifiques, cette pénurie découlant directement de la désaffection des jeunes pour les études universitaires en mathématiques et en sciences de la nature. C'est pourquoi la mission considère qu'il faut envoyer un message fort aux bacheliers et aux étudiants, sous forme d'un prérecrutement, de nature à transformer l'image des études universitaires scientifiques longues. ¬ Redonner toute sa place à l'enseignement des sciences en formant et en accompagnant les maîtres. ¬ Généraliser les méthodes d'apprentissage par l'expérimentation et l'investigation en liaison avec des scientifiques. ¬ Développer le calcul mental et l'apprentissage des techniques opératoires des quatre opérations dès le cours préparatoire. ¬ Lutter contre la présentation sexuée des activités. AU COLLÈGE ¬ Rompre avec le cloisonnement des disciplines scientifiques en les faisant converger selon une approche pluridisciplinaire autour de thèmes communs. ¬ Rendre obligatoire les activités d'investigation, d'observation et d'expérimentation dans une approche interdisciplinaire. ¬ Passer progressivement de la science (en classe de sixième et de cinquième) aux sciences plus diversifiées, en privilégiant la mise en histoire des sciences. ¬ Encourager et former les enseignants à pratiquer la bivalence en prenant en charge deux matières scientifiques voisines et en faisant travailler les élèves sur des thèmes de convergences. ¬ Développer les laboratoires de mathématiques, en s'appuyant sur les expériences en cours. ¬ Permettre aux principaux de collèges de mettre en place à titre expérimental, dans le cadre de leur projet d'établissement des enseignements pluridisciplinaires sur des thèmes scientifiques transversaux définis en commun par les enseignants. ¬ Organiser des concours inter-établissements sur des thèmes scientifiques avec l'exposition des résultats des meilleurs travaux. ¬ Mettre en valeur la dimension culturelle du savoir scientifique. ¬ Intégrer les technologies à tous les enseignements scientifiques. ¬ Aider les filles à mieux valoriser leurs capacités et à lutter contre l'auto-censure vis-à-vis des mathématiques et des sciences. AU LYCÉE ¬ Développer l'enseignement des mathématiques comme science vivante en interaction avec les autres sciences et se construisant sur des problématiques très variées. ¬ Développer les laboratoires de mathématiques en s'appuyant sur les expériences en cours. ¬ Créer et généraliser une option science en classe de seconde. ¬ Recréer une véritable filière scientifique en première et terminale en allégeant les programmes dans les matières non scientifiques. ¬ Introduire des épreuves d'évaluation des capacités expérimentales en mathématiques, en sciences et vie de la terre et en physique-chimie au baccalauréat scientifique. ¬ Consacrer un temps suffisant aux activités de recherche et d'investigation qui favorisent le développement des capacités de raisonnement et de construction des savoirs. ¬ Réintroduire l'épreuve de mathématiques au baccalauréat en terminale littéraire, au besoin en réduisant le volume horaire dans d'autres matières. ¬ Introduire une meilleure articulation entre les programmes et les méthodes de travail de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. ¬ Encourager et développer les activités scientifiques dans et hors l'école, sur des thèmes transversaux encadrés par des chercheurs ou des ingénieurs. ¬ Favoriser le développement des clubs scientifiques et l'organisation de compétitions nationales et internationales sur le modèle des Olympiades de physique et de Maths sans frontières. À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAÎTRES ¬ Introduire dans les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des professeurs des écoles une épreuve obligatoire de sciences de la nature et de technologie. ¬ Assurer un niveau de connaissances scientifiques et de culture scientifique suffisant aux professeurs des écoles avec un minimum de 100 heures de formation au cours des deux années d'Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). ¬ Former les enseignants scientifiques du secondaire au travail en équipe et à l'approche pluridisciplinaire des sciences. ¬ Introduire dans les concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement de second degré (CAPES) et de l'agrégation de mathématiques et de sciences de la nature des épreuves obligatoires permettant de mesurer la réalité d'une culture scientifique, historique et technologique. ¬ Introduire dans les concours du CAPES de mathématiques, de physique-chimie et des sciences de la vie et de la terre des éléments de connaissances solides dans une autre discipline scientifique, ces connaissances faisant l'objet d'une épreuve d'admissibilité affectée d'un coefficient. ¬ Introduire au cours de l'année de formation professionnelle des enseignants stagiaires titulaires d'un CAPES ou d'une agrégation scientifiques un stage obligatoire dans un laboratoire de recherche. ¬ Renforcer au cours de la formation l'apport de la didactique des mathématiques et des sciences et consacrer un nombre d'heures suffisant aux questions de pédagogie et à la causalité des comportements d'apprentissage, notamment des comportements féminins. ¬ Rendre obligatoire la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire, cette formation étant prise en compte dans l'évolution des carrières. À L'UNIVERSITÉ ¬ Généraliser les licences pluridisciplinaires. ¬ Accorder, dès la fin de la première année de licence (L1), des bourses au mérite sans condition de ressources, pour les étudiants qui entreprennent des études universitaires scientifiques. ¬ Mettre en place une politique de prérecrutement des futurs enseignants du secondaire, assorti d'une indemnité de préparation à l'enseignement secondaire. ¬ Développer par tous les moyens les contacts et les actions communes entre les enseignants-chercheurs et les enseignants du secondaire afin de rapprocher les méthodes de travail au lycée et à l'université. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent rapport d'information au cours de sa réunion du mardi 2 mai 2006. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. M. Pierre-André Périssol a souligné les nombreux points de convergence existant entre les conclusions de ce rapport et celles du rapport de la mission d'information sur la définition des savoirs enseignés à l'école, notamment en ce qui concerne le décloisonnement des disciplines et l'accent mis sur les capacités d'observation et d'expérimentation. Ce constat se retrouve également dans l'avis du Haut conseil de l'éducation sur le contenu du socle commun des connaissances et des compétences. Nous nous trouvons à un tournant entre un mode de pensée qui perdure depuis des décennies et une nouvelle approche qu'il est nécessaire de conduire pour revaloriser les filières scientifiques. Soit on conserve une définition basée sur les acquis en termes de simples connaissances, ce qui conduit à une approche essentiellement disciplinaire favorisant l'intelligence spéculative et abstraite, soit on prend en compte les compétences et toutes les formes d'intelligence, notamment pratiques et expérimentales, et ce aussi bien dans le socle commun des connaissances que dans l'évaluation des enseignements et la formation des maîtres. Une définition moderne du socle commun est donc fondamentale et il conviendra d'être extrêmement vigilant pour que les observations de ces différentes missions d'information parlementaires soient prises en compte par les rédacteurs du décret. Lors de son audition par la commission le 21 mars 2006, M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est engagé à associer le Parlement à l'élaboration du socle commun. C'est un point important sur lequel l'ensemble des parlementaires devront être attentifs. M. Frédéric Reiss a indiqué que les conclusions du rapport sont tout à fait conformes aux observations de la mission. Le diagnostic est implacable mais la France n'est pas seule à le faire, comme la mission a pu le constater lors de déplacements à l'étranger. L'initiative des « scientifines » menée au Québec apparaît tout à fait intéressante et originale, notamment dans sa dimension d'intégration sociale, ce type d'initiative constituant une réponse au désintérêt des filles à l'égard des filières scientifiques. Le déplacement de la mission au Vaisseau, à Strasbourg, a également permis de constater les efforts menés localement par le conseil général pour que les jeunes puissent découvrir les sciences de manière ludique. Il est nécessaire de faire acquérir aux jeunes une véritable démarche de chercheurs et à cet égard l'exploitation pédagogique de ces différentes expériences mérite d'être intégrée à la formation des maîtres en IUFM. Les recommandations du Haut conseil de l'éducation sur la définition du socle commun rejoignent celles de la mission s'agissant de l'acquisition des compétences expérimentales et de la nécessité de donner le goût des sciences au plus grand nombre. L'audition par la mission de l'ancien ministre de l'éducation, M. Luc Ferry, a mis en évidence que l'appréhension des sciences en termes de risque plutôt que de progrès est liée à la naissance de l'écologie radicale. Des questions comme celles relatives aux organismes génétiquement modifiés (OGM) ou à l'effet de serre ne sont certes pas négligeables mais ce n'est pas en faisant moins de science que l'on résoudra les problèmes. Il est nécessaire de présenter la science de manière attrayante afin de susciter des vocations et la formation des enseignants doit impérativement évoluer dans ce sens. Il faut également souligner le rôle capital des chefs d'établissement sur ces questions. L'enseignement des mathématiques ne repose pas sur des bases assez solides, il faut insister sur les tables de multiplication, le calcul mental, les représentations graphiques... Beaucoup de personnes auditionnées ont souligné l'importance de la pratique de la division et la nécessité d'acquérir de la rigueur et des repères clairs dès le plus jeune âge, ce qui n'exclut pas ensuite la découverte du doute scientifique. En ce qui concerne les sections « S », force est de constater que l'enseignement des mathématiques y est en recul et que ces sections ne revêtent plus le même caractère scientifique qu'auparavant. Il s'agit d'une des conséquences perverses de la démarche s'attaquant à l'hégémonie des mathématiques dans les filières scientifiques. Les sections « S » sont devenues des sections généralistes, dans lesquelles les mathématiques et les sciences sont enseignées de manière superficielle, ce qui favorise une nouvelle forme d'élitisme. Parmi les propositions de la mission concernant le lycée, le développement de l'enseignement des mathématiques comme science vivante en interaction avec les autres sciences est particulièrement importante ainsi que la création et la généralisation d'une option science dès la classe de seconde. Cette option pourrait en effet favoriser l'acquisition d'une culture scientifique et motiver les candidats indécis. Il est également indispensable d'insister sur l'aventure scientifique et l'enthousiasme qui caractérisent la recherche scientifique. Aussi doit-on mettre un terme au désamour entre la science et la communication et afficher clairement la volonté de diffuser plus de culture scientifique à la télévision. Des émissions d'un format court de l'ordre de treize minutes, comme cela se pratique à la BBC, pourraient retracer l'histoire des découvertes ou la vie de grands scientifiques. Les cahiers des charges des chaînes publiques devraient contenir l'obligation de produire de telles émissions scientifiques car, comme l'a rappelé récemment l'Académie des sciences, elles illustrent la grande aventure de l'esprit humain. M. Yves Boisseau, président, a rappelé que l'amélioration de l'enseignement des disciplines scientifiques poursuit deux objets : la formation au meilleur niveau d'ingénieurs et de chercheurs, l'augmentation du niveau général de connaissances de la population. Bien que la mission ait procédé à de très nombreuses consultations et auditions, la question de savoir si notre pays, en ce qui concerne l'enseignement scientifique, fait mieux ou moins bien que les autres, reste posée. Il est curieux de constater à la fois un niveau de formation moyen et de grandes réussites scientifiques et industrielles. Il importe en tous les cas d'améliorer considérablement l'enseignement scientifique dans le primaire et le secondaire, ce à quoi contribuent les propositions du rapport de la mission d'information. En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes : - Il est primordial que le Parlement soit bien associé à la définition du socle commun de connaissances et de compétences ; - La rénovation de l'enseignement scientifique passe par le développement des musées scientifiques et l'utilisation des médias. Il est indispensable de promouvoir significativement les émissions de nature scientifique dans le paysage audiovisuel français. Cette proposition a déjà été formulée, notamment dans un rapport d'information du Sénat sur la diffusion de la culture scientifique, déposé le 10 juillet 2003, mais elle garde tout son intérêt. S'agissant des musées, la mission a visité la Cité des sciences et le Palais de la Découverte à Paris ainsi que le « Vaisseau » à Strasbourg, initiative du département du Bas-Rhin. Il s'agit d'un beau succès de la décentralisation scientifique, qui permet de rompre avec l'inégalité territoriale dans l'accès à la culture scientifique et applique les principes de l'action de La main à la pâte en privilégiant l'observation et la manipulation. - Les programmes de la terminale S sont effectivement les plus chargés et pas seulement dans les matières scientifiques ; il est nécessaire de les alléger, mais par où commencer ? - Il est évident que les discours récurrents sur les scientifiques, assimilés à des apprentis sorciers ou au docteur Frankenstein, provoquent un désamour pour la science et une crise des vocations pour un métier jugé par ailleurs difficile et peu lucratif ; M. Luc Ferry a raison de dénoncer ces mythes de la dépossession, qui rencontrent un écho d'autant plus grand que la mondialisation libérale effraye. - Il est essentiel d'améliorer les conditions de l'enseignement scientifique afin d'accroître le nombre et la qualité des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens de notre pays. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, les enjeux de recherche et développement constituent des questions fondamentales pour l'indépendance nationale. Il est également nécessaire de mieux former les citoyens pour qu'ils puissent se déterminer en toute autonomie et participer pleinement aux débats sur les questions scientifiques ; - La promotion des filles en matière d'enseignement scientifique est un sujet central, rien ne justifie qu'elles soient plus nombreuses en médecine qu'en physique et en chimie. En application de l'article 145 du Règlement, la commission a décidé le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication. Députés M. Jean-Marie Rolland, président-rapporteur, député de l'Yonne (UMP) M. Yves Boisseau, député du Calvados (UMP) M. Yves Durand, député du Nord (Socialiste) M. Yvan Lachaud, député du Gard (UDF) M. François Liberti, député de l'Hérault (CR) M. Daniel Prévost, député de l'Ille-et-Vilaine (UMP) M. Frédéric Reiss, député du Bas-Rhin (UMP) Mme Irène Tharin, députée du Doubs (UMP) LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES (par ordre alphabétique) ¬ M. Thierry Aubin, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, membre de l'Académie des sciences, section mathématiques ¬ M. Jean-François Bach, professeur à l'université René Descartes, membre de l'Académie des sciences, section biologie humaine et sciences médicales ¬ Mme Geneviève Berger, ancienne directrice du CNRS, chercheure en biophysique ¬ M. Norberto Bottani, directeur du service de la recherche en éducation du département de l'instruction au canton de Genève ¬ M. Christian Bréchot, directeur de l'INSERM ¬ M. Edouard Brézin, président de l'Académie des sciences ¬ M. Rémi Brissiaud, chercheur en didactique des mathématiques, enseignant à l'IUFM de Versailles, auteur d'ouvrages sur les mathématiques en primaire ¬ M. Georges Charpak, professeur émérite à l'école de physique et chimie industrielle et physicien de l'organisation européenne pour la recherche nucléaire membre de l'Institut de France ¬ Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques, membre de l'association Femmes et Sciences ¬ M. Xavier Clément, directeur de la communication et porte-parole du CEA, et M. Jean-Pierre Vigouroux, chargé des relations avec le Parlement ¬ M. Roland Debbasch, directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ¬ M. Jean-Pierre Demailly, professeur à l'université de Grenoble I, Institut Fourier, président du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes (GRIP), et M. Michel Delord, vice-président du GRIP ¬ Mlle Eva Dumontet, secrétaire nationale de l'Union nationale lycéenne (UNL), et Mlle Floréale Mangin, secrétaire nationale aux questions de société ¬ M. Jean-Jacques Dupin, professeur des universités en physique à l'IUFM d'Aix-Marseille, chercheur en didactique des sciences, ancien Vice-président de la Conférence des directeurs d'IUFM ¬ M. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale et de la recherche, ancien président du Conseil national des programmes, président du Conseil d'analyse de la société ¬ M. Christian Forestier, membre du Haut conseil de l'éducation, ancien président du Haut conseil de l'évaluation de l'école ¬ M. Michel Fréchet et M. Bruno Descroix, membres de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP) ¬ M. Farid Hamana, secrétaire général de la fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE), et M. Gilbert Lambrecht, membre de la FCPE ¬ M. Anders Hingel, direction de l'éducation de la Commission européenne ¬ M. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint à la direction de l'éducation de l'OCDE ¬ M. Pascal Huguet, directeur de recherche au laboratoire de psychologie cognitive d'Aix-Marseille (CNRS) ¬ M. Jean-Charles Jacquemin, Président de l'union des professeurs de physique et de chimie (UdPPC), et Mme Marie-Fraçoise Karatchentzeff, membre de l'association ¬ M. Jean-Pierre Kahane, professeur émérite de mathématiques, membre de l'Académie des sciences, président de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques ¬ M. Michel Kasser, directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ¬ M. Laurent Lafforgue, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques (IHES), médaille Fields 2002 ¬ M. Michel Lagües, directeur de l'espace sciences à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles (ESPCI) ¬ M. Pierre Léna, professeur à l'université Denis Diderot, membre de l'Académie des sciences, section sciences de l'univers ¬ M. Christian Loarer, inspecteur général de l'enseignement primaire ¬ M. Yves Malier, professeur d'université, membre de l'Académie des technologies, ancien directeur de l'Ecole normale de Cachan ¬ M. Christian Margaria, directeur de l'Institut national des télécommunications, président de la Conférence des grandes écoles ¬ M. Philippe Meirieu, directeur de l'IUFM de Lyon ¬ M. Jean-Marc Monteil, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ¬ Mme Claudine Peretti, directrice de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ¬ M. Dominique Perrin, directeur de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE), de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) ¬ M. François Perret, doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale et M. Claude Boichot, inspecteur général ¬ M. Antoine Petit, directeur interrégional Sud-Ouest du CNRS, et M. Hervé Mathieu, secrétaire général du CNRS ¬ M. Marc Peyrade, directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications ¬ M. Yves Quéré, membre de l'Académie des sciences, co-fondateur de La main à la pâte ¬ Mme Marie Reynier, directrice générale de l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), présidente de la commission Amont de la Conférence des grandes écoles ¬ M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ¬ M. Elie de Saint-Jores, chef de service formation initiale au sein de la direction de la formation du MEDEF ¬ M. Jean-Michel Schmitt, président de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI) ¬ Mme Eliane Vernet et M. Jean Ulysse, membres de l'association des professeurs de biologie et géologie (APBG) ¬ M. Yohan Yebbou, président de l'union des professeurs de spéciales (UPS), et M. Bruno Jeauffroy, secrétaire général ¬ N.B. : La Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) a décliné la proposition d'audition faite par la mission LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES DÉPLACEMENT EN FINLANDE ET EN SUÈDE (du 22 au 25 janvier 2006) À Helsinki _ Entretiens à la Direction des écoles de Finlande : - M. Jorma Kuusela, spécialiste de planification sur les sciences cognitives et la recherche en science de l'éducation dans les écoles finlandaises - Mme Riitta Lampola, directrice des relations internationales _ Entretiens sur la formation des enseignants en Finlande : - M. Teijo Koljonen, conseiller spécial - M. Leo Pahkin, conseiller d'éducation, spécialiste des méthodes d'enseignement des mathématiques et des sciences dans l'école de base et dans le lycée en Finlande _ Visite de l'école de Kulosaari Secondary School : - Entretien avec Mme Kyllikki Vilkuna, proviseure À Stockholm _ Table ronde au service culturel de l'Ambassade : - M. Laurent Devèze, M. Pierre-Julien Trombe et Mlle Nadia Nguyen, chargés de mission scientifique, Mme Anne-Karine Lescarmontier, du Service culturel et scientifique de l'Ambassade, M. Bertil Carstam et Mlle Mylène Savoye - Association franco-suédoise pour la Recherche (AFSR), M. Torsten Kälvemark représentant de Högskolverket, l'Agence Nationale de l'Enseignement Supérieur, Mme Vanja Jarl-Liljigren, M. Lars Axsäter et M. Lars Valentin, enseignants scientifiques de Franska Skolan (Ecole Française), M. Christian Nonnenmacher, proviseur du Lycée Saint-Louis, M. Cyril Mailloux et M. Jérôme Labarbe, professeurs au lycée Saint-Louis, des étudiants scientifiques suédois et français ayant effectué une partie de leur cursus scolaire et universitaire en France et en Suède, Mme Ulrika Rasmussen - programme NTA (Sciences pour tous), Mme Françoise Sule, professeur à l'université de Stockholm _ Entretien avec Mme Elisabeth Sörhuus, directrice de l'école Hyllingeskolan à Spanga Tensta qui présente un profil « scientifique » spécial avec une stratégie spécifique en matière d'enseignement des disciplines scientifiques - Visite de l'école _ Entretien avec M. Ulf Lundgren, professeur d'université, ancien directeur général de l'agence d'évaluation et de pilotage du système éducatif suédois à l'Institut de recherche pédagogique d'Uppsala _ Entretiens avec M. Erick Henriks et M. Gôran Isberg, de l'Agence nationale de l'éducation DÉPLACEMENT AU CANADA (du 1er au 6 mars 2006) _ Entretiens à l'ambassade à Ottawa avec: - Mme Diane Pennock coordonnatrice du programme PISA pour tout le Canada, au Conseil des ministres de l'Éducation, Mme Marie-Josée Berger, doyenne de la Faculté d'Education de l'Université d'Ottawa, Mme Renée Forgette-Giroux, vice-doyenne de la faculté d'Education de l'Université d'Ottawa, M. Louis Trudel, professeur de didactique des Sciences au secondaire à la faculté d'Education de l'Université d'Ottawa, Mme Donatille Mujawamariya, chercheure et enseignante en didactique des sciences au secondaire et responsable de l'Unité de recherche éducationnelle sur la culture scientifique à la Faculté d'éducation _ Entretiens au Centre Franco-Ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) - M. Robert Arseneault, directeur du centre, Mme Monique Châteauvert, chef du bureau régional d'Ottawa du Ministère de l'Éducation de l'Ontario _ Visite d'une école secondaire, le Collège Catholique Samuel-Genest, du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l'Ontario et entretien avec Mme Carole Morrissette, spécialiste des programmes de science au niveau secondaire _ Visite d'une école élémentaire publique Le Prélude, du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario et entretien avec Mme Michelle Lapointe, spécialiste des programmes de science au niveau élémentaire _ Dîner de travail avec : - M. Jacques Chagnon, ancien ministre de la sécurité publique, président de la commission de l'éducation à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Diane Gagnon, directrice des affaires internationales et canadiennes du ministère de l'éducation, du loisir et du sport, Mme Julie Bissonette, direction des affaires internationales et canadiennes du ministère de l'éducation, Mme Marie-France Germain, Conseil de la science et de la technologie, Mme Claire Deschênes, Département de génie, Université Laval, (spécialiste de la question« femmes et sciences ») _ Petit-déjeuner de travail à Québec avec : - Mme Renée Moreau, direction de la culture scientifique et de la relève, ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation, Mme Francine Lacroix, direction de la culture scientifique et de la relève, ministère du développement économique, de l'innovation et de l'exportation, Mme Paquin (projets d'intégration des sciences et des technologies en enseignement au secondaire [Pistes] de l'Université Laval), M. Yvon Fortin, centre de démonstration en sciences physiques, M. Robert Plamondon, centre de démonstration en sciences physiques _ Visite de l'école l'Etincelle à Sainte-Marie en Beauce et entretien avec M. Stephan Baillargeon, responsable des services pédagogiques de la commission scolaire de Beauce-Etchemin, présentation des projets d'expérimentation avec les élèves _ Rencontre-bilan avec dix enseignants du primaire ayant expérimenté la démarche d'investigation raisonnée en science _ Entretiens au ministère de l'éducation, du loisir et du sport à Montréal avec M. Patrick Charland (Direction de la formation des jeunes), M. Patrice Potvin, professeur à l'UQAM (Formation initiale des enseignants du primaire et du secondaire _ Table-ronde avec des représentants de trois projets mis en oeuvre par des équipes de Montréal soutenues par le ministère du développement économique de l'innovation et de l'exportation : - Mme Maria Dolorès Otero, responsable du projet « l'école montréalaise pour l'enseignement des sciences et de la technologie », - Mme Charlène Bélanger, responsable du projet « Eclairs de sciences » - Mme Marcela Cid, responsable du projet « La clé des sciences » DÉPLACEMENT AU LYCÉE CAMILLE SÉE À PARIS (18 janvier 2006) - Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques et des élèves de l'atelier MATh.en.JEANS DÉPLACEMENT AU VAISSEAU À STRASBOURG (1er février 2006) - Guy-Dominique Kennel, vice-président du Conseil général du Bas-Rhin et président de la commission de pilotage du Vaisseau, Mme Anne Weber, directrice du Vaisseau, M. Jean-Marc Planeix, directeur adjoint de l'IUFM Alsace, M. Hubert et M. Bartholet, enseignants en mathématiques et membres de « Maths sans frontières », association qui organise des compétitions inter-classes pour les collégiens et les lycéens, M. Etienne Meyer, inspecteur d'académie. DÉPLACEMENT AU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE À PARIS - M. Guy Simonin, directeur scientifique, Mme Brigitte Zana, directrice du développement, de l'éducation et des réseaux DÉPLACEMENT À L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL LANGEVIN À CLICHY-SOUS-BOIS (9 mars 2006) pour une séance de La main à la pâte - Mme Marie-France Joncoux, enseignante de CP, a accueilli la délégation dans sa classe en présence de Mme Weiss, inspectrice des écoles et de M. Pierre Léna, membre de l'Académie des Sciences DÉPLACEMENT À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE À PARIS (14 mars 2006) - M. Guillaume Boudy, directeur général, M. Jean-Marie Sani, directeur des publics, et M. Joël de Rosnay, conseiller du président du musée. LES ÉVALUATIONS NATIONALES EN 2005 EN MATHÉMATIQUES BILAN ÉTABLI PAR LA DIRECTION DE L'ÉVALUATION ET DE LA PROSPECTIVE Depuis 1989, l'éducation nationale organise des évaluations diagnostiques auprès des élèves de CE2 et de 6ème en français et en mathématiques. Les résultats sont présentés comme des outils professionnels qui aident les enseignants à déterminer les acquis et les faiblesses des élèves. Les résultats nationaux réalisés à partir de la synthèse des résultats particuliers ne sont que des repères et ne constituent pas un bilan du cycle 2 (classes de CP et de CE1) ou du cycle 3 (classes de CE2, CM1 et CM2) mais un diagnostic, au début d'un nouveau cycle scolaire, des réussites, des erreurs et des difficultés éventuelles de chaque élève par rapport à son avancée dans les apprentissages. Les épreuves élaborées ne couvrent pas exhaustivement les connaissances et les compétences acquises ou en cours d'acquisition. Elles n'évaluent que ce qui peut relever d'une passation collective, à travers des exercices courts et écrits. Les réponses des élèves de CE2 à l'évaluation de septembre 2005 Synthèse Mathématiques CE2 Champ « calcul » Les additions sont maîtrisées par plus de huit élèves sur dix tant en calcul mental qu'en calcul posé. On peut cependant noter que les élèves rencontrent des difficultés lorsque l'addition comporte plus de deux termes. En effet, pour les additions très simples, la meilleure performance est obtenue sur « 2 + 8 » (95% de réussite) ; un élève sur dix ne donne pas « 9 + 9 » ou « 5 + 6 » ou « 9 + 4 » ; 2 sur 10 échouent sur « 8 + 7 ». Au-delà de l'inattention de certains élèves, on constate qu'un nombre non négligeable d'élèves n'ont pas acquis totalement la table d'addition. Les calculs de différences (à l'exception toutefois de la complémentation à 10 : 71%) et de produits constituent des exercices difficiles pour l'ensemble des élèves. Si quatre élèves sur cinq savent trouver immédiatement le résultat de « 50 - 30 », il n'y en a qu'un sur deux à trouver « 40 - 8, » et un sur 3 pour « 45 - 9 ». Champ « Connaissance des nombres » Les dictées de nombres sont très bien réussies : qu'il s'agisse des nombres à 2 chiffres ou à 3 chiffres, les scores sont supérieurs à 92 % et atteignent même 97 %. Sept élèves sur dix sont capables de sélectionner dans une liste des nombres appartenant à un intervalle donné. C'est un exercice qui requiert de tenir compte de deux contraintes, connaissance de la notion d'ordre et de la position des chiffres, auxquelles s'ajoutent les difficultés liées aux réponses multiples. La compétence de comparaison n'est pas complètement installée. Plus de neuf élèves sur dix savent associer les désignations chiffrées et orales des nombres de 1 à 1000 et plus de huit élèves sur dix sont capables de restituer les doubles de nombres inférieurs à 10. Des difficultés apparaissent avec le terme « moitié » quand il y a nécessité d'effectuer un calcul ; par exemple, « moitié de 30 » ou « moitié de 24 ». Les élèves parviennent à trouver un nombre correspondant à une graduation lorsque l'intervalle représente une unité. En revanche, une difficulté apparaît lorsque la droite est graduée de 10 en 10. Cet exercice complexe est réussi par six élèves sur dix. Champ « exploitation des données numériques » Les problèmes additifs ont des résultats supérieurs à ceux des problèmes soustractifs. Notons toutefois qu'un tiers des élèves reconnaît la situation soustractive. On retrouve dans ce champ les difficultés soulignées dans le champ « calcul ». Environ un tiers des élèves n'utilise pas les cadres de recherche. On peut émettre l'hypothèse qu'une part non négligeable de ceux-ci a effectué un calcul mental. Les scores de réussite concernant les problèmes de partage et de groupement montrent l'aptitude de plus de six élèves sur dix à développer des procédures personnelles efficaces. La procédure experte est présente plus souvent pour la multiplication que pour la division. Près de 8 élèves sur 10 déterminent un rang dans une série et trouvent un objet à partir de son rang. La première opération est plus difficile que la seconde. Champ « espace et géométrie » La construction du carré et du rectangle était testée dans des situations complexes et inhabituelles pour les élèves. La réussite à cet exercice, construction sur un quadrillage à 45°, est la garantie d'une maîtrise des concepts de rectangle et de carré allant au delà de la simple identification de ces figures en « bonne position ». Les scores de 65% (pour le rectangle) et 79% (pour le carré), sont encourageants. Le tracé d'un rectangle à partir de quatre points choisis parmi dix, plus difficile, est réussi par un élève sur deux. Plus de huit élèves sur dix repèrent bien la droite et la gauche. Plus de six sur dix sont capables de le faire quelle que soit l'orientation de l'interlocuteur (dos ou face). Trois élèves sur quatre sont capables de repérer, parmi quatre figures, au moins une figure qui possède quatre angles droits. L'obligation de donner des réponses multiples influe sur les scores de réussite ; 18% s'arrêtent à la première trouvée. Globalement, les élèves ont une bonne reconnaissance perceptive de l'angle droit. Champ « Grandeurs et mesures » Plus de huit élèves sur dix associent correctement une grandeur avec des unités de mesure. Les résultats sont homogènes pour les longueurs, durées et masses. On peut faire l'hypothèse que les erreurs sont dues à un manque de « représentation concrète ». Ordonner des objets suivant leur longueur est un exercice réussi par 63% des élèves qui donnent la réponse sans erreur ; 5% rangent en sens inverse (mauvaise compréhension de la consigne). En outre 25% des élèves intervertissent les objets dont la longueur est proche (erreur prévue). Malgré la difficulté de la situation et le nombre de compétences à mobiliser simultanément, un élève sur deux est capable de comparer des longueurs de lignes brisées et un sur trois de justifier sa réponse. Près de neuf élèves sur dix sont capables de mesurer la longueur ou de tracer un segment de longueur donnée. Si plus de huit élèves sur dix savent lire un calendrier, ils ont, en revanche, des difficultés à inférer une date (41%). Les réponses des élèves de 6e à l'évaluation de septembre 2005 Synthèse Mathématiques sixième Champ « calcul » Les résultats des tables d'addition sont disponibles pour 95% des élèves. Il n'en va pas de même pour les tables de multiplication (73%). En calcul mental réfléchi, les difficultés proviennent principalement de la maîtrise insuffisante de la structuration de la numération et des relations entre les nombres. Par exemple, la compétence développée dans le calcul « 126 + 9 » n'est pas transposée dans celui de « 37 + 99 ». On ne relève pas de difficultés majeures pour les additions et les soustractions de nombres entiers. Les scores de réussite aux items concernant la division montrent que, à l'entrée en sixième, sa technique de calcul est en phase de consolidation. Pour les multiplications, les erreurs proviennent souvent d'une connaissance lacunaire des tables. En ce qui concerne les calculs sur les nombres décimaux, l'analyse des résultats des codes d'erreur spécifique montre que plus de 25% des élèves considèrent un nombre décimal comme la juxtaposition de deux entiers. Champ « Connaissance des nombres » Les dictées de nombres sont globalement réussies par plus de huit élèves sur dix. On peut toutefois noter une corrélation entre les taux de réussite et la taille des nombres dictés. On constate qu'environ un tiers des élèves perçoit le rapport entre deux nombres, mais n'emploie pas le terme approprié ; par exemple, on note la confusion entre « tiers » et « triple ». Globalement, à peine la moitié des élèves utilise, à bon escient, les expressions telles que « double », « moitié », « tiers », « quart ». La fraction de l'unité est reconnue par plus de sept élèves sur dix. Mais, moins de la moitié parvient à représenter des fractions d'un segment donné. En 2005, de nombreux items testaient le lien entre diverses écritures d'un nombre décimal (écriture à virgule, écriture utilisant les fractions décimales, etc). S'il apparaît que 20% des élèves assimilent le trait de fraction à la virgule, on peut néanmoins noter qu'environ 60% des élèves établissent correctement ce lien. La comparaison des nombres décimaux est en cours d'acquisition. Lorsque cette connaissance est à mobiliser dans un exercice d'encadrement, compétence en cours d'acquisition, les élèves ont d'autant plus de difficultés. Champ « exploitation des données numériques » Lecture et interprétation des diagrammes sont bien maîtrisées par plus de sept élèves sur dix. Plusieurs exercices portent sur la proportionnalité. Globalement, on peut dire que deux élèves sur trois sont capables de résoudre un exercice simple de proportionnalité directe, c'est-à-dire de reconnaître le type de situation et de mettre en jeu une technique faisant appel aux propriétés linéaires. Champ « espace et géométrie » Globalement dans ce champ 80% des élèves réussissent plus de la moitié des items. Les difficultés rencontrées concernent essentiellement la prise en compte de deux contraintes simultanées et la reconnaissance de figures simples dans une construction complexe. Champ « Grandeurs et mesures » L'adéquation du protocole aux programmes de cycle 3 et de sixième, a entraîné l'apparition de ce nouveau champ qui n'était pas présent dans les protocoles précédents. En 2005, les items testaient essentiellement les équivalences entre les différentes unités d'une même grandeur. On retrouve, dans ce champ, les difficultés perçues à propos de la connaissance des nombres décimaux. EXEMPLES D'EXERCICES DE MATHÉMATIQUES 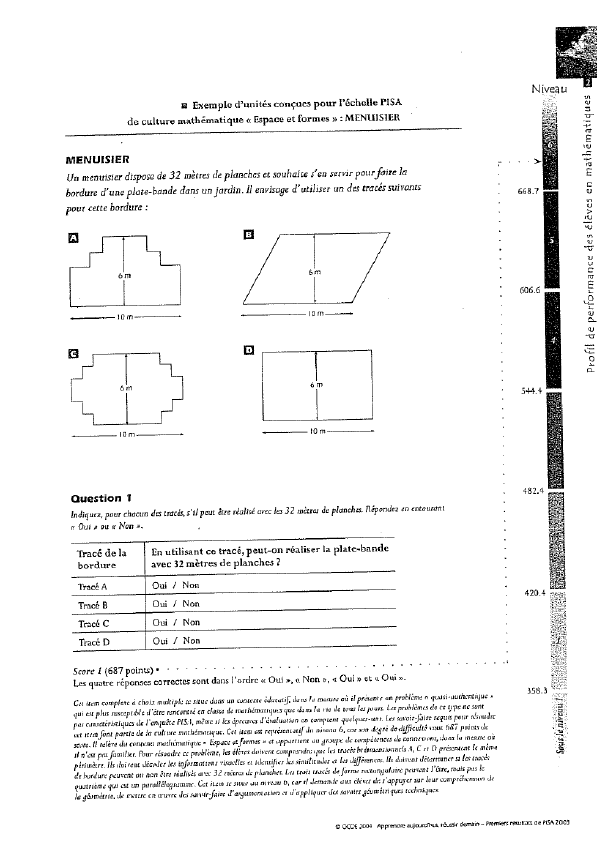 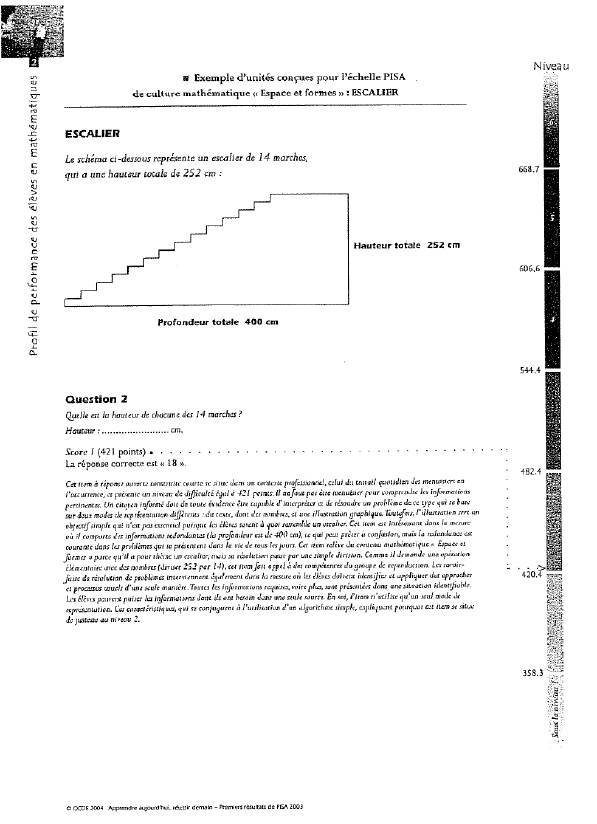 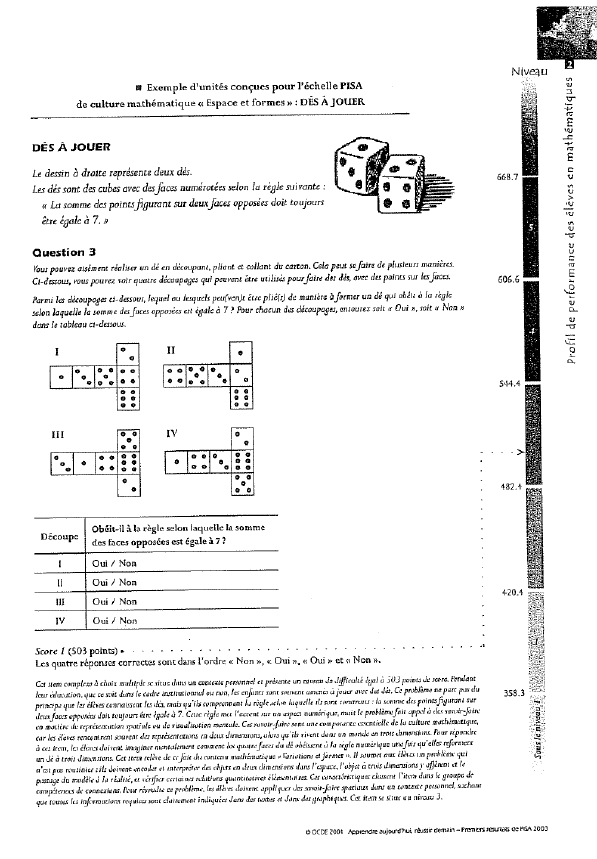 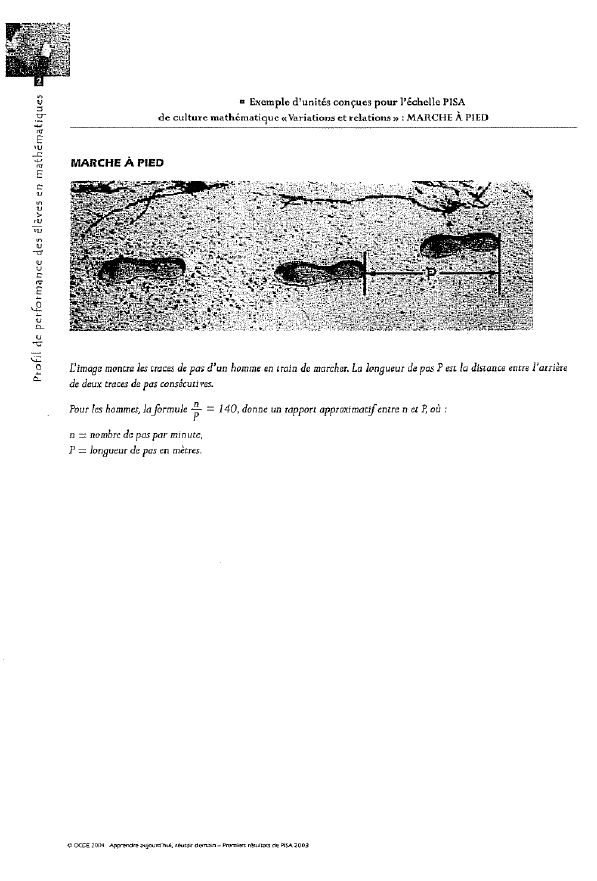 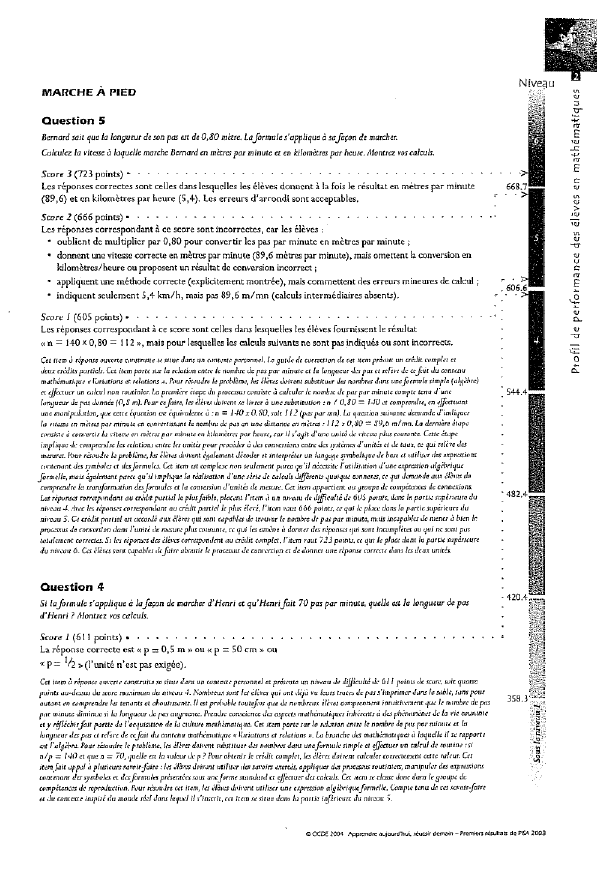 CLASSEMENT DES PAYS SUR LES QUATRE DOMAINES ÉVALUÉS PAR PISA 2003 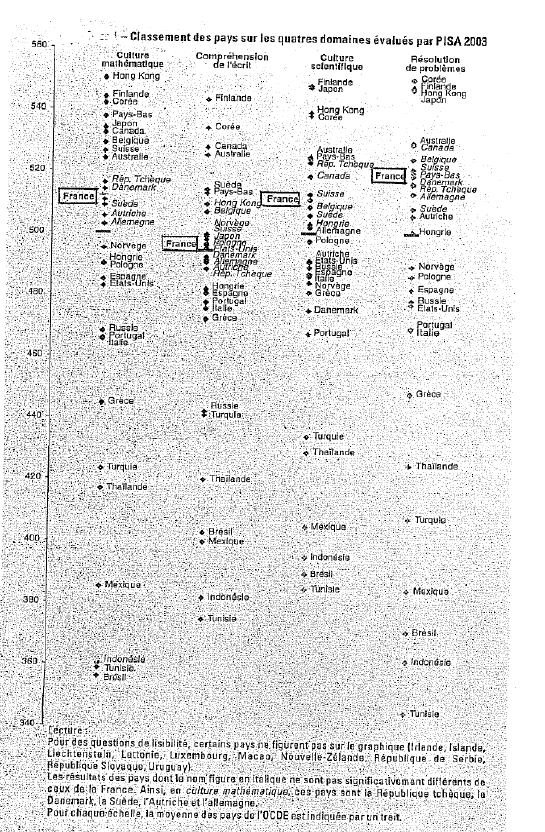 PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION MATHS EN JEANS Méthode d'Apprentissage des Théories mathématiques en Jumelant des Établissements pour une Approche Nouvelle des Savoirs L'idée : offrir à des élèves de collège, de lycée et parfois de primaire ou du supérieur, la possibilité de « faire des mathématiques autrement », en les mettant en situation de recherche et ceci en relation avec des mathématiciennes et des mathématiciens et des jeunes d'autres établissements. Etablir un lien entre le monde de l'école et celui de la recherche. Mise en place depuis 1989, cette expérience intéresse aussi bien la communauté mathématique que les instances éducatives et l'Inspection de mathématiques. Le principe : Jumelage de 2 établissements de niveau équivalent : dans chacun d'eux, des élèves volontaires travaillent en groupes durant toute l'année scolaire, à raison de 2 à 3 heures par semaine, sur les mêmes sujets proposés par un chercheur. Les temps forts sont : _ Les séminaires, 3 ou 4 par an, au cours desquels élèves et professeurs des 2 établissements se réunissent avec le chercheur pour faire le point, comparer les démarches et les résultats, trouver de nouvelles pistes... _ Le congrès, qui rassemble tous les participants à MATh en JEANS, venant de toute la France, ainsi que des mathématiciennes et des mathématiciens et des personnalités du monde scientifique. Pour chaque sujet, les élèves communiquent leurs travaux et résultats par un exposé devant un public composé de leurs pairs mais aussi d'observateurs variés. Ils réalisent aussi des posters pour présenter ces travaux. Entre les exposés des élèves s'intercalent quelques conférences de mathématiciennes et des mathématiciens. _ La rédaction des actes du colloque. Etape délicate pour les élèves, car d'une part le congrès leur semble un aboutissement, d'autre part le travail de synthèse et d'écriture ne leur est pas spontané et, en plus, il intervient en fin d'année scolaire. Etape motivante, néanmoins, due à l'attrait d'un article personnel sur le site Internet de MATh en JEANS. Les sujets proposés : Les thèmes d'étude proposés par les chercheurs sont très variés : sujets sur l'histoire des mathématiques ou sur des questions connues, ou au contraire des sujets plus ouverts portant sur des mathématiques actuelles. Les différents domaines des mathématiques sont abordés. Il est clair que les mathématiques produites par les élèves ne constituent pas une avancée, mais il leur arrive d'étonner les chercheurs par leur imagination, en utilisant des démarches originales. * * * PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION ANIMATH Promenades mathématiques Si l'on veut que les lycéennes et lycéens, les étudiantes et les étudiants s'engagent en nombre suffisant dans les voies scientifiques, il est important qu'ils comprennent que les mathématiques sont une science vivante, riche en débouchés, qui passionne de nombreux chercheuses et chercheurs. Les jeunes sont d'ailleurs avides d'informations sur l'activité des femmes et hommes qui ont fait de la recherche leur métier, et sur le rôle des mathématiques dans notre société, et il y a chez les professeurs qui ont la charge de leur formation une réelle demande en ce sens. D'ores et déjà, des mathématiciennes et mathématiciens se sont engagés dans cette voie pour faire connaître aux lycéennes et lycéens quelques aspects des mathématiques d'aujourd'hui, en donnant des conférences, en publiant des livres ou des articles destinés à un large public, en réalisant des films ou des expositions. Il faut cependant constater que les collègues enseignant en lycée ou collège, bien souvent, ne savent pas comment faire ou à qui s'adresser pour qu'un intervenant extérieur vienne par exemple ponctuellement faire, dans un établissement scolaire, une conférence ou débattre de ses travaux et de son métier à l'occasion d'une exposition ou d'une remise de prix, ou participe de manière un peu plus durable aux activités d'un club ou atelier scientifique. Avec l'aide de la société des mathématiques de France (SMF), de la société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI), l'association Animath se propose de mettre en contact, dans chaque académie, les mathématiciennes et mathématiciens, enseignants-chercheurs ou chercheurs, avec les lycées et collèges. Le CNRS soutient l'initiative dans le cadre de « Passion science ». On s'appuiera d'une part sur les équipes de recherche et d'autre part sur l'Inspection générale de mathématiques et les inspecteurs pédagogiques régionaux de mathématiques pour bâtir de telles relations. Il va de soi que ce schéma n'a rien d'exhaustif et ne nourrit aucune ambition hégémonique. Il s'agit plus modestement que les collègues se parlent, échangent leurs expériences, se rencontrent plus facilement. En prenant appui sur ce qui existe déjà, on permettra que le savoir-faire accumulé dans le cadre d'initiatives locales, ou individuelles, puisse être mis à disposition de tous. La structure, légère, que nous voulons mettre en place s'appuierait sur un réseau de correspondants dans les départements et laboratoires. Cette liste serait diffusée dans les milieux de l'enseignement secondaire, mise à disposition sur le réseau. Des documents seraient réalisés, en particulier un vade-mecum qui décrirait les démarches administratives à suivre pour faire venir un intervenant extérieur dans un collège ou un lycée, les sources de financement possible. * * * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 29 NOVEMBRE 2005 Audition de Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques, membre de l'association Femmes et sciences M. Jean-Marie Rolland, président : Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Mme Véronique Chauveau, professeur de mathématiques et membre de l'association Femmes et sciences. Vous êtes, madame, la première personne que notre mission auditionne. Nous souhaitons que vous nous parliez des difficultés que rencontrent les jeunes français avec les sciences et avec les mathématiques, que vous insistiez plus particulièrement sur la question des femmes et des mathématiques, mais aussi que vous nous disiez ce qui se fait concrètement, sur le terrain, comme l'initiative « Maths en jeans ». Mme Véronique Chauveau : Je suis depuis dix ans professeur de mathématiques au lycée Camille-Sée à Paris, et j'enseigne en première et en terminale S. Les questions relatives à la diffusion des matières scientifiques chez les jeunes et aux études scientifiques me concernent donc au premier chef. Je suis également présidente de l'association Femmes et mathématiques et membre de Femmes et sciences. La première a été créée après que la mixité a été instaurée à l'École normale supérieure au début des années 1980, ce qui avait eu comme effet paradoxal de conduire à ce qu'il n'y ait plus de fille en mathématiques et en physique à Ulm et à Saint-Cloud. Son objet principal est de donner une plus grande visibilité aux femmes qui font des mathématiques, les chercheuses représentant la majorité des 200 membres de l'association, dont 10 % seulement sont des professeurs du secondaire. Il s'agit, en créant un lien privilégié entre toutes ces personnes et des mathématiciennes confirmées, de faire en sorte que toutes se sentent plus à l'aise. Depuis 2000, nous sommes très sollicitées pour des interventions dans les établissements secondaires, en raison du constat du déficit en étudiants et surtout en étudiantes en sciences. En première et en terminale S, il y a en moyenne dans les établissements scolaires français 46 % de filles, ce qui n'est pas mal du tout. Mais si on observe les spécialités en terminale, on s'aperçoit qu'elles sont moins de 30 % en mathématiques, à peu près la moitié en physique et la majorité en biologie. On retrouve donc là une répartition traditionnelle selon les sexes. La création de l'association Femmes et sciences, en 2000, répondait à la volonté de disposer de correspondantes dans différents pays concernés par ce sujet. Les deux associations, qui ont de nombreux membres en commun, interviennent dans les établissements scolaires. Elles ont passé une convention avec le ministère de la recherche pour développer des outils d'intervention dans les classes, en privilégiant les filles mais en s'intéressant aussi aux garçons. De même, si sur le site « Elles en sciences » tout a été mis au féminin, il est évident qu'il s'adresse aussi aux garçons. Nous nous rendons dans les établissements pour présenter les matières scientifiques aux jeunes, en réponse à une très forte demande des chefs d'établissement, préoccupés par la diminution du nombre d'élèves en S et pour qui les filles pourraient constituer un vivier, mais aussi de collègues isolées, de conseillers d'orientation et de conseillers principaux d'éducation. Un petit nombre de proviseurs ont intégré nos interventions dans le projet d'établissement. Je suis intervenue à plusieurs reprises dans des zones d'éducation prioritaire, en particulier à Jacques-Brel à La Courneuve, à la demande d'un professeur de mathématiques qui s'était rendu compte que l'offre faite par Sciences-Po détournait les bons élèves des enseignements scientifiques. Je fais également partie du collectif Action Sciences, qui regroupe, autour de cette question de la désaffection pour les sciences et des remèdes à y apporter, une quinzaine d'associations et de sociétés savantes et scientifiques dans plusieurs disciplines. Un colloque organisé par l'OCDE a montré que la tendance est la même dans la plupart des pays, mais qu'en France la chute est spectaculaire dans les cycles universitaires de mathématiques et physique, matières dont le niveau est par ailleurs excellent. Pourtant, au lycée, les effectifs en S se maintiennent, tandis que ceux en L diminuent et que ceux en ES augmentent. C'est donc après le bac que les choses se dégradent. Bernard Convert, sociologue à l'université de Lille, a beaucoup travaillé sur cette question. Il a en particulier constaté que la réussite des élèves avec un bac S était meilleure qu'avec un autre bac, mais aussi que ceux qui ont obtenu le bac S réussissent mieux dans toutes les disciplines que dans les études mathématiques et physique. En fait, l'idée que la série S est meilleure reste très présente dans l'opinion, et le groupe Action sciences considère qu'on a échoué en remplaçant les filières C et D par la filière S et qu'on a même abouti à un système plus pervers car, désormais, seuls s'en sortent ceux qui le connaissent bien. La réforme de 1995 a donc eu des effets néfastes pour les études scientifiques après le bac. En fait, opter pour S correspond à un choix stratégique pour bien réussir ses études et non à la volonté de poursuivre des études scientifiques. Le groupe Action sciences a procédé à un certain nombre de pondérations qu'on retrouve sur le site de la société française de chimie. Le collectif avait également décidé d'aller à la rencontre des députés, ce qui n'a hélas pas été possible, pour faire des propositions concrètes d'organisation des études en première et en terminale S. Car il est quand même frappant de constater qu'il est aujourd'hui possible, par le jeu des coefficients, d'obtenir le bac S avec une mauvaise note en mathématiques et des notes simplement moyennes dans les autres matières scientifiques. J'observe à ce propos que, selon une étude du ministère de l'éducation nationale que vous pourriez sans doute vous procurer plus facilement que nous, les notes moyennes en mathématiques en terminale S sont très mauvaises. Par ailleurs, si en biologie et en physique, sur les 20 points de l'épreuve au bac, 4 sont attribués à une épreuve expérimentale, tel n'est pas le cas en mathématiques alors que ce serait tout à fait envisageable. J'y suis personnellement favorable. Les membres de la commission enseignement secondaire de l'Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public travaillent à l'idée d'une telle épreuve, qui pourrait prendre la forme d'une demi-heure de programmation sur un ordinateur, en liaison avec le programme, ou de la mise en œuvre d'un programme tout fait. Nous avons également constaté, au sein du collectif Actions Sciences, que, quelle que soit leur série scientifique, les étudiants avaient ensuite des difficultés en mathématiques aussi bien en BTS qu'en IUT, qu'en université et que dans les écoles d'ingénieurs à préparation intégrée. De mon point de vue de professeur comme de celui de mes collègues de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP), il n'y a pas de diminution du niveau des connaissances attendues des élèves en terminale S alors que le nombre d'heures a été sensiblement réduit dans les collèges et les lycées. Le niveau est loin d'être ridicule mais il est évident qu'on ne se donne pas assez de moyens et j'ai vu ces dernières années arriver en terminale des élèves qui avaient des difficultés en calcul fondamental. M. Yves Durand : La pédagogie des TPE (travaux personnels encadrés) en vous paraissait-elle intéressante ? Mme Véronique Chauveau : Les professeurs de mathématiques ont eu du mal à s'approprier les TPE. Je suis persuadé que les choses auraient été différentes avec une épreuve de travaux pratiques au bac. Si on veut tenir la route par rapport à des projets d'études raisonnables après le bac, il nous faut tenir compte de ce qui se fait dans les autres disciplines. Alors que la manière de travailler en mathématiques évolue, on ne prend peut-être pas assez en compte dans les épreuves du bac. Des progrès sont encore à faire, même si, sous la pression de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP), les épreuves sont désormais plus en rapport avec l'évolution des programmes et si le bac est un peu plus dynamique qu'auparavant. M. Jean-Marie Rolland, président : Confirmez-vous l'impression qu'on a parfois qu'on rend les matières scientifiques plus complexes afin de sélectionner les élèves ? Avez-vous le sentiment que les programmes répondent aux besoins de la société ou qu'ils s'inscrivent dans une logique de sélection des meilleurs ? Mme Véronique Chauveau : Dans la représentation des jeunes comme des parents, il s'agit bien de matières qui font une sélection. Tel n'est pas mon sentiment quand j'exerce mon métier. Derrière les programmes, il y a un travail très élaboré pour répondre aux besoins des universités et des grandes écoles. Mais on leur reproche parfois, quand on les trouve trop exigeants, d'être gouvernés par des besoins plus élitistes. Et puis on est toujours déçus quand quelque chose n'est pas dans le programme alors qu'on n'est pas prêt à renoncer à ce qui y figure... La plupart du temps, dans le secondaire, les professeurs se contentent de suivre ce qui leur est imposé. M. Frédéric Reiss : Pensez-vous que les bourses de la vocation scientifique des femmes, lancées à l'initiative du ministère des droits des femmes, sont une bonne chose ou que les résultats ne sont pas à la hauteur ? Mme Véronique Chauveau : C'est une très bonne façon de faire, mais tout ce qui est incitation positive n'est pas très bien vu en France et il me semble que cette initiative n'est pas suffisamment mise en valeur. Ainsi, la remise des récompenses se fait souvent en catimini et on ignore largement ce que deviennent ensuite les jeunes filles récompensées. Surtout, on parle très peu de ces bourses dans les établissements et le système repose largement sur l'initiative personnelle de certains professeurs et chefs d'établissement. Je constate souvent d'ailleurs combien il est difficile qu'une information qui part du ministère arrive jusque dans les classes. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pensez-vous qu'il soit possible de faire avant le lycée, dans le primaire et au collège ? Mme Véronique Chauveau : Je connais peu le primaire, mais j'ai le sentiment que, jusqu'à l'opération « La main à la pâte », bon nombre des enseignants y étaient très réticents vis-à-vis des sciences. Ce n'est pas très étonnant dans la mesure où un grand nombre d'entre eux sortent de terminale littéraire : ayant fui les mathématiques et la physique et ne les ayant plus rencontrées dans la suite de leurs études, il leur déplaît de devoir enseigner des matières qui leur ont laissé un goût amer. Cela n'est guère propice à faire aimer les sciences aux enfants. Je crois donc qu'il faut poursuivre le mouvement engagé de rencontres entre l'université et les professeurs des écoles, qui a déjà permis d'améliorer les choses. M. Jean-Marie Rolland, président : Pensez-vous qu'il est encore temps d'inculquer une culture scientifique au sein des IUFM ? Mme Véronique Chauveau : Tout à fait ! On rejoint d'ailleurs la problématique des filles et des sciences : de nombreuses filles considèrent encore à la fin du secondaire qu'elles ne sont pas faites pour faire des mathématiques. Cette image est encore largement véhiculée, y compris par les médias : j'ai entendu M. Martin Winckler, se demandant, dans une chronique sur France Inter, si le cerveau avait un sexe, constater que les filles n'étaient pas faites pour faire des mathématiques. De même, un récent article du journal Phosphore montrait que les filles acceptent de faire des maths quand on leur tient la main alors que les garçons sont motivés par un éclair de génie... Moi, je dis à mes élèves que c'est une matière difficile pour tout le monde. M. Jean-Marie Rolland, président : Pouvez-vous nous parler de Maths en Jeans ? Mme Véronique Chauveau : C'est une initiative qui fonctionne de façon formidable, en particulier au collège. Un chercheur donne des sujets ouverts à deux groupes d'élèves volontaires de deux établissements différents. Les élèves se retrouvent autour de ces sujets, sans que leurs professeurs aient la solution. Ils travaillent pendant plusieurs mois, ce qui est très déstabilisant et très formateur. Alors que jusque-là les mathématiques sont enseignées comme une matière éthérée ce qui fait que les élèves se disent qu'ils ne sont pas faits pour ça s'ils n'ont pas un accès direct au Saint-Esprit, la démarche de Maths en Jeans leur montre que le raisonnement mathématique se construit par essais et erreurs. Un certain nombre de professeurs travaillent d'ailleurs déjà de cette façon, en montrant aux élèves comment se construisent les mathématiques, en parlant de l'histoire des maths, en leur expliquant que les professeurs aussi tâtonnent et que c'est tout aussi formateur que de rédiger une démonstration. Maths en Jeans c'est une rencontre entre jeunes, mais aussi avec le milieu de la recherche et avec des professeurs dans d'autres conditions. On va d'ailleurs jusqu'au bout de la démarche, avec un congrès de recherche où les élèves présentent leurs résultats. Donner ainsi le goût de chercher est un acquis formidable pour la formation des élèves. J'attache une grande importance à cette démarche qui fait de l'élève l'acteur de son propre savoir. Le slogan de l'opération est d'ailleurs « Ne subissez plus les maths, vivez-les ! » De façon plus générale, au collège, les enfants ont une vraie curiosité et mes collègues font un travail remarquable pour la conserver. Mais, là aussi, la difficulté tient à la réduction du nombre d'heures alors que le programme demeure aussi exigeant. Or on ne peut pas faire des mathématiques à 100 km/h, sauf à travailler pour une élite et à inciter les autres à prendre des cours particuliers, ce qui est absolument scandaleux. Si on veut un bon niveau, il faut laisser aux élèves le temps de s'approprier le programme. C'est en réduisant les horaires qu'on vide les mathématiques de leur substance et qu'on en fait un instrument de sélection, seuls ceux qui peuvent se payer des cours réussissant. Or, en terminale S, on est passé, en dix ans, de plus de sept heures et demie de cours à cinq et demie aujourd'hui. Le groupe Action Sciences a d'ailleurs fait un travail de récapitulation de l'ensemble des horaires. M. Frédéric Reiss : Quel est votre sentiment sur le socle commun de compétences et de connaissances de la loi Fillon ? Mme Véronique Chauveau : Mieux vaudrait vous adresser au groupe collège de l'APMEP. Je sais qu'ils n'ont pas refusé en bloc le projet, mais travaillé et beaucoup discuté. M. Jean-Marie Rolland, président : Disposez-vous de comparaisons avec les pays étrangers ? Mme Véronique Chauveau : Il n'est pas très étonnant de constater que nous ne sommes pas bien placés dans l'enquête PISA, car nos élèves sont confrontés à des épreuves auxquelles ils ne sont pas accoutumés. En ce qui concerne les Olympiades des maths, en faveur desquelles l'association Animath a beaucoup œuvré, alors que d'autres pays n'envoient que leurs meilleurs éléments, tel n'est pas le cas en France pour ne pas paraître élitiste. On peut donc difficilement comparer les résultats obtenus. L'idée d'Animath était plutôt de se servir des résultats du concours Kangourou pour repérer des élèves ayant envie de faire des mathématiques en plus et de leur proposer un tutorat par des élèves des Écoles normales supérieures. Peut-être pourriez-vous auditionner Martin Andler, président d'Animath, qui est très attaché à la vulgarisation et à la grande diffusion des mathématiques et qui dispose d'éléments de comparaison avec les États-Unis. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pensez-vous de l'idée selon laquelle on dispose en France d'une élite mathématique de haut niveau, mais que le problème tient aux résultats de la moyenne des élèves et des étudiants ? M. Daniel Prévost : Il y a aussi un problème de résultats au CAPES et une crise des vocations pour l'enseignement des mathématiques. Ainsi, en Bretagne, dans bon nombre de petits établissements ruraux, nous avons des enseignants marocains, maliens, libanais, qui restent DMA pendant plusieurs années. Même s'il s'agit d'excellents enseignants, le fait qu'ils ne maîtrisent pas bien le français pose des problèmes de compréhension et suscite l'inquiétude des familles. Mme Véronique Chauveau : Action Sciences souligne qu'il est nécessaire de se préoccuper de la chute des recrutements pour améliorer la qualité de l'enseignement. Pour y remédier, une programmation pluriannuelle des postes au CAPES et à l'agrégation serait fort utile. Peut-être pourrait-on également revenir à un système comme celui des anciens IPES, qui était peut-être onéreux, mais qui jouait un rôle d'ascenseur social et qui permettait d'attirer les jeunes vers l'enseignement. M. Daniel Prévost : Quelle est votre position quant à l'utilisation des calculatrices ? Mme Véronique Chauveau : Nous ne pouvons pas faire comme si elles n'existaient pas et je crois même qu'il nous appartient d'apprendre aux élèves à s'en servir, d'autant que si nous ne le faisons pas, ce sont les filles qui se trouvent le plus souvent pénalisées car elles ont un accès moins facile à cette technologie, comme d'ailleurs à l'informatique. L'APMEP a envisagé qu'il y ait deux épreuves de mathématiques au bac, l'une avec et l'autre sans calculatrice. * Audition de Mme Marie Reynier, directrice générale de l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM), présidente de la commission Amont (27) M. Jean-Marie Rolland, président : Nous accueillons maintenant Mme Marie Reynier, scientifique, directrice générale de l'École nationale supérieure des Arts et Métiers. Pourriez-vous nous parler, Madame, de l'influence qu'a l'enseignement des sciences dans le primaire et dans le secondaire sur la formation des ingénieurs et sur la façon dont notre enseignement supérieur répond à la demande des entreprises. Mais peut-être souhaiterez-vous, commencer par nous parler de votre parcours personnel de femme et de scientifique. Mme Marie Reynier : Originaire d'une famille apatride de Gibraltar, je suis arrivée en France à huit ans, après quelques années cahotiques. J'y ai suivi un parcours scolaire classique, jusqu'à que je sois obligée d'abandonner la classe préparatoire pour des raisons financières. J'ai toutefois réussi le concours expérimental de l'ENSAM. À la sortie de l'école, j'avais envie de faire de la recherche mais j'ai passé l'agrégation de mécanique pour me nourrir. Par la suite, j'ai participé pendant cinq ans au Conseil national des programmes. Aujourd'hui, la responsabilité de onze cycles d'études et de l'administration de la recherche et de la formation ne me laisse plus le temps d'enseigner. L'ENSAM accueille 4 500 étudiants et 350 doctorants sur onze sites. Sur l'ensemble des étudiants, nous ne comptons que 9 % de filles. Je crois personnellement beaucoup à l'apprentissage, mais cette filière est passée de 50 à 400 étudiants. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous êtes également présidente de la commission Amont, et vous êtes donc bien placée pour analyser les flux qui arrivent dans ces écoles, du point de vue tant du niveau que de la répartition des sexes. Mme Marie Reynier : S'agissant du niveau, si les professeurs ont souvent du mal à se reconnaître dans les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'en fait ces derniers savent les choses de façon sans doute plus étendue qu'auparavant mais moins intense. Surtout, la réflexion, la pensée scientifiques apparaissent moins développées. Aujourd'hui, l'impératif de réussite fait primer la recherche de recettes et d'une méthodologie. Cette évolution me paraît catastrophique car ce formatage, cette disparition de toute transgression, conduit à faire disparaître l'idée même de pensée. Cette dérive vers la cléricature fait primer la forme sur le fond. Aujourd'hui, la pensée scientifique n'est absolument pas promue. Pour ma part, je suis persuadée qu'on peut acquérir dès le lycée un bagage scientifique qui permette de dire les choses et de fonder une démarche déductive et inductive. La commission Amont s'intéresse aux questions de recrutement et au décalage entre l'attente des écoles et ce qui se passe du côté des classes préparatoires. M. Jean-Marie Rolland, président : Le concours de l'ENSAM est-il très sélectif ? Mme Marie Reynier : Non : il y a environ 500 reçus pour 2 000 candidats. J'ajoute que nous sommes l'une des très rares écoles à avoir encore 20 % de boursiers, soit plus que les universités scientifiques. M. Frédéric Reiss : Menez-vous des actions spécifiques pour attirer les jeunes filles ? Mme Marie Reynier : Notre image est très liée à celle de l'usine, ce qui n'attire guère les filles... En outre, de nombreux pères qui ont connu les restructurations dans leur vie professionnelle pensent que leurs filles supporteraient mal d'être bousculées de la sorte. C'est ce qui ressort des enquêtes que nous menons auprès non seulement de nos élèves, mais aussi de ceux qui ne se sont pas présentés au concours. Nos élèves ont le bac S, la suppression de la filière E nous ayant privés de notre base habituelle de recrutement. M. Jean-Marie Rolland, président : Quel est votre sentiment sur la façon dont est injectée la culture scientifique en primaire, au collège, au lycée et en classes préparatoires ? Mme Marie Reynier : Le problème vaut pour l'ensemble de notre jeunesse : nous sommes devenus un pays de technologie plus que de science. Il y a même une résistance à la science, résistance inquiétante car si la technologie ne se nourrit pas de science, il n'y a plus d'innovation. Ces phénomènes débutent dès le primaire, les jeunes étant habitués à ce que la technologie permette la satisfaction immédiate d'un désir et leur procure un confort, ce qui tend à disqualifier la science. La technologie est en outre source d'illusions, comme l'idée que tout est réversible, que tout est un jeu, qu'il n'y a pas de responsabilité. À l'inverse, parce que la science montre que rien n'est définitivement vrai, que les modèles qu'on bâtit peuvent être détruits, elle joue un rôle essentiel dans la construction de l'individu. Un enfant n'aime pas entendre quelque chose qui le déstabilise, comme le fait que la terre est ronde. Il aime avoir le sentiment que la connaissance est magique et que l'avenir ne dépend pas que de lui. Nous avons engagé un psychologue pour qu'il étudie les jeunes à leur arrivée dans l'école. Il nous a appris que 80 % d'entre eux ne voulaient pas faire d'industrie. Certes, les choses changent au bout de trois ans d'école, mais il nous paraît important de comprendre par quels mécanismes la technologie, qui se nourrit de la science, la disqualifie en fait aujourd'hui. Pour intéresser les jeunes dès l'enfance, il ne faut pas leur donner à étudier un téléphone portable mais des objets qu'ils ne manipulent pas habituellement. Il me semble donc qu'il faudrait se tourner vers les nanotechnologies, l'infiniment petit, la conquête spatiale, la domotique. L'objet quotidien n'est pas, pour les jeunes, objet de curiosité scientifique. Hubert Curien l'avait bien compris, qui voulait mettre l'accent sur « l'arrivée de la troisième dimension ». M. Frédéric Reiss : Mais comment inculquer le goût de l'effort ? Mme Marie Reynier : Par le goût d'une nouvelle aventure, en montrant que les bénéfices de cet effort peuvent apporter un confort encore plus grand, ce qui satisfait le très grand pragmatisme des jeunes. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous mené des expériences en ce sens ? Mme Marie Reynier : Nous avons invité 600 lycéens de ZEP, afin de mener une expérience d'ouverture sociale à partir de tests d'aptitude sortant des schémas académiques, comme la vision du mouvement dans l'espace. M. Frédéric Reiss : Je suppose que vous avez eu moins de filles que de garçons... Mme Marie Reynier : Non, c'était moitié-moitié. Pour savoir si les filles ont plus de mal pour ce genre de test, il faudra attendre que les neurosciences progressent. Rien ne permet de dire que le système de l'équilibre se réduit aux systèmes hormonaux. Pour l'ensemble des perceptions, l'humain a des dispositifs de rattrapage et on ne peut donc pas dire que parce que telle ou telle zone du cerveau ne serait pas activée un sexe ne disposerait pas de telle ou telle capacité. On dit souvent que les femmes ont facilement tendance à se perdre en ville, je pense que c'est vrai mais parce qu'il y a beaucoup de magasins. Pour en revenir à ces élèves, nous les avons emmenés dans le laboratoire de l'École, où on ne fait rien qui se rapporte aux objets quotidiens et ils se sont beaucoup intéressés au système d'imagerie reconstructive ou aux moules en plastique complètement fermés, leur curiosité ayant ravi nos enseignants. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment faire renaître l'esprit scientifique dans les lycées, les collèges, mais aussi les écoles primaires dont les maîtres, et surtout les maîtresses, ont rarement reçu une formation scientifique ? Mme Marie Reynier : C'est bien le problème : on ne promeut que ce qu'on connaît ! M. Jean-Marie Rolland, président : Mais est-il encore temps d'injecter la curiosité scientifique pendant la scolarité dans les IUFM ? Mme Marie Reynier : Il serait merveilleux de pouvoir y susciter un intérêt pour la science, même au sens de Science et Vie et Science et Avenir, c'est-à-dire en présentant les sciences de façon avenante. On ne remerciera jamais assez les auteurs du Grand Bleu d'avoir intéressé les jeunes à des questions scientifiques, car en parlant de plongée en grande profondeur, on fait passer mille idées de physique. M. Jean-Marie Rolland, président : Pensez-vous que les programmes sont adaptés ? Mme Marie Reynier : Il faut cesser de réduire l'éducation aux programmes, comme d'ailleurs au « projet personnel » des élèves : à vingt ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et il faudrait qu'à quatorze ans celui qui ne réussit pas à l'école le sache ! Il faut guider les élèves au lieu de chercher à leur asséner un savoir universitaire. On a vu quels effets néfastes a eus l'introduction d'une grammaire de type universitaire à l'école primaire, alors qu'il faut avant tout faire en sorte, bien sûr sans faire de la langue un concept strictement utilitaire, que le jeune puisse communiquer ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Il ne faut plus que l'éducation nationale réduise sa formation à des programmes mais qu'elle pense avant tout aux compétences à acquérir. M. Jean-Marie Rolland, président : Pouvez-vous nous parler de l'apprentissage ? Mme Marie Reynier : Plus on monte en niveau de qualification, plus les choses sont difficiles car il faut concilier une double exigence d'opérationnalité en entreprise et de capacité de conceptualisation à l'université. Nous constatons donc que les deux formations ne donnent pas les mêmes ingénieurs. M. Daniel Prévost : Pensez-vous qu'il y a assez de travaux pratiques au lycée ? Mme Marie Reynier : L'expérimentation, la rencontre avec la matière sont très importantes. Travailler avec ses mains, par exemple en poterie, met en contact avec le caractère irréversible de l'échec. Il n'est pas facile de donner son incompétence en spectacle aux autres, mais cela permet de vaincre ensuite la peur de rater. Plus le jeune arrive tard dans la manipulation expérimentale, moins il a de chances d'en faire ensuite. M. Frédéric Reiss : Disposez-vous de comparaisons avec ce qui se fait à l'étranger ? Mme Marie Reynier : On dit souvent que l'enseignement scientifique fonctionne mieux ailleurs, en particulier dans les pays nordiques. Mais si on utilise l'étude PISA, il faut comparer des groupes comparables. Les mesures sont faites à quinze ans. Or si on prend les jeunes Français qui ne sont ni en avance ni en retard, soit la moitié du groupe, leurs résultats sont supérieurs à ceux de l'ensemble des pays européens, comme d'ailleurs ceux des élèves de quatorze ans. Les 40 % qui ont un an de retard sont pratiquement à la moyenne européenne, et ce sont les 10 % qui sont très en retard qui font chuter les résultats. On constate donc que notre système n'est pas mauvais du point de vue de l'organisation, des contenus et de la pédagogie, mais qu'il n'est pas démocratique parce qu'il ne permet pas de faire arriver tout le monde à un niveau correct. C'est ce système socialement marqué qui permet le succès de l'éducation parascolaire On peut lier les résultats PISA à l'immigration : ils sont meilleurs dans les pays nordiques, où elle est faible, qu'en France où elle est beaucoup plus importante et qu'en Allemagne, où, à la forte présence des Turcs, s'ajoutent les effets du tri sélectif en primaire. M. Daniel Prévost : C'est aussi parce que nous avons peu d'immigration que les résultats au bac sont aussi bons en Bretagne. Mme Marie Reynier : J'ajoute que la sélection se fait largement par les sciences, c'est ce qui ressort de l'intéressant colloque sur La crise mondiale des sciences qui s'est tenu à Lille les 28 et 29 novembre. En France on est dans un système d'auto-reproduction des élites... Nous avons plutôt bien géré l'ouverture sociale et la méritocratie pour la population paysanne, il nous faut désormais parvenir à faire de même pour les jeunes issus de l'immigration. Il faut prendre le problème à bras-le-corps sans se cacher derrière l'idée qu'ils sont « comme les autres », d'autant que la culture maghrébine est une culture de la fatalité. La prise en compte culturelle des immigrés me paraît d'autant plus nécessaire que nous aurons ensuite à gérer les petits Chinois... Cela doit être possible car nous ne sommes pas engagés dans un schéma d'apartheid comme aux États-Unis et notre melting-pot fonctionne plutôt bien, y compris dans les grandes écoles et même, à l'ENSAM, dans le corps professoral puisque, à Paris, 25 de nos 90 professeurs sont issus de l'immigration. M. Daniel Prévost : Quelles visites d'entreprises conseilleriez-vous à des jeunes de douze à quinze ans ? Mme Marie Reynier : Tout ce qui les dépasse, en particulier le montage des grands systèmes de transport comme le TGV, l'A380 et les paquebots. * Audition de M. Dominique Perrin, directeur général de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) M. Jean-Marie Rolland, président : Notre dernier invité de cette journée est M. Dominique Perrin, directeur de l'École supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique (ESIEE), qui représente également la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP). M. Dominique Perrin : J'ai reçu une formation scientifique puisque je suis issu de polytechnique. Je suis également professeur d'informatique à l'université et j'ai été président d'université. Je suis très attentif à l'évolution de l'attractivité des filières scientifiques, mais je connais moins les problèmes de l'enseignement primaire et secondaire. Mes fonctions au sein de la CCIP me permettent de mesurer les préoccupations des entreprises en ce qui concerne le recrutement des ingénieurs. Le déclin des filières scientifiques n'est pas un phénomène spécifiquement français puisqu'on constate également une baisse importante des effectifs dans les universités des autres pays d'Europe et des États-Unis. Les origines en sont peut-être toutefois différentes, dans la mesure où la carrière d'ingénieur est moins prestigieuse en Grande-Bretagne qu'en Europe du Sud. La France présente en outre la spécificité que ses très grandes écoles ont un rôle qui va bien au-delà de la formation des ingénieurs, car elles jouissent d'une image très positive de corps d'origine des dirigeants des plus grandes entreprises industrielles. Les écoles d'ingénieurs plus spécialisés n'ont pas connu jusqu'ici de difficultés de recrutement. Ainsi, l'ESIEE admet un candidat sur dix. Nous venons de créer, avec l'ensemble des écoles d'ingénieurs en cinq ans, qui offrent 7 000 places, un portail commun de recrutement sur l'Internet. Notre école étant perçue comme technique, nous n'arrivons pas à accroître le nombre de filles, qui reste inférieur à 10 % des élèves. En fait, après la crise d'un certain nombre de grosses sociétés informatiques en 1993, qui a tari un temps le recrutement, les filles ne sont pas revenues quand le secteur a repris avec l'explosion de l'Internet. Il semble qu'elles se dirigent plus facilement vers les écoles où il y a déjà des filles, et il est assez difficile d'inverser la tendance. Peut-être est-il possible de donner une autre image de nos écoles en féminisant le corps enseignant. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais quand les entreprises recrutent vos ingénieurs, le fait d'être un homme ou une femme joue-t-il ? M. Dominique Perrin : Non ! Les entreprises sont soucieuses de la parité, elles aiment recruter des femmes et il n'y a aucun problème d'égalité salariale. Les filles réussissent également très bien au cours de la formation, tout comme dans les classes préparatoires où elles sont un peu plus nombreuses. Je rappelle par ailleurs que la réforme des Écoles normales supérieures a eu comme effet désastreux qu'il n'y avait plus de filles en mathématiques a Ulm et à Saint-Cloud, ce qui allait bien sûr à l'opposé de l'effet recherché. Tout cela confirme que la question n'est pas celle du débouché mais de l'image de la formation. Je me demande même parfois s'il ne faudrait pas réserver des places aux filles, car il est quand même préoccupant que nous soyons ainsi coupés de la moitié de la population scolaire. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment expliquez-vous ce désintérêt mondial pour les métiers d'ingénieurs et pour les études scientifiques ? M. Dominique Perrin : Ce sont des études très difficiles, les classes préparatoires sont dures, le prestige social des carrières est sans doute moindre qu'auparavant. Les élèves se dirigent volontiers vers les préparations aux écoles de commerce, qui sont quand même plus faciles. M. Frédéric Reiss : Vos étudiants sont à l'aise dans les nouvelles technologies, mais pensez-vous qu'ils ont une véritable culture scientifique ? M. Dominique Perrin : Le problème n'est pas le même à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. Peut-être la culture scientifique est-elle davantage présente dans la première, où le fait que les étudiants choisissent librement leurs cours est sans doute un gage d'ouverture de leur curiosité. Même si elle a moins l'occasion de s'exprimer, cette curiosité n'est pas moindre chez les étudiants en informatique et je ne suis pas persuadé que l'Internet la diminue, si on l'utilise comme une encyclopédie en ligne. Le problème des élèves ingénieurs, c'est aussi que les classes préparatoires sont très scolaires - c'est d'ailleurs aussi ce qui rebute les étudiants - et que la curiosité n'y est guère éveillée. Comme une fois qu'on a intégré l'école on éprouve le désir légitime de souffler un peu, ce n'est qu'en toute fin d'études que cette curiosité peut revenir. M. Jean-Marie Rolland, président : Lors d'une audition précédente, on nous a dit qu'en classe préparatoire on cherchait davantage des recettes pour réussir aux concours qu'une culture scientifique véritable. Est-il encore temps de s'ouvrir à cette culture ensuite ? M. Dominique Perrin : Il ne faut pas noircir le tableau à l'excès, mais il est vrai que les classes préparatoires sont des boîtes à concours. Dans les écoles d'ingénieurs en cinq ans, les étudiants peuvent davantage étaler leurs efforts et leur curiosité peut plus facilement être mobilisée, d'autant qu'ils accèdent au travail expérimental dès le début de leur scolarité. En nous inspirant de ce qui a déjà été fait pour la préparation à Sciences Po et à l'Ecole normale supérieure de Cachan, avec plusieurs autres établissements universitaires, nous allons créer à Marne-la-Vallée une préparation d'un nouveau style, dans laquelle les étudiants passeront la moitié de la semaine dans un lycée des environs et l'autre moitié à des travaux pratiques au sein des écoles et de l'université. Ils auront davantage de possibilités d'accéder aux écoles participantes, ceux qui ne seront pas reçus au concours poursuivant un second cycle universitaire. Nous espérons que cette formule sera attractive et qu'elle permettra d'aider les étudiants des zones peu favorisées, dont la réussite aux concours est assez faible. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous connaissance d'expériences menées dans le primaire et dans le secondaire ? M. Dominique Perrin : L'an dernier, l'université de Marne-la-Vallée a organisé, parallèlement à l'opération « Maths en jeans », une demi-journée de visites pour les lycéens, sous le nom « Vive les maths-Info ». Le fait que l'informatique ne soit pas une discipline à part entière dans le secondaire paraît un peu suranné. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, et il me semble qu'il serait utile de couvrir tout le champ de l'utilisation de l'informatique, c'est-à-dire non seulement la bureautique et l'usage de l'Internet, mais aussi les bases de l'informatique scientifique. On insiste beaucoup sur la question de l'agrégation, mais on pourrait sans doute recourir à des solutions plus simples pour avancer rapidement. Il y a un autre problème dans les lycées, c'est l'absence de personnel technique apte à faire fonctionner les systèmes informatiques, mais on pourrait y remédier assez facilement en formant enseignants et personnels, je suis sûr que les universités y sont prêtes. M. Daniel Prévost : Dans quel langage pensez-vous qu'il serait bon de donner des bases aux élèves ? M. Dominique Perrin : Le langage C est très répandu. Nombreux sont également ceux qui préconisent Java. Mais en fait l'important est d'apprendre à programmer, de savoir traduire une idée dans un programme et de le faire fonctionner, peu importe le langage. M. Jean-Marie Rolland, président : On nous a dit que les connaissances scientifiques des élèves étaient plus étendues mais aussi plus superficielles qu'auparavant, et que si l'élite était brillante, le reste était moins bon. Avez-vous le sentiment que le niveau de vos étudiants baisse ? M. Dominique Perrin : Il est assez difficile d'en juger. Les enseignants ont l'impression que chaque année c'est un peu moins bien, mais je ne vois pas vraiment de différence. Les sciences expérimentales restent en France un point fort. Cela étant, la désaffection brutale pour les études scientifiques à l'université est préoccupante pour le recrutement des futurs enseignants. Ce phénomène est toutefois moins important que pour les sciences expérimentales comme la physique. Faute d'avoir créé de véritables filières d'ingénieurs, l'université n'a pas préparé les étudiants à exercer directement une profession et a ainsi créé des chômeurs. M. Daniel Prévost : Comment faire renaître l'esprit scientifique ? M. Dominique Perrin : La difficulté tient aussi au fait qu'avec tout ce qui est dit sur les pollutions, le nucléaire, les risques technologiques, les épidémies, l'image des scientifiques s'est dégradée dans l'opinion. Sans doute conviendrait-il que les scientifiques expliquent davantage l'intérêt de ce qu'ils font. Le rôle des médias n'est pas neutre dans cette affaire. M. Frédéric Reiss : J'ai entendu François de Closets expliquer qu'il était impossible de diffuser une émission scientifique à une heure de grande écoute. M. Daniel Prévost : Pensez-vous que nous devrions rencontrer un certain nombre de grands scientifiques ? M. Dominique Perrin : Vous pourriez auditionner Pierre-Gilles de Gennes, Georges Charpak, ainsi que le climatologue Jean Jouzel, mais aussi Philippe Courtier, directeur de l'École nationale des ponts et chaussées. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons en effet prévu d'entendre des hauts fonctionnaires travaillant dans le domaine de l'éducation, des représentants du monde de l'entreprise, mais aussi des scientifiques, en particulier ceux qui, comme vous, sont responsables de formations. Nous avons également l'intention de nous intéresser particulièrement à la question des femmes et des sciences. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 6 DÉCEMBRE 2005 Audition de M. Christian Margaria, directeur de l'Institut national des télécommunications, Président de la Conférence des grandes écoles M. Christian Margaria : La conférence des grandes écoles compte 215 membres (écoles d'ingénieurs, de gestion et écoles militaires). Plusieurs sujets préoccupent actuellement la Conférence: l'ouverture sociale de l'enseignement supérieur, la désaffection des jeunes pour les filières scientifiques, l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre des études scientifiques et l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le déroulement des carrières. En 1995, 79 % des bacheliers S continuaient dans l'enseignement supérieur scientifique. En 2000-2001 on était tombé à 72 % soit 10 000 bacheliers S de moins. Ce problème corellé à la pyramide des âges va aboutir à une grave pénurie de scientifiques au moment des départs à la retraite massifs. Cette baisse est moins sensible dans les classes préparatoires aux grandes écoles (les chiffres sont les mêmes que dans les années 80) qu'à l'université où la désaffection pour les filières scientifiques, notamment les mathématiques et la physique, est très nette (certains effectifs ont été divisés par 2 ou 2,5). Les approches pluridisciplinaires (maths/informatique par exemple) ont plus de succès auprès des étudiants. Ce problème n'est pas spécifique à la France et se retrouve dans tous les pays européens. S'agissant des filles et de l'enseignement des sciences, 50 % des bacheliers scientifiques sont des filles et leur taux de réussite est supérieur à celui des garçons au niveau du bac S. C'est après que les choses se dégradent avec 23 % de filles dans l'enseignement supérieur scientifique et les classes préparatoires. Elles sont en revanche majoritaires en première année de médecine et dans les filières de gestion. Dans les très grandes écoles, on compte seulement 10 % de filles. En revanche, à l'institut national des télécommunications, on en compte 25 % en moyenne et 30 % dans les années de pointe. Les filles sont beaucoup plus sensibles que les garçons à l'environnement d'une école et à son aspect plus ou moins exclusivement technologique. Le comportement des enseignants dès l'école primaire vis-à-vis des filles et des garçons est déterminant. Beaucoup de stéréotypes sont véhiculés par la société, les familles et les enseignants. Dans les matières scientifiques, les enseignants consacrent 20 % de temps de plus pour les garçons que pour les filles. Sur le niveau des élèves et des étudiants, on constate un problème de méthode de travail plutôt que de compétences. Il faut cependant nuancé car il y a une quinzaine d'années l'ancien bac C comportait deux matières essentielles (mathématiques et physique), aujourd'hui le bac S est beaucoup plus différencié et donc chaque matière est moins approfondie. Les problèmes viennent essentiellement des méthodes de travail : absence de formation à la prise de notes correllée à de faibles capacités de synthèse, ces dernières faiblesses semblant découler de l'usage exclusif du contrôle continu et de la disparition de bilans plus espacés qui obligeaient à un exercice de synthèse. On constate également des difficultés en logique élémentaire, un manque d'aisance dans l'usage du vocabulaire (confusion entre la notion d'équivalence et la notion d'implication), qui entraînent des difficultés sérieuses pour comprendre un énoncé et rédiger la solution. On progresse par « essai-erreur » : on essaie une méthode un peu au hasard sans se préoccuper de savoir si elle est pertinente pour le problème traité. Plus généralement, on note chez les élèves un comportement de consommateur peu propice à l'effort nécessaire pour appréhender de nouvelles choses et l'acquisition de connaissances. Nous préconisons : un travail en amont sur les méthodes de travail, le renforcement dans toutes les disciplines des exigences en matière de logique élémentaire et surtout une meilleure articulation entre les programmes du secondaire et du supérieur. Il faut donc définir les connaissances de base indispensables au niveau bac + 5 au sein de chaque grand domaine scientifique, mais aussi pour tout cadre supérieur. Un consensus s'est peu à peu installé entre le monde économique et le monde scolaire et universitaire pour définir les connaissances nécessaires à tout cadre supérieur niveau bac + 5, en fonction de la filière choisie. M. Jean-Marie Rolland : Est-ce que les méthodes d'enseignement en primaire et dans le secondaire permettent aux élèves d'acquérir les bases d'un esprit scientifique ? M. Christian Margaria : À l'exception des expériences du type « la main à la pâte » ou les « projets scientifiques parrainés », les élèves n'ont pas beaucoup l'occasion de découvrir les méthodologies du raisonnement scientifique et la démarche expérimentale mais ces méthodes sont chronophages. Sur la définition des programmes et les méthodes d'enseignement, on peut dire que les premiers sont relativement adaptés malgré de graves défaillances concernant les technologies de l'informatique et des communications (TIC). Le brevet informatique et internet (B2i) récemment introduit devrait permettre de remédier à ce dernier point (savoir manipuler un traitement de texte et un tableur et faire une recherche sur internet). Mais la diminution des heures d'enseignement de mathématiques au lycée pose des problèmes d'articulation non seulement avec les programmes de l'enseignement supérieur mais aussi avec les programmes de physique des classes de lycée. La diminution des horaires fait obstacle à l'approfondissement de la méthodologie et du raisonnement ce qui nuit notamment en troisième/seconde à de bons choix d'orientation des élèves faute d'une réelle sensibilisation aux sciences. Sur les projets scientifiques parrainés (PSP), ils doivent être rattachés à la démarche « école ouverte ». La démarche est la suivante : une classe volontaire de lycéens fait le choix d'un thème scientifique sur lequel ils vont travailler pendant toute l'année scolaire. Ils sont encadrés par des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui font office de tuteurs pour mener à bien leur projet en effectuant notamment des manipulations pratiques en laboratoire. Chaque équipe présente son projet à la fin de l'année à un jury en vue d'une remise de prix. Cette expérience est née dans le département de l'Essonne il y a six ans et le préfet d'Ile de France a décidé de la généraliser à toute la région. Il faut faire « saliver » les jeunes sur l'intérêt de la science et de la technique et leur faire acquérir les bonnes méthodes. On les laisse perdre du temps pour trouver par eux mêmes les solutions. Les sujets sont très variés : conception d'une maquette électronique, piano à odeurs, machine à concevoir des cocktails, l'important étant la démarche d'analyse et de synthèse du problème et non le produit fini. Des entreprises (SEGMA ou IBM) sont partenaires de cette expérience ainsi que le conseil général, l'inspection d'académie et les grandes écoles. La motivation des filles est aussi forte que celle des garçons dans les PSP où elles sont en nombre égal. Ce qui détourne les filles de la science, c'est l'absence de modèle féminin proche de leur âge. En effet, les jeunes chercheuses ou ingénieures n'ont pas assez de temps pour s'impliquer dans des expériences comme les PSP. Cela conduit à l'idée qu'une telle implication, tout en restant volontaire, ne devrait pas être bénévole, mais être prise en compte dans les obligations générales des jeunes professionnels. Le PSP touche chaque année 150 à 160 élèves dans l'Essonne et les enseignants sont de plus en plus demandeurs. Ces activités se passent en partie sur les horaires de cours et en partie le mercredi après midi. Si l'on fait des comparaisons internationales en matière de méthode d'enseignement on s'aperçoit qu'il n'y a pas de solution miracle. En Europe du Nord, on applique des méthodes pédagogiques plus actives et sans doute plus efficaces fondées sur le projet de l'élève et sur son travail personnel et moins sur des programmes à suivre. On attend que les élèves comprennent qu'ils ont besoin des mathématiques pour que le professeur vienne faire son cours. Les mathématiques jouent un rôle sélectif alors qu'elles devraient être vécues comme un outil nécessaire aux autres matières. La réduction du nombre d'heures est sans doute à l'origine de la difficulté à transmettre aux élèves la capacité d'un raisonnement logique. * Audition de M. Yves Malier, professeur d'université, membre de l'Académie des technologies, ancien directeur de l'Ecole normale de Cachan M. Yves Malier : Je voudrais tout d'abord livrer quelques chiffres pour illustrer la diminution des vocations scientifiques. En 2003, à la sortie du collège, 58,7 % des élèves intègrent l'enseignement général et technologique et 40,7 % entrent dans l'enseignement professionnel. Après un ou deux ans, 7 % des lycéens de la filière générale et technologique passent dans la filière professionnelle. Il en résulte que 48 % (soit la moitié d'une classe d'âge) des lycéens sont en formation professionnelle dont 14 % en apprentissage et 34 % en lycée professionnel. La principale distinction entre l'apprentissage en CFA (Centre de Formation des Apprentis) et le lycée professionnel est que dans le premier cas les élèves ont choisi leur discipline alors que dans le second ils sont affectés là où il y a de la place et là où il y a un établissement. En classe terminale, les effectifs en 2003 étaient les suivants : - Bac S : 155 000 : ce chiffre est constant depuis 15 ans, - Bac L : 60 000 : cette chute d'effectifs est inquiétante, - Bac ES : 100 000 : on note une légère croissance, - Bac techno : 180 000 : cette filière alimente de moins en moins les classes de BTS et les IUT, elle a été dévalorisée depuis son intégration aux lycées généraux, - Bac pro : 90 000, - BEP : 210 000, - CAP : 32 000. Ces trois dernières filières ne débouchent pratiquement plus sur un enseignement supérieur scientifique comme cela a été le cas pendant des années avec l'accès à l'école nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) par exemple. L'enseignement professionnel n'a plus pour objectif depuis une vingtaine d'années de repérer des élèves susceptibles de faire des études scientifiques (souvent de l'ordre de 25 % des effectifs). Il s'est trop efforcé de se rapprocher de l'enseignement général et a perdu sa raison d'être. M. Yves Boisseau : Je constate souvent le contraire, de nombreux titulaires du bac professionnel intègrent des classes de BTS et poursuivent ensuite des études. M. Yves Malier : Ce rôle d'ascenseur social n'appartient plus à l'enseignement professionnel et d'ailleurs tout se joue dans ce domaine dès l'école élémentaire. Dès ce niveau en effet, plusieurs handicaps s'opposent à une bonne formation scientifique des jeunes en France : les méthodes d'acquisition des bases fondamentales générales privilégient la devinette ludique sur l'éveil et la logique, l'enseignement des sciences est très insuffisant et prépare à l'incompréhension du monde, à la montée de l'obscurantisme et à la fermeture très précoce à de nombreux métiers. Les anciennes écoles normales d'instituteurs reflétaient dans leur composition un équilibre entre scientifiques et littéraires. Aujourd'hui, les futurs professeurs des écoles dans les IUFM sont tous de formation littéraire et de surcroît le volume d'heures d'enseignements scientifiques varie entre 18 et 50 heures au cours des deux années d'IUFM. Il en résulte une incapacité à éveiller des élèves aux matières scientifiques et même à leur apprendre à compter. Quelles propositions ? - Changer la méthode d'enseignement car le jeu de devinettes permanentes ne prépare pas bien à l'esprit scientifique. - Recruter les professeurs des écoles de façon plus équilibrée entre littéraires et scientifiques. - Réformer les contenus des enseignements à l'IUFM et y développer la pédagogie appliquée. - Généraliser les méthodes d'observation et d'expérimentation. - Mieux gérer les individualités et les problèmes spécifiques de chaque élève ce qui évitera de passer à côté de nombreux talents et d'élèves doués mais peu soutenus par leur environnement. Au collège, la sélection est très dure et dès la fin de la sixième, les enseignants savent qui sera orienté en fin de troisième. Beaucoup d'élèves ne supportent pas le découpage excessif de l'enseignement en plus de dix disciplines ce qui interdit tout suivi personnalisé de l'élève (certains enseignants ont jusqu'à 480 élèves chaque année) qu'ils ne peuvent évidemment pas connaître. Il faudrait au minimum rétablir les enseignements bivalents en sixième et en cinquième ce qui se fait dans tous les autres pays. Les sciences notamment sont traitées par quatre enseignants différents sans coordination entre ces enseignements, il en résulte un effet repoussoir de ces matières qui deviennent un outil d'évaluation et d'orientation. Quelles propositions ? - Des programmes équilibrés réalistes et pluridisciplinaires. - Des enseignants moins spécialisés et à double compétence (il serait intéressant de distinguer une agrégation des collèges portant sur trois disciplines et une agrégation des lycées rattachée à une seule discipline). - L'introduction de formation technologique contribuerait à l'envie de comprendre l'évolution du monde. - Des commissions de programme moins académiques et ouvertes à la société civile. - Des formations initiales et continues des enseignants rénovées et transdisciplinaires. A propos de l'enseignement technologique au lycée, on retrouve le même problème avec un enseignement trop monodisciplinaire du à un recrutement de professeurs monoprofil. Prenons l'exemple des travaux publics et de la construction : cette discipline devrait reposer sur plusieurs sciences de base : mécanique, géologie, physique, thermique et gestion, or tous les enseignants sont agrégés de génie civil qui relève exclusivement de la discipline mécanique. Il en résulte un déphasage des enseignements concentrés sur un seul aspect des problèmes. D'une manière générale, l'enseignement des technologies est incomplet, il n'apporte rien sur les métiers concernés et laisse les élèves faire seuls le lien indispensable. A propos de l'enseignement professionnel, on doit tout d'abord noter qu'il se déroule pour 14 % des élèves en apprentissage, ce ratio ne pourra pas être augmenté faute de maîtres d'apprentissage dans les entreprises. Il faut donc développer les lycées professionnels pour tous ceux qui ne peuvent aller en apprentissage. Il existe une réelle incompréhension de l'enseignement professionnel de la part des politiques (sur les huit derniers cabinets ministériels de l'éducation nationale, aucun conseiller n'avait une réelle compétence dans ce domaine). A Paris, où les besoins d'ouvriers qualifiés dans le secteur du bâtiment sont immenses, on vient de fermer l'unique lycée professionnel du bâtiment qui avait un très bon niveau. La carte scolaire est trop déconnectée des besoins de l'emploi, les choix des élèves ne sont jamais respectés, les professionnels ne sont pas assez présents dans les conseils d'administration comme dans l'enseignement. Il faut également déplorer la disparition des internats, l'absence ou l'insuffisance de projet culturel dans les lycées professionnels, l'incapacité à promouvoir les meilleurs élèves par des formations complémentaires et enfin la faiblesse de l'enseignement des langues. * Audition de M. Elie de Saint-Jores, chef de service formation initiale au sein de la direction de la formation du MEDEF M. Elie de Saint-Jores : Il faut commencer par faire état du sérieux problème de l'orientation et de l'information des jeunes et du manque d'articulation entre les différents niveaux d'enseignement. Dans la définition du socle commun des connaissances, il faudra mentionner la formation à l'esprit scientifique (démarche inductive et déductive). On doit notamment se demander pourquoi l'expérience de « la main à la pâte » n'est pas généralisée. Il faut évaluer ces expériences et les généraliser si elles sont concluantes. Dans le socle, il faudra également faire le lien entre la science et la technique. On peut également citer l'expérience des plates-formes de coopération technologique dans les lycées, qui intéressent vivement les branches professionnelles. Elles rassemblent des lycéens, des enseignants et des universitaires sur un projet commandité par des petites entreprises. Il en existe 83 qui visent à développer l'esprit scientifique et à motiver les jeunes. Il faudra là aussi procéder à des évaluations. Sur la pédagogie la méthode et les contenus : il ne faut pas opposer les sciences et les lettres car un bon maniement de la langue et un bon niveau de vocabulaire sont indispensables pour formuler un problème scientifique. Mais il est surtout essentiel de développer l'approche expérimentale et la méthode inductive et toutes les formes de pédagogie active comme les TPE. Le niveau des contenus et des programmes est souvent trop élevé par rapport aux aptitudes de l'ensemble des élèves ce qui contribue à éliminer des jeunes trop tôt et sans leur laisser le temps de développer leurs aptitudes scientifiques. Cette sélection n'est pas seulement l'effet des mathématiques mais de toutes sortes de pressions. Oui à la compétition mais non à l'élimination de talents en éveil. Aux Etats-Unis 50 % d'une classe d'âge accède à l'enseignement supérieur contre seulement 37 % en France. Quant au rapport des filles et des sciences, on ne peut faire que des hypothèses : elles auraient moins l'esprit de compétition et pourtant elles représentent 60 % des étudiants en médecine, surtout elle s'éloignent des sciences parce que cet enseignement est souvent dénué de sens et de lien avec une dimension humaine. L'enseignement des sciences pures et dures doit être mis en relation avec leur finalité et leur dimension humaine le plus tôt possible. L'éducation nationale ne s'appuie pas assez sur les collectivités locales notamment pour développer les classes de découverte. S'agissant de la relation école-entreprise, on constate quelques innovations à l'école primaire qu'il faudrait généraliser en développant, comme parfois pour l'enseignement des langues, le rôle d'intervenants extérieurs, notamment de représentants du monde économique (ingénieurs, chercheurs...) dans les écoles. Il faut sans doute trouver une évolution statutaire pour cela. L'option de découverte professionnelle au collège devrait être plus orientée vers les métiers scientifiques. La fête de la science est une bonne occasion pour ces rencontres et pour mobiliser davantage les entreprises. Il faut également développer des stages en entreprise pour les enseignants, ils sont prévus dans les IUFM mais n'ont jamais lieu. Il faut favoriser par le troisième concours d'accès à l'enseignement secondaire préparé dans les IUFM, la conversion des cadres du privé qui souhaitent enseigner. Il faut développer les jumelages entre les établissements scolaires et les entreprises ou les laboratoires de recherche. Le MEDEF organise un concours dans le domaine du développement durable et il a mobilisé pour cela tous les masters environnement de France en mettant en avant le rôle des entreprises dans ce domaine. Mais comment faire redescendre vers l'école le collège et le lycée, les savoirs qui sont ainsi créés par les étudiants et plus généralement les savoirs produits par la recherche. La valorisation et la diffusion des savoirs issus de la recherche sont essentielles. M. Jean-Marie Rolland : les entreprises se heurtent-elles à une pénurie d'ingénieurs et de techniciens ? M. Elie de Saint-Jores : on rencontre ce problème essentiellement dans le secteur industriel. M. Yves Boisseau : et pourtant des ingénieurs ont du mal à trouver du travail M. Elie de Saint-Jores : c'est moins le cas pour ceux qui ont fait des études en alternance et en apprentissage. Les IUT et les STS, où les stages sont obligatoires, jouent encore un véritable rôle d'ascenseur social, conduisant à la licence professionnelle puis à des écoles d'ingénieurs. En effet les entreprises ont besoin d'un niveau de qualification de plus en plus élevé et souvent supérieur à bac + 2. Les stages en entreprises devraient être réservés aux formations professionnelles de grande qualité car on tend actuellement vers une surcharge des entreprises accablées de demandes notamment avec l'introduction de l'option de découverte professionnelle. S'agissant de la formation des enseignants, on doit déplorer un déficit de formation scientifique chez la plupart d'entre eux et un déficit de connaissance de l'entreprise. Il faudrait également revenir à la bivalence des enseignants. M. Frédéric Reiss : ne faudrait-il pas que les enseignants fassent également des stages en entreprise ? M. Elie de Saint-Jores : C'est une demande forte de toutes les branches professionnelles. Il faudrait également développer le tutorat réalisé dans les lycées professionnels et les écoles par de jeunes scientifiques, étudiants ou chercheurs. * Audition de Mme Geneviève Berger, chercheure en biophysique, ancienne directrice du CNRS. Mme Geneviève Berger : Je tiens à souligner la nécessité d'un bon enseignement des sciences dès le plus jeune âge. Cela contribue à donner à chacun les bases du raisonnement scientifique pour la vie courante et permet d'utiliser des technologies compliquées et de s'impliquer dans les débats citoyens sur l'évolution des sciences pour lesquelles chacun doit être apte à se former un jugement. La qualité de la formation est également de nature à résoudre le grave déficit de scientifiques dans les années futures en France comme dans tous les pays industriels. Toutes les réunions de dirigeants d'organismes de recherche au niveau international sont amenées à poser ce problème et à chercher des solutions. La National science foundation (NSF) est l'organisme qui a fait le plus de propositions constructives sur ces questions. Cette pénurie explique que tous les pays cherchent à accaparer les jeunes cerveaux et particulièrement les français considérés comme plutôt bien formés. Quels sont les mots clés à prendre en considération dans l'enseignement des sciences, tout d'abord le jeu et le plaisir, l'enseignement des sciences est trop fonctionnel, on veut en faire trop et on enseigne mal surtout en matière de méthodologie. Il faut faire prévaloir le jeu sur le fonctionnel et ce qui est bien compris sur une somme de connaissances mal assimilées. Il faut également développer l'interdisciplinarité, les disciplines sont trop cloisonnées et les mathématiques déconnectées de leurs applications dans les autres sciences. C'est à la frontière des disciplines que les choses deviennent intéressantes. Bien sur, il faut des approches différentes suivant les disciplines mais l'objectif général est de ne pas dégoûter les jeunes en cherchant à les pousser trop vite trop loin et une démarche ludique n'est pas contradictoire avec l'accès à un très haut niveau. L'enseignement de l'informatique en tant que matière scientifique est indispensable et doit être introduit à l'école. S'agissant des jeunes filles, les choses ont bien évolué. Dans ma promotion à l'école normale supérieure de Cachan nous n'étions que trois filles, et Cachan était la seule école normale supérieure mixte. A l'époque les internats des classes préparatoires étaient réservés aux garçons. De grandes améliorations ont eu lieu mais un plafond de verre subsiste. Si le CNRS compte 50 % de femmes dans ses effectifs totaux, il y a beaucoup plus de chercheurs hommes que de chercheurs femmes alors que l'on trouve plus de femmes chez les techniciens et administratifs et le système pyramidal aboutit au niveau de la direction à un nombre très réduit de femmes. Il y a plusieurs explications à cette situation : faute de temps, les femmes sont moins présentes dans les réseaux et dans les commissions à prédominance masculine, la science n'est pas présentée comme un métier féminin et elle a un déficit d'image en direction des femmes. L'environnement scolaire et familial est souvent peu favorable à l'accès des filles aux filières scientifiques. Il leur est souvent suggéré de préférer les métiers du droit ou de la santé. Les femmes sont moins attachées à la notion de pouvoir et de management. M. Frédéric Reiss : Comment peut-on enseigner peu mais bien les sciences, faut-il privilégier une discipline ? Mme Geneviève Berger : Non, il faut faire peu mais bien dans toutes les disciplines, en privilégiant le questionnement sur les connaissances et en ciblant les thèmes d'intérêt des élèves. Il faut donc alléger les programmes et bien préciser ce que l'on veut mettre dans le socle commun de connaissances. * Audition de M. Bernard Hugonnier, directeur-adjoint de la direction de l'éducation de l'OCDE M. Bernard Hugonnier : Les enquêtes PISA réalisées par l'OCDE mesurent les compétences et la capacité à utiliser un savoir, des élèves de 15 ans dans différents domaines. Nous allons lancer en 2007 un nouveau programme pour mesurer les compétences des adultes de 16 à 65 ans. L'enquête 2003 a privilégié les mathématiques pour lesquelles les tests portaient sur quatre matières : algèbre, géométrie, arithmétique et calculs de probabilité. Des tests en sciences concernant des problèmes d'actualité ont également eu lieu ainsi qu'un quatrième volet concernant la résolution de problèmes ce qui est une extension des mathématiques, de la lecture et des sciences. Dans l'ensemble des matières, la France est légèrement au-dessus de la moyenne mais c'est en sciences que les élèves français obtiennent les moins bons résultats (10 sur 20). Ces enquêtes ont permis de révéler que le système éducatif français est en retard. Bien que la 6ème puissance industrielle du monde, la France compte moins de diplômés et moins de chercheurs par habitant que les autres Etats membres de l'OCDE. Le taux de chômage y est plus élevé qu'ailleurs y compris chez les ingénieurs et les docteurs. Il est certain que tout cela est en rapport avec le système éducatif. Si les sciences étaient mieux enseignées peut-être que le taux de croissance de la France serait plus élevé. Les jeunes Français sont plus anxieux que les autres à l'égard des mathématiques, surtout les filles, leur sentiment d'appartenance à leur école est un des plus faible. L'OCDE procède en effet à des enquêtes contextuelles qui intègrent les relations avec les professeurs, la motivation et l'ambiance générale à l'école et on pose les mêmes questions aux chefs d'établissement. M. Jean-Marie Rolland : Comment et par qui sont élaborés les tests ? M. Bernard Hugonnier : L'OCDE n'a qu'un rôle de gestionnaire. Les tests et le déroulement des épreuves relèvent de la compétence des Etats membres (30 pays membres et 40 participants) qui font des propositions. Une équipe de spécialistes retient les questions les plus universelles et les plus détachées d'un contexte. Les écoles où se déroulent les tests sont choisies au hasard (150 écoles par pays et 30 élèves de 15 ans par école). Les tests sont corrigés par une équipe internationale de spécialistes. Sur l'enseignement des sciences il faut se donner quatre objectifs : - la transmission des savoirs indispensables, - le plaisir de la découverte, - l'augmentation des capacités à apprendre, à trouver des informations et à les gérer, - la capacité à développer une raison critique permettant un jugement sur les grands problèmes scientifiques du moment (OGM, clonage, environnement et climat). En France, le système éducatif sous-estime les trois derniers objectifs. Il n'y a pas de solution miracle mais dix mesures peuvent être dégagées : - développer des programmes en sciences plus en phase avec la maturité intellectuelle des jeunes (les travaux des neurosciences démontrent qu'à 14 ans les jeunes en moyenne ont une quasi incapacité à maîtriser des idées abstraites) faute de quoi on élimine une grande quantité d'élèves prématurément ; - initier très tôt, dès le primaire, les jeunes enfants aux sciences. Certains livres tels que celui très brillant qui s'appelle « Les engrenages » paru chez Ground, peuvent y contribuer. - il faut développer l'expérimentation et les applications pratiques, ça coûte cher mais c'est indispensable pour motiver et valoriser l'image des sciences ; - contextualiser l'enseignement qui est trop théorique et sans lien avec une application pratique (par exemple à quoi sert une dynamo ?) ; - utiliser l'informatique qui facilite l'apprentissage et le rapproche d'une forme de jeu familière aux élèves ; à terme il n'y aura plus de cahiers mais uniquement l'ordinateur; - améliorer le langage et la communication. Le langage des enseignants est souvent abscond et incompréhensible, ils doivent se mettre au niveau des élèves - motiver en faisant sans cesse référence aux problèmes scientifiques du monde (OGM, clonage, maladies...) et en présentant des perspectives de débouchés intéressantes. On constate en effet une grosse ignorance pour tous les métiers scientifiques et l'utilisation des sciences; - évaluer différemment les élèves. Le système de note-sanction est une approche comptable dévalorisante qui ne permet pas de mettre en valeur les progrès. L'évaluation doit être qualitative et renseigner l'élève sur ses faiblesses et sur ses forces. Il ne faudrait pas mettre de notes avant 13 ans. La note est une manifestation de l'autorité et de la hiérarchie très prisées en France mais on ne motive personne avec les mauvaises notes ; - interdire les devoirs à la maison. Tous les travaux scientifiques démontrent qu'ils ne servent à rien et enfoncent les élèves qui ne peuvent bénéficier d'un soutien familial et d'une bonne ambiance à la maison. A l'inverse ils favorisent les élèves de familles aisées qui peuvent payer des cours particuliers. Les devoirs, surtout en sciences, doivent être faits à l'école avec un soutien personnalisé. - fixer des standards minimums. L'objectif obsessionnel des professeurs est de faire les programmes et tant pis pour ceux qui ne suivent pas, on les abandonne. Si l'objectif devient l'acquisition d'un socle commun par tous les élèves, la problématique est renversée. C'est ce qui se passe dans les systèmes canadiens et finlandais. - former les enseignants en renouvelant la formation initiale et permanente. M. Jean-Marie Rolland : qui doit définir les standards ? M. Bernard Hugonnier : il faut partir d'un projet de société. Il n'est pas nécessaire de tout connaître mais il faut se demander quel genre de citoyens on veut former. Une expérience psychologique a été réalisée sur des jeunes étudiants en sciences : à un premier groupe on pose une question à laquelle ils doivent répondre par écrit, à un autre groupe on montre une expérience et on leur demande d'écrire ce qu'ils ont vu. La comparaison des résultats est édifiante : dans le premier groupe les étudiants font appel à leur intuition et à des fausses évidences et dans le second ils décrivent la réalité. Il faut donc familiariser les jeunes à tous les problèmes scientifiques qui débouchent sur des problèmes sociaux et les programmes doivent être élaborés en fonction de ces problèmes. M. Frédéric Reiss : comment une meilleure éducation scientifique peut faire de meilleurs citoyens ? M. Bernard Hugonnier : une meilleure connaissance d'un problème rend les citoyens plus responsables par exemple en ce qui concerne le bon usage des médicaments. Il faut pour reprendre une ancienne formule former des têtes bien faites et développer la capacité de jugement. M. Jean-Marie Rolland : Quels sont les pays qui ont le plus développé l'usage de l'informatique dans l'enseignement ? M. Bernard Hugonnier : le champion du monde sur ce point est la Corée qui obtient par ailleurs de très bons résultats éducatifs et scolaires et a un nombre d'étudiants de plus en plus élevé. Viennent ensuite la Finlande le Canada l'Australie et le Japon. Mais il y a des explications sociologiques à ces résultats. La Finlande par exemple compte très peu d'immigrés, le principe d'autorité est encore très respecté et le statut social des enseignants très élevé. Ce pays ne pratique pas de sélection précoce contrairement à l'Allemagne (en effet si on arrête les études abstraites à 14 ans, on stoppe définitivement le développement des capacités cognitives), tous les enfants quel que soit leur niveau ou leur handicap, sont mélangés et il existe une seule école en continu depuis la fin du primaire jusqu'à la terminale. Les problèmes individuels sont traités de façon très précoce et l'élève peut être retiré très momentanément de la classe. Si il y a un problème collectif c'est la classe qui est traitée. Le nombre d'élèves par classe est comparable en Finlande à celui de la France mais l'école n'est obligatoire qu'à partir de sept ans. L'apprentissage des langues vivantes est très développé. Quelles leçons retenir des enquêtes PISA : six niveaux de compétence ont été élaborés. Seuls 4 % des élèves français atteignent le meilleur niveau contre 10 % pour la moyenne des autres élèves. Le dernier niveau, le plus faible, concerne 15 % de l'ensemble des élèves testés, la seule conclusion c'est que nos pays sont sous-éduqués. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2005 Audition de Mme Claudine Peretti, directrice de l'évaluation et de la prospective du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Madame Claudine Peretti : Je vais tout d'abord préciser les rôles de la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP), cette direction existe depuis vingt ans et elle a succédé à un service de statistiques. Sa mission première consiste à rassembler les informations statistiques sur le fonctionnement du système éducatif ainsi que sur les travaux de recherche publique et privée dans le domaine de l'éducation. La DEP procède également à des évaluations du système éducatif. Elle évalue les acquis des élèves dans les différentes disciplines et l'évolution des connaissances à un âge donné, elle participe également aux enquêtes internationales sur l'évaluation des acquis. D'autre part elle évalue les établissements d'enseignement et les politiques publiques. Tous les résultats de ces travaux sont rendus publics et servent d'outil d'aide au pilotage de l'éducation et d'aide à la décision. Ces travaux doivent permettre également aux enseignants de mieux comprendre les difficultés d'apprentissage de leurs élèves afin de leur apporter le soutien nécessaire. La DEP compte 210 personnes dont la moitié de statisticiens mis à disposition par l'INSEE. Elle se distingue de l'inspection générale car cette dernière travaille sur pièces et sur place alors que nous utilisons les outils statistiques et les enquêtes ainsi que des tests normalisés auprès des élèves qui permettent d'évacuer la subjectivité du correcteur. La DEP réalise les opérations diagnostics en CE2 et en 6ème en français et en mathématiques, introduites à la fin des années 1980. L'objectif de ces diagnostics est d'aider les enseignants à identifier les difficultés des élèves. En primaire cette évaluation va prochainement être avancée à la classe de CE1. Dans les autres disciplines, on procède à des évaluations bilans qui mesurent les acquis par rapport au contenu des programmes en fin de primaire et en fin de collège. Ces dernières évaluations sont réalisées sur un échantillon représentatif d'élèves et non pas sur la totalité. Une telle évaluation a été réalisée en 2003 sur la maîtrise de la langue française et en 2004 sur les compétences en anglais et en allemand. Elle permet de voir si les objectifs de l'enseignement tels qu'ils sont fixés dans les programmes sont atteints et comment les élèves se répartissent entre les différents niveaux de compétences (10 % atteignent tous les objectifs et 1,5 % ne savent rien faire). Peu de choses sont faites en revanche dans le domaine de la prospective faute de moyens. Une exception cependant consiste à évaluer à dix ans les besoins de recrutement de jeunes en fonction d'un grand nombre de paramètres (taux de croissance, niveau de formation, marché du travail, nouveaux métiers etc...). La DEP participe à l'enquête internationale PISA dont l'objectif est différent du nôtre. En effet, PISA vise à mesurer si à 15 ans quelque soit le système éducatif, les enfants ont une maîtrise suffisante des compétences nécessaires pour la vie courante sociale et professionnelle. Les résultats sont parfaitement correllés au type d'enseignement reçu par les élèves (par exemple, les élèves français n'ont pas de cours de probabilités avant le lycée, il est donc normal qu'ils aient échoué au test de probabilités de l'enquête PISA). L'intérêt est donc de vérifier cette corrélation entre un enseignement reçu et une compétence et permet de s'interroger sur les contenus des enseignements dispensés. Dans l'exemple des probabilités on pourrait se demander s'il faut les enseigner plus tôt en France. M. Jean-Marie Rolland, président : Quelles sont les conséquences tirées à partir des constats de vos travaux par exemple au niveau des programmes? Mme Claudine Peretti : La DEP n'est pas habilitée à prendre des décisions mais intervient uniquement en soutien au directeur des programmes. Il faut cependant bien constater que depuis le milieu des années 90 notre système éducatif stagne et le nombre de bacheliers généraux n'augmente plus, pas plus que le taux d'accès aux baccalauréats. On s'est aperçu grâce au suivi de panels d'élèves que plus les difficultés sont précoces, plus les élèves ont du mal à les surmonter. Il faut mettre un accent fort sur le début des apprentissages. Il existe d'énormes écarts de compétences entre les élèves dès le CP et si les enseignants n'en tiennent pas compte, aucun enseignement efficace ne peut être effectué. M. Jean-Marie Rolland : L'entrée à l'école à 2 ans a-t-elle un effet ? Mme Claudine Peretti : Cette entrée précoce a très peu d'effet sauf pour les enfants de familles défavorisées qui peuvent améliorer leur maîtrise de la langue mais on constate que ce ne sont pas eux qui bénéficient de cette entrée à l'école à 2 ans. Les problèmes sont donc essentiellement d'origine socio-culturelle ce qui explique la très grande difficulté des élèves des établissements classés en ZEP. Sur l'acquisition de l'esprit scientifique et la désaffection pour les études scientifiques, la part de la série S au bac n'a pas changé depuis les années 1990 (le bac S représente la moitié des bacs généraux et le quart de l'ensemble des bacs). Pas de désaffection pour le bac S. Néanmoins, on dénombre un moins grand nombre de bacheliers S qu'en 1995 ce qui est lié à une baisse globale de la filière générale. Je ne parlerais pas de désaffection pour les études scientifiques en général mais uniquement pour le premier cycle d'études scientifiques universitaires surtout en sciences physiques. A l'inverse, les études médicales et les sciences pour l'ingénieur, les CPGE, sont de plus en plus attractives. Les jeunes sont très pragmatiques et choisissent en priorité les filières sélectives (CPGE ou IUT par défaut) qui débouchent sur des études très valorisantes et des métiers plus valorisés socialement. A l'inverse, le premier cycle universitaire censé conduire à l'enseignement ou à la recherche ne fait pas recette. Il n'y a pas de baisse du nombre d'étudiants dans le deuxième et le troisième cycle universitaire mais cela est du en partie à l'afflux de nombreux étudiants étrangers. On ne devrait donc pas parler de désaffection pour les sciences en général mais de désaffection pour la physique. Un effort particulier devrait donc être conduit pour mieux accompagner les étudiants du premier cycle universitaire dans lequel on constate le plus faible taux de réussite pour les lauréats du bac S, par rapport aux autres choix d'études (CPGE, IUT ou disciplines non scientifiques). M. Jean-Marie Rolland : C'est donc le manque de carrières valorisantes et le risque d'échec en premier cycle qui détourne les étudiants des études de sciences ? Mme Claudine Peretti : En effet, les disciplines de sciences physique et chimie se sont progressivement dévalorisées et d'autres disciplines ont pris le pas sur ces disciplines traditionnelles (sciences pour l'ingénieur). Il faut cependant noter qu'il n'y a pour l'instant aucune pénurie de candidats pour les concours de recrutement pour l'enseignement et la recherche dans ces disciplines. C'est la même chose en sciences de la vie où on trouve 60 candidats qualifiés pour un poste. C'est l'image de ces disciplines qui est moins valorisée qu'avant, probablement parce qu'elles ne correspondent plus à la structure du marché de l'emploi. D'autres disciplines telle que les sciences pour l'ingénieur ont supplanté la physique chimie. Une enquête en cours semble démontrer que les sciences-physiques ne sont pas aimées des élèves et que même les enseignants ont une image dévalorisée de leur discipline. La désaffection trouve sa racine dans le second degré où les sciences physiques ne sont plus valorisées y compris bien souvent par les chefs d'établissement. M. Jean-Marie Rolland : Cela ne résulte-t-il pas d'un enseignement trop théorique ? Mme Claudine Peretti : C'est une hypothèse puisqu'on ne retrouve pas ce même rejet pour les sciences de la vie ni pour les mathématiques. M. Jean-Marie Rolland : Avez-vous constaté une baisse du niveau moyen en mathématiques ? Mme Claudine Peretti : C'est difficile car nous n'avons pas d'éléments de comparaison. Une évaluation en sciences est programmée pour 2007. On peut dire que la majorité des jeunes qui choisissent la filière S ne le font pas par goût pour les sciences mais pour s'assurer le meilleur avenir possible. M. Jean-Marie Rolland : Les TIC sont-ils un outil d'enseignement ? Mme Claudine Peretti : Les enquêtes réalisées montrent que les enseignants, y compris ceux du primaire, sont bien formés à l'usage des TIC à des fins personnelles et pour leurs propres recherches mais ne les utilisent pas comme outil pédagogique parce qu'ils n'ont pas été formés pour cela. Cela résulte évidemment de la formation reçue en IUFM, cette formation est très variable d'un établissement à l'autre et porte en réalité sur une seule année. Il faudra prendre ces problèmes en compte dans le cadre de l'établissement du cahier des charges des IUFM et développer la formation continue des enseignants qui devrait être obligatoire. Ces derniers y sont favorables à condition que cette formation ait lieu pendant les heures de travail. * Audition de M. Norberto Bottani, directeur du service de la recherche en éducation du département de l'instruction au canton de Genève M. Norberto Bottani : Je vais revenir un instant sur l'origine des enquêtes PISA réalisées par l'OCDE. Elles sont liées aux difficultés qu'avait l'OCDE à produire des indicateurs fiables sur les systèmes d'enseignement des Etats membres afin de permettre aux décideurs de mieux piloter leur système éducatif. L'enjeu était tout simplement d'améliorer considérablement la qualité de l'enseignement et le rapport coût-qualité. Tout est parti en 1983 d'un rapport d'une commission américaine très accablant sur l'état de l'enseignement public aux Etats-Unis. Petit à petit un consensus international s'est dégagé sur la nécessité d'agir malgré la résistance des différents organismes de statistiques on peut parler de « confrérie des statisticiens » très attachés à leurs méthodes et à leur culture statistique lesquelles consistaient à livrer en vrac des chiffres en grande quantité mais dénués de tout moyen de compréhension et à leur utilisation par les responsables politiques. Il est curieux de constater que dans tous les pays les cadres du système éducatif qui sont souvent des ex-enseignants constituent de puissants groupes de résistance au changement et à l'évaluation du système. A la fin des années 1980 on ne disposait d'aucunes données comparables sur les acquis des élèves. Les Etats-Unis ont imposé une évolution mais en utilisant dans un premier temps des tests américains en lecture, en mathématiques et en sciences. Il fallait répondre vite à un besoin urgent d'informations et ces tests ont été acceptés sauf par la France qui n'a pas participé aux premières enquêtes (en 1989 et 1991). Par la suite, grâce au tollé des scientifiques de tous les pays, les tests américains ont été retirés. Il existe d'autres types d'enquêtes, notamment sur les acquis en mathématiques. Par exemple, les enquêtes TIMSS (Tests en mathématiques et en sciences) qui concernent 40 pays et 300 000 élèves de 13 ans et qui intègrent la comparaison des compétences avec les programmes enseignés et les manuels scolaires, auxquelles la France a participé mais seulement sur le volet connaissances. Les résultats ont été publiés en 1995. En 2006 les évaluations en mathématiques de type TIMSS seront faites sur des élèves de 18 ans. Toutefois, faute d'une réelle politique de recherche en sciences de l'éducation, la France est en retard par rapport à toutes ces initiatives auxquelles elle participe peu. Par exemple il existe une autre enquête expérimentale qui utilise la vidéo pour voir ce qui se passe en classe (150 cours de mathématiques filmés) et qui concerne 10 pays, conduite par le Service de la recherche en éducation à Genève (SRED). Pour revenir à PISA, cette enquête n'évalue pas les systèmes scolaires, mais mesure le capital humain et la culture scientifique et mathématique des futurs citoyens. PISA ne renseigne pas sur la capacité des écoles à transmettre des connaissances et un bagage scientifique. Les tests sont bâtis à l'envers puisqu'ils partent d'une analyse théorique et abstraite élaborée par des scientifiques qui ont décidé ce que l'on doit maîtriser à 15 ans. On ne peut en aucune façon évaluer un système d'enseignement, ses capacités et ses faiblesses, à partir des résultats des enquêtes PISA qui sont spectaculaires mais ont des résultats limités et il ne faut pas leur faire dire n'importe quoi. Les enquêtes sont accompagnées de questionnaires à destination des élèves, des enseignants et des chefs d'établissement. Il reste que la France n'est pas équipée pour participer efficacement à toutes ces enquêtes internationales. M. Jean-Marie Rolland : Quel est votre point de vue sur l'enseignement des sciences en France ? M. Norberto Bottani : Il est beaucoup trop sous l'emprise des didacticiens et des pédagogues qui cherchent à se faire plaisir. Les commentaires et les analyses de ces pédagogues sur les résultats des évaluations en mathématiques en primaire sont de ce point de vue significatifs car terriblement complaisantes et manquant de vision critique vis-à-vis des résultats et des enseignements. Il faudrait faire un énorme travail en direction des enseignants car les enquêtes PISA ont révélé un grave déficit d'attention des enseignants français vis-à-vis de leurs élèves et l'absence d'interaction enseignants-élèves et d'encouragement des élèves. Au Japon par exemple, les professeurs de mathématiques d'un collège ont l'obligation chaque semaine de travailler ensemble pendant une heure sur le cours de l'un d'entre eux qui le présente aux autres collègues et il en résulte une véritable prise en charge collective de l'enseignement. * Audition de M. Laurent Lafforgue, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques (IHES), membre de l'Académie des sciences, médaille Fields 2002 M. Laurent Lafforgue : depuis ma démission du Haut conseil de l'éducation, j'ai reçu des piles de courriels d'enseignants du primaire et du secondaire, scientifiques et littéraires qui pour la grande majorité d'entre eux se déclarent d'accord avec mes positions. C'est surtout l'enseignement primaire qui est dramatiquement malade en France. On ne peut même pas parler de niveau en baisse mais de totale déstructuration de l'enseignement dès le cours préparatoire. Le premier problème est la destruction de l'enseignement du français, ce qui se répercute sur les étudiants en université qui sont incapables de former une phrase, y compris les lauréats du bac S. La méthode de lecture utilisée et le renoncement à faire de la grammaire qui est le début de l'apprentissage de la logique sont à l'origine de cet effondrement. La faiblesse du vocabulaire est également criante, des enseignants se plaignent que leurs étudiants ne comprennent pas ce que signifie un adjectif invariable. En classe préparatoire les étudiants ne savent pas raisonner. Au lycée, dans la filière scientifique les épreuves du baccalauréat sont tellement standardisées, que l'on apprend aux élèves à identifier les questions et à apporter la bonne réponse de façon automatique, sans même comprendre le fond du problème. On crée chez les élèves de véritables réflexes conditionnés pour contourner le fait qu'ils ne comprennent pas les questions à cause de leur mauvaise maîtrise de la langue. L'empoisonnent de tout le système vient de l'IUFM où l'on apprend à se soumettre docilement à la doctrine officielle. Un stagiaire d'IUFM qui fait faire une dictée dans sa classe se voit vertement critiqué par l'inspecteur et est menacé de ne pas être titularisé ou de voir son salaire amputé, au motif que c'est un exercice trop scolaire. C'est un exemple vécu qui m'a été rapporté par l'intéressé. Les professeurs des écoles ne disposent d'aucune liberté pédagogique, ils sont très souvent inspectés par des inspecteurs choisis pour leur conformité à la doctrine officielle et les instituteurs sont notés en fonction du respect de cette doctrine et non pas en fonction des résultats obtenus. Tout le mal vient du sommet de l'éducation nationale et des formateurs dans les IUFM qui sont le plus souvent des psychopédagogues spécialistes des sciences de l'éducation, totalement coupés du terrain et qui développent des théories fumeuses. Il faudrait leur préférer des enseignants en exercice qui pourraient transmettre leur expérience. J'ai été enchanté par la déclaration de M. de Robien, ministre de l'éducation nationale, qui exige que l'on renonce à la méthode globale d'apprentissage de la lecture. Il faut savoir que des méthodes qui s'intitulent syllabiques sont des méthodes globales ou semi-globales déguisées. Mais le redressement va prendre du temps car les enseignants ont eux-mêmes subi un enseignement dégradé. S'agissant de l'enseignement des sciences, rien de bon ne peut être fait avec des élèves qui ne connaissent pas leur langue, disposent d'un vocabulaire très frustre et ne connaissent pas les règles de grammaire. De plus j'ai constaté que les étudiants à l'université ne connaissent pas la règle de trois et ne la comprennent pas. L'éducation nationale est une énorme machine qui coûte cher, avec beaucoup de gens qui se donnent beaucoup de mal et au final les étudiants ne connaissent pas la règle de trois. C'est de la chair sans os, l'accumulation de connaissances ne peut pas tenir car il n'y a pas de structure solide et pas de progression logique des apprentissages. Pas de logique, pas de structure, pas d'apprentissage un peu austère mais nécessaire. On ne demande pas aux enfants d'apprendre du vocabulaire on préfère les amener faire des visites et le résultat est qu'ignorant les mots ils ne peuvent lire même des textes simples (Alphonse Daudet ou Molière leur sont inaccessibles). Même chose pour l'apprentissage des conjugaisons totalement abandonné. A l'université les enseignants se plaignent que les étudiants ne savent pas faire la différence entre 5/3 et 3/5. Je ne sais pas si ces gens qui dirigent l'Éducation nationale depuis très longtemps sont fous ou malveillants, ce que je sais c'est qu'il faut rompre radicalement avec tout ça. M. Jean-Marie Rolland : est-ce qu'il y a un lien avec l'objectif de 80 % d'une génération au niveau du bac ? M. Laurent Lafforgue: c'est probable, mais l'ossification de l'école primaire remonte au début des années 1980. Il n'y a rien de commun entre l'école primaire d'aujourd'hui et celle d'il y a trente ans qui accueillait tous les enfants et il y avait aussi des problèmes sociaux à cette époque. Même chez les élites en classe préparatoire par exemple, on constate des déficiences au niveau du raisonnement et de l'utilisation de la langue, quant à l'école normale supérieure, élite de l'élite, pour les cinq premiers de chaque promotion, il n'y a pas de changement mais derrière le niveau est de plus en plus faible et hétérogène et surtout socialement ciblé. On compte en effet de plus en plus d'enfants de mathématiciens dans les promotions d'étudiants en mathématiques. Il faut donc en conclure que le niveau d'un élève ne dépend plus de l'école mais de l'apport de sa famille. Cela explique l'attractivité de plus en plus grande des écoles privées hors contrat car les parents n'ont plus confiance dans l'école publique. S'agissant de l'enquête PISA je suis très méfiant vis-à-vis des évaluations internationales car les tests sont très frustres et sommaires afin de pouvoir être appliqués dans tous les pays. Les résultats de ces enquêtes et leur utilisation poussent les systèmes éducatifs vers un enseignement basique, universel et superficiel. Par exemple le genre de question posée par les tests PISA est : Pierre habite à 5 km de l'école, Paul habite à 3 km, à quelle distance Pierre et Paul habitent-ils l'un de l'autre ? La réponse attendue par PISA est 2 ce qui n'est pas correct. Pour les tests en mathématiques de l'enquête PISA, la hiérarchie des résultats obtenus par les pays ne correspond pas à la valeur des mathématiciens de ces pays. Par exemple un tiers des chercheurs en mathématiques dans le monde sont russes alors que les élèves russes obtiennent des résultats médiocres dans les tests internationaux et alors que les meilleurs manuels du secondaire en maths sont des manuels russes. Les pays du nord de l'Europe qui à l'inverse obtiennent de très bons résultats ne sont pas des modèles car ils ont un système d'éducation totalitaire dans lequel il ne s'agit pas de transmettre des savoirs mais des compétences et des sentiments bien pensants. * Audition de M. Michel Lagües, directeur de l'espace sciences à l'ESPCI (Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles), membre de « La main à la pâte M. Michel Lagües : L'enseignement des sciences exige de la part de tous les pays un effort tenace d'innovation important. L'esprit de « la main à la pâte » consiste à enseigner très tôt les sciences fondamentales non seulement parce que les pays ont besoin de scientifiques mais pour former des citoyens à l'esprit et au sens critiques. Si l'on veut véritablement relancer l'égalité des chances, c'est par un enseignement efficace des sciences que l'on y parviendra. L'action de l'homme sur la nature est tellement importante que l'enseignement des sciences pour tous les citoyens est indispensable. Les choses se sont effet bien dégradées puisqu'à l'origine, par exemple, l'école polytechnique était très démocratique et très ouverte avec des étudiants provenant de toutes origines. Mais 10 ans plus tard un nouveau directeur a introduit la danse dans les nouveaux programmes des épreuves d'entrée à l'école ce qui a déclenché une formidable sélection sociale. C'est exactement le contraire que nous devons faire aujourd'hui. L'une des grandes idées de « la main à la pâte » est l'accompagnement scientifique. Ce système est mal connu car indigeste pour l'éducation nationale, sa hiérarchie et son corps enseignant. Il consiste à faire accompagner les élèves pendant les séances d'expérimentation et de travail par un accompagnateur scientifique (étudiant, ingénieur ou chercheur) ce qui conduit à bien distinguer la fonction pédagogique de l'enseignant de celle du référent du savoir scientifique. Cet accompagnateur pourra dire « je ne sais pas mais allons voir ensemble » ce que l'enseignant ne peut pas dire. Cela est d'autant plus important à l'école primaire où les professeurs des écoles n'ont bien souvent aucune formation en sciences. Les actions de « la main à la pâte », démarrées il y a dix ans, continuent à l'école primaire et se développent maintenant au collège notamment dans une école privée active et bilingue (EABJM) avec une équipe enseignante particulièrement motivée. Cette initiative est soutenue par l'Académie des sciences qui soutient également l'introduction de la main à la pâte dans 20 collèges publics. C'est un véritable laboratoire expérimental où l'on fait ce que l'on veut et où l'on est autorisé à dire « je ne sais pas ». Au collège, le tronçonnage des enseignements scientifiques en plusieurs disciplines est une mauvaise idée. S'il est illusoire de revenir à un enseignement polyvalent, on peut au minimum demander aux enseignants de participer à un travail collectif et à une approche transversale des matières. Par exemple un thème comme « les sens, les capteurs, les instruments de mesure et l'ordinateur » sur lequel on travaille, constitue une mine de possibilités. Le point de départ se situe dans le secteur de la biologie. La question posée est « est-ce que les sens sont fiables » et on s'aperçoit que l'on peut se tromper. Alors on découvre l'existence de capteurs et d'instruments de mesure qui débouchent sur des problèmes de physique et de la construction d'un instrument de mesure. Tout cela peut se faire au cours d'un module de trois semaines à raison d'un après-midi par semaine. Les élèves participent à trois modules de chacun trois semaines dans l'année. La bonne démarche pédagogique ne peut être que pluridisciplinaire et transversale puisqu'elle doit partir d'un questionnement général tel que : les conditions d'apparition de la vie sur terre ou l'histoire des idées scientifiques. Il faut partir de l'observation, du questionnement et de la curiosité avant d'apporter des réponses. Le problème essentiel est la motivation des élèves. Il n'apprennent rien si on n'arrive pas à les accrocher en partant de leurs interrogations et en développant une pédagogie de résolution de problèmes concrets par exemple comment faire voler un objet, ce qui débouche sur des questions de physique de technologie et de biologie. Il faut laisser les élèves interroger le monde et la science (le clonage, le big bang, le trou noir...) et il faut leur répondre en faisant preuve de beaucoup d'innovations pédagogiques. L'histoire des sciences est souvent très utile pour illustrer un phénomène. Tout cela demande encore une fois un gros travail en direction des enseignants car aujourd'hui le bon prof est celui qui n'entend que les questions auxquelles il peut répondre c'est-à-dire celles qui sont dans le programme. Cette démarche exige une remise en cause des enseignants dans leur façon de travailler et dans leur rapport à leur propre discipline. Il faut parfois apporter des réponses tout de suite aux élèves et parfois non. Je cite souvent l'exemple d'une pédagogue anglaise à laquelle un élève montrait une goutte d'eau sur sa manche et lui demandait pourquoi l'eau ne mouille pas la manche. Elle explique qu'il ne faut surtout pas dans ce cas parachuter une réponse toute faite, mais inciter à faire d'autres observations (de l'eau sur du plastic, sur du papier ou sur du bois). L'important est de développer les capacités d'imagination des enfants. C'est très difficile mais c'est le prix à payer pour accrocher les enfants. M. Jean-Marie Rolland : Les expériences de « la main à la pâte » ont-elles été évaluées par l'éducation nationale ? M. Michel Lagües : Tout ça est très récent et ponctuel. Les enseignants du primaire qui n'ont pas de formation scientifique sont prêts à se lancer dans de nouvelles pratiques tout en conservant leur responsabilité de dirigeant de la classe. Ce n'est pas le cas au collège, où les professeurs de sciences sont sur la défensive et développent de nombreux blocages. C'est dommage, car les enfants arrivent au collège avec un grand appétit d'apprendre et ils sont vite déçus. Le seul moyen serait de faire travailler les enseignants ensemble toutes disciplines confondues en privilégiant la méthode, l'esprit critique, la formation d'hypothèses, la confrontation des résultats sur la transmission des connaissances et la confrontation des conclusions au savoir établi. Le propre d'un chercheur c'est de se tromper, c'est beaucoup plus difficile pour un enseignant. Au lycée il n'y a sans doute pas de grande révolution à faire dans l'enseignement, en revanche tout est à faire au collège. Lorsque la main à la pâte intervient, c'est dans le respect des programmes officiels qui ne sont d'ailleurs pas si mal faits (les programmes rénovés de sciences et techniques sont directement inspirés de la main à la pâte), le problème réside dans les conditions dans lesquelles il sont suivis, le fonctionnement des enseignants et l'attente qu'ils ont en direction des enfants. Par exemple il est exeptionnel qu'un enseignant s'appuie sur l'hisoire des sciences parce que le plus souvent il ne la connaît pas. Si dans le cadre de la main à la pâte on ne parle jamais d'atomes et de molécules ce n'est pas parce que ce n'est pas au programme mais parce que ces thèmes ne se prêtent pas à l'expérimentation. M. Jean-Marie Rolland : pouvez-vous nous parler de l'utilisation des technologies de l'information et de communication (TIC) dans l'enseignement ? M. Michel Lagües : à l'école primaire, l'usage des TIC n'est pas véritablement justifié, en revanche c'est incontournable au collège pour faire des recherches et des investigations (par exemple comment fabriquer un objet capable de mesurer la vitesse du vent), à condition de discuter des informations trouvées. L'usage des TIC et d'internet ne doit pas être au centre de la démarche, c'est un outil qui nécessite que les enseignants soient formés autrement et développent une autre vision de leur métier. * Audition de M. Thierry Aubin, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, membre de l'académie des sciences, section mathématiques M. Thierry Aubin : il y a beaucoup à dire sur le niveau scientifique et mathématique des étudiants. Il est impossible de faire des raisonnements logiques avec des élèves de quatorze ans car l'enseignement consiste à leur donner des règles à apprendre par cœur, ils ignorent tout du raisonnement logique. Dans l'ensemble il y a environ 20 % des élèves qui ne devraient pas être dans une classe de collège ou de lycée car ils ne comprennent rien et s'ennuient. Environ 10 % des jeunes sont aptes au raisonnement logique mais ils s'ennuient aussi beaucoup car on les force à apprendre par cœur. Au milieu on trouve 70 % d'élèves moyens qui sont à peu près concernés par ce qui est enseigné. Mélanger tous les élèves indépendamment des niveaux est une mauvaise chose car ils s'ennuient tous, autant les bons que les mauvais et on fait de la discrimination vis-à-vis des meilleurs. Les meilleurs élèves devraient avoir un enseignement spécial, car ce sont eux qui sont intéressants pour l'avenir du pays et de la recherche. J'ai vu dans une émission de télévision, en Chine, un élève de 10 ans qui faisait des intégrales, c'est inconcevable chez nous où par exemple les professeurs de mathématiques n'ont pas le droit d'utiliser des epsilon parce que personne n'y comprend rien, en tout cas c'était le cas il y a quelques années. Mais les 10 % eux ils comprendraient. On a cru bien faire en mélangeant tous les niveaux mais en sport pour courir le 100 mètres on ne mélange pas les très rapides et les très lents si non il y aurait trop de bousculade. Donc ce qui est bon pour le sport devrait valoir aussi pour le reste. M. Jean-Marie Rolland : Est-ce que le niveau en mathématiques des élites est toujours très bon, seul le niveau moyen ayant baissé et par ailleurs les mathématiques doivent elles être la base de la culture scientifique et servir de moyen de sélection ? M. Thierry Aubin : S'agissant du rôle des mathématiques à l'école, ils constituent un outil de sélection et non pas la base de la culture scientifique. On constate d'ailleurs que les fondamentaux en mathématiques (multiplications, fractions, ...) ne sont plus enseignés à l'école. Pourtant il est essentiel d'enseigner les sciences et les nombres le plus tôt possible. Par exemple mon grand-père jouait aux dés avec moi alors que j'avais 3 ans. A 7 ans je savais extraire des racines carrées. Il y a d'une manière générale un glissement des programmes vers le bas, on enseigne aujourd'hui en troisième ce que l'on enseignait hier en cinquième mais ça se rattrape puisque l'on a supprimé pratiquement toute la géométrie. En physique il est normal d'apprendre des règles et de les appliquer sans explication, mais en mathématiques le raisonnement et la méthode doivent prendre plus de place. Les mathématiques ne sont pas de la grammaire et il faut inciter les élèves à poser des questions et à discuter. Les mathématiques, et pas seulement la règle de trois (mais les équations, la géométrie...) constituent un enseignement indispensable qui sert dans tous les compartiments de la vie. La désaffection pour les études scientifiques peut s'expliquer notamment en mathématiques par l'absence de débouchés. Mes étudiants en maîtrise veulent continuer les maths mais après le DEA il n'y a pas de débouché. M. Jean-Marie Rolland : est-ce que l'on constate une différence de niveau entre les promotions de polytechniciens aujourd'hui et celles d'il y a cinquante ans ? M. Thierry Aubin : les concours sont très calibrés et on ne cherche pas à recruter des gens vraiment intelligents mais des gens bien entraînés auxquels on a appris à réfléchir à l'intérieur d'un système donné et sans possibilité d'en sortir. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 20 DÉCEMBRE 2005 Audition de M. Jean-François Bach, professeur à l'université René Descartes, membre de l'Académie des sciences - section biologie humaine et sciences médicales M. Jean-Marie Rolland, Président : Nous accueillons M. Jean-François Bach, à qui je souhaite la bienvenue. La mission s'interroge sur ce qui peut être fait pour améliorer l'enseignement des disciplines scientifiques à l'école. En effet, l'étude PISA réalisée sous l'égide de l'OCDE qui fournit des données comparatives internationales sur les résultats de l'école pour la compréhension de l'écrit et pour le niveau et le raisonnement scientifiques chez les jeunes de quinze ans, n'a pas montré de résultats très brillants pour les collégiens français. Par ailleurs, la mission a été alertée sur les difficultés que rencontrent les entreprises qui souhaitent recruter des ingénieurs et des techniciens. Elle a donc souhaité recueillir votre point de vue sur l'évaluation, la place des femmes dans les sciences, la vulgarisation scientifique, les sciences et les entreprises et enfin les sciences dans le processus de sélection des parcours éducatifs. M. Jean-François Bach : Je suis impliqué à un triple titre. D'abord en ma qualité de Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, car l'Académie a signé avec le ministère de l'Education nationale une convention qui lui donne une forte responsabilité de conseil en matière d'enseignement des sciences. L'Académie, qui suit le sujet de très près, a créé en 2005 le comité sur l'enseignement des sciences qui doit contribuer par ses avis et travaux à doter la France d'un enseignement scientifique et technique de qualité. Par ailleurs, j'ai présidé la commission de réforme de l'enseignement des sciences au collège, dont le rapport a été adopté par le Conseil supérieur de l'éducation et publié au Journal officiel cet été. Enfin, j'ai participé à la rédaction du socle commun du savoir pour les enfants qui sortent du collège. J'ai donc eu de multiples occasions de rencontrer des enseignants, enseignants par lesquels tout doit commencer car rien ne se fera s'ils ne suivent pas ; or, s'ils manifestent un grand désir d'améliorer la qualité de leur travail, ils sont aussi très résistants aux réformes dès que l'on passe aux propositions précises. On constate alors une levée de boucliers, des craintes s'expriment et l'antienne « il nous faut plus de moyens » se fait entendre de manière répétée. Pourtant, on doit pouvoir faire mieux dans l'état actuel des moyens, qui sont relativement importants. Aujourd'hui, les enseignants de physique, de chimie et de sciences de la vie et de la terre ressentent une forte frustration car ils constatent que beaucoup d'enfants « n'accrochent pas » et s'ennuient pendant les cours. Cette situation est déplorable car il n'y a rien de plus beau que l'enseignement des sciences, et comme il n'y a aucune raison pour que les choses restent en l'état, elles doivent changer. A l'école primaire, l'idée est à présent diffusée que l'on ne peut plus asséner les connaissances et qu'il faut passer à un enseignement interactif. Les enseignants du second cycle ont un grand désir de travailler ainsi, mais ils estiment qu'ils ne sont pas assez nombreux pour le faire et qu'ils manquent de moyens. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas aller plus avant dans la démarche d'enseignement par l'investigation. Mais il y a à cela un préalable, qui est l'amélioration de la formation scientifique des enseignants. Une réflexion de fond sur le fonctionnement des IUFM est indispensable, et le comité ad hoc de l'Académie travaille particulièrement à la réforme de l'enseignement des sciences qui y est dispensé. Actuellement, la formation des élèves maîtres est relativement monothématique. L'Académie considère qu'il n'y aurait rien d'anormal à ce que les professeurs de sciences de la vie et de la terre aient quelques notions de physique et de chimie, et réciproquement. Les enseignants ne doivent plus se limiter à enseigner la science, ils doivent apprendre à la raconter pour la rendre vivante. Il faudra donc moderniser les IUFM, c'est impératif. Il faut, d'autre part, défendre l'idée que la science et la médecine sont constitutives de la culture générale au même titre que la littérature et l'histoire, ce qui en France, pays latin, ne va aucunement de soi. A cet égard, l'Académie est très fière d'avoir obtenu de M. Fillon que le socle commun de connaissances mentionne la culture « humaniste et scientifique ». Cet enseignement répond à trois objectifs. Le premier est, précisément, culturel. Il s'agit de faire intégrer la rigueur scientifique dans la pensée et dans la vie quotidienne. Les sciences sont par ailleurs source de loisir et de stimulation intellectuelle. Le deuxième, c'est la préparation professionnelle. Bien sûr, toutes les professions n'ont pas besoin du même niveau de préparation scientifique mais l'on sait bien qu'en médecine par exemple, des connaissances scientifiques, d'ailleurs exagérées, sont exigées au départ, et qu'elles sont capitales pour d'autres métiers. On sait aussi que si un enfant n'est pas bon en sciences dès la troisième, il n'a aucune chance d'intégrer une grande école d'ingénieurs. Le troisième objectif, c'est la préparation à la vie de citoyens. Par exemple, bien moins d'erreurs seraient commises si la population disposait d'un certain niveau d'éducation à la santé. Or, on n'enseigne rien de la médecine aux enfants au collège, on ne leur explique ni ce qu'est un cancer ni ce qu'est un infarctus du myocarde alors même que plusieurs membres de leur entourage peuvent être affectés par ces pathologies, mais on leur dit tout de la tectonique des plaques. L'Académie s'est employée à faire ajouter quelques modestes éléments dans les programmes à ce sujet. Mais ce qui vaut pour la santé vaut également pour l'informatique ; l'enseignement des sciences peut grandement améliorer la vie des citoyens, ce qu'ils ignorent. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Voilà dans quel esprit la réflexion de l'Académie se poursuit pour réformer l'enseignement des disciplines scientifiques en France, avec la réserve déjà dite que si la formation des maîtres n'est pas améliorée, on n'arrivera à rien. S'agissant du volume horaire d'enseignement des sciences, rien ne permet de penser qu'il faudrait faire beaucoup plus. La seule anomalie est l'absence de physique chimie en classe de sixième, ce qui est un peu dommage sans être catastrophique. Au demeurant, on voit mal que l'on puisse mordre pour cela sur l'horaire alloué à certains autres enseignements, tel celui de l'anglais, totalement insuffisant, ou du français. M. Jean-Marie Rolland, Président : Un mathématicien entendu par la mission s'est dit furieux de la suppression de deux heures de mathématiques en première et en terminale. M. Jean-François Bach : La mathématique est la seule discipline scientifique dans laquelle la France est la première au monde. Il y a une tradition française d'enseignement mathématique d'assez haut niveau, et une autre tradition française consistant à fonder la sélection sur les mathématiques. La discipline ne semble pas particulièrement maltraitée et il n'est pas dramatique que deux heures aient été supprimées car le temps qui reste est raisonnable. De plus, l'importance donnée aux mathématiques dans la sélection des filières est excessive. M. Jean-Marie Rolland, Président : La sélection par les mathématiques, notamment pour la filière médicale, va-t-elle se perpétuer ? M. Jean-François Bach : Etant donné que l'on n'accepte que 15% des candidats en fin de première année, il faut trouver une discipline évaluable pour les sélectionner. Or, on ne peut enseigner en un an aux candidats les matières utiles à leur futur métier. Mais l'on pourrait envisager une réforme de l'enseignement en première année, visant à déterminer les aptitudes des futurs médecins et des futurs pharmaciens. J'en viens aux programmes et à la manière dont ils sont enseignés au collège. Le travers français qui consiste à ajouter des strates sans jamais en retrancher fait que les programmes sont un peu lourds. Dans ce cas précis, c'est grave, car on aboutit à un enseignement superficiel où, pire encore, à ce que des pans entiers du programme ne soient pas enseignés. Il peut ainsi arriver qu'un enfant, parce qu'il a été malade à un moment de l'année, ne sache rien de l'électricité à la sortie du collège. Cette manière de procéder est inconcevable. Les programmes devraient être allégés, mais l'on n'y parvient pas parce que l'on se heurte à des réactions corporatistes. Il faudra pourtant faire un effort en ce sens et aussi moderniser les programmes car, en voulant tout embrasser, on met tout au même niveau. Et comme les programmes actuels n'ont pas d'ossature, on n'insiste pas sur ce qui est véritablement important. Faute de hiérarchie dans ce qui est enseigné, les enfants terminent leur scolarité en ignorant des sujets qu'ils ne devraient pas ignorer. L'Académie a fait des propositions à ce sujet. Enfin, on peut rendre les choses intéressantes. Si l'on considère la biologie, on sait très bien que la reproduction intéresse les enfants ; de même, en physique, tout ce qui a trait à l'énergie a une importance particulière. Il faut mettre en évidence certains sujets pour les raccrocher à la vie sociale. En d'autres termes, il faut décloisonner l'enseignement pour replacer l'enfant dans la société qui l'entoure. J'ai eu l'idée de définir six grands thèmes parmi tous ceux possibles : les énergies ; la climatologie et la météorologie ; l'environnement ; la sécurité ; la santé ; la vision statistique du monde. Il s'agit de faire comprendre aux enfants que les chiffres n'ont rien d'absolu. Sur ces thèmes de convergence - mais il en existe bien d'autres, tels que l'eau, l'agriculture ou l'industrie -, il conviendrait non pas de formuler de nouveaux programmes mais de parvenir à une approche transversale. Actuellement, l'enseignement des sciences est divisé en cinq disciplines ; il est temps de parvenir à une interaction entre elles, ce qui suppose des séances de discussion entre les enseignants. Au-delà, on peut même imaginer un continuum tel qu'en classe de sixième les collégiens auraient un seul professeur de sciences qui dispenserait un enseignement transversal. Ce ne serait pas sans avantage pour des enfants qui sont un peu perdus lorsqu'ils arrivent en sixième. M. Jean-Marie Rolland, Président : Quels sont les effets concrets de la convention passée entre l'Académie des sciences et le ministère de l'Education nationale. Les académiciens vont-ils sur le terrain ou rencontrent-ils les délégués syndicaux ? M. Jean-François Bach : Il m'est arrivé d'aller m'asseoir au fond d'une classe. J'y ai rencontré des enseignants et des inspecteurs généraux, parmi lesquels des gens de grande qualité. J'ai aussi rencontré des associations de professeurs, qui ont leurs propres idées, quelque peu corporatistes, et les syndicats, extraordinairement politisés. Ainsi, lorsqu'il m'est arrivé d'aborder la question de la prévention en tant que thème de convergence pour l'éducation à la santé, je me suis entendu reprocher d'être répressif et culpabilisateur en disant que certains comportements peuvent rendre malade. L'accusation est un peu injuste, car lorsqu'on s'intéresse aux maladies secondaires au comportement, on se rend compte que les catégories sociales défavorisées sont beaucoup plus atteintes que les autres. A ne pas vouloir le reconnaître, à ne pas vouloir chercher à modifier ces comportements pathogènes, on parvient à l'inverse de ce que l'on souhaite. De même, les syndicats d'enseignants sont opposés au travail à la maison; ils l'estiment injuste, considérant que tous les enfants ne bénéficieront pas des mêmes conseils. C'est vrai, mais le nivellement par le bas n'est pas une bonne idée non plus. M. Jean-Marie Rolland, Président : Quelles sont les réactions à l'idée de la transversalité de l'enseignement scientifique ? M. Jean-François Bach : Elles sont furieusement hostiles. Cela peut se comprendre, car l'enseignement français est corseté et tellement figé dans des horaires que prétendre supprimer une heure dans une discipline donnée cause un drame. Pourtant, on peut expliquer ce qu'est l'hépatite B en trente secondes, deux minutes, une heure ou une matinée. Chacun peut s'adapter ! Dans la pratique, les enseignants le font, mais ils ne veulent pas l'admettre, si bien que l'on en vient à des bagarres dérisoires pour défendre une heure d'enseignement. Si un enseignement est en crise, c'est celui de la technologie. L'idée de départ n'était pas mauvaise, puisqu'il s'agissait de préparer les enfants à une vie professionnelle manuelle, mais l'on a créé un corps professoral de qualité inégale dont le niveau global est, statistiquement, inférieur aux autres. Il faut donc engager une réflexion approfondie sur le contenu de l'enseignement et raccrocher l'enseignement de la technologie à l'enseignement des sciences car le découplage actuel est une erreur conceptuelle. Enfin, cet enseignement doit être fait par des maîtres dont on aura modifié la formation - on en revient à l'indispensable réforme des IUFM, qui doit permettre un enseignement beaucoup plus transversal. M. Daniel Prévost : Quelle part conviendrait-il d'accorder à l'expérimentation ? M. Jean-François Bach : La première chose à faire est de moderniser les programmes pour réintégrer le plus possible la science dans la société au lieu de la considérer comme purement théorique. En second lieu, la démarche scientifique doit consister à apprendre aux enfants à raisonner. Les mathématiques jouent là un rôle fondamental mais les autres sciences peuvent apporter beaucoup si, à partir d'une observation, on remonte à des principes après s'être livré à une interprétation. Cette démarche dite d'investigation a une vertu éducative sans pareil. Il faudrait donc étendre l'expérience de La main à la pâte au collège et, si possible, au lycée. Cela se fait déjà dans certaines classes mais cela demande de gros efforts de la part des enseignants et aussi des directeurs d'établissements, car cela suppose des classes allégées et une formation spécifique des enseignants. Tout dépend donc de la bonne volonté de chacun, mais le dispositif pourrait être généralisé. L'idée est intéressante mais elle ne plaît pas du tout aux syndicats. Par ailleurs, il serait intéressant de donner aux enfants la possibilité de faire des travaux personnels en petits groupes, ce qui présenterait le double avantage de leur apprendre à travailler en équipe et de libérer du temps pour les enseignants. Mais cela pose des problèmes pratiques et les syndicats estiment que cela créerait des iniquités. M. Jean-Marie Rolland, Président : Qu'en est-il des relations entre les filles et la science ? M. Jean-François Bach Je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation spécifique des filles, qui sont nombreuses sur les bancs des facultés de sciences et de médecine. M. Jean-Marie Rolland, Président : La médecine fait exception. M. Jean-François Bach : Je considère que le socle commun de connaissances en cours d'élaboration est une bonne idée pour les classes des banlieues défavorisées, mais qu'il faudrait sans doute le revoir à la baisse, car le niveau prévu dans le texte remis au ministre est trop élevé. Le problème, évidemment, est que si l'on fixe un niveau trop bas, on risque un nivellement par le bas général. Le programme unique jusqu'à la fin de la troisième était une idée généreuse de la République, mais elle est irréaliste. Le socle commun va d'ailleurs à l'encontre de cette conception. Actuellement, le problème est contourné par la création de classes de niveau. Il faudra revenir sur la notion de classe unique car on touche là à l'un des problèmes principaux des classes défavorisées, qui conduit à l'absentéisme. La création d'un socle commun y contribuera. M. Jean-Marie Rolland, Président : Quel peut être le rôle des media dans la vulgarisation scientifique ? Et peut-on espérer surmonter par cette voie, au moins pour partie, les difficultés exposées ? M. Jean-François Bach : Des émissions télévisées scientifiques faisant intervenir le Palais de la découverte ou la Cité des sciences seraient d'un très grand intérêt. Malheureusement, ce genre d'émissions ne fait pas de bonnes audiences. L'Académie des sciences a proposé qu'au moins France Télévisions se dote d'un Haut conseil scientifique appelé à donner des idées à ce sujet. Les journaux télévisés parlent, souvent remarquablement, de sujets scientifiques. Là encore, l'essentiel est d'ancrer la science dans la vie sociale. * Audition de M. Georges Charpak, professeur émérite à l'Ecole de physique et chimie industrielles et physicien à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire Institut de France M. Jean-Marie Rolland, Président : Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à M. Georges Charpak. Je rappelle que nous sommes partis de l'étude PISA menée par l'OCDE, qui montre que les Français sont à la 21ème place dans l'Union européenne pour les compétences scientifiques à 15 ans. Nous avons aussi constaté que nous étions régulièrement confrontés au constat dressé tant par les chefs d'entreprise que par les responsables des grandes écoles : le niveau scientifique baisse dans notre pays et il est de plus en plus difficile de recruter des ingénieurs et des techniciens. Nous nous intéressons aussi à la place des femmes dans les sciences. Nous espérons que vous nous ferez part de vos idées et de vos propositions, à partir de vos expériences, en particulier celle de La main à la pâte. M. Georges Charpak : Je m'attendais plutôt à vous parler de mes autres activités, bien que celles que vous venez d'évoquer mobilisent les neuf dixièmes de mon temps. Il n'y a pourtant qu'une dizaine d'années que je m'occupe d'éducation : après avoir été converti par l'expérience de mon ami Leon Ledermann dans le ghetto noir de Chicago, qui m'a montré qu'il avait trouvé la méthode pour faire des pas de géant dans l'enseignement scientifique. J'ai ainsi franchi le pas et, pour la première fois, je me suis lancé en politique en sachant où je voulais aller. Je suis donc allé trouver François Bayrou, alors ministre de l'éducation, qui a envoyé une dizaine de personnes en mission sur place. Elles sont revenues convaincues, après avoir vu des enfants qui adoraient ce qu'ils faisaient, des enseignants qui, bien que plus mauvais que les nôtres au départ, aimaient enseigner et assuraient des cours d'un niveau bien supérieur à ceux que suivaient alors mes enfants dans les environs de Genève... Les Américains avaient mis trente ans à découvrir qu'on pouvait aller très loin dès lors qu'on exploitait et titillait la curiosité des élèves par l'expérimentation, en investissant dans un peu de matériel qui leur permette d'apprendre simplement l'eau qui bout, la glace qui flotte - tout ce qui les émerveille mais que leurs instituteurs ne leur enseignent pas, avant tout parce qu'ils n'y connaissent rien. J'ai fait l'expérience d'emmener un chef d'État d'Amérique latine, en compagnie de l'ambassadeur de France, dans une classe de dernière année d'école maternelle où il a constaté qu'après trois leçons sur la densité, les élèves de cinq et six ans savaient mieux que lui, que tous les membres de son cabinet et que l'ambassadeur ce qui, d'un pamplemousse ou d'un haricot, flottait ou coulait une fois dans l'eau... Il a vu qu'ils avaient aussi appris à s'exprimer, qu'ils tenaient un cahier d'expériences. Aussitôt après, il m'a dit qu'il voulait 100 000 enfants comme ceux-là en cinq ans. Aujourd'hui, parce que le gouvernement colombien, soutenu par les industriels, a mis le paquet, on trouve cinq lycées flambant neufs dans les quartiers les plus sinistres de Bogotá. Là aussi, à partir du moment où on se débrouille pour se procurer le matériel, où on forme les enseignants, on obtient des résultats spectaculaires grâce à des méthodes originales. Ce miracle, je l'ai vécu maintes fois depuis dix ans. Ainsi, nous nous étions rendus il y a quelques années à Sainte-Geneviève-des-Bois avec Jean-Louis Borloo, qui avait choisi lui-même l'école et m'avait demandé de me taire car son collègue du gouvernement Luc Ferry, sans doute parce qu'un philosophe sait tout, m'avait qualifié de « baratineur » et lui avait dit que ça ne valait rien. Au bout d'une heure, c'est lui que M. Borloo a qualifié d'un mot vulgaire, tout simplement parce qu'il avait vu des instituteurs enchantés et des enfants heureux. Autre exemple, cette visite que j'ai effectuée il y a peu, en compagnie d'un responsable de la Commission européenne, à Nogent-sur-Oise, tandis que des voitures incendiées fumaient encore sur un parking. Là aussi, mon interlocuteur a été convaincu et il m'a dit qu'il était prêt à tout faire pour m'aider car il a vu que le baratin et les bouquins ne servaient à rien et que rien ne servait davantage que l'exemple. Pourtant, je n'avais pas d'emblée réussi à lancer un projet européen car je m'étais heurté à une bureaucratie à faire pâlir de jalousie Leonid Ilitch Brejnev. Mais, grâce à un lobbying florentin, j'ai convaincu M. Durão Barroso d'investir 1,7 million d'euros en faveur de douze « villes pollen ». Bien sûr, cette somme ne suffit pas, mais des collectivités locales comme Saint-Etienne prennent de plus en plus le relais. Et je suis persuadé que, dans la mesure où la Commission entend promouvoir une grande réforme en 2010, elle viendra tôt ou tard voir ce que nous faisons et constatera qu'il n'y a que cela qui marche et que les arguments que nos détracteurs empruntent aux sciences cognitives ne pèsent pas bien lourd dans la balance. Peut-être, comme ils le disent, sommes-nous des naïfs et n'y connaissons-nous rien, mais nous le faisons ! Et si nous le faisons, c'est parce que ce qui nous excite dans cet apprentissage des sciences, c'est que l'enfant formule une hypothèse, débat avec son voisin et apprend à respecter son opinion, comprend que son instituteur peut ne pas savoir, qu'un chercheur va dans son laboratoire précisément parce qu'il ne sait pas. Nous mettons à leur disposition quatre-vingts scientifiques qui, sur l'Internet, répondent en 36 heures aux questions qu'ils leur posent. Bien sûr, cela a coûté de l'argent, que nous avons trouvé auprès des pouvoirs publics en n'hésitant pas à aller frapper aux portes. Nous avons aussi bénéficié de l'appui précieux de l'Académie des sciences. Je suis également très satisfait de nos rapports avec l'éducation nationale. Nous avons avec nous des inspecteurs qui font preuve d'un grand enthousiasme, qui leur vient, là encore, de la visite de classes. Nous avons aussi eu l'aide des grandes écoles. Chaque année une dizaine d'élèves de l'École polytechnique font leur service civique auprès de nous. C'est un plaisir de lire leur rapport : ils ont découvert la France profonde et ils ont sans doute été bien mieux acceptés par les instituteurs que ne l'aurait été un académicien. L'alphabétisation scientifique est une tache formidable, notamment parce qu'elle évite que les enfants ne suivent des gourous qui peuvent leur raconter n'importe quoi. Car nous avons des ennemis, des gens qui pensent qu'il faut apprendre aux enfants à faire de la lévitation, mais sûrement pas à faire des sciences. Ils confondent par exemple le téléphone avec un objet scientifique : ce n'est pas parce que vous savez vous servir de cette petite boîte mystérieuse que vous avez appris les sciences. Nous faisons aussi des émules dans le monde : les Chinois viennent apprendre chez nous. Dans quelques jours, je me rendrai à Davos pour essayer de convaincre des financeurs, en particulier George Soros, qui investit un milliard de dollars chaque année depuis six ans pour l'éducation. Nous savons des choses qu'il ne peut pas savoir parce qu'il mène des expériences localisées, par exemple en Moldavie, alors que nous disposons d'un réseau des Académies des sciences, que nous collaborons avec de bons professionnels et que nous pouvons apporter quelque chose à ceux qui font autrement. La vice-présidente de l'Académie chinoise des Sciences, qui a visité en ma compagnie une école à Troyes, m'a dit qu'elle venait de voir le plus bel exemple d'apprentissage scientifique et, a-t-elle fini par ajouter, démocratique... Il est vrai que les enfants chinois ont sans doute le défaut de répéter scrupuleusement ce qu'a dit la maîtresse alors que la science a besoin qu'on dise « ce n'est pas vrai ». Apprendre aux enfants à débattre de façon démocratique est bien une qualité essentielle pour une société humaine. Nous avons fait le calcul : étendre le système coûterait 15 euros par an et par enfant pendant dix ans. Mais de telles sommes, qui semble astronomiques, sont déjà cachées dans les budgets de l'éducation nationale et je suis persuadé que, maintenant que nous avons vaincu les réticences des autorités européennes, nous allons désormais avancer très vite. Au collège, les choses deviennent plus difficiles dans la mesure où nous sommes confrontés à ces concurrents que sont les mass media. Ainsi, Grichka et Igor Bogdanov ont vendu 200 000 exemplaires de leur livre Avant le Big Bang, simplement parce que le sujet est très excitant pour les enfants, alors que, docteurs ès sciences, ils n'y connaissent rien. Les médias répondent en fait à la fascination que la science exerce sur les jeunes et c'est à nous d'apporter une autre réponse si nous ne voulons pas laisser toute la place aux marchands de soupe. Certains, dans une cinquantaine de collèges, se sont attelés à la tâche de faire les choses différemment. Mais les professeurs se considèrent comme les membres d'une profession libérale, qu'on ne peut pas obliger à faire quelque chose, et nous risquons fort de les avoir contre nous et de nous heurter à l'inertie des syndicats, qui empêche par exemple d'aller vers une réponse verticale et inventive à un certain nombre de grandes questions. Alors qu'il y a un siècle qu'on a découvert la physique nucléaire et la radioactivité, je suis persuadé qu'aucun de nos dirigeants actuels n'a jamais entendu le cliquetis d'un compteur Geiger. Or, avec une mallette à moins de 75 euros, on peut faire des expériences magnifiques, simplement en creusant dans son jardin pour trouver du radon. Ainsi, les enfants peuvent apprendre tout en s'amusant et on est bien loin de ces écoles tchadiennes financées par l'Arabie saoudite, où on attache des enfants de cinq ans pour qu'ils n'aillent pas jouer... M. Jean-Marie Rolland, président : Comment les choses se passent-elles dans la pratique ? Je suppose que les établissements et les enseignants sont volontaires. M. Georges Charpak : Tout part souvent d'un inspecteur de l'éducation nationale capable de mobiliser une vingtaine de classes. Ensuite, il faut bien sûr des professeurs. Nous avons aussi besoin du soutien du Gouvernement. Il y a eu il est vrai quelques progrès et nous avons désormais en face de nous des interlocuteurs intéressés. Je me bats particulièrement pour le matériel, car il ne s'agit pas d'abstraction mais d'expérimentation. Certains veulent développer l'enseignement en Afrique subsaharienne pour y fabriquer des prix Nobel... Bien sûr, leur ai-je dit, avec l'argent que vous y mettez, vous en aurez, mais ils travailleront dans les grands laboratoires américains ! Faites donc plutôt des choses comme Main à la pâte et les « villes pollen ». J'aimerais beaucoup qu'on parvienne à installer quelques écoles dans le monde car je crois à la force de conviction des enfants heureux de faire ce qu'ils font : on comprend comment il faut apprendre quand on les voit tous lever la main parce qu'ils connaissent la réponse. Mais cela ne vaut que jusqu'à douze ans, ensuite nous devons faire très attention à ne pas nous faire avoir par ceux qui disent « je soulève la jupe de Dame Nature et je sais ce qu'il y avait avant le big bang ». Vous pouvez acheter le livre, il ne doit pas être trop mauvais puisqu'il s'est aussi bien vendu, mais n'essayez pas de comprendre cela de trop près parce qu'en fait on ne sait pas grand-chose. M. Frédéric Reiss : Si l'enseignant doit jouer le rôle du naïf devant ses élèves, comment voyez-vous la formation de ceux qui vont être les acteurs du dispositif ? M. Georges Charpak : Les instituteurs ont droit une formation chaque année, certains choisissent la sculpture ou les claquettes, mais le nombre de ceux qui optent pour les formations à La main à la pâte progresse manifestement au sein des IUFM. Nous nous heurtons aussi parfois à des directeurs qui ne croient à rien et qui sont persuadés que tout est fichu. Je crois aussi que ceux qui nous sont hostiles devraient s'en expliquer devant vous. L'un d'entre eux, Laurent Lafforgue, académicien et titulaire de la médaille Fields, a été nommé au Haut Conseil de l'enseignement alors qu'il n'a jamais mis les pieds dans une école, simplement parce qu'il sait résoudre des problèmes mathématiques. Mais dans ce cas pourquoi ne pas y nommer Bobby Fischer parce qu'il sait résoudre les problèmes d'échecs ? Cela étant, comme il s'agit de quelqu'un d'intelligent, je ne désespère pas de le voir un jour nous rejoindre. M. Jean-Marie Rolland, Président : Nous avons reçu M. Lafforgue la semaine dernière, et nous lui avons posé la même question qu'à vous sur le niveau scientifique des jeunes Français. Pour lui la principale difficulté tient à l'acquisition des capacités d'expression dans sa langue maternelle. Il développe une théorie sur la déstructuration liée à la perte des fondamentaux avant même le primaire. M. Georges Charpak : Mais a-t-il une démarche expérimentale ? Moi, arrivé à sept ans en France, venant d'une région située à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, j'ai appris le français et j'ai obligé mes parents à faire de même. Je suis prêt à discuter de ces sujets avec lui en tête-à-tête car j'ai l'impression qu'il n'a pas d'expérience. A La main à la pâte, les enfants apprennent le français, leur cahier n'est pas calligraphié, mais cela leur permet, quelques années plus tard, de mesurer les progrès accomplis. Ils en font, parce qu'ils écrivent sur ce qui les passionne. Il conviendrait aussi qu'ils rencontrent ces jeunes beurs qui sont parmi les premiers à l'Ecole polytechnique... M. Jean-Marie Rolland, Président : Il ne conteste pas que notre école soit capable de produire une élite. Mais il constate que la règle de trois n'est plus apprise et qu'en fin de lycée, certains jeunes ne font pas la différence entre 3/5 et 5/3. Pour lui, quand on n'a pas la logique du français, on a du mal à être logique dans son analyse mathématique ou physique. Il dit quand même un certain nombre de choses intéressantes sur ce qu'il appelle la dégradation générale et sur les IUFM. M. Georges Charpak : Mais pourquoi n'est-il jamais venu discuter avec nous ? Leon Ledermann, qui est mon gourou, a fait un lycée prodigieux près de Chicago. En le visitant, nous avions tous envie d'avoir quatorze ans. Il a imposé comme règles autant de filles que de garçons, autant de chicanos et de noirs que de blancs. C'est probablement le meilleur lycée des États-Unis. J'y suis allé en compagnie d'un autre lauréat de la médaille Fields, Jean-Christophe Yokkoz, qui s'est régalé. Les élèves choisissent entre trois cours de mathématiques, selon qu'ils veulent devenir mathématicien, physicien ou biologiste. Quand ils sortent à dix-sept ans, Harvard et Yale se les arrachent. Ils n'ont jamais passé aucun concours, ils ont été pris sur la base d'une interrogation orale, avec leurs cahiers devant eux. Ils passent une journée par semaine dans un laboratoire sur un sujet qui les intéresse. À titre de comparaison, 87 % des élèves de Polytechnique ont comme profil familial une mère enseignante et un père cadre supérieur. C'est aberrant ! L'élève qui m'accompagnait lors de cette visite a désormais donné son nom à une méthode de filtration biologique. Un autre, deux ans après être sorti, a donné un million de dollars au lycée, tout simplement parce qu'il les avait gagnés. Bien sûr, ils ne deviennent pas tous scientifiques, mais on est loin du scandale de Polytechnique, où 7 % seulement des élèves font ensuite des sciences, les autres devenant par exemple banquiers. Quel gâchis ! Et même ceux qui décident de faire des sciences, après avoir passé sept ans dans un laboratoire américain, se voient offrir royalement 1800 euros par mois quand ils reviennent en France. Comment s'étonner qu'ils optent pour d'autres professions ? M. Jean-Marie Rolland, président : Comment procède-t-on à l'évaluation des élèves dans votre méthode ? M. Georges Charpak : C'est une question très importante. La moitié des budgets européens est consacrée à l'évaluation : il faut pouvoir montrer des progrès, sans cela on ne nous croit pas. C'est ainsi que Leon Ledermann a pu prouver l'efficacité de son système pour élever le niveau des enfants des ghettos. Mais je suis persuadé que les élèves qui sont passés par La main à la pâte s'expriment mieux. Ainsi, lors d'une réunion à Montreuil, j'ai eu l'impression que votre collègue Jean-Pierre Brard trouvait le niveau des élèves bien supérieur à celui de son conseil municipal... A Nogent-sur-Oise, les instituteurs ont eu l'idée formidable de demander aux élèves de consacrer les derniers temps de La main à la pâte à enseigner eux-mêmes à ceux qui ne l'avaient pas suivie et qui, par l'expérience, apprenaient ainsi vraiment quelque chose. Il faut refaire une technique de l'enseignement. Je crois que pour les petites classes nous avons quelque chose de bon entre les mains. Sans doute avons-nous des choses à apprendre pour le français et la poésie, mais de comédiens comme Gérard Depardieu plutôt que de M. Laurent Lafforgue... Il faut repenser les IUFM, se convaincre que le bourrage de crâne n'apporte rien, il ne sert à rien d'expliquer le laser à un enfant qui ne saura jamais ce qu'est la relativité. Avoir 10 fois 11/20 sur des sujets différents ne vaudra jamais un seul 19/20 obtenu parce que vous avez été actif. Si vous avez appris à apprendre, vous surmonterez vos lacunes. M. Frédéric Reiss : Que pensez-vous de l'informatique ? M. Georges Charpak : Un stylo à bille ne fera pas de vous un poète. De même, l'informatique n'est qu'un outil. Je n'en fais pas un ennemi, mais je ne m'en sers qu'à mon corps défendant car je hais tout appareil dans lequel il y a plus de trois boutons. * Audition de M. Pierre Léna, professeur à l'université Denis Diderot, membre de l'Académie des sciences - section sciences de l'univers, membre de La main à la pâte M. Jean-Marie Rolland, Président : Nous accueillons maintenant M. Pierre Léna, à qui je souhaite la bienvenue. La mission consacre ses travaux à l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. L'étude PISA menée sous l'égide de l'OCDE et les demandes des responsables de grandes écoles, d'instituts de recherche et d'entreprises qui alertent sur les difficultés de recrutement de chercheurs et d'ingénieurs ont en effet conduit la Mission à se demander si le niveau scientifique a effectivement baissé et ce qu'il faut entendre par là, à s'interroger aussi sur la place des femmes dans les sciences et, d'une manière générale, sur les problèmes de l'enseignement des disciplines scientifiques. La main à la pâte a acquis une grande notoriété. Comment la méthode fonctionne-t-elle ? M. Pierre Léna : Je suis très heureux que le Parlement se penche sur une question d'une grande importance pour l'avenir. En 1996, par divers biais, plusieurs académiciens ont constaté que l'enseignement de la science avait pratiquement disparu de l'école primaire française, au point qu'en 1995, 2 à 3 % seulement des professeurs des écoles enseignaient le programme de science. Cela ne pouvait durer. Il fallait comprendre comment on en était arrivé là. Si les maîtres, gens sérieux, n'appliquaient pas les programmes, c'est qu'il devait y avoir de raisons sérieuses. Les initiateurs de La main à la pâte ont alors lancé une méthode pédagogique qui n'était pas radicalement nouvelle et qui était inspirée des Etats-Unis, ce qui leur a été reproché. Leur objectif était de passer des 3 % constatés à 100 % d'enseignement des sciences à l'école primaire. A ce jour, on en est à 30 %, et l'on constate que la méthode mise au point est devenue un produit majeur d'exportation culturelle, puisque La main à la pâte a engagé une collaboration très étroite avec une trentaine de pays, souvent appuyée par le réseau des académies des sciences. En s'attachant à analyser le phénomène, on a compris que le mal-être était très profond. Les maîtres se sentaient mal à l'aise avec la science, se considéraient mal formés et étaient même parfois, par conviction écologiste très répandue en leur sein, opposés à cet enseignement. Ils ne se sentaient pas, pour beaucoup d'entre eux, en mesure de répondre aux questions des enfants, craignaient de rater les expériences et, d'une manière générale, ne se sentaient pas convenablement préparés à cet enseignement. De surcroît, la plupart des instituteurs sont des femmes et le modèle implicite est que la science n'est pas faite pour elles. Dans ces conditions, comment pourraient-elles oser transmettre cet enseignement à des fillettes ? Le remède consistait à faire comprendre aux professeurs des écoles que la science est autre chose que l'idée qu'ils en avaient et qu'ils allaient être aidés à l'enseigner. L'Académie des sciences s'est donc engagée à accompagner les enseignants par toutes sortes de moyens. En particulier, un site Internet a été créé qui leur est exclusivement réservé. Il y a 320 000 instituteurs en France et le site reçoit 250 000 requêtes par mois depuis huit ans, ce qui dit l'ampleur du besoin. Les demandes portent sur le contenu, sur la pédagogie et sur la manière de répondre aux questions des enfants. Incontestablement, le site est un service utile et nécessaire. Bien entendu, rien n'aurait été possible sans l'appui du ministère de l'éducation nationale. Toutefois, La main à la pâte a choisi de rester à l'extérieur de l'institution et de s'en faire l'aiguillon. Depuis le lancement de la méthode, sept ou huit ministres de l'Education nationale se sont succédé ; à tous il a été rappelé que l'objectif devait s'inscrire dans la durée, indépendamment des alternances politiques. Toutes les transformations en profondeur du système éducatif doivent dépasser la durée d'un mandat ministériel, la pesanteur institutionnelle et les blocages syndicaux. Les membres de La main à la pâte ont donc montré aux maîtres que l'enseignement des sciences est possible, et ils ont mobilisé les maires et les parents pour que le dispositif s'applique dans les ZEP. L'aspect universel de la science a été mis en avant, avec succès. L'ouvrage L'enfant et la science narre cette aventure. Le parcours est encore inachevé, mais le ministère a soutenu l'expérience - avec des hauts et des bas. En revanche, il y a eu échec dans un domaine : celui de la formation des maîtres. M. Jean-Marie Rolland, Président : L'expérimentation est-elle fondée sur le volontariat des écoles ? M. Pierre Léna : Il en est ainsi pour les 350 classes de départ. En 1998, les classes concernées se comptaient par milliers. Des centres pilotes ont alors été créés, qui sont des lieux d'innovation, financés par l'Académie des sciences avec la Délégation interministérielle à la ville. Ces centres sont des lieux d'élaboration de nouveautés qui sont ensuite diffusées à l'ensemble du territoire. En 2002, les nouveaux programmes de l'école primaire ont été publiés sous le ministère de M. Lang et leur volet scientifique s'est largement inspiré des propositions de La main à la pâte. Mais, d'une part, les programmes ne changent pas le comportement des professeurs, comme en témoigne la situation antérieure, celle qui a déclenché l'expérience. D'autre part, dans le même temps, l'enseignement de la science dans les IUFM était pratiquement réduit à néant, ce qui était pour le moins paradoxal au moment où le ministre expliquait que la science avait sa place à l'école. La main à la pâte a eu un effet stimulateur, et la dynamique s'est enclenchée grâce aux media et à la personnalité charismatique de M. Georges Charpak ; en revanche, le système de formation des maîtres demeure totalement insuffisant, qu'il s'agisse de l'enseignement de la science ou des autres disciplines. M. Jean-Marie Rolland, Président : Comment améliorer cette situation sans attendre que les enfants qui ont profité de La main à la pâte intègrent les IUFM ? M. Pierre Léna : Dans leurs avis respectifs sur l'enseignement de la science et de la technologie dans la scolarité obligatoire, publiés en juillet 2004 pour l'Académie des sciences et en septembre 2004 pour l'Académie des technologies, les deux institutions abordent la question de la formation des maîtres. L'Académie des sciences a aussi adressé au ministre un avis spécifique à ce sujet en avril 2005. Elle y expose ce qu'elle a fait depuis dix ans pour l'école primaire et formule des propositions nouvelles pour le collège et pour l'enseignement professionnel. Pour ce qui est des professeurs des écoles, l'Académie des sciences propose que le cahier des charges national, qui est de la responsabilité du Haut Conseil de l'éducation, prenne clairement parti en faveur de la formation scientifique des professeurs des écoles et que cette formation se fasse dans le volume d'heures indiqué par l'Académie. Actuellement, un instituteur peut avoir pour formation initiale une licence d'anglais et ne recevoir au cours de son passage en IUFM que moins de dix heures de formation en sciences, ce qui est tout à fait déraisonnable. L'Académie propose donc que l'horaire d'enseignement scientifique en IUFM soit compris dans une fourchette de 60 à 80 heures pour l'ensemble de la formation. Mais la question n'est pas seulement quantitative. Il faut faire des liens entre la science, l'histoire des sciences, l'apprentissage du français et l'expérimentation, autrement dit atténuer sinon supprimer les barrières entre les disciplines. Mais l'Académie craint que le cahier des charges national se limite à donner de grandes orientations très vagues et qu'ensuite les Universités, dont les IUFM dépendent, fassent les choses dans le désordre. M. Jean-Marie Rolland, Président : Les licenciés en physique sont très peu nombreux. M. Pierre Léna : C'est tout à fait exact. Il faudrait que davantage d'étudiants en sciences soient incités à devenir professeurs des écoles. Car actuellement ils sont très peu nombreux et, si l'on continuait, la science demeurerait une affaire de spécialistes. Or, il suffit qu'un enseignant qui a pour seul souvenir ses connaissances scientifiques de classe de seconde se remette à l'ouvrage. S'il est convenablement accompagné, il y parviendra, le constat en a été fait. M. Jean-Marie Rolland, Président : Les IUFM diffusent-ils la méthode de La main à la pâte ? M. Pierre Léna : On n'en est pas encore là. La main à la pâte a un réseau de correspondants au sein des IUFM, mais l'institution attend les instructions du cahier des charges national en cours d'élaboration. M. Frédéric Reiss : L'amélioration de la situation suppose que l'ensemble des professeurs des écoles soient saisis de curiosité scientifique. M. Pierre Léna : Très juste. En outre, il faudrait que les enseignants se persuadent que les ressources nécessaires seront trouvées et, surtout, que leurs craintes sont infondées. M. Frédéric Reiss : Quelle était la situation au collège. La scission, dans le secondaire, entre sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et mathématiques paraît bien compliquée. M. Pierre Léna : Au collège, au contraire de ce qui se passe à l'école primaire, les programmes scientifiques sont enseignés, puisqu'un horaire spécifique est prévu et que les enseignants sont là. Mais, si l'on excepte les meilleurs élèves, l'image que les enfants ont de la science à l'issue du collège est mauvaise, la consultation Meirieu l'a très bien montré. Les collégiens ont acquis des connaissances éparses dont ils ne comprennent pas à quoi elles mènent et ils ont des sciences une perception complètement fausse. Par ailleurs, l'orientation, à la fin du collège, est bien souvent une orientation négative dans laquelle la science joue un rôle, si bien que les mathématiques ne sont pas seulement des mathématiques. Il faut changer la situation au collège, d'autant qu'il existe une corrélation certaine entre le niveau en mathématiques en sixième et la poursuite d'études générales jusqu'en troisième. De ce fait, la science est perçue comme fabriquant des élites, et elle suscite le rejet. Cette orientation négative nuit à la France. Il faut assurer une transition plus douce entre l'école et le collège et ne pas saucissonner trop vite les disciplines scientifiques. Les élèves de sixième, qui reçoivent un enseignement hebdomadaire d'une heure trente dans chacune des disciplines scientifiques au programme, sont incapables d'établir une unité entre ces enseignements. Quant aux professeurs, tenus d'assurer 18 heures d'enseignement hebdomadaire par unités d'une heure trente également, ils voient quelque 500 élèves différents chaque semaine, qu'ils sont incapables de connaître et auxquels ils sont encore plus incapables d'appliquer une méthode d'investigation. Voilà pourquoi l'Académie de sciences propose qu'à terme un seul professeur enseigne sciences et technologie au collège. M. Frédéric Reiss : Dans un tel schéma, l'enseignement des mathématiques demeurerait-il distinct ? M. Pierre Léna : Oui, car ce serait beaucoup demander aux professeurs de mathématiques que d'enseigner aussi la physique et la technologie. Il n'empêche que les professeurs de sciences devraient se rapprocher des mathématiciens. L'Académie des sciences a proposé au ministre, qui en a accepté le principe, une expérimentation dans une cinquantaine de collèges ; elle commencera en septembre. L'Académie a souhaité qu'une vingtaine des collèges concernés soit située en ZEP, car elle a la conviction, étayée par les résultats obtenus dans le primaire, que de telles expérimentations sont facteurs d'intégration pour les jeunes en difficulté. M. Jean-Marie Rolland, Président : L'expérimentation porterait-elle aussi sur des collèges situés en zone rurale ? M. Pierre Léna : La méthode de La main à la pâte est appliquée en tous lieux du territoire, y compris dans des zones rurales du Puy-de-Dôme ou de l'Yonne. Toutefois, on ne peut trop se disperser. Une dizaine de centres existe en France, chacun étant suivi par l'un des membres de l'Académie des sciences, qui s'y rend régulièrement. A terme, l'Académie souhaite que le programme des CAPES de sciences ait un champ scientifique plus large pour éviter l'hyperspécialisation. L'Académie des technologies considère également qu'un enseignement technologie spécifique n'a pas lieu d'être. Mais puisqu'il est difficile de revenir sur ce qui a été fait, un corps ayant été créé, on peut contourner le problème en introduisant des « mineures » de technologie dans les CAPES scientifiques. M. Jean-Marie Rolland, Président : Quel est le coût du matériel nécessaire pour l'enseignement des sciences par la méthode de La main à la pâte ? M. Pierre Léna : Il est très faible, puisqu'il peut suffire d'un verre d'eau : toute la physique n'est-elle pas contenue dans une bulle de savon ? Le ministère avait alloué au départ 40 millions de francs pour l'équipement, alors que ce type de dépenses est normalement du ressort des communes. Ces ressources ont aidé beaucoup d'enseignants à se rendre compte qu'ils pouvaient y arriver. Maintenant, ils s'équipent dans le commerce ou ils fabriquent le matériel nécessaire eux-mêmes. A Auxerre, un centre de distribution irrigue les classes qui font partie du dispositif. M. Jean-Marie Rolland, président : Est-ce l'école qui demande ou l'inspecteur qui propose ? M. Pierre Léna : Il y a un programme, que tous les instituteurs doivent enseigner. Ce qui les en empêche, c'est soit la peur, soit le fait que leur inspecteur les en dispense. En fait, les inspecteurs n'inspectent jamais les sciences. Pour la première fois, la circulaire de rentrée a insisté sur l'inspection des sciences. C'est la clé du dispositif, non parce qu'on a besoin d'un bâton mais parce qu'on montre ainsi qu'elles relèvent de l'obligation professionnelle. Très souvent, le matériel est déjà dans les circonscriptions et, même quand il faut l'acquérir, on peut se tourner vers les municipalités car le coût est extrêmement faible : un ou deux euros par enfant, alors qu'on a dépensé dix, si ce n'est cent fois plus pour l'équipement informatique des écoles. Bien sûr, il faut aussi former les enseignants. On sait que la formation continue est optionnelle alors qu'il conviendrait à terme - l'objectif est sans doute trop ambitieux pour l'immédiat - qu'elle figurât dans les obligations professionnelles normales des enseignants. La loi d'orientation a retenu l'option inverse puisqu'un enseignant est payé pour être formé. Les chiffres sont particulièrement préoccupants : 50 % des enseignants ne font jamais de formation continue et, sur le total des 800 000 journées de formation, les sciences ne représentent que 2 %. En clair, cela signifie qu'il faut 50 ans pour faire passer tout le monde une fois. C'est évidemment un défaut majeur pour des disciplines qui changent très vite. Une fois qu'on a le matériel et que l'enseignant a été formé, ça va tout seul : les enseignants, les enfants, les parents sont contents. M. Jean-Marie Rolland, Président : Comment les choses se passent-elles concrètement ? Si l'enseignant a accès au site Internet, est-il parrainé par un scientifique de haut rang ? M. Pierre Léna : Le site Internet est pour tout le monde : il est conçu dès l'origine pour être mutualisé. En effet, alors que pour un scientifique un résultat intéressant doit immédiatement être publié et partagé, il apparaît que les enseignants font des choses très bien, mais qu'ils ne savent pas les échanger. C'est pourquoi notre site est non seulement une ressource pour les enseignants, mais aussi un outil de travail coopératif entre eux, afin que ce qui réussit puisse être généralisé. S'agissant d'ailleurs de la généralisation, je suis persuadé qu'on peut faire mieux que les 30 % actuels et tendre vers les 100 %, mais il faut pour cela une volonté politique. Un enseignant qui sera inspecté en sciences, il en fera ensuite car il n'y a pas de difficultés de fond : si on prend 10 % des investissements informatiques, il y a de quoi financer très largement le dispositif. M. Frédéric Reiss : En effet, un ou deux euros, cela semble peu : je suis persuadé qu'au total la réalisation d'un objet technologique coûte chaque année entre 10 et 15 euros aux familles. M. Pierre Léna : Le fait que le ministère ait mis de l'argent a été important car une société a pu construire des kits avec des modes d'emploi pédagogiques qui ont été fort utiles aux maîtres. Les élèves n'ont pas besoin de manuel, mais d'un cahier d'expériences, où ils capitalisent ce qu'ils font année après année. C'est aussi, pour le maître, un excellent outil pour faire le lien entre la science et le langage. M. Jean-Marie Rolland, Président : Comment se fait l'évaluation ? M. Pierre Léna : Pour l'enseignant, l'inspecteur demande les cahiers d'expériences aux enfants, il contrôle combien d'heures sont consacrées à la science sur les 26 heures hebdomadaires, il regarde où et comment est rangé le matériel. Pour les élèves, l'évaluation en 6e ne concerne que les mathématiques et le français. Quant à l'évaluation PISA, elle n'intervient qu'à quinze ans, quand le primaire est déjà loin. Le ministère travaille à des bilans qui seraient faits en fin de CE1, de CM2 et de 3e. Nous contribuons à ce travail afin que les futures évaluations en sciences soient bien faites et qu'on ne puisse pas leur faire les mêmes reproches qu'à PISA. Pour notre part, nous constatons que les enfants qui ont eu accès à La Main à la pâte en primaire, sont toujours meilleurs par la suite, ce qui n'est guère surprenant quand on voit comment ces classes fonctionnent. Au collège, les enfants sont souvent déçus par l'enseignement scientifique car ils ont l'habitude d'expérimenter et de poser des questions. Confrontés à une méthode classique, à un enseignant qui dicte son cours, ils disent : « Les sciences, ce n'est pas ça ! ». Je ne jette pas la pierre aux enseignants, qui sont confrontés à dix classes dans lesquelles ils doivent faire de la discipline. Ils demandent souvent à leurs collègues du primaire comment ils ont réussi à intéresser autant les élèves aux sciences. Depuis trois ans, nous menons avec des enseignants volontaires des expériences sur le principe d'un enseignement scientifique et technologique intégré en 6e et 5e. La principale difficulté tient à la peur des enseignants. Nous allons donc les accompagner avec des scientifiques professionnels. L'Académie des technologies est avec nous dans ce processus. Cela ne devrait pas coûter cher en matériel, car les collèges sont plutôt bien équipés en laboratoires, mais en formation car, pour cinquante collèges, il faudra former environ un millier d'enseignants pendant au moins trois semaines. Par la suite, nous tirerons le bilan de cette expérience et nous ferons des propositions, comme nous l'avons fait pour La Main à la pâte. M. Jean-Marie Rolland, Président : Y a-t-il des différences entre garçons et filles ? M. Pierre Léna : La différence est dans l'image. Dans L'enfant et la science, on voit que, quand on lui demande de représenter la science, un enfant ne dessine jamais une femme. Mais, après six mois de Main à la pâte, les choses ont changé. Je crois que les représentations des familles et le fait que les enseignantes ont peur de la science jouent également beaucoup. Dès qu'une institutrice fait une belle classe de sciences, je suis sûr que le processus d'identification des fillettes joue. Et si nous réussissons dans le primaire, cela aura bien sûr un impact par la suite Dans ce que nous faisons, il y a d'abord l'idée de citoyenneté : si on veut que tous les petits Français face des sciences dès le primaire, c'est d'abord pour qu'il devienne des citoyens qui comprennent. Il y a ensuite la volonté de soutenir les filières scientifiques et techniques car les choix des adolescents se préparent très largement dès le primaire. Dans son rapport Europe needs more scientists, José Mariano Gago, ancien ministre portugais de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur, cite une enquête européenne qui montre que, à la fin du primaire la moitié des enfants disent déjà que la science et la technologie ne sont pas pour eux. A la fin du collège, ils sont 90 %. Une étude menée en Norvège donne des résultats similaires. On peut donc dire que l'enseignement des sciences au primaire et au collège dégoûte les enfants, c'est dommage pour eux et c'est grave pour le pays. Je reviens sur la méthode au collège. Parce que nous devons faire face à la contrainte des programmes, nous proposons qu'au moins pendant une partie de l'année un seul enseignant assure à la fois la physique, la chimie, les SVT et la technologie, ce qui lui permettrait d'avoir les élèves pendant plus de quatre heures chaque semaine. Nous ne travaillons pas comme Maths en jeans, qui intervient en dehors des heures de cours car nous nous ne nous inscrivons pas dans la remédiation. Pour notre part, nous ne nous résignons pas à ce que ce qui est fait à l'école, qui coûte si cher et qui touche tout le monde, ne soit pas réussi. Il est pour nous rassurant de constater que ce décloisonnement est déjà mis en œuvre et fonctionne bien depuis plusieurs années en Israël et en Grande-Bretagne, et qu'il commence à l'être en Argentine. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 17 JANVIER 2006 Audition de M. Anders Hingel, direction de l'éducation à la Commission européenne M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que notre mission a pour but d'examiner les difficultés que rencontrent les Français avec l'enseignement des matières scientifiques et que nous nous intéressons particulièrement au problème des filles et des sciences. Une liste de questions vous a été transmise, la première a trait à l'appréciation que porte la Commission sur les tests d'évaluation PISA de l'OCDE et sur le classement qui en résulte, qui montre les bons résultats des pays scandinaves et les résultats plutôt moyens de la France et de l'Allemagne. M. Anders Hingel : Je suis Danois et je vous prie de m'excuser de maltraiter votre langue. C'est d'ailleurs en anglais que j'ai préparé une présentation PowerPoint. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à vos questions, car nous traitons certes de la même problématique mais nous utilisons des moyens différents. Je rappelle que la Commission travaille sur les questions de l'éducation mais n'a pas de responsabilité dans ce domaine, qui relève de la compétence nationale. Ce n'est donc pas Bruxelles qui va expliquer à un pays comment enseigner les sciences : même si nous avons souvent le sentiment que c'est ce qu'attendent les nouveaux États membres, nous ne pouvons leur répondre car nous sommes les gardiens des traités. Notre rôle est donc plutôt d'utiliser la diversité des systèmes éducatifs pour mettre en exergue les bonnes pratiques, les forces et les faiblesses des différents pays. Cette diversité est passionnante. Cela fait maintenant trente-cinq ans qu'on demande tous les six mois aux Européens, par l'eurobaromètre, s'ils sont satisfaits de leur vie privée. C'est une question absurde, mais les réponses montrent une extrême diversité entre les pays puisque 70 % des Danois sont très satisfaits, alors que le taux de divorce et de suicide est au plus haut, contre 3 % seulement des Portugais. Cela ne dit bien sûr rien de la véritable qualité de vie dans les pays, mais beaucoup sur la diversité culturelle. Pour en revenir au système éducatif, je suis convaincu que son efficacité suppose un recours aux structures nationales. Il y a ainsi une manière française de faire l'éducation, qui n'est pas seulement lié à une vision politique mais à la manière même dont les Français conçoivent leur vie et qui est très éloigné de celle, par exemple la Finlande, pays dans lesquels il y a très peu d'étrangers. C'est pour cela qu'il me semble très difficile d'utiliser les données PISA, ou tout autre analyse comparative, pour discerner la meilleure manière de faire les choses. Pour nous, s'emparer de ces données équivaudrait à tomber dans le piège de la compétition entre les pays. Je préfère m'intéresser aux vraies questions, par exemple en cherchant en quoi les Finlandais répondent aux besoins spécifiques des élèves, en particulier grâce à l'éducation spéciale. Quand on parle d'éducation en Europe, cela renvoie bien évidemment au sommet de Lisbonne en 2000 où, afin de renforcer la coopération entre trente-deux pays et de relever un certain nombre de défis liés à la société de la connaissance, les chefs d'État ont fixé des objectifs très concrets alors que l'éducation relève, je le rappelle, des politiques nationales. Le plan éducation et formation 2010 a été lancé en février 2002 par des discussions ayant permis de fixer trois objectifs communs : qualité de l'éducation, accès à éducation et ouverture du système éducatif sur le monde. Ces objectifs se déclinent de façon très concrète : réduire de 10 % l'échec scolaire et de 20 % le nombre des jeunes en difficulté, porter 85 % des moins de 22 ans au niveau du baccalauréat, faire en sorte qu'au moins 12,5 % des adultes actifs soient engagés dans la formation tout au long de la vie, accroître de 15 % le nombre des diplômés en mathématiques, sciences et technologie tout en réduisant l'écart entre les sexes. Ce dernier objectif est d'ailleurs le seul qui soit d'ores et déjà dépassé, l'Europe étant largement supérieure au Japon et aux États-Unis dans ce domaine, même si l'utilisation des compétences y est très différente, puisqu'on trouve davantage de jeunes diplômés dans l'industrie et les services en Europe et dans la recherche aux États-Unis. En proportion de diplômés dans ces disciplines, la Chine vient de dépasser l'Europe. Les tableaux dont je dispose montrent un très haut niveau de diplômés en mathématiques, sciences et technologie en France, mais cela tient largement au double, voire triple comptage des titulaires de licences, puis de maîtrises, puis de doctorats. 30 % des étudiants sortent avec un diplôme dans ces matières, mais on constate une diminution du nombre de diplômés en physique et une augmentation en informatique, domaine dans lequel la France a beaucoup d'entreprises nouvelles, puisqu'elle est en particulier leader dans le traitement de l'image numérique. Le problème du nombre de femmes diplômées dans ces matières se rencontre dans la plupart des pays, mais pas vraiment en France, où elles sont 20 %, contre 10 % dans le reste de l'Europe. En fait, il apparaît que c'est dès l'âge de 10 ou 11 ans que les filles sont perdues pour ces matières. C'est pourquoi le processus de Lisbonne insiste sur la nécessité d'enseigner les mathématiques, les sciences de la technologie le plus tôt possible. Nous avons essayé de lancer une expérience dans 31 pays pour voir ce qu'il convenait de corriger pour renforcer la place des femmes. Les solutions proposées vont des clubs techniques pour les filles en Belgique, jusqu'aux classes séparées en Autriche, en passant par la lutte contre les stéréotypes dans les manuels scolaires au Luxembourg, par les quotas de filles en informatique en Norvège, par la formation des enseignants aux bonnes pratiques en Espagne et par la coopération avec les femmes engagées dans l'industrie au Royaume-Uni. Au Danemark, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Suède et en Irlande, on essaie de soutenir les enseignants grâce à des centres de ressources. Des ressources spécifiques ont été engagées en Autriche en Norvège pour développer la formation pédagogique universitaire. En Finlande, une école doctorale a été créée pour les enseignantes des matières scientifiques. Alors que de nombreux pays essaient d'introduire très tôt les enseignements scientifiques et technologiques, ils restent facultatifs en France. Le pôle universitaire européen implanté en Lorraine et placé sous l'autorité de Marc Durando essaie d'identifier les bonnes pratiques et d'animer les discussions à ce propos. La Commission, le Parlement et le Conseil européens travaillent aussi sur les compétences de base, parmi lesquelles figurent bien sûr celles en mathématiques et technologie. Le rapport sur l'enseignement des matières scientifiques préconise donc de commencer très tôt, dès l'âge préscolaire, de rendre l'enseignement de ces matières plus attractif en l'ouvrant sur le monde extérieur à l'éducation, de définir le profil professionnel des enseignants, d'aller vers une pédagogie permettant un meilleur équilibre entre théorie et pratique, d'adapter la pédagogie aux différences sociales , ethniques et de sexe, de renforcer les partenariats entre les écoles, les universités, les organismes de recherche, les parents et les autres acteurs. Aux États-Unis, les chercheurs travaillent beaucoup avec les écoles, par exemple dans le domaine de l'astronomie. Ce n'est pas le cas en France. En fait, ce que montrent les études PISA, c'est que la France a surtout un problème de réflexion, ou plus exactement de capacité réflective à utiliser les connaissances. C'est sans doute pour cela que les experts français préfèrent parler de réaction plutôt que de réflexion. On observe aussi que les mathématiques jouent dans votre pays un rôle énorme dans la sélection, donc dans l'échec scolaire. C'est par ailleurs en investissant beaucoup et très tôt en faveur des élèves en difficulté que la Finlande parvient à élever son niveau moyen. En France, on fait des choses extraordinaires avec l'école de la deuxième chance qui a été créée à Marseille par Thierry Gaudin, à partir de l'idée que les jeunes qui sortent du système scolaire sans compétence vont droit vers l'exclusion. Cette école accueille 700 jeunes qui sont de vrais exclus des banlieues nord de Marseille. Il y a aujourd'hui 10 ou 12 écoles de ce type en France, qui font preuve d'une remarquable capacité inventive. Dans le cadre de notre travail, nous nous apprêtons à constituer un groupe de pays pour l'évaluation des bonnes pratiques et un rapport conjoint sur l'éducation et la formation sera présenté au le sommet du printemps. Un rapport sur les progrès du processus de Lisbonne sera également publié dans un mois, à partir d'un grand nombre d'indicateurs, et des recommandations sur les compétences de base seront faites préalablement au débat du printemps prochain. M. Jean-Marie Rolland, président : Êtes-vous parvenus à un accord sur les compétences de base ? M. Anders Hingel : Il y a déjà une tradition de coopération sur ce sujet, autour de l'initiative de l'OCDE sur les compétences de base. L'OCDE s'apprête aussi à lancer une initiative sur les compétences des adultes, qui cherchera à identifier les compétences nécessaires dans la société de connaissances. Nous rencontrons davantage de difficultés sur la recommandation relative à la qualification des enseignants, qui ne pourra sans doute pas être publiée avant l'été 2006. Mais ces discussions sont nécessaires. Ainsi, dans les compétences de base comme dans les compétences tout au long de la vie, il y a « apprendre à apprendre ». Or ce n'est pas enseigné spécifiquement comme le sont les compétences dans les écoles. Les enseignants ne sont pas formés pour cela. Une communication sur l'enseignement supérieur, l'université et la recherche sera aussi faite au sommet du printemps. Elle portera en particulier sur l'enseignement supérieur de très haut niveau. M. Jean-Marie Rolland, président : Ressentez-vous en Europe une crise de vocation dans les disciplines scientifiques ? M. Anders Hingel : Non. Il y a un problème aux États-Unis mais pas en Europe. Tout au plus observe-t-on que le pourcentage des étudiants qui choisissent ces matières a un peu diminué depuis 20 ans, mais il a plutôt augmenté ces cinq dernières années. M. Jean-Marie Rolland, président : En faudra-t-il davantage à l'avenir ? M. Anders Hingel : On produit énormément de diplômés, la difficulté est plutôt de tirer profit de leurs compétences quand ils sortent de l'enseignement supérieur, de traduire ces compétences en termes d'innovation et de recherche. Pour moi cela tient essentiellement aux questions de carrière et de salaire. Les jeunes chercheurs vont chercher un emploi ailleurs, aux États-Unis ; il faut se battre pour qu'ils restent en Europe, en investissant dans la société de connaissances. Les entreprises doivent créer des postes de chercheurs en ayant une vision à plus long terme. Un autre vrai problème que nous rencontrons est celui de la présence des filles dans certaines disciplines et dans l'éducation secondaire. * Audition de M. Pascal Huguet, directeur de recherche au laboratoire de psychologie cognitive d'Aix-Marseille (CNRS) M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous connaissez les objectifs de notre mission, qui s'intéresse particulièrement au problème des filles et des sciences. Nous aimerions que vous nous parliez de pédagogie et de méthodes d'apprentissage. M. Pascal Huguet : J'ai préparé une présentation assez précise de données expérimentales car il me semble important de partir de la réalité, c'est-à-dire de phénomènes constatés soit en laboratoire soit en milieu scolaire. Bien évidemment cette évaluation ne couvre pas tous les aspects du sujet et ne constitue pas en elle-même un jugement de valeur. Simplement, elle part de l'idée que les disciplines scientifiques sont en haut de la hiérarchie des matières scolaires et que cette hiérarchie est très présente dans la tête des enfants, des parents et des enseignants, les professeurs des matières moins valorisées le savent bien. Les disciplines scientifiques sont très évaluées, mais qu'évalue-t-on exactement ? Les savoirs, les savoir-faire, les compétences scientifiques des élèves, ou bien le rapport que l'élève peut entretenir à l'objet traité, par exemple à un théorème mathématique ? Ce rapport peut-être nourri à la fois de l'histoire scolaire de l'élève et de stéréotypes sociaux, en particulier pour les femmes dont on affirme souvent qu'elles sont intrinsèquement inférieures dans la pensée logico-mathématique. Vous constaterez que nos résultats remettent fortement en question cette approche. Notre hypothèse de base est que la signification autobiographique du contexte d'apprentissage influence à elle seule la capacité d'attention du sujet dans l'activité cible et donc dans ses performances. Ce que nous avons cherché à mesurer, c'est quelle était cette influence et jusqu'où elle s'exerçait. Car on ne traverse pas le dispositif scolaire sans fabriquer en même temps une représentation, positive ou négative, de soi-même à l'égard de certains objets, des savoirs et des savoir-faire scientifiques. La première expérience porte sur 54 garçons élèves de 6ème/5ème dont 26 « bons élèves » et 28 « mauvais élèves ». Elle utilise un test de reproduction de mémoire d'une figure sans signification particulière, adaptée de la figure complexe de Rey. On explique à un premier groupe qu'il s'agit d'évaluer les compétences en géométrie et à l'autre les compétences en dessin. Les enfants, qui disposent de 50 secondes pour l'encodage et de cinq minutes au rappel, croient tout à fait ce qui leur est expliqué et participent volontiers. La figure de Rey se présente ainsi : 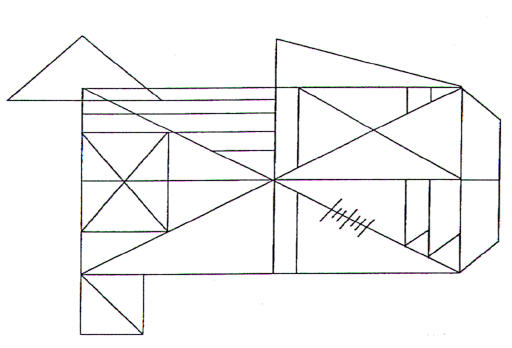 Elle est très utilisée en neuropsychologie pour l'évaluation des capacités d'organisation perceptive, de construction visuospatiale et de mémoire visuelle. Ce sont donc des compétences très importantes qui sont en jeu, indépendamment de l'apprentissage. La grille de correction se présente ainsi : _ 2 points sont accordés si l'unité est correctement reproduite et positionnée ; _ 1 point si elle est soit altérée mais correctement positionnée, soit intacte mais incorrectement positionnée ; _ 1/2 point si elle est à la fois altérée et incorrectement positionnée ; _ 0 point si elle est absente et en cas d'intrusion. Notre hypothèse spécifique est que la performance des élèves en échec scolaire sera inférieure à celle des élèves en réussite, mais uniquement dans la condition dite de « géométrie », la plus menaçante pour les élèves faibles, car propice à la récupération de souvenirs d'échec. Et on constate bien un écart important entre les bons élèves et ceux qui sont en échec dans la construction d'images en géométrie, alors qu'il n'y a pas de différence dans le contexte du dessin. La même étude, menée dix ans plus tôt, avait donné les mêmes résultats. Dans la mesure où on observe que l'intérêt accordé à la tâche ne varie pas entre les deux contextes, on voit bien qu'une explication strictement motivationnelle est insuffisante et que la cause de l'échec est manifestement ailleurs. Or, sur la question absolument fondamentale de la causalité des comportements, la formation des enseignants est médiocre, ce qui explique d'ailleurs la référence quasi-exclusive à la motivation des élèves. J'ajoute que ces résultats sont peu explicables dans le cadre strictement neuropsychologique du test de Rey, où les variations de la performance tiennent majoritairement à des différences de nature structurale. Chez les élèves faibles, le contexte de la géométrie augmente l'accessibilité de certaines connaissances, en rapport à soi, coûteuses en ressources attentionnelles au moment de l'encodage et/ou de la récupération de la figure complexe. Ce contexte conduit donc à l'échec, ce qui alimente un cercle vicieux. Nous avons mené en 2005 avec le même dispositif une autre étude sur l'influence de la notion de réputation dans les classes. On sait que les enseignants ont une connaissance intuitive des élèves dès la maternelle et qu'ils ont tendance à catégoriser les élèves dans le champ scolaire, mais nous voulions en mesurer les effets. Notre hypothèse était que la réputation favorise la formation de souvenirs, d'échec comme de réussite, chroniquement accessibles. Car le regard des pairs entretient quotidiennement l'image dont on a vu l'influence qu'elle exerçait dans la dynamique d'échec. En fait, quand, pour aider les élèves en difficulté, on les rapproche du bureau de l'enseignant et on les envoie plus souvent au tableau, on contribue à alimenter cette réputation puisque tous les élèves le savent. D'ailleurs, pour les élèves moins conscients de leur réputation, on voit que les résultats, globalement comparables à ceux de l'expérience précédente, sont moins marqués. Ces résultats montrent que l'accessibilité à la connaissance autobiographique-scolaire dépend, au moins en partie, de la conscience qu'ont les élèves de leur réputation dans la classe. La conscience de cette réputation favorise une accessibilité chronique à certaines connaissances en rapport à soi, plus ou moins susceptible d'interférer avec la performance. En fait, pour certains enfants, dès que le cours de mathématiques commence, toute leur attention est mobilisée par le prochain échec annoncé. Il est donc très important pour les enseignants de connaître ces phénomènes et de s'intéresser à la gestion des informations liées à la performance dans la situation de classe. Or c'est un domaine auquel les enseignants sont très peu formés. Mais la réputation renvoie aussi aux stéréotypes sociaux, c'est-à-dire à des croyances partagées, à des degrés divers, à propos de certaines catégories ou de certains groupes sociaux. Ainsi, une idée est très répandue dans nos sociétés, celle de l'infériorité intrinsèque des femmes en mathématiques et plus largement dans les disciplines scientifiques et techniques. En fait, certains stéréotypes négatifs conduisent ceux qui en sont la cible à craindre de confirmer, à leurs propres yeux ou à ceux d'autrui, les faiblesses et autres traits négatifs supposés caractériser leur groupe d'appartenance. La seule connaissance de ce stéréotype peut entraîner, notamment chez les filles qui réussissent, une crainte de confirmer, aux yeux de l'enseignant et des pairs, les faiblesses de leur groupe. Et cette crainte interfère elle aussi avec la performance. On a des exemples similaires aux États-Unis : si on fait passer un test de QI verbal aux étudiants noirs de Stanford, en leur disant dans un cas qu'il s'agit d'un diagnostic de QI et en leur donnant dans l'autre une explication qui lève cette condition évaluative très forte, on constate une infériorité dans le premier cas et une égalité dans le second. S'agissant des femmes, pour la composante mathématique du test très difficile d'entrée à l'université, dans un cas on leur dit qu'on constate des différences de sexe mais sans préciser lesquelles, dans l'autre on leur dit qu'on ne constate habituellement aucune différence. Et on observe une très forte infériorité des femmes dans le premier cas et une égalité dans le second. L'hypothèse biologique est ainsi mise à mal. Revenons à notre expérience géométrie/dessin. On prend 40 élèves de 6è/5è, des deux sexes, tous en réussite en géométrie, avec au moins 14/20 au deuxième trimestre, juste avant l'étude. On applique une procédure identique, mais en plaçant la condition dessin remplacée par une condition plus explicitement ludique : « Jeu de mémoire». Eh bien, dans la condition géométrique, les résultats des garçons sont meilleurs, tandis que dans la condition dessin, les filles l'emportent très largement. Nous sommes aussi placés en condition de classe, en prenant 199 élèves (92 filles et 107 garçons) de 6e et 5e avec des niveaux variables de réussite ou d'échec. Chaque classe était divisée en deux groupes mixtes. Les enfants étaient installés individuellement à des tables séparées. Il disposait d'une minute et demie pour la phase d'encodage et de cinq minutes pour le rappel. Et nous avons constaté exactement les mêmes phénomènes qu'en laboratoire, encore amplifiés pour les élèves ayant une note trimestrielle supérieure à 13/20, qui peuvent craindre qu'un échec ne remette en cause leur réputation. Donc, pour réussir en mathématiques et plus généralement en sciences, les filles du secondaire mais aussi du primaire doivent faire face à un obstacle, ancré dans le stéréotype de genre, auquel ne sont pas confrontés les garçons. Les enfants connaissent très tôt ces stéréotypes. Et il y a donc sans doute un travail important à faire dans l'environnement scolaire pour les faire tomber. Car ces barrières peuvent expliquer, au moins en partie, pourquoi on constate ultérieurement une telle désaffection massive ultérieure, en classes préparatoires, à l'université, pour les filières scientifiques et techniques. M. Jean-Marie Rolland, président : Ce conditionnement intervient-il vers 5/6 ans ou est-il antérieur ? M. Pascal Huguet : Il est antérieur. On observe des comportements stéréotypés chez les enfants très jeunes, dès la maternelle. M. Jean-Marie Rolland, président : Le sexe de celui qui présente l'expérience joue-t-il ? M. Pascal Huguet : Nous avons des raisons de le penser. Nous nous sommes donc attachés à ce que nos expérimentateurs auprès d'un groupe d'enfants soient toujours de même sexe. M. Yves Boisseau : Peut-on conclure de ce que vous nous avez dit de la représentation chez les élèves qu'il faut renoncer à la notation ? M. Pascal Huguet : Pas du tout. L'évaluation est nécessaire car tout système biologique a besoin de feed-back, pour savoir vers quoi aller. L'idée est donc de gérer plus finement les retours d'évaluation, qui sont aussi de redoutables retours de comparaison sociale. Car il ne faut pas oublier que nos élèves apprennent en présence des autres, qu'ils sont très attentifs au regard de leurs pairs et qu'ils sont en permanence dans un environnement compétitif. Un autre élément me paraît important. On sait que, dans le primaire, on a souvent affaire à des institutrices, dont on a dit pendant longtemps qu'elles n'enseignaient pas assez les sciences. On peut bien sûr se demander s'il n'y a pas un lien avec ce que montrent nos expériences. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous rendez-vous parfois dans les IUFM ? Je suppose que votre présentation « décoiffe »... M. Pascal Huguet : Elle irrite aussi. Les enseignants ont des pratiques bien établies, ils ont tendance à considérer que les résultats scolaires ne sont que la combinaison entre la qualité didactique de l'enseignant et les compétences de l'élève. Or il y a toujours un contexte, créateur de représentations plus ou moins positives ou négatives de soi-même, qui participe pleinement à la performance. Cela vaut d'ailleurs chez l'adulte comme chez l'enfant. * Audition de M. Edouard Brézin, président de l'Académie des sciences et M. Yves Quéré, membre de l'Académie des sciences, co-fondateur de La main à la pâte M. Jean-Marie Rolland, président : Je suis heureux de vous accueillir ce soir. Je vous rappelle que nous nous intéressons aux enseignements scientifiques dans le primaire et dans le secondaire ainsi qu'à leurs conséquences sur la recherche et sur le recrutement d'ingénieurs et de techniciens. Avez-vous pour votre part l'impression que le niveau scientifique baisse dans notre pays ? M. Édouard Brézin : Ce sont des questions centrales dont nous débattons souvent, car elles sont au cœur de nos métiers comme de nos missions au sein de l'Académie des sciences. En ce qui concerne la recherche, nous sommes inquiets, non pas en raison d'une désaffection des jeunes, mais parce que les carrières qui leur sont offertes n'ont cessé de se dégrader. Ainsi, de nombreux jeunes qui aiment les sciences s'en détournent finalement. Nous en avons des illustrations concrètes : autrefois 20 à 25 % des candidats à l'INSERM avaient une formation médicale, ils ne sont aujourd'hui plus que 2 à 3 %. De même, alors qu'un nombre significatif d'anciens élèves de l'École polytechnique se tournaient auparavant vers la recherche publique, ce n'est plus du tout le cas. Pour ces raisons, l'avenir, en particulier qualitatif, de notre recherche nous préoccupe. S'agissant des études, on ne peut pas parler de désaffection car les populations dans les filières d'ingénieurs sont constantes, même si davantage d'étudiants se tournent vers des formations « professionnalisantes ». En revanche, les jeunes se détournent considérablement des enseignements scientifiques généraux, à tel point que l'enseignement des sciences dans les lycées nous paraît aujourd'hui menacé. C'est pour cela que l'Académie des sciences propose de revenir au système des indemnités de préparation à l'enseignement secondaire (IPES). J'ajoute qu'un constat similaire est fait par nos confrères britanniques. Pour le baccalauréat, les effectifs en section S restent stables, de même que pour les bacs professionnels, ceux de L diminuent. Sans qu'on puisse parler de désaffection, le problème tient au fait que la France aura, demain, besoin de plus de gens disposant d'une formation scientifique et technologique de haut niveau et que le nombre des personnes se destinant à de telles études devrait donc augmenter, ce qui n'est pas le cas. C'est à partir de ces observations que Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré ont créé, il y a dix ans, La main à la pâte, grande opération qui a maintenant pris une dimension nationale et internationale. M. Yves Quéré : Selon les déclarations des enseignants, de 30 à 50 % des écoles sont désormais concernées, soit dix fois plus qu'en 1995. Il s'agit d'un enseignement fondé sur une méthode active et non dogmatique, qui dépasse de loin la science puisqu'on apprend aux élèves à s'exprimer et a réagir en tant que citoyens. Il s'agit de leur montrer que le monde se laisse interroger. M. Édouard Brézin : Nous sommes intervenus à l'occasion de la préparation de la loi sur l'école et nous avons obtenu, in fine, qu'une culture « humaniste et scientifique » soit ajoutée au socle commun de connaissances, l'idée étant qu'il ne faut pas bourrer les esprits mais les ouvrir. Nous avons aussi commencé, à cette occasion, à réfléchir à une extension de La main à la pâte aux deux premières années du collège. Nous l'avons proposé au ministre de l'éducation nationale et, à notre grande surprise, M. François Fillon a réagi avec enthousiasme et confiance en signant avec l'Académie des sciences une convention qui nous demande de réfléchir, bien au-delà de ce que nous avions proposé, à toutes les questions d'enseignement, qu'il s'agisse de la formation professionnelle, de la formation par la recherche ou du devenir des docteurs. Bien sûr, la complexité est bien plus grande en sixième et en cinquième qu'en primaire, en particulier en raison de la pluralité des enseignements scientifiques. M. Yves Quéré : Nous sommes partis de l'idée qu'il fallait poursuivre l'expérience engagée au primaire parce que, quand ils arrivent en sixième, les élèves ne rencontrent bien souvent que la technologie, qui d'ailleurs ne permet même pas l'appréhension des mécanismes techniques. Les SVT sont la seule matière scientifique enseignée, et ils n'ont cours ni de physique ni de chimie. En fait, alors que nous avions introduit au primaire l'idée qu'il y avait une science, l'élève se trouve confronté à un morcellement des sciences au moment où il arrive au collège, ce qui nous semble un peu prématuré. C'est pour cela que nous avons essayé de promouvoir une vue globale des sciences mais aussi d'introduire les sciences expérimentales, en faisant en sorte que les enfants manipulent eux-mêmes. À la rentrée prochaine, sera institué en sixième, dans une trentaine de collèges volontaires, un enseignement unifié des sciences, qui sera étendu à la cinquième l'année suivante. Un professeur en aura la responsabilité et il traitera les grands thèmes du programme. En fait, le seul problème que nous avons rencontré jusqu'ici est un certain raidissement des unions de professeurs, même si le dialogue a maintenant permis d'améliorer les choses. M. Jean-Marie Rolland, président : Souhaitez-vous créer un réseau de professeurs ? M. Yves Quéré : Cela se fait déjà en Bretagne, mais nous voudrions que ce soit officialisé. M. Édouard Brézin : Vous avez aussi souhaité aborder la question de la perception de la science par la société. Nous, scientifiques, avons le sentiment que nous vivons dans une société où la perception des scientifiques est assez bonne mais où celle de la science est assez frileuse. En fait, cette dernière fait un peu peur, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis ou en Asie. D'ailleurs nous sommes le seul pays où le principe de précaution ait été inscrit dans la constitution, sans qu'on y fasse figurer symétriquement le principe de progrès. Et vous aurez noté il y a quelques semaines que, pour la première fois, un juge a touché à la matière scientifique en décidant que les recherches sur les OGM, même dans les champs expérimentaux, ne satisfaisaient pas à ce principe de précaution. Nous sommes aussi dans un pays où les médias font peu de place à la science, qui ne fait l'objet d'aucune émission à une heure de grande écoute depuis la suppression d'Archimède. Pour sa part, la BBC diffuse de bonnes émissions, même si elles traitent souvent d'un grand homme de science. Chez nous le déficit de perception des enjeux de la science est préoccupant. Et je ne parle même pas d'hostilité. J'ai eu l'occasion d'interroger de jeunes Américains, qui ne comprenaient même pas l'idée d'une culpabilité de la science, qui fait ici l'objet de débats constants. À tout cela, il n'y a guère de remède autre que l'éducation de base et c'est bien pour cela que l'enjeu de La main à la pâte n'est pas de faire des scientifiques mais des citoyens. M. Yves Quéré : Avant l'intervention de l'Académie des sciences, le mot « sciences » ne figurait nulle part dans la définition du socle commun de connaissances. M. Édouard Brézin : Cet oubli est symptomatique mais il n'est pas rare : en mai dernier, lorsqu'il a organisé au Palais-Royal d'importantes rencontres sur l'Europe de la culture, le ministre Renaud Donnedieu de Vabres a tout simplement oublié la culture scientifique. Pourtant, le CERN a été créé avant la signature du traité de Rome. J'ai écrit au ministre, je l'ai rencontré et il a reconnu que nous avions raison. Simplement, il n'y avait pas pensé, ce qui montre bien qu'on ne considère pas que la science fait partie de la culture. M. Jean-Marie Rolland, président : Et que pensent les physiciens que vous êtes de la prépondérance des mathématiques, en particulier de leur rôle sélectif ? M. Édouard Brézin : C'est un débat difficile, que nous avons régulièrement. Alors que La main à la pâte cherche à mobiliser ce qui est nécessaire dans les champs mathématiques, de nombreux mathématiciens français - et je rappelle ici l'excellence de notre école mathématique - voient cela comme une menace car, pour eux, les mathématiques existent indépendamment de tout rapport au monde réel et supposent donc une formation au raisonnement indépendante de tout ce qui peut être application. C'est en particulier ce que pense Laurent Lafforgue, qui est un grand mathématicien mais un drôle de type... Pour ma part, je crois plutôt que chez les très jeunes c'est en reliant les mathématiques à des situations réelles qu'on intéresse les élèves. Pour ce qui est de la fonction sélective des mathématiques, il est vrai qu'elles ont gardé un rôle prédominant historique qui, à mon avis, ne se justifie plus beaucoup. Ainsi, Polytechnique a décidé depuis dix ans d'ouvrir autant de places au concours en MP qu'en PC. Pour autant, cette hiérarchie reste présente dans les esprits. Les formations qui donnent plus de place à l'imagination, où il faut savoir regarder, toucher, faire avec ses mains, conduire une expérience, ne sont pas du tout assez valorisées par rapport à la résolution d'un problème mathématique dans un temps limité. M. Yves Quéré : Dans le cadre de La main à la pâte, nous avons tenté de tendre la main aux mathématiciens, et la vision d'un certain nombre d'entre eux a maintenant évolué. Nous parlons quand même de choses très simples : quand un enfant dit « trois pommes », il fait des maths avec le chiffre 3 et des sciences expérimentales avec l'objet pomme. Nous menons des expériences merveilleuses en faisant mesurer par les enfants le rayon de la Terre grâce à la méthode d'Ératosthène. Il s'agit en fait de trigonométrie en minuscules et les enfants sont ravis. C'est cela que nous voudrions faire avec les mathématiciens. M. Édouard Brézin : Je suis préoccupé par la diminution du nombre des heures de sciences dans les IUFM. M. Yves Quéré : En effet, l'enseignement scientifique déjà misérable a été divisé de moitié en 2002. C'est d'autant plus grave que 80 % des professeurs des écoles ont une licence non scientifique. Comment leur demander d'enseigner les sciences deux ans plus tard quand ils ont reçu au mieux une trentaine d'heures d'enseignement de sciences et de technologie ? M. Jean-Marie Rolland, président : Nous rencontrerons les représentants des IUFM lors de la dernière partie des travaux de notre mission. J'ajoute que comme la plupart des enseignants sont des enseignantes, on reproduit en fait le système social. Comment êtes-vous reçus quand vous parlez de formation continue ? M. Yves Quéré : Nous avons rencontré 60 000 instituteurs et nous avons été très bien reçus. Mais ils nous disent à la fin de nos interventions qu'ils ne peuvent pas enseigner les sciences parce que c'est beaucoup trop difficile. En fait ils - je devrais plutôt dire « elles » - en ont l'image compliquée que leur en donne la télévision : ils ne comprennent par exemple rien à au fonctionnement d'un accélérateur de particules. Nous leur expliquons que ce n'est pas du tout cela la science à l'école primaire, mais simplement faire pousser un haricot, le mesurer et voir comment les choses se sont passées en fonction de la salinité et de la lumière. Mais là on nous dit « ce n'est pas la science, c'est du jardinage »... M. Édouard Brézin : Nous rencontrons aussi des professeurs de lycées qui nous disent que nous ne connaissons rien aux élèves. Au début de nos interventions dans les IUFM, l'accueil était glacial. Nous avions beau expliquer que nous n'imposions rien, que nous proposions notre aide, notre arrivée était vécue comme une tentative de mainmise de l'Académie des sciences. Dix ans plus tard, j'espère que les choses ont changé... M. Jean-Marie Rolland, président : Pouvez-vous aborder maintenant la question des femmes ? M. Édouard Brézin : Pour ma part, je n'ai jamais constaté la différence de capacités scientifiques entre les hommes et femmes que certains mettent parfois en avant. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes dans les laboratoires en France et en Italie alors qu'il n'y en a presque pas en Allemagne. En fait, nous parlons d'un problème d'image et d'un problème social. En effet, c'est au cours des années où une jeune femme doit aussi fonder une famille et avoir des enfants, qu'elle doit construire sa carrière, soutenir sa thèse, devenir maître de conférences et entrer au CNRS. Elle a donc besoin d'une aide sociale extrêmement forte et notre système de crèche et de protection maternelle et infantile sont des éléments très importants. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais on trouve des femmes en médecine... M. Édouard Brézin : C'est vrai, alors que les mathématiques et la physique ont une image épouvantable. J'ai ainsi vu des jeunes filles brillantes être soumises à une véritable pression pour qu'elles n'aillent pas vers une carrière dont d'autres estimaient qu'elle n'était pas faite pour elle. J'avoue ne pas avoir de solution miracle à vous proposer. M. Yves Quéré : En fait, tout se passe au moment du bac : dans les classes préparatoires, la proportion de filles diminue de 20 %, mais ensuite elles ne sont pas moins nombreuses que les garçons à intégrer les grandes écoles. M. Jean-Marie Rolland, président : Quel est votre sentiment sur la place de l'informatique dans la diffusion des sciences ? Est-ce un outil supplémentaire ? M. Édouard Brézin : L'Internet est bien sûr un moyen extraordinaire d'accéder à l'information, mais il faut prendre garde à ne pas tout mélanger, d'autant que, faute de contrôle, on peut trouver n'importe quoi, par exemple dans l'encyclopédie libre Wikipédia. Aussi, s'il est bon de savoir se servir d'un micro-ordinateur, il ne me paraît pas souhaitable d'encourager à l'excès le recours à l'informatique dans la formation scientifique. M. Yves Quéré : Dans le cadre de la main à la pâte, nous avons préconisé de mettre l'ordinateur au placard afin de ne pas céder à la tentation de montrer une expérience à l'écran au lieu de la réaliser. M. Édouard Brézin : Alors que les universités américaines disposent des vidéos des cours des plus grands physiciens, on ne s'en sert jamais pour remplacer le contact humain. Cela dit, aux États-Unis les étudiants n'hésitent pas à interrompre l'enseignant ; en France, ils ont peur du regard des autres s'ils posent une question. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 31 JANVIER 2006 Audition de M. Xavier Clément, directeur de la communication et porte-parole du CEA, M. Jean-Pierre Vigouroux, chef de la cellule des affaires publiques, chargé des relations avec le Parlement M. Jean-Marie Rolland, président : Je suis heureux de vous accueillir. Je vous rappelle que nous nous intéressons aux enseignements des matières scientifiques dans le primaire et dans le secondaire. Nous souhaitons en particulier savoir si notre système produit assez d'ingénieurs, de techniciens et de chercheurs ; si, comme on le dit souvent, le niveau baisse ou bien s'il monte ; quelle est la véritable place des disciplines scientifiques ; si de grandes institutions comme le CEA s'attendent à rencontrer des problèmes de recrutement, tant en qualité qu'en quantité, au cours des prochaines années. Avez-vous connaissance des difficultés rencontrées par d'autres institutions ou à l'étranger ? Nous aimerions aussi avoir votre sentiment sur la diffusion de l'esprit scientifique en France, notamment vis-à-vis des grands débats de société, qu'il s'agisse du nucléaire, du réchauffement ou des OGM. M. Xavier Clément : Le document que je vous ai remis met l'accent sur les actions pédagogiques du CEA, mais il répond aussi à la plupart de vos questions. Ses pères fondateurs ayant été des universitaires et des enseignants, le CEA a toujours contribué à la promotion de la science et à la démonstration qu'elle était capable d'apporter des réponses aux grandes questions de la société. Vous nous interrogez sur l'attractivité des filières scientifiques et vous nous demandez si le nombre des scientifiques, ingénieurs et techniciens est suffisant. Comme tous mes collègues, en France et à l'étranger, je constate une certaine désaffection pour les filières scientifiques et une diminution du nombre de jeunes qui s'engagent dans des formations aux sciences dures. Mais, paradoxalement, le CEA parvient à attirer suffisamment de très bons étudiants pour répondre à des besoins importants puisqu'il recrute de 400 à 500 ingénieurs, scientifiques et chercheurs chaque année. Ces embauches nombreuses correspondent aux départs en retraite, qui sont aussi pour nous l'occasion de réorienter notre recrutement sur nos programmes prioritaires, ainsi qu'aux effets de ce qu'on appelle « l'optimisation du soutien support », qui permet de récupérer des postes administratifs pour recruter des scientifiques mais aussi des techniciens, au niveau bac +2, ces derniers postes étant pourvus par des personnes venant des BTS et des IUT, mais aussi issues de notre politique de promotion interne grâce à la formation permanente. M. Jean-Pierre Vigouroux : Il faut rappeler que le CEA ne fait pas de distinction statutaire entre ingénieurs et chercheurs, conformément à la volonté de ses créateurs qui ont souhaité ainsi le distinguer du CNRS. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous des « matheux » purs ? Plus généralement, que pensez-vous de la place des mathématiques dans la sélection des scientifiques de haut niveau ? M. Xavier Clément : La simulation numérique, en particulier sur la machine Terra à Bruyères-le-Châtel, qui met la France au premier rang européen en puissance de calcul disponible, et la physique fondamentale, par exemple la mécanique quantique ou l'étude de la matière noire, nécessitent des mathématiciens de haut niveau. En tant que chimiste de formation, j'ai dû ingurgiter des mathématiques, mais cela m'a passionné. On peut imaginer qu'on ne fonde pas tout sur les maths, mais il paraît impossible d'y échapper totalement car c'est une forme de pensée, en particulier par la logique et l'approche globale, dont on a absolument besoin dans toute formation scientifique. M. Jean-Marie Rolland, président : Les physiciens que nous avons reçus nous ont semblé dubitatifs sur la place donnée aux maths en France, nous parlant de gens qui n'ont pas pu entrer à l'École nationale supérieure de chimie parce qu'ils n'avaient pas eu une bonne note en maths. M. Xavier clément : C'est avant que le problème se pose, car en classe préparatoire MP, Mathématiques et Physique, est vue comme la filière d'excellence, en particulier pour accéder à l'X, tandis que PC, Physique et Chimie, est un peu en retrait. Mais mes enfants, qui sont pragmatiques, se sont aperçus que les chances étaient finalement plus grandes en PCSI, Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur, car le niveau moyen est moins bon. S'agissant des femmes, nous pourrons vous fournir des statistiques précises. Si nous revendiquons l'égalité professionnelle, tout le monde convient que la parité n'est pas possible. Au moins nous battons-nous pour qu'on retrouve dans nos effectifs un pourcentage de femmes similaire à celui des candidates, soit environ 30 % du total. Les femmes sont surtout présentes en biologie et en chimie. Nous ne constatons pas par ailleurs une baisse du niveau. Cela tient peut-être au fait que, parmi nos recrutés, un grand nombre sont déjà passés par le CEA, en stage, en apprentissage ou en post-doc et que leur intégration préalable dans nos équipes a comblé des lacunes scolaires. Peut-être aussi nous situons-nous au-delà de la barrière du bac, qui pose vraiment problème. Mais, le Haut Commissaire, qui détermine les critères de sélection, voit tous les dossiers et je ne l'ai jamais entendu déplorer une baisse dramatique de la qualité des chercheurs. M. Jean-Marie Rolland, président : Les universitaires semblent considérer que si nous disposons d'une élite brillante, celle qui accède par exemple à votre établissement, pour la grande masse des autres, le niveau est moins bon que chez nos voisins. M. Xavier Clément : Le CEA travaille en relation étroite avec l'Université et avec le CNRS, dans le but non pas de les piller, mais de valoriser les formations doctorales. Nous voyons un grand intérêt à constituer des équipes de valeurs tout en donnant des débouchés aux chercheurs formés à l'Université. Pour la diffusion de l'esprit scientifique, le CEA mène un grand nombre d'actions pédagogiques en direction du primaire et du secondaire, en collaboration avec le ministère de l'éducation et l'ONISEP et je vous ai apporté des exemplaires de nos nombreuses publications. Mais nous avons le sentiment - et c'est peut-être une explication de la désaffection pour les filières scientifiques - que la science n'est plus associée au progrès et au bien-être de l'humanité comme elle l'était pendant les « trente glorieuses ». Il faut donc faire œuvre de pédagogie pour aller à contre-courant de cet état d'esprit contre-productif et pour montrer que les excès que l'on reproche à la science ne trouveront des solutions que dans la science elle-même. Dès ma prise de fonctions, j'ai rencontré les représentants du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences. Nous préparons l'ensemble des expositions sur l'énergie et sur les nanotechnologies. C'est aussi ainsi qu'on attirera plus de jeunes vers ce rêve qui conduit à devenir ingénieur et qu'on redonnera une vision positive de la science et du progrès. M. Jean-Pierre Vigouroux : J'ai vu moi-même il y a quelques années dans une classe de physique un poster sur l'énergie absolument scandaleux, mêlant bombe atomique, fils électriques d'EDF et déchets nucléaires. Une telle dérive négative de la société ne peut pas donner l'envie de faire des sciences. M. Jean-Marie Rolland, président : N'est-ce pas, là aussi, la formation des enseignants qui ne leur permet pas d'accéder à l'idée que la science est source de progrès ? M. Xavier Clément : Lors de visites organisées dans un de nos centres pour des élèves de l'IUFM de Créteil, nous avons bien vu que les enseignants découvraient des choses qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils constataient que les chercheurs étaient des êtres normaux et plutôt jeunes, honnêtes, qui conduisaient des recherches extraordinaires qu'ils mettaient immédiatement à la disposition des autres, par exemple sur l'énergie solaire ou sur l'imagerie médicale. Ceux-là qui ont découvert un CEA tel qu'ils ne l'imaginaient pas, je suis persuadé qu'ils ne se laisseront plus aller à une telle dérive dans leur vie professionnelle. Toujours dans le même but, grâce aux programmes européens, nous avons diffusé à 12 000 exemplaires à destination des CDI des collèges et lycées un CD-ROM contenant une quinzaine de portraits de jeunes chercheurs. Nous cherchons plus généralement à développer nos actions en direction de l'éducation nationale. Ainsi, notre centre de Saclay travaille avec l'académie de Versailles. C'est aussi pour éviter une éventuelle baisse de qualité liée à la perte d'attractivité des filières scientifiques, que 300 de nos chercheurs sont impliqués dans des actions pédagogiques dans le primaire et dans le secondaire. Cela nous paraît important pour mettre en valeur la science. M. Jean-Pierre Vigouroux : Vous nous avez aussi demandé si nous avions connaissance d'initiatives prises à l'étranger. Je sais que le Japon se préoccupe fortement des difficultés de recrutement de scientifiques et il développe un énorme programme destiné à redonner goût aux sciences. M. Jean-Marie Rolland, président : Le statut d'ingénieurs chercheurs que vous proposez peut-il être aussi attirant que le débouché d' une école de commerce à « bac +5 » ? M. Xavier Clément : Le fait que nos salariés relèvent du droit privé est un avantage en termes de gestion des ressources humaines. Leurs revenus se situent dans la bonne moyenne des filières scientifiques, mais ils ne nous permettent pas de rivaliser avec des écoles de commerce. Cela aussi peut contribuer à la désaffection pour les sciences. * Audition de M. Christian Orange, professeur des universités en sciences de l'éducation (didactique des sciences), agrégé des sciences de la vie et de la terre, formateur à l'IUFM des Pays de la Loire M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes le premier représentant d'un IUFM que nous entendons. On nous a dit jusqu'ici que très peu d'enseignants avaient reçu une formation scientifique et que la place de cette dernière était très faible dans les IUFM. M. Christian Orange : Je suis ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé en sciences de la vie et de la terre. Après avoir enseigné en collège et en lycée, je me suis consacré à la formation des enseignants et j'ai mené des travaux sur la didactique des sciences. Je travaille actuellement à l'IUFM des Pays de la Loire à la formation des professeurs de sciences ainsi qu'à la formation des formateurs et je suis chargé de mission à la recherche et à la formation par la recherche auprès de la directrice de l'IUFM. Mes recherches portent en particulier sur l'accession des élèves aux savoirs scientifiques et je travaille sur les questions de problématisation et de débats scientifiques dans les classes. Il est vrai qu'assez peu de futurs professeurs des écoles viennent de filières scientifiques, même si les élèves des IUFM ne sont pas tous des littéraires et si un certain nombre d'entre eux ont fait des études de biologie. En fait, les choses varient selon la façon dont est faite la sélection à l'entrée en première année, mais il faut aussi comparer l'attractivité de nos métiers avec ce que peuvent faire par ailleurs des étudiant qui sortent des sections scientifiques. Par ailleurs, si les professeurs des écoles n'ont pas tous reçu une formation scientifique, ils sont appelés à devenir des enseignants polyvalents. Mais leur première année de formation est essentiellement consacrée à la préparation du concours, où les épreuves scientifiques sont finalement assez peu importantes puisque, si celle de mathématiques est obligatoire, on choisit entre histoire-géographie et sciences et techniques. La véritable formation n'a donc lieu qu'au cours de la deuxième année, c'est-à-dire en sept mois. Après la réforme intervenue l'an dernier, le concours ne permet plus que de procéder à une vérification de niveau et je dirais que le niveau moyen en mathématiques et en sciences est celui de 2de ou 1ère, ce qui est assez logique puisque les titulaires d'un bac L ne font plus de mathématiques ni de physique après la fin de la 1ère. Mais une chose est d'avoir un niveau correct dans une discipline, une autre est de savoir l'enseigner. Dans les IUFM, entre 50 à 60 heures sont consacrées aux mathématiques et de 0 à 30 heures, suivant les instituts, à la physique et aux sciences de la vie et de la terre. Les formateurs ont ainsi le sentiment d'avoir à peine le temps de commencer leur travail. Pour autant, dès qu'ils sont en stage, les professeurs des écoles doivent enseigner les différentes disciplines, et ils le font. Mais ils s'aperçoivent qu'enseigner de façon intéressante et faire travailler les élèves pour l'apprentissage des mathématiques et des sciences demandent un grand professionnalisme. En effet, si l'on se contentait il y a trente ans, de faire lire des pages de manuel, il faut aujourd'hui mettre les élèves devant des expériences, susciter un échange d'idées et développer la pensée critique : c'est bien plus compliqué et cela implique une capacité à prendre en compte la pensée des élèves et les difficultés qu'ils rencontrent. C'est un travail passionnant et difficile et il y a quand même une contradiction entre une formation réduite et l'exigence de capacités professionnelles plus importantes. Quand on explique à un élève comment cela fonctionne, pourquoi on parvient à tel résultat, on mène un travail fondamental, qui va au-delà du seul enseignement des sciences et qui demande des compétences importantes. C'est par rapport à ces exigences que, faute de temps, les formateurs ont souvent l'impression de laisser les enseignants au milieu du gué. Un allongement du temps de formation me paraît donc tout à fait nécessaire. Il convient aussi que le concours prenne en compte les connaissances scientifiques. Il faut également permettre aux étudiants de réfléchir au fonctionnement intellectuel des élèves. M. Jean-Marie Rolland, président : Dans la mesure où les IUFM ont une certaine latitude pour développer l'esprit scientifique, certains ont-ils noué des liens a avec des établissements de recherche et avec l'industrie ? M. Christian Orange : Nous profitons de la dynamique de La main à la pâte qui s'est traduite, dans 44 départements pilotes, par un plan de rénovation des sciences à l'école. Mais j'ai l'impression que cet élan est retombé parce que un grand nombre d'autres priorités ont été ajoutées. C'est plutôt dans le cadre de la formation continue des enseignants que des visites de laboratoires peuvent être organisées, mais comment ferait-on de même en formation initiale, quand 20 heures en tout sont consacrées à l'enseignement soit des SVT soit de la physique et de la technologie ? Cela étant, nous travaillons avec le muséum de Nantes et avec des entreprises pour essayer de mettre en place une dominante « culture scientifique » au sein de notre IUFM. Sachez par ailleurs que la recherche en didactique des sciences n'est pas limitée à l'université et s'exerce aussi en IUFM. Dans les Pays de la Loire, l'IUFM est en liens étroits avec l'université, enseignants et chercheurs en didactique travaillant ensemble. Je l'ai dit, mes recherches portent sur la problématisation dans l'apprentissage scientifique et sur le débat dans la classe, et tout ce travail est réinvesti dans la formation, auprès d'enseignants du premier comme du second degré. Il porte aussi sur les aspects langagiers et je travaille donc également en liaison avec des formateurs en français, autour de l'idée que le développement de l'esprit scientifique va se traduire chez l'élève par celui de l'esprit critique. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pense l'agrégé des sciences de la terre que vous êtes de la place des mathématiques dans le mode de sélection ? M. Christian Orange : S'il est vrai que faire une terminale S ne signifie pas qu'on se destine à une carrière scientifique, il me semble que l'image sociale des sciences attire moins les bons élèves qu'il y a quinze ou vingt ans. Plus généralement, la sélection est aujourd'hui fondée sur des domaines de compétence. Cela apparaît dès le collège et se développe au lycée, avec des moments importants que sont l'entrée dans chacun des deux établissements. On a l'impression que notre système éducatif a une fonction davantage sélective que formatrice. Il faudrait donc se demander si les IUFM sont destinés à former les enseignants à pointer les difficultés des élèves pour contribuer à ce processus de sélection ou pour les aider au mieux. C'est aussi pour cela que je pense qu'il est nécessaire d'avoir acquis un bagage suffisant dans les matières scientifiques pour comprendre les difficultés des élèves à accéder à ces savoirs. Alors que, dans leur scolarité, on demande aux élèves de fonctionner selon une mise en histoire, en SVT, dès qu'on aborde des sujets plus compliqués, il faut sortir de cette logique et c'est la que nous rencontrons des difficultés. Or une partie de l'enseignement des sciences au collège et au lycée évite précisément ces difficultés, ce qui fait qu'un très bon élève peut obtenir un bac S sans avoir compris véritablement le fonctionnement du corps humain : tout dépend de la façon dont on l'interroge, certaines questions ne permettant pas de dévoiler la compréhension de sujets comme la circulation sanguine. Je vous remets la communication que j'ai faite à ce propos une communication au colloque sur « la crise mondiale des sciences »organisé à Lille en novembre 2005. * Audition de M. Jean-Pierre Demailly, professeur à l'université de Grenoble I Institut Fourier, président du groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes (GRIP) et de M. Michel Delord, vice-président du GRIP, enseignant de collège en mathématiques M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Vous connaissez les grands thèmes de nos travaux. Pouvez-vous, en particulier, nous dire quelles sont les méthodes qui pourraient redonner goût aux sciences et faciliter leur apprentissage ? Que pensez-vous également de la place des mathématiques dans la sélection au sein de la société française ? M. Jean-Pierre Demailly : Pour moi, les problèmes du système éducatif français sont extrêmement profonds et tiennent à l'application, à tous les échelons, de méthodes de pensée inadéquates, inspirées par des idéologies fallacieuses, en particulier celle qui met l'élève au centre de la classe, détournant ainsi l'école de sa mission première : l'acquisition de connaissances. Il y a aussi une perte générale de repères, due au fait qu'on a dépossédé les enseignants de leurs prérogatives en réduisant leurs responsabilités en matière d'évaluation et d'orientation des élèves : ce n'est plus leur avis qui fonde la décision finale. On observe également un affaiblissement général des exigences dû au mythe de l'égalité face à l'instruction et aux apprentissages, qui a conduit à une dévalorisation systématique des programmes et à un nivellement par le bas. On applique des méthodes d'enseignement tout à fait inadaptées car on a renversé l'ordre des choses : avant, on partait de l'élémentaire pour aller vers l'élaboré, on prenait les lettres, puis les syllabes, puis les mots, puis les phrases, maintenant il faut que les élèves photographient les mots puis qu'ils en extraient les lettres par synthèse. Michel Delord entrera davantage dans le détail pour le calcul, mais le principe est le même : on veut faire accéder les élèves au sens avant de leur apprendre la manipulation concrète. Ce renversement de la méthode traditionnelle est nocif aux apprentissages. Ces idéologies pédagogiques perverses ont pour effet une déstructuration complète des progressions scolaires. Cela commence dès la maternelle avec une imprégnation globale en trois ans particulièrement grave car les enfants sont très malléables à cet âge et on leur inculque déjà cette vision globale de la lecture et des mots. Il y a un retard d'apprentissage considérable dans les programmes par rapport à ce qui avait cours de 1880 à 1970, moment où on a réduit brutalement les contenus des programmes, notamment en calcul, en renonçant aux manipulations sur les nombres décimaux et en repoussant au collège l'apprentissage de la technique de la division. Ainsi, en classe de 3e, en même temps qu'on pose des exigences considérables sur le concept de puissance électrique, on apprend aux élèves à faire une réduction de fractions au même dénominateur, mais par une méthode incompréhensible aux enfants, pour introduire un concept qui autrefois était enseigné en CM2. Il y a des incohérences monstrueuses, des lacunes dans les programmes, un manque d'interaction entre les disciplines pour la progression dans la langue et dans le calcul. Du coup, au lycée, où les programmes sont restés importants, se produit une accélération que la plupart des élèves ne peuvent pas suivre, et les choses sont encore pires à l'Université. Beaucoup des gens de terrain partagent ce constat, malheureusement ceux qui ont été les inspirateurs des programmes actuels s'en sentent dépositaires et font obstruction à une analyse objective des difficultés. M. Jean-Marie Rolland, président : Ce message est-il bien reçu par vos collègues ? M. Michel Delord : Tout à fait, j'en veux pour preuve que moi, qui ne suis pas universitaire mais simple professeur de collège et qui avais pris des positions tranchées, ai été élu puis réélu avec 70 % des voix au bureau de la Société mathématique de France, qui regroupe la moitié des 4000 mathématiciens français. Cela montre que la conception actuelle de l'enseignement de la matière est minoritaire parmi les professionnels. Pourtant, ce que je dis n'apparaît toujours pas dans les médias ni dans les programmes tels qu'ils ont été récemment rénovés. J'ai acquis une certaine notoriété en lançant en 2002 une pétition sur le primaire, qui a recueilli la signature de grands mathématiciens, y compris américains. Las, personne n'en a tenu compte. Sur la page d'accueil de mon site Internet, j'ai fait figurer cette phrase : « Site dédié aux parents qui s'inquiètent que leurs enfants ne sachent toujours pas faire une division en cours moyen à qui on a répondu : "Vous êtes des rétrogrades" ». J'aurais pu dédier aussi ce site à ceux qui sont qualifiés de réactionnaires quand ils s'étonnent que leurs enfants ne mettent pas de « s » au pluriel. Prenons le résultat moyen des évaluations à l'entrée en 6e en septembre 2005. - Dans les exercices de maîtrise générale du calcul : · Écrire six cent vingt sept mille en chiffres : 25 % d'échecs ; · Quel nombre faut-il ajouter à 25 pour trouver 100 : 28 % d'échecs ; · Combien valent 60 divisés par 4 : 60 % d'échecs ; · 876 x 34 : 53 % d'échecs ; · 27,5 x 23 : 70 % d'échecs. Et les résultats étaient identiques les années précédentes, même si les comparaisons sont difficiles pour la bonne raison que, quand un test donne de mauvais résultats la Direction de l'Évaluation et de la Prospective le supprime dans l'évaluation de l'année suivante. Ainsi, c'est parce que les résultats étaient mauvais que la division à virgule a été supprimée des programmes en 2002. Et cela vaut aussi pour les évaluations en français. On pourrait toutefois se dire qu'il est normal que les élèves ne sachent pas, à l'entrée en sixième, réaliser des divisions comme 80 : 6 (8 % d'échecs) ou 408 : 12 (46 % d'échecs). Mais il y a eu, une seule fois, en 2002, une évaluation en cinquième, vite abandonnée tant les résultats étaient catastrophiques. Ainsi, on avait 59 % d'échecs à l'exercice constituant à diviser 3978 par 13, et 74 % quand il fallait diviser 178,8 par 8. Cela explique que quand on veut faire travailler la division en 4e, ce qui est indispensable, il faut y consacrer trois mois et qu'on prend ainsi du retard sur le reste du programme, au risque de s'attirer des critiques. Il est dit dans les programmes que les élèves doivent utiliser des procédures personnelles, fondées sur une définition de la division comme une suite de soustractions, et non pas la procédure dite « experte », c'est-à-dire celle que nous connaissons vous et moi. Or cela ne peut pas fonctionner pour des opérations compliquées. Je puis ainsi vous montrer la copie d'une très bonne élève de sixième qui en procédant de la sorte pour diviser 223 200 par 3600, a procédé à un nombre tellement important d'opérations que cela lui a pris 25 minutes sans qu'elle obtienne un résultat exact. Or cette méthode figure dans plusieurs manuels et elle était utilisée dans trois des sept écoles primaires dont venaient mes élèves, plutôt par des jeunes instituteurs certains sortant des IUFM sans savoir eux-mêmes faire des divisions. M. Jean-Marie Rolland, président : Il y a quand même une épreuve de mathématiques au concours, dont le coefficient est équivalent à celle de français. M. Michel Delord : Pour moi, le problème tient largement au fait que plus personne, enseignants comme élèves, n'est aujourd'hui capable de donner la définition d'une multiplication. Or, pour résoudre un problème, le principe est de disposer de nombres et de savoir quelle opération on fait. Et il est impossible de la choisir avec de bons arguments si on n'en connaît pas la définition. Ainsi, si l'on demande à une classe « sachant qu'il y a six rangées de cinq tables dans une salle, quel est l'âge de la maîtresse », quelques uns seulement vont trouver l'exercice idiot, les autres vont procéder par tâtonnement aux cinq opérations possibles et proposeront le seul résultat plausible, c'est-à-dire 6 x 5 = 30. Pourtant la définition de la multiplication reste la même : « opération par laquelle on répète un nombre appelé multiplicande autant de fois que l'indique un autre nombre appelé multiplicateur ». Cela peut paraître tout bête, mais si on sait que le multiplicande est toujours un nombre concret, qui exprime des objets déterminés comme des arbres, des mètres, des euros, cette définition est aussi l'introduction au calcul dimensionnel, qui est important en physique. Depuis des années, dans les programmes, on insiste sur la commutativité de la multiplication. C'est vrai quand les nombres sont abstraits, mais quand on a 7 pièces de 10 centimes, cela ne fait pas10 pièces de 7 centimes. À partir de cela, on arrive logiquement à la définition de la division, c'est-à-dire par exemple que dans 12 m : 3 m = 4 : quand on divise des mètres par des mètres, on ne trouve pas des mètres. Même si on ne le dit pas alors aux élèves, il s'agit d'une propriété algébrique et celui qui sait faire cela en 4e saura plus tard donner le résultat de 12x : 3x. Et cela débouche aussi sur la géométrie, en permettant de calculer l'aire d'un rectangle. C'est à tout cela qu'on a renoncé quand les mathématiques modernes ont décrété qu'il ne fallait pas mettre les unités dans les opérations. Or il faut apprendre très tôt la division à la main, dés le CP, âge où l'élève aime encore imiter le maître. Comme il s'agit d'une technique difficile, elle peut s'acquérir lentement de manière non rébarbative, en en faisant une tous les deux jours de la fin du CP au CM2, ce qui rend l'apprentissage, en cinq ans, aussi indolore qu'efficace. C'est indispensable parce que : · La maîtrise de la division est la meilleure preuve de la maîtrise des trois autres opérations ; · La division sans poser les soustractions, spécificité française, est un des meilleurs exercices de base du calcul mental ; · L'apprentissage des propriétés de la division, telle que « si on divise le dividende et le diviseur par un même nombre, le quotient ne change pas », est une introduction à la notion de fraction et donne les règles pour une division à virgule ; · La connaissance de l'algorithme de la division est la seule manière de faire la différence entre les nombres décimaux, rationnels et irrationnels, qui est une base de l'algèbre, et que ne permet pas la calculette ; · La division à virgule poussée est l'introduction à la notion mathématique extrêmement importante de limite. Or un élève de terminale S qui ne sait pas que la suite 0,7 ; 0,71 ; 0,714 ; 0,7142 a pour limite 5/7 ne sait pas ce qu'est vraiment un nombre. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous dites qu'on n'enseigne pas tout ceci, mais cela figure dans les programmes. M. Jean-Pierre Demailly : On peut être abusé par une lecture superficielle des programmes : l'addition est introduite au CP, la soustraction à la fin du CP et au début du CE1, la multiplication n'apparaît qu'à la fin du CE1 et au début du CM1 mais dans les classes, il y a un retard d'au moins une année. Nous avons lancé à la dernière rentrée un réseau expérimental baptisé SLECC, Savoir Lire, Écrire, Compter, Calculer, d'une trentaine de classes dont certaines se situent dans des zones très défavorisées. Nous y avons remis en place un processus d'apprentissage des quatre opérations et de la méthode de lecture syllabique. Dans un CE1/CE2 où de nombreux élèves ont des parents non francophones, avec un apprentissage systématique de l'orthographe, des règles de grammaire, ils arrivent à 15 de moyenne en dictée. Dans d'autres classes, on fait les quatre opérations dès le CP, ce qui est totalement contraire aux programmes, avec de très bons résultats, alors que se polariser longtemps sur une seule opération est un frein à l'acquisition des savoirs. Nous espérons pouvoir poursuivre cette démarche au collège et au lycée. Elle n'est possible que grâce à des maîtres rebelles, qui prennent des risques pour leur carrière. Certains inspecteurs sont compréhensifs et nous aident, mais la plupart restent polarisés sur les dogmes ambiants et sont prêt à sanctionner ceux qui s'en écartent. M. Michel Delord : Je reprends les programmes de 6e : « la mise en place des techniques expertes est poursuivie en se limitant à des diviseurs à un ou deux chiffres ». M. Jean-Marie Rolland, président : Mais les quatre opérations doivent être maîtrisées au cours de la 6e. M. Michel Delord : Mais personne ne le vérifie, faute de temps et par crainte de résultats catastrophiques. Les élèves ne savent pas faire ce qui est dans le programme, comment irait-on au-delà ? Pour faire correctement la division des entiers, avec une classe moyenne de 6e, il me faut trois mois, et je ne récupère que 60 % des élèves. M. Yves Boisseau : Mais alors, que savent vraiment nos 70 % de bacheliers ? M. Michel Delord : Je vous répondrai par une information : depuis l'an dernier la direction d'EADS recrute en Inde ses ingénieurs de recherche, non pas pour les payer moins cher, mais en raison du faible niveau des écoles d'ingénieurs françaises. M. Jean-Pierre Demailly : J'enseigne à l'Université depuis vingt ans et je vous assure que le niveau a chuté de manière dramatique depuis une dizaine d'années. Nous avons des étudiants qui présentent des lacunes fondamentales dans tous les savoirs de base, qui ont perdu, faute de disposer du langage nécessaire, toute aptitude au raisonnement mathématique, qui ne savent plus manipuler la logique élémentaire. Qui plus est, l'Université a vécu la mise en place du LMD, Licence-Mastère-Doctorat, qui a fait table rase de toute l'organisation existante et qui impose un carcan là où il faudrait au contraire une diversité des parcours, pour pousser les bons étudiants - car il y en a quand même, qui sont capables d'apprendre tout seuls - et pour soutenir les autres, ainsi que pour tenir compte de leurs objectifs différents. Nos collègues de nombreux autres pays font d'ailleurs les mêmes observations. Je reviens de Slovénie, qui est entrée dans l'Union européenne l'an dernier et qui hésite à appliquer le LMD. C'est un des rares pays où l'enseignement n'est pas dégradé : ils ont encore les quatre opérations au CP et, avec 2 millions d'habitants, ils placent chaque année des élèves parmi les premiers aux Olympiades de mathématiques, alors que les meilleurs Français, y compris les élèves de Louis-le-Grand, échouent régulièrement à des places déshonorantes pour un grand pays mathématique comme le nôtre. C'est bien le signe que même l'élite est touchée par cette dégradation générale de l'enseignement. J'ai enseigné à l'École normale supérieure de Lyon ; j'y ai fait le même cours l'an dernier qu'en 1995 et j'ai constaté que sur une promotion d'élèves qui figurent parmi les plus brillants de la nation, la baisse est importante. Bien sûr, ils vont finir par rattraper, car il sont extrêmement motivés et travaillent beaucoup, mais ils ont subi un retard du fait de la désintégration de l'enseignement secondaire. Malheureusement, le fossé entre ces meilleurs étudiants et ceux qui viennent ensuite, dont un certain nombre deviendront enseignants, s'est creusé. Quand je suis arrivé à l'université de Grenoble il y a vingt-cinq ans, nous avions en quatrième année des élèves dont le niveau était presque comparable à celui des normaliens, on en est très loin aujourd'hui : ils ne maîtrisent même pas les savoirs de base. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons reçu avant vous des représentants du CEA, qui recrute 400 chercheurs, ingénieurs et techniciens chaque année ; ils ne partagent pas du tout votre analyse quant au niveau des gens qu'ils recrutent. M. Jean-Pierre Demailly : Ceux qui entrent comme chercheurs au CNRS ou au CEA sont les dix meilleurs dans leur spécialité, ils sont capables de travailler seuls, avec un livre. Mais tous ceux qui doivent s'appuyer sur l'école, notamment ceux qui viennent des classes les plus défavorisées, sont terriblement pénalisés par le système actuel. Cela explique la dégringolade de la proportion d'étudiants issus de ces milieux dans les grandes écoles. M. Jean-Marie Rolland, président : Il s'agit de 400, pas de 10 ! Quant au recrutement du CNRS, nous en parlerons dans quelques minutes avec ses représentants. Mais nous avons aussi auditionné Laurent Lafforgue, qui tient le même discours que vous : il a longuement insisté sur la responsabilité de la mauvaise formation des maîtres. Nous allons retravailler la question des programmes. M. Michel Delord : Nous avons organisé un débat entre la Société mathématique de France et Roland Charnay, responsable des contenus en calcul et mathématiques des programmes du primaire, et il a été totalement incapable de défendre les programmes. Le compte rendu a été publié dans la Gazette des mathématiciens. Tous les programmes du primaire sont fondés sur un renversement de l'ordre logique dans lequel les choses devraient être apprises : méthode semi-globale pour la lecture, apprentissage supposé du sens des calculs avant d'apprendre la manipulation. M. Jean-Marie Rolland, président : Ce n'est pas ce qui figure dans les programmes. Pour la lecture : « deux manière d'identifier les mots : · Apprendre à identifier les mots par la voie indirecte (déchiffrer) ; · Apprendre à identifier les mots par la voie directe. » Le déchiffrage vient donc bien en premier. M. Michel Delord : Je viens d'écrire un texte sur la lecture, intitulé « la globale et la syllabique ». J'y montre que le déchiffrage n'intervient qu'à partir du CP, c'est-à-dire que pendant trois ans de maternelle, les enfants ont baigné dans une méthode non pas globale mais idéo-visuelle, par exemple avec leur prénom au-dessus de leur portemanteau. Et c'est bien pour cela que Gilles de Robien a jugé utile de publier une circulaire sur la lecture. Mais il est vrai qu'il faut être comme nous habitué à décrypter, à lire entre les lignes des programmes pour bien mesurer tout cela. Il est donc bien urgent de remettre les programmes en chantier. * Audition de M. Antoine Petit, directeur interrégional Sud-Ouest du CNRS et M. Hervé Mathieu, secrétaire général du CNRS M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Vous connaissez les grands thèmes de nos travaux. Pouvez-vous nous dire pour commencer si vous considérez que, comme nous venons de l'entendre, le niveau scientifique général baisse ? M. Hervé Mathieu : Pour nous, il ne baisse pas. Les graphiques que j'ai apportés montrent qu'au CNRS la pression au recrutement ne diminue ni en qualité ni en quantité, alors que, dans le passé, nous avons connu des périodes de pénurie. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais on nous a expliqué que c'était parce que vous recrutiez la crème de la crème, des étudiants qui, en dépit des lacunes du système éducatif, sont parvenus à acquérir les connaissances nécessaires. M. Hervé Mathieu : Il y a eu un léger décrochage entre 1999 et 2002, mais depuis, l'augmentation du nombre de candidats par poste est constante, grâce à l'amélioration de la publicité pour les concours et surtout à une action déterminée d'ouverture internationale, le fait de bénéficier d'un emploi permanent de fonctionnaire attirant de nombreux chercheurs étrangers séduits si ce n'est par les salaires, du moins par la sécurité. La plupart ne restent chez nous que quelques années, mais cela permet de donner une bonne image de la recherche française du CNRS et de tisser les liens durables avec les pays et les laboratoires auxquels ils se destinent ensuite. On observe par ailleurs une forme d'autocensure, les gens qui estiment n'avoir aucune chance ne se présentant pas aux concours, ce qui fait que la pression est bien moins forte que pour les maîtres de conférences. Il y a des différences selon les disciplines : pour les chercheurs la pression est forte en biologie car il y a énormément de formations de haut niveau tandis que les postes de recherche sont rares dans le public comme dans le privé, ce qui fait que nous avons parfois 200 candidats par poste. La tension est un peu plus forte en informatique, mais nous ne percevons pas pour autant de risque de pénurie. Même si les départs en retraite seront moins importants que prévu car la loi Fillon les a étalés dans le temps, nous continuerons à jouer la carte de l'international pour assurer le renouvellement de nos personnels. La faible progression dans le recrutement de chercheuses est une de nos déceptions ces dernières années. On sait les difficultés que rencontrent les jeunes femmes à la fin de leurs études supérieures comme dans leurs carrières, en particulier en raison des interruptions liées à la maternité. La situation ne se dégrade pas mais elle reste défavorable. Elle varie toutefois selon les filières : il y a plus de femmes dans les sciences du vivant et pratiquement pas en informatique. Depuis quelques années nous fournissons ces statistiques à nos jurys, non pas pour instaurer des quotas mais pour qu'il mesurent les effets de leurs décisions : s'il y a 15 % de candidates, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait que 10 % de reçues. L'effet d'autocensure dont je parlais est sans doute encore plus fort pour les femmes. Nous n'avons pas d'inquiétude quant à l'attractivité des matières scientifiques, y compris de la physique. Il est vrai que, dans nos domaines d'excellence, nous recrutons beaucoup de gens qui sortent de l'École normale supérieure et que, pour des jeunes étudiants brillants, devenir maître de conférences est dangereux parce qu'on glisse assez rapidement du rôle d'enseignant-chercheur à celui de simple enseignant et qu'il est bien difficile de se remettre à la recherche quand on l'a abandonnée pendant quelques années. Je crois que si nous-mêmes rencontrons un jour des problèmes pour recruter, il faudra vraiment s'inquiéter. Nous encourageons de plus en plus le recrutement de contractuels, qui nous semble relever de notre mission de formation : même si ceux qui font chez nous un séjour d'un ou deux ans, pour travailler à un projet donné, ne font pas ensuite de carrière scientifique, cela augmentera leurs chances d'accéder dans de bonnes conditions au marché du travail. Nous souhaitons recruter de la sorte plusieurs milliers de personnes chaque année, soit autant que de titulaires. Les programmes européens de soutien à la recherche et les actions de l'Agence nationale pour la recherche favorisent tout à fait ce mouvement, dans lequel s'engagent de plus en plus d'autres pays. M. Antoine Petit : Je crois qu'il faudra poser un jour la question de la différence de salaire selon la discipline d'origine : alors que, pour pouvoir concurrencer les universités américaines, il faut offrir un revenu annuel de 50 000 euros à un post-doc en informatique, avec 40 000 €, un mathématicien est ravi. M. Hervé Mathieu : Il est évident que le modèle égalitaire de la fonction publique n'est pas celui des universités étrangères concurrentes comme Berkeley. Parmi nos contractuels, la grande majorité sont français, mais certains viennent de toute l'Europe ainsi que, par tradition, d'Afrique du Nord. Le statut de chercheurs permanents est séduisant pour de nombreux Européens, en particulier de l'Est, qui apprécient la capacité de faire de la recherche à temps plein avec une garantie d'emploi. Globalement, il me semble que la France est en train de renforcer sa position sur un marché de l'emploi de plus en plus international, comme celui du football. M. Antoine Petit : Même si cela ne relève pas du champ de votre mission, j'observe que nous avons un problème avec la loi Toubon sur l'usage du français, que nous sommes obligés de contourner en permanence : il serait quand même dommage de se priver de la possibilité de recruter un chimiste indien de haut niveau au motif qu'il doit, quelles que soient ses autres compétences, être capable de passer une audition en français. M. Jean-Marie Rolland, président : Menez-vous des actions pour diffuser l'esprit scientifique dans la société ? Avez-vous en particulier des liens avec les IUFM ? M. Hervé Mathieu : Nous avons une mission de diffusion de l'information scientifique et technique et les jeunes sont notre cible privilégiée. Nous utilisons de nombreux canaux : journées d'accueil, visites de laboratoire, publications, produits audiovisuels, clubs lycéens. M. Antoine Petit : Au sein de nos cinq directions interrégionales, dans chacune de nos 19 délégations régionales un chargé de la communication a en charge cette mission de diffusion. Mais nous constatons sur le terrain que tout repose surtout sur le volontariat et qu'il faut un certain engagement des chefs d'établissement pour que les choses se passent bien. Beaucoup de nos laboratoires travaillent aussi avec les universités et accueillent mêmes des lycéens. Statistiquement, ce n'est sans doute pas très important, mais nos chercheurs aiment ça et participent volontiers. Dans le cadre de notre opération Science et société, désormais appelée « CNRS Jeunes », nous organisons chaque année au Futuroscope, pendant deux jour et demi, des ateliers à thème pour 500 jeunes Français et étrangers et nous projetons d'organiser cela dans chaque région et de faire de cette session nationale l'apothéose de l'opération. Mais le problème majeur tient au faible nombre d'enseignants qui sont prêts à participer, faute de se montrer réceptifs à de telles actions, mais aussi d'y être incités par leur encadrement. Bien sûr, ils voient cela comme une tâche supplémentaire alors qu'ils en ont déjà beaucoup, mais organiser une semaine d'action scientifique intégrée dans le projet pédagogique produit des bénéfices pendant plusieurs mois. C'est tout le principe de La main à la pâte : alors que qu'il faut enseigner beaucoup de choses dont les enfants ne comprennent pas l'utilité, montrer les répercussions concrètes d'un apprentissage a des effets importants sur l'ensemble du processus. Vous avez par ailleurs souhaité que je parle plus précisément de l'enseignement de l'informatique. Un bref historique montre que les premières maîtrises ont été créées au milieu des années 1960 et qu'elles se sont beaucoup développées à la fin des années 1970 et au début des années 1980, que l'enseignement est devenu obligatoire en DEUG de Sciences dans les années 1990 et que l'option Informatique en classes préparatoires a été créée en 1995. On ne s'est donc absolument pas situé dans un processus de bottom up mais de top down. Mais aujourd'hui on n'avance plus vers le lycée et le collège. De 1996 à 2001, le nombre des enseignants chercheurs dans l'ensemble des STIC, Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, a augmenté de 213 %, et même de 320 % dans le seul domaine de l'informatique, tandis que l'accroissement n'était que de 87 % pour l'ensemble des disciplines. Selon les prévisions du ministère de l'emploi des États-Unis, les cinq métiers dans lesquels la progression devrait être la plus forte d'ici 2010 sont tous liés aux STIC. Ces chiffres expliquent, en France comme ailleurs, l'énorme augmentation de la part de l'informatique à l'université. Le tableau de l'évolution des effectifs des étudiants entre 1995 et 2000 montre une diminution dans les universités scientifiques et en physique, mais une forte augmentation pour l'informatique, à l'université comme en IUT, et pour les sciences et techniques industrielles. Si la désaffection des étudiants pour les sciences est une réalité, l'idée mérite donc toutefois d'être affinée. On peut dire que l'informatique est aujourd'hui une vraie science, en prise constante avec la société et dont les impacts économiques sont forts. Face à ces enjeux, la place de l'informatique dans l'enseignement primaire et secondaire paraît très insuffisante. Il faut donc offrir plus d'options informatique en lycée et faire en sorte qu'elle soit considérée comme une véritable discipline, en mettant un terme à la confusion avec l'alphabétisation - ce que les Anglo-Saxons appellent computer literacy - et avec l'utilisation « presse-bouton » des outils. Cela suppose, tout simplement, des professeurs formés et des horaires réservés. Bien sûr, nous nous heurtons pour cela à un certain nombre de difficultés : · Grande réticence des disciplines existantes pour faire de la place à une nouvelle matière ; · Idée qu'il y a déjà beaucoup - trop? - de disciplines ; · Idée que l'informatique ne s'apprend pas, encore trop répandue, en particulier chez les enseignants du primaire et du secondaire. Je me souviens en particulier de ce discours schizophrène que tenaient il y a quelques années les professeurs de mathématiques, affirmant qu'ils n'étaient pas formés pour enseigner les statistiques tout en demandant à enseigner l'informatique... Je me souviens aussi de cet inspecteur général qui déclarait « on ne va quand même pas faire une agrégation d'informatique, il y a déjà une agrégation d'hôtellerie »... M. Hervé Mathieu : J'ai pour ma part souvenir d'une réunion des présidents d'universités d'Île-de-France au cours de laquelle chacun disait que sa priorité était l'informatique. Mais nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait non pas de la discipline et des enseignants, mais des moyens en réseaux, en matériels et en personnels pour les faire fonctionner. M. Antoine Petit : On peut tracer quelques pistes de réflexion : · Mieux former les futurs professeurs des écoles car aujourd'hui ils disposent d'une formation empirique dangereuse et ils sont perdu des que le niveau de difficulté s'accroît ; · Proposer des formations complémentaires adaptées aux certifiés et agrégés des autres disciplines, car les professeurs de géographie n'ont pas besoin de connaître la même informatique que les professeurs de physique · Créer - ou plutôt recréer - une option Informatique · Mettre progressivement place un réel enseignement d'Informatique · Créer des concours d'Agrégation et de CAPES en STIC et en Informatique. Cela ne doit toutefois pas être mis comme un préalable car on connaît les réticences de l'institution. Pour la première fois en 2006, une option informatique figurera à l'agrégation de mathématiques, mais les doubles cursus semblent bien compliqués. Un certain nombre de pays ont mieux compris cela que nous et proposent déjà des enseignements en informatique. Nous risquons donc de nous trouver en difficulté si nous ne réagissons pas rapidement. Je pense en outre que l'informatique, si elle n'est pas vue uniquement comme un outil presse boutons, peut être un moyen d'intéresser, donc de récupérer des élèves en difficulté. M. Jean-Marie Rolland, président : Il y a eu dans le passé quelques échecs retentissants, comme celui de Thomson avec le T07. Les collectivités locales ont beaucoup investi en matériel et il est quand même dommage qu'on n'en fasse rien. M. Antoine Petit : Il est très difficile de faire bouger le « mammouth » : il y a bien actuellement en 5e une initiation à l'informatique, au cours de laquelle on se contente d'apprendre à l'élève à changer la police d'un document Word. Mieux vaudrait qu'il n'y ait rien du tout car ce qui est nécessaire c'est plutôt de familiariser aux algorithmes, par exemple en montrant que les fonctions « enregistrer » et « enregistrer sous » mobilisent des plages de mémoires différentes. On pourrait aussi apprendre aux enfants à formuler des requêtes plus compliquées sur un moteur de recherche. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2006 Audition de M. Marc Peyrade, directeur de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications M. Jean-Marie Rolland, président : quel est votre regard sur le niveau scientifique des étudiants qui entrent à l'école nationale des télécommunications ? M. Marc Peyrade : Je pense pouvoir répondre utilement à cette question non seulement en ma qualité de président de l'école mais d'ancien président du jury du concours commun d'accès aux grandes écoles. Il y a environ un an et demi un enseignant chercheur de l'école m'a fait observer que le niveau en mathématiques des candidats au concours commun était en baisse et que l'écart se creusait entre ce niveau et celui auquel on devrait les conduire. Nous avons alors diligenté une enquête auprès des autres écoles laquelle a permis de conclure aux mêmes constats d'une baisse de niveau en mathématiques et aussi à l'hétérogénéité de plus en plus grande des niveaux. On a constaté la même chose en physique. On a organisé une journée d'études le 10 mai 2005 avec les écoles, les professeurs de mathématiques spéciales, des mathématiciens et deux entreprises (EADS et Michelin) sur ces problèmes. Les entreprises font valoir la nécessité de recruter des ingénieurs pointus en mathématiques et physique et reconnaissent que dans les années précédentes elles ont eu tendance à privilégier les compétences en communication et en marketing. Les entreprises ne parlent pas d'une baisse de niveau en mathématiques, mais laissent entendre que si cela arrivait, elles n'hésiteraient pas à recruter à l'étranger. Il est certain que les épreuves proposées au concours commun à l'entrée des écoles d'ingénieurs dans les années 80 ne seraient pas proposables aujourd'hui parce que les élèves n'ont pas le niveau. Aujourd'hui on pose 50 questions apportant chacune 2 points, ce qui conditionne les élèves à avoir un comportement très analytique et « ras des pâquerettes ». M. Jean-Marie Rolland : Cette baisse du niveau peut-elle s'expliquer par l'augmentation massive des connaissances à maîtriser ? M. Marc Peyrade : On peut évoquer plusieurs causes : les connaissances en mathématiques et leurs domaines d'application progressent incontestablement et le niveau des élèves devrait suivre cette progression ce qu'il ne fait pas. Par exemple les GPS ne pourraient pas fonctionner si la mécanique des corps célestes était celle de Newton, il faut la théorie de la relativité pour que ça marche. Il faut souligner que la dernière réforme des classes préparatoires scientifiques a réduit le nombre d'heures en mathématiques. Lorsqu'il s'agit d'être à la pointe de l'innovation on a besoin des mathématiques. Lorsqu'on interroge les proviseurs de lycées, ils nous disent que leurs meilleurs élèves en mathématiques et en physique et notamment les jeunes filles, se détournent très souvent des études scientifiques dont l'image sociale s'est considérablement dégradée. Les jeunes perçoivent le travail des scientifiques comme un travail très dur, très solitaire et mal payé. Ils veulent des emplois qui impliquent des contacts humains. Même les polytechniciens préfèrent souvent effectuer leur stage dans des cabinets de conseil plutôt que dans des laboratoires de recherche. On constate un renversement de la hiérarchie des salaires entre les fonctions scientifiques et les fonctions commerciales depuis 20 ans parce que les grands enjeux des entreprises sont avant tout financiers. M. Daniel Prévost : Quel est le pourcentage de filles présentes dans votre école ? M. Marc Peyrade : Le pourcentage de filles présentes en classes préparatoires scientifiques s'établit à 20 % mais à l'école des télécommunications, ce pourcentage est supérieur et il a atteint 28 % au dernier concours. Je souligne également que l'école compte 40 % d'étudiants étrangers, qui le plus souvent restent en France après la fin de leurs études. L'image du métier d'ingénieur est très mauvaise ches les femmes qui le considèrent comme dépourvu de toute dimension humaine. L'époque de l'ingénieur roi, héros de la révolution industrielle, est révolue. A cette époque, les grandes icones du peuple étaient Marie Curie ou Einstein. La science ne fait plus rêver aujourd'hui. Le rôle des média et surtout de la télévision ne doit pas être oublié car ils se contentent le plus souvent de l'événementiel sans donner d'explications ce qui détourne le public des notions complexes. Quelles solutions peut-on imaginer ? Il faut enseigner différemment les sciences et les mathématiques à l'école et au collège, par exemple la méthode d'apprentissage du calcul est inadaptée et les livres scolaires sont souvent incompréhensibles. On ne pratique plus le calcul mental ni les quatre opérations, peut-être parce que l'on pense que l'usage des calculettes est suffisant. Les élèves savent souvent résoudre les problèmes mais sont incapables de calculer correctement. Ils se trompent même souvent sur des ordres de grandeur de simple bon sens. M. Jean-Marie Rolland : Avez-vous des polytechniciens à l'école des télécommunications ? et par ailleurs que pensez-vous du rôle des mathématiques dans la sélection scolaire et sociale ? M. Marc Peyrade : Nous avons des polytechniciens qui complètent leur formation à l'école pendant une année mais pas pour faire de la recherche. La France a choisi de sélectionner par les mathématiques, ce qui n'est pas le cas de nombreux autres pays, mais le plus préoccupant est que l'on enseigne les mathématiques sans faire le lien avec leurs applications pratiques. De même en physique, on réduit trop l'apprentissage à des formules sans prendre le temps de faire appréhender les problèmes par les élèves et de les amener à une réelle compréhension de ces problèmes. Cela rejoint les expériences de « la main à la pâte » : susciter la curiosité scientifique. * Audition de M. Michel Kasser, directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques M. Michel Kasser : Je voudrais tout d'abord souligner un point important concernant la géographie : l'enseignement de cette matière jusqu'au baccalauréat est désastreux. La géographie est un véritable repoussoir dans les filières scientifiques. Les enseignants d'histoire-géographie sont d'abord dans la plupart des cas des passionnés d'histoire et la géographie est une servitude de service. A l'université, la géographie est toujours rattachée aux filières littéraires et l'enseignement de son volet scientifique est nul. De même dans les IUFM, les professeurs des écoles et les professeurs du secondaire n'apprennent pas le volet technique et scientifique de la géographie qui pourrait séduire certains élèves. On ne voit pas d'amorce de solution, sauf par le biais de l'utilisation de données géographiques numériques. De ce point de vue, l'institut géographie national (IGN) qui est notre principale source de données, est en pleine réorganisation. Pendant très longtemps le cadastre était uniquement chargé de percevoir l'impôt foncier. Le cadastre a deux siècles, la cartographie en a trois, et il existe beaucoup de pesanteurs. S'agissant de l'enseignement de la physique, j'ai dirigé pendant plusieurs années une école d'ingénieurs où l'on se demandait très souvent pourquoi les étudiants sont si mauvais en physique alors qu'il n'y avait rien à dire sur le niveau en mathématiques. Ils n'ont pas le « sens physique » c'est-à-dire le goût de décrire un phénomène et de le mettre en équation. Cela se passait de 1990 à 2000 et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les étudiants soient meilleurs en physique. Il faut déplorer le caractère trop monolithique du pilotage de l'enseignement de la physique par l'inspection générale de l'éducation nationale. En ce qui concerne l'enseignement du français, on ne peut pas former un ingénieur ni même un technicien de bon niveau, s'il ne maîtrise pas parfaitement sa langue. Cette maîtrise est indispensable pour la conceptualisation, pour récupérer les connaissances accumulées par les générations précédentes et tout simplement pour se positionner sur le marché du travail. La aussi, il faut regretter que l'école ne fasse plus une place suffisante à l'écrit. Enfin, sur les langues vivantes, on constate que si la logique européenne est intégrée chez les jeunes et les étudiants, l'obstacle majeur de la pratique des langues subsiste. Il faut imaginer un dispositif complètement nouveau prenant en compte ce problème depuis les toutes petites classes sans se contenter d'apprendre l'anglais. Par rapport aux langues étrangères, la France est dans une logique de grand pays où, contrairement aux Pays-Bas ou à la Suisse par exemple, on ne ressent pas le besoin de parler plusieurs langues. Le développement de l'enseignement de l'arabe par exemple aurait d'énormes avantages sur le plan économique. Je voudrais parler également du déficit de connaissances dans le domaine spatial. La France a fourni un gros effort en matière de recherche et de développement dans ce domaine. Mais il est très peu valorisé dans l'enseignement scolaire notamment en géographie et en physique où il y aurait de très belles applications à traiter dans le domaine spatial. Là aussi la présentation médiatique du secteur spatial est trop simplificatrice, il en résulte une vision de la nature dans le public très rustique. M. Jean-Marie Rolland, président : Quelle est la place des femmes dans votre secteur et quel est le devenir des étudiants de votre école ? M. Michel Kasser : On compte 30 à 35 % de femmes dans mon école selon les promotions. Sur le manque d'attractivité des sciences pour les femmes, on ne peut pas dire qu'il y ait une mauvaise volonté de la part des entreprises pour les recruter. De surcroît les femmes n'ont pas besoin d'être protégées et ne demandent pas à être recrutées sur d'autres critères que ceux de l'excellence. C'est un problème social qui relève en particulier de la répartition des tâches domestiques, les sexes ne sont pas égaux puisque ce sont les femmes qui portent les enfants. Les débouchés offerts par l'école des sciences géographiques, pour les ingénieurs, les techniciens, et les chercheurs sont en train de se diversifier, avec l'apparition de nouveaux métiers autour de la donnée géographique, comme le géomarketing (savoir construire des bases de données marketing et en faire des extractions intelligentes). Les collectivités locales, notamment, sont très intéressées par ces formations car elles ont besoin de géographes ayant des connaissances en informatique et pas seulement d'informaticiens, notamment pour la gestion du cadastre numérisé. Mais il faut regretter une raideur de la fonction publique territoriale dans sa gestion des ressources humaines. * Audition de M. Christian Loarer, inspecteur général de l'enseignement du primaire, auteur d'un rapport sur la rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'école M. Jean-Marie Rolland, président : Pouvez-vous nous indiquer ce qu'il en est au juste de l'apprentissage de la technique opératoire de la division et des calculs sur les fractions à l'école primaire ? M. Michel Loarer : L'inspection générale de l'éducation nationale a rédigé deux rapports sur les problèmes de l'enseignement des mathématiques et des sciences à l'école primaire, le premier en février 2002 et un plus récent d'octobre 2005, complémentaire, qui porte sur l'enseignement des sciences expérimentales et de la technologie mais aussi de l'histoire et de la géographie et contient une orientation plus pédagogique. De plus, l'enseignement des mathématiques à l'école primaire est le thème de travail retenu par l'inspection générale cette année mais je ne suis pas un spécialiste des mathématiques. Il est vrai que la technique opératoire de la division n'est plus au programme de l'école primaire, seule l'appréhension du sens de l'opération est demandée aux élèves ainsi qu'une démarche visant à obtenir des résultats approchés : savoir ce que signifie diviser un nombre par un autre. On a en effet constaté au cours des évaluations à l'entrée en 6ème que les élèves ne maitrisaient pas les techniques opératoires. Or, le primaire a pour rôle de préparer les élèves à la suite de leurs études. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi la technique de la division est désormais apprise en 6ème. Il est faux de dire que l'on retire des tests d'évaluation les questions auxquelles les élèves ne savent pas répondre car en moyenne les questions posées sont satisfaites par plus de 60 % des élèves et les résultats sont stables d'une année à l'autre. Donc si chaque année on enlevait les questions les plus difficiles on aurait des résultats en constante amélioration. Il est vrai que certains élèves obtiennent des scores très faibles dans des domaines assez surprenants. Il faut revenir sur l'histoire récente de l'enseignement des mathématiques en primaire. Jusqu'en 1970, il s'agissait d'un enseignement purement pratique et concret portant sur la géométrie et les nombres. A partir des années 1970, on a voulu mettre l'accent sur une culture mathématique avec les mathématiques modernes et les résultats que l'on connaît. Depuis les années 80, on met l'accent sur la notion de problème, l'idée force de l'enseignement des mathématiques (nombres, calculs, mesures...) est de faire comprendre à l'élève ce qu'il fait. Les mauvais résultats des élèves dans certains domaines peuvent s'expliquer par le fait que les maîtres se sont souvent trop écartés de certaines notions fondamentales à trop vouloir pratiquer les problèmes et le sens des mathématiques. Par exemple, le calcul mental qui est au programme, doit être pratiqué tous les jours en classe, ce qui n'est pas toujours le cas. On sent monter dans le pays une demande forte d'instruction. Les nouveaux programmes introduits en février 2002 et qui ne sont pas très différents de ceux de 1995, ont été bien accueillis par les enseignants parce qu'ils sont très clairs et mettent principalement l'accent sur l'introduction de données numériques et sur la maîtrise de la langue dans l'enseignement des mathématiques. M. Jean-Marie Rolland, président : que pense l'institution scolaire de l'opération « la main à la pâte » ? M. Christian Loarer : Elle a servi de levier à la rénovation des sciences et le ministère en est partie prenante. Mais cette démarche expérimentale n'est possible que dans certains domaines de la physique et de la technologie. L'idée de susciter une démarche active chez les élèves est essentielle mais il ne faut pas perdre de vue la nécessité d'aboutir à la construction d'un savoir. Les programmes gardent les principes et la démarche de « la main à la pâte » en ajoutant la nécessité de faire acquérir des connaissances aux élèves. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment devrait évoluer la formation des enseignants du primaire ? M. Christian Loarer : Compte-tenu de la part actuellement réservée à l'enseignement des sciences au cours de la formation continue des professeurs des écoles, il faudrait 50 ans pour former correctement tous les enseignants. Il faut mettre en place à côté des stages, des actions d'accompagnement dans les écoles afin d'aider les professeurs des écoles à surmonter leurs difficultés dans l'enseignement des sciences et de faire circuler les bonnes pratiques. Ils n'ont pour la plupart d'entre eux pas de formation scientifique mais ils peuvent parfaitement conduire des activités scientifiques avec leurs élèves, en utilisant notamment toutes les informations qui sont à leur disposition sur internet ou celles communiquées par le ministère. Les professeurs des écoles demandent qu'on leur montre ce que signifie concrètement une démarche d'investigation et comment la conduire et ils demandent surtout de quelle façon il faut répartir au niveau des classes les programmes qui sont organisés par cycle de façon à aboutir à la fin du CM2 à un savoir structuré : faut-il favoriser la répétition, classe après classe, ou étaler l'enseignement sur la durée du cycle ? Dans le rapport de 2005 visé précédemment nous donnons des exemples de programmation qui n'existaient pas. S'agissant de la formation initiale des maîtres le volume horaire de l'enseignement des mathématiques est limité à 50 heures en 2ème année d'IUFM, alors qu'il était de 150 heures dans les écoles normales. Nous avons mis en place un groupe de travail à la demande du ministre pour préparer le futur cahier des charges des IUFM sur lequel le Haut conseil de l'éducation devra donner son avis. Ce groupe de travail fait valoir que l'enseignement des mathématiques et des sciences doit constituer un domaine disciplinaire à part entière avec un horaire minimum dans tous les IUFM d'une centaine d'heures par an. M. Yves Boisseau : Ne trouvez-vous pas contraire au bon sens d'établir des moyennes nationales de niveau des élèves ? M. Christian Loarer : Il existe en effet des écarts très importants, que les moyennes ne répercutent pas, entre l'académie de Rennes et celle de Créteil par exemple. Mais on assiste à un phénomène nouveau et inquiétant qui est que dans les quartiers difficiles à Rennes, comme à Créteil, les enseignants, sans doute inconsciemment ont tendance à rabaisser leur niveau d'exigence et pratiquent une pédagogie du détour afin de ne pas désespérer leurs élèves. Cette démarche ne peut conduire qu'à éloigner les enseignants de leur priorité qui est d'amener les élèves de ZEP au meilleur niveau. Il faut réintroduire dans les ZEP un enseignement basé sur les fondamentaux et sur des méthodes traditionnelles. Par exemple, dans une bonne classe, pour apprendre la lecture, on part d'un texte puis on travaille un phonème nouveau par exemple le son i. En revanche dans les zones défavorisées, on en reste beaucoup plus longtemps à un stade global et en décembre les élèves en sont encore à découper des étiquettes avec des mots pour les coller sur leurs cahiers. Il faut rétablir un équilibre entre une démarche de construction des apprentissages par l'élève et une démarche de transmission plus directe des connaissances. Il faut ramener le curseur à mi-chemin entre l'acquisition des connaissances et les méthodes de construction des savoirs. * Audition de M. Jean-Jacques Dupin, professeur des universités en physique à l'IUFM d'Aix-Marseille, chercheur en didactique des sciences, ancien Vice-président de la Conférence des directeurs d'IUFM M. Jean-Jacques Dupin : J'ai été directeur d'IUFM pendant 5 ans puis vice-président de la Conférence des directeurs d'IUFM, j'ai participé à la réforme du DEUG scientifique, puis à la création d'une équipe de recherche sur l'enseignement de la physique au collège et au lycée, à cette époque la physique ne commençait qu'en seconde. Dans ce cadre, nous avons élaboré une étude réalisée dans plusieurs pays portant sur un total de 1200 élèves de la 6ème à la maîtrise, l'épreuve portait sur leurs acquis dans le domaine de l'électricité. Nous avons constaté de réelles difficultés conceptuelles d'apprentissage dans tous les pays ce qui a orienté les propositions de réforme dont il a été tenu compte dans les programmes adoptés depuis les années 1990. L'accent a été particulièrement mis sur la classe de seconde qui constitue un tournant entre le collège et le lycée. Le dispositif d'apprentissage mis en place était basé sur l'introduction du débat scientifique en classe partant des acquis des élèves, sur l'expérimentation et la construction conceptuelle. Des conditions précises de réussite doivent cependant être réunies, il faut notamment du matériel et des classes pas trop nombreuses. L'apprentissage par l'expérimentation ne peut marcher que dans des domaines pertinents qui doivent être limitativement choisis. Certaines situations permettent aux élèves d'émettre des idées et de formuler des hypothèses, mais cette démarche est inutile si elle ne débouche pas sur un travail d'acquisition de connaissances. Dans certains domaines scientifiques, les méthodes traditionnelles sont incontournables et donc le débat « théorie » contre « expérimentation » est un faux problème. Si les élèves ne comprennent rien aux expériences qu'ils font elles sont inutiles. Il faut une interaction entre ce que fait l'élève et l'acquisition des connaissances, mais ça ne se fait pas spontanément. Formuler des hypothèses scientifiques nécessite des connaissances minimum. A l'école primaire, la main à la pâte a permis de donner une impulsion forte à ces questions, par exemple, des séquences entières d'enseignement ont été élaborées sur le thème de l'eau et du changement de ses états. Mais il ne faut pas penser qu'il suffit de donner un habillage expérimental à l'enseignement pour faciliter les apprentissages. Il faut un travail de recherche approfondi pour mettre en place les outils pédagogiques adaptés. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pensez-vous de la formation dans les IUFM ? M. Jean-Jacques Dupin : En ce qui concerne les enseignants du secondaire, ils ont reçu une formation très transmissive dans les disciplines scientifiques et ils sont donc porteurs d'une certaine vision de la physique par exemple. De surcroit, ils étaient de bons élèves et ont du mal à comprendre les difficultés d'apprentissage des moins bons élèves. Face à une classe, il faut les former à trouver le bon équilibre entre un abaissement du niveau d'exigence et un enseignement trop élitiste. Ils sont souvent choqués face à ce qu'ils découvrent. Pour les enseignants du primaire, le problème est plus simple. Un tiers des futurs professeurs des écoles ont suivi un cursus scientifique ce qui est très honorable. Les autres doivent réussir à vaincre leur crainte et leur appréhension pour ces matières afin de développer des activités scientifiques avec leurs élèves. On note de toutes façons davantage d'écoute et d'ouverture chez les futurs professeurs des écoles que chez les futurs enseignants du secondaire très réticents face à un enseignement rénové basé sur l'expérimentation. Les formations en IUFM sont de toutes façons trop courtes : la seconde année comporte 150 heures de cours et une confrontation brutale du jour au lendemain avec les élèves. Le travail en responsabilité dans une classe prend une place énorme et il reste peu de temps pour la réflexion. Il faudrait identifier avec les nouveaux dispositifs LMD (licence, master, doctorat) dès l'entrée à l'université des parcours qui anticiperaient le futur métier d'enseignant. La France est un des rares pays qui ne professionnalisent pas d'entrée la filière de l'enseignement. Les contenus disciplinaires devraient également être pensés en fonction du futur métier. Cette évolution est amorcée avec l'apparition des licences pluridisciplinaires. Un problème subsiste néanmoins car les étudiants risquent de s'engouffrer en grand nombre dans ces filières comme ce fut le cas pour les STAPS, avec un fort taux d'échec en fin de parcours. M. Jean-Marie Rolland, président : Quels rôles peuvent jouer les musées scientifiques dans l'apprentissage des sciences ? M. Jean-Jacques Dupin : Les expériences que l'on y trouve ne permettent pas la construction d'un savoir mais ces musées permettent de développer une culture scientifique. Il ne faut pas fuir dans le spectaculaire en masquant la complexité des problèmes et l'effort intense nécessaire à leur compréhension. Il faut utiliser les musées sans penser qu'ils peuvent remplacer la démarche d'apprentissage. Le spectaculaire doit résider dans ce que découvre l'enfant et non dans ce qu'on lui montre. L'expérience de l'oscillation d'un pendule est de ce point de vue très significative, les enfants émettant toutes sortes d'explications à la variation de l'oscillation (taille de la ficelle, masse du pendule...) avant de découvrir la véritable explication. C'était un peu l'erreur de « la main à la pâte », à ses débuts, confondre le spectaculaire d'une expérience et sa portée pédagogique. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 FÉVRIER 2006 Audition de M. Philippe Meirieu, directeur de IUFM de Lyon M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Nous entendrons avec intérêt votre point de vue sur le niveau scientifique, sur le rôle des mathématiques dans les processus de sélection, sur la féminisation du corps enseignant dans le second degré et sur la faible présence des femmes dans les classes préparatoires et les écoles d'ingénieurs. Nous aimerions aussi connaître votre opinion sur les évaluations réalisées en CE2 et en 6ème et sur la manière d'enseigner les sciences. M. Philippe Meirieu : Je vous dirai pour commencer combien le renouvellement du corps enseignant, singulièrement celui du second degré, préoccupe le directeur d'IUFM que je suis, car le déséquilibre, déjà très marqué, s'accentue au bénéfice du premier degré. Le second degré connaît une désaffection significative, qui touche gravement les disciplines scientifiques et qui s'accélère. Non seulement le nombre de candidats aux concours de recrutement baisse très fortement, mais les désistements ne cessent d'augmenter parmi les étudiants inscrits en préparation au concours. Cela signifie qu'ils ont plusieurs stratégies professionnelles et que le concours de recrutement de l'Education nationale vient en second, sinon en dernier. Il y a donc un effritement significatif de la quantité des candidats. Cette inquiétude ne vaut pas pour le premier degré. Au contraire, des candidats qui pourraient prétendre enseigner dans les collèges et les lycées puisqu'ils sont, par exemple, titulaires d'un DEA, ne veulent pas en entendre parler, redoutant, disent-ils, une première affectation et un début de carrière dans un collège difficile, mais ils aspirent à devenir professeurs des écoles. Les statistiques de l'INSEE, qui donnent à penser que les candidats seront en nombre suffisant, ne doivent pas tromper, car l'approche purement statistique ne rend pas compte de la baisse des vocations à enseigner dans le second degré. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment appréciez-vous la qualité des candidats ? M. Philippe Meirieu : L'un des indicateurs est celui que je vous ai donné : certains candidats se désistent parce qu'ils se sont présentés ailleurs et ont été reçus, ce qui montre qu'ils avaient le niveau requis mais que la motivation manquait. Par ailleurs, les cellules d'orientation des universités nous indiquent que le métier d'enseignant du second degré n'est pas attractif du tout, singulièrement pour les disciplines scientifiques, car elles exigent un très haut niveau de qualification et de longues études qui font espérer un niveau de vie que l'enseignement ne paraît pas pouvoir offrir. Un étudiant en sciences titulaire d'une licence, ou d'une licence plus une année d'études, peut se voir proposer une rémunération nettement supérieure dans une autre branche, assortie d'un confort de vie jugé lui aussi supérieur. Il y a donc un retournement dans la perception qu'ont les étudiants de l'enseignement, à présent considéré comme un métier difficile et qui peut conduire à un déracinement, à des confrontations et à des problèmes personnels confirmés par la MGEN, dont les enquêtes font état d'une forte fatigabilité et d'une proportion importante de problèmes psychiatriques chez les enseignants, les débutants en particulier. M. Jean-Marie Rolland, président : Le mode de sélection des élèves professeurs vous permet-il d'avoir une opinion sur leur niveau ? M. Philippe Meirieu : Le concours de professeurs des écoles est préparé par un nombre de candidats considérable. Ainsi, l'IUFM de Lyon dispose de 700 places en préparation au concours de professeur des écoles (PE1), et nous nous apprêtons à faire passer un test de niveau à près de 5 000 candidats. Mais il est difficile de savoir combien d'entre eux se présentent dans plusieurs IUFM. Quoi qu'il en soit, comme il y a relativement peu de désistements quand il s'agit d'enseigner dans le premier degré, on constate l'existence d'un très large vivier de professeurs des écoles, pour lesquels nous ne constatons de baisse sensible de niveau ni en français, ni en mathématiques, ni en culture générale. Mais l'honnêteté commande de préciser qu'en mathématiques, le niveau des tests est celui de la fin de la classe de seconde. M. Jean-Marie Rolland, président : Un étudiant titulaire d'un DEA de physique et un autre licencié en anglais ou en géographique passent-ils les mêmes épreuves d'admission ? M. Philippe Meirieu : Oui. Seules varient les options. M. Jean-Marie Rolland, président : Pourrait-on imaginer de modifier ce mode de sélection pour avoir un plus grand nombre d'enseignants de formation scientifique ? M. Philippe Meirieu : Ces épreuves initiales pour entrer à l'IUFM ne servent pas à classer, elles ne visent qu'à vérifier l'existence des prérequis. Le classement se fait ensuite entre 2 500 personnes, en privilégiant l'équilibre entre les disciplines d'origine des candidats, si bien qu'un tiers de nos étudiants en classe de préparation ont nécessairement une licence scientifique. Après quoi, nous mettons l'accent sur la qualité des études en tenant compte des mentions obtenues, et nous nous intéressons aussi aux parcours atypiques. Par ailleurs, l'IUFM de Lyon a créé, il y a trois ans, un dispositif de reconversion vers les métiers de l'enseignement, qui commence à rencontrer un écho pour l'enseignement secondaire. Ce faisant, nous avons découvert un très important vivier de candidats issus de l'entreprise qui, ayant fait des études d'ingénieurs ou d'agents de maîtrise, souhaitent se reconvertir. La première année, 15 places avaient été ouvertes dans ce nouveau dispositif et, sans publicité particulière, nous avons eu plus de 500 demandes. A la rentrée prochaine, ce sont 330 stagiaires, pratiquement tous issus de l'entreprise, qui viendront s'agréger à nos 700 étudiants, stagiaires qui ne peuvent, statutairement, être considérés comme des étudiants « normaux », du moins actuellement, ce qui les désavantage, car ils n'acquièrent pas les points liés à leur passage à l'IUFM. J'ai appelé l'attention de la direction des personnels sur ce sujet. Nous fondons en effet beaucoup d'espoirs sur ces stagiaires : parce qu'il s'agit de gens très motivés ; parce qu'ils sont susceptibles de modifier le corps enseignant et de montrer aux élèves que la science n'est pas complètement déconnectée de la vie quotidienne ; parce qu'étant donné leur âge et leur expérience, ils sont beaucoup plus exigeants à l'égard de leurs formateurs. Leur moyenne d'âge est de 37 ans, le plus jeune ayant 30 ans, le plus âgé 54 ans. M. Jean-Marie Rolland, président : Et où ce dernier sera-t-il nommé ? M. Philippe Meirieu : Comme, contrairement à ses camarades étudiants, il sortira de l'IUFM sans avoir acquis de points, il sera sans doute nommé assez loin de chez lui. J'ai demandé à la direction des enseignements supérieurs de faire que ces stagiaires ne soient pas désavantagés. Il le faut si l'on souhaite qu'outre ceux de Lyon, Nice et Orléans-Tours, les autres IUFM ouvrent cette filière ; actuellement, ils sont hésitants, car les stagiaires ne sont pas intégrés dans le calcul de la dotation financière. L'Education nationale doit donc revoir ses procédures internes. Ce serait d'autant plus souhaitable que les candidats ainsi recrutés seront sans doute, étant donné leur âge, mieux à même d'encadrer les élèves que les enseignants débutants. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ce mode de recrutement pour les enseignants de disciplines scientifiques, même si l'on doit constater avec tristesse que c'est la situation économique qui fait affluer les candidats, dont certains acceptent de voir leur salaire divisé par trois en se reconvertissant dans l'enseignement, souvent avec une certaine passion. Mais, à titre personnel, j'aurais préféré que l'on privilégie le statut de « professeur associé du second degré », sur le modèle qui vaut pour l'enseignement supérieur et qui permet la double appartenance. M. Jean-Marie Rolland, président : Y a-t-il plus de femmes que d'hommes ? M. Philippe Meirieu : Il y a toujours plus de femmes que d'hommes mais le dispositif de reconversion permet un rééquilibrage important, avec 64 % de femmes « seulement », alors que leur proportion est de 82 % dans les candidats au concours de recrutement. Au delà de la crise conjoncturelle qui se profile pour les années 2010-2012, il serait intéressant d'explorer des voies permettant d'assouplir les modes de recrutement. A titre personnel, je ne pense pas que la « troisième voie », qui supprime l'obligation de diplôme sans s'interroger sur la trajectoire des personnes, soit la meilleure ; mieux aurait valu recourir à la validation des acquis de l'expérience que dévaloriser un diplôme que l'on souhaite promouvoir par ailleurs. Il y a beaucoup de candidats à cette troisième voie, mais leurs chances de réussite sont minces, car leurs études supérieures sont anciennes et ils n'ont pas tous la culture générale nécessaire. Cela étant, nous avons créé une préparation sur deux ans pour les candidats motivés. Dans tous les cas, les voies de diversification du recrutement sont souhaitables. J'en viens à l'objet plus précis de votre mission. S'agissant du niveau global des élèves, vous connaissez les conclusions de l'étude PISA. Pour ce qui est des enseignants du premier degré, si, comme je vous l'ai dit, un tiers de nos étudiants ont nécessairement une licence scientifique, deux tiers n'ont pas de formation scientifique de base. Nous tentons de la leur donner, mais elle demeure lacunaire. En mathématiques, nous sommes parvenus à stabiliser les connaissances à un niveau nécessaire mais pas suffisant. En revanche, les heures de formation aux disciplines expérimentales sont très nettement insuffisantes. Sachant que l'horaire total est de 400 heures, auxquelles s'ajoutent 50 heures pour les options, et que le minimum obligatoire est, légitimement, de 100 heures en français et en mathématiques, ce qui reste pour l'ensemble des disciplines expérimentales est très faible. Avec un horaire de 20 heures, 24 heures, au mieux 36 heures, on ne peut faire qu'une toute petite initiation, qui ne permet en aucun cas de donner à la fois des connaissances et les éléments de base de l'enseignement de la biologie, de la géologie, des sciences physiques et de la chimie. De ce fait, les enseignants du premier degré n'auront que très rarement des lacunes en mathématiques mais des lacunes réelles en sciences expérimentales et en technologie. Alors que ce sont précisément les matières qui peuvent donner le goût des études scientifiques aux élèves, on constate que les pratiques expérimentales sont plutôt en baisse dans les écoles. Lorsqu'elles demeurent, elles sont le fait d'enseignants marginaux et novateurs qui en ont le goût, mais elles ne sont pas systématisées. La main à la pâte a eu un effet d'entraînement, mais s'essouffle, dépendant trop de la motivation des professeurs. Or, les enfants qui ont pu pratiquer des expérimentations sont eux-mêmes très motivés. Le fait que la démarche expérimentale ne soit pas systématique dans l'enseignement du premier degré est un facteur d'inquiétude. Pour moi, cette démarche expérimentale participe de l'enseignement de la distinction entre le croire et le savoir, et donc de la laïcité. L'incapacité à faire cette distinction entraîne l'échec scolaire, mais aussi des comportements préjudiciables à la démocratie. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pensez-vous de la bivalence ? M. Philippe Meirieu : Dans le second degré, l'enseignement des disciplines de l'enseignement général motive inégalement les élèves. Si celui des mathématiques et des SVT s'est renouvelé, les formateurs en sciences physiques restent dans une conception formaliste qui rend difficile la mobilisation des élèves. Pour ce qui est de la bivalence, Durkheim observait dès 1904 que le fait de passer d'un instituteur unique à dix enseignants en classe de sixième n'est pas justifiable. J'aurais tendance à penser que l'on peut regrouper les sciences expérimentales au collège. D'autre part, il faut entièrement repenser les programmes de l'enseignement de la technologie. Le fait qu'ils ne soient pas centrés sur les métiers, ceux de l'artisanat en particulier, renforce considérablement l'orientation par l'échec, qui est mauvaise pour les élèves, pour l'école et pour l'avenir de la nation. M. Daniel Prévost: Quel regard portez-vous sur l'enseignement primaire ? M. Philippe Meirieu : Je ne le trouve pas aussi sinistré qu'on le dit. Il a dû assumer successivement un grand nombre de missions, et il me semble spécieux de comparer ce qu'il était il y a vingt ans et ce qu'il est maintenant pour arguer du fait qu'il serait moins efficace sans tenir compte de l'évolution du public auquel il s'adresse. Globalement, les professeurs des écoles formés dans les IUFM sont beaucoup plus diplômés que les professeurs des collèges. Ils ont souvent une thèse, ou la préparent. M. Jean-Marie Rolland, président : Est-ce normal ? M. Philippe Meirieu : Pas entièrement. C'est la conséquence de l'effet répulsif de l'enseignement dans le second degré et de la crainte de la première nomination, mais c'est aussi parce que les étudiants ont le sentiment qu'à l'école primaire, ils auront prise sur les choses, dans l'esprit militant de la foi républicaine en l'éducation. M. Jean-Marie Rolland, président : Seriez-vous favorable à la reprise du dispositif des Instituts de préparation aux enseignements du second degré (IPES) ? M. Philippe Meirieu : Je n'y serais pas défavorable, à la condition qu'il ne soit pas obligatoire d'y être passé pour devenir enseignant, au risque d'écarter des vocations. J'insiste enfin sur la nécessité de mieux former les professeurs de collèges et de lycées. Après un concours uniquement fondé sur les aptitudes académiques, une formation pédagogique de six mois seulement est trop courte et le choc de l'enseignement est brutal. Par ailleurs, la formation dispensée actuellement en IUFM n'est pas conforme au système LMD, puisque nous avons la singularité de recruter des étudiants à bac+3, qui ressortent à bac+3 après deux ans de formation... M. Daniel Prévost: S'agissant de l'orientation des élèves, que pensez-vous de la création des classes de troisième à orientation professionnelle« TOP » ? M. Philippe Meirieu : Je ne suis pas hostile à la pré-orientation mais, aussi longtemps que les trois disciplines spéculatives feront l'orientation, ce sera le tonneau des Danaïdes. L'orientation vers les filières professionnelles continuera de se faire par défaut, sans que l'on tienne compte des capacités des élèves en technologie ou en SVT par exemple. C'est la pierre d'achoppement. * Audition de M. François Perret, doyen de l'Inspection générale de l'éducation nationale et M. Claude Boichot, inspecteur général secteur physique chimie au lycée et post bac M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Les conclusions de l'étude PISA nous font nous interroger sur le niveau scientifique général en France, sur les raisons du manque d'attrait des disciplines scientifiques et sur la formation des formateurs. Nous aimerions connaître votre avis sur ces questions et sur les évaluations réalisées en CE2 et en classe de sixième, qui font débat. M. François Perret : La plupart des études comparatives internationales montrent que la frange la plus élevée des jeunes Français demeure à un niveau très remarquable, et l'évaluation PISA ne nous place pas mal en matière scientifique puisque nous figurons au dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Le paradoxal et l'inattendu, c'est que si les jeunes gens de quinze ans, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont très bons en déduction, ils souffrent de la comparaison lorsqu'elle porte sur la capacité d'investigation scientifique et la formulation d'hypothèses. Les maîtres du premier degré sont très largement issus des disciplines non scientifiques. L'une des questions qui se posent à nous, alors que nous élaborons le futur cahier des charges des IUFM, est de savoir comment faire pour initier les jeunes licenciés en lettres à la polyvalence, particulièrement dans les matières les plus éloignées de leur formation initiale. L'inspection générale a publié en octobre 2005 un rapport consacré à l'enseignement des sciences expérimentales, de la technologie, de l'histoire et de la géographie. Il pointe d'une part le manque de rigueur des enseignants du premier degré, qui s'accommodent d'un faible niveau d'exigence en ces matières, d'autre part le fait que les programmes de ces disciplines ne sont jamais traités dans leur totalité, les horaires pratiqués étant en deçà des horaires affichés, eux-mêmes inférieurs à l'horaire obligatoire. M. Jean-Marie Rolland, président : Depuis quand en est-il ainsi ? M. François Perret : Probablement depuis une vingtaine d'années, en dépit de l'évolution des programmes. Il faut souligner que le manque de rigueur relevé tient aux lacunes de la formation. M. Claude Boichot : Si nous avions le choix entre des programmes idéaux animés par des maîtres moyens et des programmes moyens animés par des maîtres idéaux, il est clair que nous opterions pour la deuxième solution. Quand on relit les programmes, y compris assez anciens, on voit qu'ils contiennent absolument tout ce qu'il faut. Le seul problème est qu'ils ne sont pas vraiment mis en œuvre. Bien sûr on peut se demander : « mais que fait l'inspection générale ? ». Eh bien, elle fait ce qu'elle peut dans un faux débat entre savoirs et compétences. Car il n'y a pas de compétences sans savoirs. C'est un peu comme si on considérait que dans un ordinateur il n'y a que de la mémoire vive, alors que c'est la mémoire morte qui contient les bases de données et qu'il faut la charger ; mais pour cela il faut au moins un peu de mémoire vive... Comment expliquer à des jeunes qu'il faut qu'ils investissent dans un savoir pour pouvoir ensuite développer ce savoir en activité ? Même dans leur pédagogie, certains maîtres et professeurs se laissent abuser par l'idée qu'il faut une capacité à faire adhérer les élèves à leur discours. Ainsi, ils en viennent à privilégier ce qui est « périphérique » au savoir. Si ce n'est qu'une astuce pour montrer la trajectoire aux élèves, en se mettant à leur portée, pourquoi pas ? Mais je constate dans l'enseignement des sciences qu'on fait surtout du « périphérique » et que ce dernier n'enracine pas des savoirs durables, ceux qui doivent être installés en premier pour permettre au citoyen comme au scientifique d'évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Il est donc très important de savoir choisir les bons savoirs. Quant à la désaffection, si le problème est réel, une comparaison avec la filière littéraire ramène à une juste vision des choses. En effet, cette dernière est tombée en dix ans de 69 500 à 49 000 élèves, tandis que les effectifs du bac S passaient de 136 553 à 130 225 élèves, hors correction des variables démographiques. Je crois qu'il convient de distinguer désaffection pour la science, pour les sciences et pour les études scientifiques, mais aussi ce qui se passe en élémentaire et au collège de ce qui se passe au lycée et après le bac. On sait que l'élévation de son propre niveau en sciences procède toujours par rupture avec le bon sens. Or cette confrontation est très difficile à vivre pour les collégiens car elle remet en cause leur potentiel de curiosité, leur comportement quotidien n'étant guère compatible avec le fait de passer d'une certitude à une autre. C'est pourtant le début de la marche vers l'excellence que chacun porte en lui. S'agissant du niveau, je suis aussi président depuis douze ans du concours d'entrée aux école centrales et à Supélec, qui voit passer chaque année 12 000 candidats. Quand j'entends certains, dans des concours voisins, s'émouvoir de la baisse du niveau en mathématiques dans les filières sélectives, je me dis qu'il conviendrait d'abord, surtout pour des mathématiciens, de définir la mesure du niveau. Bien sûr, les élèves sont en difficulté, mais il faut prendre la mesure de ce que sont devenues les épreuves des concours scientifiques de haut niveau. Or la complexité des sujets se retourne contre l'ouverture sociale car, en mettant le sujet en situation de réalité, elle met en jeu un contexte culturel auquel tous les élèves n'ont pas accès. De même, insister sur les compétences conduit à l'évidence à favoriser ceux qui, dans leur vie quotidienne, ont une approche culturelle déliée, alors que les autres auraient plus de chances si on se concentrait sur les savoirs. M. Jean-Marie Rolland, président : On nous a dit, à propos des évaluations en CE2 et en 6e, qu'on ne reposait surtout pas l'année suivante une question qui avait mis les élèves en difficulté. Cela correspond-il à la réalité ou relève-t-il uniquement de la polémique ? Nous avons aussi entendu beaucoup de choses sur l'apprentissage de la division à deux chiffres. Il serait intéressant de connaître le sentiment d'inspecteurs généraux à ce propos. M. François Perret : Si on vous a dit que certains items étaient supprimés l'année suivante uniquement parce que les élèves avaient mal répondu, cela relevait effectivement de la polémique. Mais il est vrai qu'interviennent des psychomotriciens qui sont capables de voir si les thèmes sont discriminants ou non. L'importance du caractère discriminant est très forte dans tous les tests sérieux. J'ajoute qu'il est difficile de faire des comparaisons d'une année sur l'autre car, si les compétences visées demeurent les mêmes, les exercices changent. Peut-être en viendra-t-on bientôt à proposer les mêmes tests, ce qui permettra des comparaisons. Enfin, les statisticiens insistent sur le fait qu'on ne peut pas faire dire aux tests ce qu'ils ne sont pas censés dire, en particulier sur l'évolution des niveaux. Il est vrai que la division de deux chiffres à décimale n'est pas dans le programme du primaire, qui ne prévoit que la division des entiers. M. Claude Boichot : On peut être nostalgique, surtout si on considère que la capacité opératoire a un sens, qu'il faut envisager de réintégrer la division dans le programme. Il est quand même un peu irritant que certains s'érigent en donneurs de leçons à partir d'interprétations abusives. Chacun d'entre nous est passé par l'école, mais il ne viendrait à l'idée d'aucun mathématicien sérieux de construire une théorie et d'extrapoler à partir de cette singularité. Il me semblerait donc beaucoup plus intéressant de se pencher sur d'autres sujets, en particulier sur les horaires. Car, de 1983 à 2002, c'est-à-dire avec la réforme de 1995 et la fusion des bacs C et D qui a permis de garder nos 130 000 bacheliers, on est tombé en mathématiques de 8 heures de cours plus 1 h de travaux dirigés à 4 h 30 et 1 h de TD. Dans le même temps, on a fait jouer à la spécialité mathématique le rôle, qui n'était pas prévu pour elle, de bagage minimal. Bien sûr, on a augmenté considérablement les horaires des autres disciplines et les mathématiques y trouvent leur place, dans ce que j'appellerai une transversalité à épaisseur nulle. M. François Perret : Toujours sur la division, il faut convenir qu'il y a eu pendant des années une certaine dérive pédagogique qui a visé à mieux faire comprendre les mécanismes intellectuels en jeu, au détriment de l'activité elle-même. Cela tient en partie au fait qu'une bonne partie des maîtres du premier degré et des inspecteurs de l'éducation nationale ont été formés avec les perspectives et les méthodes des années 1970-1980. Le même phénomène a joué pour l'apprentissage de la lecture. Mais, après les errements d'une certaine pédagogie constructiviste, on paraît revenir à de plus justes considérations. Aujourd'hui, malgré l'introduction de la calculatrice, on observe un retour assez net dans les pratiques des maîtres vers un entraînement au calcul, qui amène à insister beaucoup, dès le primaire, sur le calcul mental et sur les ordres de grandeur. Le Haut Conseil à l'éducation va se prononcer dans les prochains jours sur le socle commun de connaissances : je ne sais pas comment la division sera traitée. M. Daniel Prévost : Quid de l'expérimentation au collège ? M. Claude Boichot : En ce qui concerne les sciences dites expérimentales, l'inspection générale est totalement en phase avec les positions de l'Académie des sciences, notamment à propos d'expériences comme celle que mène Georges Charpak avec La main à la pâte. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais pourquoi ces expériences ne sont-elles pas davantage prises en compte par l'Education nationale ? Pourquoi faut-il toujours qu'elles reposent sur la motivation des enseignants ? Pourquoi plafonne-t-on ? M. Claude Boichot : Il faut aussi, dans le cadre du plan de rénovation des sciences et techniques au collège, que les maîtres soient bien formés pour être capables de décortiquer et d'expliquer ce que font les élèves, et cela pose la question de l'enseignement dispensé dans les IUFM à des étudiants plutôt d'origine littéraire. M. François Perret : Qui plus est, trop peu d'établissements sont équipés en locaux et matériels qui permettent l'expérimentation. Pour l'instant, on n'arrive pas à généraliser ce dispositif innovant. Cela étant, toutes ces opérations, y compris celles qui sont menées à une toute petite échelle, qui présentent les sciences comme un élément du bagage culturel de l'élève, finissent par changer peu à peu le paysage, grâce à une prise de conscience du pouvoir de l'investigation par les enfants et par les maîtres. Enfin, l'obligation de parcourir l'ensemble du programme fait obstacle à ce qu'on consacre trop de temps aux méthodes expérimentales. Là aussi, nous verrons ce qui sera proposé pour le socle commun de connaissances. M. Claude Boichot : On insiste beaucoup, à propos des contenus et des programmes, sur les querelles de mots, mais les vrais maux tiennent à notre incapacité à former des enseignants parfaitement capables de s'imprégner des orientations qu'on leur donne. * Audition de M. Rémi Brissiaud, chercheur en didactique des mathématiques, enseignant à l'IUFM de Versailles, auteurs d'ouvrages sur les mathématiques en primaire M. Jean-Marie Rolland, président : Je suis heureux de vous accueillir devant cette mission, qui s'intéresse à l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire, et qui a été amenée à se pencher plus particulièrement sur la question de la baisse, supposée ou réelle, du niveau moyen en sciences, sur le manque d'attractivité des disciplines scientifiques, sur la place des femmes dans les sciences. Nous souhaitons que vous nous parliez de la formation des formateurs et des moyens qui permettraient selon vous d'améliorer l'esprit scientifique général dans notre pays. Nous savons que vous avez été instituteur puis mathématicien avant de vous consacrer aux sciences de la pédagogie et peut-être souhaiterez-vous commencer par nous présenter votre parcours. M. Rémi Brissiaud : Il est en effet assez original, et il me permet de disposer à la fois d'une bonne connaissance de la classe, d'une formation de mathématicien et des apports de la psychologie cognitive, puisque je suis aujourd'hui maître de conférences en cette matière à l'IUFM de Versailles. Après avoir longtemps fait de la formation des maîtres comme professeur l'école normale en mathématiques, je continue aujourd'hui mais en psychologie, en m'appuyant sur mes recherches sur la façon dont les enfants construisent les concepts arithmétiques. C'est cela qui m'a amené à faire des propositions théoriques qui ont aujourd'hui une influence importante puisque la moitié des maîtres en CP travaillent selon les hypothèses que j'ai avancées dans mon ouvrage Comment les enfants apprennent à calculer. Sans doute mes idées se sont-elles moins diffusées dans les IUFM car la formation y est essentiellement faite par des mathématiciens qui prennent peu en compte la psychologie cognitive. Pour se rendre compte des points cruciaux de l'enseignement des mathématiques en élémentaire, il suffit de regarder les grandes évolutions des programmes. Ainsi, alors que dans l'école de la République on apprenait à l'origine à lire, à écrire et à compter dès les premières classes, on a assisté à un véritable bouleversement de 1970 à 1985, le Monde de l'éducation allant jusqu'à écrire en 1983 que les enfants de cinq ans n'apprenaient a compter jusqu'à dix que pour faire plaisir à leurs parents. Aujourd'hui, par un nouveau mouvement de balancier, sous l'influence des travaux américains, en particulier en mnémologie, et de l'idée que le petit homme a une capacité naturelle au comptage, on apprend à nouveau à compter dans un grand nombre de petites sections de maternelles, alors que certains enfants n'y comprennent rien. Alors qu'au cours de la période 1970-1985, les enfants ne voyaient pas le signe moins avant février ou mars au CE1, désormais ils y sont confrontés dès le début du CP, mais il est enseigné de la pire des façons, comme une simple abréviation sténographique, c'est-à-dire ce que les enfants sauraient s'ils n'allaient pas à l'école. Or c'est bien là pour moi l'essentiel : que savent faire les enfants qui vont à l'école et ne savent pas faire ceux qui n'y vont pas ? Autrement dit, quelle est la responsabilité de l'école dans l'apprentissage ? Une expérience menée à Recife, au Brésil, sur des enfants de douze ans n'ayant jamais fréquenté l'école, montrent qu'ils sont capables à 75 % de dire quel est le prix de trois objets à 50 cruzeiros chacun, mais pas de trouver le prix de 50 objets à 3 cruzeiros l'un. Construire l'équivalence entre plusieurs procédures, montrer qu'un même résultat ne va pas de soi, telle est l'utilité de l'école, que l'on vérifie aussi pour les fractions et pour les divisions. L'expérience analogue, menée en France sur des enfants de CE2 n'ayant jamais eu aucune leçon sur la division, montre que 64 % d'entre eux sont capables de dire combien de paquets de 50 on peut faire avec 150 gâteaux, mais que 11 % seulement savent dire combien on peut faire de paquets de trois gâteaux. C'est à l'école qu'on apprend l'équivalence entre les procédures de groupement et de partage. Prenons les fractions : si je vous dis que Sherlock Holmes a trois heures devant lui et qu'il veut consacrer le même temps à chacun de ses quatre témoins, vous allez passer en minutes et diviser 180 par 4, ce qui vous donne 45' par personne. Mais si vous vous étiez souvenus que vous êtes allés au collège et que vous y avez appris les fractions, vous vous seriez dit immédiatement que trois heures sur quatre, cela donnait 3/4, c'est-à-dire trois quarts d'heure... Vous n'y avez pas pensé parce que la barre de fraction est le symbole de l'équivalence entre deux façons de calculer : d'un côté j'imagine trois unités que je vais partager équitablement en quatre, de l'autre j'imagine une seule unité que je partage entre quatre parts égales, des quarts, et j'en prends trois. Pourquoi n'explique-t-on pas cela simplement aux enfants ? Les maîtres qui utilisent les outils que j'ai élaborés le font. Cela vaut aussi pour la règle de trois, qu'il ne faut pas envisager comme un rituel mais, dans une situation de proportionnalité, comme une possibilité de repasser par l'unité. Il faut enseigner cela comme un rapport stratégique au problème. Quand on acquiert cette définition de psychologue des concepts arithmétiques, on est amené à considérer l'apprentissage des mathématiques à l'école un peu différemment. Mais aujourd'hui en France, le discours dominant est celui de l'équipe ERMEL, Équipe de Recherches Mathématiques à l'École Élémentaire, dirigée par Roland Charnay, professeur de mathématiques, qui a rédigé le livre qu'il faut avoir lu pour réussir le concours de l'IUFM, qui préside la commission des nouveaux programmes, qui a en charge la formation des inspecteurs de l'éducation nationale, qui refuse d'entendre mon discours et qui ne cite jamais mes travaux, sans doute parce qu'il me considère comme un renégat des mathématiques. Pour ma part, je me dis que remettre le balancier là où il était en 1945 serait la pire des choses, mais aussi qu'enseigner les équivalences n'est pas aussi simple que cela. Pourtant, il suffit de prendre un groupe d'élèves de CE1, de demander à certains de faire trois groupes de quatre ronds, à d'autres trois groupes de quatre, à d'autres encore quatre rangées de trois, à d'autres enfin trois rangées de quatre, puis de leur faire découvrir que tout le monde arrive à 12 alors qu'on leur a demandé quelque chose de différent. C'est ainsi qu'ils peuvent comprendre pourquoi les hommes ont inventé le signe x. On peut mettre cela au service du calcul mental : pour obtenir le résultat de 7 x 10, mieux vaut faire des groupes de 10 que des groupes de 7. Ce sont de bonnes leçons de conceptualisation, qui font apparaître un concept arithmétique comme un symbole d'équivalence entre deux procédures. Mais faire cela au CP serait très difficile. Roland Charnay et les documents d'accompagnement des nouveaux programmes prennent prétexte des réussites précoces en division pour retarder l'enseignement des équivalences entre les procédures. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop tarder, alors qu'aujourd'hui certains maîtres n'enseignent l'équivalence entre le partage et le groupement, qui fonde la division, qu'en fin de CM1. Nous devrions débattre du juste moment. M. Jean-Marie Rolland, président : Précisément, y a-t-il, selon le psychologue que vous êtes, un « bon moment » ? M. Rémi Brissiaud : Je pense qu'il est bien d'enseigner la multiplication en CE1 et la division en CE2. Mais je n'ai pas été associé à l'élaboration des programmes, qui ne paraît concerner que les mathématiciens et non les psychologues. Tout au plus ai-je convaincu Jean Hébrard, inspecteur général de l'éducation nationale, qu'il ne convenait pas de retirer des programmes de l'élémentaire le sens quotient des fractions. Mais cela figure toujours dans les documents d'accompagnement. Je me bats pour qu'on ne retarde pas trop le moment où l'on aborde certaines notions, d'autant que quand le temps pendant lequel il est permis d'apprendre est trop court, ce sont ceux qui apprennent le plus vite qui s'en sortent le mieux. Il faut trouver un juste équilibre pour faire aussi la part à l'enseignement qui essaie de faire comprendre au plus grand nombre d'élèves la raison d'être des concepts arithmétiques, pourquoi les hommes les ont inventés, en quoi ils sont des outils pour affronter la réalité. M. Yves Boisseau : Vous avez été professeur de mathématiques en école normale. Si vous enseigniez aujourd'hui en IUFM, le feriez-vous de façon totalement différente ? M. Rémi Brissiaud : Je le fais, et ma double formation m'est précieuse, qui m'a ouvert de nouveaux horizons. M. Yves Boisseau : Quand j'étais enfant, on apprenait beaucoup par cœur, et il me semble qu'on utilisait le signe : et non la barre de fraction pour caractériser la division. M. Rémi Brissiaud : Lors de ma scolarité, on appliquait encore les programmes de 1945, mais c'est au moment de la règle de trois que la barre de fraction prenait le sens de division, et je me rappelle m'être demandé pourquoi. On ne l'expliquait pas, alors que je crois qu'on peut expliquer simplement que 3/4 c'est aussi 3 divisé par 4. Je ne crois pas qu'il faille revenir à ce qu'on faisait avant, quand on apprenait par cœur, car seuls certains élèves s'interrogeaient eux-mêmes sur le pourquoi des choses. Il faut mettre les enseignements à la disposition du plus grand nombre, c'est pour cela qu'il ne me paraît pas raisonnable de repousser la division au-delà du CE2, car ainsi on n'étudie plus la division poussée au-delà de la virgule. Si on ne voit la division qu'à la fin du CM1, le maître qui est en retard dans son programme ne la traite pas. Or le maître qui est en retard est souvent en ZEP, et il est catastrophique de ne pas offrir à ces élèves les mêmes possibilités qu'à tous les autres. Or si on explique les choses, si les élèves comprennent le fractionnement, il est plus facile qu'ils comprennent les chiffres qui sortent après la virgule. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous intéressez-vous à ce qui se fait à l'étranger ? M. Rémi Brissiaud : C'est une grande partie de mon travail. Ce sont les pays asiatiques qui s'en sortent le mieux. Mais allez n'importe où dans le monde, demandez à rencontrer des gens forts en maths, et vous vous apercevez qu'à tous les coups, ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 2-10, etc. Pour mesurer l'importance de cela, il suffit d'avoir vu la joie d'un petit français qui découvre qu'après seize les adultes sont devenus raisonnables et ont enfin renoncé à inventer de nouveaux mots. La régularité du langage joue un rôle crucial dans toutes les langues asiatiques. Du coup, les enfants de ces pays comprennent les nombres jusqu'à 20, en moyenne deux ans avant les enfants américains. Cela s'explique simplement parce que les enfants construisent les relations numériques élémentaires de façon complètement différente : les petits Américains progressent dans les vingt premiers nombres en améliorant leurs procédures de comptage, les petits Asiatiques procèdent par une stratégie de décomposition-recomposition : pour 8+6, je prends 2 à 6, j'arrive à 10 et j'ajoute 4, cela fait 14, ou plutôt 10-4. En fait, ces enfants se donnent immédiatement pour but de savoir de combien le nombre inconnu entre 10 et 20 dépasse 10. Le petit Français ne se donne pas ce but, sauf si un maître lui dit : « Fais-moi confiance et adopte cette stratégie ». C'est en ce sens que j'ai élaboré les outils qui sont aujourd'hui les plus utilisés au CP. Mais j'avais découvert cela avant la publication des études interculturelles, parce que j'avais consacré une partie de ma thèse de psychologie à étudier la construction du nombre chez des enfants sourds-muets, qui procèdent de la même façon que les enfants asiatiques, mais en langage des signes, par collection de doigts, en baissant une main pour signifier qu'ils sont après 10 et qu'ils sont donc passés à 10-1, 10-2, etc. Et j'avais constaté que sur cinq enfants sourds-muets intégrés au CP, deux étaient largement en avance dans la construction du calcul mental. Je suis donc connu pour prêcher l'enseignement de stratégies de décomposition-recomposition et pour dire aux maîtres que le comptage en petite section n'est pas la panacée, qu'il y a d'autres façons de parler des nombres avec les jeunes enfants. M. Daniel Prévost : À quel moment pensez-vous qu'il faille introduire la notion d'ordre de grandeur ? M. Rémi Brissiaud : Il existe des compétences innées, mais elles sont de très bas niveau, et la capacité d'apprécier les ordres de grandeur n'en fait pas partie. M. Jean-Marie Rolland, président : Pouvez-vous nous dire un mot du niveau des professeurs en IUFM ? Vous n'avez jamais eu l'occasion d'appliquer vos concepts sur une ou deux générations d'élèves d'IUFM ? Je suppose que les étudiants ouvrent des yeux comme des soucoupes en vous entendant... M. Rémi Brissiaud : Je regrette de ne pas pouvoir promouvoir ma méthode. Moi, avant de faire une recherche en psychologie, je lis tout ce qui a été publié sur le sujet. Manifestement, mes collègues mathématiciens ne font pas de même, parce qu'ils ne lisent pas en anglais, qui est aujourd'hui la langue internationale de la recherche, et surtout parce qu'ils ne lisent pas les articles de psychologie. Mes idées sont assez largement diffusées dans les IUFM, mais par la base : ce sont les instituteurs qui, lorsqu'ils vont en stage, rencontrent des conseillers pédagogiques qui utilisent ma technique. Pour ma part, je rencontre environ 10 000 professeurs des écoles chaque année et les choses se passent très bien. Ils ne sont pas plus étonnés que vous par ce que je leur dis, car cela leur parle des élèves qu'ils ont dans leurs classes. J'essaie de faire passer des concepts, j'introduis un vocabulaire savant, mais en m'appuyant sur des pratiques de classe. Je leur explique qu'il y a en fait discordance entre la représentation initiale et l'économie du calcul car la procédure activée par la représentation initiale ne donne pas la solution. Encore faut-il savoir que deux procédures sont en jeu. J'ai connu un certain nombre d'inspecteurs généraux lorsqu'ils étaient conseillers pédagogiques, mais mes idées ne parviennent pas à passer au-delà, et il est évident que pour réussir le concours d'entrée dans les IUFM, il faut maîtriser son « petit ERMEL ». ERMEL développe l'idée que si les enfants ne réussissent pas mieux dans les classes, c'est parce qu'on ne les laisse pas suffisamment chercher, parce que l'enseignement est trop magistral, parce que l'enseignant n'est pas assez constructiviste. Moi, je dis qu'il est bon d'avoir une position constructiviste, qu'il est vrai qu'avant tout enseignement les enfants savent résoudre un certain nombre de problèmes, mais qu'il y a aussi des problèmes qu'ils ne savent pas résoudre et que l'école a une responsabilité. Si on n'enseigne pas à l'école les équivalences entre procédures qui fondent les concepts arithmétiques, peu d'enfants les découvriront seuls. Il faut donc compléter le discours d'ERMEL par un autre message. M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous remercie beaucoup. Vous êtes passionné et donc passionnant. M. Rémi Brissiaud : C'est mon travail qui est passionnant car il me permet d'apporter des choses à la fois en pédagogie des mathématiques et en psychologie cognitive. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 28 FÉVRIER 2006 Table ronde des enseignants M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue devant cette mission d'information sur l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. J'ai demandé que cette mission soit créée après avoir entendu certains de vos collègues enseignants de ma région me faire part de leur inquiétude devant le manque d'attractivité des filières scientifique pour les jeunes Français, mais aussi après avoir rencontré des chefs d'entreprise confrontés à des difficultés pour recruter des ingénieurs et des techniciens. Pour notre travail, nous sommes partis de l'étude PISA de l'OCDE, qui montre que les jeunes Français ne sont pas les plus brillants en sciences, puis nous avons rencontré les responsables de grandes écoles d'ingénieurs et de grands organismes scientifiques, mais aussi les gens qui ont testé des méthodes pédagogiques comme Maths en jeans et La main à la pâte, et nous sommes allés voir dans les établissements comment les choses se passent. Nous avons aussi eu la chance de nous rendre en Finlande et en Suède. Je vous rappelle que nous nous intéressons également à la place des femmes dans les sciences. Nous accueillons cet après-midi : - MM. Michel Fréchet et Bruno Descroix, membres de l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement Public ; - M. Jean-Charles Jacquemin, président de l'union des professeurs de physique et de chimie, et Mme Marie-Françoise Karatchentzeff, membre de cette association ; M. Jean-Michel Schmitt, président de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles ; MM. Johann Yebbou, président, et Bruno Jeauffroy, secrétaire général de l'union des professeurs de spéciales (classes préparatoires aux grandes écoles) ; Mme Éliane Vernet et M. Jean Ulysse, de l'association des professeurs de biologie et géologie. Je propose que nous commencions par faire un tour de table qui vous permettra de dresser un constat, avant que vous nous fassiez part des solutions que vous proposez, puis des solutions innovantes qui pourraient être développées pour l'enseignement des disciplines scientifiques, nous pourrons enfin, si le temps le permet, avoir un débat un peu plus large. Peut-être pourrez-vous nous dire également si vous pensez, comme nous l'avons entendu, que les mathématiques sont aussi un élément de sélection sociale. M. Jean Ulysse : Un rapport ministériel a dressé le constat que 73 % des élèves en élémentaire ne font pratiquement pas de sciences. Cela tient largement au fait que le cadre institutionnel n'incite pas les professeurs des écoles - à qui on ne saurait lancer la pierre car ils doivent tout faire - à enseigner ces matières. Pourtant, l'appétence pour les sciences de la vie, l'étude du corps, les grands concepts de biologie est bonne, sans doute en adéquation avec l'importance dans la société et dans les médias des sujets d'environnement, de développement durable et de santé. Le manque de présence des sciences dans les écoles ne semble pas tenir aux programmes, qui sont assez structurées et complets, les documents d'accompagnement étant bien faits. Je suis aussi membre du comité scientifique d'Ebullisciences, qui préconise la découverte par le tâtonnement, mais avec la prise de conscience de la nécessité d'un savoir cadre. On me demande parfois d'intervenir sur le terrain et les choses se passent très bien. Nous ferons tout à l'heure des propositions en vue de développer ces expériences ainsi que les relations entre les professeurs des collèges et des écoles. Les collégiens sont à l'âge des modifications de leur propre organisme et de leur statut social. Les programmes sont correctement construits, d'autant qu'on a réparti sur deux ans, à la demande des parents, l'enseignement sur la procréation et les MST. La France était pionnière en ce qui concerne la méthode et cela se retrouve aujourd'hui un peu dans ce que fait La main à la pâte. L'idée est de partir du concret, de situations vécues, et que progressivement, grâce aux travaux pratiques, les collégiens construisent des savoirs et des savoir-faire. Mais cela pose évidemment la question des effectifs : dans la méthode expérimentale, il ne faut pas dépasser 18 élèves par groupe. Bien évidemment, nous avons besoin d'un outil mathématique et physique qui accompagne notre enseignement et il n'y a donc pas d'opposition entre les matières. S'agissant de l'attractivité des sciences en général, il faut tenir compte de l'a priori de plus en plus défavorable dans la société. La pédagogie paraît donc d'autant plus importante, et beaucoup d'expériences sont aujourd'hui menées, par exemple avec les sentiers écologiques, grâce auxquels ce sont les enfants qui amènent les parents découvrir la forêt. En ce qui concerne enfin le lycée, le programme en section ES semble parfaitement adapté à la diffusion d'une culture scientifique, mais l'examen lui-même traduit une dérive qui consiste à faire de ses élèves des sous-scientifiques. M. Yohan Yebbou : En tant que représentant des professeurs de classes préparatoires, je n'ai pas de commentaire à faire sur l'ensemble du système éducatif. Pour notre part, nous n'avons pas à nous plaindre du manque d'attractivité des sciences chez les élèves que nous accueillons : les effectifs ont battu des records en 2004 et les « prépas » attirent beaucoup d'étudiants. Ceux qui entrent dans des prépas scientifiques le font en particulier par goût des disciplines enseignées. Nous avons toutefois quelque difficulté à faire le pont entre les élèves qui sortent de terminale et les exigences des grandes écoles. Pour autant, il est difficile de parler de dégradation du niveau, et il reste beaucoup d'élèves de grande qualité capables de réussir dans les plus grandes écoles. Tout au plus constatons-nous une plus grande hétérogénéité dans des classes qui se sont beaucoup ouvertes ces dernières années, et cela peut compliquer la tâche des professeurs. Si on se concentre sur les capacités techniques comme le calcul en maths, peut-être y a-t-il eu un petit déclin par rapport aux années 1970-1980, mais il est compensé par une plus grande réactivité à l'oral. S'agissant de l'amont, c'est-à-dire du lycée, la transformation des filières scientifiques C, D et E en une filière unique S a donné une grande importance à cette dernière, qui compte la moitié des bacheliers généraux, la seule différence tenant à la spécialité. Je ne sais pas si, en créant cette grosse filière indifférenciée, on a augmenté ou réduit l'attractivité pour ces enseignements, mais en tout cas elle a fait de l'ombre aux deux autres, et si les effectifs en S se sont un peu tassés ces dernières années, en L ils ont carrément plongé. L'enseignement des mathématiques en classes préparatoires reste important, même si l'horaire a été réduit ces quinze dernières années. L'équilibre auquel on est parvenu ne me semble pas mauvais. La question de la baisse du niveau des élèves est parfois posée, certaines écoles d'ingénieurs s'interrogeant sur le niveau de leurs étudiants. En fait, on a un peu l'impression que le collège à quelques difficultés à maintenir un certain type d'exigences formelles et qu'il est difficile de corriger ensuite ces défauts. M. Bruno Jeauffroy : Je puis aussi intervenir en tant que citoyen et parent de trois enfants au lycée. J'ai aujourd'hui l'impression que les mathématiques sont un peu minoritaires dans la charge de travail des élèves de la section S. Or on sait que si l'élève ne peut pas acquérir une certaine masse critique, si ses bases ne sont pas assez développées, il y a moins de chance qu'il ait le goût des mathématiques. En tant qu'enseignant en physique en classes préparatoires, si un étudiant arrive avec une lacune dans ma matière, j'en fais mon affaire ; si c'est en maths, je peux lui donner le résultat, mais je suis quand même un peu surpris et il me semble qu'il faudrait un bagage mathématique un peu plus fort. M. Jean-Marie Rolland, président : Quels sont les effectifs dans vos classes ? M. Bruno Jeauffroy : Normalement 35, mais ils peuvent monter à 40 et même au-delà en première année. Il faut toutefois savoir que 2000 places sont restés libres à la dernière rentrée, bien sûr pas dans le centre de Paris, mais en proche banlieue. Il faut que les élèves osent venir. M. Jean-Charles Jacquemin : Il faudrait non pas une, mais des voies scientifiques. Les sciences et techniques industrielles, comme celles de laboratoire, permettent à des élèves qui ont des besoins différents de réussir dans des domaines qui les amèneront ensuite à poursuivre leurs études et à entrer dans des emplois scientifiques et techniques. À l'inverse, la filière généraliste S capte une énorme partie des élèves qui ne continuent pas après le baccalauréat sur une voie scientifique. Pour être incités à suivre ces voies, les élèves sont beaucoup plus motivés par le côté pratique que théorique. Il faut donc leur faire savoir qu'il ne s'agit pas de voies de garage, ce qui suppose l'existence de passerelles. Il y a en effet aujourd'hui une demande des bacheliers professionnels de continuer leurs études, mais on ne sait pas où les mettre, d'autant qu'ils sont noyés dans les programmes actuels des BTS. Ne pas donner une chance de continuer à des jeunes qui sont intéressés par les sciences est un vrai gâchis. Il faut suivre l'exemple de l'ENS de Cachan, qui accueille une dizaine d'élèves issus de classes préparatoires après le BTS. Bien sûr, il s'agit de petites formations mais qui ont un grand succès auprès de quelques élèves très motivés. Mme Marie-Françoise Karatchentzeff : Nous tenons tout particulièrement à l'enseignement expérimental, car c'est lui qui donne un sens à ce que reçoit l'élève : ce dernier assimile mieux les connaissances quand il fait ce qu'il aime. En outre, dans le travail expérimental, l'enseignant à une relation plus étroite avec l'élève, qui favorise la remédiation. Or, dans les collèges, ce travail est difficile avec des classes entières, il suppose beaucoup d'énergie de la part des professeurs Au lycée, il s'agit de finaliser les connaissances, ce qui est assez difficile car nous sommes en face d'élèves qui ont les lacunes en mathématiques. La physique et la chimie présentent la particularité de procéder par allers-retours permanents entre le concret et l'abstrait. C'est une approche difficile pour les jeunes, mais ils y adhèrent si on leur en laisse le temps. Ainsi, les professeurs essaient de leur faire acquérir un raisonnement rigoureux, de les inciter à avoir une attitude humble et humaine et à accepter la réalité. M. Jean-Charles Jacquemin : L'exercice que vous nous demandez aujourd'hui dans un temps restreint nous amène à insister sur les points négatifs. Jusqu'ici, pour chercher à remédier à ces problèmes, on a souvent changé les programmes, voire les structures avec la fusion des filières C, D et E. Mais tout est décidé dans la précipitation et on ne procède jamais aux évaluations nécessaires. Parce que le travail scolaire n'est pas mis au premier plan, l'attitude des élèves peut surprendre. Ainsi, des enseignants de maths spéciales s'étonnent de devoir faire une pause au bout de deux heures de cours, quand leurs étudiants commencent à s'agiter. Aujourd'hui, un cours formel, frontal, est presque impossible. Peut-être faut-il aussi incriminer l'attitude de la société vis-à-vis de la science. Alors que se déroule aujourd'hui le débat sur la recherche à l'Assemblée, j'entendais ce matin un membre du collectif Sauvons la science constater que les jeunes se détournent de la recherche et qu'il faut leur donner des perspectives. Mais ils se détournent aussi des métiers scientifiques : aujourd'hui les élèves de terminale S ne rêvent pas d'obtenir le prix Nobel mais de devenir trader... On donne à la section S la fonction de former toute l'élite française. Par ailleurs, quels peuvent être les effets du plan de rénovation de l'enseignement des sciences et techniques quand, dans le même temps, la part des sciences chute dans les nouveaux concours de recrutement des professeurs des écoles ? On parle de culture scientifique, pour ma part je préférerais que les sciences soient dans la culture au sens large : pourquoi le Monde traite-t-il des sciences et de l'environnement dans les premières pages, et de la culture à la fin du journal ? M. Jean-Michel Schmitt : Il n'y a aucune filière pour les sciences de l'ingénieur alors qu'il s'agit de la seule spécialité qui fasse référence à un métier, mais peut-être cela lui donne-t-il une connotation de formation professionnelle. L'approche des STI (sciences et technologies industrielles), qui concernent un grand nombre de bacheliers, est de s'appuyer sur une culture scientifique de base, indispensable à chaque ingénieur et technicien, tout en privilégiant une approche concrète. Dans le secondaire, la filière SSI (sciences de l'ingénieur)28 se porte relativement bien parce qu'elle est vecteur d'excellence. Elle contribue à former de futurs ingénieurs de haut niveau, car il y a quand même des étudiants qui poursuivent sur la voie scientifique et ne deviennent pas traders. Mais elle représente un trop faible pourcentage des bacheliers S (10 %), c'est dommage car elle pourrait être utile à certains élèves qui ont du mal à appréhender tout ce qu'il leur est présenté sous forme théorique. Il faudrait que chaque lycée qui a une section S propose un bac SSI. Pour que le recrutement ne se tarisse pas, il faudra bien prendre en compte différentes formes d'intelligence et différents rythmes d'apprentissage, d'autant que cette filière a vocation à alimenter l'enseignement supérieur dans le cadre de l'objectif d'y conduire 50 % d'une classe d'âge d'ici 2010. Au collège, la technologie a longtemps pris la forme de l'éducation manuelle et technique. Aujourd'hui encore, il est dommage que sa part soit aussi réduite. Un nouveau programme devrait émerger pour la sixième. Il convient en particulier de donner plus de clinquant à la discipline et de la mettre en phase avec le monde actuel M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous des informations sur le retard dans la parution des programmes de technologie ? M. Jean-Michel Schmitt : Les programmes sont prêts à l'inspection générale, mais ils se heurtent à un certain corporatisme. Pour redynamiser l'enseignement de la technologie, il faudrait un véritable programme, pour tout le collège, afin que les élèves puissent s'orienter en toute connaissance de cause, sans que la filière technologique soit vue comme une voie de garage. C'est un enjeu important. Dans le primaire, la technologie est inexistante : on retombe ici sur le fait que trop peu de professeurs des écoles ont un profil scientifique et qu'il faudrait faire évoluer les filières de recrutement. M. Michel Fréchet : Les mathématiques ont été attaquées par plusieurs ministres de l'éducation nationale : Claude Allègre disait qu'elles étaient finies puisqu'on disposait des ordinateurs, et Luc Ferry se vantait de ne pas savoir résoudre une équation du premier degré... Alors que, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur le président, les maths sont devenus un instrument de sélection, une enquête récente montre que moins les effectifs sont importants, plus les élèves ont de chances de réussir en maths en primaire. Au collège, nous dénonçons la trop grande hétérogénéité des classes, d'autant que nous sommes passés de quatre à trois heures d'enseignement. Au total, de la sixième à la terminale, les élèves ont perdu une année et demie d'enseignement, et il n'y a pas à s'étonner qu'ils soient incapables de réaliser des choses assez simples : elles ne sont plus au programme. Au lycée, en section S, l'inadéquation entre les horaires et les programmes est totale, d'autant que l'épreuve du baccalauréat est lourde. Il est vrai que la série S n'est plus une série scientifique mais une filière d'excellence, où l'on retrouve les meilleurs, j'en veux pour preuve qu'un élève qui sort de terminale S peut entrer en khâgne alors qu'un bachelier L n'a aucune chance d'accéder en maths sup. Qui plus est, on peut réussir un bac S en étant moyen dans les disciplines scientifiques. Dans ces conditions, on ne peut plus faire travailler sérieusement les élèves, parce qu'ils sont très sollicités dans les autres matières et parce qu'on a réduit les horaires de mathématiques. Car, pour nous, 6 + 2 ne font pas 8, mais bien six heures de mathématiques et deux heures de spécialité. Or cette séparation empêche une progression logique dans l'enseignement. Nous nous sommes battus pour que les mathématiques reviennent en série L, en particulier pour que les futurs professeurs des écoles fassent des maths. Globalement, nous ne demandons pas plus d'heures, mais un équilibre qui nous permette de disposer du temps nécessaire pour faire le programme et pour donner du plaisir aux élèves. On ne fait pas assez confiance aux professeurs, nous avons l'impression d'être traités comme quantité négligeable, l'administration allant parfois jusqu'à nous mettre des bâtons dans les roues. M. Bruno Descroix : Nous avons lancé en Seine-Saint-Denis une animation dans sept établissements auprès d'élèves de seconde et de première intéressés par les sciences et que nous plaçons, pour des séquences de deux à trois jours, en situation de recherche dans des laboratoires. Dans le contexte des violences dans les banlieues, tout le monde a été emballé par ce projet. Néanmoins nous nous sommes sentis très seuls, les inspecteurs étant débordés par les nécessités de la gestion de l'urgence. Je crois qu'il y aurait vraiment intérêt à mettre en relation toutes ces petites initiatives innovantes dans le domaine de l'animation. M. Michel Fréchet : Au sein du collectif Action Sciences, nous prônons la création d'une option sciences en seconde. Elle fonctionne déjà dans 200 ou 300 établissements, mais nous avons du mal à la faire admettre par certains inspecteurs, tout simplement parce qu'elle n'est pas officielle. Je crois qu'il est nécessaire de dénoncer cette inertie, qui conduit parfois à abandonner certaines expériences avant même qu'elles aient été évaluées. Par ailleurs, la complexité croissante de notre métier nous conduit à utiliser les TICE (technologies d'information et de communication pour l'enseignement), mais il faut former les gens pour cela car sinon y recourir est contre-productif. M. Jean-Marie Rolland, président : Quels obstacles rencontrez-vous quand vous voulez amener les élèves à fréquenter les laboratoires ? M. Bruno Descroix : Il existe à Marseille un projet qui fonctionne en biologie et en maths, mais c'est parce qu'il est en phase avec la volonté de l'université. Bien souvent les professeurs se sentent seuls dans leurs établissements. Dans le cadre d'un projet d'école ouverte pendant les vacances pour faire des maths, nous avons eu 130 inscrits et nous avons dû refuser des élèves. Cela montre bien que l'appétit pour les sciences existe. Ce qui l'empêche de se développer, c'est d'une part le fait que les élèves croulent sous le travail dans les premières scientifiques, d'autre part le manque de lien avec l'université, faute d'information en direction non seulement des élèves mais aussi des professeurs. C'est pour cela que nous avons monté un dispositif dans lequel d'anciens élèves viennent raconter leur parcours à leurs camarades plus jeunes et aux enseignants. On ne peut pas parler de blocage à proprement parler mais, comme l'a dit Michel Fréchet, nous nous sentons un peu seuls : jamais un inspecteur général ne vient nous demander de quoi nous avons besoin. L'idée est vraiment de relier un ensemble de petites innovations plutôt que de bâtir un établissement avec des murs. Pour cela, un réseau paraît nécessaire, mais comment le faire fonctionner si nous ne disposons pas de moments de concertation ? M. Jean-Marie Rolland, président : Quelles améliorations préconisez-vous ? Quelles méthodes expérimentales ou innovantes pouvez-vous décrire ? M. Jean Ulysse : Les conditions d'enseignement sont importantes, et pouvoir travailler avec de petits groupes d'élèves est une condition favorable. D'autre part, il y a une distorsion entre ce que certains professeurs voudraient mettre en œuvre et le carcan institutionnel. En d'autres termes, il y a « ce qui est prévu par les textes », et pour le reste, l'inspection générale freine, ce qui ne favorise pas l'innovation ; si un texte de loi permettait l'innovation, ce serait une bonne chose, la contrepartie étant une évaluation. Enfin, il est regrettable que les travaux personnels encadrés (TPE) aient été supprimés. Lors de leur création, ils avaient constitué une sorte de révolution car, pour la première fois, des professeurs spécialistes travaillaient en groupe. Cela a eu des effets très positifs, tant pour le contenu de l'enseignement que parce que cela favorisait les passerelles entre l'enseignement secondaire et l'Université et apprenait aux élèves à faire des recherches personnelles tout en travaillant en équipe ; les TPE ont sans conteste favorisé l'appétence pour les sciences. M. Michel Fréchet : Le collectif Action Sciences souhaite la création et la généralisation d'une « option sciences » en classe de seconde, comme il en a déjà été créé dans certaines académies dont celle de Montpellier. L'idée est de redonner le goût des sciences aux élèves de seconde en leur faisant découvrir les mathématiques, la physique, la chimie et les SVT (sciences de la vie et de la terre). Nous souhaitons que cette option devienne un enseignement de détermination. Mais on nous répond que ce n'est pas possible, parce que ces matières sont enseignées au collège. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous préférez donc que plusieurs professeurs de disciplines différentes travaillent en commun, plutôt qu'un professeur polyvalent ? (Assentiment général vigoureux) M. Jean Ulysse : Dans les écoles élémentaires, on trouve des maîtres « à dominante » ; j'en ai moi-même formé en IUFM. Mais sans ces dominantes, la polyvalence est d'un exercice très difficile. M. Frédéric Reiss : Proposer la découverte des sciences en seconde, n'est-ce pas signifier que le collège a failli ? M. Bruno Descroix : Il s'agirait d'aborder des questions que l'on a très peu le temps de traiter au collège, et selon une façon de travailler qui se pratique encore assez peu en France, au contraire d'autre pays. M. Jean-Charles Jacquemin : Votre observation relative au collège est tout à fait pertinente, et c'est pourquoi on essaie de faire travailler ensemble les professeurs des collèges par le biais des thèmes de convergence. Mais on est encore loin de la pluridisciplinarité. M. Michel Fréchet : L'« option sciences » ne se conçoit que si les trois matières sont à égalité, y compris sur le plan des horaires. M. Jean Ulysse : L'un des maux premiers du collège, c'est une hétérogénéité telle que lorsque les classes sont grandes, on détruit l'appétence pour le savoir. Il faut pouvoir faire des travaux pratiques en petits groupes. M. Daniel Prévost : Je partage votre point de vue sans réserve. On peut composer trois groupes de dix-huit élèves avec deux classes ; le problème tient à ce que, bien souvent, les professeurs travaillent dans deux ou trois établissements différents. M. Jean Ulysse : C'est surtout que la dotation globale horaire ne permet plus rien. M. Frédéric Reiss : Ne peut-on imaginer des enseignants en sciences bivalents au moins pour les classes de sixième et de cinquième ? M. Michel Fréchet : Notre association n'a rien contre une certaine forme de bivalence, et elle compte dans ses rangs des professeurs de lycée professionnel parfaitement satisfaits de leur sort. Il y a bivalence pour l'histoire et la géographie, pourquoi pas pour les mathématiques et la physique ? Mais tout dépend de la formation donnée aux enseignants, et c'est pourquoi nous sommes contre le CAPES avec mention complémentaire. La bivalence est une piste à étudier, mais à condition qu'il ne s'agisse pas d'un enseignement au rabais. Les professeurs doivent dominer la discipline qu'ils enseignent. Certains PEGC, par exemple, n'avaient pas de connaissances mathématiques suffisantes. M. Jean-Charles Jacquemin : Notre association, qui réfléchit à cette question depuis longtemps, ne veut pas la création d'un nouveau corps de professeurs voués à être professeurs de sciences en collège ad vitam aeternam. On sent le malaise qu'éprouvent les professeurs de technologie d'être le seul corps qui ne peut enseigner qu'au collège. Les futurs professeurs de physique et de chimie sont des physiciens et des chimistes passionnés, qui renoncent de fait à l'ambition d'être chercheurs pour enseigner la discipline qu'ils aiment. Si on leur dit qu'ils sont destinés à enseigner toute leur vie à des classes de sixième et de cinquième, on peut s'attendre à une chute brutale des vocations. M. Bruno Jeauffroy : Le niveau des candidats au dernier CAPES était déjà juste alors qu'il porte sur une discipline... Il est difficile de penser qu'ils en maîtriseraient deux - mais pourquoi pas, s'ils sont convenablement formés ? M. Jean-Marie Rolland, président : Je ne perçois pas un enthousiasme débordant. M. Bruno Jeauffroy : C'est que cela semble peu réaliste. M. Jean Ulysse : Le volume de connaissances, en biologie, double tous les cinq ans ; il paraît très difficile d'enseigner une autre discipline en plus. Nous refusons, nous aussi, un enseignement au rabais, mais nous ne sommes pas contre l'idée de travailler en équipe, ce qui est tout autre chose. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous sommes allés en Suède et en Finlande et nous avons constaté que dans ces deux pays, qui obtiennent les meilleurs résultats de l'étude PISA, les professeurs enseignent plusieurs matières. M. Jean-Michel Schmitt : Parce qu'ils sont très bien formés ! M. Frédéric Reiss : La question qui se pose à nous est précisément de savoir comment améliorer la formation des élèves-maîtres en culture générale, culture scientifique comprise. M. Jean-Michel Schmitt : Je voudrais revenir un instant sur l'« option sciences » de détermination en seconde pour souligner qu'en l'état le projet ne tient pas compte des sciences de l'ingénieur. Si on s'en tient à cela, on s'achemine davantage vers la reconstitution d'une filière dissoute - la filière C - que vers l'innovation. Pour ce qui est de la technologie au collège, on améliorerait l'efficacité de l'enseignement, à horaire constant, en révisant rapidement les programmes de toutes les classes et non pas seulement ceux de la sixième. Mais il est vrai que les collègues qui arrivent à l'âge de la retraite sont réticents à une réforme, car enseigner aux élèves ce qui a trait aux satellites ou aux téléphones portables n'a rigoureusement rien à voir avec ce qu'ils enseignaient lorsqu'ils sont entrés dans la carrière. Il faut donc procéder en douceur et favoriser le travail en équipe, car le corpus de connaissances requises n'est pas à la portée d'un seul individu. Dans un autre domaine, il est essentiel que les initiatives individuelles soient reconnues et professionnellement valorisées. M. Michel Fréchet : Il y a un grand intérêt à travailler en équipe. Cela permet par exemple de montrer aux élèves qu'il y a un continuum entre les mathématiques enseignées par le professeur de mathématiques et celles qu'enseigne le professeur de physique. Or, on n'arrive pas à imposer la pluridisciplinarité. M. Bruno Descroix : Il serait bon que les élèves-maîtres puissent se rendre dans les classes où les enseignants font un travail particulier ; ainsi sauraient-ils que cela existe. Mme Eliane Vernet : L'enseignement doit aussi tenir compte de ce que les enfants ont changé depuis quatre ou cinq ans ; ils sont beaucoup plus lents. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment l'expliquez-vous ? Mme Eliane Vernet : Je ne l'explique pas, mais je le constate, comme tous mes collègues, y compris les plus jeunes. Ils sont lents, y compris pour s'installer...De plus, ils ont beaucoup de mal à se concentrer - ils zappent... M. Michel Fréchet : Une étude faite en installant des caméras dans les classes montre que les enfants décrochent au bout de cinq minutes. C'est le temps d'un clip... Mme Eliane Vernet : Les cours magistraux, c'est fini. En revanche, les travaux pratiques marchent bien. Les élèves sont en binômes, et le travail de recherche, qui leur plaît, suscite de grandes discussions. M. Jean-Marie Rolland, président : Les auteurs de l'étude PISA parlent de l'anxiété des jeunes Français à l'égard des mathématiques. Qu'en pensez-vous ? M. Bruno Descroix : Je la ressens assez fortement, et un important travail est nécessaire pour convaincre les élèves qu'ils peuvent réussir. M. Jean-Marie Rolland, président : Lenteur, anxiété... sans doute devrions-nous interroger des pédopsychiatres... Mme Eliane Vernet : La solution, ce sont de petits groupes où chacun travaille à son rythme. M. Bruno Jeauffroy : Je tiens à préciser qu'il existe un enseignement de détermination de sciences industrielles, qui ne sont donc pas oubliées, et nous sommes tout prêts à ajouter cette option dans les lycées où la filière existe. Il faut revoir le nombre de matières au baccalauréat dans la filière S. C'est la filière où le nombre de disciplines enseignées en terminale est le plus élevé, et la seule épreuve anticipée est le français. Il faut y adjoindre une autre, quitte à continuer de l'enseigner en terminale comme spécialité facultative. Il faut typer la filière S qui, pour l'instant, devrait plutôt être libellée « E » comme « élitiste » ! Dans le schéma actuel, les bons élèves n'ont pas de problèmes, mais notre préoccupation a trait aux élèves qui sont scientifiques dans l'âme mais moyens en tout, voire mauvais en lettres ou en langues. Ceux-là ne pourront compenser leurs incapacités par des surcapacités en sciences, et l'accès aux filières scientifiques leur sera barré. Par ailleurs, je rappelle que l'on a supprimé une heure de mathématiques pour instituer les TPE, qui ont ensuite été supprimés sans que l'horaire initial soit rétabli. M. Michel Fréchet : Mais le programme, lui, n'a pas changé ! M. Bruno Jeauffroy : Nous ne voulons pas la réduction des programmes, nous voulons l'adéquation entre les programmes et les horaires. Il faudra donc supprimer une matière en terminale S, ce qui contribuera à rétablir l'équilibre entre disciplines non scientifiques et disciplines scientifiques au bénéfice de ces dernières. M. Jean-Charles Jacquemin : Les élèves de la filière S option SI (sciences de l'ingénieur) ont pris un mauvais coup l'année où il a été brutalement décidé qu'ils devraient subir une épreuve écrite de seconde langue au lieu qu'elle soit, comme jusqu'alors, orale. Ils se sont mis à travailler comme des fous. Mais ceux qui suivent cette filière sont-ils les meilleurs en français, en histoire et géographie, en langues ? On a démesurément chargé leur barque. M. Jean-Marie Rolland, président : Etes-vous cependant favorable à l'apprentissage de deux langues vivantes ? M. Jean-Charles Jacquemin : La difficulté tient à l'évaluation. Pourquoi ne pas la faire en classe de première ? Au fil des ans, on n'a cessé d'augmenter la charge de travail demandée aux élèves de la filière S dans les matières autres que scientifiques. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous nous direz donc sans mal quelles disciplines non scientifiques il convient d'alléger. (Rires) M. Michel Fréchet : S'est-on posé la question lorsqu'on a supprimé les mathématiques pour les séries littéraires? M. Bruno Jeauffroy : Parce qu'il n'ose pas dire que l'apprentissage de l'anglais devrait être obligatoire pour tous, le ministère fixe l'obligation de deux langues vivantes, considérant que rares seront alors ceux qui n'auront pas l'anglais dans leur combinaison linguistique. A Supelec, il est d'ores et déjà impératif d'avoir un niveau suffisant en anglais à la sortie de l'école, et cette exigence vaut même pour les étudiants étrangers non anglophones venus passer leur dernière année d'études en France. C'est un peu dommage, et c'est une politique à courte vue, dans laquelle nous allons laisser des plumes. Pourquoi, si l'on suit cette voie, ne pas obliger à apprendre le chinois ou l'hindi ? M. Jean Ulysse : En Angleterre, 60 % des élèves n'apprennent plus les langues étrangères. M. Jean-Marie Rolland, président : Dans les pays scandinaves, il n'y a que trois ou quatre épreuves à l'examen équivalent au baccalauréat. Est-ce une piste possible ? M. Yohan Yebbou : C'était le cas pour le baccalauréat C. La comparaison entre ce qu'était l'examen au début de années 1960 et en 2005 montre une augmentation continue du nombre d'épreuves. M. Michel Fréchet : Le pic ayant été atteint en 1995 pour le baccalauréat scientifique. M. Bruno Descroix : J'ai assez bien compris l'inquiétude de mes élèves de Bobigny à l'idée d'une évaluation locale. La ségrégation sociale est telle qu'ils se sont vus estampillés « bac Seine-Saint-Denis ». M. Jean-Charles Jacquemin : Si la solution retenue pour réduire le nombre des épreuves est l'évaluation locale, c'est un vrai problème. Toutefois, on procède ainsi pour certaines épreuves du BTS. M. Jean Ulysse : Mais il n'y a pas d'accord général de tous les professeurs pour cela. M. Jean-Michel Schmitt : Cela s'explique par les contraintes techniques. M. Yohan Yebbou : Il faudrait en premier lieu faire une évaluation précise de l'évolution du lycée depuis 1995 pour connaître l'effet de la réforme. S'agissant de l'étude PISA, il est difficile de tirer des conclusions des chiffres avancés, car les écarts entre les pays sont faibles en valeur absolue. Pour la France, il serait intéressant de savoir si les résultats sont ventilés par académie, car les taux de réussite au baccalauréat sont très différents. M. Jean-Marie Rolland, président : Les auteurs de l'étude ont procédé par tirage au sort pour tous les pays. M. Bruno Descroix : Parler de désaffection à l'égard des sciences, c'est partir du postulat que la France a besoin de scientifiques. Des études prospectives ont-elles été faites qui montrent qu'elle doit en former ? M. Jean-Marie Rolland, président : Un minimum de savoir scientifique est nécessaire au citoyen pour qu'il puisse se déterminer sur des sujets tels que les OGM, le réchauffement climatique, l'homéopathie... La lecture des courriers que reçoivent les parlementaires dès qu'ils abordent les questions médicales est affolante. Ainsi, le débat sur les cures thermales n'est pas mort... M. Michel Fréchet : Le collectif Action Sciences, qui regroupe quinze associations, a demandé par courrier un rendez-vous à M. de Robien le 24 octobre. Ce courrier est resté sans réponse même après qu'une lettre a été adressée au Premier ministre le 6 janvier à ce propos. Certes, le cabinet de M. de Villepin nous a fait savoir que notre requête serait transmise au ministre, mais nous avons le sentiment que la question n'intéresse pas le Gouvernement, qui ne prend même pas la peine de refuser le rendez-vous demandé. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous ferons savoir au ministre les difficultés de transmission de courrier auxquelles vous vous heurtez. M. Jean-Charles Jacquemin : Toute solution passe par la formation des professeurs, et rien ne se fera sans eux. Or, l'Education nationale ne forme pas son personnel. Il est scandaleux que les obligations faites au secteur privé ne soient pas respectées pour ce qui nous concerne. Nous sommes partisans d'une formation continue obligatoire et valorisée. Il est ahurissant que mon CV fasse apparaître que j'ai obtenu mon dernier diplôme quand j'avais vingt-cinq ans. M. Jean-Marie Rolland, président : Quelle formation continue un professeur de technologie de cinquante ans qui a eu son baccalauréat au début des années 1970 a-t-il suivi? M. Jean-Michel Schmitt : Hormis les stages mis sur pied pour les professeurs des lycées professionnels lorsque les programmes ont été mis à niveau il y a dix ans, aucune s'il n'a pas décidé de suivre, volontairement, les formations que nos associations organisent elles-mêmes, en partenariat avec de grandes entreprises telles que la SNCF. De là à ce que ces sessions de formation soient formalisées... Le seul fait de trouver, au ministère, l'interlocuteur qui a permis la prise en charge des frais jusqu'alors assumés par notre association dans ces occasions a été un long combat. Mme Marie-Françoise Karatchentzeff : La formation continue académique des professeurs se réduit comme peau de chagrin, sauf en cas de changement de programme. Mais il est tout aussi fondamental de les faire réfléchir à l'évolution des élèves et aux manières d'enseigner. Les innovations ne peuvent venir que des professeurs. Encore faut-il les former. M. Bruno Descroix : D'innombrables enseignants mettent leur cours en ligne, assorti de corrigés d'exercices. Rien ne regroupe ces initiatives individuelles en réseau. M. Jean Ulysse : Notre association a largement contribué à la mutation de l'enseignement de la biologie, et pendant dix ans l'Etat a assuré une formation continue complète. Mais, excepté la formation, insuffisante, que notre association dispense et alors que, je l'ai dit, les connaissances doublent tous les cinq ans en immunologie, en génétique ou en sciences de l'univers, ces disciplines ont disparu des IUFM au cours de la dernière décennie. Or, quand nous organisons des sessions de formations, nous réunissons 750 professeurs qui se déplacent sans aucune prise en compte de cet effort volontaire ni même aucune assurance accident du travail ! C'est dire leur désir de formation. M. Michel Fréchet : En 1968, nous avons plaidé en faveur de la création des instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Ils fonctionnent très bien mais ils sont en danger, car les cordons de la bourse commencent d'être coupés, et nous nous battons pour qu'ils continuent d'exister. En bref, on ne donne pas les moyens de fonctionner à ce qui marche, au motif que « les collègues ont du temps pour se former eux-mêmes »... M. Jean-Charles Jacquemin : L'institution bloque, sinon sabote, tout ce qui n'émane pas d'elle. Mais si elle ne sait pas faire, pourquoi ne laisse-t-elle pas agir des associations comme les nôtres ? Nous avons demandé publiquement à l'inspection générale que les formations que nous organisons soient reconnues et valorisées professionnellement ; notre demande a été accueillie avec indifférence. M. Michel Fréchet : Pour notre part, nous avons organisé une session de formation à Caen, à laquelle ont participé 800 professeurs, sur leur temps de vacances. La presse, sollicitée, n'a pas répondu à notre invitation, mais Libération a jugé utile de consacrer une demi page à je ne sais quelle réunion sur les OVNI qui se tenait dans le même temps. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous n'avons pas eu le temps d'aborder la question de la diffusion de l'esprit scientifique, mais il y faudrait un autre débat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2006 Audition de M. Christian Forestier, membre du Haut Conseil de l'éducation, ancien président du Haut conseil de l'évaluation de l'école M. Jean-Marie Rolland : Je vous souhaite la bienvenue. Notre mission, qui a pris connaissance de l'étude PISA, s'interroge sur le manque d'attrait des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. Nous entendrons votre point de vue avec intérêt. M. Christian Forestier : La crise des études scientifiques est réelle. Notre pays n'est pas le seul touché ; la plupart des pays comparables le sont également, l'Allemagne notamment, où les choses sont sans doute encore plus graves, puisque ce pays craignait en 1996 déjà le manque à venir d'ingénieurs chimistes. En France, la discipline qui suscite la plus grande préoccupation est la physique ; ensuite viennent la chimie et, dans une moindre mesure, les sciences de l'ingénieur. Les sciences de la vie et de la terre ne connaissent pas de crise, et elles sont relativement féminisées. Une enquête réalisée en 1998 par M. Philippe Meirieu sur les goûts des élèves montrait que la physique est la discipline qui leur pose le plus de problèmes. S'agit-il d'un phénomène de société ? Les disciplines qui attirent le plus les jeunes sont celles qui tournent autour de l'individu ; de plus, on a peut-être laissé se diffuser auprès d'eux une image du nucléaire qui nuit à l'attrait pour la physique, au bénéfice de disciplines plus hédonistes et plus écologistes. La difficulté tient peut-être aussi aux méthodes d'enseignement. « C'était déjà comme ça avant », me direz-vous peut-être. Eh bien, non. Je me souviens avoir manipulé dès la classe de sixième ; aujourd'hui, nos enfants ne manipulent plus. La main à la pâte fait exception, mais cela reste marginal, puisque 10 % seulement des enfants d'une génération sont concernés. Ce n'est pas le prix, dérisoire, du matériel qui est en cause : c'est que les maîtres doivent être formés. Il est difficile de faire manipuler quand on n'a pas été formé à cela ! L'enseignement de la physique est donc très mal fait. Il ne l'est pas du tout à l'école et il est magistral au collège, ce qui ne convient pas. De même, alors que n'importe quel enfant a du goût pour les boîtes de Petit chimiste, a envie de faire des expériences, la chimie est enseignée par des croquis dessinés au tableau. Pour autant, la voie scientifique dans le second degré ne perd pas spécialement d'élèves, puisque son poids demeure constant dans l'ensemble des filières. Le drame, c'est que la grande majorité des bacheliers scientifiques ne se destinent pas à faire des sciences. Il y a là un effet pervers de notre incapacité à sortir de cette déviance récente de la société française - puisqu'elle remonte à vingt-cinq ans environ - qui fait de la voie scientifique la voie de sélection de l'élite. J'ai le souvenir que M. Bayrou, alors ministre de l'Education nationale, souhaitant revaloriser les études littéraires, s'était proposé de créer une filière d'accès littéraire aux études de médecine. Il y eut, de la part des doyens des facultés de médecine, une levée de boucliers, leur argument étant que cela « dévaloriserait » les études de médecine... Pourtant, qui, parmi les cinquantenaires, n'a connu un médecin, pas plus mauvais qu'un autre, qui avait fait des études littéraires avant de se spécialiser ? D'autres exemples de ce type existent et nous finirons par payer très cher ces effets pervers. M. Jean-Marie Rolland, président : L'étude PISA montre qu'il existe toujours une élite scientifique en France mais que le fossé se creuse entre elle et le reste de la population des élèves. Qu'en pensez-vous ? M. Christian Forestier : L'étude PISA a été conduite à partir de tests qui ne participent pas de notre culture d'évaluation et dont on voit bien qu'ils renvoient à une vision de l'école plus utilitariste que la nôtre. Autrement dit, on enseigne les mêmes mathématiques aux petits Finlandais et aux petits Français, mais on ne les leur enseigne pas de la même manière, et les jeunes Français ont été désarçonnés. Nous avons toujours privilégié l'idée que les mathématiques et la physique sont des matières pour spécialistes, au point de prendre, parfois, des mesures aberrantes. C'est ainsi que M. Claude Allègre a supprimé les mathématiques dans la filière littéraire. J'ai réussi à les faire rétablir par M. Jack Lang, en arguant de ce que de nombreux bacheliers littéraires allaient devenir instituteurs - et que feraient-ils ? Mais ces évaluations existent, et rien ne serait pire que de les ignorer au motif qu'elles auraient été obtenues par application d'un procédé anglo-saxon qui ne nous serait pas adapté. Les conclusions de cette étude nous préoccupent, car nous ne sommes pas les meilleurs, et elles nous renvoient à notre système. Si l'on considère les pays de tête, on constate que la différence est peu visible avec la Finlande. Mais les Finlandais de quinze ans ont un cursus linéaire, sans redoublement. En France, la génération des 15 ans se répartit, en gros, par moitié : ceux qui sont « à l'heure » ou en avance, et ceux qui sont en retard d'un an ou plus. Dans l'étude PISA, les jeunes Français sont, dans l'ensemble, notés 12 sur 20. Mais, si l'on distinguait les populations considérées, on se rendrait compte que les jeunes de 15 ans qui sont en classe de seconde seraient notés 18 ou 19 et surpasseraient tout le monde, mais que ceux qui sont en troisième - et qui, donc, n'ont fait que déraper - n'auraient que 6, et seraient au niveau de la Turquie. Notre système est donc schizophrénique, en ce qu'il a pour effet qu'un enfant sur deux lui est bien adapté et réussit bien, mais qu'un enfant sur deux regimbe et ne réussit pas bien. M. Jean-Marie Rolland, président : Il nous est apparu, au cours de nos déplacements en Finlande et au Canada, que plus grande est l'autonomie dans les établissements, plus grande est la marge de manœuvre et meilleur le résultat. M. Christian Forestier : C'est incontestable. M. Jean-Marie Rolland, président : Jusqu'où pourrions-nous aller ? M. Christian Forestier : Il me semble que le consensus politique existe désormais pour considérer le chef d'établissement comme un maillon essentiel. M. Jean-Marie Rolland, président : Vraiment ? M. Christian Forestier : Je puis vous assurer que le chef d'établissement est une pièce maîtresse, en France comme dans tous les pays du monde. M. Jean-Marie Rolland, président : En Finlande, il y a dix candidats par poste... M. Christian Forestier : Aujourd'hui, en France, les conditions d'exercice de cette profession sont correctes, et la situation évolue. De nouveau, des jeunes postulent. J'ai dû me battre pour que l'on abaisse la limite d'âge, car nous avions des candidats de plus de 55 ans alors qu'il nous faut des managers de 35 ans. Faut-il modifier les textes ? Bien sûr. Mais je puis vous assurer, d'expérience, qu'un chef d'établissement qui veut prendre le pouvoir peut le faire, car les professeurs sont prêts à accepter une autorité pédagogique dans un établissement. Les textes le lui permettent en l'état, mais il faut de la personnalité, et le soutien du recteur. Mais peut-être les chefs d'établissement ne savent-ils pas qu'ils seront soutenus par leur hiérarchie en cas de grogne. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment améliorer l'enseignement des sciences à l'école ? Quelle sera la place des sciences dans le socle de connaissances ? Qu'en est-il des filles et de la science ? M. Christian Forestier : La grande difficulté tient à la formation des maîtres, puisque l'on recrute des littéraires qui n'ont plus suivi d'enseignement des sciences après la classe de première. L'objectif de l'enseignement des sciences à l'école est bien d'apprendre à observer et à réfléchir. M. Pierre-Gilles de Gennes avait donc raison de me suggérer un jour de rétablir la leçon de choses. L'esprit de La main à la pâte est celui-là. Or, les maîtres n'arrivent pas devant leur classe dans cet esprit, et ils ne sont pas formés pour cela. Nous sommes en cours d'élaboration du socle commun, dont la définition sera publiée très bientôt. Nous nous sommes beaucoup inspirés des recommandations de la mission Périssol29, et nous insisterons sur la culture scientifique en suivant les préconisations de l'Académie des sciences, qui milite pour l'émergence d'un bloc « sciences et technique ». L'une des grandes erreurs des années passées fut en effet la segmentation, alors que mathématiques, physique et sciences de la vie et de la terre (SVT) peuvent, au collège, être enseignés par la même personne, comme le faisaient les PEGC. C'est tout à fait possible, mais difficile à faire avaler. J'ai ainsi constaté que l'enseignement scientifique dans les séries littéraires semble se résumer à l'écriture de textes sur des sujets variés, comme l'a montré un scandale récent à propos d'un sujet sur l'avortement proposé au baccalauréat... Le socle établira que sciences et technique forment un tout, l'objectif étant de donner aux citoyens une vision responsable des enjeux scientifiques, qu'il s'agisse de l'énergie, du nucléaire, des problèmes de l'information ou du bouleversement que représente l'irruption des sciences de la vie dans notre quotidien. Pour ce qui est des relations entre les filles et la science, je ne sais que vous dire, sinon que c'est un échec. M. Jean-Marie Rolland, président : Il apparaît qu'elles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons pendant tout le cursus mais qu'elles s'orientent moins vers les filières d'excellence. M. Christian Forestier : La féminisation du corps enseignant m'avait donné un espoir, mais il a été déçu. La difficulté tient à la représentation sociale, qui fait de la science une affaire de garçons. Mon collègue Jean-Marc Monteil m'a fait part à ce sujet d'une expérience éloquente, maintes fois réitérée. Prenez cent copies de mathématiques écrites par 50 garçons et 50 filles, faites-en deux piles en fonction du sexe des rédacteurs puis féminisez la moitié des prénoms des copies des garçons et masculinisez la moitié de celles écrites par des filles : les copies « masculines » seront systématiquement surnotées, quel que soit le sexe du correcteur ! Il n'y a pas une fille de plus qu'il y a cinquante ans dans la filière « sciences de l'ingénieur », et si elles sont présentes en S grâce à la biologie, elles sont totalement absentes de la filière STI. M. Jean-Marie Rolland, président : Cela s'explique-t-il par l'orientation en troisième ? M. Christian Forestier : Oui, et ces représentations font que le taux de féminisation des filières STI ne change pas, alors que BTS et IUT offrent des probabilités d'emploi bien supérieures à d'autres voies. Il est vrai que les lycées techniques ont longtemps été très machistes. Mais c'est maintenant une femme qui dirige l'Ecole des Arts et Métiers, et tout cela aurait dû évoluer. Sur ce point, l'Europe du Nord est moins touchée que nous. Par ailleurs, les grandes universités scientifiques sont, de toutes les universités celles qui accueillent le moins de boursiers, ce qui traduit une évolution sociale. Le statut des sciences a changé : on oriente vers les filières littéraires les enfants de milieu modeste, où ils ne sont pas forcément les mieux armés pour réussir, cependant que les classes aisées se réservent le monopole des classes scientifiques. On pourrait envisager une autre répartition des bourses, ou des bourses différenciées selon les disciplines. M. Jean-Marie Rolland, président : Voilà qui est très intéressant. M. Christian Forestier : Enfin, l'articulation entre l'enseignement du second degré et l'enseignement supérieur me paraît être un enjeu majeur pour notre pays. Or, selon moi, il n'y a pas assez d'étudiants en France, et ils sont mal orientés. * Audition de M. Gilles de Robien, ministre de l'Education nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, accompagné de M. Jean-Louis Nembrini, conseiller chargé de la pédagogie, du second degré et de la formation des enseignants, de M. Gilbert Knaub, conseiller chargé de l'enseignement supérieur et Mme Béatrice de Lavalette, conseillère chargée des relations avec le Parlement et les élus M. Jean-Marie Rolland, président : Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Vous connaissez les grands thèmes de nos travaux. Peut-être souhaitez-vous faire un exposé liminaire avant que nous en venions à nos questions. M. Gilles de Robien : Le sujet que vous traitez est très important, il est même capital pour l'avenir de notre pays. Avant de répondre précisément à vos questions, je souhaite vous dire dans quel esprit je conçois l'enseignement des sciences. Il est inutile de rappeler ici à quel point l'enseignement des mathématiques et des sciences expérimentales est important pour notre économie, pour notre recherche, pour notre industrie. Attention : je ne parle pas seulement des futurs prix Nobel ou médailles Fields, mais des ingénieurs, des techniciens supérieurs, de tous les professionnels qualifiés qui devront demain participer à notre développement intellectuel et économique. Si nous n'avons pas demain suffisamment d'ingénieurs, d'informaticiens, de chimistes, de physiciens, de bactériologistes, de biologistes, de professeurs de sciences, nous ne pourrons pas rester un grand pays ! Et ce n'est pas seulement un problème de quantité de scientifiques : il faut aussi penser à la qualité des formations que délivre notre système. Cela signifie donc que le défi ne consiste pas seulement à attirer des jeunes vers les carrières scientifiques, bref, à faire de la publicité pour ces filières et à organiser des campagnes de communication. Il est impératif de faire en sorte que ces filières soient d'excellent niveau et que les élèves étudient les sciences dès le plus jeune âge. C'est ainsi que nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le rapport que le Parlement avait adopté lors de la discussion du projet de loi pour l'avenir de l'école et qui consistent, d'ici 2010, à augmenter de 15 % le nombre d'étudiants suivant une formation supérieure scientifique hors santé et de 20 % le nombre des filles dans les séries scientifiques générales et technologiques de nos lycées. Je réunirai d'ailleurs le 16 mars l'ensemble des inspecteurs pédagogiques régionaux pour leur donner des instructions spécifiques pour la promotion de l'enseignement des sciences. Si nous voulons atteindre ces objectifs, il faut commencer par assurer aux élèves des fondations solides. Bref, rien ne se fera sans une école primaire de qualité. Il est impératif qu'elle assure l'acquisition des bases sans lesquelles on ne peut rien construire. Cette acquisition doit être ferme et assurée. Cela signifie que le but du primaire ne saurait être uniquement la découverte purement ludique, ou même inductive, des réalités mathématiques. Il faut apprendre de manière systématique, méthodique, progressive, les éléments essentiels de l'arithmétique. Le socle commun - pour lequel le Haut Conseil de l'éducation me remettra dans les tout prochains jours ses propositions - devra fixer très clairement la liste des connaissances et des compétences indispensables. Le primaire assurera les bases, le collège procédera à l'approfondissement. Vous le savez, j'ai déjà agi pour la lecture dans un esprit de bon sens, pour assurer les bases. Je veux agir dans le même esprit pour l'enseignement des sciences. D'ores et déjà nous agissons. L'orientation générale est très claire : il convient de rendre les enseignements de sciences moins éparpillés, moins éclatés, plus cohérents, et tous animés par un même objectif: la découverte de la démarche expérimentale. Il faut en effet que les élèves comprennent l'intérêt de la science, qu'ils y soient comme « accrochés ». C'est nécessaire, si l'on veut que l'enseignement le plus aride - qui est nécessaire - trouve en eux le ressort de la passion ! A l'école primaire, la nécessité de rendre plus effectif l'enseignement des sciences et de la technologie a été prise en compte. Le Plan de rénovation de l'enseignement des sciences et de la technologie à l'École - PRESTE - a été intégré au programme en 2002. Il vise deux objectifs essentiels : la construction des apprentissages par les élèves et la généralisation de l'enseignement scientifique dans toutes les classes. Il intègre pleinement la dimension expérimentale, puisqu'il encourage le développement de la méthode mise au point par les professeurs Charpak, Léna et Quéré et connue sous le nom de La main à la pâte. Pour faire des scientifiques, il faut non seulement de bons élèves, mais des élèves qui ont la curiosité scientifique, qui ont compris en quoi consiste l'aventure intellectuelle du découvreur ! Pour cela, la démarche de La Main à la Pâte est très précieuse. S'agissant des mathématiques : le programme est centré sur la résolution de problèmes. Une place importante y est consacrée. Le calcul n'acquiert totalement son sens et sa légitimité qu'à partir du moment où il est un outil que les élèves sont capables d'utiliser pour traiter des problèmes sur les quantités ou sur les grandeurs. L'enseignement de la géométrie, quant à lui, vise un double objectif : permettre à tous les élèves de maîtriser l'espace ordinaire - se situer, se déplacer, articuler différents points de vue, utiliser un plan... - et de s'approprier de premières notions géométriques nécessaires. J'en viens au collège, où de nouveaux programmes de sciences entrent en vigueur. Ils sont le fruit du travail remarquable conduit par le professeur Jean-François Bach, membre de l'Institut. Avec des experts des trois disciplines : mathématiques, biologie et sciences physiques, il a donné une véritable cohérence aux enseignements scientifiques, qui se répondent et s'épaulent. L'intérêt des mathématiques pour les autres sciences est ainsi, par exemple, bien mis en évidence. Les élèves sont amenés de la sorte à comprendre que la science est une manière totale d'aborder la réalité et de la décrypter. Ils ne l'abordent pas comme une collection de disciplines, mais comme une méthode. Ces nouveaux programmes permettent ainsi le développement d'une véritable culture scientifique. Ils rattachent en outre l'enseignement des sciences à des enjeux qui manifestent clairement l'intérêt de la science : je pense par exemple à l'énergie, au développement durable, à la météorologie et à la climatologie, à la santé, etc. Des progrès très importants ont ainsi été accomplis par les enseignants, soutenus par les nombreuses actions de formation menées tant sur le plan national que dans les académies, les départements et les circonscriptions du premier degré. J'ajoute que la convention-cadre signée le 7 avril 2005 entre l'Académie des sciences et le ministère de l'Éducation nationale permettra de conduire une expérimentation en classe de sixième et de cinquième dans le prolongement de La main à la pâte à l'école primaire. Cette expérimentation s'appuie sur la mise en œuvre des programmes rénovés ; elle vise les grands objectifs suivants : atténuer la difficulté de la transition entre l'école et le collège ; construire un enseignement scientifique intégré - un même professeur enseigne les programmes de sciences de la vie et de la terre (SVT), technologie et physique-chimie - ; mettre en œuvre la démarche d'investigation inscrite dans les nouveaux programmes des disciplines scientifiques ; développer la culture scientifique dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences. J'en viens enfin au lycée. La même logique est à l'œuvre : nous devons développer le goût de la science en développant et en approfondissant la démarche expérimentale. C'est pourquoi, en physique-chimie et biologie, l'enseignement met désormais beaucoup plus l'accent sur cette démarche. Le baccalauréat scientifique comprend d'ailleurs désormais une évaluation des compétences expérimentales. Enfin, pour évaluer l'efficacité de cet enseignement, nous mettons en place un nouvel outil : l'évaluation, conduite par la direction de l'évaluation et de la prospective (DEP), permettra d'établir un état des lieux - un niveau de référence - des compétences et connaissances des élèves à la fin du primaire et du collège. Elle sera testée durant cette année scolaire et sera menée en 2007-2008. Renouvelée dans sept ans elle donnera une image de l'enseignement scientifique apporté par les nouveaux programmes et le renforcement des pratiques pédagogiques. Je propose que nous en venions maintenant à vos questions. M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous remercie. Le nombre de bacheliers scientifiques a diminué de 6,4 % depuis 10 ans. Même si les disciplines littéraires connaissent une désaffection encore plus forte, comment expliquer ce phénomène et comment l'enrayer ? M. Gilles de Robien : Le nombre total de bacheliers S est en fait globalement stable depuis dix ans : 137 000 lycéens ont obtenu leur baccalauréat dans cette série à la session 2005, soit 2 000 de moins seulement qu'en 1995. Le fléchissement de leur nombre est ainsi beaucoup plus limité que celui du nombre de bacheliers généraux au cours de la même période car c'est en réalité le nombre de bacheliers littéraires qui diminue ; les bacheliers de la série S représentent aujourd'hui 50 % des bacheliers généraux, soit deux points de plus qu'il y a dix ans. Dans le même temps le nombre des lauréats de la série STI stagne autour de 35 000. La proportion de bacheliers scientifiques dans une classe d'âge tend même à s'améliorer : puisqu'elle est passée, de 1997 à 2003, de 15,7 à 16,9 %. La population des bacheliers S continue à se féminiser lentement : la part des filles est passée de 42 % en 1995 à 47 % en 2005. Elle progresse également en STI, même si elle reste marginale : 9 %. M. Jean-Marie Rolland, président : La dernière enquête PISA donne, pour les jeunes Français, des résultats à peine supérieurs à la moyenne dans l'ensemble, les écarts étant très importants entre les très bons élèves et les autres. On constate aussi parmi les élèves un véritable phénomène d'anxiété - chez les filles plus que les garçons - lorsqu'ils font des mathématiques. Quels enseignements peut-on tirer de ces résultats ? M. Gilles de Robien : L'évaluation internationale PISA 2003, menée dans une quarantaine de pays, a principalement porté sur la culture mathématique des élèves de 15 ans, c'est-à-dire sur la capacité des jeunes arrivant en fin de scolarité obligatoire à utiliser leurs connaissances et savoir-faire mathématiques pour faire face à des situations de la vie quotidienne. Elle ne vise pas l'évaluation des acquis disciplinaires. Globalement, les élèves français ont des résultats significativement supérieurs à ceux de la moyenne des pays de l'OCDE et la proportion d'élèves aux performances les plus faibles est sensiblement plus réduite en France que dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Par ailleurs, la moitié de nos élèves de 15 ans ont en moyenne des résultats qui les situent au sommet du classement international des pays. Les résultats de l'enquête sont ensuite variables selon les champs explorés. Ainsi la France obtient un score supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE pour les représentations graphiques, un score moindre pour les exercices à support géométriques et se situe seulement dans la moyenne, dans le domaine des statistiques et des probabilités, les élèves de 15 ans n'ayant reçu aucun enseignement en probabilités au collège. C'est pourquoi, le fait d'introduire une approche des probabilités dans les nouveaux programmes de mathématiques pour la classe de troisième est tout à fait dans l'esprit de ce qui est demandé dans PISA. Il faut sans doute prendre en compte les conditions dans lesquelles les élèves passent ces épreuves et leur anxiété. Le constat d'une plus ou moins grande anxiété vis-à-vis des mathématiques, doit cependant être analysé avec prudence : les niveaux de l'anxiété des élèves ne sont pas corrélés à leurs résultats. Il est, en revanche, plus préoccupant que les filles déclarent une anxiété nettement plus grande vis-à-vis des mathématiques que les garçons, et ce dans les 41 pays participants. M. Jean-Marie Rolland, président : Dans de nombreux pays étrangers l'apport de la recherche en psychologie, en didactique et en science de l'éducation constitue un outil précieux pour faire progresser les pratiques des enseignants. Il semble qu'en France ce secteur de recherche soit un peu délaissé n'est-ce pas regrettable ? M. Gilles de Robien : L'apprentissage met en jeu des processus complexes au sein de notre cerveau. Pour les appréhender nous avons besoin de toutes les connaissances, de toutes les compétences aussi bien théoriques que pratiques. C'est donc en s'appuyant de façon équilibrée sur des résultats dans ces deux domaines de recherche qu'on pourra aider les enseignants à faire progresser leur pratique de l'enseignement. Les sciences pédagogiques se sont surtout développées dans les années 1970 et ont apporté des avancées incontestables dans la manière d'enseigner. Nous ne sommes pas en retard dans ce domaine. J'aurais même tendance à dire que nous avons un peu trop donné la primauté à ces sciences par rapport aux apports de recherches plus en « amont » sur le fonctionnement du cerveau ainsi qu'aux recherches en didactique des disciplines. Les neurosciences et la psychologie cognitives sont récentes - moins de 15 ans - et connaissent un développement très rapide. Ces recherches ouvrent de vastes champs qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, et en particulier la manière dont il apprend, notamment dont il apprend à lire. Sans prétendre à la vérité absolue, ces enquêtes apportent des éclairages intéressants sur la manière d'apprendre, qui peuvent être utiles tant pour la didactique que pour la science de l'éducation. Je suis convaincu qu'il faut pour cela créer davantage de passerelles entre ces sciences « amont » et leurs applications « aval ». Quant aux recherches en didactique des disciplines, je pense que ce qui est effectué dans les instituts de recherche pour l'enseignement des mathématiques, où se rencontrent des enseignants-chercheurs et des pédagogues, pourra être étendu aux autres disciplines dans le cadre de l'intégration des IUFM à l'université, qui est un des gros chantiers des mois qui viennent. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous avez évoqué le PRESTE. Mais les rapports publiés en février 2002 et en octobre 2005 montrent qu'on a du mal à obtenir d'un grand nombre de maîtres qu'ils utilisent la totalité de l'horaire de sciences prévu. Comment progresser plus vite ? Pourquoi les activités de La main à la pâte, dont tout le monde constate les avantages, ne sont-elles pas généralisées dans toutes les écoles ? Nous avons cru comprendre que 10 % seulement des classes étaient concernées. M. Gilles de Robien : À l'école primaire, il faut rendre les sciences attractives et mieux former les maîtres. C'est dans ce cadre, que le PRESTE a été mis en place en 2000 au cycle III - CE2, CM1 et CM2 - puis étendu en 2002 aux autres cycles et surtout intégré aux programmes. Des documents d'application et d'accompagnement, nombreux et nourris, ont été distribués aux enseignants. Ce plan de rénovation s'est appuyé sur l'expérience de La main à la pâte proposée par Georges Charpak, Prix Nobel, et a bénéficié du soutien de l'Académie des sciences. Il a été piloté par l'Inspection générale de sciences physiques. La priorité est actuellement la formation des maîtres dans le domaine des sciences expérimentales et de la technologie, et l'accompagnement par les équipes de circonscriptions - inspecteurs, conseillers pédagogiques -. Pour la première fois cette année, les candidats au concours de professeur des écoles auront obligatoirement une épreuve de sciences. Au collège, il faut donner du sens à l'enseignement scientifique et le mettre en perspective. Il faut davantage d'interdisciplinarité. Les « thèmes de convergence » que je mets en place y contribueront. Il faut enfin faire découvrir les carrières scientifiques : c'est l'une des finalités de la découverte professionnelle. La place des enseignements scientifiques au collège a été réaffirmée par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005. Les éléments de mathématiques et la culture scientifique constituent, conformément à l'article 3 de la loi, des composantes du socle commun de connaissances et de compétences qui doit être acquis par tous les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. Les programmes de sciences du collège ont été entièrement rénovés en 2004-2005 sous l'autorité du professeur Jean-Pierre Bach. Au lycée, la priorité est de susciter chez les élèves une orientation vers les filières scientifiques et technologiques, à l'issue de la seconde. Un effort particulier est entrepris pour conduire les jeunes filles vers les carrières scientifiques. Pour cela, il faut privilégier la démarche pédagogique : l'introduction récente de l'évaluation des capacités expérimentales au baccalauréat, tant en physique-chimie qu'en science de la vie et de la terre, doit conduire à des pratiques plus interactives, mettant l'accent sur le questionnement. Le rôle des inspecteurs et des animateurs pédagogiques est très important dans la motivation des enseignants. L'enseignement des sciences a longtemps été délaissé à l'école élémentaire. C'est un effort au long cours qu'il faut entreprendre, les progrès sont trop lents, j'en ai conscience. La main à la pâte est un enseignement vivant, concret, bref à la portée des élèves supposent des maîtres formés à la pédagogie active et maîtrisant un minimum de connaissances et de concepts scientifiques. Nous nous efforçons donc, d'une part, de recruter davantage de professeurs des écoles de formation scientifique et, d'autre part, de favoriser une initiation aux sciences dans le cadre des nouvelles épreuves du concours de recrutement. M. Jean-Marie Rolland, président : Quels sont selon vous les obstacles à la diffusion de La main à la pâte ? M. Jean-Louis Nembrini : On se heurte d'abord à l'absence de compétences scientifiques des maîtres recrutés ces vingt dernières années. Promouvoir une telle réforme nécessitera qu'on s'y consacre pendant au moins dix ou quinze ans. De ce point de vue, la décision que vient de prendre le ministre d'instituer une épreuve de science obligatoire au concours aura des effets importants puisqu'elle obligera à avoir reçu une formation en amont : pour devenir professeur des écoles en étant titulaire d'une licence en lettres, on devra compléter sa formation initiale par un module de remise à niveau en sciences. Même si la totalité des horaires qui leur sont en principe destinés ne sont pas utilisés, il y a toutefois déjà eu des progrès, plutôt rapides en matière de sciences : il y a cinq ans, il n'existait pratiquement rien. La démarche expérimentale et la culture scientifique sont en train de se développer et les enseignants osent désormais se lancer dans la pédagogie des sciences. Le rapport remis en 2005 met l'accent sur le fait que le cahier des charges des IUFM peut-être un levier pour les années à venir. M. Jean-Marie Rolland, président : Ma question suivante portait précisément sur ce cahier des charges. M. Gilles de Robien : Il est en cours d'élaboration. Il ne limitera pas la formation des enseignants aux deux années d'IUFM, mais envisagera également les années passées à l'université. Ainsi, il me semble que les étudiants se destinant au professorat des écoles doivent pouvoir bénéficier d'un parcours de licence comprenant un module dans un champ disciplinaire différent de leur principale discipline. En effet, une très grande majorité de futurs professeurs des écoles sont titulaires d'une licence relevant des sciences humaines et sociales et éprouvent des difficultés lorsqu'il s'agit d'enseigner les disciplines scientifiques. Les professeurs doivent, au sortir de leur formation, être en situation de pourvoir enseigner les sciences. Les contenus qui leur sont dispensés prennent donc essentiellement en compte les programmes d'enseignement. En ce qui concerne les professeurs du second degré, la formation devra montrer que l'enseignement d'une discipline scientifique s'appuie nécessairement sur des connaissances relevant d'une ou plusieurs disciplines connexes : mathématiques, physique, chimie, science et vie de la terre. M. Jean-Marie Rolland, président : Ne conviendrait-il pas d'allonger la durée de la formation des enseignants stagiaires à l'IUFM, qui est actuellement de sept mois, stages en classe compris ? M. Gilles de Robien : La durée de la formation des enseignants stagiaires à l'IUFM est semblable à celle de la plupart des autres pays européens. Le séquençage est, en revanche, différent. En effet, beaucoup de pays d'Europe abordent en même temps les aspects disciplinaires et les aspects professionnels du métier d'enseignant, alors que la France, à l'instar de quelques autres pays, réserve la formation professionnelle à l'année qui suit le concours. Il est possible, dans le cadre de l'intégration des IUFM aux universités, d'anticiper certains éléments de professionnalisation, qui peuvent trouver leur place dans les parcours universitaires, dès lors que le projet professionnel est formulé par les étudiants. Pour les professeurs des écoles, il me semble que nous aurons intérêt à un allongement significatif de la formation par alternance. Celle-ci, actuellement de neuf semaines réparties en stages de trois semaines dans les écoles, pourrait être allongée, portant de 12 à 15 semaines la durée totale de la formation « en situation » dans les écoles. M. Jean-Marie Rolland, président : La mission a constaté une réelle désaffection des bacheliers scientifiques pour le premier cycle universitaire notamment en physique-chimie. Cela vous paraît-il tenir aux conditions d'études ou au manque de perspectives professionnelles, dans la mesure où les étudiants semblent plus intéressés par les classes préparatoires scientifiques ou par les IUT que par l'université ? M. Gilbert Knaub : Il s'agit surtout d'un problème d'orientation : les bacheliers sont persuadés que l'enseignement supérieur scientifique ne prépare qu'à l'enseignement et à la recherche, ce qui en détourne tous ceux qui n'envisagent pas de se lancer dans un parcours long pour cela. Ce qui fait d'abord défaut, c'est donc une lisibilité de ce parcours étudiant, dont on pense en outre qu'il conduit surtout à étudier les notions abstraites et complexes. Il est vrai par ailleurs que ceux qui recherchent en priorité une insertion professionnelle sont tentés, pour des questions de débouchés, de se tourner d'abord vers les écoles d'ingénieurs et les filières courtes. Les choses sont toutefois en train d'évoluer de façon fondamentale avec ce que font un certain nombre d'universités comme Lille-I. La rénovation des DEUG engagée dans les années 1990 les a par ailleurs mieux adaptés à l'état réel des lycéens à la sortie du lycée. On sait en effet que le passage à l'enseignement supérieur est souvent pour eux un véritable choc. La progressivité, la constitution de petits groupes et le tutorat vont donc tout à fait dans le bon sens et portent leurs fruits, avec une augmentation du nombre des inscrits à l'université. Ce mouvement s'accompagne d'un travail en amont, par l'organisation de réunions dans les lycées et par des visites de lycéens dans les laboratoires. Par ailleurs, la réforme LMD (licence, master, doctorat) repose sur la notion de parcours étudiant en fonction de ce projet d'insertion. Dans ce cadre, il est désormais possible de combiner l'étude d'une science dure avec des modules de gestion ou de sciences humaines. Ainsi, pour devenir journaliste scientifique, il aurait autrefois fallu commencer par faire des sciences pour disposer du bagage nécessaire, aujourd'hui, grâce aux modules, il est possible de mener de front l'ensemble des études nécessaires afin d'aller progressivement vers son insertion professionnelle. Même si on constate une certaine stabilité des effectifs de bacheliers S, il ne faut pas oublier qu'on a assisté ces dernières années à une multiplication du nombre de classes préparatoires attirant ces étudiants. Un schéma national est en cours de préparation, qui va réviser les perspectives. Enfin, les filles, dont on sait qu'elles sont nombreuses dans les filières universitaires et qu'elles y réussissent très bien, commencent depuis quatre ou cinq ans à être plus sensibles à ces disciplines. M. Gilles de Robien : J'ajoute que les bacheliers S se dirigent aussi souvent vers les disciplines non scientifiques du DEUG - droit, sciences économiques, lettres et sciences humaines - tandis que la filière STAPS continue à attirer toujours plus de bacheliers S. Une majorité des bacheliers S qui n'ont pas poursuivi leurs études dans les disciplines scientifiques de l'université, hors santé et IUT, l'expliquent non par une absence d'intérêt pour les sciences mais avant tout le choix d'une insertion professionnelle. Ainsi, 47 % des bacheliers S qui n'ont pas poursuivi en DEUG scientifique citent en première raison que cette filière ne correspond pas à leur projet professionnel et 14 % pensent qu'elle ne mène qu'à des métiers d'enseignement ou de recherche. Ils sont même 35 % à évoquer ce dernier argument parmi leurs deux principales raisons : la non-poursuite en DEUG scientifique paraît ainsi relever en partie d'un manque de visibilité des débouchés professionnels que peut procurer cette filière en dehors de ces métiers. M. Daniel Prévost : Ma question porte sur les technologies de l'information et de la communication (TIC). Y aura-t-il un plan de formation pour les enseignants dont un très grand nombre n'ont aucune compétence en la matière ? Où en est-on par ailleurs du brevet informatique et Internet, ou B2i ? Une évaluation a-t-elle été menée ? M. Jean-Louis Nembrini : Le lancement du B2i et l'introduction de l'informatique dans le socle commun obligent à un énorme travail de formation des maîtres, que devra prendre en compte le cahier des charges des IUFM. Un gros effort a aussi été fait depuis vingt ans en matière de formation continue, mais l'institution a à chaque fois été rattrapée par le progrès : nous avons commencé par former à la programmation avant de nous apercevoir que cela ne servait plus à rien, puis nous avons formé aux logiciels de base mais il a rapidement fallu passer à Internet. Quoi qu'il en soit, il faut déterminer des plans de formation cohérents, ce qui répond d'ailleurs souvent aux souhaits des enseignants. Une réforme importante est également intervenue avec l'introduction d'une épreuve informatique dans l'agrégation de mathématiques : au lieu de créer une agrégation spécifique, on a préféré procéder de la sorte et c'est une voie qui pourrait sans doute être suivie pour d'autres disciplines scientifiques. Cela supposerait bien sûr de disposer des équipements nécessaires pour faire passer les concours, mais la démarche est intéressante en ce qu'elle montre qu'il ne s'agit pas d'un champ spécifique mais d'un accompagnement des autres disciplines. M. Yvan Lachaud : Disposez-vous déjà de chiffres sur le B2i ? A-t-on une idée des difficultés rencontrées et d'éventuelles disparités ? M. Jean-Louis Nembrini : Les statistiques globales n'ont pas vraiment de sens et il convient de procéder à une étude fine, académie par académie. M. Frédéric Reiss : Nous avons vu, dans d'autres pays, qu'on mettait l'accent dès les petites classes sur la langue maternelle et sur les mathématiques. Par ailleurs, quand on voit que la moitié des élèves qui sortent de terminale S ne font pas de sciences ensuite, on se dit qu'il y a un réel problème. Peut-être les filières étaient-elles plus claires auparavant. M. Gilles de Robien : Il est vrai que la France était jusqu'ici plutôt en avance sur les autres pays européens dans le niveau des connaissances en maths ; il ne faudrait pas que nous perdions cette avance. M. Frédéric Reiss : On dit parfois que la géographie devrait être traitée de manière plus scientifique, notamment à partir des statistiques. Quel est votre sentiment à ce propos ? M. Jean-Louis Nembrini : La géographie nécessite en effet aujourd'hui la maîtrise des statistiques, mais cela s'inscrit tout à fait dans les thèmes de convergence dont a parlé le ministre, l'évolution du programme de sciences au collège n'ayant pas encore produit tous ses effets. Il est vrai que l'époque où la géographie donnait à connaître le monde par les mots est bien finie et qu'on le perçoit désormais surtout par les chiffres. Son enseignement passe donc aussi par une formation scientifique, il doit s'appuyer sur celui des mathématiques : c'est bien l'idée de la transversalité. La réforme de l'agrégation de géographie prend d'ailleurs en compte cette approche. M. Yves Boisseau : Au cours de nos auditions, on a dressé devant nous des états des lieux très divergents à propos de l'entrée en sixième, de la situation au collège ou des compétences des élèves. Et il est vrai que dans le domaine de l'éducation les moyennes statistiques ne veulent pas dire grand-chose : enseigner les sciences dans une petite école du Pays d'Auge et en Seine-Saint-Denis n'a pas grand-chose à voir. Nous avons vu, en Suède, des expériences intéressantes sur des élèves issus de milieux difficiles. Est-il aujourd'hui possible d'affiner aussi notre approche ? M. Jean-Louis Nembrini : L'extension de La main à la pâte aux classes difficiles est un élément de réponse, car il est très important de donner ainsi le goût des sciences. La marge de progression réside plutôt dans l'acte pédagogique que dans l'augmentation des horaires. Avec La main à la pâte, pour laquelle Georges Charpak s'est d'ailleurs inspiré de l'expérience menée dans les quartiers difficiles de Chicago, l'élève est acteur même s'il ne maîtrise pas bien la langue et on valorise son expérience. M. Gilles de Robien : J'ai suggéré qu'on s'appuie aussi sur cela dans le cadre des collèges « ambition réussite ». M. Jean-Marie Rolland, président : Nous nous rendrons après-demain à Clichy-sous-Bois pour assister à une séance de La main à la pâte. Au cours de nos auditions, nous avons constaté que plus l'autorité du chef d'établissement était importante, puis il se comportait en véritable chef d'équipe, mieux les choses fonctionnaient. M. Gilles de Robien : J'envisage de proposer aux syndicats enseignants que des délégations se rendent dans un certain nombre de pays européens d'ici la fin de l'année. C'est ce que vous même avez fait, pensez-vous que cette expérience pourrait nous être utile ? Avez-vous vous trouvé dans d'autres pays, par exemple en Finlande, des leçons dont nous pourrions nous inspirer ? Je connais déjà une expérience menée dans les faubourgs de Londres avec deux enseignants par classe, l'un devant les élèves et l'autre au milieu d'eux afin d'apprécier ce qui se passe dans la classe. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous pouvons vous conseiller de vous rendre en Finlande, pour la qualité de l'enseignement, et en Suède, pour la réussite de l'intégration. Le contexte de la Finlande est quand même très différent du nôtre, avec des enfants isolés géographiquement et pratiquant une langue qu'ils sont seuls à parler. Le choix qui a été fait est celui de la réussite de la « cohorte », tous les enfants passant dans la classe supérieure afin d'éviter la rupture entre les bons et les moins bons. Le métier d'enseignant est particulièrement mis en valeur dans la société et il y a dix candidats pour un poste. En revanche, s'agissant des conditions de travail et du nombre d'enfants par classe, vous pouvez dire aux syndicats enseignants que nous avons vu des choses tout à fait similaires à ce qui se passe chez nous. En Suède, nous avons vu une école avec 98 % de non-nationaux et 44 nationalités différentes, sans surveillant ni conseiller d'éducation. C'est la force personnelle de la proviseure et la qualité de l'équipe enseignante qui faisaient que la maison était parfaitement tenue. M. Daniel Prévost : En Finlande, il y a un seul syndicat, la dernière grève remonte à quinze ans et les enseignants passent 35 heures dans les établissements... M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons aussi pu observer l'importance de l'ouverture aux parents. M. Gilles de Robien : Nous y travaillons particulièrement dans le cadre de la future charte des parents. J'aimerais que les enseignants soient plus disponibles pour cela. Dans le cadre des collèges « ambition réussite », une classe par établissement sera destinée à l'accueil des parents. M. Jean-Marie Rolland, président : Merci beaucoup à vous et à vos collaborateurs. * Audition de M. Jean-Pierre Kahane, professeur émérite de mathématiques, membre de l'Académie des sciences, président de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques M. Jean-Marie Rolland : Vous êtes professeur de mathématiques et nous avons beaucoup parlé des maths dans cette mission, en particulier à propos de la perte d'attractivité des matières scientifiques pour les jeunes Français, dont certains voient les effets dans leurs résultats à l'enquête PISA. Plusieurs de nos interlocuteurs ont insisté sur le rôle sélectif que jouent les mathématiques dans notre société et nous avons aussi traité de leur place dans les relations entre les femmes et les sciences, autour de l'idée d'une certaine anxiété, en particulier chez les jeunes filles, face aux maths. Ce qui nous intéresse surtout, ce sont vos idées et les solutions que vous proposez pour que notre pays dispose des chercheurs, des ingénieurs et des techniciens dont il a besoin. M. Jean-Pierre Kahane : S'agissant de la désaffection, il est intéressant de regarder ce que dit précisément l'enquête PISA. Quand on leur demande si la phrase « Je m'inquiète souvent en pensant que j'aurai des difficultés en cours de mathématiques » correspond à leur sentiment, les jeunes Français répondent oui à 61 %, alors que la moyenne de l'OCDE est de 57 %. Pour la phrase « Je suis très tendu(e) quand j'ai un devoir de mathématiques à faire. » : France 53 %, moyenne OCDE 29 %. « Je deviens très nerveux (nerveuse) quand je travaille à des problèmes de mathématiques » : France 39 %, moyenne OCDE 29 %. « Je me sens perdu(e) quand j'essaie de résoudre un problème de mathématiques » France 37 %, moyenne OCDE 29 %. « Je m'inquiète à l'idée d'avoir de mauvaises notes en mathématiques. » : France 75 %, moyenne OCDE 59 %. Sur les performances des élèves à ces tests, les sociétés mathématiques de France et de Finlande et plusieurs autres sociétés savantes ont mené une étude conjointe qui permet de porter une critique forte sur les modalités de questionnement des élèves. Les Espagnols sont très mécontents à ce propos. Vous connaissez, je suppose cette anecdote : quand on demande aux jeunes Finlandais s'ils aiment l'école, ils répondent « oui », quand on leur demande pourquoi, ils répondent : « parce qu'on y mange bien »... Je n'ai pas de « solutions » à proposer, mais je puis vous faire part de mes réflexions. D'ailleurs la plupart n'étaient pas les miennes à l'origine, elles le sont devenues dans l'exercice des différentes responsabilités qui ont été les miennes, en particulier en tant que président de la commission internationale de l'enseignement mathématique et président de la commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques qu'avait créée M. Allègre. Ces réflexions tournent essentiellement autour de l'idée des laboratoires de mathématiques. Un certain nombre de mes collègues montent sur leurs grands chevaux quand ils entendent parler de cela : pour eux les mathématiques sont une science qu'on pratique dans sa tête, à la rigueur avec des outils, mais pour laquelle il n'est nul besoin d'un laboratoire. L'idée est pourtant ancienne puisqu'elle remonte au début du XXe siècle, époque d'une grande réflexion et de la création de la commission internationale. L'un de ceux qui ont porté les réformes de l'enseignement des sciences était un mathématicien, Émile Borel. Dans un discours superbe sur les travaux pratiques d'enseignement des mathématiques prononcé le 3 mars 1904, il dit d'abord que les professeurs devraient davantage se soucier du calcul mental et du calcul numérique et qu'il ne devrait pas y avoir dans les lycées un enseignement de dessin graphique indépendant de l'enseignement de la géométrie. La seconde partie de son discours débute ainsi : « Mais pour amener, non seulement les élèves, mais aussi les professeurs, mais surtout l'esprit public à une notion plus exacte de ce que sont les Mathématiques et du rôle qu'elles jouent réellement dans la vie moderne, il sera nécessaire de faire plus et de créer de vrais laboratoires de Mathématiques ». Il explique ensuite que dans un tel laboratoire, il faut du bois, du fil, et même un préparateur qui soit un menuisier. Le résultat, c'est qu'il y a eu un seul laboratoire créé, à l'École normale supérieure. Dans la réflexion de la commission sur l'enseignement des mathématiques, lorsqu'il s'est agi de la géométrie, du calcul, des statistiques et surtout de l'informatique, l'idée du laboratoire a resurgi. J'étais la semaine dernière à un colloque organisé sur ce thème à Maubeuge, ville sinistrée mais à l'activité intellectuelle remarquable. Il y avait des participants étrangers, l'inspectrice générale, des responsables des laboratoires de Montpellier, de Lille, de Massy-Palaiseau. J'étais chargé de l'introduction et j'ai rappelé que la commission sur l'enseignement des mathématiques avait proposé au ministre mais aussi aux professeurs de créer dans tous les lycées et collèges des laboratoires de mathématiques semblables aux laboratoires de physique-chimie et de biologie des lycées, pourvus de locaux propres, de matériel, en particulier informatique, de livres et de documents, afin de rassembler les élèves par petits groupes et de servir de salles de réunion et de travail aux professeurs. Les activités de certains clubs mathématiques ou de l'association Maths en jeans, ainsi que, dans d'autres pays, les activités expérimentales, les musées et expositions où collaborent professeurs et élèves, préfigurent une partie des activités à venir dans ces structures permanentes que seraient les laboratoires. Ils seraient des lieux privilégiés pour la rencontre entre chercheurs, enseignants et élèves. En donnant une nouvelle image des mathématiques et de leur aspect expérimental, ils favoriseraient les relations interdisciplinaires ; ils pourraient être en lien avec les mathématiciens des universités les plus proches. Des expériences existent aussi en France : au lycée professionnel Louis-Blériot de Besançon, certaines activités s'apparentent à celle d'un laboratoire, avec des travaux donnant lieu à exposition et mettant les élèves en valeur. À Massy-Palaiseau, c'est au lycée technique que se développe un laboratoire avec, qui plus est, un département de mathématiques. À Montpellier, le laboratoire permet des relations nouvelles avec les professeurs de physique et de biologie. On le voit le mouvement démarre lentement, mais il a démarré. Le rapport que j'ai établi a été remis aux ministres successifs de l'éducation nationale. Seul Jack Lang m'a reçu, trois jours avant de quitter son poste, et son attention a été retenue par les aspects relatifs à la formation des enseignants et aux laboratoires de mathématiques. Il a immédiatement envoyé une lettre circulaire aux recteurs et à la direction de l'enseignement secondaire afin de recommander la création de laboratoires, soulignant : « Une proposition me semble particulièrement pertinente. La commission, constatant l'importance de plus en plus reconnue de l'aspect expérimental dans la construction des savoirs mathématiques, suggère la création dans les établissements scolaires d'ateliers ou de laboratoires de mathématiques. » Peut-être aurais-je dû faire alors le siège de la direction d'enseignement secondaire pour obtenir la création effective des laboratoires. Je ne l'ai pas fait, notamment parce qu'il me semblait qu'il y avait dans la lettre de Jack Lang des indications assez précises sur les moyens à engager. Je n'ai pas pour autant plaidé coupable lors du colloque de Maubeuge parce que, même si cela a pris quatre ans, aujourd'hui ce mouvement part non pas d'en haut, mais de la volonté des professeurs eux-mêmes, avec l'agrément de chefs d'établissement et avec le concours d'élèves. Les premières expériences sont très favorables. Cela tient d'abord au fait que s'instaurent de la sorte des nouveaux rapports, entre professeurs de différentes disciplines, mais aussi entre le professeur et l'élève : la relation n'est pas du tout la même quand, dans une salle, chaque élève à son ordinateur portable qui appartient au laboratoire, quand il manipule, quand le professeur est un conseiller qui répond aux questions, tandis que les élèves ont une grande liberté dans le choix des méthodes voire des sujets. Les rapports changent aussi entre enseignants du secondaire, professeurs du supérieur et chercheurs. Il m'arrive d'intervenir dans les lycées et de parler devant plusieurs classes à la fois, l'impact de mon discours serait bien plus fort si j'allais visiter un laboratoire de mathématiques : il n'y aurait que 10 élèves, mais au moins nous travaillerions ensemble. Dans nos rapports, nous nous sommes préoccupés non pas de ce qu'on peut faire tout de suite, mais des perspectives pour ce qu'on pourrait faire plus tard. Car il y a beaucoup de portes d'entrée dans les mathématiques. L'informatique notamment trace des pistes qu'on n'a pas encore assez explorées. Que les choses soient claires : nous ne demandons pas à ce qu'on alourdisse les programmes car ce serait une catastrophe, mais qu'on traite dans les laboratoires des sujets qui sont en dehors de ce qu'on enseigne en classe. Ce serait séduisant pour les professeurs comme pour les élèves, et très formateur. Il s'agit aussi de donner aux mathématiques une couleur expérimentale : on cherche, on explore, on construit des exemples et des contre-exemples, on formule et on teste des hypothèses. C'est cette activité que tous les mathématiciens professionnels connaissent. On dispose des instruments pour mener des expérimentations numériques et graphiques totalement nouvelles pour l'humanité. C'est stimulant pour les élèves mais aussi pour l'enseignant, qui aborde d'une nouvelle façon de nouveaux sujets. Ces pistes tracées, je veux insister sur ce qui me paraît de votre ressort si vous êtes convaincus qu'il convient de les explorer. Pour que les laboratoires existent, il faut des locaux. Il est possible d'y consacrer les salles nécessaires à l'occasion des plans de rénovation des lycées, qui dépendent des conseils régionaux. Il convient donc que les chefs d'établissement pensent à inclure ces locaux et leur équipement dans les plans de rénovation. Cet équipement peut être assez important et comprendre une participation à l'achat des logiciels et, ce qui serait préférable, une participation à l'élaboration de logiciels libres qui exigent néanmoins certains investissements. Ce problème se pose concrètement au lycée technique de Massy dans sa collaboration avec l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique : il faut dégager quelques moyens pour qu'au lieu d'acheter des logiciels très chers, on construise des logiciels à la disposition de tous. Pour que les laboratoires fonctionnent, il faut que les professeurs y aient une partie de leurs services d'enseignement, comme en physique et en biologie. Aujourd'hui, ils peuvent au mieux obtenir des heures supplémentaires académiques, mais elles ne sont jamais définitivement acquises. Pour que les choses changent, la pression politique peut être déterminante. Les effets des laboratoires sur la motivation sont également importants : les professeurs, qui eux-mêmes s'intéressent davantage à cet enseignement, observent que les élèves sont plus impliqués, qu'ils commencent à apprécier les mathématiques et à voir les liens avec d'autres choses. Outre l'informatique, il devrait y avoir dans les laboratoires du bois, de la matière plastique, des balances, des Lego, des robinets, un pneu qui permet nombre d'exercices sur la géométrie plane. Car si les polyèdres, les figures, les constructions géométriques peuvent se faire sur ordinateur, ils doivent aussi être faits à la main : on doit pouvoir plonger les polyèdres dans l'eau pour voir comment se comportent les constructions planes ; on doit pouvoir lier la notion de nombre et la notion de grandeur par l'intermédiaire de la notion de mesure, qui est commune aux mathématiques et à toutes les disciplines expérimentales. Bien sûr, on a rectifié beaucoup des anciennes aberrations pédagogiques et scientifiques, mais on n'a pas encore donné aux mathématiques l'impulsion nécessaire. Vous parliez de la désaffection des élèves, mais je pense aussi à celle du public et des administrations. Un rapport d'un professeur de mathématiques à l'école d'ingénieurs de Nantes montre qu'on est passé de 180 heures de mathématiques en première année à 90 heures au motif que les ingénieurs qui sortent des écoles se voient confier des tâches d'encadrement et que ce qu'on leur apprend en mathématiques n'est pas utile. Cela montre qu'il faut vraiment réfléchir à ce que les mathématiques apportent. M. Jean-Marie Rolland, président : Qu'avez-vous à nous dire sur la formation des enseignants, notamment des professeurs des écoles. M. Jean-Pierre Kahane : Très majoritairement, les professeurs des écoles ont une formation littéraire et ils éprouvent une certaine répulsion spontanée à l'égard des mathématiques. Un certain nombre de propositions sont faites dans le rapport sur la formation des enseignants. Je pense qu'il faut intéresser les enseignants non seulement à ce qu'ils vont avoir à enseigner mais aux mathématiques elles-mêmes, afin que qu'ils se sentent un peu autonomes, capables de situer les mathématiques dans l'ensemble des connaissances, qu'ils puissent prendre à leur égard la même hauteur que vis-à-vis des autres matières dont ils ressentent la place dans la culture. Face aux enseignements scientifiques en général, il n'est pas mauvais de se référer à Paul Bert, qui avait introduit dans les programmes de l'école primaire, dans un ordre qui ne devait rien au hasard, les sciences naturelles, les sciences physiques et les sciences mathématiques, qui sont directement utiles, Paul Bert s'en explique dans le contexte de son époque, mais la raison d'être commune, dit-il, est « la discipline de l'intelligence ». Articuler l'utilité pratique et la discipline de l'intelligence, c'est une ambition toujours actuelle. Je sors d'une réunion consacrée à l'histoire des sciences, dont il me semble qu'elle devrait avoir une place dans les IUFM. Pour ceux qui ont déjà une formation de spécialité, c'est la manière de montrer la place que la discipline occupe dans l'histoire des hommes, c'est la lier à la culture générale. Pour les futurs professeurs de l'enseignement élémentaire, je forme l'hypothèse que l'histoire des mathématiques est une manière d'entrer dans les mathématiques elles-mêmes : il est passionnant de voir ce qu'était la notion de nombre premier chez Euclide et de faire le lien avec la technologie actuelle. * Audition de M. Luc Ferry, ancien ministre de l'éducation nationale et de la recherche, ancien président du Conseil national des programmes, président du Conseil d'analyse de la société M. Jean-Marie Rolland : Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Notre mission a entendu un grand nombre de personnalités depuis qu'elle a engagé ses travaux. Il ressort de ces auditions que notre pays a toujours une élite scientifique mais que le fossé se creuse faute d'attrait pour les sciences en général. Dans ces conditions, comment le citoyen pourra-t-il appréhender les questions scientifiques et techniques de l'époque ? Comment régler la question des relations entre les filles et la science ? La France parviendra-t-elle à former tous les ingénieurs dont elle aura besoin ? Qu'en est-il de la formation des formateurs ? Que penser de l'évaluation PISA, contestée par certains au motif qu'elle est fondée sur des tests à l'anglo-saxonne inadaptés aux esprits français ? Sur tous ces points, votre perspective nous sera utile. M. Luc Ferry : La science est très aimée, le grand succès des émissions et des ouvrages de vulgarisation le montre, mais elle n'est pas aimée en tant que discipline que l'on choisit pour en faire une carrière universitaire. Les programmes scientifiques sont très bons à l'école primaire et excellents au lycée, à l'exception de ceux de biologie, beaucoup trop difficiles. Pour la physique, deux points de vue très respectables se sont opposés quand on les a revus. L'un était de partir de l'environnement immédiat de l'élève, son walkman par exemple, ce qui m'a paru être une fausse bonne idée car le walkman est un objet très compliqué. J'ai donc tranché en faveur de l'autre, qui était de partir de la physique fondamentale, et je pense que nous avons bien fait, car les programmes sont épatants. Au collège, en revanche, les programmes ne sont pas très bons, particulièrement celui de géologie en quatrième et de troisième ; lourd et ennuyeux, il devrait être modifié. Mais, dans l'ensemble, ce ne sont pas non plus les programmes qui pêchent. Même si elle masquée dans les statistiques car elle est inégale selon les disciplines, la crise des vocations scientifique est réelle, le vrai problème étant l'effondrement de la physique. Sachant les liens entre science, croissance et innovation, cela risque de nous coûter très cher. Au contraire des Etats-Unis et du Japon, nous ne sommes plus dans une économie d'innovation, mais dans une économie d'imitation. Or, le coût de la protection sociale et celui du travail sont tels que nous ne pourrons survivre que dans une économie d'innovation. Là est le véritable enjeu, car la culture scientifique peut s'acquérir grâce à la vulgarisation. Tout se joue au niveau des terminales S, dont les élèves s'orientent ensuite vers des carrières commerciales plutôt que vers des carrières scientifiques. Le Conseil d'analyse de la société s'est livré à un travail en amont du vôtre. Qu'en retenir ? Faut-il trouver une explication dans la féminisation de l'enseignement ? Je n'y crois pas beaucoup. Le problème est le même au Canada et en Allemagne et, dans ce dernier pays, on va jusqu'à dire que les familles brisées produisent moins de scientifiques faute de référent paternel... Des études sont faites à ce sujet, mais cela ne me paraît pas être le facteur fondamental. Ce qui joue, en revanche, c'est que depuis la naissance de l'écologie radicale, la science est plus associée à l'idée de risque qu'à celle de progrès. Voilà pourquoi la crise des vocations scientifiques est plus marquée encore dans ces deux pays, où le mouvement écologiste est très prégnant. Pour autant, la science peut rester populaire dans le peuple même si elle est impopulaire auprès des étudiants, beaucoup plus écologistes. Ce phénomène expliquerait la situation bien davantage que la question des moyens car, au Canada comme en Allemagne, les conditions de vie des chercheurs sont très bonnes. Mais si l'on s'avise, en France, de payer 1 800 euros par mois des chercheurs qui ont « bac+25 » et de ne leur offrir que des contrats précaires, tout en débloquant dans le même temps des centaines de milliards pour les restaurateurs, cela peut être mal perçu... C'était une grave erreur de maltraiter les chercheurs et il y a là une variable importante, mais qui n'est pas décisive. Ce qui est décisif, c'est la pédagogie. Or, depuis quarante ans, on a privilégié l'approche ludique et l'expression de la spontanéité au détriment de l'apprentissage « dur ». C'est ainsi que l'on a construit tous les cours d'histoire sur les documents, ce qui est une grave erreur pédagogique car un enfant de huit ans n'est pas un apprenti historien. C'est un exemple de fausse bonne idée, l'autodictée en étant un autre. L'individualisme contemporain veut que l'on s'émancipe de la tradition. Mais l'éducation et l'enseignement, ce sont 98 % de tradition et 2 % d'innovation, qu'il s'agisse de courtoisie, de politesse, de civilité ou d'apprentissage de la langue ! Ce dont il s'agit, c'est de transmettre des héritages, un patrimoine. Or, on a développé chez les enfants une arrogance totalement contraire à l'humilité de l'apprentissage et, dans le même temps, l'autorité a été jetée aux orties. Les conséquences de cette évolution ont été particulièrement fortes pour l'apprentissage des sciences, qui demande avant tout travail et humilité. Si l'on vous enseigne les vingt protéines, il y a très peu à discuter, il faut apprendre par cœur... Selon moi, on ne s'intéresse qu'à ce à quoi on a travaillé. Il faut d'abord faire travailler les enfants, et pour cela il faut de l'autorité car il n'y a pas de motivation sans contrainte. Le vrai problème est celui du rétablissement de l'autorité nécessaire pour faire travailler les enfants. De même, la crise de l'apprentissage de la langue n'a rien à voir avec la méthode globale : elle s'explique par un manque de respect des enfants pour l'héritage. Plus on ajoutera du ludique dans l'enseignement, plus on aggravera le mal, qui se manifestera dès la classe de cinquième quand on entrera dans le « dur ». Il faut donc restaurer l'autorité du professeur. Mais il faut aussi valoriser l'image de la science dans la société et, au moins, réduire l'association entre science et risque qui est l'un des grands méfaits de l'écologie. Une chaîne publique devrait proposer une émission de vulgarisation à une heure de grande écoute. M. Yves Boisseau : Vous considérez que nous sommes entrés dans une économie d'imitation. Mais n'avons-nous pas réussi le nucléaire ou la carte à puce ? Par ailleurs, vous estimez que l'enseignement est composé pour 98 % de tradition et pour 2 % d'invention, et qu'il n'y aurait donc pas besoin d'innover. Mais la tradition apprend-elle ensuite à être inventif ? M. Luc Ferry : Oui. Cela peut paraître paradoxal, mais rien ne rend plus inventif qu'une bonne maîtrise de la tradition. Ainsi, je suis profondément hostile à ce qu'en philosophie on enseigne les notions quand il faudrait enseigner les grandes idées, car il n'y a rien de plus utile que de maîtriser la tradition - et ça fait gagner un temps fou. Quant à l'analyse du Conseil d'analyse de la société, elle ne fait pas référence à l'époque où l'on inventait encore. M. Yves Boisseau : Vous voulez dire que nous vivons sur la lancée d'inventions anciennes ? M. Luc Ferry : Oui, et s'agissant de l'informatique ou de la haute fidélité, nous sommes dans une économie copiste. Reportez-vous à ce sujet au rapport qu'Elie Cohen a consacré en 2003 à « Croissance et innovation ». Il recommandait de corriger le tir en affectant un plus grand budget à l'enseignement supérieur qu'à l'enseignement scolaire. Aujourd'hui, à de très rares exceptions près, l'Europe n'est pas spécialement innovante et, globalement, pour toutes les nouvelles technologies, elle est à la remorque du Japon et des Etats-Unis. M. Frédéric Reiss : M. Jean-Pierre Kahane, membre de l'Académie des Sciences, nous a parlé tout à l'heure de laboratoires de mathématiques qui pourraient, pense-t-il, donner le goût des mathématiques. Quel est votre avis à ce sujet ? M. Luc Ferry : Pourquoi pas ? Mais le problème n'est pas de donner le goût des sciences aux enfants, c'est qu'ils continuent dans cette voie ; ce n'est pas de les intéresser, c'est de les faire travailler. Pendant quarante ans, on a cru que l'on pourrait faire travailler les enfants en les séduisant ; c'est faux. De plus, l'enseignement étant désormais obligatoire jusqu'à 16 ans, il n'y a plus de sanctions possibles, si bien que le professeur, quelles que soient ses qualités, n'a aucun moyen d'intervention face à des élèves qui ne veulent pas travailler. Le problème de l'école est avant tout celui de l'éducation et le problème politique est celui de l'autorité à tous les niveaux. M. Frédéric Reiss : Mais l'on sait bien que les rapports sont aussi affectifs et que des élèves tiennent à bien travailler « pour le prof ». M. Luc Ferry : S'il y a de grands professeurs, cela marche toujours. Le problème des sciences, c'est la situation des professeurs. M. Frédéric Reiss : J'ai du mal à croire que les élèves rechigneraient à se diriger vers les filières scientifiques parce que la notion de risque leur serait associée. M. Luc Ferry : D'une part, l'image de la science est atteinte, d'autre part les disciplines scientifiques sont celles où l'on peut le moins discuter - et en physique, on ne peut pas discuter du tout. Autant dire que toute pédagogie fondée sur les épanchements du cœur se heurte à la science. Je vous renvoie à la littérature scientifique publiée après le tremblement de terre de Lisbonne. Tous les auteurs ont écrit la même chose : la nature est mauvaise mais, grâce à la connaissance scientifique, on pourra, à l'avenir, prévenir de telles catastrophes. Analysons maintenant la manière dont la presse contemporaine rend compte du débat sur les OGM, et l'on constate que, depuis quinze ans, elle file les mêmes métaphores, celles de Frankenstein et de l'apprenti sorcier - deux mythes de la dépossession, qui rencontrent un écho d'autant plus grand que la mondialisation libérale effraye. Et c'est ainsi que le petit grain de maïs fait peur. Il y a là un nœud de peur qui dissuade très efficacement les jeunes gens de s'engager dans les carrières scientifiques, par ailleurs peu attrayantes parce que très difficiles et peu lucratives. Et l'on s'étonne que cela ne marche pas très bien ! La difficulté de fond est là, bien davantage que dans les programmes ou dans l'enseignement. On parvient très bien à accrocher les élèves, beaucoup moins à les faire travailler. Cela vaut aussi pour le latin : il n'y a jamais eu autant de latinistes qu'aujourd'hui en cinquième, mais ils ne sont plus que 10 000 en seconde, parce que c'est leur choix qui s'exerce en seconde, et celui des parents en cinquième. M. Jean-Marie Rolland, président : Monsieur le ministre, je vous remercie. * COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 14 MARS 2006 Audition de M. Farid Hamana, secrétaire général et M. Gilbert Lambrecht, chargé de mission de la FCPE - Fédération des conseils de parents d'élèves M. Jean-Marie Rolland, président : Nous travaillons depuis plusieurs mois sur la question de l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. Nous nous sommes intéressés à l'attractivité des filières scientifiques, à la sélection par les mathématiques, à la place des femmes, aux méthodes pédagogiques, à la formation des maîtres, aux autres modes de diffusion de la pensée scientifique, comme la presse et les musées - nous nous sommes d'ailleurs rendus ce matin à la Cité des Sciences. Sur tous ces sujets, nous souhaiterions connaître l'avis général de la FCPE, avant d'en venir peut-être à quelques questions plus précises. M. Farid Hamana : C'est en effet dans ce champ assez large qu'on se place habituellement quand on parle des disciplines scientifiques à l'école. La particularité de la filière S, très sélective, c'est qu'on y retrouve ceux qui sont considérés comme des bons élèves, qui y trouvent de larges possibilités en vue de la poursuite de leurs études, et non pas particulièrement ceux qui sont attirés par les disciplines scientifiques. C'est ainsi qu'il y a en S des élèves qui entendent poursuivre leurs études par des classes préparatoires commerciales ou littéraires. On peut donc se demander à quoi sert une filière qui ne mène pas les jeunes là où ils veulent aller. C'est sans doute une des raisons principales du désintérêt des élèves pour les filières scientifiques. Sans doute convient-il aujourd'hui de revoir l'organisation de la section S, en particulier en se demandant si le choix de regrouper les anciennes sections C, D et E est toujours pertinent : une diversification ne répondrait-elle pas davantage aux attentes réelles des élèves ? Par ailleurs, les disciplines dures, mathématiques et physiques, jouent, depuis le primaire, une grande importance dans l'évaluation des élèves, alors que d'autres matières sont tout aussi intéressantes pour construire les itinéraires d'apprentissage. Il semble que le poids de la physique pose un problème particulier pour le bac sciences et technologies de laboratoire (STL), dont la réforme fait l'objet d'un conflit entre l'inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) de physique et celle de biologie. Donner une part trop importante à la physique peut en effet effrayer certains élèves. S'agissant de la place des filles, on peut regretter qu'elles ne soient pas plus nombreuses dans les options élitistes maths-physique, mais le fait qu'elles soient davantage en biologie constitue peut-être une liberté et une chance qui leur sont offertes. Sans doute faudrait-il aussi que les classes soient composées de façon différente pour les attirer vers les disciplines où elles sont peu présentes. Bien évidemment, la pédagogie est essentielle si on veut que les élèves s'intéressent aux sciences. Alors que l'enseignement des sciences est devenu très abstrait, l'expérience de La main à la pâte montre qu'il est possible de donner un sens à ce qu'on apprend. Un article paru samedi dernier dans Libération montre comment la physique et la chimie interviennent dans la cuisine, par exemple quand on monte des œufs en neige ou une mayonnaise. Il faudrait que cette dimension soit plus systématique dans l'enseignement : en mathématiques, on apprend à résoudre une identité remarquable, mais bien peu d'élèves sont capables d'en expliquer l'utilité. Sans doute serait-il également profitable d'enseigner la philosophie et l'histoire des sciences, qui montrent l'enchaînement des découvertes. C'est par la pédagogie que l'on peut donner l'envie de découvrir. La Cité des Sciences est en effet un outil pour cela, mais il est évident que tout le monde n'y a pas accès. Peut-être faudrait-il développer des supports technologiques permettant une meilleure diffusion de ce qui s'y fait. On pourrait aussi s'inspirer de l'exemple du British Museum qui, outre qu'il est gratuit, permet de réaliser des travaux d'une grande qualité et donne ainsi l'envie de découvrir les sciences. M. Jean-Marie Rolland, président : Quels sont selon vous les freins à la diffusion de La main à la pâte, alors que tout le monde semble enthousiaste ? M. Farid Hamana : Le problème tient surtout à la formation des enseignants, dont beaucoup sont des femmes et des littéraires, qui ne savent pas conduire une séquence de ce type, autour de l'expérimentation et de la formulation des hypothèses. Il faut donc leur donner les outils qui leur font aujourd'hui défaut dans une formation centrée sur l'apprentissage pur et dur d'un certain nombre de disciplines. M. Jean-Marie Rolland, président : Pensez-vous qu'il serait possible d'attirer davantage d'étudiants issus des filières scientifiques vers les IUFM en distribuant différemment les bourses ? M. Farid Hamana : Ceux qui s'engagent dans une filière scientifique à l'université sont plus souvent enclins à devenir ingénieurs ou scientifiques de haut niveau qu'enseignants, d'autant que les salaires ne sont pas tout à fait les mêmes... C'est donc dès la première année qu'il faut attirer les étudiants et je ne crois guère pour cela à un système de bourses : je préfère que les gens s'engagent dans cette voie parce qu'ils sont vraiment motivés et parce qu'ils ont envie d'être devant des élèves. M. Jean-Marie Rolland, président : Quand on entre dans un IUFM avec une licence littéraire, on a plus fait de mathématiques et de physique depuis au moins trois ans. Qui plus est, les jeunes issus des filières littéraires ressentent souvent une véritable aversion pour ces disciplines. Comment les IUFM pourraient-ils donner un esprit scientifique à ceux qui ne l'ont pas en y entrant ? M. Farid Hamana : Il faut surtout stabiliser leurs connaissances : quelqu'un qui sort de trois ans de fac de lettres doit quand même être capable de maîtriser les principales opérations. Or, c'est ce qu'on lui demande : la maîtrise du programme en primaire est une absolue nécessité car il s'agit de former des enseignants généralistes, pas des professeurs de maths, de physique ou de biologie. C'est pour cela qu'il faut développer dans les IUFM les ateliers permettant de re-familiariser les étudiants avec la pédagogie des mathématiques, de la technologie et des activités scientifiques. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons assisté la semaine dernière à Clichy-sous-Bois à une séance de La main à la pâte dispensée en CP par une enseignante qui était une vraie littéraire et qui menait un cours parfait. Cela montre que c'est possible, mais qu'est-ce qui peut en donner le goût ? M. Farid Hamana : Les enseignants qui participent à La main à la pâte sont ceux qui sont portés vers l'innovation pédagogique, qui cherchent à trouver des réponses aux questions qu'ils se posent à ce propos, dans le domaine des sciences comme dans tous les autres. Sans doute serait-il utile que les étudiants des IUFM voient cette façon de transmettre les connaissances, ce qui pourrait aussi éveiller leur appétence pour ces disciplines. M. Gilbert Lambrecht : Il y a un important problème dans la représentation des filières et des disciplines que se font tant les enseignants que les familles. Les parents qui souhaitent que leur enfant réussisse le poussent à obtenir un bac S avec mention. Mais j'ai rencontré un étudiant dans ce cas qui, après une première année de licence de SVT, a trouvé sa vocation dans un BTS de gestion forestière... Il me semble donc essentiel d'affirmer l'identité scientifique de la série S, ainsi que l'identité des deux autres filières générales, afin de les mettre toutes sur un pied d'égalité. Par ailleurs, les enseignants attachent une grande importance à leur discipline, à sa différence par rapport aux autres et même à une hiérarchie entre toutes. Dès le collège, il y a des matières de « haut de bulletin » : français, mathématiques, langue vivante 1 (LV1). Les parents sont bien obligés d'intégrer ce phénomène, au point de pousser leurs enfants, qui ont pourtant peut-être d'autres centres d'intérêt, vers ce qu'on présente comme la filière royale. M. Farid Hamana : Il y a aussi un problème en seconde avec les options : alors que tous les élèves devraient faire autant de mathématiques, ceux qui ont choisi mesures physiques et informatique (MPI) en font davantage. M. Gilbert Lambrecht : Alors qu'au collège les enseignants de mathématiques et de technologie ont selon moi vocation à travailler ensemble, les seconds sont vus comme des manuels et des bricoleurs et leur discipline ne jouit pas de la même considération aux yeux des élèves et de leurs parents, c'est dommage. Je crois par ailleurs qu'on aurait intérêt à travailler sur l'enrichissement croisé des matières. Il faudrait faire comprendre aux étudiants dans les IUFM que manipuler un objet, adopter une démarche expérimentale, permet aussi d'enrichir le vocabulaire des enfants et de leur apporter une série de concepts qui leur seront utiles dans toutes les autres matières. Il faut également montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les disciplines, qu'au-delà de la seconde dite de « détermination » - alors qu'en fait tout est déjà déterminé avec un cycle d'orientation virtuel composé de la troisième et de la seconde, que le tri se fera de toute façon dans le supérieur et dans le choix de la profession, et qu'il est donc vraiment inutile de commencer dès le primaire. Laissons aux enfants le temps d'être des enfants ! À l'école, on les appelle élèves parce qu'on veut les « élever », mais il faut prendre en compte toutes les formes d'intelligence et admettre qu'ils peuvent trouver des satisfactions dans toutes les matières par le développement de leur curiosité intellectuelle. Au risque de décourager les élèves, le système français privilégie l'abstrait et l'enseignement hypothético-déductif par opposition au concret et à l'enseignement inductif. Il n'y a rien de pire pour dégoûter ses propres enfants que de leur dire qu'on n'a jamais rien compris aux mathématiques. Il ne faut pas culpabiliser l'enfant qui a un peu de mal, précisément parce qu'on l'a mis en difficulté. C'est bien par un changement des représentations qu'on peut faire évoluer les choses, y compris pour les filles : alors qu'elles sont meilleures que les garçons dans toutes les matières, on entend encore trop souvent dire « ça, ce n'est pas pour les filles »... M. Jean-Marie Rolland, président : Certains de nos interlocuteurs ont suggéré qu'on ne sépare plus la physique-chimie et la biologie dans le secondaire. Êtes-vous favorables à cette idée ? M. Farid Hamana : Nous regrettons la disparition des travaux personnels encadrés (TPE) et des itinéraires de découverte (IDD), qui ouvraient une brèche en faveur d'un enseignement pluridisciplinaire. En dépit de leurs réticences initiales, les enseignants s'étaient appropriés ces outils. M. Jean-Marie Rolland, président : Quel est votre sentiment quant à la bivalence ? M. Farid Hamana : Outre quelle est très utile au collège, il me semble qu'elle offre aux enseignants l'avantage de ne pas être bloqués dans un domaine pendant toute leur vie professionnelle. Alors que chacun est obligé aujourd'hui de s'adapter en permanence, on comprendrait mal qu'ils soient les seuls figés, d'autant que les connaissances évoluent perpétuellement. La polyvalence est donc un atout pour les enseignants, à condition que les universités les y préparent. M. Gilbert Lambrecht : Dans Corridors of Power, Charles Percy Snow montre qu'au moment de la guerre froide la culture générale et la culture cybernétique étaient toutes deux nécessaires à la conduite de la politique internationale. L'université met aussi désormais l'accent sur les formations pluridisciplinaires : un avocat d'affaires doit connaître non seulement le droit mais aussi les mécanismes économiques. Ainsi, entre l'école primaire qui est polyvalente et le supérieur qui le devient, il y a un tunnel dans lequel les disciplines s'affrontent pour s'imposer, par l'abstraction, dans une hiérarchie. Il conviendrait donc de réunir un peu les disciplines et de donner aux enseignants une ouverture assez large pour permettre à leurs élèves de passer eux-mêmes d'un champ disciplinaire à un autre. On s'est posé la question du socle commun au collège, mais il faudrait aussi se demander ce qu'il conviendrait d'enseigner aux élèves jusqu'au bac, quelle que soit la série. N'est-il pas étonnant que, dans nos sociétés en voie de judiciarisation, l'enseignement du droit soit aussi peu développé, d'autant que l'apprentissage des raisonnements juridiques serait utile dans d'autres disciplines ? M. Jean-Marie Rolland, président : Certains enseignants nous ont dit qu'on avait tendance à réduire les horaires de mathématiques et de physique pour ajouter d'autres enseignements et que cela leur posait problème. M. Farid Hamana : Se focaliser sur les horaires, notamment en mathématiques et en physique, est aussi un moyen de décourager les élèves de poursuivre des études universitaires scientifiques. Si on dit qu'on a besoin d'ingénieurs, il faut se donner le temps de les préparer, mais aussi réfléchir aux besoins actuels en responsables de la fabrication et de la mise en œuvre des process plutôt qu'en concepteurs. C'est peut-être ainsi qu'on remédiera à l'échec excessif en fin de première année. Je crois par ailleurs que c'est quand on aura cessé de sacraliser le bac qu'on pourra vraiment parler de formations universitaires et d'augmentation du nombre des étudiants et s'intéresser à l'information scientifique de nos enfants. Car force est de constater que pour un pays qui compte autant de savants, les résultats de nos élèves à l'enquête PISA sont très décevants. La France est, avec le Japon, le pays qui stresse le plus les élèves. Prenons les donc tels qu'ils sont et non comme on les imagine ! M. Jean-Marie Rolland, président : Je suppose que vous avez lu l'article de l'Express à propos d'André Antibi et du « tiers macabre ». M. Farid Hamana : Nous travaillons avec lui pour essayer de sortir de cette logique. Il faudrait que les enseignants apprennent à évaluer : il faut se demander ce qu'on évalue et pourquoi. M. Gilbert Lambrecht : Certains parents reçoivent des bulletins où la moyenne trimestrielle dans une matière est de 7,31 ! Ce caractère pseudo-scientifique de l'évaluation est dramatique. Si on avait un minimum de lisibilité dans l'enseignement, on ne stresserait de la sorte ni les enfants ni les parents, et les enseignants paraîtraient, avec tout le respect que je leur dois, un peu moins ridicules. M. Farid Hamana : Certains inspecteurs généraux de l'éducation nationale (IGEN) ont fait évaluer la même copie par 150 correcteurs et ont constaté des écarts considérables dans les notes, y compris en mathématiques. Le jour où on s'attaquera vraiment à la question de l'évaluation, on ira vers l'égalité de l'ensemble des élèves sur le territoire. * Audition de M. Roland Debbasch, directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale, de l'enseignement et de la recherche accompagné de M. Jean-Luc Bénéfice, sous-directeur et de Mme Véronique Fouquat, chargée d'études au bureau du contenu des enseignements M. Jean-Marie Rolland, président : Nous travaillons depuis plusieurs mois sur la question de l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire. Nous avons fait un tour d'horizon sur les questions de l'attractivité, de la sélection par les maths, de la place des femmes, des notions scientifiques que tout citoyen devrait connaître pour pouvoir donner son avis sur les grands sujets de société. Nous sommes allés voir ce qui se faisait ailleurs, en particulier en Finlande, où se développe un véritable tourisme éducatif, et au Canada. Nous sommes aussi beaucoup penchés sur les résultats de l'enquête PISA. Peut-être souhaiterez-vous dans un premier temps nous exposer votre sentiment général sur ces thèmes, avant que nous en venions à des questions plus précises, en particulier sur le baccalauréat et la réforme de la terminale S. M. Roland Debbasch : Nous avons conscience d'un déficit d'orientation vers les filières scientifiques, en particulier dans le secondaire et à l'université. Face à un phénomène dont les explications sont diverses, nous essayons de trouver des solutions depuis plusieurs années. Une des premières pistes consiste à faire progresser l'orientation des jeunes filles. J'ai bien vu sur le terrain, en tant que recteur d'académie, que leurs capacités offrent des marges de progression certaines et malgré nos efforts, nous avons peu remédié à leur désaffection pour les disciplines scientifiques. Lors de la préparation de cette audition, vous nous avez interrogé sur la baisse du nombre des bacheliers scientifiques ces dix dernières années. Au total, ce mouvement ne semble pas réellement significatif puisque, avec 137 000 bacheliers S en 2005, nous sommes sensiblement au même niveau que dix ans plus tôt. La baisse a été plus importante dans les autres filières. Il n'y a donc là rien d'alarmant, d'autant que dans le même temps la part des bacheliers scientifiques dans l'ensemble des bacheliers généraux a progressé. Sans doute aurait-il fallu faire mieux, mais j'observe également que le nombre des bacheliers scientifiques dans une classe d'âge est passé de 15,7 % en 1995 à près de 17 % aujourd'hui. Par ailleurs, même si le résultat n'est pas conforme aux objectifs que nous nous fixons, la part des jeunes filles parmi les bacheliers S atteint 47 %, contre 42 % en 1995. Pour attirer plus de jeunes filles vers les filières scientifiques, nous utilisons essentiellement les procédures d'information, de communication et d'orientation. On peut en particulier citer la diffusion de la brochure Devenir ingénieure. M. Jean-Marie Rolland, président : Êtes-vous certain que cette information arrive jusqu'aux plus petits collèges ruraux ? M. Roland Debbasch : Oui. Il existe aussi un certain nombre d'initiatives de terrain, comme le prix de la vocation scientifique et technique. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons le sentiment qu'il y a une élite, bonne partout, mais qu'il faudrait s'intéresser davantage au reste de la cohorte. Pour cela, il existe des méthodes pédagogiques dynamiques aptes à susciter des vocations, comme La main à la pâte et Maths en jeans, mais qui ne se diffusent pas assez sur l'ensemble du territoire. C'est aussi l'impression que nous avons eue ce matin en visitant la Cité des Sciences : elle reçoit un grand nombre de visiteurs, mais ce sont toujours les mêmes et il y a finalement beaucoup de laissés pour compte. Est-ce que, finalement, tout cela ne dépend pas surtout du chef d'établissement ? M. Roland Debbasch : Sans doute, mais nous savons que nous pouvons compter sur eux et qu'ils diffusent avec beaucoup de soin les informations extrêmement nombreuses qu'ils reçoivent. Les obstacles sont plutôt culturels : pour avoir travaillé dans le Nord-Pas-de-Calais, région de tradition industrielle, j'ai constaté qu'il fallait sans doute y faire plus encore pour convaincre les jeunes filles et leurs familles. M. Jean-Marie Rolland, président : Lors des débats sur la loi d'orientation, il est apparu que la formation des conseillers d'orientation psychologues posait d'importants problèmes et qu'ils étaient particulièrement démunis dans leurs échanges avec des jeunes eux-mêmes difficilement capables de se projeter dans l'avenir. M. Roland Debbasch : Il est trop tôt pour faire le bilan de la loi d'orientation. Certes, chacun est perfectible, mais il est difficile de porter une critique globale sur ce corps. M. Jean-Luc Bénéfice : Sans doute conviendrait-il de revoir leur formation initiale, dispensée en milieu extrêmement fermé par l'INETOP, l'Institut national d'étude du travail et d'orientation professionnelle. Il est difficile pour une seule personne d'exercer deux métiers qui peuvent être aussi différents que ceux de conseiller d'orientation et de psychologue. Pour revenir à votre question sur l'irrigation de l'ensemble du système, jusqu'aux plus petits collèges ruraux, je crois qu'il faut partir de tout ce qui est fait à l'école primaire grâce à la charte et à la convention que le ministère a passées avec l'Académie des sciences, qui permet en particulier d'aider les enseignants à franchir le pas de l'expérimentation, alors que leur formation n'a pas toujours été formidable. Ce travail effectué en amont irrigue l'ensemble du système éducatif et aide à susciter des vocations, notamment chez les jeunes filles. M. Jean-Marie Rolland, président : Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet de La main à la pâte dans le primaire et nous avons constaté d'une part qu'il faut que l'enseignant soit motivé, d'autre part qu'alors que tout le monde semble satisfait de cette expérience, sa diffusion n'est pas très rapide puisque nous estimons que 10 % des classes seulement sont aujourd'hui concernées. M. Jean-Luc Bénéfice : Je dirais plutôt 15 %. Le ministère s'est vraiment approprié La main à la pâte, dans le cadre du Plan de Rénovation de l'Enseignement des Sciences et de la Technologie à l'École, le PRESTE, engagé dès 1996. Une véritable prise de conscience dans les académies et dans les départements permet de faire avancer les choses, en particulier en termes de diffusion sur l'ensemble du territoire. M. Roland Debbasch : Nous vous rejoignons sur la nécessité de diffuser ce type d'expériences, qui sont des leviers d'actions pour susciter le plus tôt possible des vocations scientifiques, la sensibilisation devant être précoce. M. Jean-Marie Rolland, président : En ce qui concerne les programmes, les professeurs de mathématiques ont déploré une réduction du volume horaire de leur discipline dans la filière S. Ils ont le sentiment qu'on ajoute sans cesse des matières et que ce sont celles qu'ils considèrent comme fondamentales qui pâtissent de cette modification des équilibres. Que pensez-vous de cela et, plus généralement, de la réforme de la filière S intervenue en 2000 ? M. Jean-Luc Bénéfice : La réforme de 2000, qui a par ailleurs introduit les statistiques et les ordinateurs dans les programmes, a eu comme effet très positif de permettre à chacune des filières d'affirmer sa personnalité, à laquelle les programmes de mathématiques ont été adaptés, S restant la filière des scientifiques. M. Roland Debbasch : Il y avait aussi dans cette réforme la volonté de décloisonner les disciplines scientifiques et de montrer que les sciences ne se résument pas aux mathématiques. M. Jean-Marie Rolland, président : On nous a dit que le nombre d'heures avait diminué mais que les programmes avaient été peu modifiés, ce qui fait qu'il est pratiquement impossible de les traiter entièrement. Surtout, il apparaît que les élèves n'ont ainsi pas le temps de réfléchir et de s'approprier les connaissances, ce qui se ressent à l'université, l'aspect méthodologique ayant été laissé de côté. En fait, on apprend des recettes pour réussir le bac mais pas pour poursuivre des études scientifiques. Dans les documents que vous nous avez remis, les moyennes en maths au bac S ne sont pas brillantes. On peut donc se demander ce que vont devenir les élèves dans les filières scientifiques, où la méthode et le raisonnement sont très largement fondés sur les mathématiques. Tout ceci confirme que la filière S est faite pour sélectionner une élite, pas pour former des scientifiques. M. Roland Debbasch : C'est un phénomène bien antérieur à la réforme de 2000. Mme Véronique Fouquat : La nouvelle épreuve de mathématiques au baccalauréat va précisément permettre d'éviter qu'on se contente d'apprendre des recettes. Jusqu'ici, la terminale se passait à bachoter les annales parce qu'on savait qu'on aurait au bac un exercice sur les nombres complexes, un problème principal sous la forme d'une étude de fonction et un autre exercice. C'est pour cela que l'inspection générale a proposé que l'épreuve prenne la forme d'exercices très différents permettant de balayer davantage le programme. Il pourra s'agir de QCM, d'exercices de réflexion, d'exercices de démonstration permettant de vérifier que le cours a été vraiment compris. Ce changement, qui interviendra dès l'épreuve de cette année, va sans doute conduire à modifier l'enseignement des mathématiques en terminale, dans la mesure où l'étude des annales ne sera plus utile. M. Jean-Marie Rolland, président : Dans les données que vous nous avez transmises sur les notes des élèves, on constate que la moyenne n'est supérieure à 10 que dans 4 académies sur 30, avec des écarts très importants entre les notes les plus faibles et les plus fortes. Quelles conclusions en tirez-vous ? Pensez-vous qu'il faudrait aller vers un autre mode de notation ? M. Jean-Luc Bénéfice : Ces écarts peuvent être dus à de nombreux facteurs, pas seulement à la notation. M. Roland Debbasch : Qui plus est, ils ne sont pas probants. Il faudrait que nous vous fournissions des données sur un plus grand nombre d'années. M. Jean-Marie Rolland, président : On constate quand même une différence abyssale entre les bons et les mauvais. Disposez-vous d'éléments qui permettraient d'apprécier le niveau des bacheliers en mathématiques ? Mme Véronique Fouquat : L'année 2003 n'est pas une bonne année de référence car un des sujets proposés a désarçonné les élèves, et il y a eu par la suite de très importantes disparités entre les commissions d'harmonisation. M. Jean-Marie Rolland, président : Autant dire qu'il nous serait utile de connaître les statistiques pour l'année 2004, ce qui, au 15 mars 2006, devrait être possible. M. Roland Debbasch : Nous vous les transmettrons. M. Jean-Marie Rolland, président : Une réforme de la filière S est-elle en cours qui tendrait à recentrer les programmes sur les mathématiques et la physique et à alléger les autres disciplines, donnant ainsi plus de temps aux futurs scientifiques pour travailler et évitant qu'ils ne se trouvent, à l'Université, devant des professeurs qui déplorent leurs lacunes ? M. Roland Debbasch : La réflexion se poursuit, les arbitrages n'ont pas eu lieu, et il n'y a pas de calendrier pour une telle réforme. M. Jean-Luc Bénéfice : Le problème tient à ce que la filière S est devenue la filière de sélection, dans laquelle les élèves s'engagent pour faire ensuite d'autres études. M. Jean-Marie Rolland, président : Ce qui a comme répercussion que les étudiants de première année en DEUG de sciences n'ont pas le niveau requis... M. Roland Debbasch : C'était déjà ainsi il y a trente ans. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais, en trente ans, les choses auraient pu évoluer. Madame, Messieurs, je vous remercie. * Audition de M. Jean-Marc Monteil, directeur de l'enseignement supérieur au ministère de Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche M. Jean-Marie Rolland, président : Notre mission s'interroge sur ce qui peut être fait pour améliorer l'enseignement des disciplines scientifiques dans le premier et le second degrés. On a fait état devant nous d'une désaffection des bacheliers scientifiques pour le premier cycle universitaire alors que ni les classes préparatoires scientifiques ni les IUT ne seraient touchés. Est-ce aussi ce que vous avez relevé ? Si tel est le cas, comment l'expliquer, et que peut-on faire ? M. Jean-Marc Monteil : Je partage ce constat. La désaffection pour les filières scientifiques à l'université est réelle, au point que certaines licences sont quasiment dépeuplées. Il est très difficile d'expliquer les causes de ce phénomène, à mon avis multifactoriel. Si les élèves se dirigent vers les classes préparatoires scientifiques, c'est que, au delà, leur insertion professionnelle est à peu près assurée. En effet, étant donné le nombre d'écoles d'ingénieurs, il n'y a pratiquement pas d'échecs aux concours après taupe, au contraire de ce qui vaut pour les khâgneux. Mais va-t-on dans ces classes préparatoires pour faire des études scientifiques ou pour entrer dans une école ? D'ailleurs, quand on prépare une de ces écoles, reçoit-on une formation scientifique ? La désaffection ne tient pas à la baisse du nombre de bacheliers scientifiques mais à l'effet « insertion ». D'autre part, suivre un enseignement des sciences qui ne se traduit pas directement par un emploi suppose un intérêt intrinsèque pour les sciences qui ne peut s'être développé que si l'on a suivi un enseignement scientifique auparavant. Or, si l'on enseigne les sciences dans le secondaire, je ne suis pas certain qu'on y apprenne les sciences. Aujourd'hui, un professeur de sciences physiques certifié ou agrégé n'est jamais confronté à la réalité d'un laboratoire. C'est un vrai problème, car l'appétit pour la science passe nécessairement par la manipulation. Dans le secondaire, les enseignants déroulent le programme mais il n'est pas sûr que les élèves en retirent tout le bénéfice souhaitable car le système est organisé sans les travaux pratiques qui feraient percevoir eux enfants l'intérêt de ces disciplines ardues. On ferait alors de la science pour la science, et non pour passer un examen. En résumé, il existe un problème d'enseignement des sciences dans le second degré, les débouchés professionnels ne sont pas directement appréhendables lorsqu'on se dirige vers l'université et les sciences sont considérées comme des disciplines difficiles - alors que les disciplines littéraires le sont largement autant. Mais tout le monde parle français et tout le monde pense pouvoir faire de l'histoire ou de la géographie...Tout cela entraîne une inhibition. De plus, le numerus clausus en médecine a un effet mécanique : 70 % de très bons élèves, bacheliers scientifiques avec mention « bien » ou « très bien », échouent au concours, sortent du système et se dirigent plutôt vers les écoles de commerce. Certes, tous ne le font pas, mais il y a d'évidence une perte sèche d'étudiants scientifiques de valeur. M. Jean-Marie Rolland, président : Les conditions de travail et l'encadrement contribuent-ils à cette tendance ? M. Jean-Marc Monteil : Démographie aidant, l'époque des amphithéâtres de 300 ou 400 étudiants est révolue et l'enseignement s'appuie sur la démonstration, avec des travaux pratiques en petits groupes et un matériel scientifique de bonne qualité. Je ne pense donc pas que les conditions d'enseignement soient un facteur d'inhibition. M. Jean-Marie Rolland, président : M. Christian Forestier vient de nous indiquer que le nombre de boursiers est inférieur dans les grandes universités scientifiques à ce qu'il est dans d'autres universités. Qu'en pensez-vous ? M. Jean-Marc Monteil : Il faut commencer par identifier ce que l'on entend par « grandes universités scientifiques ». Ensuite, il me semble assez normal que l'Université Paris-VI et, globalement, toutes les universités du centre parisiennes soient peuplées d'enfants de catégories sociales plutôt favorisées. Je ne suis pas convaincu que cela vaille pour les universités de province. M. Jean-Marie Rolland, président : Ne pourrait-on pour autant augmenter le nombre de bourses « scientifiques » ? M. Jean-Marc Monteil : Pourquoi pas ? Mais, selon moi, les problèmes sont plus profonds. Il s'agit de représentation sociale des sciences et de culture scientifique. Non seulement les grands medias ne présentent pas la science en des termes qui la rendent attrayante, mais ils stigmatisent des erreurs liées à la falsification de processus scientifiques, ce qui n'est pas sans effet. M. Yvan Lachaud : Qu'en est-il des IUT ? M. Jean-Marc Monteil : Ils perdent des étudiants. Très peu d'IUT strictement scientifiques sont à créer, car on ne saurait les remplir. La désaffection pour les sciences et les techniques est évidente. M. Jean-Marie Rolland, président : Je suis heureux de pouvoir reprendre avec vous l'entretien que, pressés par le temps, nous avions dû interrompre la semaine dernière. J'aimerais revenir un instant sur la question des bourses car je me demande s'il n'y a pas là un moyen d'action. Vous le savez, il nous a été dit qu'il y a proportionnellement moins de boursiers dans l'enseignement universitaire scientifique que dans l'enseignement universitaire en général. Qu'en pensez-vous ? M. Jean-Marc Monteil : C'est exact si l'on inclut dans les formations scientifiques les écoles d'ingénieurs, filière sélective à sociologie particulière puisqu'il existe une corrélation élevée entre le niveau socio-économique et le niveau scolaire. Autrement, non. Ainsi, l'Université d'Evry, à dominante scientifique, compte quelque 38% de boursiers, tout comme l'Université Paris XI, mais à l'Université Paris IV, spécialisée en lettres et sciences humaines, il y a plutôt moins de boursiers qu'ailleurs. M. Jean-Marie Rolland, président : Quel avenir imaginez-vous aux filières scientifiques, pratiquement désertées, des petites universités ? M. Jean-Marc Monteil : La question ne se pose pas seulement pour les sciences, elle vaut aussi pour le droit, certaines disciplines littéraires et certaines langues telles que l'italien ou l'espagnol. Le problème est celui de la qualification de ces établissements mais, plus largement, il s'agit d'aménagement du territoire. Indépendamment de nos quelque quatre-vingt-dix universités de plein exercice, nous avons 158 sites universitaires, IUT compris. La loi sur la recherche est fondée sur le principe de pôles puissants, ce qui est très bien. Mais, outre les grands centres pluridisciplinaires, des sites universitaires se trouvent dans des villes petites ou moyennes. L'important est de mettre ces sites, ces IUT et ces plateaux technologiques secondaires de qualité au service du développement local par un apport d'expertise. La carte actuelle des sites universitaires n'est pas raisonnée ; ou plutôt, on en comprend les strates en se remémorant les alternances politiques successives... Maintenant, ces sites doivent être qualifiés, mais comment ? Prenons le cas de l'Université de Perpignan. On y trouve un laboratoire de recherche en écologie marine qui est parmi les meilleurs d'Europe ; il n'est peut-être pas indispensable que cette université se lance dans l'enseignement du latin et du grec ni, d'ailleurs, de la chimie ou de la biochimie, puisqu'elle a une compétence spécifique reconnue. Or, la tendance générale est à l'extension, alors que la démarche devrait être, pour tout laboratoire, de se renforcer dans un domaine de compétence donné pour devenir une référence non plus seulement européenne mais mondiale. Le ministère soutient cette approche, qui consiste à laisser dépérir ce qui doit dépérir et à consolider ce que les établissements savent faire. Mais pour cela, il faut comprendre qu'il est d'égale dignité d'être enseignant-chercheur à Perpignan, Rodez, Albi et à Montpellier. Certes, on ne fera pas d'astrophysique à Rodez, mais le site universitaire de Rodez est indispensable au développement économique de la nation. Il faut donc en même temps modifier les représentations et qualifier les sites universitaires en fonction de leurs compétences. Alors, on n'appréhenderait plus la question des petites universités en s'inquiétant de leur disparition éventuelle mais en disant que l'on a besoin d'elles pour tel segment, et pas au delà. Après tout, il n'y a que 10 000 étudiants à Princeton ! Cette approche serait bien meilleure pour l'économie générale du système et pour la visibilité de l'ensemble. Aujourd'hui, chaque collectivité souhaite une université de plein exercice, ce qui n'est pas possible. Nous allons répétant que "tout, partout" signifie "rien, nulle part", mais il est difficile de convaincre. Pourtant, 121 sites comptent moins de 1 000 étudiants, et parfois 25 seulement ! Cela étant, il y a peu d'enseignements universitaires scientifiques dans les petites villes - mais guère davantage en master à Paris VI, hélas. M. Jean-Marie Rolland, président : Quelles réactions suscitez-vous lorsque vous présentez les petites universités comme facteur d'expertise pour le développement local ? M. Jean-Marc Monteil : Elles sont plutôt positives, même si certains souhaitent à tout prix conserver des doctorats. Or, point n'est besoin de préparation au doctorat pour avoir un site universitaire de qualité. Une réflexion s'impose sur la division du travail, ce qui n'interdit pas le développement d'une recherche de haut niveau, mais sur un petit segment. Ainsi les étudiants des petits sites cesseraient-ils de converger vers les grandes universités. M. Jean-Marie Rolland, président : Existe-t-il des sites universitaires sans premier cycle ? M. Jean-Marc Monteil : Non. M. Jean-Marie Rolland, président : Au nombre des 158 sites que vous avez mentionnés, vous comptez les IUT, mais pas les BTS ? M. Jean-Marc Monteil : Oui. Mais il arrive souvent que IUT et BTS doublonnent dans un même secteur. Il est capital de conserver les BTS, mais il faut probablement leur faire recevoir les bacheliers technologiques et professionnels qui, s'ils ne se dirigent pas dans cette voie, vont à l'université, apprendre, par exemple, l'histoire, enseignée par les meilleurs spécialistes. C'est, pour ces jeunes gens, un double échec : après le premier, qui les a écartés des études longues, ils se trouvent à l'université dans des conditions qui leurs sont défavorables. C'est insupportable. Nous avons un problème manifeste d'orientation et de sélection. A mon sens, il faut prendre des mesures réglementaires imposant aux proviseurs qui ont des filières de BTS dans leur établissement d'accepter en priorité les bacheliers technologiques et professionnels. La chimie enseignée en BTS n'est pas la même que celle qui est enseignée à l'université, si bien que la passerelle ne fonctionne pas et que les titulaires d'un BTS entrés à l'université sont largués. Leur durée d'étude s'allonge d'autant, et elle aurait été plus courte s'ils étaient entrés à l'université directement. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment, alors, expliquer l'appréhension à entrer à l'Université ? M. Jean-Marc Monteil : Les familles incitent fortement leurs enfants à commencer par passer un BTS, quitte à entrer en faculté ensuite. Or, quelles que soient les difficultés de l'Université, c'est là, et non pas dans les écoles d'ingénieurs, ni dans les classes préparatoires, ni dans les BTS, que l'on trouve les meilleurs enseignants-chercheurs. On assiste donc a un double gâchis : l'échec de l'élève qui a suivi deux années de BTS et qui, s'il est admis à l'université, se trouve dans un monde étranger, et l'échec de celui qui aurait voulu faire un BTS et qui, s'il entre à l'université, sera toujours en première année au bout de trois ans. Cela vaut aussi pour certains IUT, mais dans une moindre mesure car ils sont pour la plupart inclus au sein des universités. Il s'agit d'une question cruciale, qui demande à être réglée clairement. Que l'on dise, si c'est ce que l'on souhaite, que certains baccalauréats n'ouvrent pas le droit à des études ultérieures. On a créé des baccalauréats professionnels sous la pression des professionnels mais aujourd'hui ces bacheliers tiennent à continuer leurs études - et où le font-ils ? A l'université. Or, je défie quiconque de faire réussir un élève titulaire d'un baccalauréat professionnel à l'université. Actuellement, 16 % des bacheliers professionnels sont inscrits à l'université ; ils étaient 3 % il y a cinq ans. Ils s'inscrivent en histoire, en droit, en sociologie parce que c'est là qu'il y a de la place. Quelques égarés s'inscrivent en sciences parce qu'ils ont obtenu 17 dans ces matières au baccalauréat, et ils se trouvent mêlés à des condisciples qui ont suivi la filière S. Voilà la réalité ! Après quoi, on entend des discours sur l'échec de l'Université, qui serait matérialisé par de piètres résultats en première année de DEUG. Mais s'il n'y avait pas d'échec en première année de DEUG, cela reviendrait à dire que l'on donne la première année en même temps que la carte d'étudiant ! Si l'on souhaite que l'Université devienne une ZEP avec tutorat permanent, qu'on le dise. Prenez un lot de copies de première année de lettres : vous vous arracherez les cheveux. Pour améliorer le niveau des étudiants à l'Université, notre pays ne peut sélectionner en première année. Pour ma part, je suis favorable à une sélection en fin de licence, sélection qui s'opère déjà, mais de manière hypocrite ; on devrait dire clairement que, pour passer un master, il y aura une sélection. Mais si l'on ne prend pas les étudiants en première année à l'Université, il faut inventer un établissement pour les accueillir et faire que les élèves de niveau 4 soient insérables professionnellement. Mais, à ce sujet, on se heurte à des exigences toujours croissantes ; ainsi de ces entreprises de transport qui veulent désormais que les routiers parlent deux langues... Tout le monde demande qu'il y ait des formations complémentaires et, de formation complémentaire en formation complémentaire, on pervertit le système. Quant aux licences professionnelles, elles demandent des bases qui ne sont pas celles d'un bachelier professionnel. On pourrait envisager un système dans lequel on formerait clairement les techniciens et les techniciens supérieurs dont notre économie a grand besoin. Au lieu de cela, on a un galimatias, si bien que ceux qui veulent faire des sciences vont dans les IUT, où ils sont mieux encadrés. M. Yves Boisseau : Vous attribuez donc une part de responsabilité aux employeurs potentiels, qui demandent une surqualification systématique ? M. Jean-Marc Monteil : Une coresponsabilité générale nous a conduit à laisser énormément de gens au bord de la route. Quand est venue la professionnalisation des baccalauréats, on a voulu des gens formatés. Or, c'est l'adaptabilité qui est nécessaire et elle suppose elle-même une base de culture générale suffisante pour permettre la professionnalisation tout au long de la vie grâce à des formations nouvelles. Aujourd'hui, le monde académique et le monde économique se connaissent mieux et se parlent plus et leurs représentants cohabitent au sein des commissions d'habilitation pour les licences professionnelles et de la commission des titres d'ingénieurs. Mêler les deux cultures est dans l'intérêt du pays. Les difficultés sont en amont : comment gérer les sorties de baccalauréat ? Les bons bacheliers scientifiques ne vont pas à l'Université... si ce n'est qu'ils y viennent en doctorat, après avoir fini l'école d'ingénieur, pour la raison que je vous ai dite : parce qu'ils savent que c'est à l'Université qu'ils trouveront une formation doctorale d'excellence ! * Audition de M. Christian Bréchot, directeur général de l'INSERM M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Partant des conclusions de l'enquête PISA conduite sous l'égide de l'OCDE, notre mission s'est intéressée au niveau scientifique moyen en France - et vous pourrez nous dire si vous avez du mal à recruter des chercheurs -, à la place des femmes dans le monde des sciences, au système de sélection des élèves et aux méthodes pédagogiques. Votre point de vue sur ces questions nous importe. M. Christian Bréchot : L'INSERM attache une grande importance à la diffusion de la recherche. C'est ce qui nous conduit dans les établissements d'enseignement pour des événements ponctuels. Notre perception de la place de la science dans l'enseignement secondaire est issue du réseau Inserm jeunes, cadre dans lequel nous organisons des animations autour de la science, destinées aux lycéens. J'admets volontiers que ce ne sont pas des éléments de sondage aussi précis que peuvent en avoir d'autres, mais je n'ai jamais senti de perte d'enthousiasme de la part des lycéens pour la carrière scientifique dans la cinquantaine d'établissements où nous intervenons. C'est lorsque se pose la question de l'entrée à l'université que nous les perdons, car intervient le principe de réalité. L'enseignement de la science doit certainement être amélioré, qu'il s'agisse de la compétence des enseignants ou des méthodes pédagogiques, qui devraient être beaucoup plus ludiques, mais le défaut d'attrait pour les carrières se manifeste plus en aval dans le cursus. Non seulement on propose aux élèves des filières aux perspectives floues, mais il faut être héroïque pour s'y engager puisque, outre que l'on explique mal aux élèves ce qui va se passer, les carrières de chercheur sont des carrières difficiles, avec une sélection importante, pour une rémunération de base qui n'est pas attractive. M. Jean-Marie Rolland, président : Les élus de circonscriptions rurales que nous sommes sont particulièrement conscients de la grande différence d'accès des élèves à la science selon qu'ils ont, ou non, un professeur passionné. M. Christian Bréchot : La qualité de l'enseignement et celle de la compétence des maîtres sont des questions capitales. J'entends souvent dire que les élèves auraient perdu l'appétence pour les sciences et je ne suis pas certain que ce soit exact. En revanche, il existe un problème de fond, qui tient à la représentation sociale de la recherche, en France comme, d'ailleurs, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Ce qui fait défaut, c'est un parcours clairement défini dès la terminale, quand les orientations se font. Mais cette absence d'informations a elle-même pour cause que l'on ne sait pas quoi dire, si bien que l'on donne pour conseil aux lycéens de passer par une grande école, ce qui leur permettra de tout faire... y compris de la science. L'INSERM et l'Université ont beaucoup à faire pour améliorer l'information sur les carrières scientifiques et leur donner davantage de visibilité. Pour l'INSERM, les années qui viennent seront celles de la cassure, car entre 2006 et 2012, 30 % de son personnel partira à la retraite, une proportion inconnue depuis la création de l'organisme. C'est un défi d'ampleur, mais c'est aussi une formidable occasion pour rebattre les cartes. Aussi avons-nous défini une politique des carrières correspondant à notre souhait de donner une situation à vie à nos chercheurs. La première différence avec le système antérieur, c'est que nous estimons normal que ce recrutement soit précédé d'une période pendant laquelle les capacités de l'impétrant sont testées. Nous avons donc mis au point le programme Avenir. Après ses premières années de recherche, thèse en poche, le jeune chercheur part en stage de post-doctorant à l'étranger pendant deux ou trois ans. Il revient alors à l'Inserm avec un contrat de trois à cinq ans, période pendant laquelle il lui est loisible de se présenter aux concours de recrutement de tous les établissements de recherche, dont l'INSERM. S'il est reçu, il devient titulaire. Il a alors 35 ou 36 ans, et de 36 à 40 ans s'il est médecin. Le système anglo-saxon de la senior position est également un emploi à vie, mais régulièrement réévalué, ce qui est une bonne chose. La deuxième différence avec le système antérieur, c'est une rémunération constituée pour deux tiers d'un salaire de base et pour un tiers d'un complément de salaire. Ainsi conjugue-t-on sécurité, forte pression et stimulation à une activité d'interface sous la forme de contrats de transferts de compétences passés avec des universités, des industriels, des agences sanitaires...Nous envisageons aussi des contrats d'interface internes à l'organisme, précisément destinés à la mise sur pied de programmes de diffusion de la connaissance scientifique. Nous proposons donc désormais une gamme de carrières clairement définies. Déjà, 350 de nos 2 000 chercheurs ont signé de tels contrats ; nous souhaitons que la moitié d'entre eux bénéficient de ces mesures élitistes. Les dossiers de candidatures sont examinés à la fois par une commission scientifique de l'INSERM et par le partenaire envisagé, qui évalue si le programme correspond au transfert de connaissances attendu. L'enveloppe budgétaire émane du ministère de la santé, les CHU attribuant les contrats interface après la double évaluation. Nous avons fortement renforcé nos contacts avec les écoles doctorales pour faire connaître ces perspectives nouvelles aux chercheurs. M. Jean-Marie Rolland, président : Parmi vos 2 000 chercheurs, comment s'établit la répartition entre femmes et hommes ? M. Christian Bréchot : Schématiquement, par moitié, mais pas dans tous les grades : il y a beaucoup moins de femmes directrices de recherche que de femmes chargées de recherche. Alors qu'à mon arrivée à la direction de l'INSERM, il y a cinq ans, je n'étais pas du tout convaincu du bien-fondé d'une action en faveur de la parité, je suis maintenant persuadé qu'elle est indispensable. C'est parce que cette pression existe que l'on s'oblige à trouver des solutions et à identifier les personnes. Nous mettons en œuvre cette politique à chaque fois qu'il est question d'une nomination pour un prix et à chaque fois qu'un correspondant doit être nommé en région. La grille de la fonction publique fait que les salaires sont rigoureusement identiques et les contrats d'interface sont tout à fait paritaires. La parité lors du recrutement s'explique par le grand nombre de femmes qui se présentent aux concours. Dans les années 1980, 30 % des chercheurs statutaires recrutés par l'INSERM étaient de formation médicale ; ils n'étaient plus que de 5 à 10 % en 1999-2000, faute d'une rémunération suffisamment attractive. Nous avons créé l'Ecole de l'INSERM et des postes d'accueil pour les internes, et nous avons aussi modifié les règles de recrutement pour permettre que se présentent aux concours des gens plus âgés, comme le sont habituellement ceux qui ont fait des études de médecine. Toujours dans le souci d'une plus grande visibilité, nous avons obtenu que les doyens de faculté réunissent les étudiants pour les informer des possibilités de recherche à l'INSERM. Je le répète : ce qui manque profondément dans le système scolaire français, c'est la lisibilité des carrières scientifiques. Il faut faire comprendre qu'un chercheur n'est pas condamné à un parcours d'errance pour un salaire de misère ! Par ailleurs, la représentation sociale du chercheur « apprenti sorcier » contribue aussi à la désaffection constatée. M. Jean-Marie Rolland, président : Au terme de nos auditions, nous avons le sentiment qu'il existe toujours une élite scientifique brillante en France mais que le niveau scientifique moyen du citoyen a tendance à baisser, ce qui pose un vrai problème dans une société pour laquelle les enjeux scientifiques et technologiques sont si forts. M. Christian Bréchot : L'INSERM souhaite obtenir que de courts programmes scientifiques soient diffusés avant 20 heures sur des chaînes de télévision de grande écoute, et non pas après minuit sur des chaînes à diffusion confidentielle. Mais les budgets ne le permettent pas. Or, les jeunes gens n'entendent pas beaucoup parler de sciences dans les medias. Il le faudrait ; ce serait très efficace. De même, le réseau INSERM jeunes permet de démystifier bien des sujets, et c'est une entreprise de grande importance que les chercheurs se montrent et montrent leurs compétences et leur enthousiasme. Notre problème n'est pas celui de la formation de fond, c'est que nous ne savons pas nous extraire des rigidités administratives pour réussir à fixer en France et à y faire venir, des scientifiques qui y trouveraient pourtant un excellent terreau. L'INSERM compte 20 % d'étrangers dans ses rangs, et nous avons réussi à attirer quelques grosses pointures, mais nous avons encore des difficultés par rapport à nos concurrents britanniques, scandinaves ou suisses. Quant aux Allemands, ils ont les mêmes problèmes que nous. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment les Britanniques ont-ils réussi à trouver de l'argent ? M. Christian Bréchot : En donnant l'autonomie aux universités, et en raison d'une recherche privée plus dynamique que la nôtre. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous d'autres moyens d'information des lycéens que le réseau Inserm jeunes ? M. Christian Bréchot : Le réseau fonctionne très bien, et il a des antennes à l'étranger. Mais nous souhaitons trouver de nouvelles modalités de fonctionnement car nous touchons trop peu de classes. Je serai très favorable à une réflexion nationale sur cette question, et à un engagement plus fort. Nous pourrions nous-mêmes impliquer davantage de chercheurs... à condition que ce soient de bons enseignants ! M. Jean-Marie Rolland, président : Est-il exact que l'on peut être agrégé en mathématiques ou en physique sans avoir jamais mis les pieds dans un laboratoire? M. Christian Bréchot : Oui. M. Jean-Marie Rolland, président : Il nous semblerait aussi utile de sensibiliser les documentalistes des établissements d'enseignement, qui ne sont pas, dans l'ensemble, de formation scientifique, à l'utilisation des bases de données scientifiques afin d'éviter toute fracture territoriale en ce domaine. M. Christian Bréchot : L'effort devrait être à la fois européen et bilatéral. Ces actions conjointes avec l'Allemagne seraient particulièrement intéressantes. * Audition de Mlle Eva Dumontet, secrétaire nationale à la presse, et de Mlle Floréale Mangin, secrétaire nationale aux questions de société à l'Union nationale lycéenne (UNL) M. Jean-Marie Rolland, président : Je vous souhaite la bienvenue. Notre mission, qui s'intéresse à l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire, entendra avec intérêt votre point de vue sur l'attrait pour ces matières, sur la place des mathématiques dans le processus de sélection, sur la place des filles dans les sciences et sur les méthodes pédagogiques visant à favoriser l'enseignement des sciences. Pourriez-vous, pour commencer, nous dire à quel stade de vos études vous en êtes ? Mlle Eva Dumontet : Je suis élève de seconde au lycée Montaigne à Paris. Je pense faire une première L puis essayer une école de théâtre. Je n'ai aucune passion pour les sciences. Mes résultats en physique ont toujours été catastrophiques. En SVT, ils étaient corrects au collège ; à présent, j'oscille entre 9 et 10. Je n'ai jamais éprouvé de difficultés particulières en mathématiques au collège mais elles ne m'ont jamais intéressée. La discipline manque de concret, et les exercices n'appellent pas à la réflexion. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous a-t-on enseigné les statistiques ? Mlle Eva Dumontet : Nous les avons effleurées en troisième et c'est la seule chose qui m'a intéressée car on se plaçait dans un contexte sociologique. M. Jean-Marie Rolland, président : En physique, ni l'électricité ni les forces ne vous ont intéressée ? Mlle Eva Dumontet : Pour vous donner un exemple, on nous a rendu ce matin un contrôle auquel j'ai eu 6 sur 20. On nous avait demandé de calculer la masse de l'atome et de dire le nombre de protons, mais on ne sait rien de ce qu'est un atome. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous des travaux pratiques ? Mlle Eva Dumontet : Une fois par semaine mais si, en chimie, ce sont bien des travaux pratiques, en physique ils sont remplacés par des cours théoriques. Il est vrai que les travaux pratiques se font en demi-groupe et sont plus vivants que les cours magistraux, et que ce serait mieux s'il y en avait plus. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous préféreriez donc passer des heures à manipuler ? Mlle Eva Dumontet : Bien plus que de passer des heures à faire des calculs de puissances. M. Yves Boisseau : Comment expliquez-vous que vous n'aimiez pas la physique alors que vous êtes à l'aise en mathématiques ? Mlle Eva Dumontet : Les professeurs de physique n'ont pas les mêmes méthodes pédagogiques que les professeurs de mathématiques. Mlle Floréale Mangin : Je suis élève de première littéraire au lycée Paul-Eluard à Saint-Denis et je pense entrer dans une classe préparatoire littéraire. J'aimais bien les mathématiques et les sciences mais quand nous avons commencé à apprendre la physique et la chimie, et alors que le collège était équipé de grandes tables de travaux pratiques, nous n'avons eu qu'une ou deux séances dans l'année ; tout le reste a été fait sous forme de cours théoriques. Au collège, j'arrivais encore à comprendre mais, au lycée, il n'y a plus eu que des cours théoriques, sans travaux pratiques du tout ; on n'y comprenait rien. Pourtant, ça m'intéressait, j'ai fait des efforts, mais j'ai eu trois professeurs différents et plutôt que d'expliquer les choses, ils les ont compliquées. Maintenant, je suis en première L et les cours de sciences se font en travaux pratiques. C'est plus vivant. On traite de la vision, des oligoéléments, de l'eau... M. Jean-Marie Rolland, président : De l'eau dans tous les volets de la question ? Mlle Floréale Mangin : Oui, car les programmes de SVT et de physique sont liés, la question n'étant pas abordée avec le même point de vue par les professeurs. Mais les choses sont différentes pour les élèves de la filière S. M. Jean-Marie Rolland, président : Seriez-vous favorable à ce que SVT et physique soient enseignées par un seul professeur ? Mlle Floréale Mangin : J'aime bien entendre des points de vue différents. Peut-être pourrait-on le faire au collège, où les liens manquent entre SVT et physique. Surtout, au collège, les programmes sont très chargés. Peut-être faudrait-il les alléger. Mlle Eva Dumontet : Cela ne me semble pas une bonne idée : les matières sont assez différentes et les méthodes pédagogiques le sont aussi. De plus, le fait qu'il y ait deux professeurs permet à l'élève qui se sent mal à l'aise avec l'un d'être plus à l'aise avec l'autre. Il serait préférable de garder les deux professeurs mais de lier davantage les différentes matières. Il paraît étrange d'étudier la question de l'eau sans mettre le sujet en relation avec l'histoire et la géographie. M. Jean-Marie Rolland, président : Quel âge a votre professeur de physique ? Mlle Floréale Mangin : C'est un agrégé d'une trentaine d'année. L'année dernière, c'était un professeur de la vieille école, et j'étais la seule à suivre son cours. M. Jean-Marie Rolland, président : Pour un professeur de SVT dont c'est la dernière année de cours avant la retraite, l'évolution, en trente ans, a été considérable. Avez-vous ressenti de sa part une sorte de difficulté à être dans le coup ? Mlle Floréale Mangin : Il y a un besoin de formation continue. M. Jean-Marie Rolland, président : Elle est volontaire. Mlle Floréale Mangin : L'enseignement doit bouger et dans son contenu et dans sa forme. Les manières d'enseigner doivent évoluer parce que les élèves et les manières de vivre ont changé. Si on ne le fait pas, cela peut bloquer. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous l'occasion d'utiliser l'informatique ? Mlle Floréale Mangin : Surtout en mathématiques. Mais autant les élèves participent à la classe en SVT et en physique, autant en mathématiques la pédagogie pèche tellement qu'on en vient à douter des capacités réelles de l'enseignant. M. Yves Boisseau : Avez-vous le sentiment que les garçons sont plus intéressés par les sciences que les filles et si oui, pourquoi ? Mlle Floréale Mangin : En filière S, il y a une majorité de garçons. J'avais le choix, mais j'ai renoncé en raison du climat de compétition permanente et du mépris pour les matières littéraires qui y règne, climat entretenu par les professeurs. Plus généralement, parents et professeurs perpétuent un formatage tel que les garçons sont dirigés vers les filières scientifiques et les filles vers les filières littéraires. Dans ma classe de littéraires, il y a six garçons pour vingt-quatre filles. M. Jean-Marie Rolland, président : Est-ce que les enseignants de matières scientifiques traitent différemment les garçons et les filles ? Mlle Floréale Mangin : En mathématiques, notre professeur nous méprise parce que nous sommes en L et que nous suivons un programme simplifié. Pour moi, le problème avec les mathématiques commence à l'école. Il faudrait changer les méthodes d'éveil dès le primaire pour que l'on ne soit pas perdu au lycée. Mlle Eva Dumontet : Dans ma classe, nous sommes presque quarante, avec une répartition filles-garçons équitable. Mais il y a une grande désaffection pour la filière littéraire, vers laquelle ne veulent s'orienter que quatre ou cinq élèves. Tous les autres, filles et garçons, choisissent la filière S - mais c'est parce que nous sommes au lycée Montaigne. On sent malgré tout que les matières scientifiques sont plus « masculines » : les filles ne participent pas alors que dans les autres disciplines, elles participent plus que les garçons. Deux des professeurs de SVT sont des femmes et il y a aussi une femme professeur de physique, et tous les autres enseignants de disciplines scientifiques sont des hommes. Les préjugés font que les garçons s'orientent vers les sciences. Au lycée Montaigne, les filles s'y dirigent aussi, non par amour pour les sciences mais parce que c'est la voie royale, la filière qui ouvrira des portes, même si l'on ne sait pas encore exactement ce que l'on veut faire. Mlle Floréale Mangin : Il est dommage que la filière S soit la voie royale, car les parents poussent fortement leurs enfants à s'y engager même si cela ne les intéresse pas, avec pour résultat une moyenne de 5. Cette hiérarchie, qui place en premier la filière S, puis ES et enfin L - où toutes les portes sont fermées - est vraiment regrettable. Il serait bon de penser à inclure quelques matières scientifiques en terminale L. M. Jean-Marie Rolland, président : Qu'en est-il au collège ? Mlle Floréale Mangin : La mixité est meilleure, mais dès que l'on s'oriente vers les filières littéraires, elle devient presque virtuelle. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous êtes-vous rendu avec vos classes respectives à la Cité des sciences ou au Palais de la découverte ? Mlle Floréale Mangin : J'y suis allée plusieurs fois avec mes parents, dès l'école primaire, mais jamais avec ma classe. C'est dommage, parce qu'il faut y être allé pour avoir envie d'y revenir. J'étais excellente en sciences et j'ai beaucoup hésité l'année dernière, mais le climat qui règne en S m'a poussée à choisir la filière L, où j'ai pu, de plus, m'inscrire en option « arts plastiques », ce que j'aurais dû abandonner en S, car les emplois du temps sont ainsi faits que l'inscription à des enseignements facultatifs est pratiquement impossible, sinon à des horaires extravagants. M. Jean-Marie Rolland, président : Qu'en est-il de l'option « musique » ? Mlle Floréale Mangin : Il n'y en a pas dans mon lycée mais, quoi qu'il en soit, on ne peut présenter au baccalauréat à la fois arts plastiques et musique. Mlle Eva Dumontet : L'option « arts plastiques » n'est pas déterminante en filière S, elle n'est que facultative. Je ne suis pas allée à la Cité des sciences avec l'école, mais avec mes parents. Je serais intéressée par les disciplines scientifiques, par l'astronomie en particulier, mais hors du cadre scolaire. Il faudrait inciter les classes à de telles sorties pendant le temps du collège ; pour ce qui nous concerne, nous sommes passés complètement à côté. M. Jean-Marie Rolland, président : Les centres de documentaion et d'information (CDI) font-ils des efforts pour attirer les élèves vers les matières scientifiques et vers le site de la Cité des sciences ? Mlle Floréale Mangin : Le lycée est abonné à plusieurs magazines scientifiques et offre des invitations pour aller visiter musées et salons, mais il revient aux élèves de faire la démarche. M. Jean-Marie Rolland, président : Les professeurs n'y incitent-ils pas ? Mlle Eva Dumontet : Jamais. L'intéressant, ce sont les travaux de recherche que nous demande de faire notre professeur de SVT. Il serait bien que cela soit plus fréquent. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous visité des laboratoires ? Mlle Eva Dumontet et Mlle Floréale Mangin : Non, jamais. M. Jean-Marie Rolland, président : Avez-vous des suggestions à nous faire ? Mlle Floréale Mangin : C'est un paradoxe que l'on parle de désaffection pour les sciences mais que tout le monde veuille aller en filière S. Ceux qui sont motivés mais qui n'ont pas le niveau des classes préparatoires se retrouvent à la faculté, et c'est ressenti comme un déshonneur ! Il faudrait revaloriser les diplômes universitaires et il faudrait aussi que les professeurs changent d'attitude à l'égard de l'université. M. Jean-Marie Rolland, président : Ils ne poussent pas les élèves à aller à l'université ? Mlle Floréale Mangin : Non. Ils la dévalorisent. M. Jean-Marie Rolland, président : Comment pourrait-on la revaloriser ? Mlle Floréale Mangin : Je ne sais pas. M. Jean-Marie Rolland, président : Aujourd'hui, tout le monde peut entrer en faculté avec un baccalauréat, qu'il soit général ou professionnel. Qu'en pensez-vous ? Mlle Floréale Mangin : Que c'est bien. On ne peut pas interdire à un bachelier telle ou telle filière. Après, tout dépendra de son implication personnelle. Mais si l'on a un diplôme, pourquoi n'aurait-il aucune valeur ? M. Jean-Marie Rolland, président : Des enseignants disent que la diversité des formations initiales fait que certains se trouvent alors en situation d'échec garanti. Mlle Floréale Mangin : C'est qu'il faut des passerelles véritables entre les filières. C'est une chance que les bacheliers professionnels puissent faire des études de sciences, et cela introduit de la diversité dans les métiers. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais l'on nous dit que cela ne marche pas. Mlle Floréale Mangin : C'est peut-être que l'éducation nationale ne fait pas ce qu'elle devrait. M. Jean-Marie Rolland, président : N'est-ce pas une forme de gaspillage que les meilleurs professeurs du pays, ceux de l'Université, soient conduits à faire ce qui n'a pas été fait dans le secondaire ? Mlle Floréale Mangin : Peut-être faut-il mettre sur pied une structure intermédiaire pour établir de véritables passerelles permettant un égal accès à l'Université. M. Jean-Marie Rolland, président : Que pensez-vous de la sélection ? Mlle Floréale Mangin : Il y a toujours une sélection à un moment donné, mais cela n'empêche pas de réfléchir à un système, facultatif, de remise à niveau. M. Yves Boisseau : À supposer que cela soit possible. N'est-ce pas tenter le diable que de prétendre passer de la mécanique de précision à l'histoire ? Mlle Floréale Mangin : On ne peut pas empêcher quelqu'un qui a une passion de s'y livrer. M. Yves Boisseau : Mais n'est-ce pas un gâchis pour l'intéressé et pour l'Université ? Mlle Floréale Mangin : La question est de se connaître soi-même. M. Jean-Marie Rolland, président : Vous avez peur que l'on refuse une seconde chance ; mais l'on peut reprendre des études à trente ans et, en Suède par exemple, on ne devient étudiant que vers 27 ou 28 ans, après avoir fait d'autres choses, ce qui permet d'exercer un choix argumenté. Mlle Floréale Mangin : Combien de jeunes diplômés ne trouvent pas de travail en France ? Voyez ce qu'il en est des techniciens de rivière, pourtant très diplômés. Les postes sont très peu nombreux. M. Jean-Marie Rolland, président : Il est vrai que l'on a fait rêver avec cette formation, en laissant croire que chaque village se doterait d'un technicien de rivière. M. Yves Boisseau : Les sessions d'orientation organisées en classe de troisième mettent-elles l'accent sur les métiers de l'artisanat ? Mlle Floréale Mangin : L'information sur l'orientation connaît des problèmes considérables. J'ai rencontré plusieurs conseillers, et je suis sortie tout aussi perplexe des entretiens que j'ai eus avec eux. Les forums des métiers ne m'ont pas plus aidée. Mlle Eva Dumontet : Au collège, on venait nous dire : « Vous ne savez pas quoi faire ? Essayez la plomberie ou la cartographie » ! Mais c'est à peine si un élève par classe a choisi la voie professionnelle ou technologique. Et, au lycée Montaigne, le discours des conseillers d'orientation ne porte que sur la filière S sous toutes ses formes. M. Jean-Marie Rolland, président : Le moment où l'on vous demande de vous déterminer n'est-il pas un peu précoce Mlle Floréale Mangin : Si. Je doute toujours. Mlle Eva Dumontet : Non. J'étais pressée d'arrêter les mathématiques. Pour ce qui est de l'accès à l'Université, on nous a dit qu'il existe une école, et une seule, qui permet à des bacheliers L d'envisager de se tourner vers la médecine. Mais il n'y a que 25 places pour toute la France. La démarche est pourtant intéressante. M. Jean-Marie Rolland, président : Mais combien de gens ont-ils été véritablement remis à niveau et ont pu passer le concours d'entrée en médecine ? Mlle Eva Dumontet : Je l'ignore. Je le demanderai à la conseillère d'orientation. Mais ce n'est pas parce que l'on a passé un bac de plomberie que l'on doit rester plombier si l'on n'en a pas envie. Il faut plus de ces écoles de remise à niveau. M. Jean-Marie Rolland, président : Il y en a eu une à Bobigny, mais cela n'a pas marché. Mlle Floréale Mangin : Je crois savoir que 1 % des bacheliers L font des études de médecine. Ce n'est pas énorme, mais cela existe. --------------- N° 3061 Rapport d'information de M. Jean-Marie Rolland sur l'enseignement des disciplines scientifiques dans le primaire et le secondaire 1 () « Europe needs more scientists » 2 () Cf. le journal du CNRS n°194 mars 2006 . 3 () Cf. l'article de Jim Gaskell « De l'égalité des sexes » dans le n° 14 de juin 1997 de la revue internationale d'éducation. 4 () Bilan de la progression des Québécoises en sciences et en technologies de 1993 à 2003 5 () Cf. notamment « Femmes et maths, sciences et technos » Presses de l'université du Québec 6 () cette figure est reproduite en annexe du rapport dans le compte rendu de l'audition de M. Pascal Huguet 7 () voir notamment le rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) « Politique économique et croissance en Europe » mars 2006 8 () Désaffection des étudiants pour les études scientifiques, mars 2002 9 () voir l'enquête SOFRES politique « Les attitudes des Français à l'égard de la science », janvier 2001 10 () « Les jeunes et les études scientifiques » 11 () Motivation,orientation, et réussite scolaire : quelle éducation pour les filles ? 12 () Avis n° 16 - mai 2005 13 () rapport n° 392 de Mme Marie-Christine Blandin et M. Ivan Renar : « La diffusion de la culture scientifique » 14 () L'enfant et la science, l'aventure de La main à la pâte, octobre 2005, publié chez Odile Jacob 15 () rapport sur l'opération "la main à la pâte" et l'enseignement des sciences à l'école primaire 16 () En 205 avant JC, le mathématicien grec Ératosthène observa que les ombres ne sont pas les mêmes suivant l'endroit où l'on se trouve et utilisa ces différentes positions pour calculer la circonférence de la terre. 17 () « Mathématiques, sciences expérimentales et d'observation à l'école primaire » 18 () Association cherchant à promouvoir l'activité mathématique chez des jeunes, sous toutes ses formes : ateliers, compétitions, clubs. On trouvera en annexe du présent rapport une présentation détaillée de l'action de l'association ANIMATH. 19 () Avis de l'académie des sciences sur l'enseignement scientifique et technique dans la scolarité obligatoire : école et collège 20 () créé par la circulaire n° 2000-206 du 16 novembre 2000 21 () Avis sus visé de l'académie des sciences et avis de l'Académie des technologies sur le même sujet le 8 septembre 2004. 22 () Au Québec, les études supérieures se déroulent en deux phases à la fin du cycle secondaire (l'équivalent de la classe de 1ère en France), les élèves entrent en collège d'enseignement général et professionnel (CEGEP) pour une formation pré-universitaire. 23 () La constante macabre ou comment a-t-on découragé des générations d'élèves, Éditions Math'Adore, septembre 2003 24 () biologie de laboratoire et paramédicale, initiation aux sciences de l'ingénieur, mesures physiques et informatique, physique et chimie de laboratoire. 25 () Rapport n° 2005-112 « Sciences expérimentales et technologie, histoire et géographie, leur enseignement au cycle III de l'école primaire ». 26 () Rapport n°2975 sur la mise en application de la loi du 23 avril d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école 27 ()Composée d'environ 40 membres (directeurs d'écoles, représentants des associations de professeurs des classes préparatoires, représentants de l'Inspection générale de l'éducation nationale, des bureaux concernés au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que des tutelles des écoles relevant d'autres ministères), la commission Amont s'intéresse aux viviers des futurs élèves (classes terminales, classes préparatoires, formations universitaires, etc ..) et aux modalités de recrutement (par voie de concours, sur dossier et/ou entretiens, ..) de l'ensemble des grandes écoles dans la diversité des formations offertes (écoles d'ingénieurs, de commerce et de gestion, écoles agronomiques, vétérinaires, ...). Par la complémentarité des membres qui la composent, la commission Amont constitue une structure d'échanges, de concertation et de coordination. 28 Conduit au bac S, options sciences de l'ingénieur 29 Rapport d'information n° 2247 « La définition des savoirs enseignés à l'école » - 13 avril 2005 |