N° 3467 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2006 RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, sur les délocalisations ET PRÉSENTÉ PAR Mme Chantal BRUNEL, Rapporteur en conclusion d'une mission d'information présidée et composée en outre de M. Jean-Marie
BINETRUY, Jean-Paul CHANTEGUET, Mme Claude DARCIAUX, M. Pierre DUCOUT, Mmes Arlette FRANCO, Députés. RÉSUMÉ DU CONSTAT ET PRINCIPALES PROPOSITIONS 9 INTRODUCTION 15 PREMIÈRE PARTIE : LES DÉLOCALISATIONS, UN PROBLÈME MAL APPRÉHENDÉ ET SOUS-ESTIMÉ 19 I.- UN PROBLÈME MAL APPRÉHENDÉ 19 A.- QUELLE DÉFINITION POUR LES DÉLOCALISATIONS ? 19 B.- DES DIFFICULTÉS D'APPRÉHENSION DU PHÉNOMÈNE EN L'ABSENCE D'INDICATEURS SPÉCIFIQUES 22 C.- UNE APPROCHE « MACRO-ÉCONOMIQUE » QUI PASSE SOUVENT À CÔTÉ DES RÉALITÉS HUMAINES ET TERRITORIALES 29 II.- UN PROBLÈME SOUS-ESTIMÉ 35 A.- POUR UNE DÉFINITION PLUS RÉALISTE DES DÉLOCALISATIONS 35 B.- DES EFFETS NÉGATIFS QUI NE SE LIMITENT PAS AUX SEULES PERTES D'EMPLOIS 39 C.- DES EFFETS « POSITIFS » DIFFUS DIFFICILEMENT PERCEPTIBLES PAR LES SALARIÉS 41 III.- LES CAUSES GÉNÉRALES DE LA MONTÉE DU PHÉNOMÈNE 46 A.- LA FINANCIARISATION DE L'ÉCONOMIE OU LA VALORISATION DU COURT TERME 46 B.- LA RÉDUCTION DES DISTANCES ET DES DÉLAIS OU LA LEVÉE DES FREINS À LA DÉLOCALISATION 47 C.- LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES ET L'APPARITION DE NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES 47 D.- LA SEGMENTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 49 E.- UNE PRESSION ACCRUE SUR LES PRIX 50 IV.- DIFFÉRENTS FACTEURS PROPRES À LA FRANCE INCITENT À LA DÉLOCALISATION 50 A.- LES ÉCARTS DE COÛTS SALARIAUX 50 B.- LE POIDS DE LA FISCALITÉ ET LES COÛTS ADMINISTRATIFS 54 1. Le poids des prélèvements obligatoires 54 a) Le poids élevé des prélèvements obligatoires en France 55 b) Un constat global à nuancer en fonction en particulier de la répartition de la charge 55 2. Les coûts administratifs 61 C.- LA COMPLEXITÉ RÉGLEMENTAIRE ET L'INCERTITUDE JURIDIQUE 61 1. Le droit des marchés publics à la recherche d'un sens 62 a) Un droit instable et formaliste 63 b) Un droit obscur, voire ésotérique 66 2. Pour une plus grande sécurité juridique 67 DEUXIÈME PARTIE : UN PHÉNOMÈNE DONT ON PEUT CRAINDRE L'AGGRAVATION AU COURS DES ANNÉES À VENIR 69 I.- UNE ACCÉLÉRATION PRÉVISIBLE DES DÉLOCALISATIONS AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES 69 A.- UN PHÉNOMÈNE QUI S'ALIMENTE DE LUI-MÊME 69 B.- UN PHÉNOMÈNE QUI S'ÉTEND À D'AUTRES SECTEURS 71 1. Le secteur des services 71 2. La recherche et développement 73 3. Un mouvement encore peu visible 75 4. La France a jusqu'ici été moins affectée par les délocalisations que d'autres pays 76 II.- UNE COMPÉTITIVITÉ INSUFFISANTE 77 A.- LES CONTRAINTES NATIONALES : UN FREIN À LA COMPÉTITIVITÉ 77 1. Un indicateur préoccupant de la compétitivité de l'économie française : le commerce extérieur 78 2. L'emploi ne se limite pas aux services : ne pas négliger une industrie en perte de compétitivité 80 3. La rigidité du droit du travail 80 4. Les contraintes culturelles : une nécessaire évolution des mentalités 83 B.- L'UNION EUROPÉENNE, UNE CHANCE ET UN HANDICAP POUR LA FRANCE 83 TROISIÈME PARTIE : RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE POUR ASSURER L'AVENIR 87 I.- LA FRANCE DOIT TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES D'UNE ÉCONOMIE FONDÉE SUR L'INNOVATION 87 A.- L'INNOVATION, UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT DE LA CROISSANCE 88 1. Le couple « recherche-innovation », clef de voûte de la préparation de l'avenir 90 a) Les objectifs de la stratégie de Lisbonne 90 b) Un objectif non atteint 91 2. La France a tardivement intégré cette préoccupation 92 a) La faiblesse relative des dépôts français de brevets 93 b) L'urgence de ratifier les accords de Londres 95 B.- L'INSUFFISANCE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ, NOTAMMENT POUR LES PME, CONSTITUE UN PROBLÈME RÉCURRENT 96 1. Une complémentarité évidente 98 2. Une complémentarité qu'il convient de développer 99 3. La loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche crée les outils du développement de la recherche 100 a) En termes de financement 101 α) Une programmation des moyens affectés à la recherche 101 β) Des moyens budgétaires conformes aux orientations 101 b) En termes de pilotage 103 c) En termes de dynamisme 106 d) Le crédit d'impôt recherche 109 e) Le renforcement de l'attractivité des jeunes entreprises innovantes (JEI) 111 f) En termes de simplifications administratives 111 C.- LA RECHERCHE DOIT FACILITER L'ADAPTATION À L'INTERNATIONALISATION DE L'ÉCONOMIE 112 1. Recherche fondamentale et recherche appliquée doivent ensemble mieux concourir 113 2. Quelle place pour les centres régionaux d'innovation et de transfert technologique ? 114 3. Les pôles de compétitivité : un outil au service de l'innovation 115 4. Les pôles d'excellence rurale, un complément indispensable des pôles de compétitivité 117 5. Activer au plus tôt les pôles de recherche et d'enseignement supérieurs (PRES) 118 6. Accélérer la mise en place des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) 118 7. Faciliter la création de groupements d'intérêt économique (GIE), une voie à explorer 118 8. Rendre plus attractives les carrières de chercheurs 120 II.- POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PME 122 A.- LES ACTIONS EUROPÉENNES 123 B.- LES MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DÉJÀ MISES EN œUVRE 124 1. Faciliter et encourager la création d'entreprise 125 2. Simplifier l'embauche et la gestion des PME 126 3. Favoriser le financement et la transmission des PME 128 C.- PERMETTRE AUX PETITES ENTREPRISES DE DEVENIR DES MOYENNES ENTREPRISES 130 1. Les initiatives destinées plus particulièrement aux « gazelles » 131 a) En matière de financement 131 b) Accompagner la croissance des « gazelles » 133 c) Faire émerger des « gazelles » par essaimage de grandes entreprises 133 2. Les programmes à portée générale 133 a) Renforcer la compétitivité, la valeur ajoutée et les performances des entreprises 133 b) Faciliter l'accès à de nouveaux marchés 134 c) Permettre les rapprochements et les fusions des PME 134 D.- POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE 134 III.- UNE ÉVOLUTION INDISPENSABLE DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS EN DIRECTION DES PME 135 A.- CRÉER UN SITE INTERNET UNIQUE EN FRANCE 135 B.- POUR UN « SMALL BUSINESS ACT » EUROPÉEN 136 1. La politique américaine en faveur des PME 136 a) Accès au capital 136 b) Promotion des entreprises 137 c) Marchés publics 137 2. Lever les obstacles juridiques à l'introduction d'une préférence en faveur des PME 139 a) Les accords de l'OMC 139 b) Autres obstacles 141 C.- UNE OUVERTURE ASYMÉTRIQUE DES MARCHÉS EUROPÉENS 142 IV.- POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DES AIDES PUBLIQUES 143 A.- UN DISPOSITIF FRANÇAIS D'AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES PEU TRANSPARENT 143 B.- UNE RATIONALISATION INDISPENSABLE DU DISPOSITIF D'AIDES PUBLIQUES 145 C.- VERS PLUS D'ÉVALUATION : DISSUADER LES COMPORTEMENTS OPPORTUNISTES ET OPTIMISER L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS 147 V.- FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE : DIMINUER LA CHARGE PESANT SUR LES ENTREPRISES PAR UN POINT DE TVA SOCIALE 151 A.- UN ÉCART ENTRE COÛT DU TRAVAIL ET SALAIRE NET PARMI LES PLUS ÉLEVÉS DES PAYS DE L'OCDE 151 B.- UNE RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE INDISPENSABLE POUR AFFRONTER LE DÉFI DE LA MONDIALISATION 153 1. La TVA sociale, facteur de rétablissement de la compétitivité relative des entreprises françaises 154 a) Rétablir les conditions d'une concurrence loyale sur le marché domestique et stimuler nos exportations 154 b) Responsabiliser le consommateur sur ses choix 155 2. Des dispositifs déjà mis en œuvre ou envisagés dans d'autres pays européens 155 3. Quelles modalités pour la mise en œuvre d'une TVA sociale en France ? 158 VI.- POUR UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES ADAPTÉE À LA MONDIALISATION ET À L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE 161 VII.- POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF : ALLÉGER, SIMPLIFIER, METTRE FIN À L'INCERTITUDE JURIDIQUE ET S'ADAPTER AU MONDE MODERNE 163 A.- LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL CONSTITUE UN OBJECTIF PRIORITAIRE. 164 B.- LE DÉBAT SUR LA « FLEXISÉCURITÉ » 165 C.- SIMPLIFIER ENCORE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 167 D.- LE SERPENT DE MER DES DÉLAIS DE PAIEMENT 168 VIII.- MIEUX OBSERVER L'ÉVOLUTION DE LA MONDIALISATION ET DES DÉLOCALISATIONS 170 CONCLUSION 173 EXAMEN EN COMMISSION 175 ANNEXES 185 ANNEXE I : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA MISSION 187 ANNEXE II : LA POLITIQUE DE L'INNOVATION EN FINLANDE 191 ANNEXE III : OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR MADAME JANINE JAMBU AU NOM DU GROUPE DES DÉPUTÉ-E-S COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS 197 ANNEXE IV : OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR MADAME CLAUDE DARCIAUX AU NOM DU GROUPE SOCIALISTE 203 RÉSUMÉ DU CONSTAT ET PRINCIPALES PROPOSITIONS Sont considérés comme des délocalisations au sens du présent rapport tous les arbitrages d'entreprises qui renoncent à maintenir, développer ou créer leurs activités en France pour produire ou sous-traiter à l'étranger, à destination du marché national ou des marchés d'exportation. Ces délocalisations sont un phénomène à la fois mal mesuré et sous-évalué. Les conséquences directes sur les personnes et sur les territoires affectés sont souvent dramatiques. Les délocalisations sont d'autant plus génératrices d'angoisses que leur simple menace constitue un outil de pression fort sur les salariés. La situation est d'autant plus préoccupante que tout indique que les délocalisations sont appelées à s'amplifier, non seulement dans l'industrie mais aussi dans les services. Aujourd'hui des pays comme l'Inde ou la Chine sont capables de nous concurrencer sur les produits à forte valeur ajoutée. La suprématie des pays industrialisés est donc en train d'être remise en cause. Dans un monde devenu un vaste atelier, la France est confrontée à un choix simple, subir ou réagir. Subir, c'est-à-dire considérer la France comme une terre isolée susceptible d'échapper à la mondialisation. Cette vision fournit une justification théorique pour ne pas s'adapter à la nouvelle donne mondiale et maintenir des blocages. Il est ainsi certain que les 35 heures ont été un facteur de rigidité qui n'a pas contribué à accroître la compétitivité de la France. Subir, c'est la garantie d'un déclin continu et, faute de moyens, la certitude de voir s'effondrer le modèle social même que l'on voulait protéger. L'autre approche consiste à s'adapter à la mondialisation en s'efforçant de profiter de la croissance économique qu'elle induit tout en en luttant contre les inconvénients. Contrairement à une idée reçue, la mondialisation n'emprunte pas une voie unique. En témoignent les expériences suivies avec succès par le Japon, le Danemark, le Royaume-Uni, les États-Unis ou la Finlande. Encore faut-il réagir. 1. Création d'un observatoire de la mondialisation et des délocalisations Son rôle serait de mieux cerner l'évolution de ces deux notions, tout en offrant une instance de dialogue sur un sujet essentiel. Afin de ne pas créer un nouvel organisme, il serait rattaché au Conseil d'orientation pour l'emploi, compte tenu certes du lien évident entre emploi et délocalisations mais également de la présence de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux dans cet organisme. Enfin, comme l'ont souligné MM. Fontagné et Lorenzi, une telle décision éviterait d'abandonner l'expertise sur les sujets internationaux aux think tanks européens ou américains. 2. Moins d'aides, plus de résultats _Les aides sont multiples, complexes, non évaluées et difficiles à appréhender par les chefs d'entreprise. Un audit de ces aides doit être effectué prochainement à l'initiative du ministre du budget. S'il n'était pas effectué, il appartiendrait au Conseil d'Orientation pour l'Emploi d'accomplir cette mission. Les chefs d'entreprises pourraient se consacrer à des tâches plus productives que la constitution de dossiers. Il est essentiel de ne pas systématiquement aider les entreprises condamnées. Les fonds publics sont une ressource rare. Concentrons nos efforts sur les entreprises qui peuvent être sauvées et, dans les autres cas, protégeons la personne des salariés. Les régions assurant une tâche de coordination au plan régional dans leur zone de compétence, il appartiendrait au Conseil d'Orientation pour l'Emploi d'en assurer la synthèse au plan national afin que l'ensemble des aides soient recensées. _Des engagements sur la création ou le maintien d'emplois doivent être liés à ces aides. _L'objectif est de dépenser plus efficacement l'argent public en investissant d'abord dans les secteurs stratégiques qui assureront les emplois de demain. La suppression des aides inutiles dégagera des ressources. Le Conseil aura pour mission d'identifier les secteurs particulièrement menacés par les délocalisations et où il conviendrait d'investir massivement dans la formation professionnelle des salariés concernés pour les adapter aux mutations économiques. 3. Recherche et innovation : _La stratégie de Lisbonne (fonder la croissance de l'Europe sur l'innovation, notamment en augmentant les dépenses de recherches et développement) est bonne dans son principe. Elle souffre d'un manque de moyens pour sa mise en œuvre au niveau communautaire. Un effort budgétaire de l'Union européenne plus important s'impose. _Faciliter la mobilité, dans les deux sens, entre l'industrie et la recherche et faciliter la venue en France de chercheurs étrangers. _Ratification de la Convention de Londres sur le dépôt des brevets. Cette ratification permettrait de diminuer significativement le coût de dépôt d'un brevet. _Accroître les avantages fiscaux accordés aux FCPI (Fonds communs de placement dans l'innovation). _Diligenter un audit sur les centres régionaux d'innovation et de transfert technologique. _Améliorer les conditions de travail des chercheurs, les rémunérations en particulier, pour éviter leur expatriation à terme, quitte, en contrepartie, à différencier les rémunérations en fonction des résultats par la fixation d'objectifs et leur évaluation. _Rapprocher l'université et l'entreprise par des partenariats publics/privés : → Moduler les crédits de recherche des universités hors dépenses de personnel et de fonctionnement, en fonction de l'existence d'un partenariat avec une entreprise, en en faisant un critère prédominant dans l'appréciation des projets de recherche appliquée par l'Agence Nationale de la Recherche. → Étudier la modulation du crédit d'impôt recherche pour les moyennes et les grandes entreprises en fonction du partenariat avec une université. _Améliorer le crédit d'impôt recherche pour l'emploi de docteurs. _Dans la mesure où la Commission européenne ferait évoluer sa position sur ce point, il serait intéressant de moduler le crédit d'impôt recherche en fonction des secteurs afin de dynamiser des secteurs particulièrement porteurs d'avenir, comme le préconise le rapport Mc Kinsey [octobre 2006]. _Faciliter la constitution de GIE entre entreprises, afin de permettre aux PME de financer « collectivement » des recherches. _Le principe des pôles de compétitivité est excellent. Ils ont favorisé le développement d'une culture de collaboration entre tous les acteurs de ces pôles. À terme, une plus grande concentration des moyens sur ceux qui réussissent le mieux est envisageable. 4. Une politique d'aide aux PME Celles-ci sont en effet très vulnérables aux mutations actuelles et, du fait des règles en vigueur, les PME ont des difficultés supplémentaires d'accès aux marchés publics. a) Faciliter l'accès des PME aux marchés publics _Par un « Small Business Act » français et européen : par une préférence en faveur des PME sur le modèle des États-Unis. _Par un site internet unique assurant une meilleure information des PME. _Par la création d'une structure aidant les PME à soumissionner aux marchés publics. _Cesser ce jeu consistant à modifier en permanence les règles - quatre codes des marchés publics en six ans ! - et ne plus faire du raffinement contentieux une spécialité française. L'existence de règles compréhensibles et stables, reconnues par tous, aiderait à mettre fin à cette absurdité consistant à faire du prix le critère majeur d'attribution de beaucoup de marchés, au détriment tant de la qualité de l'achat public que des entreprises soumissionnaires poussées au dumping. b) Assurer le financement des PME _Il conviendrait d'encourager la souscription de titres émis par les PME en augmentant les avantages fiscaux existants. _Augmenter les contraintes sur un certain nombre d'investisseurs (compagnie d'assurance par exemple) qui investissent peu dans les PME, en aménageant les règles accordant aux souscripteurs certains avantages fiscaux en contrepartie des investissements réalisés. Ainsi, la part des titres à risque ouvrant droit au bénéfice d'une exonération d'impôt liée à une durée de détention minimale devrait représenter 12 % (au lieu de 10 % actuellement) au moins de l'actif, parmi lesquels les titres non cotés représenteraient au moins 8 % (au lieu de 5 %). c) Raccourcir les délais effectifs de paiement des entreprises par les personnes publiques d) Mobiliser les réseaux d'aides à l'exportation en direction des PME avec des objectifs par zones géographiques ou groupes de pays 5. Financement de la protection sociale : diminuer la charge pesant sur les entreprises par un point de TVA sociale _Il conviendrait d'approfondir la manière dont pourrait être introduite une « TVA sociale », sur la base de l'augmentation d'un point du taux normal [19,6 %] de TVA (5,7 milliards d'euros), à l'exclusion évidemment des produits de première nécessité taxés à 5,5 %, avec en contrepartie une réduction à l'euro près des charges patronales. Ainsi, la TVA sociale frapperait également les importations et non plus le seul travail en France. À la différence des cotisations sociales, elle ne pèserait pas sur le coût des exportations, rendues ainsi plus compétitives. Cette réforme aurait l'avantage d'introduire plus de transparence dans le financement de notre système de protection sociale. Actuellement, les cotisations financent à la fois des actions relevant de l'assurance (retraite) ou de la solidarité (prestations familiales). La diminution de cotisations permise par l'augmentation de la TVA porterait donc sur les cotisations relevant d'une logique de solidarité. La France se rapprocherait ainsi de l'Allemagne à un moment où celle-ci a fait de la réduction de ses coûts une priorité très forte. _Il serait intéressant d'étudier cette réduction dans la perspective d'une remise en cause de la forte progressivité de ces cotisations et d'étudier une réforme de la prime pour l'emploi. 6. Droit social et contraintes administratives : alléger, simplifier, mettre fin à l'incertitude juridique et s'adapter au monde moderne. _Pour s'adapter au monde moderne (la France étant un des pays qui travaille le moins), il conviendrait de stimuler l'emploi en aménageant le temps de travail pour répondre aux besoins des entreprises et à la diversité des aspirations des salariés. Il serait souhaitable de pouvoir transférer les JRTT [jours de récupération du temps de travail] sur un Plan Épargne Entreprise avec les mêmes avantages que l'intéressement, hors charges salariales et patronales. _Afin de libérer le travail, sans altérer les droits fondamentaux des salariés, l'évolution du droit du travail doit se faire par la négociation. Le gouvernement en listerait les thèmes essentiels qui seraient soumis aux partenaires sociaux. Ils disposeraient d'un certain délai pour parvenir à un accord ou à un relevé des points d'accord et de désaccord. Le Parlement serait ensuite appelé à légiférer. _Une priorité : faire en sorte que l'administration réagisse plus rapidement, pour tenir compte des réalités économiques. Aujourd'hui, les délais de réaction des entreprises sont chaque jour plus courts alors le système public n'a pas d'horloge. Ainsi, à titre d'exemple, toute interrogation d'une entreprise sur le caractère éligible d'une dépense au titre du crédit d'impôt recherche serait réputée acceptée faute de réponse de l'administration dans un délai de six semaines. 4L'entreprise qui se crée se débat dans le carcan que constitue le cadre juridique et fiscal dans lequel elle doit se mouvoir. L'institution d'une sorte de moratoire pour ce type d'entreprises serait de nature à faciliter la création d'entreprises et un démarrage plus aisé. Le « guichet unique », déjà mis en œuvre en matière fiscale pour les grandes entreprises, va l'être pour les PME à compter de cette année. Dans cet esprit, afin de permettre aux petites entreprises d'amorcer leur « décollage » dans des conditions optimales, il serait intéressant d'étudier la généralisation du chèque emploi très petites entreprises créé par l'ordonnance du 2 août 2005, à l'ensemble des PME pendant les deux premières années de leur existence, avec maintien de l'obligation d'un contrat de travail écrit. _La formation professionnelle ne doit pas se limiter à l'adaptation aux postes de travail. Il faut d'abord beaucoup plus de lisibilité dans l'usage des crédits de la formation professionnelle (24 milliards d'euros en 2004 pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage, soit 1,46 % du PIB). Il convient d'élaguer et de recentrer ces crédits sur l'encouragement à la mobilité de qualification ainsi qu'à la mobilité géographique des salariés. Le salarié doit être encouragé à retrouver le plus vite possible un emploi, en lui accordant par exemple une prime. Le droit à la formation devrait être particulièrement important pour les salariés n'ayant pas au départ un niveau élevé de qualification. _Le gouvernement s'engagerait à communiquer le coût des nouvelles formalités imposées aux entreprises avant toute décision. 7. Pour une certification sociale européenne _Il serait souhaitable de mettre en place une certification sociale au niveau européen, témoignant du respect par les entreprises labellisées du respect d'un ensemble minimal de règles. Les consommateurs seraient ainsi en mesure d'orienter leurs achats en fonction de ce label. 8. Adapter le droit fiscal aux besoins de l'économie _Il faut soutenir les propositions de la Commission Européenne tendant à harmoniser l'assiette de l'IS en Europe afin de permettre des comparaisons objectives sur ce sujet et pour limiter les délocalisations fiscales et entraver les stratégies d'optimisation fiscale. Les comparaisons n'ont, en effet, guère de sens si les assiettes ne sont pas comparables. _Baisse de l'IS : actuellement, ce taux est limité à 15 % pour les PME, sur la fraction de leurs bénéfices inférieure à 38 120 euros. Le taux normal est aujourd'hui de 33 % en France, la moyenne européenne étant de 26 %. Il serait souhaitable d'instaurer un taux de 18 % sur les 500 000 premiers euros imposables, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, avec 100 000 euros imposables à 18 % sans condition de chiffre d'affaires, le taux de 15 % restant applicable dans les conditions actuelles aux très petites entreprises. « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. » Sénèque : Lettres à Lucilius MESDAMES, MESSIEURS, Les délocalisations sont l'une des manifestations du changement radical qu'a connu le monde au cours des vingt dernières années. La fragmentation de la chaîne de production traditionnelle a été probablement l'événement majeur. « Les différents étages de la grande entreprise industrielle sont dissociés les uns des autres. On recourt aux sous-traitants pour les tâches réputées inessentielles. On regroupe les ingénieurs dans les bureaux d'études indépendants où ils ne rencontrent plus guère les ouvriers. Les employés chargés du nettoyage, des cantines, du gardiennage, sont chacun recrutés par des entreprises spécialisées (1) ». L'externalisation n'a ainsi fait que précéder les délocalisations. L'essentiel de la valeur ajoutée provient aujourd'hui de la conception et de la commercialisation. Pour reprendre un exemple de M. Daniel Cohen, sur une paire de Nike vendue 70 $ aux États-Unis, le coût du salaire de celui qui la fabrique est de 2,75 $. La conception peut ainsi se faire aux États-Unis ou en France et la fabrication en Chine. Toute cette évolution n'est évidemment possible qu'en raison de l'abaissement des coûts de transport et des nouvelles technologies de l'information, accompagnée par la libre circulation des marchandises et des capitaux, en d'autres termes la mondialisation. Une première mondialisation était déjà intervenue avant la première guerre mondiale (2). À certains égards, elle était plus large qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse de la mobilité des capitaux ou de celle de la main-d'œuvre. La véritable différence entre la première mondialisation et l'actuelle tient avant tout au poids des pays émergents. La Chine et l'Inde sont en passe de remettre en cause le monopole de ce qu'il est convenu d'appeler les pays développés. Une autre caractéristique de la période actuelle tient à la montée en puissance des actionnaires. « Dans un renversement copernicien des fondements mêmes du salariat, ce sont désormais les salariés qui subissent les risques, et les actionnaires qui s'en protègent. (3) » L'exigence de rentabilité des capitaux ne cesse ainsi de croître, ajoutant un élément de pression de plus en faveur de la réduction des coûts et des délocalisations, et ce même si la « finance » ne doit pas être diabolisée naïvement : sans finance, pas d'anticipation, pas de prise de risques et des investissements réduits. L'économie d'aujourd'hui est aussi particulièrement complexe, « contre-intuitive », pour reprendre une expression de M. Patrick Artus (4). Il rappelle ainsi que 60 % des importations des États-Unis depuis la Chine sont des productions d'entreprises américaines installées en Chine. Il y a eu un remplacement de la production domestique par les importations de productions délocalisées. La baisse du dollar conduit donc à une hausse des importations. Le débat ne se pose donc plus, du fait des délocalisations, en termes de substituabilité. Le choix qui s'offre à nous n'est pour autant pas d'approuver ou de rejeter la mondialisation. La France ne peut être l'Albanie du XXIème siècle. Le pire n'est pas de s'adapter à la mondialisation, mais d'en être à l'écart. Comme l'exprime avec force M. Paul Bairoch, « L'Occident n'a pas besoin du tiers-monde, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le tiers-monde ». En revanche, s'adapter ne signifie pas s'aligner automatiquement et intégralement sur le modèle américain. Mme Suzanne Berger a bien montré dans son ouvrage « Made in Monde » que plusieurs voies étaient possibles. Elle souligne qu'elle n'a pas rencontré de modèle unique et supérieur à tous les autres. Une entreprise prospère peut être créée à n'importe quel point de la chaîne de valeur et il n'y a pas de secteur condamné. Ainsi, le textile peut prospérer dans un pays développé. Elle ne cache pas pour autant que la mondialisation ne profite pas à tout le monde. L'exemple des pays scandinaves montre néanmoins qu'adaptation à la mondialisation et justice sociale ne sont pas antithétiques. Dans un tel contexte, le pire choix serait de ne rien faire. À l'évidence, le statu quo ne marche pas ! Nous ne pouvons pas vivre de nos rentes ! En termes de pouvoir d'achat, la France est certes dépassée par les États-Unis, mais aussi... par l'Irlande. La mission a pu constater le redressement tant du pays basque espagnol que de la Finlande. Au début des années 90, Nokia était au bord de la faillite, comme son pays d'origine. Aujourd'hui, cette entreprise est la première du monde en téléphonie mobile et la Finlande un modèle en termes de politique de l'innovation. L'effort paie ! Et si l'on s'inquiète du renforcement des inégalités induit, incontestablement, par la mondialisation, il convient de se rappeler que l'on ne peut redistribuer que la richesse produite ! Une économie prospère est la condition sine qua non d'une politique sociale généreuse, même s'il ne faut pas pour autant accepter n'importe quoi. L'Union européenne n'est pas dépourvue de défauts : primat absolu accordé à la concurrence, absence de véritable politique industrielle - même si le mot y a fait une apparition - paralysie fréquente due à la règle de l'unanimité, etc. Pour autant, l'Europe constitue l'un des atouts dont nous disposons pour atténuer les effets les plus pervers de la mondialisation. Son poids économique est en effet suffisant pour infléchir la marche des grandes entreprises. L'exemple des États-Unis est là pour nous montrer que l'État américain est loin d'avoir perdu tout pouvoir sur l'économie. Actuellement, les États européens, à défaut d'harmonisation, ne trouvent quant à eux rien de mieux à faire que de se livrer une féroce concurrence fiscale. Dans son ouvrage sur la première mondialisation, Mme Suzanne Berger rappelle que « Les mêmes changements dans les structures de la vie quotidienne produisant les mêmes anxiétés, les Français du tournant du siècle établirent entre les mécanismes de la mondialisation et leur impact sociétal des liens qui rappellent étrangement ceux que nous faisons aujourd'hui. » Elle cite à l'appui de cette remarque l'ouvrage de M. Edmond Théry, « Le péril jaune », publié en 1901 et dont votre rapporteur en citera l'extrait ci-après qui, le style mis à part, illustre si bien nos craintes... 105 ans après sa parution. « La Chine d'aujourd'hui, misérable et affamée, ne peut être la cliente de l'Europe que pour l'achat des machines nécessaires à son industrie naissante, mais la réciprocité des échanges manufacturiers ne pourra jamais exister entre elle et l'Europe, même quand elle sera outillée, par cette raison péremptoire que si le développement du bien-être des Chinois et la transformation de leurs besoins actuels les poussent un jour à user des produits de consommation courante dans nos pays, ils les fabriqueront aussitôt et dans de telles conditions de prix de revient, que toute concurrence d'ordre extérieur sera impossible. (...) La question de la qualité de ces produits ne se posera pas car tous les Européens qui ont habité la Chine, tous les ingénieurs qui ont employé la main-d'œuvre indigène, affirment que les Chinois sont des ouvriers incomparables. (...) II ne restera, donc pour nous défendre, que la question de la distance, c'est-à-dire la question des frais de transport... : mais on oublie trop, dans le monde du libre-échange, que l'emploi de l'électricité et de la vapeur l'ont presque supprimée et que, en ce qui concerne spécialement l'Extrême-Orient, le canal de Suez, les grands steamers à marche rapide et la concurrence des frets - sans parler de l'influence prochaine du Transsibérien - ont décuplé la vitesse de circulation des marchandises, assuré à leur livraison une régularité presque mathématique et réduit leurs frais de transport dans des proportions telles que leur prix de revient - surtout lorsqu'il s'agit de produits manufacturés - n'en peut plus être sensiblement affecté. D'une manière générale, les nouvelles conditions des communications terrestres et maritimes nivellent, dans le monde entier, le prix de vente des marchandises de fabrication et de consommation générales. C'est naturellement dans le sens du plus bas prix de revient de ces marchandises que ce nivellement se produit. » La première guerre mondiale n'a pas permis de savoir si cette crainte était fondée, la mondialisation ayant été stoppée net par ce conflit. Aujourd'hui, la peur devant l'avenir est d'autant plus forte qu'il existe une contradiction insoutenable entre une approche macroéconomique abstraite, non dépourvue de lacunes, et une réalité humaine et territoriale parfois dramatique, affectant en priorité les travailleurs les moins qualifiés et des bassins d'emplois souvent déjà fragilisés. Cette approche méconnaît également la pression qu'exerce sur les salariés, contraints d'accepter ainsi une dégradation de leur situation, la menace des délocalisations. Au plan mondial, cette contradiction entre le vécu et le raisonnement désincarné était à son comble lors du cycle de négociations de Doha. Leur succès était crédité d'une augmentation de 300 milliards de dollars du PIB mondial, agrégat abstrait s'il en est ! De quel poids pèse cet argument si l'ouverture supplémentaire des marchés qui en résulterait se traduisait par de nouvelles vagues de délocalisations ? Face à cette situation, l'ambition de ce rapport est double. Elle est tout d'abord de faire le point sur ce phénomène mal évalué et sous-estimé que sont les délocalisations, tout en en dégageant les causes ; elle est ensuite de dégager des pistes pour l'avenir, pour faire de l'innovation et de la compétitivité de la France une priorité et de l'avenir un espoir et non une crainte. Dans cette perspective, Votre Rapporteur souhaite que ce rapport puisse jouer un rôle pédagogique et contribue à une meilleure appréhension des réalités économiques. Cela ne signifie pas pour autant que la compétition sera aisée ni même jouée selon des règles équitables (conditions de travail, taux de change manipulés dans certains pays et absence de politique européenne en ce domaine, normes environnementales, etc.). Mais nous n'avons pas le choix et nous avons de nombreux atouts pour gagner cette guerre économique. * * * PREMIÈRE PARTIE : LES DÉLOCALISATIONS, Dans cette première partie, votre rapporteur analysera ce phénomène, mal connu et sous-estimé, avant d'examiner les raisons de sa montée en puissance. I.- UN PROBLÈME MAL APPRÉHENDÉ A.- QUELLE DÉFINITION POUR LES DÉLOCALISATIONS ? Le phénomène des délocalisations occupe aujourd'hui une place centrale au sein des débats économiques qu'illustre le nombre important de publications parues sur ce sujet et bénéficie d'un traitement médiatique privilégié, relayant certains cas particulièrement spectaculaires. Pour autant, l'analyse de ce phénomène se heurte encore à la multiplicité d'acceptions du terme délocalisation, qui brouille le débat en autorisant toutes les hypothèses et en alimentant des interprétations tout à fait contradictoires : certains s'appuient sur une définition très restrictive pour souligner un impact marginal, quitte à jeter un voile sur la réalité multiforme du phénomène et à différer les adaptations nécessaires ; d'autres à l'inverse, n'hésitent pas à privilégier une définition très extensive dérivant vers les notions voisines de « désindustrialisation » ou de « restructuration » liée à la concurrence internationale, en prenant le risque de nourrir un climat anxiogène et de ne plus pouvoir en comprendre les véritables causes et spécificités. La définition des délocalisations ne va pas de soi. Sous le terme de délocalisation, se cache en effet une réalité disparate, difficile à définir par des critères précis. Au sens le plus strict, les délocalisations se définissent comme la fermeture d'une unité de production implantée en France, suivie de sa réouverture à l'étranger, en vue de réimporter sur le territoire national les biens produits à moindre coût. Le critère de réimportation vers le pays investisseur peut néanmoins apparaître trop restrictif car il revient à ne pas prendre en compte la fermeture d'un site national doublée de l'ouverture d'un site de même nature à l'étranger, dès lors qu'il s'agit de productions destinées à être écoulées dans un pays tiers et non réimportées. Certaines études ont donc ajouté un autre critère alternatif : le fait de continuer à fournir les marchés d'exportation. Cependant, si MM. Lionel Fontagné et Jean-Hervé Lorenzi, auditionnés par la mission d'information, retiennent cette définition classique dans leur rapport réalisé pour le Conseil d'Analyse économique, ils n'en occultent pas les limites : « la réalité industrielle se prête mal (...) à une définition aussi étroite du phénomène : la réorganisation des firmes au niveau international prend des formes beaucoup plus complexes, à de rares mais très médiatiques exceptions près ». En effet, cette définition ne prend pas en compte les cas de sous-traitance à l'étranger (« offshore outsourcing ») pour lesquels il n'y a ni investissement direct à l'étranger ni déplacement physique d'une unité de production à l'étranger. Ce sont des ressources déjà existantes à l'étranger qui sont alors exploitées. Parallèlement, lorsqu'il y a transfert d'activités à l'étranger au sein d'une même entité, celui-ci n'affecte pas forcément l'ensemble du processus de production, compte tenu de la fragmentation croissante de la chaîne de valeur ; dans ces conditions, ce transfert ne se traduira pas par la fermeture d'une usine mais plutôt par une réorganisation interne. Difficulté supplémentaire : les considérations liées à l'optimisation du coût des facteurs de production ne constituent pas le seul déterminant des délocalisations. La recherche d'une plus grande flexibilité de la main-d'œuvre peut être l'objectif à atteindre et la définition classique, justifiée par la volonté de séparer logique de conquête de marché et logique de délocalisation, risque alors de passer à côté d'une partie du phénomène. Résultat d'un bilan coût-avantages, le choix de transfert d'une activité à l'étranger repose par ailleurs souvent sur plusieurs motivations, qui peuvent être imbriquées et dans lesquelles il est difficile de faire la part des choses, d'autant plus que ces facteurs peuvent évoluer dans le temps. En effet, que penser d'une entreprise qui implante à l'étranger un nouveau site de production pour accéder à la fois à de nouveaux marchés et réduire ses coûts de production ? Doit-on qualifier ce transfert de délocalisation ? L'exemple de la production de la Logan de Renault en Roumanie est à cet égard révélateur de ces ambiguïtés : initialement motivée par la recherche de coûts salariaux plus faibles permettant de proposer un produit en adéquation avec le pouvoir d'achat de la clientèle des pays d'Europe de l'Est, la création de l'usine de Pitesi permet aujourd'hui d'alimenter également le marché automobile français. Prenant en compte ces limites et ambiguïtés, une étude de l'INSEE réalisée en 2005 par MM. Patrick Aubert et Patrick Sillard, et évoquée par M. François Loos, ministre de l'industrie, lors de son audition par la mission d'information, retient une autre définition, plus large : est considérée comme délocalisation toute « substitution de production étrangère à une production française, résultant de l'arbitrage d'un producteur qui renonce à produire en France pour produire ou sous-traiter à l'étranger ». Le premier avantage de cette définition est de reposer sur une approche plus micro-économique, qui met en avant l'arbitrage défavorable à la France réalisé par un agent économique, et non la situation qui en découle, ce qui permet d'écarter ainsi explicitement les effets plus diffus liés à la concurrence internationale. En ne posant aucun critère lié à l'identité du producteur étranger et en ne visant pas la (ré)ouverture d'une unité à l'étranger, cette définition permet d'appréhender en outre les cas de sous-traitance à l'étranger ainsi que les différentes modalités que peuvent prendre les délocalisations selon le degré de maîtrise de la chaîne productive étrangère : création de filiales dites « greenfield », c'est-à-dire ex nihilo, fusions-acquisitions, co-entreprises et joint-venture, accords de licences, alliances sans prises de participation... En ne faisant plus référence à la fermeture d'une unité de production, elle permet également de prendre en compte les délocalisations progressives ou diffuses, qui ne se traduisent que par une réorganisation interne et la suppression d'un nombre peu élevé d'emplois par site. Pour évaluer l'ampleur du phénomène, l'étude de l'INSEE retient une diminution d'au moins 25 % des effectifs initiaux et de la masse salariale sur une période de trois années maximum. Votre rapporteur estime cependant que cette définition laisse pendante la question du non-développement des activités existantes sur le territoire national et de la localisation concomitante d'activités nouvelles à l'étranger. L'étude de l'INSEE pose en effet comme préalable l'existence « d'une production en France et que celle-ci soit bien remplacée par une production à l'étranger ». Ce préalable peut cependant prêter à discussion. Comment avoir la certitude que la production à l'étranger est bien le substitut à la production intérieure ? Enfin et surtout, le fait qu'une firme réalise la croissance de sa production, de l'investissement et des emplois dans ses filiales installées à l'étranger plutôt que dans le pays d'origine de la société mère, sans changement du lieu de destination des produits, est tout aussi inquiétant. Même s'il ne se traduit pas par une perte nette d'emploi, ce mouvement est révélateur d'une logique de délocalisation au sens large. Entre 1997 et 2002, la part des effectifs des 32 grands groupes français non financiers du CAC 40 sur le territoire national est passée de 50 à 32 % de leurs effectifs totaux. Se focaliser sur la partie visible de l'iceberg, c'est indéniablement se condamner à une vision faussée du phénomène et à une réaction tardive. C'est cette limite qui a conduit le président de la Commission des Finances du Sénat, M. Jean Arthuis, après un premier rapport en 1993, à retenir, toujours dans une perspective micro-économique basée sur les stratégies individuelles des entreprises, une autre approche plus globalisante dans un rapport d'information du 22 juin 2005 sur la globalisation de l'économie et les délocalisations d'activité et d'emplois. Il considère ainsi que « la délocalisation regroupe tous les arbitrages réalisés par les entreprises dans un sens défavorable à la localisation des activités et des emplois sur le territoire français » et distingue les délocalisations pures, les délocalisations diffuses, qui correspondent au regroupement vers un pays étranger d'une activité répartie sur plusieurs sites en France, et les non-localisations, constituées par les ouvertures à l'étranger d'activités qui auraient pu être localisées en France. Le rapport d'information du groupe du travail du Sénat sur la délocalisation des industries de main-d'œuvre (5) retient lui aussi à la fois les « transferts d'un site domestique à un site étranger, l'extériorisation à l'étranger, ainsi que les investissements de capacité à l'étranger qui auraient sans doute pu être effectués sur le territoire national si un certain nombre de conditions attractives y avaient été réunies ». Pour votre rapporteur, le doute n'est pas permis, il s'agit bien dans tous ces cas d'un manque à gagner en terme d'emploi pour la France. B.- DES DIFFICULTÉS D'APPRÉHENSION DU PHÉNOMÈNE EN L'ABSENCE D'INDICATEURS SPÉCIFIQUES Faute de définition consensuelle, ce processus économique complexe n'est pas directement pris en compte dans les statistiques économiques existantes, qui répondent à d'autres objectifs, et reste donc difficilement quantifiable, comme l'a souligné M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, devant les membres de la mission. De plus, les délocalisations peuvent retenir dans leurs modalités des supports différents (filialisation d'une activité, sous-traitance) et au niveau global, leurs effets sont difficiles à distinguer de ceux de la spécialisation internationale. En outre, la frontière est parfois difficile à tracer entre la logique de conquête de marché et celle d'abaissement des coûts, les stratégies des entreprises pouvant être mixtes. Tout au plus, peut-on conjuguer l'observation de différentes données macro-économiques à une analyse plus qualitative et micro-économique des motivations pour avoir un faisceau d'indices sur l'évolution du phénomène. Un premier indicateur possible pourrait être les investissements directs français à l'étranger (IDE), sachant qu'une délocalisation qui se fait par implantation d'une filiale à l'étranger implique un flux de capital à destination de ce pays étranger. Les flux d'IDE sont inclus dans le compte financier de la balance des paiements et se définissent comme les opérations ayant pour but d'acquérir un intérêt durable dans une entreprise et d'exercer une influence significative sur sa gestion. Selon la définition du FMI, une relation d'investissement direct est établie dès lors que l'investisseur détient au moins 10 % du capital social de l'entreprise. Outre les opérations en capital social et les bénéfices réinvestis sur place, les IDE comprennent également les prêts et flux de trésorerie entre sociétés déjà affiliées. Comme l'indique le tableau ci-dessous, les investissements directs français à l'étranger, qui ont connu une nette reprise en 2005 en atteignant 93 milliards d'euros en flux, se concentrent encore essentiellement aux États-Unis et dans les pays de la zone euro, que l'on raisonne en stock (au 31 décembre 2004, 19,5 % pour les États-Unis, 15,2 % pour le Royaume-Uni et 44,2 % pour les pays de la zone euro) ou en flux (en 2005, 9,9 % pour les États-Unis, 11,9 % pour le Royaume-Uni et 55,3 % pour les pays de la zone euro). Seul 1,7 % du flux des IDE a concerné en 2005 les dix nouveaux États membres, 1 % l'ensemble des pays du Maghreb. Le Brésil arrive en tête des pays émergents, avec 1,3 % du flux d'IDE, contre seulement 0,6 % pour la Chine et 0,1 % pour l'Inde. RÉPARTITION PAR ZONES GÉO-ÉCONOMIQUES DU STOCK D'INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS A L'ÉTRANGER (montants en milliards d'euros et parts de pourcentage)
(a) données révisées Source : Banque de France Cependant, la répartition géographique des investissements directs à l'étranger ainsi présentée reste difficile à interpréter et doit être relativisée dans la mesure où les investissements directs réalisés dans les pays émergents ou en voie de développement sont par nature faibles, en raison du biais lié à la disparité de taux de change avec la France (parfois aggravée par une sous-évaluation, comme dans le cas du yuan) et de niveau de prix. D'autre part, les investissements directs liés à des délocalisations sont souvent réalisés dans des secteurs intensifs en travail et non en capital et le niveau des rémunérations, lié à une productivité moyenne faible, y est peu élevé. En outre, selon les prescriptions du FMI, les ventilations géographiques ne reflètent que le pays de première contrepartie qui ne correspond pas nécessairement au pays où l'IDE est réalisé finalement. Par exemple, si la société holding d'un groupe textile délocalise une partie de la production du groupe vers un pays du Maghreb via une sous-holding implantée aux Pays-Bas, c'est un investissement aux Pays-Bas qui sera retenu. Or, comme l'indique une étude de la Banque de France de décembre 2004, « ce type de montage juridique s'est développé au cours des dernières années pour des raisons économiques ou fiscales ». La répartition sectorielle des investissements directs à l'étranger n'apporte quant à elle guère d'enseignements car elle est dominée par le secteur des holdings (39,9 % du total du stock), classé dans la rubrique « services aux entreprises », suivi par le secteur financier (20,1 %). De plus, dans ces statistiques, le secteur retenu pour l'entreprise étrangère est le secteur de l'entreprise française qui effectue l'investissement. L'investissement des holdings est donc réputé être dans le secteur des holdings mais qu'en est-il exactement ? Les investissements directs correspondent en outre dans leur grande majorité à des opérations d'autre nature que les délocalisations. Le rapport annuel de la Banque de France sur la balance des paiements et la position extérieure de la France indique d'ailleurs que la nette progression de ces flux « est à rapprocher du mouvement mondial de reprise des fusions-acquisitions constaté en 2005 ». Or, le rachat par Suez de la totalité d'Electrabel en Belgique ou l'acquisition au Royaume-Uni d'Allied Domecq par Pernot-Ricard, cités par ce rapport comme les opérations les plus importantes (pour respectivement 33,7 et 10,7 milliards d'euros), n'ont rien à voir avec la problématique des délocalisations. Les IDE peuvent répondre à une logique purement financière, sans création de capacités productives nouvelles, ou s'inscrire uniquement dans une logique d'accès à un marché. Il est logique dans ces conditions que certaines études, qui tentent d'estimer la part des délocalisations dans les IDE, bien que celles-ci ne figurent jamais en tant que telles dans les différentes composantes des IDE, aboutissent à des chiffres relativement bas. M. Christian Pierret, lors de son audition par la mission d'information, a ainsi évalué à 2 milliards d'euros en 2002 les investissements directs français à l'étranger pouvant être attribués à des délocalisations, soit 3 % du total. La DREE attribue aux délocalisations 4 % au plus des investissements directs de la France à l'étranger pour un montant équivalent à 19 milliards d'euros sur la période allant de 1997 à 2001. De même, l'enquête réalisée par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sur les délocalisations et présentée par M. Jean-François Bernardin aux membres de la mission avance un chiffre de 5 % pour l'année 2004. En outre, le niveau des investissements directs à l'étranger n'englobe pas la totalité des délocalisations, comme l'a souligné M. Jacky Fayolle, directeur de l'Institut de recherches économiques et sociales, lors de son audition. En effet, il ne peut pas prendre en compte le recours à la sous-traitance à l'étranger, en raison du critère lié à la détention d'au moins 10 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise dans lequel l'investissement est réalisé. Les IDE constituent donc à la fois un instrument de mesure trop large et trop réduit du phénomène des délocalisations. L'évolution de l'emploi industriel peut-elle apporter un éclairage sur le phénomène des délocalisations dans les industries de main-d'œuvre ? Les délocalisations ont-elles accéléré le processus de désindustrialisation à l'œuvre dans les économies modernes ? Font-elles peser un risque de perte de substance industrielle au-delà de cette tendance naturelle ? M. Christian Pierret a ainsi rappelé aux membres de la mission que la part de l'emploi industriel était passée de 26 % en 1981 à 16 %, tandis que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée avait chuté de 28 à 21 %. D'autres facteurs que la concurrence internationale et a fortiori les délocalisations peuvent cependant expliquer cette tendance. Comme l'a expliqué M. Lionel Fontagné lors de son audition, il y a à la fois un effet demande (demande davantage orientée vers les services et développement des services aux entreprises, notamment par externalisation) (6) et un effet d'offre (gains de productivité plus rapides dans l'industrie). De plus, la décroissance de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée est également liée à un effet de prix relatif (baisse plus rapide des prix des biens industriels que des services), la part de l'industrie dans le volume de richesse créée restant quant à elle constante depuis 30 ans, à près de 18 %, une fois cet effet neutralisé. S'appuyant sur des travaux réalisés avec Hervé Boulhol, M. Lionel Fontagné a ainsi estimé à 350 000 au plus le nombre d'emplois industriels supplémentaires qui auraient pu être conservés en France en 2002, si la part des pays de délocalisation dans nos échanges n'avait pas augmenté depuis 1970, c'est-à-dire en prenant une définition très extensive des délocalisations recouvrant toutes les importations issues de ces pays. Votre rapporteur estime toutefois qu'une analyse sectorielle peut apporter un éclairage complémentaire très utile. Si l'on s'intéresse à certains secteurs traditionnellement affectés par les délocalisations, le recul de l'emploi industriel y prend une acuité particulière : dans l'Union européenne à 15, le secteur textile-habillement est passé de 2,5 millions de salariés en 1995 à 1,75 million en 2004, soit une perte de 750 000 emplois en 9 ans. Sur la même période, l'industrie de la chaussure a perdu environ le quart de ses entreprises et de ses effectifs et a connu une baisse de production s'élevant en moyenne à 5,6 % par an. La dégradation de la balance commerciale et l'évolution de sa structure pourraient également constituer des signaux permettant d'apprécier l'ampleur du phénomène des délocalisations. Cependant, cet indicateur n'est pas totalement satisfaisant car la dégradation du solde commercial peut être due à des effets de change (appréciation de l'euro par rapport au dollar par l'exemple) ou au renchérissement de la facture énergétique ou du coût des matières premières. Indépendamment de ces facteurs exogènes, son évolution est délicate à interpréter : elle témoigne soit d'un moindre dynamisme des exportations, soit d'une incapacité de l'appareil productif français à répondre à la demande intérieure, soit du résultat de l'effet combiné des deux. L'évolution des importations est elle-même davantage liée aux effets globaux de la concurrence internationale qu'aux seuls flux liés aux délocalisations. Cependant, on ne peut qu'être frappé du maintien d'une vive croissance des importations de produits manufacturés (+6,6 % en 2005 après +7,6 % en 2004), que le rapport sur les Comptes de la Nation attribue à un redressement du contenu en importations de la demande des entreprises, qui pourrait recouvrir des phénomènes de sous-traitance. Le taux de pénétration des importations industrielles est passé de 31 % en 1995 à plus de 38 % en 2003. Cette évolution est encore plus forte si l'on se focalise sur certains secteurs concernés par les délocalisations. Si les importations d'habillement et de cuir ont peu augmenté en valeur en raison de la baisse des prix à l'importation des vêtements liée à la levée des quotas imposés à la Chine, l'évolution en volume a atteint aux cours des deux dernières années des rythmes inédits : +8 % en 2004, +13 % en 2005. Le taux de pénétration des biens de consommation destinés à l'habillement, qui traduit le rapport entre les importations et la demande intérieure aussi bien pour la consommation finale que pour les consommations intermédiaires, est passé en volume de plus de 12 % au milieu des années 80 à 38,5 % en 2001 et culmine aujourd'hui à 44,5 %, après un bond de cinq points par rapport à 2004. Cette progression plus rapide des importations que de la demande intérieure est assurément un indicateur révélateur des délocalisations, si on la combine avec deux autres critères cumulatifs proposés par la Banque de France dans une étude de décembre 2004 (7) : accroissement plus rapide du déficit extérieur que de la demande intérieure, qui permet d'écarter les effets liés à l'intensification des échanges intra-branche, et diminution de l'emploi relatif de la branche. Cette grille de lecture a ainsi permis à la Banque de France d'aboutir à la conclusion que « cinq branches industrielles auraient délocalisé une partie de leur production sur la période 1978-2002 : l'habillement et cuir, l'industrie textile, les équipements du foyer, la production de combustibles et de carburants et les équipements électriques et électroniques ». SENSIBILITÉ DES DIFFÉRENTES BRANCHES AUX DÉLOCALISATIONS
Source : INSEE Même sans lien direct avec des mouvements de délocalisation, le solde commercial demeure également aux yeux de votre rapporteur un indicateur général de compétitivité. À cet égard, le fait que le solde commercial soit négatif depuis 2004 et que le déficit continue à se creuser pour atteindre en septembre 2006 un niveau cumulé de 27,891 milliards d'euros sur les douze derniers mois n'est pas en soi un signal positif pour notre pays. Car, si le choc pétrolier et l'appréciation de l'euro expliquent en partie la détérioration de notre balance commerciale, tous les pays de la zone euro en ont subi les conséquences. Or, en Allemagne, la croissance plus rapide des exportations que des importations s'est traduite par des excédents commerciaux qui ont augmenté très rapidement de 2001 à 2005, au prix il est vrai d'une politique quasiment déflationniste. Si l'on raisonne par répartition géographique, le bilan de nos échanges commerciaux avec les zones de délocalisation n'apporte pas non plus de conclusions définitives car il très hétérogène : si, à l'égard de pays comme la Chine ou la Corée du Sud, nous avons des déficits commerciaux croissants (près de 14 milliards d'euros pour la Chine qui représente notre deuxième déficit bilatéral, en raison notamment d'une présence limitée de la France sur ce marché à fort potentiel de croissance), il n'en est pas de même pour d'autres pays de délocalisation tels la Pologne ou la Turquie, pour lesquels nous enregistrons des excédents commerciaux. Les cinq premiers pays dont proviennent les importations françaises restent l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni. Selon le huitième rapport de la Commission permanente de concertation pour l'industrie, les importations industrielles directes issues de zones émergentes (y compris PECO), qui reflètent, d'une façon certes imparfaite (8), les échanges générés par les délocalisations dans le secteur industriel, n'ont ainsi représenté en 2002 que 16 % des importations de biens manufacturés réalisés par les entreprises industrielles de 20 salariés ou plus, pour un montant équivalent à près de 20 milliards d'euros, soit près de 5 % de leurs achats et un peu moins de 3 % de leur production. D'après l'enquête sur les relations entre entreprises réalisée par le Sessi, la moitié prendrait la forme d'une sous-traitance à l'étranger, soit l'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros. Cependant, la part de ces importations d'entreprises industrielles issues des pays émergents a presque doublé entre 1993 et 2003, en passant de 9 à 16 %. La répartition entre pays émergents a également évolué : l'Asie représente toujours la zone la plus importante avec plus de 40 % des importations mais son poids relatif fléchit en raison de la montée en puissance des importations en provenance des PECO (30 % des importations des entreprises industrielles françaises en 2004 contre 15 % en 2003) ; dans le même temps, la Chine se substitue progressivement aux autres pays d'Asie en tant que fournisseur. De plus, ce pourcentage global de 16 % cache de fortes disparités entre secteurs car ces importations sont ciblées sur quelques secteurs très intensifs en main-d'œuvre : habillement-cuir (60 % des importations de ce secteur proviennent des pays de délocalisation), équipements du foyer (35 %), équipements électriques et électroniques (26 %) et composants (22 %). Parmi les secteurs qui ressortent par le poids économique des entreprises ayant une relation stratégique d'achat hors catalogue avec un pays émergent, se retrouvent encore en tête l'habillement et l'équipement du foyer, et dans une moindre mesure le textile, les composants, les équipements électriques et électroniques et la métallurgie. PART DES IMPORTATIONS PROVENANT DES PAYS ÉMERGENTS (en pourcentage)
Source : Douanes, EAE (Sessi) 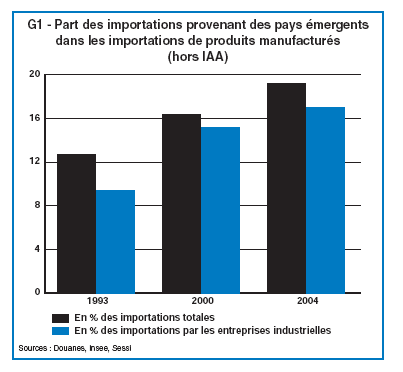 IAA : industries agroalimentaires. Par ailleurs, même s'il ne permet pas de mesurer directement le phénomène des délocalisations, l'essor rapide du commerce des produits intermédiaires paraît à votre rapporteur un indice intéressant. Le commerce des pièces et composants a augmenté de 9 % en moyenne sur la décennie 1990-2000, contre 6,5 % pour l'ensemble des échanges mondiaux. Aux États-Unis, la part des produits intermédiaires dans les importations est passée de 12 % en 1992 à 17 % en 2000. C'est bien là le signe d'une intégration verticale croissante de la production à l'échelle mondiale. De même, cette réorganisation des fonctions de production se traduit par le développement des échanges intra firmes. Selon une enquête réalisée par le SESSI en 1999 auprès de 4 000 entreprises industrielles, 41 % des exportations et 36 % des importations françaises de produits industriels sont dues à du commerce intra firmes. Le recours aux statistiques dites FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics), qui permet de connaître la présence des filiales (détenues à 50 % et plus par la maison mère) à l'étranger d'entreprises françaises, pourrait permettre en outre de relativiser en termes d'effectifs le constat fait pour la localisation des IDE : il y a pratiquement autant de salariés de filiales d'entreprises françaises dans les PECO qu'au Royaume-Uni, c'est-à-dire 7 %. Mais rien ne permet cependant de faire la part entre logique de conquête de marché et stratégie de délocalisation. C.- UNE APPROCHE « MACRO-ÉCONOMIQUE » QUI PASSE SOUVENT À CÔTÉ DES RÉALITÉS HUMAINES ET TERRITORIALES Ce type d'évaluation globale contraste de manière spectaculaire avec les réalités vécues sur le terrain dans les entreprises et les bassins d'emplois concernés. Se fondant sur des données agrégées, semblant indiquer que le phénomène des délocalisations est jusqu'ici d'une ampleur limitée, ces approches macroéconomiques occultent en effet le fait que ses effets défavorables sont concentrés dans le temps et l'espace. Les délocalisations affectent en priorité les moins qualifiés et les régions les plus périphériques. C'est pourquoi elles sont si visibles et ce sujet si sensible auprès de l'opinion publique. La division internationale du travail, qui conduit à fractionner le processus de production pour tirer profit des différences de coûts des facteurs au niveau mondial, est assimilable par ses effets à un progrès technique biaisé contre les non qualifiés. Conformément au modèle Heckser-Ohlin, qui identifie les différences de dotations en facteurs de production comme sources des avantages comparatifs, les pays émergents se sont spécialisés dans la production du bien qui utilise intensément le facteur dans lequel ils sont relativement les mieux dotés, c'est-à-dire le travail non qualifié. Les travailleurs non-qualifiés voient ainsi la délocalisation s'ajouter au progrès technique pour faire disparaître leurs emplois. Selon les travaux de Vanessa Strauss-Kahn, la fragmentation de la chaîne de valeur expliquerait 25 % de la diminution de la part du travail non qualifié dans l'emploi de l'industrie sur les années 1985-1993. De même, s'il récuse l'idée d'un mouvement massif d'activités et d'emplois des 15 anciens États membres vers les nouveaux États membres à la suite de l'élargissement intervenu en 2004, un document de la Commission européenne intitulé « Élargissement, deux ans après : une évaluation économique » de mai 2006 reconnaît cependant que la structure des emplois dans l'Europe des 15 pourrait évoluer en raison de délocalisations intracommunautaires et qu'en Allemagne, le recours à des sous-traitants situés dans les PECO avait contribué à la diminution de la part relative des emplois manufacturiers. Le remplacement du travail non qualifié par du travail qualifié n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'emploi dans des pays où le chômage des non qualifiés est déjà important ; il n'est l'est pas dans tous les cas si ce mouvement ne s'accompagne pas d'une croissance de la qualification de la main-d'œuvre. Les délocalisations entraînent une déformation de la structure des emplois vers le travail qualifié, mouvement qui s'opère entre les différents secteurs mais surtout désormais au sein même de chaque activité. Les emplois créés par la mondialisation ne sont en effet pas les mêmes que ceux qui sont perdus : comme l'indiquent MM. Lionel Fontagné et Jean-Hervé Lorenzi, « tandis que 70 000 programmeurs perdaient leur emploi depuis 1999 aux États-Unis, 115 000 emplois d'ingénieurs-logiciel mieux rémunérés étaient créés ». Les travailleurs non qualifiés ont d'autant moins de chance de retrouver un emploi qu'ils sont souvent les moins mobiles. Le déménagement de l'outil de production à l'étranger est vécu comme un véritable traumatisme voire un arrachement pour des ouvriers qui ont souvent travaillé toute leur vie dans la même usine. La réinsertion professionnelle des salariés licenciés s'avère aussi particulièrement délicate en raison de l'âge souvent assez avancé des ouvriers. En outre, les inégalités entre travailleurs qualifiés et non qualifiés risquent de s'exacerber : une étude américaine de M. Robert Feenstra et de M. Gordon Hanson en 1999 constate que les délocalisations de biens ont financé 40 % de l'augmentation de la prime de salaire qualifié, les étapes de la production à forte intensité de main-d'œuvre non qualifiée étant celles qui sont délocalisées en premier. De même, une étude conduite au Royaume-Uni conclut à un impact important de l'« outsourcing », c'est-à-dire de la seule externalisation, sur les inégalités internes de salaires entre qualifiés et non qualifiés, de l'ordre d'un tiers (Hijzen, Görg et Hine, 2003). Même si elles sont faibles en nombre au niveau national, les délocalisations peuvent avoir un fort impact au niveau territorial, en raison de leur caractère brutal et du nombre d'emplois menacés, qui peut atteindre plusieurs centaines de postes dans des bassins d'emplois déjà limités, que ce soit en termes de taille ou de diversification. Dans le Tarn-et-Garonne, la délocalisation au Maroc de l'usine de câblage de Labastide-Saint-Pierre dépendant de l'équipementier Valeo a ainsi entraîné la suppression de 450 emplois en octobre 2003. La moitié seulement de ces salariés a retrouvé aujourd'hui un emploi dans ce département peu industrialisé. À Reims, le géant suédois de l'électroménager Electrolux a fermé début 2005 son site de production de cuisinières et de fours encastrables dans une logique de réorganisation de ses activités à l'échelle mondiale et de redressement de sa marge opérationnelle. Or, Reims a connu à la même période une multiplication de plans sociaux (Fujifilm, Henkel, Valeo, Malteurop, VMC, groupe Trèves, ARRIES), qui ont amplifié les effets de la disparition de 244 emplois induite par la fermeture du site et rendu plus difficiles les réinsertions professionnelles. Autre exemple, la décision récente de l'entreprise Aubade de délocaliser en Tunisie à compter de 2007 la partie de ses activités d'assemblage de sous-vêtements restée en France (soit 30 %) pourrait entraîner la fermeture du site de la Trimouille et la suppression de 180 emplois sur les 283 que l'entreprise comptait sur ses deux sites situés dans la Vienne. Si le nombre de ces suppressions d'emplois n'est dans l'absolu pas spectaculaire, il doit être rapporté à la petite taille du département (400 000 habitants) et à sa faible industrialisation (17 % d'emplois dans l'industrie contre 20 % pour la moyenne nationale ; le premier employeur industriel est le fabricant de volants Autoliv avec 900 salariés). Cette délocalisation intervient en outre à un moment où le bassin d'emploi a déjà été affecté par la liquidation judiciaire du fabricant de meubles Domoform et la fermeture du site Michelin de Poitiers, qui employait cinq cents salariés. La direction a cependant accepté le 15 octobre dernier de suspendre le plan de sauvegarde de l'emploi en vue de l'élaboration d'un accord de méthodes avec les syndicats. La Commission européenne elle-même, dans l'étude précitée, n'écarte pas l'hypothèse d'un impact significatif des délocalisations intra-européennes sur certaines régions de l'Europe des 15, spécialisées dans les secteurs du textile, du matériel de transport et des technologies de l'information et de la communication. Il convient également de ne pas oublier les effets indirects sur les sous-traitants, transporteurs et fournisseurs, ainsi que sur l'économie locale en général, des délocalisations : la baisse de la demande induite par la baisse de revenu des familles touchées se répercute sur l'activité des commerces. Lorsqu'elles prennent la forme d'un déménagement massif de l'outil de production, elles peuvent générer des friches industrielles et mettre en difficulté des collectivités territoriales en raison des pertes de recettes fiscales (taxe professionnelle, impôts fonciers, etc...), au moment où ces dernières sont les plus sollicités en termes de revitalisation du territoire ou de dépenses sociales. Ces coûts sociaux et territoriaux sont d'autant plus forts en France que les délocalisations ne font l'objet dans leur grande majorité que d'un traitement à chaud, même si ce dernier s'est amélioré et comporte désormais, au-delà des mesures d'accompagnement des salariés contenues dans les plans sociaux (PSE), une obligation de revitalisation du territoire (article L. 321-17 du code du travail) à la charge des entreprises ainsi que la mise en place de contrats territoriaux ou de contrats de site, permettant d'engager des moyens importants sur la base d'une démarche partenariale pour les bassins d'emplois les plus sinistrés. Plaidant pour une reconversion à titre préventif plutôt qu'à titre curatif, M. Michel Ghetti, président directeur général de France Industrialisation et Emploi, a souligné lors de son audition la nécessité d'une anticipation en vue de la création d'emplois de compensation, s'appuyant sur les informations collectées par les agences de développement économique et associant les grands groupes. M. Jacky Fayolle, directeur de l'IRES, a en outre, estimé que l'apparition sur la scène politique d'un débat sur les délocalisations en France et aux États-Unis (initiative parlementaire pour écarter des marchés publics les entreprises qui font fabriquer leurs produits à l'étranger), que l'on ne retrouvait pas au Royaume-Uni, s'expliquait par le manque de tradition de dialogue social, ce problème n'étant pas traité par anticipation dans le champ des relations sociales. Il a ainsi regretté dans notre pays un manque de traitement anticipé et négocié des restructurations en général. Néanmoins, le législateur a souhaité récemment faire évoluer cette gestion conflictuelle et à chaud, en favorisant l'anticipation en matière de gestion de l'emploi par le dialogue. La loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale invite désormais les entreprises à conclure des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), pouvant comprendre des mesures de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, l'article L. 320-2 du code du travail rendant obligatoire une négociation (et non plus une simple consultation) triennale en la matière pour les entreprises de plus de 300 salariés. Ce même article dispose en outre que « l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie d'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. ». Par ailleurs, dans un souci de dissocier le temps de la procédure du temps de la solution, la faculté introduite récemment de conclure des accords de méthode « à froid » peut permettre aux partenaires sociaux de se mettre d'accord à l'avance sur des modalités dérogatoires d'information et de consultation du comité d'entreprise en cas de licenciements collectifs, en vue à la fois de sécuriser les procédures et de rechercher les conditions d'un reclassement plus efficace des salariés ; ces accords peuvent notamment organiser, sur une base négociée, « la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe ». Cette démarche d'anticipation reste cependant délicate à mettre en œuvre dans un pays ne disposant pas d'une forte tradition de dialogue social et se heurte à plusieurs obstacles, qui peuvent en réduire sa portée. En effet, l'annonce anticipée d'une restructuration à moyen terme, de surcroît accompagnée d'un transfert d'activité à l'étranger, reste porteuse de traumatisme et peut provoquer une véritable crise interne à l'intérieur de l'entreprise (grèves...), de nature à accroître sa fragilité. Elle peut aussi déclencher à l'extérieur de l'entreprise des réactions peu contrôlées et potentiellement néfastes. Apprenant les difficultés de leur fournisseur, les clients essaieront de diversifier leurs sources d'approvisionnement, les fournisseurs demanderont quant à eux à être payés plus tôt et les banquiers exigeront des garanties supplémentaires, susceptibles de paralyser le fonctionnement de l'entreprise. S'il s'agit de biens de consommation, l'entreprise risque aussi de faire l'objet d'un boycott des consommateurs. Cet effet « boule de neige » pourrait paradoxalement conduire l'entreprise à accélérer le transfert de l'activité à l'étranger, simplement envisagé, ou à fermer son site, devant l'ampleur des difficultés. Le délit d'entrave a en outre été cité par M. Michel Ghetti, PDG de FIE, lors de son audition, comme un obstacle à une politique de reconversion de ses salariés menée par l'entreprise à titre préventif : les entreprises qui se rapprochent de structures territoriales (agences de développement, conseils régionaux, chambres de commerce et d'industrie...) pour anticiper la création d'emplois de compensation risquent de s'exposer à une condamnation pour délit d'entrave, c'est-à-dire pour absence d'information du comité d'entreprise en matière économique, notion dont les contours ont été définis de façon extensive par la Cour de Cassation. Enfin, alors même que les PME représentent 60 % de l'emploi salarié en France, cette approche leur est difficilement applicable sachant qu'elles n'ont pas les mêmes moyens et ne sont pas d'ailleurs pas soumises aux mêmes obligations légales que les grandes entreprises (pas d'obligation de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et donc de mesures de reclassement pour les entreprises de moins de 50 salariés, pas d'obligation de revitalisation du territoire) ; l'échelle de temps très courte qui caractérise la vie des PME complexifie le travail d'anticipation. Au-delà de ces difficultés, votre rapporteur estime qu'il est souhaitable de promouvoir des démarches inscrites dans la durée comme des programmes de formation permanente des employés et de leurs dirigeants, dans le contexte général d'évolution rapide des métiers, ou de dynamisation du tissu économique local. Pour une grande entreprise, participer au développement local, c'est une façon d'anticiper une éventuelle restructuration, en réduisant son impact sur le territoire, mais c'est aussi une nécessité. On ne se développe pas dans un désert ; un bassin local dynamique contribue à la présence de fournisseurs et de sous-traitants réactifs et permettra d'attirer une main-d'œuvre qualifiée. Le programme ALIZE, évoqué par M. Pierre Mirabaud, délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité du territoire, et M. Laurent Fiscus, directeur du pôle « mutations économiques » à la DIACT, lors de leur audition, part de cette idée. Implanté sur une vingtaine de territoires, il fédère localement des entreprises et acteurs territoriaux qui acceptent de mettre en commun des moyens humains et financiers pour soutenir les projets de développement des PME/PMI en vue de densifier et diversifier le tissu économique local. 880 projets ont pu être accompagnés à ce jour, représentant 6 000 emplois soutenus. L'anticipation demande aussi de la part des pouvoirs publics une véritable stratégie de collecte de l'information et à cet égard, M. Pierre Mirabaud, délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires, et M. François Loos, ministre délégué à l'industrie, ont souligné chacun lors de leur audition la mise en place d'observatoires régionaux des mutations économiques, effective dans la moitié des régions, permettant d'aboutir à un diagnostic partagé Etat/collectivités territoriales et d'initier des programmes de formation de la main-d'œuvre ou de prospective d'entreprises. Au niveau national, le pôle interministériel d'anticipation des mutations économiques récemment mis en place pourra s'appuyer sur ces observatoires, ainsi que sur les services déconcentrés de l'État, pour procéder à une analyse prospective à moyen et long terme des évolutions sectorielles, technologiques et réglementaires et de leur impact sur les besoins de main-d'œuvre et de qualification, comme sur les stratégies territoriales des entreprises. Suite aux travaux de ce pôle sur le secteur automobile, le CIACT du 6 mars 2006 a ainsi lancé la mise en place d'un accompagnement expérimental des mutations dans la filière des équipementiers automobiles. Cette action engagée dans les bassins d'emploi de sept régions fortement dépendantes du secteur automobile s'est traduite par la mise en place d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences territoriales en partenariat avec les entreprises du secteur (encouragement aux synergies entre petits équipementiers, formation qualifiante et transversale des salariés...). Au niveau européen, les coûts d'ajustement liés à la mondialisation ne faisaient jusqu'ici pas l'objet d'une prise en compte spécifique et n'étaient traités que de façon globale dans le cadre de la programmation des fonds structurels. La proposition de règlement de la Commission européenne du 1er mars 2006 visant à la création d'un fonds européen d'ajustement à la mondialisation constitue à cet égard une première prise de conscience à la fois de l'existence de ce coût d'ajustement concentré sur certains emplois et territoires et de la légitimité d'une intervention à l'échelon européen. Sur le modèle du « Trade Adjustment Act » américain, il a vocation à offrir une aide individuelle et ponctuelle ciblée sur les travailleurs « personnellement et sévèrement touchés par des licenciements résultant des transformations profondes dans les échanges commerciaux internationaux ». Il ne s'agit donc pas d'un instrument destiné à traiter les restructurations en général mais à compenser les effets spécifiques des changements structurels liés à l'ouverture du commerce international ; les restructurations liées aux changements technologiques ne sont donc pas visées ici. Selon les estimations de la Commission européenne, 35 000 à 50 000 personnes pourraient en profiter. Votre rapporteur ne peut qu'approuver le ciblage de ce dispositif sur les seuls salariés victimes des ajustements liés à la mondialisation : aider des entreprises en difficulté n'aurait fait que retarder des évolutions inévitables, en maintenant un statu quo artificiel, et empêcher les adaptations nécessaires des économies des États membres. De même, on ne peut que se féliciter de la décision de ne prendre en charge que des dépenses actives (aides à la création d'entreprise, formation...) ou des compléments salariaux pour les travailleurs de plus de 50 ans (souvent contraints à ne retrouver que des emplois déclassés), à l'exclusion de toute dépense passive. Indemnisation du chômage et mise en œuvre de dispositifs de préretraites restent exclusivement à la charge de l'État membre en application du principe de subsidiarité. Le fonds d'ajustement ne pourra financer que 50 % du plan d'action présenté par l'État membre, le reste pouvant cependant faire l'objet d'une prise en charge par le Fonds Social Européen. Signe tangible d'une solidarité à l'échelle européenne, ce fonds reste cependant d'ampleur limitée et à visée exclusivement curative. L'enveloppe financière ne peut dépasser 500 millions d'euros par an et dépend de la sous-utilisation de crédits budgétaires. Le champ d'application, défini par plusieurs critères d'éligibilité, actuellement encore en cours de discussion, est aussi restreint : les restructurations doivent être à la fois liées au commerce international et avoir une envergure européenne et un impact important sur le contexte régional. Trois critères alternatifs ont été définis pour illustrer le lien avec le commerce international : une croissance massive des importations dans un secteur donné, une diminution de parts de marché importante, une délocalisation dans un pays tiers. Votre rapporteur regrette l'ambiguïté de ce dernier critère, excluant les délocalisations intracommunautaires, critère justifié par la Commission européenne par le principe de liberté d'établissement et par le souci de ne pas financer des mouvements à l'intérieur de l'Union européenne. Cependant, si elles ne constituent pas une preuve suffisante de restructuration liée au commerce international, les délocalisations intracommunautaires ne sont pas exclues en tant que telles du champ d'application du fonds car il existe d'autres critères alternatifs d'éligibilité. Pour apprécier l'envergure de la restructuration et de son impact, la Commission propose deux critères : soit 1 000 licenciements dans une zone de NUTS III (l'équivalent des départements français), dans laquelle le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale ou communautaire, soit 1 000 licenciements quand le secteur concerné représente plus d'1 % de l'emploi marchand régional. Dans les deux cas, les suppressions d'emploi doivent intervenir dans les six mois et peuvent aussi concerner les sous-traitants de l'entreprise qui se restructure. Votre rapporteur estime cependant que les répercussions en terme d'emploi sur les sous-traitants peuvent n'apparaître que tardivement et approuve la possibilité d'une clause de révision précoce dès 2008 prévue par le règlement qui permettra de vérifier la viabilité des critères. Même si la mise en œuvre de ce fonds relève d'une simple décision du Conseil et du Parlement, non dénuée d'une marge d'appréciation politique, le risque existe que ce fonds ne fasse parler de lui qu'en cas de non éligibilité, ce qui réduirait à néant les efforts menés pour réconcilier l'opinion publique avec la mondialisation. Le risque le plus grand aujourd'hui vient cependant du scepticisme qu'inspire le fonds à un certain nombre d'États membres, qui pourrait dévoyer son fonctionnement (le principe de la création de ce fonds et de son financement sont actés par le Conseil et ne peuvent être remis en cause) : les petits États membres craignent de ne pas atteindre le critère des 1 000 suppressions d'emploi et plaident pour un droit de tirage par État ; d'autres États membres partisans d'une orthodoxie budgétaire pensent que le mode de financement du fonds conduisant à préempter des crédits non utilisés deviendra une machine à empêcher toute économie et demandent des critères plus stricts. A.- POUR UNE DÉFINITION PLUS RÉALISTE DES DÉLOCALISATIONS Au-delà de l'appréhension quantitative du phénomène, il est souhaitable de pouvoir en évaluer les effets, notamment sur l'emploi, pour rechercher des solutions adéquates, tant sur le plan social que territorial. Or, les problèmes d'appréhension du phénomène, liés notamment à l'absence d'une définition consensuelle et à l'absence d'indicateurs statistiques spécifiques, se retrouvent lorsque l'on souhaite en mesurer les effets. En outre, il est d'autant plus difficile d'avoir une mesure complète de ces effets qu'une entreprise fortement concurrencée qui serait restée sur le territoire national au lieu de délocaliser peut se trouver contrainte à terme de fermer ; dans ce cas, le nombre de suppressions d'emploi induites par la délocalisation de l'entreprise peut finalement se révéler inférieur au nombre d'emplois qui auraient été supprimés à terme. Malgré ces difficultés, plusieurs études récentes ont tenté d'évaluer précisément ces effets, en décomptant les présomptions de suppressions d'emploi directement liées aux délocalisations. En s'appuyant sur des données individuelles d'entreprises (répertoire SIRENE d'établissements, Déclarations Annuelles de Données Sociales, données douanières), l'étude de l'Insee précitée, réalisée en 2005 par MM. Aubert et Sillard, conclut que 95 000 emplois industriels auraient été supprimés en France pour être délocalisés à l'étranger entre 1995 et 2001, soit en moyenne 13 500 emplois par an. À titre de comparaison, cette moyenne annuelle représente 22,5 % des 60 000 emplois perdus par l'industrie manufacturière en 2005. Cette moyenne doit cependant être aussi comparée aux emplois induits par les investissements étrangers en France, qui s'élevaient en 2005 à 30 146 (dont 25 011 correspondaient à de vraies créations et 5 035 à des emplois maintenus dans le cadre de la reprise de sites en difficulté), même si ce chiffre correspond à l'ensemble de l'économie et non à la seule industrie manufacturière. Un peu moins de la moitié de ces 95 000 emplois auraient été délocalisés dans des pays à bas salaires, la Chine constituant de loin la principale destination devant l'Europe de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Amérique du Sud et les autres pays d'Asie. L'autre moitié des suppressions d'emplois s'inscrirait dans le cadre des restructurations des grands groupes multinationaux entre les différents pays développés (suppression de doublons dans des secteurs très concentrés tels que la pharmacie). Les délocalisations seraient surtout le fait de grands groupes et, dans les pays à bas coûts salariaux, le mode privilégié de délocalisation serait la sous-traitance. Si certains secteurs semblent plus durement touchés sur cette période (textile, habillement-cuir, équipement du foyer), l'étude révèle cependant que « les présomptions de délocalisations s'observent dans pratiquement tous les secteurs » et qu'il n'y a « pratiquement pas de secteur protégé ». EMPLOIS DÉLOCALISÉS (MOYENNE ANNUELLE 1995-2001)
Source : INSEE Le champ d'application de cette étude reste cependant limité. Il ne couvre que l'industrie manufacturière, hors secteur de l'énergie, alors que comme le reconnaissent les auteurs de cette étude, « les délocalisations ne concernent pas uniquement l'industrie : elles touchent également les services, notamment les centres d'appel et des activités de comptabilité ou de recherche ». De plus, outre les incertitudes inévitables liées à la définition des produits et activités dans l'appréciation de l'équivalence entre la production française et la production étrangère, l'étude ne prend pas en compte les délocalisations lorsque la production concernée n'est pas destinée au marché domestique du pays d'origine mais à des marchés extérieurs, cette restriction étant due « à la disponibilité des données ». En effet, la méthode retenue se base sur l'analyse de la création de flux d'importations concomitante à la baisse d'activité. Par ailleurs, si votre rapporteur comprend la nécessité de fixer un seuil minimal de baisse d'effectifs de 25 % sur 3 ans pour éviter toute confusion avec les variations conjoncturelles des effectifs, il n'est pas sûr que l'étude prenne en compte de façon exhaustive les délocalisations diffuses, qui se traduisent par exemple par la décision de regrouper à l'étranger sur un site unique tout le support après-vente éclaté en France entre les différents établissements ; dans ce cas, seuls quelques emplois par établissement sont concernés. Or, ce cas de figure pourrait être amené à se multiplier en raison de la fragmentation croissante de la chaîne de valeur. En outre, l'étude de l'INSEE, en posant comme préalable l'existence d'une production identique en France, écarte volontairement la question de la localisation des unités nouvelles à l'étranger sans modification des marchés desservis, résultant d'un arbitrage défavorable à la France. Elle n'apporte pas non plus d'enseignements sur les suppressions d'emplois indirects induites par les délocalisations. Cette étude a enfin l'inconvénient d'apporter un repérage statistique tardif, sur une période relativement ancienne (1995-2001) et ne reposant que sur une moyenne annuelle. Elle ne permet donc pas d'effectuer un constat sur l'évolution du phénomène au début des années 2000, alors que les personnalités auditionnées par la mission ont toutes souligné la forte probabilité d'une accélération des délocalisations au cours de cette décennie et des suivantes. Comme l'a indiqué M. Michel de Virville, secrétaire général et directeur des ressources humaines de Renault, « les délocalisations sont encore largement à venir dans le secteur automobile », cette question allant « surtout se poser avec l'obsolescence des usines implantées en Europe de l'Ouest » : en raison de la lourdeur des investissements consentis en Europe de l'Ouest, le tassement des emplois dans le secteur automobile y est resté jusqu'ici modéré mais les extensions de capacité de production s'effectuent désormais à l'étranger. Cette année, la production d'automobiles dans les pays d'Europe centrale et orientale devrait ainsi représenter 2,4 millions de véhicules ; elle pourrait atteindre 3,4 millions en 2010, soit une progression de 33 % par rapport à 2005. La production devrait, sur la même période, rester stable en France mais doubler en République tchèque. Depuis le début de l'année, près de 10 000 emplois sur 124 500 ont été supprimés chez les sous-traitants du secteur automobile en France, tandis que 11 000 emplois l'ont été chez Peugeot dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Cette situation a conduit notamment la fédération des industries des équipements pour véhicules à souligner l'urgence d'une réduction des délais de paiement de 90 à 60 jours, afin de ne pas priver les PME de leurs moyens financiers. Les résultats d'une autre étude ont été présentés aux membres de la mission d'information par M. Jacky Fayolle, directeur de l'IRES. Il s'agit de l'étude menée au niveau européen par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, dite Fondation de Dublin. Grâce à son outil de veille sur les restructurations (« European Restructuring Monitor »), qui recense les annonces de licenciements collectifs, celle-ci a compilé les cas individuels de restructuration d'entreprises européennes, dans l'industrie et les services, du 1er janvier 2002 au 15 juillet 2004, pour les analyser. Sur les quelque 1 500 cas de restructuration recensés, les cas de délocalisation et de sous-traitance internationale ne représentent que 7,19 % des emplois supprimés et 8,24 % des opérations de restructuration. Mais là encore, les « non-localisations » ne sont pas prises en compte et le champ couvert, bien qu'élargi aux services, est loin d'être exhaustif : restructurations comprenant au moins 100 suppressions d'emploi ou concernant des sites employant plus de 250 salariés et affectant plus de 10 % des effectifs. RÉPARTITION DES EMPLOIS DÉTRUITS EN EUROPE PAR TYPE D'OPÉRATION
Source : European Monitoring Monitor (EMCC), Dublin Intégrant pour la première fois la question des « non-localisations », c'est-à-dire des ouvertures à l'étranger d'activités qui, non destinées au marché local, auraient pu être implantées en France, l'étude réalisée par le cabinet Katalyse pour la Commission des Finances du Sénat aboutit à des chiffres d'une tout autre ampleur : 202 000 emplois de services devraient être perdus en France entre 2006 et 2010, soit 22 % de la création nette d'emploi salarié au cours des cinq dernières années. Ces manques à gagner en terme d'emplois se répartiraient entre 42 000 emplois délocalisés au sens strict (soit 20 % du total) et 160 000 emplois « non-localisés ». Il s'agit certes d'une étude prospective, réalisée à partir de l'analyse de stratégies d'entreprises et d'une centaine d'entretiens avec leurs dirigeants, mais une extrapolation de ces enseignements à l'industrie pourrait conduire à nuancer le caractère marginal du phénomène tel qu'il apparaît des conclusions des autres études précitées. En effet, dans l'hypothèse où la proportion de 4 emplois « non-localisés » pour 1 emploi délocalisé constatée dans les services se vérifiait dans l'industrie, ce ne seraient plus 13 500 emplois industriels qui seraient affectés par an par les délocalisations mais plus de 60 000. Votre rapporteur en appelle donc à l'élaboration d'une étude complète couvrant à la fois le domaine de l'industrie et celui des services, réalisée sur une période récente et mettant en valeur l'évolution annuelle du phénomène, ainsi que reposant sur une définition réaliste des délocalisations. Sauf à vouloir se voiler la face et prendre le risque d'un réveil douloureux, il n'est plus possible aujourd'hui de se réfugier derrière une définition stricte et obsolète des délocalisations, comme transfert en bloc d'une activité implantée sur le territoire national vers l'étranger en vue d'une réimportation des biens produits à moindre coût. Sans forcément s'accompagner de suppressions d'emploi, le mouvement en cours est aujourd'hui peu visible mais il ne sera pas indolore à terme. Les créations d'emplois ne se feront plus en totalité en France. Ce sont donc nos emplois de demain qui sont en jeu. À titre d'exemple, Axa France envisage dans le cadre de son projet « Ambition 2012 » de remplacer 4 500 départs en retraite par l'embauche de 1 500 personnes en Maroc et de 1 500 personnes en France. Votre rapporteur estime donc indispensable de retenir une définition des délocalisations qui, au-delà de l'approche traditionnelle, prenne en compte les emplois créés à l'étranger par les firmes françaises, soit par la création de filiales, soit par l'externationalisation, qui auraient pu être localisés en France (« non-localisations »), c'est-à-dire l'ensemble des arbitrages individuels des entreprises défavorables à la France pour la localisation de leurs activités. En revanche, cette définition ne prendrait pas en compte les créations d'emplois à l'étranger motivées par l'accès à un marché local, dans la mesure où ces emplois n'auraient pu être créés en France. Le concept de délocalisation regroupe ainsi, selon votre rapporteur, tous les arbitrages d'entreprises qui renoncent à maintenir, développer ou créer leurs activités en France pour produire ou sous-traiter à l'étranger à destination du marché hexagonal ou des marchés d'exportation. B.- DES EFFETS NÉGATIFS QUI NE SE LIMITENT PAS AUX SEULES PERTES D'EMPLOIS L'impact des délocalisations ne doit par ailleurs pas être apprécié à l'aune des seules suppressions d'emploi et il serait réducteur de s'appuyer sur ce seul chiffre pour en conclure que celles-ci ne constituent pas un problème économique. Le 76ème rapport annuel de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), organisme financier qui regroupe les principales banques centrales, insiste ainsi sur l'influence de la mondialisation sur la détermination des salaires. S'interrogeant sur les différents facteurs qui ont conduit à une modération de la progression des salaires nominaux et à une décrue de 5 % de la part des salaires dans l'économie ces trente dernières années, ce rapport souligne la restriction du pouvoir de négociation des salariés et de leurs syndicats induite par une délocalisation de la production ou par sa menace. L'existence potentielle d'une délocalisation est utilisée comme argument pour justifier une baisse des salaires, comme l'ont rappelé tant M. Jacky Fayolle, directeur de l'IRES, que M. Nasser Mansouri, conseiller aux activités économiques de la CGT, lors de leur audition. En Allemagne, pays pourtant présenté comme champion de la paix sociale, de grands groupes (Siemens, Daimlerchrysler, Continental, Thomas Cook...) ont pu négocier des réaménagements de salaires ou d'horaires - le plus souvent sans contrepartie salariale - contre l'abandon de leurs projets de délocalisation. Ce phénomène est également manifeste au Japon, où les secteurs ayant déployé de vastes stratégies de délocalisation ont eu tendance à réduire plus radicalement la part des salaires dans la répartition de la valeur ajoutée, comme l'illustre le graphique ci-dessous. 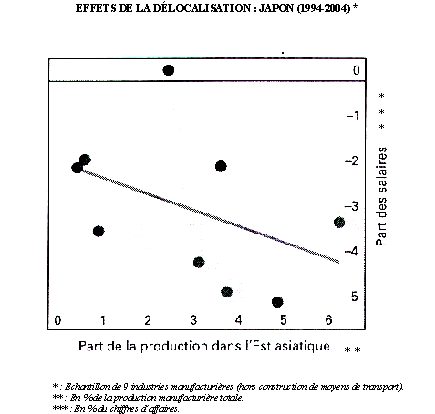 Or, cette pression sur les salaires est susceptible d'avoir un effet dépressif sur la consommation et de contribuer au maintien d'une demande intérieure atone, fragilisant par là même la croissance et l'investissement. Le manque d'investissement risque alors d'alimenter en lui-même le phénomène des délocalisations, en rendant les entreprises restées sur le territoire national plus vulnérables à la concurrence internationale. Le rapport précité de la BRI indique en outre d'une façon générale que l'intensification de la concurrence internationale, amplifiée par les délocalisations, soumet les entreprises restant sur le territoire national à de fortes pressions et les conduit à poursuivre leurs efforts de compression des coûts, stratégie qui passe le plus souvent par une réduction de la masse salariale, ou à renforcer leur recherche de gains de productivité, ce qui se traduit par une substitution du facteur capital au facteur travail. Le rapport de la BRI constate ainsi une corrélation entre le taux de pénétration des importations et l'évolution des salaires : « en moyenne, la part des salaires recule davantage dans des secteurs comme l'habillement, confrontés à une plus forte pénétration des importations ». Or, les délocalisations, qui se traduisent par une réimportation des biens sur le marché d'origine, constituent indéniablement un des facteurs d'augmentation de la part des importations. Et l'habillement, secteur cité par le rapport de la BRI, est justement l'un des secteurs, avec le textile ou le cuir, affectés depuis longtemps par des délocalisations. Les délocalisations alimentent aussi en elles-mêmes un climat anxiogène, qui rendent les salariés plus enclins à accepter des baisses de salaire ou à ne pas revendiquer de revalorisations. Par ailleurs, les délocalisations peuvent générer des externalités négatives : comme le souligne la CFDT dans un article pour la revue « Regards sur l'actualité » de juin-juillet 2005, celles-ci conduisent à un accroissement du transport de marchandises qui a un coût pour la société (émissions de gaz à effet de serre, pollutions). La complexité du phénomène et la difficulté de l'appréhender pleinement conduiront d'ailleurs votre rapporteur à proposer, en conclusion de ce rapport, la mise en place d'un observatoire chargé, notamment, de mesurer ce phénomène. C.- DES EFFETS « POSITIFS » DIFFUS DIFFICILEMENT PERCEPTIBLES PAR LES SALARIÉS Une analyse globale des délocalisations peut laisser apparaître l'existence de gains virtuels, mais ceux-ci restent, selon votre rapporteur, trop diffus pour être réellement perceptibles par les salariés. Ils sont en tout état de cause loin d'être automatiques. Tout d'abord, comme il a déjà été indiqué, la délocalisation d'activités de production peut permettre de maintenir la compétitivité globale d'une entreprise autrement condamnée à disparaître et de pérenniser les autres emplois restant sur le territoire national. L'exemple cité le plus souvent à cet égard est celui de Lafuma, dont le tiers de la production est resté en France et le reste a été délocalisé en Tunisie, au Maroc, en Hongrie et en Chine pour répondre à l'exacerbation de la concurrence internationale et permettre la survie de l'entreprise. Les délocalisations peuvent certes permettre dans certains cas à une entreprise de renforcer sa compétitivité, ce qui peut se traduire parfois par une création d'emplois dans le pays d'origine. À court terme, les délocalisations peuvent contribuer à la création dans le pays d'origine de postes d'encadrement et de supervision pour gérer et coordonner les activités délocalisées. À plus long terme, les parts de marché gagnées par l'entreprise grâce à la baisse de ses coûts de production lui permettent de développer son activité, en élargissant son offre notamment, ce qui peut permettre, en théorie, de procéder à terme à des embauches sur le territoire national. Bien qu'ancien, l'exemple de l'industrie diamantaire belge figurant dans un document de travail élaboré en 2005 pour le conseil « Compétitivité » de l'Union européenne par la DG Entreprises et Industrie et présenté par son directeur, M. Heinz Zourek, aux membres de la mission d'information illustre tout à fait cette possibilité : au début des années 80, l'industrie du diamant à Anvers employait 12 000 personnes, dont 8 000 affectées à des opérations de taille du diamant et 4 000 à des activités commerciales et de services ; après une vague massive de délocalisations en Inde et en Thaïlande durant les années 80, ce secteur emploie à la fin des années 90 près de 15 000 salariés à Anvers. Que s'est-il passé ? Les délocalisations dans l'industrie diamantaire ont entraîné la suppression de 4 000 emplois manufacturiers mais dans le même temps, les entreprises belges ont investi massivement, en développant leurs activités de distribution, de marketing, de certification ou de recherche, qui ont permis de plus que compenser les effets négatifs des délocalisations et d'acquérir de nouveaux avantages comparatifs plus durables. Mais cet exemple montre surtout que les gains possibles en terme de créations d'emploi ne sont pas automatiques : les créations d'emploi constatées à Anvers ne sont que la contrepartie des investissements réalisés dans des activités à plus forte valeur ajoutée. De plus, le système d'éducation et de formation doit être suffisamment performant pour pourvoir ces nouveaux postes et le marché du travail suffisamment fluide. Les délocalisations et la sous-traitance à l'étranger favorisent aussi le développement d'une demande solvable dans le pays d'accueil. Les exportations françaises à destination de ce pays, à fort contenu en main-d'œuvre qualifiée, bénéficient d'un effet d'entraînement : la part relative de la France dans le commerce international diminue mais le gâteau à se partager, c'est-à-dire la demande de biens et services, est plus grand. Le renforcement des activités à contenu en travail très qualifié induit par les délocalisations, selon le principe de destruction créatrice dégagé par Shumpeter, n'exclut par ailleurs pas la création indirecte d'emplois plus faiblement qualifiés : en raison du pouvoir d'achat donné aux travailleurs qualifiés, il peut induire une demande renforcée en services à la personne et autres services de proximité, dont une partie correspond à des emplois peu qualifiés, qui, par leur nature, sont peu exposés à la concurrence internationale et aux risques de délocalisation. En ce sens, on ne peut que se féliciter de l'adoption de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne qui doit permettre de lever les obstacles à l'exploitation de ce gisement important d'emplois et de doubler la croissance de ce secteur, déjà forte en terme d'effectifs employés (+5,5 % par an depuis 1990). Mais encore faut-il que nos entreprises soient suffisamment dynamiques pour pouvoir exporter et profiter de ce supplément de demande. Quant au consommateur du pays qui délocalise, il bénéficie de la baisse de prix de nombreux biens de consommation et voit son pouvoir d'achat augmenter. Cependant, comme l'a souligné Lionel Fontagné lors de son audition, le gain pour le consommateur est moindre dans le cas spécifique de la France en raison du poids des distributeurs. Il n'est par ailleurs pas certain que ce supplément de pouvoir d'achat s'oriente vers des produits nationaux plutôt que vers des produits importés. Les consommateurs bénéficient aussi d'un gain en terme de variété. Ils peuvent avoir accès à des services qui n'auraient pu être proposés en l'absence de délocalisation dans un pays à bas coût. Cette offre de services supplémentaires peut également permettre à l'entreprise de rester compétitive dans un marché très concurrentiel, sans s'engager dans une hasardeuse guerre des prix. Sofinco envisage ainsi de créer une plate-forme au Maroc pour proposer du crédit à la consommation à une clientèle qui n'y a pas accès jusqu'ici, les économies de coût réalisées permettant de s'attaquer à un marché un peu plus risqué sans faire payer plus cher le crédit au client. De même, M. François Pierson, président d'Axa France a justifié le recrutement au Maroc de 1 500 personnes affectées à des tâches administratives d'ici 2012 par le souci d'augmenter les réseaux de distribution et de pouvoir proposer des services supplémentaires demandés par le client sans augmentation du coût des produits d'assurance. Les entreprises qui absorbent dans leur processus de production une part croissante de biens intermédiaires ou de services réalisés dans des pays émergents bénéficient aussi des délocalisations. L'impact sur le PNB américain de la réduction du coût des intrants dans le domaine du matériel informatique liée à l'intégration des pays émergents dans le processus de production a été estimé à 0,3 % du PNB par an sur 1995-2002 (Mann, 2003). Le prix du « hardware » est 10 à 30 % inférieur à ce qu'il serait en l'absence de délocalisations. Cette baisse de prix des équipements informatiques a stimulé l'investissement des entreprises dans les nouvelles technologies de l'information, en les rendant plus productives. Mais ce gain n'est pas perceptible pour le salarié, la part des salaires dans la valeur ajoutée ayant diminué. Enfin, comme l'a souligné Mme Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur, lors de son audition, les délocalisations peuvent certes apparaître comme la contrepartie du développement de nouveaux pays, ce qui peut contribuer à éviter le développement anarchique de flux d'immigration. Cependant, cette affirmation doit être quelque peu nuancée dans la mesure où certaines implantations de centre d'appel à l'étranger n'ont pas de caractère pérenne et peuvent être remises en cause par l'apparition d'un autre pays offrant à un coût inférieur une main-d'œuvre d'un niveau de qualification similaire. La levée des quotas dans le domaine du textile s'est ainsi surtout traduite par une réorganisation des approvisionnements et de la sous-traitance au profit de la Chine, au détriment d'autres pays tels que le Pakistan ou les pays du Maghreb. Le Maroc ou la Tunisie, terres d'accueil des délocalisations, commencent à en devenir les victimes. Force est de constater que les effets positifs liés aux délocalisations sont diffus, agrégés au niveau de la collectivité, et étalés dans le temps. L'horizon temporel des économistes, qui se placent dans une perspective de long terme, n'est pas le même que celui des salariés et tend à relativiser les coûts d'ajustements à court terme. Or, il n'y a pas transfert immédiat et sans coût de la main-d'œuvre d'un secteur d'activité à un autre, par exemple d'une entreprise de filature qui se délocalise à une entreprise spécialisée dans les biotechnologies. La crainte majeure aujourd'hui est celle d'un décalage croissant entre les suppressions d'emplois dans les activités dites « matures » et la création d'emplois nouveaux qui dépend notamment du rythme d'innovation. De même, les économistes évaluent les effets des délocalisations pour un pays, tandis que les salariés les vivent en termes de trajectoires individuelles. Pour certains individus, dont la part dans le revenu national diminue, l'effet net de la mondialisation et des délocalisations peut être négatif, même si l'effet global est positif pour le pays. Rien n'assure que les emplois gagnés dans les secteurs innovants compenseront ceux perdus dans les secteurs abandonnés. Et quand bien même la croissance générée par le recours aux délocalisations permet aux travailleurs concernés de retrouver à terme un emploi grâce à un marché du travail suffisamment fluide, rien ne garantit à ces salariés de retrouver une rémunération équivalente à celle qu'ils percevaient, sauf à accroître significativement leur qualification. Il y a des gagnants et des perdants et, malheureusement, souvent en fait des perdants. Ces écarts justifient une intervention publique, ciblée sur les actifs perdants et non sur les emplois perdus si l'on ne veut pas freiner les évolutions inéluctables. Si les délocalisations ne semblent pas avoir jusqu'ici de traductions statistiques fortes, elles sont ainsi symptomatiques d'un débat sur la création d'emplois et sur les salaires. Le « retour sur délocalisation » varie en outre selon les pays. L'étude réalisée par le Mac Kinsey Global Institute dans le domaine des services et présentée aux membres de la mission par M. Éric Labaye, directeur général de Mac Kinsey France, révèle que la France et l'Allemagne sortent aujourd'hui perdantes des délocalisations, alors que les États-Unis parviennent à un bilan positif : pour 1euro délocalisé, la France et l'Allemagne rapatrient respectivement 0,86 euro et 0,74 euro, tandis que les États-Unis regagnent 1,14 à 1,17 dollar par dollar délocalisé. 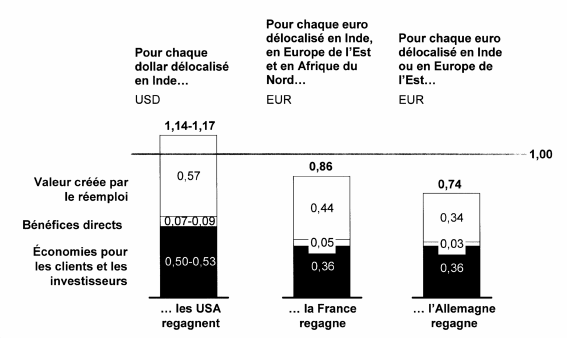 (1) (2) (3) Source : Analyse McKinsey (1) Valeur créée par le réemploi = postes d'encadrement nécessaires + % de personnes dont les emplois sont délocalisés retrouvant un emploi dans les 12 mois multiplié par le salaire récupéré (2) Bénéfices directs = rapatriement des bénéfices + demande supplémentaire de produits liée à la création de richesse dans les pays où les activités sont transférées + achats de biens et services dans le pays d'origine par les activités transférées (3) économies pour les clients et les investisseurs = économies réalisées sur le coût du travail redistribuées aux clients (baisse de prix) ou/et aux investisseurs + économies exportées Selon le cabinet Mac Kinsey, plusieurs raisons expliquent cette différence de situation. Tout d'abord, les salariés français dont le poste est délocalisé ont plus de difficultés à retrouver un emploi : le taux de réemploi dans les 12 mois atteint 60 % en France, contre 69 % aux États-Unis. Un autre facteur doit être recherché du côté de nos performances à l'export : la France tire peu parti de la demande supplémentaire de biens et services liée à la création de richesse dans les pays où les activités sont transférées. Enfin, les entreprises françaises obtiennent des réductions de coût inférieures car elles ne transfèrent pas seulement des emplois en Inde mais également en Europe de l'Est et surtout au Maghreb, en raison de l'existence d'un réservoir de main-d'œuvre francophone. Or, les salaires y sont plus élevés qu'en Inde. On peut cependant remarquer que ce facteur, pertinent dans le domaine des services, l'est sans doute moins dans l'industrie, où la production d'un bien n'est pas conditionnée à l'usage de la langue du client. Les délocalisations ne deviendront pas un problème économique majeur, si la France est capable de créer les emplois de demain, en se différenciant par l'innovation, qui seule permet de préserver les marges des entreprises et de retarder l'arrivée de concurrents, tout en favorisant le redéploiement des salariés. Comme l'a indiqué aux membres de la mission M. Heinz Zourek, directeur général « Entreprises et Industrie » à la Commission européenne, « la faiblesse de l'économie européenne n'est pas liée aux pertes d'emplois dues aux délocalisations mais à l'incapacité de créer de nouveaux postes ». Les délocalisations n'auront pas non plus de caractère massif, si, comme l'a souligné Jean-Paul Fitoussi devant les membres de la mission d'information, la réponse apportée par les pays européens ne se résume pas à une concurrence fiscale et sociale, qui n'équivaut qu'à rogner sur les parts de marchés de ses partenaires européens sans accroître le gâteau à se partager. III.- LES CAUSES GÉNÉRALES DE LA MONTÉE DU PHÉNOMÈNE Comme votre rapporteur l'a indiqué dans son introduction, les délocalisations ne constituent pas, loin s'en faut, un phénomène nouveau. Plusieurs facteurs inédits tendent cependant aujourd'hui à le rendre plus préoccupant. A.- LA FINANCIARISATION DE L'ÉCONOMIE OU LA VALORISATION DU COURT TERME Tout d'abord, comme l'a indiqué lors de son audition M. Jean-Louis Levet, responsable du pôle industriel au sein du Conseil d'Analyse Stratégique, une contradiction apparaît de plus en plus nettement au sein même des entreprises entre « le capitalisme financier » et « l'économie de la connaissance », c'est-à-dire entre la vision à court terme des actionnaires, guidée par la recherche immédiate de la rentabilité financière et la distribution de dividendes, et la perspective de long terme dans lequel doivent s'inscrire les investissements et les efforts de recherche-développement. Alors que la finance était traditionnellement au service du système productif, ce lien s'est aujourd'hui inversé. Comme l'indique en outre Daniel Cohen dans un ouvrage intitulé « Trois leçons sur la société post-industrielle », la révolution financière en cours est caractérisée par le recours à des managers « arrachés au salariat », dont on a aligné les incitations sur la rémunération des actionnaires grâce aux stock-options. Les entreprises doivent désormais concilier l'impératif de compétitivité qui les pousse à développer des stratégies sur le long terme (recherche et innovation, renforcement du capital humain par la formation) et l'exigence liée à la création de valeur à court terme pour l'actionnaire, nouvel impératif apparu dans les années 90. M. Renaud Dutreil, Ministre des PME, n'a pas dit autre chose lorsqu'il a évoqué devant les membres de la mission la dichotomie entre les « entrepreneurs » et les « managers », en rappelant la prévision de Schumpeter selon laquelle le capital mourra le jour où les seconds auront remplacé complètement les premiers. La « tyrannie du court terme » ne laisse plus aujourd'hui le temps nécessaire au processus d'innovation et favorise les délocalisations. B.- LA RÉDUCTION DES DISTANCES ET DES DÉLAIS OU LA LEVÉE DES FREINS À LA DÉLOCALISATION La vague actuelle de délocalisations est en outre liée à l'essor considérable des nouvelles technologies de l'information et de communication, qui a contribué à faire de la Terre un « village planétaire » en réduisant les délais et les coûts liés aux distances. La dématérialisation des communications, qui permet de transmettre immédiatement des instructions à distance par Internet, a accéléré la mondialisation de l'économie, mais a aussi joué le rôle de facilitateur pour les délocalisations. La diminution des coûts de transports a également joué ce rôle, même si cette tendance, constatée sur le long terme, risque aujourd'hui de se renverser en raison du renchérissement durable du prix de pétrole. C.- LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES ET L'APPARITION DE NOUVEAUX ACTEURS ÉCONOMIQUES La nouvelle donne actuelle est également marquée par la libéralisation des échanges (entre 1948 et 1998, le commerce de produits manufacturés a été multiplié par 43 alors que le PIB mondial ne l'a été que par 7) et l'ouverture des marchés, qui a permis l'insertion de nouveaux pays - et de nouveaux concurrents- dans l'économie mondiale. Ce fut d'abord le cas des quatre dragons asiatiques : Corée du Sud, Hong-Kong, Taïwan, Singapour. Mais ce sont désormais des États d'une tout autre échelle qui rentrent dans la course : la Chine et l'Inde, qualifiée à juste titre de sous-continent, sont considérablement plus peuplés que les premiers nouveaux pays industrialisés et peuvent s'appuyer sur un important potentiel technologique. M. Lionel Fontagné a ainsi indiqué aux membres de la mission qu'une rupture brutale était intervenue en 1999-2000, avec une accélération du commerce international et de la concurrence liée à l'émergence de ces deux nouveaux acteurs. Fortes de leur poids démographique (1,3 milliard d'habitants pour la Chine, soit 20,7 % de la population mondiale, et 1,05 milliard pour l'Inde), la Chine et l'Inde disposent d'un réservoir considérable de main-d'œuvre, sans précédent dans l'histoire économique, qui n'est pas près de s'épuiser en raison du poids encore important de la population rurale (près de 60 % des populations chinoise et indienne), et qui explique le maintien durable de bas niveaux de salaires en dépit de la hausse de la productivité. Il s'agit en outre d'une main-d'œuvre d'une très grande disponibilité et éduquée : le renforcement du système éducatif figure parmi les objectifs de la politique suivie par la Chine depuis 1978 ; les dépenses d'éducation et de santé qui représentaient 10 % du PIB chinois en 1978 atteignaient 25 % en 2005. Le modèle indien, largement fondé sur le secteur informatique, s'appuie sur une appétence traditionnelle pour les mathématiques (création de l'université de Tuksahila au IIIème siècle avant Jésus-Christ) ainsi que sur une communauté de langue avec les pays anglo-saxons. Ces deux pays bénéficient aussi de capitaux importants pour financer leurs investissements, issus des flux d'investissements directs à l'étranger (5,5 milliards de dollars en flux annuel en 2005 en Inde, plus de 60 milliards de dollars en Chine la même année) dont l'accueil est favorisé par un programme de libéralisation de l'économie (engagé en 1991 en Inde et renforcé par la création en juin 2005 de zones économiques spéciales, initié par étapes dès 1978 en Chine), et/ou d'un fort taux d'épargne (50 % du PIB en Chine). Disposant de facteurs de production abondants et peu coûteux, l'Inde et la Chine disposent ainsi d'un avantage comparatif redoutable. En dépit d'une réévaluation de 2,1 % par rapport au dollar intervenue le 21 juillet 2005, l'économie chinoise bénéficie en outre d'une sous-évaluation durable de sa devise par rapport aux grandes monnaies internationales, notamment l'euro, alors qu'elle enregistre des taux de croissance de l'ordre de 10 %. La sous-évaluation du taux de change réel du yuan est ainsi estimée à près de 30 % (9). Le pays qui enregistre un déficit dans sa balance des paiements courants devrait logiquement voir sa monnaie se déprécier en termes relatifs mais comme l'a souligné M. Jean-Paul Fitoussi lors de son audition, faute de gouvernance européenne, l'Union européenne s'est privée de l'instrument de la politique de change. Comme le souligne Mme Nadia Terfous dans un article de la revue « Économie et Prévision » de janvier 2006 intitulé « Mondialisation et marché du travail dans les pays développés », « la plus forte compétitivité-prix qui en résulte (...) est certainement décisive dans certains secteurs et pourrait accélérer les réallocations des facteurs ». La Chine et l'Inde représentent par ailleurs de gigantesques marchés intérieurs en voie de constitution. Le rapport d'information de la mission sénatoriale effectuée en Chine du 10 au 22 septembre 2005 (10) évalue ainsi la classe moyenne chinoise, définie par un revenu annuel compris entre 3 000 et 6 000 dollars, à 150 millions de personnes et la catégorie sociale disposant de plus de 6 000 dollars et pouvant prétendre à un pouvoir d'achat occidental à plus de 40 millions de personnes. Il rappelle en outre qu'il y a « chaque année 5 millions de nouveaux abonnés au téléphone mobile en Chine, ce qui représente la totalité des abonnés au Portugal ». Plus proches de nous, les pays d'Europe centrale et orientale offrent aussi de nouvelles opportunités aux entreprises : si les coûts du travail y sont plus élevés, les coûts de transports restent beaucoup plus faibles et ces pays bénéficient, grâce à leur adhésion à l'Union européenne, d'une forte sécurité juridique et d'une certaine stabilité politique et sociale. Ils bénéficient aussi d'avantages liés à leur présence dans une zone économique intégrée (absence de droits de douane, liberté de circulation des biens et des capitaux...). Le passage à l'euro n'étant pas concomitant à leur adhésion, ils ne subissent pas non plus les conséquences de l'appréciation de la monnaie européenne. Soutenus par les fonds structurels de la politique de cohésion européenne, ils représentent également des marchés porteurs. D.- LA SEGMENTATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR Concomitamment à l'apparition de ces nouvelles zones d'accueil disposant d'une main-d'œuvre à la fois bon marché et suffisamment bien formée, l'essor des nouvelles technologies conjugué à la liberté de circulation des biens et des capitaux a rendu possible une fragmentation croissante des processus de production et favorisé une réorganisation des entreprises sur une base mondiale. La division internationale du travail, jusqu'ici principalement fondée sur une spécialisation des pays par secteur industriel ou par produit, s'est affinée et s'exerce au sein même des firmes ; tous les pays peuvent désormais être mis en concurrence en tant que lieu d'installation de chacun des éléments du processus de production. Alors que le modèle de l'entreprise verticale intégrée, proche de ses clients et de ses fournisseurs, prévalait dans les années 80, les entreprises sont amenées aujourd'hui à s'interroger sur leur spécialisation, ainsi que sur les fonctions qu'elles souhaitent privilégier et celles dont elles veulent se désengager dans une perspective d'optimisation de leur organisation et de meilleure allocation de leurs ressources. Thomson a ainsi cédé en 2004 son activité de fabrication de téléviseurs traditionnels à une joint-venture avec le chinois TCL. Certaines entreprises ont poussé cette logique de segmentation à l'extrême, en ne possédant plus aucun outil de production et en se concentrant sur les activités de conception, de recherche et de maîtrise de la marque : « les activités immatérielles, où le coût est dans la première unité, la promotion de la marque, par exemple, sont beaucoup plus intéressantes que la stricte fabrication des biens qui en découlent (11)». Illustration parfaite de ce type « d'entreprise sans usine », si l'on reprend l'expression célèbre de M. Serge Tchuruk, Nike ne fabrique plus aucun de ses articles de sport mais conserve ses activités de définition des produits et de gestion de la marque, qui sont les plus créatrices de valeur ajoutée. Les délocalisations ne constituent que l'aspect le plus spectaculaire d'un processus général d'externalisation. Face à ces interrogations sur le périmètre d'activités des firmes, les réponses restent néanmoins multiples, y compris dans le même secteur, comme le montre Mme Suzanne Berger dans son ouvrage Made in monde issu d'une enquête réalisée par le MIT auprès de 500 entreprises entre 1999 et 2004 : dans le secteur électronique, si Dell se concentre sur la définition du produit et sa distribution en achetant tous ses composants à des sous-traitants étrangers, il n'en est pas de même pour Sony qui incorpore dans ses produits des composants fabriqués dans ses propres usines au Japon. E.- UNE PRESSION ACCRUE SUR LES PRIX Enfin, l'un des facteurs contribuant à alimenter le phénomène des délocalisations doit être cherché en dehors des entreprises : il s'agit de l'évolution du mode de consommation des ménages, de plus en plus enclins à se tourner vers le « hard discount » (14 % des dépenses des ménages dans l'alimentaire en 2004 contre 8,8 % en 1999) et peu sensibles à l'origine géographique ni aux modalités de production d'un produit, alors que ceux-ci déterminent en partie l'avenir de leur emploi. Entretenu par la politique de communication de la grande distribution, axée essentiellement sur la restauration du pouvoir d'achat (12), ce comportement, qui conduit à privilégier de façon excessive le prix d'un produit au détriment de sa qualité, s'explique aussi par le développement de nouveaux postes d'achats (loisirs), qui incite le consommateur à faire des arbitrages. Cette course aux prix les plus bas se retrouve en outre amplifiée en France par la configuration même du secteur de la distribution, qui, très concentrée, a contribué à l'établissement de relations commerciales défavorables aux fournisseurs, que le gouvernement a souhaité rééquilibrer dans la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Au total, les entreprises se trouvent soumises à une triple contrainte : celle de leurs actionnaires, celle des ménages, sensibles à leur pouvoir d'achat, et celle des distributeurs ou donneurs d'ordre lorsqu'il s'agit de sous-traitants. IV.- DIFFÉRENTS FACTEURS PROPRES À LA FRANCE A.- LES ÉCARTS DE COÛTS SALARIAUX Selon l'enquête réalisée par l'association française des chambres de commerce et d'industrie auprès d'une centaine de PME françaises ayant précédé à une ou plusieurs « délocalisations » en 2004-2005, le premier motif des délocalisations est de faire baisser le prix de revient des productions (45 % des entreprises interrogées), le second avancé par les chefs d'entreprises étant de satisfaire la pression des donneurs d'ordre (27 %). La motivation de maîtrise des coûts apparaît donc déterminante dans les décisions de délocalisation. Cette pression sur les coûts s'est en outre renforcée dans un contexte marqué par l'appréciation de l'euro face au dollar, le renchérissement du coût des matières premières et une concurrence internationale accrue avec l'arrivée des pays à bas coûts de main-d'œuvre. Explorant au maximum les possibilités techniques de la décomposition des produits en sous-ensembles, les entreprises sont amenées à fragmenter de plus en plus leur processus de production pour pouvoir tirer profit des différentiels de coût. Le géant de l'électroménager, Electrolux, par exemple, présente son programme drastique de délocalisation de ses sites de production vers les pays à bas coût, avec un objectif affiché de réalisation de 60 % de sa production là-bas contre 40 % actuellement, comme le moyen de redresser sa marge opérationnelle de 5 à 6 % et se concentre sur la valorisation de sa marque, les clients payant plus cher pour des marques connues. Les coûts salariaux jouent évidemment un rôle déterminant dans la décision de localisation des entreprises. COÛTS HORAIRES MOYENS DE LA MAIN-D'ŒUVRE (en $ par heure)
Source : U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, May 2004, IXIS CIB Comme l'indique le tableau ci-dessus, l'écart de coûts salariaux est énorme entre la France et les pays émergents : le rapport entre la France et la Chine est pratiquement de 1 à 30, et celui entre la France et l'Inde est de 1 à 57... Un tel écart s'explique à la fois par les différences importantes de niveaux de salaires et par le poids de charges sociales en France. Il ne pourra être rattrapé avant longtemps, d'autant plus que ces pays disposent d'un important réservoir de main-d'œuvre. Cependant, comme l'a rappelé M. Lionel Fontagné lors de son audition, les bas niveaux de salaires dans les pays émergents correspondent à des productivités moyennes très basses : « si la productivité moyenne des travailleurs du Bengladesh est égale au 1/33ème de la productivité américaine, le salaire moyen est du même ordre ». Dans ces conditions, il est plus pertinent de raisonner en terme de coût salarial unitaire, c'est-à-dire de masse salariale rapportée à la valeur ajoutée en volume. Or, pour des raisons tenant à la formation, aux techniques de management et à l'organisation de la chaîne de production, la productivité des salariés occidentaux est en général plus forte. Néanmoins, comme l'indique Mme Nadia Terfous dans un article de la revue « Économie et Prévision » intitulé « Mondialisation et marché du travail dans les pays développés », les coûts salariaux très bas ne reflètent que partiellement seulement une moindre productivité ; même les coûts salariaux unitaires des pays émergents restent notablement plus faibles que ceux des pays développés : « pour une base de 100 pour les États-Unis, les coûts salariaux unitaires valent 90 pour l'Union européenne et 50 en Chine ». Cette situation s'explique par le fait que la plus faible productivité peut être compensée par la flexibilité de la main-d'œuvre, dont les horaires, en l'absence de législation du travail protectrice, peuvent être adaptés à une utilisation optimale des machines, et par une durée du travail beaucoup plus forte que dans les pays occidentaux, qu'il s'agisse de la durée quotidienne de travail, du nombre hebdomadaire de jours travaillés, du nombre de jours de congés ou de l'absence de conflits du travail. De plus, l'écart de productivité avec les pays occidentaux devrait s'atténuer avec le temps, en raison de l'effet d'apprentissage pour les salariés et des investissements consentis par l'entreprise dans la nouvelle usine. M. de Virville, secrétaire général de Renault, a ainsi indiqué aux membres de la mission lors de son audition que les nouveaux investissements ne se faisaient plus en Europe de l'Ouest dans le secteur automobile. Enfin, les pays émergents dans lesquels s'effectuent principalement les délocalisations sont ceux qui bénéficient déjà d'une main-d'œuvre formée ; si tout n'était qu'une question de niveaux de salaires et de charges sociales, des délocalisations auraient également lieu en Afrique noire. Les délocalisations ne peuvent avoir lieu que dans des pays marqués par une certaine stabilité politique. L'écart de coût salarial est moins important entre la France et les PECO : il est de 1 à 3,4 dans le cas de la Pologne et de la République Tchèque, de 1 à 5 pour l'Estonie et la Slovaquie, et atteint des niveaux un peu plus élevés pour les autres pays baltes (1 à 7,5 pour la Lettonie, 1 à 6,4 pour la Lituanie) et surtout les candidats à l'adhésion (Roumanie et Bulgarie, rapports dépassant les 1 à 10). Si la proportion de charges sociales dans la masse salariale est plus importante dans ces pays que dans les pays émergents, le montant des cotisations sociales n'atteint au final pas celui des anciens États membres en raison d'une assiette beaucoup plus faible ; le niveau de salaires est en effet bien moins élevé que dans l'Europe des 15. Ce moindre écart de coût salarial par rapport aux pays émergents est cependant compensé par la proximité géographique de ces pays, qui permet de réduire les coûts de transport et de garder une certaine réactivité par rapport à l'évolution de la demande, et par l'acquis communautaire, qui crée un environnement financier et juridique plus stable. Même si la Roumanie ne fait pas encore partie de l'Union européenne, la certitude et l'échéance très proche de son adhésion ont joué aussi en sa faveur, car cette perspective rassure les investisseurs et a incité les autorités à faire un certain nombre d'efforts pour sécuriser l'environnement des entreprises (lutte contre la criminalité et la corruption, etc..). De plus, dans la majorité des PECO, le niveau d'instruction de la main-d'œuvre n'est pas éloigné de celui des autres États membres. Cependant, les avantages comparatifs des PECO risquent de s'affaiblir à terme en raison des contraintes normatives imposées par l'Union européenne (encadrement de la durée du travail, droits des salariés...) et de l'élévation progressive du niveau de vie résultant de l'élargissement. Toute la question est alors de savoir à quel horizon temporel aura lieu cette convergence. M. Michel de Virville, Secrétaire général de Renault, a souligné à cet égard la différence essentielle à faire entre le travail qualifié et le travail non qualifié : l'écart entre le salaire ouvrier roumain et le salaire ouvrier français, qui est actuellement de 1 à 10 restera important, tandis que l'écart moins élevé existant entre les salaires d'ingénieurs dans les deux pays (rapport allant de 1 à 5 à 1 à 8) se réduira. Le volume de cadres disponibles étant limité et les ingénieurs, plus mobiles que les ouvriers, pouvant être tentés de s'expatrier, une progression de leurs salaires en Roumanie est inévitable. Selon M. de Virville, ce phénomène de convergence risque en revanche de ne pas affecter l'Inde, pays dans lequel le volume d'ingénieurs apparaît presque inépuisable ; à la différence des PECO, l'écart de coût salarial pour le travail qualifié sera durable. Enfin, tout dépend de la structure de coûts du secteur concerné car l'avantage de coût procuré par une main-d'œuvre moins chère peut ne pas s'avérer suffisant pour des produits à coût de transport élevé. Cet avantage de coût peut aussi être obéré par d'autres facteurs. Par exemple, une affaire de fraude et de détournement de données confidentielles dans un centre d'appels de la HSBC (13) à Bangalore a récemment jeté le trouble en Inde et conduit certaines entreprises à faire ou faire faire des enquêtes de pré-embauche. À la mi-juin 2006, le numéro deux britannique de l'énergie, Powergen, a décidé de rapatrier en Angleterre ses centres d'appel délocalisés en Inde depuis 2001 car les candidats à l'embauche parlant bien l'anglais, sans accent, se font rares et que les meilleurs éléments ne restent pas, préférant trouver un travail mieux payé et moins stressant. Le directeur des opérations de Powergen, M. Nick Horler, a ainsi justifié la décision de sa société par la médiocrité des prestations : « Nous ne pouvons pas faire des économies au point de mécontenter nos clients ». De même, en 2004, les Taxis Bleus ont renoncé à poursuivre leur expérience de délocalisation de leurs centres d'appel au Maroc, en raison de la dégradation de la qualité de l'accueil téléphonique. D'autres coûts cachés et risques peuvent apparaître, liés par exemple au manque d'infrastructures, à l'insécurité et à l'instabilité politique ou juridique (non respect de dispositions contractuelles), au poids de la bureaucratie et de la corruption, aux transferts de technologie (espionnage industriel et contrefaçon)... D'une façon générale, même si les écarts de coûts salariaux restent un critère prédominant dans les décisions des délocalisations, ils n'en constituent pas les seuls déterminants. Les entreprises sont très attentives au marché potentiel représenté par le pays récepteur, même si leur objectif premier reste la maîtrise des coûts pour une réimportation dans le pays d'origine. L'élément déclencheur de la décision de délocaliser peut se rapporter dans certains secteurs à un autre élément financier que les coûts salariaux : le coût de l'énergie par exemple dans le secteur papetier. Votre rapporteur ne peut se féliciter dans ces conditions que notre pays se soit enfin aligné en mai dernier sur d'autres pays européens, comme l'Espagne, pour proposer un traitement spécifique aux entreprises « électro-intensives », avec la mise en place du consortium « Exeltium » qui permettra à ses membres d'obtenir un agrément fiscal et d'obtenir des droits de tirage de fourniture d'électricité à des prix compétitifs en lançant des appels d'offres. De même, s'agissant du gaz, l'adoption d'un amendement instaurant un tarif transitoire d'ajustement au marché dans le projet de loi relatif au secteur de l'énergie ne peut aller que dans le bon sens, certaines entreprises ayant exercé leur éligibilité ayant vu leur facture énergétique augmenter de près de 80 % en quelques années. Enfin, M. Michel Ghetti, PDG de FIE, a précisé aux membres de la mission que les considérations liées à la fiscalité et à l'environnement juridique étaient les plus fortes pour l'implantation des sièges sociaux et que les entreprises étaient aussi parfois confrontées à la difficulté de trouver du personnel possédant un savoir-faire spécifique, en raison de l'appauvrissement de certains centres de technologie en France, ce qui les amenait à se tourner vers l'étranger. Ainsi l'expertise dans le domaine des machines tournantes serait aujourd'hui davantage située dans les pays baltes. B.- LE POIDS DE LA FISCALITÉ ET LES COÛTS ADMINISTRATIFS 1. Le poids des prélèvements obligatoires Ce poids est incontestablement très élevé en France et de nature à inciter à délocaliser. L'entrée de nouveaux États membres dans l'Union européenne n'est pas de nature à atténuer ce constat, qu'il convient cependant de nuancer à plusieurs titres. De plus, se pose avant tout un problème de répartition de la charge. a) Le poids élevé des prélèvements obligatoires en France Votre rapporteur se limitera à rappeler quelques données chiffrées pour étayer un constat difficilement contestable. · En 2005, les prélèvements obligatoires se sont élevés à 752,2 milliards d'euros, soit 44 % du PIB, en augmentation de 0,85 point par rapport à 2004 (14). Ce taux était de 40,2 en 1980. Sur cette même période, la part des prélèvements obligatoires destinés au financement des régimes obligatoires sociaux est passée de 13,1 % du PIB en 1970 à 21,4 % en 2000, ceux destinés aux collectivités territoriales de 3,4 % du PIB à 5,2 %, alors que les prélèvements obligatoires destinés à l'État et à l'Union européenne restaient globalement stables. · Les comparaisons internationales sont également défavorables, même en tenant compte des limites de l'exercice [Conventions comptables, prise en charge de la protection sociale par une assurance ou par un système public financé par des prélèvements obligatoires, etc.] Ainsi l'OCDE [Factbook 2006] évalue à 43,4 % le poids de ces prélèvements en France en 2003 contre 36,7 % pour la moyenne de l'OCDE ou 40,5 % pour l'Europe des 15, 34,2 % pour la Pologne ou 37,7 % pour la République Tchèque. Si l'on prend les données d'Eurostat, le poids total des prélèvements obligatoires en France est évalué à 43,4 % en 2004, contre 39,6 % pour l'Europe des 15 et 39,3 % pour l'Europe de 25, en moyenne pondérée par le PIB. Ces taux sont de 32,9 % pour la Pologne ou 36,6 % pour la République Tchèque, 36 % pour le Royaume-Uni mais de 48,8 % pour le Danemark. Ce constat global mérite cependant d'être nuancé à plusieurs titres. b) Un constat global à nuancer en fonction en particulier de la répartition de la charge Il est en effet intéressant, au-delà de cet aspect global, de se pencher sur la répartition de ces prélèvements. Le tableau ci-après montre les différences entre les États appartenant à l'OCDE. IMPÔT SUR LE REVENU ET COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS, SOUS DÉDUCTION (en pourcentage des coûts de main-d'œuvre)1
n.c. Le chiffre n'est pas connu. 1. Ménage disposant d'un seul revenu et ayant deux enfants, à 100 % du niveau de salaire de l'ouvrier moyen. 2. L'augmentation de 2001 à 2002 est due à un changement dans la méthode de calcul du taux moyen d'imposition, qui a permis d'inclure les cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de l'Ontario, et non à une modification du système fiscal lui-même. 3. Moyenne non pondérée. Source : La politique fiscale dans les pays de l'OCDE : évolutions et réformes récentes. OCDE 2005 Le tableau souligne le poids de la fiscalité pesant sur le travail en France par rapport au reste des pays membres de l'OCDE. Une analyse fondée non plus sur un cas type mais sur des agrégats globaux renforce ce point. RECETTES FISCALES TIRÉES DES PRINCIPAUX IMPÔTS,
1. La somme des chiffres mentionnés en ligne n'est pas égale à 100 du fait que des taxes mineures ne sont pas prises en compte et que les impôts généraux sur la consommation (essentiellement la TVA) constituent une sous-catégorie des impôts sur les biens et les services. 2. La répartition des impôts sur le revenu et les bénéfices entre personnes physiques et sociétés n'est pas comparable d'un pays à l'autre. 3. Il n'existe pas de données concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les bénéfices des sociétés. 4. Données 2001. Source : OCDE Article précité. L'OCDE relève également une tendance moyenne chez ses membres à la réduction de l'imposition des revenus « de personnes physiques en ce qui concerne les hauts revenus entre 2000 et 2003 [...]. Cette tendance est encore plus prononcée s'agissant des taux d'imposition des sociétés, le taux moyen légal de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ayant baissé de presque trois points de pourcentage en moyenne de 2000 à 2003, et de 3.4 points de pourcentage dans l'Union européenne. Le taux marginal d'imposition sur les revenus des dividendes a baissé de 3.7 points de pourcentage dans les pays de l'OCDE. » Dans ce contexte, les réflexions tendant à réduire la charge pesant sur le travail, au profit par exemple de la « TVA sociale », prennent tout leur sens [cf. pages 153 à 163 du présent rapport]. Votre rapporteur a ainsi été frappé de ce qu'aujourd'hui des entreprises françaises délocalisent en Suisse, pays généralement peu associé aux coûts les plus bas. Les délocalisations de la France vers la Suisse Le poids des charges sociales en France est tel qu'il conduit à ce qu'un Suisse touche en Suisse un salaire supérieur de 30 % à celui qu'il aurait en France pour un coût inférieur ou égal pour l'employeur. S'y ajoutent diverses exonérations fiscales pour les entreprises s'installant en Suisse. Code du travail beaucoup moins lourd qu'en France, avec notamment une grande facilité de licenciement. Durée du travail plus longue en Suisse qu'en France. Plus grande flexibilité dans les conditions d'emplois des travailleurs. Risque de « désertification » industrielle des régions frontalières de la confédération helvétique. La France souffre doublement de cette situation car il nous a été indiqué que, dans un couple, la femme prenait souvent un emploi à temps partiel en France pour bénéficier pour elle et ses enfants de la protection sociale française. Le rapport remis au Conseil d'analyse Économique par MM. Christian Saint-Étienne et Jacques Le Cacheux sur « Croissance équitable et concurrence fiscale » souligne la réalité d'une concurrence fiscale qui est déjà dure et qui va devenir de plus en plus brutale [---]. L'élargissement de 2004, en augmentant sensiblement le nombre et l'hétérogénéité de pays membres, a encore accentué les tendances à la concurrence fiscale. » « Les 5,4 points de différence entre le taux de prélèvements obligatoires français (44,0 % du PIB) et celui de la moyenne pondérée de la zone euro (38,6 %) relevé en 2002 est, pour plus de moitié (57 %), attribuable à l'écart de cotisations sociales entre la France et la moyenne de la zone euro hors France (16,3 % du PIB en France et 13,2 % dans la zone euro hors France, soit une différence de 3,1 %). Même si les cotisations sociales sont des prélèvements proportionnels, on peut noter qu'elles frappent le travail des résidents, en épargnant le travail incorporé aux importations, et que le déplafonnement des cotisations d'assurance maladie dans les années quatre-vingt a sensiblement alourdi le « coin social » sur les hauts salaires (différence entre le coût du travail pour l'employeur et le salaire net perçu par l'employé). On pourrait d'ailleurs envisager, comme cela a été souvent suggéré de transférer une partie des charges sociales pesant sur les salaires (par exemple les cotisations sociales employeurs sur la santé) vers une taxation de la consommation via la TVA, ce qui aurait pour effet, en l'absence d'indexation des salaires sur les prix à la consommation, de faire financer la protection sociale aussi bien par la production résidente que par la production importée. Hors cotisations de sécurité sociale, le taux de PO français a atteint en 2002, 27,7 % du PIB contre 22,4 % pour la moyenne pondérée de l'OCDE et 25,4 % pour la moyenne pondérée de la zone euro hors France (voir tableau 1). Cet écart de prélèvements était quasiment nul dans la première moitié des années quatre-vingt-dix. C'est le basculement partiel du financement de la protection sociale vers la CSG, considérée comme un impôt général sur le revenu, qui explique la montée de l'écart de prélèvements hors sécurité sociale entre la France et le reste de la zone euro. La généralisation de la CSG a conduit à imposer les revenus du capital pour financer la protection sociale, ce qui contribue également à une perte de compétitivité fiscale pour les facteurs mobiles de production. » Source : Rapport de MM. Saint Etienne et Le Cacheux, page 16 Ce rapport voit un risque de délocalisations massives lors du remplacement de classes d'âge de travailleurs qualifiés. Le rapport estime que, pour un même salaire net, la dépense employeur atteint entre 1,4 et 1,75 fois le niveau atteint en Allemagne et aux Pays-Bas. Il fait valoir que la « concurrence fiscale prédatrice » remet en cause l'État providence, en s'attaquant aux dépenses qui ne bénéficient pas directement à la qualité de la main-d'œuvre, des infrastructures et de la R et D, en d'autres termes à tout ce qui est de l'ordre de la redistribution. S'agissant de l'impôt sur les sociétés (IS), le rapport souligne que le « taux implicite », c'est-à-dire le taux réel (après notamment déductions) est plus favorable que le taux nominal, qui contribue cependant à la « mauvaise réputation » de l'IS français. Comparant les États-Unis, la Suède et la France, les auteurs du rapport rappellent que l'on peut maintenir un niveau élevé de redistribution à condition d'investir massivement dans l'économie de l'innovation et de ne pas avoir des taux marginaux de fiscalité ou d'IS trop élevés. Dans ces conditions, le jugement porté par ce rapport sur la France est sévère : « Comment peut-on développer une économie de la connaissance en taxant beaucoup plus les acteurs de cette économie (chercheurs, managers, capital-risqueurs) qu'en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et en ayant un effort de R&D dans les entreprises égal aux deux tiers de l'effort américain et à la moitié de l'effort suédois ? Comment rivaliser dans les industries traditionnelles avec l'Allemagne en ayant un taux de PO supérieur de 8 points de PIB au taux allemand, sans développer massivement les entreprises moyennes et grandes dans les biens d'équipement et les matériels de transport, ce qui suppose un essor de la R&D et de l'apprentissage dans ces entreprises, mais aussi de favoriser fiscalement leur développement et leur transmission ? La France prétend être compétitive en ayant un effort de R&D en entreprises très insuffisant, une spécialisation industrielle médiocre, et en étant presque toujours au sommet de chacune des catégories d'imposition qui frappent les acteurs de l'économie moderne et compétitive. » C'est sur la base d'un constat comparable que des mesures ont été prises en faveur de l'innovation, des « gazelles » et que la fiscalité a commencé à évoluer dans un sens plus adapté à la mondialisation (bouclier fiscal, aménagement de la taxe professionnelle par exemple). Il faut poursuivre dans cette voie. Votre rapporteur préconise en particulier : - d'étudier de manière approfondie la mise en place d'une TVA sociale et plus généralement de transférer une partie de la charge des cotisations sociales vers des formes d'imposition n'ayant pas d'effet négatif sur la compétitivité de la France ; - d'encourager, comme le propose la Commission européenne, l'harmonisation de l'assiette de l'IS et d'envisager sa réduction. L'objectif doit être de préserver l'essence du système de protection sociale mais en en modifiant le financement, à l'image de ce qu'a pu faire, par exemple, le Danemark. Ce pays a une fiscalité extrêmement lourde puisque les prélèvements obligatoires représentaient 48,8 % du PIB en 2004 selon Eurostat. Mais la répartition de ces prélèvements est très spécifique : (en % du PIB)
Les impôts directs y représentent 61,8 % du total des ressources fiscales. Le taux de l'IS est de 28 %. La TVA est au taux de 25 %. La mondialisation n'est donc pas nécessairement incompatible avec un niveau élevé de protection sociale, sous réserve de faire les choix nécessaires permettant de concilier les deux. La multiplication des administrations compétentes sur un même sujet, les contrôles nombreux constituent des obstacles non négligeables au développement des entreprises. Plusieurs des personnes auditionnées par la mission ont souligné que la multiplicité des interlocuteurs (État, en ses multiples démembrements, régions, départements, démembrements et conseils de ces collectivités, communes, etc.) n'était pas de nature à faciliter la vie des entreprises ! Le cas échéant, on peut en outre ajouter à cette énumération, simplifiée, l'Union européenne. La mise en place d'un guichet unique s'impose donc dans toute la mesure du possible. Ce guichet unique se met en place pour les entreprises en matière fiscale. Il gagnerait un jour à l'être en matière sociale. Le patron d'une petite entreprise finit par se voir accaparé par de telles tâches au détriment de l'essentiel, le développement de son entreprise. Sous le titre « Les cadres étrangers peu tentés de venir travailler en France », les Echos du 19 octobre 2006 offraient un bon exemple d'un obstacle administratif à la compétitivité. Il en ressort en effet que les grands groupes présents en France se plaignent de la complexité et de la lenteur des procédures et de l'absence de guichet unique pour faire venir des cadres dans notre pays. La création d'une carte de salarié en mission par la loi du 24 juillet 2006 devrait permettre d'améliorer les choses, même si se pose ensuite le problème de sa mise en œuvre effective et uniforme par l'administration. Les coûts naissent également du décalage entre le temps de l'administration et celui de l'entreprise, obligée de réagir de plus en plus vite. De plus en plus, l'administration devra travailler en réseau et répondre rapidement. L'informatique peut faciliter la mise en œuvre du premier point. Une difficulté plus grande encore provient néanmoins de la complexité réglementaire et de l'incertitude juridique. C.- LA COMPLEXITÉ RÉGLEMENTAIRE ET L'INCERTITUDE JURIDIQUE La complexité croissante du droit, inhérente probablement à la complexité du monde actuel, est aggravée par l'incertitude juridique liée aux changements fréquents de normes. Ces changements sont parfois liés à une précipitation excessive et à la griserie des effets d'annonces. Ils sont liés également à la multiplicité des sources : conventions internationales, droit européen, loi et, il ne faut pas l'oublier, jurisprudences et décisions des « autorités administratives indépendantes ». S'y ajoutent le retard ou l'absence de textes de transposition du droit communautaire ainsi que le retard ou l'absence des décrets d'application des lois, voire des ordonnances. La fiscalité constitue un cas bien connu de changement permanent du droit applicable. La présidente de la commission fiscalité du MEDEF (15) militait ainsi pour une réforme dont « l'idée générale tient en deux mots : simplification et sécurité. Les entreprises ne supportent plus que la règle change tout le temps et soit parfois rétroactive ». Votre rapporteur examinera ici un autre exemple, moins connu, celui du droit des marchés publics. 1. Le droit des marchés publics (16) à la recherche d'un sens De par son volume même, environ 100 milliards d'euros en France, 1 500 milliards en Europe, la commande publique représente un enjeu économique majeur et un précieux instrument, potentiel, de politique économique. La réalité tend cependant à s'éloigner de cet idéal. Ce droit complexe, instable et très formaliste privilégie presque naturellement la forme sur le fond. C'est également un droit de défiance à l'égard de l'acheteur public, soupçonné dans le meilleur des cas d'être incapable de faire le bon choix économique, en l'absence de l'aiguillon du profit et, dans le pire des cas, de corruption. Cette défiance explique, par exemple, que le marché négocié constitue une exception strictement encadrée dans le domaine des marchés publics. C'est en même temps un droit qui est loin de satisfaire pleinement les entreprises. Il est coûteux de répondre à un appel d'offres et le risque existe de se voir écarté pour des raisons de pure forme, et ce d'autant plus que, pour les « petits marchés » (inférieurs à 135 000 euros pour l'État et 210 000 euros pour les collectivités locales), les règles varient d'une administration à l'autre. Pour d'évidentes raisons de sécurisation juridique, face à des règles complexes, parfois bien obscures, changeantes et sanctionnées pénalement, le prix demeure un critère très important, ce qui peut être contraire à l'intérêt général, comme le déplorent par exemple les architectes. Les PME sont également désavantagées par ce système complexe. Dans son rapport au Commissariat Général au Plan « Localisation des entreprises et rôle de l'État : une contribution au débat » (17), M. Jean-Louis Levet regrette de même que l'action de l'État soit focalisée sur les deux extrémités du système productif et les grands groupes. Car sans « milieu », « pas de France avec des usines ». Il préconise donc un recentrage de l'action de l'État sur les PME/PMI. Il regrette notamment « l'obsession des grands acheteurs sur les prix » et les « marchés publics très focalisés sur les prix », et ce en dépit des normes officielles qui voudraient n'en faire qu'un critère parmi d'autres, la qualité des produits primant. Il faut briser cette logique infernale où le formalisme et l'incertitude juridique contribuent à rendre plus difficile la poursuite d'objectifs légitimes de politique économique. Il faut « remettre l'économique au cœur du contrat (18) ». a) Un droit instable et formaliste Un syllogisme couramment employé affirme l'intérêt de ce droit puisque plus de concurrence signifierait des offres moins chères et de meilleure qualité. Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que par « concurrence », il faut entendre respect pointilleux des procédures. En soi, la mise en concurrence constitue à l'évidence une mesure positive conforme à l'intérêt général, mais cet objectif louable a été détourné de son but initial. Plusieurs des personnes auditionnées par la mission ont ainsi souligné la difficulté de concilier efficacité économique et respect de procédures lourdes et longues. Plus concrètement, que constate-t-on ? Un nouveau code aura ainsi été publié en 2001, 2004 et 2006. En six années, un acheteur public aura ainsi connu quatre codes ! Cette instabilité normative est aggravée par deux phénomènes, une jurisprudence privilégiant, s'agissant notamment de la juridiction administrative, le respect de la forme. Parallèlement, au niveau des juridictions suprêmes, Conseil Constitutionnel et surtout Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE), la création ex nihilo de nouvelles normes ne contribue ni à la sécurité juridique, ni à la clarté du droit. Quelques exemples de la jurisprudence du Conseil d'état : · CE 2 juin 2004 : « Ville de Paris » Un marché de la ville de Paris est irrégulier ; l'avis d'appel public à la concurrence ne mentionnait pas les modalités de financement de ce marché (ressources propres, ressources extérieures publiques ou privées ou contributions des usagers). M. Jean-Marie Delarue, président de la 7e sous-section du contentieux du Conseil d'État, justifiait cette décision par le nécessaire respect des textes, mais également parce que « pour une entreprise, savoir qu'une collectivité va financer son marché exclusivement sur l'emprunt ou exclusivement sur ses ressources propres, ce n'est pas du tout la même chose (19) ». Est-ce bien la préoccupation majeure des soumissionnaires ? En l'espèce, par exemple, la solvabilité de Paris était-elle en cause ? · CE 27 juillet 2001 : « Compagnie générale des eaux ». Des modèles d'avis d'appel public à la concurrence devaient être définis par arrêté ministériel, ce qui n'avait pas été fait. Le district de Caen était cependant tenu « d'assurer, nonobstant l'absence de mesures nationales sur ce point, une publicité de ses intentions compatibles avec les objectifs de cette directive, et notamment avec les prescriptions de son annexe III ». · CE 14 mai 2003 : « Communauté d'agglomération de Lens-Liévin c/société Sita Nord ». Un marché est annulé pour absence de précisions sur les modalités de financement et de paiement et parce que la case sur l'application, ou non, de l'Accord sur les marchés publics n'avait pas été cochée. La Haute juridiction administrative a en effet jugé « que la circonstance que l'accord international sur les marchés publics n'a pas d'effet direct et que son champ d'application recouvre, en matière de services, celui des directives communautaires, n'est pas de nature à priver de caractère impératif, au regard des objectifs de la directive du 18 juin 1992 précitée, la rubrique relative à cet accord prévue par l'annexe III de cette directive ». Le Conseil d'État a réaffirmé cette jurisprudence (CE 10 mai 2006 - Syndicat intercommunal des services de l'agglomération Valentinoise c/société Nicollin SAS) en décidant que le fait de n'avoir mentionné l'Accord OMC que dans le formulaire envoyé au JOUE ( Journal Officiel de l'Union Européenne) et non dans celui envoyé au BOAMP constituait un motif d'annulation d'un marché de collecte de porte à porte et d'évacuation des déchets ménagers. Il y avait en effet deux formulaires différents, l'un fait par le BOAMP (Journal officiel) et l'autre par le JOUE, qui différaient sur un certain nombre de points. Ainsi, le formulaire BOAMP ne comportait pas de case à cocher sur l'application de l'Accord sur les marchés publics. Il est important de préciser, s'agissant de l'Accord sur les marchés publics, qu'aucune entreprise d'un État non membre de l'Union européenne n'était partie au litige. Le fait de ne pas avoir coché la case ne lésait donc personne. Il n'y aurait d'ailleurs eu un dommage que si une entreprise concernée s'était vue refuser l'accès à un marché. · CE 10 mai 2006 : « Société Bronzo » Le Conseil d'État a annulé l'attribution d'un marché à une société nouvellement créée car celle-ci n'avait pas produit, comme demandé, un chiffre d'affaires des trois dernières années. La haute juridiction administrative a jugé qu'il appartenait à la communauté urbaine de Marseille de préciser que « les entreprises candidates pouvaient justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens ». Ajoutons enfin que les annulations répétées de divers articles du code n'ont en rien contribué à la lisibilité de ce droit. L'« eurocompatibilité » du code eût dû être examinée avant. Espérons ce problème réglé avec le nouveau code 2006. Le Conseil constitutionnel a créé des principes de valeur constitutionnelle en matière de marchés publics en 2003, même si ce texte a toujours été, pour l'essentiel, de nature réglementaire. C'est d'ailleurs en se fondant sur des principes de droit interne que le Conseil d'État a annulé l'article 30 du code des marchés publics qui créait une procédure très simplifiée pour les marchés de services en reprenant pourtant les dispositions de la directive « marchés publics ». La Cour de Justice n'est pas non plus dépourvue d'imagination pour inventer des normes : comme le disait l'un de ses avocats généraux, « le principe de transparence (...) a été identifié » en 2000 dans l'arrêt Telaustria. Dans une « communication interprétative » (20), la Commission s'efforce en s'appuyant sur la jurisprudence de la CJCE de réglementer les marchés en dessous des seuils communautaires qui devraient logiquement et économiquement rester en dehors du champ d'intervention des institutions européennes, ne serait-ce qu'en raison du principe de subsidiarité. La publicité retenue devra, selon la Commission, être fonction d' « une évaluation de l'intérêt du contrat pour le marché intérieur, compte tenu notamment de son objet, de son montant ainsi que des pratiques habituelles dans le secteur concerné ». Sans entrer dans une analyse approfondie de cette communication, votre rapporteur se contentera de deux citations : · L'article 21 de la directive prévoit que « la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4 », c'est-à-dire aux règles en matière de définition des spécifications techniques (article 23) et à la publication d'un avis d'attribution indiquant les résultats de la procédure (article 35, paragraphe 4). · Que dit la Commission ? « En particulier, dans le cas des marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE[---], une transparence suffisante implique normalement la publication dans un média largement diffusé ». La contradiction avec la directive est flagrante. Il est possible que la Commission soit soutenue dans sa politique par la Cour(21). Mais cela n'interdit pas quelques questions. - Si la directive est contraire au traité, pourquoi ne pas la modifier plutôt que de la laisser en vigueur ? - Cette centralisation a-t-elle un sens économique ? La publicité a un coût. Combien d'entreprises finlandaises ou même allemandes ont postulé pour des marchés de 80 000 euros en France ? Un exemple concret, au plan national, des limites de ce genre de raisonnement : par un arrêt du 7 octobre 2005, le Conseil d'État a annulé une procédure adaptée lancée pour un marché de recrutement d'un programmiste pour l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens au motif d'une publicité et d'une mise en concurrence inadaptée. Le marché était d'un montant prévisionnel de 35 000 euros et, en tout état de cause, d'un montant inférieur à 90 000 euros. Une publicité a été faite dans le journal « La voix du Nord » ainsi que sur le site Internet du conseil régional. En outre, mais ce n'était pas à la demande de la personne publique, le Moniteur des Travaux publics avait mis en ligne la publicité sur son site. Cette publicité a été jugée insuffisante. M. Didier Casas, commissaire du gouvernement, a fait valoir qu' « on peut imaginer sans peine qu'un programmiste installé en région parisienne ou, même à Barcelone, Berlin ou Milan - ce qui ne serait pas inenvisageable s'agissant d'un chantier de cette nature - ne lit pas « la Voix du Nord » et n'effectue pas une veille régulière sur le site de la région Nord Pas-de-Calais et sur celui de l'ensemble des autres collectivités. » Tout cela est incontestable si l'on imagine que des programmistes étrangers soient réellement intéressés par des marchés d'un montant aussi limité et qu'il ne doit exister aucun principe de proportionnalité entre le coût de l'opération et celui de la publicité. Si l'on allait au bout de cette logique, il faudrait aussi publier dans les journaux des 25 pays membres ( ?) et, pourquoi pas faire traduire les annonces... b) Un droit obscur, voire ésotérique Là également un exemple. · Le retard pris dans la transposition de la directive du 31 mars 2004 a mis les acheteurs publics dans une situation peu agréable. On pouvait lire ainsi, au début de cette année, dans une publication spécialisée (22) : « Les acheteurs publics doivent donc faire preuve à compter du 31 janvier 2006 d'une vigilance accrue afin de ne pas commettre d'entorse au droit communautaire par une mise en œuvre mécanique des dispositions du code des marchés publics 2004. ». Cela se passe de tout commentaire. En résumé, le droit des marchés publics est un bon exemple des maux qui affectent notre droit : - mauvaise coordination entre le droit européen et le droit français ; - instabilité de la norme ; - ésotérisme de la norme ; - supériorité du formalisme sur la réalité économique ; - forte contribution de la jurisprudence à l'insécurité juridique. 2. Pour une plus grande sécurité juridique Dans un rapport sur « Sécurité juridique et complexité du droit », le Conseil d'État souligne avec force que la sécurité juridique constitue l'un des fondements de l'état de droit. On ne peut, comme la haute juridiction, que souhaiter une meilleure articulation de la norme communautaire et de la norme nationale. Le Conseil d'État souhaite également diverses réformes de la procédure législative. Il préconise aussi de perfectionner la codification et d'adopter les outils informatiques en vue d'une meilleure accessibilité ainsi qu'une plus grande publication, conformément à la loi, des directives, instructions, circulaires,... Le développement du rescrit et de l'interlocuteur unique serait également une excellente chose. Enfin, mais cela ne figure pas dans le rapport, la publication systématique des conclusions du commissaire du gouvernement auprès du Conseil d'État contribuerait à une plus grande intelligibilité de sa jurisprudence, de même qu'une motivation parfois plus fournie, à l'image de la CJCE. De même pourrait-on souhaiter que la rétroactivité devienne une stricte exception. Tout ce qui contribuera à améliorer la situation juridique en France ne pourra évidemment que contribuer à l'attractivité de son territoire. DEUXIÈME PARTIE : UN PHÉNOMÈNE DONT ON PEUT CRAINDRE L'AGGRAVATION AU COURS DES ANNÉES Votre rapporteur examinera tout d'abord ce risque d'accroissement avant de souligner qu'il est amplifié par un certain nombre de facteurs, qu'il s'agisse de la compétitivité insuffisante de l'économie française ou d'une politique européenne qui n'est pas toujours à la hauteur des enjeux. I.- UNE ACCÉLÉRATION PRÉVISIBLE DES DÉLOCALISATIONS Nombreuses ont été les personnes auditionnées par la mission à souligner que le phénomène des délocalisations risquait de s'amplifier dans l'avenir. Plusieurs raisons étayent ce constat. A.- UN PHÉNOMÈNE QUI S'ALIMENTE DE LUI-MÊME Tout d'abord, l'enquête réalisée par l'association des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) présentée aux membres de la mission par M. Jean-François Bernardin révèle qu' « une grande part des entreprises ayant réussi une délocalisation envisagent-elles de renouveler ce type d'opération (40 % du total), mais pas nécessairement dans des pays émergents. Les délais d'exécution sont alors plus rapides et, à la motivation de maîtrise des coûts, s'en joignent ou s'y substituent d'autres (...). » . Une première expérience réussie en entraîne ainsi une autre. Certains grands groupes commencent notamment par délocaliser ou sous-traiter les activités non stratégiques destinées à des marchés étrangers avant de poursuivre dans un second temps pour les activités destinées au marché domestique du pays d'origine. La délocalisation des grandes entreprises entraîne aussi à plus ou moins grande échéance celle de ses sous-traitants et fournisseurs. En effet, les donneurs d'ordre ont besoin de constituer sur place de nouveaux réseaux de sous-traitance et d'approvisionnement fiables. Ne voulant pas perdre leurs principaux clients, les sous-traitants et fournisseurs se sont organisés pour répondre aux attentes de leurs donneurs d'ordre en termes d'accompagnement et d'implantation locale. Ce mouvement conjugue ses effets à celui, plus général, créé par une pression accrue des donneurs d'ordre sur les coûts. Comme le souligne l'enquête de l'ACFCI, « la pratique du partage des fabrications avec des unités à bas coût de main-d'œuvre a été systématisée par exemple dans les cahiers des charges des secteurs de l'aéronautique et de la construction automobile ». Il est ainsi devenu courant chez les constructeurs automobiles d'évoquer des « conditions Europe de l'Est » dans leurs relations avec les équipementiers. Autre exemple, dans le secteur du textile-habillement, les délocalisations ont d'abord frappé l'aval, c'est-à-dire la confection de vêtements, activité intensive en travail non qualifié, avant de s'étendre à l'amont, la production de tissus, activité pourtant plus capitalistique. Les producteurs de tissus et de fils ont en effet un intérêt commercial à être proches de leurs clients. Il y a en outre un phénomène de contagion ou d'imitation : la concurrence exercée par les firmes ayant délocalisé leur activité à l'étranger incite leurs concurrentes à leur emboîter le pas, après éventuellement une première phase de réorganisation de leur production ou d'externalisation sur le territoire national, pour maintenir leur compétitivité et « rester dans la course ». Il ne faut pas non plus oublier les « effets d'agglomération » : la concentration d'entreprises dans un même lieu engendre des externalités positives (environnement technologique, disponibilité de la main-d'œuvre et infrastructures notamment) qui incitent les entreprises suiveuses à choisir des zones d'implantation similaires pour profiter des mêmes opportunités. Ce phénomène d'agglutination joue également vis-à-vis d'autres entreprises non concurrentes : la présence d'autres sociétés étrangères rassure et pousse d'autres entreprises à faire de même. La concentration des constructeurs et équipementiers du secteur automobile dans ce qu'on appelle « le détroit de l'Est », un corridor de quelques centaines de kilomètres entre Varsovie et Bucarest, est à cet égard frappante. PSA Peugeot-Citroën, Toyota, Hyundai, General Motors, Renault et Suzuki, Opel et Fiat ont investi massivement en Europe de l'Est, suivant en cela l'exemple précurseur de Volkswagen, qui s'y est implanté au début des années 1990. Et entre 2000 et 2005, la production automobile dans les PECO a bondi de 39,2 % tandis que les ventes ne progressaient que de 11 %, ce qui montre bien que l'apparition de nouvelles capacités de production à l'étranger ne correspond pas seulement à une conquête de nouveaux marchés mais également à une logique de réduction de coûts, c'est-à-dire de délocalisations. 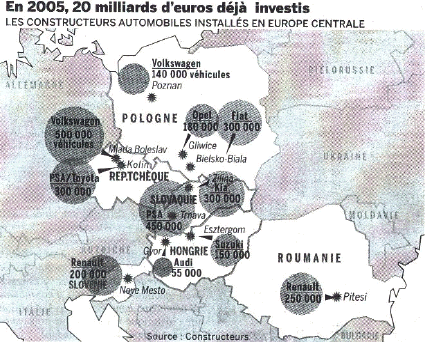 Source : Article du Monde daté du 1er juillet 2006 Enfin, les délocalisations sont liées au cycle de vie du produit et à son arrivée à maturité, c'est-à-dire à un stade où la concurrence ne s'exerce plus que par les prix. Après le transfert de son activité d'assemblage de téléphones portables à Timisoara, le PDG de Solectron en France déclarait ainsi dès 2001 que « les transferts de productions banalisées dans des pays à bas salaire font désormais partie du cycle normal de fabrication de certains de nos produits, imprimantes, PC ou mobiles » et que « c'est la seule façon de suivre les baisses de prix exigées par les clients ». Or, comme l'a souligné aux membres de la mission M. Renaud Dutreil, ministre des PME, le mouvement d'accélération de l'économie est aussi important que celui, plus connu, de mondialisation. Le rythme de l'innovation technologique s'est considérablement accru. Innovation pourtant récente, les lecteurs DVD, par exemple, sont devenus pour l'essentiel des produits banalisés. B.- UN PHÉNOMÈNE QUI S'ÉTEND À D'AUTRES SECTEURS Les délocalisations constituent un phénomène dynamique, dont le champ s'étend du fait du progrès technique. Le directeur général de Mac Kinsey France, M. Eric Labaye, a indiqué que le phénomène de délocalisation dans les services était pourtant l'instant très limité en France, mais qu'il était sans doute appelé à se développer, notamment dans les institutions financières et l'informatique. Selon l'étude réalisée par Mac Kinsey, les entreprises françaises, hésitantes face à l'impact social potentiel d'une délocalisation et aux incertitudes juridiques liées à l'application d'un droit du travail très formaliste, se sont efforcées jusqu'à présent de privilégier des solutions alternatives pour réduire leurs coûts mais risquent à terme d'emboîter le pas de leurs concurrentes américaines ou britanniques en raison de l'exacerbation de la concurrence internationale. En effet, dans le secteur bancaire et des assurances par exemple, certaines entreprises étrangères commencent à exploiter pleinement les gisements d'économies offerts par les délocalisations ainsi que l'amplitude horaire permise par les différences de fuseaux horaires. Si l'on en croit l'association indienne des sociétés de logiciels et de services informatiques, 8 % des transactions bancaires américaines sont gérées depuis l'Inde et plus de 30 % pourraient l'être d'ici 2010. Une étude du FMI (Amiti et Wei) indique quant à elle que la délocalisation des services des entreprises américaines a progressé en moyenne de 6,3 % par an entre 1992 et 2000 et qu'elle a dopé la productivité américaine. L'américain Goldman Sachs compte 1 200 salariés en Inde et y emploie de plus en plus d'analystes pointus dans la modélisation de données financières. JP Morgan Chase en emploie environ 6 000 et a annoncé en début d'année son intention de délocaliser en Inde d'ici à 2007 le tiers des emplois opérationnels de sa banque d'investissement. Du côté européen, HSBC avait déjà décidé en 2003 de transférer 4 000 emplois vers l'Inde, la Chine et la Malaisie. Aviva, dans le secteur des assurances, souhaite délocaliser 7 000 emplois dès 2007, soit 23 % de ses effectifs au Royaume-Uni. D'autres acteurs non anglo-saxons les suivent désormais : la Deutsche Bank a annoncé en mars 2006 le triplement des emplois délocalisés dans sa division « Global Markets », soit 2 000 au total, dans le cadre d'une réorganisation qui devrait augmenter son revenu d'1,9 milliard d'euros. Les fonctions délocalisées ne seraient pas des tâches d'exécution ; le personnel affecté à la recherche à l'étranger passerait de 350 à 500 personnes, soit plus de la moitié des 900 salariés actuels. Les néerlandais IGN et ABN AMRO lui ont emboîté le pas le mois suivant : ABN AMRO, dont le bénéfice au premier trimestre 2006, en croissance de 12,1 %, a atteint 1,003 milliard d'euros, va supprimer 2 400 postes dans ses activités de service dans les trois ans à venir, soit 10 % de ses effectifs, pour les remplacer par 900 embauches dans les pays à faibles coûts (Inde, Chine, Pologne) ; de son côté, ING a annoncé un programme de délocalisations portant à terme sur 2 200 postes et conclu d'ores et déjà un contrat de sous-traitance de ses activités dans les technologies de l'information entraînant la suppression de 350 emplois. Outre sa main-d'œuvre qualifiée, l'Inde présente un autre avantage aux yeux des banquiers : dans un pays dont le taux de croissance est de l'ordre de 8 %, les classes moyennes sont de plus en plus demandeuses de produits financiers et les entreprises multiplient les opérations de fusions et acquisitions ; en outre, la libéralisation du secteur bancaire est attendue pour 2009. Les entreprises françaises ne se sont pour l'instant engagées que très timidement dans cette direction. La Société générale emploie 350 personnes à Bangalore dans sa filiale SG Software (informatique, comptabilité, conseil), avec pour objectif d'en faire un « centre d'excellence » en matière d'informatique et de développement. De son côté, BNP Paribas, qui continue de choisir l'Hexagone pour ses centres d'appel, emploie depuis deux ans une quarantaine de développeurs indiens dans le cadre d'un projet de l'une de ses filiales (BNP Paribas Securities Services). Du côté des assurances, AXA compte déjà 2 200 employés en Inde, qui travaillent pour le compte de ses filiales anglaise, américaine, australienne et japonaise et depuis deux ans, une centaine de chargés de clientèle travaillent à Rabat pour sa filiale Direct Assurances. Mais le phénomène va sans doute s'amplifier. M. Henri de Castries, Président du directoire d'Axa, déclare ainsi à propos de son groupe dans la revue des auditeurs de l'IHDEN, « Défense » : « en terme d'emplois délocalisés, l'addition du Maroc, de l'Inde et de la Chine sera proche des 70 000 dans moins de cinq ans. Évidemment, ce sont des emplois qui disparaissent dans un certain nombre de back offices européens ou nord-américains. Ces emplois qui disparaissent concernent des fonctions de plus en plus qualifiées ». Si M. Henri de Castries raisonne au niveau de son groupe, il serait hâtif d'en conclure que l'entité Axa France soit exclue de ce mouvement : l'embauche de 1 500 personnes au Maroc prévue à l'occasion de départs massifs en retraite dans le plan stratégique de l'entreprise à l'horizon 2012 est là pour le confirmer. Dans le secteur bancaire, l'enjeu financier est de taille : l'étude réalisée par Mac Kinsey évalue à une fourchette comprise entre 600 millions et 1,2 milliard d'euros les économies théoriques de la délocalisation des back-offices, des fonctions de support et du développement applicatif pour une banque universelle française. L'étude de Mac Kinsey fait également valoir que si les SSII françaises n'emploient actuellement qu'une faible fraction de leur main-d'œuvre dans les pays à bas coût (2 à 6 %), les analystes financiers commencent à considérer le pourcentage « d'offshore » comme un indicateur clé de leur valorisation. Selon le cabinet Accenture, figure en outre parmi les secteurs les plus « mûrs » le crédit à la consommation. Les spécialistes du secteur réfléchissent notamment à des maintenances informatiques communes à toutes leurs implantations, à la mise en commun de fonctions supports et à la mise en place de plates-formes de back-offices, notamment pour le recouvrement des créances, les services à la clientèle ou le « scoring » (sélection des demandes de prêts en fonction des informations sur le candidat), au Maroc ou en Roumanie. Selon M. Serge Christin, chargé de ce secteur chez Accenture, « externaliser une plate-forme de recouvrement ou de relation clientèle peut générer jusqu'à 30 % d'économies ». Il n'est pas étonnant dans ces conditions que l'étude prospective réalisée par le cabinet Katalyse pour la Commission des Finances du Sénat à partir d'une centaine d'entretiens avec des dirigeants d'entreprises conclut à un chiffre de 202 000 emplois de services perdus au cours de la période 2006-2010, dont 80 % sous la forme de « non-localisations ». Si comme l'a souligné M. Lionel Fontagné lors de son audition, les délocalisations dans les services n'ont pas été massives faute d'institutions très structurées dans les pays d'accueil, votre rapporteur est persuadée qu'il n'en sera pas de même dans l'avenir, en raison de l'importance des emplois potentiellement délocalisables (75 % selon l'OCDE) et du développement des infrastructures de télécommunications dans certains pays. 2. La recherche et développement Il est dangereux de croire que la division internationale du travail est intangible et que la Chine restera éternellement l'atelier du monde : les pays émergents continueront à monter en gamme. En juin 2005, Saint Gobain a annoncé que Shangaï allait devenir son quatrième pôle de R&D aux côtés de ses deux centres historiques français et du centre américain. S'il peut paraître normal que l'expansion du marché chinois attire des implantations industrielles puis des centres de développement destinés à adapter les produits aux spécificités du marché local, il est cependant légitime de s'interroger sur le caractère pérenne de la protection dont bénéficient les activités de recherche à l'égard des délocalisations, traditionnellement liée à leur rôle stratégique dans la maîtrise de la conception du produit. M. Christian Pierret a estimé lors de son audition que les délocalisations pourraient croître dans les prochaines années, dans la mesure où elles concerneraient désormais des emplois qualifiés, et a cité le cas d'une entreprise chinoise dans le secteur des télécommunications, inexistante il y a seulement 10 ans mais devenue aujourd'hui comparable à Alcatel et employant plusieurs dizaines de milliers de chercheurs. Il a ainsi considéré que les nouveaux enjeux portaient sur des produits d'équipement intégrant de la recherche et développement, et non plus sur les seuls biens banalisés, et que dans ces conditions, la réponse à apporter aux délocalisations était beaucoup plus difficile. Cette situation est d'autant plus préoccupante à un moment où les étudiants français se détournent des filières scientifiques. La Chine a mis en place depuis quelques années les outils nécessaires pour lui permettre de développer une véritable infrastructure de R&D. Depuis 1999, une série de mesures ont été adoptées pour assurer la promotion d'une recherche privée soumise aux lois du marché et encourager l'investissement étranger dans ce secteur : définition du centre de R&D à capitaux étrangers, réductions de taxes, accès à des infrastructures s'inspirant des clusters. Selon le rapport de la mission sénatoriale effectuée en Chine en septembre 2005, 750 centres de recherche dépendant de sociétés étrangères sont recensés en Chine. Les dépenses de R&D de la Chine, comme celles d'autres pays asiatiques émergents, affichent un véritable dynamisme. En Chine, ces dépenses atteignaient 0,83 % du PIB en 1999 mais 1,23 % en 2002 et près de 1,5 % en 2005. Le nombre des chercheurs chinois en fonction est estimé à 860 000 et la formation universitaire progresse : si 5 % seulement des 25-64 ans atteignent un niveau d'éducation supérieure, les flux sont très importants avec 1,2 million d'étudiants inscrits dans les cycles supérieurs et 500 000 nouvelles inscriptions chaque année, soit autant que les États-Unis et l'Union européenne réunis. 300 000 ingénieurs sont formés en Chine chaque année. Il convient également de prendre en compte le développement rapide des études à l'étranger : sur les 10 000 non-résidents qui reçoivent chaque année un doctorat américain en « science » ou « engineering », un quart sont chinois. Enfin, des délocalisations dans le domaine de la recherche existent déjà entre pays industrialisés : Pfizer a ainsi délocalisé une partie de sa R&D vers le Royaume-Uni et Ipsen a rejoint en juin 2005 de nombreuses entreprises pharmaceutiques européennes qui ont localisé des centres de recherche importants au États-Unis. Les entreprises cherchent en effet à optimiser leur réseau mondial d'innovation. Les salaires versés aux chercheurs et aux ingénieurs aux États-Unis ne sont pourtant pas plus bas qu'en France, bien au contraire. Ce qui est en jeu ici, c'est plutôt une insuffisante attractivité de la France pour les activités de R&D et de haute technologie : les entreprises françaises sont attirées par le dynamisme des relations avec les universités et les start-up, des carrières beaucoup plus rapides, en fonction des résultats atteints, un cadre réglementaire plus souple... Selon une enquête des Nations Unies, la destination préférée des industriels occidentaux qui souhaitent mondialiser leur R&D est la Chine (61 %), devant les États-Unis, l'Inde et le Japon. Les pays européens arrivent loin derrière avec le Royaume-Uni, la Russie, la France (8,8 %) et l'Allemagne. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les représentants de la Direction générale « Entreprises et industrie » de la Commission européenne aient annoncé aux membres de la mission la préparation par la Commission d'une étude sur les risques liés aux délocalisations dans le domaine de la R&D, compte tenu du caractère stratégique de ces activités pour le maintien d'un leadership dans la chaîne de valeur ajoutée. 3. Un mouvement encore peu visible Une étude réalisée cette année par le cabinet de conseil Accenture auprès d'une centaine de cadres dirigeants des plus grandes banques montre que de plus en plus de groupes financiers envisagent d'externaliser des fonctions informatiques ou des back-offices à la faveur de l'évolution de la pyramide des âges, en évitant ainsi les risques de conflits sociaux liés aux suppressions d'emploi. Le président d'Accenture France, M. Pierre Nanterme, auditionné par la mission en tant que président de la commission « Économie » du MEDEF, a confirmé que notre pays se situait entre deux vagues en matière de délocalisations et que celle concernant les services ne serait véritablement déclenchée qu'à partir de 2010 en profitant des départs massifs à la retraite de la génération des « baby-boomers ». Le réveil pourrait être douloureux car il y a là un potentiel énorme de pertes d'emplois à valeur ajoutée. La mission a pu à la fin de ses travaux avoir connaissance d'une première illustration concrète de cette prévision, à une échéance temporelle plus rapprochée : M. François Pierson, PDG d'Axa France, a ainsi confirmé lors de son audition que son entreprise envisageait dans son projet « Ambition 2012 » de remplacer 4 500 départs à la retraite par 1 500 embauches au Maroc et 1 500 embauches en France. D'autre part, dans le secteur automobile, un autre mouvement est en cours, dont les effets sur l'emploi ne sont pas encore visibles. M. Michel de Virville a indiqué lors de son audition qu'il n'y avait pas eu depuis 5 ans d'implantations nouvelles ni d'extensions de capacités de production en Europe de l'Ouest dans le secteur automobile et qu'il n'y en aurait plus dans les prochaines années. Pour autant, le secteur a investi massivement en Europe de l'Est, celle-ci devant produire 1,5 million de véhicules par an. Les effets de ce mouvement sur l'emploi sont encore peu significatifs : les effectifs dans le secteur automobile, y compris chez les équipementiers, ne se sont tassés que de 1 à 2 %. Ces effets prendront en fait toute leur ampleur au moment où se posera la question de l'obsolescence des usines d'Europe de l'Ouest. En effet, la lourdeur des investissements effectués en Europe de l'Ouest a constitué un frein à la délocalisation des industries automobiles et a incité les constructeurs à s'orienter plutôt vers une stratégie de non-localisation, qui au final se révélera tout aussi dramatique pour le marché du travail français. M. Michel de Virville a également souligné que les effets de ce mouvement se feraient d'abord sentir chez les équipementiers de rang 2 et 3, dont les activités ne nécessitent pas autant d'investissement et sont plus exposées à la concurrence internationale. La concurrence fiscale au sein de l'Union européenne ne peut qu'amplifier les délocalisations vers les nouveaux arrivants dans l'Union européenne. 4. La France a jusqu'ici été moins affectée par les délocalisations que d'autres pays Les délocalisations sont plus avancées dans les pays où elles ont commencé plus tôt. Par sa proximité géographique avec les autres pays asiatiques, le Japon a été touché plus tôt que l'Europe par la concurrence des pays émergents et a réagi en délocalisant une partie de sa production en Chine. L'industrie allemande, en raison de ses niveaux de coûts, a pratiqué très tôt l'externalisation vers les pays d'Europe Centrale et Orientale, sans attendre la chute du mur de Berlin. Or, comme le rappelle M. Patrick Artus, ces deux pays ont connu une compression impressionnante de l'emploi et des coûts salariaux dans l'industrie par rapport aux autres pays de la zone euro. 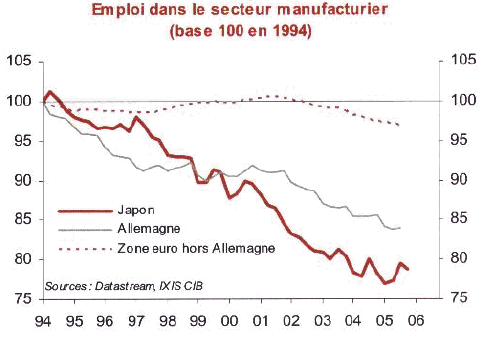 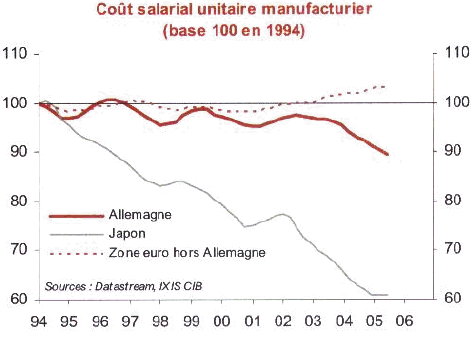 Ces pays ayant été affectés ou ayant réagi plus tôt, il est à craindre qu'ils ne constituent des indicateurs avancés de la situation future de la zone euro, hors Allemagne, et notamment de la France. II.- UNE COMPÉTITIVITÉ INSUFFISANTE Toutes les personnes auditionnées par la Mission d'information ont souligné, avec parfois quelques nuances, que l'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises constituait l'un des défis les plus importants qu'elles avaient à relever pour faire face aux délocalisations. M. Bertrand Collomb, président de l'association française des entreprises privées (AFEP) a même estimé que « la capacité d'évolution et d'accès aux marchés s'avérait fondamentale ». Par ailleurs, elles ont, dans leur majorité, considéré que l'économie française était globalement compétitive, mais qu'il convenait toutefois d'accompagner les entreprises dans leur course à la performance en conduisant une politique industrielle favorable à leur développement et en réduisant les contraintes qui pèsent sur elles ; M. Jean-François Roubaud, président de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) a exprimé le souhait que les entreprises puissent bénéficier de « plus d'oxygène ». La compétitivité est une question fondamentale. L'avenir de l'économie française est lié à la compétitivité des entreprises. Elle concerne toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande. En premier lieu, bien sûr, les entreprises dont les produits se trouvent en concurrence avec des produits étrangers, celles-ci en ont plus conscience, mais l'artisan travaillant dans son atelier, quoique moins directement menacé par l'ouverture à l'international, ne peut, pour autant, s'en désintéresser. En effet, si le bassin d'emploi dans lequel il est implanté venait à subir les conséquences de cette concurrence, son activité s'en ressentirait inévitablement. De l'aptitude et de la volonté à s'adapter à la nouvelle donne internationale des entreprises et de leurs commerciaux, de la vitalité et de l'efficacité des réseaux internationaux, notamment ceux des services du ministère du commerce extérieur (principalement les missions économiques à l'étranger) et des Chambres de commerce et d'industrie, de la mobilisation permanente du ministère des petites et moyennes entreprises dépend la capacité pour nos entreprises à gagner des parts de marchés internationaux et à les conserver. Les contraintes, tant nationales qu'européennes, ne sont pas négligeables. A.- LES CONTRAINTES NATIONALES : UN FREIN À LA COMPÉTITIVITÉ L'analyse économique discrimine la compétitivité des entreprises en deux grandes catégories : la compétitivité-coût - l'entreprise s'efforce d'optimiser ses coûts (salaires, marges, taux de change) pour proposer des tarifs inférieurs à ceux de la concurrence - et la compétitivité-structurelle - l'entreprise mise sur la qualité de ses produits ou services, de son réseau de commercialisation et de son service après vente pour justifier un prix égal ou supérieur à ses concurrents. L'analyse de notre commerce extérieur conduit à douter de la compétitivité de notre économie, quel que soit le critère. 1. Un indicateur préoccupant de la compétitivité de l'économie française : le commerce extérieur En 2005, le besoin de financement de la France a atteint 35 milliards d'euros. « Les exportations croissant moins vite que les importations, le solde commercial des biens et des services se détériore nettement : (...) il devient déficitaire en 2005, pour la première fois depuis 1991. Il s'établit à -16,4 milliards d'euros, après +4, 1 en 2004 » (23) Le solde des échanges de produits manufacturés est négatif. L'excédent touristique se réduit. La consommation de biens importés augmente fortement... En 2005, la production de l'industrie manufacturière augmente de 0,3 % (en moyenne annuelle en dépit de la croissance mondiale (24)). « La contre-performance des exportations manufacturières françaises en 2005 est doublement paradoxale. Elle survient dans une période de croissance mondiale et concerne des produits pour lesquels la demande est en pleine expansion. » Lors de son audition par la mission, M. Fontagné a tout d'abord salué les énormes progrès accomplis par l'industrie française au cours des trente dernières années. Nous sommes passés de Lipp ou Manufrance à de grands groupes internationaux. À la différence des États-Unis, les coûts d'ajustement sont, pour l'essentiel, derrière nous. Le problème est que les structures qui ont permis ce remarquable accomplissement ne sont plus adaptées à la mondialisation. Une rupture est intervenue aux environs de l'an 2000, avec la combinaison de deux facteurs, l'émergence de nouveaux concurrents et de nouveaux clients. Le seul poste réellement satisfaisant, faisait-il valoir, est celui du tourisme, ce qui n'est pas l'idéal pour préparer l'avenir. Si la France a résisté à la montée en puissance des nouvelles concurrences jusqu'en 2000, les évolutions depuis cette date de la balance commerciale montrent que les performances françaises sont moins bonnes que celles de ses voisins allemand et italien. En effet, comme il est précisé dans le bulletin n° 6 d'octobre 2006 du Conseil d'analyse économique, « Analyses économiques », « l'excédent commercial allemand, hors énergie, a été multiplié par 2,5 entre 2000 et 2005, celui de l'Italie a doublé, tandis que le faible excédent commercial français, hors énergie, est resté stable ». L'explication, si on compare au « modèle » allemand, ne tient ni aux coûts, ni à des spécialisations sectorielles ou géographiques, ces dernières n'expliquant que partiellement les écarts de performances entre la France et l'Allemagne, dans la mesure où ils sont de plus en plus semblables. La RFA progresse dans l'agroalimentaire et la France sur les machines-outils. L'explication ne tient pas non plus à une spécialisation géographique inadaptée. En revanche, on constate une bien plus grande réactivité de l'Allemagne à une augmentation de la demande. Enfin, il convient de souligner que les grandes entreprises allemandes recourent de façon importante aux délocalisations vers l'est de l'Europe, ce qui a pour effet d'abaisser leurs coûts de production et donc de gagner des parts de marché. En fait, M. Fontagné a précisé qu'un des éléments décisifs de la compétitivité d'un pays réside dans sa capacité à adopter un positionnement stratégique sur des produits haut de gamme et disposant d'une avance technologique. Selon lui, le succès de la spécialisation venait du nombre de variétés de produits, de la qualité et non de la spécialisation en grands groupes de produits ou de la spécialisation géographique. Cette variété tient, en Allemagne, au grand nombre de PME qui exportent. La France n'a pas assez de firmes qui exportent. En plus, ses PME sont trop petites. En effet, il existe une corrélation directe entre la taille des entreprises et leur comportement à l'exportation. Pour illustrer ce point, il a fourni le tableau ci-après à la mission : EMPLOI EN POURCENTAGE DE L'EMPLOI
Source : (2) E. Bartelsman, S. Scarpetta, F. Schivardi (2003) : « Comparative analysis of firm demographics and survival : micro-level evidence for OECD countries » OCDE, Economics Department Working Paper n° 348, Janvier. Le tableau met bien en lumière que les entreprises créées en France ne grandissent pas. M. Fontagné a indiqué que la grande majorité des firmes exportaient vers un seul marché et c'est souvent la Belgique ! La compétitivité de l'économie française passe donc par le développement de moyennes entreprises. 2. L'emploi ne se limite pas aux services : ne pas négliger une industrie (25) en perte de compétitivité L'idée que nous sommes entrés dans l'ère « post industrielle » nous conduit parfois à penser que les emplois se trouveront tous dans les services. Certes, comme le souligne M. Daniel COHEN (26), il existe un « contraste étonnant entre les chiffres du commerce mondial et la composition de l'emploi. Le commerce porte à 80 % sur les produits industriels ou agricoles et à 20 % seulement sur les services. » Mais, dans les pays riches, l'emploi industriel et agricole représente moins de 20 % du total contre 80 % pour les services. Mais, en France, comme le rappelle McKinsey, l'industrie génère encore près de 22 % des emplois et de la valeur ajoutée et 300 milliards d'euros d'exportations. Certes, depuis 1995, l'industrie a perdu 300 000 emplois directs alors que le secteur des services a créé, en termes nets, près de 2,5 millions d'emplois. Plus qu'un déclin, relatif, c'est la perte de compétitivité qui paraît préoccupante. En témoignent son recul au plan des exportations mais également l'augmentation des importations, qui font « de la France l'un des pays où les importations sont proportionnellement les plus élevées alors même que la vague des importations en provenance des pays à bas coûts semble sur le point de s'amplifier. » 3. La rigidité du droit du travail M. Bertrand Collomb, président de l'association française des entreprises privées (AFEP), lors de son audition par la Mission d'information estimait que la France perdait du terrain par rapport à ses concurrents internationaux et que cette perte de compétitivité était liée, pour une grande partie au passage à la semaine de 35 heures, dont les effets économiques ont mis un certain temps à être ressentis. Il indiquait que, bien que les entreprises aient réussi à organiser le travail dans le cadre de la semaine de 35 heures, et que les salariés aient fait des efforts notamment de flexibilité, les coûts salariaux des produits des entreprises françaises avaient augmenté. Selon lui, il s'agirait de l'une des raisons expliquant que les performances françaises à l'exportation se soient dégradées tandis que celles de l'Allemagne s'amélioraient. Il a rappelé que dans son rapport « Le sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France », publié en 2004, M. Michel Camdessus, proposait un ensemble de mesures pour améliorer à la fois l'efficacité et la flexibilité de notre économie, tout en renforçant l'expression des solidarités. Ce constat n'est pas contestable, malgré la productivité reconnue des salariés français. Alors qu'au début des années 1970, le nombre annuel d'heures travaillées par actif occupé en France était sensiblement identique à celui des autres pays de l'OCDE, à quelques exceptions près (Japon, Irlande) est aujourd'hui inférieur de 15 % à la moyenne de l'OCDE. HEURES TRAVAILLÉES PAR ACTIF OCCUPÉ :
Source : Base de données de l'OCDE sur la productivité. Au sein de l'Europe élargie, la France se place avec les Pays-Bas au dernier rang des pays européens en nombre d'heures travaillées par semaine. DURÉE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DANS L'UNION EUROPÉENNE EN 2004
** 2ème trimestre 2004. Source : Eurostat, enquête européenne sur les forces de travail Il faudra bien que, dans le contexte international de compétition accrue que nous connaissons, soit introduite dans notre droit du travail une dose de flexibilité sous réserve qu'elle s'accompagne, pour les salariés concernés, d'un minimum de sécurité et que ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus puissent le faire sans entrave. Comme le préconisait le rapport Camdessus, il faut rendre plus facile, moins coûteux et moins traumatisant l'ajustement des structures en concentrant toute l'énergie sur l'aide aux personnes concernées et sur leur reclassement, après une formation adaptée, dans de nouveaux emplois. Si le principe de l'assurance chômage doit être défendu, il n'en demeure pas moins que le droit du licenciement pose problème et que, sous réserve qu'il demeure encadré, il devrait être susceptible de quelques aménagements. La France ne peut plus être le seul pays, alors que la plupart des pays européens ont entamé, voire accompli, une réforme du droit du travail, à conserver un système immuable dont les conséquences sur la compétitivité nationale sont perverses. Notre code du travail n'est que peu adapté aux contraintes économiques. Il ne donne pas de marges de manœuvre aux entreprises pour s'adapter en permanence aux évolutions alors que celles-ci ont besoin d'être réactives. 4. Les contraintes culturelles : une nécessaire évolution des mentalités La situation d'un pays est le produit de ses mentalités et de ses structures institutionnelles et économiques. En Allemagne, en Irlande, en Espagne, en Finlande comme aux États-Unis, l'esprit d'entreprendre est la source du dynamisme et de l'avenir du pays. En France, cet esprit est reconnu, mais il n'est pas la principale source d'inspiration des mentalités et des comportements. Sans doute, les efforts déjà déployés pour rapprocher l'école de l'entreprise ont-ils déjà porté quelques fruits si l'on considère l'augmentation du nombre de créations d'entreprises. Les effets de seuil et la fiscalité frappant la transmission d'entreprise n'expliquent que pour partie seulement le fait que nos PME demeurent de taille modeste. Le discours morose véhiculé autour des difficultés supposées ou réelles des entrepreneurs constitue vraisemblablement un frein à la croissance des PME française. Enfin, force est de constater que l'investissement dans l'innovation n'est pas encore entré dans tous les esprits, malgré la politique volontariste conduite depuis quelques années par les pouvoirs publics. B.- L'UNION EUROPÉENNE, UNE CHANCE ET UN HANDICAP POUR LA FRANCE L'appartenance à un aussi vaste espace économique est naturellement une chance pour la France. Sur le plan économique, l'Europe existe face aux États-Unis. En témoignent le droit de la concurrence (Cf. l'action engagée par l'Union européenne contre Microsoft) ou l'édiction de normes qui s'imposent souvent au plan mondial, à l'irritation parfois des États-Unis qui trouvent excessive la réglementation européenne. Ces normes sont d'ailleurs à l'origine d'un succès industriel européen. Sans la norme GSM, l'industrie européenne n'aurait pas connu les succès qu'elle a connus. En même temps, l'Union européenne est un handicap, en particulier dans les relations avec les États-Unis. Votre rapporteur prendra ici l'exemple emblématique du droit de la concurrence. Les conceptions, autrefois divergentes, tendent à se rapprocher de part et d'autre de l'Atlantique. La vraie différence est ailleurs. La vision américaine est très pragmatique. Elle a d'ailleurs souvent évolué en fonction des nécessités politiques et économiques et de l'« esprit du temps ». Après avoir démantelé ATT, les autorités de la concurrence sont ainsi en passe d'autoriser une fusion majeure dans ce secteur. Le droit américain « antitrust » repose sur une base législative et non constitutionnelle. L'approche européenne est d'une nature différente. Elle repose sur le traité, tout d'abord, ce qui complique singulièrement les évolutions. Elle est juridique avant tout. Elle s'appuie sur une vision qui est loin de faire l'unanimité, ainsi dans notre pays. L'absence de consensus intra-européen rend encore plus difficile les adaptations. Toute une branche de ce droit, les aides d'État, est dirigée contre les États membres, afin de les empêcher de distribuer des subventions introduisant des distorsions de concurrence intraeuropéenne. Le droit de la concurrence a d'ailleurs pour objectif d'assurer l'intégration du marché intérieur. Sans entrer dans une analyse plus précise de cette question, votre rapporteur se limitera à une brève analyse de la question la plus controversée : la politique européenne de la concurrence restreint-elle la croissance européenne, en empêchant notamment ses États membres d'apporter à son industrie le soutien public dont bénéficie son homologue américaine ? Elle s'appuiera pour cela sur le rapport « Politiques de la concurrence » de MM. David Encaova et Roger Guesnerie (27). Les auteurs notent qu'« il y a un déséquilibre évident entre le système européen qui, en matière de concurrence, s'inspire des États-Unis et va éventuellement au-delà, et le système américain, qui, à côté d'une politique de la concurrence dont l'indépendance est traditionnelle, mobilise un ensemble considérable de moyens et met en place un système structuré pour soutenir l'innovation industrielle. » Cela ne constitue évidemment un problème que si l'on estime souhaitable une politique publique plus volontariste et que la politique européenne ne peut se limiter au marché intérieur, mais doit s'accompagner de politiques structurelles. Dans cette perspective, cet état de fait est d'autant plus fâcheux que la seule autre politique économique menée par l'Union européenne est une « politique » monétaire menée sans le pragmatisme qui anime la Federal Reserve Bank, toujours soucieuse d'encourager la croissance américaine. M. Greenspan a incarné parfaitement cette indifférence à la théorie et cet attachement aux réalités économiques. Une interrogation sur la politique de la Banque Centrale Européenne « Il est assez clair que, comme nous le prévoyions, une désinflation assez importante va avoir lieu dans la zone euro (si on met à part les effets de la hausse des taux de TVA en Allemagne). On voit aussi un ralentissement des hausses des prix de l'immobilier. Mais, parallèlement, le crédit au secteur privé et la base monétaire continuent à progresser rapidement, ce qui montre à nouveau que dans les économies contemporaines ouvertes internationalement, il n'y a plus de lien, pays par pays, entre croissance monétaire, demande intérieure et inflation. La Banque Centrale Européenne, si elle veut continuer à monter ses taux directeurs : · ne pourra plus évoquer le risque inflationniste, · ne pourra plus évoquer le lien entre la croissance du crédit et l'inflation ; · ne pourra plus évoquer les hausses des prix des actifs ; Elle devra donc : · soit renoncer à continuer à monter le taux repo ; · soit afficher un objectif explicite de stabilisation du crédit sans lien avec l'inflation (ni d'ailleurs avec le niveau des taux d'endettement qui est encore bas dans plusieurs pays de la zone euro). » Source : M. Patrick ARTUS - IXIS n° 2006-431 S'agissant des aides d'État, les auteurs en soulignent les limites politiques et théoriques, en observant d'ailleurs que « la logique du Traité de Rome ne relève pas strictement de l'organisation des échanges internationaux. C'est que, d'une part, les pays participants ont à l'époque des niveaux de vie assez voisins, ou en tout cas que les inégalités de salaires entre participants ne sont pas vues comme un problème éventuel. C'est que, d'autre part, l'ambition du Traité de Rome n'est pas réductible à l'accroissement du commerce : le marché commun ne vise pas seulement à l'instauration d'échanges mutuellement avantageux mais à celle d'un grand marché, et il s'agit d'un objectif qui est autant politique qu'économique. Comme pour les accords entre entreprises et pratiques concertées et les abus de position dominante, c'est à nouveau « dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres » que les aides accordées par les États sont incompatibles avec le Marché commun. Ce rappel suscite trois observations. On peut noter à nouveau, que stricto sensu, il y a peu d'actions de politique économique dans un État membre qui n'affectent pas à la marge, les échanges entre les États membres. Il faut ensuite mentionner que la littérature récente sur les effets des aides d'État sur l'équilibre entre les pays où elles s'exercent, semble conduire à des conclusions beaucoup plus mitigées que celles qui nourrissent les convictions des auteurs du Traité de Rome. Il faut enfin souligner que l'élargissement de l'Union européenne, et en particulier son dernier épisode, donnent au grand marché une dimension, celle d'une tendance à l'égalisation du prix des facteurs entre pays de vie notablement différents, qu'il n'avait pas à ce point auparavant et pas au moment du Traité de Rome. Cette question n'est pas vraiment abordée par la littérature spécialisée à laquelle on vient de faire référence. La question des conditions de la concurrence « loyale » doit être revue dans le nouveau contexte. » (28) À l'évidence, et au minimum, une plus grande subsidiarité s'imposerait. Ce droit si soucieux d'éviter les distorsions de concurrence ne prend pas en compte celles induites par le dumping fiscal intraeuropéen. « Aujourd'hui, même pour les plus sceptiques, les exemples asiatiques (et en particulier coréen), démontrent qu'une intervention ciblée de l'État peut être bénéfique si elle est conduite avec intelligence. Ainsi, en s'appuyant sur l'exemple des télécommunications, les Coréens ont favorisé les investissements des grandes entreprises, quitte à être relativement peu regardants sur le niveau de concentration du secteur. Cette option politique, souvent dénoncée par les opérateurs coréens de petite taille, permet pourtant d'obtenir des performances en tout point supérieures à la moyenne des pays industrialisés. En 2001 (2003), les investissements coréens dans les télécommunications se montaient à 1,02 % (1,33 %) du PIB contre 0,49 % (0,25 %) la même année en France ou 0,23 % (0,37 %) en Allemagne selon l'OCDE. Le seul rattrapage coréen ne permet pas d'expliquer ces écarts, croissants depuis 1995. Dans un contexte européen où le seul terme de politique industrielle était proscrit, les comparaisons internationales tendent à reposer la question du rôle de l'État et de la place des politiques industrielles par rapport aux politiques de concurrence. Notamment le cas du Japon est particulièrement instructif, dans la mesure où il n'y a pas d'autorité de régulation Votre rapporteur se limitera à regretter que l'Europe accorde un tel primat à la concurrence sur tout autre objectif, en faisant une fin en soi, et non un moyen, la seule finalité légitime étant la prospérité des citoyens de l'Union européenne. À l'évidence, d'Internet à Boeing, les États-Unis ont, eux, une véritable politique industrielle fondée sur le développement de l'innovation (aéronautique, biotechnologie, informatique, etc.). Votre rapporteur tient cependant à souligner qu'il ne suffit pas de lever les entraves mises par l'Union européenne au développement d'une telle politique. Encore faut-il s'en donner les moyens financiers. TROISIÈME PARTIE : RESTAURER LA COMPÉTITIVITÉ DE L'ÉCONOMIE FRANÇAISE POUR ASSURER L'AVENIR En vue d'atteindre cet objectif, votre rapporteur proposera de poursuivre et amplifier la politique engagée en faveur des PME, de simplifier et mieux contrôler les aides publiques et de réformer le financement de la protection sociale. Votre rapporteur commencera l'analyse par la politique de recherche, qui conditionne l'avenir. I.- LA FRANCE DOIT TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES Notre avenir dépend aujourd'hui de notre compétitivité, laquelle dépend largement de notre capacité à innover. L'innovation ne se limite pas à des produits de haute technologie, nucléaire, spatial, aéronautique, etc. Ebay est un exemple d'innovation simple dans son principe ; encore fallait-il en avoir l'idée et la mettre en œuvre. Comme l'ont répété nombre d'interlocuteurs de la mission, beaucoup d'entreprises leader de la bourse de New York n'existaient pas il y a vingt ans, à la différence du CAC 40. Il est intéressant, par exemple, de voir que deux jeunes entrepreneurs, de respectivement 28 et 29 ans, viennent de vendre leur compagnie « You Tube », à Google pour 1,65 milliard d'euros. Ils étaient au lycée il y a onze ans. Mais l'innovation ne se limite pas à Internet. Elle concerne aussi bien le textile. Dans les Vosges, une PME a par exemple breveté un procédé à mémoire de forme visant à rendre, sans additifs chimiques, ses tissus infroissables (30).Nous sommes entrés dans une économie de l'innovation, fondée sur la connaissance. En outre, par l'effet de la mondialisation, les marchés changent de dimensions et la compétition entre les entreprises devient plus vive. Comme le faisait remarquer lors de son audition par la Mission d'information M. Renaud DUTREIL, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, les entreprises n'échappent pas à l'accélération du temps. Le raccourcissement du délai entre l'innovation et la commercialisation constitue une des conséquences de l'évolution de notre environnement. De la rapidité d'adaptation à ces changements et de la capacité à les anticiper dépendent la vitalité des entreprises et leur place dans un système toujours plus concurrentiel. Plus que jamais il importe, aujourd'hui, de rassembler et de mobiliser les énergies créatrices, celles des entreprises, comme celles des universités et des grandes écoles, pour préparer notre économie de demain. Les synergies entre savoir et savoir-faire conditionnent l'innovation formant ainsi l'un des facteurs déterminant de la croissance de demain. La qualité de nos scientifiques est également un élément clé de notre compétitivité. Là également, nous sommes en concurrence avec les pays émergents. En France, près de 28 000 ingénieurs ont été diplômés en 2006 (31) contre environ 4 000 000 en Inde (32), même si tous ne sont pas au même niveau. A.- L'INNOVATION, UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT DE LA CROISSANCE L'innovation n'est plus aujourd'hui, considérée comme le fruit de l'imagination féconde d'un inventeur de génie isolé dans son atelier, d'une sorte de « savant Cosinus » ou d'un « professeur Nimbus » détachés des contingences matérielles et se désintéressant des applications et des implications économiques de ses trouvailles. Elle est maintenant la résultante du travail en commun d'une équipe poursuivant un objectif, animée par la poursuite d'un projet élaboré dans le cadre d'une stratégie définie dans une perspective « entreprenariale ». Les avancées technologiques répondent désormais à une logique économique et elles s'inscrivent dans le cadre de projets à plus ou moins longs termes visant à garantir la compétitivité et le développement futur d'un groupe industriel ou d'une entreprise avec ses conséquences économiques et sociales. Il est depuis longtemps admis que l'innovation est un élément moteur important de la croissance économique. M. Robert Solow a reçu le prix Nobel de science économique en 1987 pour ses contributions à la théorie macroéconomique moderne de la croissance. Selon la théorie de la croissance, les gouvernements peuvent favoriser le développement économique par divers moyens, notamment en appuyant l'éducation et la formation, en stimulant l'investissement des capitaux, en préconisant la réaffectation des ressources des industries à faible productivité aux industries à forte productivité et en favorisant les progrès techniques et l'innovation. La théorie de la croissance suggère notamment que c'est ce dernier facteur qui occupe une place prépondérante comme moteur de la croissance économique, d'autant plus que la recherche universitaire et technologique participe au système de formation et accroît ainsi le capital humain, facteur lui aussi déterminant de la croissance économique. Selon la théorie classique, c'est la croissance de la recherche-développement (R&D), et non le niveau de dépense de R&D qui affecte directement les gains de productivité. Selon les approches découlant de la théorie de la croissance endogène, formulées par P. Romer et reprises par Jones, la croissance économique sera plus ou moins rapide en fonction de la création des connaissances. De toute évidence, la R&D joue un rôle fondamental par son aspect formation et c'est donc le niveau de dépenses de R&D qui influera sur la croissance de productivité. Selon une étude réalisée par Jones en 2002, à partir de ces principes, 30 % de la croissance américaine entre 1950 et 1993 pourraient être attribués à une amélioration du niveau « d'éducation-formation », et 50 % à l'effort de R&D. Nombreuses sont les études économiques démontrant que les progrès techniques sont désormais à l'origine d'une part non négligeable de la croissance des économies nationales. Plus proche de nous, MM. Pierre Kopp et Patrice Geoffron, professeurs d'économie à la Sorbonne et à Paris-Dauphine, ont mis en évidence qu'un accroissement de 0,1 % de la part des investissements consacrés par les entreprises à la recherche et au développement rapportée au produit intérieur brut conduisait mécaniquement à l'augmentation de 1,2 point par an de la croissance économique (33). Ce constat conduisait M. Jean-Paul Betbèze à formuler le principe selon lequel « la croissance économique dépend, en grande part et à moyen terme, de la dynamique de la productivité qui trouve elle-même ses sources dans la Recherche Développement (34) ». Tout récemment, le Bureau d'analyse économique du ministère du commerce américain s'est efforcé de mesurer la contribution de la recherche et développement sur la croissance du PIB américain. En comparant les résultats des deux simulations des comptes nationaux de 1959 à 2002, la première considérant que la R&D était un investissement, la seconde comme une dépense, ce qui est le cas aujourd'hui, le Bureau d'analyse économique émet la thèse, qu'entre 1995 et 2002, les dépenses de R&D ont été créatrices de valeur ajoutée et qu'elles ont contribué pour 6,7 % à la hausse du produit intérieur brut. Un pays tel que la Finlande, ou une région telle que le Pays basque espagnol, ont mis en pratique une politique de l'innovation dont les effets sont aujourd'hui tangibles. En Finlande, par exemple, les dépenses de R&D sont passées de 2,2 milliards d'euros en 1999 à 5,4 milliards d'euros en 2005. Elles représentent désormais 3,5 % du PIB de ce pays. Il n'est pas sans intérêt de noter que la mise en œuvre de cette politique novatrice a fait l'objet d'un large consensus dans la population finlandaise dont le pays devait faire face à une économie chancelante suite aux bouleversements induits par la disparition de l'Union soviétique. L'annexe au présent rapport contient le compte rendu du déplacement de la mission en Finlande. À une échelle plus réduite, le Pays basque espagnol a su mobiliser l'ensemble des acteurs économiques pour relever le défi posé par une situation économique marquée par des années de terrorisme et des industries vieillissantes. La région de Bilbao est désormais considérée comme le fleuron de l'industrie espagnole car elle s'adosse à une politique dynamique et volontariste d'innovation à l'origine de laquelle on trouve la mise en place de huit pôles de compétitivité (« Cluster »). Dans ces deux exemples, les synergies résultant de partenariats entre acteurs publics et acteurs privés d'une part, et, entre recherche universitaire et recherche industrielle d'autre part, ont permis un redressement de l'économie en s'appuyant sur une politique d'innovation réaliste et efficace. 1. Le couple « recherche-innovation », clef de voûte de la préparation de l'avenir Il n'est plus, désormais, nécessaire de démontrer que l'innovation contribue à la création de richesses individuelles et collectives. La mondialisation de l'économie place la compétitivité et la concurrence au premier rang des préoccupations des acteurs économiques. La stratégie de Lisbonne reposait sur ce constat. a) Les objectifs de la stratégie de Lisbonne Parce que l'innovation découle directement de la recherche et qu'elle contribue non moins directement à la création de richesse en favorisant la croissance, elle est de nature à permettre de faire face aux enjeux économiques de demain. Elle se situe résolument dans la perspective du futur et constitue la clef de voûte de l'avenir économique et social. Ce rôle fondamental du couple « recherche-innovation » a été clairement perçu au niveau européen, l'article 163 du Traité sur l'Union européenne, introduit en 1986 par l'Acte unique européen, fixait déjà comme objectif à l'Union européenne de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de la compétitivité internationale. Le Conseil européen de Lisbonne des 23-24 mars 2000 se voulait fondateur d'une nouvelle stratégie, plus orientée vers la croissance et la compétitivité. L'objectif affiché lors de ce sommet européen est de faire de l'Europe, à l'horizon 2010, « l'économie le plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Cette orientation très générale a été complétée par la Commission avec l'adoption d'un cadre de référence, l'Espace européen de la recherche, de façon à promouvoir une véritable politique de recherche commune, avec pour ambition d'éviter la dispersion des efforts et de créer, en mutualisant les moyens dans un souci d'intégration européenne, de réelles synergies. Le Conseil européen de Barcelone, qui s'est déroulé en mars 2002 et qui s'inscrivait dans la suite logique de celui de Lisbonne, a fixé pour objectif de porter de 1,9 % à 3 % du PIB de l'Union l'investissement dans la recherche et le développement technologique d'ici 2010, les deux tiers de cet investissement supplémentaire provenant du privé. Enfin, la Commission a présenté, en juin 2003, « un plan d'action pour l'Europe », complétant ainsi le dispositif adopté trois années plus tôt à Lisbonne. La stratégie européenne décidée à Lisbonne paraissait d'autant plus indispensable qu'un écart important se creusait entre l'Europe et les États-Unis. Selon une étude réalisée par le Conseil d'analyse économique, publiée en 2005, l'Europe avait en 1995 un niveau de R&D qui représentait 88 % de celui des États-Unis, alors qu'en 2001, l'effort européen n'en représentait plus que 56 % en 2004, suite à la baisse des investissements américains. Autre indicateur : Depuis 1981, les scientifiques américains ont remporté 105 prix Nobel sur un total de 151 décernés par l'Académie suédoise (35). De même, les entreprises de l'Union européenne ont accru de 5,3 % leur investissement R&D en 2005, ce chiffre étant cependant de 7,7 % pour leurs concurrents n'appartenant pas à l'Union européenne. Trois groupes américains sont aux premières places (36). INVESTISSEMENTS EN R&D (En milliards d'euros courants)
Source : commission européenne Concrètement, atteindre cet objectif suppose une croissance annuelle globale des efforts nationaux de recherche de l'ordre de 8 %, répartis entre une augmentation moyenne annuelle de 6 % pour le financement du secteur public et de 9 % pour celui des entreprises. Peu de pays européens ont atteint ces objectifs. À ce jour seul deux pays réalisent l'objectif attendu : la Suède et la Finlande avec des investissements en faveur de la recherche qui s'élèvent respectivement à 4,3 % et à 3,4 % de leur PIB. En 2005, à l'exception des pays cités précédemment, tous les pays européens consacraient moins de 2,5 % de leur PIB à la R&D. La moyenne communautaire s'élève à près de 2 %, loin derrière le Japon à 3,1 %, alors que l'effort des États-Unis se situait à 2,7 %. L'ensemble des dépenses publiques et privées de R&D françaises s'élevait à 2,2 % de son PIB, niveau qui paraît modeste au regard de ceux consentis par le Japon et les États-Unis, mais qui situe la France parmi les pays européens qui contribuent le plus à développer la recherche. La stratégie de Lisbonne est certes ambitieuse, certains l'ont même qualifiée « d'euphorique ». Les ambitions affichées, dans un domaine relevant jusque-là des politiques nationales, supposaient que, dans un premier temps du moins, les états membres se saisissent du sujet et adoptent des mesures amorçant sa mise en œuvre. Or, en raison des faibles marges de manœuvres budgétaires, force est de constater que les réformes souhaitables ont tardé, laissant s'accroître le différentiel entre l'Europe, ses états membres, et les États-Unis et le Japon. Dans le contexte de concurrence accrue lié à la mondialisation de l'économie, les objectifs de Lisbonne demeurent plus que jamais d'actualité. Les atteindre constitue le défi que doivent impérativement relever l'ensemble des États membres. 2. La France a tardivement intégré cette préoccupation La France, comme nombre d'États membres a tardé à réagir, et ce n'est qu'après plusieurs années de stagnation du budget de la recherche que le Gouvernement a annoncé la mise en œuvre d'un plan triennal pour la recherche qui prévoyait une augmentation de un milliard d'euros par an pour 2005, 2006 et 2007, soit plusieurs années après les engagements de Lisbonne. L'effort français en faveur de la R&D était modeste en comparaison de ceux des principaux pays industrialisés. Il convenait donc que les pouvoirs publics insufflent une nouvelle dynamique en matière de recherche de façon à atteindre les objectifs de Lisbonne et relever les défis qu'impose la concurrence accrue liée à l'internationalisation de l'économie. François Loos, ministre délégué à l'industrie a bien compris les enjeux de l'innovation sur la compétitivité des entreprises françaises. C'est ainsi que, tout récemment encore, il a inscrit son action dans le cadre de la politique de soutien public à l'innovation en en recensant dans les huit grands domaines principaux d'activité économique (37) de la France, les principales technologies porteuses d'avenir. Le comité de pilotage de « Technologies 2010 », qui a procédé à ce recensement a identifié pas moins de 83 technologies clés dans lesquelles, en raison des compétences développées, l'industrie française peut attendre l'excellence. Outre sa mission de veille technologique, le comité de pilotage est chargé d'assurer, principalement auprès des PME, une information régulière dans les secteurs répertoriés et de faire la promotion des innovations technologiques auprès des entreprises petites et moyennes. Force est de constater que la recherche française présente certes de bons résultats, toutefois, il existe certaines zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les dépôts de brevets et le manque de liens entre recherche publique et recherche privée, a) La faiblesse relative des dépôts français de brevets La capacité innovatrice de la recherche passe naturellement par l'évaluation de ses résultats et, notamment, publications, prix décernés aux chercheurs et naturellement volume des brevets déposés. Lors de son audition par la Mission d'information, M. Benoît Batisttelli, Directeur général de l'INPI soulignait que si le nombre de dépôts de brevets en France était globalement stable au cours des neuf dernières années (16 882 en 1997 pour 17 275 en 2005 - + 1,5%) la part des déposants nationaux s'était quant à elle sensiblement accrue, passant de 13 215 à 14 327 sur la même période, soit une augmentation de 8,4 %. ÉVOLUTION DES DÉPÔTS DE BREVETS PAR LA VOIE NATIONALE
Source : INPI Dans un même temps, le nombre de dépôts par la voie européenne est passé de 72 904 à 128 679 (+ 76,5 %), alors que les dépôts d'origine française ne se sont accrus que de 57,8 % passant de 5 091 à 8 034, la proportion de dépôts français décroissant ainsi de 6,9 % à 6,2 % de l'ensemble des dépôts européens. ÉVOLUTION DES DÉPÔTS DE BREVETS PAR LA VOIE EUROPÉENNE
Source : INPI Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'au cours des cinq dernières années le nombre de dépôts de brevets européens d'origine américaine a augmenté de 7,5 % pour atteindre 32 738 dépôts en 2005 et ceux d'origine japonaise de 8,4 % et sont au nombre de 21 461 en 2005. L'absence de ratification de l'accord de Londres signé en octobre 2000 par les états membres de l'Union européenne, qui avait pour objectif essentiel d'aménager et de simplifier le régime linguistique de dépôt des brevets européens et pour effet principal de diminuer le coût supporté par les déposants, n'a pas aidé à enrayer ce déclin relatif. Il convient de rappeler que le brevet, titre de propriété industrielle, confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation d'une invention sur un territoire donné et pour une période limitée dans le temps. En contrepartie de la protection qui en découle, le détenteur du brevet accepte de rendre publique son invention. Pour qu'une invention soit susceptible de bénéficier de la protection, elle doit répondre à trois critères : nouveauté, activité inventive et application industrielle. À l'appui de dépôt de sa demande de brevet auprès d'un office de propriété industrielle (en : France : l'Institut national de la propriété industrielle -INPI), le demandeur doit fournir : - la « description » de l'invention, qui doit notamment indiquer l'état antérieur de la technique et exposer l'invention ; - les « revendications » qui définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, en s'appuyant sur la description. L'office de propriété industrielle établit un rapport de recherche ayant pour objectif de vérifier la brevetabilité de l'invention au regard des trois critères cités précédemment. Ces critères étant satisfaits, le brevet est délivré et comprend la description, les dessins, les revendications et le rapport de recherche. Un brevet européen a été créé en 1973 (convention de Munich). Un Office européen des brevets (OEB) centralise le dépôt et l'examen des demandes. La délivrance de ce brevet répond à des règles uniformes pour l'ensemble des États membres. Le dépôt d'une seule demande auprès de l'OEB permet d'obtenir un brevet ayant dans chacun des États membres le même effet juridique qu'un brevet national. La délivrance d'un brevet européen se distingue d'un brevet national, dans la mesure où la demande du déposant doit répondre à deux exigences particulières : la désignation et la validation. Par désignation, il faut entendre le champ territorial dans lequel la protection est souhaitée, et par validation, le dépôt, auprès de chacun des États désignés la traduction intégrale (description et revendication) dans une langue officielle de cet État. Cette procédure supposant de nombreuses traductions est particulièrement longue (près de six années en moyenne) et coûteuse (de l'ordre de 32 000 euros). Aussi, les états membres ont-ils signé le 17 octobre 2000 à Londres un accord tendant à simplifier les procédures de dépôt, notamment en ce qui concerne sa validation, l'article premier de cet accord n'imposant plus, pour la validation que la traduction dans l'une des trois langues officielle de l'Union européenne, la traduction dans la langue d'un pays pouvant toutefois être exigée en cas de litige survenant en cas de contrefaçon sur le territoire de ce pays (article 2 de l'accord). b) L'urgence de ratifier les accords de Londres L'application de l'accord de Londres a fait débat en France, certains défenseurs de la langue française arguant que sa mise en œuvre sur le territoire national serait, en l'état contraire à la Constitution (au regard des impératifs fixés en matière d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, un texte non écrit en langue française ne pouvant répondre à ces deux critères). Par sa décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, a tranché et a décidé que l'accord de Londres n'était pas contraire à la Constitution. L'incertitude juridique étant désormais levée, il est plus qu'urgent que soit entamée la procédure de ratification de l'accord de Londres et que le Gouvernement dépose dans les plus brefs délais un projet de loi en ce sens. Ainsi, l'occasion sera enfin offerte de permettre le plus rapidement son application et alléger, d'une part, le coût de dépôt des brevets européens par les entreprises françaises (l'économie ainsi réalisée avoisinerait 9 000 euros) et, d'autre part, assurer une meilleure protection des innovations françaises. L'urgence et l'intérêt de cette ratification ont d'ailleurs été soulignés avec force devant la Mission d'information par de nombreuses personnes auditionnées, notamment le directeur général de l'INPI, M. Christian Pierret, ancien ministre de l'industrie et le Président de la CGPME. Si la France, au cours des cinq dernières années, occupe la deuxième place parmi les pays européens s'agissant du dépôt des brevets européens, force est de constater que les « inventeurs » français se situent loin derrière les « inventeurs » allemands puisqu'ils ne déposent qu'environ le tiers des demandes de brevets déposés par nos voisins d'outre-rhin. Ils précèdent de peu les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Finlande et ne sont à l'origine que de 6,2 % des demandes européennes. ÉVOLUTION PAR PRINCIPALES ORIGINES DES DEMANDES EUROPÉENNES
Source : OEB La procédure simplifiée découlant de la ratification urgente des accords de Londres devrait lever les réticences dues aux coûts excessifs et dissuasifs qui frappent actuellement celles et ceux qui innovent, qu'ils appartiennent aux organismes publics ou privés de recherche ou qu'ils participent à l'effort d'innovation des entreprises situées sur le territoire français. B.- L'INSUFFISANCE DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ, NOTAMMENT POUR LES PME, CONSTITUE UN PROBLÈME RÉCURRENT La faiblesse relative du nombre de dépôts de brevets français a, selon M. Benoît Battistelli trois explications majeures : la taille de nos entreprises et, surtout, le manque de liaisons entre, d'une part, la recherche, l'université et les grands organismes de recherche (CNRS, laboratoires des grandes écoles) et, d'autre part, les entreprises ainsi que d'un environnement réglementaire contraignant (poids des contraintes éthiques dans le domaine médical et écologique dans le domaine agricole dont s'affranchissent les laboratoires étrangers). Il convient également de remarquer que les dépôts de brevets à l'INPI émanent majoritairement de grands groupes industriels (10 % des dépôts enregistrés par l'INPI en 2005 sont le fait de trois groupes industriels et 20 % de sept groupes). De fait, peu de brevets sont déposés par des entreprises petites ou moyennes. Cette faiblesse de l'implication des PME dans la recherche s'explique notamment par le manque de moyens financiers des PME françaises et une sorte d'appréhension des chefs d'entreprise face à toute collaboration avec d'autres PME où de grands groupes (captation des innovations sur des marchés très concurrentiels et risque d'absorption des PME par les grands groupes industriels). Nombreuses sont les personnes auditionnées par la Mission d'information qui ont souligné et regretté que les organismes de recherche publics et les entreprises n'entretiennent pas de liens plus étroits. Sans doute, comme cela a été souligné par plusieurs intervenants, ce phénomène trouve-t-il partiellement une explication d'ordre comportementale et culturelle, la recherche fondamentale et la recherche appliquée ne poursuivant pas les mêmes objectifs, la première ayant pour finalité la « Connaissance », alors que la seconde poursuivant à travers ses applications concrètes et commercialisables une finalité « mercantile ». Toutefois, force est de constater que les progrès de la science par ses tentatives d'explication du monde ont participé étroitement par ses applications quotidiennes à l'amélioration des conditions de vie et la frontière culturelle entre recherche fondamentale et recherche appliquée ne constitue qu'une barrière artificielle contre laquelle il convient de lutter si l'on veut promouvoir une recherche de qualité et permettre ainsi à l'économie française de jouer un rôle dans l'avenir. Bien que la France soit en tête des pays de l'OCDE pour l'effort public de recherche avec 1 % du PIB, l'effort privé de recherche (1,2 % du PIB) accuse un retard par rapport à de nombreux pays. La recherche publique a aujourd'hui un effet d'entraînement insuffisant sur le développement de la recherche privée. Il est fondamental de soutenir l'innovation et le transfert de technologies de façon à préparer l'avenir de notre économie en aidant les entreprises à anticiper et assimiler de nouveaux savoirs. Ce manque de collaboration entre les différents acteurs de la recherche est un problème récurrent posé à la recherche française. Nombreux sont les rapports regrettant la faiblesse de la coopération entre laboratoires universitaires et centres d'études, de recherche et d'essai des entreprises. Les pouvoirs publics se sont à maintes reprises interrogés sur les remèdes susceptibles d'être apportés pour pallier ce cloisonnement préjudiciable à la politique d'innovation des entreprises françaises et les initiatives visant à atteindre cet objectif ne manquent pas, sans que leur efficience soit nécessairement visible et mesurable. Quiconque souhaitant s'initier au monde de la recherche ne peut qu'être frappé par l'extrême complexité du système de recherche français. Dans le doute faut-il posséder soi-même une âme de chercheur pour parvenir à comprendre, à se repérer dans les méandres, les relations compliquées par lesquelles sont liés les organismes, les rôles respectifs de la recherche privée et de la recherche publique, les complémentarités et les particularités de chacun, la nécessaire discrétion qui entoure les travaux de chercheurs dont les statuts sont eux aussi souvent très différents. À toujours vouloir repousser plus loin les limites de la connaissance, le chercheur est confronté à la complexification des choses et des phénomènes, aux inévitables interactions entre les éléments qu'il découvre en voulant répondre à des interrogations initialement simples. L'univers de la recherche n'échappe manifestement pas à cette logique de la recherche. Pour tenter de le cerner encore faut-il rappeler quelques évidences qui s'inscrivent délibérément à contre-courant de quelques idées passéistes : la recherche publique et la recherche privée ne sont pas des domaines cloisonnés, elles concourent toutes deux à l'enrichissement de la connaissance et à l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes 1. Une complémentarité évidente Si nul ne prétendrait nier que les avancées de la recherche fondamentale profitent à la recherche appliquée, de même, personne ne pourrait défendre que les progrès technologiques nés du travail des laboratoires de recherche et développement des entreprises ne servent la cause de la connaissance en général et contribuent à enrichir la Connaissance. Cette évidente complémentarité participe activement au développement de l'économie de la connaissance. Nombreuses sont en effet les applications pratiques des découvertes théoriques qui ont germé dans les laboratoires universitaires. Les économies contemporaines reposent désormais tout autant, sinon plus sur ce qu'il est convenu d'appeler le capital intangible (éducation, formation, capital humain, recherche et développement...) que sur le capital tangible. Cette évolution a considérablement modifié les systèmes de production. Les sources et la vitesse de l'innovation et du changement technologique constituent, aujourd'hui, les fondements de l'économie moderne. L'exemple des nouvelles technologies de la communication (NTC) illustre s'il en était besoin la réalité et l'ampleur du phénomène. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont, depuis la fin des années 1990, connu une évolution rapide et leur diffusion auprès du grand public s'est accélérée. Cette accélération s'explique notamment par la convergence de différents secteurs, en partie cloisonnés jusque-là, l'informatique, les télécommunications et les médias. La technologie de base étant quasiment identique, chacun de ces secteurs s'est nourri des avancées technologiques des autres secteurs, entraînant une consolidation mutuelle entre le développement des connaissances et ses impacts économiques en terme de production et de diffusion de produits et de services. Par ailleurs, ces avancées ont permis pour chacun des secteurs considérés des gains de productivité et ont favorisé l'émergence et la croissance de nouvelles entreprises, spécialisées dans leur production, leur diffusion et leur maintenance, sans oublier leur recyclage. Ainsi, aux États-Unis, la part des investissements des entreprises dans les nouvelles technologies de l'information est-elle passée de 6,2 % de PIB en 1990, à 8,2 % en 2000, alors que sur cette même période elle passait en France de 4,8 % à 5 %. Contrairement à ce qui caractérisait les avancées technologiques au siècle précédent, où les modifications qu'elles rendaient nécessaires pour adapter l'outil de production et adapter les biens consommables mettaient près d'une trentaine d'années à être mise en œuvre, les innovations dans les NTC sont très rapidement transposables en termes de produits nouveaux et leur production et leur commercialisation s'en trouvent accélérées, ce d'autant plus que la culture consumériste conduit le client à rechercher le produit nouveau, disposant de nouvelles potentialités liées à l'innovation. Il relève de l'évidence que ces nouvelles technologies n'auraient jamais pu émerger si les ingénieurs et techniciens qui peuplent les centres de recherche et d'essai des laboratoires n'avaient été préalablement imprégnés des connaissances générales issues des recherches fondamentales dans des domaines comme les mathématiques ou la physique. Il en va de même pour toutes les technologies touchant à la chimie, à la mécanique, à la médecine et à la biologie, à l'agriculture et à l'agroalimentaire, en passant par le textile et l'habillement. 2. Une complémentarité qu'il convient de développer S'il apparaît souhaitable de renforcer les partenariats public-privé, la question est bien de savoir comment procéder à un partage entre deux systèmes qui évoluent dans des logiques différentes. Le secteur public de la recherche a pour mission la diffusion des connaissances (on évoque fréquemment ces connaissances sous l'appellation de « savoirs ouverts »), alors que le secteur privé, tirant un avantage concurrentiel des résultats des recherches entreprises (par opposition savoirs fermés) en termes de production et de propriété intellectuelle, n'a aucun intérêt à externaliser ces avancées technologiques, s'il veut tirer partie de la quasi-situation de monopole dans lequel le place le fait de disposer d'un produit plus sophistiqué que ses concurrents. Il convient, toutefois, de noter que les frontières entre les deux secteurs ne sont pas aussi hermétiques et qu'il existe une sorte de perméabilité dans la diffusion du savoir. Les transferts de connaissances sont, certes, plus nombreux dans le sens public-privé, mais force est de reconnaître que l'ancienne dichotomie ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, bien que la notion de savoirs fermés reste attachée juridiquement aux droits de propriété intellectuelle, notamment par la protection liée aux dépôts d'un brevet. Sous l'effet conjugué des contraintes budgétaires et de l'aspiration des chercheurs, la recherche publique a été conduite à collaborer avec les entreprises dont la demande de coopération était d'autant plus forte que, confrontées elles-mêmes à des objectifs de rentabilité, elles étaient conduites à externaliser une part non négligeable de leurs activités de recherche-développement. Cette collaboration est d'ailleurs encouragée par les pouvoirs publics, notamment en France par le biais des pôles de compétitivité, des centres régionaux d'innovation et de transfert technologique et de la mobilité professionnelle des chercheurs. Importée des États-Unis, la pratique de la licence exclusive tend à se généraliser. Elle suppose que l'organisme public à l'origine de l'innovation ait préalablement déposé un brevet. Il se lie alors avec une entreprise par un contrat en vertu duquel il concède à l'entreprise un droit d'exploitation de l'innovation dans le respect des clauses du contrat. Cette formule bien que non dénuée d'intérêt présente toutefois l'inconvénient majeur de freiner la diffusion du savoir en limitant l'accès des technologies aux seuls concessionnaires. Parmi les mécanismes de coopérations possibles, sont les plus fréquemment évoqués : - le consortium de recherche ou invention collective, où sont regroupés des chercheurs, ingénieurs et techniciens et qui constituent des lieux d'échanges et où se créent des espaces de partage des connaissances dans un cadre moins contraint. - une autre piste consiste dans le rachat de brevets par des états ou des fondations afin de favoriser leur diffusion dans le domaine public. D'autres formules restent encore à inventer ; dans ce domaine aussi l'innovation se doit d'être présente. Il appartient aux pouvoirs publics, mais aussi aux entreprises, de faire preuve d'inventivité pour relever ensemble dans un intérêt partagé le défi du partage de la connaissance à l'aube de ce vingt et unième siècle.
3. La loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche crée les outils du développement de la recherche Le Gouvernement s'est résolument engagé sur une voie nouvelle, lui permettant de réaliser les objectifs fixés en commun à Lisbonne. Cette volonté s'est traduite par l'adoption, début 2006, d'une loi-cadre pour la recherche (loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche). L'exposé des motifs exprimait clairement le contexte qui rendait indispensable l'adaptation de l'organisation de la recherche en France : - face à une spécialisation croissante des disciplines et à une complexification des équipements associés, les interactions entre disciplines, à l'origine de nombre d'innovations, sont devenues essentielles ; - « dans une économie mondialisée, où la concurrence de cesse de s'intensifier, il apparaît de façon évidente que le potentiel de recherche est un atout déterminant pour un pays comme le nôtre. De la qualité de notre recherche, de la pertinence de ses orientations, de la capacité réciproque de notre appareil de recherche et de nos entreprises à coopérer efficacement, dépend aujourd'hui très largement et dépendra davantage demain notre compétitivité économique. Il existe un lien étroit entre notre recherche et nos perspectives de croissance économique. En définitive, l'efficacité de notre recherche est garante de la qualité, de la pérennité et du nombre de nos emplois ». La loi de programme pour la recherche dote la recherche des moyens compatibles avec les ambitions nationales et devrait permette à la France de se rapprocher sensiblement des objectifs européens. α) Une programmation des moyens affectés à la recherche L'article premier de la loi prévoit que les moyens consacrés à la recherche « augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4 milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux moyens consacrés en 2004 ». Le troisième alinéa de cet article prévoit une programmation des moyens budgétaires que l'État s'engage à affecter annuellement à la mission « Recherche et enseignement supérieur », étant précisé qu'ils recouvreront les ressources extrabudgétaires et le montant des dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et d'innovation, mais ne comprennent pas les crédits destinés à la vie étudiante. β) Des moyens budgétaires conformes aux orientations Les engagements pris lors du vote sur la loi de programme du 18 avril 2006 pour la recherche sont tenus dans le projet de budget de la recherche pour 2007. Conformément aux objectifs de la loi de programme, les moyens consacrés à la recherche et à l'enseignement supérieur, hors vie étudiante, augmentent d'un milliard d'euros et atteignent 22 milliards d'euros. Cette augmentation correspond au volume de crédits que le Gouvernement s'était engagé à affecter à la préparation de l'avenir. Globalement, depuis 2004, soit en trois années, la recherche aura bénéficié de 6 milliards d'euros de crédits supplémentaires, ce qui représente un effort sans précédent et permet ainsi de mesurer l'effectivité des orientations fixées par la loi de programme. Le tableau, ci après, retrace l'affectation des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2007, en reprenant, pour plus de lisibilité la répartition prévue par la loi de programme : (En millions d'euros)
Source : projet de loi de finance pour 2007 Sans doute convient-il ici de rappeler que lors du débat à l'Assemblée nationale sur l'article premier de la loi de programme, le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche s'est engagé pour l'avenir sur la prise en compte de l'inflation pour les prochaines échéances : « je peux vous dire, afin de dissiper tout malentendu, que pour 2008, 2009 et 2010 les montants qui figurent dans ce projet de loi de programmation s'entendent en euros constants ». Les crédits affectés à la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur, hors « vie étudiante » relèvent pour emploi, à hauteur de 16,8 milliards d'euros (soit 86,2 %) du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à hauteur de 1,3 milliard d'euros du ministère de l'économie, des finances et du budget (soit 6,7 %), les 7,1 % restant relevant de divers ministères contribuant à la recherche : ministère de l'écologie et du développement durable, ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, ministère de la défense, ministère de la culture et de la communication et ministère de l'agriculture et de la pêche. Un effort particulier est consenti en matière des formations supérieures et de la recherche qui devrait se traduire par le recrutement et de 450 enseignants et chercheurs supplémentaires et à une revalorisation à hauteur de 8 %, à compter du 1er février des allocations de recherche. Le projet de budget de la recherche se caractérise également par une montée en puissance des appels à projets et des financements incitatifs portés par les agences. Les crédits consacrés aux agences (agence nationale pour la recherche -ANR- et Oseo Anvar) augmenteront en 2007 de prés de 40 %, passant de 590 à 825 millions d'euros. La dotation de l'ANR, transformée en établissement public administratif par la loi de programme, est portée à 825 millions d'euros. L'augmentation de crédits dont elle bénéficie permettra notamment la montée en charge du financement des Instituts Carnot (label récompensant l'excellence scientifique) et le financement des pôles de recherches et d'enseignement supérieur (PRES), les réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) et les centres thématiques de recherche et de soins (CTRS). Parallèlement, une enveloppe supplémentaire de 45 millions d'euros a été dégagée en faveur de l'Oseo Anvar, dotation qui s'inscrit dans les engagements pris par le Gouvernement de tripler le montant de cette agence en faveur des PME. S'agissant des dépenses fiscales, qui constituent l'essentiel de l'appui en direction des entreprises, il convient de noter que l'essentiel de celles-ci, qui ne constituent que des projections fondées sur les résultats obtenus en 2004 et 2005, provient des prévisions de recettes attendues du crédit d'impôt en faveur de la recherche (900 millions d'euros). Il apparaît regrettable que le ministère de l'économie, des finances et du budget, probablement absorbé par les travaux d'élaboration du projet de loi de finances pour 2007, n'ait pas disposé de la disponibilité nécessaire à la préparation du rapport sur l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépense de recherche qu'il devait remettre au Parlement avant le 1er octobre de cette année, conformément à l'article 34 de la loi de programme pour la recherche. Il eut été du plus haut intérêt pour la représentation nationale de disposer des éléments d'information sur la ventilation sectorielle des répercussions de cette mesure fiscale pour pouvoir en apprécier l'impact auprès tant des entreprises en fonction de leur taille que de la recherche en fonction du type de dépense ouvrant droit à ce crédit d'impôt (recherche fondamentale, recherche et développement, innovation, etc.). Il appartiendra au Parlement de se montrer particulièrement attentif au respect dans l'avenir de l'échéancier et des engagements financiers pris en faveur de la recherche. La politique volontariste qui se dégage de la loi de programme doit impérativement devenir opérationnelle, car elle conditionne non seulement l'avenir de la recherche, mais aussi par son impact sur les entreprises l'adaptation de notre économie aux défis de la mondialisation. La loi de programme pour la recherche a non seulement donné de nouveaux moyens financiers à la recherche, elle a aussi reformé profondément l'organisation de la recherche de façon à insuffler les grandes orientations pour l'avenir. C'est ainsi qu'elle a organisé la recherche autour de plusieurs organismes à qui elle a donné mission de piloter une recherche s'inscrivant dans le long terme. Il convient ici de noter le commentaire critique formulé par le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale : « Bien que le sujet ne relève pas de la loi, on peut toutefois regretter que le Gouvernement n'ait pas profité du grand débat sur la recherche pour introduire une réflexion approfondie sur le pilotage ministériel de la recherche. À l'évidence, la mise en place d'un Haut conseil n'épuise pas le sujet de la gouvernance du dispositif de recherche français et ne contrebalance pas l'émiettement de la thématique de la recherche dans l'organigramme gouvernemental » (Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, n° 2888-AN). - Le Haut Conseil de la Science et de la technologie Organisme consultatif, dénué de la personnalité morale, placé auprès du Président de la République et chargé d'éclairer l'exécutif sur les orientations en matière de politique de recherche et d'innovation. Il est composé de 12 à 20 personnalités qualifiées désignées par le Président de la République en raison de leur compétence scientifique et technologique. Il est doté du pouvoir de s'autosaisir de toute question intéressant la recherche. Il doit veiller à « assurer la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace européen de la recherche ». - L'Agence d'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Remplaçant le comité national d'évaluation et le conseil national d'évaluation de la recherche, l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES) a le statut d'une Autorité administrative indépendante. Son président est nommé parmi les 25 membres du conseil d'administration, composé de personnes reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifique et qui peuvent être « français, communautaires ou internationaux » (art L. 114-3-3 du code de la recherche) et se décomposent en : - 9 personnalités qualifiées dont le tiers au moins issu de la recherche privée ; - 7 membres nommés sur proposition des dirigeants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ; - 7 membres sur proposition des instances d'évaluation des personnels universitaires et des établissements publics à caractère scientifique et technique (ces instances internes à certains organismes subsistent, l'Agence doit s'appuyer sur eux) - 2 parlementaires membres de l'Office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Avec la création de l'AERES, le Gouvernement et la Représentation nationale ont pris le parti d'insuffler à la recherche française une véritable culture de l'évaluation. Au cours des débats, s'est exprimée une volonté forte en ce sens, le statut d'autorité administrative indépendante de ce nouvel organisme lui confère ainsi tous les pouvoirs, au vu des évaluations, de remettre en cause des situations acquises. - L'Agence Nationale de la Recherche Constituée d'abord sous forme de groupement d'intérêt public, l'Agence nationale de la recherche (ANR) est un établissement public d'État à caractère administratif placé sous la tutelle du Ministère de la Recherche. Ayant une mission d'agence de financement de projets de recherche, l'ANR reprend les actions incitatives anciennement dévolues au Fonds national de la science et au Fonds de la recherche technologique. Elle est dirigée par un conseil d'administration composé : - du président du Haut Conseil de la Science et de la Technologie ; - de 6 représentants de l'État ; - de 5 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique et nommées par arrêté du ministre de la recherche. - L'Agence pour l'innovation industrielle Établissement public industriel et commercial placé sous la double tutelle du ministère de l'économie et des finances et du ministère de l'industrie, l'Agence pour l'innovation industrielle (AII) est dirigée par un directoire de trois membres, placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance présidé par M. Jean-Louis Beffa et qui comprend 13 personnalités qualifiées (dont 3 représentants d'organisations professionnelles ou syndicales) et 7 représentants de l'État. À noter la présence des présidents des conseils d'administration d'OSEO et de l'ANR avec voix consultative lors des réunions du conseil de surveillance Le directeur général des entreprises du ministère de l'économie et des finances, commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement, peut notamment s'opposer aux délibérations. L'agence bénéficie du concours administratif de la Caisse des Dépôts (gestion du personnel, du contentieux...). Son financement est principalement assuré par des concours financiers de l'État ; elle a reçu en 2006 3 millions d'euros (programme « recherche industrielle » de la mission « recherche ») au titre de ses moyens de fonctionnement mais également une dotation en capital d'un milliard d'euros financée par les recettes des cessions de titres du secteur public. Cependant, il est prévu qu'un investissement du secteur privé équivalent aux moyens de l'Agence ait vocation à financer les programmes soutenus de sorte que ceux-ci devraient bénéficier au total d'une capacité d'investissement double de la dotation financière de l'État. - Oseo Anvar Société anonyme, l'Oseo Anvar est une filiale de l'établissement public industriel et commercial OSEO placée sous la double tutelle des ministères des finances et de l'industrie. Oseo Anvar reçoit de l'État une subvention de fonctionnement (en 2006, 43 millions d'euros) et une subvention d'intervention (de 75 millions d'euros en 2006), relevant toutes deux du programme « recherche industrielle » de la mission « recherche ». Oseo Anvar doit également bénéficier d'une dotation en capital de 60 millions d'euros financée par les recettes des cessions de titres du secteur public. Les aides attribuées par Oseo Anvar prennent la forme d'avances remboursables ou de subventions. Oseo Anvar peut également intervenir comme investisseur sous la forme de bons de souscription d'actions. L'articulation de ces différents organismes est notamment retracée dans l'organigramme synoptique ci-après qui s'efforce de présenter les liens entre les grands organismes intervenant dans le domaine français de la recherche. Tracer les grandes orientations de la politique de recherche et doter la recherche des outils financiers indispensables à son développement constituent des objectifs louables, mais faire en sorte de créer au sein des chercheurs et dans la population une dynamique en faveur de la recherche représente un volet non moins important des défis politiques qu'il convient de relever. En ce sens, la loi de programme pour la recherche pourrait s'apparenter, selon les termes même du ministre Gille de Robien à une véritable « boite à outils » contenant l'ensemble des instruments nécessaires à un décollage de la recherche française. Mettre à la disposition des artisans de la recherche les outils adaptés à la réussite de la politique dessinée constitue un préalable. Il appartient aussi aux pouvoirs publics d'y joindre un mode d'emploi et de fournir une assistance technique à leur utilisation. Atteindre l'excellence dans un domaine particulier, y occuper la place convoitée de leader, suppose d'abord une dynamique d'équipe, mais aussi des équipiers sur lesquels le collectif peut compter. La réussite de l'équipe ne saurait être garantie si son entraîneur n'a pas la capacité de la dynamiser et de donner à tous ses membres la volonté farouche d'être parmi les tous meilleurs, voire d'être les meilleurs. L'on peut certes figurer parmi les meilleurs, mais encore faut-il être reconnu par ses pairs pour tel. C'est pourquoi, l'une des voies à suivre pour dynamiser la recherche passe tout naturellement par la valorisation de ses résultats. Si la recherche privée peut facilement mesurer la qualité de ses travaux par les résultats commerciaux des entreprises dont elle dépend, il semble toutefois que la culture de valorisation est encore pour partie largement étrangère aux établissements publics de recherche. La France compte neuf établissements publics à caractère scientifique et technologique (CNRS, Inserm, etc.) qui ont d'ores et déjà constitué leurs structures de valorisation en société filiales, se mettant ainsi à l'abri de contentieux fiscaux. Tel n'est pas le cas du monde universitaire qui a eu bien souvent recours à la création d'associations loi 1901 et a dû faire face à des problèmes fiscaux dès lors que l'association poursuivait un but lucratif en valorisant les travaux réalisés par les universitaires. En offrant aux structures de valorisation la possibilité d'être rattachées aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur et aux réseaux thématiques de recherche avancée, la loi de programme dote la recherche universitaire de moyens réels de valorisation de ses résultats. Dynamiser la recherche passe également par la valorisation des travaux et des compétences individuelles. Trop longtemps, la valorisation par un chercheur de ses compétences a été considérée comme une sorte de détournement des moyens publics mis à sa disposition par l'établissement public qui l'employait. La loi de programme bouscule dans ce domaine également les comportements et les mentalités en ce qu'elle assouplit les conditions d'application du régime des consultations, les dispositifs permettant la mobilité des chercheurs et les facultés offertes en vue de la création d'entreprise par les chercheurs. La création du label Carnot, constitue également un outil mis à la disposition des structures publiques et parapubliques désireuses de valoriser leurs travaux. L'obtention du label suppose que l'auteur de la demande de labellisation démontre sa capacité à atteindre certains objectifs en terme de compétences technologiques, capacité à conduire des projets complexes en tenant des délais, avoir des liens avec la recherche académique et avoir déjà établi des partenariats avec le secteur économique. La dynamisation de l'innovation passe aussi par un accroissement des moyens dont dispose les entreprises innovantes. Comme le préconise Jean-Paul Betbèze dans le rapport qu'il a préparé en 2005 pour le Conseil d'analyse économique « Financer la recherche » il serait intéressant d'assouplir et de réorienter les fonds communs de placement dans l'innovation en allongeant de 2 à 3 ans la durée d'investissement, en faisant passer la limitation de détention par le porteur ou sa famille de 35 à 60 %. Ces mesures auraient pour effet de réorienter la capacité d'investissement des investisseurs institutionnels vers le financement de l'innovation. Il propose en outre « d'appliquer les principes des FCPI à des fonds souscrits par des investisseurs institutionnels et qui leur permettraient de bénéficier d'avantage (fiscaux ou autres) ». Enfin, il convient de souligner la création récente, au sein du ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. À l'instar de l'Institut des hautes études de défense nationale, ce lieu de réflexion stratégique sur les questions scientifiques et technologiques constituera un forum qui contribuera à la diffusion d'une culture de la recherche et de l'innovation dans la société. La « boîte à outil » permettant de dynamiser la recherche privée compte déjà un large éventail d'instruments qu'il convient d'aménager pour atteindre une meilleure participation privée au financement de la recherche. DISPOSITIF FRANÇAIS DE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE 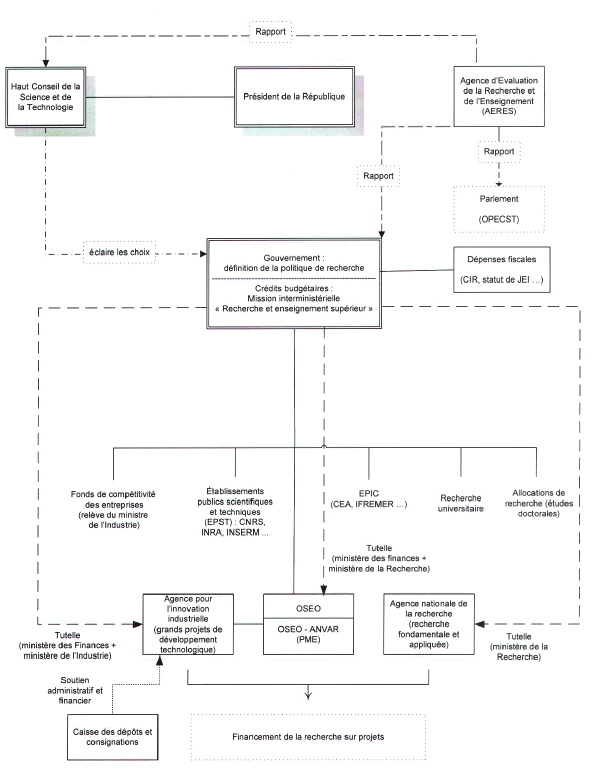 NB : La mission interministérielle « recherche et enseignement supérieur » au sens de la LOLF regroupe les crédits affectés aux différents programmes gérés par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de l'écologie et du développement durable, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministère de l'équipement, le ministère de la défense, le ministère de la culture et de la communication et le ministère de l'agriculture. d) Le crédit d'impôt recherche La création du crédit d'impôt recherche remonte à 1983. Afin de favoriser les investissements dans la recherche des entreprises et l'emploi des jeunes chercheurs dans le secteur privé, il a été profondément modifié par les lois de finances pour 2004 et 2006. Il s'agit d'un mécanisme d'incitation fiscale au développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises, prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts. Bénéficient du régime du crédit d'impôt recherche les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées selon un régime réel qui effectuent des dépenses de recherche. Parmi les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche figurent les amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche, les rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche, les dépenses de fonctionnement, les coûts des opérations de recherche sous-traitée, les frais de brevets, les dépenses de veille technologique, les dépenses de normalisation ainsi que les frais de collection des entreprises du secteur textile-habillement. Le crédit est imputé sur l'impôt dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées. Son montant est égal à la somme de 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, et de 45 % de la variation des dépenses de l'année comparée à la moyenne des dépenses exposées au cours des deux années précédentes, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac. Le crédit d'impôt est plafonné à 8 millions d'euros par an pour chaque entreprise. Selon les statistiques publiées par le ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, en 2004, dernier exercice connu, 6 369 entreprises ont bénéficié du crédit d'impôt recherche. Le montant des dépenses de recherche déclarées a atteint 11,6 milliards d'euros et le montant total du crédit d'impôt correspondant s'est élevé à 890 millions d'euros, soit 7,6 % du total des montants de dépenses de recherche déclarées. Le nombre de déclarants s'est progressivement élevé depuis sa création pour atteindre un pic de près de 9 000 entreprises autour des années 1990, pour redescendre lentement au niveau de 6 000 entreprises en 2003, tendance qui s'est inversée à compter de 2004, suite aux effets des modifications apportées par la loi de finances pour 2004. Dans un même temps le montant des dépenses de recherche déclarées a connu une augmentation continue passant de 6 milliards d'euros en en 1987 au pic de 11,67 milliards d'euros en 2002. Paradoxalement, le montant du crédit d'impôt accepté devait demeurer approximativement stable au cours des dix dernières années évoluant entre 450 millions et 500 millions d'euros. L'analyse des déclarations fiscales des dépenses de R&D permet de mieux connaître leur répartition. Ainsi, en 2004, les dépenses de personnel représentaient 39,27 % du total des dépenses, les dépenses de fonctionnement, 29,54 %, les opérations confiées a des organismes agréés, 22,44 %, les dotations aux amortissements, 5,06 %, les frais de brevets, 2,05 %, les frais de collections des entreprises industrielles du secteur textile-habillement, 1,39 %, les dépenses jeunes docteurs, 0,15 %, la veille technologique, 0,06 % et les dépenses de normalisation 0,03 %. Enfin, il apparaît que les PME de 50 salariés au plus déclarent environ 9 % des dépenses totales de R&D et bénéficient d'un crédit d'impôt représentant 20 % du montant total du crédit d'impôt accordé ; les entreprises ayant un effectif salarié compris entre 51 et 250 salariés, déclarent 9 %des dépenses de R&D et bénéficient de 13 % du crédit d'impôt ; les entreprises comptant entre 251 et 500 salariés déclarent environ 15 % des dépenses de R&D et bénéficient de 14 % du crédit d'impôt ; les entreprises salariant entre 501 et 2 000 personnes déclarent 19 % des dépenses et bénéficient de 21 % du crédit d'impôt, et les entreprises de plus de 2 000 salariés déclarent 42,5 % de l'ensemble des dépenses de R&D et bénéficient de 47 % du montant de crédit d'impôt accordé. Le régime du crédit d'impôt recherche devait connaître encore de nouveaux aménagements. À l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2007, la Commission des finances de l'assemblée nationale a adopté un amendement visant à encourager la valorisation de l'innovation, en notamment des PME puisqu'il propose d'admettre au bénéfice du crédit d'impôt recherche les frais de prise et de maintenance, ainsi que les frais de défense des marques et dessins et modèles. Plus directement en relation avec le développement de la recherche et de l'innovation d'autres aménagements du régime du crédit d'impôt recherche apparaissent hautement souhaitables : - tout d'abord, il conviendrait d'améliorer les dispositions du crédit d'impôt recherche relatives à l'emploi de personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent. Dans sa rédaction actuelle, issue de l'article 22 de la loi de finance pour 2006, les dépenses de fonctionnement qui se rapportent à l'emploi de docteurs sont évaluées forfaitairement à 200 % de leur coût, pendant les 12 premiers mois suivant leur premier recrutement sous réserve que les personnels ouvrant le bénéfice du crédit d'impôt soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente. Ce dispositif constitue un frein à l'embauche et à la mobilité souhaitée des chercheurs. En effet, l'exigence de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée manque de cohérence avec les dispositifs qui ont été créés par ailleurs et qui favorisent plutôt la notion de projets et de poursuites d'objectifs, actions qui ont par nature une portée limitée dans le temps et non une durée indéterminée. Sans doute serait-il plus réaliste et plus en phase avec la politique de la recherche définie par le Gouvernement de subordonner le bénéfice du crédit d'impôt à la signature d'un contrat de travail comprise entre 12 et 18 mois. En outre, un tel aménagement faciliterait la mobilité entre l'industrie et les organismes publics de recherche, tout en permettant aux entreprises de renforcer leur potentiel scientifique ; - ensuite, mais cela suppose préalablement que la Commission européenne fasse évoluer sa position sur ce point, il serait intéressant de moduler le crédit d'impôt recherche en fonction des secteurs économiques. Cette proposition qui avait été présentée dans le rapport Mc Kinsey, offrirait si elle était suivie d'effets, la possibilité de dynamiser, temporairement du moins, certains domaines d'activités jugés prioritaires car particulièrement porteurs d'avenir. Le choix de ces secteurs économique pourrait intervenir, pour plus de garanties, après avis soit du Haut conseil de la science et de la technologie, soit de l'agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. e) Le renforcement de l'attractivité des jeunes entreprises innovantes (JEI) Ce dispositif, mis en place par la loi de finances pour 2004, permet aux jeunes et petites entreprises (créées depuis moins de huit ans et qui engagent des dépenses de R&D représentant au moins 15 % de leurs charges) directement impliquées dans le secteur de l'innovation de bénéficier d'allégements fiscaux et sociaux. Sous réserve des conditions d'âge et de volume des dépenses de recherche déjà citées, la JEI doit être une PME (moins de 250 salariés et un chiffre d'affaire réalisé inférieur à 45 millions d'euros) indépendante, réellement nouvelle (ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité). Dès lors qu'elle satisfait à l'ensemble des critères énoncés, la JEI peut bénéficier d'une exonération totale des bénéfices pendant une durée de trois années, suivie d'une exonération partielle de 50 % les deux années suivantes. Sur délibération des collectivités locales, elles peuvent bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. La JEI est également exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests pré-concurrentiels. Les exonérations portent sur l'ensemble des cotisations : maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accident du travail et maladies professionnelles. f) En termes de simplifications administratives Les personnalités ayant à connaître du monde de la recherche qui ont été auditionnées par la Mission d'information ont souligné que les procédures pesant sur la gestion des établissements de recherche constituaient de lourdes contraintes, auxquelles leurs homologues étrangers ne sont pas soumis. Elles sont donc vécues comme autant d'entraves au bon fonctionnement de notre système de recherche gênent son efficacité. L'une des contraintes dont se plaignaient fréquemment les chercheurs des organismes publics tenait aux difficultés auxquelles ils se trouvaient confrontés par l'application à leurs approvisionnements particuliers du fait de la rigidité du code des marchés publics. Cette contrainte est en partie levée du fait de l'entrée en vigueur, à compter du 1er septembre 2006 d'une nouvelle version dudit code. En effet, par une application combinée des articles 35 et 40 du code, les marchés et accords-cadres de fournitures concernant des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dont le montant est supérieur ou égal à 4 000 euros sont dispensés de publicité. Même s'ils restent soumis, par ailleurs, au respect des autres procédures définies par le code, cette disposition a pour effet de réduire certains délais d'approvisionnements des organismes de recherche. Se pose toutefois la question de la cohérence des dispositions du code des marchés publics avec les mesures qui ont été prises par le Gouvernement et dont certaines figurent dans la loi de programme pour permettre la valorisation des travaux des organismes publics de recherche dès lors qu'il pourra être considéré par le juge administratif que l'absence d'objectif de rentabilité ne serait plus remplie, sauf à ce que celui-ci considère que la loi de programme est une norme juridique supérieure au code des marchés publics, qui résulte d'un simple acte réglementaire. Toutefois, la difficulté majeure à laquelle se heurte la recherche, publique et privée, résulte de la multiplicité des instances gouvernementales, régionales, départementales et administratives intervenant dans la mise en œuvre de la politique de recherche. Il suffit pour s'en rendre compte de consulter la liste des signataires de la loi de programme pour la recherche. Outre le Président de la République, la loi publiée est recouverte de la signature de dix membres du Gouvernement. Bien évidemment ces instances nationales ont des relais au niveau territorial, régions et départements qui doivent composer avec les mesures prises localement par les collectivités territoriales. Il y a tout lieu de s'interroger, face à cet empilage de strates diverses et variées, sur la possibilité de mettre en œuvre une politique cohérente de recherche. C.- LA RECHERCHE DOIT FACILITER L'ADAPTATION À L'INTERNATIONALISATION DE L'ÉCONOMIE Les moyens dont dispose désormais la recherche, tels qu'ils découlent de la loi de programme, devraient permettre une rénovation en profondeur l'édifice français de recherche et faciliter son adaptation à l'internationalisation de l'économie. 1. Recherche fondamentale et recherche appliquée doivent ensemble mieux concourir Sous l'impulsion des organismes mis en place, au premier rang desquels figure le Haut conseil de la science et de la technologie, la communauté des chercheurs se doit de dépasser les clivages traditionnels qui les ont trop souvent opposés pour participer ensemble à l'ascension de la recherche française vers l'excellence. L'ensemble des nouvelles structures tient compte de la nécessité d'associer étroitement recherche privée et recherche publique. Il appartient désormais au monde de l'entreprise et à celui de la recherche académique de joindre leurs compétences. L'économie de la connaissance, dont recherche fondamentale et recherche appliquée constituent les deux piliers, est au centre des transformations des économies contemporaines, dans lesquelles la dimension scientifique et technologique prend chaque jour une place plus importante. Des résultats conjugués de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dépendent désormais la structure des coûts de production et de commercialisation. Dans un monde ou le rythme d'innovation est particulièrement soutenu et où la concurrence est ardue, il incombe à la communauté scientifique dans son ensemble participer, en liaison avec le pouvoir politique, à la définition des orientations majeures qui seront de nature à préparer l'économie française et européenne aux priorités futures. Parce qu'ils sont au contact permanent des technologies en devenir, les chercheurs sont à même de discerner les plus porteuses d'avenir et d'alerter suffisamment en amont de façon à orienter les décisions stratégiques. Comme le notait fort justement M. Claude Birraux dans son rapport pour avis fait au nom de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi de programme pour la recherche (rapport n° 2879-AN) : « Au-delà du besoin de renouvellement des équipements, le maintien de la demande, et donc de la croissance et de l'emploi, ne peut plus être, dans ces conditions, une simple affaire de pouvoir d'achat permettant l'écoulement d'une production de masse standardisée : l'offre doit désormais aussi entretenir cette demande en se diversifiant en permanence, par la mise au point de procédés permettant d'abaisser le prix, par l'ajout d'éléments ou de services accroissant la qualité, par la mise au point de fonctionnalités nouvelles ». L'effort d'innovation qui sous-tend ce constat démontre, s'il en était besoin, combien recherche appliquée et recherche fondamentale sont et seront de plus en plus imbriquées et détiennent non seulement deux formes complémentaires du savoir, mais au-delà, une place privilégiée dans l'élaboration des prochaines productions et des futurs services qui seront les clefs de l'économie. L'objectif de renforcer les pôles et secteurs technologiques d'excellence est une préoccupation politique constante qui a conduit à la création de nombreuses structures tendant à faciliter l'émergence d'une dynamique d'innovation efficace. 2. Quelle place pour les centres régionaux d'innovation et de transfert technologique ? Les centres régionaux d'innovation et de transfert technologique (CRITT) ont été créés au début des années 1980, sous l'égide du ministère ayant en charge la recherche, en partenariat avec les collectivités territoriales. Leur création répondait à l'objectif de faire progresser le niveau technologique des PME-PMI, en s'appuyant sur les compétences disponibles dans les établissements publics de recherche ou d'enseignement, situés dans leur environnement culturel économique et industriel. Conçus comme une véritable interface entre la recherche et les entreprises, les CRITT constituent le plus généralement des structures de taille modestes (entre 5 et 50 personnes). Très souvent implantés dans les métropoles régionales, où se trouve réuni le potentiel de formation et de recherche, les CRITT sont régis par un statut juridique de type « association loi de 1901 ». Chargés de conduire des missions concrètes, en particulier des prestations facturées aux entreprises, ils accompagnent celles-ci dans la conduite de projets en d'appuyant sur les compétences et la proximité concentrées dans les centres et laboratoires de recherche appropriés. Ils offrent ainsi une palette de prestations ciblées allant du simple essai ou mesure, en passant par la mise au point de procédés technologiques innovant, jusqu'au contrat de recherche-développement. Les CRITT figurent au nombre des partenaires privilégiés de l'État dans la mise en œuvre de soutien et de diffusion de l'innovation technologique. La plupart des CRITT sont financés dans le cadre des contrats de plan État-région, l'État apportant un soutien financier à leur fonctionnement. On dénombre aujourd'hui près de deux cents CRITT ou structures analogues répartis sur l'ensemble du territoire, département d'Outre-Mer compris. Ils relèvent soit des CRITT « interfaces », qui comprennent un ou plusieurs conseillers en développement technologique ayant pour mission d'orienter les entreprises vers les centres de compétences appropriés à leurs projets innovants, et les CRITT « prestataires », qui ont pour activité principale de répondre à la demande des entreprises en leur fournissant des prestations leur permettant d'accéder à des technologies qu'elles n'ont pas les moyens de développer ou qu'elles ne maîtrisent pas. Cette complémentarité et cette mutualisation des moyens au niveau régional constituent un apport non négligeable à l'indispensable synergie qui doit résulter d'un partenariat entre le secteur public de la recherche et les entreprises. Toutefois, leurs missions doivent mieux s'articuler avec celles des pôles de compétitivité, lorsqu'il y a coexistence géographique de ces deux types de structures. Qui plus est, la faiblesse de l'effort privé de recherche demeure vingt-cinq années après leur création, ce qui conduit à recommander que soit diligenté un audit sur les centres régionaux d'innovation et transfert technologique afin de recentrer leurs actions sur leurs missions, éviter les doublons structurels et mutualiser, chaque fois que cela est possible, leurs moyens avec ceux des pôles de compétitivité. 3. Les pôles de compétitivité : un outil au service de l'innovation C'est dans ce contexte qu'il convient de replacer la constitution de pôles de compétitivité par le Comité interministériel de l'aménagement et du développement du territoire (CIADT) du 14 septembre 2004. Cette décision, qui faisait suite aux orientations définies par le Gouvernement en décembre 2002, visait à mettre en œuvre la conduite d'une nouvelle politique industrielle ayant pour objectifs : le renforcement des spécialisations de l'industrie française, la création de conditions favorables à l'émergence de nouvelles activités à forte visibilité internationale, tout en améliorant l'attractivité des territoires et en luttant contre les délocalisations. L'ambition affichée de cette nouvelle politique industrielle visait à faire converger les moyens publics et privés pour conforter les divers agents économiques dont l'activité est dédiée à un marché final commun, en encourageant des partenariats productifs de valeur entre les entreprises, les centres de recherche, technologiques et d'essai ainsi que les organismes de formation. Il ne s'agissait pas, selon le communiqué du CIADT, « de juxtaposer, comme on l'a fait par le passé, ces différents acteurs en comptant sur une "main invisible" pour parvenir à ses effets positifs, mais de fonder les pôles sur des stratégies de développement économique à moyen terme, nourries par des projets concrets, conçus et conduits en commun et garantissant une visibilité internationale ». La création d'un pôle de compétitivité, notion qui emprunte beaucoup à celle des « clusters » inventée par M. Michel Porter et à l'origine de la « Silicon valley » ainsi que du renouveau du pays Basque espagnol, suppose la combinaison sur un même territoire, d'une part, d'entreprises, de centre de formation et d'unités de recherche et, d'autre part, de partenariat, de projets de R&D et visibilité internationale, éléments auxquels il convient d'ajouter une volonté politique incluant les acteurs publics territoriaux et nationaux. À ce jour, la France compte soixante-six pôles de compétitivité correspondant soit à des projets à vocation mondiale, soit à des projets à vocation nationale ou régionale. Il convient de noter que ce concept a suscité un engouement très important et que pas moins d'une centaine de groupements se sont porté candidats à la labellisation comme pôle de compétitivité. Ces pôles de compétitivité constituent un progrès notable, même si l'enveloppe globale qui leur est affectée, 1,5 milliard d'euros sur trois ans, est nécessairement limitée lorsque l'on prend chaque pôle individuellement. Pour autant, ces pôles sont de nature à exercer d'une part un effet de levier très positif et d'autre part à habituer tous les acteurs d'une même région à travailler ensemble. Afin de renforcer le rôle et la place occupés par les PME dans le fonctionnement des pôles de compétitivité et pour accroître l'attractivité que ceux-ci peuvent exercer sur les entreprises, le ministre délégué à l'industrie a prévu que toute firme membre d'un pôle dont le projet a été accepté bénéficiera d'une subvention du fonds interministériel pour les pôles de compétitivité à hauteur de 30 % des dépenses réellement effectuées. Les soixante-six pôles de compétitivité sont répartis sur l'ensemble des régions françaises, répondant ainsi aux spécificités des différents secteurs industriels développés localement. Les pôles de compétitivité français concernent la quasi-totalité des secteurs industriels dans lesquels la France a su développer une tradition et un savoir faire incontestable et les PME sont, selon le ministre délégué à l'industrie porteuse de 30 % des projets retenus. Ils se répartissent ainsi : - Aéronautique, spatial, défense, mer : 3 ; - Agriculture, agro alimentaire : 12 ; - Automobile, ferroviaire, propulsion : 3 ; - Biotechnologie, santé, nutrition : 7 ; - Énergie : 6 ; - Équipement du foyer et de la personne : 4 ; - Imagerie, multimédia : 4 ; - Logiciel, électronique, télécommunications : 5 ; - Logistique et mobilité : 6 ; - Matériaux, plasturgie, chimie : 5 ; - Mécanique, microtechnique : 3 ; - Procédés industriels, maîtrise des risques : 4 ; - Textile : 3 ; - Divers (filière équine) : 1. D'autres mesures peuvent compléter utilement cette politique. À terme, au vu des résultats, les pôles ayant obtenu le plus de succès pourraient bénéficier d'une certaine concentration des moyens. 4. Les pôles d'excellence rurale, un complément indispensable des pôles de compétitivité Pour soutenir les dynamiques d'initiative rurale et encourager l'innovation, l'État a décidé d'apporter un nouveau soutien aux projets qui émanent des territoires ruraux. C'est l'ambition de la politique des « pôles d'excellence rurale ». Un appel à projets national a été lancé. Cet appel à projets s'adresse aux zones de revitalisation rurale et aux communes qui ne sont pas situées dans une aire urbaine de plus de 30 000 habitants. Il doit permettre de labelliser et de soutenir 300 projets en 2006, en deux vagues successives de sélection. Quatre priorités sont définies. Les projets devront se rattacher au moins à l'une d'entre elles : 1. Des pôles d'excellence pour la promotion des richesses naturelles, culturelles, et touristiques. 2. Des pôles d'excellence pour la valorisation et la gestion des bio ressources. 3. Des pôles d'excellence pour l'offre de services et l'accueil de nouvelles populations. 4. Des pôles d'excellence technologique, pour des productions industrielles, artisanales et de services localisées. Pour être labellisés, les projets de « pôles d'excellence rurale » devront répondre aux caractéristiques suivantes : 1. Une ambition en matière d'emploi. 2. Une priorité au développement territorial durable. 3. Un ancrage rural fort. 4. Une conduite de projet multi partenariale. 5. Une place affirmée à l'innovation. Le 23 juin 2006, le Gouvernement a annoncé l'attribution du label Pôle d'excellence rurale à 175 pôles. Ces 175 pôles représentent un investissement total de plus de 570 millions d'euros dont une participation de l'État de 128 millions d'euros. Les entreprises privées partenaires de ces 175 pôles se sont engagées sur la création d'un peu plus de 7 000 emplois. Par ailleurs les emplois indirects sont évalués par les porteurs de projets à 25 000. Les pôles relatifs au tourisme et au patrimoine sont les plus nombreux avec 78 pôles sur les 175. Les pôles concernent ensuite : les bio ressources (32 pôles), l'accueil et les services (26), les filières technologiques (27) et 12 autres pôles regroupant plusieurs de ces thématiques. Les pôles proviennent de tout le territoire national : 82 départements métropolitains et les 4 départements d'Outre-Mer sont concernés. 5. Activer au plus tôt les pôles de recherche et d'enseignement supérieurs (PRES) Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur constituent l'une des innovations de la loi de programme pour la recherche. Leur création a pour ambition de regrouper sur un même territoire, ou ay sein d'une aire géographique pertinente l'ensemble des acteurs de la recherche à mettre en commun tout ou partie de leurs ressources. Il est également prévu que selon les cas, puissent être créées des articulations avec les pôles de compétitivité. Le système des PRES repose exclusivement sur la libre initiative des acteurs de terrain. 6. Accélérer la mise en place des réseaux thématiques de recherche avancée (RTRA) Les réseaux thématiques de recherche avancée devraient constituer une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par les équipes de recherches françaises à occuper une position de leader dans leurs spécialités, malgré l'excellence dont elles sont capables. Dans le cadre des RTRA, les différents établissements, publics et/ou privés, pourront nouer des coopérations de manière à assurer une maîtrise parfaite d'un procédé, ce qui constitue un avantage économique déterminant. Treize dossiers, parmi les 37 soumis ont été examinés par un comité d'évaluation, ont été retenus pour constituer le fer de lance de ce partenariat entre établissements publics et privés de recherche. Les projets retenus concernent des secteurs aussi variés que les mathématiques, l'informatique, la biologie, les neurosciences, les infections, l'économie, les nanosciences, l'aéronautique, la chimie et les sciences économiques. Au titre du budget pour 2007, les RTRA créés sous le statut de fondations de coopération scientifique leur permettant d'allier la souplesse de recrutement et de gestion de structures privées, tout en bénéficiant de fonds publics, devraient se partager une enveloppe de près de 200 millions d'euros de financement de l'État. 7. Faciliter la création de groupements d'intérêt économique (GIE), une voie à explorer Créés par l'ordonnance du 23 septembre 1967, les GIE sont des personnes morales de droit privé dotés d'un statut juridique particulièrement souple permettant à plusieurs personnes physiques ou morales de se regrouper, pour une durée déterminée, en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres et d'améliorer les résultats de cette activité. Cette formule, qui depuis la loi du 30 juin 1989 (loi n° 89-377 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique) autorise le GIE à accomplir tous les actes de commerce pour son propre compte, offre une opportunité, peu utilisée, aux entreprises d'un même secteur économique qui souhaiteraient se regrouper afin de créer un laboratoire ou un centre d'essai commun pour faciliter l'innovation dans un domaine technologique. Une telle structure pourrait fédérer ainsi autour d'intérêts communs un donneur d'ordre et ses sous-traitants, chacun retirant les bénéfices des inventions complémentaires nécessitées par la conception d'un système technologique nouveau faisant intervenir la production du donneur d'ordre et des sous-traitants. De même dans un même bassin d'activités, des PME œuvrant dans des domaines complémentaires pourraient avoir intérêt à développer ensemble, dans le cadre d'un GIE une technologie particulière, sur un projet déterminé dans un temps limité. De nombreux GIE ont déjà été constitués dans le domaine de la recherche et du développement technologique, constitués principalement des grands groupes industriels et des organismes publics, mais peu de PME s'y sont associées ou ont eu recours à ce type de structures qui suppose un investissement financier, le partage des connaissances et la volonté de travailler ensemble. Afin de faciliter la constitution de GIE permettant de financer collectivement des recherches innovantes, sans doute conviendrait-il de rendre éligible au crédit d'impôt recherche, tout ou partie, des investissements réalisés par les PME dans ce type de GIE, sous réserve que les entreprises concernées ne bénéficient pas déjà des mesures d'allégement d'impôts prévues en faveur des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité et participant à un projet de recherche et de développement agréé (exonération d'impôt sur les bénéfices pour les trois premiers exercices bénéficiaires et application d'un abattement de 50 % au titre des deux exercices bénéficiaires suivants ; exonération totale d'imposition forfaitaire annuelle ; sur, délibération des collectivités territoriales, exonération pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle). 8. Rendre plus attractives les carrières de chercheurs Bien que la France possède un système de formation performant avec ses universités et ses grandes écoles, le nombre de chercheurs ne s'élève, en France, qu'à soixante-cinq pour dix mille habitants, contre quatre-vingt-onze au Japon et quatre-vingt aux États-Unis. Les pays émergents, comme la Chine, et l'Inde ont massivement investi dans leurs systèmes de formation et, chaque année, ce sont près de 600 000 ingénieurs indiens et 800 000 ingénieurs chinois qui alimentent notamment les organismes de recherche de ces pays. Dans un même temps, comme le soulignait M. Érik Orsenna devant la Mission d'information : « à la fin de leur parcours universitaire, les étudiants français délaissent la recherche pour des emplois plus administratifs. Plus grave, il n'est pas rare que face au peu d'attractivité des rémunérations offertes et au manque de moyens de nos laboratoires, on assiste à une fuite des cerveaux nouvellement formés vers d'autres pays ». Comme le soulignait le Président Jean-Michel Dubernard dans son rapport fait, au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi de programme sur la recherche (n° 2888 AN) « les carrières de la recherche sont en souffrance. À l'université, les inscriptions dans les cycles de sciences dites ″ dures ″ sont en baisse. À l'autre bout de la chaîne la ″ fuite des cerveaux ″, même en l'absence de statistiques précises, devient une réalité tangible. Tous les directeurs de laboratoires (qu'il avait auditionnés) ont déclaré avoir perdu des doctorants ou des post-doctorants, parmi les meilleurs, partis tenter leur chance à l'étranger, principalement aux États-Unis et au Canada. ». Il constatait, par ailleurs, que « La France attire moins les chercheurs étrangers, jeunes ou moins jeunes. Dans un marché devenu mondial, elle n'est plus capable de leur offrir ni les meilleures conditions de travail ni les plus belles opportunités de carrière, là ou la Grande-Bretagne compte un tiers de docteurs étrangers dans ses universités et où 46 % des thèses en sciences et ingénierie soutenues aux États-Unis le sont par des citoyens étrangers ». Ce double constat réaliste trouve notamment son explication dans le faible niveau de rémunération offert par les organismes de recherche français. Philippe Kourilsky, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, estimait que le niveau de rémunération français est inférieur de 50 % à la norme internationale pour les jeunes, écart qui se creuse ensuite pour atteindre un rapport de un à deux voire quatre pour les stars de la discipline. (38) Pleinement conscient de l'enjeu que constitue pour un pays comme la France le fait de former des élites et de les conserver sur son territoire, le Gouvernement a d'ores et déjà pris un certain nombre de mesures propres à revaloriser la situation des chercheurs. Le premier levier pour accroître l'attractivité des carrières scientifiques est constitué par des actions fortes en faveur du doctorat. C'est ainsi qu'afin d'encourager les étudiants à se diriger vers le doctorat, le montant de l'allocation de recherche a été revalorisée de 6 % au 1er janvier 2006 et devrait être revalorisée de façon identique au 1er janvier 2007. L'amélioration des conditions de rémunération des chercheurs doit constituer un moyen fort permettant d'éviter leur délocalisation, elle pourrait avoir comme légitime contrepartie une différenciation des rémunérations qui reposerait sur une évaluation objective des résultats obtenus par les chercheurs en fonction des projets sur lesquels ils se seraient préalablement engagés. Le second levier consiste à permettre une meilleure insertion des chercheurs dans la vie professionnelle. Le Gouvernement s'est également fixé pour objectif, à l'horizon 2010, d'améliorer les débouchés tant dans la fonction publique que dans les entreprises. Les chercheurs doivent aussi pouvoir diversifier leurs parcours professionnels, et leur mobilité entre recherche publique et recherche industrielle doit s'intensifier, de même qu'il est impératif de faciliter la venue dans les laboratoires français de chercheurs étrangers. Le système britannique de recherche Les différences avec la France sont considérables : 1) Financement « dual » : Les infrastructures ainsi que le personnel académique permanent sont financés par des conseils régionaux, en fonction de la charge d'enseignement et de l'évaluation des départements scientifiques des universités lors des Research Assessment Exercises [RAE]. Les recherches sont financées sur des subventions attribuées à une équipe et à un projet pour une période de 2 à 5 ans après sélection. 2) Les enseignants chercheurs n'ont pas le statut de fonctionnaire mais sont salariés des établissements. Il existe peu de chercheurs à temps plein (sans activités d'enseignement) dans les universités. Il existe également des chercheurs à plein temps, notamment dans les instituts de recherche, recrutés sur CDD. 3) Les post-doctorats sont fondés sur : - un CDD - un salaire de 19 000 à 30 000 livres par an - un recrutement d'une durée moyenne de trois ans - un budget de recherche associé à un projet Si les chercheurs ne bénéficient pas directement d'une évaluation positive, l'université en bénéficie par contre directement. De nombreux français (2 500 doctorant, 1 500 post doctorant ainsi que des enseignants chercheurs seniors) viennent chercher et enseigner au Royaume-Uni. II.- POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA POLITIQUE DE SOUTIEN Les PME constituent un ensemble hétérogène qui se caractérise par le nombre élevé des éléments qui le forment et par l'extrême diversité des entreprises qui le composent, tant en ce qui concerne leurs tailles, leurs statuts que les secteurs d'activités où elles sont présentes, notamment dans des secteurs de haute technologie. Les PME européennes représentent 23 millions d'entreprises, 75 millions d'emplois, soit les deux tiers des travailleurs du secteur privé de l'Europe et 99 % de toutes les entreprises européennes. Le nombre de petites et moyennes entreprises, au 31 décembre 2005, s'élèverait, selon la confédération générale des petites et moyennes entreprises à 2 615 500, elles étaient selon la direction générale de l'industrie près de 2,1 millions en 2002. Elles sont présentes dans l'ensemble des secteurs de l'industrie, du commerce et des services (ICS). Elles emploient 89 % des salariés de ces secteurs, en produisent 66 % du chiffre d'affaires, 64 % de la valeur ajoutée et 51 % des exportations. Le montant cumulé de leurs investissements représente 65 % des investissements du secteur ICS. Elles se répartissent essentiellement dans trois secteurs économiques : les services (52 %), le commerce (25 %) et l'industrie (23 %). Juridiquement, les PME sont constituées majoritairement sous une forme individuelle (54 % de commerçant, d'artisans et de professions libérales) et 46 % ont un statut de société (essentiellement sous la forme de SARL). Selon les statistiques publiées par la direction générale de l'industrie, en 2002, elles occupaient (salariés et chefs d'entreprise) plus de 15,5 millions de personnes, soit environ 57,4 % de la population active et, selon MM. Jean-Paul Betbèze et Christian Saint-Étienne, elles seraient à l'origine de l'essentiel de la croissance de l'emploi depuis quinze ans (rapport du Conseil d'analyse économique : « Une stratégie PME pour la France », juillet 2006). La notion de PME est souvent difficile à appréhender car il n'existe pas de définition unique de la PME. Les critères, retenus par les différents textes législatifs et réglementaires, diffèrent en fonction de l'objectif des dispositifs qu'ils créent concernant les PME. Historiquement, après la seconde guerre mondiale, le concept de PME recouvrait communément les entreprises comptant de 10 à 20 personnes jusqu'à 500 personnes. La création de l'Europe a conduit à clarifier et à unifier la notion de PME. Une recommandation de l'Union européenne du 3 avril 1996 classe les PME en « micro-entreprises » (0 à 9 salariés), en petites entreprises (10 à 49 salariés) et en moyennes entreprises (50 à 249 salariés). Cette classification a été précisée par une nouvelle recommandation européenne, en date du 6 mai 2003, associant à la taille de l'entreprise la notion de chiffre d'affaires et de bilan, dans la perspective de mieux pouvoir déterminer l'éligibilité aux régimes nationaux de soutien aux PME et aux programmes communautaires destinés aux PME. Il convient de noter que, pour les besoins de l'analyse, statisticiens et économistes évoquent fréquemment la notion de « très petites entreprises » pour identifier les entreprises employant entre 10 et 19 salariés. La direction générale de l'industrie dénombrait, en 2002, 1,92 million de « micro-entreprises », 84 600 très petites entreprises, 59 700 petites entreprises et 23 200 entreprises moyennes. CLASSIFICATION DES PME (en millions d'euros)
Comme le rappelle M. Günter Verheugen, Vice président de la Commission européenne, Commissaire en charge des entreprises et de l'industrie, « les PME sont le fer de lance de l'économie européenne, et la plus importante source d'emplois et de croissance. C'est pour cette raison que la Commission a donné un coup d'accélérateur à la politique communautaire des PME, en plaçant les besoins des petites entreprises au cœur de son action et en prenant différentes initiatives destinées à améliorer leur environnement financier et réglementaire ». L'un des problèmes majeurs auxquels les PME sont confrontées réside dans la difficulté à trouver les financements appropriés à leurs besoins tant lors de leur création que pour assurer leur développement. La Commission a donc mis en place et financé des instruments permettant d'obtenir des prêts auprès des banques par le biais de garanties, gérées par le Fonds européen d'investissement. Afin de simplifier la vie des entreprises, la Commission a retiré plus de 60 mesures législatives en instance d'adoption et prévoit de simplifier 1 400 mesures existantes, principalement dans les secteurs les plus réglementés : l'environnement et la construction. Considérant que l'activité transfrontalière des PME européennes est insuffisante, elle a mis en place un vaste réseau (Euro Info Centres - EIC) destiné à les aider à trouver des partenaires étrangers, non seulement à l'intérieur de l'Union, mais aussi extra-européens. Conformément aux objectifs de Lisbonne qui font de l'innovation un facteur fondamental de la croissance, l'Europe a réservé une part substantielle du financement de la recherche-développement aux PME (2,3 milliards d'euros entre 2002 et 2006). La politique de l'Union européenne en matières d'aides d'État, encadre strictement les aides accordées par les États aux entreprises par la règle dite de « de minimis » prévu par règlement (CE) n) 69 /2001 du 12 janvier 2001 (aides inférieures à un plafond et sur lesquelles la Commission n'exerce pas de contrôle compte tenu de leur faible impact). La Commission propose de porter ce plafond à 200 000 euros, sur une période de trois exercices fiscaux, contre 100 000 euros aujourd'hui. Le plafond de 100 000 euros était en effet source de conflits avec les États membres tout en dispersant l'attention de la Commission sur des sujets d'importance secondaire. Se pose la question de savoir quelles sont les aides entrant dans le champ d'application de la règle. Si le crédit d'impôt recherche en est exclu, d'autres avantages fiscaux tels que les crédits d'impôt en faveur des dépenses de prospection commerciale, pour la relocalisation d'activités en France, pour dépenses pour équipement en nouvelles technologies et celui en faveur des métiers d'art entrent dans la base de calcul du plafond de minimis. Le projet de règlement de la Commission qui doublerait le plafond de la règle de minimis ne prévoit son application qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque : « aides transparentes ». Dans ces conditions, les aides consistant en des apports de capitaux ou en mesures de capital investissement ne sont considérées comme des aides de minimis qu'en dessous du plafond. Des règles plus favorables existent ainsi pour les aides régionales, afin d'encourager la création de nouvelles entreprises. Par ailleurs, sur la base d'une subvention d'un montant d'aide d'état compris dans un régime de garantie en faveur de PME viables, les aides individuelles sont traitées comme des aides de minimis « lorsque le prêt total sur lequel se fonde la garantie individuelle fournie dans le cadre de ce régime ne dépasse pas 1 700 000 euros par entreprise bénéficiaire, et que la garantie n'excède pas 80 % du prêt. » Enfin l'Europe conduit une politique de normalisation qui permet de garantir une qualité européenne reconnue à travers le monde. Il s'agit là d'un atout à l'exportation et, comme cela a été le cas pour la téléphonie mobile une réglementation susceptible de s'imposer à l'international. B.- LES MESURES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES DÉJÀ MISES EN œUVRE Conscients de l'importance du tissu économique que constituent les PME et de leur rôle positif en faveur de l'emploi, les pouvoirs publics ont développé depuis 2002 une politique active de soutien à la création, au développement et à la transmission des PME. Dans le prolongement de cette politique, une première série de mesures ont été regroupées dans la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 (loi n° 2003-721) dont les principaux objectifs consistaient à : - lever les freins à la création d'entreprises ; - favoriser la création d'emploi et l'embauche, notamment dans les très petites entreprises ; - favoriser le développement des entreprises existantes en facilitant leur accès au financement ; - relever le défi de la transmission d'entreprises, notamment dans la perspective du départ prévisible d'environ 600 000 chefs d'entreprises dans les dix années à venir. Les orientations amorcées par la loi pour l'initiative économique ont été prolongées par les dispositions de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (loi n° 2005-882), d'une part, en favorisant le développement des PME et leur pérennité et d'autre part, en renforçant le statut du conjoint collaborateur. 1. Faciliter et encourager la création d'entreprise Lors de son audition par la mission d'information, M. Renaud Dutreil, ministre en charge des PME, a rappelé que « la création d'entreprises constitue le levain de l'économie de demain, que les PME y ont toute leur place et qu'il est incombe au pouvoir politique de tout mettre en œuvre pour faciliter et encourager toutes initiatives en ce sens ». C'est ainsi que la loi pour l'initiative économique a institué plusieurs mesures pratiques et concrètes de façon à permettre aux Français qui le souhaitent de satisfaire leur envie d'entreprendre et de bénéficier, à travers la démarche de création d'entreprise, d'une nouvelle forme d'ascenseur social. En premier lieu, les entrepreneurs peuvent désormais fixer librement le montant du capital social de la société à responsabilité limité qu'ils envisagent de créer. Il leur était préalablement imposé la constitution d'un capital minimum de 7 500 euros. Autre simplification innovante, la possibilité de domicilier l'entreprise nouvellement créée à l'adresse du lieu d'habitation principal des dirigeants de l'entreprise, sous réserve du respect des clauses du bail du logement. Cette mesure, en apparence anodine, a notamment pour effet d'abaisser les coûts de premier établissement et d'alléger les formalités préalables à la création. Le régime de l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel a également été introduit par la loi du 1er août 2003. Cette distinction entre biens professionnels et patrimoine particulier permettra à l'entrepreneur, en cas de difficultés, de préserver, pour lui-même et sa famille, son habitation principale, sous réserve qu'il ait préalablement établi, par acte authentique, une déclaration d'insaisissabilité devant notaire. Tirant les conclusions de l'évolution des modes de communication, la loi a ouvert la possibilité de déclaration des entreprises par voie électronique, de façon à permettre la réduction des déplacements des créateurs et le gain de temps en ne dépendant plus des heures d'ouverture des guichets physiques et en accélérant les opérations d'immatriculation aux registres de publicité légale. Dans le même ordre d'idées, afin de permettre l'accomplissement des démarches préparatoires au lancement de l'activité sans attendre l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il a été institué un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Ce document, remis au créateur dès que le dossier déposé est complet, lui permet d'anticiper l'ensemble des démarches auprès des différents organismes administratifs, sociaux et bancaires. La création d'entreprise est également le fait de personnes rencontrant des difficultés passagères, liées notamment aux aléas du marché du travail. Plusieurs dispositifs ont été mis en place en leur faveur, notamment une exonération de charges sociales la première année d'activité, la mise à disposition d'un prêt d'honneur et une allocation de chèquiers-conseil ouvrant l'accès, à moindre frais, à une expertise juridique et comptable. La loi pour l'initiative économique a, de même, institué des dispositions tendant à favoriser la création d'entreprise par des salariés. Ainsi, les salariés peuvent désormais bénéficier d'un congé pour création d'entreprise renforcé d'un temps partiel pour création et d'une exonération, au titre de sa nouvelle activité, d'une année de cotisations sociales. S'agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la première année d'activité par une personne non salariée, elle a également prévu un moratoire permettant au créateur de les reporter, avec la possibilité d'étaler leur paiement sur les cinq années suivantes. Sur le plan fiscal, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose que les dons familiaux destinés à financer une opération de création ou de reprise bénéficient désormais d'une exonération de droit de donation, dans la limite d'un plafond de 30 000 euros. Il convenait, en effet, de permettre aux créateurs qui ne pouvaient que difficilement offrir des garanties aux établissements de crédit de lancer leur activité et éviter ainsi à leurs familles de devoir se porter caution solidaire. L'impulsion dynamique donnée par les pouvoirs publics semble d'ores et déjà avoir porté ses fruits. La progression du nombre de créations et de reprises d'entreprises enregistrée sur la période 2002- 2005 s'élève à 21,6 %. 2. Simplifier l'embauche et la gestion des PME Par l'adoption de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005, le Parlement a habilité le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour l'emploi. Parmi les sept ordonnances du 2 août 2005 prises par le Gouvernement en application de la loi d'habilitation, trois concernent la vie des entreprises : - l'ordonnance 2005-892 relative à l'aménagement des règles de décompte des effectifs des entreprises qui prévoit que les salariés de moins de vingt-six ans ne sont pas temporairement pris en compte dans le décompte des effectifs des entreprises jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire, aménageant ainsi de façon à lisser les effets de seuil jusqu'au 31 décembre 2007 et faciliter l'embauche des jeunes par les entreprises ; - l'ordonnance n° 2005-893 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » qui vise à favoriser l'embauche par les petites entreprises comptant moins de 20 salariés et le retour à l'emploi. Cette nouvelle catégorie de contrat de travail, à durée indéterminée, offre une souplesse accrue dans les relations contractuelles entre l'employeur et le salarié. En effet, pendant les deux premières années de vie du contrat et qui constitue une période de consolidation de l'emploi, l'employeur et le salarié peuvent, selon des procédures simplifiées rompre le contrat qui les lie. Selon le Gouvernement, le cumul des intentions d'embauche en CNE est de 606 000, chiffre qui représente selon les mois, de 9 à 12 % du total des intentions d'embauche des petites entreprises. Dans 10 % des cas, le chef d'entreprise a déclaré qu'il n'aurait jamais réalisé cette embauche en l'absence du CNE, pourcentage correspondant aux estimations de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale établies au vu des déclarations à l'URSSAF selon une enquête réalisée d'août 2005 à mars 2006 auprès de 3 000 chefs d'entreprise ; - l'ordonnance n° 2005-903 créant un chèque emploi pour les très petites entreprises qui a permis la mise en place d'un service à l'accomplissement des principales obligations administratives liées au recrutement et à l'emploi d'un salarié. Le chèque-emploi pour les très petites entreprises est accessible aux entreprises dont l'effectif ne dépasse pas cinq salariés et est utilisable pour les salariés déjà présents dans l'entreprise ou pour l'embauche d'un nouveau salarié. À l'instar du « chèque-emploi-service » dont bénéficient les particuliers ayant recours aux services de salariés à domicile, il permet de satisfaire aux obligations de déclaration unique d'embauche et de fourniture de contrat de travail. Ainsi, les obligations en matière sociale de l'entreprise sont simplifiées, l'organisme en charge du chèque-emploi effectue directement pour le compte de l'employeur les formalités correspondant des déclarations relatives aux cotisations et contributions et organise leur recouvrement. Au premier août 2006, plus de 32 000 entreprises avaient adhéré à ce dispositif. Préalablement, le Gouvernement avait déjà amorcé cette politique de simplification par voie d'ordonnance dans le cadre d'une première loi d'habilitation (loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit). L'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises avait entre autres dispositions concernant le commerce et l'artisanat, aménagé le fonctionnement de la société à responsabilité limitée qui constitue l'un des statuts les plus fréquemment choisis par les dirigeants de PME. Ainsi, la SARL peut désormais émettre des obligations sans appel public à l'épargne. Entre autres dispositions concernant plus particulièrement les artisans et commerçants, l'ordonnance du 25 mars 2004 visait à faciliter la transmission des entreprises par un allègement des conditions de cession des parts sociales : la transmission des parts sociales de la société peut, désormais, être organisée, dans les statuts, en faveur de l'associé décédé, de ses ayants droit ou même d'un tiers ; l'agrément de l'acquéreur des parts sociales se réalise à la majorité simple du capital social. Enfin, l'ordonnance a également simplifié le fonctionnement juridique de la gérance de la SARL. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a complété les mesures déjà prises par ordonnance afin de simplifier la gestion des SARL. Le dirigeant de SARL à associé unique peut avoir recours à un modèle de statuts types simplifié lors de la création de son entreprise s'il en assume personnellement la gérance, ce qui entraîne la suppression de certaines formalités : le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans un même délai, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. Des quorum ont été institués lors des délibérations des assemblées générales et les majorités requises pour modifier les statuts peuvent être assouplies si les associés le souhaitent. Parallèlement, le Gouvernement a porté prioritairement son action sur la refonte de l'organisation fiscale destinée aux entreprises. C'est ainsi que, dans un premier temps, un interlocuteur fiscal unique pour les grandes entreprises a été mis en place. Cette disposition a été par la suite élargie aux PME. L'interlocuteur fiscal unique pour les PME présent dans chaque département est compétent pour le paiement de la taxe sur les salaires et de l'impôt sur les sociétés. À terme, cette réforme prévoit que tous les impôts professionnels des PME seront recouvrés par l'interlocuteur fiscal unique des PME. La mise en place de la réforme s'accompagne de nouveaux services offerts aux PME : services personnalisés pour les créateurs d'entreprises, généralisation du conciliateur fiscal pour obtenir un traitement plus rapide des différends, mise en place de comités d'usagers, amélioration de l'accessibilité des services, simplification des démarches administrative et généralisation des déclarations électroniques. La mise en place de cette réforme nécessite des regroupements entre centres et recettes des impôts au plan local, ce qui explique que sa généralisation n'est pas encore effective sur l'ensemble du territoire. 3. Favoriser le financement et la transmission des PME Les principales mesures de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique relatives au financement des entreprises concernent la création des fonds d'investissement de proximité, l'amélioration significative de l'avantage fiscal accordé aux investisseurs dans les sociétés non cotées, le doublement du plafond de déductibilité des pertes en capital subies à la suite de souscription au capital, l'utilisation des plans d'épargne en actions pour la création d'entreprise, la suppression du taux de l'usure pour les entreprises et l'allègement des charges de l'entreprise nouvellement créée par le report des sommes dues au titre de la première année d'exercice sur les exercices des cinq années suivant celle de la création. D'autres dispositions de la loi sur l'initiative économique consistent en la mise en œuvre de mesures destinées à faciliter la transmission des entreprises. Il s'agit, pour l'essentiel, de dispositions fiscales ayant pour objectif d'en alléger le coût. Ainsi le seuil d'exonération des plus-values professionnelles a été sensiblement relevé, un mécanisme de « crédit-vendeur » a été institué, les droits de mutations au bénéfice d'un repreneur salarié sont exonérés jusqu'à hauteur de 300 000 euros, une réduction d'impôt au bénéfice du repreneur qui s'endette pour l'acquisition de son entreprise a été instituée et un abattement de 50 % sur les donations d'entreprises en cas de signature d'un pacte d'actionnaire avec engagement de conservation de six années a été mis en place. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a complété l'efficacité de ces dispositifs puisqu'elle institue un régime de tutorat en entreprise qui, dans le cadre d'une convention entre le cédant et son successeur, permet au cédant d'assurer une prestation de tutorat. À l'occasion de l'accomplissement de cette prestation, limitée dans le temps, l'État peut verser au cédant une prime de transmission. Par ailleurs, les dons en numéraire, destinés à la création d'une entreprise, sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit, dans la limite de 30 000 euros. Les donations avec réserve d'usufruit sont désormais possibles. De plus, l'abattement fiscal portant sur la prise en compte de la valeur de l'entreprise pour les donations a été porté à 75 %. Enfin, la loi n° 2005-1270 de finances rectificative pour 2005 a aligné le régime des plus-values professionnelles immobilières sur celui des plus-values privées immobilières en instaurant un abattement de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui conduit à une exonération totale de plus-values professionnelle immobilière pour une durée supérieure à 15 années de détention des biens immobiliers de la société. Par analogie, les gains de cessions de titre de PME bénéficient d'une exonération d'un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année de détention, soit une exonération totale dès la huitième année. Cette dernière mesure ne concerne que les cessions intervenant postérieurement au 1er janvier 2006, une exception étant toutefois prévue en faveur des chefs d'entreprise qui cèdent leur fonds ou leurs titres pour faire valoir leur droit à la retraite. C.- PERMETTRE AUX PETITES ENTREPRISES DE DEVENIR DES MOYENNES ENTREPRISES Le bilan des actions menées en faveur des petites et moyennes entreprises par les pouvoirs publics est proportionné au rôle fondamental qu'elles jouent dans l'économie nationale, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, et démontre que le Gouvernement les a placées au centre de ses priorités. La politique volontariste mise en œuvre, notamment par le ministre des petites et moyennes entreprises, pour venir en aide et favoriser la création d'entreprises en créant un environnement juridique, social et fiscal favorable à leur transmission a d'ores et déjà porté ses fruits. En effet, pas moins de 225 000 entreprises naissent désormais chaque année, contre 175 000 dans les années 1990. Toutefois, force est de constater que le nouveau défi auquel sont confrontées les PME et qu'il leur revient de relever est celui de leur croissance. En effet, si la France compte aujourd'hui de très nombreuses petites et grosses entreprises, notre économie manque d'entreprises intermédiaires. Or, comme cela a été souligné à de nombreuses reprises devant la Mission d'information, ce sont ces entreprises moyennes qui contribuent le plus à la diversité de l'offre, à la vitalité de l'innovation et des exportations chez nos voisins européens les plus proches, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie. Les petites entreprises en France éprouvent des difficultés à franchir l'étape supérieure, à se transformer en moyennes entreprises et, une fois passé les stades de la création et de la première croissance, elles peinent à atteindre la taille critique leur permettant de se confronter sur les marchés internationaux avec leurs concurrentes européennes situées dans des créneaux économiques comparables. La compétitivité de l'économie française passe aussi et surtout par la multiplication des entreprises de tailles intermédiaires ; aussi convient-il de soutenir les initiatives de ces agents économiques capables d'innover, d'exporter et de créer des emplois en amplifiant et en complétant les dispositifs déjà mis en place. Afin de permettre aux PME d'accroître leur taille et leurs moyens pour répondre aux nouvelles exigences de la compétition internationale, Renaud Dutreil, ministre en charge des PME a lancé, au moi de mai dernier un plan d'action regroupant cinq programmes ambitieux visant à développer la croissance des PME. Ce plan s'articule autour de cinq idées fortes portant sur le financement de la croissance, la compétitivité et les performances, le développement des marchés, la promotion de la croissance externe et la transmission, ainsi qu'enfin un programme destiné plus particulièrement à l'émergence des champions économiques de demain que sont les « gazelles ». L'évolution des marchés, notamment la concurrence accrue qui y règne, nécessite que soient rapidement mises en œuvre les conditions propices à renforcer la compétitivité des entreprises française, plus principalement les jeunes entreprises innovantes, communément appelées « les gazelles », par opposition aux éléphants que sont les grandes sociétés et aux souris constituées par les petites entreprises, selon la classification avancée par l'économiste américain David Birch. L'image, si l'on se réfère au mammifère portant une attention permanente à son environnement, qui par ses accélérations rapides peut réagir à tout changement de son environnement, traduit bien la réactivité indispensable que doivent avoir les jeunes entreprises tant en ce qui concerne leur adaptation aux évolutions du marché et aux changements technologiques. Parmi ces cinq programmes d'actions, deux s'adressent plus particulièrement aux « gazelles ». 1. Les initiatives destinées plus particulièrement aux « gazelles » Tout comme la gazelle de la Fontaine (le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat) qui ne doit d'échapper au chasseur dont elle constitue la proie privilégiée qu'à la solidarité des autres acteurs de la fable, il convient de donner aux entreprises innovantes les moyens d'atteindre une taille critiques leur permettant à leurs responsables de s'investir sans crainte dans le développement de leur entreprise. Il faut, pour cela, associer les ressources publiques et privées afin de soutenir la croissance des PME. Les mesures envisagées à cet effet prévoient de lever deux milliards d'euros sur les marchés financiers qui seront investis, aux côtés de souscripteurs privés, dans des fonds qui prendront des participations dans les PME pour financer leur développement. On peut constater que les acteurs les plus importants du capital risque et du capital investissement ne financent que rarement l'amorçage des PME et ne participent aux investissements dans les PME qu'au moment où l'entreprise a pris son envol et ne présente plus que des risques limités. Or, bien souvent les apports personnels du dirigeant sont souvent insuffisants pour faire face à la période de démarrage. Dans cette phase, les investisseurs de proximités, les « business angels », qui engagent une part de leur épargne dans le financement de la création d'entreprises est capital pour leur développement rapide, d'autant qu'ils y apportent également leur expérience, leur expertise et l'accès à leurs réseaux relationnels. Si, comme le montrent les statistiques établies par l'association « France Angels », le nombre d'investisseurs de proximité a plus que triplé depuis 2001 pour atteindre aujourd'hui un effectif compris entre 3 000 et 4 000 personnes, il apparaît que ce nombre est encore insuffisant si on le compare à celui de la Grande Bretagne (environ 45 000) et à celui des États-Unis (environ 400 000). Ces exemples étrangers démontrent l'importance de réseaux d'investisseurs susceptible de faciliter la rencontre entre porteurs de projet et financeurs, aussi est-il fondamental que la puissance publique encourage ces réseaux. Afin de renforcer l'existence de ces réseaux d'investisseurs et d'amplifier leurs actions, le ministère en charge des PME a lancé un appel à projet ouvert aux associations de « business Angels » demandant aux associations candidates de présenter leur plan d'actions et leurs objectifs pour les trois années à venir. Les associations dont le projet sera retenu pourront bénéficier d'un soutien financier pouvant s'élever à 1 000 euros par dossier, dans la limite d'une aide totale de 100 000 euros pour une période trisannuelle. S'agissant de l'article 40 du projet de loi de finances 2007, celui-ci modifie pour l'essentiel le dispositif actuel de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts qui institue une réduction d'impôt en faveur des personnes physiques qui effectuent, jusqu'au 31 décembre 2006, des versements au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des PME, sous réserve d'une part que celles-ci ne soient pas cotées en bourse, qu'elles soient soumises à l'IS, que plus de 50 % soient détenus par des personnes physiques et que, pour les augmentations de capital, leur chiffre d'affaires HT n'excède pas 40 millions d'euros ou que le total du bilan n'ait pas excédé 27 millions d'euros et, d'autre part, que le souscripteur s'engage à conserver pendant une durée de cinq années les parts souscrites. La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements dans la limite annuelle de 20 000 euros pour un célibataire et de 40 000 euros pour un ménage. La fraction des versements excédant la limite annuelle ouvre droit, dans les mêmes conditions à la réduction d'impôt pendant les trois années suivantes. Les modifications proposées par l'article 40 du projet de loi de finances afin de répondre aux besoins de financement des PME sont principalement les suivantes : - proroger le bénéfice fiscal jusqu'au 31 décembre 2010 ; - d'étendre le dispositif aux souscriptions au capital des PME de l'espace européen, ce qui a pour effet d'aligner les conditions de chiffre d'affaires et de bilan sur les définitions européennes, soit respectivement 50 et 43 millions d'euros ; - de permettre un meilleur financement de ces entreprises par les « business Angels » ; - d'autoriser le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre années au lieu de trois actuellement ; - d'autoriser, pendant la période obligatoire de conservation de cinq années, la possibilité de donation, dès lors que le donateur reprend à son compte l'obligation de conservation. Cet article 40 constitue donc un progrès majeur. Il pourrait être encore amélioré en augmentant le pourcentage de la réduction d'impôt (passage à 35, voire 45 %) ainsi que celles envisageant d'augmenter le plafond des versements annuels (doublement des plafonds, soit respectivement 40 000 et 80 000 euros), voire une combinaison de ces deux propositions. Il serait aussi souhaitable de favoriser les investissements institutionnels (compagnie d'assurance, etc.) dans les PME en leur assurant des contreparties en matière de plus-values ou moins-values réalisées sur les titres acquis dans le cadre des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital des PME. b) Accompagner la croissance des « gazelles » Outre les dispositions fiscales contenues dans l'article 6 du projet de loi de finances pour 2007 visant à mieux prendre en compte le développement des « gazelles » en terme d'emploi, par une meilleure prise en compte des dépenses de personnel, le Gouvernement a lancé une labellisation destinée à identifier 2 000 d'entre elles afin de leur offrir un accompagnement renforcé comprenant principalement un accès facilité à des spécialistes capables d'accélérer leur développement. Sans doute conviendra-t-il au vu des résultats obtenus de revoir à la hausse le nombre d'entreprises pouvant bénéficier du label « gazelles ». c) Faire émerger des « gazelles » par essaimage de grandes entreprises Les grandes entreprises sont fréquemment à l'initiative d'avancées technologiques de haut niveau que pour des raisons de recentrage sur leur cœur de métier elles n'envisagent pas de développer directement. L'exploitation de ces innovations en jachère pourrait être confiée à des entreprises créées par essaimage, ce qui permettrait à leurs dirigeants de bénéficier d'un soutien indispensable lors de la création de l'entreprise. En contrepartie, les charges supportées par les grandes entreprises dans le cadre du soutien à l'essaimage pourraient faire l'objet d'une déduction fiscale dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. 2. Les programmes à portée générale a) Renforcer la compétitivité, la valeur ajoutée et les performances des entreprises Dans le cadre de ce programme, le Gouvernement envisage d'encourager les PME à mieux protéger leurs innovations et d'augmenter de 50 % sur deux ans le nombre de PME déposant un brevet. Pour atteindre cet objectif, il est envisagé d'attribuer 1 000 labels « Génération innovation » ouvrant droit à une formation et à une assistance à la propriété intellectuelle, à la gratuité du dépôt 500 brevets et à la recherche d'un partenariat avec les sociétés d'assurance afin de créer une assurance protection de la propriété intellectuelle pouvant couvrir partiellement les dépenses judiciaires d'éventuels contentieux relatifs à la propriété intellectuelle. Il est également envisagé de développer l'accès à l'économie numérique des PME de façon à augmenter la réactivité des entrepreneurs et faire en sorte qu'ils aient un recours accru aux outils majeurs que constituent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. b) Faciliter l'accès à de nouveaux marchés Partant du constat qu'aujourd'hui seulement 100 000 PME sont présentes sur les marchés à l'export, alors que près de 300 000 sont actives sur des secteurs à fort potentiel à l'exportation, le ministre en charge des PME souhaite multiplier le nombre d'entreprises françaises présentes sur les marchés étrangers. De même les PME françaises ne recourent que de façon limitée au commerce en ligne qui connaît une croissance exponentielle, aussi est-il envisagé d'accroître leur présence sur Internet par le recours à 1 000 « webmestres PME ». c) Permettre les rapprochements et les fusions des PME Afin de promouvoir la croissance externe des PME le Gouvernement envisage de favoriser les rapprochements entre PME d'un même secteur susceptibles de développer des synergies et de mettre en œuvre une stratégie commune efficace en obtenant ainsi une taille critique. D.- POUR UNE PLUS GRANDE IMPLICATION DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE Par application des dispositions des articles 125-0 A, I quater et quinquies du code général des impôts, les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements assimilés (assurance-vie) bénéficient d'une exonération d'impôt, sous réserve d'une durée minimale de détention de huit années et du strict respect de règles de composition de l'actif. Ce dispositif fiscal concerne deux sortes de contrats : - les contrats dits « DSK » (ou « Strauss-Kahn »), institués par l'article 21-I de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 pour lesquels il est prévu, sous condition de respecter des quotas d'investissement un régime d'exonération des revenus financiers qu'ils produisent. Sont concernés les OPCVM (Sicav et fonds communs de placement constitués en France) dont l'actif est constitué pour 50 % au moins en titres, droits ou bons (actions, certificats d'investissement de sociétés ou certificats coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé français ou européen), sous la réserve que ces titres au sein de l'actif soient également constitués pour 5 % au moins de placements « risqués » (parts de fonds communs de placement à risques, parts de fonds communs de placement de proximité, parts de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque, cotées ou non, ou de sociétés financières d'innovation) ; - les contrats dits « NSK » (ou « Sarkozy »), institués par l'article 29 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 qui a modifié les règles de composition de l'actif en prévoyant de nouveaux quotas : · l'actif de l'OPCVM doit être constitué pour 30 %, contre 50 % avant, au moins en actions ou en parts du type d'investissements mentionnés ci-dessus ; · à l'intérieur de ce quota de 30 %, l'actif de l'OPVCM doit obligatoirement être investi à hauteur de 10 %, contre 5 % avant, en titres à risques parmi lesquels 5 % de titres de sociétés non cotées. La rénovation du régime applicable aux contrats d'assurance-vie investis en actions découlant de la loi de finances pour 2005 répondait à l'objectif du Gouvernement de renforcer l'orientation de l'épargne vers les PME, de façon à pallier les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises lors de leur création ou de leur phase de développement et à faciliter ainsi leur croissance. Afin de faciliter encore l'expansion, tant en nombre qu'en taille, des PME qui constituent un maillon important du tissu économique national, il conviendrait de renforcer le dispositif existant. À cette fin, il serait souhaitable de modifier les quotas prévus pour les contrats dits « NSK » de telle sorte que les parts de titres à risques et d'actions non cotées (qui concernent principalement le financement des PME) représentent une proportion plus importante de l'actif des OPVCM. Ainsi, les taux de 10 %de titres à risques et de 5 % de sociétés non cotées pourraient être respectivement portés à 12 % et 8 %. III.- UNE ÉVOLUTION INDISPENSABLE (39) DU DROIT DES MARCHÉS PUBLICS EN DIRECTION DES PME Votre rapporteur voudrait tout d'abord proposer quelques mesures pragmatiques, dont on peut espérer la mise en œuvre à un horizon rapproché, de nature à faciliter l'accès des PME aux marchés publics avant de soutenir la mise en place d'un accès privilégié des PME à ces marchés. Votre rapporteur soulignera enfin l'asymétrie de l'ouverture sans contreparties des marchés européens. A.- CRÉER UN SITE INTERNET UNIQUE EN FRANCE À bien des égards, la solution pourrait consister en la création d'un site national, regroupant toutes les publicités pour tous les marchés passés en France ; les modalités [durée d'affichage et contenu des informations fournies en particulier] pouvant varier selon l'importance des marchés. Les entreprises n'auraient ainsi plus à s'inquiéter de l'existence de multiples sites Internet. La consultation d'un seul site, équipé d'un moteur de recherche adéquat, leur permettrait de connaître tous les marchés susceptibles de les intéresser. Il n'y a d'ailleurs pas nécessairement besoin de créer ex nihilo un nouveau site. Moyennant quelques changements et extensions de capacité, le site du BOAMP pourrait parfaitement remplir cet office. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris rappelait ainsi récemment qu'il n'existe pas de journal ni de plate-forme qui recense l'ensemble des marchés, quel que soit leur montant ou leur secteur. Les apports étant ciblés et ponctuels, il est impossible d'avoir une vue globale. Le BOAMP n'est en effet pas obligatoire pour l'ensemble des marchés publics, en particulier pour ceux d'un montant inférieur à 90 000 euros. Le nouveau code des marchés publics comporte diverses mesures positives destinées à faciliter l'accès des PME aux marchés publics. L'idéal serait cependant la mise en place d'un « Small Business Act » en Europe et en France, sur le modèle américain, dont les grandes lignes sont décrites ci-après. Il s'agit cependant d'une œuvre de longue haleine à laquelle le gouvernement s'est attaqué en juillet 2006 en saisissant la Commission européenne de propositions en ce sens. Avant d'aborder ce point, votre rapporteur voudrait plus modestement proposer la mise en place d'une structure légère chargée d'apporter un soutien et des conseils aux PME susceptibles de soumissionner, de manière à leur permettre de faire face aux formalités complexes liées aux marchés publics, s'agissant en particulier des dossiers de candidature. B.- POUR UN « SMALL BUSINESS ACT » EUROPÉEN 1. La politique américaine en faveur des PME La « Small Business Administration » (SBA) est le plus grand bailleur de fonds américain pour les PME avec un portefeuille de prêts commerciaux, de garanties de prêts et de capital risque de plus de 45 milliards de dollars, non compris les 5 milliards de dollars prévus en cas de catastrophe naturelle. Le budget 2003 de la SBA était d'environ 800 millions de dollars. La notion de PME est définie secteur par secteur. 1/ Programme de prêts : Ce programme comprend : - un programme de garantie des prêts ; - un programme de prêts par l'intermédiaire de « sociétés de développement homologuées » (sociétés à but non lucratif) ; - un programme de micro crédits pour les plus petites entreprises. 2/ Investissement capital risque (SBIC) 3/ Programme de prêts en cas de catastrophes naturelles Il s'agit d'offrir des conseils gratuits aux résidents permanents et aux citoyens des États-Unis qui souhaitent créer une petite entreprise. Ils offrent également, à très faible coût, des ateliers ou des formations dans un large éventail de domaines. Le préambule du « Small Business Act » est ainsi rédigé (40) « L'essence du système économique américain d'entreprise privée est la libre concurrence [...]. La préservation et l'expansion d'une telle concurrence est fondamentale non seulement pour le bien être économique de la Nation, mais pour sa sécurité. Une telle sécurité et un tel bien être ne peuvent être obtenus sans que la capacité, potentielle et réelle, des PME ne soit encouragée et développée. La politique du Congrès est donc que le Gouvernement aide, conseille, assiste et protège, dans la mesure du possible, les intérêts des PME, dans le but de préserver la libre entreprise, de manière à faire en sorte qu'une proportion équitable des contrats et sous-traitances de l'État pour les biens immobiliers et les services (incluant, mais sans s'y limiter, les contrats pour la maintenance, les réparations et les constructions) soient attribuée à des PME,... ». L'objectif fixé par le Congrès est d'aider les PME à obtenir une part équitable des marchés. Le Président fixe les objectifs annuels. Ceux-ci ne pourront cependant être inférieurs à 23 % du montant total des marchés (23,085 % atteint en 2004) (41), hors dispositifs spéciaux concernant les PME contrôlées par des vétérans, des femmes, les zones défavorisées etc....Les attributions de marchés aux PME semblent s'effectuer selon trois méthodes : 1. Sans concurrence ; 2. Concurrence restreinte à certaines catégories d'entreprises ; 3. Concurrence illimitée. S'y ajoutent des objectifs de sous-traitance aux PME imposés aux grandes entreprises. Il est à noter que l'action en matière de marchés publics ne se limite pas à une préférence. Une assistance en fait partie. Elle peut consister, par exemple, à mettre en contact une PME avec des responsables d'agences fédérales. La loi et les responsables politiques poussent beaucoup les administrations à ne pas grouper les marchés (« bundling ») et à recourir, selon une terminologie française, à l'allotissement. Pour citer la présidente du « Committee on Small Business and Entrepreneurship » du Sénat des États-Unis (42) : « Ce qui n'apparaît pas cohérent, cependant, est de concilier cet objectif [en faveur des PME] avec ce qui peut apparaître comme un but contradictoire - les efforts légitimes pour réduire le coût de l'État et le faire fonctionner plus efficacement. Notre défi est de réconcilier ces deux objectifs ». Cette observation vaut évidemment pour la France. La réconciliation d'objectifs contradictoires ne va pas de soi. Pour les réconcilier, il est nécessaire de se situer à un stade supérieur, en prenant en compte la nécessité d'une France compétitive. Or, cette compétitivité passe par le développement d'un tissu d'entreprises moyennes, comme en Allemagne. Les marchés publics constituent un des instruments disponibles et il ne faut évidemment pas s'en priver. Les coûts d'une telle politique, gestion administrative plus complexe et marchés plus coûteux dans certains cas, sont inférieurs aux bénéfices retirés d'une telle politique. Le dispositif américain est loin de se résumer à une préférence pure et simple en faveur des PME. Il comporte notamment un certain nombre d'agences spécifiquement chargées de les défendre et de les soutenir et des aides financières directes et indirectes très conséquentes ainsi qu'une loi que l'on pourrait traduire littéralement par « loi pour la réduction de la paperasserie » à remplir par les PME. L'introduction en France d'une forme de « discrimination positive » en faveur des PME supposerait cependant que soient écartés au préalable divers obstacles juridiques. S'y ajoute le programme SBIR (Small Business Innovation Research, programme pour les petites entreprises scientifiques et technologiques). Une étude de l'Université de Cambridge (43) montre ainsi que ce programme permet d'attribuer 4 000 contrats de Recherche et Développement par an à des PME américaines pour une valeur annuelle d'environ deux milliards de dollars par an, y compris à des start-up. Les contrats offrent 100 % du financement nécessaire à un projet, plus un petit profit. L'étude de Cambridge souligne que s'y ajoute le quota d'au moins 23 % de marchés attribués aux PME, plus les objectifs de sous-traitance aux PME imposés aux grandes entreprises. Au total, l'étude montre qu'en 2005 les deux-cinquièmes des marchés publics passés par le Pentagone ont été attribués à des PME. L'étude invite le Royaume-Uni à s'inspirer de cette politique. 2. Lever les obstacles juridiques à l'introduction d'une préférence en faveur des PME Il s'agit d'une mesure réclamée depuis longtemps, tant par les acteurs économiques, notamment la CGPME, que par les auteurs de réflexion sur les délocalisations. Ainsi, dans leur rapport sur ce sujet, MM. Fontagné et Lorenzi demandent la mise en place de l'équivalent d'un « Small Business Act » au niveau français. Cette avancée « reconnaîtrait l'importance des petites entreprises dans le développement industriel et viserait à promouvoir leur internationalisation et leur capacité à résister à la concurrence. » L'accord sur les marchés publics (AMP) a été signé à Marrakech le 15 avril 1994, en même temps que l'accord instituant l'OMC. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1996. Il s'agit de l'un des accords plurilatéraux qui ne lie pas l'ensemble des membres de l'OMC. L'Union Européenne est partie de cet accord. L'AMP s'applique aux marchés d'un montant supérieur aux seuils fixés en DTS (Droits de tirage spéciaux ; Cf. encadré ci-après) dans les annexes à l' « Appendice 1 » de l'accord. Ces seuils varient selon la nature des organismes concernés : États / collectivités locales. Les seuils sont ainsi les suivants pour les États membres de l'Union Européenne : Fournitures : 130 000 DTS, Services : 130 000 DTS, Travaux : 5 000 000 DTS. Pour les collectivités locales, les seuils pour les fournitures et services passent à 200 000 DTS. Dans le cas de l'Union Européenne, un règlement de la Commission fixe tous les deux ans la contre-valeur en Euros de ces montants en DTS. LES DTS Le droit de tirage spécial a été créé par le FMI en 1969 pour soutenir le système de parités fixes de Bretton Woods. En effet, l'offre des deux grands avoirs de réserve, l'or et le Dollar, s'était révélée insuffisante. Or, quelques années à peine après la création du DTS, le système de Bretton Woods s'est effondré et les grandes monnaies sont passées à un régime de taux de change flottant. D'autre part, l'expansion des marchés de capitaux internationaux permettait aux gouvernements solvables d'emprunter plus facilement. Cette double évolution a réduit le besoin de DTS. Aujourd'hui, le rôle du DTS se limite à celui d'un avoir de réserve parmi d'autres et il sert principalement d'unité de compte au FMI et à certains autres organismes internationaux. Le DTS n'est pas une monnaie et il ne constitue pas non plus une créance sur le FMI. Il représente en revanche une créance virtuelle sur les monnaies librement utilisables des pays membres du FMI. Initialement fixée en or, la valeur du DTS est déterminée désormais par un panier de monnaies (le Dollar américain, l'Euro, la Livre Sterling et le Yen). Compte tenu de la valorisation de l'Euro, les seuils ont été abaissés à compter du 1er janvier 2006. Ils sont désormais les suivants :
L'AMP est fondé sur le principe de la non-discrimination ; son article X, sur les procédures de sélection des candidats, prévoit, par exemple, qu'ils seront sélectionnés « d'une façon loyale et non discriminatoire ». La conformité à cet accord d'un dispositif de discrimination positive en faveur des PME paraît très discutable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis ont expressément introduit dans l'accord [« Appendice 1 - United States - General Notes »- page 1] une dérogation en faveur des petites entreprises et des entreprises des minorités [« Small and minority business »]. Toute introduction d'un dispositif similaire en France, ou en Europe, supposerait donc l'adoption d'une dérogation comparable au profit de l'Union Européenne et ce, sous réserve de la compatibilité d'un tel système avec l'ordre juridique communautaire et national. En juillet 2006, le gouvernement français a adressé un mémorandum à la Commission européenne lui demandant de négocier au sein de l'OMC une clause dérogatoire en faveur des PME comparable à celle obtenue par les États-Unis. Mme Christine Lagarde, Ministre déléguée au commerce extérieur a indiqué (45) que la France a reçu le soutien d'un nombre significatif de pays (46). Mais la Commission s'est montrée plus réservée. Lorsqu'elle parle en effet d'améliorer l'accès des PME aux marchés publics (47), la commission entend autre chose que la mise en œuvre d'un « Small Business Act » européen. Elle propose, notamment, de promouvoir la participation des PME au processus de définition des normes, d'imposer les PME selon les règles de l'État d'origine, de renforcer le réseau des centres d'information ou de mieux suivre les plaintes déposées par les PME. S'y ajoute une volonté de simplification de la réglementation ou de faciliter le financement des PME au titre du programme cadre pour la compétitivité et l'innovation. Intéressantes, ces initiatives sont cependant sans commune mesure avec celles mises en œuvre par les États-Unis. Dans ses 91 propositions pour plus de croissance, « Croissance plus » estime que la transposition en Europe du « Small Business Act » permettrait aux PME de bénéficier de plus de 10 milliards d'euros de contrats supplémentaires. Il conviendrait ensuite après avoir modifié l'Accord sur les marchés publics, de modifier la directive 2004/18/CE sur les marchés publics, dont la rédaction actuelle ne permet pas d'opérer une discrimination en faveur des PME. La directive ainsi modifiée ne devrait pas être jugée contraire au traité par la Cour de Justice. Cette route pavée d'obstacles constitue cependant la bonne voie et votre rapporteur soutient totalement la démarche du gouvernement français en ce sens en espérant qu'elle aboutisse au plus vite. Sous les réserves développées ci-dessus, il est rappelé que l'AMP ne s'applique qu'au-delà des seuils (48) visés ci-dessus. En deçà, c'est-à-dire dans le champ des procédures adaptées du Code des Marchés Publics français, seules s'appliquent les règles européennes et françaises. Pour autant, celles-ci sont extrêmement rigoureuses et il convient d'examiner la compatibilité avec ces règles d'un dispositif privilégiant les PME. Dans l'attente des résultats des démarches ambitieuses engagés, il serait utile qu'une loi réserve une partie des marchés publics aux PME pour les procédures en dessous des seuils européens. Une loi s'impose car l'examen de la jurisprudence du Conseil d'État laisse à penser que la Haute juridiction administrative pourrait se révéler réticente à une discrimination en faveur des PME. Cette loi pourrait utilement être précédée d'une mission d'information, voire d'une commission d'enquête, mettant à plat une question essentielle. Le rapport de MM. Betbèze et Saint-Etienne suggère, page 56, qu'une méthode informelle dans l'attente d'une réforme de l'AMP, pourrait réussir : « Mais on comprend que ceci ne pourra pas se faire dans l'instant. D'où l'idée du Pacte PME du Comité Richelieu. Celui-ci contient des programmes de soutien et des indicateurs sur la part des marchés attribués aux PME. Son extension à d'autres pays européens est en cours. Dans ce cadre, les pouvoirs publics pourront fixer aux grands comptes publics des objectifs de part des achats à attribuer aux PME, et ce sans qu'il soit nécessaire de modifier l'environnement législatif. » La fixation de tels objectifs paraîtrait juridiquement fort contestable, tant au regard du délit de favoritisme que du principe d'égalité. L'éventuelle introduction en Europe d'un « Small Business Act » n'est cependant pas le seul problème soulevé par l'Accord sur les marchés publics. C.- UNE OUVERTURE ASYMÉTRIQUE DES MARCHÉS EUROPÉENS Le fait que l'AMP ne lie que ses signataires est défavorable à l'Union européenne. Comme le souligne sur son site la Commission européenne, les fournisseurs de l'Union ne sont ainsi, dans divers pays, pas protégés contre les discriminations. Par contre, les marchés publics de l'Union européenne figurent parmi les plus ouverts du monde. Si l'on ne peut qu'approuver ce constat, en revanche, il est permis de s'interroger sur la solution, empreinte d'un regrettable angélisme ou dogmatisme : « Une initiative nouvelle pour ouvrir les marchés publics des pays tiers. La meilleure façon de réduire ou d'éliminer les obstacles aux marchés publics consiste à encourager les pays tiers à négocier avec l'UE des engagements réciproques. Lorsqu'il s'avère que des partenaires commerciaux importants indiquent clairement qu'ils refusent toute réciprocité en matière d'accès aux marchés publics, il convient de trouver une solution permettant à la fois d'ouvrir ces marchés sans pour autant succomber à la tentation protectionniste de refermer ceux de l'UE. C'est dans ce cadre que la communication de la Commission « Global Europe : competing in the world » propose d'encourager nos partenaires réticents à ouvrir leurs marchés grâce à des restrictions soigneusement ciblées. Non destinées aux PVD, ces mesures auront pour effet de convaincre ces partenaires à s'engager positivement dans des négociations relatives à l'accès au marché. » Les refus d'ouverture devraient au contraire se payer d'une totale fermeture du marché de l'Union européenne, sauf à faire de celle-ci le « cheval de Troie » de nos concurrents. IV.- POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ DES AIDES PUBLIQUES A.- UN DISPOSITIF FRANÇAIS D'AIDES PUBLIQUES AUX ENTREPRISES PEU TRANSPARENT Par leur nombre important et l'absence d'un recensement exhaustif et a fortiori d'une évaluation, les aides publiques aux entreprises constituent en France une sorte de « jungle » non défrichée. Les montants financiers en jeu semblent pourtant considérables : le rapport du Commissariat général au Plan de 2003 intitulé « Les aides publiques aux entreprises : une gouvernance, une stratégie » évalue pour l'année 2001 à 1,09 % du PIB, soit 15,8 milliards d'euros, les seules aides d'État soumises à la réglementation européenne. Ce montant doit être doublé si l'on y inclut le dispositif actuel d'allègement de charges sur les bas salaires. La notion d'aide publique, qui ne fait pas l'objet en France de définition juridique s'imposant à l'ensemble des acteurs (à l'exception de l'application du droit communautaire relatif aux aides d'État), est de fait très large. Les aides publiques aux entreprises peuvent revêtir des formes très diverses : aides d'origine budgétaire, lesquelles pouvant notamment prendre la forme de primes ou subventions, d'avances remboursables, de prêt à taux réduit ou de garanties, aides de nature fiscale (crédit d'impôt, abattement, réduction de cotisations), aides matérielles (mise à disposition d'équipements ou de services à des conditions préférentielles). Ces aides se caractérisent aussi par la multiplicité des objectifs poursuivis, la Commission européenne distinguant celles qui sont à finalité régionale, limitées à certaines zones géographiques (prime à l'aménagement du territoire par exemple), celles qui sont ciblées sur certains secteurs (agriculture, pêche...) et celles, plus générales, à finalité horizontale (emploi, formation, recherche, environnement...). À cette diversité des modes d'intervention et des finalités, correspond une multiplicité des donateurs : État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics et agences (ADEME, ANAH..), organismes consulaires (CCI, chambre des métiers...), groupements d'intérêt public, personnes morales de droit privé chargé d'une mission de service public, sociétés d'économie mixte, mais aussi organismes internationaux ou communautaires (fonds structurels)... Au sein même de l'État, c'est-à-dire d'une même personne morale, les aides ont souvent été gérées d'une façon très corporatiste par les différents ministères, sans aucune concertation, et au niveau territorial, le rôle stratégique d'anticipation et de coordination dévolu au préfet reste insuffisamment exercé vis-à-vis des services déconcentrés à compétence économique. L'abondance de l'offre rend paradoxalement le système moins accessible : les PME ne peuvent être que perdues face à ce foisonnement des dispositifs, à la multiplicité d'interlocuteurs et au nombre de dossiers à remplir ; elles finissent par ne plus rien solliciter... À la multiplicité des guichets et à leur cloisonnement, correspond un système construit selon une seule logique de stratification : les aides se sont accumulées au fil du temps en réponse à des objectifs en évolution, sans remise à plat de l'existant et mise en cohérence de l'ensemble, impossibles à mettre en œuvre dans l'urgence de la décision politique. Non seulement les donateurs sont multiples mais ils se font mutuellement concurrence. Cette absence de pilotage global du système est aggravée par l'absence de recensement global de ces aides, même si le rapport du conseil d'orientation pour l'emploi remis au Premier ministre sur les aides publiques signale l'existence de certains recensements partiels (vade-mecum de la DIACT sur les règles de concurrence communautaire qui présente de façon détaillée plus de 80 dispositifs, base de données « Sémaphore » du portail des chambres de commerce et d'industrie qui couvre 13 régions et recense plus de 5 000 dispositifs d'aides et de financements, observatoire des aides aux petites entreprises conçu par l'institut supérieur des métiers qui recense plus de 2 550 dispositifs). Quant à l'évaluation, qu'elle soit ex ante ou ex post, elle s'avère particulièrement rare ou défaillante, en dépit de l'importance des montants financiers en jeu. La faiblesse de l'évaluation préalable à la décision publique n'est pas spécifique au champ des aides publiques mais relève d'une façon générale d'une spécificité française qui ne se retrouve pas dans les pays anglo-saxons : le caractère obligatoire des études d'impact, prévu en 1993, a été suspendu par la circulaire du 26 août 2003 et les études réalisées depuis cette date se comptent sur les doigts d'une main. Comme le relève le rapport du conseil d'orientation pour l'emploi, au-delà de la question des seules études d'impact, c'est « la tentation de l'effet d'annonce qui prime sur l'analyse coût-avantages » au détriment d'une action publique responsable. S'agissant des évaluations ex-post, la Cour des comptes a dénoncé leurs limites en ce qui concerne les aides à l'emploi de l'État, dans son rapport public de 2004 : évaluation dépendant largement de l'exécutif (DARES), manque de confrontation entre des évaluations d'origine différente, travaux insuffisamment intégrés au processus de décision, insuffisance des systèmes de collecte de données. D'une façon générale, comme le relève le Conseil d'Orientation pour l'Emploi, « la demande d'évaluation paraît trop peu fréquente » et celle-ci suppose des moyens importants. Enfin, le chevauchement et l'instabilité des dispositifs d'aides apparaissent comme des obstacles au développement d'évaluations lourdes. Une analyse sans appel des conséquences de cet éparpillement des donateurs et des moyens est faite par le rapport du Commissariat général au Plan: « En France, la faible coordination entre les acteurs de l'offre et la complexité administrative constituent un très lourd handicap pour le bon fonctionnement du dispositif général. Il en résulte, pour les entreprises, de nombreux dysfonctionnements : une connaissance très partielle des régimes d'aides, un temps d'instruction des dossiers d'aides ne correspondant pas au temps de l'entreprise, un phénomène d'éviction jouant au détriment de nombreuses entreprises. Au total, les procédures administratives ont tendance à s'affirmer, malgré souvent la bonne volonté des acteurs, au détriment des logiques de projet et de développement des entreprises ». Ce rapport en conclue que « de telles faiblesses ne peuvent qu'encourager les effets d'aubaine, les comportements de recherche de rente ou les logiques de subsides au détriment de logiques d'incitation ». B.- UNE RATIONALISATION INDISPENSABLE DU DISPOSITIF D'AIDES PUBLIQUES S'agissant des seules aides allouées par l'État, le fascicule « voies et moyens » du projet de loi de finances pour 2006 ne recense pas moins de 233 dispositifs d'aides destinées aux entreprises au titre des seules dépenses fiscales. Selon le « jaune » budgétaire consacré aux PME, les crédits inscrits en faveur de ces dernières au budget de l'État s'élèvent à 2,38 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 2,085 milliards d'euros de dépenses fiscales. Pour votre rapporteur, il devient urgent d'élaguer entre toutes ces aides, afin de ne maintenir que celles qui ont fait la preuve de leur efficacité ou sont clairement orientées vers l'innovation. Elle rejoint en cela l'analyse de l'Institut Montaigne (49) qui préconise d' « évaluer et de redéployer l'aide financière aux entreprises selon des critères d'efficacité ». Il est en particulier impératif d'arrêter les tentatives de sauvetage des entreprises manifestement condamnées. Protégeons plutôt la personne des salariés et préparons l'avenir. Les personnalités finlandaises rencontrées par les membres de la mission ont toutes souligné qu'en matière de soutien public aux entreprises, leur pays n'hésitait pas à « scier les branches malades ». À cet égard, on ne peut que regretter, par exemple, que la prise en charge par l'État d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle dans les zones d'emploi « reconnues en grande difficulté au regard des délocalisations » (article 1647C sexies du code général des impôts) à hauteur de 1 000 euros par salarié, dispositif par nature très coûteux pour les finances publiques, mobilise 339 millions d'euros en 2006, contre un montant de 150 millions d'euros en 2005, sans aucune évaluation de son impact en terme d'emploi et notamment des effets d'aubaine, qui doivent être considérables. À titre de comparaison, l'ensemble des crédits (crédits budgétaires et enveloppes financiers des agences) qui doivent être répartis entre les 66 pôles de compétitivité, et qui relèvent d'une vision plus tournée vers l'avenir, ne s'élèvent qu'à 1,5 milliard sur 3 ans, soit une moyenne de 500 millions par an... La suppression de dépenses fiscales, qui pour une grande partie relèvent de véritables niches fiscales et comportent un important effet d'aubaine, permettrait de gager un allègement général de la fiscalité de droit commun sur les PME, par abaissement par exemple du taux de l'impôt sur les sociétés, comme le préconise votre rapporteur. Elle permettrait aussi de supprimer les coûts de gestion de ces dispositifs, tant pour les PME - qui y consacrent une énergie considérable détournée de tâches plus productives - que pour l'administration, de mesures aux conditions souvent complexes à remplir et à vérifier. La décision prise par le gouvernement de confier en juin dernier à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales un audit sur les aides publiques, comme l'y invitait le rapport du conseil d'orientation pour l'emploi du 8 février 2006, va dans le bon sens. L'objectif de cet audit est à la fois de recenser l'ensemble des aides publiques existantes en faveur des entreprises, en en présentant les principales caractéristiques (objectifs, montant financier, critères d'éligibilité, typologie des bénéficiaires, mode de gestion et de contrôle), de se prononcer sur leur efficacité économique, d'analyser les moyens de faciliter la publicité et la gestion des dispositifs et de faire des propositions pour en améliorer la lisibilité et l'efficacité. Il conviendra d'être attentif aux résultats de ce travail de longue haleine et de savoir en tirer les conséquences qui s'imposent. La rationalisation que propose votre rapporteur est également en phase avec la politique suivie au niveau communautaire, la commissaire européenne à la concurrence, Mme Nelly Kroes, ayant fait de la réforme des aides d'État l'une des priorités de son mandat. La philosophie guidant cette réforme est la suivante : « moins et de meilleures aides d'État ». Les nouvelles règles doivent permettre aux États membres de mieux cibler les subventions qu'ils accordent et surtout de favoriser les aides publiques accordées à la recherche et à l'innovation, qui bénéficieront d'un régime plus souple. S'agissant des aides allouées par les collectivités territoriales, il serait temps de réaffirmer le rôle de « coordonnatrice » des actions de développement économique attribué à la région sur son territoire par l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de s'orienter vers une logique de guichet unique, qui n'est pas incompatible avec le principe d'interdiction de tutelle d'une collectivité sur une autre, affirmé par l'article 72 de la Constitution. Certaines régions se sont déjà engagées dans une démarche de simplification : en région Centre, par exemple, le chef d'entreprise qui sollicite une aide n'a désormais plus qu'un seul dossier à constituer, ce dernier circulant entre toutes les collectivités concernées. Au titre de leur rôle de coordination, les régions sont désormais en outre chargées de l'établissement d'un bilan annuel, quantitatif et qualitatif des régimes d'aides mis en œuvre sur leur territoire, les premiers bilans devant être publiés cette année. Il ne faut pas non plus oublier que la loi du 13 août 2004 ouvre la faculté pour les régions d'adopter un schéma régional expérimental de développement économique et, dans ce cas, de se voir confier, par délégation de l'État, l'attribution de tout ou partie des aides que ce dernier met en œuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. C.- VERS PLUS D'ÉVALUATION : DISSUADER LES COMPORTEMENTS OPPORTUNISTES ET OPTIMISER L'UTILISATION DES DENIERS PUBLICS Comme le Conseil d'Orientation pour l'emploi, votre rapporteur pense qu'il est prioritaire de recenser, de mettre en cohérence et d'évaluer les dispositifs d'aide publique aux entreprises. M. Jean-Louis Levet, responsable du pôle industriel au sein du Conseil d'Analyse Stratégique, a rappelé aux membres de la mission lors de son audition l'existence d'une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, créée par la loi du 4 janvier 2001 et finalement abrogée le 20 décembre 2002. Cette commission, qui était présidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et comprenait six parlementaires, six ministres, des représentants des organisations syndicales et des organisations patronales ainsi que des personnalités qualifiées, était chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'État et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation et les équilibres territoriaux. Le rapport du Commissariat général au plan de 2003 s'est d'ailleurs inspiré des travaux que cette commission avait engagés sur le recensement des aides, l'identification de pratiques d'évaluation et les expériences étrangères. Votre rapporteur estime nécessaire de se redonner les moyens de vérifier le respect des conditions posées par le cadre législatif ou réglementaire, et d'une évaluation de ces aides, c'est-à-dire d'une analyse de leur efficacité par rapport aux objectifs poursuivis et de leur efficience par rapport aux moyens engagés. Afin de ne pas créer de nouvelles structures, cette mission pourrait être rattachée à une structure existante, le Conseil d'orientation pour l'emploi. Cet organisme serait bien entendu destinataire des bilans réalisés par les régions en application de la loi du 13 août 2004. Ainsi une même structure serait chargée de suivre les questions relatives à l'emploi, aux aides publiques, aux délocalisations et à la mondialisation garantissant ainsi la continuité de la pensée et de l'action sur ces sujets connexes. C'est un préalable à la mise en œuvre d'une conditionnalité des aides, qui permettra de moraliser les pratiques en dissuadant les comportements prédateurs de certains groupes et d'améliorer l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût/efficacité de l'aide, dans une logique de maîtrise des dépenses publiques. Les grands groupes industriels qui procèdent à des délocalisations ont souvent préalablement bénéficié pendant plusieurs années d'aides publiques, qui ont constitué un avantage comparatif pour leurs filiales situées en France. Mais si ces dispositifs d'aides permettent de maintenir des sites de production en France dans un premier temps, ces derniers sont fermés dès que l'avantage prend fin : au bout du compte, seuls les actionnaires du groupe tirent bénéfice de cette situation, tandis que les bassins d'emploi concernés sont fragilisés. Pour votre rapporteur, les aides doivent perdre leur caractère automatique ; il est nécessaire de subordonner l'obtention des aides publiques au respect d'engagements préalables de l'entreprise bénéficiaire à maintenir son activité et ses effectifs. Évoquée le 4 mai 2004 par M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d'État de l'économie et des finances, pour sanctionner le comportement opportuniste d'entreprises bénéficiaires d'aides destinées à faciliter leur implantation sur le territoire, l'idée d'une clause de remboursement en cas de délocalisation a fait l'objet de plusieurs propositions de loi (50) et connaît déjà plusieurs applications tant en droit interne qu'en droit communautaire. Comme le conseil d'orientation pour l'emploi, votre rapporteur estime que « des clauses de remboursement existent déjà pour certains dispositifs spécifiquement liés à la localisation d'activités » et qu' « il pourrait être envisagé de les élargir à l'ensemble des aides à l'investissement ». Même s'il ne s'applique pas qu'aux seules délocalisations, l'article 1465 du code général des impôts dispose que dans les zones éligibles à la prime à l'aménagement du territoire et les territoires ruraux de développement prioritaire, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle. En outre, un dispositif spécifique aux délocalisations affectant les zones de revitalisation rurale a été instauré par l'article 6 de la loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005 : « toute entreprise, ou organisme, qui cesse volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser les concours qui lui ont été attribués ». Cet article n'a cependant pas encore été appliqué, faute de la parution de son décret d'application. S'agissant des collectivités locales, l'article L. 1511-4 du code général des collectivités territoriales dispose de façon générale que celles-ci « déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ». La jurisprudence a reconnu la possibilité et même la nécessité d'imposer des contreparties à l'aide accordée, par exemple en terme de création d'emplois : comme le rappelle le commissaire au gouvernement Touvet dans l'affaire « Commune de Fougerolles » (CE, 3 novembre 1997), les aides des collectivités à des personnes privées à but lucratif ne sont pas des libéralités, par ailleurs prohibées, pour autant qu'elles trouvent une contrepartie en termes d'intérêt général. Ces contreparties garantissent que l'intervention poursuit un but d'intérêt général, seul à même de justifier l'avantage concurrentiel apporté par l'aide. La région Centre a ainsi mis en place dès 1995 un double dispositif de contrôle et d'évaluation et conditionne toute aide ou avance remboursable (34 millions d'euros en 2005 au bénéfice de 600 entreprises) à la signature d'un contrat dans lequel les entreprises s'engagent sur les investissements, les emplois à créer, le maintien de leur siège social, etc...Si ce contrat n'est pas respecté, soit 10 à 12 cas par an environ, selon les informations figurant dans un article de la Tribune du 1er mars 2006, les entreprises doivent rembourser, totalement ou partiellement les aides, un agent du conseil régional étant chargé d'évaluer le respect des engagements pris. En cas de non-respect de ses engagements par l'entreprise, le principe d'une demande de remboursement est admis par la jurisprudence (CE 8 juillet 1988 Sabdec), et cela même si la décision institutive ne prévoit pas de sanction ; encore faut-il que la condition soit clairement posée et ne soit pas un simple critère d'appréciation pour l'attribution de l'aide, qu'elle soit en rapport avec les objectifs affichés des aides et conforme au droit communautaire : si une condition de non-délocalisation prévue pour une durée limitée respecte cette dernière exigence, il n'en est pas de même d'un engagement ne comportant pas de limite de durée, qui serait contraire au principe de la liberté d'établissement. En droit communautaire, l'existence d'une clause de remboursement est déjà prévue par la réglementation des aides d'État à finalité régionale, comme le prolongement de l'obligation de maintenir les emplois et les investissements pendant cinq ans, et envisagée par d'autres régimes d'aides publiques (régime des aides d'État à l'emploi fixé par le règlement 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 ou régime d'aide à l'investissement des PME fixé par le règlement n° 70/2001). À titre d'exemple, la réponse de la Commission au début de l'année 2000 à la notification du régime de la prime à l'aménagement du territoire demande de façon explicite le remboursement de l'aide, de surcroît dans sa totalité, en cas de non respect du délai de cinq ans pour le maintien des investissements aidés. Votre rapporteur estime que cette réflexion sur la conditionnalité des aides et l'instauration d'une clause de remboursement ne doit pas rester au seul niveau national, mais s'appliquer aussi aux aides émanant de l'Union européenne, c'est-à-dire aux fonds structurels. Elle ne peut que saluer à ce titre les récentes initiatives du Parlement européen en la matière. Une résolution sur les fermetures d'entreprises ayant bénéficié d'une aide financière de l'Union européenne votée le 13 mars 2003 prévoit notamment « que soient refusées les aides communautaires aux entreprises qui, après avoir bénéficié d'une aide dans un État membre, transfèrent leurs unités de production dans un autre pays sans avoir rempli intégralement les contrats signés avec cet État membre » et demande « à la Commission ainsi qu'aux États membres de réclamer le remboursement des subventions aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations ». Elle a été complétée par l'adoption en mars dernier d'une nouvelle résolution sur ce thème sur la base du « rapport sur les délocalisations dans le contexte du développement régional » présenté par M. Alain Hutchinson au nom de la commission du développement régional. Elle se félicite aussi que, selon les informations fournies à la mission par la direction générale « Entreprises et industrie » de la Commission européenne, le nouveau règlement relatif au FEDER sur la période 2007-2013 contienne des dispositions permettant de surveiller l'impact des fonds structurels sur d'éventuelles délocalisations et exige une description des autres implantations européennes de l'entreprise dans la demande, afin de ne pas encourager des projets qui ne seraient pas globalement créateurs d'emploi. Il n'existe donc pas d'obstacles juridiques à l'instauration de contreparties au versement des aides publiques et d'une clause de remboursement, à partir du moment où les engagements demandés aux entreprises figurent clairement dans le contrat constitutif de l'aide et s'inscrivent dans une durée limitée. L'entreprise en contrepartie du versement d'une aide s'engagerait sur des objectifs chiffrés, avec formule de calcul des pénalités et contrôle annuel. La commission indépendante, que votre rapporteur appelle de ses vœux, pourrait s'assurer que les défaillances sont sanctionnées. L'existence d'un comportement déloyal étant parfois délicat à prouver, la charge de la preuve serait renversée du côté de l'entreprise. Cependant votre rapporteur ne nie pas les difficultés pratiques que peut poser une clause de remboursement dans certains cas : le recouvrement des trop-perçus peut s'avérer coûteux pour la collectivité ; les entreprises, surtout les plus petites, hésiteront à s'engager sur un horizon temporel éloigné et sur des créations d'emploi, qui restent conditionnées à la conjoncture économique qu'elle ne maîtrise pas ; la clause de remboursement peut enfin dissuader une entreprise de se lancer dans un projet d'investissement plus risqué, même si à terme, en cas de réussite, celui-ci est plus porteur en terme d'emploi. Dans ces hypothèses, comme le suggère le rapport du conseil d'orientation pour l'emploi, il serait plus simple de prévoir des versements échelonnés et conditionnels, plutôt qu'un versement intégral de l'aide assorti d'une clause de remboursement. À titre d'exemple, la prime à l'aménagement du territoire, dont l'attribution est conditionnée à des engagements en terme d'emploi qui doivent être maintenus pendant cinq ans, est versée en trois fois : un tiers au démarrage du projet, un tiers lorsque 2/3 des créations d'emplois prévus sont réalisées et le solde à la fin du programme. En dehors de l'avance initiale de 33 %, chaque demande de paiement de l'entreprise fait l'objet d'une instruction départementale qui vérifie le niveau de réalisation des engagements et fait donc l'objet d'un versement sur « service fait », en fonction du nombre d'emplois réellement créé. Un contrôle systématique est en outre fait par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au bout de la période des 5 ans pour vérifier le maintien des emplois créés et le Comité interministériel d'aide à la localisation d'activités, commission chargée d'attribuer cette prime, prononce chaque année une trentaine d'annulations de prime avec demande de reversement des sommes indûment perçues. Dans 5 à 10 autres cas par an environ, le Comité interministériel d'aide à la localisation d'activités prononce cependant le maintien des sommes perçues en raison de la bonne foi de l'entreprise et des difficultés financières mettant en péril sa survie, privilégiant ainsi une démarche très pragmatique, moins dissuasive pour les investissements des entreprises. V.- FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE : DIMINUER A.- UN ÉCART ENTRE COÛT DU TRAVAIL ET SALAIRE NET PARMI LES PLUS ÉLEVÉS DES PAYS DE L'OCDE La France se distingue aujourd'hui de ses principaux partenaires non pas par le niveau de son salaire moyen mais par le poids de ses charges sociales, tant dans son système de financement de la protection sociale que dans ses coûts salariaux. Malgré l'élargissement de l'assiette des prélèvements intervenu avec la création de la CSG et de la CRDS, les cotisations sociales représentent en France encore 60 % des recettes de la sécurité sociale stricto sensu en 2004. En outre, les régimes d'assurance chômage et de retraites complémentaires sont financés quasi-exclusivement par des cotisations sociales. Le financement de la protection sociale pèse donc encore majoritairement sur les revenus d'activité. Depuis la substitution de la CSG à la quasi-totalité des cotisations salariales d'assurance maladie et malgré la montée en charge des différentes mesures d'exonérations de charges, ce sont les cotisations patronales qui assurent en France l'essentiel des cotisations, soit 79 % de leur ensemble en 2005. Selon les données de l'office européen des statistiques Eurostat, les cotisations sociales patronales représentaient 46,1 % du total des recettes de protection sociale en France en 2003, ce qui place notre pays largement au-dessus de la moyenne de l'Europe à 25 (38,9 %) et de la zone euro (41,2 %). La part de ces cotisations en pourcentage du PIB s'élève à plus de 11 % du PIB, soit la plus importante d'Europe. Cette forte proportion du financement de la protection sociale assurée par les cotisations sociales se répercute sur les coûts salariaux. Les cotisations patronales pesant sur un salaire supérieur à 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire à 1 949 euros, représentent ainsi près de 45 % du salaire brut, dont 28,10 % pour les cotisations au régime de base de la sécurité sociale (hors accidents du travail). Ce dernier chiffre place la France au premier rang européen pour son niveau de charges patronales de sécurité sociale, la moyenne de l'Union européenne atteignant seulement 19,1 % et le Danemark représentant l'autre extrême à 1 %. La situation est cependant nettement plus favorable pour les salaires situés au niveau du SMIC, la mise en place d'un dispositif général d'exonération de charges (réduction dite « Fillon ») ayant abaissé les cotisations patronales finançant le régime général de sécurité sociale à 2,1 % du salaire brut. COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE EN EUROPE (en % des coûts de main-d'œuvre)
Source : CDC - IXIS (2003) Dans un contexte d'économie mondialisée, ce mode de financement constitue un handicap certain pour la compétitivité des entreprises françaises et pénalise particulièrement les industries de main-d'œuvre, soumises à la concurrence des pays à bas salaire mais également à celle des pays ayant choisi un mode alternatif de financement de la protection sociale par l'impôt (Danemark, Luxembourg, Irlande) ou le recours à une assurance privée. Il ne permet pas non plus de retenir les salariés les plus méritants, comme l'ont souligné les industriels du Doubs auditionnés par la mission d'information : un cadre employé en Suisse percevra un salaire net supérieur de 34 % à celui qu'il aurait en France pour un coût identique pour l'employeur. Une étude remise à la mission par la chambre française de l'horlogerie et des microtechniques intitulée « Industrie horlogère française, vers une délocalisation en Suisse ? » est tout à fait claire : le salaire net perçu représente seulement 48 % du coût salarial total pour l'employeur en France, qu'il s'agisse d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, alors qu'il en représente 68 % pour un agent de maîtrise et 65 % pour un cadre en Suisse ; pour un coût identique total pour l'employeur de 6 200 euros, un cadre touchera près de 3 000 euros en France, contre 4 030 euros en Suisse. Ce décalage est particulièrement fâcheux pour les entreprises situées dans les zones frontalières, qui, fait aggravant, sont pénalisées en outre par le non assujettissement des travailleurs transfrontaliers à la CSG et à la CRDS (en vertu d'un arrêt de la CJCE Commission des communautés européennes contre France du 15 février 2000), mais aussi d'une façon plus générale pour l'embauche de salariés très qualifiés, qui sont les plus mobiles. Il ne joue pas en revanche pour les employés les moins qualifiés, en raison de leur mobilité géographique plus faible et de l'existence d'un dispositif général d'exonération de charges sociales. SITUATION DE LA FRANCE
SITUATION DE LA SUISSE
Source : Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques. B.- UNE RÉFORME DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE INDISPENSABLE POUR AFFRONTER LE DÉFI DE LA MONDIALISATION Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la réforme du financement de la protection sociale, ait été au cœur du débat public en cette année 2006 et fait l'objet de pas moins de quatre rapports ou avis (Groupe de travail sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs de sécurité sociale, Conseil d'orientation pour l'emploi, Conseil d'analyse économique, Centre d'analyse stratégique), à la demande du Président de la République. Parmi les pistes évoquées, les réflexions tendant à réduire les charges pesant sur le travail et à leur substituer une imposition des produits, sous la forme d'une « TVA sociale » ou « TVA de compétitivité », prennent tout leur sens dans le cadre d'une économie mondialisée. Dans son avis du 27 juillet 2006, le conseil d'analyse économique note ainsi qu'en économie fermée, plusieurs variantes de la contribution sur la valeur ajoutée ont des effets très voisins de celui d'un accroissement de la TVA mais « qu'il n'en est pas de même en économie ouverte où les formules évoquées cessent d'être approximativement équivalentes, puisque, en taxant les importations et en détaxant les exportations, la TVA a des effets positifs sur la compétitivité dont il est important de bien apprécier l'intensité et l'horizon ». Sous réserve d'un examen approfondi nécessaire de ses modalités de mise en œuvre, la TVA sociale présente en effet de nombreux avantages aux yeux de votre rapporteur. 1. La TVA sociale, facteur de rétablissement de la compétitivité relative des entreprises françaises a) Rétablir les conditions d'une concurrence loyale sur le marché domestique et stimuler nos exportations Le basculement d'une partie des cotisations patronales vers la TVA bénéficierait à double titre aux produits français. Tout d'abord, la compétitivité relative des biens produits sur le territoire national et destinés au marché français serait améliorée car les produits importés, assujettis à la TVA, verraient leurs prix de vente augmenter. Le report sur ces produits d'une partie du financement de la protection sociale pourrait même conduire en outre, dans la mesure où ce transfert ne serait pas intégralement compensé par la diminution des recettes sociales liées aux exportations, à un moindre prélèvement social, l'assiette étant au final plus large. L'enchérissement d'un produit domestique lié à la mise en œuvre de la TVA sociale pourrait être finalement inférieur à la baisse de son coût de revient consécutive à la suppression d'une partie des cotisations sociales ; dans cette situation, les producteurs français de biens intensifs en main-d'œuvre auraient la possibilité de pouvoir vendre ceux-ci moins chers en profitant de l'élargissement de l'assiette d'imposition. Or, cette nouvelle assiette risque d'être d'autant plus large que la moitié des produits industriels consommés en France sont importés. Deuxième effet positif, l'instauration d'une TVA sociale devrait permettre de soutenir les produits français à l'export car l'allègement du coût du travail n'est pas compensé dans ce cas par une augmentation de TVA, les biens exportés étant soumis au taux de TVA du pays dans lequel ils sont achetés. Au total, les effets de la TVA sociale s'apparentent à ceux d'une dévaluation compétitive : hausse des coûts des produits importés sur le marché interne, baisse des coûts à l'exportation. Cet allègement du coût du travail et ce surcroît de compétitivité des produits français devraient permettre de relancer l'emploi. Le rapport du groupe de travail interministériel sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs de sécurité sociale évalue ainsi à 23 000 le nombre d'emplois qui pourrait être créé en deux ans à l'occasion d'un basculement de 2,1 points de cotisations patronales. La création de ces emplois permettrait de soutenir la demande domestique. En cette période de concurrence fiscale sauvage en Europe, la TVA a l'avantage en outre de ne pas inciter les facteurs les plus mobiles (capital et professionnels très mobiles) à se délocaliser. b) Responsabiliser le consommateur sur ses choix Le sentiment de perte de pouvoir d'achat des consommateurs qui pourrait être généré par l'augmentation du taux de TVA n'est en lui-même pas fondé car les entreprises intègrent déjà le montant des charges patronales dans le prix final payé par le consommateur. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un simple transfert de charges globalement neutre, dans la mesure où les entreprises françaises répercuteraient la baisse de cotisations patronales sur le prix de vente HT de leurs produits. Tout dépendra en fait du « panier de la ménagère » et de l'arbitrage du consommateur entre produits nationaux et produits importés. Ce basculement serait aussi l'occasion de distinguer au sein de notre système de protection sociale les dépenses relevant davantage d'un système de solidarité, ou non subordonnées à un critère d'activité professionnelle : est-il normal de faire reposer sur les cotisations patronales le financement d'une grande partie de la branche famille, alors que le droit aux allocations familiales est déconnecté de toute assise professionnelle depuis 1978 ? De même, il n'existe plus aucun lien entre le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et le salariat. À l'inverse, les cotisations d'accident du travail relèvent à l'évidence d'une logique assurantielle, mettant en œuvre le comportement de prévention des entreprises, et leur financement ne saurait reposer sur un impôt de consommation. Les cotisations retraites s'analysent quant à elles à des éléments de salaire différé. Basculer une partie des cotisations patronales sur la TVA, c'est donc aussi donner à la société la possibilité de débattre enfin du niveau des dépenses de cohésion sociale et au consommateur de dépenses de santé d'assumer ses choix. 2. Des dispositifs déjà mis en œuvre ou envisagés dans d'autres pays européens Les règles communautaires ne constituent pas un obstacle à l'instauration d'une TVA sociale : elles prévoient que les États membres sont libres de fixer le taux normal, dès lors qu'il atteint ou dépasse 15 %. Dans le silence de la sixième directive européenne du 17 mai 1977, seul un accord non écrit entre États membres prévoit un plafond de 25 % pour le taux normal, plafond atteint par certains de nos partenaires (Danemark). Le taux normal de TVA étant de 19,6 % en France et onze États membres ayant un taux supérieur au nôtre en Europe, une marge existe. Plusieurs pays européens financent déjà une partie de leur protection sociale par le biais de la TVA : en Belgique, la TVA représente 88 % du financement par impôts affectés ; le Danemark a engagé une réforme d'envergure entre 1987 et 1989 qui a consisté à supprimer la quasi-totalité des cotisations patronales au profit d'une augmentation de 3 points de TVA ; le Portugal a également relevé de deux points son taux normal de TVA en 2005 en affectant le surplus de recettes à la sécurité sociale et aux retraites. L'Allemagne s'oriente également dans une telle voie : le taux normal de TVA sera relevé de trois points au 1er janvier 2007, cette augmentation étant partiellement affectée à hauteur d'un point à l'allègement des cotisations patronales d'assurance-chômage. Les précédents existent donc et nos produits exportés financent déjà le régime de protection sociale de ces pays, sans que les produits de ces derniers contribuent au financement de la nôtre lorsqu'ils sont exportés en France. Comme le souligne l'avis du Conseil d'analyse stratégique d'août 2006, toute réforme du mode de financement de notre système de protection sociale doit tenir compte des stratégies de réforme mises en œuvre par nos principaux partenaires et concurrents. Elle le doit d'autant plus lorsque c'est notre principal partenaire commercial, l'Allemagne, qui emboîte le pas du Danemark, en faisant passer son taux de TVA de 16 à 19 % à compter du 1er janvier 2007, un point de TVA étant consacré à la baisse des charges patronales. Et que cette même Allemagne a décidé de faire baisser son impôt sur les bénéfices des sociétés de 36 à 30 % au 1er janvier 2008, puis à 25 % en 2009. Sachant que l'Allemagne constitue à la fois le premier pays de destination de nos exportations (près de 15 % du total) et le premier pays d'origine de nos importations (17 % du total environ), il serait dangereux de ne pas en tenir compte : les parts de marché de nos entreprises risquent d'en être affectées, aussi bien sur le marché domestique que sur leur principal marché à l'export. On avance souvent à l'encontre de la TVA sociale l'argument du caractère injuste socialement de cet impôt. Il s'agit en effet d'un impôt proportionnel et non progressif. Comme beaucoup d' « évidences », celle-ci gagne à faire l'objet d'une analyse. En premier lieu, cet argument méconnaît le fait que les revenus ayant permis l'achat assujetti à la TVA ont déjà été, souvent lourdement, imposés : impôt sur le revenu, CSG, plus-values, etc. Ils l'ont même été parfois plusieurs fois, ainsi lorsqu'il y a « désépargne » pour procéder à un achat. Il est vrai que beaucoup de Français ne paient pas l'impôt sur le revenu ; la TVA est, elle, payée par tous, de même que la protection sociale profite à tous. En second lieu, quelle leçon retenir du modèle scandinave, dont la « capacité à faire fonctionner un mariage réputé impossible entre État-providence et compétitivité fascine et intrigue » ? (51) Il faut en retenir que les entreprises ne peuvent assurer le financement de la protection sociale et qu'il convient d'en assurer le financement sur d'autres bases, la TVA (au taux de 25 % au Danemark) et la fiscalité directe. Ces sociétés sont à la fois très égalitaristes et consensuelles, comme la mission a pu le constater en Finlande. Est-ce le cas en France ? Votre rapporteur en doute beaucoup. Augmenter la TVA de manière modérée apparaît donc comme la meilleure voie. En outre, le poids de la fiscalité directe est très dissuasif, même en Scandinavie. Ainsi, les Danois travaillent un nombre d'heures parmi les plus faibles au monde, ce qui n'est pas sans poser problème, si l'on cumule ceci avec le vieillissement de la population. De plus, le financement très généreux qui en résulte conduit à des excès. « Les congés pour incapacité de travail ont augmenté de 13 % de 2002 à 2005, et, pour la tranche d'âge 20-34 ans, de 28 % ! On en arrive à des situations ubuesques où des jeunes qui ne sont jamais entrés sur le marché de l'emploi sont inscrits en incapacité de travailler ! La plupart des raisons des arrêts pour maladies ou pour incapacité sont le stress, la dépression et l'épuisement au travail. En revanche, les affections lourdes et faciles à diagnostiquer, comme les cancers, les infarctus, les ruptures d'anévrisme ou l'asthme, ont diminué ou tout au moins se sont stabilisées. À l'arrivée, le paradoxe est de taille : les Suédois sont en meilleure santé et voient leur espérance de vie s'allonger, et pourtant ils ne se sont jamais sentis si malades ! Il semblerait que les descendants des Vikings soient devenus délicats en diable et restent à la maison au moindre rhume. Cette épidémie nationale a coûté la bagatelle de 10 milliards d'euros à l'État suédois en 2005, soit l'équivalent de 6 % du budget de l'État et plus que toutes les dépenses d'éducation du pays ! Les indemnités sont faciles d'accès et très généreuses, puisque le patient touche en général 90 % de son salaire pendant au moins un an d'arrêt-maladie. Sans compter les personnes indélicates qui « complètent » en travaillant au noir, en touchant des indemnités parentales ou des indemnités de chômage... Si l'État a commencé à s'attaquer au phénomène et à augmenter les contrôles, beaucoup reste à faire. Les syndicats appliquent par exemple la règle du « dernier entrant premier sorti », privant les entreprises des salariés les moins usés et désabusés. Nombreux aussi sont les trentenaires ayant reçu une éducation tout à la fois permissive et protégée, qui, si elle leur a donné une grande confiance en eux, ne leur a jamais donné la notion de l'effort et du travail. « Les performances du marché du travail laissent à désirer », souligne pudiquement l'OCDE, qui affirme, que pour avoir une chance de conserver leur modèle avec une population vieillissante, il faut que les Suédois se remettent au travail sans tarder. » Source : Ouvrage précité de Mme Marie-Laure Le Foulon, pages 146 et 147 Le risque, si l'on refuse la TVA sociale, est alors que faute d'avoir trouvé un financement de substitution, la compétitivité de l'économie française se dégrade lentement et que petit à petit l'État providence soit démantelé. En résumé, cette solution apparaît comme la plus souhaitable de celles sérieusement envisageables. Rappelons que le démantèlement de notre système de protection sociale n'affectera guère les « riches », catégorie pourtant vouée aux gémonies dans notre pays. 3. Quelles modalités pour la mise en œuvre d'une TVA sociale en France ? S'appuyant sur un impôt indirect existant et donc sur un circuit de prélèvement déjà en place, cette réforme aurait l'avantage d'être rapidement mise en œuvre. C'est un élément important aux yeux du conseil d'analyse économique qui, sans pouvoir se prononcer définitivement sur les différentes pistes de réforme du financement de la protection sociale, estime que doivent être privilégiées celles qui s'appuient sur des prélèvements existants. De même, le conseil d'analyse stratégique souligne qu' « il est préférable de recourir pour le choix des prélèvements de substitution à des assiettes larges et connues, également utilisées hors de nos frontières ». Le recours à la TVA sociale présente également l'avantage de mettre en balance des montants financiers connus. Selon les chiffres figurant dans le rapport du groupe de travail interministériel sur l'élargissement de l'assiette des cotisations employeurs, le rendement d'un point de TVA au taux normal représente 5,78 milliards d'euros et celui d'un point de TVA au taux réduit équivaut à 2,24 milliards. Le rapport de juin 2006 de la commission des comptes de la sécurité sociale évalue quant à lui à environ 4,3 milliards d'euros le rendement en 2005 d'un point de cotisation déplafonnée pour le champ du secteur salarié privé. Le groupe interministériel précité a retenu l'hypothèse d'un basculement de 2,1 points de cotisations patronales de sécurité sociale, dans la mesure où ce taux correspond au taux de cotisations patronales de sécurité sociale (hors accidents du travail) pesant sur le SMIC après exonération. Dans ces conditions, un basculement de 2,1 points de cotisations sociales correspondrait à un transfert de 9 milliards d'euros, qui n'imposerait pas un relèvement aussi important du taux de TVA. Si elle approuve le choix de ne pas retenir les cotisations d'accident du travail, d'assurance chômage ou de retraites complémentaires dont le lien avec l'exercice d'une activité professionnelle est réel, votre rapporteur s'interroge cependant sur l'ampleur et les modalités de ce basculement, qui ont été déterminés par la volonté de ne pas remettre en cause la progressivité des prélèvements sociaux sur les bas salaires. Le maintien d'une aussi forte progressivité ne doit-il pas cependant faire débat, sachant que la proportion de salariés rémunérés au niveau du salaire minimum a atteint un niveau historique en 2004 de 15,6 % contre 8,2 % en 1995 ? Votre rapporteur juge opportun de rappeler que l'écart de cotisations patronales de sécurité sociale pour un salaire égal au SMIC et un salaire équivalent à 1,6 fois le SMIC est de 26 points et s'avère particulièrement dissuasif pour la progression de carrière des travailleurs moins qualifiés. D'autant plus que le SMIC a évolué plus rapidement que le salaire moyen ces dernières années, compte tenu de son mode de calcul et d'indexation et du rattrapage lié aux 35h. À titre d'exemple, un employeur qui souhaite augmenter le salaire brut de son employé de 1 254,28 euros (SMIC) à 1 505,14 euros (soit 1,2 fois le SMIC), c'est-à-dire de 250,86 euros, devra supporter une majoration de cotisations patronales de sécurité sociale (hors accident de travail) de 11,6 points, s'élevant à près de 180 euros. STRUCTURE DES COTISATIONS SOCIALES PATRONALES (en pourcentage du salaire brut - au 1er janvier 2006)
* Plafond de la Sécurité sociale : 2 589 euros. (1) Association de gestion des fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO : financement du dispositif de retraite à 60 ans dans les régimes de retraite complémentaire. Sans supprimer totalement cette progressivité, un basculement de points de cotisations patronales sur la TVA d'un montant non uniforme et plus particulièrement ciblé sur les salaires intermédiaires supérieurs à 1,2 fois le SMIC pourrait l'atténuer et mettre fin à cette « trappe à bas salaires ». La création d'une TVA sociale permettrait ainsi de prendre le relais du dispositif déjà existant en matière d'exonérations de cotisations pour les salaires situés au niveau du SMIC, qui a permis de réduire à une portion congrue les cotisations patronales de sécurité sociale. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé une suppression totale des 2,1 points de cotisations du régime de base restant sur le SMIC pour les entreprises de moins de 20 salariés, mesure qui, tout en étant intéressante pour les très petites entreprises, encourage un maintien des salaires au niveau du SMIC et crée un nouveau seuil. En facilitant la progression de carrière des moins qualifiés, un basculement de cotisations ciblé offrirait à ces travailleurs une compensation à l'augmentation du taux de TVA, sans que cela ne coûte le moindre euro aux finances publiques. À l'inverse, avec une revalorisation de son montant maximal de 538 à 948 euros entre 2005 et 2007, soit une hausse de 76 % en deux ans, le développement de la prime pour l'emploi atteint aujourd'hui ses limites : le coût de ce crédit d'impôt représentera un montant de 4,2 milliards l'an prochain. Il sera difficile d'aller plus loin, d'autant plus que cette prime n'a fait l'objet d'aucune évaluation permettant de confirmer ou d'infirmer son efficacité dans la lutte contre le chômage des moins qualifiés. Votre rapporteur appelle cette évaluation de ses vœux, le dispositif actuel n'apportant aucune lisibilité à ses bénéficiaires et ayant été dénoncé pour son absence de ciblage et l'ambiguïté de ses objectifs par la Cour des Comptes ainsi que pour l'ampleur des fraudes. Une réflexion pourrait être engagée sur le réaménagement de cette prime. Il est important également que ce basculement ne s'arrête pas au seuil actuellement retenu pour les exonérations de cotisations sociales c'est-à-dire 1,6 fois le SMIC. En effet, il en va de la défense de nos emplois à valeur ajoutée, qui seront amenés, dans une logique de stratégie de montée de gamme, à compenser les suppressions d'emplois liées aux délocalisations. M. Pierre Nanterme, président de la commission Économie du MEDEF, a ainsi regretté qu'une plus grande attention ne soit pas portée aux emplois d'avenir. Pour votre rapporteur, il conviendrait donc d'examiner de façon plus approfondie la manière dont pourrait être introduite une TVA sociale sur la base d'une augmentation d'un point du taux normal de TVA, soit 5,78 milliards d'euros, avec une réduction à l'euro près des charges patronales du régime de base relevant d'une logique de solidarité, en s'appuyant notamment sur une évaluation précise des expériences étrangères. Ce choix d'une augmentation très mesurée d'un point de TVA permet de réduire les risques d'un impact inflationniste de cette mesure, que certains craignent en dépit de l'absence de mécanismes d'indexation automatique des salaires sur l'indice des prix. Ce souhait d'un approfondissement de la réflexion engagée sur la TVA sociale rejoint celui des économistes membres du conseil d'analyse économique, qui déplorent la faible mise en perspective de la différence due à l'ouverture de notre économie dans les simulations faites par le groupe interministériel entre les diverses pistes de réforme et regrettent le caractère plutôt sommaire de la modélisation de l'incidence à long terme de la TVA sociale, qu'il s'agisse des effets de substitution entre les différentes formes de travail et de capital et des effets de distribution entre entreprises exportatrices et celles qui ne le sont pas. « Les réactions des membres du conseil d'analyse économique montrent que la TVA sociale, vu l'intérêt qu'elle suscite, nécessite des études complémentaires » (avis du 27 juillet 2006). VI.- POUR UNE FISCALITÉ DES ENTREPRISES ADAPTÉE La charge que représentent les prélèvements obligatoires participe au risque de délocalisation des entreprises installées en France. Ils constituent, à bien des égards, un frein à la compétitivité en pesant directement sur la compétitivité-coût des entreprises par une augmentation des coûts de production et indirectement sur la compétitivité structurelle en grevant les possibilités d'investissement de recherche développement des entreprises. Outre les charges sociales et les impôts locaux, la principale contribution des personnes morales dont sont redevables les sociétés est constituée par l'impôt sur les sociétés. La France est, parmi les pays européens, l'un de ceux qui pratiquent l'un des taux d'imposition les plus élevés, avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Or, on constate qu'au cours des dix dernières années, une douzaine de pays-membres ont considérablement abaissé le taux d'imposition des sociétés dans une inquiétante spirale vers le bas des ressources fiscales. Afin de restaurer les conditions d'une compétitivité équitable entre les entreprises européennes, qui tienne compte à la fois de la mondialisation et de l'élargissement de l'Union européenne, il conviendrait de faire en sorte que la concurrence fiscale qui s'exerce entre les pays membres de l'Union européenne s'exerce selon un minimum de règles communes. Dans un article du 5 juillet 2006, Mme Agnès Bénassy-Quéré, directrice adjointe du CEPII, publié sur le site du laboratoire d'idées en ligne Telos, voit une double raison à la baisse continue de l'impôt sur les sociétés en Europe, alors que tel n'est pas le cas aux États-Unis où les bénéfices sont imposés au taux de 40 %. « D'abord, l'Union européenne se comporte comme une collection de petits pays plutôt que comme une grande puissance : Chaque État considère comme donné le taux de rendement du capital privé sur lequel il doit s'aligner, alors que collectivement, l'UE pourrait avoir un poids sur la fixation de ce taux de rendement. Ensuite, la concurrence fiscale se double du problème de l'optimisation fiscale : dès lors qu'il est possible de payer ses impôts en Estonie (où les bénéfices réinvestis sont exemptés) tout en produisant en France pour le marché allemand, les entreprises ne voient plus le lien entre le taux d'imposition et les infrastructures mises à leur disposition ». Actuellement, les entreprises françaises sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux normal de 33,34 % le taux moyen dans l'Europe des 25 étant de 26 %, contre 36,7 % en 1996. Toutefois, les petites et moyennes entreprises bénéficient d'un taux réduit de 15 % sur le montant de leur bénéfice plafonné à 38 120 euros. En s'inspirant de ce que proposent MM. Betbèze et Saint-Étienne dans leur rapport « Une stratégie PME pour la France », il serait souhaitable de créer un taux réduit de 18 % sur les 500 000 premiers euros imposables, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires, avec 100 000 euros imposables à 18 % sans condition de chiffres d'affaires, le taux de 15 % restant applicable dans les conditions actuelles aux très petites entreprises. Parallèlement, il convient de dynamiser les négociations européennes afin de parvenir au plus vite à une harmonisation fiscale de l'imposition des sociétés entre les différents pays européens. Depuis la publication en 2001 de la communication « vers un marché intérieur sans entraves fiscales », une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés (ACCIS) couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne, l'objectif de la commission a été de mettre en œuvre cette proposition, sans toutefois qu'une telle réforme ne soit mise en place. L'idée qui sous-tend ce projet consiste à consolider les bénéfices et les pertes réalisées par chaque multinationale sur l'ensemble du territoire communautaire. Le bénéfice consolidé serait alloué entre les différents pays concernés selon une clé de répartition qui pourrait tenir compte de la localisation de la production et du chiffre d'affaires. Il convient de signaler que les États-Unis et le Canada ont instauré un tel système, ce qui a pour effet d'assainir la concurrence entre les différents États. Une transposition de ce système en Europe, voie dans laquelle s'achemine la Commission, aurait ainsi pour effet que, selon l'exemple cité par Telos, « si la production est réalisée en France et les ventes en Allemagne, l'impôt ne peut plus être payé en Estonie. La consolidation-répartition de la base fiscale n'annihile pas la concurrence. Elle peut même l'exacerber puisque les différences deviennent plus transparentes. Mais elle l'assainit : les états membres offrant aux entreprises une localisation plus attrayante ou des infrastructures de qualité peuvent imposer plus lourdement les bénéfices. Et les multinationales peuvent également y trouver leur compte puisque les pertes réalisées dans un pays viennent réduire la facture fiscale dans un autre pays ». En octobre 2005, la Commission s'est fixé pour nouvel objectif de présenter une mesure législative en ce sens en 2008. Dans sa communication du 5 avril 2006, la commission fait un point sur l'état d'avancement des travaux et du programme ACCIS. Il y est notamment précisé : « La commission, suivie en cela par le Parlement européen, reste d'avis que l'ACCIS devrait dans un premier temps, être proposée aux entreprises à titre optionnelle, étant donné que son premier objectif est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et non celui des économies nationales des États membres. Toutes les entreprises n'interviennent pas dans plus d'un État membre et il n'est pas nécessaire que ces entreprises-là changent leur assiette fiscale. Même s'il est vrai que la mise en œuvre simultanée de deux assiettes fiscales - l'ACCIS et l'assiette fiscale nationale - est susceptible de soulever des questions spécifiques au sein des administrations fiscales, la Commission pense aussi qu'une ACCIS optionnelle a plus de chances de rallier les suffrages de l'ensemble des États membres et des entreprises qu'une ACCIS obligatoire. Pour les entreprises, l'utilisation d'une seule base plutôt que potentiellement 25 bases sera beaucoup plus simple. Le fait de concevoir l'ACCIS comme une option incite également à la rendre aussi concurrentielle, simple et uniforme que possible de part et d'autre de l'Union, même s'il sera nécessaire de s'assurer que les règles relatives aux aides d'États sont respectées et que des mesures anti-abus appropriées sont introduites. » Si, une telle proposition a, à tout le moins, le mérite de pouvoir être acceptée par l'ensemble des États-membres, il paraît pour le moins évident que, pour des raisons aisément compréhensibles, peu d'entreprises, sauf à être animées d'un fort sentiment européen, seront enclines à opter pour le régime de l'ACCIS. Il importe donc de s'acheminer au plus tôt vers une véritable harmonisation européenne de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : la notion de consolidation des activités doit être de nature à être conservée car elle crée les conditions d'une concurrence fiscale plus juste entre les États et aurait un effet positif sur les exportations extracommunautaires de l'ensemble des entreprises des États européens. VII.- POUR UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT SOCIAL ET ADMINISTRATIF : ALLÉGER, SIMPLIFIER, METTRE FIN À L'INCERTITUDE JURIDIQUE ET S'ADAPTER AU MONDE MODERNE Personne, aujourd'hui, n'oserait prétendre que le contexte économique et social qui a entouré l'édification de la législation du travail n'a subi de profondes mutations. De même, les pratiques administratives françaises, sont marquées du signe de l'accumulation et de la stratification, sources de lenteur dans un environnement économique caractérisé par l'accélération et le besoin impératif de réactivité des entreprises aux réalités du monde moderne. L'adaptation de l'environnement juridique, administratif et social qui prévaut dans la société française contemporaine ne peut, comme l'a souligné le Président de la République devant le Conseil économique et social le 10 octobre dernier, prendre forme que par la modernisation du dialogue social. A.- LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL CONSTITUE UN OBJECTIF PRIORITAIRE. Situant résolument son propos dans le cadre de la bataille pour l'emploi, le Président de la République a estimé nécessaire que les différents partenaires sociaux « se remettent en question » et qu'il convenait de procéder à « une révolution des esprits » et « de sortir de la logique du conflit », faisant de ces préalables la condition indispensable permettant de donner une nouvelle impulsion à la concertation. Il a considéré qu'à l'avenir, « il ne sera plus possible de modifier le code du travail sans que les partenaires sociaux aient été mis en mesure de négocier sur le contenu de la réforme engagée » et « qu'aucun projet de loi ne sera présenté au Parlement sans que les partenaires sociaux soient consultés sur son contenu ». Il rappelait que : « Bien sûr, le dernier mot restera à la représentation nationale. Mais que les pouvoirs publics vont devoir apprendre à légiférer, ou prendre des ordonnances, sur la base du travail des partenaires sociaux qui ont une connaissance et une expertise incomparables des réalités sociales », en soulignant, toutefois que « les négociations devraient se dérouler dans un délai clairement délimité, conciliable avec le temps et les exigences de l'action politique ». Le chef de l'État devait également annoncer la mise en place de « nouvelles instances de dialogue social », le cœur de la réforme résidant dans « le partage entre ce qui relève de la loi et ce qui relève du contrat. Plus du contrat et moins de loi ». Il précisait, enfin, que cette réforme qu'il appelait de ses vœux ferait l'objet d'un projet de loi devant être déposé au Parlement au cours du premier trimestre 2007. Précisant les contours nationaux de la réforme qu'il préconise, il a souhaité que le Premier ministre prononce chaque année devant le Conseil économique et social « un discours sur l'état social de la Nation » et que soit « instauré un rendez-vous annuel » entre l'état et les partenaires sociaux, estimant que « cette nouvelle règle du jeu va radicalement transformer nos façons de penser et d'agir ». Les partenaires sociaux ont déjà entamé une série de rencontres sur le thème crucial de la réforme du marché du travail et de la précarité. Les nouvelles orientations définies par le Président de la République peuvent s'appuyer sur les propositions formulées par M. Dominique-Jean Chertier, directeur général adjoint Affaires sociales et institutionnelles du groupe Snecma, dans son rapport sur « La modernisation du dialogue social » remis au Premier ministre le 28 avril 2006. Dans ce rapport qui recense une vingtaine de propositions, M. Dominique-Jean Chertier dresse un diagnostic critique de l'état du dialogue social en France et propose pas moins de vingt actions à conduire pour le renouveler. Il estime que celui-ci mériterait d'être organisé selon des méthodes plus simples et plus lisibles compte tenu de la multiplicité des instances spécialisées de consultation et de la lourdeur des procédures. Le rapport insiste sur le contraste de la situation en France et celle des autres grandes démocraties, en s'appuyant notamment sur l'exemple des modèles allemand, américain, britannique et hollandais qui, sont parvenues à établir des modalités d'élaboration des normes sociales plus consensuelles. Il préconise notamment : - l'introduction d'un délai minimal réservé à la concertation entre l'annonce d'un projet de réforme et l'adoption du texte en Conseil des ministres. Le projet de loi déposé au Parlement pourrait comporter, en annexe, un document présentant les conditions dans lesquelles se sont déroulées cette concertation et les suites qui y ont été données ; - l'engagement du Gouvernement à ne pas prendre d'initiatives de réforme dans le domaine faisant l'objet de la concertation pendant la période où elle est conduite ; - la réduction des instances de concertation existantes par fusion ou rapprochement ; - faire du Conseil économique et social une instance pivot de ce nouveau processus de dialogue social. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord, le 23 octobre 2006, à l'exception de la CGT, pour créer trois groupes de travail sur les contrats de travail, la remise à plat de l'assurance chômage et la sécurisation des parcours professionnels. B.- LE DÉBAT SUR LA « FLEXISÉCURITÉ » Comment concilier la nécessaire compétitivité des entreprises, gage de création d'emplois, et sortir de la spirale infernale du chômage ? Il s'agit bien là de la question fondamentale qui anime le débat sur la « flexisécurité » ou « flexicurité », notion qui repose sur l'idée de sécuriser la personne plutôt que l'emploi et principe qui a été appliqué avec succès par le Danemark et la Suède, pays dans lesquels le taux de chômage est largement inférieur au taux moyen européen. La « flexisécurité » consiste à donner plus de flexibilité aux entreprises, en particulier en matière de régulation des ressources humaines, tout en assurant une plus grande sécurité aux salariés grâce à l'attribution d'allocations élevées en cas de licenciement, à l'accès à un système de formation et à un suivi personnalisés. Comme le souligne M. Robert Boyer, directeur de recherche au CNRS, dans son ouvrage consacré à l'étude du modèle danois, « la fléxicurité organise la complémentarité de trois dispositifs habituellement faiblement coordonnés ; le droit du travail, le régime d'indemnisation du chômage et la politique de l'emploi » autant de facteurs auxquels il convient d'ajouter les contraintes des entreprises qui évoluent dans un univers économique difficile à maîtriser : incertitude des prévisions d'activité, accélération du progrès technique et technologique, production à flux tendus, renforcement de la concurrence. La question qui se pose face aux deux impératifs que constitue assurer la sécurité du salarié et tenir compte des contraintes économiques des entreprises est bien de savoir s'il faut maintenir en l'état un code du travail hérité de l'ère fordiste ou s'efforcer de le réformer dans l'intérêt conjoint des entreprises et des salariés. Au nombre des pistes évoquées figure la possibilité, moyennant une meilleure indemnisation du chômage d'alléger les procédures de licenciement, sous la réserve que soit organisée, non seulement à l'occasion du licenciement, mais aussi, tout au long des périodes d'activité, une formation personnalisée des salariés tenant compte non plus seulement d'une perspective d'adaptation à un poste dans l'entreprise, mais aussi à d'autres métiers de façon à anticiper et à favoriser le reclassement éventuel du salarié, créer, selon l'expression de la CFDT un parcours professionnel personnalisé. Il convient en effet de mieux préparer les salariés aux mutations économiques, par nature imprévisibles, auxquelles ils peuvent être confrontés et rendre ainsi possible une mobilité professionnelle moins difficile. De même, la formation professionnelle doit pouvoir bénéficier à l'ensemble des personnels et non se limiter comme c'est trop souvent le cas aux personnels d'encadrement. De même, dans le cadre d'une concertation entre partenaires sociaux, on pourrait envisager, afin de permettre aux entreprises d'adapter leurs effectifs aux réalités économiques, de modifier les règles relatives au contrat de travail à durée indéterminée en instituant une plus grande prise en compte de l'ancienneté dans l'attribution des droits sociaux aux salariés et tout en diminuant la durée de la période d'essai, pour laquelle d'ailleurs aucune obligation légale n'est instituée. Sans doute serai-il utile d'inscrire dans le code du travail une durée maximale, laissant aux convention collectives la possibilité d'en aménager les modalités secteur par secteur et branche par branche, voire entreprise par entreprise. Nombre de personnes auditionnées par la Mission d'information ont souligné les effets pervers pour la croissance des entreprises des effets de seuil. Il est impératif, si l'on veut tenir compte de la forte potentialité des PME dans le domaine de l'emploi de réfléchir à des propositions concrètes permettant de lisser les multiples seuils existant tant en matière fiscale qu'en matière sociale. Quelques propositions concrètes extraites · Un chèque formation, inversement proportionnel aux années d'étude, abondé tout au long de sa vie professionnelle, suivant les situations et la charge de l'État ou des régions à ce droit serait attaché à la personne du salarié. Ce droit individuel à la formation s'inscrit dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des qualifications. · Privilégier le reclassement interne ou externe avant un licenciement économique. · Aider le salarié à rebondir après un licenciement, et notamment accorder une prime de reclassement au salarié s'il retrouve un emploi avant la fin de son droit au reclassement, avec un accompagnement personnalisé du salarié et des mesures spécifiques dans les bassins d'emploi, départements ou régions sinistrées. · Assurer une continuité des droits en matière de protection sociale. « Il y a un siècle, un actif occupé sur deux seulement avait le statut de salarié. Aujourd'hui, 9 actifs sur 10 sont des salariés. En sera-t-il toujours ainsi ? La mobilité de l'emploi et la mobilité des qualifications ouvrent la voie à une mobilité des statuts [...]. Au-delà, le salarié, c'est bien le travailleur, dans le sens général du terme, dont il faut garantir le présent et l'avenir. » Cette réflexion n'est d'ailleurs pas propre à l'Europe. Aux États-Unis, la Caroline du Nord, pour faire face à des fermetures d'usines liées à des délocalisations, a mis en place un ambitieux programme de reconversion des travailleurs concernés, grâce à des formations dispensées par des « community college ». Le taux de chômage dans cet état n'est que de 4,3 %, en dessous du taux national américain (4,7 %). C.- SIMPLIFIER ENCORE LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES La rapidité avec laquelle les entreprises doivent s'adapter aux diverses mutations qui affectent leur environnement économique est de moins en moins compatible avec les délais d'études et de prises de décision de l'administration. Aujourd'hui, et demain plus encore, les entreprises si elles veulent rester concurrentielles dans un monde où tout s'accélère se doivent d'avoir un temps de réaction de plus en plus court. Or l'administration n'a pas d'horloge, où du moins son temps ne semble pas s'écouler au même rythme que celui des entreprises. Il est indispensable que le décalage horaire qui se creuse entre ces deux acteurs de la vie économique se rattrape et se comble au plus vite. Une mesure simple à mettre en œuvre consisterait à assortir toute demande d'un délai de réponse au-delà duquel, la demande serait réputée agréée. Il pourrait en être ainsi notamment en matière fiscale en ce qui concerne les différents crédits d'impôt pour lesquelles les entreprises doivent attendre la réponse de l'administration pour pouvoir établir leurs prévisions financières. Ces délais ne correspondent pas aux contraintes de la gestion à flux tendus des comptes financiers des entreprises. Afin d'alléger le carcan administratif dans lequel se meuvent et se débattent les entreprises, notamment les entreprises nouvellement créées, sans doute faudrait-il réfléchir à la généralisation du chèque emploi très petites entreprises institué par l'ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005 à l'ensemble des PME, ou du moins aux moyennes entreprises, pendant les deux premières années qui suivent leur création. Ce dispositif de simplification, déjà évoqué dans ce rapport, pourrait être généralisé, sous réserve, pour les entreprises de plus de cinq salariés que soit établi un minimum de sécurité pour les emplois (obligation d'établir d'un contrat de travail) qui les rendraient éligibles au chèque emploi PME : - à l'ensemble des secteurs d'activité et non être réservé aux seules entreprises exerçant leur activité dans un des secteurs figurant sur une liste arrêtée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - à l'ensemble des formalités et cotisation sociales auxquelles sont soumises les entreprises, en sont actuellement exclues les formalités et cotisations telles que la contribution handicapés, la formation professionnelle, la médecine du travail et la taxe d'apprentissage. D.- LE SERPENT DE MER DES DÉLAIS DE PAIEMENT Le problème pénalise fortement les PME. Les « coupables » sont aussi bien les grandes entreprises privées que l'État. En moyenne, les grandes entreprises françaises règlent leurs créances en 66,4 jours. Les collectivités publiques, et l'État en particulier, ont pour leur part de grandes difficultés à tenir des délais raisonnables. Le ministre de l'industrie, M. François Loos, a présenté le 29 juin 2006 un plan en cinq points : - les acteurs de la filière automobile ont signé un code de bonnes pratiques le 28 juin ; - un parlementaire, M. Martial Saddier, député de Haute-Savoie, est chargé de poursuivre les discussions engagées dans le groupe de travail ; - une possibilité de mobilisation des créances renforcée pour les PME. Comme l'indique le communiqué du ministre de l'industrie, plusieurs outils financiers existent déjà (escompte, affacturage, Dailly,...), mais le groupe de travail a constaté que toutes les entreprises n'y avaient pas accès. Pour remédier à cette situation trois actions concrètes sont entreprises : - le code de bonnes pratiques décrit ci-dessus comprend un engagement de toutes les parties à délivrer systématiquement aux fournisseurs et sous traitants un moyen de paiement mobilisable ; - Oseo BDPME lance un nouveau produit financier adapté aux besoins des PME, appelé AVANCE +. Jusqu'ici réservé à la mobilisation des créances sur donneur d'ordre public, le produit AVANCE + permettra aux petites entreprises de mobiliser directement auprès d'OSEO BDPME des créances sur les grands donneurs d'ordre privés. OSEO interviendra dans le respect du principe de subsidiarité par rapport au secteur bancaire. Le dispositif sera mis en place dans le cadre d'une expérimentation sur dix-huit mois ; - Une meilleure communication sur les outils de financement à disposition des entreprises sera organisée. La Fédération Bancaire Française (FBF), Oseo, et la Coface ont présenté une brochure d'information à destination des PME, élaborée avec la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CGPME), afin de mieux informer les chefs d'entreprises sur les outils à leur disposition ; - Aider les PME à se doter d'outils performants ; - Réactivation de l'observatoire des délais de paiement. En principe, le délai de paiement d'un marché public, ne peut excéder 45 jours, sauf pour les établissements de santé. Au-delà de ce délai, le paiement d'intérêts moratoires est de droit (52). Votre rapporteur constate que ce dispositif ne fonctionne pas parfaitement, loin de là, et propose donc les mesures suivantes : Tout ordonnateur public aurait pour tâche d'attribuer automatiquement une pénalité de retard calculée selon une formule à déterminer dans le cas où le paiement effectif est réalisé plus de 45 jours après la livraison. En cas de litige, le bon de livraison devrait être retourné dans un délai fixé avec la cause explicite du litige. Le décideur public se verrait notamment évalué sur sa capacité à éviter le versement de pénalités et serait ainsi plus actif dans la recherche des causes et des remèdes. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de s'engager à ce que 80 % des remboursements de TVA soient effectués en moins d'un mois, soit deux fois plus rapidement qu'en 2002. VIII.- MIEUX OBSERVER L'ÉVOLUTION DE LA MONDIALISATION Le problème majeur auquel s'est heurtée la mission d'information réside dans la difficulté à définir ce qu'est une délocalisation. D'emblée, un lien fort entre délocalisations et mondialisation semble s'imposer, tant les deux phénomènes apparaissent étroitement imbriqués. Les délocalisations ne sont à bien des égards qu'un des effets de l'internationalisation de l'économie due à la mondialisation qui se définit, selon Mme Suzanne Berger comme : « une série de mutations dans l'économie internationale qui tendent à créer un seul marché mondial pour les biens et les services, le travail et le capital » (Notre première mondialisation). Il ressort des propos tenus par les différents économistes et les personnalités diverses auditionnées par la Mission d'information au cours de ses travaux, de même que des nombreux rapports publiés sur le sujet et consultés par votre rapporteur, que le terme de délocalisation recouvre une réalité multiforme conférant aux délocalisations une apparence incertaine qui ne fait qu'ajouter à l'inquiétude perçue. En effet, il n'existe pas une, mais plusieurs définitions possibles des délocalisations, qui ont été exposées dans la première partie de ce rapport. Pour autant, l'absence de définition du concept complexe de délocalisation rend difficile toute approche statistique du phénomène. En effet, selon l'acception retenue, les critères économiques permettant d'analyser les délocalisations et leurs conséquences varient et il devient difficile d'en avoir une vision globale et cohérente. Or, compte tenu de l'ampleur connue et prévisible des délocalisations sur notre économie et sur l'emploi, il importe de mieux pouvoir en suivre et analyser tout à la fois l'évolution et les effets, en disposant d'outils objectifs permettant de mieux cerner le phénomène dans ses différentes composantes, non sans les avoir préalablement définis. Cet observatoire aurait également pour fonction d'essayer de détecter les secteurs les plus susceptibles de faire l'objet de délocalisations. Une telle mission de clarification et d'analyse, offrant la possibilité de mieux comprendre les délocalisations et leur impact, de proposer, par voie de conséquence, des orientations afin d'en surmonter les effets négatifs pourrait être confiée à un Observatoire de la mondialisation et des délocalisations, dont la première tache consisterait à mieux cerner ces deux notions, à étudier les principaux facteurs qui conduisent aux délocalisations et leurs importances respectives et, enfin, fournir, à partir de critères qualitatifs clairement définis, des données quantitatives sur le phénomène et son évolution tout en offrant une instance de dialogue sur ce sujet essentiel. Cette instance serait composée de représentants du monde politique, économique et universitaire. C'était d'ailleurs l'une des propositions du rapport de MM. Fontagné et Lorenzi remis au Conseil d'Analyse Économique [cf. encadré ci-joint]. Le problème n'est en effet pas seulement, ni même peut-être principalement, technique ; il est politique au sens large de ce mot. Sans reprendre des développements figurant déjà dans ce rapport, il suffit de prendre l'exemple récent d'AXA pour mesurer que ce qui a été perçu par beaucoup comme une délocalisation ne le serait pas dans une acception restrictive. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur estime indispensable la création de cet observatoire. Votre rapporteur approuve totalement la position de MM. Fontagné et Lorenzi de le rattacher, si possible, à un organisme existant quitte à en étendre les moyens et les statuts. C'est la raison pour laquelle, elle vous propose de le rattacher au Conseil d'Orientation pour l'emploi, compte tenu certes du lien évident entre emploi et délocalisations, mais aussi de la présence de tous les acteurs politiques, économiques et sociaux dans cet organisme. Il conviendrait d'adapter ses moyens et ses statuts à cette nouvelle mission. Cet organisme devrait naturellement disposer des pouvoirs d'investigation nécessaires pour pouvoir remplir ses missions. « Mais plus fondamentalement, la responsabilité publique est d'élaborer une stratégie d'ensemble pour « réduire les incertitudes ». Il s'agit de promouvoir une bonne compréhension des phénomènes à l'œuvre : l'information et l'animation du débat sur les questions de la mondialisation devraient être une priorité en France. Les enquêtes d'opinion réalisées sur la perception de la mondialisation sont édifiantes (Flash Eurobaromètre, nov. 2003) : la France est le pays européen dans lequel les enquêtes sont le plus hostiles à la mondialisation et à l'ouverture, mécanismes sur la base desquels ils se sont pourtant collectivement enrichis depuis trente ans. Cette « exception française » ne favorise pas les adaptations nécessaires et suscite des peurs et des réactions défensives, là où seule l'offensive paie. Comment en est-on arrivé là ? Comment se résigner à ce que 14 % des Français n'aient « jamais entendu parler de mondialisation » ? La raison en simple : nous n'avons pas su financer en France les instruments et les structures d'analyse et de suivi des évolutions industrielles mondiales. Nous n'avons pas financé à hauteur de ce que faisaient nos voisins européens les structures d'animation du débat, de formation des idées, sur les questions d'économie mondiale. Il y a une multitude de centres d'excellence danois, suédois, néerlandais... sans même parler de notre voisin allemand, de grande taille, reconnus au niveau international pour leur capacité scientifique, et qui assurent ce travail de diffusion des idées. La première piste des propositions vise à remédier à cet état de fait. Mais rappelons-le, il s'agit d'un préalable à tout. En effet, toute stratégie suppose, au-delà de l'accompagnement légitime des crises : · une capacité d'anticipation supposant une analyse prospective ; · une adhésion ou à défaut au moins une compréhension par l'opinion publique. (...) (Il faut donc) · du côté des entreprises : analyse précise des (dés)investissements (...) en France et de leurs motivations. Observation des stratégies des grandes sociétés internationales. Examen des stratégies des sociétés ayant des filiales ou succursales en France et conséquences prévisibles sur l'emploi. Réflexion sur les nouveaux modes de coopération inter et intra-entreprises, sur le contenu du nouveau modèle de croissance et sur sa réactivité (capacité d'adaptation...) ; · du côté des marchés et des concurrents. Suivi et prospective des économies émergentes ; évolution des taux de change et impact sur les spécialisations ; construction et exploitation de bases de données fines de commerce international permettant d'analyser les dynamiques concurrentielles au niveau le plus fin. Suivi des barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges ; · du côté des technologies : veille sur les risques de certaines ruptures technologiques (et sur les transferts technologiques) et sur les modifications des conditions de certains marchés (déplacement géographique des clients d'un métier, glissement d'une filière de l'amont vers l'aval...) ; · du côté des idées : veille sur les concepts, les avancées scientifiques en termes de connaissance des phénomènes, les systèmes d'information développés, participation aux débats internationaux et formation d'un corpus ne signifiant pas nécessairement l'alignement sur le prêt-à-penser international. Nous sommes donc favorables à la mise en place d'une structure française renforcée, d'une taille suffisante pour affronter la compétition internationale dans le domaine de l'expertise de la globalisation, dotée d'une forte capacité d'analyse, capable d'identifier les secteurs prioritaires et les stratégies gagnantes, et de remplir les différentes tâches évoquées ci-dessus. Plutôt que de créer une énième structure, solution privilégiant l'affichage à l'efficacité opérationnelle, nous préconisons un renforcement de l'existant, quitte à en élargir les missions et à en modifier les statuts pour les mettre en accord avec ces nouvelles missions. Ne nous y trompons pas, une telle décision irait à contre-courant du recul des financements, de la dilution de l'analyse économique dans des problématiques plus larges ; de l'abandon de l'expertise sur les sujets internationaux aux Think tanks européens ou américains, et au prêt-à-penser d'institutions internationales ; du départ de certains experts de grande qualité vers les centres d'études étrangers ou vers les organisations internationales. » Source : Rapport du Conseil d'analyse économique, MM. Fontagné et Lorenzi, p 101 et 102. Livrée à elle-même, la mondialisation conduit naturellement à distinguer deux camps, celui des perdants et celui des gagnants, les seconds étant moins nombreux que les premiers. Comme le souligne M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, c'est ainsi que « les États-Unis et leurs disciples sont en train de devenir des pays riches aux populations pauvres » (53). Il est cependant possible de faire des choix différents. L'exemple des pays scandinaves le démontre. C'est un choix qui nous appartient si nous nous donnons les moyens de rétablir pleinement la compétitivité de notre pays, afin que la mondialisation puisse « réaliser enfin son potentiel et tenir sa promesse : un meilleur niveau de vie pour tous. »(1). Il est vrai qu'une difficulté réelle tient à ce que les conditions actuelles sont parfois bien inéquitables. Sans même évoquer le travail forcé ou celui des enfants, force est de constater des situations discutables. Ainsi, les plus grosses entreprises américaines en Chine ont engagé un intense effort de lobbying contre un projet de loi du gouvernement chinois tendant à réprimer certains abus dans l'utilisation de la main-d'œuvre et à favoriser l'implantation du syndicat officiel dans les entreprises. D'aucuns ont fait valoir que la Chine s'inspirait de l'exemple, fâcheux, de la France ou de l'Allemagne (54) et que certaines entreprises pourraient cesser de construire des usines dans ce pays. Une remise en cause globale de l'ordre du monde paraît improbable. Plus modestement, on pourrait imaginer la création d'une certification sociale européenne, qui garantirait au consommateur européen que tel ou tel produit a été réalisé dans des conditions minimales d'équité. Il faudra également favoriser l'émergence d'entreprises socialement responsables dont les pratiques s'inscrivent dans les règles éthiques reconnues et respectent des valeurs fondamentales telles que le non travail des enfants et des conditions sanitaires et sociales minimales et intègrent à leur stratégie des préoccupations liées au développement durable. Il serait d'ailleurs intéressant que l'Assemblée Nationale étudie la possibilité de présenter chaque année un rapport sur ce sujet, fondé notamment sur le travail des ONG. Sur le long terme, l'indifférence aux conséquences sociales négatives de la mondialisation et à tout souci éthique ne pourrait que provoquer un fort mouvement en faveur du protectionnisme, le « remède » étant alors bien pire que le mal. Lors de sa réunion du 29 novembre 2006, la Commission a procédé à l'examen du rapport de la mission d'information sur les délocalisations. Mme Chantal Brunel, rapporteur, a tout d'abord indiqué que la mission d'information avait procédé à un vaste programme d'auditions - membres du gouvernement, représentants des partenaires sociaux, économistes, représentants d'institutions diverses et spécialistes - complété par trois déplacements à l'étranger, auprès de la Commission européenne, en Finlande et au pays basque espagnol. Le caractère omniprésent des délocalisations est illustré par les nombreux échos dans les médias d'un phénomène dont aucun secteur économique ne semble protégé et qui constitue une source d'inquiétude majeure dans la société française. Les délocalisations sont l'une des conséquences de la fragmentation de la chaîne de production. En effet, la dissociation des différentes étapes permet de recourir à la sous-traitance pour tout ce qui n'est pas jugé essentiel. La mondialisation se caractérise également par un poids de plus en plus faible de la production par rapport à la conception du produit. Il existe une multiplicité de définitions des délocalisations : la plus restrictive, pour laquelle une délocalisation consiste en la fermeture d'une unité de production en France suivie de sa réouverture à l'étranger en vue de réimporter sur le territoire national les biens produits à un moindre coût ; celle de l'INSEE, pour qui est une délocalisation toute substitution de production étrangère à une production française, résultant de l'arbitrage d'un producteur qui renonce à produire en France pour produire ou sous-traiter à l'étranger ; celle de M. Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat, pour qui les délocalisations sont le fruit d'arbitrages réalisés par les entreprises dans un sens défavorable à la localisation des activités et des emplois sur le territoire français. La mission a considéré que constituaient des délocalisations tous les arbitrages d'entreprises qui renoncent à maintenir, développer ou créer leurs activités en France pour produire ou sous-traiter à l'étranger, à destination du marché hexagonal ou des marchés d'exportation. Certaines implantations à l'étranger peuvent certes avoir pour objectif la conquête de marchés extérieurs, même s'il faut souligner l'ambivalence d'une démarche qui constitue à la fois une condition pour exporter et une recherche de baisse des coûts, ainsi Airbus en Chine ou la Logan, fabriquée en Roumanie mais désormais également vendue en France. La dimension humaine du phénomène est d'autant plus à prendre en compte qu'elle n'est pas sans conséquences graves sur les personnes et les territoires affectés par les délocalisations. Le phénomène est d'autant plus générateur d'angoisse que sa simple évocation peut être un outil de pression sur les salariés. Ils y sont d'autant plus sensibles que les salariés ayant perdu leur emploi à la suite d'une délocalisation rencontrent souvent de sérieuses difficultés à retrouver un emploi équivalent à celui qu'ils ont été contraints d'abandonner. Soulignant la difficulté d'appréhension du phénomène, le rapporteur a proposé la création d'un observatoire des délocalisations. Afin de ne pas créer de lourdeurs administratives supplémentaires, cet organisme pourrait être rattaché au Conseil d'orientation pour l'emploi en raison, d'une part, du lien évident entre les délocalisations et l'emploi et, d'autre part, de la composition de cet organisme, qui regroupe des représentants de l'ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux. L'immersion de l'économie française dans le courant des échanges internationaux tend à exclure toute tentative visant à s'opposer à la mondialisation. Dès lors que les exportations françaises représentent 26 % du PIB national et que les investissements directs étrangers en France contribuent à la création ou au maintien d'emplois, le choix est simple : subir ou réagir. Subir, ce serait considérer la France comme une terre isolée et justifier la non-adaptation de nos structures économiques à la nouvelle donne internationale, ce qui aurait pour effet de conduire au déclin et à l'effondrement du modèle social que l'on prétendrait protéger. Réagir, c'est s'adapter à la mondialisation en s'efforçant de bénéficier de la croissance qu'elle induit, tout en luttant contre ses inconvénients. En faisant des propositions concrètes et réalisables à court ou moyen terme, le rapport écarte toute mesure hors d'atteinte, notamment la politique monétaire et la politique économique européennes, sans nier leur impact sur les délocalisations. S'agissant des aides aux entreprises, les ressources publiques ne sont pas illimitées et il convient de rationaliser au mieux leur utilisation en évitant leur saupoudrage et en les concentrant sur les entreprises susceptibles d'être sauvées et sur la protection des salariés. Il est nécessaire de procéder à une évaluation objective de leur efficacité et à une coordination décentralisée par les régions, un travail de synthèse étant réalisé au plan national par le Conseil d'orientation pour l'emploi. Il serait ainsi possible d'identifier les secteurs menacés et d'investir plus particulièrement dans la formation des salariés concernés. L'octroi des aides devrait être conditionné à des engagements sur la création ou le maintien de l'emploi, et ce d'autant plus qu'un consensus politique se dégage progressivement sur cette mesure. S'agissant de la recherche et de l'innovation, les dépenses françaises de R & D se situent en deçà des objectifs européens de Lisbonne, le niveau de recherche privée et les partenariats universités-entreprises étant insuffisants, notamment au regard de la situation dans certains pays étrangers tels que la Finlande. Dès lors que l'obstacle de la constitutionnalité a été levé, il convient de ratifier au plus tôt les accords de Londres afin de favoriser les dépôts de brevets européens par les entreprises françaises en raison de la simplification des procédures et de la diminution des coûts qu'ils permettraient. Le dispositif du crédit d'impôt recherche pour l'emploi des docteurs peut être renforcé. Il convient d'améliorer le statut des chercheurs, quitte à prévoir, en contrepartie, une modulation de leur rémunération en fonction des résultats. Le rapprochement de l'université et de l'entreprise est indispensable. Pour cela, il serait intéressant de subordonner l'octroi des crédits recherche des universités, hors fonctionnement, à l'obtention de partenariats avec les entreprises lorsqu'il s'agit de recherche appliquée et d'étudier une modulation renforcée du crédit d'impôt recherche des entreprises en fonction d'un partenariat avec l'université. S'agissant du financement de la protection sociale, des craintes fortes sur la pérennité du système français sont légitimes si son financement n'est pas adapté aux contraintes de la mondialisation. Les pays scandinaves ont ainsi pris des mesures radicales afin de renforcer la compétitivité des entreprises. Il convient donc d'approfondir la manière dont pourrait être introduite une « TVA sociale », sur la base de l'augmentation d'un point du taux normal de TVA, soit 5,7 milliards d'euros, avec, en contrepartie, une réduction à l'euro près des charges patronales. La TVA sociale frapperait les importations, et non plus le seul travail réalisé en France. À la différence des cotisations sociales, elle ne pèserait pas sur le coût des exportations, rendues ainsi plus compétitives. Qui plus est, cette réforme aurait le mérite de rendre plus transparent le financement de la protection sociale dans la mesure où la réduction des cotisations permises par la « TVA sociale » porterait sur les cotisations relevant d'une logique de solidarité. Enfin, l'instauration d'un point de « TVA sociale » permettrait à la France de se rapprocher de l'Allemagne, qui a fait de la réduction des coûts une priorité. Cette mesure ne devrait pas avoir d'impact inflationniste compte tenu de la concurrence et de la baisse des charges pour les entreprises de main-d'œuvre. S'agissant des PME, le gouvernement a déjà engagé une politique volontariste, mais il est indispensable de rendre effectifs les délais de paiement, de mobiliser réellement les réseaux publics d'aide à l'exportation et d'encourager, encore plus que ne le fait l'article 40 du projet de loi de finances pour 2007, la souscription des titres émis par les PME. Il faut poursuivre la mise en place d'un « Small Business Act » européen et il est nécessaire de mettre en place un site internet unique pour tous les marchés publics. S'agissant du droit social et des contraintes administratives, il est nécessaire d'alléger et de simplifier les procédures, de mettre fin aux incertitudes juridiques et de s'adapter au monde moderne, notamment en aménageant le temps de travail pour répondre aux besoins des entreprises et à la diversité des aspirations des salariés. Ainsi, il serait souhaitable de pouvoir transférer les journées de RTT sur un plan épargne entreprise avec les mêmes avantages que l'intéressement, hors charges salariales et patronales. L'évolution du droit du travail doit passer par la négociation. La formation professionnelle ne devrait pas se limiter à l'adaptation aux postes de travail. Les crédits de la formation professionnelle devraient être plus lisibles et recentrés sur l'encouragement à la mobilité professionnelle et géographique. Le droit à la formation devrait être particulièrement important pour les salariés ayant un faible niveau de qualification. La réactivité de l'administration devrait être plus importante et plus en phase avec le « temps des entreprises ». Il faut adapter le droit fiscal aux besoins de l'économie afin de limiter les délocalisations fiscales et entraver les stratégies d'optimisation fiscale. La France devrait donc soutenir activement les propositions de la Communauté européenne visant à harmoniser l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La baisse de cet impôt s'impose aussi, le taux français était de 33 % alors que la moyenne européenne est de 26 %. Certains pays récemment entrés dans l'Union européenne n'hésitent pas à se livrer, de manière choquante, à des stratégies de « dumping » fiscal tout en bénéficiant, par ailleurs, de subventions européennes. En conclusion, le rapporteur a considéré qu'il revenait à la France de se donner le moyen de rétablir pleinement sa compétitivité et de faire ainsi le choix d'appartenir au camp des gagnants de la mondialisation et d'offrir à tous un meilleur niveau de vie. Toutefois, force est de constater que les conditions actuelles sont parfois inéquitables. La création d'une certification sociale européenne garantissant au consommateur européen que la réalisation des produits a été faite dans des conditions minimales d'équité (non-travail des enfants, protection sociale des salariés, non-discrimination sociale et culturelle, respect des normes environnementales) s'impose donc. L'indifférence aux conséquences sociales négatives de la mondialisation et l'oubli de l'éthique peuvent provoquer un fort mouvement protectionniste. Pour préparer l'avenir, il faut lutter en conséquence contre le sentiment de vulnérabilité généré par une mondialisation incontournable et prouver que l'idéal de justice sociale peut être réalisé dans le cadre d'une économie ouverte. Après avoir remercié le président Patrick Ollier pour la création de cette mission, qui a effectué un travail intéressant et utile, ainsi que le rapporteur et l'ensemble des membres de la mission pour leur assiduité et leurs contributions, M. Jérôme Bignon, président de la mission d'information, a souligné le nombre et la densité des auditions effectuées et estimé que cela démontrait que les missions d'information constituaient un outil privilégié d'information et de contrôle pour le Parlement. Le caractère pédagogique de la réflexion menée a permis une meilleure compréhension des phénomènes économiques et une prise de conscience par les membres de la mission de l'évolution rapide de la mondialisation, tant dans ses aspects économiques que sociaux. L'incompréhension nourrit souvent les peurs. Le rapport de la mission peut utilement compléter les efforts de pédagogie menés dans le domaine de la connaissance économique par le gouvernement, qui a récemment créé un conseil pour la diffusion de la culture économique. Le dernier livre de Jacques Attali, intitulé « Une brève histoire de l'avenir », met bien en lumière l'accélération de la mondialisation liée au développement des transports et des technologies de l'information et de la communication. Le récent forum économique qui s'est tenu à Singapour nous apprend que le Pacifique, premier océan du monde en matière de trafic lié au commerce international, sera bientôt parcouru par des bateaux capables de le traverser en quatre jours. Il n'est donc pas possible de proposer des solutions pertinentes si l'on ne saisit pas cette accélération. Les représentants de Nokia avaient d'ailleurs indiqué aux membres de la mission, lors de leur déplacement en Finlande, qu'un million de portables se vendait par jour et que le tiers de l'humanité en était déjà pourvu. Un milliard d'ordinateurs est désormais relié à travers Internet, 10 % du PIB mondial étant réalisé grâce à ce mode de communication. Il est indispensable de réagir : subir cette mondialisation serait en tout état de cause contraire à l'éthique politique. Le renouveau du pays basque espagnol, analysé par les membres de la mission lors d'un déplacement dans cette région, a succédé à une crise industrielle sans précédent dans les années 80, amplifiée par les problèmes liés aux actions de l'ETA. Ce renouveau tient beaucoup au niveau important de recherche et développement qui a été insufflé dans l'économie, les basques espagnols s'étant fixés comme objectif d'être les meilleurs sur un certain nombre de secteurs. La réaction des Finlandais, confrontés à l'effondrement de leur principal partenaire économique, l'URSS, et à une économie industrielle vieillissante montre aussi que l'effort pour se redresser paie. La Finlande a su couper les branches mortes pour pouvoir créer des rameaux neufs et modernes, comme l'atteste la formidable réussite de Nokia, qui représente 30 % du marché de la téléphonie mobile. Cette réussite finlandaise s'appuie sur une excellente organisation de la R&D. Il est certes vrai que le pays basque espagnol et la Finlande, qui comptent respectivement 2 millions et 5 millions d'habitants, représentent des petits territoires en comparaison de la France et qu'il est plus facile d'y faire du traitement sur mesure. En outre, la réussite finlandaise s'appuie sur une culture du dialogue social qui fait défaut à notre pays. Toute fermeture d'entreprise étant synonyme de détresse et d'incompréhension, il appartient à notre pays de s'orienter vers plus de flexisécurité, à l'instar des pays nordiques. Est également crucial le problème de la formation des salariés, les territoires les plus fragilisés étant souvent ceux où la formation initiale et la formation professionnelle continue ont été les plus négligées. Cette absence de formation explique les grandes difficultés des salariés à se reconvertir. La formation doit donc se poursuivre tout au long de la vie sans interruption et permettre une véritable adaptation aux mutations économiques. M. Jérôme Bignon a également souhaité préciser l'option prise par le rapporteur de ne s'en tenir dans son intervention qu'à la formulation de propositions cruciales dont la mise en œuvre dépend directement du gouvernement et du Parlement français. Ce parti pris, justifié par le souci de formuler des préconisations réalisables à court terme, n'exclut pas la nécessité pour la France de jouer aussi un rôle dans la concertation internationale. Mme Janine Jambu a souligné la qualité du travail approfondi réalisé par la mission. Toutefois, les propositions formulées ressemblent trop aux vœux exprimés par le MEDEF, qu'il s'agisse de la baisse de l'impôt sur les sociétés, de l'assouplissement du droit du travail ou de la TVA sociale, forme déguisée de diminution des cotisations sociales patronales. C'est pourquoi le groupe communiste ne peut approuver les orientations du rapport et entend présenter ses propres positions afin de définir une politique alternative aux choix du gouvernement et de sa majorité en matière de lutte contre les délocalisations. Cette contribution porte principalement sur une meilleure utilisation des fonds publics, l'institution de droits nouveaux pour les salariés et pour les élus locaux, le renforcement des moyens de la formation professionnelle et de la sécurité de l'emploi ainsi qu'un ensemble de mesures financières et fiscales. Mme Claude Darciaux a également salué la qualité du travail de la mission, mais a regretté que son diagnostic s'avère partiel et partial, ce qui rendra peu efficaces ses propositions, même si certaines vont dans le bon sens, notamment en matière de formation professionnelle et de soutien aux PME. Le rapport semble servir de prétexte à démonter le modèle social français afin de libéraliser le marché du travail. Il est en outre permis de s'étonner du satisfecit donné au Gouvernement concernant l'effort de recherche alors que la France a pris du retard dans ce domaine. Les délocalisations ne constituent pas une fatalité et plusieurs de leurs causes ont été ignorées dans le rapport, ainsi l'augmentation du coût de l'énergie, le taux de change entre le dollar et l'euro, le rôle insuffisant de la politique économique et monétaire européenne. De plus, l'action de la banque centrale européenne ne s'inscrit en aucune manière dans la stratégie de Lisbonne. La réglementation européenne des aides rend difficile leur octroi et met en péril des pans de notre industrie, et ce alors que des pays non européens accordent de leur côté des aides considérables à leurs industries nationales. Il en va de même des normes environnementales et des conditions de travail, contraignantes en Europe, allégées ou inexistantes ailleurs, y compris dans de grands pays industriels comme le Canada et les États-Unis. Il manque à l'Europe une réflexion globale. Le rapport n'évoque pas davantage l'augmentation des bénéfices des grands groupes internationaux et des stock-options. Il faut aujourd'hui réintroduire la préoccupation du long terme dans la stratégie des entreprises, qui ne sont trop souvent guidées que par la rentabilité à court terme. S'agissant des propositions avancées, l'introduction d'un point de TVA sociale semble une piste, qui reste cependant aléatoire en l'absence d'une sérieuse étude d'impact. La flexisécurité ne suffira pas. Il ne faut pas laisser croire que notre pays se lance dans une politique de dumping fiscal et social pour lutter contre les délocalisations. Le crédit d'impôt au profit des entreprises qui relocalisent leurs activités en France, mis en place en 2005 par M. Nicolas Sarkozy, n'a d'ailleurs en rien freiné les délocalisations. Il faut aussi arrêter de remettre en cause les politiques publiques de recherche et d'aménagement du territoire car elles donnent à la France, du fait de ses infrastructures, un caractère attrayant pour l'économie mondiale. Il devient enfin urgent d'augmenter le budget de l'Union européenne afin qu'elle puisse mener une véritable politique économique et industrielle. M. Michel Roumegoux a insisté sur l'aspect psychologique des délocalisations, qui touchent à la fois les entreprises, les salariés, l'opinion publique, les élus locaux et la collectivité nationale. C'est pourquoi il faut développer une pédagogie en la matière qui rende de l'espoir et de l'ambition aux Français. Le moral et la combativité de la communauté nationale peuvent être déterminants, comme on le constate dans des pays comme la Finlande, nation entièrement focalisée sur le souci de l'innovation. Les disparités des normes environnementales et de droit du travail donnent toute sa valeur à la proposition de TVA sociale. M. Jean-Marie Binetruy a confirmé l'utilité de la mission qui, au-delà des sensibilités politiques, a permis une prise de conscience de la complexité du problème. La comparaison avec d'autres pays d'Europe, notamment le Pays Basque espagnol, a démontré l'importance de la volonté des acteurs locaux. La mission a également entendu des industriels comtois qui ont expliqué les raisons de leur délocalisation vers la Suisse. Une réunion avec le comité de liaison des industries de main d'œuvre a fait apparaître l'intérêt de l'idée de TVA sociale. M. Alain Gouriou a insisté sur l'impact des délocalisations pour les régions touchées, souvent très brutalement, donnant l'exemple de Quimperlé, où une manifestation a rassemblé le quart de la population la semaine dernière. Aucun secteur d'activité n'est épargné et la désindustrialisation est particulièrement préoccupante dans des domaines où la France comptait des acteurs mondiaux de premier rang : elle ne compte plus aucun fabricant d'ordinateurs ni de téléphones mobiles, après les difficultés de Sagem. La menace des délocalisations constitue en outre un outil de pression sur les salariés, en matière de conditions de travail et de salaires. Les conséquences dans les bassins d'emploi sont dévastatrices, alors que le délai nécessaire pour retrouver un poste dépasse très nettement celui de deux semaines, fréquent dans les pays du nord. L'efficacité de mesures nationales restera très incertaine tant que l'Union européenne sera une économie aussi ouverte ; la conquête de marchés américains ou asiatiques est autrement plus difficile. Quant à la recherche, les propositions de la mission sont intéressantes, mais tardives, les objectifs fixés par le Président de la République au début de son mandat étant loin d'être atteints. M. Pierre Cohen a salué la prise en compte progressive, par les membres de la mission appartenant au groupe UMP, des véritables enjeux, qui ne se réduisent pas aux 35 heures et au coût du travail, remarquant que M. Louis Gallois, président d'Airbus, auditionné la veille par la Commission, n'avait jamais fait allusion à la durée du travail, mais insisté avec force sur le taux de change euro/dollar. Il a appelé à refuser toute dégradation du modèle français. La force de ce modèle repose sur les droits qu'il confère. C'est dans la qualité des ressources humaines que réside notre richesse. Enfin, la politique de recherche et d'innovation n'est pas à la hauteur des défis posés, la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche comme les choix budgétaires en témoignant malheureusement. M. François Brottes s'est félicité à son tour de la qualité du travail conduit par la mission d'information, mais a cependant regretté que les conclusions présentées relèvent plus d'un discours défensif qu'offensif. Il est regrettable que la question des délocalisations soit toujours abordée de manière fataliste, même s'il est vrai que la mission ne s'est pas contentée de mettre sur la sellette les coûts du travail, comme on le fait habituellement. Deux catégories de délocalisations peuvent être distinguées : la première, visant par une installation sur place à accroître les ventes à l'étranger, peut se justifier; ce n'est véritablement que la seconde catégorie, visant à produire depuis l'étranger à destination du marché français, qui suscite potentiellement la critique. Un traitement plus offensif de cette question relève d'un combat quotidien mené sur le terrain dans un contact direct avec les entreprises concernées, afin d'identifier leurs difficultés et essayer d'y porter remède. La mise en place d'un observatoire n'aurait éventuellement de sens qu'au regard de ce besoin d'action concrète sur le terrain. Il serait plus utile d'essayer d'établir une cartographie du monde recensant, région par région, les inconvénients d'une implantation à l'étranger, qu'il s'agisse de l'instabilité politique, des aléas dans la fourniture d'énergie ou d'eau, ou encore du laxisme de la législation sociale à l'égard du travail des enfants, de manière à mettre en évidence les risques d'échec des stratégies de délocalisation. Une analyse des délocalisations en termes de coûts du travail présente l'inconvénient d'omettre que ces coûts étant générateurs aussi de pouvoir d'achat, toute politique de diminution des coûts risque de conduire à terme à une baisse de la demande. S'agissant du régime des aides publiques, on ne peut que regretter la paralysie produite par un contrôle très strict de la commission européenne, alors que les États-Unis et le Japon se donnent en ce domaine de larges marges de manœuvre. Enfin la mission d'information aurait dû mettre en valeur le rôle joué, dans l'incitation aux délocalisations, par le refus des investisseurs en capital de sortir d'une logique d'appréciation à court terme de la rentabilité. M. Pierre Ducout a souligné l'intérêt qu'il avait pris à participer aux travaux de la mission d'information et a pris acte de ce que les conclusions mentionnent l'impact potentiellement catastrophique des délocalisations pour l'emploi local. L'idée d'une poursuite de l'effort de rapprochement entre l'université et l'entreprise, déjà engagé avec les pôles de compétitivité, est positive, de même qu'un effort accru de formation, de recherche et de transfert de technologie. Il convient de déplorer l'absence de réelle politique industrielle au niveau européen, celle-ci devant trouver son relais d'une part, au niveau des négociations multilatérales ou bilatérales, notamment en vue de défendre certains secteurs stratégiques comme ceux de l'aéronautique et de l'espace, ou d'obtenir un temps d'adaptation avant l'ouverture des frontières aux produits des pays à bas salaires, et, d'autre part, au niveau de la gestion du taux de change de l'euro, qui justifierait qu'on étudie par exemple la possibilité d'établir des taux de parité de pouvoir d'achat par branche d'activité. S'agissant des aides publiques, un effort de rationalisation de leur attribution s'impose, un rôle pivot en ce domaine incombant aux régions. Mais la réforme des aides publiques ne doit pas aboutir à priver de soutien des entreprises à fort potentiel confrontées à des difficultés passagères, comme s'y employait le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI). De nombreux pays du monde, y compris au sein de la Communauté européenne, ainsi l'Irlande, n'hésitent d'ailleurs pas à accorder des aides importantes à leurs entreprises, parfois au mépris des règles. Une entreprise de 1 000 salariés devrait rester une PME si son marché est d'envergure mondiale et, pourtant, elle ne peut juridiquement prétendre à ce statut. Il a indiqué sa réticence à l'égard de la TVA sociale, compte tenu de son caractère non progressif. Il serait préférable d'introduire une taxation des importations pénalisant les manquements aux règles internationales afférentes au travail des enfants ou à l'environnement. Mme Chantal Brunel, rapporteur, a répondu aux différents intervenants, en évoquant les points suivants : - il n'est pas possible de présenter les conclusions de la mission d'information comme étant alignées sur les positions du Medef, alors même que la mission a écouté tous les points de vue et que certaines propositions du rapport recueillent un très large accord, ainsi celles sur la formation professionnelle ; - la mission n'a pas considéré comme utile de présenter des propositions sur la banque centrale européenne, la France étant minoritaire en Europe sur ce sujet, ou sur le prix de l'énergie, que la France ne produit pas ; - le rapport fournit des chiffres sur l'effort de recherche en France depuis 1995 qui montrent une augmentation sensible au cours des dernières années ; - la politique d'encadrement des stock-options ne relève pas du champ du rapport ; - l'idée de la TVA sociale, qui semble une piste prometteuse, mérite une étude préalable approfondie ; - il est clair que la stratégie de lutte contre les délocalisations comporte une dimension psychologique importante et que cela appelle un effort de pédagogie en direction de nos concitoyens ; - l'exemple des délocalisations vers la Suisse souligne le rôle de l'instabilité de l'environnement juridique et fiscal dans le phénomène des délocalisations ; - s'il est vrai que la gestion des délocalisations doit se faire prioritairement au niveau local, un observatoire français est indispensable pour apprécier l'étendue du phénomène et avoir un constat partagé dans notre pays sur ce phénomène, ce qui n'exclut pas l'idée d'un observatoire européen ; - les aides publiques sont utiles, mais complexes ; il convient donc de faire un bilan des circuits d'attribution pour accroître la lisibilité et l'efficacité des aides ; celles-ci peuvent bien entendu bénéficier à des entreprises ne connaissant que des difficultés passagères. Il faut en contrepartie exiger des engagements en matière d'emploi ; - l'influence de la financiarisation de l'économie, et de la recherche d'une rentabilité à court terme, sur le phénomène des délocalisations a été analysée dans le rapport, de même que le handicap que représente l'absence d'une politique de l'industrie au niveau européen ; - il est exact que certains États membres ne respectent pas les règles communautaires en matière d'aides publiques ; - la définition communautaire de la PME retient la limite de 250 salariés ; - la désindustrialisation de notre pays est d'autant plus préoccupante que les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, n'ont plus seulement l'avantage des bas salaires, mais disposent aussi désormais de travailleurs qualifiés, comme l'illustre l'implantation d'un centre de 1 600 personnes appartenant à l'agence Reuters à Bangalore. La Commission a ensuite autorisé la publication du rapport, les députés membres du groupe socialiste s'abstenant. ANNEXES ANNEXE I I.- Membres du Gouvernement M. Renaud DUTREIL, Ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ; Mme Christine LAGARDE, Ministre déléguée au commerce extérieur ; M. François LOOS, Ministre délégué à l'industrie. II.- Organisations patronales Association française des entreprises privées (AFEP), délégation conduite par M. Bertrand COLLOMB, Président ; CGPME, délégation conduite par M. Jean-François ROUBAUD, Président ; MEDEF délégation conduite par M. Pierre NANTERME, Président de la Commission économie ; M. Geoffroy ROUX DE BEZIEUX, Président de Croissance Plus. III.- Organisations syndicales CFDT, délégation conduite par M. Marc DELUZET ; CFTC, délégation conduite par M. Jacky DINTINGER ; CGC, M. Michel LAMY ; CGT, M. Nasser MANSOURI. Organisations syndicales du groupe Axa France (Délégation de la CFDT conduite par M. Maurice ZYLBERBERG ; de la CFTC par M. Jean-Michel HURY ; de la CGT-FO par M. Jean-Claude STEFANINI ; de l'UDPA-UNSA par M. François BLANCHECOTTE). IV.- Économistes M. Jacky FAYOLLE, Directeur de l'Institut de recherches économiques et sociales (IRES) ; M. Jean-Paul FITOUSSI, Président de l'OFCE ; M. Lionel FONTAGNE, Conseil d'analyse économique (CAE) ; M. Jean-Louis LEVET, Centre d'analyse stratégique (ex-Plan) ; M. Jean-Hervé LORENZI, Conseil d'analyse économique (CAE). V.- Institutions M. Benoît BATISTELLI, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; M. Jean-François BERNARDIN, Président de l'Association Française des Chambres d'Industries (AFCI) ; Mme Catherine BRECHIGNAC, Présidente du CNRS ; M. Pierre MIRABAUD, Délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; M. Alain ROUSSET, Président de l'Association des régions de France (ARF). VI.- Représentants des entreprises M. Jean-Louis DABROWSKI, Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Doubs, accompagné de MM. Patrice BESNARD, Délégué national de la Chambre française de l'horlogerie, Raymond BRENET et Gérard COURLET, industriels comtois ; M. François PIERSON, Directeur général d'Axa France ; M. Michel de VIRVILLE, Secrétaire général de Renault. VII.- Personnalités diverses M. Michel GHETTI, PDG de France Industrialisation et Emploi (FI&E, cabinet en réorganisation industrielle) ; M. Érik ORSENNA, économiste, académicien, écrivain ; M. Christian PIERRET, ancien ministre. VIII.- Personnalités entendues lors du déplacement à Bruxelles M. Jean-Paul MINGASSON, directeur des affaires économiques de l'union des industries de la communauté européenne (UNICE) ; M. Denis REDONNET, Directeur adjoint du cabinet du Commissaire au Commerce Mandelson ; M. Heinz ZOUREK, Directeur général, Direction générale des entreprises et de l'industrie de la Commission européenne ; M. Xavier PRATS MONNE, Directeur en charge du Fonds social pour l'Emploi, Direction générale emploi, affaires sociales et égalité des chances de la Commission européenne ; Mme Lowri EVANS, Directeur général adjoint, chargé en particulier des aides d'État, Direction générale de la concurrence, Commission européenne ; M. Cyril COSME, Chef du service des affaires sociales à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. IX.- Personnalités entendues lors du déplacement à Bilbao M. José Maria MUNOA GANUZA, Délégué du Président de la Communauté autonome basque pour les relations extérieures ; M. Javier URRETA, Directeur de l'Unité de Construction et de Développement du Territoire (centre technologique LABEIN) ; M. Guillermo ZUBIA, Secrétaire général de CONFEBASK (organisation patronale basque) ; M. José Ignacio ZUDAIRE, Département de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme du gouvernement basque. M. Thierry FRAYSSE, Consul général de France à Bilbao. M. Jacques BERGÉ, Chef de l'antenne économique régionale française. X.- Personnalités entendues lors du déplacement en Finlande Mme Paula NYBERGH, Directrice Générale de la Technologie Ministère du Commerce et de l'Industrie, KTM M. Esko-Olavi SEPPÄLÄ, Secrétaire général Conseil National pour la Politique Scientifique et Technologique M. Jyrki KATAINEN, Président de la commission de l'avenir du Parlement finlandaiset Président du Parti conservateur (opposition) M. Miko ELO, Député, groupe social-démocrate, membre de la commission de l'avenir, Président de la délégation finlandaise au Conseil de l'Europe Mme Anneli PAULI, Vice-Présidente chargée de la politique scientifique et du financement de la recherche Académie de Finlande M. Jani KAARLEJÄRVI, Conseiller du Président du Sitra Fonds national pour la recherche et développement, SITRA M. Timo HÄMÄLAÄINEN, Directeur de recherche, programme Innovation Fonds national pour la recherche et développement, SITRA M. Jaakko PELLOSNIEMI, Directeur général de Mobidiag Oy (Entreprise de biotechnologie spécialisée dans le diagnostic des maladies infectieuses, en partenariat avec ST Microelectronics) Mme Hannele PHOJOLA, Directrice Innovation et Savoir Confédération des Industries finlandaises, EK (patronat) M. Kari KOMULAINEN, Directeur technologie, Coopération internationale Agence de financement de la recherche et de l'innovation, TEKES M. Tapio KOIVU, Directeur du secteur Recherche et Innovation (notamment chargé de la commercialisation des découvertes faites au VTT) Centre national de recherche technique, VTT M. Kyösti JÄÄSKELÄINEN, Directeur général Association finlandaise des parcs scientifiques, TEKEL M. Erkki ORMALA, Directeur de la technologie Nokia Corporation Son Excellence M. Gérard CROS, Ambassadeur de France en Finlande M. Laurent BERGEOT, Chef de la mission économique auprès de l'ambassade de France en Finlande M. Alain BÉZARD, Adjoint au chef de la mission économique ANNEXE II La politique finlandaise repose sur la conviction que l'avenir du pays passe par la recherche permanente de l'innovation et sur la recherche de l'excellence en ce domaine. Il s'agit d'une priorité qui fait l'objet d'un consensus national sans réserves, qui explique que les dépenses de R et D de ce pays soient passées de 2,2 milliards d'euros en 1999 à 5,4 milliards d'euros en 2005, soit 3,5 % du PIB, l'objectif étant de porter ce chiffre à 4 % en 2010. À l'inverse de la France, 70 % des dépenses de R et D sont d'origine privée, dont près de la moitié du fait du seul groupe Nokia. La Finlande se classe au 3ème rang mondial pour le ratio dépenses de R et D/PIB. Le consensus est d'autant plus fort que le pays a connu une très grave crise économique au début des années 90, qui l'a conduit à de profondes remises en cause. Le redressement industriel de la Finlande après la seconde guerre mondiale était comparable à celui du Japon ou de l'Allemagne de l'Ouest (55). L'industrie reposait sur le papier, l'industrie chimique et la métallurgie. Il y avait un consensus national sur une stratégie de croissance fondée sur l'investissement. L'acquisition de matériels et de technologies étrangères joua un rôle clé, de même que le développement du système éducatif. Les marchés des capitaux étaient étroitement réglementés (taux d'intérêts bas). Il existait de généreuses exonérations d'impôts pour les investissements, un commerce de troc avec l'URSS très profitable. Le Welfare state finnois était calqué sur le modèle suédois et, à la fin des années 80, la Finlande était l'un des pays les plus riches du monde. La déréglementation des marchés financiers, qui provoqua une hausse des taux d'intérêts, et l'effondrement de l'URSS révélèrent l'inadaptation de la Finlande aux nouvelles réalités économiques. À l'automne 1990, l'économie finlandaise s'est effondrée : 20 % de chômeurs, déficit budgétaire massif, le pays à la merci des financements internationaux... Pour faire face, les entreprises procédèrent à des licenciements massifs, améliorant leur productivité. L'État fit des coupes sombres dans son budget. Les exportations devinrent un objectif prioritaire. La crise élimina les obstacles mentaux à l'ajustement. L'export des produits de haute technologie dans le total des exportations est passée de 6 % en 1991 à 21 % en 1999 et ce, largement en raison des télécommunications. La part des exportations dans le PIB est passée de 22 % en 1991 à 43 % en 2000. Les marchés des capitaux ont été libéralisés. La réduction des échecs du marché est devenu le cœur de l'activité de l'État. Il est résulté de tout cela que les auteurs appellent un « nouveau paradigme mental » de la société finnoise, fondé sur le libéralisme et les industries de haute technologie. Comme l'indique une étude commandée par le ministère du commerce et de l'industrie, on peut également qualifier cette politique de survie d'une petite nation et de « success story ». Ceci étant dit, les objectifs d'égalité sociale et d'aménagement du territoire équilibrés demeurent très forts. Les négociations sociales au niveau central entre syndicats et patronat règlent encore de nombreuses questions. Cœxistent donc en fait deux modèles, le nouveau et l'ancien. Si l'on doit raisonner en termes de modèles, il semble cependant qu'on soit plus proche de la Suède, ou en tout cas des Pays-Bas, que des États-Unis. L'annexe I à la présente note est la traduction d'un tableau des auteurs précités, présenté à la mission lors de sa visite. Deux autres principes clés de la politique finlandaise sont la confiance et la transparence. Le principe de confiance signifie des contrôles très limités, de manière à éviter de gaspiller du temps et de l'argent. Cela n'est évidemment possible qu'en raison du niveau très limité de la fraude. Enfin, il semble exister une volonté d'aller dans le même sens de tous les acteurs dès lors qu'une décision est prise. Globalement, le pays jouit d'un très large consensus. Les entretiens de la mission ont seulement permis de relever deux points de divergence ; en premier lieu, l'immigration. Le patronat est favorable à un accroissement de l'immigration alors que les syndicats y sont hostiles. En second lieu, le nombre d'universités, jugé trop nombreux par certains de nos interlocuteurs, ainsi Nokia ou le représentant de l'Association des parcs scientifiques. Le dispositif public est organisé de manière assez simple, comme l'indique l'organigramme ci-après. 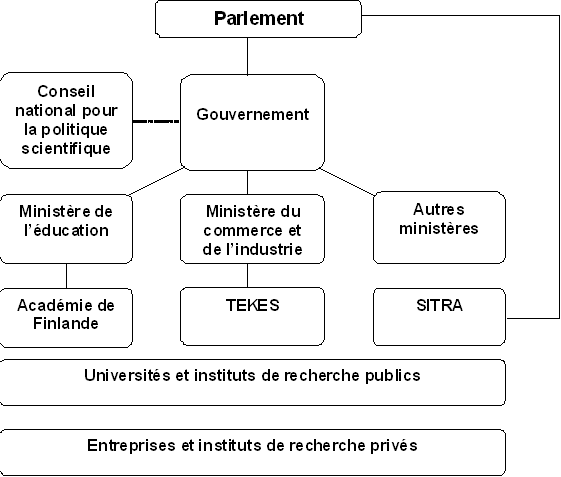 I.- Le Conseil national pour la politique scientifique et technologique : Le Conseil est responsable de la stratégie de développement et de la coordination de la politique scientifique et technologique finlandaise. Il est présidé par le Premier Ministre, les vice-présidents étant de droit le ministre de l'éducation et de la science ainsi que le ministre du commerce et de l'industrie. Il s'agit des deux ministres directement en charge des questions de recherche. En sont également membres quatre autres ministres. Il s'agit actuellement des ministres des finances, de l'environnement, du travail et de la culture. Le Conseil comporte également dix autres membres représentant les autres acteurs de la politique de recherche. II.- TEKES = Agence finlandaise du financement de la technologie et de l'innovation. C'est le principal acteur du financement de la R & D en Finlande. En 2006, il gère près de 30 % des dépenses de R et D publiques [478 millions d'euros dont 290 destinés aux entreprises et 21 millions d'euros provenant des fonds structurels de l'Union européenne]. TEKES est responsable de la coordination des activités EUREKA en Finlande. Les financements européens reçus par des organisations finlandaises au titre du VIème PCRD (2002-2005) sont estimés à 287 millions d'euros, dont 15 % pour les PME et 16 % pour les grandes entreprises. TEKES distribue tant des subventions que des avances remboursables [Tekes ne vise pas spécifiquement les PME, qui représentent 53 % du montant des financements et 79 % du nombre de projets]. Il assure également le financement de l'innovation dans les entreprises, notamment dans le cadre du programme TULI qu'il finance, mais dont la coordination est assurée par l'association des parcs scientifiques, TEKEL. Le financement moyen accordé à un projet s'élevait en 2005 à 180 000 euros (120 000 euros pour les PME et 404 000 euros pour les entreprises de plus de 500 employés). TEKES n'offre pas de soutien aux industries traditionnelles. Sa mission est de préparer l'avenir. Deux tiers des demandes de soutien sont reçus. L'économie finlandaise est aujourd'hui basée sur la connaissance dans le cadre d'un développement équilibré. La transmission des connaissances s'effectue dans le cadre d'un réseau. Les « clusters » constituent le modèle de TEKES. TEKES juge aujourd'hui que la Finlande est un pays attractif, avec cependant un manque d'esprit d'entreprises et un marché financier sous-développé dès lors qu'il s'agit de financer l'innovation des start-up, la difficulté n'existant pas pour les entreprises matures. Souvent TEKES est le premier à accorder un financement, encourageant ainsi d'autres à apporter des financements complémentaires. En 2005, TEKES a financé 2 134 projets pour un montant de 429 millions d'euros, dont 179 pour les universités et 250 pour les entreprises. Un contrat annuel avec le ministère fixe les objectifs, par exemple les nanotechnologies, mais ne précise pas les régions ou les entreprises concernées. Aujourd'hui l'innovation ne passe pas nécessairement par des nouvelles technologies : l'essentiel est de créer de nouvelles activités. TEKES a actuellement en cours une vingtaine de programmes. TEKES a des bureaux à l'étranger, aux États-Unis et en Asie. Lorsque la décision de soutenir un projet est prise, TEKES demande un rapport formel de deux pages sur l'exécution, en application du principe de confiance. Les contrôles portent sur 1 ou 2 % des projets. 80 % des clients de TEKES ont remboursé les avances consenties, ce qui a fait dire à son représentant qu'ils n'avaient peut-être pas pris assez de risques. Il a cependant précisé que TEKES utilise de l'argent public dont il doit justifier l'usage. TEKES n'est pas une banque. Le départ à l'étranger de scientifiques finlandais est jugé positivement. On ne peut en tout état de cause pas arrêter les délocalisations. Une coopération université/entreprise est exigée pour l'acceptation d'un dossier de financement, les petites entreprises étant cependant dispensées de cette obligation. III.- L'Académie de Finlande L'académie de Finlande encourage la recherche fondamentale de haut niveau. Elle finance des projets de recherche, des programmes de recherche, des centres d'excellence, des postes de chercheurs, la formation des chercheurs et la coopération internationale. Chaque année, l'Académie reçoit des dossiers de demande de financement à hauteur de 1,2 milliard d'euros et accorde environ 240 millions d'aides à la recherche de haut niveau. Répartition du financement de la recherche par l'Académie de Finlande par mode de financement en 2005.
Répartition du financement de la recherche par type d'organismes de recherche.
Un Conseil d'administration de sept personnes nommé par le Conseil des ministres définit la politique scientifique de l'Académie et la répartition des subventions de la recherche aux comités scientifiques qui décident librement du financement de leur recherche dans leur propre domaine. Il y a 4 comités scientifiques. Les décisions de financement de l'Académie sont basées sur l'évaluation scientifique du candidat et de son plan de recherche. Pour sélectionner les projets à financer, l'Académie fait appel à des experts nationaux et étrangers, eux-mêmes chercheurs renommés dans leur domaine. Il nous a été indiqué que l'on faisait notamment appel à des chercheurs finlandais expatriés à l'étranger. IV.- SITRA [Fonds national pour la recherche et le développement]. Dirigé depuis 2004 par l'ancien Premier ministre Esko AHO, ce fonds a été créé en 1967 pour célébrer le cinquantenaire de l'indépendance du pays. Le SITRA avait investi, fin 2005, 150 millions d'euros en capital risque dans 90 entreprises. Son budget en 2005 était d'environ 35 millions d'euros. Le Fonds est placé sous l'autorité, nominale, du Parlement, ce qui garantit ainsi son indépendance. SITRA exploite des fonds régionaux. Il a été réorganisé et son activité regroupée autour de 6 programmes thématiques propres : innovation, santé, alimentation et nutrition, environnement, Russie et Inde. Au cours de l'entretien, il a été notamment souligné que la Finlande ne pouvait pas être la meilleure partout. Il faut donc faire des choix. L'avantage d'un petit pays homogène est d'arriver plus facilement au consensus. Un pays n'évolue cependant que s'il connaît une évolution sociétale et pas seulement sociale. V.- VTT [Centre national de recherche technique] : cet institut de recherche public fonctionne également comme centre de recherche appliqué sous contrat pour les entreprises, y compris étrangères. Il emploie 2 700 personnes. La décomposition du chiffre d'affaires, par source de revenus, était la suivante en 2005 : Revenus externes : 147 millions d'euros : 65 % Dont : - secteur privé (national) : 67 M€ : 70 % - secteur public (national) : 49 M€ : 21 % - International : 31M€ : 14 % Principales subventions gouvernementales : 78 M€ : 35 % TOTAL : 225 millions d'euros (233 millions prévus en 2006) L'objectif du VTT est d'aider ses clients à augmenter leur compétitivité. Le développement à l'international constitue une priorité, avec un objectif de doublement du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger (14% en 2006). Depuis 2005, VTT est autorisé à prendre des participations dans des start-up (≤ à 25%). L'Etat a assigné comme tâche à VTT de contribuer à créer de nouvelles entreprises. Si VTT a un projet intéressant, il essaie de trouver un partenaire. En cas d'échec, il peut choisir de vendre la licence du produit. La recherche fondamentale doit rester au sein des universités. Il existe des projets tendant à transformer VTT en entreprise commerciale. VI.- L'Association des parcs scientifiques : Pour adhérer à cette association, un parc doit remplir certaines conditions : 1) Population bien éduquée. Centre d'enseignement supérieur de recherche 2) Entreprises capables d'utiliser les résultats de la coopération privée/publique 3) Bonnes infrastructures L'Association comptes 25 membres, dont la stratégie est de promouvoir l'internationalisation, développer une R et D de niveau mondial et améliorer leur image globale. La méthode consiste à développer la coopération public/privé, à développer la recherche fondée sur la haute technologie, à se spécialiser dans des zones d'expertise clés et à travailler en réseau. Il peut y avoir contradiction entre les impératifs de la politique régionale et ceux de la recherche.
ANNEXE III Si l'ampleur du travail accompli par les membres de la mission et la qualité du rapport présenté par Madame Brunel ne sont pas en cause, nous ne saurions en partager les préconisations qui s'inscrivent toujours dans la même logique : la réduction de l'impôt sur les sociétés, l'allègement du droit du travail et l'aggravation de la flexibilité, la mise en place de la TVA sociale, faux-nez des allègements de cotisations sociales patronales, les avantages à accorder aux investisseurs. S'il est suggéré de confier au Comité d'Orientation pour l'Emploi la mission de recenser et exercer un certain contrôle sur l'octroi des aides publiques , le rapport sous estime toujours les droits des salariés et des élus locaux à agir et intervenir pour éviter les délocalisations destructrices d'emplois. Quid de leur représentation et capacité d'intervention ? C'est une mise à l'écart inacceptable alors que bien souvent, ce sont les organisations syndicales et les représentants des salariés qui sont les premiers défenseurs de la sauvegarde de l'entreprise, se battent en faveur d'une gestion privilégiant les investissements utiles sur les dépenses spéculatives, qui, n'en déplaisent aux actionnaires, proposent bien souvent des solutions alternatives aux délocalisations et aux licenciements. Et si la pertinence de la mise en place d'un observatoire de la mondialisation et des délocalisations ne peut être contestée, encore s'agit-il de savoir pour quelle efficacité. Car le phénomène engagé depuis une vingtaine d'années, connaît aujourd'hui une ampleur sans précédent. Le quotidien l'Humanité publiait, lundi 30 Octobre une carte de France évoquant 20 000 emplois menacés et 25 000 liquidés : 53 départements y figuraient du Nord aux Ardennes, à la Moselle ou la Vienne, de la Picardie à la Normandie, des filières d'activités de la chaussure au textile-habillement, de la lingerie à l'imprimerie, de l'automobile aux services, de la téléphonie aux assurances... Des groupes et des centaines d'entreprises, petites ou grandes, délocalisent ou taillent dans les effectifs :JVC, Continental, Alcatel, ST Microélectronics, Alsthom, Arcelor, Schneider, OCT, JBR-SKF, TI-Groupe, Comilog, Mainetti, Ontex, Jackstadt, Levern Altadis, Facom, Flextronics, Schweiz-Maudoit, Aubade, Dim, Peugeot-Motocycle, Whirlpool, Flodor, Honeywell, Axa qui veut délocaliser 1 500 emplois au Maroc. Le seul secteur du textile-habillement ne compte plus, avec 86 000 emplois que le tiers des emplois de 1995. En dix ans, la part des importations en provenance des pays à bas salaires a atteint 65 %. Et contrairement à une idée reçue les industries de pointe faisant appel à des compétences de haut niveau et des emplois qualifiés sont, elles aussi, affectées : la recherche et les services à valeur ajoutée, l'informatique n'y échappent plus. Ainsi Cap Gémini crée 6 000 emplois en Inde pour des services aux entreprises françaises. La course à la rentabilité financière, le « différentiel social » et le coût de la main-d'œuvre sont invoqués. Mais les délocalisations contribuent à faire disparaître progressivement les grandes industries nécessaires au développement économique de notre pays et aggravent la fracture territoriale. Produire français reviendrait-il trop cher alors que le coût horaire de la main-d'œuvre est moins élevé en France qu'en Allemagne ou au Japon ? La part des salaires dans le PIB plafonne à 69 % pour une moyenne de 68,4 dans l'Europe des 15. La productivité horaire du travail a augmenté de 2,32 en moyenne annuelle de 1996 à 2002. Davantage qu'aux USA qui n'hésitent pas pour leur part à taxer lourdement les entreprises qui délocalisent. Enfin, la question posée est d'améliorer les protections des travailleurs du tiers-monde et non pas d'affaiblir celles en vigueur dans notre pays. Notre pays ne rebute d'ailleurs pas les investissements étrangers. Il se place au 2ème rang des pays de l'OCDE dans ce domaine et compte 2 millions de salariés travaillant pour des entreprises sous contrôle étranger. L'effet de la fiscalité sur les délocalisations doit lui aussi être relativisé, le taux de prélèvement sur les entreprises en 2003 par rapport au PIB est, en France, l'un des plus faibles d'Europe. Les allègements de cotisations sociales induits par le mécanisme de TVA sociale, aggraveraient la faiblesse du pouvoir d'achat, la limitation des dépenses publiques, et auraient des conséquences négatives sur la croissance. Il n'y a pas de fatalité à une évolution vers l'entreprise sans usine et une Europe à « forte valeur ajoutée, sans industrie ». C'est dans l'articulation d'une industrie forte, d'une recherche et de services performants que se trouvent de nouvelles sources d'efficacité. Il est urgent de repenser, tant la division internationale du travail que l'organisation du travail, d'améliorer les niveaux de qualification pour mieux exploiter les nouvelles technologies. Les facteurs explicatifs de localisation des entreprises sont un marché en développement, une main-d'œuvre efficace, une recherche dynamique, des infrastructures de haut niveau, un système productif cohérent. C'est en ce sens qu'il faut peser collectivement et politiquement sur les choix stratégiques des grands groupes. Les salariés attendent des pouvoirs publics, non de la compassion mais une action forte pour inciter les entreprises à des choix de développement et pénaliser celles qui préfèrent la facilité de la délocalisation au nom d'une rentabilité plus forte à court terme. C'est le sens des propositions qui suivent. Propositions Dans une France qui condamne 7 millions de nos concitoyens au chômage et à la précarité, comment ne pas entendre l'inquiétude que soulèvent les délocalisations ? Un quart des salariés se sentent menacés dans leurs emplois. Les Député-e-s Communistes et Républicains qui se sont toujours placés aux côtés des salariés concernés, en s'opposant aux fermetures d'entreprises, ont dans le même temps travaillé à des propositions alternatives qui ont trouvé leur expression au fil des législatures sous forme de propositions de loi telles celle de 1999 sur les licenciements économiques ou plus récemment celle sur la lutte contre les délocalisations, portée dans le débat qui a eu lieu en 2004 dans l'hémicycle. 42 % des Français estiment que la lutte contre les délocalisations doit être une priorité. L'ampleur actuelle du phénomène appelle des mesures d'urgence et de fond relevant d'une autre logique économique que nous proposons de décliner ainsi : Des mesures immédiates : Il faut établir immédiatement un moratoire des délocalisations, pour suspendre tout licenciement lié à des investissements à l'étranger, et toute fermeture décidée sans concertation avec les salariés ou leurs représentants. La suspension des délocalisations doit déboucher sur la réunion de comités d'urgence ou cellules de crise réunissant directions d'entreprises, représentants des salariés, élus locaux, représentants des banques, afin de dégager les solutions maintenant l'emploi sur le territoire, et aidant à la poursuite de l'activité. Les entreprises qui procèdent à ces délocalisations à des fins de profit maximum, doivent être tenues non seulement de s'acquitter de leurs obligations légales, mais de rembourser toutes les aides publiques perçues au titre de l'aide à l'activité et à l'emploi. Le contrôle de l'utilisation des fonds publics : Les aides financières publiques ne peuvent être accordées qu'aux groupes qui n'auront pas délocalisé l'une de leur filiale implantée en France au cours de l'année qui précède l'obtention de l'aide. Dans cet esprit, il est nécessaire de réintroduire « la loi Hue », 1ère loi abrogée par le gouvernement en 2002 ! Cette loi adoptée à l'initiative des députés communistes créait des commissions nationale et régionales de contrôle des aides publiques aux entreprises, ouvertes aux partenaires sociaux et aux élus, ayant pour mission de s'assurer que le soutien public accordé aux entreprises contribue réellement à la préservation et au développement de l'emploi. Des droits nouveaux pour les salariés et les élus: Le gouvernement a également suspendu une dizaine d'articles de la loi de la modernisation sociale qui constituaient des obstacles sérieux aux délocalisations. Abrogés par les articles Larcher de la loi de cohésion sociale, votée en décembre 2004, il conviendrait de les réinsérer dans le dispositif légal. C'est le cas du droit d'opposition du Comité d'Entreprise, instauré pour les plans sociaux affectant plus de 100 personnes. C'est aussi le cas des deux articles imposant une étude d'impact social territorial en cas de restructuration. Cette mesure, associée à l'obligation de réparation instituée dans cette même loi de modernisation sociale, aurait permis aux élus locaux d'être parties prenantes du dossier de restructuration et de pouvoir, le cas échéant, faire valoir des réclamations au regard du préjudice subi par leur collectivité. Toute entreprise qui détruit des emplois sur un territoire devrait être obligée de le redynamiser en recréant indirectement les emplois détruits et en compensant financièrement l'impact pour la collectivité. Des mesures financières et fiscales d'équité : Les importations de produits à faibles coûts, obtenus par l'exploitation des travailleurs qui subissent les bas salaires, le travail de nuit , l'absence de protection sociale, dans d'autres pays, doivent être taxées en fonction des différentiels sociaux. Cette taxe pourrait contribuer à alimenter un fonds de développement, géré dans la transparence afin d'impulser un co-développement avec les pays du Sud et leurs peuples. Le mouvement de délocalisation fiscale est préoccupant pour les finances publiques (coût estimé à 32 milliards d'euros en 2008). Il est donc indispensable de mettre en place un mécanisme de lutte efficace contre cette évasion fiscale à grande échelle et de défendre vigoureusement, sur la scène européenne, la nécessité d'une harmonisation et d'une coordination des dispositifs d'imposition des sociétés. La mesure de transparence proposée par la DGI, mais non retenue, dans le cadre de la loi de Finances 2006 et contraignant « toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d'optimisation fiscale à le déclarer à l'administration fiscale »constituerait un premier pas. Il existe aussi en France, une autre délocalisation, celle des dividendes. En 2004, 39 milliards d'euros de revenus boursiers ont été versés par les grandes sociétés du CAC 4O aux fonds anglo-saxons présents dans leur capital. La richesse existe dans notre pays. Il faut orienter cette richesse vers les investissements socialement et économiquement utiles. À la place de la politique coûteuse d'exonération des charges (plus de 23 milliards en 2005), une réforme des cotisations sociales dites « patronales » fondée sur une modulation des cotisations en fonction de la priorité que les employeurs accordent à l'emploi et la formation serait utile. La mise sur pied de fonds régionaux pour l'emploi, comme ceux dont vient de se doter le Conseil Régional Rhône-Alpes, est à encourager de même que le soutien aux entreprises qui refusent de délocaliser, en particulier celles qui économiquement rentables ferment faute de financements suffisants. C'est notamment le cas de PME qui n'accèdent que difficilement au crédit bancaire. Il s'agit dans le cadre d'orientations régionales et nationales de mobiliser de manière concertée, des ressources disponibles aujourd'hui gaspillées : aides diverses aux entreprises, crédits bancaires actuellement détournés vers la finance et de favoriser les investisseurs socialement responsables. La création d'un pôle public financier autour de la Caisse des Dépôts et Consignations et diverses institutions financières publiques, pourrait conforter une telle construction. Il serait nécessaire également de mettre la politique d'aménagement du territoire au service de la relance de l'industrie dans les régions sinistrées. Cela suppose de mobiliser les moyens financiers de l'Union Européenne et de l'État pour favoriser une réimplantation durable dans les zones défavorisées des industries les plus touchées par les délocalisations. Des moyens et une dynamique pour l'innovation et la recherche : L'innovation et la recherche sont indissociables des systèmes productifs pour assurer leur performance et leur évolution. Mais la France, en ne consacrant que 2,20 % de son PIB à la recherche, est distancée par l'Allemagne (2,45 %), les U.S.A. (2,69 %), sans parler du Japon (3,29 %). Quand on parle d'attractivité, la qualité de la formation supérieure d'un pays est un atout indéniable. L'action de l'État est là aussi, déficiente : 1,1 % de son PIB à l'enseignement supérieur contre 1,4 % en moyenne dans les pays développés. La France dépense chaque année 8 800 dollars par étudiant ; les États-Unis : 10 000. En France, à peine 59 % des étudiants achèvent leurs études, soit 11 points de moins que la moyenne de la zone OCDE, 20 % de jeunes sortent du système éducatif sans qualification. Le volume des crédits consacrés à la formation professionnelle est inférieur à celui des exonérations des cotisations sociales patronales, soit pour le budget 2007, 25,6 milliards d'euros inscrits ! Pour lutter efficacement contre les délocalisations, c'est sur l'ensemble de ces terrains qu'il faut agir. Celui de la recherche, celui du renforcement des capacités de fabrication, de création et de savoir, en s'appuyant sur l'épanouissement des potentialités humaines. Il faudrait donc porter le budget de la recherche à 3 % du PIB en faisant de la recherche, une priorité nationale. Un système de sécurité emploi-formation : La création d'un système de sécurité d'emploi et de formation, permettrait une sécurisation des parcours professionnels, où chaque salarié, victime notamment de délocalisation, pourrait accéder à une formation pour revenir par la suite à un meilleur emploi, avec une garantie de revenus et de droits. Plutôt que d'abandonner des salariés sans perspective et de les broyer dans une concurrence sauvage, il faut se donner les moyens d'anticiper les mutations et assurer les transitions, qu'elles soient nécessaires ou souhaitées par les individus. Bâtir un droit européen pour lutter contre le dumping fiscal et social : Les gouvernants successifs, artisans de la construction européenne, ont donné la priorité à la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes sous le règne de la concurrence maximale. Or, c'est cette stratégie qui favorise aujourd'hui la mise en compétition des salariés et des territoires dans la zone UE et alimente ainsi les mouvements de délocalisations sauvages. Les représentants politiques des états, les parlementaires, les organisations représentatives des travailleurs doivent agir pour une harmonisation sociale reposant sur des seuils élevés en matière de rémunérations, de droit du travail, de protection sociale ou encore de fiscalité sur le capital. ANNEXE IV Les membres socialistes de la mission d'information sur les délocalisations saluent le travail important et l'écoute lors des différentes auditions réalisées dans le cadre de cette mission. Ils regrettent cependant que le diagnostic fait sur le phénomène des délocalisations soit largement partial et partiel ; ce qui ne permet pas d'aboutir à des préconisations et des propositions efficaces même si certaines d'entre elles vont dans le bon sens. Le diagnostic dressé semble être le prétexte à démonter le modèle social français pour libéraliser le marché du travail. Ainsi, pour le rapporteur de la mission, «l'adaptation au monde moderne» passe par la nécessité de «stimuler l'emploi en aménageant le temps de travail pour répondre aux besoins des entreprises ». Par ailleurs le satisfecit accordé au Gouvernement en matière de recherche peut surprendre étant donné le retard qu'a pris la France en la matière. Les délocalisations, en particulier d'entreprises industrielles, ne sont pas une fatalité économique et résultent de multiples facteurs. Certains nous semblent partiellement voire totalement ignorés. - Tel est le cas du coût de l'énergie qui dans les années à venir pèsera de plus en plus dans la formation des prix. - C'est aussi le cas de la parité monétaire euro-dollar, ainsi que celle avec le yuan qui pèsent lourdement sur les échanges. Certes la volatilité des taux de change peut rendre difficile la définition d'une stratégie cohérente d'implantation à l'étranger. Toutefois, lorsque l'affaiblissement du dollar semble durable, comme actuellement, le handicap de compétitivité des produits fabriqués dans la zone euro peut nécessiter une délocalisation pour réduire les coûts de production. Il est regrettable que la politique monétaire menée par la banque centrale européenne ne soit pas encadrée par la stratégie de Lisbonne qui doit être progressivement l'outil de la politique économique européenne. Comme le souligne, le Sénateur Bizet, dans son rapport de mai 2006 sur la stratégie de Lisbonne, « l'outil reste embryonnaire et le contenu du programme communautaire reste du domaine de l'incantation ». (Toutefois, on peut constater que les délocalisations en Allemagne sont moins nombreuses qu'en France et que le bilan de son commerce extérieur est excédentaire. Or, l'Allemagne fait bien partie de l'Union européenne !). L'Union européenne s'est privée de l'instrument de la politique de change. - Les aides publiques considérables accordées par des pays émergents non encadrées par l'Union européenne, ainsi que l'absence de pilotage de ces aides qui ne peut que favoriser un effet d'aubaine assez pervers. - la politique européenne de régulation des marchés interdisant les aides directes met en péril tout un pan de notre industrie (aéronautique, grandes filières technologiques...) qui délocalise au travers des sous-traitants. L'absence de réflexion transversale de la Commission européenne amène ainsi chaque commissaire à faire des propositions guidées uniquement par une vision sectorielle et ainsi peuvent pénaliser les entreprises faute d'approche plus globale. - les normes environnementales dont de grands pays comme les USA et le Canada s'exonèrent et non prises en compte dans les pays émergents sont aussi un facteur de délocalisation de nos entreprises industrielles. - nécessité de réintroduire le long terme dans la stratégie des entreprises. En effet, les entreprises privilégient aujourd'hui le court terme en matière d'investissement, de recherche et développement pour répondre à une logique financière de rentabilité pour les actionnaires au détriment du long terme, nécessitant des investissements plus lourds Ne sont pas évoquées non plus l'augmentation des bénéfices des grands groupes qui délocalisent, ni celle des stocks options versées à leurs dirigeants. Concernant les propositions, celle du financement de la protection sociale par un point de TVA sociale reste aléatoire dans la mesure où aucune étude sérieuse n'a été faite sur l'impact de cette décision. La fiscalité des entreprises, de même que la modernisation du dialogue social et la flexi-sécurité ne semblent pas aujourd'hui une des réponses adaptées à la mondialisation et aux délocalisations. Elles ne doivent pas laisser croire que notre pays se lance dans une politique de dumping social et fiscal pour lutter contre ce phénomène. Il faut rappeler que le budget 2005 avait donné lieu à des annonces tonitruantes de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'économie et des finances, censées résoudre le problème des délocalisations. Deux ans plus tard, un constat s'impose : l'échec de ces gadgets médiatiques. Le crédit d'impôt de 50 % des dépenses de personnel offert aux entreprises ayant délocalisé une activité entre 1999 et 2004 et décidant de la relocaliser n'a donné lieu à aucune dépense fiscale en 2005 ! Comme le disait Nicolas Sarkozy en réponse au scepticisme des socialistes : « Si ça ne marche pas, on ne pourra pas dire que le dispositif est onéreux... ». Mesuré à cette aune, l'échec de ces dispositifs est patent. Comme l'a précisé Didier Migaud lors de 1'examen de la loi de finances pour 2005, « si la France s'engage dans une course au moins-disant fiscal et social, elle perdra plus que son attractivité et ses emplois, elle peut voir remis en cause les fondements de ce que certains appellent le pacte républicain ». Notre modèle de développement, qui offre globalement à nos concitoyens un haut niveau de vie, repose sur un niveau élevé de protection sociale, de formation et d'infrastructures, rendu possible grâce aux prélèvements sociaux et fiscaux. Grâce à ces atouts, l'attractivité de la France est réelle. N'oublions pas que nous sommes le second pays d'accueil au monde en terme d'investissements directs à l'étranger, toutes les études le démontrent. Pour la France, comme pour l'Europe, la croissance et le développement passent par le financement de nouvelles infrastructures, des dépenses de formation et de recherche. La seule chose qui peut encore motiver les investisseurs à s'implanter en France, c'est la qualité de ses infrastructures, ainsi que le niveau de formation et de productivité de sa main-d'œuvre. Dès lors, on comprend bien d'une part que si notre attractivité ne réside pas dans la fiscalité, choisir ou subir la course au moins-disant fiscal risque de nous priver des ressources nécessaires au financement de ces atouts. Et il est évident que nous avons tout intérêt à ce qu'un minimum soit défini au niveau européen en ce qui concerne le social et le fiscal, afin de limiter cette concurrence qui tire tous les pays de l'Union vers le moins-disant social et fiscal. D'abord, au plan national, il faut cesser de remettre systématiquement en cause les politiques publiques et budgétaires en direction de la recherche et de la formation, des infrastructures, de l'aménagement du territoire. Mais il faut également tenir compte des contraintes budgétaires qui pèsent sur nous. Par conséquent, il est souhaitable et même nécessaire de développer le budget de l'Union en la matière. 1 () M. Daniel COHEN - « Trois leçons sur la société post-industrielle » - Seuil - 2006 - page 12. 2 () « Notre première mondialisation » - Mme Suzanne BERGER - Seuil - 2003. 3 () M. Daniel COHEN - ouvrage précité, page 12. 4 () IXIS - n° 2006 - 420. « Des mécanismes contre-intuitifs, mais importants » 5 () Rapport d'information n° 374 du 23 juin 2004 de M. François Grignon sur la délocalisation des industries de main-d'œuvre. 6 () Le nettoyage « internalisé » rentre dans l'emploi industriel. Externalisé, il n'y rentre plus. La réalité ne change pas pour autant. 7 () « La Délocalisation » Françoise Drumetz - Bulletin de la Banque de France n° 312- Décembre 2004. 8 () Cet indicateur englobe également la substitution d'un fournisseur issu d'un pays émergent à un autre fournisseur étranger originaire d'un pays non émergent : Renault préfère acheter ses boulons en Chine plutôt qu'en Espagne. 9 () Carton, Hervé, Terfous (2005) : « Interventions de change asiatiques et taux de change d'équilibre », DPAE n°72. 10 () « La Chine est réveillée, quelles conséquences pour la France ? » : Rapport d'information n° 307 du 11 avril 2006 de la Commission des Affaires économiques du Sénat. 11 () M. Daniel COHEN - « Trois Leçons sur la société post-industrielle » - Seuil 2006. 12 () Comme l'indique Florence Krémer dans « La France industrielle en question : analyses sectorielles », « une image de prix bas redevient centrale dans la stratégie et la communication des enseignes » et « quel que soit le positionnement recherché, un prix bas au consommateur final apparaît comme une condition sine qua non de l'offre ». 13 () Article de Mme Françoise Chipaux paru dans le Monde daté du 2 août 2006 : « Des fraudes écornent la crédibilité des centres d'appels indiens ». 14 () Source : Rapport sur les prélèvements obligatoires et leur évolution annexé au projet de loi de finances pour 2007. 15 () Les Echos, 29 et 30 septembre 2006. 16 () Par droit des marchés publics, on entend, pour l'essentiel, l'Accord Marchés Publics conclu au sein de l'OMC, le droit européen, le code des marchés publics et les autres normes applicables, ainsi la loi Sapin, et la jurisprudence. 17 () Les Cahiers - Commissariat général au Plan- n° 2 - avril 2005 18 () La lettre de l'acheteur public - N° 3 - Juillet/Août 2005 - Editions WEKA. 19 () La lettre de l'acheteur public - Mars/Avril 2005 - Editions WEKA. 20 () Communication interprétative 2006/C179/02 - JO UE du 1/8/2006. 21 () La lecture récente de conclusions de son avocat général permet d'ailleurs de le penser. 22 () La lettre info marchés - Février 2006 - Le Moniteur des Travaux publics. 23 () Insee première - Juin 2006 - n° 1086. 24 () Insee première - Août 2006 - n° 1097. 25 () L'analyse de ce point repose sur l'étude réalisée par Mc Kinsey « Donner un nouvel élan à l'industrie en France » - octobre 2006. 26 () « La mondialisation et ses ennemis », M. Daniel COHEN. 27 () Conseil d'analyse économique - 2006. 28 () Rapport précité - page 131. 29 () Rapport précité sur les politiques de concurrence - Commentaire de M. Jean-Hervé Lorenzi - p 182. 30 () Les Echos - Mercredi 4 octobre 2006. 31 () Les Echos - 13et 14 octobre 2006. 32 () HERALD TRIBUNE du 17 octobre 2006. Le même numéro livre une enquête sur l'enseignement croissant du chinois en primaire aux Etats-Unis. 33 () Les conclusions de cette étude ont été publiées dans le Figaro du 3 juin 2004. 34 () Rapport de M. Jean-Paul Betbèze, « Financer la R&D » Conseil d'analyse économique - 2005 35 () Les Echos - Mardi 10 octobre 2006. 36 () Le Monde - Vendredi 6 octobre 2006. 37 () Technologies de l'information et de la communication ; Matériaux et chimie ; Bâtiment, Energie et environnement ; Technologies du vivant, de la santé et de l'agroalimentaire ; Transports ; Distribution et consommation ; Technologies et méthodes de production. 38 () Cité dans le rapport Dubernard, p.55. 39 () Les éléments d'information sur ce sujet sont tirés des sites Internet des administrations américaines compétentes. 40 () Traduction littérale. 41 () 67% des marchés du ministère fédéral du logement et de l'urbanisme ont été attribués à des PME en 2004 [Le Moniteur des Travaux Publics du 4 août 2006]. 42 () « Hearing » du 18 mars 2003. Il y a donc une Commission spécialement en charge des PME. 43 () « Secrets of the world's largest seed capital fund ». 44 () Les seuils n'ont pas été remis en cause par le nouveau code des marchés publics de 2006. 45 () Le Moniteur des Travaux Publics du 4 août 2006. 46 () Quatorze Etats-membres. 47 () Communication de la Commission sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne. Une politique des PME moderne pour la croissance et l'emploi - COM(2005) 551 final. 48 () Il est rappelé que les règles de calcul de marchés posées par l'AMP sont relativement « englobantes » ; ainsi, par exemple, prise en compte des contrats analogues sur 12 mois. 49 () Rapport de Mme Anne Dumas de juillet 2006 : « Pourquoi nos PME ne grandissent pas ». 50 () Article 73 de la proposition de loi de modernisation de la politique de la montagne et de revitalisation rurale n°420 du 24 juillet 2003 présentée par M. Christian Poncelet et plusieurs de ses collègues ; proposition de loi n° 2007 du 21 décembre 2004 tendant à rendre obligatoire le remboursement des subventions publiques perçues par les entreprises qui procèdent à des délocalisations présentée par M. Damien Meslot et plusieurs de ses collègues. 51 () Le rebond du modèle scandinave, Marie-Laure le Foulon, Éditons Lignes de repères 2006. 52 () Article 98 du code des marchés publics. 53 () Les Echos, 18 septembre 2006, « Pour une mondialisation réussie ». 54 () International Herald Tribune, 13 octobre 2006. 55 () Cette analyse historique repose sur les données fournies par Risto Heiskala et Timo Hämäläinen. « Social innovation or hegemonic change ? Rapid paragdim changes in Finland in the 1980s and 1990s » [Livre à paraître]. Ces auteurs ont été rencontrés lors de la visite de la mission au SITRA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||