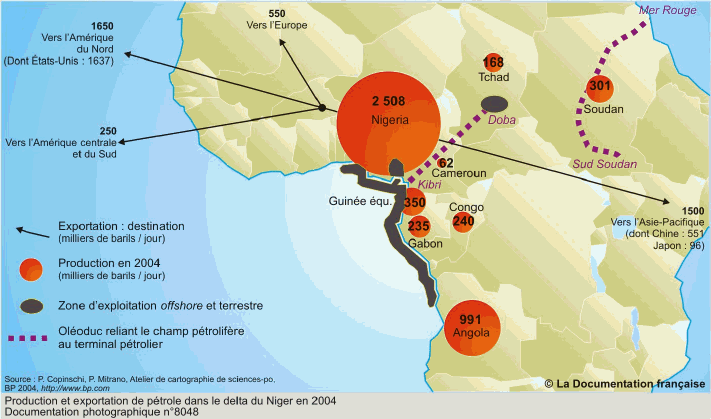N° 3468 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2006. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES en conclusion des travaux d'une mission d'information constituée le 8 février 2006 (1), sur « Energie et géopolitique » Président M. Paul QUILÈS Rapporteur M. Jean-Jacques GUILLET Députés -- __________________________________________________________________ (1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page. La mission d'information « Energie et géopolitique » est composée de : M. Paul Quilès, Président, M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur, MM. René André (1), Jean-Louis Bianco, Philippe Cochet, Jacques Godfrain, Pierre Goldberg, François Guillaume, Jean-Pierre Kucheida, François Loncle, Axel Poniatowski, Daniel Poulou, Eric Raoult, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Rudy Salles, Henri Sicre. RÉSUMÉ DU RAPPORT 9 AVANT-PROPOS - LA FIN DE L'INSOUCIANCE ÉNERGÉTIQUE 17 CHAPITRE PREMIER - LA CRISE ÉNERGÉTIQUE : UNE PRISE DE CONSCIENCE NÉCESSAIRE 23 I. LA CRISE DE L'ÉNERGIE : LA NOUVELLE DONNE ÉNERGÉTIQUE 25 A - Le temps des contraintes 27 1) Une situation explosive 27 2) La fin de l'énergie à bon marché 29 3) L'interdépendance énergétique croissante entre les Etats 32 B - Le temps de l'inquiétude 34 1) La planète malade du CO235 2) Des effets climatiques désastreux 38 3) La nécessité d'un traitement de choc 42 II. LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE INTERNATIONALE EST-ELLE DURABLEMENT MENACÉE ? 45 A - La peur de l'insécurité énergétique 48 1) La production d'énergie : la peur de l'imprévu 48 2) Le transport de l'énergie : la peur de la désorganisation 53 3) La consommation énergétique : la peur de l'insuffisance 57 B - L'interdépendance, fondement de la sécurité énergétique ? 58 1) Les faux remèdes 58 2) Les vraies solutions 61 III. LES MULTINATIONALES SONT-ELLES LES « MAÎTRES » DE L'ÉNERGIE ? 69 A - Les multinationales ne sont plus les seuls maîtres du jeu énergétique 72 1) Les résultats vertigineux des « majors » 73 2) L'illusion de la puissance 77 B - Les compagnies nationales des Etats producteurs sur le devant de la scène 81 1) Une stature de « géants » plus ou moins autonomes 81 2) Une expansion continue des compagnies des pays émergents 83 3) Des compagnies symboles de la souveraineté énergétique 86 CHAPITRE II - LA CRISE ÉNERGÉTIQUE : UNE CRISE PLANÉTAIRE 89 I. LE MOYEN-ORIENT : DES ETATS FRAGILES PEUVENT-ILS RESTER LES FOURNISSEURS DU MONDE ? 91 A - Le Moyen-Orient bientôt en situation de monopole sur le marché pétrolier ? 92 1) Près des deux tiers des réserves prouvées de pétrole sont situés au Moyen-Orient 92 2) La production du Moyen-Orient devrait, théoriquement, augmenter 93 B - Des pays exportateurs fragiles 95 1) Des pays très dépendants des exportations pétrolières 96 2) Un niveau d'investissement insuffisant 98 3) Une région à l'instabilité chronique 100 C - Le Moyen-Orient, prochain fournisseur mondial de gaz naturel ? 103 1) L'importance des réserves de gaz dans les pays du Moyen-Orient 103 2) Un gaz réservé à la consommation intérieure 104 3) Un développement incertain des exportations 105 II. LA RUSSIE : PRODUCTEUR PUISSANT OU PARTENAIRE FIABLE ? 109 A - Géant énergétique, la Russie veut se placer au cœur du grand jeu énergétique mondial 111 1) La Russie, géant énergétique 112 2) La Russie et les routes de l'énergie : la géopolitique des « tubes » comme vecteur de puissance 119 B - Producteur puissant, la Russie est-elle aussi un partenaire fiable ? 130 1) Mythes et réalités de la politique de diversification gazière en Russie 131 2) La Russie et les investissement étrangers : une dépendance totale 135 3) Du grand jeu au grand bluff ? 138 III. L' AMÉRIQUE DU SUD : UNE NOUVELLE ARME POLITIQUE, L'ÉNERGIE 141 A - La nationalisation des hydrocarbures en Bolivie et au Venezuela ou l'énergie au service de la politique 142 1) La nationalisation des hydrocarbures marque la primauté d'une logique politique sur la logique économique 142 2) Les finalités politiques de la souveraineté énergétique : l'exemple du Venezuela 149 B - L'énergie peut-elle constituer la base de l'intégration sud-américaine ? 151 1) Des priorités nationales de plus en plus contrastées 151 2) L'intégration sud-américaine est-elle encore possible ? 155 IV. L'ASIE : DES BESOINS GIGANTESQUES, DES STRATÉGIES CONCURRENTES 161 A - Inde et Japon : deux puissances dépendantes dans le domaine énergétique 164 1) Des situations économiques très différentes 164 2) Des besoins énergétiques énormes 165 3) Une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur 166 B - Face à la Chine, deux Etats en quête d'une coopération régionale 168 1) Des choix internes communs 169 2) La sécurisation de l'accès aux ressources gênée par la stratégie chinoise 173 3) Les différends énergétiques avec la Chine 177 4) La promotion d'une coopération régionale 181 V. L'AFRIQUE, UN CONTINENT ENFIN STRATÉGIQUE ? 185 A - Une Afrique à deux vitesses 187 1) L'Afrique du pétrole et du gaz 187 2) L'autre Afrique 190 B - Effets et méfaits de la rente pétrolière : l'énergie comme facteur de tensions internes aux pays africains 193 1) L'Afrique victime de la « malédiction pétrolière » 193 2) Des Etats sur la sellette 197 3) La transparence financière comme solution ? 199 C - L'énergie : pomme de discorde ou facteur de coopération entre pays africains ? 202 1) L'énergie comme source de conflits de souveraineté : une menace ? 202 2) L'énergie comme futur moteur de la coopération 202 D - Le « Grand jeu » en Afrique ou le retour des puissances 204 1) L'Afrique : une zone d'intérêt vital pour les Etats-Unis 205 2) La Chine et l'Afrique : la rencontre d'intérêts mutuels 210 VI. LES ETATS-UNIS RESTERONT-ILS LE GENDARME ÉNERGÉTIQUE DU MONDE ? 217 A - La politique énergétique américaine : de la voracité à la maturité ? 219 1) La politique énergétique américaine : préserver l'American way of life 219 2) « Les Etats-Unis sont drogués au pétrole » (George W. Bush) : un modèle en évolution ? 223 B - Une puissance énergétique magnanime : les Etats-Unis, garants des flux énergétiques internationaux 230 1) Diplomatie économique et sécurisation des flux : l'échec des piliers de la politique énergétique internationale des Etats-Unis ? 230 2) Nouvelles menaces, nouvelle politique énergétique internationale ? 236 VII. L'UNION EUROPÉENNE : PRIORITÉ À L'ÉNERGIE 245 A - La délicate équation énergétique européenne 245 1) Contenir la demande énergétique 246 2) Garantir la sécurité d'approvisionnement 250 B - A défaut de politique énergétique commune, l'Union européenne doit s'engager sur la voie de la coopération énergétique 256 1) La politique européenne de l'énergie reste embryonnaire 256 2) Réorienter les politiques européennes au service de l'énergie 260 CHAPITRE III - CONTRE LA FATALITÉ ÉNERGÉTIQUE : UNE RÉPONSE POLITIQUE GLOBALE 271 CHAPITRE IV - PLAN D'ACTION POUR LA CONTRIBUTION DE LA FRANCE À LA « PAIX ÉNERGÉTIQUE » 277 OBJECTIF : RENFORCER LA CRÉDIBILITE DE L'UNION EUROPÉENNE 279 1. Conclure un pacte européen de convergence énergétique 279 2. Engager un partenariat énergétique entre l'Union européenne et la Russie 285 OBJECTIF : MIEUX RÉPONDRE À L'IMPÉRATIF CLIMATIQUE 293 3. Elargir le processus de Kyoto après 2012 293 4. Faire de la France un exemple de transition énergétique réussie 301 OBJECTIF : DÉFINIR LES NOUVELLES RÈGLES INTERNATIONALES DU JEU ÉNERGÉTIQUE 313 5. Une conférence internationale sur l'énergie avant chaque réunion du G8 313 6. Créer des consortiums internationaux pour l'enrichissement et le retraitement 319 7. Renforcer la sécurité des « détroits d'intérêt mondial » 329 OBJECTIF : RÉDUIRE LA FRACTURE ÉNERGÉTIQUE NORD/SUD 339 8. Un fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques 339 9. Une contribution de solidarité pour l'accès à l'énergie 345 CONCLUSION 351 EXAMEN EN COMMISSION 353 ANNEXES 357 I. Liste chronologique des personnalités entendues 359 II. Tableau récapitulatif des déplacements effectués (par ordre chronologique) 360 III. Listes des personnalités rencontrées dans le cadre des déplacements effectués à l'étranger 361 IV. Données de base sur l'énergie 375 V. Liste des principaux sigles et abréviations 396 RÉSUMÉ DU RAPPORT Nous savons depuis fort longtemps que le pétrole n'est pas un « simple produit d'épicerie » mais un « produit de politique internationale ». L'histoire du pétrole, et de façon plus générale l'histoire de l'énergie, est une histoire violente, ponctuée par des guerres entre les Etats ou des conflits de territoires au sein d'un même pays. L'histoire de l'énergie est celle des rapports de force en raison de la dépendance totale des économies vis-à-vis de ce secteur hautement stratégique. L'histoire de l'énergie, c'est l'histoire des crises de l'énergie. I. La crise énergétique : une prise de conscience nécessaire Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise particulièrement préoccupante, durable et globale, qui ne peut trouver de solution que sur un plan mondial à un niveau politique. La consommation d'énergie telle qu'elle se présente aujourd'hui avec une place prédominante des énergies fossiles - pétrole, charbon, gaz - ne peut continuer à se maintenir au même rythme. Les experts estiment « qu'au rythme de consommation actuel, les réserves exploitables ne correspondraient plus qu'à une quarantaine d'années de consommation pour le pétrole, à une soixantaine d'années pour le gaz naturel et à environ 230 ans pour le charbon ». Même si la notion de réserves peut faire l'objet d'évaluations variables (découverte ou exploitation de nouveaux gisements, nouvelles techniques d'extraction...), inéluctablement les réserves s'épuisent. Ces ressources fossiles sont de surcroît géographiquement concentrées dans un nombre limité de pays, souvent peu stables sur le plan politique et au fonctionnement peu démocratique, ce qui compromet la sécurité des approvisionnements ainsi que la stabilité des prix. La variation des prix de l'énergie entraîne par ailleurs une très grande inégalité d'accès à l'énergie entre pays pauvres et pays riches. On peut véritablement parler de fracture énergétique lorsque l'on sait qu'actuellement dans le monde, 1,6 milliard de personnes n'ont pas accès à l'énergie de base qui leur permettrait de vivre dignement. A cette situation très violemment contrastée - là où les Etats-Unis consomment 25 barils de pétrole par personne par an, les Européens en consomment 12, les Chinois 2 et les Indiens un seul - s'oppose une réalité qui concerne tout le monde, celle du dérèglement climatique résultant des émissions de carbone dues à la surconsommation énergétique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. La problématique est donc la suivante : 1. Comment garantir, en préservant l'environnement, une sécurité énergétique qui assure le développement des pays émergents, le maintien de la croissance et du niveau de vie des pays développés, la garantie d'accès à l'énergie des Etats les plus pauvres ? 2. Comment cette sécurité énergétique peut-elle être obtenue dans un contexte international fortement concurrentiel et conflictuel où chaque Etat ou groupe de pays poursuit ses objectifs propres ? 3. Comment concilier la mondialisation du marché de l'énergie N'oublions pas en effet que les réserves d'hydrocarbures sont principalement aux mains des compagnies nationales des pays producteurs. Par exemple, alors que la NIOC (Iran) et la Saudi Aramco (Arabie Saoudite) détiennent chacune en réserves prouvées plus de 370 milliards de barils équivalents pétrole (bep), la première compagnie privée Exxon Mobil n'affiche que 22,5 milliards de barils équivalents pétrole et se classe au 14ème rang mondial des réserves. Il est apparu à la Mission au terme de cette étude qu'il n'y avait pas de fatalité énergétique - il nous faudra modifier nos comportements, développer des énergies de substitution,... - et que la sécurité énergétique ne doit pas être exclusivement recherchée dans la réalisation d'un objectif national d'indépendance énergétique. En effet, jamais les Etats-Unis, l'Europe ou le Japon ne seront indépendants sur le plan énergétique. Dès lors, comme le soulignait en 2000, le Livre vert de la Commission européenne, « la sécurité énergétique ne vise pas à maximiser l'autonomie énergétique de l'Europe ou à minimiser la dépendance mais à réduire les risques liés à celle-ci ». C'est à cette condition que la sécurité énergétique internationale ne sera pas durablement menacée. Il convient cependant de ne pas se limiter à cet objectif de sécurité énergétique et de contribuer à l'apaisement des tensions et à la prévention des risques liés à l'énergie. II. La crise énergétique : une crise planétaire L'analyse géographique de la situation énergétique à laquelle la Mission d'information a procédé révèle les différentes équations que les principaux acteurs ont à résoudre en matière énergétique. Cette analyse géographique de la situation révèle un état de fait : l'interdépendance des Etats et un double impératif : d'une part, la diversification de l'offre énergétique pour répondre aux problèmes de l'épuisement des réserves et de la dégradation de l'environnement ; d'autre part la définition de nouvelles règles du jeu au niveau international pour prévenir les conflits et établir la « paix énergétique ». 1. Le Moyen-Orient : des Etats fragiles peuvent-ils rester les fournisseurs du monde ? Les spécialistes prévoient une reconcentration de l'offre pétrolière sur le Moyen-Orient au cours des prochaines années, qui devrait porter sa part dans la production de moins de 30 % en 2003 à plus de 48 % en 2020. Mais il n'est pas certain que les pays de la région, fragilisés par leur dépendance à la rente pétrolière et qui investissent peu dans le secteur pétrolier, soient en mesure d'augmenter leur production et leurs exportations à la hauteur de l'évolution de la demande mondiale. L'instabilité de la région accentue encore cette incertitude : la production irakienne ne pourra retrouver son niveau de 1989 avant que la sécurité du pays soit rétablie et la production iranienne va décliner si d'importants investissements ne sont pas réalisés, lesquels sont notamment menacés par le dossier nucléaire. La part du Moyen-Orient dans les exportations de gaz naturel (5,6 %) est faible par rapport aux réserves que la région possède (40 %) et il est peu probable qu'elle augmente très significativement au cours des prochaines années. Plus encore que pour le pétrole, la région souffre d'un sous-investissement dans le secteur gazier, tandis que la croissance de la demande interne à chaque pays producteur réduit considérablement les volumes disponibles pour l'exportation. Les grands espoirs placés par les pays consommateurs dans des pays comme l'Iran (qui abrite 18 % des réserves mondiales de gaz) risquent, au moins à court terme, d'être déçus. 2. La Russie : producteur puissant ou partenaire fiable ? La Russie contrôle les plus importantes réserves de gaz naturel de la planète et constitue le premier producteur de gaz au monde. Elle détient en outre 13 % des réserves de pétrole. En 2030, les membres européens de l'OCDE importeront deux tiers de leur gaz de Russie, contre un tiers aujourd'hui. Pour les vingt-cinq membres de l'UE, la dépendance vis-à-vis des importations de gaz passera de 50 à 80 %. Cependant, la Russie a besoin de la communauté internationale pour valoriser son patrimoine énergétique, condition de sa stabilité intérieure. En effet, sans modernisation de ses infrastructures, le pays « pourrait devenir importateur de produits pétroliers dès 2009 » selon le patron du pétrolier russe Loukoil. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la Russie devrait consentir un minimum de 11 milliards de dollars par an d'investissements dans le secteur gazier pour satisfaire ses futurs engagements intérieurs et internationaux. En d'autres termes, la Russie restera un producteur puissant si elle est un partenaire fiable, capable d'offrir les garanties suffisantes pour y investir, condition nécessaire, à terme, d'une mise en valeur responsable du patrimoine énergétique russe. 3. L' Amérique du Sud : une nouvelle arme politique, l'énergie Le processus de nationalisation des hydrocarbures engagé en Bolivie et au Venezuela crée les conditions d'une instrumentalisation politique des ressources énergétiques. Les conséquences en sont cependant potentiellement redoutables pour les pays concernés. En 2005, en Bolivie, l'investissement dans ce secteur a enregistré un repli de 400 % ; la chute atteint même 830 % pour les activités d'exploration. D'ores et déjà, au Venezuela, la production pétrolière connaît une diminution sensible ces dernières années : 2,53 millions de barils/jour en 2005 contre 3,2 millions de barils/jour en 1998. Il est à craindre que l'instrumentalisation politique de l'énergie ne finisse par se retourner contre ses auteurs. En effet, utiliser l'énergie comme arme de chantage peut entraîner une double riposte de la part des pays développés : financière et commerciale, en limitant l'aide aux pays qui utilisent ce chantage énergétique ; industrielle, en poussant les pays consommateurs du Nord à retrouver des marges de manœuvre en investissant massivement dans des sources d'énergie qui ne dépendront plus des pays producteurs du Sud. 4. L'Asie : des besoins gigantesques, des stratégies concurrentes La place prise par l'Asie constitue le principal changement observé au cours de ces vingt dernières années dans le paysage énergétique mondial. Elle est désormais la première zone consommatrice d'énergie, avec près d'un tiers de la consommation mondiale, contre moins d'un cinquième en 1985. La Chine (en incluant Hong Kong), le Japon et l'Inde représentent à eux trois 73 % de la consommation totale de l'Extrême-Orient, qui importe les deux tiers de son pétrole, essentiellement en provenance du Moyen-Orient. Face à la politique très active menée par la Chine pour s'assurer, partout dans le monde, un accès aux ressources énergétiques nécessaires à la poursuite de sa forte croissance, l'Inde et le Japon, dont la satisfaction des besoins énergétiques dépend fortement de l'étranger, appliquent une stratégie assez voisine, fondée, en interne, sur l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le nucléaire, et, à l'international, sur la négociation d'accords avec les pays producteurs. C'est sur ce plan que la concurrence chinoise est très sensible et ressentie comme menaçante. La promotion de la coopération régionale pourrait être un moyen d'alléger cette tension, mais elle est encore balbutiante. 5. L'Afrique : un continent enfin stratégique ? L'Afrique détient près de 10 % des réserves prouvées et produit plus de 11 % du pétrole mondial. Relativement proche de l'Amérique et facile d'accès, l'Afrique suscite aujourd'hui l'intérêt des Etats-Unis qui en ont fait une « zone d'intérêt vital » depuis 2002. Ils portent une attention toute particulière au golfe de Guinée (ex. accord avec Sao Tomé et Principe pour la création d'un port capable d'accueillir les navires américains) qui représente aujourd'hui 15 % de leurs approvisionnements en pétrole. A un horizon proche, ils entendraient faire passer ce taux à 25 %. Les Américains doivent cependant compter avec la concurrence de la Chine, qui s'implante tous azimuts sur le continent avec une prédilection pour les pays en rupture de ban comme le Soudan. Les sociétés d'Etat chinoises sont peu scrupuleuses en matière de transparence, de corruption ou d'environnement, et n'hésitent pas à conclure des contrats là où les compagnies occidentales ne peuvent ou ne souhaitent le faire. Si la hausse des cours du pétrole a permis à de nombreux pays africains de bénéficier de rentrées financières inespérées, elle a conduit parallèlement à faire sombrer d'autres Etats non producteurs de pétrole ou de gaz (notamment en Afrique de l'Ouest), qui ne peuvent pratiquement compter que sur la biomasse pour faire fonctionner leur économie. En outre, ce que l'on appelle la « malédiction pétrolière » ou « Dutch disease » frappe les pays pétroliers d'Afrique : répartition inégale des revenus, secteur public disproportionné, absence de diversification économique... Enfin, des tensions se font jour entre certains pays avec des litiges frontaliers (Gabon et Guinée équatoriale ; Nigeria et Cameroun). 6. Les Etats-Unis resteront-ils le gendarme énergétique du monde ? Les Etats-Unis sont une puissance énergétique paradoxale. D'un côté, il s'agit d'une puissance énergétique égoïste qui défend un mode de consommation d'énergie extrêmement vorace, au détriment, notamment, des équilibres climatiques. Les Etats-Unis voient la crise énergétique actuelle avant tout comme un problème intérieur majeur, alors même qu'elle est globale et que, consommant 25 % de l'énergie mondiale alors qu'ils n'en produisent que 19 %, ils ont, à l'évidence, une politique énergétique nationale dont les incidences sont mondiales. Ce modèle est certes en pleine évolution : le rôle de certains Etats, tels que la Californie, pourrait enclencher une dynamique vertueuse, alors que même le Président Georges W. Bush a dénoncé l'addiction de son pays au pétrole. L'approche y reste cependant économique : les prix, étant les seuls « juges de paix », pousseront, ou non, les Etats-Unis vers des sources d'énergie alternatives. Tel est le discours qui reste dominant. Dans le même temps, artisans du marché pétrolier tel qu'il fonctionne actuellement, les Etats-Unis se présentent comme une puissance énergétique magnanime, garante de la fluidité des flux énergétiques internationaux. Il ne s'agit certes que de s'aider soi-même en aidant les autres, mais nul ne contestera le rôle essentiel des Etats-Unis pour assurer la sécurité physique des flux énergétiques, notamment au niveau des détroits. Au grand dam de la Chine par exemple, qui ne se satisfait pas de cette dépendance de fait... 7. L'Union européenne : priorité à l'énergie La dépendance énergétique de l'Europe va considérablement augmenter au cours des prochaines années. L'Europe doit donc limiter sa demande tout en élargissant son offre énergétique. Or l'Union européenne est un acteur fragmenté qui pèse peu sur les équilibres du marché énergétique mondial. L'Union européenne est-elle prête pour une véritable politique commune de l'énergie, au-delà des questions de dérégulation ? L'Union est-elle en mesure de s'affranchir d'un certain nombre de tabous, notamment le recours à l'énergie nucléaire ? Il semble pourtant exister un consensus européen sur les objectifs qui devraient être ceux d'une politique européenne de l'énergie : la sécurité d'approvisionnement, le développement durable et le renforcement de la compétitivité industrielle. III. Plan d'action pour la contribution de la France à la « paix énergétique » La Mission d'information propose un plan d'action qui doit se comprendre comme un ensemble de neuf propositions qui concourent les unes et les autres à la réalisation de la « paix énergétique ». 1. Conclure un Pacte européen de convergence énergétique Alors que l'énergie a été au fondement de la construction européenne 2. Engager un partenariat énergétique entre l'Union européenne et la Russie L'énormité des réserves gazières détenues par la Russie est un fait qui s'impose à tous les pays européens. La Mission ne conclut pas pour autant, comme on le lit souvent, à la nécessité de tout accepter, quoi qu'il arrive, avec la Russie, sous prétexte que nous n'aurions pas le choix. Elle propose au contraire la poursuite et l'approfondissement du dialogue énergétique avec la Russie, en vue de la conclusion d'un partenariat énergétique formalisé entre l'Union européenne et la Russie, qui prenne acte de l'interdépendance mutuelle entre les deux entités. Un tel partenariat ne remet nullement en cause le Traité sur la Charte de l'énergie de 1994, qui reste un outil essentiel pour la relation énergétique entre l'Union et la Russie et doit, pour cette raison, être rapidement ratifié par la Russie. 3. Elargir le processus de Kyoto après 2012 Un récent rapport de l'économiste britannique, Nicholas Stern, met en garde contre les conséquences économiques et sociales du réchauffement climatique « qui seront plus grandes que celles des deux guerres mondiales et de la crise de 1929 ». Dans un contexte de croissance continue des émissions de gaz à effet de serre, « si le protocole de Kyoto a constitué un incroyable pas en avant, ce pas est tout à fait insuffisant » comme l'a déclaré le Secrétaire général des Nations unies. Dans ce contexte, un élargissement du processus de Kyoto à l'ensemble des pays, notamment les Etats-Unis, la Chine et les pays en voie de développement, s'impose, à partir de 2012. La nécessité d'une mobilisation plus forte doit s'accompagner de la prise en compte, dans les mécanismes du protocole de Kyoto, de toutes les formes d'énergie, en particulier, de l'énergie nucléaire. 4. Faire de la France un exemple de transition réussie La France est moins dépendante des énergies fossiles et émet moins de gaz à effet de serre que bon nombre de pays développés, grâce à des politiques d'économie d'énergie, de diversification des fournisseurs d'hydrocarbures, ainsi que de promotion du nucléaire et des énergies renouvelables. Il lui reste néanmoins encore des progrès à accomplir pour réaliser la transition énergétique que la situation internationale rend indispensable. Les propositions récemment formulées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sont reprises par la Mission. Elles visent à faire de la transition énergétique une priorité nationale, à créer une fiscalité spécifique pour financer la transition, à encourager le développement des filières alternatives à la consommation d'hydrocarbures et à impliquer davantage les collectivités locales dans la lutte contre l'effet de serre. 5. Prévoir une conférence internationale sur l'énergie avant chaque réunion du G8 La nouvelle donne énergétique, marquée par une interdépendance croissante entre pays producteurs et pays consommateurs, vient renforcer la nécessité d'échanges sur les questions liées à l'énergie. Face à la multiplication des rencontres et des enceintes, seules les réunions du G8 bénéficient d'une réelle visibilité. Afin de tenir compte de cette réalité et d'éviter d'ajouter une structure supplémentaire, chaque réunion du G8 devrait être systématiquement précédée d'une conférence internationale chargée de l'énergie. 6. Créer des consortiums internationaux pour l'enrichissement et le retraitement du nucléaire civil Dans un contexte de regain d'intérêt pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à travers le monde, plusieurs propositions ont été faites, notamment par les Etats-Unis et par la Russie, afin de répondre à la question de la conciliation entre développement de l'énergie nucléaire civile et lutte contre la prolifération nucléaire. Compte tenu de sa place dans le paysage international du nucléaire civil et de son rôle majeur dans la lutte contre la prolifération nucléaire, la France doit élaborer sa propre proposition de création de consortiums internationaux. Une proposition structurée autour des trois axes : ouverture, sécurité et concurrence. 7. Renforcer la sécurité des « détroits d'intérêt mondial » Une très grande part du pétrole consommé dans le monde transite par des détroits particulièrement vulnérables aux accidents maritimes ou aux attaques terroristes. Assurer leur sécurité est une nécessité vitale pour les pays consommateurs d'hydrocarbures. A cette fin, il faut identifier les « détroits d'intérêt mondial » - cette mission pouvant incomber à l'ONU - et mettre en place des structures de coopération associant les Etats riverains et les pays utilisateurs de ces détroits. 8. Créer un fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques Les pays les plus pauvres subissent de plein fouet les hausses des cours du pétrole. Il importe, dès lors, d'amortir les effets de ces variations par des mécanismes financiers appropriés. C'est pourquoi il est proposé de créer un fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques qui serait financé notamment par les producteurs et les compagnies pétrolières. 9. Créer une contribution de solidarité pour l'accès à l'énergie L'accès à l'énergie est la condition même du développement économique et social des pays les plus pauvres. C'est pourquoi il est proposé la création d'un fonds pour l'accès à l'énergie et la diversification énergétique par les transferts de technologies pour développer les réseaux dans les pays les plus pauvres et encourager l'utilisation des énergies renouvelables ; ce fonds serait, en partie, alimenté par une contribution de solidarité sur les carburants. LA FIN DE L'INSOUCIANCE ÉNERGÉTIQUE La Commission des Affaires étrangères a décidé en février 2006 la création d'une Mission d'information, composée de seize de ses membres, afin d'analyser la crise de l'énergie sous l'angle de la géopolitique et de présenter une série de propositions susceptibles d'atténuer les tensions et de prévenir les conflits internationaux latents liés à la question de l'énergie. Chacun sait que le charbon, le gaz ou le pétrole ne sont pas des biens comme les autres. Au sujet du pétrole, Edgar Faure disait qu'il s'agit non pas d'un « simple article d'épicerie » mais d'un « article de politique internationale » André Giraud, pour sa part, considérait que « le pétrole est une matière première à forte valeur de défense, diplomatique, fiscale dans une moindre mesure, accessoirement énergétique ». L'histoire de l'énergie est une histoire violente, ponctuée par les tensions entre les compagnies pétrolières ou gazières et les Etats, par les guerres économiques ou militaires entre les pays, par les crises ou les conflits territoriaux entre les populations. Les questions énergétiques font surgir des revendications territoriales, apparaître de nouveaux rapports de force, justifient des alliances ou des coopérations. Elles pèsent souvent d'un poids décisif dans la définition de l'ordre du monde. La crise de l'énergie à laquelle notre planète est actuellement confrontée est sans précédent. Elle est mondiale - tous les pays sont affectés -, elle est globale - nos modes de vie et notre environnement sont concernés -, elle est durable - la modification de la situation ne peut s'opérer qu'à long terme. Pour cet ensemble de raisons, cette crise est porteuse de fortes tensions et de risques de conflits internationaux, qui conduisent à se demander : la guerre de l'énergie aura-t-elle lieu ? C'est à cette question que la Mission parlementaire s'est employée à répondre, pour conclure de façon étayée par la négative : la guerre de l'énergie n'aura pas lieu... à certaines conditions. Il n'existe pas en effet de fatalité énergétique, mais seulement deux camps : ceux qui se résignent et ceux qui croient au volontarisme politique. En décidant d'engager une réflexion sur la question de l'énergie considérée sous l'angle international, la Mission entend d'abord démontrer le caractère global et durable de cette crise, dont les conséquences sont multiples et graves, sur le plan du climat et de l'environnement - nous en mesurons un peu plus les effets désastreux chaque année - sur le plan économique - nous savons à quel point nos modes de vie sont dépendants de la consommation d'énergie -, sur le plan politique - l'actualité récente a démontré l'utilisation que certains Etats entendent faire de l'arme énergétique. Il est nécessaire et urgent de prendre conscience que la situation a profondément changé. L'heure de la fin de l'insouciance énergétique a sonné. La crise que nous connaissons marque en effet la fin d'une période d'inconscience généralisée, qui a duré près d'une vingtaine d'années, au cours desquelles la croissance non maîtrisée de la consommation d'énergie a entraîné des désordres climatiques et la dégradation accélérée de notre environnement. Cette surconsommation énergétique à bas prix est allée de pair avec la mondialisation de l'économie et la libéralisation des échanges, sur lesquelles s'est notamment fondé le décollage économique de puissances émergentes telles que la Chine, l'Inde ou le Brésil. Nous mesurons aujourd'hui, avec ce qui est devenu une crise de la demande d'énergie, le caractère insoutenable de ce rythme de consommation et d'exploitation des richesses énergétiques. Comme l'a fait observer M. Dominique Maillard, Directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : « l'humanité exploite intensivement depuis un siècle et demi des matières fossiles qui se sont constituées en 300 millions d'années... cette exploitation peut encore durer 150 ans, il est clair qu'une telle consommation n'est pas « soutenable » à long terme... Un changement sera nécessaire car, en d'autres termes, l'homme aura épuisé en 300 ans ce que la nature aura mis 300 millions d'années à produire ». Au temps de l'insouciance succède désormais le temps des inquiétudes, qui a conduit la Mission à s'interroger sur la notion de sécurité énergétique internationale et sur la définition et le sens qu'il convient de donner à cet objectif. Que faut-il sécuriser : le niveau des approvisionnements, la garantie d'un accès au marché, la stabilité des prix, les réseaux de transports ? On voit à travers ces conceptions multiples que les pays producteurs n'ont pas les mêmes priorités ni les mêmes intérêts que les pays consommateurs qui, eux-mêmes, ne répondent pas de la même façon selon qu'ils sont riches ou pauvres, entièrement dépendants ou non de l'extérieur sur le plan énergétique. Si chaque pays conserve sa propre définition de sa sécurité énergétique, il apparaît néanmoins qu'aucune solution n'est viable à long terme si elle ne tient pas compte de l'interdépendance de tous les acteurs. La Mission considère en effet que, dans un monde ouvert où l'interdépendance est un état de fait, la sécurité énergétique ne peut être réalisée à travers la seule recherche de l'indépendance énergétique. Jamais l'Europe, les Etats-Unis ou le Japon ne seront dans cette situation. Il faut donc définir d'autres priorités et s'employer à réduire entre les Etats les risques de conflits, de tensions et d'instabilité liés à l'énergie. Energie et géopolitique sont intimement liées. Le secteur de l'énergie, en raison de son caractère vital pour les économies, reste toujours marqué par l'exercice de la souveraineté des Etats. A cet égard, il est frappant de constater que les grandes compagnies multinationales, qui incarnent la mondialisation et l'effacement des Etats, ne sont pas, dans le domaine de l'énergie, les véritables maîtres du jeu. La toute puissance revient en fait aux compagnies nationales. Cet aspect, que le rapport a permis de mettre en lumière, vient opportunément rappeler que les questions énergétiques relèvent des relations interétatiques. De ce double enseignement, d'une part l'interdépendance des intérêts des Etats en matière d'énergie - même si chacun d'eux est confronté à une équation énergétique particulière, comme le montre l'approche géographique du rapport -, d'autre part la nécessité de répondre de façon collective à la menace commune que constitue le changement climatique, la Mission tire la conclusion qu'il est possible de prévenir les risques de conflits et d'empêcher les affrontements. Cette « paix énergétique » reste à construire. Le plan d'action proposé par la Mission en conclusion de ses travaux doit se comprendre comme un ensemble de mesures à engager simultanément pour parvenir à terme à cet objectif de stabilisation des équilibres politiques sur la question de l'énergie. *** La Mission a travaillé pendant dix mois, au cours desquels elle a auditionné 23 personnalités. Parmi celles-ci, les plus hauts dirigeants d'entreprises du secteur français de l'énergie ont ainsi été entendus, comme ceux de GDF, EDF, AREVA ou Total. Des chercheurs, ainsi que différents responsables de hautes institutions ou d'instituts de recherche tels que l'Institut français du pétrole (IFP), l'Institut français des relations internationales (IFRI), le Centre de géopolitique et énergie de l'Université Paris-Dauphine, l'Agence internationale de l'Energie (AIE) ou le Laboratoire d'études politiques et cartographiques (LEPAC) sont également intervenus à la demande de la Mission. Leurs analyses et leurs contributions ont été particulièrement précieuses. Les ministères de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, et des Affaires étrangères ont également été consultés. En répondant aux nombreuses questions qui leur ont été adressées, ils ont permis aux membres de la Mission parlementaire de disposer de sources d'informations variées, qui ont pu être confrontées et utilisées pour établir le bilan de la situation énergétique dans le monde. Par ailleurs, 232 personnes ont été interrogées au cours des déplacements à l'étranger que certains des membres de la Mission ont effectués dans 14 pays, ce qui a permis de présenter les termes dans lesquels se pose la question de l'énergie par Etat ou par région. Ces rencontres n'auraient pas été possibles sans l'aide et le concours des membres de nos ambassades. Cette approche géographique, envisagée de façon dynamique, constitue, en effet, une des originalités de ce travail. Elle met en évidence, dans le contexte économique et international propre à chacune des zones étudiées, les aspects politiques que revêt la question de l'énergie envisagée comme un instrument de la politique internationale. Mais cette étude aurait été incomplète si elle ne s'était pas aussi appuyée sur les recherches menées dans le cadre du master de géopolitique Paris I-ENS. Que tous ceux qui ont contribué par leurs travaux, leurs interventions ou leurs analyses à la réalisation de ce rapport trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements. ______ UNE PRISE DE CONSCIENCE NÉCESSAIRE La crise de l'énergie : Repères Le monde produit et consomme, chaque jour, environ 84 millions de barils de pétrole provenant, pour l'essentiel, des pays de l'OPEP (2) et de la Russie. Les Etats-Unis absorbent quotidiennement plus du quart de la production mondiale, l'Europe un peu plus de cinquième et la Chine, pourtant troisième consommateur mondial, près de 8 %. Au rythme de consommation actuel, les réserves exploitables ne correspondraient plus qu'à une quarantaine d'années de consommation pour le pétrole, une soixantaine d'années pour le gaz naturel et à environ 230 ans pour le charbon. Dans ce contexte de plafonnement de production des hydrocarbures à l'horizon 2020-2030, le marché de l'énergie est soumis à de fortes tensions, à l'origine d'une envolée des cours du pétrole que la récente détente des cours ne vient que partiellement corriger. Dans le même temps, il faut fournir un accès durable aux combustibles aux 2,4 milliards de personnes et à l'électricité aux 1,6 milliard de personnes qui n'y ont actuellement pas accès dans les pays en développement. Il faut enfin avoir conscience que les émissions mondiales de CO2 liées à l'utilisation de l'énergie devraient augmenter de 62 % entre 2002 et 2030 si nous ne modifions pas nos comportements. Qu'il s'agisse des effets du réchauffement climatique, de la flambée des cours sur les marchés pétrolier et gaziers ou des rivalités concernant l'utilisation des ressources énergétiques - dont le conflit entre la Russie et l'Ukraine, en décembre 2005, a constitué un épisode inédit - l'actualité récente ne manque pas d'envoyer des « signaux » révélateurs d'une nouvelle donne énergétique à l'échelle mondiale. Si les tensions que connaît actuellement le secteur apparaissent comme autant de symptômes d'une nouvelle crise énergétique, cette crise se distingue cependant assez nettement des précédents chocs pétroliers de 1973 et de 1980. La situation du marché met, en effet, en lumière des contraintes structurelles que les États ne peuvent désormais plus ignorer. Au cœur de ces contraintes figurent, d'une part, le plafonnement de la production d'hydrocarbures, lié à l'épuisement progressif des ressources fossiles ; d'autre part, les conséquences graves sur l'environnement du changement climatique lui-même résultant d'un mode de vie de plus en plus consommateur d'énergie. La perspective d'une raréfaction, à terme, des énergies fossiles vient contrarier une tendance de fond, à savoir la croissance soutenue de la demande mondiale d'énergie que tirent les traditionnels gros consommateurs, comme les États-Unis, mais aussi des pays émergents comme la Chine et, dans une moindre mesure, l'Inde. De ce déséquilibre entre offre contrainte et demande soutenue résulte une envolée des prix du pétrole et du gaz naturel qui constitue un facteur, non seulement d'alourdissement de la facture énergétique des pays consommateurs, mais aussi d'inquiétude à plus long terme. Le marché des hydrocarbures se caractérise, en effet, par une asymétrie fondamentale du fait de la concentration de l'essentiel des réserves dans un nombre limité de pays, principalement au Moyen-Orient. Cette concentration géographique des ressources vient renforcer les préoccupations de sécurité énergétique des Etats consommateurs, soucieux à la fois de garantir leur accès aux marchés et de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Enfin, pour répondre à la demande croissante d'énergie directement liée au maintien ou au développement de la croissance économique, se pose la question des investissements nécessaires visant à entretenir ou remplacer les infrastructures existantes mais aussi à encourager l'innovation en vue, notamment, de favoriser l'utilisation de nouvelles formes d'énergie. Car, à ces préoccupations d'ordre économique s'ajoute aujourd'hui une prise de conscience plus aiguë des impacts environnementaux du réchauffement climatique ainsi que de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour les atténuer. Les effets du réchauffement de la planète commencent à se faire sentir, menaçant à terme les économies et les écosystèmes de toutes les régions du monde. Ils nous conduisent à nous interroger à la fois sur nos modes de consommation et de production qui, de surcroît, accentuent les inégalités existantes. Ainsi, le continent africain, faible émetteur de gaz à effet de serre, supporte une part disproportionnée des coûts associés aux dérèglements du climat. Ces évolutions correspondent à des tendances de fond qui viennent radicalement changer la donne énergétique, de manière durable. La période actuelle apparaît donc comme une période de transition critique où les plus grandes incertitudes dominent et dont il importe de chercher à cerner les implications sur la scène énergétique mondiale. Le marché international de l'énergie se caractérise aujourd'hui par de fortes tensions entre l'offre et la demande de pétrole et de gaz naturel, dans un contexte de plafonnement de la production d'hydrocarbures à l'horizon 2020-2030. Le monde produit et consomme, chaque jour, environ 84 millions de barils de pétrole (Mb), provenant, pour l'essentiel des pays de l'OPEP et de la Russie. Les États-unis absorbent quotidiennement plus du quart (environ 21 Mb/j) de cette production mondiale, l'Europe un peu moins d'un cinquième (15,6 Mb/j soit 19 %) et la Chine, pourtant troisième pays consommateur, 8 % avec environ 7 Mb/j. Au niveau de l'offre, les capacités de production apparaissent tout juste suffisantes pour satisfaire la demande mondiale, notamment en pétrole. En 2005, malgré l'augmentation de la production en Algérie et en Arabie Saoudite, les capacités réellement disponibles sont restées trop faibles pour permettre une détente des cours. L'année a été marquée par des inquiétudes liées à la fermeture de raffineries et à l'arrêt de production dans le Golfe du Mexique, à la suite du passage du cyclone Katrina (3). De telles inquiétudes ont récemment resurgi après l'annonce, par la compagnie British Petroleum (BP), de la fermeture du plus important champ pétrolifère des Etats-Unis en Alaska (4). Autre facteur d'incertitude, les risques géopolitiques, comme l'a illustré le saut de 7 dollars du prix du baril au moment de l'offensive israélienne au Liban. Or, les risques de cette nature sont aujourd'hui nombreux dans des zones de production importante comme l'Irak, l'Iran ou le Nigeria. Ces événements ainsi que l'existence de risques géopolitiques ne doivent pas masquer des réalités différentes selon les régions du monde : la production augmente en Russie, par exemple, tandis que certains pays comme le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Turkménistan ont un potentiel appelé à se développer au cours des prochaines années. Malgré tout les grands équilibres du pétrole n'en restent pas moins fondamentalement déterminés par l'évolution de la production des pays de l'OPEP. Quant au marché du gaz naturel, il connaît également des tensions au niveau de l'offre disponible en raison du déclin des champs britanniques de mer du Nord, en Europe, mais aussi d'événements climatiques comme les ouragans dans le Golfe du Mexique qui ont occasionné d'importantes pertes de production aux Etats-Unis. Au-delà de ces évolutions récentes, la tendance de fond est à la raréfaction progressive des ressources fossiles sur lesquelles reposent nos modes de production et de consommation énergétiques. Bien que des incertitudes demeurent sur les chiffres exacts, « on estime qu'au rythme de consommation actuel, les réserves exploitables ne correspondraient plus qu'à une quarantaine d'années de consommation pour le pétrole, à une soixantaine d'années pour le gaz naturel et à environ 230 ans pour le charbon » (5). Ces perspectives mettent en lumière l'existence de contraintes structurelles sur l'offre énergétique qui ne peuvent qu'avoir une incidence durable sur le fonctionnement du marché international de l'énergie et, indirectement, sur les stratégies que les Etats mettent en place pour garantir leurs approvisionnements. Du côté de la demande, « le monde d'aujourd'hui consomme 70 % d'énergie de plus que celui d'il y a 30 ans » (6). La demande mondiale d'énergie croit à un rythme soutenu ; en 2004, elle a enregistré une hausse de 4,3 %, soit la plus forte augmentation en pourcentage jamais enregistrée en deux décennies. Une fois encore, ce rythme de croissance, en apparence linéaire, ne doit pas dissimuler une très grande inégalité de la consommation énergétique au niveau mondial. Lors de son audition, M. Claude Mandil, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), rappelait que « 25 % de l'humanité n'a pas accès à l'électricité, soit 1,6 milliard de personnes vivant en Afrique sub-saharienne et dans le sous-continent indien ». D'après le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) (7), alors que la consommation d'électricité par habitant s'élevait à 1 155 kilowatts/heure (kWh) pour les pays en développement en 2002 (contre 388 kWh en 1980), elle atteignait 8 615 kWh dans les pays de l'OCDE (contre 5 761 kWh en 1980). Si ces chiffres témoignent d'une réduction de l'écart entre ces pays depuis 1980, la consommation d'électricité dans les pays de l'OCDE n'en reste pas moins 7 fois supérieure à celle des pays en développement. S'agissant du pétrole, M. Yves Cochet, député, a précisé à votre Rapporteur que « là où les Etats-Unis consomment 25 barils par personne et par an et les Européens 12, les Chinois en consomment 2 et les Indiens un ». Toutes énergies confondues, un habitant d'un pays de l'OCDE consomme 4,6 tonnes équivalent pétrole (tep) par an, soit près de 5 fois plus de produits énergétiques qu'un habitant d'un pays en développement (0,8 tep par an) (8). A plus long terme, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que la demande mondiale d'énergie devrait augmenter d'environ 60 % d'ici 2030, les deux tiers de cette progression provenant des pays émergents. M. Claude Mandil a précisé que cette demande passerait donc de 10 à 16 milliards de tonnes équivalent pétrole (tep) en 2030, avec un maintien de la prépondérance des énergies fossiles (85 % de la consommation) : le pétrole resterait dominant, la part du charbon diminuerait pour passer derrière le gaz à partir de 2020 tandis que les émissions de gaz carbonique augmenteraient de 60 %. Avec une demande structurellement supérieure à l'offre, la situation est aujourd'hui radicalement différente de celle qui a prévalu lors des chocs pétroliers des deux dernières décennies. Dans ce contexte nouveau de crise durable, le moindre incident sur les capacités de production ou d'acheminement des produits énergétiques se répercute brutalement sur le niveau des prix. 2) La fin de l'énergie à bon marché Tel semble être le constat que chacun s'accorde à dresser, depuis trois ans, face à la flambée des cours de l'or noir mais aussi de l'« or bleu », le gaz naturel. En 2005, les cours du brut et du gaz ont battu des records historiques : avec une moyenne d'environ 55 dollars, les cours du pétrole ont bondi de près de 50 % par rapport à l'année précédente, évolution qu'ont également connue les cours gaziers. Différents événements sont à l'origine de cette augmentation dont le caractère spectaculaire révèle, mieux que toute forme de projection, le déséquilibre structurel entre l'offre et la demande d'énergie. S'agissant du pétrole, le passage du cyclone Katrina a entraîné, entre autres conséquences dramatiques, la réduction d'un dixième des capacités de raffinage des Etats-Unis et de 79 % de la production pétrolière du Golfe du Mexique (9). Cette rupture physique a été palliée par un recours aux stocks stratégiques américains, puis à ceux de l'AIE. Un tel recours ne s'était produit qu'une seule fois depuis 1974, date de création de l'Agence, lors de la Guerre du Golfe, en janvier 1991. La volatilité des prix du pétrole ne s'est pas démentie au cours du premier semestre 2006 : après l'annonce de la fermeture du champ pétrolifère de Prudhoe Bay, le prix du baril de pétrole a, en effet, atteint un « nouveau » record historique de 78,64 dollars. Si une détente des cours est aujourd'hui perceptible, il n'en reste pas moins qu'entre mars 1999 et avril 2005, le prix du brut a quintuplé (10). Le graphique ci-après illustre l'évolution du cours du pétrole brut de janvier 2003 à septembre 2006. 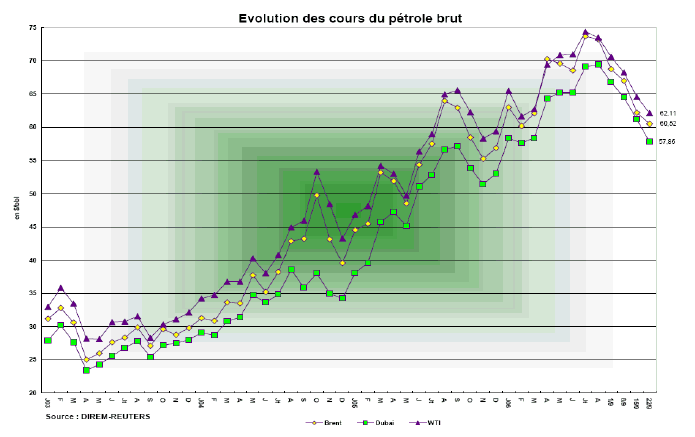 Source : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Les cours du gaz n'ont pas échappé à cette flambée des prix en raison du lien qui existe entre prix gazier et pétrolier mais aussi d'événements extérieurs. A cet égard, l'événement le plus marquant a certainement été le conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les tarifs du gaz. En décembre 2005, la Russie a exigé - et obtenu - une augmentation du prix du gaz, vendu à l'Ukraine, de 50 à 230 dollars les 1 000 m3, soit un prix de vente équivalent à celui appliqué aux pays européens. Ce conflit s'est traduit, pendant quelques jours, par une interruption des livraisons de gaz à l'Ukraine et une chute de celles destinées à l'Europe, qui a eu un impact important sur l'évolution des prix. Si ces événements ont des conséquences inéluctables sur le niveau du prix des transactions physiques, certains comportements spécifiques aux marchés financiers (effets des prises de bénéfices notamment) contribuent également à amplifier les mouvements des prix. A cet égard, les marchés à terme ont un impact sur l'augmentation du prix long terme du pétrole en intégrant la hausse des coûts d'exploration et de production ainsi que la difficulté à remplacer les réserves. Enfin, le niveau des prix ne résulte sans doute pas des seules anticipations relatives aux ajustements entre l'offre et la demande mais de comportements spéculatifs dont l'ampleur reste toutefois difficile à mesurer précisément. Au niveau européen, la Commission (11) constate que les prix du pétrole et du gaz ont presque doublé dans l'Union européenne au cours des deux dernières années, entraînant avec eux les prix de l'électricité. Compte tenu de l'augmentation de la demande mondiale de combustibles fossiles, de la longueur des chaînes d'approvisionnement et de la dépendance croissante envers les importations, la Commission européenne considère que les prix du pétrole et du gaz devraient se maintenir à des niveaux élevés. La crise énergétique actuelle se caractérise donc par une hausse continue des cours, tendance qui paraît appelée à se poursuivre de manière durable, au cours des prochaines années. Pourtant, de manière assez paradoxale, l'économie mondiale a paru, jusqu'à présent, relativement peu affectée, voire « immunisée » contre cette flambée des cours. En cela, la crise actuelle se distingue des précédents chocs pétroliers durant lesquels la hausse des prix avait provoqué une contraction de la demande globale de pétrole. En 2005, le niveau des prix en termes réels est, en effet, resté inférieur à celui atteint en 1980 tandis que « la hausse des prix entre 2003 et 2005 (113 %) n'a pas égalé celles observées au cours des crises précédentes (environ 205 % en 1974 et 180 % en 1979-1980) » (12). Cet écart a pu être interprété comme la manifestation d'un transfert des économies des pays occidentaux, qui ont connu des changements structurels à la suite des deux chocs, aux économies des pays émergents comme l'Inde et la Chine. En réalité, cette tendance semble aujourd'hui s'infléchir, la réduction des revenus réels dans la zone OCDE et le freinage de la demande qui en résulte s'approchant des ordres de grandeur observés lors des chocs de 1973et 1979 (13). Toutefois, ces comparaisons ne rendent pas compte de la situation de certains pays en développement, notamment sur le continent africain. D'après M. Jamal Saghir, Directeur du département « Energie et eau » de la Banque mondiale (14), l'augmentation de la facture pétrolière depuis 2004 a été particulièrement sévère pour les pays importateurs d'Afrique sub-saharienne, avec un impact sur les termes de l'échange d'environ - 1,2 % du PIB en 2004-2005. Au total, la hausse de 72 % des prix du pétrole de 2003 à mi-2005 a représenté, pour les pays africains importateurs nets de pétrole, une perte cumulée d'environ 3,5 % du PIB. Elle est à l'origine d'un accroissement du nombre de personnes en situation de pauvreté d'environ 4 à 6 %. En réalité, c'est l'économie mondiale dans son ensemble qui est désormais plus vulnérable face à des prix de l'énergie élevés et volatiles. Si l'on ajoute les menaces que fait peser sur les équilibres écologiques, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (cf. ci-après), la crise actuelle fait clairement apparaître un risque d'insoutenabilité des évolutions en cours. D'ores et déjà, de fortes tensions se manifestent entre les Etats dont l'interdépendance énergétique ne cesse de s'accentuer. 3) L'interdépendance énergétique croissante entre les Etats Dans le contexte actuel de ressources rares et de consommation soutenue, l'accès aux produits énergétiques prend une dimension stratégique essentielle dans la politique des Etats. Pour les Etats consommateurs, tout d'abord, dont la dépendance énergétique est en hausse. Les Etats-Unis importent aujourd'hui plus de 65 % de leur consommation de pétrole, dont environ 40,7 % des pays de l'OPEP. La dépendance américaine en matière d'importations de gaz ne cesse également de croître avec une hausse de 450 % en 2005 par rapport au niveau d'importations de 1986 (15). Pour sa part, l'Union européenne voit sa dépendance énergétique progresser, passant de 52,4 % en 2003 à 53,8 % en 2004 avec un taux élevé pour les pays les plus gros consommateurs (Allemagne : 64,6 %, Italie : 87,7 %, Espagne : 81 %, France : 54,3 %) (16). Pour le gaz naturel uniquement, la dépendance énergétique de l'Union a atteint 58 % en 2005, en augmentation de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Pour les Etats producteurs, ensuite, dont les revenus pétroliers et gaziers sont en nette augmentation grâce à l'envolée des cours. A titre d'exemple, les exportations russes alimentent un solde courant en hausse de plus de 40 % en 2005 (86 milliards de dollars, soit 11 % du PIB). Quant au Venezuela, l'activité pétrolière assure plus de la moitié des recettes de l'Etat et environ 85 % des exportations, rendant le pays extrêmement dépendant vis-à-vis du pétrole. A une plus large échelle, l'OPEP, avec 77 % des réserves d'hydrocarbures et 40 % de la production mondiale, se trouve dans une situation de quasi-monopole sur le marché de l'énergie, jouant un rôle déterminant dans la fixation des prix au niveau mondial. Cette manne financière ne rend paradoxalement pas les pays fournisseurs plus indépendants sur un marché où ils doivent veiller à s'assurer de débouchés sur le long terme et ont intérêt à entretenir des relations durables avec les pays clients. La rareté des ressources fossiles, leur concentration dans un nombre limité de pays et la perspective de la manne financière alimentent des logiques contradictoires et potentiellement conflictuelles. Malgré leurs efforts de diversification des sources d'approvisionnements et de développement de l'innovation technologique, les Etats consommateurs restent très dépendants de l'extérieur et, donc, vulnérables. Quant aux Etats producteurs, la tentation est grande de recourir à l'« arme » énergétique comme l'a illustré la crise russo-ukrainienne ou, en tout cas, de reprendre en main le contrôle des ressources et de la production, comme au Venezuela ou en Bolivie. Les Etats durcissent donc leurs positions sur les questions énergétiques dont l'enjeu stratégique prend une dimension nouvelle. Toutefois, en dépit d'antagonismes latents ou clairement déclarés, les relations entre Etats sont marquées par une interdépendance croissante : si les Etats consommateurs ont effectivement besoin de garantir leurs approvisionnements, les Etats producteurs sont, dans le même temps, tributaires des revenus que leur assurent les ventes de pétrole et de gaz. A plus ou moins long terme, certains intérêts sont partagés, en particulier en matière d'investissements. En 2003, l'Agence internationale de l'énergie estimait, en effet, à 16 000 milliards de dollars, le montant de investissements nécessaires dans le domaine de l'énergie d'ici 2030 avec environ 10 000 milliards pour l'électricité, 3 100 milliards pour le pétrole et autant pour le gaz naturel (17). Compte tenu de ses besoins, la Chine - dont la consommation a augmenté de 16 % par an au cours des quatre dernières années, contre 3 % en moyenne - devra, à elle seule, investir 2 400 milliards de dollars (15 %) entre 2003 et 2030, dans le secteur de l'énergie. Depuis, l'AIE a revu ses projections à la hausse et considère qu'un investissement de plus de 20 000 milliards de dollars est désormais nécessaire à l'horizon 2005-2030 (18). Les enjeux sont donc colossaux non seulement pour satisfaire une demande croissante, notamment des pays émergents, mais aussi pour garantir l'accès du plus grand nombre à l'énergie. Or, le secteur pétrolier a pâti ces dernières années d'un sous-investissement résultant du faible niveau du prix du baril - aux alentours de 10 dollars - dont on mesure aujourd'hui les conséquences en termes de niveau de production ou de coûts d'exploitation. Cependant, dans le contexte actuel de prix élevés, les compagnies nationales des pays producteurs comme les compagnies privées n'ont paradoxalement pas un intérêt immédiat à investir dans les moyens de production dans la mesure où cela aurait mécaniquement pour effet de baisser les prix (on observe d'ailleurs une détente des cours depuis l'annonce, par la compagnie Chevron, de la découverte d'importantes réserves dans le golfe du Mexique). En réalité, les besoins les plus importants s'expriment dans le domaine de l'électricité dont un quart de l'humanité est privée. Or, « au rythme actuel d'électrification, il faudrait plus de 40 ans pour électrifier l'Asie du Sud et près de deux fois plus pour l'Afrique sub-saharienne » (19). Si l'on ajoute à ces besoins l'urgente nécessité de développer les procédés sobres en carbone, on mesure l'ampleur des investissements à réaliser dans le domaine de l'énergie. Qu'il s'agisse de la recherche, des activités d'extraction, de la réalisation d'équipements ou du développement de technologies nouvelles, les sommes en jeu sont considérables et supposent des engagements à long terme dans un contexte politique et économique stable. L'accès à l'énergie devient de plus en plus coûteux, spécialement pour les pays les plus pauvres. Les disparités qui demeurent très grandes entre les différentes régions du monde risquent d'être aggravées à terme par le caractère durable de la crise énergétique actuelle. Il n'est donc pas possible de concevoir une aide au développement efficace sans prendre en compte cette composante essentielle que constitue le coût de l'énergie pour ces pays. La question de l'énergie apparaît aujourd'hui indissociable de celle du changement climatique. Notre planète se dégrade, victime des émissions de CO2 directement liées à l'utilisation croissante de l'énergie. Comme l'ont souligné nos collègues sénateurs de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), MM. Pierre Laffitte et Claude Saunier (20), le changement climatique, « phénomène majeur, d'ampleur historique, que les scientifiques mesurent avec plus d'acuité depuis le milieu des années 1980, est d'origine fortement anthropique ; il est une des conséquences directes de nos modes d'utilisation des ressources énergétiques ». De fait, les gaz à effet de serre, issus de la combustion des énergies fossiles, représentent environ les trois-quarts des émissions d'origine anthropique. La réalité du changement climatique a été démontrée grâce aux travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), mis en place par l'Organisation des Nations unies en 1988. Ces travaux ont permis de dresser le constat suivant (21) : _ les concentrations de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère ont atteint des niveaux jamais vus depuis 420 000 ans et évoluent, depuis deux siècles, à une vitesse jamais enregistrée depuis 20 000 ans ; _ la vitesse du phénomène observé (plus d'un demi degré en un siècle) et attendu est cent fois plus élevée que les variations naturelles du climat terrestre ; _ le CO2 fossile émis influencera de manière déterminante les concentrations de CO2 de l'atmosphère, devant toute autre source, durant le XXIème siècle. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est à l'origine d'une élévation de la température de la surface de la terre qui devrait se poursuivre pour se situer, en 2100, entre 1,4 et 5,8°C, de plus que les niveaux de 1990. Une telle projection s'explique par l'inertie du phénomène. Comme l'ont indiqué nos collègues de la Mission d'information sur l'effet de serre (22), « les gaz à effet de serre émis aujourd'hui resteront stockés dans l'atmosphère et continueront de produire leurs effets ». Autrement dit, même si des mesures de réduction des émissions sont prises, les changements climatiques se poursuivront encore longtemps car le climat s'adaptera à l'émission accrue des décennies passées. Si le phénomène est global, les différentes régions du monde sont inégalement responsables des émissions de gaz à effet de serre, comme l'illustre le tableau ci-après :
Ce tableau montre que les émissions mondiales de CO2 dues à l'énergie ont atteint 6,8 millions de tonnes de carbone (MtC), soit un bond de 20,5 % depuis 1990. La responsabilité de cette augmentation revient, à hauteur des deux tiers, à trois pays : la Chine, les Etats-Unis et l'Inde. Comparées à 2002, les émissions mondiales gagnent 4,1 % en 2003. A elle seule, la Chine y contribue pour plus de la moitié, dépassant la barre d'un milliard de tonnes de carbone, soit une envolée d'environ 16 %. Il paraît désormais acquis que la hausse des températures, résultant de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, sera à l'origine d'un accroissement de la fréquence et de la gravité des événements météorologiques, comme les vagues de chaleur et les pluies abondantes. Elle pourrait provoquer des effets à grande échelle comme des modifications des flux des océans et la fonte de grandes calottes glaciaires (23). Le GIEC estime que les effets combinés de la fonte des glaces et de la dilatation de l'eau de mer, due au réchauffement des océans, pourraient conduire à une augmentation du niveau de la mer, d'une amplitude comprise entre 0,1 et 0,9 mètre, entre 1990 et 2100. Au Bangladesh seul, une montée du niveau de la mer de 0,5 mètre exposerait près de 6 millions de personnes au risque d'inondation (24). Comme l'atteste ce dernier exemple, ces risques environnementaux globaux, s'ils menacent toutes les régions du monde, affecteront plus gravement certaines zones, créant ainsi de nouvelles formes d'inégalités. La Banque mondiale estime que les pays en développement sont les plus vulnérables aux dérèglements du climat en raison des risques de baisse de la productivité agricole et d'augmentation de l'incidence du paludisme et d'autres maladies à transmission vectorielle dans les régions tropicales et subtropicales, ou de diminution de la quantité, comme de la qualité, des ressources en eau, dans les régions arides et semi-arides (25). Plus généralement, le fonctionnement des écosystèmes et leur biodiversité sont menacés par le réchauffement du climat. Pour sa part, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) met l'accent sur la très grande vulnérabilité des Petits Etats insulaires en développement (PIED) qui sont les premiers à subir les effets des changements climatiques et de stratégies de développement inappropriées : une analyse de 47 petits Etats mettant en œuvre l'index de vulnérabilité environnementale (IVE) classe 34 d'entre eux dans les catégories « très vulnérables » ou « extrêmement vulnérables » (26). 2) Des effets climatiques désastreux Dans son annuaire GEO 2006, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) considère que « les preuves physiques du changement climatique sont de plus en plus nombreuses ». D'après l'Institut océanographique et météorologique national américain, l'année 2005 a été l'une des plus chaudes jamais enregistrées. De fortes chutes de pluies et des crues ont frappé à de multiples reprises la Chine, l'Inde et l'Europe orientale. Il s'est, par ailleurs, formé un nombre record de tempêtes et d'ouragans lors de la saison cyclonique dans l'Atlantique Nord. Des vagues de chaleur et de graves inondations ont également frappé de nombreuses régions du globe. L'encadré ci-après retrace les événements climatiques extrêmes qui ont marqué l'année 2005. 2005 : UNE ANNÉE D'ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES Janvier Sécheresse dans l'est et le sud de l'Afrique et dans les Montagnes Rocheuses en Amérique du Nord. L'Indonésie et le Sri Lanka souffrent d'inondations. De fortes pluies et des inondations touchent le Costa Rica, le Panama et la Guyane et mettent en péril 200 000 personnes. L'Algérie subit sa plus forte chute de neige depuis 50 ans. Février Suite à de fortes chutes de neige, les avalanches font plus de 200 morts au Cachemire. La neige pose également des difficultés au Tadjikistan, en Iran et dans de nombreux pays d'Europe, notamment dans les Balkans : les températures sont très basses, atteignant des valeurs record. Mars Une sécheresse persistante déclenche l'état d'urgence dans le sud du Brésil. L'Erythrée subit des pénuries alimentaires. Des inondations touchent l'Algérie, le Pakistan, l'Afghanistan, Madagascar et l'Angola ; elles font des centaines de morts et de blessés et des milliers de déplacés. Avril Une sécheresse persistante sévit dans l'est de l'Afrique, touchant le Kenya, l'Ethiopie et la Somalie. Neuf millions de personnes sont touchées en Thaïlande par les sécheresses et les pénuries d'eau. Mai Vingt-cinq mille personnes déplacées au Kenya et plusieurs douzaines de morts en Ethiopie suite à des inondations. Juin La vague de chaleur persistante en Asie méridionale cause la mort de 400 personnes. Des millions de personnes sont touchées par les plus graves inondations jamais enregistrées en Chine en 200 ans. Les orages en Afghanistan, les chutes de pluie en Inde et les coulées de boue et inondations au Guatemala, au Salvador et au Honduras font plusieurs centaines de morts. Juillet Les pluies de mousson déclenchent de graves inondations à Mumbai, en Inde. Elles laissent 1 500 morts et battent un record vieux de 95 ans : celui des plus fortes pluies tombées en 24 heures. Des vagues de chaleur sont enregistrées aux Etats-Unis, en Europe et en Afrique du Nord. Août L'ouragan Katrina frappe la Louisiane et le Mississippi, c'est l'une des plus graves catastrophes naturelles de l'histoire des États-Unis. Le typhon Matsa déplace plus d'un million de personnes à Zhejiang, en Chine. Des sécheresses touchent la côte nord-ouest du Pacifique, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne, aggravant également les feux de forêts au Portugal. Septembre L'ouragan Rita cause de graves dégâts au Texas et en Louisiane aux Etats-Unis. Octobre L'ouragan Stan fait 2 000 morts au Guatemala, tandis que l'ouragan Wilma dévaste le Yucatan (Mexique) avant de frapper la Floride. Avec les cinq tempêtes - Alpha à Epsilon - 2005 bat tous les records de la saison cyclonique dans l'Atlantique. Le nord de la Chine souffre de graves inondations qui entraînent le déplacement de 350 000 personnes. L'ouragan Vince est le premier à avoir jamais approché l'Europe, déclenchant des glissements de terrain en Espagne. Novembre Une tempête tropicale frappe pour la première fois les Iles Canaries : la tempête Delta. Décembre Le 31 décembre, 27 tempêtes tropicales (six de plus que le précédent record de 1933) et 14 ouragans battent le record de 1969 (12 ouragans). Sources : WMO 2005, NOAA-NCDC 2005b, UN News Center 2005, BBC 2005a, BBC 2005b, BBC 2005c, Weather.com 2006. Au-delà de ces événements, nos collègues de la Mission d'information sur l'effet de serre (27) ont mis l'accent sur différents effets globaux du dérèglement climatique, d'ores et déjà mesurables, tels que le recul des glaces terrestres et marines, l'élévation du niveau de la mer de 10 à 25 centimètres depuis un siècle, les perturbations des courants marins - avec notamment une diminution de 30 % du débit du Gulf Stream -, l'évolution du régime des précipitations ou, encore, la dégradation de la biodiversité. Chacun s'accorde à reconnaître l'inégalité des populations devant le risque climatique. Parce qu'ils manquent des infrastructures et des ressources nécessaires, les pays en voie de développement sont les plus exposés aux risques environnementaux qui découlent des dérèglements du climat. Alors même que ces pays ne sont que de très faibles émetteurs de gaz à effet de serre ! A titre d'exemple, un habitant du continent africain ne contribue qu'à l'émission de 0,24 tonne de carbone (t C) contre 5,37 t C pour un Américain et 2,09 t C pour un Européen (28). L'écart de développement et l'accès limité à l'énergie expliquent largement cette différence. Or, dans le même temps, le continent africain supporte une part disproportionnée des coûts associés aux changements climatiques. Au coût des dégâts matériels liés aux catastrophes naturelles s'ajoutent de fortes tensions sur des marchés qui deviennent plus volatiles. Ainsi, la puissance de l'ouragan Katrina a été telle que les marchés s'en sont immédiatement fait l'écho avec un prix du pétrole qui a grimpé à plus de 70 dollars le baril, un record pour l'année 2005. En définitive, les effets du changement climatique viennent radicalement changer la donne énergétique par rapport à la situation qui a prévalu dans les décennies 1970 et 1980 : il ne s'agit plus de consommer moins pour alléger la facture énergétique mais de consommer autrement pour préserver les grands équilibres écologiques de notre planète. Le chemin a été long pour parvenir à une véritable prise de conscience de ces menaces. Mais désormais le temps presse et il faut trouver et mettre en place des solutions nouvelles permettant de concilier développement économique et respect de l'environnement. 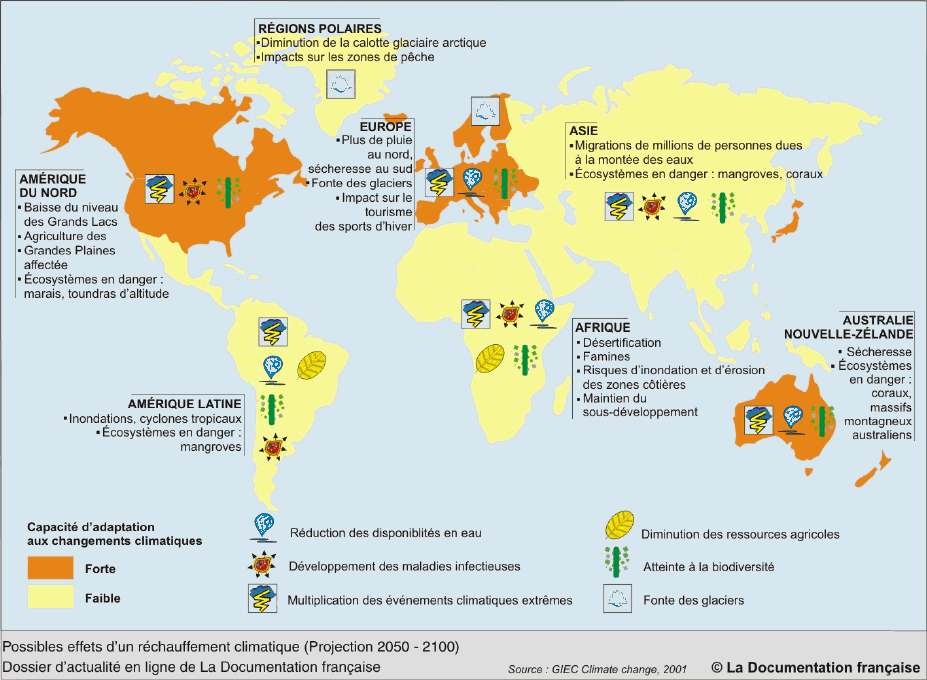 3) La nécessité d'un traitement de choc Le Protocole de Kyoto entré en vigueur en 2005 repose sur un objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 5,2 % sur la période 2008-2012 par rapport au niveau atteint en 1990. Pour remplir cet objectif global, les pays industrialisés signataires, dits « de l'annexe 1», se sont engagés sur des objectifs propres de diminution (- 8 % pour l'Union européenne, - 6 % pour le Japon, etc.) ou de stabilisation (Russie, Ukraine, etc.) des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau de l'Union européenne, cet engagement s'est traduit par une répartition de la charge de cet objectif entre les Etats membres allant de - 28 % pour le Luxembourg à + 27 % pour le Portugal et un objectif de stabilisation pour la France. Ce protocole constitue un premier pas mais il souffre de la défection américaine - les Etats-Unis sont, avec 20,69 % des émissions, le premier émetteur mondial de CO2 - et de l'absence de participation des pays en développement. Le Protocole de Kyoto prévoit des objectifs à atteindre d'ici 2012 mais les divergences apparues entre les pays quant à la stratégie mise en place par le Protocole incitent à se préoccuper, dès à présent, de l'« après-Kyoto ». L'urgence de la lutte contre les changements climatiques suppose que les émissions de gaz à effet de serre soient ramenées à la moitié de leur niveau de 1990, ce qui représente une division par quatre des émissions des pays développés. Cet objectif milite en faveur d'un cadre commun d'action, dans le prolongement immédiat du Protocole de Kyoto, où seraient présents les Etats-Unis et les pays en développement. Soucieux de ne pas compromettre leur développement économique et en raison des responsabilités historiques des pays industrialisés en la matière, les pays en voie de développement sont restés en dehors du mécanisme d'encadrement par quotas d'émissions de dioxyde de carbone. Si ces préoccupations sont légitimes, la contribution de ces pays aux émissions mondiales de CO2 n'en reste pas moins réelle et milite en faveur de leur participation - selon des modalités naturellement adaptées à leur situation - aux engagements de réduction des gaz à effet de serre. Cela est particulièrement vrai pour les pays émergents comme la Chine et l'Inde qui, s'ils ont actuellement de faibles niveaux d'émissions comparés à ceux des pays développés, devraient connaître de fortes hausses au cours des prochaines années : « selon les projections de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les émissions de CO2 mondiales liées à l'utilisation de l'énergie devraient augmenter de 62 % entre 2002 et 2030 ; un quart de cette augmentation sera due à la Chine » (29). Les Etats-Unis qui n'ont pas voulu ratifier le Protocole, en raison des coûts qui y sont associés (30) et de l'absence de participation des pays en développement à ses mécanismes contraignants, privilégient une approche technologique ainsi que la recherche, notamment dans le domaine de la séquestration géologique du CO2. Les autorités américaines prennent, par ailleurs, l'initiative d'un partenariat Asie-Pacifique, réunissant l'Australie, la Chine, le Japon, la Corée et l'Inde, qui, à la différence du Protocole de Kyoto, ne fixe aucun objectif contraignant de réduction des émissions de CO2. Cette divergence de vues est d'autant plus déplorable qu'à terme, les efforts de diminution des émissions de CO2, d'une part, et de développement de solutions technologiques, d'autre part, ne peuvent manquer d'être complémentaires. Un récent rapport sur l'économie du changement climatique, élaboré par M. Nicholas Stern, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, met, en outre l'accent sur les risques de récession économique liés à l'absence de politique rigoureuse de lutte contre le réchauffement climatique : le « laisser faire » pourrait coûter 5 % du PIB mondial chaque année, sans même évoquer les dommages collatéraux qui pourraient porter ce coût à 20 % du PIB mondial. En définitive, le secteur de l'énergie est aujourd'hui confronté à de multiples contraintes lourdes qui, conjuguées, confèrent à la crise actuelle un caractère durable : des prix du pétrole et du gaz appelés à se maintenir à des niveaux élevés et dont la volatilité fragilise l'économie mondiale ; une très grande inégalité d'accès à l'énergie ; les effets du changement climatique sur l'environnement ; et, enfin, une interdépendance énergétique croissante entre les pays. Ces tendances et les projections qui s'y rattachent font ressortir un risque sérieux d'insoutenabilité de ces évolutions. Elles participent d'un scénario que M. Claude Mandil, directeur exécutif de l'AIE qualifie d'« inacceptable » pour trois raisons principales : en premier lieu, la concentration des ressources fossiles dans un nombre limité de pays compromet la sécurité des approvisionnements ainsi que la stabilité des prix ; en second lieu, la lutte contre le réchauffement de la planète ne peut aboutir qu'à travers un effort conjoint de réduction et non de simple stabilisation des émissions de gaz carbonique ; enfin, les tendances actuelles ne peuvent conduire qu'à perpétuer la pauvreté énergétique, qui se manifeste par une très forte inégalité d'accès à l'énergie entre les différentes régions du monde. Ces tendances constituent autant de contraintes structurelles qui placent l'équation « énergie-climat » au cœur des préoccupations actuelles et des nouvelles stratégies qu'il convient aujourd'hui de définir. Cette nouvelle donne mondiale - marchés énergétiques tendus, manque d'investissements, risques environnementaux et économiques liés au réchauffement de la planète - signifie-t-elle que la sécurité énergétique internationale est durablement menacée ? la sécurité énergétique internationale Repères Si la demande continue à augmenter de 1,6 ou 1,7 % par an, scénario de base de l'Agence internationale pour l'énergie (AIE), le pic pétrolier interviendra en 2020. Les capacités excédentaires ne dépassent pas 1,5 à 2 millions de barils par jour, soit environ 2 % de la consommation mondiale. La moitié de la consommation pétrolière quotidienne transite par les canaux et détroits à travers le monde. Depuis 2005, ce ne sont plus des Etats-Unis, mais d'Asie que vient la plus forte demande en pétrole. Un Chinois consomme une tonne équivalent pétrole par an, contre quatre pour un Européen et huit pour un Américain. La sécurité énergétique est devenue l'expression à la mode. Entendue comme un synonyme de la sécurité d'approvisionnement, elle ne recouvre pourtant rien de nouveau. Dès le début du XXè siècle, les termes du débat ont en effet été magistralement posés par Winston Churchill : « On no one quality, on no one process, on no one country, on no one route, and on no one field must we be dependent. Safety and certainty in oil lie in variety and variety alone » (31). De fait, l'approvisionnement en ressources énergétiques a toujours constitué un objectif stratégique majeur pour tout gouvernement, leçon que les chocs pétroliers de 1973 et 1979 rappelèrent brutalement au monde, notamment aux pays consommateurs. Ce retour des questions énergétiques au premier plan des préoccupations internationales succède à une longue période d'inconscience. Comme l'a fait observer Mme Anne Lauvergeon, Présidente du directoire d'AREVA, lors de son entretien avec la Mission le 11 octobre 2006, nous sortons d'une période d'insouciance énergétique qui, pendant une trentaine d'années, a caractérisé les pays développés, les pays en développement n'ayant, au vu de leur situation, jamais pu s'abstraire de cette question. L'heure était à la satisfaction de voir le prix de l'énergie tombé très bas - moins de quinze dollars le baril de pétrole - alors même que cela signifiait le gel de tous les investissements pourtant nécessaires. Pourquoi, dans ces conditions, le concept de sécurité énergétique fait-il un tel retour en force ? Plusieurs facteurs ont contribué, au cours des années récentes, à l'émergence d'un très fort sentiment d'insécurité énergétique. En Europe, c'est la crise gazière entre l'Ukraine et la Russie qui a réveillé les consciences : qu'au plus fort de la vague de froid, plusieurs pays européens, dont l'Italie, qui importent du gaz russe par le biais des gazoducs ukrainiens, subissent les conséquences de l'interruption de la livraison de gaz par la Russie à l'Ukraine, pour des motifs largement politiques, a rappelé aux Européens que les grands progrès qu'ils avaient accomplis en matière d'efficacité énergétique depuis les chocs pétroliers ne les avaient pas mis à l'abri des aléas. Le fait que cette crise soit largement politique a également fait resurgir la géopolitique dans l'espace énergétique, là où, en Europe, on ne parlait plus d'énergie qu'au travers des problématiques de dérégulation et de mise en concurrence. Plus largement, en Europe comme dans le monde entier, l'insécurité énergétique s'est révélée à travers la formidable hausse des prix de l'énergie dans tous les pays importateurs. Il est courant de considérer que les questions de politique internationale n'intéressent guère l'opinion publique : les questions énergétiques font mentir ce constat, chaque citoyen vivant quotidiennement, à travers le renchérissement de son budget de transport et de chauffage, les conséquences de la situation énergétique internationale. Enfin, fait nouveau par rapport à la crise énergétique des années 1970, les préoccupations de sécurité énergétique ne sont plus limitées aux seuls pays importateurs. Le concept est devenu global : il ne s'agit plus de réduire la sécurité énergétique à l'approvisionnement en hydrocarbures des pays développés mais de garantir l'accès durable à l'énergie pour tous à un prix raisonnable et dans le respect de l'environnement. Car les menaces pesant sur la sécurité énergétique sont elles-mêmes globales : en 1974, c'était le mode de vie des pays les plus riches qui était en cause ; aujourd'hui, les enjeux sont ceux de l'accès de l'humanité à des ressources fossiles en voie d'épuisement et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D'une certaine manière, les pays importateurs ont perdu le monopole du discours sur la sécurité énergétique. De même qu'il existe un discours européen sur la sécurité énergétique, il existe, par exemple, un discours russe sur la sécurité énergétique, fait totalement nouveau dans un pays non seulement exportateur d'énergie mais même autonome sur le plan énergétique. En fait, comme le soulignait récemment M. Daniel Yergin (32), il existe aujourd'hui de multiples approches de la sécurité énergétique. Ainsi, si tout le monde parle de sécurité énergétique, tout le monde ne parle pas pour autant de la même chose. Au-delà de la définition classique qu'en donnent les pays occidentaux, les interprétations sont nombreuses : - les exportateurs y voient les moyens permettant de sécuriser la demande ; - un pays producteur comme la Russie la définit en outre comme la mainmise de l'Etat sur le contrôle des ressources et des voies de transports ; - les pays en développement la relient à l'équilibre global de leur balance des paiements alors que la hausse du coût de l'énergie ampute leur capacité de développement ; - pour la Chine et l'Inde, il s'agit de définir les moyens de s'adapter à leur dépendance nouvelle à l'égard de marchés mondialisés ; - le Japon a depuis longtemps identifié sécurité énergétique, diversification et efficacité énergétiques ; - les Etats-Unis en font la quête permanente d'une indépendance impossible ; - enfin il existe des nuances plus ou moins fortes au sein même des Etats de l'Union européenne, avec en thème central, comment gérer la dépendance vis-à-vis des importations de gaz naturel. Il existe cependant un point saillant qui ressort de ces approches multiples. En définitive, les inquiétudes actuelles concernant la sécurité énergétique sont très largement liées aux incertitudes liées à un changement de modèle énergétique : les paramètres qui gouvernaient l'offre et la demande énergétique depuis la fin de la seconde guerre mondiale sont en train de changer profondément. Pour reprendre les propos de M. Jean-Marie Chevalier, Directeur du Centre de géopolitique et d'énergie de l'université Paris Dauphine, « le monde de l'énergie est aux prises avec d'immenses d'incertitudes, sans précédent, tant sur le plan géopolitique, économique que climatique ». Comment sortir de cette spirale d'incertitudes et refonder les conditions d'une sécurité énergétique durable ? Tels sont aujourd'hui les termes du débat énergétique international. A - La peur de l'insécurité énergétique Le monde est entré dans l'ère de l'insécurité énergétique : dans quelle mesure la crise de l'énergie que nous connaissons est-elle la chronique d'une catastrophe annoncée ? Au-delà du sentiment d'insécurité énergétique, les tensions qui traversent aujourd'hui le système énergétique international sont-elles liées à de réels problèmes, à des prophéties auto-réalisatrices, à une perception exagérément pessimiste de difficultés qui ne seraient que ponctuelles ou à la conjonction malheureuse de facteurs déstabilisants, durablement pour certains, conjoncturellement pour d'autres ? Ces questions valent pour tous les maillons de la chaîne du système énergétique international : - en amont, au stade de l'exploration et de la production, ce sont les questions de l'épuisement des ressources énergétiques, de la concentration géographique, de l'instabilité politique, des risques naturels et de l'insuffisance des investissements qui sont posées ; - au stade du transport de l'énergie, les incertitudes sont liées à l'écart croissant entre lieux de production et lieux de consommation ainsi qu'à la sécurité et à la concentration des flux ; - enfin, s'agissant de la consommation énergétique, le cœur de la réflexion réside dans la problématique de l'explosion de la demande et du caractère non tenable des tendances actuelles. 1) La production d'énergie : la peur de l'imprévu L'envolée du prix du baril de pétrole a fait resurgir le serpent de mer que représente le débat sur l'état des réserves d'hydrocarbures. Il s'agit certes d'un débat très actuel mais également récurrent, qui s'articule autour de la notion de pic pétrolier (peak oil). LA NOTION DE PIC PÉTROLIER Le pic pétrolier désigne le maximum prévisible (ou historique) de production pétrolière, aussi bien pour un gisement, une zone ou un pays, que pour le monde. Après ce maximum, les conditions d'exploitation font que, bien que les réserves soient abondantes, la production ne fera que décroître. Le terme désigne également la crise prévisible découlant de l'épuisement des ressources pétrolières mondiales. On entend fréquemment le terme anglophone « peak oil », mais il s'agit en fait d'une application particulière de la loi plus générale dite du pic de Hubbert. Ce phénomène est général et se vérifie pour toutes les zones de production. Ainsi en 1956, le géologue King Hubbert avait prédit la diminution de la production américaine de brut à partir de 1970. Ce qui s'est produit. Le pic de production a déjà été dépassé dans de nombreux pays producteurs, tels que la Libye (1970), l'Iran (1976), l'URSS (1987), le Royaume-Uni (2000) et la Norvège (2000). Au total, une soixantaine de pays aurait déjà dépassé leur pic. Naturellement, si l'on considère la production mondiale de pétrole, il est évident que le même phénomène est à l'œuvre. La seule inconnue est la date à laquelle ce pic surviendra. Pour savoir quand aura lieu le pic pétrolier d'une région, il suffit en théorie de connaître le montant des réserves à un moment donné et les quantités extraites depuis le début de son exploitation : lorsque les quantités déjà extraites sont égales à celles restant à extraire, le pic est atteint. Toutefois, il est souvent difficile de connaître la valeur précise des réserves, et le pic n'est généralement identifié comme tel que plusieurs années après qu'il s'est effectivement produit. Comme l'a rappelé devant la Mission M. Olivier Appert, Président de l'Institut français du pétrole, pour en comprendre les termes, il faut se souvenir qu'« un gisement pétrolier est comparable, non pas à une baignoire qui se viderait peu à peu et ne se remplirait pas, mais à une éponge que l'on presse, la pression sur l'éponge dépendant de conditions aussi bien techniques qu'économiques. » C'est ce qui explique les estimations divergentes qui existent : plusieurs chiffres sont avancés selon le nombre de pays considérés et le type de pétrole envisagé. On peut toutefois retenir le chiffre moyen de 1 050 milliards de barils en réserve, soit quarante années au rythme de consommation actuel. Ce chiffre n'inclut pas les réserves probables supplémentaires et le complément appréciable des huiles extra-lourdes. Cette appréciation des réserves doit être nuancée par un regard ex post sur le lien entre consommation et réserves, qui montre que, en dépit d'une augmentation significative de la consommation, les réserves évaluées se sont beaucoup accrues. Ainsi, il y a trente ans, le Club de Rome avait tablé sur trente ans de réserves seulement. La situation est donc moins critique que prévu. Reste que de l'avis de tous les experts, il importe de ne pas tirer trop vite sur les réserves : si la demande continue à augmenter de 1,6 ou 1,7 % par an, scénario de base de l'Agence internationale pour l'énergie (AIE), le peak oil interviendra en 2020 ; si la croissance est limitée à 1 % par an, dix ans seront gagnés ; si elle est maîtrisée à 0,7 % par an, le peak oil sera reporté à 2040, et le temps gagné pourra être mis à profit pour s'adapter. Pour l'heure, les tensions observées en matière de production tiennent largement au sous-investissement massif qui a suivi le contre-choc pétrolier des années 1980, alors que le prix du baril avait atteint son étiage. Ce sous-investissement est à l'origine des tensions actuelles sur les prix, qui reflètent notamment la rigidité du système énergétique hérité du contre-choc pétrolier. Ainsi, en comparaison avec la situation qui prévalait au moment du premier choc pétrolier, le système d'approvisionnement en hydrocarbures a perdu beaucoup de ses éléments de souplesse. Au début des années 1970, des capacités de production et de raffinage étaient disponibles pour faire face à des aléas climatiques ou géopolitiques. Mais, depuis 1982, les surcapacités se sont progressivement réduites. Ainsi, pendant la première guerre du Golfe, l'OPEP a pu utiliser ses surcapacités pour compenser, à hauteur de 6 millions de barils par jour (soit plus de 6 % de la consommation mondiale de l'époque), l'interruption des approvisionnements koweïtiens et irakiens. Aujourd'hui, les capacités excédentaires ne dépassent pas 1,5 à 2 millions de barils par jour, soit environ 2 % de la consommation mondiale. Parallèlement, les stocks des pays consommateurs ont aussi diminué : pour l'ensemble de l'OCDE, ils sont passés de 61 jours en 1991 à environ 50 jours en 2005. Ainsi, à la suite des ouragans qui ont touché les Etats-Unis à l'automne dernier, les stocks commerciaux se sont révélés inférieurs aux besoins. Dans le contexte actuel d'un prix du baril durablement élevé, l'investissement redevient important mais se heurte aux limites physiques des compagnies. Ainsi, comme l'a expliqué M. Philippe Boisseau, directeur Moyen-Orient chez Total lors de la journée d'études organisée par la fondation pour la recherche stratégique sur la sécurité énergétique, le 19 septembre 2005, « la raison pour laquelle nous n'investissons pas davantage est que nous sommes au maximum de nos capacités. Ce ne sont pas les disponibilités financières qui nous en empêchent. Lorsque l'on dit que les pays fermés sont les pays où nous n'investissons pas, ce n'est pas non plus exact. Tout le monde investit au maximum... Mais nous atteignons nos limites techniques et humaines. Les plans de charge sont pleins pour les deux ou trois années à venir, et non pas seulement pour les six prochains mois - comme c'est le cas habituellement. La raison pour laquelle nous n'investissons pas davantage est que nous ne le pouvons pas. Pas un seul investissement n'a été refusé au comité exécutif de Total depuis deux ans. Il y a une véritable tension au niveau mondial. Le risque, c'est notre métier et nous investissons dans des pays comme l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, etc. Tous les pétroliers investissent dans les pays difficiles. Les problèmes d'investissement, y compris en Iran, ne sont pas liés à un manque de volonté mais à un problème de maîtrise technique et capacitaire. Nous verrons dans dix ans si les investissements en train d'être effectués auront été suffisants, ce qui tranchera le débat entre les pessimistes et les optimistes. Les limitations d'investissement sont d'abord physiques. Le problème va se produire dans le domaine gazier, puisque le Qatar a développé très rapidement et récemment ses capacités de production. » Reste qu'au prix actuel du baril de pétrole, de nombreux investissements naguère inenvisageables deviennent rentables. Notamment, il semble désormais possible de s'intéresser aux enjeux technologiques en matière d'exploitation des ressources pétrolières conventionnelles liés à l'amélioration du taux de récupération des gisements, qui est aujourd'hui de 35 % : s'il passait à 50 %, on pourrait multiplier les réserves par deux. S'agissant des ressources pétrolières non conventionnelles (huiles extra lourdes, sables asphaltiques), l'augmentation des prix en facilite l'exploitation, comme au Venezuela ou au Canada ; à ce jour toutefois, les quantités très importantes que recèlent ces gisements ne sont quasiment pas exploitées. Les limites physiques existent donc mais peuvent être repoussées par les prix et la technologie. b) L'industrie du raffinage en sous-régime Après les chocs pétroliers, l'industrie du raffinage, elle aussi massivement touchée par le sous-investissement, a vécu vingt années difficiles, qui ont conduit aujourd'hui à une insuffisance globale des capacités de raffinage. Cette insuffisance touche particulièrement le raffinage du diesel, carburant pour l'aviation et du fioul domestique. En termes géographiques, la situation varie beaucoup d'un pays à l'autre : la capacité de raffinage de l'Europe couvre ses besoins ; l'Amérique du Nord est nettement déficitaire ; la Russie, la CEI, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient sont excédentaires ; l'Asie est devenue déficitaire en 2005. Au total, comme l'a rappelé à la Mission M. Thierry Desmarest, Président directeur général de Total, le taux d'utilisation des capacités mondiales avoisine désormais 90 %. Les conséquences du sous-investissement structurel à l'origine des tensions actuelles ont été d'autant plus lourdes que l'industrie du raffinage américaine a été durement frappée, en 2005, par des catastrophes naturelles. Les installations pétrolières offshore ont été construites pour résister à « la tempête du siècle » mais qui avait prévu que deux tempêtes du siècle se produiraient à quelques semaines d'intervalles dans le golfe du Mexique ? Rappelons que les ouragans Katrina et Rita ont neutralisé 27 % de la production américaine de pétrole et 21 % des capacités de raffinage. Les risques de saturations en aval de la production sont de plus en plus grands, et seul un développement massif des infrastructures de raffinage pour le pétrole et de regazéification pour le gaz serait à même de garantir la fluidité du marché. Or, les investissements des compagnies privées restent frileux en la matière, le coût particulièrement élevé de ces infrastructures posant un problème de rentabilité à court terme alors même que l'épuisement des ressources fossiles semble inéluctable. En outre, dans un certain nombre de pays développés, les autorités locales ne sont plus prêtes à imposer à leur population civile de telles infrastructures polluantes ou explosives. Les espaces déjà attribués aux usines pétrolières sont déjà saturés. La solution envisagée est alors de délocaliser le traitement des hydrocarbures. Pour ce faire, les pays producteurs éloignés prendraient en charge un pré-raffinage (le plus polluant) du pétrole. c) Etats producteurs, Etats en crise ? Force est de le constater, la carte des pays producteurs se superpose avec celle des Etats en crise politique, voire en guerre. Sans compter que la carte des pays producteurs rejoint aussi celle des pays « à risque » en termes d'investissement. A cet égard, notons que, alors que, au cours des trente dernières années, ces investissements se sont concentrés dans les pays de l'OCDE, les investissements qu'il est aujourd'hui urgent de faire concernent des pays extérieurs à l'OCDE. Il est impossible de savoir s'ils seront réalisés à un niveau suffisant et dans les délais requis. Or ils doivent être massifs, les investissements à réaliser portant aussi bien sur la production que sur la transformation, le transport et la livraison du pétrole et du gaz. Faute de tels investissements, des problèmes apparaîtront dès les cinq ou dix prochaines années. A travers cette question des risques politiques pesant sur le système énergétique international, c'est notamment la question de la concentration de la production pétrolière au Moyen-Orient et l'importance toujours croissante qu'est appelée à avoir cette région dans l'équilibre du marché pétrolier qui est en cause. Pour M. Olivier Appert, c'est d'ailleurs là que réside le risque principal : « moins que la question de long terme du pic de production et des réserves, la question de leur concentration représentait le principal problème à court et moyen terme. A ce titre, le Moyen-Orient, par sa place prépondérante, est une véritable anomalie géologique. » Il est vrai que cette zone concentre plusieurs types de risque : risques liés à la fermeture de l'amont, risque terroriste, risque de saturation des passages maritimes, sans compter, pour certains, un risque pays important au sens de la COFACE. C'est notamment le cœur du système pétrolier mondial, l'Arabie Saoudite, qui suscite toutes les inquiétudes. Ce pays, qui concentre près de 25 % des réserves de pétrole et 13 % de la production, voit sa stabilité menacée. Ainsi, a récemment été déjoué un attentat suicide contre le site pétrolier d'Abqaïq, situé sur le plus grand gisement du monde et premier centre mondial de traitement du brut par lequel transitent les deux tiers de la production pétrolière saoudienne. S'ajoutent à cela des difficultés de production ponctuelles dans plusieurs pays producteurs de première importance. Les événements politiques au Venezuela ont ainsi conduit à un arrêt de la production de ce pays début 2003, alors qu'il s'agissait du fournisseur le plus fiable depuis la seconde guerre mondiale. Les événements en Irak ont également fait chuter la production, les exportations ayant baissé de 30 à 40 %. 2) Le transport de l'énergie : la peur de la désorganisation Le deuxième champ sur lequel pèsent de fortes incertitudes concerne le transport de l'énergie. a) La croissance du transport international de l'énergie En effet, du fait du déséquilibre entre zones de production (Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, CEI) et zones de consommation (Amérique du Nord, Europe, Asie, Océanie), la distance entre lieux de production et lieux de consommation confère à la question du transport de l'énergie un poids déterminant. Ce constat vaut tout d'abord en matière pétrolière. Globalement, la moitié de la consommation pétrolière quotidienne transite par les canaux et détroits à travers le monde. On estime à 40 millions le nombre de barils de pétrole qui, chaque jour, traversent les océans par bateaux, chiffre qui pourrait atteindre 67 millions en 2020 lorsque, selon les projections, les Etats-Unis importeront 58 % de leur pétrole (et non plus 33 % comme en 1973). Du fait de l'évolution de la géographie de la demande pétrolière, le pétrole devra de plus en plus utiliser les voies maritimes stratégiques, notamment le détroit d'Ormuz (35 km de large) : d'ores et déjà, 20 % du pétrole consommé y transitent aujourd'hui, proportion qui sera de 33 % en 2030 ; de même, le rôle stratégique du détroit de Malacca, du canal de Suez et du Bosphore ne fera que s'accroître. Mais c'est la mondialisation du marché du gaz qui va bouleverser le transport international de l'énergie. Comme l'a rappelé à la Mission M. Jean-Marie Chevalier, on observait jusqu'alors trois marchés segmentés : l'un en Asie ; l'autre réunissant l'Europe, la Russie et l'Afrique du Nord ; le dernier étant le marché américain. Aujourd'hui on constate que la production américaine de gaz diminue ou augmente de manière très faible, de sorte que, à terme, les Etats-Unis vont happer des cargaisons entières de gaz destinées à l'Europe, ce qui pourra poser des difficultés à l'Europe qui se trouvera en situation de concurrence avec les Etats-Unis, pour accéder au gaz russe par exemple. De fait, les projections font état d'un triplement du volume de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'horizon 2020 (soit un trafic de 460 millions de tonnes), avec là encore, un poids déterminant des Etats-Unis dans la balance puisque la part de marché du GNL dans la demande énergétique américaine passerait de 3 % aujourd'hui à plus de 25 % en 2020. La problématique des voies et passages stratégiques est identique à ce qui vaut en matière pétrolière, notamment du fait de la part croissante du transport du gaz par bateau sous forme liquéfiée (GNL). Cette évolution a pour conséquence une très forte croissance de la flotte de méthaniers, qui est appelée à s'accroître de 30 % entre 2005 et 2008, passant de 182 méthaniers en service en 2005 à 307 en 2008. Au total, à l'horizon 2030, c'est donc une globalisation des marchés gaziers qui se profile, caractérisée par une part importante du GNL dans les flux (50 % du commerce inter-régional). Et là encore, cette globalisation va donner un rôle majeur à la zone du Moyen-Orient, qui se situe à la croisée des chemins entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. b) Le rôle clé des détroits énergétiques Du fait de cette interdépendance énergétique qui va s'amplifier dans un marché de plus en plus mondial, de plus en plus intégré, et du fait de l'allongement et de la densification des routes de l'énergie qu'elle implique, la question du passage par les détroits devient plus que jamais cruciale. Sont concernés : - le détroit d'Ormuz, à l'entrée du Golfe persique ; - le canal de Suez, qui relie la mer Rouge à la Méditerranée ; - le détroit de Bal el Mandeb, qui donne accès à la mer Rouge ; - le Bosphore, par où transite le pétrole russe et de la mer Caspienne ; - et le détroit de Malacca, qui voit passer 80 % du pétrole destiné au Japon et à la Corée du Sud et la moitié de celui qui va vers la Chine. CARTE DES DÉTROITS ÉNERGÉTIQUES 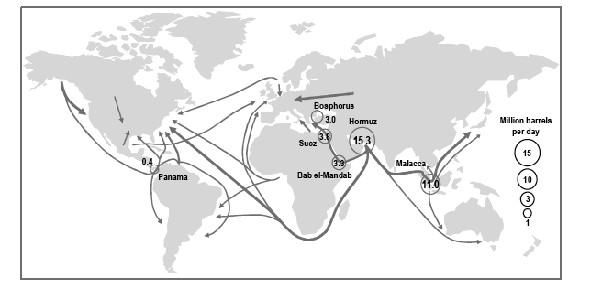 Source : Les Cahiers de Géographie du Québec, Novembre 2004. Chiffres de 2003. Il existe aujourd'hui une véritable prise de conscience internationale du rôle déterminant des détroits. Les termes du problème sont simples : alors que la demande en hydrocarbures augmente, la capacité des passages maritimes stratégiques à supporter un trafic plus important reste limitée. En outre, le transport pétrolier fonctionne quasiment en flux tendus et les capacités de stockage sont contraintes. Une restructuration rapide des routes de transport est alors inconcevable. Il s'ensuit qu'un contournement des détroits est difficilement envisageable sans déstabiliser radicalement le marché. Le risque de saturation des détroits, notamment celui du Bosphore, ne peut pas être oublié. Un accident pétrolier dans un détroit, pouvant être à l'origine d'une marée noire, serait catastrophique pour l'approvisionnement européen. De même, comme le montre l'encadré suivant, le risque d'attaque terroriste dans ces zones vulnérables doit être pris en compte, du fait des conséquences majeures d'un tel événement pour la sécurité énergétique des pays consommateurs. DIAGNOSTIC DES RISQUES D'ATTAQUES TERRORISTES OU DE PIRATERIE Comme on a pu le voir avec l'attentat contre le tanker français Limburg en 2002, les pétroliers peuvent constituer des cibles pour les terroristes. Un tel navire peut-être utilisé de deux façons : tout d'abord comme cible en tant que telle en essayant d'endommager sa coque afin que sa cargaison se déverse (cas du Limburg), ou pour permettre de bloquer un passage (détroit, canal, port, etc.). Mais le pétrolier peut également être utilisé comme une arme. En effet, on peut facilement imaginer les dommages que pourrait occasionner un super tanker lancé à pleine vitesse contre des infrastructures portuaires, contre un autre navire, ou plus simplement contre des côtes. Il paraît quasiment impossible de pouvoir arrêter un tanker qui aurait atteint une vitesse importante. Cependant, un pétrolier n'apparaît pas comme une cible facile. Il ne peut être attaqué que dans une zone géographique réduite (rade, port, détroit). Le détroit de Bab-el Mandeb et le canal de Suez doivent être considérés comme un couple. En revanche, leur stabilisation ne répond pas aux mêmes enjeux. Le premier n'est pas entièrement contrôlé par un seul pays, et les liens entre la France et Djibouti assurent une présence militaire. Une telle présence est d'autant plus indispensable que des risques terroristes pèsent réellement sur la sécurité du détroit. En effet, plusieurs actes terroristes ont déjà été recensés au large des côtes yéménites. Enfin, économiquement, l'attaque d'un pétrolier n'a que de faibles conséquences et aucun effet sur le commerce mondial (un pétrolier ne représente que 2 millions de barils, à comparer aux 900 millions dont disposent les pays occidentaux en stock). Un pipeline en surface constitue une cible beaucoup plus facile à atteindre qu'un super tanker dans la mesure où son parcours est connu. Les attaques réalisées sur un pipeline peuvent prendre plusieurs formes. En premier lieu, l'explosion d'une section du pipeline par le biais d'une bombe peut provoquer des pertes économiques ou en vies humaines (l'explosion d'un oléoduc en Colombie en 1998 a fait 70 morts). En second lieu, des sabotages permettent de détourner une partie du produit, qui est ensuite revendu sur le marché noir. Une attaque pourrait également être dirigée contre des sites de stockages stratégiques. La perte d'un ou plusieurs de ces sites pourrait avoir des conséquences économiques importantes. En particulier, la SPR [Strategic Petroleum Reserve] est stratégiquement importante étant donnée l'influence qu'ont les déclarations américaines du niveau de leurs stocks sur les cours mondiaux du pétrole. Une telle attaque est cependant extrêmement difficile à mettre en œuvre. En revanche, l'attaque d'un port paraît plus réalisable notamment en utilisant un tanker comme bélier. Les répercussions d'un tel acte seraient considérables, aussi bien du point de vue humain (perte de vies importante), qu'économique (fermeture du port, destruction des infrastructures, endommagement d'autres navires, etc.). De la même manière, les usines de regazéification situées en pays consommateurs et très explosives sont très sensibles. Enfin, les derniers lieux pouvant constituer des cibles potentielles pour des groupes terroristes sont les infrastructures pétrolières en général : les plates-formes maritimes, les stations service, les bureaux des dirigeants placés dans les grandes villes, et surtout les raffineries. Source : cet encadré est extrait des travaux réalisés par l'atelier de travail « énergie », effectué dans le cadre du master de géopolitique Paris I - ENS entre mars et mai 2005, sous l'égide de la La Direction Générale de l'Energie et des Matières Premières (DGEMP, ministère de l'Industrie). Disponible à l'adresse suivante : http://www.geostrategie.ens.fr/etudes/hydrocarbures/accueil.html. 3) La consommation énergétique : la peur de l'insuffisance Depuis cinquante ans, nous vivions dans un monde où le plus gros consommateur de pétrole était les Etats-Unis, soit un pays connu, économiquement développé et de 350 millions d'habitants. Or l'année 2005 a vu un changement historique : depuis cette date en effet, ce ne sont plus des Etats-Unis, mais d'Asie que vient la plus forte demande en pétrole et, selon la Cambridge Energy Research Associates, dans les quinze années à venir, la moitié de la croissance de la consommation de pétrole sera asiatique. Ce que signifie le passage de cette étape essentielle, c'est que, désormais, les problématiques énergétiques s'articulent autour d'une géopolitique de la demande, et non plus de l'offre comme lors de la crise énergétique des années 1970 : alors qu'en 1973, le débat se jouait, en matière pétrolière, entre les pays de l'OCDE et ceux de l'OPEP, aujourd'hui, la demande vient de plus en plus des pays en voie de développement ; d'ici à 2030, les deux tiers de la croissance de la demande seront issus de ces pays, qui représenteront, à cette date, 48 % de la demande mondiale d'énergie, contre 37 % en 2002. A elle seule, la Chine représentera 20 % de l'accroissement de la demande, alors qu'elle représente 8,2 % de la consommation mondiale, soit une consommation énergétique par tête équivalente à celle enregistrée au Japon en 1955. Il est probable que, au moins dans la partie orientale du pays - la plus dynamique et la plus développée sur le plan économique -, elle connaîtra la même évolution, c'est-à-dire que sa consommation énergétique sera multipliée par sept en quarante ans. Toute la difficulté consiste aujourd'hui à comprendre les conséquences possibles pour la stabilité énergétique internationale de ce choc massif de la demande, par nature durable, et à déterminer si l'offre est susceptible de s'y adapter. Pour le dire autrement, faut-il s'en remettre au marché pour rétablir un ordre énergétique qui garantisse la sécurité ? Ou faut-il une action volontariste des Etats pour remédier aux dysfonctionnements actuels ? Que signifie, pour le monde, la soif de pétrole, et plus largement la soif d'énergie, de 2,42 milliards de personnes (populations de la Chine et de l'Inde en 2005), c'est-à-dire presque huit fois la population américaine - chiffre qui sera, selon les projections de l'ONU de 2,985 milliards en 2050, quand les Etats-Unis compteront 395 millions d'habitants (33) ? Certes le chemin est encore long pour que ces pays rejoignent le niveau moyen de consommation d'énergie par habitant des pays d'Europe de l'Ouest ; un Chinois consomme une tonne équivalent pétrole par an, contre quatre pour un Européen et huit pour un Américain. Si les Chinois étaient motorisés au même degré que les Européens, ils consommeraient à eux seuls 17 millions de barils de pétrole par jour, soit la production du Moyen Orient, ce qui serait impossible... Toute la difficulté de la situation actuelle vient de ce que le scénario d'une Chine adoptant des habitudes de consommation occidentales n'est pas tenable. Quelle serait, en effet, la situation énergétique internationale en 2030 si les tendances actuelles étaient maintenues ? Selon ce scénario dit « tendanciel », la croissance de la consommation d'énergie primaire augmenterait de 60 %, passant de 10 à 16 milliards de tep en 2030 ; la prépondérance des énergies fossiles serait maintenue (85 % de la consommation d'énergie) globalement, avec un pétrole toujours dominant et une diminution de la part du charbon, qui passerait derrière le gaz à compter de 2020 ; les émissions de gaz carbonique augmenteraient de même de 60 %. D'où le malaise actuel devant l'émergence de la Chine, et bientôt de l'Inde, comme acteur de premier plan sur la scène énergétique internationale. D'un côté, on ne peut manquer d'être frappé par le paradoxe qui consiste à avoir constamment incité ces pays à s'intégrer dans le jeu mondial pour leur reprocher ensuite d'en adopter le modèle économique, qui a fait le succès des pays développés. D'autant qu'à ce jour, la consommation énergétique des Chinois est huit fois inférieure à celle des Américains. De l'autre, la poursuite des tendances actuelles est intenable pour des raisons tenant tant aux capacités de production et de transport qu'au changement climatique. B - L'interdépendance, fondement de la sécurité énergétique ? Comment garantir la sécurité énergétique alors même que nous entrons dans un monde énergétique dont les paramètres ne sont pas entièrement connus ? Répondre à cette question est d'autant plus complexe qu'il existe un gouffre entre la manière dont chaque pays définit sa sécurité énergétique et la réalité objective en la matière. Ce qui est certain cependant, c'est qu'aucune réponse ne saurait être ni durable ni efficace si elle nie ce qui apparaît d'ores et déjà comme une réalité essentielle du nouveau système énergétique en gestation : l'interdépendance entre les acteurs. a) Le mythe de l'indépendance énergétique Confrontés à la crise énergétique actuelle, certains acteurs sont tentés de recourir, pour y faire face, aux recettes qui prévalurent pour la crise précédente, notamment l'indépendance énergétique. Il s'agirait en quelque sorte de réduire au minimum les liens entre producteurs/exportateurs et consommateurs/importateurs, en transformant autant que possible les consommateurs en producteurs. De fait, historiquement, c'est une approche binaire qui a prévalu dans le domaine énergétique avec, d'un côté, les producteurs, de l'autre, les consommateurs. Ceci est particulièrement net dans le domaine pétrolier : ainsi, lors de la crise suscitée par la décision de l'OPEP, en 1973, de relever brutalement les prix du pétrole, les pays industrialisés, pour la plupart membres de l'OCDE, se sont réunis au sein de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), afin de se donner les moyens de réagir rapidement et efficacement aux crises pétrolières. A l'époque, c'est une logique d'affrontement qui a prévalu, producteurs et consommateurs se réunissant chacun de leur côté dans des structures propres à défendre leurs intérêts. Pour séduisante qu'elle soit, la quête de l'indépendance énergétique est, pour la quasi-totalité des pays du monde, totalement illusoire, d'abord parce qu'elle ne répond pas aux données du problème qui sont différentes, répétons-le, de celles des années 1970. Plus encore, il s'agit non seulement d'une illusion, mais plus encore de l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire : comme le note M. Nicolas Sarkis, « contrairement à un préjugé aussi aberrant que dangereux, il y a une réelle complémentarité objective d'intérêts entre les pays importateurs et les pays exportateurs. Au souci bien légitime des premiers de sécuriser leurs importations pétrolières et gazières répond le souci non moins légitime et non moins vital des seconds de garantir leurs marchés et leurs recettes d'exportations, indispensables pour développer leurs économies. » (34). Dans les deux cas, en effet, l'enjeu est celui d'une gestion rationnelle et maîtrisée des ressources énergétiques et de la conciliation entre croissance économique et énergie. Il s'agit en effet pour les producteurs de calibrer au plus près le montant des investissements à réaliser pour garantir le niveau de l'offre et d'utiliser au mieux la manne énergétique pour irriguer l'ensemble de l'économie. Pour les consommateurs, l'enjeu est d'obtenir l'énergie en quantité nécessaire au fonctionnement de l'économie et à un prix compatible avec la croissance. En bref, au cœur de la notion de sécurité énergétique, se trouve le thème de la complémentarité énergétique. Dans un monde où l'interdépendance est une donnée de fait, la sécurité énergétique ne saurait signifier l'indépendance énergétique : jamais l'Europe, les Etats-Unis ou le Japon, ne seront indépendants sur le plan énergétique. Tout au plus peuvent-ils diminuer l'importance relative de leurs importations dans ce domaine mais l'indépendance énergétique est une quête impossible, qui ne saurait donc être érigée en objectif. Plus encore, puisque la réalité énergétique du futur est celle de l'interdépendance, tout l'enjeu de la construction d'un système énergétique stable consiste à gérer cette interdépendance, c'est-à-dire à minimiser les dangers dont elle est porteuse. Le Livre vert de la Commission européenne de 2000 ne disait pas autre chose : « La sécurité énergétique ne vise pas à maximiser l'autonomie énergétique de l'Europe ou à minimiser la dépendance mais à réduire les risques liés à celle-ci ». b) L'illusion du « laissez faire le marché » Nous sommes aujourd'hui dans une phase où les grands acteurs de l'énergie hésitent sur la nature de la réponse à la question cruciale de la stabilité de la sécurité énergétique. Comme le Président de la Mission a pu le constater lors de sa visite aux Etats-Unis, au mois de juin 2006, on peut avoir le sentiment que nombreux sont ceux qui voudraient s'en tenir au credo « le marché, rien que le marché » : en un mot, laissons faire la régulation par les prix, véritables « juges de paix », qui permettront de décider ce qui, du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, du nucléaire, est le plus rationnel en termes économiques. De même, c'est ainsi qu'il faut interpréter les analyses qui tendent à interpréter la moindre diminution, de quelques dollars, du prix du baril de pétrole comme le signe que « tout va mieux », à l'instar de ces articles qui se multiplient dans la presse au début du mois de septembre 2006 alors que le baril de pétrole est redescendu en dessous des... 60 dollars. Aux yeux de la Mission, ces analyses à courte vue ne sont pas seulement erronées, elles sont également dangereuses en ce qu'elles propagent une sorte d'insouciance, et même d'irresponsabilité énergétique semblable à celle que nous avons connue au cours de la décennie 1990, qui se solde aujourd'hui par une insuffisance notoire de capacités de production et de raffinage. Dangereuses parce que, problématique économique, la sécurité énergétique est également, et même avant toute chose, une question fondamentalement politique et qu'elle est si importante pour les Etats qu'elle interagit avec l'ensemble de la politique extérieure de ceux-ci. Le retour à la réalité sera d'autant plus difficile, lorsque nous verrons les équilibres diplomatiques internationaux vaciller pour des raisons énergétiques. Prenons le cas de l'Iran et de sa farouche détermination à maîtriser l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, qui le conduit à poursuivre, en violation de l'ultimatum fixé par le Conseil de sécurité, l'enrichissement de l'uranium. Hésiterait-on à prendre des sanctions économiques vigoureuses contre ce pays s'il ne possédait pas les réserves du monde en pétrole et en gaz ? Aurions-nous à nous poser la question de l'attitude de la Chine dans cette crise si celle-ci ne dépendait pas de l'Iran pour ses livraisons pétrolières ? Pour simplifier, quel arbitrage ferons-nous entre sécurité énergétique et sécurité tout court ? D'aucuns pourraient accuser la Mission de catastrophisme mais soyons lucides : au regard du caractère toujours crucial, pour un gouvernement, de la nécessité d'assurer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, nous n'en sommes qu'aux prémisses du choc sur l'équilibre énergétique international que représente l'explosion de la demande chinoise en énergie (+ 16 % en 2004 s'agissant du pétrole !). Plus encore pour un pays dont la stabilité politique est liée à la croissance économique. Les mutations économiques à l'œuvre en Chine entraînent en effet d'importants bouleversements sociaux, qui pourraient avoir de lourdes conséquences politiques en cas de retournement brusque de la croissance. Assurément donc, une approche limitée aux questions de marché n'est pas compatible avec les enjeux internationaux contenus dans cette crise durable de l'énergie. Au sein de l'Union européenne, un tel constat explique que la Commission européenne, qui, en opposition avec la tradition française, avait toujours privilégié, jusqu'ici, la concurrence par rapport à la sécurité d'approvisionnement, place désormais les deux préoccupations sur le même plan. La véritable question désormais est la suivante : comment concilier vision et sécurité à long terme et économie de marché ? a) Du côté des consommateurs : diversification et efficacité énergétique Il n'existe pas de réponse unique au problème de la sécurité énergétique. Il existe néanmoins des recettes, qui ont fait leur preuve lors de la crise énergétique des années 1970. Pour se référer à l'exemple de la France, c'est, à l'époque, une politique de sécurité énergétique en trois volets qui fut mise en oeuvre : accroissement de la production domestique d'énergie, via le développement d'un programme électronucléaire massif ; économies d'énergie ; diversification des approvisionnements extérieurs, tant géographique que par produit. Les effets positifs de cette politique ont été flagrants : amélioration de l'efficacité énergétique de 20 %, soit une diminution du contenu en énergie du PIB de 20 %, production domestique d'énergie multipliée par 2,5 sur la période 1973-1996, taux d'indépendance énergétique qui est passé de 22,5 % en 1973 à plus de 50 % aujourd'hui, un bilan énergétique plus diversifié et des approvisionnements extérieurs beaucoup plus diversifiés à la fois sur le plan géographique et sur le plan de la composition du bouquet énergétique importé. Les solutions préconisées aujourd'hui pour faire face à la crise de l'énergie, par exemple par le Livre vert sur l'énergie de la Commission européenne n'ont donc, on le voit, rien de nouveau, ce qui n'enlève rien d'ailleurs à leur pertinence. Ainsi, à court terme d'abord, un maître-mot s'impose : l'efficacité énergétique, qui traduit le lien entre l'utilisation de la quantité d'énergie et la production de richesse. Cette politique est d'autant plus aisée à mettre en œuvre qu'une quantité très importante d'économies d'énergie est accessible à des coûts très faibles, voire négatifs. L'AIE a calculé que si les seuls appareils électro-domestiques les plus économes en énergie étaient achetés par les consommateurs, un tiers de la consommation d'électricité par ces appareils serait économisé. Les marges d'action existant en la matière sont donc très importantes : le plan d'action de la Commission européenne sur l'efficacité énergétique attendu pour décembre envisage ainsi une baisse de 20 % de notre consommation d'énergie d'ici 2020. A long terme toutefois, cette politique d'efficacité énergétique est insuffisante car elle ne permet pas de conduire à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. A cet égard, seule une politique complémentaire de diversification du bouquet énergétique en faveur de sources d'énergie non émettrices de gaz carbonique est efficace. Dans la définition de ce bouquet, aucune solution ne s'impose comme étant la panacée : ceux qui proposent une solution unique se trompent et trompent autrui ; le tout-nucléaire comme le tout-renouvelable, par exemple, ne conduiraient qu'à des absurdités. Reste que, dans le choix de ce mixte énergétique, toutes les énergies ne sauraient être mises sur le même plan. Notamment, si l'ensemble des techniques de production d'énergie non émettrices de gaz carbonique doivent être privilégiées - le nucléaire, l'éolien, la biomasse, l'hydraulique et les piles à combustible -, toutes ne se valent pas, notamment pour répondre aux besoins gigantesques de pays très peuplés comme la Chine, de même que pour des raisons de coût. Les pays consommateurs en sont bien conscients : si l'on assiste aujourd'hui à un retour en force du nucléaire - retour universel qui concerne des pays de niveau de développement, de taille et aux besoins très différents : Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chine, Brésil, Inde, Turquie, Egypte, Panama... -, c'est d'ailleurs parce que cette source d'énergie est encore beaucoup plus compétitive que les autres sources d'énergie non émettrices de gaz carbonique. Ce retour du nucléaire marque un profond changement des mentalités : c'est un « tabou » qui tombe dans bien des instances internationales, par exemple au Conseil mondial de l'énergie, qui rassemble les opérateurs énergétiques du monde entier et de tous les secteurs, jusqu'alors extrêmement réticent. Ce tabou tombera-t-il en Europe ? Car, comme l'a rappelé Mme Anne Lauvergeon, qui s'interrogeait sur les raisons de l'absence d'une politique européenne commune, c'est à cause de la question nucléaire que les sujets énergétiques ne sont aujourd'hui abordés en Europe que de manière allusive. Dans les faits néanmoins, on assiste, en Europe, comme partout, à la renaissance des projets nucléaires civils. A quelques exceptions près, tous les dirigeants européens pensent, en effet, à revenir au nucléaire - qui, rappelons-le, représente aujourd'hui 35 % de la production d'électricité en Europe (78 % en France). Même l'Italie, seul grand pays d'Europe dépourvu de centrales nucléaires après avoir renoncé à cette source d'énergie par référendum, en 1987, a saisi l'occasion de retrouver une compétence nucléaire, par le biais de l'association d'ENEL au développement du site de Flamanville par EDF. La Grande-Bretagne représente un exemple révélateur du lien aujourd'hui établi entre sécurité énergétique et énergie nucléaire. Ce pays connaît en effet actuellement un changement radical de son statut énergétique puisqu'il est en train de passer du statut de producteur au statut d'importateur : quatrième producteur de gaz naturel, ce pays est devenu importateur net de gaz en 2004, l'épuisement des réserves gazières pouvant être atteint d'ici à six ans ; de même, sauf si de nouvelles découvertes sont faites, le Royaume-Uni sera à court terme un importateur de pétrole. Ces perspectives, cumulées à la structure de la consommation énergétique actuelle du pays, conduisent les experts britanniques à estimer à 80 % le taux de dépendance énergétique pour le gaz. Par conséquent, le Royaume-Uni développe actuellement des infrastructures d'importation gazière (gazoducs internationaux et construction de plusieurs terminaux de GNL, dont le premier est devenu opérationnel en juillet 2005 et dont deux autres devraient être opérationnels en 2007). En parallèle, on assiste à une réflexion sur la diversification énergétique du pays, qui a fortement évolué récemment. Le livre blanc sur l'énergie publié en 2003 misait principalement sur le développement des énergies renouvelables et la promotion de l'efficacité énergétique. Depuis, la sécurité énergétique est devenue priorité nationale et en novembre 2005, le Premier Ministre a décidé un examen de la politique énergétique, qui s'est terminé à l'été 2006. Les orientations majeures concernent le développement des énergies renouvelables : 2,2 % de la production d'électricité britannique aujourd'hui, 10 % prévus en 2010. Les investissements se concentrent sur l'éolien et les autorités publiques déploient parallèlement des efforts de recherche importants. La nouveauté la plus importante concerne la fin du statu quo sur la question nucléaire, qui durait depuis vingt ans : le parc actuel commencera à se réduire dès 2010 (arrêt de quatre des douze centrales), les autres ayant une durée de vie prévue jusque vers 2025. De fait, le nucléaire apparaît en Europe comme la seule source d'énergie qui pourrait être produite en quantité massive en cas de crise énergétique majeure. Et, alors même que nous venons de commémorer le vingtième anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl qui a eu des effets désastreux pour l'image du nucléaire, le tabou européen sur le nucléaire n'a pas résisté au principe de réalité du baril à soixante-dix dollars. Reste que le problème de son acceptation par les opinions publiques demeure et qu'un gros travail de pédagogie, ainsi qu'une constante recherche de la sécurité doivent être menés. Plus encore, si l'Union européenne veut être en mesure de conduire une réflexion énergétique, puis à terme, une politique énergétique digne de ce nom, il faudra que l'Allemagne et l'Autriche s'interrogent sur leur position vis-à-vis du nucléaire et sur leur choix énergétique. Le moment est d'autant plus propice que, pour la première, elle est en pleine redéfinition de sa stratégie énergétique, qui devrait être finalisée à la fin du premier semestre 2007. En effet, dans quelle mesure la sécurité énergétique a-t-elle un sens en Europe si elle ne revêt pas une dimension commune ? Quel sens aura, à l'avenir, la juxtaposition entre des taux de dépendance énergétique qui s'améliorent dans certains Etats membres, quand, dans le même temps, certains pays se mettront dans la main de fournisseurs de gaz aux décisions imprévisibles ? De ce point de vue, la relation gazière entre l'Allemagne et la Russie ne saurait être considérée comme une simple question bilatérale. Rappelons que l'Allemagne est un pays fortement consommateur (cinquième rang mondial), de plus en plus dépendant, en particulier de la Russie, puisqu'elle en importe 63 % de ses ressources énergétiques, contre 44 % en 1991. Est également en jeu la compétitivité économique européenne. En effet, comme l'a rappelé Mme Anne Lauvergeon devant la Mission, la compétitivité des économies européennes est liée au choix de sources énergétiques compétitives. C'est pourquoi le Rapporteur estime qu'au regard du poids économique de l'Allemagne dans l'Union européenne, ses choix énergétiques seront essentiels. Dans le même temps en effet, les nouveaux géants économiques qui émergent en Asie sont engagés dans d'impressionnants projets nucléaires. En la matière, l'énergie nucléaire représente, pour la Chine, la seule solution pour répondre à la croissance à deux chiffres de sa consommation énergétique : ses gisements de charbon sont colossaux mais ses capacités à le transporter ne peuvent être étendues à l'infini ; ses réserves hydrauliques sont formidables mais la question du transport constitue là encore un goulot d'étranglement, la consommation étant concentrée à l'est tandis que les réserves se situent plutôt à l'ouest ; enfin, la Chine ne possède guère de pétrole. Reste que le développement du nucléaire se heurte à des limites physiques. Pour reprendre l'exemple chinois, même avec son très ambitieux plan de construction, ce pays ne pourra modifier fondamentalement la part du nucléaire dans son bilan énergétique, qui passera de 1 % à 2 % d'ici à 2020. Comme l'a souligné M. Pierre Gadonneix, Président d'EDF, bien que la première centrale nucléaire chinoise, construite il y a vingt ans par EDF, soit un succès, moins de dix ont été implantées depuis lors et le programme chinois n'en prévoit que deux nouvelles par an. Rappelons que la France, tout petit pays en comparaison de la Chine, a construit cinq centrales par an pendant des années et en dispose aujourd'hui de cinquante-huit. Cette situation s'explique par deux facteurs. Tout d'abord, même en Chine, le problème posé par le nucléaire est celui de son acceptation par l'opinion publique. En outre, le pays ne possède pas de réserves d'uranium ; or la sécurité d'approvisionnement énergétique est une préoccupation majeure des responsables politiques chinois : ils ne développeront massivement le nucléaire que lorsqu'ils auront sécurisé leur approvisionnement en combustible - c'est du reste l'objet d'un accord passé récemment avec l'Australie. Pour toutes ces raisons, le nucléaire se heurtera à des limites physiques et les Chinois continueront de s'appuyer sur leurs ressources en charbon, qu'ils possèdent en abondance. Le cas chinois permet de comprendre qu'à terme, la sécurité énergétique ne pourra véritablement être assurée sans d'importantes innovations technologiques. Cette conclusion vaut également en matière de transports, secteur pour lequel l'énergie nucléaire n'est pas une réponse. Comme l'a fait observer M. Pierre Gadonneix, le pétrole étant « le moyen le plus simple et le plus efficace pour stocker, transporter et utiliser l'énergie, (...) le transport sera la dernière application à renoncer au pétrole : l'ultime goutte produite sur terre finira dans un avion. » A l'évidence, des percées technologiques s'imposent à terme. Associées à une politique d'efficacité énergétique et à une forte augmentation de la part des énergies renouvelables et de celle du nucléaire, elles seules permettront d'atteindre une sécurité énergétique durable, c'est-à-dire satisfaisant aux besoins énergétiques de l'humanité tout en satisfaisant aux exigences environnementales. A cette fin, il faut accroître dès aujourd'hui l'effort de recherche et développement (R&D) dans ces différents domaines : - concernant les énergies renouvelables, la R&D doit viser à en baisser le coût, qui constitue aujourd'hui un obstacle à leur développement massif ; - le nucléaire, indispensable, doit être accepté par les opinions publiques. Or, à ce jour, les propositions des gouvernements et de l'industrie nucléaire ne sont pas suffisamment crédibles concernant la gestion des déchets nucléaires. La R&D est encore nécessaire sur ce point ; - en parallèle, il faut poursuivre, en matière nucléaire, les travaux sur la génération IV, auxquels un pays comme l'Inde, par exemple, s'intéresse de très près dans le cadre du développement de son programme nucléaire. En effet, avec la filière de génération IV, celle des surgénérateurs, déjà testée avec Superphénix, qui produit davantage de matière fissile qu'elle n'en consomme, les réserves d'uranium ne seront plus de quatre-vingt ans mais de deux mille à trois mille ans, voire davantage ; - en ce qui concerne les centrales au charbon, à l'horizon de vingt à trente ans, les émissions de CO2 devront être supprimées, notamment grâce aux systèmes de captation du CO2. Les expérimentations à petite échelle de capture et de séquestration doivent donc être reproduites à grande échelle et commercialisées. LES SOLUTIONS POUR LES TRANSPORTS DE DEMAIN A soixante-dix dollars le baril, le développement de la voiture électrique redevient intéressant, surtout si la raréfaction du pétrole se confirme. Les recherches se heurtent néanmoins à une difficulté physique, la batterie : en un siècle et demi, même si des progrès ont été accomplis, nul n'a découvert de mode de stockage d'électricité facile, bon marché et peu encombrant. La voie complémentaire des véhicules hybrides rechargeables mérite d'être encouragée : ils fonctionnent sur batterie pour les besoins les plus courants des utilisateurs - quarante à cinquante kilomètres - mais sont équipés d'un moteur à essence pour accroître leur autonomie. Quant à l'hydrogène, qui n'est pas une source d'énergie mais un moyen de la transporter ou de la stocker, il est susceptible de se substituer, demain, au pétrole pour les moyens de transport. Source : Audition de M. Pierre Gadonneix devant la Mission - 16 mai 2006. b) Du côté des producteurs : débouchés et investissements garantis à long terme La sécurité énergétique n'est plus, on l'a vu, la seule préoccupation des pays consommateurs mais elle est également au cœur de la réflexion des Etats producteurs. Ils y répondent aujourd'hui massivement par la réappropriation de leurs ressources énergétiques. Les Etats producteurs tendent ainsi à se réserver l'amont de la production avec un accès unique des compagnies nationales à l'exploration-production. La décision, inattendue, de Gazprom de ne retenir aucun des partenaires étrangers en lice pour le gisement de Shtokman, annoncée le 9 octobre 2006, constitue le dernier exemple en date de cette stratégie. Cette fermeture peut être guidée par des considérations politiques (Russie) ou financières (Arabie Saoudite). Or un tel choix renvoie inéluctablement à une carence technologique et donc à une exploitation des ressources non optimale. En outre, les pays producteurs ne pourront pas rester indéfiniment fermés : en effet, devant le blocage des pays producteurs, les consommateurs chercheront à développer l'exploitation du gaz (dont l'amont est beaucoup moins fermé) ou les énergies nouvelles. Ainsi, face à la concurrence des diversifications énergétiques, les pays producteurs devront petit à petit ouvrir leur amont pétrolier ou gazier. Il convient néanmoins de donner de la visibilité aux pays producteurs, afin de leur permettre de réaliser les investissements nécessaires. De ce point de vue, la position extrêmement dogmatique, qui fut longtemps exclusive, de la Commission européenne, consistant à considérer les contrats de long terme entre consommateurs et fournisseurs comme une atteinte à la concurrence, ne saurait tenir lieu de référence dans les relations que les Etats membres de l'Union doivent développer avec leurs fournisseurs étrangers. Comme l'a rappelé en effet M. Claude Mandil, directeur de l'Agence internationale de l'énergie, « le processus de libéralisation des marchés est souvent associé, à tort, à l'idée d'un marché de contrats à court terme. Or, l'important est que ce processus permette une véritable mise en concurrence avant la signature des contrats, mais pour autant ceux-ci peuvent très bien être des contrats de long terme. Or ce sont des contrats à long terme qui permettent aux investisseurs de se lancer dans la construction de nouvelles centrales. » A cet égard, pour revenir à l'exemple russe, s'il ne saurait être question de se plier aux exigences d'un Etat qui n'hésite pas à faire un usage très politique de ses ressources énergétiques, et s'il faut vigoureusement dénoncer les choix de fermeture faits par ce pays, il n'en reste pas moins que la demande de visibilité à long terme des Russes, qui transparaît à travers leur insistance à conclure des contrats de long terme avec les consommateurs européens, doit être entendue. Elle est aussi de notre intérêt, s'inscrivant dans une démarche de sécurité énergétique. Les multinationales Repères A la faveur de la flambée des cours du pétrole, les cinq « majors » ont affiché des bénéfices historiques en 2005 : 12 milliards d'euros pour Total, 26 milliards de dollars pour Shell, 14 milliards de dollars pour Chevron, 31,9 milliards de dollars pour BP et 36 milliards de dollars pour Exxon Mobil, soit au total l'équivalent du PIB des 61 pays les plus pauvres du monde. Ces profits record posent naturellement la question du partage des revenus tirés de l'exploitation pétrolière mais également dans un contexte d'insuffisance des capacités de production, celle des investissements et de l'accès aux marchés. Ces chiffres vertigineux ne doivent en effet pas masquer le rôle désormais dominant des compagnies nationales des pays producteurs qui incarnent cette nouvelle diplomatie énergétique. A l'heure où les multinationales du secteur de l'énergie engrangent des bénéfices record à la faveur de la hausse du prix du baril de pétrole, on peut légitimement s'interroger sur leur poids effectif dans le secteur de l'énergie. Les chiffres vertigineux associés à leur activité témoignent du rôle dominant de ces compagnies dans un secteur extrêmement sensible pour les Etats, soucieux de sécuriser leur accès à des ressources à la fois stratégiques et nécessaires à leur développement économique. Pour autant, peut-on considérer les multinationales comme les seuls maîtres du jeu énergétique ? L'affirmation du rôle croissant des compagnies nationales des pays producteurs et l'émergence d'acteurs indépendants incitent à apprécier la puissance des multinationales dans un environnement en mutation. Les multinationales, que l'on dénomme communément les « majors », sont des compagnies privées que l'on distingue généralement des compagnies nationales dont le capital est détenu à plus de 50 % par leur Etat d'origine. Parmi ces compagnies nationales, certaines sont intégralement propriété de l'Etat comme la compagnie saoudienne, Saudi Aramco ; d'autres sont partiellement ouvertes aux capitaux privés comme la compagnie Petrobras dont seulement 32,2 % du capital est public mais dont la majorité des droits de vote (55,7 %) est contrôlée par l'Etat brésilien. Un classement global de ces différentes sociétés met en lumière la montée en puissance continue des compagnies nationales par rapport aux multinationales privées dont la progression a été contrainte, au début de la décennie, par l'absence de fusions-acquisitions de taille significative. Le tableau ci-après illustre cette situation où 14 des 25 premières compagnies pétrolières mondiales sont intégralement ou quasi-intégralement détenues par leur Etat d'origine tandis que trois autres sont contrôlées par l'Etat mais ouvertes aux capitaux privés.
Ces données montrent que, si les multinationales continuent à jouer un rôle déterminant dans le secteur de l'énergie - et, en particulier, sur le marché du pétrole - elles ne peuvent désormais plus être considérées comme les seuls acteurs décisifs dans la « cour des Grands de l'énergie ». A - Les multinationales ne sont plus les seuls maîtres du jeu énergétique Dès le début du XXème siècle, la position de monopole des grandes compagnies internationales a été ressentie comme une menace pour le fonctionnement du marché du pétrole et a conduit, notamment, au démantèlement spectaculaire de la Standard Oil. Pour autant, les multinationales ont continué à occuper une position dominante, contrôlant, jusqu'aux années 1960, le marché pétrolier. Cette position hégémonique a été remise en cause par la vague de nationalisations, lancée par les pays producteurs désireux de récupérer la maîtrise de leurs ressources. Ces nationalisations ont profondément inversé les rapports de force, la part nette des productions pétrolières revenant à ces compagnies n'étant plus que d'environ 15 % actuellement contre près de 60 % au début des années 1970. Afin de conserver leur poids relatif sur le marché dans un contexte d'effondrement des cours du brut (35), ces compagnies ont procédé, à partir de la fin des années 1990, à d'importantes opérations de fusion-acquisitions. Les multinationales ont ainsi cherché à améliorer non seulement leur rentabilité financière mais également leur couverture géographique. Ce phénomène de concentration a donné naissance à de nouveaux grands groupes dont les quatre plus importants au niveau mondial : Exxon Mobil (décembre 1998), BP (absorption d'Amoco en avril 1998 et d'Arco en mars 1999), Chevron Texaco (acquisition de Texaco en octobre 2000) et Total (acquisition de Petrofina en décembre 1998 et de Elf en juillet 1999). Ce regroupement a permis aux grandes compagnies pétrolières de conserver leur influence malgré la montée en puissance de concurrents offensifs comme les groupes pétroliers russes Lukoil et BP-TNK ou la compagnie gazière Gazprom. Le tableau ci-après présente les principaux indicateurs de performance des 8 grandes compagnies privées figurant dans le classement précédent des 25 premières compagnies pétrolières au niveau mondial.
Ces indicateurs mettent en évidence les principales caractéristiques des multinationales dans le secteur de l'énergie, à savoir : d'une part, un résultat net élevé au cours de la période récente avec un effort en matière d'investissement et une importante capitalisation boursière qui soumet ces compagnies à des contraintes de rentabilité financière que n'ont pas les compagnies nationales ; d'autre part, une position relativement modeste en termes de production et un faible niveau de réserves, en particulier, pour le pétrole. 1) Les résultats vertigineux des « majors » L'actualité récente a été marquée par l'annonce des résultats « historiques » des multinationales et, en particulier, des bénéfices substantiels que ces compagnies ont pu réaliser à la suite de l'envolée des cours du pétrole. Le groupe des cinq « majors » constitué par Shell, BP, Total, Chevron Texaco et Exxon Mobil, a ainsi vu son chiffre d'affaires global progresser de 55 % en deux ans, passant de 740 milliards de dollars, en 2002, à 1 150 milliards de dollars, en 2004. Parallèlement, les bénéfices ont été multipliés par 2,4, passant de 35 milliards de dollars en 2002 à 85 milliards de dollars en 2004 (36). Les nouveaux records atteints par le prix du baril continuent d'alimenter cette hausse vertigineuse. En 2005, ces cinq compagnies ont, à nouveau, affiché des résultats en forte progression par rapport à 2004 (37) : - Total a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 143 milliards d'euros, en hausse de plus de 17 %. Le résultat net ajusté du groupe s'est élevé à 12 milliards d'euros, en progression de 31 % ; - La Royal Dutch Shell a déclaré un profit net de 26 milliards de dollars (+ 4,8 % par rapport à 2004) et un chiffre d'affaires supérieur à 306 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 15 % ; - Chevron Texaco a annoncé une augmentation de profits de 6 % portant son résultat net à plus de 14 milliards de dollars et son chiffre d'affaires à 194 milliards de dollars ; - BP a affiché un résultat net de 31,9 milliards de dollars (+ 27,6 % par rapport à 2004) et un chiffre d'affaires supérieur à 253 milliards de dollars. - Enfin, Exxon Mobil a publié un chiffre d'affaires de près de 359 milliards de dollars, soit une hausse de 23,25 %, et un résultat net record égal à 36 milliards de dollars (+ 42,64 % par rapport à 2004), soit un montant équivalent à celui du PIB de la Slovaquie ou de la Croatie (38). Au total, la flambée des cours de l'or noir alimente les profits de toutes les multinationales dans des proportions telles que « les bénéfices agrégés d'Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chevron Texaco, Total et ConoccoPhilips devraient atteindre, cette année, 135 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de la République tchèque » (39). Le tableau ci-après retrace l'évolution, en valeur, des résultats des « majors » depuis 2000 :
Ces résultats record ne doivent cependant pas masquer le poids relatif des multinationales dans un secteur dominé par les « géants » que constituent les compagnies nationales des pays producteurs. Les cinq « majors » totalisent, en effet, moins de 15 % de la production mondiale de pétrole brut et de gaz naturel. Dans les deux cas, les quatre principaux producteurs sont les compagnies nationales saoudienne (Saudi Aramco), russe (Gazprom), iranienne (National Iranian Oil Co. - NIOC) et mexicaine (Pemex) qui fournissent près des deux tiers de la production totale des trente premiers groupes mondiaux. La récente envolée des cours, qui a immédiatement entraîné une exceptionnelle embellie des résultats financiers, a par ailleurs conduit à remettre en question dans certains cas - comme en Amérique latine - les termes des contrats liant les compagnies pétrolières aux Etats, notamment ceux fondés sur le système de la redevance. L'augmentation des prix du brut a en effet ravivé les préoccupations relatives au partage de la rente pétrolière. Les multinationales ont dû faire face à un durcissement des conditions contractuelles ainsi qu'à un allongement de la durée des négociations. Cette situation n'est, certes, pas nouvelle comme l'atteste l'abandon progressif du système des « joint ventures » au profit des contrats de partage de production (CPP) qui « permettent à l'Etat confronté à des difficultés croissantes pour assurer sa participation de déléguer les investissements, les coûts d'exploration, voire la mise en production à la compagnie étrangère qui reçoit en retour une partie de la production.» (40). Cette évolution a cependant été accentuée par l'attitude de certains pays comme la Russie ou le Venezuela qui ont fait le choix de restreindre l'accès à leurs ressources naturelles tout en révisant à la hausse leur fiscalité pétrolière. Dans le cas du Venezuela, la renégociation des termes des contrats passés a eu pour conséquence une diminution de la part de certaines compagnies internationales au profit de la compagnie nationale Petroleos de Venezuela (PDVSA). En Bolivie, les autorités ont emprunté une voie similaire sans que la révision des contrats avec les compagnies étrangères, implantées dans le pays, n'ait encore abouti. NATURE DES CONTRATS D'EXPLOITATION PÉTROLIÈRE ET STRUCTURE DES PRIX La récente envolée des cours du pétrole a relancé la question du partage des revenus tirés de l'exploitation pétrolière ainsi que de l'utilisation des « pétrodollars ». D'une manière générale, les règles qui régissent les contrats d'exploration et de production pétrolières peuvent faire l'objet d'une loi ou relever des clauses de confidentialité, selon les cas. Au Tchad, par exemple, c'est une loi qui régit l'affectation des recettes pétrolières et rend obligatoire la publication des conclusions d'un audit externe indépendant effectué par un collège de contrôle et de surveillance des recettes pétrolières (41). Cette initiative n'est pas isolée et plusieurs pays, notamment d'Afrique, ont manifesté leur intention de participer à l'EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) afin d'améliorer la transparence de leurs recettes pétrolières. Mais, en dépit de ces efforts de transparence, les modalités de répartition de la « rente » pétrolière restent bien souvent confidentielles dans la mesure où elles sont fixées par les contrats conclus entre le pays d'accueil et la compagnie pétrolière qui se voit confier l'exploitation d'un gisement. On distingue généralement trois grands types de contrats qui déterminent les relations entre le pays qui possède un gisement et la compagnie internationale qui l'exploite pour son compte ainsi que le partage des bénéfices qui en découle. _ Le premier type de contrat est le contrat de concession à marge fixe. Dans ce cas de figure, la compagnie internationale agit comme un opérateur chargé des investissements et de la maintenance des installations ainsi que de l'exploitation. La marge de la compagnie est fixée au départ et reste stable quelle que soit l'évolution des cours, ce qui peut s'avérer extrêmement profitable au pays d'accueil, en cas de hausse des prix du baril. En revanche, ce mécanisme ne comprend aucune incitation réelle à investir dans l'exploration. _ Le second type de contrat repose sur un mécanisme de redevance que la compagnie pétrolière verse au pays d'accueil. Là encore, il s'agit d'une régime de concession où le pays d'accueil reste propriétaire de ses ressources souterraines et où la compagnie contractante dispose du brut qu'elle extrait dans la mesure où elle réalise l'intégralité des investissements. La compagnie doit, en revanche, acquitter une redevance à l'Etat sur chaque baril qu'elle commercialise, en pourcentage des prix de vente. En outre, les résultats que la compagnie génère en fin d'exercice sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans le pays hôte. Ce système présente un intérêt certain pour le pays d'accueil dans la mesure où la charge de l'investissement est assumée par la compagnie contractante. L'ampleur de cette charge est évaluée conjointement afin que la compagnie puisse l'amortir sur la durée d'exploitation du gisement (CAPEX). Contrairement au premier mécanisme à marge fixe, la compagnie pétrolière voit ici ses résultats suivre l'évolution des cours, ce qui peut lui être très favorable en cas de hausse... mais aussi conduire à une demande de révision des termes du contrat. _ Le troisième type de contrat est le contrat de partage de production. Dans ce cas, le brut produit reste la propriété du pays hôte pour le compte duquel la compagnie pétrolière opère. Cette compagnie bénéficie de deux types de rémunération : · D'une part, un prélèvement sur les ventes du pétrole qu'elle extrait, en compensation du montant des investissements qu'elle a réalisés (« cost oil ») ; · D'autre part, une marge proprement dite qui correspond à un pourcentage de la production (« profit oil »). Afin que le pays d'accueil dispose de revenus suffisants, le « cost oil » est plafonné ; en revanche, le « profit oil », sur lequel le partage des bénéfices est réalisé, varie en fonction du niveau de production et de la rentabilité de l'exploitation. Dans ce système, le pays hôte n'engage pas de frais d'investissement ni de production et bénéficie de transferts de technologies de la compagnie contractante qui doit, par ailleurs, embaucher du personnel local. La compagnie opère clairement pour le compte de l'Etat qui devient propriétaire des capacités de production mises en place. Au total, les excédents record des multinationales s'affichent sur un marché soumis à de fortes tensions sur les capacités de production : en 2004, l'industrie a ainsi été conduite à mobiliser la quasi-totalité des capacités installées dans le monde, ne disposant plus que d'une marge de manœuvre limitée à 1 ou 2 million de barils par jour, essentiellement située en Arabie Saoudite. En cela la situation distingue nettement le choc pétrolier actuel des précédentes crises de 1973 et 1979 où les pays producteurs avaient volontairement réduit les volumes disponibles sur le marché. Aussi la hausse des prix dont bénéficient les compagnies pétrolières, ne peut manquer de soulever la question du niveau d'investissement que ces dernières consentent pour développer leur production et explorer de nouveaux gisements. Dans le contexte actuel de demande soutenue de pétrole (42), les multinationales, malgré leurs performances financières, peinent à augmenter substantiellement leur production. Les réserves d'hydrocarbures, concentrées dans un nombre limité de pays, sont principalement aux mains des compagnies nationales des Etats producteurs avec un écart significatif entre NIOC, au premier rang mondial avec 370 milliards de barils équivalents pétrole (bep), et Exxon Mobil dont les 22,5 milliards de bep la placent au 14ème rang mondial. 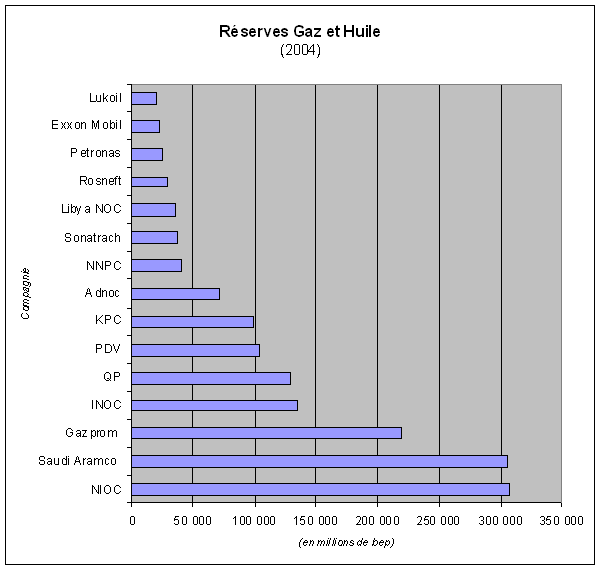 Source: The Energy Intelligence Top 100 : Ranking the World's Oil Companies - édition 2006. Qu'il s'agisse des réserves en pétrole brut ou en gaz naturel, les compagnies nationales saoudiennes, irakiennes, koweïtiennes, iraniennes et vénézuéliennes se placent très loin devant les « majors » qui possèdent moins de 5 % des réserves mondiales. L'estimation elle-même des réserves d'hydrocarbures reste délicate en l'absence de règles de comptabilisation acceptées par tous. Elle dépend également de facteurs techniques et de considérations économiques - notamment, les perspectives de prix du baril - qui en compliquent la lecture. Ces incertitudes sont à l'origine de controverses qui ont pu fragiliser les multinationales. En 2004, la compagnie Shell a ainsi provoqué un véritable scandale en procédant à des révisions successives de ses réserves prouvées (43) pour finalement conclure à une baisse de 20 %. Ces révisions ont fait peser le soupçon d'une surestimation du potentiel de nouveaux gisements et planer le spectre d'une faillite comparable à celle du groupe Enron. Lors de son audition par les membres de la Mission d'information, M. Dominique Maillart, Directeur général de la Direction générale de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Industrie, concluait que « les informations relatives aux réserves détenues par les majors cotées en bourse sont aujourd'hui fiables car elles sont très contrôlées, mais ces réserves ne représentent qu'une petite part du total, puisque ces compagnies n'assurent que 15 % de la production mondiale ; les données émanant des compagnies d'Etat, qui fournissent 85 % de la production, ne bénéficient en revanche d'aucun contrôle extérieur. L'absence d'homogénéité des méthodes utilisées est une autre source d'incertitude. Au total, les estimations des réserves ne sont jamais parfaitement satisfaisantes, mais les ordres de grandeur sont justes. » Ainsi la question des réserves fait-elle apparaître une certaine vulnérabilité des multinationales privées sur la scène énergétique mondiale. Vulnérabilité accrue par la difficulté d'accéder à certains marchés et aussi par l'implacable nécessité dans une logique de rentabilité financière de servir l'actionnaire avant d'engager des investissements importants et coûteux sur le long terme. Certains « marchés » sont totalement ou quasiment inaccessibles. Des pays, comme l'Arabie Saoudite ou le Mexique, où les sociétés nationales disposent d'un monopole pour l'exploration et la production pétrolière, sont fermés aux compagnies étrangères. D'autres pays, comme l'Iraq ou l'Iran s'avèrent, à l'heure actuelle, trop instables pour entreprendre le moindre projet et voient leur production baisser, en dépit de leur énorme potentiel. Comme l'a souligné M. Olivier Appert, Directeur de l'Institut français du pétrole (IFP), si ces compagnies réussissent encore à obtenir des marchés de gaz - produit dont l'exploitation est plus complexe et dont la commercialisation suppose un lien étroit entre le producteur et le consommateur -, « elles restent globalement à la porte des pays producteurs ». D'après les informations fournies par Total (44), les investissements mondiaux réalisés dans l'exploration et le développement ont été doublés en dix ans, pour atteindre 215 milliards de dollars, en 2005. Les cinq « majors » ont contribué à cet effort à hauteur de 47 milliards de dollars (22 %), les compagnies nationales des Etats membres de l'OPEP pour 14 milliards de dollars (7 %) et les autres compagnies nationales des pays producteurs, à hauteur de 52 milliards de dollars soit 24 % du total des investissements réalisés en 2005. L'actualité récente incite à se demander si de tels efforts sont suffisants. Les fuites apparues en mars puis en août 2006 dans le champ pétrolifère de Prudhoe Bay, en Alaska, témoigne, en effet, de défaillances de la compagnie BP dans l'entretien de ses oléoducs. A une échelle plus large, il apparaît que les capacités mondiales de raffinage étaient, en 2004, au même niveau qu'en 1980, « en partie du fait de la faiblesse de la rentabilité de cette activité pour les majors » (45). Or, l'enjeu actuel va bien au-delà de l'entretien des infrastructures existantes : il importe aujourd'hui de préparer l'avenir en développant de nouvelles capacités de production ainsi que les innovations technologiques de nature à favoriser l'utilisation de nouvelles formes d'énergie. Mais les multinationales ne sont plus les seules à disposer des technologies de pointe et doivent faire face à la concurrence de sociétés d'ingénierie comme Schlumberger et Halliburton qui proposent des prestations clés en mains. En dépit de ce manque d'opportunités et d'un renforcement de la concurrence, les multinationales représentent de très importantes compagnies cotées en Bourse. Soumises à la volonté de leur actionnariat, avant tout soucieux de la valorisation de son investissement, elles sont amenées à mettre l'accent sur la réduction des coûts afin de pouvoir procéder à une redistribution des bénéfices. Paradoxalement, leur niveau élevé de capitalisation boursière ne garantit pas toujours aux multinationales un accès privilégié aux financements : lors du rachat, en août 2005, de la compagnie Unocal, Chevron n'a ainsi pas été en mesure de renchérir sur les propositions de la compagnie nationale chinoise China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), avec une offre de 16,8 milliards de dollars contre 18,5 milliards de dollars (46). Parallèlement, confrontées à la nécessité d'accroître leurs volumes de production, les multinationales doivent s'agrandir, comme ce fut le cas à la fin des années 1990, et développer des innovations technologiques. A cet égard, l'année 2005 a connu des opérations financières de grande ampleur, similaires à celles des années 1998 et 1999 : environ 130 milliards de dollars de valeurs en réserves de pétrole et de gaz ont ainsi changé de main, avec les rachats du producteur de gaz nord-américain Burlington Resources par ConocoPhillips et de la compagnie Unocal par Chevron, ce qui a représenté une hausse de 126 % par rapport à 2004 (47). En définitive, ces exigences de rentabilité financière, d'une part, et d'investissement à long terme, d'autre part, participent de logiques contradictoires et peuvent placer les compagnies internationales dans une situation intenable, en cas de chute du prix du pétrole. L'évolution récente des cours laisse entrevoir une plus grande vulnérabilité des multinationales que leurs profits colossaux ne tendent à le faire penser. B - Les compagnies nationales des Etats producteurs sur le devant de la scène La croissance de la consommation mondiale de pétrole et de gaz se traduit par une compétition plus forte pour l'accès aux ressources ainsi qu'un pouvoir accru des pays producteurs et de leurs compagnies nationales. Ces compagnies pèsent, en effet, un poids considérable sur la production, avec une domination incontestée de la compagnie saoudienne, Saudi Aramco dont la production de pétrole s'élève à 9,8 millions de barils par jour. Lors de son audition par la Mission d'information, M. Thierry Desmarest, Président-Directeur général de Total résumait cette situation en déclarant : « les vrais géants ne sont pas les compagnies pétrolières internationales mais les compagnies nationales des pays producteurs, en Arabie Saoudite, en Russie, en Iran ou au Mexique ; s'agissant du niveau de production, Exxon Mobil descend même à la douzième place et Total à la vingt-quatrième, avec un potentiel limité à 4 % de celui des leaders saoudiens et iraniens ». » Maîtresses de la production mondiale, les compagnies nationales le sont aussi des réserves d'hydrocarbures, comme cela a été souligné précédemment. Les compagnies font donc figure de « géants » par rapport aux compagnies internationales privées. Cette position hégémonique ne doit cependant pas donner l'impression d'un bloc homogène : les structures et les stratégies de ces compagnies sont extrêmement diversifiées, en fonction des différents intérêts des Etats qui les contrôlent. Au-delà de cette diversité, leur expansion continue au cours de ces dernières années jette un éclairage nouveau sur les enjeux géopolitiques liés à l'énergie. 1) Une stature de « géants » plus ou moins autonomes Le marché pétrolier a longtemps été dominé par le modèle anglo-saxon des compagnies privées, verticalement intégrées et fortement internationalisées. Les nationalisations opérées par les pays producteurs, à partir des années 70, sont à l'origine de l'émergence d'un modèle alternatif, celui des grandes entreprises d'Etat centralisées. Au-delà de cette grande distinction, il apparaît que les compagnies nationales ont, en réalité, des structures variées qui dépendent essentiellement du degré de contrôle que l'Etat exerce sur leurs activités et leur stratégie. Lors de son audition par la Mission d'information, M. Bruno Weymuller, Directeur de la stratégie et de l'évaluation des risques de Total, a suggéré une typologie des compagnies nationales en distinguant trois catégories. La première catégorie regroupe « les sociétés nationales complètement liées aux autorités de leur pays, sous contrôle de l'Etat ». Ces sociétés ne disposent quasiment d'aucune autonomie dans la mesure où les revenus pétroliers représentent l'essentiel des recettes d'exportation qui alimentent le budget national. C'est notamment le cas des compagnies Saudi Aramco en Arabie Saoudite, PDVSA au Venezuela ou de la National Iranian Oil Corporation (NIOC) en Iran. A titre d'exemple, la compagnie Petroleos Mexicanos (Pemex), qui entre dans cette catégorie, ne dispose pas de réelle indépendance opérationnelle et contribue, de manière significative, au financement du budget de l'Etat mexicain (Pemex apporte entre 33 et 37 % des recettes fiscales fédérales). En outre, le régime spécial d'impôts auquel cette compagnie est soumise a joué au détriment de sa santé financière ; « cette contrainte a entravé la possibilité pour Pemex d'investir dans des domaines vitaux pour la bonne marche de l'entreprise tels que le renouvellement des réserves et les projets nécessaires au développement de l'industrie» (48). L'annonce récente du déclin du principal gisement de Cantarell vient pourtant confirmer la nécessité pour la compagnie mexicaine de renforcer ses investissements. La deuxième catégorie comprend les compagnies nationales qui « plus ouvertes, ont une vocation internationale plus affirmée » et dont l'objectif principal est d'approvisionner leur pays en investissant à l'étranger. Les compagnies chinoises SINOPEC (Société générale de l'industrie pétrochimique de Chine), China National Petroleum Corporation (CNPC) et China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) entrent dans cette catégorie, même si l'Etat conserve un contrôle total sur ces compagnies ainsi que l'intégralité des sièges et droits de vote dans les conseils d'administration. Enfin, la troisième catégorie est constituée de compagnies nationales dont les missions, plus ouvertes et mixtes, sont très proches des activités des grandes sociétés internationales privées. C'est le cas, par exemple, de la compagnie norvégienne Statoil qui bénéficie d'une large autonomie financière et de gestion, l'Etat n'intervenant, en principe, pas directement dans la prise de décision stratégique. Entre également dans cette catégorie la compagnie brésilienne Petrobras, détenue à un peu plus de 30 % par l'Etat qui dispose, en revanche, de la majorité des droits de vote. Contrôle public et ouverture à la concurrence résultent d'un accord politique, conclu en 1995, qui a permis à cette société de s'associer à d'autres entreprises pour exploiter les grands gisements offshore ainsi qu'à des multinationales étrangères pour chercher de nouvelles réserves dans les bassins sédimentaires du pays (49). Gérée comme une entreprise privée, Petrobras a développé une stratégie d'internationalisation de sa production : en 2004, les ventes de ses filiales à l'étranger représentaient 10,4 % de son chiffre d'affaires. Certains pays échappent partiellement à cette typologie comme la Russie où coexistent, pour l'heure, différentes formes de propriété. C'est ainsi qu'à côté du géant gazier Gazprom, dont le capital est détenu à hauteur de 51 % par l'Etat, on trouve des compagnies totalement privées comme Lukoil ou partiellement privées comme Surgutneftegaz. L'Etat s'est néanmoins assuré d'un contrôle majoritaire des actions des compagnies qualifiées de stratégiques et contrôle, au total, un peu plus de 30 % de la production pétrolière en 2006. Cette réorganisation s'est accompagnée d'un durcissement des conditions d'accès aux ressources en hydrocarbures du pays, les licences d'exploration et de développement jugées stratégiques bénéficiant, en grande partie, aux compagnies dont l'Etat est actionnaire principal (Rosneft, Gazprom) ou bénéficient de son soutien (Lukoil, Surgutneftegaz) (50). Cet interventionnisme vise à favoriser la création de grandes compagnies d'hydrocarbures intégrées (51) en fusionnant les secteurs gazier et pétrolier. Il traduit une reprise en main du secteur par l'Etat, soucieux de l'orienter en fonction de ses priorités et intérêts stratégiques. Quel que soit leur degré d'autonomie, ces compagnies dominent largement le secteur de l'énergie aussi bien pour le pétrole que pour le gaz. Au cours des cinq dernières années, elles ont connu une progression importante, qu'explique, en partie, le fort activisme des compagnies nationales des pays émergents. 2) Une expansion continue des compagnies des pays émergents La période récente a été marquée par une accélération de l'expansion des compagnies nationales, en particulier celles de pays où la demande énergétique croît le plus rapidement, comme la Chine (52) ou, dans une moindre mesure, l'Inde. Ces pays, dont la production domestique est en baisse et ne permet pas de satisfaire les besoins importants de leurs économies, cherchent, en effet, à sécuriser leur accès à des ressources, notamment pétrolières. Leurs compagnies nationales ont donc été conduites à développer une politique active d'acquisitions à l'étranger. Les compagnies chinoises figurent parmi les compagnies nationales les plus tournées vers l'extérieur, réalisant près de 40 milliards de dollars d'acquisitions (53) au cours de ces dernières années. Les quatre compagnies les plus importantes que sont Petrochina (qui fournit 65 % de la production chinoise), SINOPEC, China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) et China National Petroleum Corp. (CNPC), ont engagé des capitaux dans un grand nombre de pays, parmi lesquels le Kazakhstan, le Soudan, l'Iran, le Venezuela et la Russie, afin de diversifier leurs fournisseurs. M. Bruno Weymuller, Directeur de la stratégie et de l'évaluation des risques de Total, relève que les trois premières compagnies occupent encore une place assez faible « mais elles consacrent désormais d'énormes moyens pour leur développement international ». Le tableau ci-après retrace les opérations de prises de participation réalisées, en 2005, par ces compagnies :
La tentative de reprise de la compagnie Unocal, évoquée précédemment, a finalement échoué, suite à une intense mobilisation de certaines personnalités politiques américaines, conduisant au rachat de la neuvième compagnie pétrolière américaine par Chevron. Dans la mesure où l'offre de la compagnie chinoise CNOOC était bien supérieure à celle de Chevron, cette affaire a clairement mis en évidence « certaines limites désormais atteintes par le libéralisme et les lois du marché en matière pétrolière » (54). En revanche, dans le même temps, la compagnie CNPCI, filiale à 100 % de la China National Petroleum Corp. (CNPC), est parvenue à acquérir la compagnie PetroKazakhstan, opération qui a représenté l'investissement le plus important jamais réalisé hors de Chine. Ce fort activisme des compagnies nationales chinoises se manifeste sur tous les continents, la société CNOOC ayant récemment obtenu des droits de forage au Kenya tandis que SINOPEC participerait, aux côtés de la compagnie Rosneft, au rachat du russe Udmurtneft. Une stratégie similaire a été adoptée par la compagnie nationale indienne Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) qui a pris des participations dans quatorze pays (parmi lesquels le Vietnam, la Russie, le Soudan, l'Iran, la Libye, la Syrie, etc.), investissant environ 3,5 milliards de dollars à l'étranger (55). Appartenant à l'Etat, les compagnies nationales, sur lesquelles ne pèsent pas les mêmes objectifs de rentabilité que les multinationales, peuvent réaliser des acquisitions en fonction de critères plus souples d'investissements. Dans un entretien accordé au journal Le Monde (56), M. Robert Mabro, Président de l'Oxford Institute for Energy Studies, analysait cette marge de manœuvre supplémentaire de la manière suivante : « Les compagnies chinoises sont prêtes à explorer des pays boudés par les majors, comme le Soudan, en acceptant d'exploiter les gisements les plus difficiles et les plus coûteux. Les actionnaires des grandes compagnies exigent des taux de rentabilité de 20 % et des coûts d'exploitation relativement bas pour réduire les risques (...). Un nouveau venu peut très bien se contenter d'un taux de rentabilité de 15 % calculé sur des coûts d'exploitation plus élevés d'autant plus facilement que les cours à la vente le sont également, ce qui accroît son champ d'action. » Grâce à cette internationalisation croissante, les compagnies nationales chinoise et indienne sont désormais en mesure de fournir du pétrole et du gaz à leur marché national, ce qui confirme la volonté de leurs Etats de renforcer la sécurité de leurs approvisionnements énergétiques. Cette évolution traduit une réelle montée en puissance des compagnies nationales des pays producteurs qui incite à penser que « les vrais maîtres du monde de l'énergie siègent moins au board d'Exxon Mobil ou de Shell qu'au conseil d'administration de Gazprom ou Saudi Aramco » (57). Faut-il en conclure que les multinationales risquent, à terme, d'être totalement évincées de la scène énergétique ? De nombreuses compagnies nationales ont un faible niveau d'investissements et, encore aujourd'hui, recherchent des apports technologiques et financiers extérieurs pour développer leurs projets. C'est notamment le cas de la compagnie mexicaine Pemex qui envisage d'exploiter un gisement de gaz en eaux profondes, projet dont la réalisation nécessite une ouverture aux capitaux privés. De même, la compagnie Gazprom est actuellement fragilisée par la faiblesse de ses investissements et court le risque de ne pouvoir assumer ses projets sans un partenariat avec des compagnies étrangères disposant de la technologie qui lui fait défaut. Un espace existe donc pour la collaboration entre compagnies nationales et multinationales privées que certains Etats exploitent plus que d'autres. Qatar Petroleum (QP), par exemple, a conclu un accord avec Shell pour lancer un projet de gaz naturel liquéfié qui vient s'ajouter aux accords de plusieurs milliards de dollars qui existent déjà avec Exxon Mobil et ConocoPhillips. D'autres accords de coopération ont été signés entre la compagnie algérienne Sonatrach et BP ou encore entre la compagnie nationale indienne ONGC et Shell. Ces exemples de coopération conduisent à des transferts de savoir-faire importants qui ont permis à certaines compagnies nationales de se spécialiser dans des domaines comme la fourniture de gaz naturel liquéfié pour Sonatrach et la compagnie malaisienne Petronas. Dans le même temps, le dialogue entre compagnies nationales tend à s'intensifier pour la réalisation de projets communs comme le développement des champs pétrolifères vénézuéliens, par exemple, qui fait l'objet d'un « joint venture » entre Petroleos de Venezuela (PDV) et la compagnie chinoise CNPC. Des coopérations se mettent ainsi en place sur fond de bonnes relations entre gouvernements soucieux de renforcer leur indépendance énergétique. Parallèlement, « la crise actuelle, en favorisant une certaine prise de conscience de la gravité de la situation pour les Etats consommateurs, pourrait bien dans certains cas contribuer à resserrer les liens entre compagnies pétrolières et pouvoirs politiques » (58). 3) Des compagnies symboles de la souveraineté énergétique Puissances économiques, les compagnies nationales incarnent également la souveraineté pétrolière et gazière des pays producteurs. La nationalisation des concessions, intervenue dans les années 1970, a, en effet, inversé les rapports de force entre les multinationales privées et les pays producteurs : d'unités de production verticalement intégrées, les compagnies internationales sont devenues des « acheteurs de brut, à égale distance entre producteur et raffineur » (59) ; pour leur part, les Etats producteurs ont affirmé leur droit de propriété sur les ressources en hydrocarbures dont leur sol regorge. Parallèlement, une nouvelle logique de cartel s'est instaurée : au regroupement des « sept sœurs », les grandes majors qui dominaient jusqu'alors le marché, a succédé l'OPEP qui détient, depuis 1973, d'importants leviers de décision sur la fixation des prix du pétrole. Détenant 79 % des réserves mondiales de pétrole et réalisant environ 70 % des exportations, l'OPEP a, en effet, instauré une politique des quotas de production dont l'incidence reste décisive sur l'évolution des cours du brut. Les chocs pétroliers de 1973 et de 1979 ont illustré de manière spectaculaire l'impact de cette politique de contingentement de l'offre mais aussi les effets pervers que l'utilisation de « l'arme du robinet » (60) peut avoir. Ces deux crises ont, par ailleurs, rappelé que l'OPEP, regroupement d'Etats souverains, n'est pas un acteur uniquement économique mais aussi, et surtout, politique. Or, à partir du moment où ses membres n'avaient plus pour intérêt commun de régler leur contentieux avec les multinationales, la question de la cohésion interne de l'organisation était posée. De fait, cette cohésion est fragile et toute divergence d'intérêt entre les membres de l'OPEP est susceptible de se refléter dans l'évolution des cours, comme l'a illustré l'effondrement des prix du pétrole en 1998-1999, à la suite, notamment, du conflit entre le Venezuela et l'Arabie Saoudite (61). Le risque semble toutefois circonscrit en raison de la très grande dépendance des pays producteurs de l'organisation vis-à-vis des revenus pétroliers. Cette dépendance constitue le véritable « ciment » de l'OPEP dans la mesure où « une chute importante des prix sera jugée politiquement inacceptable à cause de ses conséquences sur les régimes en place (...) » (62). De la même manière que les Etats consommateurs s'inquiètent de la sécurité de leurs approvisionnements, les Etats producteurs revendiquent la sécurisation de leurs débouchés. Et l'enjeu n'est pas mince : l'OPEP a, en effet, vu ses revenus atteindre 513 milliards de dollars en 2005, soit une hausse de 45 % par rapport à 2004 (63) ! Dans ces conditions, on comprend que les membres de l'OPEP n'ont pas forcément intérêt au repli récent du brut (64) et envisagent de réduire leur production (65). Dans le même temps, la persistance de prix élevés fait courir le risque d'une croissance de la production hors OPEP émanant de pays comme la Russie ou de multinationales dont les budgets d'investissement sont en hausse. Ces considérations mettent en lumière toutes les ambiguïtés de « l'arme du robinet » qui suppose, de surcroît, l'instauration d'une discipline de production, difficile à faire respecter. Elles ont conduit certains à s'interroger sur l'utilité de l'OPEP dans un contexte de prix élevés et de faibles capacités excédentaires de production de ses membres. Au cours de la période récente, l'OPEP ne disposait, en effet, que de très peu de capacités inutilisées (inférieur à 0,5 Mb/j) ne permettant pas de détente des cours et exacerbant le moindre problème d'approvisionnement sur un marché extrêmement tendu. En définitive, même si son rôle reste déterminant, l'OPEP ne paraît plus aujourd'hui en mesure de dominer la scène énergétique mondiale, comme elle a pu le faire dans les années 1970. L'heure semble être davantage au regain du nationalisme énergétique : les égoïsmes nationaux s'affirment à travers une volonté des pays producteurs de reprendre en main l'utilisation de leurs ressources en hydrocarbures ainsi que les profits qu'ils peuvent en tirer. Au Venezuela, par exemple, le Président Hugo Chavez a révisé la fiscalité pétrolière et contraint les compagnies pétrolières exploitant des gisements marginaux à céder leur majorité à la compagnie nationale PDVSA tandis qu'en Bolivie, le Président Evo Morales a ordonné la reprise du contrôle des champs de gaz du pays. Pour sa part, le Président Vladimir Poutine s'est montré intransigeant sur la gestion de la manne gazière russe en réaffirmant le monopole de Gazprom sur le transport de gaz. A cette exigence des Etats producteurs d'une redistribution des revenus pétroliers et gaziers qui leur soit plus favorable s'oppose la volonté des Etats consommateurs de sécuriser leurs approvisionnements. Chaque Etat est donc conduit à développer une « diplomatie énergétique » qui n'est, certes, pas nouvelle, mais se durcit à l'heure où les ressources en hydrocarbures se font plus rares et où leurs prix s'envolent. Et M. Jeroen Van der Veer, Président-Directeur général de Shell de conclure : « Plus les prix du pétrole et du gaz augmentent, plus on pense en termes nationaux. C'est une réalité nouvelle. A la fin, les gouvernements sont toujours le patron » (66). ______ Le Moyen-Orient : des Etats fragiles Repères En 2004, le Moyen-Orient possédait près des deux tiers des réserves mondiales prouvées de pétrole et 40 % des réserves de gaz naturel. Mais il assure seulement 30 % de la production mondiale de pétrole et 10 % de celle de gaz naturel. La consommation d'énergie y est encore faible (6 % du pétrole et 8 % du gaz consommé dans le monde), mais elle augmente rapidement. Situé aux confins de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie, le Moyen-Orient occupe une position centrale qui lui permet d'alimenter tous les continents en hydrocarbures (cf. carte à la fin de l'exposé sur le Moyen-Orient). Si près des deux tiers des exportations pétrolières de la région sont à destination de la zone Asie-Pacifique, une part non négligeable bénéficie à l'Europe et une autre aux Etats-Unis. Mais, à la suite de la réussite de leur politique de diversification géographique, ceux-ci ne se fournissent au Moyen-Orient qu'à hauteur d'environ 15 % de leur consommation, dont plus de la moitié provient d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, le Moyen-Orient ne produit ni n'exporte un volume d'hydrocarbures à la hauteur des réserves dont il dispose. Cette situation est en partie le résultat de choix politiques et économiques, en partie la conséquence de contraintes internes aux différents pays. La région est composée d'Etats qui présentent des caractéristiques très contrastées, depuis les minuscules monarchies comptant quelques centaines de milliers d'habitants à la vaste République islamique d'Iran peuplée de plus de 70 millions de personnes. Mais tous présentent, à un degré plus ou moins élevé, une dépendance vis-à-vis des exportations pétrolières. MM. François Loncle et Axel Poniatowski ont été chargés par les membres de la Mission d'information d'analyser les enjeux énergétiques au Moyen-Orient. Ils ont choisi d'effectuer un déplacement en Iran, où contrairement au Golfe persique, l'avenir proche, politique comme économique, est très incertain. C'est essentiellement à cause du dossier nucléaire que la République islamique est aujourd'hui au premier plan des préoccupations de la communauté internationale, mais son poids actuel et futur sur la scène des hydrocarbures joue un rôle essentiel dans le positionnement des différents Etats vis-à-vis de cette crise. Quoiqu'il présente des particularités par rapport aux autres grands pays producteurs d'hydrocarbures de la région, l'Iran s'avère un exemple riche et très intéressant pour une étude sur les rapports entre géopolitique et énergie. La question centrale concernant le Moyen-Orient est celle de la place que cette région occupera dans l'avenir parmi les producteurs de pétrole et de gaz : alors que les spécialistes annoncent une nouvelle concentration de l'offre pétrolière au profit de cette région, les Etats producteurs sauront-ils surmonter leurs fragilités internes et externes pour répondre à l'augmentation de la demande ? Pour ce qui est du gaz, dont les réserves sont mieux réparties à travers le globe, le Moyen-Orient parviendra-t-il à renforcer sa place parmi les zones de production ? Les développements qui suivent relatifs à l'Iran se fondent en grande partie sur les informations et les éléments recueillis par MM. Loncle et Poniatowski qui ont effectué dans le cadre de la Mission d'information un déplacement en Iran en septembre 2006. A -Le Moyen-Orient bientôt en situation de monopole sur le marché pétrolier ? Malgré les efforts réalisés, depuis les années 1970, par les pays importateurs de pétrole pour diversifier leurs fournisseurs, le Moyen-Orient ne va pas seulement rester un producteur incontournable, mais, étant donné l'importance de ses réserves, il devrait logiquement voir croître sa part dans la production et l'exportation. Mais cet enchaînement logique pourrait se heurter à la réalité des situations politiques et économiques des pays de la région. 1) Près des deux tiers des réserves prouvées de pétrole sont situés au Moyen-Orient En 1944, les Etats-Unis détenaient 40 % des réserves mondiales de pétrole, le Moyen-Orient 30 %, l'Union soviétique et l'Amérique du Sud (essentiellement le Venezuela) se partageant la part restante. Aujourd'hui, le Moyen-Orient disposerait de 63,3 % des réserves mondiales prouvées, très loin devant les autres régions du monde, qui en possèdent chacune moins de 10 %. Les cinq pays qui possèdent les réserves de pétrole les plus importantes sont situés dans le Golfe persique :
Au rythme actuel de production, les réserves prouvées de l'ensemble du Moyen-Orient équivalent à quatre-vingt-dix années d'exploitation. Régulièrement réévaluées à la hausse - ce qui a encore été le cas en mars 2005, après de nouvelles découvertes qui les ont portées à 137 milliards de barils -, les réserves iraniennes assurent au pays environ cent ans de production, au taux d'extraction actuel. Elles sont localisées à hauteur de 90 % on shore, au sud-ouest du pays, dans les provinces du Lorestan et du Khouzestan ; les 10 % restant sont situées offshore, dans le Golfe persique. Aux réserves prouvées s'ajoutent des réserves probables, en mer Caspienne, estimées entre 20 et 40 milliards de barils. La richesse pétrolière iranienne est considérable, et ne s'épuisera pas de sitôt. Ainsi, même si l'importance des réserves dans un pays ne se traduit pas nécessairement par un haut niveau de production, la concentration des réserves au Moyen-Orient permettra à cette région de continuer à produire du pétrole en grande quantité dans l'avenir. 2) La production du Moyen-Orient devrait, théoriquement, augmenter Entre 1945 et 1973, la part du Moyen-Orient dans la production mondiale est passée de moins de 10 % à 37 %. Les deux hausses brutales du prix du pétrole en 1973 et 1979 ont entraîné une baisse de la demande et permis l'exploitation de ressources situées dans les pays n'appartenant pas à l'OPEP, qui n'était pas rentable auparavant. Si, en 1979, les pays de l'OPEP assuraient près de 50 % de la production, cette part ne dépassait guère 30 % en 1985. Mais, depuis les années 1990, ce sont les pays du Moyen-Orient qui ont, pour l'essentiel, répondu à l'augmentation de la demande. L'Arabie Saoudite a par exemple accru progressivement sa production d'un quart, tandis que l'épuisement de leurs réserves conduisait les Etats-Unis à réduire la leur de 15 %. En 2000, les dix premiers producteurs ont fourni 70 % du total mondial réparti entre l'OPEP (41,5 %), l'OCDE (28 %), l'ancienne Union soviétique (11 %) et le reste du monde (19,5 %). En 2003, le Moyen-Orient produisait 29,6 % du pétrole mondial, alors qu'il détenait 63,3 % des réserves. Mais l'AIE prévoit une augmentation de la part de la production du Moyen-Orient dans les prochaines années : elle devrait atteindre 33,3 % en 2010 et 48,3 % en 2020, ce qui correspondrait à un doublement de sa production totale entre 2000 et 2020. Cette production, actuellement de l'ordre d'un milliard de tonnes par an, devrait encore augmenter dans la décennie suivante pour atteindre 2,5 milliards de tonnes en 2030. Ces estimations reposent sur un certain nombre d'incertitudes, en particulier les nouvelles découvertes de pétrole, le développement de la production de pétrole non-conventionnel et l'évolution du prix du pétrole. Mais la tendance à la reconcentration de la production est présentée comme incontournable par de nombreux spécialistes : « (...) l'importance des réserves de cette région, la stabilisation ou la diminution de la production non-OPEP rendent inéluctable, à plus ou moins brève échéance, une remontée de la part du Golfe dans la production mondiale à certainement plus de 40 % ». (67) Ce raisonnement repose sur l'idée que, les réserves de pétrole situées dans le reste du monde s'épuisant progressivement, celles que renferme le Moyen-Orient devront être utilisées pour satisfaire des besoins croissants. Or, rien ne garantit que cet enchaînement logique se réalisera. M. Pierre Noël, responsable des études sur l'énergie à l'IFRI, a, devant la Mission, contesté le caractère inévitable de cette reconcentration de l'offre : « Notre dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient est un phénomène largement exagéré. Cette région n'a pas produit depuis quarante ans plus de pétrole que les pays de l'OCDE, même si le Moyen-Orient dispose de ressources bien plus importantes. Depuis plusieurs décennies on prédit que le Moyen-Orient va s'imposer dans le jeu mondial en raison de sa capacité à produire du pétrole ; on constate que cette prophétie ne se réalise pas et que cette région continue de représenter 30 % de l'offre mondiale, ni plus ni moins. Par ailleurs on observe un processus de diversification de l'offre de pétrole ce qui a conduit à une relativisation du poids des pays producteurs les plus importants et de l'OPEP. De nombreux producteurs de taille moyenne sont apparus sur la scène internationale. En fait le problème de concentration de l'offre que l'on dénonce ou que l'on craint ne correspond pas à la réalité. Du point de vue de la diversification de l'offre pétrolière, on pourrait se satisfaire du maintien de l'état actuel des choses. » Il considère « qu'il existe une relation inverse entre l'évolution [du] prix [du pétrole] et la production du Moyen-Orient » et que « plus le prix de ce produit augmentera plus nous pourrons nous affranchir de notre dépendance à l'égard de cette région. » En effet, il souligne que l'augmentation du prix du pétrole permet de rentabiliser l'exploitation de ressources pétrolières dans d'autres régions du monde. On pourrait lui objecter que cette réalité théorique ne se traduit pas immédiatement dans les faits, notamment à cause de l'importance des investissements nécessaires à toute nouvelle exploitation, laquelle est encore plus élevée pour les ressources à l'exploitation complexe. Mais, de même, sans des investissements considérables, le niveau de la production du Moyen-Orient n'atteindra jamais les prévisions de l'AIE. M. Pierre Noël affirme ainsi dans un article récent que « la principale raison pour laquelle la concentration sur le Moyen-Orient pourrait ne pas se produire est la stagnation, ou la croissance très limitée, des capacités de production du Golfe persique » (68), qui serait la conséquence d'un sous-investissement dans l'industrie pétrolière de la région. Il reconnaît ainsi la pertinence du schéma d'évolution défendue par l'AIE, tout en conditionnant sa réalisation à un niveau d'investissement suffisant. La fragilité de la plupart des pays exportateurs de pétrole de la région conduit à douter que cette condition soit remplie dans les prochaines années, et ce d'autant plus que l'augmentation de la production n'est pas nécessairement dans l'intérêt des Etats concernés. La réalisation des projections économiques fondées sur une réalité physique (la part des réserves présentes dans la région) se heurte en effet à la situation économique, politique et géopolitique des pays exportateurs de pétrole. B - Des pays exportateurs fragiles Alors que le Moyen-Orient pourrait produire plus de pétrole qu'il ne le fait, ce sont actuellement les incertitudes relatives au maintien de son niveau de production et d'exportation qui inquiètent les pays consommateurs et contribuent aux prix élevés des hydrocarbures. Les pays de la région producteurs de pétrole, dont aucun n'est véritablement démocratique, présentent des risques d'instabilité interne et externe, qui ne favorisent pas la réalisation des investissements dont le secteur pétrolier a besoin. 1) Des pays très dépendants des exportations pétrolières Si les gros consommateurs d'hydrocarbures se plaignent de leur dépendance vis-à-vis des pays producteurs, et en particulier du Moyen-Orient, les pays exportateurs sont quant à eux dépendants des recettes pétrolières. M. John V. Mitchell affirme même que « la dépendance des pays exportateurs vis-à-vis du commerce pétrolier est en réalité plus grande que celle des pays importateurs ». (69) En effet, l'augmentation du prix du pétrole entre 2002 et 2005 n'a représenté que 1,24 % du PIB mondial, mais 33,2 % du PIB des exportateurs de pétrole. Les revenus provenant de l'exportation des pays de l'OPEP auraient augmenté de 43 % entre 2004 et 2005. En 2004, les paiements du compte courant (revenus des biens, services, transferts et investissements réels) étaient couverts par les exportations pétrolières à hauteur de 68 % en Iran, 53 % au Koweït, 67 % en Arabie Saoudite et 71 % aux Emirats arabes unis. Cette forte dépendance constitue un défi pour les pays du Golfe persique : ils doivent protéger leur capacité à importer les biens et services étrangers nécessaires à la poursuite de la croissance de leur économie, malgré les fluctuations des revenus des exportations pétrolières, lesquelles sont liées aux prix internationaux et à la demande mondiale. En outre, la croissance rapide de la demande intérieure de pétrole, observée chez tous les principaux exportateurs, va contribuer à réduire les volumes destinés à l'exportation et leurs recettes. Ces pays se trouvent confrontés à la nécessité de développer leur économie non pétrolière, ce qui est aussi un moyen de créer des emplois alors que l'industrie pétrolière requiert une main-d'œuvre peu nombreuse. Mais les possibilités d'un tel développement ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Certains, comme le Koweït et Abou Dhabi, ont mené depuis des années une politique délibérée d'investissements à l'étranger pour remplacer les actifs pétroliers à mesure qu'ils se réduisaient. L'Iran a créé en 2000 un fonds de stabilisation pétrolier initialement destiné à prévenir un éventuel retournement des cours du brut (80 % des recettes d'exportation iraniennes proviennent de la vente de brut) et à aider au financement du secteur privé. Mais il s'avère que ce fonds a été dévoyé de son objet initial et qu'il finance des dépenses du gouvernement, les importations de produits raffinés (qui ont représenté 4,5 milliards de dollars en 2004-2005 et sont estimées à 5,4 milliards de dollars pour 2005-2006), indispensables pour combler le déficit de la capacité de raffinage du pays, et surtout le déficit public (de 4,7 milliards de dollars en 2004-2005 et 8 milliards de dollars en 2005-2006). Le FMI a ainsi observé que, en 2005-2006, ce fonds a été utilisé pour financer des dépenses publiques pour un montant six fois supérieur à celui investi dans des projets productifs du secteur privé. Pour l'année en cours, ce rapport serait de dix pour un. La réalisation de promesses électorales relatives à la redistribution de la manne pétrolière explique largement cette situation, qui témoigne des difficultés rencontrées dans la gestion des recettes pétrolières, y compris lorsqu'elles sont en progression rapide. Grâce à ses ressources minérales, agricoles et industrielles et à sa main-d'œuvre bien formée, l'Iran possède néanmoins des atouts pour parvenir à diversifier son économie et ses exportations. Le gouvernement libéralise progressivement l'économie, accueillant des investissements étrangers dans de nombreux secteurs non stratégiques. Mais l'équivalent de 10 % du PIB non pétrolier est dépensé en subventions sur les prix du fuel, ce qui grève les finances publiques et rend illusoires les tentatives de réduction de la demande intérieure grâce aux économies d'énergie (70). Un système visant à limiter le volume de carburant à bas prix dont chaque Iranien pourrait bénéficier est néanmoins à l'étude. La plupart des autres pays du Golfe ont déjà réduit les subventions de ce type et le boom pétrolier y a ouvert de nouvelles perspectives de développement économique. Mais le marché du travail présente des spécificités qui freinent le développement de ce secteur. En 2000, les expatriés représentaient respectivement 82 %, 90 % et 56 % de la force de travail au Koweït, aux Emirats Arabes Unis et en Arabie Saoudite. Dans ce dernier pays, les deux tiers de la force de travail du secteur privé sont des étrangers. Ces travailleurs sont dans leur grande majorité sous-payés et exercent des métiers nécessitant peu de compétences. La production locale est donc fondée sur une faible valeur ajoutée découlant du travail peu cher d'expatriés. La diversification des productions ne sera donc pas facile à réaliser, pas plus que le sera la création de recettes publiques non pétrolières, qui ne peuvent provenir que de la mise en place de nouvelles taxes. En revanche, il semble que la plupart des pays exportateurs de pétrole ont profité des prix élevés du pétrole et du gaz en 2005 pour rembourser leur dette interne et externe et pour accumuler des capitaux financiers. Selon le FMI, les pays exportateurs de pétrole d'Asie centrale et du Moyen-Orient (71) n'ont dépensé en moyenne que 30 % de leurs recettes supplémentaires, qui représentaient 50 milliards de dollars en 2003, 126 milliards de dollars en 2004 et 289 milliards de dollars en 2005, soit un revenu supplémentaire annuel moyen équivalent à 17,5 % de leur PIB total. Plus du quart de ce revenu supplémentaire aurait été investi. Globalement, les autorités des pays exportateurs de pétrole de la région ont été prudentes, et ont largement économisé ces recettes supplémentaires, ce qui n'avait pas été le cas lors des précédents chocs pétroliers de 1974-1976 et 1979-1982. Même si ces réactions ne sont que de court terme, elles contribuent à réduire la fragilité des économies de ces pays. 2) Un niveau d'investissement insuffisant Dans l'intérêt de la stabilité du marché pétrolier, il serait urgent qu'une partie des revenus supplémentaires procurés par la hausse des cours soit investie dans le secteur pétrolier lui-même, qui souffre de sous-investissement depuis plusieurs années. L'insuffisance des investissements d'exploration-production priverait les pays consommateurs de 5 millions de barils par jour, et, en dépit de la croissance soutenue de l'investissement dans le secteur parapétrolier, dénotant la mise en exploitation de nouveaux gisements, les capacités de production et de raffinage peinent à répondre à la demande. Pour que les prévisions établies par l'AIE (2,5 milliards de tonnes produites au Moyen-Orient en 2030) se réalisent, la région devra accroître sa production de plusieurs dizaines de millions de tonnes par an tout en remplaçant une bonne part de la production actuelle issue de gisements qui vont naturellement s'épuiser. Cela coûtera des centaines de milliards de dollars. Qui sera à même et aura la volonté d'effectuer de tels investissements ? Dans la plupart des pays du Golfe, une société nationale jouit du monopole de l'exploration et de la production, mais l'essentiel des revenus pétroliers est reversé au gouvernement et finance le budget de l'Etat, ce qui limite la capacité d'investissement de la compagnie publique. En outre, dans ces pays, au premier rang desquels l'Arabie Saoudite, les décisions de production et les plans d'investissement répondent aux stricts intérêts nationaux. Or, même s'il en a les moyens financiers, l'Etat n'a pas nécessairement intérêt à développer la production de pétrole, au risque de faire baisser les prix. Etant donné le niveau actuel de ces derniers, l'ouverture des frontières aux capitaux internationaux n'est pas non plus perçue comme intéressante. M. Claude Mandil, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a indiqué à la Mission que la faiblesse des investissements réalisés par les pays producteurs était « en partie due au fait que ces pays ont peu de raisons de faire des dépenses importantes dans un secteur qui leur rapporte déjà beaucoup, surtout si ces dépenses avaient pour conséquence un épuisement plus rapide de leurs réserves ». L'Iran est particulièrement touché par ce sous-investissement, auquel il souhaiterait mettre un terme. Sa production était en 2005 de 4,08 millions de barils par jour, pour une capacité officielle de 4,2 millions de barils par jour ; elle reste donc dans les faits inférieure au quota fixé par l'OPEP de 4,11 millions de barils par jour. Dans l'ensemble, les 32 champs pétroliers sont âgés et souffrent de problèmes techniques. En l'absence, ces dernières années, d'investissements significatifs de modernisation, d'aménagement et de récupération assistée, leurs productions déclinent annuellement de 7 à 8 % on shore et de 13 % off shore, soit une perte de capacité estimée par l'AIE à 350 000 barils par jour. Cette situation n'empêche pas les autorités iraniennes de fixer des objectifs très ambitieux d'augmentation de la production d'un million de barils supplémentaires par jour entre 2005 et 2010, puis d'encore 2 à 3 millions de barils supplémentaires par jour au cours des dix années suivantes. Alors que ces objectifs exigeraient des investissements estimés à 55 milliards de dollars à l'horizon 2015, aucun projet visant à accroître les capacités iraniennes de production ou de raffinage n'est en cours de réalisation. Le pays n'attire guère les capitaux étrangers dans la mesure où sa constitution, dans laquelle est inscrite la souveraineté nationale sur les ressources en hydrocarbures, a jusqu'ici été interprétée comme n'autorisant que des contrats de « buy back » d'un faible intérêt financier pour les investisseurs étrangers. En l'absence de transfert de propriété, ils s'apparentent plus, pour les sociétés occidentales, à un contrat de service doublé d'une prise de risque financier qu'à un investissement direct. Malgré la volonté des majors multinationales et des grandes compagnies publiques étrangères d'être présentes en Iran, seuls huit contrats de ce type ont été conclus à ce jour car ils n'encouragent pas les relations de long terme entre la compagnie nationale iranienne, la NIOC, et les sociétés étrangères et car les marges accordées à celles-ci sont constamment réduites, tandis que les contraintes s'accroissent. Conscient de ces freins, le gouvernement a, depuis 2005, autorisé la NIOC à négocier avec des compagnies étrangères des contrats d'exploration-développement, dans des conditions qui demeurent très encadrées et seulement dans certaines régions du pays. Les contrats de partage de production ne sont toujours pas autorisés. De grands projets de développement et de raffinage sont en discussion, mais aucun n'a encore été signé. Il semble en effet que les autorités iraniennes éprouvent toujours des difficultés à achever une négociation pour conclure un accord, puis à respecter les termes de celui-ci. L'Iran apparaît comme le pays du Moyen-Orient dans lequel il est le plus difficile pour les compagnies étrangères d'investir et de travailler, mais le besoin d'investissements existe dans la plupart des pays producteurs de la région. Cette situation est pénalisante pour les producteurs dans leur ensemble, comme pour les consommateurs. La faiblesse de la capacité excédentaire prive les premiers, et en particulier ceux du Moyen-Orient, du pouvoir qu'ils détenaient auparavant de fixer les prix du pétrole au niveau qui leur semblait le mieux adapté à leurs propres besoins. Elle donne aux seconds le sentiment que leur approvisionnement peut être menacé par le moindre incident touchant les installations de production, de transformation ou de transport du pétrole. Or, si la forte dépendance des pays exportateurs de pétrole par rapport aux revenus pétroliers rend peu vraisemblable une interruption durable des approvisionnements pétroliers de leur propre fait, une interruption accidentelle partielle est toujours possible, qu'elle soit causée par des problèmes techniques, par une catastrophe naturelle ou par une crise politique. La guerre en Irak en a donné un exemple récent, mais d'autres menaces planent sur le Moyen-Orient. 3) Une région à l'instabilité chronique Si la présence de pétrole dans une région du monde n'induit pas nécessairement le développement de troubles politiques, elle tend souvent à attiser les tensions ayant d'autres causes. Telle est la situation au Moyen-Orient. Les invasions ou tentatives d'invasion du Koweït par l'Irak, en 1961 et en 1990, traduisaient notamment le lourd contentieux qui opposait les deux pays sur la question de l'exploitation du champ pétrolier de Rumailah, la surproduction pétrolière chronique du Koweït et le règlement de la dette irakienne aux pays du Golfe. Sans qu'ils conduisent à des conflits armés, les désaccords territoriaux liés à la possession des ressources pétrolières se sont multipliés depuis l'accession à l'indépendance des Etats de la région, du fait de la proximité des gisements et de l'imprécision des frontières entre les nouveaux Etats. Des zones neutres ont dû être délimitées entre l'Arabie Saoudite et le Koweït, d'une part, en 1965, et entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, d'autre part, en 1975, ce qui permet le partage des ressources pétrolières sans trancher les différends territoriaux. Le royaume saoudien a aussi connu des conflits frontaliers avec les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Yémen. Quant à l'Iran, il est en désaccord avec les Emirats Arabes Unis à propos de la délimitation de leurs eaux territoriales respectives. Le conflit israélo-palestinien alimente les tensions dans la région. En 1973, les Etats arabes producteurs de pétrole du Golfe, emmenés par l'Arabie Saoudite, ont utilisé l'arme de l'embargo sur les livraisons pétrolières à destination des Etats-Unis et d'autres pays, parce que ceux-ci soutenaient politiquement et militairement Israël pendant la guerre du Kippour. Il est peu probable que les Etats arabes recourent à nouveau à cette arme, mais ils doivent tenir compte du sentiment de solidarité de leurs populations à la cause palestinienne. Dans la mesure où des prix bas sont considérés comme un privilège accordé aux consommateurs, la persistance des tensions entre Israël et les Palestiniens entretient un niveau des prix élevé, tandis que leur accentuation périodique contribue à faire atteindre des sommets aux cours du brut. Ces tensions s'accompagnent aujourd'hui du risque terroriste. Le terrorisme fondamentaliste islamiste pourrait en effet s'attaquer aux installations pétrolières pour déstabiliser les pétromonarchies jugées compromises avec les intérêts américains. L'Arabie Saoudite est particulièrement menacée : après une campagne d'attentats visant à renverser la famille régnante, les services de sécurité saoudiens ont déjoué en février 2006 un projet d'attentat suicide contre le site pétrolier d'Abqaïq, premier centre mondial de traitement du brut par lequel transitent les deux tiers de la production pétrolière du royaume. S'il avait réussi, cet attentat aurait gravement perturbé l'approvisionnement du marché mondial de pétrole. En plus du risque terroriste, qui pèse à des degrés divers sur l'ensemble de l'infrastructure pétrolière et sur tous les pays, les inquiétudes relatives à la stabilité de l'approvisionnement pétrolier concernent actuellement surtout deux pays : l'Irak, dont la situation de guerre civile ne favorise pas le retour au plein régime de production, et l'Iran, qui pourrait se voir infliger des sanctions économiques à cause de son refus de cesser l'enrichissement de l'uranium. Nous n'aborderons pas ici la question polémique relative aux motivations de l'intervention militaire américaine pour ne présenter que les implications de ce conflit sur le marché pétrolier. L'Irak possède 10 % des réserves pétrolières mondiales, qui ne sont exploitées qu'à hauteur d'environ 20 %, et 5 à 6 % des réserves de gaz, encore moins exploitées. Sa production était de 3,5 millions de barils par jour en 1989, de 2,8 millions en 2001 (soit 3,3 % de la production mondiale) et de moins de 2 millions en avril 2002. La réduction de la production consécutive à la guerre n'a pas été compensée par une hausse des productions saoudienne, koweïtienne et émirati, contrairement à ce qui s'était passé à l'occasion des conflits précédents. En cas de retour à une situation normalisée, l'Irak pourrait rapidement revenir à une production de 3,5 millions de barils par jour et atteindre 4,5 millions de barils par jour deux ans plus tard. A terme, ses capacités de production sont estimées entre 6 et 7 millions de barils par jour, quand l'Arabie Saoudite produit actuellement 8 millions de barils par jour. Mais un tel niveau de production ne pourra être atteint que si sont réalisés des investissements estimés par les industriels à 45 milliards de dollars sur dix ans. Ils sont nécessaires à la remise en route puis à un nouveau développement de l'industrie pétrolière. Dès juillet 2003, 1,6 milliard de dollars étaient consacrés à la relance de la production, qui a retrouvé son niveau de 2,8 millions de barils par jour fin 2003, malgré les difficultés rencontrées, en particulier à cause de l'usure des installations anciennes, qui ont été utilisées intensivement pendant les années d'embargo. Les contrats signés avant 2003 entre des compagnies occidentales non-américaines et le régime irakien ont été remis en cause par l'administration militaire américaine et le conseil de gouvernement irakien, tandis que les groupes, principalement anglo-saxons, qui ont témoigné de leur intérêt pour les marchés pétroliers ont renoncé à investir dans le pays tant que les conditions de sécurité ne seront pas améliorées. S'il ne faut donc pas espérer qu'une forte progression de la production irakienne vienne rapidement détendre le marché pétrolier, il est à craindre au contraire que celui-ci ne soit déséquilibré par la situation en Iran. Le marché pourrait en effet difficilement se passer des 3,5 à 4 millions de barils de pétrole que l'Iran produit chaque jour depuis 1999, surtout dans un contexte de faible production en Irak. Or, le refus de l'Iran de se plier aux contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique et d'interrompre ses activités d'enrichissement de l'uranium conformément aux exigences formulées par le Conseil de sécurité des Nations unies risque d'entraîner la prise de sanctions, qui auront des conséquences sur le marché pétrolier. Les sanctions économiques décidées unilatéralement par les Etats-Unis au milieu des années 1990 (72) défavorisent déjà les investissements étrangers en Iran, mais elles n'ont pas empêché, sous les réserves mentionnées plus haut, la conclusion de contrats avec certains grands groupes multinationaux et n'ont pas eu d'effets directs sur la production de pétrole. La situation pourrait se dégrader si de nouvelles sanctions économiques étaient prises, sans parler des conséquences d'une éventuelle intervention militaire américaine, qui détruirait les infrastructures pétrolières du pays. Bien que cela le priverait de ses recettes à l'exportation, l'Iran pourrait aussi décider d'utiliser l'arme pétrolière contre l'Occident, en cessant d'alimenter le marché, voire en bloquant le détroit d'Ormuz, par lequel transitent aujourd'hui 20 % du pétrole consommé dans le monde (73). Dans la mesure où les exportations iraniennes (2,4 millions de barils par jour en 2005) sont supérieures à la capacité excédentaire de l'Arabie Saoudite (1,5 million de barils par jour), il ne serait pas possible de compenser rapidement l'interruption des exportations iraniennes, ce qui entraînerait une nouvelle hausse du prix du brut. Cette situation contribue à expliquer la prudence diplomatique de certains Etats, comme la Chine ou le Japon, qui sont fortement dépendants du pétrole iranien. Ainsi, il n'est pas acquis que les pays du Moyen-Orient puissent augmenter leur participation à la satisfaction de besoins pétroliers mondiaux croissants dans les proportions que leurs réserves suggèrent. S'ajoute au défi que constitue pour eux la consolidation de leur place sur le marché du pétrole un second défi, celui du développement de leurs capacités de production et d'exportation de gaz naturel. C - Le Moyen-Orient, prochain fournisseur mondial de gaz naturel ? Le fait que l'industrie du gaz se soit développée sur la base de contrats de longue durée et dans le cadre de marchés régionaux (Amérique du Nord, Europe et Asie) explique l'absence d'un marché mondial du gaz naturel, comparable au marché du pétrole. La hausse des échanges internationaux de gaz, conséquence de la croissance de la demande partout dans le monde et d'une baisse de la production en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que le développement du gaz naturel liquéfié, qui facilite le transport du gaz, contribuent néanmoins à une certaine mondialisation du commerce de cet hydrocarbure. M. Jean-François Cirelli, Président-Directeur général de Gaz de France, a ainsi expliqué à la Mission, lors de son audition, que « à l'horizon 2030, c'est donc une globalisation des marchés gaziers qui se profile, caractérisée par une part importante du GNL dans les flux (50 % du commerce inter-régional). Cette globalisation va donner un rôle majeur à la zone du Moyen-Orient, qui se situe à la croisée des chemins entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. » Les pays du Moyen-Orient détenant une part importante des réserves de gaz, ils devraient être amenés à jouer un rôle déterminant dans ces échanges, mais il n'est pas sûr que les conditions politiques et économiques le leur permettent. 1) L'importance des réserves de gaz dans les pays du Moyen-Orient Si les réserves de gaz naturel sont géographiquement moins concentrées que les réserves de pétrole, elles se situent néanmoins à hauteur de 40 % au Moyen-Orient. En 2004, le ratio réserves sur production de gaz naturel dans le monde était de l'ordre de 65 ans, mais il dépassait 200 ans pour le Moyen-Orient, à la suite de la découverte de nouveaux champs gaziers et de la réévaluation des champs existants en Iran, en Arabie Saoudite et au Qatar. Ces trois pays et les Emirats Arabes Unis possèdent 90 % des réserves prouvées de la région ; 70 % de ces réserves sont situées en Iran et au Qatar. Avec 27 500 milliards de mètres cubes, l'Iran possède 18 % des réserves mondiales de gaz. Les deux tiers de ces réserves sont off shore, souvent à la frontière maritime avec les monarchies du Golfe, à l'exemple du champ de South Pars, le plus important du pays, partagé entre l'Iran et le Qatar. 2) Un gaz réservé à la consommation intérieure Mais la place des pays du Moyen-Orient parmi les producteurs de gaz, d'une part, les exportateurs, d'autre part, n'est pas à la hauteur de leurs réserves. Même si les exportations de gaz y ont décuplé entre 1994 et 2004, la région n'assure que 5,6 % des exportations mondiales ; sa part dans la production mondiale est limitée à 10 %. L'Iran produit 29 % du gaz naturel de la région - ce qui en fait le cinquième producteur mondial, avec 3,2 % du total -, l'Arabie Saoudite 23 %, les Emirats Arabes Unis 16 % et le Qatar 15 %. Le gaz associé, c'est-à-dire extrait en même temps que le pétrole, y est brûlé sur place, alors qu'il pourrait être commercialisé pour un coût relativement limité. Les coûts de production du gaz non associé y sont en outre parmi les plus bas du monde. Selon les prévisions de l'AIE, ces conditions favorables devraient permettre à la production de gaz naturel du Moyen-Orient de passer de 259 milliards de mètres cubes en 2003 à 425 milliards de mètres cubes en 2010, 692 en 2020 et 860 en 2030, soit une hausse moyenne de 4,5 % par an. Le Qatar et l'Iran seraient les principaux producteurs, avec respectivement 255 et 240 milliards de mètres cubes en 2030, contre respectivement 33 et 78 milliards de mètres cubes en 2003. Mais il est difficile de savoir quelle proportion de cette production sera exportée. En effet, la consommation de gaz naturel dans la région, qui, à 226 milliards de mètres cubes en 2003, est déjà élevée, va continuer de croître. Toujours selon l'AIE, elle atteindrait 324 milliards de mètres cubes en 2010, 507 en 2020 et 615 en 2030. En Iran par exemple, en 2030, la consommation interne serait de 183 milliards de mètres cubes, sur les 240 milliards de mètres cubes produits. Il faut souligner que, aujourd'hui, ce pays, détenteur des deuxièmes réserves mondiales de gaz naturel, est importateur net de cet hydrocarbure. En effet, le réseau de transport ne couvrant pas tout son territoire, l'Iran importe du gaz du Turkménistan pour alimenter l'ouest, tandis qu'il en exporte un moindre volume vers la Turquie. Plusieurs facteurs expliquent le niveau élevé et l'augmentation annoncée de la consommation de gaz dans la région. La pétrochimie, les usines d'eau douce et la production d'électricité absorbent de plus en plus de gaz naturel. La poussée démographique, le développement de l'économie grâce aux revenus des exportations pétrolières contribuent à cette croissance. Mais elle est aussi liée à l'envolée des prix du pétrole qui conduit les pays producteurs à substituer le gaz au pétrole dans leur économie, afin de pouvoir exporter plus de pétrole, et donc tirer plus de profit des prix élevés de celui-ci. En Iran, le gaz représente 50 % de la consommation énergétique nationale, part qui devrait atteindre 69 % à l'horizon 2010. Les autorités iraniennes justifient d'ailleurs leur volonté de disposer de centrales nucléaires par leur souci de réduire leur consommation nationale d'hydrocarbures, et surtout de gaz, afin de pouvoir proposer de plus grands volumes à l'exportation. Il est donc très probable que le gaz naturel produit au Moyen-Orient sera utilisé en priorité dans les pays producteurs et pour les transferts transfrontaliers à l'intérieur de cette région du monde. La part de la production disponible pour l'exportation extra-régionale pourrait être finalement assez limitée. 3) Un développement incertain des exportations Comme pour le pétrole, les prévisions de production reposent sur l'évaluation actuelle des réserves dans les différents pays, mais elles ne se réaliseront que si les infrastructures nécessaires sont mises en place, ce qui suppose que les pays réalisent des investissements d'un volume considérable. La Qatar, premier exportateur de GNL au monde depuis mars 2006, pourrait assurer 65 à 75 % des exportations de gaz de la région en 2030. Mais le pays étant arrivé à son objectif d'exportation, il applique désormais un moratoire, certes non officiel, sur les nouveaux projets relatifs au GNL. Les deuxième et troisième exportateurs de GNL de la région sont le sultanat d'Oman et les Emirats Arabes Unis, mais il ne faut pas compter qu'ils développent beaucoup leurs exportations dans l'avenir : le premier dispose de réserves relativement limitées et sa demande intérieure croît ; les seconds importent déjà un peu de gaz par pipeline et ils devraient devenir importateurs nets à partir de 2020, sous l'effet d'une augmentation plus rapide de sa demande nationale que de sa production. Quant à l'Arabie Saoudite, sa production nationale reste très inférieure à ses besoins internes et cette situation ne devrait pas changer avant 2020-2025, malgré la conclusion, ces dernières, de trois contrats d'exploration-production de gaz avec des multinationales. Reste l'Iran, sur la production duquel pèsent bien des incertitudes. Contrairement à ce que pensaient les observateurs à la veille comme au lendemain de la révolution de 1980, il n'a guère développé sa production, qui ne suffit même pas à satisfaire les besoins nationaux. Avant même qu'éclate la crise du nucléaire iranien et que plane sur le pays la menace de sanctions économiques onusiennes, l'opposition des Etats-Unis à tout projet énergétique avec l'Iran et le caractère peu attractif des contrats proposés, déjà souligné en matière pétrolière, gênaient les investissements nécessaires à une augmentation de la production et au développement d'exportation de gaz. Les autorités iraniennes n'en affichent pas moins des objectifs très élevés de croissance des exportations : elles passeraient de 19 millions de mètres cubes par jour, en direction de la Turquie, aujourd'hui, à 54 millions de mètres cubes par jour à l'horizon 2010, grâce à la conclusion de plusieurs contrats de fourniture par le biais de gazoducs. Des négociations sont engagées avec l'Arménie, les Emirats Arabes Unis, le Koweït, l'Inde, via le Pakistan, et l'Europe, par l'intermédiaire du projet Nabucco, qui relierait l'Iran à Vienne. Parallèlement, l'Iran développe un vaste programme de liquéfaction de gaz en aval du champ de South Pars qui pourrait inclure trois projets associant la NIOC à des sociétés étrangères, et s'intéresse à la technologie du « gas-to-liquids » qui lui permettrait de devenir un exportateur de diesel peu polluant. Tout comme pour les projets pétroliers, les difficultés pour les compagnies étrangères tiennent aux conditions générales d'investissement en Iran et à la différence de traitement entre l'amont (contrats de « buy back ») et l'aval (investissement direct). Mais ces projets représentent des enjeux essentiels pour les sociétés internationales car ils leur permettraient de structurer une présence à long terme dans le pays. Il faut néanmoins souligner que la volonté d'augmenter les exportations de gaz naturel, affirmée par les autorités iraniennes, ne fait pas l'unanimité dans le pays, certains groupes estimant que le gaz devrait être exclusivement utilisé pour la consommation interne. Il apparaît donc difficile d'affirmer que le Moyen-Orient continuera à dominer le marché du pétrole et régnera sur les exportations gazières pendant les prochaines décennies. Il possède incontestablement les ressources nécessaires, mais bien des incertitudes demeurent. LE GOLFE ET LES ROUTES DU PÉTROLE EN 2002 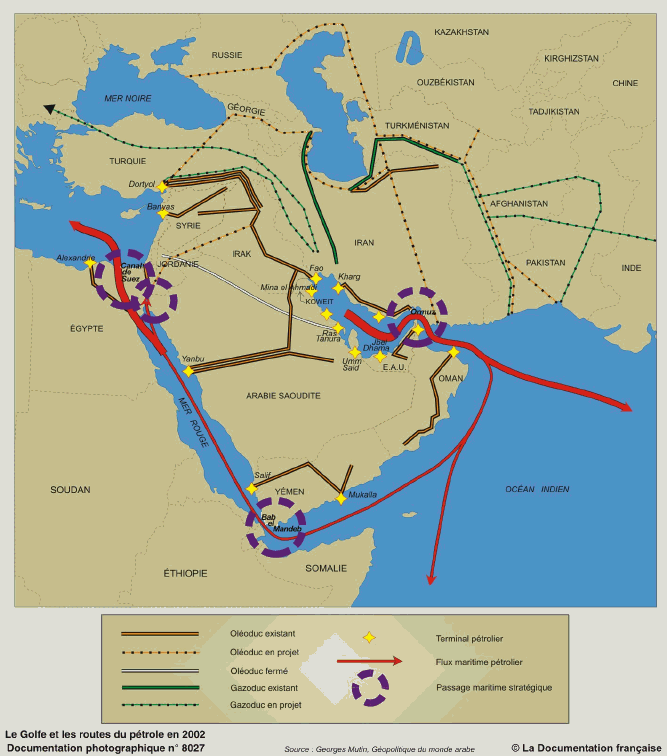 La Russie : Repères La Russie détient 30 % des réserves mondiales de gaz (48 trillions de mètres cubes), 6 % des réserves mondiales de pétrole (74,4 milliards de barils), 20 % des réserves mondiales de charbon et 14 % des réserves mondiales d'uranium. Premier exportateur mondial d'énergie (pétrole, gaz, électricité), la Russie est le troisième plus gros producteur de pétrole dans le monde, après l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis, et le deuxième plus grand exportateur de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que le plus gros producteur et exportateur de gaz naturel. S'il n'était question que d'économie en matière énergétique, cette partie n'aurait pas lieu d'être. En vertu d'un calcul économique rationnel, la Russie, géant énergétique, ferait les investissements et les réformes nécessaires pour adapter sa production aux demandes du marché et prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses piètres performances en matière d'efficacité énergétique. Et elle exporterait ses ressources vers le grand marché de consommateurs européens qui se trouve, à sa porte, sur ses frontières occidentales, profitant du réseau existant d'oléoducs et de gazoducs. Dans un contexte international de tensions sur les marchés énergétiques, le différend de l'hiver 2005-2006 entre l'Ukraine et la Russie concernant le transport du gaz russe et d'Asie centrale, via l'Ukraine, vers l'Europe occidentale a rappelé que les questions énergétiques restaient, dans cette partie du monde, des questions hautement, voire exclusivement, politiques. Ou plutôt qu'elles l'étaient redevenues, après les années Eltsine qui virent la Russie signer la très libérale charte de l'énergie, en 1994, et privatiser les entreprises clés du secteur énergétique en Russie. S'il fallait illustrer la tension que nous avons présentée en introduction entre logique de marché et logique de puissance, c'est sans nul doute le cas de la Russie qu'il faudrait choisir : ainsi, Gazprom, oligopole d'Etat, est à la fois une entreprise qui milite pour la libéralisation du marché domestique du gaz en Russie, aujourd'hui de facto subventionné, et, à l'étranger, le bras armé d'un Etat russe qui utilise l'arme énergétique pour rappeler à son étranger proche que rien ne pourra se faire dans le domaine énergétique sans la Russie. De même, vis-à-vis de l'Union européenne, Gazprom multiplie les tentatives de rachat ou de participation dans les entreprises des Etats membres, profitant de la libéralisation du marché énergétique en France pour avoir un accès direct au consommateur européen, tout en faisant en sorte de multiplier les obstacles aux investissements des entreprises d'Europe occidentale dans le secteur énergétique russe. C'est ainsi que la Russie refuse aujourd'hui de ratifier le traité sur la charte de l'énergie, cet accord multilatéral conçu au début des années 1990 pour faciliter les relations énergétiques entre l'Europe occidentale et ses voisins de l'Est récemment libérés du joug communiste. Derrière cette stratégie duale, parfois difficilement lisible, le message qui apparaît en filigrane est cependant très clair : la puissance russe est de retour ; elle fut militaire et idéologique naguère, elle est énergétique désormais et c'est la Russie qui fixe les règles du jeu. C'est ainsi que, quelques jours après le sommet de Saint-Pétersbourg qui a clôturé la présidence russe du G 8, placée sous le signe de la sécurité énergétique par le Président Vladimir Poutine, ce dernier promulguait, le 19 juillet 2006, la nouvelle loi russe « sur les exportations de gaz naturel », prévoyant la légalisation du monopole de Gazprom à l'exportation gazière. Telle fut donc la réponse de la Russie à la déclaration finale adoptée, quelques jours plus tôt, par les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres du G 8 - dont la Russie - en faveur de la création de « cadres juridiques et de réglementation transparents, équitables, stables et efficaces, comprenant les obligations en matière de respect des contrats, en vue d'attirer des investissements adéquats et durables en amont comme en aval ». Dans le même ordre d'idées, c'est, plus récemment, le Président Vladimir Poutine qui, à l'occasion de la rencontre trilatérale avec ses homologues français et allemand à Compiègne, les 22 et 23 septembre 2006, évoqua la possibilité pour Gazprom de réorienter le projet d'exploitation du gisement de gaz de Shtokman au profit des Européens. Et ce alors même que la Russie a toujours mis en avant sa volonté de devenir fournisseur des Etats-Unis grâce à ce projet dont la première phase prévoit la construction d'un terminal de liquéfaction, destiné à l'exportation du GNL vers le marché américain. Cette manière de souffler le chaud et le froid suscite évidemment de nombreuses questions quant aux intentions énergétiques de la Russie : - en Russie, les choix énergétiques en matière de prospection, d'investissement, de structuration du marché, de prise en compte de concepts tels que l'efficacité énergétique ou le développement durable obéissent-ils à une approche strictement nationale ou sont-ils négociables avec les partenaires européens de la Russie (problématique du partenariat) ou internationaux (G8) ? Pour le dire autrement, l'énergie est-elle un facteur d'ouverture ou de repli de la Russie ? Quand la Russie définira-t-elle une politique énergétique évitant le gaspillage et économiquement rationnelle ? - dans l'espace post-soviétique, l'énergie joue-t-elle un rôle de tension ou/et de cohésion, via la reconstitution d'alliances énergétiques, de facto politiques ? Peut-il y avoir des stratégies énergétiques indépendantes de la Russie dans l'espace post-soviétique (par exemple en Asie centrale) ou bien les stratégies nationales mises en œuvre chez les voisins de la Russie sont-elles déterminées par la stratégie russe, qui donne le ton ? - dans l'espace européen, est-on prêt, du côté russe mais aussi du côté européen, à envisager les relations énergétiques UE-Russie comme une relation de dépendance mutuelle, alors que cette relation est trop souvent vécue sur le mode d'une dépendance unilatérale de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, analyse non viable à moyen et long terme ? - au plan international, comment la Russie va-t-elle jouer sa carte énergétique et à quelles fins : objectif financier (réguler l'offre pour maintenir un certain niveau de prix et optimiser sa rente), objectif politique (intégration accrue dans le concert des pays développés - G8 - ou utilisation de l'énergie comme atout pour peser dans des négociations exogènes), objectif géostratégique (stratégie de puissance) ? Va-t-on vers une nouvelle rivalité russo-américaine, centrée sur le Caucase et l'Asie centrale ? Les développements qui suivent se fondent en grande partie sur les informations et les éléments recueillis au Kazakhstan par M. Jean-Louis Bianco en avril 2006, et en Russie par MM. René André et Jean-Louis Bianco qui y ont effectué un déplacement en juin 2006. A - Géant énergétique, la Russie veut se placer au cœur du grand jeu énergétique mondial L'importance des questions énergétiques dans la politique intérieure et extérieure de la Russie n'est pas nouvelle : outre que la question de la propriété du sous-sol joua un rôle certain dans la distension des liens entre les républiques soviétiques et le pouvoir central à la fin de l'ère soviétique, qui aboutit à l'éclatement de l'Union soviétique, la Russie a toujours considéré ses ressources énergétiques comme un outil politique autant qu'un instrument économique. Cette double dimension, intérieure et extérieure, des questions énergétiques en Russie reste donc pleinement valable dans la Russie de Vladimir Poutine : les ressources énergétiques sont au cœur de la restauration de la « verticale du pouvoir » voulue par Vladimir Poutine en Russie, comme de la politique russe au sein de la communauté des Etats indépendants (CEI), et de la restauration, au plan international, d'une puissance globale dont la Russie n'a jamais fait le deuil. 1) La Russie, géant énergétique a) Le poids écrasant du secteur énergétique dans l'économie russe : la Russie, « puissance unijambiste » (74) ? A l'évidence, après les années noires qui avaient suivi l'effondrement de l'Union soviétique - la production pétrolière s'effondra de 54 % entre 1987 et 1996 -, la Russie est redevenue un producteur et un exportateur majeurs de produits énergétiques. Ainsi, avec un PIB équivalent à celui des Pays-Bas, la Russie dispose de ressources en hydrocarbures de première importance : 6 % des réserves mondiales de pétrole, 30 % de celles de gaz, 10 % de la production mondiale de pétrole et 22 % de celle de gaz. C'est dire que le secteur énergétique détient un poids dominant dans l'économie russe, estimé, en 2003, à 25 % de la richesse nationale par la Banque mondiale, alors qu'il n'emploie que 1 % de la population. Tous les indicateurs économiques témoignent de la forte dépendance de la Russie vis-à-vis des ressources naturelles : on estime ainsi que combustibles et métaux représentaient, en 2000, 65 % de la valeur ajoutée dans l'industrie, tandis que l'ensemble des matières premières fournissaient, en 2003, 76 % des exportations totales. A l'évidence, les ressources énergétiques sont bien le moteur de la croissance continue du produit intérieur brut russe depuis sept ans, qui place la Russie loin devant la croissance moyenne des pays du G 8. Dans la création et la gestion de cette manne énergétique, l'Etat occupe une place de premier plan. Si, dans les années 1990, la Russie de Boris Eltsine a cru trouver dans la privatisation des principales entreprises pétrolières la solution à ses difficultés financières, la présidence Poutine restera marquée par la réorganisation complète du secteur au profit de l'Etat, le Président russe mettant en œuvre sa vision longuement nourrie du rôle des ressources énergétiques, vision qu'il développe dès les années péterbourgeoises de sa carrière politique. VLADIMIR POUTINE, L'ÉNERGIE ET LE RÔLE DE L'ÉTAT La réflexion que le Président a engagée sur le rôle des ressources naturelles dans le développement économique de son pays et le maintien de son rang sur la scène internationale est bien antérieure à son élection. Après avoir quitté, à l'été 1996, la direction des Affaires internationales de la mairie de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine soutient une thèse intitulée : « La planification stratégique du renouvellement de la base minérale et de matières premières de la région de Leningrad dans le contexte du passage à une économie de marché ». Des extraits de ce travail sont publiés en janvier 1999 dans un recueil de l'Institut d'Etat des mines de Saint-Pétersbourg (SPGGI). Le recteur de ce prestigieux établissement, Vladimir Litvinenko, était le directeur de thèse de Vladimir Poutine. Il deviendra bientôt son conseiller. Quelle est la nouvelle idéologie du Kremlin sur les questions énergétiques ? Le Président souhaite, avant tout, redonner un rôle central à l'Etat. Garant de l'intérêt national, ce dernier doit disposer des leviers nécessaires à l'impulsion d'une véritable politique industrielle, leviers en grande partie perdus lors de la privatisation des années de « transition ». En contrepartie du soutien de l'Etat - notamment sur la scène internationale - les entreprises privées et publiques doivent « jouer le jeu » (en payant leurs impôts, par exemple) et contribuer à la transformation économique du pays. Cette approche pose, comme le montrera l'affaire Ioukos, la question fondamentale des droits de propriété. Pour Vladimir Poutine, le droit de regard que l'Etat doit exercer sur le secteur énergétique n'implique pas forcément une renationalisation des actifs privatisés au cours des années 1990. Mais l'exploitation des ressources naturelles n'a pas valeur de totale liberté de gestion pour les compagnies privées. Le résident du Kremlin souligne ainsi que, « quel que soit le propriétaire des ressources naturelles, l'Etat conserve le droit de réguler leur mise en valeur et leur exploitation, en agissant conformément aux intérêts de la société ». Or il ne fait aucun doute que Vladimir Poutine considère la politique mise en œuvre par les oligarques comme a priori opposée à l'intérêt national. Le sort réservé à Ioukos l'illustre de manière éclatante (1). (1) Cet extrait est tiré de Arnaud Dubien, « Energie : l'arme fatale du Kremlin, Politique Internationale, n°111, printemps 2006. Ainsi, le Président Vladimir Poutine a systématiquement procédé au démantèlement du dispositif hérité du schéma retenu en 1996, qui avait abouti à la privatisation de la majorité de ces entreprises dans des conditions extrêmement favorables aux acquéreurs, qui avaient ainsi pu constituer les principaux groupes industriels et financiers du pays (Menatep pour Ioukos, Oneximbank pour Sidanko et Surgutneftegaz, Logovaz pour Sibneft et Vossibneftegaz, Alfa group pour Tioumen Oil Company). Dans un double souci d'affichage vis-à-vis de la population et de réappropriation par l'Etat du levier énergétique, Vladimir Poutine a mis au pas les « oligarques » honnis par la population, qui plus est, pour certains, concurrents politiques potentiels. La disparition des oligarques n'est-elle cependant pas remplacée par l'émergence d'une nouvelle « énergocratie russe » (75) ? Aujourd'hui en effet, autour de Rosneft et, surtout, de Gazprom, l'Etat russe contrôle 30 % de la production pétrolière et 87 % de la production gazière. L'année 2005 a en effet été marquée par une série d'événements majeurs qui ont permis à Gazprom d'émerger comme l'outil principal de la politique énergétique russe : au mois de juin 2005, l'État a repris le contrôle de Gazprom, faisant passer sa part dans le capital de la société de 38,4 % à 50 % plus une action, puis, à l'automne 2005, Gazprom a acquis la propriété de la compagnie pétrolière Sibneft. Ces événements, conjugués à l'augmentation des prix du gaz naturel à la fin de l'année 2005, ont fait passer la capitalisation boursière du groupe à 230 milliards de dollars, devant celle du groupe Shell. GAZPROM : PORTRAIT DU GROUPE Véritable instrument politique et stratégique de l'Etat russe, Gazprom est l'héritier des différentes structures ministérielles soviétiques qui ont organisé l'industrie du gaz en Union Soviétique puis en Russie depuis 1948. L'Etat russe est fortement représenté au conseil d'administration : Dmitry Medvedev, qui le préside, dirige par ailleurs l'administration présidentielle de la Fédération de Russie ; German Gref est Ministre du Développement Economique et du Commerce ; Viktor Khristenko est Ministre de l'Industrie et de l'énergie. L'équipe actuellement aux commandes de Gazprom, dans le sillage de son incontournable Président Alexeï Miller, a été mise en place vers 2001 par l'administration de Vladimir Poutine, s'appuyant notamment sur ses « réseaux » de Saint-Pétersbourg. Il s'agit de la plus grande société russe (300 000 employés) et du plus gros producteur de gaz au monde : Gazprom assure ainsi environ 25 % de la consommation européenne de gaz (60 % des importations européennes) et représente 25 % des réserves mondiales de gaz. La position du groupe est quasi monopolistique en Russie, le groupe détenant : - la propriété du réseau de transport principal soit 159 000 kilomètres de conduites de grand diamètre ; - le monopole de jure des exportations hors CEI et du transit du gaz d'Asie centrale ; - la moitié des régies de distribution de gaz en Russie. Gazprom souhaite se renforcer et devenir une compagnie énergétique intégrée. Il a d'ores et déjà acquis des positions significatives dans l'électricité, considérablement renforcé son poids dans la production pétrolière russe et dispose d'une forte présence en pétrochimie. Gazprom a également fait une rentrée remarquée dans le nucléaire. Il faut enfin rappeler que la société GazpromMedia contrôle aujourd'hui plusieurs médias audiovisuels et dans la presse écrite. b) Les mots : la « stratégie énergétique de la Russie à l'horizon 2020 »... C'est donc à Gazprom qu'il revient de mettre en œuvre la « stratégie énergétique de la Russie à l'horizon 2020 », document adopté en 2003, qui constitue la référence de la politique énergétique de la Russie. Ce document définit trois priorités : maximiser l'utilisation efficace des ressources en combustibles et en énergie ; exploiter le potentiel du secteur pour contribuer au développement socio-économique et améliorer le rendement énergétique, notamment pour protéger l'environnement. Extrêmement ambitieux, ce document témoigne d'un très fort volontarisme : les perspectives de la stratégie énergétique russe à l'horizon 2020 sont fondées sur un taux de croissance du PIB de 5 % par an, associé à des changements structurels dans les activités économiques et à une politique vigoureuse d'efficacité énergétique, conduisant à une forte diminution de l'intensité énergétique. De la sorte, la faible croissance de la demande énergétique intérieure, combinée à une augmentation de la production et à une diminution de la part du gaz naturel dans la production d'électricité garantit un potentiel élevé pour les exportations de pétrole et de gaz en 2020 compatible avec les besoins d'importation d'énergie de la future Union européenne et la sécurité de cet approvisionnement. La Russie a, en effet, identifié l'efficacité énergétique comme une priorité de sa stratégie nationale de l'énergie pour 2020. Il était temps : s'il est courant de pointer du doigt les Etats-Unis en cette matière, sait-on que, alors que les Etats-Unis consomment 1,5 fois plus d'énergie que l'Europe des 25 par unité de PIB, ce chiffre est de 3,3 pour la Russie (76) ? De sorte que, « par unité marginale de PIB, la Russie, dont 91 % de la consommation énergétique finale proviennent des trois énergies fossiles, émet donc en moyenne près de quatre fois plus de CO2 que l'Union européenne et les Etats-Unis 1,7 fois plus ». Les experts russes rencontrés par la Mission à Moscou, le 13 juin 2006, estiment leur potentiel d'économies d'énergie immense et visent, d'ici à 2020, à diviser par deux l'intensité énergétique du PIB, afin de la rapprocher du niveau européen. Les moyens envisagés sont doubles : d'une part, poursuivre la politique constante d'augmentation progressive du prix du gaz et de l'électricité et libéraliser le secteur de l'énergie - actuellement, 10 % seulement de l'énergie produite est vendue au prix du marché ; réformer la politique de logement. Plus largement, l'accroissement de l'efficacité énergétique est visé au travers de la modification de la structure industrielle héritée de l'Union soviétique. En complément de cette démarche, la Russie, après vingt années d'un itinéraire nucléaire complexe, souhaite s'engager dans une « renaissance nucléaire », pour reprendre l'expression employée par M. Vladimir Travine, Directeur Général adjoint de Rossatom, lors de son entretien avec MM. René André et Jean-Louis Bianco à Moscou, le 13 juin dernier. C'est un programme ambitieux de construction de deux tranches minimum de un gigawatt par an d'abord, puis de trois et enfin de quatre tranches par an d'ici à 2030, qui est envisagé, sans compter la construction de réacteurs à neutrons rapides à l'horizon 2012 et de centrales nucléaires flottantes, à moyen terme également. A long terme, la Russie envisage également la construction de réacteurs à cycle fermé. Cet ambitieux programme d'extension du parc nucléaire russe a pour but affiché de faire passer la proportion d'énergie électrique produite à partir du nucléaire de 17 % à 22 % à l'horizon 2020, soit une augmentation de 3 gigawatt par an de la capacité installée. Cela implique de construire 100 centrales nucléaires de 2010 à 2030, soit cinq par an. Or, à ce jour, le rythme est plutôt de deux par an... Cette croissance se ferait également via l'extension de la durée de vie des centrales de type RBMK (15 de 1000 MW, soit 300 à 400 milliards de dollars pour quinze années de plus) et de type (VVR). L'importance des investissements à réaliser s'explique par l'absence d'investissements dans des capacités nouvelles depuis vingt ans. Le retard pris dans ce domaine est d'ores et déjà préoccupant puisque le croisement entre la courbe de demande d'électricité nucléaire et celle de l'offre, prévu globalement vers 2012-2013, s'observe déjà dans certaines régions, notamment celle de Moscou. Ajoutons que, dans le cadre de ce programme nucléaire, la Russie entretient des relations très proches avec le Kazakhstan. Il n'en reste pas moins qu'elle doit améliorer l'exploitation de ses propres ressources en uranium, dont la production baisse, le secteur ayant été longtemps délaissé du fait de l'existence d'importants stocks d'uranium d'origine militaire. Un programme d'investissement est prévu dans l'exploration et la production, notamment en Sibérie et en Yakoutie. A ce jour toutefois, le financement (60 milliards de dollars) n'existe pas, ni en volume ni en ce qui concerne le véhicule de financement. c) ... Et les faits : existe-t-il une véritable stratégie énergétique russe ? A dire vrai, nombre de spécialistes (77) doutent de la faisabilité de ce schéma certes volontariste, mais à bien des égards peu réaliste. Ainsi, l'Agence internationale de l'énergie table pour sa part sur une croissance économique beaucoup plus faible et sur une diminution limitée de l'intensité énergétique ; en outre, s'agissant de l'augmentation des capacités de production d'hydrocarbures de la Russie, elle souligne qu'elle est conditionnée par un effort d'investissement massif. Ce sont donc trois hypothèques lourdes qui pèsent sur la réalisation du fort potentiel d'exportation de pétrole et de gaz naturel de la Russie à l'horizon 2020. Il est donc tentant de poser la question : au-delà des mots, existe-t-il une stratégie énergétique russe ? Si l'on s'en tient à l'examen de la forme, la réponse est positive : les documents, les plans stratégiques sont là. Reste qu'ils reposent sur des hypothèses peu réalistes et que ni les financements ni le calendrier ne permettent d'atteindre les objectifs fixés en termes de production et de capacité à honorer les engagements à l'exportation. Pour résumer, il existe certes une stratégie énergétique russe mais ses objectifs et ses fondements ne sont ni économiques (maximiser le profit) ni industriels, en sorte qu'elle semble davantage relever de l'affichage politique à usage international. Ce constat est conforté par la nature même de l'entreprise qui est censée être la cheville ouvrière de cette stratégie, la société Gazprom. Il s'agit assurément d'un objet difficile à définir, société privée et publique, holding financier qui gère la production et le transport gaziers, une institution à la fois hiérarchique et décentralisée. Ce qui est certain en revanche, c'est que cette entité ne fonctionne pas, tant s'en faut, comme un ensemble homogène, ainsi que l'ont expliqué aux membres de la Mission un certain nombre de leurs interlocuteurs à Moscou. Au sein de cette puissance machine, nombreux sont les intérêts en présence, qui se heurtent de front, de sorte que les luttes de clan y sont incessantes. En outre, le gigantisme même de cette société qui ne cesse de diversifier ses activités pose la question de la qualité de sa gouvernance. D'après des spécialistes russes eux-mêmes, rencontrés à Moscou par MM. René André et Jean-Louis Bianco, on peut afficher le plus grand scepticisme quant à l'efficacité de la gestion de cette énorme structure publique, qui n'est pas des plus transparentes. Par exemple, nul ne sait exactement quelle est la proportion de revenus tirée de l'extraction, du transport ou de l'exportation. Sur le long terme, le scepticisme portant sur la fiabilité de l'entreprise est nourri par sa politique actuelle peu convaincante d'achats d'actifs étrangers, loin d'être toujours judicieux. Sans compter, enfin et surtout, que le poids du politique dans Gazprom lui confère un profil tout à fait particulier. En termes purement financiers, si l'entreprise est endettée à hauteur de 23 milliards de dollars, ce qui ne représente certainement pas une menace sérieuse en soi, le fait que le volume de la dette de Gazprom augmente plus rapidement que le volume de la production risque en revanche de poser problème à moyen et long terme. De même, aux yeux d'experts financiers russes indépendants, la question du sous-investissement de Gazprom pose un problème réel. En effet, au cours de la décennie 1990, du fait de la chute substantielle de la production de pétrole et de gaz née de l'arrêt des exportations énergétiques vers la CEI, aucun investissement de capacité ou de prospection n'a été réalisé. De la sorte, en 1999, lorsque la croissance économique a repris, on s'est contenté de recourir aux anciennes infrastructures, qui sont aujourd'hui utilisées à 90 %. L'absence d'investissements d'envergure dans de nouvelles capacités et dans la prospection est préoccupante pour la croissance ultérieure du secteur et pour l'économie russe en général. Sa bonne santé dépend en effet de la rentrée de devises, dont la source principale vient des exportations énergétiques : sans ce moteur pour la demande intérieure, c'est tout le système qui peut s'effondrer. Cette situation préoccupante est soulignée par les acteurs énergétiques russes eux-mêmes. Ainsi, selon le patron du pétrolier russe Loukoil, deuxième compagnie pétrolière internationale pour la taille de ses réserves, sans modernisation de ses infrastructures, le pays, qui détient un tiers des réserves mondiales de gaz et 13 % des réserves de pétrole « pourrait devenir importateur de produits pétroliers dès 2009 ». De même, il est intéressant de relever que, bien que la Russie ne soit pas membre de l'Agence internationale de l'énergie, son directeur, M. Claude Mandil, a publiquement mis en cause la stratégie de Gazprom : « nous sommes inquiets de la capacité réelle de Gazprom à approvisionner ses clients dans les quantités promises par contrat » (78). De fait, certains chiffres relatifs à la production pétrolière russe ne peuvent pas manquer d'attirer l'attention. Ainsi, comment expliquer par exemple qu'en 2005, au plus fort des tensions sur le marché du pétrole et de la hausse des cours du brut, la production de pétrole brut en Russie ait vu sa croissance fortement diminuer (+ 2,2 % au lieu de 8,5 % en moyenne au cours des cinq années précédentes) et que les exportations aient chuté de 1,5 %, là où elles augmentaient de 14 % par an depuis 1999 ? La Mission, on le comprendra aisément, ne peut se contenter des explications qu'elle a reçues à Moscou, selon lesquelles la Russie agit, ce faisant, pour le bien-être des générations futures... Les explications fournies par les économistes sont plus convaincantes. Ainsi, pour l'économiste américain Clifford G. Gaddy, rencontré par le Président de la Mission à Washington en juin 2006, la réponse se trouve dans les insuffisances de la gestion des ressources en Russie : « le pétrole qui aurait dû arriver sur le marché en réponse à la hausse des cours avait déjà été produit », parce que les droits de propriété étant incertains en Russie, l'horizon temporel des producteurs indépendants est court (79). C'est toute la question de la sécurité juridique en Russie qui est posée. Cette thèse de la « malédiction des ressources » mise en avant par les économistes Sachs et Warner en 2001, qui voudrait que les Etats riches en ressources naturelles souffrent de problèmes de gouvernance politique et économique de ces ressources, est certainement convaincante. La Russie semble en effet accréditer la thèse évoquée par M. Jean-Christophe Victor lors de son témoignage devant la Mission, le 14 juin 2006, selon laquelle la dépendance de certains Etats au pétrole tendrait à éroder les règles démocratiques : « l'examen des séries tend à montrer que plus le prix du pétrole augmente, plus les Etats deviennent autoritaires - cela s'est vérifié au Kazakhstan, en Russie, (...) au Venezuela, qui se caractérisent désormais par des régimes "pétro-autoritaires ". » Dans le cas de la Russie, la problématique est certainement complexe. Au-delà d'un environnement relativement incertain dans le domaine économique, les maux traditionnels de l'économie russe handicapent à l'évidence un développement rationnel du secteur énergétique : faiblesses institutionnelles, tensions entre le centre et la périphérie - les régions les plus riches étant peu désireuses de financer les plus pauvres -, corruption, difficultés de mise en œuvre de la politique fiscale, etc. 2) La Russie et les routes de l'énergie : la géopolitique des « tubes » comme vecteur de puissance La disparition de l'Union soviétique a remis en cause le statut de la puissance énergétique russe sur le continent eurasiatique, notamment sa capacité à rester le pivot du réseau de transport des hydrocarbures dans l'espace eurasiatique. Le système de transport de pétrole soviétique avait en effet été construit dans la perspective principale de pourvoir aux besoins du complexe industriel local, la Russie y jouant un rôle central de producteur comme de consommateur. L'accession à l'indépendance d'un certain nombre d'Etats eux-mêmes producteurs de pétrole ou de gaz (Kazakhstan et Azerbaïdjan pour le pétrole, Turkménistan pour le gaz) ou jouant un rôle essentiel en matière de transit (Ukraine et Biélorussie) a contraint la Russie à redéfinir ses liens avec ces Etats, de manière à préserver ses marges de manœuvres énergétiques ainsi que son rôle central dans le réseau de transport des ressources énergétiques sur le continent eurasiatique. a) Les routes de l'énergie dans la CEI : qui contourne qui ? A la disparition de l'Union soviétique, la Russie s'est heurtée à une double contrainte : d'abord, contourner les zones à problèmes, ensuite se garantir une marge de manœuvre maximale en matière de transport de produits énergétiques, de manière à ne pas être tributaire des États devenus souverains après l'éclatement de l'URSS. L'indépendance de l'Ukraine et de la Biélorussie - par lesquelles passe la quasi-totalité des exportations russes vers l'Europe au travers du gazoduc EuroSibérien (par l'Ukraine) et du gazoduc Yamal (par la Biélorussie) - a en effet multiplié les pays de transit à destination de l'Europe. Ainsi, les premiers travaux entrepris par Transneft (80) en Russie depuis 1999 ont consisté à contourner tant la Tchétchénie, notamment pour améliorer la fiabilité du transit de pétrole azerbaïdjanais, que l'est de l'Ukraine, afin d'éviter la station de pompage ukrainienne de Loutchansk, et de rediriger des flux d'huile russe vers Novorossisk au lieu de Kherson et Odessa. De même, avec la réalisation d'un oléoduc débouchant sur un nouveau terminal baltique à Primorsk, projet phare de Transneft, la Russie a obtenu un contournement de la Lettonie - en plus d'un accroissement progressif de sa capacité d'acheminement. De leur côté, les voisins de la Russie nouvellement indépendants se sont rapidement heurtés à la difficulté d'atteindre de nouveaux marchés - Europe, Chine, Japon, sous-continent indien. En effet, la dislocation de l'Union soviétique a donné naissance à une nouvelle zone potentiellement forte productrice d'hydrocarbures, la Caspienne, qui pourrait s'affirmer comme un concurrent majeur de la Russie et redessiner la carte des approvisionnements de l'Europe et de l'Asie. LE DÉBAT SUR LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES DE LA MER CASPIENNE Les Etats bordant la Caspienne qui, hors l'Iran et la Russie, sont principalement l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan, détiendraient des réserves encore incertaines. La Caspienne est un bassin gigantesque, largement inexploré mais difficile du fait de la faible profondeur de la mer et du climat - elle est gelée six mois de l'année durant. Les conditions d'exploitation de ses gisements y sont complexes, et coûteuses : il faut creuser jusqu'à 4 ou 5000 mètres, dans une mer très peu profonde, dans des gisements à haute teneur en soufre. L'évaluation des réserves de la Caspienne reste de ce fait très controversée : 39,4 milliards de barils pour MacKenzie, 80 pour d'autres, 17 à 33 pour le secrétaire d'État américain à l'énergie Abraham en 2002. Pour Total, partie prenante dans le consortium de Kashagan à hauteur de 18,5 %, les vraies réserves sont celles que les opérateurs pensent pouvoir mettre en production, étant en droit de le faire. De ce point de vue, la compagnie française les évalue à 37 milliards de barils. Pour le seul Kazakhstan, les réserves totales de pétrole seraient équivalentes à 20 milliards de barils. Le potentiel de l'offshore caspien permettrait d'envisager une croissance importante de la production (qui passerait à près de 60 millions de tonnes/an, dont 50 millions de tonnes seraient exportées). De tels niveaux de réserves permettraient en 2010 d'assurer une production oscillant entre 2,4 Mb/j et 5,9 Mb/j pour le pétrole et entre 200 et 270 milliards de m3 pour le gaz. La mise en valeur des hydrocarbures de cette zone nécessitant des investissements considérables, le développement des grands gisements d'hydrocarbures que sont Chirag, Azeri, Gunashli et Shah Deniz, pour l'Azerbaïdjan et Karachaganak, Tengiz et Kashagan, pour le Kazakhstan se fait sous l'égide des principales compagnies pétrolières internationales au travers des formes contractuelles que sont les accords de partage de production. S'agissant toutefois de l'exploitation des ressources de la mer Caspienne, la question essentielle concerne son statut international, les pays riverains ne s'entendant pas sur les conditions de partage de cette mer : les discussions entre les protagonistes (Russie, Kazakhstan, Azerbaïdjan d'un côté, favorables à une répartition proportionnelle à la longueur de la bande côtière, Iran et Turkménistan de l'autre, favorables à une division en parts égales) sont actuellement au point mort. De ce fait, tous les débats sur la possibilité de construire des oléoducs et des gazoducs qui la traversent sont actuellement en suspens, alors que cette possibilité aurait un impact essentiel sur la rentabilité des projets au Kazakhstan, qui serait désenclavé. LOCALISATION DES RESSOURCES PÉTROLIÈRES ET RÉSEAU DE TRANSPORT : RUSSIE / CEI 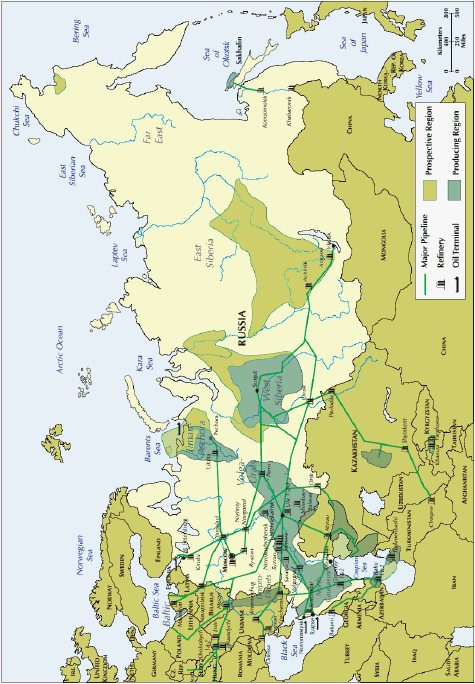 Source : AIE, Russia Energy Survey 2002. LOCALISATION DES RESSOURCES GAZIÈRES ET RÉSEAU DE TRANSPORT : RUSSIE / CEI 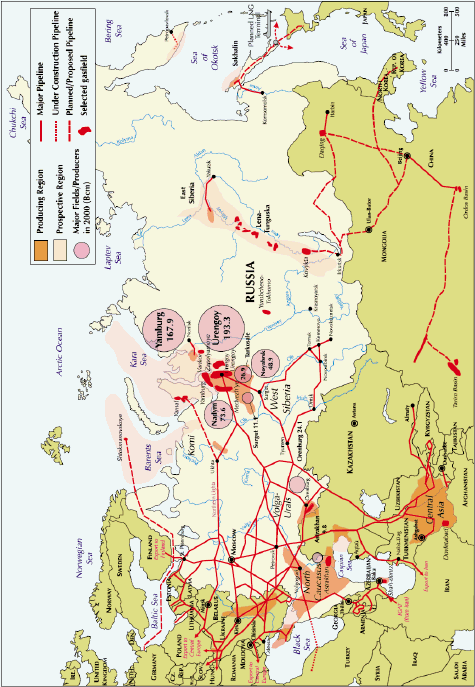 Source : AIE, Russia Energy Survey 2002. Cependant, le caractère incontournable, au sens propre, de la Russie, est rapidement apparu à ces Etats. En effet, la Russie est présente sur tous les axes : elle contrôle l'axe est-ouest d'évacuation du gaz du Kazakhstan et du Turkménistan ; par des branches nord-sud, elle alimente le Caucase et la Turquie ; dans le Caucase, la Russie contrôle plusieurs gazoducs - Russie-Azerbaïdjan, Russie-Géorgie-Arménie. Sans compter que la Russie contrôle aussi la quasi totalité du réseau de gazoducs intérieur en Géorgie qui menace d'imploser faute de moyens pour son entretien et qu'aucun investisseur n'est intéressé à racheter. Dans ces conditions, les tentatives de contournement du grand voisin russe n'ont, à ce jour, pas donné de résultats très convaincants. Ainsi, l'Ukraine, désireuse de se positionner sur le transit du pétrole caspien, s'est lancée dans la construction d'un oléoduc visant une réexpédition de ce pétrole vers l'Europe centrale. Elle a pour cela réalisé un pipeline de Pivdenny (Odessa) vers Brody, point de raccordement à l'oléoduc Droujba. Une extension Brody- Plock vers la Pologne est envisagée, qui permettrait d'atteindre le terminal de Gdansk. Cet oléoduc, achevé en 2001, est toutefois resté vide près de trois ans. Un accord signé avec la Russie en août 2004 a lancé son exploitation dans le sens inverse de celui prévu initialement, permettant ainsi, compte tenu des capacités de l'oléoduc Droujba, d'élargir la capacité d'exportation au brut russe via le terminal de Pivdenny... De même, les tentatives d'autonomisation des pays baltes n'ont pas été couronnées de succès. Opérateurs des exportations pétrolières russes vers le Nord-Ouest jusqu'en 2001, ces pays sont aujourd'hui confrontés à la concurrence du terminal russe de Primorsk, dont la construction semble avoir été notamment motivée par des relations russo-lettonnes difficiles. Ainsi, le port letton de Ventspils fait aujourd'hui l'objet d'un boycott total de la part de Transneft, ce dernier arguant de la surcharge de son réseau dans cette direction pour ne pas desservir ce terminal. Au total, si Ventspils reçoit toutefois par rail des cargaisons d'huile brute, le port travaille bien en dessous de sa capacité nominale. Quant aux options d'évacuation alternatives, elles se heurtent à des considérations géopolitiques, juridiques ou financières majeures, soit en raison de l'instabilité politique des régions à traverser (Afghanistan, conflits « gelés », du Caucase - Abkhazie, Ossétie, Haut-Karabakh), soit du fait de litiges juridiques (statut de la Caspienne), soit enfin du fait de la politique américaine (sanctions contre l'Iran). Dans ce contexte, quinze ans après la disparition de l'URSS, les trois axes majeurs des exportations d'huile depuis la CEI ont été confortés : - La mer Noire reste le premier débouché des huiles caspienne et russe. Le principal terminal de la zone est celui de Novorossisk, en Russie opéré par Transneft, qui devrait céder le pas en 2008 au Caspian Pipeline Consortium (CPC). - La mer Baltique a connu un accroissement considérable des volumes, accompagné d'une redistribution des rôles. La mise en service en décembre 2001 du terminal russe de Primorsk (Baltic Pipeline System ou BPS), a totalement détourné les flux d'huile du port letton de Ventspils. Le BPS fait, depuis, l'objet de tous les efforts de Transneft, qui en accroît la capacité tous les ans. - En Europe continentale, l'oléoduc Droujba (Samara - Europe centrale) est le principal oléoduc d'exportation. Il se divise au niveau de l'Ukraine en deux branches : au Nord, il va, via la Biélorussie, vers la Pologne et le terminal de Gdansk ; au Sud, il dessert successivement la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et l'Allemagne. Son point de départ est le hub de Samara, où il reçoit aussi bien de l'huile de Sibérie que de la région Caspienne. La problématique de l'évacuation des hydrocarbures n'est cependant pas épuisée et, si les projets de contournement de la Russie n'ont, jusqu'alors, pas vu le jour, la carte du transit des hydrocarbures dans la zone eurasiatique est en pleine mutation. L'entrée en service, en 2006, de l'oléoduc BTC (Bakou-Tbilissi-Ceyhan), projet d'origine américaine, est emblématique de cette redistribution des cartes dans une zone convoitée, où toutes les grandes puissances sont présentes. Ainsi, comme le montre l'entrée en service du BTC, les Etats-Unis ont réussi à faire prévaloir leur vision d'un axe Asie-centrale-Caspienne-Caucase-Turquie. Dans la même veine, un gazoduc reliant Bakou à la ville turque d' Erzerum, via Tbilissi, est en cours. Etape suivante, une alimentation du BTC par du pétrole provenant du gisement géant de Kashagan, au Kazakhstan - la plus importante découverte pétrolière depuis trois décennies, et amené par mer, est prévue. D'autres évolutions sont en cours, qui pourraient également bouleverser la problématique de l'évacuation des hydrocarbures dans l'espace post-soviétique. En premier lieu, la Chine se rapproche rapidement, non seulement de la Russie, mais également du Kazakhstan, et aurait des visées sur le Turkménistan. L'oléoduc ouest-est qui relie le Kazakhstan et la Chine est entré en service en 2006 et un gazoduc est également envisagé entre ces deux pays. Par ailleurs, des sociétés pétrolières chinoises (CNPC, Sheng-Li) commencent à se positionner dans la région, notamment en Azerbaïdjan et au Kazakhstan, le long des axes Ouest-Est. En deuxième lieu, le Turkménistan pourrait devenir à long terme une voie d'évacuation vers le sous-continent indien, alors que l'Inde affiche des besoins croissants. Une option consisterait à construire un gazoduc et un oléoduc amenant les hydrocarbures turkmènes à travers l'Afghanistan et le Pakistan. Enfin, en dépit de l'Iran Libya Sanctions Act, l'Iran reste un acteur, certes encore virtuel à maints égards, du grand jeu énergétique dans l'espace post-soviétique. S'il a été écarté des projets BTC, il reste présent sur l'axe est-ouest, pour le gaz. Par ailleurs, des « swaps » de pétrole du Kazakhstan et du Turkménistan, y compris par des compagnies américaines, ont lieu en utilisant le port iranien de Neka sur la Caspienne et le terminal de Kharg dans le Golfe persique. L'Iran demeure enfin une option pour l'évacuation du pétrole de Kashagan par un éventuel oléoduc Nord-Sud Kazakhstan-Turkménistan-Iran : le projet KTI, dont Total a lancé l'initiative dès 1998, se heurte cependant pour l'instant à la volonté de l'administration américaine d'écarter toute voie d'évacuation par l'Iran. Le Président Noursoultan Nazarbaev confirme néanmoins régulièrement son intérêt pour cette option qui est de loin la plus rationnelle en termes économiques et la mieux à même de répondre au problème d'enclavement du Kazakhstan. De même, les autorités azerbaïdjanaises sont conscientes de leur dépendance par rapport à l'axe Est-Ouest et n'excluent pas à moyen terme une voie Nord-Sud par l'Iran. b) Quel avenir pour la Russie dans le grand jeu énergétique autour de l'Asie centrale ? La Russie ne reste pas inactive face aux tentatives de contournement de son territoire. Dans l'objectif affiché de rester la plaque tournante du transit énergétique dans l'espace eurasiatique, elle met en œuvre une politique qui s'appuie sur l'instrumentalisation systématique de la situation de dépendance énergétique qui caractérise de facto les relations qu'elle entretient avec ses anciens membres. C'est, en réalité, une stratégie multiforme qui est mise en oeuvre, qui va de la participation financière dans les sociétés de transit présentes chez ses voisins au recours à l'arme énergétique et à la pression diplomatico-politique contre les pays récalcitrants. Plus récemment, c'est au moyen du prix du gaz que la Russie a réaffirmé sa volonté de préserver son influence énergétique dans l'espace ex-soviétique. La palette des armes utilisées par la Russie pour préserver et développer sa puissance énergétique peut être illustrée par la comparaison entre les relations que conduit la Russie avec l'Ukraine d'une part (1), les républiques d'Asie centrale, et notamment le Kazakhstan, d'autre part (2), ces deux exemples formant les deux extrémités du spectre de mesures mise en œuvre dans ce domaine par la Russie. (1) La stratégie de l'affrontement : les relations énergétiques entre l'Ukraine et la Russie La situation géographique unique de l'Ukraine, entre l'Europe occidentale et les pays producteurs d'hydrocarbures lui confère un rôle incontournable au sein des flux énergétiques trans-eurasiatiques. Elle détient ainsi le deuxième plus grand réseau de gazoducs et oléoducs au monde. On comprend dès lors que la Russie se soit émue de voir l'Ukraine, après la révolution orange et l'élection à la présidence de Victor Iouchtchenko, s'engager résolument à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN. Reste que le contentieux énergétique entre la Russie et l'Ukraine n'est pas nouveau et n'est pas né avec l'évolution politique récente - et peut-être avortée - de l'Ukraine. En effet, les relations entre les deux pays ont, tout au long de la décennie 1990, été empoisonnées par les questions énergétiques. Comme l'ont montré nos collègues René André et Jean-Louis Bianco dans le rapport qu'ils avaient consacré aux relations entre la Russie et l'Union européenne en 2004 (81), Moscou a, dès la fin des années 1990, choisi de recourir à l'arme énergétique à l'égard de l'Ukraine. Arme dont l'efficacité est garantie par la dépendance ukrainienne à l'égard du gaz russe (à hauteur de 80 %) et du pétrole (40 %). C'est ainsi que sous le premier mandat de Vladimir Poutine, la dette gazière ukrainienne a été systématiquement instrumentalisée : en 1999 et 2000, effacement de 100 millions de dollars de dette par an contre un bail sur 80 % des installations militaires de Sébastopol en faveur de la Russie, 285 millions de dollars de remise contre la rétrocession de bombardiers stratégiques et de 600 missiles de croisière ; tentative - manquée, l'Ukraine ayant opposé ses intérêts de souveraineté - d'effacement de l'intégralité de la dette en échange de prises de participation russes dans plusieurs entreprises ukrainiennes ; menace de construction d'un gazoduc de dérivation via la Pologne et la Slovaquie, Gazprom accusant l'Ukraine de siphonner le gaz transitant sur son territoire à destination de l'Europe. L'arme économique est également largement utilisée et l'on observe d'importantes prises de contrôle, par des capitaux russes, d'entreprises ukrainiennes intervenant dans les secteurs de la métallurgie, de la chimie, de l'énergie, de la finance, des médias ou des télécoms. Ainsi, les compagnies pétrolières russes Loukoïl et TNK contrôlent les quatre principales raffineries du pays ainsi que le réseau de distribution d'essence. Dès lors, dans le contexte politique particulièrement tendu entre les deux pays né de la révolution orange, l'Ukraine a fait les frais de la décision prise par Gazprom, pour 2006, de cesser de subventionner le gaz de la CEI et de lier le prix de celui-ci aux cours mondiaux du pétrole - puisque c'est ainsi qu'a été présenté le relèvement des tarifs du gaz vis-à-vis de ses voisins de la CEI par Moscou. LA CRISE GAZIÈRE DE L'HIVER 2005 ET L'ACCORD DU 4 JANVIER 2006 Au printemps 2005, la partie ukrainienne a souhaité sortir d'un système de troc pour passer à un système de règlement financier : la sortie des accords intergouvernementaux existants s'est faite brutalement à la fin de l'année 2005. L'Ukraine n'a pas, alors, sollicité les arbitrages internationaux que lui permettaient les accords intergouvernementaux en vigueur avec la Russie. Elle a signé le 4 janvier 2006, dans la plus grande confusion, un ensemble d'engagements qui ont été progressivement divulgués au fil des mois. Sujets à interprétation différente selon les sources, ces accords prévoient : - prix du gaz : 95 dollars les 1000 m3, jusqu'au 1er juillet 2006 selon Moscou, valable cinq ans sauf renégociation entre les parties selon Kiev. - prix du transit : 1,69 dollar les 1000 m3/100 km, fixé pour cinq ans selon Moscou ; selon Kiev ce prix, inférieur aux cours européens, est aussi révisable si le prix du gaz est lui aussi renégocié. - l'entrée sur le marché ukrainien, sous divers artifices, de RosUkrEnergo (RUE), intermédiaire imposé par Moscou selon Kiev ; choisi par Kiev selon Moscou ; intermédiaire obligé pour toute l'importation du gaz pour l'Ukraine, ainsi que, de plus en plus présent, pour la distribution aux consommateurs industriels, bénéficiant, de plus, de facilités de stockage à bon prix en Ukraine. Toutefois, dans le même temps où la Russie demanda à l'Ukraine 230 à 240 dollars/1 000 m3, elle signait un contrat de fourniture de gaz à la Biélorussie au prix de 46,68 dollars/1 000 m3 ; avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie au prix de 110 dollars/1 000 m3 ; avec les pays baltes à des prix compris entre 100 et 120 dollars/1 000 m3. Sans compter que la Russie continue, sur le marché intérieur, de facturer le gaz à des prix très inférieurs à celui du marché mondial (22 dollars/1 000 m3 pour la population et 31-33 pour les prix de gros). Cette décision de Gazprom a suscité une crise ouverte entre la Russie et l'Ukraine en décembre 2005, qui s'est soldée par la conclusion d'accords gaziers entre les deux pays, dont une partie seulement nous est connue et dont certaines dispositions ne laissent pas, disons-le, de susciter de nombreuses questions. A court terme, nombre d'analystes voient dans les accords du 4 janvier 2006 l'aliénation de l'indépendance énergétique et économique de l'Ukraine, et la prise de contrôle indirecte par Gazprom, tant des réseaux de gazoducs ukrainiens, que de la distribution locale aux industriels, voire, au bénéfice d'intérêts privés russes, d'entreprises monodépendantes de l'énergie (engrais par exemple). A ce jour, il reste difficile de comprendre pourquoi Kiev a accepté de tels accords : ils ne semblent pas, en effet, donner à l'Ukraine de garanties formelles sur le prix du gaz livré à l'Ukraine au-delà des six premiers mois de l'année 2006 et ils pourraient remettre en cause l'accord bilatéral passé avec Achgabat pour l'achat d'un volume de gaz turkmène. Qui plus est, ces accords sont le fruit d'un montage reposant sur un intermédiaire, RosUkrEnergo, dont la structure financière, côté ukrainien, est totalement opaque, ce qui va à l'encontre de l'objectif de transparence dont les autorités ukrainiennes se prévalent auprès de leurs partenaires occidentaux. Enfin, il prévoit la création, en Ukraine, d'une société mixte pour le transport du gaz, qui porte en germe un risque d'aliénation des infrastructures, même si les autorités se vantent de ne rien avoir cédé sur ce point. (2) La diplomatie énergétique de Moscou : les relations énergétiques entre l'Asie centrale et la Russie Si la Russie sait rappeler son poids et sa volonté à ses anciens satellites ou ses anciennes possessions dans le cadre de l'URSS, elle est également engagée dans une stratégie de rapprochement et de coopération avec un certain nombre de ses voisins et mène une véritable diplomatie énergétique. Cette politique est particulièrement flagrante vis-à-vis des Républiques d'Asie centrale, l'instrument privilégié de cette diplomatie étant la Communauté économique EurAsiatique (CEEA), organisation régionale née en 2000, héritière de l'union douanière constituée à Minsk en 1995 et regroupant la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et la Russie. Le Tadjikistan l'a rejointe en 1998 et l'Ouzbékistan en 2006. Le traité fondateur de cette organisation, aujourd'hui présidée par le Président Vladimir Poutine, est très ambitieux, comme l'est l'objectif tendant à la création d'un espace économique unique entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. L'Ukraine y occupe un statut d'observateur et le nouveau premier ministre ukrainien a évoqué une possible « intégration économique dans le cadre de la CEEA » lors de la réunion de l'organisation à Sotchi, à la fin du mois d'août 2006. La Russie insiste quant à elle sur son souhait de régler les questions énergétiques dans le cadre global d'un espace économique unique, notamment la question de la nécessité d'investissements massifs. L'intérêt de la Russie pour ce cadre est également lié à ses projets de développement de l'axe oriental de sa politique énergétique. L'objectif est de faire passer la part de l'Asie dans les exportations de pétrole de 3 % aujourd'hui à 30 % en 2020 et de gaz de 5 à 25 % sur la même période. Par cette diplomatie énergétique menée depuis plusieurs années en Asie centrale, dont la CEEA est le nouveau vecteur privilégié, Moscou s'est constitué une véritable « aire d'influence gazière ». Les succès diplomatiques sont là : le principal d'entre eux est constitué par le contrat de vingt-cinq ans signé en avril 2003 avec le Turkménistan, principal pays producteur de la région en dehors de la Russie ; de même, des contrats de transit de gaz ont été conclus, pour quinze ans, avec le Kazakhstan, le Kirghizstan et l'Ouzbékistan. Avec ces accords, Gazprom contrôle de facto la totalité des ressources des trois républiques centrasiatiques. La Russie reste donc la puissance dominante dans le jeu énergétique en Asie centrale, via ses groupes énergétiques, ses investissements, ses accords sécuritaires ou économiques ou encore sa coopération transfrontalière, culturelle et universitaire. Comme a pu le constater M. Jean-Louis Bianco, lors de la mission qu'il a effectuée au Kazakhstan au mois d'avril 2006, la Russie est effectivement omniprésente dans le discours des responsables d'un pays considéré comme un futur géant énergétique. La qualité des relations avec la Russie, nous a-t-il été dit, est une condition nécessaire pour permettre au Kazakhstan d'être à la hauteur de ses responsabilités énergétiques. C'est ainsi que le Président Noursoultan Nazarbaev avait déclaré, lors de la visite du Président Vladimir Poutine, en janvier 2004, que la Russie resterait la voie d'évacuation n°1 des huiles kazakhes. De fait, la Russie reste le partenaire « naturel » : l'outillage mental, comme la langue d'ailleurs, sont russes. Ajoutons à cela une frontière commune de 7 500 km, une importante minorité russe représentant 35 % de la population, la dépendance pour les questions de sécurité et, enfin, le rôle de la Russie comme premier partenaire économique. Toutefois, même si le Kazakhstan mène une politique déterminée d'intégration dans l'espace de la CEI, il est en réalité dans un exercice d'équilibre subtil afin de valoriser au mieux sa position géographique stratégique, aux confins de l'Europe et de l'Asie. Cette politique d'équilibre s'exprime au travers des multiples projets d'évacuation des hydrocarbures alternatifs à la Russie. L'ENCLAVEMENT DU KAZAKHSTAN La question de l'enclavement du Kazakhstan représente le principal point noir pour le développement énergétique du pays. Actuellement, l'évacuation du pétrole kazakhstanais se fait principalement par : - l'oléoduc Atyraou/Samara, dont la capacité devrait être doublée pour atteindre 20 Mt/an ; - l'oléoduc Tenguiz Novorossiisk (Caspian Pipeline Consortium, d'une longueur de 1 500 km), entré en service en novembre 2001. La capacité initiale du CPC - qui est de 28 Mt/an - pourrait être portée à 67 Mt. Plusieurs autres projets d'oléoducs sont aujourd'hui en cours de réalisation ou envisagés : - l'option Ouest : l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan (dit MEP "Main Export Pipeline"), qui vient d'être inauguré et qui entrera en service à la fin de l'année. Sa capacité pourrait être portée jusqu'à 1 million de barils/j. Le remplissage de cet oléoduc dépend en partie des huiles kazakhstanaises qui pourraient être acheminées par barge d'Aktau à Sangatchal à partir de 2006 à hauteur de 0.4 million de barils/j (la construction d'un oléoduc de raccord transcaspien se heurte à l'absence de définition du statut de la Caspienne). Le Président kazakh a renouvelé les engagements du Kazakhstan à alimenter ce pipeline lors de son inauguration à Bakou, le 25 mai 2005. - l'option chinoise : présenté par les interlocuteurs gouvernementaux de la Mission comme la priorité, le projet d'oléoduc sino-kazakh se concrétise, sa mise en fonctionnement étant prévue pour le mois de juin. Il relie un gisement de la Caspienne à la province du Xinjiang et a été achevé en décembre 2005. Sa capacité initiale devrait atteindre 200 000 b/j. - la troisième et dernière option est l'option iranienne (Kazakhstan - Turkménistan - Iran), évoquée ci-dessus. Toutefois, même si le discours officiel est celui d'un équilibre entre Russie, Etats-Unis, Chine, Europe et pays musulmans, les Kazakhstanais sont néanmoins prompts à rappeler à leurs interlocuteurs qu'ils ne peuvent qu'avoir la politique de leur géographie. Or celle-ci leur rappelle qu'ils partagent avec la Russie la plus longue frontière terrestre au monde... B - Producteur puissant, la Russie est-elle aussi un partenaire fiable ? Cette question peut sembler paradoxale : la Russie n'a, y compris pendant la période soviétique, jamais manqué à ses engagement contractuels vis-à-vis de ses partenaires européens. Reste que la crise gazière avec l'Ukraine à l'hiver 2005, dont certains Etats membres de l'Union européenne ont subi les conséquences négatives, a fait ressurgir cette question. Celle-ci n'est en réalité que la synthèse, brutale, d'un ensemble d'interrogations tenant in fine à la lisibilité de la stratégie énergétique russe - voire à son existence pour certains - et à sa crédibilité à moyen et long terme. A l'évidence, la Russie veut s'imposer comme une puissance énergétique globale, active non seulement dans l'espace eurasiatique, mais également dans le monde entier. L'utilisation de sa présidence du G 8 pour placer la sécurité énergétique au cœur des travaux de l'organisation internationale témoigne de cette volonté russe de s'affirmer sur la scène énergétique mondiale. Dans le même temps, en dehors de la CEI, la Russie n'a cessé de renforcer ses liens avec le Venezuela ou avec l'Algérie. Même si l'heure n'est pas encore à la mise sur pied d'une OPEP du gaz, une « OPEG », on notera avec intérêt l'engagement mutuel qu'ont pris la Russie et l'Algérie de coordonner leurs positions sur le marché du gaz, au-delà de l'exploitation conjointe de gisements de gaz en Afrique du Nord qu'elles ont décidée. Dans la même veine, le discours russe met en avant le thème de la diversification de ses clients, reprenant, à l'égard de l'Europe notamment, le thème du balancement vers l'Est, sous une forme parfois menaçante : c'est ainsi que sont triomphalement annoncés des projets pharaoniques de transport du gaz et du pétrole russes vers la Chine. L'ensemble des ambitions russes est résumée par le Président russe lui-même : ainsi, Vladimir Poutine, dans le Wall Street Journal du 28 février 2006, explique que « la redistribution de l'énergie inspirée uniquement par les priorités du petit groupe des nations les plus développées ne sert pas les objectifs du développement global. Nous nous efforcerons de créer un système de sécurité énergétique qui réponde aux intérêts de toute la communauté internationale ». Faut-il, avec Françoise Thom, voir dans cette déclaration du Président russe la volonté de Vladimir Poutine de « réaliser en dehors des frontières russes ce qu'il a réussi à faire chez lui, à savoir abolir le libre marché de l'énergie et organiser un super-cartel des producteurs, dans lequel le Kremlin détiendrait les postes de commande et qui maintiendrait les pays développés à la merci des producteurs enrégimentés par Moscou » (82) ? Géant énergétique, la Russie a-t-elle les moyens de cette ambitieuse réforme du système énergétique mondial ? 1) Mythes et réalités de la politique de diversification gazière en Russie Le 18 avril 2006, devant les ambassadeurs des Etats membres de l'Union européenne, le Président de Gazprom, Alexis Miller, expliquait dans une longue déclaration que la Russie pourrait réorienter ses exportations de gaz d'Europe vers la Chine et les Etats-Unis et que la fourniture de quantités supplémentaires de gaz à l'Europe serait conditionnée à la conclusion de contrats de fourniture à long terme. Les exportations vers les Etats-Unis se feront sous la forme de GNL, tandis que celles vers la Chine pourront avoir lieu soit sous cette même forme soit par gazoducs. Une étude de faisabilité a ainsi été annoncée pour la fin de l'année 2006, relative à la construction d'un oléoduc partant de Sibérie occidentale pour rejoindre, via les montagnes de l'Altaï (Mongolie occidentale) le gazoduc chinois Ouest-Est, afin d'approvisionner la Chine orientale. La fourniture annuelle de 30 milliards de m3 commencerait en 2011 et le coût du projet était estimé à 5 milliards de dollars. L'affirmation par la Russie de son souhait de diversifier son portefeuille de clients en matière d'exportation de gaz n'est pas nouvelle : c'est un objectif politique affiché depuis au moins dix ans. Le développement du gisement pétrolier et gazier de Sakhaline, sur la côte pacifique de la Russie a joué à cet égard un rôle déterminant et a conduit la Russie à envisager d'autres projets orientaux : plusieurs sont à l'étude qui concernent la Sibérie orientale, sans qu'aucun n'ait encore toutefois vu le jour. Au regard de la proximité géographique avec les grands marchés de consommation asiatiques, il est de toute façon évident que les ressources énergétiques de Sibérie orientale ne pourront être exploitées que si elles sont destinées, au moins en partie, sinon quasi-totalement aux marchés asiatiques (Chine orientale, Japon, Corée du Sud). Aucune infrastructure de transport n'existe cependant à ce jour. La question d'une concurrence entre l'Europe et la Chine ne se pose donc pas s'agissant des gisements de Sibérie orientale ; en revanche, les ressources de Sibérie occidentale peuvent aussi bien être destinées à l'Europe qu'à l'Asie. Ce sont donc ces ressources qui sont visées dans les discours russes sur la diversification. En termes strictement géographiques cependant, ce sont bien les marchés européens qui sont les plus proches (4 000 kilomètres jusqu'à l'Autriche, dont 2 800 en territoire russe) ; ajoutons que le réseau de gazoducs existe déjà, même s'il a grand besoin d'être modernisé - le tiers de ce réseau a plus de trente ans et 60 % plus de soixante ans - voire développé, dans la mesure où, dans certaines sections, il fonctionne à plus de 95 %. Du côté oriental, Pékin est à plus de 5 000 kilomètres, dont 2 000 en territoire russe si le trajet passe par la Mongolie occidentale et 3 500 par la Mongolie orientale. En l'occurrence, le projet de gazoduc de l'Altaï passerait par la Mongolie occidentale : il s'agirait de compléter le gazoduc existant qui relie la Sibérie occidentale à Novossibirsk par des tuyaux complémentaires et de le prolonger de 700 kilomètres à travers les montagnes de l'Altaï, jusqu'à la frontière chinoise. De là, la Chine devra construire un gazoduc pour le relier au gazoduc existant qui traverse la Chine d'Ouest en Est et augmenter la capacité de ce dernier, qui n'est aujourd'hui que de 12 milliards de m3 par an. Ajoutons que la traversée de la chaîne de l'Altaï signifie construire un gazoduc qui traversera des terres situées entre 3 200 et 4 300 mètres d'altitude... et dans une zone sismique. Le dernier tremblement de terre en date dans la région a eu lieu le 27 septembre 2003 et fut d'une magnitude de 7,3 sur l'échelle de Richter. Défi technique d'une redoutable complexité, ce gazoduc est également un défi financier pour Gazprom. Le budget d'investissement annuel de la société russe oscille aujourd'hui entre 10 et 11 milliards de dollars par an et se porte principalement sur les infrastructures de transport, qui bénéficient du double d'investissements par rapport aux capacités de production. Ce budget est largement destiné au maintien à leur niveau actuel des opérations en cours - la seule maintenance du réseau de transport requiert 2 milliards de dollars par an -, tandis que le seul projet majeur d'investissement mis en œuvre aujourd'hui est constitué par les premiers travaux du gazoduc Nord Europe à destination de l'Allemagne. Si l'on dresse un bilan des investissements à réaliser dans les années à venir par Gazprom, le budget d'investissement actuel de la société d'Etat apparaît largement insuffisant pour financer tous les projets prévus, soit : - 5 milliards de dollars pour le projet « Altaï », à répartir entre les parties chinoise et russe, certains experts estimant cependant ce chiffre notoirement sous-évalué et évoquant jusqu'à 12 milliards de dollars ; - 4,7 milliards de dollars jusqu'à 2011 pour la partie sous-marine du gazoduc Nord Europe, dont la moitié pour Gazprom, auxquels s'ajoutent 6 milliards de dollars pour la partie terrestre de l'ouvrage ; - 12 à 14 milliards de dollars d'ici 2011 (dont probablement la moitié pour Gazprom) pour le développement du gisement de Shtokman et la construction d'une usine GNL ; - 1,5 milliard de dollars pour la modernisation, voire l'extension du gazoduc entre l'Asie centrale et la Russie ; - 20 milliards de dollars au bas mot pour le développement du champ de Yuzhno-Russkoye et de la péninsule de Yamal en général ; - un milliard de dollars dans les deux années qui viennent pour équiper les régions russes en infrastructures leur permettant l'accès au gaz. Autant de projets auxquels il faut ajouter le développement des sites de stockage en Europe, le développement du potentiel de la Sibérie orientale, les investissements multiples en matière de liquéfaction du gaz ou dans un certain nombre d'infrastructures en dehors du secteur gazier (centrales électriques, secteur pétrolier...), etc. Au regard de cette liste impressionnante, il semble évident que la part chinoise du financement de l'Altaï sera déterminante pour la poursuite du projet. Ce qui renforcera d'autant le poids de la Chine dans la négociation, dès lors qu'il s'agira de négocier le prix du gaz fourni. En tout état de cause, la Russie ne sera pas en mesure de vendre son gaz à la Chine le même prix qu'elle le vend à l'Europe, ayant face à elle une entité unie, c'est-à-dire un marché unique où l'Etat chinois dispose du monopole d'achat, disposant par là même d'un très puissant levier de négociation. Levier d'autant plus puissant d'ailleurs que, dans le même temps où la Chine négocie avec la Russie, elle multiplie les contacts avec d'autres fournisseurs : la Chine a d'ores et déjà conclu des contrats de fourniture de gaz liquéfié avec l'Australie, l'Indonésie et l'Iran, et elle poursuit activement les négociations avec l'Asie centrale. Sachant que le volume total des importations gazières chinoises est évalué, pour 2010, à 40 milliards de m3 par an, pour augmenter à 80 milliards à l'horizon 2020, c'est dire que, dans l'hypothèse d'une finalisation du projet « Altaï », la Russie fournirait 30 milliards de m3, soit, dans un premier temps, la quasi-totalité des besoins chinois importés. A long terme, elle deviendrait un fournisseur majeur de la Chine. Dans quelle mesure celle-ci a-t-elle l'intention de dépendre à ce point de la Russie et quel serait son intérêt à se mettre dans une telle situation ? La question mérite assurément d'être posée... Et ne doit pas manquer de l'être dans la confidentialité des cercles du pouvoir russe, qui ont en mémoire l'expérience cuisante du projet Blue Stream à destination de la Turquie, qui vit cette dernière remettre en cause les conditions (volume et prix) du contrat de fourniture de gaz dès que le gazoduc fut opérationnel, arguant de possibles excédents d'importations. Au total, construire et entretenir ce gazoduc sera indubitablement un redoutable défi. Alors que les gazoducs envisagés entre les Républiques d'Asie centrale et la Chine ne sont pas encore en service, la gazoduc Altaï facilitera considérablement le développement, par la Chine, des infrastructures nécessaires à l'acheminement direct du gaz depuis l'Asie centrale, donnant par là même aux Chinois un puissant levier de négociations sur le prix du gaz avec la Russie. Pour le dire autrement, en construisant ce gazoduc, la Russie va permettre à la Chine de s'approvisionner directement en gaz en Asie centrale. C'est-à-dire obtenir ce qu'elle veut précisément éviter, à savoir un contournement de son territoire et la relativisation du rôle de pivot énergétique qu'elle veut se voir reconnaître dans l'espace eurasiatique. En outre, en permettant à la Chine de diversifier son portefeuille de fournisseurs, la Russie va se priver de sa capacité à négocier les prix en position de force, c'est-à-dire inverser le rapport de force en faveur de la Chine. Pour toutes ces raisons, l'Union européenne affiche aujourd'hui un très grand scepticisme à l'égard du discours russe de la diversification vers l'Asie, certains experts de la Commission allant même jusqu'à affirmer que ce projet ne se fera pas et estimant que la Russie privilégiera le développement de l'extrême orient sibérien, objectif d'ailleurs abondamment mis en avant par le Président Vladimir Poutine dans des déclarations récentes. Ce serait assurément un choix plus raisonnable mais il n'est écrit nulle part que la géopolitique de l'énergie soit rationnelle... En tout état de cause, ce que démontre a contrario l'exemple des relations énergétiques russo-chinoises, c'est, d'une part, la réelle dépendance à ce jour de la Russie vis-à-vis de l'Europe, le gaz russe n'étant, pour l'heure, exporté que vers les pays de la CEI et l'Europe, et, d'autre part, que l'Europe aurait tout intérêt à faire valoir que cette dépendance, outre qu'elle est mutuelle, n'est nullement problématique. L'argument de la Russie sur la fiabilité de ses livraisons à l'Europe peut lui être retourné : l'Europe est un client fiable, dont on ne peut pas supputer qu'il remettra en cause les clauses contractuelles conclues et ayant conduit à de lourds investissements. Sans qu'il soit ici question de faire quelque procès d'intention que ce soit, les chiffres eux-mêmes montrent que, si la Russie applique le même raisonnement à la Chine, elle doit prendre conscience qu'il s'agit en partie d'un pari. 2) La Russie et les investissement étrangers : une dépendance totale Qui plus est, le discours russe sur la diversification de sa clientèle est, en réalité, second par rapport à la question première de la capacité de l'Etat russe à maintenir le niveau de sa production énergétique. Pour pouvoir exporter, il faut au préalable produire, et produire beaucoup en l'occurrence. Bien que la Russie soit, en effet, vue d'Europe, considérée comme un fournisseur énergétique, c'est surtout et avant tout un consommateur gourmand, très en retard en matière d'efficacité énergétique. Avant de savoir où la Russie exportera ses ressources dans l'avenir, il faut donc s'interroger sur sa capacité à honorer ses engagements à l'exportation dans les années à venir. Pour l'Union européenne, c'est surtout la question du gaz qui est en cause, la Russie étant, en matière pétrolière, un fournisseur parmi d'autres, et pas le premier, loin de là. Qu'en est-il, d'ici à 2010, des capacités de production, a fortiori d'exportation, de la Russie en matière gazière ? En 2005, Gazprom a produit 548 milliards de m3 de gaz, auxquels s'ajoutent les 93 milliards de m3 produits par les producteurs russes indépendants et 20 milliards de m3 importés d'Asie centrale, soit au total 661 milliards de m3. A l'horizon 2010, il est difficile de prévoir exactement à combien cette production s'élèvera, dans la mesure où l'évolution de celle-ci dépendra de plusieurs facteurs : - Gazprom effectuera-t-il les investissements nécessaires dans les nouveaux champs de Sibérie occidentale, c'est-à-dire bien au-delà de ce que la société russe y investit actuellement ? - Les compagnies indépendantes vont-elles développer leur production ? Ceci pose, non pas la question technique du potentiel géologique des champs dont elles ont la responsabilité, mais celle de l'environnement économique et politique dans lequel elles sont amenées à évoluer, aujourd'hui marqué par le monopole de Gazprom en matière de transport et d'exportation et par un marché intérieur régulé, sur lequel sont pratiqués des prix de facto subventionnés. - Dans quelle mesure les importations en provenance d'Asie centrale vont-elles s'accroître, alors que, faute d'informations sur l'état des réserves turkmènes, Gazprom a suspendu les investissements nécessaires à l'accroissement de la capacité du gazoduc qui relie l'Asie centrale à la Russie et que le Turkménistan multiplie les contrats à l'exportation (Chine, Iran) ? Selon les réponses qui seront apportées à ces questions, trois scénarios peuvent être identifiés, que nous empruntons aux travaux réalisés par la délégation de la Commission européenne à Moscou : - dans le scénario optimal, la production gazière totale atteint 850 milliards de m3 en 2010 ; - le scénario moyen, qui repose sur un maintien des conditions actuelles, verrait cette production atteindre 720 milliards de m3 ; - enfin, dans le scénario du pire, qui verrait Gazprom subir le déclin des champs géants sans qu'ils soient remplacés, la production tomberait à 630 milliards de m3 en 2010. Les conséquences de chacun de ces scénarios sur les capacités d'exportation gazières de la Russie dépendent de l'évolution de la consommation interne. D'après la stratégie énergétique de la Russie élaborée en 2003, celle-ci augmentera de 1,3 % par an, s'établissant en 2010 à 475 milliards de m3. Il s'agit toutefois là d'une prévision optimiste, qui repose sur une sous-évaluation de la croissance annuelle de la consommation interne de gaz en Russie telle qu'elle peut être observée au cours des années récentes (environ 2,3 %). Certes, du fait de sa faible efficacité énergétique, la Russie dispose d'un potentiel d'accroissement énorme et Gazprom ne ménage pas ses efforts pour essayer d'obtenir une « libéralisation » des prix du gaz. Toutefois, on remarquera que, même augmentant de 10 à 15 % par an en termes réels, les prix du gaz n'ont pas modifié les habitudes de consommation. Par ailleurs, l'approvisionnement en gaz de certaines régions de la Russie, qui figure au nombre des projets nationaux du Président Poutine, devrait se traduire, d'après les experts, par l'arrivée sur le marché domestique de 11 millions de consommateurs supplémentaires et une consommation supplémentaire de 9 milliards de m3. Au total, c'est donc plutôt le chiffre de 503 milliards de m3 qui devrait être retenu pour la consommation interne de gaz en Russie en 2010. Si l'on croise ce paramètre avec les scénarios de production observés, on obtient, s'agissant, des capacités russes d'exportation en 2010, trois cas de figure : - le scénario optimiste, combinant les hypothèses les plus favorables en matière de production et de consommation, aboutit à une évaluation de 375 milliards de m3 disponibles à l'exportation, ce qui est amplement suffisant à la fois pour honorer les engagements existants et satisfaire les nouveaux marchés ; - le scénario moyen, qui aboutit au chiffre de 217 milliards de m3 disponibles à l'exportation (720 milliards de m3 produits diminués des 503 milliards nécessaires au marché domestique), verrait la Russie être en mesure d'honorer ses engagements actuels ; en revanche, le développement d'exportations vers la Chine ou les Etats-Unis l'empêcherait de maintenir à niveau ses exportations vers l'Europe ; - enfin, dans le scénario du pire (127 milliards de m3), la Russie ne serait même pas en mesure d'honorer ses contrats actuels avec l'Europe, sauf à ne pas renouveler ceux qui viendront à échéance à ce moment. Les conséquences en seraient dramatiques en Russie même, Gazprom réalisant deux tiers de ses bénéfices à l'export. Au vu du temps nécessaire à la réalisation des projets d'infrastructure, cette situation perdurerait au moins cinq ans. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le gaz d'Asie centrale est à terme vital pour la Russie, contrairement aux propos entendus par les membres de la Mission à Moscou. On comprend également a fortiori pourquoi la Russie n'a aucun intérêt à aider la Chine à se connecter directement au réseau de gazoducs de l'Asie centrale, ce à quoi aboutirait le projet « Altaï »... Ce que montrent également ces différents scénarios, c'est que beaucoup va se jouer dans les deux années à venir, au regard de l'envergure des projets d'investissement dans le domaine énergétique. Telle est sans doute la raison qui explique la pression actuellement mise par la Russie sur l'Union européenne en faveur de contrats de long terme. On notera que l'Union européenne n'est pas seule à établir des scénarios aussi pessimistes s'agissant de l'évolution des capacités d'exportation russes en matière gazière. Ainsi, l'institut de politique énergétique de Moscou prévoit un déficit gazier en Russie et en Europe de l'ordre de 100 milliards de m3 par rapport à la demande réelle dès 2010. De même, le Président de l'AIE, M. Claude Mandil, ne disait pas autre chose en juillet 2006 : « Gazprom n'a pas assez investi dans le développement de nouveaux gisements pour contrebalancer la décroissance de ses trois principaux champs gaziers » (83). La Russie souffre elle-même de ce sous-investissement chronique dans le développement de nouveaux secteurs de la production. Comme le note M. Vladimir Milov, « pour la première fois, les centrales électriques russes ont subi des restrictions d'approvisionnement en gaz au cours de l'été 2006, période durant laquelle la demande est traditionnellement basse. En janvier et février 2006, les volumes d'approvisionnement des centrales électriques russes ont chuté de 80-85 % par rapport aux volumes prévus par les contrats initiaux. » (84). Et l'auteur, Président de l'institut énergétique de Moscou, d'expliquer que « le secteur de l'énergie a dû recourir à des combustibles alternatifs », choix particulièrement onéreux, qui a en outre provoqué des émissions de dioxyde de carbone supérieures de 40 % à celles issues de la combustion de gaz. Comme l'indique M. Vladimir Milov, en dépit de ce contexte de sous-investissement chronique, entre 2003 et 2005, Gazprom, appuyé par l'Etat russe, a consacré 14 milliards d'euros à des prises de participation dans des compagnies opérant en dehors du secteur gazier : « cette somme dépasse à elle seule le total des capitaux mobilisés ces dix dernières années pour le développement en amont de la production gazière ». Et la participation de sociétés étrangères à des projets russes continue de relever du parcours du combattant. Ainsi, même l'entreprise E. ON-Rhurgas, qui détient pourtant 6,4 % du capital de Gazprom, a dû attendre plusieurs années pour négocier un accord solide lui assurant un accès au champ gazier Yuzhno-Russkoye en Sibérie orientale. L'accord cadre a été signé en juillet 2006 et l'accord final ...une nouvelle fois reporté sine die. 3) Du grand jeu au grand bluff ? Dans le domaine de l'énergie, la stratégie et la prévision à long terme sont nécessaires pour définir les approches à retenir en matière d'extraction d'hydrocarbures et de création de routes de transport. Aujourd'hui, la Russie engrange des sommes considérables provenant de l'exportation de produits énergétiques. Cependant, du fait d'un système inefficace, marqué par la méfiance entre les Etats et les entreprises et par de lourdes carences institutionnelles, dans un contexte d'opacité de la décision, les investissements à réaliser ne le sont pas. Ce d'autant moins que, par crainte d'une chute du cours du pétrole brut, la stratégie qui prévaut est celle d'une accumulation d'argent dans le fonds de stabilisation. Dans le même temps, vis-à-vis de l'Union européenne, la Russie a choisi une position de négociation conflictuelle. De son côté enfin, l'Union européenne n'est pas épargnée par le repli frileux, les tentatives des sociétés russes d'accéder aux réseaux de distribution étant le plus souvent bloquées. A l'évidence, l'échéance prochaine de la renégociation de l'accord de partenariat et de coopération, en 2007, entre l'Union européenne et la Russie n'est pas étrangère à la partie de poker menteur qui se joue aujourd'hui de part et d'autre. A cet égard, il serait souhaitable que chacun abatte ses cartes et consente à jeter un regard objectif sur son jeu. La dépendance européenne vis-à-vis du gaz russe est réelle, ce d'autant plus que les positions de Gazprom en Europe se renforcent. On rappellera par exemple que, si Gazprom contrôle 100 % du réseau de transit biélorusse, 45 % du réseau polonais, 46 % en Moldavie, 45 % en Arménie et 38 % dans les Etats baltes, en Allemagne, via sa filiale Wingaz, l'entreprise russe contrôlerait déjà 35 % des quatre principaux axes de transit du gaz. Reste que la dépendance russe vis-à-vis de l'Europe n'est pas moins réelle, comme on vient de le montrer, et que la Russie est consciente de ses limites. Ainsi, l'annonce, par le Président Vladimir Poutine, d'une réorientation du gaz de Shtokman vers l'Europe, ne peut-elle pas être interprétée comme la reconnaissance implicite de l'impossibilité, pour la Russie, de mener à bien à la fois ses projets européens, chinois et américains ? Si l'on en revient aux réalités, les chiffres sont clairs, 75 % des recettes d'exportation du secteur énergétique russe viennent de l'Union européenne et à l'inverse, l'Union des 25 dépend à 50 % de la Russie pour la fourniture de son gaz et de son pétrole. C'est dire que l'interdépendance est totale et que, tant que cette réalité n'aura pas été reconnue sereinement par les deux parties, on restera dans un jeu de rôles stérile. Les relations énergétiques entre l'Union européenne et la Russie doivent clairement poser les termes du marché : la Russie veut accroître sa sécurité énergétique, c'est-à-dire disposer d'une visibilité à long terme sur la demande, tandis que l'Union veut participer au développement de l'offre énergétique russe en apportant ses technologies. Il y a là matière évidente pour des investissements croisés, dès lors que le cadre juridique adéquat existera. Le moment est assurément propice pour une négociation constructive avec la Russie. Notamment, la présidence allemande de l'Union, qui débutera le 1er janvier 2007, est très désireuse de modeler durablement le futur de la relation russo-européenne et a assurément les moyens de le faire, du fait de son poids dans l'Europe et de ses intérêts à la stabilité de la relation euro-russe. De même, ne faut-il pas voir dans la déclaration du Président Vladimir Poutine, à l'occasion de la rencontre trilatérale avec ses homologues français et allemand à Compiègne, les 22 et 23 septembre 2006, évoquant la possibilité pour Gazprom de réorienter le projet d'exploitation du gisement de gaz de Shtokman au profit des Européens, un signal positif de la part de la Russie ? Outre le fait que cette décision survient à un moment de refroidissement très net des relations russo-américaines, ne peut-on y voir l'esquisse d'une base de négociation, la Russie demandant en contrepartie de ce geste vis-à-vis de l'Union, une charte européenne de l'énergie plus favorable aux intérêts russes ? Le temps est assurément venu de prendre quelque distance vis-à-vis du discours russe, ou européen d'ailleurs, qui tend à survaloriser la puissance de la Russie, ce qui peut avoir un sens à court, voire à moyen, terme mais certainement pas à long terme. Réelle, la puissance énergétique de la Russie ne saurait faire oublier quelques évidences qui reposent, non sur des discours, mais sur des faits : la Russie a au moins autant besoin de ses partenaires que ses partenaires ont besoin d'elle. La Russie est donc un géant énergétique ...mais elle est un géant aux pieds d'argile, qui a un besoin crucial de la communauté internationale pour valoriser et exporter son patrimoine énergétique, condition de sa stabilité intérieure. En d'autres termes, la Russie ne saurait rester un producteur puissant si elle n'est pas dans le même temps un partenaire fiable. L' Amérique du Sud : Repères En 2005, l'Amérique du Sud a produit 9 % de l'énergie mondiale ; elle en a consommé 6,7 % avec 8 % de la population mondiale. Le sous-continent possède 8,9 % des réserves pétrolières conventionnelles mondiales. 64,6 % de ces réserves sont concentrées au Venezuela (hors pétroles non-conventionnels) et 19 % au Mexique. L'Amérique du Sud représente 15 % de la production pétrolière mondiale et ne consomme que 8,5 % du total mondial. S'agissant du gaz naturel, l'Amérique du Sud possède 4,5 % des réserves mondiales, dont 2,5 % pour le Venezuela et 0,9 % pour la Bolivie. Le sous-continent produit 7,5 % du total mondial et en consomme 6,8 %. En ce qui concerne l'hydroélectricité, l'Amérique du Sud dispose d'un potentiel encore très largement sous-exploité. Le phénomène de la mondialisation issu de la libéralisation généralisée des échanges de biens, de services et de flux financiers révèle une unité toute particulière en matière énergétique, en soulignant la très forte interdépendance de tous les Etats et l'importance stratégique de certains territoires ou passages maritimes. Toutefois, alors que la mondialisation s'accompagne, dit-on, de la montée en puissance d'entités supranationales incarnées en matière énergétique par les compagnies pétrolières multinationales et de l'effacement corrélatif des Etats, le secteur de l'énergie présente la particularité d'être à la fois un marché totalement mondialisé et de faire prévaloir les Etats souverains sur les acteurs transnationaux. Les décisions récentes prises par la Bolivie ou le Venezuela de nationaliser le secteur énergétique illustrent parfaitement cette prééminence des Etats. Cet acte de souveraineté pétrolière que justifie la réalisation d'un modèle politique de développement peut-il à lui seul permettre de satisfaire cet objectif dans un monde où les intérêts économiques et politiques de tous les acteurs - Etats comme compagnies pétrolières - sont intimement liés ? L'énergie peut-elle être la nouvelle arme politique de l'Amérique latine ? Les développements qui suivent se fondent en partie sur les informations et les éléments recueillis par MM. Cochet et Goldberg qui ont effectué dans le cadre de la Mission d'information un déplacement en Bolivie, au Brésil et au Venezuela en juillet 2006. A - La nationalisation des hydrocarbures en Bolivie et au Venezuela ou l'énergie au service de la politique Avec l'accession au pouvoir d'Hugo Chavez au Venezuela en 1998, puis l'élection d'Evo Morales en Bolivie en décembre 2005, la question énergétique est devenue un enjeu géopolitique de premier plan. Le poids des idéologies, très présentes dans de débat énergétique, révèle en la matière la primauté d'une logique politique sur une logique économique. 1) La nationalisation des hydrocarbures marque la primauté d'une logique politique sur la logique économique Liée à la hausse des prix de l'énergie, la tendance à la nationalisation des ressources en hydrocarbures est un phénomène observé à l'échelle mondiale. Dans le contexte latino-américain, après la décennie « libérale » des années 1990, ce mouvement de nationalisme économique a été lancé par le Président vénézuélien Hugo Chavez. Il est présenté comme un juste rééquilibrage après des décennies de « pillage » des ressources naturelles nationales au profit d'intérêts étrangers. Ce mouvement de nationalisation est néanmoins perçu par les opérateurs étrangers comme une remise en cause hostile des contrats signés et des concessions obtenues lors de l'ouverture du marché au cours des années 1990. Les compagnies étrangères ne contestent pas tant le rééquilibrage des termes des contrats que la brutalité de la méthode utilisée par les gouvernements vénézuélien et bolivien. a) Un acte de souveraineté pétrolière En 2005, le Venezuela a été le neuvième producteur et le sixième exportateur mondial de pétrole. Les réserves pétrolières prouvées du Venezuela s'élèvent à 78 milliards de barils de brut léger, soit le sixième rang mondial et 80 % des réserves de l'Amérique du Sud. Si l'on y ajoute les réserves de brut lourd et extra lourd de la ceinture de l'Orénoque (estimées à 120 milliards de barils exploitables en l'état actuel des technologies sur un total d'environ 235 milliards de barils), les volumes totaux placent le pays dans les premiers rangs mondiaux (aux côtés de l'Arabie Saoudite et de l'Iran). LES CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR PÉTROLIER VÉNÉZUÉLIEN
Source : OPEP / AIE. HUGO CHAVEZ : LA CONQUÊTE DU POUVOIR AU VENEZUELA Elu avec 57 % des suffrages, Hugo Chavez est devenu Président du Vénézuéla le 6 décembre 1998. Facilement réélu en juillet 2000 avec 60 % des voix, il a toutefois dû faire face à une importante contestation politique, qui s'est soldée par une tentative de coup d'Etat (le 11 avril 2002) puis une grève générale insurrectionnelle au sein de la compagnie pétrolière nationale PDVSA (entre décembre 2002 et février 2003). Toutefois, le Président Hugo Chavez est sorti largement victorieux du référendum révocatoire organisé par l'opposition. Ce succès (59,25 % des voix) a renforcé sa légitimité tandis que l'opposition est désormais très affaiblie et divisée. Tant les élections locales du 7 août 2005 que les élections législatives du 4 décembre 2005 ont confirmé la progression électorale du régime chaviste. La nationalisation des hydrocarbures trouve son origine dans la loi organique de 2001 sur les activités pétrolières, qui a défini un nouveau cadre juridique pour les compagnies privées. La participation du secteur privé (national ou international) aux activités d'exploration-production pétrolière n'est plus autorisée que dans le cadre de co-entreprises ou sociétés mixtes dont le secteur public vénézuélien doit détenir plus de 50 % des parts. En application de cette nouvelle législation, le gouvernement vénézuélien a exigé en 2005 la migration de tous les contrats d'exploitation pour le compte de la compagnie nationale Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) vers des entreprises mixtes détenues majoritairement par PDVSA. Puis l'Assemblée nationale vénézuélienne a récemment adopté, le 11 mai 2006, une modification substantielle de la législation pétrolière de 2001, ayant pour objectif d'élever la fiscalité des opérateurs de brut lourd de la ceinture de l'Orénoque ; la pression fiscale est passée d'environ 37 % à environ 60 %. Encouragé par ses succès électoraux passés et la perspective de la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2006, le Président Hugo Chavez a été incité agir de la sorte en raison des cours élevés du baril de pétrole et des profits considérables dégagés et annoncés par les majors. Mais en procédant ainsi, le régime s'affranchit des engagements pris sous les gouvernements précédents, au risque d'éroder la confiance des investisseurs privés et des compagnies étrangères dont il pourrait pourtant avoir besoin demain. Le nouveau dispositif prévoit : - des royalties de 33,33 % dont la base de calcul est fondée sur la valeur de la production ; - une taxe municipale additionnelle de 1 % sur la production ; - un impôt de 50 % sur les bénéfices réalisés par les compagnies pétrolières ; - un impôt supplémentaire à l'exportation de 0,1 % de la valeur ajoutée. Cette nouvelle fiscalité dispose toutefois d'un régime d'exception pour les projets non rentables qui bénéficieront de royalties réduites à 20 %. LA PRÉSENCE DE TOTAL AU VENEZUELA Total est le second producteur d'hydrocarbures privé du Venezuela avec une production propre de 113 000 barils/jour (derrière Chevron Texaco à 165 000 barils/jour) mais le premier investisseur étranger du pays avec un montant cumulé de plus de 3 milliards de dollars. Jusqu'en mars 2006, le pétrolier détenait des intérêts sur quatre titres miniers : - Le projet phare du groupe est celui de Sincor, filiale à 47 % de Total (en partenariat avec PDVSA et la compagnie norvégienne Statoil) et consiste en l'exploitation et la transformation de bruts extralourds de la ceinture de l'Orénoque. Après un investissement initial de 4,2 milliards de dollars, ce gisement d'huiles lourdes produit environ 200 000 barils/jour. Fort de ce succès, Total a proposé un projet de doublement des capacités, baptisé « Sincor II », sans avoir cependant pu à ce jour en commencer les négociations avec les autorités vénézuéliennes. - Le re-développement du champ de Jusepin (production de 30 000 barils/j). Le gouvernement vénézuélien a décidé en 2005 de remettre en cause tous les contrats de service, dont celui de Jusepin, et de transférer leur gestion à une entreprise mixte à créer dont PDVSA serait majoritaire. Les partenaires de ce permis, conduits par l'opérateur Total, ayant refusé d'accepter une participation inférieure à 40 % dans l'entreprise mixte avant la date butoir du 31 mars 2006, la fin du contrat de service leur a été notifiée par les autorités à cette date. Les discussions avec les autorités sur le règlement de cette terminaison contractuelle unilatérale se poursuivent actuellement. - Le re-développement du champ de gaz de Yucal Placer (participation à 69,5 % en association avec Repsol et deux sociétés vénézuéliennes, 100 millions de pieds cubes/jour, soit 2,83 millions m3/jour) pour lequel les partenaires préparent actuellement un projet de triplement de la production à 300 millions de pieds cubes/jour. - Enfin, le groupe a acquis, en janvier 2005, une participation de 49 % dans le permis d'exploration offshore Bloc 4 (Plataforma Deltana) en association avec Statoil. Les partenaires recherchent du gaz sur ce permis. Un différend oppose les autorités vénézuéliennes et Total depuis mai 2005 suite à la mise en accusation de Sincor pour avoir excédé ses droits de production ainsi que le périmètre du bloc attribué. Total et Statoil estiment qu'ils ont respecté le cadre contractuel ainsi que toutes les autorisations délivrées par les autorités de l'époque leur permettant d'exploiter la concession accordée par les autorités à un débit de 214 500 barils/jour. Les discussions avec les autorités sur cette divergence d'interprétation se poursuivent actuellement. Avec 890 milliards de m3 fin 2004, la Bolivie dispose des deuxièmes réserves de gaz d'Amérique latine après le Venezuela. La nationalisation des hydrocarbures de Bolivie n'est pas une surprise ; c'est la mise en œuvre d'une promesse d'Evo Morales lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. L'exploitation de la ressource gazière, susceptible de constituer un important levier de développement, n'a cessé de provoquer des controverses dans une Bolivie hantée par un sentiment de spoliation historique lié à l'exploitation de l'argent de Potosi, du caoutchouc et de l'étain. Un sentiment aggravé par l'amputation de son territoire lors de la guerre du Pacifique contre le Chili (1880), qui entraîna la perte du littoral bolivien, et de celle du Chaco avec le Paraguay (1932-1935), sur laquelle planait déjà l'odeur du pétrole. C'est à la lumière de ces événements de l'Histoire qu'il faut analyser l'annonce faite le 1er mai 2006 par le Président Evo Morales de l'adoption du décret suprême sur la mise en œuvre de la nationalisation des hydrocarbures. Ce décret suprême n° 28 701 « Heroes del Chaco » du 1er mai 2006 reprend une promesse faite de longue date aux électeurs boliviens par le candidat Morales. Alors que la Bolivie avait déjà connu deux nationalisations du secteur des hydrocarbures, en 1937 et 1969, le processus de privatisation de la compagnie Yacimientos petroliferos fiscales bolivianos (YPFB) entamé en 1996 était fortement contesté. En septembre 2003, un projet d'exportation du gaz vers le Mexique et les Etats-Unis, via le Chili (considéré comme l'ennemi historique) avait provoqué un mouvement social de grande ampleur réprimé brutalement et causant la mort de 80 personnes. Cette « guerre du gaz » avait entraîné la démission du Président Sanchez de Lozada et l'organisation par son remplaçant, le vice-Président Carlos Mesa, d'un référendum - le 18 juillet 2004 - sur la nationalisation des hydrocarbures. Une nouvelle loi sur les hydrocarbures (17 mai 2005) avait ensuite fixé à 50 % les droits d'exploitation imposés aux entreprises étrangères. Après la publication du décret de nationalisation du 1er mai, le Président Evo Morales avait donné 180 jours aux compagnies étrangères pour trouver un accord avec le gouvernement sur la nouvelle répartition des revenus. A défaut, les compagnies étaient invitées à quitter le pays. L'annonce in extremis, les 27 et 28 octobre, à moins de 24 heures de la date limite fixée par le décret de nationalisation, d'un accord avec chacune des dix compagnies étrangères (85) présentes en Bolivie - dont Total - représente un succès incontestable pour le Président Evo Morales, qui était de plus en plus critiqué en raison de la lenteur et de l'incertitude de la mise en œuvre de son projet (86). Il aura finalement réussi le pari de réaliser la nationalisation des hydrocarbures, tout en s'assurant de la continuité de la production et de la reprise de l'exploration. Au-delà des postures des uns et des autres, le scénario de la rupture n'a jamais paru réaliste. La Bolivie ne dispose en effet ni des moyens technologiques ni des ressources financières suffisantes pour se priver des compagnies étrangères. Les débouchés commerciaux du pays sont réduits en raison de son enclavement territorial. Sans les investissements et l'appui des compagnies étrangères, la Bolivie n'est donc pas en mesure d'assurer l'exploitation de ses ressources gazières. La nationalisation des hydrocarbures prévoit que 82 % des revenus des hydrocarbures doivent désormais être reversés à l'Etat. En application des nouveaux contrats, qui se substituent à ceux conclus sous le régime de la loi de 1997, l'Etat bolivien recevra environ 1 300 millions de dollars par an sur une valeur de production estimée à 2 000 millions de dollars ; la compagnie nationale YPFB devrait percevoir 300 millions de dollars (contre 250 pour l'Etat et YPFB avec les anciens contrats). Les nouvelles ressources ainsi dégagées devraient être consacrées au développement économique et social du pays. Outre la clé de répartition des revenus, les nouveaux contrats diffèrent des précédents, essentiellement en ce qu'ils font des entreprises des prestataires de services pour le compte d'YPFB, propriétaire du gaz et responsable de sa commercialisation. Après vente du gaz, YPFB rémunérera les compagnies et reversera les taxes à l'Etat. b) Un climat d'insécurité juridique qui provoque une chute des investissements étrangers La nouvelle donne vénézuélienne et la nationalisation bolivienne, surtout si elles devaient avoir un effet de contagion sur d'autres pays de la région (le Pérou, par exemple), pourraient aboutir à un repli durable des investissements étrangers dans le secteur des hydrocarbures en Amérique du Sud et à une baisse des capacités de production sur le sous-continent. Pour mémoire, au Venezuela, les compagnies étrangères ont investi 27 milliards de dollars depuis 14 ans et représentent près de 10 % du PIB du pays. Il ne fait pas de doute que l'insécurité juridique qui prévaut dans le secteur des hydrocarbures est préjudiciable aux investissements étrangers. Au Venezuela, la production pétrolière connaît une diminution sensible ces dernières années : 2,53 millions de barils/jour en 2005 contre 3,2 millions de barils/jour en 1998. Pour relancer la production, les autorités vénézuéliennes ont annoncé mi-2005 un plan d'investissement du secteur pour la période 2006-2012 d'un montant de 56 milliards de dollars. Trois raisons peuvent expliquer cette baisse de la production : - la grève pétrolière de décembre 2002 à février 2003 : les experts considèrent que le Venezuela a perdu, au cours de cette grève, une capacité d'environ 400 000 barils/jour ; - le manque d'investissement de la compagnie publique PDVSA, dont les ressources sont assez largement obérées depuis deux ans par le financement massif de projets sociaux visant à réduire la pauvreté ; - la stratégie des autorités vénézuéliennes tendant à refuser, en période de renégociation des accords et partenariats, les projets d'investissement présentés par les opérateurs étrangers. En Bolivie, l'investissement dans le secteur des hydrocarbures a enregistré en 2005 un repli de 400 % ; la chute atteint même 830 % pour les activités d'exploration. Ainsi, le lendemain de l'annonce de la nationalisation, la compagnie brésilienne Petrobras a annoncé la suspension de ses investissements en Bolivie. Or les investissements sont indispensables pour la découverte de nouveaux gisements. Si la production gazière bolivienne continue encore d'augmenter fortement, c'est grâce aux investissements réalisés au cours des années précédentes. A cet égard, la conclusion de nouveaux contrats intervenue à la fin du mois d'octobre 2006 va permettre aux compagnies de reprendre leurs investissements, même si les conditions de rentabilité seront moins favorables qu'auparavant. Le Président bolivien Evo Morales a admis la nécessaire sécurité juridique dont doivent disposer les opérateurs étrangers et précisé que celle-ci devrait être garantie par la ratification parlementaire des contrats. Polémique sur l'étendue des réserves Le principal enjeu du secteur pétrolier vénézuélien est l'importance de ses réserves, qui en font un acteur clé aujourd'hui mais surtout dans les prochaines années. En effet, le Venezuela détient les premières réserves mondiales si l'on agrège pétrole léger et lourd. Le Venezuela a besoin des compagnies étrangères. En effet, la conjonction des insuffisances techniques et humaines au sein de la compagnie nationale PDVSA et de l'ambitieux programme d'investissements de la compagnie publique sur les prochaines années entraîne des besoins importants et un marché potentiellement dynamique pour notre industrie pétrolière (fournisseurs, équipementiers et prestataires de service, etc.). S'agissant de la Bolivie, il faut en effet garder à l'esprit que ce sont les multinationales étrangères qui ont mis au jour les richesses énergétiques du sous-sol bolivien. Les réserves de pétrole sont passées de 178 millions de barils en 1996 à 929 millions en 2002. Durant la même période, les réserves de gaz estimées ont été multipliées par 12,5 passant de 4,24 TCF (trillions de pieds cubiques (87), mesure utilisée par les exploitants) à 52,3 TCF (dont 28,7 sont certifiés). 2) Les finalités politiques de la souveraineté énergétique : l'exemple du Venezuela L'impératif de redistribution sociale Le maintien de fortes inégalités contribue à entretenir l'instabilité sociale, ce qui conduit à une instrumentalisation politique de la ressource énergétique. Au Venezuela, le Président Hugo Chavez mène ainsi une politique active en direction des secteurs défavorisés. Reprise en main par le gouvernement après une grève « historique » de soixante-quatre jours, la compagnie pétrolière PDVSA a consacré, en 2004, 3,5 milliards de dollars à des programmes sociaux. La compagnie nationale soutient ainsi 90 % de l'investissement social du gouvernement. Les compagnies étrangères participent également de façon significative à l'effort social ; elles ont développé près de 1000 projets sociaux qui concernent, directement ou indirectement, plus de 1,5 million de personnes. Les compagnies pétrolières se substituent ainsi aux pouvoirs publics, et la rente pétrolière fait apparaître l'urgence d'une réforme de l'Etat et de la structuration d'une administration disposant des moyens et des compétences pour concevoir et mettre en œuvre les politiques de redistribution. Les risques d'un retournement de conjoncture Au Venezuela, le budget de l'Etat connaît un niveau de recettes record. En effet, celles-ci ont été quasiment multipliées par deux entre 2004 et 2006, passant de 24 % du PIB à 26,6 % en 2005 et probablement 36 % en 2006 (soit de 27 à 45 milliards de dollars). Cette progression est liée pour partie à une augmentation sensible des recettes fiscales pétrolières. L'activité pétrolière est le pilier de l'économie vénézuélienne, assurant plus de la moitié des recettes de l'Etat et environ 85 % des exportations. Grâce à l'augmentation des cours du brut, l'économie a enregistré une croissance inédite de 17,3 % en 2004. Néanmoins, la période récente est marquée par une flambée des dépenses publiques, qui ont bondi de plus de 30 % (elles sont passées de 26,3 % du PIB en 2004 à 36,5 % du PIB en 2006). Ainsi, malgré l'importance des recettes pétrolières, le Venezuela devrait connaître en 2006 un déficit budgétaire d'environ 2 % et le Fonds de stabilisation économique censé protéger le Venezuela contre un retournement de la conjoncture pétrolière n'a pas été alimenté. Nombre d'experts s'interrogent sur la soutenabilité d'un tel niveau de dépenses publiques dès lors que la variable d'ajustement est essentiellement constituée par le prix du pétrole et son impact sur les recettes fiscales pétrolières. Le Venezuela constitue un exemple caractéristique du « syndrome hollandais », à savoir un abandon des activités productives traditionnelles (café, cacao, élevage) et une dépendance croissante à l'égard des importations. Tout à son projet de « révolution bolivarienne », le Président Hugo Chavez est également soucieux de réduire la dépendance traditionnelle du Venezuela vis-à-vis du marché des Etats-Unis et de développer une stratégie propre à l'égard des pays dits « émergents ». Les autorités vénézuéliennes souhaitent développer une coopération Sud-Sud, notamment avec la Chine et avec l'Iran, mais aussi avec l'Afrique. En effet, tout en réaffirmant régulièrement qu'elle n'interrompra ni ne réduira ses exportations vers les Etats-Unis, Caracas s'efforce néanmoins de diversifier ses débouchés pétroliers, avec une prédilection pour l'Inde et la Chine, gros pays consommateurs invités à participer au développement du Venezuela. dix-neuf accords de coopération ont été signés avec la Chine dont cinq concernent plus spécifiquement le secteur pétrolier. Les plus notables portent sur le développement et la gestion de douze champs marginaux à l'Est du Venezuela, la garantie de livraison de 120 000 barils/jour pour compenser le déficit énergétique chinois et l'engagement de la construction d'un oléoduc à travers le Panama pour faciliter les livraisons à la Chine. Cette instrumentalisation politique de l'énergie ne risque-t-elle pas de se retourner contre ses auteurs ? L'utilisation de l'énergie comme arme de chantage pourrait en effet renforcer la volonté des pays consommateurs d'accélérer la diversification de leur approvisionnement et d'investir plus massivement dans des sources d'énergie alternatives. B - L'énergie peut-elle constituer la base de l'intégration sud-américaine ? 1) Des priorités nationales de plus en plus contrastées a) L'objectif du Venezuela : fédérer le monde contre l'impérialisme américain Depuis l'arrivée au pouvoir du Président Hugo Chavez, la politique des autorités vénézuéliennes dans le secteur pétrolier vise à favoriser les accords énergétiques régionaux afin d'assurer au Venezuela une position de leadership. C'est à la lumière de cette ambition que peut se lire l'entrée du Venezuela dans le Mercosur. Cette adhésion - il s'agit du premier élargissement du Mercosur depuis sa création formelle en 1991 - permet au Président vénézuélien de revenir au centre du jeu sud-américain. En intégrant la quatrième économie d'Amérique du Sud, avec un PIB qui devrait frôler les 150 milliards de dollars à la fin de l'année 2006, le Mercosur représentera bientôt environ 75 % du PIB du continent sud-américain et étend désormais ses frontières jusqu'à la mer des Caraïbes. Au surplus, il compte désormais dans ses rangs le détenteur des premières ou des secondes réserves pétrolières au monde, au niveau de l'Arabie Saoudite. On peut raisonnablement penser que la dimension énergétique a joué un rôle essentiel dans l'adhésion du Venezuela dès lors que les pays du cône Sud sont confrontés depuis plusieurs années à une crise énergétique latente. Le Président Hugo Chavez, que le Président Fidel Castro présente comme son fils spirituel, entend promouvoir la révolution bolivarienne au-delà des frontières vénézuéliennes et s'imposer comme le porte-parole de l'anti-impérialisme et de la résistance aux Etats-Unis. Il s'en prend de plus en plus souvent ouvertement au Président George Bush, qualifié tantôt d' « idiot » ou de « terroriste ». Le Président vénézuélien n'a jamais pardonné aux Etats-Unis leur attitude bienveillante lors de la tentative de coup d'Etat qui, en avril 2002, l'éloigna quarante-huit heures du pouvoir. Dans son discours prononcé le 20 septembre 2006 à la tribune des Nations unies, le Président Hugo Chavez a même qualifié le Président américain de « diable », de « menteur » et de « tyran ». Il n'aura toutefois pas réussi à obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Au terme d'un long bras de fer engagé contre le Guatemala - soutenu par les Etats-Unis -, et après 47 tours de scrutin à l'Assemblée générale, les deux pays ont finalement retiré leur candidature au bénéfice inattendu du Panama. b) L'objectif de la Bolivie : enrayer la fatalité de la pauvreté Bien que possédant les deuxièmes réserves de gaz d'Amérique latine, la Bolivie est paradoxalement le pays le plus pauvre (après Haïti) d'Amérique du Sud. Par la nationalisation, la Bolivie entend se donner les moyens de renégocier les prix de vente de son gaz à ses voisins (pour l'essentiel, le Brésil). Il n'existe en effet pas de prix international du gaz car il n'y a pas de marché unifié du gaz naturel au niveau mondial. En Amérique du Sud, comme sur la majorité du continent européen, les marchés gaziers fonctionnent ainsi essentiellement sur la base de contrats bilatéraux d'approvisionnement. Parallèlement à l'annonce des nationalisations, le gouvernement bolivien a lancé le 16 juin 2006 un plan quinquennal (2006-2011) pour une Bolivie « digne, souveraine, productive, démocratique afin de vivre bien ». Ce plan vise à construire un Etat « social communautaire » et à extirper les séquelles « de cinq siècles de colonisation et de plusieurs décennies de néolibéralisme et d'exclusion ». Au sommet de Puerto Iguazu, qui a réuni le 4 mai 2006 les présidents Evo Morales (Bolivie), Hugo Chavez (Venezuela), Luiz Inácio Lula da Silva (Brésil) et Nestor Kirchner (Argentine), la Bolivie s'est vu reconnaître son « droit souverain de définir sa propre politique en matière de ressources naturelles ». Le pays s'est engagé à assurer l'approvisionnement en gaz du Brésil, dont les besoins en gaz naturel sont couverts à plus de 50 % par la Bolivie, mais à des prix qui seront révisés à la hausse. Un contrat très important a également été signé le 19 octobre 2006 avec l'Argentine, qui prévoit la fourniture de gaz bolivien pendant vingt ans. En fournissant 27,7 millions de mètres cubes de gaz par jour contre 7,7 millions actuellement, la Bolivie pourrait ainsi permettre à Buenos Aires d'éviter une nouvelle crise énergétique. c) L'objectif du Brésil : garantir son indépendance énergétique Le Brésil a atteint en 2006, pour la première fois de son histoire, l'autosuffisance pétrolière, alors qu'en 1979, le pays importait 80 % de son pétrole, ce qui représentait 50 % du total de ses importations. Une caractéristique importante est que l'essentiel de la production provient de puits en eaux profondes, voire ultra-profondes. Les réserves combinées de pétrole et de gaz sont estimées à 15 milliards de barils équivalents pétrole (bep) dont 13,5 milliards de barils de pétrole et 316 milliards de m3 de gaz, ce qui constitue une augmentation majeure au cours des dernières années (en 2001, les réserves étaient de 9,7 milliards bep). Toutefois, le Brésil, grande puissance régionale, est de plus en plus dépendant des choix politiques et énergétiques de ses voisins, comme le révèle la crise du gaz bolivien, quelques années à peine après l'achèvement du gazoduc Gasbol entièrement financé par Petrobras pour deux milliards de dollars et reliant Santa Cruz (Bolivie) à Porte Alegre (Brésil) via Campina dans l'Etat de Sao Paulo. A ce jour, Gasbol - d'une longueur totale de 3 150 km dont 2 583 km au Brésil - est le plus long gazoduc jamais construit en Amérique du Sud. Avant que n'éclate la crise énergétique en Bolivie, les importations de gaz naturel en provenance de ce pays permettaient au gouvernement brésilien de garantir la couverture des besoins nationaux. Or la situation actuelle souligne à quel point les choix stratégiques du gouvernement brésilien sont largement dépendants des politiques énergétiques des pays voisins (88). Mais la Bolivie ne constitue pas pour le Brésil seulement une source de gaz ; elle est aussi la principale frontière terrestre du Brésil, ce qui implique la prise en compte d'autres dimensions dans la relation entre les deux pays. Le Président Luiz Inácio Lula da Silva a été critiqué pour sa gestion parfois qualifiée de « laxiste » de la crise bolivienne ; mais pour le Brésil, la priorité demeure le maintien de la stabilité régionale. La hausse du prix du gaz peut être le prix à payer pour préserver cette stabilité. Alors que le gaz bolivien représente plus de 50 % du gaz consommé au Brésil, Petrobras pourrait être amené à accélérer ses projets d'investissement dans des unités de regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), lequel pourrait être importé de plusieurs pays d'Asie (Indonésie, Malaisie) mais aussi du Qatar, d'Algérie, de Libye ou encore de Trinité et Tobago. Le renchérissement à prévoir du prix du gaz importé de Bolivie - même si la hausse des tarifs devrait dans un premier temps être absorbée par Pétrobras (89) - a également pour effet d'ouvrir un débat public sur la politique énergétique du Brésil et plus particulièrement en ce qui concerne la filière électrique. En effet, même s'il ne représente qu'environ 9 % de la matrice énergétique du Brésil, le gaz est appelé à jouer un rôle croissant dans la production d'électricité, en raison des retards pris dans la construction d'usines hydroélectriques, même si l'hydroélectrique demeure la priorité puisque 85 % de la production électrique est d'origine hydraulique. L'électricité est un enjeu majeur au Brésil comme en a témoigné la crise de 2001/2002 qui a rendu nécessaire la mise en œuvre de mesures de rationnement de l'énergie. C'est dans ce contexte que la filière nucléaire est en train de renaître au Brésil, mais aussi en Argentine. Vers la relance de la filière nucléaire L'énergie nucléaire représente moins de 3 % de la capacité et de la production d'électricité au Brésil, avec deux centrales (Angra I et Angra II) situées dans l'Etat de Rio de Janeiro. Une troisième tranche (Angra III) devait être construite par Siemens dans le cadre d'un accord gouvernemental germano-brésilien dans les années 1970 mais, faute de financements, le projet a dû être suspendu en 1986. En 2004, une étude commandée par le Président Luiz Inácio Lula da Silva recommandait la reprise de la construction ; néanmoins, en l'absence de consensus au sein même du gouvernement, aucune décision n'a à ce jour été formellement annoncée. Quoi qu'il en soit, le Brésil fait partie du club restreint des pays disposant de compétences sur toute la chaîne de production et d'enrichissement de l'uranium. Bien que le Brésil soit le sixième producteur mondial d'uranium, le combustible est actuellement enrichi à l'étranger et importé pour alimenter les deux centrales en service. L'un des arguments en faveur de la conclusion d'Angra III est qu'elle permettra à l'INB (Industrias Nucleares Brasileiras) à Resende (Etat de Rio de Janeiro), fabricant du combustible lié au ministère de la Science et de la Technologie, de rentabiliser sa production d'uranium enrichi, avec un objectif à long terme de fournir jusqu'à 60 % du combustible nécessaire, voire atteindre l'autosuffisance et même exporter. L'entrée du Brésil dans la filière d'enrichissement de l'uranium a fait l'objet d'un bras de fer en 2004 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), en raison de la résistance opposée par le gouvernement de Brasilia à l'inspection des installations nucléaires situées à Resente, dans l'Etat de Rio de Janeiro. Alors que l'AIEA pouvait suspecter la dissimulation d'un programme nucléaire militaire, le Brésil justifiait ses réticences aux inspections par la volonté de protéger sa technologie. Les autorités brésiliennes rappellent que leur Constitution mentionne la finalité pacifique du recours au nucléaire. En outre, l'existence d'une Agence argentino-brésilienne de surveillance nucléaire (ABACC) est censée garantir l'absence de programme militaire clandestin. L'Argentine vient d'ailleurs de relancer son programme nucléaire. L'annonce en a été faite le 23 août 2006 alors que l'Argentine connaît une crise énergétique sans précédent. Parmi les mesures décidés figurent l'achèvement de la centrale nucléaire Atucha II, le lancement d'une étude de faisabilité sur la construction d'une quatrième centrale nucléaire, la relance de l'usine d'eau lourde dans le Neuquen et la réouverture d'une usine d'enrichissement d'uranium dans la même province. Le pari stratégique des biocarburants Le Brésil mène parallèlement une politique très active de diversification énergétique à travers les biocarburants. Compte tenu des cours actuels du pétrole, l'utilisation de l'alcool comme carburant devient de plus en plus attractive sur le plan économique. La grande compétitivité du Brésil dans ce domaine le place en bonne position pour tirer profit de cette situation. Suite au premier choc pétrolier de 1973, la dictature militaire alors au pouvoir avait lancé un « plan Proalcool » qui, en établissant des incitations fiscales, visait à encourager les constructeurs automobiles et les producteurs de canne à sucre à s'associer pour construire des voitures roulant à l'éthanol. La hausse des prix du pétrole (début 2006, l'éthanol était plus de deux fois moins cher que l'essence), la volonté de diversification des approvisionnements, l'impératif environnemental (réduction des émissions de gaz à effet de serre) ainsi que l'avantage concurrentiel dont le Brésil dispose pour la production d'éthanol expliquent la forte croissance de ce secteur. Le Brésil produit actuellement 52 % du total de l'éthanol produit dans le monde (environ 50 milliards de litres par an) et y consacre près de 60 % de la production nationale de canne à sucre. Le Brésil dispose d'environ 350 sites de production et affirme ses ambitions à l'export, à destination du Japon, de la Corée, des Etats-Unis et de l'Union européenne (la Suède, en particulier). En parallèle, le Brésil tente également de prendre pied dans les pays en voie de développement en proposant son assistance technique sur des projets de développement de la culture de la canne à sucre et de production d'éthanol. Le gouvernement ambitionne de dupliquer le succès du plan éthanol avec le programme biodiesel lancé par le Président Luiz Inácio Lula da Silva en décembre 2004. Conçu avant tout comme un instrument destiné à la création d'emplois et à la formation de revenus pour l'agriculture traditionnelle familiale dans les régions les plus pauvres du Brésil, il pourrait contribuer à placer le pays comme l'un des premiers fournisseurs mondiaux sur l'ensemble de la gamme des biocarburants. 2) L'intégration sud-américaine est-elle encore possible ? Les pays d'Amérique du Sud peuvent-ils trouver une base d'entente sur les questions énergétiques ? L'énergie peut-elle être un facteur d'unification de l'Amérique au même titre qu'elle a été à l'origine de la construction européenne ? La CECA peut-elle être un modèle pour l'Amérique latine ? a) Face à la paralysie des alliances existantes... Qu'il s'agisse du Mercosur ou de la Communauté andine des Nations (CAN), ces organisations régionales sud-américaines sont en crise. Le Mercosur est tiraillé par son déséquilibre interne entre d'un côté les deux « grands » pays que sont le Brésil et l'Argentine, et de l'autre les deux « petits », à savoir l'Uruguay et le Paraguay. Tandis que le Paraguay resserre ses liens avec les Etats-Unis, en ouvrant ses ports aux soldats nord-américains (depuis août 2005, le pays autorise ces troupes à opérer sur son territoire), la récente adhésion du Venezuela risque de changer l'âme du Mercosur, qui pourrait faire les frais de la radicalisation idéologique de Caracas. Quant à la Communauté andine des Nations, le retrait du Venezuela, consécutif à son adhésion au Mercosur, est un choc majeur pour le groupement régional. Avec un PIB représentant la moitié de la CAN, le Venezuela était la première économie du bloc ; sa richesse pétrolière, mais aussi la faiblesse de son tissu industriel et agro-alimentaire - notamment au regard de ceux de la Colombie et du Pérou - en faisaient également la première puissance importatrice du bloc régional. Face aux difficultés des structures existantes, de nouvelles alliances peinent à se construire. Il en va ainsi de la Communauté sud-américaine des Nations (CSN), qui vise à relancer l'intégration du sous-continent, mais peine à émerger. Créée en décembre 2004 à Cuzco lors du IIIe Sommet sud-américain, la CSN regroupe les Etats du Mercosur, ceux de la Communauté andine, ainsi que le Chili, la Guyana et le Surinam. L'objectif poursuivi vise à constituer à terme un ensemble à la fois économique et politique, capable de défendre les populations face aux Etats-Unis. Bien que partie prenante à la CSN, le Président Hugo Chavez ne cache pas son scepticisme ; le dirigeant vénézuélien estime que ce projet répète les erreurs du Mercosur et de la CAN et qu'à ce rythme, l'intégration régionale ne deviendra une réalité qu'en 2200 ! (90) b) La diplomatie pétrolière du Président Hugo Chavez pourrait s'imposer comme un puissant levier d'intégration régionale Trois séries d'obstacles hypothèquent à l'heure actuelle les projets d'intégration énergétique : - des obstacles géographiques : l'immensité du territoire sud-américain, le relief et l'existence de zones enclavées (cf. Amazonie) ; - des obstacles financiers : l'intégration énergétique suppose l'existence d'une intégration physique du continent sud américain, qui est loin d'être achevée en raison du sous-développement des infrastructures d'interconnexion. Cela implique de se placer dans une perspective de long terme tant les besoins financiers en équipements énergétiques (barrages, centrales, gazoducs, oléoducs, raffineries, etc.) sont considérables : ils sont estimés à au moins 1 000 milliards de dollars ; - des obstacles politiques : il ne faut pas sous-estimer la portée des tensions persistantes qui existent entre plusieurs Etats (Venezuela/Mexique ; Bolivie/Chili ; Venezuela/Colombie) et qui rendent complexe la concrétisation de projets d'intégration. En outre, s'il est courant d'affirmer que l'acier fut la locomotive de l'intégration européenne et que le gaz et le pétrole pourraient bien jouer un rôle similaire dans le cas sud-américain, il faut rappeler que la construction de l'unité européenne a été une affaire d'Etats pour les principaux pays comme l'Allemagne et la France, de sorte que ce projet a pu être mené à bien malgré les alternances politiques. Or personne ne peut garantir aujourd'hui en Amérique du Sud que les projets d'intégration lancés ici et là survivront à leurs promoteurs. Dans ce contexte, la « diplomatie pétrolière » du Président Hugo Chavez représente un projet plus solide et viable, puisqu'il tisse des alliances bilatérales et bénéfiques pour toutes les parties. Sans renoncer à son propre projet d'intégration, l'ALBA (91), le Président Hugo Chavez avance de manière concrète sur un thème aussi stratégique qu'est l'énergie. Dans un entretien paru le 2 octobre 2005 dans le journal argentin Clarin, le Président Hugo Chavez ne cachait pas ses intentions : « Au Venezuela, nous avons une importante carte pétrolière à jouer sur l'échiquier géopolitique, et nous allons clairement la mettre sur la table dans le processus d'intégration régionale » ; et d'ajouter qu'il utilisera cette carte pour « jouer dur contre les joueurs les plus durs du monde : les Etats-Unis ». Le Venezuela a ainsi conclu des accords avec le Mercosur, à travers la création de Petroamérica, une entreprise pétrolière régionale, indépendante des grands monopoles nationaux, au sein de laquelle le Venezuela est le véritable moteur. Le Venezuela, le Brésil et l'Argentine se sont mis d'accord pour une plus grande intégration politique, énergétique et culturelle sud-américaine, en annonçant la création d'une entreprise pétrolière commune, Petrosur. La transnationale sud-américaine devrait commencer ses activités en lançant des investissements conjoints sur trois projets : l'exploration gazifière et pétrolière en Argentine, la construction d'une raffinerie dans le nord du Brésil pour traiter du pétrole vénézuélien, et l'exploration pétrolière dans le bassin de l'Orénoque au Venezuela. Avec les Caraïbes, le Président Hugo Chavez a lancé « Petrocaribe », une alliance régionale fondée le 29 juin 2005 entre le Venezuela et treize pays de la Caraïbe (92) et qui a vocation à devenir une organisation de coordination et de gestion de la production, du transport et de la fourniture de pétrole dans l'arc caribéen. Il s'agit donc d'une alliance régionale dont la colonne vertébrale est le pétrole, et qui comprend un fonds de coopération et d'investissement dans lequel le Venezuela a placé 50 millions de dollars. L'entreprise publique vénézuélienne PDVSA a créé une filiale, PDV-Caraïbe, qui transportera le brut aux destinataires dans ses propres bateaux et qui ne recouvrera que les coûts du fret, sans bénéfices et avec un financement souple de quinze ans. Il faut par ailleurs souligner le traitement spécial accordé à Cuba, qui, indépendamment de Petrocaribe, bénéficie d'un accord spécifique qui lui garantit la livraison de 53 000 barils/jour et qui permet la possibilité d'un paiement par compensation (troc) sans limite. Il est en effet prévu que Cuba prête des services (fourniture de médecins, experts militaires...), des technologies et des produits (médicaux, alimentaires...) dont elle dispose pour soutenir le programme de développement économico-social du Venezuela. Parallèlement, le Venezuela a lancé l'initiative « PetroAndina » avec la Communauté andine des Nations (CAN) dont il ne fait plus partie suite à son adhésion au Mercosur. L'objectif est de développer les ressources énergétiques des Etats concernés pour favoriser leur développement économique et social. Le désir de contrer la présence économique et politique américaine dans la région n'est pas étranger à cette initiative. En effet, Caracas n'a pas apprécié que la Colombie et le Pérou, membres de la CAN, concluent des accords bilatéraux de libre échange avec les Etats-Unis ; Petroandina est ainsi un moyen - parmi d'autres - pour le Président Hugo Chavez de reprendre la main dans cette région. Mais l'illustration la plus spectaculaire de la stratégie d'intégration du Président Hugo Chavez est incontestablement le projet pharaonique de gazoduc du Sud , long de 9 000 km, visant à relier les réserves vénézuéliennes à l'Argentine et au Brésil, avec des ramifications en Bolivie, au Paraguay et en Uruguay. Selon les estimations, le coût de ce projet est évalué entre 10 et 20 milliards de dollars. A en croire certaines déclarations, les travaux pourraient débuter dès 2007, alors que nombreux sont ceux qui doutent de la pertinence d'un tel projet face à l'alternative moins coûteuse du recours au transport maritime de gaz naturel liquéfié. L'unité latino-américaine constitue incontestablement l'objectif de la révolution bolivarienne, mais pour le Président Hugo Chavez, cette unité doit répondre à certaines exigences fondamentales : - elle doit se faire sans les Etats-Unis, et même contre eux, et exclut par conséquence tout traité de libre-échange avec la puissance du Nord ; - cette intégration doit posséder un fort contenu social et se différencier fondamentalement d'un projet libre-échangiste ; - l'unité ne pourra vraiment fonctionner qu'avec des gouvernements de gauche, c'est-à-dire en rupture avec Washington. S'opposer à l'ALCA ou aux traités de libre-échange n'est pas la même chose que d'établir les bases durables d'une intégration régionale différente de celle défendue par les marchés internationaux ou les élites de la région. Au-delà des déclarations et des discours, il paraît ainsi encore prématuré de miser sur l'intégration énergétique sud-américaine. L'Asie : des besoins gigantesques, Repères Grâce à sa forte croissance économique, l'Asie est désormais la première zone consommatrice d'énergie, avec près d'un tiers de la consommation mondiale, contre un cinquième il y a vingt ans, alors qu'elle abrite plus de la moitié de la population. La région dépend du reste du monde pour 60 % de son approvisionnement énergétique, la seule ressource présente sur place en abondance étant le charbon, qui continue à fournir les deux tiers de l'énergie consommée en Chine et plus de la moitié de celle qui est consommée en Inde, contre un quart au niveau mondial. La place prise par l'Asie constitue un des principaux changements observés au cours de ces vingt dernières années dans le paysage énergétique mondial. L'Asie est désormais la première zone consommatrice d'énergie, avec près d'un tiers de la consommation mondiale, contre moins d'un cinquième en 1985. Cette évolution témoigne à la fois du rôle moteur de l'Asie dans l'économie mondiale et de la forte intensité énergétique qui caractérise la plupart des économies de la région. La Chine (en incluant Hong Kong), le Japon et l'Inde représentent à eux trois 73 % de la consommation totale de l'Extrême-Orient. La dépendance énergétique de l'Asie à l'égard du monde extérieur est supérieure à 60 % en termes d'approvisionnement énergétique, l'Indonésie, la Malaisie, Brunei et l'Australie étant les seuls Etats autosuffisants de la zone. L'Extrême-Orient importe les deux tiers de son pétrole, essentiellement en provenance du Moyen-Orient. En 2025, l'Asie représentera 40 % de la demande énergétique mondiale. Elle continuera en effet à conjuguer une densité démographique élevée, un dynamisme économique très soutenu et l'émergence de nouveaux besoins. La Chine constitue aujourd'hui l'un des principaux pays utilisateurs : sa consommation d'énergie a augmenté en moyenne de 5 % par an depuis 1980, avec une accélération particulièrement marquée ces dernières années, ce qui a porté sa part dans la consommation mondiale de 7,4 % en 1985 à 14,7 % en 2005. Selon les évaluations de l'AIE, sa consommation énergétique devrait encore doubler d'ici à 2030. Sa consommation de pétrole a atteint 6,8 millions de barils par jour (93) en 2004, alors que c'est encore le charbon qui est à l'origine de près des deux tiers de l'énergie primaire consommée. Les autres sources d'énergie ne représentent qu'une faible part de la consommation, mais elles devraient augmenter dans les prochaines années : la part du gaz (94) devrait passer de 2,5 % aujourd'hui à 8 % en 2010, celle de l'hydroélectricité devrait doubler, pour représenter 10 %, après l'entrée en fonction du barrage des Trois Gorges et les autorités comptent parvenir à 4 % d'énergie d'origine nucléaire à moyen terme, contre moins de 1 % actuellement. Etant donné le poids du charbon, la Chine est confrontée à un problème de protection de l'environnement. Mais le rythme de la croissance chinoise, qui est très gourmande en énergie et s'accompagne d'une plus forte urbanisation, devrait conduire le pays à importer plus de la moitié de son énergie dès 2010, ce qui accroîtra sa dépendance énergétique, en particulier vis-à-vis du Moyen-Orient, dont 75 % de ses importations devraient provenir en 2015, contre un peu plus de 40 % actuellement. Lors de son audition par la Mission d'information, Mme Valérie Niquet a souligné le caractère nouveau de cette dépendance pour la Chine « qui n'était pas, jusqu'au début des années 1990, dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique ; cette situation nouvelle développe un sentiment sécuritaire. » Cette inquiétude est particulièrement forte parmi les dirigeants chinois qui craignent que la croissance économique soit freinée par des interruptions de l'approvisionnement énergétique ou par des hausses de prix, ce qui pourrait générer une instabilité sociale susceptible de menacer leur pouvoir. Ce raisonnement peut être résumé dans les termes suivants : « Les dirigeants de Pékin (...) établissent donc un lien étroit entre la fiabilité de l'approvisionnement en énergie et la stabilité politique et économique du pays, ainsi que le maintien du contrôle et du leadership du parti. » (95) Dans ce contexte, la sécurité énergétique est naturellement considérée comme trop importante pour être réglée par les seules forces du marché. Aussi, pour sécuriser ses approvisionnements, la Chine multiplie les investissements extérieurs, dans les secteurs du pétrole et du gaz : son objectif est de porter à 25 % la part des approvisionnements énergétiques extérieurs contrôlés par des sociétés chinoises. L'achat de gisements étrangers de pétrole et de gaz par les grands groupes chinois leur permet de les contrôler directement. La Chine souhaite en fait, à terme, faire de certains pays des sources d'approvisionnement exclusives pour couvrir ses propres besoins. C'est pour éviter cette appropriation que l'Etat américain s'est opposé, au nom de la sécurité nationale, à l'acquisition par la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) de la société pétrolière américaine Unocal et a préféré l'offre, pourtant inférieure de 2 milliards de dollars (l'offre chinoise s'élevait à 16 milliards de dollars), de l'américain Chevron. La Chine développe aussi des partenariats bilatéraux avec des pays producteurs, en particulier avec des pays vulnérables, « laissés pour compte » ou en délicatesse avec la communauté internationale, d'une part car son arrivée tardive sur le marché limite ses possibilités de choix et d'autre part car la faiblesse de ses partenaires renforce sa propre capacité de contrôle. Des partenariats ont ainsi été mis en place avec le Kazakhstan, l'Indonésie, la Birmanie, l'Iran, Oman, la Syrie, la Libye, le Soudan, le Venezuela ; des projets d'accords d'exploitation sont négociés avec l'Algérie, l'Egypte et le Gabon ; l'Argentine, le Kenya et l'Angola suscitent aussi l'intérêt de Pékin. Votre Rapporteur reviendra sur la stratégie chinoise vis-à-vis de l'Afrique dans la partie du présent rapport consacrée à ce continent. Cette politique énergétique s'accompagne d'un volet politique, la Chine jouant de son statut de grande puissance, membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour soutenir un pays ou bloquer d'éventuelles résolutions qui lui seraient hostiles. Cet activisme chinois dans le domaine énergétique, qui est sensible sur tous les continents, entretient la méfiance des autres grands pays asiatiques, et en particulier celle du Japon et de l'Inde, qui se trouvent en concurrence avec la Chine l'un pour sécuriser son approvisionnement, l'autre pour s'assurer les ressources énergétiques nécessaires à sa vive croissance économique. C'est justement en Inde et au Japon que votre Rapporteur a choisi de se rendre, afin d'étudier les stratégies suivies par ces deux démocraties - les seules d'Asie - grosses consommatrices et importatrices d'énergie pour sécuriser leurs approvisionnements présents et futurs et tenter de contrer l'omniprésence chinoise. Les deux pays rencontrent des difficultés similaires pour faire face à leurs besoins énergétiques, en forte croissance pour la première, stabilisés pour le second. Il en va de même pour les choix qu'ils ont faits afin de tenter de les résoudre. On associe souvent l'Inde et la Chine à cause de leur décollage économique et de la demande supplémentaire en énergie qu'il entraîne, mais les orientations de la politique énergétique indienne ressemblent plus aux orientations japonaises qu'à la stratégie chinoise, car Inde et Japon présentent, pour des raisons différentes, une relative faiblesse diplomatique qui contraste fortement avec la puissance chinoise. Les développements qui suivent se fondent en grande partie sur les informations et les éléments recueillis par M. Jean-Jacques Guillet qui a effectué dans le cadre de la Mission d'information deux déplacements, l'un au Japon en juillet 2006, l'autre en Inde, en septembre 2006. A - Inde et Japon : deux puissances dépendantes dans le domaine énergétique Les situations économiques du Japon et de l'Inde sont très différentes, le premier faisant partie des pays les plus riches du monde, quand la seconde commence seulement à émerger depuis quelques années. Mais tous les deux ont de gros besoins énergétiques et peu de ressources sur leur territoire, ce qui les place dans une difficile situation de dépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs étrangers. 1) Des situations économiques très différentes · Avec un PIB de plus de 4 500 milliards de dollars, soit 60 % du PIB de l'Asie orientale, et un PIB par habitant de 29 000 euros, le Japon possède la deuxième économie du monde. Des réformes structurelles lui ont permis de sortir de la stagnation économique qu'il connaissait depuis plusieurs années pour retrouver un rythme de croissance de 2,6 à 2,7 % par an. Sa population de 127,5 millions d'habitants, très homogène ethniquement et culturellement, n'enregistre qu'une croissance de 0,11 % par an, et va très prochainement commencer à diminuer. Le pays occupe le neuvième rang mondial pour le développement humain. · La situation de l'Inde est radicalement différente. Alors que le pays compte déjà plus de 1,065 milliard d'habitants, la croissance démographique est estimée à 1,44 % par an et le PIB par habitant ne dépassait pas 608 dollars en 2004. L'Union indienne occupe le 127ème rang mondial en terme de développement humain. Mais elle enregistre un taux de croissance élevé depuis quelques années : en moyenne de 6 % par an depuis 2000, il devrait se stabiliser autour de 8 % au cours des prochaines années. L'Inde est encore un pays en voie de développement, qui, malgré l'image de « l'Inde qui brille », compte une classe moyenne comprise entre 50 et 300 millions d'habitants selon les analystes, mais abrite surtout entre 700 millions et un milliard de pauvres. Un Indien sur deux seulement dispose de l'électricité, ce qui explique que la consommation d'électricité par habitant soit limitée à 553 kilowatts/heure, quand elle approche 1 400 en Chine et s'établit à plus de 2 400 en moyenne mondiale. L'Inde est enfin un pays qui reste marqué par l'économie dirigée. En dépit d'une politique de libéralisation progressive menée depuis le début des années 1990, les autorités publiques, Etat fédéral ou Etats fédérés, sont encore très présentes, notamment, dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'électricité, ainsi que dans toutes les activités liées aux hydrocarbures, que cinq entreprises publiques dominent encore largement. 2) Des besoins énergétiques énormes La demande énergétique japonaise est stable, mais très élevée ; la demande indienne est encore relativement modeste, mais augmente rapidement. · Le bilan énergétique du Japon est le suivant : pétrole, 50 % ; charbon, 19 % ; nucléaire, 13 % ; gaz naturel, 12,5 %, dont 97 % sont importés sous forme de GNL ; hydroélectricité, 3,5 % ; énergies renouvelables, 1 %. Le Japon, dont plus de 80 % des besoins en énergie primaire sont couverts par des énergies fossiles, est le troisième consommateur mondial de produits pétroliers (5 % en 2005), derrière les Etats-Unis (22,2 %), et, depuis 2003, derrière la Chine (14,7 %). Entre 1973 et 2003, l'accroissement de l'efficacité énergétique a permis d'économiser environ 37 % de l'énergie nécessaire à la production d'une unité de PIB ; l'objectif est une nouvelle réduction de 30 % entre 2003 et 2030. Etant donné la délocalisation, notamment en Chine, des activités les plus consommatrices d'énergie, et le vieillissement de la population, la consommation énergétique du Japon devrait se stabiliser avant de décroître. · En 2003, la consommation de pétrole de l'Inde représentait 3,27 % de la consommation mondiale et sa consommation de gaz naturel 1,29 % ; en 2030, ces parts pourraient atteindre respectivement 7,5 % et 5,43 %. En effet, selon les évaluations de l'AIE, la consommation indienne d'énergie devrait progresser de l'ordre de 6 % par an, grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique, soit 90 % entre 2002 et 2030. Cette augmentation globale s'accompagne d'un profond changement dans la structure de sa consommation. En effet, le développement des transports entraîne une plus forte consommation d'hydrocarbures et, en proportion, une moindre utilisation du charbon (96), même si ce dernier continue d'assurer plus de la moitié de la consommation d'énergie commerciale (97) du pays. En 1997, le pétrole représentait 19 % de la consommation d'énergie et le gaz naturel, 4 % ; en 2003, le premier atteignait 30 % et le second 7 %. Actuellement, la consommation énergétique primaire indienne est composée comme suit : 54 % proviennent du charbon, 33 % du pétrole, 8 % du gaz naturel, 4 % de l'hydroélectricité et 1 % du nucléaire. Elle représentait un total de près de 300 millions de tonnes équivalent pétrole en 2001-2002 ; les projections pour 2020 s'établissent entre 530 et 826 millions de tonnes équivalent pétrole. La croissance de la consommation énergétique indienne est réelle et va s'accentuer ; pour l'instant, il ne faut cependant pas exagérer son poids dans l'évolution des besoins mondiaux. Par exemple, entre 2000 et 2005, la consommation mondiale de pétrole a augmenté de 261,4 millions de tonnes, mais près de 40 % de cette progression étaient dus à la Chine et 18 % aux Etats-Unis ; l'augmentation de la consommation indienne ne représentait que 3,7 % de la consommation supplémentaire. 3) Une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur Bien que l'Inde possède plus de ressources énergétiques (98) que le Japon, qui en est presque entièrement dépourvu, les deux pays sont très dépendants de l'extérieur pour leur approvisionnement énergétique, et cette dépendance va croître en ce qui concerne l'Inde. Le Japon dépend des importations pour plus de 80 % de ses besoins énergétiques. Hors nucléaire, il n'est autosuffisant qu'à hauteur de 4 % ; la production d'électricité d'origine nucléaire permet de porter ce taux à 19 %. Les importations japonaises de pétrole proviennent à 90 % du Moyen-Orient. Les principaux fournisseurs étaient, en 2004, les Emirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, pour environ un quart chacun, l'Iran, à hauteur de 15 %, le Qatar, pour 9 %, et le Koweït, pour 7 %. Le gaz provenait d'Indonésie (27,6 %), de Malaisie (21,7 %), d'Australie (14,3 %), du Qatar (12 %), de Bruneï (10,7 %) et des Emirats Arabes Unis (9,3 %). En outre, seuls 15 % de la production du pétrole et du gaz consommés au Japon sont assurés par des entreprises japonaises, ce qui place le pays en position de dépendance par rapport à des compagnies étrangères. Il n'existe en effet pas de grande compagnie japonaise dans le domaine énergétique : une dizaine de monopoles régionaux se partagent le marché de l'électricité ; la distribution du gaz est répartie entre environ deux cents petites sociétés et deux grandes entreprises, ces dernières exerçant respectivement un monopole à Tokyo et Osaka. Pour ce qui est du marché pétrolier, la déréglementation intervenue dans la deuxième moitié des années 1990 a conduit à une certaine concentration dans le domaine du transport et de la distribution - il y avait dix compagnies en 1995, elles ne sont plus que quatre aujourd'hui -, comme dans celui de l'exploration et de la production. Mais la compagnie nationale créée en 1967, la Japan National Oil Company (JNOC), a été dissoute en 2002 : elle avait vocation à soutenir les entreprises japonaises d'exploration et d'exploitation pétrolière au Moyen-Orient, mais elle était fortement endettée et avait enregistré des pertes records. Produits à l'étranger essentiellement par des compagnies non japonaises, les hydrocarbures doivent être acheminés jusqu'au Japon. Ils empruntent nécessairement la voie maritime, ce qui constitue une source supplémentaire d'insécurité pour l'approvisionnement japonais. Ils transitent en effet par des zones peu stables, et notamment par le détroit de Malacca. 41 % des importations totales de l'archipel et 80 % de son pétrole passent par ce détroit, dont la sécurité repose en droit sur les trois pays riverains, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie. Seul l'Etat de Singapour investit réellement dans ce domaine, alors que les actes de piraterie sont fréquents dans cette zone. La dépendance indienne est aujourd'hui moins marquée que la dépendance japonaise car les besoins de l'Union indienne sont moins importants que ceux du Japon. Mais la poursuite de sa croissance économique va placer l'Inde dans une situation, à terme, presque aussi délicate. D'ores et déjà, les ressources indiennes en pétrole assurent moins du quart de sa consommation (99). La part des importations pétrolières devrait s'établir à 85 % en 2010 et 92 % en 2020. Cette évolution fragilise la croissance de l'Inde puisqu'une hausse du prix du pétrole de 10 dollars par baril lui ferait perdre un point de croissance (100) selon l'AIE. La Commission du plan indienne a élaboré différents scénarios à l'horizon 2031-2032, sur la base d'un taux de croissance du PIB de 8 % par an. La part du charbon serait comprise entre 54 et 41 %, celle du pétrole entre 23 et 29 %, celle du gaz naturel entre 5,5 et 11 % ; la part de l'hydroélectricité ne dépasserait guère 2 %, celle du nucléaire représenterait entre 4 et 6,4 %, tandis que les énergies renouvelables atteindraient 5,6 % dans le meilleur des cas. Dans tous les scénarios, environ 10 % de l'énergie consommée continueraient à relever du secteur « non commercial », c'est-à-dire des sources d'énergie traditionnelles, essentiellement d'origine végétale. Toujours selon la Commission du plan, en fonction des différents scénarios, le taux d'importation des différentes énergies en 2031-2032 sera compris entre 90 et 93 % pour le pétrole, entre 0 et 49 % pour le gaz naturel et entre 11 et 45 % pour le charbon (101). Sans souffrir du même isolement que le Japon, l'Inde n'a pas pour autant une situation géographique facile. Certes plusieurs pays, situés non loin d'elle, sont riches en hydrocarbures. Mais soit ces pays ne sont pas ses voisins immédiats, soit, lorsqu'ils le sont, ils ont de mauvaises relations avec l'Union indienne. Celle-ci est en effet entourée d'Etats avec lesquels elle est, à un degré ou un autre, en conflit : le Pakistan, notamment à cause du différend historique relatif au Cachemire, le Bangladesh, qui désapprouve sa gestion des ressources en eau, la Chine, avec laquelle les problèmes frontaliers ont été résolus, mais dont la diplomatie indienne se méfie. En fait, seuls le Bhoutan et le Népal sont des pays amis, mais ils ne veulent pas renforcer leur dépendance, déjà forte, vis-à-vis de leur grande voisine, en la faisant bénéficier de leur très importante capacité hydroélectrique. Ses voisins relativement hostiles isolent l'Inde par rapport aux Etats de la région riches en hydrocarbures que sont en particulier l'Iran, les pays d'Asie centrale et la Birmanie (102). L'Inde est ainsi aujourd'hui surtout dépendante des ressources énergétiques du Golfe persique : 20 % de l'énergie consommée dans le pays provenaient, sous forme de pétrole et de gaz, du Moyen-Orient en 2003 ; cette proportion devrait atteindre 30 % dès 2010. Cette dépendance n'est guère surprenante dans la mesure où le Golfe persique est géographiquement proche du sous-continent indien et où les courants d'échanges entre cette zone et l'Inde ont des origines anciennes. B - Face à la Chine, deux Etats en quête d'une coopération régionale En réponse à leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur, le Japon s'efforce de sécuriser son approvisionnement énergétique et l'Inde de faire face à la croissance de ses besoins. Les stratégies des deux pays présentent beaucoup de points communs. a) L'amélioration de l'efficacité énergétique Les efforts du Japon pour accroître l'efficacité énergétique de son industrie ont commencé à la suite des chocs pétroliers des années 1970 ; ils se poursuivent aujourd'hui pour faire face aux tensions croissantes sur le marché des combustibles fossiles, mais aussi dans un souci environnemental, afin de réduire les émissions des gaz à effet de serre. Les méthodes trop consommatrices d'énergie dans les industries lourdes ont été abandonnées tandis que l'efficacité énergétique des appareils ménagers et des bureaux a été accrue. Par exemple, le programme « top runner » mis en place par le ministère de l'Economie, du commerce et de l'industrie (METI) oblige les fabricants de dix-huit catégories de produits (comme les téléviseurs, les ordinateurs) à respecter certains standards. Ainsi, si le Japon est le deuxième pays de l'OCDE pour sa consommation énergétique, l'intensité énergétique de son PIB (c'est-à-dire la consommation d'énergie par unité de PIB et par an) est la plus faible des pays de l'OCDE. 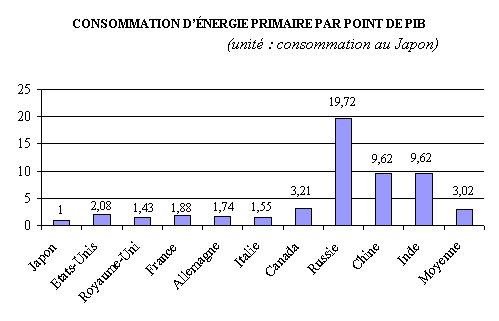 Source : ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI) japonais, La nouvelle stratégie énergétique nationale préconise la poursuite des efforts réalisés, afin de stabiliser la consommation à partir de 2015 et d'atteindre, à terme, une réduction. Elle met l'accent sur les secteurs peu concernés par les mesures déjà prises : elle prévoit par exemple le développement et la diffusion de systèmes de fourniture d'eau chaude et de climatisation à haut rendement et l'application commerciale de la pile à combustible. Une part importante des financements publics de la recherche est consacrée aux technologies de maîtrise de l'énergie. L'expertise acquise par le Japon dans le domaine de l'efficacité énergétique fait l'objet d'une coopération en direction des autres pays, notamment en développement. L'Inde, dont l'efficacité énergétique est encore faible, souhaite bénéficier de transferts de technologies dans ce domaine. La loi sur la préservation de l'énergie a créé, en 2002, un bureau de l'efficacité énergétique, placé sous l'autorité du Premier Ministre (103). Après une mise en route un peu difficile, ce bureau lance un programme de labellisation des appareils électroménagers visant à informer les utilisateurs de leur consommation électrique. Une campagne de sensibilisation de la population est aussi prévue. Le bureau, qui a signé un protocole de coopération avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) en février 2006, élabore actuellement des standards minimums en matière de conservation de l'énergie applicables aux bâtiments commerciaux. Il s'intéressera ensuite au secteur des transports en labellisant les véhicules à moteur et en promouvant des transports en commun plus confortables et plus économiques. Etant donné l'importance des besoins énergétiques indiens - seuls 50 % de la population disposent de l'électricité et la production ne permet pas de répondre aux pics de demande -, l'amélioration de l'efficacité énergétique ne permettra pas de diminuer de manière importante la croissance de la demande. Mais elle contribue à un souci louable d'économie d'énergie et témoigne d'une sensibilité aux questions environnementales, qui se traduit aussi par un grand intérêt pour le charbon propre. b) Le développement des énergies renouvelables Le Japon et l'Inde promeuvent le développement des énergies renouvelables. Pour accélérer celui-ci et porter la part de ces énergies à 3 % du bouquet énergétique primaire en 2010, le Japon impose depuis 2002 aux compagnies électriques un quota de production d'électricité à partir des énergies renouvelables. Grâce aux soutiens du METI, la production d'électricité d'origine solaire et d'origine éolienne progresse régulièrement. De même, alors que 98 % des transports dépendent aujourd'hui du pétrole, le METI a fixé un objectif de réduction de ce taux à 80 % en 2030, grâce à l'amélioration du fonctionnement des moteurs, au développement des biocarburants et à la promotion des véhicules mixtes. Le gouvernement indien a aussi des projets ambitieux en matière d'hydroélectricité et d'énergies renouvelables, qui assurent actuellement respectivement 26 % et moins de 5 % de la capacité de production électrique. Mais les difficultés sont réelles : la construction de grands barrages se heurte à l'opposition des populations devant être déplacées, l'énergie solaire, dont le potentiel est immense, est encore très coûteuse, et l'utilisation de la biomasse à grande échelle suppose d'y consacrer de vastes étendues, qui demeurent indispensables pour nourrir la population. L'Inde souhaite bénéficier de transferts de technologies afin d'accélérer le développement de ces sources d'énergie renouvelables et rejetant peu de gaz à effet de serre. Ce développement présenterait aussi l'avantage de permettre à chaque Etat de l'Union d'adapter sa production d'énergie aux ressources dont il dispose, ce qui résoudrait les déséquilibres actuels entre zones de production et zones de consommation d'énergie. Le choix du nucléaire est un autre point commun entre les deux démocraties asiatiques. Le Japon, qui compte déjà cinquante-deux centrales nucléaires et est doté de la troisième capacité nucléaire après les Etats-Unis et la France, poursuit un ambitieux plan de construction de centrales : quatre tranches sont en cours de construction et six sont programmées à courte échéance. L'objectif est de porter de 30 à 40 % d'ici à 2030 la part du nucléaire dans l'électricité utilisée au Japon. Les investissements sont strictement privés, mais le gouvernement réfléchit aux modalités d'une sécurisation de l'environnement de ces investissements : il envisage de prendre en charge le risque spécifique au secteur du nucléaire. Malgré les nombreux scandales et incidents qui ont terni l'image de l'électricité nucléaire ces dernières années, le Japon n'est donc pas tenté de renoncer au nucléaire, qui constitue le seul moyen de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Le site de Rokkasho-Mura, qui devrait entrer en fonction prochainement, montre la pérennité de ce secteur : il comprend une usine d'enrichissement par centrifugation, des centres de stockage pour les déchets et une usine de retraitement. Cette dernière, construite grâce à des transferts de technologie avec AREVA, devrait réduire, sans les supprimer, les transports de déchets du Japon vers l'usine de retraitement de La Hague. En Inde, le nucléaire civil est encore balbutiant et ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, environ 3 % des 127 gigawatts de capacité de production électrique proviennent du nucléaire. Le Gouvernement a pourtant fixé un objectif de 20 gigawatts en 2020, sur une production électrique totale prévue de 220 à 230 gigawatts, soit près de 9 % (104), objectif que Mme Anne Lauvergeon, Présidente du directoire d'AREVA, a jugé réaliste, au cours de son audition par la Mission. Il existe seulement trois centrales nucléaires en Inde, qui disposent d'une technologie indienne ancienne, les règles du Traité de non-prolifération interdisant les transferts de technologies au profit d'un pays qui n'y est pas partie. Les Russes construisent actuellement deux autres centrales, d'une capacité de 1 gigawatt chacune, dont ils se sont engagés à assurer la fourniture en combustible pendant vingt-cinq ans. Le programme indien prévoit la construction de huit autres centrales de technologie indienne, de quatre sur-générateurs et de six centrales de technologie étrangère - la technologie française étant unanimement considérée comme la meilleure -, pour atteindre leur objectif de production en 2020. A terme, il est envisagé de produire de l'énergie nucléaire à partir du thorium, qui est abondant en Inde, contrairement à l'uranium. C'est officiellement pour réaliser ce programme que l'Inde a conclu un accord bilatéral avec les Etats-Unis dans le domaine du nucléaire civil, lequel vise à autoriser ces derniers à coopérer avec elle dans le domaine nucléaire, sans que ces derniers ne violent les règles du TNP, qui leur interdisent toute coopération avec un Etat qui n'a pas signé un accord de garantie complet. Dans le même temps en effet, l'Inde a accepté la séparation entre activités militaires et activités civiles et de l'exercice du contrôle de l'AIEA sur ses installations civiles. Même si cet accord ne constitue qu'un premier pas, le groupe des fournisseurs nucléaires (NSG) devant aussi approuver le mécanisme proposé, alors que la Chine n'y est pas favorable, il apparaît lourd de conséquences. Pour l'Inde, il s'agit surtout de se voir reconnaître un statut d'exception qui pourrait lui ouvrir la voie à la reconnaissance de son état de puissance nucléaire militaire, tandis que les Etats-Unis y voient un moyen de renforcer leur partenariat avec l'Inde, pour faire contrepoids à la puissance chinoise, et de peser sur la diplomatie indienne, afin de l'éloigner de l'Iran. Cette seconde dimension n'a pas échappé à de nombreux observateurs indiens qui s'inquiètent des conséquences du rapprochement entre l'Inde et les Etats-Unis. En effet, étant donné le volume des investissements à réaliser, les délais de construction des centrales et le coût de l'électricité ainsi produite, le nucléaire ne pourra pas représenter avant longtemps une source d'énergie importante pour l'Inde, alors que celle-ci a besoin du gaz iranien de manière urgente. Etant donné les spécificités de la demande indienne, le pays ne peut se priver aujourd'hui des hydrocarbures iraniens en échange de promesses relatives à une énergie considérée par beaucoup d'Indiens comme celle du XXIIème siècle. 2) La sécurisation de l'accès aux ressources gênée par la stratégie chinoise Dans les deux pays, la diversification des sources d'énergie se double d'une diversification des fournisseurs (105). Les partenaires des deux pays sont d'ailleurs parfois les mêmes. a) L'Iran et la Russie, partenaires recherchés des Japonais Malgré les pressions américaines en faveur de l'abandon du projet, le Japon entend participer au développement du champ pétrolier d'Azadegan, en Iran. Depuis 2000, les entreprises japonaises sont déjà bien implantées dans ce pays, en particulier dans le projet de développement des champs pétroliers de Soroosh et Nowroos, dont le potentiel est estimé à un milliard de barils. Une filiale de la Japan National Oil Corporation participe à ce projet à hauteur de 221 millions de dollars, soit 20 % du total. En février 2004, les deux pays ont signé un accord selon lequel le japonais INPEX devrait recevoir le droit d'exploiter les gisements d'Azadegan, situés près de la frontière avec l'Irak, dans le Khouzistan. Les investissements prévus atteignaient 2 milliards de dollars, dont 75 % devaient être apportés par INPEX et 25 % par la compagnie nationale iranienne. Les réserves de ces gisements sont estimées entre 26 et 45 milliards de barils ; la production devait démarrer en 2007 à hauteur de 50 000 barils par jour, avant de tripler l'année suivante et d'atteindre 260 000 barils par jour au maximum de la production. Les deux tiers devaient être exportés vers le Japon, pendant douze ans et demi. Le Japon tenait à la réalisation de ce projet, dont la production, assurée par une compagnie nippone, devait équivaloir à 6 % de ses importations pétrolières en 2003, et dont la négociation avait mobilisé sa diplomatie pendant quatre ans. Il voulait en outre absolument éviter que sa renonciation ne conduise l'Iran à proposer ce projet à la Chine. Pourtant, début octobre 2006, INPEX a annoncé que sa participation au projet allait être ramenée de 75 % à 10 %, ce qui conduit l'opérateur japonais à renoncer au contrôle opérationnel de la production. Il a mis en avant deux raisons à ce repli : d'une part, le déminage du champ de forage (106) n'aurait pas été réalisé de manière aussi complète que le contrat ne le prévoyait ; d'autre part, les coûts d'investissement du projet auraient dérivé à la hausse, sans que le groupe japonais précise dans quelles proportions. Une entreprise russe ou chinoise pourrait prendre la place laissée vacante. La concurrence sino-japonaise s'exerce également pour l'accès aux ressources énergétiques russes. Les deux pays se disputent en particulier le tracé d'un oléoduc qui assurerait leur alimentation en pétrole de Sibérie. L'oléoduc, qui pourrait ensuite être doublé d'un gazoduc, devait initialement relier Angarsk soit à Daqing, en Chine, soit à Nakhodka, sur la côte est de la Fédération russe, à une centaine de kilomètres de Vladivostok. Il a depuis été décidé de le faire partir de Taïshet et passer par Skvorodino, près de la frontière russo-chinoise, mais la question de son débouché reste posée. Le tracé vers Daqing permettrait d'alimenter uniquement le marché chinois, alors que celui vers Nakhodka serait ouvert vers le Japon, la Corée et le Pacifique. C'est surtout la volonté des producteurs russes de ne pas dépendre trop étroitement de la Chine qui a conduit Moscou à s'orienter vers la seconde option, qui n'a néanmoins pas encore été l'objet d'un accord définitif. Cette option présente aussi des avantages financiers importants, puisque des investisseurs japonais, publics et privés, prendraient à leur charge une part considérable du projet de construction, qui est évalué entre 12 et 15 milliards de dollars. Même si la contribution japonaise n'a pas encore été précisément définie, la générosité des propositions formulées montre bien que, pour Tokyo, le pétrole n'est pas une marchandise régie par les seules lois du marché, mais qu'il constitue au contraire un facteur de puissance ou de vulnérabilité politique. L'investissement initial devra d'ailleurs être complété car les réserves du gisement d'Angarsk seraient limitées à une dizaine d'années, rendant nécessaires des investissements d'exploration en Sibérie. En novembre 2005, le Japon s'est ainsi engagé à consacrer entre 100 et 200 millions de dollars à des études de prospection de nouveaux gisements. La Russie tire incontestablement profit de la concurrence que se livrent le Japon et la Chine pour assurer la pérennité de leur approvisionnement énergétique. Cette concurrence est aussi sensible à Sakhaline. Le Japon s'est récemment inquiété de la volonté chinoise de prendre part au marché du gaz qui y est exploité (107). En effet, le Japon a beaucoup investi dans les gisements de gaz de Sakhaline, zone située juste au nord de l'archipel. Les efforts réussis de développement de l'utilisation du gaz naturel au Japon sont liés à la présence de cette ressource à proximité. Des entreprises japonaises sont ainsi fortement présentes dans les projets d'exploitation de Sakhaline I et Sakhaline II. La compagnie japonaise Sakhaline Oil and Gas fait partie du consortium du projet Sakhaline I, dont l'opérateur est une filiale du groupe ExxonMobil, et le projet Sakhaline II associe Shell, à hauteur de 55 %, à Mitsui, pour 25 %, et Mitsubishi pour 20 %. Il devrait constituer le plus gros investissement direct jamais réalisé en Russie, les opérateurs annonçant un chiffre de 20 milliards de dollars. Il est prévu d'extraire du pétrole et du gaz par trois plates-formes au nord de l'île, puis de l'acheminer par deux pipelines souterrains jusque dans le sud, à 800 kilomètres, où le gaz serait liquéfié dans une usine ultramoderne, avant d'être exporté, à partir d'un nouveau port artificiel, vers le Japon, la Corée et l'Amérique du Nord. Mais, depuis quelques mois, les autorités russes semblent tentées de revenir sur les concessions de gisements qu'elles ont accordées, notamment à Sakhaline, aux groupes étrangers. Le souci de sécuriser ses approvisionnements énergétiques influence directement la diplomatie japonaise. Il la conduit à entretenir de bonnes relations avec des pays stratégiques du point de vue énergétique mais qui ne sont pas des amis naturels du Japon. C'est le cas de la Russie, qui n'a toujours pas conclu de traité de paix avec le Japon depuis 1945 à cause de l'absence de règlement de la question territoriale (108). La situation est aussi délicate vis-à-vis de l'Iran : les Etats-Unis reprochent à Tokyo d'avoir tardé à condamner le Président Mahmoud Ahmadinedjad lorsqu'il a exprimé son souhait de « rayer Israël de la carte » par peur de faire échouer le projet d'Azadegan ; de même, le Japon hésite à se rallier à des sanctions sévères sur la question du nucléaire iranien. Mais la forte réduction de la participation du groupe INPEX au projet d'Azadegan, même si elle a été justifiée par des raisons techniques et financières, est sans aucun doute la conséquence de la pression exercée sur le Japon par les Etats-Unis afin d'isoler économiquement l'Iran et de le priver des investissements étrangers dont il a besoin pour développer sa production d'hydrocarbures. Les compagnies pétrolières nippones s'intéressent aussi aux hydrocarbures libyens : en 2005, trois compagnies japonaises ont obtenu des permis d'exploitation en Libye et le Japon accorde à ce pays une coopération, notamment technologique, d'un montant élevé dans le domaine énergétique. Il apparaît donc que, malgré la proximité entre sa diplomatie et la diplomatie américaine, le Japon est susceptible de prendre des positions en désaccord avec celles des Etats-Unis, dès lors que l'avenir de son approvisionnement énergétique est en jeu. b) L'Iran, l'Asie centrale et la Birmanie, futurs fournisseurs de l'Inde ? Même si du pétrole a été récemment découvert au Rajasthan, l'épuisement progressif des réserves de Bombay High, actuellement exploitées, et l'augmentation rapide des besoins conduisent l'Inde à mener une politique de contrôle des ressources pétrolières dans d'autres pays, notamment afin de limiter sa forte dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient. Comme la Chine et le Japon, elle souhaite que des entreprises nationales s'assurent des droits d'exploitation de champs pétroliers situés à l'étranger. Cette volonté a conduit des entreprises indiennes à prendre pied au Vietnam, en Angola, au Soudan, en Libye, au Kazakhstan par exemple. Mais dans tous les pays, ces entreprises sont en concurrence avec leurs rivales chinoises, qui l'emportent le plus souvent, leur pays ayant plus à offrir que l'Inde, en termes financier et politique. Des efforts ponctuels de coopération entre les deux pays existent néanmoins : en Syrie, des entreprises chinoises et indiennes explorent ensemble un champ pétrolier. Si le fonctionnement du marché du pétrole permet à l'Inde de s'assurer un approvisionnement à la hauteur de ses besoins, à la seule condition qu'elle puisse en payer le prix, la satisfaction de ses besoins en gaz naturel est plus difficile à réaliser. Le volume de gaz naturel qu'elle se procure aujourd'hui, qui atteint près de 92 millions de mètres cubes par jour, pour un cinquième sous forme de GNL, ne suffit pas à assurer l'alimentation de toutes ses centrales thermiques ; il est à l'origine de seulement 10 % de sa production électrique, certaines centrales ne produisant pas à la hauteur de leurs capacités. La demande va être amenée à augmenter sous l'effet à la fois de la croissance de l'économie et des efforts de substitution du gaz, moins polluant, au pétrole et au charbon : la consommation de gaz naturel devrait s'établir à 224 millions de tonnes équivalent pétrole en 2030, contre 29 millions de tonnes équivalent pétrole en 2003. Pour résoudre son problème de fourniture, le pays essaie de mener à bien deux stratégies parallèles. Alors que le gaz importé provient surtout du Qatar, l'Inde souhaite conclure un accord d'approvisionnement de long terme avec l'Iran ; elle projette aussi la réalisation de plusieurs gazoducs, ce moyen de transport étant considéré comme moins coûteux que la liquéfaction pour les distances inférieures à 4 500 kilomètres. La négociation de l'accord avec l'Iran est d'ores et déjà bien avancée : celui-ci porterait sur la livraison de 5 millions de tonnes de gaz par an, voire 7,5 millions de tonnes à terme, sous forme de GNL en provenance du champ de South Pars, pour la somme de 20 milliards de dollars sur vingt-cinq ans. Mais les discussions, que la partie indienne croyait bouclées, sont actuellement relancées pour ce qui est du prix, à la suite des hausses du prix des hydrocarbures et du vote indien à l'AIEA contre le programme nucléaire iranien. L'Iran devrait aussi être un partenaire privilégié de l'Inde en ce qui concerne l'acheminement de gaz naturel par gazoduc. Depuis plusieurs années, est étudié un projet de gazoduc reliant l'Iran à l'Inde, sur 2 700 kilomètres, en traversant le Pakistan. Pour un investissement total compris entre 4 et 7 milliards de dollars, il assurerait à l'Inde la fourniture de 90 millions de mètres cubes de gaz par jour. L'Iran apparaît favorable au projet, qui achoppe encore sur les différends indo-pakistanais. Il semble néanmoins que, notamment dans le cadre du « dialogue composite » noué entre les deux pays, les discussions continuent. Les interlocuteurs indiens de votre Rapporteur ont insisté sur les espoirs que suscitait ce projet, tant du point de vue strictement énergétique que dans un souci de normalisation des relations, au moins économiques, entre leur pays et le Pakistan. Un autre projet vise à relier l'Inde à la Birmanie par un gazoduc de 1 000 kilomètres et d'une capacité de 33 millions de mètres cubes par jour, qui devait initialement passer par le Bangladesh. Malgré les avantages financiers que ce petit pays pourrait trouver au passage d'un gazoduc sur son territoire, les autorités du Bangladesh n'y sont pas favorables, si bien qu'un tracé alternatif, plus long mais passant uniquement en territoire indien, a été élaboré. L'Inde doit agir vite dans ce pays, car la Birmanie a déjà conclu d'importants accords de fourniture de gaz avec la Chine, y compris à partir de champs explorés par des entreprises indiennes et coréennes. Enfin, un troisième projet propose d'alimenter l'Inde en gaz turkmène, pour 55 millions de mètres cubes par jour, grâce à un gazoduc long de 2 000 kilomètres qui traverserait l'Afghanistan, pays avec lequel New Delhi a de bonnes relations. Mais l'un des tracés envisagés déboucherait à Gwadar, au Pakistan, ce que l'Inde voudrait éviter, tandis que la construction d'un autre gazoduc entre le Turkménistan et la Chine est aussi à l'étude. Les Etats-Unis pressent l'Inde de favoriser le projet turkmène, d'un coût de 3,5 milliards de dollars, plutôt que le projet iranien. Mais l'Inde considère qu'elle ne peut se passer du gaz iranien et beaucoup d'Indiens s'inquiètent des pressions exercées par les Etats-Unis sur ce dossier. L'accord sur le nucléaire civil leur fournit un moyen de pression supplémentaire. 3) Les différends énergétiques avec la Chine Japonais et Indiens se concurrencent mutuellement pour l'accès au gaz iranien ou la prise de participation dans tel ou tel projet hors de leurs frontières, mais ils ne se perçoivent pas comme des adversaires. La Chine est en revanche considérée dans les deux pays comme une menace. a) Des relations sino-japonaises particulièrement délicates dans le domaine énergétique Comme l'a expliqué Mme Valérie Niquet au cours de son audition par la Mission d'information, « (...) l'énergie n'est pas le sujet fondamental de la rivalité sino-japonaise, qui s'explique plus profondément comme la rivalité entre deux puissances dotées d'une stratégie de retour à une position normalisée, la Chine souhaitant revenir à une situation de leadership qu'elle estime naturel en Asie, le Japon voulant affirmer son statut de puissance démocratique, légitime, influente au plan international, notamment via une présence au Conseil de sécurité. La Chine n'est donc pas disposée à accepter une Asie multipolaire. Dans cette perspective, les conflits énergétiques ne sont que le témoignage d'une rivalité beaucoup plus profonde. » Il est clair que la compétition entre les deux pays sur l'approvisionnement énergétique, sensible au Moyen-Orient comme en Asie, attise ces tensions aux origines plus profondes. Les personnalités japonaises rencontrées par votre Rapporteur au cours de son déplacement à Tokyo sont apparues réellement préoccupées par l'activisme diplomatique et économique chinois dans le domaine énergétique. Néanmoins, cette méfiance n'empêche pas toute coopération. C'est en mer de Chine orientale que les tensions entre la Chine et le Japon apparaissent de la manière la plus directe : elles concernent les gisements gaziers de Chunxiao et les îles Senkaku. Dans les deux cas, intérêts énergétiques et revendications territoriales sont étroitement mêlés. Depuis août 2003, la Chine explore le champ gazier sous-marin de Chunxiao, qui abriterait 200 milliards de mètres cubes de gaz naturel ; il est situé à proximité de la ligne des 200 miles nautiques délimitant, selon le Japon, les zones économiques exclusives. Comme les nappes se prolongent de l'autre côté de la ligne, les Japonais se considèrent comme spoliés, tandis que la Chine conteste cette délimitation des zones économiques exclusives et estime que l'intégralité du plateau continental, et donc du gaz, lui revient. Alors qu'il s'y était toujours refusé depuis trente ans pour éviter de froisser Pékin, le gouvernement japonais a accordé, en avril 2005, des droits d'exploration dans cette zone à deux compagnies nippones. Les deux pays se disputent aussi l'archipel Senkaku, situé au Sud d'Okinawa, depuis qu'une étude des Nations unies a établi, en 1969, que la zone serait riche en hydrocarbures. Bien que l'intérêt réel des ressources ne soit pas démontré, le Japon a donné une preuve de sa fermeté en février 2005 en plaçant sous le contrôle de sa marine un phare construit par un groupe d'extrême droite sur la plus grande des îles. Au cours de son audition par la Mission, M. Bruno Weymuller, directeur de la stratégie et de l'évaluation des risques de Total, a ainsi qualifié de « heurt frontal » l'opposition entre les deux pays à propos des zones de la mer de Chine renfermant des hydrocarbures. Mais les sujets de conflits énergétiques entre Japon et Chine sont loin de se limiter à cette zone. Outre la rivalité déjà signalée à propos du pétrole sibérien et la concurrence sous-jacente en Iran, l'opposition entre les deux pays s'observe partout dans le monde. En Arabie Saoudite, la compagnie japonaise Arabian Oil Company s'est vu refuser l'extension de ses droits de concession en 2000, alors que la Chine est parvenue, contrairement au Japon, à s'intégrer au consortium chargé d'exploiter l'un des quatre gisements gaziers ouverts aux intérêts étrangers (109). Les ressources de la mer Caspienne intéressent aussi les deux pays : le japonais INPEX a lancé l'exploitation du gisement offshore de Kashagan (au Kazakhstan) avec Total et a pris des participations dans l'oléoduc Bakou-Ceyhan ; la Chine a quant à elle entrepris la construction d'un pipeline destiné à l'alimenter en pétrole kazakh. Au Brésil, les Chinois ont obtenu le financement d'un programme visant l'extension d'un réseau de gaz, initialement attribué à la Banque japonaise de coopération internationale, qui se verra finalement confier d'autres tronçons de ce projet. Cette concurrence dans le domaine énergétique constitue un sujet d'inquiétude de plus pour Tokyo, que la montée en puissance de la Chine préoccupe aussi bien du point de vue militaire, géostratégique qu'économique. Mais le Japon a aussi conscience du lien qui existe entre ses intérêts économiques et ceux de son grand voisin. Celui-ci est devenu son premier partenaire commercial, devant les Etats-Unis. Les entreprises des deux pays coopèrent, y compris dans le secteur énergétique. Nippon Oil a ainsi conclu un contrat d'un an avec China Oil, portant sa capacité de raffinage de 20 000 à 30 000 barils par jour, destinés au groupe PetroChina. Quant au gouvernement japonais, il a centré son aide au développement à destination de la Chine sur des transferts de technologies en matière de protection de l'environnement - notamment en faveur d'une production et d'une utilisation plus propre du charbon - et d'amélioration de l'efficacité énergétique, particulièrement nécessaires dans un pays où les industries sont très gourmandes en énergie. La Chine est aussi associée au développement de l'approche régionale des questions énergétiques. b) La sécurité énergétique indienne menacée par la Chine ? Comme votre Rapporteur l'a indiqué supra, la Chine n'hésite pas à utiliser ses moyens économiques, politiques et diplomatiques pour s'assurer un approvisionnement énergétique à la hauteur de ses immenses besoins. La croissance de la demande indienne suit depuis quelques années un rythme proche de celui de la croissance des besoins chinois, mais l'Inde a environ quinze ans de retard sur la Chine, et une capacité d'influence extérieure nettement moins forte. Bien que pays non-aligné et attaché à cette notion, l'Inde a du mal à définir une ligne cohérente pour sa diplomatie. Après avoir été proche de l'Union soviétique, elle veut garder de bonnes relations avec la Russie et se rapproche depuis quelques années des Etats-Unis. Elle aspire à accéder au statut de grande puissance, notamment en obtenant un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies, mais elle a du mal à défendre ses propres intérêts. Avec son droit de veto au Conseil de sécurité et sa diplomatie aussi subtile qu'indépendante, la Chine est autrement armée pour faire pression sur un partenaire énergétique potentiel. L'Etat comme les groupes pétroliers et gaziers chinois disposent de moyens financiers bien supérieurs à ceux de l'Inde, tandis que sa position géographique lui permet de multiplier les voies, terrestres ou maritimes, de son approvisionnement énergétique. Au Kazakhstan, en Angola, au Soudan, au Vietnam par exemple, les entreprises indiennes et chinoises entrent directement en concurrence ; elles ont en revanche décidé de travailler ensemble sur un champ libyen. Mais c'est surtout lorsque la Chine intervient fortement dans des pays géographiquement très proches de l'Inde que les autorités de cette dernière s'inquiètent. Or, la présence chinoise est de plus en plus marquée au Pakistan d'une part, en Birmanie d'autre part. Au Pakistan, les Chinois sont en train de construire un nouveau port militaire et commercial à Gwadar, sur la mer d'Oman, dans la province du Baloutchistan. Ce port en eau profonde constituera un terminal d'hydrocarbures proche du Golfe persique et un véritable poste d'observation du détroit d'Ormuz. Situé près de la frontière pakistano-afghane, il est un point de passage stratégique entre l'Asie centrale et le sous-continent indien, en offrant aux républiques enclavées de la région un débouché maritime. Il pourrait donc détourner de l'Inde une partie de l'approvisionnement énergétique provenant d'Asie centrale. Cette réalisation est le fruit des liens anciens unissant la Chine et le Pakistan, autour d'un ennemi commun, l'Inde. Celle-ci y est d'autant plus hostile que le nouveau port offrira à l'armée pakistanaise une base arrière plus sûre que le port de Karachi en cas de nouvelle guerre entre les deux pays. L'Inde s'inquiète aussi des projets chinois en Birmanie, qui visent à assurer la fourniture des hydrocarbures birmans à la Chine, alors que l'un des projets de gazoducs défendus par New Delhi relierait justement la Birmanie à l'est de l'Inde. La Chine étudie deux possibilités : la construction d'un terminal de débarquement du brut à Sittwe, d'où il serait acheminé vers le sud de la Chine par un pipeline de 900 kilomètres, ou la création d'une voie ferrée entre l'est du Yunnan et Rangoon. Les Chinois cherchent parallèlement à obtenir la possibilité de faire stationner leur marine dans des ports birmans, ce qui la positionnerait à proximité des eaux indiennes. Les relations diplomatiques indo-chinoises sont traditionnellement articulées entre conflit, concurrence et coopération : ce triptyque se retrouve dans le domaine énergétique. Mais les relations économiques entre les deux pays sont en rapide expansion, la Chine étant devenue le deuxième partenaire commercial de l'Inde, ce qui devrait favoriser un rapprochement pragmatique entre les deux puissances asiatiques montantes. 4) La promotion d'une coopération régionale D'ici à 2020, la consommation énergétique de l'Asie du Nord-Est (Chine, Corée du Sud, Japon et Taiwan) devrait dépasser celle de l'Amérique du Nord. Japonais et Indiens défendent donc l'idée que l'intérêt des grands consommateurs asiatiques d'énergie est d'améliorer la coopération économique régionale. C'est pourquoi le Japon a lancé en septembre 2002 l'initiative Hiranuma, du nom de l'ancien ministre de l'économie, visant à établir une coopération sur les questions de réserves stratégiques et de coordination d'urgence en cas de pénurie. Cette démarche a contribué à l'établissement, en juin 2004, d'un accord de partenariat énergétique dans le cadre de l'ASEAN+3 (110), qui marque une avancée significative, envisageant à terme des projets de réseaux transfrontières. La Corée du Sud et le Japon ont souligné l'importance des questions énergétiques dans la perspective de la conclusion d'un accord de libre-échange et une réunion associant aussi la Chine évoquait, fin 2004, l'établissement d'un cadre de discussion formalisé entre les trois pays. En juillet 2005, a été annoncée la conclusion d'un « partenariat Asie-Pacifique pour le développement propre et le climat » entre le Japon, les Etats-Unis, l'Australie, la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Plusieurs volets de ce partenariat, qui a déjà donné lieu à des réunions, concernent la production et la consommation d'énergie. C'est aussi par la voie de la coopération que les Japonais s'efforcent de sécuriser les voies maritimes nécessaires à leur approvisionnement énergétique, en provenance du Golfe persique notamment. Ils ne peuvent en effet intervenir directement pour protéger les navires en route vers le Japon des attaques terroristes ou des actes de piraterie, très fréquents dans le détroit de Malacca. Les gardes-côtes japonais, qui dépendent du ministère des Transports, s'appuient sur deux structures de coopération internationale : - le Forum des gardes-côtes du Pacifique Nord, qui regroupe le Japon, le Canada, la Chine, la Corée du Sud et les Etats-Unis ; - le Séminaire des agences de gardes-côtes d'Asie, auquel participent dix-sept pays, dont la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. Dans le cadre du Forum sont organisés des exercices communs et un réseau intranet permet de relier les agences des six Etats membres afin d'échanger des informations. Le fonctionnement du Séminaire est financé par la Fondation du Japon ; Tokyo souhaite en effet amener les agences des autres Etats à élargir leur action au-delà du sauvetage maritime, qui demeure la seule mission des gardes-côtes dans certains d'entre eux. L'accent est mis notamment sur la lutte contre la piraterie et la criminalité transnationale et sur la sécurité maritime. L'Agence japonaise de sécurité maritime s'efforce de contribuer à la sécurité des lignes de communications maritimes en Asie. Depuis de nombreuses années, elle envoie des navires en Asie du Sud et assure des programmes de formation au bénéfice de la Malaisie, des Philippines et de l'Indonésie. Le Japon fournit aussi des équipements aux agences malaise et indonésienne de gardes-côtes. Il a aussi organisé en 2000 une conférence des chefs des agences de gardes-côtes pour lutter contre la piraterie et les attaques de bâtiments de commerce au cours de laquelle il a proposé de lancer une coopération opérationnelle commençant par un échange d'informations sur les actes de piraterie et conduisant à des actions d'assistance multilatérales policières et judiciaires. Une coopération technique, pour la formation et la fourniture d'équipements, était aussi envisagée. Même si les efforts japonais n'ont pas encore eu de traductions opérationnelles réelles, ils témoignent de l'importance que la sécurité des voies maritimes revêt aux yeux des autorités japonaises et traduisent leur volonté d'améliorer la situation dans le respect de la souveraineté et de la susceptibilité des Etats côtiers concernés. La Chine, qui participe à la plupart des structures de coopération précitées, partage entièrement cette préoccupation mais, privée des capacités navales qui lui permettraient d'assurer elle-même la sécurité de ses navires, elle axe actuellement sa stratégie autour de la construction de ports au Pakistan, au Bangladesh et en Birmanie, c'est-à-dire le long des itinéraires empruntés par les pétroliers qui l'approvisionnent, afin que les flottes américaines et indiennes ne soient pas les seules présentes dans cette zone. Enfin, les transferts de bonnes pratiques et de technologies japonaises en faveur des économies d'énergie ne sont pas dirigés uniquement vers la Chine, mais aussi vers les autres pays asiatiques, comme la Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam et l'Inde. L'Inde, qui participe à certaines des structures précitées, défend aussi la coopération régionale, mais les initiatives qu'elle prend en Asie du Sud sont souvent perçues par ses voisins comme des tentatives de satellisation, tant le poids démographique, politique et économique de ce pays est important dans la zone. Ni l'Association de l'Asie du Sud pour la coopération régionale (SAARC) (111), ni la Coopération économique entre le Bangladesh, l'Inde, la Birmanie, le Sri Lanka et la Thaïlande (BIMST-EC) n'ont permis de réaliser de véritable progrès dans le développement des relations économiques intrarégionales. L'Inde se rapproche de l'ASEAN, avec laquelle elle a signé un partenariat pour la paix, le progrès et la prospérité commune en novembre 2004. Elle a enfin participé au premier Sommet de l'Asie de l'Est, à Kuala Lumpur, en novembre 2005. Ces différentes structures intergouvernementales, aux périmètres géographiques différents, ont une dimension économique générale, mais certains des interlocuteurs indiens de votre Rapporteur espèrent qu'elles vont évoluer sur le modèle de l'Union européenne, l'énergie étant susceptible de jouer le rôle rempli en Europe par le charbon et l'acier. Cela supposerait que les nombreuses divergences politiques soient écartées au profit des enjeux économiques, l'éventuelle participation de la Chine à une telle organisation régionale constituant une autre question délicate. Aujourd'hui l'ébauche d'actions communes et de coopérations régionales ne doit pas cacher que les grands Etats asiatiques défendent avant tout chacun leurs propres intérêts énergétiques, y compris au détriment des autres, et que l'existence de préoccupations communes n'est venue à bout ni des rivalités historiques ni des jeux de puissance. Dans ce domaine, la Chine devance largement ses concurrents et voisins que sont le Japon et l'Inde. 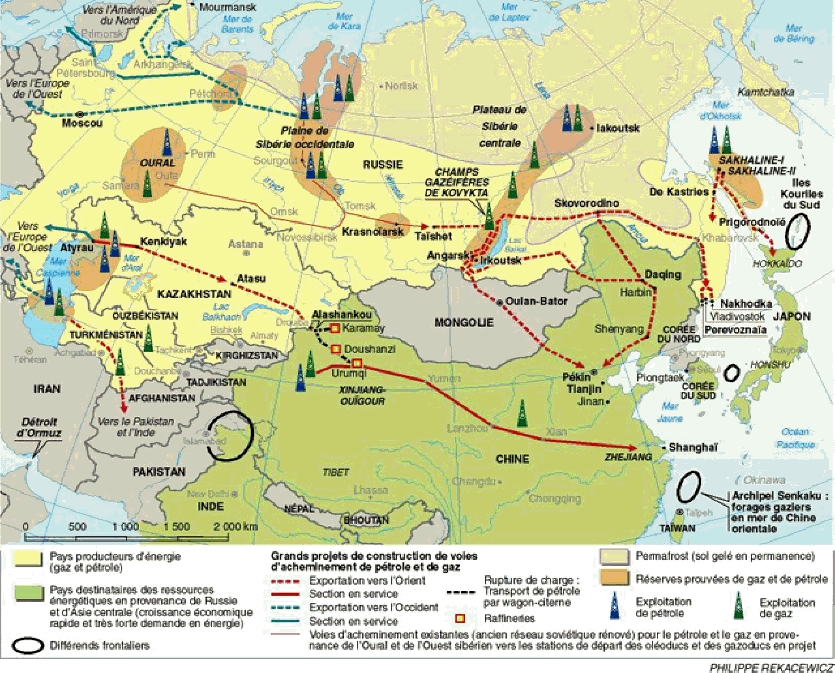 L'Afrique, Repères L'Afrique représente aujourd'hui 10 % des réserves et 12 % de la production mondiales de pétrole ainsi que 8 % des réserves et 6 % de la production mondiales de gaz. Les principaux producteurs africains sont le Nigeria, l'Algérie, la Libye et l'Angola, le Golfe de Guinée apparaissant comme une zone d'avenir suscitant l'intérêt très vif des Etats-Unis et de la Chine. Mais nombre de pays africains n'ont pas accès aux hydrocarbures : la biomasse représente les trois quarts de l'énergie primaire consommée. La consommation énergétique par habitant est extrêmement faible en Afrique : 0,5 tonne équivalent pétrole contre 4 tonnes en Europe et 8 tonnes aux Etats-Unis Pendant toute la Guerre froide et pour son plus grand malheur, l'Afrique fut le champ sur lequel les deux puissances s'affrontèrent par alliés interposés. Mais la situation changea du tout au tout lorsque l'Union soviétique s'effondra et le bloc de l'Est avec elle. Ravagé par des années de guerre, le continent africain sembla délaissé par tous. Représentant 2 % du commerce mondial pour plus de 900 millions d'habitants, soit 15 % de la population du globe, on avait le sentiment que l'Afrique n'intéressait pas le reste de la planète. La situation politique, économique et sociale n'est pas aujourd'hui beaucoup plus satisfaisante qu'il y a vingt ans, au sortir de la Guerre froide. Mais on observe un intérêt de plus en plus soutenu pour le continent africain. La boulimie énergétique auquel le monde fait face aujourd'hui n'y est pas étrangère. L'Afrique apparaît comme un immense réservoir de ressources naturelles, parmi lesquelles les hydrocarbures figurent en bonne place. La crise énergétique pourrait avoir pour conséquence - bénéfique ? - de faire à nouveau de l'Afrique un continent stratégique. Pour examiner cette question, nous raisonnerons en quatre temps. _ On s'arrêtera un instant sur les ressources dont dispose ce continent qui est tout sauf homogène. D'Alger au Cap, de Dakar à Djibouti, les problèmes ne se posent pas de la même manière ; ces différences sont particulièrement prononcées entre les pays qui regorgent ou non de gisements de pétrole ou de gaz. On constatera ensuite qu'en termes politiques, la question énergétique peut conduite à des crises ou des conflits en Afrique sous trois formes que nous examinerons successivement. _ Le premier risque de crise est interne aux pays africains eux-mêmes. Ceux qui disposent de ressources en hydrocarbures peuvent voir leur situation se dégrader et même aboutir à des guerres civiles et à un démembrement de l'Etat dans deux hypothèses : primo si leurs ressources s'épuisent, qu'ils n'ont pas été prévoyants pour gérer « l'après-pétrole » et que la crise économique et sociale qui s'ensuit se transforme en conflit politique voire ethnique ; secundo si leurs ressources demeurent abondantes mais que l'Etat ne réussit pas à développer le pays et à répartir équitablement les fruits de l'exploitation pétrolière ou gazière. _ Le deuxième risque est interne au continent africain. La recherche de nouveaux gisements - en particulier dans les pays où les anciens se tarissent - peut conduire à des conflits de souveraineté entre Etats cherchant à s'approprier sur terre et surtout sur mer - là où les frontières sont les plus difficiles à tracer - des zones d'exploitation. _ Le troisième et dernier risque est externe, celui de voir de grandes puissances - les Etats-Unis et la Chine et peut-être demain l'Inde - entrer en concurrence sur le continent africain à la recherche de toujours plus de pétrole et de gaz pour alimenter leur économie. Les développements qui suivent se fondent en grande partie sur les informations et les éléments recueillis par M. Jean-Jacques Guillet, qui a effectué un déplacement en Algérie, et par M. Henri Sicre, qui a effectué un déplacement au Gabon, en septembre 2006, dans le cadre de la Mission d'information. A - Une Afrique à deux vitesses 1) L'Afrique du pétrole et du gaz a) Des réserves de pétrole très concentrées géographiquement Selon les données délivrées par la BP Statistical Review of World Energy 2006, qui fait référence en ce domaine (112), l'Afrique disposait de réserves prouvées en pétrole de 57 milliards de barils en 1985, de 72 milliards en 1995 et de 114 milliards en 2005, soit 15 milliards de tonnes, ce qui équivaut à 9,5 % des réserves mondiales. Cela correspond aux réserves de l'Irak classées en troisième position après l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais deux tiers des réserves prouvées africaines sont situés sur le territoire de la Libye - 39,1 milliards de barils soit 5,1 milliards de tonnes - et du Nigeria - 35,9 milliards de barils soit 4,8 milliards de tonnes. La production de pétrole connaît aussi une nette expansion. En 2005, l'Afrique a produit 467,1 millions de tonnes contre 441 l'année précédente et 339,3 en 1995. La progression de 2004 à 2005 a été de plus de 6 % et l'Afrique représente aujourd'hui 12 % de la production mondiale, soit l'exact équivalent de la Russie. Le pétrole africain provient principalement de deux grandes régions : l'Afrique du Nord, avec l'Algérie et la Libye ; le Golfe de Guinée - pris au sens large - avec le Nigeria, l'Angola, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, la République démocratique du Congo et Sao Tomé et Principe. L'Afrique du Nord recèle un peu moins de 5 % des réserves de pétrole mondiales. La production de la zone représente un peu plus de 5 % de la production totale. Le golfe de Guinée, qui concentre l'essentiel des réserves de pétrole d'Afrique sub-saharienne, renferme plus de 4 % des réserves mondiales, et la production agrégée atteint près de 6 % de la production totale. Le Soudan recèle le différentiel des réserves et assure le reste de la production. PRODUCTION ET EXPORTATION DE PÉTROLE DANS LE DELTA DU NIGER EN 2004 b) Une production mondiale de gaz en forte croissance L'Afrique est également riche en gaz, même si sa position est ici moins favorable que pour le pétrole. Le continent dispose de 8 % des réserves prouvées (la Russie représente 26,6 %, l'Iran 14,9 %, le Qatar 14,3 %) soit 14 000 milliards de m3. La production de gaz a connu une nette progression. Toujours selon la même source (BP statistical review), l'Afrique produit 5,9 % de la production mondiale, avec une augmentation de plus de 13 % de 2004 à 2005. En 2005, le continent a produit 163 milliards de m3 contre 83,3 en 1995. L'Afrique du Nord renferme plus de 4 % des réserves mondiales et assure un niveau de production équivalent. En Afrique sub-saharienne, le Nigeria concentre l'essentiel de la ressource soit plus de 3 % des réserves mondiales ; il assure moins de 1 % de la production totale mais à peu près 8 % de l'approvisionnement du marché du GNL. c) Les producteurs : Nigeria, Algérie, Libye et Angola en tête En 2005, douze pays africains, se présentant comme producteurs de pétrole, étaient regroupés au sein de l'Association des pays producteurs de pétrole africains (APPA) qui a vu le jour en 1987 : l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Libye, le Nigeria et la République démocratique du Congo (113). Cette association n'accueille pas tous les pays producteurs cependant. Ainsi le Soudan, qui figure au septième rang des pays produisant du pétrole en Afrique, n'en fait pas partie, pas plus que Sao Tomé et Principe ou le Tchad, à qui on prédit un grand avenir dans le domaine des hydrocarbures. Au-delà, il semble que tous les pays africains se soient mis en quête de gisements de pétrole ou de gaz. Les explorations se multiplient, sur terre (onshore), au Niger ou en Ouganda, et sur mer (offshore) au large de la Namibie, du Maroc, de la Mauritanie, du Mozambique ou de Madagascar. LE PÉTROLE AFRICAIN DANS LE MONDE EN 2004 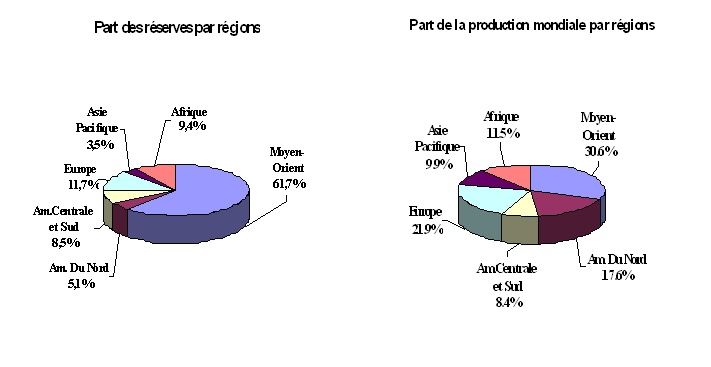
Source : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Au sein du continent africain, le Golfe de Guinée est appelé à jouer un rôle prépondérant dans les années à venir, le Nigeria demeurant la force de production la plus importante de la région, loin devant l'Angola. GOLFE DE GUINÉE 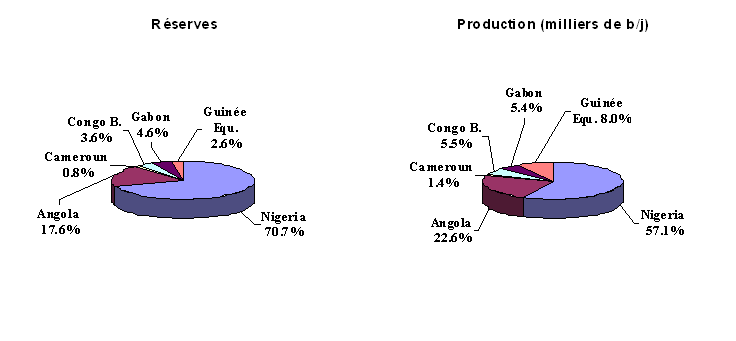 LE GAZ EN AFRIQUE (2004)
L'accès à l'énergie constitue l'une des conditions du développement. L'Occident a commencé et poursuivi son décollage économique grâce au charbon puis au pétrole et à l'énergie nucléaire. En examinant la situation de l'Afrique, on mesure aujourd'hui à quel point cette donnée est essentielle. Comment peut-on espérer éduquer correctement des enfants ou former des adultes s'ils ne peuvent étudier après la tombée de la nuit faute d'électricité pour s'éclairer ? Comment peut-on améliorer les conditions sanitaires, produire de manière fiable si l'on est dépendant d'une production électrique de mauvaise qualité, erratique et coûteuse ? Prise globalement, la consommation énergétique par habitant est extrêmement faible en Afrique : 0,5 tonne équivalent pétrole contre 1,2 en moyenne mondiale (114), bien loin des 4 tonnes européennes et des 8 tonnes américaines (115). Les infrastructures électriques sont notoirement insuffisantes dans la plupart des pays africains (116). L'augmentation des cours du pétrole conduit d'ailleurs bon nombre de sociétés de production d'électricité à des situations financières intenables car elles ne peuvent répercuter sur les clients la hausse de leurs coûts de production. Les conséquences de ces carences en électricité sont très concrètes. Dans les faubourgs d'Accra au Ghana, les programmes de travail des entreprises sont rythmés par les coupures. On rapporte le cas de conserveries alimentaires dont les stocks deviennent avariés en raison de l'interruption inopinée de la distribution d'électricité (117). Pour y remédier, peu d'entrepreneurs, souvent découragés, ont les moyens d'investir dans un groupe électrogène. Les investisseurs étrangers hésitent à s'engager pour ce motif. De telles difficultés touchent les Etats producteurs de pétrole comme le Nigeria mais plus encore les pays qui ne le sont pas. Pour eux, la hausse des cours est une catastrophe économique (118). Récemment, la Banque africaine de développement (BAD) s'inquiétait de la hausse de l'inflation dans les pays du continent importateurs de pétrole, mais aussi de la dégradation des comptes publics. Les entreprises réduisent leurs coûts salariaux en licenciant pour pouvoir régler leur facture énergétique. L'ensemble de ces facteurs a des conséquences démultipliées sur l'économie générale des pays concernés, avec une balance des paiements qui se dégrade et un endettement qui s'aggrave (119). Comme le note M. Jean-Marie Chevalier dans l'article précité, « la hausse des prix touche les pays les plus pauvres et, dans ces pays, elle touche les catégories les plus défavorisées, parmi celles qui ont accès aux énergies modernes : gazole pour les transports, butane, pour la cuisson, fioul pour la production d'électricité. » b) La biomasse : les trois quarts de l'énergie primaire consommée La biomasse demeure la source d'énergie première sur le continent africain puisqu'elle représente plus des trois quarts de l'énergie primaire consommée. Elle se présente, surtout dans les zones rurales, sous la forme de déchets d'activités agricoles ou forestières. La biomasse constitue ainsi la seule ressource véritablement nationale pour bon nombre d'Etats africains. C'est grâce à elle qu'est satisfait l'essentiel des besoins en énergie des ménages, que ce soit pour la cuisson des aliments ou le chauffage. L'utilisation de la biomasse n'est pas satisfaisante pour deux raisons. Elle pose tout d'abord des problèmes d'environnement significatifs comme la déforestation, avec l'utilisation du charbon de bois. Selon certaines expertises, le rythme moyen de déforestation en Afrique serait de 0,7 % par an ; ce phénomène entraîne une érosion et une dégradation des sols très dommageables. Le recours à la biomasse pose aussi des difficultés d'ordre sanitaire. Sa combustion favorise les maladies respiratoires ou oculaires en raison des fumées qui se dégagent. Ces pathologies constitueraient l'une des principales causes de mortalité pour les populations subsahariennes, touchant en particulier les femmes et les enfants en bas âge (120). Le ramassage du bois, tâche très lourde, qui incombe aux femmes, est aussi un obstacle à leur éducation et à leur émancipation. c) Un recours marginal aux énergies renouvelables Bénéficiant d'un riche ensoleillement (121) et battue par les vents, l'Afrique pourrait tirer partie des énergies renouvelables, solaire ou éolienne. Il semblerait ainsi que la moitié des côtes pourraient être utilisées potentiellement pour produire de l'énergie à partir du vent, en particulier dans la partie sud du continent (Afrique du Sud, Mozambique et Namibie). Si les expériences qui ont été menées jusqu'à maintenant furent modestes, elles ont constitué des solutions intéressantes en milieu rural pour assurer l'électrification et permettre de faire fonctionner des pompes. Quelques solutions sont trouvées pour améliorer la production d'électricité grâce à la construction de barrages dans une Afrique qui est très riche en cours d'eau à fort débit. On peut évoquer le barrage de Manantali au Sénégal inauguré en 2002. Dans le cadre du NEPAD (122), plusieurs projets de barrages hydroélectriques et d'interconnexions ont été identifiés pour un investissement total évalué à 16 milliards de dollars. Soutenus par les grandes instances internationales, les responsables africains essaient de stimuler la mise en place d'énergies nouvelles. Ainsi, lors d'une conférence des Nations unies qui s'est tenue en 2003 à Nairobi, les participants se sont fixé comme objectif la production de 1 000 MW d'énergie géothermique en Afrique de l'Est d'ici 2020. Grâce au soutien de la Banque mondiale notamment, certains pays se sont lancés dans l'expérience ; c'est le cas du Kenya qui a déjà pu mettre en place une unité de 45 MW. Ces projets sont porteurs d'espoir. Une chose est cependant certaine: il serait illusoire de compter sur un apport significatif de ces sources d'énergie, relativement coûteuses et complexes à valoriser dans une Afrique frappée par la pauvreté. B - Effets et méfaits de la rente pétrolière : l'énergie comme facteur de tensions internes aux pays africains 1) L'Afrique victime de la « malédiction pétrolière » a) Des pays riches mais pauvres On aurait tort de penser que la richesse en hydrocarbures est synonyme de développement pour les pays africains. Les pays producteurs du continent sont frappés comme partout ailleurs par le phénomène de rente pétrolière, dont les caractéristiques sont aujourd'hui bien connues. Avec la hausse des cours, les pays producteurs engrangent des recettes considérables qui leur permettent d'accroître significativement leur PIB (123). Une étude de la Banque mondiale estime qu'une augmentation durable du prix du baril de 10 dollars entraînerait une hausse de plus de 15 % du PIB des grands exportateurs d'Afrique mais aussi - soulignons-le - une diminution de 4 % de celui des pays importateurs les plus pauvres (124). Tous les pays producteurs sont extrêmement vulnérables à la variation des cours ; les pays africains le sont d'autant plus que leur niveau de développement est faible. Une baisse significative du prix du pétrole peut faire sombrer ces pays dans le plus grand des marasmes, touchant une population qui vit déjà dans un extrême dénuement. Les pays africains exportateurs sont touchés par ce qu'il est convenu d'appeler la « malédiction pétrolière » ou « syndrome hollandais » (« Dutch disease ») (125). Cette expression est apparue au cours des années 1970 à l'époque où l'économie néerlandaise connaissait des difficultés après la mise en exploitation de ses gisements de gaz naturel dans la province de Groningue. L'expression a été popularisée en 1977 au Royaume-Uni où l'on trouvait alors des gisements de gaz. Le « syndrome hollandais » désigne une modification de la structure économique d'un pays dont les exportations - en l'occurrence en hydrocarbures - connaissent une forte et rapide expansion. La balance courante devient excédentaire ce qui entraîne une appréciation du taux de change. Dès lors, les importations deviennent plus compétitives que les productions locales, ce qui provoque un affaissement de la partie de l'activité intérieure qui n'est pas consacrée aux hydrocarbures. On assiste à une contraction de la production nationale à une forte dépendance aux importations, à une hausse du taux de chômage et à un exode rural (126). A ce phénomène économique, s'ajoutent d'autres conséquences tout aussi néfastes pour la population concernée. La majeure partie des recettes fiscales qui provient de l'exportation d'hydrocarbures est utilisée pour des dépenses dites « improductives » ; le secteur public et parapublic devient pléthorique, les subventions versées sont telles qu'elles peuvent avoir un effet désincitatif pour les agents économiques qui n'ont aucun intérêt à investir et à entreprendre. L'Etat prend ainsi en charge des dépenses pour s'assurer la paix sociale dans des pays où les inégalités sont criantes. C'est ce qu'on a observé au Gabon, où le gouvernement subventionne massivement le carburant pour un montant de 100 milliards de francs CFA (plus de 150 millions d'euros) afin de maintenir un prix à la pompe acceptable pour les Gabonais. On mesure l'importance de ce dispositif quand on constate que son coût est équivalent à la moitié du budget d'investissement de l'Etat et à 100 % du fonds pour les générations futures constitué à partir des recettes pétrolières. Les économies de rente se caractérisent aussi par une gestion peu transparente des recettes pétrolières, une forte corruption et de piètres performances en matière de développement. Ces questions renvoient plus largement à la problématique de la gouvernance. Face à la menace de variations des cours du pétrole, les pays africains se trouvent démunis. Certains ont bien tenté de mettre en place des fonds de stabilisation mais sans grand succès. Le pétrole est ainsi une richesse évidente pour ces pays, mais difficile à gérer à terme. La question est encore plus inquiétante si l'on se projette à plus long terme lorsque les ressources commenceront à se tarir. Comment les Etats réussiront-ils à négocier cette transition ? b) La perspective préoccupante de l'après-pétrole L'Algérie et le Gabon offrent deux exemples intéressants pour étudier la manière dont on peut envisager l'après-pétrole. · L'Algérie L'une des principales questions évoquées lors de la visite du Rapporteur à Alger fut celle des ressources en hydrocarbures de l'Algérie qui produit aujourd'hui : 1,4 million de barils/jour de pétrole en 2006 et près de 150 milliards de m3 de gaz par an. L'Algérie se situe, dans le monde, au troisième rang des exportateurs de gaz après la Russie et le Canada. Ce producteur présente une particularité ; il produit presque autant de GNL que de gaz « gazeux » (57 % pour le second contre 47 % pour le premier). Pour le pétrole, on estime que l'Algérie dispose de dix à quinze années de réserves avérées ; pour le gaz, de vingt-cinq à trente ans (4 550 milliards de m3 contre 48 000 milliards en Russie ou 27 000 en Iran). Les Algériens sont conscients de cette disparition annoncée de leur principale ressource économique. On a toutefois le sentiment, sur place, qu'ils se préparent assez confusément à cette issue, sans stratégie très claire. Pour l'heure, les recettes importantes tirées de la vente des hydrocarbures servent, outre le financement de l'Etat, à créer des infrastructures comme des routes ou des bâtiments - souvent construits d'ailleurs par des sociétés chinoises - ou à régler la dette extérieure de l'Algérie. Ainsi, la dette contractée par l'Algérie à l'égard de ses créanciers privés va être totalement remboursée prochainement dans le cadre d'un accord au sein du Club de Londres. Plusieurs personnes entendues lors de cette Mission se sont interrogées sur le rendement économique de l'utilisation ainsi faite des recettes pétrolières et gazières. L'après-pétrole et gaz ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. L'Algérie dispose de peu d'industries rentables ; le tourisme ne décolle pas ; l'agriculture ne saurait seule suffire pour assurer une vie convenable à 34 millions d'Algériens aujourd'hui et 50 millions en 2025. On pourrait évoquer la création du fonds pour les générations futures qui représente aujourd'hui 30 milliards de dollars. Mais cette somme importante est placée sur des produits financiers à très faible rendement et l'Etat envisage de ponctionner ce fonds pour financer de nouvelles infrastructures lourdes. Sur le plan énergétique, il faut être conscient que l'Algérie risque d'ici dix ans de devoir exporter du gaz pour pouvoir importer le pétrole dont elle manquera désormais. Ajoutons qu'aujourd'hui, elle importe des produits raffinés faute de disposer d'installation permettant, par exemple, de produire suffisamment de diesel, alors que le parc automobile s'accroît à grande vitesse. · Le Gabon Lors de tous les entretiens qu'a pu avoir au Gabon notre collègue Henri Sicre, la question des réserves en hydrocarbures a également été posée continuellement. Les responsables gabonais ne semblent pas inquiets outre mesure de cette perspective d'assèchement des puits. Le ministre de l'énergie parle ainsi du Gabon comme d'une « ancienne province pétrolière mais qui a de l'avenir » ; il a fait état notamment de la faible superficie du territoire gabonais exploré ou exploité. Pourtant, de 18 millions de tonnes produites en 1997, on est passé à un peu plus de 13 millions de tonnes, un palier étant atteint aujourd'hui dans la production pétrolière. Avec 265 000 barils par jour, le Gabon est le trente-huitième producteur de pétrole au monde. Dans la région, le Nigeria produit plus de 125 millions de tonnes, l'Angola 61 millions de tonnes et la Guinée équatoriale, près de 18 millions. Les dirigeants gabonais espèrent vivement que de nouveaux gisements vont être mis au jour, notamment dans ce que l'on appelle le offshore profond. Toutefois cet espoir n'est pas partagé par les professionnels rencontrés, qui estiment que le Gabon n'a pas le même potentiel géologique que ses voisins angolais, nigérians ou même équato-guinéens ou congolais. Le Gabon souffre en tout cas d'une absence assez criante de diversification économique, qui est propre à toutes les économies pouvant compter sur de telles ressources en hydrocarbures. L'exploitation de la forêt est le deuxième secteur économique. Quelques projets dans l'écotourisme sont envisagés, mais sans que cela puisse être une alternative au pétrole. Ce sont encore les matières premières (minerais, manganèse, fer, uranium ...) qui semblent la solution la plus prometteuse. On peut se demander si l'après-pétrole est préparé de manière très active au Gabon, en raison d'un optimisme officiel qui est de mise dans cet Etat qui a bien vécu du pétrole pendant des décennies. Il faut espérer pour ce pays que ces espoirs seront réalisés, mais on peut aussi légitimement s'interroger sur les risques de tensions sociales et politiques le jour où ses ressources en hydrocarbures s'épuiseront. Ces risques ne sont pas immédiats mais ils sont sérieux à l'horizon d'une génération, c'est-à-dire demain. c) Une crise environnementale ? La dégradation de l'environnement en Afrique est un problème global dans lequel les conditions d'exploitation des ressources énergétiques tiennent une place importante (127). La question du delta du Niger est, de loin, la plus préoccupante. On ne compte plus les cas de maladies respiratoires observés dans cette région du Nigeria en raison des cocktails toxiques recrachés par les torchères. Comme le rapportait la presse récemment, pour échapper à la pollution affectant la chaîne alimentaire, des milliers de personnes, qualifiées de « réfugiés écologiques », quittent le cœur du delta pour rejoindre Port Harcourt ou Lagos. Au printemps dernier, une fuite dans un oléoduc aurait répandu plus de 10 000 barils de pétrole dans la nature, polluant les mangroves et les rivières. Les activités de pêche dans le delta sont lourdement affectées par cette situation. Les questions d'environnement sont propres à susciter la mobilisation des populations locales. C'est le cas au Cameroun où l'implantation en 2003 d'un oléoduc qui permet d'évacuer le pétrole tchadien vers le Golfe de Guinée a eu pour conséquence la disparition de sources d'eau indispensables pour les habitants. La Cameroon Oil Transportation Company (Cotco), détenue à 80 % par le consortium exploitant le pétrole tchadien, qui comprend notamment Exxon Mobil, avait bien construit un puits de remplacement mais il ne fonctionna jamais, selon les responsables locaux (128). La construction du tube a fait apparaître un marécage entraînant l'apparition de moustiques et des risques de paludisme. Un récif corallien au large a également été dynamité alors qu'il constituait une réserve en poissons pour les pêcheurs locaux. Le récif artificiel promis par la Cotco n'a toujours pas été construit. La question environnementale se pose enfin avec plus d'acuité encore dans les pays où la production en hydrocarbures est en phase de déclin. Les installations destinées à l'exploitation sont vétustes et ne répondent plus aux normes en matière de protection (129). Là encore, on doit préparer l'avenir et ne pas se contenter des bénéfices présents. L'exploitation des hydrocarbures attise bien souvent les tensions au sein des pays producteurs, même si celles-ci ont des causes multiples et anciennes : tracé des frontières hérité de la période coloniale, rivalités ethniques... Deux pays illustrent parfaitement ce fait : le Nigeria et l'Angola. a) Le Nigeria : comment redistribuer la rente pétrolière pour assurer la stabilité de la fédération ? Pour la Fédération nigériane, l'une des principales difficultés est la redistribution de la manne financière née de la vente des hydrocarbures comme M. Jean-Christophe Victor l'a souligné lors de son audition par la Mission le 14 juin 2006. Alors que l'essentiel des ressources se situe au sud du pays, le pouvoir, dans la Fédération, a longtemps été aux mains de représentants du nord du Nigeria. Depuis 2000, une politique dite de « rattrapage » a été mise en œuvre pour tenter de rééquilibrer la situation mais beaucoup reste à accomplir. Outre l'opposition traditionnelle entre le Nord musulman où douze Etats ont adopté la charia au début des années 2000 et le Sud majoritairement chrétien qui voit émerger une église évangélique de plus en plus présente, on assiste à une montée en puissance des revendications de tous ordres dans le delta du Niger. Sans entrer dans les détails de la situation dans le delta (130), on notera que la lutte entre factions ou gangs rivaux dans cette région conduit à une situation de désordre dont sont victimes, au premier chef, les populations locales mais aussi les compagnies pétrolières occidentales. Courant octobre 2006, des employés expatriés de sous-traitants d'Exxon Mobil ont été enlevés par un groupe qualifié de « séparatiste » par la presse. Le même jour, les troupes nigérianes subissaient de lourdes pertes après un affrontement avec de tels groupes, liés au Mouvement d'émancipation du delta du Niger, qui se pose en défenseur de l'ethnie Ijaw, forte de 14 millions de personnes et majoritaire dans la région du delta. Ces mouvements séparatistes sont divers, souvent aussi proches de la délinquance organisée et armée que de la revendication politique. Le pétrole exploité dans le delta est l'enjeu de ces luttes, qui font du Nigeria l'un des pays les plus dangereux du continent (131). Le spectre de l'éclatement de la Fédération est évoqué bien souvent. Certains spécialistes relativisent ce risque mais le Nigeria n'est pas à l'abri de troubles très graves à l'avenir. L'Angola a la particularité d'être un pays géographiquement séparé en deux. Le Cabinda est la province la plus septentrionale d'Angola ; elle en est séparée par une étroite bande de terre qui constitue l'accès à la mer de la République démocratique du Congo. Or le Cabinda, petit territoire de 7 200 km2, enclavé entre la République démocratique du Congo et le Congo, produit plus du tiers du pétrole congolais ; c'est là que, dans les années soixante, l'exploitation du pétrole a débuté. Ce territoire a des velléités d'indépendance et le Front de libération de l'enclave de Cabinda (FLEC) n'a pas déposé les armes. D'ailleurs, l'Organisation de l'unité africaine l'a classé, en 1964, comme un Etat à décoloniser distinctement de l'Angola. Même si le FLEC dispose de peu de moyens, il pratique le harcèlement des forces gouvernementales sans s'en prendre cependant aux intérêts pétroliers, ce qui n'empêche nullement les expatriés américains et français de Chevron et Texaco de résider dans la cité pétrolière de Malongo qui, selon les termes de M. Sébille-Lopez, constitue « une enclave dans l'enclave ». On pourrait évoquer d'autres pays où le pétrole constitue un enjeu interne important : le Tchad ou le Soudan, où la question de la sécession sudiste ou le problème du Darfour ne sont pas sans lien avec les ressources en hydrocarbures, même si les clivages religieux pèsent beaucoup. Pour réduire ces situations conflictuelles, une meilleure redistribution des recettes pétrolières est un préalable. Est-elle possible sans une plus grande transparence ? 3) La transparence financière comme solution ? a) L'opacité, à l'origine de bien des maux On doit malheureusement constater que les revenus considérables tirés du pétrole n'ont pas assuré le développement des pays africains producteurs d'hydrocarbures. Le gaspillage, les détournements, les conséquences négatives de l'effet de rente ont maintenu ces sociétés dans une grande précarité. Si l'Afrique n'a pas le monopole de ces dérives, elle en souffre plus encore que les autres régions en raison de son retard considérable en matière de développement. Aujourd'hui les bailleurs de fonds, les ONG, bon nombre d'Africains eux-mêmes sont convaincus que l'amélioration de la situation passe par la réduction de l'opacité qui caractérise les circuits financiers de l'or noir. Des pays comme le Nigeria ou l'Angola sont souvent montrés du doigt. L'ONG britannique Global Witness a estimé qu'entre 1997 et 2001, 8,5 milliards de dollars de recettes pétrolières s'étaient évaporés sans laisser de trace en Angola. Le Fonds monétaire international avait, pour sa part, évalué à 1 milliard de dollars le montant disparaissant chaque année dans ce même pays. La situation paraît inacceptable quand on sait que 70 % de la population angolaise est dans la plus extrême pauvreté et que ce pays est classé 160e sur 177 en termes d'indice de développement humain. Les ONG s'engagent en faveur de cette transparence financière. En France, elles se sont regroupées au sein de la plate-forme « Publiez ce que vous payez », qui a lancé une campagne en vue de convaincre les industries pétrolières mais aussi minières à publier tous les revenus qu'elles versent aux Etats dans lesquelles elles ont des activités. b) L'Initiative de transparence des industries extractives lancée par M. Tony Blair Le Premier Ministre britannique, M. Tony Blair, a lancé, en 2002, lors du Sommet mondial sur le développement durable à Johannesburg, l'Initiative de transparence des industries extractives (ITIE ou Extractive Industry Transparency Initiative, EITI) (132). La Banque mondiale a rapidement soutenu ce projet et l'adhésion à cette initiative est devenue une condition, certes informelle, que les créanciers occidentaux consentent des réductions de dette. Dès lors, le Nigeria, le Congo, le Gabon, le Cameroun et le Tchad se sont déclarés prêts à respecter les conditions imposées par cette initiative. Ainsi le Congo a mis en ligne des centaines de pages faisant le point sur les différents contrats pétroliers. Certaines ONG demeurent sceptiques en constatant que les données délivrées de la sorte sont difficilement exploitables et n'offrent qu'une vue partielle des circuits financiers en cause. Mais les organisations financières internationales ne semblent pas partager ces doutes, puisque le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont reconnu en mars 2006 l'intérêt de cette démarche congolaise et, dès lors, le droit de bénéficier d'une remise de dette. On constate aussi des progrès en Angola, où le Fonds monétaire international a observé une plus grande transparence en 2005 sur les contrats pétroliers. Des avancées sont donc possibles si certains Etats, comme la Chine, ne viennent pas fausser l'effort de la communauté et des institutions internationales pour améliorer la transparence et la gouvernance dans ces pays pétroliers. La démocratie est indispensable dans ces Etats, comme partout ailleurs. Mais elle ne devrait pas prendre uniquement la forme d'une compétition électorale qui tourne, pour l'essentiel, dans ces régions pauvres, à du clientélisme (133). La démocratie, c'est aussi l'organisation de contrepouvoirs et la mise en place d'instances de régulation qui imposent aux institutions une plus grande transparence dans leur fonctionnement. Cet effort de démocratisation doit être soutenu par la communauté internationale. La gestion des matières premières et des revenus tirés de leur exploitation ne pourra qu'en être améliorée. c) L'engagement français en faveur de la transparence Les autorités françaises considèrent que la transparence est un élément central du renforcement de la sécurité énergétique globale. C'est pourquoi elles font la promotion de toutes les initiatives en faveur de la transparence dans les enceintes internationales qui s'y prêtent. Notre pays s'est engagé en faveur de l'initiative de M. Tony Blair, dont les principes ont été endossés lors du Sommet du G8 à Evian sous présidence française. La France a aussi pesé fortement pour que les Etats exportateurs de pétrole mais aussi de minerais adhèrent à l'ITIE, en particulier dans la zone franc. L'intérêt de l'initiative et les modalités d'adhésion ont ainsi été présentés aux ministres des finances de la zone franc le 23 septembre 2004 et de nombreuses démarches ont été engagées par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministère des Affaires étrangères pour favoriser leur adhésion à l'initiative. Depuis lors, la majorité des Etats de la zone franc éligibles (134) a adhéré officiellement à l'initiative. La France a annoncé une contribution de 500 000 euros pour financer l'ITIE. Elle rejoindra alors le Royaume-Uni, la Norvège, les Pays-Bas et l'Allemagne parmi les bailleurs de l'ITIE. Notre pays est également présent, avec les autres Etats donateurs, au sein de l'enceinte décisionnelle de l'ITIE, l'International Advisory Group (IAG), aux côtés des Etats et des compagnies privées mettant en œuvre l'initiative. Elle y est représentée par l'ambassadeur en mission chargé de la lutte contre la criminalité organisée. La question de la gouvernance est donc aujourd'hui l'un des grands thèmes de la politique d'aide au développement des pays occidentaux. C'est un progrès, mais il faut demeurer prudent sur les effets de cette politique, désormais plus exigeante en termes de transparence ; la lutte contre la corruption est l'une des plus difficiles à mener. *** La question de la gestion des revenus du pétrole n'est pas aujourd'hui résolue en Afrique, comme dans d'autres parties du monde. Exprimant une préférence très nette pour le présent, les Etats africains ne semblent pas non plus avoir tous pris la mesure des risques sérieux de crise qui surgiront lorsque les réserves en hydrocarbures s'amenuiseront. A l'horizon de vingt, trente ou quarante ans, comment le continent aura-t-il négocié l'après-pétrole ? Nul ne le sait. Mais il est certain que le pétrole, que ce soit dans les pays qui en sont pourvus en abondance ou qui, au contraire, en sont démunis, peut être un facteur de crise interne aux pays africains. De telles crises peuvent aussi apparaître cette fois entre les pays africains même si on peut observer que la question de l'énergie suscite des solidarités nouvelles entre Etats. C - L'énergie : pomme de discorde ou facteur de coopération entre pays africains ? 1) L'énergie comme source de conflits de souveraineté : une menace ? Les tensions se manifestent notamment par des litiges territoriaux qui mettent en jeu des questions habituelles de souveraineté et de susceptibilité nationales mais aussi des intérêts économiques. Les exemples sont nombreux ; on en évoquera deux. a) L'îlot de Mbanié entre Gabon et Guinée équatoriale Comme cela a été souligné lors de la mission de M. Henri Sicre au Gabon, ce pays et son voisin équato-guinéen se disputent un îlot désert - Mbanié - mais qui pourrait permettre à l'un des deux protagonistes d'étendre son domaine maritime dans des zones à fort potentiel en hydrocarbures. Les négociations n'aboutissent pas et certains interlocuteurs gabonais n'ont pas fait mystère de leur circonspection à l'égard des positions de leur voisin mais aussi de leur détermination. b) Le Nigeria, des velléités hégémoniques ? En 1993, le Nigeria a envahi la presqu'île de Bakassi située sur le territoire camerounais. La question a été portée devant la Cour internationale de justice, qui a ordonné sa restitution en octobre 2002. Cette invasion militaire montre les ambitions du Nigeria qui entend bien qu'on reconnaisse son rôle dans le Golfe. La condamnation par la Cour de la Haye a néanmoins convaincu les autorités nigérianes de l'intérêt d'user d'autres moyens ; ainsi le Nigeria a préféré négocier, mais avec une force de conviction proportionnelle à sa puissance économique et militaire, avec le petit Etat de Sao Tomé et Principe en obtenant 60 % de la production pétrolière tirée d'une zone maritime contestée entre les deux pays. Cet accord a été jugé extrêmement favorable au Nigeria. On pourrait aussi, à ce stade, évoquer les relations tendues entre le Tchad et le Soudan. Il ne faudrait pas cependant donner à ces quelques exemples plus de signification qu'ils n'en ont. Au regard des enjeux économiques et de la pauvreté de la plupart de ces pays, on doit constater que les conflits interétatiques ne sont pas l'hypothèse la plus probable à moyen terme. 2) L'énergie comme futur moteur de la coopération Le continent africain regorge de structures de coopération entre les Etats. Pour la question qui nous concerne, l'énergie, deux organisations semblent particulièrement intéressantes et témoignent de la volonté des Etats africains de créer, si ce n'est de réels liens de solidarité - les rivalités peuvent exister, on l'a vu - tout du moins des instances de concertation à même d'éviter des situations de crises. a) La Commission africaine de l'énergie La première d'entre elles est la Commission africaine de l'énergie. Cet organisme est né de la prise de conscience en 1980 par plusieurs Etats africains de la situation énergétique préoccupante du continent lors d'une conférence à Lagos. Est né alors le projet de créer une Commission africaine de l'énergie. Ce projet soutenu par le PNUD a abouti en 2001 à l'adoption à Lusaka en Zambie d'une convention créant cette commission (135). Cet organe (136) sera chargé de l'élaboration des politiques, des stratégies et des plans de développement de l'énergie sur la base des priorités de développement sous-régional, régional et continental ; il devra notamment indiquer les voies et moyens de leur mise en œuvre. Il aura pour mission de concevoir, élaborer et actualiser une banque de données continentale dans le domaine de l'énergie et de promouvoir la diffusion rapide des informations et de l'échange d'informations entre les Etats membres et les communautés économiques régionales. La Commission aura également pour tâche l'identification, l'élaboration et le lancement de grands projets énergétiques interafricains de coopération, favorisant une intégration sous-régionale, régionale et continentale. L'installation de cette instance constitue l'aboutissement de deux décennies d'efforts et la concrétisation d'un objectif stratégique qui, selon les pays africains, tend à faire du développement énergétique un des facteurs moteurs d'un développement global et durable, susceptible de renforcer l'Union africaine et de faciliter l'adhésion de l'Afrique à l'économie mondiale. Comme le reconnaissent les pays membres, il faut maintenant une volonté politique sans faille de la part de tous les Etats pour permettre à la Commission de jouer tout son rôle. b) La Commission du Golfe de Guinée La Commission du Golfe de Guinée constitue une autre tentative d'installer un outil de coopération qui ne porte pas sur l'énergie mais n'est pas sans lien avec elle. L'intérêt porté par les Etats-Unis à la région du Golfe a convaincu les pays riverains de se rapprocher pour mieux peser face à leurs interlocuteurs. Les Etats-Unis n'ont d'ailleurs pas vu de façon hostile cette tentative de rapprochement qui permettrait, selon eux, de réduire les risques d'instabilité dans la région. Le Gabon, l'Angola, le Congo, La République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Nigeria, Sao Tomé et Principe et le Cameroun ont signé en 1999 un accord visant à créer une Commission du Golfe de Guinée qui aura pour objet de renforcer la coopération de ces Etats pour les questions d'intérêt régional, notamment l'accès aux ressources en hydrocarbures. La mise en place de cette institution s'est accélérée depuis quelques mois avec un accord prévoyant son siège à Luanda et la répartition des postes entre les différents pays du Golfe. Il faut attendre pour voir ce que sera cette institution ; l'Afrique ne manque pas de tels organismes de coopération dans le centre du continent, comme la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) ou la CEEAC (Communauté économique des Etats d'Afrique centrale). Leur efficacité reste aujourd'hui à démontrer. On peut se réjouir cependant d'ores et déjà que les pays de la sous-région aient pris conscience de la nécessité de créer une instance de concertation pour prévenir les crises éventuelles. c) Coopération et interconnexions La construction d'oléoducs ou de gazoducs en Afrique peut aussi être un moteur puissant de rapprochement entre les pays, dont la solidarité est alors matérialisée par ces tubes. Cet aspect a été souligné par les autorités nigérianes dans la contribution qu'elles ont apportée à nos travaux, insistant sur le projet de gazoduc reliant leur pays au Bénin, au Togo et au Ghana. On pourrait également évoquer le Nigal, ce tube gazier entre le Nigeria et l'Algérie, dont le projet est soutenu activement par les autorités algériennes. Toutefois, comme le souligne la réponse des autorités du Congo au questionnaire qui leur a été adressé par MM. Jacques Godfrain et Henri Sicre, ces liaisons peuvent aussi induire pressions, marchandages, et conflits potentiels. D - Le « Grand jeu » en Afrique ou le retour des puissances Comme le soulignait un dossier récent du quotidien Les Echos : « La boulimie énergétique des Etats-Unis et des pays asiatiques, Chine et Inde en tête, a replacé l'Afrique au cœur de la grande bataille pour le contrôle des ressources pétrolières » (137). Aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne, on voit poindre une concurrence intense entre les Etats-Unis et la Chine. Le continent africain semble ainsi, dans le monde, le champ privilégié où se rencontrent les ambitions des deux puissances. De quelle nature est cette concurrence ? Pourrait-elle conduire un jour à des affrontements directs ou indirects ? L'Afrique peut-elle tirer profit de cette confrontation ? 1) L'Afrique : une zone d'intérêt vital pour les Etats-Unis Les Etats-Unis ont longtemps délaissé le continent africain, laissant le soin notamment à la France de défendre les intérêts de l'Occident sur ce territoire au moment de la Guerre froide. Après le 11 septembre 2001, la donne a changé, bien que le mouvement débute quelque temps avant. En Afrique, les Etats-Unis poursuivent trois objectifs : la lutte contre le terrorisme, la sécurisation de leurs ressources en énergie, l'aide au développement(138). Les Américains ont trois zones d'attention prioritaire : l'Afrique de l'Est, en raison de l'activité de groupes terroristes liés à Al Qaïda et de ressources stratégiques notamment au Soudan ; la bande sahélienne, pour des raisons similaires ; le golfe de Guinée, zone stratégique d'approvisionnement pétrolier. Ces priorités sont servies, sur le plan politique, par des rencontres bilatérales ciblées, comme la visite du Président Georges W. Bush en Afrique en 2003, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Botswana, en Ouganda et au Nigeria, selon une sélection qui tient compte des « bons alliés » et des « bons élèves ». a) Retour sur la genèse d'un intérêt nouveau pour l'Afrique C'est en 2000 que plusieurs compagnies pétrolières, parmi lesquelles les majors ExxonMobil et Chevron Texaco (139), font connaître leur intérêt croissant pour l'Afrique au sous-comité chargé de ce continent à la Chambre des représentants à Washington, à l'occasion d'une réunion consacrée au potentiel énergétique africain. Cette démarche est appuyée par les milieux néo-conservateurs, notamment par un think tank, l'Institute for Advanced Strategic and Political Studies. L'élection de George W. Bush et les attentats de New York de 2001 ont accentué l'intérêt porté au pétrole africain, les milieux dirigeants américains cherchant une solution pour sécuriser leurs approvisionnements en énergie en réduisant leur dépendance à l'égard du Moyen-Orient. C'est alors qu'est mis en place un lobby, l'African Oil Policy Initiative Group, assurant une coordination entre les milieux privés et politiques. C'est aussi à cette époque, en 2002, que fut publié un document intitulé African Oil, A Priority for US National Security and African Development. Depuis 2002, l'intérêt de l'administration Bush pour le pétrole africain n'a pas faibli. En décembre 2005, le ministre de l'énergie, M. Samuel Bodman, a parrainé le Forum sur le gaz et le pétrole africain organisé par le Corporate Council on Africa. Au cours de cette conférence, il a explicité la position américaine, qui entend renforcer ses liens avec le plus de pays africains possibles. Le ministre a réaffirmé le message sur la politique internationale adressé par le Président Georges W. Bush peu de temps après avoir pris ses fonctions. Il avait alors prôné un renforcement des liens entre les pays, la transparence, l'inviolabilité des contrats, la sécurité des biens privés, la protection de la propriété intellectuelle, l'adhésion à des règles bien définies et le respect de la primauté du droit. Pour le ministre de l'énergie : « ce ne sera que lorsque ces piliers seront en place que les sociétés privées (...) seront suffisamment confiantes pour faire les gros investissements qui sont nécessaires pour développer les abondantes ressources que recèlent nombre de pays africains » (140). On voit que les Etats-Unis affichent très clairement leurs intentions, ce qui n'est pas critiquable. Ils entendent cependant fonder leur politique en Afrique sur le respect de certaines règles et valeurs dont on verra qu'elles ne sont pas forcément au cœur des préoccupations de leurs concurrents chinois. Le gouvernement américain entend instituer un jeu « gagnant-gagnant » avec les Africains insistant sur la nécessité de renforcer la transparence, la gouvernance et le développement dans ces pays qui doivent s'ouvrir à l'économie de marché (141). b) Les objectifs américains en matière énergétique Les Etats-Unis portent une attention toute particulière au golfe de Guinée, qui représente aujourd'hui plus de 15 % de leurs approvisionnements en pétrole. A un horizon proche, ils entendraient faire passer ce taux à 25 %. Il est vrai que le pétrole de cette région présente plusieurs avantages pour les Etats-Unis. Sa qualité - il est pauvre en soufre - convient particulièrement au marché américain ; ses zones d'extraction sont relativement proches des lieux de consommation ; sa production offshore rend moins dangereuse son exploitation et permet de rester à l'abri des turbulences locales. Déjà en 2003, les exportations en provenance du Nigeria et de l'Angola vers les Etats-Unis étaient plus importantes que celles venant du Mexique et du Venezuela (142). Les Etats-Unis ont aussi fait des tentatives pour se rapprocher de la Guinée équatoriale du Président Obiang Mbasogo, qui est désormais le troisième producteur de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria et l'Angola, supplantant ainsi le Gabon et le Cameroun. Le golfe de Guinée n'est pas la seule sous-région africaine qui suscite l'intérêt des Américains. On s'aperçoit qu'ils sont présents, par exemple, au Tchad par le biais de leurs grandes compagnies. Pour certains observateurs, celles-ci ont su profiter des incertitudes nées de la restructuration du secteur pétrolier en France et des critiques qui ont été portées notamment contre l'action d'Elf, sur le continent, au cours des décennies précédentes (143). Votre Rapporteur a pu observer lors de sa mission en Algérie que les Etats-Unis y étaient aussi très actifs notamment dans le domaine du parapétrolier ; par exemple, la société Halliburton, dont on connaît les liens avec certains membres de l'administration Bush, a obtenu des contrats de gré à gré pour des montants très importants. Cette bonne entente entre l'Algérie et les Etats-Unis n'est d'ailleurs pas nouvelle ; elle s'est exprimée, aujourd'hui encore, dans la lutte contre le terrorisme. Ces deux pays coopèrent pour réduire les mouvements extrémistes salafistes, qui sont encore présents dans le sud de l'Algérie. c) Une diplomatie active et ciblée L'administration Bush n'a pas ménagé ses efforts pour s'attirer les bonnes grâces des dirigeants africains. Le Président lui-même a multiplié les rencontres. Il s'est rendu en juillet 2003 dans cinq pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Nigeria. Le Secrétaire d'Etat de l'époque, Colin Powell, s'est rendu au Gabon et en Angola en 2002. On constate d'ailleurs que le Président nigérian Olusegun Obasanjo a été l'invité de George W. Bush dans son ranch de Crawford, ce qui est loin d'être anecdotique pour qui sait décrypter la politique étrangère américaine. Les dirigeants africains ne sont pas insensibles à cet intérêt que leur portent les Etats-Unis. Le Président angolais José Eduardo Dos Santos a ainsi fait des déclarations publiques dans lesquelles il affirmait entendre « travailler avec les Etats-Unis pour contribuer à leur sécurité énergétique » (144). Il faut souligner que l'activité intense de la diplomatie américaine s'appuie sur un intérêt très profond de nombreux centres d'études ou de stratégies pour les questions africaines, dont les Européens semblent dépourvus malheureusement. On peut citer, entre autres, l'Africa Center for Strategic Studies qui, financé par le Pentagone, a organisé en 2004 à Abuja au Nigeria un séminaire réunissant des experts de la sécurité, des militaires et des représentants des autorités de plusieurs pays africains. d) Les compagnies pétrolières comme fer de lance On connaît les liens étroits qui unissent certains membres du gouvernement américain et l'industrie du pétrole. Ainsi Condoleezza Rice, l'actuelle Secrétaire d'Etat, occupait des fonctions dirigeantes chez ChevronTexaco avant l'avènement du Président Georges W. Bush. Sans sombrer dans la thèse d'un complot des « forces de l'argent » prêtes à « piller » le sous-sol africain, il faut insister sur la place déterminante des compagnies privées dans la stratégie américaine en Afrique. Comme l'a affirmé le ministre de l'énergie américain dans le discours précité, l'objectif est bien de permettre aux grandes compagnies d'asseoir leur présence sur le continent africain, pour valoriser ses ressources au profit des Etats-Unis mais aussi des pays producteurs, en assurant à ces sociétés l'environnement politique, économique, social et juridique le plus sûr possible, condition essentielle pour qu'elles consentent à engager les investissements massifs qu'imposent l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Ces investissements colossaux que les pays producteurs seraient bien incapables d'engager, les compagnies américaines y consentent. Ainsi de 1998 à 2003, ChevronTexaco aurait, selon ses dires, consacré 5 milliards de dollars à l'Afrique et aurait prévu 20 milliards pour les cinq années suivantes. En Angola, ChevronTexaco supervise 75 % de la production pétrolière. Les pétroliers américains - tant ExxonMobil et ChevronTexaco que les plus discrets Amerada Hess, Marathon ou Ocean Energy - ont investi en 2003 plus de 10 milliards de dollars dans la région du golfe de Guinée. Cet engagement des grandes compagnies a eu une conséquence simple : la majeure partie des réserves découvertes aujourd'hui dans le monde le sont en Afrique (145). e) La nécessité de stabiliser et de sécuriser l'Afrique La présence directe des forces américaines en Afrique est encore assez limitée. Les Etats-Unis ne disposent que d'une base permanente sur le continent : la « Combined Joint Task Force for Horn of Africa » basée à Djibouti, qui mobilise 1 300 personnes. Toutefois, la coopération militaire se fait plus intense dans cette sous-région, notamment à Djibouti, au Kenya et en Ethiopie. Parallèlement, en Afrique de l'Ouest, des actions de renforcement des capacités de maintien de la paix à destination notamment des forces terrestres sont menées par les Etats-Unis : avec le Sénégal, le Ghana, le Bénin, le Botswana et l'Afrique du Sud. Dans le domaine de la lutte antiterroriste, le programme « Trans Saharian Counter Terrorism Initiative » (TSCTI), approuvé par le Président Goerges W. Bush en mars 2005, porte sur neuf pays africains (Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Nigeria) pour un budget 2005 de 16 millions de dollars qui pourrait monter jusqu'à 100 millions de dollars. Dans le cadre de la TSCTI, un millier de soldats américains, dont 700 membres des forces spéciales, entraînant 3 000 soldats africains à des opérations de contrôle de zone et d'interception, ont été déployés pour un exercice en juin 2005. On a beaucoup glosé sur l'installation d'une base américaine à Sao Tomé et Principe après l'annonce faite par le Président Georges W. Bush lors de son passage dans la région en juillet 2003. Il est vrai que ce pays s'est retrouvé tout à coup au cœur du dispositif stratégique de la plus grande des puissances. Il faut cependant ramener à une juste proportion cette décision. D'après les informations qui ont pu être recueillies lors du déplacement de notre collègue Henri Sicre au Gabon, il s'agit pour les Etats-Unis d'aménager un port qui soit en mesure d'accueillir leurs navires de guerre et non d'installer une base permanente. Ce n'en est pas moins significatif de la priorité que le gouvernement américain entend donner à cette région. En 2002, le commandant en chef adjoint des forces américaines en Europe, le général Fulford, s'est rendu à Sao Tomé et Principe. En 2004, c'est le général Wald, commandant adjoint de l'Eucom (146) qui effectuait une tournée dans la région, passant notamment par le Gabon. Ces visites manifestent clairement l'attention portée par les Etats-Unis à la question de la sécurité dans le Golfe de Guinée. Cette politique de coopération avec les pays de la région est également très active avec les Etats de l'Afrique du Nord ou du pourtour saharien, l'objectif essentiel étant de lutter contre les menées terroristes (147). La stabilisation du continent ne passe pas seulement par le déploiement de forces armées ; elle suppose aussi une progression du développement économique. Les Etats-Unis s'engagent de plus en plus en faveur de l'Afrique, tant le gouvernement que les organisations privées. L'aide bilatérale des Etats-Unis à l'Afrique subsaharienne a été multipliée par 2,8 entre 2000 et 2004 ; l'aide totale a, elle, été multipliée par 2,3 en quatre ans. Il est vrai que la majeure partie de cette augmentation (environ 56 %) était constituée d'aide d'urgence, plutôt que d'aide « durable » au développement. Avec 3,4 milliards de dollars en 2004 (contre 2,6 milliards de dollars pour la France (148)), les Etats-Unis sont devenus les premiers fournisseurs d'aide bilatérale à l'Afrique subsaharienne. Cette aide représentait, en 2004, 21,6 % de l'aide publique au développement américaine totale (contre 53,2 % pour la France). Le Président américain a, par ailleurs, annoncé en juin 2005 que son pays allait doubler son aide à l'Afrique d'ici 2010. Les Américains mènent donc une politique active en Afrique. Il serait cependant erroné de croire que leur puissance diplomatique, militaire et financière puisse suffire à leur assurer un leadership sur ce continent. Ils doivent compter avec la concurrence de la Chine qui s'implante tous azimuts en Afrique, avec une nette prédilection, qui n'est pas exclusive, pour les pays en rupture de ban comme le Soudan. 2) La Chine et l'Afrique : la rencontre d'intérêts mutuels La présence de la Chine en Afrique se fait chaque jour plus forte. On ne compte plus les visites de dignitaires chinois sur ce continent et les entreprises de la République populaire remportent marchés sur marchés dans tous les secteurs. Cette situation est à l'image du dynamisme de la Chine dont l'Occident prend maintenant conscience avec une certaine inquiétude. Pour ce pays, l'Afrique constitue un nouveau territoire à conquérir par ces moyens efficaces et pacifiques que sont le commerce et les investissements. a) Une conquête pacifique par la diplomatie et le commerce On aurait tort de croire que l'intérêt de la Chine pour l'Afrique est récent. Son ampleur nouvelle nous frappe, mais ce pays s'est depuis longtemps intéressé au continent. Pendant la Guerre froide, il vendait des armes et soutenait les pays ou les mouvements qui lui étaient proches idéologiquement. Toutefois ce sont bien les années 1990 et surtout 2000 qui ont marqué une explosion des relations sino-africaines. C'est à cette époque que s'est tenu pour la première fois le forum Chine-Afrique, réunissant des chefs d'Etat et des entrepreneurs, avec pour objectif de « combattre ensemble l'hégémonisme et la domination occidentale » et d'« établir un nouvel ordre mondial ». Lors du deuxième forum, qui s'est tenu à Addis Abeba en 2003, 250 accords d'assistance économique et 20 sur la protection des investissements ont été signés. Le 12 janvier 2006, Pékin a publié son Livre blanc sur la politique africaine de la Chine (149). Ce document entend présenter au monde les principes de la diplomatie chinoise en Afrique ; il s'agit principalement de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, ceux-ci devant, en contrepartie, reconnaître uniquement la Chine populaire et mettre fin à leurs relations avec Taiwan (150). Ce texte marque la volonté chinoise de maintenir un dialogue régulier et à haut niveau par des visites fréquentes, de développer le commerce bilatéral par l'exemption de droits de douane au profit des pays africains, de renforcer les échanges militaires, de privilégier le cadre du forum sur la coopération sino-africaine, de rééquilibrer globalement les relations au profit des Etats d'Afrique. Si ce Livre blanc s'apparente plus à une liste de grands principes qu'à un programme concret, il n'en est pas moins emblématique de l'engagement chinois sur ce continent. Un quotidien titrait au printemps 2006 : « La Chine fait son marché en Afrique » (151), à l'occasion de la tournée sur le continent du Président chinois Hu Jintao, la seconde en l'espace de deux ans. Il est vrai que la politique de la Chine en Afrique est fondée notamment sur des investissements massifs rendus possibles par les formidables réserves de change dont dispose ce pays grâce à sa croissance économique. Les compagnies chinoises adossées à l'Etat n'hésitent pas à proposer à leurs clients africains des prêts à taux réduits (152) ou la construction d'infrastructures imposantes. Notre collègue Henri Sicre a pu l'observer au Gabon, où la Chine vient de se voir attribuer une concession pour exploiter une mine de fer au nord du pays, après avoir supplanté un concurrent brésilien. Le projet chinois prévoit non seulement l'exploitation de ladite mine mais aussi la construction d'un port minéralier non loin de Libreville, d'une route pour acheminer le minerai et d'un barrage hydroélectrique. On voit mal le Gabon refuser la livraison de tels équipements clés en main. Plus largement, la Chine déploie une activité tous azimuts dans l'exploitation des matières premières, par exemple dans le domaine forestier au Gabon, où 60 % des exportations sont destinées à l'Asie mais aussi au Congo. Elle est également très active dans le secteur du bâtiment, comme le montre la construction massive de logements en Algérie ou du nouvel aéroport Boumediene inauguré en juillet 2006 mais aussi de bâtiments officiels en Guinée équatoriale ou au Gabon ou encore de l'aéroport de Luanda, aux termes d'un marché passé en toute discrétion par les autorités angolaises, sans aucun appel d'offres. Des sociétés chinoises s'aventurent aussi avec succès dans le domaine des télécommunications, comme l'illustre le succès de Zhongxing Telecom à Djibouti. Ce déploiement d'énergie se mesure en chiffres : en 2004, les exportations de la Chine vers l'Afrique ont augmenté de 36 % pour un montant de 13,6 milliards de dollars et les importations de 81 % pour 15,6 milliards de dollars. En 2004, la Chine est devenue le deuxième fournisseur de l'Afrique subsaharienne avec 9,4 % de part de marché derrière l'Allemagne (9,8 %) et devant la France (8,7 %). Dans le domaine pétrolier, cet activisme forcené est spectaculaire. La Chine est par exemple le troisième client du Gabon après les Etats-Unis et la France. Lors de la venue du Président Hu Jintao, en 2004, la Société générale de l'industrie pétrochimique de Chine (SINOPEC) a signé un protocole d'accord avec le Ministre gabonais des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques. La Chine absorbe le quart de la production nigériane en concurrence directe avec l'Amérique qui en consomme la moitié. Alors que le pétrole nigérian était le monopole des grandes compagnies occidentales il y a peu encore, la Chine a réussi à s'implanter dans ce pays au prix d'une intense et habile activité diplomatique, en soutenant notamment la nécessité d'ouvrir le Conseil de sécurité de l'ONU à l'Afrique, l'un des projets du Président nigérian Olusegun Obasanjo. La Chine a obtenu des permis d'exploitation importants dans le delta du Niger en échange d'un investissement de 4 milliards de dollars dans la raffinerie de Kaduna. Ce pays est également devenu le premier client de l'Angola en 2006, important 456 000 barils par jour, alors même que la Banque mondiale entend limiter les échanges avec cet Etat tant qu'il n'aura pas assuré plus de transparence sur ses revenus tirés des hydrocarbures. Les compagnies chinoises multiplient les prises de participation dans des blocs jusque là chasses gardées des majors occidentales. Ainsi en 2004, la Chine a obtenu, moyennant des aides financières, une participation de 50 % dans un gisement angolais auparavant exploité par Shell. L'Algérie suscite également l'intérêt des Chinois comme nous avons pu le constater sur place avec nos interlocuteurs en septembre 2006. Dès 2003, deux sociétés chinoises ont signé plusieurs contrats importants : un plan d'importation pour 350 millions de dollars, un accord de 31 millions de dollars autorisant les Chinois à prospecter sur les hydrocarbures algériens et un autre de 525 millions de dollars pour l'exploitation du gisement de Zarzaïtine. Nous évoquerons plus loin les relations très étroites que la Chine entretient avec le Soudan. La Chine se fait même courtiser par des pays peu producteurs qui espèrent pouvoir développer leur potentiel en hydrocarbures. C'est le cas, par exemple, de Madagascar qui a proposé, au printemps dernier, par la voix de son Président Marc Ravalomanana, des partenariats à des compagnies chinoises comme la CNOOC. D'ailleurs, la Chine a déjà obtenu des blocs dans ce pays, devenant, par ailleurs, le deuxième investisseur après la France. Cette présence chinoise correspond à une stratégie globale (153) autour d'une idée essentielle : diversifier et accroître les importations de pétrole en assurant la sécurité de ces approvisionnements. b) Une coopération militaire en progression et une aide au développement très intéressée Il est vrai que la sécurisation des approvisionnements est pour la Chine une obsession. En Afrique, elle passe par deux instruments, la politique chinoise ne se distinguant guère sur ce point de celle menée par les Etats-Unis. Il s'agit pour la Chine de renforcer sa coopération militaire avec ses fournisseurs africains mais aussi de leur octroyer des aides financières substantielles pour les aider à se développer. La Chine a conclu un accord militaire avec le Congo prévoyant notamment la formation des troupes congolaises. Elle vend également du matériel militaire à l'Angola, à la République de Centrafrique, au Burkina Faso, au Tchad, au Liberia, à la République démocratique du Congo ou au Sénégal. La Chine entend aussi mener une politique active en matière d'aide au développement comme certains autres pays émergents, le Brésil notamment, qui ont besoin des matières premières africaines. L'instrumentalisation de cette aide est patente. Elle est étroitement liée aux enjeux commerciaux. Au-delà de la sécurisation des approvisionnements énergétiques et en matières premières, il s'agit aussi pour la Chine de trouver dans les pays d'Afrique, en particulier subsaharienne, des débouchés pour les exportations chinoises. On estime aujourd'hui que près de 70 % de l'aide chinoise à l'Afrique est consacrée au financement de biens et services chinois. La République populaire essaie de valoriser une aide limitée mais alternative, et ouvertement présentée comme « désintéressée et non conditionnelle » par rapport aux efforts bien plus conséquents du reste de la communauté internationale. Elle participe également au financement des fonds multilatéraux les plus présents en Afrique ; sa participation au Fonds africain de développement est deux fois supérieure à celle du Fonds asiatique de développement. La Chine utilise en fait des méthodes éprouvées. Les pays occidentaux ont souvent fait l'objet de critiques à ce sujet et ont souvent modifié leurs pratiques, mais il semble que les autorités chinoises ne s'embarrassent guère de scrupules en la matière. c) Une concurrence déloyale, une complaisance coupable Bon nombre de responsables de compagnies pétrolières rencontrés lors de nos différentes missions - nos collègues ont fait le même constat lors de leurs déplacements - ont insisté sur le fait que leurs concurrents chinois ne s'embarrassaient pas des mêmes scrupules qu'eux pour emporter des marchés. Il est vrai que le versement de commissions semble, autant qu'on puisse en juger, monnaie courante. De même, les sociétés chinoises, qu'elles interviennent dans le domaine des hydrocarbures ou dans l'extraction de minerais, ne font guère d'efforts pour respecter l'environnement, alors que les compagnies occidentales s'engagent de plus en plus en ce domaine, sous la pression des ONG et des opinions publiques. Cette concurrence, que l'on pourrait qualifier de déloyale, se double d'une action diplomatique de la Chine sur le continent africain marquée par une certaine complaisance à l'égard des Etats en délicatesse avec la communauté internationale. La Chine applique le principe de « non-ingérence », formule délicate pour signifier que l'on n'exigera pas de ses partenaires qu'ils respectent les droits de l'homme, sujet sur lequel la Chine elle-même n'est pas des plus irréprochables. La présence de la Chine au Soudan est à ce titre exemplaire. Les compagnies occidentales sont quasiment absentes de ce pays. Les découvertes de pétrole au Soudan remontent à 1980, mais quatre ans après cet Etat était inscrit sur la « liste noire » des compagnies, en raison du comportement du gouvernement soudanais mais aussi de l'assassinat de personnels de la société Chevron. Les Asiatiques ont tiré profit de ce retrait occidental. Une « province de l'unité » a été créée ex nihilo au sud du pays par le gouvernement soudanais afin de contrôler au mieux l'exploitation pétrolière à l'abri des menées rebelles et c'est un consortium international qui a obtenu le droit d'exploiter les gisements situés au sud du Soudan, non loin de Fachoda. Baptisé GNPC (Greater Nile Petroleum Corporation), ce consortium était composé à l'origine de sociétés chinoises (CNPC, China National Petroleum Company, premier actionnaire à hauteur de 40 %), malaisienne (Petronas), soudanaise (SUDAPET) et canadienne (Talisman). Cette dernière dut se retirer en 2002 sur pression internationale et fut remplacée par la compagnie d'Etat indienne ONGC Videsh. Cet exemple montre bien que le marché du pétrole, à l'instar de la nature, a horreur du vide et que les principes auxquels adhèrent les compagnies occidentales n'embarrassent pas certains de leurs concurrents. Le Soudan représenterait aujourd'hui 8 % des importations pétrolières de la Chine et la CNPC y a construit un oléoduc de 1 300 km de long destiné à évacuer le pétrole exploité sur le champ de Muglad (154). Aujourd'hui, treize des quinze plus importantes sociétés étrangères qui opèrent au Soudan sont chinoises. Cette présence chinoise au Soudan a des incidences évidentes en termes diplomatiques. Ainsi, à propos du Darfour, en 2004, même si elle s'est finalement abstenue, la Chine a menacé d'user de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher l'adoption de sanctions contre le Soudan, pays où elle a investi massivement ces dernières années. La Chine entretient également de très bonnes relations avec le régime du Président Robert Mugabe au Zimbabwe ou avec l'Angola qui, comme on l'a vu, est dans la ligne de mire de la Banque mondiale. Les déclarations au Nigeria de l'un des gouverneurs de la région du Delta du Niger en réaction aux réticences occidentales concernant des fournitures d'armes après les attaques dont la compagnie anglo-néerlandaise avait été la cible en disent finalement plus que de longs développements : « Si les Britanniques ne veulent pas de notre pétrole, nous le vendrons aux Chinois » (155). A cet égard, on a pu voir apparaître, ça et là, des points de crispation entre les Etats-Unis et la Chine. En voici un exemple. La société PetroChina, filiale de la CNPC, envisagea en 2000 d'entrer en bourse à New York. Les organisations militantes des droits de l'homme dénoncèrent cette opération qui concernait une entreprise soupçonnée de financer des opérations militaires au Soudan contre les séparatistes chrétiens du Sud. Des parlementaires américains emboîtèrent le pas et le gouvernement Clinton prit des mesures mais, après quelques atermoiements, contre les seules entreprises pétrolières soudanaises. PetroChina put entrer en bourse mais pour une valeur moindre cependant que celle escomptée initialement. Si les dirigeants des pays africains voient d'un œil très favorable la Chine leur proposer des investissements massifs sans exiger quoi que ce soit de leur part, si ce n'est l'abandon des relations avec l'autre Chine, la présence chinoise dans les pays africains ne va pas sans heurt cependant. Le fait que les sociétés chinoises n'ont pratiquement pas recours à la main-d'œuvre (156)ou à la sous-traitance locales est, par exemple, critiqué. Mais ces critiques ne vont pas jusqu'à une remise en cause de la présence chinoise sur le continent. *** A la question que nous posions au début de ce chapitre - l'Afrique : un continent enfin stratégique ? - on aura compris que la réponse est nécessairement affirmative. Comme dans de nombreuses autres régions du monde, l'énergie joue aujourd'hui un formidable rôle d'accélérateur. Les grandes puissances s'empressent d'investir les lieux, les pays africains multiplient les accords avec les Etats consommateurs, au rythme des variations du cours du pétrole, les richesses s'accumulent ou, au contraire, les économies s'écroulent, les relations entre les Etats évoluent en fonction des découvertes de gisements qui attisent les convoitises mais suscitent aussi des coopérations. Des trois risques que nous avons identifiés - risque de crise interne aux pays africains, de crises entre pays du continent ou de crises entre puissances - il nous semble que ce dernier, qu'on évoque le plus souvent, n'est pas aujourd'hui le plus inquiétant car la concurrence entre les puissances reste cantonnée, pour l'heure, à une compétition économique dont les compagnies pétrolières sont le fer de lance. De plus, les projets pétroliers qui supposent de colossaux investissements sont de plus en plus l'œuvre de consortiums qui associent des sociétés de plusieurs nationalités ; dès lors une solidarité de fait s'installe. Notre mission en Algérie ainsi que celle de notre collègue Henri Sicre dans le Golfe de Guinée ou les réponses au questionnaire que MM. Henri Sicre et Jacques Godfrain ont adressé à tous les gouvernements africains, laissent apparaître que les risques les plus grands sont ceux qui menacent le cœur même des pays du continent. La question énergétique, que ce soit la répartition actuelle des bénéfices tirés des hydrocarbures ou demain la gestion de l'après-pétrole est de nature à exacerber les tensions et les risques d'éclatement de ces Etats et de ces sociétés. Dès lors, par un effet classique, des crises internationales pourraient survenir, les gouvernements se lançant dans des aventures pour ressouder leur population ou la distraire de ses revendications sociales et politiques. Les grandes puissances pourraient alors jouer leur jeu grâce aux forces qu'elles commencent à implanter timidement aujourd'hui, plus résolument demain. Face à ce danger qui est réel et inquiétant, l'Europe peut jouer son rôle. Les responsables des pays africains qui ont contribué à nos travaux souhaitent vivement que l'aide au développement des pays africains, producteurs ou non, contribue à préparer l'après-pétrole ou à gérer la pénurie actuelle. Cela passe par l'amélioration de la transparence dans l'utilisation des recettes pétrolières, dans le respect de la souveraineté des Etats à laquelle ils sont fort justement attachés. Cela suppose aussi une aide pour construire des réseaux électriques qui permettront de créer de l'activité ainsi que des projets hydroélectriques, une assistance pour l'adoption de normes juridiques et techniques adaptées. Une course contre la montre est lancée : pour cette raison aussi, il faut que l'Afrique se développe vite pour éviter son implosion dans les trois ou quatre décennies qui viennent. Personne n'a intérêt à un tel collapsus, ni les Etats-Unis, ni la Chine, ni l'Europe voisine. C'est sans doute là que réside l'une des principales chances pour l'Afrique, continent redevenu enfin stratégique. les Etats-Unis resteront-ils Repères En 2004, les Etats-Unis étaient le plus gros producteur mondial d'énergie, talonnés par la Chine. Ils occupaient la première place en matière nucléaire, la deuxième pour la production de gaz et de charbon, la troisième pour le pétrole et la quatrième pour la production d'énergie d'origine hydroélectrique. Les Etats-Unis sont le plus gros importateur et le premier pays pour la consommation d'énergie. Ils représentent 4,5 % de la population mondiale, 19 % de la production d'énergie internationale et 25 % de la consommation d'énergie dans le monde. Les Etats-Unis sont une puissance énergétique globale : gros consommateurs, ce sont également de gros producteurs et de gros importateurs d'énergie. Ils sont également une puissance énergétique en mutation. Ainsi, en un demi-siècle, les Etats-Unis sont passés du statut de premier exportateur mondial de pétrole - ils le furent jusqu'en 1948 - à celui d'importateur net. Et, aujourd'hui, même si 41 % de la consommation énergétique totale des Etats-Unis est issue de la production domestique, ce ratio ne cesse de diminuer. Contrairement donc aux Européens qui ont toujours vécu dans l'idée de leur inéluctable dépendance énergétique, ce n'est que récemment et progressivement que les Etats-Unis apprennent à vivre avec cette idée qu'ils devront compter sur d'autres pour leurs approvisionnements énergétiques. La conjonction entre le renouveau du débat énergétique aux Etats-Unis et leur intervention en Irak a contribué à réveiller les fantasmes sur les liens entre la politique énergétique des Etats-Unis dans le monde, notamment en matière pétrolière, et leur action militaire à l'étranger. De fait, les questions énergétiques ont toujours revêtu une dimension stratégique aux Etats-Unis. Ainsi, « les Etats-Unis ont été les premiers à utiliser le pétrole comme une arme au service de leur diplomatie » (157), lorsqu'ils décidèrent, en 1931, à la suite de l'intervention du Japon en Mandchourie, une quarantaine à l'encontre des produits pétroliers à destination du Japon. C'est d'ailleurs la décision américaine d'embargo total des exportations de pétrole vers le Japon, en juin 1941, qui conduira l'Empire du soleil levant à déclencher la guerre contre les Etats-Unis à Pearl Harbour, le 7 décembre 1941. Il faut pourtant sortir de cette image souvent fantasmée de la politique énergétique américaine. D'abord parce qu'il n'est guère étonnant qu'un sujet qui met en jeu la souveraineté et conditionne la prospérité économique occupe une place prééminente dans l'histoire et la pensée américaines. Ensuite parce que s'en tenir à cette vision fantasmée, par trop réductrice, empêche de comprendre la réalité, complexe, de la question énergétique aux Etats-Unis. De fait, celle-ci met en jeu de multiples aspects de la réalité américaine, aussi bien sur le plan institutionnel que dans les domaines politique, militaire, économique et social. Ainsi, les sujets à aborder sont particulièrement nombreux : parler de la politique énergétique des Etats-Unis a-t-il un sens ou serait-il plus juste de parler des politiques énergétiques américaines, au regard des compétences des Etats fédérés en la matière ? S'agissant en revanche de la stratégie énergétique des Etats-Unis au plan international - le pluriel ne semblant pas s'imposer en la matière -, quelle est la vision américaine et son évolution éventuelle ? Enfin, comment les Etats-Unis lient-ils sécurité énergétique et sécurité nationale et qu'en est-il de l'insertion des questions énergétiques dans la politique de défense américaine ? Aucune de ce questions ne se laisse appréhender facilement tant les Etats-Unis se présentent comme une puissance énergétique paradoxale. D'un côté, il s'agit d'une puissance énergétique inconsciente, voire égoïste, qui défend un mode de consommation énergétique extrêmement vorace, au détriment, notamment, des équilibres climatiques. Certes, le climat américain, de même que l'organisation physique de l'espace dans ce pays continent jouent un rôle important dans cette voracité énergétique : les Etats-Unis sont un pays continent, aux contrastes climatiques importants et où les distances sont immenses. Il n'empêche : même si, avec M. Christophe-Alexandre Paillard, responsable du bureau « Prospective technologique et industrielle » à la délégation des affaires stratégiques du ministère de la Défense, auditionné par la mission le 2 mai 2006, nous admettons volontiers qu'« il n'y a pas forcément un complot américain derrière la politique énergétique de ce pays » (158), il n'en reste pas moins que les choix énergétiques de ce pays n'ont pas été faits dans un souci d'économie. Ce modèle est certes en pleine évolution : il faut se souvenir que, dans cet Etat fédéral, il n'existe pas une, mais des politiques énergétiques. Ainsi, le rôle de certains Etats, tels que la Californie notamment, sous l'égide de son gouverneur pourtant républicain, Arnold Schwartzenegger, pourrait enclencher une dynamique vertueuse, alors même que même le Président Georges W. Bush lui-même a dénoncé « l'addiction » de son pays au pétrole. De même, il n'est pas anodin qu'un ancien vice-président et ancien candidat à l'élection présidentielle, Al Gore, se fasse le chantre d'un réexamen de la politique énergétique américaine, au nom de cette « vérité qui dérange » (159) qu'est le changement climatique. Dans le même temps, artisans du marché pétrolier tel qu'il fonctionne actuellement, les Etats-Unis se présentent comme une puissance énergétique magnanime, garante de la fluidité des flux énergétiques internationaux pour l'ensemble de la communauté internationale. Les Américains sont devenus, qu'ils le veuillent ou non, et que nous le voulions ou non, les garants de la sécurité énergétique de la planète parce qu'il en va de la stabilité du monde. Il y a du reste fort à parier que, même en situation d'autosuffisance, les Etats-Unis continueraient donc à s'impliquer dans les questions énergétiques mondiales. En d'autres termes, c'est l'ensemble de la sécurité énergétique internationale qui dépend de l'instrument militaire américain. Dans un monde où s'affirme, notamment dans la plus importante région productrice de pétrole, un très fort sentiment anti-américain, où émerge, en Asie, un nouveau géant énergétique, peu disposé à laisser ses approvisionnements énergétiques dépendre de la marine américaine et où le modèle énergétique interne des Etats-Unis est de plus en plus pointé du doigt pour son caractère insoutenable, à terme, la question se pose : les Etats-Unis peuvent-ils rester le gendarme énergétique du monde ? Les développements qui suivent se fondent en grande partie sur les informations et les éléments recueillis par M. Paul Quilès qui a effectué dans le cadre de la mission d'information un déplacement aux Etats-Unis en juin 2006. A - La politique énergétique américaine : de la voracité à la maturité ? 1) La politique énergétique américaine : préserver l'American way of life Les Etats-Unis sont généralement vus comme une puissance énergétique vorace. C'est en réalité à travers le prisme de leur seule consommation pétrolière que nous jugeons l'ensemble de leur profil énergétique et, de fait, les Etats-Unis sont surreprésentés dans la consommation mondiale de pétrole. Regroupant moins de 5 % de la population mondiale, ils consomment actuellement 25 % du pétrole disponible. Ce jugement, partiellement fondé, est cependant lacunaire. Il conduit notamment à faire oublier que les Etats-Unis présentent un profil énergétique complexe, étant à la fois de gros consommateurs certes, mais également de gros producteurs d'énergie. Ainsi, comme l'a relevé M. Dominique Maillard, Directeur Général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, lors de son audition par la Mission le 21 février dernier, si l'on dresse un tableau des cinq premiers producteurs dans chaque filière d'énergie primaire, le premier trait marquant concerne la présence des Etats-Unis dans toutes les filières. Ainsi, en 2005 (160) : - pour le charbon, les Etats-Unis occupent la deuxième place derrière la Chine ; - en matière pétrolière, ils occupent le troisième rang derrière l'Arabie Saoudite et la Russie ; - ils sont le deuxième producteur de gaz naturel derrière la Russie ; - ils sont de loin les premiers producteurs d'électricité d'origine nucléaire, devant la France ; - enfin, s'agissant de l'hydroélectricité, ils occupent le quatrième rang, derrière la Chine, le Canada et le Brésil. Cette situation, qui faisait des Etats-Unis en 2004 le plus gros producteur d'énergie juste devant la Chine, n'est, il est vrai, pas destinée à perdurer, les Etats-Unis exploitant leurs réserves pétrolières et gazières à un rythme qui diminue très rapidement leurs réserves. Les Etats-Unis vivent ainsi une évolution accélérée de leur paradigme énergétique, qui les fait passer de manière croissante dans le double rôle de principal consommateur et importateur, tandis qu'ils s'apprêtent à céder la place de producteur dominant à la Chine et que leur taux de dépendance énergétique s'accroît. Pour cette raison, ils voient la crise énergétique actuelle comme un problème intérieur majeur avant tout, alors même qu'elle est globale et que, consommant 25 % de l'énergie mondiale alors qu'ils n'en produisent que 19 %, ils ont, à l'évidence, une politique énergétique nationale dont les incidences sont mondiales. Ce qui reste frappant pour l'observateur de la politique énergétique de cet acteur énergétique pourtant global, c'est, en effet, à quel point son approche y reste nationale : l'inquiétude des milieux politiques américains, largement relayée par les médias, tient donc plus à l'évolution plus ou moins prévisible de la seule dépendance en pétrole et en gaz qu'à la situation globale actuelle. C'est de ce point de vue que le Pentagone, le département d'Etat et les spécialistes du sujet dans les think tanks s'inquiètent de la crise systémique des marchés énergétiques mondiaux. Inquiétude d'autant plus renforcée que, puissance énergétique gourmande, les Etats-Unis vont le rester si l'on en croit les perspectives établies tant par l'Agence internationale de l'énergie que par l'administration américaine pour l'information sur l'énergie (Energy Information Administration ou EIA). Comme l'a souligné M. Christophe-Alexandre Paillard lors de son audition, dès 2003, les importations nettes de produits pétroliers (exprimées en volume) avaient déjà dépassé 55 % de la consommation, et les prévisions de l'EIA laissaient prévoir que cette dépendance continuerait à s'aggraver au cours des prochaines décennies. Les dernières analyses publiées en 2006 par l'EIA, qui prennent en compte l'impact de l'accroissement récent du prix des énergies fossiles, sont cependant moins pessimistes. Ainsi, pour 2025, l'EIA prévoit maintenant un niveau d'importation de 60 %. Cependant, de telles évolutions des prévisions, d'une année sur l'autre, ne sont pas forcément pour rassurer les politiques américains qui ont encore en tête le chiffre souvent cité d'une dépendance extérieure en pétrole de 75 % à cet horizon 2025. De fait, la consommation énergétique américaine ne cesse de croître, fortement qui plus est, depuis dix ans. D'ici 2020, la consommation de pétrole, de gaz et d'électricité devrait y croître respectivement de 33 %, 50 % et 45 %. Or, dans la mesure où le gaz naturel et le pétrole sont les deux produits énergétiques que les Etats-Unis vont être conduits à importer de plus en plus du fait de l'épuisement de leurs propres ressources, ces produits occupant d'ores et déjà une place majoritaire dans le bilan énergétique américain - respectivement 40 et 23 % -, les Etats-Unis ne font qu'accroître leur dépendance énergétique. Dépendance vécue sur un mode d'autant plus tragique qu'au même moment où le débat énergétique aux Etats-Unis est dominé par la question de la dépendance, le prix du pétrole, et du gaz par là même, flambe, suscitant un âpre débat de politique intérieure. Il y a plus : dans l'hypothèse d'un baril de pétrole à 60 dollars, les Etats-Unis seront confrontés à une facture d'importation de pétrole de 4 320 milliards de dollars en 2006, ce qui représente une composante très importante du gigantesque déficit commercial américain. En 2005 déjà, la facture énergétique américaine a augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente et a représenté 40 % de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Il faut avoir conscience qu'aux Etats-Unis, cette situation revêt une dimension traumatique puisqu'elle touche au cœur de l'American way of life. Certes, la dépendance pétrolière américaine n'a rien de nouveau, le déficit en pétrole des Etats-Unis existant depuis 1948 et les Etats-Unis important 59 % de leur consommation. De plus, le gaz naturel reste encore très américain (82 % de la consommation), même si on observe une dépendance extérieure en très forte croissance depuis dix ans, 80 % du gaz importé venant du Canada. Enfin, le secteur charbonnier reste encore largement exportateur. Il n'en reste pas moins que les Etats-Unis connaissent une hausse continue de leur dépendance extérieure, étant passés d'un taux de couverture de 150 % de leur consommation énergétique en 1920 à 74 % aujourd'hui. En outre, le pétrole joue un rôle très particulier dans l'histoire, l'économie et la civilisation américaines. Ainsi, historiquement, les Etats-Unis sont à la fois le premier des pays producteurs (1859) et le premier consommateur mondial. De même, pour comprendre le rapport spécifique des Américains aux questions pétrolières, il faut se souvenir du rôle du pétrole dans l'histoire américaine au XXème siècle. Ainsi, comme le rappelle. Christophe-Alexandre Paillard, « durant la Première Guerre mondiale, ils ont été les seuls et uniques pourvoyeurs de carburant pour les armées françaises. Durant la Seconde Guerre mondiale, sans le pétrole américain, il n'y aurait pas eu de victoire alliée. Le pétrole a donc une dimension particulière, notamment liée aux victoires militaires. » (161) En matière économique, les premières entreprises américaines appartiennent au secteur pétrolier (ExxonMobil, ChevronTexaco, ConocoPhillipps...) Plus fondamentalement, la place du pétrole est également largement liée à la structure sociale du pays, et notamment à la faible part des transports publics dans les transports quotidiens. Le modèle social américain contemporain est fondé sur le développement d'immenses conurbations et sur l'utilisation massive de l'automobile. Ce point est essentiel pour comprendre combien toute initiative publique concernant la voiture reste un tabou aux Etats-Unis, comme le montre l'incapacité du Congrès à légiférer pour inciter les constructeurs automobiles à améliorer le standard de consommation kilométrique des véhicules individuels et encore plus celui des « Sport Utility Vehicles » (SUV), ces voitures à quatre roues motrices qui représentaient en 2004 56 % des nouvelles immatriculations sur le marché américain. Quand, en France, le débat porte sur le fait de savoir si elles ont leur place dans les villes, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, elles bénéficient des mêmes exemptions que les véhicules utilitaires... Faut-il ajouter que les Etats-Unis souffrent d'un retard important par rapport à leurs partenaires européens en matière de renforcement des normes de consommation de carburant par les véhicules automobiles ? Tel n'était pourtant pas le cas au lendemain des chocs énergétiques des années 1970. En effet, à l'époque, l'essor aux Etats-Unis de la demande pour des véhicules plus petits et moins gourmands en carburant a constitué une sorte de révolution dans un pays qui avait longtemps privilégié la taille et les performances des voitures au détriment de leur consommation en carburant. Et les Etats-Unis précédèrent l'Europe en la matière. Cependant, dès la chute des cours du pétrole, on assista à un mouvement inverse et les nouveaux SUV devinrent omniprésents lors de la période d'essence bon marché qui accompagna la perte d'influence de l'OPEP dans les années 1980 et 1990. L'absence d'une vigoureuse politique gouvernementale pour encourager l'utilisation d'automobiles moins gourmandes en carburant et le sous-financement de l'infrastructure de transports publics dans cet immense pays ont rendu les Etats-Unis vulnérables aux augmentations des prix mondiaux de l'énergie. Aujourd'hui, cette politique a pour résultat un marché de l'automobile sinistré, les constructeurs d'automobiles américains, attirés par les ventes très profitables de SUV, ne s'étant guère préparés à des solutions alternatives, tout en s'opposant résolument à l'adoption de normes plus sévères d'efficacité énergétique. De sorte que c'est une société japonaise qui rafle le marché des véhicules hybrides, qui bénéficient d'incitations fiscales. On comprend dès lors la sensibilité des responsables politiques américains à cette dépendance en pétrole : elle est d'autant plus importante que sur les 20 millions de barils/jour que consomment les Américains, 13 millions sont consacrés au seul secteur du transport, dont une large partie pour le transport individuel ; quant au transport aérien, il ne représente que 12 % de ce total soit 1,6 million de barils/jour. 2) « Les Etats-Unis sont drogués au pétrole » (George W. Bush) : un modèle en évolution ? La situation est devenue à ce point préoccupante qu'à la surprise générale, le Président George W. Bush, dont nul n'ignore pourtant les liens avec l'industrie pétrolière texane, a prononcé cette phrase très forte dans son discours sur l'état de l'Union du 31 janvier 2006 : « les Etats-Unis sont drogués au pétrole ». Le Président Georges W. Bush serait-il, aux Etats-Unis le fossoyeur de l'American way of life, quand il en aura été un ardent promoteur hors des frontières américaines ? A dire vrai, la réflexion du Président Bush s'inscrit dans un mouvement amorcé dès le tournant de la présente décennie, qui révèle un retour de la réflexion géopolitique en matière énergétique. C'est le vice-Président américain Dick Cheney qui a ouvert le débat en 2001, mettant fin à ce qu'il faut bien appeler, avec le recul, une longue période d'inconscience, voire d'irresponsabilité énergétique. Passé les chocs pétroliers des années 1970, les Américains ont longtemps négligé les problèmes énergétiques : autosuffisants en pétrole il y a trente ans, ils n'ont pas lancé de programmes d'économies d'énergie et en consomment deux fois plus que les Européens, à tel point que 55 % de leur pétrole est importé. Ils ont certes décidé de moins dépendre du Moyen-Orient et ont investi dans des programmes de biocarburants, mais leur prise de conscience de l'ampleur de l'enjeu a été tardive. a) Du rapport Cheney à la loi sur l'énergie de 2005 La stratégie énergétique américaine a été définie dans le rapport du National Energy Policy Development Group, rédigé par le vice-président américain en mai 2001. Ce plan national sur l'énergie, dit « plan Cheney », mettait clairement l'accent sur la croissance de la demande en énergie et le problème de sécurité des approvisionnements, soulignant la dépendance stratégique des Etats-Unis vis-à-vis des importations en pétrole. Il s'agit là d'une évolution considérée comme inacceptable du point de vue géopolitique (dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient en particulier) et qui a conduit l'administration Bush à promouvoir une politique tournée vers le développement des capacités nationales de production d'énergie. Cette analyse peut surprendre alors même que le pétrole importé par les Etats-Unis ne vient que pour 15 % au plus du Moyen-Orient. Ainsi, comme le montre la carte ci-dessous, le pétrole consommé par les Etats-Unis vient essentiellement de l'hémisphère nord : il est à 41 % domestique, 9 % venant du Canada, 8 % de l'Arabie Saoudite et du Venezuela, 7 % du Mexique et 5 % du Nigeria. Au total, plus des deux tiers du pétrole consommé par les Etats-Unis viennent du continent américain et entre 12 % et 15 % seulement viennent du Moyen-Orient, selon les années. La carte ci-dessous présente l'origine géographique du pétrole importé par les Etats-Unis en 2004. 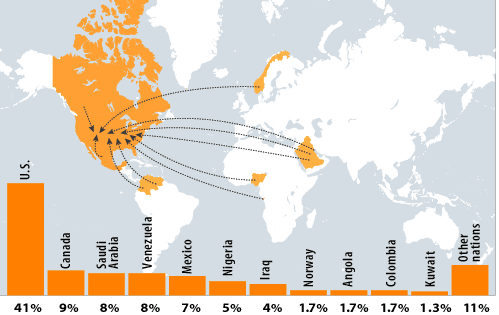 S'agissant de la production d'électricité, le plan « Cheney » s'inscrivait dans la continuité en prévoyant que la majorité des nouvelles capacités électriques nécessaires pour soutenir la croissance (400 GWe en vingt ans) serait fournie par de nouvelles unités de production de type cycle combiné au gaz naturel. Cette stratégie s'est cependant révélée calamiteuse au cours des années récentes, conduisant de surcroît à une dépendance gazière. Comme l'a expliqué M. Régis Babinet, conseiller nucléaire à l'ambassade de France à Washington, au Président de la mission, le 18 juin dernier, à l'occasion du déplacement qu'il fit aux Etats-Unis, dans un contexte de dérégulation du marché de l'électricité, les producteurs indépendants se sont effectivement lancés dès la fin des années 1990 dans un programme d'investissement massif. Celui-ci a conduit, sur la seule période 2000-2002, à la construction de plus de 140 GWe d'unités de production à gaz. La production nationale en gaz naturel, malgré des déclarations optimistes du lobby pétrolier à la fin des années 1990, a été incapable de suivre cette croissance, avec pour conséquence une explosion des cours. Alors que la stratégie « tout gaz » de cette fin des années 1990 était fondée sur un prix du gaz de 2,5 dollars par MBtu (162), le prix spot 2005 a été régulièrement au-dessus de 10 dollars par MBtu. Il apparaît aujourd'hui que la demande actuelle ne pourra être satisfaite que par un recours substantiel aux importations de gaz naturel liquéfié, un recours qui accroît la dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient et/ou de la Russie, où sont localisées les principales réserves mondiales en gaz naturel, un recours enfin qui tire les prix vers le haut avec une tendance long terme au dessus de 6 dollars par MBtu. A un tel prix cependant, les centrales à gaz ne peuvent plus fonctionner, le prix du combustible étant la part principale du coût marginal de production pour de telles installations. Les Etats-Unis n'ont donc que deux recours possibles pour alimenter les nouvelles installations : le charbon qui contribue déjà à 50 % de la production électrique et le nucléaire dont la part dans la production a su se maintenir aux environs de 20 %, grâce aux gains de productivité du secteur. C'est ainsi que l'un des principaux moteurs de la dynamique de relance de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis est la peur de la dépendance gazière. Restait à donner une traduction législative aux orientations du rapport Cheney. A cette fin, pendant trois années consécutives, de 2002 à 2004, le Congrès a tenté en vain d'adopter une loi globale sur l'énergie, relais législatif du plan « Cheney » de mai 2001. Ces échecs successifs résultaient en grande partie de l'insistance des Républicains - en particulier à la Chambre des Représentants - à vouloir introduire dans la loi certaines dispositions considérées comme totalement inacceptables par le parti démocrate, notamment l'ouverture à l'exploration pétrolière de la réserve nationale arctique. Faut-il ajouter que le sujet hypersensible que constitue l'énergie pour l'électeur américain n'était guère porteur à l'approche de l'élection présidentielle de 2004 ? Démocrates ou Républicains, les responsables politiques, au moins au niveau fédéral, évitent en effet d'aborder de front un sujet perçu comme touchant aux choix individuels des Américains. Même le très démocrate John Kerry, dans son plan énergie pour la dernière campagne présidentielle, en juillet 2004, commençait par rappeler le droit des Américains à conduire les véhicules de leur choix avant d'inciter à en améliorer le rendement : « Nous estimons que tous les Américains ont le droit de conduire les voitures, les SUV, les minivans et les camions de leur choix, mais que ces véhicules peuvent être plus efficaces, plus sûrs et plus abordables ». Toutefois, face à la montée du prix de l'essence à la pompe qui a atteint localement trois dollars par gallon (163) à la fin du printemps, le Congrès n'a pas pu résister aux appels répétés du Président Georges W. Bush demandant à ce que lui soit présenté un projet de loi pour signature avant la clôture de la session parlementaire. En réalité, cette augmentation à la pompe a servi de catalyseur, car les raisons qui poussent à une redéfinition de la politique énergétique dépassent la seule question des prix du pétrole. Les signaux d'une crise énergétique multiforme se sont, en effet, multipliés au début de la décennie 2000. Notamment, les Etats-Unis ont été à plusieurs reprises confrontés au caractère défectueux ou insuffisant d'une part importante des réseaux électriques, les distributeurs imposant ou subissant des coupures (crise en Californie du printemps 2000, coupure générale dans le Nord-Est du 14 août 2003). Par ailleurs, dans un contexte de fermeture des anciennes raffineries, la capacité de raffinage est tombée en dessous de celle de 1975, ses limites ayant été atteintes en permanence depuis 2000. En outre, la plupart des raffineries américaines sont concentrées sur le golfe du Mexique. Or, s'il y avait quatre ouragans par an dans le golfe dans les années 1950, il y en a douze de nos jours et nul n'oserait prédire que les ouragans Katrina et Rita ont été les « tempêtes du siècle ». C'est dans ce contexte porteur que l'Energy Policy Act, privé des dispositions les plus contestées, a été finalement adopté par les deux chambres du Congrès et signé par le Président Georges W. Bush le 8 août 2005. L'ENERGY POLICY ACT DU 8 AOÛT 2005 Visant à organiser les conditions d'une production qui puisse répondre aux exigences de la consommation à venir, il est axé autour de cinq grandes priorités : - Moderniser les techniques pour économiser l'énergie et favoriser le développement des techniques de protection de l'environnement. Sont par exemple cités la réduction des pertes en énergie des maisons américaines ou l'amélioration de l'efficacité énergétique des biens de consommation. - Réduire le niveau de consommation du gouvernement fédéral, sur la base d'Energy Savings Performance Contract Program. - Améliorer les infrastructures de distribution. - Favoriser la hausse de la production : le texte insiste sur les énergies renouvelables et les biocarburants. - Préserver la sécurité d'approvisionnement par une plus grande diversification des sources. b) Un nouveau réalisme énergétique américain ? Doit-on aujourd'hui conclure à un virage durable de la politique énergétique américaine ? Indéniablement, le rapport Cheney, associé à la loi de 2005, texte fondateur de la nouvelle politique énergétique américaine, marque une certaine prise de conscience par les Etats-Unis de leur dépendance énergétique notamment envers les pays du Golfe. Et le fait que, même après l'adoption de cette loi, le Président Georges W. Bush ait à nouveau annoncé, dans son discours sur l'état de l'Union du 31 janvier 2006, que les Etats-Unis devraient réduire de 75 % leur dépendance énergétique à l'égard du Moyen-Orient dans les vingt prochaines années, montre que ce thème est durablement présent dans la politique américaine. Nul doute non plus que l'échec patent de la politique de l'administration Bush au Proche-Orient qui, non seulement se solde par la détérioration de la situation en Irak, mais également par le renforcement des réseaux terroristes et la paralysie vis-à-vis de l'Iran, n'est pas pour rien dans cette déclaration. A cet égard, on notera que le changement du climat n'est pas apparu jusqu'ici comme un argument important en faveur de l'inflexion de la politique énergétique américaine en général, et en particulier de la relance de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis. N'oublions pas à ce propos que c'est Dick Cheney qui a jusqu'à récemment donné le ton dans la politique énergétique américaine. Or, Dick Cheney est le porte-parole du « réalisme pétrolier » qui domine le mode de pensée américain depuis des années et dont les opinions tendent à décourager la recherche d'alternatives à l'utilisation des hydrocarbures, et même des mesures concertées de préservation de l'environnement. Dick Cheney ne déclarait-il pas ainsi à Toronto, le 30 avril 2001, à des journalistes que « la protection [de l'environnement] est peut-être un signe de vertu personnelle, mais qu'elle ne constitue pas une base suffisante pour une politique énergétique saine et globale » ? Cependant, le public américain dans son ensemble est plutôt convaincu de la thèse du réchauffement climatique, une thèse reprise régulièrement par les médias à propos de la série exceptionnelle d'ouragans qui ont touché les Etats-Unis au cours de cette année 2005. Certains Etats, la Californie en particulier, toujours à l'avant-garde des questions environnementales, mais aussi plusieurs Etats du Nord-Est, ont adopté des mesures législatives ou réglementaires favorisant la limitation des émissions de gaz carbonique. Au niveau fédéral, les positions pourraient donc également être amenées à évoluer. Observons à ce titre que le Président Georges W. Bush QUEL AVENIR POUR L'HYDROGÈNE ? L'administration Bush défend avec insistance l'hydrogène comme solution énergétique à long terme susceptible de faire diminuer la dépendance par rapport au pétrole étranger. Cette voie pourrait être prometteuse, mais il reste à apporter des solutions à de nombreux problèmes. En premier lieu, les coûts d'infrastructure nécessaires pour assurer sa fourniture au niveau national comme carburant pour véhicules sont colossaux et économiquement prohibitifs, compte tenu des prix actuels et de l'état de la technologie. De plus, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie mais un vecteur énergétique, qui permet de stocker ou de transporter de l'énergie. La production de l'hydrogène est un processus gourmand en énergie et ne constitue donc pas, en soi, une panacée au problème de la sécurité énergétique. L'on pourrait même imaginer d'utiliser des carburants fossiles pour produire de l'hydrogène, ce qui irait à l'encontre du but recherché, notamment en terme environnemental. L'hydrogène ne représente donc une solution que couplée à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Par exemple, l'Islande cherche à produire de l'hydrogène par le biais de ses abondantes ressources géothermiques bon marché. Acheminer cette énergie jusqu'à des marchés lointains représente un formidable défi en l'état actuel de la technologie et des infrastructures. Signalons enfin que, pour permettre aux véhicules à pile à combustible de rivaliser avec la fonctionnalité actuelle des moteurs à carburant fossile, il faudra surmonter de sérieux obstacles technologiques. Là encore, aux côtés de la biomasse, deux autres voies sont privilégiées comme sources primaires d'énergie : le charbon, avec la recherche associée sur la séquestration du C02, et le nucléaire dans le cadre des systèmes du futur. Ainsi, en février 2006, les Etats-Unis ont publié l'Advanced Energy Initiative un ensemble de propositions prises en faveur de l'augmentation de 22 % des crédits pour la recherche sur les énergies propres (l'énergie solaire et éolienne, l'éthanol, le développement des voitures hybrides, la lutte contre la pollution des centrales au charbon, productrices de près de 50 % de l'électricité américaine). En dépit de son nom - l'Advanced Energy Initiative -, ce programme en faveur de la mise au point d'énergies alternatives présenté par le Président reste modeste, financé à hauteur d'un milliard de dollars dans le budget 2007, 10 milliards de dollars ayant été dépensés depuis 2001 dans ce secteur. Ces initiatives ne sont, à l'évidence, pas encore suffisantes pour parvenir à l'objectif recherché de réduction de la dépendance vis-à-vis des principaux hydrocarbures. Pas plus que l'administration n'est encore prête à admettre les vertus stratégiques plutôt que personnelles de la préservation de l'environnement. D'autres membres de l'establishment à Washington, notamment le sénateur de l'Indiana, Richard Lugar, se sont cependant désormais ralliés à la thèse de la nécessité d'une forte inflexion de la politique énergétique américaine. Le discours prononcé par ce sénateur au Brookings Institute, le 13 mars dernier, reflète cette évolution récente du débat énergétique à Washington. Fondé sur le principe de la nécessité d'un « nouveau réalisme » de la politique énergétique américaine, le discours du sénateur Richard Lugar désigne l'énergie comme « l'albatros de la sécurité nationale américaine ». Le ton en est pessimiste : « le pétrole deviendra un aimant encore plus puissant des conflits et des menaces d'action militaire qu'il n'a jamais été ». Et le Sénateur Richard Lugar, Républicain répétons-le, de mettre en cause la « minimisation » des sources d'énergie alternative par l'administration Bush. Reste que ce discours n'est pas encore partagé au sein du pouvoir exécutif américain, ainsi que le Président de la mission d'information a pu le constater lors de son déplacement aux Etats-Unis au mois de juin 2006. Concernant les projets de charbon propre et, plus largement de recours au charbon comme substitut au pétrole pour fabriquer du carburant (charbon liquide), lui a-t-il été expliqué, la prudence des compagnies pétrolières internationales à investir massivement dans la recherche en faveur des solutions alternatives au pétrole s'explique par le souvenir vivace qu'elles ont gardé des coupes claires dans la recherche et l'emploi pendant les années 1990, alors que le prix du baril était au plus bas. Il faut leur laisser le temps de se rassurer... En un mot, c'est le marché et les mécanismes de prix qui feront évoluer les habitudes énergétiques. Au total, il est indéniable que les termes du débat énergétique aux Etats-Unis sont en train d'évoluer. On notera cependant que, pour l'heure, le problème de la sécurité énergétique est abordé uniquement du côté de l'offre, qu'il s'agisse de la mise en cause de la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis du Moyen-Orient ou de la timide tentative en faveur de la diversification des sources d'énergie. En aucun cas, il n'est question à ce stade de s'interroger sur le niveau de la demande énergétique américaine, c'est-à-dire sur la viabilité des habitudes de consommation des Etats-Unis. B - Une puissance énergétique magnanime : les Etats-Unis, garants des flux énergétiques internationaux L'énergie est un enjeu à la fois économico-financier et politique : d'un côté, c'est un domaine où sont brassées d'énormes masses financières, tant en matière d'investissements que de profits, de tels besoins financiers impliquant par définition un rôle important du marché ; de l'autre, c'est un secteur stratégique, qui met en jeu des questions de souveraineté et de sécurité nationale, c'est-à-dire place l'Etat au cœur du système. Seule cette double grille de lecture permet de comprendre la politique énergétique internationale des Etats-Unis. 1) Diplomatie économique et sécurisation des flux : l'échec des piliers de la politique énergétique internationale des Etats-Unis ? a) Les deux piliers traditionnels de la politique énergétique américaine dans le monde Comme l'a expliqué à la mission M. Pierre Noël, chercheur à l'Institut français des relations internationales (IFRI), la politique énergétique internationale des Etats-Unis s'articule autour de deux principes majeurs, inchangés depuis plusieurs décennies : La politique de diplomatie économique tout d'abord. Les Etats-Unis ont constamment œuvré pour « marchandiser » les ressources pétrolières, c'est-à-dire en vue de leur mise à disposition sur le marché par les Etats producteurs. Ils ont mené avec constance une politique de construction et d'extension des marchés énergétiques internationaux. La politique énergétique américaine dans les différentes régions du monde ayant fait l'objet de développements spécifiques dans les différentes parties consacrées aux zones géographiques, nous nous contenterons d'un rappel succinct des résultats de cette politique. Ainsi : - cette politique a largement réussi en Amérique latine, où cette politique est suivie depuis les années 1980, mais elle suscite un mouvement de rejet aujourd'hui, dont l'emblème est la réaction du Venezuela ; - de même, dans la zone de la mer Caspienne, les Etats-Unis ont réussi à faire en sorte que les Etats concernés définissent leur politique énergétique dans un sens favorable aux intérêts occidentaux, l'administration Clinton étant largement à l'origine de cette internationalisation des ressources de la Caspienne ; - le même constat de succès peut être fait concernant l'Afrique de l'Ouest, où la politique américaine de diplomatie pétrolière suivie dans la deuxième moitié des années 1990 et depuis le début de la présente décennie, visant à cette même internationalisation, ne s'est nullement traduite par une « mainmise » américaine sur le pétrole africain. A cet égard, on relèvera que, depuis dix ans, la croissance des exportations pétrolières africaines vers les Etats-Unis a été inférieure à la croissance totale des exportations africaines, ce qui montre bien que les principaux bénéficiaires de l'internationalisation du pétrole africain ont été l'Europe et la Chine ; - en Russie cependant, la politique américaine n'a connu qu'un succès limité et les évolutions actuellement observées en Russie ne laissent pas entrevoir un changement en la matière, tout au contraire. La sécurisation des flux ensuite. Cette politique prend deux formes : la sécurisation des voies maritimes, y compris des détroits et la sanctuarisation de l'Arabie Saoudite. Le lien entre stratégie de défense américaine et ressources énergétiques semble réel, mais il ne paraît pas pour autant que cette stratégie vise à poursuivre une position de domination. En Afrique par exemple, les armées américaines n'ont pas ainsi recherché à exclure ou marginaliser les armées françaises dans des pays tels que le Gabon et le Tchad, malgré leurs richesses pétrolières. Ceci pourrait certes s'expliquer par le très fort taux d'engagement actuel des forces américaines poussant à des priorités, ou bien par l'habitude de coopération bilatérale en matière de formation en Afrique depuis cette décennie. Plus probablement s'agit-il d'une vision logique de subsidiarité, dont les choix sont limités aux besoins de protection des intérêts économiques et des ressortissants américains, dès lors que les autres objectifs de sécurité sont préservés par les alliés. La présence militaire mondiale des Etats-Unis est en partie destinée à assurer le maintien de l'approvisionnement en pétrole et en autres matières premières vitales à destination de leur territoire et de leurs partenaires commerciaux. Notamment, deux tiers environ du transport pétrolier mondial, couvrant aussi bien du pétrole brut que des produits raffinés, s'effectuant par voie maritime, la marine américaine est véritablement devenue la garante de la libre circulation sur les voies de navigation mondiales. Elle a un rôle particulier à jouer dans la défense des goulots d'étranglement, au niveau desquels l'approvisionnement en pétrole peut être facilement interrompu à la suite d'une action militaire hostile, voire même de raids de terroristes ou de pirates. Les Etats-Unis sont le seul pays de l'OTAN disposant de ressources navales suffisantes pour défendre ces goulots d'étranglement de manière crédible. Il s'agit là d'un service au commerce mondial, qui n'est pas soutenu financièrement par les alliés militaires des Etats-Unis. Les contribuables américains en supportent aujourd'hui le coût : l'Institut pour l'analyse de la sécurité globale signale que la défense des voies de communication maritimes et la fourniture d'une assistance militaire à des partenaires dans les pays fournisseurs de pétrole coûte aux Etats-Unis 50 milliards de dollars par an (165). DES DÉTROITS SOUS HAUTE SURVEILLANCE : LE RÔLE CLÉ DE L'ARMÉE AMÉRICAINE Malacca, Ormuz et Bab-el-Mandeb nécessitent une protection particulière contre le terrorisme par les forces armées : - A Malacca, la marine indonésienne dispose d'une vingtaine de bateaux de patrouille pour contrôler 17 000 îles ! Singapour et la Malaisie sont certes mieux équipés, mais n'ont pas le droit de poursuivre des bateaux dans les eaux indonésiennes. Dans une telle situation, le PACOM (US Pacific Command) a lancé une initiative régionale de sécurité maritime (RMSI), dont le but est de lutter contre les trafics en tout genre. Mais Indonésie et Malaisie ont refusé cette aide, dans laquelle ils voyaient une volonté d'ingérence américaine. Les deux pays ont préféré, avec Singapour, mettre en place des patrouilles communes à partir de juillet 2004 : les fameuses « Malsindo ». - Le détroit d'Ormuz bénéficie notamment de la présence américaine en Arabie Saoudite, dans les Emirats Arabes (QG de Doha, au Qatar) et dans l'océan Indien. - Le détroit de Bab-el-Mandeb bénéficie de la présence française à Djibouti et en mer (plusieurs navires français croisent en permanence au large du golfe d'Aden). Mais le gouvernement djiboutien a également ouvert son territoire à l'armée américaine, qui est de plus en plus présente dans la région. Les Américains ont ainsi mis en place, avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, la Combined Joint Task Force (CJTF), dont la mission est de surveiller les espaces maritimes, aériens et terrestres des six pays de la Corne de l'Afrique (Erythrée, Ethiopie, Somalie, Djibouti), du Kenya et du Soudan. Source : cet encadré est extrait des travaux réalisés par l'atelier de travail « énergie », effectué dans le cadre du master de géopolitique Paris I - ENS entre mars et mai 2005, sous l'égide de la La Direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP, ministère de l'Industrie). Disponible à l'adresse suivante : http://www.geostrategie.ens.fr/etudes/hydrocarbures/accueil.html. Sans doute serait-il plus équitable du point de vue économique de faire directement payer une partie de celui-ci aux consommateurs d'énergie, qui sont les premiers bénéficiaires de ce dispositif sécuritaire mondial. Notamment, une telle démarche contribuerait à fixer le prix de l'essence en fonction de son coût véritable plutôt qu'implicitement subventionné. Si le positionnement des troupes américaines à travers le monde n'a pas toujours comme premier objectif la sécurisation des routes d'approvisionnement des hydrocarbures (comme en Asie centrale), il n'en demeure pas moins que la présence militaire américaine représente un atout stratégique primordial et offre aux Etats-Unis le monopole de cette sécurisation. Comme le montre l'encadré suivant, c'est essentiellement le Moyen-Orient qui concentre les efforts américains, dans le cadre de la politique de sanctuarisation de l'Arabie Saoudite évoquée plus haut. POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAINE Les remarquables travaux de l'institut de géopolitique de l'Ecole normale supérieure en matière d'énergie mettent en lumière cette dimension de la politique énergétique américaine. Notamment, ils montrent comment les Etats-Unis ont systématiquement négocié l'obtention de bases militaires pour garantir la protection des principales infrastructures de la région Caspienne (1) du Moyen Orient (2), du Golfe de Guinée (3) et de l'Amérique latine (4). « (1) Le Caucase et la Turquie sont deux des points stratégiques les plus importants pour l'approvisionnement de l'Europe et des Etats-Unis s'agissant des hydrocarbures en provenance du golfe Persique et de la région de la mer Caspienne. Les Etats-Unis ont conclu de nombreux contrats afin de disposer de bases militaires dans différents pays de la région. Ainsi 250 soldats des forces spéciales américaines ont été envoyés en 2002 à la base de Vasiani en Géorgie pour former les troupes géorgiennes. Cette base se trouve à proximité des oléoducs Baku-Supsa et BTC. De plus, les troupes américaines sont stationnées depuis plusieurs années en Turquie (base de Incirlik). On observe également un redéploiement des forces militaires, stationnées jusqu'à présent en Allemagne, sur le pourtour de la mer Noire : l'installation de quatre bases militaires américaines sur le littoral roumain a été annoncée en avril 2005, et des négociations avec la Bulgarie sont en cours. La mer Noire constitue une zone stratégique de première importance pour la sécurisation du détroit des Dardanelles et des ports dans lesquels débouchent les pipelines en provenance de la mer Caspienne, de la Russie (port de Novorossisk) et d'Irak. De plus, la présence de la VIème flotte américaine en mer Méditerranée orientale constitue une double sécurité et permet d'intervenir dans la région en question et de sécuriser le détroit du Bosphore. Il est à noter également que les Etats-Unis participent au financement de la marine azérie, ceci dans l'hypothèse d'un conflit naval sur la mer Caspienne qui toucherait les pipelines sous-marins permettant l'évacuation du pétrole et du gaz turkmène et kazakh. (2) Dans le golfe Persique, premier enjeu stratégique des approvisionnements d'hydrocarbures à destination de tous les pays consommateurs, les Etats-Unis contrôlent les points stratégiques de la zone, ainsi que les voies d'entrée et de sortie de la zone. Et ce, au détriment d'autres alliés. Des bases militaires américaines sont installées en Arabie Saoudite (base aérienne de Prince Sultan, 9 000 hommes), au Qatar (QG du commandement militaire US basé à Al-Udeid), à Bahreïn (siège de la Vème flotte américaine) et au Koweït (100 000 soldats). Toutes ces bases permettent la « sanctuarisation » de l'Arabie Saoudite et la sécurisation du détroit d'Ormuz. De plus, depuis la guerre en Irak de 2003, 150 000 soldats américains stationnent sur le sol irakien et tentent de sécuriser les pipelines, qui sont la cible de nombreux sabotages. Les Etats-Unis ont également placé des troupes aux alentours du Golfe, comme la Vème flotte en Méditerranée orientale, qui permet de sécuriser le canal de Suez. En septembre 2002, un camp militaire américain ouvrait à Djibouti. Non seulement cette base signifie une volonté de limiter la menace terroriste qui pèse sur le détroit de Bab el-Mendeb (cf. les attentats réalisés au Yémen et dans la Corne de l'Afrique) ; mais elle marque aussi une confrontation stratégique avec des pays alliés, en l'occurrence la France. Si Djibouti était considéré jusqu'à présent comme une chasse gardée française, cela n'a pas empêché les Etats-Unis de rechercher un compromis avec les autorités djiboutiennes, afin de profiter de la valeur géostratégique de Djibouti. Enfin, les Etats-Unis veillent à la sécurisation des voies maritimes en provenance du Golfe qui longent soit la côte orientale de l'Afrique, soit le sous-continent indien. Ce contrôle est possible grâce à la base navale de Diego Garcia, placée au milieu de l'océan Indien. (3) En outre, dans le cadre de la nouvelle stratégie américaine de diversification des approvisionnements, largement fondé sur le plan Cheney, on assiste au déploiement croissant de la présence militaire américaine dans le golfe de Guinée. Sont visés aussi bien la sécurisation des routes d'approvisionnement (le golfe de Guinée, l'oléoduc Tchad-Cameroun et l'oléoduc Higleig-Port-Soudan à l'est) mais également les sites d'extraction de la région. La tentative de coup d'Etat à Sao-Tomé et Principe a fourni aux Etats-Unis un motif pour déployer des forces militaires sur l'archipel et sécuriser les eaux profondes du Golfe riches en hydrocarbures que ce petit pays partage avec la Guinée équatoriale et le Nigeria. Là encore, l'interventionnisme militaire américain se réalise en concurrence directe avec la présence traditionnelle française notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon. (4) Enfin, sur le continent sud-américain, la lutte contre le trafic de drogue offre aux Etats-Unis une bonne raison d'intervenir militairement, directement ou non, dans la région afin de limiter les risques pesant sur l'exploitation et l'exportation des ressources. Non seulement les Etats-Unis disposent de forces militaires présentes sur le sol sud-américain (bases de Manta en Equateur, Tres Esquinas y Leticia en Colombie, Iquitos au Pérou, Reina Beatrix à Aruba ou encore Comalapa au Salvador), mais ils financent également les forces militaires des pays concernés. La première raison de ce déploiement est la lutte contre le trafic de drogue. Cependant, il apparaît que les guérillas communistes qui sévissent en Amérique du Sud s'en prennent de plus en plus aux infrastructures pétrolières des grandes compagnies nationales ou étrangères (sabotage de pipelines, explosion de stations services), et à leur personnel (prise d'otages, kidnapping). Ainsi, en intégrant ces guérillas dans la lutte contre le terrorisme engagée en 2001, les Etats-Unis ont augmenté leur présence militaire et l'apport de financements pour améliorer la formation des militaires latino-américains ainsi que leurs équipements. Ceci leur permet de sécuriser les gisements pétroliers et gaziers présents sur le sol ainsi que l'exportation de ces hydrocarbures. Les Etats-Unis ne se limitent pas à la propre sécurisation de leurs approvisionnements. Ils prennent également en charge la sûreté des flux à destination de pays consommateurs placés en dehors des routes d'approvisionnement américaines : le Japon, la Chine, et la Corée du Sud entre autres. En effet, devant la montée des périls menaçant le détroit de Malacca (13 % du ravitaillement mondial en pétrole y transite), tels que la piraterie ou le terrorisme, plusieurs bases américaines ont été installées dans la région (notamment aux Philippines). Les experts du département d'Etat américain rencontrés par le Président de la mission ont expliqué que la marine américaine n'effectuait pas de patrouille systématique dans les détroits d'Ormuz ou de Malacca, le département de la défense n'intervenant qu'en cas de menace immédiate. Néanmoins, outre la présence internationale de la Marine américaine, les Etats-Unis coopèrent étroitement avec les Etats intéressés par la protection des détroits, même s'ils n'interviennent pas directement dans les pays concernés. Enfin, concernant la sécurité du détroit de Malacca, un groupe d'experts de l'APEC (166), dont des experts chinois, travaillent sur le sujet. Ce déploiement permet ainsi aux Etats-Unis de contrôler un point stratégique vital pour la Chine et de continuer l'endiguement de ce pays. Cette même logique peut également s'observer concernant le déploiement militaire américain en Asie centrale au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Des bases militaires ont été installées en Ouzbékistan (base aérienne de Khanabad), au Tadjikistan et au Kirghizistan (aéroport de Manas), ceci avec l'accord des autorités russes. Le pétrole ne joue plus alors qu'un rôle secondaire, mais s'inscrit dans les logiques stratégiques du déploiement. En cas de crise avec la Chine, les Etats-Unis pourront facilement couper l'approvisionnement pétrolier chinois, qui se fait via le détroit de Malacca et, de plus en plus, par la construction de pipelines en provenance de la mer Caspienne (Kazakhstan), où la CNOOC (Compagnie pétrolière nationale chinoise) a conclu des contrats d'exploitation. Enfin, la présence militaire américaine en Asie du Sud-Est s'inscrit également dans la lutte contre le terrorisme : de nombreux groupes terroristes tels que la Jemaah Islamiyah (JI) et Abu Sayyaf sévissent dans la région et pourraient s'en prendre aux intérêts pétroliers. » Sources : atelier de travail « énergie », effectué dans le cadre du master de géopolitique Paris I - ENS (cf. encadré précédent) et entretiens du Président de la Mission à Washington, juin 2006. b) La politique énergétique des Etats-Unis a-t-elle échoué ? Dans une partie des milieux dirigeants américains, se développe cependant aujourd'hui une crise de confiance vis-à-vis de ces deux piliers traditionnels : la capacité des Etats-Unis à faire fonctionner le marché pétrolier correctement et à sécuriser l'Arabie Saoudite face aux menaces intérieures qui se développent dans ce pays est mise en question. De fait, les Etats-Unis importent du pétrole de toute une série de pays qui sont non seulement confrontés à l'insécurité intérieure et régionale, mais qui se caractérisent également par la montée d'un sentiment anti-américain et anti-occidental, ce que révèlent tous les sondages. Notamment, le Moyen-Orient est devenu massivement anti-américain depuis la guerre en Irak. Les Etats-Unis sont donc contraints de faire face à certaines tensions manifestes résultant de leur agenda de promotion de la démocratie d'une part et, d'autre part, de leur dépendance vis-à-vis du pétrole fourni par un certain nombre de gouvernements hautement autoritaires. Comme le sénateur Richard Lugar l'a récemment fait remarquer, des sociétés d'Etat contrôlent 77 % des réserves mondiales de pétrole et nombre de ces Etats ne sont pas démocratiques. Sans compter les Etats dont les régimes sont même ouvertement hostiles aux Etats-Unis. Cette crise de la politique de sécurisation du marché pétrolier mondial se manifeste sur tous les continents : - c'est ainsi que le Président du Venezuela, Hugo Chavez, considère les Etats-Unis comme le principal ennemi de son pays et a annoncé son intention de diversifier la base de la clientèle pour le pétrole vénézuélien. Prêtes à fermer les yeux sur la dégradation des relations entre le Venezuela et les Etats-Unis, la Chine et l'Inde sont invitées à participer à l'exploration pétrolière au Venezuela (Groupe Eurasie, 28 avril 2005) ; - les rebelles au Nigeria attaquent les installations pétrolières à des moments de fortes tensions pour l'approvisionnement mondial et sont récemment parvenus à interrompre 25 % de la production de ce pays. - parallèlement, les experts américains de la sécurité sont convaincus que l'Iran utilise ses revenus pétroliers pour soutenir un programme d'armement nucléaire, en violation du Traité de non-prolifération nucléaire. Ce pays menace en outre indirectement d'utiliser le pétrole comme arme politique si la communauté internationale devait lui imposer un régime de sanctions. Même si la crédibilité d'une telle démarche est faible, au regard de l'extrême dépendance de l'Iran par rapport à ses revenus pétroliers, une telle possibilité ne saurait être exclue, du fait de la tendance, et de l'habilité, du régime à utiliser les crises internationales pour renforcer sa légitimité. C'est dans ce contexte qu'une inflexion du discours se fait jour. Ainsi, un accent nouveau est mis sur des mesures de sécurité plus passives, à l'instar de la disposition de l'Energy Act d'août 2005 qui prévoit un accroissement significatif de la taille des réserves stratégiques américaines (de 700 millions à un milliard de barils). Parallèlement émerge l'idée qu'il faut contenir la croissance de la demande. Enfin, les cercles qui réfléchissent sur la sécurité nationale s'intéressent de plus en plus à l'énergie. Au total, c'est un interventionnisme accru qui se dessine, sans qu'il faille pour autant y voir une tentation impérialiste : nul ne conçoit, aux Etats-Unis, que le souci de la sécurité énergétique doive conduire à dominer l'Irak, l'Iran ou l'Arabie Saoudite. 2) Nouvelles menaces, nouvelle politique énergétique internationale ? a) Sécurité énergétique et guerre contre le terrorisme : même combat ? Si les Etats-Unis ont toujours établi un lien entre leur politique de défense et leurs préoccupations énergétiques, le virage stratégique opéré depuis les attentats du 11 septembre 2001 a rendu plus poreuse encore la frontière entre énergie et sécurité dans la politique étrangère américaine et les questions énergétiques ont été, elles aussi, enrôlées sous la bannière de la lutte contre le terrorisme. Certes, avant même le tournant de septembre 2001, les problèmes énergétiques faisaient d'ores et déjà l'objet d'une analyse en termes de menaces. Notamment, dès son élection, le Président Georges W. Bush marqua son intention de réviser la politique énergétique américaine. En mars 2001, Spencer Abraham, secrétaire d'Etat à l'énergie, déclarait aussi : « Les Etats-Unis sont confrontés à une importante crise énergétique pour les deux prochaines décennies. Tout échec à relever ce défi menacera notre prospérité économique nationale, compromettra notre sécurité nationale et modifiera totalement notre mode de vie » (167). C'est d'ailleurs en vue de redéfinir les orientations de la politique énergétique que fut mis en place le groupe de travail qui élaborera le rapport Cheney, qui identifie comme principale menace la dépendance énergétique vis-à-vis du Moyen-Orient et la nécessité de diversifier les fournisseurs. Après les attentats du 11 septembre 2001, l'analyse de la « menace » sur les approvisionnements en pétrole et en gaz des Etats-Unis, ainsi que la réponse possible en terme de politique de défense, continua à mêler les considérations liées au marché et les questions politiques et de sécurité, même si celles-ci allaient désormais largement prendre le pas. Ainsi, on met encore en avant les thèmes des perspectives de déséquilibre, au niveau mondial, entre l'offre et la demande, ou encore des contraintes pesant sur l'aval, telles que l'absence de réserves de capacité pour les raffineries situées aux Etats-Unis. Mais dorénavant, la nécessité de réduire la dépendance à l'égard du Moyen-Orient et les préoccupations relatives à la protection des transports (oléoducs, gazoducs, routes maritimes) vont prendre une place croissante dans l'analyse. Le discours sur la « menace » que représenterait la dépendance énergétique des Etats-Unis à l'égard du Moyen-Orient est symptomatique du caractère réducteur, dans la nouvelle pensée stratégique américaine, du slogan de « guerre contre le terrorisme ». Les chiffres sont éclairants : globalement, là où, en 1974, les Etats-Unis dépendaient très largement des importations de pétrole provenant du golfe Persique, celles-ci ne représentent plus aujourd'hui que 2,5 millions de barils par jour soit 20 % seulement des importations totales de pétrole. Ces chiffres soulignent bien la dimension de politique intérieure de l'intervention du Président Georges W. Bush, lors de son discours sur l'état de l'Union du 31 janvier 2006, lorsqu'il a déclaré que les Américains étaient « drogués au pétrole », et qu'il fallait réduire des trois-quarts la dépendance vis-à-vis des importations du Moyen-Orient. Ce faisant, il ne faisait que reprendre une antienne du discours d'une partie du camp républicain depuis les événements du 11 septembre : la question porte, pour cette frange du parti républicain, non pas sur le degré de dépendance des Etats-Unis vis-à-vis du Moyen-Orient, mais sur le principe même d'une dépendance à l'égard de pays susceptibles de financer le terrorisme à coups de pétro-dollars. On ne peut manquer d'être frappé par le caractère moralisateur de ce discours, qui plus est totalement irréaliste au regard des projections à terme qui font de cette région l'hypercentre des problèmes énergétiques. Sans compter que cet objectif ne répond pas forcément à la menace : à regarder les chiffres, les Etats-Unis doivent tout autant, sinon plus, se préoccuper de diminuer leur dépendance et/ou sécuriser leurs approvisionnements vis-à-vis des importations en provenance du Venezuela ou du Nigeria. Cette invasion de l'espace de la politique énergétique par le thème de la guerre contre le terrorisme se retrouve également dans la volonté des Etats-Unis d'introduire les problématiques énergétiques au sein de l'Alliance atlantique. De même que l'OTAN est instrumentalisée au profit de la guerre contre le terrorisme, de même, les Etats-Unis entendent que l'OTAN se saisisse des sujets énergétiques. Le principe est toujours de ne considérer l'OTAN que comme un cadre pratique, au mépris de sa vocation première d'alliance militaire. Ainsi, dans la « longue guerre » qui voit les Américains lutter contre toutes les formes de trafics - piraterie, prolifération, drogue, immigration... -, tous les moyens sont mobilisés : l'OTAN en Méditerranée, une large coalition dans l'océan Indien, une alliance avec les pays riverains dans le détroit de Malacca. De même, les Américains souhaiteraient lancer une telle initiative dans le golfe de Guinée. En l'occurrence, la question n'est pas de créer une « OTAN de l'énergie », à l'instar de ce qu'avait proposé la Pologne, qui n'a évidemment pas été repris, étant par trop ouvertement russophobe. L'idée qui se fait jour, y compris chez certains membres européens de l'OTAN, est de transformer le comité de gestion des oléoducs de l'OTAN en comité pour la sécurité énergétique, qui conduirait l'OTAN à intervenir dans des zones de production pétrolières ou gazières. La volonté d'inscrire la question de la sécurité énergétique au menu du prochain sommet de l'OTAN, à Riga, en novembre 2006, s'inscrit dans ce cadre de réflexion. Devant cette confusion des genres, on peut être tenté de s'interroger : la « guerre contre le terrorisme » est-elle un prétexte pratique qui permet de masquer des préoccupations énergétiques extrêmement pragmatiques ou bien vise-t-elle uniquement à répondre à une menace perçue comme réelle ? A dire vrai, cette question revêt un intérêt largement théorique. Certes, « la lutte contre le terrorisme qui sous-tend le repositionnement et modifie les formes mêmes de la présence militaire des Etats-Unis dans le monde, recoupe pour l'essentiel les principales zones d'instabilité potentielle du globe en matière de production et d'acheminement des hydrocarbures » (168) et chacun a en tête les débats sur le lien entre les préoccupations pétrolières des Etats-Unis et leurs interventions armées sur des théâtres extérieurs, notamment en Irak. Le sujet reste ouvert : pour M. Pierre Noël, entendu par la mission, il ne faut pas voir de tentation impérialiste dans l'interventionnisme accru des Etats-Unis ; de même, M. Christophe-Alexandre Paillard a considéré que « les Etats-Unis ne sont pas intervenus en Irak pour le pétrole, mais parce qu'ils ont cru pouvoir résoudre le problème du Moyen-Orient ; c'est ce même raisonnement qui pourrait les conduire à commettre l'irréparable en Iran. » Mais, même aux Etats-Unis, on continue, à l'instar d'un John Judis, journaliste américain, à pointer du doigt les ambitions pétrolières américaines au Moyen-Orient (169). En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que la « guerre contre le terrorisme », monopolisant l'ensemble du débat stratégique américain, devient une grille de lecture unique qui modèle pour l'essentiel l'ensemble des politiques américaines à l'étranger et qu'elle est appauvrissante. Il ne s'agit pas, derrière ce constat de nier les menaces terroristes pesant sur la sécurité énergétique, mais de souligner que la simplicité, sinon le simplisme, de l'analyse à travers ce seul prisme peut conduire à accroître les dangers au lieu de les réduire. Qui peut nier aujourd'hui que la politique des Etats-Unis au Moyen-Orient, en Irak notamment, aura conduit, sinon à nourrir, du moins à maintenir à un niveau élevé la menace terroriste, y compris dans le domaine énergétique, accroissant par là même le sentiment d'insécurité énergétique ? Qui peut nier que, avec cette intervention extérieure, les Etats-Unis se sont lié les mains vis-à-vis de l'Iran, qui a désormais le champ libre pour pratiquer un véritable chantage énergétique, touchant tant au niveau des approvisionnements pétroliers des pays consommateurs qu'à la sécurité maritime du commerce énergétique international ? A l'évidence, des menaces croissantes pèsent sur l'approvisionnement en énergie. A cet égard, le fait que la région du golfe Persique, qui renferme, à elle seule, les deux tiers des réserves prouvées de pétrole de la planète, soit politiquement aussi instable, est éminemment préoccupant. Dans ces régimes où la faiblesse du dialogue démocratique et l'incapacité des gouvernements à mener les réformes sociales nécessaires nourrissent l'essor de mouvements terroristes régionaux, dont le but avoué consiste à s'engager dans la « guerre asymétrique », il est certain que les infrastructures énergétiques représentent une cible tentante pour ceux qui ne disposent pas des moyens de défier directement les armées de la région. Les dirigeants d'Al Qaeda ont ainsi menacé en de multiples occasions de couper les « artères économiques vitales » des sociétés industrialisées occidentales, en attaquant des infrastructures énergétiques essentielles. Le fait que la politique américaine au Moyen-Orient n'ait pas contribué, tant s'en faut, à stabiliser et à modifier ces régimes, mais soit au contraire à l'origine d'une déstabilisation majeure du monde sunnite, au profit de l'Iran, renforce la crédibilité de la menace. Et de fait, l'organisation terroriste n'a pas tardé à mettre ses menaces à exécution. Ainsi, en octobre 2002, le Limburg, un superpétrolier français a été attaqué au large de la côte du Yémen, par un bateau rempli d'explosifs, qui l'a sérieusement endommagé. Si les attaquants avaient pleinement atteint leur objectif, l'approvisionnement en énergie des marchés mondiaux aurait été gravement perturbé. Les infrastructures terrestres sont tout autant visées : la principale raffinerie d'Arabie Saoudite fit, quelques mois plus tard, l'objet d'une attaque, qui fut cependant déjouée sans que les assaillants ne parviennent à pénétrer au sein du périmètre de protection. Là encore, un succès des terroristes aurait entraîné de considérables pénuries mondiales de pétrole, affectant les marchés pendant des mois. De même, les oléoducs et les gazoducs, par lesquels sont acheminés quelque 40 % de l'approvisionnement mondial en pétrole et un pourcentage beaucoup plus élevé de gaz naturel, sont particulièrement vulnérables, comme les événements en Irak l'ont montré. Ces installations sillonnent des milliers de kilomètres et traversent certaines des régions les plus instables au monde. Bien que l'Europe soit plus directement dépendante des systèmes internationaux d'oléoducs et de gazoducs, en particulier pour l'acheminement du gaz naturel, les Etats-Unis comptent plus de 257 000 kilomètres d'oléoducs et de gazoducs sur leur territoire et dépendent de ces installations pour leur approvisionnement en pétrole et en gaz provenant du Canada et du Mexique. Les oléoducs et les gazoducs doivent donc être considérés comme des goulots d'étranglement potentiels particulièrement vulnérables au sabotage. D'ores et déjà, ces menaces se sont traduites en termes économiques. Ainsi, en raison de la situation sécuritaire de plus en plus fragile dans certains pays producteurs de pétrole et des régions par lesquelles le pétrole transite, les primes d'assurance pour un superpétrolier transportant deux millions de barils sont passées de 150 000 à 450 000 dollars par voyage, uniquement en couverture du risque pour le navire - la cargaison étant couverte séparément. A elle seule, cette augmentation ajoute approximativement 15 cents au coût d'un baril de pétrole. Il ne fait pas de doute qu'une attaque réussie contre un superpétrolier entraînerait très probablement une véritable envolée des primes d'assurance. Dans quelle mesure les Etats-Unis sont-ils prêts à payer le prix de la sécurité énergétique ? On l'a dit, les Etats-Unis consacreraient au total 50 milliards de dollars par an à la sécurité maritime internationale, sans qu'il ait été toutefois possible de vérifier la validité de ce chiffre. Pour impressionnant qu'il puisse paraître, ce chiffre est faible au regard des enjeux en cause. Evidemment, les Etats-Unis consacrent certainement l'effort financier le plus important en la matière. Mais, de manière générale, les experts, à l'instar de M. Daniel Yergin, Président du Cambridge Energy Research Associates (CERA), estiment que les Etats-Unis ne se donnent cependant pas les moyens d'une réelle protection des infrastructures critiques, énergétiques notamment, à commencer par celles qui sont sur leur sol, faute de la coordination nécessaire entre le secteur privé, le gouvernement fédéral et les agences. Lors de la visite qu'il a effectuée aux Etats-Unis au mois de juin 2006, le Président de la mission d'information a de fait été frappé par l'extrême dispersion des moyens américains consacrés à la sécurité maritime. Le maintien de la liberté des océans - un des espaces communs (commons, dans le langage stratégique américain) à défendre, avec l'espace et le cyberspace, selon la revue quadriennale de défense - a toujours fait partie de la culture stratégique américaine. L'intérêt des Etats-Unis pour la sécurité maritime nationale ne doit rien à la philanthropie : selon les termes mêmes du Président Georges W. Bush, dans un discours du 20 novembre 2004, il s'agit pour le pays d'exporter et d'importer de la sécurité en exportant et important des biens et services, afin de stabiliser les régions qui exportent quant à elles leur instabilité et leurs maux. L'objectif est bien la préservation de la sécurité des Etats-Unis, y compris économique, qui dépend de leur capacité à pouvoir utiliser en toute sécurité les océans du globe. Ainsi que le résume le document sur la Stratégie nationale pour la sécurité maritime, « les Etats-Unis ont un intérêt national vital dans la sécurité maritime » car « comme tous les autres pays, les Etats-Unis sont hautement dépendants des océans pour la sécurité et le bien-être de leur peuple et de leur économie ». C'est cependant seulement au mois de septembre 2005 que les Etats-Unis ont adopté une Stratégie nationale pour la sécurité maritime : jusqu'alors, une telle stratégie n'existait pas, chaque département ministériel ayant mis au point sa propre stratégie. Ce document ne constitue en réalité qu'une tentative de coordination de programmes existants et la définition d'un cadre intellectuel destiné à clarifier les responsabilités de chacune des administrations impliquées. Il faut espérer que cette stratégie ne pâtira pas de la difficulté globale des Etats-Unis à mettre en œuvre une stratégie de sécurité nationale pour la défense de leur territoire : le nouveau département ministériel dédié à la Homeland Security, censé chapeauter l'ensemble des initiatives en la matière ne parvient pas à remplir sa mission dans un Etat qui n'a jamais possédé de culture fédérale de la sécurité. b) Les Etats-Unis face au géant chinois : un containment énergétique de la Chine ? Lors de la visite qu'il a effectuée aux Etats-Unis au mois de juin 2006, le Président de la mission a été très frappé de constater que l'un des premiers thèmes abordés par M. Guy Caruso, qui venait présenter le dernier rapport sur les prévisions énergétiques américaines à 2030 établies par le département de l'énergie, était l'importance de la consommation chinoise. En l'occurrence, M. Guy Caruso a expliqué qu'elle dépasserait la consommation américaine de 10 % en 2030 (170). S'agissant de l'émergence de la Chine sur la scène énergétique, le discours américain est ambivalent. _ D'un côté, le discours officiel entendu par le Président de la Mission au département d'Etat reprend le thème de l'intégration de la Chine dans le système international. Ainsi, « l'un des plus grands défis aujourd'hui posés en matière énergétique réside dans les modes de consommation de la Chine, et de l'Inde : en l'absence d'initiatives, ces deux pays vont construire des centrales au charbon très inefficaces. L'enjeu consiste donc, via le G8, à faire en sorte que ces pays se tournent vers l'énergie nucléaire et disposent de techniques de captation du gaz carbonique. L'Union européenne et les Etats-Unis doivent y travailler ensemble. Avec la France, les Etats-Unis sont tout particulièrement désireux de travailler sur la question de l'énergie nucléaire, de façon à convaincre l'Inde et la Chine de s'engager clairement dans cette voie. Certes, la part du nucléaire dans le bilan énergétique chinois restera faible, quand bien même la Chine doublerait son parc nucléaire. C'est la raison pour laquelle, concernant la Chine, on n'échappera pas aux deux questions du charbon propre et de l'efficacité énergétique. ». Dans le discours « diplomatiquement correct », le dialogue régulier entre les Etats-Unis et la Chine sur les questions économiques est mis en avant. C'est ainsi qu'en 2005, la diplomatie américaine a introduit le thème de la Chine comme « international stakeholder in the international system » (171). Dans ce cadre, les Etats-Unis abordent notamment avec la Chine la question des liens qu'elle noue avec des pays que les Etats occidentaux considèrent avec prudence voire méfiance, dans le cadre de sa quête de ressources énergétiques. Pour le reste, les Etats-Unis considèrent la croissance chinoise comme une « évolution positive, longtemps attendue ». L'objectif de la diplomatie américaine à l'égard de la Chine est de la conduire à « adopter les règles du jeu occidentales. En matière énergétique, cela signifie que la Chine en vienne à adopter des prix de marché sur son propre territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui : en dépit de la hausse du brut, le prix de pétrole n'a quasiment pas évolué sur le marché intérieur chinois, aucun signal de ralentissement de la demande pétrolière n'étant par conséquent envoyé au marché. Nous comprenons leur souci de conforter leur sécurité énergétique mais leur seule politique d'investissements à l'étranger ne suffira pas pour leur permettre d'atteindre cet objectif puisqu'ils ne couvriront ainsi que 20 % maximum de leurs besoins énergétiques. La Chine n'a donc d'autre choix que de s'insérer dans les mécanismes de marché. Pour l'y aider, nous l'associons comme observateur, avec l'Inde, à certains travaux de l'Agence internationale de l'énergie. Il s'agit de familiariser ces pays avec les notions de Emergency preparedness ou d'efficacité stratégique. » · Ce discours officiel, entendu au département d'Etat, ne reflète que partiellement les vues américaines sur l'émergence de la Chine au premier plan de la scène énergétique internationale. La question se situe en effet au cœur d'une réflexion stratégico-militaro-énergétique. Comme l'a expliqué à la mission, M. Christophe-Alexandre Paillard, « les Etats-Unis estiment qu'ils font face à un nouveau grand jeu entre trois mondes : Occident/Chine/les autres. » et, à ce titre, le département de la défense élaborerait des scénarios guerriers pour faire face aux nouvelles menaces. Ainsi, à l'égard de la Chine, les Etats-Unis mettent au point un dispositif de containment. Ils interprètent en effet les efforts d'équipement militaire chinois comme ayant pour objectif d'assurer à la Chine les moyens de sécuriser ses approvisionnements, y compris énergétiques, à l'horizon 2020-2025. De fait, la Chine devient un consommateur de plus en plus massif (les perspectives à 2025 font état d'importations quotidiennes chinoises qui représenteraient la production quotidienne de pétrole de l'Arabie Saoudite). Ce que les Etats-Unis voient comme la stratégie du « collier de perles chinois », à savoir l'implantation militaire de la Chine autour de l'océan Indien, est considérée par les responsables américains comme une question stratégique majeure. De même, l'intérêt nouveau des Etats-Unis pour l'Afrique ne doit sans doute pas qu'à leur volonté de diversifier leurs approvisionnements, mais également à une volonté de faire pièce à l'accroissement de l'influence chinoise en Afrique (172). De fait, la Chine est également dans une démarche duale, énergétique et stratégique : si les Etats-Unis portent une attention toute particulière à la question de la protection des routes maritimes, qu'empruntent 60 à 70 % du commerce pétrolier - 50 % du transport du gaz à l'horizon 2012-2015 -, y compris en direction de la Chine, celle-ci projette pour sa part de construire des oléoducs et des gazoducs majeurs, afin de relier ses villes en plein essor économique aux sources de pétrole et de gaz d'Asie centrale et de Russie... et aussi (surtout ?) de rendre le pays moins dépendant de l'approvisionnement énergétique qui transite par des eaux en grande partie contrôlées par la marine américaine. A noter que la démarche américaine de containment revêt également une forte dimension économique, comme l'a montré l'épisode de la tentative de rachat, par la compagnie chinoise CNOOC, de la compagnie pétrolière californienne Unocal - neuvième compagnie pétrolière américaine. Que « certaines personnalités politiques écriv[ir]ent au Président Bush ou, comme James Woolsey, ancien directeur de la CIA durant l'administration Clinton témoign[èr]ent devant différentes commissions du Congrès à Washington pour faire prendre conscience à l'establishment et à l'opinion américaine de la menace pour la sécurité nationale constituée par cette OPA » (173) montre à quel point les préoccupations affichées d'intégrer la Chine au marché international de l'énergie trouvent rapidement leur limite... A dire vrai, il y eut dans cette affaire bien plus qu'un réflexe de patriotisme économique : « pour l'administration Bush, l'enjeu était notamment constitué par le 1,75 milliard de barils de réserves détenus par Unocal et situés pour l'essentiel en Asie du Sud-Est, dans le golfe du Mexique et dans la région de la mer Caspienne » (174), c'est-à-dire à proximité du territoire chinois... Faut-il aller jusqu'à lire, avec M. Christophe-Alexandre Paillard, la « longue guerre » actuelle contre l'extrémisme islamiste et le dispositif militaire américain à l'échelle mondiale comme visant à offrir la possibilité d'imposer un blocus énergétique vis-à-vis de la Chine ? Nous n'irons sans doute pas jusque là. Constatons seulement les faits : les partenariats de défense en création avec l'Inde, la Mongolie, le Kirghizstan, le Tadjikistan, l'Afghanistan serait de nature à permettre, de facto, un encerclement de l'Empire du milieu. Par ailleurs, le maintien dans la dernière revue de défense américaine (Quadrennial Defense Review 2006 ou QDR) des grands programmes d'armement maritime ne peut avoir pour seul objectif la défense en profondeur du territoire américain ni même celle de Taiwan. On peut supposer qu'il s'agit de s'assurer dans les vingt-cinq ans à venir de la supériorité américaine sur mer en contrôlant en particulier les axes de ravitaillement pétrolier. L'Union européenne : Repères Avec près de 500 millions de consommateurs, l'Union européenne représente le deuxième marché de l'énergie au monde : 15 % de la consommation mondiale pour 6 % de la population de la planète. L'Union européenne absorbe 19 % du pétrole consommé dans le monde, 16 % du gaz naturel, 10 % du charbon et 35 % de l'uranium. Quel paradoxe ! Bien que la composante énergétique ait existé dès les origines de la construction européenne - à travers les traités CECA et Euratom - les Européens n'ont pas réussi, en un demi-siècle, à s'accorder sur une politique commune de l'énergie. La crise du gaz ukrainien de l'hiver 2006 a révélé aux opinions publiques l'ampleur du défi énergétique posé à l'Union européenne. Préservation du climat, sécurisation des approvisionnements, diversification des sources d'énergie, amélioration de l'efficacité énergétique, etc : les questions sont nombreuses et appellent des réponses concertées à l'échelle de l'Union. Dans le contexte d'une crise de l'énergie globale et manifestement durable, l'énergie s'est imposée comme la nouvelle priorité européenne. A - La délicate équation énergétique européenne Les termes de l'équation énergétique européenne résultent du fort niveau de dépendance de l'Union, qui ne va cesser d'augmenter au cours des prochaines années. Alors que l'envolée des cours des hydrocarbures menace directement la compétitivité de l'Union, l'Europe n'a d'autre choix que celui de contenir sa demande énergétique tout en se donnant les moyens d'assurer la sécurité de son approvisionnement. 1) Contenir la demande énergétique a) Une demande globale en forte progression La consommation annuelle d'énergie de l'Union européenne est équivalente à plus de trois tonnes et demi de pétrole par habitant. Si les données publiées par Eurostat en septembre 2006 indiquent une stabilité de la demande au sein de l'Union européenne en 2005 par rapport à 2004, la tendance sur une plus longue période souligne une croissance continue de la consommation d'énergie en Europe. Entre 1995 et 2004, la demande a en effet progressé de 11 % et les importations, dominées par le pétrole et le gaz, ont augmenté de 29 %. Selon les estimations de la Direction générale Energie et Transports de la Commission européenne, la consommation de l'UE 25 atteindra 1 900 Mtep par an en 2030 et connaîtra d'ici là une croissance moyenne de 0,5 % par an. La part du pétrole devrait diminuer au bénéficie du gaz et surtout des énergies renouvelables. Quant à la part du nucléaire, elle devrait diminuer, sauf à ce que certains Etats (en particulier l'Italie et l'Allemagne) reviennent sur leur décision de renoncer à cette source d'énergie. La croissance de la consommation sera nettement plus forte chez les douze nouveaux Etats membres que dans l'Europe des quinze ; mais cette dernière continuera à représenter l'essentiel de la consommation (85 %, contre 88 % en 2000). Les énergies fossiles, qui représentaient environ 80 % de la consommation en 2000 pèseraient encore près de 77 % du total à l'horizon 2030. 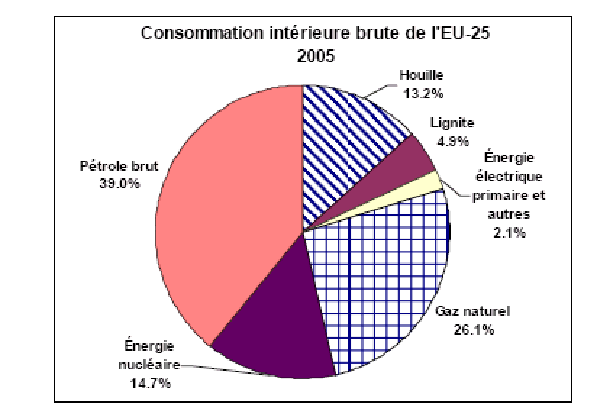 Source : Eurostat. b) L'Europe est-elle condamnée à la « finlandisation » ? En dix ans, la consommation d'énergie dans l'Union européenne a augmenté de 11 %, face à une baisse de 2 % de sa production. En conséquence, sa dépendance énergétique est passée de 44 % en 1995 à 56 % en 2005. Les taux de dépendance varient néanmoins sensiblement d'un Etat membre à l'autre, selon les ressources énergétiques dont ils disposent. Ainsi Chypre est totalement dépendant, suivi par le Portugal (99,4 %), le Luxembourg (99 %), la Lettonie (94 %) et l'Irlande (90,2 %). Les pays les moins dépendants sont le Royaume-Uni (13 %), la Pologne (18,4 %), l'Estonie (33,9 %), la République tchèque (37,6 %) et les Pays-Bas (38,9 %). Le Danemark, quant à lui, est le seul pays membre de l'Union européenne à produire davantage d'énergie qu'il n'en consomme. Les niveaux de dépendance énergétique sont très différents entre les pays, mais chaque Etat entend gérer lui-même sa dépendance. C'est ainsi que, s'agissant du gaz, l'Allemagne a préféré négocier directement avec la Russie pour la construction d'un gazoduc sous la mer Baltique qui évite le transit par les Pays baltes et la Pologne, tandis que le Royaume-Uni et les Pays-Bas veulent garder pour eux leur « stock » de la mer du Nord, et que l'Italie cherche à signer un accord global avec Moscou. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, l'Europe devra importer au moins 70 % de ses besoins en énergie en 2030 contre 50 % actuellement. Ainsi, l'Union sera dépendante à hauteur de 90 % pour sa consommation en pétrole, de 70 % pour le gaz et jusqu'à près de 100 % pour le charbon. Mais la dépendance de l'Europe n'est pas considérée par l'AIE comme une faiblesse stratégique en elle-même ; la sécurité énergétique n'a pas pour objectif de maximiser l'auto-suffisance de l'Europe en énergie ou de minimiser sa dépendance, mais plutôt de réduire les risques liés à cette dépendance. Il faut souligner que la dépendance énergétique est beaucoup plus marquée chez les quinze « anciens » Etats membres, où les parts du pétrole et du gaz représentent plus de la moitié des besoins énergétiques. TAUX DE DÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE L'UE 25 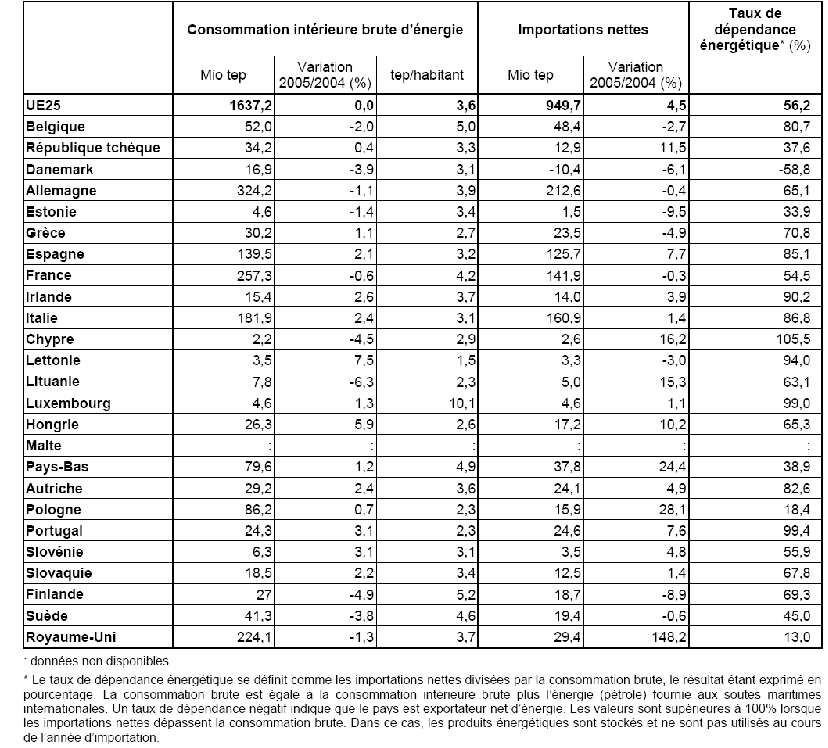 Source : Eurostat. L'accroissement de la dépendance énergétique de l'Union européenne s'explique par l'épuisement progressif des ressources énergétiques. En 2005, la production de tous les types d'énergie a diminué dans les vingt-cinq pays de l'Union européenne. Les données Eurostat indiquent ainsi que la production de pétrole brut a reculé de 9 % par rapport à 2004, celle de gaz naturel de 5,8 %, celle de charbon de 5,7 % et celle d'énergie nucléaire de 1,3 %. 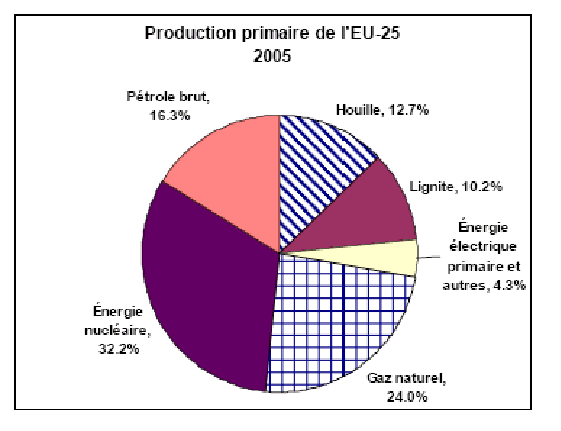 Source : Eurostat. Le Royaume-Uni a produit 70 % du pétrole brut de l'UE 25, suivi du Danemark (15 %). Dans ces deux Etats membres, la production a diminué en 2005 respectivement de 11,4 % et de 3,8 %. Le Royaume-Uni a été également le premier producteur de gaz de l'UE25, réalisant 44 % de la production totale, devant les Pays-Bas (32 %). La production de ces deux Etats membres a baissé respectivement de 7,7 % et 5,9 %. En Pologne, qui a produit 57 % du charbon de l'UE 25, la production a reculé de 2,1 %. En Allemagne, deuxième producteur de charbon avec 19 % du total de l'UE 25, et au Royaume-Uni, troisième producteur avec 13 %, la production a reculé respectivement de 3,9 % et 17,9 %. En France, qui a produit 46 % de l'énergie nucléaire de l'UE 25, la production a augmenté de 0,9 %, mais en Allemagne (deuxième producteur avec 16 % du total), elle a baissé de 3 %. L'EXEMPLE FINLANDAIS Le bouquet énergétique finlandais est composé pour 51 % de sources d'énergie fossiles (charbon, gaz et pétrole), 23 % d'énergie renouvelable (biomasse, hydroélectricité) et 17,6 % de nucléaire. La situation énergétique de la Finlande est marquée par sa très forte dépendance à l'égard des hydrocarbures. Ce pays ne produit ni gaz ni pétrole et sa situation géographique limite la création d'interconnexions tandis qu'en hiver, le transport maritime d'hydrocarbures dans le golfe de Finlande peut se trouver entravé par les glaces. Quoiqu'en diminution, le poids des industries fortement consommatrices d'énergie (sidérurgie et papeterie) dans l'économie finlandaise reste très important : 40 % du PIB et 80 % de la consommation d'énergie. Or, l'approvisionnement de la Finlande repose uniquement sur ses importations. La crise russo-ukrainienne de l'hiver dernier, cumulée avec plusieurs ruptures d'approvisionnement en électricité en provenance de Russie comme de Suède, a relancé les réflexions sur la sécurité et l'indépendance énergétiques du pays. L'hiver dernier, la Russie a interrompu pendant plusieurs jours ses livraisons de gaz en raison de la vague de froid qui a balayé l'Europe centrale. Pour faire face au défi de sa sécurité énergétique, la Finlande a constitué des stocks de pétrole qui correspondent à cinq mois de consommation moyenne. 2) Garantir la sécurité d'approvisionnement La sécurité énergétique revêt une dimension géopolitique grandissante. La moindre crise, même locale, le moindre conflit, potentiel ou actuel, ont un impact sur le marché des hydrocarbures. La compétition pour l'accès aux ressources s'intensifie, non seulement au niveau des industriels, mais aussi de plus en plus souvent au niveau des Etats. Dans le même temps, la nécessité de la diversification des sources et des voies d'approvisionnement apparaît de plus en plus clairement à tous. a) Prévenir les risques de ruptures d'approvisionnement La « crise ukrainienne » de l'hiver 2006 a révélé à l'opinion publique européenne les risques qui pèsent sur l'approvisionnement énergétique de l'Union. Pour autant, la prise de conscience de la nécessité de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'Europe est bien antérieure. En novembre 2000, la Commission européenne avait ainsi publié un Livre vert intitulé « Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement (175) » par lequel elle soulignait la multiplicité des risques engendrés par la dépendance énergétique de l'Union. Comme en fait état le Livre vert de la Commission européenne, les aléas de l'approvisionnement énergétique sont de plusieurs natures : - le risque physique d'une rupture temporaire ou permanente d'approvisionnement, pouvant résulter d'une cessation de production liée à une grève, une crise géopolitique ou une catastrophe naturelle. La sécurisation des voies de transit est une priorité, tant pour les pays consommateurs que pour les pays producteurs (176) ; - le risque économique, qui trouve son origine dans la volatilité des cours des produits énergétiques ; - le risque social, lié à la diminution de pouvoir d'achat que provoque l'augmentation de la facture énergétique. La hausse du prix de l'essence à la pompe ou du fioul est directement perceptible par les consommateurs et génératrice de tensions sociales ; - le risque environnemental, qui résulte des dommages causés à l'environnement : catastrophes nucléaires, marées noires. La plupart des pays européens ont signé le Mémorandum de Paris, s'engageant à contrôler au moins 25 % des navires de passage dans leurs ports. Malgré l'obligation de la double coque pour les pétroliers adoptée à l'automne 2003, des navires russes à simple coque continuent de traverser la mer Baltique et la mer du Nord. A plus long terme, le risque environnemental majeur est celui du réchauffement climatique. - A ces risques mentionnés par le Livre vert de 2000, il convient d'ajouter le risque terroriste, d'autant plus marqué depuis le 11 septembre 2001. b) L'impératif de diversification Diversification des sources d'approvisionnement : le potentiel énergétique du « Grand Nord » Actuellement, la moitié environ du gaz consommé dans l'Union européenne provient de seulement trois pays (Russie, Norvège et Algérie). Si les tendances actuelles se maintenaient, la part du gaz importé passerait à 80 % du total au cours des vingt-cinq prochaines années (177). L'importation d'énergie en Europe n'est pas en soi un problème, dès lors que l'Union européenne maintient une diversité tant en ce qui concerne les types de combustibles importés que l'origine géographique des produits achetés. A cet impératif de diversification s'ajoute la nécessité de sécuriser les voies de transit. Au fur et à mesure que la dépendance énergétique de l'Europe s'accroît, l'attention des nations européennes se porte ainsi sur la stabilité politique des pays producteurs. C'est à l'aune de ce critère que doivent être considérées les relations qu'entretient l'Union européenne avec la Norvège - pays tiers, mais néanmoins membre de l'Espace Economique Européen (EEE) -, véritable réservoir énergétique de l'Union. Son pétrole s'épuise - la Norvège aurait atteint son pic de production -, mais ses ressources en gaz demeurent considérables et disponibles pour au moins un siècle. La Norvège est aujourd'hui au maximum de sa capacité de production et n'a pas les moyens d'influer sur les cours mondiaux. Ce pays pourrait cependant jouer un rôle utile de médiateur entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Grâce à ses ressources naturelles, la Norvège est devenue l'un des pays les plus riches au monde et ses fondamentaux économiques sont très sains. Le pays se prépare toutefois à l'épuisement progressif des gisements actuels en mer du Nord et en mer de Norvège en définissant une nouvelle politique énergétique pour la mer de Barents, où l'exploitation des ressources énergétiques, qui nécessite une technologie avancée et coûteuse, devient de plus en plus réalisable sur la base actuelle des prix de l'énergie. Les recettes provenant de l'activité pétrolière sont placées dans un Fonds pétrolier créé par le gouvernement norvégien - dont le montant atteindrait 200 milliards d'euros (178) - pour assurer l'avenir de l'Etat providence, en prévision de la période qui suivra l'épuisement des ressources. Dans ce contexte, le développement du « Grand Nord » est devenu une priorité nationale pour la Norvège, alors que l'exploitation énergétique de la mer du Nord arrive à saturation. Le « Grand Nord » recouvre la région norvégienne de l'Arctique, à savoir l'archipel du Spitzberg/Svalbard (64 000 km2), la partie occidentale de la mer de Barents (libre de glace, même en hiver), l'île Jan Mayen et les eaux qui l'entourent. Certains géologues estiment que 25 % des réserves mondiales d'hydrocarbures se situeraient dans la zone arctique. Mais la question se pose, au plan juridique, du régime d'exploitation des ressources gazières dans une région où les souverainetés ne sont pas clairement établies (179). L'enjeu majeur est donc la délimitation de la frontière entre la Norvège et la Russie. La zone contestée de la mer de Barents est en effet supérieure en superficie à la partie norvégienne de la mer du Nord. La Russie souhaite lancer une activité pétrolière commune avec la Norvège en mer de Barents avant même d'obtenir un accord sur la délimitation de la frontière maritime. Or la priorité pour la diplomatie norvégienne vise à bâtir une relation de sécurité avec la Russie. Une politique de coopération avec la Russie permettrait à la Norvège d'affirmer une position modérée et équilibrée entre les Etats-Unis et l'Union européenne. La Norvège veut sensibiliser ses partenaires sur l'enjeu du « Grand Nord ». La « bataille pour l'énergie » qui se prépare ici relance l'intérêt pour cette région de nombreux pays et acteurs non étatiques (compagnies pétrolières, ONG, institutions multinationales...). L'exploitation du gisement de Stockhman découvert par les Russes à l'époque soviétique représente un enjeu géopolitique de premier plan. Le 9 octobre 2006, le gazier russe Gazprom a toutefois décidé d'exploiter seul ce gisement géant, fermant ainsi la porte aux compagnies occidentales qui espéraient devenir partenaires de ce projet de 20 milliards de dollars (180). La production du gisement devrait bien être destinée à l'Europe, et non plus aux Etats-Unis, comme cela avait été un temps envisagé. L'enjeu géopolitique du « Grand Nord » est stratégique dans le contexte d'une demande mondiale de pétrole et de gaz en constante augmentation. Si leur production se concrétise, les hydrocarbures de la mer de Barents pourraient permettre d'éviter un nouveau choc pétrolier. Le développement de l'exploitation de cette région apparaît également comme un substitut aux pressions géopolitiques et à la dépendance énergétique, notamment vis-à-vis du Moyen-Orient. Diversification des sources d'énergie et efficacité énergétique La diversification suppose également le développement des énergies alternatives et renouvelables. Depuis la publication, en 1997, du Livre blanc « Energie pour l'avenir : les sources d'énergie renouvelables », l'Union européenne s'est donné pour objectif de porter à 12 % d'ici 2010 la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. L'ambition est de conquérir le premier rang mondial en ce qui concerne ces sources d'énergie. Pour se donner les moyens d'atteindre un tel objectif, la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité a préconisé que la part de l'électricité « verte » passe à plus de 21 % dans la consommation électrique totale de l'Union en 2010. Quant aux biocarburants, l'objectif de la Commission européenne vise à porter leur part à plus de 20 % de la consommation européenne d'essence et de diesel d'ici à 2020 (181). LA PART D'ÉLECTRICITÉ Comparaison entre les résultats de 2004 et les objectifs pour 2010 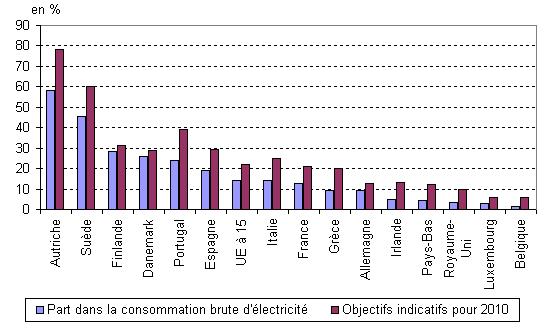 Source : Eurostat.
(1) Hors pompages, y compris usine marémotrice de la Rance. (2) Bois-énergie + déchets renouvelables + biogaz . (3) Il s'agit des objectifs indicatifs concernant la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité en 2010 figurant en annexe de la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 (2001/77/CE). Source : AIE (Agence internationale de l'énergie). Un rapport du Parlement européen (182) relatif au Livre vert de la Commission européenne sur l'efficacité énergétique recense jusqu'à 21 sources d'énergies renouvelables pour le XXIeme siècle. Toutefois, cinq formes d'énergies renouvelables se partagent le marché européen : l'hydraulique, le solaire, le bois, le biogaz et l'éolien. Un second chantier prioritaire est celui du renforcement de l'efficacité énergétique. La Commission européenne a ainsi présenté le 19 octobre 2006 un plan d'action pour mieux utiliser l'énergie (183) qui prévoit des mesures pour économiser l'énergie. Les Européens gaspillent en effet 20 % de l'énergie qu'ils consomment. Le plan d'action comprend un certain nombre de mesures visant notamment à rendre plus efficaces du point de vue énergétique les appareils électroménagers, les bâtiments et les transports. Selon la Commission européenne, l'efficacité énergétique est cruciale pour l'Europe. Si nous agissons maintenant, le coût direct de notre consommation d'énergie pourrait être réduit de plus de 100 milliards d'euros par an d'ici à 2020 et nos émissions de CO2 diminueront en conséquence d'environ 780 millions de tonnes par an (184). B - A défaut de politique énergétique commune, l'Union européenne doit s'engager sur la voie de la coopération énergétique Est-il nécessaire de disposer d'une politique commune européenne pour gérer efficacement l'approvisionnement, la production et la distribution d'énergie, ou suffit-il d'assurer la coordination des politiques nationales ? Il apparaît que les politiques européennes susceptibles d'influencer directement ou indirectement les bilans énergétiques ne font, à l'heure actuelle, qu'accompagner les choix nationaux. 1) La politique européenne de l'énergie reste embryonnaire a) L'absence de base juridique Dès l'origine (Traité CECA en 1951, Traité EURATOM en 1957), la Communauté européenne s'est dotée des éléments d'une politique énergétique. Mais la mise en place de cette politique commune demeure fondée sur le respect des choix énergétiques des Etats membres. Ceci explique que le Traité instituant la Communauté européenne ne comporte pas de base juridique spécifique dans le domaine de l'énergie. Les principes sont ainsi fixés par les dispositions sectorielles du traité et servent de support juridique (185) aux principaux objectifs stratégiques de la politique énergétique européenne qui concernent : - le bon fonctionnement du marché intérieur ouvert et concurrentiel, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux ; - la gestion de la dépendance énergétique ; - la promotion du développement durable ; - le développement de la recherche et de la technologie. En règle générale, le régime juridique est celui de la codécision entre le Conseil et le Parlement européen, à l'exception des mesures affectant « sensiblement le choix d'un Etat membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique », et en cas de « graves difficultés » d'approvisionnement. En l'absence de base juridique sectorielle, l'Union européenne ne peut alors intervenir qu'en ayant recours à la clause de flexibilité de l'article 308 TCE (c'est-à-dire à l'unanimité et sans codécision) qui autorise les institutions à prendre les dispositions appropriées dans le cas où l'action européenne apparaîtrait nécessaire pour réaliser l'un des objectifs de la Communauté (186). La question de la base juridique est en réalité un faux problème ; c'est un prétexte qui masque l'absence de volonté politique. Chaque fois que les Etats ont voulu agir au niveau européen, une base juridique a été trouvée, le cas échéant en recourant à une interprétation extensive de l'harmonisation des législations. Qui plus est, des contraintes ont bien été fixées s'agissant de la part des énergies alternatives dans le « bouquet » européen sans qu'à aucun moment n'ait été invoquée l'absence de base juridique. b) Le respect de la souveraineté énergétique des Etats membres Le talon d'Achille de l'Union européenne est incontestablement l'absence de consensus sur ce que devrait être le bouquet énergétique européen. Le profil énergétique des pays membres de l'Union européenne révèle en effet l'extrême hétérogénéité des choix opérés par les Etats dans la définition de leur matrice énergétique. Pour toute une série de raisons culturelles, géographiques, politiques, économiques, stratégiques ou encore de ressources, les pays européens ont pris des options différentes ; et aucun Etat membre n'est aujourd'hui prêt à un quelconque transfert de compétence à Bruxelles. Or, les choix opérés par un pays ont inévitablement une incidence sur la sécurité énergétique de ses voisins et de l'Union européenne dans son ensemble. Le nucléaire est central en France, tandis que le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas s'intéressent prioritairement au gaz. Le charbon reste l'énergie du futur pour la Grèce et l'Allemagne, alors que les énergies renouvelables occupent une place importante dans le bilan énergétique des pays nordiques. Ces choix nationaux font en outre l'objet d'une organisation industrielle spécifique à chaque pays et dans laquelle l'Etat joue un rôle différent. Chacun s'appuie sur son propre réseau d'entreprises, lesquelles tissent parfois leurs propres liens avec les pays producteurs. COMPARAISON DES BOUQUETS ÉNERGÉTIQUES Moyenne UE 15 Moyenne UE 10 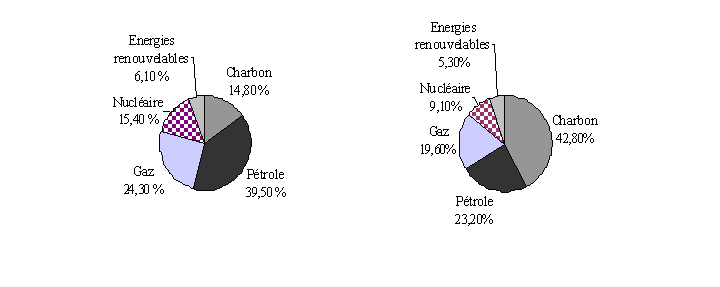 Source : Eurostat, données 2004. Enfin, l'adhésion à l'Union européenne des pays d'Europe centrale et orientale a créé un réel clivage entre anciens et nouveaux membres. Le charbon occupe encore une part déterminante dans le mix énergétique des nouveaux entrants. Héritage de la période soviétique, la présence du nucléaire y est également importante. Dans ce paysage éclaté, la question nucléaire fait figure de cas d'école. L'hétérogénéité des préférences nationales rend le sujet tabou à Bruxelles. En Allemagne, la loi sur l'énergie atomique entrée en vigueur en avril 2002 prévoit l'abandon de la production nucléaire d'électricité d'ici 2021 au plus tard. La Suède (1980), l'Italie (1990), les Pays-Bas (1997) et la Belgique (2002) ont choisi de fermer progressivement leurs installations. D'autres pays comme le Portugal, l'Autriche, le Danemark et l'Irlande n'ont jamais opté pour l'énergie nucléaire, à l'instar de trois des dix nouveaux Etats membres de l'UE, la Pologne, l'Estonie et la Lettonie. Parmi les Etats disposant de centrales nucléaires, la France est le pays qui en détient la plus forte densité, puisque 80 % de son électricité est d'origine nucléaire. En Finlande, la construction d'un quatrième réacteur est en cours. De même, la Hongrie, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Lituanie n'ont aucunement l'intention d'abandonner le charbon, même si plusieurs des sites de construction soviétique doivent être fermés d'ici 2009 pour des raisons de sécurité. Le Royaume-Uni et l'Espagne acceptent l'énergie atomique, sans prévoir la construction de nouvelles centrales. Le respect du protocole de Kyoto, qui impose une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, devrait logiquement induire un retour au nucléaire qui, à l'inverse des produits carbonés, ne produit pas de gaz et qui ne peut pas encore être concurrencé par les énergies renouvelables. c) Une politique énergétique limitée au principe de libre concurrence L'instauration du marché intérieur de l'énergie en 1993 a rendu nécessaire l'harmonisation des règles nationales en ce qui concerne les normes techniques, la sécurité, la fiscalité, l'accès aux marchés publics. Le traité de Maastricht a prévu l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux de distribution de l'énergie sur tout le territoire de l'Union. C'est donc d'abord par la politique de concurrence que l'Europe intervient dans le secteur de l'énergie en interdisant l'existence, non pas de groupes à 100 % publics, mais de monopoles. L'ouverture à la concurrence s'est engagée progressivement : la directive « électricité » de 1996 et les directives « gaz » de 1998 et 2003 ont fixé un calendrier pour la libéralisation, qui a été largement anticipé par une majorité d'Etats membres. C'est ainsi que le Royaume-Uni et l'Allemagne avaient déjà totalement ouvert leur marché du gaz en 2000 tandis que la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont opté dès 2000 pour une ouverture complète du marché de l'électricité. Ainsi, l'ouverture du marché intérieur de l'énergie devra être totale au 1er juillet 2007. Comment toutefois s'assurer que la libéralisation du secteur énergétique permettra à la fois de répondre aux impératifs de compétitivité de l'industrie européenne, d'exercice effectif de la concurrence dans l'ensemble des Etats membres, de diversification et de sécurité de l'approvisionnement énergétique et de respect de l'environnement ? Un véritable marché commun et une concurrence libre et non faussée supposent l'existence d'un certain degré d'interconnexions, base indispensable d'un vrai réseau européen de l'électricité et du gaz. Or les flux transfrontaliers ne représentent qu'environ 10 % de la consommation européenne ; l'absence d'interconnexions suffisantes pourrait empêcher la montée en puissance d'un véritable marché. En outre, la libéralisation du gaz et de l'électricité a pour effet actuel d'accélérer la concentration du secteur aux mains de quelques grands groupes : EDF, E.ON, RWE, Suez-Electrabel ou Vattenfall dans l'électricité et ENI ou GDF dans le gaz. A défaut de monopoles, la libéralisation du marché pourrait en réalité favoriser la constitution de duopoles. Face aux profonds bouleversements qui caractérisent actuellement le marché de l'énergie, l'Europe paraît aujourd'hui se trouver au milieu du gué : alors qu'elle s'est engagée dans un processus irréversible de libéralisation des marchés de l'énergie, il est encore trop tôt pour voir émerger une politique européenne de l'énergie qui puisse avoir un effet stabilisateur. Le temps paraît venu de se demander si l'Europe est aujourd'hui prête pour une véritable politique énergétique qui ne s'attacherait pas seulement à des questions de construction de réseaux ou de dérégulation des marchés du gaz et de l'électricité. La politique de concurrence n'est en effet pas une fin en soi et ne doit pas entrer en contradiction avec l'objectif de sécurité d'approvisionnement. C'est ainsi qu'un équilibre devrait être trouvé entre les contrats de long terme et le recours aux marchés « spot ». 2) Réorienter les politiques européennes au service de l'énergie En quelques mois, à la faveur de la montée spectaculaire du prix du pétrole, l'énergie s'est imposée comme une question prioritaire et figure en haut de l'agenda européen. D'abord à l'occasion du sommet informel de Hampton Court, le 27 octobre 2005, puis lors du Conseil européen des 23 et 24 mars 2006, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont formellement relancé le débat sur la politique européenne de l'énergie, sur la base d'un Livre vert de la Commission. Le 8 mars 2006, la Commission européenne a en effet rendu public son Livre vert sur l'énergie (187), qui établit les bases possibles d'une future politique européenne de l'énergie. La Commission invite les Etats membres à prendre les mesures appropriées pour donner corps à une politique énergétique européenne autour de trois objectifs : - la durabilité, pour lutter activement contre le changement climatique en promouvant les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, - la compétitivité, pour améliorer l'efficacité du réseau européen à travers la réalisation du marché intérieur de l'énergie ; - la sécurité d'approvisionnement, pour mieux coordonner l'offre et la demande énergétiques intérieures de l'UE dans un contexte international. Le livre vert retient six domaines d'action prioritaires pour lesquels la Commission propose des mesures concrètes afin de mettre en œuvre une politique énergétique européenne. Il n'est cependant pas question - tant pour des raisons politiques que juridiques - de prôner la création d'une politique commune de l'énergie, au même titre qu'il existe une politique agricole commune. De la réalisation du marché intérieur à l'activation des leviers disponibles dans le champ de l'action extérieure, ces axes prioritaires identifiés par la Commission doivent permettre à l'Europe de se doter d'une énergie sûre, compétitive et durable pour les décennies à venir. Au terme de la consultation publique lancée avec ce Livre vert, la Commission européenne devrait présenter en janvier 2007 un ensemble de propositions législatives et règlementaires de nature à définir une stratégie européenne. a) Utiliser les politiques internes au service d'une stratégie énergétique commune Qu'il s'agisse des politiques menées par l'Union dans le domaine des transports, de l'environnement, du rapprochement des fiscalités ou de la recherche, toutes concourent à un objectif commun : ajuster la politique énergétique à l'impératif climatique et permettre à l'Union européenne de respecter les engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto. La fiscalité est ainsi un outil, parmi d'autres, qui peut être utilisé pour favoriser une convergence des politiques énergétiques nationales, en particulier au regard d'objectifs environnementaux. Des politiques non coordonnées des Etats membres et l'absence d'harmonisation fiscale peuvent en effet provoquer d'importantes distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. Mais en l'état du traité instituant la Communauté européenne, la prise de décision à l'unanimité bloque toute avancée réelle en matière de rapprochement des systèmes fiscaux nationaux. Les délais de prise de décision sont considérables, et les consensus, lorsqu'ils existent, n'interviennent qu'a minima. On peut toutefois recenser quelques progrès - quoique timides - avec l'adoption de la directive 2003/96/CE qui définit le cadre législatif communautaire en matière de taxation des produits énergétiques. Cette directive fixe des niveaux de taxation minimaux au-delà desquels les Etats membres sont libres de définir leurs taux nationaux, au niveau qu'ils considèrent le plus approprié. En conséquence, la taxation effective varie grandement d'un Etat membre à l'autre : sans prendre en compte les pays qui bénéficient d'une période de transition pour atteindre ces minimaux, le montant d'accises prélevé pour 1 000 litres de carburant peut varier de 302 à 782 euros. Le faible niveau de taxation du diesel commercial (ou diesel routier) en vigueur au Luxembourg incite ainsi les transporteurs routiers à se ravitailler au Grand Duché plutôt qu'en Allemagne ou en France. Alors que la consommation par habitant est inférieure à 750 litres par an dans les autres Etats membres, elle dépasse 4 200 litres au Luxembourg ! Si les transporteurs effectuent des détours par rapport à leur itinéraire normal pour leur plein de réservoir dans les pays ayant fixé les taux d'accises aux niveaux les plus bas, ce phénomène peut aussi avoir des conséquences négatives sur l'environnement, puisqu'une plus grande distance est parcourue par rapport à celle qui serait normalement nécessaire si les différences de taxation n'existaient pas. Ceci n'est pas sans conséquences sur le niveau d'émission de gaz à effet de serre. La politique des transports est également utilisée par l'Union européenne pour renforcer l'efficacité énergétique et contribuer à une meilleure protection de l'environnement. A titre d'exemple, l'initiative CIVITAS lancée par la Commission européenne vise à développer des solutions de substitution à l'utilisation des voitures particulières dans les villes afin de réduire la congestion et la pollution et de promouvoir une utilisation plus rationnelle de l'énergie. Les villes qui participent au programme CIVITAS introduisent des solutions innovantes en matière de planification et de gestion des transports, en appliquant de nouvelles technologies pour accroître l'efficacité énergétique et en utilisant des carburants de substitution. Jusqu'à présent, trente-six villes européennes ont bénéficié d'une aide au titre de ce programme et la Commission a assuré un cofinancement pour un montant de 100 millions d'euros. La politique de recherche et développement représente également un axe fondamental de la politique européenne de l'énergie. A très long terme, l'objectif du projet ITER de réacteur expérimental à fusion nucléaire vise à obtenir un moyen de production énergétique massive d'avenir et l'exploitation d'une source d'énergie quasi inépuisable et peu polluante. Dans le secteur de la recherche, la Commission dispose d'un outil de prospective sans équivalent dans les Etats membres à travers le Centre commun de recherche, un organisme d'assistance scientifique et technique, tant auprès de la Commission que des Etats. Ce centre dispose d'un budget annuel de 300 millions d'euros, emploie 2 700 personnes mobilisées sur environ 120 projets et travaille en réseau avec près de 2 000 structures publiques et privées en Europe. Dans le secteur de l'énergie, les travaux du Centre commun de recherche concernent plus particulièrement la sécurité nucléaire, le fonctionnement des réseaux et des infrastructures, la protection de l'environnement et la sensibilisation du public aux enjeux énergétiques. Dans le cadre de la mise en place d'une politique européenne de l'énergie, cet organisme représente un instrument très utile de prévision stratégique. b) Développer la composante énergétique de l'action extérieure de l'Union : vers une diplomatie énergétique européenne ? Le Conseil européen de juin 2006 a examiné un document conjoint de la Commission européenne et du Haut Représentant de l'Union européenne pour la PESC intitulé « Une politique extérieure au service des intérêts de l'Europe en matière énergétique (188) ». Ce document définit les principes directeurs qui doivent guider l'action de l'Union pour renforcer la sécurité extérieure de ses approvisionnements énergétiques. Les dix objectifs suivants ont été fixés : - promouvoir la transparence et une meilleure gouvernance du secteur énergétique par des partenariats avec des pays tiers, l'objectif étant de créer des conditions juridiques stables, non discriminatoires, transparentes, ouvertes et mutuellement bénéfiques pour les investissements et les échanges dans le domaine de l'énergie ; - améliorer les capacités de production et d'exportation des pays producteurs, développer et moderniser les infrastructures de transport de l'énergie dans les pays producteurs et les pays de transit ; - améliorer le climat d'investissement des sociétés européennes dans les pays tiers et ouvrir la production et l'exportation des ressources énergétiques à l'industrie de l'Union ; - améliorer les termes de l'échange en matière énergétique en offrant aux pays tiers et de transit un accès non discriminatoire aux infrastructures d'exportation ; - renforcer la sécurité matérielle et environnementale ainsi que la sécurité des infrastructures énergétiques ; - favoriser l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables y compris des biocarburants, de technologies à faible émission et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le monde entier ; - appliquer les mécanismes appropriés du protocole de Kyoto ; - diversifier les importations d'énergie par produit et par pays ; - créer, pour les pays qui ont opté pour le nucléaire, un régime international d'approvisionnement en uranium enrichi qui soit conforme aux engagements en matière de non-prolifération et prenne en considération les dispositions du traité Euratom ; - promouvoir la constitution de réserves stratégiques et encourager leur détention en commun avec des pays partenaires. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs instruments peuvent être utilisés, qu'il s'agisse de la politique de voisinage, de la politique d'aide au développement ou de la politique commerciale. _ La politique de voisinage au service de la coopération énergétique A l'Est : Le partenariat UE-Russie La crise énergétique a renforcé le poids de la Russie, qui détient 6 % des réserves mondiale de pétrole et 25 % des réserves de gaz. Le partenariat énergétique établi entre l'Union européenne et la Russie lors du sommet bilatéral de Paris du 30 octobre 2000 vise à développer les relations énergétiques entre les deux parties, et à favoriser l'intégration progressive de leurs marchés. Ce dialogue politique permet d'évoquer toutes les questions d'intérêt commun relevant du secteur énergétique, y compris l'instauration d'une coopération en matière d'économies d'énergie et de rationalisation des infrastructures de production et de transport, des possibilités d'investissements européens, ainsi que des relations entre pays producteurs et consommateurs. L'accord couvre les secteurs pétrolier, gazier et électrique. L'accent est mis sur les aspects suivants : - la refonte des monopoles naturels et l'ouverture du marché énergétique domestique à une concurrence accrue ; - l'amélioration de l'environnement économique ; - les investissements ; - la coopération dans le domaine du changement climatique et de la sûreté nucléaire. Le dialogue énergétique est central dans les échanges économiques russo-européens, au regard de la situation d'interdépendance des deux pays sur le plan énergétique. La coopération énergétique doit permettre à l'Union européenne de stabiliser sa relation avec la Russie. L'Union européenne est certes très dépendante du gaz russe, mais la Russie est plus que jamais tributaire du marché européen. L'Union européenne représente en effet 78 % des débouchés pétroliers russes et près de 90 % de ses débouchés gaziers. L'Union européenne achète près de 50 % de son gaz naturel en Russie et 20 % de son pétrole. Le facteur énergétique est donc véritablement clé pour comprendre les enjeux de la politique étrangère russe et les rapports entretenus avec l'Union européenne et ses Etats membres. L'autre sujet de la relation énergétique entre l'Union européenne et la Russie est celui de la ratification par la Russie, du Traité sur la Charte de l'énergie. L'article 45 de ce traité, signé en 1994 (189), prévoit que le Etats sont liés dès la signature sauf s'ils déclarent, au moment de la signature, qu'ils ne seront engagés qu'au moment de la ratification. Or à l'époque, la Russie de Boris Eltsine a accepté ce mécanisme d'application provisoire qui lie un Etat même en l'absence de ratification. Depuis 1994, la Russie n'a d'ailleurs pas manifesté la volonté de sortir du mécanisme d'application provisoire du Traité de la Charte de l'énergie, ce qu'elle pourrait faire par simple notification. En conséquence, la Russie est bel et bien juridiquement liée par le Traité sur la Charte de l'énergie, lequel prévoit une protection rétroactive de vingt ans pour les investissements réalisés sur son fondement. On peut penser que si la Russie retarde aujourd'hui sa ratification, c'est parce qu'elle y voit un moyen de pression sur les pays occidentaux dans la négociation sur le protocole de transit (notamment le transport du gaz) qui doit être adjoint au Traité. Au Nord : les relations avec la Norvège Bien que ne représentant que 1 % de la population européenne, la Norvège détient 60 % des ressources pétrolières de l'Europe et 40 % des ressources en gaz. 99 % de la production est exportée (190). La Norvège est le troisième exportateur mondial de pétrole et le deuxième exportateur mondial de gaz ; elle produit et exporte deux fois la consommation annuelle française de gaz. Le peuple norvégien a rejeté par référendum, à deux reprises, l'adhésion de son pays à l'Union européenne. La Norvège est toutefois membre de l'Espace Economique Européen (EEE), ce qui implique la reprise de l'ensemble de l'acquis communautaire en matière de marché intérieur, à l'exception des secteurs de l'agriculture et de la pêche. Si la Norvège semble considérer que ses intérêts sont garantis de manière satisfaisante par l'accord de l'EEE, la question se pose de savoir quelle est la part que ce pays pourrait prendre dans la mise en œuvre d'une politique européenne de l'énergie. La Norvège affiche l'ambition de rester un fournisseur énergétique majeur et fiable de l'UE. En contrepartie, elle attend des pays européens qu'ils « sécurisent » leur demande. Avec l'entrée en service du gisement de Snovhit prévue en 2007, la Norvège pourrait, notamment à travers Statoil, devenir à terme un fournisseur du marché européen comparable à Gazprom. Toutefois, le réseau de gazoducs qui relie actuellement le socle continental norvégien à l'Europe de l'Ouest étant arrivé à saturation, un renforcement des infrastructures de transport du gaz naturel serait indispensable. Au Sud : le partenariat Euro-Méditerranée Lancé en 1995, le processus de Barcelone, qui instaure un partenariat euro-méditerranéen, comporte un volet consacré à la coopération dans le secteur de l'énergie. Ce volet est stratégique, pour deux raisons majeures liées à la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union : - l'importance des pays partenaires : les pays méditerranéens profitent d'une proximité géographique avec l'Union, importateur d'énergie, et avec les pays qui exportent vers l'Union (par exemple, les pays du Golfe et du Caucase) ; - les réserves importantes de pétrole et de gaz dans certains pays partenaires, notamment l'Algérie, qui contribuent à garantir la sécurité d'approvisionnement de l'Union européenne. Un cadre de coopération a été établi à travers le « forum euro-méditerranéen de l'énergie ». Les principaux axes de la coopération concernent la réforme du cadre législatif et réglementaire, la restructuration de l'industrie énergétique, l'intégration des marchés méditerranéens et le développement des interconnexions, la promotion du développement durable et l'utilisation des énergies renouvelables. _ L'intégration d'une dimension énergétique dans la politique européenne d'aide au développement La contribution globale de l'Union européenne au titre de l'aide au développement dans le domaine de l'énergie s'élève à environ 700 millions d'euros. Les Européens se sont fixé cinq objectifs de long terme : - intégrer l'énergie comme élément horizontal des programmes d'aide au développement de l'Union européenne ; - développer le soutien institutionnel, l'assistance technique et la mise en réseau ; - développer un cadre réglementaire et des mécanismes financiers innovants afin de mobiliser les capitaux privés ; - encourager la coopération régionale ; - développer la coordination au sein de l'UE et avec d'autres organismes et bailleurs de fonds internationaux. Afin d'atteindre ces objectifs, une « initiative européenne pour l'énergie » a été lancée en 2002 lors du Sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg avec l'objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la promotion du développement durable. Il s'agit notamment de faciliter l'accès des populations des pays en développement à des services énergétiques modernes. L'Union européenne a ainsi dégagé 250 millions d'euros pour accroître l'accès des populations des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) aux services énergétiques modernes. Cette aide au développement doit avoir un effet de levier et attirer des financements issus d'autres sources. Elle repose sur quatre principes clés : la gouvernance, l'appropriation, la souplesse et l'innovation. Le 6 octobre 2006, la Commission européenne a également annoncé la création d'un Fonds mondial de capital-risque doté de 100 millions d'euros, destiné à développer l'investissement privé dans les projets de promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les pays en développement et les économies en transition. L'objectif poursuivi vise à accélérer la mise au point, le transfert et le déploiement de technologies respectueuses de l'environnement, contribuant ainsi à la stabilité de l'approvisionnement en énergie des régions les plus pauvres du monde. La Commission entend doter le Fonds d'une contribution de départ de 80 millions d'euros pour les quatre prochaines années et s'attend à ce que d'autres sources publiques et privées portent cette dotation à au moins 100 millions d'euros. A terme, ce fonds devrait permettre le financement de projets pour près d'un milliard d'euros. La politique commerciale est un outil appelé à jouer un rôle croissant. Dans son Livre vert de mars 2006, la Commission européenne propose de mieux utiliser les instruments de la politique commerciale pour promouvoir des objectifs tels que le transit non discriminatoire de l'énergie et la création d'un environnement plus sûr pour les investissements. Jusqu'à présent, les questions de l'énergie ne sont abordées qu'à la marge au sein de l'OMC, et plus particulièrement sous deux angles : - celui du commerce des services liés à l'énergie, pour lequel le niveau d'engagement en termes d'accès aux marchés est globalement assez faible. C'est ainsi que les services énergétiques n'ont pas été négociés en tant que secteur séparé durant le Cycle d'Uruguay. Quelques membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ont pris des engagements ponctuels concernant divers services liés à l'énergie, mais au niveau mondial, ces services, dans leur grande majorité, ne sont pas couverts par des engagements spécifiques au titre de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) ; - celui des questions liées aux règles de concurrence, notamment la question récurrente de la disparité entre le prix de l'énergie vendue aux industriels nationaux et le prix mondial, et des conséquences de cette disparité sur les marchés et les flux d'investissements internationaux. Les pays membres de l'OMC n'ont jusqu'à présent pris que très peu d'engagements en matière d'accès aux marchés du commerce des services liés à l'énergie. Ce faible niveau d'engagement s'explique en partie par un système de classification inadapté qui contribue à disperser les activités liées à l'énergie. Chaque secteur de négociation comporte une dimension énergétique, mais l'énergie n'est pas un secteur à part entière. Certains services liés à l'énergie transcendent la classification sectorielle. Quelques membres, dont l'Union européenne, plaident en faveur d'une révision de la classification et de la création d'un véritable secteur « Energie ». Mais il n'existe pas aujourd'hui de consensus sur ce point. Dans le cadre des négociations d'adhésion à l'OMC ou d'accords de libre-échange, les négociateurs peuvent plus particulièrement peser sur des politiques nationales discriminatoires. Ainsi, la Commission européenne a-t-elle conclu, le 21 mai 2004, un accord bilatéral avec la Russie, dans le cadre de la négociation d'accession de ce pays à l'OMC. Si l'Union européenne n'a pas pu traiter dans le cadre de sa négociation bilatérale avec la Russie la question du monopole à l'exportation de Gazprom, elle a en revanche obtenu de la Russie un certain nombre d'engagements de nature plus ou moins contraignante, sous la forme d'un soutien à la convention de Kyoto, des indications rassurantes sur les objectifs poursuivis quant à la politique de prix du gaz et sur la stratégie globale qui vise notamment à améliorer l'utilisation des ressources énergétiques en Russie. *** En raison de sa dépendance de plus en plus accentuée, l'Europe n'est pas en position de force sur l'échiquier énergétique mondial. Pour autant, l'Union européenne n'a pas vocation à demeurer un « non acteur » énergétique. Alors que l'énergie est un domaine où l'expression des souverainetés nationales empêche l'émergence - au moins à moyen terme - de toute politique intégrée au niveau européen, l'Union doit mobiliser un certain nombre de leviers internes et externes, pour autant qu'il existe une volonté politique autour d'objectifs communs. Une coopération européenne pourrait ainsi se déployer autour de trois principes structurants : sécurité, solidarité (entre les territoires et entre les générations) et subsidiarité. Plus généralement l'Europe a son mot à dire dans ce qui devrait être la mise en œuvre de nouvelles règles internationales du jeu énergétique ce qui suppose tout d'abord l'engagement d'acteurs autres que ceux qui sont aujourd'hui en première ligne. En effet, même si l'action internationale des Etats-Unis fondée largement sur la défense de leurs intérêts énergétiques est prédominante, même si l'on peut s'attendre à ce que la Chine prenant conscience de ses responsabilités au plan mondial joue un rôle croissant, même si la Russie se trouve en raison de ses richesses gazières en position de négociation favorable, l'arrivée d'acteurs nouveaux qui permettent à un nouvel équilibre de s'instaurer est souhaitable. On pourrait considérer que l'Europe est marginalisée sur cette question énergétique. L'essentiel ne se passe-t-il pas ailleurs, au Moyen-Orient, dans le golfe de Guinée, en Russie ? Les grands acteurs ne sont-ils pas aujourd'hui les Etats-Unis, le Japon, la Chine, demain l'Inde ? Notre continent semble subir les événements. En effet, sans en être l'acteur principal, l'Europe est aussi au cœur de cette crise. Elle dispose de peu de ressources. Elle est proche de la plupart des régions productrices, que ce soit le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et subsaharienne, la Russie, l'Asie centrale. De fait, elle est physiquement liée par des tubes aux continents qui l'entourent, comme sous perfusion. N'est-ce pas l'Europe qui aurait à subir le plus directement les crises qui pourraient secouer ces régions productrices dont on a souligné l'instabilité intrinsèque. On a vu, ces derniers mois, que notre continent était la destination de flux migratoires qui ne manqueraient pas de grossir en cas de crises. On sait aussi, sans lien avec ce qui vient d'être évoqué, que notre continent est particulièrement vulnérable au risque terroriste. Pourtant nous ne disposons pas de l'autorité politique et du poids stratégique des Etats-Unis ou même de la Chine. Cette faiblesse est flagrante ; on le voit vis-à-vis de la Russie. L'unique moyen pour l'Europe de peser sur le cours des événements, c'est de prôner au plan international une action équilibrée en faveur d'une coopération plus étroite entre les différents acteurs, c'est de s'impliquer dans cette démarche et de s'organiser en conséquence. Peu suspecte de tentations hégémoniques, à la différence des Etats-Unis ou de la Chine, l'Europe peut jouer ce rôle de médiateur entre plusieurs mondes, ce qui semble être finalement sa vocation. ______ CONTRE LA FATALITÉ ÉNERGÉTIQUE : Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise énergétique d'un type nouveau. Il s'agit d'une crise mondiale qui, d'une façon ou d'une autre, concerne tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique : les pays émergents tels que la Chine ou l'Inde, dont la demande énergétique connaît une accélération croissante, les pays développés, pour lesquels l'énergie constitue un secteur stratégique vital nécessaire au maintien de leur niveau de vie, les pays les plus pauvres, que la flambée des prix du baril rend de plus en plus vulnérables en menaçant la satisfaction des besoins les plus élémentaires de leurs populations. Quant aux Etats détenteurs des richesses énergétiques - qui seront à terme concentrées principalement au Moyen-Orient pour le pétrole et en Russie pour le gaz - ils ne se trouvent pas, comme on pourrait le penser a priori, dans une situation hégémonique, en raison principalement de l'état de sous-investissement et de sous-production qui caractérise la plupart d'entre eux. Satisfaire une demande intérieure et extérieure sans cesse croissante nécessite le renouvellement ou la réalisation sur le long terme - des dizaines d'années - de nouveaux investissements coûteux et à fort contenu technologique. Or le manque de stabilité politique, le défaut de fonctionnement démocratique ou de sécurité juridique qui caractérisent nombre de ces pays producteurs n'incitent pas les multinationales à procéder à ces investissements indispensables. La forte tension qui existe actuellement entre le niveau de la production mondiale et celui de la demande va par conséquent se maintenir. La crise de l'énergie se présente donc comme une crise d'autant plus durable que les autres sources d'énergie respectueuses de l'environnement ne sont pas encore produites en quantité suffisante pour remplacer avantageusement les énergies fossiles. L'énergie est porteuse, en elle-même, de crises potentielles. Elle exacerbe des rivalités souvent anciennes et plus profondes, comme on l'a vu, par exemple, pour la Chine et le Japon. Elle devient une arme de négociation, comme en Russie ou un nouveau moyen d'affirmer son existence sur la scène internationale, comme en Bolivie. Les pays producteurs reprennent en main leurs ressources ; les compagnies nationales deviennent les véritables majors mondiales ; les dispositifs militaires, américains notamment, se mettent en place pour sécuriser les routes du pétrole ; les Etats se disputent leurs frontières terrestres ou maritimes pour accroître leurs ressources ou sécuriser leur approvisionnement. A l'heure où on évoque un monde de plus en plus virtuel, la crise de l'énergie marque le retour d'une réalité physique, celle du territoire et de ses ressources. On voit ici réapparaître ce qui est au fondement de la géopolitique, au sens le plus classique , on pourrait même ajouter, le plus dur du terme, car il est ici question de rapports de force, de sécurité d'approvisionnement, de conditions d'exploitation des ressources fondamentales pour la vie ou la survie même des populations. En somme, la question énergétique sera de plus en plus à l'origine de tensions entre pays ou entre régions et d'une concurrence très vive entre compagnies pétrolières. Le simple jeu du marché peut-il mécaniquement permettre d'opérer une détente ou un rééquilibrage ? Cela est peu probable. Dans un domaine aussi stratégique que celui de l'énergie où le principe de la souveraineté étatique est constamment réaffirmé, la crise ne se réglera qu'au travers de solutions politiques. Aujourd'hui la notion d'indépendance énergétique, trop souvent assénée comme une priorité évidente, doit s'apprécier de manière beaucoup plus nuancée compte tenu, comme cela vient d'être montré, de la mondialisation de la question énergétique. Aussi faut-il plutôt partir de cette réalité d'une crise durable et globale qui révèle la très forte interdépendance entre tous les acteurs pour s'interroger sur l'alternative à laquelle chacun doit désormais faire face pour garantir sa sécurité énergétique : la confrontation ou la coopération. La réaffirmation de la souveraineté des Etats sur leurs ressources énergétiques n'est pas synonyme d'affrontements ou de conflits inéluctables entre acteurs aux intérêts divergents voire antagonistes. Il est au contraire permis de penser que les Etats vont être amenés, parce qu'ils y trouveront leur intérêt, à agir de concert. On a pu observer d'ores et déjà que des coopérations se mettaient en place, avec plus ou moins d'ambition et de succès, il est vrai. Mais l'essentiel figure dans ce mouvement qu'on constate dans le golfe de Guinée et plus largement en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Certes, les tentatives d'organisation régionale n'ont pas toujours des objectifs congruents : en Amérique du Sud, il s'agit de peser face aux Etats-Unis ; en Afrique, il est question d'éviter des tensions entre Etats ; en Europe, le but est d'être moins dépendant. On voit également que cette logique d'association touche également les compagnies pétrolières qui se réunissent souvent autour de projets communs pour exploiter des gisements. La seconde raison qui nous permet de penser que ce choix politique de la coopération sera retenu réside dans la nature même de la question énergétique. Parce que le marché est mondial, que les producteurs et les consommateurs sont enserrés dans des liens d'intérêts mutuels, mais aussi parce que les conséquences d'une crise aggravée de l'énergie sur le climat - élément déterminant pour l'opinion - sont nécessairement globales, les acteurs prennent conscience qu'une stratégie de « cavalier seul » ne peut, à terme, que mener à une impasse. En matière énergétique, nous avons tous partie liée. Néanmoins, ces coopérations ne pourront fonctionner efficacement et de manière équilibrée que si, pour les définir, on porte un regard d'ensemble sur la question de l'énergie considérée comme une question diplomatique et politique. Toute la difficulté, on l'a vu, consiste à faire la part des choses entre un sentiment diffus d'insécurité énergétique et les risques objectifs en la matière. Il n'y a pas de fatalité énergétique mais une nécessité impérieuse de prévenir les crises liées à l'énergie. En partant du constat établi dans la première partie de ce rapport, on peut avancer des propositions et des orientations susceptibles de contribuer à la définition à l'échelle du monde d'une politique globale de l'énergie. Il s'agit, en définitive, de prévenir plusieurs types de crises d'intensité variable : diplomatiques, économiques, militaires, environnementales, sociales. Eviter des crises diplomatiques, c'est avant tout prévoir des mécanismes de régulation et de coopération par l'instauration d'une procédure régulière de discussions entre Etats ou une clarification des relations entre producteurs et consommateurs (exemple de la Russie et de l'Union européenne). Prévenir une crise économique voire militaire, c'est assurer une plus grande sécurité des approvisionnements en protégeant non seulement le transport terrestre des hydrocarbures mais aussi en garantissant la sécurisation des routes maritimes, notamment le passage des détroits « d'intérêt mondial » contre les actes terroristes. C'est aussi proposer aux pays qui le souhaitent de pouvoir accéder à l'énergie nucléaire civile à travers des mécanismes internationaux qui préservent en même temps du risque de prolifération. Empêcher une crise sociale, c'est partager la ressource énergétique avec les pays les plus pauvres et les protéger contre les effets dévastateurs des variations des cours du pétrole, en mettant en place des mécanismes de stabilisation qui amortiraient ces amplitudes ou des facilités financières internationales d'accès à l'énergie Réduire le risque de crise environnementale c'est favoriser l'émergence d'une énergie propre, en finançant la recherche consacrée aux énergies renouvelables, en réintroduisant l'énergie nucléaire, en taxant les émissions de carbone, en renforçant les transferts de technologie vers les pays en développement. La Mission d'information a souhaité montrer que, dans ce contexte structurel de mondialisation des échanges et d'interdépendance énergétique entre les Etats, rien n'est inéluctable et tout est encore à la portée de la politique, c'est-à-dire de nous-mêmes. C'est dans cette perspective d'apaisement des tensions et de prévention des risques que la Mission propose un plan d'action qui doit se comprendre comme un ensemble de neuf actions à engager simultanément et qui concourent les unes et les autres à la réalisation de la « paix énergétique ». Quatre objectifs doivent être prioritairement recherchés : 1) Mener des actions au niveau européen pour faire de l'Union et des Etats membres des acteurs plus engagés, désireux d'affirmer leur poids politique et économique sur le plan énergétique. L'Europe, qui représente un marché de 450 millions de consommateurs doit pouvoir définir des priorités communes et préciser ce qu'elle attend de ses principaux fournisseurs, notamment la Russie. 2) Mieux répondre à l'impératif climatique. Sans doute pour la première fois dans l'histoire du monde, l'ensemble des Etats doit apporter une solution globale à un problème qui nous est par définition commun, celui de la dégradation de la planète par notre fait. Si l'on peut admettre qu'il n'y ait pas de règles uniformes, encore faut-il pouvoir engager avec tous les pays du monde les discussions post-Kyoto et accepter de considérer toute les filières énergétiques et notamment le nucléaire, susceptibles de faire baisser le niveau des émissions de gaz carbonique. 3) Définir de nouvelles règles du jeu international. La question de l'énergie occupe encore trop souvent une place secondaire parmi les sujets inscrits à l'ordre du jour des réunions internationales, même si l'on observe un changement récent en la matière. Cette question se pose par ailleurs en termes très différents selon les Etats, leur degré de développement, leur niveau de croissance ou leur statut de producteur ou de consommateur. Pourtant, nous l'avons montré, nos intérêts sont interdépendants. De ce fait la question énergétique doit faire l'objet d'une concertation internationale régulière. Par ailleurs, cette interdépendance se matérialise physiquement et géographiquement par les routes de l'énergie qu'il faut protéger et sécuriser. Les détroits qui constituent les points de passage de matières énergétiques les plus faibles doivent faire l'objet d'une attention et d'un statut particulier. Enfin, dans un contexte où l'énergie nucléaire suscite à nouveau l'intérêt, la France, dont le savoir-faire est incontestable, doit présenter, comme la Russie ou les Etat-Unis l'ont fait, une proposition permettant l'accès au nucléaire civil tout en maîtrisant le risque de prolifération. 4) Réduire l'inégalité d'accès à l'énergie entre les pays du Nord et ceux du Sud. La hausse du coût de l'énergie pénalise gravement les pays les plus pauvres qui subissent de plein fouet ces variations des cours. Il devient indispensable de prévoir des mécanismes correcteurs et de stabilisation qui offrent aux pays les moins développés la garantie d'accès à l'énergie à des prix stabilisés à un niveau raisonnable. L'ensemble des mesures énoncées dans le plan d'action répondent à ces quatre exigences. _______ PLAN D'ACTION POUR LA CONTRIBUTION DE LA FRANCE À LA « PAIX ÉNERGÉTIQUE » OBJECTIF : RENFORCER LA CRÉDIBILITE DE L'UNION EUROPÉENNE 1. CONCLURE UN PACTE EUROPÉEN Résumé : Face à la flambée des cours du pétrole et devant la multiplication des risques qui affectent sa sécurité d'approvisionnement, l'Europe, fortement dépendante de l'extérieur pour couvrir ses besoins énergétiques, peine à se doter d'une politique énergétique crédible. Alors que l'énergie a été au fondement de la construction européenne - avec les traités CECA et Euratom - force est de constater que l'Union européenne n'envisage les questions énergétiques que de façon incidente, essentiellement sous le prisme du marché intérieur et de la politique de concurrence. Dans une Europe élargie à vingt-sept Etats membres, il serait illusoire de prôner la mise en place d'une politique commune uniforme de l'énergie, au même titre qu'il existe une politique agricole commune. Cela n'est ni réaliste, ni souhaitable au regard du respect du principe de subsidiarité. Il faut au contraire s'engager sur la voie d'une coopération intergouvernementale entre les Etats qui en manifestent la volonté politique, sur le modèle des accords de Schengen pour la circulation des personnes. Un pacte européen de convergence énergétique, en permanence ouvert à tous les Etats membres, devrait ainsi être conclu autour de trois objectifs que sont la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement et le renforcement de la compétitivité. A travers les traités CECA (1951) et Euratom (1957), l'énergie a été l'un des fondements de la construction européenne. Ces deux traités n'ont pourtant pas donné naissance à une politique commune de l'énergie - au même titre que la politique agricole commune, par exemple - tant la maîtrise des choix énergétiques est un attribut de la souveraineté nationale. Le traité de Rome créant la Communauté économique européenne (CEE) ne comporte d'ailleurs pas de base juridique spécifiquement consacrée à la politique énergétique. Ce n'est que de façon indirecte que l'Union européenne aborde les questions énergétiques, à travers diverses compétences sectorielles relatives au marché intérieur, à la concurrence, à l'environnement, aux transports, à la fiscalité, aux réseaux transeuropéens et aux relations extérieures. Or dans le contexte géopolitique actuel d'une crise énergétique manifestement durable et globale, chacun s'accorde à reconnaître l'insuffisance de la réponse européenne. La flambée des prix de l'énergie depuis l'été 2005, associée aux problèmes d'approvisionnement constatés lors du conflit gazier entre la Russie et l'Ukraine ont marqué les opinions publiques et ont conduit les dirigeants européens, lors du sommet informel de Hampton Court d'octobre 2005, à souhaiter donner un nouvel élan à la politique européenne de l'énergie. Le 8 mars 2006, la Commission européenne a présenté un Livre vert sur la stratégie énergétique européenne. Ce document sert de base à une vaste concertation avant la présentation, probablement au début de l'année 2007, d'une série de propositions normatives. Dans ses conclusions des 23 et 24 mars 2006, le Conseil européen a préconisé « une politique énergétique pour l'Europe afin à la fois d'assurer l'efficacité de la politique communautaire, la cohésion entre les Etats membres et la cohérence entre les actions menées dans différents domaines » et a donné à la politique européenne de l'énergie l'ambition « d'atteindre, tout en les équilibrant, les trois objectifs que sont la sécurité de l'approvisionnement, la compétitivité et la viabilité environnementale ». Une fois les objectifs fixés, reste à savoir comment les atteindre. Contrairement à une idée largement répandue, l'Union européenne est loin d'être inactive dans le domaine énergétique. Les initiatives sont en effet nombreuses et concernent aussi bien la recherche d'une meilleure efficacité énergétique que le renforcement de la sécurité d'approvisionnement (à travers la constitution de stocks stratégiques nationaux), l'instauration d'un cadre communautaire pour la fiscalité des produits énergétiques et de l'électricité, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre l'effet de serre, etc. Ce n'est donc pas tant le manque d'initiatives européennes qui fait l'objet de critiques que l'absence d'une véritable stratégie coordonnée à l'échelle de l'Union. Dans quelle voie les Européens devraient-ils s'engager, sans renégociation préalable des traités, pour se donner les moyens d'une véritable politique européenne de l'énergie ? Deux écueils doivent être évités : - le premier serait celui d'une communautarisation de la politique de l'énergie qui, à ce stade, n'est ni réaliste, ni même souhaitable au regard du respect du principe de subsidiarité. En effet, s'il est un sujet sur lequel les Etats sont bien d'accord, c'est celui du respect de leur souveraineté dans la définition de leur politique énergétique. Les Etats membres ne sont pas prêts à des transferts de compétences dans un domaine où les disparités sont très importantes d'un pays à l'autre. Il faut se faire à l'idée que le caractère uniforme et règlementaire de la méthode communautaire s'appliquera de plus en plus difficilement à des domaines d'intégration mettant en jeu vingt-sept profils nationaux différents ; - le second consisterait à se contenter du recours à la « méthode ouverte de coordination », déjà expérimentée dans des domaines pour lesquels les Etats souhaitent rester maîtres des choix fondamentaux (tels que les questions d'emploi et la politique sociale), tout en partageant leurs expériences (analyse des meilleures pratiques) à travers un exercice de suivi d'indicateurs. Faute de cadre juridique réellement contraignant, cette méthode ne saurait, à elle seule, permettre de mener une politique européenne de l'énergie. Dans ces conditions, c'est le scénario d'une coopération restreinte à un nombre limité d'Etats - ceux qui en manifestent la volonté politique et souhaitent s'en donner les moyens - qui a notre préférence. Mais il faut aussitôt préciser les modalités d'une telle coopération. La construction européenne a longtemps reposé sur l'uniformité du droit communautaire et sur l'identité des droits et obligations des Etats membres. Toutefois, au fil des élargissements successifs, la nécessité de consacrer une relative flexibilité - c'est-à-dire d'accepter une intégration différenciée - s'est imposée. La réflexion sur la différenciation s'est développée, et plusieurs concepts sont apparus : la « géométrie variable », les « cercles concentriques », « noyaux durs », « avant-gardes », etc. Le Traité d'Amsterdam a institutionnalisé l'éventualité d'une Europe à « plusieurs vitesses » à travers la possibilité d'enclencher, sous certaines conditions (191), des « coopérations renforcées » entre un nombre restreint d'États membres. Le Traité de Nice a étendu à la politique étrangère (à l'exception des questions de défense) le droit de recourir à de telles coopérations. Les conditions posées rendent difficile le recours aux coopérations renforcées au point qu'aucune n'a été jusqu'à présent constituée, alors même qu'elles sont rendues possibles depuis près d'une dizaine d'années. Dès lors, un scénario plus pragmatique consisterait à envisager non pas une coopération renforcée au sens du traité, mais une coopération spécialisée, en dehors du cadre des traités européens, sur une base intergouvernementale. Des exemples existent dans l'histoire de la construction européenne, le plus emblématique étant celui des accords de Schengen du 14 juin 1985(192). Signés à l'origine par cinq Etats membres, ils ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures et renforcé ceux aux frontières externes ainsi que la coopération policière et judiciaire entre les Etats participants. Ils regroupent aujourd'hui quinze Etats et des pays non membres de l'Union y sont associés. Signe du succès de cette méthode, ce qu'il convient d'appeler « l'acquis Schengen » a finalement été intégré dans les traités communautaires, par un protocole annexé au Traité d'Amsterdam. C'est précisément cette méthode qu'il est proposé d'appliquer à la politique énergétique, dans l'hypothèse où une coopération renforcée - au sens juridique des traités - se révèlerait impossible. La création d'une telle « coopération spécialisée », théorisée par le Président Edouard Balladur (193), présente en effet l'avantage de ne pas requérir un nombre minimum d'Etats membres. Deux conditions devraient toutefois être respectées : - elle devrait en permanence rester ouverte à tous les Etats qui n'en font pas partie ; - elle devrait respecter l'acquis communautaire et ne pas contredire les politiques menées au sein de l'Union européenne. Cette initiative ne doit en effet pas être perçue comme une tentative de contournement de l'Union, mais au contraire avoir un effet d'entraînement. La coopération spécialisée en matière énergétique pourrait prendre la forme d'un protocole entre les pays concernés. L'initiative politique pourrait provenir du couple franco-allemand, dans le prolongement des conclusions du Conseil des ministres franco-allemand du 12 octobre 2006 (194). Conformément aux principes de subsidiarité, de sécurité et de solidarité, cette coopération spécialisée pourrait reprendre à son compte les objectifs fixés dans le Livre vert de la Commission européenne, à savoir la sécurité d'approvisionnement, la protection de l'environnement et le renforcement de la compétitivité. A travers une méthode progressive par étapes - à l'instar du processus qui a conduit à la création de la monnaie unique - les Etats participant à la coopération spécialisée pourraient ainsi se lier par un pacte de convergence énergétique. A titre indicatif, cinq axes prioritaires pourraient être identifiés : 1 - La définition progressive d'un bouquet énergétique commun compatible avec l'impératif climatique Si le choix de sources d'énergie relève des compétences de chaque Etat, cette décision n'est pas sans conséquences sur la sécurité énergétique des pays voisins. La mise en place d'une politique européenne de l'énergie suppose de favoriser la complémentarité des choix énergétiques des Etats membres, dans le respect de leur souveraineté. Des critères de convergence devraient être fixés au service d'objectifs supranationaux en vue notamment de prévoir une utilisation accrue des énergies renouvelables et de faire toute sa place à l'énergie nucléaire. 2 - L'instauration d'un mécanisme de solidarité en cas de rupture d'approvisionnement Dans un marché ouvert, aucun acteur n'a vocation à assurer à lui seul, la responsabilité de la sécurité de l'approvisionnement. Mis en situation de concurrence, il n'est pas certain que les fournisseurs de gaz, pour prendre cet exemple, donneront la priorité stratégique à la sécurité d'approvisionnement. Dans ce contexte, il paraît nécessaire d'aller au-delà des dispositions communautaires existantes et du mécanisme prévu dans le cadre de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui requiert l'unanimité des Etats. Il convient ainsi d'étudier la mise en œuvre de mécanismes de réaction rapide et concertée en cas de crise gazière, y compris leurs aspects commerciaux. A terme, une mise en commun des stocks stratégiques pourrait être envisagée entre les Etats participants. Ces mécanismes de solidarité devraient être étendus aux principales sources d'énergies. 3 - La mise en place d'un « serpent fiscal énergétique » Le cadre législatif communautaire en matière de taxation des produits énergétiques est défini par la directive 2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003, qui restructure la fiscalité communautaire des produits énergétiques et de l'électricité. Cette directive fixe des niveaux de taxation minimaux au-delà desquels les Etats membres sont libres de définir leurs taux nationaux, au niveau qu'ils considèrent le plus approprié. Au niveau communautaire, l'instrument fiscal présente néanmoins l'inconvénient majeur de requérir l'unanimité du Conseil, ce qui a pour effet de paralyser l'action de l'Union en la matière et de se limiter au moins-disant fiscal. Aussi, un rapprochement des fiscalités nationales pourrait être plus facilement obtenu par le biais d'une coopération spécialisée entre un nombre limité d'Etats qui s'accordent sur des objectifs communs. Les Etats concernés pourraient convenir d'affecter une part de la recette fiscale à la R&D. 4 - Le soutien à la R&D au service de la compétitivité En liaison avec les programmes communautaires de recherche et développement et avec le programme « EUREKA », les Etats membres du pacte de convergence énergétique pourraient notamment lancer entre eux des initiatives technologiques communes, le cas échéant fondées sur des partenariats public-privé, dans des domaines tels que la capture du CO2 ou la pile à hydrogène. 5 - La coordination des actions des régulateurs nationaux Actuellement, les autorités nationales de régulation du secteur de l'énergie ont des compétences différentes selon les Etats membres. Les pays participants au pacte de convergence énergétique devraient s'accorder sur une harmonisation de leurs compétences et sur une coordination de leur action. 2. ENGAGER UN PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE Résumé : La poursuite du dialogue énergétique avec la Russie est nécessaire mais il convient de l'approfondir pour parvenir à un partenariat énergétique formalisé. Ce partenariat serait un complément, et non un substitut au Traité sur la Charte de l'énergie, qui reste un instrument essentiel et doit être ratifié par la Russie. L'énormité des réserves gazières détenues par la Russie est un fait qui s'impose à tous les pays européens. La Mission ne conclut pas pour autant, comme on le lit souvent, à la nécessité de s'entendre, quoi qu'il arrive, avec la Russie, sous prétexte que nous n'aurions pas le choix. Elle propose au contraire la poursuite et l'approfondissement du dialogue énergétique avec la Russie, en vue de la conclusion d'un partenariat énergétique formalisé Union européenne (UE)-Russie, qui prenne acte de l'interdépendance mutuelle entre les deux entités. Un tel partenariat ne remet nullement en cause le Traité sur la Charte de l'énergie de 1994, qui reste un outil essentiel pour la relation énergétique entre l'Union et la Russie et doit, pour cette raison, être rapidement ratifié par la Russie. A - Le bilan du dialogue énergétique UE-Russie 1997-2007 1) A ce jour, les relations énergétiques entre l'Union européenne et la Russie sont organisées autour du dialogue énergétique engagé depuis 2000 Le dialogue énergétique entre l'Union européenne et la Russie a été établi lors du sommet bilatéral qui s'est tenu entre les deux pays, le 30 octobre 2000 à Paris. Ce dialogue permet d'évoquer toutes les questions d'intérêt commun relevant du secteur énergétique, y compris l'instauration d'une coopération en matière d'économies d'énergie et de rationalisation des infrastructures de production et de transport, des possibilités d'investissements européens, ainsi que des relations entre pays producteurs et consommateurs. Ce dialogue, établi dans le cadre juridique de l'Accord de partenariat et de coopération (APC) qui lie, depuis 1997, pour dix ans, l'Union européenne et la Russie, a pour objectifs globaux de développer les relations énergétiques entre l'UE et la Russie, de favoriser l'intégration de leurs marchés, l'objectif final étant d'avancer vers un partenariat énergétique. Il couvre les secteurs nucléaire, pétrolier, gazier et électrique. Cinq thématiques transversales ont été assignées à ce dialogue : - assurer tant la sécurité de l'offre que de la demande d'énergie ; - établir une coopération en matière d'économies d'énergie ; - rationaliser les infrastructures de production et de transport ; - mettre en avant l'importance des interconnexions des réseaux électriques ; - faciliter les investissements. 2) Ce dialogue énergétique a produit des résultats Ce dialogue a produit des résultats qui ne doivent pas être sous-estimés. Ainsi, quatre groupes thématiques ont été mis en place, qui regroupent les représentants des Etats membres de l'UE, de la Commission et de la Fédération de Russie, en vue de poursuivre la formulation de concepts sur les investissements, les infrastructures énergétiques, le rendement énergétique et les flux commerciaux. De même, une réflexion est menée sur l'établissement de relations institutionnalisées entre l'UE et la Russie dans le domaine de l'énergie. En termes sectoriels, le dialogue énergétique a porté sur les sujets suivants. En matière d'interconnexion des réseaux électriques, un groupe d'experts conjoints devrait, à la fin de l'année 2006, rendre une étude de faisabilité complète, après qu'un certain nombre de conditions ont été identifiées pour que la Russie puisse vendre de l'électricité aux Etats membres : harmonisation des normes techniques, réciprocité de l'ouverture des marchés, accordant aux entreprises de l'UE un accès équivalent au marché russe, intégration de la notion de protection de l'environnement, instauration d'un niveau élevé de sûreté nucléaire, comparable à celui qui existe dans les Etats membres de l'UE, tarification fondée sur les coûts. Dans le domaine de l'intégration des marchés, l'Union européenne revient sur la position trop dogmatique qu'elle a longtemps adoptée, défavorable aux contrats de long terme. Elle a ainsi reconnu qu'ils étaient essentiels pour le développement du marché du gaz de l'Union, qu'ils permettaient un partage des risques entre les producteurs russes et les acheteurs de l'UE, garantissant ainsi la sécurité de l'offre et celle de la demande et que, par là même, ils étaient de nature à favoriser la mise en œuvre de nouveaux projets importants de production et d'infrastructures. L'Union reste cependant attachée à ce que ces contrats respectent le droit de la concurrence communautaire et n'autorise pas pour cette raison les clauses de destination explicites, qui traditionnellement existaient (le contrat mentionne explicitement à quel pays le produit livré est destiné). On pourra s'interroger sur la justification et l'intérêt de ce choix, qui aboutit à ce que les entreprises des pays producteurs livrent le gaz à la frontière du pays concerné, ce qui n'est pas nécessairement conforme à la sécurité énergétique puisque le pays consommateur se retrouve également soumis aux aléas de l'acheminement de l'énergie. S'agissant de ce que la Russie et l'Union ont désigné comme des « projets d'intérêt commun » - connexion des oléoducs Drouzba-Adria, interconnexion des réseaux électriques et éventuellement nouveaux oléoducs pour approvisionner l'UE en réduisant la croissance du transport maritime à travers des régions écologiquement sensibles (mer Baltique) -, une étude de faisabilité est en cours au sein du Fonds européen d'investissement, afin que soit examinée la possibilité d'instaurer un mécanisme de garantie favorisant le financement à long terme de ces projets d'intérêt commun. Il s'agirait notamment de développer un système de garantie visant à offrir des prêts commerciaux à long terme (jusqu'à quinze ans) aux grands projets de production et de transport d'énergie. Pour faciliter les contacts directs entre entreprises, un groupe de pilotage sur l'énergie, composé de représentants à haut niveau de l'industrie de l'UE et de la Russie, a été mis en place. Ses objectifs sont divers : partage d'informations, utilisation du savoir et de l'expertise des entreprises pour contribuer à améliorer les conditions juridiques, administratives et financières des grands projets énergétiques communs, élaboration de recommandations spécifiques en vue d'assurer des conditions de concurrence équitables, renforcement de la dimension «entreprises» du dialogue sur l'énergie afin d'améliorer le cadre global pour un partenariat stratégique en matière d'énergie. Pour ce qui est de la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, un groupe de travail a été mis en place afin d'examiner les possibilités de coopération en matière d'amélioration du cycle du combustible, de traitement des déchets radioactifs, de non-prolifération et de comptabilité et contrôle des matières nucléaires. Dans le domaine nucléaire encore, des négociations sont en cours, depuis le printemps 2004, en vue de conclure un accord mutuellement acceptable sur la question des échanges de matières nucléaires. Les questions pétrolières sont abordées sous les angles suivants : soutien aux entreprises européennes dans le cadre de leurs politiques d'investissement, examen des possibilités d'accroître le transport de pétrole russe par oléoduc, amélioration de la sécurité maritime, association de la Russie à un système d'observation du marché de l'énergie mis en place par la Commission. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, des projets d'assistance technique financé dans le cadre de TACIS ont permis le développement de projets pilotes dans trois régions (oblasts) russes. En outre, il existe un partage des meilleures pratiques de l'UE concernant par exemple le rendement énergétique dans les secteurs de la construction et des transports, l'utilisation de combustibles de substitution ou de gaz naturel comprimé dans le secteur des transports. 3) Les résultats du dialogue énergétique sont loin d'être à la hauteur des enjeux Ces résultats sont-ils toutefois à la hauteur des enjeux ? Certes, la Commission considère qu'en quatre ans, les compagnies européennes investissant dans le secteur énergétique en Russie et celles d'origine russe rencontrant des difficultés à pénétrer le marché unique ont profité de ce dialogue. Depuis son lancement en 2000, ce cadre d'échange a également permis de résoudre d'importantes questions relatives notamment aux restrictions à l'importation de gaz et de pétrole, comme la préservation des contrats d'approvisionnement à long terme et la suppression de mesures contraires aux règles communautaires de la concurrence. Néanmoins, en six ans, on le voit, les deux interlocuteurs ne sont en effet guère allés au-delà du stade du dialogue et peu de projets concrets, qu'il s'agisse de projets de terrain ou d'accords en bonne et due forme, ont émergé. Du côté de l'Union européenne comme du côté russe, on a d'ailleurs le sentiment que ce dialogue ne fonctionne pas bien. Le décalage entre les résultats obtenus et les intérêts communs des deux parties paraît effectivement flagrant, comme le montre l'ampleur des sujets en suspens : - la coopération sur l'efficacité énergétique et le transfert de technologies, après la ratification du protocole de Kyoto par la Russie ; - le soutien aux réformes du secteur en Russie ; - la promotion du transport terrestre par pipelines ou chemins de fer; - la création d'un marché paneuropéen du gaz et de l'électricité ; - la promotion et la protection des investissements. Cette dernière question est, rappelons-le, essentielle à la préservation de la sécurité énergétique européenne alors que les besoins d'investissements russes - 735 milliards de dollars d'ici à 2030 - sont énormes. BESOINS D'INVESTISSEMENTS DE LA RUSSIE EN MATIÈRE ÉNERGÉTIQUE 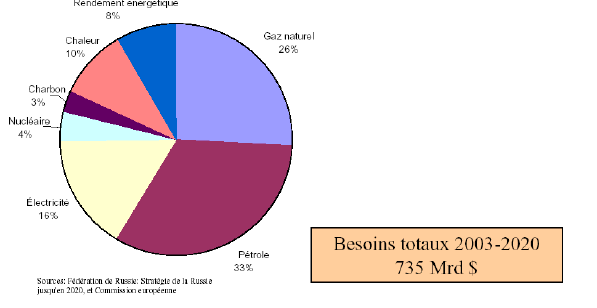 B - Conclure un partenariat énergétique d'égal à égal entre l'Union européenne et la Russie Les relations énergétiques entre l'Union européenne et la Russie doivent être décrispées et répondre aux vrais enjeux, dont on rappellera brièvement les termes : - 58 % des exportations de pétrole par la Russie ont été dirigées vers l'UE en 2003 et 88 % des exportations totales de gaz naturel par la Russie ont été adressées à des pays européens en 2003. Environ 65 % du gaz naturel exporté vers l'Europe en 2003 a été dirigé vers des membres de l'UE ; - 22 % des importations nettes totales de pétrole par l'UE en 2002 provenaient de la Russie et représentaient 16 % de la consommation totale de pétrole de l'UE ; 32 % des importations de gaz de l'UE en 2003 provenaient de Russie, c'est-à-dire 19 % de la consommation totale de gaz de l'UE. Pour qu'une relation sereine et utile s'établisse, formalisée dans un partenariat énergétique qui conclut toutes les discussions en cours sur les sujets évoqués ci-dessus, l'Union européenne doit clarifier ses objectifs vis-à-vis de la Russie, tout comme la Russie doit cesser de bluffer. Il est temps de tordre le cou au mythe qui veut que l'Union européenne soit entre les mains d'un fournisseur tout-puissant, avec lequel elle ne pourrait pas fixer les termes du débat. Aujourd'hui en effet, la relation énergétique entre l'Union européenne et la Russie est trop souvent vécue sur le mode d'une dépendance unilatérale de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, analyse non viable à moyen et long terme, ainsi que nous l'avons montré précédemment. De même, l'Union européenne doit abandonner la vision trop bureaucratique de sa relation énergétique avec la Russie pour en reconnaître la dimension géopolitique. Un discours de vérité s'impose : l'Union européenne ne doit avoir peur ni de la Russie, ni des investissements russes dans l'aval du secteur énergétique (transport et distribution) en Europe occidentale. Notamment, les appétits affichés par Gazprom ne doivent pas effrayer. Il convient à ce propos de faire la part entre la communication et la réalité des actes du côté russe. Si Gazprom affiche sa volonté de prendre sa place dans le marché de l'aval en Europe, les résultats concrets de cette démarche sont pour l'heure modestes. Hormis en Allemagne, où des investissements déjà anciens - datant de l'ère Eltsine - ont permis à l'entreprise russe de prendre 15 % du marché de la distribution du gaz, en association avec le chimiste allemand BASF, Gazprom n'a pas réalisé d'investissements lourds en Europe. Le discours de la Russie sur sa volonté de voir ses entreprises s'implanter dans l'aval du secteur de l'énergie relève donc pour l'instant surtout de l'affichage politique et de la démarche commerciale. De toute façon, comme nous l'avons montré dans la partie consacrée à la Russie, l'intérêt de Gazprom réside avant tout dans le développement de ses gisements et dans la maîtrise des grands axes d'acheminement du gaz. C'est donc à l'établissement d'un rapport de forces utile entre l'Union européenne et la Russie qu'appelle la Mission - utile, c'est-à-dire favorable à la conclusion d'un accord de partenariat énergétique, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où chacun est crispé sur des positions qui ne sont pas constructives. Le moment est favorable, alors qu'en 2007, intervient le renouvellement de l'accord de partenariat et de coopération UE-Russie conclu en 1997. A cet égard, l'Allemagne, qui présidera l'Union européenne au cours du premier semestre 2007, aura une responsabilité historique, dont le succès dépendra de sa capacité à faire la part des choses entre son intérêt national, qu'elle a choisi de faire dépendre étroitement, dans le domaine énergétique, de la Russie, et l'intérêt global de l'Union, qui consiste à rappeler avec fermeté à la Russie la réalité de l'état des lieux. Que les relations particulières entre l'Allemagne et la Russie, qui remontent loin dans le passé, conduisent la première à confier une partie importante de sa sécurité énergétique à la seconde, ne saurait avoir pour conséquence, pour l'Union européenne, de faire une lecture partielle de ses intérêts. De toute façon, les Etats membres de l'Union européenne qui ont été sous le joug soviétique, et dépendent encore largement de leur grand, et proche, voisin pour leurs approvisionnements énergétiques, ne sauraient accepter que l'Union traite avec la Russie sans lui tenir tête. C - Ne pas remettre en cause le Traité sur la Charte de l'énergie mais continuer d'en demander la ratification rapide à la Russie Dans la perspective d'un tel partenariat, faut-il continuer à chercher à obtenir de la Russie la ratification du Traité sur la Charte de l'énergie ? La Mission tient à réaffirmer l'importance majeure de ce traité conclu en 1994. Comme votre Rapporteur l'a montré dans la partie du constat consacrée à l'Union européenne, la Russie, non seulement est tenue d'appliquer ce traité, mais, en outre, le fait. C'est d'ailleurs dans le cadre des procédures instaurées par le traité que la Russie est engagée dans une démarche arbitrale concernant l'affaire Youkos... « Mieux, dans ses déclarations officielles, la Russie a affirmé à de nombreuses reprises que le traité est un élément fondamental de sa politique énergétique. C'est ce qu'a souligné par exemple Monsieur Andrei Denisov, vice- ministre russe des Affaires étrangères, en décembre 2002. » (195). Même si la Russie applique de fait ce traité, l'Union européenne doit néanmoins continuer d'en demander la ratification, afin que la Russie puisse plus difficilement revenir ses engagements. En effet, il est possible pour un Etat de sortir de l'application provisoire par une simple notification. Même si, dans une telle hypothèse, la protection juridique du traité joue encore pendant vingt ans pour le passé, politiquement, la ratification a une portée plus importante, sans compter que, juridiquement, elle donne une stabilité plus grande. OBJECTIF : MIEUX RÉPONDRE À L'IMPÉRATIF CLIMATIQUE 3. ELARGIR LE PROCESSUS DE KYOTO APRÈS 2012 Résumé : Un récent rapport de l'économiste britannique, Nicholas Stern, met en garde contre les conséquences économiques et sociales du réchauffement climatique « qui seront plus grandes que celles des deux guerres mondiales et de la crise de 1929 ». Dans un contexte de croissance continue des émissions de gaz à effet de serre, « si le protocole de Kyoto a constitué un incroyable pas en avant, ce pas est tout à fait insuffisant » comme l'a déclaré Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unies, lors de la Conférence de Nairobi qui vient de réunir l'ensemble des pays signataires de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Dans ce contexte, un élargissement du processus de Kyoto à l'ensemble des pays s'impose, à partir de 2012. La nécessité d'une mobilisation plus forte doit s'accompagner de la prise en compte, dans les mécanismes du protocole de Kyoto, de toutes les formes d'énergie, en particulier, de l'énergie nucléaire. Le protocole de Kyoto met en place un cadre à la fois ambitieux, en ce qu'il fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et limité dans la mesure où il ne porte que sur la période 2008-2012. A la défection américaine en 2001 et l'absence de participation des pays en développement aux objectifs contraignants s'ajoutent, aujourd'hui, les difficultés rencontrées par les Etats signataires à respecter leurs engagements. Certains, comme le Canada, envisagent même de se retirer du protocole, ce qui en fragiliserait incontestablement la portée. Ces éléments d'incertitudes sur l'avenir du régime multilatéral du climat, après 2012, s'inscrivent dans un contexte où, malgré les efforts engagés, les émissions mondiales de CO2 poursuivent leur croissance exponentielle. Dans ce contexte, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont appelés à être plus contraignants avec, pour les pays industrialisés, la perspective de diviser par quatre leurs émissions de CO2 d'ici 2050 (« facteur 4 »). Une plus forte mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique rend nécessaire la participation de tous les pays au processus de Kyoto ainsi que la prise en compte, dans ses mécanismes, de toutes les formes d'énergie, en particulier, l'énergie nucléaire. A - Elargir le processus de Kyoto aux principaux émetteurs de CO2 au niveau mondial Lors de la conférence de Montréal de décembre 2005, les pays signataires du protocole de Kyoto ont décidé de lancer les négociations destinées à prolonger le protocole, au-delà de 2012. Parallèlement à ce processus, un accord a été conclu pour des discussions dans le cadre, moins contraignant, de la Convention climat (CCNUCC) de 1992, auxquels des pays non signataires du protocole, comme les Etats-Unis et l'Australie, ont accepté de participer. Le déroulement de ces échanges doit être mis à profit pour créer les conditions politiques d'un accord d'ici 2009, afin d'éviter une suspension du dispositif de Kyoto, à la fin de la première période d'engagements (2008-2012). 1) Soutenir les initiatives de certains Etats et villes américaines en faveur de la réduction des émissions de CO2 En 2001, les Etats-Unis d'Amérique se sont retirés du protocole de Kyoto, en raison des coûts qui y sont associés et de l'absence de participation des pays en développement à ses mécanismes contraignants. Or, les Etats-Unis sont, de loin, le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Au-delà du niveau fédéral, il existe, en réalité, de nombreuses initiatives américaines de lutte contre le changement climatique, lancées par les Etats et les villes. La Californie - douzième émetteur mondial - a signé, fin août 2006, un accord avec le Royaume-Uni pour développer des liens entre les mécanismes de marché britanniques et californiens. Cet Etat a, par ailleurs, adopté, le 30 août 2006, le « Global warming solutions act » qui prévoit l'adoption, avant le 1er janvier 2008, de dispositions permettant de réduire de 25 % ses émissions de CO2 à l'horizon 2020, afin de retrouver leur niveau de 1990. Les Etats du Nord-Est sont également actifs dans ce domaine comme en témoigne le « Regional Greenhouse Gas Initiative » (196) aux termes duquel les Etats du Connecticut, du Delaware, du Maine, du New Hampshire, du New Jersey, de New York et du Vermont se sont engagés à réduire de 10 % leurs émissions d'ici 2019. Enfin, l'initiative lancée par le maire de Seattle, Gregory Nickels, a été signée, à la date du 26 septembre 2006, par 307 maires représentant 50 millions d'Américains. Son objectif est l'adoption, au niveau local, des « mêmes engagements » que les signataires du protocole de Kyoto. De telles initiatives témoignent d'une réelle prise de conscience de la nécessité de réduire les émissions de CO2 pour atténuer les effets du changement climatique. Si, pour l'heure, ces initiatives ne sont pas relayées au niveau fédéral, elles laissent néanmoins augurer une évolution de la position des autorités américaines qu'il faut encourager. 2) Aménager les mécanismes existants pour associer les grands pays émergents aux efforts de réduction des émissions de CO2 En vertu du principe de « responsabilité commune mais différenciée », les pays en développement sont restés en dehors du mécanisme d'encadrement par quotas d'émissions de CO2, afin de ne pas compromettre leur développement économique. Des projections de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) indiquent cependant que les pays émergents devraient représenter 55 % des émissions totales en 2025 et 70 % des augmentations d'émissions d'ici là. Les efforts de lutte contre le changement climatique, au niveau mondial, ne peuvent donc être pleinement efficaces sans une implication plus forte de ces pays dans le processus de Kyoto. Pour leur part, les pays émergents expriment une attente forte en matière de transferts de technologies, plus économes en énergie, mais ils considèrent que les mécanismes existants sont encore insuffisamment développés pour parvenir à des modes de développement plus sobres en carbone. Il convient de renforcer la coopération étatique, d'accélérer les transferts technologiques en direction des grands pays émergents et d'imaginer des modalités de participation de ces pays aux efforts de réduction des émissions de CO2, adaptées à leur situation. La fixation d'objectifs d'efficacité énergétique par pays ou la conclusion d'accords sectoriels (dans le domaine de la sidérurgie, par exemple), mesures détaillées par nos collègues de la Mission d'information sur l'effet de serre (197), pourraient constituer des pistes intéressantes. Nous considérons que ces orientations doivent être soutenues afin de parvenir, de manière concertée, à des efforts partagés de réduction des émissions de gaz à effet serre. Dans le prolongement de ces efforts de coopération, nous considérons que l'hypothèse d'un retrait du Canada du protocole de Kyoto serait extrêmement préjudiciable et recommandons une forte mobilisation pour convaincre ce pays de ne pas recourir à cette solution extrême. 3) A défaut d'accord, instituer une taxe sur le carbone des produits industriels en provenance de pays qui refuseraient de participer aux efforts communs de réduction des émissions de CO2, après 2012 A défaut d'évolution significative, une option serait d'instituer une taxe sur le carbone des produits industriels en provenance des pays qui refuseraient de s'engager en faveur du protocole de Kyoto, après 2012. Cette idée, présentée par le Premier Ministre, au terme du comité interministériel pour le développement durable du 13 novembre dernier, n'a pas encore fait l'objet de concertations au niveau européen. Toutefois, elle n'est pas entièrement nouvelle. Nos collègues de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologique (198) avaient suggéré une orientation similaire, en précisant qu'une taxe sur le carbone, pour être conforme aux règles de l'OMC, resterait limitée dans la mesure où elle « ne concernerait pas les émissions imputables à la production d'énergie, qui est la plus importante source d'émission de CO2 ». De même, nos collègues de la Mission d'information sur l'effet de serre (199) ont développé cette idée, en indiquant que : « deux raisons justifient de commencer tôt à préparer et à négocier un tel dispositif : d'une part, les investissements dans les technologies à faible émission de gaz à effet de serre sont plus faciles dès lors que les futurs outils juridiques sont connus ; d'autre part, les mécanismes d'allocation en cours de discussion ne reposent pas exclusivement sur les droits acquis à partir des niveaux d'émissions précédents mais tiennent également compte des niveaux actuels d'émissions afin de réduire les discriminations anticipées contre les nouveaux entrants. L'ajustement fiscal à la frontière pourrait donc jouer un rôle crucial dans ce processus ». L'objectif est, en effet, d'éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises des pays qui luttent contre le réchauffement climatique et celles des pays qui refusent de s'engager dans cette voie ou, comme l'a indiqué le Premier Ministre, de se prémunir contre le risque de « dumping environnemental ». Il vise aussi bien les Etats-Unis que les grands pays émergents, comme la Chine, dont les émissions de gaz carbonique pourraient dépasser celles des Etats-Unis avant 2010, d'après le rapport « Les perspectives mondiales de l'énergie en 2006 », présenté par l'AIE, le 7 novembre dernier, à Londres (200). L'idée d'une taxe sur le carbone a le mérite de poser clairement les termes du débat sur l'élargissement de l'effort de lutte contre le réchauffement climatique au plus grand nombre de pays. B - Elargir le processus de Kyoto à l'énergie nucléaire Si le protocole de Kyoto n'interdit pas de bénéficier des avantages de l'énergie nucléaire en termes de réduction des émissions de CO2, il contient, cependant, des dispositions qui conduisent à l'exclure de deux des trois mécanismes de flexibilité institués par le protocole, à savoir le Mécanisme de développement propre (MDP) et le Mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC). Dans un contexte où, malgré les efforts engagés, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent de croître, on peut s'interroger sur le maintien de cette exclusion dans le futur régime multilatéral du climat, qui doit prolonger le protocole de Kyoto, après 2012. 1) La contribution de l'énergie nucléaire à la réduction des émissions de CO2 D'après les dernières projections de l'AIE, les émissions mondiales de CO2, émanant du secteur énergétique, ont augmenté de 1,2 milliard de tonnes entre 2003 et 2004, avec une contribution du charbon à cette croissance d'environ 60 %. Représentant 26,6 milliards de tonnes, le niveau de ces émissions a enregistré une hausse de 28 % par rapport à celui de 1990, année de référence du protocole de Kyoto. L'AIE estime qu'au rythme actuel, les émissions mondiales de CO2 devraient atteindre 40 milliards de tonnes en 2030, soit une augmentation de 55 % par rapport au niveau actuel. Au-delà de cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre, l'Agence considère que le monde ne se dirige pas vers une gestion énergétique soutenable et encoure le risque d'approvisionnements perturbés. L'AIE recommande donc la mise en œuvre de politiques résolues d'amélioration de l'efficacité énergétique ainsi qu'un recours plus important au nucléaire, au cours des vingt-cinq prochaines années. Un rapport plus ancien (201) de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) démontre que l'énergie nucléaire contribue, de manière significative, à la baisse des émissions de carbone du secteur énergétique. Comparé aux autres filières, le nucléaire se situe, en effet, à un niveau similaire à celui des énergies renouvelables et très en dessous de celui des énergies fossiles, en termes d'émissions globales de la chaîne énergétique. Se référant à des travaux antérieurs de l'AIE, ce rapport relève également que sans l'énergie nucléaire, « les émissions de dioxyde de carbone des centrales seraient aujourd'hui d'environ un tiers supérieures, ce qui représente une économie annuelle de 1 200 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit 10 % des émissions totales de CO2 liées à la consommation d'énergie dans la zone OCDE ». Compte tenu de ces caractéristiques, l'AIE considère qu'un recours plus important à l'énergie nucléaire pourrait contribuer à une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre, tout en réduisant la dépendance des pays consommateurs aux énergies fossiles importées. Certains estiment, à l'inverse, que les spécificités du nucléaire, liées à la sûreté, au traitement des produits de fission et des déchets radioactifs à vie longue ainsi qu'aux risques de prolifération, ne permettent pas de considérer son exploitation comme durable. En outre, les ressources affectées à l'énergie nucléaire apparaissent disproportionnées par rapport à celles consacrées aux autres formes d'énergie. Autrement dit, son développement conduirait à un effet d'éviction préjudiciable au développement des énergies renouvelables, notamment. 2) Une option écartée pour la première période d'engagements (2008 - 2012) Le protocole de Kyoto fixe aux pays dits « de l'annexe I » des objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre. Pour remplir leurs objectifs propres de réduction, les pays concernés doivent, avant tout, fournir des efforts au plan domestique mais peuvent également recourir, de manière additionnelle, à des mécanismes de flexibilité, au nombre de trois : le système d'échanges de quotas d'émission de CO2, le mécanisme de développement propre (MDP) et la mise en œuvre conjointe (MOC). Au cours de la 6ème conférence des Parties au protocole (COP6), qui s'est tenue à La Haye, en 2000, les Parties ont convenu de reconnaître que les pays dits « de l'annexe I » (202) « doivent s'abstenir d'utiliser les unités de réductions certifiées (203) des émissions générées par des installations nucléaires pour remplir leurs engagements au titre du paragraphe 1 de l'article 3 » (204). Cette « obligation d'abstention » s'est traduite, au niveau européen, par une exclusion des crédits, associés à la construction de centrales nucléaires, du système d'échange des quotas d'émissions de CO2, à la suite de l'adoption de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, modifiée par la directive 2004/101/CE du 27 octobre 2004. Autrement dit, les installations nucléaires sont exclues du Mécanisme de développement propre (MDP), destiné à aider les pays en développement à mettre en place des projets de développement sobres en carbone, avec l'assistance financière et des transferts technologiques des pays industrialisés. Les pays industrialisés ne sont donc pas incités à participer à la mise en place d'un projet nucléaire, au titre du MDP, dans la mesure où ils ne bénéficieront pas de la possibilité d'utiliser les crédits d'émissions qui pourraient en résulter, pour remplir leurs engagements de réduction des émissions de CO2. La conception qui a prévalu, lors de l'adoption de ces dispositions, était que le Mécanisme de développement propre doit être réservé à des projets destinés à favoriser les énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité énergétique. Rappelons toutefois que, si les pays de l'annexe I ne sont pas autorisés à bénéficier des réductions de gaz à effet de serre associées à la construction de tranches nucléaires, dans les pays hors annexe I, ils restent libres d'exploiter l'énergie nucléaire chez eux pour respecter leurs engagements de Kyoto. Le rapport précité de l'AEN précise cependant que la prise en compte du nucléaire importe moins pour la première période d'engagements que pour l'après 2012 : « Même si les projets nucléaires devaient bénéficier des dispositions du MDP, il est peu probable qu'ils puissent être menés à bien et produire des unités de réduction certifiées d'ici 2012, étant donné les délais nécessaires pour les planifier et les construire. Par conséquent, l'énergie nucléaire n'a de chance de pouvoir contribuer de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du mécanisme de développement propre, qu'après la période d'engagement du protocole de Kyoto. C'est également à cette échéance que la réflexion sur la place de l'énergie nucléaire, dans une perspective de développement durable, prendra toute son importance ». 3) Une position à reconsidérer dans le cadre des négociations sur le futur régime multilatéral du climat « post 2012 » Dans un contexte où des objectifs plus sévères de réduction des émissions de CO2 devront être définis, il nous paraît nécessaire, tout comme à nos collègues de la Mission d'information sur l'effet de serre, que « (...) soit redébattue, au niveau européen, comme sur le plan international, la question de l'intégration du nucléaire dans le système des crédits Kyoto » (205). Comme l'a récemment souligné l'AIE, l'énergie nucléaire constitue une technologie compétitive, faiblement émettrice de CO2, qui pourrait utilement être prise en compte au titre des Mécanismes de développement propre (MDP) et de mise en œuvre conjointe (MOC) (206). Cette énergie peut, en effet, constituer une alternative intéressante pour les pays en transition ou les pays en développement. Certains de ces pays ont, en effet, des besoins considérables en énergie pour assurer leur développement économique. Or, cette demande (207) est susceptible d'engendrer de fortes émissions de CO2, en particulier, si les filières de production propres ne sont pas privilégiées. Ajoutons que la reconnaissance d'un projet, au titre du MDP ou du MOC, appartient au pays hôte, lors de son enregistrement auprès du secrétariat ad hoc des Nations unies. Exclure les projets nucléaires de ces mécanismes revient à limiter les effets environnementaux, sociaux et économiques de ces projets laissés à l'appréciation des pays émergents. L'ampleur des enjeux doit inciter à préserver toutes les options énergétiques. C'est pourquoi, il sera indispensable de définir un cadre adapté pour le développement de centrales nucléaires dans les pays émergents, incluant des conditions de sûreté, de sécurité et de non-prolifération maximales ainsi que des options claires pour la gestion des combustibles usés et la protection de l'environnement. En tout état de cause, il nous semble important de relancer les discussions sur l'intégration de l'énergie nucléaire dans les mécanismes de Kyoto, afin d'accroître les moyens de lutte contre le réchauffement climatique. FAIRE DE LA FRANCE UN EXEMPLE Résumé : La France est moins dépendante des énergies fossiles et émet moins de gaz à effet de serre que bon nombre de pays développés grâce à des politiques d'économie d'énergie, de diversification des fournisseurs d'hydrocarbures, ainsi que de promotion du nucléaire et des énergies renouvelables. Il lui reste néanmoins encore des progrès à accomplir pour réaliser la transition énergétique que la situation internationale rend indispensable. Les propositions récemment formulées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques visent à faire de la transition énergétique une priorité nationale, à créer une fiscalité spécifique pour financer la transition, à encourager le développement des filières alternatives à la consommation d'hydrocarbures et à impliquer davantage les collectivités locales dans la lutte contre l'effet de serre. Ces propositions transversales sont complétées par des préconisations spécifiques aux secteurs des transports d'une part, du résidentiel-tertiaire d'autre part, tous deux gros émetteurs de gaz à effet de serre. Le renforcement des engagements internationaux en matière de réduction des gaz à effet de serre est une nécessité absolue. La France doit œuvrer en ce sens, et se donner les moyens d'atteindre les objectifs qui la concernent directement. Ceux qui lui ont été attribués au niveau communautaire pour la période 2008-2012 dans le cadre du protocole de Kyoto ne sont pas très ambitieux, mais la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (208)a fixé un objectif de division par quatre des émissions françaises de gaz à effet de serre d'ici 2050. Notre pays doit aussi appliquer les différentes directives communautaires en vigueur dans ce domaine. Nous sommes au début d'un indispensable processus de transition qui doit conduire tous les pays développés à changer leurs pratiques énergétiques pour lutter contre les conséquences dommageables de la consommation sans frein d'hydrocarbures, au premier rang desquelles figurent l'émission de gaz à effet de serre et la dépendance vis-à-vis de pays producteurs souvent instables. Ce changement exige une large prise de conscience des enjeux énergétiques et climatiques et des décisions politiques volontaristes, au sein de chaque Etat. Grâce aux choix opportuns effectués à la suite du premier choc pétrolier, la France est dans une situation énergétique plus favorable que beaucoup de pays développés ; elle doit accentuer ses efforts pour consolider cette situation et devenir un exemple de réussite en matière de transition énergétique. A - Les choix faits par la France la placent d'ores et déjà dans une situation plus favorable que bon nombre de pays développés 1) Grâce au choix du nucléaire, la France est moins dépendante des hydrocarbures et moins émettrice de gaz à effet de serre que nombre de pays développés En 2005, la France a consommé 284,25 Mtep d'énergie primaire, dont 13,55 (4,77 %) proviennent du charbon, 94,75 (33,33 %) du pétrole, 40,78 (14,35 %) du gaz naturel, 117,67 (41,4 %) d'origine nucléaire et 17,5 (6,16 %) d'énergies renouvelables et déchets. En 1973, quand la consommation primaire totale était de 180 Mtep, les proportions étaient bien différentes : 15,5 % pour le charbon, 67 % pour le pétrole, 7 % pour le gaz, 4,5 % pour le nucléaire et 5 % pour les énergies renouvelables. Grâce au doublement de la part du gaz naturel, et surtout au décuplement de la production d'électricité nucléaire, la part du pétrole a été réduite de moitié, sa consommation ayant aussi chuté en valeur absolue (elle était de 121 millions de tonnes en 1973). Le taux d'indépendance de la France est ainsi passé de 22,5 % en 1973 à 48 % aujourd'hui, ce qui est supérieur à la moyenne européenne de 44 %. La part des énergies fossiles dans sa consommation primaire est limitée à 53 %, contre 87 % aux Etats-Unis. L'importance de la production d'électricité nucléaire (80 % de l'électricité produite) a pour résultat de ramener à 9 % - au lieu de 40 % à l'échelle mondiale - la part des émissions de gaz carbonique imputables à la production d'électricité, alors qu'elle était de 90 % en 1973. Parallèlement, la part des énergies fossiles dans la consommation finale d'énergie reste élevée : elle est passée de 83 % en 1973 à 73 % en 2005 (48,5 % de pétrole, 21 % de gaz naturel et 3,5 % de charbon). L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques en tire la conclusion suivante : « Si notre pays a très largement surmonté le problème des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité, son bilan en matière d'usages de l'énergie est moins convaincant. » (209). Le caractère relativement meilleur de la situation française par rapport à celle de ses partenaires européens a conduit à fixer un objectif de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Kyoto par l'Union européenne à Quinze, alors que celle-ci s'est engagée à réduire de 8 % ses émissions par rapport à l'année de base (1990 pour l'essentiel) sur la première période d'engagement du protocole (2008-2012). Les obligations imposées aux autres grandes économies européennes sont nettement plus lourdes : par exemple, l'Allemagne doit réduire ses émissions de 21 %, le Royaume-Uni de 12,5 % et l'Italie de 6,5 %. Tout en diminuant relativement sa dépendance énergétique, la France s'est efforcée, depuis le début des années 1980, de diversifier ses fournisseurs. En 2005, le gaz naturel qu'elle importait provenait ainsi de Norvège, à hauteur de 28 %, de Russie, pour 21 %, des Pays-Bas, pour 19 %, d'Algérie, à hauteur de 12 %, le reste étant fourni par d'autres pays. Sa dépendance vis-à-vis du gaz de Russie est donc nettement moins grande que celle de nombre de pays européens, et très inférieure à la moyenne européenne (la moitié du gaz consommé dans l'Union européenne vient de Russie). La politique énergétique française d'aujourd'hui repose sur deux volets principaux : le premier, et le plus ancien, vise à maîtriser la demande d'énergie en favorisant les économies, le second, plus récent si on en exclut le développement du nucléaire, s'efforce de promouvoir les énergies renouvelables comme alternatives aux hydrocarbures. 2) La politique en faveur des économies d'énergie Lancée à la suite du premier choc pétrolier, la politique en faveur des économies d'énergie poursuit deux objectifs complémentaires : la réduction des consommations d'énergie et une consommation optimale. Les modalités d'intervention des différents acteurs de cette politique sont diverses : - la sensibilisation du public sur la nécessité d'adopter des modes de consommation plus économes en énergie, par des campagnes de communication et par l'insertion de la problématique énergétique dans les programmes scolaires ; - les mesures réglementaires : la réglementation thermique, élaborée en 2000, a été renforcée pour s'appliquer aux bâtiments neufs et exiger que la performance énergétique des bâtiments soit améliorée de 15 % par rapport à la norme antérieure ; l'affichage de la consommation de carburants et des émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières est obligatoire sur les lieux de vente depuis décembre 2002 ; depuis mai 2006, les véhicules sont classés par catégorie en fonction des émissions de CO2, sur le modèle de la classification des appareils électroménagers selon leur performance énergétique ; - les mesures fiscales : la loi de finances pour 2005 a créé un crédit d'impôt plus incitatif en faveur de certains équipements de chauffage (chaudières à basse température et à condensation), de certains matériaux d'isolation thermique, des appareils de régulation de chauffage, de certains équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude fonctionnant à l'énergie solaire et des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables ou des installations de cogénération ; - les moyens d'intervention et d'études proposés par l'ADEME, ou par un certain nombre de collectivités territoriales, qui ont également des agences locales de maîtrise de l'énergie ; c'est par exemple l'ADEME qui a récemment lancé une campagne de mobilisation nationale prévue pour durer trois ans sur le thème « Faisons vite, ça chauffe ! » ; - les programmes d'économies d'énergie proposés par les opérateurs énergétiques français, comme Electricité de France ; - les grands programmes pluriannuels de l'Union européenne ; - le dispositif du certificat d'économies d'énergie, destiné à faire réaliser des économies d'énergie dans les secteurs résidentiel ou tertiaire, où les gisements sont importants mais diffus, définis dans le cadre de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique : l'Etat impose aux fournisseurs d'énergie de réaliser des économies d'énergie sur une période donnée ou de les faire réaliser par leurs clients, selon les modalités de leur choix. S'ils remplissent les engagements qu'ils ont pris, ils recevront des certificats attestant du volume d'économies réalisé ; dans le cas contraire, ils devront s'acquitter d'une pénalité auprès du Trésor public. La possibilité d'échanger ces certificats doit en outre guider les acteurs, fournisseurs d'énergie, mais aussi collectivités territoriales, vers la réalisation des économies d'énergie les plus intéressantes pour eux. Grâce aux efforts réalisés depuis plusieurs décennies, la France fait partie des pays industrialisés qui présentent l'intensité énergétique la plus faible. En France, la consommation d'énergie primaire par habitant s'établit à 4,4 tep par an, contre 1,6 tep de moyenne mondiale, mais 9 tep aux Etats-Unis. La consommation d'énergie primaire par unité de PIB s'établit à 0,19 tep/1 000 dollars ppa 95 (210) pour la France, contre 0,177 pour l'Union européenne, 0,237 pour la moyenne mondiale et 0,254 pour les Etats-Unis. Ses résultats sont meilleurs que ceux des Etats-Unis et du Canada, notamment, mais le Japon, ainsi que plusieurs de nos voisins européens obtiennent une plus grande efficacité énergétique ; des progrès sont donc encore possibles. Au cours des vingt dernières années, la France a enregistré une baisse de son intensité énergétique de 0,8 % par an en moyenne ; la loi d'orientation précitée fixe l'objectif ambitieux d'une réduction moyenne de l'intensité énergétique de 2 % par an d'ici à 2015 et de 2,5 % d'ici à 2030. 3) Les mesures de promotion des énergies renouvelables La loi d'orientation a aussi inscrit des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. Elles devraient assurer 10 % des besoins énergétiques à l'horizon 2010, grâce à des efforts dans trois directions : la production intérieure d'électricité d'origine renouvelable doit être portée de 14 % aujourd'hui à 21 % en 2010, soit une hausse de 50 % en valeur absolue ; le développement des énergies renouvelables thermiques doit permettre une hausse de 50 % de la production de chaleur d'origine renouvelable d'ici à 2010 ; l'incorporation de biocarburants et autres carburants renouvelables doit atteindre 5,75 % de la consommation de carburants au 31 décembre 2010, conformément au taux indicatif prévu par la directive européenne du 8 mai 2003 (211). Si ces objectifs témoignent d'un volontarisme certain, la France a des atouts en matière d'énergies renouvelables : elle possède des ressources hydroélectriques importantes, une des premières forêts d'Europe, un très bon gisement éolien, de vastes zones, notamment dans les départements d'outre-mer, où certaines énergies renouvelables sont moins chères à produire que l'électricité et une technique reconnue en matière d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique. La France est ainsi le premier producteur d'énergies renouvelables de l'Union européenne, devant la Suède et l'Allemagne ; avec 17,5 Mtep en 2005, elle assurait plus de 15 % du total de la production européenne. Ces énergies présentent non seulement l'avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre et d'être produites sur le territoire national, mais aussi celui d'avoir un contenu en emplois plus fort que les autres énergies. En revanche, la plupart ne sont pas rentables aux prix actuels de l'énergie, même si, sous l'effet de la hausse du prix des hydrocarbures, elles s'approchent désormais du seuil de rentabilité. C'est pourquoi la stratégie du gouvernement vise à conduire une action structurante sur l'offre, grâce à des programmes pluriannuels liant les producteurs, EDF et l'ADEME. Elle s'adapte à la situation économique des sources d'énergies visées : les aides publiques visent à faciliter le recours aux énergies renouvelables dans toutes les niches où elles sont d'ores et déjà rentables (électrification des sites isolés, solaire thermique outre-mer), à soutenir les filières pré-compétitives pour leur permettre d'accéder plus rapidement à la rentabilité économique (grand éolien raccordé au réseau, chauffage collectif au bois), à encourager la recherche sur les technologies prometteuses mais dont la rentabilité n'est espérée qu'à plus long terme (production photovoltaïque raccordée au réseau...). Très concrètement, le gouvernement français a lancé des appels d'offres qui ont conduit, en 2005, à la sélection de plus de vingt projets devant assurer une production de 600 mégawatts d'électricité d'origine renouvelable, principalement éolienne ou issue de la biomasse. Au cours de la même année, le parc éolien français a doublé pour représenter une puissance cumulée de près de 750 mégawatts, outre-mer compris. Certaines installations peuvent bénéficier, si les producteurs en font la demande, de l'obligation d'achat par EDF : il s'agit de celles qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur et de celles qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telle que la cogénération. En 2006, le gouvernement a révisé à la hausse les tarifs d'achat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, et a lancé un nouvel appel d'offres pour la cogénération à partir de la biomasse. Le soutien aux biocarburants repose sur deux instruments : - depuis le début des années 1990, ils bénéficient de taux réduits de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) qui visent à compenser une partie de la différence entre leurs coûts de production et ceux des produits pétroliers auxquels ils sont appelés à se substituer ; ce dispositif a représenté une dépense fiscale de près de 200 millions d'euros en 2005, année où la consommation de biocarburants a atteint 1 % de celle des carburants classiques (en pourcentage énergétique) ; - la loi de finances pour 2005 a institué un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes destiné à inciter les entreprises qui mettent à la consommation des produits pétroliers, à incorporer un volume global de biocarburants dans les carburants fossiles ; le taux de cette taxe est progressif et peut être réduit à due concurrence des volumes de biocarburants incorporés dans chacun des types de carburants (gazole ou essence). Devant la flambée des cours des hydrocarbures, il a été décidé d'augmenter les objectifs d'incorporation de biocarburants : le taux de 5,75 %, initialement prévu pour 2010, a été avancé à 2008 et porté à 7 % en 2010 par la loi de finances pour 2006. Un objectif de 10 % est envisagé pour 2015. Pour augmenter la production, de nouveaux appels d'offres ont été lancés (212). La France, qui a pris conscience très tôt de l'importance des enjeux liés au prix des hydrocarbures, n'a donc pas relâché son attention ; la nouvelle flambée des prix et la préoccupation environnementale l'ont conduite à renforcer ses actions d'incitation. Sans nier les résultats positifs déjà obtenus, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (213) souligne certaines incohérences et les lacunes des dispositifs en place et propose des mesures encore plus volontaristes. B - Il reste à la France des progrès à accomplir pour réussir la transition énergétique : les propositions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques formule « dix propositions pour réussir la transition énergétique », parmi lesquelles six sont purement nationales. Quatre peuvent être présentées comme transversales, tandis que les deux autres sont sectorielles. 1) Des propositions transversales, pour placer la transition énergétique au cœur des politiques publiques L'Office en appelle d'abord à une prise de conscience nationale : « La mesure des enjeux de la transition énergétique a-t-elle été réellement prise ? Au regard d'un chantier qui est de l'ampleur de la reconstruction que la France a dû mener après-guerre, on peut en douter. Le développement durable devient certes, peu à peu, une préoccupation nationale dans les discours mais la transition énergétique qu'il implique n'est pas encore perçue comme une priorité nationale urgente. » (214) Il convient de mieux coordonner l'action de l'Etat, de donner une cohérence d'ensemble et une plus grande visibilité à l'action publique. Des objectifs consensuels à moyen et long termes doivent être fixés. Pour que le changement réussisse, tous les acteurs, et notamment le grand public, doivent être informés à la fois des enjeux généraux et des moyens concrets que chacun peut mettre en œuvre pour contribuer à faire évoluer positivement la situation. Le rapport de l'Office insiste sur les avantages énergétiques, mais aussi économiques, qu'il y a à stimuler le développement des différentes filières d'énergies renouvelables, ce que nos voisins allemands ont bien compris. Ce secteur, qui emploie 150 000 personnes outre-Rhin, compte des leaders mondiaux et exporte une part importante de sa production et de son savoir-faire. La France doit aussi favoriser le développement industriel de ces filières. Conscient du coût initial de la transition énergétique, qui s'autofinancera largement à terme, l'Office propose des solutions fiscales susceptibles d'assurer le financement de la recherche-développement et du déploiement des filières de substitution. Elles corrigeraient également le régime fiscal actuel qui « se caractérise plus par une volonté d'exonérer certaines professions sensibles que par la nécessité d'établir une fiscalité correspondant aux enjeux de la transition énergétique » (215). Les deux possibilités retenues sont l'augmentation de la TIPP, solution idéale en théorie, « puisqu'elle décourage directement l'usage des fluides qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre », mais qui est socialement délicate à mettre en œuvre, et la création d'une vignette carbone, dont seraient redevables tous les véhicules à moteur, y compris les deux roues, en fonction de leurs émissions de CO2. Cette nouvelle taxe pourrait assurer une ressource de 2 milliards d'euros dès 2007, alors que l'augmentation de la TIPP devrait être progressive - une hausse supérieure à 2 % par an n'étant guère envisageable -, mais pourrait rapporter 5 milliards de plus qu'aujourd'hui au bout de dix ans. Enfin, il est proposé de faire davantage participer les collectivités locales à la lutte contre l'effet de serre, en incluant le développement durable dans les contrats de plan Etat-régions, en proposant des bonifications d'intérêt aux investissements des collectivités effectués dans le domaine de la lutte contre l'effet de serre, et en modulant les dotations accordées aux collectivités en fonction des politiques qu'elles mènent dans ce domaine. Rédigé par deux sénateurs, le rapport met l'accent sur la sensibilité de cette dernière proposition « qui ne pourra être mise en œuvre qu'après une large concertation avec l'ensemble des collectivités intéressées » (216). Mais le seul fait qu'elle ait été formulée témoigne d'une évolution favorable des esprits en faveur d'une mesure de ce type, présentée comme conforme à l'équité entre les collectivités qui consentent des efforts pour lutter contre l'effet de serre et celles qui restent inactives dans ce domaine.
2) Des propositions spécifiques pour deux secteurs clés Ces propositions générales sont complétées par des propositions spécifiques aux deux premiers secteurs consommateurs : les transports, qui sont responsables de plus de 30 % de la consommation finale française d'énergie (contre 20 % en 1973), presque exclusivement d'origine pétrolière, et le secteur résidentiel-tertiaire, qui en représente 42 % (comme en 1973). Les premiers sont à l'origine du quart des émissions de dioxyde de carbone dans le monde, le second du tiers. Pour ce qui concerne le secteur des transports, le rapport de l'Office souligne la rigidité des utilisations de l'automobile, mais aussi les facteurs favorables à une action dans ce domaine : d'une part, la hausse du prix du pétrole, d'autre part, l'existence de solutions technologiques d'ores et déjà utilisables, comme les biocarburants, proches de la maturité, à l'exemple de l'hybridation ou des motorisations plus économes en carburant, ou émergentes, comme la voiture électrique. Il est donc proposé de recourir de manière spécifique à la normalisation et à la fiscalité pour accélérer le déploiement des nouvelles technologies moins consommatrices d'énergie ou émettant moins de gaz à effet de serre. L'Office suggère aussi d'infléchir la pratique sociale de l'automobile, jugée « quelquefois abusive et souvent inutile » (217), en expérimentant différentes solutions alternatives à l'utilisation de l'automobile. Par exemple, il conseille que soient examinées les conditions dans lesquelles on pourrait développer le ferroutage massif des véhicules individuels à l'occasion des congés d'hiver, d'été ou des ponts. Dans le secteur résidentiel-tertiaire, il existe déjà une réglementation thermique qui a permis d'améliorer l'efficacité énergétique des logements et des bureaux, mais le rapport de l'Office insiste sur la nécessité d'amplifier cette action. En effet, l'ADEME a estimé entre 400 et 600 milliards d'euros le coût des travaux à réaliser pour diviser par trois la consommation du parc de logements existant ; la construction de logements, actuellement dynamique, s'effectue sur la base de normes qui seront dépassées dans quinze ans, alors que les constructions doivent durer au moins un siècle ; le développement de l'urbanisme pavillonnaire périurbain contraint les habitants à un usage quotidien de l'automobile et conduit à la multiplication de maisons individuelles auxquelles s'appliquent des normes d'isolation moins strictes que pour les immeubles collectifs ; les consommations d'électricité spécifiques des produits électroménagers, informatiques et audiovisuels augmentent. Les propositions formulées par l'Office visent donc à favoriser l'anticipation des règles futures, plus contraignantes, dans la construction de logements et de bureaux. Le niveau des subventions attribuées à la construction de logements sociaux serait liée à leur performance énergétique ; les constructeurs pourraient bénéficier de dérogations aux coefficients d'occupation des sols lorsqu'ils appliqueraient des normes plus strictes que celles actuellement en vigueur ; la formation et l'indépendance des techniciens chargés de délivrer les certificats d'efficacité énergétique (218) devraient être mieux assurées. Pour favoriser l'amélioration de l'efficacité énergétique des logements existants, un système de préfinancement des travaux pourrait être créé en recourant à des comptes ou des plans d'épargne bénéficiant de bonification d'intérêts ; le crédit d'impôt déjà applicable aux dépenses de gros équipements, d'équipements de production d'énergies renouvelables et de matériaux d'isolation thermique pourrait être amélioré par l'augmentation de son volume et des taux de déductibilité, par son extension aux résidences secondaires et par son application aux dépenses d'installation des équipements. Il est enfin proposé de durcir les normes applicables aux appareils d'éclairage, électroménagers, audiovisuels et informatiques, dans la mesure où des technologies permettant d'économiser l'énergie sont disponibles.
La Mission estime que ces propositions sont à la fois ambitieuses et réalistes. Outre l'intérêt de chacune d'entre elles, elles présentent globalement l'avantage de prévoir des mécanismes de financement susceptibles d'avoir aussi un effet positif direct sur la consommation d'énergies fossiles et le mérite de pouvoir bénéficier d'un consensus politique. Si l'objet du présent rapport n'était pas d'élaborer des propositions d'actions internes à notre pays, la Mission se rallie sans réserve à celles que l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a formulées. Face à l'importance des enjeux énergétiques et climatiques, chaque pays, développé ou en développement, doit mener des politiques intérieures visant à maîtriser sa consommation d'énergie et à développer les sources d'énergie substituables aux hydrocarbures. Depuis plus de trente ans, la France a montré que cela était possible ; elle doit aujourd'hui accentuer ses efforts et devenir un exemple pour les autres pays. Pour ce faire, la France devrait traduire dans ses structures administratives la dimension géopolitique et l'interdépendance des questions liées à l'économie, l'environnement et l'énergie. C'est dans cette perspective que votre Rapporteur a préconisé, lors du débat budgétaire, la mise en place d'une direction des affaires globales, chargée, au sein du ministère des Affaires étrangères, de traiter de ces problèmes dans leur ensemble. On observe par ailleurs un mouvement général dans les pays développés, marqué par la prise en compte des objectifs de la politique énergétique et environnementale dans les dispositifs fiscaux. Votre Rapporteur se demande dans quelle mesure ce type de fiscalité, appelé à se développer, si nous voulons respecter nos engagements internationaux en matière environnementale, ne va pas bouleverser l'approche traditionnelle des prélèvements obligatoires largement assis sur le travail dans les pays développés. OBJECTIF : DÉFINIR LES NOUVELLES RÈGLES INTERNATIONALES DU JEU ÉNERGÉTIQUE 5. UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L'ÉNERGIE Résumé : La nouvelle donne énergétique, marquée par une interdépendance croissante entre pays producteurs et pays consommateurs, vient renforcer la nécessité d'échanges sur les questions liées à l'énergie. De nombreuses initiatives en ce sens ont été lancées sans aboutir, pour autant, à une réelle gouvernance mondiale de l'énergie. Face à la multiplication des rencontres et des enceintes, seules les réunions du G8 bénéficient d'une réelle visibilité. Afin de tenir compte de cette réalité et d'éviter d'ajouter une structure supplémentaire aux multiples qui existent déjà, chaque réunion du G8 devrait être systématiquement précédée d'une conférence internationale sur l'énergie. La période actuelle de transition énergétique soulève une série d'interrogations autour de trois préoccupations majeures : la sécurité énergétique, le développement économique et la protection de l'environnement. Décrits comme les « 3 E » (219), ces aspects, désormais indissociables, sont à l'origine de ce que d'aucuns considèrent comme un « nouveau paradigme économique ». La nature mondiale de ces interrogations et l'interdépendance croissante entre pays producteurs et pays consommateurs viennent renforcer la nécessité d'échanges et de partenariats entre toutes les parties prenantes. Depuis le début de la décennie 1990, la communauté internationale tend à se mobiliser, à travers une multitude d'initiatives aux plans intergouvernemental et régional mais aussi au sein d'organisations multilatérales. Battant en brèche la logique de confrontation qui avait dominé lors des deux chocs pétroliers des années 1970, une nouvelle forme de dialogue s'instaure qui tente à la fois d'intégrer les dimensions « énergie » et « climat » et d'associer les pays consommateurs et les pays producteurs. Les rencontres se multiplient à différents niveaux comme l'illustre le recensement ci-après des réunions qui se sont tenues, au premier semestre 2006, avant le G8 de Saint Petersbourg (220) : - la session spéciale du conseil de gouvernance du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), en février à Dubaï, qui a notamment traité du thème « énergie et environnement pour le développement » ; - le Xème Forum international de l'énergie (FIE) qui a réuni quelque 70 ministres de l'énergie des pays producteurs et consommateurs, à Doha, en avril ; - la 14ème session de la Commission du développement durable des Nations unies, dont la réunion ministérielle, qui s'est tenue à New York, début mai, a examiné plus particulièrement la problématique de l'énergie et de l'industrie dans une perspective de développement durable ; - l'annonce, par la Commission européenne, de la publication d'un nouveau Livre vert sur le thème : « Pour une politique énergétique européenne sûre, durable et compétitive » ; - enfin, le début des réunions des groupes, prévus lors de la Conférence de Montréal de décembre 2005, entre pays industrialisés et pays en développement, destinés à examiner les différentes solutions concernant les émissions de gaz à effet de serre, pour la période post-2012 (221). Cette énumération, loin d'être exhaustive, montre que les approches restent relativement cloisonnées même si les problématiques énergétique, d'une part, et environnementale, d'autre part, ne s'ignorent plus. En outre, les rencontres organisées sur les questions énergétiques paraissent beaucoup moins visibles que celles relatives aux changements climatiques, sans doute en raison d'une moins grande sensibilisation de l'opinion publique à ces aspects. Au-delà de la prise de conscience qui se manifeste et des déclarations d'intention, ce foisonnement d'initiatives pose la question du renforcement de la gouvernance internationale de l'énergie. DE LA CONFRONTATION AU DIALOGUE : LA MULTIPLICATION DES INITIATIVES ET Le besoin d'échanges et de partage des diagnostics dans le domaine de l'énergie est ancien. En 1923, des experts et techniciens ont ressenti la nécessité de se réunir régulièrement et suscité la création du Conseil mondial de l'énergie (222). Organisation non gouvernementale, agréée par l'Organisation des Nations unies, ce Conseil est constitué de comités nationaux, représentant près de 100 pays dans le monde entier, et composés de dirigeants du secteur énergétique. S'intéressant à toutes les énergies, le Conseil fonctionne par cycles de travail de trois ans, qui se concluent par un Congrès mondial de l'énergie, réunissant environ 5 000 délégués (223). L'approche globale, promue par le Conseil mondial de l'énergie, n'est cependant pas celle qui a dominé la scène énergétique mondiale, marquée par des bouleversements majeurs depuis les années soixante. 1) Les « héritiers » des chocs pétroliers : l'OPEP et l'AIE Comme cela a été précédemment évoqué, le marché de l'énergie a été dominé, au cours des années 1960 et 1970, par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), cartel de pays producteurs de pétrole, qui, en décidant la hausse brutale du prix du pétrole en 1973, est à l'origine du premier choc pétrolier. En 1982, le cartel a institué un système de quotas visant à éviter la surproduction et l'effondrement consécutif des prix du pétrole. L'abandon de cette politique, en 1986, a provoqué un contre-choc pétrolier, avec une chute du prix du baril à 10 dollars. L'OPEP, qui concentre les trois-quarts des réserves pétrolières mondiales, reste un acteur avec lequel il faut compter. Toutefois, les capacités de production de ses membres (224), légèrement excédentaires par rapport à une demande en forte croissance, ne lui permettent plus de jouer un rôle aussi décisif que par le passé. Face aux décisions de l'OPEP pendant la première crise pétrolière, les pays industrialisés consommateurs ont cherché à s'organiser en créant, en 1974, à l'initiative de Henry Kissinger, l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette agence avait initialement pour mission de coordonner les mesures à prendre en temps de crise des approvisionnements pétroliers. Cette mission demeure, puisque l'agence a été conduite à utiliser ses stocks stratégiques, après le passage de l'ouragan Katrina aux Etats-Unis. L'AIE, qui fonctionne dans le cadre de l'OCDE, compte aujourd'hui 26 pays, dont la France depuis 1992. Ces événements, brièvement retracés, illustrent la logique conflictuelle entre pays producteurs et pays consommateurs qui a longtemps dominé la scène énergétique mondiale, autour des enjeux pétroliers. A l'heure actuelle, l'AIE et l'OPEP restent des acteurs importants mais, si les divergences d'intérêts demeurent, les stratégies ont changé pour s'adapter à la nouvelle donne énergétique. Ainsi, le mandat de l'AIE s'est élargi et l'Agence traite désormais aussi bien des politiques climatiques que de la réforme des marchés et de la coopération en matière de technologies de l'énergie. Les deux organisations dialoguent mais restent animées par des logiques propres, qu'il importe de dépasser pour parvenir à un renforcement de la gouvernance mondiale de l'énergie, au bénéfice de l'ensemble des pays. 2) Les initiatives régionales Au niveau régional, la plupart des Etats ont éprouvé le besoin d'instituer une enceinte de discussions et d'échanges sur les questions énergétiques, comme en témoignent les activités de l'Organisation latino-américaine de l'énergie (OLADE) ou de la Commission africaine de l'énergie (l'AFREC, créée en 2001). En Europe, de telles préoccupations se sont exprimées, très tôt, avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), en 1950, puis, de la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM), en 1957. A l'heure actuelle, l'Union européenne multiplie les initiatives en vue de garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques tout en encourageant le développement de technologies « propres », respectueuses de l'environnement. D'une part, un récent Livre vert (225) de la Commission européenne, intitulé « une stratégie européenne pour une énergie sûre, propre, compétitive et durable » a proposé la mise en place d'un observatoire européen de l'approvisionnement énergétique et la définition d'une politique énergétique extérieure commune. D'autre part, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, souscrit dans le cadre du protocole de Kyoto, a été réparti entre les Etats membres, tandis qu'un système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre a été mis en place en 2003 et fonctionne effectivement depuis le 1er janvier 2005. Par ailleurs, le traité créant une « Communauté européenne de l'énergie » entré en vigueur en 2006, est ouvert à tout pays désireux d'accepter les règles du marché de l'énergie de l'Union ayant des liens physiques directs avec les réseaux électriques et gaziers de l'Union européenne. Ses membres actuels sont l'Union européenne (les 25 et bientôt 27 Etats membres), la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Montenegro, l'Albanie, la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (UNMIK), l'ancienne République Yougoslave de Macédoine. La Turquie, l'Ukraine, la Moldavie et la Norvège viennent d'accéder au statut d'observateur. Ces différentes initiatives attestent de la place centrale qu'occupent les questions énergétiques dans le dialogue régional ainsi que des efforts de coordination dans le domaine. 3) Les initiatives et instances de dialogue sur l'énergie au plan mondial A la fin des années 1980, l'idée d'un dialogue entre producteurs et consommateurs de pétrole a pris forme à la suite de la publication du rapport Brundtland (226) et, surtout, de la première guerre du Golfe. Soutenue par la France, la Norvège et le Venezuela, elle s'est concrétisée par un premier séminaire ministériel, qui s'est tenu, à Paris, en 1991. L'intérêt de ces échanges a conduit à des rencontres régulières, dans le cadre du Forum international de l'énergie (FIE), à partir de 2000. Ce Forum, qui s'est doté, fin 2003, d'un secrétariat permanent, basé à Riyad, est un lieu d'échanges informels, au niveau politique, qui se réunit tous les deux ans (227). Il réunit les ministres d'une soixantaine de pays producteurs et consommateurs, industrialisés et en développement, ainsi que les dirigeants d'institutions multilatérales comme l'AIE, l'OPEP, etc. Les réunions du FIE ont notamment permis de lancer l'initiative commune sur les données pétrolières (JODI (228)) afin de parvenir à une certaine transparence sur les données de production et de consommation. Un des objectifs de cette initiative est l'élaboration de normes mondiales de déclaration des réserves de pétrole mais aussi d'autres sources d'énergie. Parallèlement à ces travaux de standardisation des données pétrolières, les efforts ont également porté sur le renforcement de la transparence de la gestion des recettes publiques, provenant des exportations de produits énergétiques. Lors du sommet d'Evian, en juin 2003, les pays du G8 ont accepté l'Initiative sur la transparence dans les industries extractives (EITI (229)), présentée en septembre 2002, à l'initiative du Royaume-Uni, au Sommet mondial sur le développement durable. Les principaux engagements pris par les pays adhérant à l'EITI sont les suivants (230) : - les entreprises extractives doivent régulièrement publier l'ensemble de leurs transactions financières avec l'Etat ; - l'Etat doit, pour sa part, publier le montant des recettes tirées de l'ensemble des industries extractives ; - les comptes des entreprises concernées doivent être soumis à un audit indépendant, appliquant une norme internationale (cette mesure inclut les entreprises publiques) ; - un plan de financement pour le développement doit être établi par les Etats avec, en tant que de besoin, l'appui des institutions financières internationales ; - la société civile doit être associée au processus. Au 31 mai 2006, l'EITI regroupait 22 pays dont 14 d'Afrique sub-saharienne. Cette initiative s'est accompagnée de la publication d'un guide du FMI sur la transparence des recettes générées par les ressources naturelles. Au plan institutionnel, le Traité sur la Charte de l'Energie de 1994 (231) constitue le principal instrument multilatéral destiné à favoriser les investissements dans les installations pétrolières et gazières, en prévoyant une protection juridique, sur une période de vingt ans. Ratifié par près de cinquante Etats à ce jour et entré en vigueur en avril 1998, ce Traité ajoute une sanction juridique aux protections habituellement accordées aux investisseurs qui estiment que leurs droits n'ont pas été respectés : en cas de différend, la partie lésée peut, en effet, saisir un tribunal arbitral pour faire constater la violation du Traité, exiger une juste indemnisation et engager la responsabilité internationale de l'Etat concerné (232). Au-delà de la protection des investissements et des modalités de règlement des litiges, les dispositions les plus importantes du Traité portent sur le commerce des matières et des produits énergétiques ainsi que le transit. Ce Traité prévoit, par ailleurs, que les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'appliquent au commerce lié à l'énergie avec et entre les pays non membres de l'OMC, qui sont parties au Traité. Le contrôle de l'application des dispositions du Traité relève de la Conférence de la Charte de l'énergie, organisation intergouvernementale qui regroupe les Etats ayant ratifié le Traité. Si ces différentes initiatives témoignent d'une réelle mobilisation de la communauté internationale pour traiter des questions énergétiques, celles-ci, privilégiant les rencontres de haut niveau ou entre experts, restent cependant assez confidentielles et ne permettent pas véritablement de répondre aux principaux besoins, comme par exemple un plus large accès à l'énergie. En outre, si la dimension environnementale est systématiquement évoquée, l'accès aux ressources fossiles reste la priorité des Etats, ce qui pose la question d'un renforcement du lien entre les questions énergétiques, d'une part, et les questions environnementales, d'autre part. En réalité, seules les réunions du G8, au cours desquelles les déclarations ou engagements politiques exprimés constituent des références, bénéficient d'une réelle visibilité, comme en témoigne l'adoption du « plan d'action sur le changement climatique, l'énergie propre et le développement durable », lors du sommet de Gleneagles, en 2005. Le dialogue sur les questions énergétiques ne peut cependant pas se limiter à cette enceinte, par nature, restreinte. Afin de tenir compte de cette réalité et d'éviter d'ajouter une structure supplémentaire aux multiples qui existent déjà, chaque réunion du G8 devrait être systématiquement précédée d'une conférence internationale sur l'énergie. L'organisation de cette conférence pèserait sur les pays du G8, préalablement à leur réunion. La conférence internationale sur l'énergie regrouperait le plus grand nombre d'Etats afin d'encourager un dialogue approfondi entre pays consommateurs, pays producteurs, pays de transit et pays dont les économies sont particulièrement vulnérables aux chocs énergétiques. Contrairement au Forum international de l'énergie (FIE), très concentré sur les enjeux pétroliers, cette conférence serait appelée à s'intéresser à toutes les formes d'énergie : charbon, pétrole, gaz naturel, énergie nucléaire, hydraulique et énergies renouvelables et traiterait des trois questions suivantes : la sécurité énergétique mondiale, la préservation de l'environnement et la réduction de la pauvreté énergétique. Les principales conclusions de cette conférence seraient inscrites à l'ordre du jour de G8 afin qu'elles soient prises en compte et bénéficient de la visibilité de ces rencontres. 6. CRÉER DES CONSORTIUMS INTERNATIONAUX POUR L'ENRICHISSEMENT ET LE RETRAITEMENT Résumé : Dans un contexte de regain d'intérêt pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à travers le monde, plusieurs propositions ont été faites, notamment par les Etats-Unis et par la Russie, afin de répondre à la question de la conciliation entre développement de l'énergie nucléaire civile et lutte contre la prolifération nucléaire. Compte tenu de sa place dans le paysage international du nucléaire civil et de son rôle majeur dans la lutte contre la prolifération nucléaire, la France doit élaborer sa propre proposition de création de consortiums internationaux. Une proposition structurée autour des trois axes : ouverture, sécurité et concurrence. L'augmentation prévisible de la demande énergétique est indissociable d'un recours accru à l'énergie nucléaire. Ce retour en grâce du nucléaire, décrit dans la première partie du rapport, pose la question de la conciliation entre l'impératif de la non-prolifération nucléaire et le respect du droit « inaliénable » de tous les Etats à « développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire », pour reprendre les dispositions de l'article IV du Traité de non-prolifération (TNP). Si cette préoccupation a toujours existé depuis que nous sommes entrés dans l'âge nucléaire, elle est devenue particulièrement aiguë à l'heure où le régime de non-prolifération nucléaire est sérieusement menacé par l'Iran. Alors que ce pays se targue d'un droit spécifique à l'enrichissement que reconnaîtrait le TNP - alors même qu'il n'existe nullement pour qui lit attentivement le TNP et qu'il a été explicitement dénié aux Etats, à quatre reprises en 1967 et 1968, lors des négociations de ce Traité -, il est impératif de définir les solutions permettant de satisfaire les besoins mondiaux en énergie sans risque de prolifération et d'accès aux technologies sensibles d'Etats ou de groupes non étatiques qui pourraient menacer la stabilité internationale. A - La renaissance de l'énergie nucléaire : un défi pour la sécurité internationale Le monde est aujourd'hui confronté à un redoutable dilemme. Dans une perspective de sécurité énergétique et de sécurité climatique, la renaissance de l'énergie nucléaire apparaît comme une conséquence inéluctable de la raréfaction prévisible des ressources en hydrocarbures, de la volonté, universellement affichée par les Etats, de diversification de leur bouquet énergétique et de l'impératif de lutte contre le changement climatique dû à l'émission de gaz à effet de serre. Dans le même temps, la sécurité et la stabilité internationale sont menacées par un Etat, l'Iran, qui, au nom du droit aux bénéfices de l'énergie nucléaire, mène un programme nucléaire civil dont l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) n'est pas en mesure de garantir la conformité aux engagements internationaux de l'Iran de ne pas développer l'arme nucléaire. Il apparaît dans ce contexte que le recours durable à l'énergie nucléaire, acceptable par les Etats et par les peuples, est soumis à trois conditions : - le respect des impératifs de non-prolifération ; - le respect des impératifs de sûreté et de sécurité ; - un accès non discriminatoire aux bénéfices de l'énergie nucléaire pacifique, comme le mentionne explicitement le TNP. B - Plusieurs propositions ont été lancées afin de répondre à la question de la conciliation entre développement de l'énergie nucléaire civile et lutte contre la prolifération nucléaire Afin de résoudre cette équation complexe, deux propositions importantes ont été faites par les Etats-Unis et la Russie, ayant en commun la mise en œuvre d'une coopération internationale entre, d'un côté, des pays qui maîtriseraient l'ensemble du cycle du combustible, et, de l'autre, des pays qui pourraient bénéficier des services du cycle du combustible, sans pour autant disposer, chez eux, de la maîtrise de ces technologiques. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) réfléchit également à une solution efficace pour concilier ces impératifs. 1) L'initiative américaine de Partenariat global pour l'énergie nucléaire (Global Nuclear Energy Partnership ou GNEP) Dans son discours sur l'état de l'Union de janvier 2006, le Président George W. Bush a pris l'engagement de réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis des combustibles fossiles. Il a insisté sur l'importance de développer des sources d'énergie propres mais à des prix abordables, non seulement pour les Etats-Unis et leurs partenaires mais aussi pour l'ensemble de la planète. Dans ce cadre, le 6 février 2006, les Etats-Unis ont présenté une stratégie d'ensemble visant à « favoriser au niveau mondial le développement d'une énergie sans gaz à effet de serre en démontrant l'apport et en favorisant l'introduction de nouvelles technologies pour recycler le combustible nucléaire et réduire les déchets. Elle doit (aussi) nous permettre d'améliorer notre capacité à garder les technologies et matériaux nucléaires hors de portée des terroristes. » (233) Ce « Partenariat global pour l'énergie nucléaire » (GNEP) vise aussi bien à favoriser la reprise du programme nucléaire américain qu'à encadrer la renaissance des projets nucléaires dans le monde, en vue de leur compatibilité avec la non-prolifération. Y figurent ainsi les mesures suivantes : - construction d'une nouvelle génération de centrales nucléaires aux Etats-Unis ; - développement et mise en place de nouvelles technologies de recyclage du combustible nucléaire ; - traitement efficace du combustible nucléaire usé et à terme stockage aux Etats-Unis ; - conception de réacteurs avancés pour la transmutation des déchets (Advanced Burner Reactors) produisant de l'énergie à partir de combustible nucléaire recyclé ; - établissement d'un programme de mise à disposition de combustible nucléaire permettant aux pays en développement d'acquérir et d'utiliser l'énergie nucléaire économiquement tout en minimisant le risque de prolifération nucléaire ; - développement et construction de petits réacteurs conçus pour les besoins des pays en développement ; - amélioration des garanties de sécurité pour permettre une meilleure résistance à la prolifération et une plus grande sûreté dans l'utilisation accrue de l'énergie nucléaire. En présentant cette initiative, le Secrétaire américain à l'Energie a ainsi résumé le projet des Etats-Unis : « Le GNEP apporte aux économies émergentes sur l'ensemble de la planète la promesse d'une énergie virtuellement sans limites dans le respect de l'environnement tout en réduisant la menace de prolifération nucléaire. Si nous réussissons à faire du GNEP une réalité, nous pourrons faire de la planète un endroit meilleur, plus propre et plus sûr. » Ce projet, doté pour l'année budgétaire (depuis le 1er octobre au sens américain du terme) d'un modeste budget de 250 millions de dollars, mais qui devrait massivement augmenter dans les trois années à venir, est présenté sous la forme d'un partenariat ouvert. Les pays qui sont dotés de centrales nucléaires, notamment la Chine, la France, le Japon, le Royaume-Uni, la Russie et peut-être, plus tard, l'Inde sont mentionnés comme susceptibles de participer au GNEP. 2) L'initiative Poutine de création de centres internationaux du combustible nucléaire Dans la droite ligne de l'initiative américaine, la Russie, par la voix du Président Vladimir Poutine, a proposé la création, en Russie notamment, de centres internationaux du cycle du combustible nucléaire, qui offriraient des services pour la fabrication, la fourniture et le traitement de combustibles nucléaires, y compris l'enrichissement de l'uranium et le retraitement de combustibles usés. Pour le dire autrement, l'enrichissement et le retraitement présentant des risques, la Russie propose d'« internationaliser » ces deux phases, en développant des infrastructures fiables en Russie, mais aussi en France ou au Japon. Ces usines, à finalité exclusivement civile, seraient placées sous le contrôle de l'AIEA et pourraient être construites avec la participation financière du pays utilisateur. La proposition russe concerne également le traitement des déchets. Cette initiative, inspirée des solutions qui ont été envisagées par la Russie pour répondre au cas de l'Iran, pourrait s'appliquer à tous les pays non nucléaires intéressés. Les conditions de l'initiative Poutine sur la création de centres internationaux du combustible nucléaire sont encore peu documentées. Il est néanmoins possible de souligner à ce stade les différences entre les initiatives américaine et russe. Dans une approche de compromis par rapport à la proposition américaine de GNEP, qui ne concerne que des stocks garantis d'uranium, la vision russe comporte un réseau de centres internationaux d'enrichissement, accueillant des pays tiers investisseurs, et auprès desquels seront situés des stocks intermédiaires d'uranium enrichi, propriété des centres internationaux. Cet uranium serait livré aux pays tiers après accord de l'AIEA. En outre, une particularité de la proposition russe est de proposer, en complément, la création de centres de formation et de certification des personnels des clients. Enfin, la Russie propose la création, sur le modèle du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), de centres d'étude de nouvelles technologies, qui pourraient être construits sur une base multilatérale ou bilatérale. 3) Le projet de l'AIEA d'une banque internationale de combustible De son côté, l'AIEA, a commencé, au mois de septembre 2006, à débattre de la création d'une banque internationale de combustible, une mesure qui permettrait d'éviter que des pays comme l'Iran ne cherchent à se doter de leurs propres filières d'enrichissement d'uranium. « Je veux m'assurer que tout pays qui utilise de bonne foi l'énergie nucléaire et qui remplit ses obligations en matière de non-prolifération obtienne du combustible » nucléaire grâce à cette future banque, a expliqué Mohamed El Baradei, le Directeur de l'AIEA. C - Au regard de sa place dans le paysage international du nucléaire civil et de son rôle majeur dans la lutte contre la prolifération nucléaire, la France doit élaborer sa propre proposition de création de consortiums internationaux 1) La logique qui sous-tend ces différents initiatives rejoint pleinement l'approche de la France Ces différents projets rejoignent une idée qui est apparue dès l'entrée du monde dans l'âge nucléaire. Ainsi, la toute première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies portait sur la nécessité d'éviter la diffusion des armes nucléaires. C'est également en 1946 que les Etats-Unis présentèrent à l'ONU un plan qui, pour éviter que l'équipement et les matières nucléaires ne soient utilisés abusivement à des fins militaires, prévoyait de placer et maintenir toutes les activités nucléaires susceptibles de conduire à de telles utilisations sous le contrôle rigoureux d'une autorité internationale du développement atomique et d'internationaliser le cycle du combustible nucléaire. Ce plan, dit plan Baruch, du nom du représentant américain auprès de l'ONU qui l'avait avancé, se heurta à l'opposition des Soviétiques, qui ne manquèrent pas d'y voir la reconnaissance de facto d'un monopole nucléaire aux Etats-Unis, alors même que l'URSS était engagée dans la fabrication de sa propre arme nucléaire. Notons que la France réserva, à l'époque, un accueil favorable à la proposition américaine. Ne nous y trompons pas, les plans actuels proposés en vue de limiter les risques de prolifération procèdent également du principe selon lequel il faut autant que possible « geler » la carte des pays maîtrisant l'ensemble du cycle du combustible, afin que les contrôles de l'Agence internationale puissent s'effectuer aussi souvent et de manière aussi approfondie que possible. La logique qui sous-tend ces projets ne peut qu'être soutenue par la France, dans la mesure où il ne s'agit nullement de dénier le droit aux Etats non dotés de l'arme nucléaire de bénéficier des applications pacifiques de l'énergie nucléaire. Tout au contraire, c'est pour que ce droit puisse être effectif qu'il est impératif d'imaginer des solutions permettant de garantir au maximum l'efficacité du contrôle international. Là réside le nœud du problème : en matière nucléaire, les enjeux sont trop lourds pour que le système de garanties internationales contre la prolifération puisse tolérer de trop nombreuses failles, ce qui ne manquerait pas de se produire si l'accès au combustible nucléaire n'est pas mieux encadré. Dans cette optique, les solutions proposées dans le débat international présentent l'avantage d'être, dans leur économie générale, à la fois pragmatiques et réalistes. Elles le sont d'autant plus qu'elles correspondent, dans certains de leurs aspects, à des actions d'ores et déjà existantes. Ainsi, que fait la France à l'usine de La Hague, premier site mondial pour ce type d'activité, sinon offrir aux pays qui le souhaitent le traitement des combustibles nucléaires usés ? La logique des propositions russe et américaine fait donc déjà partie de notre approche de ces questions. De même, plus ponctuellement, on remarquera, s'agissant de la proposition russe de formation des personnels des pays clients, qu'elle n'est pas sans évoquer une expérience proche mise en oeuvre par la France à l'occasion de la vente de la centrale de Daya Bay en Chine : les personnels chinois ont été formés dans le domaine de la sûreté au sein de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN). 2) Elles ne sont pas pour autant dénuées de limites ni d'arrière-pensées Chacune des propositions américaine et russe comporte toutefois des dispositions problématiques. S'agissant de l'initiative américaine GNEP, la France doit être vigilante concernant le choix américain en faveur du développement de technologies avancées de traitement du combustible usé. D'abord parce que le développement de technologies nouvelles moins perméables au risque de prolifération ne saurait être considéré comme un substitut à la mise en œuvre des garanties de l'AIEA et du protocole additionnel existant en la matière depuis 1994. Il est important aujourd'hui de continuer à travailler sur l'élaboration et la mise en oeuvre de nouvelles mesures de garanties. Ensuite parce que le choix technique proposé par les Etats-Unis ne saurait disqualifier la technologie existante, et éprouvée, de traitement-recyclage, d'ailleurs mise en avant dans l'initiative Poutine. Il faut être conscient que l'initiative américaine pourrait conduire à la gestion d'un volume considérable de combustibles usés à entreposer, question qui ne se pose pas lorsque l'on recourt à la filière MOX (234), que les Etats-Unis semblent pourtant vouloir exclure de leur initiative. Concernant la proposition du Président Poutine, même si une appréciation globale est actuellement prématurée, justement en l'absence des précisions qu'il est nécessaire de lui apporter, deux limites peuvent être soulignées : - Si les principes annoncés sur le contrôle international de ces centres correspondent bien aux nécessités de respect des principes de non-prolifération, le détail des modalités de contrôle par l'AIEA au titre de l'offre volontaire de la Russie reste à préciser. On peut rappeler à titre de comparaison, que le contrôle des installations d'enrichissement du consortium germano-néerlando-britannique URENCO par l'AIEA, fait l'objet de modalités tout à fait spécifiques, destinées notamment à préserver la confidentialité des procédés. - En ce qui concerne les principes de sûreté et de sécurité, il sera très important de savoir quels standards de sûreté ou recommandations de sécurité et de protection physique seront appliqués et sous quelle autorité. - Enfin, s'agissant de la neutralité de ces centres vis-à-vis des mécanismes du marché, les conditions de transparence des informations financières, et des coûts industriels, restent à préciser et organiser. L'initiative Poutine garde cependant suffisamment de flexibilité pour permettre aux mécanismes du marché de trouver à s'appliquer, au moins dans le domaine de l'enrichissement. Ce point est loin d'être neutre, et vaut également pour la proposition GNEP. Il ne faut pas être naïf : les perspectives aujourd'hui offertes par la reprise du nucléaire recouvrent un enjeu industriel majeur. Ces considérations à caractère industriel sont essentielles, les acteurs fondamentaux du développement de l'énergie nucléaire étant précisément les industriels en charge de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires, ainsi que de la gestion de l'ensemble du cycle du combustible nucléaire (jusques et y compris la gestion des déchets nucléaires). Le marché de l'enrichissement relève en effet du domaine des entreprises, qu'il faut se garder de perturber, alors que la formation des prix de ce marché est maîtrisée. Il importe par conséquent que les différentes propositions concernées ne conduisent pas à créer des standards qui remettent en cause la diversité des modèles nationaux de développement de l'énergie nucléaire. En effet, il existe actuellement, dans les pays disposant de programmes nucléaires civils, plusieurs modèles de cycle du combustible (cycle ouvert, retraitement/recyclage, cycle fermé). Les initiatives doivent donc respecter les options existantes. Dans cette perspective, les arrière-pensées de politique industrielle contenues dans la proposition américaine ne sauraient être sous-estimées. Notamment, en quoi la proposition américaine de stocker les déchets radioactifs ultimes dans le pays qui aura procédé à l'enrichissement, alors même qu'il s'agit d'un coût énorme pour le pays qui entrepose et que cela pose des problèmes d'acceptabilité majeure dans la population, se justifie-t-elle du point de vue de la prolifération, ces déchets n'étant, une fois conditionnés après traitement, en rien proliférants ? Une telle proposition vise manifestement à pénaliser des pays qui, comme la France, ont une législation interdisant ce stockage sur leur propre territoire et imposant le retour des déchets dans le pays client, ce qui est coûteux pour ce dernier. Les Etats-Unis justifient cet aspect de leur proposition en invoquant le danger que représenterait le transport des combustibles usés (risque d'accident, possibilité de détournement par des terroristes). Plusieurs décennies d'expérience française, y compris vers des destinations très lointaines (Japon) montrent que cet argument ne résiste pas à l'analyse. 3) C'est pourquoi la France doit élaborer sa propre proposition de consortiums internationaux Face à des initiatives de ce type, la France ne peut pas rester muette. Pas plus qu'il n'est satisfaisant de la voir se cantonner dans une posture de réaction, au détriment d'une démarche d'action. Le risque est important en effet de voir les Etats-Unis notamment, familiers d'une telle démarche, imposer un standard industriel officiellement motivé par des considérations stratégiques. Au regard de sa place dans le paysage international du nucléaire civil, de ses intérêts industriels alors que la France est leader mondial dans ce domaine, et de son rôle majeur dans la lutte contre la prolifération nucléaire, la France doit élaborer sa propre proposition de création de consortiums internationaux. Cette proposition doit présenter trois caractéristiques : ouverture (1), sécurité (2) et respect des règles de concurrence (3). (1) L'affichage d'un principe d'ouverture est essentiel au succès de toute initiative de ce type, alors que la propagande iranienne sur la volonté des Etats nucléaires de priver les autres, et notamment les pays en développement, d'un pseudo droit à l'enrichissement fait mouche dans un certain nombre de pays. Le proposition française doit donc être ouverte aux Etats qui le souhaitent, sous réserve qu'ils remplissent leurs obligations internationales en matière de non-prolifération. Cette ouverture pourrait, par exemple, prendre la forme de participations internationales au capital de la nouvelle usine d'enrichissement actuellement en construction, Georges Besse II, dont les premières productions d'UTS (235) pourraient intervenir dès 2008 (236). Qu'il soit nécessaire, pour des raisons de non-prolifération, de limiter le nombre de pays qui coopèrent sur le développement de technologies avancées en matière de cycle du combustible pendant la phase de R&D, cela ne fait pas de doute. Il n'est cependant pas tenable à terme d'exclure, par principe, le transfert de technologies avancées, résistantes en terme de prolifération à destination de pays qui respecteraient leurs obligations internationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que la France doit participer activement aux travaux visant à améliorer et approfondir le système de garanties internationales. Dans le même esprit, le recyclage du plutonium dans les pays clients ne doit pas être exclu. (2) Dans cet esprit, la proposition française doit présenter les conditions de sûreté et de sécurité les plus approfondies. Elle doit ainsi mettre en valeur une expérience universellement reconnue, qui conduit y compris les Etats dotés de l'industrie nucléaire la plus avancée à demander des coopérations sur ce sujet à la France. (3) Enfin, la proposition française doit être réaliste et pragmatique, c'est-à-dire préserver le bon fonctionnement du marché de l'enrichissement et du recyclage, en conformité avec les intérêts industriels de notre pays. Tout comme les Etats clients ont d'ailleurs eux aussi intérêt à bénéficier d'un marché concurrentiel. 7. RENFORCER LA SÉCURITÉ Résumé : Une très grande part du pétrole consommé dans le monde transite par des détroits particulièrement vulnérables aux accidents maritimes ou aux attaques terroristes. Assurer leur sécurité est une nécessité vitale pour les pays consommateurs d'hydrocarbures. A cette fin, il faut identifier les « détroits d'intérêt mondial » - cette mission pouvant incomber à l'ONU - et mettre en place des structures de coopération associant les Etats riverains et les pays utilisateurs de ces détroits. A - Les détroits : « maillons faibles » du système pétrolier mondial 1) Des détroits incontournables... Dans la première partie de ce rapport, on a évoqué le caractère stratégique de certains détroits pour l'approvisionnement en hydrocarbures des Etats-Unis, du Japon, de la Chine ou de l'Europe. Quatre parmi eux justifient une grande attention : Ormuz, Malacca, les détroits turcs et le couple formé par un détroit, celui de Bab El-Mandeb, et par un canal, celui de Suez. Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique à la mer d'Oman. Celui de Malacca, auquel on associe le détroit de Singapour, est situé entre la péninsule malaisienne et l'Indonésie. Il relie l'océan Indien à la mer de Chine méridionale. Les détroits turcs des Dardanelles et du Bosphore relient la mer Noire et la mer Egée. Enfin le détroit de Bab El-Mandeb sépare la péninsule arabique et l'Afrique ; c'est là que se retrouvent la mer Rouge et l'océan Indien. Ces quatre ensembles géographiques revêtent une importance particulière pour le transport des hydrocarbures car ils constituent les voies maritimes les plus commodes pour aller des pays producteurs aux consommateurs américains, européens ou asiatiques. Alors que 62 % du pétrole mondial est exporté par mer, une très grande part de ce pétrole transite par les détroits (237) que l'on vient de citer et, en particulier, par le détroit d'Ormuz : aujourd'hui 20 % du pétrole consommé dans le monde passe par cet étroit bras de mer de 35 km de large ; d'ici vingt-cinq ans, cette proportion atteindra un tiers du total. Contourner ces détroits par la construction de gazoducs ou d'oléoducs est possible. Mais si de tels projets sont de nature à desserrer l'étau autour de ces goulets d'étranglement, ils ne peuvent suffire à régler la question. C'est l'évidence même pour des pays comme les Etats-Unis ou le Japon. Les détroits sont, par nature, vulnérables. Les risques de navigation y sont élevés en raison de l'étroitesse de ces passages, de leur faible profondeur et de l'intensité du trafic qui multiplie les possibilités de collisions et d'accidents (238). Certains détroits comme celui de Malacca sont également frappés par un mal endémique : la piraterie (239). On sait aussi que des attaques terroristes sont envisageables puisque les navires croisent à proximité immédiate des côtes, où ils sont beaucoup plus vulnérables qu'en haute mer. La perspective de voir l'un de ces détroits stratégiques frappé par une catastrophe qui en rendrait l'utilisation impossible n'est pas une vue de l'esprit. Les attaques terroristes qui se sont succédé dernièrement en Indonésie et la présence avérée d'organisations proches d'Al Qaïda dans cette région inquiètent à juste titre les Etats riverains du détroit de Malacca et les pays qui dépendent du trafic par cette passe maritime, comme la Chine, le Japon ou la Corée du Sud. On se souvient aussi qu'en octobre 2002, le pétrolier français Limbourg a subi une telle attaque au large du Yémen. Comme il est, à la fois, pratiquement impossible de contourner ces détroits pour livrer le pétrole aux pays consommateurs dans des conditions compétitives et qu'ils constituent des zones extrêmement fragiles dans le « système pétrolier » mondial, la seule solution est de tenter d'en renforcer la sécurité. Elle suppose que l'on définisse, au préalable, la notion même de « détroit énergétique ou stratégique », qui dépasserait celle, toute juridique, de « détroit international ». L'idée est bien de déterminer des règles d'action pour assurer la sécurité des détroits que nous choisirons de qualifier d'« intérêt mondial ». B - Définir les « détroits d'intérêt mondial » Un détroit se définit, tout d'abord, d'un point de vue géographique. Il s'agit tout simplement d'un « bras de mer entre deux terres rapprochées et qui fait communiquer deux mers ». Mais l'usage qui en est fait peut conduire à lui octroyer la qualité de « détroit international ». Dès lors, il est soumis à un régime juridique particulier qui impose droits et obligations aux Etats riverains mais également aux pays utilisateurs. 1) Qu'est-ce qu'un détroit international ? La définition du détroit international est subtile (240). La première en a été donnée par la Cour internationale de justice, dans son arrêt du 9 avril 1949, Détroit de Corfou, Royaume-Uni c/ Albanie. La Cour a autorisé le libre passage dans ce détroit, ce que demandait le Royaume-Uni, en faisant référence à un critère fonctionnel, celui de l'utilité du détroit pour la navigation internationale, et à un critère géographique : le détroit devait relier deux parties de la haute mer où la circulation des navires est libre. Cette définition, que certains souhaitaient réviser, a fait l'objet de négociations très intenses lors du travail de codification du droit de la mer engagé sous l'égide des Nations unies dans les années soixante-dix, travail qui a abouti à la signature de la convention du 10 décembre 1982, dite de Montego Bay. On peut même affirmer que c'est la question qui a lancé le mouvement en faveur de cette codification. Les grandes puissances navales comme les Etats-Unis et l'Union soviétique souhaitaient que les détroits soient, à l'égale de la haute mer, des zones de libre passage, que leurs bateaux puissent emprunter sans entrave, que leurs sous-marins puissent traverser sans refaire surface et que leurs avions puissent survoler. Les Etats côtiers s'opposaient à ces vues, craignant notamment que le transit de navires de guerre étrangers menacent leur sécurité et les entraînent dans des conflits avec des pays tiers. Finalement, la convention de 1982, qui est entrée en vigueur en 1994, a trouvé une voie médiane qui préserve au mieux les intérêts de chacun. Le régime juridique des détroits internationaux est fixé par la troisième partie de la convention de 1982 (articles 34 à 45). Pour qu'un détroit soit qualifié d'international au sens de la convention de 1982, il doit remplir deux critères. Ce détroit doit tout d'abord mettre en communication une zone maritime où la navigation est libre - soit une zone de haute mer, soit une zone économique exclusive (241) - et une autre zone présentant le même caractère ou la mer territoriale d'un Etat. En second lieu, le détroit doit servir à la navigation internationale. Dans l'affaire du Détroit de Corfou, la Cour internationale de justice avait estimé qu'il suffisait alors qu'une voie soit « utile au trafic international » sans qu'on tienne compte de la densité du trafic et de l'importance de ce détroit pour la navigation internationale. Aux termes de cet arrêt, peu importait que ce point de passage soit incontournable ou non pour les navires (242). La convention de 1982 est revenue sur ce critère ; son article 36 exclut du champ d'application du régime juridique des détroits servant à la navigation internationale ceux qu'il est possible de contourner par une autre route de commodité comparable. Cette définition est donc légèrement plus restrictive. 2) Un statut juridique très varié La convention de 1982 fixe clairement le principe selon lequel le régime des détroits internationaux n'affecte pas celui applicable aux détroits où le passage est réglementé par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur (article 35, c). En effet, des conventions ont souvent été conclues pour réglementer le passage dans les détroits les plus importants ; ils relèvent de régimes propres qu'il a paru difficile, lors de la codification du droit de la mer de 1982, de remettre en cause. Ces régimes particuliers sont issus de conventions bilatérales, multilatérales ou même de réglementations internes aux pays concernés et acceptées par la communauté internationale. On peut en citer quelques uns, parmi lesquels le détroit de Gibraltar, large de 14,6 kilomètres, dont le régime est caractérisé par la liberté de passage et l'interdiction de fortifier ses rives en vertu de la déclaration franco-britannique du 8 avril 1904 et de la convention franco-espagnole du 27 novembre 1912 sur le Maroc. On pourrait aussi évoquer le détroit de Tiran qui, large de 5 à 25 kilomètres, relie la mer Rouge et le golfe d'Akaba. Son régime est fixé par le Traité de paix signé par l'Égypte et Israël le 26 mars 1979, aux termes duquel « les parties considèrent que le détroit de Tiran et le golfe d'Akaba doivent être des voies d'eau internationales ouvertes à toutes les nations qui y jouiront d'une liberté, sans entraves et à laquelle on ne pourra surseoir, de navigation et de survol » (243). Parmi les détroits qui nous intéressent particulièrement, on trouve ceux du Bosphore et des Dardanelles. Le détroit du Bosphore est long de 28 kilomètres et large de 0,6 à 3,3 kilomètres ; celui des Dardanelles est long de 65 kilomètres et large de 2 à 5 kilomètres. Leur statut juridique a commencé à être discuté au XVIIIe siècle lorsque la Russie, occupant la Crimée, est devenue riveraine de la mer Noire et a souhaité disposer d'un débouché maritime par les détroits alors sous le contrôle de l'Empire ottoman. Le Traité de paix de Koutchouk-Kanardji, conclu en 1774, fixa le principe de la libre circulation des navires de commerce russes par le détroit. Après plusieurs traités signés au cours du XIXe siècle, on a abouti à la convention de Montreux du 20 juillet 1936, favorable à la Turquie, qui maintient le principe du libre passage des navires de commerce en temps de paix. Les navires de guerre des Etats riverains ou non de la mer Noire peuvent également circuler, en temps de paix, sous certaines conditions qui s'avèrent plus strictes pour les non-riverains. En temps de guerre, si la Turquie est belligérante, elle a le droit d'accorder librement le droit de passage ; si elle demeure neutre, ses détroits ne sont ouverts qu'aux navires de guerre des Etats ayant signé avec elle un traité d'assistance mutuelle, ce qui était le cas, par exemple, en 1939 pour la France et le Royaume-Uni. La Turquie dispose du droit de militariser les rives de ces deux détroits. Enfin, elle n'hésite pas à imposer des règles drastiques pour la circulation des navires afin d'éviter les accidents (limitation du tonnage des pétroliers, interdiction de circulation de nuit pour certains navires...). Cet exemple permet de mesurer l'équilibre qu'il faut trouver entre les intérêts souverains des Etats côtiers et ceux des utilisateurs du détroit. Il montre aussi qu'il serait difficile de remettre en cause par de nouvelles règles internationales uniformes des statuts aussi anciens. Pour clore cette présentation non exhaustive, on rappellera que le détroit de Malacca demeure sous l'empire d'un accord signé le 24 février 1977 par l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. Il est le premier exemple d'une réglementation de la navigation dans un détroit qui ait pour objet essentiel la sécurité de la navigation et la prévention de la pollution. De ce point de vue, il a pu apparaître comme précurseur des règles contenues dans la convention de 1982 qui distingue deux cas de figure : a) Pour les détroits qui relient une partie de la haute mer ou de la zone économique exclusive d'un pays à la mer territoriale d'un ou de plusieurs Etats et pour les détroits pour lesquels existe une autre voie maritime comparable, le principe est celui du « droit de passage inoffensif », c'est-à-dire un passage ininterrompu qui ne peut être suspendu par l'Etat côtier. b) Pour les détroits internationaux enfermés dans les eaux territoriales des Etats riverains et mettant en communication deux zones de libre navigation, la convention de 1982 a institué un régime plus ouvert : celui d'un « droit passage en transit » sans entrave. Ce transit doit être continu et rapide sans possibilité de s'arrêter, comme le prévoit, pour le cas précédent, le droit de passage inoffensif. En revanche, il va plus loin, puisqu'il permet un survol libre et le passage en plongée des sous-marins. Si ce droit de transit ne peut être suspendu par l'Etat riverain, celui-ci peut invoquer des raisons de sécurité pour réglementer le passage en créant des couloirs de navigation, des dispositifs de séparation du trafic. Cette réglementation ne saurait instituer un traitement discriminatoire entre les navires. Il s'agit là d'une définition juridique, neutre, qui entend simplement permettre aux navires de circuler librement. La convention de Montego Bay n'a pas eu pour objet de mettre en œuvre des politiques de coopération actives entre Etats côtiers et utilisateurs pour assurer la sécurité de ces détroits. Elle n'a pas, non plus, eu pour but de définir ce que pourrait être un détroit d'intérêt mondial du point de vue géopolitique et économique. 3) Les « détroits d'intérêt mondial » L'une des principales conclusions du présent rapport est que l'énergie, problème de dimension mondiale, doit être l'objet d'une coopération internationale active dont le but ultime est d'éviter les situations de crises. Les détroits stratégiques pour le transport des hydrocarbures doivent s'inscrire dans ce mouvement. On pourrait même dire que permettre une coopération aux fins de garantir le bon usage de ces détroits et leur sécurité constituerait un moyen simple et opérationnel pour rapprocher non seulement les grands consommateurs entre eux mais aussi ces consommateurs avec les producteurs d'hydrocarbures, afin qu'ils prennent pleinement conscience de la mutualité de leurs intérêts. On sait que le droit international moderne a beaucoup progressé, aux XIXe siècle notamment, sur des questions techniques comme la gestion des fleuves internationaux comme le Danube ou le Rhin. Il pourrait en être de même pour les détroits. Comment définir alors cette nouvelle catégorie - non juridique pour l'heure - des détroits d'intérêt mondial ? Ces détroits seraient ceux dans lesquels le trafic est tel que son interruption pourrait conduire au déséquilibre de l'économie d'une région, déséquilibre qui aurait lui-même pour conséquence possible, probable, une crise économique mondiale. On pourrait, tout d'abord, considérer le volume de biens qui empruntent des passes maritimes au plan mondial. On pourrait également tenir compte, d'un point de vue plus qualitatif, du caractère stratégique pour l'économie mondiale de certains types de produits qui transitent par ces détroits, les hydrocarbures entrant à l'évidence en ligne de compte. Cette liste pourrait être établie par l'ONU et serait évolutive. On peut imaginer ainsi que les détroits arctiques canadiens et russes pourraient ultérieurement entrer dans la catégorie s'ils devenaient des voies commerciales importantes, comme certains l'envisagent, avec la fonte de la calotte glacière. C - Quel statut pour les « détroits d'intérêt mondial » ? 1) L'impossibilité de créer un statut juridique unique Si le droit international de la mer ne prend pas en considération le caractère stratégique de certains détroits, peut-on le faire évoluer de telle sorte qu'il le puisse ? Le droit international est le fruit de compromis entre les intérêts différents, parfois divergents, d'Etats souverains ; le débat engagé sur le régime des détroits entre puissances navales et pays côtiers, lors des négociations de la convention de 1982, l'a montré amplement. Il n'est pas envisageable de soustraire les détroits à la souveraineté des Etats riverains, pour en faire une sorte de « patrimoine commun de l'humanité » à l'instar de ce que la convention de 1982 a institué pour la « Zone », c'est-à-dire le fond des mers et des océans et leur sous-sol situés au-delà des limites des juridictions nationales (244). Il paraît également difficile d'instituer, à moyen terme, un statut unique pour tous ces détroits, dont on a vu qu'ils étaient soumis à des conventions souvent anciennes dont l'application ne soulève pas aujourd'hui de difficultés aigues. En revanche, on peut multiplier les initiatives, détroit par détroit, cas par cas, pour en assurer une sorte de cogestion de fait. 2) Vers une cogestion des « détroits d'intérêt mondial » Une solution qui laisserait aux seuls riverains le soin d'assurer la protection de ces détroits n'est guère envisageable, notamment en raison des faibles moyens financiers dont la plupart d'entre eux disposent. De même, on n'imagine pas les grandes puissances s'arroger le droit de contrôler seules ces détroits sans égards pour les pays côtiers. Comment instituer alors cette cogestion de fait ? La manière dont une telle coopération semble se mettre en place dans le détroit de Malacca peut être une source d'inspiration pour tracer des perspectives plus générales. A la fin des années soixante, l'Indonésie avait essayé d'intégrer dans un ensemble élargi la Malaisie et Singapour, de sorte que les détroits de Malacca et de Singapour fassent partie de ses eaux territoriales. Aux termes d'une confrontation tendue, ces trois pays se sont mis d'accord pour considérer qu'ils avaient un intérêt commun à gérer ensemble ces détroits. Après la signature d'accords sur la délimitation de leurs eaux territoriales, ces pays ont mis en place le Tripartite Technical Experts Groups (TTEG) à la suite du naufrage d'un pétrolier. Des règles de trafic ont ainsi pu être élaborées par ce groupe d'experts. En 1968, le ministre japonais des transports, en coopération avec des compagnies pétrolières, des transporteurs et des organisations intervenant dans le domaine maritime comme des groupes d'assurances, fonde le Malacca Strait Council (MSC) afin d'améliorer les conditions de navigation dans le détroit en proposant une aide technique et financière (245). Grâce à ce conseil du détroit de Malacca, des campagnes de relevés hydrographiques ont été menées de 1968 à 1978, un système électronique d'aide à la navigation a été créé et, en 1981, un fonds pour la prévention et la suppression de la pollution dans le détroit. Faisant suite à d'autres réunions, en septembre 2006 s'est tenue à Kuala Lumpur une conférence sous l'égide de l'Organisation maritime internationale (OMI), réunissant 31 pays et 10 organisations ou groupements régionaux dont l'ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Cette conférence avait pour objet la sécurité et l'environnement dans les détroits de Malacca et de Singapour. Les participants se sont accordés pour reconnaître à ces détroits « une importance stratégique pour l'économie mondiale », premier pas vers ce que nous avons proposé d'appeler des « détroits d'intérêt mondial ». Les Etats côtiers, dont les moyens sont limités, à l'exception de Singapour, ont indiqué qu'ils allaient se concentrer sur la lutte contre la piraterie et le terrorisme, souhaitant que les utilisateurs et les différents acteurs du transport maritime prennent en charge une partie du financement de la protection de l'environnement et de la sécurité nautique. Il est vrai que seulement un cinquième des passages par le détroit sont imputables aux trois pays riverains ; pourquoi assumeraient-ils seuls la charge de la modernisation des infrastructures en matière de sécurité et de protection de l'environnement ? On a pu observer quelques divergences de vues entre pays utilisateurs. Le Japon estime que les nouveaux pays qui utilisent désormais ce détroit doivent prendre leur part à ce financement. Les représentants japonais ont milité pour une répartition plus équitable et plus transparente du fardeau financier. Ils ont également appelé de leurs vœux une extension de l'organisation multilatérale de coopération créée en 1968. Les Etats-Unis ont manifesté leur soutien aux pays riverains sans s'engager plus avant sur la question de l'organisation multilatérale. Ils ont, en revanche, soutenu l'idée de créer un fonds international qui permettrait de financer ces actions en faveur de la sécurité de la navigation et de la protection de l'environnement. Les Européens n'ont pas pris part à cette conférence, ce qui s'explique par le fait qu'ils sont moins directement concernés par ce détroit que les Asiatiques. On peut toutefois objecter à cela que, si le détroit se trouvait fermé, l'économie japonaise ne manquerait pas d'en souffrir, ce qui ne serait pas sans conséquence sur les échanges mondiaux. Les approches sont enfin nuancées parmi les pays riverains du détroit de Malacca. L'Indonésie et la Malaisie sont moins promptes, semble-t-il, à accepter des interventions extérieures alors que Singapour y est plus favorable, cherchant dans l'appui de puissances tierces un contrepoids à l'influence de ses deux grands voisins immédiats qui, eux-mêmes, souhaiteraient que Singapour, principal bénéficiaire du trafic, s'engage financièrement (246). Les perspectives de coopération qui semblent s'ouvrir pour le détroit de Malacca pourraient être une source d'inspiration pour d'autres « détroits d'intérêt mondial ». Toutefois, il faut être conscient que chacun d'entre eux renvoie à des problématiques propres. Pour le détroit de Bab El-Mandeb, on ne peut espérer, dans l'immédiat, avec Djibouti, la Somalie ou l'Erythrée, le même type de coopération qu'avec Singapour et ses voisins ; que dire de la coopération que l'on pourrait mettre en place avec l'Iran pour ce qui concerne le détroit d'Ormuz ? De même si le détroit du Nord canadien devenait une route essentielle pour le transport des hydrocarbures, la coopération avec le Canada prendrait des formes particulières, justifiées par la nature spécifique de ce détroit et les capacités de ce pays à assumer la protection de ce passage. Pour certains détroits, le recours à des organisations régionales pourrait être une solution - on pense à l'ASEAN, par exemple - pour d'autres, on peut envisager des structures institutionnelles permanentes à vocation politique ou technique mais aussi un système de fonds financier alimenté et co-géré par les pays côtiers et utilisateurs. Même si une approche concrète et pragmatique semble nécessaire en l'état, on peut envisager que l'ONU ou certaines organisations spécialisées, comme l'OMI, puissent définir un cadre d'action qui présenterait une méthode et des orientations, utiles dans la plupart des cas. Resterait ensuite aux pays utilisateurs à s'engager et à convaincre les Etats côtiers de l'intérêt qui s'attache à une coopération efficace. Dans cette perspective, l'Europe et singulièrement la France - compte tenu de la puissance de sa flotte et l'étendue de son domaine maritime - ne doivent pas rester passives. D'un point de vue réaliste, nous avons un certain intérêt immédiat à laisser les Etats-Unis assurer la sécurité des détroits, pour des raisons financières notamment. L'Europe n'est pas aujourd'hui encore en mesure de mettre en œuvre les moyens considérables que les Américains déploient autour de ces objectifs stratégiques. On observe cependant que les Etats-Unis associent certains pays européens à leur dispositif de sécurité, par exemple dans la région de la Corne de l'Afrique, dans le détroit de Bab El-Mandeb. La France, l'Espagne et l'Allemagne participent à la Combined Joint Task Force mise en place par les Américains. Mais cette position est-elle viable à terme ? Rien n'est moins certain. Même si notre alliance avec les Etats-Unis n'est pas contestée, certains intérêts peuvent apparaître divergents. Il importe, en tout état de cause, que les pays européens restent partie prenante à la gestion multilatérale de ces détroits stratégiques. L'un des moyens pour l'Europe de demeurer présente serait de participer notamment au fonds international que les Etats-Unis souhaitent instituer pour le détroit de Malacca. Une initiative pourrait être prise, par exemple, au sein de l'OMI pour soutenir la création de cet instrument qui aurait vocation, à terme, à être utilisé pour tous les « détroits d'intérêt mondial ». OBJECTIF : RÉDUIRE LA FRACTURE ÉNERGÉTIQUE NORD/SUD UN FONDS DE STABILISATION CONTRE LES CHOCS ÉNERGÉTIQUES Résumé : Les pays les plus pauvres subissent de plein fouet les hausses des cours du pétrole. Il importe, dès lors, d'amortir les effets de ces variations par des mécanismes financiers appropriés. C'est pourquoi il est proposé de créer un fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques qui serait financé notamment par les producteurs et les compagnies pétrolières. Les développements précédents consacrés à l'Afrique, ont montré à quel point la résolution de la question énergétique était la condition même du développement des pays du Sud. Le constat fait pour les Etats africains vaut aussi, par exemple, pour les pays océaniens. On pense ainsi à ces archipels du Pacifique qui paient leur énergie dix fois le prix en raison du coût du transport par bateau. Pour l'ensemble de ces pays, la question se pose sous deux angles : - Comment amortir le choc économique d'une hausse des cours du pétrole qui grève le budget de ces Etats et étrangle les entrepreneurs locaux ? - Comment améliorer l'accès à l'énergie dans ces pays, accès qui conditionne le développement économique et social et ce faisant, l'éradication de la pauvreté ? Observons dès maintenant que les initiatives ne manquent pas au plan mondial et que l'Europe n'est pas la moins active en ce domaine. Pourtant, l'effort n'est pas suffisant. Tant s'en faut. L'Agence internationale de l'énergie estimait récemment à 320 milliards de dollars par an les investissements nécessaires pour répondre pleinement aux besoins énergétiques des pays en développement et des pays à revenu intermédiaire, soit 8 000 milliards de dollars sur vingt-cinq ans. A partir de là, deux attitudes sont possibles : le découragement face à l'ampleur de la tâche à accomplir ou l'action « tous azimuts » pour multiplier les possibilités de financement et les projets concrets. Il est de l'intérêt de tous, des pays riches comme des pays pauvres, que ces derniers puissent se développer. L'Europe y a d'ailleurs un intérêt particulier, puisqu'elle est placée en première ligne dans cette confrontation Nord/Sud, comme l'ont montré au cours des derniers mois les arrivées massives et dans des conditions humainement déplorables de jeunes migrants africains en Espagne, à Malte ou en Italie. Dès lors, il faut soutenir et même renforcer les initiatives qui ont été prises récemment pour amortir l'impact des hausses des cours du pétrole sur les économies des pays les moins développés. Il faut également consacrer une plus grande part de l'aide publique au développement à l'amélioration de l'accès à l'énergie. Les pays les plus riches, dont nous sommes, ne peuvent se contenter de sécuriser leurs approvisionnements pour préserver leur niveau de vie en méprisant le milliard d'être humains qui vit aujourd'hui dans la plus extrême des pauvretés. Il faut aller au-delà. C'est le sens des deux dernières propositions de ce rapport qui correspondent au quatrième objectif du plan d'action présenté ici. La première de ces propositions consiste à assurer le financement d'un fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques par les producteurs et les compagnies pétrolières, la seconde ayant pour objet la création d'un fonds pour l'accès à l'énergie et la diversification énergétique par les transferts de technologies, alimenté par une contribution de solidarité sur les carburants. A - Encourager les initiatives politiques concertées en faveur des pays pauvres affectés par la hausse des cours du pétrole Déjà, en 2000, alors que la hausse des prix du pétrole n'avait pas atteint les pics qu'elle a enregistrés depuis, M. Kofi Annan, Secrétaire général des Nations unis, déclarait : « Très souvent, on considère que le prix des produits pétroliers est une question qui intéresse uniquement les pays producteurs et le monde industrialisé. Or, il existe une tierce partie, dont les intérêts sont généralement ignorés, pour laquelle il s'agit d'un enjeu vital. Je veux parler, bien entendu, de la majorité des pays en développement qui sont des importateurs nets de pétrole (247). » Dans le contexte actuel de hausse durable des prix de l'énergie, cette préoccupation est naturellement plus forte : l'accroissement de la facture énergétique des pays pauvres, importateurs nets de pétrole et de gaz, pèse lourdement sur leur développement économique et menace les efforts entrepris pour réduire le poids de la dette extérieure. La facture pétrolière excède, en effet, 10 % du PIB dans de nombreux pays africains, alors qu'elle ne représente que 2 % dans les pays non producteurs, membres de l'OCDE (248). L'économie des pays les plus pauvres ne peut durablement supporter la charge que représente le niveau sans précédent atteint par les prix du pétrole, malgré une détente récente des cours. Dans ces conditions, il importe de soutenir, voire renforcer, les initiatives destinées à contenir l'impact de l'envolée des cours du pétrole dans ces pays, en instaurant des mécanismes de correction au plan multilatéral. 1) L'association des pays africains non producteurs de pétrole De ce point de vue, la naissance de l'Association des pays africains non producteurs de pétrole (APNPP) est un premier pas vers un dialogue plus équilibré. A l'initiative du Président sénégalais Abdoulaye Wade, une conférence ministérielle s'est tenue à Dakar, le 27 juillet 2006, réunissant une vingtaine de pays africains non producteurs de pétrole. Cette conférence, dont l'objectif était d'organiser la solidarité africaine en matière pétrolière, a débouché sur la création de l'Association des pays africains non producteurs de pétrole (APNPP) qui regroupe actuellement quinze pays (249). Les participants ont formulé des recommandations, parmi lesquelles le partage de la surcharge financière due à la hausse du prix du baril entre les pays africains producteurs de pétrole et la communauté internationale ; la mise en place d'un Fonds de stabilisation des cours du pétrole ainsi que la promotion, à l'échelle continentale, des biocarburants à partir de la culture des plantes énergétiques. Au-delà de la mobilisation des pays affectés par l'envolée des cours et de la mise en place d'un cadre de concertation et d'échanges, à l'image de l'OPEP, cette initiative témoigne d'une volonté d'anticiper sur les évolutions prévisibles de l'offre énergétique. La perspective d'un épuisement progressif des ressources fossiles doit conduire à envisager des solutions alternatives comme la production d'énergie propre, à laquelle le continent africain pourrait contribuer de manière significative en développant les biocarburants. Ces efforts doivent être soutenus par la communauté internationale 2) Le Fonds africain de stabilisation du pétrole La création récente d'un Fonds africain de stabilisation du pétrole constitue également une initiative à conforter. Au cours de la période récente, les pays de l'Union africaine se sont attachés à définir une stratégie de coopération et de solidarité entre les pays producteurs de pétrole et les pays importateurs nets afin, notamment, de pallier l'impact de l'augmentation des prix du pétrole sur les pays les plus pauvres du continent africain. Lors du sommet de Khartoum, en janvier 2006, les pays de l'Union africaine ont ainsi décidé la création d'un « Fonds africain du pétrole » , dont l'objectif principal est d'assister les pays non producteurs en facilitant le financement de leurs importations pétrolières. Les ressources destinées à alimenter ce fonds proviendraient des pays africains, mais également de la communauté internationale, selon des modalités qui restent à définir. Au cours de la septième session ordinaire de la conférence de l'Union africaine, qui s'est tenue en juillet 2006, ces orientations ont été confirmées : une prochaine rencontre ministérielle doit permettre d'examiner les modalités concrètes d'établissement de ce fonds. Au-delà du financement de l'achat de pétrole à un prix raisonnable pour les pays affectés par la crise énergétique, cette démarche vise également à améliorer et accroître la production pétrolière des pays africains dotés de ressources en hydrocarbures, afin de réaliser les objectifs de développement du continent. Là encore, il importe que la communauté internationale soutienne cette démarche en apportant l'expertise et les ressources financières nécessaires pour garantir un fonctionnement efficace du Fonds africain de stabilisation du pétrole. On peut souhaiter une extension de ce dispositif aux pays à faible revenu d'autres continents. Si l'Afrique concentre le plus grand nombre de pays affectés par l'envolée des prix du pétrole, certains pays à faible revenu d'autres continents sont également fragilisés par cette évolution. Il apparaît donc nécessaire de prévoir l'élargissement du dispositif de soutien aux pays africains les plus vulnérables à d'autres régions du monde : les pays bénéficiaires pourraient être ceux qui sont actuellement admissibles à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), gérée par le Fonds monétaire international (FMI). B - Pour un Fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques financé par les principaux bénéficiaires du marché de l'énergie La gestion du risque lié au pétrole ne constitue pas la seule priorité des pays les plus pauvres, également affectés par la fréquence élevée des catastrophes naturelles ou les fluctuations des cours des matières premières dans le cadre de la libéralisation des échanges. Ces chocs exogènes perturbent davantage l'économie de ces pays, dans la mesure où leur capacité à constituer des réserves de change (250) ou à consolider les recettes publiques est extrêmement limitée. Afin d'atténuer l'impact de ces chocs, le FMI a mis en place une facilité de protection contre les chocs exogènes (dite « facilité FCE ») dont un assouplissement des conditions d'accès serait souhaitable. 1) Amplifier la portée de la facilité de protection contre les chocs exogènes (dite facilité FCE) La facilité FCE fournit un soutien à la politique économique et une aide financière aux pays à faible revenu qui subissent les effets de perturbations externes. Elle s'adresse aux pays admissibles (251) au bénéfice de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC). Les conditions dont est assortie la facilité FCE sont plus avantageuses que celles de la politique d'aide d'urgence du FMI ; cette facilité exige toutefois l'élaboration d'un programme économique complet, en particulier, une stratégie de réduction de la pauvreté. Le montant de l'aide accordée au titre de la facilité FCE est déterminé au cas par cas. Sauf circonstances exceptionnelles, l'encours cumulatif total de cette aide est fixé à 50 % de la quote-part du pays concerné au FMI. Les prêts sont assortis d'un taux d'intérêt annuel de 0,5 % ; les remboursements, semestriels, commencent cinq ans et demi après le décaissement et se terminent au bout de dix ans. Dans la plupart des cas, l'aide du FMI - le montant total visé pour la facilité FCE est de 700 millions de dollars - ne pourra cependant pas suffire à compenser les effets d'un choc exogène, incitant les pays concernés à recourir à des aides complémentaires, émanant d'autres bailleurs de fonds internationaux. L'insuffisance des montants pose la question de la participation des pays producteurs de pétrole au financement de cette facilité. Compte tenu du niveau de leurs recettes d'exportations, leur contribution à ce mécanisme serait, pour le moins, légitime. En outre, la durée de l'aide, prévue pour deux ans, ne correspond pas à la réalité de l'impact des chocs exogènes dont les effets persistants sur l'économie d'un pays se font, bien souvent, ressentir sur une période plus longue. Par ailleurs, la facilité FCE ne s'adresse qu'à 78 pays ne disposant que d'un revenu annuel par habitant de 895 dollars, ce qui pose le problème de certains pays à revenu intermédiaire non producteurs de pétrole. Enfin, les conditions d'accès à cette facilité restent nombreuses et l'appréciation de l'existence d'un « choc exogène » incertaine. Dès lors, si l'établissement de la facilité FCE constitue une avancée certaine, ses modalités de mise en œuvre mériteraient d'être assouplies. 2) Associer les bénéficiaires du marché de l'énergie au financement d'un Fonds de stabilisation contre les chocs énergétiques Surtout, il semble indispensable de renforcer les conditions de financement de ce fonds en prônant un engagement plus grand des principaux bénéficiaires du marché de l'énergie, c'est-à-dire les pays producteurs et les compagnies pétrolières. On a mis en évidence les bénéfices importants qui étaient accumulés par les pays producteurs - souvent via des compagnies nationales - et les majors pétrolières. Il paraîtrait conforme à l'idée que l'on se fait de la solidarité internationale de mettre à contribution ces acteurs qui engrangent des profits qui sont autant de surcoûts pour les pays et les populations les plus vulnérables. La Mission mesure la difficulté qui s'attache à la mise en place d'un tel mode de financement. Comment faire en sorte que les pays producteurs et les grandes compagnies acceptent de s'associer à cette initiative ? Si la voie d'une taxation internationale paraît aujourd'hui peu réaliste, on peut penser qu'une campagne appropriée de sensibilisation pourrait contribuer à convaincre ces acteurs de contribuer à ce fonds, ne serait-ce que pour améliorer leur image. UNE CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L'ACCÈS À L'ÉNERGIE Résumé : L'accès à l'énergie est la condition même du développement économique et social des pays les plus pauvres. C'est pourquoi il est proposé la création d'un Fonds pour l'accès à l'énergie et la diversification énergétique par les transferts de technologies. Ce fonds contribuerait à développer les réseaux dans les pays les plus pauvres et à encourager l'utilisation des énergies renouvelables ; il serait, en partie, alimenté par une contribution de solidarité sur les carburants. Si l'accès à l'énergie est l'une des conditions du développement des pays les plus démunis, il importe que les efforts accomplis pour rendre cet accès plus facile soient résolument orientés vers les énergies renouvelables. Il serait paradoxal d'inciter les pays les plus pauvres à accroître leur consommation d'énergies fossiles, alors qu'ils en sont dépourvus, qu'ils peuvent mettre en valeur les énergies renouvelables - solaire, géothermique ou hydraulique - et, surtout, qu'ils sont les premières victimes des dérèglements de la planète. La mise en place d'un fonds financé par une contribution de solidarité pour permettre des transferts de technologies paraît une nécessité pour ce faire. A - Réduire la fracture énergétique, priorité de l'aide publique au développement 1) Une prise de conscience récente La question de l'accès à l'énergie dans les pays les plus pauvres a longtemps été ignorée. Cet accès est pourtant l'une des conditions pour sortir de la pauvreté en se développant économiquement et plus largement pour atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L'éradication de la pauvreté qui constitue le premier des OMD nécessite, à l'évidence, la disponibilité de services énergétiques pour créer de nouvelles activités économiques, qu'il s'agisse par exemple d'irriguer des champs ou de transformer les produits agricoles. De même, pour obtenir un meilleur taux de scolarisation et l'égalité des genres (OMD nos 2 et 3), il faut libérer les femmes et les jeunes filles de tâches comme l'acheminement de l'eau ou la collecte de bois de feu. On peut aussi considérer que la diminution de la mortalité infantile et maternelle (OMD n°s 4 et 5) et plus généralement l'amélioration de la santé passent par l'installation de l'électricité dans les dispensaires, ne serait-ce que pour disposer d'une chaîne du froid nécessaire à la conservation des vaccins, de lumière pour les traitements d'urgence la nuit, ou pour améliorer les conditions d'hygiène et d'asepsie... La réduction de la pollution de l'air dans les maisons liée à la mauvaise utilisation du bois pour la cuisson ou du kérosène pour l'éclairage permettrait par ailleurs de réduire les affections respiratoires et d'éviter de nombreux morts. On estime que 2 millions de personnes décèdent chaque année en raison de l'utilisation de ces combustibles, essentiellement des jeunes enfants et des femmes. Nous ne reviendrons pas sur le constat qui a été établi dans la première partie de ce rapport consacrée à l'Afrique. Observons cependant qu'après un très net désengagement des acteurs publics et privés du secteur énergétique dans les pays en développement, dans la décennie précédente, le taux d'accès à des sources modernes d'énergie est demeuré très faible ; il atteint moins de 20 % en Afrique subsaharienne et 1,6 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. C'est au début de cette décennie, et en particulier lors de la neuvième session de la Commission du développement durable en 2000, puis en 2002 à Johannesburg lors du sommet mondial du développement durable, que l'importance de cette question est apparue au plan international. L'Initiative énergie de l'Union européenne pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable (EUEI), lancée en 2002, témoigne de cet intérêt nouveau et de l'engagement des pays donateurs et des bailleurs de fonds. 2) Conjuguer les efforts des acteurs publics et privés Contrairement au dogme qui a dominé dans les années quatre-vingt dix, la plupart des acteurs considèrent aujourd'hui que les acteurs privés ne peuvent répondre seuls à cette exigence. Ils hésitent trop à investir dans des secteurs et des pays où les perspectives de rentabilité ne répondent pas aux exigences capitalistes habituelles. Dans le domaine énergétique, les investissements privés dans les pays du Sud sont passés de 47 milliards de dollars en 1997 à 14 milliards en 2006. Les Etats et les organisations internationales doivent intervenir pour faire en sorte que l'énergie soit accessible au plus grand nombre. C'est le sens de l'action actuelle de la Banque mondiale qui a tenu, les 29 et 30 mai 2006, sa conférence annuelle pour l'économie du développement, à l'occasion de laquelle l'accent a été porté sur les infrastructures énergétiques. Comme l'a souligné le Directeur de l'énergie et de l'eau de la Banque, M. Jamal Saghir, celle-ci place désormais l'énergie au cœur et à l'avant-garde de la lutte contre la pauvreté. Face aux masses financières immenses qui sont nécessaires, il importe de réunir des fonds publics pour pouvoir lever ensuite des fonds privés, grâce à un effet de levier. C'est une conjugaison des moyens et des efforts qui est la condition même de la réussite de ce projet. On sait aujourd'hui, contrairement à certaines idées trop souvent répandues, que l'aide publique au développement produit des effets bénéfiques réels dans les pays pauvres. Les nouveaux mécanismes de financement et de contrôle ont permis de donner à cette aide une plus grande efficacité. Pour réduire la pauvreté, il n'y a nul secret : il faut plus d'argent. C'est possible et la réduction de la fracture énergétique est l'un des vecteurs qui nous paraît le plus adapté et le plus sûr pour éradiquer la pauvreté. En 2005, M. Jeffrey Sachs, dans son important rapport sur l'état d'avancement des OMD, considérait que, pour atteindre ces objectifs, les pays riches devraient porter leur aide publique au développement à 0,5 % de leur RNB d'ici 2015, soit une aide totale de 195 milliards de dollars (contre 100 milliards aujourd'hui). C'est un effort qui n'est pas insurmontable si l'on reprend les chiffres dont le Président Jacques Chirac avait lui-même fait état à Davos en janvier 2005 : le chiffre d'affaires des cent premières entreprises mondiales était de 7 000 milliards de dollars en 2004 et celui cumulé des deux premières de ces sociétés dépassait le RNB de l'Afrique toute entière. On sait aussi que M. Jeffrey Sachs avait fixé comme objectif une aide publique au développement à hauteur de 135 milliards de dollars pour 2006 ; ce montant, qui n'a pas été atteint malheureusement, représente 5 % des dépenses militaires mondiales. Le rapprochement de ces chiffres permet de relativiser l'effort à accomplir pour réduire la pauvreté. Ensuite, viendra l'objectif plus ambitieux de permettre aux pays du Sud de se développer pleinement, grâce à des efforts financiers démultipliés (les 320 milliards de dollars annuels évoqués par l'Agence internationale de l'énergie) qui concerneront les pays en développement mais aussi les pays intermédiaires. C'est pourquoi il faut soutenir les initiatives prises, d'ores et déjà, par l'Union européenne pour réduire la fracture énergétique entre le Nord et le Sud. L'Initiative énergie de l'Union européenne pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable, lancée en 2002 vise, par divers instruments, à associer le secteur privé, les institutions internationales, la société civile et les consommateurs finaux pour atteindre les OMD en développant l'accès à l'énergie. Dans le cadre de cette initiative, a été créée une Facilité énergie ACP-UE (252), sur proposition de la Commission européenne, qui serait dotée de 220 millions d'euros dans le cadre du neuvième FED (Fonds européen de développement). L'idée est d'octroyer à des projets améliorant l'accès des populations pauvres aux services énergétiques des financements qui manquent aujourd'hui, en encourageant la coopération entre secteurs public et privé. Les premiers appels à projets ont été lancés le 19 juin 2006. Il faut saluer cette initiative et l'encourager fermement. Enfin, l'Europe a mis en place un cadre politique, en 2002, permettant aux membres de l'Union de coordonner leurs actions dans le domaine de l'énergie pour les pays en développement. C'est la facilité de dialogue et de partenariat qui a déjà permis à six membres (France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) de se concerter avec les pays bénéficiaires de l'aide. A côté de ces structures européennes existent de très nombreuses initiatives publiques, privées ou mixtes qui entendent porter l'accent sur la question de l'accès à l'énergie. On pourrait citer le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), le Forum des ministres de l'énergie africaine, la Johannesburg Renewal Energy Coalition (JREC), le Global Village Energy Partnership... Ce foisonnement est utile, car il permet de prendre en considération le caractère transversal de la question énergétique qui doit se retrouver dans toutes les stratégies et tous les programmes sectoriels (éducation, santé, eau...). B - Créer un fonds pour l'accès à l'énergie et la diversification énergétique par les transferts de technologies alimenté par une contribution de solidarité assise sur la vente des carburants Afin d'augmenter le volume financier consacré à l'aide publique au développement et d'utiliser ce supplément au bénéfice des transferts de technologies dans le domaine des énergies renouvelables, la Mission propose de créer un fonds consacré à ces transferts de technologie et alimenté par un prélèvement, d'un montant modeste, sur le prix de l'essence et du gazole. 1) Les contributions de solidarité : une idée nouvelle, bien acceptée et efficace Cette idée s'inspire de celle qui a conduit à la création de la Facilité internationale pour l'achat de médicaments, et à la mise en place, réalisée dans cinq pays à ce jour, d'une contribution de solidarité sur les billets d'avion dont le produit est affecté au financement de cette facilité. Elle est aussi à rapprocher d'initiatives beaucoup plus modestes mais obéissant à la même logique, conduites par certaines collectivités locales. Ainsi, depuis 1986, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France prélève 0,3 centime d'euro sur chaque mètre cube d'eau qu'il vend, ce qui lui a permis de financer 170 opérations dans seize pays d'Asie et d'Afrique francophone, ayant fait accéder à l'eau potable 1,6 million de personnes. Ce prélèvement apparaît bien accepté par la population, dans la mesure où il est peu élevé et utilisé pour un objectif précis dont la pertinence est incontestable. La contribution sur les billets d'avion, qui devrait rapporter environ 200 millions d'euros par an, est nettement plus élevée, puisqu'elle est comprise entre 1 et 40 euros selon le type de billet, mais sa légitimité n'est pas non plus critiquée. 2) La perspective de récolter 500 millions d'euros par an en France Accélérer le développement des énergies renouvelables dans les pays pauvres présente le triple avantage de donner accès à l'énergie aux populations concernées, de limiter les tensions sur le marché des hydrocarbures - et les hausses de prix qu'elles induisent - et d'éviter l'accroissement des émissions de gaz à effet de serre. A condition que ces enjeux soient clairement expliqués, comme l'ont été ceux de l'achat de médicaments, les Français seront certainement prêts à apporter une contribution. La Mission estime envisageable un prélèvement de l'ordre de 1 centime d'euro par litre de carburant fossile consommé pour les transports. Comme les Français ont utilisé environ 42 millions de tonnes de carburant en 2005 (un quart sous forme d'essence, le reste sous forme de gazole), soit plus de 50 milliards de litres, ce prélèvement pourrait assurer une recette de plus de 500 millions d'euros par an. Afin d'éviter des coûts administratifs élevés, votre Rapporteur estime que cette taxe pourrait être recouvrée en même temps que la taxe intérieure sur les produits pétroliers, et que la gestion du fonds qu'elle alimenterait pourrait être confiée à l'Agence française de développement, qui a déjà une réelle expertise dans la réalisation de projets en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Par souci d'efficacité, la création de ce fonds est proposée au niveau national, mais il serait souhaitable, dans un deuxième temps, qu'il soit ouvert à nos partenaires européens, voire extra-européens, et que ceux-ci décident de l'alimenter par la création d'une recette affectée ou par un autre moyen. * * * La question du « partage énergétique » est, à nos yeux, déterminante. Nous ne pouvons imaginer construire un monde équilibré si nous n'acceptons pas, en tant que pays riches, d'aider les populations les plus pauvres à disposer des moyens de vivre décemment. Nous ne pourrons éternellement nous réfugier dans notre confort énergétique qui nous préoccupe tant, sans penser à ceux qui n'ont rien ou presque. C'est pourquoi il faut non seulement soutenir les initiatives prises récemment tant au plan mondial qu'européen ou africain mais surtout redoubler d'efforts. La France montre l'exemple. Sur la période 1998-2004 notre aide publique au développement en matière d'énergie a été de 120 millions d'euros par an. L'année 2005 a vu une augmentation importante, puisque les engagements ont été de 240 millions d'euros pour ce secteur. Mais l'objectif étant d'atteindre 0,7 % de notre RNB consacré à l'aide publique au développement en 2012, il faudra que les aides à l'accès à l'énergie occupent une place sans cesse croissante dans cet ensemble. Si les pays riches veulent réduire la fracture énergétique, ils doivent renouer avec l'idée de partage. Au-delà d'une vision morale, il s'agit de la prise en compte de nos intérêts bien compris, dans un monde qui ne pourra supporter plus longtemps un tel fossé. Changer nos modes de production, d'utilisation et de consommation de l'énergie : c'est ce que nous impose la nouvelle donne énergétique mondiale. La montée des risques environnementaux le justifie plus que tout. Si l'on veut répondre à ce que le vice-Président Al Gore a appelé l' « urgence planétaire », probablement faut-il consommer moins, mais surtout consommer mieux. Notre réflexion collective sur les enjeux géopolitiques de l'énergie a clairement montré que nous devons, dès à présent, changer nos modes de vie, modifier nos comportements, envisager d'autres façons de produire, de nous déplacer, de nous loger, de nous chauffer... Ceux qui sont aujourd'hui habitués à leur confort matériel devront se résoudre à partager une richesse qu'ils considèrent comme étant la leur ; nous savons qu'elle est un bien commun de toute l'humanité. Il n'existe évidemment pas de plan d'action miracle mais il ne faut pas se résigner à la fatalité. Au-delà de l'indispensable volonté politique que doivent manifester les Etats, des progrès sont possibles si nous agissons ensemble dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Cela implique de redoubler nos efforts de recherche au service des énergies du futur. Les grands gagnants de la crise énergétique actuelle - et au premier chef les compagnies pétrolières, dont les profits n'ont jamais été aussi élevés - doivent investir encore plus largement dans la recherche, qui aidera à accélérer la transition énergétique, grâce à une utilisation systématique des énergies de substitution aux hydrocarbures. Mais sans le soutien des populations, de tels efforts seront vains. Le temps est venu d'une révolution des esprits, des méthodes, des comportements. Le Président Kennedy aimait à citer cette anecdote. Le Maréchal Lyautey demanda un jour à son jardinier de planter un arbre. Celui-ci lui objecta que cet arbre mettrait un siècle à pousser. Et Lyautey de lui répondre : dans ce cas, pas de temps à perdre : plante-le maintenant ! Chacun a entre ses mains le destin de tous. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. Au cours de sa séance du mercredi 29 novembre 2006, la Commission a examiné le rapport d'information sur les travaux de la Mission « Energie et géopolitique ». Le Président Edouard Balladur a salué la qualité du rapport présenté par la mission d'information, se félicitant de la précision et de la multiplicité des informations qu'il contenait. Indiquant que la Mission d'information avait approuvé le rapport à l'unanimité, M. Paul Quilès, Président de la Mission d'information, a remercié ses membres, notamment le Rapporteur, M. Jean Jacques Guillet, et ceux qui avaient effectué des déplacements dans quatorze pays - Kazakhstan, Belgique, Finlande, Norvège, Russie, Etats-Unis, Algérie, Japon, Bolivie, Venezuela, Brésil, Gabon, Iran, Inde -, où ils avaient rencontré 232 personnes. Après les exposés de MM. Paul Quilès et Jean-Jacques Guillet, une discussion s'est engagée. Le Président Edouard Balladur a salué l'ampleur du travail accompli par les membres de la mission d'information ainsi que la richesse du rapport qui contient des propositions d'un grand intérêt. Après avoir rappelé qu'au début de l'année 2006, il avait remis un rapport à la Délégation pour l'Union européenne sur l'efficacité énergétique dans l'Union, M. André Schneider a déclaré partager les appréciations déjà portées sur la qualité du rapport proposé par la mission d'information ainsi que sur ses conclusions. Il a constaté que la production d'énergie nucléaire était un atout pour la France, observant que l'Allemagne qui démantèle ses centrales nucléaires s'approvisionne pourtant en électricité française produite notamment dans la centrale de Fessenheim. Le partenariat avec la Russie est évidemment indispensable. Il faut également s'engager en faveur des nouvelles sources d'énergie. La France a consenti des efforts importants pour réduire sa consommation énergétique depuis 1973. Or si, dans un Livre vert, la Commission recommande aux Européens de réduire encore leur consommation de 20 % d'ici 2020, il est clair que de telles mesures de réduction seront plus faciles à engager dans les pays qui n'ont pas déjà fourni, contrairement à la France, un effort substantiel en ce domaine. Pour réussir, de simples recommandations ne suffiront pas. L'heure est aux décisions avec l'adoption de directives européennes ouvertes et cohérentes sans quoi nous courrons à la catastrophe. M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur de la mission d'information, a constaté que la consommation allemande en électricité française avait pour effet d'augmenter les prix de cette énergie en France alors qu'elle est produite dans notre pays à moindre coût. Après s'est associé aux félicitations adressées au Président et au Rapporteur de la mission d'information pour la qualité de leur rapport M. Michel Destot a estimé que le plus difficile, dans ce type de travail, était les conclusions politiques qui pouvaient en être tirées. Il a souhaité savoir quelles étaient les priorités politiques qui constituaient le soubassement des propositions qui concluent ce rapport. S'agit-il de préserver avant tout la sécurité énergétique ou de poursuivre des objectifs environnementaux ? Ces deux problématiques ne sont pas sans lien car si l'on consomme moins d'énergie on réduit sa dépendance et accroît sa sécurité énergétique. Mais ces deux objectifs ne sont pas totalement congruents. Par exemple, si l'on entend donner la priorité aux questions d'environnement, il importe de s'interroger sur le développement de la pile à hydrogène, de pousser les feux dans le domaine de la recherche en faveur des piles photovoltaïques ou des véhicules électriques, mais aussi de s'interroger sur notre système fiscal, sur nos modes de transports, sur l'habitat... Il ne suffit pas ainsi de dire que l'on va taxer les hydrocarbures ; il faut également savoir vers quoi l'on va orienter les recettes tirer de telles taxes. Il convient aussi de s'interroger sur la manière dont la société internationale peut s'organiser autour de ces questions. Faut-il créer une agence consacrée non seulement à l'environnement, comme il en est question, mais aussi à l'énergie ? Adressant ses compliments au Président et au Rapporteur de la mission d'information, M. François Loncle a jugé que ce rapport serait très utile pour l'avenir. Il a insisté sur la nécessité de porter une attention toute particulière à la question de la sécurité nucléaire à l'heure où il apparaît que cette énergie pourrait se développer plus encore qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut garantir la sûreté de toute la filière nucléaire. M. Paul Quilès, Président de la mission d'information, a convenu que le développement de l'énergie nucléaire, notamment dans les pays émergents, devait aller de pair avec une plus grande sécurité. La proposition de création des consortiums internationaux pour l'enrichissement et le traitement va clairement dans ce sens. Il a observé que la mission d'information avait souhaité se concentrer sur des objectifs comme l'impératif climatique, l'Europe, les modes de débats et de décisions au plan international, les rapports Nord / Sud. Ainsi le règlement des problèmes énergétiques ne peut être seulement français, même si notre pays peut agir de son côté comme le rapport le propose. Il est possible de réunir des pays européens autour d'objectifs communs pour progresser en ce domaine. Au plan international, il existe nombre de lieux d'expression ou de discussion. Mais il faut aussi que des décisions soient prises ; c'est pourquoi la mission propose que le G8 soit l'enceinte où seront évoquées principalement les questions énergétiques qui auront été préalablement évoquées dans une enceinte plus large. Enfin, l'accès à l'énergie conditionne, pour beaucoup, le développement des pays du Sud et leur capacité à atteindre les Objectifs du Millénaire fixés par l'ONU en 2000. Mais les pays riches ont également intérêt à soutenir ces efforts en faveur de l'accès à l'énergie pour réduire la pauvreté et éviter des phénomènes migratoires difficiles à gérer. Les propositions de la mission d'information ne constituent pas une solution miracle mais un plan d'action réaliste. M. Jean-Jacques Guillet, Rapporteur de la mission d'information, a ajouté que l'objet de ce rapport était d'identifier les sources de tensions dans le monde autour de la question énergétique et de proposer les moyens d'y remédier par une plus grande coopération internationale. Après avoir rappelé qu'il appartenait aux membres de la Commission des Affaires étrangères d'autoriser la publication du rapport de la mission d'information, le Président Edouard Balladur a déclaré que ce travail honorait la Commission et a suggéré qu'il puisse être actualisé dans les années à venir. La Commission a autorisé la publication du rapport d'information. I. Liste chronologique des personnalités entendues 1) Par la Mission d'information - M. Dominique Maillard, Directeur général à la direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) au ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - M. Jean-Marie Chevalier, Directeur du Centre de géopolitique et d'énergie - Paris Dauphine - M. Jean-François Cirelli, Président-Directeur général de Gaz de France - M. Claude Mandil, Directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie - M. Pierre Noël, responsable des études sur l'énergie à l'Institut français des relations internationales (IFRI) - M. Olivier Appert, Président de l'Institut français du pétrole - M. Christophe-Alexandre Paillard, chef du bureau Prospective technologique et industrielle à la délégation pour les affaires stratégiques du ministère de la Défense - Mme Valérie Niquet, Directeur du centre Asie à l'IFRI - M. Bruno Weymuller, membre du comité exécutif, Directeur stratégie évaluation des risques de Total - M. Pierre Gadonneix, Président-Directeur général d'Electricité de France - M. Thierry Desmarest, Président-Directeur général de Total - M. Jean-Christophe Victor, Directeur du Laboratoire d'études politiques et cartographique (LEPAC), auteur du magazine de géopolitique « le dessous des cartes », accompagné de M. Mathias Strobel - Mme Anne Lauvergeon, Présidente du directoire d'AREVA 2) Par le Président ou le Rapporteur - M. Tim Osborne, Président du groupe Menatep - M. Hervé Pouliquen, chargé de mission énergie au Centre d'analyse stratégique - M. Yves Cochet, Député - M. Bernard Faubournet de Montferrand, ancien ambassadeur de France à Tokyo - M. Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil - M. Jacques de Naurois, Directeur des relations institutionnelles de Total - M. André Antolini, Président du syndicat des énergies renouvelables, et M. Philippe Chartier, conseiller stratégie et recherche - M. Jean-Marie Dauger, Directeur général délégué, responsable de la branche « approvisionnement et production » de Gaz de France II. Tableau récapitulatif des déplacements effectués
III. Listes des personnalités rencontrées Déplacement au Kazakhstan ___ Représentants de l'ambassade de France - Son Exc. M. Gérard Perrolet, Ambassadeur de France au Kazakhstan - M. Daniel Patat, chef de la mission économique - M. Daniel Lehouchu, adjoint à la mission économique - Mme Janate Tamenova, assistante sectorielle à la mission économique Ministres - M. Baktykoja Izmoukhambetov, Ministre de l'Energie et des Ressources minérales - M. Kaïrate Kelimbetov, Ministre de l'Economie et de la Planification budgétaire - M. Askar Boulatovitch Batalov, vice-Ministre de l'Industrie et du Commerce Responsables d'entreprises - M. Jaksybek Abdrakhmetovitch Koulikeev, premier vice-Président de KazMunaïGaz - M. Alain Langlois, Directeur de Total Kazakhstan - M. M. D. Perry, Directeur Général d'AES Kazakhstan - M. Hakim Janah, vice-Président de Conoco Phillips - M. Jean-Michel Meunier, représentant de la Société générale au Kazakhstan Experts - M. James Loveland, conseiller pour les questions « Energie » de l'Ambassade des Etats-Unis au Kazakhstan - M. Loup J. Brefort, représentant de la Banque mondiale au Kazakhstan - Dr. Bolate Soultanov, Directeur de l'Institute for strategic studies under the President of the Republic of Kazakhstan Déplacements à Bruxelles ___ Le 17 mai 2006 - Mme Maud Arnould, conseillère chargée du secteur de l'énergie au cabinet de M. Louis Michel, Commissaire européen au développement - M. Laurent Muschel, chef d'unité des relations internationales à la direction générale de l'énergie et des transports - M. Maxime Lefebvre, conseiller à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, professeur de relations internationales à Sciences-Po et à l'Ifri - M. Christopher Jones, Directeur adjoint du cabinet de M. Andris Piebalgs, commissaire européen à l'énergie - M. Mikael Sami, chargé de mission à la direction générale de Relex Le 5 octobre 2006 - M. Thomas Carroll, chef d'unité de la fiscalité de l'énergie à la direction générale Taxes et Union douanière (Taxud) de la Commission européenne - Mme Gaëlle Michelier, administratrice à la direction générale « Taxud » de la Commission européenne - M. Lars Kjølbye, chef d'unité Energie et Eau à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne - M. Pierre Schellekens, Directeur adjoint du cabinet de M. Stavros Dimas, Commissaire à l'environnement - Mme Lise Deguen, conseillère pour l'industrie et l'énergie à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne - M. François Gave, conseiller « écologie et développement durable » à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne - Mme Eleni Kopanezou, chef d'unité "développement durable" à la direction générale de l'énergie et des transports - Mme Isabelle Kardacz, chef d'unité adjoint « transports propres et développement durable » à la Direction générale Energie et Transports de la Commission européenne - M. Marc Steen, chef d'unité des programmes de recherche sur l'énergie à la direction générale de la recherche - M. Laurent Bontoux, chercheur au Centre commun de recherche de la Commission européenne Déplacement à Helsinki ___ Représentants de l'ambassade de France - M. Gérard Cros, Ambassadeur de France en Finlande - M. Xavier Delamarre, Premier conseiller à l'Ambassade de France - M. Alain Bezard, adjoint au chef de la mission économique - Mme Yvane Bocchi-Wirman, chef du secteur « Energie » de la mission économique Parlement finlandais - M. Jouko Skinnari, Président de la Commission des Affaires économiques du Parlement Représentants de l'administration finlandaise - M. Rikku Huttunen, Directeur du département nucléaire du ministère du Commerce et de l'Industrie - M. Markku Nurmi, Directeur département recherche et développement du ministère de l'Environnement Experts finlandais - M. Mikko Kara, Directeur département énergie VTT (centre de recherches national) - M. Juha Kekkonen, vice-Président FINGRID (gestionnaire réseau électrique) - M. Jukka Laaksonen, Directeur général de l'autorité de sécurité nucléaire - Mme T. Kylä-Harakka-Ruonala, Directeur du département infrastructures (dont énergie) - Patronat Déplacement à Oslo ___ Représentants de l'ambassade de France - Son Exc. Mme Chantal Poiret, Ambassadeur de France en Norvège - M. Olivier Remond, chef de la mission économique - M. Philippe Jolivel, chef adjoint de la mission économique Parlement norvégien - M. Olav Akselsen, Président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement, ancien Président de la Commission Energie et Environnement et ancien ministre Ministère de l'énergie - Mme Anita Utseth, Secrétaire d'Etat à l'Energie Administration norvégienne - Mme Janne Julsrud, conseillère au département économie et industrie du ministère norvégien des Affaires étrangères Représentants des entreprises françaises - à Oslo : M. Bernard Ott, Directeur général de Gaz de France - à Paris : M. Patrice de Vivies, Directeur général de Total Norvège Déplacement à Moscou ___ Représentants de l'ambassade de France - Son Exc. M. Jean Cadet, Ambassadeur de France en Russie - M. Jean-Charles Berthonnet, Ministre conseiller - M. Jean-Yves Lavoir, conseiller - M. Gilles Mentré, conseiller - M. Denis Flory, conseiller nucléaire - M. Jean-François Collin, chef de la mission économique - M. Loïc Desprez-Le Goarant, attaché commercial Parlementaires russes - M. Youri Lipatov, vice-Président de la Commission de l'Energie, des Transports et des Communications de la Douma - M. Valentin Ivanov, membre de la Commission de l'Energie, des Transports et des Communications de la Douma Représentants de l'administration - Mme Elvira Nabioulina, chef du Conseil d'experts auprès du Comité de préparation du G8 - M. Anatoly Yanovsky, Directeur du département de l'énergie et des combustibles du ministère de l'Industrie et de l'Energie - M. Vladimir Travine, adjoint de M. Kirienko, Directeur général de Rossatom pour les questions économiques Responsable d'entreprise russe - M. Ebguéniy Gavrilenkov, Directeur exécutif de la banque Troïka Dialogue Déplacements à Washington et à San Francisco ___ Washington Représentants de l'ambassade de France - Son Exc. M. Jean-David Levitte, Ambassadeur de France aux Etats-Unis - Mme Geneviève Chedeville-Murray, conseiller - M. Régis Babinet, conseiller pour les affaires nucléaires Représentants des administrations - M. Guy Caruso, Directeur de l'agence d'information du département de l'énergie - M. John Byerly, deputy assistant secretary au Département d'Etat - M. Paul Simons, deputy assistant secretary au Département d'Etat - M. Stephen M. Miller, senior adviser au Département d'Etat Experts - Mme Erica Downs, Fellow, Brookings Institution - Dr. Clifford G. Gaddy, Senior Fellow, Brookings Institution - M. John Judis, Senior Fellow, Carnegie Endowment for Peace San Francisco Représentant du consulat général de France - M. Frédéric Desagneaux Représentants des entreprises - M. Edgard Habib, chief economist for Chevron corporation - M. Douglas E. Uchikura, global manager public affairs for Chevron corporation Experts - M. Severin Borenstein, directeur d'Energy Institute - M. Christian B. Larsen, vice-President, Electric Power Research Institute - M. Jeremy Platt, manager power & fuel supply, Electric Power Research Institute - M. Richard Schomberg, vice president research & new technologies, EDF International Déplacement à Tokyo ___ Représentants de l'ambassade de France - M. Christophe Penot, Ministre-conseiller à l'Ambassade de France - M. Dominique Ochem, conseiller nucléaire - M. Fabien Fieschi, premier secrétaire - M. Olivier Lenfant, attaché de défense - M. Stéphane Austry, conseiller financier, adjoint au chef de la mission économique - M. Frédérik Künkel, attaché économique Parlementaires japonais - Mme Midori Matsushima, Députée - M. Tokio Kanoh, Sénateur, président de la Commission de l'économie et de l'industrie du Sénat - M. Akira Amari, Député - M. Keizo Takemi, Dénateur - M. Goshi Hosono, Député Représentants des administrations concernées - M. Manabu Miyagawa, Directeur de la division de la sécurité économique au bureau des affaires économiques du ministère des Affaires étrangères - MM. Akihisa Watanabe, Directeur pour l'international du Maritime security planning, Nobuharu Kagami, Directeur pour les affaires internationales, et Takashi Arikawa, son assistant, de l'Agence japonaise de gardes côtes - M. Kiyoshi Sawaki, Directeur adjoint de la division de l'efficacité énergétique et de la conservation de l'énergie, au ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (METI) - M. Shinichi Mizumoto, Directeur des affaires énergétiques nucléaires internationales, au METI - M. Yasuyuki Kasai, Directeur adjoint de la division de la politique générale, au METI Représentant d'une entreprise française - M. Igor Czerny, représentant d'EDF pour le Japon et la Corée Déplacements en Bolivie, au Venezuela et au Brésil ___ En Bolivie - Son Exc. M. Alain Fouquet, Ambassadeur de France en Bolivie - M. Jorge Alvarado, Président de YPFB - M. Manuel Morales Oliveira, conseiller de la présidence de YPFB - M. Adel Banna, Directeur de l'exploration de Total Bolivie - M. Juan Marcos Braga, Directeur des affaires institutionnelles de Total Bolivie - M. José Fernando de Freitas, Président de Petrobras Bolivia - M. Luis Garcia Sanchez, Président de Repsol YPF Bolivia - M. Julio Gomez, vice-Ministre d'exploration et de production - M. Raúl Kieffer, Directeur général et ancien président de la chambre bolivienne des hydrocarbures - M. Gaston Mujia, représentant de Total à La Paz - M. Santos Ramirez Valverde, Président du Sénat - M. Victor Hugo Saenz, surintendant des hydrocarbures Au Venezuela - Son Exc. M. Pierre-Jean Vandoorne, Ambassadeur de France au Venezuela - M. Pascal Maccioni, chef de la mission économique - M. Dominique Mas, Premier Secrétaire à l'Ambassade de France - Melle Rachel Caruhel, attachée de presse à l'Ambassade de France - M. Georges Buresi, Président Total Venezuela - M. Descourtieux, Directeur général de Perenco Venezuela - M. Luis-Xavier Grisanti, association vénézuélienne des hydrocarbures - Mme Lemaître, Directrice des affaires juridiques de Schlumberger - M. Bernard Momer, vice-Ministre de l'Energie et du Pétrole - M. Carlos Mendoza Potela, conseiller secteur énergie à la présidence de la banque centrale - Mme Marianna Parraga, journaliste à El Universal - M. Michel Seguin, Directeur Amériques et M. Aliro, Directeur adjoint du groupe Total - Députés de la Commission Energie et Mines de l'Assemblée nationale Au Brésil à Rio de Janeiro : - M. Hugues Goisbault, Consul général de France - Mme Chantal Garnier, chef de la mission économique - M. Cedric Prieto, Consul adjoint - M. Bertrand Velon, adjoint au chef de la mission économique - M. Jean-Pierre Bel, Directeur Président de Light - M. Frédéric Delormel, Directeur Président de Technip Brésil - M. Carlos Fen Alvim, Directeur de l'ONG « Economia e energia » - M. Johannes Hoebard, Directeur exécutif d'AREVA - Professeur Luiz Pinguelli Rosa, coordinateur du programme de la planification énergétique de l'université fédérale de Rio de Janeiro - M. Adriano Pires, Directeur exécutif du centre brésilien d'infrastructure - M. Patrick Yves Pluen, Directeur général de Total Brésil - M. Paul Poulallion, Directeur exécutif de Sinergia & Desenvolvimento - M. Jean-Paul Prates, consultant - M. Ildo Sauer, Directeur gaz et énergie de Petrobras - Mme Cinthia Silveira, Directrice gaz et électricité de Total - M. Mauricio Stolle Bahr, délégué général de Suez Energy Brasil - M. Mauricio Tolmasquim, Président d'Entreprise d'études énergétiques - M. Otto Torsten, représentant d'AREVA, centrale nucléaire d'Angra à Brasilia : - Son Exc. M. Jean de Gliniasty, Ambassadeur de France au Brésil - M. Alexis Loyer, adjoint au chef de la mission économique - M. Aldo Rebello, Président de la chambre des députés du Brésil - M. Paulo Egler, consultant - M. Luis Fernando Galvão, sous-chef de la division du désarmement et des technologies sensibles - M. Ronaldo Schuck, Secrétaire d'Etat de l'énergie électrique - M. Antonio Simões, chef du département énergie au Ministère des Affaires étrangères Déplacement à Alger ___ Représentants de l'ambassade de France - M. Hubert Colin de Verdière, Ambassadeur de France en Algérie - M. Pierre Mourlevat, chef de la mission économique - Sébastien Andrieux, chef du pôle énergies, industries et infrastructures à la mission économique Ministère de l'énergie et des mines - M. Maamar Hamada, Directeur des relations extérieures au ministère de l'Energie et des Mines - M. Abdelkader Yacine, Directeur général des hydrocarbures au ministère de l'Energie et des Mines - M. Dahmani, conseiller du Ministre de l'Energie et des Mines Experts algériens - M. Maâmar Benguerba, ancien ministre du travail, ancien expert de l'OPEP - M. Abdelmadjid Attar, ancien ministre des ressources en eau et ancien PDG de Sonatrach Parlementaires algériens - M. Reguieg Bentabet, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Emigration de l'Assemblée populaire nationale - M. Tayeb Nouari, Président de la Commission des Affaires économiques, du Développement, de l'Industrie, du Commerce et de la Planification Représentants des entreprises françaises - M. Marc Morandeau, Directeur administratif et financier de Total Algérie - Robert Argiolas, Directeur de Gaz de France Algérie - Bertrand Huet, Directeur résident de Entrepose Contracting Déplacement à Libreville ___ Représentants de l'ambassade de France - M. Jean-Marc Simon, Ambassadeur de France au Gabon - M. Dimitri Verdet, conseiller économique et commercial - Les représentants des différents services de l'ambassade chargés de la coopération avec le Gabon Ministres et représentants du Président de la République - M. Richard Onouviet, Ministre de l'Energie, des Mines et du Pétrole - M. Ali Bongo Ondimba, Ministre d'Etat, Ministre de la Défense nationale - M. Egide Boundono Simangoye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs - M. Alexandre Barro Chambrier, Ministre délégué aux Finances - M. Charles Mba, Ministre délégué aux Finances - M. Patrice Otha, Directeur de cabinet adjoint du Président de la République - M. Michel Essonghe, conseiller personnel du Président de la République - M. Eric Chesnel, conseiller spécial du Président de la République, secrétaire général de l'association France-Gabon Parlementaires - Michel Menga Essone, Président de la Commission des Affaires Economiques de l'Assemblée Nationale Représentants des entreprises françaises - M. Jean Privey, Directeur Total Afrique et PDG de Total Gabon - M. Jean Bié, Directeur Total Gabon - M. Serge Findji, Maurel & Prom - M. Didier Lespinas, Directeur général de la SOGEC - M. Vincent Lepouse, Directeur de l'administration de la concession de la Société d'énergie et d'eau du Gabon - M. Bernard Bartoszek, Directeur général de Axa Assurances Gabon - M. Erik Watremez, associé du cabinet Ernst & Young au Gabon - M. Michel Gonzalez, Directeur général adjoint de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Gabon Représentant du FMI - M. Richard Randriamaholy, représentant résident du FMI au Gabon. Déplacement à Téhéran ___ Représentants de l'ambassade de France - M. Bernard Poletti, Ambassadeur de France - M. David Cvach, deuxième conseiller - M. Michel Lallemand, chef de la mission économique - M. Emmanuel Debroise, adjoint au chef de la mission économique Responsables des compagnies pétrolières et gazières iraniennes - M. Mohammad Reza Nematzadeh, vice-Ministre du Pétrole, Directeur général de la NIORDC (National iranian oil refined products and distribution company) - M. N. Sayifi, Directeur général de NIGEC (National iranian gas import company) Experts - son Excellence M. Hossein Adeli, MM. Nasser Hadian, Bijan Khajehpour et Bernard Hourcade, responsables et analystes politiques - MM. Paul Graf, Hatef Haeri, Farzin Aram et Saïd Leilaz, consultants et analystes spécialistes des enjeux énergétiques Représentants des entreprises étrangères - M. Jean-Claude Ragot, Directeur général de Total South Pars - M. Sharam Motevasselian, représentant résident de Technip - M. Yves Mérer, Directeur général de Shell companies in Iran - M. Klaus Angerer, Directeur général d'OMV Iran, responsable du projet Nabucco Déplacement à New Delhi ___ Représentants de l'ambassade de France - Son Exc. M. Dominique Girard, Ambassadeur de France en Inde - M. Gilles Bourbao, conseiller - M. Anne Genoud, Première secrétaire - M. Jean Leviol, chef de la mission économique - M. Eric Pierrat, conseiller commercial - M. Stéven Curet, attaché commercial Parlementaires indiens - M. Singh Gill, membre du Parlement - Maj. Gen. Bhuwan Chandra Khanduri, membre du Parlement Ministre et représentants des administrations - M. Murli Deora, Ministre du Pétrole et du Gaz naturel - M. Ajay Mathur, Directeur général du bureau de l'efficacité énergétique - M. Kirit Parikh, conseiller sur l'énergie à la Planning commission Responsables d'entreprises indiennes - M. Prosad Dasgupta, Directeur de Petronet LNG (société publique d'importation de gaz liquide) - M. Vaidhyanathan Raghuraman, Directeur du département pétrole et gaz de la Confederation of Indian Industry Experts - M. Rajendra Pachauri, Directeur général du TERI (The energy and resource institute), président du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) - Prof. Sukh Deo Muni, conseiller auprès du président de l'Observer research foundation - Dr. Sudha Mahalingam, chercheur, spécialiste de la sécurité énergétique - Prof. Leena Srivastava, Directrice exécutive du TERI - M. Talmiz Ahmad, Directeur général de l'Indian Council for World Affairs - M. Siddarth Varadarajan, rédacteur en chef du Hindu Représentants d'entreprises françaises - M. Marc Philippe, vice-Président de Suez pour les pays de la SAARC - M. Frederic Lalanne, vice-Président et directeur d'Alstom Inde - M. Jean-Pierre Junqua, Directeur de Total gaz et électricité Inde - M. Ajay Dhagat, directeur d'AREVA T&D Inde - M. Rajendra Shrivastav, représentant d'EDF pour l'Inde - M. H. L. Suresh, Président de l'Indo-french technical association, représentant de l'IFP en Inde IV. Données de base sur l'énergie Annexe 1 Energie : définitions fondamentales 377 Annexe 2 Les équivalences énergétiques 381 Annexe 3 L'énergie dans le monde 382 annexe 3.1. Les réserves 382 annexe 3.2. La production 383 annexe 3.3. Les sources d'approvisionnement 384 annexe 3.4. La consommation 385 Annexe 4 Les prix du pétrole 391 Annexe 5 Les routes du pétrole et du gaz 396 ANNEXE 1 Energie : définitions fondamentales L'énergie primaire : c'est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, le gaz naturel, les combustibles minéraux, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium. C'est l'énergie primaire qui est prise en compte pour évaluer la production d'énergie. L'énergie finale : c'est la quantité d'énergie disponible pour l'utilisateur final (l'essence à la pompe, l'électricité à la prise de courant...). La différence entre le chiffre de la production d'énergie primaire et celui de la consommation finale d'énergie provient des pertes et des rendements de conversion, notamment pour la production d'électricité. Les énergies fossiles : il s'agit du charbon (houille, lignite, tourbe), du pétrole et du gaz naturel. Elles proviennent de la transformation de la biomasse (arbres, plantes, animaux, micro-organismes) enfouie depuis plusieurs milliers ou millions d'années. Lors de la combustion des énergies fossiles, l'énergie solaire qui a permis la croissance de la biomasse (à partir de l'eau, du gaz carbonique - CO2 - et de l'azote de l'air) est restituée sous forme de chaleur, tandis que du CO2 (gaz à effet de serre) est libéré dans l'atmosphère. L'énergie nucléaire : c'est l'énergie liant les constituants du noyau d'un atome. L'éclatement (fission nucléaire) de certains atomes lourds comme l'uranium ou le plutonium en atomes plus petits libère de la chaleur. Dans les centrales nucléaires, cette chaleur est utilisée pour produire de l'électricité. C'est la source d'énergie la plus concentrée utilisable actuellement. L'énergie nucléaire n'est pas issue de la matière organique. Elle ne produit pas de gaz à effet de serre (gaz carbonique, etc.). En revanche, elle génère des déchets radioactifs. L'énergie géothermique : c'est la chaleur fournie par la Terre. Elle provient principalement de la désintégration des éléments radioactifs naturellement présents dans les roches du sous-sol et elle n'est utilisable que dans des zones particulières où elle s'est accumulée. Elle est récupérée sous forme d'eau chaude (sources thermales, puits artésiens, geysers). Son utilisation la plus répandue est le chauffage (habitations, serres, etc.) efficace avec de l'eau à température modérée (à partir de 15 ou 20° C). La production d'électricité par géothermie demande une eau beaucoup plus chaude (plus de 150° C). Elle ne se rencontre qu'au voisinage des zones volcaniques actives (en Guadeloupe ou en Islande par exemple). L'énergie géothermique n'est pas une énergie renouvelable. Lorsqu'ils sont exploités, les gisements d'eau chaude se tarissent ou se refroidissent. Les énergies renouvelables : une énergie est dite renouvelable quand, sur une centaine d'années, on n'en consomme pas plus que la nature n'en produit. La plupart des énergies renouvelables proviennent directement ou indirectement du soleil. Il s'agit de l'énergie solaire, utilisée directement par les chauffe-eau solaires (panneaux solaires) et les piles solaires, de l'énergie hydraulique, qui provient essentiellement du passage de l'eau à travers les barrages et est donc issue du cycle de l'eau, de l'énergie éolienne, qui utilise la force du vent, et de l'énergie de la biomasse (arbres, plantes, animaux, micro-organismes), qui provient de sa combustion. LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Source : Energie et géopolitique, aide mémoire, document établi par le SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile de France). LE CAS PARTICULIER DE L'HYDROGÈNE L'hydrogène n'est pas une source d'énergie. C'est un vecteur énergétique : il permet de stocker ou de transporter de l'énergie.
Il se dit beaucoup de choses sur « la fée hydrogène » qui serait la solution miracle à l'horizon 2050. - L'hydrogène n'est pas une source d'énergie (il n'y a pas de mines d'hydrogène sur terre). Il faut donc le fabriquer : _ le plus souvent à partir de gaz naturel ; mais se pose alors le problème d'une énergie fossile donc épuisable et contributive au réchauffement climatique (bien que la séquestration du CO2 produit soit possible à terme) ; _ ou à partir d'eau (électrolyse de l'eau) ; mais cela nécessite beaucoup d'électricité, ce qui pose problème, sauf si l'électricité est renouvelable ou au moins non produite par une énergie fossile. - En revanche, c'est un vecteur énergétique : il permet de transporter l'énergie qui voyage mal sous certaines formes, comme l'électricité. Il facilite la diversification et optimise la contribution de chaque source d'énergie. Voici un exemple de schéma prospectif (avec les réserves d'usage liées à l'exercice) : _ mise en place de centrales (solaire, éolienne, hydraulique, marémotrice...) produisant de l'électricité renouvelable dans des zones inexploitables pour l'homme (déserts, océans) ; _ fabrication de l'hydrogène localement à partir d'eau et de cette électricité renouvelable ; _ transport de l'hydrogène par bateaux, éventuellement après liquéfaction comme le gaz naturel, même si ce n'est pas simple ; _ puis consommation pour des applications dans les bâtiments et les transports. Source : SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France). ANNEXE 2 Les équivalences énergétiques Afin de comparer la quantité d'énergie contenue dans différentes sources, l'usage est de comparer la quantité de chaleur (quantité maximale d'énergie) produite par la combustion complète d'une quantité donnée de chacune d'elles : une tonne de pétrole fournit 42 milliards de joules, une tonne de charbon 26 à 28 milliards de joules selon sa qualité, une tonne de gaz naturel liquide 46 milliards de joules. Bien qu'il n'y ait pas à proprement parler de combustion, cette équivalence est aussi utilisée pour l'électricité (1 000 kWh, ou 1 MWh, d'électricité équivalent à 3,6 milliards de joules) et pour les matières radioactives (la radioactivité contenue dans 1 kg d'uranium naturel dégage 360 milliards de joules dans une centrale nucléaire). Pour faciliter les comparaisons économiques, l'unité de mesure couramment utilisée est la tonne d'équivalent pétrole (tep). C'est la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole (42 milliards de joules). La combustion complète de 0,619 tonne de pétrole dégage autant de chaleur que celle d'une tonne de houille, et celle de 1,096 tonne de pétrole autant que la combustion complète d'une tonne de gaz naturel.
ANNEXE 3 L'énergie dans le monde 3.1. Les réserves
En partant des gisements découverts, on extrapole différentes valeurs sur les réserves de pétrole restant à découvrir (253) : · la première, appelée réserves prouvées, est la quantité de pétrole qui sera exploitée avec les moyens actuels avec une probabilité d'au moins 90 % ; · la deuxième, appelée réserves probables, est la quantité de pétrole qui sera produite, mais avec une probabilité de 50 % au minimum ; · la troisième, appelée réserves possibles, est la quantité de pétrole très hypothétiquement produite, si le prix de vente augmente de façon à absorber les coûts d'extraction qui seront très élevés, avec une probabilité pouvant aller jusqu'à seulement 5 %. Il existe, par ailleurs, des ressources de pétrole dit non conventionnel. Il s'agit par exemple de pétrole dense, fortement visqueux et qu'il faut rendre plus fluide et plus léger pour le produire en quantités suffisantes et économiquement rentables. Il existe ainsi de grandes quantités de bruts extra-lourds au Venezuela et de sables asphaltiques au Canada représentant un potentiel pratiquement équivalent aux actuelles réserves de pétrole conventionnel du Moyen-Orient. Même si leur extraction n'est pas toujours très aisée, leur exploitation a déjà commencé sur certaines zones. 3.2. La production
3.3. Les sources d'approvisionnement (254)
3.4. La consommation
CONSOMMATION MONDIALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE D'ICI 2030 SELON LE SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE PUBLIÉ EN 2004 PAR L'AGENCE INTERNATIONALE DE L'ÉNERGIE (en millions de tonnes équivalent pétrole) 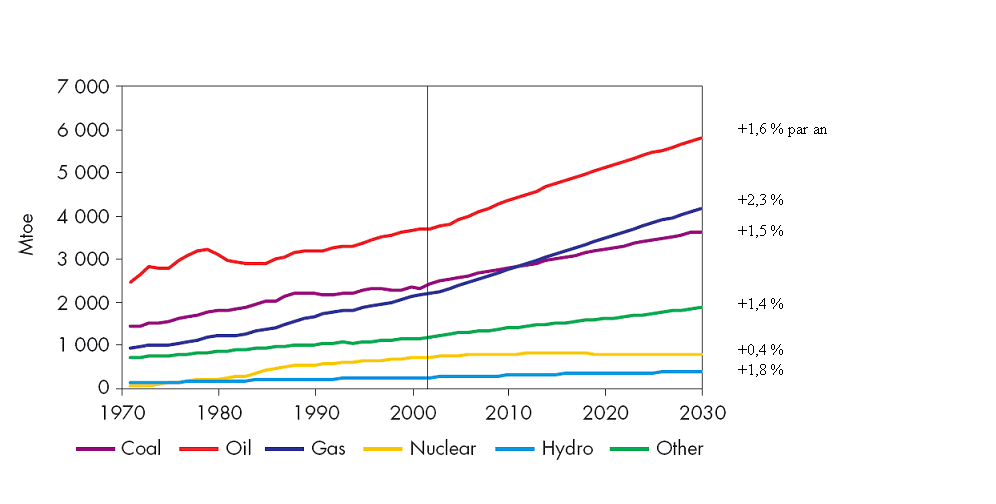 Une consommation totale en croissance de 1,7% par an pour atteindre 16,5 Gtep en 2030 Source : ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, d'après l'Agence internationale de l'énergie.
ÉVOLUTION DE LA DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE, PAR SECTEUR (en millions de barils par jour) 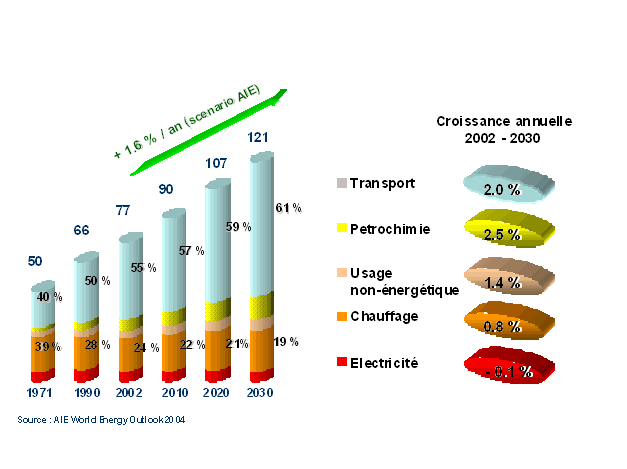 NB : Au-delà de 2010, cette prévision est peu réaliste, car elle ne tient pas compte du fait que la production de pétrole ne pourra pas continuer de croître au même rythme. Source : Total, d'après l'Agence internationale de l'énergie.
CONSOMMATION DE PÉTROLE DANS QUELQUES PAYS ET RÉGIONS EN 2003 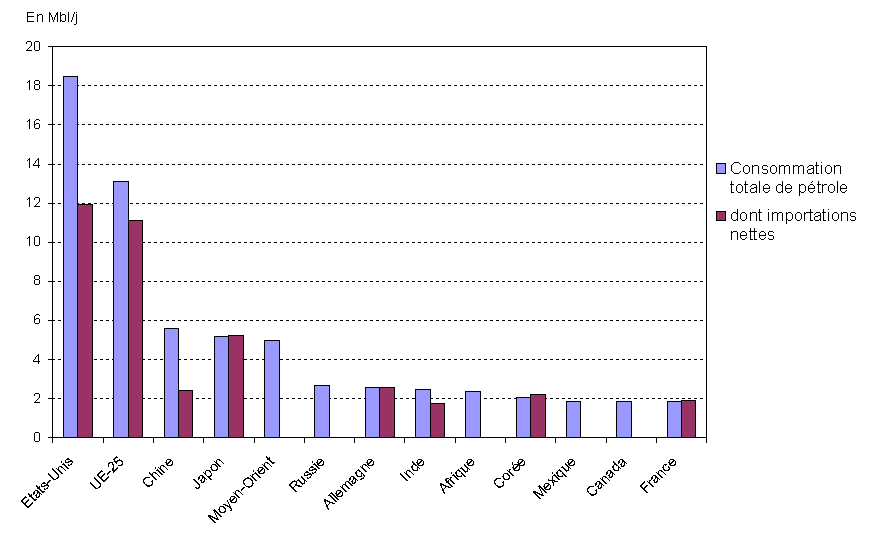 Consommation considérée = 89% de la consommation mondiale Source : ministère de l'Economie, des Ffinances et de lIindustrie. CONSOMMATION MONDIALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE PAR HABITANT : (en tonnes équivalent pétrole) 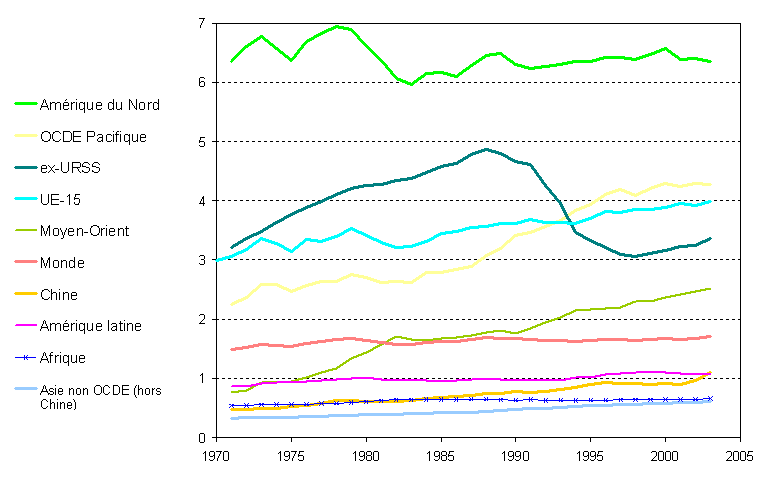 Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, d'après l'agence internationale de l'énergie. ANNEXE 4 Les prix du pétrole COMPOSITION DU PRIX D'UN LITRE D'ESSENCE DANS LES PAYS DU G7 (en dollar américain par litre) 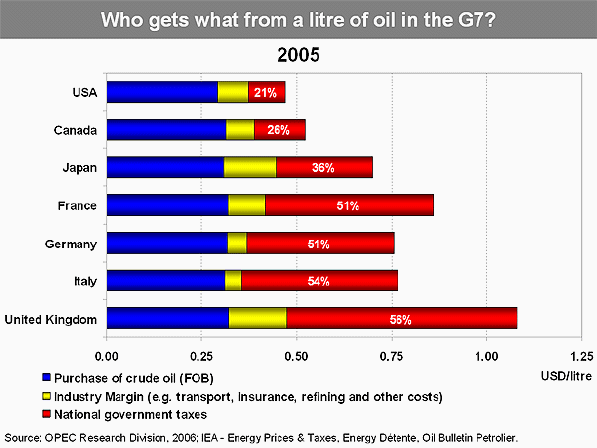 NB : Purchase of crude oil : achat du pétrole brut Industry Margin (e.g. transport, insurance, refining and other costs) : marge de l'industrie (transport, assurance, raffinage et autres coûts) National government taxes : taxes gouvernementales nationales COURS MOYEN ANNUEL DU PÉTROLE BRUT (en dollars américains courants et constants par baril) 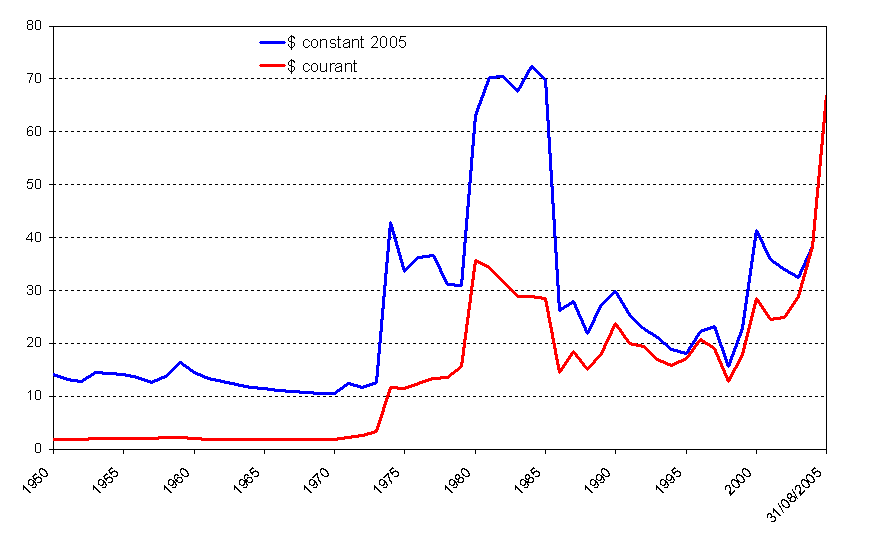 NB : Arabe léger jusqu'en 1985, Brent depuis 1986 Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. ANNEXE 5 Les routes du pétrole et du gaz FLUX DE PÉTROLE ET PRINCIPAUX GOULETS D'ÉTRANGLEMENT : 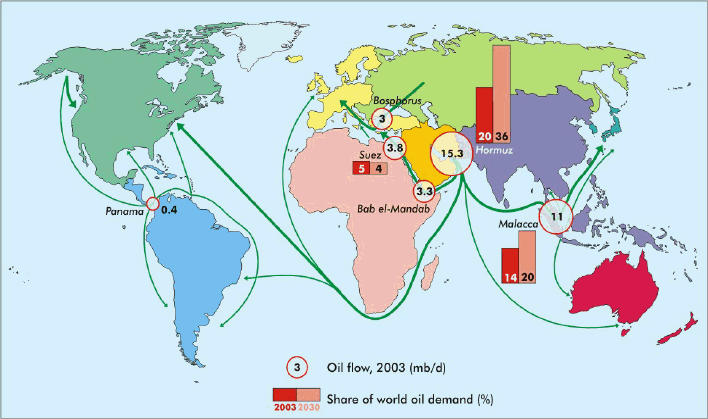 NB : Oil flow : flux pétrolier, en millions de barils par jour. Share of world oil demand : part de la demande pétrolière mondiale Source : Institut français du pétrole. PRINCIPAL RÉSEAU INTERRÉGIONAL DE FLUX COMMERCIAUX DE GAZ 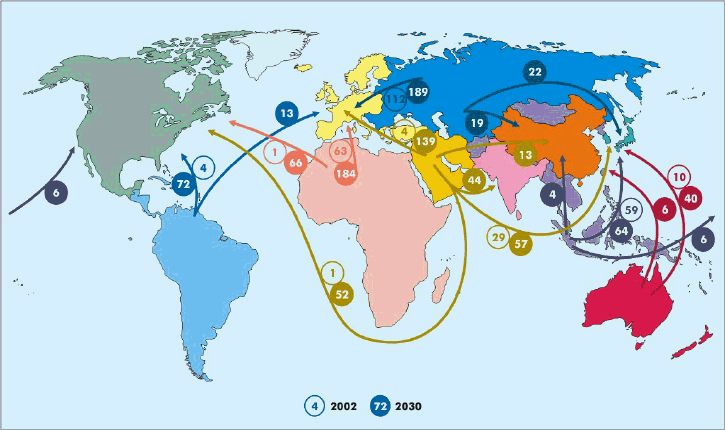 Source : Institut français du pétrole. 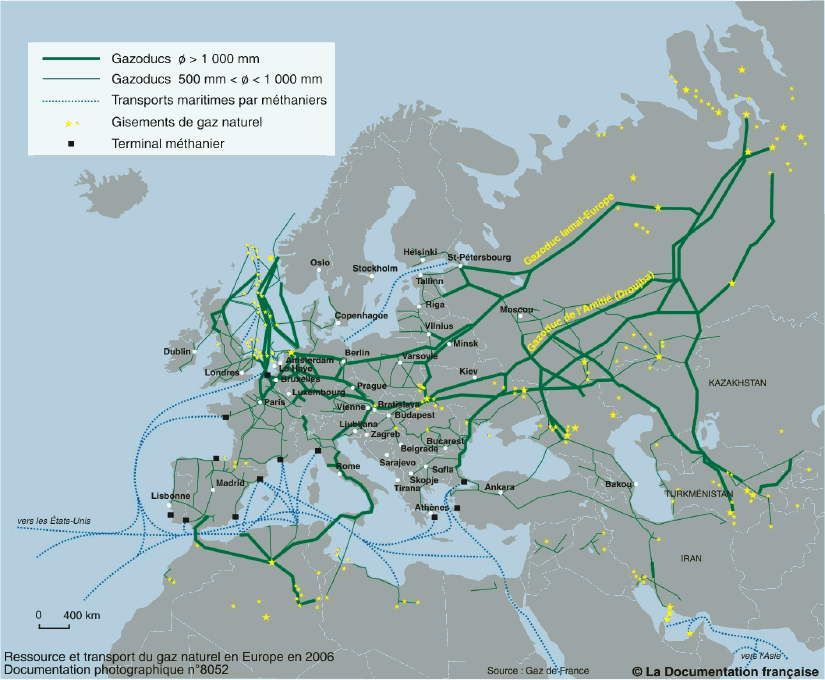 V. Liste des principaux sigles et abréviations
1 () Jusqu'au 3 octobre 2006. 2 () Organisation des pays exportateurs de pétrole qui regroupe l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, le Koweït, le Venezuela, le Qatar, l'Indonésie, la Libye, les Emirats arabes unis, l'Algérie et le Nigeria. 3 () On estime la perte de production pétrolière cumulée en 2005, après cet événement, à 109 millions de barils. L'ensemble de ces données est extrait de L'industrie pétrolière en 2005 (ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, DGEPM). 4 () La fermeture du champ devrait amputer la production américaine de 400 000 barils, soit près de 8 % du total - Le Monde, 9 août 2006. 5 () Jean Lamy, « D'un G8 à l'autre : sécurité énergétique et changement climatique », Politique étrangère, 1 : 2006, p. 133. 6 () Jean Lamy, op. cit., 1 : 2006, p. 132. 7 () PNUD, Rapport sur le développement humain 2005. 8 () « Comprendre l'espace mondial contemporain », Atlas de la mondialisation, Presses de Sciences Po. 9 () L'industrie pétrolière en 2005, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, DGEPM. 10 () « 60 ans après la guerre, un monde en recomposition » - Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies (Ramses) 2006 - Institut français des relations internationales (IFRI). 11 () Livre vert « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable » - COM (2006) 105 final. 12 () Problèmes économiques, 21 juin 2006. 13 () « Perspectives économiques de l'OCDE », n°79, juin 2006, p. 9. 14 () « Global Energy Security Perspectives » - Allocution au sommet d'Evian du 30 mai 2006. 15 () Mission économique, fiches de synthèse d'août 2006. 16 () Eurostat, « Aspects statistiques du secteur de l'énergie en 2004 », mai 2006. 17 () Jean Lamy, op. cit., 1 : 2006, p. 134. 18 () Agence internationale de l'énergie, World Energy Outlook 2006. 19 () François Cattier, Lisa Guarrera, Prabodh Pourouchottamin, « L'accès à l'énergie : un défi majeur du XXIème siècle », Géopolitique n° 93, p. 12. 20 () Rapport présenté par MM. Pierre Laffitte et Claude Saunier, sénateurs, sur « Les apports de la science et de la technologie au développement durable », tome I : « Changements climatiques et transition énergétique : dépasser la crise », au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 3197, Sénat n° 426, juin 2006. 21 () Synthèse de la Mission interministérielle de l'Effet de Serre (MIES). 22 () « Changement climatique : le défi majeur » - rapport n°3021 tome 1 de la Mission d'information sur l'effet de serre présidée par M. Jean-Yves Le Déaut et dont la rapporteure est Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. 23 () Pour une analyse détaillée de ses effets, se reporter au rapport n° 3021 précédemment cité. 24 () « Déclaration commune des Académies des sciences sur la réponse globale au changement climatique » (Sommet du G8 de juillet 2005, à Gleneagles). 25 () Banque mondiale, « Managing Climate Risk-Integrating Adaptation into World Bank Group Operations », août 2006. 26 () PNUE, Annuaire GEO 2006 : « Tour d'horizon d'un environnement en pleine mutation » . 27 () Rapport n° 3021 précédemment cité. 28 () Au sein de l'Union européenne à 25 membres, les émissions s'élèvent à 2,32 t C par habitant. 29 () Aurélie Vieillefosse, op. cit., p. 7. 30 () Les Etats-Unis estiment ce coût à 400 milliards de dollars et 5 millions d'emplois [source : ministère des Affaires étrangères]. 31 () « Nous ne devons être dépendants ni d'une seule qualité [de pétrole], ni d'un seul procédé, ni d'un seul pays, ni d'un seul trajet ni d'un seul champ. La sécurité et la certitude résident, en matière pétrolière, dans la diversité et seulement dans la diversité ». 32 () Daniel Yergin, « Ensuring Energy Security », Foreign Affairs, mars-avril 2006. 33 () ONU, World Population Prospects : the 2004 Revision, analytical report, 2005. 34 () Nicolas Sarkis, « L'après-pétrole a déjà commencé », Le Monde diplomatique, 1er mai 2006. 35 () En 1997-1998, les cours du brut sont momentanément passés sous la barre des 10 dollars le baril. 36 () L'industrie pétrolière en 2004 - ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction générale de l'énergie et des matières premières. 37 () L'industrie pétrolière en 2005 - ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction générale de l'énergie et des matières premières. 38 () D'après le classement de la Banque mondiale (« World Development Indicators database », World Bank, 1st July 2006). 39 () « La pétro-politique rebat les cartes », La Tribune, 12 juin 2006. 40 () Christine Rosellini, « La répartition de la rente pétrolière en Afrique », Problèmes économiques, n° 2.902. 41 () Christine Rosellini, « La répartition de la rente pétrolière en Afrique », Problèmes économiques, 21 juin 2006. 42 () En 2004, la demande mondiale s'établissait à 44 Mbep/j, en augmentation de 3,1 % par rapport à 2003, elle-même hausse de 2,1 % par rapport à 2002 : il s'agit de la plus forte hausse des trois dernières décennies. 43 () Pour l'exercice 2002, le 9 janvier 2004, la compagnie déclarait détenir 3,9 Gbep de réserves ; le 18 mars, 470 Mbep. 44 () Documents transmis lors de l'audition de M. Bruno Weymuller, le 3 mai 2006. 45 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitique du pétrole, Armand Colin, Paris, 2006. 46 () Une mobilisation de certains lobbies américains a cependant permis à Chevron de finalement acquérir Unocal. 47 () L'industrie pétrolière en 2005, ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, DGEMP. 48 () Isabelle Rousseau, « La réorganisation administrative de Pemex (1989 - 2005) : vers une nouvelle gouvernance d'entreprise ? », Problèmes d'Amérique latine, n° 57/58, été/automne 2005. 49 () André Furtado, « Les changements institutionnels et organisationnels dans l'industrie pétrolière brésilienne : répercussions sur les stratégies des acteurs », Problèmes d'Amérique latine, n° 57/58, été/automne 2005. 50 () Sadek Boussena, Catherine Locatelli, « Le nouveau rôle de l'Etat dans l'industrie pétrolière en Russie : le privé sous tutelle ? », avril 2006 - à paraître dans MEDenergie. 51 () En 2005, la compagnie gazière Gazprom a acheté 72,66 % du cinquième producteur pétrolier russe, Sibneft, donnant naissance à la troisième plus grande capitalisation boursière du monde et permettant à Gazprom d'augmenter sa production de 1,17 million bep/j [source : DGEMP, ministère des Finances]. 52 () En 2004, la demande mondiale de pétrole a augmenté de 3,4 % soit la plus forte augmentation depuis 1976. La Chine a été le moteur de cette hausse avec une augmentation de la demande de brut de 0,9 million de barils par jour, suivie par les Etats-Unis (+0,5 Mb/j). 53 () The Energy Intelligence Top 100 : Ranking the World's Oil Companies - édition 2006. 54 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitique du pétrole, Armand Colin, Paris, 2006. 55 () Energy Intelligence Top 100 : Ranking the World's Oil Companies - édition 2006. 56 () Dossier « Pétrole : les pays émergents en embuscade » Le Monde, 28 juin 2005. 57 () « Les nouveaux nababs du pétrole », Le Monde, 10 août 2006. 58 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitique du pétrole, Armand Colin, Paris, 2006. 59 () Robert Mabro, « Les dimensions politiques de l'OPEP », Politique étrangère, 2/2001, p. 408. 60 () Cédric de Lestrange, « L'OPEP, combien de divisions ? », Géoéconomie, n° 38, été 2006, p. 60. 61 () L'Arabie Saoudite est un acteur majeur au sein de l'OPEP dans la mesure où elle détient 25 % des réserves mondiales et constitue le premier producteur de l'organisation (sa production correspondait à 30 % de la production OPEP en 2004). 62 () Robert Mabro, op.cit., p. 405. 63 () « A qui profite la hausse des matières premières ? », La Tribune, 25 septembre 2006. 64 () De juillet à septembre 2006, le brut a perdu plus de 18 dollars pour se fixer sous la barre des 60 dollars. 65 () En décembre 2004, l'OPEP avait utilisé « l'arme du robinet » après la dégringolade de près de 30 % du prix du brut les trois mois précédents - Le Monde, 26 septembre 2006. 66 () Entretien au Financial Times rapporté dans Le Monde du 10 août 2006. 67 () Jean-Pierre Favenec, « Au centre de la scène pétrolière : le Moyen-Orient », in Gérard Chaliand et Annie Jafalian, La dépendance pétrolière, Universalis, 2005, 196 p., p. 26. 68 () Pierre Noël, « La " doctrine Bush " et la sécurité pétrolière », Politique étrangère, n° 2, 2006, p. 251. 69 () John V. Mitchell, « L'autre face de la dépendance énergétique », Politique étrangère, n° 2, 2006, p. 255. 70 () Un plein d'essence coûte en Iran l'équivalent d'un euro ; le carburant est vendu à un prix inférieur au prix du marché auquel une partie est importée, mais aussi inférieur au coût de la production nationale. 71 () Au sens du FMI, ces pays sont l'Algérie, l'Azerbaïdjan, Bahreïn, l'Iran, le Kazakhstan, le Koweït, la Lybie, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis. 72 () Les Etats-Unis appliquent un embargo économique total vis-à-vis de l'Iran depuis 1995. S'y est ajouté, en 1996, l'Iran Libya Sanctions Act qui vise à interdire, sous peine de sanctions sévères, à tout Etat et toute société étrangère d'investir plus de 20 millions de dollars par an dans le secteur pétrolier et gazier de l'Iran (et de Libye). Mais ni Total, ni Gazprom, ni la compagnie malaisienne Petronas, qui ont signé ensemble un important contrat pour développer l'immense champ gazier de South Pars, ne se sont vues infliger de sanctions américaines. 73 () Selon M. Olivier Appert, Président de l'Institut français du pétrole, cette part pourrait atteindre 33 % en 2030. 74 () Nous empruntons cette expression à Thomas Gomart, Politique étrangère, 1, 2006. 75 () Françoise Thom, « La naissance de l'"énergocratie" russe », Commentaire, n° 114, été 2006. 76 () Jean Lamy, Politique étrangère, 1-2006. 77 () Bernard Laponche, « Les perspectives énergétiques de la Russie et le dialogue Union européenne-Russie sur l'énergie », Revue de l'énergie, 2003, n° 548. 78 () Les Echos, 21 mars 2006. 79 () Cf. Clifford G. Gaddy et Barry W. Ickes, "Resource Rents and the Russian Economy", Eurasian Geography and Economics, 46, n° 8. 80 () Le site de Transneft www.transneft.ru/Shema/Shema.asp?LANG=EN fournit une excellente carte du réseau. On peut également se reporter à la carte ci-après. 81 () Rapport n° 1989 déposé au nom de la Commission des Affaires étrangères le 14 décembre 2004 http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/041989.asp. 82 () « La naissance de l'énergocratie russe », Commentaire, n° 114, été 2006. 83 () International Herald Tribune, 6 juillet 2006. 84 () Vladimir Milov, « Le dialogue énergétique UE-Russie : concurrence contre monopoles », Note Russie. Nei. Visions n° 13, IFRI, programme de recherche Russie/NEI, septembre 2006. 85 () Les dix compagnies étrangères ayant signé un contrat avec le gouvernement bolivien sont : Total, Vintage, Repsol-YPF, Petrobras Bolivie, Petrobras Energia, Mac Petrol, Plus Petrol, Bristish Gas Bolivia, Andina et Chaco. 86 () Lors de la cérémonie de signature des nouveaux contrats, on pouvait lire, sur un grand panneau placé derrière la tribune où se trouvait le Président Evo Morales : « Nos hydrocarbures, notre dignité, nationalisation pas un pas en arrière, la Bolivie change, Evo tient ses engagements ». 87 () 1 m3 = 35,31 pieds cubes. 88 () C'est vrai de la Bolivie, mais aussi de l'Argentine qui traverse une grave crise énergétique et qui n'est pas en mesure d'honorer bon nombre de contrats de vente de gaz destinés aux entreprises brésiliennes. 89 () Une hausse de 2 dollars du prix payé par Petrobras se traduirait par un alourdissement de 400 millions de dollars de sa facture annuelle. 90 () Le Président Hugo Chavez s'est exprimé en ces termes le 30 septembre 2005 à l'issue du Sommet de Brasilia sur la Communauté sud-américaine des Nations. 91 () L'« Alternative bolivarienne des Amériques » (ALBA) est l'initiative phare du Président Hugo Chavez, inspirée de la lutte du libertador Simon Bolivar, et lancée pour contrecarrer le projet américain de « Zone de libre échange des Amériques » (ALCA), que Caracas juge excessivement déséquilibrée car dominée par les Etats-Unis. 92 () Grenade, la Dominique, Saint Vincent et les Grenadines, la Jamaïque, Cuba, Antigua et Barbuda, les Bahamas, la République dominicaine, le Surinam, Guyana, Sainte Lucie, Belize et Saint Kitts et Nevis. 93 () La production chinoise de pétrole était de 3,62 millions de barils par jour en 2005. 94 () La Chine produit 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, ce qui couvre ses besoins actuels. 95 () Heinrich Kreft, « La diplomatie chinoise de l'énergie », Politique étrangère, n° 2, 2006, p. 353. 96 () L'Inde est le troisième producteur mondial de charbon, derrière la Chine et les Etats-Unis. 97 () Environ 90 % de la consommation d'énergie est commerciale, le reste étant couvert par des sources d'énergie traditionnelles, essentiellement d'origine végétale. 98 () De récentes découvertes de pétrole au Rajasthan et de gaz dans le golfe du Bengale suscitent beaucoup d'espoirs, mais le pétrole trouvé est lourd et éloigné des capacités de raffinage, tandis que le gaz est situé à une très grande profondeur et présent en quantité encore mal déterminée. 99 () En Chine, la production nationale de pétrole assure aujourd'hui plus de la moitié de la consommation. 100 () Et 0,8 point à la Chine. 101 () Bien que le pays possède de très abondantes réserves de charbon, il importe une partie de sa consommation, principalement d'Australie, d'Afrique du Sud et d'Indonésie, car le charbon indien contient beaucoup de cendres, ce qui lui donne un faible rendement et le rend particulièrement polluant. 102 () Le Bangladesh possède aussi des réserves de gaz, mais ses autorités souhaitent les conserver pour une utilisation interne, et refusent absolument d'en faire profiter l'Inde. 103 () Au niveau de l'Union indienne, cinq ministres sont actuellement compétents dans le domaine de l'énergie, responsables respectivement de l'électricité, du charbon, des énergies renouvelables, des énergies non conventionnelles, du pétrole et du gaz (les deux relevant du même ministre). S'y ajoute un département de l'énergie nucléaire qui dépend du Premier Ministre. 104 () Pour la Commission au plan, la part du nucléaire ne devrait pas dépasser 6,4 % en 2030, dans le scénario le plus favorable. 105 () Cf., à la fin du développement sur l'Asie, la carte des grands projets de construction de voies d'acheminement de pétrole et de gaz dans la région. 106 () Ces mines sont un héritage du conflit Iran-Irak des années 1980. 107 () Pékin a négocié avec ExxonMobil l'achat d'une partie du gaz de Sakhaline I. 108 () Le différend territorial porte sur les quatre îles les plus au sud de l'archipel des Kouriles, qui sont appelées Territoires du Nord par les Japonais, dont les deux pays se disputent la souveraineté. Le Traité de San Francisco stipulait en effet que les îles Kouriles devaient être cédées à la Russie, mais le Japon estime que les quatre îles du sud ne font pas partie de cet archipel mais se rattachent à Hokkaido. Le 16 août 2006, un pêcheur japonais a été abattu par des gardes-côtes russes, alors qu'il travaillait dans une zone dont la souveraineté est contestée. 109 () C'est à la suite de cet échec que le Japon a commencé à s'intéresser au pétrole iranien. 110 () L'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) compte dix membres : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam ; les trois autres Etats de l'ASEAN+3 sont la Chine, la Corée et le Japon. 111 () Celle-ci comprend le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka. 112 () http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=91&contentId=7017990/ 113 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitiques du pétrole, Paris, Armand Colin, p. 132. 114 () Céline Kauffmann, « Energie et pauvreté en Afrique », Repères, n° 8, centre de développement de l'OCDE, mai 2005 (www.oecd.org/dev/reperes). 115 () Jean-Marie Chevalier, « l'Afrique et le pétrole : entre la malédiction des exportations et celle des importations », www.dauphine.fr/CGEMP/. 116 () Tous les pays africains qui ont répondu au questionnaire adressé par MM. Jacques Godfrain et Hneri Sicre ont insisté sur cette difficulté, en particulier le Togo, le Niger, le Nigeria et le Sénégal. 117 () Itai Madamombe, « L'énergie, clé de la prospérité en Afrique », Afrique renouveau, 4 mars 2005. 118 () Dans sa réponse au questionnaire de MM. Jacques Godfrain et Henri Sicre, les autorités sénégalaises observent que « les faibles ressources budgétaires qui devraient prendre en charge une partie de la demande sociale et/ou améliorer la compétitivité de (la) production, servent plutôt à supporter des surcoûts souvent spéculatifs des produits pétroliers ». Le Togo constate, pour sa part, que sa facture pétrolière a été multipliée par quatre depuis 1999 et le Niger que « la valeur des importations des produits pétroliers représente près du tiers des recettes d'exportations en 2004 contre seulement 14 % en 2000. ». 119 () Faustin Kuediasala, « Les pays africains peuvent-ils survivre à la flambée des prix du pétrole ? », www.laconscience.com, 22 août 2006. 120 () Des actions sont menées en coopération avec la France, en particulier par le biais du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique) afin d'améliorer l'utilisation de la biomasse. 121 () 47 % du territoire africain dispose d'un niveau d'ensoleillement supérieur à 2100 kWh/m². 122 () Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (www.nepad.org). Voir Alioune Fall, « Energie et développement durable en Afrique : l'apport du Nepad », Liaison énergie francophonie, « Le nouveau partenariat pour le développement en Afrique », n° 65, 4e trimestre 2004, Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, p. 12. 123 () Dans la plupart des pays producteurs, la hausse des cours a pour effet d'accroître le pourcentage des recettes tirées de l'exploitation des puits par les compagnies privées grâce à des mécanismes contractuels favorables ; c'est le cas en Algérie, au Gabon ou au Congo, notamment par le biais de contrats dits de « partage de production ». 124 () Céline Kauffmann, « Énergie et pauvreté en Afrique », op. cit., p. 23. 125 () Pour un point de vue global sur la question de la rente pétrolière, on se reportera avec profit à Problèmes économiques, « Que faire de la rente des pétrodollars ? », n° 2.902, 21 juin 2006. 126 () Fatiha Talahite, « Le concept de rente : le cas des économies du Moyen-Orient et de l'Afrique du nord », Problèmes économiques, op. cit., p. 5 ; voir aussi B. Massuyeau, « Le point sur le syndrome hollandais », La lettre des économistes de l'AFD, n° 8, mars 2005. 127 () Toutes les contributions adressées en réponse au questionnaire de MM. Jacques Godfrain et Henri Sicre insistent sur cette question inquiétante. 128 () « Au Cameroun, l'oléoduc achemine aussi des problèmes », Libération, 18 juillet 2006. 129 () Olivier Charnoz, « Le pétrole africain : des clés pour comprendre », Afrique Contemporaine, n° 216, 2005-4, p. 25. 130 () Voir Philippe Sébille-Lopez, Géopolitiques du pétrole, Paris, Armand Colin, p. 154 et suivantes. 131 () Sylvie Fanchette, « Le delta du Niger (Nigeria), rivalités de pouvoir, revendications territoriales et exploitation pétrolière ou les ferments de la violence », Hérodote, n° 121, 2e trim. 2006, pp. 190-220. 132 () Le Royaume-Uni a organisé en 2003 une grande conférence sur le sujet avec 140 délégués regroupant 70 gouvernements, compagnies, groupes industriels, organisations internationales, ONG, sous l'égide de la DFID (Department For International Development) qui est l'organe chargé de l'aide publique au développement (voir http://www.dfid.gov.uk/). Cette réunion ainsi que d'autres tenues en 2002 et 2003 ont permis de mettre en place des documents permettant de rendre plus facilement publiques des informations pour promouvoir la transparence des industries extractives. 133 () Pour une analyse détaillée de ce phénomène dans les pays producteurs de pétrole : Paul Collier et Anke Hoeffler, « Démocraties pétrolières », Afrique contemporaine, Afrique et développement, n° 216, 2005-4, p. 107-123. 134 () Sont éligibles les pays dont les revenus fiscaux issus des industries extractives (hydrocarbures, minerais) constituent plus de 25 % des revenus fiscaux du pays et les pays dont le volume des exportations d'hydrocarbures et de minerais dépasse 25 % du revenu total des exportations (56 pays selon le FMI, Guide on Resource Revenue Transparency, juin 2005). 135 () Dans les années quatre-vingt dix plusieurs réunions se sont tenues sur la question de l'énergie : Première conférence panafricaine des ministres de l'énergie (Tunis, mai 1995) ; première et deuxième conférences régionales des ministres chargées de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources minérales et énergétiques en Afrique (Accra en 1995 et Durban en 1997). 136 () Pour plus de détails : http://afrec.mem-algeria.org/. 137 () « Afrique : la ruée vers l'or noir », Les Echos, 2 juin 2006. 138 () Le Gouvernement américain doit prendre en compte des considérations humanitaires et religieuses, l'intérêt de la communauté noire et des Eglises pour le continent africain étant de plus en plus important. 139 () La genèse de cet intérêt nouveau pour l'Afrique est décrite par Philippe Sébille-Lopez, op. cit., p. 137 et suiv. 140 () http///usinfo.state.gov/fr/Archive/2005/Dec/02-765085.html. 141 () Les Etats-Unis entendent inciter les pays africains à participer à des programmes dans le cadre de la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA, Africa Growth Opportunity Act) qui, depuis 2000, permet aux pays bénéficiaires d'accéder au marché américain en franchise de droits de douane pour la majorité de leurs produits. 142 () Cédric de Lestange, Christophe-Alexandre Paillard, Pierre Zenko, Géopolitique du pétrole. Un nouveau marché, de nouveaux risques, des nouveaux mondes, Paris, Editions Technip, p. 158. 143 () Gérard Magrin, Synthèse sur les enjeux d'un enrichissement pétrolier en Afrique centrale : le cas du Tchad, Centre international en recherches agronomiques pour le développement, Observatoire économique de géopolitique, novembre 2001, p. 2-3. 144 () Philippe Sébille-Lopez, op. cit., p. 142. 145 () En 2001, sur 8 milliards de barils de réserves découverts dans le monde, 7 l'avaient été en Afrique de l'Ouest (Le Figaro, 16 juillet 2003). 146 () Commandement européen de l'armée américaine. 147 () Pour preuve la réunion consacrée à la lutte antiterroriste dans les pays du Sahel qui s'est tenue les 23 et 24 mars 2004 au siège du commandement américain de l'Eucom avec les représentants de huit pays africains - Tchad, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Sénégal, Algérie, Tunisie - ainsi que les manœuvres organisées en juin 2005 dans ces mêmes pays sous commandement américain. 148 () Compte tenu de la différence de PIB entre la France et les Etats-Unis, notre pays n'a pas à rougir de ce montant d'aide. 149 () Disponible sur le site : www.chinadaily.com.cn 150 () La Chine entend également tirer profit de ses liens avec les pays africains dans les instances internationales comme la Commission des droits de l'homme de l'ONU pour éviter sa mise en cause pour sa politique en la matière. 151 () Libération, 27 avril 2006. 152 () Ainsi la Chine aurait mis à disposition de l'Angola 2 milliards de dollars sur dix-sept ans avec un taux d'intérêt privilégié en échange de 10 000 barils de pétrole par jour. 153 () Pierre-Antoine Braud, « Anatomie d'une nouvelle stratégie chinoise », octobre 2005 (http://www.iss-eu.org/). 154 () 500 000 barils par jour. La CNPC aurait également construit une raffinerie d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an. 155 () Le Potentiel de Kinshasa, 27 avril 2006. 156 () On les accuse notamment de recourir à des détenus chinois pour l'exécution des travaux. 157 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitique du pétrole, Armand Colin, Paris, 2006. 158 () Christophe-Alexandre Paillard, « La politique énergétique des Etats-Unis : mythes et réalités », Actes de la journée d'étude « Sécurité énergétique : vers de nouveaux rapports de force ? », Fondation pour la recherche stratégique, 12 septembre 2005. 159 () Titre du documentaire de David Guggenheim (2006), présentant l'action d'Al Gore en matière de lutte contre le changement climatique. 160 () Source : Agence internationale de l'énergie, Key World Statistics 2006. 161 () Christophe-Alexandre Paillard, op. cit. 162 () 1 MBtu ~ 293 MWh, le BTU ou British Thermal Unit étant l'unité de mesure utilisée en Amérique du Nord. Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit. 163 () Le gallon représente, aux Etats-Unis, 3,785 litres. 164 () Cf. annexe IV-1 sur les énergies renouvelables. 165 () http://www.iags.org/oiltransport.html. 166 () L'APEC ou Asia-Pacific Economic Cooperation est un forum réunissant 21 Etats bordant le Pacifique, établi en 1989 en vue de renforcer la croissance économique dans cette région. 167 () Cité par Philippe Sébille-Lopez, op. cit. 168 () Philippe Sébille-Lopez, op. cit. 169 () Entretien avec le Président de la Mission, à Washington, en juin 2006. 170 (1) M. Guy Caruso a évoqué le chiffre de quatre quadrillions de BTU, ce qui, d'après les calculs du Président de la Mission, représentera 110 % de la consommation énergétique américaine. 171 () « Partie prenante dans le système international ». 172 () Cf. sur ce point le chapitre II du présent rapport. 173 () Philippe Sébille-Lopez, Géopolitique du pétrole, Armand Colin, 2006. 174 () Ibidem. 175 () COM (2000) 769 final du 29 novembre 2000. 176 () Un règlement communautaire est ainsi entré en vigueur le 1er juillet 2004, rendant obligatoire la mise en œuvre de plans de sûreté dans les terminaux portuaires et à bord des navires. 177 () Source : Livre vert de la Commission européenne : « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », COM (2006) 105 final. 178 () Ce Fonds avait envisagé à l'automne 2005 d'exclure Total en raison des activités du groupe pétrolier français en Birmanie. 179 () Pour une analyse des enjeux géopolitiques du « Grand Nord », cf. Thierry Garcin, « Le Grand Nord, nouvel espace géopolitique », Défense nationale, novembre 2006, pp. 64 à 74. 180 () Cinq partenaires potentiels avaient pourtant été sélectionnés pour l'exploitation du gisement de Stockhman : Statoil, Total, Chevron, Hydro et ConocoPhillips. 181 () Pour une analyse plus détaillée des questions relatives à l'efficacité énergétique dans l'Union européenne, se reporter au rapport de notre collègue M. André Schneider : L'après-pétrole en Europe (rapport n° 2839 du 1er février 2006 déposé au nom de la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne). 182 () Rapport d'initiative du député européen M. Claude Turmes sur « la part des sources d'énergie renouvelables dans l'Union européenne et les propositions d'actions concrètes » ; rapport 2004/2153 (INI), juillet 2005. 183 () « Plan d'action pour l'efficacité énergétique : réaliser le potentiel », COM(2006)545 final. 184 () Ces données ont été mentionnées par le commissaire européen chargé de l'énergie, M. Andris Piebalgs, lors de la présentation du plan d'action pour l'efficacité énergétique. 185 () Les principales bases juridiques sont les suivantes : - traité EURATOM pour l'énergie nucléaire civile, - articles 154 à 156 TCE sur les réseaux transeuropéens, - article 100 TCE sur la sécurité de l'approvisionnement, - article 175 TCE sur l'environnement. 186 () Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoyait l'introduction d'une base juridique spécifique pour la politique de l'énergie (article III-256) qui entrait explicitement dans le champ des compétences partagées entre l'Union européenne et les Etats membres (article I-14). L'ajout de l'énergie à la liste des compétences partagées fut très discuté tant à la Convention européenne qu'au sein de la Conférence intergouvernementale. L'Allemagne faisait partie des Etats les plus réticents. Aussi, le Traité constitutionnel prévoyait un certain nombre de restrictions à la compétence de l'Union qui « n'affecte pas le droit d'un Etat membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique ». 187 () « Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable », COM(2006) 105 final du 8 mars 2006. 188 () Document de la Commission et du Secrétaire Général du Conseil/ Haut Représentant pour le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 (Réf. S160/06). 189 () Le Traité sur la Charte de l'énergie est un instrument juridique international contraignant, à la différence de la Charte de l'énergie adoptée en 1991 et dont la portée est exclusivement politique. 190 () La Norvège est en revanche importateur d'électricité. 191 () - une coopération renforcée ne peut être déclenchée qu'en dernier ressort, si les dispositions pertinentes des traités n'ont pas permis d'atteindre les objectifs poursuivis « dans un délai raisonnable » ; - elle doit réunir un minimum de huit Etats membres ; - tout Etat membre est en droit d'opposer son veto au déclenchement d'une coopération renforcée. 192 () D'autres exemples existent, à l'instar de l'harmonisation européenne des diplômes universitaires (LMD), initiée sur une base exclusivement intergouvernementale (processus Sorbonne-Bologne) et reprise à son compte par l'Union européenne. 193 () Edouard Balladur, L'Europe Autrement, Fayard, 2006, pp. 95 à 123. 194 () Les conclusions du Conseil des ministres franco-allemand du 12 octobre 2006 indiquent notamment que « La France et l'Allemagne souhaitent contribuer activement à la mise en place d'une politique énergétique européenne visant des coûts de l'énergie compétitifs et une sécurité d'approvisionnement accrue pour l'ensemble de l'Union européenne, et respectant nos objectifs environnementaux, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique ». 195 () Sur ce point, cf. Emmanuel Gaillard, « Un instrument d'avenir : le traité sur la charte de l'énergie », Géopolitique, mars-mai 2006. 196 () RGGI, formalisé dans un mémorandum du 22 décembre 2005. 197 () Rapport n°3021 intitulé : « Changement climatique : le défi majeur ». 198 () Rapport n°3197 intitulé : « Changement climatique et transition énergétique : dépasser la crise ». 199 () Ibidem. 200 () Agence internationale de l'énergie, World Energy Outlook 2006. 201 () Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, « L'énergie nucléaire et le protocole de Kyoto », 2002. 202 () Pays industrialisés, pour l'essentiel, qui ont souscrits des engagements contraignants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Les pays en développement, qui ne sont pas soumis à de tels objectifs, sont désignés comme les pays « hors annexe I ». 203 () Quotas d'émissions de CO2. 204 () Mais les Parties au protocole sont également convenues « d'affirmer qu'il appartient à la Partie hôte [bénéficiaire], dont c'est la prérogative, de confirmer si une activité de projet, exécutée au titre du mécanisme de développement propre [MDP], contribue à l'instauration d'un développement durable. » La Partie hôte a donc la possibilité de déclarer qu'un projet électronucléaire contribue au développement durable. 205 () Ibidem. 206 () Mécanisme similaire au MDP en faveur des pays en transition. 207 () L'AIE anticipe un bond de 53 % de la demande d'énergie primaire entre 2004 et 2030, dont 70 % proviendraient des pays en développement - World Energy Outlook 2006. 208 () Loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique. 209 () Rapport présenté par MM. Pierre Laffitte et Claude Saunier, sénateurs, sur « Les apports de la science et de la technologie au développement durable », tome I : « Changements climatiques et transition énergétique : dépasser la crise », au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, Assemblée nationale n° 3197, Sénat n° 426, juin 2006, p. 87. 210 () Tonne équivalent pétrole pour 1 000 dollars produits en parité de pouvoir d'achat 1995. 211 () Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. 212 () La réduction du taux de TIPP est conditionnée à l'obtention d'agréments, attribués à des unités de production à l'issue d'une procédure d'appel à candidature. 213 () Rapport présenté par MM. Pierre Laffitte et Claude Saunier, sénateurs, sur « Les apport de la science et de la technologie au développement durable », tome I : « Changements climatiques et transition énergétique : dépasser la crise », au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, rap. cit.. 214 () Ibidem, p. 158. 215 () Ibidem, p. 166. 216 () Ibidem, p. 179. 217 () Ibidem, p. 171. 218 () Depuis le 1er juillet 2006, en application de la directive européenne sur l'efficacité énergétique, un tel certificat (libellé de A à E) devra être fourni par le propriétaire d'un bien immobilier à l'occasion de toute cession ou location. Ces certificats d'efficacité énergétique sont à distinguer des certificats d'économies d'énergie récemment mis en place en France et présentés supra parmi les instruments de la politique en faveur des économies d'énergie. 219 () Energy security of supplies (sécurité des approvisionnements énergétiques), Economic growth (croissance économique), Environment protection (protection de l'environnement). 220 () Jean Lamy, « D'un G8 à l'autre : sécurité énergétique et changement climatique ». 221 () Experts des organes subsidiaires de la Convention climat, d'une part, et experts des Parties au protocole de Kyoto, d'autre part. 222 () World Energy Council (WEC). 223 () Le dernier congrès s'est tenu à Sydney, en septembre 2004 ; le prochain aura lieu en novembre 2007 à Rome. 224 () Au nombre de onze actuellement, après le retrait du Gabon et de l'Equateur dans les années 1990. 225 () Publié avant le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 dont une partie avait pour thème : « une politique énergétique pour l'Europe ». 226 () Intitulé « Notre avenir commun », ce rapport est issu des travaux de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement. 227 () Le dixième Forum s'est tenu à Doha, du 23 au 24 avril 2006 ; le prochain Forum aura lieu en 2008, en Italie. 228 () « Joint Oil Data Initiative », initiative lancée en 2001. 229 () « Extractive Industries Transparency Initiative » dont l'élaboration s'inspire de la campagne « Publish what you pay » lancée, en 2001, par plusieurs ONG. 230 () Banque de France, Rapport Zone franc, 2005. 231 () Le Traité sur la Charte de l'Energie et le protocole sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ont été signés le 17 décembre 1994, à Lisbonne, par l'ensemble des signataires de la Charte européenne de l'énergie de 1991, excepté les Etats-Unis et le Canada. Les Communautés européennes et leurs Etats membres sont signataires du Traité et du protocole. 232 () Emmanuel Gaillard, « Un instrument d'avenir : le Traité sur la Charte de l'Energie », Géopolitique, n° 93, mars-mai 2006. 233 () Discours de Son Exc. M. Craig Stapleton, Ambassadeur des Etats-Unis en France, devant l'Association nationale des auditeurs jeunes de l'institut des hautes études de la défense nationale, 15 février 2006. 234 () Le plutonium contenu dans les combustibles usés peut être utilisé pour fabriquer de nouveaux combustibles composés d'un mélange d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium, le « MOX », de l'anglais « mixed oxide ». 235 () L'enrichissement de l'uranium est une opération de séparation isotopique qui permet d'augmenter la proportion d'uranium fissile (U 235) dans le combustible. Elle se mesure en UTS (unité de travail de séparation). 236 () Sur ce sujet, cf. le rapport n° 2601 présenté au nom de la Commission des Affaires étrangères par M. Jacques Remiller, sur le projet de loi n° 2555, autorisant l'approbation de l'accord entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas, relatif à la coopération dans le domaine de la technologie de la centrifugation, 19 octobre 2005, http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r2601.pdf. 237 () Sur 48 millions de barils de pétrole brut transportés quotidiennement par voie maritime en 2004, 35 millions passeraient par ces goulets d'étranglement (Philippe Sébille-Lopez, Géopolitiques du pétrole, op. cit., p. 43). 238 () Depuis 1975, on a compté cinq naufrages majeurs de pétroliers soit par collision soit par échouage dans le détroit de Malacca. Le détroit du Bosphore est, pour sa part, considéré comme l'un des plus dangereux en raison de son étroitesse, des courants et des conditions climatiques souvent difficiles mais aussi de son trafic : 52 000 navires en 2004, dont 9500 pétroliers. 239 () Sur la question de la piraterie dans le détroit de Malacca et plus largement pour ce qui concerne ce détroit, on se reportera à : Peter J. Rimmer, « Les détroits de Malacca et de Singapour. Etats côtiers et Etats utilisateurs », Etudes internationales, vol. XXXIV, n° 2, juin 2003, p. 227-253 ; Sumathy Permal, « Piracy and Sovereignty in the Strait of Malacca", Centre for Maritime Security & Diplomacy, Maritime Institute of Malaysia, mai 2005, http://www.mima.gov.my/. 240 () Observons, comme le fait Mme Agnès Gautier-Audebert dans son article paru au Juris-Classeur Droit international, que dans la catégorie des zones de communication internationale, on distingue les détroits internationaux des canaux internationaux qui, eux, sont des passages artificiels construits par les hommes. 241 () La zone économique exclusive ne s'étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale (article 57 de la convention de 1982). Dans cette zone, l'Etat côtier a des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. Il y exerce également sa juridiction pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin. 242 () Sur cette question, voir Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillet, Alain Pellet, Droit international public, LGDJ, p. 118 et suiv. 243 () On pourrait également citer les détroits danois - le Sund, le Petit Belt et le Grand Belt - régis par le Traité de Copenhague de 1857, celui du Pas-de-Calais dont le régime est issu d'une simple déclaration franco-britannique du 2 novembre 1988 ou encore le détroit de Magellan qui est régi par la convention du 23 juillet 1881 entre l'Argentine et le Chili. 244 () La Zone fait l'objet de la partie XI de la convention (art. 133 à 191) qui proclame le principe de non-appropriation par les Etats, d'utilisation pacifique et d'exploitation dans le seul intérêt de l'humanité entière, la gestion des ressources de ces fonds marins et de leur sous-sol étant confiée à une organisation internationale créée par la convention de Montego Bay : l'Autorité internationale des fonds marins. 245 () Voir l'étude sur le détroit de Malacca de Mme Nathalie Fau, publiée sur le site Géoconfluences, www.geoconfluences.ens-lsh.fr. 246 () Il existe par ailleurs des contentieux profonds entre ces Etats riverains, par exemple sur la délimitation des eaux territoriales entre la Malaisie et l'Indonésie dans la mer des Célèbes. La présence de réserves de pétrole dans cette zone n'est pas étrangère à ces tensions. 247 () Kofi A. Annan, « Là où la hausse des prix du pétrole se fait vraiment sentir », The International Herald Tribune, 3 octobre 2000. 248 () Philippe Niyongabo, « The infrastructure Consortium for Africa », 20 juin 2006. 249 () Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Sénégal, Sierra Léone, Togo, Zambie. 250 () Nous n'évoquerons pas ici en détail la question de la diversification des monnaies de facturation des énergies. Cette diversification serait essentielle pour éviter d'ajouter aux effets pervers de la volatilité des cours du pétrole ceux des variations du dollar. 251 () 78 pays à faible revenu étaient admissibles en août 2006. L'admissibilité repose sur l'évaluation, par le FMI, sur revenu par habitant du pays, qui s'inspire du critère d'admissibilité au guichet concessionnel de la Banque mondiale (actuellement, revenu national brut par habitant de 895 dollars en 2003). 252 () ACP : Afrique - Caraïbes - Pacifique. 253 () Les définitions sont disponibles sur le site de l'Institut français du pétrole. 254 ()L'AIE les calcule comme suit : production d'énergie + importations - exportations - soutages maritimes internationaux (le pétrole utilisé pour le transport par navire de l'énergie) + variation des stocks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||