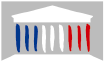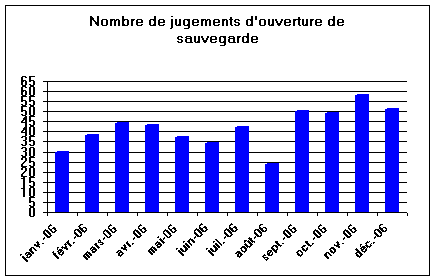N° 3651 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2007. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE sur la mise en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ET PRÉSENTÉ PAR M. Xavier DE ROUX, Député. -- INTRODUCTION 7 I. - UNE RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS DONT L'ESSENTIEL A PU ENTRER EN VIGUEUR DANS LES DÉLAIS IMPARTIS PAR LE LÉGISLATEUR 9 A. LES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMÉDIATE, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LOI, LE 27 JUILLET 2005 9 B. LA MODIFICATION DES ANNEXES DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE N° 1346/2000, RELATIF AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ, DÈS L'AUTOMNE 2005 10 C. LA PUBLICATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION LES PLUS INDISPENSABLES AVANT LE 1ER JANVIER 2006 11 1. Des décrets d'application d'ampleur et d'importance inégales 11 a) Le décret n° 2005-1677, du 28 décembre 2005, pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises, modifié par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 11 b) Les dispositions du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de difficultés des entreprises, modifiées par le décret n° 2006-185 du 20 février 2006 12 2. La prévention des difficultés des entreprises 13 a) Les pouvoirs de détection et de concertation du président du tribunal de commerce 14 b) Le mandat ad hoc 15 c) La conciliation 16 d) La rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert 17 e) Quelques dispositions spécifiques aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique 18 3. Les procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires 18 a) L'ouverture des procédures 19 b) Les différents acteurs 19 c) Les créances 20 d) L'élaboration et l'entérinement des plans 21 d) Les formalités de publicité applicables aux cessions 23 e) La liquidation judiciaire simplifiée 24 f) La clôture des procédures 24 4. Les responsabilités et sanctions 25 5. Les dispositions générales de procédure 26 a) Les voies de recours 26 b) Le formalisme des procédures 27 c) Le rythme des procédures 28 d) Les nouvelles dispositions applicables dès le 1er janvier 2006 aux procédures en cours 28 D. LES MESURES RÉGLEMENTAIRES PUBLIÉES POSTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI 31 1. Le décret n° 2006-893 du 18 juillet 2006 modifiant le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des tribunaux de commerce 31 2. Le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires 32 E. LE PETIT NOMBRE DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES MANQUANTES 34 1. Le régime des remises de dettes par les créanciers publics : une question en passe d'être résolue 34 a) Le champ des remises de dettes publiques susceptibles d'être accordées 35 b) Une procédure de concertation des créanciers publics respectueuse de la philosophie de la loi 36 c) Le régime applicable aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur du décret 37 2. Les conditions d'appel des cotisations du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : un silence règlementaire marginal mais regrettable 38 II. - UN PREMIER BILAN PLUTÔT POSITIF, UN AN APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES PRINCIPALES INNOVATIONS DE LA LOI 39 A. DE NOUVELLES PROCÉDURES QUI COMMENCENT À S'IMPOSER DANS LA PRATIQUE DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS 39 1. Des nouvelles procédures de prévention qui entrent progressivement dans les usages 40 a) Le succès incontestable du mandat ad hoc et de la conciliation 40 b) La sauvegarde : de la méconnaissance à la reconnaissance 41 2. Un effet positif sur les statistiques des entreprises défaillantes ? 45 B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION D'ORES ET DÉJÀ RÉVÉLÉES PAR LA PRATIQUE 46 1. Les problèmes rencontrés dans la conciliation 46 a) Les effets inattendus du monopole du débiteur dans l'initiative de la requête en homologation de l'accord amiable des parties 46 b) Les incidences fâcheuses des retards de publication au BODACC sur l'obtention d'argent frais 47 c) Une publicité de la conciliation homologuée qui effarouche les créanciers 48 d) Les incertitudes nées du silence de la loi sur les constats ou homologations séparés dans le cas de groupes de sociétés 49 2. Les difficultés révélées dans les procédures de sauvegarde 49 a) L'importante question de la qualification juridique des hedge funds 49 b) Les problèmes nés de l'exclusion des obligataires des comités de créanciers 51 c) L'inadaptation des règles de vote des détenteurs de créances évolutives au sein des comités de créanciers 53 d) Des comités de créanciers parfois encore mis devant le fait accompli dans la définition du plan de sauvegarde 55 e) Le sujet récurrent du critère de cessation des paiements 56 3. Un assouplissement des procédures de redressement et de liquidation judiciaires encore insuffisant 57 a) La persistance des handicaps résultant de l'absence de droit social dérogatoire 58 b) Des restrictions entourant la liquidation judiciaire simplifiée partiellement levées 59 4. La persistance d'incertitudes entourant la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait de concours consentis 60 CONCLUSION 63 EXAMEN EN COMMISSION 65 PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 66 La loi de sauvegarde des entreprises, du 26 juillet 2005, constitue certainement la réforme la plus importante du droit commercial votée sous la XIIème législature. La doctrine s'accorde-elle même sur ce point. Il n'est d'ailleurs pas de plus éclairant point de vue sur le sujet que celui formulé par le professeur François-Xavier Lucas, à l'occasion du colloque du 13 septembre 2005, sur les apports de la loi : « cette loi de sauvegarde éclose au cœur de cet été 2005, (...) tant par son ampleur que par sa portée, est à ranger parmi les grandes lois intéressant le droit des affaires. Des mois et même des années de gestation... des débats parlementaires d'une grande âpreté... des discussions à perte de vue sur ce droit Droit complexe, qui concerne et définit dans une certaine mesure les conditions d'existence des entreprises, le droit des procédures collectives n'a pas fait l'objet de modifications aussi fréquentes que d'autres pans du droit français. Depuis la loi du 13 juillet 1967 et l'ordonnance du 23 septembre de la même année, qui sont considérées comme les textes fondateurs du droit moderne des entreprises en difficultés, le législateur n'est intervenu qu'à quatre reprises pour en aménager le contenu. Les lois du 1er mars 1984, sur la prévention des difficultés et le règlement amiable, puis du 25 janvier 1985, sur le redressement judiciaire et la liquidation, ont cherché à placer la préservation de l'emploi au cœur des procédures, parfois au détriment des créanciers. La loi du 10 juin 1994 est venue y apporter des corrections techniques bienvenues, avant que celle du 26 juillet 2005 intègre de nouvelles procédures destinées à mieux prévenir les difficultés et à anticiper d'éventuelles défaillances. La loi de sauvegarde des entreprises ne s'apparente pas à une énième réforme, mais bien à un ajustement particulièrement mûri des dispositions du code de commerce relatives aux procédures collectives. L'environnement économique, commercial et financier des entreprises ayant profondément évolué depuis le milieu des années 1990, il était devenu nécessaire d'adapter le droit français en tenant compte des expériences étrangères et européennes. C'est désormais chose faite. Au-delà des principes fixés par le législateur, se pose à présent la question de l'effectivité des mesures nouvelles. Le rapporteur du texte, conformément au droit de suite que lui confère l'article 86 alinéa 8 du règlement de l'Assemblée nationale, ne pouvait se désintéresser de sa mise en œuvre et plus particulièrement de la publication des actes réglementaires nécessaires à son entrée en vigueur dans les délais impartis par le Parlement, à savoir au 1er janvier 2006. En l'occurrence, une certaine satisfaction s'impose : malgré l'ampleur de la tâche, le Gouvernement a publié dans les temps les principaux décrets, permettant ainsi la mise en œuvre concrète de la très grande majorité des dispositions de la loi. Il plaît au rapporteur de le souligner car, depuis l'instauration du suivi par les députés des textes d'application des lois, tous ses homologues n'ont pas nécessairement dressé un constat identique. Certes, quelques dispositions d'importance, à l'instar du régime de la rémunération des administrateurs et mandataires judiciaires ou des remises de dettes accordées par les créanciers publics, sont parues après les délais fixés par le Parlement ou sont en passe de l'être. Néanmoins, au regard des 196 articles que comporte la loi, force est de reconnaître que le Gouvernement, et tout particulièrement le ministère de la justice, a mené à bien la concertation préalable puis la rédaction des décrets avec la célérité qui sied à une réforme aussi cruciale pour l'avenir du tissu entrepreneurial et de l'emploi dans notre pays. Tout au plus peut-on regretter que les principaux décrets d'application soient parus quelques jours seulement avant l'entrée en vigueur des dispositions votées par le législateur, ce qui n'a pas facilité la tâche des praticiens et des professionnels concernés, même si, comme on le verra, le pouvoir exécutif n'a pas révolutionné les règles jusque-là en vigueur. Le rapporteur s'attachera bien sûr à présenter les textes pris pour l'application de la loi mais il ne s'en tiendra pas à cette seule démarche d'analyse critique, aussi nécessaire soit-elle. En effet, il importe également de dresser un bilan des nouveaux instruments offerts, depuis le 1er janvier 2006, aux entrepreneurs et aux juridictions commerciales. En l'espèce, sans être suffisant, le recul de ces derniers mois peut permettre de dégager certaines conclusions éclairantes pour tous les acteurs de la réforme. I. - UNE RÉFORME DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS DONT L'ESSENTIEL A PU ENTRER EN VIGUEUR DANS LES DÉLAIS IMPARTIS PAR LE LÉGISLATEUR La loi de sauvegarde des entreprises comporte une trentaine de renvois à un décret d'application. D'autres articles, même s'ils ne contiennent pas de telles références, n'en nécessitent pas moins des mesures réglementaires pour devenir effectifs, de sorte que peu de dispositions votées par le législateur ont pu entrer en vigueur par elles mêmes. A. LES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMÉDIATE, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA LOI, LE 27 JUILLET 2005 Certaines dispositions directement applicables sont entrées en vigueur dès la publication de la loi, le 27 juillet 2005, par dérogation au délai de six mois prévu pour permettre aux différents acteurs concernés par la réforme de s'en approprier le contenu. Ces dérogations sur la date d'entrée en vigueur ont été inscrites à l'article 190 de la loi. Toutes concernaient des mesures favorables aux débiteurs. C'est ainsi que les procédures et les situations en cours se sont vues appliquer sans délai le plafonnement des sanctions résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Par voie de conséquence, et comme le souligne très clairement la circulaire CIV/15/05 du garde des Sceaux datant 22 juillet 2005 (2), l'ensemble des mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté, lorsqu'elles ont été prononcées plus de quinze ans avant la publication de la loi, ont pris fin au 27 juillet 2005. Dans un arrêt du 29 novembre 2005 (3), la Cour de cassation a d'ailleurs excipé de cette règle nouvelle pour rendre un non lieu à statuer dans l'affaire qui lui était soumise. Ont également bénéficié d'une anticipation similaire de leur effectivité : - l'article L. 624-10 du code du commerce, relatif aux demandes de restitution, bénéficiant (du moins jusqu'au 28 décembre 2005) du maintien des mesures réglementaires prévues par le décret n° 85-1388 ; - l'article L. 643-9 du code du commerce, prévoyant, dans le souci de raccourcir autant que possible la longueur des procédures de liquidation judiciaire, que le débiteur ou tout créancier peut saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure à l'issue d'un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les dérogations ont enfin concerné le dernier alinéa de l'article L. 811-11 du code du commerce, relatif aux règles de transparence que la Caisse des dépôts et consignations doit observer à l'égard des personnes chargées de l'inspection des administrateurs judiciaires, tout spécialement pour la communication des renseignements ou documents utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur ses comptes au nom de ces professionnels. Au regard du nombre de dispositions inscrites dans la loi, ces mesures d'application immédiate sont restées très minoritaires. B. LA MODIFICATION DES ANNEXES DU RÈGLEMENT DU CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE N° 1346/2000, RELATIF AUX PROCÉDURES D'INSOLVABILITÉ, DÈS L'AUTOMNE 2005 Le règlement du Conseil de l'Union européenne n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, n'a pas pour ambition d'unifier les règles des différents droits nationaux, mais plutôt de coordonner leur application et de régler les éventuels conflits de juridiction susceptibles de se faire jour. Ce texte est entré en vigueur le 31 mai 2002. L'annexe A du texte comporte une liste extensive des procédures d'insolvabilité pour les pays auxquels s'applique le règlement. Au moment de l'adoption définitive de la loi de sauvegarde des entreprises, seuls la liquidation et le redressement avec désignation d'un administrateur judiciaire étaient mentionnés. Conformément aux indications recueillies par le rapporteur lors des débats parlementaires, le Gouvernement a notifié le 27 novembre 2005, soit cinq semaines avant l'entrée en vigueur de la loi, des modifications de coordination, permettant une reconnaissance de la réforme votée par le législateur dans les vingt-trois autres États européens à qui le règlement n° 1346/2000 est opposable (le Danemark étant le seul non concerné). Sans qu'il s'agisse d'une mesure d'application au sens traditionnel du terme, cette initiative n'en revêt pas moins une importance significative, dans un contexte de forum shopping et de law shopping dont il n'est plus permis de douter depuis les récentes décisions rendues tant par les juridictions internes (4) que par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (5) s'agissant de procédures d'insolvabilité concernant des groupes de sociétés localisées en plusieurs pays. L'inscription de la sauvegarde à l'annexe A du règlement n'allait pas de soi, puisque l'article 1er de ce dernier circonscrit son champ d'application aux « procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent un dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic ». En outre, la jurisprudence de la CJCE conduisait à ce que ce dessaisissement implique que le débiteur perde les pouvoirs de gestion qu'il détient sur son patrimoine (6). Or, par définition, la sauvegarde ne conduit pas nécessairement au dessaisissement du débiteur une fois la procédure ouverte, comme en atteste l'article L. 622-1 du code de commerce. Avec son insertion à l'annexe A, cette question se trouve pourtant tranchée : désormais, avec ou sans désignation d'administrateur, la sauvegarde doit être regardée comme une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2 du règlement n° 1346/2000. Et il en va de même pour le redressement judiciaire, la précision de la nomination de l'administrateur ayant été supprimée. C. LA PUBLICATION DES ACTES RÉGLEMENTAIRES D'APPLICATION LES PLUS INDISPENSABLES AVANT LE 1ER JANVIER 2006 Deux décrets pris en décembre 2005 et modifiés par la suite ont permis une entrée en vigueur effective de la très grande majorité des dispositions de la loi n° 2005-845 à partir du 1er janvier 2006, comme l'avait voulu le législateur. C'est là le résultat d'un travail préparatoire en amont approfondi. 1. Des décrets d'application d'ampleur et d'importance inégales Des deux décrets pris par le Gouvernement pour l'application de la loi de sauvegarde des entreprises, l'un l'a été de manière très spécifique, ce qui explique qu'il présente un caractère très volumineux, et l'autre de manière plus indirecte, seules quelques-unes de ses dispositions concernant la mise en œuvre de la loi n° 2005-845. a) Le décret n° 2005-1677, du 28 décembre 2005, pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises, modifié par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 En écho au nombre très important d'articles de la loi, le décret n° 2005-1677, du 28 décembre 2005, dont certaines dispositions ont été modifiées un an après sa publication par le décret n° 2006-1709, affiche lui aussi un nombre significatif de dispositions, puisqu'il contient pas moins de 364 articles. Sa structuration répond à celle de la loi, en en reprenant pour l'essentiel les grandes subdivisions du titre Ier. Le but avoué de cette concordance consiste à faciliter la codification imminente de la partie réglementaire du livre VI du code de commerce. Contrairement à la méthode retenue pour modifier la partie législative du livre VI du code de commerce, que le rapporteur avait regrettée dans son rapport en l'assimilant à « une suite de "confettis" législatifs » (7), ce texte a supprimé la plupart des dispositions réglementaires antérieures pour leur substituer les nouvelles mesures désormais applicables. Ont ainsi été abrogés les articles 22 à 26 et 35-1 à 39-2 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, concernant les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ainsi que la prévention des difficultés et le règlement amiable, l'intégralité du décret n° 85-98 du 25 janvier 1985, pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier de la même année et les 175 premiers articles du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaire, à l'exclusion de l'article 25-1, portant sur la notification et le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière d'avance des frais par le Trésor public, et de l'article 74, sur l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel à la requête du Trésor public. Il est heureux que, à défaut d'avoir pris le parti de la réécriture intégrale des dispositions législatives modifiées, lors de l'élaboration de la loi de sauvegarde des entreprises, le Gouvernement se soit finalement rallié à ce procédé pour conférer à la réforme davantage de clarté et de compréhension. b) Les dispositions du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005, fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de difficultés des entreprises, modifiées par le décret n° 2006-185 du 20 février 2006 Le décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 est d'une moindre ampleur que le précédent, ne serait-ce que par sa longueur, puisque seuls quatre articles (15 à 18) concernent directement les modalités d'application du livre VI du code du commerce, tel qu'il résulte de la loi de sauvegarde des entreprises. Il comporte néanmoins des dispositions absolument nécessaires, en dressant la liste des tribunaux compétents, en métropole et outre-mer, pour connaître des nouvelles dispositions et procédures instituées par le législateur à l'intention des entreprises en difficultés. La présentation retenue à l'occasion de sa rédaction constitue là aussi un gage de lisibilité, et donc de bonne compréhension par les justiciables concernés. Les tableaux annexés, intégrés au code de l'organisation judiciaire, énumèrent successivement, en suivant l'ordre alphabétique des départements métropolitains, les tribunaux de grande instance compétents pour connaître des procédures applicables aux personnes qui ne sont ni commerçants, ni artisans (essentiellement les agriculteurs, les sociétés civiles non commerçantes et les professions indépendantes exercées à titre individuel), puis les tribunaux de commerce ou de grande instance compétents en matière commerciale pour ce qui concerne les affaires relatives aux commerçants et artisans immatriculés au répertoire des métiers (y compris sous forme de sociétés). Dans le premier cas, un seul tribunal se trouvait initialement désigné dans chaque département, le choix s'étant porté sur la juridiction la plus importante. Cependant, le décret n° 2006-185 a considérablement changé ces dispositions, en rétablissant la compétence de tous les tribunaux de grande instance du pays, en métropole et outre-mer. Ce qui pouvait apparaître comme un premier élément tangible de rationalisation de notre carte judiciaire a ainsi été complètement remis en cause. Dans le second cas, l'énumération égrène les tribunaux de commerce ou les tribunaux de grande instance compétents en matière commerciale, en précisant leur ressort. Mais là, nulle surprise à la lecture du décret, puisque la carte des juridictions commerciales qui n'a pas été épargnée par les restructurations ces dernières années (8), a fidèlement été reproduite, 209 tribunaux étant mentionnés (le décret n° 2006-185 n'apportant à cet égard que de menues corrections d'erreurs matérielles, en rectifiant notamment l'omission du tribunal de commerce de Condé-sur-Noireau, dans le département de l'Orne). Le ressort diffère, selon qu'est en cause un tribunal de grande instance ou un tribunal de commerce, et même, dans ce dernier cas, selon qu'existe un seul ou plusieurs tribunaux de commerce dans le département. Les autres dispositions concernent les juridictions compétentes outre-mer et des corrections de références au sein du code de l'organisation judiciaire. Celles relatives à la juridiction compétente pour l'île de la Réunion ont fait l'objet de nouveaux aménagements, techniques et ponctuels, à travers le décret n° 2006-956 du 31 juillet 2006, modifiant le tableau XI du code de l'organisation judiciaire. Il convient de souligner que les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1677 comportent eux aussi des dispositions relatives aux juridictions compétentes. Ils prévoient notamment que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce est celui dans lequel le débiteur a son siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou celui dans lequel a été déclarée l'adresse de l'entreprise, si le débiteur est une personne physique. Il en va de même pour l'identification du président du tribunal compétent pour convoquer les dirigeants d'une société, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une entreprise individuelle en difficultés, afin d'envisager avec eux les mesures propres à redresser la situation, voire, le cas échéant, pour leur enjoindre de communiquer les informations utiles pour évaluer cette même situation. En l'occurrence, le décret de 2005 est sur ces points plus explicite que celui de 1994, qui se référait uniquement au siège de l'entreprise. En définitive, on ne peut que regretter que ces dispositions aient été dissociées en plusieurs décrets. L'exigence de clarté pour le justiciable aurait sans doute gagné à ce que toutes figurent dans le même texte réglementaire et, de préférence, dans celui spécifiquement pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises, à savoir le décret n° 2005-1677. 2. La prévention des difficultés des entreprises La loi de sauvegarde des entreprises confère une place nouvelle à l'anticipation des problèmes des entreprises dans les procédures destinées à en redresser le sort. Fort logiquement, le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 décline les modalités concrètes de mise en œuvre de cette prévention des difficultés. Plutôt que de faire l'exégèse des dispositions du décret, tâche que d'aucuns trouveraient sans doute rébarbative, le rapporteur s'attachera en la matière à mettre en exergue les innovations et les points les plus significatifs contenus dans le texte. Les modalités de concertation du président du tribunal avec les dirigeants des personnes morales ou les gérants des entreprises individuelles, prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce, sont explicitées dans un sens conférant une large place au principe du contradictoire. La convocation du débiteur intervient un mois à l'avance par lettre recommandée, accompagnée d'une note dans laquelle le président du tribunal expose les faits motivant son initiative. Lorsque le débiteur choisit de ne pas se rendre à l'entretien, il doit être averti que des investigations sur sa situation économique et financière peuvent être engagées par le président du tribunal auprès des commissaires aux comptes, des membres et représentants du personnel, des administrations publiques, des organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que des services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, lesquels ne sont pas tenus d'y répondre en cas d'irrégularité. L'entretien donne lieu à un procès-verbal ne mentionnant que la date, le lieu et les participants, ce qui constitue une garantie de confidentialité de nature à inciter les chefs d'entreprise à déférer à leur convocation ; en effet, rien n'aurait été plus dissuasif pour des gestionnaires que de courir le risque de voir étalées sur la place publique d'éventuelles difficultés de trésorerie, encore susceptibles à ce stade de se résorber sous réserve qu'ils continuent de bénéficier de l'appui de leurs créanciers, notamment bancaires. En cas d'absence de réponse à la convocation du président du tribunal, un procès-verbal de carence est dressé par huissier et la demande de renseignements sur la situation de l'entreprise est envoyée dans la foulée. Le décret précise également la procédure d'injonction pour la publication, le cas échéant sous astreinte, des comptes annuels. Une présentation du décret, parue au lendemain de sa publication, explique que : « Le dispositif mis en place s'efforce de concilier un impératif d'efficacité de cette procédure fondée sur un élément objectif aisément constatable et le respect des droits de la défense » (9). Concrètement, le président du tribunal rend, dans un premier temps, une ordonnance insusceptible de recours faisant injonction, sous astreinte, au représentant légal de la personne morale débitrice de déposer ses comptes dans un délai d'un mois et fixant une date d'audience pour la liquidation de cette astreinte. Au cours de cette seconde audience, le représentant légal du débiteur a la possibilité de faire valoir ses observations avant que le président du tribunal statue. L'audience n'est retirée du rôle que dans deux cas de figure : un dépôt des comptes dans le délai imparti ou un retour de la notification de la décision d'injonction au greffe du tribunal avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Le rapporteur n'est pas certain que le formalisme, voire la solennité, découlant de cette recherche du plus grand respect possible des droits de la défense dès la concertation préalable avec le débiteur soit compatible avec l'urgence qui préside bien souvent à l'avenir des sociétés qui rencontrent leurs premières difficultés. Les préventions des chefs d'entreprise ainsi convoqués à l'égard du juge consulaire en sont redoublées, alors même que le législateur souhaitait seulement établir un dialogue préalable susceptible de déboucher sur des conseils. Le résultat des dispositions du décret n'a d'ailleurs pas tardé à se faire sentir puisque, de 2005 à 2006, les entretiens de prévention et détection des difficultés des entreprises accordés par les présidents de tribunaux de commerce ont sensiblement diminué (de l'ordre de 10 % pour le tribunal de commerce de Paris, par exemple). En fait, pour être réellement utiles, ces entretiens devraient avoir lieu sans délai, sur convocation par une seule lettre simple. Le décret n° 2005-1677 détaille les conditions de mise en place du mandat ad hoc, innovation prétorienne émanant du tribunal de commerce de Paris lors de la crise immobilière des années 1990, dans le prolongement de sa consécration législative. Le rapporteur constate que cette technique qui ne répond pas au formalisme habituel des procédures et dont la réussite n'est plus à démontrer, puisqu'elle permet de sauver deux entreprises sur trois quand elle est mise en œuvre, fait maintenant l'objet d'un encadrement juridique contraire à la souplesse qui a fait son succès. S'il était sans doute utile d'en conforter l'assise dans notre droit, peut-être eut-il été préférable de ne pas entrer autant dans le détail ? Sur le fond, comme le souligne le professeur Yves Chaput, dans une étude sur le sujet : « L'esprit de la négociation n'est pas entaché par le décret » (10). C'est là un constat dont on ne peut que se réjouir, car le contraire eut hypothéqué sérieusement le bien-fondé des dispositions réglementaires. Le décret comporte essentiellement des dispositions classiques de procédure. Il précise notamment que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est présentée par écrit et adressée au président du tribunal de commerce ou de grande instance compétent. Le mandataire est nommé dans un délai d'un mois à compter de l'audience du représentant légal de la personne morale ou du débiteur personne physique, faute de quoi la demande de désignation est réputée non admise. L'ordonnance désignant le mandataire définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération. Cette désignation est notifiée au débiteur, lequel peut demander à tout moment au président du tribunal de mettre un terme au mandat ad hoc, celui-ci prenant alors fin sans délai. On observera que ce dernier point est moins neutre que les précédents dans ses implications car il revient à garantir au débiteur la maîtrise de la durée de la procédure. Ce faisant, néanmoins, le pouvoir exécutif n'a fait que s'inscrire dans la logique de la loi de sauvegarde des entreprises, qui a réservé au seul débiteur l'initiative de la désignation du mandataire ad hoc. La conciliation occupe à elle seule la plus grande place dans le chapitre Ier du décret. Le texte entoure la procédure d'un formalisme assez prononcé, dans la mesure où elle est susceptible de déboucher sur une décision de justice donnant force exécutoire, voire homologuant, ce qui ne constitue au départ qu'un simple accord amiable aménageant les contraintes financières du débiteur. Fort logiquement, l'énoncé des règles applicables à l'ouverture de cette procédure reprend les dispositions jusqu'alors en vigueur pour l'ancien règlement amiable, avec cette différence particulière toutefois (comme pour le mandat ad hoc, d'ailleurs) qu'à défaut de réponse du président du tribunal dans un délai d'un mois, il n'est pas prévu que la demande d'ouverture de conciliation est réputée non admise. Huit articles du décret énoncent des dispositions totalement nouvelles sur la récusation du conciliateur par le débiteur, procédure qui s'inspire de celle en vigueur pour la récusation des juges, aux articles 342 à 355 du nouveau code de procédure civile, tout en comportant malgré tout certaines spécificités. En l'espèce, les dispositions du décret procèdent de « la recherche d'un équilibre entre la nécessité de ne pas retarder à l'excès le déroulement de la conciliation et la préoccupation de voir s'instaurer des relations de confiance entre le débiteur et le conciliateur » (11). En témoigne le mouvement de balancier opéré dans le texte entre la brièveté du délai de récusation, limité à quinze jours à compter de la notification de la décision désignant le conciliateur, et le caractère extensif des causes de récusation (existence d'un intérêt personnel à la procédure, d'un lien avec l'un des créanciers, d'une cause de défiance réciproque, d'une situation d'incompatibilité, notamment pour les juges consulaires en activité ou ayant cessé leurs fonctions moins de cinq ans auparavant, et cas de radiation ou de destitution). M. Yves Chaput observe que « le débiteur comme le conciliateur gardent la liberté de "sortir" du jeu » (12). Il convient de préciser que cette faculté présente un caractère discrétionnaire pour le débiteur, aucun recours n'étant possible dans ce cas, alors qu'elle est soumise à l'appréciation du juge lorsque le conciliateur formule une demande en ce sens. Pour ce qui concerne l'homologation de l'accord par l'autorité judiciaire, faculté soumise à la volonté des parties, les règles instaurées par le décret s'efforcent de traduire en termes procéduraux la faible marge d'appréciation laissée par la loi au président du tribunal. En effet, son ordonnance est rendue sans audience préalable, au vu du seul accord signé et de la déclaration certifiée du débiteur attestant qu'il ne se trouvait pas en cessation des paiements lors de la conclusion de l'accord ou que l'accord conclu y met un terme. De même, le contenu du jugement d'homologation a été encadré afin de faciliter la tierce opposition, tout en préservant la confidentialité de l'accord : le jugement ne peut reproduire les termes de l'accord mais il fait mention des garanties et privilèges institués pour en assurer l'exécution et il précise les montants garantis par le privilège de la conciliation. Les règles de communication de l'accord tendent à ce même équilibre entre confidentialité et information. Le décret précise en effet que l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir, c'est-à-dire principalement les garants du débiteur. Il s'agit là d'une condition nécessaire pour inciter les entrepreneurs concernés à rechercher une conciliation avec leurs créanciers, lorsqu'il est encore temps. Faute de telles précautions sur la publicité des difficultés des entreprises concernées, la confiance de leur clientèle serait certainement ébranlée et, par voie de conséquence, leur redressement compromis. Il est heureux que cette dimension psychologique ait été prise en considération. L'homologation est notifiée par le greffier au débiteur, aux créanciers parties à l'accord, et communiquée au ministère public. Dans les huit jours suivant le jugement, un avis doit être inséré au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, du lieu du siège de son activité. Nous verrons cependant que, dans les faits, tel n'est pas véritablement le cas et que cela pose un problème. Cette publicité prend les mêmes formes pour toute décision de résolution de l'accord homologué, prononcée par le juge à la demande de l'une des parties. Outre la suspension des actions en justice et des poursuites individuelles sur les meubles et immeubles du débiteur ainsi que celle des créances exigibles par les parties à l'accord, cette homologation permet la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit du débiteur. L'encadrement de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert vise à offrir au débiteur une prévisibilité suffisante s'agissant de dépenses à sa charge qui ne sont pas négligeables. Dans cette perspective, le décret prévoit de laisser à l'appréciation du président du tribunal ou du débiteur les différents aspects de la détermination de cette rémunération, sous réserve de la fixation d'un montant maximal et de la possibilité que puissent être révisées, avec l'accord du débiteur, les conditions initiales. Concrètement, l'assentiment du débiteur est requis sur les critères de base ainsi que sur le plafond et le montant des provisions. Il se trouve consigné par écrit avant la désignation officielle du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert. L'ordonnance arrêtant la rémunération est notifiée à l'ensemble des intéressés par greffier ; elle est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. Faute d'accord du débiteur pour réviser le montant, il est mis un terme à la mission de l'intermédiaire sollicitant une révision de ses émoluments. À noter que, dans le cas du mandat ad hoc, à la différence de ce qui est prévu pour les administrateurs ou les mandataires judiciaires, aucune obligation de garantie ou d'assurance n'est imposée. e) Quelques dispositions spécifiques aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique Il est prévu, au titre de la prévention des difficultés, l'établissement de comptes annuels et la désignation d'un commissaire aux comptes pour les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui cumulent deux des trois critères suivants : 50 salariés ; 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires hors taxes ou de ressources ; un bilan total de 1,55 million d'euros. Celles qui comptent 300 salariés ou plus et affichent un chiffre d'affaires hors taxes ou un niveau de ressources supérieur ou égal à 18 millions d'euros, pour leur part, sont tenues de produire une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, ainsi qu'un compte de résultat prévisionnel, un tableau et un plan de financement. La mise en œuvre de la procédure d'alerte par le commissaire aux comptes reprend les dispositions en vigueur pour les sociétés anonymes (article 251-1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967) lorsque la personne morale dispose, pour son administration, d'un organe collégial distinct de celui en charge de sa direction, et celles applicables aux sociétés autres que les sociétés anonymes dans tous les autres cas (article 251-2 du décret susmentionné). En outre, le décret apporte des précisions sur le contenu du rapport du commissaire aux comptes quant aux conventions conclues entre la personne morale et l'une ou plusieurs personnes physiques exerçant un rôle important en son sein (mandataire social, associé, gérant, directeur général, entre autres). On soulignera que ces diverses mesures relèvent tout autant de la transparence de gestion que de la prévention des difficultés, mais l'expérience montre que l'une et l'autre restent effectivement étroitement associées. 3. Les procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires Apport essentiel de la loi, au point de lui avoir légué son nom, la sauvegarde des entreprises occupe une place tout autant prééminente dans le décret d'application, puisque le tiers des articles que comporte ce texte - 119 très exactement - lui est consacré. Le pouvoir réglementaire a été très prolixe sur le sujet, ce qui n'est pas surprenant dans la mesure où la nouvelle procédure, qui est un « redressement judiciaire anticipé » jusqu'alors inexistant dans notre droit, a été mise en place quasiment ex nihilo, à la différence d'autres procédures qui, comme la conciliation (ex-règlement amiable), reprenaient plus largement, en les modernisant, certains dispositifs en vigueur. Les dispositions relatives au redressement judiciaire sont moins nombreuses et, dans la plupart des cas, s'alignent très logiquement sur la procédure retenue pour la sauvegarde. La liquidation judiciaire constitue l'autre grand sujet du décret n° 2005-1677, avec 103 articles dédiés. En la matière, les retouches du droit antérieur n'ont pas conduit à une véritable révolution, si ce n'est pour tenir compte du transfert des dispositions relatives au plan de cession (auparavant rattachées au redressement judiciaire) et de la mise en place de la liquidation judiciaire simplifiée. La saisine du tribunal s'effectue, dans chaque cas, selon les mêmes modalités que pour l'ancien redressement et la liquidation judiciaire (critères formels de dépôt de la demande par le débiteur, auditions complémentaires à celle du seul débiteur, possibilité de commission d'un juge chargé de rendre un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise en difficulté, entrée en vigueur à la date du jugement et notification, notamment). Quelques aménagements ont néanmoins été prévus par le décret. Le plus important d'entre eux concerne l'assignation en redressement ou liquidation, qui ne devra désormais plus contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées par le créancier pour le recouvrement de sa créance mais tout élément de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. L'objectif ici clairement poursuivi est double : accélérer les actions des créanciers bien informés et décourager les saisines intempestives, notamment par les organismes de recouvrement agissant souvent mécaniquement. Les règles relatives à la décision du tribunal ont également été complétées dans le sens d'une plus grande protection des droits de la défense. Ainsi, l'enquête préalable par un juge commis ne peut plus être ordonnée qu'après un débat contradictoire. De même, aucune procédure différente de celle visée dans l'acte de saisine ne peut plus être ouverte d'office sans que le débiteur ait été spécifiquement cité à cette fin, dans les formes requises. Certains magistrats consulaires y voient une source de retard, dans le cas d'un redressement manifestement impossible ou d'une entreprise ayant totalement cessé son activité notamment, mais il s'agit d'une sécurité juridique forte pour le débiteur qui échappe à l'automatisme des procédures. Enfin, dans le même esprit, le décret a supprimé la faculté pour la cour d'appel de prononcer une liquidation judiciaire après annulation ou infirmation d'un jugement de redressement judiciaire. Dans l'ensemble, ces aménagements confortent le double souci du législateur d'assurer l'efficacité des procédures et de préserver les droits de la défense. Le décret n° 2005-1677 introduit en l'espèce plusieurs innovations qui méritent d'être soulignées. · Pour ce qui concerne les mandataires de justice, il précise notamment les seuils en deçà desquels la désignation d'un administrateur judiciaire devient facultative. Dès lors que les entreprises en difficultés réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 3 millions d'euros et emploient moins de vingt salariés, ces deux seuils constituant des critères cumulatifs, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire et les dispositions des articles L. 627-1 à L. 627-4 du code de commerce sont applicables. Le seuil antérieur de 3,1 millions d'euros s'est trouvé arrondi tandis que le nombre de salariés a été ramené de cinquante à vingt, de manière à ne pas alourdir le coût des procédures collectives pour les entreprises de taille modeste. En outre, de manière à garantir que toutes les missions soient conduites avec la même rigueur, le décret a organisé l'information des mandataires non inscrits sur les listes prévues aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce, en spécifiant notamment qu'ils se voient rappeler leurs obligations en matière de comptabilité, d'assurance et de dépôt de fonds à la Caisse des dépôts et consignations. · S'agissant du tribunal, il convient de relever que la possibilité qui lui était antérieurement accordée de se saisir d'office aux fins d'annulation ou de réformation des ordonnances du juge-commissaire ou lorsque ce dernier n'a pas statué dans un délai raisonnable a été supprimée. À vrai dire, cette modification s'inscrit dans le prolongement de la loi, qui renforce le rôle des parties dans la conduite des procédures. Il faut également souligner que le décret a aussi introduit une nouvelle obligation : celle de notifier les ordonnances du juge-commissaire aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Une telle mesure va dans le sens d'une plus grande transparence à l'égard des tiers et d'une meilleure sécurité juridique, puisque les recours des tiers seront ainsi plus encadrés. · Enfin, pour le cas spécifique des débiteurs en liquidation exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, le décret prévoit la désignation par le tribunal d'un représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente pour accomplir les actes relevant de la profession. S'il le souhaite, ce représentant peut déléguer sa mission à un autre membre de la profession, en activité ou retraité. Dans tous les cas de figure, la rémunération est fixée par le juge-commissaire. Les nouveautés les plus notables en la matière concernent les créances régulièrement nées après le jugement d'ouverture de la procédure. C'est ainsi que le décret a prévu l'établissement par les mandataires de justice d'une liste des créances postérieures bénéficiant du privilège conféré par les articles L. 622-17 et L. 631-14 (13) ainsi que l'article L. 641-13 (14) du code de commerce. Cette liste doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal à l'issue du délai fixé pour faire connaître les créances en question, à savoir un an après la fin de la période d'observation, six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou un an à compter de la publication du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. La liste de ces créances peut alors être consultée par tout intéressé et contestée devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'insertion au BODACC indiquant son dépôt au greffe du tribunal. De même, les créances écartées de la liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions applicables aux créances antérieures. La lecture de ces dispositions illustre de manière assez claire l'objectif poursuivi : il s'agit en l'occurrence de limiter dans le temps les contentieux issus de la sélection des créances relevant de la liste des créances postérieures ainsi que de l'obligation de les porter à la connaissance du mandataire de justice, sous peine de déchéance du privilège dont elles bénéficient. Autre apport du décret, il est précisé que la déclaration des créances postérieures non privilégiées résultant d'un contrat à exécution successive, essentiellement liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique, porte sur la totalité des sommes échues et à échoir. Au demeurant, elle doit être réalisée sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter, soit de la publication du jugement d'ouverture si le contrat a été conclu antérieurement, soit de la première échéance impayée. S'agissant de la déclaration des créances antérieures au jugement d'ouverture, le décret fixe le délai imparti aux créanciers à deux mois, prorogés de deux mois pour ceux qui « ne demeurent pas sur [le] territoire » de la juridiction compétente. L'expression retenue par l'article 99 du décret apparaît néanmoins plutôt malheureuse puisqu'elle est imprécise, notamment lorsqu'il s'agit de créances d'une entreprise ayant des établissements multiples. Il eût été préférable de se référer au « siège social », comme le fait la Cour de cassation (15). · Innovation dont le législateur s'était félicité lors des débats sur la loi de sauvegarde des entreprises, les comités de créanciers n'occupent pas, de manière quelque peu surprenante, une large place dans le décret d'application n° 2005-1677. Il prévoit que ces comités ne concernent que les débiteurs réalisant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 20 millions d'euros ou employant plus de 150 salariés, ces critères étant alternatifs. Par voie de conséquence, le caractère obligatoire du nouveau dispositif se trouve restreint à un nombre relativement limité d'entreprises, à tout le moins aux plus grandes d'entre elles, et cela contrairement à la volonté que le législateur avait exprimé lors des débats parlementaires. Cela ne signifie aucunement, néanmoins, que les plus petites soient complètement écartées, puisqu'il est précisément indiqué que le juge-commissaire, s'il est saisi en ce sens par le débiteur ou l'administrateur, peut décider au cas par cas de l'opportunité de créer de tels comités. Les rédacteurs du décret mettent en avant que : « Le fonctionnement des comités de créanciers fait l'objet d'un encadrement réglementaire minimal, afin de laisser une large place à la pratique » (16). Il reste que, même peu nombreuses, certaines de ces dispositions règlementaires, notamment s'agissant de la définition des établissements de crédit, apparaissent au mieux restrictives, au pire en contradiction avec la souplesse voulue par le législateur. Nous verrons ultérieurement leurs conséquences concrètes sur le déroulement des instances et les ajustements qu'il conviendra, sans beaucoup tarder, de prévoir sur ce point. La loi prévoyant l'intervention d'un administrateur judiciaire lorsque des comités de créanciers sont mis en place, le décret instaure une procédure pour le cas où, à l'ouverture de la sauvegarde, cet administrateur n'aurait pas été nommé : en l'occurrence, le juge-commissaire procède à sa désignation en cantonnant sa mission aux seules prérogatives qu'il est tenu d'exercer vis-à-vis des comités de créanciers. La médiation d'un tiers maîtrisant le droit et la pratique des procédures collectives apparaît de nature à faciliter le dialogue entre créanciers et débiteur ; en ce sens, elle est utile. Les modalités de calcul des pourcentages du total des créances servant à déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs et la pondération des votes ont également été précisées. Le texte indique ainsi que, d'une part, chacun des établissements de crédit (17) créancier du débiteur est membre de droit du comité des établissements de crédit et, d'autre part, chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 5 % du total des créances hors taxe des fournisseurs, à la date du jugement d'ouverture, est membre de droit du comité des principaux fournisseurs. Néanmoins, les plus petits fournisseurs peuvent être associés au comité des principaux fournisseurs, à la demande de l'administrateur. Le décret dispose aussi que la décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, lequel est calculé hors taxes et arrêté au plus tard huit jours avant la date du vote. Les dates de calcul retenues ne sont pas uniformes afin qu'il puisse être tenu compte de la possible évolution du montant des créances entre la date d'ouverture de la procédure et le vote, notamment en cas de cession des créances détenues. · L'essentiel des dispositions réglementaires consacrées au plan de cession de l'entreprise qui figuraient dans l'ancien redressement judiciaire a été repris dans le titre IV du décret, qui traite de la liquidation judiciaire. En cas de cession dans le cadre d'un redressement, le délai de communication des offres est fixé par l'administrateur et le prix de cession versé entre les mains du mandataire judiciaire, à charge pour lui de le remettre ensuite, selon les cas, au commissaire à l'exécution du plan ou au liquidateur. Par ailleurs, un même jugement ne peut statuer sur le sort de l'entreprise et celui du débiteur. Une fois le plan arrêté, la procédure se poursuit en vue de l'arrêté d'un plan de redressement ou du prononcé de la liquidation. Pour le reste, les autres règles applicables au plan de cession sont identiques à celles de la liquidation. · La présence du ministère public aux débats relatifs à l'arrêté d'un plan de sauvegarde, d'un plan de redressement ou d'un plan de cession est obligatoire dès lors que se trouve en cause une personne morale dont le nombre de salariés est inférieur à 20 et dont le chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 3 millions d'euros, ces deux seuils constituant des critères cumulatifs. Comme le souligne une étude rédigée par M. Jean-Pierre Rémery, publiée le 19 avril 2006, se pose en l'espèce la question de savoir si le parallélisme des formes doit être observé à l'occasion d'un jugement en appel sur les différents plans de sauvegarde, de redressement ou de cession judiciaires. Le décret reste muet sur ce cas de figure, ce qui n'empêche pas l'auteur de cette étude de recommander la présence du parquet, au vu notamment du risque de vice de forme qui pourrait résulter de son absence (18). On soulignera que les seuils retenus sont identiques à ceux pour la désignation obligatoire d'un administrateur judiciaire et qu'ils concernent plus particulièrement les petites et moyennes entreprises (PME) qui commencent à occuper un rôle économique et social important au plan local. Ce choix d'harmonisation des seuils applicables répond également à un objectif d'intensification de l'implication du parquet dans les procédures collectives concernant des entreprises de taille moyenne. En atteste la circulaire CIV/08/06 signée par le garde des Sceaux le 18 avril 2006, relative à l'action du ministère public dans les procédures du livre VI du code de commerce en conséquence de la loi de sauvegarde des entreprises, qui souligne que « le principe de la présence obligatoire du ministère public (...) consacre son rôle indispensable dans le cours des procédures collectives » (19), même s'« il s'agit là davantage de consacrer un état de fait ». Le décret s'efforce de moduler le contenu de l'obligation de publicité préalable à toute cession d'actifs ou cession d'entreprise, prescrite par la loi, en fonction de l'importance de l'opération envisagée. L'article 286 du texte précise que les mandataires de justice doivent procéder à ces formalités au moyen d'un service accessible par Internet. Cette disposition n'est nullement exclusive d'autres procédés plus traditionnels, puisque la publicité par voie de presse se trouve également prévue, précision étant faite néanmoins que leur étendue est déterminée par le juge-commissaire. Dans le cas d'actifs de faible valeur, explicitement visé, la publicité par voie de presse n'est même pas systématique ; c'est le juge-commissaire qui détermine s'il y a lieu d'y procéder. La loi de sauvegarde des entreprises a créé une procédure de liquidation judiciaire accélérée et moins formelle que la liquidation à proprement parler, principalement pour les petites entreprises dont le montant des actifs est faible. Le législateur est particulièrement attaché à cette innovation importante, qui vise à diminuer la longueur des procédures et à en réduire les coûts, dans l'intérêt des créanciers, des débiteurs et de la justice commerciale. Le décret du 28 décembre 2005 définit les conditions concrètes de mise en œuvre de cette procédure et, partant, en détermine l'efficacité. Trois critères ont été retenus pour identifier les débiteurs concernés : l'absence d'actif immobilier (prévu par le second alinéa de l'article L. 641-2 du code de commerce), un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 750 000 euros et un effectif salarié inférieur ou égal à 5 personnes au cours des six mois ayant précédé la procédure (inscrits à l'article 223 du décret). À noter également le principe d'une convocation du débiteur à l'audience, à l'issue de laquelle il doit être statué sur l'application de la procédure simplifiée ou sur le retour au droit commun. Par ailleurs, l'exercice du recours devant le juge-commissaire à l'encontre du projet de répartition établi par le liquidateur se trouve restreint dans un délai d'un mois à compter du dépôt de l'avis de ce projet au greffe du tribunal. Les dispositions antérieures à la loi de 2005 et les décrets de 1985 n'organisaient qu'incomplètement la clôture des procédures. Le législateur a introduit davantage de souplesse lors de l'adoption de la loi de sauvegarde des entreprises, notamment en instituant la possibilité de mettre un terme à la sauvegarde ou au redressement judiciaire au cours de la période d'observation à la condition d'une disparition des difficultés du débiteur. Par ailleurs, le décret n° 2005-1677 a complété le dispositif pour les situations où la loi est restée silencieuse. Deux nouvelles hypothèses de clôture de la procédure de sauvegarde par jugement ont ainsi été créées. Elles concernent les cas d'absence de présentation d'un projet de plan dans un délai permettant au tribunal de statuer avant l'expiration de la période d'observation, à l'article 134 du décret, ainsi que les cas de rejet du projet de plan par une décision devenue définitive sans que la procédure de sauvegarde n'ait été convertie en redressement ou en liquidation, à l'article 138 du décret. Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions nouvelles produisent d'importants effets juridiques puisqu'elles font recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions. Ce faisant, ils se trouvent prémunis contre le risque qu'un débiteur, une fois obtenu l'arrêt des poursuites, reste inactif ou présente un projet de plan non crédible. De même, lorsqu'il y a lieu de constater l'achèvement de la procédure, le président du tribunal doit rendre une ordonnance en ce sens qui, parce qu'elle constitue une mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours. Il apparaît ainsi plus clairement que la procédure ayant conduit à l'adoption du plan ne se poursuit pas pendant l'exécution de ce dernier. Le décret précise aussi que toutes les clôtures de procédures se trouvent précédées ou suivies d'un compte rendu de fin de mission établi par les mandataires de justice. Ce document doit comporter les opérations de recettes et de dépenses, ainsi que les débours et rémunérations payés à tous les intervenants (mandataires de justice, experts, entre autres). Le greffier lui-même est tenu d'y annexer le détail de ses émoluments, frais et débours, ajoutant ainsi à l'effort général de transparence. L'ensemble est adressé au débiteur, au ministère public et aux contrôleurs. Ces comptes rendus peuvent également être consultés au greffe du tribunal par tout intéressé. Il est enfin indiqué que le juge-commissaire procède à leur vérification, ce qui implique une intervention plus large de l'autorité judiciaire. 4. Les responsabilités et sanctions La loi de sauvegarde des entreprises n'a pas apporté de révolution en matière de responsabilité (responsabilité de droit ou de fait dans l'insuffisance d'actif et obligation aux dettes sociales) et de sanction (faillite personnelle, banqueroute et interdiction de gérer) des dirigeants, ce qui explique que le décret d'application ne comporte que peu de dispositions, au regard de sa longueur globale, sur le sujet. L'innovation la plus conséquente par rapport au droit antérieur résulte de l'article 323 du décret, aux termes duquel la date de cessation des paiements prévue par la loi ou arrêtée par la juridiction civile s'impose à cette même juridiction lorsqu'elle statue en matière de sanctions. Il s'agit là d'un renversement de la règle applicable par rapport à la jurisprudence constamment affirmée sur le sujet (20), qui présentait entre autres inconvénients de placer les dirigeants concernés dans une insécurité juridique préjudiciable. Au demeurant, cette précision apparaît logique, car il aurait été pour le moins surprenant que le critère de la cessation des paiements fut interprété de manière différente selon qu'il s'agisse de favoriser le devenir de l'entreprise en difficultés ou d'appliquer des sanctions personnelles à ses dirigeants. Le décret apporte également des précisions bienvenues sur les conditions dans lesquelles la majorité des créanciers nommés contrôleurs peuvent agir en cas d'inaction du mandataire de justice. Conformément à la volonté exprimée par le législateur, le mécanisme de saisine du tribunal par la majorité des créanciers contrôleurs, innovation introduite par la loi aux articles L. 651-3 et L. 653-7 du code de commerce pour défendre l'intérêt collectif des créanciers, doit s'entendre comme consécutif à une mise en demeure par au moins deux contrôleurs du mandataire de justice ayant qualité pour agir, qui serait restée sans suite pendant deux mois. L'objectif est bien évidemment d'éviter les initiatives individuelles susceptibles de conduire à une multiplication des saisines ne correspondant pas nécessairement à la préservation de l'intérêt du plus grand nombre de créanciers. Quant au délai, s'il était plus bref, il serait de nature à empêcher le mandataire de la possibilité d'engager lui-même une action, par manque de temps. On observera enfin qu'à l'instar des dispositions du décret du 27 décembre 1985, l'article 318 du décret n° 2005-1677 précise que le dirigeant exposé à une sanction pécuniaire se trouve convoqué pour audition en chambre du conseil. Or, cette reconduction du droit existant ne correspond pas à l'esprit de l'alinéa 2 de l'article L. 662-3 du code de commerce, qui dispose que les débats ont lieu en audience publique, la formation de la chambre du conseil ne pouvant statuer que si le débiteur en formule la demande. Ainsi, comme l'a souligné le professeur Jean-Pierre Legros, dans une récente étude, « Les mots "en chambre du conseil" sont de trop à l'article 318 qui contrarie ainsi la loi » (21). Ceci est d'autant plus ennuyeux que l'audience publique a pour objet de mettre fin à des pratiques parfois contestables de certaines « chambres de sanction » des juridictions consulaires, dont les motivations étaient, jusque-là, parfois opaques. 5. Les dispositions générales de procédure Le décret n° 2005-1677 comporte, en fin de texte, un certain nombre de dispositions générales qui concernent essentiellement les voies de recours et le formalisme qui sied aux instances. En l'espèce, la plupart des dispositions en vigueur antérieurement ont été reprises par le texte. Parmi les évolutions méritant d'être soulignées, on mentionnera notamment l'élargissement de la dérogation à l'exécution provisoire de plein droit des jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation, aux décisions statuant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif, l'obligation aux dettes sociales ainsi que les frais de procédure. Cette dérogation ne concernait jusqu'alors que les jugements ou ordonnances rendus pour le paiement provisionnel de créances, la substitution de garantie sur un bien, la réalisation de la liquidation judiciaire et les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. L'extension au mandat ad hoc de la procédure tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction autre que celle normalement compétente ainsi que la possibilité offerte au ministère public près la juridiction dont les intérêts en présence justifieraient sa saisine de recourir à cette même procédure constituent deux apports nouveaux du décret. Désormais, pour le mandat ad hoc comme pour les procédures collectives, lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi devant une autre juridiction ou lorsque le ministère public formule une demande en ce sens, le premier président de la Cour d'appel, voire le premier président de la Cour de cassation quand la délocalisation juridictionnelle concerne un ressort différent de Cour d'appel, est conduit à désigner, dans les dix jours de sa réception du dossier, le tribunal ou la Cour d'appel compétents. Mesures d'administration judiciaire, ces décisions sont insusceptibles de recours. La circulaire CIV/08/06 du 18 avril 2006 sus-mentionnée précise que lorsque le ministère public se trouve à l'origine de ces renvois, « tant le parquet près le tribunal saisi que celui près le tribunal vers lequel il apparaît que la procédure doive être transférée peut prendre cette initiative » (22). Mais ce document d'ajouter une restriction au sujet du mandat ad hoc, « par principe inconnu des parquets, qui ne peut être renvoyé d'une juridiction à une autre que d'office ou à l'initiative du débiteur ». En l'espèce, il convient particulièrement de souligner que l'article 336 du décret dispose que les règles du nouveau code de procédure civile sont applicables aux matières régies par le livre VI du code du commerce, sauf dispositions explicitement contraires. Le décret précise également, à son article 351, les modalités d'information du garde des Sceaux, du procureur de la République, ainsi que des magistrats inspecteur régional et coordonnateur, sur l'activité des mandataires de justice découlant des mandats que les juridictions en charge des procédures collectives leur ont confié : pour chaque débiteur concerné, sont mentionnés le chiffre d'affaires hors taxe et le nombre de salariés, ainsi que le chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre précédent par les mandataires judiciaires du fait de l'ensemble des mandats qu'ils ont exercé. Ces données, actualisées chaque semestre, sont transmises au plus tard deux mois après leur collection aux autorités et magistrats susmentionnés. À vrai dire, le rapporteur ne peut que se déclarer déçu par le caractère elliptique des précisions apportées par le décret à l'article L. 662-3 du code de commerce. Les professionnels concernés ont tout à gagner à afficher le maximum de transparence possible, sous peine de continuer à se voir critiquer par certains pourfendeurs de l'honnêteté de la justice commerciale de notre pays. Le décret ne répond pas à l'exigence formulée par le législateur en 2005. Pour le moins, sa rédaction manque d'ambition. En matière de prévention des difficultés des entreprises, la longueur excessive des procédures - aussi justifié leur déclenchement soit-il - conduit nécessairement à un accroissement des problèmes financiers du débiteur. Le décret n° 2005-1677 essaie de surmonter cet écueil, en fixant un rythme procédural ambitieux. Ainsi, l'article 328 du décret dispose que, sauf exceptions expresses, les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. De principe, le délai d'appel ou de tierce opposition est de dix jours. Certains délais d'information des parties ou de notification par les greffiers, à l'exemple des trente jours prévus à compter de l'ouverture de la sauvegarde pour permettre à l'administrateur judiciaire d'aviser les créanciers de leur appartenance aux comités de créanciers ou des trente jours prévus à compter de la réception du projet de plan par ces mêmes créanciers pour leur laisser le temps de se prononcer, peuvent se révéler matériellement délicats à respecter. Cependant, ils restent exceptionnellement longs car le décret comporte la plupart du temps des délais compris entre huit et dix jours. Ce souci de faciliter un déroulement le plus rapide possible des procédures est plus que louable. Il répond en tout cas à l'intention du législateur, ce dont le rapporteur ne peut que se féliciter. Par dérogation au principe général posé à l'article 191 de la loi de sauvegarde des entreprises, aux termes duquel la loi nouvelle ne s'efface au profit de la loi ancienne que si, au 1er janvier 2006, une procédure collective est en cours, certaines procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur de la réforme de 2005 peuvent bénéficier de ses innovations. Il s'agit, pour mémoire : - du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce, relatif à la liquidation simplifiée ; - de l'article L. 626-27 du code, concernant la sanction de l'inexécution du plan par le débiteur et la résolution du plan à la suite de la cessation des paiements du débiteur constatée lors de l'exécution du plan ; - de l'article L. 643-11, qui détermine les conditions de reprise des actions individuelles des créanciers après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; - de l'article L. 643-13 offrant la possibilité de reprendre une procédure de liquidation judiciaire alors que sa clôture a été prononcée pour insuffisance d'actif, lorsqu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées ; - des deux premiers chapitres du titre V du livre VI du code de commerce, qui modernisent et assouplissent le régime des sanctions financières ; - de l'article L. 653-7, qui modifie la liste des titulaires du pouvoir de saisine du tribunal pour demander qu'il prononce la faillite personnelle du débiteur ; - de l'article L. 653-11, qui limite la durée maximale des sanctions professionnelles à quinze ans ; - de l'article L. 662-4, fixant les règles de publicité des débats. L'article 192 de la loi dispose également que les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes aux fins de sanction, en application des articles L. 621-98, L. 624-1, L. 624-4 et L. 624-5 du code de commerce, antérieurement au 1er janvier 2006, ne sont pas affectées par l'abrogation de ces différents cas de figure à compter de cette dernière date. Quelques jours à peine après l'entrée en vigueur effective de ces dispositions, complétées par le décret n° 2005-1677, une circulaire ministérielle et la jurisprudence de la Cour de cassation sont venues éclairer les contours de leur application. · Le 4 janvier 2006, la Cour de cassation a précisé la portée de l'article 192 et le sens à donner à l'expression « procédures ouvertes », figurant à cet article (23). Dans ses attendus, la Cour a explicitement indiqué que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, fut-elle frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, « peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée ». Il résulte de cet arrêt que tout appel d'un jugement rendu sur le fondement sur l'article L. 624-5 avant le 1er janvier 2006 devra lui aussi faire application de cet article dans sa rédaction antérieure ; inversement, à défaut de décision ayant ouvert contre le dirigeant une procédure collective sur le fondement de cet article dans son ancienne rédaction, la loi du 26 juillet 2005 devient directement applicable à la procédure en cours, conformément au 5° de son article 191. La circulaire CIV/02/06 du ministère de la justice en date du 9 janvier 2006, relative aux mesures législatives et règlementaires de la loi de sauvegarde des entreprises applicables aux procédures en cours (24), précise quant à elle qu'« Il résulte des termes de la loi que les actions engagées sur le fondement de ces articles, mais n'ayant pas abouti au prononcé d'une telle décision d'ouverture, ne peuvent être poursuivies ». Et le document d'ajouter : « Si ces conditions d'applications sont réunies, notamment en ce qui concerne son délai de prescription de trois ans, une action en obligation aux dettes sociales peut se substituer à la procédure "sanction" de l'article L. 624-5 (ancien) ». La jurisprudence de la Cour de cassation a été confortée, depuis lors, par plusieurs arrêts. Dans une décision rendue le 16 mai 2006 (25), la Cour a ainsi précisé que la poursuite des procédures collectives pendantes visant à la sanction des dirigeants, voulue par l'article 192 de la loi, s'impose quel que soit le mode de saisine du tribunal avant le 1er janvier 2006. Ainsi, de même que pour l'action en ouverture d'une procédure contre un dirigeant, aussi bien pour l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif que pour l'action en prononcé de la faillite personnelle, la saisine d'office intervenue sous l'empire de l'ancien livre VI du code de commerce demeure valable et n'entache nullement d'irrégularité le prononcé, postérieur au 1er janvier 2006, d'une condamnation à combler le passif social ou d'une mesure en faillite personnelle, ce qu'au demeurant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait déjà jugé le 13 avril 2006 (26). De même, dans un arrêt du 27 juin 2006 (27), la Cour de cassation a souligné que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'égard des personnes, membres ou associées d'une personne morale en procédure collective, indéfiniment et collectivement responsables du passif social, par une décision prononcée antérieurement au 1er janvier 2006, même lorsqu'elle est frappée de recours, continue d'être régie par les dispositions du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, « peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée ». · Pour ce qui concerne la portée de l'article 191 de la loi, la circulaire CIV/02/06 apporte plusieurs indications très importantes. L'application de la procédure de liquidation simplifiée, tout d'abord, se trouve autorisée dans deux cas de figure bien précis : - si une procédure de redressement judiciaire est en cours et le prononcé d'une liquidation judiciaire envisagé de manière subséquente, sous réserve que le débiteur a dûment été appelé ou entendu et que les conditions du second alinéa de l'article L. 641-2 se trouvent respectées (absence d'un bien immobilier dans l'actif, 5 salariés au plus au cours des six mois précédant l'ouverture du redressement judiciaire, un chiffre d'affaires hors taxes égal ou inférieur à 750 000 euros) ; - si une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi, les mêmes conditions qu'énumérées dans le cas de figure précédent se trouvant remplies. Par ailleurs, le droit pour les créanciers de la procédure initiale de ne pas déclarer à nouveau leur créance après ouverture ou prononcé d'une procédure suivant une résolution de plan, en vertu du III de l'article L. 626-27, ne s'applique pas aux procédures en vigueur. En effet, aux termes du droit en vigueur, ces dernières ne peuvent qu'être liquidatives alors que le 2° de l'article 191 vise uniquement les procédures de redressement judiciaire. S'agissant de la poursuite de la suspension des actions des créanciers à la clôture des plans de cession et des procédures de liquidation judiciaire en cours, les nouvelles dispositions introduites par la loi du 26 juillet 2005 doivent être mises en œuvre. Si l'initiative revient aux créanciers de faire valoir leur droit, le tribunal est désormais appelé à statuer expressément sur la reprise de ces poursuites pour cas de fraude, lors du jugement de clôture voire à l'occasion d'une requête ultérieure. On mentionnera enfin, dans le domaine des sanctions, que l'application aux redressements et liquidations judiciaires en cours des règles relatives à l'action aux fins d'obligation aux dettes sociales est devenue immédiate à compter du 1er janvier 2006, aucune condamnation ne pouvant plus être prononcée sur le fondement de l'ancien article L. 624-5. En outre, les juridictions ne peuvent plus se saisir d'office et le juge-commissaire ne doit ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. La circulaire souligne aussi que, compte tenu du caractère général de l'article L. 653-11, les conditions du relèvement d'une interdiction de gérer prononcée à l'occasion d'une procédure encore en cours, peuvent s'apparenter à une formation professionnelle. D. LES MESURES RÉGLEMENTAIRES PUBLIÉES POSTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI Plusieurs mesures réglementaires d'application de la loi ont été publiées postérieurement aux délais fixés par le législateur. L'essentiel reste néanmoins que ces textes, parfois très importants, soient parus dans l'année suivant l'entrée en vigueur des dispositions législatives. 1. Le décret n° 2006-893 du 18 juillet 2006 modifiant le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des tribunaux de commerce L'article 175 de la loi de sauvegarde des entreprises a créé un article 379 bis au sein du code des douanes afin d'introduire un dispositif de publicité des créances privilégiées de l'administration des Douanes qui soit similaire à celui dont bénéficie l'administration du Trésor, aux termes de l'article 1929 quater du code général des impôts. Jusqu'alors, il n'existait pas de publicité obligatoire des sommes dues et non payées dans les délais impartis aux douanes par les entreprises redevables, alors même que l'inscription de ces sommes au registre des privilèges et nantissements peut se révéler très utile pour détecter les difficultés de paiement des sociétés concernées, notamment lorsqu'elles ont une activité d'exportation ou d'importation. À l'instar de l'article 1929 quater du code général des impôts, le nouvel article 379 bis du code des douanes renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les formes et les délais des inscriptions et de leur radiation. Ce texte réglementaire n'a pas été publié au journal officiel avant l'entrée en vigueur de la réforme, puisqu'il est paru le 20 juillet 2006. Il est vrai qu'au regard des autres mesures réglementaires d'application prévues par le législateur, son importance pouvait sembler relative. Modifiant le décret n° 80-307 du 29 avril 1980, portant règlement d'administration publique fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce, le décret n° 2006-893 du 18 juillet 2006 se borne à abaisser de trois à deux le coefficient de taux de base (fixé quant à lui à 1,3 euro) servant à définir les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce pour procéder aux mesures de publicité précitées. La portée de cette disposition vaut tout aussi bien pour l'inscription et la radiation des privilèges des créances fiscales que pour celles des privilèges des créances douanières. 2. Le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires La loi n° 2005-845 a conféré des missions nouvelles et importantes aux mandataires de justice, jusque dans la liquidation judiciaire. Il apparaît normal, par voie de conséquence, que leurs émoluments évoluent pour en tenir compte. MISSIONS DES MANDATAIRES DE JUSTICE AUX DIFFÉRENTS STADES
Les dispositions réglementaires régissant le tarif des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en matière commerciale ont été adaptées un an après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises, par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 (28). Ces mesures étaient attendues car, comme le soulignait le professeur Yves Chaput, dans l'étude mentionnée plus haut : « L'équilibre de la réforme ne se stabilisera qu'avec la publication [d'un décret] sur la rémunération de l'activité des administrateurs et mandataires judiciaires (Ubi onus, ibi emolumentum) » (29). PRINCIPALES RÉMUNÉRATIONS FIXÉES PAR LE DÉCRET N° 2006-1709
Les principaux intéressés se montrent, dans l'ensemble, plutôt satisfaits des nouvelles dispositions réglementaires. La revalorisation de leurs rémunérations est d'ailleurs restée relativement mesurée, comme le montre le tableau ci-dessus, qui détaille les principaux cas de figure envisagés par le décret. E. LE PETIT NOMBRE DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES MANQUANTES Peu d'articles de la loi de sauvegarde des entreprises demeurent inappliqués, faute de publication d'un acte réglementaire. Stricto sensu, on dénombre uniquement, dans ce cas, l'article 63, relatif aux possibilités de remise des créances publiques, et l'article 187, qui fixe pour le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce les conditions d'appel de ses cotisations. Mais l'article 63 est essentiel. Il devrait très bientôt voir ses mesures d'application publiées ; en effet, le décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, se trouve désormais à la signature des ministres concernés, de sorte que sa parution au journal officiel et son entrée en vigueur ne sauraient tarder. 1. Le régime des remises de dettes par les créanciers publics : une question en passe d'être résolue La loi de sauvegarde des entreprises a élargi substantiellement le nombre de créanciers publics pouvant consentir des remises de dettes à un débiteur en difficultés, en y incluant les organismes gérant l'assurance chômage et l'ensemble des comptables publics, ainsi que le champ des remises accordées, qui peuvent désormais porter sur tout ou partie des impôts directs de l'État et des collectivités locales ou sur les intérêts de retard, les majorations, les pénalités et les amendes fiscales des impositions indirectes, ces dernières (notamment la taxe sur la valeur ajoutée) étant de fait collectées auprès de tiers pour le compte des collectivités publiques. Vu l'importance très souvent prise par les créances publiques dans le passif des entreprises en difficultés, cette mesure revêt par nature une dimension essentielle dans la réforme adoptée en 2005 par le législateur. Le décret d'application de l'article 63 de la loi est désormais prêt et sa parution, grâce à l'insistance du rapporteur, imminente. Les retards pris pour son élaboration trouvent leur explication dans deux raisons fort différentes : - la première, tout à fait recevable, est la large concertation préalable des différents intéressés par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - la seconde, moins acceptable, tient à de traditionnelles réticences administratives, le principe de remises de créances publiques concertées représentant un véritable changement culturel auquel, visiblement, certaines administrations sociales n'étaient pas préparées. Il convient de se féliciter que l'État ait accepté de se mettre à égalité avec les créanciers privés d'entreprises en difficultés pour une large part de ses créances, ce qui était loin d'être le cas jusqu'alors. Le décret énumère en effet, à son article 2, six catégories de dettes pouvant être remises par des créanciers publics, lesquelles sont de nature très large puisqu'elles recouvrent les aspects fiscaux, les cotisations et contributions sociales ainsi que des redevances diverses. Le texte vise très exactement : - les pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'État auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; - les majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions mutualistes régies par les livres IX du code de la sécurité sociale et VII du code rural ; - les majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu aux articles L. 351-3 et suivants du code du travail ; - les cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; - les droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ; - les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et autres produits divers du budget de l'État. Une double limite quantitative est néanmoins prévue à ces remises de créances publiques, de manière à satisfaire aux prescriptions de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et à éviter qu'elles soient assimilables à une aide de l'État, devant être notifiée à la Commission européenne (30). L'article 7 du décret prévoit en effet, d'une part, que le montant des remises de créances publiques ne doit pas excéder trois fois le montant des remises de dettes privées consenties à l'entreprise en difficultés et, d'autre part, que le taux de remise accordé par chaque créancier public (le Trésor, les douanes, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales -URSSAF-, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce -ASSEDIC-, notamment) ne doit pas excéder le taux moyen pondéré de remise des dettes privées. Ces critères s'inspirent d'une jurisprudence communautaire infirmant des sanctions prises par la Commission à l'encontre de l'État espagnol, au motif qu'il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé, d'une taille qui puisse être comparée à celle du créancier public, aurait pu être amené à réaliser une opération d'une importance similaire à la remise de créances consentie (31). Une autre limite, qualitative cette fois, découle de la définition des créances privées, qui figure à l'article 8 du décret. En l'occurrence, ne peuvent être prises en considération par les créanciers publics pour déterminer s'ils sont en mesure de consentir eux aussi des remises de dettes, que les créances de personnes morales ou physiques n'ayant avec le débiteur ni lien familial (parents ou alliés jusqu'au quatrième degré), ni lien d'affaires (actionnaires, associés et membres du directoire ou du conseil de surveillance, notamment). Il en résulte, entre autres, que les remises de créances publiques s'avèreront impossibles pour la grande majorité des entreprises artisanales financées familialement, ce qui peut paraître regrettable et peu dans l'esprit de la loi. Sans instaurer l'équivalent des comités de créanciers pour les créanciers publics d'une entreprise en difficultés, notamment pour ne pas donner lieu à des prises de décisions non consensuelles par diverses administrations ou structures dépendant d'une même personne juridique (l'État), le décret a cherché à respecter le plus possible la philosophie de dialogue et de concertation sous-jacente à la loi de sauvegarde des entreprises. C'est ainsi que son article 6 crée une commission réunissant, au niveau départemental, les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés (CCSF). Cette commission, au sein de laquelle les différents créanciers publics discuteront des remises qu'ils sont prêts à consentir, sera l'interlocuteur unique des entreprises défaillantes. Il lui appartiendra de statuer, par consensus, dans un délai de dix semaines à compter de la réception des demandes, son silence valant décision de rejet. Chaque créancier public évoquera les remises de dettes qu'il est susceptible de consentir. Il est très probable que la mise en place de cette concertation entre créanciers publics aura des répercussions sur le comportement des créanciers privés, dans la mesure où la souplesse des premiers pourra être interprétée par les seconds comme un signe de confiance quant à la viabilité du débiteur. Le décret précise que le régime des remises de créances publiques applicable aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur continuera à obéir aux dispositions des articles 179 et 181 du décret n° 85-1388, du 27 décembre 1985. On indiquera toutefois que l'article 179 de ce décret, à cause de son renvoi à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, est trop restrictif en ce qu'il ne permet finalement que des remises au profit de contribuables dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence et qu'il empêche les autorités publiques d'effectuer une remise totale ou partielle des impôts indirects (droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, taxes sur le chiffre d'affaires, contributions indirectes et assimilées), en totale contradiction avec l'esprit de la loi de sauvegarde des entreprises. De fait, depuis le 1er janvier 2006 et jusqu'à l'expiration des procédures ouvertes antérieurement à la date de publication du nouveau décret d'application, la mise en œuvre de l'article L. 626-6 du code de commerce est appelée à rester incomplète et infidèle à la volonté exprimée par le législateur. Les articles 179 à 181 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Article 179 : « Des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R. 247-12 et R. 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. » Article 181 : « Ont compétence pour accorder des remises les comptables du Trésor et le ministre du budget lorsqu'il s'agit de créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Ils exercent cette compétence en tant que de besoin dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général sur la comptabilité publique. Dans le régime général du redressement judiciaire, il est statué sur les demandes écrites des représentants des créanciers dans les six semaines suivant la date de leur présentation. Dans la procédure simplifiée, il est statué sur les demandes dans le délai de quatre semaines. Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. » 2. Les conditions d'appel des cotisations du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce : un silence règlementaire marginal mais regrettable À la différence des greffiers des juridictions judiciaires de droit commun, qui sont fonctionnaires de l'État, les greffiers des tribunaux de commerce ont un statut privé. Officiers publics et ministériels dont les émoluments sont fixés par décret, leur profession (environ 250 personnes sur toute la France) se trouve organisée par les articles L. 821-1 à L. 821-4 et L. 822-1 à L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire. La loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, a institué leur représentation auprès des pouvoirs publics par la création du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dotée de la personnalité morale, cette instance, dont les membres sont désignés pour un mandat renouvelable de quatre ans, se trouve chargée de défendre les intérêts collectifs de la profession. La loi de sauvegarde des entreprises, à son article 187, a apporté des aménagements substantiels sur le fonctionnement de cet organe, notamment dans ses aspects financiers (32). Parmi eux, figure le principe selon lequel le montant des cotisations annuellement appelées par le conseil auprès de chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce résulte d'un barème progressif, qui prend en compte l'activité de l'office et éventuellement le nombre des associés et est fixé par décret. À l'initiative du rapporteur, ce dispositif avait été précisé et amélioré, en prévoyant explicitement, en premier lieu, que la loi fixe le montant annuel maximal susceptible d'être appelé au titre de l'ensemble des cotisations (soit 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente), en deuxième lieu, que le décret détermine le barème applicable à chaque greffe (le projet de loi initial conférant cette mission au conseil) et, en troisième lieu, que le conseil national des greffiers de tribunaux de commerce décide du montant appelé dans la limite fixée par la loi. À ce jour, le décret nécessaire pour définir le barème des cotisations n'a toujours pas été publié. Quoique marginal, ce retard est fâcheux, dans la mesure où il affecte le fonctionnement d'une institution utile. En outre, il apparaît regrettable que la confiance que le législateur avait placée dans le pouvoir réglementaire à l'occasion du vote de la loi, en prévoyant ce renvoi au décret initialement non envisagé, se trouve, en quelque sorte, mise à mal. II. - UN PREMIER BILAN PLUTÔT POSITIF, UN AN APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES PRINCIPALES INNOVATIONS DE LA LOI L'analyse d'un rapporteur sur l'application d'une loi qu'il a contribuée à faire voter ne saurait se limiter à une présentation des différents textes règlementaires pris pour rendre ses dispositions législatives effectives. L'application d'une loi doit aussi s'apprécier sur le plan qualitatif, à la lumière de la concordance ou non de ses résultats avec les objectifs initialement poursuivis. En l'occurrence, la loi n° 2005-845 a déjà apporté la démonstration de son utilité. Les statistiques en offrent l'illustration. Il n'empêche que la pratique a aussi mis en exergue un certain nombre de problèmes qui, sans nécessairement avoir un caractère rédhibitoire, appellent des correctifs à une échéance plus ou moins lointaine. A. DE NOUVELLES PROCÉDURES QUI COMMENCENT À S'IMPOSER DANS LA PRATIQUE DU DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS La loi de sauvegarde des entreprises a été élaborée et adoptée afin de conjurer l'exception française consistant à privilégier les procédures collectives plutôt que la prévention des difficultés. Pour mesurer ses premiers effets, il convient de disposer d'un état des lieux des décisions des juridictions commerciales pour les entreprises en difficultés ces dernières années. Le tableau ci-après permet, en l'espèce, de rappeler qu'en 2005 les liquidations judiciaires ont été au nombre de 45 146 et que les plans de redressement se chiffraient à 5 290. C'est au regard de ces statistiques qu'il convient d'apprécier les débuts des nouvelles procédures entrées en vigueur le 1er janvier 2006. DÉCISIONS DES JURIDICTIONS COMMERCIALES
1. Des nouvelles procédures de prévention qui entrent progressivement dans les usages Il n'est pas aisé, un an à peine après l'entrée en vigueur de la loi, de recueillir des statistiques suffisamment fiables et pertinentes. Cette démarche se heurte, au demeurant, au caractère confidentiel des actions de prévention menées par les juridictions commerciales (le mandat ad hoc et la conciliation non homologuée, notamment). Ainsi, fin janvier 2007, les services de la Chancellerie, pas plus que la conférence générale des tribunaux de commerce, n'étaient en mesure de dresser un bilan définitif sur le nombre d'ouvertures des procédures instituées par la loi de sauvegarde des entreprises au cours de l'année 2006, catégorie par catégorie. Il n'en demeure pas moins que les données existantes permettent d'ores et déjà d'esquisser des tendances assez parlantes. En l'espèce, il apparaît clairement que les procédures de prévention ont notablement progressé, indiquant en cela que l'objectif d'une meilleure anticipation des difficultés, que le législateur s'était fixé lors du vote de loi, est réaliste et atteignable. De surcroît, après de timides débuts, la procédure de sauvegarde a visiblement pris sa place dans la panoplie des procédures à la disposition du juge des entreprises en difficultés. Cela augure de développements positifs pour l'avenir. En l'absence de chiffres consolidés, on ne peut que faire état d'observations convergentes émanant des différents intéressés (juridictions, organisations professionnelles, administrations centrales) s'agissant de la hausse très significative du nombre de mandats ad hoc et de conciliations depuis l'entrée en vigueur de la loi. Le constat semble sans appel : les procédures de prévention des difficultés des entreprises ont réellement bénéficié des nouvelles dispositions inscrites dans le code de commerce en 2005. Les quelques chiffres connus à ce jour se passent de commentaires. Pour le seul ressort du tribunal de commerce de Paris, le nombre de désignations de conciliateurs est passé de 16, en 2005, à 81, en 2006, soit une augmentation de plus de 300 %. Les données du greffe et du tribunal relatives au mandat ad hoc, quant à elles, apparaissent moins significatives dans la mesure où la juridiction commerciale parisienne était de longue date pionnière en la matière. De fait, la stabilisation du nombre de désignations de mandataires ad hoc (79 en 2006 contre 83 en 2005) n'est que la confirmation d'un usage déjà bien répandu chez les juges consulaires de la capitale. Sur le plan national, la conférence générale des tribunaux de commerce s'est essayée à dresser un bilan statistique des nouvelles procédures de prévention. Actuellement, seuls sont disponibles les chiffres d'une enquête lancée au premier semestre 2006 par sa commission « procédures collectives » (33) ; ils n'en apportent pas moins d'éclairantes conclusions : en premier lieu, les comparaisons effectuées entre les situations au 31 mai 2005 et au 31 mai 2006 confirment l'engouement pour les conciliations puisque, de 66 anciens règlements amiables, les juridictions sont passées à 268 conciliations, soit là aussi un accroissement de 306 % ; en second lieu, les juges consulaires provinciaux semblent avoir pris conscience de l'intérêt des mandats ad hoc, puisque le nombre de ceux-ci a augmenté de 45 % (417 contre 218 à la même période en 2005). Ces tendances apparaissent confirmées par des évaluations ultérieures qui ont chiffré, fin novembre 2006, la progression des mandats ad hoc aux alentours de 30 % et celle des conciliations à plus de 200 %. Au total, la mise en œuvre de la loi de sauvegarde des entreprises a conduit au quasi-doublement du nombre des procédures préventives. La Chancellerie évalue d'ailleurs entre 500 et 700, le nombre de conciliations qui pourraient être finalement dénombrées sur l'an passé. Le législateur, qui poursuivait l'objectif de conforter la pratique de la prévention des difficultés, ne peut que s'en féliciter. D'un point de vue qualitatif, il convient de souligner que, dans la plupart des conciliations (plus de 90 % selon la chambre de commerce et d'industrie de Paris), le jugement d'homologation n'est pas sollicité, par souci de confidentialité. Les professionnels se gardent pour autant de critiquer l'éventail des possibilités offertes par la loi, au motif que chaque situation est ainsi davantage susceptible de trouver sa solution. Il n'en demeure pas moins que ce constat ne fait que conforter le Parlement dans sa conviction qu'il était absolument indispensable de laisser le plus de marges de manœuvre possible aux intéressés, ce que la version initiale du projet de loi ne prévoyait pas mais que la discussion parlementaire a finalement permis. Grande innovation de la loi du 26 juillet 2005, la procédure de sauvegarde des entreprises a un peu tardé à s'imposer : seulement 99 ont été ouvertes en France au premier trimestre 2006, puis 116 le second, selon l'institut Altares. Ce constat n'est guère étonnant pour une mesure complètement nouvelle ; pour mémoire, on rappellera que la loi du 1er mars 1984 a mis près de dix ans avant de trouver sa place auprès des praticiens et des entreprises en difficultés, ce qui ne semble pas devoir être le cas de la loi n° 2005-845. Depuis le second semestre de 2006, le recours à la procédure de sauvegarde semble s'être accentué, sous le double effet de l'acclimatation des professionnels aux règles nouvelles et de la médiatisation de cas retentissants (Eurotunnel et Libération). Ainsi, au 10 janvier 2007, la délégation de l'union nationale pour l'emploi dans le commerce et l'industrie (UNEDIC) auprès de l'association pour la garantie des salaires (AGS) dénombrait 500 procédures de sauvegarde ouvertes sur toute l'année 2006. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
Avec un taux de 26,4 %, le secteur d'activité le plus concerné par les procédures de sauvegarde est l'industrie. Le commerce arrive en seconde position avec une proportion de procédures l'impliquant de l'ordre de 19,4 %, suivi par les services aux entreprises (18,4 %) et les services aux particuliers (12,2 %). RÉPARTITION EN FONCTION DU SECTEUR D'ACTIVITÉ
Les entreprises relevant de la procédure sont clairement des très petites structures (TPE), ou des PME-PMI de moyenne importance (dix à cinquante salariés). Ces résultats sont à comparer avec le profil des entreprises françaises, employant pour 90 % d'entre elles moins de cinq salariés. Cependant, le tableau ci-dessous montre que la taille des entreprises qui ont recours à la sauvegarde est, en termes relatifs, plus importante que ce que laisserait augurer une simple transposition des statistiques nationales sur le profil des sociétés défaillantes. PROFIL DES ENTREPRISES SOUS PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Par ailleurs, près d'un tiers des sociétés en sauvegarde réalisent plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, alors que seulement 6 % des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires se trouvent dans la même situation. La dimension des entreprises en sauvegarde apparaît donc largement supérieure à celle des entreprises concernées par une procédure collective classique. Par voie de conséquence, il est permis de considérer que la sauvegarde ne s'est pas substituée à des procédures existantes mais qu'elle a plutôt répondu à un réel besoin. COMPARAISON DES ENTREPRISES EN SAUVEGARDE ET EN REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRES EN FONCTION DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES
Autre aspect qui mérite de retenir l'attention, alors que, de manière constante, les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires sont jeunes (beaucoup ayant une ancienneté inférieure à 5 ans), celles qui demandent l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ont davantage d'antériorité et, de ce fait, elles sont mieux implantées économiquement et géographiquement. C'est ainsi que 70 % des procédures de sauvegarde ouvertes concernent des entreprises créées depuis plus de 10 ans. Une fois encore, le législateur ne peut que se féliciter d'avoir vu juste en créant cette procédure destinée à préserver l'emploi et l'activité durables. On observe malgré tout une certaine disparité géographique dans la mise en œuvre de la procédure. La région dans laquelle il y est le plus souvent recouru est la région Rhône-Alpes, où la proportion de sauvegardes ouvertes atteint 17,7 % des procédures nationales. Suivent la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (15,9 %) et, dans une moindre mesure, l'Île de France (8,4 %). RÉPARTITION, PAR RÉGIONS, DU NOMBRE DE PROCÉDURES DE SAUVEGARDE
S'il n'est pas étonnant que les régions au potentiel économique le plus important se trouvent en tête du palmarès, il apparaît pour le moins paradoxal que l'Île de France figure en relatif retrait, alors même que s'y concentrent près de 20 % du produit intérieur brut et de très nombreuses entreprises. Les raisons à cela semblent diverses : outre le fait que le dynamisme économique y est peut-être un peu plus vigoureux qu'ailleurs, la politique juridictionnelle à l'égard des critères de recevabilité des demandes de sauvegarde y est sans doute plus stricte. Il y a tout lieu de penser, en outre, que le recul manque pour pouvoir forger des conclusions définitives, les chiffres ayant véritablement évolué à Paris depuis l'automne 2006. 2. Un effet positif sur les statistiques des entreprises défaillantes ? Le législateur a adopté la loi de sauvegarde des entreprises avec le souci de préserver l'activité économique et aussi l'emploi. Les premiers éléments d'appréciation disponibles, s'ils ne permettent pas de dresser un bilan catégorique, n'en sont pas moins encourageants à plusieurs titres. En premier lieu, parmi les 500 sauvegardes ouvertes en 2006, seulement quarante et une ont été converties en redressement judiciaire et vingt-cinq en liquidation judiciaire ; trois ont été clôturées et seize ont abouti à un plan de sauvegarde. Jusqu'alors, 70 % des redressements judiciaires échouaient rapidement et débouchaient sur une liquidation judiciaire. L'instauration des nouvelles procédures a permis d'infléchir cette tendance, en favorisant dans 70 % des cas un dialogue et la recherche de solutions aux difficultés rencontrées. Ce constat apparaît d'autant plus intéressant que les sauvegardes en cours concernent, à l'échelle nationale, près de 11 000 salariés. L'AGS est intervenue dans soixante-neuf procédures (14 % des cas) et, aujourd'hui, trente et une restent en cours. Autrement dit, la mise en place de la procédure de sauvegarde ne s'est pas traduite par une aggravation des interventions de l'AGS, bien au contraire. On constate par ailleurs que les licenciements n'ont touché que la moitié des salariés concernés par les interventions de l'AGS, ce qui signifie que, contrairement à certaines craintes manifestées lors du vote de la réforme, la sauvegarde n'a pas été utilisée pour réaliser des restructurations sociales. En second lieu, le profil des entreprises bénéficiaires des procédures de sauvegarde ouvertes correspond à celui des entreprises pour lesquelles il a été constaté une baisse du nombre de défaillances. En effet, Altares a mis en évidence, au second trimestre de l'année 2006, un recul de 11 % des procédures collectives par rapport à la même période de l'année 2005 : 11 000 jugements d'ouverture ont ainsi été prononcés contre 12 200 un an plus tôt. La chambre de commerce et d'industrie de Paris, quant à elle, a évalué à 6,6 %, au plan national, et à 30 %, sur la région parisienne, le recul du nombre de redressements et liquidations ouverts, fin novembre 2006. Or, dans tous les cas, la grande majorité des procédures de sauvegarde ouvertes a concerné des sociétés de moins de cinq salariés ou de sociétés employant entre dix et cinquante personnes, tandis que dans le même temps les défaillances des sociétés de plus de cinquante salariés enregistraient une hausse de 15 %, contraire à la tendance générale. Autrement dit, l'embellie constatée sur le plan des défaillances d'entreprises a concerné plus particulièrement les catégories de sociétés pour lesquelles le nombre de procédures de sauvegarde ouvertes était le plus élevé. De là à conclure que les procédures de sauvegarde ouvertes permettent le plus souvent d'éviter une liquidation judiciaire, il y a un pas qu'il faut se garder de franchir pour le moment, faute de recul suffisant. Il n'en demeure pas moins que la coïncidence est troublante et qu'elle ne peut que conforter l'impression générale de satisfaction qui se dégage au sujet de la loi, un an après son entrée en vigueur. B. LES DIFFICULTÉS D'APPLICATION D'ORES ET DÉJÀ RÉVÉLÉES PAR LA PRATIQUE Le rapporteur s'est attaché à écouter l'avis des professionnels directement concernés par la mise en œuvre de la loi. Tous ont porté un jugement positif sur le contenu du texte. Cependant, en dépit de leurs horizons divers, ils ont également souligné de manière convergente un certain nombre de problèmes plus ou moins importants, auxquels il appartiendra soit au législateur, soit au pouvoir réglementaire d'apporter une solution. 1. Les problèmes rencontrés dans la conciliation La conciliation emporte de nombreux suffrages auprès de celles et ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre. Elle n'en a pas moins révélé, à l'usage, quelques difficultés, certes non insurmontables, mais parfois pénalisantes pour certaines des parties à la procédure. a) Les effets inattendus du monopole du débiteur dans l'initiative de la requête en homologation de l'accord amiable des parties Alors que le président du tribunal constate l'accord amiable des parties, conclu au cours de la période de conciliation, à la requête conjointe de celles-ci, il n'en va pas de même pour l'homologation de l'accord, qui relève de la requête exclusive du débiteur (article L. 611-8 du code de commerce). Ce faisant, le législateur avait souhaité ménager au débiteur la possibilité de solliciter l'intervention du tribunal de commerce pour le placer sous la protection offerte par l'homologation, à savoir la suspension de toute action en justice ou de toute poursuite individuelle sur ses meubles ou immeubles. La pratique de cette procédure a cependant montré ses limites. Dans plusieurs affaires, des débiteurs conciliés ont délibérément choisi de ne pas introduire leur requête en homologation de l'accord à l'amiable, une fois celui-ci conclu, pour le plus grand désappointement de leurs créanciers qui désiraient, par là, sécuriser les engagements. Il faut reconnaître que l'article L. 611-8 du code de commerce, précité, confère au simple constat de l'existence d'un accord par le président du tribunal une force exécutoire qui, dans bien des cas, suffit à satisfaire le débiteur sans, en revanche, apporter toutes les garanties souhaitées aux créanciers. Dans la plupart des cas, les créanciers mis devant le fait accompli jugent préférable de se contenter d'un accord non homologué pour la simple et bonne raison que, en en contestant la validité devant le tribunal, ils aggraveraient la situation du débiteur ainsi que les risques de ne pas recouvrer leurs créances. La situation n'apparaît néanmoins pas vraiment satisfaisante, dans la mesure où elle peut exonérer le débiteur d'une contrepartie aux gages de confiance qui lui sont manifestés. Le rapporteur estime, pour cette raison, que la mauvaise volonté du débiteur devrait pouvoir être levée par un aménagement des dispositions existantes. Il conviendrait, en l'espèce, en cas de défaillance du débiteur, de permettre au conciliateur d'exercer une requête en homologation d'un accord à l'amiable comprenant cette obligation pour assurer la pérennité de l'entreprise en difficultés. Cette éventualité apparaît réaliste, dans la mesure où l'article 33 du décret n° 2005-1677 dispose que le tribunal statue sur l'homologation avant le terme de la procédure de conciliation, et donc avant l'expiration de la mission du conciliateur. Certaines conditions pourraient sans doute être posées, de manière à ce que la liberté du débiteur ne soit pas excessivement remise en cause. Ceci impliquerait sans doute un aménagement du II de l'article L. 611-8 du code de commerce. La loi de sauvegarde des entreprises a été conçue à partir du présupposé d'une relation entre des entreprises en difficultés et des créanciers ou des banques traditionnels. Les faits ont quelque peu démenti cette perspective, en raison du désengagement réel des grandes banques institutionnelles des affaires les plus significatives (et corrélativement les plus risquées), au profit de nouveaux venus que sont les hedge funds, fonds financiers spécialisés dans le redressement et la valorisation de sociétés fortement dépréciées en vue de réaliser, à court ou moyen terme, d'importantes plus-values. L'arrivée en force de ces investisseurs, nous le verrons plus loin, pose des problèmes juridiques. Elle s'accompagne néanmoins d'une forte capacité de refinancement, qui faisait parfois défaut aux créanciers classiques. La contrepartie reste néanmoins l'obtention d'un certain nombre de garanties juridiques. L'homologation des accords amiables figure au premier rang d'entre elles, comme l'ont révélé un certain nombre de cas comme la société informatique Infogrames, qui a bénéficié, début janvier 2006, d'un versement d'argent frais de 30 millions d'euros de la part de la Banc of America, intervenant pour le compte d'un hedge fund qui avait racheté les créances de la société pour 48 millions d'euros (34). Dans l'hypothèse d'une opération de sauvetage faisant intervenir de tels acteurs internationaux, l'argent frais n'est versé qu'une fois l'accord homologué et cette homologation publiée. Or, l'expérience montre malheureusement que les délais de publication de l'homologation peuvent prendre des semaines là où l'urgence exige une réactivité très importante. La procédure administrative retenue relève du décret n° 2005-1677, et non de la loi de sauvegarde des entreprises. En effet, c'est l'article 36 du décret du 29 décembre 2005 qui prévoit qu'un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au BODACC. Beaucoup de professionnels la trouvent trop lente, les délais entre le dépôt du jugement au greffe du tribunal et sa publicité oscillant entre cinq et sept semaines. Lors de leur audition par le rapporteur, les représentants du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ont avancé une solution à ce problème. Il s'agirait, en l'occurrence, de prévoir la publication de l'avis de chaque jugement d'homologation d'un accord amiable entre débiteur et créanciers au registre du commerce et des sociétés. La démarche ne prendrait, au pire, que quelques jours. Pour toutes ces raisons, une modification en ce sens de l'article 36 du décret n° 2005-1677 s'avère hautement souhaitable. Il reste que, dans la très grande majorité des entreprises en difficultés, de petite ou de moyenne taille, les créanciers demeurent des banques traditionnelles qui n'exigent pas l'homologation de l'accord amiable avant de procéder à la délivrance de fonds nouveaux. Ce n'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes, quand l'on se souvient que l'homologation des accords amiables était une exigence des banques lors des débats parlementaires. On l'a vu, les principaux promoteurs de la procédure de conciliation par homologation, c'est-à-dire les établissements de crédit, en relativisent désormais l'intérêt et souhaitent que certaines garanties qui lui sont associées, notamment le privilège accordé aux créanciers apportant de l'argent frais, soient étendues à la conciliation constatée. Aux termes de l'article L. 611-11 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les personnes qui consentent un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation. Cet article pose néanmoins une condition essentielle : que cet apport de trésorerie soit intervenu dans le cadre d'un accord amiable homologué, et donc faisant l'objet d'un jugement déposé au greffe du tribunal de commerce. Les établissements bancaires considèrent, à la lumière de la pratique, que la publicité ainsi donnée aux difficultés rencontrées par l'entreprise bénéficiant d'un accord homologué, débouche plus souvent sur une aggravation des problèmes financiers que sur une amélioration de la situation de la société en cause. Pour cette raison, ils sont réticents à recourir à cette procédure et lui préfèrent, comme le démontrent les statistiques détaillées précédemment, la conciliation constatée. En un sens, la pertinence de la position de la commission des lois de l'Assemblée nationale, lors des débats, sur le maintien d'une alternative entre confidentialité (que le projet de loi initial écartait) et publicité (seule envisagée par le projet de loi initial), s'en est trouvée confortée. De là à élargir le champ du privilège de l'argent frais, il y a néanmoins un pas que l'on ne saurait franchir sans porter un coup fatal à la conciliation homologuée. La revendication d'une extension de ce privilège à toutes les conciliations peut paraître justifiée du point de vue de l'incitation des banques à prendre davantage de risques mais elle se heurte néanmoins à certaines préventions liées au caractère confidentiel de la conciliation constatée. d) Les incertitudes nées du silence de la loi sur les constats ou homologations séparés dans le cas de groupes de sociétés Aux termes de l'article L. 611-4 du code de commerce, les procédures de conciliation peuvent bénéficier aux « personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». La définition retenue par le Parlement s'est voulue suffisamment souple et englobante pour permettre à un large panel d'entreprises en difficultés, y compris individuelles, de pouvoir y recourir. Il reste que les entreprises concernées relèvent parfois d'un ensemble juridique complexe. Il peut en effet arriver que la conciliation soit requise pour un groupe d'entreprises, contrôlé par une société holding, dont les filiales éprouvent des difficultés disparates et suscitent une appréciation différenciée par les créanciers. S'il ne saurait être question de priver le juge du discernement qu'il convient d'exercer en chaque cas d'espèce, il semble malgré tout que les ambiguïtés du code de commerce laissent libre cours à tous types d'interprétations, parfois plus ou moins fondées. Tel est du moins ce qui ressort des exemples vécus par certains praticiens. Pour ces raisons, il ne serait sans doute pas inutile de préciser à l'avenir qu'une conciliation peut intervenir, alors même qu'elle a été ouverte pour l'ensemble des sociétés d'un groupe, de façon séparée sur l'une d'entre elles seulement ou, à l'inverse, que seule la conciliation de l'ensemble du groupe est possible. 2. Les difficultés révélées dans les procédures de sauvegarde Le placement d'entreprises en difficultés sous le régime de la sauvegarde a fini par être apprécié à son juste intérêt par les différents intervenants des procédures collectives. Des sociétés de renom, telles Eurotunnel ou l'entreprise de presse Libération, en ont bénéficié, de sorte que cette nouvelle procédure a rapidement acquis une bonne notoriété auprès de ceux qui sont plus particulièrement susceptibles d'en bénéficier. Néanmoins, un an seulement après son entrée en vigueur, un certain nombre de problèmes juridiques importants sont apparus. Les concours financiers consentis au titre de l'argent frais aux entreprises en difficultés non encore en situation de cessation des paiements proviennent majoritairement, pour les plus petites d'entre elles, de leurs partenaires bancaires habituels. Dans le cas des affaires de plus grande envergure, en revanche, l'expérience montre que les banques cherchent le plus souvent à céder leurs créances, en raison du risque qu'elles estiment y être attaché. Or, de tels actifs intéressent les fonds d'investissement alternatifs, plus connus sous le vocable de fonds spéculatifs ou hedge funds. Ces fonds sont des organismes de gestion collective, fonctionnant comme les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou les mutual funds américains, mais ils répondent à des principes d'investissement et de couverture de risques fort différents. Spécialisés le plus souvent sur un type bien particulier d'opérations (les produits dérivés ou le redressement d'entreprises en difficultés par exemple), ils obtiennent des performances généralement déconnectées de la tendance générale des marchés d'actions ou d'obligations. Développée depuis près de soixante ans, le premier hedge fund ayant été créé en 1949, essentiellement aux États-Unis, la gestion alternative représentait, en 2005, un encours de 1 070 milliards d'euros, réparti en quelque 8 000 fonds d'investissement. Contrairement à certaines idées reçues, la France présente un réel intérêt pour ces opérateurs financiers puisque selon Eurohedge, notre pays avait attiré 5% des actifs des hedge funds européens au premier semestre 2005, devenant ainsi leur seconde priorité européenne. Il semble que l'adoption de la loi de sauvegarde des entreprises ait conforté cette tendance, les hedge funds trouvant notamment dans le privilège de l'argent frais, inscrit au II de l'article L. 622-17 du code de commerce, la sécurité juridique à laquelle ils aspirent en contrepartie des volumes financiers souvent conséquents qu'ils sont prêts à investir. Il reste que, à l'occasion de la procédure engagée au sujet d'Eurotunnel, s'est posée une question juridique d'importance : les fonds spéculatifs peuvent-ils être inclus dans le comité de créanciers regroupant les établissements de crédit de l'entreprise en difficultés, auquel cas les règles de majorité qualifiée et, en cas de manœuvres abusives pour gêner l'aboutissement du plan de sauvegarde, de responsabilité (35) leur sont opposables au même titre que n'importe quelle banque traditionnelle lors de l'approbation du plan ? Il convient de souligner que le législateur a volontairement retenu une acception large du comité de créanciers regroupant les établissements de crédit, mentionné aux articles L. 626-30 et suivants du code de commerce. En effet, la loi vise les établissements de crédit sans en fixer restrictivement les critères, se distinguant en cela de l'article 164 du décret d'application n° 2005-1677, dont on peut se demander s'il n'a pas outrepassé, en la matière, les limites qui lui étaient fixées. Le décret apporte une précision qui a valeur de fâcheuse restriction, puisqu'il dispose que les établissements de crédit évoqués par la loi « sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier (36), les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code (37) et les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen », autrement dit ceux qui exercent des opérations de banque au sens le plus traditionnel et pour lesquels le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a donné son agrément. Dans le cas d'Eurotunnel, les administrateurs judiciaires se sont appuyés sur le texte de la loi pour justifier l'inclusion des fonds spéculatifs parties aux créances de la société dans le comité de créanciers regroupant les établissements de crédit. De la sorte, les hedge funds pouvaient se voir imposer le projet de plan de sauvegarde grâce aux règles de majorité prévues par l'article L. 626-30 du code de commerce alors que, s'ils avaient été assimilés à des obligataires, l'article L. 626-32 du même code aurait obligé leur consultation séparée, avec une exigence de validation par chaque catégorie d'obligataire à la clé. Inutile de dire qu'en de pareilles circonstances, les perspectives d'adoption du plan de sauvegarde d'Eurotunnel eurent été encore bien plus minces, voire inexistantes. Le 15 novembre 2006, le juge consulaire a donné raison aux administrateurs judiciaires d'Eurotunnel, considérant qu'en achetant des créances en cours, les fonds spéculatifs participent à une opération de banque et sont, de ce fait assimilables à un établissement de crédit. Le rapporteur estime lui aussi que le critère essentiel pour définir la substance du droit ne doit pas être l'agrément ministériel, simple acte administratif, mais bien la qualification de l'activité réalisée. Il reste que, en l'état de la contradiction entre le décret et la loi, c'est au juge (la Cour d'appel de Paris et éventuellement la Cour de cassation) qu'il appartiendra d'apporter une réponse définitive. Pour qu'à l'avenir, de telles contestations ne soient plus possibles et que les fonds spéculatifs ne trouvent plus d'astuces juridiques leur permettant de s'affranchir des règles posées par le législateur pour les créanciers, il conviendrait sans doute de modifier la rédaction de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 626-30 du code de commerce, de manière à insérer, lors du renvoi aux « établissements de crédit », les mots « et les cessionnaires de créances consenties au débiteur au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde ». De la sorte, en effet, l'interprétation restrictive du décret n° 2005-1677 n'aurait plus cours et les hedge funds ne pourraient plus tenter de s'exclure du champ du comité de créanciers regroupant les établissements de crédit. Lors des débats sur la loi du 26 juillet 2005, la question s'était posée de savoir s'il était nécessaire d'inclure les obligataires au sein des comités de créanciers ou de se contenter de maintenir leur régime existant, en l'assortissant de dispositions destinées à assurer sa cohérence avec le nouveau dispositif de la sauvegarde. La seconde option avait finalement prévalu, l'article L. 626-32 du code de commerce disposant des conditions d'information et de consultation des obligataires sur le plan de sauvegarde. Le rapporteur avait en effet considéré que les dispositions du livre deuxième du code de commerce n'appelaient pas de complément législatif, en raison de leur extrême précision. On rappellera pour mémoire qu'en application des articles L. 228-44 à L. 228-89 du code de commerce, les créanciers obligataires sont représentés par une « masse ». Dépourvue de patrimoine mais dotée de la personnalité civile depuis 1935, elle se trouve elle-même physiquement représentée par un à trois mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. La spécificité de ce régime juridique, par rapport aux créanciers visés par la loi de sauvegarde des entreprises, tient à ce que chaque catégorie d'obligations donne lieu à la constitution d'une masse. Il faut bien reconnaître qu'il a échappé au législateur, en 2005, que la multiplication potentielle des masses d'obligataires pouvait représenter un handicap sérieux, dès lors que l'accord de chacune est nécessaire à l'approbation du plan de sauvegarde. La réalité s'est chargée de mettre en évidence ce problème, à l'occasion de l'affaire Eurotunnel, dont les créances obligataires représentent quelque 2,8 milliards d'euros et sont réparties entre deux séries de trois contrats d'émission en euros et en livres sterling, régis, pour les uns, par le droit français et, pour les autres, par le droit anglais. En l'occurrence, l'élaboration du plan de sauvegarde de la société a longtemps achoppé sur les réticences de certaines masses d'obligataires. Pour lever tout risque de blocage par une minorité de l'assentiment se dessinant parmi une large majorité de créanciers, y compris obligataires (car là est bien le paradoxe de ce cas d'école), les administrateurs judiciaires d'Eurotunnel ont, une fois les modalités du plan arrêtées, réuni la totalité des obligataires afin de soumettre le projet à leur approbation. Pour ce faire, ils se sont fondés sur les dispositions du droit anglais, qui ne prévoit pas de régime de masses (contrairement au droit français), au motif que les obligataires d'Eurotunnel répondaient pour la plupart de ce régime. Le droit français n'offrait, en l'espèce, aucune solution. En effet, le dernier alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce ne précise nullement à quelles conditions de quorum et de majorité l'assemblée générale des obligataires peut décider d'abandonner tout ou partie des créances obligataires. Le silence du décret sur ce point ne permet pas davantage de permettre l'application de l'article L. 228-65 du code de commerce, sur les délibérations habituelles de l'assemblée générale des obligataires. En définitive, là où la loi a considérablement simplifié la consultation et l'accord des créanciers traditionnels, elle a conservé des règles inadaptées et pénalisantes s'agissant des obligataires. Avec le recul, il apparaît qu'il aurait certainement fallu prévoir, dans le cas spécifique des consultations relatives à un plan de sauvegarde, la création d'un comité d'obligataires répondant à des modalités de majorité et de vote similaires à celles des comités des établissements de crédit et des fournisseurs, voire l'inclusion des obligataires dans le comité des établissements de crédit. L'expérience de l'affaire Eurotunnel devra inévitablement conduire à des modifications de la loi sur ce point (à l'article L. 626-32 du code de commerce, notamment), sous peine de voir se multiplier les contentieux du même type s'agissant d'entreprises d'envergure internationale. On peut aussi souhaiter que la Commission européenne se penche sur le sujet, étant donné l'absence d'harmonisation des droits nationaux en la matière et la complexité du règlement des contentieux y afférent. À tout le moins, et à titre transitoire, le décret n° 2005-1677 pourrait être complété de manière à prévoir que le dernier alinéa de l'article L. 626-32 du code de commerce s'entend d'une assemblée générale unique, dont les conditions de délibération et de décision répondent aux exigences de quorum et de majorité fixées à l'article L. 228-65 du même code. c) L'inadaptation des règles de vote des détenteurs de créances évolutives au sein des comités de créanciers Les modalités de prise de décision des comités de créanciers revêtent un caractère essentiel pour la poursuite de l'activité et la pérennité de l'entreprise faisant l'objet de l'ouverture d'une sauvegarde. Outre les difficultés liées au profil des membres du comité des établissements de crédit précédemment mentionnées, il existe des problèmes qui résultent de la nature évolutive de certaines créances prises en compte pour l'établissement de ce comité de créanciers. C'est notamment le cas des créances des sociétés d'affacturage, relevant d'établissements de crédit, qui sont parfois remboursées entre la date d'ouverture de la sauvegarde, qui sert au calcul des droits de vote des différents membres du comité, et celle à laquelle le plan de sauvegarde est examiné. L'affacturage est un achat ferme de créances par une société d'affacturage (factor), par lequel l'entreprise obtient une garantie contre le risque d'impayé, la gestion de son poste clients et le financement immédiat de ses créances. La société d'affacturage remplit trois types de missions : - la prévention du risque et la garantie contre les impayés, en assurant en cas d'insolvabilité l'indemnisation jusqu'à 100 % des créances cédées et garanties. Dans la délivrance des agréments, la société d'affacturage fournit aussi en amont à ses cédants, une information commerciale sur ses clients leur permettant de sélectionner les bons partenaires commerciaux ; - la gestion du poste clients, la société d'affacturage se chargeant, de l'enregistrement à l'encaissement des factures, de relancer les débiteurs et gérant les règlements de ces derniers (effets, chèques). Elle entame également les procédures précontentieuses et contentieuses si nécessaire pour les débiteurs agréés ; - un financement immédiat des créances, permettant de transformer une trésorerie potentielle et différée en une trésorerie réelle et disponible. Il faut également noter que les sociétés d'affacturage fixent les plafonds de financement en fonction de la qualité des clients de l'entreprise et non de la situation financière de cette dernière. En définitive, l'affacturage est la combinaison d'une prestation de services (la gestion du recouvrement des créances), d'une opération analogue à l'assurance (la garantie de crédit des débiteurs) et d'une opération de crédit. Cependant, la question de la fixation des droits de vote des détenteurs de créances évolutives pose le problème plus général de la circulation de la dette, à l'ère de la finance immatérielle. De la sorte, ce sont tous les systèmes de transaction de créances qui se trouvent ici concernés. L'article 167 du décret du 28 décembre 2005 dispose que le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue à l'article L. 626-30 du code de commerce, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur judiciaire au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert comptable, huit jours au plus tard avant la date du vote sur le plan. Dans les faits, bien souvent, la date retenue pour effectuer ce calcul est celle du jugement d'ouverture. Or, le décret reste silencieux sur l'hypothèse d'une évolution du poids respectif des créanciers après ce calcul et avant le vote du plan de sauvegarde. Par voie de conséquence, de manière assez pernicieuse, certains affactureurs initialement dotés d'un poids prépondérant dans le comité des établissements de crédit adoptent une position d'autant plus intransigeante à l'égard des solutions proposées par les mandataires de justice pour assainir leur débiteur en difficultés qu'ils ont récupéré, entre-temps, la plus grande partie de leurs concours financiers. Ce faisant, ils peuvent se voir attribuer un pouvoir de décision sans rapport avec leurs créances, du seul fait du délai entre le moment où les droits de vote ont été calculés et celui de l'adoption du plan de sauvegarde. La solution à ce problème est de nature règlementaire. Il conviendrait en l'occurrence de prévoir, à l'article 167 du décret n° 2005-1677, qu'en cas de modification des équilibres au sein du comité des établissements de crédit, l'un des créanciers membres dudit comité peut saisir le président du tribunal de commerce afin qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de vote, préalablement au vote du plan de sauvegarde. Certaines interrogations ont également pu naître au sujet de l'habilitation d'un détenteur facial de dette à représenter le sous-participant auquel il se trouve contractuellement lié dans les réunions du comité de créanciers. En l'occurrence, le rapporteur considère que la représentation d'un sous-participant par le banquier initial qui est à l'origine de la sous-participation et qui apparaît facilement ne saurait être interprétée comme contraire à l'esprit de la loi, dès lors que la situation a été contractuellement convenue au préalable entre les intéressés. d) Des comités de créanciers parfois encore mis devant le fait accompli dans la définition du plan de sauvegarde La loi de sauvegarde des entreprises ambitionne de révolutionner les comportements des chefs d'entreprises mais aussi des mandataires de justice. La contractualisation des solutions aux difficultés de trésorerie est apparue constituer l'un des moyens de sortir de l'exception française de procédures collectives débouchant quasi-systématiquement sur des liquidations judiciaires. C'est ainsi que le législateur a entendu conférer un rôle véritable aux comités de créanciers dans la phase d'élaboration et d'adoption du plan de sauvegarde de toute entreprise en difficultés. S'il est vrai que le troisième alinéa de l'article L. 626-30 du code de commerce dispose que ces comités se prononcent « Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire », termes qui laissent une certaine marge de manœuvre aux intéressés, la pratique semble illustrer de la persistance de méthodes avec lesquelles la loi visait pourtant à rompre. Cette difficulté résulte pour partie de l'absence de délai minimum entre la communication du projet de plan et le vote sur ce dernier, l'article L. 626-30 se bornant à exiger des comités de créanciers qu'ils se prononcent « au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur ». Il eût sans doute été préférable d'enserrer cette exigence dans une fourchette de délais allant de quinze jours minimum à trente jours maximum. Mais de telles situations ne sont pas toutes à porter au débit de la loi. Il n'est pas sûr, en effet, que tous les administrateurs judiciaires aient saisi l'exacte mesure des changements apportés par la nouvelle procédure de sauvegarde par rapport à l'ancien plan de redressement. Dans certaines régions, où ces professionnels sont peu nombreux, les comités de créanciers se voient parfois encore imposer, sans négociation et, plus exceptionnellement, sans discussion, des plans de sauvegarde sur lesquels il leur revient uniquement d'émettre un vote. Ces plans, qui suggèrent dans la majorité des cas, une consolidation des créances sur huit à dix ans, ressemblent étrangement aux plans de redressement jusqu'alors mis en œuvre. Ces méthodes ne sont pas le fait de tous les administrateurs judiciaires, loin s'en faut. Elles traduisent néanmoins une insuffisante compréhension, par quelques professionnels, du changement d'état d'esprit voulu par le législateur. Les créanciers, au premier rang desquels les établissements de crédit, les déplorent et sont enclins à ne pas maintenir leur soutien à leurs débiteurs dans de telles conditions. Le rapporteur estime que, dans les régions où les mandataires de justice sont insuffisamment nombreux et croulent sous la charge de travail, davantage de mise en concurrence est nécessaire, soit par un recours plus important du juge consulaire à des administrateurs extrarégionaux, soit par la possibilité qui lui serait offerte de faire appel à d'autres personnalités susceptibles de définir un plan de sauvegarde en liaison avec les créanciers. En tout état de cause, si les travers parfois observés au cours de cette première année d'application de la loi devaient durer et se confirmer, il conviendrait de se pencher résolument sur la question. Depuis la loi du 25 janvier 1985 (38), inspirée elle-même de la jurisprudence de la Cour de cassation, la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour une entreprise débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La loi de sauvegarde des entreprises a cherché à relativiser l'effet couperet qui caractérisait antérieurement cette notion, sans en modifier le fond. La cessation des paiements était jusque-là déterminante pour l'engagement ou la clôture des procédures collectives. Pour tenir compte des cas de figure dans lesquels des sociétés fondamentalement viables et solvables peuvent techniquement se trouver en état de cessation des paiements (en raison d'un décalage, aussi faible soit-il, entre des échéances de créances et des rentrées régulières de trésorerie, par exemple), le législateur lui a donc fait perdre son automaticité dans le déclenchement des procédures dites judiciaires. C'est ainsi, notamment, que l'article L. 611-4 du code de commerce dispose désormais que la conciliation peut s'engager jusqu'à quarante-cinq jours après la cessation des paiements. Parallèlement, à l'article L. 620-1 du même code, la sauvegarde a été prévue pour les débiteurs désireux de se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites lorsqu'ils justifient de difficultés qu'ils ne sont pas en mesure de surmonter et de nature à les conduire à la cessation des paiements. Cela ne signifie aucunement, cependant, que la sauvegarde puisse s'accommoder d'un état caractérisé de cessation des paiements, puisque le code prévoit, dans ce cas, une reconversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaires. Il n'en demeure pas moins que la loi a estompé la frontière entre procédures amiables (la conciliation) et procédures judiciaires (redressement et liquidation), conférant au juge le soin de faire vivre, dans la pratique, l'exigence de prévention des difficultés qui sous-tend la réforme de 2005. Bien évidemment, dans un tel contexte, le pragmatisme des tribunaux de commerce revêt une importance considérable. Lors de l'examen parlementaire des dispositions de la loi n° 2005-845, certaines voix s'étaient faites l'écho de la nécessité de faire évoluer la définition légale de la cessation des paiements, en prévoyant que celle-ci soit caractérisée par la non-concordance de l'actif disponible avec le passif exigible et exigé, de manière à inciter le juge à davantage de souplesse. Il s'agissait là de conforter, dans la loi, une prise de position isolée de la Cour de cassation, au statut incertain, fondant sa décision sur le fait que « le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur » (39). Le rapporteur s'était contenté de reproduire les tenants et aboutissants de ce débat, tout en convenant qu'il n'était sans doute pas encore mûr. Un an après l'entrée en vigueur des nouvelles procédures, apparaît-il nécessaire de relancer ces questionnements sur l'utilité de restreindre l'acception légale de la cessation des paiements ? La pratique n'a pas encore permis d'entrevoir une position bien établie du juge commercial en matière d'application de la reconversion des procédures de sauvegarde en redressement. On peut néanmoins observer que, comme cela était déjà le cas auparavant, les tribunaux de commerce ont plutôt tendance à apprécier l'existence ou non d'un état de cessation des paiements, en fonction des circonstances. Le rapporteur en veut pour preuve les cas de la société Eurotunnel. En l'espèce, dans son jugement du 2 août 2006 (40), autorisant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce de Paris a considéré que les accords de restructuration financière des créances convenus les 23 et 30 mai précédents avec les principaux créanciers (représentant plus de 50 % de la dette sociale) rendaient lesdites créances non exigibles jusqu'à la fin de l'année et empêchait, par voie de conséquence, une cessation des paiements avant le 1er janvier 2007. Le rapporteur considère, pour sa part, que les créances restaient juridiquement exigibles et que c'est uniquement parce qu'elles n'étaient pas effectivement exigées qu'Eurotunnel ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. On le voit donc de manière assez éclatante : le pragmatisme du juge est fonction de l'importance économique et sociale des enjeux. Or, il peut apparaître dommage de ne pas généraliser le raisonnement à toutes les entreprises en difficultés, d'autant plus que certaines critiques mises en avant contre le critère du passif exigé (notamment le retardement des procédures) ne tiennent pas devant le constat, statistiquement souligné plus haut, de la marginalisation du redressement judiciaire. Tout au plus, pourrait-on craindre l'apparition de difficultés nées du comportement de certains créanciers, qui s'abriteraient derrière le pouvoir d'exiger leur créance pour exercer une forme de pression sur leur débiteur. Cette critique ne saurait être prise à la légère, assurément, mais elle n'est pas insurmontable dès lors que de tels agissements pourraient se trouver sanctionnés par la loi. Le rapporteur estime qu'on ne pourra pas très longtemps faire l'économie d'une adaptation de la définition de la notion de cessation des paiements. Le pragmatisme qui entoure actuellement sa mise en œuvre le justifie, dans l'intérêt même des entrepreneurs justiciables. 3. Un assouplissement des procédures de redressement et de liquidation judiciaires encore insuffisant La loi de sauvegarde des entreprises a apporté de réelles améliorations, en termes de simplification notamment, aux procédures collectives à proprement dites. La mise en œuvre de celles-ci reste néanmoins marquée par des difficultés, résultant tantôt du statu quo observé en 2005 en matière de droit social, tantôt d'une complexité entretenue par les textes règlementaires d'application. Le rapporteur l'avait laissé entendre lors de la discussion de la loi à l'Assemblée nationale : il est aujourd'hui tout à fait invraisemblable qu'il n'existe aucun droit dérogatoire, à quelques exceptions près, au droit commun du travail, issu des articles L. 321-1 à L. 321-17 du code du travail, relatifs au licenciement pour motif économique, s'agissant des entreprises qui disparaissent. Les mandataires de justice se trouvent ainsi confrontés à de sérieux problèmes, pour ne pas dire à des incompatibilités totales entre les différentes législations applicables. En premier lieu, il convient de rappeler que les délais de mise en œuvre des licenciements sont inadaptés aux procédures collectives. En cas de liquidation, les délais séparant, d'une part, la convocation du salarié à l'entretien préalable et la tenue de ce même entretien ainsi que, d'autre part, la tenue de l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, sont peu compatibles avec le délai de quinze jours imposé par la prise en charge des salaires par l'AGS. Ces délais sont en outre inutiles, voire pénalisants, pour les salariés d'une entreprise qui a déjà cessé son activité. Ainsi, alors que les salariés manquent à l'évidence d'informations et sont souvent inquiets quant à leur avenir, lorsque leur entreprise a cessé son activité, ils se trouvent contraints de patienter cinq jours (délai légal pour la convocation à l'entretien préalable) alors qu'une information collective ou individuelle, sous une forme adaptée à chaque cas, serait largement préférable. En deuxième lieu, il importe de souligner que les obligations de reclassement sont presque toujours impossibles à satisfaire. En l'état actuel du droit du travail, les mesures de reclassement doivent être mises en œuvre avant la procédure de licenciement. Or, compte tenu du calendrier qui s'impose au liquidateur, dans la limite des quinze jours imposés par la prise en charge par l'AGS, ce dernier dispose au mieux d'un à deux jours pour tenter un reclassement. Autant dire que cette situation confine à l'impossible. Par ailleurs, les sociétés en liquidation ne disposent généralement d'aucun moyen matériel ou financier pour procéder efficacement à un reclassement. En troisième et dernier lieu, faute de ressources financières, les plans sociaux élaborés à l'occasion d'une liquidation judiciaire sont généralement insuffisants au regard des exigences légales. Il en résulte de très nombreuses condamnations prud'homales (environ 40 000 à l'issue des 44 000 procédures prud'homales engagées à l'occasion d'un licenciement en procédures collectives), ce qui a pour effet de grever le budget de l'AGS. Sous-estimer ces problèmes serait contreproductif vis-à-vis de l'emploi et de la préservation de l'employabilité des salariés directement concernés. Le débat sur ces questions devra donc, tôt ou tard, être rouvert. La liquidation judiciaire simplifiée n'a pas connu le succès escompté lors de sa mise en place par le législateur, même si le nombre de procédures ouvertes sur le fondement du deuxième aliéna de l'article L. 641-2 du code de commerce n'a pas été, semble-t-il, négligeable. La raison de ce relatif désintérêt pour une procédure pourtant attractive réside très certainement dans les conditions initialement posées pour son ouverture. Jusqu'à la publication du décret n° 2006-1709, la liquidation judiciaire simplifiée ne faisait pas l'objet, sur ce point précis, de conditions spécifiques par rapport à la liquidation judiciaire, qui, du reste, était le cadre normal de son déclenchement. Par voie de conséquence, le débiteur directement concerné, possédant par définition un actif très réduit (pas de biens immobiliers, un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 750 000 euros et un effectif salarié inférieur ou égal à cinq personnes au cours des six mois ayant précédé la procédure), se trouvait contraint d'assister à l'audience d'ouverture de la liquidation et de surcroît à celle qui statuait sur le rapport du liquidateur, déposé au greffe, concernant l'application à la procédure des règles de la procédure de liquidation simplifiée, en vertu de l'article 312 du décret du 28 décembre 2005. Dans les faits, cette double convocation à délais très rapprochés s'est révélée plutôt pesante et contraire à l'objectif de rapidité, initialement souhaité par le législateur. Dans son avis du 10 juillet 2006, la Cour de cassation a indiqué que : « L'application de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L. 641-2 alinéa 2 du code de commerce est une faculté dont le tribunal peut faire usage dès l'ouverture de la procédure » (41). Cette précision était en elle-même de nature à lever les contraintes et le formalisme exigés jusqu'alors pour mettre en œuvre la liquidation judiciaire simplifiée. Le décret du 23 décembre 2006 a conforté cette interprétation, en modifiant opportunément l'article 312 du décret n° 2005-1677. Désormais, le tribunal statue d'office sur l'application à la procédure de liquidation des règles de la liquidation simplifiée dès réception du rapport du liquidateur. De surcroît, sa décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ce qui garantit la rapidité de sa mise en œuvre. Il n'en demeure pas moins que, malgré les aménagements récemment apportés, les professionnels considèrent que le régime de la liquidation simplifiée engendre des diligences trop complexes au regard des enjeux, notamment du fait de la multiplicité des jugements et de l'exigence d'un état de répartition ou de créances. 4. La persistance d'incertitudes entourant la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait de concours consentis À l'initiative du rapporteur, les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises ont été complétées afin de sécuriser la position des créanciers qui prennent le risque de soutenir un débiteur en difficulté. Jusqu'alors, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoyait que la responsabilité d'une banque pouvait être engagée, dans les conditions du droit commun, si cette dernière octroyait un nouveau crédit ou maintenait un crédit existant à une entreprise dont la situation est « irrémédiablement compromise », c'est-à-dire n'ayant aucune chance raisonnable de se redresser (42). L'article L. 650-1 du code de commerce, introduit à l'Assemblée nationale et voté conforme par le Sénat, a modifié en profondeur cet état des choses, en posant le principe d'une irresponsabilité des banquiers pour préjudices subis du fait des concours consentis, sauf exceptions de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de garanties disproportionnées prises en contrepartie desdits concours. Naturellement, la Cour de cassation n'a pas encore eu l'occasion de faire application de cet article qui reprend les termes de sa jurisprudence antérieure, mais il soulève d'ores et déjà plusieurs interrogations de la part des professionnels plus particulièrement concernés. Ceux-ci s'inquiètent, tout d'abord, de la signification à accorder au caractère disproportionné des concours consentis. Le seul élément de comparaison existant, à leurs yeux, résiderait dans l'article 2161 du code civil, relatif aux inscriptions excessives prises en vertu d'une hypothèque légale. En l'occurrence, « sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent des immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoire légaux, augmenté du tiers de ce montant », la sanction étant la réduction de ces inscriptions et non leur nullité. Il s'ensuit, dans leur raisonnement, qu'à partir du moment où le caractère excessif des inscriptions prises en hypothèque légale n'est sanctionné que par une réduction, le caractère disproportionné, frappé quant à lui de nullité, suppose nécessairement un montant supérieur à celui fixé par l'article 2161 du code civil. Pour autant, les établissements de crédit se gardent bien d'appliquer cette logique, de crainte d'être contredits par la suite par la jurisprudence. Le rapporteur considère pour sa part qu'une telle comparaison est certainement hâtive, en ce qu'elle met en parallèle des situations différentes. Le législateur, lors de l'adoption de l'article L. 650-1 du code de commerce, n'a pas entendu se substituer à l'appréciation, au cas par cas, du juge. Il souhaitait, au demeurant, traiter principalement des problèmes de cautionnement et intégrer les principes de la jurisprudence dans la loi. Au besoin, le simple rappel de l'exposé sommaire de l'amendement dont est issue la rédaction de cet article apporte à lui seul les éclaircissements qui s'imposent : « Cet amendement prévoit une limitation de la responsabilité des créanciers pour les concours qu'ils consentent à leur débiteur. Le projet de loi de sauvegarde des entreprises accorde cette limitation de responsabilité aux seuls concours consentis dans le cadre d'un accord de conciliation homologué par jugement. Afin de favoriser l'octroi de crédit aux entreprises, il est préférable de prévoir cette limitation de responsabilité de façon générale. La règle générale serait ainsi l'irresponsabilité des créanciers, sans distinction entre eux, pour les concours qu'ils ont apportés à leur débiteur. Toutefois, la responsabilité pourrait être recherchée dans trois cas : les cas de fraude, les prises de garanties disproportionnées, les cas d'immixtion dans la gestion du débiteur » (43). En outre, lors des débats à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a parfaitement résumé l'interprétation qu'il convient de faire de l'exception des garanties disproportionnées : « Il s'agit ici de viser les prises de garanties inhabituelles au regard de la pratique. Il va de soi que les crédits immobiliers qui sont consentis en échange d'une hypothèque sur la totalité du bien alors qu'ils n'en financent qu'une partie demeurent possibles puisque telle est la pratique » (44). Faisons confiance au juge pour s'inspirer des travaux parlementaires lorsqu'il établira sa jurisprudence. Il est regrettable que les banquiers se retranchent derrière la supposée incertitude rédactionnelle de cet article L. 650-1 justement destiné à leur permettre de soutenir plus facilement des entreprises en difficultés pour ne pas s'affranchir d'une frilosité dont ils sont parfois coutumiers. En l'espèce, le législateur a été aussi loin qu'il lui était possible, le ministre de la justice évoquant d'ailleurs un « juste équilibre entre la nécessité de ne pas décourager les apporteurs de crédit aux entreprises et les principes généraux du droit de la responsabilité » (45). La deuxième interrogation des établissements de crédit concerne le champ de la sanction de nullité, qui assortit le principe d'une disproportion des garanties par rapport aux concours financiers consentis. L'article L. 650-1 du code de commerce dispose que, pour les cas où la responsabilité du créancier serait reconnue sur le fondement d'une disproportion entre les garanties et les concours financiers, « les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles ». L'emploi du possessif et non d'un démonstratif a potentiellement une incidence juridique car, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le principe de continuation des contrats (46), il n'y a pas à distinguer là ou la loi ne distingue pas. Par voie de conséquence, il pourrait résulter d'une lecture littérale de l'article que la sanction de nullité s'applique non pas aux seules garanties disproportionnées mais à l'ensemble des garanties prises par le créancier sur le débiteur, aussi justifiées soient-elles. Ce faisant, de manière assez paradoxale, l'article L. 650-1 du code de commerce incite les banques à la plus grande circonspection là où le législateur avait justement voulu libérer leur esprit d'initiative. La sagacité du législateur a ainsi été prise en défaut sur la rédaction du second alinéa de cet article, la nullité devant s'appliquer, dans son esprit, aux seules garanties disproportionnées et non à la totalité de celles consenties par ailleurs en contrepartie des concours de la banque. Un correctif rédactionnel serait utile afin de rassurer les créanciers financiers et de ne pas orienter la jurisprudence dans une voie contraire aux souhaits du législateur, encore que l'état actuel de la rédaction de cet article n'interdit nullement une interprétation du juge qui soit conforme au but visé par le Parlement. Un peu plus d'un an après son entrée en vigueur, la loi de sauvegarde des entreprises commence déjà à atteindre ses objectifs. L'ambition du législateur était de favoriser la prévention des difficultés ; à elles seules, les nouvelles procédures n'y seraient pas parvenues si les intéressés, au premier rang desquels les chefs d'entreprise et les juges ne s'étaient approprié la réforme. Les statistiques démontrent que l'exception française consistant à privilégier les liquidations d'entreprises en difficultés est peut-être en train de disparaître, ou du moins de s'estomper, au profit d'une nouvelle culture de l'anticipation. Il est sans doute trop tôt pour se prononcer de manière définitive en la matière mais, si tel était effectivement la tendance de fond induite par la loi du 26 juillet 2005, le Parlement ne pourrait que se féliciter du travail accompli. Il faut voir dans les premiers succès de l'application de la loi le résultat d'une préparation en amont très approfondie, assortie d'une large concertation avec les acteurs chargés de la mise en œuvre du texte. Il s'agit là d'un exemple que les gouvernements seraient bien inspirés de méditer pour l'élaboration des autres grandes réformes dont notre pays a besoin. La plupart des décrets d'application ont été pris et, le plus souvent, dans les temps. Bien entendu, il reste regrettable que l'intégralité des mesures réglementaires nécessaires n'ait pas encore été publiée. Pour autant, force est de reconnaître que les dispositions règlementaires manquantes n'empêchent pas la réforme de produire ses effets. Or, là est bien l'essentiel. Il n'empêche que la pratique a révélé certains problèmes, dont la solution relève, selon leur importance, du comportement des principaux intéressés, du juge, du règlement ou de la loi. Des ajustements, à plus ou moins brève échéance, seront indispensables si l'on veut éviter de rééditer les difficultés rencontrées dans des affaires aussi complexes que celle d'Eurotunnel. Sous cette réserve, cependant, le jugement porté sur l'application de la loi de sauvegarde des entreprises ne peut qu'être positif. Après avoir apporté sa modeste contribution à l'amélioration du contenu de la réforme, le rapporteur a, pour ce qui le concerne, le sentiment du devoir accompli. Au cours de sa réunion du 31 janvier 2007, la Commission a procédé, en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement, à l'examen du rapport de M. Xavier de Roux, sur la mise en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises. Après avoir salué le travail du rapporteur, à l'issue de son exposé, le président Philippe Houillon a estimé que le législateur pourrait être conduit à lever certaines incertitudes quand il aura davantage de recul sur les premières années d'application de la loi. Les questions liées à la compatibilité des règles du droit du travail avec la nouvelle procédure mériteront manifestement des ajustements, comme cela avait d'ailleurs été souligné lors des débats parlementaires, mais on se souvient que le Gouvernement s'était alors refusé à ce que cette question soit abordée. M. Etienne Blanc a rappelé que le Gouvernement avait en effet refusé, au moment des débats, que cette question soit même évoquée. Concernant la difficulté d'interprétation de la notion de cessation des paiements, au regard notamment de la jurisprudence évolutive du tribunal de commerce de Paris qui peut être source d'incertitude, il a demandé si une réflexion était menée afin de mieux cerner cette notion. Le rapporteur a indiqué que la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation continuait, en l'espèce, de prévaloir dans les jugements des tribunaux de commerce, notamment à Paris. Il a estimé que les magistrats de la Cour défendent le maintien de leur position par le fait qu'une substitution de la notion de « créances exigées » à celles de « créances exigibles » reviendrait à placer l'entreprise en difficultés à la merci du bon vouloir de ses créanciers bancaires. Le président Philippe Houillon a indiqué que la Cour de cassation sera probablement conduite à prendre position sur l'application de la procédure de sauvegarde à des entreprises en cessation des paiements si elle est saisie de contentieux relatifs à certaines procédures comme celle dont a bénéficié Eurotunnel, concernant des entreprises qui sont manifestement dans cette situation. Puis la Commission a autorisé le dépôt du rapport d'application de la loi en vue de sa publication. PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR · Conférence générale des tribunaux de commerce - Mme Perrette REY, présidente. · Parquet du Tribunal de grande instance de Paris - M. Jean-Claude MARIN, procureur de la République ; - M. Jean-Louis LECUÉ, vice-procureur de la République. · Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce - M. Christian BRAVARD, président ; - M. Michel JALENQUES, vice-président ; - M. Frédéric LAISNÉ, secrétaire général. · Avocats - Maître Jacques HENROT, avocat au cabinet De Pardieu, Brocas, Maffei ; - Maître Olivier PUECH, avocat au cabinet Gide, Loyrette, Nouel ; - Maîtres Jean-Pierre FARGES et Éric BOUFFARD, avocats au cabinet Ashurst. · Direction générale du Trésor et de la politique économique - M. Xavier MUSCA, directeur général ; - M. Franck DUMAILLE, secrétaire général adjoint du comité interministériel des restructurations industrielles (CIRI), adjoint au chef du bureau du financement des entreprises (Finent2). · Direction des affaires civiles et du Sceau - M. Marc GUILLAUME, directeur ; - M. Jérôme DEHARVENG, chef du bureau du droit de l'économie des entreprises. · Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires - M. Maurice PICARD, président ; - M. Philippe FROELICH, vice-président. · Mouvement des entreprises de France - Mme Joëlle SIMON, directrice des affaires juridiques. · Confédération générale des PME - M. Gérard ORSINI, président de la commission juridique et fiscale ; - M. Lionel VIGNAUD, juriste à la direction des affaires économiques. · Banques * Fédération nationale du Crédit-Agricole - M. Guillaume ROESCH, secrétaire général de la Fédération nationale du Crédit Agricole ; - M. Jean-Michel DAUNIZEAU, directeur des affaires juridiques du Crédit Agricole SA. * BNP-Paribas - M. Jean-Louis GUILLOT, directeur juridique. * Société générale - M. Gérard GARDELLA, directeur des affaires juridiques. · Assemblée permanente des chambres de métiers - M. François MOUTOT, directeur général. · Chambre de commerce et d'industrie de Paris - Mme Anne OUTIN-ADAM, directeur des développements juridiques. 1 () Actes du colloque reproduits par le n° 54 des Petites affiches, publié le 16 mars 2006, p. 8. 2 () JUS C 05 20 585 C publiée au bulletin officiel. 3 () Cass. com., 29 novembre 2005, « M. Michel X c/ Procureur général près la cour d'appel de Douai ». 4 () Voir à ce sujet l'arrêt du tribunal de commerce de Nanterre du 15 février 2006 ou celui du tribunal de grande instance de Lure du 29 mars 2006, par exemple. 5 () Voir l'arrêt « Eurofood » du 2 mai 2006. 6 () Ibidem. 7 () Voir le rapport en première lecture n° 2095, mis en distribution le 24 février 2005, p.88. 8 () Ont d'ailleurs été récemment supprimés, par le décret n° 2005-624 du 27 mai 2005, les tribunaux de commerce de Mayenne, l'Ile Rousse, Salins-les-Bains, Issoudun, Romorantin-Lanthenay, Paimpol et Montélimar, portant à 43 le nombre de ces juridictions disparues depuis le 1er janvier 2000 dans le ressort des cours d'appel d'Amiens, Angers et Orléans, ainsi que de Bastia, Besançon, Bourges, Caen, Dijon, Grenoble, Montpellier, Poitiers, Riom et Rennes. 9 () Etude de Mme Anne-Sophie Texier, adjointe au chef du bureau du droit de l'économie de l'entreprise au ministère de la justice, publiée dans la revue « Lamy droit des affaires » de janvier 2006, p. 22. 10 () Etude de doctrine parue dans « La semaine juridique » du 12 avril 2006 (n° 15), p. 724. 11 () Etude de Mme Anne-Sophie Texier précitée, p. 22. 12 () Etude de M. Yves Chaput précitée, p. 724. 13 () Créances pour les besoins du déroulement des procédures de sauvegarde et de redressement ou les besoins du déroulement de la période d'observation ainsi que celles nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle pendant cette période. 14 () Créances nées après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, ainsi que celles résultant des besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation antérieure, ou nées d'une prestation fournie au débiteur pour son activité professionnelle postérieure à l'un des jugements. 15 () Cass. com., 19 février 2002, « M. Lize, en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Denis et autres c/ société Locaumat ». 16 () Étude de Mme Anne-Sophie Texier précitée, p. 24. 17 () Le décret se réfère, pour les qualifier, aux établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, aux institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. 18 () Voir à ce sujet « JCP/ La semaine juridique » n° 16, p.786 et 787. 19 () JUS C 06 20 263 C, publiée au bulletin officiel. 20 () Cass. com., 11 juin 1996, « M. Boireau c/ M. Jumel, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Boireau Construction », et 20 mai 1997, « M. Knaus c/ procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar », notamment. 21 () Étude de M. Jean-Pierre Legros, professeur à l'université de Franche-Comté, publiée dans la revue mensuelle « Droit des sociétés-LexisNexis-Jurisclasseur » de mai 2006, p. 14. 22 () JUS C 06 20 263 C, publiée au bulletin officiel. 23 () Cass. com., 4 janvier 2006, « M. Jean-Paul Thuet c/ M. Jean-Claude Masson ». 24 () JUS C 06 20 008 C, parue au bulletin officiel. 25 () Cass. com., 16 mai 2006, « M. Elisario Colaco c/ M. Jean-Claude Herbaut ». 26 () CA Aix-en-Provence, 8e Ch. A, 13 avril 2006, RG n° 04/12392. 27 () Cass. com, 27 juin 2006, « M. Jacques Moyrand, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C2F constructions c/ M. Guy Visini et autres ». 28 () Décret publié au journal officiel du 29 décembre 2006. 29 () Etude de M. Yves Chaput précitée, p. 727. 30 () A noter que la Commission européenne envisage de porter le plafond du règlement « de minimis » du 12 janvier 2001, en deçà duquel une aide financière sur une période de trois ans en faveur d'une entreprise n'est pas considérée comme une aide d'État, de 100 000 à 150 000 euros. 31 () Tribunal de première instance de la Communauté européenne (TPICE), 11 juillet 2002, « Hijos de Andrès Molina » (HAMSA). 32 () Pour plus de détails, voir le rapport n° 2095, présenté au nom de la commission des lois à l'occasion de la première lecture, p. 497 à 500. 33 () Supplément au bulletin « Le juge du commerce », La lettre, publié en octobre 2006 (n° 16), p. 2. 34 () Tribunal de commerce de Lyon, 14 avril 2006, « Infogrames ». 35 () En application des articles 1382 et 1147 du code civil. 36 () C'est-à-dire ceux qui effectuent à titre habituel des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du même code ou des opérations connexes au sens de l'article L. 311-2. 37 () Le Trésor public, la Banque de France, La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. 38 () Loi n° 85-98, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, publiée au journal officiel du 26 janvier 1985. 39 () Cass. com., 28 avril 1998, « M. Laroppe c/ Mme Perrotel épouse Morel », non publié au bulletin. 40 () Tribunal de commerce de Paris, 2 août 2006, « Société de droit anglais faisant appel public à l'épargne Eurotunnel PLC ». 41 () Cass., 10 juillet 2006, avis « tribunal de grande instance de Thonon les Bains ». 42 () Cass. com., 22 juillet 1986, « Société Générale c/ Entreprise Deux et autres ». 43 () Exposé sommaire de l'amendement n° 602 au projet de loi sur la sauvegarde des entreprises, déposé par M. Xavier de Roux, rapporteur, au nom de la commission des lois. 44 () Compte-rendu intégral de la troisième séance du 8 mars 2005, après l'article 142. 45 () Ibidem. 46 () Cass. com., 8 décembre 1987, « Société Stratimme Cappello et autre c/ Banque nationale de Paris ». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||