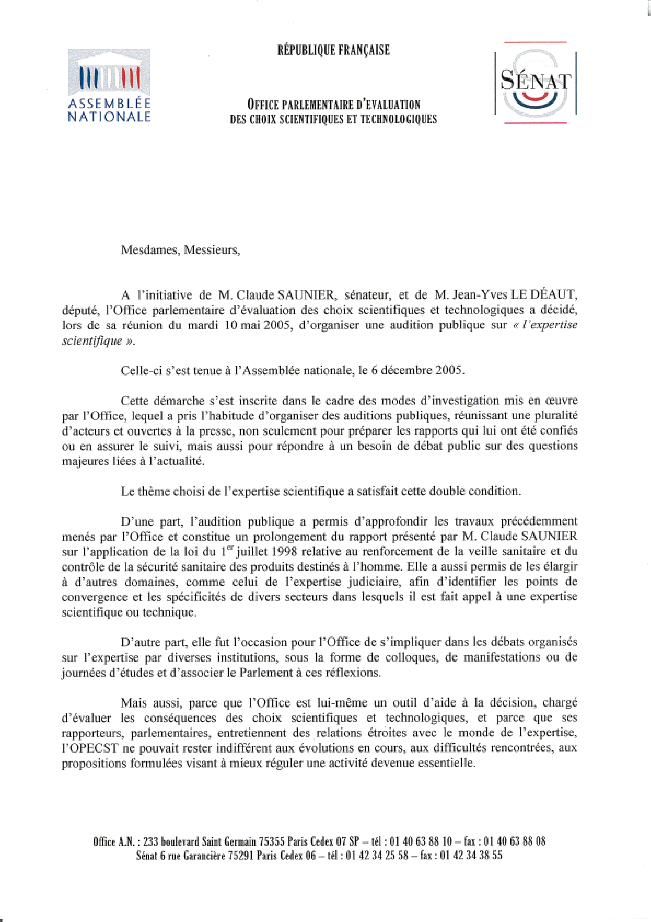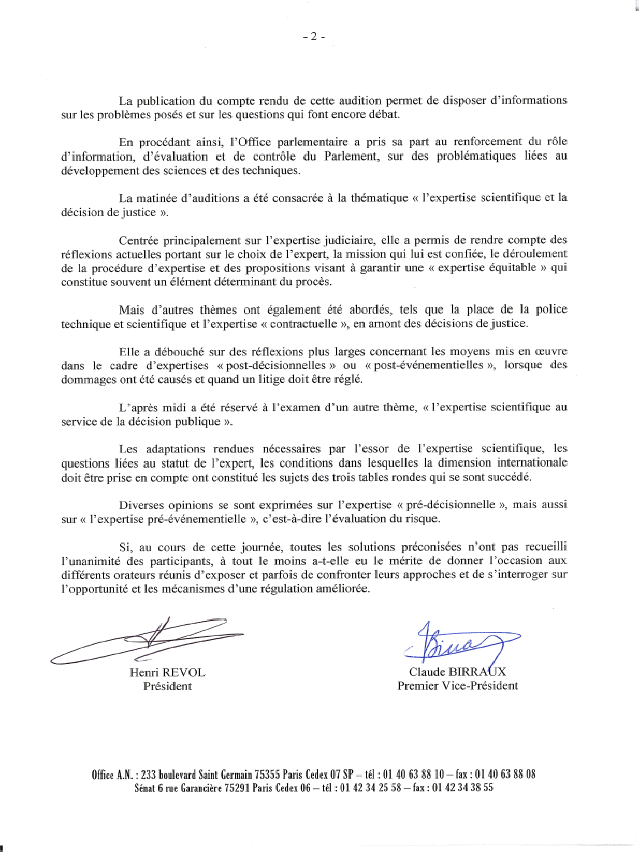OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ________________________ COMPTE RENDU DE L'AUDITION PUBLIQUE du 6 décembre 2005 sur L'expertise scientifique
___________________________________________________________________________ Composition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Président M. Henri REVOL Premier Vice-Président M. Claude BIRRAUX Vice-Présidents M. Claude GATIGNOL, député M. Jean-Claude ÉTIENNE, sénateur M. Pierre LASBORDES, député M. Pierre LAFFITTE, sénateur M. Jean-Yves LE DÉAUT, député M. Claude SAUNIER, sénateur
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) ______________ « L'expertise scientifique » _____________ Compte rendu de l'audition publique du Mardi 6 décembre 2005 Assemblée nationale - salle Lamartine Table des matières PREMIÈRE PARTIE : L'expertise scientifique et la décision de justice Présidence de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Député, Vice-Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 99 Ouverture par M. Claude BIRRAUX, Député de Haute-Savoie, Premier Vice-Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 1111 Introduction de M. Jean-Yves LE DÉAUT, Député de Meurthe-et-Moselle, Vice-Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 1515 M. Philippe BELAVAL, conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Versailles 1818 M. Jean-Claude MAGENDIE, Président du Tribunal de Grande Instance de Paris 2222 Mme Claude NOCQUET, Conseiller à la Cour de Cassation, Chambre criminelle 2424 M. Patrick MATET, Conseiller à la Cour d'Appel de Paris 2727 Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris, chargée du pôle santé publique 3030 M. Arnold MUNNICH, Membre de l'Académie des Sciences, Professeur à l'Université René Descartes, Centre de génétique de l'hôpital Necker 3535 M. Dominique GAILLARDON, Commissaire divisionnaire, Adjoint au Sous-Directeur de la Police technique et scientifique de la Direction centrale de la police judiciaire 3737 Mme Sandrine VALADE, Ingénieur en Chef, Responsable de la section « Biologie » du laboratoire de police scientifique 3939 M. François FASSIO, Président de la Fédération nationale des Compagnies d'experts judiciaires 4343 M. Alain KARLESKIND, Président d'honneur de la Compagnie des Ingénieurs experts près la Cour d'Appel de Paris 4646 M. Jean-Marie HEISSER, Président d'honneur de la compagnie française des experts judiciaires près la Cour d'Appel de Nancy 4848 M. Michel JARRAULT, Vice-Président de la Compagnie française des experts construction 5252 M. Alain JAKUBOWICZ, Avocat 5555 Mme Jeanne GOERRIAN, Présidente de l'Association des victimes de l'hormone de croissance et Secrétaire nationale de l'Association des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 5858 M. Claude DELPOUX, Directeur des assurances de biens et de responsabilité, à la Fédération française des sociétés d'assurances 6161 M. Bernard PECKELS, Rédacteur en chef de revue « Experts » 6363 DEUXIÈME PARTIE : L'expertise au service de la décision publique Présidence de M. Claude SAUNIER, Sénateur, Vice-Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 6767 Introduction par M. Claude SAUNIER, Sénateur des Côtes-d'Armor, Vice-Président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 6969 Modérateur : M. Guy PAILLOTIN, Président du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 7070 Mme Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord, membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 7070 Docteur Jean MARIMBERT, Directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 7272 Docteur Jeanne ETIEMBLE, Directrice du centre d'expertise collective, INSERM 7474 Mme Marie-Thérèse HERMANGE, Sénatrice de Paris 7575 Mme Pascale BRIAND, Directrice générale de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) 7676 Professeur Daniel VITTECOQ, Président de la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) 7878 M. Jean-Marie SCHWARTZ, Responsable de la cellule support des avis et expertises institutionnelles au CNRS 7979 M. Benoît MANGENOT, Directeur de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) 8181 M. Philippe GUERIN, Président du Conseil national de l'alimentation 8282 Modérateur : M. Gérard PASCAL, Directeur de recherche honoraire à l'Institut national de recherche agronomique (INRA) 8585 M. Jean-Claude AMEISEN, Unité 552 INSERM, Président du Comité d'éthique de l'INSERM 8686 Professeur Daniel MARZIN, Président de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (Comtox) 8787 M. Lionel BENAICHE, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre 8989 M. André CICOLELLA, Directeur de l'évaluation des risques sanitaires à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) 9191 Mme Blandine FAURAN, Directrice juridique et fiscal au LEEM (les entreprises du médicament) 9494 Mme Claire SABBAGH, Directrice de l'unité d'expertise scientifique de l'INRA 9696 Professeur Christian RICHÉ, Chef du service pharmacologie du CHU de Brest 9898 Modérateur : M. Philippe VERGER, Directeur de recherche à l'Institut national de recherche agronomique (INRA) 102102 Professeur Philippe EVEN, Hôpital Necker-Enfants malades 103103 M. Bruno TOUSSAINT, Directeur de la rédaction de la revue « Prescrire » 105105 Docteur Anne CASTOT, Chef du département surveillance du risque à l'AFSSAPS 107107 M. Guy TUFFERY, Délégué à la qualité de l'AFSSA 109109 Professeur Christian RICHÉ, Chef du service pharmacologie du CHU de Brest 112112 Conclusion par M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Président du Museum national d'histoire naturelle et M. Robert BADINTER, Sénateur des Hauts-de-Seine, ancien Garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel 115115 M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Président du Museum national d'histoire naturelle 117117 M. Robert BADINTER, Sénateur des Hauts-de-Seine, ancien Garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel 118118
PREMIÈRE PARTIE : Ouverture par Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour débattre de l'expertise scientifique. Vaste sujet, il est vrai, complexe aussi. Mais, malgré tout, sujet devenu d'actualité. L'expertise scientifique et technique se trouve aujourd'hui au centre de multiples réflexions en France et dans le monde. Elle suscite aussi des controverses parfois inépuisables, au moment même où elle semble devenir incontournable, conduisant ainsi les institutions publiques, les acteurs économiques, les citoyens et les experts eux-mêmes à exiger de meilleures garanties et une plus grande efficacité. De plus en plus nécessaire et jamais suffisante, semble-t-il, l'expertise scientifique prend une importance croissante dans notre société, dans le fonctionnement de nos institutions et dans notre économie. Face à cette évolution, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a pris l'initiative d'organiser cette audition publique, afin d'informer le Parlement sur la diversité des questions soulevées par l'expertise, les difficultés rencontrées et les adaptations jugées souhaitables dans ce domaine. La création en 1983 de cet organe parlementaire, associant Députés et Sénateurs, visait précisément à doter le Parlement d'un outil d'expertise indépendant, afin de l'éclairer sur les conséquences des choix scientifiques et technologiques. C'est dire que le thème de l'expertise intéresse tout particulièrement les membres de l'Office. Près d'une centaine de rapports ont répondu à cette attente, et presque autant d'auditions, ouvertes à la presse, rassemblant toujours une pluralité d'intervenants. Pour effectuer ce travail, l'Office s'appuie sur les travaux d'expertise disponibles, en ne se cantonnant pas à ceux produits en France, mais en tentant de rechercher l'information là où elle se trouve et en confrontant les différents points de vue et les différentes approches. Il dispose aussi d'un conseil scientifique et entretient des relations avec les Académies et les différentes institutions de recherche. L'Office n'est cependant pas un organe de décision ; il est un outil d'aide à la décision. Un outil particulier puisqu'il appartient aux parlementaires eux-mêmes de recueillir les informations nécessaires, de les présenter sous une forme aussi intelligible que possible, d'en tirer les conclusions qui leur semblent les plus pertinentes et d'essayer de convaincre leurs collègues, les acteurs publics et privés, les citoyens de la justesse de leurs analyses. Autant dire qu'ils rencontrent, dans leurs activités, des difficultés analogues à celles des autres acteurs recourant à l'expertise, comme des experts eux-mêmes : comment préserver son indépendance, comment s'assurer de la qualité des informations collectées, comment garantir la plus grande transparence possible, comment rendre des conclusions dans des délais raisonnables, alors qu'il faut en même temps remplir les autres fonctions liées au mandat parlementaire, quelle position adopter face à l'incertitude ou face aux certitudes contradictoires ? Ce sont des questions que se posent aussi les parlementaires de l'Office, avec de surcroît le souci constant de l'intérêt général, la volonté de rendre les débats constructifs et le besoin de concilier le respect de ses convictions et le sens de ses responsabilités. La généralisation du besoin d'expertise, devenue un élément de plus en plus inévitable de la prise de décision, a abouti à une augmentation des activités d'expertise, avec une multiplication des lieux et des procédures d'expertise. Le Parlement n'a pas été épargné par cette évolution, avec la mise en place de missions d'information temporaires s'appuyant elles-mêmes sur l'audition d'experts. Cela montre l'importance prise par l'expertise, ce qui est une bonne chose. Mais cette évolution doit être mieux régulée, car le foisonnement non contrôlé d'activités d'expertise peut se révéler négatif, comme peut se révéler néfaste la mise en œuvre d'une logique rétrospective qui jugerait les résultats d'une expertise sans tenir compte de l'état des connaissances acquises au moment où cette expertise a été réalisée, ni du contexte général dans lequel elle a été effectuée. C'est là une des tâches extrêmement difficiles pour l'Office. Il travaille certes entouré d'experts, mais ses conclusions sont celles de ses rapporteurs, adoptées par l'assemblée plénière des membres de l'Office. C'est une grande différence avec d'autres systèmes qui existent dans le monde, et en particulier en Europe. Au sein du Parlement européen, par exemple, le bureau du STOA, le Scientific and technological options assessment, présidé par M. Philippe Busquin, accepte de conduire les expertises qui lui sont demandées parce qu'il ne peut pas les refuser, mais lance ensuite un appel d'offres pour confier à des consultants le soin de réaliser le travail, après quoi l'expertise reçoit simplement la signature du STOA. L'indépendance des consultants ne peut certes être mise en doute, mais ils ont tendance à se demander quelle réponse veut entendre celui qui a posé la question... Il en va autrement au sein de notre Parlement. Les travaux de l'Office demandent un investissement considérable de la part des rapporteurs, ce qui est un gage d'indépendance. Cette notion d'indépendance de l'expert mérite d'ailleurs d'être débattue. J'ai l'impression que trop souvent, l'expert dit indépendant est celui qui est d'accord avec vous quand vous êtes contre quelque chose. Dans le cas contraire, il est affublé de qualificatifs peu flatteurs. Parce qu'ils sont habitués à travailler en collaboration avec des experts, mais restent à l'écoute de la société, les membres de l'Office ont conscience des difficultés liées à l'évolution des connaissances et des techniques, aux pressions économiques qui s'exercent, aux attentes, aux peurs et aux souffrances des individus, à l'existence de situations conflictuelles. De façon peut-être paradoxale, la première leçon à tirer de ce besoin toujours plus grand d'expertises et de contre-expertises est, à mon sens, une leçon de modestie. Une leçon d'humilité pour tous, qui doit nous pousser à modifier notre manière de faire, et non pas nous inciter à nous replier sur nous-mêmes, qui doit nous apprendre à changer notre mode d'action, et non nous soumettre à l'indécision. Cela ne signifie pas que n'importe qui doit se voir reconnaître le statut d'experts. Il paraît que « lorsque l'on paie des experts comme des femmes de ménage, on a des expertises de femmes de ménage ». L'auteur de ces propos, qui n'est pas très gentil pour les femmes de ménage, manque peut-être d'humilité... J'emprunterai une citation d'Albert Camus pour terminer : « Le démocrate est modeste. Il avoue une certaine part d'ignorance (...). Et, à partir de cet aveu, il reconnaît qu'il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'ils savent ». C'est un peu ce que l'Office a entrepris aujourd'hui en organisant ces auditions, et c'est ce que pratiquent quotidiennement la multitude de ses rapporteurs. Introduction de Mesdames, Messieurs, mon collègue Sénateur Claude Saunier et moi-même vous remercions à notre tour de votre participation à ce débat organisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Cet Office, composé de dix-huit Députés et dix-huit Sénateurs, se veut un lieu de contact entre la science, l'industrie, les institutions, dont l'institution judiciaire, et le Parlement. Il tente de réaliser des expertises collectives, publiques et contradictoires. Sa démarche est ambitieuse. Il travaille en amont du processus législatif sans coller à un événement donné, sans chercher à éclairer une décision précise. Les travaux que nous avons conduits sur la sûreté nucléaire, sur les organismes génétiquement modifiés, sur les effets des ondes électromagnétiques, sur la biométrie, sur l'effet de serre, ou d'autres sujets encore, ont souvent été conduits très en amont du processus législatifs, et ont souvent débouché sur des lois ou des règlements. Nous évitons toutefois d'accumuler les textes en oubliant les bonnes lois qui existent et qui ne sont pas toujours appliquées. Nous sommes tous confrontés, vous comme nous, à des problèmes d'une complexité croissante, auxquels le public réclame des réponses simples. C'est une difficulté pour les experts comme pour les décideurs politiques. Si le pouvoir politique a mis en place un certain nombre d'agences qui lui permettent de préparer une décision politique, c'est parce qu'il est conscient que notre société est inquiète. Les grandes avancées qui ont été accomplies dans les domaines scientifiques et technologiques ont également leurs revers. Si elles ont fait disparaître certains risques, d'autres sont survenus. Or, l'opinion publique n'admet pas la fatalité quand un sinistre survient, même en cas de catastrophe naturelle. Le risque est de moins en moins accepté. En cas d'accident majeur, en particulier dans les domaines industriel, énergétique, environnemental, alimentaire et sanitaire, la société souhaite que des responsables soient désignés. Elle souffre également de déficits démocratiques et aspire à être consultée avant toute décision. Elle souhaiterait qu'un dialogue s'instaure entre l'expert, le politique et le citoyen. De cette analyse sociétale est née la création de mécanismes qui permettent de contrôler le cours du progrès technique, et d'anticiper ses conséquences. Le Parlement y a participé, notamment par l'intermédiaire de l'Office. Dans le domaine judiciaire, un certain nombre de dossiers sont classiques et ne posent pas de difficultés majeures, mais il y a aussi des affaires de type et d'envergure différents. Le crash du Concorde, l'effondrement du terminal E de Roissy, l'affaire des farines animales qui ont entraîné le développement de la pandémie de l'ESB, l'affaire du sang contaminé, la contamination par l'hormone de croissance, l'incident du tunnel du Mont-Blanc ou la catastrophe d'AZF sont autant d'affaires qui ont abouti à des litiges dont les dimensions sont considérables, avec des conséquences sociales, humaines et économiques énormes. L'expertise est une phase nécessaire de la découverte de la vérité par le juge. Les moyens humains et financiers susceptibles d'être mis en œuvre pour répondre à cette nouvelle demande ont-ils été mis en place ? La formation et les statuts des experts sont-ils adéquats ? Notre système d'expertise ou de recours à des experts, malgré les progrès introduits par la loi de février 2004, correspond-il à ces nouvelles affaires ? La pluridisciplinarité de l'expertise est-elle suffisante ? Doit-on rester dans un cadre strictement hexagonal, faut-il rechercher les compétences là où elles se trouvent et mettre en place des collaborations avec des experts étrangers ? Les différents statuts, souvent source de cloisonnements, permettent-ils d'utiliser toutes les compétences existantes et de parvenir à une pluridisciplinarité de plus en plus nécessaire ? Sur le plan financier, la mise en jeu de compétences de haut niveau et le recours à des technologies de pointe, comme les tests ADN, sont onéreux ; la dépense s'accroît en conséquence (et pas seulement par le seul effet de la multiplication des activités d'expertise). Mais jusqu'où peut-on aller ? Cette interrogation pose à son tour la question de l'efficacité de l'expertise. Comment réduire les délais, comment garantir la qualité de l'expertise ? Se pose également la question de la confiance que les citoyens, les justiciables, les différents acteurs placent dans cette expertise et dans le rendu de la justice. Une deuxième série de questions porte sur les incidences de cet accroissement des activités d'expertise sur les institutions qui y recourent, sur les procédures qu'elles utilisent, sur leur organisation. Longtemps l'expertise est restée peu régulée, sauf peut-être dans le domaine judiciaire où les procédures sont précisément définies. Même dans le domaine judiciaire, on peut d'ailleurs se demander s'il ne faut pas adapter les choses et favoriser les réflexions et les débats sur l'expertise. Une adaptation pourrait être nécessaire pour tenir compte de l'évolution de la société. Je ne fais pas allusion ici à la « judiciarisation » de la vie sociale, ni à la modification de l'image de la science. Je veux parler des nouveaux besoins ressentis par les citoyens : plus de débats, plus de transparence, plus de contradictoire, en évitant bien sûr de tomber dans une spirale vertigineuse. Il faut également, pour rétablir une confiance émoussée, de meilleures garanties d'indépendance et des procédures adaptées aux besoins. Une autre question concerne l'adaptation des outils techniques d'aide à la décision finale s'appuyant sur l'expertise. Deux logiques parfois poussées à l'extrême s'affrontent aujourd'hui : celle du développement économique, dans un contexte de concurrence exacerbée où l'innovation devient un enjeu essentiel pour les entreprises et les pays, et celle de la précaution, pour ne pas, par négligence, créer des dommages irréparables et mettre en danger la vie d'individus. On parle beaucoup de l'expertise publique ; on réagit souvent aux décisions de justice rendues sur la base d'expertises judiciaires ou celles sanctionnant des décisions prises sur la base d'expertises publiques ou privées. Cette audition sera l'occasion, humblement, de donner la parole aux différentes « parties prenantes » et de prendre conscience des difficultés rencontrées et des réflexions qu'elles suggèrent aux magistrats, aux experts, aux victimes, aux avocats et aux assureurs. On trouvera peut-être le programme un peu hétéroclite, mais cela est dû au fait que le point de convergence est constitué par la thématique de l'expertise elle-même, dans ses relations multiformes avec la décision de justice telle qu'elle est perçue par les différentes personnes impliquées dans le processus juridictionnel. On trouvera aussi certainement le programme incomplet ou déséquilibré. Il l'est, mais il a fallu faire des choix pour essayer de rester dans le temps initialement fixé. Pour ce premier tour d'horizon, l'accent a été mis sur le juge et l'expert. La pluralité des intervenants, parmi les juges et les experts, nous permettra d'identifier des lignes de consensus, mais aussi peut-être des nuances d'appréciation, voire des divergences sur ce qu'il est nécessaire d'entreprendre, ce qui me paraîtrait particulièrement sain. Car, face à une évolution à mes yeux inéluctable, celle d'un recours accru à l'expertise, qui peut prétendre détenir les clés d'une maîtrise assurée des conséquences de cette évolution ? Comment parvenir à conserver les caractères d'un procès équitable, lorsque l'expertise prend une place de plus importante et nécessite la mise en jeu de moyens de plus en plus sophistiqués ? Comment garantir l'égalité des citoyens face à une expertise de plus en plus complexe et coûteuse ? Comment gérer aussi ce nouveau risque, celui de voir l'expertise elle-même - l'expertise publique, l'expertise privée, voire peut-être demain l'expertise judiciaire - devenir de plus en plus l'objet de litiges ou la source de nouveaux conflits dans la société ? Cela ne risque-t-il pas de porter finalement atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée, à la crédibilité de la justice ? Le système français, qui place l'expert auprès du juge, est-il le bon ? Ou le système anglo-saxon, où les parties ont leur propre expert, apporte-t-il plus de garanties ? Je souhaiterais également que vous nous indiquiez ce que vous pensez de la place croissante de la responsabilité sans faute, de l'indemnisation des victimes sur le seul préjudice, de la banalisation de la notion de faute en cas de carence de la prévention des risques, des régimes spéciaux d'indemnisation qui ont été mis en place par le législateur, ou encore des expertises visant à évaluer la carence de l'État. La question du rôle des médias se pose également. Autant le juge et l'expert s'abstiennent de prendre publiquement la parole lorsqu'ils sont saisis d'un dossier, autant, durant cette période, les industriels, les milieux associatifs, les chercheurs, les journalistes ou les hommes politiques peuvent s'exprimer sur la place publique. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Philippe Belaval, conseiller d'État, Président de la Cour administrative d'appel de Versailles. M. Philippe BELAVAL, conseiller d'Etat, Le juge administratif, comme d'ailleurs son homologue judiciaire, est confronté, dans l'examen des litiges dont il est saisi, à la nécessité d'apprécier des situations qui échappent à ses compétences intellectuelles en raison de leur nouveauté ou de leur degré de spécialisation, ou, plus couramment, en raison de leur insuffisante explicitation dans le dossier qui lui est soumis. Pour l'aider à résoudre ces difficultés, il a, comme son homologue judiciaire, la faculté de recourir à une expertise. Celle-ci peut être ordonnée soit dans le cadre d'une instance au fond, d'office, c'est-à-dire à l'initiative du juge, soit à la demande des parties, ainsi que le prévoit l'article R. 621-1 du code de justice administrative, soit en référé, à la condition que cette mesure apparaisse comme utile, comme le prévoit l'article R. 532-1 introduit dans le code de justice administrative par une réforme récente puisqu'elle date de 2000. Sous réserve de quelques nuances, dans le détail desquelles il ne me semble pas nécessaire d'entrer ici, le régime de l'expertise ordonnée au fond est pour ainsi dire le même que celui de l'expertise ordonnée en référé. Il est fixé par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Au moins dans l'inspiration, il ne me paraît pas fondamentalement éloigné de celui défini dans le domaine judiciaire par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, notamment eu égard à son souci de garantir l'impartialité de l'expert et le caractère contradictoire des opérations de l'expertise. Comme dans l'ordre judiciaire, la jurisprudence s'est chargée de compléter le cadre juridique applicable, qui est aujourd'hui parvenu à un stade d'équilibre qui ne me semble remis en cause par personne. Il n'existe malheureusement aucune centralisation statistique ni du nombre, ni du type d'expertises ordonnées chaque année par le juge administratif. C'est là que l'expérience du chef de juridiction vient suppléer aux statistiques. Deux domaines sont particulièrement concernés. Le domaine médical l'est dans le contentieux de la responsabilité des établissements publics d'hospitalisation et de soin. L'expertise peut porter sur la description des soins reçus ou des traitements délivrés, sur la conformité à l'état de l'art des gestes pratiqués, sur les éléments susceptibles d'être qualifiés de fautifs par le juge, sur l'imputabilité de certains troubles à certains actes, sur la description d'un état de santé à un moment précis, sur la fixation d'une date de cristallisation d'un handicap, sur l'énumération des éléments de préjudice, sur la réunion des éléments permettant d'évaluer et donc de réparer le préjudice, notamment pour tout ce qui concerne l'incapacité, la douleur ou le trouble dans les conditions d'existence. À ce stade, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez fait allusion, monsieur le président, à l'élargissement des régimes de responsabilité sans faute. Il est vrai que l'apparition de ces régimes est susceptible de priver d'utilité l'expertise pour tout ce qui concerne la recherche d'une faute éventuelle. Par contre, même dans ces cas-là, l'expertise est susceptible de garder son utilité pour tout ce qui concerne la description du préjudice et son évaluation. Le second domaine dans lequel le juge administratif recourt très fréquemment à l'expertise est celui du bâtiment et des travaux publics, dans le cadre du contentieux de la responsabilité décennale. L'expertise peut porter sur la description des désordres, sur les éléments d'imputabilité aux actes des différents intervenants dans l'opération de construire, sur la détermination du coût de remise en état. Dans le cadre du contentieux de la réparation des dommages de travaux publics, l'expertise peut porter sur les questions d'imputabilité et d'évaluation du préjudice. Les mesures d'expertise ordonnées dans d'autres domaines sont beaucoup plus rares. Certes, le contentieux fiscal en connaît un certain nombre, notamment dans le domaine comptable, mais beaucoup moins qu'on ne pourrait le croire, dans la mesure où dans le contentieux fiscal administratif, la question de la dévolution de la charge de la preuve joue un très grand rôle. Par exemple, pour l'appréciation du caractère probant d'une comptabilité, domaine dans lequel on pourrait imaginer l'intervention d'un expert pour dire si telle écriture a été passée selon les règles comptables, ou si l'entreprise ou l'artisan a rempli ses obligations comptables, on est en fait souvent dispensé de recourir à l'expertise parce que c'est soit à l'administration soit au contribuable qu'il appartient de justifier de la régularité de sa comptabilité. Il peut y avoir aussi des expertises ponctuelles. Je cite souvent un cas que j'ai personnellement rencontré lorsque je présidais la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le litige concernait l'attribution d'une concession funéraire dans un cimetière. Le maire refusait l'attribution de l'unique concession restée vacante parce qu'il prétendait que, le caveau voisin s'ouvrant par le côté, il était nécessaire de laisser la concession vacante pour permettre les inhumations et les exhumations. Le pétitionnaire prétendait, lui, que le caveau s'ouvrait par le haut. Il n'y a pas eu, pour trancher le litige, d'autre moyen que d'ordonner une expertise pour voir comment le caveau s'ouvrait. C'est un exemple très anecdotique, sans doute extrêmement éloigné des préoccupations de l'Office. On le voit, c'est essentiellement sur des points précis que l'expertise peut intervenir, et non sur des grands sujets de principe qui pourraient constituer des enjeux en termes de développement des sciences ou de progrès des techniques. Il n'est pas courant que, dans ces derniers cas, le juge administratif recoure à l'expertise pour se forger une opinion. Deux exemples me paraissent révélateurs à cet égard. Le premier est celui du diagnostic prénatal. Je fais référence à un arrêt du Conseil d'État de 1997, l'arrêt Centre hospitalier régional de Nice contre Quarez, qui a constitué, comme vous le savez, le pendant administratif de ce qu'a été l'arrêt Perruche rendu par la Cour de cassation. Dans cette affaire, le tribunal administratif avait ordonné une expertise sur les conditions dans lesquelles le diagnostic prénatal litigieux avait été effectué. Cette expertise, classique, n'a pas influencé directement le jugement. Amené à régler l'affaire au fond après l'annulation de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, le Conseil d'État ne s'est pas du tout abrité derrière l'expertise pour se prononcer. Il a procédé à une qualification des faits sans faire référence le moins du monde à l'expertise ordonnée par le premier juge. Le second exemple est celui du contentieux des organismes génétiquement modifiés. Il est de plus en plus fréquent que le juge soit saisi de la légalité de mesures prises pour prévenir les risques susceptibles d'être présentés par la culture des organismes génétiquement modifiés. Mais jusqu'à présent, il n'a pas éprouvé le besoin d'ordonner une expertise pour mesurer l'ampleur exacte de ces risques et la proportionnalité des mesures par rapport aux risques. Une récente ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Toulouse, du 22 juillet 2005, a été publiée dans L'Actualité juridique du droit administratif le 10 octobre 2005. Le juge des référés était invité à dire si le moyen tiré, à l'encontre d'un arrêté d'autorisation, d'une évaluation insuffisante du risque environnemental était sérieux ou non. Il a dit ceci : « Les risques ont été appréciés pour chaque demande d'autorisation, tant par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire prévue à l'article L. 531-4 du code de l'environnement que par le service régional de protection des végétaux, dont il est constant qu'il disposait d'un exemplaire du dossier de demande d'autorisation des disséminations mentionnant avec une précision suffisante la localisation des essais envisagés, qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation aurait été accordée au vu d'une évaluation insuffisante du risque environnemental. » On voit que le juge a pris une décision sans éprouver le besoin de recourir à une expertise. Le développement de contentieux relatifs à l'application du principe de précaution est-il susceptible de faire évoluer cette attitude ? Ce n'est pas impossible. Mais je ne pense pas, à titre tout à fait personnel, qu'il faille imaginer des développements spectaculaires dans ce domaine. D'abord, le juge est limité par l'étendue des litiges dont il est saisi. Le juge de terrain n'a pas tous les jours à juger une affaire qui pose des grandes questions de principe. Ensuite, même si l'occasion s'en présentait, le recours à l'expertise pourrait se révéler comme une fausse bonne solution. À qui confier une expertise portant sur les risques des organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ? On peut évidemment écarter le risque de recours à un expert trop partial par la constitution d'un collège d'experts, mais cela permet-il de répondre complètement à la question ? Enfin, la dernière limite, qui demeurera toujours, est qu'il revient au juge et à lui seul de trancher les contestations de droit. L'expertise peut jouer un rôle dans la découverte de la vérité, mais la qualification juridique des faits et les conséquences juridiques qui en découlent sont de la responsabilité du seul juge. L'expert peut éclairer le juge, il ne se substituera jamais à lui, de sorte que face aux grandes interrogations scientifiques ou techniques, le juge, même lorsqu'il exerce ses fonctions collégialement, reste finalement un homme seul. M. Jean-Yves Le Déaut, Président : Je vais maintenant donner la parole à M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris. En lisant vos travaux, monsieur le président, j'ai vu que vous avez insisté sur la célérité et la qualité de la justice. Vous souhaitez que l'on réduise le plus possible les contre-expertises, qui sont l'une des causes de l'allongement des procédures judiciaires. Le paradoxe est effectivement que la connaissance au service de la vérité fait de plus en plus l'objet de litiges. Vous pourrez peut-être nous dire également un mot des pôles spécialisés, dont vous avez beaucoup parlé dans vos travaux. M. Jean-Claude MAGENDIE, L'expertise nous place face à la question centrale, celle de l'office du juge. Le juge est celui qui, à partir de faits, donne à ceux-ci une qualification juridique. Or, la connaissance des faits devient de plus en plus complexe, pour des raisons que vous avez indiquées, monsieur le président. De sorte que le juge, dans un grand nombre de cas, ne peut pas apprécier sans données techniques le bien-fondé d'une position. Pour cela, il se tourne tout naturellement vers l'expert. Celui-ci apporte ses lumières au juge, comme le prévoit l'article 232 du nouveau code de procédure civile. Cette expertise a un rôle tout à fait essentiel en ceci qu'elle contribue à la qualité de la justice puisque celle-ci, en étant mieux éclairée, sera mieux à même d'adopter une solution juste. C'est bien en cela que l'expert est le collaborateur occasionnel du service public de la justice. Occasionnel, certes, mais incontournable. Bien sûr, l'expert peut se tromper. C'est vrai pour les politiques publiques, mais aussi à propos de toutes les questions qui divisent les scientifiques, qu'il s'agisse des OGM ou des déchets nucléaires. Cela peut également être le cas au plan judiciaire, comme la démonstration en a hélas été faite récemment. On voit bien là la place essentielle de l'intervention de l'expert, y compris dans le dysfonctionnement de la justice, même lorsqu'à ces défaillances expertales s'ajoutent les insuffisances des autres intervenants au procès criminel. L'enjeu de l'expertise est important au regard de la question des frais de justice, en particulier dans le cadre de la LOLF. Dans le système français, l'expert, comme je l'ai dit, est le collaborateur du service public de la justice et intervient à la suite d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge. Celui-ci n'a pas les experts des parties en face de lui, comme dans le monde anglo-saxon. Il ne me paraît pas possible d'adopter cette dernière procédure tout en conservant la conception de l'office du juge qui est la nôtre. J'espère que nous saurons résister à la fascination qu'exerce, tel un mirage, la justice anglo-saxonne. Comment améliorer l'expertise civile ? Vous avez fait allusion, monsieur le président, au rapport que j'ai remis à M. le garde des sceaux en 2004, Célérité et qualité de la Justice : la gestion du temps dans le procès. L'expertise est au centre de la problématique du temps judiciaire, comme d'ailleurs du coût de la justice. Dès lors que l'on réfléchit sur le temps du procès, qui essentiel pour nos concitoyens, se pose immédiatement la question de savoir comment l'expertise peut intervenir au service de la qualité de la justice sans pour autant être cause de délais qui deviendraient insupportables. Nous devons d'ailleurs nous demander si une réponse judiciaire qui intervient après dix ans, douze ans, a encore un sens. J'appelle votre attention sur le fait que l'expertise judiciaire répond aux normes européennes. Les normes qui définissent le procès équitable dans la Convention européenne des droits de l'homme ont été transférées à l'expertise. On parle aujourd'hui d'exigence d'une expertise équitable, ce qui fait peser sur l'expert les mêmes contraintes que celles qui pèsent sur le juge, en particulier en termes d'indépendance, d'objectivité et de délai. Je ne peux pas développer ce point, mais il est lourd de conséquences. La réforme introduite par la loi du 11 février 2004 est essentielle en ce qui concerne la formation de l'expert. Celui-ci doit être formé si l'on ne veut pas qu'il soit instrumentalisé dans un processus qui lui échapperait. Il faut donc faire en sorte qu'il connaisse parfaitement le cadre procédural dans lequel sa démarche intervient. Aussi lumineux soit-il, il sera un mauvais expert s'il ignore la logique judiciaire dans laquelle s'inscrit son action. À cet égard, la formation mise en place en 2004 est tout à fait essentielle. Elle doit répondre aux exigences de l'expertise équitable, ce qui exige de l'expert qu'il veille en permanence à ce que le contradictoire soit assuré. A cet égard, les pièges et les obstacles ne manquent pas. On voit bien d'ailleurs que, de plus en plus, l'aspect procédural de l'expertise va donner lieu à un contentieux. Plus l'expertise est solide sur le fond, relativement à la démonstration factuelle qu'elle opère, plus on tentera de l'affaiblir en l'attaquant sur l'aspect procédural, en particulier au regard de la Convention européenne. L'expertise est également centrale par le nombre d'affaires qui donnent lieu à une expertise. J'entends dire parfois que le tribunal de Paris ordonnerait trop d'expertises. Ce fort pourcentage des affaires donnant lieu à expertise peut s'expliquer de manière simple. On sait que 80 % des expertises sont ordonnées en référé. Or, à Paris, le quart du contentieux civil prend la forme procédurale du référé, alors que la moyenne nationale est de 16 %. Bien entendu, la qualité du rapport d'expertise est essentielle. L'expertise insuffisante, celle qui ne répond pas à l'attente du juge, entraînera en effet soit un complément d'expertise soit une contre-expertise. Cet échec de la démarche expertale sera nécessairement la source de délais et de coûts supplémentaires. Je ne vais pas développer ici les propositions contenues dans le rapport que j'ai remis à M. le Garde des Sceaux. Je n'en mentionnerai que quelques-unes. Comme vous le savez, le greffe doit notifier à l'expert sa désignation. Or, cette transmission à l'expert est trop tardive. Il est navrant qu'il faille attendre un mois pour que l'expert connaisse la désignation dont il a été l'objet. Les parties doivent également faire preuve de loyauté. Elles devraient donner le maximum des pièces dès le début de l'expertise et non les distiller au fur et à mesure que l'expertise se déroule. Il est anormal que des parties qui disposent de certaines pièces ne les fournissent pas immédiatement. Il conviendrait également de fixer une date limite pour les dires à experts. Il arrive en effet que certaines parties recourent à une stratégie consistant à retarder l'issue de l'expertise. Elles attendent le moment où l'expert va déposer son rapport, pour déposer un dire. L'expert est alors obligé, pour respecter le principe du contradictoire, d'y répondre, ce qui retarde d'autant l'expertise. Il faut mettre fin à ces stratégies dilatoires. Enfin, on pourrait se poser la question de la limitation de la durée de l'expertise. En matière d'arbitrage, si les parties n'ont pas fixé dans la clause compromissoire un délai précis, on estime que la mission des arbitres ne peut durer que six mois. Pourquoi ne pas introduire le principe d'une durée déterminée pour l'expertise, le juge pouvant accorder à l'expert un délai supplémentaire si l'expert le demande et le justifie ? J'indique enfin deux pistes qui peuvent être explorées en matière de contractualisation. Chaque fois que l'on peut réguler les pratiques, on obtient une meilleure justice. On peut déterminer un code des bonnes pratiques entre les experts, les juges et les avocats. J'espère qu'il sera adopté au Tribunal de Grande Instance de Paris au début de l'année prochaine. On peut d'autre part mettre en place des contrats de procédure. Il est normal que des parties soient informées des délais qui seront générés par leurs demandes, et qu'elles connaissent le coût des mesures d'expertise. La responsabilisation de chacun, en matière de délais, est importante. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je donne maintenant la parole à Mme Claude Nocquet, Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Mme Claude NOCQUET, Conseiller à la Cour de Cassation, Je vais tenter de vous faire part de mon expérience de pénaliste dans le domaine financier : à Paris, j'ai été juge d'instruction financier puis j'ai présidé des chambres correctionnelles spécialisées en matière financière, enfin j'ai participé comme première Vice-Présidente à la création du « pôle financier », avant d'être nommée à la chambre criminelle de la Cour de cassation ainsi qu'à l'AMF, où je préside une section de la commission des sanctions. Lorsque je suis arrivée dans la « galerie financière » d'instruction en 1986, il m'est arrivé de constater des comportements s'apparentant à une forme de démission du juge. Quand un dossier devenait trop complexe, il arrivait en effet que l'expert se substitue au magistrat instructeur selon un processus assez simple. Celui-ci confiait le dossier à l'expert, en lui laissant le soin d'examiner les questions qui se posaient. L'expert procédait à une étude très approfondie à l'issue de laquelle il soumettait - respectueusement - au juge le contenu et le libellé de la mission d'expertise qui pouvait lui être confiée. Le magistrat signait la mission d'expertise ; au bout d'un temps assez long, pendant lequel il avait d'ailleurs le sentiment agréable d'être totalement débarrassé de ce dossier encombrant, le juge recevait le rapport d'expertise, qui prenait parti sur l'ensemble du dossier, y compris sur ce qui était susceptible de caractériser telle ou telle infraction. Il ne lui restait plus qu'à procéder aux interrogatoires en suivant pas à pas les conclusions de l'expert ; l'inculpé - c'était le terme employé à l'époque - ne manquait pas d'adresser ensuite au juge une note écrite contestant à peu près toutes les infractions. Le magistrat instructeur demandait alors à l'expert une note en réponse... de telle sorte que le dossier était, après trois, quatre ou cinq ans, parfaitement ficelé... et obsolète. La justice avait été dépossédée de bout en bout, tandis que la procédure avait été trop longue et trop coûteuse, même si elle atteignait une certaine qualité : elle avait été, de fait, conduite par l'expert, avec l'accord démissionnaire du magistrat. Je viens là d'évoquer des pratiques du passé, qui sont heureusement restées marginales. Les magistrats, pour la plupart, ont en effet réagi à cette tentation de la facilité en s'efforçant de se réapproprier leurs dossiers. Nombreux sont ceux qui ont conduit les procédures d'un bout à l'autre, en coordonnant l'ensemble des interventions et en les adaptant au fur et à mesure du cheminement de la procédure. Ils ont pratiqué « l'instruction interactive », où la délégation donnée aux experts est, tout à la fois, beaucoup mieux circonscrite dans le temps puisque des délais sont imposés, beaucoup mieux délimitée dans l'espace dès lors que la mission est déterminée exclusivement par le juge, enfin, beaucoup plus réduite dans son coût et dans sa durée. Avec un tel processus, le juge garde la pleine maîtrise de son instruction, qui ne subit pas de retard injustifié ; mais deux risques majeurs subsistent. Le premier risque est l'échec résultant de l'inégalité des armes entre, d'un côté, le magistrat solitaire, de l'autre, une équipe d'avocats extrêmement spécialisés dans chacun des domaines abordés, le domaine fiscal, le domaine bancaire, le domaine boursier... Le second risque est l'erreur d'appréciation du juge qui, faute d'un recul suffisant, est inconsciemment tenté de faire entrer le dossier dans un cadre préétabli qu'il s'est fixé au fil de la lecture des pièces : ayant appréhendé les faits à sa manière, il reconstruit l'histoire selon son cheminement personnel, selon sa propre intuition. Dans cette construction intellectuelle, le rôle de l'expert peut être tout à fait pernicieux : celui-ci peut céder à la tentation de répondre aux attentes du juge en adhérant à son système de réflexion... et en confortant ses erreurs. On l'a vu dans un dossier récent, qui n'était hélas pas une affaire financière, mais une tragédie humaine. Pour conjurer un tel risque, les seuls correctifs sont les contrôles des instances supérieures et les débats à l'audience ; encore faut-il que les uns et les autres se déroulent de manière satisfaisante ! J'ai vu naître et se développer une troisième phase, qui me paraît infiniment plus heureuse et qui conduit à une redéfinition du rôle de l'expert. Je veux parler de toutes les réformes récentes qui ont permis de mettre en place des pôles spécialisés. D'une part, les juges sont mieux formés et moins solitaires. C'est une révolution qui a grandement modifié les comportements : une équipe de juges « sachants » n'aura pas les mêmes résultats qu'un magistrat isolé non spécialisé. D'autre part, à partir de 1999, les assistants spécialisés sont intervenus dans les procédures d'instruction, en provenance de milieux très divers, de la Banque de France, des douanes, de l'administration fiscale... Réunissant en leur personne une expérience professionnelle effective et une compétence technique pointue, ils ont été rattachés directement aux juges. Ils savent dépouiller les documents, ils savent analyser les comptes, ils savent évaluer la cohérence économique et financière des données, ils savent déterminer les enjeux. Voilà des personnes qui aident l'équipe des magistrats instructeurs à lire le dossier, et à le lire dans toutes ses dimensions. C'est ainsi que l'expertise financière peut retrouver le rôle qui aurait toujours dû rester le sien : après que les magistrats ont précisément circonscrit les problèmes techniques non résolus, ils saisissent l'expert, qui est appelé à fournir sur des points bien déterminés des réponses exclusivement techniques . Ces réponses sont dès lors plus rapides, moins coûteuses, et peuvent être examinées, appréciées, soupesées par l'équipe des magistrats instructeurs, aidés de leurs assistants spécialisés, avec davantage de recul et de professionnalisme. On évite ainsi les risques de démission ou d'erreur du juge ; au lieu de « vassaliser » l'expert, la justice lui redonne tout son rôle, mais rien que son rôle. Ce qui implique, de la part de ce dernier, une technicité pointue, une objectivité parfaite, une grande disponibilité et un certain désintéressement. Pour conclure, l'expert généraliste doit laisser la place à l'expert hyper-spécialisé. Dans des domaines extrêmement précis comme l'application des normes IFRS au plan international, l'adaptation des directives européennes ... la justice financière s'est extraordinairement complexifiée, elle s'est européanisée, elle s'est mondialisée. Ce qui conduit nécessairement à une très grande spécialisation et à une non moins grande exigence qualitative. C'est seulement à ce prix que l'on pourra atteindre les objectifs de sûreté et de célérité que la justice pénale s'est à juste titre fixés en matière financière. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je donne maintenant la parole à M. Patrick Matet, Conseiller à la Cour d'appel de Paris. Il a dirigé un groupe de travail sur l'expertise. Il m'a semblé, monsieur Matet, que vos analyses ne sont pas tout à fait convergentes avec celles du président Magendie. Mais vous allez nous le dire vous-même. M. Patrick MATET, Conseiller à la Cour d'Appel de Paris En prenant connaissance du thème des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation, je me suis demandé si, en associant les deux notions « expertise scientifique » et « décision de justice », vous n'aviez pas voulu signifier qu'il existe entre les deux un décalage irréductible, voire une opposition. Ce serait pourtant un paradoxe, car, a priori, la décision de justice relève du domaine du juge, lequel peut demander les lumières d'un technicien, sa formation ne lui permettant pas de répondre lui-même aux questions scientifiques ou techniques. Mais apporter des lumières au juge suppose que l'expert soit parfaitement compétent. S'il ne l'est pas, l'expert va entraîner le juge - mais aussi les avocats, les parties au procès et, au pénal, le parquet - dans l'erreur. Et plus la science à laquelle se réfère l'expert sera fine et pointue, plus il sera difficile de déceler son erreur. Nous mesurons chaque jour que nous sommes entrés dans l'ère des experts et qu'ils constituent la caution de toutes nos interrogations. Il n'est donc pas surprenant que ce mouvement touche la justice. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de filiation. Elle a dit que l'expertise biologique est de droit, privilégiant la vérité biologique de la filiation sur des considérations sociologiques. En conséquence, dès que les conclusions de l'expertise réalisée par la comparaison des empreintes génétiques sont déposées, le procès est virtuellement achevé, tant le juge est soumis à cette preuve scientifique. Pourtant le risque est grand de considérer, par un effet de contagion, que toutes les expertises sont scientifiques et que l'avis de l'expert vaut vérité. Deux affaires très médiatisées illustrent cette situation, qui ont provoqué de véritables séismes judiciaires. Dans l'affaire d'Outreau, on a confondu une analyse psychologique avec une vérité scientifique en donnant foi à un avis d'expert qui déclarait crédibles les déclarations d'enfants victimes. En sens inverse, l'affaire du mont Sainte-Odile nourrit des inquiétudes quant à l'expertise scientifique lorsque l'on constate que, près de quatorze ans après le crash d'un avion, aucune solution scientifique claire n'a été apportée pour expliquer les causes de cet accident alors que sept experts ont œuvré dans ce dossier. Aussi, la question qui se pose est celle de savoir comment renforcer la sécurité juridique en présence d'une expertise scientifique. La force de l'expertise est qu'elle constitue un des éléments essentiels du mécanisme du procès et qu'elle en est indissociable. C'est ce qu'exprime très bien la Cour Européenne des Droits de l'Homme lorsqu'elle dit, à propos d'une expertise française (affaire Mantovanelli contre France - 18 mars 1997), qu'elle est susceptible d'influencer de manière prépondérante l'appréciation du juge. La faiblesse de notre système d'expertise tient à notre difficulté de discuter les conclusions de l'expert, soit parce que toute critique utile en est impossible car les parties ou leurs avocats ne sont pas en situation de le faire pour des raisons matérielles, juridiques, intellectuelles ou psychologiques, soit parce que son rapport est inintelligible pour un profane. C'est pourquoi le choix de l'expert est déterminant : il doit diriger la controverse technique et scientifique et tenter, après épuisement du débat technique, de se forger une opinion qu'il fera partager aux parties et au juge. Aussi ma première réflexion concerne-t-elle la personne même de l'expert. Si l'on veut améliorer les conditions de la discussion lors des opérations d'expertise, il est nécessaire d'engager un débat judiciaire sur le choix de l'expert, ce qui permet de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les compétences techniques, processuelles et même la déontologie de l'expert sont en adéquation avec la mission pour laquelle il pourrait recevoir mission. Je pense même que l'on doit aller plus loin en laissant aux parties la faculté de choisir le nom d'un expert. C'est ce que favorise la procédure anglaise : le système classique de la common law ne connaît pas l'expertise judiciaire, et chaque partie possède la faculté de faire appel à son propre expert, qui a le statut de témoin. Depuis la réforme impulsée par Lord Woolf en 1999, réforme inspirée des modèles continentaux, le juge peut, dans une affaire donnée, décider qu'un expert unique sera désigné par lui, mais les parties ont le droit de choisir conjointement cet expert. Cette mesure est transposable en droit français puisque l'on constate qu'en 2004, au tribunal de grande instance de Paris, environ 600 expertises ont été ordonnées par le juge du fond, tandis que 6 000 l'ont été par le juge des référés, et que le dépôt du rapport dans ces affaires en référé sera assez rarement suivi d'une saisine du juge du fond. J'en veux pour preuve une étude menée à Rennes montrant que 20 % des expertises ne débouchaient pas sur une procédure au fond en raison de la transaction des parties. Je pense qu'à Paris la proportion est beaucoup plus importante. Ma deuxième observation est qu'il convient d'améliorer l'organisation du débat technique et scientifique. En effet, les parties se plaignent souvent d'être des spectatrices de l'expertise tandis que l'expert avance solitairement dans ses investigations techniques. L'organisation du débat judiciaire en droit anglais ou américain, où l'expert est interrogé et contre-interrogé par les parties - parfois rudement - favorise la vérité scientifique en raison de la confrontation des points de vue. Il faut donc que les parties, tant au civil qu'au pénal, participent plus activement au débat technique, et y soient associées plus étroitement, afin qu'elles n'aient pas le sentiment que leurs arguments ont été escamotés. En effet, si la discussion scientifique ne s'instaure pas durant les opérations d'expertise, elle sera différée et aura lieu devant le juge. Mais cette discussion sera théorique, car il s'agira d'une exploitation critique du rapport, d'une sorte d'exégèse sans relation avec la vérité scientifique et technique. Pour renforcer cette discussion technique, il est nécessaire que l'expert soit présent à toutes les étapes de la procédure. Or dès que l'expert a déposé son rapport, ni les parties ni le juge n'ont plus de contacts avec lui. Puisque le rapport de l'expert judiciaire constitue un élément de preuve apporté par un auxiliaire du juge, il n'est pas logique que cet expert disparaisse sitôt son rapport remis et que, lorsque le juge se pose des questions ou que les parties critiquent l'avis du technicien, il n'en soit pas référé au principal intéressé pour qu'il éclaire ses conclusions ou lève une zone d'ombre. Seule la cour d'assises procède systématiquement à l'audition de l'expert. La recherche de la controverse technique et scientifique a inspiré la procédure australienne, pourtant rattachée au système de la common law, avec l'instauration de la procédure dite du hot tub. Cette technique impose à l'expert de remettre un rapport écrit, puis les avocats, dans une audience uniquement consacrée à l'audition de l'expert, lui posent des questions selon le principe classique de la cross-examination, c'est-à-dire qu'il est interrogé et contre-interrogé. Cette phase particulière de la restitution de l'avis de l'expert permet de mieux cerner la vérité scientifique par le jeu de la confrontation des idées et des thèses différentes. Il est vrai que les experts français sont assez peu préparés à ce type d'exercice et que les juges redoutent qu'une nouvelle étape de procédure allonge les délais de l'instance. On dit souvent que la phase expertale constitue un véritable petit procès au cœur du procès lui-même. Mais il ne faudrait pas que l'on soit passé de la toute-puissance de l'aveu à la toute-puissance de l'expertise scientifique sans que des mécanismes de régulation se mettent en place pour que le jugement rendu soit le plus juste possible. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Madame Marie-Odile Bertella-Geffroy, vous êtes Vice-Présidente du tribunal de grande instance de Paris, où vous êtes chargée du pôle santé publique. C'est l'un des pôles que Mme Nocquet appelait de ses vœux. Vous avez souvent demandé un renforcement des moyens, compte tenu de la complexité des dossiers. Je souhaiterais connaître votre point de vue sur la notion d'illusion rétrospective, dont parle Olivier Godard. Comment est-on capable de juger, dix ans après les faits, quand l'évolution des connaissances scientifiques a abouti à des résultats différents de ce qu'ils étaient au moment des faits ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, Je vais commencer par répondre à cette dernière question. En effet, dans des affaires de santé publique importantes, comme le sang contaminé, l'hormone de croissance ou la vache folle, il convient de confier à l'expert la tâche de reconstituer l'état des connaissances scientifiques au moment des faits, connaissances d'alors sur le SIDA, sur le prion et sur leur transmission, par exemple. J'ai même parfois recours à des experts en vidéo qui retranscrivent différentes émissions d'archives, télévisées ou radiodiffusées, pour reconstituer les connaissances de l'époque. Dans les affaires du pôle santé publique, le rôle de l'expert est primordial. Ainsi que Mme Nocquet a eu raison de le souligner, le juge ne doit cependant pas se cacher derrière l'expert. Celui-ci donne un avis technique qui éclaire le juge, mais c'est au juge qu'il appartient de traduire en termes de responsabilité juridique les constatations et les conclusions de l'expert. Il importe de définir avec soin la mission d'expertise. Car pour obtenir les bonnes réponses, il faut d'abord poser les bonnes questions. C'est pourquoi j'insiste, comme M. le président Magendie l'a souligné, sur la formation, celle des experts mais aussi celle des juges, lesquels dans certaines matières doivent impérativement être spécialisés. Dans le domaine financier, dans celui de la santé publique, ou de la propriété littéraire et artistique, un magistrat qui n'est pas bien formé aura difficilement la capacité de poser les bonnes questions. Il faut également clairement distinguer entre l'expert scientifique et le scientifique lui-même. Le scientifique répond aux questions que se pose la science, alors que l'expert scientifique répond aux questions que pose le demandeur (le juge en l'espèce), dans le cadre d'un dossier particulier. La grande difficulté se trouve d'ailleurs être pour le juge, que les questions qu'il pose à l'expert, notamment dans les affaires de responsabilité médicale, peuvent être des questions que la science se pose encore. Quels experts peuvent aider l'institution judiciaire ? Nous faisons appel à des experts judiciaires, inscrits sur une liste et dont la spécialité y est définie. Les experts en santé publique sont très peu nombreux, à telle enseigne qu'il est parfois difficile d'en trouver, et nous devons parfois aller les chercher à l'étranger, où l'on peut, dans certaines spécialités très pointues, disposer de meilleurs experts. C'est également à l'étranger que sur certaines questions de santé publique on peut annexer à la procédure des rapports plus complets ou de meilleures conférences de consensus, auxquelles a participé la société civile. En matière de responsabilité médicale collective, les faits à l'origine du dommage datent souvent de plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années et les infractions spécifiques sont alors déjà prescrites. Il ne reste pratiquement plus que l'homicide ou les blessures involontaires qui peuvent s'appliquer car ils se prescrivent trois ans après la date du décès. Pour caractériser ces infractions il faut déterminer le dommage, l'existence de fautes involontaires, et le lien de causalité entre les deux :c'est essentiellement le travail que le juge demande à l'expert . Par exemple, la maladie de Creutzfeldt-Jakob peut prendre plusieurs formes : il y a les MCJ iatrogènes, qui ont une cause extérieure, comme l'hormone de croissance ou des greffes, les MCJ sporadiques, les MCJ génétiques et enfin les nouveaux variants de MCJ et chaque MCJ présente des lésions caractéristiques du cerveau. Comment déterminer si tel plaignant atteint de MCJ peut être recevable pour tel type de MCJ, lié à la vache folle ou à l'hormone de croissance ? Ce sont les experts scientifiques qui seuls peuvent donner ces réponses. Heureusement, les connaissances progressent, en particulier en biochimie. J'ai ainsi fait analyser par des experts de cette spécialité, à plusieurs stades de la procédure, des lots d'hormones de croissance de la période à risque qui avaient été saisis au début de l'instruction. C'est au tout dernier stade de l'instruction que des expertises ont enfin pu aboutir à des résultats, grâce à de nouveaux procédés d'analyse mis en œuvre par les progrès scientifiques. Il faut en outre analyser les mesures que les pouvoirs publics pouvaient prendre et celles qu'ils ont prises ou n'ont pas prises, ainsi que les raisons qui les ont conduits à les prendre ou à ne pas les prendre. Par exemple, les familles des victimes du nouveau variant MCJ (vache folle) qui s'adressent au pénal posent les questions : Pourquoi la France a-t-elle interdit les farines animales un an après le Royaume-Uni, après avoir acheté à moitié à prix celles qui étaient interdites outre-Manche ? Pourquoi a-t-on interdit les petits pots pour bébé contenant des abats, alors qu'on n'a pas interdit les abats eux-mêmes en même temps ? Il est nécessaire de recourir alors à l'expertise pour connaître l'état des connaissances scientifiques de l'époque: on rejoint là votre question initiale Le problème du lien de causalité entre le dommage et les fautes est essentiel au plan judiciaire. Il est très difficile, par exemple, d'établir que le nuage de Tchernobyl a été la cause de la survenue du cancer de la thyroïde de M. ou Mme untel car ceux-ci contrairement à certains cancers comme le mésothéliome, qui est signé amiante, ne sont pas signés nucléaire. Le juge d'instruction peut seulement tenter d'établir un lien de causalité d'ordre épidémiologique, global, en constatant une correspondance des mesures de radioactivité entre certaines zones françaises où l'exposition aux radionucléides émanant du réacteur de Tchernobyl aurait été plus importante qu'ailleurs, ce qui pourrait notamment être le cas dans certaines régions de Corse, et les zones voisines de Tchernobyl pour lesquelles il est reconnu par la communauté scientifique internationale une augmentation notable des cancers de la thyroïde chez les enfants. Voilà des questions que le juge doit se poser dans ces affaires et qui imposent le recours à des experts. Cependant il faut aussi parler des limites de l'expertise judiciaire. Dès lors que l'affaire comprend une dimension collective, la pluridisciplinarité des experts est nécessaire. Or, il est particulièrement difficile de trouver plusieurs experts judiciaires dans des spécialités où ils sont peu nombreux, à la fois compétents et indépendants Les experts peuvent avoir des avis contradictoires. Je pense au cas d'une infirmière qui s'était trompée de médicament et avait ainsi causé la mort d'un bébé de trois jours. Cette infirmière avait connu des problèmes psychiatriques. Un premier expert judiciaire en psychiatrie la disait responsable, un deuxième la disait irresponsable. J'ai demandé aux deux experts d'effectuer une expertise commune, après consultation des dossiers médicaux dans les hôpitaux psychiatriques que l'infirmière avait fréquentés. Ils ont pu alors, en confrontant leurs arguments, adopter une position commune, en l'espèce d'irresponsabilité pénale. Dans le système australien du hot tub, dit encore le chaudron bouillant, les experts se confrontent à l'audience. Peut-on arriver ainsi à une vérité scientifique, qui deviendra une vérité judiciaire ? C'est une vraie question. L'expertise a effectivement des limites, dont la plus importante est, alors qu'il y a au judiciaire nécessité d'établir un lien certain entre la cause et le dommage, l'incertitude de la science. Dans le cas de la vaccination contre l'hépatite B, c'est une controverse scientifique sur la réalité des effets secondaires de cette vaccination qui s'est traduite sur le plan judiciaire en incertitude sur le lien de causalité lorsque les victimes de sclérose en plaques ont déposé plainte en incriminant le vaccin. Une autre limite concerne la pluralité des experts qui sont rarement plus de trois pour une expertise judiciaire : peut-on considérer que leur expertise, parce qu'elle serait judiciaire, serait plus éclairante et convaincante qu'une expertise collective ? Il faut dire également que l'indépendance de l'expert n'est pas une garantie suffisante. L'expert peut aussi vouloir faire passer sa conviction scientifique. L'essentiel, c'est que les arguments de l'expert soient fondés, et qu'ils le soient sur des documents scientifiques. Par contre l'avantage des expertises judiciaires scientifiques c'est qu'elles sont argumentées sur des documents que le juge d'instruction a pu faire saisir. C'est un grand atout. Cela dit, ce ne sont pas effectivement des juges qui pourront trancher les controverses scientifiques. S'agissant des perspectives qui sont devant nous, je dirai qu'il y a deux solutions. Soit la justice accepte les limites et les incertitudes de la science, en comprenant qu'il n'y a pas de vérité intangible et unique, surtout quand il s'agit de pathologies humaines, et dans ce cas, il appartient à la justice de trouver des solutions proprement juridiques dans un contexte d'incertitude scientifique. Soit la justice pénale n'a plus sa place - la plupart des catastrophes sanitaires qu'elle traite datent des années 80 -, et dans ce cas il conviendrait à mon sens de recourir à ce que j'appelle « l'expertise pré-décisionnelle » pour précisément éviter le renouvellement de catastrophes similaires. Des agences de sécurité sanitaire ont déja été créées après le drame du sang contaminé, et celles-ci recourent à des expertises multidisciplinaires. Un statut d'experts pré-décisionnels, qui permettrait la séparation entre les scientifiques experts dans leur spécialité, et le décideur, pourrait être créé en s'inspirant de celui de l'expert post-décisionnel, autrement dit l'expert judiciaire avec ses garanties d'impartialité et de contradictoire, expert qui est en cas de dommages collectifs l'expert de la catastrophe et en quelque sorte à l'heure actuelle l'expert de l'expertise. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : On dit beaucoup que la loi de 2004 a fait progresser les choses. Certains affirment cependant que le législateur a manqué l'occasion d'aller plus loin dans la définition des relations entre juges et experts. Vous avez dit, Madame Nocquet, que le juge, à une certaine époque, avait démissionné devant l'expert. Vous avez également décrit une justice idéale, où un magistrat serait formé dans un domaine particulier en étant assisté de spécialistes. On n'en est pas encore là. S'agissant des OGM, Monsieur Belaval, des commissions se prononcent sur les précautions qui entourent les expériences en plein champ. Le problème est que c'est précisément ces commissions qu'une partie de l'opinion publique récuse. Toute la difficulté est de faire en sorte que les commissions ou les agences puissent rendre des avis qui ne soient pas contestés. Les jugements qui n'abordent pas cette question ne sont pas de nature à répondre aux attentes de l'opinion publique. En ce qui concerne le vaccin de l'hépatite B, il sera peut-être possible un jour d'établir un lien de causalité entre un vaccin et une hépatite. Mais on sait avec certitude dès aujourd'hui, globalement, en termes de santé publique, ce qui se passe si l'on vaccine une population et si on ne la vaccine pas. Un vaccin peut avoir un effet pervers, mais comment prendre une décision judiciaire quand on sait que, globalement, ce vaccin apporte un bénéfice pour une population ? M. Alain JAKUBOWICZ : Je pense qu'il faudrait se garder d'examiner la question de l'expertise judiciaire à travers le seul prisme des dossiers médiatiques. La réalité de l'expertise est évidemment bien différente. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Mme Nocquet. Cela dit, je voudrais faire trois remarques avant que les experts interviennent. La première est que l'expertise civile est différente de l'expertise pénale en ceci qu'elle est contradictoire : les parties sont présentes, ainsi que leurs conseils. Dans l'expertise pénale, les parties sont très souvent absentes, de même que leurs conseils. D'autre part, l'expertise se spécialise à un point tel que l'on assiste à l'émergence d'une profession d'expert, ce qui me semble contradictoire avec la fonction même de l'expert. L'expert devrait être choisi parce qu'il est un professionnel dans le domaine où on le consulte. Or, dans les affaires financières, par exemple, nous voyons des experts qui n'ont d'autre profession que celle d'expert. Dans le domaine de la santé, notamment en obstétrique, des pontes, de grands professeurs sont nommés experts alors qu'ils n'ont plus mis les pieds dans une salle d'accouchement depuis des décennies, ce qui ne les empêchera pas de donner des avis définitifs, lesquels seront in fine retenus par le juge. Et je ne parle pas de la vieille querelle entre l'hôpital public et le privé, qui vient singulièrement compliquer les débats. Enfin, on insiste à juste titre sur l'indépendance de l'expert. Mais quand les experts sont systématiquement nommés par certains juges ou certaines juridictions, quand ils sont devenus des professionnels de l'expertise, quand ils s'en sont fait, pardonnez-moi cette expression volontairement polémique, un fonds de commerce, peuvent-ils être véritablement indépendants ? M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Puisque M. Matet s'est interrogé sur le titre de notre table ronde, j'indique que nous avions d'abord pensé au titre suivant : « Les connaissances scientifiques au service de la recherche de la vérité, mais de plus en plus objets de litige »... Je donne maintenant la parole à M. Arnold Munnich, qui est membre de l'Académie des sciences, professeur à l'Université René-Descartes, et exerce au centre de génétique de l'hôpital Necker. M. Arnold MUNNICH, Membre de l'Académie des Sciences, Georges Brassens disait : « Il n'y a pas de vérité, il faut choisir entre plusieurs erreurs ». La science n'est pas une vérité. C'est un instantané de connaissances à un moment donné, ce qui est tout autre chose. Cet instantané change en fonction de données. Ces données, ce sont les concepts en cours, les idées ambiantes, les moyens d'exploration. La science brouille donc régulièrement les cartes pour le législateur. Elle ne fait pas bon ménage avec les certitudes. C'est pourquoi le savant n'a pas vocation à être un expert, et s'il devient un expert, il ne sera plus un savant. Je pense à ce verset du Coran : « Si tu vois un savant s'approcher des marches du palais, tu dois douter de sa science. » L'opinion se fait de la science une image exactement inverse. Elle s'imagine que la science comprend tout, peut tout, maîtrise tout. Or, nous savons, nous scientifiques, que nous progressons par une succession d'erreurs. L'erreur est un outil d'accès à la connaissance. Cela dit, le scientifique ne doit pas se dérober. Il serait trop facile de nous cacher éternellement derrière nos doutes. Je crois tout d'abord que l'on peut progresser en informant mieux les citoyens. Il y a un déficit d'informations important, qui est à la source de bien des difficultés qui existent entre les citoyens et les professionnels. Le contexte médiatique simplificateur et la judiciarisation de la médecine et de la science ne sont pas pour arranger les choses. Il conviendrait que des scientifiques puissent, sans pour autant être montrés du doigt, aller vers les médias et expliquer la réalité des choses. Deuxièmement, il nous faudrait mieux informer nos usagers, nos patients. En matière de génome, il y a une discordance entre la puissance de nos connaissances et notre impuissance à guérir et à prédire. Séquencer le génome, connaître tous les gènes, voire connaître une mutation dans un gène, cela ne signifie pas pour autant que l'on puisse prédire l'avenir ni traiter la maladie. J'en donnerai trois exemples. Un de nos collègues très proche est actuellement l'objet d'une plainte pour infanticide parce qu'il a procédé à une interruption médicale de grossesse en raison d'une hernie de coupole qu'il avait déclarée incurable. Le père porte plainte parce qu'il a lu, ou entendu, que l'hernie de coupole est parfois curable. Notre collègue avait considéré, en son âme et conscience, que l'affection du fœtus était incurable. L'appréciation du risque est extrêmement difficile. Avant la naissance, que dire de ce que l'avenir nous réserve ? Deuxième exemple, des familles nous interpellent, voire nous mettent en accusation pour des informations que nous leur avons données à une époque où les connaissances n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Je pense à des maladies métaboliques, ou la maladie dite des os de verre. Troisièmement, je voudrais souligner que la notion de « médecine prédictive » nous a fait un tort considérable. Ce terme malheureux, que l'on doit pourtant à un de nos plus éminents scientifiques, le professeur Jean Dausset, prix Nobel de médecine, est pour nous une véritable catastrophe. Dans l'esprit des gens, connaître le statut génétique d'un sujet signifie que l'on est capable de lire dans son avenir comme dans une boule de cristal. Il n'en est rien. Le fait de porter un gène de cancer du sein, de mort subite, de cardiomyopathie, ne permet en rien de prédire l'avenir. Si l'on prend des décisions sur la base d'une conception génétique, on s'expose à d'énormes erreurs. Il y a dans cette salle des gens qui ne seraient pas parmi nous s'ils avaient été l'objet d'un diagnostic prénatal. Beethoven aurait probablement été l'objet d'une interruption médicale de grossesse en raison d'une malformation d'un gène de l'oreille interne. On peut améliorer les choses. D'une part, en informant mieux les citoyens. D'autre part, en informant mieux les usagers. Enfin, en améliorant le système d'accès aux experts. Il ne faut pas hésiter, étant donné la très grande complexité des questions qui se posent, à référer les problèmes à l'expert compétent, et à un expert des experts. Or, les professionnels sont souvent trop orgueilleux pour admettre les limites de leur savoir. Il nous faudrait progresser dans notre capacité à douter de nous-mêmes. Le doute devrait être enseigné à la faculté de médecine. Je le répète, la science ne peut prétendre tout maîtriser. Le doute et l'erreur sont des outils de travail. L'idée que l'erreur est inacceptable constitue un frein aux progrès des connaissances. Si les scientifiques et les professionnels sont glacés, comme ils le sont aujourd'hui, par le risque de se tromper, la crainte d'être poursuivis, la crainte de l'expertise contradictoire, nous allons assister - nous assistons déjà - à une paralysie de l'innovation. Or, s'il existe un principe de précaution, il existe aussi un principe d'action. Il faut les mettre en balance. Peut-être pourrait-on progresser en associant les usagers à la prise de risque, à la prise de décision. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Vos propos vont dans le sens d'un « droit à l'intimité génétique »... J'estime d'autre part que les listes d'experts auprès des tribunaux devraient être, du moins sur certains sujets, nationales et non pas régionales. Elles devraient même parfois inclure des experts européens. C'est une réflexion que nous devons avoir. Nous allons nous tourner à présent vers la police. Monsieur Dominique Gaillardon, vous êtes commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur de la police technique et scientifique au sein de la Direction centrale de la police judiciaire. Nous allons vous demander quelles sont vos activités et quelle est la place de l'expertise dans les activités de la police. Le coût de l'expertise est également une question. J'ai cru comprendre que la LOLF faisait obligation d'établir des préavis en matière pénale. Si tel est le cas, peut-on procéder à toutes les investigations ? M. Dominique GAILLARDON, Commissaire divisionnaire, Adjoint au Sous-Directeur de la Police technique et scientifique de la Direction centrale de la police judiciaire Je précise tout d'abord que je ne suis pas un expert. Je voudrais attirer votre attention sur la place qui est désormais celle de l'élément scientifique et technique au sein de l'enquête. Je ne reviendrai pas sur l'élément scientifique en tant qu'élément de preuve auprès des juridictions d'instruction et de jugement, et insisterai avant tout sur le fait qu'il s'est maintenant imposé dans toutes les enquêtes de police judiciaire. Trop longtemps réservée aux manifestations les plus graves de la délinquance et de la criminalité, la police scientifique doit désormais lutter contre toutes les formes de délinquance, notamment la délinquance de masse. L'élément scientifique est devenu un facteur essentiel de l'élucidation des affaires, sans pour autant qu'il se substitue aux investigations classiques. C'est souvent par le recueil et l'exploitation des traces et des indices sur une scène d'infraction qu'apparaît le seul élément d'identification susceptible d'orienter les recherches. C'est notamment possible grâce à la création de grands fonds documentaires automatisés en matière d'empreintes digitales et d'empreintes génétiques. Dans les disciplines classiques de la criminalistique, les données du problème sont la plupart du temps assez simples. Il s'agit d'identifier une empreinte digitale, de trouver une trace biologique et d'en déterminer le profil, d'examiner des documents, de déterminer si telle arme a bien tiré le projectile retrouvé sur une scène d'infraction. Ces problèmes sont simples dans leur formulation, mais n'en sont pas moins lourds de conséquences pour la personne susceptible d'être mise en cause et pour la réparation des préjudices subis par les victimes. Depuis une vingtaine d'années, un dispositif de police technique et scientifique a été élaboré. C'est à la DCPJ et une direction spécialisée créée au sein de celle-ci en 1985 qu'est revenue la charge d'opérer le renouveau de la police technique et scientifique française, qui avait pris du retard par rapport aux autres pays européens. Nous avons aujourd'hui des instruments comparables à ceux dont disposent ceux-ci, sur le plan technique, scientifique, mais aussi législatif. Nous disposons de près de 1 800 fonctionnaires spécialisés, auxquels il faut ajouter plusieurs milliers de policiers de terrain qui sont formés aux actes de base très importants destinés à alimenter les fonds documentaires et à rechercher les traces sur les scènes d'infraction de la délinquance de masse. Je ne parle ici que de la police, mais la gendarmerie a également un dispositif, peut-être plus centralisé autour de son Institut de recherche criminelle. Celui de la police est constitué de services centraux, de services régionaux dans les SRPJ, de services locaux au sein des circonscriptions de sécurité publique. Il faut y ajouter cinq laboratoires de police scientifique, regroupés depuis cette année au sein d'un établissement public, l'Institut national de police scientifique. Notre action est, depuis l'origine, guidée par trois axes : améliorer les outils de criminalistique, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ; mettre en œuvre les outils de la police technique et scientifique au profit des enquêtes de toute nature, notamment en réponse à la délinquance de masse ; faire descendre les prestations initialement définies dans les laboratoires des services centraux au plus près des services d'enquête, dans un souci de rapidité et de proximité. La police technique et scientifique participe à la mission d'expertise. Mais c'est là un concept qui s'est révélé insuffisant. Des membres de nos laboratoires ont été inscrits sur des listes d'experts, ce qui, pour diverses raisons, est moins fréquent depuis 1995. Dans les autres services, des fonctionnaires sont régulièrement désignés experts dans le cadre d'une procédure pénale. Cette conception de l'expertise est insuffisante en raison de la place quasi permanente de la police scientifique et technique dans toutes les enquêtes et à tous les stades de l'enquête. Le code de procédure pénale, en son article D7, a donné un statut aux actes d'expertise scientifique et aux examens techniques et scientifiques permettant, à partir de 1972, leur introduction dans le cadre de l'enquête préliminaire, en amont de l'intervention du juge d'instruction. Si le code de procédure pénale a évolué en la matière, c'est notamment à la suite d'une suggestion faite par le Conseil supérieur de la police technique et scientifique et par son groupe criminalistique, qui réunit magistrats, policiers et gendarmes. Nous attachons de l'importance à ces examens techniques et scientifiques : formation de nos personnels, élaboration des protocoles de travail, contrôles qualité. Ils se situent maintenant dans un cadre européen, à travers le réseau des laboratoires de police qui a reçu du Conseil de l'Europe mission d'harmoniser les procédés de travail. Nous avons l'ambition que ces examens soient de même nature que les travaux d'expertise : les rapports sont les mêmes, seules les pages de garde diffèrent. Ces examens, selon moi, n'obèrent pas le recours à l'expertise puisque la plupart sont reproductibles et que certaines dispositions ont été complétées : par exemple, la nécessité d'avoir l'autorisation expresse du magistrat concerné à ce stade de l'enquête si l'examen technique et scientifique entraîne un risque de destruction ou d'altération grave de la pièce. Un tout dernier point, pour vous montrer que l'expertise occupe une place réelle, même si elle n'est pas quantitativement la plus importante : en 2004, juste avant qu'ils ne deviennent Institut national de police scientifique, les simples LPS avaient traité 3 125 expertises au cours de l'année soit à peu près autant qu'en 2003, mais 39 394 réquisitions contre 16 543 en 2003. Dans la même période, les services centraux et territoriaux de la sous direction de la DPS avaient traité 469 expertises et mené 564 réquisitions. 60 000 travaux techniques, soit sous forme de réquisitions, soit en prolongement des dispositions de l'article D7 du code de procédure pénale, avaient été traités par l'ensemble de ces services de police technique et scientifique. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Madame Sandrine VALADE, vous êtes responsable de la section biologie du laboratoire de police scientifique à Paris. Je vous donne la parole. Mme Sandrine VALADE, Ingénieur en Chef, Je suis également expert, exerçant depuis dix ans dans ce laboratoire qui, avec les autres laboratoires de police scientifique de France, vient d'être regroupé dans l'Institut national de police scientifique ou INPS. Ma présentation sera un témoignage d'expert sur l'expertise scientifique au sein du processus pénal. La qualité d'une expertise dépend de la compétence, de l'indépendance, de la probité des experts et de la démarche de l'expertise elle-même, dont on exige de plus en plus souvent la transparence et la justification. L'investigation génétique dans le domaine judiciaire n'échappe pas à ces exigences, encore amplifiées par les capacités d'identification d'une personne qu'apportent ces résultats. Le développement exponentiel de cette spécificité impose des réflexions que je vais tenter ici d'alimenter en vous exposant le principe de l'investigation génétique, sa spécificité, son évolution, ses difficultés ainsi que les perspectives envisagées dans ce domaine. Les analyses génétiques sont réalisées à partir de traces, d'origine biologique, recueillies sur les lieux de crimes ou de délits. Ces éléments, dits de question, sont comparés aux prélèvements de la victimes ou d'un ou plusieurs auteurs. Ces analyses génétiques peuvent être demandées sous forme d'ordonnances d'expertise par le juge d'instruction ou de réquisitions par les magistrats du parquet ou des officiers de police judiciaire, qu'ils soient policiers ou gendarmes. Bien que le principe de l'investigation génétique dans le domaine judiciaire puisse apparaître simple, sa concrétisation n'en demeure pas moins complexe. Ce domaine d'activité est réglementé par un décret du 6 février 1997 modifié le 25 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire. Une commission dite d'habilitation, composée de spécialistes et de magistrats, contrôle, outre la qualification des experts, les moyens humains et matériels dont ils disposent et s'assure également que la fiabilité des locaux est compatible avec le niveau d'exigence que requiert ce type d'analyses. Pour être expert en empreintes génétiques dans le domaine judiciaire, il faut être d'une part être inscrit sur une liste de cour d'appel, et d'autre part être habilité par cette commission d'habilitation. D'une manière générale, les textes régissant l'expertise ont évolué : formation obligatoire, inscription à renouveler, conformément au décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires dont nous avons déjà parlé. Les difficultés de l'expertise sont nombreuses. J'ai choisi de vous parler des principales, qui sont d'ordre scientifique et volumétrique. Sur le plan scientifique, l'expert va devoir détecter la trace ou l'indice intéressant, puis en estimer la pertinence par rapport au contexte de l'affaire. Dans le cadre d'une affaire criminelle, par exemple, où de nombreux objets ont été saisis, son rôle sera de rechercher les indices intéressants parmi tous ces objets transmis, afin d'aider la justice à confondre l'auteur. Le choix de l'expert sera déterminant. L'interprétation des résultats requiert également un bon professionnalisme, associant expérience et compétence. L'expert doit rendre l'interprétation écrite et verbale compréhensible, notamment lors des dépositions en cour d'assises. Cette interprétation peut être complexe. A l'issue de nos analyses, le profil génétique détecté peut être inexploitable : soit l'ADN était dégradé, soit le prélèvement effectué ne supportait pas assez de cellules, soit encore inexploitable car nous nous trouvons en présence d'un mélange d'ADN tel que l'interprétation en devient impossible car trop peu significative. En outre, le travail sur l'ADN dans le domaine judiciaire exige d'énormes précautions. La fiabilité des résultats dépend en amont des méthodes de prélèvement drastiques sur la scène d'infraction, là où les techniques utilisées en laboratoire sont extrêmement sensibles et imposent de strictes précautions d'usage. L'expertise en génétique judiciaire représente une avancée considérable pour la justice. C'est un élément de l'enquête important qui se fonde sur des éléments matériels. Mais il faut garder en mémoire que l'expertise ne fournit pas la preuve d'une culpabilité, mais celle d'un fait matériel. Les indices peuvent être plus ou moins pertinents. En effet, que signifie un ADN détecté sur un mégot ? Qu'une personne a fumé ou touché ce mégot, c'est tout. Seule la totalité des éléments du dossier permettra de dire si ce résultat est déterminant. Mais que représente de l'ADN extrait de sperme, mis en évidence sur un prélèvement gynécologique d'une fillette victime d'un viol ? Autre difficulté, celle qui a trait à la volumétrie : le FNAEG, fichier national automatisé des empreintes génétiques créé par la loi du 17 juin 1998, a pour objectif d'identifier les auteurs présumés de crimes ou de délits ainsi que des personnes disparues par rapprochement entre des traces non résolues et des profils génétiques de personnes. Tous ces profils génétiques, qu'il s'agisse de traces ou de personnes, proviennent de tous les laboratoires habilités en France pour ce type d'analyses. Initialement, l'intégration de ces profils génétiques, qu'il s'agisse de traces ou de personnes, n'était prévue que pour les infractions de nature sexuelle. Mais la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu ce fichier à toutes les infractions criminelles. Enfin, la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a marqué une nouvelle étape dans l'extension de ce fichier, qui peut désormais être sollicité pour la quasi-totalité des crimes et délits d'atteinte aux personnes et aux biens. La gestion de cette évolution a été et reste encore délicate pour les laboratoires. Concomitamment à l'évolution des textes, le nombre de saisines a considérablement augmenté. Les demandes d'envois au FNAEG de profils génétiques de personnes condamnées ou suspectées ont augmenté de 600 % entre 2002 et 2004, passant de 980 saisines à 16 300 pour le seul laboratoire de Paris. S'agissant des traces trouvées sur les lieux, nous avons procédé à 6 000 analyses en 2002, 8 000 en 2003 et plus de 10 000 en 2004. La croissance a été exponentielle. Les laboratoires scientifiques de police scientifique, sous-dimensionnés pour une telle augmentation d'activité, n'ont pu répondre à la demande. Ce n'est que tardivement qu'ils ont été renforcés en personnel et dotés en matériel. L'amélioration passera par une réorganisation structurelle, une évolution informatique, et un relationnel à développer avec nos demandeurs. Actuellement, les laboratoires de police scientifique mettent en place deux chaînes d'analyse distinctes : l'une qui va analyser les prélèvements sur les personnes, prélèvements qui sont maintenant standardisés et dont les étapes analytiques peuvent être semi-automatisées, et l'autre qui concerne l'analyse des traces, laquelle ne fait pas appel à des prélèvements standardisés, puisque chaque affaire est différente et que seules quelques étapes analytiques peuvent être automatisées. En outre, une plate-forme automatisée pour les prélèvements sur les personnes va être créée au laboratoire de police scientifique de Lyon avec une capacité de 135 000 profils génétiques par an. Les chaînes d'analyse sont développées selon une démarche qualité dans laquelle les laboratoires se sont engagés. Outre la finalisation de ces processus dans les laboratoires, l'un des objectifs majeurs est la transmission au FNAEG, en temps réel, des profils génétiques générés dans les laboratoires. La transmission automatisée des informations permettrait d'éviter que les opérations manuelles d'alimentation de celui-ci ne constituent un goulet d'étranglement. Les saisines sont de plus en plus nombreuses, les délais exigés par les magistrats et les services requérants sont de plus en plus courts et la pression exercée sur les experts est réelle. Pourtant, il reste essentiel de consacrer du temps à certaines affaires. Les analyses d'urgence sont maintenant quotidiennes. Elles requièrent une organisation particulière et peuvent être demandées suite au placement d'un individu en garde à vue. Ces analyses peuvent permettre d'éviter un placement en détention provisoire sur de simples soupçons par exemple. Il peut être important également de savoir s'il y a de l'ADN exploitable avant de prévoir une interpellation ou encore s'assurer d'un mode opératoire identique est effectivement la conséquence de l'agissement d'un même auteur. L'investigation génétique est un carrefour entre science, police et justice. Ce n'est qu'après une concertation étroite et constante entre ces différents partenaires que sera assurée l'efficacité du processus. Enfin, la génétique judiciaire doit pouvoir être utilisée par les magistrats et les services d'enquête comme un moyen puissant et réactif d'investigation. Pour cela, l'Institut national de police scientifique, représenté par ses experts judiciaires, devra assurer l'efficacité du processus et obtenir la reconnaissance du savoir faire criminalistique au service de la recherche de la vérité. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Après avoir examiné les moyens d'investigation et l'organisation du service public de la justice dans le cadre de l'expertise, nous allons passer à l'audition des experts et des représentants des compagnies d'experts. M. Jakubowicz avait déjà lancé le débat en disant que les experts ne devaient pas devenir des professionnels. Qu'en pensent-ils donc ? M. François Fassio, qui est le président de la fédération nationale des compagnies judiciaires, s'exprimera le premier. M. François FASSIO, Président de la Fédération nationale des Compagnies d'experts judiciaires Intervenant après d'éminents magistrats, académicien, et responsables de la police technique et scientifique pour parler de l'expertise judiciaire, vous voudrez bien excuser quelques unes de mes réflexions qui seront redondantes par rapport à tout ce qui vient d'être brillamment évoqué. Mais j'ai tenu à rappeler dans quel cadre légal et réglementaire cette expertise s'insère dans le processus judiciaire. Les articles 232 du nouveau code de procédure civile, 156 du code de procédure pénale et R. 621-1 du code de justice administrative consacrent la possibilité pour le juge de faire appel à un technicien pour l'éclairer par une expertise sur des questions de fait qui requièrent ses lumières. Qui est donc cet expert judiciaire ? Aux termes de la loi du 11 février 2004 et de son décret d'application du 23 décembre 2004, c'est un technicien figurant soit sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation, soit sur une de celles dressées par chaque cour d'appel. Cependant, les magistrats peuvent aussi faire appel à des techniciens non inscrits sur ces listes. Afin d'obtenir ce titre, le technicien doit, dans un premier temps, prouver son expérience et ses connaissances dans la technique ou la science considérée puis, après une période probatoire de deux ans et ensuite tous les cinq ans, se soumettre à une procédure de réinscription. Dans ce cadre, il aura notamment à justifier la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines. Il doit, par ailleurs, exercer une profession et mettre sa compétence et une partie de son temps et de ses moyens au service de la justice, en respectant d'une part les obligations de son statut individuel constituées par la loi et le décret de 2004, d'autre part les codes de procédure civile, pénale et des tribunaux administratifs, qui doivent être son référentiel. La fonction d'expert judiciaire est exercée à l'occasion de chacune des missions qui lui sont confiées par une décision qui précise, de façon détaillée, sa mission à réaliser dans un délai fixé en vue d'aboutir à un rapport qui devra, en éclairant le tribunal sur une ou des questions de fait, lui permettre de résoudre en droit un des très nombreux litiges qui lui sont soumis portant sur des problèmes relevant de techniques variées, très nombreuses et d'importances différentes aux niveaux économique, financier, social et humain. C'est à ce stade que se présente au juge une difficulté, qui consiste à mettre en adéquation l'objet technique du litige, le choix d'un expert compétent pour l'éclairer et la définition de la mission. Concernant le choix d'un expert en fonction de la nature technique du litige, les tribunaux sont aidés par la composition des listes qui classent les experts par grandes branches d'activités : agriculture, art - culture, bâtiment travaux publics, économie et finances, industrie et santé. Ces branches sont décomposées en rubriques, elles-mêmes subdivisées en spécialités, dans le cadre d'une nomenclature nationale qui vient d'être mise à jour. Cependant, le seul critère de la compétence technique ou scientifique n'est pas suffisant. L'importance économique, financière, sociale et humaine du litige peut nécessiter la nomination d'experts ayant un haut niveau d'expérience et de qualification. En effet, la mission ne pourra pas être confiée au même type d'expert s'il s'agit d'un dégât des eaux ou du crash du Concorde, d'une jambe cassée ou d'une recherche génétique, de l'examen de la comptabilité d'un petit commerce ou des mouvements de fonds d'une grande banque, et je pourrais multiplier à l'infini les exemples. Les techniques étant de plus en plus complexes et, de surcroît, en évolution constante, la demande du justiciable en matière de preuve scientifique étant parallèlement de plus en plus pressante, de nombreuses missions d'expertise nécessitent l'intervention de techniciens devant posséder, outre des compétences dans son domaine d'activité, une forte expérience en matière de procédure, une grande pédagogie, un sens analytique développé et d'importants matériels d'analyse. Dans le cadre de ces opérations, l'expert, comme le juge, étant tenu au grand principe du contradictoire - en matières civile et administrative - cela permet de mettre en valeur l'apport et les responsabilités des parties. Pour des litiges de grande importance, l'expert judiciaire sera amené à travailler dans le cadre d'un réseau multidisciplinaire, à travers un processus de recherche et d'analyse des divers éléments techniques du problème posé, suivi d'une délibération entre les divers intervenants pour une mise en commun du résultat de leurs études. Pour que les tribunaux puissent arriver à sélectionner les experts en fonction de l'importance des litiges et de la complexité des problèmes posés, la Fédération nationale des compagnies d'experts judiciaires a chargé une commission ad hoc, non seulement d'établir un programme détaillé des formations à donner aux experts débutants pour leur faire connaître l'organisation judiciaire, les principes directeurs du procès et les règles relatives à la déontologie, à la procédure et à la conduite des opérations d'expertise, mais encore de prévoir des sessions de recyclage avec actualisation des connaissances, jeux de rôle, afin de placer les experts au plus près des conditions rencontrées au cours des opérations d'expertise, mise en place de comités pédagogiques par ressort de cour d'appel, développement des connaissances en matière de psychologie, en un mot tout ce qu'il est nécessaire de connaître pour être un expert au plus haut niveau au service de la justice. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : M. Alain Karleskind est président d'honneur de la Compagnie des ingénieurs experts près la Cour d'appel de Paris. Mais avant de lui donner la parole, je pense qu'il convient de clarifier les positions et de déterminer quels sont les problèmes. Mme Nocquet a fait remarquer tout à l'heure que certains grands dossiers demandaient des spécialisations. Le juge peut avoir à affronter cinq ou dix parties, des bureaux conseils, des avocats spécialisés. Il faut donc travailler en équipe, d'abord dans des pôles spécialisés, ou simplement parce que le juge en décide ainsi et s'adresse à des experts reconnus. Est-on parvenu à un équilibre ? La « nouvelle » loi commence déjà à dater. M. Matet a dit à peu près la même chose. Il a distingué plusieurs phases dans l'instruction d'un dossier. J'ai été assez sensible aux thèses qu'il a avancées. M. Fassio vient de dire qu'un expert ne pouvait plus être seulement un technicien. Il doit acquérir des connaissances procédurales car il a en face de lui des spécialistes de la question. Monsieur Karleskind, pouvez-vous nous dire si la situation actuelle est satisfaisante et répondre à M. Jakubowicz ? M. Alain KARLESKIND, Président d'honneur de la Compagnie des Ingénieurs experts près la Cour d'Appel de Paris Monsieur le Président, la réponse à la question que vous me posez viendra peut-être en conclusion de mon propos. J'entends vous faire part de la réflexion et du point de vue des ingénieurs experts judiciaires, qu'ils ont tenté d'exprimer lors de leur congrès d'avril 2005. Ils y ont examiné les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'expertise judiciaire dans leur domaine respectif, à une époque marquée par l'évolution du cadre législatif relatif à la fonction expertale, ayant eu pour objet d'améliorer la qualité des expertises, notamment par une meilleure sélection et formation des experts et de remédier à certaines critiques sur la réalisation des expertises, notamment en matière de délais ou de coûts, en rappelant que l'expert n'est que l'un des acteurs de la procédure expertale. Époque marquée également par une évolution de la technologie, de l'économie ainsi que du contexte sociologique et de plus en plus médiatique constituant l'environnement de l'expertise judiciaire. Cette réflexion leur est apparue importante, compte tenu de la gravité des conséquences des résultats des expertises judiciaires pour les justiciables. L'expertise judiciaire participe en effet de manière importante, voire capitale, au traitement des litiges, des conflits qui sont les pathologies de l'ensemble des activités de notre époque, indépendamment de leur nature et de leur dimension. A titre d'information préliminaire, il peut être signalé qu'en 2005, 500 missions d'expertise, tous domaines confondus, auraient été ordonnées par le Tribunal de commerce de Paris, contre 1 000 il y a quatre ou cinq ans et que 5 000 auraient été ordonnées dans les mêmes conditions par le Tribunal de grande instance de Paris, cette année aussi, avec le même ratio de réduction dans le temps. Cette réduction du nombre des procédures se serait accompagnée a contrario, pour nombre d'entre elles, du développement de leur importance. Il faut savoir par ailleurs qu'il n'existe pas, à notre connaissance, de données précises sur leur nombre à l'échelon national et pas davantage sur leurs divers et multiples impacts économiques, qui, de notre point de vue, sont loin d'être négligeables. Toujours à titre d'information, il est estimé, essentiellement dans le domaine des litiges relevant du champ d'intervention des ingénieurs experts, que 80 % sont traités dans le cadre de procédures amiables, en particulier par et avec l'aide des assurances. Les 20 % restants relèvent donc de procédures judiciaires et 80 % de ces dernières ne feraient pas l'objet de procédures au fond, ceci en général après dépôt du rapport des experts à la suite, par exemple, de l'intervention d'une transaction. Cela signifie qu'environ 5 % des litiges, généralement les plus compliqués, feraient finalement l'objet d'une procédure au fond. Au risque de choquer un peu certains, je dirais que l'expertise judiciaire dans le champ d'activité des ingénieurs experts ne relève pas du domaine de la science fondamentale. Elle est davantage du domaine de la science appliquée, et plus précisément de celui de la technologie, avec en général un concept négatif. En effet, le but de son exécution n'est pas de savoir pourquoi et comment un système fonctionne, mais de comprendre pourquoi et comment il s'est avéré défaillant. Du fait de l'évolution technico-économique et, fréquemment, du regroupement des entreprises, du fait aussi de l'effet sériel et de la dimension, souvent nationale, à terme européenne, voire mondiale, et donc de l'impact et de l'ampleur de certains litiges, il est apparu aux ingénieurs que dans nombre de cas il en résultait un certain nombre d'obligations au niveau de l'évolution de la fonction expertale. D'une part, l'expert ne peut plus être sélectionné au seul titre de son savoir, de son expérience, mais de son aptitude à écouter, à communiquer, en un mot de sa compétence dans le management des situations conflictuelles que sont les expertises judiciaires. D'autre part, l'expert risque, compte tenu de la dimension prise par certains litiges, tant du point de vue de la technique expertale que de la technique technicienne, de ne plus pouvoir fonctionner en homme seul, de surcroît de manière complémentaire à son activité principale. Et on touche là au problème du professionnalisme de l'expert dans certains domaines. Cela étant, le système de l'expertise à la française, principalement dans le domaine des procédures civiles, de par la stricte application des directives du nouveau code de procédure civile qui constitue un excellent référentiel, est très satisfaisant. Il permet, selon les propos de M. Comte-Sponville, philosophe qui s'est intéressé à notre fonction : à l'expert de dire le vrai, à l'avocat de dire l'utile, au magistrat de dire le juste. Il assure au juge, contrairement au système anglo-saxon, un échelon de sécurisation de son jugement en lui permettant de suivre, d'interpréter ou de rejeter l'avis de l'expert. Compte tenu de l'amalgame existant souvent, de fait, entre toutes les expertises au niveau des services du contrôle des expertises des tribunaux, et malgré l'existence d'une modification récente - la loi du 11 février 2004 et son décret d'application du 23 décembre 2004 -, justifiée et fondée, du système de fonctionnement des experts, il serait souhaitable que dans le cas des litiges particulièrement importants, par suite des difficultés rencontrées - AZF - ou des délais nécessaires - mont Sainte-Odile - dans l'élucidation de la cause des désordres, il soit procédé à une réflexion sur l'adaptation des moyens de l'expertise aux caractéristiques des problèmes à traiter. Il est en effet très souhaitable que l'expertise judiciaire ne puisse, à terme, être considérée comme un maillon faible de la procédure. Cela, bien évidemment, pour une meilleure administration de la justice. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Nous allons maintenant auditionner les quatre experts qui se trouvent autour de cette table et représentent la profession, en commençant par M. Jean-Marie Heisser, président d'honneur de la compagnie des experts judiciaires près la cour d'appel de Nancy. M. Jean-Marie HEISSER, Président d'honneur de la compagnie française des experts judiciaires près la Cour d'Appel de Nancy De par une longue pratique de l'expertise, essentiellement dans le cadre judiciaire, à la suite de nombreuses années de présence et d'animation en structures représentatives des experts, je pense être en mesure d'énoncer des idées qui me semblent fortes sur les évolutions nécessaires de la pratique expertale. Il m'appartient d'évoquer ici deux thèmes, le second étant le corollaire du premier : la mutation du concept d'expert vers le concept d'expertise et la nécessité du professionnalisme dans le management de l'activité expertale. Il s'agit d'abandonner l'idée traditionnelle que le donneur d'ordre fait appel à un expert au profit d'une conception plus moderne : c'est la procédure qui demande un acte d'expertise. A cette demande d'acte d'expertise, il doit être répondu par le déroulement d'une procédure de maîtrise d'œuvre expertale, au bénéfice d'une instruction technique transparente, et le tout au travers d'une méthode scientifique. Transcrite dans le langage judiciaire, cette idée devient l'interrogation suivante : le juge fait-il appel à un expert ou demande-t-il une expertise scientifique judiciaire ? On sent bien que l'« acte de justice » - acte de souveraineté tel que l'évoquait le Premier Président Drai - est partagé entre ces deux pôles puisque, si l'article 232 du nouveau code de procédure civile fait référence à une personne, à savoir l'expert, en revanche l'article R 621-1 du code de justice administrative prévoit, quant à lui, que la juridiction ordonne un acte d'expertise. Mais qu'est-ce qu'une expertise ? C'est un acte intellectuel et méthodique, dont la finalité est d'exprimer le vrai ou, plutôt, pour reprendre une heureuse reformulation due au philosophe André Comte-Sponville, l'expertise doit dire le « possiblement vrai » ou le « certainement faux ». Pour reprendre aussi l'expression de Patrick de Fontbressin en octobre 1999 à la Biennale de Poitiers sur la protection de l'expert judiciaire, « l'expert est le débiteur du vrai, au profit du juge qui est le débiteur du juste ». Cela dans un instant donné, à une époque donnée. Cet énoncé confirme qu'il y a bien une vérité technique, le vrai, et une vérité judiciaire, le juste. Quelles sont les frontières géographiques et politiques de notre réflexion ? Rien moins que notre monde tout entier ! En effet, s'il y a mondialisation dans le développement et les évolutions économiques et techniques, il ne peut être imaginé qu'il n'y ait mondialisation aussi dans la manière d'exprimer la vérité technique, puisque le vrai est universel. Les systèmes judiciaires peuvent varier, le « juste » romano-germanique peut différer de celui de la common law ou de la charia, mais nul ne peut concevoir que le « vrai » soit sensible à la longitude ou à la latitude, aux frontières ou à toute autre considération. C'est donc sans risque que nous pouvons convier à notre réflexion les contributions des juges, des scientifiques et des experts du monde entier. Le monde anglo-saxon, et en particulier nord-américain, nous offre quelques belles anticipations sur l'encadrement des techniques d'expertise. J'évoquerai, pour l'illustrer, la règle fédérale 702 sur l'acceptation générale, reconsidérée par le jugement Daubert de la Cour suprême des États-Unis du 28 septembre 1993, il y a plus de dix ans. En substance, le principe des conclusions d'expertises fondées sur une norme d'acceptation « générale » est maintenant supplanté par le principe de conclusions d'expertises fondées sur une méthode déjà testée, publiée, normalisée et « largement » acceptée, et dès lors que l'expert peut également démontrer qu'il sait appliquer et maîtriser cette méthode. On peut traduire les conséquences de la décision Daubert en affirmant qu'une expertise n'est ni un témoignage, ni une opinion, qui sont par ailleurs tout à fait acceptables dans une controverse, mais qui ont un autre « statut » scientifique ou judiciaire que l'expertise. En revanche, une expertise est l'expression d'une vérité technique étayée par une méthodologie acceptée en préalable dans un débat où la transparence, la justification et la contradiction sont trois règles cardinales -toujours dans un instant donné, en fonction de l'évolution des connaissances. Par ailleurs, l'indépendance apparente, récemment visée par le CEDH, et donc l'objectivité de l'expert découleront de la méthode, et non plus l'inverse. Le contexte démocratique actuel, notamment énoncé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, énonce le principe d'un procès équitable, dans tous ses actes, et en particulier dans les actes d' « instruction confiée à des techniciens », c'est-à-dire, d'expertise. C'est une nouvelle exigence dans laquelle, certes, les qualités de l'expert figurent toujours, mais, dans le nouveau contexte démocratique, ces valeurs qualitatives ne sont plus suffisantes. La personne, entité physique, morale et intellectuelle qu'est l'expert, doit s'effacer ou, à tout le moins, être en recul devant son acte expertal. Il faut donc bien affirmer qu'il existe, dès lors, une indispensable philosophie de l'expertise. En effet, l'expertise est la traduction de la recherche, d'une part, et de l'expression, d'autre part, d'une vérité technique. Cette vérité technique ne sera jamais décelable par les seuls moyens d'un débat purement judiciaire. Elle sera toujours issue d'un débat contradictoire suivant une méthode rigoureuse. Comment parvenir à cette rigueur méthodologique ? La réponse s'impose : c'est au travers d'une normalisation, au travers de règles de méthode qu'il pourra y avoir aboutissement de cette recherche. Deux évènements concrétisent cette volonté méthodologique du monde expertal : en premier temps, la publication de la norme NFX 50.110 en mai 2003 par l'AFNOR sur « les prescriptions générales de compétences pour une expertise ». Ces prescriptions édictées concernent les expertises les plus diverses, dont on exige transparence et justification. En second temps, la réflexion actuelle de l'Institut des hautes études sur la justice animée par M. Antoine Garapon et portant sur le thème « incertitude et expertise ». En matière d'expertise judiciaire, comme de toute autre expertise, qu'elle soit de risque, c'est-à-dire pré-événementielle, ou de responsabilité, c'est-à-dire post-événementielle, on ne peut plus imaginer une démarche individuelle et péremptoire de l'expert : l'argument d'autorité n'est plus acceptable. Le corps expertal est largement conscient de cette nécessité d'évoluer vers une méthodologie débattue et acceptée en préalable. Cette nécessité implique, toutefois, une sérieuse réflexion pour une évolution vers une contractualisation de l'acte expertal, qu'il soit judiciaire, public ou civil. Par « contractualisation », nous entendons l'accord préalable de deux ou plusieurs volontés pour parvenir à la réponse à une question selon les principes énoncés précédemment dans un cadre prévu a priori. Un certain nombre d'évolutions de l'organisation interne du corps expertal est évidemment nécessaire pour cela, en particulier un professionnalisme générant une « professionnalisation » au double sens du terme : au sens spécialisé d' « organisation réglementée d'une activité d'auxiliaire de justice » et, bien sûr, au sens commun où le professionnalisme s'oppose à l'amateurisme. Selon moi, la nécessaire évolution du statut de l'expert demande un corollaire : un nouveau statut pour l'expert, c'est-à-dire une évolution vers un véritable professionnalisme expertal, et donc vers une profession au sens administratif du terme, même si cette profession n'est pas exercée à plein temps. Le débat sur la professionnalisation des experts a été obscurci pendant trente ans par la confusion entre « profession » et « occupation unique ». Pourtant, par exemple, on peut être à la fois expert-comptable et commissaire aux comptes et appartenir ainsi à deux professions différentes. Enfin, la fiabilité du technicien nécessite des outils pour permettre une réactivité procédurale de l'expert, et donc sa disponibilité, une mise à disposition de moyens techniques et humains spécifiques à l'acte expertal, une pratique expertable sans cesse réactivée et enfin, et surtout, le maintien de l'activité professionnelle de base de l'expert. Ces derniers moyens se traduisent par un double professionnalisme permettant de confier l'expertise à un technicien qui devra être continuellement baigné dans sa source d'activité professionnelle, vivant ainsi l'évolution de sa science tant au sujet des acteurs qui l'animent que dans les techniques de la dite science et régulièrement acteur de l'acte expertal, impliquant donc une acquisition d'un savoir dans la maîtrise d'œuvre expertale et son management. Cette situation est néanmoins à moduler pour certaines spécialités dans lesquelles l'activité professionnelle de base est elle-même source de production d'une expertise : notamment toutes les activités liées à l'évaluation, telles que les métiers de l'art ou l'estimation immobilière. Enfin, on ne peut évoquer la fiabilité de l'expert sans énoncer la responsabilité de ce technicien de la méthode. Plus la responsabilité de l'expert sera affirmée, et plus la fiabilité du technicien sera réelle. C'est un gage de crédibilité. Or, comment justifier la responsabilité d'un expert si ce n'est que contractuellement ? En conclusion, l'expertise équitable exige une transparence, une contradiction et une justification puisée au travers d'une méthodologie rigoureuse, normalisée, reconnue car débattue et donc une évolution vers une véritable contractualisation de l'expertise, définissant également une responsabilité précise de l'expert. Je citerai à nouveau Patrick de Fontbressin : « Il doit y avoir protection de l'appel au droit par la science ». M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : M. Michel Jarrault est Vice-Président de la Compagnie française des experts construction. Il a réfléchi sur la responsabilité des experts et travaillé sur le problème des expertises privées, peu abordées jusqu'à présent. Je lui donne la parole. M. Michel JARRAULT, Vice-Président de la Compagnie française des experts construction Je veux dire tout d'abord comment l'expertise construction contribue à la réparation des désordres et au règlement des litiges. Je veux dire ensuite de quelle façon l'expert construction peut agir en amont de l'apparition des désordres et en amont de la procédure judiciaire. Je souhaite terminer en indiquant quel est le profil de l'expert construction et quelle procédure pourrait être mise en œuvre pour apporter à tous ceux qui peuvent avoir recours à l'expertise construction les garanties nécessaires sur les compétences des experts et sur la pertinence de leurs avis. Comment peut-on définir l'expertise construction ? C'est une mesure d'instruction technique, confiée à une personne physique ou une personne morale, portant sur l'état d'un ouvrage de construction ou sur l'interaction entre cet ouvrage et son environnement. Quand on dit ouvrage de construction, il s'agit de l'ouvrage au sens l'article 1792 du code civil, revu et corrigé par la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction. Cet ouvrage repose sur le sol, n'a pas de caractère provisoire, et peut être un ouvrage de génie civil ou un ouvrage dit de bâtiment. Je me limiterai aux ouvrages de bâtiment : bâtiments d'habitation, collectifs ou individuels, bâtiments de bureaux, bâtiments commerciaux, industriels et agricoles, bâtiments scolaires et cultuels. Si l'expertise concerne l'état de la construction, elle répond à certaines interrogations de la part du maître d'ouvrage public ou privé, du gestionnaire du patrimoine ou de l'exploitant, de l'assureur - assureur dommages ouvrage ou assureur de responsabilité d'un constructeur - du juge, pour ne citer que les principaux demandeurs. Elle intervient pendant la construction de l'ouvrage, lors des opérations de réception, pendant la période de garantie décennale ou au-delà de cette période, après plusieurs décennies d'exploitation par exemple. La demande peut être motivée par le fait que l'ouvrage est atteint d'un désordre ou d'un dommage. Il s'agit d'une expertise après « sinistre » Exemples : expertise « dommages ouvrage » motivée par un défaut d'étanchéité de la terrasse ou expertise demandée par le juge dans un litige ayant pour origine la dégradation des gardes corps en bois des balcons, etc. Cette demande d'expertise peut être aussi motivée par le fait que le propriétaire ou le gestionnaire du patrimoine immobilier souhaite s'informer sur l'état de la construction, pour éviter précisément que l'ouvrage ne soit atteint ultérieurement de désordres qui viendraient perturber ou compromettre son utilisation ou son exploitation. Il s'agit dans ce cas d'une expertise préventive. On peut citer par exemple, le syndic de l'immeuble qui veut savoir si l'étanchéité de la terrasse, qui a été réalisée il y a quarante ans, doit être remplacée, et si oui, dans quel délai, sous quelle forme et à quel coût. Si l'expertise concerne l'interaction entre la construction et son environnement, elle est alors demandée par un tiers, une personne, étrangère à la construction, qui estime avoir subi un préjudice du fait de la construction. Tel est le cas, par exemple, du voisin qui pense que la couverture de son pavillon a été endommagée par la construction de l'immeuble édifié en limite de sa propriété. Lorsqu'il y a désordre, et qu'il est saisi dans un cadre amiable, l'expert définit les travaux de remise en état - de réparation ou de réfection -, les évalue et donne éventuellement un avis sur le partage du coût des réparations entre les différents acteurs concernés. Il consigne ses conclusions dans un rapport qu'il doit déposer dans un délai assez bref, et dans certains cas, comme celui de l'expertise dommages ouvrage, dans un délai imposé par la loi - imposé d'ailleurs indirectement, car l'obligation est faite à l'assureur qui utilise le rapport de l'expert. S'il y a désordre, il n'y a pas toujours litige, heureusement, mais s'il y a litige, l'expert s'efforce de renouer le dialogue, de rétablir un climat de confiance et d'éviter que celui qui a subi le préjudice ne soit conduit à demander au juge de se prononcer pour qu'il obtienne réparation. S'il échoue dans sa tâche, s'il ne réussit pas à régler le problème de façon amiable, le juge sera saisi et désignera lui-même un expert construction, de même profil, qui sera chargé lui aussi de fournir toutes les informations de caractère technique et contractuel qui permettent au juge de se prononcer en toute connaissance de cause. Qui est l'expert construction, personne physique ? D'où vient-il, quelle est sa formation ? Son titre est il reconnu ? Est-il un professionnel de l'expertise ou est-il expert occasionnellement ? C'est un ingénieur, un architecte ou un technicien de la construction. Il est généraliste ou spécialisé dans un domaine technique particulier. S'il est généraliste, c'est un homme de terrain, il connaît l'ensemble des corps de métier, des fondations à la couverture, en passant par la structure, les menuiseries extérieures, et les carrelages. Ou bien il est hautement qualifié dans un domaine particulier, par exemple, le domaine des structures métalliques « tridimensionnelles ». Il est devenu expert après un certain nombre d'années d'expérience professionnelle - une dizaine d'années en moyenne, dont une partie au moins sur le chantier - comme concepteur, réalisateur ou contrôleur technique. Il est devenu expert parce qu'il avait un goût certain pour l'analyse technique, pour le dialogue et que sa rigueur et ses aptitudes ont été reconnues - par les assureurs, par le juge, par ses pairs. Ce professionnel de la construction a dû apprendre la méthodologie de l'expertise : le diagnostic, la conduite de l'expertise, en particulier le respect du contradictoire. Il a dû recevoir une formation sur la pathologie de la construction et sur les méthodes de réparation. Il a dû acquérir des connaissances juridiques pour juger du fondement des responsabilités, des connaissances sur les contrats d'entreprise au sens large, sur les contrats d'assurance, sur les conventions entre les assureurs, et sur la procédure d'expertise judiciaire s'il a sollicité son inscription sur une liste de cour d'appel. Son titre n'est pas reconnu, n'importe qui peut dire : « Je suis expert construction ». Qui juge donc de ses compétences ? Ceux qui lui confient des missions, soit a priori, soit a posteriori. Les juges, pour leur part, établissent des listes à partir de certains critères et de l'examen de dossiers de candidature. Les assureurs, dans le domaine particulier de l'assurance dommages ouvrage, établissent des listes d'experts généralistes et d'experts spécialistes, en utilisant, depuis 1995, une procédure dite de « qualification CRAC » - il s'agit de la convention de règlement d'assurance construction -, mise en œuvre par une commission paritaire experts-assureurs et comprenant un examen écrit et un examen oral, technique et juridique. Demain sans doute une certification d'expert construction sera proposée aux candidats, certification individuelle de compétence assortie elle-même d'un examen technique et juridique, écrit et oral qui je l'espère sera opérationnelle en 2007. Une réflexion est conduite actuellement au sein de notre organisation. Une décision sera prise, à ce sujet prochainement ; si la décision de mise en œuvre d'une procédure de certification individuelle est retenue, elle sera annoncée officiellement début 2006. L'expert est- il un professionnel de l'expertise ou un occasionnel ? L'expert généraliste doit être un expert professionnel, c'est-à-dire que l'expertise ne doit pas être pour lui une activité secondaire, accessoire ou rattachée à une autre activité de constructeur au sens large, une activité d'entrepreneur, d'architecte, d'ingénieur conseil ou de contrôleur technique. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : M. Alain Jakubowicz a lancé le débat sur les questions qui viennent d'être abordées. Il a l'expérience de plusieurs affaires, dont celle du Mont-Blanc. Je lui donne la parole. Dans ce débat, la place de l'avocat est assez symptomatique. Combien de hauts magistrats, d'experts très compétents, pour un avocat ! Ce n'est pas une critique, encore moins un reproche. Cela correspond bien à la place de l'avocat dans l'expertise. N'oubliez pas, cependant, qu'il représente celui pour le compte de qui la justice est rendue. Or, au cours de l'expertise, et surtout de l'expertise pénale, le justiciable est singulièrement absent. Tout à l'heure, j'ai manifesté mon désaccord avec un propos tenu par deux experts : les experts ne sont pas là pour dire le vrai ni le juge pour dire le juste. Un tel contresens est significatif de la très haute conception que les experts ont de leur mission.Les experts ne sont pas là pour dire le vrai ; ils sont là pour éclairer le juge, pour donner un avis scientifique, un avis technique, pour répondre aux questions qui leur sont posées. Point final ! Le vrai, c'est le juge qui le dira. Car, en matière de justice, la vérité émane de la décision qui sera rendue et qui doit être rendue au nom du peuple français. C'est extrêmement grave. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, ce ne sont pas les grands procès comme celui du tunnel du Mont-Blanc qui sont importants. Ce sont les procès de tous les jours et le praticien que je suis est bien obligé de constater que, hélas, in fine, ce que les experts disent est vrai : au bout du compte, ils disent le vrai parce que les juges ont tendance, de façon quasi systématique, à entériner leur avis, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, que c'est plus simple et que leur métier n'est pas de connaître la technique. Le problème, c'est que les contre-expertises ou les compléments d'expertise, dans la justice de tous les jours, se comptent sur les doigts de la main. Le dossier du tunnel du Mont-Blanc en est un exemple, ou plutôt un contre-exemple. En effet, c'est la justice médiatique, celle dont on parle et à l'occasion de laquelle la justice consacre des moyens que certains ont considéré comme surdimensionnés. Certains se sont demandé s'il fallait mettre en place un pôle spécialisé dans les catastrophes et accidents collectifs. Or le TGI de Bonneville a prouvé comment un juge d'instruction, dans une toute petite juridiction, pouvait conduire dignement une instruction de cette importance et de cette durée. Pour le dossier du tunnel du Mont-Blanc, il y a eu une multiplicité d'expertises tout à fait exceptionnelles, sur tous les sujets. Or ces rapports d'expertise sont illisibles pour la plupart d'entre nous : plusieurs centaines de pages, d'une technicité ahurissante. Le juge d'instruction, en raison de l'importance de l'affaire, avait fait droit à toutes les demandes de compléments d'expertise et de contre-expertises qui lui ont été présentées. L'audience était surréaliste, avec les experts, les contre-experts, les experts privés des parties, auxquels on donne la parole. Elle s'est transformée en show Power Point, l'oralité des débats sacrifiant à l'informatique. Un tel procès, admirable dans sa conduite, a mis en évidence les limites de l'expertise. On a même assisté à des prises à partie personnelles d'experts, chacun voulant vendre son école. Il a mis également en évidence l'appropriation du procès par le juge. En fin de compte, dans un jugement de plus de 600 pages, le tribunal a été obligé de trancher. Dans ce type de procès, comme dans tous les procès d'ailleurs, le justiciable attend de la justice en général et des expertises en particulier. C'est grâce à elles et au travail des experts que les familles des victimes de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc ont pu savoir - en l'occurrence, savoir comment leurs proches étaient morts et s'ils avaient souffert. Il faut saluer également le travail de la police scientifique française. La Cour des comptes a égratigné le tribunal de Bonneville en raison du coût des expertises. Je voudrais néanmoins relever que celles-ci ont été bloquées parce que le TPG refusait de payer les experts. Cela devait être dit devant la représentation nationale. On aura une vraie justice lorsqu'on en aura les moyens. Et on aura les meilleurs experts lorsqu'on se donnera les moyens de les honorer eu égard à leur science, du temps qu'ils y passent et à ce qu'on leur demande. Au-delà de la récente polémique qui concernait un expert dont les propos étaient effectivement inacceptables, un vrai problème a été posé. Ce problème avait été vécu au moment de l'affaire du tunnel du Mont-Blanc ; on a alors perdu des mois de procédure, simplement pour des questions liées au paiement des experts. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Y a-t-il des réactions ? Mme Marie-Odile BERTELLA-GEOFFROY : Il y a des contre-expertises au pénal. Quand quelqu'un est mis en examen, il a droit à une expertise et à des explications des experts. Et quand une partie civile conteste une expertise, je fais procéder, pratiquement de droit, à une contre-expertise, un peu comme le juge des référés. Il ne faut pas croire que le pénal, c'est l'Inquisition. M. Alain JAKUBOWICZ : Singulièrement, et vous ne me contredirez pas, l'expertise pénale, sauf exception, se déroule sans les parties. Il y a un contact direct entre les experts et le juge. Les parties sont totalement absentes, et lorsqu'elles ont connaissance de l'avis de l'expert, c'est souvent trop tard : le rapport a été déposé, et le juge d'instruction notifie aux parties les seules conclusions du rapport d'expertise. Pour le justiciable, la messe est dite. J'ai lu, sous la plume d'experts psychologues ou psychiatres, des avis condamnant définitivement la personne mise en examen. Et obtenir une contre-expertise après un avis péremptoire d'un psychologue ou d'un psychiatre, c'est un véritable chemin de croix ! Cela me semble éminemment dangereux. S'il y a bien une matière dans laquelle le législateur doit réfléchir, c'est bien celle-là. Dans le domaine de la construction, des sciences « exactes », la marge de manœuvre et les conséquences des erreurs ne sont pas les mêmes que dans le domaine de sciences aussi subjectives que la psychologie et la psychiatrie. Leurs rapports sont la plupart du temps soit définitifs et péremptoires, soit incompréhensibles. Mme Marie-Odile BERTELLA-GEOFFROY : Je suis tout à fait d'accord pour introduire le contradictoire dans le pénal. Cela évitera justement des contre-expertises qui peuvent durer un an, deux ans. Si le législateur le décide, pourquoi pas ? M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : L'Office travaille sur ces sujets depuis maintenant une vingtaine d'années. Nous constatons que l'expertise publique, collective et contradictoire est sans doute le meilleur moyen d'éviter l'affrontement entre des camps certains de « leur » vérité. Voyez le cas des OGM : comment voulez-vous alors qu'on puisse rendre la justice ? Il faut que les expertises soient les plus contradictoires et ne pas en arriver à des expertises ficelées au moment du procès. Votre suggestion me semble donc très bonne. Je passe maintenant la parole à Mme Jeanne Goerrian. Nous avons hésité à lui demander de venir parce que nous avons constaté que, dans la plupart de ces dossiers, les affaires étaient encore en cours. Or nous n'avons pas à organiser ici de procès. Néanmoins, il nous a paru très important que la présidente d'une association de victimes, en l'occurrence celles de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, nous expose comment elle a vécu les évènements dans la pratique et ce qu'elle a pensé de l'expertise. Mme Jeanne GOERRIAN, Présidente de l'Association des victimes de l'hormone de croissance et Secrétaire nationale de l'Association des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob Je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis en effet présidente de l'association des victimes de l'hormone de croissance, mais également la secrétaire nationale de l'Association des victimes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (AVMCJ), concernant toutes les autres formes de cette maladie et particulièrement celle des victimes du Nouveau Variant plus communément appelée « vache folle ». J'ai perdu Eric, mon fils de 24 ans qui a développé cette maladie transmise à la suite de la contamination par l'hormone de croissance. Quelqu'un s'est demandé tout à l'heure si une réponse judiciaire douze ans après avait un sens. Pour nous, bien sûr que oui. Il vaut mieux une procédure de douze ans qu'un dossier classé sans suite par manque d'éléments. Dans le dossier de l'hormone de croissance, de nombreuses critiques ont été émises à propos de la durée de l'instruction. Il faut savoir que chaque année, des dizaines de victimes viennent grossir le dossier. Un travail considérable a été fait. Pour moi, l'expertise a une double vocation : éclairer le juge d'une part et éclairer les familles des victimes d'autre part, voire des victimes lorsqu'elles sont encore en vie. Je vais vous exposer mon cas personnel, que l'on peut considérer comme un cas d'école. Lorsque mon fils est décédé, il a été « exclu » des victimes de l'hormone de croissance. Lorsque j'ai eu cette information, je l'ai reçue comme un coup de poignard : on tuait mon fils une seconde fois ! Une mère qui a perdu son enfant a besoin d'aller au bout de la vérité. Pourtant ce combat, tout le monde le donnait perdu d'avance. Le juge d'instruction, Mme Bertella-Geoffroy, elle-même, ne croyait pas trop à mon affaire, puisqu'elle avait nommé un collège de cinq experts, les meilleurs qui soient. Comme l'a dit M. Munnich tout à l'heure, « les professionnels sont trop orgueilleux pour reconnaître les limites de leur profession ». Certains des experts nommés ne connaissaient rien à la maladie de Creutzfeldt-Jakob ! Me basant sur mon intime conviction, j'ai demandé à être entendue par les experts. J'ai été entendue pendant quinze minutes, et j'ai été suffoquée : la conclusion avait déjà été faite, sans qu'il y ait eu de discussion. Je me demandais à qui j'avais affaire ! J'ai tout de suite fait un rapport au juge sur cette audition, où on m'avait pour ainsi dire mise au banc des accusés. Quatre ans après la mort de mon fils, les experts n'avaient toujours pas rendu leur rapport. Pourtant, je connaissais leurs conclusions. Or, sur les cinq experts, l'un s'est désolidarisé du collège : le regretté Professeur Dormont, le seul spécialiste de la question. Lorsque je lui ai demandé les raisons pour lesquelles il n'était pas présent lors de notre audition, il m'a fait savoir qu'il avait préféré ne pas venir étant donné le ton sur lequel il avait été convoqué. Souvent, la confraternité l'emporte sur la vérité des faits. Au bout de plus de quatre ans, les quatre autres experts ont rendu leur rapport, dans lequel le nom de Creutzfeldt-Jakob n'est pas orthographié une seule fois correctement, et qui comportait beaucoup d'erreurs. Ce rapport n'a pas expliqué la cause de la mort de notre enfant...Ils ont méprisé la souffrance de notre famille, ils nous ont fait du mal. J'ai alors adressé une lettre ouverte, pour leur dire ce que je pensais d'eux, non pas sur le fond, mais sur la forme. A la lecture de cette lettre, le président de la Compagnie des experts va nous convoquer tout de suite. Dans les huit jours qui suivent, il va reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'erreurs et va téléphoner devant moi au juge d'instruction, Mme Bertella-Geoffroy. Il lui demandera s'il serait possible de faire un complément d'expertise parce que ce rapport comporte des anomalies et qu'il faut revoir la copie. Le complément d'expertise qui devait prendre quelques mois, durera deux ans, sans que personne ne fasse rien. Ma chance a tenu au fait que la juge d'instruction m'ait entendue, même si au début elle ne m'a pas crue. Elle a compris ma souffrance et ma douleur, et a accepté de nommer un expert hors de la région parisienne pour une contre-expertise. L'expert qui a été nommé a fait un travail considérable ; il a conclu que mon fils était bien décédé d'une maladie de Creutzfeldt-Jakob ; il m'a enfin expliqué les causes de la mort de mon enfant et a eu le courage de contredire les affirmations des précédents experts, preuves à l'appui. J'ai vécu un véritable roman noir, seule contre un collège de cinq experts, parmi lesquels deux experts à la Cour de cassation, dont le président de la Compagnie des experts, qui a été odieux avec moi. Depuis, je crois savoir qu'il n'a pas été réélu à la tête de cette compagnie. On m'a félicitée pour mon combat auquel personne ne croyait, mais quelle énergie, quel courage il m'a fallu pour me battre pendant neuf ans dans la douleur ! Pourtant, nous sommes au pays des droits de l'homme. Par ailleurs, je voudrais parler de l'intrusion, dans les expertises judiciaires, de l'État. Je pense notamment à l'INSERM, qui s'est introduit dans le dossier de l'hormone de croissance de façon irrégulière. Un de ses membres étant mis en examen, l'INSERM a organisé sa propre expertise, a réuni des experts internationaux, sans que le juge d'instruction ne le leur ait jamais demandé. En deux fois quatre heures, sans connaître la globalité des faits, ils ont démonté toute l'instruction pour conclure que ce drame était dû à l'ignorance et non à la négligence. Nous nous battons sur ce point. Nous avons demandé une enquête administrative au Ministère de la Santé, parce que la première mission demandée par M. Bernard Kouchner, Ministre de la Santé, a été transformée par le directeur de l'INSERM. Nous avons alors découvert, à l'occasion des différentes saisies demandées au juge, une note interne indiquant que dans le cadre de la procédure pendante devant le juge pénal, impliquant un chercheur de l'INSERM, il a été mis en place un comité d'experts. Il est important que, lorsqu'il y a une enquête judiciaire, l'administration ne s'en mêle pas. C'est très important pour nous. De nombreuses expertises ont été commandées dans le dossier de l'hormone de croissance. Et si nous en sommes là, c'est uniquement grâce au juge d'instruction qui a fait un travail énorme et que les familles de victimes ne remercieront jamais assez. Ce que nous voulons, c'est la vérité. Nous n'avons pas à juger les personnes mises en examen. Nous voulons que la justice aille jusqu'au bout. Certes, elle a été longue, mais je pense que les différentes expertises, soit personnelles, soit collectives, nous permettront d'aboutir à un procès que nous espérons proche. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Merci, Madame, pour ce témoignage. Vous avez abordé la question de la recherche des causes de certains décès, et celle des responsabilités dans ce type de dossiers. Je ferai cependant remarquer qu'un organisme de recherche n'appartient pas à l'administration. Cela dit, je ne le défends pas, d'autant que je ne connais pas le dossier. Mme Jeanne GOERRIAN : Cet organisme de recherche s'est appuyé sur une mission d'un ministre de la santé. Or cette mission a été transformée, modifiée. A l'origine, elle concernait les maladies de Creutzfeldt-Jakob et non pas seulement le drame de l'hormone de croissance. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : En effet. Cela nous amène à une autre question : lorsqu'on demande une expertise à un organisme de recherche, il faudrait que cette expertise soit collective et contradictoire. Certains demandent des expertises indépendantes. Mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est à nous d'organiser un système d'expertises qui soient contradictoires, qui puissent être discutées bien avant. Je ne connais pas ce dossier, mais je ne pense pas qu'on puisse aller ainsi vers une justice idéale. Mme Jeanne GOERRIAN : Il est tout de même ahurissant que l'INSERM, qui est un organisme reconnu, se permette d'organiser une réunion de deux fois quatre heures. La cassette qui avait enregistré les débats sera curieusement perdue deux mois après, le rapport qui sera rendu sera très succinct. On va y interroger la personne mise en examen, lui demander de remettre des expertises que le juge avait fait faire et qui sont concernées par le secret de l'instruction. Je trouve cela bien curieux. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je donne maintenant la parole à M. Claude Delpoux, qui est directeur des assurances de biens et de responsabilités à la Fédération française des sociétés d'assurance, et qui va nous donner la position de sa fédération en matière d'expertise. M. Claude DELPOUX, Directeur des assurances de biens et de responsabilité, à la Fédération française des sociétés d'assurances Le témoignage de Mme Goerrian nous a montré que l'essentiel, pour les victimes, est de savoir ce qui s'était passé, avant même qu'on ne s'intéresse aux problèmes de responsabilité et d'indemnisation. Au début de ce débat, a été posée la question de la responsabilité objective. Mais en aucun cas cette responsabilité objective ne peut nous dispenser de la recherche de la vérité, des faits et des fautes commises, surtout dans des dossiers aussi dramatiques. Je voudrais faire observer que les expertises de sinistres pour la plupart des affaires sont suivies d'un règlement amiable des sinistres, et que l'expertise judiciaire courante doit être distinguée de celle des affaires exceptionnelles. Je m'attacherai au problème de l'assurance face à l'expertise scientifique. L'assurance, bien que couvrant par essence les conséquences d'évènements aléatoires, a besoin de certitudes : certitude technique, pour calculer le coût global des risques qu'elle assure, et certitude juridique concernant l'application des clauses contractuelles qui régissent les rapport assureur-assuré. La certitude juridique est aussi nécessaire que la certitude technique sur des faits potentiellement générateurs de responsabilité. Pourquoi un tel besoin de certitude ? Parce que l'assureur ne joue pas aux dés, et qu'il ne peut pas exposer au hasard et à l'aveuglette les sommes que les assurés lui ont confiées pour gérer les sinistres. A une époque où les avancées technologiques sont permanentes, de nouveaux risques émergent. L'assureur, auquel on demande de les couvrir, se trouve donc interpellé. Mais il n'est pas évident que tout puisse être couvert par l'assurance : c'est tout le problème de l'assurabilité. Le premier critère de l'assurabilité, c'est le caractère mesurable du risque. Cela signifie que le risque inconnu n'est pas assurable, et que le fait qu'il se révèle un jour ne le rend pas a posteriori assurable. Par ailleurs, l'assureur n'a pas la capacité d'assurer les conséquences dommageables des risques de développement, dans la mesure où on ne sait pas les mesurer. Le risque émergent, jusque là inconnu et qui se révèle, demande un certain nombre d'années d'expérience pour être apprécié et maîtrisé par l'assureur : les assureurs et réassureurs ne s'aventurent qu'avec prudence sur de tels risques. Il est parfois nécessaire d'avoir recours à la garantie de l'État, au moins pendant le temps que se crée l'expérience. On peut prendre l'exemple des OGM. Les risques avérés peuvent prendre une importance telle que le marché de l'assurance et de la réassurance n'est plus en mesure de les couvrir, du moins à des montants de prime acceptables par les assurés concernés. Il ne faut pas oublier que le principe de précaution doit rester un principe de gestion publique de l'incertitude sur les risques. Cela ne signifie pas que tous les acteurs n'ont pas un devoir de précaution. Mais il ne faudrait pas que le paradigme du principe de précaution engendre de nouveaux cas de responsabilité que l'assureur ne pourrait pas couvrir. Il peut y avoir concours entre la responsabilité des pouvoirs publics, en ce qui concerne la gestion de la précaution, et la responsabilité des acteurs, liée au devoir de précaution. Cela fait intervenir des ordres de juridiction différents : administratif et judiciaire, et donc des expertises différentes. D'où les problèmes que vous pouvez imaginer. Bien entendu, nous sommes les assureurs d'un justiciable et nous attendons, en matière de lien de causalité, un éclairage qui sera ensuite également donné au juge. L'expertise équitable, dont la notion a été évoquée, est aussi un besoin pour l'assureur. Nous devons attendre de l'expert qu'il nous dise ce qui est scientifiquement établi et ce qui ne l'est pas et lorsqu'il n'y a pas de certitude sur le lien de causalité, si ce lien peut ou non être exclu. Pour le reste, ce n'est plus le rôle de l'expert, c'est celui du juge. On a cité l'affaire Perruche : ce n'était pas un problème d'expertise scientifique, mais un problème d'appréciation et de compréhension du lien de causalité par le juge. L'assurance a donc besoin d'une expertise scientifique et technique, soit en amont pour estimer si un risque est assurable, soit en aval pour l'instruction des sinistres. S'agissant de la couverture du risque, en cas d'incertitude, l'assureur cherche une solution. Il cherche à cibler ce qui pourrait être assurable. Si le risque n'est pas scientifiquement avéré, on se trouve dans l'hypothèse du risque développement, qui n'est pas assurable. Mais, en revanche, si on prend l'exemple d'actualité des champs OGM et non OGM, en cas de contamination du champ voisin au-delà du seuil d'acceptabilité préalablement prescrit, on peut trouver des solutions assurantielles. On a dit tout à l'heure que l'État pouvait s'engager à nos côtés. Et bien entendu, il ne faut pas que la décision judiciaire balaie les limites d'engagement qui ont été contractuellement prévues par les assureurs. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je donne maintenant la parole au dernier intervenant, M. Bernard Peckels, rédacteur en chef de la revue Experts. M. Bernard PECKELS, Rédacteur en chef de revue « Experts » J'ai été interpellé par le titre de ce colloque, « L'expertise scientifique au service de la décision judiciaire et de la décision publique », car l'expertise scientifique dépasse très largement ces deux seuls domaines. En effet, l'expertise scientifique comprend également l'expertise contractuelle, à savoir l'expertise d'assurance et l'expertise privée, officieuse ou amiable, qui à elles seules constituent près de quatre vingt dix pour cent du contentieux expertal. Ceci étant précisé, j'ai souhaité vous faire part d'une évidence, d'un projet et d'un souhait. L'évidence concerne les spécificités et les liens qui unissent ou distinguent l'expertise judiciaire et l'expertise publique. A propos des spécificités je ne reviendrai pas sur celles de l'expertise judiciaire dont je rappellerai simplement que, pour l'essentiel, il s'agit d'une mesure d'instruction demandée par un juge. Par contre, pour ce qui concerne l'expertise publique, moins connue que la précédente, il convient peut-être de déborder un peu sur ce qui sera dit cet après-midi et d'énoncer dès maintenant pour une meilleure compréhension de ce qui suit : qu'elle se déroule toujours dans le cadre des agences de sécurité sanitaire et de l'environnement, qu'elle est ordonnée par l'État, par les diverses administrations centrales ou territoriales mais aussi par auto-saisine des dites agences, qu'elle est collective et effectuée au sein de comités d'experts, et enfin qu'elle est publique en ce sens que ses rapports peuvent être officiellement mis à la disposition de tous et affichés. A propos des liens qui unissent l'expertise judiciaire et l'expertise publique nous rappellerons, d'abord que ces deux types d'expertise sont encadrés par la loi, celle de 1971 pour la première et celles créant les instituts de sécurité sanitaire et de l'environnement pour la seconde, mais surtout que l'une et l'autre entrent dans le cadre plus global de l'expertise qui, quel qu'en soit le donneur d'ordre, a toujours d'une part un même et seul objet, apporter un éclairage technique sur des faits ou des prévisions, et un tronc commun dont les fondamentaux sont, pour l'expert, la compétence, la déontologie et l'indépendance, pour l'expertise proprement dite, une mission claire et précise, une méthodologie déterminée et une réponse à toutes les questions posées, et enfin pour les deux l'indissociable couple expert-expertise. Le projet a trait à la création prochaine d'un Observatoire de l'expertise. Ceci va dans le sens de ce qui a été dit ce matin par l'un des intervenants, c'est-à-dire qu'il « convient de faire évoluer l'expertise ». L'objet de cet organisme, qui précisons-le sera indépendant est, selon ses statuts, d'une part de « développer une réflexion permanente sur l'expertise en tous domaines, en toutes circonstances et sous tous ses aspects », et d'autre part de « réaliser toute étude en relation avec l'activité expertale ». A son propos les experts et leurs représentants doivent être rassurés, en premier lieu parce que ledit organisme n'a vocation ni à pratiquer des expertises, ni à se substituer aux activités expertales de ses membres, et en second lieu parce que toutes les composantes de l'expertise judiciaire, publique ou d'assurance, mais aussi de l'entreprise et de l'université, seront invitées à y participer. Enfin, le souhait que je tiens à exprimer pour terminer est, face à l'évolution et à la modification des données de l'expertise et de la société, de redéfinir sans plus attendre les termes d'expert et d'expertise, de fixer les limites et les spécificités de chacun, et enfin de reconnaître et protéger le titre d'expert. Ainsi en ira-t-il du bon fonctionnement de notre société dont l'expertise est, souvent et en tous domaines, un élément régulateur incontournable. M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je tiens à vous remercier, toutes et tous, d'être venus. Même si certaines professions étaient moins représentées que d'autres, nous avions tenu à ce qu'elles puissent s'exprimer. Un certain consensus est ressorti de cette matinée : le service public de la justice doit rechercher la vérité. Pour cela, il faut que les juges en aient les moyens et soient formés. C'est le sens de la création des pôles spécialisés. Et s'il en existait dans d'autres domaines que la santé, la grande criminalité ou les finances, par exemple sur les risques industriels ou la propriété intellectuelle, la justice serait plus efficace. Il est évident que les experts, qui apportent leur contribution au service de la justice, sont nécessaires. Le débat contradictoire doit pouvoir s'organiser dans le cadre de la justice. Dès les premières phases de l'instruction, on doit pouvoir faire appel à des collaborateurs, à des experts compétents en cas d'affaires compliquées - même si ce ne sont pas les plus courantes. Le Parlement peut jouer le même rôle que les commissions d'enquête, il le joue d'ailleurs déjà. Sauf que la loi indique très clairement que, lorsque l'on est encore dans la période d'instruction judiciaire, nous n'avons pas le droit de traiter des mêmes questions que la justice. Cela signifie que, dans ce cas, la commission d'enquête que nous créons travaille en parallèle, sans mettre en cause la moindre responsabilité, car ce n'est pas notre rôle. J'ai été rapporteur de deux commissions d'enquête : la première sur le SIDA en 1992, la seconde sur AZF en 2001. S'agissant de cette dernière, le juge nous a demandé la totalité de nos dossiers. Nous avions pu, en effet, collecter des documents importants pour rechercher la vérité. Il faut donc qu'au Parlement, mais pas seulement au Parlement, un débat collectif et contradictoire puisse se mettre en place. Ce débat doit respecter certains principes communs, que nous avons eu l'occasion de définir collectivement : l'indépendance, la transparence, la compétence, l'ouverture avec ces fameuses expertises collectives et contradictoires ; la recherche d'un consensus, qui n'est pas contradictoire avec la recherche de la vérité. Sur certains dossiers, il faudra traiter du problème de la responsabilité des experts, ce qu'on n'a peut-être pas fait au niveau de la loi. Cela dit, un dialogue qui aurait lieu uniquement entre le juge et l'expert ne serait pas compris par la société. Même s'il n'est pas concerné personnellement, et qu'il s'intéresse simplement à la responsabilité collective et au développement de son pays, le citoyen doit y avoir accès. DEUXIÈME PARTIE : Introduction par L'Office a pour mission d'améliorer l'articulation entre le monde politique et le monde scientifique. Les pouvoirs publics ont la responsabilité de la maîtrise de l'application des découvertes scientifiques et technologiques attendues par notre société. À l'intersection entre le monde politique et administratif d'un côté, et le monde scientifique de l'autre, les experts expriment des avis et aident les représentants du peuple à prendre leurs décisions. Notre réflexion intervient dans un contexte paradoxal : la science est capable comme jamais d'apporter des réponses à la société, celle-ci utilise massivement les apports de la science et de la technologie mais multiplie les doutes, les interrogations, voire les suspicions. Il est vrai que nos concitoyens, au cours des dernières décennies, ont eu de bonnes raisons de se poser des questions sur la notion de progrès : la vache folle, les catastrophes aériennes, l'amiante, la grippe aviaire, Tchernobyl, etc. L'Office a publié plusieurs rapports abordant le problème de l'expertise. J'en ai pour ma part rédigé récemment un sur les agences de sécurité sanitaire ; sans mettre en cause leur fonctionnement général, j'y pointe des problèmes réels. Quel est le niveau d'implication de l'expertise technique dans la décision politique et administrative ? Quelle est la répartition des responsabilités entre les acteurs scientifiques, administratifs et politiques ? Les règles de l'expertise sont-elles suffisantes ? Le choix des experts ne doit-il pas être revu ? Leurs méthodes et leurs pratiques ne posent-elles pas problème ? L'intelligibilité et la transparence de leurs avis sont-elles suffisantes ? Ne convient-il pas d'inscrire chaque expertise dans son contexte historique ? Les avis des experts sont-ils bien médiatisés ? Le statut des experts - sachant que, dans certains domaines, la question des conflits d'intérêts est sensible - est-il suffisamment clair ? La dimension internationale est-elle prise en compte ? Il ne s'agit évidemment pas d'affaiblir l'expertise publique, mais au contraire de la valoriser et de la conforter. Plus que jamais indispensable aux décideurs publics, elle doit être reconnue comme un instrument au service des institutions, de l'État. Dans la sérénité mais aussi dans la clarté, à travers vos témoignages, l'objectif de cette séance est de faire le point sur l'état actuel de l'expertise publique, de signifier les avancées récentes, de pointer les dysfonctionnements et de proposer des améliorations. Je vous invite par conséquent à refuser la langue de bois, à sortir des discours convenus, à nous faire partager la grande richesse de votre expérience par une expression libre et responsable, quitte à soulever des débats entre nous. La démocratie, c'est aussi cela. J'ajoute que mon rapport sur les agences de sécurité sanitaire m'a conduit à rédiger une proposition de loi, avec le concours très actif de MM. Benaiche, Riché, Tufféry, sans oublier le soutien moral de M. Cicolella. Modérateur : M. Guy PAILLOTIN, Président du conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail Il est en effet très important d'éviter la langue de bois. L'expertise au service de la décision publique n'est pas simple à exercer. Nous avons tous vécu des expériences qu'il est temps de porter à la connaissance du législateur. Mme Marie-Christine BLANDIN, Sénatrice du Nord, Pour nous, parlementaires, l'expertise est une aide indispensable à la décision, et nous avons conscience que ce message ne prend chair que s'il est bien entendu. Je prendrai trois exemples. L'amiante est un sujet grave puisque l'on annonce 100 000 décès par an dans le monde. Selon le rapport Dériot du Sénat, beaucoup d'acteurs déclarent qu'ils savaient, alors que les personnes auditionnées en défense affirment au contraire qu'elles ne savaient pas. Parmi les facteurs déterminants, j'ai noté le crédit accordé à l'émetteur d'alerte, l'interaction de résistances et de conflits de paroles autorisées, ainsi que la sensibilité ou l'indifférence des institutions. Le crédit est une affaire de titre, de masse critique et de nationalité. En 1906, personne n'a entendu l'unique inspecteur du travail qui avait rédigé un rapport sur le sujet. Une conférence internationale organisée à New York en 1965 a tout dit sans être prise au sérieux. Une résolution alarmante du Parlement européen de 1978 n'a pas été suivie d'effets parce qu'elle émanait de l'Europe. Un scientifique courageux, le professeur Bignon, avait écrit au Premier ministre le 5 avril 1977 mais, simultanément, M. Claude Allègre, président de l'Institut de physique du globe et membre de l'Académie des sciences, prétendait qu'il n'y avait pas de danger ! En 1982, la Conférence de Montréal conclut que même les faibles doses sont cancérigènes. Mais, en 1996, l'Académie des sciences déclare que l'amiante n'est pas un danger majeur. Il aura fallu, pour agir, attendre l'expertise collective de l'INSERM de 1997 ! Ces conflits de paroles autorisées, qui ont duré cent ans, ont eu pour effet d'accroître l'influence de ceux qui avaient intérêt à faire croire à l'innocuité du matériau : l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et le CPA, le Comité permanent de l'amiante, tous deux arc-boutés sur l'usage contrôlé et l'attente de produits de substitution ; le MEDEF et la CGPME, qui ont encore fait une déclaration en ce sens devant les Sénateurs. La prise en compte institutionnelle de l'expertise s'était traduite dès 1945 par l'inscription au tableau des maladies professionnelles et en 1981 par un article de la revue du ministère du travail, mais l'interdiction a pris un retard mortifère jusqu'en 1997. L'exemple du tabac fait également froid dans le dos. Un ancien directeur de la recherche appliquée chez Philip Morris relate, dans le livre Infiltration, une taupe à la solde de Philip Morris, la façon dont un expert membre de l'agence de sécurité sanitaire suisse, et donc rémunéré sur fonds publics, était également payé par l'entreprise pour rendre des rapports contestant la dangerosité du tabagisme passif. Cet expert est allé jusqu'à traîner devant les tribunaux, pour diffamation, le président d'une association de défense des victimes, et a gagné par deux fois, avant de perdre devant l'équivalent de notre Cour de cassation. Je précise que ce M. Rylander était professeur de médecine environnementale aux universités de Göteborg et de Genève ! Dans le climat de peur actuel, l'expertise doit cerner les périmètres des risques que font peser les OGM. La globalité de l'expression « OGM » fausse complètement le débat : elle met dans le même sac les bactéries modifiées pour produire des médicaments, les végétaux étudiés en milieu confiné et les céréales cultivées en plein champ. Il convient d'évaluer les effets sur l'organisme animal, sur l'organisme humain consommateur au premier ou au deuxième degré, sur la biodiversité périphérique ainsi que la pertinence économique et sociale de la filière. Pensons également transparence : quand la France intervient auprès de l'Union européenne pour que les résultats des tests scientifiques de la firme Monsanto ne soient pas communiqués au public afin que celui-ci ne s'alarme pas, croyez bien que cette information effraie au contraire l'opinion publique ! Nous avons besoin d'organismes pleinement indépendants, riches en ressources humaines et en moyens, exclusivement dédiés à la veille et à l'expertise. La publicité des curricula vitae et des sources de rémunération des experts serait la bienvenue. Les procédures de prise en compte des conclusions doivent être rigoureuses. Il faut accorder une place reconnue aux alertes des usagers, des salariés, des observateurs non experts, et prendre en compte cette expertise d'usage. Enfin, je vous invite tous à regarder de près l'article 6 du projet de loi sur la recherche qu'examine le Sénat, et à nous faire connaître ce que vous en pensez. M. Guy PAILLOTIN : Je vous remercie d'avoir appelé notre attention sur cet article du projet de loi. Docteur Jean MARIMBERT, Directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) L'expertise sanitaire ne peut se réduire à une approche fondamentaliste ou théoricienne ; elle doit s'inscrire dans la réalité du soin, en associant des compétences cliniciennes. L'expertise sanitaire doit avoir un caractère collectif et non pas rester une juxtaposition d'expertises individuelles - c'est l'esprit des agences de sécurité sanitaire - mais cela suppose d'associer des savoirs pluridisciplinaires, d'alterner des phases individuelles et des phases collégiales, dans un processus garantissant la cohérence de l'évaluation dans le temps et dans l'espace. L'expertise sanitaire doit être impartiale : indépendante des intérêts économiques en jeu, qu'il s'agisse des résultats des opérateurs industriels ou de la maîtrise des dépenses des payeurs publics ; libre de préjugés par rapport au savoir établi et aux querelles d'école, qui obscurcissent parfois la réalité des enjeux ; suffisamment pluraliste pour ne pas être dictée par les convictions ou les certitudes d'individualités faisant référence. La collégialité s'est améliorée à partir de la fin des années soixante-dix, avec la mise en place de la commission d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, et les premiers essais cliniques. Un rééquilibrage a été opéré entre l'expertise externe, auparavant quasi exclusive, et l'expertise interne à l'autorité sanitaire, avec la création, en 1993, de l'Agence du médicament, devenue plus tard l'AFSSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation et des produits de santé, puis des autres agences. La déclaration des liens d'intérêts a été introduite en 1994 puis rendue obligatoire par la loi du 1er juillet 1998. Mais des difficultés demeurent. D'abord, du côté de l'expertise externe, l'expertise pharmacologique et clinique de haut niveau est le plus souvent en interaction avec l'industrie, notamment au titre des essais cliniques. La sophistication des thérapeutiques tend à accentuer ce phénomène et à réduire le nombre d'experts maîtrisant des sujets pointus. Les meilleurs experts peuvent ressentir une certaine usure, du fait de la tension entre leur métier de base et la participation à une expertise sanitaire insuffisamment gratifiante et valorisée : les emplois du temps des experts, qui œuvrent pour l'intérêt général, sont de plus en plus chahutés, pour une rétribution matérielle et une reconnaissance sociale modestes. Du côté de l'expertise interne, les connaissances scientifiques bougent, et la compétence des agences doit être entretenue, surtout quand des défis supplémentaires sont posés. Nous passons de l'évaluation chimique de médicaments produits à grande échelle à l'évaluation biologique de médicaments produits à petite échelle, avec des thérapies de plus en plus sur mesure - mais, à terme, les deux démarches cohabiteront. Pour une agence comme l'AFSSAPS, assez particulière par sa taille mais aussi par le fait qu'elle organise de l'expertise tout en étant délégataire d'une vaste mission de service public, le défi consiste à valoriser l'expertise et à travailler sur l'impartialité. Mais nous butons sur la nécessité de relais extérieurs, notamment du côté des décideurs gouvernementaux et parlementaires, surtout pour faire en sorte que l'apport du savoir-faire des experts soit pris en compte dans la gestion de leur carrière comme un apport à l'intérêt général. Si ces sujets ne sont pas traités rapidement, les contradictions pourraient encore s'accentuer. M. Guy PAILLOTIN : Nous entrons là dans les aspects pratiques de la question. Docteur Jeanne ETIEMBLE, Directrice du centre La mission première d'un établissement public à caractère scientifique et technique est de produire de la connaissance nouvelle à travers les activités de ses laboratoires. Néanmoins, en 1993, à la suite de l'affaire du sang contaminé, la direction générale et le conseil scientifique de l'INSERM ont mis en place une activité d'expertise collective d'aide à la décision pour répondre aux besoins des partenaires publics et privés en matière de bilan de connaissances. Les activités d'expertise, comme les activités de recherche, participent de l'action de santé publique. La recherche s'inscrit toutefois dans un laps de temps beaucoup plus long que l'expertise. Recherche et expertise font partie du processus décisionnel. L'expertise de l'ensemble des connaissances accumulées par la recherche internationale est souvent insuffisante, et il faut donc faire appel à d'autres processus : débat citoyen, forums, expertise opérationnelle, de façon à aboutir à des actions concrètes. L'expertise scientifique est donc indispensable, mais pas toujours suffisante pour conduire à la décision. L'expertise scientifique est un processus dynamique, qui part d'une question posée par un commanditaire. La première étape est une reformulation, un cadrage, afin d'établir un cahier des charges avec ce dernier. Il s'agit de définir d'abord la problématique scientifique qui se cache derrière la commande, puis les questions scientifiques et les champs disciplinaires, soumis ensuite à un groupe d'experts. Entre le décideur et le groupe d'experts, cette phase tampon consiste donc à transformer la question du décideur en questions scientifiques. Il est alors possible de réunir une bibliographie, de déterminer les compétences nécessaires et de constituer un groupe d'experts. Celui-ci se livrera à une analyse critique de la littérature internationale, à partir de quoi émergeront le champ des connaissances et les lacunes scientifiques. Les points saillants sont réunis dans une synthèse parfois accompagnée de recommandations. Il importe par conséquent de distinguer le questionnement des décideurs de la problématique scientifique qui sera traitée par les experts. Quels sont les types de produits des expertises effectuées par l'INSERM ? Les expertises collectives sont tantôt assez transversales, portant sur l'ensemble d'un sujet et impliquant plusieurs disciplines, tantôt plus ciblées, en vue d'effectuer des mises à jour. Les expertises opérationnelles s'appuient sur les connaissances des expertises collectives pour aller plus loin dans l'aide à la décision. Les thématiques des expertises collectives peuvent être regroupées en trois grands champs : la prévention et la prise en charge de problèmes de santé publique comme la grippe, l'ostéoporose, la migraine, l'obésité ou les troubles mentaux chez l'enfant ; la connaissance et l'évaluation de risques en santé, concernant l'amiante, le plomb, les éthers de glycol, les dioxines, le cannabis, l'alcool ou le tabac ; l'aide à la définition de stratégies comme les politiques vaccinales ou la recherche de nouvelles thérapeutiques. Sur ces sujets parfois sensibles, la communication est indispensable mais délicate. M. Guy PAILLOTIN : Dans le cas de la recherche, le savant s'adresse à ses pairs ; dans le cas de l'expertise, aux décideurs publics. Nous n'avons pas encore fait le tour de la question des tensions entre expertise et recherche mais vous nous avez donné quelques aperçus intéressants. Mme Marie-Thérèse HERMANGE, Sénatrice de Paris N'étant ni chercheur ni expert, c'est avec modestie que je m'exprime devant vous, en qualité de représentante du législateur, c'est-à-dire en quelque sorte de l'opinion. L'expert est celui ou celle qui conçoit, propose et crée. C'est aussi le lieu d'un pouvoir. Dans un texte célèbre, Gaston Bachelard affirme : « La science s'oppose absolument à l'opinion. S'il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion ; de sorte que l'opinion a, en droit, toujours tort. L'opinion pense mal ; elle ne pense pas ; elle traduit des besoins de connaissance. On ne peut rien fonder sur l'opinion. » Le décideur a beau ne détenir aucune compétence technique, le dossier, une fois que l'Agence européenne pour l'évaluation du médicament a étudié une molécule, arrive devant la commission administrative compétente. Quel pouvoir celle-ci reconnaît-elle à l'expertise ? Comment la rencontre se déroule-t-elle ? Est-il tenu compte de critères indispensables, en particulier l'indépendance, la collégialité et la transparence ? Ce travail effectué en amont requiert un lien de confiance entre l'expert et le décideur. J'aurais pu prendre comme exemple, dans le domaine sanitaire, le débat sur les cellules souches, dans le domaine éducatif celui sur la méthode globale, dans le domaine social celui sur les droits de l'enfant. Dans les années quatre-vingt, des expertises ont assuré qu'il fallait, d'une part, créer des internats et, d'autre part, laisser les enfants maltraités dans leur famille, à partir de quoi a été élaborée une véritable idéologie du lien familial. Les experts, en transformant la question du décideur, replacent les préoccupations de l'expertise dans un autre champ, de nature scientifique, c'est-à-dire clos. Ce mode de conceptualisation est capable de susciter l'unanimité en créant un paradigme. Et la force de ce paradigme est qu'il permettra de partager les mêmes évidences et les mêmes anticipations, au détail près que, pour être valable, il devra être invisible. Dans les années soixante-dix, on s'est aperçu que l'hôpital coûtait cher et on a inventé le budget global. Mais celui-ci n'a pas fonctionné et il a fallu imaginer une norme totalement invisible : l'indice synthétique d'activité, le point ISA, encore en vigueur aujourd'hui. Cette norme est explosive car elle ne permet pas d'atteindre l'objectif - faire des économies -, dans la mesure où elle a des effets pervers à l'intérieur de l'administration hospitalière. Sauf qu'à l'époque de sa création, les administrations compétentes, prétendument expertes, affirmaient qu'elle était la panacée pour guérir la sécurité sociale. Il me semble crucial, au-delà des mots, que la rencontre entre, d'une part, l'expert et, d'autre part, le législateur et le citoyen intervienne dans l'objectivité et la confiance, afin que l'opinion publique ait accès à toute l'information nécessaire. M. Guy PAILLOTIN : Décidément, nous sommes loin de la langue de bois... Personne n'a jamais revendiqué le pouvoir laissé aux experts, et il convient effectivement de trouver des médiations. M. Claude SAUNIER, Président : C'est la démocratie qui en jeu. Mme Pascale BRIAND, Directrice générale de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) Les exposés précédents ont montré combien est complexe l'activité d'expertise, qu'il s'agisse de la question posée comme de la mécanique qui conduit de la connaissance à l'aide à la décision. La gymnastique intellectuelle de la recherche est presque inverse à celle de l'aide à la décision, en ce sens que le chercheur pulvérise la complexité du réel afin de faire avancer les connaissances sur des unités de question abordables par la science tandis que l'expertise intègre un maximum d'éléments pour répondre à une question complexe. L'activité d'expertise constitue par conséquent pour les chercheurs un enrichissement et une formation qui devraient être mieux reconnus. Dans leur carrière, ils ne trouvent pas la reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre de leur investissement. De fait, les membres des comités d'experts sont de plus en plus des chercheurs seniors, et de plus en plus seniors. C'est bien, parce qu'ils sont expérimentés, mais il serait également important que des jeunes y participent, car ils pourraient s'y former tout en apportant leur contribution propre. La procédure est longue, comporte plusieurs pans, et de nombreux facteurs influant sur ses résultats. Il convient d'abord que la démarche soit collégiale et fondée sur les meilleures compétences scientifiques. Ensuite, la qualité de l'expertise dépend des procédures : comment transforme-t-on une question pour faire émerger tous les éléments d'aide à la décision ? Le dialogue entre les tutelles à l'origine de la saisine et les opérateurs qui la traitent est très important pour préciser les termes de celle-ci. Il est enfin essentiel que les démarches conduites soient parfaitement claires : pour restaurer ou instaurer la confiance, un effort de communication doit être accompli non seulement sur les avis mais aussi sur les procédures au terme desquelles ils ont été rendus. Vu la complexité des questions abordées, le champ d'expertise déborde toujours de la compétence d'un scientifique pris individuellement. C'est le croisement des compétences qui apporte une valeur ajoutée et permet de relever le défi du respect des délais. Car il s'agit non seulement d'orchestrer l'expertise collective en l'enrichissant le plus possible mais aussi souvent de prendre des décisions dans l'urgence, les délais requis étant extrêmement brefs. Il importe de s'y préparer et d'anticiper les demandes risquant de parvenir un jour ou l'autre par un travail de fond, comme les laboratoires de recherche et les comités d'experts de l'AFSSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'ont fait pendant des années. Cela peut paraître irréaliste mais les publications accumulées contribuent à former un tissu de connaissances permettant, le moment venu, d'aller plus vite sans altérer la qualité de l'expertise. Émettre des avis de valeur est une chose, les rendre intelligibles en est une autre. La difficulté consiste à parvenir à une formulation ne déformant en rien le fond de ces avis tout en garantissant une présentation compréhensible, ce qui justifie des efforts décuplés. Enfin, se pose la question de l'articulation entre les niveaux d'expertise national et européen. Même s'il est important que les experts participent à des comités européens, cela ne doit pas se traduire par un affaiblissement de l'expertise française, faute de quoi notre sécurité sanitaire serait pénalisée. M. Guy PAILLOTIN : C'était un baptême du feu.... Nous vous souhaitons la plus grande réussite dans vos nouvelles activités. Professeur Daniel VITTECOQ, Président de la commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) Je suis médecin, médecin d'abord et avant tout, spécialiste en médecine interne et maladies infectieuses, domaine dans lequel nous avons enregistré de grandes avancées entre 1975 et 1985, avec le grand bond en avant des antibiotiques. Je participe à l'AMM depuis une quinzaine d'années et je la préside depuis deux ou trois ans. Je demande avant tout que l'expert soit respecté par ses pairs et par l'opinion publique. Il est souvent critiqué alors qu'il a essentiellement le droit de se taire et que c'est un citoyen militant passionné, au service de la santé publique. L'expert n'est pas un professionnel et ne souhaite pas le devenir. Je ne suis pas d'accord avec les remarques qui ont été faites sur son pouvoir : l'exercice d'expertise, pour moi, ne se situe pas dans la dimension du pouvoir. Il faut protéger l'expert vis-à-vis de sa tutelle car ce sera une denrée de plus en plus difficile à trouver, l'hôpital public ou l'université ne voyant pas toujours d'un bon œil ses salariés s'occuper d'autre chose. Certains m'ont clairement fait savoir qu'il était temps pour eux de s'arrêter pour se consacrer à leur service hospitalier ou leur université - et je rends particulièrement hommage aux provinciaux, pour lesquels c'est plus difficile encore. Une partie de l'activité hospitalière fonctionne à la tarification et, en tant que chef de service, je suis obligé de m'en soucier, même si la fonction d'expertise compte dans la MIGAC, la Mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation. L'expert ne souhaite pas apparaître comme un pion. Les dossiers sont abordés sous des angles différents entre l'amont et l'aval des agences. L'opinion publique est donc encline à ne pas leur donner la même valeur. Il faut garder le caractère univoque de l'expertise. L'expert souhaite de plus en plus répondre à des questions précises et ne plus porter sur ses épaules, par exemple, la responsabilité de la mise sur le marché. Nous travaillons de façon collégiale et nous ne sommes donc pas isolés, sauf en matière de maladies orphelines, où les spécialistes sont rares et où la demande de l'opinion publique est très forte. L'expert ne porte pas les responsabilités du dossier qu'il interroge, sans quoi plus personne n'accepterait de l'être. Ce n'est pas en faisant évoluer l'expertise ou les experts que la nature du produit, ses effets secondaires, ses bénéfices et ses risques changeront. L'expert est en attente de clarté. Les agences doivent continuer à fonctionner de façon totalement transparente. Les décisions de l'expert s'inscrivent dans une temporalité. Nous travaillons à un moment donné, sur un médicament précis, dans une situation particulière. Il y a dix ans, nous aurions parlé du SIDA. La période 1965 à 1985 s'est caractérisée par un bond en avant des antibiotiques, mais, avec l'essor fantastique des antirétroviraux, le thème des antibiotiques est devenu désertique. L'expert n'est pas responsable de cette situation. J'invite tout le monde à méditer sur l'ouvrage de Charles Nicolle, Naissance, vie et mort des maladies infectieuses. M. Guy PAILLOTIN : Je vous remercie d'avoir soulevé la problématique de la responsabilité. M. Jean-Marie SCHWARTZ, Responsable de la cellule support des avis et expertises institutionnelles au CNRS Le CNRS n'a pas encore de pratique en la matière, mais je vais témoigner du travail de réflexion qui a été entamé il y a près d'un an. Les choix que nous avons faits sont, je le crois, les plus adaptés à une maison comme le CNRS : sa mission de départ étant de s'intéresser à tous les aspects de la recherche fondamentale, il doit couvrir tous les sujets susceptibles d'appeler une expertise scientifique. Pourquoi le CNRS ne s'est-il pas lancé dans l'aventure plus tôt ? Les velléités sont anciennes - elles datent de quinze ou seize ans - mais nous avons attendu longtemps avant de passer aux actes car, dans l'esprit du CNRS, tout ce qui ne contribue pas directement à la production scientifique est secondaire et doit bénéficier d'un volontarisme très poussé pour aboutir. De surcroît, l'expertise est extrêmement dangereuse ; elle soumet les institutions à des critiques lourdes. Le plan stratégique 2002-2006 prévoyait que le CNRS franchisse le pas ; c'est maintenant chose faite. L'expertise scientifique se situe entre science et décision mais aussi entre science et société. Nous avons décidé de ne pas trancher entre les deux articulations et de mettre en place un système qui nous permette de répondre au mieux aux demandes des décideurs tout en nous adressant à la société : la quasi-totalité de la procédure sera publique. J'insiste moi aussi sur l'importance de la reformulation des questions posées afin qu'elles soient traitables par des scientifiques et que la réponse ne soit pas trop frustrante. Les scientifiques ont une tendance naturelle à frustrer ceux qui attendent des réponses simples, dans la mesure, en particulier, où ils raisonnent de manière statistique et présentent des échelles de risques, laissant au politique ou au décideur la charge de prendre ses responsabilités. Le CNRS ne s'autosaisira pas. Il passera contrat avec des commanditaires qui ne pourront être que des structures publiques ou quasi publiques. La diffusion des travaux sera publique et nous ferons intervenir des tiers, représentants d'associations ou du public, leur avis contribuant à l'impartialité de la démarche. Le premier objectif est la diffusion de la méthode scientifique dans le public. Il nous paraît notamment important de faire comprendre ce que signifie le principe de précaution. Cela nous aidera à sortir du cléricalisme et à ouvrir l'organisme sur la société, mais aussi à développer l'interdisciplinarité ainsi que la coopération inter organismes. La méthodologie sera fondée sur la rigueur, la rigueur et la rigueur. Les experts employés seront connus et signeront leur rapport, mais sous la garantie méthodologique du CNRS, qui, le cas échéant, s'interposera. L'ensemble de la société interagira dans le processus, selon des modalités à définir. Nous insistons beaucoup sur la démarche qualité et la démarche éthique, qui se manifesteront par des procédures de relecture, un contrôle méthodologique indépendant et l'organisation systématique d'un colloque final ouvert à l'occasion duquel les résultats seront soumis à la critique. Le processus sera probablement assez lourd et assez long, ce qui est toutefois nécessaire pour obtenir un produit de qualité. Les conflits d'intérêts constituent une autre préoccupation forte. Il est illusoire d'imaginer que nous puissions réunir des personnes à la fois compétentes et libres de tout conflit d'intérêts. Il convient simplement de connaître la situation dès le départ et d'adopter des dispositions méthodologiques de nature à éviter les dérives. Cette méthode sera expérimentale. Nous n'avons pas encore de sujet d'expertise ; nous cherchons actuellement à faire savoir que nous sommes disponibles et que nous attendons les clients, sur des thèmes qui en valent la peine. M. Guy PAILLOTIN : L'intérêt de cette table ronde est notamment de confronter les scientifiques et les utilisateurs de l'expertise, y compris ceux du secteur privé. Aussi donné-je a parole à M. Benoît Mangenot. M. Benoît MANGENOT, Directeur de l'Association nationale des industries alimentaires (ANIA) L'Association nationale des industries alimentaires ne représente que des intérêts privés, ceux des 10 000 entreprises de l'industrie alimentaire, très concernées par le sujet. L'industrie alimentaire vit en effet depuis dix ans dans une ambiance de crises successives - vache folle, OGM, dioxine, listeria - qui a instauré une véritable culture du risque. Celle-ci est alimentée par des dangers tantôt réels tantôt perçus comme tels par les consommateurs, qui mettent les entreprises sous une pression terrible et vont jusqu'à atteindre la réputation de leurs marques et menacer leur survie même. Les entreprises n'ont pas l'expertise interne suffisante pour évaluer ces risques et élaborer les réponses appropriées. Surtout, elles n'ont pas la crédibilité nécessaire pour apporter des réponses aux médias et aux consommateurs. Elles ont donc besoin de faire appel à une expertise incontestable, et seule l'expertise publique peut jouer ce rôle. C'est pourquoi nous avons été parmi les partisans de la création de l'AFSSA. Les entreprises portent généralement une revendication de sécurité car elles ont besoin de savoir où elles vont. Le contexte réglementaire fait également croître notre intérêt pour l'expertise publique. Le principe de précaution est maintenant inscrit dans la Constitution. La jurisprudence reconnaît désormais la faute inexcusable de l'entrepreneur. La réglementation, notamment européenne, évolue en permanence : c'est ainsi qu'un règlement communautaire sur les allégations santé est attendu pour 2006. L'expertise publique est nécessaire pour la mise sur le marché de nouveaux aliments. De même, la liste des additifs devra être réévaluée tous les dix ans et le répertoire des substances aromatisantes doit déjà être révisé régulièrement par les scientifiques. Le nouveau « paquet hygiène », qui entrera en vigueur au 1er janvier 2006, encourage la rédaction puis l'évaluation par l'AFSSA et enfin la validation par l'administration de guides de bonnes pratiques hygiéniques ; il faut par conséquent s'attendre à un doublement du nombre de guides existants et donc de demandes d'évaluation. Et je ne parle pas des allergènes, de la grippe aviaire, des matériaux de contact et de tous les autres risques que nous encourons dans nos activités. En parallèle, les relations entre les entreprises et le monde de la recherche s'intensifient. Dans la plupart des appels d'offres de recherche, qu'ils soient communautaires ou nationaux, la participation d'entreprises aux programmes proposés est une condition d'éligibilité, et c'est bien normal. Il s'agit d'un souhait partagé par les organismes de recherche, pour lesquels cela représente un complément financier non négligeable, et par les industriels, dont la recherche est moins fondamentale que celle menée par les instituts publics. Le vivier de l'expertise publique est le même que celui de la recherche publique, ce qui soulève beaucoup de problèmes. Les chercheurs nous disent que leur activité d'expert n'est pas reconnue dans leur parcours professionnel et que le seul critère sur lequel ils sont jugés est le nombre de publications ; cela explique sans doute que les appels à candidature d'expert ne débouchent pas sur une pléthore de postulants. L'indépendance et l'excellence sont les maîtres mots des agences d'évaluation ; mais faire de la recherche avec l'industrie, c'est perdre un peu de son indépendance. Parmi les critères de sélection des experts, il faut faire un compromis entre compétence et indépendance car la compétence suppose la connaissance du secteur et l'évaluation de l'enjeu, ce qui complique le respect nécessaire de l'indépendance. Nous pensons qu'il faut sortir de cette impasse apparente et adapter la participation des experts en fonction du niveau de conflit d'intérêts, en jouant sur la transparence. La déclaration d'intérêts est nécessaire mais on peut sans doute aller au-delà. L'expertise privée est complémentaire de l'expertise publique. L'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, par exemple, s'est très nettement désengagé de la recherche technologique sur les procédés, seul le CEMAGREF, l'Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement, en faisant encore un peu. Cette connaissance des procédés est maintenant essentiellement dans les mains de l'industrie. Il faut donc pouvoir conjuguer ces compétences, issues de l'industrie, avec celle des chercheurs du public. D'où notre souhait, réitéré maintes fois, de faire participer l'expertise privée à l'évaluation collective, notamment dans le cadre de l'AFSSA, au moins au stade de l'instruction. La décision doit être prise en totale indépendance et en l'absence de tout intérêt privé mais l'intervention de l'expertise privée au cours de la première phase est utile et même nécessaire. Nous souhaitons également que la possibilité de saisir les experts publics soit reconnue au secteur privé. M. Philippe GUERIN, Président du Le Conseil national de l'alimentation, le CNA, est un organisme indépendant, créé il y a vingt ans pour aider les acteurs publics et privés dans le domaine de l'alimentation et de la politique alimentaire. Il rassemble tous les acteurs de la chaîne, des producteurs aux distributeurs en passant par les associations de consommateurs, l'industrie de transformation, l'artisanat, la restauration et les syndicats de salariés, ainsi que plusieurs personnalités qualifiées. Il vote des avis et émet des recommandations. Il a un rôle de proposition mais aussi de plus en plus d'identification de la demande sociale et d'incubation de questionnements. Le thème de cette après-midi, le retour d'expérience, rejoint celui sur lequel seront centrés nos débats de la semaine prochaine : une nouvelle gouvernance pour la politique de l'alimentation. Nous partirons en particulier des suites données à cinq avis émis par le CNA au fil de son existence, sur les thèmes suivants : la traçabilité des denrées alimentaires, expression magique qui recouvre bien des mystères ; le principe de précaution et la responsabilité ; l'étiquetage des aliments et ingrédients issus d'OGM ; l'information du consommateur sur les denrées alimentaires ; l'allégation alimentation et santé. S'agissant de l'avis sur le principe de précaution émis il y a quatre ans, quelles sont les recommandations qui n'ont pas été suivies d'effets ? L'accent était mis sur la nécessité d'organiser l'évaluation socioéconomique et juridique des risques distinctement et indépendamment de l'évaluation scientifique. Or aucune réflexion n'a été amorcée et ce débat n'a pas été tranché, par les parlementaires non plus, qui ne sont pas revenus sur le cadre des lois de 1998. L'un des grands principes de l'analyse de risque est la décomposition en trois phases bien scindées : l'évaluation, la gestion et la communication. Ne conviendrait-il pas plutôt de distinguer évaluation et décision ? À la lumière de l'expérience, il faut avoir le courage de regarder les choses en face et de reconnaître qu'il y a confusion des genres. Prendre une décision recèle des risques. Mais par qui le niveau acceptable de risque est-il fixé ? Par le décideur tout seul ? L'analyse socioéconomique et l'analyse scientifique ne forment certainement pas deux cercles concentriques et doivent fonctionner en interaction. Le dispositif actuel est manifestement lacunaire, même si des instances comme le CNA ont sans doute participé à des prises de conscience. S'agissant de la possibilité pour les organisations professionnelles ou de consommateurs d'interroger l'autorité compétente sur la sécurité des produits avec l'assurance de recevoir une réponse, force est de constater qu'aucune des trois directions générales directement concernées -santé, agriculture et répression des fraudes - n'a accompli d'avancées. La confiance générale dans le système ne pourra être rétablie que si la plus grande attention est prêtée à la communication. Il ne s'agit pas seulement de transparence mais également d'allers-retours entre acteurs, parmi lesquels les médias ne sont évidemment pas les moindres. Le CNA avait préconisé la saisine directe par les opérateurs économiques mais cette mesure n'a toujours pas été mise en place. N'existe-t-il pas des obstacles idéologiques, concernant les conflits d'intérêts ou les relations entre recherche publique et recherche privée ? Enfin, donner un rôle et un pouvoir aux salariés en cas de suspicion d'un danger émanant de leur entreprise suppose de refonder le droit du travail : Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous avez du pain sur la planche. Plus généralement, il est crucial de dépasser les querelles corporatistes et boutiquières entre écoles scientifiques, disciplines ou ministères. La démarche d'expertise suit aujourd'hui deux approches, qui parfois se combattent : la première, a posteriori, est celle des épidémiologistes ; la seconde, a priori, celle des ingénieurs et des modélistes. Nous devons arriver à les coordonner. En 2000, Jean-Jacques Duby, alors directeur général de Supélec, l'Ecole supérieure d'électricité, avait écrit une lettre ouverte aux politiques qui disait en substance : « Ne nous demandez pas de prendre des décisions à votre place, définissez la responsabilité juridique de l'expert scientifique, et ayez le courage de revenir sur des mesures que vous avez prises précédemment ». M. Guy PAILLOTIN : Les relations entre l'expertise et la décision publique, voire l'opinion publique, posent des problèmes énormes. Peut-être serait-il bon de songer à l'opportunité de créer une autorité indépendante sur les questions de sécurité et de sûreté. Il pourrait être utile de prendre modèle sur le nucléaire, domaine dans lequel les choses ont bien avancé. M. Claude SAUNIER, Président : L'une des dispositions centrales d'une proposition de loi actuellement en préparation tend précisément à mettre en place une haute autorité chargée de renforcer l'expertise sur ce sujet. Modérateur : M. Gérard PASCAL, Directeur de recherche honoraire à l'Institut national de recherche agronomique (INRA) Le décor est maintenant bien planté, nous avons longuement évoqué précédemment la nécessité d'une approche pluridisciplinaire de l'expertise, et je n'y reviendrai donc pas. S'agissant en revanche de l'indépendance et de la transparence du processus d'expertise, je poserai la question : qu'est-ce que l'indépendance ? Qui peut, y compris parmi nous, se dire « indépendant » ? Je préfère, pour ma part, parler d'impartialité, car l'indépendance doit s'apprécier non seulement vis-à-vis de tel ou tel secteur économique, mais aussi vis-à-vis des décideurs et des institutions : un chercheur payé par un organisme, par exemple, n'est pas complètement indépendant, et l'on peut se demander si la déclaration d'intérêts ne devrait pas mentionner aussi ce genre d'intérêt, d'ordre administratif, voire intellectuel. Ont été évoqués aussi les droits et devoirs de l'expert, sur lesquels les intervenants à cette deuxième table ronde vont nous apporter maintenant quelques éléments supplémentaires, notamment en matière de reconnaissance sociale et professionnelle, ainsi que de déontologie de l'expertise. Auparavant, toutefois, je voudrais soulever la question de l'expertise interne, qui rejoint d'ailleurs celle de l'indépendance administrative, et évoquer d'un mot le principe de précaution, pour dire qu'à mon sens nous ne devrions pas y consacrer trop de temps, car ce n'est pas à proprement parler un problème d'expertise, mais de décision. Je donne d'abord la parole au professeur Jean-Claude Ameisen, président du comité d'éthique de l'INSERM, en l'invitant, comme d'ailleurs les orateurs suivants, à la concision, afin que nous ayons le temps d'avoir un bref débat au terme des interventions. M. Jean-Claude AMEISEN, Unité 552 INSERM, Président du Comité d'éthique de l'INSERM Le statut de l'expert et les questions éthiques qui lui sont liées dépendent du statut que l'on confère à l'expertise elle-même. Or, on confond souvent plusieurs choses. Il y a l'expertise d'urgence, qui vise à protéger la collectivité. Il y a une expertise qui revêt un caractère essentiellement déontologique, un caractère de régulation des bonnes pratiques. Et puis il y a, en amont de l'urgence comme de la régulation, une expertise qui est une aide à la réflexion, au débat, aux choix, et qui est également très importante. Ces différentes définitions de l'expertise déterminent largement le statut de l'expert. Au moment où les rapports entre le médecin et le patient, pour prendre cet exemple, évoluent de la notion de prescription vers celle de consentement informé, vers l'idée, donc, que « personne ne peut décider à ma place quel est mon intérêt », on peut se demander pourquoi il n'en irait pas de même entre l'expert et la société, pourquoi on ne donnerait pas à l'expertise la dimension d'une aide à la décision, en la mettant au cœur du processus démocratique. L'idée a longtemps prévalu, notamment pour s'opposer au vote des femmes, qui n'est pas si ancien en France, qu'il y a des personnes qui n'ont pas les éléments pour décider et qu'il vaut donc mieux décider pour elles. Or, il n'y a pas de responsabilité sans liberté, pas de liberté sans choix, et pas de choix véritable qui ne comporte des éléments d'incertitude. Le rôle de l'expert est d'éclairer ce champ de l'incertain, sans se substituer à la société. La communication des résultats de l'expertise s'envisage très différemment selon que l'on est dans le cadre d'une prescription, d'une recommandation directe, ou dans celui du consentement informé, qui suppose qu'on donne à la société les éléments de connaissances afin qu'elle se les approprie. Il y a là une dimension épistémologique : comprendre de quoi il s'agit, comprendre les mots, les concepts, les éléments de la décision est au moins aussi important que de détenir la somme des informations - nous le voyons bien, d'ailleurs, dans la relation médecin-malade. Un mot sur la méthodologie : l'expert peut parfaitement faire œuvre d'indépendance vis-à-vis de ses sources. Certaines affaires judiciaires récentes, aux Etats-Unis, ont montré que la mise à disposition de résultats primaires, ne correspondant pas forcément aux résultats publiés, pouvait être un élément majeur d'information, qui contribue au bilan des connaissances. Si l'on veut éviter de tomber dans une vision restrictive et positiviste de l'expertise, il ne faut pas forcément rechercher le consensus. Les divergences de vues, surtout dans le cadre d'une expertise multidisciplinaire, permettent à la société de prendre conscience de la complexité des problèmes, tandis que la tentation du consensus peut appauvrir la réflexion. Troisièmement, il faut savoir qu'il y a toujours dans l'expertise, et donc dans la décision, des aspects extérieurs à la discipline : culturels, sociaux, économiques, politiques. Il convient donc de poser les limites et les perspectives au même titre que les données elles-mêmes. Pourquoi les experts reformulent-ils les questions qu'on leur pose ? Parce que ce sont des scientifiques et qu'il leur faut rendre les choses testables. C'est pourquoi il faut restituer le contexte en même temps que la reformulation, ce qui suppose l'intervention en aval d'autres experts appartenant à d'autres champs. On a évoqué le problème de la qualité scientifique de l'expertise, sa nécessaire dimension multidisciplinaire. J'insisterai pour ma part sur la dimension internationale, car on ne peut pas porter sur une collectivité un regard à la fois objectif et intérieur. Il est essentiel d'avoir des regards qui représentent d'autres intérêts. S'agissant des conflits d'intérêts, la première chose est évidemment de les rendre publics, différentes modalités étant possibles. Certaines instances internationales prévoient par exemple que les personnes potentiellement concernées par ces conflits peuvent être entendues comme témoins, sans siéger dans le collège d'experts lui-même. Quant au crédit qu'il faut redonner à l'activité d'expertise, c'est une question que je suis tenté d'aborder sous un autre angle, en disant que s'interroger sur les implications de sa recherche, c'est poursuivre son activité de recherche sous une autre forme, et qu'il y a donc un lien direct entre l'activité de chercheur et l'activité d'expert. M. Gérard PASCAL : Je vous remercie, et donne maintenant la parole à M. Daniel Marzin, président de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dite commission des toxiques en agriculture, dite encore COMTOX. Professeur Daniel MARZIN, Président de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés (Comtox) Il y a environ vingt ans que je suis impliqué dans l'expertise du médicament, et je siège à la commission d'autorisation de mise sur le marché, mais c'est la première fois que je vois associé le mot statut et le mot expert : soyez-en remerciés ! L'expert est quelqu'un qui a une expérience. On n'est pas expert à vingt ou à trente ans, on commence à être expert « junior » à quarante -et « senior » bien plus tard. Cela rend nécessaires une formation à l'expertise et une planification, car les jeunes chercheurs que nous commençons à former aujourd'hui auront des compétences dans le domaine de l'expertise dans une vingtaine d'années seulement. Il est donc indispensable de prévoir à long terme les besoins d'expertise que nous aurons à cet horizon. Il y a un domaine que je connais plus particulièrement : c'est la toxicologie. A ma connaissance, deux unités de l'INSERM ont ce mot dans leur titre, mais une seule en fait vraiment. Chaque année, trois bourses de thèse en toxicologie sont attribuées par le ministère de la recherche, cinq dans le meilleur des cas, mais une grande partie de ces toxicologues partiront travailler dans l'industrie. Aurons-nous, dans ces conditions, les experts dont nous aurons besoin dans vingt ans ? J'insiste donc sur la nécessité absolue d'une planification des besoins, au-delà de l'exemple ponctuel de la toxicologie. Mon deuxième point porte sur la question de la reconnaissance de l'expert, pour laquelle ont plaidé Jean Marimbert et Pascale Briand. Dans les premières commissions d'AMM, dans les années 1990, le ministre de la santé de l'époque disait recommander à ses collègues chargés de l'éducation nationale et de la recherche de prendre en considération les activités d'expertise dans les évolutions de carrière. Mais ces recommandations, bien que renouvelées par ses successeurs, n'ont jamais été suivies d'effet, et l'activité d'expertise reste considérée par le CNU comme une activité mineure, comme une perte de temps. Je peux même confirmer au représentant des industries alimentaires que seules les publications, l'impact factor, sont prises en considération, et que l'expertise ne l'est jamais - elle est même plutôt un critère qui vous écarte de la progression de carrière. En d'autres termes, on ne peut se consacrer à l'expertise qu'une fois qu'on n'attend plus rien en termes de carrière, c'est-à-dire au terme de celle-ci, et que rester pendant plusieurs années un expert junior, c'est sacrifier sa carrière. Il y a trois ans, nous avons eu à donner un avis, dans le cadre du conseil scientifique, sur les experts de l'AFSSA. Nous avons constaté que l'âge moyen était de plus en plus élevé et qu'il se posait un problème de renouvellement. Il faut absolument trouver un moyen d'attirer des jeunes, en créant une voie de progression par l'expertise, par exemple en leur donnant des postes dans les instances en charge de l'expertise, postes qui seraient attribuées sur dossier par un jury, de la même façon que procède le CNU. La gestion des conflits d'intérêts a trouvé une solution partielle avec la publicité qui en est faite, et je suis tout à fait d'accord avec Mme Blandin quand elle dit que les relations clandestines avec l'industrie sont très dommageables - le cas dramatique de Philip Morris est particulièrement éclatant. Il est évidemment indispensable que les déclarations d'intérêts soient publiques, mais il ne faut pas pour autant qu'elles équivalent à une mise au pilori de tous ceux qui ont des relations avec l'industrie. Comment un clinicien pourrait-il évaluer des essais cliniques sans en avoir réalisé lui-même ? Et comment, compte tenu du coût des essais dignes de ce nom, pourrait-il en avoir réalisé sans le soutien de l'industrie ? Il y a donc forcément une relation avec le privé, et c'est cette relation qui permet d'avoir une analyse fine, de poser des questions pertinentes et réalistes lorsqu'il s'agit d'examiner, d'accepter ou de rejeter certains essais réalisés. On voit souvent des jeunes experts dont les exigences sont tout à fait à côté de la plaque, parce qu'ils n'ont pas l'expérience suffisante. M. Gérard PASCAL : Je vous remercie d'avoir fait une proposition concrète sur la carrière des chercheurs-experts. Nous allons rester sur la question des conflits d'intérêts en écoutant M. Lionel Benaiche, Vice-Président du tribunal de grande instance de Nanterre - mais ce n'est pas principalement à ce titre qu'il va nous parler. M. Lionel BENAICHE, Vice-Président du Tribunal Je suis revenu dans l'activité juridictionnelle, en effet, mais je ne suis pas totalement coupé du monde de l'expertise, auquel j'ai appartenu pendant les six ans où j'ai été en charge de la cellule de veille déontologique de l'Agence du médicament, puis de l'Agence des produits de santé. J'y ai participé à la définition et à la hiérarchisation des conflits d'intérêts, et l'Agence a publié récemment une notice dressant une typologie des conflits, recensant les cas possibles et définissant ceux dans lesquels les experts peuvent siéger ou non. Il existe une obligation de déclaration d'intérêts, et même d'actualiser en ligne cette déclaration. On retrouve cette exigence de transparence, ce souci du contradictoire dans les autres législations européennes et internationales. Nous sommes dans une période où, de plus en plus, l'expertise devient un pouvoir, où l'expert s'engage, en a conscience, et est responsable : responsable au sens où il peut avoir rendre des comptes devant une instance ou une juridiction, certes, mais aussi, de façon plus positive, responsabilisé par la définition d'une éthique ou d'une déontologie professionnelle. Le fait même que la responsabilité des experts puisse être mise en cause, tant au plan civil que pénal ou disciplinaire, montre bien qu'ils détiennent un pouvoir. Alors que seule la responsabilité du décideur était jusqu'à présent recherchée, les juges d'instruction remontent maintenant parfois jusqu'à l'avis de l'expert. L'Agence a fait des progrès incontestables en matière de gestion des conflits d'intérêts. La cellule de veille déontologique se perpétue - sous une forme un peu différente, mais il est normal que chaque directeur général imprime sa marque... La difficulté principale, dans ce genre d'institutions, tient à la place et au rôle de l'expert. Beaucoup, en effet, sont des collaborateurs occasionnels, quasi clandestins, que l'on arrive à faire venir, parfois de province, au prix de mille difficultés matérielles, et surtout de problèmes de considération, de reconnaissance et de statut. J'en ai souvent entendu se plaindre d'être à la fois pénalisés dans leur institution d'origine par leur activité, pourtant utile, d'experts, et maintenus à l'Agence dans une situation d'insécurité juridique totale. Et de fait, il n'y a pas d'entrée solennelle en expertise, l'expert n'est pas accueilli, mais désigné sur une liste, sans appel d'offres ni vraie sélection, comme cela se passe aux Etats-Unis où les nominations sont publiées sur le Federal Register et dans toutes les publications scientifiques. Il n'y a pas non plus de formation dispensée à l'expert qui prend ses fonctions, alors qu'il y en a une pour les experts judiciaires, quoi qu'on puisse penser par ailleurs de l'expertise judiciaire... Outre ces procédures, ces rituels, cette solennité où ils voient un élément de protection, les experts ont également besoin d'avoir la garantie de pouvoir consigner d'éventuelles opinions divergentes sur les procès-verbaux. Il existe désormais à l'AFSSAPS des fiches de divergence, mais de mon temps c'était très difficile à obtenir, faute de secrétariat spécialisé. C'est pourtant essentiel, car dans la recherche des responsabilités que j'évoquais tout à l'heure, le premier réflexe du juge est de demander les procès-verbaux, et si l'expert ne peut prouver qu'il a vainement exprimé une opinion contraire, il est considéré comme englobé dans la décision collégiale. Il est sans doute très bien de prévoir une gradation des conflits d'intérêts, de distinguer entre conflits dirimants, majeurs, mineurs, etc, mais chaque expert entend les choses à sa manière, et il est difficile de dessiner une typologie. Cela doit nous amener à réfléchir sur le type d'expertise que l'on veut : peut-on en rester à une expertise duale reposant sur la confrontation des expertises interne et externe ? J'aimerais que l'on repose la question de l'expertise interne, dont je ne sais pas si elle est soumise à déclaration d'intérêts. La question du statut est également lié à celle de la sanction : comment sanctionner des personnes dont on risque d'avoir besoin ? En six ans à l'AFSSAPS, je n'ai pas vu une seule sanction, alors que j'ai pourtant vu un certain nombre de transgressions, d'illégalités, voire de fraudes patentes.... Peut-être faudrait-il faire présider les commissions par des non-spécialistes ? C'est ce qu'avait suggéré le professeur Labrusse-Riou en 1990, et le directeur général de l'époque n'avait pas été hostile à cette idée d'un président-arbitre, impartial, qui gérerait les conflits. M. Claude SAUNIER, Président : Vous êtes en plein dans le sujet... M. Gérard PASCAL : Et votre intervention illustre la grande hétérogénéité de statut des experts au sein des différents domaines. Je donne maintenant la parole à M. André Cicolella, directeur de l'évaluation des risques sanitaires à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. M. André CICOLELLA, Directeur de l'évaluation des risques sanitaires à l'Institut national de l'environnement industriel L'Unité « Evaluation des Risques Sanitaires » de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, que je dirige, effectue des expertises dans le cadre de prestations à l'administration, par exemple dans l'affaire de l'Erika, mais aussi de prestations commerciales, notamment sur de l'impact sanitaire des installations classées. J'ai effectué précédemment le même type de travail à l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, sur les éthers de glycol, où 15 équipes du monde entier ont évalué les risques liés à ces solvants alors largement utilisés dans des usages professionnels et domestiques. Les résultats, mettant notamment en évidence pour la première fois le lien entre malformation de l'enfant et exposition professionnelle maternelle, devaient être présentés lors d'un colloque international à Pont-à-Mousson, ville chère à M. LE DÉAUT, mais j'ai été licencié quelques jours avant le colloque pour faute lourde et celui-ci a été annulé - avant d'être finalement maintenu suite aux pressions des organisateurs, et que la cour d'appel de Nancy, puis la Cour de cassation, désavouent clairement mon ancien employeur, l'INRS. J'ai par ailleurs publié aux éditions Fayard, en mai dernier, un livre intitulé Alerte santé, en collaboration avec la journaliste scientifique Dorothée BENOÎT-BROAWEYS. Nous vivons dans une période de mutation du modèle d'expertise. Dans le modèle ancien, l'expert parlait intuitu personae, il parlait d'autorité et n'avait pas besoin de dire sur quelle base il fondait son expertise. A ce modèle opaque en a succédé un nouveau, transparent et plus collectif, et qui repose sur l'obligation de définir la méthodologie et les critères utilisés. Cette évolution a des implications, tant au plan scientifique que déontologique. Suite aux interrogations croissantes de la société sur les risques environnementaux, une méthode d'évaluation des risques a été codifiée par l'Académie des Sciences des Etats-Unis en 1983, et reprise par l'Union Européenne dans ses règlements de 1993 et 1994 relatifs à l'évaluation des risques des substances chimiques nouvelles et existantes. Elle repose sur la mise en évidence de l'existence d'une phase d'évaluation des risques, intermédiaire entre la phase de production de connaissances et la phase de gestion des risques. Cette phase d'évaluation se décompose elle-même en quatre sous-phases : identification des dangers, évaluation de la relation dose-effet, évaluation de l'exposition, caractérisation du risque. Cette méthode permet, dans un certain nombre de situations, de quantifier le risque. Pour ce faire, elle s'appuie sur des lignes directrices. L'INERIS a ainsi élaboré un guide méthodologique pour l'évaluation des risques chimiques des installations, qui prend appui sur les méthodologies de l'agence de protection de l'Environnement (EPA) des Etats-Unis. C'est sur cette base que le futur règlement européen REACH devrait être mis en œuvre. Les limites de cette approche résident dans le fait que les données de base sont largement insuffisantes. Il n'existe, par exemple, que 600 valeurs toxicologiques de référence sur la base de l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis, alors que le nombre total de substances est de 100 000, dont 2 500 environ sont produites ou importées en Europe à concurrence de plus de 1 000 tonnes. Les sciences de l'anticipation, qui sont principalement la toxicologie, épidémiologie et l'expologie - évaluation des expositions -, sont encore trop peu développées, et l'on manque de recherches fondamentales sur l'évaluation des risques. On ne sait pas, par exemple, évaluer correctement les effets d'un mélange, alors que c'est la situation la plus courante. Sur le plan déontologique, il faut que l'expert qui s'exprime puisse le faire en dehors de toute consigne hiérarchique, et soit en conséquence protégé contre les représailles, soit directes - pouvant aller jusqu'au licenciement - soit indirectes - réduction de budget, retrait de techniciens, dessaisissement de projets, dissolution d'unités sous prétexte de réorganisation - que pourraient lui valoir ses recherches. Actuellement, en effet, il n'existe aucun recours interne ou externe par rapport à ce type de pressions insidieuses. S'agissant du processus d'expertise lui-même, on peut identifier trois problèmes. Les conflits d'intérêts ont été évoqués, je serai donc bref. Il est inacceptable qu'une expertise ait lieu sans que ces conflits soient signalés. Un exemple récent et caricatural, en France, a été, l'avis rendu par l'Académie des sciences sur la dioxine, qui concluait à l'absence de risque alors que près de la moitié des membres du CADAS, le Conseil pour les applications de l'Académie des sciences, étaient des représentants de l'industrie chimique... S'agissant du respect du principe de l'expertise contradictoire, le contre-exemple le plus marquant est l'expertise de l'AFSSE sur les champs électromagnétiques émis par les téléphones portables et les antennes relais, qui a conclu à l'unanimité à l'absence des risques, alors qu'aucun des scientifiques ayant publié des articles allant dans le sens contraire n'avait été retenu dans le comité d'experts constitué à cette fin. Le président de l'AFSSE a d'ailleurs émis récemment des réserves sur la validité de cette expertise. Troisième problème : la référence à une méthodologie transparente, et validée par des organismes ad hoc. Un contre-exemple récent, outre l'expertise précitée de l'AFSSE, est l'expertise collective rendue par l'INSERM, en1999, et intitulée « Ethers de glycol : quels risques pour la santé ?» alors qu'elle ne portait pas sur les risques, mais seulement sur les dangers. En 2002, une expertise du Conseil supérieur d'hygiène publique devait en revanche montrer que, pour des scénarios simples d'exposition à des produits de consommation courante, l'indice de risque pouvait atteindre un niveau de l'ordre de 1000. Je voudrais que soit élaborée une loi de protection de l'alerte et de l'expertise qui comporterait notamment la création d'une haute autorité indépendante, sorte de CNIL de l'expertise. Cette haute autorité veillerait à la mise en place de codes de déontologie et de comités de déontologie dans tout organisme de production d'expertise ou de connaissance, qu'il soit public ou privé. Aujourd'hui ces fonctions sont remplies par des comités dont le fonctionnement n'est contrôlé par personne. Mon organisme, l'INERIS, ne s'est doté d'un code de déontologie que cette année, et encore celui-ci ne prend-il pas en considération les conflits internes, tranchés par la hiérarchie elle-même ! Elle protégerait également le processus d'expertise, en vérifiant l'application du principe d'expertise contradictoire, en examinant les conflits d'intérêts et en tranchant le cas échéant sur les participations à des comités d'experts, en définissant des lignes directrices ou des guides méthodologiques par grands domaines d'expertise et en s'assurant de leur respect par les comités d'experts. Elle serait saisie en cas de conflits quant à leur application. Elle organiserait, enfin, la relation des organismes d'expertise avec les citoyens. Il conviendrait en outre de définir un nouveau statut d'établissement public de sécurité sanitaire et environnementale. La question du statut est, en effet, essentielle pour ce qui est des garanties déontologiques, ainsi qu'un exemple récent le démontre. Pour la mise en œuvre de la directive Biocide et du futur règlement européen REACH sur l'évaluation des substances chimiques existantes, on vient, en février 2005, de confier cette tâche à une association loi de 1901, le BERPC, Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques, créé par l'INRS et l'INERIS, et qui ne dispose à ce jour d'aucun code de déontologie. Plusieurs pays anglo-saxons se sont dotés d'une telle loi de protection de l'alerte : les Etats-Unis avec le Whistleblower Act, le Royaume-Uni avec le Public Interest Disclosure Act. C'est ce type de loi qui fait aujourd'hui défaut en France, et qui permettrait de protéger tout lanceur d'alerte contre les représailles de l'entreprise. Monsieur le Président, vous avez souhaité que chacun s'exprime sans faire usage de la langue de bois. J'espère avoir répondu à votre demande... M. Gérard PASCAL : Je vous en remercie. Nous allons maintenant aborder la question des relations entre les professionnels du médicament et l'expertise, et je donne la parole à Mme Blandine Fauran, directrice juridique et fiscale de LEEM - les Entreprises du Médicament. Mme Blandine FAURAN, Directrice juridique et fiscal au LEEM (les entreprises du médicament) L'expertise est au cœur de toutes les décisions publiques relatives au médicament. L'expertise oriente l'ensemble des décisions en matière de recherche, d'évaluation en vue de la mise sur le marché des médicaments et de leur remboursement, de contrôle de l'information et de la publicité, et également les décisions relatives à leur surveillance - par la pharmacovigilance - et à leur retrait. Cette expertise s'exerce au sein de commissions consultatives, de composition pluridisciplinaire, chargées de rendre un avis sur lequel va se fonder l'autorité administrative compétente pour prendre une décision. L'évaluation en santé a pour spécificité, en France, de reposer sur une expertise interne et externe. L'expertise interne est réalisée par des membres de l'administration ; l'expertise externe fait appel à des personnalités extérieures indépendantes, désignées en fonction de leurs compétences spécifiques dans les domaines traités par chacune des commissions. Ce cumul entre expertise interne et externe permet de conjuguer la garantie des procédures réglementaires avec la pratique et la compétence scientifique de terrain. Les experts externes sont issus du monde de la recherche, du monde scientifique et médical, et sont en général des praticiens libéraux ou hospitaliers, et des universitaires qui travaillent plus ou moins régulièrement avec l'industrie pharmaceutique et le secteur privé. C'est cette collaboration avec le secteur privé qui leur permet de développer leur expertise et d'être toujours à jour de la technique et de la connaissance scientifique et médicale. L'importance du rôle de l'expertise externe ne peut aller qu'en se renforçant, avec l'émergence et la croissance des nouvelles approches thérapeutiques, tels les thérapies géniques et cellulaires ou les médicaments d'origine biologique, qui vont conduire à faire appel à une expertise toujours plus spécialisée et à la pointe de l'innovation technique et scientifique. Il est donc nécessaire de prendre des mesures incitant les personnalités compétentes à apporter leur concours à la décision publique, et de faire en sorte que la participation à la décision publique devienne une véritable étape professionnelle de la carrière des experts. Deux grandes catégories de mesures vont dans ce sens : la sécurisation juridique de l'expertise et sa valorisation en tant qu'activité d'intérêt général. Dans la mesure où l'intérêt et l'apport de l'expertise externe sont avérés, il faut sécuriser les conditions de cette expertise, de manière à ce qu'elle puisse être conduite en toute neutralité et impartialité. La rigueur juridique des conditions dans lesquelles l'évaluation est réalisée, et donc le caractère incontestable des décisions administratives prises sur cette base, sont de l'intérêt de tous. Il est de l'intérêt de l'administration de ne pas voir ses décisions remises en cause, il est de l'intérêt des experts de ne pas voir leurs positions contestées ou leur responsabilité engagée, il est de l'intérêt des entreprises de fonder la recherche, la mise sur le marché et le suivi des médicaments sur des considérations incontestables au plan scientifique, éthique et juridique. La première des garanties est certes le fonctionnement collégial et pluraliste des commissions. Mais au delà de ces procédures, un système rigoureux de déclaration des liens et de gestion des conflits d'intérêts est indispensable. L'AFSSAPS s'est engagée dans cette voie depuis plusieurs années, et vient de mettre en ligne sur son site de nouveaux outils permettant de renforcer et de clarifier les conditions de traitement des conflits d'intérêts. La mise en place d'un groupe référent sur l'indépendance des experts chargé de rendre des avis sur la qualification du niveau de risque de conflits d'intérêts dans une situation d'espèce est une initiative particulièrement intéressante. Il serait d'ailleurs sans doute utile que la Haute Autorité de Santé et ses différentes commissions spécialisées s'engagent dans la même voie. Un autre mode possible de sécurisation de l'expertise serait de s'engager dans une démarche de normalisation, avec l'objectif, à terme, de structurer et d'harmoniser la conduite des expertises. Une réflexion transversale avec les autres secteurs industriels ayant déjà travaillé sur le sujet serait probablement très constructive. Enfin, une meilleure reconnaissance de la spécificité, des implications et du rôle de l'expertise apparaît nécessaire si l'on veut maintenir la présence d'une expertise externe performante dans les commissions. Une voie possible serait l'amélioration des compensations financières des travaux d'expertise. Mais au delà, certaines mesures pourraient être prises pour mieux valoriser l'expertise au plan qualitatif. En effet, le temps mis au service de la décision publique n'est pas valorisé, notamment dans le cadre de la progression de carrière des experts. L'objectif serait notamment de faire en sorte que les travaux d'évaluation ne soient pas désavantagés dans l'appréciation d'un candidat lors de l'inscription sur les listes d'aptitude à un poste de maître de conférence ou de professeur des universités. M. Gérard PASCAL : L'expertise collective semble parvenue à maturité à l'INSERM, et être dans sa phase de démarrage au CNRS. Mme Claire SABBAGH, qui dirige l'unité d'expertise scientifique de l'INRA, va nous parler de cet organisme, qui paraît être dans une situation intermédiaire. Mme Claire SABBAGH, Directrice de l'unité d'expertise scientifique de l'INRA Je me réjouis de constater que les trois organismes que nous représentons aient une réflexion commune dans ce domaine, où l'INSERM a joué un rôle pionnier. L'expertise collective existe à l'INRA depuis 2002. Notre souci est de favoriser une activité jusqu'ici vécue comme spontanée, comme étant dans le droit fil de l'activité de production des connaissances - je ne reviens pas sur la question du lien ou de la séparation entre les deux. Nous avons créé une petite cellule chargée de l'organisation d'expertises collectives en appui à la décision publique dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation. Il ne s'agit toutefois pas, à l'issue du travail d'expertise, de formuler des avis ni des recommandations, mais un bilan des connaissances scientifiques mondiales à un instant donné. Le document princeps n'est pas un rapport, ce n'est pas non plus une succession de contributions, mais un document de synthèse concis et lisible, présentant non seulement les conclusions de l'expertise mais aussi les éléments de raisonnement qui ont conduit leurs auteurs à ces conclusions. Je fais au passage un peu de publicité pour une expertise sur les pesticides et la façon d'en réduire tant l'usage que l'impact sur l'environnement, étude qui sera disponible à compter du 10 décembre sur le site de l'INRA. L'expertise collective requiert un cadre déontologique et méthodologique, dont je dirai seulement, compte tenu de ce qui a déjà été dit, que l'objectif est de garantir la qualité de l'expertise tant au niveau des compétences des experts qu'à celui des procédures d'expertise, qui doivent toutes être, j'insiste, reproductibles. C'est aussi une façon de stimuler l'intérêt des chercheurs mobilisés et de rendre ainsi la fonction d'expertise plus attractive. L'expert participant à une expertise collective est un producteur de connaissances, immergé dans le milieu de la recherche, et dont les compétences sont reconnues et sanctionnées par ses pairs à travers ses publications, ou par le milieu professionnel de son domaine de recherches. Il n'y a pas d'expert professionnel : tout chercheur est potentiellement un expert. Ce qui fait l'expert, c'est la question qu'on lui pose, et on recherche celui qui est le plus à même d'y apporter une réponse. L'expert participant à une expertise collective est aussi un individu susceptible d'avoir des conflits d'intérêts -je n'y reviens pas non plus, sauf pour signaler que l'INRA s'est engagée sur la fixation de règles en matière de déclarations d'intérêts. Il est, je tiens aussi à le souligner, un chercheur libre par rapport à l'institution. Sa liberté d'expression est totale dans la mesure où elle se fonde sur des sources répertoriées, quand bien même il mettrait l'institution en difficulté par rapport à son commanditaire, voire le commanditaire lui-même. Il est un chercheur capable de comprendre les enjeux de la question posée par celui-ci, et prêt à sortir des frontières de sa discipline, à les transgresser pour débattre avec ses collègues et participer à la production d'un argumentaire collectif qui ne soit pas une addition de points de vue disciplinaires distincts, mais un produit au sens arithmétique du terme. Il est, surtout, un chercheur soutenu, entouré, protégé dans sa logistique et ses conditions d'exercice, car l'expertise est une activité lourde, difficile, intéressante dans la mesure où elle n'est pas une prestation de service, mais une activité étroitement liée à l'activité de recherche. S'agissant du statut, il reste beaucoup de progrès à faire, et il faut aller contre les idées reçues selon lesquelles il s'agirait simplement de compiler des résultats obtenus par d'autres : il s'agit bel et bien d'un exercice créatif, qui met au jour quelque chose qui n'existait pas, et utile socialement. Plutôt que de l'évaluation et de la formation, je parlerai surtout de l'implication du commanditaire dans le travail d'expertise et de la nécessité d'une interaction active et féconde. Les experts ne travaillent bien, ne travaillent avec cœur que si le commanditaire manifeste un intérêt soutenu, aussi bien dans la phase d'instruction que dans le comité de pilotage tout au long de l'expertise elle-même et qu'au moment de la restitution et de la communication. Il est également plus gratifiant pour eux de pouvoir constater les effets de l'expertise sur les décisions publiques. Dans le même esprit, il serait bon de créer des lieux de rencontre et de débat entre experts et politiques. M. Gérard PASCAL : Je vous remercie, et donne maintenant la parole au dernier intervenant, le Professeur Christian Riché, chef du service de pharmacologie du CHU de Brest, après quoi nous pourrons, comme prévu, conclure cette table ronde par un bref débat. Professeur Christian RICHÉ, Chef du service pharmacologie Je vais répondre brièvement aux six questions qui étaient contenues dans le document préparatoire, en moins d'une minute pour chacune. Selon moi, il n'existe pas, il ne peut pas exister d'expertise collective. L'expertise est le dire individuel d'un expert, et il n'y a que des confrontations d'expertises, en vue de synthèses d'expertises préparant elles-mêmes des procédures décisionnelles. Ce sont donc trois procédures distinctes, dont il conviendrait de clarifier la terminologie. La question de l'expertise interne ou externe est liée à celle de l'inéluctable professionnalisation. C'est encore une question de terminologie. Il y a l'expert indépendant, et il y a le « sachant ». Il est capital de faire la différence entre expertise et audition. Faut-il sélectionner les experts exclusivement sur leurs compétences et leurs connaissances ? Pas forcément : de bons chercheurs peuvent être de mauvais enseignants et inversement. Je rejoins Daniel Marzin sur le fait que l'expertise est une discipline qui s'apprend, même s'il va de soi qu'on ne peut être expert sans avoir été chercheur. Y a-t-il différents types d'expertises ? Non, il y a simplement différents types de questions. Mais toutes les expertises doivent avoir en commun des critères de qualité, qui conditionnent la confiance - et ce mot est capital - dans l'expertise. Il ne saurait y avoir de hiérarchisation entre les conflits d'intérêts. Il peut certes y avoir des classifications dans certains domaines, mais le problème central est celui de la confiance dans l'expertise, confiance qui est fondée sur la perception que l'extérieur a de l'expert. J'adhère, enfin, à tout ce qui a été dit sur la valorisation de l'expertise, car elle est un élément fondamental de cette confiance. On ne peut pas avoir confiance dans quelqu'un qui a été toute sa vie un professeur de second rang et a toujours été retoqué par le CNU. IL est donc nécessaire que l'activité d'expertise soit reconnue pour que l'extérieur ait confiance dans l'expertise. M. Gérard PASCAL : Merci de votre grande concision, qui va nous permettre d'avoir le bref débat annoncé, ainsi que pour avoir souligné l'importance de la perception par l'extérieur, importance qui n'est pas liée, en effet, à la nature du conflit d'intérêts. Mme Marie-Christine BLANDIN : Mme Sabbagh a affirmé que les chercheurs experts de l'INRA avaient une totale liberté d'expression. Mais elle a aussi dit que le commanditaire devait être impliqué dans le comité de pilotage et présent lors de la restitution de l'expertise... Or, lorsque l'argent public se confond avec l'argent privé, par exemple celui des grands semenciers dont on sait bien quelles conclusions ils attendent et espèrent, cela ne limite-t-il pas la liberté des chercheurs dont le laboratoire est tributaire de ces fonds privés ? Mme Claire SABBAGH : Le cas ne s'est pas posé pour l'instant, mais il peut évidemment se produire, et il n'est pas dit, d'ailleurs, que nous puissions accepter toutes les expertises. Nous essayons d'anticiper cela dans notre réflexion. Il est certain que la crédibilité de l'expertise rendue par les chercheurs les plus compétents ferait problème si ces derniers étaient sous contrat avec l'industrie. M. Gérard PASCAL : La question se pose davantage, en fait, aux individus qu'aux organismes, et devrait donc être traitée de façon collective, au niveau des départements de recherche. Ce n'est pas simple, et j'aimerais que l'INRA se penche sérieusement sur ces problèmes de partenariat. M. Georges LABROYE, Directeur général de l'INERIS L'INERIS, dont je suis le directeur général, a lancé sa charte de déontologie le 28 septembre 2000 et ne l'a finalisée qu'en janvier 2004. Elle est maintenant consultable sur notre site Internet. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore des progrès à faire et nous le savons. Un comité de personnalités extérieures suit les cas de déontologie et fait un rapport annuel au conseil d'administration. J'ai écouté avec une grande attention tout ce qui a précédé, et je pense que parmi les facteurs de nouveaux progrès figure le BERPC, Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques, entité commune à l'INERIS et à l'INRS, qui vient d'être constituée et a décidé d'appliquer les chartes des deux organismes, en recherchant cette indépendance de jugement que nous tenons pour essentielle. Mme Pascale BRIAND : A la différence de l'INSERM, du CNRS ou de l'INRA, qui sont saisies de demandes d'expertise de longue haleine, sur des dossiers de fond, et ont le temps nécessaire pour cela, l'AFSSA doit rendre, elle, quelque 400 avis bon an mal an, avec une obligation de résultat et dans un tout autre contexte, car certaines études peuvent s'étaler sur quelques mois, mais d'autres demandent une réponse très rapide, avec des recommandations tranchées lorsqu'il s'agit de faire face à un risque imminent. M. Jean-Claude AMEISEN : Je m'interroge, pour ma part, sur l'opportunité de professionnaliser l'expertise. Si je prends l'exemple de l'instance dont je fais partie, et dont la première tâche est d'expertiser la qualité scientifique des laboratoires, des chercheurs et de leurs publications, la professionnalisation des experts qui l'accomplissent reviendrait à les couper de leur milieu. M. Gérard PASCAL : Je n'ai pas eu le sentiment que les autres participants aient vraiment plaidé pour la professionnalisation. M. Guy PAILLOTIN : Je souhaiterais, quant à moi, qu'il y ait deux mots différents et non un seul pour désigner l'expertise, selon qu'il s'agit de la procédure, claire, sophistiquée et encadrée, d'aide à la décision publique en situation d'incertitude, ou d'études et avis de fond. On ne peut pas répondre à 400 demandes d'avis par an, comme le fait l'AFSSA avec les mêmes règles de procédure certifiées AFNOR ! M. Bruno TOUSSAINT, Directeur de la rédaction de la revue « Prescrire » et M. Guy TUFFERY, Délégué à la qualité de l'AFSSA : Si ! M. Guy PAILLOTIN : Tout le monde ici pense le contraire sauf vous, il faut tout de même que vous le sachiez, pour ne pas être tenté de dire n'importe quoi n'importe où ! Il faudrait qu'il y ait deux mots différents, sans quoi on va vers l'aventure. Professeur Christian RICHÉ : Je crois, moi aussi, qu'il faut changer la terminologie. Il y a l'audition et il y a l'expertise. Et quand je parle de professionnalisation, je ne dis pas qu'on doive être expert de 18 à 65 ou 70 ans, mais qu'il y a des moments dans la vie, ou dans l'année, où l'on a un comportement de professionnel, avec tout ce que ça implique. M. Guy TUFFERY : L'AFSSA a engagé une démarche de certification de ses services d'expertise collective, en faisant vérifier par des audits indépendants, voire internationaux, que les 220 exigences fixées par la norme NFX 50-110, sont respectées. C'est une grande première, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde.. M. Gérard PASCAL : Nous arrivons au terme de cette deuxième table ronde, et je cède ma place de modérateur à Philippe Verger, pour la troisième et dernière table ronde. Modérateur : M. Philippe VERGER, Directeur de recherche à l'Institut national de recherche agronomique (INRA) Avant de lancer cette dernière table ronde, je voudrais revenir sur la fin de la précédente, pour dire qu'à mon sens on confond souvent expertise et évaluation du risque. Et lorsqu'on parle de professionnalisation, on parle en fait d'évaluation du risque, de ce que les Anglo-Saxons appellent risk assessors, qui ne sont pas forcément des experts. Nous abordons maintenant la dimension internationale, et comme la majorité des participants sont des spécialistes du médicament, je vais dire quelques mots du secteur de l'alimentation, où les choses semblent se présenter assez différemment, en particulier au niveau international. Je ne parlerai pas de l'Union européenne, qui a fait énormément de progrès ces dernières années, avec une structuration très importante des agences, un fonctionnement en réseaux qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui témoigne au moins d'une volonté politique. Au niveau international proprement dit, il reste, par rapport aux décisions, aux normes, aux accords de l'OMC, d'énormes enjeux scientifiques et d'importants obstacles non tarifaires, et il n'y a ni structuration de l'expertise, ni retours d'expériences, ni même invitations d'experts nationaux. Quand une question semble stratégique aux ministères, aux cabinets, aux administrations nationales, on se contente d'écrire aux instances internationales pour leur recommander tel ou tel expert français. Cette attitude, que j'ai observée plus d'une fois à la FAO ou à l'OMS, est extrêmement mal perçue par lesdites instances, car il est hautement présomptueux de penser que l'on puisse ainsi proposer des experts ne justifiant pas des qualités scientifiques requises ni de la reconnaissance de leurs pairs. Mais je pense qu'il s'agit moins, dans le cas français, de prétention que de naïveté, et cela révèle surtout une absence de politique en matière d'expertise internationale. Je vais donner d'abord la parole à nos collègues spécialistes du médicament, qui nous diront s'il en va de même dans leur domaine, et d'abord au professeur Philippe Even, auteur de nombreux ouvrages sur l'évaluation scientifique. Professeur Philippe EVEN, Hôpital Necker-Enfants malades Le domaine du médicament et celui de l'évaluation de la recherche sont tous deux en pleine mutation. L'internationalisation n'est plus à faire : elle est faite. 100 % des molécules, je dis bien 100 %, sont inventées par de grandes firmes américaines ou par des firmes européennes qui sont en fait américaines, étant donné que le marché se trouve, pour 55 %, aux Etats-Unis, et que le poids des filiales américaines de Serono, Glaxo, Novartis, etc., est considérable. En outre, nous avons copié nos institutions sur les Etats-Unis. La Food and Drug Administration, la FDA, a été créée en 1906, suite à la parution d'un roman d'Upton Sinclair, The Jungle, qui décrivait la façon dont on fabriquait les saucisses. Par la suite, elle a ajouté à ses compétences les sulfamides, les éthers de glycol, puis les médicaments. Nous l'avons copiée, mais à la française, avec les moyens qui sont les nôtres - alors que la FDA a un budget de 2 milliards de dollars et emploie 10 000 personnes -, mais le schéma général et l'organisation du travail sont les mêmes. Les problèmes qui se posent sont les mêmes aussi, et notamment celui des experts. Les trois quarts du budget de la FDA comme du budget de l'agence européenne et des agences françaises proviennent des industries pharmaceutiques, lesquelles paient pour les dossiers qu'elles soumettent, ce qui est normal mais, qui crée un lien institutionnel, dont la FDA s'émeut d'ailleurs, craignant que d'émettre trop de jugements négatifs lui fasse perdre des clients et l'oblige à licencier. C'est ce qu'on peut lire dans la presse américaine. Sur l'indépendance des experts, Jean Marimbert a tenu un discours généreux, et parfois angélique, car il n'est ni biologiste, ni médecin, ni gestionnaire d'entreprise. Parlons donc des conflits d'intérêts ! Il y a 200 000 médecins en France et 1 200 experts travaillant pour l'Agence. La plupart, j'ai pu le constater en travaillant avec eux, sont des gens totalement désintéressés, et même plus que cela. La plupart, mais pas tous. On parle souvent de transparence, on publie même sur le web les déclarations d'intérêts, mais la transparence n'est pas la clarté, or ce qu'il faut, c'est la clarté. Qu'importe que les vitres soient en verre dépoli ou transparent, si l'on ne regarde pas à travers ? Je ne trouve pas normal qu'un petit nombre de ces experts, qui ont parfois présidé des commissions et accédé à de hauts postes, notamment à la Haute Autorité de Santé, soient parmi les cinquante qui ont le plus grand nombre de contrats avec les industries pharmaceutiques. Si 60 % des experts ont un ou plusieurs contrats, ils sont 15 % à en avoir 4 à 50 en permanence, et pas seulement pour rémunérer leurs labos, mais pour se rémunérer eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que leur jugement ne sera pas objectif, mais quand une part importante de votre revenu dépend de ceux que vous êtes appelé à juger, il vous est difficile de garder un jugement indépendant 24 heures sur 24... De deux choses l'une : ou bien on est expert pour l'industrie, avec tout l'intérêt que peut avoir, y compris sur le plan scientifique et théorique, le fait de travailler sur de nouveaux médicaments, ou on ne l'est pas. Je crois que nous avons en France suffisamment de médecins de qualité parmi nos 4 000 professeurs d'université, nos 2 000 maîtres de conférence, nos 16 000 médecins hospitaliers - sans compter un grand nombre de médecins libéraux - pour les transformer en experts. On dira qu'un expert, ça se forme, mais c'est un aspect parcellaire des choses. Je crois que ceux qui se préoccupent du médicament, qui ont développé depuis toujours un esprit analytique et critique sur le médicament sont au moins aussi qualifiés pour être experts que ceux qui n'ont pas su faire preuve du même esprit critique et analytique. L'idée de créer un organisme qui évaluerait les experts est excellente. Je suis frappé de constater qu'aujourd'hui, alors qu'il y a vingt ans on ne parlait jamais d'évaluation, le CNRS s'évalue lui-même - et affirme même être le seul à pouvoir le faire -, que l'INSERM a fait des progrès considérables dans cette voie, mais qu'on en reste toujours à l'auto-évaluation. L'Etat a bien créé une instance publique nationale d'évaluation, mais sur 14 membres, la moitié représente les ministères, l'autre moitié l'administration des différents instituts de recherche, et on n'y trouve pas un seul chercheur... Il est donc assez peu probable qu'on puisse en tirer des conclusions utiles au politique ou au citoyen. Mais après tout, peut-être évaluer n'est-il pas l'essentiel, même dans le domaine du médicament. Le vrai problème est plutôt, me semble-t-il, celui des cibles que se donnent - en toute liberté, et très légitimement - les industries pharmaceutiques, dont les meilleurs clients sont les gens riches - ou bien remboursés - des pays riches. Pourquoi n'y a-t-il quasiment plus de recherche sur les antibiotiques ou les vaccins ? Parce que ça ne rapporte rien de traiter les gens pendant quatre jours seulement, ni de les protéger une fois pour toutes, par une seule injection. Il y a dans le monde deux labos, en tout et pour tout, qui s'intéressent aux vaccins, et qui n'y gagnent pas d'argent. Le résultat est qu'on ne fait rien contre les malarias ni même contre les vraies maladies des pays riches. Le docteur Knock l'avait bien compris : le curatif, c'est de la pêche à la ligne, quand le préventif, c'est de la pisciculture ! Les pouvoirs publics pourraient agir, par la négociation ou en usant de l'arme absolue que sont les taux de remboursement, pour qu'on relance les recherches sur les maladies qui tuent plutôt que sur des maladies hypothétiques qui tueront peut-être. M. Philippe VERGER : Merci pour ce message très clair et percutant. Je donne maintenant la parole à Bruno Toussaint, directeur de la rédaction de la revue Prescrire. M. Bruno TOUSSAINT, Directeur de la rédaction Prescrire est née en janvier 1981. C'est une revue indépendante, car financée par les abonnements des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, qui ont compris qu'ils avaient besoin, pour faire des choix thérapeutiques, de sources d'information indépendantes, objectives, impartiales et fiables. Le constat que faisait, dans les années 1970, la petite équipe qui devait lancer la revue est toujours d'actualité. Le budget de la FDA est, on vient de le dire, de 2 milliards de dollars, à rapprocher des 2,6 milliards d'euros dépensés, en France, selon les entreprises du médicalement elles-mêmes, en actions de promotion en direction de la population et, surtout, des prescripteurs. Il y a un visiteur médical pour neuf médecins ! C'est une force de pression suffisamment puissante pour qu'un certain nombre de médecins et de pharmaciens aient accepté de payer assez cher pour recevoir cette revue qui n'a ni publicité ni subvention. La rédaction est confrontée à un problème : comment fabriquer une information synthétique, indépendante et fiable pour aider les praticiens à conseiller les patients ? L'information vient généralement de plusieurs sources : les agences du médicament, les firmes pharmaceutiques elles-mêmes, qui financent l'essentiel de la recherche clinique, et d'autres publications indépendantes qui existent dans d'autres pays, riches ou moins riches - car la France n'est pas le centre du monde - et dont les collaborateurs finissent par être, eux aussi, experts, sans pour autant être financés par l'industrie. Un cas d'école, bien connu, est celui du VIOXX, que le Sénateur Saunier a évoqué en introduction. Le VIOXX, comme on sait, est un anti-inflammatoire, qui ne prétend pas guérir mais seulement soulager, et surtout avoir des effets moins indésirables que ses prédécesseurs. Les essais cliniques, financés par la firme elle-même puisque telle est la règle édictée par les pouvoirs publics, avaient été peu probants, et on ne pouvait affirmer qu'il s'agissait d'un progrès thérapeutique. Il a pourtant reçu son AMM en 1999. Sur quels motifs ? On ne le sait pas bien. L'AFSSAPS n'a publié aucun rapport d'évaluation, la commission non plus. On ne sait d'ailleurs même pas qui y a siégé. Il paraît qu'il y a des déclarations d'intérêts consultables sur l'Internet et actualisées en temps réel ; fort bien, mais à quoi bon si l'on ignore qui a siégé à telle ou telle commission sur tel ou tel dossier ? Comment faire les rapprochements, mettre au jour les fraudes ? Ni le citoyen ni la revue Prescrire ne peuvent le faire, malgré la directive de 2004 qui aurait dû être transposée au 31 octobre dernier ! Nous avons ici deux représentants de l'AFSSAPS. Siégeaient-ils ? Nous ne le savons pas. Quelqu'un a-t-il a exprimé un avis défavorable, minoritaire, un désaccord ? Nous ne le savons pas non plus. Le médicament s'est finalement avéré dangereux, plus même que les autres, contrairement à ce qui était espéré, et la firme l'a retiré du marché en 2004, d'elle-même semble-t-il. Le laboratoire avait financé un autre essai, pour une autre pathologie chronique, car il pensait que le médicament aurait pu réduire le risque de cancer du côlon, ce qui aurait été une bonne nouvelle, mais il est apparu, au contraire, qu'il créait autant de dégâts cardio-vasculaires que le traitement de l'hypertension artérielle permet d'en éviter. Quelle a été l'étendue des dégâts en France ? On ne la connaît pas sur le plan sanitaire. L'AFSSA ne l'a pas révélée. En revanche, le VIOXX a été remboursé à hauteur de 100 millions d'euros par an jusqu'en 2004. Je ne tire pas ces chiffres de mon chapeau : ce sont ceux de l'assurance maladie ! On a dit que l'AMM avait été accordée au vu des données dont on disposait alors, et que des études post-AMM ont permis de mieux savoir ce qui se passait. Il y a eu une étude CADEUS sur les gens qui prenaient des anti-inflammatoires, dont le VIOXX et ses cousins germains, on a fait beaucoup de battage là-dessus, les résultats étaient annoncés pour mars 2005, puis ont été reportés à octobre, mais ce matin, il n'y avait plus de site CADEUS, le nom de domaine n'étant plus payé. Si vous voulez, on peut se cotiser pour le reprendre, mais en attendant, je ne sais pas où sont les résultats, et la collectivité non plus. On ne sait pas, car il n'y a pas de rapport d'AMM, sur quelles données s'est fondée la commission. On se doute bien qu'elles ont été fournies, pour l'essentiel, par la firme. Mais le conflit d'intérêts est en réalité bien plus profond que cela. Nos pouvoirs publics font en effet financer la recherche par les firmes pharmaceutiques. C'est, en soi, un conflit d'intérêts structurel. Certes, les essais cliniques coûtent cher, très cher, mais est-il raisonnable de les faire faire par des gens qui ont tout intérêt à ce qu'ils soient concluants ? D'autres pays font pourtant financer des essais par les pouvoirs publics. En France, pas tellement : on n'est pas trop courageux. Mais aux Etats-Unis, il y a eu un essai de grande ampleur, financé sur fonds publics, portant sur 40 000 personnes souffrant d'hypertension et suivies pendant cinq ans afin de comparer quatre traitements : il en est ressorti que le meilleur traitement était aussi le plus ancien et le moins cher... Alors, quand j'entends dire que les industriels sont dévoués au progrès et à l'innovation, j'ai envie de répondre que ce n'est pas si simple, que cela dépend des conditions que leur font les pouvoirs publics, et que ceux-ci autorisent des prix élevés pour de nouveaux médicaments qui, trois fois sur quatre, n'apportent aucun progrès, parfois même une régression et un danger, comme dans le cas du VIOXX : on estime, aux Etats-Unis, que 30 000 à 100 000 infarctus ou attaques cérébrales lui sont dus. Comme quoi les questions d'expertise ont des conséquences concrètes sur la vie et la mort des gens. Docteur Anne CASTOT, Chef du département surveillance Je vais garder, après cette intervention, ma sérénité d'expert... Je suis responsable du département de la surveillance du risque et de l'information sur le médicament à l'AFSSAPS. J'ai présidé par ailleurs, ces derniers années, le groupe de pharmaco-vigilance au niveau européen, j'ai donc une double expérience. Je ne souhaite pas focaliser ma brève intervention sur le VIOXX, mais je pourrai y revenir tout à l'heure. La question que je me suis posée en venant était : y a-t-il un profil d'expert européen, qui présenterait des différences par rapport à celui d'un expert national ? Après avoir entendu l'ensemble des interventions, et au vu de mon expérience, je ne le crois pas. L'expert européen est avant tout un expert national, il a à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts, les mêmes insuffisances, en tout cas en matière d'expertise du risque médicamenteux. Face à ce risque, le positionnement de l'expertise est souvent ambigu, car l'expert qu'on mobilise, que ce soit au plan national ou européen, est là pour résoudre une problématique et proposer des mesures satisfaisant le demandeur, autrement dit à la fois pour expertiser et analyser une situation de risque et pour gérer le risque. Au départ, en 1995, quand est née l'Europe du médicament, on s'est demandé si une expertise nationale unique pouvait contribuer à créer une décision collective de l'Union européenne, sachant que, dans le reste du monde, pour une même expertise sérieuse, on arrive souvent à des décisions différentes - ce qui, pour le profane, remet en cause l'expertise elle-même. Un exemple : nous avons été saisis dès 1995 du risque, très médiatisé, représenté par les coupe-faim pour l'anorexie des jeunes. Nous avons jugé qu'il y avait un risque, et sans doute un manque d'efficacité. Le dossier a été porté devant l'Agence européenne, il y a eu appropriation de l'expertise par les Quinze, avec des études pharmaco-épidémiologiques qui ont confirmé le risque, et pourtant l'Agence a pris la décision, contre l'avis de la France, de laisser le produit sur le marché, en modifiant simplement l'information dont il faisait l'objet. Et au même moment, la FDA a accordé l'AMM sur la foi de la même expertise, pour un produit qui était commercialisé depuis plus de dix ans en France. La question qui se pose est : comment concilier l'expertise européenne avec la souveraineté nationale en matière de décision ? Dans l'Union européenne, depuis 1995, il existe dans le domaine du médicament une procédure intégrée d'autorisation de mise sur le marché, avec une décision contraignante de la Commission européenne, sur la foi d'expertises, de l'avis d'une commission d'experts de l'Agence européenne, que la Commission suit ou non. Nous avons donc peu de marges de manœuvre, si ce n'est, et c'est ainsi que le ressentent les experts qui siègent à la commission française d'AMM, que cet avis, pris à la majorité, n'est pas consensuel. C'est assez délétère, car nous sommes parfois amenés à accepter des produits sur la foi d'analyses que nous ne partageons pas. Mais à côté, il y a une autre procédure, celle de l'AMM nationale, où nous gardons notre liberté de décision. Le problème, c'est qu'en 2005, pour un même produit commercialisé dans tous les pays, il paraît difficile de ne pas aboutir à la même décision. Or, malgré des recommandations assez consensuelles du comité européen de pharmaco-vigilance, souvent chacun rentre chez soi et fait procéder à une contre-expertise nationale, de sorte que des décisions conflictuelles reposent sur des opinions médicales en contradiction avec ce qui s'est dit, et qui tiennent compte du contexte sanitaire, socio-économique, politique. Nous sommes en 2005. Je suis certaine que le VIOXX pose un vrai problème, car c'est un médicament avec AMM européenne M. Bruno TOUSSAINT : Non centralisée... Docteur Anne CASTOT : Non centralisée, certes, mais une expertise a été menée par un pays, et nous avons tous eu, à un moment donné, la naïveté de penser qu'il était temps d'accepter de se reposer sur l'expertise de nos voisins européens. M. Bruno TOUSSAINT : Pourquoi ne pas la publier ? Docteur Anne CASTOT : J'y viens. La décision VIOXX, c'est le labo qui l'a finalement prise, et qui l'a prise au niveau planétaire, parce que nous n'avons pas su prendre la décision qu'il fallait quand il le fallait. C'est toute l'expertise qui s'est trouvée ainsi mise en cause, aussi bien l'expertise européenne qu'américaine et française. Pour finir sur le VIOXX, le gros problème de l'expertise française et européenne, c'est son manque de transparence. La législation de l'Union européenne dit qu'il faut rendre publics les agendas, les procès-verbaux, les rapports publics d'évaluation, et c'est ce que fera l'Agence française à compter du 1er janvier 2006. Avec un peu de retard, mais ce sera mis en place. M. Philippe VERGER : Nous sommes là à la limite du problème de l'expertise scientifique et de celui des mécanismes de décision européens. Docteur Anne CASTOT : J'ai cherché, dans mon intervention, à répondre à la question : existe-t-il un expert européen ? Celui-ci se caractérise malheureusement par trois choses : les titres et travaux qu'il communique à l'Agence européenne, sa déclaration d'intérêts, et le soutien de son chef d'agence nationale - ce qui est, a priori, le plus petit commun dénominateur. M. Philippe VERGER : C'est un domaine très particulier. On ne peut pas définir de façon générale l'expert européen de cette façon-là. Dans les autres secteurs que le médicament, la gestion du risque est intimement liée à son évaluation, et les experts européens ne vont pas à Bruxelles pour défendre les intérêts nationaux. Docteur Anne CASTOT : Dans le médicament, contrairement à l'alimentaire, chacun des 25 Etats est représenté avec une voix, et chacun amène ses 25 ou ses 50 experts. Je crois qu'après 2006, on ira tout doucement vers une sélection de centres d'excellence qui pourront expertiser pour l'ensemble de l'Union. M. Guy TUFFERY, Délégué à la qualité de l'AFSSA Mon propos ira dans le même sens que celui de Mme Castot, même s'il s'agit d'un autre domaine. Les avis d'experts compétents sont ce que la société a de mieux à sa disposition pour prendre des décisions dans la complexité et l'incertitude, mais encore faut-il qu'elle puisse y croire. Or nous faisons encore confiance, même au prix du doute, à la science, mais d'abord et avant tout à nos propres organisations, à nos chercheurs et à nos experts nationaux. Le décideur, quant à lui, devra agir dans un contexte incertain, sachant que le droit à l'erreur n'existe pour ainsi dire plus si tant est qu'il ait existé, que toute erreur de décision est vécue comme une faute, et qu'à la recherche des causes fait très vite suite celle des responsables, ou plutôt des coupables. C'est au prix d'une expertise de qualité que le principe de précaution demeurera un principe d'action réfléchie et non un refuge face aux incertitudes et aux craintes légitimes qui en découlent. Désormais le besoin de confiance dans les avis sollicités, dans l'expertise dont ils découlent, est revendiqué par tous, qu'il s'agisse des décideurs ou des citoyens. Les facteurs-clés de la confiance dans l'expertise sont les suivants : la clarté de la question posée par le décideur, la confiance dans les experts eux-mêmes, dans leur compétence, leurs méthodes, leurs qualités personnelles, leur déontologie et leur éthique, dans leur mode de recrutement, dans le suivi et le contrôle de la qualité de leurs travaux, dans les connaissances issues de la science, ainsi que dans les résultats de l'expertise, leur intelligibilité et leur capacité à être utilisés dans la décision. La première question qui se pose est donc de savoir si, au plan international, les exigences que nous nous imposons pour donner confiance dans l'expertise sont partagées par tous et si nous pouvons en obtenir la preuve ? Au plan pratique, peut- on utiliser les avis issus des autres organismes d'expertise en toute confiance ? Que savons-nous des autres ? Comment réalisent-ils leurs expertises ? Sommes-nous à des niveaux de fiabilité comparables ? Actuellement il n'est pas possible, dans beaucoup de domaines, de connaître avec exactitude les pratiques d'expertise, les procédures utilisées, de savoir comment ont été construits les avis de sécurité sanitaire. Par exemple, la consultation des sites Internet des agences de sécurité sanitaire des aliments en Europe ne permet pas de répondre à cette question. Tout au plus y trouve-t-on des documents généraux de déontologie, d'organisation administrative, mais qui ne renseignent pas, loin s'en faut, sur les moyens de maîtrise de tous les aspects critiques de l'expertise scientifique des risques. Autrement dit, dans bien des domaines, pas forcément dans tous, on doit donc faire une confiance quasi aveugle aux autres organismes d'expertise. Sommes-nous en mesure de garantir aux décideurs publics de notre pays que, lorsqu'ils utilisent pour fonder leurs décisions des avis issus des autres agences nationales, le risque qu'ils vont prendre et qu'ils acceptent est de même nature, de même niveau que celui qu'ils prennent avec nos propres avis ? Il est très difficile de répondre oui. Que se passerait-il si une décision administrative était prise en France sur la base d'un avis d'un organisme d'expertise étranger et qu'elle fasse l'objet d'un recours devant nos juridictions administratives ? Quel serait le pouvoir du juge administratif pour missionner un expert afin d'aller ouvrir les dossiers d'expertise d'une agence étrangère ou de l'AESA dans le cadre de l'instruction ? Car si le problème a trouvé sa solution pour la justice judiciaire, cela ne semble pas encore être le cas pour la justice administrative. Il faut donc soit « expertiser les expertises des autres » afin d'évaluer leur fiabilité, soit refaire ces expertises tant qu'il n'existe pas de systèmes de confiance de portée internationale ! Comment sont contrôlées les expertises des autres organismes ? Quels sont les standards, les référentiels de pratique d'expertise admis et comparables, les modalités et l'organisation des contrôles, etc. ? Autant de questions sans réponse totalement satisfaisante pour l'instant au plan international. Des axes de progrès sont cependant possibles. Tout d'abord, s'obliger à une transparence et à une information internationales sur l'organisation et les pratiques d'expertise publique. Un réel effort doit être engagé pour faire connaître les manières de conduire et de réaliser les expertises d'intérêt général, pour éviter le doute et les craintes, en utilisant tous les moyens d'information et de communication à notre disposition. Deuxièmement, normaliser les pratiques d'expertise autant qu'il est possible. Depuis 1999, les travaux engagés en France par l'AFNOR à l'initiative de l'AFSSA sur le thème de la qualité en expertise ont conduit à la norme NFX 50-110, dont une version anglaise a été établie et validée dans la même année, et très diffusée. La commission de normalisation AFNOR XD50, dite « Expertise », et dont l'installation officielle aura lieu le 8 décembre, proposera de lancer une démarche de normalisation internationale, soit dans le cadre du Comité européen de normalisation, soit à l'ISO, Organisation internationale de normalisation, selon la stratégie qui sera arrêtée après concertation, afin d'obtenir une norme internationale. Enfin, il conviendra aussi de réfléchir à l'intérêt qu'il y aurait à promouvoir, dans l'avenir, une directive ou un règlement sur les pratiques d'expertise d'aide à la décision publique, en Europe, ou bien un accord international à plus vaste échelle. Troisièmement, évaluer, contrôler, reconnaître la qualité des pratiques d'expertise. Il convient d'encourager la mise en place de systèmes appropriés d'évaluation et de reconnaissance de la qualité des pratiques d'expertise par des autorités ou des organismes compétents et indépendants. Quatrièmement, reconnaître mutuellement des pratiques équivalentes entre les organismes impliqués dans l'expertise publique en Europe, voire au-delà, à partir de processus d'évaluation croisés, d'audits réalisés selon des méthodes éprouvées, à l'aide d'auditeurs compétents en conduite d'expertise. Former, enfin, en expertise publique. Organiser des formations supérieures internationales à l'expertise publique est indispensable pour parvenir aux objectifs qui ont été développés tout au long de cette présentation. Si, comme il a été dit la science est mondiale, l'expertise reste encore locale. L'avenir, c'est aussi d'être en capacité d'organiser, chaque fois que nécessaire, des campagnes internationales d'expertise publique collective sur des sujets d'importance mondiale, qu'il s'agisse des risques naturels et technologiques majeurs, de la sécurité sanitaire ou du développement durable. M. Philippe VERGER : Je vous remercie de cette présentation, bien que je ne sois évidemment pas d'accord avec vous. Lorsque la France, qui est incapable de placer des experts dans les comités internationaux, donne des leçons aux Etats-Unis et au Japon et leur dit qu'elle va faire expertiser leur système, elle me paraît courir à l'échec... Je donne la parole au Professeur Riché. Professeur Christian RICHÉ, Chef du service pharmacologie Comme tout à l'heure, je serai bref, et mon intervention tiendra en trois points. La coordination des expertises internationale et nationale, dont a parlé Mme Briand, est une vraie question, qui n'a pas encore trouvé de réponse. J'aurais tendance à considérer, pour ma part, qu'il y a conflit d'intérêts lorsqu'on appartient à plusieurs systèmes d'évaluation, et qu'on ne peut pas être à la fois expert européen et national. L'expertise européenne crée-t-elle des inhibitions ? On a la démonstration que oui. Il faut les vaincre, et Mme Castot a apporté quelques éléments dans ce sens. Enfin, je fais mien le plaidoyer de M. Marzin tout à l'heure : l'expertise est un travail de longue haleine, et sa planification une nécessité impérieuse, car la qualité de l'expertise, qui est le témoin d'un savoir-faire en situation, est un critère important pour l'attractivité internationale d'une économie. Il faut donc que nous développions notre expertise pour lui donner de la crédibilité et pour favoriser la reconnaissance de l'expert, car les retombées sont également économiques. M. Claude SAUNIER, Président : Nous arrivons au terme de cette dernière table ronde, qui a vu la température monter fortement... Mon souhait que chacun s'exprime librement a été plus qu'exaucé, et je donne la parole à Jean-Yves LE DÉAUT, qui bouillait, je le sentais, de participer à l'échange... M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Je serai bref, étant déjà intervenu ce matin. J'ose espérer que la loi sur les biotechnologies prévoira deux instances et deux niveaux d'évaluation, portant respectivement sur l'intérêt scientifique et sur les données socio-économiques, afin d'éviter la confusion que nous avons connue sur les OGM. Faut-il faire évaluer les experts par une haute autorité ? Oui, mais encore faut-il savoir de qui elle dépendra... On a évoqué le nucléaire, mais s'il s'agit de faire de la gestion de crise, mieux vaut que ce soit l'Etat qui le fasse, car cela fait partie de ses domaines régaliens, contrairement à d'autres où il peut déléguer. Mais si des cabinets ministériels se sentaient investis, dans d'autres domaines, d'une autorité que le pouvoir législatif ne leur a pas conférée, ce ne serait pas une bonne solution. Mme Bertella-Geoffroy a suggéré ce matin qu'il appartenait au Parlement d'améliorer son fonctionnement, de jouer mieux son rôle en créant de vraies commissions d'enquête. Je ne partage pas du tout, enfin, ce qui a été dit sur l'organisation de l'expertise. Si l'on fait l'Europe, il est évident qu'il faut organiser l'expertise au niveau européen, comme on l'a fait dans le secteur de l'alimentation après la crise de la vache folle. Je sais qu'il y a conflit entre l'agence française et l'agence européenne. Il faut bien définir les rôles respectifs, et choisir les experts européens au niveau de l'Europe, et non à l'échelle d'un pays ou d'une juridiction. M. Claude SAUNIER, Président : Je voudrais faire la synthèse, très rapide, de mes impressions au terme de cette riche après-midi. Premièrement, tout le monde s'accorde sur la nécessité de consolider et de renforcer l'expertise publique. Je n'ai entendu aucun avis divergent. Deuxièmement, il y a eu, malgré les insatisfactions et les faiblesses, de vrais progrès dans notre pays ces dernières années, et les crises ont été salutaires d'une certaine façon, car elles ont permis aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités, en créant des structures qu ne sont pas encore parfaites mais qui marquent un réel progrès. Cela dit, des difficultés ont été énoncées : les conflits d'intérêts, sur lesquels M. Benaiche et le Professeur Even ont dit des choses très nettes, mais aussi la réduction du vivier d'experts, dont on a moins parlé, mais qui n'en est pas moins préoccupante, car s'il n'y a plus d'experts, il n'y aura plus d'expertise. Il faut mieux valoriser et mieux reconnaître l'activité d'expertise, dont le statut au sein de la société est très insuffisant. Des pistes ont été tracées : sur les conditions de la saisine des experts, la formulation des questions, l'articulation entre le commanditaire et l'expert, la définition des méthodes de travail, sur la nécessité pour les grands organismes d'anticiper les besoins en expertise afin de pouvoir, lorsqu'ils sont sollicités, réagir avec rapidité, efficacité et compétence, sur la nécessité enfin de définir l'environnement socio-économique de chaque expertise à caractère scientifique et technique - car l'irruption d'une innovation peut donner lieu à des interrogations qui ne peuvent être traitées sous le seul angle des sciences dures. Certaines questions sont néanmoins restées sans réponse, ou avec des réponses contradictoires. Peut-on être expert et savant en même temps ? Les avis sont divergents, selon les uns ce sont des démarches intellectuelles complémentaires, selon les autres elles sont divergentes. En suspens aussi, la question de la responsabilité des experts, celle de l'articulation avec les décideurs, celle enfin du pouvoir, théorique ou réel, des experts et de leur conjugaison avec le pouvoir démocratique issu du peuple. Enfin, nous sentons bien, s'agissant de la dimension internationale de l'expertise, que nous sommes au milieu du gué. Il faudra bien qu'un jour nos experts nationaux portent leur regard au-delà de la ligne bleue des Vosges, qu'ils s'engagent, portés par les institutions dont ils sont issus, au-delà de l'Atlantique ou du Pacifique, et il faudra aussi sortir, au niveau européen, de la situation ambiguë actuelle, où nos logiques d'expertise hexagonale ne sont pas en cohérence avec les logiques européennes. Bref, il faut construire, naturellement avec toutes les garanties nécessaires, une Europe plus européenne. Je laisse maintenant à Bernard Chevassus-au-Louis, puis à Robert Badinter, le soin de conclure cette journée. Conclusion par M. Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, Président du Museum national d'histoire naturelle Vous l'avez vous-même fort bien résumé, et je crois exprimer le sentiment de tous les intervenants en remerciant les organisateurs de ces tables rondes qui nous ont permis d'avoir un regard critique sur nos propres pratiques - ce qui n'est pas si fréquent. J'en extrairai ce qui me semble relever du Parlement, en en séparant ce qui appartient à ceux qui sont intervenus au nom des responsabilités qui sont les leurs. L'expert est à l'interface entre la science et la société, et considéré comme un traître des deux côtés, aussi bien par la société que par la communauté scientifique qui voit en lui, si l'on me pardonne ce jeu de mots quasi lacanien, un « ex-pair ». J'ai toutefois la faiblesse de penser que la reconnaissance de la communauté scientifique est plus importante que celle de la société... Que reste-t-il, à ce niveau, au politique ? D'abord la question des disciplines en déshérence dont l'expertise a besoin : la toxicologie, ainsi que d'autres dont je ne ferai pas ici la liste, mais qu'il faut faire vivre davantage, dans les projets de recherche, dans les orientations des organismes, afin qu'il y ait un vivier d'experts. Vous allez d'autre part examiner la loi d'orientation pour la recherche, qui crée une agence nationale d'évaluation de la recherche. Sans doute faut-il que cette évaluation ne se limite pas à compter les publications, mais appréhende toute la diversité des activités confiées aux chercheurs, et qui comprennent celles d'expertise, dimension importante de leur métier. S'agissant du rapport de l'expert à la population, la crédibilité du processus d'expertise ne pourra être que procédurale, puisque le citoyen comme le décideur ne peut apprécier la qualité du contenu. Cependant, les institutions étant généralement moins crédibles dans l'opinion que les individus, il faut se garder d'une vision trop technocratique de la procédure, et y intégrer des représentants de la société ordinaire, car la crédibilité ne se décrète pas, et rien ne sert de dessiner une procédure idéale si, dès le départ, le citoyen n'y croit pas. La question de l'indépendance financière des organismes est également importante. Le fait que les expertises soient financées souvent sur fonds privés, et portent sur des données fournies par des opérateurs privés peut poser un problème de crédibilité, car on ne peut expertiser que ce qu'on a sur la table, même s'il coûterait évidemment très cher de faire autrement. L'expertise est un élément du processus de décision publique, élément qui doit être pertinent et considéré comme tel, si l'on veut qu'il concoure au consentement éclairé de la société. Rien ne sert d'avoir la meilleure expertise du monde si le système, globalement, ne fonctionne pas bien. Comment combiner la compétence, l'indépendance des experts, les autres qualités que l'on attend eux, d'une part, et la nécessité d'interagir avec les autres éléments de la décision publique, d'autre part ? On n'a jamais dit, même dans les systèmes internationaux, qu'il doive y avoir une séparation structurelle entre évaluation et gestion : le Codex alimentarius parle seulement d'étapes fonctionnelles. Cette question est, à mon sens, encore ouverte. On a évacué un peu vite le principe de précaution et la gestion de l'incertitude, de même que la question de la responsabilisation - car, face à la justice, la protection qu'un EPST peut accorder à ses chercheurs ne pèsera pas très lourd... On a peu évoqué aussi la difficulté de faire participer la capacité d'expertise du secteur privé, qui est réelle, notamment par sa connaissance fine des lieux où se situe le risque. On n'a pas du tout évoqué, enfin, l'expertise citoyenne, qui a et aura, quoi qu'en pensent les institutionnels, une crédibilité de plus en plus forte dans l'opinion : faut-il l'ignorer ou l'associer, et si oui, comment. S'agissant de la dimension internationale, je retiendrai trois questions qui restent en suspens. Peut-on se montrer plus audacieux qu'au moment de la création de l'AFSSA et intégrer des experts étrangers dans des instances nationales ? Comment gérer les conflits internationaux entre deux instances ayant exprimé leur désaccord ? Quelle répartition des rôles entre le niveau national et le niveau européen, entre le niveau européen et le niveau international, mais aussi entre les niveaux régionaux, locaux, voire municipaux qui revendiquent le droit de prendre des décisions en matière de gestion des risques ? Tels sont les quelques points que je voulais souligner au terme de cette journée très instructive. M. Robert BADINTER, Sénateur des Hauts-de-Seine, ancien Garde des Sceaux, ancien Président du Conseil constitutionnel Pardonnez-moi mon retard, dû au fait que le Sénat examine aujourd'hui même le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme, et qui me place dans la situation embarrassante d'avoir à conclure des échanges que je n'ai pas entendus... Grâce aux propos fort éclairants du professeur Chevassus-au-Louis que j'ai néanmoins pu écouter, et en me fondant sur le titre de cette journée consacrée à l'« expertise scientifique », je me rassure de penser que, de toute façon, un juriste ne saurait prétendre à la qualité d'expert scientifique, pas même, peut-être, à celle d'expert tout court, et invoquerai les mânes du doyen Carbonnier, pour qui « le droit est la science du contradictoire et exclut par conséquent la certitude, c'est bien ce qui fonde l'autorité de la chose jugée »... Parce qu'il est angoissé par la quête de la certitude, ou tout au moins du vraisemblable, du plus vraisemblable possible, le juge recourt de plus en plus volontiers à l'expertise scientifique, et l'on ne mesure pas à quel point elle est pour lui un confort, car elle soulage sa conscience et lui confère la garantie d'une autorité supérieure aux yeux du justiciable. Il est d'ailleurs frappant que le problème numéro un du budget de la justice soit l'inflexion irréversible, incontrôlable, des frais de justice, et en particulier des frais d'expertise. Elle n'est pas seulement due au fait que les techniques sont plus sophistiquées et plus onéreuses, mais aussi et surtout à un usage de plus en plus fréquent : chacun se souvient de ce célèbre magistrat instructeur qui avait, pour résoudre l'énigme du viol, suivi de meurtre, d'une jeune vacancière anglaise en Bretagne, fait passer un test d'ADN à tout le village... Pourquoi y a-t-il cette exigence accrue ? A cause de la quête de la vérité, bien sûr, mais aussi pour cette raison que les Anglais ont résumé par cette excellente formule : il ne suffit pas que la justice ait été rendue, il faut encore que l'on croie qu'elle l'a été. Autrement dit, la crédibilité de la décision est un élément fondamental de la croyance des citoyens en leur justice. Et pour fortifier le crédit de ses décisions, rien n'égale l'expertise scientifique. Elle est indiscutable en matière d'ADN, de balistique, ainsi que dans d'autres domaines relevant des sciences exactes, mais il est d'autres domaines où il est moins certain qu'elle réponde à la rigueur qu'on est en droit d'attendre. L'expertise psychiatrique ou psychologique, par exemple, est depuis longtemps l'objet d'une grande incertitude quant à sa crédibilité scientifique, avant même certaines affaires récentes que chacun a en tête. Mais pas seulement : dans les procès récents pour crimes contre l'humanité, on a recouru à des experts historiens pour expliquer aux juges et aux jurés ce que fut la persécution des Juifs sous Vichy, ce que furent les lois d'exception et les pratiques de l'administration française pour pourvoir aux exigences des forces d'occupation. C'est ainsi qu'aux procès Barbie et Papon, est venu témoigner Robert Paxton, qui est un historien très remarquable, mais la démarche n'est-elle pas très singulière d'appeler « experts » de bons historiens ? Elle s'explique par la volonté d'éclairer la justice, mais aussi par celle de témoigner devant l'opinion qu'on est allé jusqu'au bout du possible. Il faut analyser, face à ce besoin, les exigences et les garanties que l'on attend des experts. Certes, la qualité de leurs travaux scientifiques antérieurs à leur mission judiciaire est importante, et vous avez sans doute débattu de cette question : comment sélectionner, désigner les experts les plus qualifiés. Mais il y a plus : je le souligne car on en parle rarement, c'est l'expertise elle-même, son déroulement, qui doit satisfaire à des exigences de plus en plus précises. On le constate dans la jurisprudence, assez complexe, de la Cour de Strasbourg : dans la plupart des grands procès contemporains, notamment ceux qui concernent un grand nombre de victimes, qu'il s'agisse de l'effondrement d'un barrage, d'empoisonnements ou de pandémies, non seulement on a recours à des experts, mais l'expertise tend à être au cœur du procès, et le raisonnement implicite qui commence à apparaître, et qui ne pourra que se manifester de plus en plus, est que les exigences procédurales propres au procès lui-même doivent s'appliquer également à l'expertise. En d'autres termes, on passe du procès équitable à l'expertise équitable. On voit tout de suite les bienfaits à attendre d'une telle évolution. Il y a certes l'exigence d'objectivité, d'impartialité, mais il y a aussi le principe du contradictoire, qui suppose que l'on ait connaissance des travaux des experts à mesure qu'ils se déroulent. Il y a aussi la question, trop oubliée, de la durée de l'expertise, car qui dit procès équitable dit délai raisonnable. Je note au passage que la Cour de Strasbourg, prompte à vérifier que cette exigence est respectée partout en Europe, s'en affranchit elle-même assez allègrement, tel Thomas More qui se libérait complètement de l'éthique du magistrat sur laquelle il philosophait. Ses délais de jugement peuvent atteindre cinq, six, voire sept ans ou davantage, comme dans cette affaire concernant un plaignant italien, et où il a fallu onze ans entre la commission des experts et le dépôt des rapports - c'est beaucoup, même pour la Sicile... Parmi les exigences nouvelles, il y a aussi celle de l'égalité des armes. C'est un problème délicat. Les parties sont-elles à égalité quand il y a d'un côté le laboratoire scientifique de la police, et de l'autre le laboratoire privé choisi par la partie défenderesse ? Reste qu'en s'acheminant vers le concept de droit à une expertise équitable, on fera progresser les exigences procédurales, qui rendront à leur tour plus efficaces et crédibles les démarches des experts, et je crois que les justiciables et les citoyens ne s'en trouveront que mieux. Telle aura été ma modeste contribution à vos travaux qu'il m'est revenu de conclure... M. Jean-Yves LE DÉAUT, Président : Merci beaucoup. Vous n'étiez pas là ce matin, mais vous avez très bien résumé ce qui s'est dit... ----------------------- N° 2890 Rapport déposé par M. Claude BIRRAUX au nom de l'office d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur l'expertise scientifique |