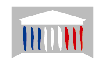______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 novembre 2006.
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la prévention de la délinquance,
PAR M. JEAN-MICHEL DUBERNARD
Député.
——
Voir les numéros :
Sénat : 433, 476, 477 et T.A. 134 (2005-2006).
Assemblée nationale : 3338.
A. MIEUX SOUTENIR LA MISSION ÉDUCATIVE DES PARENTS 9
B. COORDONNER LES INTERVENTIONS D’ACTION SOCIALE AUPRÈS D’UNE MÊME FAMILLE 14
C. ENCADRER LA MISE EN PLACE DU SECRET PROFESSIONNEL PARTAGÉ 17
D. DONNER DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS AUX MAIRES POUR AIDER LES FAMILLES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES 18
II.- RENFORCER LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE À L’ÉCOLE 21
A. INSÉRER LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LES MISSIONS DE L’ÉCOLE 22
B. LUTTER CONTRE L’ABSENTÉISME SCOLAIRE 28
III.- PROTÉGER L’ENFANCE CONTRE LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES SEXUELS OU VIOLENTS 35
A. EMPÊCHER LE DÉVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU CHAMP D’EXPANSION DE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE 35
B. METTRE EN PLACE UNE PROTECTION RENFORCÉE DES ENFANTS 41
IV.- CONCILIER LES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LES DROITS DES MALADES HOSPITALISÉS SOUS CONTRAINTE 43
A. PRENDRE EN COMPTE LES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LE SUIVI DES PERSONNES HOSPITALISÉES D’OFFICE 43
B. METTRE EN PLACE UNE RÉFORME PRAGMATIQUE ET RESPECTUEUSE DES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISÉS D’OFFICE 47
C. PROPOSER DANS LES MEILLEURS DÉLAIS UNE RÉFORME GLOBALE DE LA LOI DU 27 JUIN 1990 52
V.- RÉACTIVER L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE ET L’OBLIGATION DE SOINS VISANT LES TOXICOMANES 55
A. LUTTER CONTRE L’USAGE DE STUPÉFIANTS PAR UN DISPOSITIF RÉPRESSIF ET DES MESURES SANITAIRES 55
B. METTRE EN PLACE UNE INTERFACE MÉDICALE ENTRE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE ET L’USAGER DE DROGUE 58
VI.- PRENDRE EN COMPTE LES DANGERS DE L’ALCOOL 61
A. PERMETTRE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PROPOSER UNE MESURE D’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION PÉNALE 61
B. ÉTUDIER LE PRONONCÉ D’UNE MESURE D’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR LES CONDUCTEURS EN ÉTAT D’ALCOOLÉMIE HABITUELLE ET EXCESSIVE 61
Article 5 : Coordination des interventions en matière d’action sociale en faveur des familles en difficulté et secret professionnel partagé 73
Article 6 : Création du conseil pour les droits et devoirs des familles 81
Article 7 : Désignation du travailleur social coordonnateur comme tuteur aux prestations familiales 85
Après l’article 7 90
Article 8 : Possibilité pour le maire d’adresser un rappel à l’ordre aux personnes troublant l’ordre public 90
Article 8 bis : Missions du service public de l’éducation 92
Article 9 : Contrôle de l’absentéisme scolaire – Statut des « Écoles de la deuxième chance » et des « Lycées de toutes les chances » 93
Article 17 : Réorganisation du contrôle administratif des documents électroniques à caractère pornographique ou violent – Protection des mineurs contre la pédophilie sur Internet 96
Après l’article 17 100
Article 18 : Renforcement du contrôle des sorties d’essai des établissements psychiatriques 101
Article 19 : Création d’un fichier national des hospitalisations d’office 104
Article 20 : Recours obligatoire à l’hospitalisation d’office en cas d’atteintes à la sûreté des personnes ou à l’ordre public 109
Article 21 : Renforcement du rôle du maire dans la procédure de l’hospitalisation d’office 111
Article 22 : Renforcement des garanties médicales lors de la confirmation des décisions d’hospitalisation sans consentement 113
Article 23 : Possibilité pour le préfet d’ordonner une expertise médicale 114
Article 24 : Régime d’hospitalisation d’office pour irresponsabilité pénale 116
Article 27 : Modalités de l’injonction thérapeutique applicables aux personnes signalées par l’autorité judiciaire 117
Article 28 : Peines applicables en cas d’usage illicite de stupéfiants 122
Article 29 : Procédures judiciaires applicables à l’injonction thérapeutique 126
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales s’est saisie pour avis des articles du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance entrant dans son champ de compétences : l’aide aux familles en difficulté (articles 5 à 8), la prévention de la délinquance à l’école (articles 8 bis et 9), la lutte contre la pornographie et la violence diffusée via les supports électroniques de vidéos ou de jeux et contre la pédophilie sur internet (article 17), les malades mentaux hospitalisés sous contrainte (articles 18 à 24) et la prévention de la toxicomanie et l’obligation des soins pour les toxicomanes (articles 27 à 29).
Sur tous ces points le projet de loi comporte de réelles avancées pour permettre une prévention efficace. Il n’est, en effet, pas possible de considérer comme une fatalité l’augmentation de la délinquance des mineurs qui a progressé de 80 % en dix ans. Ce triste constat doit conduire les pouvoirs publics à se remettre en cause pour examiner avec lucidité les raisons de l’échec des politiques publiques passées, tant dans leur dimension pénale que sociale.
Le présent projet de loi propose donc deux axes d’action :
– adapter les sanctions à la gravité des actes pour renforcer leur caractère dissuasif ;
– revoir l’organisation des actions publiques sur le terrain en donnant au maire un rôle pivot pour la prévention de la délinquance mais aussi pour la coordination des multiples travailleurs sociaux qui interviennent souvent de manière trop cloisonnée auprès des mêmes familles en difficulté.
Le projet de loi attribue de nouvelles compétences aux maires. Ils pourront désormais proposer la mise en place d’un accompagnement parental quand des enfants paraissent être une menace pour l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics en raison d’un défaut de surveillance ou d’assiduité scolaire, cette mesure pouvant être suivie d’un contrat de responsabilité parentale ou d’une mise sous tutelle des prestations familiales. Ils seront également chargés de contrôler l’effectivité de la scolarisation des enfants.
En matière de sécurité publique, leurs pouvoirs seront accrus car ils deviendront l’autorité de droit commun pour le déclenchement des procédures l’hospitalisation d’office des personnes atteintes de troubles mentaux et constituant une menace pour la sécurité des personnes.
Le maire sera l’interlocuteur privilégié de tous les publics en difficulté mais aussi des acteurs sociaux de la prévention. Le projet de loi lui donne de nouveaux instruments gradués d’intervention dans le cadre de la prévention.
Les compétences des autorités sociales et judiciaires sont respectées. Les coordinations entre les différents acteurs de la prévention de la délinquance sont améliorées et l’efficacité des mesures d’alerte ou de sanction renforcée.
Les dispositions du projet de loi relatives à l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte ont suscité de multiples réactions. Cette réforme se veut pragmatique : il s’agit de trouver un équilibre délicat entre la prise en charge sanitaire des malades mentaux dans le respect de leur dignité et la prise en compte des exigences de la sécurité publique, ce qui peut conduire à des décisions attentatoires à la liberté individuelle. Les dispositions des articles 18 à 24 du projet de loi, loin d’être attentatoires aux droits des patients, apportent de nouvelles garanties pour les malades : l’hospitalisation d’office décidée en urgence ne pourra plus être justifiée sous prétexte que « la notoriété publique » atteste de la dangerosité d’une personne ; un avis médical sera toujours nécessaire pour éclairer la prise de décision de l’autorité administrative.
Malgré ces avancées, on peut comprendre l’émotion suscitée chez les professionnels de la santé mentale, les patients et leurs familles par l’insertion dans un texte de sécurité publique d’articles relatifs à l’hospitalisation sous contrainte. Il est urgent de parvenir à une réforme globale des soins psychiatriques dans le cadre de la révision de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation, objectif poursuivi depuis dix ans par les professionnels, l’ensemble des structures et associations ainsi que les familles concernées.
Le gouvernement s’est engagé à tout mettre en œuvre pour parvenir à une réforme globale de la loi du 27 juin 1990 en privilégiant la voie de l’habilitation à légiférer par ordonnance. Il n’existe pas d’autres solutions si l’on veut véritablement réformer la loi de 1990 avant la fin de cette législature.
Le texte de cette ordonnance devrait être négocié avec l’ensemble de la profession et les associations de patients, déjà parties à la concertation mise en œuvre depuis plusieurs mois par le ministère de la santé et des solidarités. La négociation portera sur l’ensemble des dispositions de la loi du 27 juin 1990, y compris les articles 18 à 24 du présent projet de loi. Les professionnels et les familles pourront donc discuter des problèmes de fond comme la réforme de l’hospitalisation à la demande d’un tiers, la création d’une obligation de soins qui pourrait se dérouler dans un cadre ambulatoire ou le renforcement des prérogatives de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Aujourd’hui, il faut déterminer le véhicule législatif qui permettra d’habiliter le gouvernement à réformer par voie d’ordonnance la loi du 27 juin 1990. L’objectif est de réussir à déposer un projet de loi de ratification de cette ordonnance avant la fin de la législature. Dans l’attente, il est nécessaire d’examiner et de voter les articles 18 à 24, qui répondent à un réel besoin de sécurité publique. Ces articles pourront être supprimés au cours de la navette entre les deux assemblées, dès lors que le Parlement aura constaté que la procédure de l’ordonnance a été menée à son terme.
Si la loi de 1990 est réformée, chacun sera satisfait, familles et patients, associations et ministères de l’intérieur et de la santé, qui ont tous travaillé sur cette question.
Par ailleurs, l’autorité sanitaire est remise au centre du dispositif sanitaire de la procédure d’injonction thérapeutique et d’obligation de soins pour les usagers de drogues. Un médecin relais est institué pour servir de véritable interface entre l’autorité judiciaire et la personne concernée par une mesure d’injonction thérapeutique.
Enfin, les nouveaux dangers pour les mineurs sont pris en compte. Le projet de loi adapte la procédure d’interdiction des vidéos et jeux électroniques présentant un risque pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographiques, violent, ou incitant à la discrimination ou la haine raciales ou encore à l’usage de stupéfiants. Une signalétique spécifique est mise en place pour permettre de limiter la mise à disposition de ces produits à certaines catégories de publics en fonction de leur âge. Un nouveau délit de sollicitation sexuelle faite à un mineur de quinze ans par un moyen de communication électronique est institué.
Malgré le foisonnement des dispositifs pour aider les familles en difficulté, force est de constater que le sentiment d’impuissance grandit tant chez les élus locaux, qui sont confrontés à la montée des incivilités, que chez les professionnels du secteur éducatif, qui peinent à maîtriser les comportements violents des élèves ou à traiter les phénomènes d’absentéisme. Quant aux parents, beaucoup se sentent dépassés par les comportements à risques de leurs enfants et sont inquiets de leurs difficultés d’insertion professionnelle.
Cette difficulté grandissante à assumer le rôle de parent s’explique par de multiples facteurs, parmi lesquels on peut citer la fragilisation des unions et le développement des familles monoparentales, le changement de statut de l’enfant qui en quelques années s’est vu reconnaître des droits, ce qui conduit à une évolution de la manière de considérer l’exercice de l’autorité parentale, ou encore l’affaiblissement des liens intergénérationnels : les parents sont souvent seuls pour surmonter des difficultés éducatives alors qu’auparavant la famille élargie pouvait plus facilement suppléer à certaines carences éducatives des parents.
Les politiques d’action sociale ont été longtemps inadaptées pour répondre à cette nouvelle demande des familles : les seuls dispositifs existants relevaient de la protection de l’enfance et s’adressaient à des familles fortement déstructurées chez lesquelles les risques de maltraitance ou de carence éducative étaient patents. Il n’existait pas de mesure intermédiaire entre l’intervention du juge des enfants ou des éducateurs de l’assistance éducative en milieu ouvert et la démarche volontaire des parents qui, confrontés à une difficulté éducative, devaient trouver de l’aide auprès de psychologues ou de certaines associations spécialisées comme la Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs.
Les pouvoirs publics ont institutionnalisé le soutien à la fonction parentale en créant les Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP) en 1999. Ce dispositif, institué par l’État en partenariat avec la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et les grandes associations familiales, a pour objectif d’aider et d’accompagner les parents en valorisant leur rôle et leurs compétences. Dans le cadre d’une logique d’entraide et de solidarité entre les familles, les REAAP ont vocation à s’adresser à tous les parents et s’appuient sur les initiatives associatives existantes tout en soutenant le développement de nouveaux services aux familles. Par le dialogue les parents s’aident mutuellement à trouver des repères ou des réponses à leurs interrogations (accueil de l’enfant à la naissance, petite enfance, adolescence, co-parentalité, exercice de l’autorité parentale, assiduité scolaire…)
Les réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
Selon les informations communiquées par le ministère de la santé et des solidarités, il ressort du bilan réalisé sur l’année 2005 que 5 389 actions ont bénéficié d’un financement dans le cadre du dispositif des Réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP).et plus de 550 000 familles en ont bénéficié. Ces actions s’inscrivent dans une logique préventive et interviennent principalement dans les domaines suivants :
– prévention et appui aux parents les plus fragilisés (27 %) ;
– accompagnement des parents de jeunes enfants (15,3 %) ;
– amélioration des relations entre les familles et l’école (12,5 %) ;
– soutien aux parents de pré-adolescents et d’adolescents (12 %).
L’aide à la parentalité s’organise selon différentes modalités :
– des conférences débats (14,5 % des actions en 2005) ;
– des groupes de parents (17,2% des actions en 2005) ;
– des groupes de parole (28 % des actions en 2005) ;
– des groupes d’activité parents-enfants (28,5% des actions en 2005) ;
– des lieux d’accueil et d’écoute individuels (11,8 % des actions en 2005).
Ce premier bilan des REAAP conduit à s’interroger sur le point de savoir s’ils sont réellement adaptés pour des familles très fragilisées, qui répugnent souvent à exposer devant d’autres personnes leurs difficultés. Il serait sans doute préférable de développer le mécanisme d’entretiens individuels au cours desquels les personnes peuvent s’exprimer plus librement sans avoir l’impression d’être jugée car elles ne sont pas « dans la norme ». Dans son bilan d’évaluation des REAAP en mars 2004, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)1 soulignait qu’il fallait faire un effort pour toucher les familles « ne demandant rien » et qui sont souvent celles qui auraient le plus besoin d’un accompagnement à la fonction parentale. Elle préconisait un effort de communication non pas de la part des responsables institutionnels mais par une incitation des parents bénéficiaires des services des REAAP à les faire connaître auprès d’autres parents en difficulté.
Par ailleurs, l’action sociale des caisses d’allocations familiales subventionne les actions de soutien à la parentalité, la branche famille ayant une conception extensive de la notion d’aide à la parentalité.
La convention d’objectifs et de gestion (COG) entre l’État et la CNAF, signée en juillet dernier pour la période 2005-2008, prévoit de renforcer l’intervention de la branche famille en faveur du soutien à la parentalité. La branche s'engage en effet à poursuivre des actions aux moments clés de la vie de la famille : naissance, changements de rythme de vie (passages scolaires par exemple), disparition d’un parent, rupture conjugale, etc. À cette fin, elle encourage l'offre de lieux d’accueil des enfants et de leurs parents, d’échanges entre parents et entre parents et professionnels, de soutien aux couples en difficulté et aux parents dont les enfants ne résident pas en permanence avec eux, mais aussi le développement d'espaces de rencontre pour le maintien des liens des enfants avec le parent dont les enfants ne résident pas en permanence avec eux.
À partir des priorités fixées dans la COG au titre de l’action sociale, chaque caisse d’allocations familiales définit sa propre politique dans ce domaine et les interventions en matière d’aide à la parentalité sont donc très variées d’une caisse à l’autre, selon les caractéristiques socio-économiques du département, l’implication des collectivités territoriales et la richesse du tissu associatif. Pour l’année 2005, le montant total des aides à la parentalité financé par la branche famille atteignait 35,6 millions d’euros alors que l’Etat y consacrait 9 millions d’euros. Les collectivités locales sont aussi parties prenantes, la plupart des services d’aide à la parentalité reposant sur un partenariat entre les collectivités locales, la Caf et les associations familiales. C’est ainsi que de nombreuses communes disposent de leur « maison des parents » qui permet aux familles à la fois de trouver de l’information sur des problèmes pratiques comme les modes de garde, l’orientation scolaire ou les activités périscolaires, mais aussi de pouvoir bénéficier de conseils individuels en cas de difficulté éducative ou de conduite à risques de leurs enfants.
Un autre mode de soutien à la fonction parentale est apparu nécessaire avec l’augmentation des divorces et des familles recomposées. La médiation familiale a été créée pour pacifier l’exercice conjoint de l’autorité parentale après la séparation des parents et permettre que les enfants conservent des relations étroites avec leurs deux parents, le parent n’ayant pas la garde de l’enfant devant continuer à jouer son rôle éducatif. Les CAF se sont fortement impliquées pour soutenir la médiation familiale depuis 1998. Trente CAF gèrent elles-mêmes un service de médiation familiale. Le soutien apporté par les caf aux associations familiales spécialisées dans la médiation familiale a facilité la professionnalisation de cette forme spécifique d’aide à la parentalité.
Afin de diminuer l’impact des conflits familiaux sur l’enfant et privilégier la préservation de liens familiaux entre les parents et les enfants, l’Etat s’est engagé dans une phase de reconnaissance institutionnelle de la médiation familiale. Cette reconnaissance s’est traduite par son inscription à l’article 373-2-10 du code civil et par la professionnalisation des médiateurs familiaux, via la création d’un diplôme d’Etat.
Pour la période 2006-2008, une enveloppe de 18,89 millions d’euros a été prévue par la CNAF pour le financement des services de médiation familiale.
La CNAF a souhaité que le financement de la médiation familiale s’inscrive dans le cadre d’un partenariat institutionnel, lequel a été formalisé par la signature d’un protocole national de développement de la médiation familiale le 30 juin 2006 avec le ministère de la justice, le ministère chargé de l’action sociale et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et par la mise en place d’un comité national de pilotage regroupant tous les signataires du protocole.
La mise en place de ce partenariat relatif à la médiation familiale s’est aussi traduite par la mise au point d’un barème pour la participation des familles qui est adapté aux capacités contributives des familles, ce qui va favoriser l’accès à ce service qui jusqu’à présent était assez onéreux.
Les pouvoirs publics se sont progressivement rendus compte que les familles connaissent mal l’étendue des services dont elles peuvent bénéficier en raison de la multiplicité des intervenants. L’idée d’un « guichet unique » pour les familles a donc été concrétisée par la mise en place de « Points Info Famille ».
La conférence de la famille du 29 avril 2003 a décidé de créer des lieux d’information, de conseil et d’orientation ayant pour objectif de favoriser l’accès des familles à l’information et de simplifier ainsi leurs démarches quotidiennes. Ces Points Info Famille sont chargés d’informer les parents de l’existence de services pouvant les appuyer pour faire face à des difficultés dans l’éducation de leurs enfants. Après une période d’expérimentation menée au premier semestre 2004 avec quinze sites pilotes, le dispositif a été généralisé sur l’ensemble du territoire. L’appel à projet lancé en septembre 2004 a abouti à la labellisation de 234 Points Info Famille. La campagne de labellisation a été poursuivie sur l’année 2005. Environ 270 projets ont été recensés sur l’ensemble du territoire national. Dans de nombreuses communes la maison des parents regroupe ainsi un Point Info Famille et un lieu d’accueil labellisé REAAP.
Certaines associations familiales ont eu un rôle précurseur pour aider les parents à assumer leur fonction parentale et continuent de mener des actions spécifiques, tout en étant partie prenante des REAAP. On peut ainsi citer l’action de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs (FNEPE) qui fédère les 40 écoles des parents et des éducateurs (EPE). Cette fédération offre toute une palette de services aux familles : des services d’information téléphonique dont le service national « Fil Santé Jeunes », des consultations de guidance parentale, de conseil conjugal et de médiation familiale. Elle offre aussi des conseils pour des publics particuliers : accueil des parents adoptants, aide aux parents d’enfants placés, aux familles dont un des parents est incarcéré, etc.
Jusqu’en 2005, les services offerts aux parents dans le cadre de l’aide à la fonction parentale reposaient sur une démarche volontaire des parents qui, conscients de la nécessité de se faire aider pour assumer leur fonction d’autorité parentale, entreprenaient une démarche pour chercher un soutien auprès de professionnels. En revanche, rien ne semblait exister pour pallier les carences éducatives avérées de certains parents dont les enfants ont des conduites délinquantes ou de marginalisation sociale.
Plusieurs travailleurs sociaux et magistrats ont ainsi constaté une carence du dispositif d’aide à la fonction parentale. Si la dimension psychologique des difficultés relationnelles entre parents et enfants est assez bien cernée, il ne semble pas exister d’outils adaptés pour expliquer aux parents les aspects juridiques de l’exercice de l’autorité parentale. Cette carence est patente pour les familles immigrées qui sont confrontées à un fort décalage entre leur culture d’origine et la culture française en matière de « normes éducatives ». C’est ainsi que M. Jean-Pierre Rosenczeig, président du tribunal pour enfants de Bobigny, lorsqu’il a été auditionné par la mission d’information sur la famille et les droits des enfants (2) a souligné la nécessité de faire œuvre de pédagogie pour expliquer aux parents quelles sont leurs responsabilités éducatives. Il a donné comme exemple le cas des parents d’origine étrangère qui ont du mal à comprendre que l’interdiction dans le droit français des violences sur les enfants par les ascendants ne signifie pas que tout acte d’autorité d’un parent sur son enfant soit prohibé. Les droits reconnus aux enfants ne doivent pas être perçus, par ces parents, comme une manière de décourager tout acte d’autorité parentale.
C’est pourquoi le dispositif d’aide aux familles en difficulté a évolué récemment pour parvenir à une gradation de mesures adaptées à la gravité de la situation de la famille.
Il est tout d’abord apparu nécessaire de moderniser les mesures les plus coercitives lorsque la carence de l’autorité parentale est patente ou les risques de maltraitance avérés. Le juge des enfants peut décider de mesures de mise sous tutelle des prestations familiales et de mesures dites d'assistance éducative, pouvant déboucher sur un accompagnement en milieu ouvert ou sur un placement du mineur.
Le projet de loi relatif à la protection de l'enfance, adopté en première lecture au Sénat en juin 2006, s'attache précisément à moderniser ces dispositifs : il met en lumière le rôle éducatif et non punitif de la tutelle aux prestations familiales (désormais intitulée, pour plus de clarté, mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial) ; il introduit plus de souplesse dans la prise en charge des mineurs grâce à la reconnaissance de l'accueil de jour, de l'accueil temporaire ou encore du placement à domicile, afin de disposer d’outils adaptés pour retirer temporairement le mineur de son milieu familial tout en poursuivant un accompagnement social des parents pour permettre un retour du mineur dans sa famille dans de bonnes conditions.
Le contrat de responsabilité parentale (CRP) est une mesure intermédiaire – entre l’aide à la parentalité et les mesures de contrainte décidées par le juge – qui repose sur une logique contractuelle. Mis en place par la loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances, il vise à responsabiliser les parents défaillants en leur rappelant leurs obligations éducatives tout en leur proposant un accompagnement, adapté aux difficultés traversées par leur famille et leur enfant, par les travailleurs sociaux du conseil général. Il s'agit notamment de répondre aux comportements qui, sans être délictueux, entraînent leurs auteurs sur la voie de la marginalisation.
La responsabilisation des parents, à la base du CRP, passe aussi par la sanction des parents en cas de non-respect de leurs engagements. Il ne s'agit pas d'une sanction automatique, mais de la possibilité accordée au président du conseil général d'enclencher une procédure plus contraignante, à savoir une mesure de suspension des allocations familiales, une demande de mise sous tutelle de ces mêmes prestations ou, dans les cas les plus graves, l'engagement de poursuites pénales.
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance cherche à poursuivre ce mouvement en favorisant une meilleure coordination des interventions sociales dont peut bénéficier une famille, en reconnaissant au maire un rôle spécifique et en facilitant le décloisonnement des services sociaux.
L’efficacité des dispositifs d’accompagnement social des familles en difficulté est pénalisée par le manque de coordination des travailleurs sociaux qui interviennent auprès d’une même famille.
Même si les départements ont un rôle de chef de file dans la définition des politiques d’action sociale et ont à leur disposition 80 % des travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement social des familles, ils rencontrent des difficultés à imposer leurs orientations stratégiques aux caisses d’allocations familiales, qui définissent leur propre plan d’action sociale ou aux communes, qui par l’intermédiaire de leurs centres communaux d’action sociale, et les dispositifs d’animation de la politique de la ville décident de leurs propres outils d’intervention.
Ce défaut de coordination en matière de pilotage de l'action sociale en faveur des familles en difficulté a des conséquences préoccupantes : il arrive ainsi fréquemment que des travailleurs sociaux relevant d'institutions différentes interviennent auprès d'une même famille sans le savoir ou tout au moins sans communiquer entre eux.
Ce cloisonnement des services sociaux empêche de mener un bon diagnostic sur le degré de gravité de la situation de certaines familles. La mission d’information parlementaire sur la famille et les droits de l’enfant a souligné la nécessité d’améliorer les procédures de détection des situations à risques, notamment pour prévenir des maltraitances d’enfants mais aussi pour prendre en charge suffisamment tôt certains comportements à risques chez les adolescents conduisant souvent à la délinquance.
Ainsi, les actes de privation et de maltraitance constatés à Drancy en août 2004 sont emblématiques de l’impuissance des services sociaux faute de coordonnateur social chargé d’assurer la cohérence des interventions auprès d’une même famille. Rappelons en quelques mots le cas de cette famille : au cours du mois d’août 2004 quatre enfants pieds nus, sales et mal vêtus ont été repérés dans la rue par la gardienne remplaçante de l’immeuble où ils habitaient. Après deux heures de négociation avec les parents, la police nationale est parvenue à entrer dans le domicile de la famille et a découvert un enfant de treize mois qui pesait quatre kilos et qui vivait au milieu de détritus. Cette famille, dont la mère avait plusieurs fois accouché à domicile, était connue des services sociaux et notamment du centre de Protection maternelle et infantile (PMI). Toutefois, aucune visite à domicile n’avait eu lieu et les différents signalements effectués, notamment par les enseignants, n’avaient été recoupés par aucun service social. Ce manque de coordination entre services sociaux a conduit à ce drame qui a touché une famille certes marginalisée, mais qui ne connaissait pas de précarité financière, le père de famille ayant une activité professionnelle régulière.
Comme le constatait M. Jean-Michel Lagarde, député-maire de Drancy, qui a été auditionné par la mission d’information parlementaire, les services sociaux demeurent impuissants face à des personnes qui, comme « les parents et la grand-mère employaient une stratégie constante d’évitement de tous les dispositifs sociaux (…) Le parquet, l’éducation nationale, les services sociaux départementaux et ceux de la municipalité avaient, chacun, des bribes d’informations, mais nul n’était en mesure de reconstituer le puzzle dont ils avaient certains morceaux en mains. Personne n’a imaginé le drame vécu par les enfants. Dix-huit mois plus tard, l’échange d’informations n’a toujours pas eu lieu » (3).
Ce cloisonnement des services sociaux est aussi très mal ressenti par les familles bénéficiaires de ces différents dispositifs. Le morcellement des compétences ne permet pas d’avoir une vision d’ensemble des difficultés rencontrées par une famille et les principaux intéressés doivent, face à chaque intervenant social, réexpliquer leurs problèmes et fournir à nouveau des pièces justificatives avec souvent l’impression d’être renvoyé d’un interlocuteur à l’autre sans que personne n’ait le souci de personnaliser l’accompagnement social demandé pour qu’il réponde réellement aux besoins.
La coopération entre professionnels se heurte aussi aux contraintes imposées par le secret professionnel en matière de partage d'information. Mais, même lorsque les règles relatives au secret professionnel ne s’y opposent pas, le partage d’information s’accorde difficilement avec la culture de ces professions pour lesquelles l’efficacité de l'action repose en grande partie sur la confiance des jeunes et des familles et dont les personnels se sentent, par déontologie professionnelle, tenus à une obligation de discrétion.
Le projet de loi cherche à améliorer cette situation en apportant deux innovations importantes dans le code de l’action sociale et des familles.
Il attribue, tout d’abord, au maire un pouvoir général de coordination de l'action sociale sur le territoire de sa commune. Cette compétence générale se traduit par une obligation, pour le professionnel de l’action sociale qui constate la nécessité d'une intervention pluridisciplinaire lorsqu’une famille est dans une situation particulièrement grave, d'en avertir le maire de la commune de résidence.
Cette information devrait permettre au maire de désigner, lorsque plusieurs professionnels interviennent effectivement auprès d'une même famille, un coordonnateur investi d'un double rôle : assurer la cohérence de la prise en charge et servir de relais d'information entre les différents travailleurs sociaux et le maire.
Le projet de loi autorise, ensuite, un partage d'informations entre les travailleurs sociaux intervenant auprès d'une même famille, la vie privée des personnes concernées étant naturellement protégée par le fait que les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel.
Le texte donne une consécration législative à une pratique déjà courante sur le terrain, consistant à organiser des réunions de synthèse sur des situations individuelles. Il apporte à ces dispositifs informels de coordination une sécurisation juridique indispensable, dans la mesure où, malgré les nombreuses « chartes de confidentialité » adoptées au niveau local, ils restaient manifestement contraires à la lettre des articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel.
Par ailleurs, dès lors que le coordonnateur estimera que certaines de ces informations confidentielles sont nécessaires au maire pour assurer ses missions sociales, éducatives et sanitaires, il sera autorisé à les divulguer au maire sans risque, pour les travailleurs sociaux concernés, de voir leur responsabilité pénale engagée à raison d'un non-respect du secret professionnel.
Le rapporteur partage l’objectif recherché par le gouvernement de coordonner les interventions sociales dont bénéficie une même famille mais il s’interroge sur la répartition des compétences entre le département et la commune pour le pilotage de l’action sociale. La rédaction de l’article 5 du projet de loi a été amendée à juste titre par le Sénat pour tenir compte de la compétence attribuée au conseil général en matière de coordination et de pilotage de la politique d’action sociale. Il convient en effet de rappeler les termes de l’article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que « le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale » et qu'il « coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent. ».
Le rapporteur tient par ailleurs à préciser que l'action sociale en faveur des familles en difficulté a une vocation beaucoup plus large que d'assurer la seule prévention de la délinquance. Ainsi, si le maire est le mieux placé pour veiller à la sécurité au niveau local, il n’est pas certain qu’il en aille de même en matière d'action sociale, car la plupart des moyens d'intervention disponibles en la matière ne relèvent pas de la commune mais du département notamment pour ce qui concerne les moyens humains, puisque 80 % des travailleurs sociaux relèvent du conseil général et 4 % seulement des communes, les autres étant salariés du secteur associatif.
Il est donc tout à fait logique que le Sénat ait fortement remanié le texte du projet de loi pour prévoir que le président du conseil général doit, d’une part, donner son accord sur le choix du travailleur social désigné par le maire comme coordonnateur, lorsque ce dernier est un agent du conseil général, et d’autre part, être informé, au même titre que le maire, des informations confidentielles relatives à une famille en difficulté si la divulgation de ces informations apparaît comme nécessaire à l’accomplissement des compétences d’action sociale du département.
Le rapporteur souligne l’importance de l’article 2 du projet de loi qui permet par convention au département de déléguer tout ou partie des compétences d’action sociale relevant du département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles. Là où les textes actuels imposent des délégations par blocs entiers de compétences, l’article 2 du projet de loi permet une délégation « à la carte ». Grâce à cette nouvelle mesure il sera possible d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement tendant à améliorer la coordination de l'action sociale à destination des familles en difficulté et à impliquer les maires dans cette action sociale, sans bouleverser la répartition des compétences entre les différents niveaux de collectivité. De plus, cet article prévoit que la convention précise les conditions financières de cette délégation et les moyens humains des services départementaux qui seront mis à la disposition de la commune.
Le rapporteur approuve les amendements adoptés par le Sénat visant à mieux encadrer le partage d’informations confidentielles sur une famille en difficulté entre les professionnels de l’action sociale d’une part et le coordonnateur social et les élus (le maire et le président du conseil général) d’autre part.
Il convient toutefois de s’interroger sur l’opportunité de mettre en place une procédure de partage d’informations entre professionnels de l’action sociale qui diffère du dispositif relatif au secret professionnel partagé prévu par l’article 7 du projet de loi réformant la protection de l’enfance. Selon les informations communiquées par M. Jean Jacques Trégoat, directeur général de l’action sociale les deux mécanismes peuvent différer car le présent projet de loi a un objet beaucoup plus large que celui réformant la protection de l’enfance, ce dernier texte devant être analysé comme une loi spéciale pouvant déroger au dispositif de droit commun posé par l’article 5 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Tout en comprenant ce raisonnement, le rapporteur souhaite que le rapprochement des deux mécanismes de partage d'informations aille aussi loin que possible afin d'éviter que les travailleurs sociaux, faute de pouvoir déterminer avec certitude la procédure adéquate, s’abstiennent tout simplement de transmettre les informations en leur possession.
Le rapporteur s’interroge aussi sur l’opportunité de prévoir sous quelle forme se fera le partage d’informations confidentielles. Un texte réglementaire ne devrait-il pas être prévu pour définir les modalités d’échange et de conservation des informations nominatives relatives aux familles en difficulté ? Il conviendrait également de s’interroger sur l’opportunité de prévoir une modalité d’information préalable des familles dont la situation va faire l’objet d’un partage d’informations entre travailleurs sociaux et d’un signalement au maire ou au président du conseil général.
Si le code pénal protège de façon si ferme le secret professionnel, c'est parce qu'il constitue une garantie fondamentale pour le respect de la vie privée. Il vise à rendre possible la relation de confiance entre ces personnes, souvent placées en situation de vulnérabilité (malade face à son médecin, famille en difficulté face à une assistante sociale...), et le professionnel. Il apparaît comme un élément essentiel pour l’efficacité du travail social. L’information préalable de la famille est sans doute indispensable pour distinguer ce dispositif de coordination sociale d’autres mécanismes décidés par l’autorité judiciaire et qui mettent en œuvre des dispositifs d’accompagnement social sous la contrainte, comme dans le cas des actions éducatives en milieu ouvert.
D. DONNER DE NOUVELLES ATTRIBUTIONS AUX MAIRES POUR AIDER LES FAMILLES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES
Comme le projet de loi attribue au maire un rôle de coordonnateur de l'action sociale en faveur des familles en difficulté, il est nécessaire de lui donner les moyens de répondre aux situations qui lui seront signalées par les professionnels.
Ces moyens sont de portée différente : le premier, l’accompagnement parental, est un nouveau dispositif d’action sociale et le second, « le conseil des droits et des devoirs des familles », est un outil d’aide à la décision.
L’accompagnement parental est un outil d'action sociale individuelle : le projet de loi donne ainsi la possibilité au maire de proposer aux familles un accompagnement parental. Dans ce cadre, il pourra coordonner plus efficacement les mesures d'aide à la parentalité correspondant aux besoins des familles, en mobilisant dans un cadre formalisé les mesures de soutien individualisé ou d'aide à domicile nécessaires.
● Le conseil des droits et devoirs
La création de ce dispositif vise également à solenniser les responsabilités éducatives des parents et il constitue, à ce titre, un premier échelon de mobilisation des pouvoirs publics, avant le recours à des mesures plus contraignantes comme le contrat de responsabilité parentale, voire d'autres mesures, éventuellement judiciaires, de protection de l'enfance.
Le conseil des droits et des devoirs, créé par l’article 6 du projet, est une instance consultative auprès du maire : le texte place ainsi auprès du maire un conseil des droits et des devoirs des familles, composé, à la discrétion de celui-ci, de représentants de l'Etat, d'autres collectivités locales et de personnes qualifiées œuvrant dans le domaine social, sanitaire, éducatif ou dans celui de la prévention de la délinquance, et chargé de proposer au maire les mesures les plus appropriées dans les situations individuelles que celui-ci décide de lui soumettre.
II.- RENFORCER LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE À L’ÉCOLE
La violence à l’école est une question débattue depuis de longues années. Mais si le phénomène n’est pas nouveau, le sentiment d’insécurité croît chez les élèves et les parents. Il existe à ce sujet une importante littérature, de nombreuses études sociologiques, pédagogiques, médicales et des rapports administratifs réguliers. Chacun s’accorde à dire que la violence à l’école est un phénomène multiforme, aux origines multiples, aux acteurs et aux victimes très divers, qui ne peut être appréhendé d’une seule manière, qu’elle soit pédagogique, répressive, psychosociologique.
La transgression des normes par l’enfant scolarisé est chose aussi ancienne que l’école elle-même. Le projet de loi ne vise pas à mettre un terme aux transgressions, mais à inscrire dans les missions et les méthodes de l’Education nationale une action visant à contenir la délinquance des plus jeunes : la lutte contre la violence et l’absentéisme scolaire.
Il s’agit de tracer une frontière claire entre la déviance tolérée et acceptée par la société (les jeux de cour d’école dont la violence n’est pas exempte, les rapports de force inégalitaires au sein des élèves, la dureté de la vie en collectivité,…) des violences et comportements intolérables conduisant l’enfant non encadré à des actes de délinquance répréhensibles (injures, vol, vandalisme, racket, violence physique ou psychologique sur des personnes ciblées). La violence ne peut pas être éradiquée mais elle peut être jugulée et canalisée afin de ne pas entraîner l’enfant dans la délinquance.
Dans ce contexte, la prise en compte de l’absentéisme au titre des politiques de lutte contre la violence scolaire fait débat. Comment en effet considérer qu’il y a violence puisque l’élève n’est pas là ? Il faut néanmoins la prendre en compte car il y a une perméabilité de plus en plus grande entre la violence interne et la violence externe aux établissements d’enseignement. L’Education nationale a montré sa capacité à contrôler les violences purement internes aux établissements (cf. par exemple les bizutages). En revanche, le service public doit s’organiser pour affronter la violence de la société faisant irruption dans les établissements. Or l’absentéisme prolongé et non justifié est le premier indice d’un risque de déviance délinquante.
La violence croît à l’école car la société est plus violente, parce que l’enfant est plus en contact avec la violence de la société, parce que l’Education nationale ne s’est pas organisée pour lutter contre cette violence. Comme on le verra ci-après, l’exercice de quantification est difficile mais le sentiment d’insécurité croissante correspond à une réalité et il appartient au politique de le traiter.
Le 22 septembre 2005, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a publié une expertise sur les troubles de conduite de l’enfant et de l’adolescent. L’INSERM souligne la précocité des troubles de conduite : deux tiers des adolescents présentant des troubles de conduite manifestaient les mêmes symptômes pendant leur enfance. Les troubles d’opposition et ceux d’hyperactivité ou de manque d’attention se prolongeraient à l’âge adulte par le développement d’une personnalité antisociale.
Les troubles de conduite se manifestent par des conduites agressives, la destruction de biens sans agression physique, des fraudes et des vols, la violation grave de règlements établis. L’absentéisme, les incivilités et l’échec scolaire sont reliables à ces troubles.
Les symptômes s’expriment aussi bien à l’école qu’en dehors des établissements scolaires. Ils se distinguent des comportements normaux des enfants (agressivité, mensonge, vols d’objets) par leur fréquence et leur prolongation au-delà de la petite enfance.
● Un phénomène difficilement quantifiable
En 2001, le logiciel SIGNA a été mis en place pour recueillir les données sur les actes graves de violence survenus dans les établissements et écoles publiques du second degré et les écoles des circonscriptions du premier degré.
Ce recensement repose sur des déclarations des chefs d’établissements. Il a pour premier objectif de dénombrer les incidents dont la qualification pénale est évidente ou qui ont fait l’objet d’un signalement à la police, à la justice ou aux services sociaux ou qui ont eu un retentissement important dans la communauté scolaire.
Ce recensement repose sur l’application mise par les chefs d’établissements à assurer un suivi de la vie scolaire et à transmettre la totalité des incidents relevés. La circulaire interministérielle n° 2006-125 du 16 août 2006 signale d’ailleurs qu’« un nombre encore trop important d’établissements ne renseigne pas les indicateurs de manière régulière ». Par ailleurs, il n’englobe pas les établissements d’enseignement privés.
Sous ces réserves méthodologiques, les incidents violents recensés dans les établissements du second degré ont été les suivants depuis 2001.
Incidents signalés dans le premier degré
(maternelles et écoles élémentaires publiques)
Établissements ayant déclaré au moins un incident |
Pourcentage dans l’ensemble des établissements |
Nombre d’incidents signalés |
Nombre d’incidents pour mille élèves | |
Année 2001-2002 |
2 491 |
4,7 % |
4 469 |
0,8 |
Année 2002-2003 |
2 284 |
4,3 % |
4 142 |
0,7 |
Année 2003-2004 |
2 464 |
4,6 % |
4 358 |
0,8 |
Année 2004-2005 |
2 350 |
4,6 % |
4 300 |
0,8 |
Sept.2005–Avr.2006 |
1 890 |
3,7 % |
3 320 |
0,5 |
Source : ministère de l’éducation nationale, logiciel SIGNA.
Recensement des actes violents dans les établissements publics du second degré
Taux de réponse |
Établissements ayant répondu et déclaré au moins un incident |
Nombre moyen d’incidents | |||
Sur les établissements ayant répondu |
Sur les établissements ayant déclaré au moins un incident |
Nombre moyen d’incidents pour mille élèves | |||
Sept.-Oct. 2001 |
70 % |
41 % |
3,0 |
5,0 |
3,5 |
Sept.-Oct. 2002 |
70 % |
58 % |
2,7 |
4,7 |
4,6 |
Nov.-Déc. 2002 |
77 % |
64 % |
3,1 |
4,8 |
5,2 |
Janv.-Fév. 2003 |
77 % |
61 % |
2,7 |
4,4 |
4,5 |
Mars-Avr. 2003 |
74 % |
61 % |
2,6 |
4,2 |
4,3 |
Sept.-Oct. 2003 |
73 % |
63 % |
2,7 |
4,3 |
4,6 |
Nov.-Déc. 2003 |
83 % |
65 % |
3,1 |
4,8 |
5,3 |
Janv.-Fév. 2004 |
78 % |
66 % |
3,0 |
4,6 |
5,2 |
Mars-Avr. 2004 |
76 % |
63 % |
2,7 |
4,3 |
4,6 |
Sept.-Oct. 2004 |
68 % |
63 % |
2,8 |
4,4 |
4,8 |
Nov.-Déc. 2004 |
77 % |
66 % |
3,1 |
4,7 |
5,3 |
Janv.-Fév. 2005 |
76 % |
63 % |
2,7 |
4,3 |
4,7 |
Mars-Avr. 2005 |
76 % |
64 % |
2,9 |
4,5 |
5,1 |
Sept.-Oct. 2005 |
74 % |
61 % |
2,6 |
4,2 |
4,5 |
Nov.-Déc. 2005 |
78 % |
65 % |
3,1 |
4,7 |
5,3 |
Janv.-Fév. 2006 |
78 % |
69 % |
3,2 |
4,6 |
5,6 |
Mars-Avr. 2006 |
75 % |
65 % |
2,8 |
4,4 |
5,0 |
Source : ministère de l’éducation nationale, logiciel SIGNA.
Répartition par types d’incidents dans les établissements publics du second degré
Année |
Année |
Année |
Septembre 2005 à avril 2006 | |||||
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% | |
Violences physiques sans arme |
21 003 |
29,1 |
23 754 |
29,2 |
23 094 |
28,9 |
21 189 |
30,03 |
Insultes ou menaces graves |
16 623 |
23,1 |
20 082 |
24,7 |
20 732 |
25,9 |
18 031 |
25,55 |
Vol ou tentative |
7 844 |
10,9 |
8 535 |
10,5 |
8 051 |
10,1 |
6 007 |
8,51 |
Autres faits graves |
3 092 |
4,3 |
4 079 |
5,0 |
4 736 |
5,9 |
4 758 |
6,74 |
Dommages aux locaux |
2 675 |
3,7 |
2 963 |
3,6 |
3 049 |
3,8 |
2 621 |
3,71 |
Jet de pierres ou autres projectiles |
|
|
|
|
|
|
|
|
Intrusion de personnes étrangères à l’établissement |
|
|
|
|
|
|
|
|
Violences physiques avec arme ou arme par destination |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fausse alarme |
1 438 |
2,0 |
1 420 |
1,7 |
1 488 |
1,9 |
1 396 |
1,98 |
Tags |
1 635 |
2,3 |
1 845 |
2,3 |
1 769 |
2,2 |
1 383 |
1,96 |
Racket ou tentative |
1 757 |
2,4 |
1 838 |
2,3 |
1 557 |
1,9 |
1 358 |
1,92 |
Consommation de stupéfiants |
1 654 |
2,3 |
2 135 |
2,6 |
1 698 |
2,1 |
1 187 |
1,68 |
Dommages au matériel autre que le matériel de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dommages aux véhicules |
1 386 |
1,9 |
1 342 |
1,6 |
1 276 |
1,6 |
1 092 |
1,55 |
Violences physiques à caractère sexuel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Injures à caractère raciste |
850 |
1,2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Dommages au matériel de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tentative d’incendie |
567 |
0,8 |
529 |
0,7 |
546 |
0,7 |
662 |
0,94 |
Port d’arme autre qu’arme à feu |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trafic de stupéfiants |
671 |
0,9 |
1,0 |
824 |
614 |
0,8 |
371 |
0,53 |
Tentative de suicide |
409 |
0,6 |
545 |
0,7 |
429 |
0,5 |
362 |
0,51 |
Dommages aux biens personnels autres que véhicules |
|
|
|
|
|
|
|
|
Incendies |
261 |
0,4 |
217 |
0,3 |
192 |
0,2 |
315 |
0,45 |
Bizutage |
235 |
0,3 |
275 |
0,3 |
295 |
0,4 |
288 |
0,41 |
Trafics divers autres que de stupéfiants |
|
|
|
|
|
|
|
|
Port d’arme à feu |
42 |
0,1 |
42 |
0,1 |
40 |
0,1 |
30 |
0,04 |
Suicide |
28 |
0,0 |
29 |
0,0 |
19 |
0,0 |
25 |
0,04 |
TOTAL |
72 057 |
100 |
81 356 |
100 |
79 987 |
100 |
70 564 |
100 |
Source : ministère de l’éducation nationale, logiciel SIGNA.
● Les mesures adoptées depuis quinze ans
Dès le début des années 1990, les gouvernements ont mis en place des dispositifs tendant à réprimer systématiquement les actes d’incivilité et l’absentéisme à l’école. Ces actions s’inscrivent dans le prolongement de l’émergence dans le débat politico-médiatique du problème des banlieues, du « mal-être » des jeunes des cités et du chômage des jeunes ou de l’absence d’avenir pour toute une jeunesse défavorisée par son lieu de résidence ou son origine. Le mouvement des lycéens d’octobre 1990, contrairement à celui de novembre et décembre 1986, présentait des revendications en matière de sécurité à la suite d’événements graves survenus dans des établissements d’enseignement. Depuis cette date, sept ou huit plans contre la violence scolaire ont été élaborés.
Pour la première fois, la circulaire du 27 mai 1992 du ministre de l’éducation nationale a mis en place des groupes opérationnels d’action locale pour la sécurité qui institutionnalisent un partenariat entre l’Education nationale et la police ; 175 établissements sensibles sont répertoriés pour lesquels une circulaire du 16 mars 1993 donne des moyens supplémentaires.
En 1994, un programme de recherche interministériel sur les violences à l’école est présenté. Il débouche sur le rapport d’Eric Debarbieux de 1996 sur la violence en milieu scolaire. L’accent est mis sur la lutte contre les violences scolaires et l’incivilité. La mesure centrale retenue par les gouvernements est l’accroissement de l’encadrement dans les écoles.
Dès mars 1995, le ministère de l’éducation nationale a présenté un plan de lutte contre la violence scolaire renforçant la sécurité des établissements, assurant l’indemnisation des enseignants, renforçant la formation des enseignants et les partenariats extérieurs. En mars 1996, le plan a été complété pour accroître l’encadrement des élèves.
À la suite du décret n° 96-378 du 6 mai 1996, le fait de pénétrer dans un établissement scolaire sans y être habilité ou y avoir été autorisé est de nouveau punissable d’une amende de cinquième classe comme c’était le cas avant 1981. La circulaire du 14 mai 1996 sur la coopération ministérielle pour la prévention de la violence en milieu scolaire a, en outre, rendu obligatoire le signalement de toute absence non justifiée de plus de quatre demi-journées. La circulaire du 25 octobre 1996 sur la prévention de l’absentéisme a considéré les absences prolongées et non justifiées comme une manifestation de comportement déviant pouvant conduire, en cas de situation aggravée, à une marginalisation, à la délinquance ou à la violence.
L’introduction de cette circulaire du 14 mai 1996 débute ainsi :
« Les établissements scolaires sont confrontés à des actes de violence qui tendent à revêtir des formes nouvelles, souvent graves, parfois répétitives, et à toucher des enfants de plus en plus jeunes. La violence en milieu scolaire prend une acuité particulière dans les quartiers difficiles.
« Outre la violence verbale, fréquente et diffuse, et les formes diverses d’incivilité, apparaissent en milieu scolaire des phénomènes préoccupants : il peut s’agir notamment d’agressions physiques, de racket, d’usage et de trafic de drogues. Le renforcement de la coopération de l’ensemble des services de l’Etat permettra d’assurer la sécurité des établissements et de leurs abords, des élèves et des personnels, et de restaurer ainsi le climat de sérénité indispensable au travail et aux apprentissages scolaires. »
Ces constats restent d’actualité. À l’époque, la circulaire a été suivie de la signature de conventions entre les procureurs de la République et les inspecteurs d’académie.
Le 5 novembre 1997, le gouvernement de M. Lionel Jospin a présenté un plan de lutte contre la violence en milieu scolaire – renforcement des postes d’encadrement, apprentissage de la citoyenneté, contrats locaux de sécurité, procédures rapides d’intervention en cas d’incidents, dispositif d’évaluation des violences et classification pénale des actes de violence – et a arrêté des décisions lors du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998 relatif à la délinquance des mineurs. Des « unités à encadrement éducatif renforcé » ont été mises en place.
La circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des partenariats a prolongé la circulaire du 14 mai 1996 avec des moyens supplémentaires : renforcement du rôle éducatif, développement de la médiation, accroissement des partenariats extérieurs. L’éducation est mise au premier plan de l’action de prévention. La prévention de la violence est promue par des mesures de rappel à la loi, notamment via les règlements intérieurs, et par des partenariats extérieurs. La circulaire du 6 novembre 1998 relative à la délinquance des mineurs a entendu agir sur l’environnement des jeunes en responsabilisant les parents, en renforçant le rôle de prévention de l’école, en améliorant l’accès des jeunes à l’emploi, en protégeant les mineurs des effets de certains médias et en s’attaquant aux trafics, notamment de drogue. Elle a demandé qu’une une réponse systématique, rapide et lisible soit apportée à chaque acte de délinquance quel qu’il soit.
Les classes relais de collège, permettant d’accueillir temporairement des élèves en voie de déscolarisation ou de marginalisation, ont été créées par une circulaire du 12 juin 1998. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998 a créé et sanctionné le délit de bizutage.
La poursuite de la montée des violences scolaires a conduit le ministre de l’éducation nationale, le 27 janvier 1999, à étendre son plan du 5 novembre 1997 (augmentation des effectifs d’encadrement, campagne anti-racket, possibilité d’intervention directe de la police, sans demande préalable des autorités scolaires ou académiques, dans les établissements signalés comme étant difficiles, renforcement des sanctions), puis à mettre en place le Comité national de lutte contre la violence à l’école par un arrêté du 19 octobre 2000 et des contrats éducatifs locaux par décision du 22 novembre 2000. Ce comité de trente-six membres, placé auprès du ministre de l’éducation nationale, a pour mission d’identifier et d’analyser les phénomènes de violence à l’école et de proposer des réponses. Une circulaire du 15 mars 2001 a défini les conduites à tenir en cas de violence sexuelle.
Dès 2001, le gouvernement a renforcé l’action de lutte contre les violences scolaires en mettant l’accent sur les établissements difficiles, notamment en Ile-de-France, et en mutualisant l’information entre les services administratifs concernés (circulaire du 13 août 2001). Ces actions se sont accompagnées d’un renforcement des moyens humains (création de cinq cents postes d’adultes relais).
Dès la constitution du gouvernement Raffarin, M. Nicolas Sarkozy, ministre de l’intérieur, a proposé de pénaliser l’absentéisme scolaire. Il a cependant seulement été décidé dans un premier temps d’aggraver les sanctions pour les outrages à personne investie d’une mission de service public (loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice) et pour les actes racistes et antisémites (circulaire du 13 septembre 2004). L’action du gouvernement a également porté sur la prévention des violences par des actions d’information et de prévention ciblées (protocole d’accord interministériel du 4 octobre 2004).
La circulaire du 16 août 2006 sur la prévention et la lutte contre la violence en milieu scolaire a recadré l’ensemble des dispositifs éducatifs et de partenariat. Son caractère interministériel permet d’avoir une approche globale et cohérente du problème. Elle réaffirme la primauté de l’acte pédagogique et du cadre éducatif comme moyen de prévention de la violence à l’école. Cependant, selon ses termes, « l’action éducative ne suffit pas, à elle seule, à prémunir l’école contre tout risque d’irruption de la violence ». Elle fixe donc six objectifs pour l’aide aux victimes, le renforcement de la prévention et la formation des personnels :
– soutenir et accompagner les victimes de la violence, par une protection juridique des personnels, l’information et l’aide aux victimes, le soutien au fonctionnement des établissements ;
– assurer la sécurité des personnes : réalisation d’un diagnostic de sécurité dans les établissements scolaires, sécurisation des établissements et identification de correspondants pour la sécurité de l’école au sein de la police et de la gendarmerie ;
– organiser le recueil de l’information par le traitement des signalements adressés par les chefs d’établissement, l’information des chefs d’établissement sur les suites données aux saisines des procureurs et la collecte des informations de l’enquête SIGNA ;
– responsabiliser les élèves et associer étroitement les parents par le respect des règlements intérieurs et l’obligation d’assiduité, la mise à disposition de locaux hors des heures de classe, la mise en œuvre des procédures disciplinaires et la prise en compte du comportement des élèves ;
– améliorer l’efficacité des partenariats grâce à la définition d’objectifs ciblés précis et mesurables dans le département, la régularité des réunions, le partage d’informations, l’organisation de formations communes et l’établissement de bilans annuels ; chaque établissement scolaire devra établir un plan de prévention de la violence ;
– développer la formation.
Chacun convient que l’assiduité à l’école est une condition fondamentale de réussite d’un parcours scolaire. L’absentéisme scolaire est une réalité aussi ancienne que l’école publique obligatoire (loi du 28 mars 1882). Tous les ministres de l’instruction publique puis de l’éducation nationale ont lutté contre ce phénomène.
Aujourd’hui, la lutte contre l’absentéisme scolaire ne passe plus uniquement par une action des enseignants, des responsables d’établissements scolaires, des inspecteurs et recteurs d’académie mais également par une implication des parents d’élèves et une attention des divers services publics et des travailleurs sociaux chargés de surveiller l’enfance.
Conformément à l’article L. 131-1 du code de l’éducation, « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » Cette instruction peut être dispensée soit dans un établissement scolaire, public ou privé, soit directement dans les familles par les parents ou toute personne de leur choix. Si elle est assurée dans un établissement scolaire, l’enfant est soumis à une obligation d’assiduité.
L’article L. 131-8 du code de l’éducation définit comme suit l’obligation d’assiduité scolaire :
« Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.
« Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
« L’inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
« 1º Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
« 2º Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
« L’inspecteur d’académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Les articles 5, 5-1 et 5-2 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l’obligation scolaire (modifié par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004) organisent ainsi le suivi de l’assiduité :
« Art. 5. - Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.
« Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8 du code de l’éducation.
« En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. »
« Art. 5-1 - Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
« En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. »
« Art. 5-2 - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
« Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
« Le contenu et les modalités des actions d’aide aux parents sont définis par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l’État, de la communauté éducative, des caisses d’allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
« S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant. »
« Art. 5-3 - Pour l’application du premier alinéa de l’article 5-2 aux élèves relevant de l’enseignement agricole, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 5-2 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale. »
La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 sur le contrôle et la promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire a explicité les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. Elle a notamment défini le cadre du soutien à la responsabilité parentale : une convention type entre, d’une part, l’inspecteur d’académie et le directeur des services départementaux de l’éducation nationale et, d’autre part, l’institution sociale ou l’association chargée du soutien (service social, organisme public, fédération ou association de parents d’élèves, association du mouvement familial, collectivité,...). Ce soutien permet de réunir six familles au maximum autour d’un intervenant spécialisé. Le ministère de l’éducation nationale propose la mise en place de deux demi-journées : l’une consacrée à l’explication de la loi, notamment sur le rôle des parents, à la mobilisation des familles pour l’assiduité des enfants, à la valorisation de l’école, à la présentation des dispositifs et actions d’accompagnement des parents organisés localement dans le cadre du soutien à la parentalité (réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents, accompagnement à la scolarité, veille éducative, médiation familiale,...) et à l’accompagnement de chaque famille pour le retour en classe de son enfant, l’autre qui a pour but, un à deux mois après, à réguler et mutualiser ce qui a été entrepris par les parents.
Le décret n° 2004-162 du 19 février 2004 a introduit une section IV relative au manquement à l’obligation d’assiduité scolaire dans le chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie du code pénal. Elle contient l’article suivant :
« Art. R. 624-7 - Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article 5-2 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaires, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe [750 euros].
« Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article.
« La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41. »
Le dispositif de sanction permettant de suspendre le versement des prestations familiales a été jugé inefficace et inéquitable ; la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance l’a donc supprimé. Seul est aujourd’hui applicable le dispositif relatif aux contrats de responsabilité parentale qui a été institué par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006. Il permet de soutenir et responsabiliser les parents d’enfants en difficulté éducative.
Jusqu’en septembre 2003 il n’existait pas de centralisation nationale des informations établies au sein des écoles et établissements d’enseignement sur l’absentéisme scolaire. Pour mesurer l’importance du phénomène, la direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale a mis en place un dispositif de mesure des absences mensuelles des élèves du second degré à compter de la rentrée scolaire de septembre 2003. Les données sont recueillies par l’étude d’un échantillon de mille collèges et lycées publics répartis sur le territoire métropolitain.
L’étude mesure les absences sans justification d’au moins quatre demi-journées par mois. Les derniers résultats de cette enquête sont les suivants.
Proportion moyenne par établissement d’élèves absents
au moins quatre demi-journées par mois sur l’année scolaire 2005-2006
(en %) |
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
Collèges |
1,2 |
1,9 |
2,6 |
2,0 |
3,4 |
2,3 |
4,7 |
2,8 |
Lycées |
1,5 |
2,2 |
3,5 |
2,8 |
5,4 |
4,9 |
19,5 |
10,5 |
Lycées professionnels |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
2,4 |
3,6 |
4,9 |
3,6 |
6,4 |
5,9 |
18,7 |
11,1 |
Source : direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale (enquête annuelle sur l’absentéisme scolaire).
Les taux très élevés des mois de mars et d’avril 2006 s’expliquent par les mouvements de grève contre le contrat première embauche.
Si l’absentéisme de quatre demi-journées ou plus par mois tourne autour de 5 % en moyenne en année normale, l’absentéisme non justifié de plus de dix demi-journées par mois concerne environ 1 % des élèves.
L’absentéisme scolaire touche inégalement les établissements. Des établissements sont peu ou pas du tout concernés par l’absentéisme
Proportion d’établissements ne déclarant aucune absence d’élève
non régularisée sur l’année scolaire 2004-2005
Septembre |
Octobre |
Novembre |
Décembre |
Janvier |
Février |
Mars |
Avril |
33,2 % |
25,7 % |
21,7 % |
24,5 % |
19,1 % |
18,8 % |
16,2 % |
16,4 % |
Source : direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale (enquête annuelle sur l’absentéisme scolaire).
D’autres établissements déclarent un absentéisme massif. Dans la tranche des 10 % d’établissements qui signalent le plus d’absences d’au moins quatre demi-journées non justifiées, la proportion d’élèves absents a atteint, respectivement en janvier et en février 2006, 9,3 % et 5,9 % dans les collèges, 14,3 % et 17,1 % dans les lycées d’enseignement général et 34,5 % et 31,8 % dans les lycées professionnels. Les établissements des zones d’éducation prioritaire sont les plus touchés.
● La connaissance des situations d’absentéisme scolaire
Le contrôle de l’assiduité scolaire est assuré à tous les niveaux administratifs pertinents.
Au niveau de l’établissement, les absences sont repérées. Les absences des élèves sont mentionnées par classe dans un registre d’appel. Tout personnel responsable d’une activité pendant le temps scolaire signale les élèves absents qui sont alors inscrits sur ce registre. La famille doit faire connaître au plus vite le motif de l’absence ; si l'absence est prévisible, l’école ou l’établissement doit être prévenu à l’avance et informé du motif. Pour chaque élève non assidu, un dossier individuel d'absence est ouvert pour la durée de l'année scolaire ; il comprend le relevé des absences, leur durée, leur motif, ainsi que le cas échéant l’ensemble des mesures prises pour rétablir l’assiduité et les résultats obtenus.
Si la famille n’a pas signalé l’absence, l’école ou l’établissement prévient la famille de cette absence le plus rapidement possible en lui demandant de fournir le motif de l’absence. Dans le premier degré, l’enseignant noue un dialogue avec les parents sur ce problème. Dans le second degré, le dialogue s’établit entre le conseiller principal d’éducation et la famille, en liaison avec les professeurs principaux pour ce qui concerne le volet pédagogique et les personnels sociaux et de santé pour ce qui concerne leur domaine.
Dans chaque école ou établissement, les taux d’absence sont suivis classe par classe ; dans le second degré, ce suivi figure au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement qui est présenté au conseil d’administration.
Si les actions entreprises au niveau de l’établissement n’ont pas rétabli l’assiduité de l'élève, le directeur d’école ou le chef d’établissement transmet le dossier individuel d’absence à l’inspecteur d’académie. L’inspecteur d’académie peut faire effectuer une enquête sociale.
Au niveau de l’académie, l’inspecteur d’académie adresse un courrier à la famille pour lui rappeler ses obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elle s’expose. Il la convoque à un entretien au cours duquel des propositions susceptibles de restaurer l’assiduité de l’enfant sont formulées. Ces propositions sont transmises par écrit à la famille. Cette procédure contradictoire est un préalable indispensable à toute saisine ultérieure éventuelle du procureur de la République.
L'inspecteur d’académie peut par ailleurs proposer à la famille de suivre un module de soutien à la responsabilité parentale. Ce module est facultatif et son acceptation ne préjuge pas des poursuites pénales éventuelles.
Si l'assiduité n’est pas rétablie, l’inspecteur d’académie saisit le procureur de la République qui apprécie l’opportunité d’engager une action publique sur le fondement de l’article R. 624-7 (cf. ci-dessus).
Au niveau du département, le préfet est chargé d’installer une commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire. Cette instance partenariale a pour mission de mobiliser l’ensemble des partenaires en faveur de l’assiduité.
La mise en place du module de soutien à la responsabilité parentale (cf. ci-dessus) est confiée par le préfet à une ou plusieurs institutions représentées dans la commission départementale de suivi de l’assiduité scolaire. Une convention relative aux modalités de mise en œuvre du module est signée entre l’inspecteur d’académie et l’opérateur du module.
À l’échelon national, le ministère établit une statistique nationale qui permettra, à partir de la rentrée de l’année scolaire 2007-2008, de mesurer l’absentéisme selon des coupes géographiques et compléter la capacité d’orienter les actions des inspections académiques pour mieux cibler les phénomènes les plus graves.
Le projet de loi complète ce dispositif en assurant l’information du maire qui est l’autorité politique et administrative la plus proche des familles.
III.- PROTÉGER L’ENFANCE CONTRE LES MESSAGES ÉLECTRONIQUES SEXUELS OU VIOLENTS
Les outils et services de communication électronique constituent le nouveau champ d’expansion de la délinquance sexuelle visant les mineurs. Les pratiques délictuelles s’y répandent d’autant plus aisément qu’elles se dissimulent dans la masse gigantesque des informations circulant sur le réseau Internet, que l’on peut passer d’un fournisseur d’accès, d’un site ou d’un forum à un autre pour parvenir à ses fins de manière presque instantanée et sans formalité, que les communications ne s’arrêtent pas aux frontières des États et que l’anonymat des utilisateurs facilite toutes les perversions.
La dématérialisation et l’expansion accélérée de ces moyens de communication ont pris au dépourvu les législateurs des États dont les dispositifs de protection des mineurs reposaient sur le contrôle du texte écrit ou parlé, de l’image imprimée, filmée ou diffusée par voie hertzienne ou câblée et des vidéos fixées sur des supports matériels ainsi que sur le contrôle des éditeurs et distributeurs et des lieux de mise à disposition du public autorisé. Ces modalités sont abolies par les nouveaux moyens de communication : n’importe qui peut être éditeur ; la plupart des prestataires de services et des fournisseurs d’accès peuvent se retrouver en situation de distribution de contenus illégaux ; les lieux d’édition et de consommation sont le plus souvent des domiciles bénéficiant d’une grande protection juridique ; les sites de mise à disposition de documents sont publics et peu protégés contre l’accès de personnes mineures ; les textes et images peuvent être créés, transmis et supprimés du réseau instantanément ; les numéros d’identification des postes des internautes sur le réseau sont attribués par des automates et changent après chaque déconnexion, seul le fournisseur d’accès étant en mesure de fournir une identité physique correspondant à un numéro ; enfin, les échanges d’un internaute à un autre sur le réseau sont couverts par le secret des correspondances privées.
Concrètement, en se limitant aux atteintes à la protection des mineurs, ces moyens de communication rendent possibles une rencontre ou des échanges sur des forums de discussion entre un mineur et des inconnus dissimulant leur identité réelle, conduisent à confronter les mineurs à des contenus illégaux, notamment pédophiles, au hasard des navigations sur le réseau Internet ou à des contenus pornographiques ou violents réservés au public adulte et susceptible de les choquer profondément, peuvent les inciter à communiquer des données personnelles (nom, adresse, téléphone, photographie) à l’insu de leurs parents et permettent enfin de s’affranchir, derrière l’anonymat des écrans et des pseudonymes, du respect de la loi par des incitations à l’acte sexuel ou à des pratiques violentes.
Internet et les services de communication au public en ligne doivent d’autant plus être pris en compte par les pouvoirs publics que leur importance dans la vie sociale et la vie privée des Français a pris une très grande ampleur depuis l’an 2000.
Au 30 juin 2006, la France comptait 11,1 millions d’abonnés à un service d’accès à Internet à haut débit, ce qui représente une croissance de plus de 40 % en douze mois (+ 3,2 millions d’abonnements Internet haut débit). Le nombre d’abonnements à l’Internet bas débit s’élevait à 3,1 millions, en recul de 29 %.
Médiamétrie a évalué à 28 millions le nombre de Français âgés d’au moins onze ans qui se sont connectés sur le réseau Internet sur le seul mois de septembre 2006, soit 53,7 % de la tranche d’âge concernée. Cette population internaute a progressé de 12 % en un an. Environ 19,3 millions d’internautes de onze ans et plus, soit 88,6 % des internautes, se connectent à leur domicile par une liaison à haut débit ; cette catégorie a progressé de 36 % en un an.
Au troisième trimestre 2006, selon l’enquête menée par Médiamétrie et GfK, 13,5 millions de foyers, soit 52,9 % du total des foyers français, étaient équipés d’un micro-ordinateur, ce qui représente une progression de 10 % en un an. Parmi eux, 10,88 millions de foyers ont accès à Internet, soit 42,6 % des foyers français (contre 35,5 % au troisième trimestre 2005).
À la même date, le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile multimédia, qui permet de se connecter à Internet et de recevoir et envoyer des documents sonores et visuels, a atteint 13,5 millions. La croissance dépasse 25 % sur les douze derniers mois (+ 2,7 millions de clients). Sur le seul deuxième trimestre 2006, 74 millions de messages multimédias et 3,6 milliards de SMS ont été émis sur les réseaux de téléphonie mobile français. Le volume total des communications passées sur les réseaux de téléphonie mobile a dépassé 23,5 milliards de minutes sur le seul deuxième trimestre 2006.
L’encadrement strict des éditeurs, distributeurs et prestataires techniques, même au prix d’une limitation de la liberté d’expression, est donc justifié, au même titre que dans la presse écrite, l’édition, l’audiovisuel et le cinéma. L’article 17 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 demande d’ailleurs aux Etats de « [favoriser] l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être » et son article 10 affirme que « l’exercice de ces libertés [d’expression] comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires (…) à la protection de la santé ou de la morale ».
La France s’est dotée d’un arsenal répressif centré sur l’article 227-24 du code pénal qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la fabrication, le transport, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, d’un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine et susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, ou le commerce d’un tel message.
La France a encadré de manière spécifique la presse écrite, l’édition littéraire, l’affichage, le cinéma, la télévision et la radio. L’article 22 de la directive Télévision sans frontière du 3 octobre 1989 dispose que « les États membres prennent les mesures appropriées pour que les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence ne comportent aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment des programmes comprenant des scènes de pornographie ou de violence gratuite. » Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a mis en place un cadre de régulation très strict (interdictions de diffusion, horaires de diffusion en cas d’autorisation, signalétique, interdictions de promotion, information sur la commercialisation et la distribution). Mais Internet est resté hors du champ de ces réglementations des médias.
Si Internet est passé au travers des régulations sectorielles, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a néanmoins défini les responsabilités lorsque sont en cause l’édition, le transport, la fourniture d’accès à Internet et la mise à disposition du public d’un contenu litigieux par un moyen de communication électronique.
Le législateur a retenu le principe de la responsabilité de l’éditeur, c’est-à-dire de l’internaute créant le contenu litigieux et le mettant sur le réseau ; la responsabilité du distributeur (fournisseur d’accès, gestionnaire de site) ne peut être directement mise en cause. Ainsi, les gestionnaires de site ou tout prestataire fournissant une capacité de stockage d’informations en vue de leur mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne « ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible » (article 6 de la loi du 21 juin 2004). Ces personnes ainsi que les fournisseurs d’accès à Internet « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites » (article 6 de la loi du 21 juin 2004). L’article L. 32-3-3 du code des postes et communications électroniques dispose que « toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d’accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission. »
La quantification de la réalisation des risques que font peser les communications électroniques sur les mineurs est difficile à réaliser.
Une étude de l’INSERM et du CSA a évalué l’impact sur les adolescents des messages pornographiques ou consacrés à la sexualité diffusés par la radio et la télévision ; 16 833 élèves de 900 classes différentes de 450 établissements scolaires tirés au sort dans 85 départements ont été interrogés en 2003. Elle montre que l’accès à des programmes pornographiques parmi les adolescents est très répandu, que la pornographie touche avant tout les garçons : 71 % des garçons de 14 à 19 ans ont vu un film pornographique à la télévision, 59 % en vidéo et 52 % sur l’Internet tandis que le taux moyen des filles n’est que de 40 %. Il ressort que la pornographie suscite une relative complaisance chez les garçons alors qu’elle provoque des sentiments de rejet parmi les filles. Cette enquête montre également que le fait pour les adolescents d’être spectateurs de ces programmes est statistiquement associé à d’autres « pratiques à risque », comme être souvent ivre, consommer du cannabis, faire une fugue ou commettre des actes violents.
Source : résumé de l’étude publié sur le site Internet du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Une étude, rendue publique en août 2006, de l’Université du New-Hampshire pour le compte du National center for missing and exploited children sur les atteintes à la jeunesse via les services en ligne a défini et évalué de manière précise les risques supportés par les mineurs navigants sur Internet (enquête sur 1 500 jeunes âgés de 10 à 17 ans représentatifs de la population) :
– Réception de sollicitations sexuelles non demandées : 13 % des mineurs interrogés, contre 19 % lors de la précédente étude réalisée en 2000 ; 4 % des mineurs (contre 3 % en 2000) ont déclaré avoir subi un incident pénible et 4 % (contre 5 % en 2000) un incident à caractère agressif ; 81 % des mineurs ayant reçu des sollicitations sexuelles non demandées sont âgés de 14 ans ou plus ; aucun enfant âgé de 10 ans n’a été sollicité.
– Exposition non voulue à des contenus sexuels : 34 % des mineurs interrogés, contre 25 % lors de la précédente étude réalisée en 2000 ; 9 % des mineurs (contre 6 % en 2000) ont déclaré avoir subi un incident pénible ; un quart de ces 9 % de mineurs sont âgés de 10 à 13 ans ; dans 37 % des incidents d’exposition, le mineur déclare avoir vu des images de personnes ayant des relations sexuelles, dans 13 % des cas des images d’actes sexuels violents, dans 10 % des cas des images de « choses sexuelles impliquant des animaux ou d’autres choses étranges », dans 57 % des cas soit des images de relations sexuelles, soit des images violentes, soit des représentations sexuelles « déviantes ».
– Harcèlements, menaces ou autres conduites déplacées ou choquantes : 9 % des mineurs interrogés, contre 6 % lors de la précédente étude réalisée en 2000 ; 3 % des mineurs (contre 2 % en 2000) ont déclaré avoir subi un incident pénible (68 % de filles et 32 % de garçons) ; 44 % des harceleurs sont des amis (hors Internet) ou des connaissances du mineur ; 58 % des harceleurs sont des mineurs.
L’étude donne les indications suivantes sur les auteurs de sollicitations et approches sexuelles :
– 73 % sont des hommes ; parmi les 16 % de femmes ayant adressé des sollicitations sexuelles agressives, 64 % étaient âgées de moins de 18 ans et 36 % de 18 à 24 ans ;
– 39 % des mineurs sollicités (contre 24 % dans l’étude réalisée en 2000) affirment que le solliciteur était un adulte ; 30 % décrivent le solliciteur comme étant âgé de 18 à 25 ans ;
– 43 % de l’ensemble des sollicitations et 44 % des sollicitations agressives proviennent de mineurs de 18 ans ;
– dans 86 % des cas les mineurs ont rencontré pour la première fois leur solliciteur sur un service en ligne et dans 14 % des cas il s’agit de personnes qu’ils connaissaient auparavant.
L’étude analyse le contexte des sollicitations sexuelles :
– 79 % des sollicitations sont reçues sur l’ordinateur du domicile ;
– 37 % des incidents surviennent dans des chatrooms (contre 65 % dans l’étude de 2000) ; 40 % des sollicitations ont commencé par un message instantané du solliciteur ;
– 41 % des sollicitations sexuelles sont survenues alors que le mineur était avec des amis ou d’autres mineurs qu’ils connaissaient ;
Les sollicitations sexuelles ayant un caractère agressif se traduisent par les comportements suivants :
– 75 % des solliciteurs ont demandé à rencontrer le mineur en personne ;
– 34 % ont appelé le mineur par téléphone ;
– 18 % sont venus au domicile du mineur sollicité ;
– 12 % ont donné de l’argent, des cadeaux ou d’autres articles au mineur sollicité ;
– 9 % ont envoyé un courrier postal ou une télécopie au mineur ;
– 3% ont acheté un titre de transport pour le mineur sollicité ;
– 0,9 % des mineurs sollicités ont été encouragés à s’enfuir de leur domicile.
Il ressort néanmoins de cette étude que les mineurs sont plus prudents qu’il y a six ans lorsqu’ils utilisent des services en ligne : 34 % déclarent échanger des messages ou discuter sur des forums avec des inconnus alors qu’ils étaient 40 % en 2000. Les équipements électroniques de protection, les mesures de signalisation et les campagnes d’information et de prévention portent donc leurs fruits.
Dans ce contexte, l’article 17 du projet de loi propose quatre réformes :
– prévoir l’impression d’une signalétique spécifique de protection de l’enfance sur les supports analogiques et numériques sur lesquels sont enregistrés des documents à caractère violent ou pornographique ;
– redéfinir les règles d’exposition et d’interdiction des documents à caractère pornographique ou violent dans les lieux dont l’accès n’est pas réservé au seul public adulte ;
– définir une nouvelle infraction pénale permettant de sanctionner les propositions sexuelles faites à un mineur de quinze ans au moyen d’un service de communication électronique ;
– autoriser la police judiciaire, sans être pénalement responsable, à participer sous des noms d’emprunt aux échanges électroniques sur Internet, à prendre des contacts et à extraire et conserver des contenus illicites en vue de rassembler les preuves et rechercher et déferrer à la justice les auteurs d’infractions de mise en péril de mineurs.
IV.- CONCILIER LES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LES DROITS DES MALADES HOSPITALISÉS SOUS CONTRAINTE
A. PRENDRE EN COMPTE LES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LE SUIVI DES PERSONNES HOSPITALISÉES D’OFFICE
● La France connaît un fort taux d’hospitalisation sous contrainte
La France connaît une situation paradoxale en matière de santé mentale : elle connaît un taux d’hospitalisation sous contrainte élevé par rapport à la moyenne européenne (112 pour 100 000 habitants conte 48 au Royaume-Uni) et le nombre d’hospitalisation sous contrainte a presque doublé en quinze ans. Ces chiffres pourraient laisser penser que la France poursuit une politique sécuritaire mais en réalité il s’avère que les établissements de soins psychiatriques ont du mal à bien évaluer la dangerosité des patients. Du fait de la réduction des moyens dont a bénéficié la psychiatrie depuis quinze ans, les établissements d’hospitalisation sont en situation de saturation ce qui conduit à réduire le travail de prévention. Confrontés aux pathologies les plus graves dans un contexte de pénurie de moyens, les établissements hospitaliers accueillant des malades mentaux ne peuvent assurer une coordination avec les professionnels médicaux chargés de prendre en charge les patients dans le cadre de soins ambulatoires assurés par les centres médico-psychologiques (CMP). Beaucoup reste encore à faire pour disposer d’une gamme diversifiée de modes de soins alternatifs à l’hospitalisation complète (centres permettant ne hospitalisation de jour, centres d’accueil thérapeutiques à temps partiel, appartements ou accueil familial thérapeutiques…).
Le diagnostic porté par la mission commune de l’IGAS et de l’IGSJ, chargée d’établir des propositions de réforme à la loi du 27 juin 1990 sur les soins en psychiatrie est assez alarmant (4). Il repose sur le constat suivant :
– La psychiatrie a vu ses moyens diminuer ces quinze dernières années. Entre 1989 et 2002, le nombre des personnels non médicaux, en équivalent temps plein, a diminué de 8 %. Celui des personnels médicaux est resté stable. Dans le même temps, le temps d’attente pour une première prise en charge ambulatoire par les secteurs psychiatriques a augmenté de 62 %. Plus que d’autres disciplines médicales, elle connaît une baisse de sa démographie médicale qui devrait même s’accentuer dans les années à venir. En 2000, 9 % des postes de praticiens hospitaliers (PH) à temps plein étaient vacants dans les hôpitaux depuis plus de un an et 14 % des postes de PH à temps partiel (5). Cette situation aurait pour conséquence une diminution des activités de prévention et du travail auprès des associations de malades (les groupes d’entraide mutuelle-GEM) qui peuvent éviter la survenue de certains états de crise obligeant à des mesures de contrainte.
– Le recours à l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) serait détourné de son objectif initial. Conçue pour obliger une personne malade à se soigner, la mesure serait en fait utilisée pour obliger l’hôpital à admettre un patient qu’il aurait sinon refusé du fait de sa suroccupation (6). Entre 1995 et 2000, le taux d’occupation moyen a augmenté de 10 % (7).
Le suivi médical des patients en ambulatoire reste problématique faute de disposer de procédure adéquate pour imposer une obligation de soins en dehors des murs de l’hôpital. Les sorties d’essai servent aujourd’hui à poursuivre une surveillance médicale obligatoire pendant de longues périodes et maintiennent des patients sous un statut de soins sous contrainte alors qu’il s’agit d’une utilisation dévoyée de la procédure d’hospitalisation d’office.
● Il est difficile d’apprécier les facteurs de risque de violence propres aux malades mentaux
Cette importance des soins en milieu hospitalier n’a pas épargné à notre pays de graves actes de violence commis par des malades mentaux, faute d’un suivi satisfaisant après la sortie de l’hôpital ou d’une prise en charge adéquate des troubles psychiques et psychiatriques en prison (à leur sortie de prison, ces personnes peuvent être dangereuses pour elles-mêmes et pour autrui mais aucun suivi médical n’est prévu).
Plusieurs missions d’expertise ont été récemment menées pour améliorer la prise en charge médico-judiciaire des auteurs d’infractions atteints de troubles mentaux ou dont le comportement particulièrement violent laisse à penser qu’ils sont susceptibles de récidiver. Suite au travail de la Commission Santé – Justice présidée par M. Jean-François Burgelin, procureur général honoraire près la Cour de cassation, un premier rapport intitulé « Santé, justice et dangerosité, pour une meilleure prévention de la récidive » a été remis au Premier ministre le 6 juillet 2005 (8).
Si certaines de ces préconisations ont trouvé un aboutissement dans la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, d’autres ont paru devoir faire l’objet d’une réflexion plus avancée avant d’être éventuellement mises en œuvre.
C’est ainsi que le 23 février 2006, le Premier ministre a confié à M. Jean-Paul Garraud une mission auprès du ministre de la justice et du ministre de la santé et des solidarités, portant sur « l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions pénales atteints de troubles mentaux » (9). Dans le cadre de cette mission, il lui était notamment demandé « d’approfondir les suggestions de la commission présidée par M. Jean-François Burgelin qui seraient susceptibles de constituer des outils d’aide à la décision pour les magistrats tout au long de la procédure ».
Il a été demandé à M. Garraud de faire des propositions sur :
– la création d’« équipes ressources » interrégionales, composées de magistrats, de psychiatres et de psychologues chargées d'examiner la dangerosité des personnes en cause ;
– la mise en place d’un « centre de documentation psycho-criminologique » et, plus particulièrement, d’une base de données nationale regroupant les expertises et la mention des hospitalisations d’office après application de l’article 122-1 du code pénal (irresponsabilité pénale) ;
– l’amélioration de la qualité des expertises psychiatriques des mis en cause, notamment à travers la formulation des questions posées.
Dans son rapport, M. Garraud constate que les connaissances scientifiques sur la notion de dangerosité psychiatrique sont assez lacunaires et il souligne, comme M. Burgelin l’avait déjà fait dans son rapport, qu’il faut bien distinguer les notions de dangerosité psychiatrique et de dangerosité criminologique : « Il importe [en effet] de ne pas confondre (…) les troubles mentaux liés à une pathologie mentale avérée et les troubles de la personnalité et du comportement [qui] ne sont pas tous du ressort de la psychiatrie. »
Le rapport de M. Jean François Burgelin définit la dangerosité psychiatrique comme « un risque de passage à l’acte principalement lié à un trouble mental et notamment au mécanisme et à la thématique de l'activité délirante ».
Dans les pays industrialisés le taux d’homicides est compris entre 1 et 5 pour 100 000 habitants. Les troubles mentaux graves seraient responsables de 0,16 cas d’homicides pour 100 000 habitants.
D’après une synthèse des travaux publiés entre 1990 et 2006 (10), on peut retenir que les personnes présentant un trouble mental et notamment une psychose schizophrénique ou un trouble bipolaire présentent quatre fois plus de risques de commettre un acte violent que la population générale. Dans une étude très récente portant sur 1 410 personnes schizophrènes chez lesquelles la violence majeure ou mineure avait été étudiée dans les six mois précédents, on a noté 3,6 % de violences graves. Les auteurs insistent sur le fait que la violence est multifactorielle, associant la maladie mentale et son incidence comportementale, aux facteurs d’environnement social négatifs.
Au sein de la population de personnes présentant des troubles mentaux, quatre facteurs spécifiques de risque de violence paraissent se dégager : les signes psychotiques spécifiques, la présence d’une atteinte cérébrale, l’association d’une personnalité psychopathique, l’abus d’alcool ou de drogues.
Pour conclure, le risque de violences des malades mentaux tient autant à la pathologie psychiatrique qu’à des facteurs situationnels tels que la désinstitutionalisation psychiatrique, la rupture de soins, la précarisation et la marginalisation. La prise d’alcool et la consommation de drogues sont des facteurs centraux de la dangerosité associée à la maladie mentale.
Selon les auteurs de cet article, les risques de violence des malades mentaux tiennent autant à la pathologie psychiatrique qu’à des facteurs situationnels tels que la désinstitutionalisation psychiatrique, la rupture de soins, la précarisation et la marginalisation. La prise d’alcool et la consommation de drogues sont des facteurs centraux de la dangerosité associée à la maladie mentale.
Cette majoration du risque de violence des malades mentaux a bien à voir avec les moyens donnés dans chaque pays à la psychiatrie publique, aux équipes soignantes ainsi qu’à la qualité de l’organisation des soins. La désinstitutionalisation psychiatrique, la diminution du nombre de lits, la fermeture de lits de crise va dans le sens d’une majoration du risque de violence et confirme le vieil adage selon lequel moins on psychiatrise, plus on criminalise. Il apparaît que le rapprochement du suivi psychiatrique, en particulier dans les vingt semaines suivant la sortie de l’hôpital limite ce risque : le nombre d’événements violents est inversement proportionnel à l’intensité du suivi psychiatrique ; le groupe des patients suivis toutes les semaines présente quatre fois moins de risque de violence que le groupe suivi mensuellement.
Quant à la dangerosité criminologique, elle peut faire l’objet de plusieurs définitions. Toutes sont néanmoins fondées sur des critères identiques : l’absence de pathologie psychiatrique et l’existence d’un risque de récidive ou de réitération d’une nouvelle infraction empreinte d’une certaine gravité. La commission présidée par M. Burgelin avait défini la dangerosité criminologique comme « un phénomène psychosocial caractérisé par les indices révélateurs de la grande probabilité de commettre une infraction contre les personnes ou les biens ».
M. Jean Paul Garraud, après avoir mené un long travail de consultation des professionnels de la psychiatrie et de la criminologie, souligne que « Les notions de dangerosité psychiatrique et de dangerosité criminologique sont donc éminemment protéiformes et complexes ». Il reconnaît que les outils scientifiques actuels ne sont pas suffisants pour permettre aux juridictions et aux experts judiciaires d’évaluer efficacement la dangerosité des auteurs et des délits les plus graves. C’est pourquoi, il souligne qu’« il apparaît inévitable de préconiser que la recherche scientifique soit développée sur ce point afin que puissent être définis des critères objectifs de dangerosité en distinguant la dangerosité criminologique de la dangerosité psychiatrique ».
B. METTRE EN PLACE UNE RÉFORME PRAGMATIQUE ET RESPECTUEUSE DES DROITS DES PATIENTS HOSPITALISÉS D’OFFICE
La société ne pouvant rester impuissante devant la multiplication de crimes ou de délits très graves commis par des personnes souffrant ou ayant souffert de troubles mentaux, le projet de loi cherche à trouver des réponses pragmatiques à des problèmes très complexes car il s’agit de trouver un équilibre délicat entre la prise en charge sanitaire des malades mentaux dans le respect de leur dignité et la prise en compte des exigences de la sécurité publique qui peut conduire à des décisions attentatoires à la liberté individuelle du patient.
Dans cette recherche d’équilibre il convient de garder à l’esprit le principe posé par la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation : lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement « les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en ouvre de son traitement. » (art. L. 3211-3 du code de la santé publique).
Cependant, le bilan de l’application de la loi de 1990 montre que sa mise en œuvre ne prend pas assez en compte les enjeux d’ordre public. Elle tire ses fondements de la loi du 30 juin et du 6 juillet 1838 sur les aliénés, qui crée deux catégories de placements : le placement d'office, décidé par le préfet pour les individus dont les troubles affectent l'ordre public ou la sûreté des personnes, et le placement volontaire, décidé par le directeur de l'établissement à la demande d'un tiers pour les malades nécessitant un internement thérapeutique. Les malades mentaux étaient donc, dès cette date, pris en charge en fonction de la dangerosité de leur comportement.
Les premières modifications ne sont intervenues qu'avec la loi du 27 juin 1990 relative à l'hospitalisation sans consentement, qui a introduit la possibilité pour un malade d'être placé à sa demande. En conséquence, le placement volontaire, rebaptisé « hospitalisation à la demande d'un tiers », est réservé aux personnes dans l'impossibilité de donner leur consentement. Par ailleurs, le préfet est autorisé à hospitaliser d'office les personnes que l'autorité judiciaire a renoncé à poursuivre ou à condamner en raison de leur état mental et qui nécessitent des soins. Ce texte fait suite aux recommandations adoptées, le 22 février 1983, par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en matière de sécurité juridique des personnes atteintes de troubles mentaux.
Enfin, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a précisé les conditions de l'hospitalisation d'office : le critère thérapeutique de l'internement est affirmé et l'état du patient doit gravement porter atteinte à l'ordre public.
Aux termes de la législation actuellement en vigueur, l'hospitalisation d'office constitue donc une mesure de police administrative spéciale dévolue au préfet et, en cas d'urgence, au maire. Ce pouvoir est toutefois largement encadré : ainsi, la décision d'hospitalisation est conditionnée à la production d'un certificat médical. De fait, les progrès de la psychiatrie ont progressivement imposé un impératif de soins, parfois au détriment du critère de sécurité publique.
Pour tenter de mieux connaître les problèmes de sécurité liés à l’hospitalisation d’office, l’Inspection générale de l'administration (IGA), l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et l’Inspection de la gendarmerie nationale (IGN) ont été chargées d'une mission conjointe. Leur rapport dresse un constat inquiétant : dans la majorité des situations observées, les enjeux de sécurité publique ne sont pas suffisamment pris en compte.
La mise en œuvre des régimes d’hospitalisation sous contrainte pose plusieurs problèmes dont la gravité varie toutefois d'un département à l'autre :
– une relative confusion dans l'application des procédures d'urgence, qui conduit des personnes dangereuses à être trop souvent prises en charge sous les régimes de l'hospitalisation libre ou à la demande d'un tiers, moins contraignants que celui de l'hospitalisation d'office sur le plan administratif pour les professionnels de la psychiatrie ;
– une difficulté, pour de nombreux préfets, à accomplir les missions qui leur sont dévolues dans le domaine de l'hospitalisation sans consentement ; cette situation s'expliquant notamment par le contrôle insuffisant exercé par la DDASS, en tant qu'interlocutrice principale des autorités sanitaires et administratives, sur les personnes hospitalisées ; de fait, le préfet ne dispose souvent pas des informations nécessaires à la prise des décisions qui lui reviennent ;
– le prolongement des sorties d'essai dont peuvent bénéficier les personnes placées sous le régime de l'hospitalisation d'office, a tendance à se prolonger au risque de compliquer les conditions du suivi des malades et de favoriser, « faute de dispositif d'alerte efficace », les fugues ; or l'absence constatée du patient aux rendez-vous médicaux peut se conclure non par la mise en oeuvre des recherches nécessaires mais par la levée pure et simple de la décision d'hospitalisation.
Forte de ce constat, la mission confiée aux inspections a proposé une série de modifications de la législation relative à l'hospitalisation sans consentement, dont plusieurs ont été reprises par le présent projet de loi.
Les propositions du rapport de mission commune de l’IGA, de l’IGPN et de IGN
1. Donner plus de cohérence au dispositif des hospitalisations sous contrainte en :
– instaurant des mesures initiales d'hospitalisation par le maire ou le préfet et une phase d'observation et de diagnostic de soixante-douze heures minimum permettant de confirmer ou d'infirmer la décision prise ;
– instituant une obligation de soins, qui remplacerait l'actuelle hospitalisation à la demande d'un tiers, distincte de l'hospitalisation d'office. Aucune superposition ne serait par ailleurs possible entre les deux régimes, les personnes dangereuses ne pouvant être prises en charge que sous contrainte, même si le passage de l'un à l'autre demeure envisageable ;
– supprimant les incohérences du régime d'hospitalisation des personnes dangereuses à l'encontre desquelles les poursuites pénales ont été abandonnées ;
– aménageant les régimes d'hospitalisation des détenus atteints de troubles mentaux afin de mieux protéger l'ordre public.
2. Faciliter le travail des acteurs de terrain en :
– renforçant le rôle du maire, qui serait désormais chargé, en premier chef, des décisions initiales d'hospitalisation d'office ;
– instituant une procédure d'alerte par les psychiatres de secteur ;
– permettant l'accès au domicile du malade pour faciliter la mise en œuvre des mesures initiales d'hospitalisation d'office ;
– clarifiant les responsabilités en matière de transport des malades : les équipes sanitaires, et non plus les forces de l'ordre, en seraient ainsi chargées ;
– mettant un terme à l'extraterritorialité des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget pour en restituer la responsabilité au département de Seine-Saint-Denis en matière d'hospitalisation d'office.
3. Renforcer la prise en compte des impératifs de sécurité publique aux stades de l'instruction et de la décision administratives en :
– confiant la compétence en matière d'hospitalisation d'office au directeur de cabinet du préfet ;
– enrichissant les informations contenues dans les dossiers présentés à l'autorité préfectorale pour signature ;
– reconnaissant au préfet le pouvoir de demander des contre-expertises médicales des personnes hospitalisées ;
– créant un fichier national des hospitalisations d'office pour mieux exploiter les informations disponibles, notamment dans le domaine de la législation sur les armes.
4. Améliorer les modalités d'hospitalisation dans la perspective d'une meilleure prise en compte des impératifs de sécurité publique en :
– réorganisant le régime des sorties d'essai ;
– appliquant plus rigoureusement les règles relatives aux autorisations de sortie de courte durée des personnes hospitalisées d'office ;
– définissant la notion de fugueur et en prévoyant les moyens de réaction appropriés ;
– précisant les limites géographiques des établissements afin de n'autoriser leur franchissement qu'aux titulaires d'autorisation.
Le projet de loi s’est inspiré directement de ces recommandations relatives à l’hospitalisation d’office. S’il contient des dispositions relatives aux malades mentaux hospitalisés sous contrainte, c’est uniquement pour répondre à des impératifs de sécurité publique. Il était urgent de prendre des mesures pour mieux encadrer les hospitalisations d’office et les sorties d’essai. Le rapporteur tient à souligner que les dispositions des articles 18 à 24 de ce texte, loin d’être attentatoires aux droits des patients, apportent de nouvelles garanties pour les patients : l’hospitalisation d’office décidée en urgence ne pourra plus être justifiée sous prétexte que « la notoriété publique » atteste de la dangerosité d’une personne, un avis médical étant toujours nécessaire pour éclairer la prise de décision de l’autorité administrative.
Le projet de loi attribue, tout d’abord, un rôle majeur au maire dans le déclenchement de la procédure d’hospitalisation d’office. La proposition majeure du projet (article 20), dans son volet relatif à l'hospitalisation sans consentement, vise à faire du maire, ou du commissaire de police à Paris (ce qui est nouveau), l'autorité responsable de la décision initiale d'internement, sur le fondement d'un avis ou d'un certificat médical d'un psychiatre. Il convient de rappeler qu’actuellement le rôle du maire est limité aux cas d'urgence.
Sa décision doit toutefois être confirmée dans les soixante-douze heures par le préfet, qui est informé de l'hospitalisation dans les vingt-quatre heures, après expertise médicale. Il peut également décider lui-même de l'internement en cas de nécessité. De fait, le préfet, dès lors qu'il a confirmé la décision du maire, demeure l'autorité responsable du suivi des hospitalisations d'office.
Le projet de loi clarifie, également, les critères justifiant une hospitalisation d’office et ceux de l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
À cet effet, il exclut de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers les individus dont les troubles portent atteinte à la sécurité des personnes ou à l'ordre public : seule une mesure d'hospitalisation d'office leur sera désormais applicable. L'internement à la demande d'un tiers sera donc limité aux personnes ne pouvant pas donner leur consentement et à celles dont l'état impose une prise en charge immédiate en milieu hospitalier. Il s'agit d'éviter que des individus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres soient hospitalisés sous un régime trop souple, notamment pour ce qui concerne les modalités de sortie de l'établissement.
Les modalités de contrôle et de suivi des personnes hospitalisées sont renforcées par :
– un encadrement plus strict des sorties d’essai : désormais, le document relatif à la décision de sortie d'essai, dont bénéficient les patients en vue de préparer leur réinsertion sociale, devra préciser l'identité du malade, ses coordonnées, le calendrier des visites médicales qui a été fixé et la date de son retour en établissement (article 18) ; il sera ainsi plus facile de suivre le patient au long de sa sortie, notamment dans le cas où il ne se présenterait pas aux consultations médicales obligatoires, ce d'autant que le maire de la commune où est implanté l'établissement psychiatrique et celui de la commune de résidence du malade seront informés systématiquement de chaque décision de sortie ;
– la création d’un fichier national rassemblant, pendant six ans à compter de la date de l'hospitalisation, les informations administratives relatives aux personnes internées d'office : l'objectif recherché est double, d’une part améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office et, d’autre part, renforcer le contrôle de la détention d'armes, le fichier étant notamment destiné à être consulté par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de détention ou d'acquisition de ce type de produits (article 19) ;
– la possibilité pour le préfet d’ordonner une expertise médicale des personnes hospitalisées sous contrainte (article 23).
Le suivi médical du patient est, par ailleurs, largement renforcé par les articles 22 et 23. Ainsi, dès les premiers jours de l'hospitalisation, il bénéficiera, en plus de l'examen médical pratiqué vingt-quatre heures après son hospitalisation, d'un second rendez-vous soixante-douze heures après l’hospitalisation. Les certificats médicaux correspondants seront transmis au préfet, chargé de la confirmation de la décision d'hospitalisation, et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. L'information de l'autorité préfectorale sur l'état de santé des individus internés sera également améliorée dans la mesure où le préfet pourra demander, à tout moment et en plus des examens prévus chaque mois, une expertise psychiatrique destinée à aider le préfet dans sa mission de suivi des dossiers.
La mise en place d’une période de diagnostic s’étendant sur 72 heures, lors de l’hospitalisation, permettra au patient de bénéficier d’un diagnostic médical beaucoup plus étayé. Cette période d’observation ne doit pas être analysée comme une période de non-droit mais au contraire comme une période permettant, une fois la période de crise surmontée, d’instaurer avec le patient une relation de confiance favorable à la recherche d’un consentement aux soins. Cette période de prise en charge intensive du patient permettra dans tous les cas, même si le soin sous contrainte demeure, d’orienter le patient vers une prise en charge thérapeutique mieux adaptée à sa situation médicale personnelle alors qu’une décision prise dans l’urgence risque de confondre les symptômes de la crise avec la pathologie réelle du patient.
Malgré ces avancées, le rapporteur comprend l’émotion suscitée chez les professionnels de la santé mentale et chez les patients par l’insertion dans un texte de sécurité publique d’articles relatifs à l’hospitalisation sous contrainte. Le gouvernement n’a jamais eu l’intention d’assimiler les personnes placées sous le régime de l’hospitalisation d’office à des délinquants : ce sont avant tout des malades qui ont besoin d’une prise en charge sanitaire.
Le rapporteur estime très urgent de parvenir à une réforme globale des soins psychiatriques dans le cadre de la révision de la loi du 27 juin 1990. Il s’est d’ailleurs efforcé d’obtenir des engagements du gouvernement pour que l’ensemble de ces questions – aussi bien celles liées à l’ordre public figurant dans ce texte que celles portant sur les aspects sanitaires des soins de santé mentale – puissent être réglées avant la fin de cette législature. La loi de 1990 aurait dû être évaluée au bout de cinq ans et tous les rapports d’expertise qui se sont succédé depuis le premier rapport d’évaluation présenté par Mme Hélène Strohl en 1997 jusqu’à celui de la mission commune IGAS-IGSJ de mai 2005 ont conclu à la nécessité de la réviser en profondeur.
Certains thèmes de réforme font consensus chez les professionnels de la psychiatrie. Suite à la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui exige que le tiers puisse justifier de relations personnelles antérieures à la crise qui a justifié la demande d’hospitalisation, il convient de réformer la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers. Le dernier rapport commun IGAS/IGSJ préconise le maintien du dualisme entre hospitalisation d’office (HO) et hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) car l’unification des procédures conduirait à placer la procédure unique sous l’égide du préfet, ce qui conduirait à exclure l’environnement familial ou le tiers de la procédure.
Pour préserver l’intervention du tiers, qui est souvent le meilleur garant que l’hospitalisation sous contrainte se déroule dans le respect des droits et libertés du patient, le rapport propose d’améliorer cette procédure en trouvant un moyen pour pallier l’absence de tiers correspondant aux exigences posées par la jurisprudence du Conseil d’État. Par ailleurs, le tiers, lorsqu’il s’agit d’un membre de la famille, peut avoir des réticences à prendre la responsabilité de faire interner un proche.
Pour parer aux réticences de l’entourage familial de demander une hospitalisation sous contrainte, la mission commune IGAS/ IGSJ fait la proposition suivante. Le directeur de l’établissement, au vu d’un certificat médical, déciderait de l’hospitalisation du patient à titre conservatoire sous réserve qu’il saisisse le procureur de la République d’une demande de désignation d’un curateur pour la personne hospitalisée après avoir démontré que l’environnement familial ou amical n’existait pas ou refusait de demander une HDT. Désigné en urgence, le curateur pourrait alors défendre les intérêts du malade hospitalisé et, si besoin est, demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation (saisine du juge des libertés et de la détention). Le curateur pourrait être une personne physique ou une personne morale et les modalités de sa désignation pourraient s’inspirer des articles du code civil relatifs aux gérants de tutelle et curateurs (personnes physiques et associations tutélaires agréées par le parquet).
La désignation d’un curateur par la justice serait respectueuse des droits du malade et l’intervention d’un tiers « neutre » par rapport à l’environnement familial pourrait aussi faciliter les relations entre la famille du malade et les soignants.
La réforme de la loi de 1990 devrait aussi comporter un volet renforçant les droits des malades. Il serait souhaitable de garantir à la personne hospitalisée sous contrainte qu’elle sera entendue par l’autorité qui décide de son internement. Actuellement, dans le cas d’une HDT le directeur de l’établissement n’a pas l’obligation de recevoir la personne en cause : il serait possible de rendre obligatoire un entretien préalable avec l’autorité qui décidera de cette hospitalisation. Pour la procédure d’hospitalisation d’office, la décision d’internement est formalisée par un arrêté motivé du préfet mais les modalités de la notification à l’intéressé sont très disparates.
Il serait aussi possible de renforcer les obligations du juge des libertés et de la détention lorsqu’il est saisi en référé pour une contestation de la décision d’hospitalisation sous contrainte. Il serait possible de prévoir un délai maximum pour le prononcé de la décision du magistrat et pour l’expertise que le juge peut ordonner (saisine du juge art. L.3211-12 du code de la santé publique).
Un autre thème important concerne le renforcement des prérogatives de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CHDP) pour leur permettre de mieux surveiller la justification thérapeutique des hospitalisations sous contrainte et de procéder régulièrement à des visites inopinées d’établissements hospitaliers accueillant des malades mentaux.
La réforme de la loi de 1990 devrait aussi prévoir la création d’une obligation de soins qui ne se traduira pas forcément par une hospitalisation.
Dans la loi de 1990 il n’existe pas de possibilité de contraindre un malade à être suivi médicalement en dehors de l’hospitalisation sous contrainte. Pour atteindre cet objectif de suivi, la seule procédure existant actuellement est celle de la sortie d’essai : le malade sait que s’il ne respecte pas le protocole de soins il peut être réhospitalisé.
Dissocier l’obligation de soins de la modalité de la prise en charge thérapeutique permettrait de clarifier les rôles entre le tiers (le plus souvent la famille), le médecin et le patient. En effet, les familles seraient ainsi moins réticentes à intervenir car en demandant qu’une décision d’obligation de soins soit prise elles ne porteraient pas la responsabilité de l’internement de leur proche. Il reviendrait au corps médical de définir les modalités les plus adaptées de la prise en charge selon la gravité de la pathologie. L’obligation de soins ne se traduirait plus automatiquement par une hospitalisation.
Si une obligation de soins était créée, il faudrait en contrepartie limiter la durée des sorties d’essai qui peuvent aujourd’hui être prolongées sur plusieurs années pour justement permettre un suivi médical obligatoire des patients.
V.- RÉACTIVER L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE ET L’OBLIGATION DE SOINS VISANT LES TOXICOMANES
Depuis 1970, la lutte contre la consommation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants s’organise autour de dispositions répressives et de mesures sanitaires.
Le code pénal et le code de procédure pénale organisent la répression du trafic, de l’importation, de l’exportation, du transport, de la détention et de l’offre de drogues illicites.
La répression touchant l’usage illicite de stupéfiants est traitée par le code de la santé publique. Les infractions et leurs sanctions sont les suivantes : la répression de l’usage illicite est punie d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende et entraîne la confiscation des substances et plantes illicites par (article L. 3421-1) ; la répression au titre de la provocation au délit d’usage ou de trafic est passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article L. 3421-4) ; l’usage, le commerce et la détention de drogues illicites dans des lieux ouverts au public peuvent entraîner la fermeture administrative des lieux où ces pratiques sont constatées (article L. 3422-1).
Les mesures sanitaires, qui figurent dans le code de la santé publique, tendent, elles, à accompagner le consommateur ou usager interpellé par la police, la gendarmerie ou la douane et à mettre fin à l’usage illicite de drogues. Parmi ces mesures sanitaires figure l’injonction thérapeutique qui consiste, aux termes des articles L. 3413-1 à L. 3413-3, L. 3423-1 et L. 3424-1 à L. 3424-5 du code de la santé publique, en une obligation de suivi d’une cure de désintoxication ou un placement en surveillance médicale avec le cas échéant application de mesures de réadaptation. Le terme d’injonction thérapeutique ne figure pas dans la loi (celle-ci ne parle que d’injonction du procureur de la République pour les mesures de désintoxication ou de suivi médical se substituant à l’engagement de l’action publique) ; ce terme est apparu dans la circulaire interprétative du 20 novembre 1984. À proprement parler, l’injonction thérapeutique ne s’applique qu’aux mesures décidées par le procureur de la République en substitution à l’engagement de l’action publique à l’encontre de la personne interpellée pour usage illicite de drogue. Les mesures de traitement sanitaire prononcées par les autorités judiciaires d’instruction (dans le cadre d’un contrôle judiciaire) et les formations de jugement sont qualifiées d’obligations de soins. Le projet de loi fusionne les deux expressions, qui ne figurent pour aucune d’entre elles dans la loi (code de la santé publique), sous les termes d’injonction thérapeutique.
L’injonction thérapeutique a été mise en place par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses qui, parallèlement a prohibé et sanctionné pénalement l’usage illicite de drogues. Son objectif est de substituer aux poursuites pénales diligentées à l’encontre des usagers de drogue interpellés par la police une prise en charge à la fois sociale et sanitaire tendant à apporter à ces derniers une aide pour sortir de la consommation illicite de stupéfiants. L’injonction thérapeutique permet donc aux personnes interpellées pour consommation de stupéfiants d’accéder à un traitement sanitaire.
Les mesures d’injonction thérapeutique fixées par la loi du 31 décembre 1970 ont fait l’objet de nombreuses circulaires interprétatives :
– circulaire du 28 septembre 1971 répartissant les rôles des parquets et des directions départementales de l’action sanitaire et sociale ;
– circulaire du 30 mars 1973 prévoyant des visites régulières chez le médecin ;
– circulaire du 17 mai 1978 précisant le type d’usager de drogue illicite susceptible de bénéficier de l’injonction thérapeutique (il est précisé qu’elle est inadaptée aux consommateurs de haschisch) ;
– circulaire du 20 novembre 1984 ajoutant un volet social au traitement sanitaire ;
– circulaire du 12 mai 1987 qui abroge toutes les circulaires précédentes et tend à relancer l’injonction thérapeutique et les mesures d’obligation de soins en définissant le public cible (« l’usager d’habitude présentant des signes d’intoxication ou reconnaissant se livrer régulièrement à la consommation de stupéfiants »), en assimilant les usagers de drogues dures et de drogues douces du fait qu’elle ne retient désormais que des critères de volume de consommation et de degré de dépendance, en recommandant le traitement de la procédure d’injonction thérapeutique par un magistrat spécialisé du parquet et en assignant à la direction départementale d’action sanitaire et sociale une mission d’orientation et d’information du parquet ;
– circulaire du 23 mars 1992 sur l’action sanitaire et sociale ;
– circulaire du 14 janvier 1993 excluant du bénéfice de l’injonction thérapeutique les usagers ayant commis un délit de droit commun connexe ;
– circulaire du 15 février 1993 sur l’action sanitaire et sociale ;
– circulaire du 28 avril 1995 ouvrant la possibilité d’une injonction thérapeutique même en cas de délit de droit commun connexe ;
– circulaire du 13 septembre 1999 mettant en œuvre le plan triennal 1999-2001 de lutte contre la drogue et de prévention des dépendances, qui est accompagnée d’une circulaire du 17 juin 1999 relative aux réponses judiciaires aux toxicomanes. Ce plan triennal a été dynamisé par le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool pour 2004-2008.
À l’origine, l’injonction thérapeutique était conçue comme une alternative à la répression. Cependant, en dépit des circulaires interprétatives, l’imprécision de ses fonctions, de son contenu et de ses effets sur les patients a fait mettre en doute son utilité dès les années 1970. Il a fallu attendre le travail d’expertise de M. Michel Setbon (11) pour disposer d’une évaluation complète du dispositif. Cette étude approfondie conclut que l’injonction thérapeutique « est et restera, dans le cadre actuel, sans effet sur le problème de l’usage de drogue, car son taux d’effectivité est trop faible. L’hétérogénéité de l’injonction thérapeutique (…) n’est pas due au hasard, ce qui ajoute à l’absence d’impact une injustice de distribution. De plus, tout porte à penser que les rares usagers de drogue qui ont bénéficié d’une injonction thérapeutique n’ont qu’une faible probabilité de recevoir une prise en charge correspondant à leur état ».
L’étude propose de restaurer la fonction sanitaire de l’injonction thérapeutique. Les objectifs sanitaires et sociaux de traitement de l’usager de drogue devraient être inscrits dans l’injonction thérapeutique dès le lancement du processus judiciaire. À cette fin, il faut « renoncer à l’hégémonie de la fonction judiciaire de l’injonction thérapeutique qui rend accessoire les objectifs sanitaires ». L’acteur sanitaire devrait donc être intégré dans le processus de décision. La notification de l’injonction thérapeutique présenterait alors un véritable caractère mixte, judiciaire et sanitaire.
L’étude recommande également de diversifier les objectifs sanitaires de l’injonction thérapeutique. La nature du produit ou la gravité de l’usage ne peuvent plus être les seuls critères d’appréciation. L’injonction thérapeutique doit s’adapter aux nouveaux modes de consommation et de prise en charge. Ainsi, des objectifs de réduction de consommation de drogues douces ou de prévention de passage à des drogues plus dures peuvent être pertinents. L’injonction thérapeutique doit donc pouvoir, selon le cas, prévenir la dépendance, limiter la dépendance, substituer une dépendance, etc. Seul un diagnostic socio-sanitaire croisé avec un diagnostic judiciaire est en mesure de définir les objectifs adaptés de l’injonction thérapeutique. D’un point de vue sanitaire, il serait également utile de prendre en compte le risque d’infection virale associée à l’usage de drogue.
Cette réorientation suppose un effort de transparence des deux systèmes judiciaire et sanitaire et une meilleure circulation de l’information entre les acteurs judiciaires et sanitaires et sociaux. L’étude propose que cette transparence soit rendue effective par une présence de l’acteur sanitaire dans l’enceinte judiciaire.
En dernier lieu, comme l’indique M. Michel Setbon, « sans évaluation, le dispositif est aveugle ». Il convient donc de mettre en place un système d’information fiable, simple et permanent sur les paramètres de prise en charge des usagers de drogue illicite par l’injonction thérapeutique.
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool pour 2004-2008 reconnaît la difficulté de la mise en œuvre de l’obligation de soins dans son « articulation avec le système socio-sanitaire ». Elle est néanmoins considérée comme ne présentant pas les mêmes faiblesses que l’injonction thérapeutique. Il prévoit de mettre en place une « interface justice/santé » de nature à évaluer la situation de l’intéressé, préparer la prise en charge sanitaire et sociale et assurer un suivi périodique. Le rôle des travailleurs sociaux mandatés par la justice (service pénitentiaire d’insertion et de probation, protection judiciaire de la jeunesse, associations de contrôle judiciaire) est réaffirmé.
Concernant l’injonction thérapeutique elle-même, le gouvernement donne acte des critiques avancées à son encontre : lourdeur de la procédure, forte « déperdition » existant entre le prononcé des mesures, et leur exécution et leur suivi ; faible capacité à atteindre le public pour lequel elle a été conçue ; évolution des consommations et des modes de prise en charge des usagers rendant moins pertinent le dispositif légal en vigueur (les usagers dépendants ayant eu la plupart du temps un contact avec le système de prise en charge socio-sanitaire, notamment par la médication de traitements de substitution, et les usagers de cannabis ayant besoin d’un traitement au long court).
Conformément à ces orientations, le projet de loi propose de renforcer le rôle de l’autorité sanitaire en mettant en place un médecin relais qui joue le rôle d’une interface médicale entre l’autorité judiciaire et l’usager de drogue : il est chargé de procéder à l’examen médical de la personne interpellée, il propose le contenu de l’injonction thérapeutique, il assure le suivi de son exécution, il informe l’autorité judiciaire du déroulement des mesures prononcées. La procédure de l’injonction thérapeutique est, dans le même temps, simplifiée. En outre, le projet de loi étend l’injonction thérapeutique à toutes mesures de soins afin d’adapter la mesure judiciaire à chaque situation d’usage de drogue.
Le projet de loi renforce également les peines encourues en cas d’usage illicite de stupéfiants en cas d’infraction commise par une personne investie de l’autorité publique ou d’une mission de service publique ou par une personne chargée de la sécurité d’un transport. Des peines complémentaires nouvelles sont définies, parmi lesquelles le suivi d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage illicite de stupéfiants.
Le projet de loi renforce enfin la répression de la provocation à l’usage illicite et au trafic de drogues visant les mineurs.
Données sur l’usage illicite de stupéfiants en France
Cannabis |
Cocaïne |
Ecstasy |
Amphétamines |
Héroïne | |
Consommateurs réguliers déclarés |
1,2 million |
nd |
nd |
nd |
150 000 à 180 000 |
Consommation au moins une fois dans leur vie par les jeunes de 17-18 ans : | |||||
Pourcentage des garçons ayant déclaré avoir consommé |
nd |
2,8 % |
5,2 % |
3 % |
1,3 % |
Pourcentage des filles ayant déclaré avoir consommé |
nd |
1,7 % |
3 % |
1,5 % |
0,8 % |
Consommation au moins une fois dans les trente derniers jours par les jeunes de 17-18 ans : | |||||
Pourcentage des garçons de 17-18 ans ayant déclaré avoir consommé |
38 % |
1,2 % |
2,2 % |
1,2 % |
0,5 % |
Pourcentage des filles de 17-18 ans ayant déclaré avoir consommé |
26 % |
0,6 % |
1 % |
0,6 % |
0,3 % |
Usage régulier par les jeunes de 17-18 ans (dix fois ou plus au cours des trente derniers jours) : | |||||
Pourcentage des garçons de 17-18 ans ayant déclaré avoir consommé |
18 % |
nd |
nd |
nd |
nd |
Pourcentage des filles de 17-18 ans ayant déclaré avoir consommé |
8 % |
nd |
nd |
nd |
nd |
Consommation au moins une fois dans leur vie par les adultes âgés de 18 à 64 ans : | |||||
Total hommes et femmes |
32 % |
||||
Pourcentage des hommes ayant déclaré avoir consommé |
nd |
4 % |
3,1 % |
2 % |
1,3 % |
Pourcentage des femmes ayant déclaré avoir consommé |
nd |
1,5 % |
1 % |
1 % |
0,4 % |
Consommation au moins une fois dans l’année par les adultes de 18-64 ans : | |||||
Pourcentage des hommes ayant déclaré avoir consommé |
12 % |
nd |
nd |
nd |
nd |
Pourcentage des femmes ayant déclaré avoir consommé |
7 % |
nd |
nd |
nd |
nd |
Interpellations pour usage simple |
91 705 |
2 458 |
1 569 |
256 |
3 730 |
Age moyen de l’interpellé |
23 ans |
29 ans |
24 ans |
29 ans | |
Interpellations pour usage, revente et trafic |
13 670 |
2 484 |
1 013 |
91 |
1 905 |
Comparaison européenne sur 27 pays (pourcentage de jeunes scolarisés de 15-16 ans ayant consommé la drogue au cours des trente derniers jours) : | |||||
Place de la France |
1ère place (22 %) |
6e place (3 %) |
8e place (4 %) |
17e place (2 %) |
nd |
Première place européenne |
— |
Espagne (6 %) |
Rép. Tchèque (8 %) |
Estonie |
nd |
Consommation régulière déclarée : données de l’Office français des drogues et toxicomanies pour 2005.
Consommation par les jeunes de 17-18 ans : données pour 2003. Consommation par les adultes de 18-64 ans : données pour 2005. Comparaison européenne : données pour 2003.
Interpellations : données pour 2004. Les données pour 2002 donnent une décomposition fine des interpellations : 81 254 usagers de stupéfiants avaient été interpellés, dont 73 449 pour usage de cannabis, 3 449 pour usage d’héroïne, 1 576 pour usage de cocaïne, 1 384 pour usage d’ecstasy et 854 pour usage de crack. Les mineurs constituaient 13,4 % des usagers interpellés.
Source : livre Drogues et dépendances réalisé par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (avril 2006).
VI.- PRENDRE EN COMPTE LES DANGERS DE L’ALCOOL
Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance contient une mesure nouvelle concernant les situations de consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
A. PERMETTRE AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PROPOSER UNE MESURE D’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE DANS LE CADRE DE LA COMPOSITION PÉNALE
L’alinéa 5 de l’article 30 permet de soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique les personnes alcooliques dans le cadre de la procédure de la composition pénale.
Cette procédure s’applique aux personnes reconnaissant avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. La mesure d’injonction thérapeutique est alors ordonnée par le procureur de la République ; elle ne peut l’être que tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.
B. ÉTUDIER LE PRONONCÉ D’UNE MESURE D’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE POUR LES CONDUCTEURS EN ÉTAT D’ALCOOLÉMIE HABITUELLE ET EXCESSIVE
La réforme importante et utile prévue par l’alinéa 5 de l’article 30 ne s’appliquera pas à toutes les personnes alcooliques interpellées.
Or les ravages de l’alcool montrent qu’il est indispensable d’avoir une action de prévention poussée.
La Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) estime qu’en 2004, en moyenne, chaque habitant âgé de quinze ans et plus buvait l’équivalent de 2,9 verres de vin par jour, soit 13,1 litres d’alcool pur par an.
Il ne faut pas se cacher que la consommation d’alcool en France comporte une dimension culturelle et sociale importante. Le Français (âgé de quinze ans et plus) n’est cependant plus le premier consommateur d’alcool en Europe : selon les statistiques de 2003, il arrive en quatrième position avec 13,5 litres d’alcool pur par an derrière le Luxembourgeois (17,5 litres), le Tchèque (16,2 litres) et l’Irlandais (14,4 litres). Contrairement aux préjugés, le Suédois est dernier du classement (6,9 litres), le Polonais avant-dernier (8,7 litres) et le Britannique treizième (10,4 litres).
Des efforts considérables ont été faits en France pour réduire les consommations excessives et améliorer la qualité des vins, de très loin la principale boisson alcoolique consommée en France, afin de remplacer la quantité par la qualité. En quarante ans, la consommation en équivalent d’alcool pur a été réduite de moitié (25,78 litres par habitant âgé de 15 ans et plus en 1961 et 13,08 litres en 2004). Cette évolution s’est faite par une réduction considérable du volume de consommation des vins (20,56 litres en 1961, 12,70 litres en 2004) tandis que les spiritueux ont peu baissé (2,95 litres en 1961, 2,68 litres en 2004) et que la bière a stagné (2,27 litres en 1961, 2,25 litres en 2004)
Les conséquences sanitaires et pénales de la consommation excessive d’alcool restent toutefois lourdes. La MILDT estime qu’environ 100 000 personnes en difficulté avec l’alcool sont venues consulter dans les centres de cure ambulatoire en alcoologie en 2003, environ 93 000 hospitalisations avec un diagnostic principal de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool ont été constatées en 2002 et environ 48 000 patients ont vu un médecin de ville pour un sevrage en une semaine en 2003. La mortalité par l’excès de consommation alcoolique n’est plus à démontrer (environ 40 000 décès par an, dont la troisième cause, après le cancer des voies aérodigestives et la cirrhose du foie, est la psychose et dépendance alcoolique). En 2002, 104 610 condamnations ont été prononcées pour conduite en état alcoolique, 3 736 pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et 421 pour homicide involontaire par conducteur en état alcoolique.
Beaucoup plus inquiétants sont les résultats de l’étude d’octobre 2006 de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur les liens entre violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale au travers des populations concernées et des traitements judiciaires. L’INSERM a analysé 2 207 affaires pénales (agressions dans des couples ou à l’égard d’enfants, violences graves, agressions sexuelles ou viols déqualifiés envers adultes et mineurs) enregistrées sur l’année 1999-2000 par le parquet d’un gros tribunal de grande instance de la région parisienne ; 89 % des auteurs de ces délits ont été condamnés.
L’usage d’alcool lors des faits ou dans les habitudes des auteurs est observé chez plus du tiers d’entre eux. Lorsque les faits sont commis par des conjoints violents cette proportion atteint la moitié. Dans plus des deux tiers des affaires de viols et d’agressions sexuelles sur majeurs, l’auteur est alcoolisé lors des faits ou est buveur d’habitude. Les usages de stupéfiants associés aux violences n’apparaissent que secondairement.
Dans plus des deux tiers des affaires de viols et d’agressions sexuelles sur majeurs, l’auteur est alcoolisé lors des faits ou est buveur d’habitude. C’est pour ce type d’infractions que l’état éthylique est le plus présent. Viennent ensuite les viols déqualifiés et agressions sexuelles sur mineurs ainsi que les violences dans les couples où l’alcool peut être relié aux auteurs dans un cas sur deux. Pour les autres types d’infractions étudiées l’alcool est présent dans un quart à un tiers des cas.
Rapport entre violences et infractions sexuelles et alcool
Infractions étudiées |
Auteurs alcoolisés au moment des faits |
Auteurs |
Total des auteurs d’infraction | |||
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% | |
Violences conjugales |
77 |
46 % |
74 |
45 % |
166 |
100 % |
Coups à enfants |
6 |
14 % |
12 |
29 % |
42 |
100 % |
Violences avec arrêt temporaire de travail supérieur à huit jours |
68 |
30 % |
40 |
18 % |
225 |
100 % |
Viols et agressions sexuelles sur majeurs |
16 |
64 % |
18 |
72 % |
25 |
100 % |
Viols et agressions sexuelles sur mineurs |
18 |
32 % |
29 |
52 % |
56 |
100 % |
Source : rapport de l’INSERM « violences physiques et sexuelles, alcool et santé mentale », octobre 2006 – page 256.
Une conclusion inquiétante de l’étude est que la présence d’alcool dans un tiers environ des affaires d’infractions violentes ou sexuelles n’a pas varié depuis trente ans en France, date d’une précédente étude comparable.
En matière criminelle, l’état éthylique est encore plus prégnant : 69 % des homicides sont commis par des personnes en état d’ébriété ou par des alcooliques chroniques, ainsi que près de la moitié des incestes.
Permettre que la mesure d’injonction thérapeutique prévue à l’article 29 du projet de loi puisse être ordonnée à tous les stades de la procédure à l’endroit des personnes faisant une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, comme il est prévu pour les usagers de stupéfiants, paraîtrait donc justifié mais cette extension du dispositif du projet de loi sur l’injonction thérapeutique est inadaptée en droit.
En l’état actuel du droit, le code pénal érige en délits les infractions suivantes liées à l’alcoolisme :
– les blessures involontaires commises par un conducteur ivre et entraînant une interruption temporaire de travail inférieure à trois mois (trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende : article 222-20-1) ;
– les blessures involontaires commises par un conducteur ivre et entraînant une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois (cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende : article 222-19-1) ;
– l’homicide involontaire commis par un conducteur ivre (sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende : article 221-6-1) ;
– provocation directe d’un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (deux ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende : article 227-19) ;
– provocation directe d’un mineur de quinze ans à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende : article 227-19).
Dans le code pénal, il n’existe donc pas de délit pour simple consommation excessive d’alcool. L’ivresse publique est seulement punie d’une contravention de deuxième classe (article R. 3353-1 du code de la santé publique). L’action publique est toujours engagée à l’encontre des consommateurs habituels et excessifs de boissons alcooliques pour un autre motif pénal d’une particulière gravité.
Il serait totalement inopportun de permettre à des personnes ayant provoqué des blessures ou un homicide involontaires de bénéficier d’un abandon des poursuites judiciaires au bénéfice d’une mesure d’injonction thérapeutique.
L’article L. 234-1 du code de la route punit toutefois de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende la conduite avec 0,8 gramme ou plus d’alcool dans le sang ou en état d’ivresse manifeste.
Prévoir une mesure d’injonction thérapeutique pour les personnes interpellées pour infraction au seul délit prévu par l’article L. 234-1 du code de la route exigerait de transposer aux conducteurs consommateurs habituels et excessifs de boissons alcooliques le dispositif entier relatif à l’injonction thérapeutique et aux mesures de soins prévu au livre IV du code de la santé publique relatif à la lutte contre la toxicomanie. Cette réforme exige un temps d’étude et de mise au point.
Elle constituerait par ailleurs une charge de travail supplémentaire pour les personnels de justice et les médecins relais puisque l’on estime que 26 000 à 27 000 personnes seraient susceptibles de bénéficier d’une mesure d’injonction thérapeutique pour motif d’alcoolémie alors que le nombre d’usagers de drogues bénéficiaires serait de 8 000. Ces 35 000 injonctions thérapeutiques annuelles représenteraient, selon une information fournie par le gouvernement, une dépense de 6,3 millions d’euros.
La commission a procédé à l’examen pour avis du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la prévention de la délinquance (art. 5 à 9, 17, 18 à 24, 27 à 29) au cours de sa séance du 14 novembre 2006.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Jean-Marie Le Guen a indiqué qu’il n’avait pas encore bien compris l’articulation entre le présent projet et la future et hypothétique ordonnance relative aux soins psychiatriques sans consentement que prépare le gouvernement. Il s’agit pourtant d’un point fondamental. En tout état de cause, si le projet de recourir à une ordonnance n’est pas satisfaisant pour mener à bien une réforme de cette ampleur, la décision de sortir du texte du projet de loi les articles concernant la santé mentale représente un progrès certain. Le maintien de ces dispositions dans le texte constitue en effet une régression inouïe consistant à assimiler la pathologie mentale à la délinquance. Il apparaît par ailleurs que la question de la toxicomanie devrait connaître un sort équivalent et disparaître du présent projet de loi. Il s’agit en effet d’un problème de santé publique et non d’ordre public.
À côté de ces deux sujets qui ne devraient évidemment pas figurer dans ce projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, d’autres dispositions comme celles sur le secret professionnel partagé sont susceptibles de nombreuses critiques. Ce texte souffre également de certaines lacunes, notamment d’une absence de réflexion sur la montée de la violence dans la société en tant que phénomène pathologique, réflexion qui ne se focaliserait pas sur les conséquences de la violence en termes de délinquance.
Le projet de loi a une vision réductrice de la prévention de la délinquance en cherchant à renforcer l’exemplarité des sanctions alors que les comportements sociaux qui conduisent à la délinquance ne sont en rien rationnels. Pour que les mesures annoncées soient réellement dissuasives encore faudrait-il que les auteurs de faits délictueux soient capables de mesurer les risques qu’ils prennent en adoptant de tels comportements. Tout reste donc à faire pour mettre en place une véritable politique de prévention.
Plusieurs questions demeurent donc en suspend : Va-t-on traiter du problème de la santé mentale dans ce projet de loi ou fera-t-il l’objet d’un traitement dans un texte spécifique ? Qu’en est-il du problème de la toxicomanie ?
Par ailleurs la question de l’injonction thérapeutique requiert un travail très fin puisqu’il pose de vrais problèmes de déontologie, comme celui de savoir si le médecin relais agira en qualité de médecin ou d’auxiliaire de justice. La création d’une structure pivot peut se révéler intéressante mais l’idée même d’injonction thérapeutique comporte trop d’ambiguïtés. En ce qui concerne l’usage du cannabis, qui n’entraîne pas obligatoirement de dépendance tout en présentant un caractère nocif, on peut s’interroger sur l’adaptation et la signification d’une obligation de soins. Plus généralement, ces questions complexes liées à la toxicomanie n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les professionnels de santé concernés et témoignent d’une réflexion pour le moins frustre.
M. Pierre-Louis Fagniez s’est félicité de ce que ce texte attendu de longue date reçoive enfin une traduction législative et a remercié le rapporteur d’avoir répondu positivement à la sollicitation forte des professionnels pour que soit traitée séparément la question de la santé mentale. Il est impérieux de distinguer clairement cette question de santé publique de celle de la prévention de la délinquance. En ce qui concerne la question de la toxicomanie, elle pourrait sans doute être traitée d’une manière identique.
La mission d’information sur la famille et les droits des enfants, présidée par Mme Valérie Pécresse, a démontré tout l’intérêt que revêt le secret professionnel partagé, afin de parvenir à une meilleure prise en charge des familles en difficultés en décloisonnant l’intervention des services sociaux et en permettant aux élus de remplir pleinement leurs missions d’action sociale. Or, si l’on compare l’actuelle rédaction de l’article 5 avec le secret professionnel médical, qui est partagé entre les différents acteurs de soins tout en pouvant être levé dans certaines conditions par une intervention du juge, le partage d’informations confidentielles entre travailleurs sociaux d’une part et entre le coordonnateur, le maire et le président du conseil général d’autre part, amène à s’interroger sur les éventuelles atteintes aux droits de la personne qui pourraient en résulter. Cet article suscitera sans doute beaucoup de discussions car il est difficile d’instaurer un secret professionnel partagé sans l’encadrer strictement pour éviter de remettre en cause les droits fondamentaux des personnes.
M. Bernard Perrut a souligné que le projet de loi place le maire au centre du dispositif de prévention de la délinquance. Un certain nombre de conseils intercommunaux de surveillance et de prévention de la délinquance (CISPD) sont d’ores et déjà en place. Les présidents de ces organes intercommunaux disposent-ils des mêmes compétences que le maire ? En outre ces CISPD ne fonctionnent pas toujours de manière très satisfaisante en raison du défaut de partage et de transmission de l’information. On ne peut donc que se réjouir de la création d’un cadre légal réglementant la transmission de l’information. Renforcer le rôle des maires en matière d’absentéisme scolaire est également un point positif même si, sur le terrain, des actions sont déjà menées en ce sens. Il en va de même pour la possibilité reconnue aux maires de placer sous tutelle les prestations familiales.
Le texte comprend également une série de mesures relatives à la protection de la jeunesse qui ont été introduites par le Sénat ; il en va ainsi de la réintroduction des gardiens d’immeuble au sein de cités sensibles. Le rôle de ces gardiens d’immeuble est en effet très important, aussi bien dans le domaine social que pour servir de relais en matière de prévention. La possibilité de résilier les baux d’habitation pour troubles de voisinage suscite en revanche certaines interrogations et demandera à être précisée.
La présence de dispositions relatives à la prévention de la toxicomanie constitue un aspect positif de ce texte, notamment pour ce qui concerne la création de médecins relais dans le cadre de la procédure de l’injonction thérapeutique.
Il convient enfin de réaffirmer le rôle fondamental de l’école en matière de prévention de la délinquance et de se féliciter de la mise en place de l’accompagnement parental conduit par le conseil pour les droits et les devoirs de la famille qui constitue une institution remarquable.
Mme Christine Boutin a indiqué que son intervention serait volontairement brève puisque la discussion se prolongera nécessairement en séance publique, tout en déclarant qu’elle ressentait un malaise profond vis-à-vis du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le malaise atteignant son point culminant avec les dispositions relatives aux malades psychiatriques même si le retrait de ces articles est annoncé. Pourquoi ce malaise ? La philosophie générale du projet de loi est à l’exact opposé de l’objectif louable de prévention de la délinquance. Il n’est question ici que d’une pure logique de sanctions qui conduit immédiatement à l’enfermement alors que chacun sait, quelle que soit son appartenance politique, que cette réponse n’est pas adaptée à la prévention de la délinquance ou qu’elle trouve en tout cas des limites certaines. De plus, l’état actuel des prisons françaises devrait conduire à privilégier d’autres types de sanctions.
L’examen approfondi du projet de loi laisse apparaître des confusions d’autant plus regrettables que la société perd déjà ses repères. L’article 5 assimile, par exemple, la délinquance à la précarité sociale, tandis que l’article 7 relatif à la tutelle aux prestations familiales introduit une confusion entre ce qui ressort du domaine de compétence du juge et ce qui relève du maire. En matière de contrôle de l’assiduité scolaire, les missions respectives du maire et de l’éducation nationale ne sont également pas suffisamment distinguées.
Les articles relatifs aux troubles psychiatriques, même s’ils vont probablement être retirés de ce texte, risquent d’être repris dans le cadre de l’ordonnance, si bien qu’au final le projet de loi inquiète plus qu’il ne rassure. Il n’est même pas sûr que les amendements déposés sur ce texte pour tenir compte des remarques précédentes, qui seront défendus lors de la séance publique, parviennent à la clarification nécessaire.
M. Maurice Giro a attiré l’attention sur les problèmes de délégation de compétences et de pouvoirs. Il convient de rester prudent sur l’extension des pouvoirs du maire. Celui-ci n’est, en effet, pas amené à exercer tous les pouvoirs qu’on lui prête. Par exemple, l’expulsion des logements reste en définitive une compétence des sociétés d’HLM et non pas un pouvoir de police du maire. Par ailleurs, ces pouvoirs de police du maire ne se délèguent pas. Si un maire devient président d’une structure intercommunale, il est obligé en tout état de cause de solliciter ses collègues maires seuls compétents en matière de police sur le territoire de leurs communes respectives. Il en va de même pour ce qui concerne l’éducation nationale et la lutte contre l’absentéisme : c’est l’inspecteur d’académie ou le directeur d’établissement qui restent au final compétents. Il convient donc d’éclaircir ce problème des délégations de compétences et de pouvoirs.
M. Jean-Marie Le Guen a jugé que le projet de loi traduit un désengagement de l’Etat qui se défausse de ses responsabilités sur les maires en augmentant considérablement leurs missions.
M. Maurice Giro a fait remarquer que le maire peut demander à ce qu’on agisse dans tel ou tel sens mais ne peut pas agir par lui-même, puisque la loi ne permet pas en l’état des délégations de compétence.
Mme Valérie Pecresse a estimé que, pour l’essentiel, ce projet de loi vient utilement équilibrer la lutte contre la délinquance par un volet préventif réclamé par tous. Contrairement à ce qu’il ressort de la condamnation radicale exprimée par Mme Christine Boutin, le projet de loi contient de bonnes dispositions. Il n’est pas question uniquement de police et de justice, mais également de la famille, de l’action sociale, de l’éducation et du rôle du maire comme garant du bon fonctionnement de la société. Si tous ces points primordiaux figurent bien dans le texte du projet de loi, on ne peut néanmoins que partager certaines réserves déjà exprimées et notamment le fait de mêler à ce projet de loi des dispositions relatives à la psychiatrie, même si on sait que les graves pathologies mentales peuvent conduire à des troubles de l’ordre public. Il faut donc se réjouir du consensus qui semble en voie d’aboutir sur ce point pour parvenir à régler dans un texte spécifique la question des soins psychiatriques sous contrainte.
Le secret professionnel partagé est également une source de préoccupation. Un tabou a été levé dans le cadre des travaux de la mission parlementaire sur la famille et les droits des enfants, qui a souhaité que ce sujet soit abordé dans une loi sur la protection de l’enfance mais celle-ci sera examinée par le Parlement après le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance. Dès lors, on peut craindre que les dispositions relatives au partage des informations confidentielles qui figurent dans le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne viennent contredire le mécanisme de secret professionnel partagé qui figure dans le projet de loi réformant la protection de l’enfance. Des craintes se sont même exprimées au sujet des réticences que pourraient avoir les professionnels de la protection de l’enfance à partir du moment où l’information partagée pourra être utilisée par les maires dans le cadre de leur politique de lutte contre la délinquance. Il faut dire néanmoins que la rédaction de l’article 5 du présent projet, et notamment l’institution du coordonnateur social qui ne communiquera au maire et au président du conseil général que les informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’action sociale, est de nature à rassurer les professionnels de l’enfance. Il conviendrait toutefois de rajouter un volet sur l’information des familles dans un texte qui n’aborde pas ce point pour l’instant.
M. René Couanau, président, a déclaré partager les mêmes préventions que de nombreux autres commissaires au sujet des dispositions relatives aux troubles psychiatriques, qui sont effectivement une source de confusion. L’initiative du rapporteur tendant à les sortir du projet de loi apporte toutefois une réponse satisfaisante. Par ailleurs, même si certaines réalités relèvent plus de la compétence de la commission des lois, elles ne peuvent néanmoins pas être ignorées : 57 % des réponses à la délinquance des jeunes se traduisent par un simple rappel à la loi, une admonestation ou une reconduite chez les parents. Lorsqu’une peine est prononcée, elle n’est en outre exécutée que dix-huit mois après !
Mme Christine Boutin a fait remarquer que le texte ne changera rien sur ce point.
M. René Couanau, président, a souligné qu’il ne partage pas les inquiétudes exprimées au sujet de la toxicomanie. Dans ce domaine, le texte prévoit effectivement une procédure judiciaire, avec consultation de médecins. Avec l’injonction thérapeutique décidée par un juge, on est très loin du dispositif d’hospitalisation d’office qui est une mesure de police administrative sans aucun contrôle a priori de l’autorité judiciaire.
Pour ce qui concerne le secret partagé, pourquoi tant de suspicion à l’encontre des maires qui sont pourtant élus au suffrage universel ? Pourquoi la confiance ne pourrait-elle être accordée qu’à des fonctionnaires ? Comment les maires pourraient-ils exercer leurs compétences en matière d’action sociale s’ils ne sont pas concernés par le partage d’informations confidentielles ? Or ils travaillent déjà avec des travailleurs sociaux et la fonction de coordonnateur social sera assumée par un travailleur social. Le dispositif de secret professionnel partagé paraît donc suffisamment encadré pour éviter toute mise en cause de la vie privée des familles. Cela étant, la mise en œuvre des dispositions de ce projet de loi entraînera des charges supplémentaires et l’Association des maires de France va d’ailleurs attirer l’attention sur ce point. Même si les centres communaux d’action sociale (CCAS) existent déjà, l’impact financier des nouvelles attributions données aux maires par le projet de loi, notamment en matière de personnels, a été sous-estimé.
Si M. Bernard Perrut a justement demandé que soit explicitée l’application des dispositifs du projet de loi aux structures intercommunales, il convient de mettre généralement en garde contre des transferts de compétences trop importants au bénéfice de ces structures. Les structures intercommunales ont d’abord pour mission de coordonner les politiques publiques sur un territoire mais elles ne peuvent s’attribuer des pouvoirs de police qui restent dévolus aux maires.
En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a donné les éléments d’information suivants :
– À l’évidence le problème de la prévention de la délinquance est complexe à traiter et l’équilibre entre le renforcement des sanctions et la réponse sociale est difficile à trouver. Il y a certainement un besoin de clarification, mais si une seule solution simple existait, cela se saurait !
– Une nécessaire part de fermeté doit être associée à la compassion et l’accompagnement social, ce qu’on peut aussi appeler « la douceur », pour que les personnes vulnérables retrouvent de l’espoir.
– Il est évident que les sept articles 18 à 24 relatifs à l’hospitalisation d’office concentrent bien des interrogations. Il y a aujourd’hui un problème qui s’explique peut-être par la pression exercée il y a vingt-cinq ans pour réduire le nombre de places dans les hôpitaux psychiatriques, voire fermer ces structures. Le mensuel Lyon Mag posait cette semaine même la question : « Les fous sont-ils dangereux ou inoffensifs : difficile de répondre tant qu’ils ne sont pas passés à l’acte ». On sait pourtant, au travers des exemples de Pau et de Nanterre notamment, que certains passent à l’acte.
– Suivant les estimations, entre 3 et 10 % des malades mentaux sont des menaces pour l’orde public et la sécurité des personnes. Il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter les conséquences dommageables, en termes de sécurité publique, des comportements violents de certains malades mentaux. Le projet de loi propose ces mesures.
– L’émotion des professionnels de santé est compréhensible car l’insertion dans un texte de sécurité publique d’articles relatifs à l’hospitalisation sous contrainte relevant du code de la santé publique peut conduire à une confusion entre délinquance et troubles psychiatriques. C’est pourquoi il a fallu faire bouger les choses.
M. Jean-Marie Le Guen a salué l’initiative du rapporteur.
Le rapporteur a ajouté que la réforme de l’hospitalisation d’office est indispensable et urgente. Mais les points litigieux auraient mérité de figurer dans un dispositif législatif consacré à la réforme du code de la santé publique et, mieux, dans le cadre d’une réforme globale de la loi du 27 juin 1990. Pour des raisons de temps, la solution de l’habilitation à légiférer par ordonnance est proposée. Il faut espérer que cette solution pourra aboutir.
M. René Couanau, président, s’est interrogé sur la procédure qui pourrait être retenue pour ce faire, puisque les articles en question vont être votés incessamment par l’Assemblée nationale.
Le rapporteur a répondu en fournissant les précisions suivantes :
– Il sera demandé de voter les articles 18 à 24 du projet mais la possibilité reste ouverte, au cours de la navette, voire en commission mixte paritaire, de les supprimer si la procédure de l’ordonnance est menée à son terme et permet la refonte de la loi du 27 juin 1990.
– S’agissant de la lutte contre la toxicomanie et le problème de l’alcool, le projet de loi complète utilement le code de la santé publique. Un amendement viendra préciser les conditions de la lutte contre la consommation excessive d’alcool.
– Les interventions coordonnées de M. Pierre-Louis Fagniez et de Mme Valérie Pecresse, tous les deux membres de la mission d’information sur la famille et les droits des enfants, ont souligné le problème posé par la création d’un secret professionnel partagé. Cependant, en instituant un « travailleur social coordonnateur », le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance atteint un double objectif : donner de la cohérence aux interventions sociales dont bénéficie une même famille en difficulté et garantir que le partage d’informations confidentielles relatives à une famille se fera dans le respect d’une stricte déontologie. Le coordonnateur évaluera ainsi les informations confidentielles qu’il est nécessaire de transmettre au maire et au président du conseil général pour l’exercice de leurs compétences d’action sociale respectives. Un bon équilibre a été trouvé entre respect de la vie privée des familles et efficacité du travail social. L’article 5 du projet de loi permet une coordination avec les dispositions du projet de loi relatif à la protection de l’enfance. Elle est cohérente avec l’attention soutenue qui doit être portée aux familles en difficulté. Il y a là un équilibre à trouver en coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l’enfance.
– L’intervention très pertinente de M. Bernard Perrut a porté sur des points qui relèvent plutôt de la compétence de la commission des lois. Le projet de loi apporte des réponses convaincantes sur les sujets de l’absentéisme scolaire et du gardiennage d’immeuble.
– La philosophie générale du projet de loi est de placer le maire au cœur du dispositif. Cette proposition prend tout son sens dans les communes petites, moyennes et grandes, peut-être moins dans les plus grandes villes.
M. René Couanau, président, a relevé que l’alinéa 3 de l’article 21, qui concerne l’hospitalisation d’office et prévoit que la personne en cause est retenue le temps strictement nécessaire dans une structure médicale adaptée lorsque l’avis médical justifiant l’hospitalisation d’office ne peut être obtenu immédiatement, va poser un problème de vide juridique. En effet, le texte ne précise pas la structure médicale où sera accueillie la personne, ni quel sera le statut juridique de la personne contrainte de demeurer privée de liberté.
M. Jean-Marie Le Guen a considéré qu’au moins un point fait consensus au sein de la commission, c’est que les articles 18 à 24 du projet de loi relatifs à l’hospitalisation d’office posent un véritable problème de stigmatisation des personnes concernées. Cependant, la solution avancée par le rapporteur semble dépourvue de cohérence. En effet, comment inviter les commissaires à discuter d’articles dont la suppression sera proposée au bénéfice de l’écriture d’un texte par le gouvernement sous la forme d’une ordonnance ? Cette solution est de nature à rendre schizophrènes les commissaires, appelés à faire leur travail de parlementaires tout en sachant que le gouvernement rédigera une ordonnance sur le sujet. Le gouvernement, semble-t-il, réfléchit actuellement à une fusion des régimes de l’hospitalisation d’office et de l’hospitalisation à la demande de tiers. On s’orienterait vers un régime privilégiant d’abord l’hospitalisation à la demande de tiers, puis, en cas d’impossibilité, l’hospitalisation d’office. Cette approche médicale paraît meilleure ; le problème est qu’elle n’est pas cohérente avec le contenu du projet de loi. Enfin, persister à vouloir débattre des articles 18 à 24 ne résoudra pas du tout le problème fondamental de la stigmatisation : le débat que la commission va tenir conduira bien à cette stigmatisation et le mal sera fait. Il est donc tout à fait inopportun de procéder à la discussion de ces articles.
Mme Valérie Pecresse a estimé que les arguments de M. Jean-Marie Le Guen sont réversibles. En effet, à supposer que ces articles soient in fine supprimés, les débats de commission et le texte adopté auront le mérite d’éclairer le gouvernement sur la position du Parlement, même s’il est vrai qu’il est difficile, en tant que parlementaire, de légiférer alors qu’il est annoncé que le gouvernement rédigera une ordonnance sur le sujet.
M. Dominique Tian a rappelé qu’il s’agit d’examiner un texte adopté par le Sénat. Il n’est pas possible de refuser d’examiner ces articles au prétexte qu’une hypothétique ordonnance va être prise.
Le rapporteur pour avis a estimé utile que la commission examine les articles. En effet, rien n’est encore fait et compte tenu de la signification politique des dispositions en cause, il serait regrettable que la commission ne donne pas son avis.
M. Jean-Marie Le Guen a jugé que la proposition de débattre d’articles appelés à être supprimés au profit d’une ordonnance s’apparente à une manœuvre de dernière minute. En la matière, le choix est clair : il faut soit se taire, soit discuter les articles. Si les commissaires commencent à examiner les articles, il faut aller jusqu’au bout et voter le texte. Voter le texte tout en laissant ouvert le recours à une ordonnance n’a pas de sens.
Article 5
Coordination des interventions en matière d’action sociale en faveur des familles en difficulté et secret professionnel partagé
Cet article attribue au maire une mission de coordination des interventions d’action sociale sur le territoire de sa commune et autorise, sous certaines conditions, le partage d'informations entre professionnels intervenant auprès d'une même famille, ainsi que leur divulgation au maire, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
Partant du constat que l’efficacité de l’accompagnement social des familles en grave difficulté était problématique du fait de l’intervention de multiples services sociaux dont la coordination n’était pas assurée, cet article attribue au maire une mission de coordination des interventions sociales sur son territoire alors même que les professionnels qui interviennent ne relèvent pas de son autorité. L’objectif recherché est de décloisonner les interventions de différents « spécialistes » qui ne connaissent la situation sociale de la famille que sous un angle particulier afin d’éviter que des situations dramatiques puissent s’aggraver sans qu’aucune autorité n’ait la responsabilité d’envisager la situation de telle ou telle famille dans sa globalité.
C’est pourquoi cet article institue la fonction de coordonnateur social qui sera assumé par un des travailleurs sociaux intervenant auprès de la famille. Désigné par le maire, son rôle sera de veiller à la coopération des différents intervenants et d’assurer une fonction de médiation entre les intervenants sociaux et les élus c'est-à-dire le maire et le président du conseil général. Il déterminera notamment les informations confidentielles détenues par les professionnels de l’action sociale sur une famille en difficulté qui pourront être transmises au maire et au président du conseil général si leur transmission apparaît nécessaire à la continuité et à l’efficacité de l’accompagnement social de la famille.
Cet article comporte un deuxième volet qui vise à donner une base légale à une pratique du travail social à savoir l’échange d’informations entre professionnels relevant d’autorité différentes alors que ces professionnels sont soumis au secret professionnel ou tout au moins à un devoir de discrétion(service social polyvalent de secteur dépendant du conseil général, éducateur dépendant d’associations habilitées au titre de l’aide sociale à l’enfance, médecins de PMI, personnel des CAF chargé de l’action sociale etc.). Ces échanges d’information sont strictement limités à la détection de situations sociales graves et visent à protéger des personnes vulnérables (plusieurs intervenants peuvent par exemple échanger des informations qui sont autant d’indices concordants permettant de présumer des actes de violence conjugale).
L’objectif est de favoriser le partage d’informations préoccupantes qui prises isolément ne sont pas suffisamment probantes mais conduisent à la nécessité d’agir, au besoin malgré l’opposition des intéressés, lorsqu’elles sont recoupées.
Cet article a été profondément remanié par le Sénat qui a cherché un juste équilibre entre le souci de donner au maire, interlocuteur de proximité des familles un rôle de coordonnateur des interventions d’action sociale et le respect de la compétence attribué au conseil général pour l’ensemble de la politique d’action sociale. En effet, les communes ne disposent pas de compétences propres en matière d’intervention sociale même si par l’intermédiaire de leur centre communal d’action social elles peuvent aider les familles en difficulté.
Le Sénat a aussi modifié le dispositif de secret professionnel partagé pour mieux l’encadrer. Un mécanisme de partage des informations confidentielles relatives à une famille à deux niveaux a été défini :
– un secret professionnel partagé entre les professionnels de l’action sociale pour permettre dans l’intérêt des bénéficiaires de l’accompagnement social, une prise en charge globale et efficace
– une possibilité de communiquer au maire et au président du conseil général des informations confidentielles nécessaires à l’exercice de leurs compétences respectives en matière d’action sociale, éducative et sanitaire.
Ces amendements étant le fruit d’un compromis entre les « départementalistes » attachés à maintenir le département comme chef de file de la politique d’action sociale et les partisans d’une autorité de proximité c'est-à-dire le maire chargé tout à la fois de prévenir la délinquance et de garantir la cohérence des interventions sociales auprès des familles en difficulté, le texte adopté présente certaines ambiguïtés.
Une analyse plus détaillée du texte adopté permettra de mettre en lumière la complexité du dispositif.
Cet article, qui insère un nouvel article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles confie au maire un rôle de coordination en matière d'action sociale à destination des personnes et des familles qui connaissent de grandes difficultés sociales, éducatives ou matérielles.
Lorsqu'un travailleur social, qu'il relève ou non de l'autorité du maire, a connaissance de telles difficultés et constate que leur traitement requiert l'intervention de plusieurs acteurs, il en informe le maire qui désigne alors un coordonnateur parmi les travailleurs sociaux concernés. Afin de respecter la compétence générale du département en matière d'action sociale, le nouvel article L. 121-6-2 précise toutefois que le travailleur social a aussi l’obligation d’en informer le président du conseil général.
C’est au maire à qui revient la responsabilité de désigner parmi les travailleurs sociaux qui interviennent auprès de la famille un coordonnateur après s’être assuré de l’accord de l’autorité hiérarchique dont il relève et après avoir consulté le président du conseil général.
Il convient ici de se demander de quelle marge de manœuvre disposera le maire pour décider de l’opportunité de désigner un coordonnateur. Dans sa rédaction actuelle ce ne sont pas les travailleurs sociaux qui apprécieront la nécessité de désigner un coordonnateur compte tenu de la gravité ou de la complexité de la situation de la famille. Le maire pourra de sa propre initiative ou à la demande du président du conseil général décider de la nécessité de désigner un coordonnateur. Sur un plan plus technique, la rédaction du texte ne permet pas de déterminer si le maire sera dans l’obligation de désigner un coordonnateur dès lors que plusieurs professionnels interviennent auprès d’une famille ou s’il disposera d’un pouvoir d’appréciation pour juger de l’opportunité de le faire.
Lors de son audition par le rapporteur M. Laurent Puech, président de l’association nationale des assistants sociaux a fait remarquer que dans la majorité des cas une famille est suivie par au moins deux professionnels de l’action sociale et qu’il paraissait très lourd de désigner systématiquement un coordonnateur. De plus, si la nomination de coordonnateur devient systématique une grosse part du travail social sera absorbée par cette fonction de coordination au détriment de l’accompagnement des familles.
Le quatrième alinéa de l’article précise par ailleurs que lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l’autorité du président du conseil général (80 % des travailleurs sociaux dépendent du département) il reviendra au président du conseil général de proposer le nom d’un coordonnateur que le maire désignera officiellement comme tel.
1. Les missions du coordonnateur
La fonction du coordonnateur gagnerait aussi à être précisée notamment au regard des informations couvertes par le secret professionnel.
La première mission du coordonnateur sera de veiller au décloisonnement des services sociaux intervenant auprès de la famille afin de permettre un accompagnement social efficace, chaque travailleur social pouvant échanger des informations s’il estime que dans l’intérêt de la famille, il est nécessaire de révéler à d’autres intervenants des informations qu’il détient sur cette famille. La deuxième mission de ce coordonnateur sera selon les termes de l’exposé des motifs du projet de loi :
« C'est par l'intermédiaire de ce coordonnateur que le maire, autorité administrative générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. Ainsi, sera sauvegardé le principe de la confidentialité de l'information sans pour autant que l'autorité administrative compétente ne soit réduite à une inaction justifiée jusqu'alors par la crainte de transgresser le secret professionnel. »
Selon les termes de l’exposé des motifs le coordonnateur devrait être le seul travailleur social habilité à transmettre au maire et au Président du conseil général des informations couvertes par le secret professionnel. Or tel ne semble pas être le cas puisque dans le deuxième alinéa de l’article 5 il est indiqué que lorsqu’un professionnel de l’action sociale constate que la gravité de la situation sociale d’une famille appelle l’intervention de plusieurs professionnels il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général.
Le texte précise d’ailleurs explicitement que cette transmission d’information à un élu n’est pas considérée comme une violation du secret professionnel : « L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. »
Dans le septième alinéa de cet article il est par ailleurs précisé que :
« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences d’action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Il existe donc deux procédures parallèles d’information des élus, ce qui risque de réduire la portée novatrice de la fonction de coordonnateur social dont la justification première était de permettre un rôle d’interface entre les élus et les travailleurs sociaux pour permettre une divulgation aux élus des seules informations strictement nécessaires à l’exercice de leurs compétences d’action sociale.
2. Le secret professionnel partagé entre professionnels
L’autorisation donnée aux professionnels de l’action sociale de partager des informations confidentielles devrait aussi être précisée.
Afin de donner toute son efficacité à la coordination de l'action sociale sur le territoire communal, le sixième alinéa de l’article 5 organise les modalités du partage d'informations entre professionnels concernés par une même famille. Ceux-ci pourront désormais échanger toutes les informations utiles pour assurer la continuité de leurs actions et leur efficacité.
Le coordonnateur a connaissance des informations confidentielles partagées entre les différents professionnels intervenant pour la même famille, ce qui lui permettra de disposer de l’ensemble des informations relatives à cette famille et de ne pas être « court-circuité par des travailleurs sociaux qui remettraient en cause la légitimité de la fonction de coordonnateur social.
Le texte, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas si les informations pouvant être partagées sont couvertes par le secret professionnel, il semblerait que certaines informations n’en relèvent pas car elles sont détenues par des professionnels de l’action sociale non soumis au secret professionnel (cas par exemple des psychologues ou des éducateurs de prévention).
Si les informations concernées par le nouveau dispositif concernent à la fois des informations couvertes par le secret professionnel et d’autres qui n’en relèvent pas une nouvelle source de complexité risque d’être créée : ces informations – qui étaient auparavant diffusables – deviennent confidentielles dès lors qu'elles sont partagées dans le cadre de la coordination. Ainsi, une même information pourra dorénavant être ou non secrète selon le cadre dans lequel on la partage.
La rédaction semble également imprécise en ce qui concerne les professionnels autorisés à participer au partage de l'information : la rédaction retenue par le Sénat ouvre la possibilité d'un partage entre tous les professionnels travaillant auprès d'une famille, qu'ils soient ou non préalablement soumis au secret professionnel. Suite à l’adoption de l’amendement présenté par M. Jean René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des Lois les professionnels concernés par le partage d’information sont les professionnels « soumis au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion ».
Le rapporteur pour avis est conscient de la complexité de cette question car tous les professionnels œuvrant dans le domaine de l’action sociale n’y sont pas astreints de la même façon par la loi ou par la jurisprudence.
Parmi les professionnels intervenant dans le champ de l’action sociale, seule la profession d’assistant de service social est explicitement désignée, par l’article L. 411-3 du code de l’action sociale et des familles, comme soumise à l’obligation de secret professionnel. D’autres acteurs sont soumis au secret professionnel en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire :
– l’article L. 2112-9 du code de la santé publique définit très largement les personnes soumises au secret professionnel puisqu’il s’agit de « toute personne appelée à collaborer au service de PMI » ;
– l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles dans son premier alinéa prévoit que toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret professionnel.
Ces dispositions soumettent donc au secret professionnel les personnes, et notamment les enseignants et les élus, qui n’appartiennent pas aux services de la PMI ou de l’ASE, mais concourent à leurs actions.
Pour d’autres professions c’est la jurisprudence qui a défini celles qui étaient soumises au secret professionnel. Dans un arrêt du 4 novembre 1971 la cour de Cassation a par exemple considéré que les éducateurs de la prévention spécialisée n’étaient pas assujettis au secret professionnel mais tenus à une grande discrétion.
M. Nicolas About, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales du Sénat a d’ailleurs fait remarquer qu’il serait opportun de s’inspirer du dispositif de secret professionnel partagé sur le modèle de celui prévu par le projet de loi relatif à la protection de l'enfance en matière de signalement des enfants en danger. Le mécanisme retenu dans ce cadre lui semble en effet offrir davantage de clarté et de garanties juridiques : il prévoit de façon explicite une dérogation ponctuelle aux règles du code pénal, il limite le partage d'informations à un partage entre personnes préalablement et également soumises au secret professionnel, il précise que les informations ainsi partagées restent confidentielles à l'égard de tiers, il subordonne le partage d'informations à une stricte nécessité pour l'accomplissement des missions de protection de l'enfance et il prévoit enfin une information préalable des intéressés.
Tenant partiellement compte de ces observations, le sénat a d’ailleurs amélioré la rédaction initiale du projet de loi. Le dernier alinéa de l’article 5 limite explicitement la communication au maire et au président du conseil général aux seules informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d’action sociale respectives et précise que les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers (voir ci-joint le schéma présentant les deux dispositifs de coordination des informations préoccupantes et de secret professionnel partagé).
Il n’en demeure pas moins que les deux mécanismes de partage d’informations confidentielles demeurent différents. Selon les informations données par M. Jean Jacques Trégoat, directeur général de l’action sociale les deux mécanismes peuvent différer car le présent projet de loi a un objet beaucoup plus large que celui réformant la protection de l’enfance, ce dernier texte devant être analysé comme une loi spéciale pouvant déroger au dispositif de droit commun posé par l’article 5 du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance.
Le rapporteur pour avis tout en comprenant ce raisonnement souhaite que le rapprochement des deux mécanismes de partage d'informations aille aussi loin que possible afin d'éviter que les travailleurs sociaux, faute de pouvoir déterminer avec certitude la procédure adéquate, s'abstiennent tout simplement de transmettre les informations en leur possession.
Le texte de l’article 5 dans sa rédaction actuelle ne traite pas de la question de savoir sous quelle forme se déroulera le partage d’informations confidentielles entre les professionnels de l’action sociale, le coordonnateur et les élus d’une part et entre les professionnels eux-mêmes, d’autre part. Comment seront conservées les informations nominatives relatives aux familles en difficulté ? Ces informations nominatives pourront-elles faire l’objet d’un droit de consultation et de rectification comme le prévoit l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il serait possible de s’inspirer des dispositions de l’article 1110-4 du code de la santé publique relatif à la protection des données médicales pour prévoir que la conservation sur support informatique comme la transmission par voie électronique entre professionnels d’informations confidentielles relatives à des familles en difficulté sont soumises à des règles définies par décret en conseil d’Etat après avis de la CNIL.
Le rapporteur aimerait enfin aborder un point particulièrement délicat : est-il souhaitable au nom du respect de la dignité des personnes bénéficiaires des mesures d’accompagnement social de prévenir la famille préalablement à la mise en place d’un dispositif de coordination et donc de partage d’informations à son sujet ? Interrogé sur ce point au Sénat M. Philippe Bas a indiqué que contrairement à la procédure prévue dans le texte sur la protection de l’enfance où l’information de la famille est préalable au partage d’information sauf si l’intérêt de l’enfant s’y oppose, il ne lui paraissait pas opportun de rajouter cette formalité supplémentaire dans ce texte dont l’objet est beaucoup plus large. Les travailleurs sociaux quant à eux soulignent que l’information de la personne ou de la famille est indispensable pour éviter une perte de confiance entre la famille et les travailleurs sociaux. Ils font d’ailleurs remarquer qu’il s’agit d’améliorer l’efficacité des interventions d’action sociale qui ne peuvent fonctionner sous le régime de la contrainte, d’autres procédures décidées par l’autorité judiciaire sont d’ailleurs prévues s’il faut passer outre l’opposition des intéressés.
*
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin visant à ce que la possibilité de transmission d’informations entre les travailleurs sociaux et le maire soit soumise à l’exigence de l’intérêt des personnes.
Mme Christine Boutin a précisé que cet amendement est le premier d’une série de quatre amendements à l’article 5. Ces amendements poursuivent tous le même objectif : éviter la confusion entre la délinquance et la situation de précarité des personnes.
Se déclarant en accord sur le fond avec les propositions de Mme Boutin, le rapporteur a indiqué que les amendements proposés s’insèrent dans un dispositif déjà très complexe et qu’il serait donc préférable que leur rédaction soit revue afin qu’ils soient en cohérence avec les amendements du rapporteur modifiant l’article 5. Les modifications complémentaires de cet article pourront être examinées par la commission des lois dans le cadre de la réunion qu’elle tiendra en application de l’article 88 du Règlement.
À l’invitation du rapporteur, Mme Christine Boutin a retiré ses amendements.
Mme Valérie Pecresse a relevé que Mme Boutin évoque « l’accord » de la personne, alors que le dispositif de son amendement se limite à « l’information » de la personne pour la transmission entre travailleurs sociaux d’informations la concernant. Si l’amendement se limite effectivement à l’information, il est opportun. En effet, il sera sans doute impossible de recueillir l’accord des personnes alors que l’on se place dans un contexte de prévention de la délinquance.
M. Jean-Marie Le Guen a demandé si les informations concernées par le dispositif du projet de loi peuvent revêtir un caractère médical, ce à quoi Mme Valérie Pecresse a répondu par la négative.
M. Jean-Marie Le Guen a soulevé le problème d’une mère de famille atteinte du SIDA. Cette information appartient bien au dossier social, mais en aucun cas le travailleur social ne doit pouvoir la transmettre à un tiers non soumis au secret professionnel.
Mme Valérie Pecresse a rappelé que les informations en cause sont strictement liées au suivi de l’enfant.
Le rapporteur a estimé que, sous réserve de leur réécriture, les amendements de Mme Christine Boutin pourront utilement améliorer la cohérence du projet de loi avec le texte relatif à la protection de l’enfance.
La commission a ensuite adopté trois amendements du rapporteur pour avis :
– un amendement de simplification rédactionnelle pour éviter de détailler les domaines de compétences de l’action sociale de la commune ;
– un amendement indiquant clairement que les professionnels de l’action sociale pourront partager entre eux des informations à caractère secret ;
– un amendement visant à coordonner le projet de loi avec celui réformant la protection de l’enfance : si l’évaluation des problèmes de la famille révèle une situation de danger pour un ou des mineurs, le coordonnateur devra saisir le président du conseil général au titre de sa compétence spécifique en matière de protection de l’enfance.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 5 ainsi modifié.
Article 6
Création du conseil pour les droits et devoirs des familles
Cet article donne aux maires la possibilité de proposer aux familles dont les enfants troublent l'ordre public un accompagnement parental et rend obligatoire, dans toutes les communes de plus de 10.000 habitants, la création d'un conseil pour les droits et les devoirs des familles, chargé d'émettre un avis sur l'accompagnement proposé.
Cet article introduit, dans le code de l'action sociale et des familles, un nouveau chapitre intitulé « Conseil pour les droits et les devoirs des familles », composé de deux articles (L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’action sociale et des familles). Il prévoit que les maires pourront mettre en place des aides à la parentalité pour accompagner les parents confrontés à de graves difficultés éducatives avec leurs enfants.
L'article L. 141-2 donne ainsi au maire la possibilité de proposer aux parents des mineurs qui troublent l'ordre public – soit à cause d'un défaut de surveillance des parents, soit par un manque d'assiduité scolaire – un accompagnement parental, consistant en un suivi individualisé, doublé d'actions de conseil et de soutien à la parentalité. Les parents qui s'estiment eux-mêmes dépassés par le comportement de leurs enfants pourront également demander au maire de leur commune à bénéficier d'un tel accompagnement.
Afin d’aider le maire dans son rôle d’interlocuteur privilégié des parents en difficulté, il sera donc créé dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants un conseil pour les droits et devoirs des familles. Présidé par le maire ou un de ses représentants, le conseil est composé, à la discrétion du maire, de représentants de l'Etat, d'autres collectivités locales et de personnes qualifiées oeuvrant dans le domaine social. Les informations échangées dans le cadre de ce conseil sont couvertes par le secret professionnel.
Il s’agit ainsi de donner une base légale à de nombreuses expériences menées localement, de nombreuses communes ayant, par exemple, ouvert, avec le concours d’autres partenaires de l’action sociale, « des maisons des parents ».
Ce conseil sera un lieu de concertation et d’écoute pour les familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale mais ne constituerait pas une instance décisionnelle, seul le maire étant responsable des décisions relatives aux familles en difficulté. Le conseil aura pour principale mission d’informer les familles sur leurs droits et devoirs envers l’enfant qui pose difficulté et d’examiner les mesures d’aide à la parentalité susceptibles de leur être proposées par les différents intervenants sociaux de la commune ou du département. Les attributions du conseil sont les suivantes :
– entendre les familles en difficulté et leur adresser toutes les recommandations qu'il estime nécessaires pour prévenir des comportements susceptibles soit de mettre en danger l'enfant lui-même, soit de porter atteinte à l'ordre public ;
– déterminer s'il est nécessaire d'informer les travailleurs sociaux en contact avec la famille et d'éventuels autres tiers intéressés des recommandations qui lui ont été adressées ou de l'existence d'un contrat de responsabilité parentale (CRP) ;
– proposer au maire de demander à la Caf la mise en place d'un accompagnement de la famille dans sa gestion des prestations familiales, lorsque la situation de celle-ci est de nature à compromettre l'éducation des enfants ou la stabilité familiale et que cette situation a des conséquences en matière d'ordre public.
Enfin le maire consultera le conseil lorsqu’il envisagera de proposer à la famille un accompagnement parental.
Le rapporteur a bien noté les explications données par M. Christian Estrosi, ministre délégué à l’aménagement du territoire, durant la discussion du texte au Sénat lorsqu’il a indiqué que l’accompagnement parental et le contrat de responsabilité parentale ne se faisaient pas concurrence mais se complétaient. Il a souligné que l’accompagnement parental était « une mesure de proximité sans sanction qui aide à restaurer l’équilibre familial » et qui relève « de l’action sociale facultative de la commune ». L’objectif recherché selon le gouvernement est de disposer d’une gradation de mesures, le contrat de responsabilité parentale devant se substituer à l’accompagnement parental si l’aide informelle apportée grâce à l’intervention du conseil pour les droits et les devoirs des familles n’a pas été suffisante. Il s’agit donc d’une mesure de prévention avant de passer à un dispositif plus coercitif : le contrat de responsabilité parental (CRP), voire la saisine du juge des enfants pour carence manifeste de l’autorité parentale.
Le rapporteur s’interroge toutefois sur la coordination de ce nouveau dispositif relevant des maires avec celui du contrat de responsabilité parentale relevant des présidents de conseil général dans le cadre de leur compétence relative à la protection de l’enfance et à l’assistance éducative.
Les mesures susceptibles d'être proposées dans le cadre de l'accompagnement parental sont similaires à celles qui peuvent l'être dans le cadre du contrat de responsabilité parentale : mesures d'aide à la parentalité, suivi individualisé, recours à une technicienne de l'intervention sociale et familiale, à une conseillère en économie sociale et familiale ou à un médiateur familial.
De plus, les raisons conduisant à recourir à l'une ou l'autre procédure se recoupent très largement : si l'accompagnement parental peut être mobilisé en cas de défaut de surveillance des parents ou manquement à l'assiduité scolaire, le CRP peut l'être tout autant puisque l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles l’envisage « en cas d'absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement d'enseignement ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale ».
La seule différence entre les deux dispositifs semble être liée à la nécessité de troubles à la sécurité ou à la tranquillité publique : dans le cas de l'accompagnement parental, le projet de loi exige que le défaut de surveillance ou le manquement à l'assiduité scolaire de l'enfant provoquent des troubles à l'ordre public. Les conditions pour justifier d’un contrat de responsabilité parentale sont plus larges et centrées sur les conséquences dommageables pour le mineur de la carence de l’autorité parentale mais le souci de prévenir les conséquences de certains comportements violents figure aussi dans le contrat de responsabilité parentale qui peut être proposé en cas de « de trouble porté au fonctionnement d'un établissement d'enseignement ».
Le rapporteur s’interroge sur l’opportunité de disposer de deux outils très proches : l'accompagnement parental et le contrat de responsabilité parentale. De plus, il convient de souligner que le maire peut déjà saisir le président du conseil général en vue de la conclusion d'un CRP, lequel est alors tenu de donner suite, d'une façon ou d'une autre, à cette demande, soit par la conclusion d'un tel contrat, soit par une autre mesure de protection de l'enfance, puis d'informer le maire de la nature de la mesure mise en place.
De nombreuses communes ne seront pas en mesure d’organiser elles-mêmes des dispositifs d’aide à la parentalité et auront recours aux associations et organismes habilités par le conseil général pour mettre en œuvre les mesures d’assistance éducative et de médiation familiale. Le premier échelon de l’accompagnement parental sera donc mis en œuvre par les mêmes professionnels que ceux chargés du contrat de responsabilité parentale ou des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert. Enfin, pour les familles les plus déstabilisées ajouter une étape préalable risque de repousser l'échéance sans grandes chances de succès tout en les stigmatisant auprès de leur voisinage car le passage devant le conseil pour les droits et les devoirs des familles pourra difficilement rester confidentiel.
Le rapporteur tient à relayer les inquiétudes de la Coordination nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE) sur les garanties offertes aux familles qui devront venir s’expliquer devant le conseil pour les droits et les devoirs des familles. Le texte ne donne aucune précision sur la composition de ce conseil ni sur son fonctionnement. Il n’apporte aucune précision sur le droit à la défense des familles mises en cause et sur la garantie d’une procédure objective et contradictoire. Selon ces associations, ce « flou » procédural est problématique dans la mesure où le conseil peut remettre en cause le libre usage des prestations familiales et demander à la caisse d’allocations familiales de mettre en place « des mesures d’aide et de conseil de gestion » pour une utilisation des prestations familiales conformes à l’intérêt de l’enfant.
Le conseil disposera aussi du pouvoir d’apprécier « l'opportunité d'informer les professionnels de l'action sociale et les tiers intéressés des recommandations qui lui sont faites ».
Le texte ne prévoyant pas explicitement que la famille peut s’opposer à la divulgation d’information la concernant, il conviendrait de préciser la notion de « tiers intéressés » et de veiller à ce que seuls des travailleurs sociaux astreints au secret professionnel puissent être destinataires de telles informations. Il pourrait être particulièrement dommageable pour la famille mise en cause que le bailleur social, par exemple, puisse être informé de certaines de ses difficultés.
Le rapporteur tient à souligner que la mise en place d'une aide à la gestion des prestations familiales, parmi les solutions que ce conseil est susceptible de proposer, soulève des problèmes de coordination avec le projet de loi relatif à la protection de l'enfance. En effet, le présent article fait intervenir les caisses d'allocations familiales alors que l’article 12 du projet de loi réformant la protection de l’enfance crée précisément une nouvelle mesure de ce type, intitulée « accompagnement en économie sociale et familiale » et la place sous la responsabilité des départements.
Les motifs de recours à cette nouvelle mesure d'aide à la gestion des prestations familiales sont, de plus, contestables : ils ne se fondent en effet pas sur l'utilisation dévoyée des prestations familiales ou même, plus largement, sur les difficultés des parents à gérer leur budget pour répondre aux besoins de leurs enfants, mais sur l'existence de troubles à l'ordre public liés à une situation de nature à compromettre l'éducation des enfants ou la stabilité familiale. Elle prend donc un caractère de sanction et non pas de mesure éducative.
Le rapporteur s’interroge sur le rôle du conseil du conseil pour les droits et devoirs des familles. Sa mise en place risque d'engendrer des lourdeurs administratives pour les communes sans offrir de garanties de confidentialité suffisantes pour permettre à des familles d’exposer leurs difficultés dans le respect de leur vie privée. C’est pourquoi il serait préférable de laisser aux communes la liberté de décider de l’opportunité de créer un conseil des droits et devoirs des familles.
*
La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour effet de supprimer, parmi les mesures dont le conseil pour les droits et devoirs des familles peut prendre l’initiative, la faculté de proposer au maire de demander à la caisse d’allocations familiales de mettre en place un dispositif d’accompagnement des familles consistant en des mesures d’aide et de conseil de gestion.
Le rapporteur a expliqué qu’il s’agit de simplifier le dispositif en ne conservant que deux options, la mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale et la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
La commission a adopté l’amendement, ce qui a rendu sans objet un amendement rédactionnel du rapporteur.
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin supprimant l’obligation de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles dans toute commune de plus de 10 000 habitants.
Mme Christine Boutin a estimé qu’avant d’imposer de nouvelles obligations institutionnelles, il faut d’abord laisser le champ libre aux structures sociales existantes et à leurs évolutions.
M. René Couanau, président, a approuvé l’amendement.
Après que le rapporteur s’est déclaré partagé sur cet amendement, la commission l’a adopté.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 6 ainsi modifié.
Article 7
Désignation du travailleur social coordonnateur
comme tuteur aux prestations familiales
Cet article vise à permettre, à la demande conjointe du maire et de la Caf, la désignation du travailleur social coordonnateur comme tuteur aux prestations familiales. À cette fin, il introduit un nouvel article L. 552-7 dans le code de la sécurité sociale, complétant ainsi les dispositions relatives à la tutelle aux prestations familiales.
En cas de tutelle aux prestations familiales décidée par le juge des enfants, cet article ouvre au maire la possibilité de demander, conjointement avec la Caf, au juge de désigner comme tuteur le travailleur social déjà choisi par le maire pour être coordonnateur des interventions sociales auprès de la famille en question (voir la disposition introduite à l’article 5 du projet de loi). L'objectif de cette mesure est de donner une cohérence à l'ensemble du soutien apporté à la famille, en rassemblant dans les mains du coordonnateur tous les instruments utiles à sa prise en charge.
Tout en étant sensible à ce souci de cohérence de la prise en charge des familles, le rapporteur tient à souligner cependant que la gestion d'une tutelle exige des compétences particulières et un formalisme que tous les travailleurs sociaux ne sont pas en mesure d’assumer, tout particulièrement si la situation patrimoniale ou juridique de la famille est complexe (familles étrangères relevant de plusieurs législations nationales notamment pour leur statut personnel, familles recomposées, etc...). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il existe aujourd'hui des associations spécialisées dans ce domaine, dénommées associations tutélaires. La désignation du coordonnateur comme tuteur aux prestations familiales ne pourrait donc être décidée qu'au cas par cas, en fonction des compétences propres de ce dernier et selon la complexité juridique de la situation de la famille.
Cet article soulève, en outre, plusieurs problèmes de cohérence avec le projet de loi réformant la protection de l’enfance : en effet, dans ce texte la tutelle aux prestations familiales est supprimée et remplacée par une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, relevant désormais du code civil. De plus, les dispositions essentielles de cet article semblent relever du pouvoir réglementaire : la fixation de la liste des personnes habilitées à saisir le juge des enfants pour qu’une décision de mise sous tutelle des prestations familiales soit prononcée et les modalités de désignation des tuteurs relèvent en effet d’un décret.
Il semble utile de présenter brièvement le régime actuel de mise sous tutelle des prestations familiales et d’indiquer comment le projet de loi réformant la protection de l’enfance l’a profondément modifié.
1. Le droit en vigueur
Aux termes de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, le juge des enfants peut ordonner la mise sous tutelle des prestations familiales lorsque les enfants donnant droit à ces prestations sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant de ces prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants. Le juge désigne un tuteur, qui le plus souvent exerce dans le cadre d’une association tutélaire, auquel sont versées les prestations familiales.
Jusqu’à présent le recours à la mise sous tutelle des prestations familiales était assez peu fréquent même s’il pouvait être demandé par les services sociaux ou par les services de la protection de l’enfance (l’article R167-2 liste les personnes habilitées à saisir le juge des enfants à cet effet).
Avec la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, qui a consacré le rôle central du département en matière de soutien à la parentalité et de lutte contre l'absentéisme scolaire, le président du conseil général dispose désormais du pouvoir de demander au juge des enfants la mise sous tutelle des prestations familiales. Le président du conseil général propose aux parents, dont l’enfant est en voie de marginalisation, la signature d'un contrat de responsabilité parentale de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du maire, du chef d'établissement d'enseignement, du préfet ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Lorsque les parents ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu du contrat de responsabilité parentale ou lorsqu'ils refusent de le signer sans motif légitime, le président du conseil général peut notamment, au titre des sanctions, saisir le juge des enfants aux fins d'une mise sous tutelle des prestations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
Si le juge ordonne la mise sous tutelle, il désigne un tuteur aux prestations sociales. Le fonctionnement de la tutelle est défini par les articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale. Le 2° de l'article L. 167-5 renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions d'agrément des tuteurs et du choix des délégués à la tutelle. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées aux articles R. 167-1 à 28 du code de la sécurité sociale.
2. Le projet de loi réformant la protection de l'enfance
Le Sénat a adopté le 21 juin 2006, en première lecture, le projet de loi réformant la protection de l'enfance, qui réforme notamment le dispositif de mise sous tutelle des prestations familiales.
L'article 12 de ce projet de loi donne aux départements un nouvel outil d’assistance éducative à domicile, tout d’abord avec la création d'une « mesure d'accompagnement en économie sociale et familiale ». Cette mesure doit permettre une prise en charge précoce des familles qui connaissent des difficultés dans la gestion de leur budget. Il s’agit ainsi de donner une reconnaissance législative au travail mené par les conseillers en économie sociale et sociale et familiale qui, tout en luttant contre la pauvreté et les conséquences du surendettement, ont permis de mettre en place un suivi social des familles très précieux pour prévenir des formes de carences éducatives entraînées par la très grande précarité économique. Cette mesure doit intervenir le plus tôt possible afin d'éviter la mise sous tutelle des prestations familiales par le juge.
Cet article 12 tend, ensuite, à réformer en profondeur la procédure de mise sous tutelle des prestations familiales. Il complète la création du premier échelon de protection, que constitue le nouvel accompagnement en économie sociale et familiale à la charge des départements, par un transfert, du code de la sécurité sociale vers le code civil, des dispositions relative à la tutelle aux prestations familiales, désormais intitulée « mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ». L'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale renvoie à l’article 375-9-1du code civil qui définit le nouveau régime de cette « tutelle ».
Ce transfert vers le code civil est l'occasion de modifier le dispositif de la tutelle aux prestations familiales sur trois points importants :
– des précisions sont d'abord apportées sur les situations susceptibles de conduire à l'ouverture d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial : la référence aux conditions défectueuses d'alimentation, de logement ou d'hygiène, qui peuvent être totalement indépendantes de la bonne volonté des parents, est supprimée ; seule subsiste donc la référence à l'utilisation des prestations familiales dans un sens contraire à l'intérêt de l'enfant ;
– la mesure d'aide à la gestion du budget familial devient subsidiaire par rapport à l'accompagnement en économie sociale et familiale pouvant être proposé, avec l'accord des parents, par le département : le texte adopté exprime ainsi de façon explicite le principe général selon lequel l'autorité judiciaire n'est fondée à intervenir que lorsque la protection administrative s'avère insuffisante pour garantir la protection de l'enfant ;
– la procédure de déclenchement de la décision judiciaire d'aide à la gestion du budget familial est encadrée : pour saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure, une habilitation sera nécessaire, la liste des personnes habilitées étant fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le tuteur aux prestations familiales serait dénommé « délégué aux prestations familiales ».
3. Le rôle donné au maire pour la saisine du juge des enfants dans le cadre du présent projet de loi
Le présent article dispose tout d'abord que le maire ou son représentant pourrait saisir le juge des enfants au titre de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux fins de mise sous tutelle des prestations familiales.
Pour l’instant, l'article R. 167-2 du code de la sécurité sociale, qui fixe la liste de personnes qui peuvent demander au juge des enfants l'ouverture de la tutelle aux prestations familiales, ne donne pas cette compétence au maire.
Un lien peut être fait entre cette saisine et l'article 6 du projet de loi. Celui-ci prévoit que le conseil pour les droits et les devoirs des familles, réuni par le maire, peut lui proposer de demander à la caisse d'allocations familiales de mettre en place, en faveur de la famille, un dispositif d'accompagnement consistant en des mesures d'aide et de conseil de gestion destinées à permettre une utilisation des prestations familiales conforme à l'intérêt de l'enfant et de la famille. En cas d'échec de cet accompagnement, le maire pourrait saisir le juge des enfants.
À l'occasion de cette saisine, le présent article ajoute que le maire pourrait, en sa qualité de président du conseil pour les droits et les devoirs des familles et conjointement avec la caisse d'allocations familiales, proposer au juge des enfants que le professionnel coordonnateur de la commune soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales. L'expression « professionnel coordonnateur de la commune » renvoie à l'article 5 du projet de loi qui prévoit la nomination par le maire d'un coordonnateur parmi des professionnels de l'action sociale intervenant auprès d'une même personne. Il ne s'agit pas obligatoirement d'un agent de la commune. Le projet de loi précise que la désignation du coordonnateur comme tuteur constituent une dérogation au 2° de l'article L. 167-5 du code de la sécurité sociale qui pose le principe de l'agrément des tuteurs.
Dans un souci de coordination avec le projet de loi réformant la protection de l’enfance, M. Jean-René Lecerf, rapporteur au nom de la commission des lois du Sénat, a fait adopter un amendement pour remplacer le terme de tutelle aux prestations sociales par le terme introduit par le projet de loi précité : ainsi le coordonnateur pourrait être désigné pour exercer la fonction de « délégué aux prestations familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ».
En revanche, il est dommage que le texte voté par le Sénat ait maintenu la référence, dans le dernier alinéa de l’article 7, aux articles du code de la sécurité sociale qui visent les conditions de fonctionnement de la tutelle aux prestations sociales. En effet, les conditions d’exercice de cette nouvelle forme de la tutelle aux prestations familiales seront définies par décret dans le cadre des mesures d’application du projet de loi réformant la protection de l’enfance.
Ne serait-il pas préférable de traiter de cette question dans le cadre du décret d’application de l’article 12 du projet de loi réformant la protection de l’enfance ? Il serait tout à fait possible au gouvernement d'intégrer, par voie réglementaire, le coordonnateur désigné par le maire parmi les personnes susceptibles d'être désignées en qualité de délégué aux prestations familiales. Cette solution aurait pour avantage, outre le fait de respecter le partage voulu par la Constitution entre domaine de la loi et domaine du règlement, d'éviter des coordinations nécessairement compliquées entre les deux projets de loi.
*
La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de Mme Christine Boutin.
Mme Christine Boutin a fait état de son hostilité de principe à la mise sous tutelle des prestations familiales et indiqué qu’elle développerait son argumentation en séance publique.
Le rapporteur a émis un avis défavorable à l’adoption de l’amendement, soulignant qu’il peut être utile que le coordonnateur social puisse être désigné comme délégué (anciennement tuteur) aux prestations familiales, le juge pour enfants appréciant l’opportunité de désigner ce travailleur social plutôt qu’un autre professionnel spécialisé dans la tutelle aux prestations sociales.
La commission a rejeté l’amendement.
La commission a examiné un amendement de rédaction globale de l’article de Mme Christine Boutin, prévoyant que seul le maire, informé de cas où les prestations familiales ne seraient pas employées dans l’intérêt des enfants, puisse saisir le juge des enfants pour lui signaler ces difficultés.
Mme Christine Boutin a déclaré que cet amendement relève d’une logique de clarification des rôles respectifs du maire et du juge. Il est clair que l’amendement va à l’encontre de l’orientation générale du texte et cette question sera donc plus développée en séance publique. Il faut cependant souligner dès à présent les très grandes réticences de l’Association des maires de France (AMF) quant à la confusion des rôles du maire et du juge.
Le rapporteur a estimé que cet amendement n’est pas utile, car la définition des autorités habilitées à saisir le juge pour enfants relève du pouvoir réglementaire.
M. René Couanau, président, a rappelé que lorsqu’on vise le « maire » dans un texte législatif, ce sont aussi, bien évidemment, les initiatives des services municipaux, des travailleurs sociaux, qui sont en cause. À cet égard, il convient de veiller à ce que certains agents municipaux ne soient pas dotés de prérogatives que n’aurait pas le maire.
M. Jean-Marie Le Guen a observé qu’effectivement dans le projet de loi un « maire », c’est un « père ».
La commission a rejeté l’amendement.
Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 7 ainsi modifié.
La commission a examiné un amendement de M. Dominique Tian donnant au procureur de la République la faculté d’ordonner une tutelle aux prestations sociales dès lors qu’un mineur a fait l’objet de deux condamnations pénales définitives.
M. Dominique Tian a expliqué qu’il s’agit de transférer au parquet la prérogative de mise sous tutelle des prestations familiales en cas de condamnations répétées de mineurs. Cette mesure s’appliquerait pendant un an et pourrait être prolongée en cas de nouvelles poursuites pendant cette période.
Le rapporteur a indiqué que plusieurs mesures peuvent être prises vis-à-vis des familles confrontées à de graves difficultés éducatives et qu’il est nécessaire de laisser au juge des enfants la prérogative exclusive du choix entre ces mesures.
La commission a rejeté l’amendement.
Article 8
Possibilité pour le maire d’adresser un rappel à l’ordre
aux personnes troublant l’ordre public
Cet article, qui complète la partie du code des collectivités territoriales consacrée à la police municipale, ouvre la possibilité au maire de procéder verbalement à un rappel à l'ordre à l’encontre d’une personne dont les actes sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Le maire pourrait déléguer cette compétence à l'un de ses adjoints.
Cet article officialise une pratique largement répandue : les maires ont recours à cette admonestation verbale car ils jouissent d’une autorité morale auprès de leurs administrés, surtout dans les zones rurales et dans les petites villes. De l'avis de tous, cette pratique est efficace dans un grand nombre de cas car elle permet un rappel à l’ordre immédiat après le comportement fautif. L'autorité morale du maire est parfois plus immédiatement efficace que celle du juge.
Toutefois certains maires ont fait part de leurs réserves sur l’officialisation de cette pratique. Ils se refusent en effet à jouer un rôle de censeur d’autant plus que les procureurs de la République sont assez circonspects à l’égard de cette pratique car ils voient dans le rappel à l'ordre les prémices d'une sanction que l'autorité judiciaire est seule compétente à appliquer.
Il est important de préciser que le texte se limite à permettre un simple rappel à l'ordre et qu’il n'autorise nullement d'autres interventions du maire, comme par exemple l’incitation à la réparation amiable du dommage. Le rappel à l'ordre ne doit pas être assimilé à une sanction. Il se traduira simplement par un face à face entre le maire et la personne concernée. Le maire ne pourra garder aucune trace écrite de cette admonestation.
Lorsque le rappel à la loi s’adresse à des mineurs il est précisé qu’il doit être prononcé, sauf impossibilité, en présence des parents ou du représentant légal. Il s'agit en effet de faire prendre conscience non seulement aux mineurs mais également à leurs parents du fait que leur responsabilité civile et pénale pourrait être engagée en raison des incivilités répétées commises par leurs enfants.
*
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin précisant que le rappel à l’ordre du maire doit être effectué dans le respect de la compétence des services de la justice et de la police judiciaire.
Mme Christine Boutin a indiqué que l’objectif est là aussi de clarifier les rôles. La mise en œuvre du rappel à l’ordre par le maire ne doit intervenir qu’à titre dérogatoire.
M. René Couanau, président, a estimé que si cette précision est utile, elle mérite d’être prise en compte.
Le rapporteur ayant jugé l’amendement superfétatoire, la commission l’a rejeté.
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin disposant que le rappel à l’ordre du maire n’est pas effectué « verbalement », mais « par tout moyen ».
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin prévoyant que le maire informe le procureur de la République lorsqu’il procède à un rappel à l’ordre.
Mme Christine Boutin a déclaré que son amendement vise à donner une plus grande solennité à la procédure de rappel à l’ordre : les mineurs concernés attacheront plus d’importance à la mesure quand ils sauront que le procureur est tenu au courant. À ce titre, il va aussi dans le sens d’une bonne cohérence des prérogatives des différentes autorités.
M. René Couanau, président, a considéré que cette proposition relève du bon sens, tandis que M. Jean-Marie Le Guen s’est déclaré sceptique quant à la distribution des rôles respectifs du maire et du procureur vis-à-vis des mineurs.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 8 sans modification.
Article 8 bis
Missions du service public de l’éducation
Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par Mme Annie David et cosigné par les membres du groupe communiste républicain et citoyen. Il complète le chapitre du code de l’éducation relatif aux objectifs et missions de l’enseignement scolaire par un article précisant que « le service public d’éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violences. À cet effet, les programmes d’enseignement, les activités complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur contenu. »
La portée normative du dispositif est limitée : ses dispositions reprennent des principes inscrits dans les circulaires ministérielles, mais la dimension politique du sujet qu’il traite est importante. Cet article vient en soutien aux actions successives des gouvernements et ministres de l’éducation nationale depuis 1990 tendant à lutter contre la violence à l’école et autour des établissements d’enseignement par des actions éducatives conduites par les enseignants et des actions de veille, de suivi et d’assistance des personnels du service public de l’éducation (cf. introduction du présent rapport). Cet article confirme la nécessaire implication du service public de l’éducation dans la prévention de la délinquance au travers de sa mission pédagogique comme de ses modalités d’organisation.
L’amendement ne se limite pas aux activités dispensées au sein des établissements scolaires en application des programmes d’enseignement scolaires ; il englobe les activités périscolaires qui sont les activités pédagogiques dispensées en dehors des cours et relevant de l’Éducation nationale et les activités postscolaires qui sont des activités placées hors du champ de l’Education nationale et consistant le plus souvent en des « écoles ouvertes » proposant des activités d’éveil les plus diverses qui sont essentiellement organisées par les municipalités. Il paraît donc impropre de placer sous le service public de l’enseignement les activités postscolaires mais les animateurs de ces activités peuvent contribuer efficacement à la lutte contre la violence.
*
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 8 bis sans modification.
Article 9
Contrôle de l’absentéisme scolaire –
Statut des « Écoles de la deuxième chance »
et des « Lycées de toutes les chances »
Le présent article contient trois ensembles de dispositions relatives à la prévention de la délinquance parmi les enfants scolarisés : un complément sur les missions des établissements scolaires ; la création d’un fichier automatisé des enfants scolarisés ; la fixation du statut des Ecoles de la deuxième chance et des Lycées de toutes les chances.
1. Les missions des établissements scolaires
Le 1° de l’article inscrit dans les missions générales assignées aux établissements d’enseignement l’éducation à la responsabilité civique et la participation à la prévention de la délinquance.
2. La création d’un fichier automatisé des enfants scolarisés dans la commune
Les 2°, 3° et 4° de l’article renforcent le contrôle de l’assiduité des élèves en autorisant les maires à mettre en place un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans leur commune.
L’article L. 131-6 du code de l’éducation impose aux maires de dresser la liste de tous les enfants soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire « les enfants français et étrangers, entre six ans et seize ans » (article L. 131-1) et résidant dans leur commune. La loi oblige les « personnes responsables », c’est-à-dire les parents et tuteurs, à y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. L’inscription repose donc sur une démarche volontaire de ces personnes.
En application de l’article R. 131-3 du même code, cette liste est établie chaque année à la rentrée scolaire et mise à jour le premier de chaque mois. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant ainsi que les nom, prénom, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
Les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent, par ailleurs, déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité municipale, l’inspecteur d’académie, le directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
Aucune précision supplémentaire ne vient interférer dans la libre administration des communes : le maire peut donc choisir librement la forme de cette liste. Néanmoins, il doit informer la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de l’existence de ce fichier.
Le projet de loi propose d’enrichir cette liste en y ajoutant des données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire provenant de la caisse d’allocations familiales et de l’inspection académique. Le Sénat a ajouté les données fournies par le directeur de l’école ou le chef d’établissement en cas d’exclusion temporaire ou définitive ou d’abandon de l’école en cours d’année.
Le projet de loi permet également aux maires de mettre en place un traitement automatisé de ces données. Actuellement, en effet, pour vérifier la concordance entre la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire, qui est établie sur déclaration des parents, et les listes d’inscription dans les écoles qui sont communiquées chaque mois aux maires, un travail de recoupement doit être effectué par les services municipaux. Le dispositif législatif proposé facilitera ainsi grandement la vérification du respect de l’obligation scolaire par les enfants domiciliés dans la commune.
L’alinéa 6 de l’article renvoie la détermination de la nature des données transmises aux maires et leur durée de conservation, à un décret en Conseil d’État, soumis à l’avis préalable de la CNIL.
Les alinéas 9 et 11 prévoient de fournir aux maires deux types de données à caractère personnel nouvelles :
– les directeurs d’établissement scolaire doivent informer le maire de la commune où est domicilié l’enfant concerné des demandes qu’ils adressent à l’inspecteur d’académie tendant à envoyer aux parents ou responsables de l’enfant un avertissement en cas d’absence scolaire ;
– l’inspecteur d’académie communique au maire la liste des enfants domiciliés dans sa commune pour lesquels un avertissement a été notifié.
3. Le statut des Écoles de la deuxième chance (E2C) et des Lycées de toutes les chances
Le 6° de l’article résulte d’un amendement défendu par M. Jean-Marie Bockel et cosigné par les membres du groupe socialiste et adopté sur l’avis favorable de la commission et du gouvernement. Il tend à donner un statut et une consécration législative aux Écoles de la deuxième chance et aux Lycées de toutes les chances.
L’idée de créer des Écoles de la deuxième chance date de 1995 et revient à Mme Edith Cresson, alors commissaire européenne chargée de l’éducation. Elles s’adressent aux jeunes âgés de 18 à 25 ans en situation d’échec scolaire – chaque année, entre 60 000 et 70 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification et sans diplôme – et sans expérience professionnelle. Leur objectif est de les aider à acquérir ou à compléter des compétences de base afin de pouvoir engager une formation ou leur permettre de trouver un emploi. Elles s’appuient sur un partenariat fort avec les entreprises et reposent sur un principe de validation des compétences personnelles et professionnelles.
Aucun critère de sélection n’entre en jeu pour s’inscrire dans ces écoles. Seule la motivation des candidats est prise en compte. Le processus d’admission comporte des réunions d’information étalées sur un mois. Au terme de ce processus, le parcours de formation débute et dure environ quarante-six semaines, dont seize de stage. Cette formation est rémunérée au minimum 350 euros selon l’expérience de l’élève.
Plus de 1 500 jeunes sont aujourd’hui formés dans les douze écoles françaises de la deuxième chance. Leur moyenne d’âge est de vingt ans ; 92 % ont un niveau CAP, 53 % n’ont aucune expérience professionnelle.
Le Lycée de toutes les chances est la transposition, depuis 1998, de ces principes aux publics des lycées.
Le dispositif législatif adopté par le Sénat assure la reconnaissance du diplôme de fin d’étude délivré par les Écoles de la deuxième chance et les Lycées de toutes les chances. Il prévoit le concours de l’État et des régions aux formations agréées selon des conditions déterminées par convention, comme cela est pratiqué actuellement.
*
La commission a examiné un amendement de Mme Christine Boutin précisant que la communication au maire de la liste des élèves domiciliés dans la commune est effectuée « à titre d’information ».
Mme Christine Boutin a expliqué que cet amendement répond toujours au même objectif de clarification des rôles, en l’espèce entre le maire et l’éducation nationale. À terme, cette loi risque de conduire à une centralisation de tous les pouvoirs locaux entre les mains du maire, ce qui représentera un profond changement institutionnel.
Le rapporteur s’est interrogé sur la portée de l’amendement sans s’opposer à son adoption, dans la mesure où le dispositif du traitement automatisé mis en place par le projet de loi vise déjà à améliorer l’information du maire.
La commission a adopté l’amendement.
La commission a ensuite examiné un amendement de Mme Christine Boutin disposant que la liste des élèves auxquels un avertissement a été notifié ne peut être communiquée qu’aux personnes habilitées à la connaître.
Mme Christine Boutin a souligné que le partage nécessaire de certaines informations doit être concilié avec la protection de leur confidentialité : c’est le « secret partagé ».
M. René Couanau, président, a regretté que l’on jette en permanence la suspicion sur les maires.
M. Jean-Marie Le Guen a estimé qu’en l’occurrence il ne s’agissait pas de suspicion mais de protection des maires.
Le rapporteur a déclaré partager cette analyse après avoir observé que le maire est l’unique destinataire de la liste des élèves en question. La précision apportée par l’amendement pourrait jeter un doute sur l’utilisation de cette liste.
La commission a rejeté l’amendement.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 9 ainsi modifié.
Article 17
Réorganisation du contrôle administratif
des documents électroniques à caractère pornographique ou violent –
Protection des mineurs contre la pédophilie sur Internet
Cet article contient deux ensembles de dispositions : le I réforme la procédure d’interdiction des vidéocassettes, vidéodisques, CD, DVD, cartes mémoires et autres supports de stockage des images, films et vidéos à caractère pornographique ou violent ; le II vise à réprimer les sollicitations sexuelles adressées aux mineurs de quinze ans par un moyen de communication électronique.
1. La signalisation des supports contenant des documents pornographiques
Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ont interdit de mettre à disposition du public mineur des documents fixés sur un support à lecture électronique lorsqu’ils présentent un caractère pornographique, qu’ils mettent en avant le crime, la violence, la discrimination ou la haine raciales ou qu’ils incitent à l’usage, la détention ou le trafic de stupéfiants. L’interdiction peut également porter sur la publicité faite à ces documents hors des lieux interdits d’accès aux mineurs. En application de cette loi, tout document fixé sur un tel support doit être examiné par une commission administrative qui rend un avis sur l’opportunité d’une mesure d’interdiction, l’interdiction étant prononcée par arrêté ministériel.
Le gouvernement propose de refondre l’ensemble du dispositif qui s’est révélé peu opérationnel. La commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d’interdiction ne s’est en effet réunie qu’une dizaine de fois depuis sa mise en place et s’est trouvée dans l’incapacité de procéder à l’examen des dizaines de milliers de supports électroniques mis sur le marché chaque année.
Le projet de loi propose donc de supprimer cette commission consultative et de donner à l’autorité administrative le pouvoir de prendre directement une mesure d’interdiction de mise à disposition des mineurs, de publicité hors des lieux interdits d’accès aux mineurs et – mesure nouvelle – d’exposition de ces documents à la vue du public hors des lieux interdits d’accès aux mineurs.
En outre, pour renforcer le contrôle des documents à caractère pornographique, le projet de loi met en place une obligation d’imprimer la mention suivante sur les unités de conditionnement de ces documents : « mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ».
De surcroît, il impose la présence d’une signalétique spécifique, dont les caractéristiques seront définies par l’autorité administrative, sur les documents présentant un danger pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou la haine raciales ou encore à l’incitation à l’usage, la détention ou le trafic de stupéfiants. Cette signalétique s’appliquera en fait aux supports et aux unités de conditionnement car le document est de nature électronique et doit être déchiffré par un appareil électronique pour être visible. Il n’est pas dans l’intention du législateur de faire apparaître en permanence sur l’écran de lecture du document cette signalétique. Cette signalétique constitue un avertissement au moment de l’achat ou de la cession du document ; elle doit donc être visible sans exiger la lecture du document même par un appareil électronique de déchiffrage analogique ou numérique. La dernière phrase de l’alinéa 3 est d’ailleurs claire sur les objectifs de cette signalétique : « limiter la mise à disposition [des documents visés] à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge »
Selon les mêmes principes qu’a appliqués le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la diffusion des programmes de télévision, un logo signalisera l’interdiction aux mineurs, lorsque le document aura un caractère pornographique, ou le caractère fortement déconseillé d’une mise à disposition des mineurs. Le logo sera donc décliné en tranches d’âge à l’instar de ce qui est pratiqué pour la diffusion audiovisuelle qui a repris les préconisations des médecins, pédopsychiatres, sociologues et assistants sociaux chargés de la protection de l’enfance (– 18 ans, – 16 ans, – 12 ans et – 10 ans). Le système PEGI (Pan european game information) a ainsi mis en place un découpage en cinq tranches : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+.
Cette réforme est vivement demandée depuis cinq ans par les associations familiales et de protection de l’enfance. Elle constitue un moyen d’information des parents et des commerçants de nature à contenir les dérives violentes engendrées par la surconsommation des vidéos et jeux sollicitant les instincts les plus bas du public.
Le projet de loi maintient par ailleurs les quantums de peines applicables en cas de violation des interdictions (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ; peines doublées en cas d’utilisation d’un artifice visant à éluder l’application de la loi). Il maintient également le régime spécial applicable aux œuvres cinématographiques.
Le rapporteur estime que la refonte des articles 32 à 39 de la loi du 17 juin 1998 est l’occasion de réexaminer des dispositions pénales aujourd’hui datées compte tenu de l’évolution des technologies numériques.
Tout d’abord, en 1997 et 1998, le législateur a défini les supports des documents à caractère pornographique ou violent par référence à des concepts liés à des produits technologiques précis : « document fixé soit sur un support magnétique, soit sur un support numérique à lecture optique, soit sur un support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique ». Cette définition n’a pas été modifiée depuis la promulgation de la loi du 17 juin 1998.
Le support magnétique vise les cassettes VHS. Le support numérique à lecture optique vise les CD, DVD, vidéodisques dont la surface possède des pistes de trous dont la lecture par un laser stimulant en réflexion une cellule photoélectrique permet de les faire correspondre, selon un procédé électronique, à des données numériques. Le support semi-conducteur vise les cartes électroniques utilisées notamment dans les boîtiers de jeux électroniques. La référence dans la loi au « jeu électronique » est d’ailleurs déplacée puisque le jeu électronique n’est pas un support mais le document lui-même fixé sur un support. En outre, la référence au concept de support semi-conducteur apparaît juridiquement mal adaptée car un semi-conducteur ne caractérise pas la capacité d’un support à stocker des informations : un semi-conducteur est un composant électrique ou électronique contenant une résistance ; c’est le composant essentiel des transistors. Or tous les supports auxquels la loi fait référence sont avant tout des supports permettant le stockage de données et leur lecture par un procédé électronique. La lecture de ces données peut se faire selon un procédé analogique (lecture d’une bande magnétique où sont directement stockés les images et les sons) ou un procédé numérique (lorsque les images et les sons sont convertis en codes numériques).
Une amélioration de la rédaction du dispositif légal est donc possible et opportune afin d’assurer la pertinence de la loi au regard des technologies électroniques de stockage des informations.
2. La répression des sollicitations sexuelles par moyen de communication électronique
Comme il a été montré dans l’introduction du présent rapport, il est indispensable de donner à la police judiciaire les moyens de combattre la délinquance sexuelle visant les mineurs sur Internet.
Le projet de loi crée, à cette fin, une nouvelle infraction pénale : « faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique » (nouvel article 227-22-1 du code pénal). La mention de la personne se présentant comme étant mineure de quinze ans vise à permettre aux officiers et agents de police judiciaire de participer aux échanges électroniques en prenant une fausse identité sans être pénalement responsable et tout en permettant la poursuite des auteurs des sollicitations qu’ils recevraient. L’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende en cas de sollicitation suivie d’une rencontre. Comme les enquêtes l’ont montré (cf. introduction), ce fait aggravé n’est pas anecdotique.
La sollicitation doit utiliser un moyen de communication électronique. Ce type de moyen dépasse le seul cadre des communications par Internet qui relèvent d’un procédé de communication au public en ligne. La communication au public en ligne est une « transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur » (article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique). La communication électronique est définie par l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et ses services incluent les services communication au public par voie électronique et les services de communication ayant le caractère de correspondance privée ; sont donc compris dans le champ des services de communications électroniques – et donc de l’infraction pénale – la téléphonie vocale fixe ou mobile, la transmission de SMS, MMS et de données sur les réseaux téléphoniques et la transmission de courriers électroniques.
Le projet de loi permet également de rassembler les preuves des infractions et d’en rechercher les auteurs en autorisant la police judiciaire à participer sous un nom d’emprunt aux échanges électroniques, à contacter par voie électronique les auteurs des infractions et à extraire et conserver les contenus illicites. Le projet de loi ne permet toutefois pas que ces manœuvres prennent la forme d’une incitation à commettre l’infraction poursuivie. Est ainsi, pour la première fois, autorisée la pratique du « sous-marin » pour traquer les délinquants sur les réseaux de communication.
*
La commission a examiné un amendement de simplification rédactionnelle présenté par le rapporteur et portant sur la définition des différents types de supports électroniques de documents.
Le rapporteur a indiqué sa préférence pour une formulation la plus générale possible afin d’anticiper les évolutions technologiques.
La commission a adopté l’amendement.
La commission a également adopté deux amendements de clarification rédactionnelle du rapporteur concernant la fixation de la mention d’interdiction et de la signalétique sur les supports électroniques et leurs unités de conditionnement.
Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la faculté pour le ministère de l’intérieur d’interdire la location ou la vente aux mineurs de documents fixés sur un support électronique qui est prévue par le projet de loi uniquement en cas de non-respect des obligations relatives à la signalétique de protection de la jeunesse. Une telle interdiction pourrait être prononcée en opportunité dans le cas où ces documents présenteraient un risque pour la jeunesse au regard des différents critères retenus par le présent article 17, notamment en cas de sous-évaluation de la signalétique.
Enfin, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le IV de l’article dans une nouvelle rédaction pour assurer la coordination de certains articles du code pénal avec le cadre juridique des communications électroniques défini par la loi n° 2044-669 du 9 juillet 2004.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 17 ainsi modifié.
La commission a examiné un amendement de M. Bruno Gilles obligeant les fournisseurs d’accès à internet à mettre en œuvre des dispositifs techniques activés par défaut qui permettent d’empêcher l’accès à des contenus en ligne mettant en péril les mineurs.
M. Dominique Tian a rappelé qu’en novembre 2005, tous les fournisseurs d’accès se sont engagés à fournir à leurs abonnés, à partir du 31 mars 2006, des logiciels de contrôle parental gratuits et efficaces. Il apparaît que, sur de multiples points, cet accord n’est pas respecté par les intéressés. C’est pourquoi il est légitime que le législateur intervienne.
Le rapporteur a déclaré comprendre les intentions des auteurs de l’amendement, mais a mis en avant la nécessité de vérifier sa compatibilité avec la directive communautaire du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information. En particulier, l’article 15 de cette directive interdit aux États membres d’imposer aux fournisseurs d’accès une obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent. La directive ne permet pas non plus à ces fournisseurs de dresser des listes noires d’interdiction d’accès, compétence qui appartient exclusivement aux Etats. Cet amendement doit donc être réexaminé et éventuellement réécrit.
M. Jean-Marie Le Guen a indiqué que le groupe socialiste fera des propositions sur cette question. Effectivement, on ne peut concevoir que ce soient les opérateurs qui établissent les listes noires : ce serait de la discrimination commerciale. Ce qui est en cause, c’est la responsabilité de l’État.
M. Dominique Tian n’ayant pas souhaité retirer l’amendement, la commission l’a rejeté.
Article 18
Renforcement du contrôle des sorties d’essai des établissements psychiatriques
Le présent article vise à mieux assurer le contrôle des personnes qui, dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement, bénéficient de sorties d'essai en modifiant l’article L. 3211-11 du code de la santé publique.
Ces sorties d'essai ont pour objet de favoriser la guérison, la réadaptation ou la réinsertion sociale des intéressés. Elles peuvent notamment se dérouler au sein d'équipements et de services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet. La sortie d’essai se caractérise par une obligation de soins et comporte une surveillance médicale assurée par le secteur psychiatrique compétent.
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation a précisé le régime des sorties d'essai, consacrant ainsi des pratiques qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire (une circulaire de 1957 prévoyait cette possibilité d’alternative à l’hospitalisation permanente).
La sortie d'essai est assortie de plusieurs garanties destinées à vérifier que cet aménagement du traitement médical est compatible avec l'état de santé de la personne et les considérations de sécurité.
Ces garanties concernent d'abord la décision de sortie d'essai, son renouvellement et sa cessation. Deux cas de figure doivent être distingués :
– dans l'hypothèse d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, la décision appartient à un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au représentant de l'Etat dans le département ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
– dans l'hypothèse d'une hospitalisation d'office, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ailleurs, la sortie d'essai est limitée à trois mois, renouvelable. Dans les faits, il est courant de rencontrer des patients qui sont sous ce régime transitoire depuis plusieurs années, aucune limite n’ayant été prévue pour les renouvellements des sorties d’essai.
Le projet de loi prévoit de modifier le régime actuel des sorties d’essai sur deux points :
– la décision de sortie devra désormais préciser l'identité du malade, l'adresse de sa résidence habituelle ou de son lieu de séjour, le calendrier des visites médicales obligatoires ainsi que, le cas échéant, son numéro de téléphone et la date du retour dans l'établissement psychiatrique ;
– le maire de la commune où est implanté l'établissement et celui de la commune de résidence ou de séjour du patient devront être informés dans les vingt-quatre heures de toute décision de sortie d'essai d'un malade hospitalisé d'office.
Ces deux aménagements de la procédure de la sortie d’essai ont été préconisés par le rapport de mai 2004 de la mission conjointe de l'Inspection générale de l’administration (IGA), de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l'Inspection de la gendarmerie nationale (IGN) sur les problèmes de sécurité liés aux régimes d'hospitalisation sans consentement.
Il y était proposé que la décision de sortie d'essai précise les conditions de son déroulement, soit « l'identité du malade, la date du retour à l'hôpital et le calendrier des visites médicales obligatoires, l'adresse de sa résidence habituelle et celle de son séjour durant la sortie, le nom du médecin de secteur chargé du suivi médical, (...) une clause de réintégration à l'hôpital au terme normal de la sortie ou à tout moment sur proposition du médecin traitant », ces deux dernières mentions n'étant pas reprises dans le projet de modification de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique.
Par ailleurs, ce même rapport préconisait que les maires soient informés des sorties d'essai liées aux hospitalisations d'office qui se déroulent sur le territoire de leur commune ou concernent un patient qui y a sa résidence. Il était aussi conseillé que le préfet en informe les services de police et de gendarmerie, cette disposition ne nécessitant toutefois pas de traduction législative mais pouvant prendre la forme d’une instruction ministérielle aux préfets.
Selon les informations communiquées par le ministère de l’intérieur, une partie importante des personnes hospitalisées sous contrainte sont placées sous le régime de la sortie d’essai : 65 % pour les hospitalisations d’office relevant de la préfecture de police de Paris et 50 % pour les autres départements.
Les propositions de modifications du régime des sorties d'essai se justifient par le constat suivant : aujourd'hui, la majorité des sorties d'essai relèvent davantage de l'obligation de soins en milieu ambulatoire, sous peine de réhospitalisation, que de réinsertion. Le patient voit alors son autorisation de sortie se prolonger plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui est propice aux fugues et à la rupture de traitement. Or, en l'absence d'un suivi efficace – les médecins alertent rarement les autorités lorsqu'un malade ne suit plus son traitement –, il est fréquemment procédé à la levée de la décision d'hospitalisation lorsque le patient ne se conforme plus à ses obligations, ce qui est particulièrement problématique dans le cas de patients hospitalisés d'office.
L'information systématique du maire et le fait de disposer de données précises sur la localisation du malade pendant la sortie permettront d'améliorer le suivi du dispositif et d'en éviter les effets pervers. En cas de fugue, l'alerte pourra ainsi rapidement être donnée.
Cette disposition complète l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, qui prévoit déjà que le maire de la commune de résidence du patient est informé par le préfet dans les vingt-quatre heures en cas d'hospitalisation d'office, de renouvellement ou de sortie définitive.
Le rapporteur approuve les modifications apportées au régime des sorties d’essai, le renforcement des contrôles n’ayant pas comme unique objectif de prévenir des troubles à l’ordre public mais tenant également compte de l'intérêt des malades : mieux connaître la situation des personnes placées sous le régime des sorties d'essai permettra de leur apporter plus rapidement une assistance adaptée s’il est avéré que l’obligation de soins n’est pas respectée.
Le rapporteur estime par ailleurs justifié l’amendement présenté par la commission des affaires sociales du Sénat, qui a supprimé le 1° de l’article 18 qui énumérait les précisions que devait comporter la décision de sortie, ces informations ne relevant pas du domaine de la loi mais du règlement.
*
La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de M. Jean-Marie Le Guen.
M. Jean-Marie Le Guen, après avoir précisé que son argumentation vaut pour la série d’amendements de suppression qui va suivre sur les articles 18 à 24, a indiqué que les dispositions relatives à l’hospitalisation psychiatrique sans consentement n’ont pas leur place dans un texte traitant de la prévention de la délinquance. Ces mesures reposent en effet sur un amalgame entre troubles mentaux, dangerosité et délinquance et stigmatisent les patients et la psychiatrie. Il faut rappeler que la principale recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en matière de santé mentale est précisément la lutte contre la stigmatisation. Il s’agit d’un véritable problème de santé publique car la stigmatisation et la criminalisation aboutiraient à la rétraction des malades, de leur entourage et des médecins face à une logique punitive qui nous ferait basculer dans le XIXè siècle. Aucune urgence n’exige que des dispositions relatives à la psychiatrie et à la réforme de la loi de 1990, devenue indispensable, figurent dans le présent projet de loi alors qu’un texte distinct pourrait être examiné en première lecture, après une large concertation, au début de l’année prochaine.
M. René Couanau, président, a précisé que tous les commissaires s’interrogent à propos de la procédure alternative envisagée qui consisterait à autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance.
Le rapporteur ayant émis un avis défavorable, la commission a rejeté l’amendement.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 18 sans modification.
Article 19
Création d’un fichier national des hospitalisations d’office
Cet article met en place un traitement national des données à caractère personnel, placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé, destiné à améliorer le suivi et l’instruction des mesures d’hospitalisation d’office.
Les lacunes des sources d’informations existantes sur les personnes ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office ont été soulignées par différents rapports et tout particulièrement par de celui de M. Jean Paul Garraud, député, qui a été chargé d’une mission d’information par le Premier ministre sur l’évaluation de la dangerosité des auteurs d’infractions pénales atteints de troubles mentaux (12). Il apparaît en effet que les fichiers existants ont été créés dans un cadre départemental sous la responsabilité des directions départementales de l’action sanitaire et sociale sans qu’aucune interconnexion ne soit possible. De plus, la durée de conservation des données est limitée à un an après la décision de levée de l’hospitalisation sans consentement.
Plusieurs affaires criminelles récentes ont démontré les lacunes de notre système de suivi des personnes qui ayant connu de graves troubles mentaux peuvent présenter un danger pour la sécurité de leurs concitoyens car ils sont susceptibles de comportements violents plusieurs années après la période durant laquelle ils ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office ou d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Les lacunes du système actuel sont d’autant plus patentes que des divergences d’interprétation sont apparues entre le ministère de la santé et le ministère de l’intérieur sur le point de savoir si les préfets pouvaient avoir directement accès aux fichiers départementaux des hospitalisations sous contrainte, dits fichiers « hopsy ».
Un bref rappel de la mise en place des fichiers Hopsy s’avère utile pour démontrer l’opportunité de la réforme proposée.
L'arrêté du 19 avril 1994 relatif à l'informatisation du suivi des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et au secrétariat des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques a créé les fichiers Hopsy, qui regroupent au niveau de chaque département les données relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers.
Ces fichiers ont, depuis lors, été progressivement mis en place dans les départements sous la responsabilité de la DDASS, qui en assure la gestion. Toutefois, leur création n'est pas obligatoire et toutes les DDASS n'ont pas à ce jour développé d'application Hopsy. Selon le rapport précité de M. Jean Paul Garraud, une cinquantaine seulement de départements a mis en place un fichier informatisé mais une refonte de l’application informatique est prévue pour permettre la généralisation des fichiers Hopsy au cours de l’année 2007.
Par ailleurs, l'intérêt des bases de données Hopsy est limité pour les autorités, dans la mesure où les fichiers départementaux existants ne sont pas interconnectés. Il est donc impossible de vérifier une information relative à un patient hospitalisé dans un autre département.
En outre, des divergences sont apparues entre le ministère de la santé et celui de l’intérieur dans le cadre de la réglementation sur les autorisations de détention d’arme.
En 2002, le ministre de l'intérieur a attiré l'attention des préfets sur les conditions de délivrance des autorisations de détention d'armes en leur demandant notamment de procéder à la vérification des décisions antérieures d’autorisation de détention d’armes pour la même personne et de consulter lorsqu'il existe, le traitement informatisé d'informations nominatives gérées par la DDASS (fichier Hopsy), pour s’assurer que le demandeur n’a pas été soigné pour de graves troubles psychiatriques.
Par ailleurs, une circulaire du ministère de la santé en date du 3 mai 2002 a précisé les modalités de cette consultation : « la demande de consultation du fichier Hopsy doit porter sur des demandes nominatives (...) et la consultation doit être opérée par les soins de la DDASS, ce qui exclut que les fichiers des personnes hospitalisées sans leur consentement, Hopsy ou manuels, puissent être mis à la disposition des services de la préfecture ».
La position du ministère de la santé se fondait alors, d'une part, sur le principe posé par la loi du 27 juin 1990 selon lequel une personne hospitalisée sans son consentement, en raison de troubles mentaux, conserve ses droits et ses devoirs de citoyen, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés (article L. 3211-5 du code de la santé publique) et, d'autre part, sur la protection du secret professionnel (articles 226-13 et 226-14 du code pénal).
Il semble cependant que la position défendue par le ministère de la santé soit plus restrictive que celle retenue alors par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
En effet, dans son rapport d'activité 2001, celle-ci rappelle que « le préfet et les services placés sous son autorité chargés d'instruire les demandes de port d'armes sont bien sûr habilités à avoir accès [...] aux informations détenues par la DDASS [...] La CNIL a autorisé la mise en œuvre de tels fichiers tant par les DDASS pour les personnes hospitalisées d'office que par les préfectures pour les détenteurs d'armes. Les uns et les autres sont bien entendu accessibles au préfet et à ses services compétents. »
En pratique, il semble que les DDASS fassent preuve de réticence à communiquer les informations qu'elles détiennent, fussent-elles de nature strictement administratives alors même qu’elles se trouvent sous l’autorité hiérarchique du préfet.
Ce cloisonnement de l'information et l'absence de fichiers dans certains départements compliquent singulièrement le suivi des mesures d'hospitalisation sans consentement et ne permettent pas toujours d'assurer efficacement la sécurité publique.
La création d’un fichier national des hospitalisations d’office devrait permettre de résoudre ces difficultés.
Afin de remédier aux insuffisances des fichiers Hopsy et de permettre aux autorités concernées de disposer des mêmes données sur l'ensemble du territoire et de pouvoir y accéder directement, l’article 18 du projet de loi complète le chapitre du code de la santé publique relatif à l'hospitalisation d'office par un article L. 3213-9-1 nouveau portant création d'un fichier national des hospitalisations d'office.
Le fichier ainsi créé est un traitement national de données à caractère personnel placé sous l'autorité du ministre chargé de la santé. Il est destiné à améliorer le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office. À cet effet, il regroupe, pendant la durée de l'hospitalisation et jusqu'à la cinquième année suivant la sortie du patient, les données relatives à la situation administrative des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de ce type.
Il ne comprend, en revanche, aucune autre donnée personnelle de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, soit des informations « à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci », autres que celles en rapport avec la situation administrative des individus concernés.
Les personnes autorisées à accéder directement, par des moyens sécurisés, aux informations contenues dans les fichiers sont le préfet, le préfet de police à Paris, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ainsi que les personnes habilitées par leurs soins.
Par ailleurs, l'autorité judiciaire, comprise ici comme l'ensemble des magistrats exception faite du procureur qui accédera directement aux informations, est également destinataire de ces données lorsqu'elle en fait la demande.
Le fichier ne fait, en outre, l'objet d'aucune mise à disposition, rattachement ou interconnexion avec d'autres traitements de données personnelles, comme c’est déjà le cas par exemple pour le fichier relatif aux délinquants sexuels.
Afin de mieux garantir la confidentialité des informations contenues dans ce fichier national, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour la commission des lois au Sénat a fait adopter un amendement visant à préciser que les autorités concernées ne peuvent bénéficier de l'accès direct au fichier que dans le cadre de leurs attributions en matière d'hospitalisation d'office et que les personnes habilitées par ces autorités pour connaître des informations du fichier doivent être nominativement désignées. L’habilitation ne vise donc pas une fonction mais une personne désignée à titre individuel.
La deuxième partie de cet article traite de la consultation de ce fichier dans le cadre de la réglementation sur l’acquisition ou la possession de certaines armes.
Il est ainsi précisé que le représentant de l'Etat dans le département et le préfet de police à Paris peuvent consulter le traitement relatif aux hospitalisations d'office dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des première et quatrième catégories ou de détention d'armes des cinquième et septième catégories.
Aux termes de l'article L. 2336-3 du code de la défense, toute personne sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions, ou faisant une déclaration de détention d'armes des catégories susmentionnées, doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces biens. Dans le cas où le demandeur suit ou a suivi un traitement psychiatrique, il doit également produire un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
Afin de préserver les droits des personnes dont il sera fait mention dans ce fichier national il est prévu qu’un décret pris après avis de la CNIL précisera les modalités de mise en œuvre de ce fichier. Ce décret devra notamment préciser :
– la nature des données à caractère personnel enregistrées ;
– la nature des données à caractère personnel susceptibles d'être consultées dans le cadre de la réglementation sur les armes ;
– les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès ;
– les modalités d'alimentation du fichier national, de sa consultation et de mise à disposition des données ;
– les conditions de sécurisation des informations et en particulier d'habilitation des personnels à accéder au fichier et à demander la communication des données.
Le rapporteur approuve la création de ce fichier national mais il attire l’attention sur le fait que, pour constituer un outil efficace, ce nouveau fichier devra être tenu strictement à jour par les DDASS.
Le préfet détenant, en matière d'hospitalisation d'office le pouvoir de décision, il paraît logique et conforme aux principes de la loi du 6 janvier 1978 précitée qu'il puisse bénéficier d'un accès direct à ce fichier national. La DDASS n'exerce dans ce domaine qu'un rôle d'instruction et de suivi. En outre, elle est placée sous l'autorité du préfet : il serait paradoxal d'interdire au préfet l'accès direct au fichier en en réservant l'exclusivité au directeur d'un service départemental.
En conclusion, le rapporteur tient à préciser que la mise en œuvre de ce nouvel outil ne doit pas conduire à la suppression des fichiers Hopsy, dont il faudrait améliorer le fonctionnement en permettant au moins une interconnexion, voire une refonte totale. En effet, ils concernent l'ensemble des personnes hospitalisées sans consentement, et pas seulement celles internées d'office, et constituent à ce titre une information utile, notamment à des fins statistiques pour mesurer l’évolution des soins sous contrainte.
*
Pour des motifs identiques à ceux évoqués précédemment, la commission a rejeté deux amendements de suppression de l’article présentés par M. Jean-Marie Le Guen et Mme Christine Boutin.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 19 sans modification.
Article 20
Recours obligatoire à l’hospitalisation d’office en cas d’atteintes à la sûreté des personnes ou à l’ordre public
Cet article a pour objectif de clarifier les conditions d’application respectives des deux régimes d’hospitalisation sous contrainte : l’hospitalisation d’office (HO) et l’hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT). Il restreint le champ de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en interdisant le recours à cette procédure si le comportement du patient compromet la sûreté des personnes ou porte une atteinte grave à l’ordre public.
L'hospitalisation sur demande d'un tiers ne peut intervenir qu'à deux conditions cumulatives : les troubles dont la personne est atteinte rendent impossible son consentement ; son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (article L. 3212-1 du code de la santé publique).
L'hospitalisation d'office peut être décidée par le préfet si, d'une part, l'intéressé nécessite des soins et, d'autre part, les troubles mentaux dont il est atteint compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public (article L. 3213-1 du code pénal).
Cependant dans la pratique les patients qui auraient dû être hospitalisés sous le régime de l’hospitalisation d’office, car leur comportement représente un danger manifeste pour la sûreté des personnes, bénéficient souvent de la procédure de l’hospitalisation à la demande d’un tiers. Cette tendance s’explique par de multiples facteurs et les derniers rapports rendus sur la prise en charge des malades psychiatriques relèvent tous ce phénomène d’évitement du recours à la procédure d’hospitalisation d’office. C’est ainsi que le rapport commun à l’Inspection générale de l’administration (IGA), à l’Inspection générale des services judiciaires (IGSJ) et à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la prise en charge des patients susceptibles d’être dangereux constate : La prise en compte de la dangerosité des patients hospitalisés sous contrainte fait souvent l’objet de décisions contestables. La facilité pousse à recourir très souvent à la procédure d’HDT alors que l’hospitalisation d’office s’imposerait. Ce choix prive par la suite le représentant de l’Etat de l’exercice plein et entier de sa responsabilité. Il est démuni face à des sorties d’essai ou des sorties accompagnées accordés pour de tels patients et dont les régimes juridiques sont insuffisamment définis. (13)
La procédure d'hospitalisation d'office, jugée complexe (recours au maire et/ou au préfet) et stigmatisante par les acteurs sanitaires et sociaux, est souvent utilisée en dernier recours, ce qui conduit à hospitaliser des personnes dangereuses à la demande d'un tiers, voire avec leur consentement. Cette observation est d'autant plus vraie que ces services sont de plus en plus souvent amenés à agir dans l'urgence, leur objectif principal étant alors le dénouement rapide de la crise.
Cette mauvaise prise en charge n'est que rarement corrigée par la suite par les services préfectoraux, souvent trop peu informés des situations individuelles par la DDASS et les établissements psychiatriques, même si théoriquement une procédure existe. En effet, les articles L. 3212-9 et L. 3213-6 du code de la santé publique prévoient, dans un souci de préservation de l'ordre public, que lorsqu'une personne hospitalisée à la demande d'un tiers répond aux critères de l'hospitalisation d'office, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. Cette décision doit être confirmée dans les quinze jours au vu d’un certificat médical circonstancié. À défaut, l’hospitalisation d’office devient caduque.
Au total, il apparaît que de nombreux malades dangereux pour eux-mêmes et pour les autres ne sont pas pris en charge sous un régime qui correspond à leur pathologie mais qui dépend largement des circonstances de leur admission à l’hôpital.
Cette situation est particulièrement préoccupante s'agissant du régime des sorties. Dans le cas d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, le préfet n'a qu'une compétence réduite en matière de sortie définitive du patient. Elle est en effet décidée par un psychiatre de l'établissement en cas de disparition des troubles ou par le préfet si les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. Dans tous les cas, la sortie est de droit lorsque le curateur, le conjoint, un membre de la famille en l’absence de conjoint, le tiers qui a signé la demande d'admission ou la commission départementale des hospitalisations psychiatrique en fait la demande.
Le rapporteur est favorable au principe d'une séparation stricte entre les deux régimes d'hospitalisation sans consentement, qui permettra d'assurer une prise en charge adaptée des personnes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.
*
La commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Marie Le Guen et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 20 sans modification.
Article 21
Renforcement du rôle du maire dans la procédure de l’hospitalisation d’office
Cet article vise à transférer au maire la compétence de principe pour prononcer une décision d’hospitalisation d’office sous réserve d’en référer au préfet du département dans les 24 heures de la prise de décision.
Actuellement ce pouvoir est attribué au préfet. En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office est prononcée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police, au vu d'un certificat médical dressé par un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil du malade.
Les arrêtés préfectoraux doivent être motivés et énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Le pouvoir du préfet est donc conditionné à la production d'un certificat médical conforme. Il dispose cependant d’un pouvoir d’appréciation : il peut refuser l'hospitalisation même si le certificat la rend possible.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet un certificat médical, établi par un psychiatre de l'établissement, au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques.
Cependant, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, l'article L. 3213-2 prévoit que le maire, ou un commissaire de police à Paris, arrête les mesures provisoires nécessaires à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes.
Le maire, ou le commissaire de police, doit ensuite en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office. Faute de décision de sa part, les mesures provisoires sont caduques après quarante-huit heures.
Dans les faits, et compte tenu de la proportion majoritaire d'hospitalisations d'office prononcées dans l'urgence sur les lieux de la manifestation publique de troubles mentaux (60 %), il apparaît que la procédure de l'article L. 3213-2 est plus souvent utilisée que le dispositif ordinaire. Ainsi, 65 % des hospitalisations d'office sont aujourd'hui précédées d'une intervention d'un commissaire de police à Paris.
Pour tenir compte de cette évolution, qui fait du maire l’autorité de proximité qui doit régler dans l’urgence les situations de crise portant atteinte à l’ordre public, cet article modifie la procédure d’hospitalisation d’office en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 3213-1 et en supprimant le dispositif dérogatoire de l'article L. 3213-2 (procédure d’urgence).
Désormais, l'hospitalisation d'office est prononcée, dans tous les cas, par arrêté motivé du maire ou, à Paris, d'un commissaire de police, au vu d'un certificat médical ou, en cas d'urgence, d'un avis médical. Le préfet doit être informé du placement dans les vingt-quatre heures ; il conserve les missions qui lui sont actuellement dévolues pour la suite de l'hospitalisation.
Les conditions justifiant de l’hospitalisation d’office restent inchangées : les troubles mentaux dont souffre le patient doivent requérir des soins urgents et la sûreté des personnes ou l’ordre public doivent se trouver menacés.
Lorsque l'avis médical ne peut être rendu ou que le placement ne peut être immédiat, l'individu est retenu, « le temps strictement nécessaire et justifié », dans une structure médicale adaptée. Il s'agit, le plus souvent, de l'infirmerie de la préfecture.
Tout en transférant la compétence de principe en matière d’hospitalisation d’office au maire, le texte préserve les compétences du préfet au stade initial de la procédure : en cas de nécessité le préfet peut toujours décider une hospitalisation d'office. Le Sénat a adopté un amendement précisant que lorsque le préfet est amené à prendre une décision initiale d'hospitalisation d'office à la place du maire, celle-ci doit reposer sur des critères médicaux et d'ordre public identiques (arrêté motivé, certificat ou avis médical, double condition de soins nécessaires et de troubles à l’ordre public).
En l'absence de confirmation par le préfet après expertise médicale, le placement est caduc au terme de soixante-douze heures. Cette durée peut être inférieure si l'hospitalisation est levée sur décision du préfet ou du préfet de police à Paris.
Le rapporteur tient à souligner que cet article représente un véritable progrès pour le respect des droits des patients. En effet, en supprimant la possibilité de prononcer une mesure provisoire sur le fondement de la notoriété publique, cet article permet de supprimer une procédure certes tombée en désuétude mais qui était particulièrement attentatoire au respect des droits fondamentaux des patients.
Enfin, en donnant au psychiatre la possibilité de se prononcer par un simple avis, et non un certificat, elle prend en compte les cas extrêmes où le médecin ne peut pas examiner convenablement un patient en état de crise violente, notamment lorsque celui-ci refuse l'accès de son domicile.
Le rapporteur approuve donc cette réforme pragmatique qui attribue au maire la décision initiale d'hospitalisation d'office. Cette réforme, loin d'inverser les rôles entre le maire et le préfet, conforte ce dernier comme étant la véritable autorité responsable de l'hospitalisation d'office : en effet, il confirme la décision initiale du maire, le remplace dans ce rôle en cas de nécessité et continue à être chargé du suivi des patients (renouvellement de la décision d'internement, sorties d’essai, etc.) au cours de leur traitement.
*
La commission a rejeté deux amendements de suppression présentés par M. Jean-Marie Le Guen et de Mme Christine Boutin et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 21 sans modification.
Article 22
Renforcement des garanties médicales lors de la confirmation
des décisions d’hospitalisation sans consentement
Cet article vise à renforcer les garanties médicales qui accompagnent la confirmation des décisions d'hospitalisation sans consentement.
Dans le souci de garantir au mieux le bien-fondé d'une hospitalisation sans consentement, toujours privative de liberté pour le patient, le présent article s'attache à renforcer le diagnostic médical qui précède la confirmation de la décision de placement.
Ainsi, le I complète l'article L. 3212-4 relatif à l’hospitalisation à la demande d’un tiers, pour prévoir que, outre le certificat établi dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un second certificat émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, autre que celui qui a produit le certificat accompagnant le placement, doit être rédigé dans les soixante-douze heures.
Un consensus est en effet apparu chez les professionnels de la psychiatrie pour souligner que la situation de crise qui accompagne le plus souvent la décision d’hospitalisation sous contrainte ne permet pas un véritable diagnostic médical.
L’excessive rapidité de la phase en amont du processus d'hospitalisation sous contrainte peut conduire à prendre des décisions privatives de liberté qui ne sont pas justifiées médicalement. Le certificat sur lequel se fonde le préfet présente la description d'un trouble du comportement et non un diagnostic précis. Seule une phase d'observation plus longue permet une juste évaluation de l'état du malade en distinguant notamment les troubles mentaux caractérisés des réactions liées à la consommation de certains produits – médicaments, alcool, drogue. C’est pourquoi il est proposé d’instaurer une phase d'observation de 72 heures, au terme de laquelle la personne sera orientée soit vers une hospitalisation d'office, soit vers une hospitalisation sur demande d'un tiers.
Le certificat médical établi au bout de 72 heures doit faire le point sur l'état mental de la personne et confirmer, ou infirmer, la nécessité de maintenir l'hospitalisation. Comme le premier certificat, il est adressé au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques par le directeur de l'établissement.
De manière symétrique, le II propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3213-2 pour appliquer à l'hospitalisation d'office, désormais décidée par le maire ou par un commissaire de police à Paris, une garantie médicale identique avant qu'elle ne soit confirmée par le préfet.
De la même manière, deux certificats médicaux doivent donc être établis dans les vingt-quatre heures puis dans les soixante-douze heures suivant la décision de placement par un psychiatre qui ne peut être celui ayant rédigé le certificat qui a permis l'hospitalisation. Ils sont transmis au préfet et à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques par le directeur de l'établissement.
Le préfet ou le préfet de police, à Paris, prononce par arrêté la confirmation de l'hospitalisation d'office pour les personnes qui en réunissent les critères sanitaires et de sécurité au vu de ces certificats. Cet arrêté doit être motivé et énoncer avec précision les motifs qui ont rendu le placement nécessaire. Il est inscrit sur le registre de l'établissement d'accueil.
Le rapporteur se félicite de cette mesure particulièrement protectrice des droits des personnes hospitalisées. L'allongement à soixante-douze heures de la période d'observation initiale et l'obligation de disposer d'un certificat médical supplémentaire à l'issue de ces trois jours. Permettra d'affiner le diagnostic des troubles observés et de mieux juger de leur dangerosité. De plus, cet approfondissement du diagnostic médical initial offrira au préfet une information plus complète sur l'état du patient, ce qui devrait permettre, à terme, d’améliorer le suivi des patients.
*
La commission a rejeté deux amendements de suppression présentés par M. Jean-Marie Le Guen et Mme Christine Boutin et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 22 sans modification.
Article 23
Possibilité pour le préfet d’ordonner une expertise médicale
Cet article vise à permettre au représentant de l'Etat d'ordonner à tout moment une expertise médicale dans le cadre de l'hospitalisation sur demande d'un tiers comme dans celui de l'hospitalisation d'office Il s’agit de donner au préfet des moyens nouveaux pour éviter les internements abusifs ou les prises en charge mal adaptées. En recourant à l’expertise, le préfet pourra disposer d’un avis médical extérieur à l’établissement psychiatrique sur l’opportunité de maintenir un patient sous un régime d’hospitalisation sous contrainte.
L'hospitalisation sur demande d'un tiers est levée dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de cette hospitalisation ne sont plus réunies (article L. 3212-8 du code de la santé publique). Le préfet est alors informé dans les 24 heures suivant la fin de l'hospitalisation par le directeur de l'établissement.
En matière d'hospitalisation d'office, si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre d'établissement que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statue sans délai.
Ce dispositif d’expertise permettra de compléter les informations dont dispose le préfet sur chaque patient hospitalisé d'office. L'article L. 3213-3 prévoit déjà, en effet, que le préfet est destinataire, dans les quinze jours, un mois après le placement, puis au moins une fois par mois, d'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et faisant le point sur l'évolution des troubles qui ont justifié l'hospitalisation d'office du malade.
Compte tenu des responsabilités qui incombent au préfet au titre des deux régimes d'hospitalisation sous contrainte en matière de sortie des personnes atteintes de troubles mentaux, il apparaît légitime de donner au préfet la possibilité d'ordonner une expertise médicale, y compris pour confirmer ou infirmer une expertise précédente.
Le nouvel article L. 3213-5-1 du code de la santé publique précise d'ailleurs que cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du malade et choisi par le préfet sur la liste des experts psychiatres inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.
Le Sénat a adopté un amendement précisant qu’à Paris la possibilité d'ordonner à tout moment l'expertise médicale d'un malade hospitalisé sans son consentement revient au préfet de police.
Le rapporteur estime très utile de renforcer les moyens d’information du préfet qui pourra ainsi mieux assurer sa mission de suivi des malades hospitalisés sous contrainte. Cependant il convient de rappeler les observations assez alarmantes faites par M. Jean Paul Garraud dans son rapport précité, dans lequel il souligne les difficultés à obtenir des expertises psychiatriques de qualité, le nombre d’experts étant assez faible (800 pour toute la France) et très inégalement répartis sur le territoire. Il fait aussi remarquer que certains experts en raison d’une relative pénurie ont tendance à consacrer une trop grande partie de leur activité à des expertises au détriment d’une activité de praticien, ce qui risque de nuire à terme à la fiabilité du diagnostic.
*
La commission a rejeté un amendement de suppression de M. Jean-Marie Le Guen et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 23 sans modification.
Article 24
Régime d’hospitalisation d’office pour irresponsabilité pénale
Cet article vise à mettre fin à une anomalie juridique pour permettre au parquet, à l’occasion d’un classement sans suite de demander au préfet la mise en œuvre de la procédure spécifique d’hospitalisation d’office applicable aux personnes qui n’ont pas été poursuivies par l’autorité judiciaire en raison de leur état mental, c'est-à-dire les personnes ayant fait l’objet d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondé sur l’article 122-1 du code pénal.
En application de l'article 122-1 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Cette irresponsabilité peut être constatée par la juridiction de jugement et donner lieu à une décision de relaxe (prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) ou à une décision d'acquittement (prononcée par la cour d'assises). Elle peut aussi avoir été déclarée auparavant par le juge d'instruction (décision de non-lieu). Elle peut l'être, aussi, plus en amont de la procédure pénale, par le procureur de la République (classement sans suite).
Paradoxalement, si le code de la santé publique prévoit des dispositions particulières pour l'hospitalisation d'office après un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, il ne vise par le classement sans suite.
Cet article a donc pour objet de compléter l’article L. 3213-7 du code de la santé publique pour inclure dans cette procédure particulière d’hospitalisation d’office les personnes ayant bénéficié d’un classement sans suite en raison de leur état mental.
La constatation d'une irresponsabilité pénale, si elle met fin aux poursuites, ne règle en aucun cas la prise en charge médicale de la personne concernée.
À cet effet, l'article L. 3213-7 du code de la santé publique prévoit que, lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application de l'article 122-1 du code pénal précité nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public, elles en avisent le préfet et la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Celui-ci peut alors prononcer une décision d'hospitalisation d'office s'il le juge utile au vu du certificat médical prévu dans de telles circonstances.
Si l'hospitalisation d'office a été prononcée en application de cette procédure spécifique, il ne peut y être mis fin que sur décision conforme de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du patient et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République, après avis de la DDASS du département dans lequel est situé l'établissement. Ces décisions doivent résulter de deux examens séparés et concordants, qui doivent établir que l'individu n'est plus dangereux, ni pour lui-même, ni pour autrui (article L. 3213-8 du code de la santé publique).
Cette procédure est plus rigoureuse que lorsque l'hospitalisation d'office est décidée dans le cadre de droit commun de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique puisque, dans ce cas, la sortie est ordonnée par le préfet sur le certificat médical d'un seul psychiatre.
Cet article vise aussi à renforcer les contrôles lors de la levée du régime de l’hospitalisation d’office. Selon les termes de la rédaction adoptée par le Sénat pour l'article L. 3213-8, l’hospitalisation d’office pourra être levée sur l'avis convergent de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement d'accueil du patient et choisis par le préfet sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Contrairement au régime actuel où la décision qui met fin à l’hospitalisation d’office doit être prise par les décisions « conformes et concordantes » de deux psychiatres, la décision de sortie appartiendra in fine à l’autorité préfectorale qui ne sera plus tenu de suivre les préconisations des psychiatres.
Il convient de noter qu’un amendement adopté par le Sénat a réintroduit, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 3213-8, l'avis de la DDASS en matière de décision de sortie des personnes hospitalisées d'office après un signalement de l'autorité judiciaire.
Comme pour l’hospitalisation d’office de droit commun, en matière de levée de l’hospitalisation d’office le préfet ne sera plus lié par les avis médicaux et disposera d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de prendre une telle décision.
*
La commission a rejeté deux amendements de suppression présentés par M. Jean-Marie Le Guen et Mme Christine Boutin et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 24 sans modification.
Article 27
Modalités de l’injonction thérapeutique
applicables aux personnes signalées par l’autorité judiciaire
L’injonction thérapeutique a été instituée par la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses, dont les dispositions figurent aux articles L. 3411-1 et suivants du code de la santé publique. Les mesures d’application ont été définies par le décret n° 71-690 du 18 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et inculpées d'infraction à l’article l 628 du code de la santé publique (aujourd’hui l’article L. 3421-1 punissant l’usage illicite de stupéfiants d’un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende) peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxication.
Le code de la santé publique aborde l’usager de drogue illicite comme un patient auquel une réponse médicale peut être apportée pour mettre fin aux nuisances sanitaires que sa consommation de stupéfiants entraîne. La première circulaire interprétative de la loi du 28 septembre 1971 souligne bien que le toxicomane est un malade, « sujet en péril qui a besoin de protection ». La réduction des risques pour la santé publique résultant de l’usage de drogue passe par l’interdiction de la consommation mais celle-ci ne peut être pleinement effective sans le concours des usagers considérés comme des personnes malades ou fragiles.
À tous les stades de la procédure judiciaire, l’usager de drogue, quelle que soit sa consommation de stupéfiants, se voit donc appliquer un traitement de nature pénale et un traitement sanitaire. En amont de l’engagement des poursuites pénales, le procureur de la République doit, en application de l’article L. 3423-1 du code de la santé publique, suspendre les poursuites si l’usager interpellé pour la première fois pour usage illicite de stupéfiant accepte de suivre « une cure de désintoxication » ou de se placer sous surveillance médicale. L’action publique n’est pas exercée à condition que l’usager se conforme jusqu’à son terme au traitement médical prescrit. En cas de récidive, l’exercice de l’action publique est laissé à l’appréciation du procureur de la République.
De même, les poursuites pénales ne sont pas engagées à l’encontre de l’usager de drogue illicite qui s’est soumis, de lui-même ou à la requête d’une autorité sanitaire, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale depuis le constat d’infraction pour usage illicite de drogue.
Le procureur de la République met en œuvre cette procédure en saisissant l’autorité sanitaire qui fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé. Si l’intoxication de cette personne est constatée médicalement, l’intéressé est amené dans un établissement agréé qu’il a choisi ou qui est, à défaut, désigné d’office, pour y suivre une cure de désintoxication. Si l’examen médical montre qu’une cure de désintoxication n’est pas nécessaire, l’autorité sanitaire enjoint à cette personne de se placer, pour une durée qu’elle fixe, sous surveillance médicale auprès d’un médecin, d’un dispensaire d’hygiène sociale ou d’un établissement de santé agréé. La cure de désintoxication ou la surveillance médicale sont placées sous le contrôle de l’autorité sanitaire.
Au stade de l’instruction judiciaire, lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction ou le juge des enfants peut, par ordonnance, imposer à la personne mise en examen de subir une cure de désintoxication accompagnée éventuellement de mesures de surveillance médicale et de réadaptation sociale. Lorsque le juge d’instruction ou le juge des enfants prononce une mesure d’obligation de soins, la juridiction de jugement ne peut plus infliger la peine d’emprisonnement et d’amende prévue en cas d’usage illicite de stupéfiants. L’exécution de l’ordonnance du juge peut être poursuivie, le cas échéant, après la clôture de l’information judiciaire. À proprement parler, il ne s’agit plus d’une injonction thérapeutique mais d’une obligation de soins.
Au stade du jugement, la juridiction peut également astreindre la personne poursuivie à subir une cure de désintoxication, y compris en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des enfants ou en prolongeant ses effets. Lorsqu’une mesure d’astreinte à une cure de désintoxication est décidée par la juridiction de jugement, la peine d’emprisonnement et d’amende peut ne pas être prononcée. La majorité des peines prononcées consiste en un sursis avec une mise à l’épreuve, mais il peut s’agir également de mesures de contrôle judiciaire, d’ajournement de peine ou de travaux d’intérêt général. L’emprisonnement est rarement prononcé en cas d’infraction unique d’usage illicite de drogue.
Dans les trois hypothèses, l’injonction thérapeutique ou l’obligation de soins est une mesure sanitaire retenue en opportunité par l’autorité judiciaire. Elle constitue une mesure de substitution ou d’accompagnement de la sanction pénale. L’obligation de soins prononcée au stade de l’instruction ou du jugement doit être distinguée de l’injonction thérapeutique proprement dite prononcée par le procureur de la République. L’obligation de soins est prononcée à la fois dans l’intérêt de la personne et dans un but de préservation de l’ordre public tendant à prévenir la récidive. L’orientation de la politique pénale est d’ailleurs de ne pas considérer l’obligation de soins comme une mesure de substitution mais comme une mesure d’accompagnement du traitement pénal. Cette réorientation est confirmée et renforcée par le projet de loi qui érige l’obligation de soins, dénommée « injonction thérapeutique », en peine complémentaire.
Dans les deux cas où l’obligation de soins est prévue, ces mesures sont des choix à la disposition du magistrat : dans ses décisions, l’autorité sanitaire n’intervient que pour éclairer l’appréciation faite par le magistrat du cas qui lui est soumis. De son côté, l’intéressé peut refuser cette alternative et choisir ainsi d’être confronté à des poursuites judiciaires, d’être placé en détention et finalement d’être emprisonné et frappé d’amende.
Le présent article 27 réforme les mesures sanitaires imposées aux personnes signalées au procureur de la République comme usagers de drogue. Il modifie les modalités selon lesquelles l’injonction thérapeutique est prononcée en substitution à l’engagement de l’action publique et les modalités de son suivi. Il réécrit le chapitre III du titre Ier du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique (articles L. 3413-1, L. 3413-2 et L. 3413-3). La référence au procureur de la République est remplacée par une référence à l’autorité judiciaire et la notion d’injonction thérapeutique est introduite dans la loi.
Trois novations sont introduites dans le code.
En premier lieu, la mention du procureur de la République est remplacée par une référence à l’autorité judiciaire, qui inclut les magistrats du siège et du parquet. Le procureur de la République conserve le pouvoir d’ordonner une injonction thérapeutique avant l’engagement des poursuites mais le juge d’instruction, le juge des enfants et le juge de l’application des peines disposent également du pouvoir d’ordonner ou de fixer une telle mesure (cf. article 29 du projet de loi).
En deuxième lieu, l’injonction ne porte plus sur le suivi d’une cure de désintoxication ou le placement sous surveillance médicale mais sur une mesure de soins ou de surveillance médicale. La notion de soins est plus large et donne ainsi à l’autorité judiciaire, sur la proposition de l’autorité sanitaire représentée par le médecin relais, la latitude de définir des mesures adaptées à chaque cas.
En dernier lieu, il est institué un médecin relais qui constitue une véritable interface médicale entre l’usager de drogue interpellé et l’autorité judiciaire. Cette personne doit être un médecin habilité par l’administration. Il procède à l’examen médical de la personne susceptible de faire l’objet d’une injonction thérapeutique. Il peut demander à ce qu’une enquête soit diligentée par l’autorité sanitaire sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé. Cette dernière attribution résulte d’un ajout apporté par un amendement de M. Nicolas About, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, qui a été adopté par le Sénat. Le médecin relais rend un avis motivé sur l’opportunité médicale de l’injonction thérapeutique.
Aux termes du nouvel article L. 3413-2 du code de la santé publique, lorsque l’examen médical effectué par le médecin relais conclut à « l’état de dépendance physique et psychologique » de l’usager interpellé, le médecin relais « invite ce dernier à se présenter auprès d’un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d’un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d’office, pour suivre un traitement médical ou faire l’objet d’une surveillance médicale adaptés ». L’emploi du présent de l’indicatif (« invite ») place le médecin relais dans une situation de compétence liée lui imposant d’ordonner un traitement ou un suivi médical dès lors que son examen médical conclut à un état de dépendance physique et psychologique.
Le nouvel article L. 3413-3 charge le médecin de proposer à l’autorité judiciaire les modalités de la mesure d’injonction thérapeutique, d’assurer la mise en œuvre de la mesure décidée et d’en contrôler le suivi sur le plan sanitaire. À ce titre, il informe l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale des personnes soumises à une injonction thérapeutique.
Il convient de souligner que la mesure d’injonction thérapeutique est ordonnée par l’autorité judiciaire, conformément aux articles L. 3413-1 et L. 3413-3, mais le contenu thérapeutique de cette mesure (obligation de soins et suivi médical) est arrêté par le médecin relais. Celui-ci peut, au vu de l’examen médical qu’il a prescrit, considéré qu’il n’y a pas lieu à prononcer une injonction thérapeutique. Si une telle mesure est ordonnée par le procureur, il appartient au médecin relais d’en définir les modalités (consistance du traitement médical, fréquences des visites thérapeutiques, etc.).
Le projet de loi reprend une disposition datant de 1970 aux termes de laquelle la personne soumise à une mesure de soins adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date de début des soins, sa durée probable et les coordonnées du centre spécialisé ou l’identité du médecin chargé de la mise en œuvre de la mesure de soins ou de surveillance (article L. 3413-2). Le projet de loi initial prévoyait que l’intéressé informait l’autorité judiciaire de l’exécution de l’injonction thérapeutique ; le Sénat a adopté un amendement de M. Nicolas About, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires sociales, pour que l’information soit adressée au médecin relais par souci de cohérence avec le dispositif d’ensemble qui fait de ce dernier le point de passage obligé de toutes les mesures médicales.
En cas d’interruption du suivi médical par l’usager de drogue intéressé, l’autorité judiciaire doit en être informée immédiatement par le médecin relais (article L. 3413-3). Il en est de même – ce qui est un ajout par rapport au droit en vigueur – en cas d’incident survenant au cours de la mesure. Le flou de cette notion d’incident doit conduire le médecin relais à assurer une information précise de l’autorité judiciaire sur tout événement anormal ou imprévu survenu lors du traitement ou de la surveillance médicale.
*
La commission a rejeté un amendement de suppression de M. Jean-Marie Le Guen.
Elle a examiné un amendement du rapporteur permettant à l’autorité sanitaire de faire procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de la personne interpellée, le cas échéant à la demande du médecin relais, et renvoyant au juge le soin de se prononcer sur l’opportunité de cette enquête au cas où l’autorité sanitaire ne donnerait pas suite à la demande du médecin relais.
Le rapporteur a précisé que le but est de concilier les objectifs poursuivis par le médecin relais, l’autorité sanitaire et l’autorité judiciaire qui doivent, dans leur domaine de compétences respectives, travailler conjointement afin de rendre plus efficaces les mesures d’injonction thérapeutique. Les directions départementales de l’action sanitaire et sociale peuvent, à bon droit, estimer que les enquêtes demandées par le médecin relais sont inutiles. L’autorité judiciaire est la mieux placée pour trancher ce désaccord.
La commission a adopté l’amendement.
Elle a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 27 ainsi modifié.
Article 28
Peines applicables en cas d’usage illicite de stupéfiants
Le projet de loi ne modifie pas la peine principale prévue par l’article L. 3421-1 du code de la santé publique en cas d’usage illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants (un an d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende), ni la mesure complémentaire de confiscation des substances et plantes saisies prévue par l’article L. 3421-2. En revanche, il institue une peine complémentaire nouvelle – le suivi d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants – et aggrave les peines encourues lorsque l’infraction d’usage illicite de stupéfiants est commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par un personnel d’une entreprise de transport exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.
Les modalités du stage de sensibilisation sont fixées par l’article L. 131-35-1 du code pénal. Le stage peut non seulement être imposé aux usagers de drogues (article L. 3421-1 du code de la santé publique) mais également aux personnes coupables de provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants (article L. 3421-4 du code de la santé publique). L’article L. 131-35-1 du code pénal prévoit que l’exécution de cette peine est accomplie aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
L’aggravation des peines à l’égard des personnes exerçant des responsabilités auprès du public est justifiée par l’exemplarité et la probité exigée de toutes personnes investies de ces responsabilités. Pour ces personnes, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
Le projet de loi vise tout d’abord les personnes dépositaires de l’autorité publique : il s’agit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires mais également des personnes privées habilitées à exercer des fonctions d’autorité par l’administration (notaires, commissaires priseurs, par exemple). Le projet de loi vise également les personnes chargées d’une mission de service public ; cette notion permet d’englober les personnels d’entreprises, d’établissements ou d’associations privées exerçant une mission de service public : par exemple, les fédérations de chasse, les fédérations sportives, les entreprises de pompes funèbres mais également les agents des chambres consulaires, les médecins agréés de l’administration, les concierges des offices publics d’habitation à loyer modéré, les agents des restaurants employés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, etc.
L’aggravation des peines s’applique également à une catégorie particulière de personnes dont l’usage de drogue a des conséquences d’une extrême gravité sur la sécurité des personnes : les personnels exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité d’un transport. Cette précision a été ajoutée au projet de loi par un amendement adopté par le Sénat sur la proposition du rapporteur de la commission des lois. Sont concernés les personnels des entreprises de transport terrestre, maritime ou aérien de marchandises ou de voyageurs. L’extension du dispositif au transport de marchandises et à toutes les entreprises de transport, qu’elles exercent, comme le prévoyait le projet de loi initial, ou non une mission de service public, résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du rapporteur de la commission des lois.
Les conducteurs de véhicules ne sont pas les seules personnes visées ; toute personne impliquée dans la sécurité du transport est passible de ces peines aggravées : les assistants de cabine, les personnels chargés de la navigation ou de l’orientation des véhicules sur site propre ou voie ferroviaire, les personnels chargés de la signalisation des voies de circulation, les techniciens chargés de l’entretien ou du contrôle technique des véhicules, etc. La liste en sera fixée par décret en Conseil d’Etat.
Le transport est une chaîne de responsabilité où à chaque stade la sécurité peut être remise en cause par un manquement de l’agent responsable ; or l’usage de stupéfiants nuit à l’attention exigée de ces agents pour le bon accomplissement de leurs missions.
Pour cette dernière catégorie d’agents, l’article L. 3421-7 introduit par le projet de loi dans le code de la santé publique met en place des peines complémentaires adaptées à leur situation : suspension pour un maximum de trois ans du permis de conduire, annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus, interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d’exercer une profession ayant trait au transport, interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur pour une durée maximale de cinq ans, stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli au frais du condamné.
Le projet de loi vise les infractions commises par « le personnel d’une entreprise de transport ». En droit, il s’agit des salariés sous contrat de travail avec l’entreprise. Or ce dispositif doit s’appliquer à tous les salariés impliqués dans la sécurité du transport, y compris les travailleurs intérimaires qui sont mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure dont l’objet social n’est pas le transport. Les entreprises de transport françaises font régulièrement appel à des sous-traitants et à l’intérim.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, il serait hasardeux de considérer que le juge pénal assimilera deux différentes catégories de personnel pour l’application d’une mesure de sanction alors que celle-ci est définie en référence à l’une seule des deux catégories mais qui, compte tenu de sa finalité, devrait s’appliquer aux deux catégories. Un amendement de précision paraît nécessaire.
À l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, le projet de loi insère également dans le code de la route, au chapitre sur la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la peine complémentaire relative au stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants (articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route).
Ce même article définit également de nouvelles peines complémentaires applicables à tous usagers de drogues visés à l’article L. 3421-1 et aux personnes refusant de se soumettre aux vérifications des lieux d’exercice d’une activité de transport et de leurs annexes et dépendances (nouvel article L. 3421-6) : travail d’intérêt général, jour-amende, stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants accompli au frais du condamné.
Pour mémoire, ces mesures s’ajoutent aux dispositions de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants qui a modifié le code de la route afin de punir de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende toute personne conduisant ou ayant conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Si l’analyse sanguine de cette personne révèle également la présence d’alcool égale ou supérieure au taux de 0,5 gramme par litre, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 9 000 euros d’amende.
Afin de renforcer l’effectivité des nouvelles dispositions relatives aux personnels en charge de la sécurité des transports de marchandises ou de personnes, le projet de loi insère deux articles L. 3421-5 et L. 3421-6 dans le code de la santé publique afin de permettre à la police judiciaire, sur réquisitions du procureur de la République, de procéder, dans les lieux d’exercice du « transport public de voyageurs » et leurs annexes et dépendances, à l’exception des domiciles, aux vérifications utiles à la recherche et au constat du délit d’usage illicite de drogue, à savoir le contrôle d’identité des personnes présentes et le dépistage d’usage de stupéfiants s’il existe à l’encontre des personnes concernées une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’un tel usage.
Le nouvel article L. 3421-5 définit la procédure judiciaire applicable et le nouvel article L. 3421-6 rend passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de refuser de se soumettre à ces vérifications.
Sur la proposition du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, le Sénat a également renforcé les peines prévues aux articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal en cas de provocation directe à l’usage illicite ou au transport, à la détention, à l’offre ou à la cession de stupéfiants faite à l’endroit d’un mineur, notamment lorsqu’elle est commise à l’intérieur ou aux abords des établissements d’enseignement ou d’éducation. Le tableau suivant synthétise le relèvement des peines opéré par le Sénat qui a, en fait, supprimé la gradation des peines pour les unifier.
Peines applicables en cas de provocation visant un mineur
Infraction |
Droit en vigueur |
Texte voté par le Sénat |
Provocation directe à l’usage illicite de stupéfiants : | ||
– visant un mineur |
5 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende |
7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende + stage de sensibilisation |
– visant un mineur de 15 ans |
7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende | |
– commise à l’intérieur d’un établissement d’enseignement ou d’éducation ou à ses abords |
(aux abords seulement lors des horaires d’ouverture) | |
Provocation directe au transport, à la détention, à l’offre ou à la cession de stupéfiants : | ||
– visant un mineur |
7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende |
10 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende + stage de sensibilisation |
– visant un mineur de 15 ans |
10 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende | |
– commise à l’intérieur d’un établissement d’enseignement ou d’éducation ou à ses abords |
(aux abords seulement lors des horaires d’ouverture) | |
*
La commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Marie Le Guen.
Elle a examiné un amendement du rapporteur précisant que les peines applicables à l’usage illicite de stupéfiants par le personnel d’une entreprise de transport devront s’appliquer à tous les travailleurs impliqués dans la sécurité du transport, y compris les travailleurs intérimaires ou ceux mis à la disposition d’une entreprise de transport par une entreprise extérieure.
M. Jean-Marie Le Guen a tout d’abord demandé si les parlementaires doivent être regardés comme des personnes dépositaires de l’autorité publique et donc soumises aux peines renforcées. Par ailleurs, il serait utile de savoir sous quelle forme se dérouleront les opérations de dépistage, prises de sang ou autres, et quels éléments devront être réunis en vue d’un diagnostic.
Le rapporteur a indiqué qu’il semblerait que le président de l’Assemblée nationale soit dépositaire de l’autorité publique mais pas un député.
La commission a adopté l’amendement.
La commission a adopté quatre amendements du rapporteur, le premier habilitant la police judiciaire à pénétrer dans les lieux de transports collectifs, le deuxième et le troisième étendant les peines de suspension et d’annulation du permis de conduire aux titres de conduite des navires de plaisance à moteur et le quatrième modifiant l’article par coordination.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article 28 ainsi modifié.
Article 29
Procédures judiciaires applicables à l’injonction thérapeutique
Cet article propose une nouvelle rédaction des articles du code de la santé publique organisant l’injonction thérapeutique prononcée par le procureur de la République (article L. 3423-1 actuel) et définissant les pouvoirs du juge d’instruction et de la juridiction de jugement en matière d’obligation de soins et de surveillance médicale (articles L. 3424-1 à L. 3424-5 actuels). Le projet de loi distingue clairement, selon trois chapitres différents, l’injonction thérapeutique prononcée par le procureur de la République (chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique), celle ordonnée par le juge d’instruction et le juge des enfants (chapitre IV) et celle décidée par la juridiction de jugement (chapitre V).
On se reportera au commentaire de l’article 27 pour une présentation de la procédure judiciaire actuellement en vigueur.
Concernant l’injonction thérapeutique prononcée par le procureur de la République (articles L. 3423-1 et L. 3423-2 nouveaux), le projet de loi introduisait trois novations :
– l’obligation de subir une cure de désintoxication est remplacée par la soumission à une mesure de soins ; cette notion est plus large et offre ainsi plus de possibilités à l’autorité judiciaire, sur la proposition du médecin relais, de choix de mesures adaptées à chaque cas ;
– l’usager de drogue interpellé doit donner son accord écrit à l’injonction thérapeutique ; s’il est mineur, cet accord est recueilli en présence de ses représentants légaux ;
– l’injonction thérapeutique prend effet à compter de sa notification à l’intéressé ; sa durée est de six mois maximum, renouvelable une fois selon les mêmes modalités de son prononcé ;
– les plantes et substances saisies sont détruites lorsque leur conservation n’apparaît pas nécessaire.
Sur la proposition du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a supprimé la deuxième novation. L’exigence d’un accord du bénéficiaire de l’injonction thérapeutique n’a pas paru opportune du fait que cette mesure constitue une alternative aux poursuites. En outre, l’injonction thérapeutique permettrait parfois de transformer l’attitude du malade et de l’amener à adhérer à l’obligation de soins et de suivi médical. Le gouvernement a accepté cette suppression dans la mesure où un excès de formalisme alourdirait la procédure et pourrait retarder sa mise en œuvre.
Sur la proposition du rapporteur de la commission des lois et du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, le Sénat a également supprimé la troisième novation. Il lui a paru inadapté de limiter dans le temps une mesure sanitaire. Le rapporteur approuve cette suppression, le traitement de la dépendance notamment vis-à-vis du cannabis ou des opiacés ne pouvant être menée à bien en six ou douze mois.
Concernant l’injonction thérapeutique prononcée par le juge d’instruction et le juge des enfants (article L. 3424-1 nouveau), le projet de loi n’apporte pas de modification au droit en vigueur hormis celles mises en place par l’article 27 du projet de loi, au nombre desquelles figure la possibilité de prévoir dans l’ordonnance toutes mesures de soins adaptées.
Concernant l’injonction thérapeutique prononcée par la juridiction de jugement (articles L. 3425-1 et L. 3425-2 nouveaux), le projet de loi apporte trois précisions par rapport au droit en vigueur :
– l’autorité judiciaire chargée de prononcer l’injonction thérapeutique à titre de peine complémentaire décidée par la juridiction de jugement est le juge de l’application des peines ;
– il n’est plus prévu que la juridiction de jugement prononce la mesure d’injonction en confirmant l’ordonnance du juge d’instruction ou du juge des enfants ou en en prolongeant ses effets ; cette ordonnance n’est plus exécutoire par provision ;
– désormais, les peines d’emprisonnement et d’amende en cas d’usage illicite de stupéfiant sont applicables y compris en cas d’injonction thérapeutique qui est prononcée à titre de peine complémentaire ;
– au cas où la personne déférée à la justice se serait soustraite à une mesure d’injonction thérapeutique ordonnée par le procureur de la République, le juge d’instruction ou le juge des enfants, la juridiction de jugement impose une mesure identique et applique les peines prévues pour usage illicite de stupéfiants.
Le projet de loi complète également le 3° de l’article 132-45 qui définit l’obligation de mise à l’épreuve consistant à « se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation ». L’injonction thérapeutique prévue par le code de la santé publique est ajoutée lorsque le condamné fait usage de stupéfiants ou fait consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.
*
La commission a rejeté un amendement de suppression présenté par M. Jean-Marie Le Guen et donné un avis favorable à l’adoption de l’article 29 sans modification.
M. René Couanau, président, a tenu à faire observer que si la discussion a permis de dégager une unanimité au sein de la commission sur le fait que les articles relatifs à l’hospitalisation psychiatrique doivent faire l’objet d’un texte distinct, l’information fournie sur le processus législatif qui devrait être retenu est insuffisante et ne permet pas à la commission de se prononcer de manière satisfaisante.
La commission a donné un avis favorable à l’adoption des articles du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 3338) dont elle s’est saisie, ainsi modifiés.
*
En conséquence, et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter les articles du projet de loi (n° 3338) dont elle s’est saisie.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
Article 5
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots :
« dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant de la compétence du maire, ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans la première phrase de l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et »
le mot :
« professionnels ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Compléter l'alinéa 7 de cet article par la phrase suivante :
« En outre, lorsqu'il apparaît qu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur en informe sans délai le président du conseil général en vue de la mise en œuvre par celui-ci, des dispositions de l'article L. 226-4 ; le maire est informé de cette transmission. »
Article 6
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Après les mots : « la sécurité publique, proposer au maire de », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 de cet article :
« saisir le président du conseil général en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement en économie sociale et familiale ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis, et Mme Christine Boutin :
Supprimer l’alinéa 9 de cet article.
Article 7
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« la caisse d’allocations »
les mots :
« l'organisme débiteur des prestations ».
Article 9
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis, et Mme Christine Boutin
Dans l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« au maire »,
insérer les mots :
« à titre d'information ».
Article 17
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« soit sur un support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque ou jeu électronique »,
les mots :
« par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« ce document doit comporter, sur chaque unité de conditionnement, »,
les mots :
« le support et chaque unité de son conditionnement doit comporter ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« document répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa »,
les mots :
« support et unité de conditionnement visé ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Après les mots :
« les documents mentionnés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« au deuxième alinéa de l’article 32 ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Substituer à l’alinéa 26 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« IV.- Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 227-22, le mot : « télécommunications » est remplacés par les mots : « communications électroniques ».
« 2° A la fin du troisième alinéa de l’article 227-23, le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».
« 3° Dans le dernier alinéa de l’article 227-24, après les mots : « presse écrite ou audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de la communication au public en ligne ».
Article 27
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet article les deux phrases suivantes :
« Elle fait également procéder, s’il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l’intéressé, le cas échéant à la demande du médecin relais. S’il n’est pas donné suite à la demande du médecin relais, celui-ci peut en aviser l’autorité judiciaire afin qu’elle se prononce sur l’opportunité de cette enquête. »
Article 28
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Pour l’application de ces dispositions, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.»
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer au mot :
« public »,
le mot :
« collectif ».
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 18 de cet article, après les mots :
« permis de conduire »,
insérer les mots :
« ou du titre de conduite des navires de plaisance français à moteur »
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 19 de cet article, après les mots :
« permis de conduire »,
insérer les mots :
« ou du titre de conduite des navires de plaisance français à moteur »
Amendement présenté par M. Jean-Michel Dubernard, rapporteur pour avis :
Dans l’alinéa 19 de cet article, après les mots :
« nouveau permis »,
insérer les mots :
« ou d’un nouveau titre de conduite ».
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
(par ordre chronologique)
Auditions communes avec la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ø Union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (UNASEA) – M. Jean-Jacques Andrieux, directeur général
Ø Ministère de la santé et des solidarités – M. Jean-Jacques Tregoat, directeur général de l’action sociale, Mme Maryse Schaix, sous-directrice de l’animation territoriale et du travail social, et Mme Laure Néliaz, chargée de mission
Ø Conférence nationale des présidents de commissions médicales d’établissements de centres hospitaliers spécialisés – Dr Yvan Halimi, président, Dr Jean-Louis Senon et Dr Jean-Charles Pascal
Ø Association nationale des assistants de service social – M. Laurent Puech, président
Ø Fédération nationale des associations d’ex-patients en psychiatrie –
Mme Claude Finkelstein, présidente
Auditions de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Ø Direction générale de la santé – M. Bernard Basset, chargé de la sous-direction de la santé et de la société
Ø Syndicat des psychiatres d’exercice public (SEP) – Dr Eric Malapert, président, et Dr François Caroli
Ø Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – M. Jean-Marie Jutant, médiateur de l’Education nationale
Ø Ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille – Mme Anne Delavauvre, chef adjointe du cabinet du ministre, chargée des relations avec le Parlement, et Mme Fabienne Quiriau, conseillère technique au cabinet du ministre
Ø Ministère de l’intérieur – M. Guillaume Larrivé, conseiller juridique au cabinet du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, Mme Rachida Dati, conseillère technique, M. Eric Jalon, conseiller technique, Mme Constance Le Grip, attachée parlementaire, et M. Bernard Hagelsteen, secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance