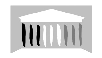
N° 3597
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE M. Jacques DESALLANGRE tendant à lutter contre les délocalisations et favoriser l’emploi (n° 3559),
PAR M. JACQUES DESALLANGRE,
Député.
——
Voir le numéro : 3559.
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I.— LES DÉLOCALISATIONS, UN PHÉNOMÈNE RÉVÉLATEUR DES EFFETS RAVAGEURS D’UNE MONDIALISATION NON RÉGULÉE 7
A.— UN IMPACT MINIMISÉ PAR LES ÉCONOMISTES 7
1. Des études non exhaustives et biaisées par le choix d’une définition restrictive et de périodes souvent anciennes 7
2. Une amplification des délocalisations est pourtant en cours 9
B.— DES CATASTROPHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POURTANT BIEN RÉELLES : CHÔMAGE ET DÉSINDUSTRIALISATION EN FRANCE, EXPLOITATION DANS LES PAYS À BAS SALAIRE 12
1. Dans les pays développés, les délocalisations touchent de plein fouet les salariés les plus vulnérables et contribuent à la désindustrialisation des territoires 12
2. Dans les pays émergents, les délocalisations n’apportent que l’illusion d’un développement pérenne, au prix d’une exploitation intense de la main-d’œuvre et de l’environnement 14
II.— SEULES DES ACTIONS FORTES PERMETTRONT DE PROTÉGER LES SALARIÉS CONTRE LES DÉLOCALISATIONS SAUVAGES ET DE RESTAURER UNE CONCURRENCE LOYALE 16
A.— METTRE LES ENTREPRISES DEVANT LEURS RESPONSABILITÉS 16
1. En créant une restitution sociale pour les entreprises qui procéderaient à des licenciements boursiers ou à des délocalisations 16
2. En rendant les donneurs d’ordres ou les grands groupes responsables des conséquences de leurs décisions sur l’avenir de leurs filiales ou sous-traitants 19
3. En dissuadant les comportements prédateurs, grâce à un véritable contrôle des aides publiques aux entreprises 19
B.— METTRE FIN AU DUMPING SOCIAL EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS À UN PRÉLÈVEMENT CALCULÉ EN FONCTION DU DIFFÉRENTIEL SOCIAL 21
EXAMEN EN COMMISSION 27
MESDAMES, MESSIEURS,
La mondialisation a mis en exergue un monde profondément inégalitaire, qu’il s’agisse d’accès à la santé, à l’éducation ou à un travail décent. Inégalités fragrantes entre pays en développement et pays développés, mais aussi au sein même de ces pays, une minorité d’actionnaires s’enrichissant toujours davantage en captant la valeur ajoutée aux dépens des travailleurs. Cette situation explosive est bien évidemment porteuse de violence : montée des intégrismes, émeutes dans les banlieues…
Dans notre pays, quels que soient la conjoncture économique et les résultats des entreprises, le feuilleton des plans sociaux se poursuit sans relâche, laissant de plus en plus de personnes sur le bord de la route. Le quotidien « l’Humanité » a publié le 30 octobre dernier une carte de France évoquant 20 000 emplois menacés et 25 000 autres supprimés. 53 départements y figuraient, dans des secteurs très divers allant de la lingerie aux assurances. Si 2,1 millions de nos concitoyens sont comptabilisés parmi les chômeurs indemnisés, 2,3 millions ne le sont pas et sont tout autant à la recherche d’un emploi, sans rien recevoir des Assedic. Le dernier rapport du Conseil d’Analyse Stratégique nous révèle de son côté que la proportion de titulaires d’un emploi stable chez les moins de 25 ans a régressé de 70 % en 1977 à 55 % aujourd’hui.
Dans cette tourmente, un processus a pris une importance croissante et profondément choqué nos concitoyens par sa violence : il s’agit des délocalisations qui conduisent des entreprises à déménager leur outil de production, parfois en l’espace de quelques jours, dans des pays à bas salaires. Ce phénomène, ignoré avec obstination par les économistes, est le résultat d’une course effrénée au moins-disant social et fiscal désormais réalisée à l’échelle mondiale et pour chaque segment de la chaîne de la production. Ainsi des pièces d’usinage pour l’automobile peuvent être réalisées en République Tchèque, assemblées en Chine, pour finalement être vendues en France, tandis que la comptabilité et l’informatique de l’entreprise ont été externalisées en Inde. Apparaissent ainsi des « entreprises sans usine ».
Après avoir montré que l’impact des délocalisations reste à ce jour largement occulté et que ce phénomène est loin d’être bénéfique pour la modernisation de notre économie ou le développement des pays émergents, votre rapporteur, convaincu que la représentation nationale ne peut rester passive, présentera les mesures d’urgence figurant dans la proposition de loi soumise à l’Assemblée nationale, qui tendent à la fois à protéger les salariés des licenciements boursiers et des délocalisations, à restaurer un véritable contrôle des aides publiques et à restaurer les conditions d’une concurrence loyale et équitable. Cette dernière ne peut être obtenue qu’en améliorant la protection des travailleurs du tiers-monde et non en affaiblissant celles en vigueur dans notre pays, au faux prétexte d’un coût horaire trop cher.
I.— LES DÉLOCALISATIONS, UN PHÉNOMÈNE RÉVÉLATEUR DES EFFETS RAVAGEURS D’UNE MONDIALISATION NON RÉGULÉE
Il existe aujourd’hui un gouffre entre le vécu et la perception par nos concitoyens et les élus locaux des délocalisations et leur analyse dans les études économiques, qui les considèrent comme un phénomène marginal, dont l’impact sur l’emploi serait quasi nul. « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
1. Des études non exhaustives et biaisées par le choix d’une définition restrictive et de périodes souvent anciennes
Les délocalisations ne recouvrent pas aujourd’hui une catégorie statistique déterminée et leur définition ne fait elle-même pas consensus, permettant ainsi à certains de jeter le voile sur une réalité multiforme et aux pouvoirs publics de fermer les yeux sur ce phénomène. Qu’est-ce qu’une délocalisation ? Si les salariés touchés par la fermeture d’une usine vivent au plus profond de leur chair cette réalité, la réponse ne semble au contraire pas aisée pour les économistes.
Certaines études s’appuient sur le niveau des investissements directs français à l’étranger (IDE) et leur répartition géographique pour arriver à des chiffres relativement bas et en conclure que les délocalisations constituent un phénomène marginal. Or, les IDE n’incluent pas les opérations de sous-traitance internationale, qui n’impliquent pas la détention d’une partie du capital social de l’entreprise par l’investisseur. Et si les IDE restent concentrés dans les pays de la zone euro et aux États-Unis et faibles dans les pays émergents, cela n’est pas lié au caractère marginal des délocalisations mais au fait que cette catégorie intègre des opérations purement financières, telles des fusions-acquisitions. Les deux notions ne correspondent donc pas, même si l’implantation d’une filiale hors du territoire national implique un flux de capital à destination d’un pays étranger.
Faute d’indicateurs spécifiques, les économistes ont souvent fait le choix d’une définition très restrictive, consistant en la fermeture d’une unité de production implantée en France, suivie de sa réouverture à l’étranger, en vue de réimporter sur le territoire national les biens produits à moindre coût. Privilégiant en outre une approche macroéconomique, ils en concluent que les délocalisations ne sont pas un problème… sans préciser à quelle échéance temporelle les emplois supprimés seront remplacés par la création d’emplois à valeur ajoutée, emplois qui ne seront de toute façon pas accessibles aux salariés licenciés !
Faire le choix d’une telle définition, c’est passer sous silence le recours à la sous-traitance internationale, qui ne se traduit pas par le déplacement physique d’une usine à l’étranger mais qui poursuit le même objectif qu’un tel transfert – remplacer les salariés français par une main-d’œuvre à bas coût et corvéable à merci – et entraîne les mêmes effets : des suppressions massives d’emplois en France, des territoires sinistrés. Il n’y a donc pas forcément réouverture d’une unité à l’étranger ni même identité entre le producteur initial et le producteur final à l’étranger.
De même que penser du critère de la réimportation des biens produits ? Il revient en effet à exclure tous les transferts à l’étranger d’activités exportatrices. Or, si l’implantation de sites de production à l’étranger destinée à conquérir de nouveaux marchés dans les pays émergents ou en Europe de l’Est ne correspond pas à une logique de délocalisation, il n’en est pas de même pour le transfert en Chine d’un site installé en France et produisant des biens à destination du marché allemand…
Enfin, comme le reconnaissent les économistes Lionel Fontagné et Jean-Hervé Lorenzi dans leur rapport réalisé pour le Conseil d’Analyse Économique intitulé « Désindustrialisation, Délocalisations », « la réalité industrielle se prête mal (…) à une définition aussi étroite du phénomène : la réorganisation des firmes au niveau international prend des formes beaucoup plus complexes, à de rares mais très médiatiques exceptions près ». En effet, il n’y a pas forcément fermeture totale d’une usine mais réduction progressive de son activité sur le territoire d’origine, qui aboutira au final au même résultat.
Une étude de l’INSEE, réalisée en 2005 par MM. Aubert et Sillard, retient une définition un peu plus large – « substitution de production étrangère à une production française, résultant de l’arbitrage d’un producteur qui renonce à produire en France pour produire ou sous-traiter à l’étranger » – et avance le chiffre de 95 000 emplois industriels supprimés en France entre 1995 et 2001 pour être délocalisés à l’étranger, soit une moyenne de 13 500 emplois par an. Cette étude est cependant loin d’être exhaustive : elle ne s’intéresse qu’à l’industrie manufacturière, hors secteur de l’énergie, alors que les délocalisations touchent de plus en plus les services ; de même elle ne prend pas en compte les délocalisations de productions destinées à d’autres marchés que le marché français, faute de « disponibilité des données ». Elle s’appuie en outre sur une période de référence assez ancienne et n’apporte pas d’éclairage sur l’évolution du phénomène au cours de ces années. Enfin, elle laisse pendante la question des « non-localisations », c’est-à-dire de l’extension des capacités de production réalisée à l’étranger plutôt qu’en France sans modification des marchés desservis. Paradoxalement, la seule étude réalisée qui prenne à la fois en compte la question des « non-localisations » et les délocalisations dans les services est celle commandée au cabinet Katalyse par le sénateur Jean Arthuis pour la Commission des Finances du Sénat. Et cette étude aboutit à la conclusion suivante : 202 000 emplois devraient être perdus en France dans le seul secteur des services entre 2006 et 2010…
Votre rapporteur en appelle donc à des indicateurs statistiques adaptés, qui n’occultent pas la réalité de l’impact des délocalisations. En leur absence, il lui semble néanmoins important de rappeler certaines tendances particulièrement inquiétantes pour notre industrie et notre modèle social, qui sont en contradiction avec le discours dominant des experts sur le caractère marginal des délocalisations.
La vive croissance enregistrée ces dernières années des importations de produits manufacturés (+ 7,6 % en 2004 ; + 6,6 % en 2005 selon le rapport sur les Comptes de la Nation) et plus encore la progression plus rapide des importations que de la demande intérieure sont assurément des indicateurs révélateurs des délocalisations lorsqu’on les combine à la dégradation du solde extérieur et au recul relatif de l’emploi dans certains secteurs. L’industrie de l’habillement et des fourrures a perdu près de 40 % de ses entreprises et le tiers de ses effectifs entre 1995 et 2002, tandis que les importations dans ce secteur passaient sur la même période de 524 à 877 millions d’euros, soit une hausse de 67 %. Et les suppressions d’emploi annoncées chez Dim, Well, Arena ou Aubade ces derniers mois montrent que la vague des délocalisations n’est pas terminée. De même, le secteur du cuir et de la chaussure a perdu près du quart de ses entreprises et de ses effectifs entre 1995 et 2002, tandis que les importations ont grimpé de 170 à 299 millions d’euros.
L’évolution de la part des importations industrielles issues des pays émergents est également révélatrice de l’accélération du phénomène : si, au niveau global et agrégé, ce taux n’atteint encore que 16 %, il a quasiment doublé entre 1993 et 2003. Et ce taux global cache des niveaux beaucoup plus élevés dans certains secteurs intensifs en main-d'œuvre : habillement-cuir (60 %), équipements du foyer (35 %), équipements électriques et électroniques (26 %)…
Pour votre rapporteur, au-delà de l’impact dramatique sur l’emploi des délocalisations, c’est également notre potentiel productif qui est jeu, avec la menace d’une désindustrialisation du territoire et la disparition progressive de certains pans entiers de notre économie. Notre pays doit-il renoncer à toute production dans le domaine du textile ou de l’équipement du foyer pour dépendre exclusivement des importations ? Ne faut-il pas s’alarmer des pertes de savoir-faire induites par une telle situation ?
Le phénomène des délocalisations est par nature cumulatif. Une première délocalisation dans un pays à bas salaire en entraîne souvent une autre : certains grands groupes commencent par expérimenter le transfert de certaines activités non stratégiques destinées à des marchés étrangers (exemple : centre d’appel d’une banque française pour sa clientèle anglo-saxonne) pour procéder ensuite à la délocalisation de leur activité principale destinée au marché domestique de leur pays d’origine. Il y a en outre un fort phénomène de contagion ou d’imitation : les entreprises restées sur le territoire national emboîtent le pas de leurs concurrentes pour « rester dans la course », au nom du maintien de leur compétitivité, sans même examiner les autres alternatives possibles en termes par exemple de renforcement de la qualité du service offert ou d’innovation. Or, comme le souligne Suzanne Burger dans son ouvrage « Made in Monde », face à la mondialisation, une multitude de stratégies est possible ; une seule s’avère perdante à tous les coups, celle consistant à rechercher toujours les prix les plus bas.
La délocalisation d’une grande entreprise entraîne aussi à plus ou moins brève échéance celle de ses sous-traitants et fournisseurs, qui préfèrent accompagner leurs plus gros clients pour ne pas perdre leurs marchés. Ce mouvement conjugue ses effets à celui, plus général, d’une pression accrue des donneurs d’ordre en termes de coût. Les équipementiers automobiles se voient ainsi imposés des « conditions Europe de l’Est » dans leurs relations avec les constructeurs.
« Le comportement d’investissement des entreprises est-il normal ? » Tel est le titre provocateur….d’un encart du Bulletin de la Banque de France d’août 2006, qui tente d’expliquer l’écart qui sépare dans les pays du G7 l’épargne des entreprises privées de leur investissement productif. Après avoir constaté qu’ « en pourcentage du PIB, les profits des entreprises sont à leur plus haut niveau depuis des décennies », cet article s’interroge sur l’utilisation de ces profits et arrive à la conclusion que les entreprises « accumulent des liquidités considérables » (les actifs liquides représentent 9 % du total de leurs bilans, un niveau sans précédent historique), « redistribuent beaucoup d’argent aux actionnaires » et « sont engagées dans une activité intense de fusions et acquisitions ».
Même la Banque de France ne conteste donc plus la montée en puissance des actionnaires et l’exigence croissante de rentabilité immédiate des capitaux et de distribution de dividendes, élément de pression supplémentaire en faveur de la réduction des coûts et des délocalisations. Comme le souligne Daniel Cohen dans son essai intitulé « Trois leçons sur la société post-industrielle », « Dans un renversement copernicien des fondements mêmes du salariat, ce sont désormais les salariés qui subissent les risques et les actionnaires qui s’en protègent ». La rémunération des dirigeants par des stock-options ne fait encore qu’aggraver ce dévoiement.
Cette course à la rentabilité financière faite au détriment des salariés conduit en outre à négliger tout investissement dans la recherche ou la formation du personnel, pourtant essentiels à l’avenir de l’entreprise. Elle se répercute aussi sur les sous-traitants, qui sont obligés de procéder à des restructurations internes ou à des délocalisations, pour pouvoir répondre à des exigences de réduction de coût du donneur d’ordre, dictées par l’objectif de rentabilité déterminé par l’assemblée des actionnaires.
La multiplication des rachats d’entreprises par des fonds de pension en France, tel qu’on peut le voir par exemple de façon spectaculaire dans l’industrie du décolletage dans la vallée de l’Arve en Haute-Savoie, n’est bien évidemment pas étranger à ce phénomène. En 2004, 39 milliards d’euros de revenus boursiers ont été versés par les sociétés du CAC 40 aux fonds anglo-saxons présents dans leur capital.
c) Les bombes à retardement liées aux départs massifs à la retraite et au manque d’investissement productif en France
Plusieurs mouvements sont actuellement en cours, dont les effets ne seront pleinement visibles qu’au cours des prochaines années. Première bombe à retardement, les départs massifs à la retraite de la génération des « baby-boomers » devraient être un puissant levier pour une nouvelle vague de délocalisations dans les prochaines années. Comme l’ont révélé les travaux récents de la mission d’information sur les délocalisations créée par notre commission (1), de plus en plus de groupes envisagent d’externaliser à l’étranger des fonctions informatiques ou administratives à la faveur de l’évolution de la pyramide des âges, en évitant ainsi les risques de conflits sociaux liés aux suppressions d’emploi… mais en remettant en cause nos emplois de demain. C’est ce qu’a déjà prévu de faire, malgré l’image « citoyenne » dont se prévaut l’entreprise et sans aucune concertation avec les salariés et les syndicats, la direction d’Axa France dans son projet « Ambition 2012 » en remplaçant 4 500 départs à la retraite par 1 500 embauches au Maroc et 1 500 emplois plus précaires de commerciaux non salariés en France. Seule justification avancée : une économie de 75 millions d’euros par an... dans le cadre d’un projet global qui vise à réaliser des « performances » supérieures à la profession, c’est-à-dire à faire encore plus de profits qui ne bénéficieront pas aux salariés (objectifs d’un quasi-doublement du chiffre d’affaires à l’horizon 2012, multiplication par 2,5 d’un résultat opérationnel qui atteint déjà 640 millions d’euros en 2004).
Deuxième bombe à retardement, la lourdeur des investissements réalisés dans certains secteurs qui constituait jusqu’ici un frein aux délocalisations risque de ne plus l’être. En effet, dans certains secteurs, comme l’industrie automobile ou la chimie, les nouveaux investissements ou extensions de capacités de production ne se font plus en France mais à l’étranger. Dans la chimie, cette question va se poser de façon encore plus prégnante lors de l’entrée en vigueur des dispositions du règlement Reach, qui imposent une remise à niveau des installations existantes, compte tenu des exigences liées aux tests et à la substitution de certaines substances chimiques par d’autres. Dans l’automobile, la production des nouveaux modèles est faite en Europe de l’Est plutôt qu’en France. Nous ne voyons aujourd’hui seulement que les premiers effets sur l’emploi de ce processus ; les suppressions d’emploi prendront une ampleur inédite au moment où les usines des constructeurs implantées en Europe de l’Ouest seront devenues obsolètes. Dans l’immédiat, les effets sur l’emploi de cette stratégie délibérée de « non-localisation » ne se font aujourd’hui sentir que sur les équipementiers de rang 2 et 3, dont les activités nécessitent souvent moins d’investissement et sont plus exposées à la concurrence internationale.
Il est illusoire de croire que les délocalisations ont vocation à se cantonner aux seules industries manufacturières, activités à forte intensité de main-d’œuvre peu ou pas qualifiée et qu’elles ne sont que l’illustration d’une division internationale du travail. La Chine ne restera pas longtemps « l’atelier du monde », compte tenu de la forte progression du niveau de formation de ses ingénieurs et du nombre de ses chercheurs. 300 000 ingénieurs sont formés en Chine chaque année. Le développement des formations de haut niveau en Chine ou en Inde favorisera la délocalisation d’activités à forte valeur ajoutée. Les activités de recherche et développement seront elles aussi attirées vers les pays à moindre coût dans lesquels sont déjà implantés des sites industriels. Si nous laissons partir aujourd’hui nos usines, nous serons confrontés demain à une hémorragie de nos centres de recherche.
Au-delà des activités de recherche, l’extension aux services sera incontestablement l’enjeu majeur des prochaines années. Une étude réalisée en 2006 par le cabinet Hackett Group à partir de l’analyse des comportements des 500 premières entreprises européennes considère que celles-ci devraient redéployer 1,3 million d’emplois administratifs (finance et comptabilité, gestion de la paie, gestion des achats…) en dix ans, soit 2 600 emplois en moyenne par entreprise, en raison des facilités apportées par les nouvelles technologies de l’information pour assurer une gestion décentralisée de ces fonctions et du niveau de formation de la main-d’œuvre en Asie et en Europe de l’Est. Elle relève que les gains liés à ces délocalisations, estimés à une moyenne de 96 millions d’euros par an et par entreprise, sont « trop énormes pour être ignorés ».
B.— DES CATASTROPHES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES POURTANT BIEN RÉELLES : CHÔMAGE ET DÉSINDUSTRIALISATION EN FRANCE, EXPLOITATION DANS LES PAYS À BAS SALAIRE
1. Dans les pays développés, les délocalisations touchent de plein fouet les salariés les plus vulnérables et contribuent à la désindustrialisation des territoires
Il serait réducteur, comme le font les économistes, de mesurer l’impact des délocalisations à l’aune du seul nombre de suppressions d’emplois, qui de surcroît reste lui-même à ce jour mal appréhendé et largement sous-estimé. La Banque des règlements internationaux (BRI), qui regroupe les différentes banques centrales et que l’on ne peut accuser d’être l’écho des syndicats, souligne ainsi dans son dernier rapport que les délocalisations ou leur menace ont contribué à une restriction du pouvoir de négociation des salariés et à une décrue de 5 % de la part des salaires dans l’économie ces trente dernières années. Si la BRI prend comme exemple le Japon, chacun a en tête les nombreux cas d’entreprises allemandes (Siemens, Daimlerchrysler…) qui ont réussi à négocier des réaménagements d’horaires ou de salaires sans autre contrepartie que l’abandon d’un projet de délocalisation. Tout cela dans un pays souvent présenté comme un modèle en matière de relations sociales ! Enfin, sans même être brandies comme une menace, les délocalisations concourent à alimenter un climat anxiogène au sein des entreprises, qui incite les salariés à ne plus demander de revalorisations salariales et érode leur foi en l’avenir.
Cette pression sur les salaires n’est évidemment pas acceptable et s’avère même contraire à la logique économique. En effet, elle se traduira inévitablement par une baisse de la consommation et une demande atone, qui fragiliseront la croissance et les entreprises françaises. Les salariés, amputés de leur pouvoir d’achat, n’auront d’ailleurs pas d’autre solution que de se tourner vers des articles peu onéreux fabriqués dans des pays à bas salaire…alimentant ainsi le cercle infernal des délocalisations.
De façon plus générale, par leur caractère brutal, les délocalisations mettent à mal tout notre édifice social. Elles dégradent les finances publiques, empêchant par là même la conduite de politiques publiques ambitieuses visant à la réduction des inégalités ou à la réalisation d’infrastructures de qualité, et remettent en cause la pérennité de notre système de protection sociale. Leurs effets sont concentrés sur les travailleurs les moins qualifiés, qui, faute d’avoir bénéficié d’une formation suffisante et en raison souvent d’un âge avancé, n’ont guère de chance de pouvoir retrouver un travail ou de se reconvertir… notamment lorsque plusieurs plans sociaux se succèdent dans le même bassin d’emploi, situation hélas qui tend à se banaliser. Moins de la moitié des 451 salariés de Wolber licenciés en 1999 à Soissons ont retrouvé leur emploi. À ces difficultés insolubles s’ajoute la réduction des droits sociaux engagée par la majorité actuelle depuis 2002, avec la baisse de la durée d’indemnisation des chômeurs mise en œuvre dans le cadre du plan d’aide au retour à l’emploi (PARE), et la précarisation des formes d’emploi, qui conduit les victimes des délocalisations à ne se voir proposer – dans le meilleur des cas – que contrats à temps très partiel, CDD, interim ou CNE.
Or, le travail est une des valeurs fondatrices de notre société. Les ravages psychologiques et sociaux entraînés par des années de chômage montrent bien l’importance d’un emploi dans la construction de l’identité sociale d’un individu. Le déménagement de l’outil de production est en outre vécu comme un véritable traumatisme pour des ouvriers qui ont souvent travaillé, comme leurs parents et grands-parents, dans la même usine toute leur vie. Cette valeur fondatrice du travail a été consacrée par le cinquième alinéa du Préambule de 1946, intégré dans notre bloc de constitutionnalité, qui reconnaît le « droit d’obtenir un emploi ». À l’heure où le gouvernement parle de droit au logement opposable, pourquoi ce droit, déjà inscrit dans notre Constitution, n’est-il pas mis en œuvre ?
À une fracture sociale, qui n’a jamais été aussi forte, répond aussi une fracture territoriale, les délocalisations affectant prioritairement certains bassins d’emplois souvent déjà fragiles et portant atteinte à l’objectif d’un développement harmonieux du territoire.
Aucune étude économique ne prend en compte les effets indirects des délocalisations. Or, comment peut-on nier en toute honnêteté l’impact massif d’une délocalisation sur les sous-traitants, transporteurs, fournisseurs et même sur toute l’économie locale ? On évalue généralement l’incidence des effets indirects d’une restructuration à deux fois le nombre d’emplois supprimés dans l’entreprise. Les petits commerces voient également leur activité fléchir en raison de la baisse de revenus des familles frappées par ces licenciements. Le déménagement massif de l’outil de production laisse aussi souvent derrière lui des friches industrielles et les collectivités territoriales se retrouvent en difficulté en raison de pertes importantes de recettes fiscales, au moment même où elles sont le plus sollicitées en termes de dépenses sociales ou de revitalisation du territoire.
2. Dans les pays émergents, les délocalisations n’apportent que l’illusion d’un développement pérenne, au prix d’une exploitation intense de la main-d’œuvre et de l’environnement
Si l’on en croit certaines études économiques, les délocalisations s’inscriraient dans une « dynamique d’évolution de la division internationale du travail bénéfique à l’économie dans son ensemble ». La croissance et le développement économique apportés par les délocalisations en Asie du Sud-est sont-ils vraiment synonymes de progrès pour la population de ces pays ? À l’évidence non. Les délocalisations sont motivées par l’existence de niveaux de salaires extrêmement bas dans les pays d’accueil et par la quasi-absence de protection sociale et donc de charges sociales, qui permettent une très forte rentabilité et la vente de produits moins chers que la concurrence. Elles ne répondent donc pas à une quelconque visée altruiste, d’autant plus qu’elles s’appuient également sur l’absence de droit du travail (liberté syndicale, droit du licenciement, réglementation du travail de nuit…) et de législation protectrice en terme de durée du travail et de repos compensateur… À cet égard, il n’est pas étonnant que des entreprises américaines se soient récemment opposées par une forte action de lobbying à l’adoption d’un projet de loi en Chine visant à réprimer certains abus dans l’utilisation de la main-d’œuvre et à favoriser l’implantation du syndicat officiel dans les entreprises. Les jeunes enfants, dont l’éducation est sacrifiée, ne sont pas non plus épargnés et affectés parfois dans les tâches les plus pénibles. N’oublions pas que 13 millions d’enfants travaillent dans des conditions dangereuses en Inde !
L’exploitation des hommes se double aussi d’une exploitation de l’environnement : la Chine n’hésite pas à accueillir des usines polluantes, en permettant à certains grands groupes de continuer à produire à bas coût et de s’affranchir des nouvelles normes environnementales en vigueur dans les pays occidentaux ; résultat : le tiers du territoire chinois est désormais soumis à des pluies acides.
Enfin, il n’est pas possible de considérer comme certains que les délocalisations sont le prix à payer pour la croissance des pays en développement. Elles n’apportent en effet que le mirage d’un développement pérenne, et ce au prix d’une course au « moins-disant social ». L’implantation de centres d’appel peut être remise en cause du jour au lendemain par l’apparition d’un autre pays offrant à un coût inférieur une main-d’œuvre possédant un niveau de qualification similaire. De même, la levée des quotas dans le secteur textile s’est traduite de façon spectaculaire par une réorganisation de la sous-traitance au profit de la Chine : le Pakistan ou les pays du Maghreb, terres traditionnelles d’accueil des délocalisations, en sont devenus les victimes…
II.— SEULES DES ACTIONS FORTES PERMETTRONT DE PROTÉGER LES SALARIÉS CONTRE LES DÉLOCALISATIONS SAUVAGES ET DE RESTAURER UNE CONCURRENCE LOYALE
Face aux délocalisations, la seule réponse du gouvernement actuel a été de mener une politique onéreuse de réduction des cotisations sociales des entreprises (près de 20 milliards d’euros au total en 2005), sans aucune contrepartie en termes d’emplois et au détriment de nos finances publiques, dont l’inefficacité a notamment été dénoncée l’an dernier par la Cour des comptes (2), et d’alimenter une concurrence fiscale avec nos voisins, avec notamment l’annonce récente par le Président de la République d’une baisse massive pluriannuelle de l’impôt sur les sociétés ou le crédit d’impôt offert par M. Nicolas Sarkozy aux entreprises décidant de relocaliser leur activité en France. Telle n’est pas l’orientation de la proposition de loi.
1. En créant une restitution sociale pour les entreprises qui procéderaient à des licenciements boursiers ou à des délocalisations
Pour votre rapporteur, le principe de responsabilité est le corollaire du principe de liberté et dans la mesure où la liberté d’entreprendre est pleinement garantie dans notre ordre juridique, il n’est pas acceptable que les entreprises soient les seules entités juridiques à ne pas répondre des préjudices dont elles sont l’auteur. Il est indispensable d’aller plus loin que la reconnaissance de la simple responsabilité pénale pour affirmer une véritable responsabilité sociale des entreprises. En outre, comme le rappelle l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » et il appartient au législateur d’en fixer les bornes.
L’article premier de la proposition de loi encadre le régime juridique du licenciement pour motif économique pour mettre fin aux abus de certaines entreprises dans le recours à cette notion, qui se manifestent notamment par des licenciements boursiers ou par des délocalisations. Regrettant vivement mais prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel de janvier 2002 faisant prévaloir la liberté d’entreprendre sur le droit au travail et censurant la nouvelle définition globale du licenciement économique votée par la précédente majorité dans la loi de modernisation sociale, votre rapporteur et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains proposent aujourd’hui d’en compléter la définition actuelle de façon négative, en excluant de son champ d’application ses dévoiements les plus graves. L’annonce simultanée en septembre 1999 par la direction de Michelin – Wolber d’un plan de 7 500 suppressions de postes sur trois ans et d’une hausse de 20 % du bénéfice semestriel du groupe suivie, dès le lendemain, d’une envolée de 12 % du cours en Bourse a suscité un émoi considérable dans notre pays et révélé que des entreprises pouvaient licencier tout en engrangeant des bénéfices, et même que l’annonce de licenciements faisait désormais partie intégrante de la stratégie de valorisation boursière des entreprises. Pour votre rapporteur, licenciements boursiers et délocalisations répondent à une logique commune : la course au profit et la recherche d’économies, au prix d’une pression accrue sur les salariés ; ils doivent donc tous les deux être combattus par les pouvoirs publics.
Sans toucher aux dispositions régissant le licenciement pour motif personnel, l’article premier complète à cette fin l’article L. 321-1 du code du travail par deux alinéas précisant les contours de la notion de licenciement pour motif économique. Ce type de licenciement est actuellement défini comme un licenciement effectué pour « un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives « notamment » à des « difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». Ce licenciement ne peut intervenir que « lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés » et que le reclassement du salarié dans les entreprises du groupe ne peut être réalisé. Cette formulation assez lâche a été aggravée par l’interprétation récente qu’en a fait la Cour de Cassation dans sa décision « Pages jaunes » du 11 janvier 2006, qui n’oblige plus les entreprises à invoquer des difficultés financières immédiates, pour justifier les licenciements opérés en vue de la sauvegarde de leur compétitivité. La chambre sociale de la Cour de cassation reconnaît ainsi désormais que l’évolution d’un contexte concurrentiel menaçant la compétitivité peut, en tant que telle, justifier une réorganisation « sans être subordonnée à des difficultés économiques à la date du licenciement ».
Le deuxième alinéa de l’article premier de la proposition de loi va à l’encontre des effets potentiellement ravageurs de cette jurisprudence et précise que le licenciement pour motif économique est « l’ultime acte d’une entreprise en difficulté » et que cette difficulté « n’a pu être surmontée par la réduction des coûts autres que salariaux ». Cette disposition rappelle fort opportunément aux chefs d’entreprises que les coûts salariaux ne représentent pas la seule variable d’ajustement à leur disposition ; la disparition progressive des tubes cathodiques ou de la technologie argentique dans la photographie, ainsi que la banalisation de la fabrication des lecteurs de DVD, peuvent très bien être pris en compte dans la stratégie de l’entreprise par une diversification de l’activité et davantage d’investissement dans la recherche et l’innovation. De même, est-il raisonnable de distribuer des dividendes dont la croissance atteint deux chiffres, sans rapport avec le plan de charges de l’entreprise ? La deuxième phrase de cet alinéa transfère la charge de la preuve de la nécessité du licenciement à l’employeur, à l’instar de ce qui existe déjà en matière de licenciement pour faute lourde, conformément à la recommandation de l’OIT dans sa convention n° 158.
Le troisième alinéa définit deux cas dans lesquels des licenciements prononcés pour motifs économiques sont réputés dénués de cause réelle et sérieuse. Il s’agit des licenciements prononcés :
– lorsque l’entreprise, ou sa filiale dans le cadre d’un groupe, a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices ;
– lorsque l’entreprise a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services à l’extérieur du territoire national pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé. Les implantations nouvelles d’une entreprise dans un pays émergent pour desservir le marché local ne sont donc pas visées.
Cependant, la seule interdiction faite aux entreprises de procéder à des licenciements lorsqu’elles sont prospères ou lorsqu’elles transfèrent leur activité à l’étranger ne saurait suffire. L’activité des juridictions révèle que les mesures protectrices sont régulièrement bafouées et qu’il est souvent difficile de remédier des années après aux effets désastreux de tels agissements, l’usine n’existant plus. Ainsi, les salariés de l’usine Wolber-Michelin de Soissons se sont battus plus de trois ans avant qu’un tribunal ne reconnaisse que leur licenciement n’avait pas de caractère économique.
L’article 2 de la proposition de loi met donc en place un dispositif à caractère dissuasif, s’appuyant sur un véritable droit à réparation en faveur des salariés et de l’ensemble de la collectivité nationale.
Tout d’abord, il met à la charge des entreprises qui procèdent à un licenciement collectif pour motif économique sans cause réelle et sérieuse une obligation de réintégration de l’ensemble des salariés qui le souhaitent. Cette réintégration n’est actuellement obligatoire qu’en cas de licenciement nul, en cas d’atteinte par l’employeur à une liberté fondamentale, et n’est prononcée que de façon exceptionnelle par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette réintégration peut cependant n’être pas souhaitée par l’ancien salarié qui peut craindre des mesures vexatoires pour le pousser à la faute ou à la démission, ou tout simplement n’être plus possible en cas de disparition du site de production de l’entreprise en France.
En cas d’absence de réintégration des salariés, l’article 2 instaure donc une restitution sociale versée par l’entreprise à un fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette restitution est égale à la somme de la masse salariale (salaires + charges sociales) correspondant aux salariés licenciés, des dépenses de formation entraînées le cas échéant par les suppressions de poste et de l’ensemble des préjudices subis par les territoires dont elle se désengage : moins-values fiscales, frais de dépollution et de réaménagement de friches... Les sommes gérées par le fonds sont reversées sous forme d’indemnités aux salariés, aux collectivités territoriales et aux organismes sociaux en fonction de leur préjudice. Cette restitution est due pour chaque salarié licencié jusqu’à ce que celui-ci retrouve un emploi en relation avec sa qualification.
Pour votre rapporteur, il est vain d’investir dans la création d’infrastructures ou la réalisation de zones d’accueil pour les entreprises ou d’aménager la fiscalité dans certaines zones défavorisées, tout en laissant une entière liberté pour les entreprises de bénéficier de ces avantages sans jamais rendre compte de l’impact social et territorial des conséquences de leurs décisions.
Outre le caractère dissuasif de ce dispositif, de nature à renverser le bilan coût/avantages d’une délocalisation, la mise en œuvre de cette restitution sociale inciterait fortement l’entreprise ayant procédé à une délocalisation à s’investir réellement dans la redynamisation d’un territoire en vue de la recréation indirecte des emplois qu’elle a détruits, afin de réduire la durée de versement et le montant d’une telle contribution.
2. En rendant les donneurs d’ordres ou les grands groupes responsables des conséquences de leurs décisions sur l’avenir de leurs filiales ou sous-traitants
L’article 2 prend en compte également le problème des entreprises sous-traitantes dépendantes des entreprises donneuses d’ordres, ainsi que celui des filiales. Si 66 % des salariés travaillent aujourd’hui dans une PME, cette situation masque un renforcement de la concentration financière qui profite aux multinationales : près d’un salarié sur deux travaille dans une entreprise contrôlée par un groupe. Comme l’a déjà souligné votre rapporteur, il existe un effet « boule de neige » des délocalisations, les délocalisations des donneurs d’ordre conduisant souvent les sous-traitants à faire de même, pour s’adapter aux nouvelles exigences de leur client. C’est pourquoi le dernier alinéa de l’article 2 rend responsable l’entreprise qui procède à un transfert d’activité de production ou de service à l’étranger « des conséquences économiques et sociales pour ses filiales et sous-traitants », c’est-à-dire des entreprises dépendant étroitement de son activité, et institue une obligation « in solidum » pour le versement de la restitution sociale. Le fonds spécial géré par la Caisse des dépôts et consignations pourra donc se retourner vers la société-mère ou l’entreprise donneuse d’ordre pour le paiement de tout ou partie de la restitution sociale.
3. En dissuadant les comportements prédateurs, grâce à un véritable contrôle des aides publiques aux entreprises
Comme l’a révélé en septembre 2005 l’affaire Hewlett-Packard avec l’annonce de la suppression de 1 240 postes dans la banlieue de Grenoble, les grands groupes industriels qui procèdent à des licenciements massifs ou à des délocalisations ont souvent préalablement bénéficié d’aides publiques et d’exonération de cotisations sociales pendant plusieurs années. Si l’existence de ces aides a pu permettre la création ou le maintien de sites de production en France dans un premier temps, elle ne constitue pas un avantage comparatif durable au profit de nos territoires : la fin du versement des aides se traduit par la fermeture à brève échéance de l’établissement. Au final, les actionnaires se sont enrichis, tandis que les bassins d’emplois se retrouvent fragilisés et les collectivités territoriales exsangues pour concourir à la revitalisation du territoire et financer des dépenses sociales au profit de la population.
Bien que malheureusement non mise en œuvre de façon systématique, la conditionnalité du versement des aides publiques aux entreprises au respect d’engagements pris en matière d’emplois est admise par la jurisprudence (arrêt du Conseil d’État du 3 novembre 1997 « Commune de Fougerolles »), de même que le principe d’une demande de remboursement (CE 8 juillet 1988 « Sabdec »). Elle présente un double avantage : elle permet de moraliser les pratiques des entreprises et d’améliorer l’efficacité des aides, en évitant tout gaspillage de l’argent public.
Mais, comme le souligne à juste titre le Conseil d’Orientation pour l’Emploi dans son rapport au Premier ministre du 8 février 2006, rien ne sert de mettre en place ou de revendiquer une conditionnalité des aides publiques, si les conditions posées ne sont pas effectivement contrôlées ou sanctionnées. La majorité parlementaire de la précédente législature l’avait compris et avait voté la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds accordés aux entreprises. Cette loi, adoptée à l’initiative des députés communistes, créait une commission nationale des aides publiques aux entreprises chargée d’évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs et de contrôler l’utilisation des aides publiques de toute nature accordées par l’État et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d’en améliorer l’efficacité pour l’emploi, la formation et les équilibres territoriaux. Cette commission présentait l’avantage d’avoir une composition très large, au-delà des seuls experts ou représentants de l’administration. Si elle était présidée par le ministre de l’économie et comprenait six ministres et des personnalités qualifiées, six parlementaires et des représentants des syndicats et des organisations patronales y siégeaient également. De même, afin d’éviter une vision trop centralisée et déconnectée des réalités locales, cette commission nationale pouvait s’appuyer sur les commissions régionales des aides publiques créées dans chaque région par cette même loi et co-présidées par le préfet de région et le président du conseil régional.
La nouvelle majorité arrivée au pouvoir en 2002 s’est cependant empressée d’abroger cette loi par l’article 84 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002. Geste qu’une partie de ses membres semble aujourd’hui regretter puisque Mme Chantal Brunel, rapporteur au nom de la mission d’information sur les délocalisations créée par notre commission et présidée par M. Jérôme Bignon, estime nécessaire dans son rapport de « se redonner les moyens de vérifier le respect des conditions posées par le cadre législatif ou réglementaire et d’une évaluation de ces aides ».
L’article 3 de la proposition de loi propose donc d’abroger l’article 84 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et par conséquent de remettre en vigueur la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds accordés aux entreprises et créant une commission nationale et des commissions régionales des aides publiques.
B.— METTRE FIN AU DUMPING SOCIAL EN SOUMETTANT LES IMPORTATIONS À UN PRÉLÈVEMENT CALCULÉ EN FONCTION DU DIFFÉRENTIEL SOCIAL
Tandis que le premier chapitre de la proposition de loi s’attache à « protéger les salariés contre les délocalisations », en rendant sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés à cette occasion, en créant une restitution sociale et en renforçant le contrôle des aides publiques, le second s’adresse aux entreprises installées sur le territoire national et vise à les protéger de tout dumping social.
Les délocalisations sont en effet principalement motivées par le différentiel de coût salarial dans des activités à forte intensité de main-d’œuvre. Une approche strictement arithmétique conduit naturellement les multinationales, dont les actionnaires réclament toujours plus de bénéfices, à établir pour chaque segment de la chaîne de production une étude comparative par pays des coûts et à transférer leurs usines dans des pays émergents où les niveaux de salaires sont très bas, la protection sociale quasi inexistante et les droits fondamentaux souvent bafoués. Une enquête réalisée par l’association française des chambres de commerce et d’industrie auprès d’une centaine de PME françaises ayant procédé à une délocalisation en 2004-2005 révèle là encore le caractère déterminant de la maîtrise des coûts dans les processus de délocalisations : la baisse des prix de revient apparaît comme le premier motif avancé par 45 % des chefs d’entreprise, tandis que 27 % mettent en avant la pression des donneurs d’ordre.
Il est vrai que les écarts constatés entre les pays développés et de nombreux pays émergents, en termes de coûts salariaux, sont éloquents. Le rapport entre le coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière en Chine et en France est pratiquement de 1 à 30, tandis qu’une comparaison franco-indienne laisse apparaître un rapport de 1 à 57… Sans une action volontariste menée à l’échelle mondiale, cet écart ne pourra se résorber avant longtemps, d’autant plus que ces deux pays disposent encore d’un important réservoir de main-d’œuvre.
L’écart de coût salarial est moins important entre la France et les PECO : il est de 1 à 3,4 dans le cas de la Pologne et de la République Tchèque, mais atteint des niveaux plus élevés pour les pays baltes (1 à 7,5 pour la Lettonie, 1 à 6,4 pour la Lituanie) et pour les deux nouveaux États membres, Roumanie et Bulgarie (rapports dépassant les 1 à 10). Ce moindre écart de coût salarial par rapport aux pays émergents est compensé aux yeux des investisseurs par une plus grande proximité géographique et un environnement juridique plus sûr, lié à l’adhésion à l’Union européenne.
C’est en rétablissant les conditions d’une concurrence loyale et en pénalisant de façon ciblée les importations de biens produits dans des conditions socialement inacceptables que l’on pourra dissuader les délocalisations et relancer nos industries, en renforçant leur compétitivité et en leur permettant de mettre en valeur leurs atouts (savoir-faire de la main-d’œuvre…). À l’heure où le gouvernement français réfléchit à l’instauration d’une taxe sur le carbone, votre rapporteur estime que l’intégration d’une dimension sociale et éthique dans les négociations commerciales ne doit pas être oubliée et rester une priorité et qu’une taxation pourrait de même être mise en place en matière sociale.
À cette fin, l’article 4 de la proposition de loi instaure un prélèvement sur les biens importés, établi sur la base des différences de salaires et de charges sociales entre pays importateur et exportateur. Le montant de ce prélèvement est calculé par l’application à une assiette, le niveau représenté par le salaire et les charges sociales dans le prix de revient du produit, un taux correspondant au différentiel de coût du travail entre pays exportateur et importateur. Ce taux, fixé par un décret en Conseil d’État, est établi pour chaque pays et chaque secteur. Des critères objectifs qui pourraient s’inspirer des indicateurs de l’Organisation Internationale du Travail présideront à sa détermination, afin d’éviter toute contestation. Ce taux sera bien évidemment remis à jour en fonction de l’amélioration des conditions sociales dans chaque secteur et pays et le montant du prélèvement sera diminué d’autant.
Ce prélèvement différentiel présente de nombreux avantages. Tout d’abord, il permettra de faire la part entre les investissements français à l’étranger correspondant à des délocalisations et ceux réellement destinés à la recherche légitime de nouveaux marchés dans les pays émergents : ainsi la production de la Logan ne sera pas pénalisée si elle vise à satisfaire les besoins des marchés des pays de l’Est ; en revanche, il n’y a pas de raison à produire des Logan en Roumanie plutôt qu’en France pour desservir une clientèle française, sauf à réaliser du profit et dégager des bénéfices pour les actionnaires. Seuls les véhicules importés en France seront soumis au prélèvement différentiel.
Par ailleurs, dans un premier temps, le prélèvement différentiel rétablira les conditions d’une concurrence équitable et loyale, en permettant aux entreprises installées sur notre territoire de lutter à armes égales avec leurs concurrentes et en préservant ainsi nos emplois. La TVA sociale, parfois préconisée pour rétablir la compétitivité relative de nos entreprises, n’apporte au contraire aucune garantie en la matière ; manœuvre injuste destinée à faire prendre en charge par les consommateurs, et notamment par les populations pauvres dont la propension à consommer est la plus forte, une partie du financement de la protection sociale à la place des entreprises, elle conduira inéluctablement à une baisse du pouvoir d’achat ou à de l’inflation. Il est en effet angélique de croire que les entreprises répercuteront intégralement la baisse de cotisations sociales sur leurs prix et embaucheront. La TVA sociale n’est de plus pas à la hauteur de la différence du coût du travail existant entre notre pays et les pays émergents et risque même d’accroître les écarts de prix existants entre produits nationaux et produits importés, dans la mesure où la TVA est par définition proportionnelle et que les producteurs français ne répercuteront sans doute pas la baisse de cotisations sur leur prix hors taxe. Il ne s’agira ni plus ni moins d’alimenter une concurrence fiscale et sociale stérile avec nos partenaires.
En revanche, les importations des pays dans lesquels le coût du travail est analogue au nôtre ne seront pas pénalisées par la mise en œuvre du prélèvement social différentiel. Le mouvement des délocalisations devrait en outre s’enrayer, leur intérêt financier étant annulé par le prélèvement différentiel.
Dans un second temps, la mise en œuvre de ce différentiel, de surcroît si elle est réalisée à une échelle mondiale, déclenchera un cercle vertueux : les États et les entreprises seront incités à augmenter les salaires et le niveau de protection sociale, de telle sorte que le prélèvement s’appliquant à leurs exportations se réduise. L’harmonisation des conditions sociales s’effectuerait ainsi par le haut et non par le bas, l’affaiblissement de la protection des travailleurs français, voie hélas privilégiée par l’actuel gouvernement.
Ce prélèvement procurera aussi de nouvelles recettes, qui seront affectées à un fonds de rééquilibrage des conditions de la juste concurrence, créé par l’article 5 de la proposition de loi. La majeure partie de ces ressources sera reversée aux organismes sociaux (CNAVTS, CNAM, UNEDIC…) dans la mesure où les délocalisations et le dumping social pratiqué par certains États conduisent à tarir le montant des recettes de ces organismes et à augmenter considérablement leurs dépenses (indemnités d’assurance-chômage…).
L’autre partie de ces ressources permettra de financer des programmes d’aide au développement pour les pays les moins avancés et de soutenir les entreprises engagées dans des démarches d’investissement socialement responsable. L’utilisation de ces fonds devra bien entendu être soumise à des conditions strictes d’emploi et à un véritable contrôle. Elle permettra d’accélérer le processus de rattrapage du niveau de vie, de protection sociale et de formation des salariés des pays en développement. L’affectation d’une partie du produit de ce prélèvement à des programmes sociaux ou éducatifs en faveur des pays en développement permettra en outre de favoriser un compromis commercial au niveau mondial sur la généralisation d’une telle mesure, notamment dans le cadre d’un accord au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de fonctionnement de ce fonds et notamment la part des ressources reversée aux organismes sociaux et celle affectée aux programmes d’aides au développement et au soutien aux investissements socialement responsables.
Votre rapporteur est bien entendu convaincu que le dispositif qu’il préconise n’a tout son sens et son efficacité qu’à une échelle supra-nationale, idéalement mondiale. C’est pourquoi l’article 6 de la proposition de loi fait obligation au Premier ministre de présenter un rapport au Parlement dans l’année qui suit sa promulgation sur les initiatives menées auprès de l’Union européenne, de l’Organisation des Nations Unies, de l’Organisation Internationale du Travail et de l’OMC afin d’étendre le champ d’application de ce prélèvement différentiel.
Votre rapporteur reste également conscient qu’il appartiendrait davantage à l’Union européenne, compétente en matière de politique commerciale, de prendre l’initiative d’un tel dispositif et de le promouvoir à l’échelle mondiale, notamment dans le cadre de l’OMC. Il estime cependant que dans la mesure où la Commission européenne, aveuglée par une politique de concurrence érigée en une fin en soi, n’intervient pas pour endiguer les délocalisations, le principe de subsidiarité doit pouvoir être invoqué pour permettre au législateur français de le faire directement. L’adoption de cette proposition de loi au niveau national serait un signal politique fort en direction de l’Union européenne, pour la rappeler à ses responsabilités, que ce soit en matière de politique commerciale ou sociale, et lui montrer que la liberté de circulation et la libre concurrence ne sont pas acceptées par nos concitoyens à n’importe quel prix.
La seule initiative mise en avant par la Commission pour lutter contre les délocalisations, d’ailleurs sous la pression de la France, est le fonds d’ajustement à la mondialisation, créé par le règlement CE n° 1927/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre dernier pour venir en aide aux salariés licenciés en raison des modifications majeures de la structure du commerce mondial. Mais cet instrument, dont la durée a finalement été limitée à la période 2007-2013, est strictement curatif et d’un champ d’application ridiculement petit. L’enveloppe financière affectée à ce fonds ne dépassera pas 500 millions d’euros et dépendra de la sous-utilisation de crédits budgétaires. Les critères d’intervention sont excessivement restrictifs (licenciement d’au moins 1 000 salariés d’une entreprise d’un État membre, sur une période de 4 mois, y compris les suppressions d’emplois chez les fournisseurs et sous-traitants, ou licenciement pendant une période de 9 mois d’au moins 1 000 salariés d’un secteur donné dans une région ou deux régions contiguës) et la clause de sauvegarde, permettant de rendre éligibles des restructurations ayant une incidence grave sur l’emploi et l’économie locale et ne respectant pas ces critères, ne pourra pas mobiliser plus de 15 % des ressources du fonds par an. À titre de comparaison, seules 7 (3) restructurations impliquant au moins 1 000 licenciements ont eu lieu en France sur la période 2003-2005, tandis qu’on recense dans notre pays chaque année plus de mille plans de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire plus de mille procédures concernant au moins dix salariés engagées par des entreprises de plus de cinquante salariés. Enfin, il est regrettable que le règlement communautaire mette explicitement en avant les délocalisations vers des pays tiers comme preuve suffisante de restructuration liée au commerce international, sur laquelle chaque État membre peut s’appuyer pour justifier sa demande, sans en faire de même pour les délocalisations intracommunautaires, pourtant tout aussi liées à la mondialisation et pas plus légitimes que les précédentes.
Dans ces conditions, pour votre rapporteur, le fonds d’ajustement à la mondialisation ne doit pas servir d’alibi à l’absence de progrès dans l’harmonisation des conditions sociales au sein de l’Union et l’adoption du prélèvement différentiel par la représentation nationale serait un moyen de rappeler au contraire à la Commission que la liberté de circulation est indissociable de la construction d’une Europe sociale. La priorité donnée jusqu’ici à la liberté de circulation et à la concurrence maximale favorise la mise en compétitivité des salariés et des territoires au sein de l’Europe des 25 et désormais des 27 et alimente ainsi les mouvements de délocalisations sauvages. Le message de rejet d’une Europe libérale donné par nos concitoyens lors du référendum de 2005 sur le projet de constitution pour l’Europe est en ce sens sans appel et il nous importe en tant qu’élus d’en tenir compte. Dans la mesure où les conditions sociales seront harmonisées au sein de l’Union européenne, le prélèvement différentiel ne s’appliquera pas aux biens importés d’autres États membres.
Enfin, l’adoption de ce dispositif serait un appel à l’Union européenne pour mener une politique commerciale prenant véritablement au sérieux les risques de dumping social, en négociant des accords commerciaux « sous condition » avec les pays tiers, permettant une concurrence loyale et équitable et tendant à promouvoir les normes fondamentales du travail (interdiction du travail des enfants, liberté syndicale, rémunération décente…) et l’instauration d’une véritable protection sociale.
◊
◊ ◊
Les dispositions présentées dans la proposition de loi constituent des mesures symboliques fortes pour montrer que les délocalisations ne sont pas une fatalité et qu’il importe de promouvoir l’égalité plutôt que l’inégalité pour organiser la montée en puissance des pays émergents. Elles ne sont bien entendu pas exclusives d’une politique industrielle forte et d’une recherche performante dotées de moyens conséquents, qui doivent donner à notre pays les moyens d’anticiper les mutations.
Au cours de sa réunion du 17 janvier 2007, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jacques Desallangre, sa proposition de loi (n° 3559) tendant à lutter contre les délocalisations et favoriser l’emploi.
Après l’exposé du rapporteur, Mme Chantal Brunel a indiqué partager l’objectif de la proposition de loi visant à lutter contre les délocalisations – dont l’ampleur est plus importante que ne le disent les études économiques existantes – et donc à préserver l’emploi en France.
Toutefois, les solutions envisagées soulèvent de fortes objections : la rédaction de l’article premier interdit de fait tout licenciement économique, sauf à ce que l’entreprise se trouve en situation de faillite. Pourtant, cette disposition risque d’avoir des effets contraires à l’objectif recherché : plus on restreint les possibilités de licencier, plus les entreprises hésiteront avant de procéder à de nouvelles embauches.
L’article 2 prévoit une disposition qui existe déjà à l’article L. 321-17 du code du travail, mettant à la charge des entreprises procédant à des licenciements économiques une obligation de revitalisation des bassins d’emploi, notamment sous la forme d’une contribution financière. Un seuil d’effectifs fixé à 1 000 salariés est certes prévu mais ce même article prévoit par ailleurs pour les entreprises occupant au moins 50 salariés que le préfet et l’entreprise définissent les modalités selon lesquelles cette dernière prend part aux actions visant au développement d’activités nouvelles et à l’atténuation des effets de la restructuration envisagée.
L’article 3 vise à rétablir un article de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 prévoyant un recensement des aides publiques versées aux entreprises et de rendre ce versement conditionnel. On peut toutefois se demander s’il est opportun de créer un nouvel organisme pour procéder à ces évaluations alors que le Conseil d’orientation pour l’emploi pourrait s’en charger avec l’aide des régions. Le groupe UMP partage toutefois l’idée selon laquelle le versement d’aides publiques doit avoir pour contrepartie des engagements de l’entreprise sur le maintien de l’emploi dans une région.
Par ailleurs, le groupe UMP est très défavorable aux dispositions du chapitre II de la proposition de loi, excessives dans la mesure où elles supposent que la France sorte de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il serait intéressant de réfléchir à l’instauration de quotas d’importation, mais sans que cela remette en cause les engagements internationaux de la France.
Pour l’ensemble de ses raisons, le groupe UMP ne souhaite pas passer à la discussion des articles de la proposition de loi.
S’exprimant au nom du groupe socialiste, M. François Brottes a rappelé que la loi n’était qu’un des instruments possibles de lutte contre les délocalisations. Les deux premiers articles de la proposition de loi présentent l’avantage de dissuader les entreprises de délocaliser leur activité, sans pour autant leur interdire de licencier en cas de difficultés économiques, notion sur laquelle il est légitime d’avoir un regard exigeant. En revanche, l’article 4, compte tenu des mesures de rétorsion possibles, pose problème au regard des engagements communautaires de la France, même s’il est fort regrettable que l’Union européenne s’implique peu en matière de politique industrielle. Des alternatives pourraient être étudiées, notamment en recourant à la TVA. Quant à l’article 7, qui prévoit de compenser les charges résultant pour l’État de l’application du dispositif par une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, il semble contre-productif dans la mesure où il reviendrait à financer une politique de lutte contre les délocalisations en surtaxant les entreprises vertueuses restant sur notre territoire et par conséquent soumises à l’impôt.
Le président Jean Proriol a souligné les effets pervers du dispositif proposé, qui risque de dissuader les entreprises d’embaucher en contrat à durée indéterminée et de les empêcher de se redresser en cas de baisse de leur chiffre d’affaires. Les deux premiers articles de la proposition de loi posent en outre des problèmes de constitutionnalité, dans la mesure où ils pourraient porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. On peut citer à cet égard la jurisprudence formulée par le Conseil constitutionnel lors de son contrôle de constitutionnalité de la loi de modernisation sociale. Il semble que les avis de Mme Chantal Brunel et de M. François Brottes convergent s’agissant du problème de compatibilité entre l’article 4 et la participation de la France à l’Union européenne et à l’OMC. Cet article n’offre par ailleurs aucune parade aux délocalisations dans le secteur des services et pourrait constituer un frein à nos exportations.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les éléments suivants :
– le code du travail a fait l’objet de plusieurs révisions par la majorité actuelle dans le sens d’une plus grande flexibilité sans que la situation sur le marché de l’emploi ne s’améliore pour autant ;
– il est peu probable que la proposition de loi soit censurée par le Conseil Constitutionnel dans la mesure où elle se contente d’exclure du champ d’application du licenciement économique ses dévoiements les plus choquants ;
– s’agissant de l’obligation de revitalisation du territoire prévue à l’article L. 321-17 du code du travail, elle ne vise que les entreprises d’une certaine taille, principalement les entreprises de plus de 1 000 salariés ; en outre, aucune contribution financière minimale n’est fixée par cet article du code du travail pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 999 salariés, contrairement à ce qui est envisagé par la proposition de loi ;
– plusieurs pays, tels les États-Unis, ont mis en place des taxes, sans pour autant subir de rétorsions ni sortir de l’OMC ;
– si les arguments avancés par la majorité sur les problèmes d’incompatibilité avec nos engagements communautaires et les règles de l’OMC se révèlent pertinents, il y a alors lieu d’être inquiet sur l’avenir de la taxe carbone qu’elle entend instaurer.
La Commission a alors décidé de ne pas passer à l’examen des articles et en conséquence de ne pas présenter de conclusions.
———fpfp——
© Assemblée nationale