TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 décembre 2011.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux,
Président
M. Claude BARTOLONE,
Rapporteur
M. Jean-Pierre GORGES,
Députés.
——
La commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux est composée de : MM. Claude Bartolone, président ; Jean-Pierre Gorges, rapporteur ; Dominique Baert, Michel Diefenbacher, Henri Plagnol, Éric Raoult, vice-présidents ; Jean-Jacques Candelier, Thierry Carcenac, Marc Francina, Philippe Vigier, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Balligand, Jean-Marie Binetruy, Daniel Boisserie, Patrice Calméjane, Bernard Derosier, Mme Valérie Fourneyron, MM. Jean-Louis Gagnaire, Guillaume Garot, Louis Giscard d’Estaing, Marc Goua, Sébastien Huyghe, Serge Janquin, Charles de La Verpillière, Jean-François Mancel, Étienne Mourrut, Jacques Pélissard, Jean Proriol, Didier Quentin, Paul Salen, Guy Teissier.
AVANT-PROPOS DE M. CLAUDE BARTOLONE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE 7
INTRODUCTION 9
I.– DES PRODUITS INNOVANTS MAL MAÎTRISÉS 13
A.– QU’EST CE QU’UN EMPRUNT STRUCTURÉ ? 14
1.– Une combinaison entre prêt bancaire et dérivé de marché 14
a) Un taux déterminé par l’évolution d’un indice sous-jacent 15
b) Une typologie permettant la classification des emprunts structurés 17
2.– Les emprunts structurés et les swaps ou contre-swaps 20
a) La distinction entre les produits de financement et les produits dérivés 21
b) Les produits dérivés comme les swaps et contre-swaps sont traités sur le même plan que les emprunts structurés 22
3.– La cotation Gissler, une matrice de référence pour l’ensemble de la place 23
B.– UN ESSOR RAPIDE À COMPTER DES ANNÉES 2000 28
1.– Un mode de financement innovant et attractif 28
a) Les emprunteurs ont bénéficié, sur une période parfois longue, de taux très en dessous du marché 30
b) Bien utilisés, ces produits ont permis de financer des investissements sans peser sur la fiscalité 32
2.– Un encours total sous-estimé 33
3.– Un risque global limité mais une forte concentration auprès de certains acteurs locaux 40
a) Dans les collectivités territoriales et leurs groupements 41
b) Dans les hôpitaux 42
c) Dans le secteur du logement social 43
C.– LA TOXICITÉ DE CERTAINS DE CES PRODUITS RÉVÉLÉE PAR LA CRISE DE 2007-2008 44
1.– Des indices volatils, décorrélés de l’activité locale 44
a) L’inversion de la courbe des taux, au début de la crise, a renchéri les taux des produits de pente 44
b) Le renchérissement du franc suisse, de 2008 à 2011, a déstabilisé les produits de change 46
2.– Les incertitudes entourant l’évolution au cours des prochains mois de certaines formules 47
II.– UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE 49
A.– DES ÉLUS QUI ONT PARFOIS MANQUÉ DE VIGILANCE 49
1.– Les exécutifs locaux n’ont pas toujours souscrit ces emprunts en connaissance de cause 49
2.– Des assemblées délibérantes mal informées 52
3.– Une qualification insuffisante des services pour gérer des produits aussi sophistiqués 55
4.– Le rôle ambigu des cabinets de conseil aux collectivités 56
5.– Les établissements hospitaliers invités à investir sans le soutien de la puissance publique 57
6.– L’absence d’alerte des agences de notation 59
B.– LA POLITIQUE COMMERCIALE AGRESSIVE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES 61
1.– Le marché des prêts aux collectivités est devenu le lieu d’une lutte commerciale sans merci 61
2.– La nécessité de retrouver des marges a conduit à une politique commerciale agressive 62
3.– L’étendue de la responsabilité des banques actuellement en jeu devant les tribunaux 65
a) L’absence de jurisprudence sur les emprunts structurés 65
b) La limite résultant de la notion d’usure est-elle inopérante ? 66
c) Les conséquences possibles du défaut de conseil et de mise en garde 70
d) Les conséquences judiciaires qui pourraient être tirées du défaut de conseil 72
4.– La charte de bonne conduite de 2009 : les limites de l’autodiscipline 76
a) La charte Gissler, une avancée indéniable, mais des lacunes 76
b) La médiation décidée par le Gouvernement : un bilan en demi-teinte 78
C.– LE CONTRÔLE DES SERVICES DE L’ÉTAT : TROP LIMITÉ SUR LE TERRAIN, PEU VIGILANT EN ADMINISTRATION CENTRALE 80
1.– Un contrôle de légalité à la portée insuffisante 80
2.– Des comptables publics laissés sans instructions des services centraux 82
3.– Une exception : le rôle d’alerte des juridictions financières 84
4.– La Commission bancaire : une préoccupation davantage tournée vers le bon fonctionnement du système bancaire que vers la protection du client 86
III.– LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 88
A.– LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, UNE PRIORITÉ NATIONALE 88
1.– Le rôle majeur des collectivités dans l’investissement public 88
2.– L’insuffisante liquidité du marché du crédit pèse sur les collectivités 90
a) Des tours de tables difficiles à boucler 90
b) Les émissions obligataires ne sont accessibles qu’aux grandes collectivités 91
3.– La puissance publique doit s’impliquer davantage 92
a) La fin annoncée de Dexia 92
b) Au-delà des fonds débloqués par la Caisse des dépôts, les incertitudes sont nombreuses 95
c) La création d’une agence de financement des collectivités territoriales 96
B.– L’ENCADREMENT STRICT, POUR L’AVENIR, DES MODALITÉS D’ENDETTEMENT DES COLLECTIVITÉS 97
1.– Une solution à écarter : un énième renforcement des obligations d’information 98
2.– La restriction des produits financiers accessibles aux acteurs publics 99
a) Le refus de fonder une discrimination dans l’accès à certains produits financiers sur la taille des collectivités et établissements publics 99
b) L’interdiction des produits structurés ou dérivés avec multiplicateur 100
c) La mise en place d’un capping global pour tous les prêts aux collectivités territoriales, aux hôpitaux ou aux organismes du logement social 101
3.– L’adaptation du cadre budgétaire et comptable 102
a) L’institutionnalisation d’un débat sur la dette dans les assemblées délibérantes 103
b) L’introduction de nouvelles annexes sur les emprunts 104
c) L’obligation de provisionner les risques pris 105
d) L’encadrement de la conclusion des contrats d’emprunt avant les échéances électorales 107
4.– Le renforcement de l’encadrement juridique 108
a) L’extension du contrôle de légalité aux contrats de prêt 108
b) Le refus de la soumission des contrats d’emprunt au code des marchés publics 110
5.– L’information du Parlement 111
a) Vers un rapport annuel sur la dette locale 111
b) Clarifier les prérogatives des commissions d’enquête parlementaires à l’égard des établissements de crédit 112
C.– LA GESTION MUTUALISÉE DE LA SORTIE DES DETTES LOCALES STRUCTURÉES, SANS DÉFAISANCE 112
1.– Une piste abandonnée : la création d’une structure de défaisance 113
a) Le coût de la capitalisation d’une structure de gestion de passifs serait prohibitif 114
b) La déresponsabilisation des emprunteurs 114
2.– Le regroupement des acteurs publics locaux pour négocier avec leurs créanciers 115
a) Un pôle d’assistance et de transaction s’appuyant sur les moyens des services de l’État 115
b) Le recentrage du rôle de la médiation sur les produits atypiques ou fortement toxiques 120
TRAVAUX EN COMMISSION 121
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 149
CONTRIBUTIONS 151
GLOSSAIRE DES INDICES COURAMMENT UTILISÉS 155
ANNEXE 1 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS 159
ANNEXE 2 : EXEMPLES DE CONTRATS D’EMPRUNTS STRUCTURÉS 447
AVANT-PROPOS DE M. CLAUDE BARTOLONE, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
Lorsque le 5 mai 2011, j’ai eu l’honneur de déposer comme premier signataire la proposition de résolution qui aboutira à la création de cette commission d’enquête, les collectivités territoriales mais aussi les autres acteurs publics locaux, avaient le sentiment d’être confrontés à une crise dont l’ampleur n’a été ni prévue ni rapidement appréhendée par les responsables publics.
Différents acteurs publics locaux ont ainsi souscrit, à partir des années 1990, des prêts structurés à taux variable, aux mensualités de remboursement moins importantes au départ, mais beaucoup plus risqués que les prêts à taux fixes ou variables classiques. Ces prêts avaient pour particularité d’être indexés sur des valeurs ou des rapports entre indices qui se sont révélés très volatils, entraînant une augmentation exponentielle des taux d’intérêt à régler. Ces produits financiers sont devenus une charge très lourde pour plusieurs collectivités territoriales, aggravant leur vulnérabilité dans le contexte budgétaire tendu que nous connaissons aujourd’hui. Certains élus ont employé l’expression « bombe à retardement », car ces produits ont été présentés, à l’époque de la souscription, comme une solution moderne de gestion active de la dette, et jamais comme l’instrument spéculatif qu’ils recelaient en réalité.
Les quelques mises en garde, montrant que tous les services de l’État n’avaient pas failli, mettent en lumière que cette situation n’était ni imprévisible, ni inéluctable. Pourtant, aucune mise en garde généralisée n’est intervenue avant que les premiers dérèglements, liés à la crise financière de 2008 et à l’augmentation soudaine de la volatilité des indices financiers sous-jacents, viennent montrer comment, en incitant les acteurs publics à spéculer avec les deniers publics, on leur avait fait courir des risques inconsidérés.
Les travaux de notre commission d’enquête, qui se sont déroulés dans un climat particulièrement favorable d’écoute et de coopération, ont ainsi été à la fois éclairants, édifiants et constructifs.
Éclairants, car les données que notre rapporteur a pu obtenir et synthétiser fournissent à la fois un état des lieux et des chiffres incontestables de l’ampleur de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Avec 10 690 prêts structurés recensés, représentant un encours d’emprunts à risques de 18,8 milliards d’euros, il est impossible de soutenir, comme le faisait encore le Gouvernement au début de nos travaux, qu’il s’agit d’un problème concernant quelques cas isolés.
Édifiants, car les auditions que nous avons menées ont montré comment les établissements bancaires avec lesquels les acteurs publics locaux avaient historiquement noué des relations de confiance, leur ont proposé de façon systématique, et notamment à de nombreuses petites communes, des produits potentiellement toxiques, leur faisant courir à terme des risques sans qu’ils disposent des outils nécessaires à leur gestion financière. La montée en puissance de ces emprunts indexés sur des formules toujours plus compliquées, toujours plus exotiques, s’est faite en l’absence totale de réaction de l’État, qui a largement failli dans sa mission de surveillance et de contrôle des pratiques commerciales des prêteurs au secteur local.
Travaux constructifs enfin, car si la commission d’enquête a cherché à déterminer les responsabilités des différents acteurs, elle s’est aussi penchée sur la recherche de solutions pour permettre aux collectivités et acteurs publics d’apurer les éléments toxiques de leur endettement, ainsi que sur la nécessité de fixer des règles qui éviteront aux collectivités et établissements publics de subir à l’avenir les conséquences financières de risques sous-jacents dont ils ne pouvaient mesurer toute la portée.
Trente ans après les lois Deferre de 1982, cet exemple ne peut que nous inciter à repenser le rôle de l’État dans la décentralisation, ainsi que les modes de financement des investissements publics locaux, question qui a été négligée par la puissance publique.
Car le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales ne peut et ne doit signifier l’absence de règles et de cadre garantissant les modalités de l’action des collectivités. Il convient en particulier de rétablir une véritable transparence dans la gestion de l’endettement des acteurs publics locaux, trop longtemps laissé candidement entre les mains des banquiers et des seuls spécialistes.
Je me félicite du travail consensuel qui a pu être mené par notre commission d’enquête. Celle-ci a pu obtenir toutes les informations nécessaires de la part des différentes parties prenantes de ce dossier, sans que l’on oppose le secret bancaire à la recherche de la vérité.
Les solutions proposées par le rapport nécessiteront un réel volontarisme du Gouvernement et de ses services pour que soit résorbé l’encours de prêts structurés existants. Elles exigeront aussi d’engager un processus législatif pour mettre en place le cadre de l’endettement des collectivités et des établissements publics.
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux de la commission, il est clairement apparu que ceux-ci ont permis à tous les responsables publics, locaux comme nationaux, une réelle prise de conscience des enjeux en termes d’accès au financement comme de sécurité pour le budget des acteurs publics locaux. C’est pourquoi ce rapport d’enquête ne peut être que la première étape d’une feuille de route, qui devra être rapidement mise en œuvre.
Le présent rapport conclut les travaux de la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux. Cette commission avait été créée par la résolution n° 675 adoptée par l’Assemblée nationale le 8 juin 2011 (1) dans les conditions prévues par l’article 141 de son Règlement, lequel permet à un président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire de demander un débat sur une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, celle-ci ne pouvant être alors rejetée qu’à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée. La proposition de résolution avait été adoptée à l’unanimité par la commission des Finances le 25 mai 2011.
C’est à M. Claude Bartolone, premier signataire de la proposition ayant conduit à la création de la commission d’enquête, qu’est revenue la présidence de cette instance, en application de l’article 143 du Règlement.
La commission, composée de trente représentants de tous les groupes politiques de l’Assemblée, a procédé à 23 auditions entre le 6 juillet et le 29 novembre, au cours desquelles 80 personnes ont été reçues. Elle a également tenu quatre réunions dont deux débats d'orientation entre ses membres.
Au cours des six mois écoulés, le Rapporteur a rassemblé un maximum d’éléments objectifs et quantifiables afin de dresser un « diagnostic » de la situation, c'est-à-dire tout d’abord le montant de l’encours global des prêts structurés et au sein de celui-ci, la part de l’encours à risque. Pour cela, nous avons obtenu que les sept établissements de crédit actifs sur le marché des prêts au secteur local lèvent le secret bancaire : nous ont ainsi été communiqués les montants et les caractéristiques des 10 688 contrats de prêts souscrits par des acteurs publics locaux.
Le Rapporteur a également obtenu copie de cinq rapports confidentiels de l’Inspection générale des finances et de l’ancienne Commission bancaire.
Nous avons entendu les différentes parties concernées : les représentants des collectivités territoriales et autres acteurs publics ayant souscrit des emprunts à risque, les représentants des établissements bancaires ayant commercialisé ces emprunts, les représentants des services de l’État, au niveau local et central, qui auraient dû faire l’analyse de l’évolution de l’endettement local et de ses caractéristiques. Des spécialistes des finances locales ont été auditionnés et, enfin, les représentants des organes de surveillance et de contrôle des banques.
D’autres élus de collectivités connaissant de graves difficultés à cause de la hausse des taux d’intérêts de leurs emprunts auraient souhaité être entendus par la commission, afin de témoigner des erreurs commises par les élus qui les ont précédés ou de la rigidité dont font preuve aujourd’hui les établissements bancaires lorsqu’il leur est demandé de consentir à une solution viable pour la collectivité emprunteuse. La commission devant achever ses travaux dans un délai légal de six mois, il n’a pas été possible de recevoir toutes les personnes qui l’ont souhaité. Toutefois, nous pensons que les cas qui ont été examinés de manière approfondie étaient représentatifs des difficultés de nombreuses autres collectivités ou autres acteurs publics.
Cette commission d’enquête n’avait pas vocation à régler des comptes, mais à éviter que ces situations dangereuses ne se reproduisent. Elle devait soutenir les collectivités en difficulté et s’efforcer de trouver des solutions adaptées.
La première partie du rapport est consacrée à la description des emprunts et des swaps structurés, avec des exemples précis des formules utilisées. Nous avons évalué l’encours total des emprunts structurés, puis l’encours à risque, qui s’élève à 18,807 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs publics locaux, soit 58,6 % de l’encours total. Pour les seules collectivités territoriales, cet encours à risque représente 13,648 milliards d’euros, dépassant l’estimation avancée par la Cour des comptes dans son rapport public thématique paru en juillet dernier (2).
La deuxième partie du rapport montre que les responsabilités ont été partagées entre les élus qui ont souvent manqué de vigilance ou ne disposaient pas des compétences nécessaires pour comprendre les risques sous-jacents aux emprunts qu’ils contractaient, les banques qui ont développé une politique commerciale systématique et très agressive, souvent trompeuse, et enfin, le troisième responsable, l’État, avec un contrôle superficiel localement et une certaine myopie de l’administration centrale face aux alertes qui apparaissaient ici ou là.
Nous avons vu que les banques se sont mises à inventer des formules de plus en plus sophistiquées et intrinsèquement risquées. Ces produits dits structurés présentent à très court terme des taux très avantageux, mais qui ont montré très vite, dans le contexte financier et monétaire perturbé que nous connaissons depuis 2007, qu’ils pouvaient vite sortir des prévisions rassurantes, du fait d’indexations sophistiquées.
Les collectivités ont été des proies parfaites pour les banques qui ont proposé ces produits structurés : elles doivent faire face à des besoins de financement importants liés au niveau élevé de leurs dépenses d’investissement, toujours équilibrées bien sûr par la fiscalité ; et, bien souvent, les collectivités concernées se trouvaient dans une situation délicate : ces produits paraissaient donc attirants. Elles sont de plus pour les banques une clientèle solvable, car elles offrent la garantie implicite de l’État, cadre très protecteur pour des créanciers.
Nous avons examiné quel rôle avaient joué les représentants de l’État dans ce dossier au cours des dernières années. En vertu du principe de libre administration des collectivités, l’État ne doit pas s’immiscer dans la gestion des affaires locales ; mais il a conservé un rôle de conseil et d’alerte, qui en l’occurrence n’a pas été rempli. Les organes de surveillance et de contrôle ne disposaient pas d’une mission étendue à la protection de l’acteur public emprunteur, mais il a été constaté qu’ils semblaient aussi s’être autolimités, ne voulant pas entrer dans l’analyse des caractéristiques et des dangers potentiels de ces nouveaux produits financiers qu’étaient les emprunts structurés.
La commission a examiné les réponses apportées par l’État depuis le déclenchement de la crise des emprunts toxiques, à partir de 2009 : la mise en œuvre de la charte de bonne conduite en 2009 et l’institution d’une médiation confiée à M. Éric Gissler. Il est apparu clairement que ces réponses n’étaient pas à la hauteur des besoins d’encadrement et de sécurisation du financement des acteurs locaux d’une part, et, d’autre part, de l’urgence à traiter de manière rapide de très nombreux dossiers d’emprunts dont les risques latents se révèlent actuellement ou vont se révéler l’année prochaine, puisque la période bonifiée de ces produits est sur le point de prendre fin.
Dans la troisième partie de ce rapport, nous avons d’abord proposé des mesures pour une meilleure gouvernance budgétaire et comptable des collectivités, davantage de transparence, ainsi qu’un encadrement de leurs modalités d’endettement.
Enfin, nous avons élaboré une méthode pour traiter le cas des collectivités qui détiennent des emprunts à risques. A été choisi un principe de regroupement des acteurs publics locaux pour négocier avec leurs créanciers, non plus collectivité par collectivité, mais produit par produit. Nous avons souhaité privilégier l’apurement définitif des emprunts structurés, plus encore que de proposer une solution aux emprunteurs en situation difficile.
Le Rapporteur a constaté que les travaux de la commission se sont déroulés dans une assez large unanimité ; il s’est efforcé pour sa part de tenir compte des expériences des nombreux élus qui ont apporté leur témoignage, qu’ils soient membres de la commission ou auditionnés par la commission. Il souhaite vivement que les propositions, élaborées de manière consensuelle au sein de la commission, soient mises en œuvre dans les prochains mois par le Gouvernement, afin d’éviter une aggravation de la situation des collectivités concernées et une incompréhension des élus et des citoyens quant au traitement favorable réservé aux banques, soutenues par la puissance publique en cas de nécessité mais peu ouvertes à admettre leurs erreurs face aux emprunteurs locaux.
I.– DES PRODUITS INNOVANTS MAL MAÎTRISÉS
La dette des administrations publiques locales (APUL) représente une part assez faible de l’endettement public par rapport à la richesse nationale, puisqu’elle ne dépasse pas 10,1 % du produit intérieur brut. L’encours correspondant atteint tout de même 160,6 milliards d’euros auxquels s’ajoutent encore 89,5 milliards pour le secteur du logement social et 24 milliards pour les établissements de santé – soit, pour les acteurs publics locaux retenus dans le champ de l’enquête, un total de 276,8 milliards d’euros.
La composition de la dette locale est, en revanche, moins bien connue. Au-delà des montants bruts publiés chaque année par le ministère du Budget et l’INSEE, aucune statistique publique ne permet de déterminer de quels types d’emprunts cet encours est constitué, encore moins d’obtenir une ventilation par type de taux d’intérêt ou d’en connaître la maturité moyenne. Comme l’a souligné le Président de la formation interjuridictions chargée d’élaborer le récent rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la dette publique locale (3), « indéniablement il reste des progrès à accomplir en matière de classification des composantes de cette dette.» (4)
Au-delà du financement des besoins ponctuels de trésorerie (5), trois grandes catégories d’emprunts de moyen ou long terme souscrits par les acteurs publics locaux peuvent être distinguées :
● Les emprunts à taux fixe, représentant moins de la moitié des encours (47 %), sont des prêts consentis par les établissements bancaires dont le montant de rémunération est fixé, une fois pour toutes, au moment de la souscription par le client.
● Les emprunts à taux variable, soit un tiers de la dette locale, se distinguent des premiers car le niveau de rémunération de la banque n’est pas fixé à l’avance mais le processus de fixation de celle-ci est connu – une formule fait ainsi référence à un (variable mono-index) ou plusieurs indices (variable multi-index) afin de déterminer le taux et, le cas échéant, la durée (prêts à échéances fixes).
Les indices les plus fréquemment utilisés sont l’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), l’EONIA (Euro Overnight Interest Average) et ses dérivés que sont le T4M (Taux moyen mensuel du marché monétaire), le TAM (Taux annuel monétaire) ou le TAG (Taux annuel glissant) (6).
● Les emprunts structurés atteignent un cinquième des encours de dette ; ils sont décrits en détail infra.
Le Rapporteur met néanmoins en garde contre la tentation d’apprécier la dangerosité des emprunts sur le fondement d’une typologie aussi simpliste.
Certains prêts à taux fixe ou variable peuvent en effet se révéler particulièrement risqués lorsqu’ils sont, par exemple, souscrits en devises étrangères. Selon les informations transmises par le groupe Dexia, premier créancier des collectivités territoriales et des acteurs publics locaux, 2 169 emprunts (à taux fixe ou variable) libellés en devises figurent au bilan de la banque, soit 746 millions d’euros, représentant toutefois à peine 1 % de l’encours total.
En sens inverse, les emprunts structurés sont loin d’être tous toxiques. Des formules basées sur des indices monétaires dans (EURIBOR) ou hors de la zone euro (LIBOR britannique, WIBOR polonais, PRIBOR tchèque…) avec une barrière simple, mais sans multiplicateur ni effet levier, présentent un risque faible et sont, par conséquent, notées 1B ou 4B dans la cotation élaborée par l’inspecteur général M. Éric Gissler (cf. le 3. ci-dessous).
A.– QU’EST CE QU’UN EMPRUNT STRUCTURÉ ?
Conçus au gré des besoins, sans souci de catégorisation juridique, ces emprunts sur-mesure ou structurés regroupent des produits financiers hétéroclites au point qu’il est difficile d’en donner une définition systématique.
1.– Une combinaison entre prêt bancaire et dérivé de marché
Les emprunts structurés se décrivent plus commodément qu’ils ne se rangent dans une classification ; c’est pourquoi l’on met souvent en avant leur caractère mixte pour les distinguer (7). Ils intègrent en effet, dans un seul et même contrat, deux éléments :
– un financement initial, sous la forme d’un prêt bancaire ;
– et une ou plusieurs opérations sur produits dérivés, qui constituent autant d’instruments financiers.
S’apparentant à la fois à des activités de crédit, de haut de bilan (8) et de marché, ces produits sont conçus par les directions des financements structurés au sein des établissements bancaires, en recourant à l’expertise technique des équipes des salles de marchés.
Ils sont mis au point par les banques afin de répondre aux besoins de financement de leurs clients : les emprunts structurés ne sont donc pas spécifiques aux acteurs publics locaux mais peuvent être souscrits par des entreprises (financements dits corporate – financement de la croissance externe, financement de projets) voire des investisseurs individuels (financement de transmission – leveraged finance).
À titre d’exemple, au sein du groupe des Caisses d’épargne – devenu Banques populaires Caisses d’épargne (BPCE) – l’ingénierie financière était assurée par la banque de financement et d’investissement Ixis puis par Natixis, qui regroupe les activités de financements spécialisés et de marchés de capitaux. Chez Dexia, les salles de marchés étaient également « chargées de définir les caractéristiques du prêt conformément aux demandes des collectivités » (9) en liaison avec la direction commerciale et de l’ingénierie financière, avant sa distribution par les 38 unités commerciales régionales du réseau.
a) Un taux déterminé par l’évolution d’un indice sous-jacent
Partie intégrante des emprunts structurés, les produits dérivés sont des instruments de gestion des risques financiers utilisés pour couvrir quatre types de risque (marché, liquidité, contrepartie, taux) (10). Ils sont négociés soit sur des marchés de gré à gré, soit sur des marchés réglementés (autrement dit, des bourses).
Les emprunts structurés combinent, de manière étroite, trois catégories de produits dérivés :
● Les swaps désignent des échanges de flux financiers, calculés à partir d’un montant théorique de référence appelé notionnel, entre deux entités pendant une certaine période de temps : en matière d’emprunts, les swaps de taux d’intérêt permettent d’échanger par exemple un taux fixe contre un taux variable.
Ces produits sont à la base des structures dans lesquelles, avant ou après la phase d’amortissement où le taux dépend de l’évolution d’un indice sous-jacent, l’emprunteur bénéficie d’une phase bonifiée – généralement de deux à cinq ans, parfois davantage – avec un taux très faible voire nul.
Ainsi le contrat TOFIX OVERTEC proposé par Dexia comporte-t-il deux phases :
– la première, assez courte (onze mois pour l’emprunt contracté par Compiègne (11) en 2006), avec un taux fixe (3,20 % l’an) ;
– la seconde (dix ans) avec un taux calculé suivant la formule [2 x Euribor12M – TEC10 + constante] (fixée à 0,85 %, en l’espèce).
Selon les informations recueillies par le Rapporteur, trente-quatre contrats basés sur des formules analogues ne totalisaient plus, fin août, qu’un encours de 185 millions d’euros dans les comptes de Dexia ; la plupart des contrats du même type, devenus moins intéressants avec la remontée des taux, ont été renégociés au cours des dernières années. Ce type d’emprunt est aujourd’hui classé 3D dans la cotation Gissler.
● Les contrats d’option par lesquels une partie accorde à une autre le droit (mais non l’obligation) de lui acheter ou de lui vendre un actif, durant une période ou à une date précise, moyennant le versement d’une prime ; grâce à ces instruments – le plus simple est le cap qui permet de faire face à une hausse excessive des taux – l’acquéreur peut se couvrir de manière conditionnelle contre un risque.
Ce sont les produits dans lesquels la formule correspondant au taux d’intérêt est construite avec une condition – ils se reconnaissent aisément par la présence de la conjonction « si » dans les contrats.
Le groupe Dexia a, par exemple, proposé à ses clients des financements à taux fixe (ou indexé sur l’EURIBOR) annulable pour lesquels, après une première phase en taux fixe (ou variable), la banque pouvait à une date donnée décider de basculer définitivement le taux fixe en taux variable (ou le taux variable en taux fixe). En dépit de l’imprévisibilité de leurs modalités d’indexation, ces emprunts structurés peu volatils sont considérés comme faiblement risqués et cotés 1C.
Comme leurs concurrents, les caisses d’épargne ont également commercialisé un contrat-type HELVETIX dont les annuités reposaient, après une phase bonifiée (quatre années au taux fixe de 2,74 %, dans le cas du contrat souscrit par Melun (12) en 2007), sur la formule suivante :
– si la parité entre l’euro et le franc suisse (EUR/CHF) est supérieure ou égale à 1,44 alors le taux d’intérêt applicable sera un taux fixe de 2,74 % ;
– sinon, le taux d’intérêt est égal à [2,74 % + 0,6 x (EUR/CHF au jour de souscription – EUR/CHF)/(EUR/CHF)].
De tels contrats, basés sur des indices hors zone euro, sont exclus de la charte Gissler (classés « hors charte » ou 6F).
● Les contrats à terme, de type forwards (gré à gré) et futures (sur un marché réglementé), sont des engagements fermes d’acheter ou de vendre une quantité convenue d’un actif à un prix et à une date future convenus : les forward rate agreement permettent ainsi de fixer à l’avance le taux d’intérêt pour un montant nominal donné.
Dans certains produits, ce n’est pas la formule sur laquelle est basé le taux d’intérêt mais l’indice sous-jacent lui-même qui dépend des anticipations des marchés. La formule utilisée fera, par exemple, référence à un écart entre deux points plus ou moins éloignés sur la courbe des taux – ce que l’on nomme spread entre les taux longs et les taux moyens. Beaucoup de contrats sont ainsi basés sur des CMS (constant maturity swaps) ; il s’agit d’opérations d’échanges périodiques d’intérêt entre un taux long glissant et un taux court, sur une maturité donnée (13).
À titre d’illustration, le Rapporteur rappelle que Dexia a commercialisé un contrat « TOFIX FIXMS » comportant trois phases :
– une première phase (deux ans pour la commune de Gourdon
– 4 858 habitants – dans le Lot (14)), pendant laquelle le taux appliqué est fixe (3,84 %) ;
– une deuxième phase (pendant quinze ans), où le taux est égal à
[5,21 % – 5x (CMS EUR 30 ans – CMS EUR 2 ans)] si la différence entre le CMS EUR 10 30 ans et le CMS EUR 2 ans est négative et à 3,84 % sinon ;
– une troisième phase (pendant les sept dernières années), avec un taux à nouveau fixé à 3,84 %.
Du fait de son multiplicateur, une telle formule est cotée 3E sur le fondement de la charte Gissler. Selon le dernier pointage effectué par la commission d’enquête, 926 contrats analogues ont été souscrits auprès de Dexia pour un encours de 5,217 milliards d’euros.
b) Une typologie permettant la classification des emprunts structurés
Grâce aux combinaisons permises par ces instruments dérivés, et à la variété des indices sous-jacents, la multiplication et la sophistication des formules à la base des emprunts structurés sont virtuellement illimitées. Alors que « le Crédit local de France, ancêtre de Dexia, commercialisait trois types de prêts en 1995 ; Dexia en commercialisait quarante-trois en 2000, cent soixante-sept en 2006, deux cent vingt-trois en 2008, et n’en commercialise désormais plus que quinze », selon ses dirigeants actuels (15).
Une première analyse des dangers inhérents à ces produits structurés pourrait s’appuyer sur une étude de la volatilité et du risque de dé-corrélation (16) des indices sous-jacents. Il est toutefois délicat d’apprécier in abstracto la stabilité d’indices aussi variés, adossés à un taux d’intérêt (monétaire ou obligataire), une monnaie (taux d’inflation ou parité de change avec une autre devise) ou des obligations (SIFMA swap index, par exemple) (17).
Ces indices peuvent éventuellement être combinés au sein d’une même formule, ce qui accroît la volatilité du produit ; ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis a-t-il contracté (18) auprès de la Société Générale un emprunt structuré avec trois phases et deux index :
– sur 2007-2008 : un taux fixe de 2,80 % ;
– sur 2008-2009 : un taux fixe de 3,27 % ;
– de 2009 à 2022 : si EUR/USD<1,52 alors le taux d’intérêt est égal à EURIBOR 12 MOIS (Postfixé)–0,6 sinon il est égal à 4,95+(50 x (1–(1,52/EUR–USD))).
Les indices plus exotiques comme les matières premières, les actions voire les indices propriétaires (19) semblent, sur la foi des documents transmis par les banques au Rapporteur de la commission d’enquête, avoir disparu des formules aujourd’hui proposées aux acteurs publics locaux. Il y a lieu de s’en féliciter, même si certaines structures, parfois publiquement décriées, pouvaient ponctuellement répondre à un besoin spécifique.
En 2008, Dexia avait ainsi mis en place pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes un emprunt structuré dénommé Energilys, avec un sous-jacent atypique (cours du baril de brent) et a priori hautement spéculatif, mais destiné à lui permettre de neutraliser la hausse du prix de l’énergie (20).
Afin de mieux appréhender les structures les plus fréquemment rencontrées, cette approche peut être croisée avec une typologie fondée sur l’amplitude des variations permises par les formules utilisées.
● L’effet de levier, encore appelé multiplicateur, permet de démultiplier le taux lorsque le sous-jacent (taux, parité de monnaie…) sur lequel il est indexé atteint un niveau donné.
Le groupe bancaire Dexia a commercialisé une formule, cotée 2E, qui illustre bien ce mécanisme, avec un multiplicateur de 5 :
– si EURIBOR 12 MOIS EUR ≤ 6,25 % alors le taux d’intérêt est égal à 6,8 % – MAX (0 ; Inflation zone euro) ;
– sinon le taux est égal à 6,8 % – MAX (0 ; Inflation zone euro) + 5*(EURIBOR 12 MOIS EUR – 6,25 %).
L’effet est alors très important puisqu’un coefficient de 5 majore de 100 points de base le taux d’intérêt dès lors que l’EURIBOR s’accroît de 0,2 % (20 points de base).
● L’effet de change caractérise, quant à lui, l’indexation du taux sur la parité de deux monnaies ou l’écart entre les parités de plusieurs monnaies. Il peut se combiner avec le précédent.
Le contrat suivant, proposé par Dexia, est classé hors charte puisqu’il a pour sous-jacent la parité avec une devise : [4,18 % x (113 / (EUR/JPY))].
● On parlera, en revanche, d’effet de pente lorsque le taux est déterminé par référence à l’écart entre deux points plus ou moins éloignés sur la courbe des taux d’intérêt, par exemple le différentiel (en anglais, spread) entre les taux longs et les taux moyens.
Additionné à un effet de levier, un produit de cette nature verra le taux d’intérêt payé par le souscripteur évoluer plus rapidement que le sous-jacent : la formule suivante [taux égal à 3,62 % si CMS 20 EUR – CMS 2 EUR > 0,15 % sinon 3,62 % – 9,60 * ((CMS 20 EUR – CMS 2 EUR) – 0,15 %)], proposée par le groupe Crédit agricole, peut connaître d’importantes variations ce qui justifie sa cotation 5E. Une telle formule, comme le précise le contrat, ne fonctionne en effet que lorsqu’il y a inversion de la courbe et que donc (CMS 20 EUR – CMS 2 EUR) est négatif ; 3,62 % est alors un minimum et non plus un maximum.
● À la différence de la barrière simple qui conditionne à chaque échéance le taux d’intérêt au franchissement ou non par un indice sous-jacent d’un niveau de référence, la barrière activante s’apparente à un effet cliquet. Une fois réalisée la ou les conditions prévues au contrat, le taux d’intérêt applicable est majoré, sans possibilité de retour en arrière quelle que soit l’évolution des conditions de marché.
Symétriquement, la barrière désactivante (knock-out ou KO) fonctionne de la même manière que la structure à barrière activante sauf que la majoration du taux est désactivée lorsque la ou les conditions sont réalisées. La filiale française de la banque irlandaise Depfa a ainsi signé avec une commune un prêt structuré, classé hors charte, selon la formule [3,50 % + Max [0 % ; (0,85–USD/CHF)/USD/CHF] x Y, où Y=0 définitivement si USD/CHF >= 0,96 une seule fois du 20/06/14 jusqu’à maturité].
● Par produits de courbe, on désigne les structures dans lesquelles le taux d’intérêt est conditionné à l’évolution comparée de deux taux d’intérêt issus de deux zones économiques distinctes – d’où leur nom anglais channels. Il s’agit le plus souvent du différentiel entre un taux britannique et un taux européen, suisse ou japonais.
● Enfin, l’effet cumulateur ou « boule-de-neige » (snowball) traduit l’augmentation du taux à chaque échéance par incorporation du taux de l’échéance précédente. Concrètement, une marge, encore appelée coupon, est calculée (trimestriellement, par exemple) sur la base d’un indice sous-jacent. Chaque trimestre, une nouvelle marge est calculée et vient se rajouter à la marge précédente. C’est l’effet cumulatif.
Un contrat de ce type a été souscrit auprès du Crédit agricole, selon la formule suivante :
– du 01/02/08 au 01/02/09 : 3,53 % ;
– du 01/02/09 au 01/02/20 : 3,53 % + coupon conditionnel ; avec coupon conditionnel (n) = Max [0 % ; 2 x (3,20 % – CMS10)+coupon n-1] ;
– du 01/02/20 au 01/08/27 : 3,53 %.
En clair, si le CMS EUR 10 ans reste toujours supérieur à 3,20 %, la marge trimestrielle reste la même d’un trimestre à l’autre. Dans le cas contraire, la marge augmente. Selon les informations recueillies par le Rapporteur, le dernier taux payé par la contrepartie atteint déjà 4,38 % ; ce type de produit est désormais exclu de la charte de bonne conduite.
2.– Les emprunts structurés et les swaps ou contre-swaps
Afin de se protéger de la hausse des taux variables et de profiter de la baisse des taux fixes des emprunts qu’ils ont souscrits, les acteurs publics locaux ont, comme les autres agents économiques, recours à des opérations d’échanges de taux (swaps) qui leur sont ouvertes depuis 1992. Ces produits dérivés permettent, sans remettre en cause les conditions du prêt initial, de recevoir d’une contrepartie les intérêts dus à l’établissement prêteur en échange du versement d’intérêts calculés selon un autre indice.
Comme le rappelait l’un des experts entendus par la commission, l’utilité des swaps n’est pas à remettre en cause, même pour des produits simples tels qu’un taux fixe ou l’Euribor, qui présentent des risques opposés et nécessitent donc un dosage approprié : « il n’est pas toujours possible, quand on anticipe une évolution défavorable des marchés, de procéder à un remboursement anticipé – on ne peut souvent le faire qu’une fois par an, à l’issue d’un préavis et au prix d’une surfacturation (…) au lieu d’attendre, il peut être tout à fait pertinent de faire un swap pour transformer immédiatement la structure. » (21)
a) La distinction entre les produits de financement et les produits dérivés
À ce titre, ils peuvent être considérés comme des instruments de couverture. Le capital couvert ne constitue pas un encours puisqu’il n’y a pas d’échange entre acheteur et vendeur ; c’est le notionnel. Le cas échéant, plusieurs swaps successifs peuvent être conclus : on parle alors de contre-swaps.
S’ils peuvent être combinés à un emprunt (dans un produit « structuré »), comme détaillé précédemment, ces swaps peuvent aussi être souscrits pour eux-mêmes et ne porter que sur le taux d’intérêt proprement dit sans donner lieu à endettement supplémentaire. Toutefois, la distinction n’est pas toujours aussi claire et, dans certains montages, les swaps sont accompagnés d’une partie financement, qui peut prendre différentes formes : paniers d’actions accompagnés d’un equity swap, panier d’obligations avec asset swap, repurchase agreements (repo)...
LES PRODUITS DÉRIVÉS DE COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX
INTITULÉ DU PRODUIT |
DÉRIVÉ DESCRIPTIF ET UTILISATION DU PRODUIT |
SWAP différé / forward SWAP |
Ce SWAP est un SWAP classique dont les modalités sont fixées immédiatement, mais dont la date de départ est différée de plusieurs mois après la date de conclusion. |
SWAP modifiable au gré de l’acheteur |
L’acheteur du SWAP a la possibilité de modifier une ou plusieurs caractéristiques de son SWAP à une date et à des conditions fixées dans la transaction. |
Option de SWAP / SWAPTION |
Une option de SWAP est une opération par laquelle l’acheteur de l’option, payant une prime au départ, a le droit de choisir le moment où le SWAP est mis en place, sachant que les conditions du SWAP sont fixées dès la conclusion de l’opération. L’acheteur peut également décider de ne pas exercer l’option, l’opération se termine alors sans aucun échange. |
SWAP contingent |
Ce type de SWAP est proche de l’option de SWAP, à la seule différence que l’existence du SWAP ne dépend pas de la volonté d’une des parties, mais d’un événement extérieur. |
INTITULÉ DU PRODUIT |
DÉRIVÉ DESCRIPTIF ET UTILISATION DU PRODUIT |
SWAP à taux bonifiés |
Cet instrument permet de se garantir un taux fixe bonifié, c’est-à-dire inférieur au taux de SWAP du marché. |
SWAP prolongeable |
Cet instrument permet de se réserver le droit de prolonger un SWAP pour une durée définie, aux mêmes conditions que le SWAP initial. |
CAP à degrés |
Il s’agit d’un contrat de garantie de taux plafond présentant deux niveaux de protection suivant l’évolution du taux variable de référence. Ce mécanisme permet aussi une réduction de la prime à payer. |
CAP à taux évolutif |
Ce CAP présente plusieurs niveaux de protection, définis le jour de la conclusion du contrat. Chaque taux couvre une période d’un an. La structure des taux garantis peut être croissante ou décroissante. |
CAP à cartouches / CAP flexible |
Ce CAP fonctionne comme un CAP classique, mais pour un nombre limité de constatations, de « cartouches ». À chaque constatation, l’acheteur du CAP décide ou non d’utiliser une de ses cartouches. Ce mécanisme permet aussi de réduire la prime à payer. |
CAP à prime restituable |
Ce CAP se présente comme un CAP standard dans lequel la prime, associée à l’option de taux, est remboursée partiellement à l’échéance si le CAP n’a pas été exercé. |
Tunnel à prime zéro |
Le contrat est conclu de telle manière que la vente du FLOOR procure une prime égale à la vente payée sur le CAP. |
Source : Circulaire du 25 juin 2010 précitée.
b) Les produits dérivés comme les swaps et contre-swaps sont traités sur le même plan que les emprunts structurés
Ces instruments de couverture n’ont pas échappé à la sophistication croissante des produits financiers ; sont ainsi apparues des possibilités de modulation du taux du swap versé à la contrepartie en fonction de la réalisation d’une condition de marché. Cette possibilité de bonifier le taux du swap a pour corollaire un accroissement du risque encouru, comme pour les produits structurés. C’est pourquoi la charte de bonne conduite et le système de cotation proposés par M. Éric Gissler visent, à bon escient, l’ensemble des produits financiers, c’est-à-dire à la fois emprunts (structurés ou non) et les produits dérivés comme les swaps.
Cette complexification croissante peut être aisément illustrée par un exemple. Le département de la Seine-Saint-Denis a successivement souscrit un emprunt structuré auprès de Depfa, un swap sur ce sous-jacent auprès de Natixis et enfin un contre-swap auprès de Depfa (en 2007). C’est donc ce dernier qui doit être regardé pour apprécier la position finale du département.
Ce contre-swap bénéficie actuellement d’un taux fixe bonifié de 1,80 %. À compter du mois de février 2012, il sera soumis à une formule basée sur la double parité euro/dollar et euro/franc suisse [Taux égal à 1,80 % + MAX (0 ; EUR/USD-EUR/CHF)]. Il s’agit d’un produit de courbe potentiellement risqué, classé « hors charte ».
Selon les anticipations du 4 novembre 2011 communiquées à la commission d’enquête, le taux d’intérêt pourrait atteindre 17,30 % pour l’échéance de février 2012. En rythme annuel, cela engendrerait 1,64 million d’euros d’intérêts contre 0,19 million d’euros sur la base de la bonification en 2011.
Le Rapporteur souligne que ce contre-swap demeure moins risqué que le swap qu’il couvre car ce dernier afficherait, pour la même échéance, un taux d’intérêt de 18,15 % alors que le prêt initial ne présente pas de dangers particuliers, la structure conduisant, suivant les conditions de marchés, à l’application d’un taux de 2,88 % ou de 4,88 %.
3.– La cotation Gissler, une matrice de référence pour l’ensemble de la place
Missionnée par la ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi, le 15 janvier 2009, l’inspection générale des finances s’est vue confier la rédaction d’un rapport sur « le recours par les collectivités territoriales aux produits structurés » incluant l’élaboration d’un projet de charte de bonne conduite. Le Rapporteur de la commission d’enquête a pu prendre connaissance de ce document (22).
Préparé par M. Éric Gissler et remis à la ministre au mois de février 2009, ce rapport préconise l’abandon de certains produits financiers et la classification des autres en fonction des risques. L’approche retenue se fonde sur une évaluation des risques en termes d’indices sous-jacents et en termes de structures. Elle aboutit à la création d’une double échelle de cotation destinée à permettre à chaque établissement de crédit de coter les risques inhérents à tout produit financier (financement ou swaps, structuré ou non).
Les produits les moins risqués sont ainsi classés 1A lorsqu’ils ne sont pas structurés (produits à taux fixe, variable et variable plafonné), 2A pour les produits simples indexés sur l’inflation et jusqu’à 2B pour les produits structurés peu dangereux (barrière sans multiplicateur) pour lesquels le risque de dé-corrélation entre le taux payé et les conditions de marché est limité.
COTATION GISSLER DES RISQUES
Indices sous-jacents |
Structures | |||
1 |
Indices Zone euro |
A |
Taux fixe simple. Taux variable simple. Échange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Échange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | |
2 |
Indices inflation française ou inflation zone euro ou écart entre ces indices |
B |
Barrière simple. Pas d’effet de levier | |
3 |
Écarts d’indices zone euro |
C |
Option d’échange (swaption) | |
4 |
Indices hors zone euro. Écart d’indices dont l’un est un indice hors zone euro |
D |
Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5 capé | |
5 |
Écart d’indices hors zone euro |
E |
Multiplicateur jusqu’à 5 | |
Source : Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, p.3.
À l’inverse, les produits les plus risqués dont la charte de bonne conduite interdit la commercialisation (dits « hors charte ») sont relégués hors de cette matrice. Le Rapporteur observe néanmoins que certains établissements de crédit ou cabinets de conseil persistent à substituer au classement « hors charte » une cotation assez trompeuse de 6 en risque sous-jacent ou F en risque de structure.
Dans tous les cas, les produits concernés sont principalement :
– des emprunts libellés en devises, qui exposent la contrepartie à un risque supplémentaire de change ;
– des produits indexés sur le change, mais libellés en euros, car la volatilité des cours de change peut conduire à des taux d’intérêt élevés ;
– des produits de courbe, fortement soumis au risque de dé-corrélation ;
– et des produits cumulatifs, dans lesquelles le taux payé accumule échéance après échéance l’écart entre un index et une barrière.
Ce système de cotation a été repris, sans modification, dans la « charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » à l’appui du troisième engagement visant à garantir une présentation objective des produits financiers et des risques associés ainsi que du septième engagement prévoyant que « les établissements bancaires coteront systématiquement les produits proposés aux collectivités locales en fonction de [cette] grille (…) ».
Même si la charte elle-même n’a été signée que par quatre groupes bancaires – Dexia, BPCE, la Société Générale et le Crédit Agricole – la cotation des risques qui en découle est désormais communément utilisée par l’ensemble des intervenants sur le marché des prêts aux acteurs publics locaux. Les filiales françaises de banques étrangères, comme Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland ou Depfa/Deutsche Pfandbriefbank, acceptent d’y recourir.
Du côté des élus locaux, la cotation Gissler est également devenue une base importante d’autant que la circulaire du 25 juin 2010 s’y réfère expressément (23). Elle est désormais utilisée, en particulier, dans :
– le modèle de délibération déléguant à l’exécutif la décision de recourir à l’emprunt ;
– l’annexe à joindre aux maquettes des instructions budgétaires et comptables des collectivités.
C’est pourquoi le Président et le Rapporteur de la commission d’enquête sont convenus de l’utiliser afin de permettre la comparaison sur des critères communs. La double échelle de cotation imaginée par M. Gissler n’en souffre pas moins de plusieurs imperfections et limites que révèle la comparaison avec d’autres systèmes.
D’autres classifications des risques ont en effet été développées sans toutefois atteindre une diffusion aussi large. Le cabinet de conseil Finance Active s’est ainsi doté d’un « observatoire de la dette » et d’un tableau des risques, reproduit ci-après.
COTATION DES RISQUES PAR FINANCE ACTIVE
Classe de risque |
Risque de structure | |
Ancienne classification |
Nouvelle classification |
|
1 |
1 |
Taux fixe, Swap vanille, |
2 |
Taux fixe révisable ou à phases | |
3 |
Taux variable standard | |
4 |
Taux variable couvert (ie. capé) | |
5 |
Indexation sur le livret A | |
6 |
Indexation sur l’inflation | |
7 |
Taux variable hors zone euro | |
1,5 |
9 |
Taux fixe à barrière sur zone euro |
10 |
Taux fixe à barrière sur zone euro avec multiplicateur | |
2 |
8 |
Taux fixe ou variable annulable au gré de la banque |
11 |
Taux fixe à barrière hors zone euro | |
12 |
Taux fixe à barrière hors zone euro avec multiplicateur | |
3 |
13 |
Barrière sur écart entre inflation européenne et inflation française |
3,5 |
/ |
Taux fixe avec une vente multiple d’options vanilles |
4 |
14 |
Barrière sur écart taux long-taux court (produit de pente) |
15 |
Barrière sur écart taux de zones monétaires différentes (produit de courbes) | |
5 |
16 |
Emprunts en devise - Barrière sur taux de change |
17 |
Produit cumulatif (snowball) | |
18 |
Autres | |
Source : Lettre du cadre territorial n° 118 - avril 2010 ; Fiche technique Finance Active du 17/10/2011.
Cette classification initialement en cinq classes (et deux classes intermédiaires) s’est enrichie dans la dernière évolution de l’outil web Insito, proposé aux clients de l’entreprise, qui permet une analyse de la dette par type de risque. La nouvelle répartition du risque comporte désormais 18 catégories.
L’approche retenue, plus lisible pour le client avec son échelle unique, marque plusieurs différences avec la cotation Gissler qui sont riches d’enseignements :
– elle réintègre au sein de la cotation les produits les plus risqués, ce qui permet une approche plus fine du « hors charte » ;
– le risque inhérent aux produits de pente est mis en exergue, alors que ceux-ci peuvent bénéficier d’une cotation 3B dans le système concurrent ;
– une classification spécifique est ménagée pour les emprunts à taux fixe ou variable annulable au gré de la banque, ce qui permet de sensibiliser les clients au risque spécifique à ce type d’option qui ne peut être assimilé à une barrière simple ;
– il n’est en revanche fait aucune distinction entre les multiplicateurs faibles (jusqu’à 3) et élevés (plus de 5), ce qui peut conduire à classer 10 des produits par ailleurs cotés 3E (c’est-à-dire à risque) ;
– les produits indexés sur les matières premières sont assimilés à un risque fort, alors qu’ils peuvent avoir une finalité de couverture.
Les établissements de crédit se sont également dotés, parfois tardivement, d’outils d’évaluation des risques pour le prêteur induits par l’activité de financements structurés. L’évaluation (scoring) ainsi effectuée vise à hiérarchiser le risque commercial induit par ces produits. D’usage interne à la banque, il n’est jamais communiqué au client.
En avril 2008, Dexia s’est ainsi doté d’une méthode de scoring spécifique, commune à l’ensemble des implantations du groupe. Celle-ci repose sur deux paramètres : le type de sous-jacent et le format de structuration. Elle permet d’obtenir un classement par points (de 0 à 32, soit six profils distincts (24)) destiné à mesurer le risque inhérent au produit mais aussi à segmenter son octroi selon les catégories de clients (adéquation client/produit, en anglais suitability).
Le groupe BPCE a également revu en septembre 2008 son système d’évaluation du risque, en introduisant quatre niveaux de produits (P1 à P4) : gamme structurée standard sur indice européen, gamme structurée intermédiaire, gamme structurée avec levier avec cap, gamme structurée avec levier sans cap. Là encore, l’évaluation des produits est croisée avec les catégories de clients.
Au sein du groupe Crédit agricole, les outils manquaient jusqu’à présent de cohérence : chez Crédit Agricole Corporate Investment Bank (CA CIB), les produits étaient classés de A (faible risque) à D (risque élevé) tandis qu’à la Banque de Financement et de Trésorerie (BFT), ils étaient classés de 3 à 1
(1 correspondant au risque le plus élevé). Les portefeuilles seront prochainement regroupés, et le scoring unifié, « la BFT [étant] bientôt appelée à fusionner avec le CA CIB » (25).
B.– UN ESSOR RAPIDE À COMPTER DES ANNÉES 2000
Sous l’effet des premières lois de décentralisation, le marché de la dette publique locale a connu une longue phase d’expansion, l’encours total des seules collectivités territoriales étant passé de 387 milliards de francs (59 milliards d’euros) fin 1985 à 682 milliards de francs (près de 104 milliards d’euros) à la fin de l’année 1995.
Cette tendance s’est néanmoins inversée à compter de 1995-1996, le stock de dette des collectivités ayant même diminué de 7 % entre 1997 et 2002 (26). Marqués par les déroutes financières de collectivités étrangères (les villes de Fulham et Hammersmith au Royaume-Uni en 1988, le comté d’Orange aux États-Unis en 1993) ou françaises (Angoulême en 1989, Briançon en 1992), les élus locaux ont mené à l’époque des stratégies de désendettement dans un souci de saine et bonne gestion.
Sur un marché aussi étroit, la concurrence entre les établissements de crédit est devenue plus vive et ceux-ci ont été contraints, au tournant des années 2000, de baisser leurs marges afin de préserver leur activité (27).
1.– Un mode de financement innovant et attractif
Dans ce contexte particulier, trois facteurs peuvent expliquer l’essor des produits structurés sur le marché des prêts aux acteurs publics locaux :
● La dernière décennie a été marquée par une sophistication continue des produits financiers. Le développement de l’ingénierie financière a constitué un phénomène global, dont les effets ont concerné l’ensemble des activités du secteur bancaire. Le métier des financements structurés n’a pas échappé à cette tendance de fond ; les produits proposés à la clientèle corporate comme aux institutionnels ont évolué – et continuent d’évoluer – vers davantage de technicité.
Sur le marché de la dette publique locale, ces produits plus sophistiqués ont constitué un moyen pour les établissements de crédit de se démarquer de leurs concurrents et de restaurer une partie de leurs marges.
De fait, les tout premiers emprunts sophistiqués apparaissent à la fin des années 1990 pour répondre aux besoins spécifiques d’organismes du logement social, d’hôpitaux ou de grandes collectivités.
Ainsi, en 1996, le syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) de Marne-la-Vallée, Val Maubuée doit-il s’engager dans une vaste opération de restructuration de sa dette. La délibération du comité syndical (28) autorise alors la souscription de quatre emprunts PRISMA auprès du Crédit Local de France – qui n’était pas encore devenu Dexia – dans les conditions suivantes :
– une première phase de 5 ans pendant laquelle le taux d’intérêt est indexé sur LIBOR DEM (en Deutsche Mark) majoré d’une marge maximum de 0,45 % ;
– une seconde phase de 10 ans avec un taux indexé sur PIBOR 12 mois majoré d’une marge maximum de 0,45 %.
Cet « ancêtre de la complexité » (29) paraît rétrospectivement assez inoffensif, puisqu’il s’apparente à un emprunt à taux variable à phases, dans lequel le changement d’indexation du taux est opéré à une date connue à l’avance sans condition liée à l’évolution des marchés.
Une étape supplémentaire est franchie, au début des années 2000, avec l’apparition d’emprunts à barrière simple. En 2001, la commune de Châteauroux (30) a renégocié huit prêts auprès de Dexia – dont trois à taux fixes – contre un emprunt unique, dit TIP TOP, caractérisé par un taux d’intérêt fixe de 4,82 % tant que l’EURIBOR 3 mois est inférieur à 5,50 % et un taux variable égal à l’EURIBOR 3 mois + 0,08 % lorsqu’il est supérieur.
● La reprise de l’endettement des collectivités territoriales, à compter de 2003, correspondait à un effort d’investissement concomitant à l’acte II de la décentralisation (31). Le besoin de financement des APUL a ainsi atteint 1,4 et 2,9 milliards d’euros en 2003 et en 2004. La croissance de l’investissement s’est ensuite ralentie sur les exercices 2005 et 2006, ce qui a permis aux collectivités publiques de la financer grâce à la mobilisation des excédents supplémentaires de gestion, sans augmenter le besoin de financement.
À nouveau, à partir de 2007, la forte croissance de l’investissement s’est traduite par un besoin de financement des APUL accru du même ordre (+ 4 milliards d’euros et + 7 milliards euros l’année suivante) qui s’est prolongé, à un rythme plus modéré, jusqu’en 2010.
● Autre élément d’explication, la forte remontée des taux d’intérêt entre 2006 et 2008 n’a pas été acceptée par les acteurs publics locaux. Ceux-ci ont cherché les moyens de poursuivre leurs investissements dans les mêmes conditions financières, d’autant que cette hausse des taux correspondait à une période préélectorale.
a) Les emprunteurs ont bénéficié, sur une période parfois longue, de taux très en dessous du marché
Les emprunts structurés ont permis aux emprunteurs de tirer le meilleur profit de l’évolution constante des marchés.
● En assurant des taux bonifiés – les premières années, au moins – ces produits ont pu exercer sur les élus et responsables locaux un attrait certain. L’ancienne équipe municipale de Saint-Étienne a ainsi pu souscrire en juin 2007 auprès de Depfa Bank (32) un emprunt structuré de 22 millions d’euros d’une durée de trente-cinq ans, avec une première période à taux d’intérêt nul jusqu’en 2020 !
Alors qu’à l’automne 2007 les taux fixes atteignaient 4,50 % et l’EURIBOR 12 mois 4,75 %, cette commune affichait un taux d’intérêt moyen de sa dette de 2,76 %, grâce à la souscription d’emprunts structurés et à la conclusion de nombreux swaps. Auditionné par la commission d’enquête, le maire de l’époque, M. Michel Thiollière, a résumé sa stratégie en ces mots : « Nous avons bénéficié de taux d’intérêt très bas. Comme beaucoup d’autres collectivités, nous avons géré notre budget de façon active afin d’économiser les moyens financiers de la ville. » (33)
La CRC de Rhône-Alpes s’est essayée à quantifier le gain budgétaire théorique retiré de cette gestion « active » ; en comparant les taux moyens pondérés de la ville à ceux d’une stratégie plus classique, les magistrats concluent à un gain de court terme important, de l’ordre de 14 millions d’euros cumulés sur 2004-2008 (34). Cette somme représente entre 6 et 7 % des dépenses d’équipement, ou encore 3,5 % du produit de la fiscalité directe, sur la même période.
● La durée d’amortissement des emprunts structurés contractés par les collectivités territoriales et les autres acteurs publics locaux est souvent très longue, en général supérieure à celle des emprunts classiques et pouvant parfois aller jusqu’à trente, voire quarante ans. Les rapports d’observations définitives des CRC ont, par exemple, mis en évidence des durées moyennes de vingt-quatre années pour Saint-Maur-des-Fossés, vingt-cinq années pour la communauté d’agglomération de Grenoble et le département de l’Ain, trente-cinq années pour la commune de Sassenage (Isère).
La situation est identique pour certains établissements publics de santé, comme le centre hospitalier de Lens (vingt-neuf années) ou Saint-Dizier (trente années). Dans ce dernier cas, il a fallu financer la reconstruction complète de l’hôpital – bâtiments et équipements – pour un montant total de 100 millions d’euros, ce qui a nécessité d’emprunter 60 millions d’euros en 2006-2007.
Le directeur du centre de Saint-Dizier a détaillé, lors de son audition, les caractéristiques de l’un des emprunts. « [Ce prêt] de 9 millions a été souscrit auprès de Dexia, sur trente ans. Il comprend trois périodes : les deux premières années à un taux fixe très avantageux – 2,99 % – alors qu’un taux fixe sur trente ans aurait coûté autour de 4 % ; les quinze années suivantes, le taux est indexé sur les CMS – swaps de maturité constante – à 1 an et à 30 ans. Tant que le CMS 1 an reste inférieur au CMS 30 ans, nous bénéficions du taux de 2,99 %. C’est toujours le cas aujourd’hui mais, au moment de la crise des subprimes, il y a eu 111 jours de dépassement, ce qui aurait signifié pour nous, si nous avions été dans cette phase de l’emprunt, un taux de 5,63 %, et le surcoût annuel pour 365 jours de dépassement aurait été de 225 000 euros, ce qui représente un risque modéré. Pour les treize dernières années, ce sera de nouveau le taux fixe de 2,99 %. » (35)
Paradoxalement, comme l’ont souligné les magistrats des CRC (36), certains équipements publics financés par de tels emprunts s’amortissent sur une durée beaucoup moins longue. Ainsi la communauté de communes de Bar-sur-Aube (37) a-t-elle contracté, afin de renégocier un prêt à taux fixe destiné à financer la construction d’une nouvelle gendarmerie, un prêt structuré sur trente ans alors que le bail signé avec l’État pour l’occupation de ces locaux ne dépassait pas neuf années…
● Des différés d’amortissement importants sont également consentis avec de tels produits. Ils permettent aux emprunteurs de retarder le paiement de la première échéance du prêt de six ou douze mois, voire davantage.
L’exemple de Saint-Étienne est, à nouveau, très éclairant : l’emprunt de 22 millions d’euros déjà évoqué, d’une durée de trente-cinq ans, prévoyait un différé d’amortissement de dix-huit mois.
● Comme le notait la Cour des comptes dans son rapport public annuel pour 2009, les emprunts structurés sont fondés sur l’échange de gains transitoires, notamment au moyen de taux bonifiés, en contrepartie d’une prise de risque à moyen et long terme. Rappelant les difficultés auxquelles la société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL) a été confrontée suite à la souscription de swaps à effet cumulatif (snowballs) auprès du Crédit agricole, son directeur concluait ainsi la table ronde sur le logement social organisée par la commission d’enquête : « Les premières années des dits prêts structurés sont relativement confortables, mais au-delà de cinq ans, personne ne peut prédire ce qu’il va se passer. En ce qui me concerne, j’en ai six qui entrent dans la phase active à partir de 2018 et qui s’étalent sur une période de trente à trente-quatre ans. Nous avons donc une période non sécurisée qui va durer entre vingt-sept et vingt-huit années. Le risque est donc réel. » (38)
b) Bien utilisés, ces produits ont permis de financer des investissements sans peser sur la fiscalité
Certains élus ou responsables locaux ont su utiliser les emprunts structurés pour alléger la charge de leur dette et financer des investissements supplémentaires. C’est la stratégie qui a été suivie dans la commune et la communauté d’agglomération de Chartres, comme l’a relaté l’adjoint au maire chargé des finances (39) : « En 2001, lorsque Jean-Pierre Gorges a été élu, nous avons trouvé un encours de 50 millions d’euros alors même que nos prédécesseurs avaient réalisé peu d’investissements. En tenant compte de la structure de cette dette, j’ai pu, pendant une partie du premier mandat, réduire cet encours de plus de moitié, ce qui m’a permis par la suite de relancer l’investissement pour un montant de 185 millions d’euros au cours des six dernières années, pour la seule ville de Chartres. »
Ces marges de manœuvre ont également permis aux élus d’éviter de faire peser l’effort consenti en faveur de l’investissement sur les contribuables locaux ; l’adjoint au maire de Chartres précisait : « J’ajoute que cela a été fait tout en diminuant chaque année la pression fiscale, sans garder l’œil rivé sur les charges financières, qui ne représentent que 2 % de mon budget. Je dispose donc bien de marges financières, y compris si ces charges étaient appelées à doubler ou à tripler. » S’ils sont suffisamment maîtrisés et que les marges financières de la collectivité le permettent, les emprunts structurés permettent donc de financer des projets qui n’auraient pas vu le jour sans eux ; le risque de taux auquel s’expose la collectivité doit alors être mis en balance avec les retombées des investissements réalisés.
À l’inverse, la quasi-totalité de la dette a parfois été considérée comme « une variable d’ajustement » (40), les marges dégagées étant utilisées pour régler des charges de fonctionnement. Dans le cas de Saint-Étienne, la CRC relève qu’entre 2004 et 2008, alors que l’encours de dette était renégocié en produits structurés, les dépenses de fonctionnement de la commune évoluaient plus vite que ses recettes : plus 17 millions d’euros, soit une augmentation de 14 %. Cette évolution touche particulièrement les charges de personnel ; il est évidemment très difficile de revenir ensuite sur de telles dépenses, ce qui place la ville dans une situation dramatique si le risque inhérent à la structure se concrétise.
2.– Un encours total sous-estimé
L’évaluation de l’ampleur et de la concentration des risques liés aux emprunts structurés constitue évidemment un préalable à l’enquête. Le manque d’informations contribue à dissimuler le phénomène et à retarder la décision ; comme le soulignaient les associations d’élus, pour justifier leur prudence : « Pour le moment, il y a peu d’information et elle n’est pas fiable. Il existe des entreprises privées, telle Finance Active, qui fournissent des statistiques élaborées à partir de leur clientèle. Certains médias se livrent à de la désinformation en publiant des chiffres anciens et incomplets. Nous réclamons à l’État depuis 2008 une information fiable, car elle est indispensable pour se positionner et savoir si, oui ou non, il y a un risque systémique. » (41)
Des chiffres ont tout de même été avancés. L’inspection générale des finances, sous la plume de M. Éric Gissler, a tenté la première d’évaluer l’encours global des produits à risques au second semestre 2008, retenant des montants de 7 milliards d’euros (42) (sur un total de 13 milliards) pour les emprunts structurés et de 2 milliards d’euros (sur un total de 7 milliards) pour les swaps. En l’absence de tout recensement par les services de l’État (43), ces estimations se fondaient sur l’échantillon de l’observatoire Finance Active et retenaient les produits souscrits par des collectivités territoriales et des EPCI. Elles additionnaient :
– d’une part, les encours des prêts structurés sur le change, des produits de courbe ainsi que des produits de pente avec fort multiplicateur ;
– et, d’autre part, les notionnels de swaps taux fixe (ou variable) contre taux structuré, ou taux structuré contre taux structuré.
Pour quantifier le risque global, l’approche retenue consistait à multiplier ces encours à risque par leur taux d’intérêt moyen, soit 280 millions d’euros pour les prêts structurés et 112 millions d’euros pour les swaps. Le rapport concluait à l’absence de risque systémique ; il estimait en effet que, même dans l’hypothèse d’un triplement des taux moyens des produits à risque (pour atteindre respectivement 12 % et 16,8 %), l’augmentation du volume global des intérêts financiers supportés par les collectivités ne dépasserait pas 10 à 15 %, soit un surcoût inférieur à 1 % des charges de fonctionnement.
Plus récemment, la Cour des comptes s’est également essayée à estimer le volume d’emprunts structurés souscrits par les collectivités territoriales. Ce second rapport, publié en juillet dernier, n’inclut donc pas les dettes des établissements de santé et des organismes du logement social. Elle conclut néanmoins à un encours de 10 à 12 milliards d’euros d’emprunts à risque pour 30 à 35 milliards d’emprunts structurés.
Cette augmentation a pu paraître surprenante, d’autant que la Cour fonde elle aussi son estimation sur les données publiées par l’observatoire de Finance Active. Comme elle ne peut pas s’expliquer par des variations de périmètre, et que la charte Gissler a considérablement limité le flux de nouveaux crédits structurés, il faut supposer que la première estimation était trop optimiste.
Ajoutant à la confusion, le quotidien Libération a publié, à son tour, une « carte de France des emprunts toxiques » au mois de septembre, évaluant à 25 milliards d’euros l’encours et à 3,9 milliards d’euros le surcoût de ces emprunts. Las, les données utilisées ne concernaient que Dexia et dataient de près de deux ans. L’article procédait, surtout, à un amalgame dommageable entre prêts structurés et prêts toxiques ou à risque ; la méthodologie de calcul du surcoût a également été contestée.
Dans un tel contexte, la commission d’enquête s’est efforcée d’aboutir à une évaluation aussi précise que possible. Le Rapporteur a choisi de ne pas s’appuyer sur les mêmes sources que l’inspection générale des finances et la Cour des comptes, afin d’autoriser un recoupement des données. Usant des prérogatives que lui confère l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il a interrogé les sept principaux établissements de crédit – Dexia, BPCE, Crédit agricole CIB, Société générale, Depfa Bank, Royal Bank of Scotland et Deutsche Bank – actifs sur le marché du prêt au secteur local afin que ceux-ci lui communiquent, à titre confidentiel, les encours et caractéristiques des contrats de prêt souscrits (44). L’analyse globale de ces données est présentée ci-dessous.
● Les prêts structurés au secteur local : un marché étroit, sur lequel Dexia jouit d’une position dominante.
Le marché des prêts aux acteurs publics locaux n’est plus l’apanage du seul groupe Dexia, comme cela était encore le cas il y a dix ans. L’héritier du Crédit local de France a en effet dû faire face à une concurrence croissante des réseaux mutualistes, grâce à leur réseau local dense, mais également de nouveaux venus.
Avec plus du quart des encours de prêts au secteur local, Dexia conserve la première place, mais il est désormais talonné par des acteurs historiques comme BPCE (18 % des encours), s’appuyant sur les caisses d’épargne, ou encore le Crédit agricole (12 %), via ses filiales Calyon (devenue CA CIB) et BFT. Année après année, le groupe bancaire franco-belge a continué à perdre des parts marché (– 2 points entre 2009 et 2010), notamment au profit de nouveaux entrants comme le groupe Crédit mutuel-CIC, BNP Paribas et, ponctuellement, des filiales françaises de banques étrangères.
Deux acteurs institutionnels – la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et la Banque européenne d’investissement (BEI) – assurent le financement de projets plus structurants (réseaux de transports en commun en site propre, infrastructures hospitalières dans le cadre du plan Hôpital 2007, mise en conformité des installations de retraitement des eaux usées…) grâce à des prêts dont le taux (45) et la durée sont attractifs. La CDC joue, par ailleurs, un rôle tout à fait considérable dans le financement des organismes de logement social, à hauteur de 73 milliards d’euros ; ce qui se traduit par une part globale de 30 % en dépit de sa place plus modeste s’agissant des prêts aux collectivités territoriales et aux établissements de santé.
MARCHÉ DES PRÊTS AU SECTEUR LOCAL
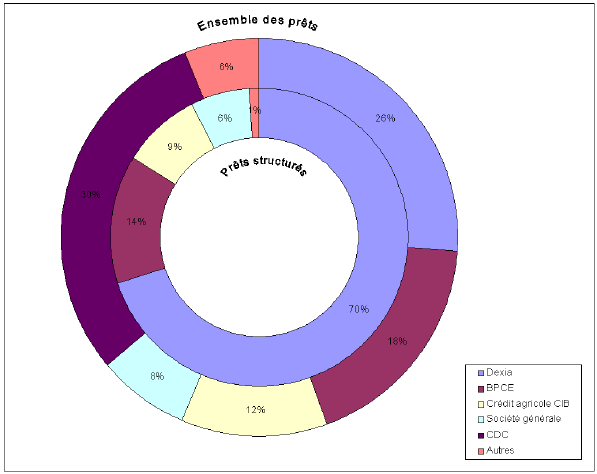
Source : commission d’enquête.
Sur le segment plus réduit des prêts structurés aux acteurs publics locaux (11,6 % de l’ensemble des encours), les équilibres sont sensiblement différents. Avec plus des deux tiers du stock, Dexia s’arroge une position largement dominante sur un marché dont le nombre d’intervenants est plus réduit. Reléguées loin derrière, les trois banques généralistes – BPCE, Crédit agricole CIB et Société générale – totalisent un tiers du marché, grâce au savoir-faire de leurs équipes spécialisées dans les financements structurés (logées dans les filiales Natixis et CA Corporate Investment Bank, pour les deux premières). Deux filiales françaises de banques étrangères (Royal Bank of Scotland et Depfa Bank) sont également actives sur le marché français, privilégiant une logique de niche.
La physionomie du marché des swaps structurés aux acteurs publics locaux est, en revanche, très différente. Le groupe Dexia en est totalement absent ; l’acteur principal est par conséquent le Crédit agricole CIB avec 44 % du notionnel. BPCE et la Société générale regroupent, quant à eux, 18,5 % et 12 % des swaps structurés. Les banques étrangères sont assez actives sur ce marché : Royal Bank of Scotland avec 12,6 %, Deutsche Bank avec 8,4 % et Depfa avec 4,0 % du notionnel.
● Un encours global plus précis que les estimations précédentes
Sur la base des données recueillies par le Rapporteur de la commission d’enquête, il est possible d’évaluer à 32,125 milliards d’euros l’encours total (46), au second semestre 2011, des prêts structurés souscrits par l’ensemble des acteurs publics locaux dans le champ d’investigation de la commission : communes, EPCI et syndicats, départements, régions, établissements publics de santé et organismes du logement social. Cet encours doit être rapporté au volume global d’endettement des mêmes acteurs, qui atteignait 276,8 milliards d’euros fin 2010. Les emprunts structurés ne constituent donc qu’une modalité de financement parmi d’autres, loin derrière les prêts à taux fixe ou à taux variable qui totalise, comme on l’a vu, les quatre-cinquièmes de la dette.
En ne retenant qu’un périmètre restreint, limité aux seules collectivités territoriales, l’encours total atteint encore 23,323 milliards d’euros. L’évaluation de la Cour des comptes – avec le même périmètre mais avec des données datant de la fin de l’année dernière – aboutissait donc à une surestimation du volume des emprunts structurés de près du tiers.
Par ailleurs, le notionnel de swaps structurés souscrits par les acteurs publics locaux s’établit à 6,561 milliards d’euros, soit un niveau proche de celui mis en avant par M. Éric Gissler dans son rapport.
● Ces encours ont diminué d’un tiers depuis la crise bancaire et financière de l’automne 2008
Compte tenu de l’amortissement naturel des emprunts et des renégociations menées pour sécuriser la dette des acteurs publics locaux, les principaux établissements de crédit sont parvenus à réduire les encours de prêts structurés de près de 5 milliards d’euros sur trois ans, les ramenant de 43,964 milliards d’euros à 39,136 milliards d’euros hors effets de périmètre (47).
Cet effort est toutefois très inégal d’un établissement à l’autre : Dexia a réduit son encours de 8,1 % alors que BPCE diminuait le sien de 22,2 %.
ÉVOLUTION DES ENCOURS D’EMPRUNTS STRUCTURÉS AU SECTEUR LOCAL
(en millions d’euros)
Etablissements de crédit |
T3 2008 |
T3 2011 (périmètre 2008) |
T3 2011 |
CA CIB |
n.d. |
n.d. |
2 785 |
BPCE |
6 882 |
5 356 |
4 447 |
Dexia |
29 725 |
27 300 |
22 510 |
Autres |
3 575 |
3 107 |
2 383 |
Ensemble du marché |
43 964 |
39 136 |
32 125 |
Source : commission d’enquête. Les montants en italique sont des estimations.
De surcroît, la réduction du stock d’emprunts structurés ne s’est pas accompagnée d’une désensibilisation significative, c’est-à-dire d’une diminution dans les mêmes proportions des encours à risque. En effet, les renégociations ont porté en priorité sur des crédits structurés cotés dans la charte Gissler qui ont été définitivement reclassés en crédits non structurés. Le réaménagement des crédits les plus risqués – classés hors de la charte – s’est révélé beaucoup plus difficile.
● L’encours des produits à risque a, en revanche, été sous-estimé.
Seule une partie de cet encours global présente un risque. Pour distinguer entre les emprunts structurés à risque (voire à fort risque) et les emprunts structurés qui ne présentent pas de danger, la commission d’enquête s’est basée sur la cotation Gissler, comme cela a déjà été indiqué.
Ont ainsi été tenus pour risqués les emprunts structurés dont l’indice sous-jacent était coté 5 (écarts d’indices hors zone euro) ou la structure cotée 5 (multiplicateur de 3 à 5 sans cap), ainsi que l’ensemble de ceux qui ont été interdits par la charte (dits hors charte). En pratique, sont concernés :
– les indexations sur le WIBOR, le STIBOR, le PRIBOR (mais également le LIBOR) ;
– une partie des produits de pente, du fait d’un fort multiplicateur ;
– la plupart des emprunts indexés sur la parité euro/franc suisse, du fait là encore de leur effet levier ;
– tous les produits hors charte : de courbe (channel), à effet cumulateur (snowballs), libellés en devises (à taux fixe ou variable), indexés sur des matières premières ou sur des indices propriétaires…
En complément, sont considérés comme à risque fort les emprunts classés hors charte (HC) ou en bas de la charte (3E, 4E et 5E).
L’encours total des emprunts structurés à risque est évalué à 18,828 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs publics locaux, dont 15,787 milliards d’euros présentent même un fort risque. Ces proportions sont préoccupantes car elles représentent respectivement 58,6 % et 49,2 % de l’encours total, alors que l’encours sain ne dépasse pas 41,4 %. Même au niveau des seules collectivités territoriales, cet encours à risque atteint 13,648 milliards d’euros ce qui dépasse le haut de la fourchette retenue par la Cour des comptes.
CARTOGRAPHIE DES RISQUES (EMPRUNTS STRUCTURÉS)
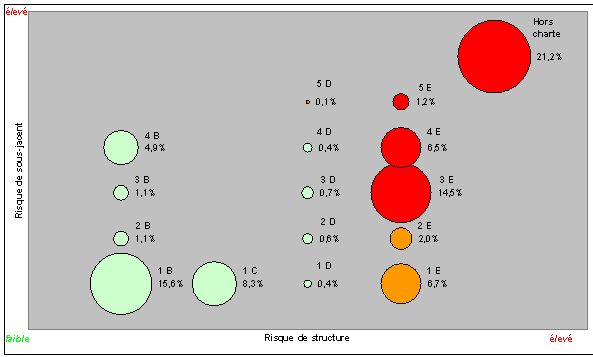
Source : commission d’enquête.
Au sein de cet encours risqué, les emprunts classés hors charte représentent 21,2 % de l’ensemble des prêts structurés, avec de forts contrastes entre établissements prêteurs. Ce sont les produits les plus dangereux, avec un contingent important de prêts indexés sur la parité euro/franc suisse
Les emprunts classés 3E, regroupant la plupart des produits de pente adossés sur le différentiel entre les taux long et les taux cours, totalisent à eux seuls 14,5 % tandis que les emprunts indexés sur l’écart entre un indice européen et un indice hors zone euro (4E) ou sur l’Euribor avec un fort multiplicateur (1E), pour l’heure moins préoccupants, représentent respectivement 6,5 % et 6,7 % des encours.
Au niveau des swaps structurés, le notionnel jugé à risque totalise 2,530 milliards d’euros, soit 38,6 % du total.
CARTOGRAPHIE DES RISQUES (SWAPS)
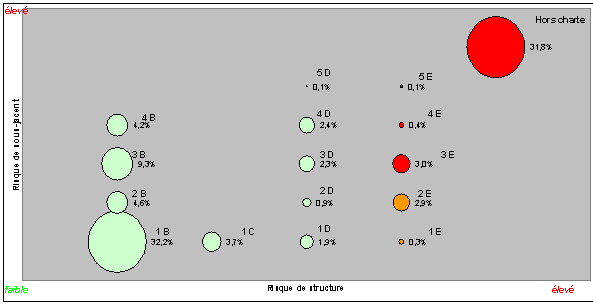
Source : commission d’enquête.
● Au-delà de l’estimation de l’encours, qui ne constitue qu’une photographie du stock des emprunts structurés à risque, la commission d’enquête s’est attachée à mesurer le surcroît des intérêts financiers qui pourrait peser sur les acteurs publics locaux. Cet exercice est particulièrement délicat car il suppose d’anticiper les évolutions des marchés, dont on a pu mesurer depuis 2008 l’imprévisibilité.
La méthode retenue consiste à mesurer l’impact d’un stress-test sur les trois principales catégories d’emprunts à risque : les produits classés 5 ou E ; les produits à fort levier classés hors charte ; les produits de change classés hors charte. Les taux « stressés » retenus sont des moyennes : 5 % pour la première catégorie, 8 % pour la deuxième et 14,9 % pour la dernière (48). Pour chaque catégorie de contrepartie, le surcoût est égal à la différence entre le taux stressé et un taux de référence – Euribor + 300 points de base, niveau au-delà duquel le produit obère durablement les budgets locaux – multipliée par l’encours.
Selon les estimations de la commission d’enquête, le surcoût lié aux emprunts structurés à risque s’établirait à 730 millions d’euros par an, pour l’ensemble des acteurs publics locaux, en cas de forte dégradation des paramètres de marché. Ce coût correspondrait à une augmentation d’environ 10 % du volume global des intérêts financiers supportés chaque année par les acteurs publics locaux, aussi longtemps que dure la mauvaise conjoncture.
ESTIMATION DU SURCOÛT
(en millions d’euros, sauf indication contraire)
Surcoût par contrepartie |
Emprunts structurés cotés 1E ; 2E ; 3E ; 4E ; 5E ; 5B ; 5C ; 5D |
Emprunts structurés hors charte de par leur coefficient multiplicateur |
Emprunts structurés hors charte de par l’effet de change |
Total des emprunts à risque |
Collectivités territoriales |
||||
Encours (E) |
7 680 |
422 |
5 546 |
13 648 |
Taux moyen 2011 |
3,80 % |
4,16 % |
4,50 % |
|
Taux de référence Euribor+300 pb (T ref.) |
5,04 % |
5,04 % |
5,04 % |
|
Taux stressé (T) |
5,0 % |
8 % |
14,9 % |
|
Surcoût (T - T ref.) x E |
0 |
13 |
547 |
560 |
Établissements de santé |
||||
Encours (E) |
2 126 |
13 |
1 162 |
3 301 |
Taux moyen 2011 |
3,41 % |
3,06 % |
3,23 % |
|
Taux de référence Euribor+300 pb (T ref.) |
5,04 % |
5,04 % |
5,04 % |
|
Taux stressé (T) |
5,0 % |
8 % |
14,9 % |
|
Surcoût (T - T ref.) x E |
0 |
< 1 |
115 |
116 |
Organismes du logement social |
||||
Encours (E) |
1 335 |
11 |
534 |
1 880 |
Taux moyen 2011 |
3,66 % |
4,60 % |
3,71 % |
|
Taux de référence Euribor+300 pb (T ref.) |
5,04 % |
5,04 % |
5,04 % |
|
Taux stressé (T) |
5,0 % |
8,0 % |
14,9 % |
|
Surcoût (T - T ref.) x E |
0 |
< 1 |
53 |
54 |
TOTAUX |
0 |
15 |
715 |
730 |
Source : Commission d’enquête.
À ce surcoût lié aux emprunts structurés à risque, il reste encore à ajouter celui résultant des swaps dangereux. Au terme d’un calcul analogue, en retenant l’hypothèse d’une dégradation du taux moyen à 15 % pour l’ensemble de l’encours à risque (soit 2,530 milliards d’euros), ce surcoût atteindrait 252 millions d’euros par an, soit une augmentation complémentaire de 3,5 % des intérêts financiers, tant que les conditions de marché demeureraient mauvaises. En cas d’amélioration de la tendance, ce surcoût diminuerait aussitôt.
Dans le cas des financements structurés comme dans celui des swaps, le risque n’est donc pas systémique, ce qui ne l’empêche d’être fortement concentré dans certaines collectivités.
3.– Un risque global limité mais une forte concentration auprès de certains acteurs locaux
Si l’encours des emprunts structurés, ou le notionnel des swaps, considérés comme à risque demeure largement en deçà de ce qui pourrait être jugé systémique, leur concentration au sein de certaines catégories de contrepartie, voire dans certaines collectivités, peut se révéler dangereuse.
Le tableau ci-dessous retrace les encours par type d’acteurs publics locaux.
ENCOURS DES EMPRUNTS STRUCTURÉS PAR CONTREPARTIE
(en millions d’euros)
Emprunteurs |
Nbre de contrats |
Encours total des emprunts structurés |
Encours à risque faible |
Encours à risque |
Dont encours très risqué | |||
(5B, 5C, 5D, 2E, 3E, 4E, 5E, HC) |
(3E, 4E, 5E, HC) | |||||||
Collectivités territoriales |
8 968 |
23 323 |
9 675 |
41,5 % |
13 648 |
58,5 % |
11 641 |
49,9 % |
Communes |
6 230 |
11 190 |
4 279 |
37,0 % |
6 912 |
61,8 % |
5 721 |
51,1 % |
dont -10 000 hab |
3 804 |
3 049 |
1 341 |
44,0 % |
1 708 |
56,0 % |
1 394 |
45,7 % |
dont 10 000 à 100 000 hab |
2 237 |
6 568 |
2 182 |
33,2 % |
4 387 |
66,8 % |
3 627 |
55,2 % |
dont +100 000 hab |
189 |
1 573 |
756 |
48,1 % |
817 |
51,9 % |
700 |
44,5 % |
EPCI et autres structures (CCAS, SDIS, syndicats…) |
2 135 |
5 818 |
2 454 |
42,2 % |
3 364 |
57,8 % |
2 847 |
48,9 % |
Départements |
402 |
4 205 |
1 744 |
41,5 % |
2 461 |
58,5 % |
2 282 |
54,3 % |
Régions |
201 |
2 110 |
1 198 |
56,8 % |
911 |
43,2 % |
791 |
37,5 % |
Hôpitaux et établissements de santé |
1 180 |
5 964 |
2 664 |
44,7 % |
3 300 |
55,3 % |
2 689 |
45,1 % |
Organismes de logement social |
540 |
2 838 |
959 |
33,8 % |
1 879 |
66,2 % |
1 457 |
51,3 % |
TOTAUX |
10 688 |
32 125 |
13 298 |
41,4 % |
18 807 |
58,6 % |
15 787 |
49,2 % |
Source : Commission d’enquête, encours au 28 octobre 2011 (sauf Dexia : 31 août 2011). Les cotations utilisées sont celles de la charte Gissler (HC=hors charte).
a) Dans les collectivités territoriales et leurs groupements
Avec 14,5 % de leur endettement constitué d’emprunts structurés, les collectivités territoriales ont globalement souscrit davantage de contrats de ce type que l’ensemble des acteurs publics locaux qui affichent une moyenne de 11,6 %.
Leur encours est également plus risqué que celui des établissements publics de santé, avec respectivement 58,5 % contre 55,3 % d’emprunts cotés 5B, 5C, 5D, 2E, 3E, 4E, 5E ou « hors charte », sans atteindre toutefois la même proportion que la dette des organismes du logement social.
Avec un peu moins de la moitié de l’encours, les communes concentrent une part prépondérante des emprunts structurés mais également des risques : alors que les encours risqués des EPCI, des départements et des régions représentent 57,8 %, 58,5 % et 43,2 %, ceux des communes dépassent 61,8 %.
L’encours moyen structuré, par client et par banque, atteint 57 millions d’euros pour les régions, 46 millions d’euros pour les départements et à peine 3,9 millions d’euros pour les communes.
Les petites communes de moins de 10 000 habitants ne sont pas épargnées puisqu’elles ont souscrit pour 3,049 milliards d’euros d’emprunts structurés, aujourd’hui considérés comme risqués à hauteur de 56 %. Pour le portefeuille clientèle du seul Dexia (49), 1 595 petites communes – sur 2 229 communes clientes du groupe et 3 575 clients toutes catégories confondues – ont souscrit 2,18 milliards d’euros d’emprunts structurés, dont 1,44 milliard d’euros à risque soit 66,1 %.
Ces éléments objectifs confirment l’impression que les membres de la commission d’enquête avaient retirée de l’audition des maires de Trégastel et Sassenage, notamment (50).
Le Rapporteur observe que, contrairement à ce qu’ont avancé les anciens responsables de Dexia (51), ces petites communes ont fait l’objet d’un démarchage intensif. Ce cas n’est pas isolé : les mêmes communes représentent 577 millions d’euros (sur 1,581 milliard d’euros pour l’ensemble des communes, soit 36,5 %) chez BPCE et 250 millions d’euros (sur 534 millions d’euros, soit 46,9 %) au Crédit agricole CIB, avec toutefois un profil de risque beaucoup moins marqué (52).
Il est permis à tout le moins de s’interroger sur l’effectivité des dispositifs d’adéquation (suitability) et des consignes données, à partir de 2008, aux équipes commerciales censés recentrer l’offre de prêts structurés sur des contreparties mieux outillées pour en assurer la gestion.
À eux seuls, les hôpitaux et les établissements de santé totalisent 5,964 milliards d’euros d’emprunts structurés – soit près d’un cinquième des encours pour à peine plus d’un dixième des contrats – dont 55,3 % peuvent être considérés comme à risque. Il ne faut donc pas les écarter de la réflexion menée sur la gestion des emprunts à risque.
Comme le rappelait l’un des représentants des directeurs d’hôpitaux auditionné par la commission d’enquête (53), « [il] était une époque où tout le monde, y compris les autorités publiques, nous encourageait à financer nos investissements par emprunt [ ; le] plan Hôpital 2007 en est un exemple [ ; il] répondait à un incontestable besoin de modernisation, mais il incitait les gestionnaires à rechercher les meilleures solutions possibles à l’aune de la rentabilité immédiate, auprès d’établissements financiers qui vantaient avec aplomb la sécurité de leurs produits [ ; c’est] dans ce contexte que les choix ont été faits ». De fait, les établissements prêteurs sont relativement variés : Dexia ne concentre qu’un peu plus de la moitié des encours (55,6 %), devant BPCE (18,1 %) et le Crédit agricole CIB (12,1 %).
Toutefois, les grands hôpitaux ont paru mieux armés pour gérer la complexité de certaines structures de financement ; certains centres hospitaliers, comme celui de Dijon, ont recruté du personnel qualifié pour gérer leur dette structurée. Surtout, les établissements publics de santé disposent d’un cadre comptable plus moderne qui leur impose la constitution de provisions sur le compte 158-4 « Autres provisions pour frais financiers ».
Il reste que de petits établissements, comme le centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire), ou de plus grands tel que l’hôpital d’Ajaccio sont plongés dans de graves difficultés à la suite à la souscription d’emprunts structurés. Dans les cas les plus préoccupants, les provisions constituées ne suffiront pas et les établissements concernés devront être associés aux dispositifs de gestion du stock de dette structurée qui pourront être mis en place pour les collectivités territoriales.
c) Dans le secteur du logement social
Au-delà de la diversité de leurs statuts juridiques, les organismes du logement social, pris dans leur globalité, concentrent 2,838 milliards d’euros (pour 540 contrats) d’emprunts structurés, dont les deux tiers sont considérés comme à risque.
Ces prêts, d’un encours moyen de 14 millions d’euros par client, ont à 82,8 % été souscrits auprès de Dexia qui a su capter une partie des encours échappant au prêteur traditionnel du secteur qu’est la Caisse des dépôts et consignations. Les représentants de l’Union sociale pour l’habitat (USH) (54), auditionnés par la commission d’enquête, rappelaient ainsi : « pour comprendre pourquoi les organismes d’habitat se sont intéressés à ces emprunts, il faut revenir quelques années en arrière : ils s’y sont intéressés parce que, à un certain moment, leurs stocks de prêts issus de la Caisse des dépôts étaient largement au-dessus du marché (…) et la Caisse des dépôts, sur la base des instructions que lui donnait le Trésor, refusait de renégocier la dette (…) si l’adaptation de la gestion du Livret A avait été un peu plus fine, la question ne se serait pas posée dans les mêmes termes ».
Le secteur du logement social se caractérise également par un notionnel de swaps très important : selon le pointage réalisé par la commission d’enquête, des swaps et des contre-swaps ont été conclus pour un notionnel de 2,922 milliards d’euros, principalement auprès du Crédit agricole CIB et de la Deutsche Bank. Ces swaps sont globalement peu risqués : seulement 28,7 % sont cotés 5B, 5C, 5D, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E ou « hors charte ».
Au total, le stock d’emprunts et de swaps structurés à risque représente 2,718 milliards d’euros, soit un niveau comparable à celui évoqué par le président de l’USH lors de son audition.
Même si le risque lié à ces produits structurés ne doit pas être minimisé, le Rapporteur observe que, dans ce secteur, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) permet d’assurer une mutualisation des risques en cas de dépôt de bilan.
C.– LA TOXICITÉ DE CERTAINS DE CES PRODUITS RÉVÉLÉE PAR LA CRISE DE 2007-2008
Loin de prendre la mesure des risques encourus, beaucoup de collectivités se sont laissé convaincre, afin d’enrayer le renchérissement des annuités de leurs emprunts, de procéder à des restructurations successives. Certains arbitrages se sont révélés désastreux : aux emprunts dont les conditions s’étaient dégradées (produits de pente) ont été substituées d’autres catégories de produits (de change, notamment) plus risqués qui, à leur tour, ont souffert des dérèglements des parités entre monnaies…
1.– Des indices volatils, décorrélés de l’activité locale
Les indices sous-jacents sur lesquels sont construits les emprunts structurés les plus toxiques – spread entre les taux longs et courts, parité de change… – sont absolument sans lien avec l’activité d’intérêt général des acteurs publics locaux. La volatilité de ces indices, accrue par la crise financière mondiale ouverte en 2008, a favorisé le franchissement de barrières et l’activation des formules de calcul les plus défavorables.
a) L’inversion de la courbe des taux, au début de la crise, a renchéri les taux des produits de pente
L’aplatissement puis l’inversion de la courbe des taux sur l’euro (2 ans-10 ans) en 2007-2008 ont correspondu à l’anticipation par les marchés financiers d’une remontée des taux de la Banque centrale européenne. Cette anomalie dans la perception des taux d’intérêt a dégradé fortement la situation des acteurs locaux ayant souscrit des produits de pente massivement commercialisés par les banques en 2005-2006.
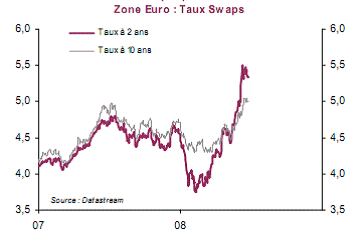
L’agence de notation Fitch ratings France, dont le directeur a été auditionné par la commission d’enquête (55), a retracé a posteriori l’enchaînement des événements pour une collectivité ayant souscrit un produit de pente en janvier 2006 (56). La commune de Saint-Étienne, qui a souscrit en avril 2006 le même produit TOFIX FIXMS proposé par Dexia, aurait pu en fournir un autre exemple (57).
L’option incluse dans ce contrat a pour sous-jacent la différence entre les taux CMS à dix ans et à deux ans ; « elle spécule donc sur la pente de la courbe des taux ». Dans ce contrat, l’emprunteur paye 3,13 % tant que (CMS 10
– CMS 2)>=0,30 % et 5,99 % dans le cas contraire.
Sachant que le taux de référence des OAT 10 ans était en moyenne de 3,34 % en janvier 2006, ce produit offrait des conditions de financement relativement favorables tant que l’option n’était pas activée. Le risque associé à ce produit était pourtant réel puisque, seulement un an après sa souscription, la collectivité s’est trouvée en situation de payer le taux dégradé.
Le risque est d’autant plus important que les formules proposées sont fréquemment affectées d’un multiplicateur très élevé afin de permettre à l’emprunteur d’obtenir un taux proche de zéro pendant les premières années de l’emprunt.
Plutôt que d’accepter de payer le taux dégradé, la plupart des collectivités concernées (dont Saint-Étienne) ont décidé au premier semestre 2007 de refinancer cet emprunt à l’aide d’un autre produit structuré qui permet, du moins en apparence, d’obtenir un taux encore plus bonifié. Ce nouveau produit
– souvent indexé sur la parité euro/franc suisse comme le DUAL FIXE EUR/CHF ou d’autres parités de monnaies comme le DUALIS et le TOFIX DUAL USD/JPY – est nécessairement beaucoup plus risqué que le précédent puisque l’option vendue doit financer à la fois la valeur négative du premier prêt, une bonification encore plus forte et la rémunération de « la banque qui se trouve, dans ce cas, en position de force pour augmenter sa marge ».
b) Le renchérissement du franc suisse, de 2008 à 2011, a déstabilisé les produits de change
À leur tour, certains produits de change – parfois ceux-là même qui avaient été souscrits pour refinancer en 2007 un produit de pente – ont été déstabilisés par le rôle de valeur refuge joué par le franc suisse dans la seconde partie de la crise financière européenne.
Fin janvier 2007, le taux de référence des OAT 10 ans était en moyenne de 4,06 % tandis que le taux euro/franc suisse atteignait 1,60. Des produits comme le DUAL FIXE EUR/CHF de Dexia souscrit par Saint-Étienne ou HELVETIX de BPCE souscrit par Melun, bâtis sur des formules du type [Si EUR/CHF ≥ 1,44 alors taux égal à 3,48 % ; sinon taux égal à 3,48 % + 50 % x ((1,44/EUR/CHF) – 1 )], présentaient une bonification potentielle extrêmement forte pour un risque qui pouvait alors paraître minime. Les séries historiques sur dix ou vingt années accréditaient l’idée que la parité entre les deux monnaies ne pouvait pas tomber en dessous de 1,44 quels que puissent être les événements internationaux.
ÉVOLUTION DE LA PARITÉ EURO/FRANC SUISSE

Source : www.trader-forex.fr
Force est de constater – il est vrai a posteriori – que le risque était bien réel et qu’il est bien plus important encore qu’avec les produits de pente décrits précédemment. Ainsi, si l’emprunteur était sorti de la période bonifiée et avait dû payer une échéance sur la base du minimum atteint le 10 août 2011 (1 EUR = 1,026 CHF), il lui en aurait coûté 23,66 %.
La dégradation de la parité a, pour l’heure, pu être stoppée : la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé, le 6 septembre, qu’elle fixait un cours plancher de 1,20 franc pour un euro afin de répondre à la surévaluation de sa devise suisse. À la suite de cette décision, le franc a chuté massivement sur le marché des changes, avant que son cours ne se stabilise un peu au-dessus du plancher visé. Les collectivités françaises concernées par ces emprunts bénéficient pour l’instant de l’intervention de la banque centrale helvétique ; le taux d’intérêt du produit cité en exemple est en effet ramené à 13,48 %. La capacité des autorités monétaires suisses à défendre durablement ce plancher pose néanmoins question.
TAUX D’INTÉRÊT D’UN PRODUIT À BARRIÈRE
SUR TAUX DE CHANGE EURO/FRANC SUISSE
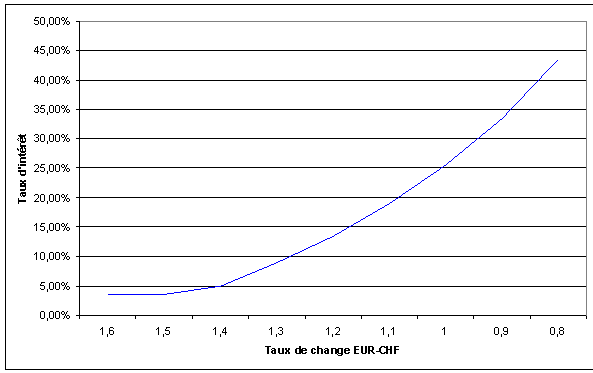
Source : Calculs de la commission d’enquête.
Selon deux des experts convoqués devant la commission d’enquête (58), « nous ne sommes qu’au début du problème : fin septembre 2011, seuls 45 % de ces produits étaient sortis de la phase sécurisée ; cette proportion va passer à 54 % à la fin de l’année et à 77 % en 2012, pour atteindre 87 % en 2013. »
2.– Les incertitudes entourant l’évolution au cours des prochains mois de certaines formules
● Face à la dégradation de la parité euro/franc suisse au cours du premier semestre 2008, certaines collectivités se sont vu proposer de refinancer leurs emprunts structurés. Il leur a alors été proposé des produits particulièrement élaborés, dits « de 2ème génération », dont l’indexation reposait sur deux zones économiques différentes.
Le département de la Seine-Saint-Denis a souscrit en 2008 auprès de Dexia un emprunt avec un fort effet multiplicateur. Selon les constatations des magistrats de la CRC Île-de-France (59), ce contrat passe à partir de 2011 d’un taux bonifié de 1,19 % à une formule à deux paliers de dégradation.
Même si l’écart entre les parités EUR-USD et EUR-CHF demeurait favorable à cette dernière sur la base d’une comparaison historique, le premier palier prévoyait, en cas de différence de zéro à 10 centimes, que le taux servi passait en taux fixe à 3 %.
Le second palier de dégradation était encore plus marqué : en cas d’inversion du différentiel de change, le multiplicateur est élevé lorsque l EUR-USD devient très supérieur à l’EUR-CHF : par exemple, si 1 EUR-USD=2 EUR-CHF, alors le taux atteint 28,27 %). Si la différence se limitait à 15 centimes, ce qui est déjà important compte tenu des historiques, le taux servi serait de 10,80 % et les intérêts supplémentaires s’élèveraient, pour l’année 2011, à 5,5 millions d’euros.
Même si cette situation paraît peu probable, la parité étant depuis plusieurs années – sauf quelques journées en 2003 – dans le sens favorable avec un différentiel réduit, le Rapporteur juge trop imprévisibles les évolutions macroéconomiques actuelles pour ne pas inciter les acteurs publics locaux concernés à sortir dès que possible de tels emprunts, sans attendre la fin de la période bonifiée.
● Plusieurs des experts auditionnés par la commission d’enquête ont également exprimé une vive inquiétude à l’égard des produits de pente. La courbe des taux CMS euro s’est sensiblement aplatie depuis le mois de janvier 2011 car, dans une conjoncture inflationniste, le marché anticipait une hausse des taux de la BCE dans les prochains mois.
Pour l’heure, la courbe des taux ne s’est pas retournée comme en 2007-2008 et nul n’est capable de prédire son évolution. Mais comme le résumait l’un des magistrats financiers auditionné : « un retournement n’est jamais à exclure [ ; aujourd’hui,] on ne parle que des produits assis sur le franc suisse, mais cela n’est que le dernier accident, pas le prochain. » (60)
II.– UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Les auditions conduites par la commission ont mis en évidence que les responsabilités à l’origine de la situation difficile dans laquelle se trouvent aujourd’hui de nombreux acteurs locaux sont partagées. Les élus ou les gestionnaires, selon les cas, ont souvent manqué de vigilance ou ne disposaient pas des compétences nécessaires pour comprendre les risques sous-jacents aux emprunts qu’ils contractaient, les banques ont développé une politique commerciale systématique et très agressive, souvent trompeuse, et enfin, le troisième responsable, l’État, n’a exercé qu’un contrôle très limité localement, alors que l’administration centrale ne réagissait guère aux alertes qui apparaissaient ici ou là.
A.– DES ÉLUS QUI ONT PARFOIS MANQUÉ DE VIGILANCE
La plupart des personnalités entendues par la commission d’enquête se sont accordées sur le fait que les exécutifs locaux n’ont pas toujours souscrit les emprunts structurés en ayant pleinement connaissance des risques qui leur étaient associés.
1.– Les exécutifs locaux n’ont pas toujours souscrit ces emprunts en connaissance de cause
Dans nombre de cas, les collectivités territoriales n’ont donc pas fait le choix délibéré de contracter des produits risqués dans la perspective de maximiser leurs gains, mais se sont vues contraintes de recourir à une gestion active de leur dette afin de répondre au besoin de financement de projets d’investissement structurants.
Dans d’autres cas, le recours aux emprunts structurés a été fait dans l’objectif de restructurer la dette : les banques, considérant l’existence d’une dette rémunérée par un taux fixe, ont proposé à la collectivité une transformation de sa dette, lui faisant valoir des avantages immédiats, et voyant pour elles-mêmes un gain immédiat et à terme dans le processus de « renégociation ».
● De nombreuses collectivités territoriales ayant contracté des emprunts structurés se trouvaient dans une situation de vulnérabilité financière avant même d’avoir recours à ce type de produit.
En ce sens, il convient de rappeler que, si la réalisation d’emprunts structurés a profondément dégradé l’équilibre financier ex post des collectivités en question, les difficultés structurelles que celles-ci ont éprouvés ex ante ont précisément justifié le recours à ce type de produit.
Face au besoin de dégager des liquidités induit par les projets d’investissement, et compte tenu du niveau de leur endettement et de leurs charges financières, certaines collectivités n’ont pas pu recourir à des emprunts classiques, dont la charge financière était trop onéreuse. Ainsi ont-elles contracté des produits structurés.
S’agissant des agglomérations les plus importantes, l’exemple de la ville de Saint-Étienne est éclairant sur ce point. Depuis les années 1950, Saint-Étienne a dû faire face à un choc économique, qui a entraîné de profondes restructurations industrielles, doublé d’un choc démographique, qui s’est traduit par une baisse de sa population de 220 000 à 170 000 habitants en cinquante ans. Privée de ses principales industries et de sa population la plus solvable, la commune a alors été confrontée à un effet de ciseau : ses recettes fiscales se sont réduites tandis que les dépenses en matières sociale et économique ont augmenté. La ville de Saint-Étienne a alors connu une profonde dégradation de ses finances publiques : en 1995, les charges financières représentaient 17 % des dépenses de fonctionnement, de même que 37 % du budget servait à rembourser le capital et les intérêts de la dette selon les élus de l’époque (61). Ne pouvant contracter des prêts classiques, qui auraient représenté une charge financière trop élevée, la commune a souscrit des emprunts structurés.
Quant aux plus petites communes, celles-ci se trouvaient également dans une situation difficile tant sur le plan financier (niveau d’endettement et de charges financières élevé), qu’économique (faiblesse structurelle du tissu et de l’activité économiques) et enfin démographique (population faible, en baisse ou soumise à une forte saisonnalité). Pour un simple exemple, la commune de Trégastel (Côtes d’Armor) dont le maire a été auditionné par la commission d’enquête (62) voit sa population être multipliée par 5 en période estivale et vit principalement de l’activité touristique. La commune présentait une dette de 10 millions d’euros lorsque ses emprunts ont été renégociés en 2007.
À l’instar des collectivités territoriales, beaucoup d’établissements publics évoluaient également dans un contexte financier contraint, rendant ainsi le recours aux produits structurés attractif. Dans le cadre du Plan Hôpital 2007, les établissements hospitaliers étaient incités à se restructurer et à se moderniser en se finançant par l’emprunt. Par ailleurs, les organismes de logement social devaient faire face à des problèmes de financement, leurs principales ressources issues du livret A étant insuffisantes.
● Si des difficultés financières ont conduit certaines collectivités territoriales à souscrire des produits structurés, les capacités de financement ainsi dégagées ont été mises au service de grands projets structurants.
L’endettement a ainsi poursuivi sa finalité première, qui est de lisser le financement de projets de long terme et non de reporter la charge de dépenses courantes sur les générations futures. Par ailleurs, le recours aux produits structurés s’est accompagné dans certaines collectivités d’une réduction de l’endettement global et d’une amélioration de la capacité d’autofinancement.
La ville de Saint-Étienne a utilisé la majorité des liquidités disponibles pour financer des projets de réaménagement urbain et plus spécifiquement de reconversion des friches industrielles. Dans les petites communes, les prêts structurés ont permis d’investir dans des travaux de réfection de la voirie ou de bâtiments communaux.
Quant aux établissements hospitaliers et aux organismes de logement social, les emprunts structurés ont assuré le financement de travaux de réaménagement et d’extension du parc immobilier, dont la situation s’était dégradée ces dernières décennies. Certains hôpitaux devaient réaliser une rénovation profonde, transformant par exemple les unités comportant des chambres à plusieurs lits en chambres individuelles.
● Bien que les exécutifs locaux aient pu percevoir les produits structurés comme un moyen de financement optimal, il n’en demeure pas moins que ceux-ci n’ont pas su prendre la mesure des risques induits par ce type de produit.
Dès lors, comment expliquer cette erreur d’appréciation ?
Trois explications se font jour :
– La première est d’ordre économique :
Face à un besoin de financement élevé dans un contexte financier contraint, les élus ont pu considérer les produits structurés, non comme la solution la plus risquée, mais la plus avantageuse. Dans certains cas, ce type d’emprunt pouvait apparaître comme le seul moyen de financement disponible. L’intervention de M. Michel Thiollière, ancien maire de Saint-Étienne, a donné à voir ce raisonnement : « Nous avons (…) souhaité investir pour restructurer la ville, et pour cela nous avons eu besoin d’emprunter. Comme toutes les collectivités, nous avons ouvert le jeu en direction des banques et choisi les produits les moins chers du marché de l’époque. La chambre régionale des comptes indique dans son rapport que, si nous avions souscrit à des taux fixes de 3,60 %, cela aurait représenté une charge supplémentaire pour la ville de 14 millions d’euros. Or je suis obligé de dire que nous avions besoin de ces 14 millions d’euros. » (63)
– La seconde est de nature informationnelle :
En présence d’une situation d’asymétrie d’information, où les banques avaient une bien meilleure connaissance du risque associé aux prêts structurés que les élus, ceux-ci ont pu se laisser convaincre de recourir à des produits dont ils minoraient ou ignoraient la toxicité. Les propos de M. Antoine Alfieri, ancien adjoint en charge des finances de Saint-Étienne, au sujet de la souscription par la commune d’un contre-swap proposé par une banque, illustrent cette difficulté : « (…) Nous avons été entraînés dans des risques importants en nous faisant croire (les banques) qu’on nous faisait sortir du risque. Nous avons peut-être été naïfs, je veux bien l’admettre.» (64)
– La troisième tient au contexte institutionnel :
Ni les assemblées délibérantes, ni les services de l’État n’ont su éclairer la décision des élus. Les activités de conseil et de contrôle internes ou externes n’ont pas permis d’identifier le risque financier. Dans le cas de Saint-Étienne, M. Michel Morin, préfet de la Loire (2002-2006), a souligné les limites du contrôle de régularité : « Ma principale préoccupation était de savoir si la ville et la communauté d’agglomération étaient capables de supporter les lourds investissements engagés. (…) J’ai donc attentivement suivi l’évolution du niveau d’endettement de la commune. En tout état de cause, la préfecture avait toute ignorance de la structure de cet endettement.» (65)
2.– Des assemblées délibérantes mal informées
De nombreux intervenants ont également indiqué à la commission d’enquête que les assemblées délibérantes n’ont pas été suffisamment associées à la politique de gestion de la dette.
Dans les communes et les conseils généraux, qui sont les collectivités territoriales ayant eu le plus recours aux produits structurés, la décision d’emprunter relève de la compétence des assemblées délibérantes. Compte tenu des contraintes techniques et de délais qui caractérisent la réalisation d’emprunts, ces dernières délèguent très fréquemment cette compétence aux exécutifs locaux. Aussi les assemblées délibérantes sont-elles peu impliquées, tant dans la prise de décision qu’en matière de contrôle.
● Dans nombre de cas, la pratique de la délégation de pouvoir a marginalisé les assemblées délibérantes lors de la prise de décision.
La quasi-totalité des conseils municipaux et des conseils généraux dont les membres ont été auditionnés par la commission d’enquête a délégué sa compétence en matière d’emprunt au maire, dans le premier cas, ou au président du conseil général, dans le second. Par ailleurs, les exécutifs locaux ont très souvent eu recours aux subdélégations de signature en faveur de leurs adjoint ou vice-président.
Ainsi que l’a indiqué le président de la chambre régionale des comptes de Picardie, M. Alain Levionnois, la pratique des délégations de compétence est parfaitement justifiée et par ailleurs très répandue : « L’une des particularités du contrat d’emprunt, c’est qu’il doit être conclu rapidement. Il ne peut que s’agir d’une décision exécutive du responsable au sein de la collectivité, et la soumettre aux délais de la délibération ne serait pas adapté.» (66)
Néanmoins, utilisées « en cascade », ces délégations de compétence et de signature ont pu conduire à éloigner la décision des assemblées délibérantes voire dans certains cas à brouiller les responsabilités au sein de l’exécutif local. Au final, la décision d’emprunt a souvent été prise par un élu isolé, ne disposant pas de toute l’information nécessaire, et contraint d’agir dans un laps de temps rapide car en contact téléphonique direct avec la salle de marché. En outre, ainsi que l’ont indiqué plusieurs personnes auditionnées par la commission d’enquête, la décision d’emprunt intervient formellement une fois l’emprunt réalisé sur le marché.
M. Simon Fortel, directeur des finances de la ville de Rouen, a exposé à la commission d’enquête un résumé éclairant de la situation : « La ville de Rouen fonctionne sensiblement selon le même schéma, avec une délégation donnée au maire et une signature des contrats par un adjoint. Cela a été dit, ces opérations échappent au code des marchés publics. Il faut souvent agir dans une « fenêtre de tir » extrêmement réduite ; tout se passe au téléphone avec la salle des marchés ; on tope à l’instant t ; puis l’opération est bouclée, éventuellement débouclée, sur les marchés. De la sorte, la décision intervient a posteriori et est récapitulée dans un compte rendu au conseil municipal. L’ingénierie et le vocabulaire complexes rebutent nombre d’adjoints et même de techniciens et tout cela apparaît comme une affaire de spécialistes traitée entre spécialistes.» (67)
● Par ailleurs, la faiblesse de l’information contenue dans les annexes budgétaires a rendu inopérant le pouvoir de contrôle des assemblées délibérantes.
Si les assemblées délibérantes ont consenti à déléguer leur compétence en matière de décision d’emprunt, leur pouvoir de suivi et de contrôle a été limité par la faiblesse des éléments d’information mis à leur disposition. Or, comme l’a rappelé le président de la Chambre régionale des comptes de Picardie, M. Alain Levionnois : « une délégation de compétence doit avoir comme contrepartie un pouvoir de contrôle, qui nous paraît actuellement insuffisant.» (68)
Ainsi que l’avait souligné la Cour des comptes dans son rapport thématique de 2011 consacré à la gestion locale de la dette, le manque d’information des assemblées délibérantes était dû, pour une part, à la volonté délibérée de certains exécutifs locaux, et pour une autre part, aux insuffisances liées aux annexes budgétaires transmises aux assemblées délibérantes.
Les annexes budgétaires répondant aux instructions budgétaires et comptables M14, pour les communes, et M52, pour les départements, étaient insuffisamment détaillées et difficilement lisibles, ce qui ne permettait pas aux élus d’identifier les risques liés à l’endettement. Comme l’a indiqué à la commission le trésorier-payeur de la Loire (2000-2005), M. Yves Terrasse (69), si les montants de la dette, des charges financières et du remboursement anticipé des emprunts figuraient dans les annexes budgétaires, d’autres informations importantes manquaient.
– La répartition des emprunts par type de taux ne figurait pas dans les annexes budgétaires, ce qui ne permettait pas d’identifier la nature des prêts contractés et les risques qui leur étaient associés : il était impossible d’évaluer la part de l’endettement de nature spéculative.
– Le montant des soultes était indiqué dans un autre état budgétaire et était par conséquent difficile à déceler, ce qui rendait quasiment impossible l’évaluation de la charge financière des emprunts : il était donc malaisé de mesurer la rentabilité financière de ces opérations.
– Enfin, en l’absence d’obligation de constituer des provisions, les collectivités n’ont pas su se prémunir contre le risque de taux et prévenir la dérive de leurs finances.
Compte tenu de ces informations parcellaires et peu lisibles en matière d’endettement, les assemblées délibérantes se trouvaient dans une situation paradoxale : surveillant le montant global de la dette et le niveau des taux d’intérêt sans connaître la nature des emprunts, les élus ont pu avoir l’illusion d’une situation financière globalement saine, la période de bonification étant en effet caractérisée par des taux d’intérêt exceptionnellement bas, des charges financières en diminution et un niveau d’endettement globalement maîtrisé.
L’intervention de M. Maurice Vincent, maire actuel de Saint-Étienne et élu d’opposition lorsque les prêts structurés ont été contractés, illustre bien ces difficultés : « Selon moi, avant 2008, il était inimaginable pour n’importe quel élu que des produits spéculatifs de cette nature soient proposés et souscrits par les collectivités. (…) À Saint-Étienne, l’opposition connaissait l’existence d’une dette importante. Elle surveillait donc son montant global. (…) L’opposition surveillait également le taux d’intérêt. Mais celui-ci était bas puisque c’étaient les emprunts toxiques qui le faisaient baisser, ce que nous ne savions pas. (…) Ainsi, jusqu’en 2007, nous constations, en tant qu’opposants, que la dette augmentait un peu et que le taux d’intérêt était plutôt bas. » (70)
Avec la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements, et les arrêtés du 16 décembre 2010 relatifs aux instructions budgétaires et comptables M14 et M52, l’information contenue dans les annexes budgétaires a été complétée : en particulier, la répartition de l’encours de la dette selon le type de taux doit être indiquée, de même que les investissements réalisés en partenariats publics-privés (PPP) doivent être intégrés à l’endettement.
3.– Une qualification insuffisante des services pour gérer des produits aussi sophistiqués
Si les exécutifs locaux ont pu manquer de vigilance et les assemblées délibérantes de moyens d’information, les auditions réalisées par la commission d’enquête ont fait apparaître que certains des services financiers des collectivités territoriales n’ont pas pu fournir aux élus locaux l’assistance nécessaire en matière de gestion de dette.
Seules les agglomérations les plus importantes bénéficiaient de services financiers de taille critique. Ceux-ci avaient pour tâche de fournir une expertise financière aux élus, de les assister lors de la négociation avec les banques et dans la décision d’emprunt, et enfin de suivre et de contrôler l’évolution de l’endettement. Des comités techniques, réunissant élus et fonctionnaires territoriaux, avaient été mis en place dans la plupart des grandes agglomérations.
Les attributions des fonctionnaires territoriaux et la formation que ceux-ci reçoivent ne se limitant pas aux enjeux financiers, il est évident que les services financiers ne pouvaient être et n’ont pas vocation à devenir des experts en matière de gestion active de dette. Ce constat a été rappelé à la commission d’enquête par M. Simon Fortel, directeur des finances de la ville de Rouen : « Les fonctionnaires territoriaux doivent-ils pour autant devenir des spécialistes des salles de marché ? Je ne le pense pas. Nous avons d’autres métiers – davantage tournés vers la population – à développer. » (71)
Toutefois, il importe de souligner que la faiblesse numérique, dans les plus petites communes, et le manque de qualification des services financiers, dans les agglomérations les plus importantes, ont pu porter préjudice à la qualité de l’information délivrée aux élus, de même qu’aux décisions qui en ont résulté. Ainsi que l’a indiqué M. Philippe Yvin, directeur général des services du conseil général de la Seine-Saint-Denis, dans la plupart des cas, les services financiers n’ont pas été en mesure de rééquilibrer la relation asymétrique entre les collectivités territoriales et les banques en matière d’information : « Quand on lit les comptes rendus de ce qui s’est dit en commission permanente du conseil général tout au long de ces années, on s’aperçoit que les arguments avancés reproduisaient ceux des commerciaux, de Dexia notamment (…). Élus et fonctionnaires n’étaient évidemment pas en mesure de contrer ces discours (…). » (72)
Quand bien même les collectivités territoriales auraient disposé de services financiers suffisamment qualifiés et dotés en personnel, il n’est par ailleurs pas certain que les élus locaux aient pu s’approprier leur expertise étant donné la complexité des enjeux en présence. M. Antoine Alfieri, ancien adjoint en charge des finances de Saint-Étienne a clairement soulevé cette difficulté devant la commission d’enquête : « La ville de Saint-Étienne – dont je rappelle qu’elle emploie 3 500 personnes – dispose d’un service financier chargé de procéder à ces analyses. En ce qui me concerne, on me transmettait un résumé de ces informations, mais on ne m’a jamais alerté, loin s’en faut. (…) J’ai peut-être été mal informé, mais peut-être aussi n’ai-je pas su lire les informations qui m’étaient transmises car je ne suis pas un spécialiste des finances : j’en ai simplement reçu la délégation lorsque j’ai été élu » (73).
4.– Le rôle ambigu des cabinets de conseil aux collectivités
En plus des difficultés liées à la qualification de leurs services financiers, certains élus locaux entendus devant la commission d’enquête ont également pâti des défaillances du conseil délivré par les cabinets de consultants privés auxquels ils ont eu recours.
Dans plusieurs cas, des cabinets de conseil ont encouragé les collectivités à contracter des prêts structurés, en dépit des risques que ceux-ci comportaient. Le rôle de ces cabinets de conseil pose question au regard de trois points :
– La qualification et l’expertise des consultants apparaissent inégales selon les collectivités et sujette à caution compte tenu de la politique d’emprunt extrêmement risquée que ceux-ci ont promue.
– Par ailleurs, les obligations de publicité et de concurrence lors du choix du consultant n’ont pas toujours été respectées.
– Enfin, les conditions de rémunération des consultants n’étaient pas forcément liées aux résultats obtenus.
La ville de Saint-Étienne a ainsi eu recours à deux prestataires privés qui l’ont assistée dans la gestion active de sa dette. Pour l’un d’eux, la société Techfi, la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes constatait dans son rapport de 2010 que le choix avait été effectué de manière discrétionnaire au moyen de lettres de commande. Elle ajoutait également que le niveau de rémunération élevé du prestataire n’était pas toujours en rapport avec les résultats attendus. Au total, la ville de Saint-Étienne avait consacré, selon la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, une somme globale de 450 000 euros à compter de 2001 à ces missions d’expertise externes. Entendu devant la commission d’enquête, M. Antoine Alfieri, ancien adjoint en charge des finances de Saint-Étienne, a précisé que la rémunération du consultant de la société Techfi était plafonnée et prenait en compte les résultats obtenus : « La rémunération de M. Rastel était plafonnée. Nous avons tout de même gagné pratiquement 20 millions d’euros pendant la période où nous avons eu recours à ses prestations. 0,5 % de cette somme correspondent à un million d’euros ; or il n’en a même pas perçu 360 000 sur plusieurs années. » (74)
Selon le témoignage apporté par M. Michel Klopfer, spécialiste du conseil financier aux collectivités, la rémunération proposée par certaines collectivités (les exemples de Saint-Étienne métropole et de Rouen ont été cités), la rémunération proposée au conseil financier était exclusivement proportionnelle aux gains budgétaires effectués la première année. Cet arrangement est dangereux, car il fait du conseil un allié objectif de la banque, l’incitant à se prévaloir d’un taux extrêmement bas cette première année (donc source d’une économie dont l’affichage est très facile pour la collectivité), mais avec ce risque caché de charges beaucoup plus lourdes par la suite.
La pratique de la prime de résultats calculée sur le gain budgétaire constituait en effet une pratique courante chez les acteurs de marché au début des années 2000. On notera qu’à l’inverse, les représentants de la société Finance Active ont indiqué lors de leur audition pratiquer une rémunération objective, fixée à l’avance sous forme d’abonnement annuel et indépendante des opérations effectuées, établie plutôt sur le nombre d’emprunts gérés et l’encours de la dette.
Face à la disparité des pratiques et des qualifications de ces intervenants, il paraît indispensable de réfléchir à un encadrement du secteur du conseil financier aux acteurs publics locaux. Les qualifications nécessaires pourraient faire l’objet de diplômes spécialisés en gestion des finances locales, pouvant être acquis, le cas échéant, par valorisation des acquis de l’expérience. Une certification des organismes, ainsi qu’une charte de bonnes pratiques, interdisant notamment la rémunération en fonction des résultats à court terme, devraient être mises en œuvre volontairement par le secteur ou à défaut par la puissance publique.
5.– Les établissements hospitaliers invités à investir sans le soutien de la puissance publique
Tout comme les collectivités territoriales, certains établissements publics comme les hôpitaux, ont également contracté des prêts structurés afin, d’une part, d’abaisser leurs charges financières, et d’autre part, de permettre le financement de projets d’investissement structurants. Revenant sur le cas du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital, a rappelé à la commission d’enquête que les produits structurés ont permis d’aplanir les charges financières de l’établissement de 10 à 11 millions d’euros pendant la période de bonification et de financer sa reconstruction, prise en charge par l’emprunt dans sa quasi-totalité (75).
Ces projets d’investissement se sont inscrits dans le cadre du Plan Hôpital 2007, qui a encouragé les hôpitaux à entreprendre des opérations de restructuration, en recourant notamment au financement par l’emprunt. Comme l’a indiqué M. Pierre-Charles Pons, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Dijon : « (…) Il faut se souvenir du contexte. Le plan Hôpital 2007 était indispensable pour relancer, après quinze ans de stagnation, l’investissement hospitaliers » (76). De nombreux hôpitaux ont alors eu besoin de dégager des moyens de financement importants de manière concomitante. La situation du marché de l’investissement hospitalier étant marquée par une situation oligopolistique, les prix du marché, déjà initialement élevés, se sont accrus compte tenu du dynamisme de la demande : « Nous avons été nombreux à avoir en même temps des besoins importants. Et comme il n’y a en France que trois entreprises qui savent construire un hôpital – Bouygues, Eiffage et Vinci –, les prix ont monté. Quand nous avons ouvert les plis, les offres affichaient entre 20 % et 25 % de plus que les sommes initialement prévues » (77). Face à cette situation, les établissements hospitaliers ont eu recours à des emprunts structurés, comme dans le cas du centre hospitalier régional universitaire de Dijon : « Pour faire baisser un peu l’addition, nous avons négocié une avance qui a exigé un appel de fonds important. Et c’est à ce moment-là que le CHRU de Dijon a contracté deux emprunts hors charte Gissler pour un montant de 75 millions d’euros » (78)
Si la conjoncture et les besoins financiers des établissements expliquent le recours à des prêts structurés, on constate que les risques associés à ce type de produits n’ont pas pu être identifiés, ni au moment de la décision prise par le directeur d’hôpital, ni lors des contrôles exercés par les services du Trésor.
Depuis 2005, la décision d’emprunter n’est plus soumise à une délibération du conseil d’administration mais relève du directeur d’hôpital, qui en informe le directoire et le conseil de surveillance. L’isolement des directeurs d’hôpital lors de la décision d’emprunt a pu conduire ces derniers à réaliser des opérations risquées ; et ce, d’autant plus que bon nombre d’entre eux ne disposaient ni des compétences nécessaires, ni de l’appui de services financiers suffisamment formés.
Par ailleurs, les hôpitaux doivent transmettre aux services du Trésor un plan global de financement pluriannuel, présenté avec l’état prévisionnel de leurs recettes et leurs dépenses. Ainsi que l’a souligné M. André Bury, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier, ce document présente la stratégie d’endettement de l’établissement et indique le montant, les taux et la durée des emprunts (79). Cependant le plan global de financement pluriannuel ne détaillant pas toujours suffisamment la structure de l’endettement, il n’a pas permis d’identifier les risques associés aux emprunts structurés. Les incomplétudes de l’information financière disponible, de même que la faiblesse de la formation des services du Trésor en matière de produits structurés, ont nui à l’efficacité de leur contrôle.
Les directeurs d’hôpital auditionnés par la commission d’enquête ont également formulé des propositions pour l’avenir :
● S’agissant des produits pouvant être contractés par les établissements hospitaliers, M. Frédéric Boiron a souligné la nécessité pour les établissements hospitaliers de ne recourir qu’aux produits inscrits dans la charte Gissler, en veillant à limiter la durée de ces produits dans le temps et à les proportionner à leur taille et à leur niveau d’endettement (80).
● Par ailleurs, il a présenté la coopération et la mutualisation entre les établissements hospitaliers comme le moyen de palier le manque d’expertise financière et les insuffisances du conseil interne. En plus du conseil pouvant être délivré par des consultants privés, des cellules d’expertise financière communes à plusieurs établissements hospitaliers pourraient être développées, alors que se mettent en place par ailleurs des communautés de territoire.
● Enfin, pour le traitement du « stock » des emprunts structurés, une juste répartition du surcoût devrait être recherchée entre les établissements hospitaliers, les établissements bancaires et les collectivités publiques. Il conviendrait selon le président de l’Association des directeurs d’hôpitaux que les établissements bancaires assument leur part de risque et soient mis à contribution. S’agissant des établissements hospitaliers les plus endettés, M. André-Gwenaël Pors, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, a fait observer à la commission d’enquête l’opportunité d’envisager la mise une place d’une structure de défaisance ainsi qu’une recapitalisation des établissements hospitaliers par l’État (81).
6.– L’absence d’alerte des agences de notation
Les agences de notation n’ont semble-t-il joué aucun rôle d’alerte dans la diffusion des emprunts à risques, alors que la crise financière de 2008 pouvait conduire à un changement des conditions et des prévisions. Il est arrivé qu’elles consolident les notes des collectivités qui en faisaient usage, comme cela a été le cas de la notation de Lille Métropole Communauté urbaine par l’agence Standard and Poor’s, par exemple. Dans ce cas, l’agence n’a pas su évaluer les risques financiers associés aux produits structurés, car il faut supposer qu’elle a pris connaissance de la structure de la dette et non seulement du niveau d’endettement.
Peu de collectivités font l’objet d’une notation, une vingtaine environ, aussi la portée de l’analyse est-elle restreinte. En outre, certaines des collectivités notées n’ont souscrit aucun emprunt à risque, comme la région Rhône-Alpes. Les agences de notation doivent notamment apprécier le risque de non-remboursement des emprunts souscrits. Les notes attribuées par les agences permettent aux collectivités, d’une part, d’accéder plus facilement à l’emprunt auprès des établissements de crédit, et d’autre part, de témoigner au contribuable local de la bonne gestion des deniers publics.
Comme l’a rappelé à la commission d’enquête M. Alban Caillemer du Ferrage, avocat associé au cabinet Gide, spécialiste des produits dérivés et des financements structurés, les notes attribuées aux collectivités ont été globalement positives, ce qui a pu conduire les établissements bancaires à surévaluer la capacité des collectivités territoriales à rembourser leurs emprunts. Cette appréciation globalement positive sur la gestion de la dette locale s’explique par le fait que l’endettement public local progressait peu. En outre, les charges financières des collectivités, qui s’établissaient en moyenne autour de 3 % de leurs dépenses de fonctionnement, étaient relativement faibles. Enfin, « à la différence de ce qui s’est passé dans beaucoup de pays voisins nous n’avons connu pratiquement aucune insolvabilité ou défaut de paiement » (82). Ce contexte relativement favorable en matière d’endettement local a pu inciter les agences de notation à juger la situation financière de certaines collectivités territoriales globalement saine.
L’on peut se demander si les indicateurs et ratios utilisés par les agences de notation étaient appropriés. Ainsi que l’a indiqué M. Christophe Parisot, directeur des finances publiques de Fitch Ratings France, le coût de la dette figure parmi les indicateurs importants permettant aux agences de notation de juger de la qualité de crédit, de la solvabilité et de la compétence de gestion des collectivités territoriales (83). Or, on rappelle que, lors de la phase de bonification, les produits structurés ont contribué à abaisser la charge financière des collectivités en maintenant des taux d’intérêt faibles. Par ailleurs, selon M. Christophe Parisot, les produits structurés ont différé « à une période bien ultérieure la survenue de risques, des risques qui de surcroît ne dépendaient pas intrinsèquement de la collectivité considérée mais de scénarios de marchés » (84). Abaissant artificiellement la charge financière et différant la survenue des risques dans le temps, les produits structurés ont introduit un biais dans l’évaluation réalisée par les agences de notation quant à la situation financière de certaines collectivités territoriales.
Les agences, en délivrant ainsi des bonnes notations aux collectivités ayant contracté des emprunts à risques pour une proportion élevée de l’encours, n’ont-elles pas conduit les banques à surestimer la capacité des collectivités territoriales à faire face à leurs obligations au terme de ces opérations ? Les responsabilités s’entrecroisent, comme on peut l’observer.
B.– LA POLITIQUE COMMERCIALE AGRESSIVE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Sous l’impact de la décentralisation, la dette publique locale est passée de 59 milliards d’euros, à la fin de 1985, à près de 104 milliards d’euros à la fin 1995. La tendance s’est inversée à partir de 1996, avec une volonté de désendettement liées aux mauvais exemples de déroute financière de certaines collectivités, tendance qui s’est prolongée jusqu’en 2003 : pendant cette période l’encours diminue et les prêteurs connaissent une période difficile, avec un marché en baisse de 10 % par an. Dans ce marché en récession, les banques baissent leurs marges pour tenter de préserver leur part, la concurrence étant aggravée par l’arrivée sur le marché français de banquiers étrangers.
1.– Le marché des prêts aux collectivités est devenu le lieu d’une lutte commerciale sans merci
C’est dans un tel contexte que l’abondance des liquidités disponibles pour les collectivités, dans un contexte de baisse de l’encours global de leur dette, a déclenché une lutte commerciale sans merci entre les banques, qui ont dû proposer des produits innovants facialement attractifs, et « toujours légèrement différents par rapport à ceux de la concurrence de manière à éviter la comparaison des prix », ainsi que l’observe l’inspecteur général Gissler dans son rapport de février 2009.
Par ailleurs, après la longue période de baisse continue des taux, certaines collectivités locales n’ont pas accepté, à l’inverse des autres agents économiques, la remontée des taux à partir de 2005. Ce facteur économique intervenait de manière d’autant plus inopportune qu’il s’agissait d’une période préélectorale puisque les élections municipales devaient se dérouler en 2007, avant d’être reportées en 2008 en raison du calendrier d’échéances politiques très chargé. Certaines collectivités parvenaient alors à la fin de la phase de taux fixe très bas et allaient devoir afficher les surcoûts d’intérêts de la phase variable évidemment politiquement plus défavorable ;
En effet, comme nous l’avons vu dans la première partie du présent rapport que certaines conditions paraissant au départ du contrat peu dangereuses se sont révélées sur le point d’être réalisées et de contraindre les emprunteurs à devoir payer un taux dégradé, très supérieur au marché. La perspective de reconnaître avoir fait preuve d’une mauvaise analyse économique, ou d’avoir à verser une soulte élevée pour sortir du contrat, a conduit à rechercher des solutions permettant de continuer à payer des taux bas…
Or les contrats prévoyaient la possibilité de renégocier le prêt à l’approche de la sortie de la phase garantie. Il était possible d’obtenir une nouvelle période bonifiée moyennant une vente d’option, en réalité encore plus risquée.
Cette « opportunité » allait évidemment rencontrer le besoin des banques de « faire tourner la dette » par la renégociation pour multiplier les commissions et restaurer quelque peu leurs marges.
L’on peut se demander pourquoi les collectivités ont été conduites à réaménager les emprunts plutôt qu’à les rembourser de manière anticipée moyennant le versement d’une soulte.
L’article 3 du code des marchés publics exclut de la mise en concurrence les contrats portant sur des services financiers. Toutefois, cette exclusion n’abolit pas la mise en concurrence de fait pour la souscription d’un emprunt, et les représentants des collectivités auditionnés ont souvent témoigné avoir comparé plusieurs offres lors de la souscription initiale.
Par contre, lorsqu’il s’agit de la renégociation, le contrat oppose un verrou : « c’est à prendre ou à laisser », ainsi que l’ont exprimé certaines des personnes auditionnées. Le souscripteur est captif du contrat initial et ne peut procéder à une nouvelle mise en concurrence des offres.
2.– La nécessité de retrouver des marges a conduit à une politique commerciale agressive
La concurrence avait conduit les banques à proposer des financements avec des marges inférieures ou égales à 0,2 % de l’Euribor, c’est-à-dire que les banques étaient allées jusqu’à prêter largement en dessous du coût de la ressource financière. Ne pouvant donc plus se rémunérer sur les produits classiques, les banques ont dû imaginer d’autres moyens de reconstituer leurs marges commerciales.
L’un de ces moyens a été de proposer des produits plus sophistiqués à marge commerciale plus élevée, dont la caractéristique était d’être totalement indécelable par le client qui ne peut plus comparer les offres existant chez les différents établissements bancaires. Or si la marge est opaque, voire invisible, elle a des conséquences plus graves lorsqu’il s’agit d’un produit structuré, car elle est réalisée sur l’augmentation des effets de leviers inclus dans le produit, ce qui accroît le risque de perte du client.
Dans ces circonstances, ces nouveaux prêts structurés sont apparus très profitables et les banques ont adopté une politique commerciale offensive, demandant à leurs commerciaux de proposer aux emprunteurs des restructurations de prêts. C’est ainsi que dans certains cas, il a été proposé de « renégocier » – terme ici mal employé – la dette tous les deux ans, en majorant les marges à chaque fois. Selon les termes de M. Michel Klopfer, spécialiste du conseil financier aux collectivités et « adversaire » des emprunts structurés dès leur apparition, « quand on a accordé jusqu’à trois fois deux années de « douceurs », avec trois doublements ou décuplements de marge, comment voulez-vous qu’on n’aboutisse pas à des produits assortis d’options astronomiques sur des durées de quinze ou trente ans ? » C’est ainsi que les collectivités se trouvent détentrices de produits qui peuvent perturber leur équilibre financier jusqu’en 2030, voire, dans les cas les plus défavorables, jusqu’en 2040.
Malgré l’affirmation de M. Pierre Richard, ancien président de Dexia, selon laquelle les produits structurés ont été élaborés pour répondre à une demande de la clientèle collectivités désireuse de saisir les opportunités du marché, et laquelle la « renégociation » des prêts est intervenue à la demande des représentants des collectivités, les témoignages de nombreux auditionnés montrent plutôt un démarchage appuyé des commerciaux adressant leurs propositions au client lors des rendez-vous réguliers, ou même en dehors de ces moments.
La relation bancaire a donc progressivement changé à partir de 2001 : alors qu’elle était déclenchée par la collectivité à l’occasion d’un appel d’offres ou d’une demande de renégociation, elle est devenue une relation « pilotée » par la banque, qui en donne le rythme au gré de ses propositions spontanées de réaménagement de la dette.
M. Jacques Descourtieux, directeur général de l’entreprise de conseil Finance Active, indique que sur la période 2004-2008, les clients ont transmis à sa société, pour demande de conseil, 8 000 propositions de réaménagement de la dette reçues des banques et 7 000 propositions de nouveaux financements, comportant des produits structurés, soit 15 000 propositions au total comportant une offre structurée. Certaines collectivités auraient reçu jusqu’à dix propositions en sept mois.
Ce traitement « de masse » de la clientèle des collectivités montre que les banques s’étaient donné des objectifs commerciaux précis de placement des produits, et que des personnels avaient été recrutés pour faire face à ce changement d’échelle, comme la progression des effectifs commerciaux de Dexia de 500 personnes en 1993 à plusieurs milliers dix ans plus tard le laisse comprendre.
Contrairement à l’affirmation de M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit local devant la commission, selon laquelle « dès l’origine, nous avons réservé aux grandes collectivités les produits incluant des formules mathématiques complexes », les emprunts structurés ont été vendus aux petites collectivités, puisqu’elles en ont souscrit pour plus de 3 milliards d’euros, dont 56 % sont considérés comme risqués (1 729 petites communes clientes de Dexia ont souscrit des emprunts structurés à risque).
Les marges réalisées sur les produits structurés auraient été, selon les représentants des banques auditionnés par la commission, de 20 à 30 centimes d’euro. Cela correspond davantage à la marge de rémunération d’un emprunt à taux fixe dans les années 1990, qui pouvait varier de 20 à 30 centimes selon le risque lié au client. En revanche, selon M. Patrice Chatard, directeur général de Finance Active, les marges réalisées sur les emprunts structurés « atteindraient au minimum 60 centimes, et vraisemblablement 80 à 90 centimes, voire davantage, à la fin de la période ».
La présentation commerciale des prêts, telle qu’elle peut apparaît dans les documents donnés aux responsables des collectivités, insiste sur le caractère sûr et stable des formules proposées, jusqu’au nom du produit qui peut introduire la confusion comme le « TOFIX-Dual » commercialisé par Dexia. Les références rassurantes sont nombreuses dans l’exemple d’offre joint en annexe au présent rapport.
La volonté de tromper a paru évidente à M. Gilles Sébé, président de Seldon Finance, qui souligne que « les banquiers, qui avaient une connaissance approfondie des marchés, trouvaient pour interlocuteurs bien peu de spécialistes capables de dire « non » à leurs propositions. Et lorsqu’il se produisait qu’un directeur financier refuse ces produits, on le court-circuitait en traitant avec l’adjoint aux finances puis, si besoin était, avec le maire directement. Tout a été fait pour que les collectivités signent ces contrats. Ensuite, la flambée de l’Euribor a fait peur, et cela a permis aux banquiers d’enchaîner les marges successives ».
On soulignera que, selon les témoignages des représentants des petites communes, il ne leur était pas proposé d’autre type de produits que le produit appelé TOFIX, qui a été décrit dans la première partie du présent rapport. Ceci témoigne de la pression exercée en faveur du placement de ce produit.
Selon la déclaration de M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit Local, le comité « Nouveaux produits » de la banque avait fixé à 50 % le seuil d’emprise maximal des prêts structurés souscrits auprès de Dexia dans l’encours de dette de chaque collectivité. Les directives de ce comité n’ont pas été observées par les commerciaux puisque dans plusieurs cas, l’ensemble des contrats signés avec Dexia étaient des contrats structurés, tous classés au niveau maximal de risques spéculatifs, et pouvaient représenter plus de 80 % de la dette totale comme dans le cas de la ville de Plaisir (Yvelines). Dans de nombreux cas, l’encours de produits structurés dépassait les 50 % comme en Seine-Saint-Denis, à Saint-Étienne, à Carvin ou encore pour la communauté d’agglomérations d’Argenteuil, où la part du structuré atteint 97 %.
Face à cette politique commerciale résolue et aux présentations trompeuses des produits, les alertes de certains professionnels sont passées inaperçues de beaucoup de gestionnaires. La renégociation ne se traduit pas nécessairement par un gain, comme certains observateurs professionnels en alertaient à l’époque leurs clients et la presse spécialisée. Ainsi M. Michel Klopfer a-t-il clairement indiqué que le calcul de la valeur actuelle nette (VAN) du nouvel emprunt permettait souvent de constater qu’il n’y a pas de gain. De manière plus systémique, il était impossible, de manière globale, que chaque collectivité effectue une opération favorable pour elle !
3.– L’étendue de la responsabilité des banques actuellement en jeu devant les tribunaux
Une partie des prêts structurés parvient actuellement à la fin de la période bonifiée de taux fixes très bas, et cette sortie vers la période dite « structurée » peut se traduire par l’accroissement important des charges d’emprunt ; il faut souligner que le phénomène n’est qu’à son début puisque 50 % environ des prêts restent en phase bonifiée jusqu’à 2012 ou 2013. Dans cette situation, la collectivité empruntrice se tourne vers l’établissement bancaire peut solliciter un nouvel aménagement du prêt, ou proposer un remboursement de sa dette : dans ce dernier cas, la soulte demandée est extrêmement élevée et peut avoisiner le montant du capital restant dû lui-même, ainsi que les élus de certaines collectivités l’ont indiqué à la commission.
Selon l’observatoire de Finance Active, 350 collectivités détiendraient des produits indexés sur le change (chiffre corroboré par Dexia qui indique 300 collectivités), et qui pourraient donc se trouver fortement déséquilibrées dans les prochains mois par des variations de cours. Toutefois, toutes ne se trouvent pas dans la même situation : pour certaines, ces produits ne constituent qu’une faible proportion de l’encours de dette, d’autres demandent à leur banque une sécurisation de l’emprunt avec une contrepartie d’allongement sur un taux Euribor.
Toutefois, une dernière catégorie de collectivité se trouve dans une situation beaucoup plus difficile si l’encours est constitué en très forte proportion de produits indexés sur le change : 80 à 90 % par exemple. Il y aurait cinquante à cent collectivités dans ce cas, pour lesquelles ni le versement de la soulte ni le report du risque sur l’avenir ne peuvent régler la question.
Dans ces derniers cas, la question de l’imprudence de la banque et de sa responsabilité doit être particulièrement posée et les représentants de Finance Active, par exemple, ont indiqué devant la commission qu’ils conseillaient alors à la collectivité de contester le contrat devant les tribunaux.
Environ quinze collectivités, devant aujourd’hui faire face à la progression du taux d’intérêt de l’emprunt mettant en jeu leur équilibre financier, et face à l’inquiétante absence de visibilité même à court terme, ont annoncé avoir saisi les tribunaux pour obtenir l’annulation du contrat de prêt. D’autres contrats ont très vraisemblablement été portés devant la justice sans que l’action ait été rendue publique. En outre, plusieurs dizaines de collectivités se trouvent dans une phase précontentieuse, ayant confié leur dossier à un conseil.
a) L’absence de jurisprudence sur les emprunts structurés
Il n’y a pas encore en France de jurisprudence consacrée aux emprunts structurés des acteurs publics locaux. Quelques décisions de justice peuvent être citées, pour constater qu’elles ne forment pas un droit positif permettant aux collectivités d’opter pour ou contre l’action en justice.
Un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, le 27 mars 2008, retient pour le banquier une obligation d’information et de conseil précontractuelle lors de la souscription de contrats de swaps pour une société d’HLM. Une ordonnance de référé du Président du Tribunal de grande instance de Nanterre de juin 2011 a rejeté la demande de la commune de Servian (Hérault) consistant à être autorisée à procéder au remboursement anticipé du capital restant dû de six prêts contractés entre avril 1994 et décembre 2005.
Tout récemment, une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2011 par le Premier vice-président adjoint du TGI de Paris a débouté la Royal Bank of Scotland de son assignation pour obtenir le paiement à titre conservatoire des échéances dues par la ville de Saint-Étienne dans le cadre d’un contrat de swaps faisant l’objet d’un recours en annulation sur le fond. Le magistrat a estimé en l’espèce que « les mécanismes de swaps vendus aux collectivités territoriales se sont révélés être des produits spéculatifs à haut risque et dont la légalité est aujourd’hui sérieusement contestée devant le juge du fond » ; en conséquence la cessation du versement des échéances de ses emprunts par la ville n’a pas été considérée comme un trouble manifestement illicite. Si cette décision peut apparaître encourageante pour les collectivités qui éprouvent de grandes difficultés à faire face aux échéances de prêts entrés dans leur phase variable, elle ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le fond, et la prudence demeure de mise.
Si l’on replace la responsabilité relative aux emprunts structurés dans le cadre plus général de la responsabilité du prêteur, on considère que le prêteur, aux termes de la jurisprudence, peut être inquiété dans trois cas :
– lorsque l’emprunt ne fait pas référence au TEG ;
– lorsque les opérations de swap sont rédigées en anglais ; en application de la loi Toubon du 4 août 1991, le contrat peut être considéré comme illégal ;
– dans le cas de contrats signés après le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de la directive MIF, lorsque la banque ne s’est pas assuré que son client avait la compétence nécessaire alors que la collectivité ne s’est pas déclarée comme un professionnel.
Dans les cas que nous évoquons, de telles obligations ont été remplies, aussi les chefs de mise en cause certaine de la responsabilité du banquier sont-ils très limités à ce jour. C’est pourquoi la question est posée de la mise en jeu de la responsabilité du prêteur sur la base des dispositions du code monétaire et financier.
b) La limite résultant de la notion d’usure est-elle inopérante ?
Il importe de comprendre pourquoi le taux d’usure ne peut être invoqué pour obtenir l’annulation du contrat de prêt.
En vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.
Le taux effectif global (TEG) a été institué en 1985 ; il est calculé selon la méthode actuarielle depuis 1996, et constitue un élément de référence qui devrait en principe figurer dans tout contrat d’emprunt. Pourtant, ce n’est plus le cas, car de nombreux contrats comportent une clause selon laquelle les parties conviennent qu’il n’est pas possible de calculer le TEG, compte tenu de la structure de financement, et qu’à titre indicatif, il est fixé à un certain taux (2,12 % par exemple) sur la base de l’Euribor au jour de la signature.
L’application de cette disposition trouve une limite dans le fait que pour un contrat à taux variable, le taux effectif global ne s’applique qu’au taux initial, et non au produit de la formule mathématique retenue. Le code de la consommation prescrit que le TEG donné dans le contrat l’est à titre indicatif, et c’est ce taux qui est rapporté au taux de l’usure.
En cette matière, un angle d’attaque est possible, selon les juristes auditionnés par la commission : c’est le cas où le TEG a été omis au contrat, ce qui n’est en général pas le cas. Dans certains cas, il a été soulevé que la base de calcul du TEG était erronée, n’ayant pas été calculée sur la base de 365 jours, et le contrat contraire aux dispositions du code monétaire et financier. Les contrats ayant depuis été corrigés sur ce point, une action sur cette base est peu probable. Reste l’hypothèse d’un TEG manifestement sous évalué, qui pourrait être jugé comme une pratique de mauvaise foi par le juge, au titre de l’article 1134, alinéa 3, du code civil.
L’encadré qui suit rappelle la teneur de la notion d’usure et les catégories et taux actuels.
LE TAUX D’USURE 1.– Définition et répression de l’usure Afin de protéger les consommateurs désireux d'emprunter de l'argent, le code de la consommation définit comme taux de l’usure le taux effectif global (TEG) maximal auquel certains prêts peuvent être accordés. Tout prêteur qui proposerait des prêts présentant au moment où il est consenti un taux supérieur d’un tiers au « taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues » (article L. 313-3) s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et d'une amende de 45 000 euros (article L. 313-5). La Banque de France est en charge de la détermination de ces taux (article D. 313-6). Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux (article L. 313-4). 2.– Les prêts concernés Aujourd’hui, tous les financements aux particuliers, aux associations et aux collectivités territoriales sont soumis à la législation sur l’usure. Celle-ci impose d'ailleurs aux prêteurs d'informer leurs clients du taux de l'usure en vigueur pour le prêt qu'ils leur proposent. En effet, l’article L. 313-3 du code de la consommation n’exclut de son application que les « personne[s] physique[s] agissant pour [leurs] besoins professionnels » et les « personne[s] morale[s] se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. » Pour les entreprises et les professionnels, le législateur a estimé en 2003 et 2005 que cette contrainte avait aussi pour conséquence de fermer les portes du crédit à certaines entreprises jugées trop fragiles pour pouvoir emprunter. Aussi l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a donc supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis aux entreprises commerciales, industrielles ou financières. Seule demeure la sanction civile pour les découverts en compte qui leur sont consentis. L'article 7 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a étendu cette suppression du délit aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (entrepreneurs individuels). La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a prévu une modification des catégories des crédits à la consommation qui consiste en la seule distinction par niveau de montant emprunté (jusqu'à 3 000 €, entre 3 000 et 6 000 €, et, au-delà de 6 000 €). L’arrêté du 22 mars 2011 a mis en application cette réforme depuis le 1er avril 2011, avec une période transitoire de deux ans. À terme, le seuil de l'usure sera donc identique pour un crédit de même montant que ce soit sous forme de prêt amortissable, d'un découvert en compte, ou d'un crédit renouvelable. 3.– Les catégories et taux actuels tels que déterminés par la Banque de France
Source : Banque de France. 4.– La situation dans les autres pays européens En règle générale, les pays développés conservent des garde-fous pour les crédits aux particuliers mais ont entièrement libéralisé leurs régimes de l'usure pour les crédits aux entreprises. Seule la France et l'Italie font encore figure d'exception. Dans la plupart des pays, le contrôle des taux d'intérêt ne s'appuie pas sur la loi, mais sur la jurisprudence. C'est le cas de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. En Allemagne, les tribunaux évaluent en se basant sur les moyennes du marché publiées chaque mois par la Bundesbank pour les différents types de crédit. L’écart est considéré comme excessif quand il excède le double de celui du marché. Comme la France, l'Italie dispose d'une loi régulant les taux d'intérêt. Le taux d'usure y est également réévalué chaque trimestre. Mais un taux d'intérêt y est considéré comme usuraire s'il excède de plus de 50 % le taux moyen appliqué par les banques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Les conséquences possibles du défaut de conseil et de mise en garde
Des actions pénales ont été engagées pour dol, tromperie ou escroquerie. Selon M. Richard Routier, spécialiste de la responsabilité du banquier, auditionné par la commission, de telles actions ont peu de chances d’aboutir, car il faut pouvoir démontrer l’existence d’un élément intentionnel qui, étant donné l’aléa des marchés et le fait que les signataires des contrats n’étaient pas forcément au courant de ce qu’ils signaient, sera difficile à rapporter.
Les chances d’une action civile semblent plus réelles en ce que plusieurs chefs de responsabilités peuvent être envisagés, sur la base des articles L. 313-1 du code monétaire et financier.
La plus simple est l’obligation de conseil et d’information, qui a sa traduction dans le code civil et dans le code monétaire et financier, et est particulièrement marquée pour le milieu bancaire, car les produits financiers sont toujours d’une appréhension complexe, en particulier dans le cas des emprunts fondés sur un taux d’intérêt qui peut varier d’année en année en fonction de la parité entre l’euro et le franc suisse.
En vertu de cette obligation, tout établissement financier est tenu d’exécuter les contrats « de bonne foi », c’est-à-dire de manière loyale, professionnelle et transparente, et de communiquer des informations dont le contenu ne soit pas trompeur. À cet égard, le rapporteur s’interroge, comme certains juristes auditionnés, s’il est bien transparent et loyal d’intituler « Tofix » un contrat de prêt à taux structuré. Il pourrait être considéré comme un manquement à l’obligation d’information que de qualifier de « fixe » un produit spéculatif dont le taux d’intérêt peut s’avérer erratique.
Un autre chef est relevé par M. Bruno Wertenschlag, avocat, auditionné par la commission. Celui-ci tire de son examen de nombreux contrats souscrits par des collectivités territoriales et de l’analyse de centaines de lignes de swaps, « qu’une interprétation visiblement faussée a été faite de la circulaire du 15 septembre 1992, selon laquelle les collectivités territoriales peuvent souscrire des produits de couverture, la souscription de produits spéculatifs leur étant interdite. Or certains établissements prêteurs, au lieu de rappeler la difficulté qui pouvait se présenter de ce fait, ont déclaré ou fait déclarer dans la documentation commerciale, dans les pré-confirmations et dans les actes d’emprunt que les collectivités savaient que le produit considéré était conforme aux objectifs de couverture visés par la circulaire ». Il pourrait être considéré que l’information loyale et transparente a là encore fait défaut.
Un autre élément restait généralement caché des emprunteurs : la perte en capital qui pouvait intervenir en cas de remboursement du contrat par anticipation. Les collectivités n’ont semble-t-il pas été informées qu’elles encourraient une pénalité comprise dans une fourchette de 10 à 30 % sur le capital restant dû.
Enfin, la question de la marge cachée, au cœur de l’information que le banquier doit donner à son client, peut se poser. Le code monétaire et financier dispose que le banquier doit prendre toutes dispositions pour empêcher qu’un conflit d’intérêts ne porte atteinte aux intérêts de son client ; il lui interdit en particulier de réaliser un gain au détriment de son client. Or il pourrait être montré que la marge réalisée par la banque est d’autant plus élevée que le risque pris par le client est important. Il pourrait donc y avoir conflit d’intérêts, car il ne semble pas que les banques, avant la souscription, aient expliqué au client que le mécanisme proposé – une période de prêt bonifié suivie d’une période, beaucoup plus longue, de prêt erratique – a un coût mais aussi un prix, celui que la banque encaisse sous forme de marges.
En amont de la question du conseil au client se pose celle du droit à une information honnête et loyale. Les cas étudiés par la commission d’enquête montrent bien l’asymétrie de l’information qui s’est installée, par les pratiques que nous avons décrites, entre le banquier et son client. Cette symétrie pourra certainement être reconnue, dans nombre de cas, par les tribunaux.
La directive européenne de 2004 sur les marchés d’instruments financiers (MiFID), transposée en droit français, classe les collectivités territoriales dans la clientèle non-professionnelle. L’on peut se demander si cette catégorisation ne renforce pas les obligations de mise en garde, due à tout emprunteur non averti, à son égard. Cela peut conduire à s’interroger sur le point de savoir si une collectivité territoriale peut être considérée comme non avertie lorsqu’elle est assistée par un cabinet de conseil. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait que le client ait à ses côtés une personne avertie ne dispense pas le banquier de son obligation de mise en garde. Les collectivités devraient donc pouvoir bénéficier de cette jurisprudence, s’attachant davantage à la complexité du produit qu’à la qualité publique ou privée du plaignant professionnel.
Une autre obligation incombe au banquier, qui découle de l’obligation de conseil : l’obligation de mise en garde, qui suppose que le banquier attire l’attention de son client sur les dangers potentiels d’une opération donnée. Cette obligation née en 2005 de la jurisprudence de la Cour de cassation s’intercale, selon l’analyse du professeur Richard Routier, entre l’obligation d’information et celle de conseil.
Elle peut inclure un conseil de « ne pas faire » (sans pour autant être tenu de refuser le prêt) ; elle implique de montrer au client les avantages et les inconvénients du choix qui s’offre à lui, de l’éclairer au-delà d’une simple information passive et neutre, d’expliciter le contrat, et, enfin, de prévenir un risque qui ne doit pas être négligé. Le manquement à cette obligation peut se cumuler avec un manquement au devoir de conseil. L’obligation de consentir un crédit adapté a été consacrée par le juge comme par le législateur ; en outre, le crédit doit rester en proportion avec les facultés de l’emprunteur ou avec les perspectives de rentabilité de l’opération. La notion de proportionnalité est donc présente comme principe d’action du banquier.
Selon M. Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit local, le comité « nouveaux produits » avait fixé à 50 % le seuil d’emprise maximal des prêts structurés souscrits auprès de Dexia dans l’encours de dette de chaque collectivité. Cette intention n’a visiblement pas été respectée, dans les cas, assez nombreux, où des collectivités se trouvent chargées de produits structurés à risque pour 80 à 90 % de leur encours de dette. Face au risque qui pouvait être décelé par le banquier, et qui se révèle aujourd’hui, on pourrait concevoir que l’inexécution de l’obligation de mise en garde soit reconnue à l’encontre de l’établissement.
Par ailleurs, certaines associations de défense des collectivités locales se sont placées sur le terrain de l’illicéité de l’indexation de l’emprunt pour absence de lien direct avec l’objet du contrat ou avec l’activité d’une des parties. À l’encontre de leur position, on notera que le code monétaire et financier dispose expressément que pour les contrats financiers l’indexation est libre.
En résumé, selon les termes de Richard Routier, « le seul terrain du devoir de mise en garde ou de l’obligation de conseil semble le plus fécond s’agissant d’un banquier dispensateur de crédits, et on peut penser que l’action civile aurait des chances d’aboutir – en fonction des dossiers bien sûr, car il ne faudrait pas que le contrat contienne la reconnaissance qu’un avis a été donné par l’établissement financier ».
d) Les conséquences judiciaires qui pourraient être tirées du défaut de conseil
Si le manquement à l’obligation de conseil ou au devoir de mise en garde était reconnu, le plaignant se verrait reconnaître un préjudice pour perte de chance – la chance de ne pas avoir pu renoncer à contracter. La réparation intégrale de ce préjudice ne pourrait être demandée, en vertu de l’existence d’un « aléa ». S’il existe une forte probabilité que la collectivité, eût-elle été informée, n’aurait pas contracté, des taux d’indemnisation de 90 pour cent de la créance de la banque ont déjà été accordés par la jurisprudence. (référence)
Les juristes entendus par la commission ont indiqué par ailleurs qu’ils déconseillaient à leurs clients d’interrompre les paiements avant que la justice ne se soit prononcée sur la licéité du contrat. Le débiteur en mesure d’apporter la preuve de difficultés financières peut, sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du code civil, obtenir du juge le report du paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans.
Certaines collectivités n’ont pas suivi ce conseil et bloqué leurs paiements ou décidé de ne verser que la part correspondant à un taux fixe ; d’autres se sont déclarées en désaccord avec l’interprétation de la formule. Ces décisions constituent selon M. Gilles Sébé un chemin risqué. Deux possibilités se présentent alors selon ce dernier : l’une est de faire un dépôt auprès de la Caisse des dépôts, dépôt qui produit des intérêts qui permettront, en cas de condamnation finale, de payer une partie des intérêts intercalaires ; l’autre est de ne pas payer en espérant que le préfet ne procèdera pas à l’inscription d’office de la dépense – ce qui est pour l’instant le cas, car les banques n’ont jamais obtenu l’inscription d’office de cette dépense.
Les conséquences du concours de circonstances qui a été décrit précédemment peuvent s’analyser comme une prise de risques par les collectivités, risques qui auraient dû rester étrangers à leur nature : risque de garanties sous formes d’options dans des secteurs où elles n’avaient ni l’information pertinente, ni les moyens de se couvrir, et risque d’un engagement sur une durée telle (jusqu’à 40 ans !) que la combinaison des indices fait relever du pari.
LES EMPRUNTS STRUCTURÉS FACE À LA JUSTICE : Si les juridictions suprêmes françaises n’ont pas encore eu l’occasion d’examiner la validité des contrats relatifs à des swaps ou des emprunts structurés souscrits par des personnes publiques, la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe a rendu le 22 mars 2011 un arrêt (85) dont la portée dépasse le cadre juridique allemand. En effet, il est généralement cité au titre de référence par les différentes assignations qui ont été déposées par des acteurs publics locaux en vue de faire annuler les contrats de prêts structurés conclus il y a plusieurs années. ● Dans le cas d’espèce, une PME dénommée Ille Papier avait souscrit auprès d’un établissement financier (la Deutsche Bank) un swap à effet cumulatif (dit snowball) adossé à un sous-jacent fonction de la pente de la courbe des taux. Selon les termes du contrat, le prêteur acceptait de payer à son client 3 % d’intérêts sur deux millions d’euros pendant cinq ans. Le client devait payer à la banque 1,5 % pendant la première année et ensuite un taux variable basé en partie sur la différence entre les taux Euribor à deux ans et à dix ans. La banque a incité son client d’acheter ce swap en fonction de ses espérances que le spread s’élargirait et que le client gagnerait de l’argent. L’établissement prêteur a limité son risque à l’occasion de la transaction en souscrivant les options correspondantes sur le marché. Pris à la gorge par l’augmentation exponentielle des sommes « ruineuses » à verser, le client conclu un accord avec son créancier pour déboucler ce contrat de swap, en échange du versement d’une soulte conséquente, puis introduit une action en annulation du contrat et remboursement de la soulte. Déboutée en appel, la PME a obtenu gain de cause devant la Cour, la banque étant contrainte de lui verser 566 850 euros à titre d’indemnisation (86). L’argumentation retenue par le juge allemand s’est fondée sur deux éléments : le contenu du devoir d’information en matière de produits d’investissement complexes et l’existence d’un conflit d’intérêts et d’une asymétrie des risques encourus, la banque ayant souscrit des garanties en cas d’évolution à son détriment du contrat. ● Pour la Cour, en cas de produits d’investissements complexes, l’information du client doit lui permettre de disposer des mêmes connaissances et informations sur les risques de l’opération que la banque. Celle-ci doit donc lui expliquer qu’en l’absence de tout plafonnement, les pertes réelles peuvent s’avérer très importantes si les conditions prévues par les termes du contrat venaient à se réaliser. La banque doit donc détailler tous les éléments de la formule de calcul du taux complexe et insister sur l’inégalité entre les parties : le risque du client est illimité, celui de la banque est d’emblée étroitement limité. La banque doit non seulement expliquer les risques mais aussi s’assurer de la bonne compréhension de son client. Or si la banque soutenait que n’importe quel étudiant de première année d’université pouvait comprendre de tels montages ainsi que la formule selon laquelle le swap était calculé, encore fallait-il que la banque expliquât quels risques comprend une telle opération d’investissement. Comme l’a commenté le Président de la Cour, le fait de savoir lire un poème ne signifie pas forcément qu’on en comprend le sens. ● D’autre part, les deux parties se trouvaient en situation de conflit d’intérêts, car dans le cadre des recommandations d’investissement faites par la banque figurait un pari dont les intérêts étaient opposés à ceux de son client, situation dont elle aurait dû aviser son client. Elle faisait courir un risque potentiel grave à son client, alors que ses propres risques étaient fortement limités par la souscription des options correspondantes. Par ailleurs, seule la banque était en mesure de savoir que le swap avait une valeur de débouclement négative dès sa conclusion, ce qui signifiait que le client avait alors plus de chances de perdre de l’argent que d’en gagner. Dès lors, cette valeur exprimait un conflit d’intérêts puisqu’à partir du moment où la banque-conseil tire avantage du fait que le marché apprécie négativement le risque assumé par le client avec le produit qui lui a été recommandé, il y a alors un risque que sa recommandation ne soit pas uniquement motivée par l’intérêt du client. N’ayant pas respecté le principe de l’égalité des armes, en s’assurant que son client disposait des mêmes informations qu’elles, la banque a été condamnée à lui verser des dommages et intérêts. ● Comme l’ont observé les commentateurs en France (87), si l’arrêt se fonde sur des normes de droit allemand relatives aux obligations d’information, de mise en garde et de loyauté du banquier envers son client, celles-ci trouvent leurs équivalents en droit français dans les articles 1147 du code civil et L. 533-10 du code monétaire et financier. Cette décision, relative à un cas d’espèce concernant un swap souscrit par une personne morale de droit privé, pourrait ainsi inspirer d’autres contrats de produits financiers complexes, tels que les emprunts structurés, souscrits par des personnes publiques. |
Nous allons à présent évoquer la réponse apportée par l’État avec la Charte de bonne conduite adoptée en 2009 et entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Nous verrons que cet accord, qui a eu le mérite de formuler un diagnostic des difficultés et de les voir enfin reconnues par l’administration centrale, formule des principes extrêmement importants mais ne fournit pas une réponse complète à la question des risques liés au financement des acteurs locaux.
4.– La charte de bonne conduite de 2009 : les limites de l’autodiscipline
C’est à l’automne 2008 que la présence « d’emprunts toxiques » a été dénoncée, à travers la presse généraliste, par quelques exécutifs locaux inquiets de l’envolée des taux d’intérêts d’emprunts qui commençaient à sortir de leur phase bonifiée. La commission d’enquête a pu constater que la presse spécialisée s’était fait l’écho des risques sous-jacents bien auparavant : M. Pierre Klopfer, par exemple, a rappelé qu’il avait publié plusieurs articles alertant vigoureusement les responsables de collectivités quant aux risques croissants entraînés par les « renégociations » proposées par les banques visant à transformer leurs prêts classiques en prêts structurés (88).
Le 3 novembre 2008, le ministre de l’Intérieur, de l’outremer et des collectivités territoriales et le ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi réunissaient les représentants des banques les plus impliquées dans le financement des acteurs publics locaux et ceux des associations d’élus locaux. Ces dernières demandaient un dialogue direct entre les collectivités et leurs banquiers. Les ministres ont quant à eux souhaité la rédaction d’une charte de bonne conduite afin d’éviter que de telles difficultés ne se reproduisent à l’avenir ; la rédaction en a été confiée à l’Inspection générale des finances. En février 2009, un rapport sur « le recours par les collectivités territoriales aux produits structurés » (89), établi par M. Éric Gissler, était présenté, comportant une série de propositions qui devaient conduire, en juin, à la Charte de bonne conduite annexée au rapport et citée dans la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements. Les termes de la charte résultent également d’échanges avec les représentants des banques et des collectivités.
a) La charte Gissler, une avancée indéniable, mais des lacunes
Selon ce document, les établissements bancaires doivent notamment s’engager à : ne plus proposer de produits exposant à des risques sur le capital ou reposant sur certains indices à risques élevés ; ne plus proposer de produits avec des effets de structure cumulatifs ; présenter leurs produits selon une classification comportant 5 niveaux de risques (de 1 à 5 et de A à E) ; reconnaître le caractère de non professionnel financier des collectivités locales et le français comme langue exclusive des documents. Quant aux collectivités territoriales, celles-ci doivent développer la transparence des décisions concernant leur politique d’emprunts et de gestion de dette, ainsi que l’information financière sur les produits structurés qu’elles ont souscrits.
Si la charte Gissler constitue une avancée indéniable, elle présente néanmoins des limites et des incomplétudes, tant dans son contenu que dans sa portée.
S’agissant du contenu de la charte, M. Éric Gissler, inspecteur des finances et médiateur désigné par le Premier ministre, a regretté devant la commission d’enquête que sa proposition de proportionner le type d’emprunt pouvant être souscrit à la démographie des collectivités n’ait pas été retenue : « Quand j’expliquais qu’il faillait proportionner la capacité de la collectivité au niveau de risque, et limiter, par exemple, les communes de moins de 10 000 habitants aux 1A, on me reprochait de porter atteinte à leur dignité ou à leur autonomie financière. Je regrette toutefois que la mesure n’ait pas été mise en place » (90).
En outre, la pertinence de la classification des produits inscrite dans la charte a été contestée par plusieurs intervenants. M. Michel Klopfer, président et fondateur d’un cabinet de conseil, a indiqué que les risques induits par certains produits semblent avoir été sous-évalués : « (…) De quoi la catégorie 2 de la charte Gissler est-elle composée ? D’indices portant sur l’inflation, française ou européenne et sur les écarts d’inflation. L’inflation française est un excellent indice, car les budgets y sont soumis, et l’on peut également admettre l’inflation européenne ; en revanche, il est dangereux de greffer une option, pouvant porter sur une période de trente ans, sur un écart d’inflation qui est de nature spéculative » (91). De manière plus générale, M. Gilles Sebé, président de Seldon Finance, a montré que la cotation Gissler ne tient pas suffisamment compte l’évolution du risque dans le temps soulignant qu’un produit classé peu dangereux dans la charte peut se révéler explosif. Selon son exemple, si la Grèce faisait défaut, il y aurait une flambée de taux courts et tous les produits de pente qui paraissent peu risqués pourraient présenter un risque très grave. La charte Gissler ne donne pas une vision correcte du risque dans le temps (92).
Enfin, la faiblesse des obligations des établissements bancaires en matière d’information et de conseil, telles qu’elles sont prévues par la Charte, n’est pas satisfaisante. Ainsi que l’a observé M. Olivier Poindron, consultant au sein du cabinet FIDAL : « Les banques « consentent à respecter » des obligations prééxistantes à la charte définies dans les articles 1147 et 1134 du code civil, dans les règles de bonne conduite du code monétaire et financier et dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et très supérieures à celles définies par la Charte » (93).
Quant à la portée de la charte, M. Éric Gissler a souligné que l’autorégulation a permis de modifier positivement les pratiques commerciales des établissements bancaires, qui ne commercialisent plus de produits non autorisés par la charte et prennent davantage en compte la démographie des collectivités dans leur proposition d’emprunts : « (…) et ont dû renoncer à commercialiser certains niveaux (…) » (94). Néanmoins, l’autorégulation reste impuissante à résoudre la situation d’endettement actuelle des collectivités. En outre, il a indiqué que les renégociations qui devaient succéder à la mise en place de la charte n’ont pas toujours eu lieu : « La charte a été rédigée dans l’idée qu’une renégociation interviendrait quasiment à marche forcée. Il n’en a rien été ».
Certains intervenants ont fait part de réserves marquées quant à la finalité même de la charte. M. Richard Routier, professeur à l’université de Strasbourg, a ainsi indiqué que la charte contribuait, dans une certaine mesure, à banaliser les pratiques spéculatives au sein des collectivités : « Cette affaire est l’occasion de revenir à un principe simple : l’argent public ne doit pas permettre la spéculation de ceux qui le manipulent. Or les prêts structurés sont des produits spéculatifs. Votre commission doit s’interroger sur le fait que la charte Gissler pérennise ces pratiques » (95). M. Gilles Sébé a, quant à lui, souligné à la commission que la charte permettait aux établissements bancaires de différer les contentieux : « C’est un document ponctuel, et surtout un moyen subtil, pour les banques, de différer les contentieux » (96).
b) La médiation décidée par le Gouvernement : un bilan en demi-teinte
La médiation encouragée par le rapport de l’inspection générale des finances cité précédemment doit permettre aux collectivités territoriales de renégocier l’encours de leur dette avec les établissements bancaires, afin d’assainir à terme leur situation financière.
La situation évolue et certains dossiers se traitent, comme en atteste le recul de la part des emprunts structurés dans les encours. Des dossiers aboutissent : dans certains cas, la soulte est partagée, parfois avec une offre de refinancement de la soulte à la collectivité sous forme de prêts sur cinq, sept ou dix ans. Toutefois, les emprunts les plus complexes, comportant un produit de change, sont plus difficiles à traiter.
Le tableau ci-dessous présente le bilan des procédures de médiation en cours de réalisation, qui demeurent peu nombreuses et peu avancées :
RÉPARTITION PAR TYPE D’INDEXATION DES CONTRATS
FAISANT L’OBJET D’UNE DEMANDE MÉDIATION
SITUATION À LA DATE DU 28 OCTOBRE 2011
Taux indexés sur : |
nombre de contrats |
EUR/CHF |
41 |
EUR/USD |
3 |
USD/CHF |
29 |
USD/JPY |
8 |
autres(coef >5) |
11 |
total intermédiaire |
92 |
capital basé sur CHF |
10 |
total général |
102 |
NB : à la date du 28/10/2011, seuls 89 dossiers sur 102 sont administrativement complets pour permettre l’engagement de la renégociation par le médiateur.
TAILLE DES COLLECTIVITÉS AYANT SOLLICITÉ LA MÉDIATION
collectivités de moins de 10 000 habitants |
33 |
collectivités de plus de 10 000 habitants |
17 |
syndicats |
3 |
RÉPARTITION PAR DATE, DES COLLECTIVITÉS AYANT SOLLICITÉ LA MÉDIATION
jusqu’en avril 2010 inclus (franchissement barrière de 1,44 en mars 2010) |
à mai 2010 à octobre 2011 |
8 |
48 |
RÉSULTATS DES MÉDIATIONS DEPUIS L’ORIGINE EN NOMBRE DE CONTRATS
renégociations définitives |
12 |
solutions temporaires acceptées |
13 |
solutions temporaires refusées |
2 |
sorties suite à assignation |
14 |
sorties à la demande de la collectivité |
3 |
Source : Médiateur désigné par le Premier ministre pour les emprunts des collectivités territoriales.
Selon M. Éric Gissler, la médiation a permis de donner aux exécutifs locaux, dont bon nombre se sont vu confier la gestion d’une situation qui leur préexistait ou dont ils ignoraient l’existence, une meilleure information quant à l’endettement de leur collectivité. Les élus qui entrent en médiation ne sont généralement pas ceux qui ont signé le contrat. Les accords ont été conclus sans témoin et la médiation permet de reconstituer pièces en main l’historique des dossiers. La médiation apaise le débat (97).
Par ailleurs, la médiation permet d’éviter que les collectivités territoriales et les établissements bancaires ne se rejettent la responsabilité, et prennent conscience qu’il est dans l’intérêt de chacun d’eux de trouver un accord.
Cependant, la médiation connaît plusieurs difficultés.
D’une part, les banques peuvent être réticentes à engager un processus de médiation qui, bien que confidentiel contrairement à une action en justice, fait peser le risque de lever le secret des pratiques bancaires auquel elles sont attachées. Comme l’a indiqué M. Eric Gissler, « le premier souci des banques est qu’on ne sache pas ce qu’elles décident, dossier par dossier ».
D’autre part, les collectivités, dont les conseils juridiques et financiers sont inégaux, peuvent souhaiter attendre la fin de la période de bonification pour recourir à la médiation, ou préférer une action en justice en l’absence d’une jurisprudence bien établie en matière de réalisation d’emprunt et à accepter certaines solutions. Le phénomène tient certainement à l’absence de jurisprudence et certaines pensent qu’elle jouera en leur faveur, et attendent l’issue des procès.
Enfin, dans certains cas, des établissements bancaires ont proposé des produits non inscrits dans la charte lors de la renégociation d’emprunts structurés. M. Éric Gissler a admis l’existence d’une telle pratique indiquant avoir posé une condition à sa mise en place : « (…) on peut proposer un produit hors-charte à la seule condition qu’il améliore la sécurité de la collectivité, par exemple en raccourcissant la durée du prêt, en élevant la barrière ou en mettant en place un multiplicateur plus faible ».
Ces lacunes conduisent votre commission à envisager des solutions différentes pour l’avenir, tant en ce qui concerne la « déontologie » des emprunts que le traitement du stock des produits structurés.
C.– LE CONTRÔLE DES SERVICES DE L’ÉTAT : TROP LIMITÉ SUR LE TERRAIN, PEU VIGILANT EN ADMINISTRATION CENTRALE
1.– Un contrôle de légalité à la portée insuffisante
Nombre d’intervenants ont souligné l’incapacité des services préfectoraux à alerter les collectivités territoriales quant aux risques induits par les prêts structurés qu’elles ont contractés. En ce sens, les difficultés liées à la gestion de la dette locale résultent pour partie des insuffisances du contrôle de légalité.
En matière de gestion de la dette, le préfet doit contrôler la légalité des actes administratifs des collectivités territoriales, tant sur un plan formel que matériel. Il doit s’assurer, d’une part, de la conformité de l’emprunt souscrit à l’intérêt général, et d’autre part, de la légalité des délégations de compétence. Ces contrôles trouvaient leur fondement dans la circulaire du 15 septembre 1992, relative aux contrats de couverture de taux d’intérêt offerts aux collectivités et aux établissements publics locaux, et la circulaire du 4 avril 2003, relative aux régimes des délégations de compétences en matière d’emprunt, de trésorerie et d’instruments financiers. La circulaire du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics est venue se substituer à ces dispositions.
Il est clairement apparu, au cours des auditions, que le contrôle de légalité, réalisé par le préfet, n’a pas permis d’identifier les risques associés aux produits structurés.
Ainsi que l’a rappelé le préfet de la Loire de 2002 à 2006, M. Michel Morin, le contrôle de légalité ne saurait se muer en un contrôle d’opportunité compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales inscrit à l’article 72 de la Constitution. En pratique, les services préfectoraux, soucieux de respecter le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, n’avaient donc pas forcément les moyens d’exercer un contrôle très approfondi de la gestion de la dette locale : « [Le] contrôle, d’un caractère essentiellement formel, se fait a minima dans la mesure où les collectivités, attachées au respect du principe constitutionnel de libre administration territoriale, n’accepteraient pas que nous allions plus loin ; j’en ai d’ailleurs fait l’expérience. » (98)
Par ailleurs, les services préfectoraux ne disposaient pas toujours d’états financiers pleinement exploitables, ni des conventions d’emprunt dont la transmission par les collectivités n’est pas obligatoire.
D’une part, comme évoqué précédemment dans le rapport, les annexes budgétaires répondant aux instructions M14 (pour les communes) et M52 (pour les conseils généraux) n’étaient pas suffisamment détaillées pour permettre d’identifier la nature spéculative des produits structurés.
D’autre part, la transmission des conventions d’emprunt au préfet était soumise à une réglementation ambiguë. Selon l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les conventions relatives aux emprunts doivent être transmises aux préfets. Toutefois, l’article L. 2131-4 du même code prévoit également que les actes relevant du droit privé, dont font majoritairement partie les conventions d’emprunt, ne sont pas soumis à cette obligation et relèvent de dispositions propres. Mettant fin à cette ambiguïté, la circulaire du 25 juin 2010 est venue préciser que : « dans la mesure où le contrat d’emprunt est presque exclusivement un contrat de droit privé et que la délibération autorisant sa signature doit faire apparaître les principales caractéristiques de l’emprunt, il n’a pas à être transmis au préfet (…) En revanche, lors de la conclusion d’un contrat d’emprunt, quand la décision d’emprunt ne fait pas l’objet d’une délibération distincte du contrat, c’est donc la convention relative à l’emprunt qui doit être transmise à l’autorité préfectorale afin de revêtir un caractère exécutoire ».
Face à ce déficit d’information, les services préfectoraux ne sont pas parvenus à identifier la nature spéculative des emprunts structurés et à alerter les juridictions et les autorités compétentes. M. le préfet Michel Morin l’a clairement indiqué à la commission d’enquête, à propos du cas de la ville de Saint-Étienne : « Entre 2002 et 2006, l’endettement de la commune n’augmentait pas et les charges financières allaient même diminuant, du moins jusqu’en 2005. Il n’y avait donc aucun signe d’alerte ; si nous en avions perçu, nous aurions sans doute examiné les choses de plus près. »
En outre, les services préfectoraux n’avaient pas reçu d’instruction particulière en matière de produits structurés de la part de l’administration centrale. La circulaire du 15 septembre 1992 ne portait pas sur les produits structurés, et il a fallu attendre la circulaire du 25 juin 2010 pour actualiser le cadre règlementaire en vigueur. M. le préfet Michel Morin a indiqué devant la commission que les préfets n’avaient jamais été mis en garde contre ces nouveaux types d’emprunt avant la circulaire de juin 2010.
Même si les services préfectoraux avaient disposé d’informations suffisamment détaillées, et d’instructions suffisamment précises, les personnels n’avaient pas forcément la formation nécessaire pour traiter d’enjeux financiers d’une telle complexité. Aujourd’hui encore, il semble que ni la Direction des finances publiques, ni les préfectures n’aient les compétences suffisantes pour analyser des produits financiers complexes et mettre en garde les gestionnaires des collectivités et les agents responsables du contrôle de légalité.
Enfin, les services préfectoraux n’ont que trop rarement été alertés par les assemblées délibérantes. Aux limites du contrôle de légalité que peut conduire le préfet, s’est souvent ajouté un contrôle politique insuffisant par les assemblées délibérantes et plus particulièrement par les élus de l’opposition. S’agissant du cas de Saint-Étienne, M. le préfet Michel Morin l’a indiqué à la commission d’enquête : « Je n’ai pas davantage été alerté par l’opposition municipale – alors que je le fus dans d’autres villes –, sans doute parce qu’elle n’était pas elle-même en mesure d’apprécier le danger. Notez bien qu’il s’agit d’un élément d’explication factuel : notre rôle n’est évidemment pas d’attendre des alertes. »
2.– Des comptables publics laissés sans instructions des services centraux
Plusieurs personnalités auditionnées par la commission d’enquête ont également indiqué que le contrôle de régularité des opérations budgétaires et comptables, réalisé par le comptable public, présentait lui aussi des insuffisances.
À l’instar du contrôle de légalité dont le préfet à la charge, le contrôle de régularité des opérations budgétaires et comptables ne saurait s’apparenter à un contrôle d’opportunité. L’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales dispose ainsi que le comptable public « ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l’opportunité des décisions prises par l’ordonnateur », ce qui ne saurait être remis en question. En matière d’emprunt, la circulaire du 25 juin 2010 est clairement venue rappeler que « le comptable n’a pas à juger de la forme du contrat d’emprunt du moment que ce contrat a un caractère exécutoire ». Ainsi que l’a observé M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire de 2000 à 2005 : « Dès lors que la dépense est fondée sur un texte ou s’appuie sur une délibération ayant un caractère exécutoire, et une fois effectués les contrôles de régularité, le comptable doit procéder au paiement : il n’a pas à juger du contenu du contrat. » (99)
Outre la question des insuffisances des annexes budgétaires, qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises, les comptables publics ne disposaient pas des pièces justificatives qui auraient pu leur permettre d’identifier la nature spéculative des emprunts structurés. En effet, le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, modifié par le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, qui fixe la production des pièces justificatives nécessaires au contrôle de régularité, n’oblige pas à la transmission des contrats d’emprunt au comptable public. Doivent en revanche être fournis les documents suivants : le tableau d’amortissement, les avis d’échéance et de domiciliation ainsi que la délibération exécutoire ou la décision (100). Le contrôle de régularité en matière d’emprunt est donc nécessairement limité : les vérifications portent en pratique sur le montant de l’annuité par rapport au tableau d’amortissement, et sur le fait que l’emprunt a fait l’objet d’une délibération validée par le contrôle de légalité. Le comptable n’a pas les moyens d’aller plus loin.
Plus encore, jusqu’à la crise financière de 2008 qui a nécessité l’introduction de nouvelles pratiques, le réseau des comptables publics était insuffisamment coordonné. D’une part, les comptables publics ne bénéficiaient d’aucune instruction spécifique quant aux produits structurés et ne pouvaient s’appuyer sur un cadre règlementaire pleinement satisfaisant. Jusqu’à la fin de 2005, le réseau d’experts de la comptabilité publique n’avait reçu aucune instruction de l’administration centrale sur ces nouveaux types d’emprunts : ces instructions ne sont venues qu’en 2008. Les agents ne pouvaient donc que s’appuyer que sur la circulaire de 1992, mais celle-ci ne concerne que les swaps.
D’autre part, les comptables publics ne mutualisaient que peu d’informations relatives aux budgets des collectivités et ne pouvaient que difficilement identifier les difficultés financières liées aux produits structurés. « L’organisation en réseau de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) permet (…) de mutualiser certaines informations issues de nos expériences respectives ; toutefois, jusqu’à la fin de 2005, nous n’avons pas eu d’échanges sur les innovations financières dans les budgets territoriaux, et n’avons pas été conviés aux colloques organisés par les banques, notamment Dexia », a indiqué M. Yves Terrasse.
Enfin, comme les personnels de préfectures, la formation des comptables territoriaux était lacunaire en matière de produits structurés. Depuis la crise de 2008 cependant, un effort semble avoir été réalisé. Si la formation des comptables du Trésor sur ce type d’emprunts était inexistante à l’époque, après la crise de 2008, qui a fait prendre conscience que ces derniers étaient massivement présents dans la dette de certaines collectivités, un effort important, qui avait débuté dès 2007, a été réalisé pour combler cette lacune.
Il est regrettable que la Direction générale des collectivités territoriales ou la Direction générale des finances publiques n’aient pas réagi tout au moins aux publications émanant de professionnels du conseil dans la presse spécialisée destinée aux gestionnaires des collectivités territoriales. Pourtant des articles relayant des inquiétudes et des mises en garde sont parus dès 2004 dans la Gazette des communes sous la plume de Jacques Paquier, puis en 2005 et 2006, sous la plume de M. Olivier Nys, directeur général adjoint de la Ville de Lyon,enfin en avril et octobre 2007, des alertes sur « les dérives qui s’annoncent pour les collectivités » signées de Michel Klopfer, consultant en finances locales et enseignant (101).
Il est regrettable que ces inquiétudes et ces alertes n’aient pas suscité un travail d’analyse des administrations centrales concernées ; elles ont pourtant arrêté de nombreux clients de ces conseils dans la souscription d’emprunts à risque.
3.– Une exception : le rôle d’alerte des juridictions financières
Si les contrôles exercés tant par les services préfectoraux que les comptables publics ont présenté des défaillances, plusieurs juridictions financières et certains services d’inspection ont alerté les collectivités territoriales et les organismes de logement des risques associés aux produits structurés.
Le premier rapport public particulier de la Cour des comptes avait attiré l’attention dès 1991 sur les évolutions que l’on pouvait constater dans le recours à l’emprunt des collectivités, et la diversification des produits, au sein desquels apparaissaient les emprunts en devises. La Cour notait que pour ces emprunts, « les défaillances techniques s’ajoutent aux déconvenues liées au risque de change. Les difficultés de comptabilisation des emprunts en devises ne semblent toujours pas résolues. Les règles formulées par l’instruction n° 85-12 MO du 8 février 1985 avaient précisé les règles à suivre afin, notamment, de réviser périodiquement le montant du capital restant à rembourser en fonction de l’évolution du cours de la devise, mais la Cour constatait que ces règles ne paraissent pas encore bien appliquées.
Quant aux chambres régionales des comptes, certaines d’entre elles avaient également émis des inquiétudes quant aux difficultés posées par les produits structurés. M. Marc Larue, président de section à la chambre régionale des comptes de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, a ainsi rappelé à la commission d’enquête que la chambre avait mis en garde les gestionnaires contre la complexité et les risques induits par les produits structurés au cours de ses contrôles ; et ce, dès l’année 2005 (102).
S’agissant des organismes de logement social, la mission interministérielle d’inspection du logement social (Miilos), dont le chef M. Denis Vilain a été auditionné par la commission d’enquête, avait identifié des problèmes liés aux produits structurés lors de contrôles réalisés en 2006, et avait plus largement attiré l’attention sur les risques posés par l’endettement des organismes du logement social dans un rapport annuel de 2006, paru en 2007 (103). Deux préconisations avaient été régulièrement formulées par la Miilos dans ses rapports annuels : la première appelait les directions d’organismes de logement social à faire le point sur la structure de leur endettement et à identifier les risques qui pouvaient lui être associés ; la seconde consistait en la promotion d’un encadrement plus étroit du recours aux emprunts structurés.
Plusieurs facteurs expliquent que les juridictions financières et les services d’inspection aient pu détecter les problèmes liés aux produits structurés, contrairement aux services préfectoraux et aux comptables publics dont les contrôles sont restés inopérants.
D’une part, M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la chambre régionale des comptes d’Alsace, a indiqué à la commission d’enquête que le profil varié de ses équipes, l’information et les formations qui ont pu leur être dispensées, de même que le recours à des consultants extérieurs ont donné à la juridiction les moyens de mener à bien sa mission de contrôle et d’alerte (104).
D’autre part, M. Denis Vilain, chef de la Miilos, a fait observer que les contrôles périodiques que la mission réalise auprès des organismes de logements sociaux, même s’ils ne permettent pas d’offrir un panorama exhaustif de la situation financière des établissements en question, servent de base solide à sa mission d’alerte dont les rapports annuels sont l’expression la plus aboutie (105).
En dépit des alertes données par les juridictions financières et les services d’inspection, celles-ci ont semblé impuissantes à prévenir la réalisation des risques liés aux produits structurés.
Tout d’abord, les services d’inspection n’effectuant qu’une mission de contrôle et non de conseil, les gestionnaires ne se sont pas toujours approprié les préconisations délivrées par dans les rapports. M. Denis Vilain a indiqué à la commission d’enquête les limites inhérentes aux activités de son service d’inspection : « (Le) rapport est traditionnellement le canal d’expression de nos synthèses et c’est le seul. (…) La Miilos, dans son activité, dans ses rapports de contrôle, n’a pas à prodiguer de conseil : elle applique la séparation entre le contrôle et le conseil. En revanche, dans ses rapports annuels, elle donne une alerte, elle rend publiques ses préoccupations et elle les assortit de préconisations. » (106).
Plus encore, faute d’une coordination des actions et d’une mutualisation des informations suffisantes entre les juridictions financières, les services préfectoraux et la Direction générale des finances publiques, les préfets et les comptables publics n’ont parfois pas su réagir aux alertes des juridictions. Ainsi que l’a indiqué M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire de 2000 à 2005, à la commission d’enquête, les informations délivrées par la chambre régionale des comptes étaient insuffisantes pour justifier d’une action des services de l’État dans le cas de Saint-Étienne : en effet, la chambre régionale des comptes avait rédigé un premier rapport, mais il s’arrêtait en 2004 et ne portait que sur le problème de l’endettement global, non sur la structure de cet endettement. L’analyse détaillée sur ce dernier point n’a été réalisée que dans le rapport de 2010. » (107)
4.– La Commission bancaire : une préoccupation davantage tournée vers le bon fonctionnement du système bancaire que vers la protection du client
Dès le début des années 2000, la Commission bancaire, dans ses rapports annuels, a régulièrement émis des inquiétudes quant aux risques induits par la situation d’endettement des collectivités territoriales, pointant le recours croissant aux produits de restructuration de dette (108).
Si la Commission bancaire faisait état d’une situation financière globalement positive en matière de finances locales, elle soulignait toutefois les risques que faisaient peser un marché du financement local de plus en plus concurrentiel, et une offre bancaire de plus en plus diversifiée.
En premier lieu, les rapports soulignaient la faiblesse des marges nettes des établissements bancaires et enjoignaient les prêteurs à veiller à la rentabilité des opérations de crédit, à identifier de manière exhaustive les produits commercialisés et à estimer le risque de défaut des bénéficiaires de crédit.
Par ailleurs, les tensions financières pouvant être observées dans certaines collectivités étaient évoquées dans les rapports, la Commission bancaire appelant les établissements bancaires à faire preuve d’une vigilance accrue.
Enfin, dans un contexte marqué par l’essor de l’intercommunalité, les rapports faisaient également état de la complexité des relations financières et juridiques entre les collectivités territoriales et leurs établissements, et soulignaient la difficulté d’appréhender les risques financiers de manière globale.
En outre, il convient également de rappeler qu’après la crise de 2008, plusieurs rapports d’inspection relatifs à la commercialisation de produits structurés par certains établissements bancaires avaient été réalisés par la Commission bancaire.
La particularité des services financiers et d’assurances, marquée par la forte asymétrie d’information entre les clients et le professionnel financier a été prise en compte lors de la création de l’Autorité de contrôle prudentiel par l’ordonnance du 21 janvier 2010 ratifiée le 22 octobre 2010. L’Autorité, qui, on le rappelle, regroupe quatre organismes de surveillance dont la Commission bancaire, est en effet investie de la mission de veiller au respect des règles destinées à protéger la clientèle ; règles résultant de dispositions législatives, réglementaires, issues des bonnes pratiques des professions ou de codes de bonne conduite. Son champ d’intervention a été largement défini, incluant la publicité, l’information précontractuelle, le devoir de conseil jusqu’au déroulement du contrat.
III.– LE SOUTIEN NÉCESSAIRE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Face à ce constat, la commission d’enquête s’est efforcée de réfléchir sur les solutions à apporter. Alors que s’esquisse la perspective d’un resserrement du crédit bancaire offert aux acteurs locaux, il convient de proposer à la fois des réformes visant à garantir que le secteur local ne connaisse pas de pareilles dérives. Dans le même temps, la commission d’enquête souhaite que l’État joue effectivement son rôle pour résorber la partie toxique de l’encours des prêts aux collectivités territoriales et établissements publics locaux, au moyen d’une solution globale qui ne repose ni sur la solidarité nationale, ni sur le traitement particulier.
Elle appelle donc à la mise en place rapide de deux chantiers :
– pour l’avenir, la mise en place un cadre législatif encadrant les modalités d’emprunt des collectivités et acteurs locaux ;
– pour l’apurement du stock existant, l’organisation, sous l’égide de l’État, d’un regroupement des acteurs publics locaux afin de négocier une solution de sortie des produits structurés, non plus acteur par acteur, mais produit par produit.
A.– LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, UNE PRIORITÉ NATIONALE
1.– Le rôle majeur des collectivités dans l’investissement public
Le mouvement de décentralisation amorcé il y a aujourd’hui trente ans a conduit à transférer aux collectivités territoriales un poids croissant dans la réalisation et la gestion des équipements publics. En particulier, « l’acte II de la décentralisation », mis en place par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, a organisé des transferts de compétences aux collectivités territoriales qui ont également induit un recours accru à l’emprunt par les départements et les régions.
Les investissements locaux ont ainsi connu jusqu’en 2009 une nouvelle dynamique liée au développement de l’intercommunalité, favorisée par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Les transferts de compétence dont ont bénéficié les nouveaux EPCI ont favorisé « une dynamique propre d’investissement, donc d’endettement » (109).
Plus récemment, les régions ont réalisé des investissements importants, notamment dans le domaine ferroviaire.
Ainsi, le double mouvement de développement de leurs compétences et de relatif désengagement de l’État a conduit les collectivités territoriales à effectuer 71,5 % du total des investissements publics en France en 2010.
POIDS DES INVESTISSEMENTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
DANS L’INVESTISSEMENT PUBLIC GLOBAL
(en pourcentage)
Année |
Pourcentage de l’investissement public global |
1950 |
44,3 % |
1960 |
53,7 % |
1970 |
58,8 % |
1980 |
65,9 % |
1990 |
68,3 % |
2000 |
70,8 % |
2008 |
73,4 % |
2009 |
70,7 % |
2010 |
71,5 % |
Source : Insee, Comptes nationaux - base 2005.
En 2010, les dépenses d’investissement des collectivités ont ainsi représenté 64 milliards d’euros, soit 30,1 % de leurs dépenses, effectuées en large partie par les communes et leurs groupements.
MONTANT AGRÉGÉ DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN 2010
Montant |
Évolution annuelle | |
Bloc communal |
38,3 |
– 2,4 % |
Départements |
15,5 |
– 11,2 % |
Régions |
10,2 |
+ 15,2 % |
Total |
64,0 |
– 6,9 % |
Source : Les finances des collectivités locales en 2011, Rapport de l’Observatoire des finances locales, sous la direction de M. André Laignel, président, et M. Charles Guené, rapporteur, 12 juillet 2011.
Si en 2009, le plan de relance et l’anticipation des versements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ont permis de maintenir le niveau de l’investissement par rapport à l’année précédente, en 2010, les dépenses d’investissement ont subi le contrecoup de l’anticipation de 2009 et de la conjoncture économique fragile.
Les organismes en charge du logement social participent aussi à cette dynamique. L’Union sociale pour l’habitat (110) évalue, compte tenu de la diversité de leurs structures, leur investissement total à 13 milliards d’euros en 2009.
Les établissements publics de santé ont également un rôle non négligeable : en 2009, leur investissement a atteint 6,8 milliards d’euros (111), en hausse de 12 % depuis 2002. Ce montant résulte de la mise en œuvre des différents plans d’investissement : le Plan Hôpital 2007 a ainsi engendré de 16 milliards à 18 milliards d’euros d’investissements, dont 5 milliards restent à réaliser. L’endettement des hôpitaux, qui était faible en 2002, a été multiplié par dix entre 2002 et 2009, passant de 350 millions d’euros à plus de 3 milliards, soit 46 % des investissements.
2.– L’insuffisante liquidité du marché du crédit pèse sur les collectivités
Au cours de la décennie précédente, le développement des investissements des acteurs locaux a pu globalement s’appuyer sur une progression de l’endettement, dans un contexte où les offres de prêt ne manquaient pas. Les circonstances sont aujourd’hui différentes, laissant craindre un financement plus difficile dans les prochains mois.
a) Des tours de tables difficiles à boucler
La recomposition en cours du marché des prêts aux collectivités territoriales conduit à un resserrement des offres de crédit, pouvant potentiellement affecter les projets en cours de financement.
Une étude réalisée par l’Association d’étude pour l’agence de financement des collectivités territoriales (112) montre ainsi que « les banques semblent vouloir se désintéresser durablement du secteur local ».
Si pour les collectivités comptant moins de 10 000 habitants, entre 59 et 65 % des offres de crédits permettent de couvrir l’intégralité de l’investissement, les communes de plus de 50 000 habitants semblent les plus touchées : les questionnaires recueillis par l’association indiquent que les banques n’ont répondu, en 2011, à la totalité du volume demandé par ces collectivités que dans 30 % des cas.
Même pour des montants relativement modestes, les offres individuelles correspondant à la totalité de la demande deviennent rares. Pour des consultations situées entre 5 et 9 millions d’euros, le volume moyen proposé par les banques est de 28 % de la somme demandée (hors réponses négatives). Dans une majorité de cas, les collectivités sont contraintes de multiplier les emprunts auprès de plusieurs prêteurs afin de parvenir au volume souhaité. En conséquence, elles souscrivent, pour partie, à des offres qui se situent dans le haut de la fourchette en termes de marges proposées.
Les établissements bancaires évoquent notamment, pour justifier un désengagement du marché du prêt aux acteurs locaux, de nouvelles règles prudentielles dites de « Bâle III » limitant leur financement de long terme et imposant d’avoir beaucoup plus de ressources liquides, règles qui leur seront applicables partiellement dès 2013 et progressivement jusqu’en 2018. Les acteurs locaux ayant pour obligation de déposer leurs liquidités auprès du Trésor, ils ne constituent pas une clientèle susceptible de générer de l’épargne bilancielle pour les banques – quelque soit par ailleurs l’excellence de la signature de ces acteurs (113).
Ainsi, en mars 2011, l’encours de dette des administrations publiques locales avait baissé de 4 milliards, à 156,5 milliards d’euros (114).
Face à la raréfaction de l’offre bancaire, l’ajustement se fait par les prix. Certaines collectivités doivent payer un coût nettement plus élevé que les entreprises alors qu’elles sont mieux notées. Selon l’enquête de l’Association d’étude pour l’agence de financement des collectivités territoriales, « Alors qu’il y a un an à la même période, la fourchette des marges sur Euribor pour des offres à 15 ans s’établissait entre 40 et 65 points de base (moyenne de 56 points de base à la mi-2010 selon Finance Active), le bas de la fourchette est désormais voisin de 100 points de base (et le haut de 200 points de base). »
b) Les émissions obligataires ne sont accessibles qu’aux grandes collectivités
Face au resserrement du crédit bancaire, l’emprunt obligataire constitue un moyen de financement direct pour les collectivités territoriales, et en particulier les plus importantes d’entre elles, sur le marché des capitaux. Ces émissions obligataires peuvent se faire par placement privé auprès d’un petit nombre de souscripteurs qui achèteront la totalité de l’émission, ou par émission sur le marché obligataire public.
Cependant, les emprunts qui font l’objet d’un appel public à l’épargne sont soumis à une réglementation spécifique destinée à protéger les épargnants et à assurer le bon fonctionnement des marchés financiers. Les collectivités locales doivent se conformer aux règles applicables à tous les emprunteurs et à celles qui régissent l’émission de titres, l’appel public à l’épargne et, le cas échéant, l’admission à la cote.
La Cour des comptes observe, dans son rapport public thématique de juillet 2011 (115) que, si le début des années 1990 a connu un développement de ces émissions, avec la présence d’émetteurs réguliers (dont notamment la région Île-de-France, la ville de Paris et le département des Hauts-de-Seine), le volume ensuite a brusquement chuté : en 1993, il représentait 1,1 milliard d’euros, avant de diminuer considérablement pour se réduire à 200 millions d’euros en 2002.
Au 31 décembre 2010, le financement désintermédié (hors billets de trésorerie) s’élevait à 5,6 milliards d’euros pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, qui sont essentiellement représentés par les régions et les communautés urbaines. En effet, les contraintes réglementaires et techniques, tels que la notation par les agences spécialisées, rendent impossibles les émissions de petit volume.
Des émissions syndiquées par plusieurs collectivités territoriales ont également été mises en oeuvre sous l’impulsion de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF). Cinq émissions obligataires ont ainsi été lancées entre 2004 et 2008 par onze puis quatorze communautés urbaines, pour des montants de 100 à 120 millions d’euros, sur vingt ans.
Malgré ces initiatives diverses (116) et le succès rencontré par les émissions réalisées, celles-ci restent un moyen de financement réservé aux émetteurs réguliers ayant une certaine assise financière : les emprunts désintermédiés ne représentent aujourd’hui que 3 % de l’encours total de la dette locale, alors qu’ils représentent plus de 40 % de l’encours de la dette des collectivités territoriales en Allemagne (117).
Cependant, face au risque d’un désengagement des établissements bancaires du marché des prêts au secteur local, la commission d’enquête souhaite qu’un plus grand encouragement soit donné par l’État à la mise en place de ces solutions de financement, notamment en apportant une plus grande assistance technique aux collectivités territoriales qui en ferait la demande.
3.– La puissance publique doit s’impliquer davantage
Issue d’une fusion concrétisée en 1996 entre le Crédit communal de Belgique et le Crédit local de France, société anonyme à caractère commercial issue de la privatisation en 1987 de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL), Dexia était jusqu’en 2008 le premier prêteur aux collectivités territoriales françaises, représentant 42 % du marché. À la suite d’une forte croissance externe, elle comprenait en outre des activités notables au Luxembourg et en Turquie.
Pour accroître la rentabilité de l’établissement, le choix avait été fait de financer une grande partie de ses prêts et placements de long terme par une dette à court terme, moins onéreuse que l’endettement de long et moyen terme. Si un tel choix permet des marges élevées, il est également extrêmement risqué car il fait dépendre le financement de la banque du marché interbancaire qui lui apporte l’essentiel de cette dette à court terme.
La structure financière si caractéristique de Dexia tirait peut-être son origine de son activité de prêts aux collectivités territoriales. Cette activité génère un besoin de financement structurel par le fait que les collectivités territoriales françaises ne peuvent effectuer de dépôt auprès de leurs établissements de crédit. En conséquence, ce surplus d’actifs doit trouver un financement qui soit suffisamment peu onéreux – donc plutôt de court terme – pour garantir le maintien des marges.
Quand la défiance entre banques apparaît et conduit à la fermeture du marché interbancaire, comme en 2008, ou à sa réduction brutale, comme constaté à partir d’août 2011, Dexia s’est trouvé dans l’incapacité de mobiliser les fonds nécessaires au remboursement de sa dette à court terme. C’est ainsi qu’en 2008, une aide de 6 milliards d’euros lui avait été consentie pour faire face à ce besoin de financement que le marché interbancaire lui refusait.
En outre, la situation critique de Dexia pourrait également être la conséquence de mauvais placements réalisés jusqu’en 2008. L’établissement détiendrait notamment, pour des montants inconnus, des produits financiers de mauvaise qualité, des « subprimes » dont la valeur dépend de l’évolution du marché immobilier américain et a fortement chuté depuis la crise financière.
L’aggravation de la crise de la dette souveraine, au mois d’août 2011, sa transformation en crise boursière et les incertitudes pesant sur la situation financière des établissements de crédit de la zone euro conduisent à une raréfaction du crédit sur le marché interbancaire. En dépit des efforts accomplis, Dexia demeure largement dépendante de ces financements. Son incapacité à faire face à ses prochains engagements explique le recours à la garantie des États et le constat d’une nouvelle crise de liquidité semble prouver que la banque est trop fragile pour affronter le contexte financier difficile en zone euro. L’unique solution est donc son démantèlement en bon ordre.
Dans ce cadre, les États belge, français et luxembourgeois se sont engagés à garantir 90 milliards d’euros de financements obtenus par Dexia. La part de la France dans cette garantie s’établit à 32,85 milliards d’euros et couvre les financements levés jusqu’au 31 décembre 2021, sans limite de maturité.
L’État s’engage également à hauteur de 6,65 milliards d’euros pour garantir des prêts aux collectivités territoriales qui pourraient être restructurés et permettre ainsi la reprise par la Caisse des dépôts de la filiale de Dexia consacrée à cette activité.
Dexia Municipal Agency, qui assure le financement des collectivités territoriales françaises, aujourd’hui filiale à 100 % de Dexia, serait cédée à la Caisse des dépôts, pour 65 % de son capital, et à la Banque postale pour 5 %. Le reste, soit 30 %, demeurerait, pour l’instant, la propriété de Dexia, sachant que la Banque postale pourrait s’en porter acquéreur à court ou moyen terme.
Une co-entreprise détenue respectivement à 65 % et 35 % par La Banque Postale et la Caisse des dépôts serait créée. Cette entité aurait pour fonction de concevoir et de distribuer des prêts aux collectivités locales françaises, prêts refinancés via Dexia Municipal Agency. Ce nouvel outil s’appuierait, au travers d’un contrat de services, sur les structures existantes de Dexia Crédit Local, la Caisse des dépôts et La Banque Postale.
Cependant, cette nouvelle structure ne viendra pas immédiatement remplacer l’offre de prêts de Dexia – même si sa part de marché avait chuté à 11 % de l’ensemble des prêts aux collectivités territoriales. Elle devrait être opérationnelle au plus tôt à partir de juin 2012 (118), le temps d’obtenir l’agrément, d’élaborer un système d’information et un modèle interne de contrôle des risques. Il faudra également former les équipes de la Banque postale qui ne connaissent pas ce nouveau métier.
Ainsi les signes inquiétants – disparition d’un acteur majeur, désengagement des autres établissements bancaires, diminution globale de la masse de prêts – laissent augurer des difficultés pour le financement des investissements des acteurs locaux dans les prochains mois, justifiant une intervention de la puissance publique.
le dÉmantÈlement de dexia Faisant suite au plan négocié par le Gouvernement français avec les autorités belges et luxembourgeoises, l’article 4 de la troisième loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-1416 du 2 novembre 2011) a autorisé le ministre de l’Économie à accorder au groupe bancaire la garantie de l’État sous deux formes distinctes : – une garantie de financement, pour un montant maximal de 32,85 milliards d’euros (I de l’article 4) ; – une garantie supplémentaire contre d'éventuelles pertes liées à la restructuration de certains prêts aux collectivités locales françaises, à concurrence de 6,65 milliards d’euros et après franchise (II du même article). ● La banque va céder tous les actifs qui peuvent l'être, ou devoir leur trouver des partenaires : cela concerne notamment la banque de détail en Belgique, l'activité de financement des collectivités locales en France (Dexia Municipal Agency), la filiale turque DenizBank. Ne resteraient, à moyen terme, dans la coquille Dexia (constituée de la holding Dexia SA et d’une filiale principale Dexia Crédit local) que quelques actifs, dont un portefeuille de titres hérité de la gestion précédente. Ce portefeuille comprend environ 95 milliards d'euros d'obligations, 2,7 milliards supplémentaires de titres américains et un peu moins de 30 milliards d'engagements sur des collectivités dans le monde, soit 125 milliards au total. Les obligations dans ce portefeuille sont, pour l'essentiel, de bonne qualité et ont, par nature, une durée de vie. Celle-ci est de 12 ans en moyenne. Il suffit donc, en théorie, d'attendre qu'elles arrivent à échéance. Toutefois ces titres ont été achetés à l'époque avec des fonds empruntés sur les marchés, avec une échéance plus courte. Il faut donc régulièrement renouveler ces emprunts en trouvant de nouveaux fonds sur les marchés. La garantie proposée par les États porterait sur ces nouveaux emprunts, pour permettre à Dexia, réduit à sa plus simple expression, d'attirer des investisseurs disposés à lui prêter, en attendant que la totalité des actifs du portefeuille soit arrivé à échéance. Sur la forme, la garantie prévue au I de l’article 4 est identique à celle déjà accordée à Dexia en 2008. Cette première garantie n'avait rien coûté à l’État français et lui avait même permis d'abonder le budget général grâce à la rémunération versée par Dexia en contrepartie. Sans impact immédiat sur les finances publiques, la garantie n'est pas pour autant sans risque. Si Dexia venait à ne pas rembourser un ou plusieurs emprunts réalisés sur les marchés, les États s'y substitueraient et honoreraient alors les créances, ce qui aurait un coût équivalent pour le budget. ● Le second étage prévu au II consiste pour l'État à garantir les 10 milliards d'encours de prêts structurés aux collectivités locales, considérés comme risqués, et qui devraient faire l'objet d'une restructuration. Cette estimation de l’encours « toxique » des prêts structurés vendus par Dexia semble très approximative ; elle se fonde probablement sur l’évaluation récente de la Cour des comptes, effectuée par sondages, mais dont les magistrats financiers ont eux-mêmes souligné les limites. Par ailleurs, l’État admet implicitement – pour la première fois – que les établissements de crédit ayant consenti des prêts structurés ne recouvreront pas l’intégralité de leur créance ; jusqu’alors, les préfets avaient pour consigne de s’opposer à toute défaillance d’une collectivité et d’inscrire d’office dans les budgets locaux les annuités d’emprunts même toxiques. Ce portefeuille de créances douteuses va être repris par Dexia, l'État apportant une sorte de contre-garantie selon les modalités suivantes : jusqu'à 500 millions d'euros de pertes constatées après restructuration, les pertes seront assumées par Dexia, et au-delà de cette franchise, elles seront assumées à 70 % par l'État et à 30 % par Dexia. Ainsi, si 1 milliard de pertes devaient être constatées, il en coûterait 650 millions à Dexia et 350 millions à l'État. |
b) Au-delà des fonds débloqués par la Caisse des dépôts, les incertitudes sont nombreuses
Afin de faire face à ce resserrement du crédit, le Premier ministre a annoncé le 7 octobre 2011 la mise en place par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations d’une enveloppe exceptionnelle de trois milliards d’euros, portée à cinq milliards d’euros le 22 novembre 2011, de prêts sur fonds d’épargne aux collectivités territoriales, ainsi qu’aux établissements hospitaliers.
Les projets finançables devront avoir été inscrits au budget d’investissement 2011, ou au budget d’investissement 2012 de la collectivité à condition que le prêt correspondant soit engagé avant le 31 mars 2012 et dans la limite de 20 % de l’enveloppe globale de trois milliards d’euros.
La moitié de cette enveloppe sera distribuée directement par la Caisse des dépôts et consignations. L’autre moitié prendra la forme de prêts de refinancement accordés aux établissements de crédit par le biais d’une adjudication qui a été souscrite par les principales banques françaises.
Les prêts proposés aux collectivités territoriales et établissements publics hospitaliers auront une durée maximale de 15 ans. Ces prêts financeront au maximum 50 % du besoin d’emprunt. Si le besoin d’emprunt est inférieur à un million d’euros, la totalité du besoin pourra être couverte.
Quatre types d’emprunts seront proposés : des emprunts à taux variables indexés soit sur le taux du livret d’épargne populaire, soit sur l’Euribor, soit sur l’inflation et des emprunts à taux fixe, d’environ 4,5 % pour des prêts à 15 ans.
c) La création d’une agence de financement des collectivités territoriales
À la suite de la réalisation, sous l’égide de l’association des communautés urbaines de France (ACUF), de plusieurs émissions obligataires groupées, l’idée de créer une structure pérenne de financement des collectivités territoriales s’est fait jour, afin de proposer à ses adhérents des prêts refinancés sur le marché obligataire.
C’est ainsi que l’association d’étude pour l’Agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) a été créée en avril 2010 par l’association des maires de France (AMF), l’association des maires de grandes villes de France (AMGVF) et l’ACUF, bientôt rejointes par les autres associations d’élus locaux. L’agence propose de mettre en place une nouvelle offre permettant aux collectivités territoriales d’aller chercher directement de l’argent sur les marchés, en complément de l’offre bancaire traditionnelle.
La future agence de financement des investissements locaux serait constituée, à sa tête, par un établissement public industriel et commercial (119). Composé d’élus de différents niveaux de collectivité, il fixerait les orientations stratégiques et sera actionnaire d’une société anonyme (SA) chargée de la gestion opérationnelle. Celle-ci emprunterait pour les collectivités locales sur les marchés financiers. Elle ne proposerait que des prêts à taux fixe ou variable, sous forme de crédits amortissables, mais aucun produit structuré.
Les collectivités intéressées pourront adhérer à l’agence sous la forme d’un droit d’entrée remboursable apporté au capital social initial. Cependant, l’adhésion ne vaudra pas droit de tirage automatique. Les collectivités sollicitant des liquidités devront faire valoir leur bonne santé financière et notamment un niveau d’endettement acceptable qui sera apprécié par l’agence elle-même. Le mécanisme, encore à préciser, doit permettre à « chaque collectivité éligible d’emprunter chaque année la moitié de ses besoins » (120).Les promoteurs de l’agence estiment que, en dix ans, celle-ci devrait occuper le quart du marché des prêts aux collectivités, estimé aujourd’hui à un peu plus de 20 milliards d’euros.
Le modèle de cette agence mutualiste existe aujourd’hui au Danemark, en Finlande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. Ailleurs, comme au Royaume-Uni, une agence adossée au Trésor public a en charge la délivrance de prêts bonifiés. Certains ont pu dénoncer le risque inflationniste d’une offre de crédit pilotée par les collectivités territoriales elles-mêmes (121).
Cependant, si la diversification des sources de financement du secteur public local par un appel direct aux marchés financiers apparaît utile, les modalités de création et de fonctionnement de l’agence posent cependant différentes questions dont la résolution conditionne la crédibilité du projet.
Selon ses promoteurs, l’agence pourrait fonctionner sans la garantie de l’État ; l’établissement public apporterait sa garantie sur l’intégralité de la dette, et les collectivités elles-mêmes à hauteur de leur part dans le capital social.
Par ailleurs, la gouvernance par des responsables locaux, eux-mêmes intéressés dans la distribution de prêts, pourrait affecter l’évaluation du risque fait par les marchés. Seule une forte crédibilité dans la solidité et la pérennité de la structure, ainsi que dans l’absence de collectivités en difficulté, lui permettra de bénéficier d’un financement à des taux intéressants sur les marchés, dans une période d’aversion pour le risque de défaut potentiel des organismes publics.
Dans l’immédiat, cette agence ne pourra voir le jour qu’à la faveur de plusieurs mesures législatives, permettant notamment à plusieurs collectivités territoriales de créer ensemble l’établissement public en charge de la gouvernance de la structure.
À terme, cette nouvelle structure pourrait cependant apparaître, pour les collectivités et établissements publics de taille moyenne, comme une alternative à l’émission directe d’emprunts obligataires. Il conviendrait ainsi, que les dispositions législatives nécessaires puissent être adoptées afin que cette structure puisse voir le jour.
B.– L’ENCADREMENT STRICT, POUR L’AVENIR, DES MODALITÉS D’ENDETTEMENT DES COLLECTIVITÉS
Les auditions menées par la commission d’enquête ont montré que l’absence de toute limite effective aux instruments financiers susceptibles d’être souscrit par les collectivités et établissements publics locaux, loin d’être une garantie de leur libre administration, pouvait se révéler, en particulier pour les plus petits d’entre eux, source d’incertitudes et de décisions contestables. Si l’article 72 de la Constitution en a fait un principe fondamental, il n’exclut pas que l’État puisse, par la loi, encadrer les modalités de financement des investissements des collectivités.
La commission d’enquête propose ainsi de mettre en place un cadre législatif organisant les modalités d’endettement et le type de produits financiers susceptibles d’être proposés par les établissements bancaires.
1.– Une solution à écarter : un énième renforcement des obligations d’information
Face aux difficultés rencontrées par des clients devant des contrats complexes et difficiles à appréhender, présentés par des fournisseurs tels que les établissements bancaires, le législateur a longtemps eu comme réaction de renforcer les garanties offertes aux clients, particuliers comme institutionnels, en termes d’information obligatoirement portée à son attention.
Ainsi, à titre d’exemple, la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a procédé à la réforme du régime des obligations des intermédiaires spécialisés dans les services financiers afin d’améliorer la protection de la clientèle, en prévoyant une immatriculation unique de tous les intermédiaires, un renforcement des obligations des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, la clarification et l’encadrement du démarchage bancaire et financier, et l’élargissement des compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel en matière de codes de bonne conduite et de règles de bonnes pratiques professionnelles.
Cependant, à l’occasion des auditions qu’elle a menées (122), la commission d’enquête a pu constater que ce n’est pas le manque d’information qui a conduit les élus et responsables locaux à souscrire des emprunts structurés, mais l’absence de compétence financière pour en comprendre tous les enjeux. Comme l’a résumé le président de la XIe Chambre civile de la Cour constitutionnelle allemande, commentant un jugement relatif à un emprunt structuré souscrit par une petite entreprise, « ce n’est pas parce qu’on peut lire un poème qu’on peut en comprendre le sens ».
Le quatrième engagement de la Charte Gissler prévoit que « les établissements bancaires reconnaissent le caractère de non professionnel financier des collectivités locales » et qu’ils doivent leur fournir « une analyse de la structure des produits et de leur fonctionnement, en mentionnant clairement les inconvénients et les risques des stratégies proposées » et « une expression des conséquences en termes d’intérêts financiers payés notamment en cas de détérioration extrême des conditions de marché (« stress scenarii ») : grille de simulation du taux d’intérêt payé selon l’évolution des indices sous-jacents ».
Ces principes de bon sens pourraient faire l’objet d’une inscription dans la loi, afin qu’ils puissent être opposables à l’ensemble des établissements bancaires et des acteurs locaux concernés.
L’ajout de pages d’explication et de mise en garde non circonstanciées n’apparaît donc pas comme une solution à même d’éclairer les élus et responsables locaux, et en particulier ceux qui ne peuvent se consacrer à plein temps aux questions financières.
C’est donc avant tout au législateur qu’il convient d’encadrer les instruments susceptibles d’être souscrits par les collectivités et établissements publics locaux.
2.– La restriction des produits financiers accessibles aux acteurs publics
a) Le refus de fonder une discrimination dans l’accès à certains produits financiers sur la taille des collectivités et établissements publics
Les auditions menées par la commission d’enquête ont révélé combien les élus locaux et responsables de petits établissements publics ont pu se retrouver démunis face à des offres des établissements bancaires semblant présenter toutes les garanties, sans disposer des moyens d’évaluer les risques sous-jacents aux offres.
Il convient de rappeler que dans les communes de moins de 10 000 habitants, comme dans les établissements publics de moins de 20 000 habitants, la réglementation existante ne permet la création que d’un seul emploi fonctionnel de direction (123). Le directeur général des services, seul cadre administratif, ne peut consacrer qu’un temps limité aux questions purement financières. Malgré leur dévouement, le crédit temps accordé aux élus locaux (124) ne peut leur permettre de manière générale de suppléer ce manque de moyens de gestion financière.
Par ailleurs, leur volume d’investissement n’est souvent pas suffisant pour leur permettre de mettre en place une diversification des instruments d’endettement, afin de limiter les risques inhérents à certains produits financiers.
Il est donc difficile pour ces personnes publiques de mettre en place une gestion active de la dette.
Cependant, votre rapporteur juge qu’il serait discriminatoire de limiter le choix des petites collectivités, établissements publics de santé dont le ressort est local et organismes en charge du logement social de taille limitée, parmi les seuls produits financiers tels que les emprunts à taux fixe ou les emprunts à taux variable indexés sur un indice de la zone euro, présentant une évolution linéaire plus aisément déterminable.
Il convient de faire confiance aux élus et responsables locaux, afin qu’ils déterminent eux-mêmes les produits financiers qu’ils sont à même de maîtriser.
L’ensemble des autres garanties fournira un cadre suffisant limitant les risques que peuvent prendre les acteurs publics locaux, quelle que soit leur taille.
b) L’interdiction des produits structurés ou dérivés avec multiplicateur
Si la libre administration des collectivités et l’autonomie de gestion des établissements publics doivent être préservées, il apparaît aussi à votre rapporteur que la souscription de certains produits, parmi les plus risqués, ne peut être justifiée par l’intérêt public.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe que chaque collectivité a pour mission de régler les affaires correspondant à ses compétences (125). L’engagement des finances locales ne peut se faire qu’en poursuivant un intérêt général présentant un caractère local.
La charte Gissler a permis de mettre en place une première échelle d’appréciation des risques pris par les acteurs locaux les ayant souscrits. Les produits à effet de levier y sont justement classés parmi les produits les plus risqués : classement D pour les produits présentant un effet multiplicateur de l’indice sous-jacent inférieur ou égal à 3 ou inférieur à 5 avec un cap, classement E pour les produits présentant un effet multiplicateur de l’indice sous-jacent inférieur ou égal à 5 ; classement hors charte pour les produits ayant un effet multiplicateur supérieur.
De la même façon, les ventes d’options peuvent conduire les taux d’intérêt à évoluer de façon non linéaire, dès le passage d’un seuil prédéterminé par un indice ou d’un rapport entre deux indices.
Pour toutes ces catégories de produits, une variation de l’indice sous-jacent va se traduire par une variation supérieure des charges d’intérêt qu’aura à subir la collectivité, avec une forte volatilité rendant illusoire toute prévision du coût total de ces crédits à moyen et long terme. Ils présentent donc un caractère spéculatif qui n’apparaît pas compatible avec une utilisation des deniers publics à des fins d’intérêt général et devraient donc faire l’objet d’une interdiction pour toutes les personnes publiques.
La circulaire du 25 juin 2010 (126) qualifie de spéculatif et contraire à l’intérêt local le seul usage spéculatif des instruments de couverture, en ne déconseillant que certains produits particulièrement risqués (127).
À titre de comparaison, il est possible de noter que dans le domaine des placements, le législateur a permis la création de fonds à effet de levier (Aria EL) à règles d’investissement allégées, mais ces instruments de gestion alternative ne peuvent être souscrits par tous les investisseurs, et en particulier jamais par les investisseurs non professionnels. C’est la défense de l’intérêt général qui confère au législateur la légitimité de mettre en place des « garde-fous » applicables au choix des instruments financiers par les collectivités territoriales
c) La mise en place d’un capping global pour tous les prêts aux collectivités territoriales, aux hôpitaux ou aux organismes du logement social
L’étude des formules d’évolution de plusieurs contrats de prêts communiqués à la commission d’enquête a montré que la charge d’intérêt de certains emprunts, et notamment ceux indexés sur des taux de change entre le franc suisse et une autre devise, pouvait atteindre des pourcentages inédits, jusqu’à dépasser 24 % (128).
Pourtant la législation française prévoit deux mécanismes d’encadrement des taux d’intérêt des prêts, sensés garantir l’emprunteur contre des pratiques de prêts à intérêt jugés inacceptables :
– la répression du crédit usuraire : tout prêteur qui proposerait un prêt présentant, au moment où il est consenti, un taux supérieur d’un tiers au « taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues » (129) s’expose à une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 45 000 euros (130) ;
– la mention du taux effectif global, taux d’intérêt incluant tous les frais annexes et primes d’assurance pour déterminer le coût total du crédit (131), rendue obligatoire au moment de l’offre de prêt pour tout type de crédit.
Cependant, ces outils ont été conçus pour des prêts à taux fixe, afin de permettre une comparaison des différentes offres et de juger de leur caractère raisonnable : en présence de taux variables, le prêteur n’est tenu d’indiquer que le taux d’intérêt applicable à la première période de remboursement, en fonction des éléments variables connus à la date de signature du contrat. Ils sont donc inadaptés face à la volatilité des produits à taux variables et des produits structurés, quel que soit l’emprunteur.
La commission d’enquête estime donc que ces deux instruments, destinés à protéger les emprunteurs, devraient faire l’objet d’une réflexion tendant à réformer ces indicateurs pour leur restituer leur caractère informatif et leur pertinence pour les prêts autres que ceux à taux fixe.
Plus précisément, en ce qui concerne les acteurs locaux, la commission estime que les missions d’intérêt général et l’usage des deniers publics ne permettent pas aux responsables d’engager la responsabilité publique sans limite. Plutôt que de déterminer a priori les instruments financiers à leur disposition, il semble raisonnable de leur laisser le libre choix de leur endettement, tout en assortissant obligatoirement la charge d’intérêts d’un taux maximal ou capping.
La définition de ce capping devra être évolutive, de façon à prendre en compte l’évolution des conditions de marché. Ainsi, il serait possible de s’appuyer sur un indice tel que l’Euribor, auquel s’ajouterait une majoration de l’ordre de 300 points de base, pour définir le taux d’intérêt plafond auxquels les emprunts à taux variables des acteurs locaux pourraient être assujettis. L’adossement à un indice reconnu permettrait aux établissements prêteurs de souscrire une option de couverture sur les marchés.
Ce dispositif de capping ne garantirait pas les personnes publiques concernées contre toute variation de la charge d’intérêt : ainsi, l’Euribor à 12 mois atteignait 5,5 % en octobre 2008 avant de tomber à moins de 2 % en mars 2009. Aussi le législateur pourrait-il renvoyer à la concertation entre les représentants des prêteurs et des emprunteurs la définition de ce plafonnement, qui sera validée par voie réglementaire.
3.– L’adaptation du cadre budgétaire et comptable
S’il faut réglementer le marché des prêts aux collectivités et autres acteurs locaux, il convient aussi de renforcer l’information des élus et responsables sur les caractéristiques de l’endettement.
La sincérité de l’équilibre réel du budget des collectivités territoriales impose, en outre, que les risques sous-jacents souscrits par celles-ci fassent l’objet d’un provisionnement rendant compte à un niveau raisonnable de leur importance.
a) L’institutionnalisation d’un débat sur la dette dans les assemblées délibérantes
Alors que la détermination d’une stratégie d’endettement et le choix du mode de financement des investissements locaux peuvent être cruciaux, il est apparu à la commission d’enquête que les assemblées délibérantes n’étaient pas correctement informées des choix effectués. Comme le remarque la Cour des comptes, « alors que la décision de s’endetter résulte souvent de choix politiques structurants, liés d’abord à la volonté d’investir mais aussi à des arbitrages, notamment entre une hausse de la fiscalité et le recours à l’emprunt, la définition claire d’une stratégie d’endettement par l’exécutif et sa formalisation dans un document de référence demeurent relativement rares. » (132)
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les organes délibérants des collectivités territoriales doivent prendre la décision d’emprunter (133). La délibération doit préciser les principales caractéristiques financières du contrat de prêt : l’objet, le taux, la durée d’amortissement, notamment. Ainsi, l’organe délibérant doit pouvoir mesurer l’étendue de l’engagement financier de l’établissement et ne doit pas se prononcer « dans l’ignorance d’éléments d’information susceptibles d’influer sur le sens de sa manifestation de volonté » (134).
Cette compétence peut être déléguée par les conseils municipaux au maire (article L. 2122-22 du CGCT). Dans les départements et les régions, la compétence de l’assemblée délibérante peut être déléguée à la commission permanente (articles L. 3211-2 et L. 4221-5). La délibération qui confère la délégation doit fixer de façon précise l’étendue des pouvoirs délégués.
En l’absence de formalisation et de présentation d’une stratégie d’endettement par l’exécutif, les assemblées délibérantes n’ont pas été en mesure d’appréhender et de débattre des choix et des risques souscrits au nom de la collectivité territoriale, surtout que seules des informations très succinctes sur les caractéristiques des emprunts souscrits étaient fournies.
Il apparaît ainsi à notre commission d’enquête qu’il est nécessaire d’imposer à toutes ces collectivités et groupements de tenir un débat annuel sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement, fondé sur un document préparé par l’exécutif retraçant l’évolution de la dette, les caractéristiques des engagements pris et présentant les choix d’endettement.
La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a étendu aux communes de plus de 3 500 habitants, ainsi qu’aux régions, l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générales du budget prévue pour les départements depuis la loi du 2 mars 1982 (135). Ce débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget par l’assemblée délibérante. Il semble raisonnable que ce rendez-vous annuel soit aussi l’occasion de débattre de la stratégie financière pluriannuelle.
b) L’introduction de nouvelles annexes sur les emprunts
Ce nouveau droit de regard des assemblées délibérantes sur l’encours et les caractéristiques de l’endettement des collectivités territoriales et autres établissements publics locaux ne peut avoir un sens que s’il est fondé sur des informations détaillées et exhaustives sur l’encours d’endettement de la personne publique.
Une fois les opérations de gestion de dette effectuées, celles-ci devraient faire l’objet d’une retranscription dans les documents budgétaires et notamment les comptes administratifs, selon la forme prescrite par le type d’instruction comptable qui leur est applicable (136).
Or jusqu’à la réforme de ces instructions comptables par arrêtés du 16 décembre 2010, ces modèles budgétaires étaient notoirement inadaptés pour retracer de manière compréhensible et adéquate, dans les annexes sur l’état de la dette, les risques réellement pris par une collectivité qui souscrivait des emprunts structurés. Ainsi, le cadre ne permettait pas de mentionner, notamment dans les emprunts à plusieurs phases d’indexation, les formules complètes de calcul des taux structurés. Les emprunts structurés apparaissaient alors le plus souvent parmi les emprunts à taux fixe en raison d’une première phase de taux fixe bonifié.
Ces documents ne permettaient donc pas d’évaluer, ni le risque par emprunt, ni le risque global pris par la collectivité au niveau de l’ensemble de son endettement. Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, a commencé à examiner la question en février 2009 (137).
D’ores et déjà, la circulaire du 25 juin 2010 ainsi que les arrêtés du 16 décembre 2010, ont apporté une première réponse : la nouvelle annexe A 2.9 « État de la dette, répartition de l’encours (typologie) », en vigueur à compter de l’exercice 2011, prescrit d’indiquer la répartition des produits d’endettement en utilisant la typologie mise en place par la Charte Gissler.
Cet enrichissement de l’information disponible est un premier pas dans une meilleure appréhension par les assemblées délibérantes et par les citoyens des risques pris par la collectivité à l’occasion de la souscription de produits d’emprunt.
Afin de refléter le niveau exact des engagements souscrits par la collectivité, cette information pourrait être complétée par l’indication de la valeur « mark to market » déterminée par deux organismes tiers à la demande de l’établissement prêteur (138).
Cependant, ce constat devrait aussi se traduire par la prise en compte des éventuelles conséquences à long terme de ces choix.
c) L’obligation de provisionner les risques pris
● En comptabilité privée, les provisions pour risques et charges représentent un passif dont le montant ou l’échéance ne sont pas fixés de façon précise, c’est-à-dire comme une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources, sans contrepartie.
Dans le cadre du Plan comptable général (PCG), une entreprise doit ainsi constituer une provision :
– s’il existe une obligation certaine de l’entreprise à l’égard d’un tiers à la date de clôture,
– et si à la date d’arrêté des comptes, il est probable que l’entreprise ait à effectuer une sortie de ressources au profit de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue du tiers après la date de clôture,
– et s’il est possible d’estimer de manière fiable cette sortie de ressources.
Ces dispositions ont pour objectif que des risques pris pendant un exercice comptable, ayant des conséquences financières sur des exercices ultérieurs, soient bien pris en charge au titre de cet exercice. Il faut souligner qu’il s’agit de la seule mesure concluante ayant permis la quasi disparition des prêts toxiques dans le secteur marchand : le coût d’inscription du risque pèse en effet si fortement dans le bilan et le résultat que la « rentabilité faciale » des produits en est annulée.
● À l’invitation de la Cour des comptes, comme de certaines personnes auditionnées, la commission a estimé que les risques pris lors de la souscription d’emprunts et de contrats d’échange de taux d’intérêt devraient faire l’objet d’un provisionnement pour risques, représentatif des risques de charges financières supplémentaires souscrites.
En effet, le principe d’un provisionnement en cas de risque n’est pas convenablement mis en œuvre par la réglementation actuellement en vigueur.
Les départements, depuis 2005, et les régions depuis 2010, ont l’obligation de provisionner « dès lors qu’il y apparition du risque » et « à hauteur du risque constaté » (139). Pour les services publics industriels et commerciaux, le provisionnement est facultatif.
Les instructions comptables et budgétaires renvoient aux principes généraux du plan comptable général, notamment au principe de prudence dont le respect impose qu’une provision soit constituée en présence de risque.
En vertu de ce principe et en application de l’article 372-2 du plan comptable général, le provisionnement des risques en fonction des variations de valeur des contrats d’opérations à terme devrait être obligatoire, sauf si le contrat a été souscrit dans le cadre d’une opération de couverture d’un risque.
La circulaire du 25 juin 2010 (140) ne présente le système du provisionnement que comme une faculté à la disposition des collectivités, « si elles l’estiment utile ». Si elles ont fait ce choix, les provisions pour perte en charges d’intérêt ne doivent alors pas être manifestement sous-estimées.
La commission d’enquête estime que cette situation n’est pas satisfaisante : en l’absence de provisionnement retranscrivant les risques souscrits dans les documents budgétaires, les comptes produits ne peuvent respecter les principes de sincérité et d’équilibre réel applicables aux collectivités territoriales.
● La méthode de détermination du niveau de ce provisionnement apparaît donc comme un enjeu crucial.
Le Conseil de normalisation des comptes publics étudie actuellement les différentes possibilités et méthodes de calcul pouvant être mise en œuvre (141). Face aux différentes solutions envisageables, il importe de définir rapidement une méthode homogène et pratique permettant de prendre en compte ces risques. Ces provisions devraient être fixées à un niveau minimal, pour ne pas peser sur la capacité d’investissement des acteurs publics locaux, tout en étant suffisamment dissuasives pour décourager la prise de risques que recèlent certains produits structurés.
● Actuellement, la circulaire du 25 juin 2010 rappelle que les provisions peuvent être faites « au regard de la valorisation aux conditions de marché des produits, fournie au moins une fois par an par les établissements financiers ». Cette méthode est dite de l’évaluation au « mark to market », conduisant à ce que la valeur et les conditions de déblocage du produit soient déterminées par deux établissements tiers à la demande de l’établissement prêteur.
Une autre solution consisterait à ce que, lorsqu’un contrat prévoirait un taux d’intérêt nominalement inférieur aux taux de marché (Euribor ou taux d’intérêt légal), la somme représentant la différence de charge d’intérêt entre ces taux fasse obligatoirement l’objet d’une provision.
Ainsi, les produits structurés reposant sur la proposition d’une première période dite bonifiée, à taux inférieur, cachant une seconde période, à taux structuré présentant des risques sous-jacents, ne présenteraient plus le même gain budgétaire, à la fois artificiel et temporaire, et seraient ainsi appelés à disparaître du marché, comme cela a été largement le cas dans le secteur marchand.
Le montant de cette provision serait naturellement appelé à être réévalué chaque année, en fonction des conditions du marché.
● Si la méthodologie permettant d’évaluer le montant de ce provisionnement peut faire l’objet de discussions approfondies, la commission d’enquête souhaite que soit affirmé dès à présent le principe de cette réintégration des risques souscrits pendant l’exercice comptable dans les documents budgétaires annuels des collectivités territoriales et de leurs groupements (142).
Les offices publics de l’habitat ayant opté pour la comptabilité publique, en étant alors soumis à l’instruction comptable M31, devront se voir appliquer les mêmes principes.
Les établissements publics de santé sont, quant à eux, soumis à l’instruction comptable M21, dont les principes se rapprochent de ceux de la comptabilité privée : ils pourront aussi voir préciser que leur choix d’endettement doit faire l’objet d’un provisionnement, dans la mesure où les provisions qu’ils constituent jusqu’à présent ne sont pas expressément liées à l’endettement.
d) L’encadrement de la conclusion des contrats d’emprunt avant les échéances électorales
À l’occasion des auditions organisées par la commission d’enquête, plusieurs élus locaux ont indiqué avoir constaté, peu de temps après leur élection, que des emprunts pour des montants importants avaient fait l’objet de négociation et de conclusion dans les derniers jours du mandat de la précédente équipe exécutive, quelque fois entre les deux tours des élections locales (143).
Le régime actuel des délégations des assemblées délibérantes aux exécutifs locaux prévoit qu’elles sont consenties « pour la durée du mandat » (144). Les maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional doivent en effet bénéficier de la plénitude de leurs prérogatives de gestion jusqu’à la fin de leur mandat, intervenant lors de l'installation du nouveau conseil issu des élections générales.
Le corollaire nécessaire à ces délégations réside dans l’obligation de rendre compte : ainsi dans les communes, « le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal » (145). Ce compte rendu doit assurer au conseil une information complète.
Or les derniers actes de l’exécutif sortant sont souvent pris sans que le contrôle démocratique de l’assemblée délibérante puisse être effectif.
C’est pourquoi il semble nécessaire à votre commission d’enquête que les délégations habituellement consenties par les assemblées délibérantes, notamment en matière de négociation et de signature des contrats de prêts, prises en application des dispositions du code général des collectivités territoriales, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale visant à renouveler l’assemblée délibérante, soit deux semaines avant la date du scrutin (146).
En cas de nécessité, il restera ainsi loisible à l’exécutif de la collectivité de réunir l’assemblée pour demander l’autorisation de prendre des mesures ponctuelles, tels que l’autorisation exceptionnelle de souscrire un emprunt, mais dans des conditions permettant l’exercice du contrôle démocratique jusqu’à la fin des mandats locaux en cours.
4.– Le renforcement de l’encadrement juridique
a) L’extension du contrôle de légalité aux contrats de prêt
Les actes administratifs pris par les collectivités territoriales doivent en principe faire l’objet d’une transmission préalable au préfet pour être exécutoires. Cette communication lui permet de procéder à un contrôle de légalité, les actes litigieux pouvant être déférés devant le juge administratif. Pour les établissements publics de santé (EPS), le contrôle de légalité est exercé par le directeur général de l’agence régionale de santé (147).
Dans ce cadre, les « conventions relatives aux emprunts » font partie des actes dont la transmission au préfet est prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT) (148).
Cependant, dans les faits, les contrats passés entre une collectivité locale et une personne de droit privé, et exception faite des contrats administratifs par détermination de la loi, sont présumés être de droit privé. Le caractère administratif ne leur est reconnu par la jurisprudence que s’ils ont pour objet l’exécution d’un service public (149) ou comportent une clause exorbitante du droit commun (150). En l’absence de ces conditions, le contrat de prêt est un contrat de droit privé (151). La banalisation du crédit aux collectivités locales a conduit à aligner les clauses contractuelles sur les règles de droit privé et la présence de clauses exorbitantes qui entraînent la qualification d’acte administratif est très rare. Par ailleurs, le contrat d’emprunt ne constitue pas en général l’accessoire d’un contrat administratif. Toutefois, certains montages financiers complexes qui associent un « contrat de financement » et un contrat de travaux publics ou un contrat d’exécution d’un service public peuvent conduire à conférer au premier un caractère administratif.
Aussi les contrats de prêt ne font habituellement pas l’objet de transmission au contrôle de légalité. En cas de litige, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître.
Seule la décision par laquelle l’assemblée délibérante peut déléguer à l’exécutif l’autorisation « de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change » (152) fait l’objet d’une transmission obligatoire au contrôle de légalité.
Cette absence de contrôle de légalité allait de pair avec l’absence de règles encadrant précisément les conditions et caractéristiques des emprunts susceptibles d’être souscrits par les collectivités territoriales.
La commission d’enquête souhaitant que la liberté de choix dans la détermination des instruments de financement des investissements des collectivités territoriales et autres acteurs publics locaux soit encadrée par la loi, il serait ainsi logique que ces contrats de prêts – initiaux ou souscrits dans le cadre de renégociation d’emprunts existants – fassent l’objet d’un contrôle de légalité, c’est-à-dire d’un examen donnant au représentant de l’État la faculté de donner des conseils et d’obtenir des renseignements qui seront d’autant plus efficaces que celui-ci dispose des moyens juridiques de déférer les contrats qui lui paraîtront contraires au cadre législatif mis en place.
b) Le refus de la soumission des contrats d’emprunt au code des marchés publics
Le corollaire de la soumission des contrats d’emprunt au contrôle de légalité pourrait être de prévoir par la loi qu’il s’agit toujours de contrats administratifs et ainsi de les soumettre au droit des marchés publics.
L’article 3 du code des marchés publics du 1er août 2006 exclut de son champ d’application les « accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers et à des opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs », en reprenant ainsi la rédaction de l’article 16 de la directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004.
Cependant, cette exclusion des emprunts du champ d’application du droit des marchés publics a fait par le passé l’objet d’une controverse entre la Commission européenne et certains États membres de l’Union européenne. Ainsi, le Conseil d’État avait annulé l’exclusion similaire insérée dans le code des marchés publics de 2004, au motif qu’elle était contraire aux objectifs de la précédente directive européenne 92/50 du 18 juin 1992 sur les marchés publics de services (153) : seuls les services financiers donnant lieu à des titres négociables, dont le prix varie en fonction de l’offre et de la demande, pouvaient être exclus du champ d’application du code. La directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, qui a remplacé la directive de 1992, n’exclut que les « opérations d’approvisionnement en argent et en capital ». La Commission européenne est d’avis que cela n’exclut pas du champ d’application du droit des marchés publics les emprunts souscrits notamment par les collectivités territoriales (154), notamment car les dispositions excluant de l’application du droit des marchés publics les opérations d’acquisition ou de location immobilière (155) réservent le cas des « contrats de services financiers conclus en relation », qui restent soumis au code des marchés publics.
Quelles que soient ces controverses juridiques, la commission d’enquête juge inadaptée cette hypothèse. L’obligation de respecter des procédures lourdes, complexes, de coût élevé et peu adaptées à la souscription d’emprunt (156) aurait pour conséquence de priver les acteurs publics locaux de la possibilité de saisir les opportunités se présentant sur les marchés financiers, alors qu’elles peuvent le faire en faisant jouer la concurrence de manière informelle et dans des délais extrêmement brefs.
Ce choix de la commission d’enquête ne l’empêche pas de réaffirmer que la souscription des emprunts des collectivités territoriales se doit de respecter, dans tous les cas, les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures suivies par les personnes publiques.
5.– L’information du Parlement
a) Vers un rapport annuel sur la dette locale
La commission d’enquête a pu constater les difficultés auxquelles elle s’est trouvée confrontée pour évaluer les montants d’emprunts structurés souscrits par les acteurs publics locaux (157).
À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté le 15 novembre 2011 un amendement en première lecture au projet de loi de finances pour 2012 prévoyant l’obligation annuelle pour le Gouvernement de déposer en annexe au projet de loi de finances « un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales »(158). Celui-ci serait établi sur la base d’un rapport « présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l’évolution de la dette […] » remis annuellement par les collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants.
Tout en prenant en compte les limites fixées par l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, tel qu’inséré par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (159), la commission d’enquête se félicite de cette avancée. Cependant, il serait plus opérationnel que ce rapport utilise les nouvelles annexes relatives à la structure de l’endettement des collectivités territoriales pour présenter des données agrégées relatives à la structuration de l’endettement local pour les 36 782 communes, et non seulement les 124 les plus peuplées.
En outre, ce rapport pourrait s’intéresser également à l’endettement des établissements publics de santé et des offices publics de l’habitat, au moyen de données agrégées collectées par leurs ministères de tutelle.
b) Clarifier les prérogatives des commissions d’enquête parlementaires à l’égard des établissements de crédit
La commission d’enquête a eu l’occasion de mettre en œuvre la plénitude des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Le septième alinéa de cet article prévoit notamment que « toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est […] tenue de déposer, sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal », qui réprime la violation du secret professionnel.
Or la définition du secret bancaire retenue par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier englobe toutes les « opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ; les opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ; les cessions ou transferts de créances ou de contrats. ». Elle est donc très large, et prévoit plusieurs exceptions en faveur des autorités de régulation (Autorité de contrôle prudentiel, Banque de France), des autorités judiciaires agissant dans le cadre d’une procédure pénale, des agences pour les besoins de la notation des produits financiers ou encore des personnes avec lesquelles les établissements négocient certaines opérations bancaires.
Si le secret bancaire a pu par le passé être opposé à plusieurs reprises aux démarches du Parlement pendant des auditions (160), il n’est pas opposable au rapporteur de la commission d’enquête, au titre de ses prérogatives personnelles de contrôle sur pièces et sur place. À ce titre, votre rapporteur a obtenu des établissements bancaires les informations qui leur avaient été demandées, sans mention du nom de l’emprunteur.
Cependant, afin de lever toute ambiguïté, il semblerait utile qu’une modification de l’article L. 511-33 prévoie explicitement l’inopposabilité du secret bancaire aux commissions d’enquête du Parlement.
C.– LA GESTION MUTUALISÉE DE LA SORTIE DES DETTES LOCALES STRUCTURÉES, SANS DÉFAISANCE
Deux ans après la nomination de M. Éric Gissler comme médiateur pour les emprunts toxiques des collectivités territoriales, la méthode choisie par l’État a montré ses limites.
Limite matérielle, car un médiateur ne peut traiter tous les dossiers présentés.
Limite juridique, car la médiation ne permet pas de peser sur la solution proposée.
Limite quantitative, car les travaux de la commission d’enquête ont révélé la masse importante d’emprunts susceptibles de se révéler toxiques dans un avenir proche, les périodes de bonifications d’intérêts venant prochainement à échéance.
En outre, lorsque, à l’issue des périodes bonifiées, les acteurs publics locaux ont constaté le franchissement des seuils prévus par les indices sous-jacents de leurs contrats et réalisé les taux d’intérêt auxquels leurs emprunts allaient être exposés, un certain nombre a choisi d’assigner les établissements prêteurs devant les tribunaux. Cependant, hormis dans les cas d’espèce où la banque aurait commis une faute avérée, en oubliant par exemple de mentionner le taux effectif global, ou fournit des informations relevant de la tromperie, il ne semble pas envisageable qu’une jurisprudence vienne annuler l’ensemble des prêts structurés souscrits (161). Par ailleurs, s’il était jugé qu’une banque n’avait pas respecté l’obligation de mise en garde de son client face à une opération risquée, la perte de chance ne pourrait conduire qu’à une indemnisation partielle du préjudice subi. Enfin, les délais des procédures judiciaires font courir aux acteurs publics plaignants le risque de se retrouver dans une situation pire au bout de quelques années, alors que des portes de sortie peuvent être imaginées, avec l’appui de l’État (162).
La commission d’enquête souhaite donc qu’une solution globale soit trouvée, qui ne repose ni sur la solidarité nationale, ni sur le traitement particulier des collectivités et établissements publics ayant pris les risques les plus inconsidérés, mais bien sûr un apurement rapide et généralisé des encours de prêts structurés détenus par les acteurs publics locaux.
1.– Une piste abandonnée : la création d’une structure de défaisance
Selon certaines personnes auditionnées par la commission d’enquête (163), la solution de la crise des emprunts toxiques reposerait nécessairement sur la mise en place d’une structure de défaisance, garantie par l’État, qui aurait pour tâche de reprendre la totalité de l’encours de produits structurés détenu par les acteurs publics locaux pour leur proposer en remplacement des prêts classiques.
La commission d’enquête est arrivée à la conclusion qu’une telle structure serait à fois d’un coût insupportable pour la solidarité nationale et déresponsabilisant pour les élus et responsables locaux qui ont contracté ces emprunts.
a) Le coût de la capitalisation d’une structure de gestion de passifs serait prohibitif
Un projet de structure de défaisance qui prendrait en charge les emprunts structurés considérés comme « toxiques » a été proposé par certains élus locaux concernés (164).
Cette structure, garantie nécessairement par l’État, devrait alors gérer le stock de cette dette toxique, avec l’aide de professionnels, jusqu’à son extinction. Les pertes potentielles pour les acteurs publics concernés seraient alors mutualisées et financées par des ressources externes, en partie exigées des banques, en partie apportées par l’État ainsi qu’éventuellement par l’ensemble des collectivités territoriales.
Contrairement aux cas des structures de défaisance mises en place lors des crises bancaires de ces dernières décennies, ce sont donc les passifs des débiteurs bancaires qui pourraient être transférés à l’exclusion d’actifs.
Le transfert des emprunts toxiques à la structure de défaisance nécessiterait l’accord des banques concernées qui n’auraient plus comme contrepartie la collectivité mais ce nouvel établissement public. Afin que les banques acceptent une telle modification, la structure de défaisance devrait présenter un profil de risque suffisamment rassurant pour elles, puisque leur risque serait concentré sur une seule contrepartie et non plus sur un grand nombre de collectivités publiques.
Les pertes enregistrées par cet établissement ne peuvent être totalement anticipées : elles seront largement dépendantes du périmètre retenu pour les emprunts pris en compte ; en outre, elles varieront en fonction de la participation demandée aux collectivités concernées, qui se verraient appliquer une décote sur la valeur de l’emprunt repris. Ce choix de règles à définir pourrait conduire à des contestations sur l’équité de l’assistance ainsi offerte.
b) La déresponsabilisation des emprunteurs
La libre administration des collectivités territoriales, principe constitutionnel, va de pair avec une responsabilité des acteurs locaux dans les choix faits, et notamment la stratégie d’endettement suivie.
En l’absence de codécision dans les choix effectués, l’État ne peut être présumé garant des engagements souscrits par les collectivités territoriales, sur lesquelles il n’exerce pas de tutelle.
Dans un tel schéma, l’absence ou les faibles pertes supportées par les collectivités auraient pour conséquence l’impunité alors que la prise de risque est avérée, ce qui pourrait être vu comme une incitation à continuer de prendre des risques en matière de gestion financière, dont les conséquences seraient assumées en fin de compte par le contribuable national.
Plus généralement, l’aide ainsi apportée aux collectivités bénéficiaires de la structure serait de nature à créer un précédent qui pourrait ensuite être exploité pour justifier l’intervention de l’État dans d’autres cas où les collectivités ont pris des risques importants.
En tout état de cause, il apparaît logique que les collectivités territoriales qui ont souhaité exercer leur liberté de choix parmi les solutions de financement à leur disposition assument les conséquences des choix individuels qu’elles ont faits dans ce domaine.
Dans l’esprit de votre commission d’enquête, il appartient aux responsables – établissements bancaires ayant commercialisé ces produits et acteurs locaux concernés – de trouver et de financer une solution pérenne, sous l’égide et avec l’apport d’une action volontariste de l’État.
2.– Le regroupement des acteurs publics locaux pour négocier avec leurs créanciers
a) Un pôle d’assistance et de transaction s’appuyant sur les moyens des services de l’État
La commission d’enquête a examiné, dans la deuxième partie du présent rapport, les responsabilités de chacun des acteurs de la crise des emprunts toxiques. La sortie de cette situation ne pourra se faire que par un effort des banques, des acteurs locaux et de l’État pour apurer l’encours existant des emprunts structurés porteurs de risques avérés ou susceptibles de se révéler dans un terme proche.
En outre, elle juge qu’une solution fondée sur un traitement des problèmes des collectivités et établissements publics les plus en difficulté, laissant la majorité des personnes publiques concernées seules face aux banques, ne serait ni productive, ni égalitaire, ni responsabilisante vis-à-vis des risques pris au nom des acteurs publics par leurs responsables présents ou passés.
C’est pourquoi elle a souhaité privilégier une approche par produit structuré à une approche par collectivité ou établissement public touché. Il s’agit moins de proposer une solution à des victimes que de gérer l’apurement définitif des emprunts structurés. La commission d’enquête souhaite tout d’abord promouvoir une démarche contractuelle et volontaire, avant d’envisager de remettre en cause l’économie des contrats de prêts existants.
● Dans un premier temps, il semble nécessaire d’achever le plus rapidement possible, et avant la date de juin 2012 indiquée à la commission d’enquête (165), l’identification et le recensement de l’ensemble des prêts structurés souscrits par les acteurs locaux. Dans chaque collectivité ou établissement public, les résultats de ce recensement, et la structure de l’endettement, devront faire l’objet d’un débat dans les assemblées délibérantes, afin de leur permettre d’être informées et de les mettre à même de prendre position sur les solutions éventuelles.
Dans le même temps, la commission d’enquête propose que soit mise en place par l’État une structure ad hoc temporaire, pôle d’assistance et de transaction regroupant des représentants de la direction générale des collectivités locales, de la direction générale des finances publiques et de la direction générale du Trésor. Des représentants des collectivités territoriales, par l’intermédiaire des associations représentatives, ainsi que des membres du Parlement seraient associés aux travaux du pôle. Ne comportant pas de personnalité juridique, cette structure pourrait commencer à fonctionner sans devoir être mise en place par la loi.
● Dans un deuxième temps, les collectivités et établissements publics volontaires seront invités à donner à ce pôle un mandat de gestion des emprunts structurés s’étant révélés toxiques ou pouvant présenter des risques sous-jacents. Le pôle d’assistance et de transaction pourra ainsi engager en leur nom un processus de renégociation de chacune des gammes de produits structurés avec les banquiers les ayant commercialisés. Cette possibilité sera ouverte pendant une durée limitée, de l’ordre de six mois, afin que la structure dispose rapidement des données relatives aux emprunts dont elle aura en charge la renégociation.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités, cette participation ne pourra se faire que de façon volontaire. Cependant, afin que les élus locaux soient mis en face de leur responsabilité, le premier débat sur la politique d’endettement devra faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante sur l’opportunité de confier ou non au pôle les emprunts structurés présents dans le portefeuille de la collectivité territoriale. L’attention de la commission d’enquête a en effet été attirée sur le fait que certaines catégories d’emprunts structurés, dont notamment les produits assis sur le différentiel entre taux courts et taux longs, ne faisaient pas volontairement l’objet de renégociation, alors que les risques – encore hypothétiques – permettraient d’envisager une transformation en emprunt classique à moindre coût, si les collectivités concernées acceptaient un taux plus élevé. C’est bien avant que le risque soit avéré qu’il conviendrait de mettre fin à ces risques sous-jacents.
Les emprunts que les acteurs publics locaux choisiraient de ne pas confier au pôle d’assistance et de transaction devraient naturellement faire l’objet d’un provisionnement à hauteur des risques pris, pour les exercices futurs. Par contre, il pourrait être prévu, par voie de circulaire, que les emprunts pour lesquels un mandat a été donné n’auraient pas à être provisionnés pendant cette phase de renégociation, le risque afférent étant en voie de résorption.
● Dans un troisième temps, disposant d’un mandat couvrant une masse critique de ces emprunts, le pôle pourrait engager un processus de négociation plus équilibré avec les banques, afin de trouver une formule permettant de convertir chaque type de prêt structuré en prêt classique, à taux fixe ou à taux variable.
Avec l’appui de l’État, il semble possible à la commission d’enquête d’aboutir, pour chaque catégorie de produits, à un accord équilibré portant transaction entre les acteurs publics et les établissements prêteurs, afin de transformer les produits structurés présentant des risques sous-jacents en produits d’emprunt classiques, les banques reprenant la gestion des risques qu’elles ont fait souscrire aux acteurs publics.
Ainsi, la Caisse des dépôts estime-t-elle que le coût de la transformation du quart le plus toxique du portefeuille de prêts actuellement détenus par Dexia en des emprunts à taux fixe, au cours actuel du marché, nécessiterait le partage d’une soulte de l’ordre de 1 milliard d’euros (166).
Pour chaque catégorie de produits structurés, l’accord global de transaction devra ainsi déboucher sur la conclusion de nouveaux contrats respectant les principes suivants :
— les éventuels gains obtenus en terme de charge d’intérêt par la personne publique du fait des taux d’intérêts bonifiés devront être réintégrés dans le bilan des charges financières dues par ces collectivités ;
— les nouveaux contrats de prêt, à taux fixe ou à taux variable, consacreront le portage par les banques de la partie toxique des emprunts ;
— la charge d’intérêt supérieure à celle correspondant au coût d’un emprunt à taux fixe ou variable conclu aux conditions de marché à la date de souscription de l’emprunt à renégocier, devra faire l’objet d’un effort financier réciproque, les personnes publiques ayant souscrit ces emprunts étant amenées à participer à la compensation du coût du portage du risque désormais repris par l’établissement prêteur.
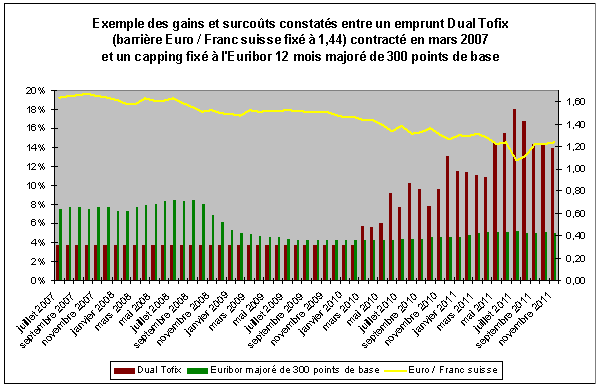
En quelque sorte, chacun des cocontractants sera ainsi amené à assumer une partie de la charge financière, à due proportion des responsabilités décrites par la commission d’enquête.
Cependant, chacune des deux parties devrait ainsi trouver un bénéfice à cette renégociation :
– les personnes publiques pourront résorber une partie de leur encours de prêts à risque. Cependant, l’accord nécessitera que les collectivités et établissements publics concernés renoncent aux gains financiers que les emprunts leur ont permis de faire dans le passé, et consentent un effort budgétaire et fiscal pour la période à venir ;
– les établissements bancaires devront assumer la gestion du risque sous-jacent en terme de charges d’intérêt. Les contrats existants repris par les banques pourront être soit renégociés sur le marché interbancaire (par débouclage des contrats existants) soit conservés par celles qui souhaiteraient conserver le risque en leur nom propre. Elles pourront ainsi choisir le moment où elles se déferont du produit sur le marché, cette gestion pouvant à terme se révéler fructueuse si on assistait à un retournement de cycle faisant retomber le taux d’intérêt à un bas niveau. Cependant, l’effort demandé aux établissements bancaires aura pour corollaire l’élimination de deux risques nécessitant d’être provisionnés : le risque juridique que la validité de certains contrats pourrait leur faire courir (167), ainsi que les risques de défaut de certains débiteurs dont les marges de manœuvre fiscales ne permettront pas de faire face à l’envolée des intérêts. Le remboursement du principal et des intérêts, tels que déterminés par le nouveau contrat de prêt, lui sera ainsi garanti.
Au total, le coût réel pour les deux parties serait lissé sur toute la durée résiduelle du prêt : pour les personnes publiques, par un taux d’intérêt supérieur à ce qu’elles pensaient devoir payer ; pour les établissements prêteurs, par une gestion de la partie toxique des intérêts des prêts repris, pour laquelle elles disposent des capacités de gestion indispensables.
Pour certains produits dont la valeur actuelle « mark to market » ne permet pas d’envisager une solution de sortie à un coût supportable, le pôle pourrait, par un mécanisme d’appel d’offres, chercher à trouver des contreparties, liquider les positions qui peuvent l’être et éventuellement coter les produits susceptibles d’être laissés en portefeuille.
● À l’issue de ce processus de renégociation, et après examen par les services de l’État, il serait possible, au cas par cas, d’envisager une subvention d’équilibre de l’État (168) afin de permettre le rétablissement du budget des plus petites collectivités, dans le cas où elles ne pourraient assumer l’effort financier et fiscal susceptible de rétablir des conditions d’endettement plus sûres pour l’avenir.
● Enfin, s’il semblait impossible d’obtenir un effort substantiel des établissements prêteurs pour trouver une sortie raisonnable aux contrats de prêts structurés en cours, le législateur pourrait alors envisager de remettre en cause l’équilibre contractuel des emprunts existants, en prévoyant que les charges d’intérêt des contrats de prêts souscrits par les collectivités territoriales ne peuvent dépasser celles qui résulteraient de l’application d’un taux déterminé, tel que le taux d’usure, à la date d’exigibilité de leur versement. Le Conseil constitutionnel a ainsi admis, dans une jurisprudence sans cesse précisée, que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle ne s’opposait pas à ce que le législateur remette en cause l’économie de contrats légalement conclus pour « un motif d’intérêt général suffisant » (169).
À titre d’information, au troisième trimestre 2011, le seuil de l’usure était établi à 5,52 % pour un prêt à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans, et 6,36 % pour un prêt à taux fixe, s’agissant de prêts aux personnes morales n’ayant pas une activité industrielle ou commerciale. Les taux effectifs moyens correspondants, tels que déterminés par la Banque de France par enquête auprès des établissements prêteurs, étaient respectivement fixés à 4,14 % et 4,77 %. (170).
b) Le recentrage du rôle de la médiation sur les produits atypiques ou fortement toxiques
La mission confiée par le Gouvernement à M. Éric Gissler depuis novembre 2008 a permis de mettre en place un cadre contractuel et de favoriser l’issue d’un certain nombre de négociations entre collectivités et banques (171). Cependant, les 102 dossiers de prêt sur lesquels a pu porter sa médiation restent un résultat faible face à l’encours de 10 690 prêts structurés recensés par la commission d’enquête.
La commission estime donc préférable de passer d’une approche particulière à une solution groupée, et d’un rôle de médiation exercé par l’État à un rôle de mandataire de renégociation. Il apparaît cependant que cette voie d’apurement des emprunts toxiques ne sera utile que pour les produits ayant fait l’objet d’une large distribution.
C’est pourquoi le rôle de la médiation pourrait être recentré sur les produits les plus atypiques, présentant un caractère de dangerosité plus avéré, tels que les produits avec des effets de structure cumulatifs (« snowballs »).
Par ailleurs, le recours au pôle d’assistance et de transaction n’étant pas obligatoire, il resterait possible, pour les collectivités qui le souhaitent, de recourir au médiateur. Une fois les principes de la transaction arrêtée sous l’égide du pôle, il sera par la suite plus facile aux collectivités et personnes publiques restées en dehors de la procédure de transaction de mettre en place un accord de transformation, fondé sur les mêmes bases de transaction financière. Cet effet d’entraînement ne pourra que renforcer la démarche engagée permettant d’apurer les produits structurés à risque, tout en garantissant le libre choix de leur stratégie d’endettement aux collectivités territoriales et acteurs publics.
La commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux s’est réunie le mercredi 30 novembre 2011 à 17 heures, sous la présidence de M. Claude Bartolone, pour examiner le rapport d’enquête de M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur.
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, notre commission a été créée le 8 juin 2011, et son existence juridique prendra fin le 8 décembre. Nous voici donc arrivés au terme de nos travaux.
Nous avons tenu 23 auditions, deux débats d'orientation, entendu 80 personnes. Les auditions ont été souvent passionnantes et fort animées vu l’importance des enjeux pour les élus que nous sommes.
Notre rapporteur, M. Jean-Pierre Gorges, a élaboré un projet de rapport. Nous allons aujourd’hui entendre son diagnostic, et prendre connaissance de ses propositions, qui porteront à la fois sur la gestion du stock des emprunts à risque et sur les mesures qui devraient être adoptées à l’avenir pour éviter que de tels errements ne se reproduisent.
Avant de lui donner la parole, je vous informe que le projet de rapport sera mis, comme c'est la règle, en consultation dans les bureaux de la commission des finances pour les membres de la commission d'enquête uniquement. La consultation prendra fin le mardi 6 décembre à 16 heures.
Nous nous réunirons enfin une dernière fois, ce même mardi 6 décembre à 17 heures pour nous prononcer sur le projet de rapport. S’il est adopté, il fera l’objet d’un dépôt au journal officiel et, sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret, il sera imprimé et distribué.
M. Gorges et moi-même prévoyons une conférence de presse le 15 décembre à 12 heures. Naturellement, les collègues qui souhaiteront se joindre à nous seront les bienvenus dans la salle des conférences de presse. D'ici là, les textes prévoient que le rapport demeure confidentiel.
La parole est maintenant à M. Jean-Pierre Gorges.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Au cours des six mois écoulés, j’ai beaucoup travaillé avec le secrétariat de la commission d’enquête afin de rassembler un maximum d’éléments objectifs et quantifiables. En ma qualité de Rapporteur, j’ai obtenu copie d’une demi-douzaine de rapports confidentiels de l’Inspection générale des finances et de l’ancienne Commission bancaire. J’ai également obtenu que les sept établissements de crédit actifs sur le marché des prêts au secteur local lèvent le secret bancaire : j’ai pu me faire communiquer les montants et les caractéristiques des 10 690 contrats de prêts souscrits par des acteurs publics locaux.
J’en viens aux grandes lignes de mon rapport.
La première partie du rapport est consacrée à la description des emprunts et des swaps structurés, avec des exemples précis des formules utilisées. Ces éléments sont désormais bien connus des membres de la commission, aussi je vous propose de nous concentrer sur l’état des lieux.
L’encours total des prêts structurés souscrits atteint 32,125 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs publics locaux (communes, EPCI et syndicats, départements, régions, établissements publics de santé et organismes du logement social). Toutefois cet encours doit être rapporté au volume global d’endettement des mêmes acteurs, qui atteignait 276,8 milliards d’euros fin 2010. Si l’on retient un périmètre plus restreint, limité aux collectivités territoriales, l’encours total atteint encore 23,323 milliards d’euros.
Au sein des emprunts structurés, l’encours à risque est évalué à 18,807 milliards d’euros pour l’ensemble des acteurs publics locaux, soit 58,6 % du total. Même au niveau des seules collectivités territoriales, cet encours à risque représente 13,648 milliards d’euros, ce qui dépasse l’estimation avancée en juillet par la Cour des comptes. En toute logique, il faut ajouter le notionnel jugé à risque des swaps structurés, soit 2,530 milliards d’euros (38,6 % du total).
Les petites communes de moins de 10 000 habitants ne sont pas épargnées puisqu’elles ont souscrit pour 3,049 milliards d’euros d’emprunts structurés, aujourd’hui considérés comme risqués à hauteur de 56 %. Cela confirme l’impression que nous avions retirée de l’audition des maires de Trégastel et Sassenage, notamment.
Pour le portefeuille clientèle du seul Dexia :
– 1 595 petites communes sont concernées sur 2 229 communes clientes du groupe et 3 575 clients toutes catégories confondues ;
– 2,18 milliards d’euros d’emprunts structurés ont été souscrits, dont 1,44 milliard à risque soit 66,1 % alors que la moyenne est de 56 % toutes banques confondues.
J’affirme donc que, contrairement à ce qu’ont avancé les anciens responsables de Dexia lors de leur audition, les petites communes ont fait l’objet d’un démarchage intensif. On est passé de la confection de produits sur-mesure pour les grandes collectivités, à une phase d’industrialisation et de commercialisation sans discernement.
Ce cas n’est pas isolé : les mêmes communes représentent 577 millions d’euros chez BPCE et 250 millions d’euros au Crédit agricole CIB, mais les structures qui leur ont été vendues étaient nettement moins risquées.
La deuxième partie du rapport montre que les responsabilités ont été partagées entre les élus qui ont souvent manqué de vigilance ou ne disposaient pas des compétences nécessaires pour comprendre les risques sous-jacents aux emprunts qu’ils contractaient, les banques qui ont développé une politique commerciale systématique et très agressive, souvent trompeuse, et enfin, le troisième responsable, l’État, avec un contrôle limité localement et une certaine myopie de l’administration centrale face aux alertes qui apparaissaient ici ou là.
Les élus ont parfois manqué de vigilance. Les exécutifs locaux n'ont pas toujours souscrit des emprunts structurés en connaissance de cause. De plus, certaines collectivités qui ont contracté se trouvaient déjà dans une situation de vulnérabilité financière. Compte tenu du niveau de leur endettement et de leurs charges financières, elles n’ont pas pu recourir à des emprunts classiques, dont la charge aurait été trop lourde.
Il me semble que les élus ont presque toujours été de bonne foi, et qu’il n’y a eu aucune malversation : les capacités de financement dégagées ont été utilisées dans le sens du service public, selon la politique de gestion choisie pour la collectivité. Les financements ainsi obtenus ont pu contribuer à de grands projets structurants (réaménagement urbain, reconversion des friches industrielles par exemple à Saint Étienne) en lissant le financement de projets de long terme. Dans les petites communes, les prêts structurés ont permis d’investir dans des travaux de réfection de la voirie ou de bâtiments communaux. Le recours aux produits structurés a pu s’accompagner d’une réduction de l’endettement global et d’une amélioration de la capacité d’autofinancement.
Les exécutifs locaux n’ont pas su prendre la mesure des risques induits par ce type de produit, pour plusieurs raisons qui sont économiques d’abord, liées à l’asymétrie d’information entre la banque et son client ensuite, et enfin institutionnelles : ni les assemblées délibérantes, ni l’opposition (faute d’information assez complète), ni les services de l’État n’ont su éclairer la décision des élus ; le contrôle et le conseil, internes comme externes, ont été défaillants.
La faiblesse de l’information contenue dans les annexes budgétaires a rendu inopérant le pouvoir de contrôle des assemblées délibérantes : ces annexes ne rendaient compte que de l’évolution de l’endettement, et non de sa structure.
Le rapport examine aussi le rôle joué par les cabinets de conseil aux collectivités qui a été ambigu.
La politique commerciale des établissements bancaires a été systématique et agressive. Le rapport décrit le contexte très concurrentiel qui a conduit les banques, dans les années 2000, à prêter largement en dessous du coût de la ressource financière. Comme elles ne pouvaient plus se rémunérer sur les produits classiques, les banques ont dû imaginer d’autres moyens de reconstituer leurs marges commerciales. C’est ainsi qu’elles ont proposé des produits plus sophistiqués à marge commerciale plus élevée, marge totalement indécelable par le client qui ne pouvait plus comparer les offres des concurrents. Les banques ont adopté une politique commerciale offensive, demandant à leurs commerciaux de proposer aux emprunteurs des restructurations : dans certains cas, les commerciaux ont démarché la collectivité pour « renégocier » la dette tous les deux ans, en majorant les marges à chaque fois.
L’étendue de la responsabilité des banques est actuellement en jeu devant les tribunaux. Environ quinze collectivités ont annoncé avoir saisi les tribunaux pour obtenir l’annulation du contrat de prêt. Plusieurs dizaines de collectivités se trouvent également dans une phase précontentieuse, ayant confié leur dossier à un conseil. Le rapport analyse les chefs de responsabilité qui sont invoqués, comme l’obligation de conseil et d’information, et l’obligation de mise en garde qui suppose que le banquier attire l’attention de son client sur les dangers potentiels d’une opération donnée.
Les mesures qui ont été prises sont d’ampleur limitée. La charte Gissler représente une avancée, mais elle est encore insuffisante. La médiation instituée par le Gouvernement porte sur un nombre de dossiers assez faible. La médiation a été demandée pour 102 dossiers au total : les renégociations définitives réalisées sont au nombre de 12 auxquelles il faut ajouter 13 solutions temporaires.
Je sais par ailleurs que beaucoup d’élus locaux attendent les résultats des travaux de notre commission d’enquête, avant d’entamer toute démarche.
Le contrôle des services de l’État a été trop limité sur le terrain et peu vigilant en administration centrale. Le contrôle de légalité, réalisé par le préfet, n’a pas permis d’identifier les risques associés aux produits structurés. Les services préfectoraux n’avaient pas reçu d’instruction particulière en matière de produits structurés de la part de l’administration centrale. Les personnels n’avaient généralement pas la formation nécessaire pour traiter d’enjeux financiers d’une telle complexité. Enfin, les services préfectoraux n’ont que trop rarement été alertés par les assemblées délibérantes.
Le contrôle de régularité des opérations budgétaires et comptables, exercé par le comptable public, présentait des insuffisances, notamment à cause du fait que les conventions d’emprunt ne figurent pas dans les pièces justificatives devant être transmises aux comptables publics. Ceux-ci ne bénéficiaient d’aucune instruction spécifique quant aux produits structurés et ne pratiquaient que peu la mutualisation de leurs informations : ces instructions ne sont venues qu’en 2008. Les agents ne pouvaient donc que s’appuyer que sur la circulaire de 1992, mais celle-ci ne concerne que les swaps.
Pourtant, les juridictions financières ont joué leur rôle d’alerte à plusieurs reprises sur les risques associés des produits structurés. Mais il semble que l’administration n’a guère tenu compte de ces alertes.
La troisième et dernière partie du rapport – sans doute, la plus attendue – est consacrée aux propositions.
Le financement des collectivités territoriales doit être une priorité nationale. Or comme nous avons pu le constater, l’insuffisante liquidité du marché du crédit pèse sur les collectivités. Les tours de table sont aujourd’hui plus difficiles à boucler pour les acteurs locaux. En partie du fait de l’absence de marge, mais surtout parce que les règles prudentielles de « Bâle III » vont leur imposer d’avoir beaucoup plus de ressources liquides, des clients n’effectuant pas de dépôts sont aujourd’hui moins intéressants. Face à la raréfaction de l’offre bancaire, l’ajustement se fait par les prix. Les émissions obligataires apparaissent comme une solution d’avenir, mais elles ne sont aujourd’hui accessibles qu’aux grandes collectivités : elles ne représentent que 5,6 milliards d’euros, levés essentiellement par les régions et les communautés urbaines.
La puissance publique doit s’impliquer davantage. Avec Dexia, un acteur majeur du crédit au secteur local disparaît. Dexia Municipal Agency, qui assure le financement des collectivités territoriales françaises, aujourd’hui filiale à 100 % de Dexia, serait cédée à la Caisse des dépôts, pour 65 % de son capital, et à la Banque postale pour 5 %. L’encours de prêts structurés sera repris avec une garantie de l’État. Mais la nouvelle structure commerciale ne sera opérationnelle qu’en juin 2012.
Au-delà des fonds débloqués par la Caisse des dépôts, les incertitudes sont nombreuses. La création d’une agence de financement des collectivités territoriales est une piste intéressante, mais sa mise en place est conditionnée par la résolution de plusieurs questions relatives à ses modalités de création et de fonctionnement. Elle ne pourra pas être opérationnelle à court terme pour pallier le manque de financement aux collectivités.
Les dérives passées rendent nécessaire de mettre en place, pour l’avenir, un encadrement strict des modalités d’endettement des collectivités.
Comme la gestion des deniers publics ne peut être une question de spéculation, je vous propose de mettre en place un cadre législatif précisant les produits financiers accessibles aux acteurs publics, adaptés à leurs moyens de fonctionnement, comprenant :
– l’interdiction pure et simple des produits structurés ou dérivés pour les petites collectivités et les petits établissements publics : il paraît nécessaire de limiter les possibilités d’emprunts des communes de moins de 10 000 habitants, comme des établissements publics de moins de 20 000 habitants, aux produits à taux fixe ou à taux variable indexés sur un indice de la zone euro.
– l’interdiction des produits structurés ou dérivés avec multiplicateur pour l’ensemble des collectivités territoriales : l’engagement des finances locales ne peut se faire qu’en poursuivant un intérêt général présentant un caractère local. La charte Gissler a permis de mettre en place une première échelle d’appréciation des risques pris par les acteurs locaux les ayant souscrits. Les produits à effet de levier, classés parmi les produits les plus risqués, présentent donc un caractère spéculatif qui n’apparaît pas compatible avec une utilisation des deniers publics à des fins d’intérêt général.
– la mise en place d’un capping global pour tous les prêts aux collectivités territoriales, aux hôpitaux ou aux organismes du logement social. Aussi les futurs contrats d’emprunt devraient être obligatoirement assortis d’un taux maximal ou capping, défini de façon évolutive, de façon à prendre en compte l’évolution des conditions de marché.
S’il faut réglementer le marché des prêts, il convient aussi de renforcer l’information des élus et responsables sur les caractéristiques de l’endettement par une adaptation du cadre budgétaire et comptable. Il est en outre nécessaire d’assurer la sincérité de l’équilibre réel du budget des collectivités territoriales. C’est pourquoi je propose de prévoir l’inscription dans la loi des principes suivants :
– l’obligation d’un débat sur la dette dans les assemblées délibérantes, pouvant être articulé avec le débat sur les orientations générales du budget ;
– l’introduction de nouvelles annexes au compte administratif, permettant aux assemblées délibérantes comme aux citoyens de connaître précisément la structure de la dette des collectivités territoriales. Cette amélioration de l’information et de la transparence a été commencée avec la réforme des instructions comptables intervenues le 16 décembre 2010 ;
– l’obligation de provisionner les risques pris, à un niveau représentatif des risques de charges financières supplémentaires souscrites. Ce provisionnement pourrait être déterminé par référence à la valeur de marché des produits souscrits, ou par rapport à un taux de marché normal. Ainsi, les produits présentant une période bonifiée tout en cachant des risques sous-jacents devraient perdre leur intérêt pour les emprunteurs.
Dans le même esprit, je vous propose de renforcer l’encadrement juridique pour faire respecter ces règles, en prévoyant l’application du contrôle de légalité aux contrats de prêt, même s’ils relèvent du droit privé, sans pour autant les soumettre au code des marchés publics.
L’information du Parlement devrait être renforcée par deux moyens : un rapport annuel sur la dette locale, présentant des données complètes et agrégées, dont le principe a déjà été esquissé dans le projet de loi de finances pour 2012 ; un renforcement des prérogatives des commissions d’enquête parlementaires à l’égard des établissements de crédit, en prévoyant explicitement que le secret bancaire ne leur est pas opposable, comme c’est déjà le cas pour les autorités de supervision et les agences de notation.
Enfin, le sujet majeur de nos travaux est bien la solution à proposer pour traiter le stock existant d’emprunts toxiques. Pour cela, l’État pourrait jouer un rôle moteur pour assurer une renégociation des produits toxiques, sans défaisance.
Nous avons écarté la création d’une structure de défaisance, pour deux raisons : le coût de la capitalisation d’une structure de gestion de passifs qui serait prohibitif et le risque de favoriser la déresponsabilisation des emprunteurs. Cette solution pourrait être vue comme une incitation à continuer de prendre des risques en matière de gestion financière, dont les conséquences seraient assumées en fin de compte par le contribuable national.
Aussi la solution proposée repose-t-elle sur un regroupement des acteurs publics locaux pour négocier avec leurs créanciers, non plus collectivité par collectivité, mais produit par produit. Un pôle d’assistance et de transaction, s’appuyant sur les moyens des services de l’État, serait mis en place. Les collectivités et établissements publics volontaires seront invités à donner à ce pôle un mandat de gestion des emprunts structurés.
Le pôle pourra ainsi engager en leur nom un processus de renégociation de chacune des gammes de produits structurés avec les banquiers les ayant commercialisés. Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités, cette participation ne pourra se faire que de façon volontaire.
La négociation aura pour objectif de convertir chaque type de prêt structuré en prêt classique, à taux fixe ou à taux variable. On obtiendrait, il faut l’espérer, un accord banque par banque, produit par produit. Cela imposera la répartition de l’effort financier entre la collectivité et l’établissement prêteur, en déduisant les éventuels gains obtenus en terme de charge d’intérêt du fait des taux d’intérêts bonifiés de la première période de l’emprunt. À l’issue de ce processus de renégociation, et après examen par les services de l’État, il serait possible, au cas par cas, d’envisager une subvention d’équilibre afin de permettre le rétablissement du budget des plus petites collectivités, dans le cas où elles ne pourraient assumer l’effort financier et fiscal susceptible de rétablir des conditions d’endettement plus sûres pour l’avenir.
Le rôle de la médiation Gissler pourrait être recentré sur les produits atypiques ou fortement toxiques, présentant un caractère de dangerosité plus avéré, tels que les produits avec des effets de structure cumulatifs de type « snowball ».
M. le président. Au nom de ses membres, j’aimerais remercier le rapporteur et le secrétariat de la commission d’enquête pour le travail fourni. Le constat et les propositions me paraissent solides.
M. Bernard Derosier. La première partie du rapport que nous a présenté notre rapporteur m’apparaît comme l’exact reflet de ce que nous avons entendu. N’étant pas concerné directement par les emprunts toxiques, je peux rappeler que nos propositions doivent se situer au-delà de ces clivages, et respecter les principes d’autonomie et de responsabilité, fondateurs de la décentralisation. C’est au cadre légal de protéger les collectivités locales et leurs élus.
Parmi les propositions, il me semble qu’il convient de mettre en place un cadre légal interdisant aux banques de proposer des emprunts structurés pour les petites communes et pour les petits EPCI. Il serait plus juste de formuler l’interdiction aux banques de proposer des emprunts avec multiplicateur, plutôt que de limiter la capacité d’appréciation laissée aux assemblées délibérantes.
Par ailleurs, depuis 1982, le concept de contrôle de légalité m’a toujours irrité. Je ne suis pas contre le contrôle du respect des lois, mais il ne convient pas de donner trop de moyens à ce pouvoir préfectoral. Il lui est ainsi tout à fait loisible de demander copie des contrats en annexe des délibérations transmises.
Enfin, la présentation exonère un peu trop l’État. Les chambres régionales des comptes, les trésoriers généraux payeurs ont aussi eu leur part de responsabilité. C’est pourquoi l’État doit aussi remplir sa mission de solidarité, en prenant une part plus importante dans la résolution des difficultés.
M. Henri Plagnol. Je voudrais souligner l’excellence du travail réalisé. Mes observations rejoignent celle de M. Derosier ; il n’y a donc pas de clivage partisan. Mais, il me semble que cette présentation va un peu trop loin dans les obligations de provision que l’on impose aux collectivités territoriales : l’obligation de provisionnement, qui risque d’achever de freiner la capacité d’investissement des collectivités locales, ne me semble pas opportune pour elles ou bien elle doit être minimale ; si on l’aborde, le ministère des Finances et les juridictions financières vont rendre les obligations de provision très contraignantes.
Quant au contrôle de légalité, il n’est pas adapté aux contrats de prêt. On pourrait plutôt prévoir qu’une copie du contrat soit envoyée au trésorier-payeur général qui respectera la confidentialité.
Les émissions obligataires devraient être encouragées par notre rapport, notamment pour les collectivités moins importantes, par un soutien à la proposition de loi qui a été déposée.
La responsabilité des banques devrait être qualifiée, dans le corps du rapport, par l’emploi des termes « usuraire » et « spéculatif » pour qualifier leurs pratiques. Le montage de résorption est intéressant, mais manque de précision sur la structure de portage. Sans aller vers une structure de défaisance, la structure de portage devrait garantir les conditions des prêts, notamment grâce à un adossement à la Caisse des dépôts.
M. Dominique Baert. Mes observations vont rejoindre celles de M. Plagnol. Ce rapport marquera une étape de la réflexion, et un document de référence. Mais il ne sera qu’un rapport d’étape ; il conviendrait qu’une évaluation soit prévue, après les prochaines échéances électorales.
L’obligation de provisionnement des risques pris est une idée qui circule depuis un certain temps, mais qui soulève de nombreuses questions, sur la définition des risques à provisionner, et sur le montant de ces provisions. S’il s’agit de provisionner à hauteur du « mark to market », cela va au-delà de la capacité des collectivités territoriales. Les chambres régionales des comptes elles-mêmes sont incapables actuellement de définir ce risque pris. Par ailleurs, ces provisions conduiront à dégager des ressources, qui seront déposées sur les comptes des correspondants du Trésor, au bénéfice de la dette de l’État. Il convient de mieux encadrer cette proposition.
Cette présentation ne souligne pas assez la responsabilité des établissements bancaires, et de certains d’entre eux en particulier. Les produits structurés et les swaps des banques étrangères sont parfois plus toxiques que ceux proposés par Dexia. Le terme de « dol » devrait être présent dans le corps du rapport, car c’est sur ce fondement que de nombreuses collectivités ont assigné les banques.
Il ne faudrait pas non plus oublier la responsabilité des agences de notation pour les collectivités qui disposaient d’une notation. Les agences de notation encourageaient à la gestion active de la dette pour la modération des charges financières.
J’étais favorable à la mise en place d’un capping ; reste la question clé du montant des soultes à payer lors de la renégociation des prêts. Il ne faut pas idéaliser les résultats à attendre de la négociation ; la menace de l’intervention législative doit toujours être présente.
M. Louis Giscard d’Estaing. À mon tour, je voudrais souligner combien les travaux de cette commission d’enquête ont été intéressants et utiles. Aussi, la présentation par le rapporteur de ses conclusions correspond à ce que l’on pouvait espérer, c’est-à-dire, d’une part, un diagnostic parfaitement partagé des tenants et aboutissants de la situation qui a conduit à ces emprunts toxiques et, d’autre part, des préconisations pour remédier à ce qui a été constaté. En félicitant le rapporteur Jean-Pierre Gorges, un collègue parfaitement pertinent dans son travail, je souhaiterais d’abord aborder la question de l’autonomie des collectivités locales.
À ce sujet, nous sommes dans l’ambiguïté entre leur responsabilité, dans le cadre de l’autonomie des collectivités locales, et la solidarité de l’État. Concernant les décisions prises par celles-ci, le contrôle de l’État n’existe qu’a posteriori, et si les trésoriers constatent éventuellement le stock de dette, ils ne rentrent pas dans le détail. Dans une collectivité, comme celle dont j’ai la responsabilité municipale depuis cinq ans maintenant, nous avions un crédit-bail à taux fixe à 9,70 % souscrit en 1992 sur vingt ans et qui se terminera l’année prochaine. Un crédit-bail de cette nature est un poids terrible. Pourtant, il est inscrit hors dette car il ne fait pas partie des engagements du stock de dette. Sur ce plan-là, l’analyse qui nous est faite par les services de la trésorerie ne comporte pas cet aspect qualitatif de la nature des risques financiers pour la collectivité.
Deuxième remarque sur l’excellent principe de solidarité financière équilibrée proposé par Jean-Pierre Gorges : on met dans un même pot commun les gains constatés par rapport à des taux fixes et les pertes éventuelles pour faire en sorte qu’il n’y ait pas, d’une part, des gagnants à court terme, notamment dans la période précédant les échéances municipales, et d’autre part, des perdants qui aujourd’hui se tourneraient vers la responsabilité de l’État qui n’était pas partie prenante dans la décision initiale de souscription.
Troisième point, le contrôle de légalité n’a pas la capacité d’intervenir si ce n’est a posteriori et encore faudrait-il que ces contrats soient déclarés illicites ou illégaux. Les chambres régionales des comptes (CRC) exercent aussi un contrôle a posteriori. Dernière évocation, le rôle de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) qui a succédé à la Commission bancaire. Nous avons auditionné, ce matin, la secrétaire générale de l’ACP qui a évoqué la création d’un pôle commun ACP-AMF visant à contrôler les pratiques commerciales des établissements bancaires et financiers. Ce contrôle commun devrait vérifier que les pratiques commerciales de distribution de certains produits et de certains contrats soient autorisées par ces deux autorités.
M. Charles de La Verpillière. Je m’associe aux félicitations qui ont été adressées à notre rapporteur et à tous ceux qui l’ont aidé. Je reviens très rapidement sur deux points. L’idée de la renégociation mutualisée est excellente : il faut bien être conscient qu’elle n’aura des chances d’aboutir qu’avec les banques qui ont encore des perspectives et des espoirs de commercialiser des prêts aux collectivités territoriales et donc seront incitées à faire des gestes ; en revanche, ce sera peut-être plus dur avec Dexia qui n’a plus rien à perdre. Par ailleurs, l’idée d’une loi qui menacerait de caper a posteriori les contrats poserait un problème de constitutionalité au nom du principe de liberté contractuelle. Cela pourrait donner lieu à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
M. Patrice Calméjane. Ce type de commission représente bien un parlement moderne : par la transparence avec laquelle on peut travailler avec l’ensemble des collègues quelles que soient les étiquettes politiques, par les auditions et la clarté des questions qu’on a pu poser et bien entendu par le travail qui a pu être fait avec les personnels de l’Assemblée nationale. Pour revenir à notre sujet, je trouve que nous sommes aimables avec les personnes qui ont prêté serment et qui nous ont juré ne pas avoir vendu ce type de produits aux petites collectivités. Nous avons aussi auditionné des élus qui nous ont dit qu’ils n’en avaient pas pris. Il faut rappeler que des personnes ont prêté serment et nous ont raconté des histoires devant cette commission. Constatant ces mensonges, nous pourrions bénéficier d’un rapport de force favorable pour aider les collectivités qui ont un réel problème. Par ailleurs, ce sujet montre, premièrement, que nous touchons les limites des lois de décentralisation : nous voyons que revendiquer une extrême liberté de gestion peut entraîner des risques importants pour certaines collectivités. Aussi, alors que certains politiques ont sciemment fait des opérations d’embellissement de bilans ou de budgets à l’approche d’échéances électorales, il n’y a pas de sanctions, autres que démocratiques. Deuxièmement, il est vrai qu’il n’y a pas eu de contrôle des services comptables ou autres de l’État. En effet, les chambres régionales des comptes ou les comptables publics ne pouvaient exercer leur rôle de contrôle étant donné que la nature des produits concernés ne correspondait pas aux nomenclatures comptables des collectivités.
Enfin, je suis d’accord avec les mécanismes proposés par le rapporteur. Par contre, il y a un bémol concernant le nécessaire retournement de situation sur un certain nombre de produits. Je voudrais être un peu plus pessimiste que le rapporteur et dire que les ratios avec le franc suisse par exemple ne sont pas prêts de se retourner. Un élément pose également problème dans ces contrats : le calcul de la soulte de sortie qui doit être cotée, non par la banque concernée, mais par deux autres établissements proches. J’ai quand même un petit doute sur la façon dont tout cela peut être calculé de sorte qu’il serait souhaitable d’introduire un élément de neutralité dans le sujet. Pour finir, il faut demander à nos collègues des autres collectivités de s’ouvrir un petit peu plus concernant les éléments à rendre publics sur les dettes. Avoir un volume de dette c’est une chose, voir ce qu’il y a à l’intérieur c’est différent : il faut trouver des outils pour renforcer l’information de l’assemblée délibérante et des citoyens.
M. Jean-Louis Gagnaire. À mon tour de remercier le rapporteur, le président et les équipes de l’Assemblée nationale. On peut être satisfait du travail fait en commun dans une saine ambiance. En effet, il pouvait y avoir au départ une certaine méfiance par rapport à la situation de telle ou telle collectivité. Au fur et à mesure qu’on est rentré dans la « boîte noire », on a pris conscience du désastre. À cet égard, on a vu qu’il n’y avait pas quelques cas particuliers, mais un effet de contamination massive et on a à peu près compris le mécanisme mis en place avec la complicité ou à l’insu des élus, cela reste à déterminer au cas par cas.
Un aspect n’a pas encore été abordé, celui de la qualification des cabinets de conseil : il faut que nous ayons un système de certification de ceux-ci. Sur la question du contrôle de légalité, nous sommes à peu près tous d’accord : celui-ci n’est pas opérant en réalité tel qu’il est aujourd’hui exercé par les préfets. En revanche, il me semble que rien n’interdit que les chambres régionales des comptes soient consultées pour avis sur un certain nombre de produits qui sortent de l’ordinaire. Les CRC me semblent tout à fait aptes à fournir ce type d’avis dès lors que cela concerne des masses importantes de crédits ; c’est quand même la Cour des comptes qui a vu la première les risques encourus. Enfin, je pense inévitablement qu’il faut aller vers le provisionnement des risques dans la mesure où, ayant à faire à des produits capés, le risque sera connu. À titre de comparaison avec la comptabilité privée, la provision limite le risque, ce qui évite de bâtir des budgets insincères. Par ailleurs, les amortissements ne sont pas suffisamment utilisés par les grandes collectivités. Or, cela éviterait, pour les fins de mandats, de laisser des cadavres dans les placards. Autant le provisionnement des risques sur le passé est impossible, autant le provisionnement sur les prêts à venir doit être supportable.
Pour le reste, il faudra distinguer Dexia des autres banques. Dexia ayant été recapitalisée par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de six milliards d’euros, j’ai le sentiment que l’on a à faire à une structure de défaisance. Il ne faudrait pas que Dexia porte seule toutes les responsabilités : les autres banques ne doivent pas passer entre les mailles du filet. Enfin, je vous invite les uns et les autres à lire le compte rendu de la Commission des affaires économiques de ce matin avec Philippe Val, de la Banque Postale, qui a donné un certain nombre d’indications éclairantes sur les mécanismes mis en place.
M. Thierry Carcenac. Je me joindrai aux félicitations déjà exprimées quant au travail accompli. Je crois que l’état des lieux comme les propositions sont de bonne qualité.
S’agissant de l’autonomie des collectivités locales, je crois qu’il faut faire attention à la manière dont on peut encadrer celle-ci. Il nous faut toutefois renforcer la transparence, et les propositions du rapport vont en ce sens.
En ce qui concerne les contrôles, je rappelle que les collectivités locales payent des frais de conseil aux comptables publics. Étant donné que les indemnités des comptables publics sont plafonnées, les collectivités locales se substituent à l’État dans le financement de ces activités de conseil. Leur mission n’est donc pas seulement de contrôler les écritures comptables. Plutôt que de renforcer le contrôle de légalité du préfet, le trésorier-payeur devrait avoir connaissance du contrat d’emprunt. On pourrait ainsi avoir un mécanisme d’alerte, les trésoriers-payeurs étant formés et pouvant recevoir l’appui de l’agence France Trésor.
S’agissant des provisions, le principe ne me choque pas mais il est nécessaire que celles-ci soient plafonnées à un certain taux, par exemple au taux normal de marché. Dans le cas contraire, selon le type de taux et le type de produits, les provisions seraient plus ou moins élevées. Par exemple, pour les produits indexés sur la parité entre l’euro et le franc suisse dont les taux atteignent 24 %, les provisions seraient trop importantes. C’est pourquoi il serait préférable de les limiter au taux normal de marché.
Quant à l’insuffisance de liquidité, il s’agit ici d’une vraie préoccupation. Je me souviens qu’avant les lois de décentralisation, des conférences réunissant la caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL), l’État et la totalité des banques avaient lieu pour discuter des investissements dans les départements. Avec ce système, lorsque le budget est voté, il est possible de connaître les investissements qui vont être réalisés et le montant des prêts qui vont être sollicités. On pourrait constituer un pool composé des différents banquiers afin de voir de quelle façon l’on peut répartir l’épargne locale, et le cas échéant, évaluer l’opportunité de recourir à d’autres moyens de financement via notamment une agence de financement intervenant directement sur les marchés. À l’échelle du territoire et en partenariat avec les banques, on devrait parvenir à trouver comment financer les collectivités locales. Ceci est d’autant plus nécessaire que toutes les collectivités vont dorénavant souscrire des emprunts à taux fixes ou des emprunts à taux variables autorisés par la charte Gissler, ce qui réduira les possibilités de financement.
M. Jean Proriol. Tout d’abord, je me félicite du bon déroulement de cette commission d’enquête. Je crois que M. le président, M. le rapporteur et tous les membres de la commission ont été à la hauteur de leur mission.
Ensuite, je m’interroge sur un point : il manque aux collectivités un relevé d’ensemble leur présentant l’état de leur endettement. Dexia faisait ce type de bilan et continue de le faire encore. Le trésorier-payeur en réalise quelquefois mais ne rédige pas les documents lui-même. Ne faudrait-il pas confier à un organisme la mission d’enregistrer les différents emprunts souscrits par les collectivités dans les différentes banques, qu’elles soient françaises, étrangères ou coopératives ?
M. le président. Tout d’abord, sur la question de la décentralisation, il est vrai que nous y sommes maintenant tous attachés. Lorsque l’on se rappelle les débats qui ont animé l’Assemblée nationale au moment où Pierre Mauroy présentait ses premiers textes, l’on voit les progrès qui ont pu être faits et l’on remarque que la décentralisation est aujourd’hui acceptée par tous.
Cependant, il faut que l’on se détermine : soit l’on considère qu’il faut préserver une autonomie totale, ce qui empêche d’appeler l’État en recours ; soit l’on fixe une règle du jeu, qui existe déjà dans bon nombre de secteurs. Le fait qu’il puisse y avoir une norme financière n’ôterait pas de pouvoir aux collectivités locales. Une autre solution consisterait à exiger que chacun des produits financiers mis sur le marché porte un label de l’État : s’il y a un tel label, l’État apporte sa garantie mais si les élus veulent sortir de ce secteur « surveillé », ils le peuvent.
Je pense qu’il faut que nous tranchions cette question car cela constitue l’un des éléments qui sera très observé par nos collègues élus et sur lequel nous sommes attendus. J’insiste sur ce point : il y a de nombreux sujets sur lesquels aujourd’hui les collectivités locales sont soumises à des normes. Chacun constate, qu’à tous les niveaux, il n’y a pas eu d’expertise suffisante : on en déduit qu’une norme devrait obliger les uns et les autres à porter une attention plus soutenue aux souscriptions d’emprunts.
J’ai eu l’occasion de vivre ces dysfonctionnements. Un rapport intermédiaire de la chambre régionale des comptes a été dressé, qui ne disait mot sur les produits structurés. Entre le rapport intermédiaire et le rapport définitif a été publié le rapport thématique de la Cour des comptes ; les membres de la chambre régionale des comptes ont souhaité récupérer leur document pour y effectuer des modifications.
S’il n’y a pas une norme financière a priori, comment voulez-vous qu’a posteriori les uns et les autres n’aient pas regardé de manière légère les différentes propositions faites aux collectivités locales en matière d’emprunts ? Sur ce point, je pense que cela est d’autant plus important que nous avons constaté une situation d’asymétrie grave de l’information entre les élus et les banques.
J’ai été très marqué par l’intervention de M. de Romanet, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Il a été très précis et a eu des gestes d’ouverture mais un point m’a un peu inquiété. Vous l’avez entendu rendre un hommage appuyé au personnel de Dexia qui a été maintenu. Mais la situation est tout de même compliquée car nous allons avoir une structure privée, avec du personnel privé, dont l’essentiel de l’activité concernera les collectivités qui ont des produits structurés, qui aura à négocier et donc à accepter des pertes au nom de ses actionnaires privés pour pouvoir sortir les collectivités des difficultés. Si tous les établissements doivent être cités, la responsabilité de Dexia est plus grande vu son rôle historique auprès des collectivités.
Quant aux provisions : même si la récente ordonnance de référé du TGI de Paris à propos de la ville de Saint-Étienne est intéressante, la ville a tout de même été obligée de provisionner. Cette question de provision porte plus sur le stock que sur le flux car sur ce dernier, nous proposons des solutions. Les provisions pourront être calculées sur la mesure du delta entre le taux et le cap. Il faut évidemment introduire une différence entre le stock et les nouveaux emprunts.
M. le rapporteur. Je vais répondre à un certain nombre de questions. D’une manière générale, sur la responsabilité, j’ai souligné dans le projet de rapport la bonne foi des collectivités, qui n’avaient pas les compétences nécessaires. Au départ, on a pensé que les banques ont fourni aux collectivités de l’argent bon marché pour leurs investissements. Mais ensuite, nous avons compris que les restructurations de prêts ont touché tout le monde, y compris les petites collectivités. Il y a au moins 1 700 collectivités de moins de 10 000 habitants qui ont contracté des prêts structurés. S’agissant des mensonges, je suis d’accord pour transférer tout cela à un procureur. Les produits sont incompréhensibles ; la démarche a été agressive. Quand on passe de 500 à 35 000 personnes dans une entreprise, il y a là une démarche agressive et on sent bien que les autres banques ont dû suivre ; et ce, d’autant que des banques étrangères sont arrivées en concurrentes sur le marché.
Sur la partie du rapport relative au diagnostic, on peut aller plus loin mais il faut tout de même que l’on puisse mettre tout le monde ensuite autour de la table. Ce qui m’intéresse, c’est que les collectivités confient un mandat de gestion du prêt, que les banques prennent une part du risque, et que l’État qui a été plutôt passif les oblige à une conciliation. Il s’agit d’un système qui permet que la charge de la toxicité soit portée par tous. L’idée est de dire que ce qui est toxique ce ne sont ni les collectivités dont on parle, ni les élus, ni les banques, mais les produits.
S’agissant des obligations, la clé de voûte du système, ce sont les provisions. La comptabilité privée le montre bien : la sincérité des comptes est garantie par la provision dans les deux sens, pour les dépenses comme les recettes à venir. Les provisions ne sont pas une dépense. Elles perturbent certes le ratio dette/autofinancement, mais il s’agit d’une dépense fictive. Si l’on impose un cap, on provisionnera quelque chose de très faible qui tombera tous les ans. C’est une dette fictive qui est remise en cause tous les ans. Je vous mets en garde quant au point suivant : on a aujourd’hui des emprunts à taux fixe et à taux variable, dont les produits structurés ; le produit de demain, nous ne le connaissons pas encore. La banque doit toujours gagner sur l’intermédiation, sur le prix de l’argent et sur les mouvements. Pour la protection, on pourrait dire que ce n’est pas la taille de la commune qui importe. À partir du moment où l’on met un capping et que l’on provisionne, on tient le système mécaniquement et on l’a protégé. On ne peut pas faire intervenir le trésorier-payeur, ce n’est pas son rôle. En revanche, on doit renforcer le contrôle de la sincérité des comptes au niveau du préfet : on ne peut laisser en dehors du contrôle une partie des comptes d’une collectivité. La provision est une charge fictive qui rétablit la sincérité des comptes.
M. Henri Plagnol. Je mets en garde les membres de la commission quant à la préconisation d’un système lourd de provisions, car je crains que cela ne bloque la capacité des collectivités à souscrire des emprunts.
M. le rapporteur. La provision est un moyen d’empêcher la collectivité de se risquer à une gestion financière dangereuse ; si les collectivités avaient inscrit par elles-mêmes de manière volontaire cette charge dans leurs comptes, le déséquilibre que risquait d’entraîner l’emprunt aurait été visible et les situations que nous connaissons ne se seraient pas produites.
Je propose que si une collectivité entre dans le dispositif proposé par mon rapport, elle n’ait pas à effectuer de provisionnement pour ses emprunts passés. Pour l’avenir, il me paraît essentiel de prévoir ce mécanisme comptable, qui correspond d’ailleurs aux exigences de l’instruction M14, selon lequel la collectivité inscrit une provision calculée par rapport à un taux d’intérêt EURIBOR + N à fixer. Je redis qu’il s’agit d’une charge fictive revue tous les ans. La conséquence n’en sera d’ailleurs pas très lourde si on adopte concomitamment le principe d’emprunt capé. Ainsi, les collectivités seront protégées à l’avenir des nouveaux produits financiers de gestion dynamique qui seront certainement imaginés par les cerveaux fertiles des établissements bancaires.
La Commission bancaire n’avait pas pour mission de protéger les clients emprunteurs des banques ; ce sera maintenant inscrit dans la mission de l’Autorité de contrôle prudentiel.
L’idée de sanctions émise par M. Calmejane est pertinente : les représentants des banques n’ont pas tous été de bonne foi lors de nos auditions, je considère même que les représentants de Dexia ont clairement menti sur plusieurs points. La responsabilité de certains élus est lourde également, lorsqu’ils ont signé un emprunt entre les deux tours des élections locales.
J’approuve la suggestion d’une labellisation des cabinets de conseil. Ce serait un progrès, car la Commission a constaté des situations alarmantes en ce domaine.
M. Dominique Baert. Un système de provisions pourrait être visé par le trésorier-payeur municipal, ce qui constituerait un élément d’analyse et d’alerte.
M. Patrice Calméjane. Il serait tout de même important que le Trésorier-payeur général puisse regarder la teneur du contrat lorsqu’il procède au paiement. Ainsi, dans le cas d’un produit d’emprunt complexe, il pourrait émettre un avis, une alerte, transmis à la collectivité.
M. Dominique Baert. La révision générale des politiques publiques a fait du TPG le chef des services économiques et financiers de l’État en région ; il me semble que le préfet n’interviendra plus ce domaine.
M. le rapporteur. L’analyse faite par le trésorier-payeur municipal donnerait en effet une information complémentaire. L’équilibre à établir n’est pas facile : il convient de préserver l’autonomie de gestion des collectivités, et imposer un seuil en fonction du nombre d’habitants paraît délicat car on a vu que des erreurs avaient été commises dans de grandes collectivités, et qu’il peut y avoir des compétences de gestion financière dans une petite collectivité.
Si l’encadrement juridique des produits financiers eux-mêmes est suffisamment précis, on peut éviter de créer un seuil entre les différentes collectivités selon leur taille et éviter cette forme d’inégalité.
M. Dominique Baert. Il convient d’être prudent dans la formulation du système de provision qui sera proposé. Je viens d’assister à un rapport de la chambre régionale des comptes consacré à la Communauté urbaine de Lille : deux préconisations posent difficulté, et ce sont justement la définition des documents annexes au compte administratif et le provisionnement. La chambre le préconise, mais n’indique pas sur quelle base. La provision doit être adossée au risque, mais la difficulté est d’évaluer ce risque : si nous prenons le « mark to market » de l’ensemble du stock de la dette, nous aboutissons à une provision négative de 170 millions d'euros, ce qui donne une provision matériellement impossible à inscrire. Beaucoup de collectivités peuvent se trouver dans ce cas de montants très importants. Pourtant, cela représente juste le coût de cession d’une créance présentée sur le marché, c’est très aléatoire. Y a-t-il lieu de le fixer à 10 %, ou à 5 % du mark to market ? Pourquoi provisionner intégralement aujourd’hui un risque futur et incertain, sur une durée de vingt-cinq ans par exemple ?
M. le président. La provision pourrait être fonction du taux qui aurait dû être payé selon le marché. Sur la base d’un taux fixe à vingt ans par exemple.
M. Dominique Baert. Oui, mais les opérations peuvent être « swapées » six ou sept fois, et par conséquence les flux ne seront pas faciles à reconstituer et la collectivité risque d’être obligée de demander au prestataire bancaire de la calculer avec des modèles économiques. Je suis d’accord sur la nécessité de provisionner mais il ne faut pas valider l’idée que l’intégralité de la provision doit être établie sur le mark to market.
M. le président. À propos de responsabilité des élus, je précise, pour votre information, qu’en ce qui concerne un dossier du département de la Seine-Saint-Denis qui a été porté en justice, le contrat d’emprunt avait été signé le 8 février 2008 soit juste avant les élections cantonales. Lorsque le fonctionnaire des services financiers a fait l’appel aux fonds, le document n’a été soumis ni à l’élu aux finances, ni encore moins au président du conseil général. Voici un exemple de la manière dont ces dérives pouvaient intervenir : le fonctionnement des collectivités locales est donc largement améliorable.
En conclusion, je vous invite à prendre connaissance du rapport qui sera mis à votre disposition. Vous pourrez proposer de joindre des contributions à ce rapport, que vous ferez parvenir au secrétariat de la commission.
*
* *
La commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux s’est réunie à nouveau le mardi 6 décembre 2011 à 17 heures, sous la présidence de M. Claude Bartolone, pour procéder à l’adoption du rapport d’enquête de M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur.
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, cette réunion est la dernière puisque les travaux de notre commission d’enquête, créée le 8 juin 2011, prendront fin le 8 décembre lorsque nous remettrons notre rapport au président de l’Assemblée nationale.
Nombre d’entre vous en sont convenus lors de notre précédente réunion, ces travaux, qui se sont déroulés dans un climat d’écoute et de coopération particulièrement favorable, ont été à la fois éclairants, édifiants et constructifs.
Éclairants, car les données que notre rapporteur a obtenues et synthétisées fournissent un état des lieux et des chiffres incontestables, qui permettent de mesurer l’ampleur du problème. Avec 10 690 prêts structurés recensés, qui représentent un encours d’emprunts à risque de 18,8 milliards d’euros, on ne peut plus soutenir, comme le faisait notamment le Gouvernement au début de nos travaux, que le problème est limité à quelques cas isolés parmi les grosses collectivités.
Édifiants, car nos auditions ont montré comment les établissements bancaires, avec lesquelles les acteurs publics locaux avaient historiquement noué des relations de confiance, leur ont proposé de façon systématique, notamment à de nombreuses petites communes qui ne disposaient pas des outils nécessaires à la gestion financière du risque, des produits potentiellement toxiques. Ces emprunts indexés sur des formules toujours plus complexes, toujours plus exotiques, se sont développés sans provoquer de réaction de l’État, qui a manqué à sa mission de surveillance et de contrôle des pratiques commerciales des prêteurs au secteur local.
Enfin, nos travaux ont été constructifs : la commission d’enquête a cherché à déterminer les responsabilités de chacun, mais aussi la manière dont les acteurs publics pourraient apurer les éléments toxiques de leur endettement. Nous nous sommes également accordés sur la nécessité de règles propres à épargner désormais aux collectivités et aux établissements publics les conséquences financières de risques sous-jacents dont ils ne peuvent mesurer toute la portée.
Notre rapporteur, M. Jean-Pierre Gorges, a présenté la semaine dernière ses propositions sur la gestion du stock des emprunts à risque et sur les mesures à adopter. Le projet de rapport a été mis, comme c’est la règle, à la disposition des membres de la commission d’enquête du vendredi 2 décembre à aujourd’hui à seize heures. Certains d’entre vous en ont pris connaissance et ont fait part de leurs points de vue au rapporteur, lequel va nous préciser le sort qu’il a réservé à leurs remarques. Nous devons aujourd’hui nous prononcer sur ce projet de rapport. S’il est adopté, il fera l’objet d’un dépôt au Journal officiel et, sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret, il sera imprimé et distribué.
M. Gorges et moi-même présenterons le résultat des travaux de la commission d’enquête au cours d’une conférence de presse qui aura lieu le 15 décembre à midi. Je remercie ceux de nos collègues qui ont déjà annoncé qu’ils se joindraient à nous. Dans l’intervalle, aux termes de l’instruction générale du Bureau, le rapport doit rester confidentiel. Vous avez été invités à transmettre au secrétariat de la commission, avant le 7 décembre à midi, vos éventuelles contributions écrites, qui pourront être publiées en annexe.
À l’issue de ce travail, nous offrons aux acteurs publics la perspective de sortir d’une passe dangereuse. Je rappelle qu’à peine 50 % des produits sont sortis de la période de bonification. Nombre des personnes que nous avons auditionnées nous l’ont confirmé, le problème que nous nous sommes donné tant de mal à mettre au jour est encore à venir.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Notre commission ayant examiné mes propositions mercredi dernier, j’indiquerai simplement les précisions qui résultent des observations formulées par plusieurs membres au cours de notre précédente réunion ou après consultation du projet de rapport.
Tout d’abord, les banques sont encore plus sévèrement mises en cause. Le projet de rapport ne permettra pas à leurs représentants de s’exonérer de leurs responsabilités. Cela étant, il paraît difficile d’employer des termes relevant de l’incrimination pénale, bien que nous ayons découvert que 1 700 collectivités de moins de 10 000 habitants avaient contracté des prêts à risque après que certains nous avaient certifié sous serment qu’ils n’avaient pas démarché les petites collectivités…
Les responsabilités de l’État à travers ses différentes administrations sont elles aussi clairement décrites. Nous avons également mentionné la responsabilité certes ambiguë des agences de notation, qui ne notent qu’une vingtaine de collectivités, mais qui ont commis des erreurs.
Nous affirmons ensuite la nécessité d’encadrer le secteur du conseil financier aux acteurs publics locaux, comme l’a proposé plusieurs fois M. Gagnaire : la vérification des qualifications nécessaires, la certification des intervenants et le recours à une charte de bonnes pratiques sont désormais requises. On a vu en effet que, dans certaines grandes villes, les conseillers financiers avaient été recrutés « à la bonne franquette » malgré leur rémunération élevée et les conséquences potentielles de leurs actes.
En outre, nous encourageons le recours aux émissions obligataires et à une agence mutualiste de financement des collectivités territoriales. J’ai personnellement l’intention de recourir, pour ma ville, aux émissions obligataires, seul moyen de pallier le manque de liquidité, à moins de me tourner vers les banques chinoises qui me démarchent très activement.
Par ailleurs, l’interdiction des produits structurés aux petites communes et aux petits établissements publics a été supprimée des préconisations, afin de ne pas distinguer les acteurs locaux en fonction de leur taille. En effet, cela n’est pas justifié dès lors que nous encadrons suffisamment la gestion des emprunts : le maire d’un village peut être très compétent, alors que les grandes communes n’ont pas fait la preuve qu’elles disposaient des compétences nécessaires.
Si l’obligation de provisionnement pour risques a été maintenue, il est précisé que « ces provisions devraient être fixées à un niveau minimal, pour ne pas peser sur la capacité d’investissement des acteurs publics locaux, tout en étant suffisamment dissuasives pour décourager la prise de risque que recèlent certains produits structurés ». Le principe du provisionnement obligatoire a gêné certains d’entre vous. Mais lui seul a fait quasiment disparaître les produits toxiques dans le secteur marchand, comme M. Gagnaire l’a rappelé. Il faut absolument le dire dans le rapport. D’autre part, seule l’obligation des provisions garantit la sincérité d’une comptabilité, dans un sens comme dans l’autre, d’ailleurs : on est aussi fautif si l’on perçoit un produit alors que l’on a levé l’impôt en vue d’une charge.
Enfin, ce principe incitera les collectivités, y compris celles qui bénéficient encore de la période bonifiée, à confier leurs prêts toxiques au pôle d’assistance et de transaction dans le délai de six mois qui leur sera imparti, puisque celles qui ne l’auront pas fait devront provisionner pour compenser le risque de taux. Les collectivités auront le marché en mains sachant que, plus l’opération intégrera de collectivités, notamment en période de bonification, plus elle sera avantageuse pour tout le monde. Les collectivités qui n’entreront pas dans la structure devront provisionner les risques pris.
Le seuil de provisionnement sera fondé sur un prix de marché : soit sur le taux d’usure, soit sur le taux de marché sous la forme « Euribor + x », afin de protéger la collectivité malgré la variabilité du taux sur l’année. On ne peut pas exonérer les collectivités du respect de la règle d’or au moment où l’on envisage de l’étendre à l’État, qui pourrait lui aussi être amené à provisionner compte tenu des variations de taux auxquelles sont soumis ses emprunts.
Ensuite, afin d’éviter que des emprunts ne soient conclus juste avant ou pendant les élections, ce qui soustrairait le responsable à l’obligation d’en rendre compte et empêcherait tout contrôle démocratique, il est proposé que les délégations consenties par les assemblées délibérantes aux exécutifs locaux prennent fin dès l’ouverture de la campagne officielle. Il est indispensable de le préciser, car si la déontologie interdit par exemple de signer un gros contrat de délégation de service public (DSP) juste avant l’échéance électorale, on nous a fait part de situations incroyables où les élus avaient conclu des contrats entre les deux tours ! Cela étant, si une urgence survient au cours de ces quelques semaines, l’assemblée délibérante pourrait autoriser une souscription d’emprunts par délibération expresse. Dans ce cas, la décision sera transparente et pourra même nourrir le débat politique.
Des parlementaires et des représentants des élus locaux participeront au pôle d’assistance et de transaction, pour que les collectivités concernées ne soient pas seules avec les représentants de l’administration et les banquiers. Ce pôle ne sera toutefois pas une structure dotée de la personnalité juridique, qui nécessiterait l’adoption préalable d’une loi, car il doit être mis sur pied très rapidement : chaque jour, en effet, des emprunteurs sortent de la période bonifiée, ce qui, on l’a vu, pénalise tous ceux qui prendront part au processus de transaction.
Les grands principes de la renégociation ont été précisés.
Les gains réalisés par la personne publique du fait de la bonification des taux d’intérêt devront être réintégrés dans le bilan des charges financières dont elles sont redevables. Quand on défait, on défait tout !
Les banques prendront en charge les encours à risque dans le cadre de la renégociation des prêts existants. Il leur reviendra de gérer ces encours toxiques comme elles le souhaitent, par débouclage immédiat ou conservation des positions jusqu’à éventuelle amélioration de la situation sur les marchés. Par exemple, si la renégociation aboutit à un taux fixe de 5 % mais que la banque obtient par la suite sur les marchés un taux de 3 %, elle dégagera deux points de marge supplémentaires, et sera gagnante, mais il faut jouer le jeu jusqu’au bout. Ceux qui veulent éviter cela n’ont qu’à en rester aux conditions antérieures. Si les banques sont fautives, c’est uniquement dans la mesure où elles ont traité les collectivités comme des entreprises, sans tenir compte de la différence entre le cycle des emprunts structurés, qui se retourne au bout de deux, trois ou quatre ans, voire davantage, et le cycle annuel auquel obéissent les collectivités du fait de la règle d’équilibre budgétaire. Peut-être faudrait-il le dire plus explicitement.
Enfin, en ce qui concerne la menace ultime d’une intervention du législateur pour limiter le montant des intérêts, nous avons pris en considération les observations des meilleurs juristes de la commission d’enquête, en particulier Charles de La Verpillière. La loi ne peut modifier un contrat de manière rétroactive sauf pour un motif d’intérêt général suffisant ; or, ici, 5 000 collectivités sont concernées.
De ce point de vue, l’ordonnance de référé rendu le 24 novembre dernier concernant la Ville de Saint-Étienne me semble très importante bien qu’elle ne tranche pas sur le fond : saisi en référé par la Royal Bank of Scotland PLC, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que, dans l’attente de la décision sur le fond, la cessation du versement des échéances de ses emprunts par la ville ne constituait un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la légalité des produits spéculatifs souscrits par la collectivité était sérieusement contestée par le juge du fond.
Il est normal de rembourser le capital et une partie des intérêts. Mais cette ordonnance de référé est un avertissement : si les 18 milliards d’encours étaient bloqués pendant des années par des procédures judiciaires, qui paierait finalement le portage ? Ni les collectivités ni les banques n’ont intérêt à s’engager dans cette voie judiciaire potentiellement très coûteuse. Nous proposons donc une prise en charge des frais de portage de la toxicité en attendant le retournement du cycle du produit, dont la banque pourrait profiter.
M. Henri Plagnol. Je remercie le rapporteur et les fonctionnaires qui l’assistent d’avoir intégré aussi vite au rapport les éléments que je leur ai transmis hier en fin d’après-midi.
Je reste inquiet des conséquences de l’obligation de provisionnement, même dans sa nouvelle rédaction, sur les collectivités dont les finances sont les plus dégradées. Je comprends que ce principe incite à la vertu et soit idéalement souhaitable, mais il asphyxiera leurs capacités d’emprunt et d’investissement.
Ce point est toutefois mineur au regard de ma préoccupation principale : les conditions des nouveaux contrats issus de l’accord global de transaction. J’en approuve tout à fait l’esprit général, et je sais gré au rapporteur d’avoir déjà intégré une partie de mes observations. Mais notre rapport sera lu de près et nous devons être particulièrement vigilants. Or la rédaction est imprécise voire contradictoire.
Je suis d’accord avec le premier principe : les gains résultant des taux d’intérêt bonifiés doivent être réintégrés dans le bilan des charges financières dues par les collectivités, car rien ne justifie que celles-ci gagnent de l’argent. Selon le deuxième principe, « la charge d’intérêts supérieure à un taux “normal”, correspondant au taux fixe ou variable que le marché proposait à la date de souscription de l’emprunt à renégocier, devra faire l’objet d’un effort financier réparti entre la collectivité et l’établissement prêteur ». Si cela renvoie au fait que la collectivité renonce à la bonification, soit ; mais s’il s’agit d’un autre partage, je ne suis pas d’accord. La rédaction devrait être précisée, afin de ne pas être en contradiction avec le troisième principe : « les nouveaux contrats de prêt, à taux fixe ou à taux variable, consacreront ainsi le portage par les banques de la partie toxique des emprunts ».
Enfin, je regrette que l’on ne mentionne pas, sous forme d’une incidente, l’éventualité que la Caisse des dépôts contribue au portage pour ne pas affecter la solvabilité des banques. Le directeur général de la Caisse nous a semble-t-il été ouvert à cette solution et cela rassurerait collectivités et banques.
Pour le reste, je salue ce très bon rapport.
M. le rapporteur. Premièrement, je rappelle que les emprunteurs qui confieront leurs contrats d’emprunts au pôle d’assistance et de transaction n’auront pas à inscrire de provisions. Les autres devront le faire, car le contraire reviendrait à nier le caractère toxique des produits. Deuxièmement, leur démarche volontaire devrait être soutenue par les services de l’État en s’abstenant de mettre en cause la sincérité des comptes pendant la période de négociation de la solution mutualisée.
Sur le second point, la collectivité ne peut pas se contenter de renoncer à sa bonification : ce serait trop facile, car il y a eu des pertes liées aux risques pris. Il faut donc qu’elle porte aussi la partie toxique, mais cette charge peut être raisonnable. La banque conservera la toxicité, et la collectivité assumera le coût du portage.
C’est certainement la Caisse des dépôts qui garantira le coût de portage le moins élevé. Mais, de toute façon, la banque devant provisionner, le dilemme est de savoir si Dexia devra se financer sur le marché, où elle s’expose à des risques considérables, ou bien se tourner vers la Caisse des dépôts. Quoi qu’il en soit, il faut imputer à la collectivité le portage de la toxicité, qui ira en diminuant au fur et à mesure de l’amortissement du prêt. C’est le minimum.
M. Henri Plagnol. La rédaction, qui mentionne « un effort financier réparti », n’est donc pas assez précise. En l’état, elle va dissuader certaines collectivités d’entrer dans le processus de transaction. Aujourd’hui, la médiation Gissler me permet d’obtenir à peu près l’équivalent de ce que nous nous apprêtons à proposer !
M. le rapporteur. La rédaction sera précisée en ce sens. En tout cas, nos propositions seront bien plus avantageuses que ce que l’on peut attendre de la médiation Gissler.
M. Henri Plagnol. N’oublions pas que ce sont les gestionnaires actuels des collectivités qui vont assumer la hausse d’impôts correspondant à ces frais financiers, supérieurs aux frais d’aujourd’hui. Il ne faut donc pas mettre la barre trop haut.
M. le rapporteur. Mais nous ne devons pas verrouiller par avance la négociation. N’incitons pas les banques à engager une action en justice ! Je vous ai donné un ordre de grandeur : pour les collectivités, le coût supplémentaire au taux du marché est marginal.
M. le président. Je comprends le problème. Mais M. Plagnol n’a pas tort : si nous jugeons que ce sont les banques qui portent la plus lourde responsabilité, nous ne pouvons trop en demander aux collectivités.
M. le rapporteur. Les collectivités ont aussi une responsabilité. C’est pourquoi elles doivent financer le portage de la toxicité.
M. le président Claude Bartolone. Oui, mais M. Plagnol relève un autre risque : si le coût du portage est trop important, elles se retrouveront dans une situation dangereuse.
M. Henri Plagnol. La rédaction consacre le portage de la partie toxique par les banques et répartit l’effort financier entre les collectivités et l’établissement prêteur. Il est nécessaire de préciser cela avant adoption du rapport.
M. le président. Puisqu’il s’agit d’un point sensible, nous laisserons au rapporteur le soin de peaufiner la rédaction.
M. Marc Francina. Le seuil de 10 000 habitants me pose problème. Pour les communes classées station de tourisme, cela peut déboucher sur des situations difficiles.
M. le rapporteur. C’est pour cela que nous avons supprimé toute différenciation en fonction de la taille des communes. Ce problème est résolu.
M. Serge Janquin. L’ampleur et la gravité des problèmes avaient de quoi nous inquiéter. Nous étions au pied d’un volcan en éruption. Si celui-ci n’est pas éteint, nous voyons du moins comment protéger les collectivités et les établissements publics qui vivent à sa base.
Je salue les propositions du rapporteur, mais la question de M. Plagnol est judicieuse. Il faut gérer l’arbitrage, sans préjuger du résultat – puisque le pôle devra négocier le partage des responsabilités – et en apportant cependant des garanties afin qu’on ne pénalise pas les collectivités plus que de raison. Pour définir cet équilibre, je suggère la formule : « à due proportion des responsabilités des uns et des autres. » L’expression ne préjuge pas de la solution qui prévaudra lors de l’arbitrage collectif.
Enfin, puisque les collectivités préparent le budget pour 2012, il faut préciser les montants à provisionner pour éviter tout rejet par l’organisme de tutelle. Le rapport peut-il formuler une proposition, du type « Euribor + x points », qu’elles pourraient opposer en cas de contrôle ?
M. Marc Goua. Je partage les craintes de M. Plagnol. Pourquoi ne pas écrire que l’emprunt renégocié fera l’objet d’un effort financier réparti entre la collectivité et l’établissement prêteur, en instaurant une limite, par exemple le taux moyen constaté pour les nouveaux crédits, éventuellement assorti d’une marge de 100 points de base ? Après avoir été anormalement faibles pendant des années, les taux reviennent à la normale avec le retour de l’inflation. Du coup, certaines banques présentent des propositions avec des marges plus importantes. Si chacun doit assumer ses responsabilités, il me semble néanmoins essentiel de prévoir une limite, sachant que la rédaction actuelle – selon laquelle l’effort financier sera « réparti entre la collectivité et l’établissement prêteur » – n’a pas de traduction concrète.
M. Henri Plagnol. Exactement !
M. Patrice Calméjane. Je vous ai adressé en début d’après-midi une contribution. Vous souhaitez interdire aux représentants des collectivités de contracter des emprunts en période préélectorale,…
M. le rapporteur. Non, ce n’est pas ce que je propose.
M. Patrice Calméjane. …mais l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dispose déjà que « Le maire peut […] être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat […] de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. » Appuyons-nous sur la loi en vigueur avant d’en rédiger une autre. Le problème vient de ce que des conseils municipaux n’ont pas limité le pouvoir des maires, ou que des élus ont renégocié des emprunts supérieurs à l’autorisation. Les mesures proposées risquent tout au plus de priver les collectivités d’opportunités d’acquisitions intéressantes pendant les quatre mois qui entourent l’élection. N’entravons pas la gestion du quotidien !
Enfin, dans un souci de lisibilité, je propose d’indiquer à la fin du rapport les ratios actuels demandés aux collectivités territoriales et les informations complémentaires qui devront désormais être apportées aux conseils municipaux et aux citoyens.
M. Jean-Louis Gagnaire. Si juste que soit son analyse, un rapport d’enquête ne crée pas en lui-même de droits nouveaux. Cependant, il pourrait comporter en annexe une marche à suivre expliquant ce qu’il est possible de faire, compte tenu de la réglementation et de la législation actuelles, et les premières mesures réglementaires à prévoir, puisqu’il est impossible de légiférer pendant les prochains mois. Nous pourrions accompagner ce mode d’emploi d’un calendrier destiné à inscrire notre travail dans la durée, puisque, même après les échéances électorales, nous ne lâcherons pas prise. Tel est le message qu’il faut faire passer aux banques et aux élus.
En principe, on ne négocie pas des emprunts en période électorale, mais ce sera toujours possible, en procédant à une convocation expresse de l’assemblée délibérante. Cela dit, même si les collectivités bien gérées n’en souscrivent pas à ce moment-là, il n’est pas impossible qu’une opportunité se présente. La commission pourrait se contenter de rappeler que les collectivités doivent faire de l’abstention de souscrire des emprunts à de telles périodes une règle normale de gestion sur le plan déontologique sinon juridique.
M. le président Claude Bartolone. Le rapport d’enquête ne peut évidemment pas modifier la loi. Ayant mesuré l’ampleur du désastre, nous avons cherché à en sortir par un compromis. Écartant l’idée que toutes les collectivités ou les banques aillent en justice, le rapport propose une solution médiane, plus intéressante pour tous, mais ses préconisations sont nécessairement limitées. Si nous promettions aux collectivités que l’État supportera tous les frais, vous seriez nombreux à dénoncer cette dérive gauchisante ! On ne peut pas non plus ne rien proposer aux collectivités et les renvoyer aux propositions des banques, qui sont prohibitives. Quant à la négociation Gissler, il faudrait un siècle pour la mener collectivité par collectivité. À tout le moins, nos propositions pourront être reprises par des décrets gouvernementaux ou renvoyées à la prochaine législature.
M. le rapporteur. Le but de la commission d’enquête est non d’écrire les procédures mais de définir une méthode pour amener tout le monde à s’installer autour de la table, sachant que les banquiers ont commis suffisamment de fautes pour courir un risque en allant devant les tribunaux.
Cela dit, chacun a le droit de conserver un prêt. La collectivité que je dirige en a souscrit deux : un emprunt Helvétix, dont la période bonifiée court jusqu’à fin 2012, et pour lequel je suis prêt à entrer dans le dispositif, et un prêt euro-dollar et euro-franc suisse, dont la variation paraît raisonnable. L’an dernier, où nous avions constitué une provision sur la base d’un taux de 10 %, celui-ci s’est maintenu à 6,25 %, ce qui a dégagé un excédent de 200 000 euros.
La solution proposée par M. Gissler consiste à faire payer aux collectivités une soulte en plus du capital, tout en prolongeant l’emprunt sur des années. C’est la méthode qu’on propose aux particuliers surendettés : on transforme leurs mensualités de 500 euros sur dix ans en mensualités de 400 euros sur vingt ans, mais je me méfie du financement à la Crazy George’s ! Dès lors que les collectivités apportent une masse importante, la banque peut prévoir une structure pour la gérer, à charge pour les collectivités de porter les sommes qu’elles n’auront pas versées en attendant des jours meilleurs. Nous proposons un partage du risque : la banque prendra la toxicité, avec le risque de la conserver, quand les collectivités paieront – le moins cher possible –, le portage de la toxicité. Si nous avions négocié à un taux normal, nous aurions obtenu l’Euribor majoré d’une marge de l’ordre de 200 points de base. Ajoutons à cette somme les frais liés au portage de la toxicité. Si nous en sortons ainsi, c’est l’idéal ! Mais M. Janquin a raison : évitons une rédaction fermée. Ne compromettons pas, par une formule trop stricte, le regroupement des collectivités, qui les mettra en position de force dans la négociation. À côté des autres possibilités – conserver l’emprunt, aller en justice ou recourir à la médiation –, nous proposons une solution originale, alors que, si chaque collectivité agit pour son compte, la jurisprudence sera contradictoire, les procédures mettront des années à aboutir et les élus peuvent avoir à payer des soultes ou des intérêts très élevés. Il faut conjurer cette menace, sans priver les collectivités des outils dont elles disposent actuellement. Cela dit, il convient sans doute de distinguer plus nettement les intérêts et le portage de la toxicité.
Mme Valérie Fourneyron. Je salue la qualité du rapport et j’insiste sur le problème du court terme. Quelle que soit la solution retenue, quelles provisions faut-il inscrire dans le budget de 2012 pour qu’il passe le contrôle de légalité ?
M. le rapporteur. Les collectivités qui entreront dans le dispositif n’auront pas de provision à constituer, puisqu’elles bénéficieront d’un retour à un taux normal. En revanche, les autres devront le faire, ce qui les incitera à rejoindre la transaction. Tant que durera la procédure de règlement, il faut que l’État contrôle la sincérité des budgets en tenant compte de la situation.
M. le président Claude Bartolone. Certains élus des petites collectivités ont annoncé qu’ils démissionneraient si on les oblige à provisionner les sommes attendues.
M. le rapporteur. Le rapport devra être plus précis sur les obligations des préfets : il ne faut pas instaurer dès le 1er janvier 2012 une obligation de provisionnement, en attendant que la procédure se mette en place.
Monsieur Calméjane, c’est l’assemblée délibérante qui donne délégation au maire…
M. Patrice Calméjane. Certains maires ont souscrit un emprunt de 100 millions, alors qu’ils n’avaient pas la possibilité de le faire.
M. le rapporteur. La procédure de contrôle par les élus n’a pas fonctionné, et le problème est le même avec les délégations de service public : à quoi s’engage un maire qui signe une DSP de 50 millions d’euros juste avant les élections ?
Mme Valérie Fourneyron. La souscription des emprunts a lieu aujourd’hui dans un contexte très différent. Auparavant, les élus attendaient la fin de la mandature, mais ceux qui ont attendu fin 2011 pour contracter un prêt se heurtent à la faiblesse des liquidités bancaires et à l’explosion des marges. Il est probable que les levées d’emprunt s’effectueront plus tôt, lors de la prochaine législature.
M. Daniel Boisserie. Je m’interroge sur un passage évoquant la possibilité, au cas par cas, d’envisager une subvention d’équilibre afin de permettre le rétablissement du budget des plus petites collectivités, dans certains cas. De quelle subvention s’agit-il ? Serait-elle ponctuelle ou renouvelable ?
M. le rapporteur. La procédure existe déjà pour les communes se trouvant dans une situation budgétaire impossible à résoudre, qui a été évoquée par M. Richert. Je n’étais pas très favorable à cette éventualité, mais, même si nous réglons 95 % des cas, il restera toujours des situations insolubles. On ne peut demander au dispositif de régler toutes les difficultés, sans quoi il deviendra une usine à gaz. Laissons à l’État le soin de dénouer les cas les plus difficiles, et traitons le cas des 5 000 collectivités confrontées au même problème.
M. Daniel Boisserie. Le passage ne concerne que les petites collectivités, particulièrement fragiles ?
M. le rapporteur. Si elles possèdent les mêmes produits que les autres, ils seront défaits en même temps par le traitement que nous proposons.
L’État fera ce qu’il fait déjà aujourd’hui pour les collectivités en difficulté avérée. Mais il ne s’agit pas de donner à l’État le rôle de garant.
M. le président. Quand nous les avons auditionnés, le ministre et les représentants de la direction générale des collectivités locales (DGCL) ont dit n’avoir reçu aucune demande de subvention d’équilibre. Selon le directeur de la DGCL, une telle opportunité serait complexe à mettre en œuvre, mais je me suis assuré qu’elle existe.
Je rappelle que, dans une commission d’enquête, il revient au rapporteur de prendre ou non en compte les amendements au rapport qui lui sont adressés.
La Commission adopte le rapport de M. Jean-Pierre Gorges à l’unanimité.
M. le président. J’ai eu plaisir à présider cette Commission. Grâce à vous, je me suis senti moins seul. La situation a changé depuis que j’ai posé pour la première fois le problème des produits structurés, au congrès de l’Assemblée des départements de France, à Orléans. Nous avons mis en évidence le nombre de collectivités touchées, tout comme la complexité du dossier et les dangers qu’il représente.
*
* *
Thème |
Proposition |
Mise en œuvre |
Favoriser un financement sûr et diversifié des investissements des collectivités territoriales et établissements publics locaux : | ||
Proposition n° 1 : |
Encourager le recours aux emprunts obligataires et le développement d’une structure mutualiste de financement obligataire des collectivités territoriales |
Modification législative |
Mieux encadrer les modalités de souscription des emprunts du secteur local : | ||
Proposition n° 2 : |
Interdire les produits structurés ou dérivés avec multiplicateur |
Modification législative |
Proposition n° 3 : |
Mettre en place un capping global pour tous les prêts aux acteurs publics locaux |
Modification législative |
Proposition n° 4 : |
Provisionner les risques liés à la souscription de produits financiers, à hauteur des charges financières supplémentaires potentielle |
Décret en Conseil d'État (pour les communes) Arrêtés relatifs aux instructions budgétaires et comptables et circulaires |
Améliorer la transparence et le contrôle sur l’endettement local : | ||
Proposition n° 5 : |
Instaurer un débat annuel des assemblées délibérantes sur la stratégie financière et le pilotage pluriannuel de l’endettement |
Modification législative |
Proposition n° 6 : |
Améliorer les nouvelles annexes aux documents budgétaires présentant l’encours d’endettement en détaillant le niveau de risque et la valeur réelle des emprunts souscrits |
Arrêtés relatifs aux instructions budgétaires et comptables |
Proposition n° 7 : |
Encadrer la conclusion des contrats d’emprunt avant les échéances électorales, en fixant l’échéance des délégations consenties à l’exécutif à l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement de l’assemblée délibérante |
Modification législative |
Proposition n° 8 : |
Étendre le contrôle de légalité à l’ensemble des contrats de prêt |
Modification législative |
Proposition n° 9 : |
Préciser le contenu du rapport annuel au Parlement sur la dette locale |
Modification législative |
Proposition n° 10 : |
Clarifier les prérogatives des commissions d’enquête parlementaires à l’égard des établissements de crédit |
Modification législative |
Engager une gestion mutualisée de la sortie des dettes locales structurées, sans défaisance : | ||
Proposition n° 11 : |
Mettre en place un pôle d’assistance et de transaction, auquel les acteurs publics locaux concernés pourraient donner mandat pour renégocier de façon groupée les encours d’emprunts structurés et conclure de nouveaux contrats à taux fixes ou variables, en organisant le portage du risque par les établissements prêteurs avec une participation des emprunteurs aux coûts afférents |
Décision ministérielle |
Proposition n° 12 : |
Recentrer le rôle de la médiation sur les produits atypiques ou fortement toxiques |
Décision ministérielle |
Contribution de Dominique BAERT (Député SRC du Nord)
Vice-Président de la commission d’enquête
Nul doute que le travail qui a été réalisé par cette commission d’enquête aura été important. Par-delà les clivages politiques, il aura permis d’appréhender la réalité d’un problème financier majeur pour beaucoup, si ce ne sont la plupart des collectivités locales françaises, d’une véritable « bombe à retardement » de beaucoup de budgets à venir, mais aussi pour le financement de demain des investissements publics locaux dans notre pays.
Encore peut-on raisonnablement penser que tous les élus locaux, notamment des collectivités de plus petite taille, n’ont pas encore nécessairement complètement conscience des risques de charges d’intérêt accrues qui se dissimulent, parfois très discrètement, dans leur portefeuille de dette. Encore peut-on redouter que bien d’autres organismes (sociétés d’économie mixte, organismes d’HLM, hôpitaux) n’ont pas non plus encore pris la mesure des dérives de taux qu’eux aussi pourraient connaître dans les proches années, surtout dans un contexte financier international où valeurs de change et taux d’intérêt sont profondément bousculés.
Les risques, on les connaît. Hausse des taux, considérable, jusqu’à ce qu’ils puissent être parfois insoutenables, d’où des dépenses supplémentaires insupportables pour les budgets concernés. Et si les collectivités doivent consacrer des moyens à payer ces intérêts gonflés, elles auront moins d’autofinancement, et donc moins de capacité d’investissement. Or, si les collectivités se mettent à investir moins, c’est un sacré moteur de la croissance économique – l’investissement public – qui risque de se ralentir ! La question économique et donc celle de l’emploi, se trouve derrière le problème du règlement de ces emprunts structurés, devenus toxiques pour certains d’entre eux.
– Les enjeux sont donc lourds. Et on en parlera longtemps dans les enceintes délibérantes de nos collectivités françaises. D’où l’intérêt de ce rapport. Dans le diagnostic, dans sa genèse, dans la connaissance des enjeux, il est vraisemblable que ce rapport fera date.
Pour ma part, je voudrais dans cette contribution insister sur deux points saillants, présents certes dans le rapport, mais qui mériteraient d’être spécifiquement mis en avant.
Ø D’abord la question-clé de la responsabilité des banques qui ont diffusé ces produits. Le rapport analyse les responsabilités de tous les protagonistes. Mais la stratégie des banques, mobilisées à commercialiser ces produits opaques, leur défaut d’information, d’alerte et de conseil, enfin la vente de produits spéculatifs proscrite par la circulaire de 1992, tout cela est manifeste de la part des banques.
Les banques ont présenté des produits de manière tellement opaque que la question se pose de leur responsabilité pour dol et tromperie ! Les obligations à la charge des banques, reprises dans la circulaire du 25 juin 2010, ne sont pas nées avec celle-ci, et la conclusion de la « Charte Gissler ». Elles étaient énoncées déjà pour l’essentiel dans la circulaire de 1992, ainsi que dans le code monétaire et financier (article L. 533-4 en vigueur avant le 01/11/2007, et l’article L. 533-11 et suivants en vigueur après le 01/11/2007) ; l’article 1147 du code civil précisant l’obligation d’information et de mise en garde du banquier (Jurisprudence « Buon »), et l’article 1134 du Code civil (alinéa 3 : exécution des contrats de bonne foi), enfin, dans le règlement de l’Autorité des Marchés Financiers.
Certaines banques ont exercé des pressions commerciales hors du commun et ont été à l’initiative des propositions ! Les présentations témoignent du fréquent défaut d’information et de conseil des banques, et l’asymétrie de compétences spécialisées sur les finances de marché entre les services des collectivités locales et les banques. Déséquilibre des informations, déséquilibre des compétences entre d’une part des établissements bancaires au fait des données financières pointues et des modèles mathématiques complexes, et des collectivités qui, au mieux, disposent d’une petite équipe administrative formée à la gestion de produits simples, et qui n’a pu qu’être sensible à des propositions, au demeurant insistantes, qui avaient l’avantage d’offrir à très brève échéance, une baisse des charges financières.
Voilà pourquoi, même si les dirigeants des établissements concernés ont le plus souvent changé, ces établissements ne peuvent être exonérés de responsabilité et donc d’apporter une contribution réelle à la résolution des problèmes désormais identifiés. Le refus de négocier, de réduire les charges à venir des collectivités n’est pas acceptable !
Ø C’est en ce sens que l’intervention du législateur ne pourra, à mon sens, être durablement différée. Bien sûr, la négociation est un bon moyen d’aboutir à une solution supportable par les parties. Encore faut-il que les établissements bancaires l’acceptent, et que les déséquilibres d’hier, qui ont prévalu dans la souscription des produits, ne se retrouvent pas, dans l’analyse des propositions faites ! Par le jeu des indemnités de remboursement anticipé additionnées au capital restant dû, il n’est pas rare que la proposition de renégociation formulée par l’établissement prêteur soit, même avec un taux d’intérêt plus faible en apparence, davantage profitable pour la banque !
Dès lors, je considère qu’il sera, à un moment pas très lointain, indispensable que la loi borde, cadre, accompagne les négociations à conduire, et cela sur deux paramètres fondamentaux :
■ le taux d’intérêt payé demain, après la renégociation. Il doit être « plafonné », ne serait-ce que par référence au taux des emprunts du Trésor, par exemple à dix ans, créant de fait une sorte de « taux d’usure » des prêts aux collectivités locales. Sa vertu serait d’éviter les chiffres aberrants, les situations excessives, qui ne pourront, par leur excès, se résoudre que dans des crises majeures ! Il faut dire très vite qu’il y a un taux maximal que paieront effectivement demain les collectivités qui ont souscrit des emprunts toxiques hier ! C’est une condition de lisibilité pour tous, gestionnaires élus, banques, et pouvoir publics.
■ le niveau admissible des indemnités de remboursement anticipé dont, légalement, contractuellement, sont assortis les emprunts souscrits. Trop lourdes, trop léonines même parfois, elles rendent difficiles, voire impossibles les renégociations. Là aussi, les plafonner ou même les annuler, en cas de responsabilité forte de l’établissement bancaire, serait un acte majeur pour faciliter le dénouement du problème que ce rapport explicite enfin !
Dominique BAERT
Contribution de Patrice CALMÉJANE (Député UMP de Seine-Saint-Denis)
Membre de la commission d’enquête
Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque, il me semble indispensable de préciser un point afin de justifier le bien fondé de notre travail.
Les nombreuses auditions que nous avons menées depuis six mois nous ont éclairées sur la chaîne des défaillances du fonctionnement des collectivités locales et des établissements hospitaliers publics. Au vu du rapport de la commission d’enquête, le principe de l'autonomie de gestion des collectivités territoriales, garanti par la Constitution (article 72-2), ne doit pas avoir pour conséquence de permettre aux gestionnaires de collectivités d’agir de manière risquée avec d'importantes conséquences de long terme sur le budget ce celles-ci.
Le rapport aborde partiellement la question de la transparence de la gestion, de la souscription des emprunts, de l’information et du contrôle sur leur encours, leur niveau de risque et leur structure. Les mêmes interrogations se posent quant à certains contrats de délégation de Service public ou à des contrats de partenariat public privé.
Il n’est pas normal que les collectivités montrent, à structures équivalentes, sans explication locale particulière, des écarts de gestion très significatifs par rapport à la moyenne portant sur les charges de personnels, les coûts de fonctionnement ou sur les dépenses de communication, par exemple.
Il est impératif pour moi que le Gouvernement, en concertation avec les associations d'élus, travaille sur des dispositifs partagés de contrôle des budgets des collectivités ; à défaut la commission d’enquête de l'Assemblée nationale, malgré ce rapport, n'aurait pas complètement rempli son rôle et nous prendrions le risque de devoir à nouveau débattre de ces questions devant une autre commission d'enquête dans quelques années, pour remédier à d’autres dérives.
Alors que les États sont en train de mettre en place des mécanismes de sanctions automatiques en cas de dérives budgétaires au plan national, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser à nouveau dériver les finances de collectivités locales victimes d’une mauvaise gestion.
C’est pourquoi je demande que de nouveaux critères d'analyse des budgets, et notamment des critères portant sur la structure de l’endettement et sur les dépenses de fonctionnement, soient rapidement instaurés afin d’éviter un recours trop facile à l'emprunt dans le but d'équilibrer le budget des collectivités territoriales.
Patrice CALMÉJANE
GLOSSAIRE DES INDICES COURAMMENT UTILISÉS
EONIA : l’index EONIA (Euro OverNight Index Average) correspond à la moyenne arithmétique des taux constatés pour des opérations de prêts interbancaires au jour le jour consenties par un panel de banques de référence, cette moyenne étant pondérée par le volume respectif des transactions effectuées. Il est publié quotidiennement sur l’écran Reuters, page 247.
T4M : l’index T4M (Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire) correspond à la moyenne arithmétique des EONIA fixés au cours d’un mois civil. Il est publié mensuellement sur l’écran Reuters, page FRTAG.
IBOR : l’index IBOR (InterBank Offered Rate) correspond à la moyenne arithmétique des taux offerts par un panel de banques de référence pour des dépôts réalisés dans la devise de référence de l’index sur des périodes de 1 à 12 mois. Les principaux index IBOR sont les suivants :
Index |
Page Reuters (1) |
Heure de publication |
EURIBOR |
248 |
11 heures (heure de Bruxelles) |
LIBOR CHF (2) |
3740 |
11 heures (heure de Londres) |
LIBOR GBP (10) |
3750 |
11 heures (heure de Londres) |
LIBOR USD (34) |
3750 |
11 heures (heure de Londres) |
LIBOR JPY (13) |
3750 |
11 heures (heure de Londres) |
LIBOR EUR (9) |
3750 |
11 heures (heure de Londres) |
NIBOR NOK (14) |
NIBR |
12 heures (heure d’Oslo) |
STIBOR SEK (26) |
SIDE |
11 heures (heure de Stockholm) |
PRIBOR CZK (3) |
PRBO |
11 heures (heure de Prague) |
WIBOR PLN (20) |
WIBO |
11 heures (heure de Varsovie) |
(1) ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait
TAG : l’index TAG (Taux Annuel Glissant) correspond à la capitalisation sur des périodes de 1 à 12 mois des moyennes arithmétiques mensuelles de l’EONIA sur les derniers mois glissants. Il est publié quotidiennement sur l’écran Reuters, page FRTAG.
TAM : l’index TAM (Taux Annuel Monétaire) correspond au taux de rendement d’un placement mensuel renouvelé à chaque fin de mois, pendant les douze mois écoulés, à intérêts composés, au T4M. Il est publié mensuellement sur l’écran Reuters, page FRTAG.
TEC 5 et TEC 10 : l’index TEC 5 et l’index TEC 10 (Taux de l’Echéance Constante à 5 ans et 10 ans) sont calculés par interpolation linéaire du taux de rendement des deux obligations assimilables du Trésor (OAT) encadrant la maturité exacte des 5 ans et des 10 ans. Ils sont publiés quotidiennement sur l’écran Reuters, page BDFCNOTEC.
SIFMA Municipal Swap : l’index SIFMA Municipal Swap est calculé par l’Association des marchés financiers et de l’industrie des valeurs mobilières à partir des taux de swaps des municipalités américaines. L’index est publié hebdomadairement sur l’écran Reuters, page MUNINDEX01.
CMS CHF : l’index CMS CHF (Constant Maturity Swap) n ans désigne le taux de swap, en CHF, calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. Pour n=1 an, c’est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre LIBOR CHF 3 mois à 1 an. Pour n>1 an, c’est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre LIBOR CHF 6 mois à n ans. Il est constaté sur l’écran Reuters, page ISDAFIX4.
CMS EUR : l’index CMS EUR (Constant Maturity Swap) n ans désigne le taux de swap, en EUR, calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. Pour n=1 an, c’est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre EURIBOR 3 mois à 1 an. Pour n>1 an, c’est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre EURIBOR 6 mois à n ans. Il est constaté sur l’écran Reuters, page ISDAFIX2.
CMS GBP : l’index CMS GBP (Constant Maturity Swap) n ans désigne le taux de swap, en GBP, calculé sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 365 jours. Pour n=1 an, c’est le taux fixe annuel milieu de fourchette contre LIBOR GBP 3 mois à 1 an. Pour n>1 an, c’est le taux fixe milieu de fourchette semi-annuel contre LIBOR GBP 6 mois à n ans. Il est constaté sur l’écran Reuters, page TGM42279.
CMS USD : l’index CMS USD (Constant Maturity Swap) n ans désigne le taux de swap, en USD, calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. C’est le taux fixe semi-annuel milieu de fourchette contre LIBOR USD 3 mois à n ans. Il est constaté sur l’écran Reuters, page ISDAFIX1.
Cours de change EUR/CHF : le cours de change EUR/CHF désigne le montant en francs suisses pour un euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne sur l’écran Reuters, page ECB 37.
Cours de change EUR/USD : le cours de change EUR/USD désigne le montant en dollars des Etats-Unis pour un euro, tel que publié par la Banque Centrale Européenne sur l’écran Reuters, page ECB 37.
Cours de change USD/CHF : le cours de change USD/CHF désigne le montant en francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, tel que publié sur l’écran Reuters, page WMRSPOT07.
Cours de change USD/JPY : le cours de change USD/JPY désigne le montant en yens pour un dollar des États-Unis, tel que publié sur l’écran Reuters, page WMRSPOT12.
Indice des prix à la consommation de la France (IPC de la France) : l’IPC de la France désigne l’indice des prix à la consommation hors tabac pour l’ensemble des ménages résidant en France (y compris DOM) tel que défini et calculé mensuellement par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et publié sur l’écran Reuters, page OATINFLATION01, sous l’égide de l’Agence France Trésor.
Indice des prix à la consommation harmonisé de la Zone Euro (IPCH de la Zone Euro) : l’IPCH de la Zone Euro désigne l’indice des prix à la consommation harmonisé hors tabac de l’ensemble des ménages de la Zone Euro tel que défini et calculé mensuellement par l’Office Statistique des Communautés Européennes (EUROSTAT) et publié sur l’écran Reuters, page OATEI01, sous l’égide de l’Agence France Trésor.
Moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois : la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 3 mois pour un mois donné est publiée le mois suivant sur l’écran Reuters, page FRTAG03.
Moyenne mensuelle de l’EURIBOR 12 mois : la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 12 mois pour un mois donné est publiée le mois suivant sur l’écran Reuters, page FRTAG03.
Taux d’inflation de la Zone Euro : le taux d’inflation de la Zone Euro désigne le taux de variation sur une période donnée de l’indice des prix à la consommation harmonisé de la Zone Euro (IPCH de la Zone Euro). Le taux d’inflation est négatif ou positif selon que l’IPCH de la Zone Euro diminue ou augmente.
Taux d’inflation française : le taux d’inflation française désigne le taux de variation sur une période donnée de l’indice des prix à la consommation de la France (IPC de la France). Le taux d’inflation est négatif ou positif selon que l’IPC de la France diminue ou augmente.
ANNEXE 1 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS
Les tables rondes et auditions sont présentées dans l’ordre chronologique des séances tenues par la commission d’enquête (toutes les auditions ont été ouvertes à la presse sauf indication contraire).
SOMMAIRE DES AUDITIONS
___
Table ronde sur La gestion des emprunts toxiques : les expériences de plusieurs collectivités territoriales, avec la participation de M. Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres, chargé des finances ; de M. Daniel Guiraud, vice-président chargé des finances du conseil général de la Seine-Saint-Denis ; accompagné de M. Philippe Yvin, directeur général des services ; de M. Axel Guglielmino, directeur adjoint de la direction du budget ; de M. Tony Di Martino, chargé de mission ; et de M. Simon Fortel, directeur des finances à la ville de Rouen (Procès-verbal de la séance du mercredi 6 juillet 2011) 163
Table ronde sur Le recours aux produits financiers à risque par les grandes municipalités : le cas de Saint-Étienne,
– avec l’audition de M. Michel Thiollière, ancien sénateur, ancien maire et ordonnateur de la commune de Saint Étienne ; de M. Antoine Alfieri, ancien adjoint en charge des finances ; de M. Jean-Claude Louchet, ancien directeur des services ; et de M. Jean-Michel Rastel, directeur général des cabinets Techfi et Fitech, ancien conseil de la ville de Saint-Étienne (Procès-verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011) 181
– l’audition de M. Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne ; de M. Jean-Claude Bertrand, adjoint au maire, chargé du budget et de la gestion de la dette ; et de M. Cédric Grail, directeur général adjoint (Procès-verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011). 196
– l’audition, de M. Michel Morin, préfet de la Loire (2002-2006) ; et de M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire (2000 2005) (Procès-verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011) 204
Suite de la table ronde du 6 juillet 2011 sur La gestion des emprunts toxiques : l’expérience de Saint-Maur-des-Fossés, avec la participation de M. Jacques Leroy, premier adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés, chargé des finances ; de M. Jean-Marc Broux, directeur général des services de la ville de Saint-Maur-des-Fossés ; et de M. Vincent Billard, directeur financier de la ville de Saint-Maur-des-Fossés (Procès-verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011). 212
Table ronde sur le thème Des prêts structurés dans les petites collectivités, pour quoi faire ? avec la participation de Mme Anne Auffret, maire de Donges (Loire-Atlantique) ; de M. Bernard Chesneau, maire de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique) ; de M. Christian Coigné, maire de Sassenage (Isère), de M. Christophe Faverjon, maire d’Unieux (Loire) ; de M. Jean Fernandez, maire de Saint-Cast-Le Guildo (Côtes-d'Armor) ; de M. Xavier Martin-Le Chevalier, maire de Trégastel (Côtes d’Armor) ; et de M. Philippe Verrier, Président de la Communauté de communes du Bocage d’Athis de l’Orne (Procès-verbal de la séance du mercredi 5 octobre 2011) 221
Table ronde sur Le recours aux prêts structurés dans les hôpitaux, avec la participation de M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital ; de M. André Bury, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier ; M. Dominique Perrier, directeur du centre hospitalier de Decazeville ; de M. Philippe Collange, directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire) ; M. Pierre-Charles Pons, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Dijon ; et de M. André-Gwenaël Pors, directeur général du centre hospitalier d’Ajaccio (Procès-verbal de la séance du mercredi 5 octobre 2011) 236
Table ronde sur Le recours aux prêts structurés dans les organismes de logement social, avec la participation de M. Thierry Repentin, sénateur, président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) accompagné de M. Luc Legras, chargé de mission auprès du délégué général de l’Union sociale pour l’habitat ; de M. Denis Vilain, chef de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) ; de M. Frédéric Monfroy, expert comptable et financier de la MIILOS ; de M. Hamid El Hassouni, président de l’OPAC de Dijon ; de M. Jean-Pierre Pirocca, directeur général ; de M. Alain Germain, directeur général adjoint ; et de M. Jean-Paul Clément, directeur général de la SA de construction de la Ville de Lyon (SACVL), organisme gestionnaire des HLM (Procès-verbal de la séance du mercredi 12 octobre 2011) 248
Auditions, non ouvertes à la presse, sur le thème Comment évaluer l’encours des emprunts toxiques ?, de M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie ; avec la participation de M. Marc Larue, président de section à la CRC PACA ; de M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace ; de M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais ; et de M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC Pays de la Loire (Procès-verbal de la séance du mercredi 12 octobre 2011) 260
Table ronde sur Les produits financiers à risque, avec la participation de Me Alban Caillemer du Ferrage, avocat associé au cabinet Gide, spécialiste des produits dérivés et des financements structurés ; de M. Olivier Nys, directeur général des services de la ville de Reims et de Reims Métropole, directeur du master « management des collectivités locales » à l’IEP de Lyon ; et de M. Christophe Parisot, directeur des finances publiques de Fitch Ratings France (Procès-verbal de la séance du mardi 18 octobre 2011) 270
Table ronde sur L’obligation de conseil des établissements de crédit, avec la participation de M. Richard Routier, professeur à l’université de Strasbourg, auteur de « Obligations et responsabilités du banquier » paru en juillet 2011 ; de Me Bruno Wertenschlag, avocat associé ; de M. Olivier Poindron, consultant, cabinet FIDAL ; et de M. Gilles Sébé, président de Seldon Finance (Procès-verbal de la séance du mardi 18 octobre 2011) 282
Table ronde sur Les produits structurés commercialisés par les banques, avec la participation de M. Pierre Mariani, président du comité de direction de Dexia SA ; de M. Olivier Klein, directeur général en charge de la banque commerciale et assurance du groupe BPCE , de M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du secteur public de BPCE ; de M. Francis Canterini, directeur général délégué du Crédit agricole Corporate & Investment Bank (CA CIB), filiale de la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit agricole ; et de M. Philippe Debin, directeur adjoint de la direction des régions de France (Procès-verbal de la séance du mercredi 2 novembre 2011). 299
Table ronde sur La politique commerciale des filiales françaises de banques étrangères, avec la participation de M. Pascal Poupelle, responsable France Belgique et Luxembourg au sein du groupe Royal Bank of Scotland ; de M. Marc Pandraud, président du groupe Deutsche Bank France ; de M. Alain Gaudry, responsable des activités de marché du groupe Deutsche Bank France ; et de M. Jean Christophe, directeur général de la filiale française du groupe irlandais Depfa Bank plc et directeur général de la Deutsche Pfandbriefbank (Procès-verbal de la séance du mercredi 2 novembre 2011). 318
Auditions, non ouvertes à la presse, sur le thème Quelle régulation des établissements de crédit spécialisés ? de Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; de M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de l’ACP ; de M. Patrick Montagner, directeur du contrôle des établissements de crédit généraux et spécialisés, de M. Thierry Mergen, délégué au contrôle sur place des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; et de M. Sébastien Clanet, chef du service du financement des particuliers et des collectivités territoriales au secrétariat général de l’ACP (Procès-verbal de la séance du mercredi 9 novembre 2011). 332
Audition, non ouverte à la presse, de M. Éric Gissler, inspecteur général des finances, médiateur désigné par le Premier ministre, sur La médiation sur les emprunts à risques : quel bilan ? (Procès-verbal de la séance du mercredi 9 novembre 2011) 348
Auditions, sur le thème La politique de prêts de Dexia, de M. Pierre Richard, ancien président de Dexia ; de M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit Local, actuellement directeur général délégué en charge du pôle entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel/Arkéa ; de M. Bruno Deletré, ancien directeur général des services financiers au secteur public, financement de projets et rehaussement de crédit de Dexia SA, actuel directeur général du Crédit Foncier , et de M. Alain Delouis, ancien directeur général de TFM, membre du comité de direction de Dexia SA, actuellement directeur des ressources humaines de Natixis (Procès-verbal de la séance du mardi 15 novembre 2011) 359
Audition de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales (Procès-verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011) 375
Table ronde sur le thème Quelle diversification du financement des acteurs publics locaux ?, avec la participation de M. Olivier Landel, délégué général de l'association d'étude pour l'Agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) et délégué général de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF) (Procès-verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011) 386
Suite de la table ronde sur Les produits financiers à risque avec la participation de M. Michel Klopfer, président et fondateur du cabinet KLOPFER (Procès-verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011) 393
Audition de M. Patrice Chatard, directeur général, et de M. Jacques Descourtieux, directeur général de Finance active (Procès-verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011) 401
Table ronde sur Les propositions des associations d’élus locaux, avec la participation de M. Michel Piron, député, président délégué de l’Association des communautés de France (AdCF) ; de Mme Claire Delpech, responsable des questions finances et fiscalité à l’AdCF ; de M. Dominique Gaubert, adjoint au maire de Sannois et membre de la commission des finances de l’Association des maires de France (AMF) ; et de Mme Soraya Hamrioui, chargée d’études au département finances de l’AMF (Procès-verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011) 409
Table ronde sur Le rôle de l’État avec la participation de M. Éric Jalon, directeur général des collectivités locales (DGCL) au ministère de l’Intérieur ; de M. Philippe Parini, directeur général des finances publiques au ministère du budget ; de M. Hervé de Villeroché, chef du service du financement de l’économie ; et de M. Sébastien Boitreaud, sous-directeur « Banques et financements d’intérêt général » de la Direction générale du Trésor (Procès-verbal de la séance du mardi 29 novembre 2011) 416
Audition de M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Procès-verbal de la séance du mardi 29 novembre 2011) 434
Table ronde, ouverte à la presse, sur la gestion des emprunts toxiques : les expériences de plusieurs collectivités territoriales, avec la participation de : M. Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres, chargé des finances ; M. Daniel Guiraud, vice-président chargé des finances du conseil général de la Seine-Saint-Denis, accompagné de M. Philippe Yvin, directeur général des services, de M. Axel Guglielmino, directeur adjoint de la direction du budget, et de M. Tony Di Martino, chargé de mission ; M. Simon Fortel, directeur des finances à la ville de Rouen.
(Procès verbal de la séance du Mercredi 6 juillet 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Notre rapporteur, Jean-Pierre Gorges, n'ayant pu être présent lors de notre réunion constitutive du 22 juin dernier, je lui donne immédiatement la parole afin qu’il nous dise dans quel esprit il conçoit le travail de cette commission d’enquête.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Je suis sensible à la confiance que m'a témoignée le groupe UMP en me proposant aux fonctions de rapporteur, dont je compte m'acquitter avec neutralité et discernement. J'assurerai à ce titre, en tandem avec Claude Bartolone, la conduite des auditions et il me reviendra, le moment venu, de vous proposer d'approuver le rapport qui conclura nos travaux
Comme notre Président, je dirige une collectivité territoriale et je suis très attaché à la fonction et à l'action publique locales. Je partage donc son souci de garantir aux collectivités les moyens financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Le recours à la dette fait normalement partie de ceux-ci. Il nous faudra étudier les produits structurés, aujourd'hui sur la sellette, avec toute l'objectivité requise et avec le souci d’aboutir à un diagnostic partagé : ont-ils permis à certaines collectivités de réduire durablement leur charge d'intérêts ? Sont-ils tous toxiques ou faut-il distinguer plusieurs catégories parmi eux ?
D’autre part, le principe de libre administration, inscrit dans notre Constitution, garantit à nos concitoyens une gestion de proximité – plus efficace – des services publics locaux. Dans l'analyse de la chaîne des responsabilités, nous ne devons en éluder aucune. Décisions des élus locaux, politique commerciale des banques, silence de certains préfets et de certains trésoriers-payeurs généraux : notre travail est de nous intéresser à tous ces éléments, qui ont pu peser lourd dans l'aggravation des difficultés de certaines collectivités.
Afin qu'ils soient efficaces, je souhaite que nos travaux débouchent sur des préconisations opérationnelles. Il nous faudra en particulier identifier les moyens juridiques permettant aux collectivités les plus fragilisées de transiger avec leurs prêteurs. Les leçons de ces difficultés devront également être tirées pour l'avenir, afin de renforcer la sincérité des comptes des collectivités territoriales.
M. le président Claude Bartolone. Nous allons maintenant débuter nos travaux en recevant les représentants de trois collectivités qui ont été confrontées aux difficultés engendrées par des emprunts toxiques : M. Daniel Guiraud, vice-président chargé des finances au conseil général de la Seine-Saint-Denis, accompagné de M. Philippe Yvin, directeur général des services, de M. Axel Guglielmino, directeur adjoint de la direction du budget, et de M. Tony Di Martino, chargé de mission ; M. Simon Fortel, directeur des finances à la ville de Rouen, et M. Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres, chargé des finances.
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de venir si rapidement témoigner devant notre commission d'enquête. Vous savez qu’elle a pour objet de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des emprunts et produits structurés ont été souscrits auprès d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement par les collectivités territoriales, par leurs groupements et par les autres acteurs publics locaux.
À compter des années quatre-vingt-dix, le groupe bancaire Dexia, spécialisé dans le financement des collectivités territoriales, ainsi que de nombreux autres établissements de crédit – Calyon, filiale de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, le groupe Banques populaires-Caisses d'épargne (BPCE), la Société générale, Royal Bank of Scotland (RBS), la Deutsche Bank ou encore le groupe irlandais Depfa Bank plc – ont développé une offre de produits de financement dits « structurés ». Les collectivités territoriales, confrontées à la même époque à des taux fixes élevés, ont été séduites par la perspective de faire baisser la charge de leur dette. Certaines ont ainsi accepté de substituer à leurs prêts à taux fixe des prêts structurés à taux variable, offrant des mensualités de remboursement moindres mais beaucoup plus risqués : ces prêts ont en effet la particularité d'être indexés, ce qui peut avoir pour effet, en cas par exemple de forte chute d'une monnaie par rapport à une autre, d'augmenter les taux d'intérêt de manière exponentielle.
Les difficultés sont particulièrement spectaculaires dans quelques grandes collectivités – comme les vôtres – mais elles concernent aussi de nombreuses municipalités moyennes ou petites. D’ailleurs, depuis que nous avons créé cette commission d'enquête, beaucoup d'élus locaux, qui hésitaient encore à évoquer publiquement les difficultés auxquelles ils sont confrontés, se décident de plus en plus à faire savoir quelle est leur situation. Gageons que nos travaux permettront de délier les langues pour nous permettre de comprendre encore mieux ce qui a pu se passer dans de grandes comme dans de très petites collectivités !
Je vais céder la parole au rapporteur, M. Jean-Pierre Gorges, pour un échange de questions et de réponses. Puis j'inviterai nos collègues à poser leurs questions.
Pour ma part, je souhaite vous demander pourquoi, selon vous, ces emprunts à risque ont été souscrits sans précaution. Quelle information a pu à l'époque être donnée aux administrations et aux élus ? En vous fondant sur les documents en votre possession, estimez-vous qu'il y a eu « tromperie sur la marchandise » ? Que pensez-vous du contrôle de légalité auquel ont été soumis les actes pris par vos collectivités ?
Avant que vous ne répondiez, je dois vous rappeler que l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires exige des personnes auditionnées par une commission d'enquête qu'elles prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
MM. Franck Masselus, Tony Di Martino, Daniel Guiraud, Philippe Yvin et Simon Fortel prêtent successivement serment.
M. le rapporteur. Mes questions, très pragmatiques, appelleront des réponses précises. Les premières portent sur la souscription de ces emprunts dont certains seraient devenus toxiques.
Quels sont les principaux types d'emprunts structurés souscrits par vos collectivités ? Quel est aujourd'hui, en volume comme en pourcentage de la dette globale, le montant de l'endettement correspondant à ces produits ? Quelle proportion de ces emprunts jugez-vous toxique ou, à tout le moins, porteuse d’un risque ? Quelle proportion est hors charte Gissler ?
M. Franck Masselus, adjoint au maire de Chartres, chargé des finances. Les directeurs généraux des services, les directeurs des finances et moi-même – en tant à la fois que vice-président de l'agglomération et adjoint au maire – travaillons de façon collégiale au sein de la commission élargie qui a été créée dès 2001, conformément à la volonté du député-maire, et qui regroupe la ville de Chartres et l’agglomération, mais aussi un certain nombre de structures comme une société d'économie mixte et Chartres habitat. Les décisions sont donc prises dans ce cadre, ainsi que sous la couverture et la signature du maire.
L'analyse consolidée des emprunts montre que l’un des produits souscrits par la ville de Chartres auprès de la Caisse d'épargne, Helvetix, peut être considéré comme toxique. Reposant sur la parité euro-franc suisse, il a connu depuis deux ans une certaine dérive. Cet encours représente aujourd'hui 11,13 % de l'encours global de la ville, soit 8,4 millions d'euros sur un total de 75 millions.
Ce produit a été souscrit en 2006, alors que j'ai eu à emprunter, tant pour la ville que pour l'agglomération, plusieurs dizaines de millions d'euros. À cette époque, l’Euribor 12 mois variait de 150 points de base. J'ai alors morcelé ces emprunts par tranches d'environ 10 millions d'euros et j'ai diversifié les placements.
Au titre de l'agglomération, nous avons également souscrit un produit reposant sur la parité euro-franc suisse et euro-dollar, qui représente 13,5 millions d'euros sur un encours global de 100 millions, et qui évolue aujourd'hui aussi de façon défavorable.
J'insiste sur le fait que, lorsque nous effectuons de tels choix, nous disposons des marges de manœuvre nécessaires. Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d'optimiser nos charges financières et le taux moyen d'intérêt est de 2,81 % pour les encours de la ville et de 2,89 % pour ceux de l'agglomération alors qu'il serait de 4,5 %, voire de 5 %, si j'avais, à la même époque, souscrit ces emprunts à taux fixe.
M. Daniel Guiraud, vice-président chargé des finances du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Dès qu'il a été élu président du conseil général de Seine-Saint-Denis, il y a trois ans, Claude Bartolone a mandaté le cabinet Michel Klopfler pour évaluer l'état des finances départementales. Le rapport remis en septembre 2008 a mis en lumière un fait extrêmement inquiétant, à savoir que l’encours de la dette était composé à 97 % de produits structurés. Le président du conseil général nous a alors donné pour consigne de consolider l'encours et, depuis trois ans, tous les nouveaux prêts ont été souscrits par le département à des taux fixes que nous sommes parvenus à négocier sur le marché à 3,6 ou 3,7 %. De la sorte, nous avons mécaniquement ramené la part des produits structurés à 71 % des 952,7 millions d'euros de l'encours global.
Composé de 46 lignes de prêts souscrits auprès de neuf institutions financières, cet encours comporte 18 produits d'opérations de couverture, dont on peut se demander en quoi ils sont sécurisants puisqu'ils aggravent parfois le sous-jacent du prêt initial. Les prêts à taux fixe souscrits depuis que Claude Bartolone est président du conseil général représentent désormais 27,7 % de l'encours, soit 263 millions, auxquels s'ajoutent, de manière résiduelle, 5,6 millions en taux capé – soit 0,5 %. Pour leur part, les produits à taux structurés représentent 71,7 % de l'encours, pour un montant de 683 millions.
Au regard de la charte Gissler, qui donne une sorte d'échelle de Richter de la toxicité de ces prêts – de 1 à 6 et de A à F –, 31 % de notre encours se situent hors charte, au niveau 6F, le plus dangereux. Il s'agit, comme dans le cas de la ville de Chartres, de produits reposant sur la parité euro-franc suisse, mais aussi de produits de pente, assis sur les courbes de taux. Au dernier fixing, un emprunt Depfa, qui était au cours de la période d'appel à un taux fixe anormalement bas de 1,47 %, est monté à 24,2 % et il serait même à 36 % si le fixing avait lieu cette semaine…
Nous sortons en effet, peu à peu, de la période d'appel. À cette occasion, un produit Crédit agricole devrait passer à 13,9 % et deux swaps de couverture Natixis à 18,4 et à 16,8 %. Les prévisions à échéance d'un an nous rendent extrêmement pessimistes car on pourrait assister à une véritable envolée des taux d'intérêt.
Le président Bartolone nous ayant demandé de sécuriser le plus possible l'encours, de très nombreux contacts ont été pris avec les banques, avec lesquelles nous avons tenu pas moins de soixante réunions. Nous avons également sollicité la médiation Gissler. Or, bien que le médiateur ait fait son travail, les résultats sont extrêmement décevants en raison de l'intransigeance des banques, notamment à propos des conditions de sortie de certains prêts hors charte Gissler – les prêts 6F –, qu’il s'agisse des taux, qui passent rapidement à deux chiffres, de la soulte de sortie, qui peut aller de 25 à 200 % du capital restant dû, ou de la durée du prêt.
M. Simon Fortel, directeur des finances à la ville de Rouen. Comme d'autres collectivités, la Ville de Rouen a été confrontée à ces produits dits nocifs ou toxiques, qui constituaient environ 80 % du stock de la dette en 2008, au moment du changement de majorité et de l'élection de Valérie Fourneyron. Il s'agissait essentiellement de produits structurés à effet cumulatif, dits snowball : une fois que l'on est sorti de la période de garantie ou d’encadrement du taux d'intérêt, ce dernier augmente par effets cliquets successifs, sans cap ni limite. Confrontée à un risque extrêmement important, la municipalité actuelle a fait beaucoup d'efforts auprès des banques concernées – RBS et Natixis – afin de sortir de ces produits à effet cumulatif.
Nous avons désormais renversé la tendance sans avoir eu besoin de recourir au contentieux, même si nous en avons menacé Natixis avant de parvenir finalement à un protocole d'accord. La solution trouvée est cependant onéreuse pour la ville puisque nous avons accepté de rembourser en dix ans les gains qui avaient été initialement dégagés. Qui plus est, la neutralisation de l'effet snowball a conduit à repartir sur la base de taux certes fixes mais avec des marges extrêmement importantes.
Aujourd'hui, notre dette n’est plus composée qu’à 15 % de produits « difficiles », dont plus de la moitié à échange de taux – euro-dollar et euro-franc suisse – pour lesquels la sortie de la période de garantie se fait à des taux tout à fait prohibitifs, de 20 ou 30 %, que le budget d'une collectivité comme la nôtre ne permet pas d'absorber.
En dépit de l'important travail réalisé, nous détenons encore, sur un stock de dette de 174 millions d'euros, 12 millions de produits RBS basés sur des taux de change et environ 7 millions de produits Dexia basés sur un taux Libor US$ avec coefficient multiplicateur.
Après nous être employés totalement en vain à poursuivre les négociations avec RBS et Dexia, qui semblent sourdes à nos difficultés, nous avons saisi le médiateur et nous attendons son intervention pour reprendre des discussions dont nous espérons qu'elles seront enfin positives.
M. le président. Vous évoquez de façon assez diplomatique la sortie des produits snowball, mais à combien estimez-vous le taux d'intérêt dans le cadre du protocole de sortie ?
M. Simon Fortel. À environ 5 %, l’indexation étant sur l’Euribor 3 mois, plus une marge bancaire de 2,76. Cela ne semble pas excessif sachant que la renégociation a eu lieu en 2009, mais le taux ne serait pas le même aujourd'hui.
M. Philippe Yvin, directeur général des services du conseil général de la Seine-Saint-Denis. De nombreuses banques contestent qu’il s’agisse de produits spéculatifs, d'autant que les collectivités locales avaient interdiction d’en souscrire. Or des contrats de couverture présentent des résultats aujourd'hui totalement négatifs et leurs taux atteignent le triple de ceux des emprunts qu'ils sont censés couvrir. Alors qu'ils étaient conçus pour protéger contre les risques des emprunts sous-jacents, leur vie autonome de produits financiers spéculatifs en a fait des produits extrêmement dangereux. C'est notamment le cas des produits spéculatifs à double parité euro-dollar et euro-franc suisse, dont les taux dépassent 10 % du fait du décrochage de l'euro par rapport au franc suisse et du raffermissement du dollar. Ainsi nous prévoyons pour 2012 une augmentation de 20 % – de 30 à 37 millions d'euros – des intérêts que le département de la Seine-Saint-Denis aura à verser, tandis que les annuités de remboursement du capital n'augmenteraient que de 1 %, autour de 54 à 55 millions. Cela tient notamment au fait que, pour la première fois depuis que le département a souscrit les contrats de couverture, ceux-ci deviendraient globalement négatifs à hauteur de 4 millions, contribuant à eux seuls pour plus de 10 % au renchérissement de 20 % des frais financiers.
M. le président. Après que vous nous avez décrit la situation, nous allons nous attacher à en comprendre la dynamique.
M. le rapporteur. Pourriez-vous nous indiquer à quelle période ces emprunts structurés ont été contractés ? Certes, on s'aperçoit maintenant que ces produits sont onéreux pour la collectivité, mais lui ont-ils été utiles, au moins pendant un certain temps, avant qu'ils ne deviennent toxiques quand leurs taux ont cessé de correspondre aux attentes ?
M. Franck Masselus. Nous avons souscrit le produit Helvetix en 2006, à un moment où notre besoin de ressources était important et où nous cherchions à optimiser nos charges financières et à accroître notre sécurité. Contrairement à mes collègues, je suis encore dans la phase des cinq ans de garantie et je bénéficie d'un taux bonifié à 2,75 % – d’où le taux moyen d'intérêt à 2,89 % pour la ville de Chartres. En prenant en compte l'échéance du 1er décembre, sur un emprunt de 10 millions, j'ai gagné 650 000 euros par rapport à un taux fixe qui nous était alors proposé à plus de 4 %.
Sur Dualis, produit de Dexia indexé sur la parité euro-franc suisse, auquel nous avons souscrit en 2007, j'ai réalisé à ce jour une économie de 743 000 euros.
Je ne me heurte pas aux mêmes problèmes que mes collègues dans mes rapports avec mes partenaires financiers, en particulier les groupes Caisse d'épargne, Crédit agricole et Dexia. Nous nous rencontrons au moins deux fois par an et le rythme de nos entretiens s’est même élevé puisque je leur demande maintenant presque chaque mois des cotations en vue d'une éventuelle sortie des produits classés 6F et j'ai de leur part des propositions concrètes à cette fin. Je les sollicite en outre en vue des investissements massifs auxquels nous continuons à procéder, par exemple pour la réalisation d'une station d'épuration ou d'un équipement culturel et sportif. Ils se montrent d'autant plus ouverts que nos besoins financiers demeurent importants.
En 2001, lorsque Jean-Pierre Gorges a été élu, nous avons trouvé un encours de 50 millions d'euros alors même que nos prédécesseurs avaient réalisé peu d'investissements. En tenant compte de la structure de cette dette, j'ai pu, pendant une partie du premier mandat, réduire cet encours de plus de moitié, ce qui m'a permis par la suite de relancer l’investissement pour un montant de 185 millions d'euros au cours des six dernières années, pour la seule ville de Chartres. J'ajoute que cela a été fait tout en diminuant chaque année la pression fiscale, sans garder l'œil rivé sur les charges financières, qui ne représentent que 2 % de mon budget. Je dispose donc bien de marges financières, y compris si ces charges étaient appelées à doubler ou à tripler.
M. le rapporteur. Dans la mesure où l'on est toujours dans la période de garantie, les menaces demeurent latentes.
M. Daniel Guiraud. La souscription de ces produits a débuté en 2002 et s'est achevée en 2008, avec l'élection de Claude Bartolone.
L'intérêt qu'ils présenteraient pour la collectivité est un des arguments des prêteurs. Ce n'est vrai que si l'on raisonne à très court terme : lorsque le taux effectif global du marché approche de 5 % et qu'un prêteur vous consent un taux à 1,5 % sur un prêt de plusieurs dizaines de millions d'euros, cela a bien évidemment des incidences importantes sur les dépenses de fonctionnement. Mais il peut suffire d'une seule année en structure activée pour annihiler tous les gains dégagés lorsque le taux était bas, pendant la période d'appel comme pendant la période de sortie. On imagine ce que peut être la perte pour la collectivité lorsque l'on demeure treize ou quatorze ans en structure activée…
M. Philippe Yvin. Ces produits existent depuis longtemps et ils ont été renégociés à plusieurs reprises, avec à chaque fois des marges considérables pour les banques. Les calculs de valeur actualisée nette qui ont été faits sur les coûts d'intérêt comparés montrent que, dès l’époque à laquelle ils ont été souscrits, et où les taux apparents bonifiés étaient très favorables, des emprunts à taux variable, basés sur l’Euribor par exemple, étaient préférables à ces produits extrêmement compliqués.
M. Simon Fortel. La ville de Rouen, pour qui un point de fiscalité représente 650 000 euros, a été touchée à partir de 2005. Dans notre protocole d'accord avec Natixis, nous nous sommes engagés à rembourser les gains dégagés par les produits en question, soit 3,6 millions d'euros en trois ans. C’est donc cette somme qu’il n’a pas été nécessaire de demander aux contribuables locaux de 2005 à 2008 alors que, les élections approchant, il devenait difficile au maire d'augmenter les impôts… C’est pourquoi, au fur et à mesure que les marges de la collectivité se sont amenuisées, une des solutions envisagées pour continuer à offrir aux habitants des services inchangés a été de réduire les charges financières.
M. le rapporteur. Mais vous vous trouvez aujourd’hui dans une situation inverse…
M. Simon Fortel. La période de garantie étant relativement brève – deux ou trois ans –, nous en sommes sortis au moment où survenait la crise de 2008, que les banquiers n’avaient pas intégrée dans leurs anticipations – ce qu’ils appellent les « forwards » et qui se résume à des formules mathématiques fondées sur les historiques.
M. le rapporteur. J’en viens aux responsabilités. Qui a signé ces contrats ? Quelle était la délégation du conseil municipal au maire ? Quelles informations ce dernier lui a-t-il données ? A-t-on fait appel à des conseils extérieurs au moment où les choix ont été faits ?
M. Franck Masselus. J’ai bien évidemment délégation du maire pour passer de tels contrats. Mais c'est un domaine dans lequel il faut être extrêmement réactif : bien souvent, on tope en direct avec la salle des marchés et il est donc exclu de passer par des commissions d'appel d'offres.
Le maire fait bien évidemment état des décisions à chaque conseil municipal. En ma qualité d'adjoint aux finances, je réunis à l'occasion de la présentation de chaque document budgétaire important une commission générale ouverte à l'ensemble des élus. Ainsi, je viens de faire approuver le compte administratif : toute une partie du rapport d'analyse était consacrée à la structure de la dette et à la charge financière. Depuis dix ans, on ne m'a pratiquement jamais interrogé sur la souscription de ces emprunts et sur la restructuration de la dette. L'opposition n'a réagi que lors du dernier conseil municipal – peut-être n'est-ce pas sans lien avec la création de cette commission d'enquête… – et semble désormais vouloir faire peur aux Chartrains, en oubliant que les décisions ont été précédées d'une analyse et qu'elles ont permis d'investir.
M. Philippe Yvin. Le conseil général de Seine-Saint-Denis a pris chaque année une délibération-cadre très générale donnant délégation au président pour les emprunts et couvrant à peu près tous les produits possibles. Le vice-président chargé des finances, qui signe lui-même les contrats, faisait ensuite en commission permanente un compte rendu des opérations effectuées.
M. Simon Fortel. La ville de Rouen fonctionne sensiblement selon le même schéma, avec une délégation donnée au maire et une signature des contrats par un adjoint.
Cela a été dit, ces opérations échappent au code des marchés publics. Il faut souvent agir dans une « fenêtre de tir » extrêmement réduite ; tout se passe au téléphone avec la salle des marchés ; on tope à l’instant t ; puis l’opération est bouclée, éventuellement débouclée, sur les marchés. De la sorte, la décision intervient a posteriori et est récapitulée dans un compte rendu au conseil municipal. L’ingénierie et le vocabulaire complexes rebutent nombre d’adjoints et même de techniciens et tout cela apparaît comme une affaire de spécialistes traitée entre spécialistes. Qui plus est, nous faisions une confiance un peu aveugle aux établissements bancaires dont les commerciaux nous vantaient « le produit de l’année » qu’il fallait saisir pour bénéficier des « opportunités » du marché…
M. Serge Janquin. Selon la taille des collectivités et selon les volumes d’engagements, ces opérations ont eu des conséquences différentes, parfois dramatiques. Dès lors, nous nous demandons si les contractants étaient à égalité dans la maîtrise des produits proposés, notamment dans la capacité d’apprécier des risques qui n’apparaissaient pas alors aussi évidents qu’aujourd’hui. Je vous trouve d’ailleurs extraordinairement fair-play vis-à-vis des organismes prêteurs – dont nous auditionnerons bien évidemment les représentants. Il me semble pourtant que vous demeurez vis-à-vis d’eux dans une certaine dépendance puisque la crise et la nécessité de sortir de ces produits structurés vous poussent à négocier de nouveaux emprunts. Parviendrez-vous cette fois à traiter d’égal à égal ?
Avec le recul, que pouvez-vous nous dire du rapport de confiance qu’entretenaient, avant ces opérations, les collectivités avec les établissements bancaires ? Lorsque ces derniers vous proposaient de souscrire dans l’urgence, aviez-vous connaissance de leurs travaux d’ingénierie financière et de leurs modèles mathématiques ? Êtes-vous désormais plus méfiants ?
Nous n’aurons vraisemblablement pas la possibilité de chiffrer les dommages que vous avez subis. Dès lors, il me paraît essentiel de mettre l’accent sur les rapports de confiance que vous avez eus, que vous pourriez encore avoir – ou que, peut-être, vous n’aurez jamais plus –, et de chercher les moyens de rétablir une égalité entre les cocontractants. Cela suppose sans doute que les collectivités locales, y compris les plus petites, disposent elles-mêmes d’une ingénierie et que les élus et leurs collaborateurs soient suffisamment formés.
M. Dominique Baert. Mes questions portent sur le déroulement des opérations. Vous avez souligné qu’il fallait réagir vite au moment de la souscription et parfois donner son accord en direct de la salle des marchés. La notion de preuve et le moment où l’accord a été donné apparaissant très importants, avez-vous souvenir que les conversations que vous avez eues ont été enregistrées ? Certains établissements vous en ont-ils fait la demande ? Lesquels ? Et si les collectivités ne disposent pas de ces enregistrements, n’est-ce pas un élément du rapport inégal qu’évoquait Serge Janquin ?
On vous a donc demandé, en direct de la salle des marchés, de donner votre accord à la souscription – et, curieusement, il s’est trouvé que le taux était très exactement celui qui vous avait été annoncé quelques jours plus tôt ! Vous a-t-on demandé à ce moment d’indiquer si vous aviez tout pouvoir et toute délégation pour engager effectivement votre collectivité ?
M. le président. Considérez-vous que les collaborateurs des collectivités sont à égalité avec les prêteurs ?
M. Franck Masselus. Nous avons constitué récemment une agglomération regroupant trente-deux communes et plusieurs ont souhaité bénéficier de l’expertise de la commission élargie créée à Chartres depuis une dizaine d’années. Les maires de petites communes se trouvent en effet dépourvus lorsqu’il leur faut mener à bien seuls une opération de refinancement.
Oui, avant que je ne « tope », l’établissement financier a chaque fois demandé qu’on lui faxe ma délégation et toutes les opérations ont fait l’objet d’un enregistrement, dont nous avions la communication. Oui également, le taux en salle des marchés était celui qu’on nous avait annoncé la veille, à quelques points de base près.
Je persiste à garder confiance dans mes partenaires financiers. L’argent est une ressource dont nous avons besoin et notre relation avec eux est une relation normale de client à fournisseur. Nous leur demandons régulièrement de re-coter les produits et nous continuons de négocier, bien que nous soyons encore en phase de taux garanti ; c’est ainsi qu’ils nous font des propositions pour sécuriser l’emprunt à un taux de 5 % au cours des deux prochaines années, le tout assorti de contreparties habilement présentées. Mais je fais re-coter par un autre établissement et je suis à même de vérifier si mon interlocuteur fait ou non un effort !
M. Philippe Yvin. Le fait de se retrouver en liaison avec une salle des marchés peut impressionner, et les banques en ont joué pour donner à des fonctionnaires territoriaux l’illusion qu’ils étaient devenus de véritables financiers, discutant presque à égalité de compétence avec leur prêteur. J’en ai moi-même fait l’expérience en arrivant en Seine-Saint-Denis – j’ai néanmoins refusé de toper ! On peut d’ailleurs s’interroger sur la légalité de cette pratique, consistant à faire toper des personnes dont on n’est pas assuré qu’elles aient qualité pour agir au nom de la collectivité. Nous avons été confrontés à un problème de ce genre à notre arrivée : en février 2008, des fonds avaient été versés au département après qu’on eut topé, et le contrat n’a jamais été signé.
Quand on lit les comptes rendus de ce qui s’est dit en commission permanente du conseil général tout au long de ces années, on s’aperçoit que les arguments avancés reproduisaient ceux des commerciaux, de Dexia notamment. On y retrouve les mêmes affirmations catégoriques, par exemple sur l’impossibilité historiquement démontrée de voir un jour franchie la barrière des 87 yens pour un dollar ou du franc suisse à 1,42 euro ! Élus et fonctionnaires n’étaient évidemment pas en mesure de contrer ces discours et c’est d’ailleurs en partie en se fondant sur cette inégalité de l’information entre le prêteur et l’emprunteur que la cour fédérale de Karlsruhe a récemment condamné la Deutsche Bank : la banque se devait de mettre à la disposition de ses clients les formules à l’aide desquelles elle évalue les risques attachés à ces produits extrêmement complexes.
M. Simon Fortel. Dans notre cas également, les banques ont toujours demandé que nous leur transmettions les documents certifiant que l’adjoint qui donnait l’accord – car il s’agissait toujours d’un élu, et non d’un fonctionnaire – disposait bien de la délégation lui permettant de s’engager.
L’accord était également enregistré, et nous en étions avisés. Ce cérémonial pouvait, c’est vrai, donner aux élus, voire aux fonctionnaires territoriaux, le sentiment d’être des experts financiers. Or, non seulement nous ne sommes pas des professionnels de la finance, mais nous avons peu de moyens pour évaluer les marges dégagées par les banques sur les produits qu’elles proposent. Nous pouvons certes demander à d’autres établissements de re-coter. Depuis trois ou quatre ans, nous pouvons également utiliser un site Internet spécialisé, celui de Finance Active. Faire une recherche sur la marge dégagée par la banque pour tel ou tel produit coté requiert néanmoins une certaine expertise, dont seuls disposent les grandes collectivités.
M. Thierry Carcenac. Le payeur départemental ou municipal a-t-il formulé des remarques dans le cadre habituel de vos relations ? Le contrôle de légalité a-t-il de même fait des observations sur les délibérations qui lui étaient transmises ?
Pour la négociation en cours sur la sortie des emprunts, parvenez-vous à trouver des banquiers prêts à discuter avec vous, hormis bien entendu vos prêteurs ? Bref, arrivez-vous à trouver d’autres partenaires ?
M. Michel Diefenbacher. Je comprends que, dans une affaire de cette nature, le payeur ait été essentiellement un observateur, et qu’il n’ait pas nécessairement la compétence pour tirer la sonnette d’alarme. Mais il a par ailleurs une fonction générale de conseil. À ce titre, il aurait pu s’interroger, et se tourner – en l’absence de réponse – vers le trésorier-payeur général, qui vous aurait alors fourni des éléments d’appréciation. Ce système d’alerte a-t-il fonctionné ? Vous-mêmes, avez-vous estimé, à un moment donné, que le payeur municipal n’était pas en mesure de vous apporter les conseils attendus, et avez-vous envisagé de vous tourner vers le trésorier-payeur général ?
Quant au contrôle de légalité, je ne suis pas surpris qu’il ne soit pas intervenu. Rien n’était en effet contraire à la légalité au moment de la souscription, et la qualification technique des préfectures dans ce domaine très pointu ne va pas de soi. En revanche, on aurait pu attendre un véritable conseil de la part des services financiers.
M. Franck Masselus. Je ne suis pas certain en effet que le payeur dispose des compétences nécessaires dans ses services. Sa démarche est plus tournée vers l’analyse, dans le cadre du rapport de gestion. Nous lui transmettons en tout cas régulièrement les informations sur ce type d’opérations.
J’en viens au contrôle de légalité. La ville de Chartres était à l’époque en conflit avec un service de la préfecture. Notre budget avait en effet été déféré à la chambre régionale des comptes pour non-constitution d’une provision sur une délégation de service public. Nous n’avons reçu aucun signe de la préfecture durant cette période. Depuis l’arrivée du nouveau préfet, j’ai pu expliquer la position de la ville, mais les analyses se sont concentrées sur la situation des petites communes, qui ne disposent pas d’une véritable expertise dans leurs services.
Voilà trente ans que les collectivités ont le pouvoir d’« aller chercher » cette ressource que constitue l’argent. En 1985, l’encours des collectivités territoriales n’était constitué que d’emprunts à taux fixe. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il faut mesurer les gains que ces années ont permis sur l’ensemble du territoire. L’encours des collectivités territoriales atteint désormais 140 milliards d’euros ; leurs investissements représentent 70 % des investissements publics. J’espère donc que cette commission d’enquête ne débouchera pas sur un durcissement de leurs relations avec leurs partenaires financiers. Il ne faudrait pas que ceux-ci soient contraints de ne plus nous proposer que des taux fixes. Quant aux provisions, elles relèvent de notre libre appréciation. Je ne vois donc pas l’intérêt d’un dispositif à cet effet.
M. Daniel Guiraud. S’agissant de notre département, le préfet et le trésorier-payeur général n’ont formulé aucune observation particulière. Mais la direction générale des collectivités locales (DGCL) elle-même ne l’a pas fait, alors même qu’une circulaire de 1992 – récemment remaniée – encadre le crédit aux collectivités locales.
M. Philippe Yvin. On peut en effet s’interroger sur la possibilité même d’une telle intervention, mais on ne peut éluder la question du rôle du contrôle de légalité. En réalité, le contrôle n’incombait guère au trésorier-payeur général ou au payeur départemental, dès lors que la légalité externe des actes qui leur étaient communiqués pour procéder au paiement était établie. Il en va autrement pour le préfet. Les comptes rendus des assemblées délibérantes faisaient en effet précisément état des contrats, dont il est difficile de dire que certains n’étaient pas spéculatifs – même si les banques affirmeront sans doute le contraire pour leur défense. Or la circulaire de 1992 excluait explicitement les contrats spéculatifs du champ des prêts pouvant être souscrits par les collectivités locales. Les préfets n’auraient-ils pas dû exercer une surveillance et veiller à ce qu’elles n’en souscrivent pas ?
M. Simon Fortel. La préfecture et le trésorier municipal n’ont pas formulé de remarques particulières. Le contrôle du second est davantage orienté vers l’exécution des dépenses publiques et le recouvrement des produits locaux. Quant à la chambre régionale des comptes, qui a procédé à une vérification approfondie des comptes de la ville de Rouen en 2006-2007, son rapport n’a pas abordé ce sujet.
M. le rapporteur. Dans la phase amont, on peut comprendre que le trésorier-payeur municipal n’ait rien décelé. Il en va de même de la chambre régionale des comptes. La ville de Chartres a été contrôlée. La chambre régionale a rendu un rapport qui nous était très favorable ; elle n’a pas vu que nous avions souscrit un produit qui était susceptible de dériver.
Maintenant que le problème est connu de tous, êtes-vous capable d’estimer les risques que vous encourez ? Avez-vous prévu des mécanismes de provisions ? Car cette fois-ci, le trésorier-payeur municipal ne manquera pas d’alerter le trésorier-payeur général. De même, le contrôle de légalité pourra considérer qu’en l’absence de provisions, les comptes ne sont pas sincères puisque la presse fait état de risques. Il est un fait que personne n’est intervenu dans la phase amont. Comment comptez-vous vous y prendre dans la phase aval ?
M. Jean Proriol. Vous aviez plusieurs banques pour interlocuteurs. Vous est-il arrivé d’avoir des « non-réponses » à vos questions sur les propositions qu’on vous faisait, ou avez-vous au contraire le sentiment que des interlocuteurs haut placés sont venus tout exprès vous trouver pour lancer un produit « miraculeux » permettant de faire un peu de spéculation ? Il semble en effet que le phénomène ait concerné tous les réseaux bancaires, qui ont tous vendu pratiquement le même produit au même moment.
M. Franck Masselus. Je me souviens qu’un partenaire financier est venu me trouver pour me vendre ce qu’il présentait à l’époque comme le produit de l’année : un emprunt assis sur le baril de pétrole. Mais un élu se doit d’être responsable : j’ai refusé de prendre ce risque, d’autant que les cours du baril étaient déjà soumis à un phénomène de yoyo. La crise n’était pas encore là mais, dans une optique de sécurisation, nous avons choisi de privilégier des placements en euros dans la zone européenne. Il faut cependant reconnaître qu’à l’époque, toutes les banques nous faisaient le même type de propositions – lorsque je lançais une consultation, je demandais un taux fixe, un taux variable et un produit structuré.
Il reste que, comme en 2008, nous risquons d’être confrontés à un problème de liquidités d’ici à la fin de l’année. J’en discutais tout à l’heure avec M. Fortel : nous avons dû devancer un certain nombre de consultations pour boucler les budgets de 2011. En effet, les banques nous ont déjà fait savoir qu’il leur serait difficile de répondre sur l’intégralité de nos demandes. De plus, nous savons que l’Euribor va se dégrader. Autant donc anticiper. La même évolution semble à l’œuvre pour les lignes de trésorerie : là où tous nos partenaires répondaient pour l’intégralité de la ligne, il faut désormais « jongler » en associant deux, voire trois partenaires financiers. C’est évidemment plus complexe à gérer.
M. Simon Fortel. L’argent devient de plus en plus rare et de plus en plus cher. Depuis environ deux ans, les conditions d’emprunt se dégradent. J’ai lancé aujourd’hui même un emprunt de 10 millions d’euros. La Caisse d’épargne – qui compte pourtant parmi les banques de dépôt et devrait à ce titre avoir de la ressource – ne répond qu’à 20 % de notre besoin de financement. Pour boucler l’emprunt, nous devrons donc nous adresser à cinq banques !
M. Philippe Yvin. Nous n’avons pas vécu la période de souscription de ces prêts. Le département de la Seine-Saint-Denis entretenait une relation de confiance avec ses partenaires historiques : contrairement à d’autres collectivités, il n’a pas souscrit auprès de banques étrangères, mais seulement auprès des grandes banques que sont Dexia, le Crédit agricole et la Caisse d’épargne. Ce sont ces partenaires historiques qui ont proposé ces produits « exotiques » – le dernier produit souscrit avant 2008, proposé par Dexia, était un contrat de 90 millions d’euros assis sur le dollar et le yen. C’est cette évolution-là qui est étonnante.
Pour sécuriser les financements nécessaires aux investissements à venir, nous avons adopté une stratégie pluriannuelle, en constituant des pools bancaires avec lesquels nous passons des conventions pour trois ans.
M. le rapporteur. Personne ne m’ayant répondu, je réitère ma question : avez-vous estimé les risques pour votre encours et prévu de constituer des provisions ?
M. Franck Masselus. Nous n’avons pas constitué de provisions, car nous sommes encore dans la période de garantie. Nous pourrions néanmoins être conduits à le faire. J’ai pris tout à l’heure l’exemple du change entre l’euro et le franc suisse, qui a bougé de 4 centimes en quelques jours suite aux annonces positives concernant la Grèce. Comment calculer la provision sur cette base ? Faut-il l’arrêter au 31 décembre, ou la conserver sur une période plus longue ? Hormis lorsqu’elles sont imposées, ce qui a été le cas à Chartres après le contrôle de la chambre régionale des comptes, ces provisions sont de toute façon toujours l’objet de litiges – encore davantage, d’ailleurs, dans le secteur privé, pour des raisons d’optimisation fiscale.
En l’absence d’obligation en la matière, nous n’avons donc pas constitué de provisions spécifiques à ce jour. Mais certains de mes collègues ont fait d’autres choix, et je suis intéressé par leur expérience.
M. Daniel Guiraud. En 2009, nous avons fait estimer par le cabinet GFS – Global Financial Services – le risque de delta lié aux produits structurés. Cette estimation a mis en évidence un risque de surcoût de 225 millions d’euros, soit 27 % de l’encours. Pour l’an prochain, c’est un surcoût de 20 % que nous devrons acquitter. En ce qui concerne la suite, nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses – quelle sera, par exemple, notre structure d’emprunt si demain, le Portugal « dévisse » comme l’a fait la Grèce ?
M. Philippe Yvin. Le chiffre de 225 millions d’euros – qui avait été très contesté en 2009 – a pourtant été confirmé par les propositions de renégociation des banques. Il a même été dépassé : à mesure que le marché se dégradait, les propositions de soulte – c’est-à-dire d’indemnités à payer correspondant au prix du risque – sont passées de 25 % à 30 %, puis 40 %. Les 225 millions constituaient donc un plancher !
En ce qui concerne les provisions, il n’existe en effet pas d’obligation en la matière. Nous avons pris le parti de provisionner les intérêts des prêts dont nous avons demandé l’annulation. Nous sommes en effet entrés dans une phase contentieuse, puisque le département de la Seine-Saint-Denis a demandé l’annulation de cinq produits.
M. le rapporteur. La constitution de provisions est en effet obligatoire dès lors qu’une procédure est en cours.
M. Simon Fortel. En nomenclature M14, il existe des provisions budgétaires et des provisions semi-budgétaires. Les provisions budgétaires sont des opérations d’ordre, purement comptables, mais qui n’apportent pas, même en cas de reprise de provision, de réelle ressource supplémentaire. Les provisions semi-budgétaires impliquent en revanche un décaissement, puisque l’argent est mis à la Trésorerie – ce qui suppose de disposer de moyens budgétaires. Compte tenu de la dégradation de ces produits, il faudrait aujourd’hui provisionner pour la ville de Rouen l’équivalent de deux, voire de trois points de fiscalité. Nous n’avons tout simplement pas les moyens de provisionner en semi-budgétaire ces 2,2 millions d’euros. Provisionner un pourcentage du risque sur des opérations d’ordre pourrait néanmoins être une manifestation de bonne volonté vis-à-vis de la chambre régionale des comptes, de la préfecture ou de la Trésorerie, sachant que nous ne pourrons faire davantage.
M. le président. Un point m’inquiète particulièrement. Dès 2008, avant même d’être au cœur de la tourmente, l’estimation que nous avions demandée pour le département de la Seine-Saint-Denis atteignait quasiment ce 30 % de dégradation. Quelques questions de principe me semblent donc posées. La vraie nouveauté a consisté à proposer ce type de produits à des collectivités locales. Il suffit en effet de se pencher sur les publicités des établissements bancaires pour constater qu’ils étaient depuis longtemps proposés pour de la gestion d’actifs. Il n’y a aucun problème à ce qu’un particulier risque ses économies en prenant ce pari. À un moment donné – il faudra sans doute y revenir –, un premier établissement a décidé de proposer ce type de produits non plus sur de la gestion d’actif, mais sur de la gestion de passif. J’entends votre inquiétude, monsieur Masselus : vous craignez qu’on ne vous interdise un certain nombre de produits. Mais peut-on permettre à des collectivités, quelle que soit leur taille, de recourir à des produits sur lesquels la visibilité est des plus aléatoires ?
Vous nous dites aussi que vous avez plus de « souplesse » parce que vous êtes encore dans la période de garantie et que les produits à risque ne représentent qu’une faible part de votre encours. Pensez-vous qu’il faille instaurer un cliquet ?
Par ailleurs, et je m’adresse ici aux représentants du conseil général de Seine-Saint-Denis et de la ville de Rouen, quelles sont vos propositions de sortie ? Si nous avons créé cette commission d’enquête, c’est en effet parce que nous savons qu’un certain nombre de collectivités ont peu de chances de s’en sortir sans dommages.
J’aimerais enfin que nous parlions de l’avenir. Quels sont d’après vous les produits que les collectivités locales seraient en mesure de gérer en disposant des capacités humaines nécessaires ?
M. le rapporteur. Des procédures en justice ou des négociations ont-elles été engagées ? La commission d’enquête a pour tâche de se préoccuper des conditions de sortie et de faire des propositions pour l’avenir, en respectant bien entendu le principe d’autonomie des collectivités – c’est un point important auquel nous devons veiller tout particulièrement.
M. le président. Il me semble que la contradiction peut être dépassée. De même qu’avoir son permis de conduire ne dispense pas de respecter le code de la route, peut-il y avoir permis d’emprunter sans code de l’emprunt ?
M. Franck Masselus. Lorsque nous prenons la responsabilité de « jouer », même si je ne prise guère ce terme, c’est toujours dans l’intérêt de la collectivité – il s’agit de lui permettre d’investir plus et de réduire ses charges financières. Si la ville de Chartres n’avait emprunté qu’à taux fixe, mes concitoyens pourraient me reprocher d’être passé à côté de possibilités plus intéressantes. Les taux fixes pouvaient en effet atteindre 5 %, voire 6 %, alors que le taux d’intérêt moyen pour les collectivités chartraines se situe aujourd’hui aux alentours de 2,80 %.
Je suis favorable à l’instauration d’un cliquet par rapport à l’encours global. Cela aurait l’avantage de ne pas nous priver des possibilités intéressantes qui peuvent se présenter sur le marché. En 2007, nous avions souscrit pour 15 millions d’euros un produit structuré, que j’ai réussi à retourner et pour lequel nous avons désormais un taux fixe de 3,29 %. Selon nos partenaires financiers, c’est une superbe opération ! Certes, Dexia m’annonce que sur le Dualis, nous pourrions payer un taux d’intérêt à 8,91 % ; mais notre situation globale est de loin plus favorable que si nous n’avions souscrit qu’à taux fixe.
Je disais tout à l’heure que nous étions confrontés à une crise de liquidités. De nouveaux partenaires financiers entrent heureusement sur le marché – par exemple la BCME (Banque commerciale pour le marché de l’entreprise), filiale du Crédit mutuel. Nous leur demandons de re-coter pour nous assurer que nous pouvons toujours avoir confiance en nos partenaires financiers. Certains d’entre eux sont acculés. Il est par exemple devenu plus difficile de négocier avec Dexia, qui n’a pas la liquidité suffisante sur le marché pour répondre à nos prochaines consultations.
Limiter la part des produits à risque dans l’encours global éviterait certaines situations que nous connaissons tous, où la souscription d’un produit débouche sur une augmentation de la fiscalité. C’est alors le contribuable qui en fait les frais.
Je suis moi aussi en contentieux avec certains partenaires financiers. J’ai fait le tour de tous pour préparer cette réunion : compte tenu des conflits en cours, ils estiment qu’à l’avenir, il leur sera difficile de répondre à certaines collectivités. Soyons donc vigilants : il n’est pas dit que nous ne fassions pas les frais des procédures dans lesquelles nous nous engagerions.
M. Daniel Guiraud. La vraie question est de savoir si une collectivité territoriale a vocation à entrer sur le terrain spéculatif et à se doter d’une salle de marché – ou presque – pour être à égalité dans la discussion avec le prêteur. Je ne le crois pas.
En ce qui concerne l’avenir, le choix n’est pas nécessairement entre le taux fixe et rien. Avant que n’arrivent les produits structurés, les collectivités avaient une marge d’appréciation entre taux fixe et taux variable. Simplement, celui-ci était encadré : il y avait un cap et un floor, de sorte qu’on ne pouvait ni descendre à des taux anormalement bas, ni monter à des taux supérieurs au taux de l’usure. Bref, nous avions un tunnel de taux assez raisonnable, calé sur des indices accessibles aux petites collectivités : variation du taux du livret A, variation de l’Euribor… Ce n’est plus du tout le cas avec les produits « exotiques », qui tiennent davantage de la loterie – et d’une loterie biaisée.
S’agissant de la Seine-Saint-Denis, seules deux formes de sortie me paraissent envisageables. Soit le juge nous donne satisfaction et condamne le prêteur, soit l’on établit à l’échelle nationale une structure de défaisance, qui permettrait d’isoler les produits les plus toxiques – ceux qui sont hors charte Gissler – selon des modalités qui restent à arrêter. Chacun – État, banques, collectivités locales – prendrait bien sûr sa part dans le montage financier de cette structure de défaisance. On permettrait ainsi aux collectivités les plus exposées de sortir de la crise, et on reviendrait à un système assaini.
M. Simon Fortel. Pour reprendre votre image, monsieur le président, ce n’est pas parce qu’on a son permis de conduire qu’on peut piloter une Formule 1… Certaines collectivités ont des spécialistes qui savent gérer ce type de produits et les retourner pour en tirer des gains, mais la plupart – notamment les plus petites – ne disposent pas des compétences qui permettent de parler d’égal à égal avec les banquiers. Les fonctionnaires territoriaux doivent-ils pour autant devenir des spécialistes des salles de marché ? Je ne le pense pas. Nous avons d’autres métiers – davantage tournés vers la population – à développer.
Nous ne pourrons donc pas nous en sortir seuls. Le montant des charges financières que nous devrons acquitter dans les deux prochaines années si la tendance se confirme ne peut que conduire à des hausses d’impôts insupportables ou à la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet. Il faut donc mettre en place une structure de défaisance tripartite pour neutraliser la partie la plus spéculative de ces produits structurés, les collectivités ne conservant que ce qu’elles peuvent supporter sans mettre en péril leur budget.
M. le rapporteur. Par rapport au particulier qui engage ses économies, les collectivités ont une particularité : leur variable d’ajustement est la fiscalité. Les emprunts à taux fixe leur permettent de faire des prévisions dans ce domaine. C’est aussi possible avec les produits à taux variable, puisqu’on connaît le taux minimum et le taux maximum. On pourrait donc considérer qu’il faut interdire tous les produits qui ne permettent pas une gestion maîtrisée de la fiscalité. C’est facile à mettre en œuvre, et ce peut être l’angle d’attaque pour les situations extrêmes. De même qu’un concessionnaire automobile ne saurait vendre un véhicule sans fournir un certain nombre de spécifications techniques, un banquier peut-il vendre un produit dont lui-même ne maîtrise pas les conséquences financières ? Quel type de responsabilité porte-t-il le cas échéant ? Serait-il si absurde de considérer qu’il encourt une condamnation à ce titre ? Après tout, tout produit vendu n’est-il pas accompagné d’une fiche technique ? Nous nous demandions tout à l’heure si le trésorier-payeur municipal pouvait avoir la maîtrise de ces produits… mais les banquiers eux-mêmes ne l’avaient pas !
L’interdiction de tels produits pourrait figurer parmi nos propositions. Je le répète, la variable d’ajustement de la collectivité est la fiscalité. Lorsqu’on achète de l’argent, on achète une ressource pour réaliser un projet. C’est un produit comme un autre, qui a un coût. Mais si celui-ci ne peut pas être déterminé précisément, il y a doute sur l’évolution de la fiscalité. Dès lors qu’on ne peut fournir le cône des possibles du produit, celui-ci devrait être interdit aux collectivités locales. Partons donc de l’idée que l’argent est une ressource comme une autre.
Reste à sortir de la situation actuelle. Nous sommes hélas confrontés à un phénomène cumulatif : les collectivités qui sont dans une situation difficile n’ont peut-être pas le volant d’affaires qui leur permettrait de renégocier. M. Masselus m’a averti il y a quelque temps qu’un produit dérivait. Mais à Chartres, les investissements atteignent 170 millions d’euros sur la durée du mandat et s’y ajoutent pour un montant équivalent ceux de l’agglomération, tandis que l’encours de la société publique locale (SPL) s’élève à 800 millions : quel banquier refuserait de traiter avec nous ? Nous avons donc les leviers qui nous permettent d’obtenir une sortie raisonnable.
M. le président. Vous ne souhaitez pas qu’on vous prive de la possibilité de saisir des opportunités de marché, monsieur Masselus. On aurait pu, dites-vous, vous reprocher de n’avoir emprunté qu’à taux fixe si les conditions de marché étaient favorables. Permettez-moi d’évoquer à ce propos un souvenir précis. Un établissement bancaire m’a présenté un jour un produit fantastique à ses dires, qui devait nous permettre de faire de réelles économies sur le fonctionnement. Ne comprenant goutte au contrat qui m’était présenté, j’ai refusé de signer. On m’a alors envoyé un représentant de la direction pour m’expliquer que je n’entendais rien aux finances modernes. J’avais l’assise nécessaire pour pouvoir dire non, mais je me suis quand même demandé si je ne passais pas à côté d’une chance…
On en revient donc à la question du rapporteur : peut-on permettre que tout produit soit proposé ? Ce n’est pas tant le caractère variable des taux qui pose problème que les indices « exotiques » – car les collectivités locales disposent rarement de spécialistes des projections sur le cours du yen, du dollar ou du franc suisse…
M. le rapporteur. La limite me paraît vraiment être la fiscalité. Si on ne peut s’engager sur son évolution à l’égard de nos concitoyens, il ne faut pas souscrire le produit.
M. Franck Masselus. M. Guiraud parlait tout à l’heure de responsabilité partagée. N’oublions pas les cabinets de conseil comme Finance Active ou Orféor : ils n’ont jamais gagné autant d’argent que pendant cette période, alors qu’ils sont censés fournir un appui aux collectivités territoriales. Sans doute n’ont-ils pas complètement joué le jeu…
M. le rapporteur. Nous proposez-vous de les convoquer ?
M. Franck Masselus. Ce serait, je pense, utile.
M. Jean Proriol. Je me suis occupé dans une vie antérieure des finances du département de la Haute-Loire et de la région Auvergne, sous l’autorité du président Giscard d’Estaing, qui était d’une prudence de Sioux dans ce domaine…
Il y a une trentaine d’années, Indosuez a proposé des swaps à notre petit département. Nous nous sommes interrogés, d’autant que la banque proposait de nous racheter une partie de notre dette. Après bien des hésitations, nous avons refusé. Les produits dérivés sont-ils des dérivés de la technique du swap étendue à des calculs mathématiciens ?
M. le rapporteur. C’est une question qui s’adresse plutôt aux banquiers qu’aux collectivités…
M. Philippe Yvin. Indépendamment de la nature des produits, il y a eu une rupture dans la relation entre prêteurs et collectivités. Avant qu’on ne commence à nous vendre ce type de prêts, nous avions des taux fixes, des taux variables, et même des swaps sur des taux de livret de Caisse d’épargne. Tout cela restait cependant acceptable dans la mesure où ces produits restaient dans les banques. Le changement fondamental tient au fait que les banques se sont mises à revendre le risque de nos produits à d’autres institutions, y compris aux États-Unis. C’est d’ailleurs ce qui explique le blocage des négociations : cela leur coûterait extrêmement cher de revenir sur leurs positions. C’est cette financiarisation des relations, y compris dans ce domaine des prêts aux collectivités locales, qui est en jeu aujourd’hui. Il pourrait être intéressant de démontrer que c’est aussi parce que ces produits sont devenus des objets de spéculation qu’on se heurte à un tel blocage.
M. le rapporteur. Ces produits deviennent en effet des produits non contrôlés – qu’une collectivité ne peut se permettre d’avoir dans son compte d’exploitation. C’est toute la relation avec le marché financier qui est transformée.
M. Simon Fortel. Les collectivités ont tout de même la possibilité d’optimiser la gestion financière par une gestion active. Il ne faut pas les en priver !
Le problème porte moins sur l’indexation que sur le cap. Si une collectivité est tentée par un produit dit exotique, ce qui peut être une stratégie financière, celui-ci doit être sécurisé par un cap, ne serait-ce que pour permettre d’anticiper une hausse de la fiscalité s’il venait à dériver.
M. le président. Bref, il doit plutôt s’agir de produits « tunnélisés ».
M. Franck Masselus. En 2008 ou en 2009, l’État a réinjecté 5 milliards d’euros dans le circuit bancaire pour financer les collectivités territoriales. Ne faudrait-il pas réitérer l’opération en 2011, pour un montant à déterminer, afin de faire face aux graves problèmes budgétaires qui se posent ? Si les partenaires financiers ne répondent plus à nos consultations, quid de nos budgets et de nos comptes administratifs ?
M. le rapporteur. Et surtout de nos investissements !
M. le président. Le débat porte d’abord sur les produits qui peuvent être proposés. Vos interventions montrent qu’il faut trouver un système qui permette une gestion active de la dette et offrir aux collectivités locales le choix entre des produits à index variable contrôlé. Vous n’avez cependant pas répondu à toutes nos interrogations. Ainsi, quid des tutelles ? À quel niveau pensez-vous qu’elles auraient dû jouer un rôle de contrôle et – surtout – de prévention ?
M. Daniel Guiraud. L’État ne pouvait pas ignorer les pratiques du secteur bancaire, ni les termes de la circulaire de 1992 qui interdisait la spéculation. Il y a donc eu un manquement assez grave de sa part.
M. le président. La circulaire de 1992 n’aurait donc pas été suffisamment précisée par la DGCL lors de l’apparition de ces produits sur le marché ?
M. Daniel Guiraud. En effet.
M. Simon Fortel. Le fait qu’il n’y ait pas d’obligation de provisions a aussi joué, puisque les produits pouvaient être souscrits sans anticipation d’une éventuelle dérive financière. Si l’on exige que les produits soient capés dès lors qu’ils sont basés sur des indices « exotiques », il faudra également réfléchir à la nécessité de provisionner – et pas seulement pour ordre.
M. le président. Un certain nombre des produits que nous évoquons seraient alors apparus bien moins intéressants dès la période de garantie. Je l’ai moi-même constaté pour des contrats signés par une collectivité que je connais bien : le lendemain de la signature, le rendement était déjà beaucoup moins bon… Si le département de la Seine-Saint-Denis devait tenir une comptabilité d’entreprise privée, il aurait dû provisionner près de 30 millions d’euros par an !
M. Daniel Guiraud. On ne peut provisionner que si l’on connaît le montant – par exemple si l’on est sur un produit variable capé. Mais ce n’est pas toujours le cas. Prenons l’exemple du produit Depfa Bank euro-franc suisse. Le franc suisse est aujourd’hui à 1,18 euro et certains spécialistes pensent que l’on pourrait arriver à la parité. Dans ces conditions, que pouvons-nous provisionner, sachant que les évolutions peuvent être très rapides? Pour parvenir à sécuriser ce genre de produits, il faut tout simplement interdire les produits sans limite.
M. le rapporteur. Le seul recours est le caping avec provisions, qui n’empêche pas une gestion active de la dette. On peut aller très loin dans une fourchette déterminée, mais il faut provisionner. Cela constituerait à mon sens un encadrement efficace.
M. Simon Fortel. Si on combine cap et provision, on peut facilement définir des modalités de calcul qui éviteraient les contestations sur le montant de la provision à constituer.
M. le président. Cela paraît séduisant. Mais le débat entre majorité et opposition dans chaque conseil portera alors sur la fixation du cap – autrement dit, faut-il choisir la variable la plus « négative » ou la plus « positive » ?
M. Franck Masselus. Je conçois qu’il faille fixer des limites pour l’avenir, mais soyons attentifs à la réaction des banquiers : si on durcit trop les conditions d’emprunt, nous risquons de le payer. L’accord de Bâle III va déjà contraindre les établissements à accroître leurs marges. Si on leur impose des conditions supplémentaires sur les produits, les collectivités paieront l’argent encore plus cher. Nous avons tous lancé des consultations : le résultat va d’un Euribor plus 110 points de base jusqu’à un Euribor plus 150, voire 170 points, alors que nous avons connu un Euribor sans marge…
Quant à l’encours, on peut toujours chercher des responsables mais encore faut-il savoir qui paye. Pour ma part, je pense que les collectivités qui sont dans une dynamique d’investissement peuvent encore parvenir à négocier avec leurs partenaires.
M. le rapporteur. Il va cependant falloir trouver des solutions pour celles dont le passif est trop lourd.
M. le président. Je crois savoir qu’à un moment donné, le conseil de surveillance de la Banque de France s’est interrogé sur les produits structurés, et qu’il a envisagé de fixer un plafond à 50 % de l’encours de la dette.
M. Franck Masselus. Nous avons été contrôlés à plusieurs reprises par la chambre régionale des comptes. Celle-ci me demande de constituer une provision de 5 millions d’euros pour un litige relatif à une délégation de service public. Or cette provision – sur un budget de 100 millions – va freiner notre investissement pour six mois, car tant que la cour administrative d’appel ne se sera pas prononcée, cette somme restera bloquée.
M. le rapporteur. Il faut distinguer la provision réelle et la provision « virtuelle ». On peut anticiper, sur le seuil bas et sur le seuil haut, ses conséquences sur la fiscalité. C’est en effet celle-ci qui est la variable d’ajustement : si les choses se passent mal, cela peut déboucher – comme c’est arrivé dans certaines communes – sur un alourdissement de la fiscalité de deux ou trois points. Je pense qu’il faut maintenir la possibilité de souscrire ces produits, mais à condition qu’ils soient capés. Ensuite, on a soit la solution de l’amortissement, soit celle de prendre le risque de l’ajustement via l’imposition. À Chartres, nous baissons les impôts tous les ans depuis 2001 tout en continuant à investir. Ce sont aussi les gains mentionnés par M. Masselus qui nous l’ont permis. Nous sommes dans une phase où le produit en question est encore maîtrisable et nous avons le volant d’affaires qui nous permettra, le cas échéant, de l’intégrer dans les prochaines négociations.
M. Simon Fortel. Pas nous…
M. le président. Il y a des différences d’une collectivité à l’autre. Tout dépend évidemment de la part qu’occupe le remboursement de la dette dans le budget.
M. le rapporteur. Quelle est la part des frais financiers dans vos budgets respectifs ?
M. Philippe Yvin. Pour le département de la Seine-Saint-Denis, 2 %.
M. Simon Fortel. Pour Rouen, 5 %.
M. le rapporteur. 2 %, ce n’est pas considérable.
M. le président. Les départements sont dans une situation particulière, l’essentiel de leurs dépenses budgétaires étant des dépenses obligatoires.
M. le rapporteur. Si les frais financiers mordent sur l’action sociale, cela pose évidemment problème. Quoi qu’il en soit, le pourcentage de 2 % est plus faible que ce que j’imaginais.
M. le président. Je remercie les représentants du département de la Seine-Saint-Denis et des villes de Chartres et de Rouen pour les informations qu’ils nous ont fournies. Je ne doute pas que le rapporteur et la commission sauront en faire bon usage…
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Michel Thiollière, ancien sénateur, ancien maire et ordonnateur de la commune de Saint-Étienne, de M. Antoine Alfieri, ancien adjoint en charge des finances, de M. Jean-Claude Louchet, ancien directeur des services, et de M. Jean-Michel Rastel, directeur général des cabinets TECHFI et FITECH, ancien conseil de la ville de Saint-Étienne
(Procès verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous reprenons aujourd’hui les travaux de notre commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux, que nous avions entamés avant l’été.
L’ordre du jour est particulièrement chargé. Nous entendrons tout à l’heure les représentants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’avaient pu prendre part à la table ronde du 6 juillet dernier. En accord avec le rapporteur, j’ai proposé cette « session de rattrapage » à notre collègue Henri Plagnol, maire de Saint-Maur, afin d’examiner en détail la situation de sa commune.
Mais auparavant je vous propose d’analyser un cas concret de collectivité confrontée à des emprunts toxiques, celui de la ville de Saint-Étienne.
Nous entendrons d’abord l’ancienne équipe municipale et poursuivrons nos travaux en auditionnant la nouvelle.
La Commission auditionnera enfin les responsables de la tutelle administrative et comptable à l’époque de la souscription des emprunts structurés : M. Michel Morin, préfet de la Loire entre 2002 et 2006, et M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire entre 2000 et 2005.
Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir accepté de témoigner devant notre commission d’enquête, qui a pour objet de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des emprunts et produits structurés ont été souscrits auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement par les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres acteurs publics locaux.
M. Michel Thiollière, M. Antoine Alfieri, M. Jean-Claude Louchet et M. Jean-Michel Rastel prêtent successivement serment.
M. le président. Monsieur Thiollière, dans quel but avez-vous souscrit des emprunts structurés au cours de votre second mandat, entre 2001 et 2008 ? Votre décision de baisser la fiscalité, dans un contexte démographique pourtant difficile, ne vous a-t-elle pas contraint à réduire par tous les moyens les charges, notamment financières ? Quand avez-vous pris conscience du caractère risqué de ces produits ? Pourquoi avez-vous malgré tout poursuivi la politique de gestion active de la dette stéphanoise, en souscrivant toujours plus de ces emprunts volatiles et opaques ?
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Monsieur Thiollière, par rapport au particulier qui engage ses économies, les collectivités ont une particularité : leur variable d’ajustement est la fiscalité. Il ne me paraît pas illégitime, lorsque les marges d’une collectivité se réduisent, d’envisager de réduire les charges financières afin de continuer d’offrir aux habitants les mêmes services sans augmenter la pression fiscale.
Toutefois, à Saint-Étienne, cette stratégie s’est révélée coûteuse et la souscription de produits structurés a abouti à une augmentation significative des charges financières, qui sont passées de 13 millions d’euros en 2004 à 14,9 millions d’euros en 2005, puis à 20 millions en 2006, 16,2 millions en 2007 et 15,4 millions en 2008, soit un ratio de 6,3 % des dépenses réelles de fonctionnement. C’est un ratio élevé comparé à la moyenne des collectivités appartenant à la même strate démographique, légèrement inférieure à 4 %. Je suis moi-même maire d’une ville où ce ratio est de 2 %. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
M. Michel Thiollière, ancien sénateur, ancien maire et ordonnateur de la commune de Saint-Étienne. Je vous remercie de votre invitation. Nous nous efforcerons d’éclairer votre Commission sur cette période particulière qu’a traversée notre collectivité territoriale, avant la crise de 2008, avec l’espoir que les parlementaires que vous êtes pourront à l’avenir faire en sorte que soient mieux encadrées les relations entre les collectivités territoriales et les organismes bancaires, qui sont leurs principaux prêteurs.
Toutes les collectivités ne se ressemblant pas, je vais en quelques mots vous présenter la ville de Saint-Étienne et vous expliquer les raisons pour lesquelles nous avons eu recours à des emprunts structurés.
Saint-Étienne a connu un désastre industriel sans précédent. Après la guerre, notre ville a perdu toute son industrie – Manufrance, la manufacture GIAT Industries, le textile, les mines, notamment – et a subi de plein fouet toutes les reconversions industrielles qu’a connues notre pays.
Cela s’est traduit par la perte de dizaines de milliers d’emplois et par un exode de la population puisque nous sommes passés de 220 000 à 170 000 habitants en cinquante ans – notre ville a perdu 50 000 habitants en quelques décennies ! Comme le relève la chambre des comptes de la région Rhône-Alpes, une ville qui perd sa population dans de telles proportions dispose de moyens de fonctionnement qui n’ont rien à voir avec ceux d’une ville qui connaît une extension croissante de sa démographie. D’autant que la population qui est partie était globalement la plus solvable et que celle qui est restée est parmi les plus fragiles – notre PIB par habitant était très inférieur à la moyenne nationale. La pauvreté relative de sa population, une perte démographique considérable ainsi qu’une tragédie industrielle que peu d’autres villes ont connue ont fait de Saint-Étienne un exemple pour les experts internationaux, qui sont venus étudier son cas au même titre que ceux de Bilbao, Sheffield ou le bassin de la Ruhr, sans pour autant nous apporter de solutions.
Il fallait relancer la ville. C’est la raison pour laquelle, en 1994 et 1995, nous avons décidé de lancer un projet urbain qui visait à résorber les friches industrielles. La présence de friches entraîne nécessairement une perte de recettes pour une ville car, non seulement elle perd de la fiscalité et des emplois, mais en plus elle doit acheter les friches. Il fallait donc trouver des soutiens. Je les ai trouvés en créant en 1995 la communauté d’agglomération. Les 43 communes qui la composent ont épaulé la ville de Saint-Étienne, tout comme la population stéphanoise, qui a compris les enjeux de cette évolution, mais aussi l’État, qui, décidé à aider une ville en déclin, a accepté de créer deux établissements publics : l’un destiné à résorber les friches industrielles, l’autre à créer de l’aménagement et à restructurer la ville. C’est un avantage rare que nous partageons avec la ville de Marseille.
Saint-Étienne était alors une ville très endettée par habitant et elle l’est toujours, ayant perdu une part de sa population. Nous avons donc fait le maximum pour redresser la ville tout en la désendettant, afin qu’elle retrouve des capacités d’investissement. Et nous avons réussi puisqu’en quinze ans nous avons réduit la dette de la ville de près de 100 millions d’euros.
Jusqu’en 2008, nous avons centré notre action principalement sur la baisse de la dette et le maintien des taux de fiscalité, même si, sur ce point, nous n’avons pas fait autant que nous le souhaitions. La population la plus solvable, qui habitait à la périphérie de la ville, avait la chance de payer de deux à trois fois moins d’impôts locaux que les Stéphanois. Dans un souci d’équité, nous avons souhaité rétablir l’équilibre, sachant que les charges de centralité étaient portées par la seule ville de Saint-Étienne que les impôts payés par les Stéphanois devaient être revus à la baisse.
Nous avons dans le même temps souhaité investir pour restructurer la ville, et pour cela nous avons eu besoin d’emprunter. Comme toutes les collectivités, nous avons ouvert le jeu en direction des banques et choisi les produits les moins chers sur le marché de l’époque.
La chambre régionale des comptes indique dans son rapport que, si nous avions souscrit à des taux fixes de 3,60 %, cela aurait représenté une charge supplémentaire de 14 millions d’euros pour la ville de Saint-Étienne. Or je suis obligé de vous dire que nous avions besoin de ces 14 millions d’euros. Nous avons bénéficié de taux d’intérêt très bas. Comme beaucoup d’autres collectivités, nous avons géré notre budget de façon active afin d’économiser les moyens financiers de la ville. Peu de grandes collectivités ont échappé aux produits structurés, comme l’indiquait un rapport publié en juin dernier par le journal Le Monde.
Ainsi que le souligne la chambre régionale des comptes, j’avais dès 2006 demandé à nos services de veiller à réduire le nombre des emprunts structurés, mais il n’est pas raisonnable, pour une collectivité, de changer de cap à 180 degrés du jour au lendemain. Il fallait se désengager peu à peu, sécuriser davantage la dette et faire en sorte de retrouver des moyens – ce que j’appelle la « matière fiscalisable » –, grâce au retour des entreprises et des ménages dans la ville.
Nous avons souscrit des emprunts pour épargner le plus possible le budget de la ville et retrouver des marges de financement disponibles pour les investissements. Le fait pour une ville de passer de 220 000 à 170 000 habitants ne supprime pas du jour en lendemain l’entretien des écoles et des kilomètres de voirie : il faut continuer à entretenir la ville et à l’aménager comme si elle avait conservé 220 000 habitants. Quand une ville perd un quart de ses habitants, l’équipe municipale doit se battre chaque matin pour réaliser des économies, y compris sur les moyens de fonctionnement. La ville de Saint-Étienne compte 3 500 fonctionnaires municipaux. Nous avons peu à peu réduit la masse salariale, qui représente 53 % du budget de la ville, de manière à épargner les contribuables et aider la ville à redémarrer.
J’avais souhaité remettre à chacun d’entre vous un document incontesté et incontestable puisqu’il émane de la London School of Economics (LCE), qui a étudié sept villes européennes en danger de désindustrialisation. Dans un rapport approfondi de 40 pages relatif à la situation de Saint-Étienne, la LSE concluait que nous étions sur la bonne voie. Je ne dirai pas que nous avons tout parfaitement réussi mais, si nous avons emprunté – pas plus d’ailleurs que de nombreuses autres collectivités – c’est que nous avions besoin de trouver les moyens de relancer l’économie.
Les ménages stéphanois solvables, soit à peu près un sur deux, n’en pouvaient plus de payer tant d’impôts. Sans faire de miracle, nous avons essayé de maintenir le taux de fiscalité. Nous avons comparé le cas de Saint-Étienne avec celui de Montpellier, mais cette dernière est passée en quarante ans de 170 000 à 240 000 habitants. Je ne dis pas que tout est facile pour Montpellier, mais la ville retrouve de la ressource et cet afflux de population nécessite de nombreuses constructions. À Saint-Étienne, en revanche, il nous fallait gérer d’innombrables friches industrielles et urbaines. L’État doit soutenir les villes en difficulté. C’est ce qu’il a fait, comme vous le dira tout à l’heure le préfet de l’époque, Michel Morin, qui avait expliqué à l’administration centrale la situation de Saint-Étienne et la nécessité de faire appel à la solidarité nationale. Il fallait que nous trouvions les moyens de rebondir. Nous les avons trouvés en créant deux établissements publics : l’EPORA, pour gérer les friches industrielles, et l’EPA, créé pour accélérer l’aménagement de la ville, qui fut doté en 2007 de 120 millions d’euros. Tous ces éléments ont été longs à mettre en place.
Une ville est comme un gros paquebot : elle ne se manie pas facilement. Il faudra sans doute de nombreuses années pour rétablir l’équilibre.
M. le rapporteur. Je note une contradiction entre vos propos et la situation décrite dans le rapport de la chambre régionale des comptes. C’est une bonne chose que d’avoir utilisé ce type d’outil pour dégager des marges et investir mais, entre 2004 et 2008, vos dépenses de fonctionnement évoluent plus que vos produits : plus 17 millions d’euros, soit une augmentation de 14 %. Cette évolution touche particulièrement les charges de personnel. Le magistrat mentionne que, lorsque le risque survient, vous utilisez vos marges pour régler des charges de fonctionnement sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir, ce qui a encore un impact sur la situation actuelle de la ville. D’ailleurs, au cours du conseil municipal du 7 janvier 2008, il est dit que la quasi-totalité de la dette est considérée comme une variable d’ajustement. Je comprends votre logique, mais je ne la retrouve pas dans les comptes de la ville.
M. Michel Thiollière. Ce que dit la chambre régionale des comptes est clair : notre potentiel fiscal, qui traduit la richesse relative de nos concitoyens, était très en dessous de la moyenne. En 2004, il était de 667 euros par habitant alors que la moyenne pour les collectivités de même strate était de 718. En 2008, nous nous trouvions sur une pente très légèrement croissante, nous avons donc augmenté le potentiel fiscal. Dans le même temps, les charges de fonctionnement représentaient 1 424 euros par habitant, contre 1 255 pour les communes de même strate. Comme l’indique la chambre régionale des comptes dans son rapport, « la baisse démographique n’est pas sans incidence sur les ressources encaissées et constitue un facteur aggravant de la situation ».
Vous devez en être persuadés, mesdames et messieurs les députés, on ne peut gérer le déclin d’une ville en utilisant des méthodes classiques. Tous les experts internationaux que j’ai rencontrés vous le diront, on ne va pas au secours d’une ville sans faire quelques sacrifices ni utiliser une méthode volontariste. C’est ce que nous avons choisi de faire. Je ne prétends pas que c’est une solution parfaite, mais je n’en connais pas d’autre. En outre, je ne connais pas de grande ville française qui se soit trouvée dans une situation comparable à celle de Saint-Étienne.
Dans sa réponse à la Cour des comptes, le maire de Bordeaux indique qu’ayant baissé sa dette de 100 millions d’euros, il ne comprend pas pourquoi la Cour lui pose des questions – nous, à Saint-Étienne, nous avons aussi fait baisser la dette. Quant à la présidente de Lille-métropole, elle indique qu’il appartient aux pouvoirs publics de réguler les relations entre les banques et les collectivités territoriales – je ne dis pas autre chose.
Nous étions dans une période tout à fait différente de celle que nous connaissons depuis 2008. Aucune demande de précaution particulière n’avait été adressée aux collectivités et pas un seul banquier ne nous avait alertés. Les représentants de l’État eux-mêmes n’étaient pas plus informés de la dangerosité de certains produits et de la survenue de la crise. Compte tenu des circonstances, ce que nous avons fait a permis d’équiper la ville, de relancer l’investissement et de maintenir la fiscalité et la dette à des niveaux raisonnables. Je le répète, si la ville continue de perdre des habitants, le ratio par habitant restera important.
M. le rapporteur. Cette baisse de la démographie me semble contradictoire avec l’évolution des effectifs. Quant aux ressources, elles ne servent qu’à augmenter les charges de fonctionnement.
Je voudrais interroger M. Alfieri sur un point : dans les réponses aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, M. Thiollière indique qu’au cours de la période allant de 2000 à 2007, au cours de laquelle beaucoup d’emprunts structurés ont été contractés, personne n’avait formulé de mise en garde. N’avez-vous jamais été alertés par vos banquiers ?
M. Antoine Alfieri, ancien adjoint au maire de Saint-Étienne, en charge des finances. Jamais ! Il est un peu réducteur de comparer les années 2004 et 2008, car lorsque nos frais financiers atteignaient 13 millions d’euros, nous avons réussi à les réduire de 2,14 % grâce aux produits de pente que nous avions choisis avec M. Rastel. Pour analyser correctement notre action, il faudrait pratiquement remonter à l’année 2001. En 1995, les frais financiers de la ville de Saint-Étienne représentaient 17 % des dépenses de fonctionnement, ce qui constituait le record de France. Mais compte tenu de l’ampleur de la dette, 37 % des budgets servaient à rembourser le capital et les intérêts. Aucune ville n’a eu à gérer un tel phénomène. Dans le même temps, nous subissions une baisse de la démographie. Mais nous n’avons jamais dépassé, et c’est toujours vrai aujourd’hui, le taux de 4 % de frais financiers dus à la dette. Le taux de 6,5 % n’existe que pour les produits toxiques.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Le taux de 6 % que j’ai évoqué correspond à la part des frais financiers sur les charges d’exploitation.
M. Antoine Alfieri. Nos frais financiers, après avoir été légèrement supérieurs à 20 millions d’euros, sont tombés à 13 millions puis remontés à 20 millions lorsque nous avons rompu notre contrat avec M. Rastel – nous n’avions alors pratiquement que des produits de pente. L’erreur que nous avons commise et que nous avons tous « cosignée » est d’avoir fait confiance aux services et aux banquiers. Michel Thiollière nous ayant demandé de sécuriser notre dette, en 2006, nous n’avons pas reconduit le contrat de M. Rastel. Les banques, connaissant le montant de 116 millions d’euros que nous avions en produits de pente, ont harcelé nos services pour que nous transformions les produits dits « à risques ». C’est ainsi que nous avons fait le choix de contre-swaps dix fois plus dangereux que les swaps. Voilà ce qui s’est passé ! Les services nous les ont présentés comme des produits miracles, capables de réduire le risque. Or nous l’avons multiplié !
Je vous citerai l’exemple frappant d’un produit de pente proposé par la Deutsche Bank (à l’époque les taux longs étaient inférieurs aux taux courts) dont le taux se situait entre 8 et 9 %. Nous avons remplacé ce produit par un produit capé à 24 %, que les services nous ont présenté comme un produit miracle. Dans un rapport de huit pages, un ancien de Dexia affirmait que la parité livre anglaise-franc suisse ne pouvait pas s’effondrer, que les parités seraient fixes pendant vingt ans et que transformer notre produit nous permettrait de bénéficier d’un taux court très bas. Eh bien, monsieur le rapporteur, c’est aujourd’hui le seul produit réellement toxique ! S’il n’était pas capé, et cela démontre la folie des banques, les taux d’intérêt atteindraient près de 130 % !
Personne n’a rien vu, pas plus les services que moi-même. Mea culpa, mais je ne veux pas porter seul la responsabilité car, comme le souligne le rapport de la chambre régionale, je ne peux passer mes jours et mes nuits à tout contrôler.
M. le rapporteur. Ce rapport contient en effet des informations intéressantes, qui parfois contredisent vos propos. Ce que nous comprenons, c’est que les emprunts structurés vous ont à une époque fait gagner beaucoup d’argent. Le bilan doit être établi sur la totalité de la période.
M. Antoine Alfieri. Quelles sont les informations qui contredisent mes propos ?
M. le rapporteur. Il apparaît dans les pièces versées au dossier que le groupe IXIS avait dès 2006 attiré l’attention de la ville sur le risque de conclure des contrats de type snow ball.
M. le président On voit bien qu’il existait entre les uns et les autres des rapports subtils, mais nous devons comprendre comment la chaîne a fonctionné. Dans quelles conditions, monsieur Alfieri, aviez-vous reçu délégation pour contracter ces emprunts ? Quelles informations détenaient les autres élus du conseil municipal ? Enfin, aviez-vous reçu des indications, de la part des banques ou de l’administration, quant au fixing de ces produits dès le lendemain du jour où ils vous ont été prescrits ? Je vous pose la question car j’ai découvert cet été que des produits proposés à des acteurs publics avaient subi une dégradation dès le lendemain de la signature ! S’il s’était agi d’entreprises privées, elles auraient été contraintes de faire des provisions. Votre société de conseil ou les banques ont-elles attiré votre attention sur la dégradation qui pouvait exister au-delà de la période de taux bonifié qui vous avait été accordée ?
M. Antoine Alfieri. Je peux vous répondre avec précision. La ville de Saint-Étienne – dont je rappelle qu’elle emploie 3 500 personnes – dispose d’un service financier chargé de procéder à ces analyses. En ce qui me concerne, on me transmettait un résumé de ces informations, mais on ne m’a jamais alerté, loin s’en faut. Si cela avait été le cas, pourquoi aurions-nous transformé des produits de pente en produits de change ? J’ai peut-être été mal informé, mais peut-être aussi n’ai-je pas su lire les informations qui m’étaient transmises car je ne suis pas un spécialiste des finances : j’en ai simplement reçu la délégation lorsque j’ai été élu.
J’avais toute la confiance du maire. Cette délégation des finances me donnait la possibilité de négocier avec les banques. Avec le secrétaire général, ici présent, nous avions créé une commission regroupant les services. Ceux-ci nous délivraient un grand nombre d’informations. Ils entamaient la négociation avec les banques et nous avertissaient de tel ou tel danger. C’est ainsi qu’ils nous ont avertis de la nécessité de sortir du produit de pente de la Deutsche Bank, nous conseillant de prendre un produit reposant sur la parité livre anglaise-franc suisse.
Il faut savoir qu’il est très difficile pour un élu, voire pratiquement impossible, de dire à des spécialistes réunis autour d’une table et d’accord entre eux qu’ils se trompent.
Quant aux fixings, ils ne m’étaient pas communiqués, mais si cela avait été le cas, sans explication complémentaire de nos services des Finances, je ne suis pas sûr que j’aurais été capable de les lire car ce sont des documents complexes. De mémoire les « snow ball » contractés par la ville de Saint-Étienne ont été conclus bien après 2006.
M. le président Votre franchise vous honore. De quelle manière aviez-vous présenté ce produit miracle au conseil municipal ?
M. Antoine Alfieri. Vous parlez sans doute de mes maladresses, soulignées par la chambre régionale des comptes. Lorsqu’un élu est « titillé » par l’opposition, certains mots lui échappent, mais je n’ai jamais eu volonté de cacher quoi que ce soit. Je n’ai fait que présenter les résultats : dans les années 2005-2006, nos frais financiers tournaient autour de 2 %, et il était normal que la majorité présente cela comme un bon résultat, puisque c’était vrai. La société Finance Active, qui a étudié le cas de 800 villes, a démontré que Saint-Étienne, avec un taux de 2,09 %, se trouvait sur le podium des villes ayant le moins de frais financiers. Que cela ait été dit avec un peu d’emphase durant un conseil municipal, cela peut arriver dans toutes les villes, qu’elles soient de droite ou de gauche. J’ai été surpris de voir que ces propos avaient été utilisés.
M. le rapporteur. J’apprécie vos remarques. Nous sommes ici, non pour faire le procès d’une commune ou de quelques élus, mais pour essayer de comprendre car nous souhaitons que la situation ne se reproduise pas. Il semble que les banquiers soient allés trop loin et n’aient pas délivré suffisamment de conseils. Comment cadrer leur action ? Jusqu’où peuvent aller les collectivités ? Vous avez admis avoir réalisé un certain nombre de provisions. C’est un choix intéressant que font pourtant très peu de communes.
M. Antoine Alfieri. Permettez-moi d’abonder dans votre sens. Ce n’est qu’après les élections de 2008 que j’ai cherché à mieux analyser les phénomènes financiers. Mea culpa ! Tous ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours travaillé dans l’intérêt de ma ville. En dix-neuf ans, je n’ai jamais engagé un euro de frais personnels. J’ai cherché à comprendre, en lisant le rapport de la chambre régionale des comptes, par où j’avais péché. J’en ai déduit qu’au fond, je le dis très franchement, nous n’avions pas toutes les compétences nécessaires, au moins jusqu’à ce que nous ayons recours à M. Rastel.
Permettez au non-spécialiste que je suis de vous faire quatre suggestions.
– Tout d’abord, il faut imposer aux banques, dans les contrats de swap, d’indiquer toutes les formules, y compris les coefficients multiplicateurs s’il y en a. Le fameux produit de la Deutsche Bank que je vous ai cité présente, dans sa formule, un taux de 5,95 %, mais ce qui est calculé entre parenthèses, doit être multiplié par 100, ce qui n’est pas indiqué ! Non seulement les formules sont fausses – est-ce volontaire ou non ? je ne sais pas, mais, surtout, et c’est beaucoup plus grave, c’est une tromperie car, si l’élu qui signe le document contrôle uniquement les formules, il se trompe lourdement. C’est ce qui m’est arrivé à l’époque.
– Par ailleurs, si les villes continuent de recourir aux swaps, il faut mettre en place un système symétrique : il suffit, pour un gain de 2 %, de fixer un cap par rapport à un taux moyen fixe de 2 % au-dessus. Cette obligation priverait les banques de la possibilité de proposer des produits fous, avec des effets multiplicateurs, et les communes sauraient rigoureusement à combien elles s’engagent et ce qu’elles doivent provisionner, au pire.
– Il convient ensuite d’imposer, pour des produits aussi sophistiqués, la double signature de l’élu et du directeur général des services ou du directeur des finances.
– Enfin, sachant que ce sont des inspecteurs des finances de haut niveau qui siègent dans les conseils d’administration, comment a-t-on pu inventer les snow balls et autoriser les banques à placer de tels produits ? Il est scandaleux de devoir payer un seul trimestre négatif jusqu’à la fin du contrat : cela relève de l’usure, voire de l’escroquerie organisée. Je pense aujourd’hui que les services finances, en proposant ces produits, n’avaient pas tout compris sur des détails du calcul des taux chaque trimestre.
M. le président Nous avons prévu d’interroger les services, mais qui sont ces « spécialistes » que vous évoquez ?
M. Antoine Alfieri. Ce sont les banques. Nous leur faisions confiance. Les prêts de Dexia, par exemple, ont couvert jusqu’à 60 % des besoins de la ville.
M. le rapporteur. Monsieur Rastel, en tant que gérant de deux cabinets spécialisés, FITECH et TECHFI, vous avez conseillé la ville de Saint-Étienne, qui pourtant disposait d’un service financier important. Quelles sont vos qualifications et votre expérience en matière de financement des collectivités ? Comment avez-vous été recruté par la municipalité ? Quelle a été la durée de cette collaboration ? Quelle prestation de conseil avez-vous assurée auprès de la ville de Saint-Étienne et selon quelles modalités de rémunération ?
M. Jean-Michel Rastel, directeur général des cabinets TECHFI et FITECH, ancien conseil de la ville de Saint-Étienne. J’ai occupé un emploi fonctionnel à la ville de Mantes-la-Jolie, dont je suis retraité. J’y étais secrétaire général adjoint chargé des finances. C’est durant cette période que j’ai acquis mon expérience et que je me suis aperçu que les banques savaient tirer d’importants bénéfices des produits qu’elles proposaient. En 1989, j’ai mis au point un produit innovant en matière de gestion de trésorerie. En 1988, la ville procédait à des ouvertures de crédits pour gérer la trésorerie. Considérant que c’était une dépense supplémentaire, j’ai passé un contrat avec le CIC pour gérer la trésorerie directement sur l’emprunt afin de diminuer les intérêts de l’emprunt sans payer ceux de l’ouverture de crédit. Pour la ville de Mantes-la-Jolie, cela représentait une économie d’un million de francs.
J’ai ensuite souhaité quitter la fonction publique pour présenter ce produit à mes collègues. Il a été mis au point et validé par la Société générale. C’est Christian Poirier, que j’ai rencontré en 1990, qui, dans un article paru dans la Gazette des communes en 1991, a fait valider l’ouverture de crédit à long terme (OCLT). Puis le produit a été copié par Dexia sous la forme du crédit à long terme renouvelable (CLTR). C’est ce qui m’a amené à conseiller les collectivités et à créer ma propre société.
J’avais pour objectif une obligation de résultats, ce qui m’a amené à travailler avec peu de collectivités, d’autant que je devais rester en permanence à l’écoute des marchés, qui ne cessent d’évoluer. J’ai travaillé notamment pour la ville de Meaux durant un mandat avec Jean-Claude Louchet, à la satisfaction de Jean-François Copé, ce qui m’a amené à conseiller la ville de Saint-Étienne.
En étudiant la dette de la ville, j’ai considéré qu’il y avait des marges de manœuvre. Tout d’abord, cette dette n’était pas compactée, ce qui rendait sa gestion très difficile. Il fallait donc revoir sa structure. La ville était également engagée dans quelques swaps perdants, pour lesquels je n’ai rien pu faire. Les produits qui étaient à l’époque proposés par les banques permettaient de faire des économies d’intérêts. La ville est ainsi passée d’un taux de 5,5 % à un taux légèrement supérieur à 2 %.
Avant de proposer une opération, j’essayais de l’analyser pour savoir comment elle pourrait jouer sur l’économie réelle. J’ai opté pour plusieurs swaps, dont j’ai proposé à la ville de sortir dès que l’économie évoluait – sur le dollar, sur le TecDis, sur l’euro-yen, sur le Libor suisse.
J’ai travaillé avec la ville de novembre 2001 à décembre 2005. Au cours de cette période, elle a réalisé des économies d’intérêts pour un montant d’environ 13 millions d’euros. Mais certaines opérations étaient en cours et, en 2006, alors que je n’étais plus en charge de sa gestion, la ville est sortie d’opérations qui lui avaient permis de percevoir des soultes. Sur l’euro-yen et le franc suisse, la ville a perçu environ 7 millions d’euros liés à la sortie d’opérations que j’avais moi-même engagées. J’ai laissé la ville avec 110 millions de CMS (constant maturity swaps) – ou swaps de courbe. Mais avant de procéder à ces swaps, j’ai recherché la présence d’une inversion de courbe dans les autres monnaies. Il y en avait eu sur le yen et la livre, mais de très courte durée. L’inversion de courbe est une chose qui peut arriver, et d’ailleurs nous l’avons connue immédiatement après avoir fait les opérations de swaps. Un taux long ne peut rester éternellement en dessous d’un taux court. Les opérations de pente étaient des opérations logiques, un taux court coûtant généralement moins cher qu’un taux long. Lorsque la courbe a commencé à s’aplanir, puis à s’inverser, nous savions pertinemment qu’elle se retournerait, mais nous ne savions pas à quel moment cela se produirait.
Une collectivité qui se trouve dans cette situation doit conserver son sang-froid et ne pas sortir des opérations en cours, même si, durant la période au cours de laquelle une opération est négative, il lui faut la financer. Or nous savons que les collectivités utilisent leur budget jusqu’à sa limite. En 2006, Saint-Étienne disposait d’une soulte positive de 7 millions d’euros. La ville aurait très bien pu conserver toutes ces opérations sans que cela lui pose le moindre problème.
À partir de janvier 2006, la direction financière a changé d’optique et les banques lui ont proposé des contre-swaps, dont les snow balls et d’autres produits que je ne connaissais pas. C’est à partir de là que la situation s’est dégradée.
À la fin 2008, tous les CMS étaient à 0 % et, en 2009, la ville aurait pu percevoir 5 millions par an. Il ne fallait donc pas bouger. À la communauté d’agglomération de Saint-Étienne, avec laquelle je travaillais, nous n’avons pas bougé. J’ai proposé de prendre des CMS, qui sont restés à 0 %. Mais la direction financière a choisi de prendre une autre voie.
M. le rapporteur. Quelles étaient les modalités de votre rémunération ?
M. Jean-Michel Rastel. Ma rémunération était assise sur le résultat, tout en étant plafonnée, pratiquement en permanence, sur l’appel d’offres des marchés publics. La plupart des collectivités préfèrent organiser une mise en concurrence sans subir les formalités de l’appel d’offres. Toutefois, quelques collectivités ont lancé des appels d’offres, auxquels j’ai répondu. J’ai été retenu dans la quasi-totalité des cas. Les trois collectivités qui ont conservé mes services pendant la crise sont toujours bénéficiaires.
M. le rapporteur. La chambre régionale des comptes mentionne que vous avez participé à la négociation d’un emprunt de 22 millions sur trente-cinq ans, avec un différé d’amortissement de dix-huit mois, avec une banque irlandaise. Pourquoi avoir conseillé un prêt dont la durée n’est pas en corrélation avec la durée d’amortissement des actifs ?
M. Jean-Michel Rastel. La ville recherche toujours à faire des économies d’intérêts. Le produit euro dollar-euro suisse est proposé par les banques, j’ai donc cherché à l’optimiser. J’ai procédé à des calculs que j’ai soumis aux établissements bancaires. Je recherchais une sécurisation la plus longue possible parce qu’on sait bien que les courbes se retournent systématiquement. On l’a vu avec les CMS. J’ai obtenu les cotations de Depfa et de Natixis et j’ai recherché la meilleure optimisation. J’ai trouvé un produit au taux de 0 % sur une durée de douze ou treize ans, voire jusqu’en janvier 2024, avec un coefficient de réduction de la formule de 50 points de base. C’était énorme !
J’avais des contacts avec M. Alfieri dans le cadre de la communauté d’agglomération. Lorsqu’il m’a fait part des choix qui se présentaient à la ville, je lui ai indiqué que ce n’était pas de bons choix. C’est au cours d’une rencontre en présence de Jean-Claude Louchet que je lui ai proposé le produit en question. Ensuite, les choses sont allées très vite et, une semaine plus tard, la ville réalisait l’opération sans que les services financiers aient été informés de mon intervention. La mise en concurrence a duré un après-midi entier, avec Dexia comme acteur principal. Mais la formule n’est pas présentée de façon identique par Dexia et Depfa, si bien qu’il y a eu un mélange entre ce qu’ont compris les services financiers et les calculs que j’avais effectués. À la fin de la journée, j’ai indiqué à M. Alfieri que je souhaitais me retirer car je sentais que quelqu’un ne comprenait rien ! Plus tard, il m’a appelé pour me dire que Depfa avait remporté l’appel d’offres. Ils avaient eu de la chance : c’était le bon choix.
Aujourd’hui, en pleine crise, j’ai repris la cotation. Quand on me dit que c’est un prêt critique… La ville a repris ce produit euro dollar-euro CHF au taux de 7,15. Je suis, moi, à moins 20 avec un taux de 0 % jusqu’en 2020. D’ici là, croyez-moi, les choses se seront inversées.
M. le rapporteur. La question portait plutôt sur la durée d’amortissement des actifs. Quoi qu’il en soit, vous démontrez la nécessité de procéder à une expertise.
Monsieur Louchet, dans une ville importante comme Saint-Étienne, quel est le rôle des services ? Quelle est votre expertise ? Quel est le montant annuel de la rémunération que vous versiez à M. Rastel en échange de sa prestation ?
M. Jean-Claude Louchet, ancien directeur des services de la mairie de Saint-Étienne. Le rôle du directeur général des services est de veiller à ce que de bons niveaux de compétences interviennent dans tous les domaines.
En matière de gestion financière, l’expertise interne nous était apportée par notre direction des finances, et nous avions l’appui de deux cabinets externes.
S’agissant de la prise de décision, nous organisions régulièrement des réunions sur la base de dossiers préparés en interne ou par les consultants externes. Ces réunions nous permettaient de faire le point sur la situation globale antérieure ainsi que sur les perspectives de la période à venir, et de définir une stratégie.
En ce qui concerne la rémunération de M. Rastel, je ne m’en suis pas occupé en tant que directeur général mais j’en connais le montant pour l’avoir lu dans le rapport de la chambre régionale des comptes : elle se situait autour de 80 000 euros par an.
M. Daniel Boisserie. Vous avez évoqué une perte de recettes due à la baisse de la population, mais cette perte de recettes n’est-elle pas également liée à la dotation de compensation de la taxe professionnelle ?
Mme Valérie Fourneyron. M. Thiollière a évoqué les circonstances qui l’avaient conduit à prendre ses décisions au regard de la diminution de l’activité industrielle de la ville de Saint-Étienne. Un certain nombre de collectivités, qui n’ont pas vécu les mêmes difficultés économiques mais qui ont eu en commun certains intermédiaires financiers, dont M. Rastel, connaissent la même situation.
Monsieur Rastel, votre société a changé de nom. Qu’est-ce qui a motivé ce changement ? Votre qualification est-elle en adéquation avec l’enjeu que représentent les produits que les banques proposent aux responsables communaux, parfois quelques jours avant les échéances électorales ?
M. Jean-Louis Gagnaire. La Cour des comptes relève qu’un certain nombre de collectivités connaissent des difficultés d’expertise interne. Si elles ont recours à des experts externes, c’est bien qu’elles recherchent les meilleurs experts, s’agissant de produits de plus en plus sophistiqués. J’ai cru comprendre qu’il existait une relation entre M. Rastel et M. Louchet. Sachant que la situation que connaît la ville est due à ses conseils, comment M. Rastel a-t-il été recruté ? Celui-ci nous explique que, si ses conseils avaient été suivis jusqu’en 2008, la situation aurait été différente. Comment les décisions étaient-elles prises ?
Vous dites, monsieur Rastel, que vous avez une obligation de résultats. Or, à l’évidence, les résultats ne sont pas là. Certaines obligations n’ont donc pas été respectées. Dans quelles conditions M. Louchet a-t-il été autorisé par le maire et l’adjoint aux finances à recourir à un cabinet qui, semble-t-il, n’avait pas toutes les compétences, en tout cas n’était pas totalement certifié pour manipuler ce type de produits ?
M. Henri Plagnol. Je suis maire d’une ville qui se trouve dans une situation comparable.
Monsieur Alfieri, votre mea culpa est un moment de vérité intéressant pour notre Commission et je vous en remercie. Sachant que vous n’aviez pas toutes les qualifications pour gérer ce type de produit, pourquoi avez-vous pris la décision de souscrire des contre- swaps ?
Doit-on en conclure qu’un élu ne devrait jamais signer un document qu’il ne comprend pas, a fortiori quand sa signature, lourde de conséquences, n’a pas été débattue en toute transparence en conseil municipal ?
M. Marc Francina. Saint-Étienne n’étant pas très éloignée de la Suisse, monsieur Rastel, pourquoi vous êtes-vous basé sur un euro dollar-euro franc suisse sachant que le franc suisse était égal à 0,125 euro en 1963 et qu’il est aujourd’hui égal à 1,20 euro ? N’importe quel employé de banque sait que choisir un placement indexé sur le franc suisse est une folie, et c’est vrai depuis 1914 !
M. Michel Thiollière. En 1999, nous avons instauré la taxe professionnelle unique au sein de l’agglomération stéphanoise. La ville de Saint-Étienne avait des taux beaucoup plus élevés que la moyenne des villes composant l’agglomération. Nous avons donc décidé de revenir, en douze ans, à un taux moyen, lequel se situe aujourd’hui autour de 17,30 %. C’était une façon de partager l’activité économique existante, mais surtout de reconstruire l’activité, tant pour l’agglomération que pour la ville de Saint-Étienne. Le système mis en place permettait toutefois aux communes de récupérer la part de taxe professionnelle qui leur serait revenue si elles avaient conservé leur propre taxe professionnelle.
Je voudrais revenir sur un point. Ceux d’entre vous qui ont présidé un conseil municipal savent bien que personne n’est capable de maîtriser l’aspect technique de chacun des quelque cent dossiers inscrits à l’ordre du jour et qui peuvent concerner la voirie, l’éclairage public ou les finances. J’avais donc mis en place des commissions, dont une commission des finances, instaurée en 1995. Une semaine avant chaque conseil municipal, cette commission permettait à tous les membres du conseil, majorité et opposition, de se renseigner sur les sujets venant en discussion au conseil. En outre, j’organisais une réunion préalable, le jour même du conseil municipal, en présence des présidents de groupes politiques, pour évoquer tous les problèmes inscrits à l’ordre du jour. Car on sait bien que le conseil municipal, s’il permet à certains de paraître à la télévision, n’est pas le lieu propice pour détailler chacun des dossiers présentés.
Vous avez choisi de débattre du cas de Saint-Étienne, mais beaucoup d’autres villes importantes ont été touchées, par les mêmes banques et au même moment. L’article du Monde que j’évoquais précédemment citait bien d’autres villes : Grenoble, Lille, pour 282 millions d’euros, Marseille, pour 272 millions d’euros, Nice, Nîmes, Clermont-Ferrand. Toutes ont connu les mêmes emprunts, les mêmes banquiers et les mêmes difficultés. Cela dit, je comprends l’intérêt que représente notre échange pour les parlementaires que vous êtes.
Je voudrais vous dire une chose : lorsque l’on est aux affaires, on ne trouve pas toujours auprès des pouvoirs publics le bon répondant. Les chambres régionales des comptes, qui disposent d’un certain nombre de documents et d’une réelle expertise, devraient pouvoir donner leur avis et leurs conseils aux collectivités qui le souhaitent, au moins sur les sujets importants. Toutes les communes de France appartiennent à des associations, telles que l’Association des maires de France ou l’Association des maires des grandes villes de France. Pourquoi ne pas établir des « tableaux de bord » qui offriraient aux collectivités la possibilité d’un échange régulier entre les pouvoirs publics, l’État, les banques et les responsables associatifs ? Cela permettrait à un élu, qu’il soit membre de la majorité ou de l’opposition, technicien ou non-initié, de se renseigner en temps réel par le biais d’internet.
Un haut magistrat de la Cour des comptes me suggérait récemment que le président de la chambre régionale des comptes vienne exposer ses conclusions devant le conseil municipal – je remarque que l’on jette parfois en pâture à l’opinion publique des documents qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Ainsi, la majorité et l’opposition pourraient s’appuyer sur un document objectif.
M. Paul Salen. Si nous participons à ces réunions, c’est pour nous documenter mais aussi pour échanger, et sur ce point nous sommes quelque peu frustrés.
À l’époque des faits, j’étais adjoint aux finances dans une ville et, parallèlement, je travaillais dans une banque. Je sais que les banques s’efforçaient de proposer aux collectivités les crédits les plus intéressants.
Lorsqu’une petite collectivité est pénalisée, je donne tort aux banques à 100 % car elle ne dispose pas des services compétents. Mais je m’étonne qu’une ville comme Saint-Étienne soit à ce point pénalisée sachant qu’elle bénéficie des compétences d’un directeur général et d’un directeur financier et qu’elle a la chance de pouvoir recourir à un cabinet de conseil. Certes, le maire ne peut pas tout vérifier. Et je connais Michel Thiollière : ce n’est ni un aventurier ni un joueur de casino.
Monsieur Alfieri, quelles informations régulières M. Thiollière recevait-il, de votre part et de la part du cabinet de conseil, sur le risque que représentaient de tels emprunts ?
J’ai cru comprendre que la rémunération du conseil était variable en fonction du résultat. Pourtant, son montant de 82 000 euros est resté inchangé pendant trois années successives. Cela signifie-t-il que le résultat a été positif durant ces trois années ?
M. Antoine Alfieri. La rémunération de M. Rastel était plafonnée. Nous avons tout de même gagné pratiquement 20 millions d’euros pendant la période où nous avons eu recours à ses prestations. 0,5 % de cette somme correspondent à un million d’euros ; or il n’en a même pas perçu 360 000 sur plusieurs années.
M. Rastel a cessé de nous délivrer ses conseils à la fin de 2005. Si nous avions conservé les produits qu’il nous avait conseillés, nous n’aurions couru aucun risque. Michel Thiollière, après avoir obtenu des informations au Sénat, m’a demandé de ne plus prendre aucun risque. Les banquiers nous ont expliqué que les produits de pente comportaient de gros risques. M. Rastel n’était alors plus le conseil de la ville. La preuve, la métropole, avec le même adjoint au finances et le même conseil, n’a connu aucun dérapage. Cela veut peut-être dire aussi qu’il y a eu une meilleure analyse, mais je n’en dirai pas plus car je ne veux attaquer personne.
J’apprécie la remarque de M. Plagnol. Je rappellerai l’exemple du contrat de la Deutsche Bank : je trouve aberrante l’utilisation de fausses formules dans les contrats. Je vous demande, mesdames et messieurs les députés, si vous légiférez sur cette question, d’imposer aux banques d’écrire toutes les formules, faute de quoi elles seraient condamnées pour défaut d’information.
Nous croyions sortir du risque avec les contre-swaps, j’ai l’honnêteté de le dire, mais ce faisant nous avons pris de véritables risques. J’ai décidé de ne dire que la vérité, nous avons été entraînés dans des risques importants en nous faisant croire (les banques) qu’on nous faisait sortir du risque. Nous avons peut-être été naïfs, je veux bien l’admettre. Pour vérifier le produit de la Deutsche Bank, j’ai fait plusieurs fois le calcul, et j’ai considéré qu’il n’y avait pas de gros risques. Cet exemple est significatif : il y a bien eu tromperie et la Deutsche Bank mériterait d’être accusée.
S’agissant de la transparence au conseil municipal, soyons attentifs : tout n’est pas parfaitement clair pour les participants. Il n’est pas possible, au cours d’un conseil municipal, d’entrer dans le détail de systèmes comme le floor ou le cap. J’ai moi-même essayé de donner des explications : il s’est ensuivi un brouhaha épouvantable car cela n’intéresse personne !
M. le président. Monsieur Thiollière, le rapport de la chambre régionale des comptes date de novembre 2010. À quelle date la chambre vous a-t-elle rendu visite ?
M. Michel Thiollière. Au cours de l’automne 2008, la chambre régionale des comptes s’est autosaisie des finances de la ville entre 2004 et 2008. Elle a établi un premier rapport, mais un an plus tard elle décidait de ne pas le rendre public et d’entreprendre, avec d’autres magistrats instructeurs, un nouveau rapport – celui paru en décembre 2010.
M. le président. Celui que vous évoquez n’a donc jamais été publié ?
M. Michel Thiollière. Pas à ma connaissance. Le président de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes m’a averti par courrier à l’automne 2009 qu’il reprenait entièrement l’analyse de la situation de la ville avec de nouveaux magistrats instructeurs et un nouveau président de section.
M. le président. Sans vous en préciser la raison ?
M. Michel Thiollière. Cela faisait suite à un entretien privé, au cours duquel j’ai indiqué, preuves à l’appui, au président de la chambre m’a indiqué que le magistrat instructeur à l’origine du premier rapport, qui n’a jamais été diffusé, ne présentait pas toutes les garanties de neutralité requises pour instruire un rapport de la chambre régionale des comptes. Et je m’exprime là avec beaucoup de diplomatie.
M. le président. Chacun appréciera…
M. Jean-Claude Louchet. Il est important, en effet, de retracer l’histoire de ma relation avec Jean-Michel Rastel. En 1995, j’étais directeur général de la ville de Meaux. Or cette ville avait des similitudes urbaines et sociales avec Mantes-la-Jolie. C’est au cours de l’une des rencontres organisées entre les deux villes que j’ai rencontré Jean-Michel Rastel, à l’époque directeur général adjoint en charge des finances. Nous avons échangé nos expériences et nous nous sommes aperçus que nous menions la même bataille. En effet, à l’époque, les communes souscrivaient surtout des emprunts à taux fixe, dont les taux étaient très élevés d’autant que le taux de l’inflation diminuait fortement. Les communes avaient pour objectif de sortir de ces emprunts à taux fixe pour souscrire des taux variables.
C’est ainsi que, lorsque Jean-Michel Rastel a créé sa société, nous avons fait appel à lui et à la ville de Meaux pour nous aider à analyser et à négocier les offres des différentes banques afin de sortir de ces taux fixes, car les banques habillaient leurs propositions de différentes manières aboutissant à ce que le coût de sortie soit le plus élevé possible. Satisfait de mon travail avec Jean-Michel Rastel, lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, je l’ai présenté à la mairie, au même titre que différents avocats et cabinets d’audit.
J’en viens à la manière dont nous sommes ensuite séparés. Fin 2005, une inversion de pente s’est produite. Il fallait réagir. J’ai considéré que notre conseil ne nous avait pas alertés en temps utile. C’est alors que Jean-Michel Rastel, qui avait permis à la ville de réaliser d’importantes économies en matière de frais financiers, a exprimé le souhait que soit supprimée la clause de plafonnement de sa rémunération. Considérant que ce n’était pas acceptable, j’ai demandé que la ville ne travaille plus avec lui. J’assume cette décision, même s’il apparaît qu’ensuite les services financiers ont pris des décisions moins intéressantes…
M. le rapporteur. Y avait-il eu une mise en concurrence ?
M. Jean-Claude Louchet. La mise en concurrence appartenait à la direction : je n’ai fait que mettre M. Rastel dans le circuit, sachant qu’il existait à Saint-Étienne une procédure particulière pour les marchés publics due à la certification ISO 9001 que la ville a obtenue pour une période de dix ans.
M. Jean-Michel Rastel. En ce qui concerne ma qualification, je l’ai obtenue au fil des années par mon travail. Quant à mon niveau d’études, j’ai fait mathématiques élémentaires en 1957. Je n’ai pas fait l’ENA et cela ne me dérange pas du tout…
S’agissant de ma rémunération, je demandais en général aux collectivités 8 % du montant des résultats. Je n’ai jamais eu recours aux snow balls et aucun des prêts structurés qui figurent dans la liste actuelle ne me concerne, sauf si l’on considère que le produit euro dollar-euro CHF est un risque, ce qui n’est pas le cas dans le climat actuel. La Banque suisse, qui commençait à connaître de sérieuses difficultés, a fixé un taux plancher de 1,20 %. Il est actuellement à 1,22 % et je pense qu’à l’avenir il ne peut que s’améliorer, selon la position de l’euro.
Pourquoi ai-je créé deux sociétés ? Lorsque j’ai créé la société TECHFI, j’y ai associé mon fils, qui travaille dans l’informatique, avec l’intention qu’il prenne la suite. Il se trouve que cela ne l’a pas intéressé. Dans la mesure où je conservais toutes les économies et ne prenais pas de dividendes, s’il m’était arrivé un accident, mon fils aurait hérité de la moitié des parts de la société et mes deux autres enfants auraient été désavantagés. J’ai donc décidé de créer une nouvelle société, la société FITECH.
En septembre 2008, le nouveau maire de Saint-Étienne, Maurice Vincent, m’a fait l’honneur de m’informer qu’il donnait une conférence sur la dette. J’avais alors la possibilité de sortir du produit euro dollar-euro franc suisse dans d’autres collectivités, dont Conflans et Mantes-la-Jolie. J’ai donc informé Maurice Vincent, dans un courrier du 14 septembre 2008, qu’il pouvait sortir du swap avec une soulte de 4 millions d’euros que m’avait cotée Natixis. Il n’y a pas eu de sortie, ce qui suppose que le produit n’était pas aussi mauvais que cela…
M. le président. Nous aurons l’occasion d’interroger M. Vincent sur ce point.
Je vous remercie, messieurs, de nous avoir éclairés sur la chaîne de commandement.
M. Bernard Derosier. Compte tenu des informations que nous venons de recevoir sur la chambre régionale de la région Rhône-Alpes, il serait intéressant que nous ayons le temps de procéder à un debriefing et d’élargir le champ de nos auditions car il est évident que son président a des choses à nous dire.
M. le président. J’ai évoqué cette possibilité avec le rapporteur, mais l’emploi du temps de notre commission d’enquête est très chargé avant la rédaction du rapport, et l’examen du projet de loi de finances va beaucoup occuper les administrateurs. Cela dit, il est évident qu’il faudra revoir le programme des auditions.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne, de M. Jean-Claude Bertrand, adjoint au maire, chargé du budget et de la gestion de la dette, et de M. Cédric Grail, directeur général adjoint.
(Procès verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. Messieurs, nous venons d’écouter avec beaucoup d’intérêt vos prédécesseurs à la mairie de Saint-Étienne.
Après le changement de majorité municipale en 2008, quelles ont été vos premières décisions pour rétablir les finances de la ville et, surtout, pour gérer la dette ?
M. Maurice Vincent, M. Jean-Claude Bertrand et M. Cédric Grail prêtent successivement serment.
M. Maurice Vincent, maire de Saint-Étienne. Dès mon élection, j’ai demandé la réalisation d’un audit sur la situation budgétaire de la ville et de sa dette. Sur le plan budgétaire, celui-ci a démontré que la ville était en grave difficulté du fait de l’effondrement de l’épargne nette. L’une des conclusions du Rapporteur a donc été la nécessité d’augmenter les impôts de 25 % pendant le mandat – ce que nous n’avons pas fait pour l’instant. Sur le plan de la dette, le rapport rendu par le cabinet Finance Active en juin 2008 a également mis en évidence une situation grave puisque 70 % de l’encours, soit 270 millions d’euros, étaient composés d’emprunts structurés. Aussitôt informé de cette situation, j’ai consulté mes adjoints et les services de la mairie, et, la semaine suivante, je leur ai demandé l’engagement d’une politique de sécurisation de la dette, consistant à saisir toutes les occasions de sortir de ces risques le mieux possible et au coût le plus faible pour la ville. Cette politique a donné des résultats puisque notre part toxique – certes, encore importante aujourd’hui : de 120 millions d’euros, soit 34 % de la dette – a été réduite de moitié en trois ans.
Par ailleurs, avec d’autres élus, j’ai alerté la ministre des finances et la ministre de l’intérieur de l’époque sur cette situation. Il s’est ensuivi, au mois de novembre 2008 au ministère de l’intérieur, la réunion des grandes banques françaises et des principaux responsables d’association d’élus locaux, puis la mise en place de la grille Gissler, visant à interrompre la diffusion de produits spéculatifs aux collectivités territoriales.
M. le Rapporteur. Vous vous êtes publiquement prononcé en faveur de la création d’une « structure de défaisance » dont l’objectif serait de prendre en charge tous les prêts structurés souscrits par certaines collectivités. Mais je vous ferai observer qu’un prêt structuré n’est pas forcément toxique.
Quels seraient selon vous les collectivités et les produits concernés par cette structure de défaisance et quel en serait le coût ?
M. Maurice Vincent. Cette idée d’une structure de défaisance constitue l’aboutissement de trois années de discussions et de résultats partiels, mais importants.
Vous avez raison : tous les produits structurés n’ont pas le même degré de dangerosité. Ceux que je n’ai pas pu renégocier sont les plus spéculatifs. Pour les autres, nous avons perdu de l’argent, nous avons accepté des taux d’intérêt rehaussés, nous avons payé de temps à autre telle ou telle soulte, mais nous en sommes sortis.
M. le président Claude Bartolone. Quelle était l’indexation de ceux que vous avez réussi à renégocier, et par quoi les avez-vous remplacés ? Et quelle est l’indexation de ceux qui subsistent dans votre budget et que vous jugez aujourd’hui très toxiques ?
M. Maurice Vincent. De mémoire, nous n’avons pas pu sortir des produits indexés sur les taux de change. Nous sommes sortis d’un ou deux produits indexés sur la pente, avec un levier faible. Nous sommes sortis parfois grâce à une opportunité et avons renégocié.
Les plus dangereux sont les produits dont la partie variable est indexée sur les taux de change, et les produits qui, étant indexés sur les écarts de pente, ont un fort coefficient multiplicateur. Ceux-là subsistent dans notre dette.
M. Jean-Claude Bertrand, adjoint au maire de Saint-Étienne, chargé du budget et de la gestion de la dette. La désensibilisation des emprunts à risque nous a coûté, en soulte, 2,4 millions d’euros. Avec certains établissements bancaires, il n’y a pas eu de soulte, mais intégration de la perte dans les nouveaux taux d’intérêt – de 3,36 % au lieu de 3,31 %.
M. Maurice Vincent. La valorisation du risque des emprunts très risqués – de niveau 6 F, ou au-delà, de la charte Gissler – est telle que le coût est impossible à supporter à la fois pour les collectivités et pour les banques. Les premières seront donc amenées soit à augmenter très fortement les impôts pour payer des taux d’intérêt dissuasifs – ce que les élus ne feront pas, à commencer par moi –, soit à multiplier les procédures contentieuses en espérant sortir de ces prêts toxiques.
Pour les produits les plus toxiques, ne rien faire n’est pas gérable car cela risquerait, d’une part, d’abîmer l’image de notre pays – plusieurs centaines de collectivités étant concernées, comme l’indique le rapport de la Cour des comptes de juillet dernier –, et, d’autre part, de laisser ces dernières dans l’incertitude.
Selon moi, il faudrait donc créer, par la voie législative par exemple, une société où serait cantonné l’ensemble des prêts les plus toxiques, afin de faire revenir les collectivités territoriales dans le droit commun. La création de cette structure de défaisance n’est qu’une idée, et je ne prétends pas avoir entièrement raison.
Le rapport de la Cour des comptes évalue le stock de prêts très toxiques entre 7 et 12 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités territoriales concernées. Il faudra néanmoins y ajouter ceux des CHU, qui ne figurent pas dans le champ du rapport.
Pour Saint-Étienne, la valorisation de nos 120 millions d’euros de prêts très toxiques est aujourd’hui de 120 millions d’euros. Le risque de perte sur cette structure de défaisance est donc compris entre 7 et 12 milliards d’euros. Je pense qu’il appartient au Gouvernement et à la représentation nationale de réfléchir à la façon dont ce fardeau doit être pris en charge. Celui-ci est, selon moi, parfaitement gérable sur trois ans. Pour ma part, je préconise une taxation des banques.
Bref, le Gouvernement doit se saisir de l’affaire et proposer une solution de sortie, car le pire serait de laisser de grandes villes, mais aussi de petites communes, dans cette situation.
M. le Rapporteur. La Cour des comptes n’est pas favorable à l’idée d’une structure de défaisance, car celle-ci reviendrait à déresponsabiliser les collectivités. Elle propose une mesure visant à mutualiser la gestion des emprunts les plus risqués par des spécialistes, plutôt que par les collectivités. Qu’en pensez-vous ?
M. Maurice Vincent. J’ai écrit à Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, dont la proposition n’est pas incompatible avec la mienne. Néanmoins, je pense que l’on ne peut pas se contenter d’une seule structure technique, car il s’agit de savoir comment on sort du risque, combien cela va coûter et qui va payer. Or des experts techniques nous aideraient, certes, à gérer ce risque, mais ne le feraient pas disparaître.
Le rapport de la Cour aborde également la question de la responsabilisation des collectivités territoriales. Je pense qu’il n’y a aucun risque pour le futur à partir du moment où des textes interdisent clairement les emprunts spéculatifs aux collectivités territoriales. J’ai toujours proposé que la charte Gissler soit plus claire en interdisant ces produits. On entend dire que les collectivités ont fait preuve d’irresponsabilité entre 2002 et 2008. Certes, ces produits étaient inadaptés, et certains élus n’ont pas été capables d’en déceler le caractère pernicieux. Néanmoins, l’origine de l’affaire ne réside pas dans l’irresponsabilité des collectivités : elle réside, et cela figure dans le rapport de la Cour, dans la volonté des banques d’augmenter leurs marges bénéficiaires dans la mesure où, en 2002, elles étaient en concurrence et avaient des marges très faibles.
La charge de la preuve ne doit pas être renversée : c’est bien le système bancaire qui, pour augmenter ses profits, est à l’origine de cette situation dramatique !
Je suis d’accord pour que l’on se prémunisse à l’avenir de tous risques d’irresponsabilité potentielle des collectivités. Cependant, on peut aujourd’hui régler le problème définitivement. Après 2008, la charte Gissler a à peu près assaini la situation : il faut maintenant sortir des stocks couvrant la période de 2002 à 2008.
M. Patrice Calméjane. Dans votre courrier du 18 novembre 2010 adressé au président de la chambre régionale des comptes, vous écrivez : « S’il me paraît évident que mes prédécesseurs ont eu une gestion désastreuse et irresponsable de la dette, il est également clair que les banques ont vendu des produits spéculatifs interdits, ce qui est d’ailleurs reconnu dans la charte Gissler. » Vous ajoutez : « Ces pratiques budgétaires et financières me semblent incompatibles avec le principe de sincérité et de prudence présidant à l’établissement des budgets, mais également incompatibles avec une gestion responsable des deniers publics. »
Autrement dit, vous mettez fortement en cause, d’un côté, la gestion de vos prédécesseurs et, de l’autre, le contrôle de légalité en stigmatisant le manque de sincérité des éléments fournis au conseil municipal de l’époque.
Aviez-vous, à l’époque, en tant que membre du conseil municipal, la capacité d’analyser les éléments qui vous étaient donnés ? Et avez-vous déféré au préfet ou à toute autre autorité administrative les délibérations du conseil municipal qui décidait de recourir à ces emprunts pour le compte de la ville de Saint-Étienne ?
M. Henri Plagnol. Je suis très frappé par la similitude des situations de nos communes. Je rejoins totalement votre constat : après plusieurs années d’efforts pour renégocier au mieux, avec des résultats non négligeables, on en arrive à un stock extrêmement dangereux à très court terme, face auquel il n’existe pas de solution à l’échelle de la collectivité. Il est très important que les membres de la Commission en aient conscience, sauf à exiger une ponction extrêmement forte sur les contribuables.
S’agissant de ma ville de Saint-Maur-des-Fossés, non seulement les conseillers municipaux de l’opposition n’avaient aucun moyen de connaître la nature de ces emprunts, mais aucun des contrôles de légalité n’a fonctionné. Des restructurations pour des montants extrêmement importants ont été opérés quelques semaines avant l’élection municipale, c’est-à-dire à un moment où le conseil municipal ne se réunissait pas.
Quel regard portez-vous sur cette question majeure pour la démocratie locale ?
M. Lionel Tardy. Le problème se pose pour l’avenir, mais il faut aujourd’hui traiter le stock. Beaucoup de maires m’ont demandé ce qu’il était possible de faire pour les collectivités, sachant que les banques, elles, ont été aidées quand elles ont eu besoin de l’être. Ils se posent des questions sur leurs budgets futurs, et certains envisagent d’attaquer Dexia ou d’autres banques sur la conformité des contrats.
S’agissant du stock de prêts toxiques, vous avancez le chiffre de 12 milliards. Un grand quotidien national donne aujourd’hui un chiffre différent et évoque 5 500 communes concernées. Or pour éclairer nos débats et traiter le stock grâce à une structure de défaisance, nous devons connaître les sommes en jeu et le nombre de collectivités concernées, sans forcément les citer.
M. le président. C’est notamment la raison pour laquelle nous avons accepté à l’unanimité la création de cette commission d’enquête.
Pour ma part, j’avais déposé, notamment dans le cadre des deux dernières lois de finances, des amendements permettant d’obtenir ces informations. Les uns et les autres ont voulu regarder ailleurs : le Gouvernement s’est demandé comment il pourrait éviter une soulte ; les banques, n’en parlons pas ; et certaines collectivités locales n’ont pas souhaité s’exprimer. Aujourd’hui, la parité entre l’euro et le franc suisse conduit un certain nombre de collectivités à « sortir du bois ».
Avant les vacances, ce sujet a fait l’objet d’un reportage dans un grand journal du soir. Aujourd’hui, il fait la une d’un grand quotidien. Néanmoins, le législateur ne peut pas se forger un avis sur des articles de presse. C’est pourquoi le programme arrêté par notre Rapporteur nous permettra d’aborder les points essentiels que vous soulevez, monsieur Tardy, en particulier celui, central, du nombre des collectivités concernées.
M. Jean-Louis Gagnaire. M. Vincent a démontré l’impossibilité, même pour une grande ville, d’aller plus loin.
Face à cette situation, il faut épurer le stock dans une structure garantie par l’État et qui porte le risque, afin de faire tomber le coût du crédit. Toutes proportions gardées, cette proposition peut être faite pour les eurobonds, puisque porter le risque mutualisé à l’échelle européenne permet de soulager le coût de la dette pour tel ou tel pays – ce qui ne veut pas dire que le pays en question ne paie pas. En l’occurrence, si je comprends bien la proposition de M. Vincent, il ne s’agit pas pour la collectivité de se décharger sur une structure : il s’agit de rembourser, à travers une structure nouvelle, une dette dont le coût explose.
S’il est très intéressant d’analyser le passé, il faut surtout trouver des solutions pour l’avenir. Le cas de Saint-Étienne est emblématique. Il y en aura certainement d’autres. Je pense que les élus qui sont allés le plus loin possible devront revenir devant notre Commission avec les banques et d’autres opérateurs pour discuter des solutions opérationnelles.
M. le président. Monsieur Vincent, quel a été votre sentiment en tant qu’élu de l’opposition lorsque ces différents produits vous ont été présentés ?
Il vous reste aujourd’hui 120 millions d’euros de produits toxiques, soit un tiers du total de votre dette. Sur l’ensemble des produits de ce stock, êtes-vous sortis de la période des taux bonifiés ?
Au dernier fixing qui vous a été communiqué, à quel taux d’intérêt sortez-vous ?
S’il vous fallait augmenter les impôts, dans quelles proportions devriez-vous le faire ?
Enfin, avez-vous entendu parler de la double vérification de la chambre régionale des comptes et de ses deux rapports, dont un semble être resté très secret ?
M. Maurice Vincent. Selon moi, avant 2008, il était inimaginable pour n’importe quel élu que des produits spéculatifs de cette nature soient proposés et souscrits par les collectivités. En tout cas, il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’on pouvait spéculer ou accepter des produits qui, de fait, revenaient à spéculer avec l’argent du contribuable.
À Saint-Étienne, l’opposition connaissait l’existence d’une dette importante. Elle surveillait donc son montant global. Comme l’a confirmé le rapport de la chambre régionale des comptes de 2010, elle a augmenté sur le dernier mandat de 14 millions. L’opposition surveillait également le taux d’intérêt. Mais celui-ci était bas puisque c’étaient les emprunts toxiques qui le faisaient baisser, ce que nous ne savions pas.
La souscription des emprunts toxiques faisait l’objet, non de délibérations du conseil municipal, mais de décisions du maire qui figuraient dans une liasse, bien connue des maires, sur une demi-page, très succincte. Il était donc très difficile de voir ces décisions.
Ainsi, jusqu’en 2007, nous constations, en tant qu’opposants, que la dette augmentait un peu et que le taux d’intérêt était plutôt bas.
Le hasard a fait qu’un élu du Syndicat intercommunal pour la destruction des résidus urbains (SIDRU) de Saint-Germain-en-Laye nous a alertés sur des prêts très avantageux souscrits par sa ville et celle de Saint-Étienne.
Cela m’a amené, lors de la séance du 18 décembre 2007 du conseil municipal, à poser les questions suivantes : « Avez-vous, comme cela semble être le cas à Saint-Germain-en-Laye, échangé des risques de taux très élevés après 2008 pour bénéficier de taux très favorables jusqu’aux élections ? Avez-vous, dans votre négociation de la dette, pris des risques sur l’évolution des taux futurs ? » « Avez-vous engagé la dette de la ville sur des produits financiers hautement spéculatifs, que ce soit sur les taux d’intérêt ou sur les taux de change pour les vingt ans qui viennent ? »
Les réponses qui m’ont été apportées à l’époque étaient rassurantes. Je pense franchement qu’il était difficile pour l’opposition d’aller au-delà dans son rôle de vigilance.
S’agissant du contrôle de légalité, je ne mets pas en cause spécialement les services de l’État. Je constate qu’ils ont exercé le contrôle de légalité sur telle ou telle délibération, mais pas sur ces décisions d’emprunts des maires, et ce dans toutes les villes de France. Peut-être ces décisions étaient-elles hors de leur champ de réflexion, ou peut-être le personnel des préfectures est-il insuffisant.
À mes yeux, la responsabilité principale revient aux organismes financiers qui connaissaient la complexité et la dangerosité de ces produits. Les proposer aux collectivités territoriales est une faute. C’est pourquoi j’ai saisi la justice sur plusieurs cas. J’ai parlé d’incompétence et d’irresponsabilité des élus, et je confirme ces critiques. En effet, même si les banques sont très agressives, les élus ne devraient jamais signer un contrat qu’ils ne comprennent pas.
J’ai découvert par la suite un autre élément qui m’a profondément choqué : la décision du maire de Saint-Étienne, par l’intermédiaire de son adjoint aux finances, prise le 18 mars 2008 après le deuxième tour de l’élection municipale, et actée définitivement le 20 mars 2008, de contracter avec la Deutsche Bank un prêt dont le taux serait aujourd’hui, si nous le payions, de 24 %. J’ai été élu maire par le conseil municipal le 21 mars. Je vous laisse apprécier les observations que j’ai faites sur la gestion de l’équipe précédente…
Selon le rapport de la chambre régionale des comptes de juillet 2011, le stock de prêts très toxiques est compris entre 7 et 12 milliards – sans compter les CHU, pour lesquels il faudrait sans doute rajouter plusieurs milliards. Ce matin, la presse donne un chiffre inférieur, mais elle ne cite que Dexia, alors que d’autres banques sont concernées. En outre, ce chiffre date de fin 2009. La valorisation du coût de la dette devrait donc, selon moi, être égale à celle du montant des emprunts – comme pour la ville de Saint-Étienne.
Pour notre ville, un emprunt est déjà sorti de la période des taux bonifiés depuis un an et demi : l’emprunt de la Deutsche Bank de 23 millions d’euros, dont le taux serait de 24 % aujourd’hui. Nous ne le remboursons pas car nous avons saisi la justice, et l’action est suspensive.
M. Jean-Claude Bertrand. Deux snow balls de la Royal Bank of Scotland (RBS) sont en période de risque depuis 2011.
M. Maurice Vincent. Nous avons saisi la justice pour les faire annuler.
Deux autres emprunts, souscrits avec Dexia, sortiront en 2012.
En dehors de l’emprunt de la Deutsche Bank, le plus préoccupant à très court terme concerne l’agglomération stéphanoise puisque nous avons deux swaps dont la période de risque commence le 1er janvier 2012, pour un total de 20 millions d’euros et dont le taux d’intérêt théorique dépasse aujourd’hui les 30 %. Ce sont des produits très spéculatifs indexés sur la parité euro-franc suisse.
S’agissant du double rapport de la chambre régionale des comptes, les choses sont très claires pour moi. Un premier rapport a été rédigé. Le courrier que j’ai reçu du Président évoquait tout simplement une erreur de la Cour puisque l’un des magistrats avait déjà exercé dans la région Rhône-Alpes. Il a donc lancé une autre équipe de magistrats.
Enfin, en matière de fiscalité, la situation pour notre ville est ingérable : l’évaluation du marché est de 120 millions de soulte, alors que les impôts directs nous rapportent 93 millions par an. Même en deux ou trois ans, aucune collectivité ne peut augmenter les impôts dans de telles proportions. C’est pourquoi je propose une structure de défaisance.
M. Michel Diefenbacher. Selon vous, les collectivités territoriales n’étant pas des emprunteurs comme les autres, les banques n’auraient pas dû leur proposer des produits de cette nature. Or je ne vois pas sur quoi cet argument peut se fonder juridiquement. Je me fais l’avocat du diable en me mettant à la place de l’organisme prêteur : d’une certaine façon, prêter à une collectivité territoriale est plus sûr puisqu’elle ne fera pas faillite.
Avez-vous mis en avant votre argument dans vos contentieux ? Avez-vous un premier écho de la justice à ce sujet ?
M. le Rapporteur. Si autant de collectivités ont souscrit des emprunts structurés, c’est à cause du problème de liquidités. Pour financer des projets, les élus cherchent des emprunts, d’abord à des taux fixes avantageux, ensuite à des taux variables, et enfin, si cela ne suffit pas, ils se tournent vers des emprunts structurés. En effet, en cas d’encours d’investissements importants, les banques locales n’arrivent pas à suivre. Cela a été le cas pour ma ville, notamment sur un complexe aquatique de 60 millions d’euros : les banques ne suivaient pas et, en bout de chaîne, nous avons souscrit des emprunts structurés.
Le problème de liquidités va donc devenir de plus en plus dur. Les banques qui accordent des prêts structurés ne sont pas des banques de dépôt : elles vont chercher l’argent sur le marché monétaire.
Qu’avez-vous mis en place pour gérer ce problème ? Faites-vous toujours appel à des cabinets extérieurs ? Comment amenez-vous ces questions au conseil municipal ?
M. Jean-Claude Bertrand. Dès que nous avons eu conscience de la structuration de la dette, un comité de sécurisation de la dette a été mis en place à la demande de Maurice Vincent. Il se compose du maire, de moi-même, du directeur général des services (DGS) et du directeur général adjoint (DGA) aux finances. Nous nous réunissons une fois par mois pour passer en revue toutes les lignes et voir si des opportunités se dessinent pour renégocier, ou s’il nous faut saisir la justice.
En outre, je rencontre une fois par semaine la directrice des finances et le DGA aux finances pour étudier la situation et chercher des opportunités éventuelles.
S’agissant de l’information du conseil municipal, je présente un état de la dette et de sa structure trois fois par an : lors d’une séance dédiée du conseil municipal – je l’ai fait en février –, lors de la présentation du budget primitif et lors de la présentation du compte administratif.
M. le Rapporteur. Malgré tout, votre commune continue de vivre. En trois ans, vous avez dû avoir des projets et recourir à des emprunts. Comment fonctionnez-vous ?
M. Jean-Claude Bertrand. Lorsque nous avons besoin d’emprunter, nous lançons un appel d’offres auprès des banques : nous recherchons le taux le plus avantageux pour la collectivité et prenons des emprunts sans risque, soit à taux fixe, soit à taux variable, mais classique, sur Euribor et Capé.
Nous faisons appel à deux expertises extérieures : Finance Active, qui conseillait l’équipe précédente, et Riskedge, cabinet spécialisé composé de traders reconvertis, avec lequel nous avons contracté.
M. Patrice Calméjane. Concernant le double rapport de la chambre régionale des comptes, je n’ai pas compris. La personne dont vous avez parlé avait-elle exercé à la chambre régionale ou avait-elle eu un mandat politique ?
M. Jean-Claude Bertrand. Elle était magistrat à la chambre régionale des comptes, mais avait été antérieurement DGA chargé des finances pour Villeurbanne, commune à direction socialiste. Selon moi, l’équipe précédente a jugé que cette personne pouvait ne pas être impartiale.
M. Daniel Boisserie. Qui vous a poussé à agir en justice ? Pensez-vous avoir une chance de gagner votre procès ?
M. Maurice Vincent. Nous avons fait un recours contre l’emprunt de la Deutsche Bank après avoir eu avec la banque des échanges qui ne nous ont pas semblé satisfaisants. Il nous était en effet proposé une sécurisation temporaire, alors que la dégradation du rapport entre la livre et le franc suisse nous amenait progressivement vers des taux ingérables. En l’occurrence, il était inenvisageable de payer un taux d’intérêt de 24 %. Avec le comité de sécurisation de la dette, nous avons donc regardé si le contrat contenait des points contestés et en avons trouvés qui nous semblent importants. Nous avons esté en justice sur ces bases.
Notre premier argument est le défaut de conseil de la banque. Sa connaissance de ces produits très spécifiques et très complexes était forcément très supérieure à celle des services et des élus de la collectivité. Il lui revenait donc de donner le meilleur conseil possible. Or, selon nous, elle aurait dû déconseiller à la collectivité de contracter ce genre de prêt très spéculatif.
Notre deuxième argument est celui du dol. De notre point de vue, la collectivité n’avait pas le pouvoir de souscrire un tel emprunt, et la banque a mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour la pousser à accepter ce produit.
En l’espèce, nous n’avons pas fondé notre démarche sur une différence entre les collectivités.
Avons-nous des chances de gagner ? Pour l’instant, nous examinons les mémoires des uns et des autres. La situation est complexe. Souvenez-vous de l’affaire concernant des particuliers auxquels une banque avait conseillé de transférer l’épargne de leur Livret A vers un produit lié à des cours de la bourse : elle a donné lieu à des jugements variables en fonction des situations puisque des clients ont gagné, alors que d’autres ont perdu.
Je tiens à dire que la Cour de cassation allemande a rendu le 22 mars 2011 un arrêt très important, opposant une banque allemande à une entreprise privée. Selon cette décision, à mes yeux fondamentalement juste, le professionnel – en l’occurrence un économiste de haut niveau – qui a conseillé l’entreprise ne pouvait pas avoir la même connaissance que le spécialiste ayant proposé le produit très spéculatif. En raison d’une asymétrie d’informations, le devoir de la banque était donc de dissuader l’entreprise de souscrire un tel emprunt.
Nous espérons voir se développer ce genre de décision. Pour autant, sur le long terme, il ne me semble pas possible d’axer une stratégie sur des contentieux à répétition pour l’ensemble des collectivités.
M. le président. L’État n’a jamais considéré les collectivités locales comme des clients comme les autres, puisqu’une circulaire de 1992 réglementait les prêts qui pouvaient leur être accordés. Malheureusement, lorsque les produits de couverture, les swaps, les produits de pente, les snow balls sont arrivés sur le marché, cette circulaire n’a pas été réactualisée.
Je vous remercie beaucoup, messieurs.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, sur le thème « Le recours aux produits financiers à risque par les grandes municipalités : le cas de Saint-Étienne » de M. Michel Morin, préfet de la Loire (2002-2006) et M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire (2000-2005)
(Procès verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. Dominique Baert, vice-Président de la commission d’enquête. Je vous remercie d’avoir accepté de venir témoigner devant notre commission d’enquête. Avec votre audition, nous achevons l’examen détaillé du cas de la ville de Saint-Étienne, examen qui ne serait pas complet sans convoquer les responsables du contrôle de légalité et du contrôle des comptes. Il sera utile, au-delà de votre témoignage, de connaître votre jugement sur les caractéristiques actuelles du contrôle public et sur les améliorations que l’on doit lui apporter. Comment ne pas considérer, au regard de la situation dans laquelle se trouve aujourd’hui Saint-Étienne, que le contrôle de légalité et le comptable public ont été défaillants ?
MM. Michel Morin et Yves Terrasse prêtent successivement serment.
M. Yves Terrasse, trésorier-payeur général de la Loire (2000-2005). Nommé trésorier-payeur général (TPG) à Saint-Étienne en septembre 2000, je suis resté à ce poste jusqu’au 31 décembre 2005 avant d’être nommé à Tours. Depuis le 1er juillet 2010, je suis agent comptable de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Je n’appartiens donc plus au réseau du Trésor public, et suis désormais assez éloigné de la problématique des finances locales.
La situation financière de Saint-Étienne était, lorsque j’y fus nommé, l’un des sujets importants, puisque cette ville figurait sur le réseau d’alerte en raison de son niveau d’endettement et du poids de ses investissements. À l’époque, c’est davantage le niveau d’endettement et la capacité de la commune à dégager l’autofinancement nécessaire pour rembourser cette dette qui préoccupait l’État.
Je commencerai par un bref rappel du cadre juridique et comptable au sein duquel l’État pouvait apprécier la situation financière des collectivités locales et formuler des préconisations ; puis j’évoquerai ce qui a été fait jusqu’en décembre 2005, avec la réserve qu’il s’agit pour moi d’événements assez anciens, pour lesquels je n’ai pas conservé toute la documentation.
S’agissant du rôle des administrations de l’État en matière de budgets locaux, je parlerai essentiellement du Trésor public, qui assure, d’une part, le contrôle contemporain de la régularité des opérations budgétaires et financières, et, de l’autre, une activité de conseil auprès des collectivités.
Le comptable territorial est chargé du contrôle de régularité, éventuellement avec le soutien de la Trésorerie générale, mais il lui est impossible, aux termes de l’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales, d’exercer un contrôle d’opportunité sur les décisions prises par l’ordonnateur. Le contrôle de régularité qui lui incombe s’exerce sur la base des articles 12B et 13 du Règlement général de la comptabilité publique, et porte sur différents éléments : qualité de l’ordonnateur, disponibilité des crédits, exacte imputation de la dépense et validité de la créance sur la foi de justificatifs. Le comptable territorial doit également s’appuyer sur la décision ou les délibérations visées par le contrôle de légalité ; enfin, il applique les règles relatives à la prescription et à la déchéance, ainsi qu’au caractère libératoire du paiement.
Dès lors que la dépense est fondée sur un texte ou s’appuie sur une délibération ayant un caractère exécutoire, et une fois effectués les contrôles de régularité, le comptable doit procéder au paiement : il n’a pas à juger du contenu du contrat.
En ce qui concerne les pièces justificatives, le comptable ne dispose pas nécessairement du contrat d’emprunt ou de swap. Le décret de 1983, modifié en 2003, fixe la liste des pièces justificatives, à savoir, pour les emprunts, le tableau d’amortissement et les avis d’échéance et de domiciliation – ainsi, bien entendu, que la délibération exécutoire ou la décision. La Cour des Comptes, dans son rapport thématique de juillet 2011, avait souligné l’inadaptation de ce décret qui ne facilite pas, selon elle, l’exercice des vérifications.
On voit donc les limites du contrôle contemporain. S’il n’est déjà pas facile d’identifier le caractère exotique de certains contrats, une analyse approfondie ex post est nécessaire pour apprécier le risque d’exposition global de la collectivité.
D’une manière générale, on a aussi relevé, à l’époque, les limites de la capacité d’expertise des services du Trésor sur ces questions, non seulement des trésoreries municipales, mais aussi des trésoreries générales.
Le rôle de conseil, valorisé par la Direction générale des finances publiques, peut s’exercer dans le cadre du contrôle au jour le jour ; cependant, s’il est très appréciable pour les petites collectivités, il reste limité pour les grandes, qui disposent de leur propre direction financière. Le comptable ne peut donc intervenir qu’à la demande des collectivités et, en tout état de cause, jamais dans les négociations avec les banques.
J’évoquerai les outils qui, de 2000 à 2005, permettaient d’exercer une vigilance sur les nouvelles modalités d’endettement des collectivités locales. Le phénomène était encore embryonnaire à l’époque, même si l’innovation financière commençait à se développer. Une circulaire conjointe relative aux contrats de couverture du risque d’intérêt – en d’autres termes, les swaps de taux d’intérêt – offerts aux collectivités locales était parue en octobre 1992, dans un contexte de déréglementation des instruments financiers ; elle permettait aux collectivités, alors lourdement endettées par des emprunts à taux fixes, d’en contracter de nouveaux à taux variables et moins élevés.
Cette circulaire, d’une lecture peu aisée, ne décrivait pas les nouveaux types de prêts structurés à taux parfois très bonifiés – produits de barrière, de change, de pente ou de courbe et emprunts snowball –, qui demeuraient donc tout à fait inconnus des services de l’État, auxquels ils n’ont été présentés qu’à l’automne 2008 ; il fallut enfin attendre la circulaire du 25 juin 2010 pour en obtenir une description complète.
Un certain nombre de ces contrats, notamment dans la catégorie des swaps de taux d’intérêt, étaient néanmoins interdits car ils contrevenaient à l’obligation du dépôt de fonds au Trésor public ; d’une manière générale, il fallait établir leur nature non spéculative et leur conformité au critère d’intérêt général. Cette appréciation n’était guère facile.
La présentation des états annexes récapitulant l’endettement des collectivités – M 14 – était, à l’époque, assez générale : elle ne permettait pas d’identifier les emprunts structurés par types de taux, donc d’en évaluer l’éventuelle dangerosité. De même, si l’un des états récapitulait le remboursement anticipé des emprunts, ces données étaient peu lisibles en l’absence d’indications quant aux soultes, dont on sait qu’elles ont souvent été neutralisées par un allongement de la durée des emprunts.
Quant aux charges financières, les règles comptables ne permettaient pas vraiment d’identifier les risques. La constitution de provisions n’est pas obligatoire pour les collectivités locales ; de surcroît, l’état annexe M 14 ne prend en compte que les intérêts effectivement versés en cours d’année. Les soultes éventuelles figurent dans un autre état, parmi d’autres éléments comptables ; il n’est donc pas facile de les repérer.
J’en viens à la situation de Saint-Étienne telle que mes services ont pu l’apprécier à l’époque. Les relations avec la commune, dont l’état d’endettement nous préoccupait, étaient courtoises mais un peu superficielles, cette dernière étant soucieuse de préserver son autonomie en matière de gestion financière. Je souhaitais mener une analyse prospective sur les dépenses prévues à trois ans, mais il fallut se contenter d’une analyse rétrospective. Nous n’avons jamais eu de discussion avec la commune sur la structure de son endettement ; nous savions seulement qu’elle cherchait des marges de manœuvre à travers la renégociation de ses contrats d’emprunt afin de bénéficier de taux d’intérêt plus avantageux ; d’une manière générale cette démarche d’allègement des charges financières était d’ailleurs saluée par l’État.
Nous avions, avec la préfecture, des relations suivies à travers le réseau d’alerte. La chambre régionale des comptes avait rédigé un premier rapport ; mais il s’arrêtait en 2004 et ne portait que sur le problème de l’endettement global, non sur la structure de cet endettement : il a fallu attendre le rapport de 2010 pour avoir une analyse détaillée sur ce point.
Deux analyses rétrospectives ont été réalisées pour l’agglomération en 2003 et 2005, et une autre pour la ville en 2006. Cette dernière analyse a révélé une persistance du niveau d’endettement, une baisse de la dette par habitant et une amélioration, assez spectaculaire, du ratio entre la dette et la charge financière : 5,4 % en 2002, 3,6 % en 2003 et 4 % en 2005.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous connaissons le contexte général et le cadre réglementaire. De quels éléments précis disposiez-vous pour prendre la décision de procéder aux paiements ? Quelles vérifications avez-vous faites ?
Outre la fonction de contrôle, vous avez aussi un rôle de conseil. En six ans, quels conseils avez-vous donnés à cette collectivité qui avait modifié la structure de sa dette ?
M. Yves Terrasse. Nous avons contrôlé, comme je l’ai indiqué, la régularité budgétaire, l’imputation des dépenses et la justification du service effectué. Quant à l’endettement, les vérifications portent sur le montant de l’annuité par rapport au tableau d’amortissement, et sur le fait que l’emprunt a fait l’objet d’une délibération validée par le contrôle de légalité. Le comptable n’a pas les moyens d’aller plus loin.
M. le rapporteur. Avez-vous procédé à certains paiements en l’absence d’éléments précis justifiant la dépense ?
M. Yves Terrasse. Toute dépense doit être justifiée par la production des documents correspondants.
M. le rapporteur. Ma question est plus précise. Pour les emprunts de longue durée à taux fixe, les contrôles sont faciles ; mais disposiez-vous, pour les produits dont nous parlons, de l’ensemble des documents nécessaires pour décider en toute connaissance de cause ?
M. Yves Terrasse. Non : la nature et les caractéristiques de l’emprunt ne sont pas forcément détaillées dans la délibération.
M. le rapporteur. En d’autres termes, certaines dépenses étaient validées de façon un peu aveugle…
M. Yves Terrasse. Non, dès lors qu’elles correspondaient au tableau d’amortissement.
Présidence de M. Claude Bartolone, Président
M. le président Claude Bartolone. Le fait que certains taux d’intérêt fussent inférieurs au cours de l’argent ne vous a-t-il jamais alerté ?
M. Yves Terrasse. Il aurait fallu, pour cela, que nous disposions des éléments de référence nécessaires. Le comptable n’était pas en mesure de faire cette vérification, et n’a d’ailleurs pas à la faire : il exécute la dépense telle qu’elle résulte des modalités de l’emprunt, après validation par le contrôle de légalité.
M. Dominique Baert. Votre administration centrale ne vous a-t-elle jamais demandé de vous intéresser à la nature des prêts souscrits par les collectivités locales ?
Les comptables du Trésor placés sous votre responsabilité avaient-ils copie des contrats de prêt souscrits par les collectivités, notamment celles qui, comme Saint-Étienne, figuraient dans le réseau d’alerte ?
Vos études financières, assez statiques, se bornent à comparer l’état des stocks d’une année sur l’autre ; elles ont ainsi conduit à constater une amélioration avec la baisse des charges financières – les agences de notation ont d’ailleurs les mêmes critères d’analyse. L’une de vos fonctions est néanmoins le conseil. Avez-vous eu l’occasion d’exercer vraiment cette fonction, non seulement pour les petites collectivités, mais aussi pour les grandes, où les sommes en jeu sont bien plus considérables ?
M. Patrice Calméjane. Vous avez rappelé le cadre réglementaire, que chacun ici connaît. Mais vous appartenez, comme trésorier-payeur général, à un réseau d’experts. L’actuel maire de Saint-Étienne nous a dit qu’il avait été alerté par l’un de ses homologues au sujet d’un produit financier suspect ; de plus, à l’époque, les banques avaient organisé des conférences et des colloques pour promouvoir ces produits. Je m’étonne que les experts que vous êtes n’aient pas eu d’échanges à ce sujet et, dans le cadre de leur mission de conseil, mis en garde certaines collectivités.
M. Henri Plagnol. Je serai plus dur encore que mes collègues : je suis profondément frustré par votre approche formaliste. Il est inconcevable, s’agissant d’une commune soumise à la procédure d’alerte, que nul ne se soit jamais intéressé à la nature de ces emprunts souscrits dans le cadre de restructurations considérables, et dont le moins que l’on puisse dire est qu’ils n’étaient pas courants jusqu’en 2003.
J’ajoute que les arrêtés du maire indiquent explicitement que ces emprunts sont gagés par le pouvoir de lever l’impôt. Une telle faillite des contrôles de l’État est stupéfiante.
Par ailleurs, avez-vous eu quelque écho de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) ?
M. Thierry Carcenac. Les receveurs sont-ils formés à l’analyse de ces produits financiers, ou leur formation se borne-t-elle au cadre réglementaire que vous nous avez décrit ?
M. Yves Terrasse. Jusqu’à la fin de 2005, notre réseau d’experts n’a pas reçu d’instructions de l’administration centrale sur ces nouveaux types d’emprunts : ces instructions sont venues en 2008. Nous ne pouvions donc nous appuyer que sur la circulaire de 1992, mais celle-ci ne concerne que les swaps.
Par ailleurs, les comptables ne reçoivent pas copie des offres de prêts et, une fois le contrat signé, elles ne constituent pas nécessairement une pièce justificative, même si la délibération peut en préciser certains éléments.
Nous n’avons pas exercé de rôle de conseil « à la demande » auprès de la collectivité de Saint-Étienne, qui ne nous a pas sollicités. Mais nous avons produit l’analyse financière de 2006, qui précisait que « la ville recourt à des instruments financiers, notamment des swaps de taux d’intérêt, qui lui ont permis de réaliser des économies substantielles. Le résultat financier s’est notablement amélioré en passant de - 19,9 millions d’euros en 2001 à - 9,2 millions d’euros en 2005 ; ces opérations, bien qu’elles soient globalement soldées par des plus-values jusqu’en 2005, présentent nécessairement un risque potentiel pour la commune dans la mesure où il est très difficile de prévoir l’évolution des taux à cinq ou dix ans. » Cette analyse financière a nécessairement été présentée à la collectivité – même si j’ignore dans quelles conditions, postérieurement à mon départ fin 2005, –, laquelle fut donc informée des risques liés aux swaps de taux d’intérêt.
L’organisation en réseau de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) permet effectivement, monsieur Calméjane, de mutualiser certaines informations issues de nos expériences respectives ; toutefois, jusqu’à la fin de 2005, nous n’avons pas eu d’échanges sur les innovations financières dans les budgets territoriaux, et n’avons pas été conviés aux colloques organisés par les banques, notamment Dexia.
Nous n’avons pas davantage été sollicités par la ville de Saint-Étienne, monsieur Plagnol : pour jouer un rôle de conseil, il nous aurait fallu pouvoir expertiser des documents nous indiquant, par exemple, les formules de rapport entre les taux courts et les taux longs. Si la banque affirme que les premiers ne doivent pas dépasser pas les seconds, et qu’il n’y a donc aucun risque d’activation des barrières, nous ne sommes pas en mesure de la contredire, sauf à faire valoir des arguments de bon sens.
La formation des comptables du Trésor sur ce type d’emprunts, Monsieur Carcenac, était inexistante à l’époque ; mais après la crise de 2008, qui a fait prendre conscience que ces derniers étaient massivement présents dans la dette de certaines collectivités, un effort important, qui avait débuté dès 2007, a été réalisé pour combler cette lacune. De même, l’administration centrale s’est dotée de nouveaux moyens d’expertise, grâce auxquels les comptables territoriaux peuvent lui transmettre des dossiers qui leur semblent complexes et risqués.
M. le rapporteur. Monsieur le préfet Morin, sur la base des circulaires du 15 septembre 1992, relative aux contrats de couverture du risque de taux d’intérêt offerts aux collectivités locales et aux établissements publics locaux, et du 4 avril 2003, relative aux régimes des délégations de compétences en matière d’emprunt, de trésorerie et d’instruments financiers, il vous appartenait de contrôler le contenu et le respect des délégations de l’organe délibérant.
Le rapport de 2010 de la chambre régionale des comptes vous a-t-il conduit à faire des vérifications approfondies ?
M. Michel Morin, préfet de la Loire (2002-2006). Depuis la décentralisation de 1982, le contrôle porte sur le budget tel que nous le présente la collectivité, la sincérité des écritures publique, les résultats de l’examen du compte administratif et la transcription des éléments concernés dans le budget, ainsi que l’inscription des dépenses obligatoires. Ce contrôle, d’un caractère essentiellement formel, se fait a minima dans la mesure où les collectivités, attachées au respect du principe constitutionnel de libre administration territoriale, n’accepteraient pas que nous allions plus loin ; j’en ai d’ailleurs fait l’expérience.
J’ai pris mes fonctions de préfet de la Loire en août 2002 et les ai quittées en mars 2006. Ce département connaissait, depuis trente ans, une série de fortes crises industrielles, et il était au début d’une nouvelle crise avec, notamment, la fermeture du site de Giat Industries à Saint-Chamond.
L’État, la ville, la métropole et le conseil général s’efforçaient de mettre en œuvre une stratégie de « redéveloppement ». Dans ce cadre mon travail consistait, pour l’essentiel, à aider les collectivités à obtenir des soutiens de l’État, de l’Agence de l’eau – puisque la plus importante opération financière concernait la station d’épuration de Porchon, avec plus de 80 millions d’euros de dépenses – et du Fonds européen de développement régional (FEDER), le préfet de région ayant accepté d’en réserver toute une part au seul département de la Loire.
Ma principale préoccupation était de savoir si la ville et la communauté d’agglomération étaient capables de supporter les lourds investissements engagés. Je rappelle néanmoins que la chambre régionale des comptes, dans son rapport, avait indiqué que ces dépenses, pour la ville de Saint-Étienne, restaient inférieures à la moyenne de la strate, même si elles demeuraient très lourdes au regard de sa situation financière, fort dégradée depuis les années quatre-vingt. J’ai donc attentivement suivi l’évolution du niveau d’endettement de la commune.
En tout état de cause, la préfecture avait toute ignorance de la structure de cet endettement, le principe de libre administration des collectivités territoriales étant d’autant plus en vogue entre 2002 et 2004 que s’ouvrait alors le deuxième acte de la décentralisation. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales, les contrats de prêt ne sont pas soumis à l’obligation de transmission aux représentants de l’État : la préfecture ne les avait donc pas en sa possession. Au reste, si elle les avait eus, elle aurait dû les transmettre aux services centraux ou assaillir la commune des questions car nul, au sein de mes services, n’avait reçu la formation nécessaire pour les analyser.
Enfin, nous n’avons pas été mis en garde contre ces produits alors que, comme le disait M. Terrasse, beaucoup de choses avaient changé depuis la circulaire de 1992. Pardon pour cet aveu un peu franc, mais Dexia, par exemple, m’apparaissait encore comme l’ancien Crédit local de France, en plus important : je n’imaginais pas que cette banque vendrait aux collectivités des produits aussi sophistiqués que ceux évoqués dans le rapport de la chambre régionale des comptes.
Les préfets, je le répète, n’ont jamais été mis en garde contre ces nouveaux types d’emprunt avant la circulaire de juin 2010. Je n’ai pas davantage été alerté par l’opposition municipale – alors que je le fus dans d’autres villes –, sans doute parce qu’elle n’était pas elle-même en mesure d’apprécier le danger. Notez bien qu’il s’agit d’un élément d’explication factuel : notre rôle n’est évidemment pas d’attendre des alertes.
M. le rapporteur. Jusqu’en 2006, si je vous ai bien compris, vous n’avez donc pas eu connaissance de produits financiers structurés dans l’endettement des collectivités.
M. Michel Morin. Personnellement, non ; et je n’ai pas davantage été mis en garde par mes services.
Entre 2002 et 2006, l’endettement de la commune n’augmentait pas et les charges financières allaient même diminuant, du moins jusqu’en 2005. Il n’y avait donc aucun signe d’alerte ; si nous en avions perçu, nous aurions sans doute examiné les choses de plus près.
M. le président. Je ne veux pas charger les banques avant d’entendre leurs représentants, mais les élus de la majorité comme de l’opposition avaient manifestement beaucoup de mal à comprendre les produits financiers qui leur étaient présentés. En l’absence d’alerte sur les provisions, comment ne pas se réjouir de taux attractifs ? En somme, on a laissé les trésoriers-payeurs généraux se débrouiller, passez-moi l’expression, avec des produits qu’ils ne connaissaient pas. Nous aurons à en reparler.
Vous avez, l’un comme l’autre, occupé des fonctions importantes et observé les effets des produits toxiques sur les finances locales. Avez-vous des conseils en ce domaine ? Quels sont les produits que vous jugez incontrôlables ? Comment les autorités de tutelle et les trésoriers-payeurs généraux pourraient-ils, selon vous, jouer leur rôle de conseil sans remettre en cause la décentralisation ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Lorsque M. Morin a été nommé préfet de la Loire, il a dû gérer d’autres urgences que l’endettement des collectivités : l’agglomération stéphanoise, ainsi que Roanne, étaient en pleine reconversion économique. Dans ces conditions, nous attendions du préfet qu’il fédère les collectivités et obtienne des ressources du FEDER ; nous sollicitions même de Paris des « sous-préfets développeurs ». Bref, les collectivités ont été un peu « pousse-au-crime » en participant à des modes de financement dont, au départ, elles ne percevaient pas les dangers. Il faut toujours rappeler ce contexte, car la Loire était un département sinistré ; il était d’ailleurs le seul, dans la région Rhône-Alpes, à voir sa population décroître.
Je sais, Monsieur le préfet, que vous ne pratiquez pas la langue de bois ; en tant que préfet de l’Isère, vous avez d’ailleurs dû vous occuper des difficultés de la ville de Grenoble. Que faire pour permettre à l’État d’exercer des contrôles intelligents, qui, tout en respectant le principe de libre administration des collectivités, ne se limitent pas à leur aspect formel ou administratif ?
M. Patrice Calméjane. Le principe de libre administration des collectivités est posé par l’article 72 de la Constitution ; son dernier alinéa dispose : « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État […] a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
En somme, monsieur le préfet, vous n’avez d’autre pouvoir que celui de contrôler le respect de la loi, et il en va globalement de même pour M. le trésorier-payeur général.
Notre pays a perdu la culture du contrôle, non seulement pour des actes administratifs tels que la délivrance des cartes d’identité, mais aussi pour la gestion globale des collectivités. J’attends donc des propositions de la part des deux hauts fonctionnaires que vous êtes, car les élus n’ont pas forcément la connaissance technique des produits qu’on leur présente, qu’il s’agisse de produits financiers ou, par exemple, de logiciels informatiques. Comment l’État, par sa vision globale et les possibilités d’échanges qu’offre internet, pourrait-il mieux accompagner les collectivités par ses conseils ?
M. Michel Morin. S’agissant du suivi de l’endettement des communes, la préfecture entretient de bonnes relations avec les maires. En revanche, pour ce qui concerne la nature même des produits financiers, le contrôle relève du niveau national et doit être assuré en temps réel, quitte à prévoir, pour ce faire, de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires. C’est là un enjeu majeur car, je le répète, ni la Direction des finances publiques, ni les préfectures n’ont à ce jour les compétences suffisantes pour accomplir cette mission. J’ajoute qu’un tel cadrage national doit se faire dans des termes lisibles : à la première lecture, certains passages de la circulaire de juin 2010 me sont restés obscurs.
Le second point essentiel est de former, de manière pointue, nos collaborateurs, voire les préfets eux-mêmes : nous devons être capables de comprendre, par exemple, les conditions précises de l’octroi d’une délégation aux élus. À défaut, nous devrions avoir la possibilité de faire appel à des sociétés de conseil.
M. Yves Terrasse. Je m’exprimerai à titre personnel. La charte Gissler dresse une liste de produits aberrants et à proscrire ; par exemple, ceux qui sont indexés sur le cours des matières premières, sur des indices propriétaires, sur des variations relatives entre devises ou sur des indices de places financières situées hors de la zone OCDE. Elle mentionne également des contrats incluant des phases de bonification d’intérêts supérieurs à 35 %. Pour les autres types de produits, l’analyse repose sur une double grille de quotation – indice et structure du produit.
Il faut néanmoins aller plus loin, car des produits dangereux peuvent échapper à certains de ces critères, en particulier ceux qui reposent sur des écarts de taux d’intérêt à court et à long terme, écarts dont on ne peut prévoir l’évolution. Je pense par exemple à des produits intégrant le rapport des taux à deux et à dix ans, assortis d’une formule de double négation telle que l’effet de retournement de l’indice entraîne une augmentation du taux d’intérêt, et ce à raison d’un coefficient multiplicateur de cinq ou dix : le taux d’emprunt devient alors extravagant.
Autre point abordé par la charte Gissler, sur lequel il n’a été statué que partiellement à ce jour : la présentation des différentes catégories d’emprunt dans les annexes budgétaires. Par ailleurs, les charges financières de ces emprunts doivent être plus lisibles et mieux anticipées, ce qui a évidemment des incidences budgétaires en termes de provisions. À tout le moins, il conviendrait de proscrire l’inclusion des intérêts dans le capital renégocié.
J’ai conscience que ces chantiers sont complexes, mais il est selon moi nécessaire de les poursuivre.
M. le président. Messieurs, je vous remercie pour ces témoignages et ces réflexions.
*
* *
Suite de la table ronde du 6 juillet 2011, ouverte à la presse, sur la gestion des emprunts toxiques : l’expérience de Saint-Maur-des-Fossés, avec la participation de M. Jacques Leroy, premier adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés, chargé des finances, de M. Jean-Marc Broux, directeur général des services de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, et de M. Vincent Billard, directeur financier de la ville de Saint-Maur-des-Fossés.
(Procès-verbal de la séance du mercredi 21 septembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous souhaitons la bienvenue à trois représentants de la ville de Saint-Maur-des-Fossés : M. Jacques Leroy, premier adjoint au maire, chargé des finances, M. Jean-Marc Broux, directeur général des services, et M. Vincent Billard, directeur financier.
Messieurs, cette Commission d’enquête aimerait comprendre comment, dans votre cas, on en est arrivé à la situation actuelle : quels mécanismes n’ont pas joué, ou ont empêché les élus de prendre la mesure de ce qui se passait ? D’autre part, que proposer pour éviter le renouvellement de semblables catastrophes – et pour éviter aux collectivités concernées d’avoir, soit à subir une mise sous tutelle, soit à augmenter fortement leurs impôts tout en renonçant à investir, voire en supprimant certains services publics ?
Avant que vous ne répondiez aux questions plus précises du rapporteur, je vous demanderai de prêter le serment exigé par l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
MM. Jacques Leroy, Jean-Marc Broux et Vincent Billard prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Nous voudrions d’abord en savoir un peu plus sur la situation de la commune de Saint-Maur. Quels sont les principaux types d’emprunts structurés souscrits par la ville ? Quel est le montant de l’endettement correspondant ? Quelle part jugez-vous toxique ? En effet, tous les produits structurés ne sont pas nocifs et certains ont même pu faire gagner beaucoup d’argent aux collectivités qui les ont souscrits. Le bilan doit donc être établi sur la durée. De surcroît, j’observe que des produits qui tournent au mal aujourd’hui peuvent redevenir avantageux, et qu’on ne parle de toxicité qu’en période défavorable. Cela étant, quelle proportion de ces emprunts est classée hors charte Gissler ?
M. Jacques Leroy, premier adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés, chargé des finances. Sous la municipalité précédente, jusqu’en 2008, les rapports entre majorité et opposition étaient des rapports de force. Nous avions constaté que l’endettement de la ville, de l’ordre de 100 millions d’euros en 2001, était passé à 240 millions d’euros. Lors des débats d’orientation budgétaire, il avait souvent été question de cette dérive, d’autant que nous ne constations aucun investissement majeur qui aurait pu justifier de tels emprunts, mais nous n’avions connaissance que d’un montant.
La nouvelle équipe, conduite par Henri Plagnol, a remporté les élections en mars 2008. Il lui est alors apparu qu’avaient été souscrits, pour 85 % du total environ, des emprunts structurés comprenant 45 % de produits toxiques, dont nous ne pouvions nous défaire. Nous avons pris la mesure du risque financier pour la ville : en début de mandat, certains emprunts ayant été contractés à 1 %, le taux moyen de la dette de Saint-Maur s’établissait à 2 % à un moment où l’argent coûtait 5 % mais, aujourd’hui, nous en sommes à 3 % et nous en serons demain à 4 %. Ayant pris l’engagement de contenir le montant de la dette, nous nous obligeons à ne pas emprunter plus que nous ne remboursons alors que la ville a des besoins d’investissement colossaux – centre sportif, mise aux normes des bâtiments communaux…– et, pourtant, nous sommes confrontés au risque de voir dériver nos frais financiers.
Voici quelques exemples. Certains prêts, souscrits sur la base d’un taux de 1 %, pourraient, en 2014, atteindre un taux de 22,5 %. Un autre, souscrit auprès de Depfa Bank, qui, au cours de la première phase, était également à 1 %, pourrait – en fonction de l’évolution du rapport entre euro et franc suisse – passer à 16,44 %. Un autre encore, souscrit chez Dexia à 0,97 %, pourrait aller jusqu’à 13,13 % et un dernier jusqu’à 14,87 %.
En début de mandat, la charge des frais financiers, avec un taux moyen de 2 %, se montait à 5 millions d’euros. Le simple doublement de ce taux entraînerait un coût supplémentaire de 5 millions. Si l’on considère qu’un point d’impôt à Saint-Maur représente environ 500 000 euros, c’est dix pour cent de plus. Vous le voyez, la charge fiscale est difficilement supportable, compte tenu notamment, et comme partout ailleurs, de l’accroissement des besoins.
Telle est la situation de la ville de Saint-Maur : le budget consolidé global, budget principal et budgets annexes – eau, assainissement et parcs de stationnement –, est de l’ordre de 250 millions d’euros. Nous devons supporter ce poids qu’il est difficile d’alléger puisque nous n’empruntons pas plus que nous remboursons.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous êtes confrontés au problème de l’augmentation du montant de la dette et, en outre, nous dites-vous, aucun investissement important n’a été effectué. Une partie de la dette paye-t-elle les frais de fonctionnement ?
M. Jacques Leroy. Ces emprunts ont permis de bénéficier d’une manne financière sans avoir à augmenter les impôts. C’était une véritable drogue. Depuis 2007, cependant, la ville était entrée dans le réseau d’alerte. En effet, l’autofinancement s’amenuisant, le ratio entre ce dernier et l’endettement faisait s’allumer un clignotant rouge – pour la capacité de désendettement, nous en étions à 27 ans alors que la norme est de 8 ou 9 ans. Mais cela, l’opposition municipale, à laquelle nous appartenions, ne le savait pas. Seul le maire était informé. Dans les courriers de l’époque, il n’est d’ailleurs jamais fait allusion à la dérive potentielle des frais financiers liés aux emprunts toxiques. Il a fallu attendre une lettre adressée à Henri Plagnol en 2010 pour que quelques remarques soient formulées à cet égard.
À l’occasion des débats d’orientation budgétaire, le conseil municipal avait obtenu, comme je l’ai dit, un certain nombre d’informations relatives aux montants des emprunts, mais aucune sur leur structure. Avec Henri Plagnol, nous avons donc constitué une sorte de think tank pour réfléchir à la façon dont nous pourrions améliorer la communication. Peut-être faudrait-il qu’il y ait un débat sur la dette. Celui-ci n’est pas obligatoire aujourd’hui. Lorsqu’on est dans l’opposition municipale, on ne connaît que le montant de la dette, on ne sait rien d’autre. Ainsi, l’opposition n’est pas informée lorsque la ville entre dans le réseau d’alerte. Il faudrait donc que tout soit mis sur la table pour que, dans une commune, majorité et opposition soient au même niveau d’information. À l’initiative du maire actuel, nous avons précisément fait voter, à Saint-Maur, une charte de bonne conduite qui nous oblige à ne pas emprunter plus qu’on ne rembourse, mais aussi à informer.
Lorsque nous étions membres de l’opposition, nous n’avions pas pu exercer notre contre-pouvoir faute d’information. Le premier adjoint ne cessait alors de répéter que l’argent était bon marché et que la municipalité avait raison d’emprunter. Il ne tenait pas compte de nos mises en garde lorsque nous faisions observer qu’à raison de 20 à 30 millions par an, cette politique finirait par arriver à une limite. Pourtant, mon prédécesseur était diplômé d’HEC, ce qui aurait dû lui permettre de comprendre qu’il ne suffisait pas que l’argent ne soit pas cher. Tel ne fut pas le cas.
M. le rapporteur. Puisqu’il n’y a pas eu d’investissements, ces sommes ont donc servi à payer des frais de fonctionnement ?
M. Jacques Leroy. Il n’y a pas eu, à Saint-Maur, d’investissements majeurs.
M. le président. À quoi donc a servi tout cet argent ?
M. Jacques Leroy. Il a été saupoudré : quelques travaux sur les trottoirs, d’autres sur des ronds-points.
M. le rapporteur. Même s’ils ne sont pas structurants, il s’agit bien d’investissements.
M. Jacques Leroy. Au cours de la même période, on constate un laisser-aller total en ce qui concerne les frais de fonctionnement, en particulier les frais de personnel – la chambre régionale des comptes a ainsi comptabilisé 150 000 heures supplémentaires par année. Les emprunts ont permis de ne plus se préoccuper du tout de l’autofinancement, qui détermine la capacité d’investissement. L’argent affluant, il n’était pas utile d’augmenter les impôts, peu importait si la DGF stagnait et si les charges de fonctionnement dérivaient. La capacité d’autofinancement fut même négative à certains moments.
M. Jean-Marc Broux, directeur général des services de la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Elle n’est positive que depuis 2009.
M. Jacques Leroy. Pour la rétablir, nous avons dû prendre des décisions politiquement difficiles. Nous avons ainsi augmenté un peu les impôts, mais surtout réduit de façon drastique le nombre des heures supplémentaires, avec les conséquences que vous imaginez sur le personnel, et verrouillé la dépense publique en remettant à plat l’ensemble des marchés. En alimentant la pompe à investissement de façon systématique et presque illimitée, nos prédécesseurs pouvaient s’exonérer d’une gestion de bon père de famille.
M. le rapporteur. Et maintenant que vous sortez la tête de l’eau, le poids des frais financiers vous tombe dessus !
Si les équipes politiques changent, ce n’est pas le cas des services. Comment fonctionnait auparavant le circuit de décision ? La ville disposait-elle de l’expertise nécessaire ? Les experts financiers conseillaient sans doute l’adjoint chargé des finances, qui expliquait au maire, qui, lui, signait les contrats. Comment, avec pratiquement les mêmes personnes, avez-vous organisé le circuit aujourd’hui ?
M. Jean-Marc Broux. Lorsque M. Plagnol m’a confié la direction générale des services en septembre 2008, je suis arrivé dans une ville où, pour 2 300 feuilles de paye, on ne comptait que 30 cadres A, y compris le conservateur du musée et le directeur du conservatoire. Saint-Maur était en déshérence totale en matière d’encadrement ! Certes, le quotidien et les fonctions régaliennes étaient assurés mais il n’y avait aucune procédure pour maîtriser l’investissement. L’application de la loi MOP, la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique, était impossible, de même que le suivi de l’investissement à long terme.
Il nous a fallu tout remettre sur les rails : recruter, former, définir des procédures…
Quel est le rôle d’un directeur général des services ? Il doit assurer le contrôle de légalité au quotidien. J’ai constaté que tel n’avait pas été le cas avant mon arrivée. Le contrôle était lointain et, surtout, il n’y avait pas de conseil alors que les collectivités paient des indemnités pour cela. Le laxisme était total, et je pèse mes mots ! Je précise, monsieur le président, que j’ai derrière moi quarante-trois ans de fonctions territoriales dont vingt-cinq de direction générale. Or c’était la première fois que je constatais un tel relâchement dans les relations entre l’État et une collectivité, même si celle-ci avait ses torts dans sa volonté de vivre seule. Lorsqu’on ne peut obtenir de financements croisés parce qu’on n’a pas monté les opérations dans le cadre de la loi MOP, on est forcément contraint d’aller chercher l’argent ailleurs. Cela explique peut-être en partie ce qui s’est passé à Saint-Maur.
Aujourd’hui, on se préoccupe des emprunts toxiques, c’est-à-dire qu’on soigne le malade. Mais les collectivités font encore l’objet d’incessantes sollicitations en matière financière. S’il n’y a plus ni conseil ni contrôle, je plains tous ceux qui seront amenés à occuper les mêmes fonctions que moi car un certain nombre de communes vont très vite se retrouver à l’abattoir.
M. le président. Revenons plus précisément sur un point : au moment de la passation de pouvoir, personne ne vous a rien dit de la structure de la dette ?
M. Jacques Leroy. Nous l’avons découverte à partir de mars 2008. Constatant que Saint-Maur était dans le réseau d’alerte, nous avons examiné les ratios et les contrats. Nous nous sommes débrouillés un peu seuls, avec l’aide du patron des services financiers qui, antérieurement, était relativement peu associé à la décision. Les élus rencontraient les banquiers qui leur expliquaient que l’argent étant bon marché, il ne fallait pas se priver d’emprunter. Nos prédécesseurs ont pris ce discours pour argent comptant, si j’ose dire, et ont souscrit systématiquement, dans le but aussi peut-être, sur fond de campagne électorale, de se faire réélire en procédant à des travaux d’embellissement de la ville. Dans la recherche des responsabilités, il ne faut pas oublier celles qui sont proprement politiques.
Les chiffres auxquels nous sommes parvenus après examen des contrats ont ensuite été confirmés par la chambre régionale des comptes, qui est intervenue sur demande du maire. Elle a souligné le risque exponentiel de certains scénarios, ce qui était conforme à nos conclusions. Dès notre arrivée, nous avions du reste, sur la base d’un appel d’offres, coopté le cabinet Deloitte qui a procédé à un audit des finances de la ville. Il a affiné l’analyse en confirmant lui aussi ce que nous pressentions.
Je l’ai dit, le service financier de Saint-Maur et les élus ont lu les contrats. Les décrypter n’est sans doute pas simple, mais on pouvait comprendre ce que cela recouvrait. Je considère que, dans cette affaire des produits toxiques, la responsabilité est double. Certes, les banquiers sont responsables d’avoir imaginé des produits beaucoup trop sophistiqués et manifestement risqués. Les élus ont néanmoins fait des choix. Lorsque j’ai découvert le fonctionnement de la deuxième phase avec ses formules mathématiques longues de trois lignes, j’ai immédiatement compris que les choses ne pourraient être stables à terme. J’ai pensé aussi que proposer de l’argent à 1 % à un moment où il coûtait 5 % cachait quelque chose. Je me suis alors penché sur le coût de sortie et de transformation et j’ai rencontré les banquiers. Il s’agissait de gens tout à fait charmants mais dont la fonction est technico-commerciale et qui, à ce titre, faisaient l’apologie du produit. Je n’ai jamais vu les vrais responsables, les spécialistes de l’ingénierie financière. L’interlocuteur de l’élu sur le terrain n’est pas un actuaire, il ne fait que vendre un produit.
Nos partenaires banquiers m’ont donc confirmé qu’en fonction des différents scénarios, les taux pouvaient effectivement décoller, mais ils ont rappelé qu’un élu avait signé. Ils m’ont également expliqué que si je voulais sortir du système, je devrais m’acquitter de pénalités allant jusqu’à 200 %... Ainsi, pour un prêt de 5 millions d’euros que j’avais étudié très précisément, l’indemnité de sortie était de 60 % ! Il m’en aurait donc coûté 8 millions et il m’aurait fallu emprunter à 5 % alors que le taux moyen de ma dette de l’époque était de 2 %. C’est une nasse dont les élus locaux, même en y mettant beaucoup de bonne volonté et de réflexion, ne peuvent pas sortir indemnes.
M. le rapporteur. Lorsqu’on a 240 millions de dettes pendant sept ans à 1 % et donc qu’on gagne quatre points sur cette somme, on récupère finalement beaucoup d’argent.
M. Jacques Leroy. La drogue est là !
M. le rapporteur. Certes, vous n’êtes pas satisfaits du choix des investissements qui ont été réalisés. Encore que, aujourd’hui, vous n’ayez plus à vous préoccuper des trottoirs… Mais en gagnant quatre points sur 240 millions pendant sept ans, on économise près de 70 millions. Cela explique que les communes aient eu recours à ces emprunts. Les administrés souhaitent de nouveaux équipements et elles trouvaient là le moyen de les réaliser. Quand on fait le bilan, il faut le faire complètement. Cet argent a été utilisé pour faire un certain nombre de choses. Certes, certains investissements sont non productifs mais d’autres peuvent l’être, tel l’aménagement d’une zone d’activité économique, qui va attirer des entreprises et générer de la taxe professionnelle.
M. Patrice Calméjane. Vous avez évoqué, monsieur Leroy, un contrôle de la chambre régionale des comptes. De quand datait le précédent ? J’aimerais comprendre la logique de fonctionnement de ces institutions. Sur Internet, trois clics suffisent pour avoir, sur dix ans et pour de nombreuses collectivités, l’ensemble des ratios et les principaux éléments financiers, mais on n’en fait pas grand-chose. C’est vrai pour les chambres régionales des comptes, pour les préfectures, pour les trésoreries générales.
Vous avez parlé de 2 300 feuilles de paye, monsieur Broux. Pour une commune de 73 000 habitants, cela pose un problème. Les ratios de personnel sont de 50 à 100 % supérieurs à la moyenne pour une collectivité de banlieue sans difficulté particulière. Certes, le travail du conseiller d’opposition n’est pas toujours simple, mais il peut disposer de ces données. Or personne – État, chambre régionale des comptes, préfecture, trésorerie, élus – n’a perçu la dérive. Par ailleurs, comment peut-on passer de 100 à 240 millions d’emprunts sans procéder à des investissements ? Cela doit permettre de refaire des kilomètres et des kilomètres de trottoirs… En tout cas, cela aurait dû alerter au regard du train de vie global de la commune. Or personne n’a rien dit. Vous avez parlé de drogue, monsieur Leroy. Mais l’emprunt structuré n’est que le résultat de la très mauvaise gestion de la ville. La situation est différente de celle de la ville de Saint-Étienne, qui connaissait de tout autres difficultés.
Législateur, je m’interroge sur les améliorations que nous pourrions apporter. Vous avez fait quelques suggestions mais, lorsqu’on est à 80 %, ou à 120 %, de la moyenne de la strate, il faut se poser des questions, quelle que soit la collectivité, sauf explication par des difficultés particulières de gestion. Je persiste donc à m’interroger : pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné ? Vous avez invoqué un défaut de relation avec les services de l’État…
M. Jean-Marc Broux. Le non-respect des procédures, aussi. Le recours systématique à des appels d’offres ouverts fait baisser de 40 % le coût de l’investissement…
M. le président. À Saint-Maur, le problème n’est pas seulement celui des produits toxiques. Il tient aussi à la mauvaise gestion de l’ancienne équipe municipale – recours multiples à l’emprunt, frais de fonctionnement. On comprend en vous écoutant, messieurs, comment on peut succomber à la tentation des produits toxiques. Comme l’a expliqué le rapporteur, dans le meilleur des cas, avec cette façon de procéder, on pouvait gagner un peu d’argent sur les intérêts de la dette et investir. Malheureusement, pour bon nombre de collectivités, ces économies de court terme n’ont servi qu’à payer du fonctionnement ou à éviter une augmentation d’impôts à la veille des élections.
Quoique les situations soient totalement différentes, ce que nous avons entendu des représentants de Saint-Étienne montre que, même avec un maire adjoint bénéficiant d’une bonne formation théorique, il existe bel et bien un rapport du fort au faible entre celui qui propose le produit bancaire et les différents échelons de responsabilité qui l’acceptent.
Comme nous pouvons le déduire des propos de ce même maire adjoint, on propose chaque année des options de plus en plus risquées aux collectivités pour leur permettre de maintenir ces taux d’intérêt bas. Moi-même, lorsque le service financier de la collectivité à la tête de laquelle j’ai été élu m’a dit quel était le montant de la dette et à quel taux elle était gérée, j’ai failli le féliciter tellement ce taux était bas !
M. Patrice Calméjane. Vous n’étiez pas dans l’opposition non plus !
M. le rapporteur. Facialement, cela pouvait paraître intéressant !
M. le président. Pour rassurer M. Calméjane, je dirai que toutes les oppositions, quelle qu’ait été leur couleur politique, se sont trouvées dans le bleu pour des raisons à peu près identiques. Ainsi, à Saint-Maur-des-Fossés, c’est l’envolée de la masse des emprunts qui a attiré votre attention, pas le contenu de chacun de ces emprunts parce qu’il est malheureusement possible de ne pas trop insister sur la technique au moment de la souscription. C’était d’ailleurs la raison de ma question, tout à l’heure, au représentant de la précédente municipalité de Saint-Étienne. J’ai en tête un exemple de contrat où le taux bonifié était à 1,42 % : lorsque j’ai vu les fixing, j’ai pu constater que ces contrats étaient perdants dès le lendemain de leur signature, mais cela n’apparaissait nulle part alors que, dans une entreprise privée, ce débours aurait déjà dû entrer dans des provisions pour pertes. Il est vrai que, lorsqu’on propose à des collectivités ayant une gestion à 5 % de leur encours de dette un produit miracle qui leur permet d’abaisser ce taux à 1,42 % pendant quatre ans, la tentation peut être forte…
M. Henri Plagnol. Je souscris totalement à tout ce que viennent de dire mes collègues. Ce qui est intéressant dans le cas de Saint-Maur, c’est qu’il n’y avait pas de raison objective à la dérive. Cette ville tranquille de la petite couronne ne se serait jamais trouvée dans une telle situation s’il n’y avait eu la rencontre entre une gestion administrative sérieusement défaillante et un produit extraordinairement séduisant. Cela a permis à l’équipe précédente de ne pas regarder la dérive en face. La ville a ainsi laissé filer, avec pour effet une augmentation pharaonique de la dette globale. Et, comme l’a dit Claude Bartolone, les services financiers ont plutôt géré de façon intelligente puisque les frais financiers, eux, n’ont pas augmenté. Jacques Leroy a parfaitement raison, on peut parler de drogue. C’est un cas exemplaire, car aucun des contrôles normaux n’a fonctionné, ni en interne ni en externe. Et les banques étaient tellement conscientes de la vulnérabilité de Saint-Maur qu’il y a eu un engrenage. En 2003, on a commencé par des produits structurés qui n’étaient pas les plus dangereux mais, dans la renégociation intervenue quelques semaines avant mon élection, sont apparus des produits extrêmement toxiques et un allongement de la durée des emprunts. Celle-ci a ainsi augmenté de plus d’un tiers pour 85 millions d’euros en janvier-février 2008, et nous avons donc maintenant des emprunts dont la durée moyenne est très supérieure à la normale. C’est tout un ensemble, mais il est évident que les banques ont une part de responsabilité.
M. Jean-Louis Gagnaire. Nous n’avons pas une vision globale de toutes les collectivités ou établissements publics qui ont été contaminés, mais leur point commun me semble être leur vulnérabilité, quelle qu’en soit la cause – le cas de Saint-Étienne est différent de celui de Saint-Maur et, ailleurs, il a pu y avoir des dépenses inconsidérées ; quant aux hôpitaux, ils devaient absolument emprunter pour réaliser les plans d’investissement. Cette vulnérabilité se vérifie-t-elle pour la totalité des 5 500 collectivités détentrices d’emprunts de Dexia ? Il sera difficile de le savoir mais il faudrait essayer de déterminer, non seulement à combien se monte la masse des emprunts toxiques, mais aussi s’il n’y a pas des caractéristiques propres aux collectivités concernées. Il me semble que toutes étaient en état de faiblesse – celles qui n’avaient aucun souci de financement n’ont d’ailleurs pas été contaminées puisqu’elles n’avaient pas besoin de faire appel à ces produits. Les banques sont donc complètement fautives dans la mesure où elles se sont comportées en prédateurs s’attaquant aux plus vulnérables.
M. le président. C’est le rapport de forces qui a mis les élus en position de faiblesse. Le rapporteur et moi-même avons prévu une table ronde qui nous permettra d’entendre les élus de petites collectivités. Nous avons créé une association à quelques-uns et je suis très surpris par le nombre croissant d’élus qui se manifestent maintenant. Au début, ceux qui s’exprimaient le plus étaient des représentants de collectivités où il y avait eu alternance, mais nous entendons maintenant de nombreux élus qui ne savaient pas ce qu’ils détenaient réellement comme produits et qui, en période de fixing, ont été alertés par le directeur général des services. Ils n’ont pas eu le choix lorsqu’ils ont négocié avec leur banque, nous disent-ils : ils ont été amenés à souscrire ce type d’emprunts sans savoir de quoi il retournait.
M. Jacques Leroy. Nous n’avons pas répondu à la question de M. Calméjane. S’agissant de la ville de Saint-Maur, le précédent contrôle de la chambre régionale des comptes remonte à quinze ans et il était subi, à la différence du contrôle que j’évoquais, qui a été demandé par le nouveau maire. Aucun clignotant rouge ne s’est donc allumé, tant du côté des services de l’État que de celui du contrôle financier.
Ceux qui ont réagi sont en effet principalement ceux qui, arrivant à la tête de leur collectivité à la faveur d’une alternance, ont souhaité procéder à un état des lieux, et il est probable que ceux qui ont conservé leur mandat après avoir souscrit des emprunts de ce type ne vont pas s’en vanter auprès de leur électorat. Pour autant, les dettes contractées ne sont pas secrètes et peut-être les services de Bercy pourraient-ils, à partir des éléments que leur font remonter les préfectures, réaliser un travail d’investigation pour mesurer la part toxique de ces emprunts. On nous parle en effet de 7 à 10 milliards, ce qui fait tout de même un écart de trois milliards. Or, nous avons tous besoin de cette information essentielle pour comprendre.
M. Gagnaire a qualifié les banques de prédateurs, mais il n’est pas sûr que toutes les communes ayant souscrit ces emprunts aient été en situation de faiblesse. La responsabilité des banques est évidente, mais sont-elles les seules fautives ? Les élus doivent-ils être tous blanchis ? Il faut peut-être aussi envisager la responsabilité de ceux qui ont signé parce que ce n’était pas cher. C’est une chaîne, comme celle qui a conduit à la crise des subprimes : finalement, tout le monde est un peu responsable ! Il faudra en tenir compte dans les réformes à venir, mais celles-ci devraient concerner également l’État, les trésoriers-payeurs généraux, etc. si l’on ne souhaite pas que les banques puissent continuer à proposer aux collectivités territoriales des produits aussi spéculatifs.
M. le rapporteur. S’agissant du montant global des emprunts structurés, des évaluations sont en cours, mais la toxicité, elle, se mesure à un instant T et il peut se produire des retournements. Le principal produit toxique est aujourd’hui l’« euro-dollar-franc suisse », mais imaginez que la conjoncture change, nous aurons peut-être une attitude complètement différente ! Aujourd’hui, pratiquement tout le monde a ce type de produits. Replacez-vous dans le contexte où ces emprunts ont été contractés : les banques n’arrivaient pas à fournir faute de liquidités. Mais les choses peuvent changer. Déjà, la Suisse a « capé » parce qu’elle a bien vu que ce différentiel de taux lui était désavantageux. Il y a là un frein qui rassure.
Il faut faire la différence entre le stock d’emprunts structurés et le montant de ceux qui sont toxiques. Si la toxicité est durable, c’est inquiétant et il va donc falloir trouver des solutions. Pour ce qui me concerne, mon taux moyen va passer de 2,8 % à 3,2 ou 3,4 %, ce qui se traduira par un manque à gagner, mais limité. En revanche, d’autres ne pourront pas s’en sortir parce que la proportion du structuré et, surtout, de sa part toxique dans leur dette est trop importante. Il ne faut donc pas tout mettre dans le même panier. Tout n’est pas mauvais. Certains emprunts structurés sont intéressants – et, je le répète, des retournements de conjoncture sont possibles.
M. le président. Monsieur Leroy, j’entends votre argument selon lequel tout le monde est responsable, mais ce qu’il faut mesurer, c’est la part de responsabilité respective des uns et des autres. J’ai plutôt été ému par le témoignage de l’ancien adjoint au maire de Saint-Étienne en charge des finances et par les efforts qu’il a faits pour essayer de comprendre ce qu’on lui proposait de signer. En l’espèce, c’est le rapport du fort au faible qui détermine le niveau de responsabilité.
Pour en revenir aux propos de notre rapporteur, le problème, c’est que certains indices sont trop éloignés de la vie des collectivités locales. Comment une commune ou un département ayant souscrit un emprunt indexé sur le rapport entre le cours de l’euro et celui du yen auraient-ils pu prévoir la catastrophe de Fukushima ? Au lendemain de celle-ci, le taux d’intérêt variait en fonction de la force avec laquelle la Banque centrale du Japon intervenait pour soutenir l’économie du pays ! C’est insupportable ! Il faut donc caper les emprunts et éviter des indices trop exotiques pour les collectivités locales.
M. Jacques Leroy. J’approuve M. Gorges : s’il nous manque de connaître le montant de la dette, nous souffrons aussi d’une absence de définition de la toxicité. Le rapport euro-franc suisse varie, mais où commence et où s’arrête la toxicité ? Selon les scénarios, un emprunt sera avantageux ou sera une bombe à retardement. Au début de notre mandat, le taux moyen de la dette était à 2 % alors que l’argent était à 5 %. Il faut donc définir la toxicité si l’on veut éviter de considérer que tout est toxique hormis le taux fixe ou le taux variable capé.
Sur les conseils de Vincent Billard, je veux aussi signaler à la Commission que, suite à l’article de Libération de ce matin, nous avons essayé de « pister » un emprunt Dexia : il est passé entre les mains de la BNP, puis de J.P. Morgan, de Goldman Sachs et de la Royal Bank of Scotland ! Il y a manifestement là une cuisine financière qui, comme le disait Claude Bartolone, dépasse totalement les capacités de gestionnaires de collectivités.
M. le président. Et qui génère des marges cachées sur lesquelles nous reviendrons !
M. Jacques Leroy. Les élus locaux n’ont pas le niveau nécessaire pour faire face à une telle financiarisation de leurs problèmes de financement et d’investissement. Ils ne peuvent lutter à armes égales avec des gens qui sont capables de titriser et de « se refiler » nos emprunts.
M. le président. Toutes ces créances sont en effet titrisées. À l’inverse des assurances, qui vous font payer une prime mais vous couvrent en cas de catastrophe, les banques vous donnent la prime mais vous laissent supporter une éventuelle catastrophe ! Or les sociétés anglo-saxonnes qui étudient le marché à moyen et long termes sont loin de se contenter d’un aveu d’incertitude : quand vous demandez à J.P. Morgan, par exemple, de faire des prévisions à vingt ans sur l’évolution de ces produits fondés sur les comparaisons de cours entre monnaies, elle compte un tiers de pertes. Le franc suisse est maintenu au cours de 1,20 pour un euro par la Banque centrale suisse, alors qu’il était tombé à 1,02 au mois d’août. Pour les collectivités dont le fixing tombait à cette période, cela signifiait des taux d’intérêt de près de 50 %. Elles ont décidé de se battre pour maintenir le ratio à 1,20, mais vous nous voyez, nous, à la tête de nos collectivités, évoquer l’éventualité d’une amélioration de la situation de l’euro, de la Grèce, du Portugal ou de l’Italie ? Les marchés anticipent déjà, pour le franc suisse, un cours inférieur à 1,20. Les grandes collectivités n’ont pas les moyens de faire ce travail : imaginez ce qu’il peut en être pour les petites ! Le jour où mon directeur général m’a dit qu’une société de cotation en ligne lui demandait des renseignements sur la gestion de nos options, j’ai cru à une histoire de fous ! Certaines entreprises recourent à des produits structurés parce qu’elles savent les gérer. EADS, Airbus ou Total ont ainsi une véritable salle de marché qui leur permet de gérer leur dette en temps réel. Ce sont des traders qui s’occupent de ces produits. Aucun de nos directeurs généraux ou de nos collaborateurs, aussi talentueux soit-il, n’en est capable. Il faudra donc bien un jour qu’ils reçoivent une formation dans ces matières si l’on veut y voir un peu plus clair.
M. le rapporteur. Il faut se limiter à du variable capé, mais nous aurons un problème de liquidités. Si j’ai souscrit un emprunt structuré, c’est que le banquier n’avait pas de produit stable.
M. le président. Je vous remercie. Au moment où nous parlons, nous ne mesurons toujours pas exactement le risque qu’il faut assumer. Comme l’a rappelé M. Leroy, l’enveloppe de ces produits, en tout état de cause formidable, pourrait varier entre 5 et 10 milliards. L’article de Libération de ce matin évaluait le surcoût pour 2009, mais songez à tout ce qui s’est passé depuis ! Nous ne pouvons donc être trop attentifs à ce dossier.
M. Henri Plagnol. J’ajoute qu’il est choquant que la presse soit en mesure de se procurer des données que le ministère des finances refuse de communiquer aux parlementaires que nous sommes.
M. le président. Dont acte.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Des prêts structurés dans les petites collectivités, pour quoi faire ? » avec la participation de Mme Anne AUFFRET, maire de Donges (Loire-Atlantique), de M. Bernard Chesneau, maire de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), de M. Christian Coigné, maire de Sassenage (Isère), de M. Christophe Faverjon, maire d’Unieux (Loire), de M. Jean Fernandez, maire de Saint-Cast-Le Guildo (Côtes-d'Armor), de M. Xavier Martin-Le Chevalier, maire de Trégastel (Côtes d’Armor) et de M. Philippe Verrier, Président de la Communauté de communes du Bocage d’Athis de l’Orne
(Procès-verbal de la séance du mercredi 5 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
La séance est ouverte à seize heures trente.
M. Claude Bartolone, Président. Après avoir examiné la situation de conseils généraux, de villes ou d’agglomérations d’une taille certaine, disposant d’une assise financière et de moyens de gestion élaborés, penchons-nous sur les emprunts structurés conclus par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de petite taille.
La première table ronde sera consacrée aux pratiques commerciales des banques et à la situation des personnes publiques qui ne sauraient mettre en œuvre une stratégie d’endettement pour gérer leur investissement. Les représentants de communes que nous entendrons sont ceux qui se sont rapprochés du rapporteur ou de moi-même pour faire part de leurs difficultés, ou qui ont fait l’objet d’observations de la part de la chambre régionale des comptes.
Mme Anne Auffret est maire de Donges (Loire-Atlantique), qui compte 6 500 habitants. M. Bernard Chesneau est maire de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique), qui en compte 7 498. M. Christian Coigné est maire de Sassenage (au sein de la communauté d’agglomération de Grenoble), qui en compte 10 634. M. Christophe Faverjon est maire d’Unieux (Loire), qui en compte 8 500. M. Jean Fernandez est maire de Saint-Cast-Le Guildo (Côtes-d’Armor), qui en compte 3 420 pendant l’année et beaucoup plus pendant l’été. M. Xavier Martin-Le Chevalier est maire de Trégastel (Côtes d’Armor), qui en compte 2 400 en basse saison. M. Philippe Verrier préside la communauté de communes du bocage d’Athis-de-l’Orne, qui regroupe seize communes de l’Orne et compte au total 78 551 habitants.
La commission d’enquête tentera d’éclairer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les autres acteurs publics locaux ont souscrit auprès d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement des emprunts et produits structurés. Elle a pour but non de mettre en cause la gestion des élus, mais de comprendre, à partir d’exemples, comment des collectivités sans grands moyens de gestion en sont arrivées là.
Au titre de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les personnes auditionnées par une commission d’enquête doivent prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.
Mme Anne Auffret, M. Bernard Chesneau, M. Christian Coigné, M. Christophe Faverjon, M. Jean Fernandez, M. Xavier Martin-Le Chevalier et M. Philippe Verrier prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. À quel moment avez-vous souscrit ces emprunts, qui existent depuis près d’une vingtaine d’années ? Comment en avez-vous connu l’existence – nous nous interrogeons aussi sur les pratiques commerciales – ? Et quels étaient les établissements prêteurs ?
Comme les grandes collectivités, auxquelles ces produits ont permis de régler des problèmes de liquidité, les petites collectivités ont-elles pu choisir entre des prêts à taux fixes, peut-être moins avantageux que les produits structurés, et, par exemple des taux variables « capés », c'est-à-dire assortis d’un mécanisme de plafonnement ? Et les produits structurés vous ont-ils permis de diminuer pendant un temps la charge d’intérêts ? À combien se monte le gain ainsi réalisé ou les investissements que ces prêts vous ont permis de financer, car il faut souhaiter que son montant n’ait pas été injecté dans des dépenses de fonctionnement ?
Mme Anne Auffret, maire de Donges (Loire-Atlantique). J’ai été élue en 2008, par conséquent après que ces emprunts ont été souscrits. Pour réaliser des travaux de voirie en 2007, la commune a consulté cinq établissements de crédit. Il lui a été proposé un prêt de 2 millions d’euros, avec une phase de mobilisation d’un an et une phase de consolidation de vingt ans. À l’époque, le marché était haussier. La Banque centrale européenne avait relevé son taux de refinancement à 4 %, après une première hausse intervenue le 8 mars 2007. Les taux fixes classiques étaient à 5,4 %, les taux courts à 4,5 %. Dans ce contexte, les prêts structurés permettaient d’obtenir des taux fixes bonifiés ou minorés, indexés sur option ou barrière. De leur propre initiative, les banques – le Crédit agricole via BFT et Dexia – ont proposé ces produits à nos prédécesseurs, qui les ont jugés intéressants. Sur le moment, la commune a économisé 42 000 euros d’intérêts, mais, lors la crise de l’été 2008, les taux sont montés de 4,5 % à 9,62 %.
M. le rapporteur. Le contrat prévoyait-il une période de garantie ?
Mme Anne Auffret. Non.
M. le rapporteur. De quel type de produits s’agissait-il ?
Mme Anne Auffret. De prêts structurés. Pour éviter l’application du contrat dont le taux était passé à 9,62 %, Dexia nous a proposé un réaménagement, le 17 juillet 2008. Sur le moment, nous avons dû nous décider très vite, et nous avons allongé la période de remboursement, ce qui n’était peut-être pas une bonne idée.
M. le président. Sur quels indices étaient fondés ces prêts ?
Mme Anne Auffret. Le taux fixe proposé par Dexia était de 4,5 %, si l’écart entre le CMS (Constant Maturity Swap) 30 ans et le CMS 1 an était supérieur à 0,20. Dans le cas inverse, le taux était de 6,99 % moins cinq fois l’écart.
M. le président. En somme, on vous a proposé un prêt traditionnel, avec un taux fixe à 5,4 %, en même temps que ce prêt, qui, sur le moment, vous a paru avantageux ?
Mme Anne Auffret. La municipalité a sollicité BFT dans le cadre d’un appel d’offre, mais Dexia l’a démarchée pour lui proposer un réaménagement.
M. le président. Il y a donc eu deux processus : une consultation et une offre de Dexia, dont les produits structurés vous ont paru alléchants.
M. Bernard Chesneau, maire de Thouaré-sur-Loire (Loire-Atlantique). Nous sommes aux affaires depuis mars 2008. C’est en juin 2006 que la municipalité a contracté un nouveau prêt, afin de renégocier sa dette. Dexia, qui était déjà partenaire de la commune quand j’étais dans l’opposition, a regroupé tous les prêts en un seul, d’un montant de 4 millions. Tant que la parité euro/franc suisse était supérieure à 1,44 – or, on nous assurait qu’il ne pouvait en être autrement, puisque c’était le cas depuis trente ans –, le taux fixe de 3,84 % s’appliquait. Sitôt que le rapport descendait au-dessous du seuil prévu, le taux progressait de manière exponentielle, alors même qu’on nous avait présenté le prêt comme sans risque.
Le différentiel entre le coût de l’argent en 2006 et le taux de 3,84 % était infime. En tout cas, il ne justifiait pas le risque auquel nous nous sommes exposés. D’ailleurs, ce bénéfice a été englouti par le seul surcoût acquitté en 2010. En 2011, où le remboursement du capital et des intérêts est de 400 000 euros, ce surcoût est de 290 000 euros. Le point de fiscalité représente pour nous 35 000 euros, ce qui donne idée de l’augmentation des impôts qui va peser sur nos contribuables.
Le montage financier est d’une extrême complexité et, malgré le respect que j’ai pour les élus et les salariés de nos communes, il dépasse largement leur compétence, ce qui explique que les petites communes aient été incapables d’évaluer de tels produits.
M. le président. Les établissements bancaires qui vous les ont proposés les ont-ils mis en concurrence avec d’autres produits ?
M. Bernard Chesneau. Je n’étais pas maire à l’époque. La commune avait besoin de dégager des marges. Quand Dexia, qui était son partenaire de longue date, a renégocié les prêts pour améliorer la capacité d’autofinancement, le montant des remboursements a diminué et la durée du prêt s’est allongée. Nous avons reçu cette proposition dans le cadre d’un partenariat. J’ignore si des solutions alternatives nous ont alors été proposées.
M. Christian Coigné, maire de Sassenage (Isère). En 2006, j’ai signé avec Dexia, qui était la banque historique de la commune, un contrat de partenariat, visant à encadrer plus précisément son intervention et ses prestations de conseil. Aux termes de la convention, ce partenariat « était destiné à favoriser l’investissement et le développement durable, dans un contexte de maîtrise des frais de fonctionnement et des prélèvements. » Cette clause impliquait de facto le recours à des produits sans risque, puisque nous indiquions notre désir de ne pas toucher à la seule variable d’ajustement disponible, à savoir la fiscalité. La convention mentionnait également une gestion active de la dette.
Pour mettre cette gestion en phase avec le contexte budgétaire communal, Dexia a réalisé une étude sur les grands équilibres financiers de la commune entre 2001, date de mon élection, et 2006. Afin qu’elle s’acquitte de sa mission de conseil de manière objective, nous lui avons remis toutes les informations financières relatives à la commune. Nous étions en confiance, notre démarche étant celle d’un partenaire et non d’un client classique. C’est dans le cadre de cette prestation d’assistance et de conseil que Dexia a proposé à la commune de restructurer sa dette, en regroupant ses six prêts en cours en deux prêts de 4,4 millions chacun, fondés le premier sur la moitié de la parité euro/franc suisse, le second sur l’évolution du CMS 30 ans.
Pourquoi ces deux prêts ont-ils reçu l’appellation de taux fixe, sinon pour nous induire en erreur ? Le document de présentation indique en effet qu’ils sont basés « sur une stratégie de taux fixe long terme très bas sécurisé ». Pour le premier, la parité retenue est 1,44 franc suisse pour un euro, qui, précise-t-on, « n’a jamais été atteinte, même lors des attentats du 11 septembre 2001 ». Selon le document de présentation, « la Banque nationale suisse conduit une politique durable de stabilité de change, et son objectif est de maintenir le taux de change à 1,55 franc suisse pour un euro. » Enfin, « cette valeur refuge n’est pas affectée par les fortes tensions liées aux menaces de l’Iran dans le domaine atomique. » Le second prêt est présenté comme « un profil de risque très sécurisé ».
La banque Dexia, principal partenaire de la commune, était le prêteur de référence des collectivités. Elle avait signé avec Sassenage une convention de partenariat et de conseil, et réalisé une étude consolidée des finances communales entre 2001 et 2006. Pour ces deux prêts, elle a utilisé l’appellation de « taux fixe », et présenté les opérations de restructuration de la dette comme « sans risque ». C’est ce qui a conduit la commune à souscrire ces deux prêts en 2006, partageant l’emprunt de 8 millions en deux prêts, conformément au montage proposé. Pendant les deux premières années, le gain a représenté 300 000 euros, mais, pour la seule année 2011, les intérêts supplémentaires sont de 500 000 euros, que nous ne savons pas comment financer.
M. le rapporteur. Vous nous transmettrez le document que vous nous avez lu, qui semble offrir des garanties contractuelles de stabilité, qui se sont révélées mensongères.
M. Christian Coigné. C’est le cas, ce qui justifie que nous nous dirigions vers une action judiciaire.
M. Christophe Faverjon, maire d’Unieux (Loire). En prenant mes fonctions en 2008, j’ai découvert l’existence d’emprunts toxiques qui n’avaient fait l’objet d’aucun débat en conseil municipal au cours de la mandature précédente, comme l’indique un rapport de la chambre régionale des comptes, saisie à la suite du vote négatif que nous avons émis sur les comptes administratifs de 2007.
La commune a contracté deux emprunts toxiques, l’un auprès de Dexia, l’autre de la Caisse d’épargne. Le premier, d’un montant de 4 millions, est indexé sur la valeur de l’euro par rapport au franc suisse. Il comporte une période de différé d’amortissement et de taux garanti de trois ans, la période structurée commençant cette année. La facture que nous avons reçue en septembre fixe le taux d’intérêt à 24,28 %, contre 3,68 % l’an dernier. Les intérêts supplémentaires s’élèvent à 802 000 euros. Pour y faire face, la commune devrait augmenter la fiscalité locale de 30 % ou supprimer les postes de vingt employés communaux en équivalent temps plein sur 115. Le deuxième emprunt, d’un montant de 2,3 millions, a été souscrit auprès de la Caisse d’épargne en 2007. Il est indexé sur la valeur du dollar par rapport au franc suisse. Nous sommes encore en taux fixe jusqu’en 2014, mais, compte tenu de l’évolution des cours, nous sommes très inquiets. Le contrat signé avec Dexia afin de renégocier l’emprunt antérieur qui serait arrivé à échéance en 2011, courra jusqu’en 2035. L’emprunt contracté auprès de la Caisse d’épargne pour financer les investissements de la période 2005-2007 court également pendant une période très longue.
Le bénéfice a été nul pour la commune, puisque la différence entre le taux des années bonifiées, qui était de 3,68 %, et 3,99 %, soit quelques milliers d’euros, a été engloutie en une seule fois par l’augmentation des intérêts en 2011. Dès 2008, Unieux a essayé de renégocier avec les deux établissements, en leur demandant de passer à un taux fixe. Déjà, nous pensions qu’une commune n’avait pas à contracter d’emprunt spéculatif et qu’elle devait sécuriser ses conditions de financement. Malheureusement, la négociation n’a pas abouti : Dexia nous a demandé de verser une indemnité de plus de 7 millions d’euros, s’ajoutant aux quatre millions de l’emprunt, pour passer à un taux fixe de plus de 5 %. De telles conditions ne sont acceptables ni moralement ni financièrement. Un contentieux est en cours. Cependant, nous continuons à discuter avec Dexia, cherchant à sortir de la situation par tous les moyens, pour sauvegarder l’intérêt de la ville et de ses habitants. Avec la Caisse d’épargne, nous avons engagé des négociations en 2008. La situation, qui avait avancé au début, est à présent bloquée. Nous envisageons une assignation, ayant reçu, là encore, des propositions inacceptables.
M. le rapporteur. Pourquoi avoir préféré ces emprunts structurés à un taux fixe, qui était à peine supérieur ?
M. Christophe Faverjon. À quelques mois des élections municipales, le différé d’amortissement permettait de réaliser des investissements d’importance sans grever le budget. Depuis lors, un ancien salarié de Dexia nous a révélé, sous couvert de l’anonymat, que la banque avait donné instruction de proposer aux collectivités de renégocier les emprunts, le but étant de rendre la clientèle captive au moyen d’un allongement des durées d’amortissement, tout en minimisant les risques et en insistant sur le bénéfice double de la période bonifiée et des marges de manœuvre que l’opération procurait. On sait ce qu’il en a été.
M. Jean Fernandez, maire de Saint-Cast-Le Guildo (Côtes-d’Armor). La situation est un peu différente à Saint-Cast. Treize prêts à taux fixe, six indexés sur l’Euribor et deux sur le taux annuel monétaire (TAM), ont été regroupés dans un prêt dit « TOFIX » de 3,5 millions, que je n’ai pas souscrit, mais dont j’assume les conséquences. Nous n’avons reçu aucune autre offre que celle de Dexia, qui, en 2010, nous a proposé de reprendre à des taux intéressants les quelques prêts à taux fixe que nous avions contractés. Une fois passés dans la machine à laver, ils en ressortaient avec un taux à 3,99 %, tant que le cours de l’euro ne tombait pas en dessous de 1,44 franc suisse. Mais, en 2011, sur ce prêt de 3,5 millions, nous avons dû verser 525 000 euros, dont 72 000 euros en capital, soit un taux de 15 %. Depuis 2007, la commune a versé en tout 1,1 million d’intérêts.
Pour comprendre comment on a pu souscrire un tel emprunt, il faut relire la proposition de Dexia :
« DUAL : un produit de la zone euro et de la zone suisse. Pourquoi utiliser la zone suisse ?
– Une économie suisse encadrée par la zone euro politiquement et économiquement stable.
– Une évolution de courbes de taux similaire sur le court terme et sur le long terme sur les deux zones, avec un différentiel permanent en faveur de la zone suisse de 1,5 %.
– Une banque centrale suisse qui pilote son inflation à 2 % et une parité euro/franc suisse à 1,50.
– Historiquement, le franc suisse constitue une valeur refuge.
– Depuis 2001, la valeur euro/franc suisse se révèle plus stable et moins volatile face aux événements internationaux (attentats de Londres et de Madrid). »
La présentation était d’autant plus séduisante que les taux étaient alors aux alentours de 5 %. Pendant deux ans, en remboursant notre emprunt à 3,99 %, nous avons été bénéficiaires, mais le taux s’est élevé l’an dernier à 8,21 %. Cette année, il atteint 15 %. Aucune solution alternative ne nous a été proposée. Quant au bénéfice que nous avons réalisé pendant deux ans en remboursant à 3,98 % au lieu de 5 %, il est pratiquement insignifiant.
Notre petite commune conseillée par Dexia ne disposait d’aucune structure permettant de réagir de manière efficace. Le montant de la dette n’a pas été modifié depuis 2006. Les propositions de la banque visaient à reconvertir tous les taux fixes en taux variables, en s’appuyant toujours sur une parité avec le franc suisse. En 2010, nous avons tenté à plusieurs reprises de négocier avec Dexia. Nous avons même proposé de rembourser le capital de 3,5 millions, mais, pour ce faire, il aurait fallu verser une pénalité de 4,7 millions ! Dexia nous a également proposé de regrouper les deux emprunts, soit un total de 8 millions, mais remplacer une dette de 3,5 millions par une dette de 8 millions à 3,5 % était impossible. Sans parler de malhonnêteté, l’opération a mis en route une machine infernale, qui a peut-être échappé à nos interlocuteurs. Je ne sais pas si les communes en difficulté se comptent en centaines ou en milliers, mais il est évident que leur nombre est élevé.
M. le président. « TOFIX » était le nom de l’emprunt qui vous était proposé ?
M. Jean Fernandez. Le nom exact était « TOFIX DUAL ».
M. le rapporteur. C’est limite !
M. le président. Beaucoup d’emprunts portaient un nom alléchant, quand leurs conditions ne l’étaient guère.
M. Xavier Martin-Le Chevalier, maire de Trégastel (Côtes d’Armor). Trégastel est une petite commune, qui regroupe 2 400 habitants en temps normal et environ 11 000 pendant l’été. En 2007, quand les prêts ont été renégociés, elle était surendettée. La dette, dont le service représente actuellement 7,5 % du budget principal, déduction faite des budgets annexes, s’élevait à près de 10 millions. Elle était étalée sur seize ans, et souscrite principalement auprès de Dexia. Le 28 février 2007, ses représentants ont proposé à mon prédécesseur, pour diminuer ces annuités trop fortes, de renégocier le stock de 8 millions, réparti entre cinq emprunts à 4,5 %, en souscrivant deux prêts structurés d’environ 4 millions chacun. Le premier, TOFIX euro/GBP CMS 10 ans, et le second, qui court sur vingt-deux ans, un TOFIX DUAL euro/franc suisse, dont une partie est en taux fixe et l’autre, malgré son nom, en taux variable. Alors même qu’il ne s’agit absolument pas d’un taux fixe, le mot apparaît huit fois dans un cas, neuf fois dans l’autre, sur les documents commerciaux. Le prêt qui nous pénalise le plus lourdement est le DUAL fondé sur une parité de 1,44 franc suisse pour un euro. À l’époque, les élus pensaient gagner 200 000 euros d’intérêt, en allongeant le prêt de seize à trente ans, pour un calcul à taux constant. Mais, alors qu’ils croyaient signer un rééchelonnement de la dette, Dexia – qui leur fournissait des documents rassurants et qui se présentait comme leur conseil – proposait en fait de refondre des prêts à taux fixe ou « capé » sur seize ans dans des emprunts structurés.
M. le rapporteur. La commune, qui connaissait des difficultés financières, avait besoin d’améliorer son ratio dette/autofinancement ?
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Oui. Nous avons amélioré l’autofinancement, et nous avons financé l’extension de l’école pour 1 million d’euros, dont les travaux étaient déjà engagés. Pour nous, un point d’impôt représente 17 000 euros. Cette année, nous avons payé 290 000 euros d’intérêts supplémentaires. Dans l’hypothèse la pire, si l’on arrive l’an prochain à un euro pour un franc suisse – nous n’en étions pas loin cet été –, le montant des intérêts se monterait à 750 000 euros. Je ne peux ni monter un budget compte tenu d’une telle somme ni annoncer aux Trégastellois que leurs impôts augmenteront de 45 %.
M. le rapporteur. En théorie, vous devriez provisionner sur la base d’un taux d’un euro pour 1,2 franc suisse, selon le plus mauvais scénario que nous ayons connu – pour l’instant !
M. Xavier Martin-Le Chevalier. En finance internationale, ce qui est valable au jour J ne l’est plus le lendemain ! Pour le premier prêt, nous avons déjà provisionné 300 000 euros pour 2011, mais, quand nous faisons le budget, nous ne connaissons pas encore le taux d’intérêt, que nous découvrons le 15 juin. Le taux du second prêt, fondé sur la livre sterling, ne sera connu qu’au 1er décembre. Comment faire un budget dans ces conditions ?
M. le rapporteur. En majorant l’estimation, par exemple en retenant un ratio à 1,2.
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Ce n’est possible que pour le premier taux. Nous provisionnons, bien entendu. Autant dire que nous ne pouvons rien faire pendant l’année. Cependant, si nous nous retrouvons en décembre avec des provisions trop importantes, la chambre régionale des comptes pourrait nous en demander la raison.
M. le rapporteur. Si vous ne le faites pas, vous faites un budget insincère.
M. Xavier Martin-Le Chevalier. C’est toute la difficulté.
M. le président. De quel personnel communal disposez-vous pour gérer votre budget ?
M. Xavier Martin-Le Chevalier. J’ai une seule personne, en plus de mon secrétaire général.
M. le président. À quelle catégorie appartient-elle ?
M. Xavier Martin-Le Chevalier. C’est un rédacteur, qui appartient au cadre B.
M. le président. Le rapporteur a raison : vous pouvez faire le calcul sur 1,2. Avez-vous consulté, pour les prochaines années, la projection du fixing concernant la parité euro/franc suisse ?
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Nous restons sur une tendance à 1,2. Pour le CMS GBP à dix ans, j’ignore son évolution, car je n’ai pas accès à Reuter.
M. Philippe Verrier, maire de la communauté de communes du bocage d’Athis-de-l’Orne. Je n’étais pas élu, il y a trois ans et demi, et je ne préside la communauté de communes que depuis six mois, le prêt de Dexia ayant eu raison de la bonne volonté de la présidente précédente, qui a démissionné en mars. Depuis cette date, j’ai pris l’affaire à bras-le-corps, et je tente de construire pour 2012 le premier budget que j’aie jamais fait.
Dexia n’a pas démarché les élus de la communauté de communes d’Athis-de-l’Orne. Ce sont eux qui lui ont demandé de leur faire une proposition. Un emprunt de 3,8 millions euros souscrit pour vingt-cinq ans à un taux de 4,85 % constituait plus de 50 % de la dette de la collectivité, qui était en réseau d’alerte. En 2007, il a été remplacé par un nouveau prêt – TOFIX DUAL – sur trente ans, à 3,39 % pendant les cinq premières et les cinq dernières années, le taux des vingt années intermédiaires variant en fonction de la parité euro/franc suisse. Ce taux actif prend effet au 1er avril 2012. Depuis mars, je suis tous les jours la parité des deux monnaies, qui est descendue à 1,026 au mois d’août, ce qui aurait généré pour nous des intérêts supplémentaires de 700 000 euros. Comment trouver une telle somme sur le budget d’une communauté de communes déjà endettée ?
Ma première démarche d’élu a été de rencontrer les dirigeants régionaux de Dexia, qui m’ont proposé de racheter le prêt de 3,4 millions en versant une pénalité de 6,08 millions. Il fallait être hardi pour nommer « proposition » une offre aussi peu acceptable ! Nous nous orientons actuellement vers une proposition de gel des taux sur une année, ce qui ne signifie pas qu’on gèlerait le taux d’intérêt à son niveau actuel de 3,39 %, mais qu’il passerait à 6,65 %, à condition d’allonger de deux ans un prêt qui court déjà sur trente ans.
M. Daniel Boisserie. Monsieur Coigné, vous étiez maire quand le prêt a été contracté. Étiez-vous assisté d’un directeur général des services et d’un trésorier, ou bien une délégation générale vous permettait-elle de prendre la décision directement ? Par ailleurs, Dexia s’est-elle servie de sa mission officielle de conseil pour inciter la commune à faire de mauvaises affaires ? L’affichage d’un taux fixe, sur lequel vous avez tous insisté, ne constitue-t-il pas une tromperie ? Enfin, comment le contrôle de légalité a-t-il pu accepter que vous contractiez un engagement vous interdisant de présenter un budget sincère, faute de pouvoir calculer le montant des remboursements ?
M. Serge Janquin. Confiance et tromperie sont au cœur du dossier. Le dialogue entre les parties semble avoir été faussé par un déséquilibre d’information et une maîtrise inégale des modèles économiques. Les élus avaient-ils compris que le Crédit local de France, établissement public qui, tout en ménageant son intérêt, se comportait envers les collectivités en bon père de famille, s’était transformé en Dexia, banque hybride, binationale, recherchant le profit dans les pires conditions pour les collectivités ? Celles-ci savaient-elles qu’elles s’adressaient non plus à un conseil mais à un prédateur ? Vos collaborateurs et vous-mêmes étiez-vous préparés à de telles négociations ? Avez-vous reçu des conseils ou recommandations de la part de l’État ? Faut-il davantage encadrer pour éviter que les collectivités, qui ont besoin de stabilité, soient assurées de recevoir un service de qualité ? En économie politique, la confiance compte plus que les calculs. Comment la rétablir entre les collectivités, qui auront encore besoin de financements, et leurs pourvoyeurs de ressources ?
M. Marc Francina. Aviez-vous signé des accords précisant que Dexia vous fournissait une activité de conseil ? Celle-ci faisait-elle l’objet d’un contrat spécifique, indépendant du contrat de prêt ? Quant au franc suisse, les élus de ma région, qui est frontalière, savent tous qu’il est passé de 0,13 euro en 1970 à 1,20 euro aujourd’hui. Et encore ! La Banque nationale suisse achète tous les jours de l’euro, ce qu’elle ne pourra pas faire pendant vingt ans. Peu importe que le taux de votre emprunt soit fixe, si l’évolution du franc suisse peut le faire varier. Le tableau sur la stabilité du franc suisse par rapport au yen ou au dollar, qu’on vous a présenté en 2005, ne retraçait sans doute pas son évolution sur dix ans, car il n’a jamais cessé d’augmenter pendant cette période.
M. Dominique Baert. Le fait que M. Coigné ait signé – comme l’a fait, à la même époque, le maire de ma commune – une convention de conseil en bonne et due forme change la donne sur le plan juridique. Dès lors que la banque s’engageait à « accompagner durablement la commune pour s’afficher dans un partenariat étroit », ne devait-elle pas expliciter les avantages et les inconvénients du dispositif qu’elle proposait ? D’autres élus, parmi vous, ont-ils signé une convention de conseil ?
La renégociation est un enjeu majeur, dont le cœur est l’indemnité de remboursement anticipé (IRA), d’autant plus élevée que le prêt est récent, qui se rajoute au stock de dette, rendant la situation intenable. Je propose d’interdire les IRA, en cas de renégociation des emprunts structurés. Le caractère exceptionnel des circonstances justifie une telle mesure, dont je conviens qu’elle remet en cause le droit des contrats antérieurs. Aucune renégociation n’est possible, si l’on ne modifie pas ce point.
Enfin, ne faut-il pas prendre dans la loi de finances, avant donc le rapport de la Commission, une disposition pour plafonner le taux maximal, par exemple le double des obligations d’État à dix ans, en cas de renégociation du taux d’intérêt ? Je comprends que, face à un taux de 15 ou 20 %, on croie limiter le risque en signant à 8 ou 10 %, mais le taux de renégociation des emprunts conclus à telle période sur des index structurés ne doit-il pas être bordé ?
Mme Valérie Fourneyron. Que les élus des petites communes se rassurent : la possibilité de nouer des relations de confiance avec les banques ne tient pas à l’importance des collaborateurs qui nous entourent ! Avez-vous pris des conseils juridiques avant d’engager des procédures contentieuses ? D’autres banques que Dexia ont-elles joué auprès de vous le double rôle de conseiller et de prêteur ? Sur quoi le contrôle de légalité a-t-il porté, lors de la souscription des emprunts ? S’exerce-t-il aujourd’hui, où l’on pourrait vous reprocher de présenter un budget insincère si vous ne provisionnez pas les sommes à payer ? Enfin, depuis que vous vous démenez pour tenter d’en sortir, les services de l’État vous ont-ils accompagnés ? Vont-ils vous imposer de payer ce qu’ils n’ont pas empêché ?
M. Jean-Louis Gagnaire. En matière de prêts, je salue le degré d’expertise des maires. Si la validation des acquis de l’expérience n’est pas un vain mot, ils ont devant eux un grand avenir professionnel dans ce domaine ! La banque Dexia s’est rendue coupable d’un abus de faiblesse en profitant des collectivités auprès desquelles elle était censée jouer le rôle de conseil. En tout cas, ce n’est pas à cause des collectivités qu’elle est en difficulté. Si elle disparaît, c’est donc manifestement à cause d’une mauvaise gestion. Faut-il interdire ou plafonner les indemnités de remboursement anticipé, en fonction de la part du nominal restant à rembourser ? Faut-il mettre en place une structure de défaisance ? Sous quelle forme ? Peut-on remonter les dettes pourries des collectivités et prévoir une garantie de l’État pour faire baisser les taux ? Pour parer aux urgences, de quel type de conseil avez-vous besoin ? Quel concours l’État peut-il vous apporter, puisqu’il est sûrement difficile de trouver à proximité de vos communes un expert ou un avocat apte à faire avancer votre cause ?
M. Patrice Calméjane. Pour la petite histoire, je rappelle que l’emprunt Pinay était à taux variable. Un banquier est un commerçant comme un autre, à ceci près qu’il fait le commerce de l’argent. Dès lors, sachant que l’inflation varie toujours sur une période, comment aurait-il promis des taux fixes sur trente ans, sans rattraper cet avantage d’une manière ou d’une autre ? J’ai déjà posé la question aux représentants de l’État, préfets ou trésoriers payeurs généraux, que nous avons reçus récemment. Quand on souscrit un prêt, il faut avant tout s’interroger sur l’intérêt de la banque.
L’argent emprunté a-t-il été investi ? Avez-vous identifié à long terme les besoins de financement réels de vos collectivités ? Les associations locales de maires vous ont-elles conseillés ? Avez-vous abordé le sujet avec d’autres maires ? Au cours des dernières années, vos communes ou communautés de communes ont-elles été contrôlées par la chambre régionale de comptes ? Celle-ci a-t-elle détecté la situation financière particulière de vos collectivités et vous a-t-elle alertés ?
M. le président. À les entendre, certains établissements bancaires n’ont proposé ces produits qu’à des collectivités qui avaient les moyens de les piloter. Votre témoignage montre ce qu’il en est. Avez-vous eu l’impression en relisant les contrats que la symétrie d’information, nécessaire à la confiance, était assurée ? Enfin, faut-il interdire les produits C3, C4 ou C5 de la charte Gissler ?
M. le rapporteur. La voie judiciaire dans laquelle vous vous engagez serait catastrophique si le premier perdait, car son cas fera jurisprudence. Dès lors que le même acteur était à la fois banquier et conseil, auquel des deux vous en prenez-vous ? Vous a-t-on fourni des informations tronquées, erronées ou mensongères, comme lorsqu’on nomme TOFIX un produit soumis à des variations ? Au reste, il arrive que la parité entre deux monnaies soit stable sur le long terme, si l’avantage constaté à une période se compense à un autre moment. J’insiste enfin sur un point : quand vous engagez en justice une procédure portant sur des montants précis, la loi vous oblige à les provisionner dans votre budget pour ne pas courir l’accusation de présenter un budget insincère.
M. Philippe Verrier. Pour l’instant, nous n’avons pas engagé de procédure contre Dexia, par crainte de couper le dialogue. Nous préférons négocier année par année, en espérant devoir le faire le moins longtemps possible. La communauté de communes était en réseau d’alerte, mais, quand le prêt à taux fixe de vingt-cinq ans a été remplacé par un prêt sur trente ans, dont vingt à un taux aléatoire, l’opération a passé sans difficulté de contrôle de légalité. En tant que néophyte, je considère que la loi devrait interdire aux collectivités de s’endetter à des taux autres que fixes.
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Si nous n’avons jamais signé de contrat de conseil, Dexia nous propose, depuis qu’il existe des produits structurés, des chartes de partenariat. Je ne les signerai pas tant que je n’aurai aucun retour sur la demande de restructuration des prêts que j’ai adressée il y a trois ans. Les seules propositions que j’ai reçues sont équivalentes. Classées 4E, elles se contentent de remplacer le DUAL franc suisse par son équivalent, FIXIA, en dollar.
M. le président. L’emprunt s’appelle FIXIA ?
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Oui ! Et les termes « taux fixe » apparaissent neuf fois sur le document : « taux fixe… taux fixe MS sur trente ans… Première phase de trois ans : taux fixe de 3,75 %... Deuxième phase de vingt-deux ans : taux fixe de 3,75 %… Arbitrage temporaire vers un taux fixe de 5,25 %… Troisième phase : taux fixe Euribor… Un produit du marché long terme à taux fixe, à des conditions de taux fixe décoté, et avec, en contrepartie, un passage temporaire sur un taux fixe à risque progressif. » Il s’agit en fait de taux variables.
M. le président. Vous nous laisserez le document que vous venez de lire.
M. Xavier Martin-Le Chevalier. Sur les conseils de notre avocat parisien, j’ai entamé une procédure pour défaut de conseil, mais surtout pour tromperie. Mon prédécesseur n’avait pas les moyens de connaître les risques qu’il prenait en souscrivant ce crédit.
À mon entrée en fonction, en 2008, j’ai alerté le TPG et le préfet sur les finances de la commune. Celle-ci étant surendettée, elle était en réseau d’alerte. La seule réponse des services de l’État a été que je ne pouvais pas prétendre à la dotation globale d’équipement (DGE). Samedi, le sous-préfet m’a demandé de lui transmettre le dossier. Il y a un an et demi, j’ai appris de manière indirecte que le TPG et le préfet avaient demandé à tous les trésoriers des Côtes-d’Armor la liste des communes ayant souscrit des emprunts toxiques, mais je n’ai eu aucun contact avec eux, et personne ne m’a proposé de l’aide.
La structure de défaisance peut être dans un second temps un outil intéressant, mais, dès lors que nous attaquons la banque pour tromperie, c’est l’annulation que nous demandons.
Depuis un mois, afin de provisionner les montants requis pour présenter un budget sincère, je supprime les emplois saisonniers pour l’année prochaine. Je ne renouvellerai pas la bibliothécaire. Je crains de ne pas pouvoir remplacer le policier municipal qui part en retraite, ce qui créera l’été prochain une situation sera très difficile. J’examine tous les dossiers article par article, dans le but de supprimer les dépenses qui ne sont pas incompressibles.
M. Jean Fernandez. Notre situation est un peu différente, puisque nous avons pu provisionner les 525 000 euros demandés cette année, mais, en l’absence d’aide de l’État, nous nageons seuls. La première audience de notre procès s’est tenue le 3 octobre au tribunal de grande instance de Nanterre ; la prochaine est fixée au 21 novembre. Le conseil municipal n’ayant pour l’heure pas d’autre choix que de prendre acte des prêts contractés, il me semble indispensable d’encadrer les responsables des collectivités. À cette fin, j’ai mis en place dans ma municipalité une commission des finances qui examine toutes les propositions. Pour ma part, je ne connais pas la méthode de calcul des intérêts à verser, dont le montant semble changer tous les jours. Je vous propose d’écouter la personne qui m’a aidé dans ce travail.
Mme Eliane Thierry, conseiller de la nouvelle équipe municipale pour la renégociation des emprunts toxiques. Actuellement à la retraite, je connais les systèmes de financement pour avoir travaillé dans une banque. C’est pourquoi, il y a deux ans, Jean Fernandez m’a demandé de l’aider dans ce dossier que nous avons décidé de porter devant les tribunaux. Pour éviter à la commune d’engager des frais importants en début de procédure, nous avons négocié un partage avec l’avocat en cas de succès.
Contrairement au Crédit agricole ou à d’autres établissements, Dexia n’est pas une banque de dépôt. Empruntant elle-même à taux variable, elle peut difficilement offrir des taux fixes. Si elle en a proposé, en période de baisse des taux, c’est en pensant se refinancer ensuite à taux plus bas. Quand elle n’a plus pu le faire, en 2007 et 2008, les prêts structurés sont arrivés car Dexia a envoyé des commerciaux dans les communes, notamment à Saint-Cast, pour transformer les prêts à taux fixe en prêts à taux variable. Ayant elle-même prêté à long terme et à taux fixe, elle était dans une situation infernale. Lors du changement de présidence, en 2008, elle n’avait devant elle que cinq jours de trésorerie. Soit elle avouait qu’elle n’avait plus de financement, soit elle manipulait les communes, particulièrement les plus faibles, pour les amener à substituer au taux fixe un taux variable.
Il y a effectivement eu tromperie, puisque l’appellation de taux fixe était appliquée à tort à des taux indexés sur des devises qui n’avaient aucun lien avec l’activité des communes. Quant à savoir s’il faut prévoir des taux fixes ou imposer un plafond, je considère, en tant qu’ancienne banquière, que tout établissement qui propose un taux à prêt variable devrait obliger le souscripteur à contracter une assurance – un complément d’assurance crédit public (CAP) – garantissant que, même si le taux monte, il ne dépassera pas un certain niveau.
M. le président. En vous écoutant, on comprend pourquoi nos amis belges considèrent que l’argent déposé dans la filiale belge a servi à financer les collectivités locales françaises. Vous avez rappelé l’époque où il ne restait en caisse que cinq jours de trésorerie. Pour comprendre ses difficultés actuelles, il suffit de convertir en nombre de jours de trésorerie les 517 milliards qui figurent à son bilan.
M. Christophe Faverjon. Quand nous établissons un budget primitif, avant mars, il nous est impossible d’anticiper une dépense dont le montant nous sera signifié en septembre. L’an dernier, à Unieux, nous avons dégagé en épargne nette 500 000 euros, quand il en aurait fallu 800 000 pour faire face au supplément d’intérêts ! Dès lors que le système de change flottant varie chaque jour en fonction des intervenants du marché, ce qui exclut les taux planchers et les valeurs plafonds, les collectivités sont incapables de déterminer les sommes à provisionner.
Avant tout, nous souhaitons négocier avec Dexia, ce qui n’a pas été possible depuis deux ans. La situation semble évoluer depuis quelques semaines. L’assignation serait pour nous une extrémité. Nous pourrions cependant la fonder sur trois motifs.
Le premier serait le défaut de conseil. À Unieux, il n’existe qu’un responsable des finances communales, compétent en matière de comptabilité, mais non de marchés financiers. La banque n’a pas joué son rôle en proposant un produit toxique à notre commune.
Par ailleurs, les contrats proposés par la Caisse d’épargne et par Dexia présentent un vice, au sens où ils ne contiennent ni le montant de la pénalité en cas de remboursement anticipé ni la formule qui permet de la calculer. Interrogée à ce sujet, la banque ne peut que nous fournir qu’un montant, qui varie selon les périodes. Il y a quelques mois, il se montait à plus de 7 millions pour un prêt de 4 millions. D’autre part, la formule de calcul du prêt TOFIX DUAL euro/franc suisse se prête à une lecture contradictoire. Il est dit que le calcul du taux d’intérêt résulte du taux de variation de l’euro par rapport au franc suisse, puis qu’il se fonde sur un coefficient multiplicateur, ce qui accroît l’amplitude des variations.
Le troisième élément pouvant justifier un recours tient au fait que le maire d’Unieux qui a signé le contrat n’avait pas la capacité juridique de le faire, le conseil municipal n’ayant à aucun moment délibéré sur le montant de l’emprunt. On relève à cet égard une triple faute : Dexia aurait dû s’assurer que le maire disposait de la capacité juridique de contracter l’emprunt, la commune d’Unieux aurait dû la lui donner, et le contrôle de légalité aurait dû vérifier que le maire avait été dûment habilité.
Nos collectivités sont face à une situation dramatique. Aucun d’entre nous ne décidera d’augmenter massivement la fiscalité locale ou de réduire des pans entiers du service public, si utiles en temps de crise. Parce que nous ne sortirons pas des discussions bilatérales avec les banques, l’État doit intervenir. La meilleure solution est de prévoir une structure de défaisance, pour aider les collectivités à se dessaisir des emprunts toxiques et à souscrire des emprunts à taux fixe dont la visibilité soit garantie. Que les banques qui ont proposé ces produits en assument le coût ! À court terme, c’est la meilleure solution. Pour l’avenir, il faut réglementer les crédits accessibles aux collectivités, en excluant les crédits spéculatifs. M. Calméjane l’a rappelé : la logique financière des banques privées étant de réaliser des profits, seul un pôle bancaire public peut offrir aux communes un crédit sélectif bon marché, qui permettra de répondre aux besoins des citoyens et de renforcer le rôle des services publics.
M. Christian Coigné. Nous avons signé en 2006 avec Dexia une convention officielle de partenariat pour « favoriser l’investissement et le développement durable dans un contexte de maîtrise des frais de fonctionnement et de prélèvement. » Je la cite : « Cette analyse et ce suivi s’effectueront chaque année à l’occasion de plusieurs rendez-vous. En début d’année, une réunion sera organisée avec la ville de Sassenage et Dexia afin de définir les objectifs que se fixe la ville de Sassenage pour la gestion de la dette. » Malgré cette convention, nous n’avons jamais été alertés sur les risques auxquels nous exposaient nos emprunts et n’avons jamais rencontré Dexia autrement qu’à notre initiative, alors même que Dexia local devait, aux termes du contrat, assurer « un suivi des marchés financiers, afin d’aider la ville de Sassenage à atteindre ses objectifs. ». Il y a donc eu défaut de conseil.
Le contrat que nous avons signé pour lisser la dette comprend une courbe précise accompagnée de ce commentaire : « La valeur de 1,44 franc suisse pour un euro n’a jamais été atteinte, même lors des attentats du 11 septembre 2001. La Banque nationale suisse conduit une politique durable de stabilité du change du franc suisse contre l’euro. Son objectif est le maintien du cours de change à 1,55 franc suisse pour un euro. La Suisse a comme premier partenaire commercial la zone euro. Son économie est donc fortement dépendante d’une parité de change favorable aux exportations. Le franc suisse est une valeur refuge. Les fortes tensions géopolitiques liées à l’Iran n’ont pas affecté le franc suisse ». La suite du document évoque la mise en place d’un taux fixe. Considérant qu’il y a tromperie dans les deux contrats, nous nous sommes entourés d’un expert juridique et d’un expert technique, pour envisager la possibilité d’un recours.
J’ai consulté le préfet pour savoir comment s’exercerait le contrôle de légalité, dès lors que, cette année, nous n’avions pas provisionné le surplus correspondant aux intérêts. Il m’a répondu que, le cas échéant, il ordonnerait un prélèvement d’office. On m’a conseillé de renégocier avec Dexia, et de remonter de l’échelon régional au niveau national, ce que je n’ai pas pu obtenir. La seule proposition que j’aie reçue visait à allonger l’emprunt de deux ans, en passant à un taux fixe de 8,2 %, après versement d’une indemnité de 9,8 millions.
Les contrats des banques doivent être plus lisibles, sincères et honnêtes, et leur contenu devrait être préalablement validé par l’Autorité des marchés financiers, peut-être avec l’aide de l’Association des maires de France, selon la procédure en vigueur pour l’information donnée aux particuliers par les sociétés cotées. Les banques doivent fournir des simulations extrêmes, notamment des tests de sensibilité, ce qu’elles ne font pas aujourd’hui. Enfin, il faut créer une instance de conseil en gestion de dette, composée de représentants détachés de la Caisse des dépôts et consignations, des anciennes missions d’expertise économique et financière du Trésor public et de fonctionnaires des autres fonctions publiques.
Aujourd’hui, la confiance est perdue. Pour nous financer, allons-nous nous tourner vers l’État, vers des conseils indépendants ou vers d’autres banques ? Pour l’instant, nous nous enfonçons, faute de pouvoir payer, et nous cherchons tous les moyens de nous en sortir. L’expertise dont nous devons faire preuve augmente sans cesse. Quand j’ai pris la mairie, en 2001, nous étions sous contrôle de la tutelle. J’en suis sorti en 2006, au prix de beaucoup d’efforts, et voilà que nous retombons dans les difficultés. Je gère une commune de 11 000 habitants avec quelques cadres. Tous étaient favorables, à l’époque, à la signature du contrat, et nul n’éprouvait le moindre doute. Le maire d’une commune voisine, qui présidait alors la Commission des finances à l’Assemblée nationale, a signé un contrat comparable tant pour sa commune que pour la communauté d’agglomération qu’il présidait. À qui pourrons-nous faire confiance, si une instance ne peut nous aider et interdire les dérives ? Les élus que nous sommes doivent, sans être techniciens, prendre des décisions importantes en termes de gestion. De ce fait, ils doivent pouvoir s’appuyer sur d’autres instances, notamment l’État. Je sais que les préfectures emploient des experts de la finance. Ceux-ci devraient pouvoir intervenir dans de tels dossiers, quitte à les bloquer, comme c’est le cas dans d’autres pays.
M. le président. En matière de compétence, les élus n’ont aucun complexe à avoir : lors de la dernière audition, un TPG nous a avoué qu’il n’avait reçu aucune formation pour ce type de produits.
M. Bernard Chesneau. Nous aussi, nous avons assigné la banque Dexia pour défaut de conseil – alors même que mon prédécesseur avait signé avec elle un contrat de conseil –, et pour non-validité du contrat, le maire de l’époque n’ayant pas autorité pour signer un contrat de plus de 1,5 million, qui, de ce fait, n’aurait pas dû passer le contrôle de légalité. Cela dit, nous aurions préféré négocier.
Il va de soi qu’une vieille dame aurait signé le même contrat que nous, la justice se serait portée à son secours. Quel que soit le niveau remarquable des employés de l’État à la préfecture de Loire atlantique, qui nous ont aidés, le premier avocat de Dexia a tout de même été l’État – notamment par la voix de M. Gissler, que j’ai eu plusieurs fois au téléphone – qui nous a toujours poussés à négocier. Mais, dans une discussion, il faut être deux. La commune de Thouaré était prête à faire un pas, sachant que l’opération ne pouvait être neutre, mais l’indemnité de remboursement constitue une barrière infranchissable. De plus, il faut que la personne avec qui l’on négocie ait la main sur les produits, ce qui n’était pas le cas avec Dexia. Dès lors, il ne sert à rien de discuter. Il faut passer à une autre échelle. Sans doute l’État pèsera-t-il plus que nous sur les banques. Le problème est l’absence non de compétence, mais de décideur. Puisque nos interlocuteurs de Dexia nous disent être soumis aux mêmes pressions que nous, négocier revient à reculer pour mieux sauter.
Comment présenter un budget sincère quand on annonce qu’on va geler un coupon pendant deux ans, sans pouvoir préjuger de ce qui se passera dans trois ou quatre ans ? Cela revient à repousser la charge sur les nouvelles générations et les futurs élus. Si nous acceptons de porter une part de la peine, il est impossible de l’assumer en totalité. Dans une négociation, il faut toujours proposer quelque chose. Dexia ne l’a jamais fait. La structure de défaisance paraît la seule solution, pourvu qu’on prévoie différentes strates de traitement. Je rappelle que, dans ma commune, un point de fiscalité représente 35 000 euros, contre 17 000 ailleurs. Si le préfet nous impose de payer, je lui donnerai les clés de la commune. L’État n’aura qu’à faire lui-même ce qu’il nous impose.
Mme Anne Auffret. La situation de notre commune est moins dramatique, mais je me garderai bien d’imiter la personne qui, en tombant du vingtième étage, répète à chaque niveau pour se rassurer : « Pour l’instant, tout va bien. » L’encours de notre dette est moins élevé. Nous avons été informés par la chambre régionale des comptes du fait les prêts structurés atteignaient environ 60 % de notre endettement. Nous avons réagi en signant un contrat de conseil avec Finance active, société spécialisée, reconnue pour l’assistance qu’elle apporte aux collectivités territoriales. Nous avons également missionné le cabinet Michel Klopfer, pour qu’il procède à une analyse rétrospective et prospective de nos finances.
M. le rapporteur. Comment se comportent les préfets quand vous entamez une procédure ? Avez-vous l’impression que celle-ci prend un caractère suspensif, qui vous dispense de provisionner les sommes, comme le prescrit la loi, ou déclenche-t-elle au contraire le mécanisme de provision ?
M. Christophe Faverjon. Je n’entretiens pas les mêmes rapports que mes collègues avec les représentants locaux de l’État. D’entrée, nous avons informé le préfet de notre décision de fixer l’été dernier, de manière unilatérale, un taux à 3,9 %, et d’assigner Dexia. Il a été à l’écoute, et s’est engagé à ne pas inscrire le supplément éventuel d’intérêts en dépense obligatoire, puisque nous avions engagé une procédure jetant un doute sur la légalité du contrat. Cette position compréhensive a été confirmée. Dans le budget primitif, nous avons voté sur une ligne spécifique le montant des intérêts calculés à 3,9 %, qui a passé le contrôle de légalité.
M. Christian Coigné. Dès lors que les préfets représentent l’État, ils devraient tous adopter la même position, ce qui permettrait de trouver des solutions. Le nôtre a refusé catégoriquement de discuter. Nous n’avons pas provisionné l’augmentation des intérêts en 2011 : nous ne savons pas comment payer.
M. le président. Madame Auffret, tant qu’une commune est dans la période de taux bonifiée, elle ne s’inquiète pas, mais nombre d’élus auront bientôt une mauvaise surprise.
M. Christian Coigné. La période de taux bonifiée commence pour nous le 15 décembre. Les experts de la préfecture nous ont dissuadés de regarder les taux tous les jours, en attendant cette date. Mais que ferons-nous alors, si nous ne pouvons pas payer ?
M. le président. Si vous consultez le fixing de Londres, vous connaîtrez déjà les projections pour décembre. Je le sais, pour être moi aussi concerné.
M. Jean Fernandez. Dans mon cas, le préfet n’est pas intervenu, alors même que nous connaissons depuis deux ans des taux majorés.
M. le président. Oui, mais vos moyens financiers vous permettent de payer… Je remercie chacun d’entre vous.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Le recours aux prêts structurés dans les hôpitaux » avec la participation de : M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital, M. André Bury, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier, M. Dominique Perrier, directeur du centre hospitalier de Decazeville, M. Philippe Collange, directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire), M. Pierre-Charles Pons, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Dijon et M. André-Gwenaël Pors, directeur général du centre hospitalier d’Ajaccio
(Procès-verbal de la séance du mercredi 5 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. Claude Bartolone, Président. Cette table ronde sera consacrée aux emprunts structurés souscrits par les établissements hospitaliers, sur lesquels la Cour des comptes a attiré l’attention dans son rapport public de 2009, consacré aux risques pris par les collectivités territoriales et les établissements publics en matière d’emprunts.
Nous accueillons donc M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital et directeur du CHU de Saint-Étienne ; M. André Bury, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier ; M. Dominique Perrier, directeur du centre hospitalier de Decazeville ; M. Philippe Collange, directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey ; M. Pierre-Charles Pons, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Dijon ; et M. André-Gwenael Pors, directeur général du centre hospitalier d’Ajaccio.
MM. Frédéric Boiron, André Bury, Dominique Perrier, Philippe Collange, Pierre-Charles Pons, André-Gwenael Pors prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. Je voudrais avant tout comprendre comment les hôpitaux ont été amenés à souscrire des emprunts structurés. Qui a décidé ? Le conseil de surveillance ou les autorités de tutelle ont-ils été consultés ? Qui a négocié avec les banques ? Avez-vous fait appel à des conseils ? Qu’est-ce que ce type d’emprunt a « rapporté » à la gestion des hôpitaux ? Voilà toutes ces questions que je me pose en tant que président, depuis dix ans, du conseil d’administration d’un hôpital.
M. le président. Pourriez-vous préciser le montant de vos emprunts structurés ? Et la proportion qu’ils représentent dans l’endettement total ?
M. Frédéric Boiron, président de l’Association des directeurs d’hôpital. Le CHU de Saint-Étienne a un encours de dette de 297 millions d’euros, pour un budget de fonctionnement de 470 millions. Aujourd'hui, 55 % de l’endettement est à taux sécurisé, et 45 % est constitué de produits dits toxiques, soit 150 millions d’euros environ. Pour en sortir, il faudrait verser pratiquement 160 millions d’euros, ce qui n’est pas à notre portée. Ces emprunts ont tous été souscrits en quelques années auprès d’un seul établissement, Dexia, qui a fortement incité le CHU à s’engager dans cette voie.
Pourquoi avoir agi ainsi ? Pour plusieurs raisons, la première étant d’abaisser les charges financières à court terme à un moment où l’établissement finançait sa reconstruction, en quasi-totalité par emprunt. Plusieurs entités anciennes, voire vétustes, ont été regroupées sur un seul site, pour répondre aux besoins de l’ensemble de la Loire en matière de santé publique. Au moyen de ces crédits devenus toxiques et très préoccupants, le CHU a pu aplanir ses charges immédiatement, pour un montant que nous estimons à 10 ou 11 millions sur la période de bonification des taux, qu’il faut rapporter à ce qu’il faudrait payer pour sécuriser ces produits, ou au dérapage potentiel qui nous menace. D’ores et déjà, notre taux d’intérêt moyen progresse.
Le souci de minimiser les charges s’est combiné avec celui d’élargir les possibilités d’investir. Nous, directeurs d’hôpital, devons d’abord et avant tout nous préoccuper de mettre des soins à disposition de la population. Nous ne sommes pas des traders, nous sommes des femmes et des hommes de service public. Peut-être avons-nous aussi le tort de faire confiance aux partenaires qui ont une coloration « publique », ou qui la revendiquent. Les hospitaliers y sont sensibles, car ils sont attachés à certaines valeurs. Sans qu’il s’agisse de faire le procès de quiconque, certains partenaires financiers ont entretenu l’ambiguïté vis-à-vis des hôpitaux, et même de certaines collectivités.
Qui fait le choix de l’endettement ? Depuis 2005, c’est le directeur. Auparavant, la décision était soumise à une délibération du conseil d’administration. Aujourd'hui, cette compétence appartient au chef d’établissement, mais après une strate de contrôles et de vérifications, notamment par le biais de la procédure budgétaire. Le plan global de financement pluriannuel – le PGFP – retrace les stratégies d’endettement. Après, il remonte aux autorités sanitaires et il est transmis au Trésor. Si, juridiquement, c’est le chef d’établissement qui décide, c’est avec les instances de pilotage. Ensuite, les documents sont soumis à approbation formelle ou au contrôle de légalité a posteriori.
Avec un mois de recul – depuis ma nomination en tant que directeur général à Saint-Étienne –, il m’apparaît que la relation avec les banques est déséquilibrée, et je le dis aussi au nom de l’Association des directeurs d’hôpital. Les établissements bancaires ont des capacités d’expertise et d’ingénierie financières que nous n’avons pas, ni n’aurons jamais individuellement. Nous avons d’ailleurs du mal à imaginer que la capacité d’un hôpital à offrir des soins à la population puisse dépendre des choix d’un trader, qui, dans une salle des marchés fort éloignée, joue des sommes d’argent pour optimiser son profit à court terme. Nous sommes là très loin de nos valeurs. Il est donc indispensable que les hôpitaux s’associent des compétences. L’un des élus présents tout à l’heure a cité Finance Active, qui intervient beaucoup dans les hôpitaux. Si elle doit continuer, il faudrait s’assurer durablement qu’aucun actionnaire futur ne puisse peser sur ses choix, de façon à garantir l’indépendance de son conseil, a fortiori si elle doit, telle une agence de notation, apprécier nos décisions financières. Avec mon collègue du CHU de Dijon, nous pensons à la possibilité, quand se mettent en place des communautés de territoire, d’introduire dans les structures communes une cellule d’expertise financière pour mutualiser cette compétence, ce qui ne doit pas empêcher de faire appel à des cabinets extérieurs.
Pourquoi ces emprunts ont-ils été choisis ? Sans vouloir, ni pouvoir, parler à la place de mes prédécesseurs, il m’apparaît que ces décisions ont été prises en faisant, peut-être parfois imprudemment, le pari d’un gain financier. Il était une époque où tout le monde, y compris les autorités publiques, nous encourageait à financer nos investissements par emprunt. Le plan Hôpital 2007 en est un exemple. Il répondait à un incontestable besoin de modernisation, mais il incitait les gestionnaires à rechercher les meilleures solutions possibles à l’aune de la rentabilité immédiate, auprès d’établissements financiers qui vantaient avec aplomb la sécurité de leurs produits. C’est dans ce contexte que les choix ont été faits.
Mais, aujourd'hui, ce qui prouve une réactivité assez forte, 100 % des emprunts souscrits par les hôpitaux sont classés 1A, ou quasiment, c'est-à-dire sans risque, et très majoritairement à taux fixe. Ainsi, 80 % du stock de dette sont sains.
M. André Bury, directeur du centre hospitalier de Saint-Dizier. Le centre hospitalier de Saint-Dizier a reconstruit l’hôpital – bâtiments et équipements – pour un montant total de 100 millions d’euros, toutes dépenses confondues. Pour financer pareil investissement, l’établissement s’est endetté à hauteur de 60 millions d’euros environ, entre fin décembre 2006 et mars 2007, avec une consolidation de ses emprunts au 30 juin 2008. Par la suite, nous avons encore souscrit deux emprunts à taux fixe, de respectivement 3 millions et 2,1 millions, si bien que le total des emprunts est de 64 757 000 euros, la différence avec le montant de l’opération correspondant à de l’autofinancement.
Sur l’encours de 64 millions, 61,4 % sont des emprunts classés 1A ou 1B, 24,7 % 3E et 13,9 % 6F, c'est-à-dire hors charte Gissler. Les deux emprunts classés 3E sont respectivement de 9 millions et de 7 millions. Le premier, de 9 millions a été souscrit auprès de Dexia, sur trente ans. Il comprend trois périodes : les deux premières années à un taux fixe très avantageux – 2,99 % – alors qu’un taux fixe sur trente ans aurait coûté autour de 4 % ; les quinze années suivantes, le taux est indexé sur les CMS – swaps de maturité constante – à 1 an et à 30 ans. Tant que le CMS 1 an reste inférieur au CMS 30 ans, nous bénéficions du taux de 2,99 %. C’est toujours le cas aujourd'hui mais, au moment de la crise des subprimes, il y a eu 111 jours de dépassement, ce qui aurait signifié pour nous, si nous avions été dans cette phase de l’emprunt, un taux de 5,63 %, et le surcoût annuel pour 365 jours de dépassement aurait été de 225 000 euros, ce qui représente un risque modéré. Pour les treize dernières années, ce sera de nouveau le taux fixe de 2,99 %. Le second prêt, classé 3E, était de 7 millions d’euros, sur quinze ans, et a été consenti par la Caisse d’épargne. Après deux ans à taux fixe – 3,09 % –, la rémunération est indexée sur le CMS 10 ans et 1 an. À ce jour, nous en sommes toujours à 3,09 %. À supposer que l’écart entre le CMS 10 ans et le CMS 2 ans atteigne 0,2 point, le taux serait de 7,5 %. Ainsi, sur la base du capital restant dû, soit environ 5,9 millions, le surcoût s’élèverait à 262 000 euros.
Enfin, l’emprunt classé 6F a été contracté auprès de la Caisse d’épargne. Il comporte deux périodes : la première à taux fixe – 3,05 % – sur quinze ans, c'est-à-dire jusqu’en 2023 ; la seconde à taux variable, en fonction de taux de change dollar/franc suisse. Si celui-ci tombe en dessous de 0,98 CHF, la formule, en retenant le cours le plus bas atteint le 10 août dernier, donnerait un taux de 20,17 %. Si l’on retient toutes les périodes où le taux de change a été inférieur à 0,98 depuis le 29 septembre 2010, date où le plancher a été crevé, le taux moyen sur la période eût été de 7,87 % au lieu de 3,05 %. Mais, pour l’instant, le taux est fixe jusqu’en 2023.
Nous avons panaché les différents types d’emprunt auprès de trois organismes bancaires pour limiter les risques sur une période donnée. Ainsi, jusqu’en 2023, nous ne sommes exposés que sur 24 % de l’encours. Ce n’est qu’ensuite que l’emprunt de 9 millions, classé 6F, portera un taux variable, étant entendu que le capital restant dû à ce moment ne sera plus que de 5,4 millions et que la dette actuelle aura diminué des deux tiers, ce qui se ressentira sur les intérêts. Aujourd'hui, nous payons 2 millions d’intérêts par an ; nous n’en serons plus, en 2023, qu’à 850 000 euros. Si nous devions alors acquitter un taux moyen de 7,9 %, le surcoût serait de l’ordre de 259 000 euros. Le panachage auquel nous avons procédé permet de lisser les risques.
Depuis ma prise de fonction en 2008, nous avons renégocié un prêt qui est passé de 3E à 1B. Renégocier actuellement l’emprunt toxique, indexé sur l’évolution du taux de change USD/CHF serait extrêmement difficile. Il faudra s’entourer des conseils avisés d’un analyste financier car, dans un établissement aussi petit que le nôtre, nous ne disposons pas en interne des ressources nécessaires. C’est pourquoi nous ne pouvons que souscrire à l’idée de mettre en place, au niveau régional ou autre, une cellule d’ingénierie partagée, d’autant que les services du Trésor n’étaient pas, à l’époque, très au fait des prêts structurés. Depuis, le personnel a été formé.
Pourquoi avoir eu recours à des emprunts structurés ? Comme le disait M. Boiron, nous étions dans une logique d’optimisation des frais financiers. Contracter un prêt à taux bonifié constituait un avantage à court terme.
La décision d’emprunter incombe, depuis 2005, au directeur qui en informe le directoire et le conseil de surveillance. La présentation du plan global de financement pluriannuel est l’occasion de préciser les montants, les taux et les durées, mais sans aller au-²delà. Il faut souligner l’asymétrie entre le prêteur et l’emprunteur qui ne dispose ni de la formation, ni de l’information nécessaire lors de la négociation ou de la renégociation. Le suivi des prêts structurés nécessite une veille quotidienne que nous ne sommes pas en mesure d’assurer. D’où la nécessité de mettre en place un dispositif de mutualisation des compétences pour pouvoir réagir rapidement.
Nous avons constitué des provisions au compte 158-4 « Autres provisions pour frais financiers », mais d’un montant modeste : 621 000 euros. Si tous les risques se réalisaient, elles ne suffiraient sans doute pas, ce qui nous amène au débat qui va nous occuper dans les années à venir, celui de la certification des comptes. Il va falloir s’entourer d’avis éclairés, que nous n’avons pas en interne.
M. Dominique Perrier, directeur du centre hospitalier de Decazeville. Les prêts structurés ont été souscrits par l’hôpital de Decazeville en 2007, dans le cadre d’une gestion active de la dette et le souci d’un retour à l’équilibre des comptes. Les deux prêts incriminés ont été renégociés en 2011.
Le premier, le plus préoccupant, est hors charte car il est indexé sur le taux de change euro/franc suisse. Au 31 décembre 2011, l’encours sera de 2,6 millions d’euros, soit 38 % de la dette de l’hôpital qui est de 6,9 millions. Le second, classé 3E selon la nomenclature Gissler, est indexé sur le CMS 30 ans et le CMS 2 ans.
Faute de solution, le premier emprunt devrait entraîner, à compter du 1er mars, un surcoût de 240 000 euros. Le second est assorti, jusqu’en 2013, d’un taux fixe de 4,47 % qui, pour l’instant, évolue bien. Nous envisageons cependant de le racheter, l’indemnité réclamée, de l’ordre de 300 000 euros, pouvant être financée. Cela nous ferait faire des économies en frais financiers parce qu’il nous est proposé un prêt de 3,60 %.
Ces prêts ont permis de réaliser, sur trois ans, des économies qui tournent autour de 85 000 euros, mais elles sont dérisoires eu égard au risque auquel nous expose l’indexation sur le cours de change euro/franc suisse.
Le processus de décision est le même qu’ailleurs. Dans un établissement de la taille de celui de Decazeville, il y a deux autres cadres de direction et le directeur s’occupe directement des questions financières. Nous n’avons pas fait appel à un conseil financier car nous considérions que la banque avait une mission de conseil. Je regrette qu’elle ne l’ait pas exercée entièrement et nous avons des documents qui présentent le produit sans décrire les risques assortis, et le vantent comme « bien fondé au niveau historique et porteur d’économies ».
Depuis, nous avons recours à un conseil financier, et pris l’attache d’un avocat pour étudier l’emprunt à taux indexé sur le cours du franc suisse. Nous avons aussi constitué dans le budget une provision pour risque de l’ordre de 350 000 euros.
La solution réside dans une mutualisation des compétences au niveau des communautés hospitalières de territoire, pour suppléer les banques dans leur rôle de conseil.
M. Philippe Collange, directeur du centre hospitalier spécialisé de Sevrey (Saône-et-Loire). L’hôpital de Sevrey est un établissement psychiatrique. Il a donc la particularité d’en être resté à un budget reposant sur la dotation globale de financement, c'est-à-dire qu’il n’a aucun moyen d’action sur ses recettes. La dotation annuelle qui nous est versée par l’Agence régionale de santé représente 90 % de nos ressources, et toute augmentation des taux d’intérêt déséquilibre immédiatement notre budget. L’Agence est notre seul recours.
L’encours de prêts est modeste – 6,6 millions – et comporte un emprunt de 2 550 000 euros, dit TOFIX DUAL dollar/franc suisse, qui a été proposé à mon prédécesseur en juin 2007. Il n’était pas destiné à construire un service nouveau – il aurait mieux valu car la situation serait sans doute moins problématique – mais à se substituer à un autre emprunt, OVERTEC celui-là. Il s’agissait d’une sorte d’opération de cavalerie. Le nouvel emprunt a eu le mérite d’offrir à court terme – comme toujours – une solution moins onéreuse et un allongement de la durée d’amortissement de quinze à vingt ans. L’hôpital est abrité dans des locaux qui ont quarante ans d’âge et, n’ayant que très peu investi, il dispose de ressources d’amortissement très faibles. Dès lors, réduire les annuités de remboursement avait l’avantage de donner un peu de marge.
Je n’étais pas là au moment des négociations, mais l’analyse des documents révèle une stratégie commerciale, s’apparentant à de la manipulation, puisqu’elle met en avant la sécurité pour mieux rassurer le client. Il s’agit tout au plus de lui donner le sentiment de devenir intelligent en invoquant des arguments de géopolitique qui le propulsent dans la sphère de la haute finance.
Avec Dexia, nous sommes dans une impasse totale. En mars 2009 – à l’époque, nous avions déjà recruté Finance Active –, nous avons eu un premier contact pour surveiller de très près le produit en question. À ma grande surprise, mes interlocuteurs ont convenu qu’il fallait le garder à l’œil et ils nous ont proposé, pour sécuriser les intérêts, de passer à un emprunt indexé sur le taux de change euro/franc suisse. Déjà, la conjoncture incitait à la méfiance. Et les deux dernières réunions que nous avons eues avec eux n’ont rien donné. Ils admettent eux-mêmes n’avoir que très peu à concéder même si nos demandes leur paraissent maintenant légitimes. Ils admettent que la situation n’est pas normale pour un acteur à vocation sociale, mais le constat n’y change rien. On nous propose de payer une soulte de 1,9 million d’euros alors que le capital restant dû est de 2,55 millions. C’est infaisable. En outre, on ne connaît pas le mode de calcul puisque, d’après le contrat, ce sont les établissements bancaires auxquels Dexia est lié qui en fixent le montant. C’est ainsi que l’indemnité est passée en quelques mois de 1,4 million à 1,9 million. La proposition alternative me paraît aussi sujette à caution : sécuriser deux ans avec, au lieu de 4,30 %, 6 % la première année et 8 et quelques la seconde ; et rallonger de deux ans la durée d’amortissement à l’EURIBOR 12 mois. Je suis réticent parce que je ne voudrais pas tomber dans un nouveau piège et enrichir Dexia, d’autant que notre nouveau conseil financier, Riskedge de Lyon, estime la commission de Dexia pour ce nouvel emprunt à 120 000 euros. En outre, allonger la durée de remboursement revient, en réduisant l’amortissement en capital, à prendre des risques plus longtemps sur des sommes plus importantes.
Ayant l’impression de ne pas être compris, j’ai fait une dernière demande : sortir définitivement de l’emprunt. Des représentants de Dexia au niveau national sont venus à Sevrey le 14 septembre. Ils nous ont proposé de geler le coupon 2011 au niveau de celui de 2010 et de signer une convention de sortie, c'est-à-dire une convention d’objectif et de moyens pour sortir de l’emprunt. Elle stipule que l’hôpital fixe le taux auquel il veut sortir et le traitement de la pénalité. Ensuite, Dexia s’engage à mettre tous les moyens en œuvre pendant la durée du contrat pour se conformer aux conditions de l’hôpital en fonction des conditions de marché. Nous ne signerons pas et nous leur avons envoyé ce matin une lettre les informant que les coupons resteront bloqués au taux de 5 et quelques pour cent. Sinon, nous irons en justice puisque nous n’avons pas d’autre moyen pour défendre nos intérêts.
L’hôpital de Sevrey est soumis à la même législation que les autres et le processus de décision est identique. Dès 2006, à cause de la dérive de l’emprunt OVERTEC, l’établissement était soumis à la procédure de budget administré, c'est-à-dire que le conseil d’administration avait refusé le budget qui était en déficit structurel de 1,8 million d’euros, et n’était bouclé que grâce à une enveloppe nationale du même montant. Dexia, qui disposait des comptes, savait dès le départ que la situation financière était totalement dégradée et que la décision qui a été prise n’était pas bonne.
Pour la suite, je suis d’accord avec une mutualisation à la fois des compétences et des moyens d’intervention, mais je penche surtout pour une interdiction claire, nette et précise de ce type d’emprunt, pour que la dette publique ne serve pas aux banques à spéculer.
M. Pierre-Charles Pons, directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Dijon. La question fondamentale, M. le rapporteur l’a posée : pourquoi les hôpitaux ont-ils fait appel à des emprunts structurés ?
Avant de répondre, il faut se souvenir du contexte. Le plan Hôpital 2007 était indispensable pour relancer, après quinze ans de stagnation, l’investissement hospitalier. Dans mon établissement, il y avait encore des chambres à trois lits avec les toilettes sur le palier. Le financement reposait d’abord sur l’emprunt, avec des aides de l’État à la contractualisation versées par l’intermédiaire des agences régionales pour compenser l’impact des frais financiers, et sur des subventions à travers le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés – FMESPP. Mais il s’est tari peu à peu. Ne restait plus que l’emprunt.
Nous avons été nombreux à avoir en même temps des besoins importants. Et comme il n’y a en France que trois entreprises qui savent construire un hôpital en entreprise générale – Bouygues, Eiffage et Vinci –, les prix ont monté. Quand nous avons ouvert les plis, les offres affichaient entre 20 % et 25 % de plus que les sommes prévues initialement. En réalité, il n’y avait souvent qu’une seule offre ayant manifestement fait l’objet d’une étude technique approfondie, l’autre pouvant être qualifiée « de formelle ». Localement, pour faire baisser un peu l’addition, nous avons négocié une avance qui a exigé un appel de fonds important. Et c’est à ce moment-là que le CHRU de Dijon a contracté deux emprunts hors charte Gissler, pour un montant total de 75 millions d’euros. Leur montage correspondait bien à notre besoin du moment.
Le CHRU de Dijon avait, sur la période 2004-2012, un programme d’investissement de 400 millions d’euros destiné à construire un hôpital neuf regroupant les services de court séjour sur un site unique. La maternité a été rénovée, un plateau technique de biologie installé, ainsi qu’une plate-forme hospitalière d’approvisionnement et une stérilisation qui répond aux besoins non seulement du CHU mais aussi de l’ensemble des cliniques de Dijon. Nous avons donc été logiquement séduits par la perspective d’un taux d’intérêt de 1 %, valable jusqu’à l’année prochaine, d’autant que le retour sur investissement pour une opération aussi lourde n’est pas attendu avant cinq ans. Grâce à ces deux emprunts, et à un troisième qui est référencé dans la charte Gissler, nous aurons économisé entre 2007 et 2011 plus de 9,6 millions d’euros.
La décision était dans la main de la direction même si elle s’est entourée de conseil.
Au moment où sont apparus ces nouveaux emprunts, nous n’avions probablement pas les compétences en interne, mais, aujourd'hui, à Dijon, nous les avons. Il y a trois ans, nous avons recruté quelqu’un qui gère activement notre dette et exerce une veille continue sur les marchés financiers pour rechercher en permanence l’occasion de se désengager. Le capital initial des deux emprunts hors charte représentait 20 % de l’encours actuel, et 4 % aujourd'hui parce qu’ils ont été « désensibilisés » à hauteur de 60 millions. Il reste donc 15 millions de produits à risque sur un encours de 372 millions d'euros.
Je suis bien conscient que le CHU a pu agir ainsi parce qu’il était engagé dans un programme d’investissement important et qu’il était vraisemblablement plus attractif que d’autres aux yeux des établissements bancaires. En quelques mots, j’insiste sur le fait que nous avons toujours joué la concurrence en sollicitant systématiquement plusieurs organismes bancaires. Dexia a rempli sa fonction de conseil, au moins depuis deux ou trois ans, en nous aidant à nous désengager. Nous n’avons pas toujours accepté ses offres parce que, parfois, le remède était pire que le mal. Mais nos relations sont restées correctes.
En ce qui me concerne, je crois vain de vouloir désigner des coupables. La responsabilité est collective, même si les banquiers sont sans doute plus responsables que les autres. Pas plus que nous, les pouvoirs publics n’ont vu venir le danger. Les services du Trésor n’avaient sans doute pas non plus les compétences pour apprécier ces nouveaux produits.
Pour l’avenir, je reste attaché à l’autonomie de nos établissements. C’est à ce niveau qu’il faut chercher des solutions, en fixant des seuils ou en prenant en compte la situation de chaque établissement. Des erreurs ont été commises, j’en revendique ma part, mais, ce qui est important pour un hôpital comme celui que je dirige, c’est de pouvoir utiliser toute la palette des instruments financiers – taux fixe ou variable, et même structuré sous certaines conditions. En 2009 et 2010, les CHU ont fait appel au marché obligataire qui constitue une solution pourvu que ce type d’emprunt ne représente qu’une faible part de l’endettement. La solution réside, à mon avis, dans la variété des sources de financement, et dans celle des prêteurs. Aujourd'hui, le CHU de Dijon est endetté vis-à-vis d’une banque à hauteur de 140 millions. Trois autres banques nous ont prêté entre 87 millions et 58 millions chacune, et d’autres banques se partagent 20 millions. Hors charte, il reste 15,4 millions, soit 4,1 % de la dette.
M. André-Gwenaël Pors, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, l’hôpital d’Ajaccio que je dirige depuis dix-huit mois est un cas particulier. Depuis une vingtaine d’années, il caresse le projet de construire un nouvel hôpital, mais il est confronté à des difficultés financières particulièrement sérieuses.
Le budget d’exploitation est de 100 millions d’euros et il présente un déficit structurel, difficile à résorber, de 10 millions, ce qui pèse sur le fonds de roulement. Au bilan de l’hôpital, on trouve une dette de 50 millions, dont 78 % d’emprunts structurés, et 25 millions de dettes institutionnelles, c'est-à-dire de charges patronales – IRCANTEC, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales… On peut donc parler d’un établissement surendetté, et même en cessation de paiement théorique depuis quatre ans, puisque, de toute façon, il n’a aucune capacité d’autofinancement. À partir de l’été, la trésorerie est nulle et nous devons recourir aux subventions de l’État–Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP). N’ayant aucun moyen d’investir, l’hôpital recherche des subventions d’investissement. Bref, la situation est bloquée, sur le plan financier, mais aussi social car la motivation serait plus grande avec la perspective d’une reconstruction que les Ajacciens réclament depuis une vingtaine d’années.
La dette bancaire atteint aujourd'hui 50 millions, après avoir explosé entre 2001 et 2006, passant de 20,6 millions à 64 millions ; et ce, en l’absence d’investissement notable. Ces montants recouvrent une multitude de petits prêts dont l’objectif était de satisfaire le besoin de trésorerie. Des consolidations ont eu lieu à partir de 2006-2007, avec l’aide de Dexia et de la Caisse d’épargne, si bien que les prêts structurés ont représenté jusqu’à 84 % de la dette.
M’étant vu fixer deux objectifs – le redressement financier et la reconstruction, qui peuvent paraître antinomiques compte tenu de la quasi-faillite de l’hôpital –, l’une de mes premières tâches en arrivant, après la fin de l’administration provisoire, a été de m’atteler à la dette. Évidemment, il y avait eu des enquêtes et des études : de la chambre régionale des comptes en 2007, en particulier, de Finance Active qui travaille avec l’hôpital depuis plusieurs années, et surtout un rapport demandé par l’Agence régionale de l’hospitalisation en juin 2008. Pendant l’administration provisoire, une demande de subvention a été faite pour couvrir le risque que recèle la dette, à hauteur de 1,6 million, et elle a été obtenue.
Pendant cette phase, aucune renégociation n’a eu lieu. Aussi m’y suis-je mis dès février d’autant que deux échéances importantes se profilaient, l’une en avril et l’autre en mai, concernant deux emprunts hors charte Gissler contractés auprès de Dexia. J’ai demandé au ministère la nomination pendant quatre mois d’une collègue spécialiste des questions financières et bancaires qui était en recherche d’affectation, et au cabinet Klopfer de faire le diagnostic de la situation. Une fois rassemblés ces éléments, nous avons entamé la négociation pendant un mois, de fin février à fin mars. Mais, l’échéance arrivant et devant l’impossibilité de négocier avec Dexia – dont les propositions étaient insatisfaisantes –, je l’ai assigné. L’effet a été immédiat : le ministère de la santé m’a demandé de surseoir car la Direction de l’hospitalisation envisageait une négociation globale, dans laquelle entraient deux emprunts du centre hospitalier d’Ajaccio. Deux nouveaux contrats m’ont été proposés par Dexia début septembre : deux emprunts initialement de 3F et 6F se sont transformés en 1E et 2E – moins risqués – et un report de quinze ans supplémentaires de façon à réduire les annuités. J’ai signé et me suis désisté de la procédure contentieuse.
Au mois de septembre, j’ai mené une négociation avec la Caisse d’épargne, qui s’est montrée plus réceptive, sur 7 millions d’euros. De 6F, l’emprunt est passé à 1A, c'est-à-dire un taux fixe avec une pénalité de 800 000 euros. Aujourd'hui, l’encours de la dette du centre hospitalier est de 50 millions d’euros, dont 78 % d’emprunts structurés. Un seul d’entre eux est hors Gissler. Il est souscrit auprès de la Caisse d’épargne, et sa période variable commence l’année prochaine. Il va donc falloir à nouveau négocier.
Faire ou ne pas faire de la gestion active de la dette dans un hôpital ? J’en suis à ma troisième négociation. Au début de 1990, j’étais directeur financier du CHRU de Lille. À l’époque, j’avais mis en place une coordination régionale entre vingt-trois hôpitaux pour gérer et restructurer la dette. En face de nous, il y avait le Crédit local de France. La discussion n’avait pas abouti et je n’avais pas osé aller jusqu’au contentieux. En revanche, nous avons fait une défaisance avec Indosuez, qui nous a permis de nous sortir de nos difficultés en souscrivant un emprunt global du tour de table duquel le Crédit local de France avait été exclu. Dans un gros établissement, comme un CHU, il est possible et même souhaitable de laisser au directeur la capacité d’optimiser la dette, sous réserve qu’il ait les compétences en interne ou qu’il soit assisté d’un cabinet suffisamment indépendant – et ce n’est pas toujours facile – pour le conseiller utilement. En revanche, un établissement de taille moyenne ou réduite n’en a pas les moyens. Il faut alors trouver un partenaire bancaire fiable, et se limiter à des produits classiques, avec une faible part de taux variable.
Quant à l’avenir, je suis persuadé, à la lumière de mes expériences, que la notion de défaisance peut être utile pour certains hôpitaux. À Ajaccio, il est impensable de conserver une dette risquée jusqu’en 2045, d’autant que, si tout va bien, un nouvel hôpital sera construit en 2017. Il n’est pas possible de conserver une structure de dette aussi désastreuse. Il faut trouver une solution qui pourrait être a priori la défaisance.
Dans les cas où, comme à Ajaccio, le bilan est complètement déséquilibré, il faut se tourner vers l’État pour obtenir une recapitalisation. Devant les syndicats, je présente l’hôpital d’Ajaccio comme la Grèce des hôpitaux. Je ne peux pas imaginer continuer ainsi sachant que je n’ai aucun moyen de le redresser. Si on retient la piste budgétaire, l’amélioration ne pourra être qu’extrêmement lente : de 10 millions de déficit, je dois passer cette année à 8 millions. Situé dans un bassin enclavé, avec des équipements mal dimensionnés, l’établissement nécessite une restructuration totale.
M. le président. En somme, vous tous avez été contraints de faire avec ce qui vous était proposé compte tenu de vos besoins d’investissement respectifs. Ne pensez-vous pas qu’il vaudrait mieux vous éviter, au moins dans une certaine mesure, de trop grandes tentations ? On peut envisager des produits capés. Dans la typologie Gissler, quels produits accepter ?
M. Frédéric Boiron. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment la taille des établissements. C’est elle qui donne un pouvoir de négociation auprès des prêteurs, et permet de disposer en interne des compétences à même d’apprécier les risques. Mais, vous avez raison, il faut se limiter à la liste Gissler. Un produit structuré peut être intéressant pour acheter un équipement si l’on ajuste les durées d’amortissement. Peut-être faudrait-il aller plus avant dans la stratégie d’endettement elle-même. Un produit structuré peut être avantageux à condition d’en limiter la durée, par exemple pour acheter des équipements biomédicaux, qui valent parfois plusieurs millions d’euros. De même, on pourrait fixer un plafond en proportion de la dette pour les produits de telle ou telle classe dans le référentiel Gissler. Cet indicateur pourrait être retenu dans le tableau de bord et faire l’objet de vérifications.
Il faudrait aussi que les établissements bancaires, qui sont des acteurs sociaux comme les autres, assument leur part de risque. Au fond, l’argent avec lequel nous remboursons les banques est le fruit de l’effort collectif – ce sont des cotisations sociales et des impôts – et, si les banques s’enrichissent, il serait normal qu’elles soient aussi mises à contribution quand le risque se concrétise. Dans les limites à fixer à l’avenir, il y a aussi les règles de partage du risque qui ne doit pas peser exclusivement sur la collectivité.
M. le rapporteur. Au cours de vos discussions avec les banquiers, avez-vous été avertis que le taux n’était pas stable ? Ou ces produits vous ont-ils été présentés comme des produits à taux fixe, comme ils l’ont été aux collectivités, alors que, en réalité, leurs modalités d’indexation les ont rendus toxiques ? Avez-vous eu conscience de l’enjeu ? Aujourd'hui, avez-vous été conduits à faire des provisions ? Si oui, selon quelles méthodes, puisque vous devez en principe présenter des comptes équilibrés ? Vous êtes-vous lancés dans des renégociations ou dans des procédures contentieuses ? Le combat pourrait ressembler à celui du pot de terre contre le pot de fer. Une collectivité a déjà perdu un référé et il faut faire attention à la jurisprudence.
M. Jean-Louis Gagnaire. J’ai longtemps été membre du conseil d’administration d’un CHU et je n’ai jamais entendu parler d’emprunts, sinon auprès de l’Agence régionale de l’hospitalisation. Comment est-ce possible ?
Vos interventions ont révélé des situations très différentes, selon que vous êtes, ou non, en capacité de renégocier. Le ministère intervient aussi puisqu’il a demandé à l’un d’entre vous de renoncer à un recours pour renégocier au niveau national. Cela signifie que les hôpitaux peuvent servir d’exemple à d’autres collectivités publiques, pour pouvoir peser collectivement face aux banques.
Enfin, vous vous êtes interrogés sur le partage du risque et l’enrichissement parfois indu de tel ou tel organisme financier. Quand une entreprise n’est pas solvable, et pour l’aider à passer le cap, il peut y avoir des abandons de créances. Mais, quand on a affaire à des collectivités publiques, un euro emprunté, c’est un euro remboursé. On touche là à la différence entre le public et le privé. Le premier rembourse toujours ses dettes alors que, dans le cas du second, le banquier peut avoir intérêt à ne récupérer que 20 % ou 30 % plutôt que de tout perdre. Nous sommes dans ce cas de figure. On voit bien que, compte tenu des indemnités réclamées, aucune collectivité, aucun établissement ne pourra rembourser en totalité.
Mes voisins et moi avons également remarqué que les indemnités réclamées n’ont proportionnellement rien à voir avec les sommes dont parlaient les différents maires tout à l’heure. On a l’impression que l’indemnité de compensation est calculée par la banque soit au « doigt mouillé », soit en fonction du rapport de force.
M. André-Gwenaël Pors. S’agissant des provisions, je vous ai répondu mais le cas d’Ajaccio est exceptionnel. L’État a accordé une dotation pour provision de 1,6 million pendant la période d’administration provisoire. Le calcul reposait sur un différentiel à cinq ans avec un taux fixe à 4,5 %.
Pour ce qui est d’honorer ses dettes, que la situation financière soit saine ou pas, le Trésor classe le remboursement des emprunts parmi les paiements les plus prioritaires.
M. Philippe Collange. En ce qui nous concerne, la Trésorerie demande de provisionner, sur toute la période restant à courir, c'est-à-dire jusqu’en 2026, le différentiel d’intérêt entre le taux de 4,30 % et le taux qui serait pratiqué au cours 1 USD = 0,90 CHF, par exemple, soit aujourd'hui une somme de 600 000 euros. Ce n’est pas faisable.
Pour vous éclairer sur la façon dont s’est déroulée la négociation, j’ai retrouvé des traces écrites. Dexia expose que le dollar est supérieur au franc suisse et que le cours ne descendra vraisemblablement jamais en deçà de l’unité. Lorsque mon prédécesseur a demandé des simulations à partir de différentes hypothèses, il lui a été répondu par écrit que ce n’était pas possible, les solutions étant infinies et tout étant affaire de sensibilité. Voilà les conseils que nous avons reçus. Et, bien sûr, était annexé au contrat un échéancier avec un taux fixe à 4,30 % pendant toute la durée de l’emprunt, mais aucun tableau présentant plusieurs hypothèses qui auraient pu donner une idée de la fourchette de taux selon les évolutions possibles de la parité. Malgré la jurisprudence et le référé, si, dans une huitaine de jours, Dexia n’accepte pas de plafonner le taux une bonne fois pour toutes à un peu plus de 5 % – nous voulons bien faire notre part du chemin –, nous n’aurons guère d’autre solution que de tenter un contentieux. Il y a bien une asymétrie dans le rapport de force. Aujourd'hui, Dexia n’a fait aucune proposition réaliste, compte tenu de notre situation.
M. le président. La question devra être posée à la lumière de l’évolution du statut de Dexia…
M. Pierre-Charles Pons. Vous nous avez interrogés sur les compétences du conseil d’administration, devenu conseil de surveillance. Avant 2005, il fallait une délibération du conseil d’administration pour autoriser le directeur à emprunter, pour un montant donné, lequel correspondait à un plan de financement d’opérations, lui aussi approuvé par le conseil. Depuis 2005, le chef d’établissement a simplement un devoir d’information envers son conseil. Il existe aujourd'hui un outil de pilotage obligatoire et extrêmement utile : le plan global de financement pluriannuel, présenté en même temps que l’état prévisionnel de recettes et de dépenses. Nous le mettons à jour régulièrement, indépendamment de l’obligation qui est faite de l’arrêter à un moment donné et de l’envoyer à l’Agence régionale. C’est pour nous un instrument vivant. Nous avons intégré dans notre PGFP ce que nous savons aujourd'hui sur l’encours de nos deux emprunts structurés. Nous mesurons ainsi notre capacité d’investissement en fonction de ces deux points faibles.
J’insiste également sur l’importance de la compétence technique. C’est grâce à la personne que nous avons recrutée que nous avons pu désensibiliser 80 % de notre encours à risque. Et il est tout à fait possible de partager cette expertise avec les autres établissements au sein d’un département ou d’une région.
M. Daniel Boisserie. En tant qu’ordonnateur de dépense publique, avez-vous le sentiment d’être des pilotes qui se sont trompés de route ? Vous sentez-vous, en conscience, responsables ?
M. Pierre-Charles Pons. En conscience, oui, mais coresponsable. Si on néglige le contexte, on ne peut pas apprécier le véritable niveau de responsabilité. Après tout, c’est notre métier de prendre des décisions risquées. Lorsqu’un CHU de taille modeste comme le nôtre décide d’acheter un robot chirurgical qui vaut 1,7 million d’euros, je prends un risque et je le sais. Mais cette décision s’inscrit dans le cadre d’une stratégie et dans un contexte particulier. À un moment donné, il était extrêmement difficile d’imaginer que les seuils inscrits dans les contrats de Dexia seraient franchis. Ils donnaient l’évolution des taux de change sur dix ans et ils restaient très en deçà. S’agissant de nos deux emprunts, les seuils seront atteints cette année.
M. le président. Vos interventions font, dans une certaine mesure, écho à celles des maires des petites communes. Dans une situation très tendue, vous avez reçu, comme eux, des propositions, dont vous avez eu le courage de reconnaître qu’elles étaient très difficiles à évaluer. Se pose alors la question fondamentale à laquelle je n’ai pas encore trouvé de réponse : quand et comment peut-on vous éviter d’être soumis à un risque excessif compte tenu de la responsabilité qui est la vôtre ? J’ignore quelle est la durée moyenne du mandat d’un maire – autour de neuf ans, me dit-on –, ou combien d’années en moyenne un directeur d’hôpital reste en poste, mais comment, à leur place, ne pas accepter, dans une passe difficile ou pour faire face à un besoin d’investissement massif, un engagement sur trente-cinq ans et sur une valeur que personne ne sait vraiment évaluer ? La tentation n’est-elle pas trop forte ?
M. le rapporteur. Il ne faut pas oublier le plan Hôpital 2007, qui a autorisé la dépense. Il vous a donné le feu vert pour lancer des projets. Je sais comment cela se passe, tout le monde est à l’affût d’un nouvel équipement. Et, dans ce contexte, on propose l’argent moins cher… Les deux effets se cumulent.
Mon hôpital a souscrit deux prêts de même nature que les vôtres parce que les banquiers n’avaient plus de liquidités pour proposer des taux fixes, ou même variables. Du moins est-ce ce qu’ils disaient. En tout cas, je ne parvenais pas à boucler le tour de table pour financer des équipements majeurs auxquels il aurait, sinon, fallu renoncer. Avez-vous rencontré un problème de liquidité, ou avez-vous été attiré par un taux particulièrement alléchant ?
M. Frédéric Boiron. Le risque est toujours présent quand on emprunte car, en dehors des hôpitaux psychiatriques qui reçoivent des dotations, nous n’avons pas d’autre moyen d’autofinancement que de générer des recettes d’activité. Les emprunts adossés à de l’immobilier s’amortissent en général sur vingt ans, voire trente. Nous essayons désormais de limiter les durées après une prise de conscience du risque. On peut donc imaginer des règles, des conseils, voire de fortes incitations à éviter les tentations qui, j’insiste, sont parfois présentées comme la seule possibilité, à l’exclusion de toute autre. Ce n’est pas toujours vrai et la taille de l’établissement peut offrir une parade. C’est pourquoi la coopération ou l’incitation à la coopération devrait permettre de résister à ce type de tentation.
M. Pierre-Charles Pons. Vous nous avez dit, monsieur le rapporteur, que nous avions reçu l’autorisation de dépenser et que, comme l’on nous avait proposé de l’argent pas cher, nous en avions profité. Le plan Hôpital 2007 a surtout permis de remettre à niveau l’offre de soins du secteur public en termes de plateau technique et d’hôtellerie. Un seul exemple : si la maternité du CHRU de Dijon a vu sa part d’activité passer de 2 200 à 3 000 accouchements en 4 ans, sur un potentiel local de 5 000 naissances, c’est d’abord parce qu’elle a été rénovée avec des chambres individuelles au moins équivalentes à celle de la clinique de la ville. Cette opération répondait à une vraie nécessité. Il fallait que le service public réagisse et cela sans aucune dépense démesurée.
Sans doute quelques investissements ont été disproportionnés au regard des besoins de santé de la population à desservir ; s’il y a eu des erreurs, elles sont dans ce registre.
Quant à l’argent pas cher, il a constitué une véritable opportunité. L’emprunt Dualis nous a procuré un financement à 1 % de 2007 à 2012, date à laquelle je réceptionnais la totalité de l’hôpital, et où l’activité fonctionnait à plein régime. Pour moi, c’était un pari, mais conscient. En ce qui concerne l’emprunt Dualis, il se décompose en trois phases : la troisième phase, de plus de quinze ans sur un total de quarante-cinq ans, correspondra à un taux fixe de 2,5 %, et elle interviendra à un moment où il faudra recommencer à investir lourdement.
M. le président. Nous vous remercions, messieurs, d’avoir participé à notre commission qui, je l’espère, devrait déboucher sur des propositions.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Le recours aux prêts structurés dans les organismes de logement social », avec la participation de M. Thierry Repentin, sénateur, président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) accompagné de M. Luc Legras, chargé de mission auprès du délégué général de l’Union sociale pour l’habitat, M. Denis Vilain, chef de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) accompagné de M. Frédéric Monfroy, expert comptable et financier de la MIILOS, MM. Hamid El Hassouni, président de l’OPAC de Dijon, Jean-Pierre Pirocca, Directeur Général, et Alain Germain, Directeur Général Adjoint et M. Jean-Paul Clément, directeur général de la SA de construction de la Ville de Lyon (SACVL), organisme gestionnaire des HLM
(Procès-verbal de la séance du mercredi 12 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Afin de clore un premier cycle d’auditions destiné à prendre connaissance de l’ampleur du recours aux emprunts structurés, et après les petites collectivités et les établissements hospitaliers, nous allons nous intéresser aujourd’hui à une troisième catégorie d’acteurs publics locaux : les organismes en charge du logement social. Les offices publics de l’habitat, entreprises sociales pour l’habitat, sociétés coopératives d’HLM et sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété représentent un secteur particulier à plusieurs titres : tout d’abord, car il disposent avec le Livret A de circuits particuliers de financement par le crédit ; ensuite, car ils obéissent aux règles de la comptabilité privée, notamment en terme de provisions pour risque.
Aussi je vous remercie d’accueillir :
– M. Thierry Repentin, sénateur, président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) accompagné de M. Luc Legras, chargé de mission auprès du délégué général de l’Union sociale pour l’habitat ; M. Denis Vilain, chef de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) ; M. Jean-Paul Clément, directeur général de la SA de construction de la Ville de Lyon (SACVL), organisme gestionnaire des HLM ; et trois représentants de l’OPAC de Dijon, à savoir M. Hamid El Hassouni, président, M. Jean-Pierre Pirocca, directeur général, et M. Alain Germain, directeur général adjoint.
La Mission interministérielle d'inspection du logement social a attiré l’attention dès 2006, dans son rapport public annuel, sur l’apparition des produits structurés dans l’encours de dette des organismes qu’elle a été amenée à contrôler. Elle a mis en garde sur les risques éventuels que ces emprunts pouvaient comporter pour des structures qui ne disposent pas de marges de manœuvres financières importantes. Aussi en préambule, je souhaiterai rendre hommage à l’organisme que vous dirigez, M. Vilain, car cette mise en garde montre que tous les contrôles de l’État n’ont pas failli dans leur mission de vigilance et d’alerte.
Avant de passer la parole à notre Rapporteur, je souhaiterais que chacun des organismes représentés puissent répondre à une question simple : pourquoi les organismes en charge du logement social, qui disposent de circuits d’endettement privilégiés, ont-ils pu avoir à recourir à des emprunts structurés ?
Les personnes auditionnées prêtent serment.
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. La SACVL est une société d’économie mixte composée d’un actionnaire majoritaire, la Ville de Lyon (75 % des parts) et d’actionnaires privés. Fin 2007, ses dirigeants souscrivent à des swaps auprès de Calyon. Quels étaient les objectifs de l’équipe dirigeante de la SACVL à l’époque ? Pourquoi souscrire ces swaps ?
Vous avez aujourd’hui renégocié ces contrats : comment se sont déroulées ces négociations ? Quel a été le montant total du surcoût qu’a dû supporter la SACVL ? Comment y avez-vous fait face ? Quelles en ont été les conséquences sur la gestion de la société et sur ses ressources, c’est-à-dire les loyers payés par ses locataires ?
M. Jean-Paul Clément, directeur général de la SA de construction de la Ville de Lyon (SACVL), organisme gestionnaire des HLM. Je suis arrivé seulement il y a deux ans, en octobre 2009, je ne peux donc dire que ce que je connais de cette affaire, qui est plus ancienne. Il est exact que la SACVL a contracté des swaps pour sécuriser sa dette, c’est ce qui a été jugé utile à l’époque.
M. le rapporteur. C’est une réponse bien réduite. Quel a été le coût du dispositif issu de la renégociation ? Quelles ont été les conséquences sur les loyers ?
M. Jean-Paul Clément. C’est par le Crédit Agricole (le CA CE) que nous avons pu obtenir un accord pour régler ce problème lié à la couverture par des swaps, mais une clause de confidentialité m’empêche de vous en communiquer les termes. L’accord a été sans conséquence sur les loyers. Il s’agissait de swaps dits toxiques appelés snow balls dans le jargon du métier, qui avaient comme particularité d’empêcher, en cas de hausse des taux, tout retour à meilleure fortune puisque les augmentations de taux d’intérêt restent acquises au créancier.
M. le président. C’est une difficulté que rencontre la Commission dans son travail : l’existence d’une clause de confidentialité nous est souvent opposée dans les cas où il y a eu renégociation. Je rappelle que les snow balls ont été interdits à la suite de la rédaction de la charte de bonne conduite ou charte « Gissler ». Dans le produit que vous décrivez, tout retour au taux de base était impossible.
M. le rapporteur. J’ai lu dans la presse que cette rupture vous avait coûté 25 à 30 millions d'euros votés par le conseil d’administration, et que cette charge supplémentaire avait nécessité la vente de quatre immeubles par la SACVL.
M. Jean-Paul Clément. La SACVL a dû céder 950 logements dont elle était propriétaire afin de régler les conséquences de ce sinistre financier, le 30 juin 2010, et de retrouver de la trésorerie pour faire fonctionner la société. Il en est résulté des pertes de loyers et un impôt sur les sociétés de 9 millions d’euros au titre des plus-values immobilières réalisées.
M. le rapporteur. La perte des logements sociaux et le surplus d’impôt représentent donc un coût assez lourd pour sortir de cette situation financière ; il ne s’agit pas d’une bonne opération.
M. le président. Je souhaiterais savoir si l’accord de sortie et ses conséquences financières ont été présentés au conseil d’administration de la SACVL.
M. le rapporteur. Quelles étaient les relations exactes entre la SACVL et son banquier ? Comment est-il possible que l’on n’ait pu différencier les produits toxiques des autres, alors que le financement du logement est normalement adossé à des ressources simples, comme celles des livrets d’épargne et de la caisse des dépôts ? Comment peut-on arriver à une solution aussi défavorable ?
M. Jean-Paul Clément. Le conseil d’administration a été informé. Nous n’avions pas d’autre solution, car il a fallu payer la contrepartie dans le cadre de la transaction. Il y a eu une négociation longue et houleuse avec le banquier pour que nous puissions arriver à une concorde la plus équitable à nos yeux. Cela étant, ces swaps toxiques n’ont constitué que la première difficulté que la SACVL a dû régler. Un autre sujet sérieux est celui des produits structurés, produits de marketing, qui sont conçus pour comporter des taux d’intérêt relativement faibles au début de 3,80 %, pendant trois à six ans. Après six ans, leur gestion devient compliquée avec des mécanismes de triple indexation sur l’euro, le dollar, le franc suisse. Le démarchage commercial sur ce genre de produits emploie fréquemment un jargon en anglais, les démarcheurs nous expliquent que les courbes ne devraient pas se croiser, et pourtant elles se sont croisées ! Les charges de taux d’intérêt n’ont plus de limites et les paiements deviennent hors de proportion. L’un des prêts avait son taux fixé à 3,68 % pendant deux ans et atteint ces jours-ci 7,38 %. La charge supplémentaire est de 1,44 million d'euros, soit 540 000 euros de plus que prévu pour un seul prêt.
M. le rapporteur. Comment peut-on en arriver à une telle situation ? La SACVL a-t-elle recherché un avantage de taux d’intérêt, ou bien a-t-elle été victime d’un démarchage commercial agressif, ou bien recherchait-elle une certaine aisance de trésorerie à court terme ?
M. Jean-Paul Clément. Je n’étais pas en responsabilité à l’époque et je présume que les choix de la SACVL n’ont pas été correctement éclairés.
M. le président. Que disent les procès-verbaux du conseil d’administration ? Aucune remarque n’a été formulée sur ces opérations ?
M. Jean-Paul Clément. Il faut vous dire que 4 représentants de banque siègent au conseil d’administration de la Société d’économie mixte, dont justement un de la banque concernée. La ville de Lyon a la majorité des parts (77 %), les banques une forte minorité du capital et des petits porteurs le reste.
M. le rapporteur. Les banques interviennent donc avec une double casquette : elles sont administrateurs et conseillers.
M. Jean-Paul Clément. Je ne trouve pas qu’en l’occurrence ils ont joué un rôle de conseil.
M. le président. Résumons la situation : pour ce qui concerne les snow ball, vous êtes tenu au respect d’une clause de confidentialité et, pour le reste, vous ne portez pas de jugement mais émettez des réserves sur les décisions prises.
M. le rapporteur. J’attire votre attention sur l’expérience de l’OPAC de Dijon. Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de Bourgogne établi en 2010 sur les exercices de 2003 à 2007, il est mentionné que la souscription d’emprunts structurés s’est faite en 2005 et 2007 à l’occasion de la renégociation d’emprunts classiques existants en emprunts indexés sur la pente des taux. Qui a pris l’initiative d’entreprendre ces renégociations ? Avec quel objectif ? Qui a conseillé l’OPAC dans cette opération ? Finalement la question est toujours la même. Pourquoi se dirige-t-on vers ce type de produits toxiques, parce que l’on recherche un avantage de taux d’intérêt, parce qu’on est la victime du démarchage commercial, ou parce que l’on souhaite s’endetter en conservant un maximum de liquidités ?
M. Hamid El Hassouni, président de l’OPAC de Dijon. Président depuis seulement trois ans, je n’étais pas aux affaires lors de la souscription de ces emprunts. Je voudrais cependant souligner que nous n’avons pas tous l’expertise nécessaire sur les emprunts structurés qui sont généralement d’une compréhension difficile. Les organismes HLM et les collectivités locales ne sont pas assez outillés pour appréhender les enjeux et, sans vouloir faire de procès d’intention, je constate qu’il y a des lacunes en matière de conseil et d’explication des contrats proposés.
En février 2005, la restructuration de la dette de l’OPAC a été autorisée par le conseil d’administration afin de limiter l’exposition au risque des hausses (liée au livret A) et de bénéficier des taux de l’époque qui étaient, à ce moment-là, parmi les plus faibles. Le réaménagement portait sur 22 millions d’euros, comprenant une partie à taux fixe négociée avec la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 8 millions d’euros et une partie à taux variable pour 14 millions d’euros.
Ce montant de 14 millions d’euros a été scindé en trois, en fonction des durées résiduelles et des collectivités garantes. Le 1er novembre 2005, l’OPAC a procédé au remboursement de 14 millions d’euros de dettes provenant de 18 contrats de la Caisse des dépôts et consignations. Trois emprunts structurés ont été souscrits auprès du Crédit agricole qui avait soumis la meilleure des propositions. Pour autant, l’équilibre de l’office HLM n’est pas en péril puisque ces emprunts ne représentent plus aujourd’hui que 11,4 millions d’euros sur une dette totale de 236 millions d’euros, soit 4 à 5 % de l’encours total de notre dette. Le reste de l’endettement de l’office repose sur des emprunts classiques, à taux fixes ou variables.
Nous avons fait appel à un prestataire extérieur, Finances active, qui prodigue des conseils et assure une veille pour saisir les éventuelles opportunités qui nous permettraient de réaménager cette dette, voire de la rembourser par anticipation, totalement ou partiellement.
En conclusion, je voudrais rappeler que si nous avons maintenant suffisamment de recul pour « tirer à boulets rouges » sur ces emprunts, ce n’était pas le cas à l’époque, lorsque les banques nous faisaient miroiter de faibles taux.
M. Jean-Pierre Pirocca, directeur général de l’OPAC de Dijon. Je voudrais insister sur les deux points suivants : d’une part, les emprunts structurés représentent une part faible de notre endettement, moins de 5 %, ce qui signifie qu’ils ne représentent pas un réel danger ; d’autre part, le conseil d’administration a bien été sensibilisé et il a donné son autorisation, en février 2005, à la restructuration de la dette de 22 millions, avec une part à taux fixe et une part à taux variable.
Je me souviens des assauts répétés du milieu bancaire qui insistait alors sur la nécessité d’avoir une gestion active de sa dette et de la diversifier avec des produits structurés pour ne pas rester exclusivement sur du livret A.
Pour l’OPAC, les 14 millions basés sur des emprunts structurés font l’objet de trois contrats dont l’un arrive à échéance en 2013. Ces contrats sont soumis à des taux d’intérêt « capés » respectivement à 5,25 %, 6,35 % et 6,50 %. Je me souviens qu’à l’époque, certains considéraient que ces emprunts n’auraient même pas dû être capés et qu’il valait mieux laisser faire intégralement le marché.
Même s’ils sont capés, ces taux restent moins avantageux que ceux du livret A. Notre accord avec Finances active court sur plusieurs années. Cette société nous alertera s’il apparaît intéressant de solder les deux derniers emprunts, le premier arrivant à échéance en 2013. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas car nous aurions à payer une soulte d’un million d’euros par contrat, soit un total de deux millions d’euros ; or, nous évaluons nos pertes à 137 000 euros. Nous examinerions une opportunité si elle se présentait mais nous ne voulons pas porter atteinte à nos capacités d’autofinancement.
M. le rapporteur. Étant moi-même maire et président d’un office d’habitat, je reçois fréquemment les visites de la Miilos – cela ne se termine pas toujours bien, d’ailleurs. L’outil financier pour les offices d’habitat, c’est vraiment le livret A qui propose des garanties de taux bas. Parler d’instabilité au sujet du livret A prête à sourire. Les fluctuations y sont très faibles. Le vrai problème pour les offices, c’est la liquidité. Il n’y a pas suffisamment d’emprunts indexés sur le livret A pour réaliser tout ce que l’on souhaite.
Vous expliquez donc qu’on est venu vous proposer de convertir des prêts basés sur le livret A en emprunts structurés. Je voudrais connaître le regard porté par l’USH sur ce type d’opérations. Quel a été le rôle de la Miilos ? Qu’a-t-elle conseillé ? Il paraît vraiment aberrant de transformer des prêts « tranquilles » issus du livret A en emprunts structurés qui deviennent aujourd’hui toxiques.
M. Luc Legras, chargé de mission auprès du délégué général de l’Union sociale pour l’habitat. Pour comprendre pourquoi les organismes d’habitat se sont intéressés à ces emprunts, il faut revenir quelques années en arrière : ils s’y sont intéressés parce que, à un certain moment, leurs stocks de prêts issus de la Caisse des dépôts étaient largement au-dessus du marché. Et la Caisse des dépôts, sur la base des instructions que lui donnait le Trésor, refusait de renégocier la dette.
Les prêts livret A de l’époque étaient basés sur des taux d’intérêt variant entre 5 %, 6 % voire 7 % pour une partie de la dette, partie variable selon les organismes. Il est arrivé un moment où ces taux étaient nettement au-dessus du marché, à la fin des années 1990, vers 1997-1998. Les demandes de renégociations des prêts se sont heurtées à un refus de la Caisse des dépôts et consignations car les bénéfices des fonds d’épargne qui étaient liés aux retours des prêts anciens permettaient d’alimenter un certain nombre de choses. À ce moment-là, des organismes d’habitation, bénéficiant de contrats qui pour lesquels les pénalités de remboursement n’étaient pas très élevées, ont décidé de rembourser et de se refinancer sur le marché. Certains d’entre eux ont fait des économies de frais financiers extrêmement importantes. Certains ont choisi du taux fixe, d’autres du taux variable. À cette époque-là, l’euro était en train de se positionner, et les taux baissaient sensiblement. Les taux variables étaient à certaines périodes inférieurs au taux du livret A. Il y a donc eu des opportunités dont certains ont bénéficié. Et des organismes ont gagné sur leurs frais financiers l’équivalent de 3 ou 4 mois de loyer.
Le Trésor et la Caisse des dépôts et consignation ont évolué par la suite, une fois que certains organismes ont renégocié et rendu à la Caisse des dépôts 20 %, 30 % voire 40 % de leur dette. Ce n’est qu’à ce moment-là que le Trésor, par le biais de la Caisse des dépôts et consignations, a fait des propositions qui sont devenues intéressantes. Il a également verrouillé les contrats, c’est-à-dire qu’il a instauré des pénalités actuarielles qui rendent plus difficiles les remboursements anticipés.
Il faut également savoir qu’une partie de la dette des organismes n’est pas forcément liée au livret A. Légalement, sur la partie construction, un organisme doit prendre plus de 50 % de sa dette en livret A pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux ; mais ce n’est pas le cas s’agissant de la réhabilitation. Or sur des durées plus courtes, par exemple sept ans, les banquiers ont parfois proposé des offres qui paraissaient avantageuses, notamment l’absence de garanties.
Un troisième facteur, récurrent sur la période 2000-2010, est la grande volatilité des taux courts. À certains moments, ces derniers étaient proches de zéro, à la fois en dessous du livret A et des taux longs. Les organismes se sont demandés s’ils n’avaient pas intérêt à se financer en taux courts, notamment sur l’Euribor et prenant des protections.
Si l’adaptation de la gestion du Livret A avait été un peu plus fine, la question ne se serait pas posée dans les mêmes termes.
M. le rapporteur. Selon vous, c’est donc le contexte économique et financier du moment qui est à l’origine du phénomène ?
M. Luc Legras. Pour la fin des années 1990, c’est très clair.
M. le rapporteur. Pouvez-vous être plus précis : on parlait de la période 2005-2007, or, vous semblez vous situer davantage sur la période 1997-2000…
M. Luc Legras. Sur l’engagement et sur les raisons pour lesquelles on est entré dans cette gestion, c’est la fin des années 1990 qui est pertinente. Quelles étaient les banques proches des organismes HLM ? Par tradition la Caisse d’épargne. Pourquoi ? Parce qu’elle avait de droit, jusqu’en 2007, un siège dans tous les conseils d’administration des offices. Mais aussi Dexia, qui était la banque des collectivités locales. Les autres s’y sont peu intéressés. Le Crédit agricole n’est entré que récemment sur ce marché.
Au total, il y a 100 milliards de dettes concernant le logement social. La part qui échappe à la Caisse des dépôts et consignation n’est certes que de l’ordre de 20 à 30 %, mais elle a été suffisante pour amener les organismes d’habitat à s’intéresser à la question de la restructuration. Ces organismes sont entrés dans un univers dont ils n’avaient pas connaissance auparavant, avec des banquiers qui leur ont fait des propositions, les banquiers eux-mêmes étant plus ou moins structurés selon les organismes.
M. le rapporteur. Parlait-on d’« emprunts structurés » en 2000 ?
M. Luc Legras : non. On parlait de « cap » ou d’« assurance », mais pas d’emprunts structurés. C’est venu après.
M. le rapporteur. Lorsqu’un banquier est membre d’un conseil d’administration d’une SEM ou d’un office, il joue certes un rôle de conseil, mais il est juge et partie. Avez-vous senti dans les offices que les banquiers « forçaient la main » ? On se demande pourquoi au même moment, en France, des organismes bénéficiant de taux fixes, même un peu élevés, décident de restructurer leurs dettes. Y a-t-il eu une démarche « agressive » des banquiers par ailleurs présents dans les conseils d’administration ? Ou s’agit-il simplement d’une gestion dynamique de la dette avec des produits qui structurent au départ puis qui « ne tournent pas bien » ? On cherche à appréhender l’attitude exacte des banquiers dans cette affaire.
M. Denis Vilain, chef de la Mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS). La Miilos avait en effet détecté les problèmes dès les contrôles de l’année 2006 et avait donné l’alerte dans son rapport annuel 2006 paru en 2007. Ce rapport est traditionnellement le canal d’expression de nos synthèses et c’est le seul. Nos rapports annuels peuvent servir à donner une alerte, sur la base des faits constatés dans le cadre du contrôle d’une année donnée.
Je rappelle que nous contrôlons périodiquement, tous les cinq ans, les organismes HLM de l’USH et aussi la partie des SEM qui traite du logement. Nous allons donc voir tous les cinq ans les organismes de plus de 500 logements et moins fréquemment ceux qui sont d’une taille moindre, ainsi que le secteur associatif. Ceci ne nous donne pas une statistique rigoureuse sur le secteur, mais fournit une photo à un instant donné d’environ 20 % du secteur des plus de 500 logements seulement. Les analyses transversales sur le secteur sont plutôt du ressort des administrations de tutelle ou des fédérations qui suivent de façon permanente les organismes.
La Miilos, dans son activité, dans ses rapports de contrôle, n’a pas à prodiguer de conseil : elle applique la séparation entre le contrôle et le conseil. En revanche, dans ses rapports annuels, elle donne une alerte, elle rend publiques ses préoccupations et elle les assortit de préconisations. Dans les deux principales préconisations, de façon constante depuis le rapport 2006, il y a d’abord une préconisation de bon sens qui est d’appeler la gouvernance de chaque organisme (président, direction générale, conseil d’administration), à se saisir de la question et à demander à son équipe financière de faire un point approfondi sur la nature des risques, sur l’exposition aux risques et, le cas échéant, sur la stratégie à bâtir pour sortir d’une situation risquée. C’est la principale préconisation et elle n’est pas banale car on voit, à la faveur des contrôles que la gouvernance n’est pas toujours informée de la souscription de produits structurés. On a vu des cas où le contrat était rédigé dans une langue étrangère. On ne voit pas comment le conseil d’administration a pu l’étudier. Et on trouve encore, au cours de nos contrôles, des organismes de taille moyenne qui continuent de souscrire des produits structurés. L’alerte reste donc de mise.
Nous préconisons aussi régulièrement un encadrement réglementaire de ces activités, non pas pour enserrer dans une réglementation supplémentaire, mais pour instaurer des balises, des garde-fous, des points de repère utiles aux organismes.
M. le rapporteur. Dans les recommandations qu’a formulées la MIILOS, certaines sont-elles destinées spécialement aux adhérents de l’Union sociale pour l’habitat ?
M. Thierry Repentin sénateur, président de l’Union sociale de l’habitat (USH). L’Union sociale de l’habitat regroupe cinq familles d’HLM. Les sociétés d’économie mixte n’en sont pas membres. C’est pourquoi les SEM n’ont pas été destinataires de conseils particuliers de la part de la MIILOS. Les 750 organismes que nous regroupons ont contracté des dettes pour un montant cumulé de 100 milliards d’euros. Sur ce total, les produits structurés représentent un encours de sept milliards d’euros ; ils sont cependant loin d’être tous toxiques. Environ deux milliards de dette recèlent un risque masqué selon la classification de la charte Gissler, et un milliard est hors charte Gissler.
M. le rapporteur. Cela nous rassure !
M. Thierry Repentin. Nous n’avons jusqu’à présent pas connu de catastrophe ou de difficulté marquée, grâce à l’autocontrôle permanent que nous pratiquons : une analyse des comptes de chaque organisme est effectuée par la fédération à laquelle appartient l’organisme et chaque fédération peut informer l’Union de l’existence d’un risque. À ma connaissance, aucun accident majeur n’est encore à déplorer. Il n’y a pas eu de dépôt de bilan d’un organisme ou d’appel à la solidarité nationale. En outre, la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) assure une mutualisation des risques en cas de dépôt de bilan. Cela devrait éviter tout dérapage. Notre démarche s’inspire de l’esprit qui guide un organisme HLM lorsqu’il négocie avec un locataire en difficulté, en travaillant au quotidien avec les familles, avec le résultat d’impayés très faibles.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est notre source de financement pour financer les constructions neuves. Les emprunts auprès d’autres organismes servent plutôt à financer des travaux de réhabilitation.
M. Luc Legras. Le montant des emprunts hors CDC s’élève à 20 milliards.
M. le président. Il paraît difficile d’établir sur quels encours il faut imputer les actifs risqués, ceux de la CDC ou d’autres. Que représentent ces 3 milliards de stock toxique par rapport à un volume hors CDC de combien ?
M. Thierry Repentin. Hors Caisse des dépôts, nous détenons pour 20 milliards de prêts. Les 3 milliards correspondent à des emprunts structurés et des swaps. Sur les 750 organismes que nous fédérons, 150 ont eu recours à des produits structurés. Pour 110 d’entre eux, cela représente moins de 10 % de l’encours de leur dette. Pour une douzaine d’autres, ce niveau dépasse les 20 %. Pour trois ou quatre seulement, la barre des 30 % est dépassée.
Aucun risque systémique n’est donc à déplorer, comme la Milos pourra le confirmer.
M. Luc Legras : Pour les emprunts à risque, un dispositif d’accompagnement a été mis en place pour suivre le risque de gouvernance, analyser la nature des contrats souscrits et le type de produits en cause. Les plus exposés font l’objet d’un audit par la Fédération et sont éventuellement suivis par un avocat pour une renégociation, au cas par cas.
M. le rapporteur. Observez-vous des blocages aujourd’hui ?
M. Luc Legras. Quelques bras de fer se sont déjà engagés entre banques et emprunteurs, mais, à notre connaissance, aucune action en justice n’a abouti à ce jour.
M. le président. Nous voudrions savoir s’il existe un risque ultime pour les finances de l’État. Selon vous, seule une minorité de structures serait touchée, et la garantie interne à la Fédération servirait par ailleurs de pare-feu en cas d’accident. Est-ce que vous êtes amenés à refuser désormais de couvrir certains produits ?
M. Luc Legras. L’USH n’entretient pas de relation directe avec les organismes, mais seulement avec les fédérations au sein desquelles ils se regroupent. Les organismes les plus exposés sont suivis par leur fédération. Mais aucun n’est en situation de défaillance. Toute la difficulté réside dans l’évolution de la parité euro/franc suisse. Au contraire des swaps, les prêts structurés ne comportent pas d’obligation de provisionnement dans les comptes. C’est pourquoi une banque s’est ainsi spécialisée dans la production de prêts structurés, sans jamais proposer de swaps. Ces derniers doivent en effet être inscrits dans les bilans comptables et valorisés au 31 décembre. Si, comme en 2008, le marché n’existe plus momentanément pour ce genre de produits, ils apparaissent dans les comptes avec une décote maximale qui peut atteindre 50 %. La souscription de swaps est donc beaucoup plus lisible sur le plan comptable. À l’inverse, la production systématique de prêts structurés permet de contourner l’exigence de provisionnement.
M. Thierry Carcenac. Les collectivités locales ne sont-elles pas aussi garantes des prêts contractés ? La CGLS ne serait pas la seule concernée en cas de problème.
M. le président. C’est juste.
M. Luc Legras. En effet, la CGLS, quand elle fonctionne, n’assume pas 100 % du risque, mais seulement un quart ou un tiers de celui-ci. Les actionnaires ou les collectivités sont aussi mises à contribution en cas de défaut de paiement.
M. le président. Selon vous, le risque systémique est moins important parce que l’essentiel des prêts a été souscrit auprès de la CDC. Il y a cette solidarité qui peut jouer. Mais on constate qu’un certain nombre de produits sont risqués : y a-t-il un niveau qui prend la responsabilité de décréter que certains produits risqués ne peuvent plus être souscrits par les fédérations ?
M. Luc Legras. En ce domaine, le comité fédéral d’auto-contrôle dans chaque fédération peut émettre des recommandations et des propositions, qu’il appartient ensuite au conseil fédéral de reprendre ou non, mais pas donner un ordre, puisque la Fédération et l’Union ne sont pas des Ordres au sens de l’Ordre des médecins. Cependant, même la charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales, dite charte Gissler, n’a pas formulé de recommandations particulières pour les organismes HLM. Nous avons recommandé de ne pas recourir aux produits de risque le plus élevé, mais en vertu du principe d’autonomie, on ne peut être sûr qu’un organisme ne le fera pas.
M. le président. M. Clément, quelle est votre position par rapport à ces recommandations ? Qu’auraient-elles donné dans la situation antérieure ?
M. Jean Paul Clément. Il est certain que je ne me serais pas engagé dans des prêts structurés. Il faut que tout le monde sache qu’il n’y a pas de marché de change au-delà de cinq ans. Les premières années des dits prêts structurés sont relativement confortables, mais au-delà de cinq ans, personne ne peut prédire ce qu’il va se passer. En ce qui me concerne, j’en ai six qui entrent dans la phase active à partir de 2018 et qui s’étalent sur une période de trente à trente-quatre ans. Nous avons donc une période non sécurisée qui va durer entre vingt-sept et vingt-huit années. Le risque est donc réel.
Aujourd’hui, sur les cinquante-cinq millions d’euros de prêts structurés de la SACVL, le capital restant dû est de cinquante et un million d’euros. Si nous voulions sortir des prêts structurés, il faudrait rembourser le capital restant dû de cinquante et un million d’euros restant, auxquels s’ajouteraient quarante-neuf millions d’euros. Pour sortir des prêts structurés, il faudrait donc payer cent millions d’euros. Il n’est donc plus question de prendre des prêts structurés à la SACVL.
M. le rapporteur. Tous les prêts auxquels vous avez souscrit sont-ils garantis par les collectivités ? Dans le cas d’une collectivité elle-même très endettée, cela pourrait être problématique.
M. Jean Paul Clément. Oui, par la ville de Lyon.
M. Jean-Pierre Pirocca, directeur général de l’OPAC de Dijon. Oui, par l’agglomération de la ville de Dijon. Le facteur risque existe même s’il y a des organismes qui sont bien plus exposés, on l’a vu avec le collègue de la SACVL de Lyon. Dans le cadre de l’OPAC, l’organisme dispose d’un capital de onze millions d’euros ce qui représente deux programmes de quarante logements. Or, nous avons un parc de dix mille logements. L’exposition au risque reste donc très faible. C’est si vrai que le législateur a souhaité qu’en aucune façon, les garanties apportées par les collectivités ne puissent faire partie de leur facteur risque.
M. Jean-Louis Gagnaire. J’entends bien les limites fixées par le législateur, mais au final, il y a une garantie qui peut jouer d’une manière ou d’une autre. Les collectivités qui ont apporté leur garantie ont-elles été régulièrement informées de la situation des prêts que vous étiez amenés à souscrire ? On a observé que la soulte était plutôt à votre avantage lorsqu’on la compare à ce qu’on a entendu dans les collectivités locales qui pour certaines avaient des soultes encore plus élevées.
M. le président. Pas toutes. Pour Lyon.
M. Patrice Calméjane. Quand vous présentez des emprunts au conseil d’administration, présentez-vous une note d’analyse pour évaluer le risque sur l’ensemble de la durée ? On peut se poser la question de la responsabilité d’un certain nombre de cadres : dans vos organismes, des mesures ont-elles été prises quant aux personnes qui vous ont proposé ces produits ? Y a-t-il eu des sanctions, des départs ?
M. le président. Il y en a eu. Quant à la remarque qui a été faite, quel est le niveau d’information des administrateurs ?
M. Jean Paul Clément. Il est variable. Le phénomène de calcul d’un prêt structuré n’est pas incompréhensible mais mérite un peu d’attention. Les swaps encore davantage.
M. Patrice Calméjane. Vous souscrivez donc à des prêts structurés sans les comprendre !
M. Jean Paul Clément. Oui, vous avez raison, c’est ce que j’ai constaté.
M. le rapporteur. Quand vous regardez un emprunt structuré, le montant de la soulte est fonction du contexte. Celui-ci ne peut donc pas être inscrit dedans et doit être estimé le moment venu. Il faut faire la distinction entre un prêt toxique et un prêt structuré : un prêt structuré peut bien se comporter toute sa vie si les différences de taux restent correctes. Les prêts ne sont pas structurellement toxiques mais le deviennent par des phénomènes de conjoncture.
M. Luc Legras. Concernant le degré d’information des administrateurs, le mien était très variable. Les cent cinquante organismes ne nous transmettent pas leurs délibérations. Si nous détenons des informations aujourd’hui c’est sans doute par la MIILOS, et par les dispositifs d’autocontrôle des fédérations, tandis que précédemment seuls les banquiers détenaient les informations.
D’autre part, un des risques revient au mode de gestion que l’on peut employer. Il est lié à deux éléments : la stratégie de l’organisme et les moyens qu’il se donne. Le danger vient du fait de prendre ce type de produit comme une assurance et de le laisser dans un tiroir. Il y a des organismes qui gèrent en permanence ces produits et utilisent les fenêtres de tir pour changer de position, et leur stratégie leur permet de gagner. C’est un autre mode de gestion qui exige une expertise qui n’est pas à la portée de tout le monde.
M. Jean Paul Clément. Je souhaiterais être sûr que tout le monde a bien entendu le montant indicatif de l’indemnité de marché qui est de quarante-neuf millions d’euros pour un emprunt initial de cinquante-cinq millions. Si on doit payer l’emprunt, il nous faut rembourser deux fois l’emprunt de base.
M. le président. Bien que vous n’ayez pas un rôle de conseil, vous trouvez à un moment donné ce genre de produits dans un certain nombre de contrôles que vous faites sur des organismes HLM. Quelles ont été vos préconisations ?
M. Denis Vilain. Le degré d’information de la gouvernance est très variable. Dès 2006, nous avons préconisé que la gouvernance se saisisse du problème et se fasse conseiller par des experts ou par des fédérations professionnelles. En somme, nous faisons une préconisation générique que nous pointons dans les rapports de contrôle : si nous avons l’impression qu’il n’y a pas eu d’examen par le conseil d’administration et les services, une question est posée à l’organisme sur ce qu’il compte faire pour mesurer le problème et apporter une réponse. Nous invitons donc l’organisme à se saisir de la question.
Aussi, bien ce que ce soit rare, nous observons à la MIILOS l’existence de contrats rédigés seulement en anglais, et aussi que des produits ont été souscrits avec des indices propriétaires que seul le propriétaire est en mesure de connaître. Pour autant ces contrats ont été signés. Il est dommage que la charte Gissler ne soit pas appliquée aux organismes de logement social, car il y a notamment la recommandation d’informer la gouvernance.
Dans le tableau de risques, le degré de risque le plus élevé concerne les produits hors zone euro. Or, les problèmes de variations du cours de change entre l’euro et le franc suisse, que nous observons aujourd’hui, correspondent précisément au degré de risque le plus élevé de la charte Gissler. On ne voit pas bien la logique de souscription de tels produits hors zone euro, ni à quelle logique économique ils répondent, sauf à profiter à un moment donné d’un avantage de taux qui n’est pas lié à l’activité de production.
M. le président. Vous tombez sur un organisme qui vous dit qu’il a eu une renégociation avec sa banque mais qu’il existe une clause de confidentialité. Comment faites-vous ?
M. Denis Vilain. Nous ne pouvons pas aller plus loin que le respect de certaines clauses. Notre rôle n’est ni de conseiller ni de mesurer le risque en premier degré, mais de faire, à travers le rapport de contrôle, une recommandation pour que la gouvernance puisse apprécier le risque. Nous ne sommes pas experts comptables comme certaines CRC. Il n’est pas de notre rôle d’aller jusqu’à donner notre mesure des risques.
M. le rapporteur. Ce n’est pas le rapport euro-franc suisse qui pose problème mais la comparaison entre les parités euro-dollar et euro-franc suisse.
Deuxièmement, vous dites que, dans le cadre de l’OPAC de Lyon, vous êtes moins exposés car vous avez la possibilité de rendre de l’actif pour payer les charges. Mais si vous poussez le sujet à ses limites, supposant que vous vendiez vos dix mille logements à un autre bailleur social pour trente mille euros par logement, la question qui se pose est celle de savoir à qui appartiennent ces trois cents millions d’euros ? En fait, les logements seront vendus à d’autres bailleurs, et le coût supplémentaire va être répercuté sur les loyers. Il y aura quand même un impact.
M. le président. M. Repentin, quel est votre avis sur ce qu’il faudrait mieux organiser ?
M. Thierry Repentin. Les collectivités locales sont-elles informées de ce qu’elles ont garanti à l’égard des organismes de logements sociaux ? Effectivement, les collectivités garantissent les emprunts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations au moment où l’opération se fait, mais elles ne sont pas informées des procédures de renégociations en cours durant la vie du programme. Peut-être pouvons-nous imaginer une information de la collectivité locale qui garantit le programme ?
À ma connaissance, aucune collectivité locale n’a été pour le moment appelée en garantie du paiement d’un emprunt initial sur des problèmes liés à des produits structurés ou à des swaps. Seule une collectivité territoriale en Guyane a eu à intervenir sur une défaillance d’un organisme, liée plutôt à des problèmes de gestion « exotique » qui ne sont pas l’objet de votre mission. Nous ne sommes donc pas sur un risque systémique.
Quelles suggestions pouvons-nous faire ? Peut-être appliquer d’une façon automatique les préconisations de M. Gissler. Je ne m’exprime que pour les organismes de la confédération USH. Je ne sais pas si la fédération des SEM s’applique les mesures de préconisations que nous faisons nous-mêmes à l’égard de nos adhérents.
M. le rapporteur. Vous suggérez de les questionner.
M. Thierry Repentin. Par exemple, au sein des personnes présentes, M. Clément est hors du système du monde HLM.
M. Jean Paul Clément : En effet, nous sommes des logements conventionnés hors du système HLM.
M. Thierry Repentin. Cette motivation de recherche de produits plus intéressants à l’extérieur de la Caisse des dépôts et consignations vient aussi du fait que celle-ci, et donc le Trésor, n’a pas souhaité que les organismes de logement HLM puissent renégocier l’encours de la dette, car cela signifiait, au niveau du résultat des fonds d’épargne, moins d’argent en fin d’année, donc moins de ponction de l’État dans les fonds d’épargne pour alimenter le budget général.
M. le président. Je remercie les représentants du secteur du logement social pour les informations qu’ils ont bien voulu nous apporter, et je ne doute pas que notre rapporteur en fera bon usage.
*
* *
Auditions sur le thème : « Comment évaluer l’encours des emprunts toxiques ? », de M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie, M. Marc Larue, président de section à la CRC PACA, M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace, M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais et M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC Pays de la Loire
(Procès-verbal de la séance du mercredi 12 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. La table ronde qui s’ouvre à présent réunit des magistrats des chambres régionales des comptes (CRC) ayant eu à connaître la situation d’endettement de nombreuses collectivités, et dont l’analyse a contribué au rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, présenté en juillet 2011.
Cette table ronde doit nous permettre d’apprécier l’encours des emprunts toxiques dans la dette publique locale, et la part qu’il représente au sein de cette dette. Mais de nombreuses autres questions seront abordées aussi, touchant l’information sur les risques de dette et les règles de la comptabilité des collectivités locales, le renforcement des moyens de contrôle interne et externe, et bien sûr les moyens d’aider les collectivités en grave difficulté.
Aussi je vous remercie d’accueillir : M. Alain Levionnois, Président de la CRC de Picardie, M. Marc Larue, président de section à la CRC de Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace, M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais et M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC des Pays de la Loire.
Les personnes auditionnées prêtent serment.
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. Paradoxalement, alors qu’une règle d’or impose aux collectivités territoriales de présenter leurs budgets en équilibre, les caractéristiques de leurs dettes restent entourées de flou. Il est ainsi impossible de déterminer précisément l’encours total de la dette des acteurs publics locaux, ni de quels types d’emprunt ces encours sont constitués, d’en connaître la maturité moyenne ou la ventilation par type de taux d’intérêt. Le rapport se borne à estimer que l’encours de la dette locale atteint 30 à 35 milliards d’emprunts structurés, dont 10 à 12 milliards présenteraient un risque potentiellement élevé.
J’aurai trois questions en relation avec cette situation : quels sont les remèdes que l’on peut apporter afin d’en finir avec la mauvaise connaissance des prêts et cette concentration des risques ? Comment, aussi, parvenir à une meilleure transparence de la gestion de la dette des collectivités ? Enfin – question la plus brutale – qui porte la responsabilité de la situation très difficile à laquelle certaines collectivités sont confrontées ?
M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie. Nous sommes très honorés d’avoir à vous rendre compte des travaux que nous avons menés. Notre équipe a en réalité travaillé sur trois rapports successifs : le premier a pris la forme d’une insertion au rapport annuel de la Cour des comptes publié en février 2009, le deuxième a consisté en une nouvelle insertion de suivi au titre du rapport annuel de février 2010 et le troisième a été un rapport thématique de la Cour sur la gestion de la dette locale, publié en juillet 2011.
Ce dernier rapport est le fruit d’une analyse plus approfondie, sous la responsabilité de Marc Larue et des autres rapporteurs ici présents, qui s’est appuyé sur l’ensemble des CRC de métropole.
Pour répondre à votre première question relative aux moyens d’améliorer la gestion de l’encours de prêts à risque, je rappellerai que la direction générale des finances publiques (DGFiP) du ministère des finances avait engagé, dès 2009, un essai de recensement des prêts structurés à risque figurant dans les comptes des collectivités territoriales, par l’intermédiaire des trésoriers payeurs généraux et des agents comptables du Trésor public. Ce recensement, qui a servi de base aux travaux d’Éric Gissler et à l’élaboration d’une charte de bonne conduite, s’est révélé aléatoire et assez peu probant : peu d’agents comptables avaient une connaissance précise de ces produits et ils ne disposaient pas non plus d’outil leur permettant de mesure le risque. La charte Gissler a constitué, de ce point de vue, une démarche intéressante de classification même si nous émettons, dans notre rapport du mois de juillet dernier, quelques réserves quant aux décisions qui en ont découlé.
De son côté, le conseil de normalisation des comptes publics a émis un certain nombre d’avis et proposé la modification des annexes comptables des budgets locaux. L’un de ces avis propose également une classification intéressante de ces produits. Il me semble que c’est un progrès important.
Toutefois, la notion d’emprunt à risque demeure assez imprécise. Dans une certaine mesure, un emprunt à taux fixe fait courir un risque à la baisse des taux : dans les années quatre-vingt, les taux fixes des emprunts des collectivités atteignaient 17 % ; c’est d’ailleurs à cette époque qu’est apparue la notion de gestion active de la dette.
L’encours global de la dette locale – 163 milliards d’euros – est aujourd’hui bien connu, grâce aux données de l’INSEE, mais indéniablement il reste des progrès à accomplir en matière de classification des composantes de cette dette.
Je serai beaucoup plus bref pour répondre à votre deuxième question sur les frais financiers. Il est impossible de prédire l’avenir de ces produits : Comment va évoluer la parité entre l’euro et le franc suisse ? Quelle sera la forme de la courbe des taux dans les prochains mois ? Je ne suis pas en mesure de le savoir.
M. le rapporteur. Comment garantir la sincérité des comptes locaux dans ces conditions ?
M. Alain Levionnois. C’est une question difficile. Un contrat d’emprunt est un contrat de droit civil. Les juridictions civiles et commerciales sont seules compétentes pour en connaître. La seule affaire jugée, en la matière, opposait les caisses d’épargne et une société anonyme d’habitat local ; c’est le tribunal de commerce qui a rendu la décision.
M. le président. À Toulouse.
M. Alain Levionnois. Tout à fait. Les contrats d’emprunt ne sont donc pas des contrats administratifs. Cela pose deux difficultés. D’abord, les collectivités territoriales ne sont pas familières de la procédure civile. Par ailleurs, pour le juge judiciaire, le contrat fait loi entre les parties et l’intérêt général n’y a guère sa place.
M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie. Le propre de la décentralisation, c’est d’avoir libéralisé les possibilités pour les collectivités territoriales de s’administrer et donc d’emprunter librement, sans autorisation administrative préalable.
M. le président. Il y a la dimension commerciale dans l’opération de prêt aux collectivités, mais aussi une dimension administrative – et des normes applicables que les produits structurés n’ont pas permis de respecter : la sincérité de l’équilibre des budgets votés, l’information des organes délibérants. Quelles sont les règles qui vous paraîtraient devoir être précisées pour avoir sincérité et transparence ?
M. Alain Levionnois. Votre question renvoie à l’une des recommandations faites dans le rapport public de juillet 2011, à savoir le renforcement de l’information et l’association des assemblées délibérantes aux décisions relatives à l’emprunt. L’une des particularités du contrat d’emprunt, c’est qu’il doit être conclu rapidement. Il ne peut que s’agir d’une décision exécutive du responsable au sein de la collectivité, et la soumettre aux délais de la délibération ne serait pas adapté. Il ne serait pas pertinent de remettre en cause cette délégation de compétence aux exécutifs locaux, alors que son champ a été constamment élargi par la loi au cours des dernières années. Mais une délégation de compétence doit avoir comme contrepartie un pouvoir de contrôle, qui nous paraît actuellement insuffisant. D’où la recommandation de prévoir par la loi que les gestionnaires locaux aient à rendre compte de leurs choix en matière d’endettement, dans un rapport annexé au budget, qui pourrait faire l’objet d’un débat. Ces questions peuvent éventuellement paraître complexes au conseiller municipal « de base », mais il pourra tout au moins demander des explications, ce qui forcerait le responsable à formaliser ses choix et à les expliquer. Ce rapport représenterait un outil pour les assemblées délibérantes, et cette évolution ne pourrait avoir qu’un effet positif et représenter un progrès en termes de transparence.
M. Patrice Calméjane. Vous évoquez les collectivités, mais vous êtes aussi les contrôleurs des gestionnaires. Or l’article R. 231-2 du code des juridictions financières prévoit notamment que « sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour ». Au vu de l’absence de consigne précise qu’ont reçu l’ancien préfet et l’ancien trésorier-payeur général que nous avons auditionnés, avez-vous eu l’occasion de faire des recommandations sur les éléments devant faire l’objet d’un contrôle ?
En outre, quel est le niveau de formation des agents de vérification de la Cour qui ont été confrontés à des produits aussi complexes que les emprunts structurés ? Les comprendre requiert une expertise pour les comprendre ; il a aussi été évoqué des documents contractuels rédigés en langue étrangère. Avez-vous fait appel à des experts extérieurs pour comprendre des produits sur lesquels vous n’avez pas eu de formation initiale ?
M. le président. Pour faire le lien entre ces interventions, j’ajouterai un cas tiré de mon expérience personnelle. Lors de ma première rencontre avec mon directeur financier, il m’a expliqué que nous étions passés d’un taux de gestion de la dette de 3,90 % à 3,15 %. Sans audit externe, je n’aurai jamais pu me rendre compte que cette gestion active de la dette cachait une perte potentielle d’un tiers, qui n’apparaissait nulle part. Or nous aurions dû être informés de cette perte.
M. Marc Larue, président de section à la CRC PACA. Comme nos différents rapports l’ont souligné depuis 2009, l’absence d’outil statistique national pose un problème. Il semble désormais se mettre en place, mais en son absence nous avons dû nous appuyer sur des chiffres de conseils extérieurs.
Notre expérience des contrôles sur le terrain nous pousse à préconiser de travailler dans deux axes :
– l’amélioration de l’information des assemblées délibérantes dans les collectivités territoriales, par un débat obligatoire sur la dette et la stratégie de la dette : ces contrats sont souvent aujourd’hui approuvés sans débat, et l’obligation de rendre compte a posteriori des décisions prises ne suffit pas. La situation des hôpitaux, où la décision est prise par le directeur seul en vertu de ses pouvoirs propres, montre a contrario l’intérêt d’un débat, même si les personnes n’ont pas de compétence particulière en la matière. L’obligation pour le gestionnaire de formaliser pour expliquer présente en effet des vertus en soi en montrant la dangerosité des produits complexes ;
– la mise en place d’un système de provisionnement : ces produits n’ont pas été réglementés, et l’innovation financière rend impossible de prévoir quels seraient les nouveaux produits qui pourraient apparaître. Dans ce contexte, l’obligation de provisionner nous apparaît comme une solution pérenne. L’analyse de la situation nous a montré que certaines personnes ont cru réellement pouvoir emprunter à des taux inférieurs à ceux du marché, ce qui n’est pas possible, mais dans certains cas les banques l’ont peut-être laissé croire. Le système de provisionnement que nous proposons a pour objet de compenser le gain lié au recours à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché.
Dès 2005-2006, nous avons attiré l’attention dans nos contrôles sur ces nouveaux produits et mis en garde les gestionnaires contre leur complexité et leurs risques. Le fait que les responsables financiers et commerciaux des banques ne comprenaient parfois pas eux-mêmes les caractéristiques de ces produits nous a confirmés dans la conviction qu’ils posaient problème.
S’agissant de la réaction des autres instances de contrôle et notamment du rôle joué par le contrôle de légalité et les comptables publics, nous abordons dans notre rapport le problème posé par les contradictions des textes applicables en ce qui concerne les documents à produire au contrôle de légalité en matière d’emprunts. De notre point de vue, même si le contrat de prêt est un contrat privé, il nous semble qu’il devrait être transmis obligatoirement au contrôle de légalité.
M. le rapporteur. Vous évoquez le taux du marché : il convient de faire la différence entre produits structurés et produits toxiques. Un emprunt structuré devient toxique quand son taux d’intérêt dépasse le taux usuraire. Le problème n’est pas uniquement ce taux, mais le coût de la sortie qui n’était pas prévisible. Faut-il protéger les collectivités en appliquant comme limite le taux de l’usure ?
M. Marc Larue. La logique des emprunts structurés est d’échanger une bonification de taux à court terme contre un risque important. Si on veut provisionner par rapport au risque de sortie, on aura une difficulté. Le vice de départ de ces produits c’est le taux bonifié inférieur au marché qui a été affiché, et anesthésié la perception du risque. Si on neutralise cet avantage par l’obligation de provisionner, on fait perdre l’intérêt de recourir à ces produits.
M. le président. S’il y avait eu obligation de provisionner le risque, bon nombre de ces produits n’auraient pas été souscrits, car pour nombre d’entre eux, le jour même de leur signature, il y avait un risque.
À partir de quels faits, quelle information, les conséquences néfastes de ces produits ont-elles été appréhendées par les chambres régionales des comptes ?
M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace. Notre équipe a des formations initiales variées. Nous avons dispensé un certain nombre de formations et élaboré des guides d’enquête au profit des équipes de vérification ; nous avons aussi pu faire appel à des experts extérieurs.
Les juridictions financières soulignent que la dette locale est comptabilisée en valeur nominale et non en valeur financière. Ceci est une difficulté structurelle pour évaluer les risques et les charges financières à venir.
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, a commencé à examiner la question en février 2009 et a publié des informations sur les annexes du budget. La compréhension de la formule de calcul de l’indexation permet de faire des projections et de constater que des taux d’intérêt à deux chiffres pouvaient être atteints.
Le second axe de travail du CNOCP concerne le provisionnement, tout en sachant que la difficulté en matière de finance locale est la difficulté budgétaire à passer la provision. Nous en sommes tous conscients : si on retient l’intégralité de la soulte de sortie pour le montant de la provision, certaines collectivités, même importantes, pourront se retrouver en difficulté, car cela représentera deux ou trois fois leur épargne brute. Nous avons écarté ce schéma pour envisager de provisionner les échéances de l’exercice suivant, par exemple.
Depuis l’apparition des difficultés, les collectivités essaient de réaménager en figeant avec la banque les conditions à un taux fixe même élevé, parfois sur seulement deux ou trois échéances, et en repoussant donc le problème sur l’avenir, et en rééchelonnant les échéances. Certaines arrivent à sortir de leurs positions à la faveur de fenêtres de marchés.
Concernant le montant des frais financiers que cela peut engendrer, étant donné qu’il est quasi impossible de disposer de visibilité par exemple, sur le niveau des changes à six mois, il est impossible de les anticiper à vingt ou trente ans. Au surplus, on ne connaît pas le poids de chacune des stratégies structurées dans l’encours des collectivités. Le système de provisionnement devrait verrouiller la réapparition de ce problème à l’avenir. Pour l’encours déjà souscrit, les produits à barrière ou snowball ne sont pas tous sortis de leur phase bonifiée, donc il faut craindre que l’on relève encore des éhcances très dégradées dans l’avenir.
M. le rapporteur. En étudiant un cas limite, on pourrait imaginer qu’une collectivité avec 200 millions d’euros de dette, dont 95 % d’emprunts structurés assis sur les parités du dollar ou du franc suisse, se retrouve avec des taux d’intérêt de 28 ou 30 %. Comment faire pour payer 60 millions d’intérêt par an ? Comment équilibrer le budget ? Par 50 points de fiscalité ?
M. Jean-Louis Gagnaire. L’exemple limite présenté par le Rapporteur montre que cette situation est intenable. Avant même d’y arriver, certains maires auditionnés nous ont dit qu’ils seraient dans l’incapacité d’élaborer leur budget et contraints de remettre cette situation entre les mains du préfet.
Je comprends l’intérêt de votre proposition de mettre en place des provisionnements pour prendre en compte les risques. Mais en comptabilité privée, il s’agit de provisionner le risque avéré et non hypothétique, quitte à l’ajuster en fonction de la réalisation de ce risque. Dans le cas des collectivités, comment mesurer ce risque ? Si pour l’avenir, ce système aura un effet préventif, en dégradant immédiatement la qualité des comptes des collectivités concernées, il ne règle pas le passé.
Une question essentielle est celle de la soulte demandée pour sortir de ces prêts : on ne connaît pas sa valeur a priori, qui est réactualisée en permanence. J’ai le sentiment qu’elle est calculée à la tête du client, en fonction de la capacité à négocier des petites communes ou des établissements hospitaliers qui eux, avaient un réseau à leur appui.
Vous appelez à diversifier l’offre de prêts, mais la période actuelle se caractérise par une pénurie d’offres de prêts. Comment diversifier l’offre de prêt dans ses conditions ? Les grandes collectivités pourraient s’adresser au marché obligataire, comme auparavant, libérant capacités de financement pour les collectivités plus petites, mais l’audition du gouverneur de la Banque de France par la commission des Finances a montré que cette raréfaction de l’offre de prêt n’a pas été encore correctement appréhendée.
M. Jean Proriol. Je ne suis pas convaincu que le système du provisionnement soit facile à intégrer. Dans le secteur privé, vous provisionnez aussi pour diminuer vos impôts. Dans les établissements hospitaliers, j’ai constaté que des tentatives de provisionner le coût des futurs départs en retraite ont été battues en brèche par les autorités de tutelle, qui défendent que rien ne presse. Quels critères proposez-vous pour quantifier la provision ?
M. le président. Je vais complexifier cette question du provisionnement. Comment doit-on l’évaluer ? Par ailleurs, pensez-vous que l’on devrait interdire la souscription de certains produits de la Charte Gissler ? Il est impossible de prévoir les évolutions des taux de change à plus de six mois ; à dix ans, cela peut dépendre de facteurs économiques et géostratégiques. Comment un élu local, quelle que soit sa formation, peut-il prendre des risques pour sa collectivité pour les vingt années à venir ? Ne doit-on pas mettre des barrières parmi les produits structurés susceptibles d’être proposés aux collectivités territoriales ?
M. Alain Levionnois. La question d’une éventuelle interdiction de certains types d’emprunts pose de multiples difficultés.
Les prêteurs voulaient placer leurs produits, leur démarche était commerciale ; les stress-tests n’étaient pas adaptés et les prêteurs considéraient les risques comme inexistants lorsqu’ils ont proposé leur souscription.
Aujourd’hui la courbe des taux étant normale, les produits de pente ne semblent pas poser de problèmes. Mais un retournement n’est jamais à exclure. On ne parle que des produits assis sur le franc suisse, mais cela n’est que le dernier accident, pas le prochain.
M. le rapporteur. Ma question allait plus loin. En cas de difficultés, la collectivité pourra toujours augmenter ses taux d’imposition. C’est le contribuable qui va payer.
M. Alain Levionnois. Depuis 1982, s’il apparaît un déséquilibre dans le budget ou le compte administratif d’une collectivité territoriale, avant de prendre une mesure d’office, le préfet doit saisir la chambre régionale des comptes. Quand cela arrive – rarement, mais notamment récemment à Hénin-Beaumont et au Portel – le surendettement est un facteur d’explication mais pas le seul. La CRC propose alors un plan de redressement, qui ne se limite pas à une augmentation des impôts. Si la loi impose un équilibre des comptes, lorsque la CRC est saisie d’un déséquilibre, elle peut proposer un plan de redressement sur plusieurs années, lorsqu’il n’est pas possible de revenir à l’équilibre dans le même exercice. La règle de l’équilibre ne permet pas de changer le plomb en or ; il nous faut tâcher de revenir à l’équilibre à terme.
M. le rapporteur. Cela revient à ne pas fermer le robinet des intérêts à verser…
M. Marc Larue. Si la collectivité a souscrit certains produits assis sur le cours du yen ou du franc suisse, il est possible d’aménager cette dette pour limiter les frais financiers pendant un ou deux ans, en espérant que le marché s’améliore. Le rapport ne propose pas une structure de défaisance, mais il nous semble possible d’améliorer le traitement actuel, un peu artisanal, de l’encours de dette toxique, étant entendu que les collectivités les plus importantes ne sont pas celles qui en ont le plus besoin. Cela pourrait permettre aux collectivités d’attendre et de saisir les opportunités qui se présenteraient pour sortir de certains produits, alors qu’aujourd’hui le risque joue à plein. Il est donc possible à nos yeux d’améliorer la gestion actuelle du risque sans avoir besoin de créer une structure de défaisance.
M. le président. Aucun d’entre vous, contrôleurs sur le terrain, n’a encore répondu à ma question : doit-on continuer à autoriser aux collectivités de souscrire l’intégralité des produits classés par la charte Gissler, ou faut-il interdire certaines classes de produits aux collectivités ?
M. le rapporteur. Faut-il légiférer ?
M. Alain Levionnois. Quel est le statut de la Charte Gissler ? C’est un accord entre quatre banques et l’Association des maires de France. Mais comme elle fait référence, elle peut être en quelque sorte considérée comme une norme professionnelle par le secteur, ce qui peut de ce point de vue être regardé comme satisfaisant.
Mais comme les prêteurs sont intéressés à la vente de produits structurés, permettant de réaliser de plus fortes marges que les produits proposés dans les années 2000, le compromis trouvé pourrait être amendé. Certains produits pourraient être exclus de la charte. Les produits de pente, avec effet de levier, risquent de basculer un jour : mieux vaut les interdire dès aujourd’hui. Les emprunts adossés sur des indices hors zone euro n’ont pas de justification pour être souscrits par les collectivités, car il y a tout ce qu’il faut sur le marché européen. La complexité ne se justifie pas. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales n’empêche pas que le législateur contrôle et encadre les conditions d’exercice de cette liberté locale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel l’a réaffirmé à de nombreuses reprises : ainsi, sa décision relative à la loi du 2 mars 1982 avait partiellement censuré le texte adopté car il prévoyait que certains actes des collectivités territoriales seraient exécutoires de plein droit. À la suite de cette décision, il a été précisé que les actes seraient exécutoires après publication et transmission au préfet. Il y a donc une place pour le contrôle.
Aussi la loi ou la charte pourrait interdire les produits à effet de levier et assis sur des indices hors zone euro. Nous l’avons écrit et nous le confirmons.
M. le président. Donc vous préconisez bien d’interdire les produits actuellement classés au-dessus de C 3 par la charte Gissler.
M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais. Je vais concentrer mon intervention sur les cas pratiques qui ont été évoqués. Dans le premier cas qui concernerait une collectivité ou un établissement public dont la structure de la dette serait caractérisée par une part importante de produits fortement risqués, il conviendrait d’être à l’affût de toutes les possibilités de renégociation. Il faudrait aussi inverser le rapport de forces avec les établissements bancaires afin d’être en mesure de renégocier dans de bonnes conditions. Enfin, il pourrait être préconisé de souscrire des produits de couverture des risques pris, afin de passer les échéances difficiles.
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu’il est expliqué à un élu que la gestion active de la dette a permis de baisser le coût total de la dette, il y a lieu qu’il se demande à partir de quelles informations ce coût a été défini. Dans l’appréciation de la situation, les risques pris apparaissent-ils vraiment, avec la valeur de marché des produits souscrits ? Les soultes renégociées y figurent-elles ? Il faut intégrer dans le résultat présenté les risques pris et notamment les provisions afférentes.
M. le président. Vous le faites remarquer avec justesse, dans le cas de ma collectivité, il a fallu que je provoque un audit pour avoir un état des risques pris. Au contraire, les fonctionnaires pensaient, de bonne foi, me présenter une bonne nouvelle, avec une dette bien gérée et une économie de 0,8 point.
M. Christian Chapard. Le gestionnaire qui souscrit, signe ou renégocie les contrats devrait avoir une vision des risques et du coût potentiel. Mais pour établir un bilan d’une gestion active de la dette, il faut toutes les données, et notamment les soultes souvent compensées, qui peuvent être demandées aux prêteurs.
Prévoir des provisions, c’est essentiel : ce n’est pas qu’une question fiscale, mais aussi consacrer une part des ressources actuelles pour faire face à des aléas pouvant survenir dans le futur en conséquence de décision de gestion actuelle.
M. Patrice Calméjane. J’aurai deux questions.
Pourriez-vous nous confirmer que les produits swap doivent être provisionnés dans les budgets des collectivités territoriales ? En prenant en compte la situation des petites communes que nous avons auditionnées la semaine dernière, faut-il prendre en compte la taille des collectivités pour déterminer quel type de produits ils peuvent être en droit de souscrire ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Au terme des négociations, il demeurera un volant incompressible d’emprunts structurés. Les collectivités territoriales concernées souhaitent pouvoir transférer ces encours vers une structure de mutualisation qui serait en position de négocier avec les banques, à charge pour elles de rembourser leur quote-part de capital et d’intérêts. C’est un modèle assez différent de celui de la bad bank de Dexia.
M. le rapporteur. Il existe une directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIFID) qui distingue la clientèle professionnelle et non-professionnelle. Les collectivités territoriales sont classées dans cette seconde catégorie. La loi française, par ailleurs, définit l’usure et fixe des taux maximums applicables aux prêts à taux variable. N’est-il pas envisageable de se fonder sur les dispositions existantes pour protéger davantage les collectivités et les citoyens qui, par leurs impôts, leur assurent des ressources ?
M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC Pays de la Loire. Pour répondre à votre question relative au taux de l’usure, je rappelle que ceux-ci sont des taux de marchés majorés.
Je reviens sur l’interdiction des produits structurés. Les raisons du développement des produits structurés sont à rechercher dans le souci des banques au début des années 2000 d’améliorer leur rentabilité alors que leurs marges sur les produits « classiques » proposés aux collectivités locales étaient très faibles, ce qui les a poussées à commercialiser des emprunts structurés, plus rémunérateurs pour elles.
Aujourd’hui, ces produits structurés ne sont plus proposés en l’état par les banques en ce qui concerne les nouveaux prêts. Cependant, la créativité des banques n’a pas ralenti pour autant. Il me semble donc inopérant d’interdire dans la loi certains types de produits risqués qui ne sont plus commercialisés et encore moins d’interdire ceux qui pourraient apparaître dans le futur, le législateur ne pouvant être aussi réactif que les financiers sont créatifs.
M. le président. Le véritable obstacle à la renégociation réside, à mon avis, dans les indemnités de remboursement anticipé et les pénalités de sortie insurmontables qui sont imposées aux collectivités qui tentent de renégocier leurs contrats.
Je rappelle aussi que les représentants des petites communes nous ont expliqué qu’on ne leur proposait pas d’autre type de produits pour leurs emprunts ; la seule proposition qu’on leur faisait était le produit appelé TO-Fix.
Enfin, j’attire l’attention de nos collègues sur l’évolution préoccupante de la parité entre l’euro et le franc suisse. Celle-ci est, pour l’heure, artificiellement contenue à 1,22 par la banque centrale helvétique mais on peut se demander combien de temps celle-ci pourra tenir le cours de sa monnaie.
M. le rapporteur. Je partage le point de vue du Président. Le vrai problème est celui de la soulte demandée aux collectivités désireuses de rembourser leurs emprunts structurés. Ce coût résulte des couvertures souscrites par les établissements de crédit mais dont les collectivités territoriales ne sont pas responsables.
M. Martin Launay. La soulte, comme le problème du stock de dette, est effectivement un obstacle difficilement surmontable pour les collectivités ayant déjà souscrit des emprunts structurés. Il n’y a pas, à cet égard, de solution miracle.
Cette question renvoie d’ailleurs à celle du partage de la responsabilité. Ce n’est pas parce que l’on est incapable d’évaluer le risque lorsqu’on analyse un contrat d’emprunt, que l’on ne peut pas voir qu’il existe un risque dans cet emprunt.
J’ajoute que votre proposition de plafonner au niveau de l’usure le taux des contrats de prêts en cours aboutirait à limiter la rémunération des créanciers et leur occasionnerait des pertes en raison du fait que les banques retournent les positions pour neutraliser le risque dans leur bilan et doivent se refinancer.
M. le président. J’entends vos remarques : ce n’est pas le moment, pour les collectivités de renégocier leurs contrats car le contexte économique ne leur est pas favorable. Mais est-il souhaitable de différer cette renégociation et tenter de gagner du temps ? Cela conduit à transmettre les difficultés au prochain maire pour solder la situation. On a vu que des emprunts avaient été souscrits la veille des élections.
M. Alain Levionnois. L’expression « renégociation d’emprunt » prête à confusion. Elle est souvent comprise de travers, faisant croire qu’il est possible d’alléger la charge d’un emprunt, alors qu’il s’agit d’un reprofilage, d’un agencement différent d’une dette qui reste la même. Le premier rapport public particulier de la Cour des comptes avait attiré l’attention sur ce point dès 1991, et ces phénomènes y sont très bien expliqués. En pratique, l’emploi de ce terme par les professionnels devrait être banni. Et si cela avait un sens, on pourrait même souhaiter qu’il soit interdit par la loi.
L’affaire Dexia est un sujet grave, qui conduit à s’interroger sur le coût de la ressource financière pour les collectivités à l’avenir, car on peut s’attendre à ce que les taux s’élèvent à l’avenir. Les marges bancaires ont déjà augmenté. De plus, le coût des ressources bancaires est majoré par le taux des CDS qu’elles doivent acheter pour garantir leurs prêteurs. Le marché interbancaire est aujourd’hui très dégradé. En outre, la mise en œuvre des dispositions sur les ratios de liquidité de l’accord de Bâle III va contribuer à majorer le coût du crédit. La dette des collectivités s’est à nouveau mise à augmenter, son coût va se renchérir.
On peut certes allonger les durées de remboursement, mais on ne peut penser que l’on fera des économies. L’idée de caper les taux par la loi se heurte peut-être à un problème de constitutionnalité ; il faudrait l’étudier ; cela aurait en tout cas des conséquences importantes sur le marché financier, qui ne le supporterait sans doute pas.
Les contrats de prêts des collectivités ne sont pas des contrats relevant du droit administratif, domaine dans lequel l’autorité publique peut, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, résilier unilatéralement le contrat sous réserve de dédommagements. Si l’on s’inspirait de cette idée pour encadrer les conditions de l’offre de prêt, dans le cadre du droit privé, l’opération serait déséquilibrée, ce qui découragerait les banques de prêter, ou bien elles se prémuniraient en facturant leur manque à gagner éventuel d’une autre manière. On ne voit pas là de solution, c’est pourquoi la règle de la provision présente des avantages.
La règle d’or de l’équilibre budgétaire des collectivités présente un inconvénient : elle joue sur une année mais n’intègre pas de pluri annualité. Or l’emprunt est une recette nette qui équilibre le budget de l’année mais c’est aussi une dépense future. Cette présentation masque la réalité des budgets futurs, qui présenteront des dépenses alourdies de frais financiers. Un emprunt d’une durée de quarante ans a des conséquences sur les comptes jusqu’en 2050 ! Le système de la provision, que la Cour a préconisé déjà trois fois, remédierait à cette faiblesse de la loi relative à la présentation des comptes des collectivités. Nous sommes conscients du fait que le principe du provisionnement obligatoire (réglementé) a soulevé des réticences. Par exemple, une première version de la réglementation M 14, apparue en 1996, prévoyait une provision pour différé d’amortissement applicable aux emprunts obligataires. Ce système a été abandonné en 2006 ; toutes les provisions réglementées ont été supprimées, et il ne reste plus que des provisions pour risques et charges. Il nous paraît utile de prévoir un complément au système actuel pour améliorer la fiabilité et la sincérité des comptes.
M. le président. Je vous remercie pour les nombreuses informations et idées qui ont été émises, dont le rapporteur fera certainement un grand usage.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Les produits financiers à risque », avec la participation de Me Alban Caillemer du Ferrage, avocat associé au cabinet Gide, spécialiste des produits dérivés et des financements structurés ; M. Olivier Nys, directeur général des services de la ville de Reims et de Reims Métropole, directeur du master « management des collectivités locales » à l’IEP de Lyon ; M. Christophe Parisot, directeur des finances publiques de Fitch ratings France.
(Procès-verbal de la séance du mardi 18 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous entamons un nouveau cycle d'auditions qui doit permettre à notre commission d'enquête de comprendre le fonctionnement des produits structurés et d'appréhender la relation commerciale qui lie les collectivités territoriales à leurs créanciers. Mieux informés de ces enjeux, nous auditionnerons ensuite les dirigeants des établissements de crédit. Nous aurons notamment l'occasion d'entendre les équipes dirigeantes de Dexia – l'actuelle et l'ancienne. Je note à ce sujet que nos travaux sont d’une pleine actualité : hier, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances rectificative relatif à Dexia, nous avons largement débattu d'emprunts structurés. Il est en effet prévu une garantie de l'État contre d'éventuelles pertes liées à la restructuration de portefeuille de prêts aux collectivités locales françaises détenu par DexMA, à concurrence de 6,65 milliards d'euros et après franchise. Pour la première fois, le Gouvernement admet implicitement que les établissements de crédit ayant consenti des prêts structurés ne recouvreront pas l'intégralité de leur créance ; jusqu'alors, les préfets avaient pour consigne de s'opposer à toute défaillance d'une collectivité et d'inscrire d'office dans les budgets locaux les annuités d'emprunts même toxiques. Je veux y voir une prise de conscience.
Pour approfondir notre connaissance des mécanismes financiers, j'ai souhaité que nous prenions le temps de décomposer le fonctionnement des produits structurés. À cette fin, nous accueillons Me Alban Caillemer du Ferrage, avocat associé au cabinet Gide, spécialiste des produits dérivés et des financements structurés ; M. Olivier Nys, directeur général des services de la ville de Reims et de Reims Métropole, directeur du master « Management des collectivités locales » à l'IEP de Lyon ; M. Christophe Parisot, directeur des finances publiques de Fitch ratings France. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner devant notre commission d'enquête.
(M. Alban Caillemer du Ferrage, M. Olivier Nys et M. Christophe Parisot prêtent successivement serment).
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Après avoir longuement entendu les contractants d’emprunts structurés, nous cherchons à mieux comprendre le mécanisme de ces produits. Je vous poserai donc des questions précises auxquelles je souhaite des réponses qui le soient tout autant. Monsieur Alban Caillemer du Ferrage, les établissements de crédit qui consentent aux collectivités territoriales des emprunts structurés doivent couvrir leur risque ; quels sont les instruments de couverture utilisés ? L'indemnité demandée par la banque en cas de remboursement anticipé d’un emprunt structuré est toujours prohibitive, et c’est pourquoi les collectivités ne parviennent pas à se défaire de ces emprunts : cette indemnité extravagante est-elle liée au coût de la couverture ? Sinon, quelle est sa justification économique ?
Depuis la crise bancaire de 2008, on a beaucoup parlé de titrisation de créances. Les emprunts structurés consentis aux collectivités locales ont-ils servi de sous-jacents à des opérations de titrisation ? Ce type de titrisation a-t-il été pratiqué à grande échelle et quelles en sont les conséquences ?
La directive européenne de 2004 sur les marchés d'instruments financiers (MiFID), transposée en droit français, classe les collectivités territoriales dans la clientèle « non professionnelle ». Quelles conséquences emporte cette catégorisation ? Des produits de marché comme les emprunts structurés pouvaient-ils être librement commercialisés à une clientèle non professionnelle ?
M. Alban Caillemer du Ferrage. Les banques sont des intermédiaires. Elles se couvrent auprès d’autres établissements de crédit en prenant des positions symétriques à celles qu’elles ont vendues à leur client. Les banques, en principe, n’ont pas vocation à conserver dans leur bilan – sauf si elles ne trouvent pas sur le marché une contrepartie leur permettant de sortir de ce risque – une position économique qui joue contre ce client. Elles s’adressent, sur le marché, aux grandes contreparties telles que Goldman Sachs, la Société générale ou la BNP, gros acteurs du marché des produits dérivés ; trouvent pour ce produit dérivé le prix qu’emballe le crédit consenti à la collectivité ; appliquent évidemment la marge commerciale normale de tout acteur économique ; concluent l’opération avec la collectivité.
En principe, le business model est que les indemnités de remboursement anticipé s’évaluent au jour le jour en fonction du mark-to-market. En principe, un emprunt fondé sur un produit dérivé est conclu « à la monnaie » : il n’a pas, à la seconde où il est traité, de valeur particulière. Quand on traite du change entre l’euro et le franc suisse, on le traite à la parité de ces deux devises à la seconde où l’on traite ; une seconde après cette opération, en fonction de l’évolution du franc suisse par rapport à l’euro, il y a gain ou perte. C’est le mark-to-market, autrement dit l’évaluation au prix du marché : l’évolution du taux de change fait évoluer la valeur de la position économique des contractants, mais l’engagement reste le même. En principe, l’indemnité de remboursement anticipé, c’est la contre-valeur économique de ce contrat au moment où l’on décide d’arrêter l’opération. En principe encore, quand une banque, ou une collectivité, ou un client demande à une banque de mettre fin à son contrat de manière anticipée, celle-ci se tourne vers les contreparties avec lesquelles elle avait elle-même traité les opérations de couverture, leur demande un prix pour dénouer ce contrat et répercute ce prix au client, augmenté du coût de réemploi des fonds pour la période d’intérêt au cours de laquelle le remboursement s’effectue. En effet, pour consentir le financement, la banque s’est elle-même refinancée, s’engageant pour cela sur une période plus ou moins longue afin de s’assurer la ressource financière nécessaire à la conclusion de ce prêt. Voilà quels sont, en principe, les coûts de dénouement qui constituent l’indemnité de remboursement anticipé.
Cette indemnité est-elle prohibitive ? Elle peut être effectivement considérable car l’opération de produit dérivé se caractérise par un aléa et un effet de levier, si bien que les prises de risque ne sont pas forcément proportionnelles à l’investissement initial : vous vous exposez au taux de change entre l’euro et le franc suisse à un niveau qui est sans rapport avec l’investissement initial demandé. C’est la différence entre un produit dérivé et un investissement réel. Mais, en principe, l’indemnité de remboursement reflète exactement la valeur de marché à cette date. Si ces indemnités peuvent apparaître prohibitives, c’est qu’elles n’ont jamais été reflétées dans la comptabilité des collectivités locales. Le plan comptable des collectivités territoriales n’impose pas, à la différence de ce qui vaut pour les sociétés commerciales, de faire ressortir à chaque arrêté de comptes la valeur de ces opérations en mark-to-market. Si, dès la première seconde, on avait constaté que la valeur des contrats était légèrement décalée par rapport aux anticipations et que la situation s’était dégradée, il y aurait peut-être eu une alerte et de ce fait une prise de conscience plus rapide, et sans doute un moindre sentiment que le montant des indemnités de remboursement sont prohibitives – des indemnités qui, encore une fois, reflètent une valeur de marché.
M. le rapporteur. Ces précisions éclairent la mécanique à l’œuvre en coulisse, et qui, parce qu’elle demeure mystérieuse, empêche de comprendre pourquoi on ne parvient pas à trouver de solution.
M. Alban Caillemer du Ferrage. Sur le plan juridique, ce qui se passe en coulisse est hors du champ contractuel. Encore une fois, les banques, qui jouent un rôle d’intermédiaire, n’ont pas vocation à prendre position contre un client. Si une banque demande à un client de payer une soulte de 100, c’est qu’elle-même doit à sa contrepartie de swap l’équivalent de 100.
Le marché de la titrisation, singulièrement depuis juillet 2007 et la suspension de la cotation d’un nombre d’OPCVM, s’est singulièrement asséché. M. Claude Bartolone a eu raison de rappeler la décision prise pour Dexia et les sociétés de crédit foncier. Une société de crédit foncier est en soi un véhicule de titrisation puisqu’il agrège des actifs dits « privilégiés » qui servent de gage au remboursement des obligations foncières. C’est un des segments du marché obligataire qui a le mieux fonctionné au cours des dernières années, et c’est une spécificité française à laquelle nous tenons particulièrement. Or il se trouve que sont éligibles à l’actif d’une société de crédit foncier – dont Dexia a dans son groupe un des plus gros émetteurs – deux types d’actifs : les crédits hypothécaires consentis à la clientèle de ces établissements de crédit d’une part, d’autre part les créances sur les collectivités territoriales, y compris les crédits toxiques. Une des raisons qui fait que la garantie donnée par l’État à Dexia a la caractéristique très particulière de porter non seulement sur le passif de l’établissement mais aussi sur les actifs qu’elle porte en collatéral : les obligations qu’elle a émises. Il s’agit donc d’une gigantesque titrisation. Les enjeux de la titrisation des cover bonds privés et des sociétés de crédit foncier sont donc considérables.
M. le président. Vous avez détaillé la mécanique vue du point de vue de la banque. Nous aimerions aussi avoir votre avis sur le scénario qui a été suivi, conformément auquel les collectivités locales ne se sont pas entendu proposer par les banques des produits adaptés à leurs besoins spécifiques mais les mêmes produits au même moment - ainsi des contrats fondés sur l’évolution du taux de change entre l’euro et le franc suisse, qui ont été proposés à la chaîne. De nombreux témoignages nous ont montré qu’en fait de conseil personnalisé, le même risque a été proposé à toutes les collectivités territoriales, indépendamment de leur taille et de leur situation. Cela ne traduit-il pas un problème dans la relation entre banques et clients ?
M. Alban Caillemer du Ferrage. L’intégration dans le champ contractuel de la préoccupation sur la sophistication de l’interlocuteur ou de la complexité du produit ne tient pas tant au choix du sous-jacent qu’aux caractéristiques données au produit : lorsque vous êtes exposé au taux de change euro/franc suisse, est-ce avec ou sans effet de levier ? Prévoyez-vous un cap, des barrières activantes ? Il existe une graduation et le sous-jacent est assez neutre. En revanche, pour les collectivités territoriales, il faut s’attacher à traiter avec les produits les plus liquides possible ; à cet égard, s’il y a eu convergence des produits vendus, c’est plutôt une bonne chose, car cela signifie qu’ils sont plus liquides que les produits plus exotiques, pour lesquels il est plus difficile de trouver un prix de dénouement : plus nombreux sont les opérateurs sur un même produit, plus facile il est de déterminer un prix et de trouver une contrepartie pour retourner la position le jour où on le souhaite. Il est indispensable de ne pas être l’acteur unique pour un produit unique, sous peine de ne trouver aucune contrepartie pour le défaire le jour où vous le souhaitez – et, dans ce cas, la collectivité est pénalisée.
M. Henri Plagnol. Je suis maire d’une commune qui a, hélas, contracté beaucoup de ces emprunts avant mon élection. Or mes interlocuteurs bancaires – Dexia en particulier – m’expliquent qu’ils ne peuvent pas faire grand-chose, les créances sur ma ville ayant, comme vous l’avez expliqué à l’instant, été revendues, souvent simultanément à la signature des contrats. Pire encore : Dexia s’est engagé vis-à-vis des institutions financières auxquelles ces actifs ont été cédés à compenser, par un mécanisme de swaps ou d’assurance, la différence qui apparaîtrait si jamais le mécanisme initial de ces prêts ne s’appliquait pas. Cette question est de la plus haute importance pour les collectivités, et aujourd’hui pour l'État qui, pour rassurer la Caisse des dépôts, a donné sa contre-garantie sur ce type de produits toxiques. Pouvez-vous nous expliquer dans un langage intelligible ce qui a conduit Dexia à agir de la sorte, et comment prêteurs et emprunteurs peuvent maintenant sortir de ce piège ?
M. Michel Diefenbacher. Vous avez centré vos réponses sur le risque encouru par la banque du fait des mécanismes de refinancement, mais vous avez très peu évoqué l’analyse du risque lié à la situation financière de l’emprunteur. Est-ce à dire qu’un prêt fait à une collectivité est sans risque car les collectivités sont obligées de rembourser cette dépense obligatoire et que si elles ne le font pas il peut y avoir inscription et mandatement d’office ? Si le raisonnement est celui-là, le risque est de considérer qu’une collectivité peut augmenter ses impôts à l’infini pour rembourser ses emprunts. N’y a-t-il pas eu une sous-évaluation manifeste, par les banques, de l’attention qu’elles devaient porter à la capacité de remboursement des collectivités ?
M. Dominique Baert. Les swaps, qui sont aussi des produits structurés, ont souvent été empilés, et ils étaient souvent d’une toxicité croissante. Que pensez-vous des opérations, souvent proposées par les banques, conduisant à multiplier swap sur swap ? Nous avons eu connaissance de formules à 5 ou 7 swaps successifs, qui font que l’on en arrive finalement à un taux d’intérêt supérieur à ce qu’il aurait été si l’on en était resté au prêt primaire ! Pensez-vous qu’il y ait un seuil optimal de swap ? Surtout, si l’on ne veut pas faire ressortir la valeur mark-to-market, souvent très importante mais virtuelle, dans les comptes des collectivités locales, comment peut-on dénouer sans trop de douleur ces prêts toxiques ?
M. Alban Caillemer du Ferrage. Cette dernière question est de toutes la plus difficile…
Je souhaiterais que M. Plagnol veuille bien préciser ses propos relatifs aux engagements pris par Dexia. En tout cas, on ne peut faire référence à des assurances, car en droit français une assurance ne donne de droit à son acquéreur que lorsqu’il a effectivement subi une perte économique ou un préjudice. Ce n’est pas le cas avec les produits dérivés, dont le profil de paiement est commandé par des paramètres de marché qui ne sont pas fonction des pertes économiques causées : on est rendu créancier ou débiteur d’un produit dérivé indépendamment des obligations contractées par ailleurs à l’égard d’un tiers.
Il ne faut pas présenter ce qu’a fait Dexia comme on le fait habituellement : ce n’est pas Dexia qui vend le produit le plus exotique possible à son client et qui essaye ensuite de le revendre sur le marché. En termes strictement économiques – et le droit n’est malheureusement pas l’outil le mieux adapté pour restituer cette réalité économique -, il y a d’un côté un financement consenti à des conditions parfaitement normales de marché – ce qui me conduira à parler ensuite du rating des collectivités locales et de la raison pour laquelle ces conditions ont été celles-là – et, d’un autre côté, on va chercher, par le jeu d’une compensation entre les primes d’acquisition des options et les paiements d’intérêts dus par la collectivité pour le financement qui lui est consenti, à réduire par un effet mécanique, car les banquiers ne sont pas des magiciens, cette charge d’intérêt. Cela signifie que si les intérêts ne sont pas payés, c’est parce que la collectivité a vendu quelque chose à quelqu’un qui le lui a acheté. Cette « autre chose » est une opération de produit dérivé qui elle-même a été acquise à son prix normal de marché et revendue à quelqu’un d’autre, généralement celui qui l’a élaborée, sur le marché très liquide du change franc suisse-euro par exemple.
Ce jeu d’assemblage est composé à partir d’éléments de base très simples qui ont chacun un prix, et je ne crois pas que dans les indemnités demandées il y ait des différences fondamentales, sauf à dire que les établissements de crédit ne seraient pas couverts correctement, ce qui ne doit pas se produire. Mon expérience de vingt ans m’a montré que c’est ainsi que s’exerce le métier de banquier, qui est un métier d’intermédiation.
Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre aux questions portant sur l’analyse des risques. Je rappellerai simplement que si le sujet des emprunts structurés est considérable et très préoccupant, il ne constitue pas un problème systémique pour la France. Le rapport thématique de la Cour des comptes indique d’ailleurs que « l’endettement public local représente une part relativement faible de la dette publique et que « sur une longue période, son poids dans le PIB n’a pas progressé malgré les transferts de compétences ». En moyenne, la charge financière de la dette locale pèse moins de 3 % des dépenses de fonctionnement. De ce fait, et aussi parce qu’à la différence de ce qui s’est passé dans beaucoup de pays voisins nous n’avons connu pratiquement aucune insolvabilité ou défaut de paiement, les collectivités locales bénéficient tout naturellement aujourd’hui en France des meilleures notations de crédit quant à leur qualité d’émetteur.
Les banques ont-elles surestimé la capacité des collectivités territoriales à faire face à leurs obligations au terme de ces opérations ? Aujourd’hui, peu de sociétés commerciales et même d’États ont encore la notation triple A, comme l’ont Paris, la Région Rhône-Alpes ou la Région Ile-de-France ! Les notations des collectivités sont généralement assez bonnes. Quant aux établissements publics, ils bénéficient d’une garantie implicite de l'État, qui lui-même bénéficie de la notation triple A. Je ne pense donc pas que les établissements de crédit aient surestimé les capacités de remboursement. En revanche, cette excellente notation peut expliquer pourquoi les établissements de crédit ont recherché cette clientèle-là : étant donné la réglementation prudentielle, les contrats conclus avec ces opérateurs sont moins chargés sur le plan du capital réglementaire que des opérations conclues avec un corporate standard. Mais qui voudrait vendre sa voiture à un insolvable ? On cherche forcément à traiter avec les entités qui bénéficient de la meilleure notation.
Pour répondre à M. Baert, j’aimerais m’assurer d’avoir correctement compris sa question.
M. Dominique Baert. Pourquoi les swaps proposés pour réaménager la dette contiennent-ils au moins autant d’éléments toxiques que les emprunts initiaux ?
M. Alban Caillemer du Ferrage. Cela s’explique par le mécanisme de couverture des banques. Quand un établissement de crédit se couvre d’un produit dérivé vendu à un client, il ne conclut pas une opération unique avec un intermédiaire ; il décompose en autant d’éléments de base traités sur les marchés de la manière la plus liquide possible les sous-éléments constituant le service qu’il a offert à son client. C’est pourquoi chaque élément de la couverture pris individuellement peut parfois paraître plus simple que l’opération globalisée vendue au client. Cela ne change rien sur le plan économique.
Quant à l’empilage des swaps, que la Cour des comptes qualifie de « fuite en avant », il est exclusivement le fait des opérations de restructuration et il est commandé par des impératifs économiques. Si les contrats ont été valablement conclus, il faut bien trouver une manière de payer les soultes dues, et pour cela restructurer les emprunts en faisant conclure à la collectivité considérée de nouvelles opérations fondées sur des sous-jacents moins risqués que les premiers mais dont la valeur d’acquisition est suffisante pour permettre à la collectivité de se défaire des prêts initiaux en vendant quelque chose de nouveau ; seuls les swaps le permettent.
Une des pistes à explorer serait de confier l’indexation ou le portefeuille de swaps à un acteur indépendant qui gérerait ces opérations de manière dynamique. Il est impératif que cela soit des produits dérivés, parce qu’on ne peut pas battre le mark-to-market, qui est la valeur économique objective sur laquelle se fait le consensus de marché. Si l’on veut l’indemniser, la payer ou l’amortir, il faut trouver d’autres produits qui permettent de le faire.
Pour répondre à la question de M. le rapporteur relative aux conséquences du classement des collectivités territoriales dans la clientèle « non professionnelle » au regard de la directive MiFID, à ma connaissance une seule disposition de notre droit interdit la vente de certains produits : c’est l’article 341-10 du code monétaire et financier qui exclut du démarchage « les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ». Cela étant, le fait d’être ou de ne pas être un professionnel ne conditionne pas la capacité à conclure ; il conditionne en revanche la mise en cause de la responsabilité des prestataires de services d’investissement ou des prestataires bancaires, sans qu’il y ait là rien de spécifique aux collectivités territoriales. Par l’arrêt Buon rendu le 5 novembre 1991, la Cour de cassation a institué un devoir d’information sur les risques encourus qui prend en compte la sophistication du client et la complexité du produit. C’est sur ce terrain qu’il faut se placer pour apprécier la situation des collectivités territoriales, qui ne constituent pas un ensemble homogène : je ne pense pas que l’on ait tout à fait les mêmes interlocuteurs selon que l’on s’adresse à la commune de Saint-Barthélémy-d’Anjou citée dans le rapport de la Cour des comptes ou à la Région Ile-de-France. Selon les principes du droit français, on doit paramétrer ces obligations d’information. La jurisprudence est très claire à ce sujet : cela va d’une obligation d’information à un devoir de conseil et jusqu’à un devoir de mise en garde dans certaines situations. Une graduation s’impose en fonction de l’interlocuteur, et sans faire d’angélisme, car certaines collectivités territoriales sont de très gros acteurs très sophistiqués. Il faut donc faire preuve de beaucoup de pragmatisme.
M. Jean Proriol. La directive MiFID, qui définit les collectivités territoriales comme une clientèle non professionnelle, doit s’appliquer ; or, vous sous-entendez que l’on ne s’en sert pas. Par ailleurs, et même si ce n’est pas du droit écrit, les banques n’ont-elles pas des obligations déontologiques à l’égard de leurs clients, sachant que ceux-ci ne sont pas des professionnels des marchés financiers ? N’y a-t-il pas eu des défaillances à ce sujet ?
M. Alban Caillemer du Ferrage. S’il y a eu des défaillances, c’est aux tribunaux qu’il revient d’en juger ; et si j’ai pu laisser penser que les catégories définies dans la directive MiFID ne sont pas appliquées, c’est que je me suis mal exprimé ; mais si la charte Gissler demande que les établissements de crédit signataires reconnaissent que leur interlocuteur est un non-professionnel, c’est parce que ce qu’impose la directive est beaucoup moins contraignant. Pour ce qui est de la violation des obligations déontologiques, il n’est pas de semaine où une jurisprudence ne condamne, ou ne condamne pas, un établissement bancaire pour ce type de grief. C’est le seul terrain où l’on doit se placer aujourd’hui : quand il y a une difficulté, il faut déterminer s’il y a eu manipulation et manœuvre, ou si l’on cherche à sortir à bon compte d’un contrat signé en connaissance de cause.
M. Olivier Nys. Il faut savoir que la plupart des grandes collectivités françaises, sollicitées par les salles de marché ou par leur banquier pour se déclarer professionnelles ou non-professionnelles, ont signé une attestation par laquelle elles se reconnaissent « professionnelles ». C’est ce qui explique la position adoptée dans la charte Gissler, qui oblige aujourd’hui à les dire « non professionnelles ». Mais, devant les tribunaux, les collectivités qui ont signé une attestation de ce type seront délégitimées.
J’en viens à la question de la déontologie. Il faut se rappeler qu’il s’agit avant tout d’un marché commercial extraordinairement rentable et très concurrentiel ; de surcroît, c’est un segment bancaire unique car sans risque pour le banquier. Sur le marché de l’entreprise ou du particulier, le banquier qui prête prend le risque de ne jamais recouvrer sa créance ; sur celui des collectivités locales, il n’y a jamais eu aucune défaillance majeure. C’est donc un marché de prix, où il faut apparaître comme le moins-disant. Les problèmes déontologiques relèvent moins de la sphère financière que de la sphère commerciale puisque entre les banquiers et les décideurs locaux, une relation commerciale particulièrement agressive et très travaillée a été mise en place. Les établissements rivalisaient d’entregent auprès des décideurs locaux. Dexia, en particulier, avait une politique de relations publiques de très grande qualité, mais limite. À titre d’illustration, Dexia a organisé un voyage de quatre jours à Rome, entièrement défrayé, pour tous les décideurs du grand Sud-est – essentiellement les directeurs généraux, non les directeurs financiers – pour leur faire visiter sa filiale italienne. Quand on prend connaissance des contrats conclus dans la foulée par Dexia auprès des collectivités invitées, on constate qu’ont été signés de très grands emprunts, bien margés et donc très rentables, sans mise en concurrence. De même, Dexia invitait chaque année pour deux jours au Festival d’Avignon, dont il était le principal sponsor, les principaux décideurs territoriaux, élus et directeurs généraux des services – on évitait aussi les directeurs financiers –, les logeant dans le plus bel hôtel de la ville et les restaurant à des tables étoilées. Les questions déontologiques sont là, mais elles valent pour tous : ceux qui proposent comme ceux qui acceptent et qui peuvent être tentés de renvoyer l’ascenseur. C’est d’un marché commercial que l’on parle ; il ne s’agit donc pas tant de prix et de technique financière que de relationnel.
M. le président. Vous signalez une grande agressivité commerciale. Mais sur quoi portait la concurrence ? Il était très difficile, en lisant les contrats, de voir en quoi une offre se distinguait d’une autre. Le piège était dans la présentation, le seul taux permettant une comparaison étant celui du prêt bonifié consenti les premières années.
M. Olivier Nys. On est là au cœur de l’extraordinaire guerre commerciale entre les banques. L’ensemble des prêts à taux variable vendus depuis 2005 l’ont été à perte : tout reposait sur la capacité à réaménager et à réinstaurer une marge. Dès 2006, j’avais écrit un article à ce sujet dans la Gazette des communes, en recommandant aux communes d’accepter une marge et de ne pas emprunter au taux Euribor majoré de 0,01% ou 0,02%, car un taux aussi faible signale un prêt fait à perte, et le prêteur voudra reconstituer sa rentabilité. Pour ce qui est des prêts structurés, le sommet de ceux qui ont été commercialisés en France, c’est un prêt sur quarante ans dont vingt ans à taux nul et vingt ans avec une option qui ne s’est pas encore déclenchée mais qui se déclenchera un jour ; on imagine le risque pris ! Mais c’est irrésistible pour un profane, ou quand on sait que l’on laissera à ses successeurs le soin de se débrouiller de tout cela. Il s’est agi avant tout d’une guerre commerciale qui a entraîné une escalade dans la prise de risques, à l’aide d’un marketing très élaboré. La puissance de feu des banques est grande, leur force de conviction tout autant.
J’ai été banquier en 2000-2001, à la Caisse d’épargne. J’ai quitté le milieu bancaire pour en dénoncer les dérives quand j’ai vu émerger les produits structurés et compris que les dés allaient être définitivement pipés : alors que, dans les années 1990, le décideur local et le banquier étaient sur un pied d’égalité, le premier pouvant comparer les offres et choisir le moins-disant, c’est devenu impossible à partir des années 2000 ; la concurrence était faussée. De facto, ce milieu devenait biaisé. Chez Dexia, il y a beaucoup d’anciens fonctionnaires très introduits – voyez son président et aussi le n° 2. Dexia a été une extraordinaire machine de guerre. À titre d’illustration, l’établissement ne laissait rien au hasard, finançant les colloques territoriaux ou les associations professionnelles à travers un fonds d’investissement. Dexia a été propriétaire du groupe Le Moniteur qui publie la Gazette des communes ou le Courrier des maires. Force est de constater que, durant cette période, les dossiers concernant la gestion de dette contenaient systématiquement la position de Dexia.
Dexia verrouillait très bien le champ de sa clientèle, mais aussi les pouvoirs réglementaires, puisque la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et la comptabilité publique, alertées depuis des années sur la dérive du marché du financement des collectivités locales, n’ont jamais pu intervenir et n’ont jamais modifié le cadre comptable, complètement suranné et déconnecté de l’évolution de la dette. À un moment, Dexia avait créé tous les verrous possibles pour dérouler sa stratégie.
M. le rapporteur. Monsieur Parisot, quel intérêt les banques ont-elles à commercialiser des emprunts structurés plutôt que des prêts à taux fixe ou variable ? Comment expliquer qu’à un moment donné des collectivités qui avaient souscrit des emprunts de longue durée à taux fixe ont transformé cet encours en emprunts structurés ? Pour les banques, le coût en fonds propres de ce type d'emprunts est-il le même que celui de prêts à taux fixe ?
M. Christophe Parisot. Les collectivités locales constituaient une clientèle captive et peu risquée, si bien que les marges rémunérant ce risque ont été très faibles pendant un moment. Dans ce contexte, les banques ont cherché à restructurer plusieurs fois le même encours en proposant des produits propres à optimiser leur compte de résultat. Mais si les banques ont commercialisé ce type de prêts plutôt que des prêts à taux fixe, c’est que les collectivités y trouvaient aussi leur intérêt. La charge financière d’une collectivité figure parmi les ratios réglementaires et les agences de notation les observent également. Le coût de la dette est un des éléments importants qui permettent de juger de la qualité de crédit, de la solvabilité et de la compétence de gestion d’une collectivité. Ce qui est effectivement troublant, c’est que ces produits différaient à une période bien ultérieure la survenue de risques, des risques qui de surcroît ne dépendaient pas intrinsèquement de la collectivité considérée mais de scénarios de marchés. Les collectivités ont besoin d’emprunter, et très peu ont une surface financière suffisante pour choisir des emprunts obligataires. Le marché bancaire étant prédominant et ces produits n’ayant pas été interdits par la circulaire de 1992, les collectivités, clientes captives, les ont utilisés.
S’agissant des fonds propres, les banques courent un risque de crédit sur les prêts qu’elles consentent aux collectivités locales. Il est difficile pour le législateur de savoir quel est le niveau de risque sur les produits dérivés volatils que les banques proposent aux collectivités. Les normes « Bâle II » qui prévalent, mesuraient, pour les banques, le risque supplémentaire lié aux swaps et autres produits dérivés, réalisés en plus des prêts.
Les collectivités locales représentaient, dans ces produits, un risque de crédit en capital qui était le nominal du prêt pour la banque. Une formule avait été trouvée pour quantifier l’équivalent crédit représenté par le produit dérivé intégré dans le package du prêt aux collectivités locales ; il était fonction du nominal du prêt : par exemple, 2 points de base du nominal qui était de 100. Le volume de risque pour les banques n’était pas du tout le même que pour le risque de crédit, à telle enseigne que les normes Bâle II pondéraient les prêts aux collectivités locales à 20 % en France et beaucoup moins pour les swaps, le régulateur jugeant ce risque bien plus faible que le risque de crédit. Les fonds propres engagés par les banques sur les produits dérivés étaient donc vraisemblablement beaucoup plus faibles.
M. le rapporteur. Peut-on estimer quelle fut l’augmentation des marges bancaires grâce aux emprunts structurés ?
M. Olivier Nys. Tout produit financier étant coté, il suffit de connaître le mark-to-market pour en détecter la marge. La banque est une activité commerciale : il existe un marché sur lequel on achète et on vend. Les marges reconstituées sur les produits structurés ont pu monter jusqu’à 150 voire 200 points de base, très tôt. Ainsi la Chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a-t-elle dénoncé l’épisode suivant. En 2001, le conseil général de l’Ain a réaménagé ses encours sur Euribor, qui étaient en moyenne à 0,10. Il lui est alors proposé une restructuration fondée sur le Pribor – le taux interbancaire offert à Prague ! Le réaménagement est fait avec une marge de moins 0,50, et l’on explique au conseil général de l’Ain que la République tchèque rejoindra sous peu la zone euro et que le Pribor deviendra alors l’Euribor, si bien que la collectivité paiera bientôt Euribor moins 0,50. Tout cela fait l’objet d’une délibération dont le contrôle de légalité ne s’émeut pas.
À l’époque, je suis banquier et je demande à ma salle de marché combien vaut exactement le produit commercialisé : la réponse est : « Pribor -1,50 % »… La banque, en revendant le produit à Pribor - 0,50 %, gagnait donc 100 points de base – le tout en partant d’un encours initial à 0,10 % ! Or, cela se passait en 2001 ; on imagine combien, depuis lors, la sophistication et les marges ont augmenté. Les cours régionales des comptes se sont efforcées de chiffrer la marge reconstituée par les banques à partir d’une restructuration : elles étaient régulièrement comprises entre 0,50 % et 0,60 % mais, parfois, des marges de 200 points de base ont été atteintes. Cette rentabilité s’est traduite dans les comptes des banques : longtemps – de 2003 à 2006 – Dexia a été la plus rentable de toutes, avec un taux de retour sur fonds propres supérieur à 20 %.
M. Dominique Baert. Monsieur Parisot a mentionné l’intérêt légitime des collectivités territoriales à voir baisser leurs charges financières et souligné que les agences de notation étaient elles aussi attentives à l’évolution des charges d’intérêt. Dans ce cadre, leur myopie persistante face à cette forme de gestion de la dette n’est-elle pas troublante ? Année après année, elles se sont limitées à féliciter les collectivités d’avoir allégé ainsi le poids de leur charge financière…
M. le président. Monsieur Nys, quelles sont, selon vous, les limites de la classification retenue dans la charte Gissler ? Comment justifier que demeurent autorisés les prêts basés sur des index hors zone euro, ou certains snowballs ? D’autre part, les marges cachées, condamnées par la Cour de Karlsruhe, ne vont-elles pas entraîner des difficultés dans les relations contractuelles entre les banques et les collectivités territoriales ?
M. Olivier Nys. La charte Gissler est largement insuffisante – je l’ai écrit dans un article intitulé « Banques : une charte pour rien ». La lacune principale de la charte est qu’elle ne fixe pas un taux plafond pour tout produit vendu à une collectivité territoriale. Le ferait-on que l’on sécuriserait tous les produits : pour les swaps, les réaménagements et les emprunts nouveaux, la prise de risque et la bonification seraient circonscrites. La barrière de taux tout au long de la vie du prêt est la seule garantie que le marché sera régulé. M. Gissler, que l’ai eu l’occasion de rencontrer, m’a semblé convaincu, mais une charte se négocie et il n’a pu imposer cette clause aux banques. C’est ma préconisation principale.
M. le président. Il conviendrait donc de supprimer tout risque supérieur à C3 ?
M. Olivier Nys. Peut-être. Si le taux de l’emprunt est plafonné, libre à la collectivité de prendre pour base ce qu’elle souhaite. C’est le niveau du risque qui compte, mais la charte n’en dit mot : elle n’évoque que les formes du risque, si bien qu’une interprétation maligne permettrait de reconstituer un risque important. C’est une première étape intéressante, mais le texte est indéniablement perfectible.
M. le rapporteur. Comment traiter le stock des créances structurées ? Vous paraît-il envisageable de "capper" par la loi des prêts déjà souscrits - par exemple en étendant la notion d'usure pour qu’elle s’applique aux collectivités territoriales, clientèle non professionnelle ? Par ailleurs, faut-il rendre obligatoire le provisionnement de ces risques dans les comptes des collectivités ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Que pensez-vous de la création éventuelle d’une structure de défaisance ?
M. Christophe Parisot. Les collectivités locales ne sont pas tenues de provisionner les risques liés à la dette. Il serait prudent que, comme les entreprises, elles provisionnent le risque latent résultant d’un stock de dette certaine pour lequel les évolutions du marché peuvent rendre très difficile l’évaluation à long terme de la charge financière. Elles y gagneraient en crédit et ce serait une mesure de bonne gestion. Quant à la création d’une structure de défaisance, c’est une décision qui relève de la puissance publique en tant que régulateur. Il y a un prêteur et un emprunteur, qui doivent trouver une solution ; s’ils n’y parviennent pas, un deus ex machina doit intervenir en apportant une garantie ou en absorbant une partie des pertes.
M. Olivier Nys. La liquidation du stock de dette est une affaire très compliquée. Beaucoup a déjà été résolu car de nombreuses collectivités ont pris une décision, par des formules discrètes : versement d’une soulte, transaction, ou, malheureusement, réaménagements qui augmentent encore les risques. Certaines situations ont donc déjà été traitées.
S’agissant de la structure de défaisance, l’architecture prévue n’est pas aberrante. La structure sera financée par les banques, et le débat portera sur la part des collectivités locales. La partie bonifiée du prêt doit notamment être correctement valorisée, car la collectivité y a trouvé un véritable intérêt budgétaire. Il faudra aussi tenir compte de la position de co-contractant de la collectivité ; elle peut avoir été crédule, incompétente ou machiavélique, mais elle a signé. Le conseil en gestion de dette existe depuis vingt ans, et depuis onze ans Finance active, un opérateur qui permet de tout coter presque en temps réel. Les collectivités qui le voulaient, notamment les plus grandes, pouvaient mesurer les risques ; elles ont une part de responsabilité dans ce dossier, responsabilité qui tient aussi à une déontologie insuffisante sur le plan commercial. La définition de la participation financière des collectivités territoriales à la structure de défaisance devra aussi prendre en compte les erreurs commises. Une telle structure ne peut être envisagée qu’avec un co-financement équilibré.
Enfin, l’État a une grande responsabilité dans ce qui est advenu car il a été alerté depuis des années par des articles et des courriers. En 2002 déjà, je publiais un ouvrage consacré à la gestion de la dette dans lequel je dénonçais la dérive du marché et dessinais ce qui allait se passer. L’État a été très passif : le cadre comptable demeure indigent – aucune provision possible, aucune valorisation bilancielle, si bien que l’on ne voit que les avantages des produits structurés sans en mesurer les inconvénients. C’est pourquoi ces produits ont prospéré auprès des collectivités locales et non dans le secteur privé. Il faut réformer le cadre comptable des collectivités et au moins instituer une obligation de provision ou une obligation bilancielle. La faute de l’État, c’est le manque de réglementation sur les emprunts : de ce fait, on pouvait tout faire, et même ne pas mettre les banques en concurrence. La charte Gissler a amorcé le changement, une circulaire l’a appliquée, mais l’on a vu qu’elle pouvait être contournée. L’État a aussi la responsabilité de muscler le cadre juridique du recours à l’emprunt ou de la renégociation, ou du recours aux instruments de couverture.
M. Alban Caillemer du Ferrage. S’agissant du stock, je souscris sans réserve aux propos de M. Nys. En premier lieu, on est dans le cadre de la liberté contractuelle : ou les contrats sont nuls ou ils ne le sont pas, c’est aux tribunaux d’en juger. S’ils sont valides, que les contractants s’entendent pour les restructurer ; nous passons beaucoup de temps à aider les parties à trouver des solutions acceptables pour tous. Et si les contrats sont valides, un capping rétroactif me paraît exclu. En revanche, en l’état, beaucoup de petites collectivités n’ont pas accès à la médiation ; il le faudrait car ce forum permettrait des discussions plus constructives qu’une bagarre au tribunal. La création d’une agence publique centralisant, en position dominante et avec un acteur professionnel, la partie indexatoire des emprunts, est une piste à explorer. Pour l’avenir, une grande marge de progression juridique est possible sans qu’il soit besoin de faire preuve de beaucoup d’imagination. J’ai cité l’article 341-10 du code monétaire et financier qui interdit le démarchage pour « les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription » : cette formule pourrait être utilement reprise si l’on s’orientait vers une capacité liée des collectivités locales qui n’existe pas aujourd’hui.
Je distingue six domaines dans lesquels la réglementation devrait progresser. Nous vivons une période de terrible incertitude juridique : le marché est tétanisé, ce qui interdit aux collectivités locales d’avoir recours à autre chose que des emprunts à taux fixes. Nous avons besoin que les choses s’apaisent et que l’on évolue dans un univers juridique stable. Il faut clarifier qui a la capacité à conclure des produits dérivés selon qu’ils sont isolés ou emballés dans un crédit : une opération est interdite, l’autre est permise. Pourquoi ? Cette incohérence réglementaire doit être rectifiée. On peut utiliser des caps, interdire certains sous-jacents, certaines structures, limiter les effets de levier… Les OPCVM, par exemple, ne peuvent conclure des produits dérivés avec un effet de levier supérieur à un par rapport à la taille de leur actif. En matière de produits dérivés, une série d’acteurs a une capacité juridique beaucoup plus encadrée que celle des collectivités territoriales ; des progrès sont nécessaires.
Ils sont indispensables aussi en matière d’autorisations, de délibérations et de délégations données par les assemblées délibérantes. Il y a dix ans, les délibérations étaient longues de dix à quinze pages et contenaient des rapports sur la dette. Aujourd’hui, ce sont des délibérations de deux pages et quand les banquiers demandent plus d’informations, il leur est répondu de faire avec ce qu’ils ont sous les yeux, faute de quoi la collectivité traitera avec un concurrent ! Les collectivités doivent être forcées à débattre mieux et à adopter des processus de décision plus transparents.
Il convient aussi de déterminer si le contrat lui-même, bien que de droit privé, ne devrait pas être soumis au contrôle de légalité.
S’agissant de la soumission de ces opérations aux règles des marchés publics, nous avons un conflit larvé avec la Commission européenne sur le point de savoir si les opérations d’emprunt doivent ou non être soumises au code des marchés publics. On dit souvent que la conclusion des produits dérivés est incompatible avec la lenteur de ces procédures. Mais la législation européenne ne nous impose pas de soumettre les produits dérivés aux règles du marché public puisque la directive ne les intègre pas. En revanche, s’agissant des financements, une amélioration est peut-être possible.
Pour ce qui est des conditions de la conclusion du contrat et de l’information, la jurisprudence française me semble constituer un corpus suffisant et suffisamment clair pour s’appliquer au cas d’espèce, mais des progrès restent à faire au sujet de la médiation.
Enfin, la norme comptable est tout à fait inadaptée ; je le redis, l’éveil des consciences aurait sans doute été plus précoce si les mark-to-markets avaient été identifiés dans la comptabilité des collectivités et avaient fait l’objet d’une communication adéquate.
M. le président. Messieurs, je vous remercie.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « L’obligation de conseil des établissements de crédits », avec la participation de M. Richard Routier, professeur à l’université de Strasbourg, auteur de « Obligations et responsabilités du banquier » paru en juillet 2011, Me Bruno Wertenschlag, avocat associé, et M. Olivier Poindron, consultant, cabinet FIDAL et de M. Gilles Sébé, président de Seldon Finance.
(Procès verbal de la séance du mardi 18 octobre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Après avoir conduit un premier cycle d'auditions au cours duquel nous avons entendu le témoignage des « plaignants », ceux qui se considèrent comme victimes des emprunts structurés – les représentants des collectivités territoriales, grandes ou petites, les établissements hospitaliers, les organismes chargés du logement social, nous en venons à l’analyse des produits financiers qui ont été proposés par les banques et à la relation entre les banques et leurs clients.
Ayant entendu des spécialistes des prêts bancaires dont la fonction est le conseil, notamment aux collectivités, nous accueillons des juristes spécialisés dans le droit bancaire : M. Richard Routier, professeur à l'université de Strasbourg et auteur de « Obligations et responsabilités du banquier » paru en juillet 2011 ; Me Bruno Wertenschlag, avocat associé, et M. Olivier Poindron, consultant, du cabinet FIDAL ; M. Gilles Sébé, président de Seldon Finance.
Cette table ronde doit nous permettre de comprendre plus précisément quels devoirs s'imposent aux banques dans le cadre d'une approche et d'une négociation avec une collectivité locale, et ce que recouvre l'obligation de conseil du banquier – obligation d'informer, de conseiller et de mettre en garde imposée par le code civil. Dans tous les cas qui nous ont été exposés au cours des auditions, il est apparu clairement que les banquiers n'ont jamais mis en garde la collectivité locale sur les risques qu'elle prenait en s’engageant dans une opération spéculative. Les banquiers ne se sont pas non plus pliés aux règles de bonne conduite qui s'imposent aux prestataires de services d'investissement, codifiées par le code monétaire et financier avant même la transposition de la directive relative aux marchés d'instruments financiers.
Il n'y a pas, en France, de jurisprudence relative à la dette structurée des collectivités locales. Les contrats de prêts et de swaps structurés sont des conventions de droit privé ; la collectivité peut donc en demander l'annulation au juge judiciaire. Auparavant, elle peut tenter d'obtenir une transaction, mais encore doit-elle pour cela pouvoir faire état de manquements bien définis. Votre éclairage permettra d’affiner la caractérisation des fautes commises par les banques. Comment les collectivités en grave difficulté, et notamment les petites, peuvent-elles mettre en cause la responsabilité de leur banque ?
(Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, MM. Richard Routier, Bruno Wertenschlag, Olivier Poindron et Gilles Sébé prêtent successivement serment).
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Les banques, qui ont rivalisé d’imagination au cours des dernières années pour proposer des produits de plus en plus sophistiqués à la clientèle très particulière qu’est celle des collectivités territoriales, peuvent-elles voir leur responsabilité mise en cause pour des présentations trompeuses et des informations incomplètes ? Certains des cas dont vous avez eu à connaître font-ils apparaître des manœuvres pour lesquelles la nullité du contrat peut-elle être invoquée ? Que penser d’appellations telles que « taux fixe structuré » ou d’un contrat intitulé « Tofix » alors qu’il est tout sauf à taux fixe ?
M. Richard Routier. Il faut se poser la question de savoir sur quel fondement on peut engager la responsabilité de la banque. J’ai lu dans la presse que des actions pénales étaient engagées pour tromperie ou escroquerie. L’exercice de la voie pénale présente des avantages mais aussi des inconvénients. L’un de ces inconvénients est qu’elle est d’interprétation stricte, si bien que de telles actions ont peu de chances d’aboutir, d’autant qu’il faut pouvoir démontrer l’existence d’un élément intentionnel qui, étant donné l’aléa des marchés et le fait que les signataires des contrats n’étaient pas forcément au courant de ce qu’ils signaient, sera difficile à rapporter.
L’action civile me semble plus féconde en ce que de nombreux chefs de responsabilités peuvent être envisagés : le manquement à l’obligation de mise en garde et de conseil mais aussi d’autres manquements, à analyser au cas par cas. Le conseil s’impose en cas de démarchage de la banque qui propose de restructurer un emprunt. La mise en garde est due à tout emprunteur non averti ; on s’interrogera donc sur le point de savoir si une collectivité territoriale peut être considérée comme non avertie alors qu’elle est souvent assistée par un cabinet de conseil. Mais le fait que le client ait à ses côtés une personne avertie ne dispense pas le banquier de son obligation de mise en garde, la jurisprudence est très claire à ce sujet.
Certaines associations se placent sur le terrain de l’illicéité de l’indexation pour absence de lien direct avec l’objet du contrat ou avec l’activité d’une des parties. À mon sens, des actions de ce type ne pourraient prospérer car le code monétaire et financier dispose expressément que pour les contrats financiers l’indexation est libre.
En résumé, sur le seul terrain du devoir de mise en garde ou de l’obligation de conseil, qui me semble le plus fécond s’agissant d’un banquier dispensateur de crédits, on peut penser que l’action civile aurait des chances d’aboutir – en fonction des dossiers bien sûr, car il ne faudrait pas que le contrat contienne la reconnaissance qu’un avis a été donné par l’établissement financier.
M. le rapporteur. Selon le journal Libération, quelque 5 500 collectivités sont touchées. Ce seul élément donne à réfléchir. Qu’une dizaine de communes se soient méprises, soit, mais face à un tsunami d’une telle ampleur, comment imaginer que toutes aient commis la même erreur en même temps ?
M. Bruno Wertenschlag. Il existe énormément de pistes permettant de mettre en cause la responsabilité des établissements financiers qui ont commis des fautes. En amont, on trouve la plus simple : l’obligation d’information, particulièrement marquée pour le milieu bancaire, qui propose des produits autrement plus compliqués à évaluer que ne l’est une nouvelle voiture. En matière financière, les produits les plus simples – les prêts à taux fixes – sont déjà d’une appréhension complexe ; les choses deviennent extraordinairement compliquées, sinon pratiquement impossibles à comprendre, quand l’emprunt structuré est fondé sur un taux d’intérêt qui peut varier d’année en année en fonction de la parité entre l’euro et le franc suisse. L’obligation d’information a sa traduction dans le code civil et dans le code monétaire et financier ; quelles sont alors les voies de justice propres à contraindre les banques, à défaut d’avoir pu négocier avec elles, à en rabattre sur ce qu’elles pourraient exiger pour que nous débouclions le contrat, c’est-à-dire la fameuse valeur de marché qui représente des sommes parfois astronomiques ? La première voie judiciaire consiste à essayer d’épingler les établissements financiers sur le manquement à leur obligation d’information, définie par des textes précis accessibles à tout lecteur, même non juriste : tout établissement financier est tenu d’exécuter les contrats « de bonne foi », c’est-à-dire de manière loyale, professionnelle et transparente, et de communiquer des informations dont le contenu ne soit pas trompeur. À cet égard, il y a lieu de se demander, comme le fait votre rapporteur, s’il est bien transparent et loyal d’intituler « Tofix » un contrat de prêt à taux structuré. Cela peut déjà caractériser un manquement à une obligation d’information de base : on ne qualifie pas de « fixe » un produit spéculatif dont le taux d’intérêt est erratique !
De l’examen de nombreux contrats souscrits par des collectivités territoriales et de l’analyse de centaines de lignes de swaps, il ressort qu’une interprétation visiblement faussée a été faite de la circulaire du 15 septembre 1992, selon laquelle les collectivités territoriales peuvent souscrire des produits de couverture, la souscription de produits spéculatifs leur étant interdite. Or certains établissements prêteurs, au lieu de rappeler la difficulté qui pouvait se présenter de ce fait, ont déclaré ou fait déclarer dans la documentation commerciale, dans les pré-confirmations et dans les actes d’emprunt que les collectivités savaient que le produit considéré était conforme aux objectifs de couverture visés par la circulaire. Est-ce là une information loyale et transparente ?
Enfin, pour tous ceux dont le rôle est d’essayer d’obtenir l’annulation ou la résiliation des contrats litigieux, la marge cachée est une question centrale car on est au cœur de l’information que le banquier doit donner à son client. Le code monétaire et financier dispose que le banquier doit prendre toutes dispositions pour empêcher qu’un conflit d'intérêts ne porte atteinte aux intérêts de leurs clients ; il lui interdit en particulier de réaliser un gain au détriment de son client. Or, que disent les experts financiers des produits structurés à ce sujet ? En termes simples – ce qui n’est pas toujours le cas… – que la marge réalisée par la banque est d’autant plus élevée que le risque pris par le client est important ! Il y a là un réel conflit d’intérêts. Je ne dis pas que ces types de contrats auraient dû être proscrits, mais que les banques, avant de les faire souscrire, auraient dû expliquer à leur client que le mécanisme proposé – une période de prêt bonifié suivie d’une période, beaucoup plus longue, de prêt erratique – a un coût mais aussi un prix, celui que la banque encaisse. Cela n’a pas été dit.
On voit qu’en amont de la question du conseil au client se pose celle du droit à une information honnête et loyale.
M. Gilles Sébé. À chaque fois que ces produits étaient vendus aux entreprises, une alerte figurait en dernière page des contrats, soulignant leur absence de liquidité ; Les banquiers s’étaient entendus pour qu’aucun contrat de prêt structuré passé avec une collectivité territoriale ne comporte cette mention. Ces contrats, c’était la poule aux œufs d’or ; ils ont d’ailleurs fait l’âge d’or de Dexia mais aussi de la Société générale et d’autres établissements financiers intervenus sur ce marché après les années 2000. Cela n’a jamais été dit, sinon par l’auteur anonyme d’un opuscule intitulé Confessions d’un banquier pourri, selon lequel les produits vendus aux collectivités locales avaient pour acronyme interne « POTT », autrement dit : « Prends l'oseille et tire-toi »… Cela dit tout de la volonté des banques de réaliser des marges exorbitantes sur ces prêts dont la particularité est d’être établis pour plus de trente ans – les entreprises empruntent plutôt à dix ans.
On a commencé par introduire dans les contrats un petit virus qui a créé quelques difficultés, ce qui a permis de vendre ensuite au client un produit un peu plus risqué, puis un autre qui l’était davantage, la banque prenant sur chaque opération une marge complémentaire. Déjà, les premiers produits structurés qui, n’étaient pas très risqués, prévoyaient une marge de 50 centimes alors que la marge sur les prêts consentis jusqu’alors était de l’ordre de 5 centimes, 10 centimes au plus ; l’amélioration de la marge était donc sensible d’emblée. De surcroît, alors que les mécanismes proposés étaient de plus en plus risqués, le banquier a toujours présenté le gain d’intérêt qui avait été réalisé mais masqué à chaque vente la perte en capital. Les collectivités n’ont jamais été informées que si elles étaient conduites à rembourser ces contrats par anticipation elles encourraient une pénalité comprise dans une fourchette de 10 à 30 % sur le capital restant dû. Par un effet boule de neige voulu, plus nombreux étaient les produits à taux structurés vendus, plus sûres étaient les banques de voir leurs clients revenir, contraints de négocier sans contrepartie. Le virus ayant été inoculé, on a dérivé peu à peu vers des produits à ce point « exotiques » que les banques elles-mêmes ne maîtrisaient plus ce qu’elles vendaient. Quelques brillants matheux avaient mis au point une « machine à cash » qu’il n’y avait aucune raison de jamais arrêter ; d’ailleurs, on ne pouvait pas l’arrêter, car l’essence même du produit était de jouer contre les marchés - ce que le banquier n’a jamais expliqué à la collectivité. Le modèle financier suivi étant mauvais – une période de remboursement de trois ou quatre ans à taux fixe faible, voire à taux nul avant les élections, suivie d’une période de remboursement à des taux progressifs explosifs pour restaurer la marge –, on allait dans le mur.
La volonté de tromper de certains banquiers – pas tous – est évidente. Des renégociations en série ont eu lieu, en Bretagne par exemple, qui ont conduit de multiples petites collectivités à passer d’un produit risqué à un autre qui l’était plus encore, avec une même date d’échéance : la banque, parce qu’elle avait certainement pris des options pour des centaines de millions d’euros, a vendu ces produits en bloc. Et l’on exige aujourd’hui de petites collectivités qui veulent se débarrasser de produits fondés sur l’évolution du taux de change entre le yen et le dollar ou l’euro et le franc suisse une pénalité pour remboursement anticipé de 7 millions d’euros, pour un encours de 3 millions !
Le mécanisme était très organisé et les banquiers, qui avaient une connaissance approfondie des marchés, trouvaient pour interlocuteurs bien peu de spécialistes capables de dire « non » à leurs propositions. Et lorsqu’il se produisait qu’un directeur financier refuse ces produits, on le court-circuitait en traitant avec l’adjoint aux finances puis, si besoin était, avec le maire directement. Tout a été fait pour que les collectivités signent ces contrats. Ensuite, la flambée de l’Euribor a fait peur, et cela a permis aux banquiers d’enchaîner les marges successives. La volonté de tromper me semble évidente.
M. le rapporteur. En dépit de cela, aucune des procédures lancées par les collectivités n’a abouti. Pourquoi ?
M. Gilles Sébé. Parce que certaines transactions ont eu lieu, restées secrètes. Mais Dexia, qui a à connaître de nombreux litiges, est aujourd’hui en grande difficulté ; pourra-t-elle poursuivre ces transactions ? On notera que les choses ont commencé à bouger le jour où l’on a évoqué des actions pénales.
M. Richard Routier. L’action pénale a pour intérêt que le secret bancaire, opposable au juge civil, ne l’est pas au juge répressif ; mais le danger est qu’elle prend du temps. Et, pendant ce temps, les délais de prescription commencent à courir sans que l’action civile ait été engagée, alors que c’est le meilleur moyen de pression que vous pouvez exercer sur les banques pour les amener à négocier.
M. le président. Pour ce que vous en savez, les chiffres avancés par le journal Libération vous paraissent-ils vraisemblables ? Avez-vous une idée du nombre de banques concernées ?
M. Bruno Wertenschlag. À supposer que nous disposions des instruments statistiques nécessaires pour répondre à cette question, ce qui n’est pas le cas, nous ne pourrions, en tant qu’avocats, vous en dire le moindre mot. J’observe simplement que, le temps passant, les grandes familles d’organismes concernées par ce douloureux problème qui, au départ, affirmaient crânement ne pas avoir de difficultés, sortent peu à peu du bois - l’article de Libération a dû jouer un rôle. À ce jour, on est dans l’incapacité de définir l’étendue du désastre et le nombre d’organismes ou de collectivités territoriales concernées. Pendant un temps, il était honteux de déclarer avoir souscrit de ces emprunts – c’était un effet du lobbying des banques, qui visait à faire admettre que les fautifs étaient les emprunteurs. Maintenant, la parole se débride.
M. Gilles Sébé. N’étant pas avocat, je parlerai plus librement. L’article de Libération donne une bonne panoplie des collectivités ayant souscrit ce type de contrats. Dexia a été le premier vecteur de diffusion de ces produits. Les caisses d’épargne et le Crédit agricole ont été beaucoup moins actifs, et l’ont été plus tardivement. Tous les produits vendus à ces 5 500 collectivités sont des produits structurés, mais tous ne sont pas toxiques. Nous avons 1 500 collectivités locales clientes ; pour elles, les « produits de pente » ne sont pas très bien cotés et il est difficile d’en sortir car ils n’ont plus de marché, mais ils sont peu risqués pour l’instant. En revanche, pour les produits fondés sur l’évolution des taux de change, la carte de Libération est extrêmement optimiste : la pénalité est maintenant égale à 200 pour cent, voire 250 pour cent du capital. La carte publiée par Libération a fait beaucoup de bruit et suscité une prise de conscience soudaine chez des maires qui n’étaient pas conscients d’avoir ce type de produits en stock – ce qui en dit long sur la manière dont les choses leur ont été présentées. La situation des collectivités qui ont souscrit les produits de dernière génération est bien pire que ne le décrit Libération. Les produits fondés sur l’évolution du taux de change entre le franc suisse et l’euro sont d’une volatilité extrême ; ils ne conviennent en aucune manière aux collectivités territoriales, dont les budgets sont assez stables.
M. Henri Plagnol. Je le confirme : après la publication de l’article de Libération, plusieurs maires ont découvert qu’ils avaient sérieusement matière à s’inquiéter. Il est exact aussi que les pénalités actuellement demandées sont bien supérieures à celles qu’évoque le journal.
Vous nous avez dit de manière assez convaincante qu’il est possible d’obtenir quelque chose au civil. Mais que se passe-t-il pendant la procédure contentieuse ? L’obstacle principal me paraît être que, le recours n’étant pas suspensif, les emprunts sont cristallisés sans possibilité de négociation ; de nombreuses collectivités hésitent pour cette raison à franchir le pas. Qu’en pensez-vous ? Par ailleurs, que peut-on obtenir ? La résiliation du contrat peut-être, et sinon ? Les coûts auxquels les collectivités sont exposées sont tels que même un jugement mitigé peut ne pas suffire à les tirer d’affaire. Enfin, saisir la juridiction administrative vous semblerait-il pertinent, sachant que, souvent, les emprunts les plus dangereux ont été souscrits très peu de temps avant les élections, parfois même à une semaine du premier tour sinon entre les deux tours ? Dans quelle mesure un maire peut-il engager sa commune pour trente ans à la veille d’une échéance électorale, au moment où aucun contrôle ne peut s’exercer ni le conseil municipal être informé ?
M. Bruno Wertenschlag. La collectivité territoriale qui a souscrit un contrat de droit privé est justiciable des tribunaux judiciaires ; elle a tous les devoirs et tous les droits d’une personne privée. Au nombre de ses devoirs, elle a celui de ne pas se faire justice à elle-même : elle ne doit donc surtout pas interrompre ses paiements avant que la justice ne se soit prononcée sur la licéité du contrat. Outre que cela froisserait le juge, cela créerait de sérieuses difficultés de financement ultérieur. Cependant, le débiteur en mesure d’apporter la preuve de difficultés financières peut, sur le fondement des articles 1244-1 et suivants du code civil, obtenir du juge le report du paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans. Mais les collectivités territoriales doivent aussi s’interroger sur leurs modalités de fonctionnement, quelque peu rigides.
M. Henri Plagnol. Je connais beaucoup de collectivités qui excluent le contentieux car elles ne peuvent prendre le risque d’avoir à payer ce que les banques leur réclament. La commission doit s’interroger sur la possibilité de prise en charge du risque contentieux, sinon cette voie échouera très largement.
M. Marc Francina. Les collectivités concernées peuvent-elles verser au trésorier-payeur, pour séquestre, les annuités dues aux établissements financiers dans ce contexte ?
M. Bruno Wertenschlag. Saisir un juge civil pour lui demander d’annuler un contrat ou de le résilier à la charge de la banque ne crée pas en soi un incident de paiement ; ce qui le crée, c’est de ne pas payer ce que l’on doit. Aussi conseillons-nous à nos clients d’assigner et de continuer à honorer leurs obligations même s’ils en contestent le fondement. Mais si la collectivité débitrice apporte la preuve de son impossibilité de payer ou des graves difficultés dans lesquelles le paiement la placerait, elle obtiendra du juge des délais de paiement qui peuvent atteindre deux ans. Dans cet intervalle, on obtient une décision de justice.
M. Richard Routier. Il ne serait pas opportun d’agir comme vous le suggérez, monsieur Francina ; il faut, comme cela a été indiqué, demander l’application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil. Ce que l’on peut obtenir par une action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil ou au devoir de mise en garde, monsieur Plagnol, c’est la reconnaissance d’un préjudice pour perte de chance – la chance de ne pas avoir pu renoncer à contracter. On ne pourra demander la réparation intégrale de ce préjudice, car il est de l’essence même de toute « chance » de comporter un « aléa » ; mais s’il existe une forte probabilité que la collectivité, eût-elle été informée, n’aurait pas contracté, la jurisprudence a déjà reconnu des taux d’indemnisation de 90 pour cent de la créance de la banque.
M. le président. Quel est votre avis sur la charte Gissler ? Traduit-elle un progrès juridique ? Que contribue-t-elle à éclaircir ? Estimeriez-vous judicieux de la compléter en mentionnant l’obligation de plafonner le taux des prêts aux collectivités territoriales ?
M. Richard Routier. La charte Gissler a le mérite d’exister, mais elle ne règle pas le problème : les produits classés « D » et « E » sont encore très nocifs et continuer de proposer ces classes de produits paraît déraisonnable. Les collectivités locales et les hôpitaux veulent préserver leur liberté de gestion et expliquent qu’ils se sont maintenant dotés de gestionnaires de dette compétents. Mais, d’une part, la science des marchés n’est pas une science exacte et les personnes les plus compétentes ont déjà pu accumuler des pertes considérables ; d’autre part, la liberté contractuelle connaît des limites dans bien des pans de notre droit. Cette affaire est l’occasion de revenir à un principe simple : l’argent public ne doit pas permettre la spéculation de ceux qui le manipulent. Or les prêts structurés sont des produits spéculatifs. Votre commission doit s’interroger sur le fait que la charte Gissler pérennise ces pratiques.
M. Olivier Poindron. Outre que la classification du risque établie dans la charte Gissler est assez contestable, il faut dénoncer le champ des obligations d’information et de conseil auxquelles les banquiers consentent par cette charte. Le scandale de ce texte, c’est que les banques « consentent à respecter » certaines obligations préexistantes à la charte. Elles sont définies dans les articles 1147 et 1134 du code civil, inchangés depuis 1804, dans les règles de bonne conduite du code monétaire et financier et dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et très supérieures à celles établies dans la charte. De surcroît, les obligations ainsi définies ne seraient pas rétroactives ; cela est proprement monstrueux puisque des obligations plus larges préexistaient à la charte.
M. Gilles Sébé. Le problème est qu’un produit classé peu dangereux dans la charte Gissler peut se révéler explosif. Si, demain, la Grèce fait défaut, il y aura flambée de taux courts et tous les produits de pente qui paraissaient peu risqués peuvent présenter un risque très grave. La charte Gissler ne donne pas une vision correcte du risque dans le temps. C’est un document ponctuel, et surtout un moyen subtil, pour les banques, de différer les contentieux.
Je reviens à la question posée par M. Plagnol : que peut-on espérer d’un contentieux ou d’une négociation ? Par la négociation, nous avons obtenu l’abandon total des pénalités et le retour au taux fixe que les banques avaient fait abandonner aux collectivités ; par le contentieux, on obtient ce qu’a expliqué M. Routier.
Certaines collectivités n’ont pas suivi nos conseils et bloqué leurs paiements ou décidé de ne verser que la part correspondant à un taux fixe ; d’autres se sont déclarées en désaccord avec l’interprétation de la formule. C’est un chemin risqué. Si on le suit, deux possibilités se présentent : l’une est de faire un dépôt auprès de la Caisse des dépôts, dépôt qui produit des intérêts qui permettront, en cas de condamnation finale, de payer une partie des intérêts intercalaires ; l’autre est de ne pas payer en espérant que le préfet ne procèdera pas à l’inscription d’office de la dépense – ce qui est pour l’instant le cas : les banquiers n’ont jamais obtenu l’inscription d’office de cette dépense.
M. Bruno Wertenschlag. Il est de jurisprudence constance que les contrats qui n’ont pas pour objet direct une mission de service public relèvent du juge judiciaire. Le juge administratif interviendrait dans la seule hypothèse où, au cours du procès judiciaire, se poserait un problème de la légalité – par exemple : la collectivité avait-elle la capacité de souscrire ? Mais cela ne soulagera pas la collectivité ni ne règlera en entier la question de la légalité du produit.
M. le rapporteur. La directive européenne de 2004 sur les marchés d'instruments financiers (MiFID), transposée en droit français, classe les collectivités territoriales dans la clientèle non-professionnelle. Ne peut-on trouver là une piste légale à explorer, par exemple en se référant à la proscription des taux usuraires ?
M. Gilles Sébé. Il n’y a pas de taux d’usure pour les taux variables.
M. Olivier Poindron. La législation relative à l’usure n’est pas applicable en l’espèce : le code de la consommation prescrit que le taux effectif global (TEG) donné dans le contrat l’est à titre indicatif, et c’est ce taux qui est rapporté au taux de l’usure. En cette matière, le seul angle d’attaque possible serait que le TEG ait été omis au contrat.
M. Richard Routier. En dehors de l’usure – car depuis 2003, il est beaucoup plus difficile de se placer sur ce terrain –, la jurisprudence a déjà décidé que le fait d’avoir affaire à un professionnel ne dispense pas le banquier, le cas échéant, de son devoir de mise en garde. Les collectivités locales pourront bénéficier de cette jurisprudence. Peu importe que ce soit un professionnel personne privée ou personne publique : si le juge considère qu’au regard de la complexité du produit, la personne publique n’était pas avertie, il prononcera la réparation.
M. le président. Messieurs, je vous remercie pour vos contributions à nos travaux. Elles complètent utilement le tableau général que nous sommes en train de dresser.
*
* *
M. le président Claude Bartolone. La table ronde qui s’ouvre à présent réunit des magistrats des chambres régionales des comptes (CRC) ayant eu à connaître la situation d’endettement de nombreuses collectivités, et dont l’analyse a contribué au rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, présenté en juillet 2011.
Cette table ronde doit nous permettre d’apprécier l’encours des emprunts toxiques dans la dette publique locale, et la part qu’il représente au sein de cette dette. Mais de nombreuses autres questions seront abordées aussi, touchant l’information sur les risques de dette et les règles de la comptabilité des collectivités locales, le renforcement des moyens de contrôle interne et externe, et bien sûr les moyens d’aider les collectivités en grave difficulté.
Aussi je vous remercie d’accueillir : M. Alain Levionnois, Président de la CRC de Picardie, M. Marc Larue, président de section à la CRC de Provence-Alpes-Côte d’Azur, M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace, M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais et M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC des Pays de la Loire.
Les personnes auditionnées prêtent serment.
M. Jean-Pierre Gorges, Rapporteur. Paradoxalement, alors qu’une règle d’or impose aux collectivités territoriales de présenter leurs budgets en équilibre, les caractéristiques de leurs dettes restent entourées de flou. Il est ainsi impossible de déterminer précisément l’encours total de la dette des acteurs publics locaux, ni de quels types d’emprunt ces encours sont constitués, d’en connaître la maturité moyenne ou la ventilation par type de taux d’intérêt. Le rapport se borne à estimer que l’encours de la dette locale atteint 30 à 35 milliards d’emprunts structurés, dont 10 à 12 milliards présenteraient un risque potentiellement élevé.
J’aurai trois questions en relation avec cette situation : quels sont les remèdes que l’on peut apporter afin d’en finir avec la mauvaise connaissance des prêts et cette concentration des risques ? Comment, aussi, parvenir à une meilleure transparence de la gestion de la dette des collectivités ? Enfin – question la plus brutale – qui porte la responsabilité de la situation très difficile à laquelle certaines collectivités sont confrontées ?
M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie. Nous sommes très honorés d’avoir à vous rendre compte des travaux que nous avons menés. Notre équipe a en réalité travaillé sur trois rapports successifs : le premier a pris la forme d’une insertion au rapport annuel de la Cour des comptes publié en février 2009, le deuxième a consisté en une nouvelle insertion de suivi au titre du rapport annuel de février 2010 et le troisième a été un rapport thématique de la Cour sur la gestion de la dette locale, publié en juillet 2011.
Ce dernier rapport est le fruit d’une analyse plus approfondie, sous la responsabilité de Marc Larue et des autres rapporteurs ici présents, qui s’est appuyé sur l’ensemble des CRC de métropole.
Pour répondre à votre première question relative aux moyens d’améliorer la gestion de l’encours de prêts à risque, je rappellerai que la direction générale des finances publiques (DGFiP) du ministère des finances avait engagé, dès 2009, un essai de recensement des prêts structurés à risque figurant dans les comptes des collectivités territoriales, par l’intermédiaire des trésoriers payeurs généraux et des agents comptables du Trésor public. Ce recensement, qui a servi de base aux travaux d’Éric Gissler et à l’élaboration d’une charte de bonne conduite, s’est révélé aléatoire et assez peu probant : peu d’agents comptables avaient une connaissance précise de ces produits et ils ne disposaient pas non plus d’outil leur permettant de mesure le risque. La charte Gissler a constitué, de ce point de vue, une démarche intéressante de classification même si nous émettons, dans notre rapport du mois de juillet dernier, quelques réserves quant aux décisions qui en ont découlé.
De son côté, le conseil de normalisation des comptes publics a émis un certain nombre d’avis et proposé la modification des annexes comptables des budgets locaux. L’un de ces avis propose également une classification intéressante de ces produits. Il me semble que c’est un progrès important.
Toutefois, la notion d’emprunt à risque demeure assez imprécise. Dans une certaine mesure, un emprunt à taux fixe fait courir un risque à la baisse des taux : dans les années quatre-vingt, les taux fixes des emprunts des collectivités atteignaient 17 % ; c’est d’ailleurs à cette époque qu’est apparue la notion de gestion active de la dette.
L’encours global de la dette locale – 163 milliards d’euros – est aujourd’hui bien connu, grâce aux données de l’INSEE, mais indéniablement il reste des progrès à accomplir en matière de classification des composantes de cette dette.
Je serai beaucoup plus bref pour répondre à votre deuxième question sur les frais financiers. Il est impossible de prédire l’avenir de ces produits : Comment va évoluer la parité entre l’euro et le franc suisse ? Quelle sera la forme de la courbe des taux dans les prochains mois ? Je ne suis pas en mesure de le savoir.
M. le rapporteur. Comment garantir la sincérité des comptes locaux dans ces conditions ?
M. Alain Levionnois. C’est une question difficile. Un contrat d’emprunt est un contrat de droit civil. Les juridictions civiles et commerciales sont seules compétentes pour en connaître. La seule affaire jugée, en la matière, opposait les caisses d’épargne et une société anonyme d’habitat local ; c’est le tribunal de commerce qui a rendu la décision.
M. le président. À Toulouse.
M. Alain Levionnois. Tout à fait. Les contrats d’emprunt ne sont donc pas des contrats administratifs. Cela pose deux difficultés. D’abord, les collectivités territoriales ne sont pas familières de la procédure civile. Par ailleurs, pour le juge judiciaire, le contrat fait loi entre les parties et l’intérêt général n’y a guère sa place.
M. Alain Levionnois, président de la CRC Picardie. Le propre de la décentralisation, c’est d’avoir libéralisé les possibilités pour les collectivités territoriales de s’administrer et donc d’emprunter librement, sans autorisation administrative préalable.
M. le président. Il y a la dimension commerciale dans l’opération de prêt aux collectivités, mais aussi une dimension administrative – et des normes applicables que les produits structurés n’ont pas permis de respecter : la sincérité de l’équilibre des budgets votés, l’information des organes délibérants. Quelles sont les règles qui vous paraîtraient devoir être précisées pour avoir sincérité et transparence ?
M. Alain Levionnois. Votre question renvoie à l’une des recommandations faites dans le rapport public de juillet 2011, à savoir le renforcement de l’information et l’association des assemblées délibérantes aux décisions relatives à l’emprunt. L’une des particularités du contrat d’emprunt, c’est qu’il doit être conclu rapidement. Il ne peut que s’agir d’une décision exécutive du responsable au sein de la collectivité, et la soumettre aux délais de la délibération ne serait pas adapté. Il ne serait pas pertinent de remettre en cause cette délégation de compétence aux exécutifs locaux, alors que son champ a été constamment élargi par la loi au cours des dernières années. Mais une délégation de compétence doit avoir comme contrepartie un pouvoir de contrôle, qui nous paraît actuellement insuffisant. D’où la recommandation de prévoir par la loi que les gestionnaires locaux aient à rendre compte de leurs choix en matière d’endettement, dans un rapport annexé au budget, qui pourrait faire l’objet d’un débat. Ces questions peuvent éventuellement paraître complexes au conseiller municipal « de base », mais il pourra tout au moins demander des explications, ce qui forcerait le responsable à formaliser ses choix et à les expliquer. Ce rapport représenterait un outil pour les assemblées délibérantes, et cette évolution ne pourrait avoir qu’un effet positif et représenter un progrès en termes de transparence.
M. Patrice Calméjane. Vous évoquez les collectivités, mais vous êtes aussi les contrôleurs des gestionnaires. Or l’article R. 231-2 du code des juridictions financières prévoit notamment que « sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris sur proposition du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près ladite cour ». Au vu de l’absence de consigne précise qu’ont reçu l’ancien préfet et l’ancien trésorier-payeur général que nous avons auditionnés, avez-vous eu l’occasion de faire des recommandations sur les éléments devant faire l’objet d’un contrôle ?
En outre, quel est le niveau de formation des agents de vérification de la Cour qui ont été confrontés à des produits aussi complexes que les emprunts structurés ? Les comprendre requiert une expertise pour les comprendre ; il a aussi été évoqué des documents contractuels rédigés en langue étrangère. Avez-vous fait appel à des experts extérieurs pour comprendre des produits sur lesquels vous n’avez pas eu de formation initiale ?
M. le président. Pour faire le lien entre ces interventions, j’ajouterai un cas tiré de mon expérience personnelle. Lors de ma première rencontre avec mon directeur financier, il m’a expliqué que nous étions passés d’un taux de gestion de la dette de 3,90 % à 3,15 %. Sans audit externe, je n’aurai jamais pu me rendre compte que cette gestion active de la dette cachait une perte potentielle d’un tiers, qui n’apparaissait nulle part. Or nous aurions dû être informés de cette perte.
M. Marc Larue, président de section à la CRC PACA. Comme nos différents rapports l’ont souligné depuis 2009, l’absence d’outil statistique national pose un problème. Il semble désormais se mettre en place, mais en son absence nous avons dû nous appuyer sur des chiffres de conseils extérieurs.
Notre expérience des contrôles sur le terrain nous pousse à préconiser de travailler dans deux axes :
– l’amélioration de l’information des assemblées délibérantes dans les collectivités territoriales, par un débat obligatoire sur la dette et la stratégie de la dette : ces contrats sont souvent aujourd’hui approuvés sans débat, et l’obligation de rendre compte a posteriori des décisions prises ne suffit pas. La situation des hôpitaux, où la décision est prise par le directeur seul en vertu de ses pouvoirs propres, montre a contrario l’intérêt d’un débat, même si les personnes n’ont pas de compétence particulière en la matière. L’obligation pour le gestionnaire de formaliser pour expliquer présente en effet des vertus en soi en montrant la dangerosité des produits complexes ;
– la mise en place d’un système de provisionnement : ces produits n’ont pas été réglementés, et l’innovation financière rend impossible de prévoir quels seraient les nouveaux produits qui pourraient apparaître. Dans ce contexte, l’obligation de provisionner nous apparaît comme une solution pérenne. L’analyse de la situation nous a montré que certaines personnes ont cru réellement pouvoir emprunter à des taux inférieurs à ceux du marché, ce qui n’est pas possible, mais dans certains cas les banques l’ont peut-être laissé croire. Le système de provisionnement que nous proposons a pour objet de compenser le gain lié au recours à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché.
Dès 2005-2006, nous avons attiré l’attention dans nos contrôles sur ces nouveaux produits et mis en garde les gestionnaires contre leur complexité et leurs risques. Le fait que les responsables financiers et commerciaux des banques ne comprenaient parfois pas eux-mêmes les caractéristiques de ces produits nous a confirmés dans la conviction qu’ils posaient problème.
S’agissant de la réaction des autres instances de contrôle et notamment du rôle joué par le contrôle de légalité et les comptables publics, nous abordons dans notre rapport le problème posé par les contradictions des textes applicables en ce qui concerne les documents à produire au contrôle de légalité en matière d’emprunts. De notre point de vue, même si le contrat de prêt est un contrat privé, il nous semble qu’il devrait être transmis obligatoirement au contrôle de légalité.
M. le rapporteur. Vous évoquez le taux du marché : il convient de faire la différence entre produits structurés et produits toxiques. Un emprunt structuré devient toxique quand son taux d’intérêt dépasse le taux usuraire. Le problème n’est pas uniquement ce taux, mais le coût de la sortie qui n’était pas prévisible. Faut-il protéger les collectivités en appliquant comme limite le taux de l’usure ?
M. Marc Larue. La logique des emprunts structurés est d’échanger une bonification de taux à court terme contre un risque important. Si on veut provisionner par rapport au risque de sortie, on aura une difficulté. Le vice de départ de ces produits c’est le taux bonifié inférieur au marché qui a été affiché, et anesthésié la perception du risque. Si on neutralise cet avantage par l’obligation de provisionner, on fait perdre l’intérêt de recourir à ces produits.
M. le président. S’il y avait eu obligation de provisionner le risque, bon nombre de ces produits n’auraient pas été souscrits, car pour nombre d’entre eux, le jour même de leur signature, il y avait un risque.
À partir de quels faits, quelle information, les conséquences néfastes de ces produits ont-elles été appréhendées par les chambres régionales des comptes ?
M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace. Notre équipe a des formations initiales variées. Nous avons dispensé un certain nombre de formations et élaboré des guides d’enquête au profit des équipes de vérification ; nous avons aussi pu faire appel à des experts extérieurs.
Les juridictions financières soulignent que la dette locale est comptabilisée en valeur nominale et non en valeur financière. Ceci est une difficulté structurelle pour évaluer les risques et les charges financières à venir.
Le Conseil de normalisation des comptes publics (CNOCP), créé par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, a commencé à examiner la question en février 2009 et a publié des informations sur les annexes du budget. La compréhension de la formule de calcul de l’indexation permet de faire des projections et de constater que des taux d’intérêt à deux chiffres pouvaient être atteints.
Le second axe de travail du CNOCP concerne le provisionnement, tout en sachant que la difficulté en matière de finance locale est la difficulté budgétaire à passer la provision. Nous en sommes tous conscients : si on retient l’intégralité de la soulte de sortie pour le montant de la provision, certaines collectivités, même importantes, pourront se retrouver en difficulté, car cela représentera deux ou trois fois leur épargne brute. Nous avons écarté ce schéma pour envisager de provisionner les échéances de l’exercice suivant, par exemple.
Depuis l’apparition des difficultés, les collectivités essaient de réaménager en figeant avec la banque les conditions à un taux fixe même élevé, parfois sur seulement deux ou trois échéances, et en repoussant donc le problème sur l’avenir, et en rééchelonnant les échéances. Certaines arrivent à sortir de leurs positions à la faveur de fenêtres de marchés.
Concernant le montant des frais financiers que cela peut engendrer, étant donné qu’il est quasi impossible de disposer de visibilité par exemple, sur le niveau des changes à six mois, il est impossible de les anticiper à vingt ou trente ans. Au surplus, on ne connaît pas le poids de chacune des stratégies structurées dans l’encours des collectivités. Le système de provisionnement devrait verrouiller la réapparition de ce problème à l’avenir. Pour l’encours déjà souscrit, les produits à barrière ou snowball ne sont pas tous sortis de leur phase bonifiée, donc il faut craindre que l’on relève encore des éhcances très dégradées dans l’avenir.
M. le rapporteur. En étudiant un cas limite, on pourrait imaginer qu’une collectivité avec 200 millions d’euros de dette, dont 95 % d’emprunts structurés assis sur les parités du dollar ou du franc suisse, se retrouve avec des taux d’intérêt de 28 ou 30 %. Comment faire pour payer 60 millions d’intérêt par an ? Comment équilibrer le budget ? Par 50 points de fiscalité ?
M. Jean-Louis Gagnaire. L’exemple limite présenté par le Rapporteur montre que cette situation est intenable. Avant même d’y arriver, certains maires auditionnés nous ont dit qu’ils seraient dans l’incapacité d’élaborer leur budget et contraints de remettre cette situation entre les mains du préfet.
Je comprends l’intérêt de votre proposition de mettre en place des provisionnements pour prendre en compte les risques. Mais en comptabilité privée, il s’agit de provisionner le risque avéré et non hypothétique, quitte à l’ajuster en fonction de la réalisation de ce risque. Dans le cas des collectivités, comment mesurer ce risque ? Si pour l’avenir, ce système aura un effet préventif, en dégradant immédiatement la qualité des comptes des collectivités concernées, il ne règle pas le passé.
Une question essentielle est celle de la soulte demandée pour sortir de ces prêts : on ne connaît pas sa valeur a priori, qui est réactualisée en permanence. J’ai le sentiment qu’elle est calculée à la tête du client, en fonction de la capacité à négocier des petites communes ou des établissements hospitaliers qui eux, avaient un réseau à leur appui.
Vous appelez à diversifier l’offre de prêts, mais la période actuelle se caractérise par une pénurie d’offres de prêts. Comment diversifier l’offre de prêt dans ses conditions ? Les grandes collectivités pourraient s’adresser au marché obligataire, comme auparavant, libérant capacités de financement pour les collectivités plus petites, mais l’audition du gouverneur de la Banque de France par la commission des Finances a montré que cette raréfaction de l’offre de prêt n’a pas été encore correctement appréhendée.
M. Jean Proriol. Je ne suis pas convaincu que le système du provisionnement soit facile à intégrer. Dans le secteur privé, vous provisionnez aussi pour diminuer vos impôts. Dans les établissements hospitaliers, j’ai constaté que des tentatives de provisionner le coût des futurs départs en retraite ont été battues en brèche par les autorités de tutelle, qui défendent que rien ne presse. Quels critères proposez-vous pour quantifier la provision ?
M. le président. Je vais complexifier cette question du provisionnement. Comment doit-on l’évaluer ? Par ailleurs, pensez-vous que l’on devrait interdire la souscription de certains produits de la Charte Gissler ? Il est impossible de prévoir les évolutions des taux de change à plus de six mois ; à dix ans, cela peut dépendre de facteurs économiques et géostratégiques. Comment un élu local, quelle que soit sa formation, peut-il prendre des risques pour sa collectivité pour les vingt années à venir ? Ne doit-on pas mettre des barrières parmi les produits structurés susceptibles d’être proposés aux collectivités territoriales ?
M. Alain Levionnois. La question d’une éventuelle interdiction de certains types d’emprunts pose de multiples difficultés.
Les prêteurs voulaient placer leurs produits, leur démarche était commerciale ; les stress-tests n’étaient pas adaptés et les prêteurs considéraient les risques comme inexistants lorsqu’ils ont proposé leur souscription.
Aujourd’hui la courbe des taux étant normale, les produits de pente ne semblent pas poser de problèmes. Mais un retournement n’est jamais à exclure. On ne parle que des produits assis sur le franc suisse, mais cela n’est que le dernier accident, pas le prochain.
M. le rapporteur. Ma question allait plus loin. En cas de difficultés, la collectivité pourra toujours augmenter ses taux d’imposition. C’est le contribuable qui va payer.
M. Alain Levionnois. Depuis 1982, s’il apparaît un déséquilibre dans le budget ou le compte administratif d’une collectivité territoriale, avant de prendre une mesure d’office, le préfet doit saisir la chambre régionale des comptes. Quand cela arrive – rarement, mais notamment récemment à Hénin-Beaumont et au Portel – le surendettement est un facteur d’explication mais pas le seul. La CRC propose alors un plan de redressement, qui ne se limite pas à une augmentation des impôts. Si la loi impose un équilibre des comptes, lorsque la CRC est saisie d’un déséquilibre, elle peut proposer un plan de redressement sur plusieurs années, lorsqu’il n’est pas possible de revenir à l’équilibre dans le même exercice. La règle de l’équilibre ne permet pas de changer le plomb en or ; il nous faut tâcher de revenir à l’équilibre à terme.
M. le rapporteur. Cela revient à ne pas fermer le robinet des intérêts à verser…
M. Marc Larue. Si la collectivité a souscrit certains produits assis sur le cours du yen ou du franc suisse, il est possible d’aménager cette dette pour limiter les frais financiers pendant un ou deux ans, en espérant que le marché s’améliore. Le rapport ne propose pas une structure de défaisance, mais il nous semble possible d’améliorer le traitement actuel, un peu artisanal, de l’encours de dette toxique, étant entendu que les collectivités les plus importantes ne sont pas celles qui en ont le plus besoin. Cela pourrait permettre aux collectivités d’attendre et de saisir les opportunités qui se présenteraient pour sortir de certains produits, alors qu’aujourd’hui le risque joue à plein. Il est donc possible à nos yeux d’améliorer la gestion actuelle du risque sans avoir besoin de créer une structure de défaisance.
M. le président. Aucun d’entre vous, contrôleurs sur le terrain, n’a encore répondu à ma question : doit-on continuer à autoriser aux collectivités de souscrire l’intégralité des produits classés par la charte Gissler, ou faut-il interdire certaines classes de produits aux collectivités ?
M. le rapporteur. Faut-il légiférer ?
M. Alain Levionnois. Quel est le statut de la Charte Gissler ? C’est un accord entre quatre banques et l’Association des maires de France. Mais comme elle fait référence, elle peut être en quelque sorte considérée comme une norme professionnelle par le secteur, ce qui peut de ce point de vue être regardé comme satisfaisant.
Mais comme les prêteurs sont intéressés à la vente de produits structurés, permettant de réaliser de plus fortes marges que les produits proposés dans les années 2000, le compromis trouvé pourrait être amendé. Certains produits pourraient être exclus de la charte. Les produits de pente, avec effet de levier, risquent de basculer un jour : mieux vaut les interdire dès aujourd’hui. Les emprunts adossés sur des indices hors zone euro n’ont pas de justification pour être souscrits par les collectivités, car il y a tout ce qu’il faut sur le marché européen. La complexité ne se justifie pas. Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales n’empêche pas que le législateur contrôle et encadre les conditions d’exercice de cette liberté locale. La jurisprudence du Conseil constitutionnel l’a réaffirmé à de nombreuses reprises : ainsi, sa décision relative à la loi du 2 mars 1982 avait partiellement censuré le texte adopté car il prévoyait que certains actes des collectivités territoriales seraient exécutoires de plein droit. À la suite de cette décision, il a été précisé que les actes seraient exécutoires après publication et transmission au préfet. Il y a donc une place pour le contrôle.
Aussi la loi ou la charte pourrait interdire les produits à effet de levier et assis sur des indices hors zone euro. Nous l’avons écrit et nous le confirmons.
M. le président. Donc vous préconisez bien d’interdire les produits actuellement classés au-dessus de C 3 par la charte Gissler.
M. Christian Chapard, premier conseiller à la CRC du Nord-Pas-de-Calais. Je vais concentrer mon intervention sur les cas pratiques qui ont été évoqués. Dans le premier cas qui concernerait une collectivité ou un établissement public dont la structure de la dette serait caractérisée par une part importante de produits fortement risqués, il conviendrait d’être à l’affût de toutes les possibilités de renégociation. Il faudrait aussi inverser le rapport de forces avec les établissements bancaires afin d’être en mesure de renégocier dans de bonnes conditions. Enfin, il pourrait être préconisé de souscrire des produits de couverture des risques pris, afin de passer les échéances difficiles.
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu’il est expliqué à un élu que la gestion active de la dette a permis de baisser le coût total de la dette, il y a lieu qu’il se demande à partir de quelles informations ce coût a été défini. Dans l’appréciation de la situation, les risques pris apparaissent-ils vraiment, avec la valeur de marché des produits souscrits ? Les soultes renégociées y figurent-elles ? Il faut intégrer dans le résultat présenté les risques pris et notamment les provisions afférentes.
M. le président. Vous le faites remarquer avec justesse, dans le cas de ma collectivité, il a fallu que je provoque un audit pour avoir un état des risques pris. Au contraire, les fonctionnaires pensaient, de bonne foi, me présenter une bonne nouvelle, avec une dette bien gérée et une économie de 0,8 point.
M. Christian Chapard. Le gestionnaire qui souscrit, signe ou renégocie les contrats devrait avoir une vision des risques et du coût potentiel. Mais pour établir un bilan d’une gestion active de la dette, il faut toutes les données, et notamment les soultes souvent compensées, qui peuvent être demandées aux prêteurs.
Prévoir des provisions, c’est essentiel : ce n’est pas qu’une question fiscale, mais aussi consacrer une part des ressources actuelles pour faire face à des aléas pouvant survenir dans le futur en conséquence de décision de gestion actuelle.
M. Patrice Calméjane. J’aurai deux questions.
Pourriez-vous nous confirmer que les produits swap doivent être provisionnés dans les budgets des collectivités territoriales ? En prenant en compte la situation des petites communes que nous avons auditionnées la semaine dernière, faut-il prendre en compte la taille des collectivités pour déterminer quel type de produits ils peuvent être en droit de souscrire ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Au terme des négociations, il demeurera un volant incompressible d’emprunts structurés. Les collectivités territoriales concernées souhaitent pouvoir transférer ces encours vers une structure de mutualisation qui serait en position de négocier avec les banques, à charge pour elles de rembourser leur quote-part de capital et d’intérêts. C’est un modèle assez différent de celui de la bad bank de Dexia.
M. le rapporteur. Il existe une directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIFID) qui distingue la clientèle professionnelle et non-professionnelle. Les collectivités territoriales sont classées dans cette seconde catégorie. La loi française, par ailleurs, définit l’usure et fixe des taux maximums applicables aux prêts à taux variable. N’est-il pas envisageable de se fonder sur les dispositions existantes pour protéger davantage les collectivités et les citoyens qui, par leurs impôts, leur assurent des ressources ?
M. Martin Launay, premier conseiller à la CRC Pays de la Loire. Pour répondre à votre question relative au taux de l’usure, je rappelle que ceux-ci sont des taux de marchés majorés.
Je reviens sur l’interdiction des produits structurés. Les raisons du développement des produits structurés sont à rechercher dans le souci des banques au début des années 2000 d’améliorer leur rentabilité alors que leurs marges sur les produits « classiques » proposés aux collectivités locales étaient très faibles, ce qui les a poussées à commercialiser des emprunts structurés, plus rémunérateurs pour elles.
Aujourd’hui, ces produits structurés ne sont plus proposés en l’état par les banques en ce qui concerne les nouveaux prêts. Cependant, la créativité des banques n’a pas ralenti pour autant. Il me semble donc inopérant d’interdire dans la loi certains types de produits risqués qui ne sont plus commercialisés et encore moins d’interdire ceux qui pourraient apparaître dans le futur, le législateur ne pouvant être aussi réactif que les financiers sont créatifs.
M. le président. Le véritable obstacle à la renégociation réside, à mon avis, dans les indemnités de remboursement anticipé et les pénalités de sortie insurmontables qui sont imposées aux collectivités qui tentent de renégocier leurs contrats.
Je rappelle aussi que les représentants des petites communes nous ont expliqué qu’on ne leur proposait pas d’autre type de produits pour leurs emprunts ; la seule proposition qu’on leur faisait était le produit appelé TO-Fix.
Enfin, j’attire l’attention de nos collègues sur l’évolution préoccupante de la parité entre l’euro et le franc suisse. Celle-ci est, pour l’heure, artificiellement contenue à 1,22 par la banque centrale helvétique mais on peut se demander combien de temps celle-ci pourra tenir le cours de sa monnaie.
M. le rapporteur. Je partage le point de vue du Président. Le vrai problème est celui de la soulte demandée aux collectivités désireuses de rembourser leurs emprunts structurés. Ce coût résulte des couvertures souscrites par les établissements de crédit mais dont les collectivités territoriales ne sont pas responsables.
M. Martin Launay. La soulte, comme le problème du stock de dette, est effectivement un obstacle difficilement surmontable pour les collectivités ayant déjà souscrit des emprunts structurés. Il n’y a pas, à cet égard, de solution miracle.
Cette question renvoie d’ailleurs à celle du partage de la responsabilité. Ce n’est pas parce que l’on est incapable d’évaluer le risque lorsqu’on analyse un contrat d’emprunt, que l’on ne peut pas voir qu’il existe un risque dans cet emprunt.
J’ajoute que votre proposition de plafonner au niveau de l’usure le taux des contrats de prêts en cours aboutirait à limiter la rémunération des créanciers et leur occasionnerait des pertes en raison du fait que les banques retournent les positions pour neutraliser le risque dans leur bilan et doivent se refinancer.
M. le président. J’entends vos remarques : ce n’est pas le moment, pour les collectivités de renégocier leurs contrats car le contexte économique ne leur est pas favorable. Mais est-il souhaitable de différer cette renégociation et tenter de gagner du temps ? Cela conduit à transmettre les difficultés au prochain maire pour solder la situation. On a vu que des emprunts avaient été souscrits la veille des élections.
M. Alain Levionnois. L’expression « renégociation d’emprunt » prête à confusion. Elle est souvent comprise de travers, faisant croire qu’il est possible d’alléger la charge d’un emprunt, alors qu’il s’agit d’un reprofilage, d’un agencement différent d’une dette qui reste la même. Le premier rapport public particulier de la Cour des comptes avait attiré l’attention sur ce point dès 1991, et ces phénomènes y sont très bien expliqués. En pratique, l’emploi de ce terme par les professionnels devrait être banni. Et si cela avait un sens, on pourrait même souhaiter qu’il soit interdit par la loi.
L’affaire Dexia est un sujet grave, qui conduit à s’interroger sur le coût de la ressource financière pour les collectivités à l’avenir, car on peut s’attendre à ce que les taux s’élèvent à l’avenir. Les marges bancaires ont déjà augmenté. De plus, le coût des ressources bancaires est majoré par le taux des CDS qu’elles doivent acheter pour garantir leurs prêteurs. Le marché interbancaire est aujourd’hui très dégradé. En outre, la mise en œuvre des dispositions sur les ratios de liquidité de l’accord de Bâle III va contribuer à majorer le coût du crédit. La dette des collectivités s’est à nouveau mise à augmenter, son coût va se renchérir.
On peut certes allonger les durées de remboursement, mais on ne peut penser que l’on fera des économies. L’idée de caper les taux par la loi se heurte peut-être à un problème de constitutionnalité ; il faudrait l’étudier ; cela aurait en tout cas des conséquences importantes sur le marché financier, qui ne le supporterait sans doute pas.
Les contrats de prêts des collectivités ne sont pas des contrats relevant du droit administratif, domaine dans lequel l’autorité publique peut, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, résilier unilatéralement le contrat sous réserve de dédommagements. Si l’on s’inspirait de cette idée pour encadrer les conditions de l’offre de prêt, dans le cadre du droit privé, l’opération serait déséquilibrée, ce qui découragerait les banques de prêter, ou bien elles se prémuniraient en facturant leur manque à gagner éventuel d’une autre manière. On ne voit pas là de solution, c’est pourquoi la règle de la provision présente des avantages.
La règle d’or de l’équilibre budgétaire des collectivités présente un inconvénient : elle joue sur une année mais n’intègre pas de pluri annualité. Or l’emprunt est une recette nette qui équilibre le budget de l’année mais c’est aussi une dépense future. Cette présentation masque la réalité des budgets futurs, qui présenteront des dépenses alourdies de frais financiers. Un emprunt d’une durée de quarante ans a des conséquences sur les comptes jusqu’en 2050 ! Le système de la provision, que la Cour a préconisé déjà trois fois, remédierait à cette faiblesse de la loi relative à la présentation des comptes des collectivités. Nous sommes conscients du fait que le principe du provisionnement obligatoire (réglementé) a soulevé des réticences. Par exemple, une première version de la réglementation M 14, apparue en 1996, prévoyait une provision pour différé d’amortissement applicable aux emprunts obligataires. Ce système a été abandonné en 2006 ; toutes les provisions réglementées ont été supprimées, et il ne reste plus que des provisions pour risques et charges. Il nous paraît utile de prévoir un complément au système actuel pour améliorer la fiabilité et la sincérité des comptes.
M. le président. Je vous remercie pour les nombreuses informations et idées qui ont été émises, dont le rapporteur fera certainement un grand usage.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Les produits structurés commercialisés par les banques » avec la participation de M. Pierre Mariani, président du comité de direction de Dexia SA ; M. Olivier Klein, directeur général en charge de la banque commerciale et assurance du groupe BPCE, et M. Jean-Sylvain Ruggiu, directeur du secteur public de BPCE ; M. Francis Canterini, directeur général délégué du Crédit agricole Corporate & Investment Bank (CA CIB), filiale de la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit agricole, et M. Philippe Debin, directeur adjoint de la direction des régions de France.
(Procès verbal de la séance du mercredi 2 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Avec les deux tables rondes organisées aujourd’hui, les travaux de notre commission d’enquête entrent dans une troisième séquence. Après avoir entendu les représentants des collectivités et les acteurs publics qui ont souscrit des produits structurés, puis les spécialistes publics et privés de ces produits financiers, nous allons désormais interroger les établissements de crédit qui les ont proposés. Deux tables rondes successives nous permettront d’interroger les dirigeants des banques françaises, puis les responsables des filiales des banques étrangères qui ont été actives pendant la dernière décennie sur le marché des prêts aux collectivités territoriales.
Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Notre commission d’enquête a été créée pour analyser les conditions dans lesquelles des emprunts et produits structurés ont pu être proposés aux collectivités, non pour juger. Je ne dirai donc pas : « Place à la défense » !
En 2005, la Cour de cassation a rappelé aux banquiers que, bien plus qu’une obligation générale de conseil, ils ont, vis-à-vis de leurs clients particuliers comme institutionnels, un devoir de mise en garde, au regard « des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts ». Nous verrons comment cette obligation a été respectée par chacun des établissements.
MM. Pierre Mariani, Olivier Klein, Jean-Sylvain Ruggiu, Francis Canterini et Philippe Debin prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Je vous remercie de m’avoir transmis les informations détaillées que je vous avais demandées sur les produits structurés commercialisés par vos établissements auprès des collectivités territoriales et des acteurs publics locaux, en invoquant l’article 6 de l’ordonnance du 17 novembre 1958, relatif au fonctionnement des commissions d’enquête parlementaire, pour demander la levée du secret bancaire. Conformément à l’esprit du texte, je me suis engagé, en contrepartie, à ne faire figurer dans le futur rapport public que des données agrégées. Elles me permettront de proposer une évaluation de l’encours global et une analyse du risque que représentent les emprunts structurés pour les finances locales.
En attendant, je souhaite vous interroger sur la politique commerciale conduite par vos établissements à l’égard des collectivités territoriales et sur les caractéristiques des produits structurés.
Pouvez-vous nous expliquer comment et par qui sont élaborées les formules à la base des produits structurés que vous proposez ? Quel est le rôle des salles de marchés ?
Comment sont choisis les indices de référence ? Qu’est-ce qui justifie, par exemple, cet incroyable engouement pour le franc suisse ?
Pouvez-vous décomposer le produit net bancaire (PNB) dégagé sur un prêt structuré ? Les marges bancaires sont-elles les mêmes pour un prêt structuré et un prêt à taux fixe ? Le coût en fonds propres est-il identique ?
M. Pierre Mariani, président du comité de direction de Dexia SA. La couverture des opérations est principalement assurée par les salles de marchés. Très souvent, les index de ces opérations figurent explicitement dans les appels d’offres lancés par les collectivités locales, comme ce fut le cas de celui d’une grande collectivité du Nord de la France. Chez Dexia, les salles de marchés sont, en premier lieu, chargées de définir les caractéristiques du prêt conformément aux demandes des collectivités ; et, en second lieu, des opérations de couverture puisque nous n’avons jamais vendu de swaps isolés d’une opération de crédit ni conservé les positions dans le bilan de la banque.
Le franc suisse est loin d’être majoritaire dans l’ensemble des prêts structurés ; mais il l’est dans les récriminations de nos clients, parce qu’il est l’index qui a le plus décalé avec la crise : il a franchi les barrières au-delà desquelles se déclenchent des taux d’intérêt plus élevés. C’est pour cette raison que l’on a surtout parlé des prêts structurés en francs suisses. On entend moins les 10 % de nos clients, qui ne paient que 0,5 % environ de taux d’intérêt sur leurs prêts structurés.
Enfin, il n’y a pas de différence de coût significative entre les prêts à taux fixe et les prêts à taux variable.
M. le rapporteur. Qu’en est-il des marges ?
M. Pierre Mariani. Elles sont un peu plus élevées pour les produits structurés ; mais, pour l’essentiel, elles sont redistribuées sur les marchés afin d’assurer notre couverture.
M. le président. Quelle est, en termes de marge, la différence par rapport aux prêts à taux fixe sur vingt ans, par exemple ?
M. Pierre Mariani. Il est difficile de vous donner une réponse globale. Notre taux d’intérêt moyen est de 3,91 % ; il est de 6,20 % pour les 10 % de nos clients qui paient les taux les plus élevés, et de 0,57 % pour les 10 % qui paient les taux les moins élevés. Les marges entre les prêts à taux fixe et les prêts structurés sont de l’ordre de quelques points de base seulement.
M. le président. Y a-t-il une comptabilité analytique par client et par opération ?
M. Pierre Mariani. Nous devons mesurer la marge réalisée pour chaque prêt et analyser l’ensemble du portefeuille.
M. Olivier Klein, directeur général en charge de la banque commerciale et assurance du groupe BPCE. Dans le cas de l’ex-groupe Caisses d’épargne, devenu BPCE, l’ingénierie financière était assurée par Ixis puis Natixis, en fonction de la demande et des produits existants. Les instruments proposés étaient sélectionnés par un comité interne au groupe Caisses d’épargne, puis agréé par ces dernières, de façon individuelle. Les indices sous-jacents dépendaient de la période, de ce qui était demandé, et de l’état du marché. Nous répondions, nous aussi, à des appels d’offres souvent précis ou aux sollicitations directes des collectivités. Les Caisses d’épargne s’adressaient alors à Ixis ou Natixis, même si, en général, les offres étaient présentées sur catalogue.
Les produits indexés sur le franc suisse ont été proposés par Ixis/Natixis à partir de décembre 2006 pour répondre à la demande ; nous y avons mis un terme à la fin de 2008, la crise ayant considérablement accru la volatilité des changes. Avant la crise, l’indexation sur le franc suisse paraissait sûre, compte tenu de la stabilité historique de cette devise. Elle offrait en outre un taux d’intérêt bien inférieur au taux en euro, ce qui correspondait à la demande. Nous avons beaucoup accompagné nos clients par la suite, conformément à notre tradition de proximité et de conseil.
Je ne sais quel est le PNB d’Ixis ou Natixis. L’un comme l’autre retournent leurs positions sur le marché pour couvrir les options souscrites par le client, le crédit étant naturellement refinancé par les Caisses d’épargne. Les marges que celles-ci réalisent sur les prêts structurés, qui répondaient à une vraie demande, sont très proches de celles réalisées pour les prêts à taux fixe, à savoir de 20 à 30 centimes de taux.
Par ailleurs, seuls 3 % de nos crédits structurés consentis aux collectivités – une centaine, au total – ont été indexés sur le franc suisse.
Les prêts structurés sont soumis aux mêmes exigences que les autres crédits en matière de fonds propres. S’agissant d’Ixis ou Natixis, les règles de Bâle II imposaient d’inclure les produits dérivés dans le ratio de fonds propres.
M. Francis Canterini, directeur général délégué du Crédit agricole Corporate & Investment Bank (CA CIB), filiale de banque de financement et d’investissement du groupe Crédit agricole. La distribution de nos produits est assurée par les caisses régionales. Les produits vendus aux collectivités locales peuvent être traditionnels ou structurés, les seconds relevant de CA CIB et de la Banque de financement et de trésorerie, bientôt appelée à fusionner avec le CA CIB.
CA CIB montait donc le produit en fonction d’un appel d’offres ou de la demande d’une collectivité. Dans ce cadre, la salle des marchés assure l’ingénierie – en copiant généralement les produits existants, puisqu’il n’existe pas de brevets en la matière –, définit un prix – lequel dépend du prix fourni par le marché, la banque n’ayant pas vocation à rester en position – et assure la couverture, afin d’exclure le risque du bilan de la banque. Lorsque l’opération est complexe, ce risque est redistribué à de nombreuses contreparties.
Les collectivités souhaitaient réduire la charge de leur endettement, ce qui suppose bien entendu des compensations : les barrières et les indexations sur les devises étaient conçues pour répondre à cette demande. Toutefois, pour CA CIB, l’indexation sur le franc suisse n’a concerné que dix opérations.
Par définition, les produits structurés sont plus sophistiqués : ils requièrent donc davantage d’ingénierie et de services. La marge, ou plutôt la commission, est donc fonction de la sophistication du produit et de sa charge en fonds propres. Si, au niveau des caisses régionales, cette charge dépend de la qualité de la contrepartie – et, par définition, les collectivités locales sont des contreparties de qualité –, au niveau de la banque d’investissement, elle dépend du nombre des opérations et des risques liés aux différentes contreparties.
M. le rapporteur. Quels sont les mécanismes de couverture utilisés par vos établissements lorsqu’ils concluent un prêt structuré ? Quel en est le coût ? Comment sont calculées les indemnités de remboursement anticipé ? Quelle est leur justification économique ?
À part les collectivités territoriales, quelle est la clientèle pour des prêts structurés ?
Outre les prêts structurés, proposez-vous une offre de produits dérivés – swaps et contre-swaps – aux collectivités territoriales ?
M. Pierre Mariani. La commercialisation de ces produits a beaucoup évolué au cours du temps. Le Crédit local de France, ancêtre de Dexia, commercialisait trois types de prêts en 1995 ; Dexia en commercialisait quarante-trois en 2000, cent soixante-sept en 2006, deux cent vingt-trois en 2008, et n’en commercialise désormais plus que quinze.
La sophistication des produits ne s’est donc pas faite de manière subreptice ; en juin 2006, le groupe Dexia, dans ses présentations officielles, se targuait de l’accompagner en indiquant qu’elle était liée aux lois de décentralisation et à la plus grande autonomie des collectivités locales. En d’autres termes, les produits dont nous parlons répondaient à une demande globale : mon prédécesseur, que vous recevrez prochainement, pourra vous expliquer ces évolutions mieux que moi.
Mes convictions sont claires puisque, depuis mon arrivée à la tête de Dexia en octobre 2008, le groupe n’a pas commercialisé un seul produit structuré hors charte Gissler, à l’exception de ceux qui sont nécessaires aux collectivités pour sortir de leur situation.
Dexia a toujours refusé de commercialiser certains produits, en particulier les snowballs, dont les taux d’intérêt appliqués une fois les barrières franchies le restent jusqu’au terme du prêt. Elle n’a jamais commercialisé non plus de swaps ou d’autres produits de couverture indépendamment d’opérations de prêt. Ceux-ci ont été consentis dans une perspective de gestion de l’encours, d’une réduction du coût de la dette ou de son étalement dans la durée. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il est si difficile de se défaire de ces emprunts : certains d’entre eux ont pu faire l’objet de quatre ou cinq restructurations successives via des swaps conclus avec des établissements que nous ne connaissons pas.
Le montant des indemnités de remboursement anticipé reflète l’évolution des taux d’intérêt et des swaps ; en d’autres termes, la valeur sous-jacente de la structure. L’indemnité de remboursement anticipé est le reflet du mark-to-market des positions qu’il faut racheter pour annuler l’opération.
L’encours global des prêts structurés par le groupe Dexia, toutes entités confondues, est passé de 30,5 milliards d’euros à la fin décembre 2008 à 22,9 milliards au 31 août 2011. Il s’élevait à environ 25 milliards au 31 décembre 2009, dont 18,4 milliards en charte Gissler et 6,8 milliards hors charte, tous clients confondus.
Au 31 août 2008, les encours de crédits hors charte Gissler atteignaient 4,8 milliards d’euros pour les collectivités locales, 0,8 milliard pour les établissements de santé et 0,47 milliard pour les organismes de logement social. Des produits structurés ont donc été vendus à toutes les catégories de clients, y compris institutionnels, mais l’ordre de grandeur de leurs encours est évidemment très différent de celui des seules collectivités locales. Sur un ensemble de 3 000 clients, seules quelque 300 collectivités locales ont souscrit des emprunts structurés hors charte Gissler.
M. le rapporteur. Les collectivités locales avaient une gestion de « bon père de famille », avec des prêts à taux fixe d’environ 4 %. Confirmez-vous que Dexia les a massivement démarchées, après avoir analysé leurs dettes, pour les encourager à souscrire des prêts structurés, avec l’avantage immédiat d’une baisse des taux en contrepartie de risques à plus long terme ?
M. Pierre Mariani. Je ne puis vous répondre, car je n’étais pas en fonction à l’époque. Cependant je n’ai pas l’impression qu’il s’agisse du point essentiel.
Beaucoup de collectivités locales s’étaient endettées à des taux fixes très élevés, si bien que les indemnités de remboursement anticipé étaient elles-mêmes très élevées ; or, entre 2004 et 2008, la tendance était à la baisse des taux : l’un des moyens d’en profiter sans payer d’indemnités de remboursement anticipé était de souscrire des prêts structurés, lesquels réintégraient une partie de ces indemnités dans la base de financement.
M. le rapporteur. Mais, aujourd’hui, les collectivités ne comprennent pas pourquoi elles doivent payer autant pour se défaire de ces prêts.
M. Pierre Mariani. Une collectivité, dont je ne peux citer le nom, nous poursuit actuellement au civil et au pénal pour défaut de conseil car, son prêt étant repassé à taux fixe en 2007, elle n’a pu bénéficier de la baisse des taux.
De fait, entre 2006 et 2008, les taux d’intérêt étaient très bas si bien que, à la veille d’échéances électorales, certaines collectivités locales ont voulu alléger encore la charge de leur dette. Il a donc fallu leur proposer des structures aux performances plus agressives, incluant des effets de levier ou des indexations plus exotiques. Reste que l’allègement de la charge de la dette est réel.
M. le président. Vous avez estimé à 300 le nombre de vos clients ayant souscrit des emprunts toxiques. Quel est le mark-to-market de l’ensemble de vos transactions hors charte Gissler ?
M. Pierre Mariani. Par définition, ce chiffre change tous les jours. Pour les collectivités locales, le mark-to-market global avoisine les 7 milliards d’euros.
M. le président. Puisqu’ils varient tous les jours, quels sont les chiffres que vous donnez aux collectivités ?
M. Pierre Mariani. En premier lieu, notre groupe est à ma connaissance le seul à envoyer aux collectivités, depuis 2009, une information complète sur leur situation, y compris sur le montant du mark-to-market à la fin de l’année. Si un client a souscrit un emprunt à taux fixe, le mark-to-market peut être négatif compte tenu du faible niveau actuel des taux d’intérêt ; mais il ne sera jamais payé si le prêt n’est pas remboursé de façon anticipée.
Sur les autres indices, la volatilité est aujourd’hui considérable : nous sommes pour ainsi dire en dehors de toutes les hypothèses de valorisation initiales.
Pour être précis, 346 collectivités locales, 68 établissements de santé et 31 organismes de logement social ont souscrit des emprunts à taux structurés hors charte Gissler.
M. Olivier Klein. L’encours total des prêts consentis aux collectivités locales et aux établissements publics concernés, soit 27 000 clients, s’élève à 62 milliards d’euros, dont 4,6 milliards de prêts structurés, lesquels représentent donc 7,4 % de l’encours et concernent seulement 5,2 % de nos clients. Nous n’avons donc manifestement pas démarché massivement dans ce domaine. L’encours des emprunts hors charte Gissler est de 1,1 milliard d’euros et concerne 0,6 % de nos clients.
M. le président. Selon les représentants des chambres régionales des comptes, les produits qui posent problème sont ceux situés à partir du seuil C3. J’aimerais donc que vous limitiez vos analyses à ces produits, ou aux produits hors charte Gissler.
M. Olivier Klein. Je peux bien entendu communiquer ces données à la commission d’enquête.
M. le rapporteur. Il doit être possible de les calculer à partir des éléments que vous avez donnés.
M. Olivier Klein. Quoi qu’il en soit, les clients concernés par les prêts hors charte Gissler sont très peu nombreux ; nous les rencontrons au moins une fois par an, comme l’ensemble de nos clients ayant souscrit des emprunts structurés. Nous les alertons dès qu’un prêt commence à poser des problèmes, tout en leur faisant des propositions.
Nous ne percevons aucune marge additionnelle sur les indemnités de remboursement anticipé, lesquelles correspondent strictement au coût de retournement des positions aux taux en vigueur. Lorsque le prêt comporte des options, Natixis nous en communique la valorisation au jour dit sur le marché.
Bien entendu, nous proposons beaucoup d’autres solutions, telles que l’allongement des échéances ou le refinancement de l’indemnité et du prêt. D’ailleurs, 20 % de nos clients se sont défaits de leur emprunt : 10 % de façon définitive depuis 2008, et 10 % de façon transitoire.
Le groupe Caisses d’épargne s’était par ailleurs interdit de vendre ces prêts structurés hors charte aux collectivités locales de moins de 10 000 habitants, sauf demande expresse de leur part.
Quant aux produits dérivés, les Caisses d’Épargne n’en ont jamais proposé directement ; Ixis ou Natixis, en revanche, continuent de le faire auprès des collectivités importantes, généralement dans le cadre des critères de gestion actuels afin d’éviter de futures difficultés. Aujourd’hui, les Caisses d’Épargne ne proposent plus que des produits structurés allant jusqu’à 2B.
M. le rapporteur. Les collectivités s’apparentent-elles plutôt, dans votre esprit, à des entreprises ou à des particuliers ? Pourquoi ce seuil de 10 000 habitants ?
M. Olivier Klein. Nous agissons toujours en fonction du niveau de professionnalisme de nos interlocuteurs. Dans chaque caisse, le comité d’agrément sélectionne ainsi les produits en fonction de la taille des collectivités. Depuis 2009, des stress scenarii sont obligatoirement annexés à nos contrats ; c’est d’ailleurs ce que faisaient la plupart des Caisses d’épargne, et notamment celle que je dirigeais, bien avant 2009.
M. Francis Canterini. L’exposition du groupe Crédit agricole aux crédits consentis aux collectivités locales atteint 39 milliards d’euros, dont 24 milliards de prêts structurés. Sur ces 24 milliards, 18 milliards correspondent à des encours décaissés, et 5 à 6 milliards à des swaps non attachés à des prêts, mais vendus à des collectivités de taille importante, qui en ont besoin pour gérer leur dette.
Notre établissement se couvre auprès d’autres établissements de crédit en prenant des positions symétriques aux produits vendus à nos clients. Le remboursement anticipé revient à inverser ce schéma en faisant de nous des clients : l’indemnité correspond donc à ce que nous devons payer à la contrepartie si nous rompons avant terme le contrat que nous avons signé avec elle. Pour l’ensemble des contreparties, le mark-to-market hors charte Gissler atteint quelque 300 millions d’euros.
Il faut souligner par ailleurs la dissymétrie entre, d’une part, les entreprises ou les collectivités – même si je n’assimile pas les secondes aux premières – et, de l’autre, les banques d’investissement. Ces dernières valorisent leurs positions au mark-to-market si bien que toute dégradation de la situation se traduit aussitôt dans la comptabilité et par des appels de marge supplémentaires, si bien qu’elles savent toujours ce qu’elles doivent à leurs contreparties. Ce n’est pas le cas des collectivités, qui ont parfois la mauvaise surprise de découvrir qu’elles doivent verser des montants qu’elles n’ont pas provisionnés.
Les banques ont payé le prix de la sophistication des prêts structurés mais cette époque est derrière nous. Le profil de risque de CA CIB, comme de beaucoup d’autres banques d’investissement, a fortement diminué avec la crise ; celle que nous traversons a d’ailleurs confirmé cette tendance.
Mme Valérie Fourneyron. Les prêts structurés qui ont été proposés aux collectivités locales étaient interdits au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Faisaient-ils l’objet de débats au sein de vos établissements respectifs ?
Aviez-vous vous-mêmes recours à ces emprunts indexés ? Il me semble que non.
Pour certaines collectivités, aux dires de leurs représentants, Dexia jouait à la fois le rôle de prêteur et de conseil. Comment conceviez-vous ce rôle ? Pouvez-vous par ailleurs nous confirmer qu’aucune commission n’a été versée aux intermédiaires financiers entre Dexia et les collectivités, intermédiaires qui ont pu jouer le rôle de conseil auprès de ces dernières ?
Même si vous n’étiez pas en responsabilité à l’époque, votre réponse sur un éventuel démarchage commercial des collectivités ne m’a pas semblé très ferme. Qu’en est-il exactement ?
M. Daniel Boisserie. Si vous étiez juge ou expert, comment départageriez-vous les responsabilités respectives de l’État, des collectivités, des services de conseil et des banques ?
M. Patrice Calméjane. Vous nous avez essentiellement parlé du détail de vos produits. Or j’aimerais surtout savoir pourquoi les produits structurés ont, à un moment donné, remplacé les emprunts à taux fixe. M. Mariani nous a par exemple indiqué que Dexia avait fortement réduit le nombre de produits proposés.
Ma deuxième question porte sur le niveau de vos interlocuteurs. Afin de vérifier que vous comprenez vous-mêmes ce que vous avez vendu, je me permets de citer quelques extraits de l’un de vos contrats de prêt, qui comporte trois phases. « Pendant la première phase » – soit deux ans – « le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est de 2,68 % par an » – jusqu’ici, chacun comprend. Pendant la deuxième phase, de dix-sept ans, « si le Libor USD 12 mois est inférieur ou égal aux 6,75 % des taux d’intérêt appliqués au décompte des intérêts égal au taux minimum constaté entre l’Euribor 12 mois et le taux fixe de 6 % – taux minimum minoré d’une charge de 0,50 % –, ce taux d’intérêt s’applique à la période d’intérêts écoulée », etc. Le paradoxe est que le même document comporte un tableau d’amortissement établi sur la base d’un taux d’intérêt, et qui précise le coût total de l’emprunt.
Mais le pire concerne le remboursement anticipé, qui « s’effectue contre le règlement d’une indemnité, à payer ou à recevoir par l’emprunteur, qui a pour objet d’assurer l’équilibre financier du contrat entre les deux parties. L’indemnité de remboursement anticipé est établie par [la banque] en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers, 10 jours ouvrés avant la date du remboursement anticipé. Par jour ouvré, il faut entendre un jour où le système transeuropéen [de règlement] TARGET est ouvert. Si la date ainsi déterminée ne correspond pas à un jour où les banques sont ouvertes à Paris, la date retenue sera le jour précédent où celles-ci sont ouvertes à Paris […]. Le Jour de Fixation, [la banque] demande préalablement à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler ». En d’autres termes, la fixation du montant de l’indemnité est déléguée à un tiers ! « L’indemnité de remboursement retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités. » Admettez qu’il est difficile d’y voir clair !
Je reviens donc à ma question : quel était le niveau de vos interlocuteurs, qui avaient à déchiffrer une telle bouillie ? Comment peut-on annexer un tableau d’amortissement à un contrat qui, par ailleurs, comporte des formules de calcul de taux d’intérêt associées à des cours de devises ? Depuis au moins trente ans, on le sait, les taux de change sont soumis à de réelles fluctuations !
Vous dites avoir souvent répondu à des appels d’offres. Mais les représentants des collectivités nous ont plutôt fait part de démarchages commerciaux agressifs. Le maire que je suis sait bien que, tous les ans, les établissements bancaires sollicitent les communes afin d’analyser leurs comptes administratifs et leurs budgets primitifs, pour leur faire des propositions sur la gestion de leur dette. Ce sont en quelque sorte des appels d’offre à l’envers.
M. Pierre Mariani. Si l’on décortiquait les appels d’offres pour la construction d’un collège ou d’un lycée, on s’apercevrait que les spécifications techniques sont tout aussi complexes.
M. Patrice Calméjane. Je ne suis pas d’accord – et j’ai travaillé pendant quinze ans dans le BTP.
M. Pierre Mariani. Et moi, pendant quinze ans dans la finance : je comprends donc mieux les index financiers.
Je vais vous donner un exemple d’indexation fréquent : le maximum entre, d’une part, la moyenne mensuelle de l’Euribor trois mois et de la moyenne mensuelle de l’EONIA divisée par quatre, plus l’inflation divisée par deux, et, d’autre part, le taux d’inflation augmenté de 0,25 %. Ce mécanisme, analogue à celui que vous avez cité, est tout simplement celui de l’indexation du Livret A. Nous parlons d’un domaine où la formalisation est nécessaire.
M. le rapporteur. Mais, puisque l’indexation est aléatoire, pourquoi associer un tableau d’amortissement précis ?
M. Pierre Mariani. Je ne connais pas précisément le contrat cité par M. Calméjane. Reste qu’un tableau d’amortissement est nécessaire pour décrire le montant prévisionnel des échéances en partant d’une hypothèse d’indexation au moment de la signature du contrat.
Si les prêts structurés ont remplacé les prêts de long terme à taux fixe, c’est que les collectivités, je le répète, ont elles-mêmes souhaité renégocier ces derniers. Je ne pense pas que Dexia se soit livré à un démarchage commercial agressif.
M. le président. Il y aurait donc eu des manifestations d’élus locaux pour vous réclamer de nouveaux produits ?
M. Pierre Mariani. Pas des manifestations, non ; mais beaucoup d’élus locaux ont émis le souhait de diminuer la charge de la dette de leur collectivité. Peut-être y a-t-il eu démarchage au départ ; mais que dire d’une collectivité qui, dans le cadre d’un prêt consenti par Dexia, a sollicité six fois de suite six établissements financiers pour renégocier à la baisse la charge annuelle de taux d’intérêts ? Reconnaissons que persévérer dans une telle démarche revient un peu à tenter le diable. Par ailleurs, le phénomène a trouvé ses limites lorsqu’il s’est agi de faire baisser des taux d’intérêt déjà historiquement bas. Il a fallu chercher des structures encore plus agressives pour faire baisser la charge des taux.
Madame Fourneyron, Dexia n’a jamais conseillé les collectivités pour lancer leurs appels d’offre. Peut-être faudra-t-il, d’ailleurs, que votre commission d’enquête se penche sur le rôle des conseils financiers, qui sont aujourd’hui les plus agressifs contre les banques, alors qu’ils étaient souvent à l’origine des initiatives des collectivités locales en matière de prêts structurés. Ce sont d’ailleurs les collectivités qui les rémunéraient, non les banques.
Mme Valérie Fourneyron. Des élus de petites communes nous ont dit que Dexia avait joué un rôle de conseil.
M. Pierre Mariani. Non, un prêteur n’a pas le droit de le faire. Peut-être faudrait-il s’interroger sur les conditions exigées pour s’installer comme conseil financier des collectivités locales. Et certains se vantaient d’avoir proposé le « deal de l’année » à telle ou telle collectivité, avec une couverture indexée, par exemple, sur le cours de matières premières.
Les problèmes de définition sont en effets importants, monsieur le président ; aussi les chiffres que j’ai cités concernent-ils l’ensemble des emprunts à taux variable.
Quant au niveau des interlocuteurs, la gestion des dossiers dépend forcément de la taille des collectivités, les plus grandes disposant de services financiers étoffés. De ce point de vue, le seuil de 10 000 habitants nous a semblé significatif eu égard au degré de complexité des dossiers : aujourd’hui, notre gestion est individualisée ; elle s’effectue au cas par cas, de façon proactive avec les grandes collectivités, et ce sans coût additionnel. Nous nous efforçons aussi de suivre de près les petites collectivités – notamment celles qui ont souscrit des emprunts indexés sur le franc suisse –, en procédant, au besoin, à des gels temporaires d’annuités ou de versements d’intérêts. Si nous pouvons le faire, d’ailleurs, c’est que nous savons qu’aucun de ces prêts ne franchit de manière définitive les barrières et que donc, si les paramètres de marché évoluent, nous pourrons proposer des solutions de sortie.
Je rappelle aussi qu’au cours des trois dernières années, certaines collectivités ayant souscrit des emprunts très structurés ont refusé nos propositions de sortie à taux fixe parce qu’elles jugeaient les taux trop élevés, or la dégradation des paramètres de marché a abouti à des situations pires que ce qu’elles étaient ces douze, dix-huit derniers mois. Ces dossiers exigent donc une gestion dans le temps.
Enfin, vous avez posé la question de savoir si nous avons recours à des structurations pour nous-mêmes, nous nous protégeons effectivement d’un certain nombre de risques ; et dans le cadre de la gestion du bilan de la banque, nous avons recours à des swaps mais qui ne sont pas sur des structures comme celles-là.
M. Olivier Klein. En matière de taux, qu’ils soient fixes ou variables, la gestion du risque est indispensable. Il va de soi qu’emprunter à taux fixe revient à anticiper une augmentation des taux, et emprunter à taux variable, à anticiper une baisse. Dans les deux cas, il y a un risque. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il convient de mixer les deux types de taux au passif d’un bilan.
Les Caisses d’épargne structurent elles aussi les produits qu’elles souscrivent, même si elles le font différemment. L’épargne des clients sert à financer les crédits, mais elle n’est pas tout à fait suffisante : nous empruntons donc à taux fixe comme à taux variable, en passant éventuellement de l’un à l’autre, selon les anticipations, via des swaps et/ou limitant les risques avec des options telles que les caps et les floors. Nous procédons de la même façon pour nos placements. Certaines entités sont plus ou moins aptes à traiter de tels dossiers, selon leur degré de complexité et la compétence des équipes. Naturellement, il faut suivre ces produits.
On nous a parfois présenté des produits dont le niveau de complexité nous semblait trop élevé ; à cet égard, j’ai toujours recommandé à mes équipes de ne pas acheter des produits qu’elles ne comprennent pas.
À la fin des années soixante-dix et au début des années quatre-vingt, les taux, qui pouvaient atteindre 17 %, sont devenus plus volatils ; c’est alors que l’on a commencé à gérer ce risque.
Si l’on peut toujours se tromper dans les anticipations, chacun souhaitait, avant la crise, bénéficier de la baisse des taux. Les produits les plus sophistiqués, induisant le plus de risques, ont été conçus à la fin des années quatre-vingt-dix, pour répondre à la demande des emprunteurs de renégocier à la baisse des taux déjà très bas.
Comme je l’ai dit, seulement 0,6 % de nos clients, soit environ 150 sur 27 000, sont concernés par les produits hors charte Gissler. Nous ne les avons d’ailleurs commercialisés qu’en 2007 et 2008, avant d’arrêter dès que les conditions d’indexation sur le franc suisse sont apparues défavorables. Nous avons alors proposé des solutions de sortie aux clients concernés ; mais, dans un contexte de bonification des taux comprise dans ces produits, l’écoute a peut-être été moindre.
Certains produits structurés n’en demeurent pas moins de qualité ; il est normal, je le répète, de gérer les risques liés aux taux : c’est d’ailleurs ce qui a été enseigné au Centre national de la fonction publique territoriale. Des conseillers financiers ont sans doute, pour justifier leur emploi, cherché des produits sophistiqués, et peut-être les banques ont-elles proposé des produits qui l’étaient trop. En tout état de cause, il existait une émulation entre les collectivités locales pour emprunter moins cher, et ce via des emprunts qui pouvaient être tantôt fiables tantôt plus risqués.
M. le rapporteur. Avez-vous eu recours à ce type de produits pour résoudre des problèmes de liquidité ?
M. Olivier Klein. Non. Les Caisses d’Épargne ont commercialisé des produits structurés, mais en allant chercher la ressource, soit dans l’épargne de leurs clients, soit sur les marchés financiers. La structuration des crédits n’a pas d’impact sur nos ressources financières.
M. le président. Vos considérations étant restées un peu techniques, permettez-moi de me faire l’avocat du diable. M. Mariani affirme que Dexia a cessé de commercialiser des produits structurés hors charte Gissler dès qu’il a pris la direction du groupe, et, aux dires des autres intervenants, ces produits répondaient à une demande des collectivités à une époque où les marchés financiers étaient plus stables. Ce qui me gêne, c’est qu’à aucun moment vous n’évoquiez votre rôle de banquier. Avez-vous mis en garde vos clients contre ces produits, comme vous l’impose la jurisprudence de la Cour de cassation ?
M. Francis Canterini. Si les taux variables ont remplacé les taux fixes, c’est parce que ces derniers étaient considérés comme trop élevés par les collectivités. Par la suite, les charges afférentes aux taux variables étant jugées encore trop élevées, les produits se sont sophistiqués et les collectivités ont, peut-être sans le savoir, vendu des options, de sorte que, dans certains cas, elles n’ont plus payé d’intérêts pendant un certain temps. Quoi qu’il en soit, on a eu tendance à oublier que la rentabilité était aussi liée au risque. On peut toujours se plaindre de l’insuffisance des conseils ; il n’en demeure pas moins que l’argent facile n’existe pas : cette règle s’impose à tous, y compris aux collectivités locales.
Les mises en garde ont peut-être été insuffisantes à l’origine mais, dès 2007 ou 2008, soit bien avant la charte Gissler, tous les établissements bancaires ont alerté leurs clients sur les produits qu’ils leur avaient vendus. Certains clients ont saisi l’opportunité ; d’autres ont jugé qu’acquitter un surcroît de charges, même faible, au titre du mark-to-market n’était pas de bonne stratégie et ont refusé des propositions. On est passé des taux fixes aux produits structurés parce que les collectivités voulaient payer moins de frais financiers en début de période.
En bonne gestion, il ne faudrait pas souscrire un produit qu’on ne sait pas comptabiliser convenablement. À cet égard, la comptabilité des collectivités a encore des progrès à faire. Il est normal que les banques envoient, une fois par an, voire plus, le mark-to-market ; mais il faudrait qu’elles soient informées plus régulièrement. Sinon, cela n’a pas grand intérêt.
S’agissant de la liquidité, la loi française interdit que les collectivités publiques déposent auprès des banques privées ou souscrivent à leurs émissions. En conséquence, CA-CIB, comme l’ensemble du groupe Crédit Agricole, ne reçoit aucune liquidité des collectivités publiques françaises. Le groupe Crédit Agricole dispose de divers mécanismes pour alléger le poids en liquidité sur son bilan de ses octrois de crédits aux collectivités publiques : mobilisation auprès de la banque centrale, refinancements par des tiers partis… Avec les nouvelles règles imposées par le comité de Bâle, cette situation deviendra beaucoup plus pénalisante. Les banques de financements devront adosser beaucoup plus les prêts qu’elles consentiront à des refinancements longs et stables, dans lesquels les dépôts des clients auront à jouer un rôle important. Les collectivités locales, empêchées de déposer aux banques privées, pèseront significativement sur la gestion du bilan de ces dernières.
La question du niveau des interlocuteurs a déjà été évoquée. Pour reprendre la comparaison avec le secteur du BTP, c’est en général un tiers qui évalue le prix d’un appartement mis en vente. Si les banques n’évaluent pas elles-mêmes le montant des remboursements anticipés, ce n’est pas parce qu’elles ne peuvent pas le faire, mais parce que la véracité de ce calcul pourrait être sujette à caution : le respect de la relation contractuelle nous impose de le confier à des tiers.
M. Daniel Boisserie. Je me doutais bien que ma question sur les responsabilités de chacun resterait sans réponse.
Je veux revenir sur la question du conseil. Dans les petites et moyennes collectivités, l’analyse financière est confiée au percepteur. Or certaines banques, à commencer par Dexia, effectuaient cette analyse de leur côté, et ce de façon très détaillée. Dexia se définissant comme la banque des collectivités locales, ne pensez-vous pas, monsieur Mariani, que ces pratiques étaient perçues comme des activités de conseil ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Les élus qui ont témoigné sous serment devant nous considéraient Dexia comme l’héritière directe du Crédit local de France ; ses commerciaux leur apparaissaient donc non seulement comme des banquiers mais aussi comme des conseillers.
Les banques ont manifestement eu des démarches proactives pour convertir les emprunts à taux fixe en emprunts à taux variable. Peu d’élus nous ont dit avoir sollicité les banques pour renégocier des prêts ; certains d’entre eux ont d’ailleurs, en cas d’alternance politique, découvert des situations dont ils n’étaient pas responsables.
Vos commerciaux étaient-ils rémunérés sur chaque contrat renégocié ?
Par ailleurs, M. Klein nous a indiqué que les Caisses d’épargne s’étaient interdit de proposer des prêts très structurés aux collectivités de moins de 10 000 habitants ; M. Mariani, de son côté, nous a dit que Dexia n’en proposait plus, ce qui sous-entend qu’il le faisait auparavant. Qu’en est-il pour les autres banques ?
Quelle était l’attitude des actionnaires de Dexia que sont, entre autres, l’État français, l’État belge, les régions belges, CNP Assurances et la Caisse des dépôts ? Quelle information leur remontiez-vous sur les prêts que vous consentiez aux collectivités territoriales ? Les actionnaires, d’ailleurs, ont le devoir de s’informer.
Les banques provisionnent-elles les risques liés aux contentieux relatifs aux prêts, et, si oui, à quel niveau ?
L’État, via la Caisse des dépôts, s’est porté garant du stock de prêts toxiques détenu par Dexia. Ne pensez-vous pas qu’il pourrait, de la même façon, garantir les prêts toxiques des petites collectivités, qui n’ont pas les moyens de renégocier avec les banques ? Cela permettrait de diminuer le coût global de cette renégociation.
M. Marc Francina. La valeur du franc suisse n’a cessé de monter depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1970, un franc suisse valait 13 centimes d’euro, aujourd'hui, 1,20 euro, seulement, car la Suisse achète tous les jours des euros. Je ne comprends donc pas la logique de ces opérations en francs suisses. Aucun employé de banque, en Haute-Savoie, n’aurait conseillé de s’endetter dans cette devise.
M. Mariani a évoqué les propositions de sortie faites par Dexia à certaines collectivités, qui ont pourtant souhaité continuer à profiter du système. Les autres banques ont-elles rencontré les mêmes difficultés avec les collectivités ?
Le problème ne vient-il pas de ce que les banquiers ont confié les formules de ces produits à des mathématiciens ?
Dans les années soixante-dix, je le rappelle, les taux des prêts consentis par le Crédit hôtelier atteignaient 17 %, pour une inflation à 15 ou 16 %. Or les collectivités n’ont jamais eu la possibilité de renégocier ces taux : elles ont dû rembourser leurs emprunts aux conditions initiales jusqu’au terme de l’échéance.
M. Michel Diefenbacher. Ma question concerne, non le passage des taux fixes aux taux variables, mais l’inverse. Quand les banquiers ont mesuré les conséquences désastreuses que pouvaient avoir les taux variables sur la situation financière des collectivités, je suppose qu’ils en ont informé ces dernières. Cette obligation d’information s’impose plus encore en cas d’alternance, puisque la nouvelle équipe n’est pas au courant du détail des emprunts souscrits par la précédente. Ces démarches d’information ont-elles été assurées ? Si oui, certaines collectivités ayant connu l’alternance politique ont-elles opté pour un taux fixe, même un peu plus élevé ? À l’inverse, d’autres ont-elles refusé ? De la réponse des banquiers dépendront aussi les solutions que nous pourrions proposer.
M. le président. Quelle est la taille de la plus petite collectivité ayant souscrit, dans chacune de vos banques, un prêt structuré ?
Par ailleurs, quel est le profil, en termes de qualifications, de vos personnels spécialisés dans les produits structurés ? Quel doit être, selon vous, le niveau de compétences en ce domaine des agents territoriaux ?
M. Pierre Mariani. Dexia est en effet l’héritière du Crédit local de France, lui-même issu de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL). Cela dit, notre travail d’analyse de données financières se poursuit ; notre groupe possède sans doute, en ce domaine, la meilleure base de données sur les collectivités, en France comme en Belgique.
Les commerciaux de Dexia n’étaient pas rémunérés sur les ventes dans le cadre des opérations de renégociation, et encore moins lorsqu’il s’agissait de crédits structurés. Pour ces catégories de personnels, les rémunérations variables s’élèvent tout au plus à 10 ou 15 % de la rémunération globale : elles n’ont donc rien à voir avec celles des banquiers d’investissement ; d’ailleurs, même pour les équipes des salles de marchés, les rémunérations sont loin d’atteindre celles des traders de banques d’investissement, par exemple.
S’agissant de l’information des actionnaires, elle s’effectuait d’abord dans le cadre du conseil d’administration de Dexia Crédit Local, où, je le rappelle, siégeaient des représentants des collectivités. Les sophistications dont nous parlons figurent dans tous les documents publics du groupe, puisqu’elles constituaient l’un de ses axes de développement.
La liste des responsables de la situation actuelle serait si longue, monsieur Boisserie, que la réponse ne peut être simple. Je rappelle cependant que les associations de régions et de départements ont fait valoir le principe de libre administration des collectivités locales pour refuser de signer la charte Gissler, estimant que celle-ci bridait leurs capacités d’ingénierie financière.
M. le président. Nous reviendrons sur ce point.
M. Pierre Mariani. En novembre 2009, j’ai saisi le ministre de l’Économie et des finances pour lui soumettre trois propositions tendant à renforcer la réglementation des prêts aux collectivités locales. La première avait pour objet de soumettre ces emprunts au code des marchés publics ; elle déclencha un tollé, notamment chez les représentants des collectivités, qui y voyaient une source de contraintes et de complications inutiles. Pour ma part, je pense qu’une telle mesure serait très utile au contrôle des finances locales.
La deuxième proposition était de soumettre les activités de crédit aux règles de MIFID – Markets in financial instruments directive –, laquelle répond assez bien à la question de l’autoévaluation du niveau de compétence requis face aux établissements financiers. Cette proposition est restée lettre morte, de même que la troisième, qui visait à interdire purement et simplement un certain nombre de produits financiers.
Des régions frontalières ont une tradition, non seulement d’intégration du franc suisse dans les formules d’indexation, mais aussi d’emprunts libellés en francs suisses. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études pour comprendre que ces emprunts sont soumis au risque de change.
M. le rapporteur. Les collectivités locales s’apparentent-elles, pour vous, à des entreprises ou à des particuliers ? Vous savez ce que dit la MIFID en la matière…
M. Pierre Mariani. Les collectivités font partie de notre clientèle institutionnelle.
M. le rapporteur. Qu’entendez-vous par ce terme ?
M. Pierre Mariani. Un client institutionnel est, par définition, un client non particulier.
M. le rapporteur. Comme on le voit actuellement avec la Grèce, le particulier est, in fine, la variable d’ajustement, via la fiscalité. Par conséquent, les collectivités emprunteuses s’apparentent plutôt à des particuliers : une entreprise, elle, peut déposer le bilan.
M. Pierre Mariani. Quoi qu’il en soit, la directive MIFID ne s’applique pas au crédit. En ce sens il ne me paraîtrait pas anormal d’établir une différence entre les investisseurs qualifiés, qui se disent prêts à assumer des risques – et à qui l’on pourrait donc vendre ce type de produits –, et les autres ; c’est d’ailleurs ce qui existe pour les placements.
M. le rapporteur. De telles mesures concernent l’avenir.
M. Pierre Mariani. Certes, mais demain, c’était hier, il y a deux ans, en novembre 2009.
M. le président. Quel niveau doit avoir un interlocuteur pour être crédible à vos yeux ?
M. Pierre Mariani. Le problème n’est pas individuel : les collectivités disposent de conseils, d’instances de décision, de commissions permanentes et d’organes délibérants.
M. le président. Prenons un exemple précis. Si une collectivité se voit proposer un contrat appelé « Tofix », est-ce aux agents territoriaux de démontrer l’ambiguïté de cette appellation ou à la banque, qui a un devoir de conseil ?
M. Pierre Mariani. Pour des raisons que vous comprendrez, monsieur le président, je souhaite que vous m’autorisiez à ne pas répondre à cette question.
M. le président. Quelle doit être selon vous la règle du jeu entre les banquiers et leurs clients ?
M. Pierre Mariani. La règle de base, pour paraphraser M. Klein, est de vendre des produits que l’on comprend. Par ailleurs, on ne vend pas de produits dérivés à un client qui ne peut assumer les risques sous-jacents. Si une collectivité frontalière avait des revenus en francs suisses, il serait de bonne gestion pour elle de s’endetter en partie dans cette devise ; mais, sauf exception, ce n’est pas le cas.
M. le rapporteur. Quand on passe de 146 produits vendus à 15, c’est qu’on ne les comprenait pas tous…
M. Pierre Mariani. Non, cela signifie seulement qu’un certain nombre de ces produits n’étaient pas utiles. Si l’on analysait les activités des banques d’investissement, on découvrirait qu’il y a lieu de s’interroger sur certaines d’entre elles.
La sophistication à tout prix a trouvé ses limites. Il faut revenir à quelques principes simples : le rôle des banques est de financer l’économie, non de trouver des formules pour des clients qui veulent payer moins d’intérêts sur leurs emprunts. Il est arrivé en matière de crédits ce qui s’était passé pour les placements : aux États-Unis, certains avaient promis une rémunération à 12 % jusqu’à la fin de la vie ; on a vu le résultat fin 2008.
M. Marc Francina. La Haute-Savoie a effectivement emprunté pendant longtemps en francs suisses, car elle avait des rentrées d’argent dans cette devise. Il n’en reste pas moins aberrant d’adosser des prêts sur le franc suisse.
Mme Valérie Fourneyron. S’agissant des risques, quelle information avez-vous passée aux collectivités, notamment après certaines échéances électorales ?
M. Pierre Mariani. La garantie de l’État en faveur de Dexia ne porte pas seulement sur les prêts structurés ; la négociation entre la France et la Belgique avait pour objet la répartition des garanties respectives apportées par ces deux pays sur l’encours global des prêts.
De son côté, Dexia s’est portée garante auprès de la Caisse des dépôts dans l’hypothèse où celle-ci reprendrait Dexia Municipal Agency, et a consenti une autre garantie sur les encours de prêts structurés. Notre groupe souhaite en effet garder la main sur la renégociation de ces emprunts : il n’est pas question de faire jouer une garantie du contribuable. En ce sens, la création d’une structure de défaisance ne me semble pas le meilleur moyen de responsabiliser les élus locaux dans la gestion de leur collectivité. Nous continuerons donc de gérer la situation au cas par cas, dans le cadre de nos relations commerciales.
M. le président. L’État s’est tout de même engagé.
M. Pierre Mariani. Non, nous ne sommes pas dans le cadre d’une structure de défaisance ; des seuils très élevés ont été fixés pour les garanties.
Mme Valérie Fourneyron. Pour les prêts structurés, l’État s’est engagé à hauteur de 7 milliards d’euros, tout de même.
M. Pierre Mariani. Non, ce chiffre est celui du mark-to-market instantané ; mais les garanties n’ont absolument pas vocation à être appelées à ce niveau.
M. le président. L’État s’est porté garant à hauteur de 10 milliards d’euros, avec un ticket modérateur de 500 millions à la charge de Dexia. La clé de répartition est de 60 % pour l’État et 40 % pour Dexia – ou ce qui en resterait.
M. Pierre Mariani. Je le répète, la garantie de l’État n’a pas vocation à jouer. Elle se substituerait à celle que Dexia a apportée à la Caisse des dépôts et qui porte sur la performance des prêts structurés, autrement dit qui garantit les revenus attendus de ces prêts.
M. le président. Pouvez-vous être plus précis sur le niveau de qualification que vous attendez des élus ou des fonctionnaires territoriaux ?
M. Pierre Mariani. Nous n’avons pas d’exigences particulières en ce domaine.
M. le président. Quel est donc le niveau de qualification des salariés de Dexia spécialisés dans les produits structurés ? Vous savez que la confiance entre une banque et son client repose sur l’égalité et la symétrie de l’information.
M. Pierre Mariani. Je pense que, statistiquement, le niveau de formation de ces personnels n’est pas très différent de celui des élus locaux.
M. le président. Quel est ce niveau ?
M. Pierre Mariani. Je n’ai pas ici toutes les données relatives à la formation de nos commerciaux !
M. le rapporteur. J’ai travaillé vingt-cinq ans dans la banque ; je sais donc que les recrutements se font sur des critères précis. Dans une collectivité, les élus peuvent être très éloignés des réalités du monde bancaire ! Une commune de 1 000 habitants, par exemple, n’a pas de directeur financier ; c’est d’ailleurs pour cette raison que le seuil de 10 000 habitants me paraît intéressant. N’importe qui, par exemple, peut être adjoint aux finances : il n’existe pas de critères de recrutement en la matière. Les collectivités ne s’apparentent donc pas à des entreprises : elles sont composées d’élus qui représentent la population, laquelle, in fine, paie la facture ; c’est pourquoi elles sont plutôt assimilables à des particuliers. Cela vous impose des obligations.
M. le président. Au nom de la commission d’enquête, je vous demande donc, monsieur Mariani, de fournir au rapporteur, dans les plus brefs délais, le nombre de personnes qui suivent les dossiers de prêts structurés chez Dexia, et leur niveau de qualification.
M. Pierre Mariani. Très bien, nous vous transmettrons ces informations.
M. Olivier Klein. Il nous est souvent arrivé de mettre en garde certaines collectivités sur des produits qu’elles nous demandaient. Reste que notre activité est soumise à la concurrence. Si celle-ci peut avoir ses vertus, elle a peut-être été aussi à l’origine de la sophistication croissante des produits.
Comme je l’ai dit, nous nous interdisions de vendre des produits structurés aux collectivités de moins de 10 000 habitants, sauf demande expresse de leur part. Nous ne leur avons pas vendu de snowballs non plus, sauf une fois, après qu’une collectivité nous en ait fait la demande par écrit. Bref, nous nous sommes efforcés de nous adapter aux besoins, quitte à émettre un avis négatif dans certains cas.
Nous n’avons à ce jour aucun contentieux avec les collectivités sur les prêts structurés – ni aucune condamnation, cela va de soi.
Quant aux profils de formation, nos personnels sont en général diplômés d’école de commerce ou titulaires de diplômes universitaires de niveau bac+3 ou bac+5, certains d’entre eux atteignant les mêmes niveaux par la formation continue que nous développons beaucoup aux Caisses d’Épargne. Notre exigence est que nos commerciaux comprennent les produits afin d’être en mesure de les expliquer. Par ailleurs, il n’existe pas de rémunération variable en fonction des produits vendus.
Ce ne sont pas les taux variables en eux-mêmes qui posent problème – puisque les taux, qu’ils soient courts ou longs, sont très bas –, mais les taux indexés sur certains indices complexes.
M. le président. Quelle est, dans votre clientèle, la taille de la plus petite collectivité ?
M. Olivier Klein. Je ne le sais pas, mais je chercherai cette information pour vous la transmettre.
M. le président. Merci.
M. Francis Canterini. Nous avons actuellement, 129 opérations hors charte Gissler, pour 99 contreparties ; parmi elles, 60 concernent les collectivités locales, dont 19 petites – soit moins de 20 000 habitants selon nos critères. La plus petite collectivité concernée compte, de mémoire, de 3 000 à 4 000 habitants. Deux dossiers sont en contentieux ; dès lors que le risque ne nous semble pas avéré sur ces dossiers, nous n’avons pas constitué de provisions.
Quels que soient leurs outils et le niveau de formation de leur personnel, les banques n’étaient pas en mesure de prévoir ce qui s’est passé depuis 2007 : les milliards qu’elles ont perdus le montrent assez. Il ne faut donc pas opposer ceux qui sauraient à ceux qui ne sauraient pas.
Dès que les premiers dérapages se sont manifestés, nous sommes entrés en contact avec toutes nos contreparties. À l’origine, 180 dossiers étaient concernés ; en d’autres termes, une cinquantaine d’entre eux ont été réglés par des restructurations, qui, malgré leur coût, ont permis de diminuer les risques. Un comité des dossiers complexes a été créé dès le début de 2008, regroupant tous les acteurs de la banque – front office, marchés, conformité, service juridique, risque – qui vérifie la conformité des restructurations et des désensibilisations proposées.
Nous informons bien entendu nos clients sur la valorisation de leurs positions, et avons refusé des restructurations qui nous semblaient être des fuites en avant. Certains clients, disons-le, ont refusé les désensibilisations que nous leur proposions, en raison de leur coût ; or, s’ils devaient se défaire de leur emprunt aujourd’hui, ce coût serait encore plus élevé.
S’agissant des prêts structurés, deux contacts existent : le contact de proximité dans les Caisses régionales et les spécialistes de l’ingénierie.
Le niveau de qualification des agents territoriaux ne doit pas être posé, selon moi, en termes techniques. Il faut surtout s’assurer que le processus de décision est collectif et que les agents, aidés le cas échéant par des conseils, posent les bonnes questions. Enfin, la meilleure façon de vérifier la qualité ou la transparence des offres est de faire jouer, sur la base d’un objectif financier précis, la concurrence entre les banques.
M. Charles de La Verpillière. Si j’ai bien compris, le groupe BPCE n’a aucun contentieux avec les collectivités locales sur les prêts structurés hors charte Gissler. Combien le CA CIB en a-t-il ?
M. Francis Canterini. Nous avons deux contentieux, dont un concerne un prêt hors charte Gissler.
M. Charles de La Verpillière. Et Dexia ?
M. Pierre Mariani. Dix.
M. Charles de La Verpillière. Devant quelles juridictions sont-ils portés ?
M. Pierre Mariani. Des juridictions civiles.
M. Charles de La Verpillière. Des décisions de justice ont-elles déjà été rendues ?
M. Francis Canterini. Oui, deux, dont une concernait le CA CIB. Ces deux décisions ont été en faveur des banques.
M. le président. S’agit-il du jugement rendu à Toulouse ?
M. Francis Canterini. Je veux parler de la décision du tribunal de commerce de Paris du 8 décembre 2009.
M. le rapporteur. La charte Gissler, dont vos établissements sont signataires, vous paraît-elle un bon outil ? Quelles sont à vos yeux ses limites ? Que pensez-vous de la typologie qu’elle propose ?
Si cette commission d’enquête a été créée à l’unanimité, ce n’est pas par hasard. Quelles solutions globales ou plus spécifiques pouvez-vous proposer pour résoudre le problème ?
M. Francis Canterini. Nous avons anticipé la charte Gissler, puisque nous en avions appliqué certains principes dès 2008. Ces principes sont élémentaires ; il convient également de laisser toute sa place à la discussion au cas par cas : c’est précisément ce à quoi nous nous engageons pour aider les collectivités. Le dispositif actuel me semble donc suffisant.
M. le président. Si l’on se réfère à la grille de la charte, à partir de quel seuil les produits doivent-ils selon vous être interdits ?
M. Francis Canterini. Nous avons identifié quatre niveaux de produits, selon leurs profils de risque ; une vigilance particulière, assortie d’éventuels refus, s’impose à partir du niveau 2.
M. Olivier Klein. Pour traiter les stocks, la procédure de médiation est une bonne façon de travailler, même si elle n’est pas toujours nécessaire. En tout état de cause, nous accompagnons nos clients.
Pour le futur, le groupe BPCE a décidé de se limiter aux produits situés en deçà de la norme 2B, c’est-à-dire aux produits ne comportant pas de risques ouverts. Nous ne vendons plus de produits incluant des ventes d’option. En revanche, il reste bien entendu possible d’acheter des options en toute connaissance de cause, afin de « caper » les taux variables, ce qui revient à payer une prime d’assurance en même temps que le crédit. Dès lors, le risque est fini, au sens mathématique.
M. Pierre Mariani. La charte Gissler a eu le mérite de formaliser un certain nombre de pratiques, notamment celles qu’il convenait d’exclure. Quelques points devraient néanmoins être clarifiés et certains principes appliqués. Une partie des difficultés tient aux fortes incitations à la renégociation. Les périodes de bonification, notamment à l’approche d’échéances électorales, devraient être selon moi limitées, voire interdites, car elles n’incitent pas à une gestion rationnelle des risques et de la charge financière.
S’agissant du stock existant, je ne vois pas d’autre solution qu’une gestion dans la durée et au cas par cas, car nous ne sommes pas en mesure, aujourd’hui, de proposer des solutions globales satisfaisantes, notamment pour les produits indexés sur le franc suisse. Environ 6 milliards d’euros d’encours de prêts structurés ont été renégociés depuis 2010 ; nous accompagnons les petites collectivités de façon très proactive, en gelant au besoin certaines échéances ou remboursements d’intérêts ; mais nous ne pouvons le faire pour les grandes collectivités, même si, depuis trois ans, nous sommes parvenus à désensibiliser les encours en gérant les situations au cas par cas.
M. le président. Quels produits faut-il selon vous interdire, si l’on se réfère à la typologie de la charte Gissler ?
M. Pierre Mariani. Tous les produits à fort effet de levier. De fait, le niveau des nouveaux crédits que nous commercialisons est aujourd’hui beaucoup moins élevé ; la plupart d’entre eux se situent au maximum à 2C.
M. le président. Messieurs, je vous remercie.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « La politique commerciale des filiales françaises de banques étrangères ». Audition de M. Pascal Poupelle, responsable France Belgique et Luxembourg au sein du groupe Royal Bank of Scotland ; de M. Marc Pandraud, président du groupe Deutsche Bank France ; de M. Alain Gaudry, responsable des activités de marché du groupe Deutsche Bank France ; et de M. Jean Christophe, directeur général de la filiale française du groupe irlandais Depfa Bank plc et directeur général de la Deutsche Pfandbriefbank.
(Procès verbal de la séance du mercredi 2 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux par l'audition des représentants des filiales des banques étrangères qui ont été actives, durant la décennie passée, sur le marché du crédit aux collectivités locales. Nous accueillons donc M. Pascal Poupelle, responsable France, Belgique et Luxembourg au sein du groupe Royal Bank of Scotland ; M. Marc Pandraud, président du groupe Deutsche Bank France accompagné de M. Alain Gaudry, responsable de la succursale « activités marché » ; et M. Jean Christophe, président de la filiale française du groupe irlandais Depfa Bank.
Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à vos collègues, représentants les banquiers historiques des collectivités territoriales, nous nous interrogeons sur les politiques commerciales qui ont conduit les établissements bancaires à placer des produits structurés et qui mettent aujourd'hui certaines collectivités dans une situation délicate.
Vos établissements étaient considérés, au début des années 2000, comme des « nouveaux venus » sur le marché des prêts aux collectivités territoriales. Or, certains intervenants nous ont expliqué qu'il s'agissait alors d'un marché mature, où les marges étaient très faibles. Dès lors, pourquoi vous être implantés sur un marché longtemps chasse gardée de quelques acteurs français ? Quels étaient les objectifs de vos maisons mères à l'époque, et en particulier quels types de produits vous ont-elles chargés de placer auprès des collectivités territoriales françaises ? Quelles étaient les instructions et contraintes particulières qu'elles ont pu vous donner ?
MM. Pascal Poupelle, Marc Pandraud, Alain Gaudry et Jean Christophe prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pourriez-vous présenter vos établissements respectifs, nous préciser s’ils sont agréés en France et à quel régulateur ils sont soumis ? Quand et pourquoi vous êtes-vous portés sur le marché des collectivités territoriales ? Quelle est la nature de votre offre – prêts à taux fixe ou variable, prêts structurés, produits dérivés ? Comment se décompose le produit net bancaire sur un prêt structuré ? Est-il le même que pour un prêt classique ? Le coût en fonds propres est-il différent ?
M. Pascal Poupelle, responsable France, Belgique et Luxembourg au sein du groupe Royal Bank of Scotland. Merci tout d’abord de nous donner l’opportunité de contribuer aux travaux de votre commission d’enquête. Le groupe Royal Bank of Scotland est né, comme son nom l’indique, en Écosse, il y a plus de 250 ans, et il s’est implanté en France il y a douze ans environ, pour accompagner les grandes entreprises dans le financement de leur croissance, la gestion de leurs risques – c’est une de nos spécialités – et, plus généralement, dans leur stratégie.
Les relations de Royal Bank of Scotland avec le secteur public local remontent à 2001. Comme pour les entreprises, nous avons dès le départ décidé de cantonner notre activité aux grands clients : tous nos clients collectivités locales comptent plus de 50 000 habitants, à trois exceptions près, qui font tout de même plus de 30 000 habitants. Mais cette activité reste marginale puisque, au cours des quatre dernières années, elle n’a représenté que 1 % de notre chiffre d’affaires en France. Assez logiquement, c’est en proposant des solutions de gestion du risque de taux que RBS est entrée en relation avec les collectivités locales, puisqu’elles sont des emprunteurs à très long terme et doivent ipso facto gérer leur risque de taux et que nous sommes reconnus comme des experts dans ce domaine. Nous n’avons accordé des financements qu’à partir de 2005.
Nous avons veillé à respecter nos devoirs d’information et de mise en garde, en particulier la circulaire du 15 septembre 1992 et son exigence de ne procéder qu’à des opérations de couverture du risque de taux. Nous avons évidemment vérifié les pouvoirs des signataires qui engageaient nos clients. Et, au-delà de la vérification formelle des pouvoirs, nous avons eu en permanence le souci de nous assurer de la compétence de nos interlocuteurs. Dans les grandes collectivités locales, ils nous sont toujours apparus comme compétents, voire souvent très compétents, en tout cas, comme des professionnels de bon niveau, formés aux techniques financières, rompus aux montages complexes comme les partenariats public-privé (PPP) par exemple. En somme, nos interlocuteurs comprenaient les avantages et les risques des contrats qu’ils signaient, d’autant qu’ils étaient souvent conseillés par des cabinets d’experts indépendants. Ils ont souvent mis les banques en concurrence en procédant à de véritables appels d’offre. Et l’État, par le biais du contrôle de légalité, n’a jamais objecté à la gestion des risques pratiquée par les collectivités locales.
En définitive, notre sentiment fait écho à celui exprimé par nos confrères français : les collectivités locales ont mis en œuvre des stratégies financières articulées, pour dégager des marges de manœuvre compte tenu des contraintes qui étaient les leurs. Elles ont échangé la certitude d’une réduction de leurs charges financières pendant quelques années contre un risque futur, dont elles avaient tous les éléments pour mesurer l’ampleur éventuelle.
Aujourd'hui encore, la majorité de nos clients du secteur public local sont satisfaits des contrats qui nous lient, mais certains connaissent des difficultés, du fait des conséquences de la crise financière et de la distorsion parfois extrême de certains paramètres de marché, soit que les taux qu’ils doivent payer deviennent difficilement supportables compte tenu de leurs ressources financières, soit que les risques futurs liés à ces contrats leur paraissent aujourd'hui trop élevés. Dans de telles situations, nous adoptons une attitude commerciale classique : nous sommes dans une relation pérenne avec nos clients, puisque les contrats conclus sont souvent de très long terme, et leur problème est également le nôtre. C’est en maintenant un dialogue permanent que nous trouverons ensemble les meilleures solutions, notre objectif étant d’aplanir les difficultés. D’ailleurs, à plusieurs reprises, nous avons trouvé des solutions à la satisfaction de nos clients, et nous continuons à en chercher activement avec tous ceux d’entre eux qui sont dans une posture de dialogue.
M. Marc Pandraud, président du groupe Deutsche Bank France. La Deutsche Bank est présente en France depuis 1970, par le biais d’une succursale, qui emploie aujourd'hui 300 professionnels à Paris. Je l’ai rejointe il y a trois ans, et, depuis mon arrivée, nous avons essayé de développer nos activités avec les grandes entreprises. C’est dans l’ADN de la Deutsche Bank de gérer des grandes contreparties. Nous sommes aujourd'hui reconnus, selon certains classements, comme la première ou la deuxième banque internationale à Paris. Nous comptons aujourd'hui 800 clients en France, dont 14 acteurs publics locaux.
La crise a changé les repères. Même les plus grandes institutions ont souffert de la dislocation des marchés, et il faut avoir conscience que la linéarité de certains paramètres était un élément important dans l’appréciation du risque collectif tant par les banques que par les collectivités locales. Depuis 2008, les acteurs bancaires en ont souffert autant que leurs clients. Je voudrais m’attaquer à une idée reçue : quand un client est malheureux, sa banque l’est aussi, parce que, à long terme, un client qui ne gagne pas d’argent en fait perdre à sa banque.
Avec la crise, les collectivités locales ont été confrontées à des problèmes. Les banques ont-elles contribué à la prise de conscience ? Nous avons une règle à la Deutsche Bank : tous les mois, nous communiquons à nos clients le mark to market de leurs positions. Quand nous avons vu certains contrats se dégrader, il était de notre responsabilité de faire prendre à nos clients la mesure de la situation et de trouver avec eux des solutions. Dans quelques cas, les clients n’ont pas souhaité entrer en négociation avec nous et nous avons aujourd'hui quelques contentieux, trois exactement, au sujet desquels je me sens tenu par le secret bancaire. Je répondrai de manière aussi transparente que possible à vos questions mais je ne citerai pas le nom de ces clients ni n’entrerai dans le détail des dossiers.
M. le président. Je vous rappelle que le secret bancaire est opposable pour les réunions en public, quand le huis clos n’a pas été prononcé. L’article 6 alinéa 7 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 dispose expressément que toute personne dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile est tenue de déposer sous réserve des dispositions de l’article 226-13 du code pénal qui réprime la violation du secret professionnel. La définition du secret bancaire retenue par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier englobe toutes les « opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ; les opérations sur instruments financiers, de garantie ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ; […] les cessions ou transferts de créances ou de contrats. » Elle est donc très large, même si plusieurs exceptions sont ménagées en faveur des autorités de régulation, des agences pour les besoins de la notation des produits financiers, ou encore des personnes avec lesquelles les établissements négocient certaines opérations bancaires. Mais, en fonction des besoins d’information du rapporteur, il pourra vous demander certaines précisions qui ne figureront pas au rapport qu’il présentera.
M. le rapporteur. Pourquoi des filiales de banques étrangères se sont-elles implantées sur le marché des prêts structurés aux collectivités locales françaises ? À cause des marges ?
M. le président. Notre curiosité est d’autant plus vive que vous étiez spécialisés dans les grandes entreprises privées. Quel attrait ce nouveau marché pouvait-il présenter ?
M. Marc Pandraud. Il n’y a pas lieu d’opposer public et privé. Les filiales internationales de la Deutsche Bank ont pour contrepartie des clients de taille importante, aux besoins sophistiqués. Nous sommes une banque de marché. Notre première mise en relation avec une collectivité locale doit dater de 2002, mais, sans être en contact direct, nous étions déjà contrepartie de banques françaises pour apporter des solutions. Il s’agissait d’un marché où le nombre d’intervenants était réduit et nous avons été sollicités.
M. Alain Gaudry, responsable des activités de marché du groupe Deutsche Bank France. Pour être précis, notre première entrée en relation date de 2001, et les contacts avec les 14 clients contreparties, sur lesquels nous avons communiqué à M. le rapporteur des informations, remontent pour l’essentiel à 2005-2006. Nous sommes donc un acteur marginal sur ce marché, et nous sommes intervenus après avoir été sollicités, en particulier par des conseils financiers, qui souhaitaient mettre les banques traditionnelles en concurrence avec d’autres établissements, ou qui cherchaient à diversifier l’offre pour limiter la concentration.
M. le rapporteur. Aviez-vous des problèmes de liquidité ?
M. Alain Gaudry. Non, nous sommes une banque d’investissement et les opérations en cause sont surtout des opérations de swap, c'est-à-dire sur produits dérivés.
M. Jean Christophe, directeur général de la succursale française du groupe irlandais Depfa Bank plc et directeur général de la Deutsche Pfandbriefbank. J’ai la particularité de porter une double casquette, de directeur général de la filiale de Depfa Bank, banque dont le siège est en Irlande, et de PBB, une banque allemande dont je suis le responsable à Paris. Dans le cadre de la restructuration du groupe Hypo Real Estate, il a été décidé que Depfa n’aurait plus d’activité nouvelle et que la Deutsche Pfandriefbank, issue de la restructuration, porterait les nouvelles opérations, notamment en France qui est, en dehors de l’Allemagne, notre principal marché stratégique.
Le profil de notre banque est un peu différent des autres dans la mesure où Depfa Bank était présente sur le marché depuis 1994, mais par le biais d’intermédiaires. Entre 1997 et 2000, nous avions ainsi un accord avec le Crédit Lyonnais en vertu duquel nous refinancions la quasi-totalité des crédits qu’il distribuait aux collectivités locales. Étant une banque sans réseau, nous nous procurions des ressources sur les marchés au moyen des covered bonds, et, désormais, des pfandbriefe, l’instrument allemand et l’un des plus vieux en Europe, notre vocation première étant le financement du secteur public. Nous étions là avant les produits structurés et nous serons là après.
Nous sommes arrivés tardivement sur le marché des produits structurés, sous la pression de nos clients, pour éviter d’être exclus des appels d’offre : quand nous mettions en place des prêts classiques, ils faisaient immédiatement ou presque l’objet d’échanges de taux avec d’autres banques. Comme n’importe quel acteur économique, nous nous sommes demandés comment assurer notre présence sur le marché. Notre première opération structurée date de 2004, et le pic de cette activité a été observé entre 2005 et 2008. Depuis 2002, Depfa était spécialisée dans le financement du secteur public, en général, dont les collectivités locales. À la fin septembre 2011, notre portefeuille en France était d’un peu moins de 7 milliards, dont 2 milliards sur les acteurs publics locaux français – collectivités, hôpitaux, organismes HLM, établissements publics de coopération communale. Nous finançons les projets directement, et les PPP.
Nos succursales – Depfa et PPB – sont agréées en France, la première étant soumise au régulateur irlandais et la seconde au régulateur allemand, la BaFin, et elles sont soumises à un reporting allégé auprès du régulateur français.
En ce qui concerne notre cible, nous nous sommes concentrés sur les clients de taille moyenne à grande. Un seul de nos clients compte moins – à peine moins – de 20 000 habitants. Notre effectif n’a jamais dépassé cinq commerciaux pour la France.
M. le rapporteur. J’en reviens aux marges : sont-elles plus élevées sur les produits structurés que sur les prêts classiques ?
M. Alain Gaudry. La marge correspond à la différence entre le taux facturé au client, d’une part, et le coût de la couverture, d’autre part. Plus les produits sont complexes, plus les coûts de couverture sont élevés. M. Mariani vous a expliqué que Dexia n’était pas une banque d’investissement et qu’elle se couvrait systématiquement auprès de ces établissements. En ce qui nous concerne, quand nous commercialisons des produits structurés, nous nous couvrons par nous-mêmes, en montant des opérations de micro-couverture par exemple.
M. le président. Pourriez-vous nous dire quelle marge vous preniez sur un prêt à taux fixe, à vingt ans par exemple ? Nous pourrons comparer.
M. Pascal Poupelle. Royal Bank of Scotland a, en France, deux succursales, l’une d’origine britannique, qui dépend de la Financial Services Agency britannique ; l’autre d’origine néerlandaise provenant du rachat d’une partie du groupe ABN Amro, il y a trois ans, et sous la surveillance du régulateur néerlandais. Nous répondons également au régulateur français, l’Autorité de contrôle prudentiel.
L’origine des relations de Royal Bank of Scotland avec les collectivités locales françaises se trouve dans la demande qu’elles exprimaient en matière de gestion du risque de taux, l’un des domaines d’expertise de notre maison mère. Mais RBS a très peu prêté, l’offre se concentrant sur des échanges de taux, des swaps.
S’agissant des revenus générés, ils sont très comparables à ceux que nous dégageons sur nos autres grands clients. Il n’y a pas de différence de nature. Les opérations en question sont complexes pour nous aussi. Nous sommes non pas des intermédiaires, mais des contreparties durables de nos clients. Nous fabriquons les produits que nous vendons, mais nous devons également gérer le risque pendant toute leur durée. Si nous concluons un contrat d’échange de taux sur quinze ans, voire plus, notre groupe porte le risque et doit le gérer. Il peut nous arriver, notamment lorsqu’une crise provoque des discontinuités de paramètres de marché, de perdre beaucoup d’argent. Il est donc difficile de faire le bilan économique de ces opérations avant terme. Nous savons ce que nous avons gagné sur des produits complexes une fois les opérations effectivement terminées.
M. le rapporteur. Les spécialistes disent que la marge serait proportionnelle au risque encouru, d’autant plus confortable que le produit est risqué. Est-ce vrai ?
Mme Valérie Fourneyron. Le prêt structuré était pour vous une activité marginale, mais les conséquences ne le sont pas pour les collectivités. À combien se monte l’encours de cette activité en France ? Combien de collectivités sont concernées ?
Vous dites avoir été « sollicités », notamment par des conseils. S’agissait-il d’une démarche individuelle ou globale des collectivités ?
M. Poupelle vient de nous expliquer avec un luxe de détails que toutes les précautions possibles avaient été prises – respect des circulaires, vérification des pouvoirs et de la compétence des interlocuteurs – mais cela ne correspond pas à l’impression que nous avons. Vous étiez peut-être persuadés que les élus que vous aviez en face de vous étaient extrêmement compétents et comprenaient parfaitement les produits hors charte Gissler que vous leur proposiez, mais nous avons des doutes.
Nous avons auditionné les collectivités et elles sont nombreuses à se rendre compte qu’elles ne pourront pas respecter les échéances, dont le taux dépasse parfois 30 %. Au prix du marché, il sera également impossible de sécuriser les emprunts toxiques. Quelle va être votre attitude envers vos clients ?
M. Jean-Louis Gagnaire. On a l’impression que vous avez reçu, avant d’entrer, des éléments de langage : vous tenez tous le même discours, mais vous ne répondez pas aux questions.
S’agissant des commerciaux, les avez-vous rémunérés en fonction de leurs résultats ? Avez-vous sollicité les responsables financiers des collectivités territoriales – c’est une accusation très grave qui a été portée contre vous – en les invitant à des séminaires, ou autres, pour leur expliquer le bien-fondé de souscrire des produits structurés ? Nous avons pu nous faire une idée de l’insistance des commerciaux auprès des collectivités territoriales et je m’étonne que vous ayez trouvé les élus et les responsables extraordinairement compétents. Pourquoi ne pas les avoir immédiatement recrutés dans vos établissements ? Nous connaissons les limites de nos collaborateurs, sachant comment ils ont été recrutés.
Il y a peu de contentieux dans les établissements français. On ne peut pas en dire autant de vous. Ainsi, la Cour fédérale de Karlsruhe a condamné la Deutsche Bank à plus de 500 000 euros pour défaut de conseil et elle doit encore rendre son verdict dans sept dossiers comparables. En outre, dix-sept autres procès contre la Banque sont en cours devant les juridictions inférieures. Même si le droit allemand n’est pas transposable en France, la Cour a relevé le conflit d’intérêt puisque la banque gagne de l’argent quand son client en perd. Beaucoup de ceux qui ont été auditionnés ici ont aussi dénoncé le manquement à l’obligation de conseil. Quant à Royal Bank of Scotland, elle est mise en cause aux États-Unis et au Royaume-Uni. Passez-vous, les uns et les autres, des provisions quand une collectivité française dépose plainte contre vous ? Et pourquoi opposez-vous une fin de non-recevoir quand vos homologues français préfèrent discuter avec leurs emprunteurs ?
Enfin, quels sont vos liens avec Dexia ?
M. Patrice Calméjane. Messieurs, on est venu vous chercher, dites-vous. Mais le milieu bancaire est un milieu fermé. Alors, comment avez-vous fait la différence, pour pouvoir entrer dans le cercle ?
Et les produits que vous avez commercialisés en France sont-ils interdits ailleurs, ou au moins encadrés ?
M. le président. En cherchant, j’ai trouvé que le taux de marge sur les crédits à taux fixes à vingt ans en 2006-2007 était compris dans une fourchette de 0,05 et 0,20 point. Il s’agissait donc de produits d’appel, non rentables. Je connais très bien le monde des élus, et je les vois mal manifester devant le siège d’une banque étrangère pour réclamer des produits structurés. En revanche, je suis persuadé que la faiblesse des marges sur les produits classiques explique ce brusque engouement pour les produits complexes. Quelles étaient vos marges ? Vous deviez bien les communiquer puisque la Cour de Karlsruhe a condamné un établissement pour « marge cachée ».
M. Pascal Poupelle. Nous avons 2 milliards d’euros d’encours environ, essentiellement sous forme de contrats d’échange de taux. Sur 160 contrats, une dizaine est aujourd'hui problématique, mais je ne préjuge pas de la suite. Sur le notionnel, 75 % sont classés dans la Charte Gissler. Sur les 25 % qui restent, 16 % portent sur des contrats de change. Ce sont eux surtout qui ont le plus mal évolué.
Nous sommes en contentieux avec deux collectivités locales, mais, contrairement à ce qui a été dit, nous sommes toujours disposés au dialogue. Nous n’avons jamais refusé le dialogue avec l’un quelconque client mais nous considérons que celui qui décide de nous assigner choisit de le rompre.
Monsieur Gagnaire, vous nous reprochez de gagner de l’argent quand nos clients en perdent.
M. Jean-Louis Gagnaire. C’est la Cour de Karlsruhe qui le dit, et qui a parlé de conflit d’intérêt.
M. le rapporteur. Plus le produit est à risque, plus la banque gagne de l’argent.
M. Pascal Poupelle. Encore une fois, je ne pense pas que, quoi qu’ait fait la Royal Bank of Scotland avec le secteur public local en France, il y ait eu le moindre conflit d’intérêt. Nous accuser de gagner de l’argent quand nos clients en perdent va contre le bon sens. M. Pandraud vous l’a dit, un banquier, lorsqu’un de ses clients est en difficulté, l’est aussi. L’intérêt bien compris d’une banque, c’est d’abord de ne pas traiter avec des clients en difficulté, et, par voie de conséquence, de ne pas les mettre en difficulté. Cela fait partie de nos préoccupations quotidiennes.
Que faire donc, quand un client ne peut pas assumer les charges liées au contrat qui nous lie ? C’est une situation malheureusement classique dans nos métiers, mais une banque n’est payée que si son client peut honorer ses engagements. Nous adoptons donc une attitude de dialogue permanent, tout en recherchant des opportunités au fur et à mesure de l’évolution des marchés. Parfois, nous procédons par étapes sur la voie de la solution, qui n’est pas toujours immédiate compte tenu de l’évolution des paramètres de marché. Elle est même parfois extrêmement difficile à trouver, nous en sommes bien conscients.
Lorsque j’ai parlé de compétences tout à l’heure, je rappelle que la plus petite collectivité cliente chez nous compte plus de 30 000 habitants. Les équipes en face de nous étaient les responsables des services financiers. L’on peut regretter que, jusqu’à la crise de 2008 et ses manifestations sur la dette des collectivités locales, la plupart des élus aient été assez éloignés de ces sujets et qu’ils aient délégué assez largement, mais cela correspondait à une réalité : la Royal Bank of Scotland a eu assez peu souvent affaire aux élus directement, même si nous prenions la peine de vérifier les pouvoirs. Je suis d’accord, les élus n’ont que rarement les compétences financières pour gérer des dettes importantes, qui plus est à très long terme.
Non, nos commerciaux n’étaient pas rémunérés au résultat au moyen d’un système de commissionnement.
Avons-nous prodigué des invitations somptuaires aux équipes des collectivités locales ? Non. Nous avons fait des séminaires à Londres pour organiser des rencontres avec nos équipes de marché, pour montrer comment les produits que les collectivités souscrivaient chez nous étaient « fabriqués » et gérés, ce qui me semble dans l’ordre des choses.
La politique de provision est extrêmement confidentielle, mais les principes sont simples. Nous ne provisionnons que lorsque nous avons des clients qui sont dans l’impossibilité manifeste d’honorer leurs engagements à notre égard.
M. le rapporteur. En avez-vous aujourd'hui ?
M. Pascal Poupelle. Nous n’avons aujourd'hui aucune provision sur le secteur public local en France puisque aucun de nos clients n’est dans une telle situation.
Nous n’opposons jamais de fin de non-recevoir, je le souligne à nouveau.
Le groupe Royal Bank of Scotland travaille avec les entreprises, mais aussi avec les institutions financières, que ce soit en France ou ailleurs. Nous avons donc avec Dexia des relations de banquiers, par exemple en lui permettant d’adosser certaines de ses opérations, pour compte propre dans le cadre de sa gestion de bilan, ou pour le compte de sa clientèle qui a souscrit auprès d’elle des produits structurés. Vous savez que j’ai été le dirigeant de Dexia Crédit local pendant quelques années, mais je ne le suis plus.
Par rapport aux banques françaises, nous apportions, Marc Pandraud vous l’a expliqué, une forme nouvelle de concurrence par un élargissement de l’offre, notamment en matière de gestion du risque de taux.
M. le président. Vous avez vous-même évoqué votre vie passée chez Dexia. Vous devez donc connaître les marges qui étaient pratiquées. Quelles étaient-elles, en particulier sur les produits qui utilisent un effet levier supérieur à 10, et qui étaient en effet très compliqués ?
M. Pascal Poupelle. Je ne parlerai pas de Dexia, je ne suis pas habilité à le faire, d’autant que vous aviez Pierre Mariani en face de vous tout à l’heure. Le groupe RBS a très peu prêté aux collectivités locales, parce que, comme Deutsche Bank, nous n’avions pas d’instrument efficace de refinancement des prêts aux collectivités locales, contrairement à Depfa par exemple. Il était donc exclu de distribuer des prêts dans les conditions que vous avez dites, monsieur le président. S’agissant de Dexia, avant la crise de 2008, le refinancement des portefeuilles de prêts par des obligations foncières était idéal, puisque l’émetteur était noté AAA, et, à l’époque, courtisé par les investisseurs et les marchés. Une situation aussi favorable explique qu’aient pu être consentis des prêts avec des marges aussi limées. Par ailleurs, les banques mutualistes, du type BPCE ou Crédit Agricole, disposaient à l’époque d’importantes liquidités dont elles croyaient le coût très faible.
M. le président. Une dernière tentative avant de laisser la main au rapporteur. J’entends ce que vous dites, mais vous avez dû expliquer à vos actionnaires ce que vous espériez en entrant sur ce marché. Pas un conseil d’administration n’accepterait de devoir attendre trente ans avant de savoir combien les opérations rapportent.
M. Pascal Poupelle. Certes, les banques n’ont pas vocation à faire des opérations non économiques. En tout état de cause, la rentabilité des opérations sur dérivés avec le secteur public local français était comparable à notre activité avec les grandes entreprises ou les grandes institutions financières.
M. le président. Combien ?
M. Pascal Poupelle. Il m’est difficile de vous répondre dans l’absolu dans la mesure où nous, nous gérons le risque sur toute la durée des produits que nous vendons. Quand une crise comme celle de 2008 survient au cours de la vie d’un produit, une banque de marché perd beaucoup d’argent.
M. le rapporteur. Nous tournons autour du pot. Les banques, que j’ai fréquentées pendant vingt-cinq ans, prennent des marges en se couvrant. Si vous ne l’avez pas fait, cela veut dire que vos banques ont elles aussi souscrit des produits toxiques pour leur propre compte. Ce n’est pas ce que nous ont dit vos homologues des établissements français, qui nous ont précisé que le coût de sortie qu’ils facturaient correspondait à celui de la couverture. Quels sont les mécanismes de couverture que vos établissements ont utilisés pour conclure ces opérations ? Et à quel prix l’avez-vous fait ?
M. Pascal Poupelle. Tous les établissements ne procèdent pas de la même façon. Dexia par exemple ne gère pas ses risques de marché, elle adosse ses opérations auprès d’autres banques, notamment auprès de RBS. Un groupe comme Royal Bank of Scotland, en revanche, fait métier de gérer ses risques. Pour les opérations simples sur les dérivés de taux, appelées dans notre jargon opérations « vanille », la couverture est parfaite parce que nos traders, qui sont installés à Londres, ont les instruments pour faire un adossement sur toute la durée du produit. En revanche, lorsque nous faisons des opérations dites « exotiques », la gestion du risque est beaucoup plus complexe car les contrats ne peuvent pas être adossés de façon parfaite pour toute leur durée. Ces contrats sont inscrits dans le livre de négociation, ou trading book, où est agrégé l’ensemble des opérations de la banque que doivent gérer les traders. Contrairement à l’idée reçue, les traders sont des gestionnaires de risque et, jour après jour, année après année selon la durée des opérations à gérer, ils font en sorte d’éviter que des chocs de marché ne fassent perdre à la banque des sommes importantes dans la gestion de ses risques. Certes, nous dégageons des marges au début, mais l’intérêt économique d’une opération ne peut se mesurer qu’in fine. Oui, ces opérations de gestion sont en général rentables sur la durée, en fonction des cycles de marché, et elles contribuent à la rentabilité de nos fonds propres.
M. le rapporteur. Il faut attendre vingt ans pour savoir à quoi s’en tenir ?
M. Pascal Poupelle. C’est un peu plus complexe que cela car, à l’échéance, nous aurons du mal à faire le bilan exact. Si, au cours de la vie du produit, il y a des pertes considérables de trading, comme en 2008 quand les paramètres de marché ont évolué de façon totalement imprévisible, elles ne sont pas attribuées à un client en particulier. Et plus les opérations sont complexes, plus les risques à gérer le sont.
M. le président. Avez-vous une comptabilité analytique par client ?
M. le rapporteur. Vous venez de dire que ce n’était pas réalisable !
M. Pascal Poupelle. Nous avons bien sûr une comptabilité analytique par client, mais, comme toutes les comptabilités analytiques, elle repose sur des conventions.
M. le président. Monsieur Pandraud, allez-vous nous éclairer sur la formation des marges ?
M. Marc Pandraud. Je commencerai par répondre à M. Gagnaire. En tant que dirigeant français, je ne me permets pas de m’exprimer sur une décision de la justice allemande concernant ma maison mère, mais je tiens à souligner que je ne vois pas le moindre conflit d’intérêt dans les dossiers qui nous occupent. Nous sommes la contrepartie, et non le conseil des collectivités. D’ailleurs, la plupart d’entre elles en ont, et ils nous mettent de manière quasiment systématique en concurrence, en fonction d’un cahier des charges.
Premièrement, s’agissant des marges, il faut tuer l’idée selon laquelle il existerait un collectif qui se mettrait d’accord pour définir des marges trop élevées. Dans une précédente audition, vous avez même parlé, monsieur Gagnaire, de « prédateurs ». Je ne me considère absolument pas comme président d’une banque prédatrice. Nous apportons des solutions en faisant au mieux. Nous gérons les risques au niveau global c'est-à-dire que, pour un produit donné, la structure de coût n’est pas la même à la Deutsche Bank qu’à la Royal Bank of Scotland. Mais, ce qui importe, c’est de se rendre compte que, si nous n’avions pas été le mieux disant, nous n’aurions pas fait l’opération.
Deuxièmement, nos commerciaux ne sont pas rémunérés à la commission, même s’il est évident que l’obtention de résultats est nécessaire pour ces fonctions. Nos professionnels sont formés non seulement aux techniques, mais à l’évaluation du risque client. Ils évaluent avec lui le risque, et ils anticipent en quelque sorte la relation commerciale. Nous ne sommes pas conseil, mais nous essayons de comprendre les besoins en dialogue avec le client dans le cadre d’un cahier des charges. En tout état de cause, un client, on essaie de le garder. Le comportement est donc important tout comme l’est la réponse à la demande du client. En tant que président de la Deutsche Bank, il est essentiel pour moi que mes collaborateurs respectent le code de déontologie qui a été mis en place.
M. Alain Gaudry. L’encours total des swaps avec nos 14 contreparties s’élève à 1,2 milliard d’euros. Il s’agit du notionnel de ces swaps et non de financements. Sur nos 14 contreparties, seules 5 ont traité avec Deutsche Bank des produits hors charte Gissler. Le mark to market de ces produits hors charte Gissler avec ces 5 contreparties s’élève à environ 250 millions d’euros.
Nous avons actuellement 3 contentieux en cours, et nous sommes en phase de négociation intense avec l’une de ces contreparties. Nous n’opposons pas de fin de non-recevoir à nos clients, nous restons à leur côté. Nous étudions la santé financière de nos clients en permanence. Depuis 2008, nous leur demandons des mises à jour régulières de leur situation financière. Ainsi, nous sommes en mesure de leur proposer des restructurations, sous forme notamment d’allongement de la durée des swaps, de passages à taux fixe et dans certains cas de financements à des coûts attractifs. Nous maintenons donc nos relations et poursuivons nos discussions avec nos clients, à l’exception de ceux qui ont choisi de rompre le dialogue.
M. Jean Christophe. Notre situation est plus proche de celle de Dexia car, quand nous offrions un produit structuré à notre clientèle, nous nous retournions vers une banque d’investissement pour acheter la couverture. Notre intervention apportait indirectement aux collectivités une mise en concurrence des banques d’investissement, pour obtenir le meilleur prix. Chez Depfa, l’objectif était de réaliser sur les opérations structurées une marge d’environ 0,4 point, soit 40 points de base, qu’il faut comparer aux 70-80 points de base qui prévalaient au début des années quatre-vingt-dix et aux conditions actuelles – soit 150-200 points de base – que les collectivités paient aujourd'hui. Il s’agit évidemment d’une moyenne. En tout état de cause, lorsque nous obtenions un marché, c’est parce que nous proposions le meilleur prix.
M. le rapporteur. Faut-il comprendre que vous vous comportiez davantage comme un négociant que comme un banquier, dans la mesure où vous achetiez des produits de couverture au lieu de les fabriquer ?
M. Jean Christophe. Nous intervenions à la fois comme structurateur et intermédiaire. Nous n’avions pas, en ce qui nous concerne, toutes les équipes de trading pour construire le produit. Nous contactions les banques d’investissement en leur exprimant nos besoins et en leur demandant leur meilleur prix.
Contrairement aux banques françaises, nos interlocuteurs n’étaient quasiment jamais les élus. Il s’agissait surtout des directeurs financiers des collectivités. Notre plus petit client étant une collectivité d’un peu moins de 20 000 habitants. Nous avions affaire aux services financiers, ceux de villes moyennes ou grandes, de grands hôpitaux. Lorsque nous avons traité des swaps, tous nos clients se sont déclarés comme professionnels dans le cadre de la MIF.
M. le rapporteur. Vous faites systématiquement signer un papier ? Comment considérez-vous une collectivité locale, comme une entreprise ou comme un particulier ?
M. Jean Christophe. Depfa Bank a appliqué les critères de la MIF aux collectivités, pour savoir si elles pouvaient être considérées comme des professionnels. Elles ont été informées par notre siège du fait qu’elles étaient classées comme tels.
M. le président. Quelle est la qualification des personnels qui, dans votre banque, s’occupent des produits structurés ?
M. Jean Christophe. Les personnels en contact direct avec les collectivités sont des bac+3 ou bac+5. Ils sortent d’écoles de commerce ou d’ingénieur.
M. le président. Et au-dessus d’eux, ceux qui conçoivent les produits, participent à leur confection et forment les commerciaux ?
M. Jean Christophe. Compte tenu de nos effectifs, nous n’avons pas la même approche que dans un grand réseau qui forme ses commerciaux aux produits qu’ils vendent. La frontière existe entre ceux qui parlaient aux clients, qui étaient basés à Paris, et ceux qui parlaient aux banques d’investissement, qui étaient basés à Londres. Mais leur formation était très similaire : école de commerce ou école d’ingénieur.
M. le président. C’est un point important. Je connais les collectivités et autant leur capacité budgétaire est incontestable, autant leur compétence financière me paraît plus limitée. D’ailleurs, quand une grande collectivité veut faire de la gestion active, elle s’adresse à l’extérieur, faute d’avoir la compétence en interne.
M. Jean Christophe. La quasi-totalité des clients était accompagnée d’un conseil financier.
En ce qui concerne notre portefeuille clients, un seul client a réalisé sa première opération structurée avec nous. Tous les autres en avaient déjà l’expérience, ne serait-ce que parce que nous sommes arrivés assez tardivement sur le marché.
J’ai créé notre succursale de Paris en 2000. Quand nous avons élargi notre offre de produits structurés à partir de 2005 et surtout 2006, nous envoyions des offres relativement exhaustives. Aucune, il est vrai, ne précisait que le taux pouvait atteindre 30 ou 40 %, mais il était écrit que, sur la base de l’historique, de l’expérience, du consensus de marché, le taux pouvait se dégrader. Des exemples de taux de 12 % ou 14 % étaient donnés. Cela étant, on a toujours indiqué que le risque pouvait être illimité. Le document fourni, de vingt ou vingt-cinq pages, présentait le produit et son mode de fonctionnement d’après les données historiques, et il y avait une réunion d’explication avec les collectivités. D’après les échos que j’ai eus, y assistaient des gens qui connaissaient ce type de produit et posaient des questions extrêmement pertinentes. Soit nos interlocuteurs donnaient l’impression de posséder les compétences nécessaires, soit ils étaient accompagnés de leur conseil financier.
M. Patrice Calméjane. Les produits que vous avez commercialisés en France sont-ils autorisés ou interdits à l’étranger ?
M. Jean Christophe. C’est très variable. En Allemagne, il n’y avait aucun encadrement et certains produits appelés snowballs ont été offerts en toute légalité. L’Italie a introduit des restrictions extrêmement sévères à la fin des années quatre-vingt-dix, ou au début des années 2000, parce que certaines collectivités étaient en difficulté. L’Espagne interdit tout effet de levier. Aux Pays-Bas, les organismes de logement social peuvent souscrire des produits structurés, mais obligatoirement couverts par un cap. Je ne connais pas bien le cas du Royaume-Uni, où nous ne sommes pas très actifs sur les produits structurés, qui est très particulier, notamment avec les prêts LOBO (Lender’s option, borrower’s option). Ce sont des prêts à échéance extrêmement longue, jusqu’à soixante-dix ans, assortis de clauses de rendez-vous offrant des options de sortie à la fois à l’emprunteur et au prêteur. Mais ce ne sont pas des produits exotiques.
M. Jean-Louis Gagnaire. Une précision. J’ai cité la Cour de Karlsruhe, qui a considéré qu’il y avait une « situation de conflit d’intérêt ». Même si l’on ne peut pas transposer le droit allemand en droit français, peut-être les juridictions françaises pourraient-elles conclure dans le même sens après les plaintes qui ont été déposées. L’argument de l’information du client n’a pas tenu devant la Cour, étant donné le déficit de connaissance entre les collectivités et vos commerciaux qui sont, eux, bien formés. Vous avez reconnu que, la plupart du temps, les élus n’étaient même pas associés aux discussions. Je suis d’ailleurs étonné que vous puissiez dire que vous vérifiiez que les élus étaient bien informés alors que les représentants de l’État ont dit strictement le contraire : ils étaient dans l’incapacité de savoir si les élus avaient été correctement informés. Le Trésor, les préfets, et même la Cour des comptes considèrent que l’information des élus est très défaillante. Elle a d’ailleurs formulé des préconisations.
M. le rapporteur. Avez-vous fait l’objet de contrôles sur pièces ou sur place de l’Autorité de contrôle prudentiel sur cet aspect de votre activité ?
MM. Pascal Poupelle, Alain Gaudry, Jean Christophe. Non.
M. le président. Vous nous expliquez avoir élargi la concurrence. Mais en quoi ? Sur le taux bonifié ? Compte tenu de la complexité des contrats proposés et les effets de levier sur lesquels reposaient les produits, les produits étaient difficilement comparables.
M. Marc Pandraud. J’ai reçu aujourd'hui même une consultation en vue d’une contractualisation d’un emprunt. Il s’agit donc d’une opération courante. « Les offres comporteront une proposition à taux fixe. Il est libre aux concurrents de proposer des produits adaptés et/ou innovants. » Voilà la preuve que le besoin existe encore aujourd'hui.
M. Alain Gaudry. Comment sommes-nous entrés en relation avec des grandes collectivités à partir de 2005-2006 ? Nous avons été contactés par les conseils financiers des collectivités, qui nous présentaient des cahiers des charges dans lesquels étaient indiqués le montant du swap, la maturité, le taux d’intérêt souhaités. Dans certains cas, lorsqu’il s’agissait de remplacer des opérateurs en cours avec d’autres établissements financiers, une soulte négative devait être reprise par Deutsche Bank. Nous proposions alors une palette de produits, nous en discutions avec les conseils financiers et la collectivité. Ils nous mettaient ensuite en concurrence avec 3 ou 4 banques. In fine, la collectivité décidait.
M. le rapporteur. La direction du Trésor vous a-t-elle sollicitée pour connaître les encours globaux de produits structurés que vous déteniez sur les collectivités ?
M. Pascal Poupelle. Oui, il y a quelques mois.
M. Marc Pandraud. Également.
M. Jean Christophe. Il me semble que oui et nous avons fourni à votre commission les données sur l’intégralité de notre portefeuille.
M. le président. Vous connaissez la charte Gissler. À votre avis, à quel niveau faut-il plafonner le risque encouru par les collectivités locales ? Par ailleurs, M. Lemaire, le patron des Caisses d’Épargne, a déclaré en 2010 qu’il regrettait que son groupe ait distribué ce type de produit. Qu’en pensez-vous ?
M. Pascal Poupelle. Nous n’avons pas signé la charte Gissler, parce que nous n’avons pas été invités à le faire. Certaines associations d’élus ne l’ont pas signée non plus. En revanche, nous l’avons appliquée dès sa publication et nous en respectons les principes. Nous allons même au-delà parce que notre démarche commerciale peut être plus restrictive, en fonction de la taille de nos clients, et de ce que nous estimons être leur niveau de compétence, et aussi de la diversification de leur dette. La diversification est un critère très important : qu’une grande collectivité ait 5 % de sa dette en produit très risqué, selon la charte Gissler, peut se justifier en termes de stratégie financière, alors que s’endetter exclusivement en emprunts risqués serait peu responsable. Il est difficile de fixer une limite absolue. Tout dépend du client, de la diversification de la dette. D’ailleurs, ce sont des aspects que nous avons toujours pris en compte dans nos démarches. Encore aujourd'hui, nos concours ne portent pas sur plus de 8 % de l’ensemble des dettes de nos clients.
Quant aux déclarations de M. Lemaire, je lui en laisse la responsabilité, n’étant pas au fait des activités qu’il disait regretter.
M. Marc Pandraud. Une nouvelle fois, je vous remercie de nous avoir conviés à participer au travail en profondeur que votre commission a engagé.
Je terminerai en citant M. Masselus, que M. Gorges connaît bien puisqu’il est son adjoint aux finances, pour se remettre dans la perspective. Il insiste sur le fait que « lorsque nous effectuons de tels choix, nous disposons des marges de manœuvre nécessaires. » Il précise : « Depuis plusieurs années, nous nous efforçons d’optimiser nos charges financières, et le taux moyen d’intérêt est de 2,81 % pour les encours de la ville, 2,89 % pour ceux de l’agglomération, alors qu’il serait de 4,5 %, voire de 5 % si j’avais à l’époque souscrit ces emprunts à taux fixe. Cette stratégie, poursuit-il, a permis de financer plusieurs équipements importants. » J’enchaînerai en soulignant que l’important, en matière financière, est la réactivité. Un produit peut dans certaines circonstances ne pas répondre aux attentes des uns et des autres, de la banque comme de la contrepartie, mais il faut assumer. Dans mon métier, qui est de conseiller des entreprises, il faut tenir un langage de vérité. Quelquefois, quand les choses dérapent, on préfère la politique de l’autruche et les risques ne vont qu’en s’aggravant.
La seule recommandation que je me permettrai, à titre personnel, c’est que les collectivités et les banques resserrent leurs liens de proximité, de manière à tenir un discours de responsabilité partagée. Je souhaiterais que, dans le sillage de cette commission d’enquête, soit édité un code de fonctionnement aussi détaillé que possible. Nous, banquiers, exerçons la profession sans doute la plus réglementée, alors que bon nombre de nos contreparties – les hedge funds notamment – ne le sont pas. Plus on est réglementé, plus on est responsable, plus les relations sont transparentes. C’est tout ce que je souhaite. Je suis à votre disposition pour en parler avec vous. J’ai rejoint la Deutsche Bank en 2008 et j’ai regardé systématiquement son comportement pendant la période concernée. Je n’ai pas le moindre doute, nous avons appliqué les règles scrupuleusement, et même l’esprit des règles.
M. Jean Christophe. En 2011, PBB a demandé à être signataire car nous entendons continuer à accompagner nos clients dans leurs opérations de financement. La demande a été adressée à M. Gissler et nous attendons la réponse. Nous considérons la charte comme une avancée. Nous l’appliquons mais la demande de produits exotiques est devenue quasi inexistante. Nous n’offrons aucun effet de levier. Si j’avais une recommandation personnelle à faire, et nous avions soulevé cette question avant la crise auprès de la Direction générale des collectivités locales, ce serait la transparence dans les comptes des acteurs publics.
M. le rapporteur. Elle existe.
M. Jean Christophe. Oui, mais elle était limitée. Une opération souscrite pour un montant réduit pouvait être répétée avec plusieurs banquiers sans que cela se sache. Avant la crise, nous avions demandé une plus grande transparence. La charte impose certaines obligations mais elles ne datent que de 2009. Elles permettront de mieux suivre ce que font nos clients et d’avoir une vision globale du risque.
M. le président. Messieurs, je vous remercie.
*
* *
Auditions sur le thème « Quelle régulation des établissements de crédit spécialisés ? » : Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) ; M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de l’ACP ; M. Patrick Montagner, directeur du contrôle des établissements de crédit généraux et spécialisés ; M. Thierry Mergen, délégué au contrôle sur place des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; M. Sébastien Clanet, chef du service du financement des particuliers et des collectivités territoriales au secrétariat général de l’ACP.
(Procès verbal de la séance du mercredi 9 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, notre rapporteur et moi-même avons souhaité entendre aujourd’hui des représentants du régulateur du secteur bancaire, l’Autorité de contrôle prudentiel.
De création récente, puisqu’elle a été installée par une ordonnance du 21 janvier 2010, cette autorité administrative indépendante est toutefois née du regroupement des anciens régulateurs intervenant dans la sphère financière : la Commission bancaire, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles – ACAM –, le Comité des entreprises d’assurance et le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – CECEI. Ces différentes autorités étaient chargées de suivre les activités des établissements de crédit et de contrôler les risques qu’ils prenaient, notamment ceux qui proposent des prêts au secteur public local. L’ACP a donc vocation à exercer sa surveillance sur les acteurs du marché financier, laissant à l’AMF le contrôle des marchés eux-mêmes.
Madame, messieurs, je vous remercie d’avoir accepté de répondre à nos questions.
Mme Danièle Nouy, M. Édouard Fernandez-Bollo, M. Patrick Montagner, M. Thierry Mergen et M. Sébastien Clanet prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur Je vous remercie à mon tour d’avoir répondu à notre invitation, et je remercie Mme Nouy de m’avoir fait parvenir le rapport d’inspection de l’ACP sur la valorisation des produits financiers par Dexia Crédit Local, rapport établi en mai 2010.
Selon vous, qu’est-ce qu’une collectivité locale du point de vue de la directive MiFID ? Doit-elle être considérée comme un particulier ou comme une entreprise ?
D’autre part, quelle est l’étendue du contrôle de l’ACP sur les produits proposés par les établissements de crédit ? La Commission bancaire a-t-elle mis en garde ces établissements contre la commercialisation de certains produits ou a-t-elle formulé une interdiction, au nom de l’intérêt du client ?
Avez-vous jamais été alertés sur le développement de produits financiers destinés aux acteurs locaux et pouvant se révéler toxiques à terme – les conditions initiales étant toujours intéressantes ? Si oui, dans quelles circonstances ?
Les articles L. 612-30 et suivants du code monétaire et financier, relatifs aux pouvoirs de police administrative de l’ACP, lui permettent de mettre en garde une banque contre des « pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients », voire de les lui interdire. Ces dispositions ont-elles été appliquées aux établissements de crédit ? Si oui, quand ? Et le sont-elles aujourd’hui ? Car ces pratiques peuvent perdurer.
Enfin, depuis la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, l’ACP peut, à la demande d’une association professionnelle, valider et rendre obligatoire un code de conduite en matière de commercialisation et de protection de la clientèle, destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents. A-t-elle déjà engagé une telle démarche ? S’agissant des prêts aux collectivités territoriales, faut-il selon vous rendre obligatoire un code de conduite tel que la charte Gissler ou est-ce au législateur d’intervenir ? Que faire du stock de prêts ?
Mme Danièle Nouy, secrétaire générale de l’ACP. Les collectivités locales sont-elles concernées par MiFID ? À la lecture de la directive, rien n’est moins clair, et les articles sur le sujet montrent bien que la question est controversée. Lorsque la directive, qui comporte plusieurs points obscurs, sera revue, il devrait être possible d’arrêter une position française. Mais cela n’empêche pas l’ACP de s’intéresser aux collectivités locales au titre de sa mission de protection de la clientèle des banques et des assurés. Je vous donnerai des exemples de ce que nous avons fait en la matière.
En ce qui concerne votre deuxième question, l’ACP n’est pas chargée de valider a priori les produits proposés par les établissements de crédit, ce qui serait du reste impossible. Mais elle étudie les risques auxquels ces produits exposent les établissements. Elle veille notamment, à des fins de prévention, à ce que ceux-ci analysent a priori les risques encourus du fait des nouveaux produits ; et à ce que leur dispositif de contrôle permanent garantisse une analyse préalable rigoureuse de ces risques, et en assure un suivi adapté – mesure, contrôle et limitation.
Pas plus que la Commission bancaire avant elle, l’ACP ne peut interdire à un établissement de commercialiser des produits, en vertu de la liberté de contracter. En revanche, la Commission bancaire a eu plusieurs fois recours à la procédure de mise en garde pour demander à certains établissements de modifier leurs pratiques, notamment à l’endroit d’un établissement dont elle a estimé qu’il ne se conformait pas à son devoir d’information des emprunteurs en matière de crédit immobilier : il s’agissait d’un crédit à taux révisable, mais le client n’était pas clairement informé des modalités de révision. L’ACP a fait à son tour usage de ce pouvoir de mise en garde dans une affaire qui concernait les comptes de syndics de copropriété.
M. le président. L’ACP a-t-elle eu connaissance de l’existence de produits complexes souscrits par les collectivités ?
Mme Danièle Nouy. Tout à fait. Nous avons été alertés fin 2007 et début 2008, notamment après les élections municipales de mars 2008, par plusieurs élus qui ont publiquement exprimé leur inquiétude. Nous avons donc organisé au cours du second semestre 2008 des réunions avec certains établissements bancaires susceptibles de prêter aux collectivités locales. À partir des informations que nous avons recueillies, nous avons présenté le 8 septembre 2008 au collège de la Commission bancaire une note qui concluait que l’effet de ces prêts était jusqu’alors limité. Cependant, le collège a souhaité diligenter des enquêtes sur place, chez les trois principaux intervenants français : Dexia, le groupe Crédit agricole et les Caisses d’épargne.
Cette décision a été prise quelques mois avant l’installation de la commission présidée par M. Gissler, laquelle a abouti courant 2009 à la charte entrée en vigueur le 1er janvier 2010 et signée par les quatre principaux établissements de crédit prêtant aux collectivités locales – ceux que je viens de citer et la Société générale, un peu moins active que les trois autres – ainsi que par certaines associations d’élus. M. Gissler a du reste sollicité le secrétariat général de la Commission bancaire pour nourrir ses réflexions.
Les trois enquêtes sur place ont été conduites fin 2008 et au premier semestre 2009. Elles ont donné lieu, comme toutes nos enquêtes sur place, à des rapports, puis à des lettres de suite adressées aux banques à l’automne 2009 pour les inviter à renforcer leur dispositif de contrôle et de maîtrise des risques auxquels les exposaient ces produits, dont des risques juridiques et de réputation, et à améliorer l’information des clients, notamment en se conformant à la charte Gissler, alors en voie d’achèvement.
M. le rapporteur. Pourrez-vous nous communiquer ces pièces ?
Mme Danièle Nouy. Bien sûr.
M. le rapporteur. Un contrat de prêt doit mentionner un taux effectif global. C’est important pour un ménage, mais aussi pour une collectivité, qui doit estimer, au moment d’établir son budget annuel, les frais financiers de sa dette. Mais, dans le cas de certains prêts structurés, comment peut-on évaluer le TEG et comment pouvez-vous vérifier cette information ?
Mme Danièle Nouy. C’est une difficulté propre à ce type de prêts. Ainsi d’un prêt conclu en franc suisse : qui peut dire ce que sera le cours de cette devise au moment où il faudra en acheter pour rembourser le prêt ? On peut donc se demander s’il ne serait pas raisonnable, au nom de l’intérêt public, de limiter la créativité en matière de prêts ; mais c’est au législateur de le faire, non au contrôleur.
M. le rapporteur. L’absence de TEG n’invalide-t-elle pas le contrat ?
M. Édouard Fernandez-Bollo, secrétaire général adjoint de l’ACP. Il y a un TEG dans ces contrats.
M. Henri Plagnol. Mais pour la quasi-totalité des emprunts dits toxiques, notamment ceux qui reposent sur des formules mathématiques complexes, intégrant des valeurs extrêmement volatiles, et dont la durée est parfois supérieure à trente ans, comment peut-on indiquer un taux effectif global ? Et comment se fait-il que les autorités de contrôle n’aient pas réagi ? La situation était bien plus grave que dans l’exemple de mise en garde que vous avez cité ! Tout récemment, la Caisse des dépôts a refusé d’intégrer à son bilan les prêts les plus toxiques consentis par Dexia au motif que la perte potentielle n’était même pas chiffrable ! Que signifie « taux effectif global » quand, une fois le dispositif déclenché, le taux d’intérêt peut passer à 15, 20 ou 30 % ? Vous êtes bien aimable de vous contenter d’envoyer des rapports ! La charte Gissler, c’est très bien ; mais c’est pour l’avenir ! Qu’avez-vous fait ?
Mme Danièle Nouy. À la différence du législateur, monsieur le député, je n’ai pas le pouvoir d’empêcher un établissement de proposer aux collectivités locales des prêts dont on ne peut pas établir le taux d’intérêt maximal.
M. Henri Plagnol. Que signifie « TEG » pour des produits dont on ne peut pas prédire le taux ? C’est une tromperie !
M. le rapporteur. Non, mais cela rend le contrat caduc.
M. le président. Vous voyez que ce sujet suscite les passions !
Mme Danièle Nouy. Je le comprends.
M. Henri Plagnol. C’est une honte !
M. Patrice Calméjane. N’oublions pas que le TEG ne doit pas dépasser le taux d’usure sous peine de sanction. Vous êtes l’Autorité de contrôle prudentiel ! Au législateur de prendre ses responsabilités, nous dites-vous. Mais avez-vous prévenu le président de l’Assemblée nationale, celui de sa commission des finances, ou d’autres autorités encore, que vous établissiez des rapports qui restaient sans effet ? Le législateur n’est pas un voyant : ceux qui savent doivent l’informer !
M. Édouard Fernandez-Bollo. En tant qu’autorité administrative, nous n’avons pas à juger de la validité juridique de ces contrats : cela relève de l’ordre judiciaire. Toutefois, nous étudions naturellement de près la jurisprudence en la matière. Il en ressort que le calcul du TEG est validé dès lors qu’il repose sur des hypothèses valables au moment de l’octroi du prêt. C’est à partir de ces hypothèses que l’on estime, à ce stade, si le taux respecte ou non le seuil de l’usure : cela ne permet pas d’intégrer le risque de variation des paramètres avec le temps. Mais lorsque, dans d’autres domaines que celui dont nous parlons, nous avons constaté que, ces conditions étant réunies, le seuil de l’usure n’était pas respecté, nous en avons informé le procureur puisqu’il s’agit d’une infraction pénale.
M. le rapporteur. Soyons clairs : par définition le TEG intègre les frais financiers qui seront acquittés sur toute la durée du contrat. Même s’il est calculé au moment de la signature, c’est une couverture contractuelle : on est assuré que, quoi qu’il arrive, il ne sera pas dépassé.
M. Édouard Fernandez-Bollo. La jurisprudence civile en France valide le calcul du TEG dès lors qu’il repose sur des hypothèses fondées, au moment de l’octroi, sur l’indice qui permet la révision du taux. Nous n’y sommes pour rien !
M. le rapporteur. Sur ce sujet, il n’y a pas encore de jurisprudence ; justement, nous allons nous en charger.
M. Marc Francina. Il est exact que le TEG est fixé le jour où l’emprunt est contracté. Le problème est que ces prêts ont été adossés au cours du franc suisse, dont la variation a fait évoluer le taux. C’est justement le lien entre la variation du franc suisse et le taux du prêt qu’il va falloir prouver.
M. le rapporteur. Le TEG est obligatoire : on n’a pas le droit de signer un contrat qui n’en prévoit pas. En fin de contrat, chacun pourrait vérifier qu’il n’a pas payé plus que le montant maximal.
M. Marc Francina. C’est à la signature du contrat que le TEG est fixé !
M. le rapporteur. Mais cela n’a pas de sens !
M. Édouard Fernandez-Bollo. Il faut tenir compte de la jurisprudence des tribunaux. En outre, le TEG est encadré par des directives européennes. Le TEG doit en effet être mentionné lorsque le taux est variable, auquel cas il est apprécié au jour de l’octroi. S’il est calculé en fonction d’hypothèses valables à ce moment-là, il est légal. Tel est l’état du droit, sur lequel nous avons fondé notre action, sachant, je le répète, qu’il ne nous appartient pas de décider de la validité d’un contrat.
M. le rapporteur. Par définition, le TEG doit intégrer les frais financiers afférents au prêt. D’autre part, on ne peut pas parler de jurisprudence sur ce sujet : si une commission d’enquête a été constituée, c’est que nous nous situons dans une zone de doute, parce qu’on a créé et mis sur le marché des produits nouveaux en tentant de les accorder à la législation en vigueur. À mes yeux, ils ne sont pas légaux, si bien que le contrat pourrait être caduc. Mais c’est à vérifier.
M. Daniel Boisserie. M. Calméjane vous a demandé si la commission des finances de l’Assemblée avait été alertée. Avez-vous prévenu d’autres organismes d’État – le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre des finances ?
Mme Danièle Nouy. Un représentant de la direction générale du trésor siège au collège de la Commission bancaire. Il a pu être informé au même titre que les autres membres du collège.
M. Daniel Boisserie. En d’autres termes, l’information a été transmise au plus haut niveau de l’État ?
Mme Danièle Nouy. Bien sûr. C’est un sujet dont on parlait beaucoup après les élections municipales de 2008. Tous ceux qui voulaient savoir ont su.
M. Daniel Boisserie. On ne peut donc nier que vous les ayez sensibilisés au problème, y compris au plus haut niveau ?
Mme Danièle Nouy. Nous intervenons en fonction de procédures définies par la loi. Nous nous sommes saisis du dossier, nous en avons parlé avec les établissements, nous nous avons enquêté sur place : bref, nous avons fait notre travail. Cela peut vous paraître dérisoire, mais c’est ainsi que nous travaillons, comme nos homologues étrangers, du reste : nous établissons des rapports, qui peuvent donner lieu à des lettres de suite, et le collège peut décider d’ouvrir une procédure disciplinaire s’il considère qu’il y a matière à le faire. Cette décision n’est pas entre mes mains, elle est collégiale. En l’occurrence, il nous a été demandé d’envoyer une lettre de suite rappelant aux établissements leur devoir d’information et de conseil vis-à-vis de leurs clients, ainsi que les risques – juridiques et de réputation – auxquels ces produits les exposaient dans l’hypothèse où le juge des contrats, que nous ne sommes pas, aurait à en connaître. Nous avons donc fait ce qui était en notre pouvoir.
Le législateur peut décider de limiter la liberté contractuelle des collectivités locales en les empêchant de souscrire des prêts qui s’apparentent à des jeux de casino. Mais cette décision ne relève pas du superviseur bancaire.
M. le rapporteur. Nos remarques ne vous visent pas personnellement, madame. Le ton est vif parce qu’il y a ici des élus concernés par le problème.
Mme Danièle Nouy. La citoyenne que je suis le comprend bien.
M. Henri Plagnol. Mais nous ne sommes pas satisfaits de vos réponses !
M. le rapporteur. Revenons pour l’instant à ce que nous disions précédemment. Le TEG est obligatoire et il doit inclure tous les frais financiers afférents au prêt. Facile à calculer dans le cas d’un prêt à taux fixe, il l’est moins lorsque des paramètres aléatoires sont en jeu. Mais, en tout état de cause, il ne doit pas dépasser le taux d’usure fixé chaque trimestre, sous peine de sanctions pénales clairement définies par le code de la consommation.
M. Henri Plagnol. Je me montrerai moins policé que mes collègues, parce que nous sommes une commission d’enquête et que je ne suis pas satisfait. Vous avez dit vous-même que ce sont les interpellations des nouveaux élus entrés en fonction en mars 2008 qui vous avaient fait réagir. Et auparavant ? Votre rôle n’est-il pas prudentiel ? Il faut prendre la mesure de la situation : plusieurs centaines de collectivités locales sont menacées de ne pouvoir faire face ; plus grave encore, une partie de notre système bancaire est profondément fragilisé – voyez la recapitalisation de Dexia. En ce qui concerne les banques mutualistes, du reste, le scandale est peut-être à venir. Comment se fait-il que vous n’ayez rien vu avant 2008 ? Car l’essentiel s’est joué entre 2003 et 2008 ; quant à l’avenir, la question est pratiquement réglée, chacun ayant bien compris que ces prêts n’étaient pas une bonne affaire.
Mme Danièle Nouy. Avant l’ACP, la Commission bancaire pouvait aborder ces questions par le contrôle de conformité et par le contrôle interne des risques que prenaient les établissements. C’est ce que nous avons fait, en commençant par des entretiens avec les établissements, surtout, c’est vrai, lorsque nous avons pris davantage conscience de l’ampleur du problème. Je comprends que vous ne trouviez pas cela suffisant, mais nous avons fait ce que nous pouvions.
M. le rapporteur. Je vous demandais tout à l’heure si les collectivités locales devaient être considérées comme des particuliers ou comme des entreprises. Lorsque nous avons auditionné les représentants de tout le système bancaire français et ceux de plusieurs banques étrangères, il est apparu que certaines banques ont fait signer aux collectivités un document stipulant qu’elles n’étaient pas des collectivités, mais des entreprises, et qu’elles contractaient le prêt à ce titre. Monsieur Clanet, pourquoi certaines ont-elles agi ainsi et non les autres ?
M. Sébastien Clanet, chef du service du financement des particuliers et des collectivités territoriales au secrétariat général de l’ACP. Dans mon domaine, la supervision directe de Dexia, je n’ai pas connaissance de clauses spécifiques. Ce problème juridique ne nous a été signalé ni par l’établissement lui-même, ni par les collectivités locales. Peut-être des banques étrangères en ont-elles usé différemment.
M. le rapporteur. Le statut des collectivités est très particulier et ne permet pas de les assimiler à des entreprises. Pour le faire, il a fallu établir un document spécifique. Et cela rejaillit sur l’application des dispositions légales relatives au TEG et au respect du seuil d’usure. Les collectivités concernées sont en général de taille importante : il s’agit de conseils généraux ou de communes de plus de 10 000 habitants.
M. Édouard Fernandez-Bollo. La directive MiFID porte sur les investissements : elle ne s’applique pas directement aux contrats de prêt. Elle établit une distinction entre investisseurs avertis et non avertis.
En ce qui concerne les collectivités locales, les banques étrangères, en particulier, avaient en mémoire certaines jurisprudences étrangères, dont l’affaire Orange County et certaines jurisprudences britanniques en matière de swap. Voilà pourquoi elles ont voulu se protéger en demandant aux collectivités de ne pas faire valoir leur statut particulier dans le cadre du contrat de prêt. Ce faisant, elles cherchaient à s’assurer que le contrat serait considéré comme un contrat commercial, relevant des tribunaux judiciaires et non des tribunaux administratifs. À cette fin, elles se sont conformées aux critères établis par la jurisprudence administrative française, dont le fait qu’aucune condition exorbitante relevant du droit public et des fonctions de droit public des collectivités ne concerne le contrat.
En tant que simple observateur du droit, je suis assez sceptique quant à l’effet de ces clauses en droit français. La clause de compétence est assez solidement établie : normalement, les contrats de prêt ne sont pas soumis au tribunal administratif. En revanche, la jurisprudence me semble tout à fait contraire à la clause d’exonération de responsabilité. Mais ce sera aux tribunaux d’en juger.
Danièle Nouy l’a dit, nous ne pratiquons pas de contrôle a priori. Nous ne connaissions donc pas ces contrats. Nous ne disposons dans nos états que de montants agrégés de crédits, tous les mois ou tous les trois mois selon les établissements. Si personne ne nous en informe, nous ne sommes pas avertis de l’existence de clauses contractuelles particulières.
M. Henri Plagnol. C’est consternant !
M. Édouard Fernandez-Bollo. Il en va de même des autres autorités prudentielles, dans l’Union européenne comme ailleurs. Le reporting permet de saisir les grands équilibres du bilan et les règles prudentielles s’appliquent au bilan tout entier. Nous n’avons pas d’informations détaillées sur les contrats de prêts signés par les établissements. En revanche, lorsqu’une difficulté est soulevée a posteriori, nous pouvons aller voir ce qui se passe, et c’est ce que nous avons fait.
M. le président. En 2008, plusieurs responsables de collectivités locales vous alertent sur la situation dans laquelle ils se trouvent vis-à-vis de certaines banques. À ce moment, quels sont les éléments qui permettent d’exercer le contrôle ? Pouvez-vous vous prononcer sur la rentabilité excessive des opérations commerciales de certaines banques ?
M. Patrick Montagner, directeur du contrôle des établissements de crédit généraux et spécialisés. Prenons l’exemple de Dexia Crédit Local, l’un des 400 établissements placés sous mon contrôle. Nos premières réunions avec Dexia au sujet des prêts structurés aux collectivités locales ont eu lieu en mars 2008, à la suite d’une jurisprudence impliquant une SA de HLM à Toulouse, la première qui nous ait alertés. Car si nous ne disposons que d’indicateurs chiffrés globaux, les contentieux formés par les collectivités locales sont aussi, pour nous, les micro-indicateurs d’un dysfonctionnement. Or, jusqu’en 2008, aucun élu n’a interpellé son prêteur car les conditions satisfaisaient les deux parties. Il est exact qu’une rentabilité excessive attire notre attention, ce qui a été le cas pour des opérations de marché. Mais les opérations de prêt aux collectivités publiques réalisées par les banques concernées ne sont pas nécessairement rentables, encore moins dans des proportions excessives. Elles ne permettent pas de dégager des marges importantes. Et rien ne prouve que lorsque le taux s’envole, la banque s’enrichit – hélas, si j’ose dire : car si la banque dégageait une marge considérable, elle pourrait la consommer si elle était condamnée en justice, ce qui serait un gage de sécurité pour tout le monde.
En fait, quand une banque proposait des produits structurés dépendant d’indicateurs de marché, elle ne prenait pas le risque pour elle, elle se couvrait auprès de banques d’affaires. Ses contreparties sont essentiellement de grandes banques américaines et britanniques dont JP Morgan, Goldman Sachs, Royal Bank of Scotland et Barclays, ainsi que, dans une bien moindre mesure, des banques françaises : BNP Paribas et la Société générale. Dès lors, toute la marge dégagée était instantanément transférée à la contrepartie sur les marchés, déduction faite d’une marge initiale qui était gelée. D’où la difficulté de ce type de contrat : quand la barrière qui constituait l’option implicite du contrat est franchie, cela ne profite pas à l’établissement qui a réalisé l’opération, sauf s’il a gardé le risque pour lui, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
M. le président. J’aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur la rentabilité des opérations réalisées par les banques de marché avec les collectivités territoriales depuis 2004. Premièrement, lors des contrôles que vous avez effectués, avez-vous constaté que le taux de marge différait selon que la transaction était réalisée avec une collectivité ou avec un grand investisseur, ou encore une grande entreprise ? Deuxièmement, pensez-vous que les transactions avec les collectivités ont représenté une part significative du profit réalisé par les départements d’options complexes de taux et de change au sein des banques ? Troisièmement, la Cour de Karlsruhe vient de condamner un établissement bancaire allemand pour défaut de conseil à client non initié et, surtout, pour marges cachées ; vous êtes-vous intéressés à ces dernières ? À partir de quel moment l’ACP serait-elle alertée ?
M. Patrick Montagner. Comme tout commerçant, la banque dégage des marges avec n’importe quel client, mais la manière dont les profits sont réalisés varie selon le type de clientèle. Avec une grande entreprise, qu’elle soit industrielle ou de services, la marge provient non seulement des prêts, mais aussi de ce qu’on appelle des ventes croisées : le client confie aussi à la banque l’émission d’actions, d’obligations, des mandats pour racheter une autre entreprise, etc. Les banques apprécient la rentabilité globale de la relation et non simplement celle du prêt. En ce sens, on peut considérer que les marges des prêts aux grandes entreprises ne sont pas plus élevées que celles des prêts aux collectivités locales.
En revanche, dans le cas d’une collectivité, le service rendu hors prêt est relativement limité, sauf si les banques parviennent à faire signer à la collectivité des contrats de services plus larges ; c’est arrivé, mais j’ignore ce que ces contrats recouvrent exactement. Ce qui intéressait les banques, et qui leur permettait d’accepter de dégager des marges plus faibles qu’auprès d’autres établissements, c’était le fait que le risque était considéré comme quasi souverain. En effet, si leur pouvoir fiscal n’est pas du même ordre que celui de l’État, les collectivités ont toujours été gérées de manière à pouvoir rembourser leurs emprunts. Le taux de perte final pour la banque n’est donc pas le même que dans le cas d’un crédit à la consommation ou d’un prêt à une PME, voire à une grande entreprise internationale, qui peut faire faillite.
Les banques évaluaient donc l’équilibre entre le risque encouru et la marge escomptée en fonction de la composition de leur clientèle. Ainsi, une banque qui se consacrait uniquement aux collectivités locales dégageait une marge plus faible, mais, le risque étant moindre puisqu’elle prêtait au secteur public, le besoin de fonds propres associé au risque était également moindre.
Quant aux marges cachées, par définition, tout résultat apparaît à un moment donné en comptabilité.
M. le président. Mais la banque doit aussi l’annoncer au client.
M. Patrick Montagner. Absolument.
M. le rapporteur. C’est le TEG qui doit le montrer.
M. Patrick Montagner. Cela étant, nos enquêtes ont révélé des ambiguïtés dans la manière de commercialiser le produit. C’est l’avantage d’une enquête sur place longue de plusieurs semaines par rapport à mon activité quotidienne, limitée à l’étude d’états globaux et à des entretiens, même si ces derniers sont nombreux – plusieurs centaines par an – et même si je cherche à pousser mes interlocuteurs dans leurs derniers retranchements. Les ambiguïtés dont je parle résultaient par exemple de l’appellation de certains prêts : Tofix Dual – où il faut comprendre que tout est dans le second terme –, Fixia, etc. Dans ce cas, l’inspecteur relevait que la banque pourrait être accusée de défaut de conseil devant un tribunal.
Par ailleurs, comme le montrent d’autres auditions réalisées par votre commission d’enquête, certains clients publics, y compris des collectivités, considèrent qu’ils ont encore intérêt à souscrire des prêts dits structurés. Ce n’est pas notre avis, mais cela relève de leur liberté contractuelle. Ces clients font valoir qu’ils pratiquent la gestion active, c’est-à-dire qu’ils renégocient en permanence avant que les barrières ne se déclenchent. Or cela permet aux établissements de se rémunérer à nouveau en prenant une marge de conseil : ils perçoivent une commission au titre de la restructuration du prêt. Est-ce une marge cachée ? Certes, elle est annoncée au client, mais elle n’est pas toujours assez clairement présentée dans le contrat. Or il ne suffit pas que l’information figure, il faut aussi qu’elle soit claire et que l’attention du client n’ait pas besoin d’être sans cesse en éveil.
M. le président. D’où ma deuxième question. Dans un cas particulier, on a pu constater que les opérations réalisées avec les collectivités représentaient une part significative du profit des départements d’options complexes de taux et de change. Cette disproportion n’a-t-elle pas servi de signal d’alerte ?
M. Patrick Montagner. J’ignore le montant des profits réalisés par les banques d’investissement américaines ou britanniques qui ont contracté avec certains établissements pour l’adossement des prêts. Rien ne dit que les prêts conclus avec les acteurs publics locaux aient permis de dégager des marges mirifiques au début du contrat. Tout le jeu, pour les banques, consistait à renégocier régulièrement. Aujourd’hui, les taux s’envolent, mais je ne sais pas exactement ce que ces contreparties ont fait du risque qui leur a été retourné, puisqu’elles échappent à mon contrôle. Je ne suis pas certain que ces établissements se procurent des marges importantes, car ils gèrent leur risque de marché de façon très générale : ils se « macrocouvrent » ; ils peuvent, au moment où ils prennent un risque avec une banque (Dexia par exemple), prendre un risque opposé avec l’un de ses concurrents (par exemple Depfa).
Les produits dits optionnels, c’est-à-dire les options d’échange, sont interdits par certaines législations en Europe. Mais certaines collectivités publiques ont contourné l’interdiction, jouant un jeu dangereux pour elles comme pour les banques.
M. le rapporteur. Vous dites que vous ne recevez que des états globaux. À quel niveau de détail parvenez-vous ? Ne pouviez-vous pas mesurer la proportion de prêts structurés ?
M. Patrick Montagner. Nous connaissions le montant total des prêts. Nous demandions très souvent un classement par type de collectivité, mais pas par type de contrats : nous avions une rubrique générale « Prêts et créances ».
Prenons les trois banques françaises que nous avons contrôlées. Elles n’ont apparemment jamais proposé de produits à effet cliquet, c’est-à-dire dont le taux ne peut diminuer en deçà d’un certain niveau une fois celui-ci atteint. On parle aussi de produits snowball, ou à effet boule-de-neige. Dans les produits commercialisés par les banques dont je parle, une fois la barrière activée parce que les deux indices de référence ont atteint un seuil donné, si ce seuil est franchi dans l’autre sens, le taux redescend. On ne peut pas en dire autant d’autres établissements, dont ceux qui ont vendu uniquement des contrats de swap et fait signer à leurs clients, comme nous le disions tout à l’heure, ce qui s’apparente à des décharges de responsabilité. Avec ces produits, si le taux redescend pour la banque, il ne redescend jamais pour le client, ce qui entraîne cette fois des marges excessives et injustifiées.
M. le rapporteur. ile un monde dont on ignore tout. Le nouveau patron de Dexia nous a dit être passé de cent cinquante-six types de prêts à quinze : c’est un aveu ! Vous ne pouvez intervenir a priori, soit ; mais une fois les produits commercialisés, avez-vous alerté Dexia ? Un autre banquier nous a dit qu’il ne commercialisait pas ce qu’il ne comprenait pas, ce qui semble plus sensé…
M. Patrice Calméjane. Plusieurs établissements bancaires et d’autres spécialistes nous ont donné les mêmes explications que vous. Pour ma part, j’attends de ces auditions qu’elles me permettent de comprendre comment tout cela a fonctionné et de trouver le moyen de sauver certains acteurs publics locaux, mais aussi de renforcer les systèmes de contrôle.
Vous représentez l’Autorité de contrôle prudentiel, chargée, selon la présentation officielle, de « veille[r] à la qualité de la situation financière des entités des secteurs qu’elle supervise dans le but de garantir la stabilité du système financier et la protection de leurs clientèles ». On aimerait que cela fonctionne ! Votre collège compte un membre nommé par le président du Sénat, lequel représente les collectivités territoriales ; un membre nommé par le président de l’Assemblée nationale ; un membre désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Les hautes autorités de l’État, nous dites-vous, ont été averties. Les membres du collège de l’ACP que je viens d’énumérer ont-ils bien participé à vos travaux ? Les collectivités locales empruntent plusieurs milliards d’euros par an : ce ne sont pas de petits clients ! À quoi sert donc votre Autorité ? J’essaie de comprendre, en tant que simple citoyen.
M. Henri Plagnol. Il est normal que les représentants du peuple français se posent cette question. M. Montagner nous a très bien expliqué que Dexia, comme d’autres, était entrée dans une logique de risque systémique, du fait notamment de la revente du risque. C’est exactement ce que je constate en tant que maire : mes interlocuteurs sont dos au mur, car tout effort consenti par eux se traduit par une perte nette, dont on voit les conséquences abyssales dans le cas de Dexia. Or votre mission première est de déceler les risques systémiques.
Il ne s’agit pas d’accusations personnelles. J’ai bien compris que, les bilans étant agrégés, tout cela n’apparaissait pas. Mais avez-vous tiré les conséquences de ce désastre, qui n’est pas terminé ? Je souhaite que cette question soit au cœur de notre rapport. Avez-vous entrepris de réviser vos méthodes de contrôle pour déceler ce risque systémique avant qu’il ne soit trop tard ? Si vous vous êtes réveillés après 2008, c’est parce que des élus du peuple vous ont alertés ! Où en serait-on aujourd’hui sans eux ? On frémit en y pensant. N’oublions pas que, pour l’essentiel, ce désastre a été consommé en cinq ans !
M. le président. Vous le voyez, nous ne comprenons pas le système ni le rôle de l’ACP. À qui s’adresser lorsqu’il y a danger ? Rien de ce que vous direz ne sera publié sans votre aval, mais éclairez-nous ! Madame, messieurs, à quoi sert votre Autorité ?
Mme Danièle Nouy. Je vous répondrai avec la même passion. Une pratique stupide, qui existe depuis très longtemps, consiste à emprunter dans une devise alors que l’on n’a pas de revenus dans cette devise. Cela vaut pour les particuliers comme pour les institutions. C’est une tragédie, mais qu’y puis-je ? Cela n’a rien de structuré ni de complexe. On sait qu’au moment de rembourser une échéance, il faudra acheter du franc suisse. Or il n’existe pas de modèle qui permette de prédire ce que vaudra le franc suisse le moment venu.
M. le président. Merci de votre franchise, madame. Mais, si vous n’y pouvez rien, qui peut faire quelque chose ?
Mme Danièle Nouy. Le législateur ! C’est à lui qu’il appartient de limiter la liberté contractuelle des collectivités locales, comme celle des particuliers ou des entreprises.
M. le rapporteur. Il l’a fait par les dispositions sur le TEG et le taux d’usure.
Mme Danièle Nouy. Mais cela ne suffit pas : la preuve !
M. le rapporteur. Je pense que si.
Mme Danièle Nouy. Si vous ne voulez pas que cette situation se reproduise, il faut encadrer la liberté contractuelle des acteurs que vous voulez protéger. Je ne peux empêcher personne de signer ce type de contrats, ni même interdire à une banque de le proposer.
M. le président. Soit ; mais, il faut bien que, parmi les observateurs et les organismes de régulation, quelqu’un alerte le législateur et lui demande de prendre des mesures.
Mme Danièle Nouy. J’ai la chance de pouvoir vous répondre et je l’ai fait.
Sachez aussi que les banques, embarrassées d’avoir pris de tels risques juridiques et de réputation, sont prêtes dans certains cas à renégocier les contrats. Or certaines collectivités locales qui sont encore en phase gagnante refusent. Quand la barrière aura été atteinte, il arrivera ce qui doit arriver : la situation est potentiellement explosive. Je ne peux pas le dire plus clairement !
M. le président. Nous devons déterminer ce qu’il faut faire du stock de prêts : comment sortir de ces contrats ? Or j’entends ce que vous dites, et qui a en effet été avancé par les banquiers ; mais les petites collectivités que nous avons reçues – des hôpitaux, des offices HLM – se voient proposer des pénalités de sortie égales au montant initialement prêté !
Mme Danièle Nouy. Comme l’a expliqué Patrick Montagner, les banques se couvrent, ce qui montre combien le risque est élevé. Et, pour cela, elles dépensent presque tout ce que l’opération leur rapporte. Plus on sort du contrat tôt, en particulier dans la phase où l’on est encore bénéficiaire, plus on a de chances d’en sortir à des conditions correctes. Mais si, dans les cas que vous évoquez, la banque risque sérieusement d’être sanctionnée par la justice et de devoir payer des dommages et intérêts, elle négociera. Il faut sortir de ces prêts.
M. le rapporteur. En règle générale, mieux vaut en effet une mauvaise négociation qu’un bon procès. Mais quelle structure pourrait payer une soulte égale au montant du capital ? Les collectivités ne seraient plus en mesure de respecter la règle d’or qui s’impose à elles !
Les banques se sont protégées, soit. Mais, en dernier ressort, l’ajustement repose sur l’impôt, c’est-à-dire sur le citoyen. Dès lors, je le répète, une collectivité peut-elle être assimilée à un particulier alors que ce sont les habitants qui vont payer ? D’autre part, je rappelle une fois encore les dispositions relatives au TEG. Puisque je dois formuler des préconisations, je dirai aux collectivités dont les comptes risquent de ne pas passer le contrôle de légalité d’inscrire dans leur budget des frais financiers correspondant au taux d’usure ; cela leur servira de provision pour présenter le budget au conseil municipal et continuer de fonctionner.
On ne peut pas reprocher à ceux qui bénéficient aujourd’hui de taux très bas d’attendre que la commission d’enquête ait rendu ses conclusions et que la situation se dénoue. Pourquoi paieraient-ils des soultes considérables, alors que la commission d’enquête pourrait montrer qu’ils ont fait quelques erreurs mais qu’il suffit d’appliquer la loi pour résoudre le problème ? Les maires sont des gens responsables.
Ne prenez pas mal nos questions : nous ne faisons pas le procès de l’ACP, nous voulons comprendre ce qu’elle apporte, y compris pour recommander, le cas échéant, de renforcer certains de ses pouvoirs. Les membres de la commission d’enquête sont eux-mêmes responsables de collectivités et doivent trouver des solutions.
M. Jean-Louis Gagnaire. J’ajoute que, malgré nos divergences politiques, nous trouvons de plus en plus de points d’accord à mesure que nos travaux progressent, ce qui est significatif, surtout dans la période actuelle !
Si nous avons constitué une commission d’enquête, c’est parce que nous avons été sollicités. Certains d’entre nous sont directement concernés en raison de ce qu’ils ont découvert. La date de 2008 n’est pas accidentelle : l’augmentation des taux a coïncidé avec le renouvellement de nombreuses équipes municipales. À la faveur de l’alternance, les nouveaux élus, qui ont tout naturellement demandé des audits budgétaires, ont découvert une situation qu’ils n’avaient pas imaginée ; bien d’autres responsables ne concevaient même pas que cela puisse arriver dans leur collectivité.
Ce que M. Montagner a expliqué à propos des appels de marge pèsera à terme sur le budget, soit sur celui de l’État par le biais de Dexia ou, au-delà de la franchise de 500 millions d’euros, de la garantie de la Caisse des dépôts ; ou bien de celui des collectivités. Vous l’avez dit, les risques sur les collectivités sont considérés comme quasi souverains. Les maires des petites communes, que nous avons auditionnés, ne peuvent pas honorer leurs dettes sans mettre leur budget en péril. Ils seront donc tentés de transmettre le budget au préfet, advienne que pourra. Le problème nous file entre les doigts : on croit tenir Dexia, mais Dexia est elle-même contrainte par la manière dont elle s’est couverte. Vous dites qu’en définitive, cela ne profite même pas aux banques prêteuses : c’est ubuesque ! Toujours est-il que le contribuable paiera.
À l’avenir, il faudra prendre des mesures de précaution et se conformer aux préconisations de la Cour des comptes : tout ira mieux si les élus locaux ont moins intérêt à faire des « coups », notamment s’ils doivent constituer des provisions pour risque. Cela étant, que faire du stock ? Vous avez contrôlé a posteriori, soit ; peut-être auriez-vous dû alerter le législateur auparavant ; je ne veux pas vous accabler. Mais aujourd’hui que tout est connu et que vous analysez clairement les phénomènes qui se sont produits, que proposez-vous pour sortir de cette situation ? Il n’est pas exact que les banques proposent des renégociations et que les élus les refusent. Nous n’avons entendu que des élus prêts à renégocier, mais qui ne peuvent le faire tant le montant des soultes est élevé, et qui n’ont pas toujours les moyens de rembourser. Que proposez-vous ? Certains élus ont suggéré de créer une structure qui reprendrait les passifs. J’évite l’expression de « structure de défaisance », négativement connotée.
Le problème se pose notamment pour les petites collectivités. On a constaté que les banques ne s’étaient pas tout à fait comportées de la même manière selon le type de clients auquel elles avaient affaire : les hôpitaux semblent en mesure de renégocier plus facilement que les communes, notamment les plus petites.
Comment apurer le passif, notamment tous les prêts qui n’auront pas été renégociés ? Nous souhaitons tous que les renégociations aillent à leur terme, mais à des taux acceptables et à des conditions acceptables par les contribuables.
Mme Danièle Nouy. Malheureusement, on ne tire jamais les leçons du passé : assurément, personne aujourd’hui ne souhaite plus conclure ce type de prêts, mais, si rien n’est fait, il s’en conclura de nouveau dans cinq, dix ou quinze ans. Voici donc une indication pour l’avenir : on ne devrait plus être autorisé à proposer aux collectivités locales des contrats de prêt n’indiquant pas clairement le taux maximal. Idéalement, le taux devrait être fixe, et s’il est variable, il devrait être « capé », c’est-à-dire plafonné. Si nous n’avons pas de problème dans l’immobilier en France, alors que les prix et le coût des crédits augmentent beaucoup, c’est que nous nous en sommes tenus au principe vertueux selon lequel on ne prête pas aux particuliers dans des devises étrangères et que les taux sont fixes ou, lorsqu’ils sont variables, très « capés ».
Que faire du stock ? Je ne représente que le superviseur bancaire. En droit français – droit dont, une fois encore, je ne décide pas –, trois solutions sont possibles : la négociation, la médiation sous l’égide de M. Gissler ou l’action en justice. Nous ne sommes qu’au début des négociations et on devrait pouvoir faire mieux qu’une soulte égale au montant du prêt. Mais lorsque la soulte n’est pas déraisonnable et que la collectivité peut la payer, cela lui garantit au moins un montant maximal. Car pour certains produits, le montant peut continuer de progresser : la facture n’est pas arrêtée, ce qui est très préoccupant.
M. le rapporteur. En l’occurrence, ce n’est plus le cas : la Suisse « cape » son taux de change contre l’euro, ayant constaté que l’envolée de sa monnaie lui coûtait cher.
M. Édouard Fernandez-Bollo. Il ne faut pas tabler là-dessus.
Mme Danièle Nouy. La Suisse bloque la remontée du franc suisse, mais cela ne durera pas nécessairement.
M. le rapporteur. Que vous disent les banques sur ce stock, si du moins vous leur en parlez ?
Mme Danièle Nouy. Bien sûr, nous leur en parlons. Nous les avertissons du risque juridique et du risque de réputation auquel elles sont exposées, nous leur disons qu’elles doivent trouver un moyen de sortir de ces contrats qui n’auraient pas dû être conclus, nous leur recommandons de renégocier.
M. le rapporteur. Quel est exactement le risque juridique encouru ?
Mme Danièle Nouy. Si elles n’ont pas respecté leur devoir d’information et de conseil, notamment vis-à-vis des petites communes que vous évoquiez, les banques risquent fort de perdre devant un tribunal, ce qui entraînera des conséquences financières.
M. le rapporteur. Environ 5 000 collectivités sont concernées. Ce nombre ne témoigne-t-il pas d’un problème structurel dès l’origine ?
Mme Danièle Nouy. Certes, mais, comme je l’ai constaté avec surprise à la lecture du compte rendu des auditions que vous avez déjà effectuées, bien des élus locaux avaient parfaitement compris qu’il s’agissait de bénéficier de taux très bas, voire quasi nuls, pendant une période donnée.
M. le président. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples. Nous avons rencontré des élus de collectivités de toutes tailles et de tous secteurs, des trésoriers-payeurs généraux, des préfets, sans parler d’une ville dont le maire adjoint chargé des finances était un ancien élève d’HEC ; nous nous sommes aperçus que, même au plus haut niveau de l’État, les informations relatives à ce genre de produits étaient très limitées.
Mme Danièle Nouy. Sur ce point, je suis parfaitement d’accord avec vous, monsieur le président.
M. le président. Les documents présentés par les banques semblaient attester d’une très grande stabilité des produits. Les noms des prêts que nous avons évoqués, les propos tenus par les banquiers contrevenaient à la symétrie de l’information qui devrait fonder la relation entre la banque et son client. M. Montagner disait que l’on ne sait pas exactement ce que les banques ont gagné. Mais je peux vous dire, pour l’avoir vérifié, qu’elles ont gagné beaucoup plus que si elles avaient proposé du taux fixe à dix ans ! Dès lors, le rapporteur et moi-même avons le sentiment que l’on a méthodiquement entrepris de remplacer les taux fixes par des produits structurés partout où cela était possible.
M. le rapporteur. Toutes les collectivités avaient souscrit des prêts à taux fixe de 4 ou 5 %. À cette époque, l’argent n’était pas cher. On voit bien qu’il s’agit d’une opération massive puisque la majeure partie des prêts n’était pas destinée à des investissements nouveaux, mais à la restructuration de la dette. Les prêts d’origine, des produits dormants, en quelque sorte, ont été renégociés, moyennant un avantage certain puisque le taux passait à 1 % pendant deux ou trois ans. Mais, contrairement à ce que disait Mme Nouy, cette durée ne dépassait jamais celle du mandat, si bien que l’on finissait par payer ses erreurs, souvent au moment des élections.
Du point de vue du banquier – j’ai passé vingt-cinq ans dans la banque –, la démarche est compréhensible : il remarque qu’il existe une masse de prêts dormants, et se demande comment la dynamiser pour faire gagner de l’argent aux collectivités, qui en ont besoin, tout en dégageant des marges. Ce n’est pas en soi répréhensible. Du reste, je préfère parler de produits structurés plutôt que de produits toxiques, car ils ne sont toxiques que de manière conjoncturelle. Imaginons que la Grèce sorte de l’euro et que la Suisse la remplace : le système fonctionnerait à nouveau et tout le monde ne demanderait qu’à continuer. À l’époque où les clients ont signé, du reste, on leur a montré que les produits étaient stables depuis quinze ans. Mon seul reproche est l’absence de « caping » alors que la loi l’impose, dans la mesure où le TEG est obligatoire et limité par le seuil de l’usure.
Cet argent dormant a donc fait l’objet d’une démarche commerciale, à laquelle se sont aussi associées les banques étrangères. Les prêts structurés n’ont servi à des investissements nouveaux que dans les cas, dont le mien, où l’on manquait de liquidités pour des investissements importants après avoir fait le tour des prêts à taux fixe et à taux variable classique – à moins, bien sûr, que le banquier n’ait menti. D’ailleurs, le problème se posera à nouveau du fait de Bâle III.
Dans l’exercice de vos missions, vous êtes-vous aperçus de cette substitution ?
Mme Danièle Nouy. Oui, nous l’avons constatée ; trop tard sans doute, comme vous l’avez dit. Mais nous ne pouvions l’interdire. Tout ce que dont nous pouvions avertir les établissements de crédit, c’est qu’ils allaient peut-être avoir besoin de fonds propres supplémentaires à cause des risques encourus.
M. le rapporteur. Avez-vous demandé par écrit à certaines banques, notamment à la plus concernée, Dexia, de constituer ces provisions ? On demande bien aux collectivités de provisionner en vue de risques futurs !
Mme Danièle Nouy. Pour l’écrire, il faut mesurer l’ampleur du problème. En 2008, les montants étaient encore limités. Aujourd’hui, les pertes effectives des banques du fait d’actions en justice liées à leurs prêts aux collectivités sont négligeables au regard du volume des prêts. Comment exiger des provisions sur ce seul fondement ?
M. le rapporteur. Mais maintenant, ce risque existe, vous le sentez !
Mme Danièle Nouy. Cela ne suffit pas !
M. le président. En somme, vous nous demandez de légiférer pour interdire d’accorder un prêt dans une autre devise que celle dans laquelle l’emprunteur perçoit ses recettes.
Mme Danièle Nouy. Absolument. C’est une règle toute simple, mais essentielle. Dans des pays d’Europe de l’Est qui n’appartiennent pas à la zone euro, des particuliers ont souscrit des crédits immobiliers en franc suisse ou en euro pour bénéficier de taux très faibles, au lieu de payer des intérêts élevés dans leur propre devise ; en 2008, lors de la crise financière, ils n’ont pu racheter de francs suisses ni d’euros et cela a été un désastre. Si l’on ne respecte pas cette règle, alors il faut au moins prendre une couverture, comme le font les banques, mais cela coûte très cher.
M. le président. Je regrette qu’il n’existe pas de dispositif vous permettant d’alerter le législateur. La règle que vous venez d’énoncer, vous l’avez formulée depuis longtemps. Comment devons-nous en tenir compte ? Par une préconisation de la commission d’enquête permettant d’améliorer les fonctions de l’ACP ?
Mme Danièle Nouy. En tout cas, il faut encadrer la liberté contractuelle des collectivités et des particuliers, et il faut qu’il existe un taux maximal, sauf si l’emprunteur est une banque, ou une grande entreprise qui a les moyens de se couvrir comme une banque : le prêt doit être à taux fixe ou à taux variable « capé ». Le TEG, c’est mieux que rien, mais nous devons constater avec vous que cela ne fonctionne pas.
M. le président. Voilà qui concerne le flux, à propos duquel nous avons bien avancé et sur lequel nous sommes à peu près d’accord. Mais en ce qui concerne le stock, vous ne nous aidez pas beaucoup.
M. Édouard Fernandez-Bollo. Il s’agit de trouver le moyen d’inciter les banques à renégocier les prêts à des conditions tenables pour les deux parties, ce qui n’est pas de notre ressort direct. Nous vous entendons : il faut non seulement que les prêteurs couvrent leurs risques par rapport à leur propre dette, mais aussi que les accords de restructuration soient tels que les débiteurs puissent payer, dans l’intérêt de tous.
Pour une personne relevant du droit privé, ce sont les procédures de restructuration forcée de dette qui jouent ce rôle.
M. Jean-Louis Gagnaire. Ou les abandons de créance.
M. Édouard Fernandez-Bollo. L’équivalent n’existant pas pour les collectivités locales, seule la loi peut forcer à renégocier. Mais il ne faut pas en négliger les conséquences sur la couverture du prêteur.
Tout ce que nous pouvons dire aux banques, et nous le leur disons, c’est qu’elles ont intérêt à renégocier à des conditions tenables pour l’emprunteur, comme pour elles : il ne faut pas les empêcher d’honorer leur propre dette vis-à-vis de leurs contreparties externes.
D’autre part, il nous sera d’autant plus facile d’agir que nous disposerons de règles claires, telles celles que Danièle Nouy vient de mentionner. Or, à l’heure actuelle, la jurisprudence n’est pas claire. Le provisionnement n’étant exigible que pour risque avéré, nous ne pouvons pas demander de provisions aux établissements.
M. Patrice Calméjane. J’ai cité la semaine dernière l’exemple d’un contrat stipulant qu’en cas de sortie, deux autres établissements bancaires que le prêteur fixent la cotation de l’indemnité. La neutralité est-elle préservée quand deux banques évaluent l’indemnité due à leur collègue ? Peut-être cela ne vous choque-t-il pas, vous qui baignez dans le milieu bancaire, mais cela me laisse sceptique. Ne devriez-vous pas intervenir comme autorité extérieure ?
M. Édouard Fernandez-Bollo. La présence d’un tiers est une bonne chose ; voilà du reste pourquoi les banques recourent à des tiers de marché. Mais nous ne pouvons pas à la fois contrôler les valorisations que prennent les banques et les donner. Cela constituerait un grave conflit de missions.
M. le président. Madame, messieurs, je vous remercie.
*
* *
Audition de M. Éric Gissler, inspecteur général des finances, médiateur désigné par le Premier ministre, sur le thème : « La médiation sur les emprunts à risques : quel bilan ? »
(Procès verbal de la séance du mercredi 9 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Monsieur l’inspecteur général des finances, nommé médiateur pour les emprunts à risque des collectivités locales, je vous souhaite la bienvenue. Votre audition nous permettra de porter un jugement sur les actions mises en œuvre pour tirer les collectivités de leurs difficultés, et de formuler des propositions pour réformer notre système de financement des acteurs publics locaux.
En qualité de médiateur, vous êtes saisi par les collectivités ou les banques engagées dans une renégociation d’emprunt structuré, afin d’évaluer les efforts nécessaires pour parvenir à une solution équilibrée. Sans doute est-il difficile de la faire accepter par les parties, vos recommandations n’étant pas contraignantes. Ma première question porte sur votre bilan et sur l’équilibre que vous proposez pour sortir de la crise. Les collectivités renoncent-elles à l’espoir que le marché revienne à des positions qui leur seraient favorables ? Les banques acceptent-elles de limiter leur marge ?
Faut-il rendre plus sévère la charte de bonne conduite entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ? En augmenter le nombre des signataires ? La transposer dans la loi en interdisant de proposer certains produits financiers au secteur public local ?
M. Éric Gissler prête serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Pouvez-vous présenter votre activité de médiation ? Quels types de contrats vous sont soumis ? À quel moment de l’évolution des taux les collectivités vous saisissent-elles ? Le bilan des renégociations définitives est faible : quelles sont les positions des uns et des autres ?
M. Éric Gissler, inspecteur général des finances, médiateur désigné par le Premier ministre. Depuis novembre 2008, c’est-à-dire depuis trois ans, je m’occupe, au moins à temps partiel, des sujets financiers qui ont trait aux collectivités locales. À ce titre, je peux dresser un état des lieux, sachant que ma mission est d’assister les collectivités.
Mon rapport sur le recours par les collectivités territoriales aux emprunts structurés tente d’abord de mesurer le risque. Même si, lors de sa rédaction, en février 2009, je disposais de peu d’éléments statistiques, il était évident que, même en l’absence de risque systémique, la rapidité avec laquelle se multipliaient les négociations finirait par poser problème, si l’on ne faisait rien, les produits les plus risqués occupant une part croissante de la dette. Un autre problème tenait à la concentration de la toxicité sur quelques collectivités.
Si l’on en est arrivé là, c’est que trois responsabilités se sont conjuguées : celle des banquiers, des collectivités locales et de la comptabilité publique.
Les banquiers qui mettent en place un crédit sur trente ans, ne gagnent quasiment que les frais de courrier, année après année, une fois encaissée la commission initiale. En revanche, celle-ci est multipliée par le nombre de fois où l’on renégocie l’emprunt. Reste que les banquiers en question ne sont pas des Madoff. Il faut éviter de regarder la situation de 2005 ou 2007, date à laquelle les emprunts ont été mis en place, avec les lunettes de 2009 ou de 2010. Bien des certitudes ont vacillé depuis. Du temps où j’étais directeur financier d’un grand établissement public, si l’on effectuait, pour revenir du franc suisse au franc français ou à l’euro, des currency swaps, on s’arrachait la signature d’AIG, seul triple A qu’on trouvait alors sur le marché. On sait ce qu’il en est advenu. De même, le meilleur placement en termes de sécurité et de rendement était alors la dette souveraine italienne. Il n’y a donc pas lieu de suspecter les banques de mauvaises intentions, en les accusant d’avoir pris des contre-positions. De même, il n’est pas vrai que les banques s’enrichissent, quand le montant des intérêts payés par les collectivités augmente.
D’autre part, si l’on en est venu au franc suisse c’est non par hasard, mais au terme de deux mécanismes bien distincts. Soit un syndicat à vocation unique, en matière de déchets ou d’énergie, ou une petite collectivité, avait besoin de quelques millions, par exemple pour construire école ou un gymnase, ou rénover une mairie, et cherchait par tous les moyens un financement en dessous des taux de marché. Soit le souscripteur choisissait des produits de pente, ce qui constituait le début d’une prise de risque croissante. En bonne logique, les taux longs sont supérieurs aux taux courts, tendance qui, en 2005 ou 2006, pouvait sembler pérenne. Mais la courbe s’est brièvement inversée. La barrière risquant d’être franchie, les collectivités locales comme d’ailleurs les banques ont caché qu’elles avaient fait un pari qui risquait de leur coûter cher. Tous les cas de figures se sont présentés. Le directeur financier ne l’a pas avoué au directeur général des services (DGS), et a renégocié un taux indexé sur le franc suisse afin de profiter de taux plus faibles pendant une période bonifiée. Le DGS ne l’a pas avoué à l’exécutif, et celui-ci, s’il était prévenu, ne l’a pas avoué à son opposition. Puisqu’on avait déjà recouru à des produits de pente, il existait une accoutumance à ce type de structure, et il était patent que les propositions des banques n’étaient pas garanties à 100 %. Le pire est que, si les collectivités locales n’avaient pas renégocié ces produits de pente, elles profiteraient aujourd’hui de taux bonifiés, puisque l’écart entre les taux longs et les taux courts est redevenu plus traditionnel.
Quant aux élus, ils se sont longtemps désintéressés des problèmes financiers. Il est aberrant qu’à l’époque, dans le cadre d’un audit de trésorerie, les auditeurs aient pu rendre compte de leur étude aux audités, alors que la logique voudrait qu’on s’adresse à un niveau supérieur. D’autre part, les élus s’étaient accoutumés à la baisse des taux. Les intérêts représentaient 12 % du budget de fonctionnement des collectivités locales en 1993, contre 8 % en 1998 et 4 % en 2007. En dépit d’une légère remontée en 2005, on pensait donc qu’ils ne pouvaient que baisser.
La comptabilité publique enregistre les décaissements, ce qui signifie qu’on ne voit que les flux financiers réels. Cela dit, le passage en comptabilité commerciale ne réglerait pas tous les problèmes : les prêts structurés ne sont pas valorisés au mark to market et, là encore, seuls les flux financiers réels sont enregistrés. Le cas des swaps est plus compliqué, puisqu’il faut déterminer s’il s’agit de swaps de couverture ou de swaps spéculatifs, lesquels ne sont pas spéculatifs par nature, comme le précise la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans une lettre directive de 2007. Pour le même type de produits, le swap de couverture n’est pas valorisé au mark to market, et ne l’est que lorsqu’il est jugé spéculatif, c’est-à-dire quand la barrière risque d’être dépassée. L’avertissement qu’on peut tirer de l’augmentation progressive du mark to market est donc annihilé par ce mode de comptabilisation.
La charte de bonne conduite doit être signée par les principaux acteurs bancaires de la place. Lors du bouclage, en juillet, j’ai recueilli leur accord et ils l’ont signée en décembre. J’ai également reçu l’accord de l’Association des départements de France (ADF) et de l’Association des régions de France (ARF). Je rappelle toutefois que la charte ne constitue qu’une annexe du rapport. Globalement, il a été presque plus facile d’obtenir des banques qu’elles renoncent à commercialiser certains produits à risque que des élus qu’ils renoncent à emprunter un capital en francs suisses. Beaucoup, parmi eux, m’ont soutenu qu’ils le faisaient depuis longtemps et s’en portaient fort bien.
La charte avait deux objectifs : mettre fin à la commercialisation des produits les plus risqués, et instaurer une échelle normative de risques sur lesquels l’exécutif se positionne de manière transparente par rapport à son assemblée délibérante, afin que, si risque il y a, il soit pris en connaissance de cause. J’ai aussi songé à des mesures coercitives, comme le passage à la comptabilité commerciale ou l’obligation de comptabiliser au mark to market ou de provisionner par rapport à un indice minimal, pour éviter des taux proches de zéro. J’y ai renoncé, car rien n’est pire à mes yeux qu’un texte non respecté. Or les services des préfectures ou des directions départementales des finances publiques (DDFIP) ne sont pas en mesure d’effectuer des vérifications trop complexes. Peu d’agents de catégorie C peuvent contrôler que le travail est fait convenablement sur un budget ou sur un compte administratif. La responsabilité du comptable public ou de la certification des comptes des collectivités locales est un autre débat.
J’appelle votre attention sur deux points. On parle toujours du seul tableau de risque, en omettant qu’il existe une corde de rappel : l’interdiction de fait que la période bonifiée soit supérieure à 15 % de la maturité totale, et que la bonification soit supérieure à 35 % du taux fixe ou du taux Euribor du moment. En pratique, cela signifie que le 5E est quasiment inaccessible. D’autre part, même si la classe 5 correspond à un indice hors zone euro, il ne faut pas y voir la persistance d’un indice exotique, puisque tout indice hors OCDE est proscrit. L’idée centrale est que la charte est autoportée. Elle ne requiert pas qu’on recoure à des vérifications complexes.
En 2009, quand je l’ai proposée à la signature, je n’ai pas réussi à faire accepter le fait que toutes les collectivités n’aient pas accès à la totalité des risques. Quand j’expliquais qu’il fallait proportionner la capacité de la collectivité au niveau de risque, et limiter, par exemple, les communes de moins de 10 000 habitants au 1A, on me reprochait de porter atteinte à leur égale dignité ou à leur autonomie financière. Je regrette toutefois que la mesure n’ait pas été mise en place. D’autre part, bien que l’existence de la charte ait pu faire croire que les renégociations aboutiraient rapidement à substituer les produits qu’elle avalisait à ceux qu’elle écartait, ce n’est pas ce qui s’est passé concrètement. Cependant, l’autorégulation a bien fonctionné, puisque les banques ne commercialisent plus de produits hors-charte, et que, de fait, elles ont introduit le critère démographique et dû renoncer à commercialiser certains niveaux, puisque la corde de rappel l’interdit techniquement.
Fin 2011, après plusieurs crises mondiales, on ne peut plus faire la même analyse qu’au début de 2009. Je ne verrais pas d’un mauvais œil l’interdiction de certains produits, au moins pendant un certain nombre d’années. La charte pourrait être plus restrictive sur le type de produits autorisés ou limiter le niveau de risque maximum que peut supporter une collectivité locale. Quand on met en place des mécanismes compliqués, il est essentiel, par ailleurs, de savoir qui les contrôle. Plus on se montrera rigoureux, plus considérable sera le stock tampon des produits susceptibles d’être renégociés, avec des zones grises. Qui vérifiera la compatibilité de la renégociation avec la nouvelle grille ? Puisqu’on ne passera évidemment pas directement d’un 5E à un 3A, qui s’assurera que la politique des petits pas ne recèle pas de nouveaux dangers ? Pour cette raison, je suis hésitant, quand on me parle de constituer un gros stock potentiel de dettes à renégocier si l’on ne peut pas fixer par écrit des règles de renégociation précises. Le conseil de normalisation des comptes publics travaille sur la notion de provisionnement, qui a tout son sens. Encore faudra-t-il s’assurer que les provisions sont passées au bon niveau et au bon moment, ce qui n’est pas si simple.
L’autorégulation qui s’est mise en place est une manière de traiter l’avenir, puisqu’on n’a pas réamorcé la pompe du risque. Reste le problème du stock. La charte a été rédigée dans l’idée qu’une renégociation interviendrait quasiment à marche forcée. Il n’en a rien été. Sur 102 prêts en médiation, 11 seulement ne sont pas des produits de change, et introduisent de forts multiplicateurs. On ne demande pas de renégociation quand on n’a pas affaire à des produits immédiatement en risque, ou pour lesquels la barrière ne sera pas franchie immédiatement. Pour l’essentiel, les dossiers correspondent donc à des produits de change, dont 73 concernent le franc suisse. La plupart d’entre eux sont arrivés après avril 2010, c’est-à-dire après que la barrière de 1,44 ou 1,45 a été franchie, ce qui crée des conditions de renégociation déplorables. Conçue à l’origine comme une infirmerie ou une cellule d’aide psychologique, la médiation est devenue une unité de soins intensifs. Douze dossiers ont été renégociés de manière définitive. Treize renégociations temporaires, c’est-à-dire hors période bonifiée 2011 et 2012, ont été conclues. Quatorze dossiers sont sortis de la médiation, parce que la proposition a été refusée et qu’il y a eu assignation. Pour les autres, il s’agit de produits en franc suisse encore en période bonifiée, pour lesquels on ne peut trouver qu’une solution temporaire, fixing par fixing. On ne pourra proposer de solution que lorsqu’on sortira de la période bonifiée, par exemple en 2012 ou en 2013.
Les élus qui entrent en médiation ne sont généralement pas ceux qui ont signé le contrat, ce qui explique, de leur part, une certaine méconnaissance historique du dossier. Pour les produits liés au franc suisse, on se trouve dans une situation extrêmement difficile, le mark to market représentant 100 % du capital restant dû (CRD), voire plus, contre 20 % ou 30 % en 2009, quand la médiation a été engagée. Je ne nie pas la difficulté pour les collectivités de payer même une partie significative de tels montants, mais on ne trouve plus aucun candidat pour sortir à de tels taux. S’ils redescendent à 20 %, les collectivités qui auront senti le vent du boulet souhaiteront peut-être renégocier, mais ce n’est pas le cas actuellement. Quant aux produits de pente, avec de forts taux multiplicateurs, l’évolution défavorable du mark to market dissuade également les candidats potentiels.
J’insiste, pour finir, sur les avantages de la médiation. Les accords concernant les prêts ont été conclus sans témoin, ce qui explique la surprise des nouveaux élus, quand on reconstitue pièces en main l’historique des dossiers. La médiation apaise le débat, et permet de prendre conscience de certaines choses. Nous avons brisé la légende selon laquelle la banque encaisserait la totalité de l’augmentation : lorsqu’un taux s’élève à 17 %, on est dans une logique perdant-perdant. En outre, quand on partage un mark to market, le dernier million est essentiel. Mus par une suspicion qui peut sembler légitime, compte tenu de ce qu’ils ont vécu, ou influencés par des conseils qui peuvent soutenir des contre-vérités, beaucoup d’élus se méfient quand on leur propose un nouveau produit et redoutent qu’il comprenne une commission. Pour les rassurer, je suis appuyé par le service de valorisation de la Banque de France, qui vérifie que l’offre proposée est dans les clous, et qui garantit l’exactitude de la somme demandée pour dénouer le swap. Mon rôle est également d’amener les banques à payer. Tandis que les avocats des collectivités locales leur promettaient que le juge se ferait un plaisir d’annuler les contrats, ceux des banques, quand ce n’était pas leurs services juridiques, leur garantissaient que les dossiers étaient solides, et qu’elles n’avaient aucune raison de bouger. Pour n’être appointé ni par les unes ni par les autres, et avoir vu un grand nombre de dossiers, je peux expliquer aux premières que, n’étant pas totalement innocentes, elles n’ont pas été volées comme au coin d’un bois, aux secondes, qu’elles y sont parfois allées un peu fort. Mais je constate que, sur les solutions temporaires auxquelles on parvient, fixing après fixing, si les banques lâchent parfois quelque chose, il y a des collectivités locales, qui ne renoncent même pas à l’assignation. Cela semble déséquilibré, puisque le principe de la médiation est la renonciation réciproque.
M. le rapporteur. Pour que les banques acceptent ce type de négociation, elles doivent se sentir bien coupables…
M. Éric Gissler. C’est ce que disent certains des représentants des collectivités à leur banquier quand commence la médiation.
M. le rapporteur. C’est maladroit quand on veut renégocier. Sur 156 produits, Dexia n’en propose plus que 15, ce qui montre que peu d’entre eux étaient bons. La Caisse d’épargne, elle aussi, a considérablement réduit son offre. Pour que des banquiers fassent signer aux représentants des collectivités des documents dans lesquels ils reconnaissent être des investisseurs avertis ou bien renoncent à porter les éventuels litiges devant les tribunaux administratifs, c’est qu’ils ne se sentent pas très à l’aise. De votre côté, considérez-vous la collectivité locale comme un particulier ou une entreprise ?
M. Éric Gissler. Je ne rentrerai pas dans le débat. Elle n’est ni l’un ni l’autre, mais il est certain que ce sera toujours le contribuable, local ou national, qui paiera.
M. le rapporteur. Quand on parle de TEG ou de taux d’usure, quels textes s’appliquent à la collectivité ?
M. Éric Gissler. N’étant pas juriste, je ne peux pas vous répondre sur ce point. Je reviens à votre question : pourquoi les banques se montrent-elles conciliantes ? L’absence de jurisprudence joue un rôle important. On ne peut préjuger de la décision des tribunaux, mais il est probable qu’ils prendront en compte certains facteurs, comme la taille des collectivités ou la nature des dossiers, selon que la présentation comprend ou non des stress scenarii par exemple. Le rôle du médiateur est d’utiliser ces éléments pour exercer une pression sur les banques. Cela dit, la médiation se heurte à des obstacles, notamment à ce qu’on peut nommer « l’incohérence des cohérences ». Le premier souci des banques est qu’on ne sache pas ce qu’elles décident, dossier par dossier.
M. le rapporteur. Elles sont donc coupables, d’une certaine façon.
M. Éric Gissler. Non, la médiation ne s’inscrit pas dans une logique juridique, sans quoi on ferait appel au juge. Elle repose par définition sur la discrétion et le secret.
M. le rapporteur. En l’espèce, le secret est impossible. Dès lors qu’on doit rendre des comptes à un conseil municipal, la décision ne peut pas être confidentielle.
M. Éric Gissler. Par construction, l’assemblée délibérante a le droit d’être informée, mais il y a plusieurs façons de rendre compte. En outre, les collectivités recourant aux mêmes conseillers, l’information est nécessairement poreuse, ce qui est gênant. Un autre problème tient à l’inégalité des conseillers juridiques et financiers, qui peuvent s’avérer, pour la médiation, des appuis ou des boulets. Enfin, les collectivités hésitent à entrer dans la médiation et à accepter certaines solutions.
M. le rapporteur. Est-ce dû à l’existence de la commission d’enquête ?
M. Éric Gissler. Non, le phénomène est antérieur, et tient à l’absence de jurisprudence. Certaines pensent qu’elle jouera en leur faveur, et attendent l’issue des procès. Seuls ceux qui pensent que la situation ne peut qu’empirer sont prêts à consentir des efforts. Beaucoup n’ont pas vu que nous ne sommes plus en 2007 ou en 2008 : après trois ou quatre crises mondiales, des solutions qui semblaient anormales ou coûteuses sont plus acceptables. Une petite collectivité à laquelle j’ai proposé de rester sur un taux de 5 % ou 6 % pendant deux ans, sans pouvoir m’engager sur la suite du prêt, qui court jusqu’en 2022, a choisi d’assigner, considérant qu’elle ne pouvait pas psychologiquement, garder cette épée de Damoclès. Autre cas de figure : ceux-là mêmes qui reprochaient à leurs prédécesseurs d’avoir, sur le conseil des banquiers, pris des risques considérables, envisagent d’attendre, quand leurs conseillers financiers leur assurent que les perspectives sont bonnes pour les deux prochaines années. Or la sécurité à un coût : c’est une devise qu’il faudrait inscrire au fronton des mairies. Certains représentants des collectivités, qui croient faire un cauchemar, rêvent qu’à leur réveil, on aura effacé l’ardoise, et qu’ils retrouveront un taux bonifié à 3,5 %. C’est tout à fait impossible.
M. le rapporteur. Je ne partage pas votre avis. Les collectivités savent bien que, quand elles souscrivent un prêt à taux variable avec "caping", celui-ci est facturé. Disons que c’est ce que vous ressentez.
M. Éric Gissler. Oui.
M. Bernard Derosier. Vous avez donné votre nom à une charte, qui a été approuvée par l’ARF et l’ADF. Quelle a été la position de l’Association des maires de France (AMF) à son égard ?
Pouvez-vous citer quelques exemples de dossiers dans lesquels, comme vous l’avez suggéré, la position des élus serait moins claire qu’on ne le pense généralement ?
Si nos travaux révèlent certaines failles dans les services de l’État, par exemple de la part du préfet, qui contrôle la légalité des actes, de la chambre régionale des comptes ou du payeur régional, départemental ou local, qui est un fonctionnaire d’État, pourriez-vous, en tant qu’inspecteur général des finances, recommander à l’État de faire jouer la solidarité vis-à-vis des collectivités ?
M. Henri Plagnol. J’aimerais livrer un témoignage, une observation et deux questions. Je témoigne d’abord que la médiation est utile, tout comme la charte qui porte votre nom, monsieur Gissler, notamment quand on se trouve à la tête d’une commune dont la dette est composée à 90 % de produits structurés. En outre, la charte garantit la transparence au sein du conseil municipal, car elle aide chacun à comprendre les risques et la nécessité d’en sortir.
J’observe aussi que les décisions que nous prendrons pour l’avenir doivent ménager le temps, très long, de la restructuration. Quand on porte des emprunts pour trente ou quarante ans, il faut les sécuriser de manière très progressive, en achetant du temps. Il serait catastrophique d’interdire brutalement aux collectivités locales tous les produits qui n’ont pas de taux fixe, ne sont pas "capés" ou n’entrent pas dans la charte.
Cela dit, la médiation est frustrante. Elle reste très prudente, même si vous êtes aux côtés des collectivités locales. Il n’y a pas d’autosaisine. De même que certaines collectivités ne veulent pas y entrer, des banques mutualistes comme le Crédit agricole ou la Caisse d’épargne font la sourde oreille, la nouvelle équipe de Dexia ayant consenti certains efforts, devant l’ampleur du désastre. Mais que fera-t-on quand il n’y a pas d’autres solutions que de ponctionner le contribuable local, auquel on a toujours caché ces transactions, ou d’infliger à des banques des pertes abyssales, dont la Caisse des dépôts elle-même ne peut mesurer l’étendue ? L’État acceptera-t-il de mettre de l’argent au pot, pour éviter que les collectivités ne soient mises sous tutelle ?
M. Éric Gissler. Monsieur Derosier, si j’ai signalé le soutien spécifique de l’ARF et de l’ADF, c’est simplement parce que l’AMF est signataire de la charte, qui a donc été approuvée par toutes les associations de représentants des collectivités locales.
Deuxièmement, je suis moins choqué par la structure des produits, qui était fort simple, que par les contrats cadres qu’on a remis aux élus. Ceux-ci devaient se pré-positionner sur une quinzaine de produits différents, présentés de manière très peu claire, alors qu’un seul les concernait. On les promenait dans la grande surface des produits existants, où ils devaient se positionner sur le taux, le change, la pente, la courbe et l’Euribor. Entre autres subtilités, si les produits de pente et de change ont la même structure mathématique, les seconds sont cent fois plus nocifs. L’écart de pente fait varier le taux de quelques points, et l’écart de change de 100 %. Une même équation a, ou non, des effets démultipliés. Enfin, sur les vingt-cinq pages remises aux clients, seules trois étaient utiles. L’excès d’information tuant l’information, ils pouvaient se noyer dans l’excès de données.
Troisièmement, bien que je ne dispose pas d’une vision complète des services de l’État, je considère qu’on n’a rien à leur reprocher, compte tenu de la capacité des fonctionnaires concernés et des questions qui se posaient. En 2009, rédigeant mon rapport, j’ai demandé à la direction générale des finances publiques combien d’élus avaient interrogé leur TPG sur la nature des produits, quitte à ce que celui-ci s’adresse éventuellement à l’administration centrale. On n’a trouvé que cinq courriers de ce type.
Monsieur Plagnol, je vous remercie d’avoir rappelé l’utilité de la charte et de la médiation. Il est exact que celle-ci est plus souvent saisie par les collectivités locales que par les banques, bien que certaines y aient recours, par exemple pour des raisons psychologiques, quand il devient presque impossible à des interlocuteurs de se parler. Quelques dossiers de ce type ont abouti. Je termine par une précision : dire qu’un risque n’est pas chiffrable signifie non qu’il est incommensurable, mais qu’il est impossible de le calculer, puisque nul ne sait comment se comporteront le yen ou le franc suisse pendant les trente prochaines années. On ne sait pas si la barrière sera franchie ni si les collectivités locales feront défaut ni si la renégociation sera possible. Et le niveau de risque qui a été envisagé amplifie considérablement le risque réel.
M. le président. Pensez-vous comme la Cour des comptes que les prêts structurés qui incluent des instruments financiers à terme sont soumis aux prescriptions de la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (MIF), notamment aux articles L.533-11, et au règlement de l’AMF, notamment aux articles 314 et suivants, particulièrement à l’article 314-10 ?
M. Éric Gissler. Quand j’ai rédigé la charte, en 2009, l’incertitude à ce sujet était totale. La direction des affaires juridiques du ministère des finances ignorait si la directive MIF s’appliquait. Deux directions du ministère étaient d’un avis opposé. N’étant pas juriste, je n’avais pas à trancher la question. J’ai tourné la difficulté en mentionnant dans la charte le caractère non professionnel de la collectivité locale.
M. le président. Avant l’été, la cour de Karlsruhe a condamné une banque pour défaut de conseil et parce qu’elle avait réalisé des marges cachées. Ces griefs pourraient-ils être imputés à des banques dans les dossiers que vous avez examinés ?
M. Éric Gissler. En matière de jurisprudence, chacun a tendance à retenir les décisions, arrêts ou jugements qui l’arrangent plutôt que ceux qui lui déplaisent. Il faut donc être prudent. Au sujet des emprunts, j’écouterais plus volontiers le TGI de Nanterre qu’un tribunal de Karlsruhe. La Cour européenne de justice a été saisie d’une question préjudicielle pour savoir si, quand on propose un emprunt structuré à un particulier, le dossier doit comprendre des stress scenarii, et à quel niveau. Le défaut de conseil ne peut s’apprécier qu’au cas par cas, collectivité par collectivité. Rappelons-nous que les spécialistes, quand il y en avait au sein des collectivités territoriales ou des hôpitaux, étaient généralement très favorables aux produits structurés. Je le répète : il ne faut pas regarder la situation de 2005 ou 2007 à la lumière des informations dont nous disposons aujourd’hui. À l’époque, il y avait un consensus de marché, qui présentait ces produits comme acceptables et en jugeait les risques mesurés. J’ai eu à connaître le cas d’une structure qui a pris les plus mauvaises décisions sur les conseils d’un banquier, qu’elle avait recruté. Peut-être cherchait-il à justifier sa rémunération particulièrement élevée, par rapport à la grille indiciaire de la fonction publique… On ne peut pas édicter de règle générale en matière de conseil, mais je n’ai pas d’état d’âme quand je dis à une banque qu’il n’était pas normal de vendre un produit à risque à une collectivité de moins de 10 000 habitants.
M. le rapporteur. Quels sont vos interlocuteurs dans les collectivités ?
M. Éric Gissler. Le problème ne peut être traité, en dernier ressort, que par l’élu.
M. le président. Celui-ci n’est pas toujours dans le circuit… Un accord entre l’administration et la banque a pu être conclu en février 2008 et activé en juillet 2011, sans qu’aucun élu ait eu à intervenir.
M. Patrice Calméjane. Cette semaine, des propositions ont été formulées pour rendre systématiques la présentation et la publication d’un rapport sur l’évolution des dépenses des municipalités, et pour que leur gestion soit plus transparente, notamment en ce qui concerne la dette et les dépenses de personnel. En dehors des dispositions de la circulaire du 15 septembre 1992, faut-il mettre en place des indicateurs pour mieux informer tant le conseil municipal et la population que l’appareil d’État, qui, tout en respectant la libre administration des collectivités, pourrait tirer le signal d’alarme ? Quand on emprunte, c’est en général parce qu’on a un projet spécifique, auquel cas on peut s’en expliquer au conseil municipal, soit parce qu’on manque de capacité d’autofinancement, auquel cas il est essentiel de corriger certaines lourdeurs de gestion avant de contracter un nouvel emprunt.
M. Jean-Louis Gagnaire. Selon vous, le défaut de conseil de la part des banques n’est pas avéré, mais plusieurs élus, anciens clients du Crédit local de France, ne concevaient pas qu’un établissement comme Dexia puisse leur présenter des produits nocifs. Au cours d’une médiation, avez-vous entendu des témoignages de ce type ? Vous arrive-t-il de conseiller à des élus de ne pas engager de contentieux, pour éviter que la jurisprudence ne s’établisse sur des dossiers hasardeux ? Enfin, si 5 500 collectivités décidaient au même moment d’entrer dans une médiation, auriez-vous les moyens de faire face à la situation ?
M. Henri Plagnol. Je reviens à ma question : quand la situation d’une collectivité est sans issue, l’État peut-il mutualiser la dette ?
M. le président. Selon vous, quelle est la nature de la circulaire du 15 septembre 1992, qui interdit aux collectivités locales de conclure des opérations spéculatives ?
M. Éric Gissler. Sur ce point, j’ai en partie répondu en rappelant que, sur le moment, la définition du contrat spéculatif était moins évidente qu’on essaie de le faire croire aujourd’hui. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes explique, dans le cas de SA d’HLM soumises à la comptabilité commerciale, comment on comptabilise les prêts structurés ou les swaps. La partie spéculative est très faible, et l’indexation sur le franc suisse ne suffit pas pour classer un swap comme spéculatif. Considérer comme spéculatif tout swap qui ne serait pas simple ou binaire serait inexact sur le plan juridique et comptable. Du reste, une circulaire n’est pas un texte législatif. À mon sens, on se tromperait en considérant que, la plupart des swaps étant spéculatifs, il aurait été interdit de les conclure et en pointant à ce titre un défaut de vigilance.
Monsieur Plagnol, j’ai commencé à travailler sur la situation des collectivités locales à partir du dossier délicat d’Angoulême. Dans la matrice de l’État, le cas des collectivités locales en difficulté obéit à une certaine logique. Angoulême n’est pas un cas isolé. Songeons aux collectivités de la région parisienne aux prises avec la géothermie, à celles dont le parc d’animation n’a pas fonctionné, ou encore à cette malheureuse commune attaquée au civil par un promoteur. Le nouveau maire n’ayant pas tenu les engagements du précédent, elle avait été condamnée à payer une amende représentant deux fois son budget annuel. La politique du Gouvernement, quelle que soit la majorité politique, a toujours été de traiter ces problèmes par exception. On regarde ce que peut financer une collectivité, dans des conditions difficiles et pas seulement en supprimant les dépenses de confort. Les maires successifs ont assumé une partie des folies dépensières de leurs prédécesseurs, mais une autre partie, non négligeable, a été assurée par les banques, et une autre encore par l’État, grâce à des subventions d’équilibre payées pendant cinq ans sur le budget communal. Des subventions exceptionnelles ont été versées pour des investissements qui semblaient nécessaires, l’État intervenant de manière presque dérogatoire. Il faut conserver cette philosophie pour respecter l’équilibre entre l’autonomie des collectivités locales, le refus de l’aléa moral, et le fait que, comme le disait le premier président de la Cour des comptes, on ne peut pas tondre un œuf, c’est-à-dire qu’il y a un moment où il faut bien que d’autres paient.
Monsieur Calméjane, au-delà même du sujet des emprunts à risque, les statistiques concernant les collectivités locales sont très peu prédictives. On se trompe lourdement et fréquemment, dans ce domaine. On croit parfois repérer une situation dramatique qui se redresse, alors qu’on n’a pas vu venir une catastrophe. Une des raisons pour lesquelles on a tant de mal à apprécier les enjeux est que, pendant la période bonifiée, les collectivités ont tranquillement classé leurs prêts en taux fixe. Je ne crois guère à la mise en place de ratios nationaux, tant qu’on ne dispose pas d’une sécurité absolue sur la manière dont les dossiers sont remplis, avec la meilleure volonté du monde, par des gens qui n’ont pas toujours la compétence pour le faire.
Il va de soi, monsieur Gagnaire, que certaines banques étaient plus désintéressées que d’autres. Cela dit, même si certains élus peuvent avoir du mal à saisir des problèmes d’écart de taux, on n’a pas besoin d’être financier pour comprendre qu’on prend un risque quand on souscrit un prêt indexé sur le cours du franc suisse par rapport à l’euro. L’élu, même de base, a changé depuis le XIXe siècle. Avant l’euro, tout le monde avait franchi une frontière et s’était rendu compte que, d’une année sur l’autre, pour une même quantité de francs français, on n’obtenait pas, la même quantité de francs suisses, de pesetas ou de lires. Même sur les conseils de Dexia, il me semble incompréhensible qu’on ait pu prendre un risque pareil, surtout sur trente ans.
M. le rapporteur. Les représentants des collectivités pensaient qu’il y avait un système de couverture standard. Quand un banquier propose un taux variable, celui-ci est automatiquement « capé » par le taux d’usure. Pourquoi la même obligation ne s’applique-t-elle pas sur un prêt structuré, qui n’est finalement qu’un prêt à taux variable spécifique ? Nous ne pouvons pas tous les questionner, mais il est probable que, si 5 000 maires ont pu faire confiance en même temps, c’est parce qu’ils croyaient qu’un « caping » implicite figurait parmi les obligations du banquier. De plus en plus, on présente les prêts structurés comme des OVNI qui sortiraient de la réglementation, mais les maires avaient le sentiment d’acheter un produit ordinaire.
À présent, allons plus loin. En tant que matheux, j’aime bien pousser les raisonnements à l’extrême. Que se passera-t-il si le rapport de change tombe non seulement à 1,44 mais 0,1 ? Qu’arrivera-t-il si personne ne peut payer ?
M. le président. Nous avons frôlé le pire au mois de juillet, quand il est tombé à 1, ce qui a fait monter certains les taux d’intérêts à plus de 50 %.
M. le rapporteur. Quand on pousse le raisonnement jusqu’à la limite, on voit ce qui est possible et ce qui ne l’est pas. On raisonne volontiers par l’absurde en mathématique. En l’espèce, je considère que le mécanisme doit être considéré comme normal, ce pourquoi je parle plus volontiers de prêts structurés que de prêts toxiques, et qu’il doit entrer dans la législation. Autre raisonnement par l’absurde : admettons qu’il y ait quinze fous en France ; il ne peut pas y en avoir 5 000.
M. Jean-Louis Gagnaire. Ne sous-estimons pas l’effet Panurge !
M. le rapporteur. J’apprécie votre action, monsieur le médiateur, mais je pense qu’à traiter les dossiers un par un, on risque d’occulter une donnée fondamentale, qui tient à leur très grand nombre. Quand, sur une série de voitures, un dispositif ne fonctionne pas, la société les rappelle toutes. Ce mécanisme, qui relève du droit commun, ne s’applique-t-il pas en matière de prêts ? Votre rôle de médiateur ne vous oblige-t-il pas à adopter un raisonnement global ?
M. Éric Gissler. Je n’ai pas répondu à M. Calméjane, qui m’a demandé si j’incitais les collectivités à passer au contentieux. Mon intérêt est que la médiation fonctionne. Celle-ci étant incompatible avec l’assignation en justice, je déconseille le procès aux élus, quand il me paraît injustifié. Parfois, un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès. Il arrive d’ailleurs qu’un maire m’envoie le mémoire de son avocat, auquel cas j’explique, si tel est le cas, que ce n’est pas avec ces arguments qu’il aura gain de cause.
Monsieur Plagnol, il est clair que l’État ne pourra pas mutualiser les dettes de 5 000 communes. Face à des collectivités en difficulté, on fait nécessairement du cas par cas. C’est du moins la logique qui est à l’œuvre dans l’État depuis vingt ans. Mais, évidemment, rien n’est définitif.
Monsieur le rapporteur, la médiation est n’est pas une autorité qui s’autosaisit, et mon rôle n’est pas de démarcher les maires en leur expliquant que je suis performant. Je ne travaille que dans le cadre d’une mission qui m’est confiée. Si, demain, on me demande de traiter les dossiers globalement, par exemple en rédigeant un rapport, je le ferai, mais il m’est actuellement impossible de convoquer des banquiers pour traiter d’un seul coup une grande quantité de dossiers.
Enfin, on peut toujours imaginer des cours de change à 0,1. Actuellement, les variations systémiques font vaciller nos certitudes. J’ai rappelé que, jadis, nul n’avait de doute sur la valeur d’AIG ou de la dette souveraine italienne. Il arrive que l’évolution de certains paramètres oblige à adopter une autre logique. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas à un modeste médiateur de déclencher des plans nationaux ou mondiaux, dont les conséquences seraient très importantes.
M. le président. Si vous n’êtes pas l’auteur de la charte, qui a fixé l’échelle Gissler allant de A à E, et de 1 à 5 ?
M. Éric Gissler. C’est moi, en travaillant avec les banques. Il était essentiel de pouvoir raisonner sur une base unique. L’existence d’une échelle, de lettres d’un côté, de chiffres de l’autre, a permis de situer l’ensemble des produits.
M. le président. Parmi les banques qui l’ont signée, certaines ont-elles proposé des produits hors charte ?
M. Éric Gissler. Cela ne s’est produit que dans une renégociation, pour sortir d’un produit hors-charte. Je me suis alors rapproché des établissements financiers, auxquels j’ai imposé ma façon de voir : on peut proposer un produit hors-charte à la seule condition qu’il améliore la sécurité de la collectivité, par exemple en raccourcissant la durée du prêt, en élevant la barrière ou en mettant en place un multiplicateur plus faible. Dans tous les cas que j’ai vérifiés, la proposition de produits hors-charte entrait dans une politique de petits pas. Par ailleurs, j’ai constaté que même les banques non signataires ont renoncé à commercialiser des produits hors-charte.
M. le président. Pensez-vous que la charte puisse être améliorée ? Mme Nouy, secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel, juge inadmissible de laisser une collectivité emprunter dans une devise étrangère dans laquelle elle n’a pas de ressources. Ce critère devrait-il figurer dans la charte ?
M. Éric Gissler. C’est le cas, puisqu’elle interdit de manière absolue – en dehors même de la grille – les produits dont le capital est en monnaie étrangère. Il est impossible aujourd’hui d’emprunter en francs suisses ou de prévoir une indexation sur le baril de pétrole.
M. le rapporteur. Le problème est que la mesure n’est pas rétroactive.
M. Éric Gissler. Conformément au principe du droit civil, la charte rédigée à un instant t, en 2009, n’est pas rétroactive. Si l’on peut encore progresser, c’est sans doute en proportionnant la nature du risque à la démographie. Beaucoup de choses se sont passées depuis deux ans, et la prudence est plus que jamais de mise.
M. le président. Avez-vous déjà exercé une médiation entre une collectivité et une banque étrangère ?
M. Éric Gissler. Plusieurs fois. Il suffit que je sois appelé par une collectivité ou par une banque qui estime qu’une collectivité va au défaut de paiement ou à l’assignation. Il y a une dizaine de jours, j’ai soldé définitivement un produit très compliqué avec une banque étrangère.
M. le président. Je vous remercie.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « La politique de prêts de Dexia » avec la participation de M. Pierre Richard, ancien président de Dexia, M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit Local, actuellement directeur général délégué en charge du pôle entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel-Arkéa, M. Bruno Deletré, ancien directeur général des services financiers au secteur public, financement de projets et rehaussement de crédit de Dexia SA, actuel directeur général du Crédit Foncier, M. Alain Delouis, ancien directeur général de TFM, membre du comité de direction de Dexia SA, actuellement directeur des ressources humaines de Natixis
(Procès verbal de la séance du mardi 15 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, nous reprenons ce matin le fil de nos travaux en recevant les responsables des banques en fonction pendant la période où des prêts structurés ont été proposés aux collectivités territoriales, et en premier lieu ceux de Dexia.
Je suis heureux d’accueillir en votre nom :
M. Pierre Richard, qui a exercé les fonctions de directeur général des collectivités locales, au ministère de l’intérieur, entre 1978 et 1979 ; à compter de 1993, de PDG du Crédit local de France devenu, sous votre impulsion – en 1997 –, Dexia ; à partir de 2000, de président du conseil de surveillance puis de président du conseil d’administration, jusqu’au premier plan de recapitalisation de Dexia, en octobre 2008 ;
M. Gérard Bayol, directeur général de Dexia Crédit Local, de 2006 à 2009, actuellement directeur général délégué en charge du pôle entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel-Arkéa ;
M. Bruno Deletré, directeur général des services financiers au secteur public, financement de projets et rehaussement de crédit de Dexia SA – de 2006 à 2008 –, actuel directeur général du Crédit Foncier ;
M. Alain Delouis, directeur de la trésorerie et des marchés financiers – de 2006 à 2008 – de Dexia, actuellement directeur des ressources humaines de Natixis.
Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Vous le savez, notre commission d’enquête a été créée pour comprendre comment des prêts et produits structurés ont pu être proposés aux collectivités. Elle n’est donc pas là pour juger la stratégie internationale et la gestion financière du groupe Dexia au cours de la dernière décennie. Cependant, le panorama révélé par nos précédentes auditions apparaît peu flatteur pour les établissements de crédit, en particulier pour ceux avec lesquels les collectivités territoriales avaient historiquement une longue habitude de travail et de confiance. Je souhaiterais, par conséquent, mieux comprendre comment le groupe Dexia en est venu à proposer aux collectivités territoriales des produits aussi risqués et contraires à leur vocation d’intérêt général que ces prêts structurés.
Quand a débuté la commercialisation auprès des clients de Dexia de prêts structurés ? Qui l’a autorisée ? Quelle était la clientèle visée ? Quelles étaient les consignes données aux commerciaux ?
MM. Pierre Richard, Gérard Bayol, Bruno Deletré et Alain Delouis prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Messieurs, à mon tour, je vous remercie d’avoir répondu à l’invitation de notre commission. Nous souhaiterions comprendre la démarche de Dexia qui a massivement transformé les dettes dormantes des collectivités territoriales en emprunts structurés. Même si les collectivités ont pu en profiter un certain temps, leur situation est aujourd’hui difficile. Cela dit, je fais toujours la distinction entre emprunts structurés et produits toxiques, la différence étant plutôt d’ordre conjoncturel que structurel.
Comment et par qui, au sein du groupe Dexia, ont été élaborées les formules à la base des prêts structurés que vous proposiez ? On a, par ailleurs, le sentiment qu’une armée de commerciaux est partie attaquer le marché français des collectivités.
Outre les prêts structurés, avez-vous proposé des swaps structurés aux collectivités territoriales ? Si oui, pourquoi et quelle était la clientèle visée ?
Comment étaient choisis les indices sous-jacents ? Qu’est ce qui justifie, par exemple, cet incroyable tropisme pour le franc suisse ou pour d’autres indices exotiques, aujourd’hui classés hors charte Gissler ?
Quel était le degré de connaissance, chez vos commerciaux de terrain, des structures complexes de ces prêts ? Et le niveau de compétence financière de leurs interlocuteurs au sein des collectivités ? S’agissait-il d’élus éloignés de la finance ou des directeurs financiers, des directeurs généraux des services ? Quelles ont été les pratiques pour inciter les collectivités à entrer dans cette dynamique ?
M. Pierre Richard, ancien président de Dexia. Ayant quitté mes fonctions exécutives fin 2005 pour devenir président non exécutif du groupe Dexia, je voudrais rappeler rapidement dans quel état d’esprit nous étions lors de l’apparition de ces produits structurés qui marquent une étape dans l’évolution du financement de l’économie. Depuis plus d’une vingtaine d’années, les marchés financiers jouent un rôle énorme dans l’économie avec la banalisation des financements et l’innovation financière. Le secteur local, qui est un très important acteur économique, a évidemment souhaité bénéficier des opportunités de marché en pratiquant, dès les années 1980, une gestion active de la dette, conformément aux souhaits des gouvernements successifs d’ailleurs, pour que soit revu l’ensemble des encours dont les taux étaient parfois très élevés – 15 %, 16 %, voire 17 %. Pour répondre à cette demande, Dexia et ses grandes filiales ont donc fabriqué des produits, ultérieurement qualifiés de structurés. Telle est l’idée générale qui a motivé la création de ces produits.
Quant au conseil d’administration, il s’assurait de la clarté des procédures et veillait à ce que les différents produits soient proposés de manière transparente dans des documents extrêmement précis présentés dans le détail par les différents services de Dexia Crédit Local, par les directeurs régionaux en particulier.
M. Gérard Bayol, ancien directeur général de Dexia Crédit Local, actuellement directeur général délégué en charge du pôle entreprises et institutionnels de Crédit Mutuel-Arkéa. Chez Dexia Crédit Local, nous avions 300 commerciaux – un nombre à peu près constant sur toute la période – pour accompagner les collectivités locales : répondre aux appels d’offre et en assurer le suivi. On ne peut donc pas parler de démarche massive ; c’était une démarche récurrente de suivi des différents clients. À l’époque, deux tiers de notre activité étaient consacrés à des opérations standard, l’autre tiers portant sur les produits structurés. Entre 1990 et 2000, l’ingénierie financière s’est sophistiquée, sous l’impulsion d’acteurs étrangers, qui sont entrés sur le marché français, ou de conseils financiers, et sous l’influence des marchés financiers.
Vous m’avez demandé comment étaient choisis les index sous-jacents. Le franc suisse a été commercialisé dès la fin des années 1990 pour la simple raison qu’il présentait, pour pratiquement tous les acteurs financiers, une possibilité de convergence vis-à-vis de l’euro, et des taux d’intérêt faibles, c'est-à-dire une opportunité dans des logiques de concurrence et d’intérêt financier pour les collectivités locales.
Nos commerciaux avaient un niveau bac+3, bac+5. Ils sortaient d’écoles de commerce ou avaient suivi un cursus universitaire avec une spécialisation finances et collectivités locales. Ils connaissaient bien les produits que nous commercialisions et suivaient une formation continue à ce sujet.
Quant à leurs interlocuteurs, ils étaient rarement les élus, mais plutôt les directeurs généraux des services des collectivités territoriales. Cela dit, la commercialisation des produits structurés dits plus complexes était limitée aux grands clients, c’est-à-dire aux collectivités de plus de 10 000 habitants.
S’agissant de l’élaboration de ces produits, au sein de Dexia Crédit Local, le comité « Nouveaux produits » a été mis en place qui, comme son nom l’indique, examinait les nouveaux produits. Son secrétaire était le directeur des engagements, et il était présidé par le responsable opérations et finances. La force de proposition relevait de la direction commerciale, secondée par des équipes financières techniques émanant de la salle des marchés. Le directeur juridique, le responsable du contrôle permanent et le responsable des affaires financières faisaient également partie de ce comité. Des contrôles étaient donc exercés. Par ailleurs, le comité « Nouveaux produits » a progressivement évolué vers le suivi de la commercialisation des produits.
M. le rapporteur. Votre successeur nous a dit qu’il y avait 156 produits différents lorsqu’il est arrivé, ce qui ne facilitait pas la compréhension pour les clients, et qu’il avait ramené ce nombre à 15. Pourquoi une telle volonté de complexification ? En outre, l’appellation « TOFIX » n’est-elle pas trompeuse vis-à-vis de collectivités habituées à une gestion de bon père de famille ? Enfin, quel TEG garantissez-vous à celui qui contracte un emprunt structuré ?
M. Gérard Bayol. Je n’ai pas le souvenir de 156 produits en tant que tels ! Nous avions en fait cinq à six grandes familles de produits – taux fixe, indexation sur l’Euribor, sur le change, produits de pente, etc. –, chacune d’elles étant sous-compartimentée. Le nombre de nouveaux produits a régulièrement diminué en 2007 et 2008. Quant aux produits ayant le label TOFIX, FIXIA ou FIXMS, qui démarraient avec une période de taux fixe et poursuivaient avec une option d’indexation sur le change notamment, ils s’adressaient seulement à nos interlocuteurs des grandes collectivités locales qui connaissaient bien notre gamme.
M. le président. Si je comprends bien, monsieur Richard, monsieur Bayol, votre argumentation se résume à deux constats : vous répondiez à une demande des collectivités locales et vous étiez en relation avec l’administration, pas forcément avec les élus. Alors, quel a été, chaque année, le bonus maximum total, cash et différé, attribué respectivement aux vendeurs, à leur supérieur hiérarchique direct et aux traders, traitant même partiellement, avec les collectivités en France lors de la période de mise en place des produits les plus structurés ?
M. le rapporteur. J’attends toujours que l’on me réponde très précisément sur le TEG !
M. Gérard Bayol. J’ai omis de vous dire que le comité « Nouveaux produits » avait émis un avis négatif à la commercialisation des crédits dits snowballs, à effet cumulatif. Par ailleurs, nous ne commercialisions pas de swaps seuls. Par conséquent, nous n’avions pas de logique de trading, donc de rémunération des traders associée à cette commercialisation. Nous n’avions pas d’incitation particulière à la commercialisation des produits structurés. Les commerciaux n’avaient pas de bonus : la part variable des rémunérations, qui pouvait aller jusqu’à 6 000 euros et représentait environ 10 % de la rémunération, se décomposait en trois volets : un premier volet qualitatif, un deuxième volet indexé sur les commercialisations croisées avec d’autres activités, et un dernier volet quantitatif calculé en fonction de l’ensemble des activités, mais pas spécifiquement la commercialisation des produits structurés.
M. Alain Delouis, ancien directeur général de TFM, membre du comité de direction de Dexia SA, actuellement directeur des ressources humaines de Natixis. Ces produits ne généraient pas de produit net bancaire (PNB) dans les salles de marché puisque Dexia adossait systématiquement l’ensemble des produits proposés à ses clients. De ce fait, la rémunération des traders dans les salles de marché n’était pas liée à la volumétrie ou au PNB généré par les produits structurés.
M. Gérard Bayol. L’ensemble de ces produits, comme le TEG, est basé sur une valorisation qui se fait à l’instant de l’appel d’offre. Les références sont prises à l’instant t, selon la définition du TEG.
M. le rapporteur. Cela vaut aussi pour un produit structuré ! La définition du TEG est la même que le prêt soit à taux fixe ou à taux variable !
M. Gérard Bayol. Exactement ! Je vous renvoie à la circulaire de 1992. On retient le même principe de fixation que pour le TEG. À l’instant t de l’appel d’offre, on fixe le prix sur toute la structure.
M. le rapporteur. Cela n’a pas de sens sur un produit structuré !
M. Gérard Bayol. Bien sûr que si, puisque le produit structuré est composé d’une partie fixe et d’une partie variable !
M. le rapporteur. En trente ans, la situation peut se retourner dix fois !
M. Gérard Bayol. C’est la même chose pour l’Euribor !
M. le rapporteur. Bien sûr, et c’est tout le problème ! Quand les gens signent, ils ont l’impression de s’engager sur un montant maximal de frais financiers. La variable d’ajustement étant la fiscalité, comment gérer ensuite la collectivité ?
Par ailleurs, parmi toutes les collectivités touchées, très peu ont plus de 10 000 habitants. Aviez-vous donné pour consigne de ne pas accorder d’emprunts structurés aux collectivités plus petites ?
M. Gérard Bayol. Oui ! Parmi les réserves exprimées au sein du comité « Nouveaux produits » figurait l’interdiction de la commercialisation de certains de ces produits pour les collectivités de moins de 10 000 habitants.
M. le rapporteur. Si l’on trouve des produits structurés chez certaines petites collectivités, c’est donc que les commerciaux les moins bien payés ont commis des erreurs !
M. Gérard Bayol. Il y a peut-être eu, effectivement, des erreurs de commercialisation !
M. le président. Vous avez évoqué la qualification de vos vendeurs, mais quel profil devaient avoir leurs interlocuteurs de l’administration pour comprendre ce qui leur était proposé ?
M. Gérard Bayol. Vous avez bien noté que Dexia ne commercialisait pas de swaps. Nos interlocuteurs avaient généralement la même formation que nos commerciaux. Ils avaient en tout cas suffisamment de connaissances en termes d’ingénierie financière pour superposer des swaps à nos propres produits structurés.
M. le président. D’après vous, ce sont donc les élus qui réclamaient ce genre de produits et qui les complexifiaient !
M. Gérard Bayol. Je n’ai pas parlé des élus. Je dis simplement que Dexia a commercialisé des prêts structurés qui ont ensuite été restructurés avec d’autres swaps. En 2008, lorsque nous envisagions de proposer une solution alternative aux clients affectés par la plus forte volatilité des marchés, nous trouvions en effet, dans certaines collectivités importantes, en plus de nos prêts structurés, des swaps qui ne venaient pas de chez nous, et qui s’y superposaient, dans une sorte de millefeuille. J’en déduis que les personnes qui effectuaient ces opérations avaient soit des conseils financiers, soit une bonne connaissance de ce type de produits.
M. le président. Monsieur Bayol, dans le cadre de la commission d’enquête, nous n’avons pas reçu que des « grands clients » ! Certains représentants de villes de moins de 10 000 habitants n’ont pas vraiment eu l’impression de réclamer des produits structurés à leur banquier ! Il est venu avec des propositions de contrat qu’il leur était, à mon humble avis, très difficile de comprendre.
Mais j’en viens à une question juridique. Une circulaire de 1992 interdisait la vente de produits financiers sans rapport avec l’activité réelle de la collectivité. Quelle a été la position de vos services juridiques sur cette circulaire ?
M. Bruno Deletré, ancien directeur général des services financiers au secteur public, financement de projets et rehaussement de crédit de Dexia SA, actuel directeur général du Crédit Foncier. J’étais en charge de la supervision du métier « Collectivités locales » pour l’ensemble des pays dans lesquels nous intervenions de 2006 à 2008. Outre le comité « Nouveaux produits », il existait un comité d’éthique et d’évaluation des risques commerciaux qui, en 2006 par exemple, a classé tous les produits selon leur risque et suivait les clients concernés. Ce comité portait aussi une grande attention à la façon dont les produits étaient présentés avec non seulement le scénario de base, mais aussi des stress scenarii fondés sur des hypothèses divergentes, pour souligner les risques attachés à ces produits. Par ailleurs, le terme « TOFIX » n’apparaissait pas seul, il était suivi d’un autre, « DUAL » par exemple, puisque seule la première période était à taux fixe.
M. le président. La direction de la conformité a-t-elle eu à se prononcer sur la circulaire de 1992 ?
M. Bruno Deletré. La vente des produits structurés ayant commencé dans les années 1990, la conformité de ces produits avec la circulaire de 1992 a sûrement été analysée.
M. le président. Mais c’est après 1992 que la mise sur le marché de ces produits structurés a connu un pic !
M. Pierre Richard. La circulaire de 1992 était adressée aux préfets et signée par les trois ministres du budget, de l’économie et des finances, et de l’intérieur. Elle indiquait très clairement que, du fait de la décentralisation, les collectivités locales étaient libres de leurs décisions, l’administration d’État n’ayant pas de droit de regard sur leurs délibérations concernant les emprunts, et qu’elles étaient amenées à développer la gestion active de la dette. Les collectivités avaient des encours compliqués, avec beaucoup de prêts de toutes natures et des taux en général assez élevés – la circulaire mentionne un taux de 16 % et j’ai même souvenir de taux plus élevés. Elles étaient donc encouragées à être plus actives pour réduire la charge de la dette, ce qui passait inévitablement par l’utilisation d’innovations dont ont beaucoup profité les acteurs économiques du secteur productif. Dans mon esprit d’ancien directeur général des collectivités locales, les circulaires étaient adressées aux préfets pour qu’ils appellent l’attention des élus locaux sur le fait qu’ils ne devaient pas demander des produits sans rapport avec l’intérêt général des collectivités.
C’est dans ce climat, en 1992, que les banques, et notamment le Crédit Local, ont élaboré des produits structurés qui ont globalement abouti à une baisse générale du taux d’intérêt. Dexia évoquait, dans un droit de réponse à un article de journal, un taux moyen des produits structurés de l’ordre de 3,5 %, ce qui est tout à fait raisonnable et sans rapport avec ce que nous avions connu dans le passé. Je comprends très bien ce que vous avez dit s’agissant des communes de moins de 10 000 habitants, monsieur le président, car certains cas posent problème. Mais globalement, les collectivités locales ont été, je le pense, bénéficiaires à ce jour. Selon une enquête réalisée début novembre par Le Courrier de la Mayenne, toutes les communes de ce département seraient bénéficiaires, certaines ayant même encore aujourd’hui un taux d’intérêt de 0 % sur trois ans.
Le vrai problème, c’est la crise épouvantable qui s’est abattue sur le monde entier en 2008. Toutes les hypothèses qu’avaient envisagées les collectivités locales et les banques sur l’évolution relative des taux ont été balayées, personne n’ayant prévu à l’époque que les dettes souveraines deviendraient un problème. Il faut donc agir au cas par cas, s’orienter vers la médiation, mais je ne pense pas qu’il faille condamner l’ensemble du secteur. Je n’ai pas la compétence technique pour entrer dans le détail de la fabrication de ces produits mais, en tant que président non exécutif de Dexia, je demandais à l’exécutif de faire preuve de transparence dans les procédures. La médiation devrait permettre de régler les cas les plus délicats.
M. Serge Janquin. Les acteurs que sont les collectivités territoriales et les établissements publics ont peu eu connaissance de la circulaire de 1992, que l’administration de l’État n’a pas fait valoir. En 2008, lorsque j’exerçais la présidence de l’EPINORPA au conseil d’administration duquel siégeaient un représentant du ministère du logement, un représentant du ministère des finances et un représentant du préfet de région. Aucun ne s’est opposé à la signature d’un contrat à risque. Je m’interroge donc sur la force des circulaires qui ont été évoquées.
La présentation qui vient de nous être faite me paraît angélique. En tout cas, elle ne correspond pas du tout à ce que nous ont dit les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics sur l’état d’esprit dans lequel les choses se sont déroulées. Les banques auraient accompli une sorte de mission de service public, à la demande des collectivités locales et de manière tout à fait désintéressée ! Il est assez habile de dire que vos interlocuteurs étaient non pas les élus, dont vous ne mettez pas en cause la responsabilité, mais les directeurs financiers et les DGS. C’est toutefois faire peu de cas de la règle selon laquelle, sauf faute lourde avérée, l’élu est responsable des décisions que ses collaborateurs lui proposent de prendre. Les chambres régionales des comptes n’opèrent d’ailleurs pas de distinction entre la responsabilité de l’élu et celle de ses collaborateurs.
Monsieur Bayol, vous avez évoqué la force d’entraînement qu’avait eu la concurrence à un moment donné et j’aimerais avoir des précisions à cet égard. Quels étaient vos concurrents ? Je pense à un établissement prêteur étranger, ABN AMRO, dont l’aventure sur le terrain des prêts aux collectivités territoriales et établissements publics a dû faire réfléchir. Vous avez perdu des parts de marché – dites-le franchement ! – et vous avez cherché à résister en proposant de nouveaux produits structurés. Si c’est la vérité, il faut nous le dire ! Nous comprendrons alors mieux votre démarche et nous pourrons relativiser la responsabilité des uns et des autres. Votre plaidoyer était destiné à vous défausser de vos responsabilités, messieurs, et je ne peux l’accepter !
M. Henri Plagnol. Plaidoyer angélique, mais plaidoyer pathétique ! Dans votre dernière intervention, monsieur Richard, vous faites un aveu terrifiant. Vous dites ne pas avoir prévu la crise qui s’est abattue sur nous, ni le bouleversement des paramètres des systèmes financiers. Mais les prêts consentis aux collectivités locales courent très souvent sur plus de vingt ans, parfois même trente ou quarante ans. Comment, devant une assemblée d’élus, justifier par la seule crise que la banque traditionnellement partenaire des collectivités locales se soit aventurée à leur consentir, sur des durées aussi longues, des prêts gagés sur l’impôt, assortis de taux découlant de formules mathématiques extrêmement complexes, et fondés sur des paramètres volatils ? C’est stupéfiant ! Pensez à la réaction qu’auraient nos concitoyens s’ils assistaient à cette audition !
Ensuite, vous n’avez pas évoqué l’engrenage dans lequel ont été prises les collectivités locales les plus touchées, c’est-à-dire celles auxquelles vous avez prêté des centaines de millions d’euros et sur lesquelles vous avez gagné beaucoup d’argent. À partir de 2003, souvent en s’associant à d’autres banques, Dexia leur a proposé des restructurations de dette globales. On aurait pu comprendre que vous proposiez aux collectivités locales des prêts un peu complexes sur 5 ou 10 % des encours, mais pourquoi avoir joué au casino 70, 80 ou 90 % de la dette ? Cela rend la médiation difficile.
Enfin, pratiquement simultanément, Dexia et les autres revendaient leurs options à une banque ou une institution financière en souscrivant, si j’ai bien compris – mais je n’en suis pas tout à fait sûr –, une espèce d’assurance par laquelle elle s’engageait à couvrir la perte si jamais le client, c’est-à-dire en l’espèce la collectivité locale, n’assumait pas l’intégralité des remboursements dans les conditions initiales. Naturellement, les collectivités locales ne le savaient pas. Comment la banque traditionnelle des collectivités locales a-t-elle pu s’engager dans des constructions aussi complexes qui aboutissent aujourd’hui au drame de l’effondrement de Dexia ? Je rappelle que l’État risque de devoir se substituer à vous pour le risque encouru par les institutions financières auxquelles vous avez revendu l’option.
M. Lionel Tardy. Nous sommes tous là pour comprendre comment Dexia, cette banque spécialiste du crédit aux collectivités locales, la quatrième banque de détail en Belgique, s’est retrouvée dans le rôle tragique de la première victime de la crise des dettes souveraines qui frappe l’Europe. Je rappelle qu’en 1993, Dexia employait 500 personnes, effectif porté ensuite à 35 000. Cette même année a été celle de la privatisation. Puis la cotation en bourse a été effectuée. La banque s’est diversifiée tous azimuts – Chine, Japon, Israël, Turquie. Pourquoi être sorti de votre métier d’origine en vous lançant dans la gestion d’actifs, la banque privée et l’assurance de titres de créance adossés à des prêts immobiliers – je pense au rachat de l’américain FSA pour 2,6 milliards. À la fin, quatorze salles de marché faisaient du trading sur les fonds propres de la banque. La holding n’avait pas d’autorité sur ses entités opérationnelles et il n’y avait pas d’outil de prévision centralisé. En 2007, la crise éclate, et les nouveaux dirigeants s’aperçoivent que la comptabilité était approximative, que le reporting financier était inexistant. C’est en faisant des calculs sur un coin de table que l’on a mesuré l’ampleur des dégâts ! Comment en est-on arrivé à une telle opacité dans la gestion, au point que l’Etat a dû intervenir deux fois ?
M. le président. Nous avons le sentiment, après les différentes auditions, que, délibérément, Dexia ne proposait plus que des produits structurés. Nous voudrions comprendre le déroulement des événements ; d’où nos questions.
M. Pierre Richard. Gérard Bayol vous expliquera très précisément comment il négociait ses services avec une collectivité locale. Vous aurez ainsi des éléments tangibles qui vous permettront de juger.
J’insiste surtout sur le fait que personne n’avait prévu une crise d’une telle intensité, la pire que nous ayons connue depuis les années 1930. Pour garantir leur liquidité, les banques étaient bien obligées d’avoir, dans leurs actifs, des dettes souveraines qui sont maintenant la cause de leurs difficultés. Certains produits ont donc été déstabilisés, mais ils comportaient des amortisseurs. Nous faisions des stress tests avec des hypothèses défavorables, mais, dans certains cas, elles ont été dépassées par la réalité de la crise actuelle. Je demande à Gérard Bayol de vous indiquer dans quelles conditions nous faisions ces stress tests qui devaient permettre de couvrir l’ensemble des risques de marché que nous avions connus sur trente ans. J’ai un profond respect pour l’institution parlementaire, mais il faut prendre la mesure de ce qui se passe dans le domaine financier depuis 2008 et qui affecte l’ensemble de la planète ! Personne ne l’avait prévu.
Malgré cela, le taux moyen des encours des prêts de Dexia aux collectivités locales françaises reste aujourd’hui modéré et, globalement, celles-ci, les grandes notamment, ont tiré bénéfice des produits structurés. Malheureusement, il y a des cas douloureux et c’est d’eux que l’on parle. Mais il faudra procéder un jour à une analyse objective d’ensemble pour mesurer l’impact de ces prêts sur le long terme.
M. le rapporteur. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec ce que vous dites, monsieur Richard. Je peux comprendre que l’on propose à une collectivité locale ayant une dette importante qui dort à 4 ou 5 % d’abaisser ses frais financiers à 2,5 ou 2,8 %. J’en ai moi-même profité. Au fait, pour vous, qu’est-ce qu’une collectivité locale ? Si vous aviez eu affaire à des particuliers, aujourd'hui ils ne pourraient plus payer et vous seriez bien obligés de vous résigner. Une entreprise, elle, déposerait son bilan. J’ai eu un frisson dans le dos tout à l’heure lorsque vous avez parlé de dettes souveraines. Autrement, vous pensiez ne courir aucun risque puisque la fiscalité était la variable d’ajustement. Mais, en contrepartie de cette sécurité, vous avez des devoirs. Avec les stress tests, vous auriez pu anticiper et prévoir certaines garanties. La crise a bon dos ! Indépendamment d’elle, le franc suisse et l’euro auraient pu diverger : les dégâts auraient été exactement les mêmes ! Nous ne pouvons donc pas accepter votre explication. Comment considérez-vous les collectivités ? Pourquoi ne pas les avoir traitées en partenaires et proposé, sur des périodes aussi longues, des mécanismes de couverture ? Une collectivité a l’obligation de présenter des comptes en équilibre tous les ans, pas sur deux ou trois années. Et quand elle économise sur ses frais financiers, elle réinvestit l’argent dans des équipements publics, des services à la population. On ne vous reproche pas votre démarche commerciale auprès des collectivités, ni de leur avoir fait gagner de l’argent. Ce que je vous reproche, c’est de vous être couverts à l’euro près, sans risque, puisque les collectivités finissent toujours par payer. Vos commerciaux, nous les connaissons tous et nous savons bien qu’ils devaient vendre des prêts structurés ; mais si tout le monde y avait trouvé son compte, cela n’aurait pas été grave ! Le problème, c’est la façon dont vous avez sécurisé ces prêts. Aucune assurance n’a été prévue pour protéger les collectivités. Considérez-vous une collectivité comme une personne physique ou comme une entreprise ?
M. le président. Monsieur Richard, les résultats de l’enquête parue dans Le Courrier de la Mayenne tiennent compte des emprunts qui sont encore dans une période de taux d’intérêt garantis. Et cela fait descendre le taux moyen ! Il faudrait connaître le taux moyen pendant la période bonifiée et celui payé par les collectivités qui sont sorties de cette période. On ne peut mélanger les carottes et les poireaux ! Les organismes de contrôle nous ont tous dit que les taux bonifiés étaient moins chers que le loyer de l’argent, mais que le banquier se rattrapait plus tard.
M. Patrice Calméjane. Pouvez-vous transmettre à la commission d’enquête les protocoles de vos commerciaux et directeurs régionaux ? Il serait intéressant, en particulier, d’avoir connaissance des éléments d’alerte que vous communiquiez à vos clients.
Vous avez parlé d’« appels d’offres » des collectivités ; en réalité, il s’agit de consultations.
L’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) aurait, aux dires de ses responsables que nous avons auditionnés jeudi dernier, rédigé des éléments d’alerte sur les produits structurés dès 2008 : avez-vous reçu des courriers en ce sens ?
Vous affirmez ne pas voir démarché les communes de moins de 10 000 habitants ; or nous avons auditionné les élus de Sassenage, qui en compte 9 800, de Thouaré-sur-Loire, qui en compte 6 700, d’Unieux, qui en compte 8 400, de Saint-Cast-Le Guildo, qui en compte 3 200, de Trégastel, qui en compte 2 400 et de Donges, qui en compte 6 300. Toutes ces communes sont engluées dans des emprunts structurés.
Vous dites également avoir parlé d’égal à égal avec les collectivités, mais je serais curieux de savoir si les directeurs généraux reçoivent, à l’Institut national des études territoriales (INET), une formation sur ce type de produits.
J’ai sous les yeux un exemple de tableau d’amortissement sur vingt-neuf ans, fondé sur des hypothèses de taux quasi fixes, ou présentés comme tels. Cette présentation offre, en apparence, une visibilité tout à fait rassurante ; mais une note, en très petits caractères, indique que « le montant des intérêts sera déterminé à chaque échéance selon les clauses contractuelles ». La transparence aurait voulu que vous décomposiez ce tableau en trois parties : la première pour les échéances fixes et les deux autres pour les évolutions aléatoires, dont les mécanismes d’indexation, très complexes, sont détaillés dans les articles du contrat. Ce sont ces effets retardés, non identifiés dans vos présentations, qui posent problème, partant l’équilibre de l’information, notamment vis-à-vis des petites collectivités – puisque les plus importantes avaient conscience de ce qu’elles faisaient, du moins je l’espère.
M. Gérard Bayol. Lorsque les collectivités locales lançaient une consultation, elles recevaient jusqu’à six ou sept offres de la part de cinq ou six acteurs, tant le marché était liquide. Le contexte était donc très concurrentiel.
Dexia répondait à ces consultations par une offre standard, en taux fixe ou Euribor, et une proposition de prêt structuré, dont la présentation comprenait une description de l’environnement des marchés financiers, une analyse des comptes administratifs de la collectivité sur quatre ou cinq ans ainsi qu’une description des produits en fonction de la demande, laquelle précisait souvent le type de structuration souhaitée et même la devise de référence.
Les différentes parties du produit étaient clairement décomposées : en général, une première partie à taux fixe, une deuxième avec options et parfois une troisième qui revenait à un taux fixe. Cette présentation était suivie d’une description, puis d’un stress test dont les scénarios, fondés sur les évolutions observées au cours des dix ou vingt dernières années, allaient jusqu’à envisager des taux de 12 %, soit quatre fois le taux initial.
Nos présentations indiquaient enfin la configuration future de la dette du client sur nos produits, dans l’hypothèse où celui-ci souscrirait ceux que nous lui proposions. Elles contenaient aussi un avertissement précisant que les analyses reposaient sur nos connaissances les plus approfondies, et qu’elles constituaient, non un conseil, mais une proposition définie en fonction de la demande.
Nous pouvions bien entendu développer tel ou tel point de cette présentation standard en fonction des consultations.
Il faut s’entendre sur ce que l’on appelle produit structuré. Les caps, les floors ou les tunnels sont des éléments de structuration : on les trouve dans les produits structurés standard, que les petites collectivités, me semble-t-il, peuvent très bien souscrire. En revanche, dès l’origine, nous avons réservé aux grandes collectivités les produits incluant des formules mathématiques complexes.
M. le rapporteur. Où est la frontière entre les produits réservés aux petites et aux grandes collectivités, en termes de risques ?
M. Gérard Bayol. Un credit scoring rapportait chacun de nos produits à un niveau de risque. C’est à partir de cette graduation que le comité « Nouveaux produits », puis le comité éthique, déterminaient l’éligibilité des collectivités en fonction de leur taille.
Dans sa politique commerciale, Dexia a toujours accompagné l’investissement des collectivités : elle a consenti des prêts – standard pour les deux tiers et structurés pour un tiers, dont 5 à 10 % de produits complexes –, mais n’a jamais proposé de swaps. Il n’était évidemment pas de son intérêt de vendre aux collectivités des produits toxiques destinés à financer des investissements à quarante ans : ç’eût été se tirer une balle dans le pied. Nous étions dans une logique d’accompagnement sur le long terme, dans le contexte d’une concurrence encouragée par la circulaire de 1992. N’oublions pas, d’ailleurs, que les collectivités locales étaient souvent accompagnées par des conseils financiers, lesquels ont eu un rôle, non seulement dans la rédaction des consultations, mais aussi dans la comparaison des offres.
Vous avez dit, monsieur le président, que le banquier se rattrapait quoi qu’il arrive ; mais il n’a rien à gagner à une évolution défavorable du produit qu’il a vendu.
M. le président. De nombreux élus et des membres des cours régionales des comptes se sont inquiétés des risques liés aux produits structurés dès 2008, soit avant la crise bancaire ; c’est pourquoi, d’ailleurs, l’ACP a commencé à s’intéresser à ces produits.
Aviez-vous une comptabilité analytique par client, transaction ou département ?
En 2006 et 2007, quels étaient les taux de marge respectifs sur les crédits « TOFIX » et à taux fixe à vingt ans souscrits par les collectivités, les hôpitaux et les offices de HLM ? Les opérations complexes de gestion active de dette étaient-elles plus rentables ? Quelle était la rentabilité, en millions d’euros et en pourcentage du nominal, des opérations actuellement classées comme structurées en 2005, 2006 et 2007 pour le secteur public local ? Ces marges étaient-elles déclarées au client ?
Comme l’a observé M. Richard, dans les années 1990, les taux fixes à vingt ans étaient très élevés ; mais, en période bonifiée, leur écart avec les taux variables s’était considérablement resserré.
M. Jean-Marie Binetruy. Aux dires de M. Bayol, Dexia proposait toujours deux types de prêt : classique et structuré. Mais cela ne correspond pas à ma petite expérience : les commerciaux de Dexia démarchaient très activement les collectivités pour qu’elles renégocient leurs encours, et substituent les taux variables aux taux fixes. La communauté de communes que je préside a résisté à ces nombreux assauts, mais une communauté voisine, elle, a cédé.
Quant aux stress tests, ils étaient accompagnés de la promesse que, si les taux maximums étaient atteints, la collectivité en serait informée et se verrait proposer des solutions : c’était le discours tenu par certains commerciaux, qui devaient être un peu intéressés à la vente de ces produits.
M. Thierry Carcenac. Dexia n’est pas une banque comme les autres, puisqu’elle a toujours été considérée comme la banque des collectivités locales : celles-ci avaient donc avec elle une approche différente, notamment dans le cadre des conventions. De fait, les collectivités avaient signé avec Dexia des documents relatifs au conseil : comment appréciez-vous ce rôle, notamment au regard des avertissements que vous avez pu adresser à vos clients ?
Les autres pays, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et le Benelux, n’ont pas la même approche des prêts structurés : votre propre approche avec eux était-elle différente ?
M. Dominique Baert. Sur le papier, les conventions de conseil de Dexia, qui prévoyaient un véritable accompagnement et des rendez-vous annuels avec les collectivités, étaient fort sympathiques ; mais elles n’ont pas eu la portée escomptée. Quel regard critique portez-vous sur elles, aujourd’hui ?
On ne pouvait certes pas prévoir que les dérèglements liés à la crise atteignent de telles proportions, d’autant que les prêts étaient souscrits sur de longues durées ; mais les contrats proposés par Dexia sont assortis de clauses que l’on peut qualifier de léonines, dans la mesure où elles prévoient des indemnités de remboursement anticipé qui, compte tenu de leur mode de calcul, lient les mains des collectivités. Dans ces conditions, ces dernières préfèrent payer des intérêts accrus pendant les trois ou quatre années qui restent plutôt que de renégocier leur dette. Les indemnités de remboursement anticipé figurent dans les contrats, certes ; mais consentiriez-vous, pour sortir de cette crise, à en exempter les collectivités qui souhaitent renégocier leurs emprunts structurés ?
M. Gérard Bayol. Si nous avons refusé de commercialiser des snowballs, c’est que nous menions une politique basée sur la « cyclicité » ; or le cycle, aujourd’hui, est haussier. Lorsque nous avons commencé à commercialiser des produits structurés, un euro valait 1,65 franc suisse ; nous avions alors placé la barrière à 1,40. Aujourd’hui, le plancher a été stabilisé à 1,20, grâce aux interventions de la Banque nationale suisse. Cependant des rumeurs de marché, hier, faisaient état d’une nouvelle intervention visant à porter l’euro à 1,30 franc suisse. Si l’évolution va jusqu’à 1,40 franc suisse, les problèmes liés à l’indexation sur cette devise auront partiellement disparu.
Les snowballs, eux, génèrent des effets cumulatifs qui empêchent de redescendre sous un pallier une fois que celui-ci est franchi.
M. le rapporteur. Il fallait appliquer des seuils bas ! Pourquoi n’y avez-vous pas pensé ?
M. Gérard Bayol. Nous n’avons peut-être pas pensé à tout…
M. le président. C’est à la Banque nationale suisse qu’il revient de « caper » vos produits, en somme !
M. Gérard Bayol. Nous n’avons pas signé de conventions de conseil : afin d’éviter tout conflit d’intérêts, nous avons toujours refusé cette activité pour nous concentrer sur l’activité financière.
Il est difficile de vous répondre sur les marges, puisque celles-ci sont, par définition, plus élevées au lancement du produit – en l’occurrence, de 5 à 20 points de base – ; puis elles diminuent sous l’effet de la concurrence. À l’origine, elles étaient légèrement supérieures pour les produits complexes, puisque Dexia achetait les options qui y étaient incluses à des banques d’investissement.
M. Bruno Deletré. Le taux d’emprise de nos produits structurés sur la dette des collectivités locales, monsieur Plagnol, était pris en compte par le comité d’éthique et d’évaluation des risques commerciaux. La difficulté est que nous ne connaissions pas la totalité des encours structurés dans les comptes de la collectivité.
En cas de vente d’un produit structuré, Dexia couvrait le risque financier sur les marchés, et assumait le risque de crédit. Les indemnités de remboursement anticipé, monsieur Baert, ne génèrent pas de marges particulières : elles sont calculées en fonction de la couverture du risque, autrement dit du montant nécessaire pour déboucler l’opération sur le marché, c’est-à-dire la soulte.
M. Henri Plagnol. Vous aviez donc conscience du risque.
M. Bruno Deletré. Bien sûr, comme en témoigne l’existence même d’un comité d’éthique et d’évaluation des risques commerciaux. Le risque est la contrepartie du gain obtenu par rapport au taux fixe d’origine.
Les marchés varient d’un pays à l’autre. Le marché américain, par exemple, est presque exclusivement obligataire ; par conséquent, les techniques de financement n’y sont pas les mêmes. Si les marchés européens diffèrent également entre eux, nous avons vendu des produits structurés dans d’autres pays d’Europe.
M. le président. Je vous invite à vous rapprocher de la commune de Fresnes, dans le Loir-et-Cher, à qui vous avez vendu un Dual euro/franc suisse, bien qu’elle ne compte que 984 habitants.
M. le rapporteur. L’élu local que je suis continue de travailler avec Dexia, qui reste la banque des collectivités.
Un certain nombre de collègues suggèrent de créer une structure de défaisance. Lorsqu’un problème technique apparaît sur un véhicule, le constructeur rappelle tous les modèles. Même si vous n’êtes plus aux commandes de Dexia, que pensez-vous d’une telle solution ? Gardez en tête que 5 000 collectivités sont concernées : faut-il considérer qu’elles ont toutes fait les mêmes erreurs ?
La période bonifiée touche à sa fin. Ne pensez-vous pas qu’à l’instar des fournisseurs de voitures, les banquiers devraient rapatrier leurs produits dans le cadre d’une structure de défaisance, structure qu’ils ont les moyens techniques de gérer ? Les masses financières concernées pourraient ainsi être couvertes et mises en sommeil : cela permettrait de passer cette période difficile. Si le seuil d’un euro pour 1,40 franc suisse est de nouveau atteint, chacun sera tranquille ; à la limite, cela permettra même aux banquiers de réinventer d’autres titrisations pour dégager des marges. En attendant, les banques ne pourraient-elles pas reprendre leurs produits et assurer le service après-vente ?
M. Patrice Calméjane. Je n’ai pas eu de réponse à ma question. L’ACP vous avait-elle alerté sur les produits que vous vendiez aux grandes et, comme vient de le rappeler M. le président, aux petites communes ? Par ailleurs, quel est le niveau de formation de vos commerciaux d’une part et des personnels territoriaux de l’autre ?
M. le président. Vous n’avez pas répondu non plus à M. Tardy, qui vous a interrogés sur la gestion interne.
M. Gérard Bayol. Nous entretenions des relations régulières avec les autorités de contrôle prudentiel, auxquelles nous présentions nos activités, qu’il s’agisse des produits standard ou des produits structurés. Je ne me souviens pas de courriers, néanmoins.
M. Patrice Calméjane. L’ACP nous a dit avoir alerté les autorités de l’État sur les dangers des produits structurés ; je suppose donc qu’ils l’ont fait aussi pour vous. Vous a-t-elle écrit à ce sujet ? Il faudrait que vos propos confirment les siens. Notre commission d’enquête cherche en effet à établir les responsabilités respectives afin d’éviter que les mêmes problèmes ne se reproduisent.
M. Gérard Bayol. Nous présentions nos activités à l’ACP tous les six mois, mais je ne me souviens pas de courriers de sa part sur ce point précis.
M. le président. Aviez-vous accueilli les représentants de l’ACP pour qu’ils étudient vos activités sur place ?
M. Gérard Bayol. Non ; en tout cas je n’en ai pas le souvenir.
Les premières alertes sur les produits de pente sont survenues en 2007. Nous avons alors alerté nos clients pour leur proposer des solutions de sortie, en souscrivant des produits plus ou moins complexes. Notre politique était bien de rester au contact de nos clients.
M. Thierry Carcenac. Je vous ai interrogé sur le conseil. En signant certaines conventions, Dexia s’était engagée à assurer, sinon des conseils rémunérés, du moins une activité en ce domaine. Qu’en est-il ?
M. le président. Les collectivités recevaient à ce sujet deux documents : le premier concernait le conseil et le second, qui lui était annexé, une proposition de prêt.
M. Gérard Bayol. Ces documents étaient envoyés par Dexia ?
M. le président. Oui.
M. Gérard Bayol. Le comité « Nouveaux produits » a toujours refusé les missions de conseil. Il n’y a donc pas eu de conseils rémunérés.
M. le président. Théoriquement, une banque doit délivrer un conseil personnalisé à chacun de ses clients. Or il s’avère que les contrats étaient rigoureusement les mêmes d’une collectivité à l’autre. Les offres étaient-elles conçues à partir d’une réelle analyse de la situation financière des clients, ou fallait-il seulement placer certains produits en vogue, comme « Dual Tofix » ?
M. Gérard Bayol. Que le produit et l’explication qui l’accompagne soient les mêmes me semble logique. En revanche, les analyses des comptes administratifs restent par définition spécifiques à chaque collectivité. Je ne suis donc pas sûr de saisir le sens de votre question.
M. le président. Je m’efforce de rester général afin d’éviter toute accusation d’être à la fois juge et partie.
Où est le conseil personnalisé, quand les produits structurés représentent 97 % de l’encours de dette d’une collectivité, dont 50 % pour Dexia ?
M. Gérard Bayol. Le comité « Nouveaux produits » avait précisément fixé à 50 % le seuil d’emprise maximal des prêts structurés souscrits auprès de Dexia dans l’encours de dette de chaque collectivité.
M. le rapporteur. Vos commerciaux se posaient-ils la question de savoir quels étaient les autres encours de prêts structurés dans les comptes locaux ?
M. Gérard Bayol. Nous ne pouvons forcer une collectivité à nous les communiquer.
M. le rapporteur. Dexia a toujours été le partenaire des collectivités : tous ces éléments sont sur la table lorsque nous discutons avec ses représentants.
M. Gérard Bayol. Si une collectivité, quelle que soit sa taille, a souscrit des swaps, ce n’est pas chez Dexia ; d’autre part, elle a pu souscrire des prêts structurés auprès d’autres banques.
M. le président. Quelle est votre part de marché sur les produits structurés vendus aux collectivités ?
M. Gérard Bayol. Environ 40 %. Ce chiffre figure dans toutes les notes de conjoncture que nous publions régulièrement.
M. le président. Dexia souscrivait-elle, de son côté, des emprunts structurés ?
M. Alain Delouis. Pour se refinancer, Dexia collectait des ressources sur les marchés, parfois via des emprunts structurés, mais en les assortissant de produits de couverture. Elle ne conservait pas de risque financier.
L’une des difficultés de la défaisance est que les produits concernés, en tout cas ceux vendus par Dexia, étaient adossés sur le marché. Dès lors, comment se répartirait-on le coût entre l’établissement prêteur et les établissements auprès desquels le prêt est adossé ?
M. le président. Tous nos interlocuteurs locaux, élus comme représentants de l’État, nous ont répété que Dexia était traditionnellement la banque de référence, notamment en matière de conseil. Or nous nous sommes rendu compte que, dans sa mission, elle n’avait pas été au rendez-vous : c’est là tout le problème.
M. Pierre Richard. Nous étions très fiers de ce rôle de banquier des collectivités. Ce fut l’objet même de la création du Crédit local de France, dont j’ai pris l’initiative avec Robert Lion en 1987, puis de celle de Dexia. François Narmon et moi pensions en effet, lorsque fut lancé l’euro, que l’européanisation des marchés financiers justifiait la création d’une banque européenne des collectivités, née de l’alliance entre le Crédit communal de Belgique et le Crédit local de France.
C’est au nom de cette tradition, d’ailleurs, que nous avons dissuadé les collectivités de souscrire des snowballs. Lors des consultations, beaucoup d’entre elles se montraient intéressées par tel ou tel produit structuré, que nous nous interdisions de leur vendre si nous ne les estimions pas suffisamment armées : ce souci du bon équilibre financier des collectivités correspond à ce qui est, au fond, l’âme de Dexia.
Nous n’étions peut-être pas meilleurs que les autres, mais notre comportement est resté fidèle à notre éthique. Les produits structurés, que chacun réclamait, ont été globalement bons pour l’économie – les grandes entreprises, d’ailleurs, ne s’en sont jamais plaintes, en tout cas publiquement. Ils ont permis d’alléger le coût d’endettements dont les encours arrivaient encore très récemment à échéance.
Le sujet est complexe, et même douloureux dans certains cas dont j’ignore le nombre ; néanmoins celui-ci me paraît limité au regard de l’ensemble des prêts souscrits, toutes banques confondues. À cet égard, un bilan exhaustif me semblerait très utile ; je sais que votre commission d’enquête y travaille.
M. le rapporteur. Oui, nous ferons ce bilan.
M. Pierre Richard. Nous aurons ainsi un panorama objectif sur la durée de vie de l’ensemble des produits ; à mon avis, le résultat ne sera pas négatif. Reste qu’il faudra, bien entendu, traiter humainement les cas les plus difficiles.
M. le président. L’une des représentantes de l’ACP a observé qu’il était absurde de prévoir des remboursements dans une monnaie quand les recettes sont perçues dans une autre. Après nos différentes auditions, en particulier de la Cour des comptes, de l’ACP ou de M. Gissler, nous voyons clairement ce qu’il convient de faire à l’avenir. Mais le stock existant nous préoccupe beaucoup. À cet égard, j’entends votre appel à la raison et à la négociation ; mais si vous étiez encore en responsabilité, quelle piste suggéreriez-vous à vos clients ?
M. Pierre Richard. Comme Gérard Bayol l’a précisé, Dexia n’a jamais prêté dans une autre monnaie que l’euro ; c’est donc dans cette devise que les collectivités ont toujours dû rembourser leurs prêts. Les taux d’intérêt, en revanche, pouvaient fluctuer en fonction des parités.
M. Gérard Bayol. Lorsque, en 2006 et 2007, les produits de pente se sont révélés volatils, nous avons proposé des solutions de sortie à un certain nombre de collectivités : environ 50 % d’entre elles les ont refusées.
M. le rapporteur. Les soultes n’étaient pas les mêmes.
M. Gérard Bayol. La crise s’est encore complexifiée ; je ne sais comment elle évoluera, mais les produits proposés par Dexia sont, je le répète, cycliques : le stress qu’ils subissent aujourd’hui peut donc s’atténuer ; c’est en tout cas l’espoir que l’on peut former.
M. le président. Et c’est toute la difficulté.
M. le rapporteur. Monsieur Richard, pondérer un ratio via une indexation sur le franc suisse revient, de fait, à s’endetter dans cette devise tout en restant dans la légalité, puisque la charte Gissler l’interdit.
M. Pierre Richard. Certaines collectivités ont emprunté directement en francs suisses, mais jamais avec Dexia : c’est ce qui fait la spécificité de notre établissement.
M. le président. Messieurs, je vous remercie.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales
(Procès verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous accueillons M. le ministre chargé des collectivités territoriales, à qui je souhaite la bienvenue.
Monsieur le ministre, votre audition marque l’ouverture de la dernière phase des travaux de notre commission d’enquête, celle des propositions. Elles sont attendues, tant le constat que nous dressons est accablant : des responsables locaux dépassés par la complexité de certains produits, des banquiers ayant fait prévaloir les objectifs de marge sur le respect de leurs clients, des contrôles de l’État largement défaillants.
Vous l’avez rappelé à plusieurs reprises, vous ne voyez aucun problème systémique dans ce que j’appellerais une véritable « crise » de l’emprunt des collectivités territoriales.
Avant de donner la parole à notre rapporteur, je vous poserai donc une question générale. Dans le cadre du démantèlement de Dexia, les encours des prêts aux collectivités territoriales françaises situés dans les catégories les plus risquées ou en dehors de celles établies par la charte Gissler ont fait l’objet d’une garantie de l’État plafonnée à 10 milliards d’euros. C’est donc que les acteurs concernés – l’État, Dexia, la Caisse des dépôts – ont reconnu que ces emprunts, sans être particulièrement rentables, présentaient des risques légaux non négligeables. Peut-on continuer à parler de cas isolés, quand la loi de finances rectificative les mentionne précisément ?
M. Philippe Richert prête serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La commission d’enquête s’interroge notamment sur d’éventuels manquements dans les contrôles de l’État. Les auditions ont en effet montré que les autorités en charge du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire au niveau des préfectures ne disposaient pas des moyens légaux pour détecter les risques éventuels liés à des emprunts structurés et mettre en garde les collectivités territoriales, d’autant plus qu’il y a eu là un phénomène massif : un effet de mode ou une démarche commerciale. Une circulaire a été prise récemment pour remédier à ces manques, mais il demeure qu’en tant que contrats de droit privé, les contrats d’emprunt échappent à tout contrôle de légalité. Si la règle d’or s’impose aux collectivités locales, il existe des failles dans la réglementation. Que proposez-vous pour améliorer la situation ?
Les préfectures ne manquent pas tant de moyens juridiques que de moyens humains pour effectuer ce contrôle. Le profil classique et le nombre des fonctionnaires sont-ils suffisants pour faire face aux problèmes complexes que pose une gestion dynamique de la dette ? Ce contrôle ne requiert-il pas des compétences différentes ?
Enfin, les collectivités territoriales sont-elles des clients comme les autres pour les banques ? Doivent-elles être regardées comme une personne physique, une entreprise, ou autre chose ? Je n’ai pas encore la réponse à cette question, mais nous devrons nous prononcer. Pour certains, une collectivité s’apparente à une entreprise, dont les agents sont formés et habilités à signer ce type de contrat. Pour leur part, les collectivités estiment que la technicité et la complexité de ces contrats les rendaient trompeurs : les élus ne sont pas tous des financiers patentés. Bref, ne faut-il pas inventer une nouvelle catégorie de clients des banques ?
M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Les emprunts dont nous parlons impactent fortement les collectivités, en tout cas bon nombre d’entre elles. C’est donc un sujet que nous ne pouvons éluder.
Je commencerai par les limites du contrôle de légalité. Vous l’avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, celui-ci est difficile à effectuer puisque les contrats passés entre une collectivité locale et une personne de droit privé, exception faite des contrats administratifs par détermination de la loi, sont présumés être de droit privé. Ils n’ont donc pas à être transmis aux services chargés du contrôle de légalité pour être exécutoires, ce qu’a confirmé le Conseil d’État. Les délibérations qui les concernent sont néanmoins obligatoirement transmises aux services préfectoraux dans le cadre du contrôle de légalité. Les services préfectoraux ne peuvent ainsi saisir le juge administratif que de la légalité de la délibération, et non du contrat de droit privé.
En matière budgétaire, le contrôle de l’emprunt des collectivités s’exerce à travers le principe d’équilibre, qui se traduit par l’interdiction de financer des dépenses de la section de fonctionnement par l’emprunt et l’obligation de rembourser les annuités d’emprunt par des ressources propres. Les services préfectoraux doivent s’assurer que les écritures sont sincères et que les documents budgétaires – notamment les différentes annexes – ont été correctement remplis. La notion de dette exigible recouvre non seulement le capital et les intérêts de la dette, mais également les frais financiers indiqués dans les contrats d’emprunt, qui peuvent faire l’objet d’une mise en demeure par le préfet et d’une procédure d’inscription d’office, en l’absence d’inscription ou en cas de sous-estimation. Ces différents points ont été rappelés dans une circulaire du 25 juin 2010 relative à l’action des services préfectoraux en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire. Dès lors, nous n’avions ni le pouvoir ni le moyen de contrôler les caractéristiques des contrats.
Les uns et les autres ont d’ailleurs insisté sur le fait que l’État n’avait pas à s’immiscer dans ce qui relève des collectivités. C’est un débat qui resurgit fréquemment à l’occasion de la discussion comme de l’application des textes législatifs. Je m’entends souvent rappeler que l’État doit rester à sa place, qu’il n’a pas à empiéter sur les prérogatives des collectivités, qu’il se doit de respecter les principes de la décentralisation, à commencer par celui de la libre administration des collectivités territoriales inscrit dans la Constitution. Dans le cas présent, l’État n’avait pas à se prononcer. Le secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF) l’avait d’ailleurs dit clairement en 2008. Je cite ses propos : « Le congrès de l’AMF prend acte des mesures prises par le Gouvernement pour faciliter l’accès des communes à l’emprunt. Il considère que les difficultés que peuvent rencontrer quelques collectivités en matière de produits financiers, dits à risque de taux, doivent être appréciées à leur juste mesure. En aucun cas, cette situation ne saurait être un prétexte pour mettre en place des règles plus contraignantes. »
M. le rapporteur. Il y a pourtant la circulaire de 1992. Comment est-elle appliquée ?
M. le président. J’entends bien les propos du secrétaire général de l’AMF, et je comprends les raisons qui vous conduisent à les citer…
M. le ministre chargé des collectivités locales. Mais non. Ne me prêtez pas d’intention particulière.
M. le président. Permettez-moi cependant de rappeler que les élus doivent voter des budgets sincères. Or en l’état actuel, ils ne peuvent pas l’être. Pour prendre l’exemple d’une collectivité que je connais bien, il manque 30 millions d’euros – qui n’apparaissent nulle part – dans mon budget.
M. le ministre chargé des collectivités locales. Permettez-moi de prendre moi aussi l’exemple d’une collectivité que je connais bien. L’emprunt total de cette collectivité s’élève aujourd’hui à environ 750 millions d’euros, dont les deux tiers ont été souscrits à taux fixe et un tiers à taux variable. À la demande expresse du président de la collectivité, un emprunt structuré, de 20 à 30 millions d’euros, a été souscrit. L’administration était plutôt réticente, mais le président, qui est très informé et très impliqué dans la gestion de sa collectivité, a expliqué qu’ainsi, il gagnerait un point environ sur les taux d’intérêt – en empruntant à 2 % au lieu de 3 %. Il avait calculé que si ce gain se maintenait pendant cinq ou six ans, la collectivité serait toujours gagnante, même si un effet de cliquet venait à jouer. Le taux d’intérêt moyen de l’ensemble de la dette s’établit aujourd’hui à 3,09 %. Nous voyons donc qu’un élu, il est vrai très au fait des questions financières, a fait un choix politique qui permettrait, selon lui, d’obtenir globalement un meilleur taux. Celle-ci aurait certes pu y gagner plus si les taux n’étaient pas remontés, mais le taux d’intérêt moyen – emprunt structuré compris – reste tout à fait acceptable. Bref, les banques n’ont pas systématiquement eu la démarche commerciale offensive qu’on leur prête : nous avons ici le choix politique d’un élu informé, qui a décidé, malgré les alertes qui pouvaient être données ici ou là. J’assume ce choix politique ; en l’occurrence, l’État n’avait pas à se prononcer.
Je vous rejoins en partie sur le deuxième point. À titre personnel, je serais particulièrement choqué si l’État venait aujourd’hui donner des leçons à ceux qui n’ont pas eu la capacité – ou les moyens – de se montrer vigilants, ou n’ont pas été alertés de cette nécessité. J’étais président de conseil général pendant cette période. Nous avons été démarchés comme d’autres, mais le conseil général du Bas-Rhin n’a souscrit aucun emprunt structuré : la responsable des finances préférait s’en tenir à des produits plus sûrs, et je me suis rangé à son avis. Il ne faudrait pas donner le sentiment que les responsables politiques n’avaient d’autre solution que de se laisser faire. Mais comme je vous l’ai dit, une autre collectivité que je connais a fait, elle, le choix politique de souscrire un emprunt structuré. Je conçois que des élus mal informés aient pu prendre des décisions sans avoir les compétences nécessaires pour agir en pleine connaissance de cause, ou que les responsables financiers de certaines collectivités – je parle ici des services – n’aient pas eu les capacités d’apprécier ce qui leur était proposé, ou n’aient pas transmis aux élus toutes les informations nécessaires. Pour autant, il ne me semble pas qu’il faille crier haro sur l’État.
Cela étant, je serais particulièrement peiné que les grandes institutions de contrôle de l’État viennent aujourd’hui donner des leçons car elles n’ont pas averti les élus qu’il fallait être plus vigilant. En tout cas, elles auraient pu le faire plus et mieux, surtout au regard de la conjoncture. À l’époque, chacun s’efforçait de diminuer au maximum l’impact de sa dette, et personne ne parlait d’emprunts toxiques ! Il ne s’agissait que d’une façon d’emprunter parmi d’autres, dont on pouvait penser qu’elle serait plus avantageuse. Certains élus disposaient des capacités d’analyse nécessaires pour se déterminer en toute connaissance de cause, d’autres non – et c’est dommage. Mais n’accréditons pas l’idée que, d’une manière générale, l’État n’aurait pas été à la hauteur. Les propos du secrétaire général de l’AMF – que j’estime personnellement beaucoup et qui sait ce qui se passe dans les collectivités – suffisent en effet à montrer que celles-ci ne veulent pas d’un renforcement des contrôles de l’État.
M. le président. Entendons-nous bien, monsieur le ministre : je ne demande pas de contrôles supplémentaires, je dis simplement qu’il y a une responsabilité de l’État à laisser les élus gérer sans leur donner les moyens de constater les pertes aussitôt qu’elles apparaissent. Pour un certain nombre des emprunts que nous avons eu l’occasion d’examiner, c’est dès le lendemain de la signature qu’ils étaient négatifs au fixing. Mais comme il y avait une période de bonification au début, les pertes latentes n’apparaissaient nulle part ! Il s’agit non pas de contrôle des élus, mais de vérité démocratique. Si l’on avait exigé dès le départ qu’elles figurent dans une ligne de réserve ou une ligne à définir, ces emprunts seraient immédiatement apparus beaucoup moins intéressants à bon nombre d’élus.
M. le rapporteur. Il ne s’agit pas de faire le procès de l’État. L’autonomie financière des collectivités est une revendication unanime, et tout gain sur les frais financiers est un produit comme un autre, qui évite de recourir à l’impôt. En ce sens, il relève bien de l’autonomie. Le lien se situe plutôt entre l’autonomie financière et le fait d’avoir des comptes sincères. Je suis assez favorable à ce que cette autonomie financière perdure – elle permet de donner libre cours à une certaine créativité, et pour ma part, j’ai gagné beaucoup d’argent avec des emprunts structurés. Mais il faut avoir les outils qui permettent de présenter des budgets sincères. Dans une entreprise privée, ces outils sont les provisions. Il n’en va pas de même en comptabilité publique. Sans doute manque-t-il à l’État certains instruments pour faire son travail. Il y a certes une différence entre une délibération et le contenu de ce qu’elle autorise – il en va d’ailleurs de même pour les délégations de service public – mais il faut voir comment on peut aller plus loin.
Raisonnons en scientifiques. Passe encore s’il n’y avait que trois cas, mais il y en a 5 000 ! La loi du nombre doit nous interpeller.
Nous avons plusieurs pistes pour éviter que le scénario se reproduise. C’est pourquoi je vous ai demandé ce qu’était pour vous une collectivité. Certaines banques ont tout de même fait signer à des collectivités une clause selon laquelle elles étaient considérées comme des entreprises. Pourquoi, sinon pour juguler un malaise ? Car si vous n’êtes pas une entreprise, vous êtes une personne physique, et la loi pose un certain nombre de règles s’agissant de la relation d’une banque avec une personne physique.
Il faut trouver une solution. Quand 5 000 collectivités se trompent en même temps, on peut parler de phénomène ; et à mesure que nos travaux avancent, nous constatons qu’à un moment donné, tout le monde s’est trompé. Le ministre doit donc nous dire ce qu’est une collectivité – autrement dit, comment un banquier devra-t-il regarder une collectivité demain ? Nous avons reçu hier l’équipe de direction de Dexia. Son président a fait un plaidoyer pour son action. Dexia était la banque des collectivités, mais elle entretenait avec elles une relation très particulière, voire fusionnelle ! Plus étonnant, il a admis qu’ils avaient été surpris : pour eux, la dette des collectivités était une dette souveraine – autrement dit, il était garanti que quelqu’un payerait. Mais ce ne peut être que le contribuable !
On parle souvent du statut de l’élu, mais quel est le statut de la collectivité face à l’activité bancaire ? Pour l’avenir, il faut donc définir le statut des collectivités : doivent-elles être considérées comme des personnes physiques, auquel cas c’est le contribuable qui supportera l’ajustement, ou comme des entreprises, ce qui suppose une comptabilité d’un type différent, avec la possibilité de passer des provisions, de déposer le bilan… Nous sommes au milieu du gué. Sachant que les élus réclament l’autonomie financière, il faut lever l’ambiguïté.
M. Éric Raoult. La commission d’enquête a plutôt l’habitude d’auditionner des personnes qui regardent par terre, monsieur le ministre. Vous, vous nous regardez droit dans les yeux. Il ne s’agit pas d’une dissonance par rapport au discours ambiant ; simplement, c’est l’État qui s’exprime par votre voix. N’y voyez aucune critique à l’égard du président ou du rapporteur, mais j’étais resté un peu sur ma faim depuis le début de nos travaux, auxquels j’avais accepté de participer en raison de la personnalité du président et du rapporteur, fins connaisseurs du dossier des collectivités locales. Je me félicite donc d’entendre le ministre rappeler un certain nombre de réalités. Il y a en effet un peu d’hypocrisie dans la petite musique du « tous responsables » que nous entendons depuis le début. Je vous remercie de nous avoir fait entendre une mélodie différente, monsieur le ministre. J’aimerais en effet pouvoir voter les propositions que nous feront Claude Bartolone et Jean-Pierre Gorges, et votre contribution nous apporte un éclairage bienvenu.
M. le ministre chargé des collectivités locales. Vous m’aviez interrogé sur les limites du contrôle de légalité. J’ai commencé à expliquer le cadre dans lequel l’État agit, mais j’ai été interrompu presque aussitôt. Je pensais être auditionné en tant que ministre pour donner la position de l’État : je ne savais pas que le président et le rapporteur feraient à la fois les questions et les réponses… J’ai expliqué pourquoi il ne fallait pas généraliser l’analyse. Il est vrai que dans certaines collectivités, les élus se sont succédé, et que certains découvrent des situations qu’ils ignoraient. Pour ma part, je n’ai laissé aucun emprunt toxique derrière moi.
M. Bernard Derosier. Vous n’êtes pas le seul.
M. le ministre chargé des collectivités locales. Je le dois d’abord à ma directrice des finances. Je comprends que d’autres n’aient pas vu – ou pas pu voir – l’ensemble des risques. Mais je veux le redire, l’État se voit en permanence opposer la décentralisation. Durant des mois, on m’a harcelé pour m’expliquer que la réforme des collectivités était une nouvelle façon pour l’État de mettre la main sur les collectivités territoriales. Je l’ai entendu des dizaines et des dizaines de fois ! On ne peut à la fois dire en permanence que l’État doit laisser faire les collectivités, et lui demander d’intervenir lorsqu’un problème survient. Pour autant, vous avez tout à fait raison : nous avons beaucoup à apprendre de cette crise, qui est une crise majeure pour les collectivités. Nous devons donc en tirer les conclusions et nous prémunir pour l’avenir. Nous l’avons déjà fait en partie.
J’en viens à l’approche de ce qu’est une collectivité. Nous allons d’abord refaire une banque des collectivités – une banque publique qui sera formée à partir de la Banque postale et de la Caisse des dépôts. Des garanties et des engagements ont été pris – pour aujourd’hui et pour l’avenir – au niveau de l’État. Les garanties, c’est la charte Gissler, que je n’ai pas besoin de détailler devant vous, qui répond pour partie à la question de M. le rapporteur sur la nature des collectivités, qu’elle reconnaît comme des acteurs non professionnels. Sachant qu’elles seraient toujours financées, certains ont considéré un peu vite qu’elles étaient informées parce qu’elles disposaient de personnels spécialisés. On sait bien que ce n’était pas le cas : non seulement les collectivités ne disposaient pas toutes de personnels spécialisés, mais sur ce sujet, les personnels spécialisés eux-mêmes n’étaient pas si avisés qu’on l’a cru…
La Cour des comptes explique qu’il ne fallait pas entrer dans cette logique. Aujourd’hui, alors qu’inspections, contrôles et vérifications se multiplient, elle précise avoir « passé des messages ». Personnellement, je ne les ai pas entendus. J’ai trente ans d’expérience publique. En tant que patron de collectivité, je n’ai pas cédé au mouvement général – non parce que j’étais plus averti que d’autres, mais parce que ma directrice des finances n’a pas voulu s’engager dans cette voie qui ne lui paraissait pas suffisamment sûre.
En ce qui concerne les précautions à prendre pour le futur, les annexes budgétaires des collectivités seront complétées. Il faut bien sûr travailler sur la notion de provision, afin que les nouveaux venus puissent savoir où ils en sont et ne se retrouvent pas contraints de faire face à des risques qui ne sont pas couverts. Bien des progrès doivent encore être faits.
Le rapporteur me demande si les services au niveau des préfectures sont assez « calibrés » pour effectuer le contrôle de légalité. Il ne s’agit pas tant du nombre que de la spécialisation des agents chargés de ce contrôle, qui doivent être avertis des points qui appellent une vérification. Pour ce qui est du contrôle budgétaire, les préfets ont été informés, notamment de la façon de remplir les annexes relatives à la dette, afin que l’on puisse disposer rapidement, à partir de documents correctement remplis, de la notion de dette exigible. Ces différents points ont été rappelés dans la circulaire du 25 juin 2010. Nous demandons donc à la fois aux collectivités de procéder à ce travail, et aux préfectures de contrôler les documents remplis pour nous assurer que nous sommes entrés dans la phase d’application de la charte Gissler, ceci afin de ne pas nous retrouver, dans six mois ou un an, dans une situation qui rappellerait ce que nous avons connu.
Nous serons aussi à l’écoute de ce que proposera la commission d’enquête. À titre personnel, je ne suis pas favorable à la création d’une structure de défaisance et je partage pleinement l’approche de la Cour des comptes. Pour m’en tenir au cas d’une collectivité que je connais bien, il me semble légitime qu’elle gère le dossier de ses emprunts structurés car elle est en mesure de le faire.
Il faut bien entendu se prémunir pour l’avenir, en appliquant la charte Gissler et en mettant en place les mesures que nous avons évoquées. Mais il faudra aussi traiter le stock, en faisant en sorte que toutes les collectivités qui le peuvent utilisent les moyens de médiation mis à leur disposition. Personnellement, je ne l’ai pas fait pour le cas que je connais : j’estime avoir la capacité de choisir le moment où j’engagerai cette discussion. Compte tenu du taux de change actuel du franc suisse, ce n’est pas le moment de sortir d’un emprunt qui ne représente que 20 millions d’euros sur un stock total de 750 millions. Mais dès que j’en aurai l’occasion, je le ferai.
J’ai rencontré toutes les banques françaises concernées. Elles font parfois aux collectivités des propositions de rachat, mais qui sont souvent refusées tant que la période de bonification court encore. C’est aussitôt qu’elle est terminée qu’elles viennent demander à l’État la mise en place d’une structure de défaisance ! Ce n’est guère raisonnable. Les banques ne peuvent le dire publiquement, car elles sont tenues par le secret bancaire.
M. le rapporteur. Mais, comme le rapporteur peut le demander, j’ai écrit à toutes les banques afin de savoir si elles avaient engagé cette démarche et quel était l’état des négociations.
M. le ministre chargé des collectivités locales. Je serais heureux d’en connaître le résultat.
L’idée est de sortir des emprunts structurés chaque fois que cela est possible. Pour ce faire, j’invite toutes les collectivités – en particulier les plus petites – à se mettre en rapport avec la mission Gissler. Les petites collectivités n’ont jamais eu à payer les taux exorbitants dont nous entendons parler : dans la quasi-totalité des cas qui m’ont été rapportés, on a trouvé des solutions de remplacement par des emprunts à taux fixe ou variable. L’État devra peut-être s’impliquer davantage là où subsistent des situations de blocage. En revanche, je ne conçois pas de mettre en place une structure de défaisance à compétence générale – pour toutes les raisons que la Cour des comptes a exposées, et aussi parce que certaines collectivités ont fait le choix volontaire et mesuré de recourir à ces emprunts structurés, et sont capables d’en sortir. À elles donc de négocier, le cas échéant avec le soutien de la mission Gissler, pour retrouver des perspectives acceptables. Telle est aujourd’hui la position que j’exprime au nom du Gouvernement. C’est donc avec intérêt que j’attends les propositions de la commission d’enquête.
M. le président. Voyez la nomenclature M14 : ce n’était pas une atteinte aux collectivités locales que de les obliger pour la première fois à constituer des provisions et des amortissements ! Il est important de garantir l’autonomie des collectivités locales, mais la nomenclature budgétaire et comptable ne constitue en rien une menace pour elle ! Ce qu’il faut, et j’insiste sur ce point, c’est assurer une transparence budgétaire. L’ancienne équipe de direction de Dexia, que nous avons rencontrée hier, nous a dit qu’elle ne voyait jamais les élus, mais seulement l’administration. Il faut seulement que, parfois, la règle du jeu soit plus claire pour que le contrôle démocratique puisse s’exercer.
Mme Valérie Fourneyron. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir reconnu franchement que l’État devrait sans doute s’impliquer davantage pour un certain nombre de collectivités. J’entends bien ce que vous dites au sujet du contrôle de légalité – notamment que les contrats d’emprunt sont des contrats de droit privé – et de l’autonomie des collectivités locales. Mais dans le cas de ma collectivité, la nouvelle équipe municipale a hérité d’un endettement constitué à 85 % de produits structurés. À aucun moment les services de l’État n’avaient donné l’alerte, y compris à l’approche des périodes électorales. Le premier courrier que la préfecture nous ait adressé sur le sujet est daté de février 2011, et il nous alertait sur la toxicité d’un produit que nous étions en train de renégocier, pour ramener le multiplicateur de 5 à 4 ! Il y a de quoi sourire !
Nous renégocions les produits au fur et à mesure, mais quand l’on n’est plus dans la période des taux bonifiés. Nous saisissons alors l’ensemble des outils mis à notre disposition, à commencer par la charte Gissler et le médiateur Gissler. Mais dans certains cas, les propositions de sortie des banques – en particulier celles qui n’ont aujourd’hui qu’une très faible partie de leur activité en France, et que nous avons auditionnées, comme la Royal Bank of Scotland ou la Deutsche Bank – ne sont tout bonnement pas acceptables. Nous avons donc besoin d’une réponse sur le stock de ces produits et sur la possibilité d’un investissement de l’État. Certes, nous sommes en mesure de négocier avec les banques dans un certain nombre de cas. Mais il y a des situations de blocage qui peuvent être dramatiques pour des petites communes, que la commission d’enquête a entendues, mais aussi pour de grandes collectivités très endettées – avec des taux d’intérêt qui dépassent l’entendement.
M. Patrice Calméjane. Notre Constitution pose en effet le principe de la libre administration des collectivités locales, monsieur le ministre, mais « sous l’autorité du contrôle de l’État ». Cela peut faire l’objet de vastes débats, mais l’important est de trouver la juste mesure.
Nous sommes là pour trouver des solutions qui permettent de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Les anciens préfets et les trésoriers-payeurs généraux nous ont dit qu’ils n’avaient pas à se prononcer sur le contenu des contrats. La semaine dernière, l’Autorité de contrôle prudentiel nous a déclaré que cela relevait du législateur, ce à quoi nous avons répondu que, si elle avait eu la courtoisie de nous avertir, nous aurions pu faire évoluer la législation ! Ma première question est donc la suivante : le ministère de l’intérieur a-t-il été averti par l’Autorité de contrôle prudentiel que certains produits pouvaient devenir dangereux pour les collectivités ?
Vous l’avez dit, les seize ratios de la loi du 6 février ne sont pas suffisants pour vérifier qu’une collectivité agit correctement, notamment en ce qui concerne ces produits particuliers. Je rappelle tout de même qu’une collectivité territoriale est tenue de faire figurer dans l’état annexe de la dette les emprunts non amortis, et d’intégrer l’amortissement et les frais financiers y afférant et les prévisions de dépenses, sous peine d’affecter l’équilibre réel du budget en cause. Or pour ces produits, on ne connaît le taux d’intérêt que pour les deux, trois ou cinq premières années, selon les cas. Ensuite, on passe à un taux variable. Comment garantir la sincérité d’un budget dans ces conditions ? Même si – vous l’avez dit – le responsable est celui qui a signé le contrat, les services de l’État – préfectures, trésoriers-payeurs généraux – auraient pu, dans le cadre de leur mission de conseil et de surveillance, s’en inquiéter. Nous leur avons d’ailleurs demandé s’il existait des réseaux d’alerte et si le sujet avait donné lieu à des discussions entre eux. Je conçois difficilement que l’on puisse accepter des budgets dans lesquels figurent des valeurs de remboursement d’emprunt pourtant impossibles à connaître au moment du vote… Ces produits auraient donc dû être interdits dès l’origine. Certes, le principe d’annualité budgétaire s’impose à la plus petite collectivité comme à l’État, mais cette difficulté aurait dû éveiller l’attention, d’autant qu’il existe une jurisprudence du Conseil d’État sur ce type de déséquilibre budgétaire – je pense par exemple à l’absence de provisionnement.
Le débat ne se limite d’ailleurs pas au problème de l’emprunt : nous avons la même difficulté avec un certain nombre de contrats pluriannuels signés par les collectivités, dans lesquels les frais susceptibles de venir en supplément ne sont pas toujours lisibles à l’origine. Les recommandations que vous pourriez faire au sujet des emprunts pourraient donc être étendues à ces contrats pluriannuels.
M. Henri Plagnol. Mes observations rejoignent celles qui viennent d’être présentées. Votre tâche n’est pas facile dans la situation qui est aujourd’hui celle de la zone euro. Nous l’avons constaté dans le débat sur la recapitalisation de Dexia et les conditions dans lesquelles la contre-garantie de l’État pour les créances toxiques serait ou non engagée, l’État ne souhaitant en aucun cas que l’on puisse accréditer l’idée que cette contre-garantie serait amenée à jouer.
Nous sommes tout aussi conscients que les collectivités locales sont autonomes : par conséquent, lorsque les élus ont fait des choix erronés engageant gravement les finances de leur collectivité, celle-ci doit faire un effort. Mais là où nous ne pouvons plus suivre, c’est lorsqu’on soutient que l’État n’a pas de responsabilité, car c’est faux – et la Cour des comptes elle-même le dit. L’État a une mission d’alerte et de contrôle général. Or aucun des dispositifs n’a fonctionné. J’insiste notamment sur la responsabilité de la direction générale des collectivités locales (DGCL). La responsabilité de l’État est donc engagée.
L’État a un intérêt majeur à ce que l’on trouve des solutions reposant sur la médiation et la négociation car plus le temps passe, plus l’addition peut se révéler gigantesque. Je rappelle qu’à l’appui de son refus de reprendre les créances les plus toxiques dans son bilan, la Caisse des dépôts a estimé que les pertes potentielles n’étaient même pas chiffrables. La thèse selon laquelle il pourrait y avoir un retour à la normale est beaucoup trop dangereuse. Les collectivités locales qui n’ont pas d’autre issue, qu’elles soient petites ou plus grandes, – je rejoins ici le témoignage de Mme Fourneyron, députée-maire de Rouen : nous sommes peu ou prou dans la même situation, déjà surendettées, avec des dettes composées à plus de 90 % de prêts toxiques – choisiront en effet d’aller en justice. Or la multiplication des contentieux serait une catastrophe. C’est un jeu « perdant-perdant » : pour les banques, car rien n’est pire que l’incertitude pour les marchés ; pour les collectivités locales puisque les contentieux ne sont pas suspensifs et que l’on ignore ce que sera la jurisprudence – dans l’intervalle, l’emprunt est gelé, et c’est la mécanique folle de ce système qui s’applique – ; enfin, pour l’État, dont la contre-garantie, notamment dans le cas de Dexia, devra jouer. Tout le monde a donc intérêt à une solution intelligente. Celle-ci consiste probablement – c’est l’une des pistes qu’explore la commission d’enquête – à cantonner le stock des prêts pour lesquels il n’y a pas de solution facile, non pour que l’État règle la totalité de l’addition, mais pour permettre une gestion dans la durée qui minimise les conséquences financières. Le terme de structure de défaisance n’est d’ailleurs sans doute pas le bon. Nous avons donc besoin du concours du Gouvernement. Les collectivités locales sont désireuses de jouer le jeu de la médiation – c’est en tout cas ce que fait la mienne – mais celle-ci touche à ses limites.
Ne partons donc pas sur un malentendu : collectivités locales, banques et État ont un intérêt commun à trouver des solutions rapides et non contentieuses.
M. Jean-Louis Gagnaire. Lorsque plus de 5 000 collectivités sont contaminées, le sujet dépasse les clivages politiques, certaines étant tenues par la majorité parlementaire, d’autres par l’opposition. La médiation atteindra vite ses limites. Le médiateur nous l’a d’ailleurs dit, il n’a pas les équipes nécessaires pour faire face à toutes les demandes de médiation. Il subsistera donc un stock que la médiation et la négociation ne permettront pas de résorber. Par conséquent, il faudra bien que l’État s’en mêle, ne serait-ce que parce que nombre de maires que nous avons entendus – notamment de petites communes – sont tentés de remettre les clés de leur mairie au préfet, car ils sont dans l’incapacité d’augmenter les impôts dans des proportions insupportables. C’est pourquoi nous cherchons une sortie acceptable pour tous. Je n’ai entendu aucun élu refuser de rembourser les prêts, notamment le nominal. La question est de savoir comment ils peuvent renégocier ces prêts avec une soulte supportable, ou les rembourser sans intérêts ni pénalités excessifs. Nous avons bien compris le rôle particulier qu’avait joué Dexia dans cette affaire, mais compte tenu de sa situation actuelle, la charge retombe sur la Caisse des dépôts et sur la Banque postale, et in fine sur l’État.
Le temps est désormais compté, monsieur le ministre : nous devons impérativement mettre en place une solution d’ici les élections : au moment où le taux du crédit augmente fortement, il faut sauver ces 5 000 collectivités – encore ne sommes-nous pas sûrs qu’elles aient été correctement recensées. Bref, nous cherchons un chemin, et nous demandons au Gouvernement de nous y aider.
M. le président. Je demande aux derniers intervenants d’être très brefs. Le ministre doit en effet se rendre au Sénat, et je voudrais qu’il puisse nous apporter quelques réponses, même s’il aura sans doute à rencontrer le rapporteur pour entrer dans le détail des propositions sur le stock.
M. Jean-François Mancel. Cette commission d’enquête commençait à ressembler au choeur des pleureuses. Nous avons reçu beaucoup d’élus qui, chez eux, brandissent l’autonomie comme un étendard, mais qui, dès qu’ils sont à Paris, viennent demander le parapluie de l’État pour les protéger des erreurs qu’ils ont commises dans leurs départements, leurs communes ou leurs régions…
J’ai vécu l’époque – c’était il y a trente ans – où le délégué régional de la Caisse des dépôts imposait aux élus locaux un quota d’emprunts. Ceux-ci, de gauche comme de droite, ont donc applaudi à l’arrivée de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales (CAECL), du Crédit local de France et de Dexia ! Aujourd’hui, la conjoncture s’est retournée et on tape donc sur celui que l’on tient pour l’un des principaux responsables. Il y a là une vraie injustice. Rappelons-nous donc ce que nous disions il y a quelques années sur le sujet…
Enfin, s’il faut trouver une solution pour en sortir, il serait injuste et anormal que l’État assume seul aujourd’hui des responsabilités qui sont largement celles des élus locaux. On ne peut tout de même pas dire qu’en souscrivant un emprunt « pourri », on n’exerce pas au moins une part de responsabilité. Il est trop facile de refuser l’État quand tout va bien et d’ouvrir le parapluie quand cela va mal !
M. le ministre chargé des collectivités locales. Je suis en effet attendu au Sénat, et ne pourrai donc être aussi complet que je l’aurais souhaité dans mes réponses. Je vous prie de m’en excuser.
J’ai indiqué au début de mon propos – que certains n’ont pu entendre puisqu’ils participaient au vote dans l’Hémicycle – quelle était la position de l’État. J’ai illustré ce propos par des exemples que je connais bien, pour montrer que l’on ne pouvait généraliser l’analyse. Il y a en effet des cas, madame Fourneyron, pour lesquels nous ne pourrons faire autrement que de trouver une solution ciblée. Je pense aux petites collectivités qui ne disposaient pas de moyens d’expertise et n’ont pas été suffisamment alertées des risques qu’elles couraient, mais aussi à des collectivités plus grandes, qui ont une proportion importante d’emprunts structurés dans leurs emprunts. Lorsque les emprunts structurés, même importants, sont en quelque sorte noyés dans la masse, on peut s’en sortir. J’avais donné l’exemple d’une collectivité que je connais bien, qui a 750 millions d’euros de dette, dont 20 millions en emprunts structurés, et dont le taux moyen de remboursement – emprunts structurés compris – s’élève aujourd’hui à 3,09 %. Il y a donc des cas dans lesquels il n’y a pas de raison que l’État s’implique : la collectivité peut gérer seule. Dans d’autres cas, nous ne pourrons en revanche faire autrement.
Grâce à la charte Gissler et aux mesures que nous avons mises en place, nous avons fait en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas, et ceci dans le respect de la liberté des collectivités locales – que nous encadrons davantage. Je pense notamment à la nouvelle annexe budgétaire, qui sera améliorée et complétée pour éviter tout nouveau dérapage. Il faut en particulier régler la question des provisions, pour que les générations d’élus successives ne soient pas confrontées brutalement aux conséquences des choix – parfois très anciens – de leurs prédécesseurs. Nous assurerons ainsi une meilleure traçabilité, tout en sachant – comme l’a observé M. Calméjane – qu’avec les taux variables, il est parfois délicat d’apprécier le niveau des provisions à constituer. Grâce à la charte Gissler, nous avons exclu un certain nombre de prêts, qui ne peuvent plus être souscrits.
Je remercie M. Plagnol de sa modération.
Il nous faut d’abord recenser le plus complètement possible l’ensemble des situations. Nous avons entrepris cette démarche avec la DGCL. Pour répondre à la question de M. Calméjane, le ministère n’avait reçu aucune information particulière, notamment de l’Autorité de contrôle prudentiel, ni été alerté sur ces produits. Nous essayons actuellement, avec les préfets et les directions régionales des finances publiques, de procéder à un recensement le plus complet possible, afin de déceler les cas qui exigent une approche particulière. Car je le redis, nous ne pouvons adopter une approche généraliste et mettre en place la structure de défaisance que certains appelaient de leurs vœux. Les réponses aux différentes situations recensées ne pourront se construire que de façon partenariale, d’abord entre les collectivités et les banques. Sachez à cet égard que nous discutons actuellement avec les banques étrangères pour essayer de les faire entrer dans la démarche de la charte Gissler.
Pour les cas où il apparaîtra délicat de trouver des solutions sans l’intervention de l’État, nous réfléchirons à la place qu’il peut occuper dans le dispositif. Dans la conjoncture actuelle, l’État ne peut en effet éteindre l’incendie à lui seul, ni apporter la solution d’un coup de baguette magique.
M. le rapporteur. Il y a quelque chose de malsain dans les propos qui sont tenus depuis tout à l’heure. Il semblerait à les entendre que nous ayons déjà proposé des solutions. Or nous n’avons fait qu’écouter. Sans doute y a-t-il beaucoup de pleureuses, monsieur Mancel, mais il nous fallait écouter tout le monde. Nous avons commencé par entendre ceux qui avaient fait part de problèmes, puis tous les acteurs du dossier. Mais partir du principe que nous avons déjà proposé une structure de défaisance, et que l’État va payer, est un procès d’intention : la commission d’enquête n’a pas fini ses travaux.
M. le ministre chargé des collectivités locales. Il n’est nullement dans mes intentions de laisser entendre que des solutions auraient déjà été proposées par la commission d’enquête, monsieur le rapporteur. Je souhaite simplement vous dire la chose suivante. Nous dressons aujourd’hui un inventaire précis des différentes situations – que nous vous communiquerons – pour pouvoir avoir l’approche la plus fine possible. Nous encourageons les partenaires que sont les banques et les collectivités locales à sortir des emprunts toxiques dans tous les cas où cela paraît possible. Mais il y a des collectivités pour lesquelles ce n’est pas possible. Cela pourrait s’avérer plus facile à d’autres moments : les parités entre les monnaies peuvent évoluer ; rien ne dit qu’elles ne s’amélioreront pas en notre faveur. Si des retournements se produisent, il faudra en profiter. Il n’est donc pas certain qu’il faille systématiquement agir aujourd’hui. Nous devons envisager les différentes situations de la manière la plus sereine possible. C’est ce que vous êtes en train de faire, et je vous redis la disponibilité de l’État.
M. le rapporteur. Nous savons bien qu’il peut y avoir des changements, monsieur le ministre. La difficulté va tenir – même si nous n’avons pas pris de décisions – à la gestion de la période de retournement de cycle. Nous faisons bien la différence entre un intérêt normal, et une partie des intérêts, qui sont toxiques. La question est de savoir comment gérer cette dernière en attendant une amélioration. À ce jour, personne n’a proposé de solution – nous n’avons fait qu’écouter. Nous avons bien sûr confiance en l’État, mais nous ignorons quel acteur sera en première ligne. En tout état de cause, et comme l’a dit M. Gagnaire, aucune collectivité ne refuse de payer. Mais dans la mesure où le phénomène touche 5 000 collectivités, nous devrons bien proposer une solution cohérente.
M. le président. Le retournement de cycle est très compliqué à prévoir. En 2008, lorsque j’ai découvert, en même temps qu’un certain nombre d’élus, les premiers effets négatifs des produits structurés, les banques m’ont dissuadé d’en sortir et assuré que – compte tenu de la parité entre l’euro et le franc suisse à l’époque – la situation ne pourrait que s’améliorer. Nous avons vu…
M. le ministre chargé des collectivités locales. Je me tiens à la disposition du rapporteur pour compléter mes réponses si vous le souhaitez.
M. le président. Je vous remercie, monsieur le ministre.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur le thème : « Quelle diversification du financement des acteurs publics locaux ? », avec M. Olivier Landel, délégué général de l'association d'étude pour l'Agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) et délégué général de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF)
(Procès verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous accueillons maintenant M. Olivier Landel, délégué général de l’association d’étude pour l’Agence de financement des collectivités locales (AEAFCL) et délégué général de l’Association des communautés urbaines de France (ACUF).
L’association d’étude a été créée en avril 2010 par Jacques Pélissard, président de l’association des maires de France (AMF), par Gérard Collomb, président de l’ACUF et par Michel Destot, président de l’association des maires de grandes villes de France (AMGVF). Quatre autres associations ont ensuite adhéré au projet, ainsi qu’une cinquantaine de collectivités.
Merci, monsieur Landel, d’avoir accepté de répondre à nos questions.
M. Olivier Landel prête serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. La période récente a vu le développement d’émissions obligataires, en particulier pour les grandes collectivités. D’autres, de taille plus modeste, s’interrogent aujourd’hui. L’agence a-t-elle vocation à remplacer ce type d’émissions ?
En second lieu, le contrôle par un établissement public de la société anonyme que vous vous proposez de créer garantira-t-il une bonne gouvernance ? Les collectivités représentées au sein de l’établissement public ne risquent-elles pas d’influer sur l’octroi des prêts et sur leurs conditions ?
M. Olivier Landel, délégué général de l'association d'étude pour l'agence de financement des collectivités locales (AEAFCL). Notre objectif est de permettre à l’ensemble des collectivités territoriales d’accéder au marché obligataire. Depuis 2004, les communautés urbaines réalisent déjà des émissions obligataires groupées et les collectivités locales peuvent accéder individuellement au marché, mais seules les plus grandes d’entre elles sont concernées, car il faut émettre d’importants volumes pour amortir les coûts de transaction et acquérir la visibilité nécessaire. À l’image des Länder allemands, ces collectivités sont connues sur les marchés et notées – elles émettent régulièrement entre 500 millions et 1 milliard d’euros sans intermédiation bancaire.
Lorsque cette initiative a vu le jour, en 2004, les directeurs financiers des communautés urbaines s’inquiétaient déjà d’un certain resserrement de l’offre de crédit : ils constataient que le nombre des acteurs intéressés se réduisait et que la concurrence n’était pas aussi vive qu’on pouvait le souhaiter. Peu désireux de mettre tous leurs œufs dans le même panier, ils voulaient diversifier l’accès aux ressources financières.
Nous avons adopté une forme juridique inédite pour procéder à des émissions groupées. Première contrainte, tous les emprunteurs devaient recevoir leur argent en même temps et dans les mêmes conditions. Deuxième contrainte, au plan matériel, il n’existe qu’un seul contrat, signé le même jour par l’ensemble des présidents des communautés urbaines. Troisième contrainte, nous avons choisi des obligations amortissables – 95 % du marché sont constitués de prêts remboursables in fine, auxquels seuls certains grands émetteurs, tels que la Ville de Paris et la région Île-de-France, ont recours car ils arrivent à reconstituer, en combinant différentes durées, une courbe d’amortissement de la dette qui ressemble à celle de prêts amortissables.
Malgré toutes ces contraintes, auxquelles s’ajoutent l’obligation d’être noté et celle d’être éligible à la Bourse de Paris, avec ce que cela implique en matière de documentation, nous avons obtenu des prix avoisinant 11 points de base pour la première année, et 3 ou 4 points à partir de la quatrième année. Grâce à ces émissions, nous avons également su à quel prix on pouvait nous prêter de l’argent et à quel prix les investisseurs prêtaient de l’argent aux banques. Tous les établissements bancaires ont, en effet, des foncières – DexMA pour Dexia et le Crédit foncier de France pour les Caisses d’Épargne –, chargées d’émettre des obligations et de revendre, sous forme de prêts, les fonds obtenus. Nous avons constaté que ces acteurs étaient capables de nous revendre de l’argent moins cher qu’ils ne l’avaient acheté. Cherchez l’erreur ! Ces banques rétablissaient leurs marges ensuite grâce aux produits structurés.
Notre idée est de permettre à l’ensemble des collectivités d’accéder directement au marché obligataire, sans intermédiation bancaire mais sans se substituer totalement aux banques, qui peuvent réaliser des opérations que nous ne pouvons pas faire. Il s’agit de compléter l’offre et de la diversifier, tout en montrant que nous comprenons le métier des banques et la manière dont sont formés les prix. Au demeurant, on peut penser que si les communautés urbaines ont eu moins recours aux emprunts structurés que d’autres, c’est peut-être parce qu’elles ont eu plus tôt conscience des anomalies du système.
Ce projet n’est lié ni à la crise de 2008, ni à celle de 2010. Il n’est donc pas conjoncturel. Dès 2007, nous avons souhaité élargir le cercle des collectivités participant aux émissions. D’autres collectivités étaient désireuses de nous rejoindre, mais nous ne pouvions pas augmenter le nombre des signataires du contrat, déjà important, même si nous étions intéressés par une augmentation des montants levés sur les marchés – nous empruntions 100 millions d’euros par an, ce qui était très peu.
Afin d’étendre l’opération à d’autres collectivités, nous avons lancé, en 2008, une émission obligataire un peu particulière, qui devait être la dernière de ce genre. Limitée à trente collectivités et portée à 250 millions d’euros, elle répondait à un cahier des charges qui tendait à engager une réflexion sur un véhicule de financement intermédiaire entre les marchés et les collectivités territoriales. Un pré-rapport d’étude a ainsi été remis dès janvier 2009.
Alors que l’opération était prévue pour le mois d’octobre 2008, en pleine crise, nous avons tout de même pu émettre. Le prix, 104 points de base, a semblé exorbitant, mais il ne paraît plus ridicule aujourd’hui. Du reste, nous avions conseillé aux collectivités de ne pas recourir à cette émission, car le dépannage proposé par la Caisse des dépôts, compris entre 75 et 80 points de base, était plus intéressant. Vingt-trois collectivités ont toutefois participé à l’émission, puis elles nous ont poussés à aller plus loin, et à constituer une agence de financement offrant aux investisseurs un risque qu’ils apprécient, celui des collectivités locales.
Si les banques ne leur prêtent plus aujourd’hui, ce n’est pas parce que le risque collectivités serait de mauvaise qualité, mais à cause d’autres facteurs tels que les ratios de fonds propres et le choix délibéré qui a été fait, compte tenu de la raréfaction des liquidités, de privilégier une clientèle plus rémunératrice – les collectivités rapportent moins dès lors qu’elles n’achètent plus de produits structurés et l’obligation de déposer leurs fonds au Trésor leur interdit les placements financiers. Je précise que nous ne souhaitons pas d’évolution sur ce point.
La création de l’agence évitera, à l’avenir, de recourir à des émissions obligataires individuelles, même si certaines collectivités, dont la signature est reconnue, pourraient avoir intérêt à conserver leur autonomie. Notre rapport d’étude, rédigé à la suite d’un dialogue compétitif, remis cet été et présenté à l’assemblée générale en septembre dernier, a montré que l’agence aura pour vertu d’assurer la liquidité des titres. Nous avons constaté, en effet, que les structures similaires ont continué à émettre sans difficulté en 2008 et 2011 aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves, et cela à des prix plus bas que ceux que nous avons connus en France. Les acteurs de ce genre sont toujours plus liquides – ils ont survécu à la crise de 1929 quand ils existaient déjà – et toujours moins chers que les autres. Les investisseurs préfèrent, en effet, prêter à une agence publique détenue par des propriétaires de fonds publics locaux plutôt qu’à des structures qui peuvent faire faillite.
J’en viens à nos choix en matière de gouvernance. Nous avons retenu une structuration en deux étages : un établissement public local et une société anonyme. L’établissement public sera la propriété exclusive des collectivités : bien que cette idée colle au projet comme un sparadrap, nous n’avons jamais envisagé une garantie de l’État. On affirme souvent que le projet ne se réalisera jamais, faute d’obtenir la garantie de l’État. Or, il n’en a jamais été question. L’établissement public détiendra la société anonyme, laquelle sera son bras armé. L’opérationnel sera assuré par des professionnels de la finance (auxquels, par ailleurs, on pourrait utilement faire appel pour conseiller les collectivités sur le stock des produits structurés). Dans le cadre de l’Agence de financement des investissements locaux (AFIL), leur mission sera double : présenter l’agence aux investisseurs et accorder des prêts aux collectivités territoriales.
Je tiens à préciser qu’il n’y aura pas de distorsion de maturité. DexMA a contribué aux difficultés de Dexia parce qu’elle empruntait court pour prêter long. L’agence empruntera et prêtera sur les mêmes durées, ce qui signifie que plus les emprunts seront longs, plus leur coût sera élevé.
Comment éviter d’accorder des traitements préférentiels à certaines collectivités ? La double structuration retenue devrait nous protéger : les élus membres de la structure de tête auront, en effet, collectivement intérêt à ce que l’agence obtienne les meilleurs prix possibles. Il faudra donc respecter des règles imposées par le marché et par l’Autorité de contrôle prudentiel. Les marchés demanderont, en particulier, que l’agence ait une note. Plus celle-ci sera élevée, meilleurs seront les prix. Ils voudront aussi que l’agence prête à des risques sains et qu’elle ne fasse pas d’exceptions à ses propres règles – conditions d’accès au financement ou conditions de taux en fonction de l’analyse financière de la situation des collectivités.
Les règles établies par la structure de tête seront appliquées par la structure émettrice sans aucune possibilité de dérogation, et elles seront connues de tous. Une collectivité désireuse d’adhérer à l’agence pourra ainsi réaliser ses propres tests : elle saura si elle peut être acceptée et à quel prix un prêt pourrait lui être consenti. Une fois membre de l’agence, elle aura intérêt à ce que les règles continuent d’être respectées, car l’acceptation d’un « vilain petit canard » ne pourrait se faire qu’au détriment de l’ensemble du système.
Par conséquent, la double gouvernance devrait garantir une certaine forme de solidité. Ce n’est pas qu’un vœu pieux, car c’est aussi ce qui ressort des comparaisons internationales que nous avons réalisées. La déconnexion entre le cadrage stratégique et l’outil opérationnel permet d’éviter la gestion de cas particuliers, à l’initiative des élus comme des professionnels – il existe aussi des dérives dans les structures privées.
M. Henri Plagnol. Merci pour ce très intéressant exposé. La porte sera-t-elle ouverte aux collectivités ayant une dette élevée, dont une part importante sous forme d’emprunts structurés ?
M. le rapporteur. Par ailleurs, des évolutions juridiques sont-elles nécessaires pour permettre la création de cette agence ? Avez-vous besoin d’une intervention du législateur ?
M. Olivier Landel. Oui, et il y a même urgence.
Pour ce qui est des produits structurés, il est certain que l’on n’en serait pas là aujourd’hui si ce type d’agence avait existé : on aurait eu un référentiel en matière de prix, et celui-ci aurait été moins élevé.
Pour adhérer à l’agence, les collectivités devront verser un ticket d’entrée et se soumettre à une analyse financière, laquelle prendra bien sûr en considération les prêts structurés. À cet égard, je rappelle que les collectivités potentiellement exposées à de sérieuses difficultés ne sont pas très nombreuses. Une grande majorité de collectivités pourra adhérer sans difficulté à l’agence, y compris celles qui ont des emprunts structurés.
Nous avons prévu six niveaux. Au sixième, les collectivités ne pourront pas adhérer en l’état, et les cinq autres niveaux correspondent à un différentiel de prix. Une analyse financière sera menée à chaque demande de prêt : il ne s’agit pas d’un dû.
M. le rapporteur. C’est une charte Gissler inversée...
M. Olivier Landel. J’avais dit à M. Gissler qu’il n’y avait pas besoin de charte si l’on créait l’agence.
J’en viens aux évolutions juridiques nécessaires. Nous avons préparé une proposition de loi et des amendements, qui ont été signés par Jacques Pélissard, Christian Estrosi et Charles de Courson, ainsi que par Michel Destot, Dominique Baert et tous les membres du groupe socialiste. La constitution d’un EPIC propriétaire d’une société anonyme nécessite la création d’une nouvelle catégorie d’établissements publics. Comme on se heurte à l’article 40, c’est au Gouvernement de prendre l’initiative. En l’absence d’action de sa part, deux amendements demandant un rapport sur les conséquences financières de la création de l’agence ont été adoptés la nuit dernière. Comme ce rapport existe déjà, il s’agit, en réalité, de demander au Gouvernement de prendre position.
Je le répète : même si la création de l’agence n’est pas un projet conjoncturel, la conjoncture rend la question plus pressante. Si l’on en croit la Caisse des dépôts et la Banque postale, le repreneur de Dexia ne devrait tenir qu’entre 20 et 25 % du marché ; le Crédit agricole et la Caisse d’épargne, qui se sont complètement retirés du jeu au cours des derniers mois, reviendront aussi, mais pour seulement 20 ou 25 % du marché chacun.
M. le rapporteur. À cause de Bâle III.
M. Olivier Landel. Tout à fait. Il n’y a pas de raison que ces établissements ne s’intéressent pas aux collectivités locales, même si ce marché est peut-être moins rémunérateur que d’autres. Il reste utile et intéressant d’aider le financement de l’investissement local : s’il n’y a plus d’investissement public local, les entreprises n’auront plus de marché et les clients des banques seront à leur tour pénalisés. Ces dernières n’ont donc aucun intérêt à assécher le marché des collectivités territoriales.
De manière générale, le paysage a complètement changé : on est passé d’une situation où la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités locales, la CAECL, dépendait entièrement de l’État à un système obéissant à des intérêts qui ont peu à peu cessé de correspondre aux priorités des collectivités locales – on a perdu, en partie, ce qui faisait le sens du financement des investissements publics locaux.
Avec la création de l’agence, nous proposons de faire de la « coopétition » : à côté des agents dotés de capitaux publics – la Caisse des dépôts et la Banque postale –, avec toute la rigueur et les priorités que cela implique, il y a aura non seulement le secteur privé, mais aussi un nouvel instrument appartenant aux collectivités locales et travaillant pour elles, sous leur gouvernance. Si la loi est votée cette année, on devrait rapidement observer une diversification de l’offre.
Pour favoriser la concurrence, l’agence ne prêtera pas au-delà d’un certain pourcentage des besoins de chaque collectivité. Il nous paraît indispensable, en effet, que l’agence ne soit pas seule présente sur le marché – on risquerait alors de retomber dans des travers que l’on a constatés dans le passé.
Qui plus est, les investisseurs s’intéressant à l’agence ne seront pas les mêmes que ceux des banques. Quand on prête à une foncière, on prête à une banque, ce qui justifie une différence de prix. Même si les foncières et l’agence ont la même note AAA, les investisseurs feront la distinction, comme ils le font entre la France et l’Allemagne.
M. Jean Proriol. Pensez-vous, monsieur le délégué général de l’Assemblée des communautés urbaines de France, que les petites communautés pourront accéder à l’agence que vous défendez ?
Je me demande, par ailleurs, dans quelle mesure la structure à deux étages que vous proposez est inspirée de celle du Crédit agricole. À la suite de certaines opérations, notamment celles qui ont été réalisées en Grèce, les dirigeants des caisses régionales ont pris le pouvoir sur la direction générale. Est-ce le schéma que vous avez suivi ?
M. Olivier Landel. C’est d’abord aux petites collectivités que nous avons pensé. Les régions et les départements réalisent déjà ce type d’opérations, voire les communautés urbaines, mais elles le font rarement seules. Outre les questions de coût des prospectus et de communication, il y a un intérêt à agir ensemble. Nous souhaitons donc nous adresser à l’ensemble des collectivités.
Les agences de notation considèrent aujourd’hui le risque local français comme quasiment souverain. Cela dit, on peut toujours tomber sur un « vilain petit canard » à cause de la grande dispersion qui prévaut. Pour y remédier, notre idée est de diluer le risque en le structurant.
M. le rapporteur. Il me semble que les difficultés actuelles ne sont pas tant liées aux emprunts structurés qu’à un problème de liquidité auquel on est confronté quand on doit investir beaucoup. Mon agglomération est certes de taille moyenne – elle compte environ 130 000 habitants –, mais les projets sont volumineux : la SEM devrait porter 800 millions d’euros sur les quinze années à venir. Pouvons-nous aller tout seuls sur le marché obligataire ?
M. Olivier Landel. Bien sûr, mais ce serait beaucoup moins cher à plusieurs, et beaucoup plus liquide.
M. le rapporteur. Il y a aussi l’image. Or, l’emprunt est moins personnalisé quand on est noyé dans la masse.
M. Olivier Landel. L’image vendue par l’agence ne sera pas celle de chaque collectivité prise individuellement. De même qu’il existe une Agence France Trésor, il y aura une Agence française de financement des investissements locaux, qui aura sa propre image pour les marchés.
Pour les collectivités, il ne s’agira pas d’une émission obligataire, mais d’un emprunt auprès de l’agence qui émettra sur les marchés. Si elles le souhaitent, les collectivités pourront toutefois continuer d’émettre directement.
Je ne peux pas vous apporter de réponse précise sur le fonctionnement du Crédit agricole, mais j’ai le sentiment que nous avons construit l’agence dans le bon sens, en précisant clairement qui sont les patrons et les opérationnels.
M. Jean-Louis Gagnaire. En attendant la création de l’agence, ne pensez-vous pas que les émissions d’emprunts obligataires par les plus grandes collectivités pourraient profiter au financement des plus petites ? Les banques affirment, en effet, qu’elles n’ont pas les moyens de prêter à tous.
M. Olivier Landel. Je ne le crois pas. Les grandes collectivités empruntent beaucoup à chaque fois, de sorte que les émissions obligataires peuvent effectivement libérer de la liquidité, mais les petites collectivités prises globalement représentent des montants non négligeables. Il s’agirait d’une solution très provisoire.
En attendant que l’agence soit opérationnelle – il faudra un an –, nous proposerons une nouvelle émission groupée, semblable à celles que nous avons précédemment réalisées et moins intéressante que ce que nous pourrions faire grâce à l’agence. Nous avons, par ailleurs, transmis toute notre documentation juridique aux hôpitaux, lesquels réalisent des émissions obligataires groupées suivant le modèle développé par les communautés urbaines.
M. le rapporteur. Nous avons vu, avec la Grèce, que certains acteurs étaient plus faibles que d’autres. L’agence ne risque-t-elle pas d’accepter des « moutons noirs », sans autofinancement net, qui risquent de ternir son image ?
M. Olivier Landel. Si l’on a accepté des « vilains petits canards » dans l’euro, c’est parce qu’il n’existait pas de règles ni de tests d’entrée. Or l’agence aura des règles, connues de tous. Ceux qui ne sont pas susceptibles d’adhérer tout de suite ne proposeront pas leur candidature avant d’avoir amélioré leur situation.
L’agence suédoise Kommuninvest a, du reste, constaté que la situation financière de l’ensemble des collectivités s’assainissait peu à peu, en raison d’un effet vertueux : pour faire partie de ce club qui permet d’emprunter moins cher, on essaie d’avoir les meilleurs ratios possibles. Il y a là une démarche qui me paraît beaucoup plus efficace que les règles tendant à encadrer les dépenses publiques ou les dispositifs tels que la charte Gissler. Il y a un intérêt partagé à avoir des partenaires dont la situation financière s’améliore.
M. le président. Il me reste à vous remercier.
*
* *
Suite de la table ronde du 18 octobre 2011, ouverte à la presse, sur « les produits financiers à risque », avec M. Michel Klopfer, président et fondateur
du cabinet Klopfer
(Procès verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous avons souhaité vous entendre, monsieur Klopfer, pour votre grande expérience des finances locales.
Nous sommes désormais bien informés sur le processus qui a conduit à l’apparition des produits structurés et au remplacement progressif des emprunts à taux fixes et à taux variables, jusque-là de règle. Comment vous avez réagi à cette évolution ? Avez-vous conseillé des produits structurés à vos clients ? Leur avez-vous adressé des mises en garde ?
Considérez-vous que les banques, que nous avons reçues, pèchent par omission quand elles réfutent avoir mené une politique commerciale offensive – donner aux commerciaux, par exemple, la consigne de renégocier les contrats tous les deux ans –, ou quand elles nient avoir une marge supérieure sur les produits structurés ?
M. Michel Klopfer prête serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Quelles mesures faudrait-il adopter, selon vous, pour protéger demain les collectivités territoriales ? Faudrait-il soumettre les emprunts au code des marchés publics, puisqu’ils échappent largement au contrôle de légalité ?
Les collectivités étant des structures très particulières, notamment dans leurs relations avec les banquiers, j’aimerais savoir quel regard vous portez sur elles. Faut-il les considérer comme de simples personnes morales ou comme des entreprises ?
M. Michel Klopfer, président et fondateur du cabinet Klopfer. En novembre 1994, j’ai été invité par la chambre régionale des comptes d’Aquitaine à animer une formation sur la gestion de dette. Son président, Alain Pichon, a ouvert la séance en me demandant à quel moment il fallait « épingler » les collectivités : fallait-il attendre qu’elles aient perdu de l’argent ? Pour montrer qu’on ne pouvait pas se contenter d’une politique de résultat, je lui ai demandé s’il regretterait d’avoir versé des primes d’assurance contre l’incendie si jamais le magnifique hôtel particulier qui abrite la Chambre régionale, place des Grands hommes à Bordeaux, ne brûlait pas au bout de dix ans. Si j’avais été plus impertinent, je lui aurais posé la question suivante : aurait-il le sentiment d’avoir réalisé une bonne opération s’il avait raflé la mise en pariant le budget de son institution sur le bon cheval dans la 5e course à Longchamp ?
À cette époque, il n’était pas encore question des produits dits « structurés » : il n’existait alors que des produits classiques, tels que les taux fixes, l’Euribor ou le taux annuel monétaire (TAM). Quand le dossier est devenu d’actualité, en octobre 2008, j’ai constaté qu’il y avait souvent une confusion entre les emprunts structurés et ceux à taux variable. Les emprunts à taux variable étant parfaitement corrélés à la structure des budgets, je n’ai rien à en dire. Si je vous ai parlé d’assurance, en revanche, c’est que les produits structurés ont conduit à une situation de contre-assurance. Lorsqu’on s’assure contre l’incendie, les dégâts des eaux ou le vol, on verse quelques centaines d’euros pour être remboursé en cas de sinistre. Or, on a demandé aux collectivités de vendre une assurance : elles ont touché quelques centaines d’euros – c’est la « bonification » bien connue –, pour couvrir les banques contre un risque potentiellement illimité.
Qu’avons-nous fait pendant cette période ? Étant composé d’une quinzaine de personnes, mon cabinet ne peut pas être présent partout. Nous avons tout de même dissuadé un certain nombre de collectivités d’acheter des produits structurés. Lorsque je suis passé dans l’émission d’Yves Calvi, j’ai cité deux grands départements, l’un dirigé par la gauche, l’autre par la droite, le Pas-de-Calais et le Bas-Rhin, qui ne détiennent pas un seul produit structuré.
Pour éviter que la situation actuelle ne se reproduise, il faut comprendre comment on en est arrivé là : il y a eu un effet d’accumulation, qui résulte de la pression exercée par les banques. On aurait d’ailleurs pu aller plus loin : si les élections municipales avaient été décalées d’une année supplémentaire – elles l’ont déjà été de 2007 à 2008 –, les multiplicateurs seraient probablement passés de 5 ou 7 à 10 ou 12. Comme dans « Fantasia », le dessin animé de Walt Disney où les balais de l’apprenti sorcier se multiplient, l’on a fini par ne plus rien maîtriser, contrairement à ce que les banques pensaient.
Lorsque les premiers produits structurés sont apparus, en 1996, ils n’étaient pas bien méchants : il s’agissait de swaps permettant de passer du Pibor à un taux post-fixé, avec une marge zéro – on arrondissait ensuite la marge de la banque en faisant croire au client que l’opération lui coûtait moins cher. Puis, on est progressivement passé à ce que j’ai appelé, dans plusieurs articles, des « tartes aux fraises » : pour que le produit se vende, on a donné aux clients l’impression qu’ils payaient moins cher, en leur offrant des petites « douceurs » au cours des premières années. Or, il fallait bien rémunérer ces « douceurs » et les marges des banques.
Quand les banques se sont aperçues que ces opérations étaient extrêmement profitables, elles les ont industrialisées. Elles ont demandé à leurs commerciaux de proposer de nouvelles renégociations. De grandes collectivités, notamment des départements et des régions, ont ainsi présenté en séance plénière ou en commission permanente des renégociations de dette en affirmant, la bouche en cœur, qu’elles avaient gagné de l’argent, comme si le banquier avait été pris de sympathie à leur égard et leur avait proposé, dans un jeu à somme nulle, de gagner de l’argent contre lui, ce qui est naturellement impossible. Quand on a accordé jusqu’à trois fois deux années de « douceurs », avec trois doublements ou décuplements de marge, comment voulez-vous qu’on n’aboutisse pas à des produits assortis d’options astronomiques sur des durées de quinze ou trente ans ? Les cadeaux initiaux ont été amortis à coups de multiplicateurs de 5 ou de 10. Voilà ce qui s’est passé.
Lorsque la circulaire de 1992 a été conçue, j’ai été auditionné par la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et par la Direction de la comptabilité publique (DCP). À cette époque, des incidents avaient eu lieu au Royaume-Uni, à Hammersmith et à Fulham : des collectivités qui avaient « swapé » des montants dix ou cinquante fois supérieurs à leur encours d’emprunt ont réussi à faire condamner les banques par les tribunaux. J’ai donc demandé qu’on s’en tienne strictement au notionnel, ce qui a été fait – on ne peut pas « swaper » sur plus d’une fois son encours en France. En revanche, il est possible de mettre un multiplicateur de 5 ou 7 sur le taux d’intérêt, ce qui conduit exactement au même résultat.
En septembre 2004, à l’occasion d’une séance de formation destinée au bureau de la gestion financière de la DGCL – la M14 était en cours de révision –, j’ai donc attiré l’attention sur l’existence de faux taux fixes et j’ai demandé l’introduction de deux colonnes supplémentaires dans l’annexe sur l’état de la dette, l’une relative aux indices de taux qui peuvent, par leur comportement, modifier l’équilibre du contrat, l’autre sur les indices de change susceptibles d’avoir le même effet. J’ai été entendu. Cela étant, la face du monde n’a pas été bouleversée, car ces colonnes ne sont pas toujours bien renseignées et elles ne font pas partie des documents que tout le monde consulte. Je suis donc revenu à la charge au début de l’année 2007, quand la situation devenait explosive.
Quelle est la différence entre un emprunt structuré et un emprunt toxique ? Vous vous souvenez certainement qu’un volcan islandais est entré en éruption, il y a dix-huit mois, et que le ciel européen en a été perturbé pendant plus d’une semaine. Ce volcan est devenu toxique parce qu’il a perturbé la situation. D’autres volcans actifs, tels que l’Etna et le Stromboli, ne sont pas toujours toxiques, mais ils peuvent aussi se réveiller. De la même façon, on a vendu aux collectivités des produits structurés qui peuvent perturber leur équilibre financier jusqu’en 2030, voire jusqu’au début des années 2040.
J’ai alerté la DGCL sur ce risque et je lui ai demandé d’adopter une réglementation pour y remédier. En effet, si la M14 a permis d’éviter un certain nombre de dérives, notamment les « factures dans les tiroirs » – telle celle du feu d’artifice du 14 juillet, par exemple, qui n’était payée qu’en janvier –, ce problème est revenu par la fenêtre à cause des produits structurés, avec cette différence que le décalage ne se limite plus à une année : on paie les premières fusées trois ou cinq ans plus tard, et le reste pendant trente ans, avec un décuplement du coût. Dans un article publié dans La Gazette des communes, le 9 avril 2007, j’ai donc écrit ceci : « il serait dommageable d’attendre les audits municipaux de l’année prochaine pour que les cadavres sortent des placards ». Or, c’est exactement ce qui s’est produit.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Si l’euro repassait la barre de 1,50 franc suisse, le fonctionnement de la majorité des prêts structurés indexés sur cette devise redeviendrait normal. Ne faut-il donc pas faire la différence entre des emprunts structurés « structurellement » toxiques et d’autres dont le fonctionnement est lié à la conjoncture ? À part vous, visiblement, puisque vous avez prédit que tout finirait mal, personne n’avait envisagé le rapport actuel entre l’euro et le franc suisse.
M. Patrice Calméjane. Vous dites avoir alerté la DGCL, mais il y a aussi l’Autorité de contrôle prudentiel, qui vérifie pour les particuliers et les entreprises, mais aussi pour les collectivités territoriales, me semble-t-il, que les produits mis sur le marché sont respectueux et fiables. L’avez-vous alertée ? Vous a-t-elle répondu ? Sinon, à quoi sert-elle ?
M. Michel Klopfer. Je n’ai pas de relations avec l’Autorité de contrôle prudentiel.
Lorsque les premiers instruments financiers sont apparus – le Matif date de février 1986 et les swaps proposés aux emprunteurs et aux prêteurs se sont développés à partir de la fin des années 1980 –, un trésorier-payeur général a demandé au ministère des finances si les swaps dont il avait connaissance, par l’intermédiaire des comptables du Trésor, étaient légaux. On lui a répondu qu’en application de la loi du 4 septembre 1985, toute opération qui n’est pas spécifiquement réglementée est, par définition, autorisée. À la suite des incidents survenus au Royaume-Uni, la circulaire du 15 septembre 1992 a apporté une réponse qui était tout à fait adaptée en son temps. Mais l’ingénierie financière a considérablement évolué depuis et le texte est désormais complètement obsolète. Il me semble que la réponse apportée par la charte Gissler et par la circulaire du 25 juin 2010 n’est pas non plus à la hauteur de la situation.
En ce qui me concerne, je n’ai pas de carte tricolore et ma société n’est pas régie par un conseil de l’ordre, contrairement aux cabinets d’avocats et d’experts comptables. Nous devons donc définir nous-mêmes notre propre déontologie. Sur ce point, je peux vous dire que j’ai refusé de participer à certaines consultations pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage financière, notamment celles de Saint-Étienne métropole et de Rouen. Constatant que la rémunération proposée était exclusivement proportionnelle aux gains budgétaires de la première année, j’ai proposé un taux de 0 %, au risque de devoir travailler bénévolement, et j’ai signalé à ces collectivités qu’il était très dangereux de faire objectivement de leur conseil un allié de la banque, en l’intéressant aux gains réalisés en leur défaveur.
M. le président. Votre société a-t-elle proposé des produits structurés ?
M. Michel Klopfer. Bien sûr que non.
M. le président. Avez-vous alerté la DGCL par écrit ?
M. Michel Klopfer. J’ai rencontré, à quelques semaines d’intervalle, la DGCL et la DGCP. Bruno Soulié, alors sous-directeur de la DGCP, m’a demandé d’animer une formation pour les chefs des services des études économiques et financières du Trésor, qui s’est déroulée à la fin du mois de mars 2007. J’ai alors présenté un document écrit sous forme de Powerpoint. Je n’ai pas eu la même demande de la part de la DGCL.
M. le président. Vos clients vous paraissent-ils correctement équipés au plan humain et au plan technologique pour comprendre les risques et les marges des banques ? Considérez-vous que votre intervention a permis de rééquilibrer le rapport de force entre les banques et les collectivités ?
M. Michel Klopfer. Je ne voudrais pas que mon propos soit perçu comme une attaque en règle contre les banques en général, ou contre certaines d’entre elles. Les élus ont aussi une part de responsabilité au plan structurel : les banques – je pense à la Caisse des dépôts, à Dexia, à la Caisse d’Épargne et au Crédit agricole –, sont des acteurs extrêmement commodes pour eux. Je rappelle qu’il y a aujourd’hui environ 1 400 sociétés d’économie mixte (SEM), auxquelles il faut trouver des actionnaires minoritaires représentant entre 15 et 50 % du capital, et que 4 % des SEM distribuent des dividendes, ce qui est bien peu. Quand on ne verse pas de revenu financier aux actionnaires, il n’y a pas lieu de s’étonner qu’ils demandent, à un moment ou un autre, un renvoi d’ascenseur.
Et quand le directeur financier n’est pas suffisamment complaisant, c’est au directeur général des services, voire au maire ou au président de la collectivité qu’on s’adresse. Certaines opérations n’ont pu être conclues que grâce à un feu vert donné au plus haut niveau. S’il l’a été, j’imagine que c’est parce qu’on avait des services à demander aux banques au même moment.
Je rappelle, en outre, qu’une collectivité qui s’attache les services d’un cabinet de conseil n’est pas obligée de le consulter sur tous ses actes, ni de suivre son avis. La Cour des comptes a ainsi indiqué, dans un rapport, que mon cabinet avait déconseillé des produits structurés à un organisme de logement social du Nord de la France, sans être suivi pour autant.
En ce qui concerne le franc suisse, j’ai toujours veillé à présenter le risque de manière politique à mes interlocuteurs, afin de donner plus de poids à mon propos : lorsqu’on aménage une zone industrielle ou lorsqu’on achète un terrain pour faire venir une entreprise, on peut perdre de l’argent, faire face à un dépôt de bilan, voire à un chantage à l’emploi, mais on a une ligne de défense contre les critiques de l’opposition, de la presse ou de la chambre régionale des comptes : on a agi pour défendre l’emploi. Quand on boit le bouillon à cause du franc suisse, en revanche, on ne peut opposer aucun motif d’intérêt public. Une entreprise privée peut jouer à quitte ou double l’argent de ses actionnaires, en connaissance de cause, mais on ne peut pas en faire autant quand on est un acteur public. C’est pourquoi je considère que les ventes d’option devraient être prohibées.
J’ajoute que si les collectivités françaises ont évité le piège de placements tels que Icesave, dans lequel leurs homologues britanniques, allemandes et néerlandaises sont tombées, c’est sans doute grâce à l’existence des comptables publics. Les collectivités ont été hypnotisées par un très mauvais ratio : le coût moyen de la dette, qui est un faux critère, comme je l’indiquais déjà dans l’édition de 2005 de mon ouvrage, réédité cinq fois. Il est certes tentant de s’attribuer le ruban bleu de la collectivité la mieux gérée en affichant un taux moyen de la dette de 2 %, mais on peut aussi arriver à 0 % grâce à des ventes d’option susceptibles de conduire, par la suite, à un taux de 15, 20 ou 30 %.
Que penserait-on d’une compagnie d’assurance qui arrêterait ses comptes au 31 décembre en comptabilisant seulement les primes qu’elle a encaissées, et non la valeur mathématique correspondant à la valeur des sinistres qu’elle aura à rembourser ? Son bilan serait faux et le commissaire aux comptes ne le certifierait pas. De même, un constructeur automobile qui accorde à ses clients une garantie sur les pièces et la main-d’œuvre est obligé de comptabiliser au 31 décembre la valeur moyenne des sinistres historiquement constatés. Il faut adopter le même raisonnement pour les collectivités locales.
M. le rapporteur. L’argent étant une ressource comme une autre, pensez-vous qu’il faut appliquer le code des marchés publics aux emprunts ? La loi doit-elle, par ailleurs, imposer un « capping » ? Et s’il y a des incertitudes sur le coût de l’argent, faut-il instaurer des provisions obligatoires ?
En dernier lieu, je reviens sur ma question concernant la nature des collectivités : doit-on les considérer comme des entreprises quand elles s’adressent aux banques ou bien s’agit-il là, selon vous, d’une relation très particulière ?
M. Michel Klopfer. Comme je l’ai indiqué à Éric Gissler lorsqu’il a demandé à me rencontrer, en novembre 2008, peu après avoir été chargé de rédiger ce qui est devenu la charte portant son nom, des provisions sont nécessaires. On ne peut certes valoriser au mark to market – le calcul serait difficile et le contrôle par les préfectures impossible –, mais il faut imposer des provisions, sans quoi certains acteurs jureront, la main sur le cœur – et ils seront parfois sincères – qu’ils ont gagné de l’argent.
Pierre Richard, pour qui j’ai beaucoup de respect, du moins pour ce qu’il a été dans les années 1970 et 1980, vous a dit, au cours de son audition, qu’il a fait gagner de l’argent à ses clients. Or, quand on raisonne ainsi, c’est que l’on ne comptabilise pas les ventes d’options. Cela revient à affirmer que tout va bien quand on arrive au troisième étage, alors qu’on est en chute libre depuis le sixième. Dans certains cas, tout se passe bien, car l’option n’a pas joué. On peut toujours croiser les doigts pour l’avenir, mais une bonne gestion publique ne consiste pas à parier aux courses, même si cela permet parfois de décupler ou de centupler sa mise.
Même modestes, les provisions ont une valeur pédagogique. Quand elles existent on ne peut plus prétendre qu’on a gagné de l’argent. J’ai donc proposé à Éric Gissler une provision fondée sur le taux d’intérêt légal.
M. le rapporteur. Le taux effectif global (TEG) ?
M. Michel Klopfer. Le TEG, qui date de 1985 et qui est calculé selon la méthode actuarielle depuis 1996 – je me suis battu sur ce point pendant des années –, est un taux de référence qui doit figurer dans tout contrat d’emprunt. Le problème est qu’il est devenu une sorte de pensum : de nombreux contrats comportent une clause selon laquelle les parties conviennent qu’il n’est pas possible de calculer le TEG, compte tenu de la structure du financement, et qu’à titre indicatif, sur la base de l’Euribor du 15 septembre 2007, par exemple, il est considéré comme égal à 2,12 %.
M. le rapporteur. Est-ce légal ?
M. Michel Klopfer. Oui, sauf si l’on a oublié de remplir la case où doit figurer le chiffre.
M. le rapporteur. Mais il y a aussi le taux d’usure.
M. Michel Klopfer. Pour un contrat à taux variable, il ne s’applique qu’au taux initial, et non au produit de la formule mathématique retenue – certaines d’entre elles font douze lignes, avec des multiplicateurs partout.
M. Jean Proriol. Vous ne nous avez pas dit beaucoup de bien des swaps. Sont-ils condamnables en soi ?
Je me souviens que le conseil général de la Haute-Loire a décliné l’offre d’une banque, Indosuez, qui proposait ce type de produits à la fin des années 1980. Or, des banques ont affirmé qu’elles n’avaient jamais offert de swaps ni de snowballs à leurs clients. Qu’en pensez-vous ?
Troisième question, les produits « capés » constituent-ils une solution ?
Quant à ces formules de douze lignes qui ressemblent à du grec ou à du chinois, considérez-vous que les collectivités locales sont en mesure de les comprendre ?
Mme Valérie Fourneyron. Je voudrais revenir sur votre profession, qui n’est pas dotée aujourd’hui d’un conseil de l’ordre, et plus généralement sur l’intermédiation. Les collectivités locales, que vous avez essayé d’alerter, du moins certaines d’entres elles, ne disposent pas de toutes les compétences nécessaires pour bien appréhender les produits financiers et nous avons pu constater, au cours des auditions, que certains intermédiaires n’avaient pas les qualifications à la hauteur des enjeux. Comment faire pour aider les collectivités à bien choisir leur conseil ? Faut-il imposer un agrément ou une labellisation ?
M. le président. Nous avons eu beaucoup de difficulté à avoir des réponses des banques sur la différence de marge entre les taux fixes et les produits structurés. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet ?
Par ailleurs, à quel niveau de risque, mesuré d’après la classification de la charte Gissler, faudrait-il se limiter ?
M. Michel Klopfer. Les swaps sont utiles, même pour des produits simples tels qu’un taux fixe ou l’Euribor, qui présentent des risques opposés et nécessitent donc un dosage approprié. Il n’est pas toujours possible, quand on anticipe une évolution défavorable des marchés, de procéder à un remboursement anticipé – on ne peut souvent le faire qu’une fois par an, à l’issue d’un préavis et au prix d’une surfacturation. Au lieu d’attendre, il peut être tout à fait pertinent de faire un swap pour transformer immédiatement la structure.
S’agissant des banques qui ont déclaré en public n’avoir proposé que des prêts – c’est-à-dire aucun swap, contrairement à d’autres acteurs –, je tiens à rappeler qu’il existe d’excellents swaps et d’autres qui sont pourris, et qu’il en est de même pour les prêts.
Par ailleurs, j’estime que la réponse apportée à chaud, entre novembre 2008 et mai 2009, n’était pas à la hauteur de la situation. La charte Gissler est à revoir, comme la circulaire du 25 juin 2010, car elles reposent sur un immense malentendu : les banques ont réussi à faire croire qu’il était question d’instruments de couverture, terme très valorisant dans notre langue – chacun se souvient de la publicité d’une compagnie d’assurance suisse qui représentait un enfant bien au chaud dans une couverture en laine. On a donc l’impression de bien faire quand on souscrit ces produits dérivés. Or, il en existe de deux sortes : les uns constituent un simple échange, sans couverture, les deux parties prenant un risque opposé ; les autres sont des opérations unilatérales par lesquelles une des parties couvre l’autre.
Qu’est-ce qu’un cap ? Par ce terme, on désigne le plafonnement d’un taux variable auquel on est exposé. Ce mécanisme entraîne un coût supplémentaire, correspondant au paiement d’une somme limitée pour couvrir un risque illimité. C’est donc une couverture. Or on est parvenu à faire passer, aux yeux des concepteurs de la charte Gissler et de la circulaire de 2010, pour de tels produits des produits qui ont exactement l’effet contraire, car ils conduisent à recevoir une somme limitée pour couvrir un risque illimité.
Un excellent avis du Conseil national de la comptabilité, datant du 10 juillet 1987, posait pourtant le principe suivant : doit être considéré comme « couverture » un instrument qui réduit la valeur du risque auquel on est exposé. Cet avis était bien connu des services de l’État, car il était cité par la circulaire du 15 septembre 1992. Or, de quoi la catégorie 2 de la charte Gissler est-elle composée ? D’indices portant sur l’inflation, française ou européenne, et sur les écarts d’inflation. L’inflation française est un excellent indice, car les budgets y sont soumis, et l’on peut également admettre l’inflation européenne ; en revanche, il est dangereux de greffer une option, pouvant porter sur une période de trente ans, sur un écart d’inflation qui est de nature spéculative.
En effet, qui va prendre une option sur le dollar ? Une entreprise qui répond à un appel d’offres et qui sait que, si elle est retenue, elle recevra dans un an le règlement de la machine qu’elle doit fabriquer. Elle achètera donc une option de vente de dollars à l’échéance correspondante. Comme cette entreprise, tous ceux qui achètent des options le font sur des durées limitées, en considération d’un risque industriel, opérationnel ou commercial. Qui achète des options sur trente ans ? C’est de la spéculation pure : personne ne couvre un risque commercial sur une telle durée. Or, on a proposé aux collectivités des produits dont le risque était illimité. J’observe, au demeurant, qu’on ne peut plus coter aujourd’hui certains de ces produits, car les salles de marché ont reçu des consignes beaucoup plus strictes depuis 2008 : dans certains cas, elles ne peuvent plus procéder à des cotations sur des durées aussi longues.
Par conséquent, la charte Gissler doit être revue : dès la catégorie 2 et dès les niveaux C2 et C3, elle comporte des risques qui ne sont pas adaptés aux collectivités.
M. le rapporteur. Nous avons donc besoin d’une charte « Klopfer ».
M. Michel Klopfer. Je n’ai rien à vous vendre.
M. le rapporteur. Je plaisantais. Quelle proposition feriez-vous pour sortir de la situation actuelle ? Je rappelle que près de 5 000 collectivités pourraient se trouver dans de véritables difficultés.
M. Michel Klopfer. Comme il n’y a que 900 communes de plus de 10 000 habitants en France, le phénomène va probablement assez loin : je connais, par exemple, des communes de 650 habitants touchées par l’évolution du franc suisse.
Au plan juridique, il peut y avoir matière à inquiéter le prêteur quand l’emprunt ne fait pas référence au TEG, quand les opérations de swaps sont rédigées en anglais – en application de la loi Toubon du 4 août 1994, le contrat est considéré comme illégal –, ou quand les collectivités ont contracté après le 1er novembre 2007, date d’entrée en vigueur de la directive MIF, sans s’être déclarées comme des professionnels, la banque devant, après cette date, s’assurer que son client avait les compétences nécessaires. Selon Aaron Nimzowitsch, grand maître des échecs, « la menace est plus forte que l’exécution » : on peut obtenir, en menaçant de déplacer une pièce mettant en danger le roi adverse, un effet plus fort qu’en le faisant réellement. La simple menace d’un procès peut ainsi conduire les banques à transiger, mais il va de soi qu’il faut ensuite renoncer à s’adresser à elles.
J’ajoute que le problème de la commande publique ne se pose pas qu’en matière de conseil, activité qui ne représente qu’une part minime des coûts d’achat des collectivités locales. S’il y a un domaine où elles doivent encore réaliser des progrès, c’est précisément là. Comme les entreprises, elles pourraient utilement se doter d’acheteurs bien rémunérés, dépendant de la direction générale des services et disposant des budgets nécessaires pour réaliser du sourcing, c’est-à-dire un marketing « achats » consistant à identifier les fournisseurs potentiels, et pour rédiger les cahiers des charges. Dans mon domaine d’activité, je vois souvent des cahiers des charges d’une page et demie, quand le règlement de consultation en fait vingt-cinq ou trente – on s’attendrait plutôt à ce que soit le contraire.
M. le président. Merci pour toutes vos réponses. Le rapporteur vous sollicitera certainement pour des compléments d’information ou pour des propositions plus précises.
*
* *
Audition, ouverte à la presse, de M. Patrice Chatard, directeur général, et de M. Jacques Descourtieux, directeur général de Finance active
(Procès verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous accueillons M. Patrice Chatard et M. Jacques Descourtieux, directeurs de Finance active.
Messieurs, vous conseillez aujourd’hui de très nombreux acteurs locaux – vous nous direz l’étendue de votre clientèle – pour la gestion de leurs opérations, la production de leurs états réglementaires et leur communication financière. Vous gérez la dette, les placements et la prospective financière en ligne au moyen de plateformes de gestion. Vos documents de communication mettent l’accent sur l’accompagnement personnalisé de haut niveau que vous assurez à vos clients.
Avez-vous conseillé des produits structurés à vos clients ? À combien d’entre eux et selon quels critères ? Avez-vous effectué une gestion active de ces emprunts afin d’éviter la détérioration des conditions financières ?
Quelles sont les caractéristiques du financement local aujourd’hui, tel que vous l’observez à travers les données que vous rassemblez ? Quelle est la classification des emprunts au sens de la charte Gissler ?
M. Patrice Chatard et M. Jacques Descourtieux prêtent serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Vous indiquez dans vos analyses sur l’état de la dette locale que la part des taux structurés a connu un repli entre 2009 et 2010, passant de 22,4 % à 20 %. Cette tendance s’est-elle poursuivie en 2011 ?
Avez-vous accompagné ce mouvement de sécurisation des emprunts chez vos clients ? Si oui, à quelles conditions s’est-il opéré ?
Selon les témoignages d’un certain nombre de collectivités, le coût de la sortie d’un emprunt structuré est prohibitif. Quelles conditions de sortie doivent être préconisées ? Renégocier, est-ce gagner ? Je sais que vous avez un avis sur ce point, puisque vous conseillez plutôt à vos clients d’éviter d’aller au contentieux.
M. Jacques Descourtieux, directeur général de Finance active. Nous vous remercions de nous avoir invités à nous exprimer devant la commission d’enquête. Nous avons préparé quelques documents pour illustrer notre propos.
Finance active est une société qui propose des services technologiques et financiers. Nous travaillons avec plus de 500 entreprises, 1 200 collectivités et 400 hôpitaux, qui recourent à nos services soit pour la partie technologique, soit pour la partie conseil, soit – le plus souvent – pour les deux. Nous travaillons aujourd’hui dans cinq pays en Europe, et employons 110 collaborateurs.
M. Patrice Chatard, directeur général de Finance active. Nous pourrons ainsi vous parler de ce qui s’est fait dans les pays voisins au sujet de la dette structurée des collectivités locales. Ce large panel de clients nous permet en effet de publier depuis cinq ou six ans un observatoire annuel, qui mesure la part de taux fixe, la part de taux variable et la part de produits structurés. Sa dernière édition – que nous vous avons apportée – fait état d’un recul de la part des produits structurés, moins imputable à notre sens aux politiques de sécurisation qu’à un effet de dilution. Cette baisse est à relativiser avec les nouveaux emprunts : les banques ne proposent plus ce type de produits aujourd’hui.
M. Jacques Descourtieux. L’observatoire Finance active de la dette est fondé sur l’analyse d’un panel de 1 000 collectivités clientes, dont la dette représente 80 milliards d’euros et est composée de plusieurs dizaines de milliers d’emprunts et de swaps. Nous tirons de cette base de grands indicateurs de gestion – répartition en termes de risque, durée, taux… – qui nous donnent une idée précise de l’exposition globale des collectivités locales au risque de taux. Nous savons ainsi qu’au 31 décembre 2010, 48 % de la dette des collectivités était à taux fixe, 31 % à taux variable, et le reste en produits structurés, avec des niveaux de risque plus ou moins importants.
M. Patrice Chatard. Nous avons classifié les niveaux de risque d’après la charte Gissler. Pour répondre à votre question, il nous est bien sûr arrivé de conseiller des produits structurés à nos clients, mais il s’agissait de produits aujourd’hui classés 1B ou 1C, c’est-à-dire de produits à taux fixe annulable ou de produits à taux fixe à barrière, en aucun cas de produits hors charte. Nous conservons du reste l’ensemble des demandes de nos clients et des réponses que nous leur adressons. Lorsque vous les avez reçues, les banques vous ont martelé qu’elles avaient vendu des produits structurés pour répondre à la demande de leurs clients. Selon nous, ce n’est pas vrai. Nous pouvons l’affirmer, puisque tout est « tracé » chez nous depuis 2000, notamment les propositions bancaires que nos clients nous transmettent pour avis. Nous pourrons donc vous donner des chiffres précis.
M. Jacques Descourtieux. Qui a vendu ces produits structurés indexés sur un cours de change (voir documents remis) ? Il s’agit à 70 % de Dexia, à 12 % de la Caisse d’épargne, à 5 % de Depfa Bank. Viennent ensuite le Crédit agricole, la Deutsche Bank, puis les autres. Je rappelle que ces chiffres sont calculés sur des volumes d’encours très significatifs à l’échelle nationale.
M. le président. Vous maintenez donc que ces manifestations d’élus venant réclamer des produits structurés sont une fable ?
Le document que vous venez de commenter a pour titre : « des produits de change d’abord vendus par Dexia ». Or l’ancienne équipe de direction de Dexia nous a affirmé qu’elle avait « couru après la concurrence ».
M. Jacques Descourtieux. Nous parlons ici en volume : les volumes de produits structurés vendus par Dexia sont sans commune mesure avec ceux vendus par les autres établissements présents sur ce marché.
Nous pouvons aller plus loin dans l’analyse des produits structurés, en particulier ceux indexés sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse. Il faut savoir que nous ne sommes qu’au début du problème. Fin septembre 2011, seuls 45 % de ces produits étaient sortis de la phase sécurisée. Cette proportion va passer à 54 % à la fin de l’année et à 77 % en 2012, pour atteindre 87 % en 2013. Aujourd’hui, les taux payés sur ces produits s’établissent en moyenne à 8,7 % ; mais plus de 50 % de ces produits ne sont pas encore passés en phase structurée.
M. le président. Le calcul de ce taux moyen de 8,7 % intègre donc les produits qui sont encore dans la phase bonifiée ?
M. Jacques Descourtieux. Exactement.
M. le rapporteur. La seule proposition de renégociation consiste aujourd’hui à prolonger la période bonifiée pour reculer l’échéance. Y aurait-il un lien entre la période proposée et les échéances électorales ?
M. Patrice Chatard. Je ne le pense pas.
Une fois que l’ensemble de ces produits seront sortis de la phase bonifiée, et si le taux de change entre l’euro et le franc suisse se maintient à 1,20, le taux d’intérêt moyen de l’encours de cette dette atteindra 14,9 %.
M. le rapporteur. Quel est l’écart-type ? Car ce qui nous inquiète, ce sont les cas où ce taux atteint 25 %, voire 30 %.
M. Patrice Chatard. Tout dépend de la construction du produit – y a-t-il un effet de levier, quelle est la barrière ?... Nous avons fait la moyenne agrégée. Certains prêts resteront peut-être à 12 %, tandis que d’autres iront jusqu’à 30 %.
Pour nous, et il est important de le dire, l’essentiel du problème porte sur les 6 % de dettes des collectivités locales qui sont hors charte, et qui sont principalement des produits indexés sur un taux de change, des produits cumulatifs ou à très fort effet de levier. Si nous devions définir le produit toxique, ce serait le cœur de notre définition.
M. Jacques Descourtieux. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce l’offre ou la demande qu’il faut incriminer ? Nous sommes équipés, comme nous vous l’avons dit, de systèmes qui permettent de tout « tracer ». Sur la période 2004-2008, nos clients nous ont transmis 8 000 propositions de réaménagement qu’ils avaient reçues des banques et 7 000 propositions de nouveaux financements comportant des produits structurés. En l’espace de quatre ans et demi ou cinq ans, 15 000 propositions bancaires de ce type leur ont donc été adressées. Pas une de ces propositions n’a une stratégie différente des autres. Or tous les décideurs financiers locaux ne pouvaient pas penser la même chose de l’évolution du dollar ou du yen. Il n’y a donc aucune ambiguïté : c’était un marché commercial, sur lequel les banques sont allées avec des moyens très importants – on a parlé d’équipes de 300 commerciaux !
Nous ne retrouvons heureusement qu’à peine 500 de ces 15 000 propositions de financement dans les produits structurés hors charte de nos bases de données. Beaucoup ont donc pu être arrêtées.
M. le président. Vous intervenez là en tant qu’historien des produits structurés, ce qui n’est pas dénué d’intérêt, puisque les banques nous affirment pour leur part qu’elles ont été submergées par la demande des collectivités locales, qui venaient réclamer des produits structurés. Mais vous-mêmes n’êtes pas neutres : vous avez eu à conseiller des collectivités. Quelle a été votre stratégie face à ce type de produits ?
M. Jacques Descourtieux. Nous publions à l’intention de l’ensemble de nos clients une lettre hebdomadaire qui analyse les pratiques bancaires. Vous en trouverez quelques exemples dans la documentation que nous vous avons remise, qui vous montreront ce que nous avons pu écrire durant cette période sur les produits structurés. Voyez par exemple les têtes de chapitres de la lettre du 4 juillet 2005 : « Ne pas payer de frais financiers pendant trois ans… Et après ? » Vous constaterez que dès cette époque, il était clair pour nous que ne pas payer de frais financiers pendant trois ans sur des produits de ce type signifiait aussi prendre « des indexations très risquées », avoir « un taux moyen de la dette biaisé », et donc « de mauvais jours à prévoir ». De plus, ces produits sont très « mal cotés ». Nous reviendrons sur ce point, car nous sommes en mesure de répondre – pour les 15 000 propositions dont nous avons eu connaissance – à une question que vous avez souvent posée lors des auditions, à savoir : combien gagnait la banque sur ces propositions ? Nous observions également que cette stratégie était « comptablement contestable », puisqu’en l’absence de provisions, le risque est reporté sur le futur. Et de conclure : « Certains ont cru découvrir la potion magique avec ces produits. Espérons seulement pour eux qu’ils ne viennent pas de goûter à une drogue dure… »
M. le président. Après l’intervenant précédent, vous êtes en train de nous apporter la preuve qu’il y a eu des signaux d’alerte. En dehors des destinataires de la lettre de Finance active, à qui avez-vous eu l’occasion de les adresser ?
M. Jacques Descourtieux. Nous n’étions pas encore très connus à l’époque, puisque nous avons créé notre société en 2000. De deux, nous sommes passés à 100 ; mais nous sommes entrés sur ce marché beaucoup plus tard que M. Klopfer. Nous entretenons aujourd’hui des relations avec la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ; nous invitons depuis trois ans les grandes institutions et la presse aux rencontres que nous organisons pour présenter l’observatoire. Nous avons donc essayé de communiquer.
M. le président. C’est un élément important par rapport à tout ce que nous avons pu entendre. Votre entreprise n’avait certes que cinq ans en 2005, mais cette lettre n’a fait l’objet d’aucune réaction ?
M. Jacques Descourtieux. Il y a bien sûr eu des réactions de la part de nos clients. Mais même si la part des produits toxiques est importante, il ne faut pas noircir le tableau : beaucoup de nos clients n’ont pas souscrit ces produits et gèrent parfaitement leur dette avec des produits très simples à taux intéressant. Notre travail n’a pas été inutile : il a permis d’arrêter beaucoup de propositions qui présentaient un risque. Dans les deux dernières années, de nouveaux clients nous ont demandé notre aide : nous sommes effarés de constater que certains sont exposés à 98 % aux produits structurés. Notre activité d’information et de formation sur les risques avait donc une utilité. Certes, des emprunts structurés ont tout de même été souscrits ; mais comprenez que nous aurions pu en avoir dix fois plus !
M. le rapporteur. J’ai du mal à saisir si vous pensez qu’un prêt structuré est toxique par construction, ou s’il s’agit selon vous d’un phénomène conjoncturel.
M. Patrice Chatard. Nous l’avons écrit en 2005 et en 2006 : cela n’a aucun sens de faire un emprunt à trente ans indexé sur le taux de change entre l’euro et le franc suisse. Sur les marchés financiers, ces options ne se traitent en général que sur un ou deux ans.
M. le rapporteur. Est-ce la durée que vous mettez en cause ?
M. Patrice Chatard. Non, c’est le fait d’utiliser une option de change pour venir bonifier une dette. Nous travaillons avec de nombreuses entreprises : le premier risque qu’elles nous demandent de couvrir est le risque de change. Je le répète, cela n’a pas de sens de faire des financements indexés sur des parités de devises. Nous l’avons écrit ; tous ceux qui étaient un peu avertis dans la profession – voire certains directeurs financiers de collectivités locales – l’ont dit.
M. Patrice Calméjane. Avez-vous des contacts avec l’Autorité de contrôle prudentiel ? Vous a-t-elle demandé votre avis sur tel ou tel produit ?
En tant que conseil, vous êtes en contact avec les directeurs financiers de collectivités locales. Vous assurez également des formations. La formation des personnels des collectivités territoriales est-elle au niveau en ce qui concerne ce type de produits ? Faut-il renforcer le cursus dans ce domaine ? Lorsque l’on ne sait pas faire, il faut se faire aider ou conseiller. Les personnels des collectivités territoriales ont-ils du moins ce bon sens ?
M. Henri Plagnol. Je souscris pleinement à votre analyse. Vos archives pourraient s’avérer passionnantes pour la commission d’enquête, voire pour les collectivités concernées. Serait-il possible de nous transmettre tout ou partie de ces archives, qui constituent un élément de preuve très important sur ce que vous avez appelé le jeu de l’offre et de la demande ? Les collectivités que vous conseillez peuvent-elles vous demander la totalité de ces archives – y compris celles qui portent sur les propositions des banques – dans le cadre de la médiation ou d’un contentieux ?
M. Jean Proriol. Nous avons entendu tout à l’heure un vigoureux procès du taux moyen, qui n’aurait guère de sens. Qu’en pensez-vous ? Pour ma part, je ne pense pas qu’il faille les fusiller à bout portant…
Vous avez fait allusion aux expériences étrangères. Vous nous avez également dit par quels établissements français ces produits avaient été commercialisés. Mais vous ne nous avez pas parlé des établissements étrangers – Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank… Pouvez-vous faire quelques comparaisons ?
M. le président. Nous avons bien compris quelle était votre préférence pour l’avenir, et je discerne facilement au travers de votre documentation les réserves que vous émettez sur les opérations sur des monnaies étrangères. Nous attendons maintenant de votre part des propositions pour sortir du stock.
M. Patrice Chatard. Nous estimons qu’il y a environ 8 milliards de produits hors charte sur le stock de dette des collectivités locales, et que la soulte à payer pour en sortir est de 10 milliards d’euros. Dès lors, le sujet devient politique : il s’agit de savoir qui va payer. Ne rien faire serait acter le fait que ce seront les collectivités locales, en lissant la charge sur la durée. Mais il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ces décisions politiques.
M. le président. Permettez-moi de vous interrompre : vous parlez bien de 8 milliards hors charte ?
M. Patrice Chatard. Je parle des produits les plus dangereux, qui n’étaient pas référencés par la charte dans un premier temps, à savoir les produits sur le change, les produits cumulatifs et les produits à effet de levier supérieur à 5. La soulte à payer pour sortir de ce stock – que nous estimons à 8 milliards sur l’ensemble des collectivités françaises – est estimée à environ 10 milliards d’euros. Il s’agit donc de masses conséquentes. Combien de collectivités sont-elles touchées ? La commission se fonde souvent sur un chiffre qui a été publié dans la presse et qui nous semble surestimé. Mais si l’on retient les seules collectivités ayant des produits dangereux, nous sommes à peu près d’accord avec ce qu’ont dit les banques. Dexia a parlé d’un peu plus de 300 collectivités pour ce qui concerne les produits sur le change : nous sommes peu ou prou en phase.
Parmi ces 350 collectivités qui détiennent des produits indexés sur le change, il faut distinguer plusieurs cas de figure.
Il y a d’abord celles pour lesquelles ces produits ne représentent qu’une faible proportion de l’encours – et pourtant, dans les historiques dont nous vous parlions, certaines collectivités ont reçu jusqu’à dix propositions en sept mois ! Cela prouve qu’il y avait bien une forte dynamique, voire un harcèlement de la part des banques pour placer ces produits. Dans ce premier cas de figure, les collectivités s’en sortiront. Elles ont certes fait un choix qui n’était pas heureux, mais comme la proportion de ces produits dans leur encours n’est pas considérable et que les taux variables sont actuellement bas, elles peuvent prendre la décision politique de « nettoyer ». Nous en avons quelques exemples.
Mais la majorité de ces collectivités – c’est le deuxième cas de figure – choisit le report du risque. Il faut savoir que les banques sont beaucoup moins actives aujourd’hui. Lorsqu’une collectivité leur demande un produit de sécurisation, elles ont donc tendance à lui proposer un gel du coupon d’un ou deux ans, parfois en contrepartie d’un allongement sur de l’Euribor – un produit simple – à la fin. Il semble qu’une grande partie des collectivités l’acceptent. Il faut dire qu’elles n’ont guère d’autre choix. C’est pourquoi nous disons que nous ne sommes qu’au début du problème sur ces produits indexés sur le change.
La troisième catégorie est constituée des collectivités ayant une très forte proportion de ces produits dans leur encours, qui sont au nombre d’une cinquantaine ou d’une centaine. La solution de la soulte comme le report de risque ne sauraient ici suffire. La question de l’imprudence des banques – qui a conduit ces collectivités à se retrouver avec 80 à 90 % d’emprunts structurés dans leur encours – peut donc être posée.
M. le rapporteur. Selon vous, on peut donc mettre leur responsabilité en cause ?
M. Patrice Chatard. Il paraît en tout cas incroyable que l’on ait pu en arriver là. Mais si l’on ne fait rien pour ces cas-là, cela va durer vingt ans. Nous pensons que la médiation n’a pas été assez forte, comparée à celle du crédit que la loi a instituée en 2008 et qui a permis de régler un certain nombre de cas délicats.
Il y a aujourd’hui des collectivités qui concentrent dans leurs encours l’ensemble des produits toxiques. Sans doute faut-il trouver les moyens d’agir plus fermement pour sortir de cette situation et prendre une décision sur le partage de la soulte.
M. Jacques Descourtieux. Pour répondre à une autre question, je ne dirais pas que nous ne recommandons pas le contentieux – qui fait partie de la liste des préconisations que nous remettons à nos clients. Simplement, nous les mettons en garde, et souhaitons en particulier nous assurer qu’ils sont conscients de la réalité de ce qu’est un contentieux. Nous avons en effet constaté que certains n’avaient pas mesuré ce que signifiait le fait de se retrouver face aux avocats des grands établissements bancaires. En bref, il faut y aller armé, savoir combien de temps cela va durer, combien cela va coûter, et ce que l’on peut en attendre. Dans le troisième cas de figure que vient de décrire M. Chatard, il est évident qu’il faut aller au contentieux : il n’y a pas d’autre solution.
M. Patrice Chatard. Ne soyons pas trop pessimistes. Sans doute assiste-t-on à une certaine prise de conscience des banques. Il nous semble que certains acteurs bancaires évoluent et que des dossiers se traitent. Dans certains cas, la soulte est partagée, parfois même avec des propositions de refinancement de la soulte à la collectivité sous forme de prêts sur cinq, sept ou dix ans. Nous avons vu des cas très complexes se régler ainsi. Voilà trois ans que nous parlons de ce sujet. L’observatoire confirme que la part de ces produits a reculé, mais sans doute pas suffisamment s’agissant de la partie la plus complexe, notamment des produits de change.
M. Jacques Descourtieux. Le taux moyen est un indicateur au même titre que beaucoup d’autres, monsieur Proriol. Il ne s’agit donc pas de l’exclure. Pour notre part, nous ne parlons jamais de taux moyen ponctuel. Dans l’observatoire, nous regardons le taux moyen prospectif sur cinq ans, en anticipant les taux qui vont être payés, notamment sur les produits structurés. On peut donc utiliser le taux moyen, à condition de ne pas le faire que de manière ponctuelle et de ne pas lui accorder plus d’importance qu’aux autres indicateurs.
J’en viens aux archives. Dans le cadre des contentieux en cours, nous transmettons bien entendu aux avocats des collectivités que nous conseillons toutes les informations en notre possession. Il suffit que le client nous libère de notre engagement de confidentialité vis-à-vis de l’avocat.
M. Patrice Chatard. En ce qui concerne les marges réalisées sur les produits structurés, je dois dire que j’ai été surpris d’entendre parler, dans les comptes rendus des auditions précédentes, de 20 à 30 centimes. Pour ce qu’il nous a été donné de voir et de calculer, cela va bien au-delà, puisque nous les estimons au minimum à 60 centimes, et plus vraisemblablement entre 80 et 90 centimes, voire davantage à la fin de la période.
M. le président. Nous avons posé la question à de nombreuses occasions, et nous avons eu l’impression de toucher à un secret… À titre de comparaison, à combien s’élevaient les marges sur du taux fixe à vingt ans sur la même période ?
M. Patrice Chatard. Dans les années 1990, je dirais qu’elle s’élevait à 20, 25 ou 30 centimes selon le risque, parfois moins s’il s’agissait d’une très bonne signature.
M. le président. C’est une comparaison qui est très importante pour nous.
M. le rapporteur. Vous-mêmes, comment vous rémunérez-vous auprès des collectivités ?
M. Jacques Descourtieux. Elles souscrivent un abonnement annuel, dont le coût est déterminé à l’avance en fonction du nombre d’emprunts et de l’encours de la dette. Le prix moyen de nos services pour les 1 000 collectivités est légèrement inférieur à 5 000 euros par an.
M. le rapporteur. Il n’existe pas de primes au résultat ?
M. Jacques Descourtieux. Jamais. C’était une pratique courante chez les acteurs du marché au début des années 2000, la prime de résultat étant calculée sur le gain budgétaire. Pour notre part, nous avons fait le choix de rémunérations objectives, fixées à l’avance et indépendantes de ce qui se fait ou non sur le compte. Ces rémunérations comprennent l’accès à la plate-forme technologique – qui permet de s’informer sur les taux, de suivre sa dette et de valoriser les propositions faites – et un accompagnement personnalisé.
M. Patrice Chatard. Cela répond à la question posée par Mme Fourneyron lors de l’audition précédente. Il me semble dangereux de choisir un conseil qui se rémunère sur les gains réalisés. Les grandes collectivités qui ont travaillé avec ce type de conseils savent toutes que si elles incitent leur conseil à leur faire faire des économies, celui-ci leur fera prendre de plus en plus de risques. Pour notre part, nous ne répondons pas à ce type d’appel d’offres – et nous expliquons pourquoi. De même, je ne puis que souscrire à la remarque formulée par M. Klopfer sur le service achats. Dans certains appels d’offres, la collectivité achète un prix. Ce n’est pas toujours une bonne démarche : le conseil se paye.
M. Jacques Descourtieux. Nous avons voulu développer l’approche la plus pragmatique possible en étudiant l’ensemble des cas. Nous souscrivons à de nombreuses observations qui ont été faites lors des auditions précédentes sur le cadre juridique ou le cadre comptable. En revanche, il serait bon d’avoir une connaissance précise du nombre de cas qui posent un vrai problème. Il s’agit pour nous des collectivités ayant plus de 25 % de produits structurés hors charte. Nous estimons qu’elles sont 100, voire 150, qui ne pourront s’en sortir. Il va donc falloir agir, et fort.
Il faut ensuite résoudre le cas des petites collectivités. Nous avons été très surpris de voir publier dans la presse les noms de petites communes, dont la dette est parfois constituée à 100 % – nous l’avons vérifié sur le site du ministère de l’économie et des finances – de produits structurés. La dette de ces toutes petites communes ne représente pas un enjeu financier important pour les banques. Objectivement, elles n’auraient pas dû vendre de tels produits, et encore moins aux petites communes. Cela devra donc être « nettoyé » très rapidement.
M. Jean Proriol. Vous ne m’avez pas répondu sur les exemples étrangers.
M. Patrice Chatard. En Belgique, les emprunts des collectivités locales sont soumis aux marchés publics. Cela n’a pas empêché celles-ci de souscrire des produits structurés. Cela étant, les produits proposés à l’étranger sont restés beaucoup plus « sages » : il n’y a pas eu de produits aussi complexes que chez nous – notamment du type des produits hors charte – en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. Il y a là une spécificité française.
M. Jean Proriol. Proposaient-ils ces crédits aux collectivités françaises ?
M. Patrice Chatard. Une des banques que vous avez citées, solidement implantée en Allemagne, a proposé des produits beaucoup plus complexes en France qu’en Allemagne.
M. le président. M. Plagnol et moi-même avons bien compris que nous étions morts… (sourires)
M. Patrice Chatard. Permettez-moi d’ajouter un dernier mot sur les difficultés auxquelles vous allez avoir à faire face. Se dessine aujourd’hui une tendance qui risque de constituer, pour reprendre l’expression d’un parlementaire, une « double peine » pour les collectivités dont la dette est constituée pour une forte proportion d’emprunts structurés : elles semblent avoir de plus en plus de difficultés à passer dans les comités de crédit des banques. C’est assez paradoxal, puisque les banques sont responsables de cette situation. On en revient donc à une nécessité que nous avons déjà formulée : celle de connaître le nombre de ces collectivités, et de trouver rapidement des solutions.
M. le président. Messieurs, je vous remercie.
Table ronde, ouverte à la presse, « Les propositions des associations d’élus locaux », avec M. Michel Piron, député, président délégué de l’Association des communautés de France (AdCF) et Mme Claire Delpech, responsable des questions finances et fiscalité à l’AdCF ; M. Dominique Gaubert, adjoint au maire de Sannois et membre de la commission des finances de l’Association des maires de France (AMF) et Mme Soraya Hamrioui, chargée d’études au département finances de l’AMF.
(Procès verbal de la séance du mercredi 16 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Cette table ronde doit nous permettre d’étudier les solutions au problème des emprunts à risque proposées par les acteurs concernés.
Les associations regroupant les collectivités territoriales ne sont pas restées impassibles face à la situation. Nous avons déjà vu, lors de notre table ronde précédente, comment trois d’entre elles, bientôt rejointes par toutes les autres grandes associations d’élus locaux se sont réunies pour porter un projet de création d’une structure de financement des collectivités territoriales.
M. Dominique Gaubert, Mme Soraya Hamrioui, M. Michel Piron, Mme Claire Delpech, M. Emmanuel Duru prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Trente ans après la loi de décentralisation, les collectivités assurent les deux tiers de l’investissement public qu’elles financent en s’endettant auprès d’établissements mutualistes ou privés. Pourquoi faudrait-il aujourd'hui qu’elles mettent en place une agence de financement ? Pourquoi une telle rupture ?
M. Michel Piron, président délégué de l’Association des communautés de France (AdCF). Je vais vous répondre brièvement, car mes voisins n’ont pas été mandatés pour répondre à cette question précise.
Ce n’est pas un hasard si la question ne s’est pas posée avant, Monsieur le rapporteur. Il faut y voir une conséquence des derniers montages, caractérisés par leur complexité et leur opacité, pour reprendre les termes de la Cour des comptes. L’enjeu réside dans la sécurisation des modes de financement des collectivités territoriales dont les investissements répondent, par définition, à une logique de long terme et doivent être à l’abri de la volatilité des marchés – ce qui n’interdit pas le recours à des taux variables, éventuellement « capés ». Le Crédit local de France donnait satisfaction mais il s’est aligné sur la concurrence, dont les règles ne correspondent pas forcément à nos besoins.
M. le rapporteur. Les dispositions issues de l’accord de Bâle III pourraient poser rapidement des problèmes de financement aux collectivités, et Finance Active nous a fait remarquer à juste titre que les collectivités qui ont des prêts structurés risquaient une « double peine » si elles devaient se procurer de nouvelles ressources auprès du secteur financier.
Venons-en aux mesures de prévention proposées par vos associations respectives.
Doit-on interdire certains produits structurés ? Que pensez-vous de réserver aux collectivités les plus importantes le recours à certains produits complexes ? Peut-on introduire des disparités de réglementation entre les collectivités, et le critère de la taille vous semble-t-il le plus pertinent ?
Doit-on soumettre les contrats de prêt au code des marchés publics et par là même au contrôle de légalité préfectoral ? L’argent est un produit que les collectivités « achètent » mais qui échappe à tous les contrôles habituels, alors qu’il contribue à l’équilibre financier des collectivités.
Doit-on obliger les collectivités qui souscriraient des produits pouvant se révéler dangereux à terme à mettre en place des provisions pour risque ?
M. le président. Notre commission a beaucoup de mal à savoir combien de collectivités sont touchées. Dans un premier temps, le secret était de mise parmi les élus qui avaient signé de tels contrats. Le ministre chargé des collectivités territoriales a écarté tout risque systémique. Ensuite, le nombre de 5 000 a circulé dans la presse, mais il semblerait que ce soit moins. Pouvez-vous faire le point de la situation ?
M. Dominique Gaubert, adjoint au maire de Sannois et membre de la commission des finances de l’Association des maires de France (AMF). Je vous prie d’excuser l’absence de Jacques Pélissard et Philippe Laurent qui auraient souhaité répondre eux-mêmes aux questions de la commission d’enquête, mais qui en ont été empêchés par leur agenda.
Nous n’avons pas tellement de remontées d’information, pour une raison simple : encore faut-il que les élus aient connaissance de la situation. La Gazette des communes a publié il y a quelques jours un excellent article expliquant comment faire la différence entre un produit toxique et un produit structuré. Le Parisien d’aujourd'hui jette les collectivités en pâture à ses lecteurs : « …des communes auraient un surcoût de 20 % à 50 % dû aux emprunts toxiques. » C’est du n’importe quoi ! Les grosses communes sont mieux équipées pour faire face, mais les autres ont fait confiance aux banques. Ce n’est pas la procédure de marché qui sécurise l’achat, M. Klopfer l’a dit. L’article paru dans Libération ne concernait que Dexia. Or Dexia n’est pas la seule banque à avoir consenti des emprunts structurés. Attention ! Tout emprunt structuré n’est pas forcément toxique. Tout dépend de la façon dont ces emprunts ont été gérés par la suite.
Mme Soraya Hamrioui, chargée d’études au département finances de l’AMF. Depuis 2008, l’AMF se préoccupe avant tout d’avoir accès à une information fiable sur l’encours de produits structurés et sur la proportion de produits toxiques. Pour le moment, il y a peu d’information et elle n’est pas fiable. Il existe des entreprises privées, telle Finance Active, qui fournissent des statistiques élaborées à partir de leur clientèle. Certains médias se livrent à de la désinformation en publiant des chiffres anciens et incomplets. Nous réclamons à l’État depuis 2008 une information fiable, car elle est indispensable pour se positionner et savoir si, oui ou non, il y a un risque systémique.
M. le rapporteur. Je vous rassure. Maintenant, nous avons les chiffres et nous sommes en train de les consolider.
Mme Soraya Hamrioui. Tant mieux ! Et nous nous réjouissons que M. le ministre ait annoncé qu’il publierait les statistiques à partir du recensement qui aura été effectué.
M. le rapporteur. Les chiffres du ministère de l’Intérieur sont difficiles à exploiter. En ce qui nous concerne, nous travaillons à partir des états des banques. Elles ont obligation de répondre et leurs chiffres seront très précis.
M. Dominique Gaubert. Normalement, les conseils municipaux devaient donner en annexe une répartition de leurs emprunts selon la charte Gissler, et les préfectures reçoivent copie de toutes les délibérations.
M. le rapporteur. Les tableaux ne sont pas toujours bien remplis.
M. le président. Ce sera toujours mieux que rien. Finance Active a avancé le chiffre de 10 milliards, d’autres 15 milliards. Ce sont des sommes considérables, surtout compte tenu de la situation du budget de l’État. Il est impératif d’y voir plus clair !
M. Dominique Gaubert. Si les préfets, qui ont tout de même quelques pouvoirs, n’arrivent pas à récupérer les informations, l’AMF encore moins !
M. le président. Quelles sont vos propositions ?
M. Michel Piron. Je confirme le flou dans lequel nous évoluons, mais il ne me choque pas, les associations n’ayant pas vocation à faire des contrôles. Nous avons surtout diffusé de l’information. La fourchette des chiffres qui circulent prouve que l’on n’y voit pas clair.
Pour l’avenir, nous partageons largement les recommandations de la Cour des comptes, à quelques nuances près. La Cour des comptes essaie à juste titre de traiter le problème en amont. La « transparence » est à la mode, mais, en l’espèce, elle ne serait pas déplacée. Il faudrait d’abord se doter des outils qui permettraient de s’y retrouver. À cet égard, je voudrais vous mettre en garde contre certains ratios qui ne sont pas forcément très pertinents, et qui peuvent même fausser l’analyse. La Cour conseille de se préoccuper davantage de la capacité de désendettement, et met en garde contre les ratios qui reposent uniquement sur l’annuité de remboursement, ignorant par définition la durée des engagements souscrits, et qui minorent les charges. Il faut donc commencer à revoir la batterie de ratios pour concevoir un outil d’information plus pertinent. Ce travail est d’autant plus nécessaire que nos communes sont plus nombreuses et plus petites qu’ailleurs : 60 % d’entre elles comptent moins de 500 habitants. Difficile, dans ces conditions, de généraliser l’ingénierie financière.
Je suis tout à fait favorable à la constitution de provisions pour risque, qui feraient perdre l’avantage de présenter un taux d’intérêt facial à 0 %, et à la transparence sur les soultes réclamées par les banques. Par ailleurs, je ne peux que souscrire au projet de suivi statistique de la structure de la dette, bien qu’il soit plus lourd à mettre en œuvre.
La Cour des comptes évoque un cahier des charges. Pourquoi pas, à condition de mettre un seuil ? Il ne faudrait pas passer d’un excès à l’autre et imposer des procédures très lourdes pour contracter des emprunts modiques.
Il va de soi qu’il faut traiter différemment les petites collectivités, mais il faudra tôt ou tard se poser la question de l’interdiction, ou non, de certains produits structurés. La Cour des comptes préconise d’écarter « les produits basés sur des écarts d’indice hors zone euro ou comportant des effets de levier », et « de modifier en conséquence la circulaire du 25 juin 2010 ». La charte n’est pas un document prescriptif mais elle pourrait l’être davantage. Reste à savoir jusqu’où pour respecter le principe de libre administration des collectivités ? Néanmoins, je ne suis pas hostile à ce qu’elles soient régulées, sinon encadrées, compte tenu de l’atomisation de nos structures locales, propre à notre pays. On ne peut pas laisser s’instaurer un face-à-face trop inégal entre des experts privés commercialisant des produits à la complexité et l’opacité relevées par la Cour et nos élus locaux.
Ensuite, la taille est-elle le critère le plus pertinent ? Je ne suis pas sûr qu’elle suffise à garantir la capacité d’expertise, ce qui nous renvoie en amont du problème, à la batterie de ratios, à l’interdiction pure et simple de certains produits qui privilégient la volatilité, à la durée des emprunts, parfois déraisonnable.
Je ne suis pas non plus assuré de la pertinence du contrôle de légalité que pourraient exercer les préfectures. Les préfets ne seraient-ils pas plutôt embarrassés d’hériter de ce surcroît de travail ?
Dans votre dernière question, Monsieur le rapporteur, vous parlez de produits « dangereux ». Je récuse ce terme car, s’ils le sont, ils doivent être interdits d’emblée. Je préférerais les qualifier de « risqués », ce qui justifierait de constituer des provisions pour risque. C’est d’ailleurs l’une des recommandations de la Cour des comptes, et elle est hautement souhaitable.
En conclusion, nous aurions tout intérêt à traiter le problème en amont plutôt qu’en aval, bref, à nous attaquer aux causes plutôt qu’aux effets. Le contrôle a posteriori de produits aussi sophistiqués reviendrait à administrer trop tardivement une potion trop diluée.
Et, pour revenir à la question initiale, dans le paysage bancaire national et international tel qu’il est, les pratiques en vigueur dans le financement des collectivités méritent d’être réinterrogées en termes d’exigences déontologiques.
M. le rapporteur. Faire des recommandations, c’est facile. Le problème, c’est le stock. Comment assumer des charges latentes aussi lourdes ?
M. Dominique Gaubert. En tout cas, le flux s’est tari. Les banques ont compris. On propose encore l’Euribor, qui n’est pas un taux fixe.
M. le rapporteur. Un taux variable n’est pas un produit structuré.
M. Dominique Gaubert. Certes. En adepte de la gestion en bon père de famille, je n’étais favorable au départ qu’au taux fixe. Il faut une souplesse de gestion, avec des offres à taux fixe et à taux variable, mais surtout une offre sécurisée.
M. Michel Piron. S’il est « capé », c’est clair et net.
M. Dominique Gaubert. Les grandes collectivités, dont le personnel devrait être compétent, ont aussi des emprunts structurés, voire toxiques. La taille de la collectivité n’est pas un critère suffisant.
Les associations d’élus doivent être très soucieuses de l’information en amont, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Quand et comment déclencher l’alerte ? Et qui doit s’en charger ? La direction générale des collectivités locales et le ministère du Budget ne manquent pas de compétences. Pourtant, ils ne nous ont pas mis en garde. Une association d’élus peut-elle le faire à la place de l’État ?
M. Michel Piron. La gestion des risques est-elle dans la vocation des collectivités locales ? Doivent-elles, et je ne dis pas que je le souhaite, élaborer chacune un plan de prévention des risques financiers ? Quelle est leur mission, qui, j’insiste, s’inscrit dans le long terme et ne consiste nullement à jouer au casino ou à boursicoter ?
Faire apparaître le plus vite possible dans les comptes les soultes payées ou reçues lors d’opérations de réaménagement permettrait déjà d’y voir plus clair, dès l’année prochaine. Il y a encore des collectivités qui ne tiennent pas à se vanter des risques qu’elles ont pris, et qui hésitent à se faire connaître. Il y aurait tout intérêt à être plus contraignant dans ce domaine.
Ensuite, une fois le stock connu, les protagonistes de premier rang seront les banques et les collectivités. On ne peut pas, d’un côté, défendre l’autonomie des collectivités contre la tutelle, et de l’autre, réclamer le parapluie de l’État à la première averse. La première question à examiner, c’est la relation banque-collectivité. À cet égard, la médiation, si elle pouvait fonctionner de manière plus efficace, est la bienvenue.
Vis-à-vis des plus petites collectivités, qui auraient pris des risques en toute méconnaissance de cause, il faut d’abord envisager la voie juridictionnelle même s’il n’y a pas encore de jurisprudence claire en France, contrairement à l’Allemagne. Quant à l’intervention de l’État, je suis plus réservé, au moins dans un premier temps. À quelles conditions ? On ne sait pas dans quel engrenage on entre.
M. Dominique Gaubert. Le gré à gré entre les collectivités et les banques se pratique depuis des années, et il devrait continuer. Mais le petit grain de sable dans la mécanique vient de ce qu’une des banques, la plus grosse en l’espèce, est très fragilisée, et risque de ne pas avoir grand-chose à renégocier. Pour négocier, il faut être deux. On nous dit que rien ne va changer. Soit, mais quelle va être l’attitude de cette banque dans les prochaines semaines ? C’est là que la commission d’enquête et l’État peuvent être utiles.
M. le rapporteur. Je vous demande ce qu’il faut faire et vous me répondez que vous attendez le résultat de la commission d’enquête !
Quel type de procédure faut-il mettre en place ? Doit-on envisager la voie contentieuse pour les petites communes, dont la dette est entièrement constituée de produits structurés ? En mettant en avant l’absence de compétences, l’existence d’une vente forcée pour obtenir une jurisprudence favorable qui fasse boule de neige. La banque que vous n’avez pas citée, et qui a vendu 70 % du stock en cause, doit se refinancer sur le marché, trouver des couvertures. Comment dénouer la situation ? Personne n’a de baguette magique.
M. Dominique Gaubert. Les responsables ont rarement signé avec le pistolet dans le dos. La plupart d’entre eux étaient de bonne foi et je pense qu’elle était partagée.
M. Michel Piron. La bonne foi n’exclut pas une forme de cécité. Dans un contexte de concurrence exacerbée entre les établissements et un environnement largement dérégulé, la virtuosité l’a emporté sur la sécurité, et le panurgisme a été la règle. Cela étant, j’en reviens aux prolégomènes, les considérations de court terme sont incompatibles avec une vision à long terme. La jurisprudence ne réglera pas tout, mais elle devrait permettre de fixer les limites de la responsabilité de part et d’autre, ce qui n’exclut pas la médiation, ni même une intervention plus large dans le cas de l’établissement auquel tout le monde pense.
M. le président. J’entends votre argument de la bonne foi partagée. Mais, si les banquiers, dont c’est le métier, n’étaient pas en mesure de gérer les produits qu’ils proposaient, comment peuvent-ils invoquer, pour leur défense, la compétence de leurs clients ? Ensuite, vous avez entendu ce qu’ont déclaré les responsables de Finance Active sur les marges bancaires, qui ont alimenté l’offre de produits structurés.
M. Michel Piron. Il me semble que, dans les milieux bancaires, certains responsables savaient qu’ils ne savaient pas ; tandis que les élus, eux, ne savaient pas qu’ils ne savaient pas.
M. Henri Plagnol. Je souscris à toutes les observations sages de Michel Piron, à une exception près. La vocation des associations de collectivités locales n’est sûrement pas de faire le ménage parmi les adhérents. Mais je m’inquiète d’entendre les responsables de l’État dire que les collectivités locales qui ont signé n’ont qu’à payer. Sur ce point, les associations ont un rôle très important à jouer.
Certes, les élus qui ont signé sont responsables, mais le dialogue avec les banquiers était inégal. Et la taille de la collectivité n’est pas un critère discriminant. Surtout, l’État est également responsable, ce que confirme la Cour des comptes. Ce n’est pas un hasard si c’est essentiellement en France que les prêts les plus toxiques ont été souscrits : aucun des systèmes de contrôle et d’alerte de l’État n’a fonctionné.
S’agissant des collectivités locales, les plus touchées, et qui sont en petit nombre, ne pourront pas payer parce que la ponction fiscale sur les habitants contribuables serait gigantesque. Il faut donc, à défaut de baguette magique, trouver une solution pour en sortir.
Dernière remarque : Les banques que nous avons en face de nous, et pas seulement Dexia, ont depuis très longtemps revendu leurs options sur les produits de change. C’est un point capital parce que cela signifie que revenir sur les termes du contrat initial équivaut pour elles à des pertes nettes.
Pour toutes ces raisons, le discours un peu simpliste qui consiste à vouloir faire payer les responsables mène à une impasse. Je suis d’autant plus à l’aise pour le dire que je suis un nouvel élu. Il faut en sortir vite car, plus le temps passe, plus le coût sera élevé. La période dangereuse ne fait que commencer.
Mme Claire Delpech. La fonction d’alerte n’a pas du tout joué. Les préfets et les trésoriers-payeurs généraux n’avaient pratiquement pas accès aux documents qui leur auraient permis de juger de la qualité de la dette, ou du risque encouru. Ensuite, au sein des collectivités elles-mêmes, les adjoints aux finances ou les responsables financiers se sont trouvés seuls pour apprécier le risque. Il faut regarder comment mieux le faire partager.
M. Dominique Gaubert. J’ai cité Dexia, parce qu’elle a le dos au mur. Or, pour qu’une négociation aboutisse, il faut pouvoir faire un geste. Les autres banques, en revanche, peuvent puiser dans leurs réserves.
Les associations peuvent donner une impulsion, mais il ne faudrait pas tomber dans le piège que pourrait nous tendre l’État et qui consisterait à ponctionner toutes les collectivités.
Je veux bien que les assemblées partagent la décision, mais on voit que les adjoints aux finances et même les maires de collectivités importantes ont du mal à comprendre. Les banques ont sans doute été trop loin, mais si les collectivités s’estiment lésées, elles ont la possibilité d’aller devant le juge qui, au bout d’un certain temps, tranchera au cas par cas sur l’existence, ou non, d’un défaut d’information. Mais je doute qu’il soit pertinent de faire de la vulgarisation auprès des élus pour des produits autres que ceux à taux fixe.
M. le président. On ne peut pas demander aux petites communes d’avoir la même ingénierie financière et le même personnel que dans les salles de marché. Ce n’est pas insulter les responsables de Finance Active ou M. Klopfer que de supposer que, s’ils ont été capables de donner l’alerte notamment sur l’évolution des parités monétaires, il y avait dans les banques des personnes aussi intelligentes qui auraient pu en faire autant.
M. Dominique Gaubert. C’est bien pire ! D’expérience, je sais que quand, par hasard, je m’aventurais à poser à mes interlocuteurs de Dexia ou autre des questions sur les risques éventuels, c’est tout juste si je ne devais pas m’excuser.
Mme Claire Delpech. Ne faudrait-il pas changer les modalités de passation des contrats entre les banques et les collectivités ? Mieux fixer les règles de responsabilité ? Mieux informer sur les risques encourus ? Les collectivités ont cru emprunter à taux fixe ; elles se sont laissées illusionner. Il faut rendre l’offre beaucoup plus lisible.
Mme Soraya Hamrioui. Le contentieux est le dernier recours. Aujourd'hui, l’information est insuffisante à tous les niveaux. La situation actuelle est le résultat d’une responsabilité partagée entre les banques, les collectivités et l’État dont chacun doit assumer sa part.
Les propositions des banques consistent seulement à repousser une échéance, ou à bloquer une annuité, en attendant. Dès lors que la collectivité refuse de payer la soulte de sortie, il n’y a pas de renégociation couvrant l’ensemble du prêt de possible. Certaines collectivités ont fait appel à la médiation, mais toutes ne connaissent pas son existence. L’État a très peu communiqué sur la médiation, et sur le nombre de collectivités qui ont fait appel à elle, que nous aimerions connaître.
M. le rapporteur. Nous le savons.
Mme Soraya Hamrioui. Nous avons demandé à ce qu’elle soit évaluée, pour savoir si elle est suffisante et juste. L’AMF a saisi la ministre de l’Économie, Christine Lagarde, de cette question le 16 mai dernier.
Une collectivité peut toujours, si sa situation est très dégradée, se lancer dans un contentieux, mais c’est une option par défaut.
Plus généralement, nous défendons le libre choix des collectivités. Elles doivent avoir la maîtrise de leur endettement, et de leur mode de financement, ce qui suppose une pluralité d’acteurs bancaires et un accès au marché obligataire. Il faut qu’elles puissent recevoir des offres diversifiées, ce qu’elles n’avaient pas, puisque les banques qui trustaient le secteur du financement aux collectivités locales ne proposaient que des produits structurés. Nous nous réjouissons donc de la création de l’entité Caisse des dépôts-Banque postale car nous espérons qu’elle améliorera la transparence du marché et servira de modèle aux autres. C’est aussi pourquoi nous proposons une agence de financement qui contribuera à une diversification de l’offre, qui est d’autant plus nécessaire que le crédit bancaire risque de s’assécher, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur l’investissement des collectivités.
M. le président. Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de nous avoir apporté votre point de vue.
*
* *
Table ronde, ouverte à la presse, sur « Le rôle de l’État » : M. Éric Jalon, directeur général des collectivités locales (DGCL) au ministère de l’intérieur ;
M. Philippe Parini, directeur général des finances publiques (DGFiP) au ministère du budget et M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor.
(Procès verbal de la séance du mercredi 23 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Nous recevons aujourd’hui les représentants des trois grandes administrations d’État chargées, au niveau central, de l’organisation du contrôle exercé sur les collectivités territoriales.
Si nous n’avons pas procédé à des auditions extensives des représentants de l’État au niveau local que sont les préfets et les directeurs départementaux des finances publiques, c’est que l’audition de l’ancien préfet et de l’ancien trésorier-payeur général de la Loire a montré de manière édifiante les limites du contrôle d’État.
Au-delà du constat, nous nous interrogerons sur les solutions concrètes et viables que peuvent proposer les services de l’État pour venir en aide aux acteurs locaux concernés et pour éviter que pareille situation ne se reproduise.
Je vous remercie d’accueillir M. Éric Jalon, directeur général des collectivités locales au ministère de l’intérieur ; M. Philippe Parini, directeur général des finances publiques au ministère du budget ; et M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor.
MM. Éric Jalon, Philippe Parini, Ramon Fernandez prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Je m’intéresserai successivement au diagnostic, aux réformes que le législateur devrait envisager pour l’avenir et à la manière de traiter le stock d’emprunts.
Sur le premier point, Monsieur Jalon, l’État a lancé par l’intermédiaire de vos services une opération de recensement des emprunts structurés des collectivités. En avez-vous tiré un état des lieux ? Nous pourrions ainsi croiser ces données et celles que nous ont fournies les banques.
Le contrôle exercé par l’État sur les collectivités territoriales comporte deux aspects : le contrôle de légalité et les vérifications du comptable public. Selon M. Michel Morin, ancien préfet de la Loire, le contrôle de légalité était purement formel, a minima, ne portait pas sur les emprunts dont nous parlons et était exercé par des fonctionnaires qui n’étaient pas assez formés pour comprendre les complexités des produits bancaires dont nous parlons. Peut-on s’en satisfaire ? Je rappelle que les collectivités sont soumises à la règle d’or et que ces contrats sont extrêmement aléatoires.
D’autre part, aux termes de la circulaire du 25 juin 2010, « les services de la DGCL assurent une mission de soutien aux services préfectoraux dans le cadre du contrôle budgétaire, et sur les questions spécifiques au financement des collectivités locales ». Dix-huit ans séparent ce texte de la circulaire du 15 septembre 1992 – abstraction faite d’une circulaire de 2003 sur les délégations de compétences en matière d’emprunt –, alors que le monde bancaire est éminemment variable : peut-on dire que les services centraux se sont montrés assez réactifs ?
Quand les services déconcentrés vous ont-ils fait part de leurs interrogations pour la première fois ? On sait que si un élu local présente des comptes non équilibrés, l’État reprend la main : avez-vous été alerté à ce stade ?
M. Éric Jalon, directeur général des collectivités locales. Le recensement se fonde sur trois sources. La première est l’étude réalisée par le cabinet FCL à partir d’un panel de collectivités représentant plus de 50 % de l’encours de la dette totale au 1er janvier 2010, étude reprise par la Cour des comptes dans le rapport sur la gestion de la dette publique locale qu’elle a publié en juillet dernier.
Désireux d’améliorer notre connaissance du stock, nous avons en outre entrepris le 5 septembre dernier, avec les services du ministère de l’économie et des finances, un recensement complet des produits à risque. Il alimentera le rapport que nous devons remettre au Parlement en juin 2012, aux termes de l’article 5 de la loi de finances rectificative promulguée le 2 novembre. Il s’agit de consolider l’encours de dette par strates de collectivités à partir de la classification Gissler telle qu’elle figure dans la charte et dans la circulaire du 25 juin 2010, en identifiant les collectivités qui ont des lignes de crédit classées 4 à 6 et/ou D à F. Nous n’avons pas encore tous les résultats, mais nous disposons de données significatives. Sur les vingt-trois régions recensées, onze ont des lignes de crédit ainsi classées, qui représentent 5,08 % de l’encours de leur dette. Sur quatre-vingt-huit départements, cinquante-huit sont concernés, pour 8,2 % de l’encours. La proportion de communautés urbaines est de huit sur seize, pour 850 millions d’euros, et celle des communautés d’agglomération est de trente-huit sur quarante-neuf recensées, pour 624 millions d’euros. Pour exploiter les données plus fines qui concernent les autres communautés d’agglomération et l’ensemble du bloc communal, nous n’aurons pas trop du temps qui nous reste avant la remise du rapport. En effet, les obligations de recensement sont récentes : elles découlent notamment des nouvelles annexes rendues obligatoires par les arrêtés du 16 décembre 2010. Les préfectures ainsi que les services locaux de la DGFiP pourront dorénavant procéder à de nombreuses vérifications auprès des collectivités.
Je laisse à M. Parini le soin de présenter le troisième recensement, réalisé sous l’égide de la DGFiP et qui porte uniquement sur les produits d’emprunt adossés à la parité entre l’euro et le franc suisse.
M. Philippe Parini, directeur général des finances publiques. Il ressort de ce recensement, effectué en septembre, que ces emprunts structurés représentent au total un capital initial de 3,6 milliards d’euros et n’ont été souscrits que par 537 collectivités, dont 91 seulement concentrent 50 % de l’encours total.
M. Éric Jalon. J’en viens à votre deuxième question, monsieur le rapporteur. Le contrôle de légalité exercé par les préfectures est soumis à un cadre très particulier, quelque peu subtil et qui a été précisé par plusieurs décisions de jurisprudence au cours de la période considérée. Les contrats de prêt relèvent du droit privé, ce qui entraîne plusieurs conséquences. Premièrement, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt de 2003 cité par la circulaire de 2010, lorsque ces contrats sont annexés à une délibération transmise aux services préfectoraux, ils sont déjà exécutoires. Deuxièmement, si le préfet obtenait l’annulation d’un acte auquel est annexé le contrat de prêt, cela ne frapperait pas celui-ci de nullité mais permettrait seulement à l’une des parties de saisir le juge des contrats, qui n’est pas le juge administratif.
Vous m’avez demandé ensuite si les dix-huit ans qui séparent les circulaires témoignent d’une réactivité suffisante des services de l’État. Je vous répondrai que la réactivité s’apprécie en fonction de l’alerte et que l’alerte, en l’occurrence, a été tardive : ce sont les crises de l’automne 2008 qui ont ouvert le débat sur l’endettement local et les produits souscrits. Voilà qui répond à votre quatrième question. Inutile de vous rappeler ce qui se disait à l’époque, et que Philippe Richert a souligné la semaine dernière en évoquant le congrès des maires de 2008 : les administrations, les associations et les collectivités étaient d’accord pour considérer que ces questions relevaient de la liberté d’administration accordée aux collectivités territoriales par les lois de décentralisation de 1982. Depuis, si l’on met à part la circulaire de 1992, nous n’étions intervenus ni par voie réglementaire ni par circulaire ; si nous avions tenté de le faire, nous n’aurions pas été entendus.
M. le rapporteur. Monsieur Parini, avez-vous vu les emprunts structurés se développer ? Quelles ont été les réactions ?
D’après M. Terrasse, ancien trésorier-payeur général de la Loire, pour régler les remboursements d’emprunt, les comptables publics n’exigeaient d’autres pièces justificatives que le tableau d’amortissement et les avis d’échéance et de domiciliation, conformément au décret de 1983. S’agissant d’emprunts structurés, c’est manifestement insuffisant. Qu’en pensez-vous ?
Enfin, selon la circulaire du 25 juin 2010, est seul déconseillé l’usage spéculatif des instruments de couverture des risques. Tous les autres produits – assis sur des indices exotiques, présentant des effets de levier –, même interdits par la charte Gissler citée en annexe, ne sont que déconseillés. Peut-on vraiment parler d’encadrement par l’État ?
M. Philippe Parini. Sur le premier point, je vous répondrai comme M. Jalon : on ne m’a pas communiqué d’informations particulières. À l’époque, j’étais sur le terrain, comme trésorier-payeur général. Je me suis donc renseigné auprès de mes collaborateurs : aucune collectivité ne s’est adressée à nous, fût-ce pour nous demander conseil. Ce n’est qu’au moment où ces problèmes ont été portés sur la place publique que nous avons été amenés à les étudier.
Sur le deuxième point, depuis les lois de décentralisation, le rôle du comptable public est très précisément défini : il participe au contrôle de légalité, mais il n’est absolument pas juge de l’opportunité des mesures. Les pièces qu’il demande ne servent donc qu’à vérifier la réalité de la dépense, non à en évaluer la pertinence. Dès lors, il suffit qu’elles en justifient l’origine et le montant exact – d’où le tableau d’amortissement. Le comptable n’a pas à en faire un autre usage dès lors que le contrat est signé. Que l’on s’en satisfasse ou non, du point de vue juridique, il n’a pas à en faire plus.
M. le rapporteur. Mais s’agissant d’un produit dont le taux d’intérêt est appelé à évoluer de manière imprévisible, le TPG comprend que le tableau d’amortissement ne correspond à rien : un taux exact aujourd’hui sera erroné demain. Aucun ne vous a-t-il fait part de ses doutes ?
M. le président. Les cabinets de conseil Finance active et Klopfer nous ont dit avoir donné l’alerte sur ces produits, notamment auprès de la DGCL, dès 2005, lors de réunions de travail. Je comprends qu’il faille appliquer les textes sur les relations entre l’État et les collectivités ; mais quand un signal d’alerte est émis, comment est-il reçu ? Est-il expertisé ?
M. Philippe Parini. Si un signal d’alerte nous est adressé, nous en accusons évidemment réception et les services de la DGFiP en parlent avec le préfet et avec le maire. Mais, comme l’a dit M. Jalon, on ne nous a pas alertés !
Monsieur le rapporteur, vous me demandez en somme si l’examen technique et strictement comptable dont le comptable public est chargé aurait dû le conduire à s’auto-alerter. Outre que l’exercice est difficile, comment aurait-il été reçu s’il s’y était essayé ? Le tableau d’amortissement, dites-vous, montre une composante variable. Mais n’est-ce pas ce qui faisait justement le charme du produit au moment où il a été choisi ? En contrepartie du risque, les taux étaient alors intéressants. Les décideurs ont arbitré au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales. Quant au comptable, il n’avait besoin que des pièces citées pour vérifier la régularité du mandatement de dépense. Ni en droit ni en opportunité, il n’aurait été dans son rôle s’il avait indiqué de sa propre initiative que le produit choisi comportait une part de risque tel qu’il refusait de payer la dépense à laquelle la collectivité s’était engagée.
M. le rapporteur. Vous parlez de la période bonifiée. Mais par la suite, que fait un trésorier-payeur général ou municipal face à des échéances assurées comportant des intérêts colossaux sans rapport avec le tableau communiqué initialement ? Demain, ce pourrait être le cas dans 5 000 collectivités. Si le législateur ne fait rien, quel sera le pouvoir du comptable public ? Devra-t-il payer alors qu’aucune pièce ne le justifie ?
M. Philippe Parini. Le comptable est dans une relation de subordination avec l’ordonnateur. Dès lors qu’il dispose du contrat et du tableau d’amortissement joint, il doit payer même s’il constate une aggravation de la somme par rapport au contrat initial. S’il ne le fait pas, il sort de son rôle. Le comptable n’est qu’un comptable ! Si le contrat existe, s’il n’est pas dénoncé, si des éléments financiers lui sont adjoints, et si l’ordonnateur lui demande de payer, il doit s’exécuter.
M. le président. Monsieur Jalon, vous dites que les difficultés ont été constatées à partir de 2008. Mais selon certains documents qui nous ont été remis, plusieurs spécialistes ont émis dès 2005, notamment lors de réunions de travail avec la DGCL, des réserves sur les produits en question, en particulier sur ceux qui dépendent de parités entre monnaies. Avez-vous procédé à des expertises ? Comment prend-on conscience du danger ?
M. Éric Jalon. Je distingue les doutes, même s’ils émanent de spécialistes, des signaux d’alerte venus du terrain. Il est possible qu’en 2005 ou 2006, mes services aient été en contact avec des spécialistes qui les ont avertis à propos de tel ou tel produit. Nous n’en avons pas retrouvé la trace, mais si d’autres vous l’ont fournie, je ne le nie pas. Simplement, à cette époque, ces doutes n’étaient pas corroborés par des alertes émises sur le terrain. Celles-ci ne nous sont parvenues que fin 2008 ; nous n’avons pas tardé à réagir, puisque les ministères de l’intérieur et de l’économie ont réuni dès novembre 2008 les principales associations d’élus et les établissements financiers, ce qui a abouti à la signature de la charte Gissler un an plus tard.
M. Patrice Calméjane. Vous avez rappelé que la libre administration des collectivités est inscrite dans la Constitution. La Constitution dispose également que, dans les collectivités territoriales, « le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge […] du contrôle administratif et du respect des lois ».
Ce cadre général étant défini, il existe des règles plus précises, par exemple, pour les communes, les règles budgétaires de la M14. Mais comment établir un budget sincère quand on ne connaît pas le montant des intérêts que l’on va devoir payer dans l’année ? Dès lors, comment un produit dont le mécanisme même ne permet pas de présenter des budgets sincères à moyen terme a-t-il pu être autorisé ? Les emprunts en question représentaient parfois 50, 70 ou 80 % du montant des investissements annuels, quelle que soit la taille de la commune ; cela n’aurait-il pas dû vous alerter ? Je ne m’explique pas que la préfecture ait laissé passer des montants pareils !
D’autre part, l’on ne vous aurait pas communiqué d’informations particulières. Les représentants de l’Autorité de contrôle prudentiel nous ont indiqué qu’ils avaient émis des alertes en 2008. Cependant, ces produits existent toujours, même si on en a limité le nombre. Comment expliquer de tels dysfonctionnements dans les relations entre l’État central et les organes de contrôle ?
Vous faites valoir que les actes sont déjà exécutoires au moment où ils sont communiqués à l’État. Va pour la première fois, mais la deuxième ? Pourquoi le préfet ou le TPG n’ont-ils pas réagi ? Malheureusement, les produits se sont ajoutés les uns aux autres. L’alerte n’a donc servi à rien. Nous voulons comprendre comment tout cela a fonctionné afin d’éviter que nos collectivités soient de nouveau confrontées aux mêmes difficultés.
M. Daniel Boisserie. Monsieur Jalon, que le contrat soit déjà exécutoire au moment où il vous parvient ne vous empêchait pas d’avertir la collectivité des risques encourus. Cela a-t-il été fait par vos services ?
Monsieur Parini, vous faites valoir que le comptable n’est qu’un comptable, comme toute sa hiérarchie, jusqu’au trésorier-payeur général. Faut-il comprendre que son devoir de conseil n’existe plus ?
M. le rapporteur. Une anecdote : le budget de ma collectivité a été placé sous le contrôle de la Cour des comptes pour défaut de provision alors qu’un recours était engagé contre un contrat de délégation de service public. Je ne suis même pas certain que les textes m’y obligeaient. Le cas dont nous parlons est un peu similaire : la collectivité ne dispose pas des réserves nécessaires pour honorer un contrat aléatoire.
M. Henri Plagnol. Nous comprenons bien que nous avons en face de nous des hauts fonctionnaires qui n’étaient pas aux affaires à l’époque et qui doivent assumer la continuité de l’action menée – comme les nouveaux élus dans les collectivités locales, d’ailleurs. Je n’en suis pas moins très frustré de vos réponses, messieurs.
Je rappellerai d’abord que la Cour des comptes, dans son récent rapport sur la gestion de la dette publique locale, signale des défaillances de l’État dans l’exercice de sa mission générale de contrôle.
Monsieur Jalon, comment la DGCL, chargée de guider les collectivités locales, a-t-elle pu laisser les banques – dont Dexia, qu’elle connaissait fort bien – leur proposer un produit intrinsèquement dangereux ? Gager la gestion des finances locales sur des options de change portant sur de très longues durées – au-delà de la période pleine de charme dont a parlé M. Parini – n’a aucun sens, ni intellectuel ni économique. Nos contribuables électeurs ne comprennent pas. Comment se fait-il que la DGCL n’ait pas soulevé le problème très tôt, et a fortiori quand les premières alertes ont été données ?
Monsieur Parini, je vous entends sur le rôle du comptable. Mais les collectivités les plus touchées aujourd’hui étaient sous le coup de la procédure dite d’alerte, qui implique que le TPG et le préfet avertissent chaque année le maire, par écrit, que ses ratios se dégradent. On a donc laissé des collectivités locales surendettées, visées par une procédure d’alerte, s’en prémunir artificiellement en restructurant la quasi-totalité de leur dette grâce à des taux d’intérêt minorés pour quelques années, sans que jamais les TPG ne s’inquiètent de la nature des emprunts. Si ce n’est pas une défaillance du contrôle, qu’est-ce donc ? Lorsqu’on s’inquiétait publiquement, en conseil municipal, du niveau de la dette, aucun des participants n’avait la moindre idée de la teneur des emprunts !
Enfin, le Trésor est chargé d’une mission générale de surveillance des risques systémiques. Comment expliquer que personne n’ait perçu quoi que ce soit avant l’effondrement de Dexia, qui a obligé l’État à la recapitaliser en apportant sa garantie ? L’État a manqué à sa mission première en échouant à protéger le système financier et les collectivités locales contre des risques extrêmes, ce qu’il va payer très cher, même s’il fait tout pour en limiter le coût, ce qui est compréhensible. Les parlementaires attendent des réponses à ces questions ; et, au-delà d’eux, les contribuables électeurs qui vont trinquer !
M. Jean-Pierre Balligand. Ma question s’adresse au directeur du Trésor, car je doute qu’il soit pertinent d’interpeller la DGCL et la DGFiP sur ces questions. Mes propos vont sembler hérétiques à nombre de mes collègues. Mais s’il y a défaillance dans cette affaire, elle est en effet liée au risque systémique qui découle du phénomène suivant : des prêts bancaires ont été consentis à des taux beaucoup trop bas, et partant, à des taux d’intermédiation bancaire infimes, du fait d’une bataille colossale entre banquiers pour se garder des parts de marché. Depuis que les règles de Bâle III obligent ces banquiers à provisionner, tout le monde fuit, parce que les prêts aux collectivités locales n’ont plus aucun intérêt par rapport aux autres prêts. Mais à l’époque, dans les grandes collectivités, il n’y avait aucun lieu de donner l’alerte au moment de la signature du contrat puisque les taux étaient très bas, très inférieurs à ceux des prêts classiques que les petites collectivités, elles, avaient l’habitude de souscrire. Le conseil général que je présidais avait 15 à 17 % de prêts structurés parmi ses emprunts, parce qu’il y gagnait de l’argent. En revanche, Vervins, la commune de 3 000 habitants dont je suis le maire, souscrit depuis plus de dix-sept ans des prêts à taux fixe : lorsque les taux sont bas, on est prêt à payer 0,4 % de plus pour s’épargner des ennuis quand on n’a ni cadre A ni directeur financier pour piloter les opérations.
À l’avenir – car que faire du passé ? –, il nous faudra absolument un dispositif permettant d’apprécier le risque systémique. Car c’est bien de cela qu’il s’agissait : il n’est pas normal que les banquiers prêtent de l’argent pour rien. Il faut bien qu’ils s’y retrouvent ! Lorsque j’ai découvert la structure des prêts qui avaient été contractés par Laval ou par Saint-Étienne, au moment où mes collègues y ont été élus, j’ai été effaré ; puis j’ai pris connaissance du taux consenti à l’époque de la signature et des différés de paiement accordés, totalement inédits à mes yeux malgré mon expérience. Qu’ils soient de droite ou de gauche, des responsables de collectivités ont réalisé des travaux un an et demi avant le renouvellement des mandats, sans acquitter la moindre échéance : ils les laissaient à leur successeur !
La direction du Trésor – et la Commission bancaire – sont en cause parce que la supervision macro-financière, qui aurait permis de déceler le risque systémique, a manqué. Loin de moi l’intention de dédouaner les banquiers. Mais à la date de la signature du contrat, le risque était nul et les conditions très intéressantes ; quelques années plus tard, parce que le contexte global a entièrement changé, le système bascule. Il faut en tirer les leçons.
M. le président. En effet, il s’agit moins ici de revenir sur le passé que de fixer des règles pour l’avenir. Quelle est votre position ? La Commission bancaire a mis en évidence un risque systémique dès son rapport pour 2001. Les auditions auxquelles nous avons procédé ont également montré, malgré quelques arrangements avec la vérité de la part de l’ancienne équipe dirigeante de Dexia, qu’il y avait quelque intérêt à proposer des produits structurés puisque la marge dégagée atteint 0,9 %, contre 0,2 % pour les prêts à taux fixe à vingt ans. On s’est en outre aperçu – et je ne parle pas seulement de l’article paru hier dans un grand quotidien du matin – que l’on avait donné instruction aux commerciaux d’aller démarcher les collectivités pour leur proposer de passer d’un taux fixe à un taux structuré. Et nous avons assisté impuissants à ce spectacle.
Vous invoquez l’autonomie des collectivités ; le ministre nous a rappelé en quels termes l’Association des maires de France avait revendiqué son indépendance. Toutefois, en matière budgétaire, les règles ont été durcies, notamment par la M14, parce qu’il aurait semblé dangereux de ne pas le faire. Tout le monde s’est rallié à l’obligation d’amortissement. Il est vrai que vous n’avez pas entendu parler des prêts toxiques lorsque les collectivités en bénéficiaient, grâce à des taux inférieurs à ceux du marché, avant de passer la patate chaude à leur successeur.
Comment mieux observer ce qui se passe ? Comment améliorer la situation ? Enfin, et même s’il est toujours facile de juger a posteriori, considérez-vous à titre personnel que l’administration aurait dû modifier certaines procédures ?
M. Éric Jalon. Je suis désolé, mais je n’ai pas la même lecture que M. Plagnol du rapport de la Cour des comptes. La Cour souligne les difficultés auxquelles se heurte le contrôle de légalité du fait notamment du cadre juridique auquel il est soumis, mais elle ne parle pas de défaut dans l’exercice du contrôle de légalité, sinon de la même manière qu’elle évoque le défaut de contrôle interne des collectivités qui ont souscrit ce type de produits.
Ensuite, selon la circulaire de 1992, « l’engagement des finances des collectivités locales dans des opérations de nature spéculative ne relève ni des compétences qui leur sont reconnues par la loi, ni de l’intérêt général ». Sur ce fondement, on aurait pu exciper du caractère spéculatif de certains contrats, notamment ceux qui touchent aux options de change, explicitement visés ici. Mais il aurait fallu démontrer ce caractère spéculatif, ce qui est beaucoup plus facile ex post qu’ex ante. Je rappelle que la même instruction interministérielle jugeait aussi « légitime pour une collectivité locale de développer une politique de gestion de la dette visant d’une part à profiter des évolutions qui lui sont ou seraient favorables, d’autre part à prévenir les évolutions de taux qui sont ou lui seraient défavorables ».
En outre, il ne s’agit que d’une circulaire. Vous me demandez si nous aurions dû interdire certains produits par voie de circulaire – car il se trouve que c’est sous cette forme que nous intervenons. Dois-je vous rappeler la hiérarchie des normes ? Les produits dont nous parlons sont légaux. Je suis heureux que, par l’intermédiaire de votre commission d’enquête, le Parlement s’interroge sur la nécessité d’en proscrire certains. Mais, à l’époque dont nous parlons, ils étaient autorisés par la loi, et la circulaire ne pouvait outrepasser les limites que lui assigne la jurisprudence quasi ancestrale du Conseil d’État.
La disproportion entre certains produits et les ressources qui doivent permettre aux collectivités de rembourser n’en est pas moins problématique. Que faire aujourd’hui ? Désormais, nous alertons très régulièrement les collectivités par l’intermédiaire des préfectures, par voie électronique. J’ai adressé en mars 2011 une note appelant l’attention des préfets sur certains produits et leur demandant d’engager des démarches auprès des collectivités. En outre, nous nous adressons directement aux collectivités dont nous savons qu’elles ont souscrit certains produits, notamment des produits de pente. Je dois dire que, dans la plupart des cas, nous ne rencontrons qu’un succès d’estime. Si tel est le cas en 2011, je n’ose imaginer l’accueil qui nous aurait été réservé en 2002, en 2000 ou en 1997 !
Enfin, nous avons créé, à la demande de nos ministres respectifs, une cellule de suivi commune. Sa première réunion a eu lieu au mois d’octobre et plusieurs des personnes ici présentes y ont assisté. Les recensements en cours permettront une approche plus fine, qu’il faudra sans doute compléter par un suivi des produits susceptibles d’être proposés, bien que le flux de produits à risque semble s’être tari depuis la circulaire Gissler.
M. Philippe Parini. M. Balligand a largement anticipé sur ce que je m’apprêtais à répondre.
La nature du produit rendait-elle les comptes insincères ? C’est à dessein que j’ai parlé du charme du produit, fût-il vénéneux. Outre que, juridiquement, nous n’avions pas à nous mêler de la structuration de l’emprunt, si l’on ne veut prendre aucun risque, il faut se limiter aux emprunts à taux fixe. Un emprunt à taux variable classique comporte déjà un risque. J’ajoute que les comptes sont examinés année par année, à partir d’un contrat déjà signé dont nous ne gérons que le taux d’amortissement.
En ce qui concerne le rôle du comptable, il comporte en effet un aspect réglementaire et une dimension de conseil. Je note que notre mission de conseil s’est étendue au conseil fiscal depuis la fusion entre la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des impôts. Dans cette fonction de conseil, nous n’intervenons en principe que si nous sommes sollicités. Toutefois, nous pouvons le faire spontanément lorsqu’une situation nous paraît particulièrement délicate. Mais la nature de ces produits ne justifiait pas, du moins au début, que nous intervenions à ce titre. Au demeurant, je ne suis pas personnellement certain que nous aurions été bien reçus.
Enfin, monsieur Plagnol, il est exact qu’au-delà du contrôle budgétaire, nous devons veiller, avec la préfecture, au respect des grands équilibres. Il ne s’agit que de quelques ratios basiques et nous faisons preuve, dans nos lettres, d’une grande diplomatie, pour ne pas donner l’impression de porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Peut-être, comme vous l’avez dit, certains sont-ils sortis de la zone d’alerte au prix d’un risque infiniment plus important. Cela signifie qu’au stade non du contrôle de légalité, mais du contrôle budgétaire, une approche plus qualitative serait nécessaire. Peut-être cela correspond-il à ce que vous envisagerez pour l’avenir.
Monsieur le président, vous avez l’amabilité de vous enquérir de notre sentiment personnel. J’ai été TPG dans un département proche du vôtre de 1998 à 2002, à l’époque où ces produits se développaient sans qu’apparaisse encore l’extrême danger dont ils étaient porteurs. C’était un département francilien puissant, doté d’équipes municipales solides. La principale banque qui proposait ces produits était très bien introduite auprès des collectivités et il ne venait à l’idée de personne, quelles que soient ses opinions politiques, de demander au service du Trésor public des conseils en matière de gestion financière. D’autant que l’environnement auquel ces produits étaient adossés n’était pas le même qu’aujourd’hui : c’est ce changement qui a révélé leur toxicité. S’il faut admettre une responsabilité collective, l’administration en prendra sa part ; mais des règles prudentielles devraient être imposées à ceux qui choisissent les produits. Des emprunts sur quarante ou cinquante ans sont dangereux du seul fait de leur durée, quelle que soit la nature initiale du risque, quelle que soit la construction du contrat.
Pour être honnête et équitable, il faudrait revoir la date de conclusion des contrats, leur présentation, leur adéquation au principe de bonne administration et la réduction de la charge financière annuelle. Mais les collectivités, à qui l’on avait confié quinze ans auparavant la libre administration de leurs finances, ne sollicitaient alors aucun conseil particulier des services de l’État, ce que je comprenais fort bien.
M. Ramon Fernandez, directeur général du Trésor. Comme d’autres, nous avons pris connaissance de ces problèmes au moment où ils sont apparus au grand jour, en 2008. Nous avons participé dès cette époque, avec la DGCL et la DGFiP, aux réunions au cours desquelles les ministres ont cherché des solutions avec les acteurs locaux et la communauté bancaire.
De manière générale, pour que la direction du Trésor – sorte de direction des risques – puisse activer les signaux d’alarme si un risque émerge, encore faut-il qu’elle en ait connaissance. Nous nous efforçons donc depuis quelques années de créer des structures et des processus qui permettent d’identifier les risques. La fusion de la Commission bancaire et de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a donné naissance à l’Autorité de contrôle prudentiel – en lien étroit avec l’Autorité des marchés financiers –, qui joue le rôle de tour de contrôle capable d’identifier différents types de risques et d’acteurs, donc de fournir des indices multiples. S’y ajoute le Conseil de régulation financière et du risque systémique (COREFRIS), créé l’année dernière, et qui réunit autour du ministre le gouverneur de la Banque de France, le président de l’Autorité des normes comptables, le président de l’Autorité des marchés financiers et plusieurs personnalités extérieures. Il a pour but d’identifier les facteurs de risque pour l’économie française.
Certaines pratiques de financement des collectivités locales auraient pu être concernées, mais, pour être franc, je doute qu’il ait été possible d’identifier le problème avant qu’il n’apparaisse. Cela étant, à condition que les mécanismes d’alerte fonctionnent et que les collectivités locales appellent l’attention des pouvoirs publics, le sujet peut être porté sur la table d’un comité comme le COREFRIS. Il en va de même du secteur immobilier, par exemple, auquel on pourrait étendre les remarques de M. Balligand sur le niveau anormal des marges et sur la compétition au sein du milieu bancaire.
M. Charles de La Verpillière. Les hauts fonctionnaires que nous auditionnons aujourd’hui sont assez convaincants lorsqu’ils répondent à la question suivante : l’État avait-il les moyens juridiques d’empêcher les collectivités de souscrire et d’honorer ces emprunts ? La DGCL ne pouvait sans doute pas recourir à des textes ayant une force contraignante suffisante, les préfets ne pouvaient exercer un contrôle réel sur les souscriptions en elles-mêmes et les comptables du Trésor ne pouvaient suspendre les paiements dès lors qu’on leur fournissait les contrats et des éléments de calcul vérifiables.
Mais la véritable question, qui nous renvoie à toutes les auditions précédentes, est celle-ci : l’État pouvait-il empêcher les banques de proposer ces produits ? Sur ce point, le directeur général du Trésor, qui a eu la chance de parler le dernier, a été un peu rapide. M. Balligand a parfaitement raison : ceux qui ont un point de vue très général sur le financement de l’économie auraient dû se demander par quel miracle des banques pouvaient proposer aux collectivités territoriales des taux nuls ou très bas pendant quatre ou cinq ans. D’autant que les banques en question n’étaient guère nombreuses et que la plus active était très connue. S’il y a eu défaillance de l’État – qui n’est pas seul responsable –, c’est plutôt sur ce point.
M. Thierry Carcenac. Monsieur Parini, vous avez dit que 537 collectivités étaient concernées, dont 91 concentraient la moitié de l’encours. Ce chiffre inclut nécessairement des régions, des départements et des communes, dont de petites communes. Or, si les grandes collectivités disposent de services qui assistent les élus en la matière, les autres sollicitent plutôt les conseils de l’ancien percepteur. Quelle est la formation de ces agents ? L’a-t-on modifiée ?
D’autre part, comment l’État peut-il aider les collectivités locales, par exemple par l’intermédiaire de France Trésor, à sortir de contrats léonins qui prévoient des indemnités de remboursement anticipé colossales, parfois égales à l’encours de la dette ? Il a installé le médiateur, me direz-vous ; mais quelle est l’étendue de ses pouvoirs ?
M. le président. J’ai mentionné le rapport de la Commission bancaire pour 2001. Qui lit ces rapports ? Servent-ils à quelque chose ? M. de La Verpillière l’a parfaitement montré, il était concrètement difficile pour les différents services d’intervenir auprès des collectivités locales. Mais de premiers indices jetaient le doute sur les produits proposés par les banques – notamment par Dexia, qui occupait près de la moitié du marché. À quel stade ce type de signal est-il pris en considération ?
M. Éric Jalon. Pour que nous empêchions les banques de proposer ce type de produits, il aurait sans doute fallu une intervention législative.
M. Charles de La Verpillière. Non : il s’agit d’un secteur réglementé.
M. Éric Jalon. Quoi qu’il en soit, je doute que nos interlocuteurs, notamment les collectivités locales et leurs gestionnaires, aient souhaité à l’époque que nous interdisions ces produits.
M. le rapporteur. Une réglementation différente s’impose aux banquiers selon qu’ils traitent avec un particulier ou avec une entreprise. Mais une collectivité n’est pas une entreprise. Quel est son statut ? Partant, à quels critères le contrat qui la lie à une banque doit-il satisfaire ?
M. Éric Jalon. Si tant est que ce point pose un problème, la charte Gissler le résout a minima puisque le quatrième engagement stipule que les établissements bancaires reconnaissent le caractère de non-professionnel financier des collectivités locales. Les choses sont désormais claires.
M. le rapporteur. Cela vaut pour l’avenir ; mais Dexia, qui se présentait comme « la banque des collectivités », aurait dû adapter son comportement.
M. Éric Jalon. À ma connaissance, avant même la charte, les collectivités étaient protégées comme les autres emprunteurs par le code monétaire et financier, le code de la consommation et le code civil.
Il y a trois manières de sortir d’un contrat : soit l’exécuter jusqu’à son terme, soit en modifier les modalités en accord avec l’autre partie, soit en obtenir l’annulation devant le juge des contrats. Certaines collectivités ont tenté la voie du contentieux en invoquant le défaut de conseil ; je ne connais pas toute la jurisprudence, mais je ne crois pas qu’elles aient obtenu gain de cause. Ainsi la petite commune de Terville a-t-elle été déboutée en 2009 par un juge judiciaire.
M. le président. Je cite le rapport de la Commission bancaire pour 2001 : « Le marché des collectivités locales continue d’être très concurrentiel. La gestion dynamique de la dette par les emprunteurs, combinée à l’évolution favorable des taux d’intérêt, a permis de réduire, au cours de ces dernières années, le poids des frais financiers (4,5 % du total des recettes de fonctionnement en 2001, contre 9 % en 1996). Les marges nettes restent faibles et leur connaissance exacte demeure imparfaite. Cette situation se traduit parfois pour les prêteurs par des manques à gagner importants en termes de marge. À cet égard, le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière sur le contrôle interne des établissements de crédit invite les prêteurs à veiller à la rentabilité de leurs opérations de crédit, à prendre des mesures pour identifier de la manière la plus exhaustive possible les produits et les charges afférents à ces opérations et à estimer le risque de défaut du bénéficiaire au cours de l’opération de crédit. »
M. Philippe Parini. Je me suis renseigné auprès de mes collaborateurs. J’ignore si nous avons été informés de ce rapport, s’il nous a été officiellement transmis, mais, si tel est le cas, nous n’en avons manifestement pas tiré les conséquences puisque nous ne sommes pas spontanément intervenus.
Monsieur Carcenac, les 537 collectivités dont j’ai parlé sont uniquement celles qui ont souscrit des produits adossés sur la parité entre l’euro et le franc suisse. L’ex-DGCP a instauré, à partir de 2007, des formations à l’analyse de la structuration des emprunts à l’intention de nos comptables. Une vingtaine de sessions ont été organisées au total. Elles ne sont pas extrêmement pointues : les comptables ne sont pas des traders. Mais nous les proposons désormais, en lien avec les services préfectoraux, aux collectivités locales, ce qui facilite le dialogue.
M. Ramon Fernandez. Le Trésor aurait-il dû surveiller les banques de plus près ? La politique de prêt bancaire aux collectivités locales n’est pas de notre ressort et nous n’en étions pas tenus informés. Les représentants de l’ACP ont dû vous donner des explications sur le système de surveillance des établissements bancaires. En revanche, si nous constatons une difficulté, nous pouvons proposer pour le compte du Gouvernement, en lien avec les autres directions compétentes, des mesures réglementaires, législatives ou de place afin de mettre fin à certaines pratiques dommageables. Ainsi avons-nous installé la médiation d’Éric Gissler, qui a donné lieu à la charte, et demandé aux banques, avec qui nous avons des échanges réguliers, de renoncer à des pratiques qui avaient été révélées comme peu acceptables.
Encore faut-il avoir connaissance de ces agissements. C’est possible lorsque l’Etat est actionnaire d’un établissement bancaire ou qu’il est représenté au conseil d’administration, ce qui ne valait pas pour Dexia. D’autre part, pour toutes les raisons déjà rappelées, les collectivités locales ne font pas partie des entités économiques que nous avions à surveiller. Si l’on nous demande de le faire, nous le ferons, mais cela ne faisait pas partie de nos missions.
Le danger que signale le rapport de la Commission bancaire à propos des marges insuffisantes concerne le prêteur, non l’emprunteur. Les mêmes préoccupations se manifestent aujourd’hui dans le secteur immobilier, comme je l’ai dit. Cela fait partie des risques sur lesquels nous pouvons appeler l’attention aux côtés du gouverneur de la Banque de France et du président de l’ACP : c’est le rôle du COREFRIS. Nous le faisons aujourd’hui pour les prêteurs, nous pourrions le faire aussi pour les emprunteurs.
M. Patrice Calméjane. Il a été fait allusion aux seize ratios issus de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Lors d’une conférence de presse, il y a une quinzaine de jours, le Premier ministre a annoncé que des informations supplémentaires devraient être ajoutées au budget des collectivités. Avez-vous des propositions à formuler à ce sujet ? Je dois rédiger un rapport de quatre pages pour justifier l’utilisation des 300 000 euros que reçoit ma collectivité au titre de la dotation de solidarité urbaine, mais quand nous listons les seize ratios sans aucun commentaire à la fin du compte administratif, personne ne trouve à y redire. Même si vous n’avez pas à juger de l’opportunité de l’action de la collectivité, de quelles informations commentées les assemblées délibérantes devraient-elles à votre avis disposer qui les éclairent sur la structure des budgets, notamment en vue de l’alternance ? Si les ratios sont inutiles, qu’on les supprime ; sinon, qu’on leur donne leur chance.
M. le rapporteur. Maintenant que le diagnostic se précise, comment aménager le système actuel afin d’éviter que cette situation ne se reproduise ? La négociation des contrats doit-elle être soumise au code des marchés publics ? La M14 est-elle adaptée ? Faut-il obliger les collectivités à provisionner pour garantir la sincérité des comptes ? Devrait-on exclure certaines catégories d’emprunts ?
D’autre part, le recul aidant, avez-vous des propositions à soumettre au législateur ?
M. Éric Jalon. Des réflexions sont en cours. Le ministre vous a parlé la semaine dernière de ce qui avait déjà été fait et de ce qui était envisagé. En outre, plusieurs dispositions annoncées par le Premier ministre et rappelées par M. Calméjane ont été adoptées dans le cadre du projet de loi de finances.
Devrait-on soumettre les contrats de prêt au code des marchés publics ? Il faudrait consulter les associations de collectivités sur ce point, mais je doute que les procédures lourdes que cela impliquerait soient compatibles avec la gestion active de la dette, dont le principe n’est pas en cause même si ses modalités ponctuelles ont posé des problèmes.
En revanche, nous souhaitons, monsieur Calméjane, rendre plus qualitatif le contrôle budgétaire exercé par les préfectures. Nous déployons actuellement une application de transmission dématérialisée des budgets locaux, « Actes-budgétaires », qui permettra à long terme, en automatisant le contrôle des grands équilibres et des ratios, de libérer des agents préfectoraux pour cette approche qualitative.
Parallèlement, nous enrichissons les annexes aux budgets et aux comptes locaux. On juge souvent ces annexes très, voire trop nombreuses. Mais la nouvelle annexe A2.9, rendue obligatoire en décembre 2010 par la DGFiP et la DGCL, présente une répartition de l’encours de dette selon le niveau de risque des emprunts et la structure des produits, sur le modèle de la typologie Gissler. Ainsi, les informations qu’elle contient seront connues et du réseau préfectoral qui l’exploitera et des assemblées délibérantes. Plus généralement, toujours avec la DGFiP, nous refondons les différentes annexes conformément à un avis rendu par le Conseil de normalisation des comptes publics en juillet 2011.
Que faut-il imposer, que faut-il interdire ? La piste du provisionnement pour risques retenue par la Cour des comptes me semble la plus prometteuse. Le Conseil de normalisation des comptes publics y travaille également, mais son avis ne devrait pas être publié avant l’été 2012. À quelles conditions les collectivités souscrivant des emprunts à taux variable – et lesquels – devront-elles provisionner ? Et dans quelles proportions, étant donné la difficulté d’appréciation du risque ? Il semblerait raisonnable de se régler sur le montant du bonus escompté de la période bonifiée, pour garantir une couverture suffisante du risque et, surtout, un effet dissuasif, le gain issu de la période bonifiée étant annulé par la charge de la provision. L’éventail des produits concernés reste également à déterminer, ainsi que le champ de l’obligation : sera-t-elle limitée au flux ou pourrait-elle s’étendre au stock, piste délicate mais pas exclue ?
À ces éléments s’ajoutent le recensement et le suivi des produits et des situations dans l’ensemble du secteur public local, auxquels nous procédons depuis 2008 et de manière plus formelle depuis quelques semaines.
M. Philippe Parini. Nous explorons également ces pistes puisqu’il s’agit d’un travail commun à nos deux directions. J’ai gardé de mon expérience sur le terrain l’idée que l’administration d’État, à commencer par la mienne, a fini par s’habituer à la décentralisation ; il serait dommage de revenir en arrière par des voies détournées. Il faut faire attention lorsqu’on parle d’autorisation préalable, de régulation, de code des marchés publics. Restons cohérents. En revanche, le regard de l’État présente quelque intérêt. Ce principe vaut de manière générale en matière de gouvernance. Or le regard que nous portons sur la situation financière des collectivités pourrait être plus aigu.
Mais, pour cela, nous avons besoin d’éléments financiers précis. C’est le rôle des annexes, qui, même si elles peuvent paraître contraignantes, nous fournissent une base de discussion avec les collectivités une fois certains contrôles traités automatiquement. Dans ce dialogue singulier avec le responsable de la collectivité, le comptable est bien dans son rôle de conseil. Je suis donc disposé non seulement à tirer parti des annexes existantes, mais à en développer de nouvelles, sur lesquelles porterait ce regard extérieur, malheureusement moins présent depuis quelques années. Le terme de conseil peut être mal compris ; il ne s’agit ni de tutelle ni de contrôle, simplement de remarques dont nos interlocuteurs seront libres de tenir compte ou non. Mais il faut que les règles soient claires, pour que l’on ne vienne pas nous reprocher en cas de problème de ne pas être intervenus davantage.
Cette action, en lien avec celle des collectivités elles-mêmes, serait parfaitement conforme à la vocation de la DGFiP, dont l’un des cœurs de métier est le partenariat avec les collectivités, dont elle tient les comptes, dont elle assure les recettes, dont elle paie les dépenses. Et je nous en donnerai les moyens.
M. le président. La décentralisation est un enjeu récurrent de nos travaux. Aucun des membres de notre commission d’enquête n’envisage de la remettre en cause. Mais, selon une métaphore que j’affectionne, ce n’est pas parce que l’on a le permis de conduire qu’il n’y a pas de code de la route. Pourquoi l’accès des collectivités locales aux produits d’emprunt ne serait-il pas réglementé ? Lorsque les produits structurés ont été introduits sur le marché des prêts aux collectivités, le conseil général de la Banque de France a envisagé, selon l’un de ses membres, d’en limiter la part à 50 % du stock de dette. Vous voyez qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause la décentralisation ! Les élus locaux ne supporteraient pas que l’État leur dise qu’ils ont droit à ceci mais pas à cela ; en revanche, des normes financières sécuriseraient la gestion des collectivités. Car, nos auditions le montrent bien, celles-ci n’étaient pas en mesure d’expertiser les nouveaux produits qu’on leur proposait.
M. Éric Jalon. Le contrôle interne aux collectivités et la transparence vis-à-vis de leurs assemblées délibérantes sont deux éléments essentiels. Je précise à ce sujet que les annexes que nous préparons pour nous conformer à l’avis du Conseil de normalisation des comptes publics devront notamment indiquer la période de bonification des prêts, les frais financiers afférents – commissions, pénalités, etc. – et les coûts de sortie. Elles s’ajouteront à la nouvelle annexe A2.9 pour offrir une vue complète de la situation dans chaque collectivité, ce qui nous manquait jusqu’à présent. Les textes seront publiés fin 2011 et s’appliqueront donc au compte administratif 2012 et au budget primitif 2013.
Enfin, aux termes de l’article introduit dans le projet de loi de finances pour 2012 à la suite des annonces du Premier ministre, article qui porte le numéro provisoire 47 sexdecies, « chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses ainsi que de l’état de la dette des collectivités territoriales ». Ces informations seront donc également transmises au Parlement qui pourra s’en saisir.
M. le rapporteur. La matière dont vous parlez peut être difficile à comprendre pour un conseil municipal. L’information est nécessaire mais non suffisante : ce sont bien les élus qui ont finalement signé les contrats dont nous parlons. En outre, ces éléments sont fournis à un moment donné alors que, dans le cas des prêts structurés, les conditions, notamment le coût de sortie, sont soumises à des variations quotidiennes. D’ailleurs, dans les négociations en cours, les banquiers conseillent aux collectivités de conserver leur taux pendant deux ans, en affirmant que la situation va s’améliorer et que la parité euro-franc suisse va finir par remonter !
M. le président. Il est en effet difficile d’expliquer un produit complexe à des personnes qui ne sont pas des expertes. On ne peut pas dire que les contrats n’ont pas été présentés aux collectivités. Mais, dans mon département, les comptes rendus des réunions de la commission permanente montrent qu’elle n’a rien trouvé à y redire, car peu de ses membres comprenaient vraiment ce qui leur était exposé. Bon nombre d’entre nous n’auraient pas mieux compris à leur place, d’ailleurs. Comme l’a dit M. Parini, de quelque transparence que l’on fasse preuve, certains sujets restent hermétiques à qui n’en est pas expert.
M. Ramon Fernandez. Comme la DGFiP et la DGCL, le Trésor juge opportune la politique de provisionnement préconisée par la Cour des comptes, qui permettrait de tenir compte du point de vue budgétaire et comptable des risques inhérents à certains produits.
Faut-il interdire certains produits ou instaurer des seuils ? La Cour l’a également suggéré. Le débat est complexe et suppose de mesurer les conséquences de telles dispositions sur la libre administration des collectivités locales. Le recours à l’emprunt est libre dans un cadre légal. Cela étant, si le Parlement ou d’autres services de l’État envisagent d’écarter certains produits a priori, nous nous associerons à leur réflexion. Mais comme l’a dit M. Parini, si l’on voulait maîtriser absolument tous les risques, il faudrait interdire jusqu’aux taux variables…
M. le président. Sans aller jusque-là, les représentants de l’ACP nous ont dit qu’il ne devrait pas être possible d’emprunter dans une monnaie lorsque l’on ne perçoit pas de recettes libellées dans cette monnaie. Il faudrait inscrire ce principe quelque part !
M. Ramon Fernandez. Je suis parfaitement d’accord. Certains produits ne sont absolument pas justifiés. Les emprunts indexés sur le cours du franc suisse n’ont rigoureusement aucun sens. Et je trouve pour le moins curieux que certaines collectivités locales souhaitent recourir à ce genre de pratiques financières, même si cela n’est pas de ma responsabilité.
Enfin, sans attendre les conclusions des travaux engagés, nous travaillons à étendre la charte Gissler à un plus grand nombre de banques, notamment aux banques étrangères.
M. le rapporteur. Personnellement, je ne comprends pas qu’on emprunte à taux fixe ! Il fut un temps où les taux atteignaient 15 %, voire 17 %. Les produits structurés ont contribué à faire baisser les taux. Le problème n’est donc pas là. Dans le logement social, d’ailleurs, tous les emprunts sont à taux variable puisqu’ils sont adossés sur le livret A. Mais il faut un encadrement : les taux variables peuvent être « capés ». Or on peut dire de certains produits que le banquier les a vendus sans protection.
La gestion active de la dette est nécessaire et l’argent, qui est une matière première comme une autre, doit être payé à sa juste valeur. La Suisse a déjà limité à 1,2 le taux de change euro-franc suisse ; si elle décidait que le franc fort lui coûte trop cher et ramenait le taux à 1,44, plus aucune collectivité ne voudrait mettre fin à son contrat ! Le problème de ces produits, c’est l’absence d’airbag.
Le diagnostic est maintenant clair et nous sommes plutôt d’accord sur les préconisations. Les collectivités ne peuvent pas à la fois réclamer l’autonomie et tenter de passer la patate chaude à d’autres quand elles sont dans l’embarras. On voit donc comment préparer l’avenir. Mais comment traiter le stock ? Avez-vous des propositions sur ce point ? Le problème concerne notamment les collectivités qui vont entrer dans la période toxique. Nous en parlions hier avec les représentants de l’association « Acteurs publics contre les emprunts toxiques » : l’encours problématique atteint aujourd’hui 15 milliards d’euros, dont 7 très toxiques. Aujourd’hui, la majorité des collectivités gagnent de l’argent car les taux sont très faibles. Mais demain, une bonne partie d’entre elles ne pourra pas présenter des comptes sincères. Comment les aider ? Comment traverser cette période intermédiaire ?
M. Jalon a rappelé les trois manières de sortir d’un contrat. La perspective de l’exécuter jusqu’à son terme a de quoi en affoler quelques-uns si la conjoncture reste la même. C’est ce qui a motivé la création de notre commission d’enquête. On peut aussi tenter de faire annuler le contrat. La voie moyenne est la négociation, à propos de laquelle on dit souvent qu’une mauvaise négociation vaut mieux qu’un bon procès. Avez-vous des suggestions à ce sujet ?
M. le président. Monsieur Jalon, la semaine dernière, nous avons entendu l’ancienne équipe dirigeante de Dexia soutenir qu’elle n’avait jamais proposé certain produit aux villes de moins de 10 000 habitants, avant de nous apercevoir que celles-ci avaient été la cible prioritaire du démarchage des banques et notamment de Dexia. Le ministre nous a également dit en votre présence qu’il fallait que les petites villes sortent de ces emprunts. Comment faire ? Et selon vous, les solutions qui permettront de traiter le stock et le flux devraient-elles être modulées en fonction de la taille de la collectivité ?
M. Éric Jalon. J’ai bien entendu le ministre, mais, avant la taille, c’est le risque que nous devons prendre en considération. Tel est l’objet des recensements en cours. Pour chaque collectivité, il faut tenir compte des deux facteurs : sa taille et sa capacité financière, d’une part, le risque auquel ses emprunts l’exposent, d’autre part.
La première solution possible est la médiation. La mission de M. Gissler, dont il vous aura rendu compte lors de son audition, a été prolongée conformément à la recommandation conjointe des administrations concernées.
Deuxièmement, depuis quelque temps, nous conseillons régulièrement aux préfets d’inciter les collectivités qui sont encore en période de bonification ou qui ont souscrit des produits conjoncturellement avantageux, tels les produits de pente, à sortir de ces contrats pendant que les conditions leur sont encore favorables. Je vous l’ai dit, cette démarche n’a pour l’instant qu’un succès d’estime.
Troisièmement, la DGCL analyse chaque année la situation de certaines communes, généralement de petite taille, dont le déséquilibre budgétaire a justifié la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet, et propose au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre du budget de leur attribuer une demi-douzaine de subventions d’équilibre. À ce jour, aucune collectivité n’a sollicité ni obtenu de l’État une subvention d’équilibre en raison du surcoût généré par l’explosion d’un emprunt toxique.
M. Philippe Parini. Sur les solutions possibles, je n’ai rien à ajouter aux propos d’Éric Jalon, dont l’administration est la première concernée. J’indiquerai simplement que, pour choisir la bonne, nous avons besoin d’un état de l’art extrêmement précis. Nous l’avons établi pour les emprunts indexés sur le franc suisse, les banques en ont fait une partie de leur côté, mais les chiffres sont assez hétérogènes et le moment où la situation va se dégrader diffère selon les produits souscrits. Nous sommes prêts à y travailler plus largement pour aider les autres services de l’État ; mais il faudra également que les banques nous fournissent leurs données. Quoi qu’il en soit, aucune des trois voies que vous avez évoquées ne pourra servir de solution universelle, car les situations, les engagements souscrits et les dates de fin de bonification sont très variables. Seul un état des lieux complet permettra à chaque structure de choisir l’une ou l’autre de ces formules.
M. Ramon Fernandez. Il faut tout faire pour inciter les collectivités à sortir des contrats tant que les soultes et les pénalités ne sont pas prohibitives.
M. le président. Actuellement, ce sont les soultes qui posent le plus de problèmes. Nous l’avons encore vérifié hier avec l’association « Acteurs publics contre les emprunts toxiques ». Pour l’instant, les banques déconseillent aux collectivités concernées de sortir de leurs contrats, sauf à l’une d’entre elles qui connaît de graves difficultés. Mais de toute façon, comment mettre fin au contrat quand la soulte est égale au montant du capital ?
M. le rapporteur. Je ne pense pas qu’il faille traiter différemment petites et grandes collectivités. Il ne faudrait pas donner l’impression que ceux qui ont fait des erreurs vont recevoir des subventions. Tout le monde doit être traité de la même manière.
Cinq mille collectivités sont potentiellement en difficulté. Certes, quelques-unes seulement ont un stock de dette constitué à 80 ou 90 % d’emprunts structurés. Mais cinq mille collectivités doivent traiter avec quelques banques. Comment simplifier la situation ? La médiation Gissler a déjà beaucoup fait, mais cette voie prendrait des siècles ; or c’est maintenant qu’il faut agir, tant que l’on est encore dans la période bonifiée. Selon la loi des 80/20, environ 20 % des produits génèrent 80 % de surplus toxiques. Certains, à tort, confondent l’encours de la dette, les intérêts et leur partie toxique. On ne peut pas évaluer la toxicité à 15 milliards d’euros : la partie toxique est celle qui vient en surplus des intérêts qu’il aurait normalement fallu payer. C’est quand cette part toxique dépasse un certain seuil que la situation devient inacceptable.
Les constructeurs remplacent bien une voiture haut de gamme quand beaucoup d’acheteurs se plaignent de dysfonctionnements de la boîte de vitesses. Or, bien qu’il n’y ait pas encore de jurisprudence, on sait déjà qu’indépendamment des retournements de conjoncture qui rendent toxiques certains produits, des mécanismes prudentiels n’ont pas été respectés – surtout par les banquiers, même si les collectivités doivent assumer la liberté qu’elles revendiquent. De son côté, le législateur n’avait peut-être pas assez encadré les pratiques en vigueur. Bref, la responsabilité est partagée. Je l’ai dit, une mauvaise négociation vaut mieux qu’un bon procès. Ne suffirait-il pas de rappeler quelques voitures défectueuses ? Car en remplaçant un petit nombre de produits abondamment souscrits, on soulagerait tout le monde. Je songe aux produits adossés sur le franc suisse, dont on pourrait montrer qu’ils n’étaient pas prudents, pas capés, pas vendus dans des conditions sérieuses, etc. Au lieu de conclure partout des contrats de swaps bilatéraux avec les collectivités, qui impliqueraient de régler des soultes affolantes, les banquiers conserveraient par-devers eux les instruments de couverture des prêts qu’ils ont consentis mais proposeraient à leurs clients des taux raisonnables, à condition qu’ils assument une part du risque puisqu’ils ont signé un contrat. Seuls sept ou huit produits et trois ou quatre banques resteraient alors en lice.
Mais, pour parvenir à cette solution, nous avons besoin de l’État. Quand la Grèce est en difficulté, l’État est le premier à aider le pays et les banquiers qui, ne l’oublions pas, auraient pu tout perdre ; quand les banques ont des problèmes, il vient à leur secours. C’est à lui de demander que ces produits soient échangés contre des produits normaux, adaptés à la gestion des collectivités, c’est-à-dire, à mon sens, des taux variables en lien avec la réalité économique et avec le coût de l’argent, de type « Euribor plus x ». La collectivité prendrait sa part du risque et la banque gérerait la toxicité.
M. Éric Jalon. Les relations avec les banquiers n’étant pas de mon ressort, je ne répondrai pas sur ce point. Je souhaite simplement dissiper une ambiguïté : les subventions d’équilibre ne sont ni un remède au déséquilibre budgétaire ni un encouragement adressé aux mauvais gestionnaires, mais un indice a contrario du fait que, pour l’instant, aucune collectivité ne doit le déséquilibre de son budget au dérapage de ses taux d’intérêt.
M. le rapporteur. Cela va venir !
M. le président. La moitié de l’encours est encore en période de bonification, et ce n’est que cette année que le volume et les taux commencent à être problématiques. Un grand quotidien économique du matin fournit dans son édition d’aujourd’hui un argumentaire presque entièrement rédigé. Le rapporteur a dit qu’elles gagnaient de l’argent, mais en fait, les collectivités ont reporté leurs pertes sur les années à venir.
M. Éric Jalon. Permettez-moi de ne pas me prononcer sur des cas particuliers. Certains produits, notamment de pente, représentent une part importante des emprunts structurés ; par les alertes que nous transmettons à notre réseau, nous incitons les collectivités à en sortir dans les meilleures conditions tant que cela est encore possible.
M. le président. Sur les très nombreuses collectivités concernées, une centaine à peine a fait appel à M. Gissler avec succès. On imagine le travail qui l’attend si les demandes de sortie se multiplient l’année prochaine ou au cours des deux ans à venir.
M. Éric Jalon. Tout dépend de la part du risque dans l’encours total de la collectivité.
M. Jean Proriol. Au congrès des maires, dont j’arrive, je n’ai guère entendu de déclaration ou de demande à ce sujet. On a l’impression que les maires concernés ne s’en vantent pas… Un maire de mon département, président d’une communauté d’agglomération, m’a confié : « Moi, j’ai fait du franc suisse, et jusqu’à présent, j’ai gagné ! Il me reste deux ou trois ans, je vais peut-être perdre un peu, mais je ne tremble pas. » Cela étant, son emprunt est assez simple.
Interdire les taux variables me paraît inconcevable. De même, lorsque nous avons autorisé La Poste à proposer des crédits à la consommation, après en avoir débattu dans l’hémicycle, l’établissement a été mis en garde à propos du crédit revolving, mais il n’était pas question d’interdire cette pratique, qui fait partie de la panoplie de tout banquier actif dans ce domaine. Les taux sont simplement « capés » par le seuil d’usure. On sait où cela finit : à la Banque de France, et ce sont les banquiers qui trinquent car ils doivent accepter une réduction de la dette.
M. Bartolone a évoqué les commissions permanentes des conseils généraux ou régionaux. Pour y avoir siégé, je peux vous dire que nous traitions des dossiers de 500 pages en une heure, même sous la présidence de M. Giscard d’Estaing, pourtant très sourcilleux sur les taux non classiques.
On a également parlé des strates de collectivités. Mais il serait bien difficile d’autoriser telle commune à souscrire des produits que l’on interdit à telle autre.
En revanche, en ce qui concerne le stock, il faut encourager les communes à sortir de ces contrats si elles le peuvent, du moment qu’elles peuvent absorber la soulte proposée, surtout quand l’emprunt ne date que de deux ou trois ans. Mais il n’y a ni solution miracle ni opération systémique envisageable.
M. le président. S’il y avait une solution miracle, nous n’aurions pas eu besoin de commission d’enquête !
M. Jean Proriol. Cela étant, nous sommes ravis quand notre percepteur dresse le bilan de la situation financière de la commune et nous le présente de sa propre initiative. Mais je doute que les percepteurs fassent de même pour toutes les communes qui relèvent de leur compétence.
M. le président. Merci, messieurs, de votre contribution.
*
* *
Audition de M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations
(Procès verbal de la séance du mardi 29 novembre 2011)
(Présidence de M. Claude Bartolone, président de la commission d’enquête)
M. le président Claude Bartolone. Mes chers collègues, nos travaux touchent à leur fin. Après le constat, l’examen des responsabilités de chacun et des propositions des différents acteurs, le moment est venu de s’interroger sur l’avenir du crédit au secteur local et des emprunts actuellement souscrits par les collectivités et les établissements publics locaux.
Je suis heureux d’accueillir en votre nom M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, accompagné de M. Sami Gotrane, direction financière. La Caisse des dépôts va être amenée à jouer un rôle crucial dans l’affaire qui nous intéresse. Tout d’abord, elle a débloqué une enveloppe qui est passée de 3 à 5 milliards d’euros afin de proposer des prêts aux collectivités locales victimes de la raréfaction du crédit ; ensuite, elle a repris, avec La Banque postale, l’encours de prêt de Dexia ; enfin, toujours avec La Banque postale, elle se prépare à mettre sur pied une nouvelle structure qui prêtera au secteur local et dont nous vous demanderons d’abord quand elle sera en mesure de distribuer ses premiers prêts.
M. Augustin de Romanet et M. Sami Gotrane prêtent successivement serment.
M. Jean-Pierre Gorges, rapporteur. Monsieur le directeur général, l’enveloppe spéciale de prêts annoncée le 7 octobre dernier a été portée à 5 milliards d’euros le 22 novembre. Elle est destinée à financer des projets d’investissement en 2011 et 2012. Les collectivités se manifestent-elles de manière spontanée ou après avoir été éconduites par d’autres établissements bancaires ? Pensez-vous que cette somme sera affectée rapidement ? Faudra-t-il prévoir une nouvelle augmentation ?
Cette enveloppe permet à la Caisse des dépôts de proposer des emprunts à taux variable indexé soit sur le taux du livret d’épargne populaire (LEP), soit sur l’Euribor, soit sur l’inflation, ainsi que des emprunts à taux fixe. Quelle est la part de chacune de ces catégories dans l’éventail disponible ?
Enfin, ces prêts ont-ils vocation à rester gérés par la Caisse des dépôts ou à rejoindre le portefeuille de la future structure de financement local ?
M. Augustin de Romanet, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Lors de la crise de 2008, le Gouvernement a décidé de débloquer en urgence, pour remédier à la pénurie du crédit, une enveloppe de 5 milliards d’euros destinée aux collectivités locales, également répartie entre la Caisse des dépôts, d’une part, et les banques commerciales, de l’autre. La Caisse a distribué 1,7 milliard de prêts ; les banques commerciales 800 millions.
Puis l’on a pris conscience du fait que le secteur des prêts aux collectivités locales connaîtrait en 2011 de nouvelles tensions. Jacques Pélissard, président de l’Association des maires de France, a sollicité le Premier ministre à ce sujet en juin et juillet ; j’ai moi-même été appelé par des maires de grandes villes dont les demandes de prêt restaient sans réponse. Nous avons alors envisagé une nouvelle enveloppe, initialement fixée à 3 milliards d’euros au motif que la crise était moins dure qu’en 2008. En réalité, 2011 est une année beaucoup plus propice à la dépense locale, car il s’agit d’une phase du cycle municipal où de nombreux projets sont engagés ; en outre, la capacité d’intervention de la Caisse est mieux connue qu’en 2008. De fait, dès l’octroi de l’enveloppe, le montant des demandes a parfois atteint cinq fois celui de l’offre, selon nos estimations initiales. De plus, les établissements de santé sont cette fois également concernés, pour 500 millions d’euros, ce qui n’était pas le cas en 2008. Le Premier ministre a donc porté l’enveloppe à 5 milliards. La question de savoir si les 2 milliards supplémentaires seront attribués par la Caisse des dépôts ou par les banques n’est pas encore tranchée. Quoi qu’il en soit, la Caisse se tient prête à les distribuer directement.
Pourquoi les collectivités locales se sont-elles tournées vers nous ? Vous l’avez suggéré, les banques ne leur proposent spontanément rien ou presque rien – ainsi le maire de l’une des cinq plus grandes villes de France m’a-t-il confié qu’on ne lui avait fait aucune offre de prêt – ou pratiquent des taux dissuasifs, de 7 % par exemple. Cette réticence des banques à aller sur le marché des prêts aux collectivités, qu’elles admettent explicitement, vient essentiellement du fait que cette activité n’est pas rentable, et ce pour trois raisons. Premièrement, une banque hésite à accorder des prêts sans dépôts associés. Deuxièmement, les ratios de solvabilité de Bâle III supposent de disposer de fonds propres importants pour des prêts à long terme. Troisièmement, le ratio de liquidité, le Net Stable Funding Ratio, représente un surcoût estimé aujourd’hui à 100 points de base, contre 55 il y a seulement trois mois. De fait, les règles de Bâle III interdisent la transformation. La Caisse des dépôts pratique la transformation de liquidités en barrages, pour reprendre la formule de François Bloch-Lainé, ou plutôt en investissements à long terme pour les infrastructures, les logements et les collectivités locales. Mais les banques peuvent de moins en moins faire de même puisqu’on leur demande, pour des emplois à vingt-cinq ans, des ressources à vingt-cinq ans, alors qu’aucune banque en Europe ne peut emprunter en non secured, sans collatéral, à plus de trois ans.
Nous proposons des emprunts dont le taux est, au choix de l’emprunteur, soit fixe, soit indexé sur le livret d’épargne populaire, l’inflation ou l’Euribor. Selon mes informations, 50 % des demandes concernent des taux fixes, 28 % un index LEP ou inflation et 22 % un index Euribor.
Ces prêts, accordés grâce à une ressource privilégiée, resteront dans le fonds d’épargne : il serait impossible de les transférer à la future structure de financement, car celle-ci se financera aux conditions de marché. Je profite de l’occasion pour remercier les membres de la commission des finances et tous les parlementaires qui ont voulu que nous disposions de tout le croît naturel du livret A. Il y a un an, en effet, certains songeaient à plafonner à 3 % la croissance de l’encours centralisé à la Caisse des dépôts, le surplus revenant au secteur bancaire. Or, si nous pouvons venir en aide aux collectivités, c’est grâce à ces ressources, qui sont considérables puisque les dépôts, dont nous récupérons 65 %, ont augmenté de 17 milliards d’euros en 2011, hors capitalisation des intérêts. En d’autres termes, en décidant de débloquer ces 5 milliards d’euros, le Gouvernement n’obère pas notre capacité de prêt aux organismes de logement social.
Quant à la future banque des collectivités locales, nous souhaitons qu’elle soit opérationnelle en juin 2012. Le Premier ministre a autorisé la signature de prêts au titre de la nouvelle enveloppe jusqu’au 30 avril. La période de carence devrait donc être aussi courte que possible. Cette joint venture, dont l’opérateur industriel sera La Banque postale, qui en détiendra 65 %, doit d’abord se doter d’un réseau de correspondants sur le territoire, auprès des collectivités locales. Nous nous efforcerons de proposer à La Banque postale de s’inspirer de la technologie de la Caisse des dépôts, qui dispose d’un réseau de directeurs régionaux.
D’autre part, la nouvelle structure devra refinancer les prêts. Pour cela, nous envisageons de recourir à un véhicule de refinancement, sous forme d’une société de crédit foncier – catégorie de société financière créée en 1999 à la suite de la crise du Crédit foncier -, chargé d’émettre des Pfandbriefe françaises, des obligations très sécurisées, généralement très bien notées. En l’espèce, notre objectif est le double A, voire le triple A. Cette société émettra du papier pendant une durée égale à celle des prêts, en tirant profit de la signature cumulée de la Caisse des dépôts et de La Banque postale puisqu’elle devrait en effet être détenue à 65 % par la Caisse des dépôts, à 5 %, dans un premier temps, par La Banque postale, et à 30 % par Dexia Crédit Local, qui en reste actionnaire. Le défi que nous devrons relever au premier semestre 2012 consistera à ranimer cette structure de refinancement, Dexia Municipal Agency, qui jouit aujourd’hui d’un crédit si faible qu’elle n’est plus en activité. Il nous faudra donc redonner confiance aux investisseurs.
Les prêts distribués par la nouvelle banque seront simples, compréhensibles, transparents, non structurés. Le taux affiché sera calculé à partir des coûts de refinancement. La gestion financière sera raisonnable. La Banque postale étant une entreprise détenue par La Poste à 100 %, elle-même détenue par l’État à 74 % et par la Caisse des dépôts à 26 %, et la Caisse des dépôts étant placée sous la surveillance particulière du Parlement, les emprunteurs seront parfaitement informés des bénéfices réalisés par la banque, puisque tous les comptes seront à la disposition de la représentation nationale.
M. le rapporteur. Cette structure bancaire pourra-t-elle participer à la renégociation d’emprunts structurés ?
M. Augustin de Romanet. Selon nos premières discussions avec Dexia, Dexia Crédit Local conserve l’apanage de la renégociation et des discussions sur les prêts qui font l’objet de contentieux. D’où un enjeu crucial de nos échanges avec elle : nous ne devons pas nous faire concurrence. Il serait en effet délicat que notre joint venture et Dexia proposent les mêmes produits aux mêmes clients. Nous travaillons donc à une clause de non-concurrence aux termes de laquelle Dexia ne pourrait accorder de nouveaux prêts aux collectivités locales qu’en conséquence des renégociations dont elle demeure responsable.
M. le président. C’est une sortie en sifflet !
M. Augustin de Romanet. Très longue.
M. le rapporteur. En ce qui concerne le stock d’emprunts de Dexia, justement, la Caisse a-t-elle provisionné le montant du risque juridique que représente cette reprise ? Dans quelles proportions ? Les emprunts structurés qui font partie de ce portefeuille ont-ils vocation à aller à leur terme ou à faire l’objet de renégociations ? Vous avez en partie répondu, mais j’aimerais que vous alliez plus loin, car la gestion du stock est notre principale préoccupation. Enfin, la Caisse a-t-elle créé une cellule particulière destinée à renégocier les emprunts structurés ? A-t-elle déjà entamé des renégociations ?
M. le président. Si Dexia ne peut prêter qu’au titre de la renégociation de prêts antérieurs, pourrez-vous intervenir dans la renégociation ?
M. Augustin de Romanet. Nous n’avons pas provisionné pour un risque juridique parce que nous nous sommes battus contre le risque financier. Lorsqu’il a été envisagé que nous rachetions DexMA, le risque, pour nous, était double. Le premier était d’acheter à une valeur supérieure à la valeur de marché. Sans les dispositifs de garantie votés par le Parlement, le jour où nous avons acheté DexMA, nos commissaires aux comptes nous auraient demandé d’enregistrer une perte de 5 milliards d’euros dans notre compte de résultats, soit 25 % de nos capitaux propres.
M. Dominique Baert. Pourquoi ?
M. Augustin de Romanet. Parce qu’au moment où les prêts ont été consentis aux collectivités par Dexia, leurs marges étaient beaucoup plus faibles qu’elles ne le seraient aujourd’hui. Dans la formidable vague de l’évaluation dite mark to market, le portefeuille de 80 milliards que nous devions reprendre avait ainsi, de l’aveu même du vendeur – il n’y a pas eu dol –, perdu 5 milliards. Cette difficulté n’a pu être surmontée que parce que l’on nous a garanti que ces prêts seraient, à terme, remboursés en totalité, grâce au dispositif que vous avez voté.
M. le président. Pour dix ans !
M. Augustin de Romanet. Un peu plus.
Un second risque découlait spécifiquement des prêts très structurés, les plus dangereux, les prêts hors charte Gissler et ceux classés E3 à E5 par la charte Gissler. Leur volume global est de 10 milliards d’euros. Sur ce montant, nous avons obtenu du Parlement qu’il vote la garantie de l’État, qui immunise entièrement la relation de la Caisse avec Dexia. Cette garantie joue moyennant une franchise de 500 millions d’euros, au-delà de laquelle un ticket modérateur de 30 % reste à la charge de Dexia. Ensuite, nous bénéficions d’une garantie dite stoploss dès lors que le coût du risque dépasse 10 points de base par an, soit 70 millions d’euros. Nous avons en effet considéré que nous pouvions assumer une perte jusqu’à dix fois supérieure au risque normal, lequel est limité à 1 point de base puisque les collectivités locales sont normalement de très bons payeurs.
Nous n’avons donc pas provisionné pour risque juridique puisque nous sommes ainsi protégés du risque financier et que le risque juridique évidemment attaché à la renégociation des prêts sera assumé par Dexia, chargée de la renégociation. Nous n’avons pas non plus prévu d’organisation particulière pour renégocier les prêts structurés inscrits au bilan de DexMA puisque les équipes de Dexia Crédit Local s’en chargeront.
Ces emprunts structurés ont-ils vocation à aller à leur terme ou à être renégociés ? On ne peut bien entendu postuler que l’opération à laquelle nous travaillons interdit les renégociations. La décision relève de la relation bilatérale entre Dexia et les collectivités locales. Mais la renégociation pourrait coûter très cher aux collectivités locales : selon les chiffres dont je dispose, un crédit structuré sur trois supposerait, pour être transformé en prêt à taux fixe, une soulte représentant 40 % du capital restant dû. Comment fixe-t-on cette soulte, et qui peut ou doit la prendre en charge ? Cette question me dépasse.
M. le président. C’est la quadrature du cercle !
M. le rapporteur. Le problème des renégociations, avec Dexia mais aussi avec d’autres banques, françaises et étrangères, est en effet le montant des soultes. La proposition classique consiste à refinancer le capital restant dû majoré de la soulte, de 40 % du montant du prêt par exemple, à des taux plus normaux et plus sûrs. Mais aujourd’hui, une collectivité locale ne peut accepter ces conditions. Notre objectif est de trouver une issue à ce problème. Les responsabilités sont partagées. D’une part, certains ont volontiers acheté de l’argent bon marché ; d’ailleurs, la majorité des emprunts bénéficient encore de ces taux bonifiés, mais plus pour longtemps.
D’autre part, les produits en question n’auraient peut-être pas dû être sur le marché. La charte Gissler les exclut aujourd’hui, mais, dès cette époque, les techniques de présentation et de vente n’ont-elles pas servi à Dexia, qui se présentait comme la banque des collectivités, à commercialiser des produits qui n’avaient rien à faire dans une collectivité territoriale ? Puis, à partir de produits fabriqués sur mesure pour les grandes collectivités gérant de grandes masses financières, on est peu à peu passé à du prêt-à-porter. On nous a juré que les communes de moins de 10 000 habitants n’étaient pas visées ; pourtant, aujourd’hui, quelque 1 800 communes de moins de 10 000 habitants ont les mêmes types de produits que les grandes communes. Bref, une vaste opération commerciale a pris pour cible un stock de dette dormant qui représentait quelque 160 milliards d’euros, et jusqu’à 270 milliards si l’on inclut les établissements de santé et les offices d’habitat, et on a ainsi transformé des prêts à 4 ou 5 % en prêts structurés. La dette est dynamisée, les emprunteurs gagnent de l’argent, les banquiers dégagent des marges beaucoup plus importantes – même si, vous l’avez dit, une collectivité n’est pas rentable car elle n’effectue pas de dépôts –, mais sur des produits tels qu’un accident, de la parité euro-franc suisse par exemple, est lourd de conséquences.
Enfin, l’État a lui aussi ses responsabilités : le recours à ces produits était-il suffisamment encadré par la circulaire de 1992 ? Les organes de contrôle exerçaient-ils une véritable surveillance ?
Les emprunts structurés problématiques représentent 15 à 18 milliards d’euros. Le capital est dû, tout le monde en est d’accord. Quant aux intérêts, il est normal d’en payer quand on emprunte de l’argent. De l’avis de tous, la bonification initiale – 1 %, voire 0 % pendant dix ans ! – n’est pas tout à fait normale ; mais ce qui nous attend n’est pas normal non plus ! Est toxique ce qui dépasse le capital et le montant normal des intérêts. Cette partie toxique est souvent exposée à des retournements de cycle : ainsi, le taux de change euro-franc suisse, qui est aujourd’hui de 1,2 du fait des interventions de la Banque nationale suisse, pourrait évoluer favorablement au cours des six mois à venir, ce qui résoudrait tous les problèmes. Mais les collectivités ne connaissent pas l’évolution de ces paramètres à long terme alors qu’elles sont tenues par la règle d’or budgétaire de présenter chaque année des comptes équilibrés.
Que faire de cette partie toxique en attendant des jours meilleurs ? Les banques et les collectivités pourraient se mettre d’accord pour revenir à des emprunts « normaux », à taux fixe ou à taux variable de type « Euribor + x », en renvoyant le paiement du surcoût à une période plus favorable. La Caisse des dépôts pourrait-elle accompagner les collectivités dans l’intervalle ? Aujourd’hui, les renégociations portent sur le capital et sur une soulte que l’on transforme et que l’on refinance. Cette solution, qui consiste à reculer l’échéance, est présentée au motif que la conjoncture va se retourner dans deux ans, mais elle est incompatible avec le mode de gestion des collectivités, qui doivent présenter des comptes sincères.
M. Augustin de Romanet. La réponse est délicate, car il ne nous est pas facile de stipuler pour autrui : la Caisse des dépôts n’a pas de banque, donc pas de structure de prêt, si l’on fait abstraction de sa participation à Dexia et à La Banque postale. Selon nos calculs, un contrat de stabilisation des intérêts transformant les 25 % d’encours les plus toxiques en taux fixe du marché coûterait au moins 1 milliard d’euros. Je vous livre ce chiffre au titre de notre assistance technique. Mais désigner les collectivités bénéficiaires, définir le volume de prêts toxiques à stabiliser et le taux fixe raisonnable auquel ils le seraient revient à des autorités politiques dont la légitimité excède de loin la nôtre.
D’autre part, aux termes de la loi du 4 août 2008, la Caisse des dépôts doit agir « dans le respect de ses intérêts patrimoniaux » ; elle ne peut donc décider ex nihilo d’enregistrer une charge pour procéder à cette stabilisation. Cette réponse ne saurait vous satisfaire, j’en ai conscience. Malheureusement, ce que vous demandez ne fait pas partie de notre mission.
M. le rapporteur. Je suis satisfait, en tout cas, que vous estimiez à 1 milliard d’euros le coût de l’opération. On parle souvent de 15 milliards, mais c’est que l’on confond le capital et le surcoût toxique. J’avais moi-même évalué la part toxique des emprunts structurés à 750 millions à 1 milliard par an.
M. Augustin de Romanet. Le coût que j’ai mentionné pour le quart le plus toxique n’est pas annuel : il est unique, non récurrent. L’encours toxique est aujourd’hui estimé à 15 à 18 milliards ; la décote de ces produits sur le marché est de 25 à 40 % ; pour en transformer la totalité en produits « normaux », il faudrait débourser au moins 4 milliards d’euros.
M. le président. Cela donne une idée du volume des produits les plus toxiques, classés E3 à E5.
M. Augustin de Romanet. Et hors charte.
M. Henri Plagnol. Je remercie très sincèrement Augustin de Romanet, car il s’agit d’un moment essentiel de nos auditions : c’est la première fois que nous entendons un discours clair sur le coût réel de la transformation du stock d’emprunts. Or ce coût, si élevé soit-il, semble maîtrisable au regard de la crise des dettes souveraines. Il risque cependant d’augmenter avec le temps ; on ne peut en tout cas prévoir les conséquences de son évolution sur notre système bancaire – notamment Dexia – et sur les collectivités locales, voire sur l’État lui-même.
Il paraît raisonnable de se concentrer sur les 25 % de prêts les plus toxiques, le reste pouvant être progressivement ramené à une norme acceptable pour les collectivités. Ce milliard, comment en répartir la charge entre les banques, l’État et, le cas échéant, les collectivités locales responsables, si elles en ont les moyens ? C’est beaucoup vous demander, j’en ai conscience ; vous avez dit très modestement que cela relevait de la compétence du législateur. Mais la Caisse des dépôts, si le Parlement en décidait ainsi, pourrait-elle contribuer à définir la meilleure répartition ? S’il ne s’agit que d’un seul versement, ce n’est pas insurmontable.
M. Jean-Louis Gagnaire. Merci pour votre intervention très claire. J’ai bien compris la nécessité d’isoler Dexia Crédit Local pour l’empêcher de contaminer la nouvelle structure. Mais comment assumera-t-elle la charge des renégociations et des contentieux ? La ville de Saint-Étienne, qui refusait de payer les intérêts d’un crédit renégocié, vient ainsi d’obtenir satisfaction en justice. Or si Dexia doit payer, cela rejaillira nécessairement sur la collectivité publique, par l’intermédiaire de la Caisse ou d’une autre structure.
Tous les prêts toxiques ne feront pas l’objet de contentieux. La médiation est une autre éventualité. La Caisse s’interdit-elle de participer à la renégociation de tous les prêts potentiellement toxiques ?
Vous avez estimé à 1 milliard le coût de la transformation d’un quart des emprunts. Les quatre quarts sont-ils équivalents ? Le coût de sortie n’est-il pas moins élevé pour les trois quarts moins toxiques ?
Enfin, les prêts les plus toxiques placent les plus petites collectivités dans une situation intenable. Elles n’ont pas les moyens de renégocier à des conditions correctes, ce sont elles qui ont le plus de mal à honorer leur dette et elles essuient souvent des refus de renégociation. Que peut-on faire pour elles ?
M. Marc Goua. Si le coût du crédit remonte, les paramètres tels que le cours du franc suisse peuvent en revanche connaître des évolutions favorables. Dès lors, faut-il convertir tous les prêts en prêts à taux fixes ou bien fixer un taux plafond correspondant au taux du marché, en attendant un retour à meilleure fortune ? Le coût résiduel de l’opération pourrait s’en trouver réduit.
M. Dominique Baert. Notre principale préoccupation est de savoir comment construire un système viable pour en sortir. Vous avez déclaré que le règlement des contentieux serait pris en charge par les équipes de Dexia Crédit Local, mais ces équipes, dont le devenir, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la structure, est encore incertain, ont-elles réellement aujourd’hui la capacité de renégocier et de formuler des propositions ?
Il importe certes de limiter les taux d’intérêt afin d’éviter qu’ils ne deviennent prohibitifs – mais qui assure, dans ce cas, le financement du solde au-delà du plafond qui serait fixé ? Par ailleurs, qui paiera la soulte inscrite dans les contrats, qui correspond à l’actualisation des prêts, et donc de leur valeur ? Bien qu’il ne soit pas de votre mission de formuler des recommandations, votre avis éclairé nous intéresse.
Quant au nouvel établissement en charge du financement des collectivités locales que vous avez présenté, je connais bien ce type d’outil, pour avoir été jadis rapporteur du projet de loi qui a créé les sociétés de crédit foncier. Emprunter sur la durée afin de prêter sur la même durée est assurément une démarche saine qui transparaît dans les ratios, mais la marge prélevée par l’établissement de crédit se répercute sur le coût pour l’emprunteur final : il semble bien que, pour les collectivités locales, qui assurent 75 % de l’investissement public, le temps du crédit bon marché soit révolu.
M Augustin de Romanet. Monsieur Plagnol, nous mettrons à votre disposition la méthodologie qui nous a permis de calculer ce montant en prenant le parti de la transparence. Je ne saurais répondre davantage à votre question, si pertinente soit-elle, sans outrepasser les missions fixées par la loi à la Caisse des dépôts : je n’ai pas les galons pour être médiateur.
Monsieur Gagnaire, vous vous êtes demandé si la CDC s’interdisait de participer aux négociations et comment Dexia Crédit Local ferait face au contentieux.
Certains ont jugé que les 6 milliards d’euros consacrés en 2008 à la recapitalisation de Dexia étaient inutiles, car ils réglaient un problème de solvabilité dans le contexte d’une crise de liquidité. Or, ces fonds propres, restés dans les caisses de Dexia, assurent aujourd’hui encore la solvabilité de cet établissement – qui, je le rappelle, était avant la crise du mois de septembre l’une des banques européennes présentant le meilleur ratio « tier 1 » – supérieur à 11 %. Les actionnaires de Dexia, dont fait partie la Caisse des dépôts au même titre que l’État français, l’État et les régions belges ou la CNP, continueront à disposer de cet argent. Le cours de bourse de Dexia est d’ailleurs aujourd’hui excessivement inférieur à la valeur de l’actif net – en d’autres termes, la book value de Dexia est très supérieure au cours de bourse, car tout le monde anticipe qu’elle va fondre comme neige au soleil. Dexia a donc des moyens lui permettant de faire face aux contentieux.
Quant à savoir si la Caisse des dépôts peut participer à cette renégociation, il me semble qu’il ne faut pas qu’il y ait deux pilotes dans l’avion. Là encore, nous n’avons pas de légitimité pour intervenir.
Par ailleurs, s’il ne faut pas exclure la faculté, pour la nouvelle joint venture engagée avec la Banque postale, d’intervenir pour faire un nouveau prêt à taux fixe et permettre à la collectivité de se refinancer, j’ai déjà indiqué tout à l’heure que c’était là un domaine où Dexia conservait sa légitimité. Il importe en effet, du fait notamment d’exigences européennes, que l’activité de Dexia ne s’éteigne pas. A priori, nous ne devrions donc pas participer à ce processus.
Par ailleurs, pour les trois autres quarts des actifs toxiques, la soulte est moins élevée que pour le premier quart, car le risque est moindre selon la classification de M. Gissler.
Enfin, le médiateur me semble en effet devoir concentrer ses travaux sur les petites collectivités, moins bien armées intellectuellement pour faire face à ces difficultés.
Monsieur Goua, je laisse M. Gotrane répondre à votre question très technique.
M. Sami Gotrane, chargé de mission à la direction finances, stratégie, filiales et international de la Caisse des dépôts et consignations. La question portait sur la possibilité de transformer les prêts à taux fixes en prêts à taux variables assortis d’un plafond, ou « cap ». Le coût de l’opération envisagée, évalué par M. le rapporteur entre 750 millions et par nous à 1 milliard d’euros, dépendra du choix d’un taux fixe ou d’un taux variable accompagné d’un plafonnement de la marge prise par rapport à l’Euribor.
M Augustin de Romanet. Monsieur Baert, la question de savoir si les personnels de Dexia sont motivés relève du management de cette entreprise. En tant qu’actionnaire, nous serons vigilants, mais je n’ai aucune inquiétude quant au fait que l’administrateur délégué, M. Pierre Mariani, fera tout son possible pour garder motivées ces équipes, qui ont encore du travail pour de nombreuses années car, même si Dexia n’empruntait plus un centime, les portefeuilles vivront encore au moins jusqu’à 2030. Dans une conjoncture défavorable à l’emploi, je ne doute pas que les personnes travaillant chez Dexia auront à cœur de bien remplir leur mission.
Je le répète, je sortirais de mon champ de compétences si je répondais à la question de savoir qui doit payer la soulte. Jusqu’à la crise de 2008, l’Europe était inondée de crédit à bas taux, grâce à la politique américaine qui s’y diffusait et permettait alors, de façon tout à fait exceptionnelle dans l’histoire économique, d’emprunter à bas taux pour placer à des taux plus élevés. Le crédit aux collectivités locales sera donc plus cher qu’auparavant, mais il n’y a pas de raison pour qu’il soit structurellement déconnecté de celui consenti aux entreprises de solvabilité comparable. Le taux directeur des prêts aux entreprises sera aussi celui du marché, du fait de l’extraordinaire tension qui se fera sentir sur les dépôts, car il faudra, pour prêter, lever des ressources auprès d’investisseurs tiers. En ajoutant le coût du refinancement et le coût du ratio de liquidités à long terme, évalué à 100 points de base, on peut prédire que les taux seront structurellement entre 1,2 % et 1,5 % plus élevés qu’auparavant.
M. Daniel Boisserie. Où situez-vous la limite entre petites et grandes collectivités ?
Par ailleurs, est-il possible que, du fait de taux trop élevés, des collectivités se trouvent dans l’impossibilité d’emprunter ? L’investissement national étant dans une très large mesure réalisé par les collectivités, une intervention forte des États européens ne sera-t-elle pas nécessaire pour contenir les taux et maintenir l’activité ?
M. Jean-Louis Gagnaire. Sachant que le portefeuille de Dexia Crédit Local ne s’éteindra qu’en 2030 et que le stock d’emprunts gérés ira décroissant, les coûts de gestion de la structure ne deviendront-ils pas prohibitifs par rapport à ce stock – sauf à dégraisser fortement cette structure, au risque de la rendre moins opérationnelle ?
Par ailleurs, les emprunts obligataires lancés par certaines collectivités sont-ils réellement susceptibles de détendre les pressions pesant sur les taux ?
M. Henri Plagnol. Je ne suis pas frustré par votre réponse, monsieur de Romanet, car c’est en effet à nous de dire qui doit payer le milliard d’euros correspondant aux 25 % de créances les plus dangereuses.
Il faut intégrer dans notre réflexion sur les remèdes de choc à administrer le fait que Dexia a été recapitalisée et dispose de fonds propres importants. Les actionnaires sont néanmoins conscients qu’ils seront amputés par les coûts induits par les contentieux en cours, ce qui se traduit par une capitalisation boursière inférieure à l’actif net.
M. le président. Monsieur de Romanet, vous avez conforté l’analyse du rapporteur sur les sommes en jeu et sur le nombre de collectivités concernées. J’observe à ce propos que, compte tenu du nombre de petites collectivités touchées et du temps qu’il a déjà fallu pour examiner les dossiers des quelques-unes d’entre elles qui ont recouru à la médiation, cette dernière ne saurait les traiter séparément : une règle globale s’impose.
Je souhaiterais que vous puissiez à la fois jouer le rôle d’expertise qui est généralement attendu de la Caisse des dépôts et consignations et réfléchir avec nous sur des pistes de sortie qui, si elles ne peuvent être proposées par la Caisse, pourraient du moins être soufflées par le législateur, bien que la somme en jeu doive encore être précisée.
M Augustin de Romanet. Monsieur Boisserie, la ville de 1 800 habitants dont j’ai jadis été conseiller municipal ne disposait pas des équipes techniques nécessaires : la limite entre petites et grandes collectivités se situe certainement au-dessus de ce chiffre – vraisemblablement entre 5 000 et 10 000 habitants.
Monsieur Gagnaire, Dexia Crédit Local conservera des activités génératrices de commissions – Sofaxis, courtier en assurances, Domiserve, Dexia CLF Régions Bail, Exterimmo. L’entreprise persévérera donc dans son être. Je fais toute confiance à M. Pierre Mariani pour faire en sorte que les coûts de gestion ne soient pas un handicap pour la viabilité de la structure.
En ce qui concerne les emprunts obligataires émis par les collectivités, les exigences du marché des capitaux commandent qu’une ligne soit de l’ordre de 500 millions d’euros pour être liquide, ce qui limite la procédure aux très grandes collectivités comme Paris, l’Île-de-France, Lyon ou Marseille. À titre personnel, je ne vois que des avantages à ce que les collectivités aillent directement sur le marché, qu’elles contribuent ainsi à élargir, par exemple en levant des capitaux auprès de banques centrales étrangères, qui ont intérêt à diversifier leurs actifs. Le financement direct par des obligations reste cependant très marginal en France, où il ne représente que 3,4 % du financement des collectivités locales, avec un stock de 5,6 milliards d'euros. En Allemagne, en revanche, les émissions obligataires représentent 40 % des financements assurés par les marchés de taux, car les Länder ont une taille suffisante pour émettre des emprunts.
Monsieur Plagnol, je n’ai pas de solution pour ce qui concerne la répartition de la charge.
M. Henri Plagnol. Mais Dexia conserve des fonds propres.
M. Augustin de Romanet. Ayant fait le serment de dire toute la vérité, je vous remercie de l’avoir relevé. Je suis obligé de dire, pour rassurer les interlocuteurs, que la maison Dexia n’est pas finie et qu’elle compte des collaborateurs qui, dans leur grande majorité, sont de grande qualité et demeurent fiers de leur métier, même s’il a été abîmé par des responsables dont nous cherchons tous à déterminer les responsabilités. Je tiens donc à leur rendre hommage car, dans la tourmente où ils se trouvent depuis septembre 2008, ils se tiennent debout. L’un des éléments qui concourent à leur dignité est le fait que leurs actionnaires aient accepté en une nuit, en septembre 2008, de mettre au pot la somme considérable de 6 milliards d’euros qui permet à la société de faire face à ses responsabilités.
Ce serait sortir de mon rôle, et risquer de sombrer dans une schizophrénie incurable, que de répondre à la question posée sur les renégociations élémentaires.
M. Dominique Baert. La gravité de la situation nous conduit à vous pousser dans vos retranchements et nous vous en demandons pardon. Vous semble-t-il toutefois que les décideurs de Dexia aient réellement les moyens de répondre aux demandes d’une renégociation qui passe nécessairement par l’abandon, la réduction ou le plafonnement des soultes ? En d’autres termes, y a-t-il encore un pilote dans l’avion ?
Encore faut-il, du reste, que les pilotes restent dans l’avion. Or, des rumeurs sur les mouvements de carrière que pourrait connaître M. Pierre Mariani abreuvent régulièrement la presse spécialisée, ce qui est quelque peu déstabilisant. Vous-même pourriez, selon une autre rumeur véhiculée par la presse économique, envisager d’être remplacé au printemps. Avez-vous des informations à nous communiquer sur ce point ?
M. le président. Je souscris à vos propos sur le compte de M. Mariani, qui a été confronté à une tâche très difficile, mais je suis plus perplexe quant au dynamisme qui pourrait marquer la poursuite de l’activité de Dexia. L’équipe précédente a ainsi déclaré devant la commission d’enquête que Dexia avait demandé à ses commerciaux de ne pas vendre de produits structurés à de petites communes, ce qui est loin d’avoir été le cas. De même, dans le business plan, une grande partie des profits considérables réalisés alors par Dexia – qui se développait aux États-Unis et, plus encore, en Belgique et prétendait même, je le rappelle, racheter la Société générale – étaient liés au commerce des produits structurés en France. Or, ces produits ne sont apparemment pas voués à un grand succès dans les prochaines années et, Dexia n’étant pas une banque de dépôt, elle va devoir aller chercher de l’argent sur le marché pour le prêter aux collectivités locales. Comment pourra-t-elle établir avec ces dernières une relation aussi forte que dans le passé si elle ne leur propose que des produits très semblables à ceux que vous-même et d’autres banques proposez ? Il importe de tenir compte de ces considérations dans notre réflexion sur les prêts et les partenaires des collectivités locales.
M. Augustin de Romanet. Monsieur le président, si nous ne pouvons vous faire de suggestions, nous sommes prêts en revanche, et dans la limite de nos missions, à tester techniquement, en jouant un rôle de tiers de confiance, des propositions que vous pourriez faire. Les équipes de M. Gotrane sont en effet plongées dans les chiffres depuis six mois. À défaut d’être apporteurs de solutions, nous pouvons donc être confronteurs d’idées.
Monsieur Baert, nous avons la responsabilité de positiver, sans pleurer devant le lait renversé. Les collaborateurs de Dexia et les collectivités locales méritent qu’on les respecte et nous avons des solutions à trouver. Je fais confiance pour cela à M. Mariani. En qualité d’actionnaire, j’ai – comme du reste le conseil d’administration où siègent, outre la Caisse des dépôts, l’État français, l’État et les régions belges – la responsabilité de ne pas désespérer les collaborateurs de Dexia, confrontés à des problèmes beaucoup plus sérieux que ceux que rencontraient leurs prédécesseurs voilà dix ans, au moment où ils se livraient à des pratiques qui ont entraîné les problèmes que nous connaissons aujourd’hui. Notre devoir est de valoriser et d’encourager ces collaborateurs et de leur dire qu’il y a un horizon.
Pour ce qui est de savoir s’il y a un pilote dans l’avion, j’ai pleinement confiance, je le répète, en la capacité de M. Mariani à jouer ce rôle. Sur mon compte, il n’est pas délicat de spéculer sur des choses qui ne vous appartiennent pas plus qu’à moi, et je ne le ferai pas.
Notre devoir est d’assurer le plus possible de transparence et de qualité au temps que nous consacrons aux collectivités locales. Le conseil d’administration de Dexia aura à cœur de faire en sorte que les collaborateurs restent motivés. Quant à vous, parlementaires, membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, elle-même actionnaire de Dexia, vous pouvez à chaque instant nous faire part de ce qui fonctionne mal.
M. Patrice Calméjane. Les collectivités vont se trouver dans la situation de particuliers surendettés. Pour les principales collectivités concernées, il reste deux budgets avant les prochaines échéances électorales. Ne faudrait-il pas prévoir un mécanisme subordonnant l'octroi du prêt à la double signature de l'exécutif de la collectivité concernée et d'un représentant de l'État qui aurait bien analysé les risques ?
M Augustin de Romanet. Si je vous entends bien, il conviendrait d'assister la collectivité en ne laissant pas le maire libre de souscrire un nouveau prêt.
M. Patrice Calméjane. Il reste deux exercices budgétaires. Certaines collectivités bénéficient encore de prêts intéressants pour un certain temps, mais il s'agit par définition de produits toxiques dont il faut sortir. Afin de ne pas laisser le responsable des finances seul devant ses responsabilités – le code général des collectivités territoriales ne lui impose même pas de consulter son exécutif avant de souscrire un prêt – un tel système de double signature ne donnerait-il pas les assurances nécessaires, tout en impliquant l'État ?
M Augustin de Romanet. Par nature, le co-pilotage est une mauvaise situation, qui déresponsabilise. Votre question relève de la responsabilité des élus et des préfets et mériterait d'être traitée avec le ministre en charge des collectivités locales. Je me garderai bien d’empiéter sur son domaine car proposer un système dans lequel le maire ne serait plus maître chez lui a des conséquences qui dépassent de loin le cadre de la présente audition.
Au-delà des activités génératrices de commissions que j'ai déjà évoquées, Dexia Crédit Local va continuer à assurer des prestations de services pour l'entité propriétaire de DexMA, dont il est aujourd’hui prévu qu’elle sera constituée par la Caisse des dépôts et la Banque postale. La banque Dexia subsistante conservera donc un modèle économique dans lequel elle devra faire plus que couvrir ses coûts : il est prévu que cet établissement continue de gagner de l'argent.
M. le président. J’insiste : l’apparition des produits structurés tient au fait que l’équipe qui était alors à la tête de Dexia a pris conscience que, sur le flux de prêts, les marges étaient très faibles – de l’ordre de 0,2 % en moyenne. Elle s’est alors spécialisée sur le stock, où elles étaient plus importantes, entre 0,7 % et 0,9 %, et elle a engrangé des profits importants, au point d’envisager de s’installer aux États-Unis et de racheter la Société Générale. Or, les produits structurés étant vraisemblablement voués à disparaître durablement, Dexia proposera des produits très comparables à ceux des autres établissements bancaires et il n’est pas du tout certain qu’elle retrouvera sa position de leader sur le marché des collectivités locales.
M. Augustin de Romanet. Cette question est liée à la réponse que j’ai faite à M. Baert : dès lors que le financement des crédits aux collectivités locales sera dépendant des ressources de marché, le coût de ces ressources sera relativement équivalent d’une banque à l’autre. Pourvu en effet qu’elles soient solvables, les banques emprunteront sur le marché à des taux comparables, puis appliqueront une marge de transformation et une marge destinée à absorber le coût de la liquidité.
On peut craindre cependant qu’il n’y ait pas foule pour prêter aux collectivités locales. L’un des défis de la nouvelle banque que nous créons avec La Banque postale consiste donc à prendre rapidement une part de marché pour éviter un credit crunch qui, faute d’offre suffisante, affecterait les collectivités locales. Au mois d’août, l’offre était si réduite que certaines collectivités, pour ne pas renoncer à leurs projets, acceptaient d’emprunter avec des marges de 200 points de base, alors que, d’habitude, elles ne dépassaient pas 60 ou 70 points de base. C’est ce qui va se passer désormais. Ainsi, même si Dexia Crédit Local n’ambitionne pas d’être la banque la plus compétitive, elle conservera une place dans le cadre des renégociations avec les collectivités locales – mais pas au-delà.
M. Daniel Boisserie. Il est inconcevable que les banques soient les seuls prestataires à ne pas être soumis à une procédure d’appels d’offres pour traiter avec les collectivités. Ne serait-il pas souhaitable, voire indispensable, qu’un texte législatif oblige les collectivités à produire un cahier des charges ou un règlement de consultation dans le cadre d’un appel d’offres auquel devraient répondre un nombre minimal de banques, sous le contrôle de l’État et éventuellement avec l’aide de bureaux d’étude spécialisés ?
M. Augustin de Romanet. Monsieur Boisserie, je suis tenté de vous répondre : « oui, mais non, et sûrement non ». « Oui », parce que le dispositif que vous proposez contribuerait à plus de transparence et à plus de rigueur, en y mettant plus d’intelligence. « Non », en revanche, parce que son coût élevé, lié notamment à la haute technicité des cabinets spécialisés, introduirait aussi de la viscosité dans le système, et ce pour un bénéfice incertain, car il est vraisemblable que, dans les années qui viennent, les appels d’offres de collectivités donneraient lieu, au plus, à deux propositions. La « réfrigération » des prêts à long terme a notamment été évoquée lors des Assises nationales du financement du long terme, le 17 novembre, où M. Jacques Pélissard a exprimé nos craintes communes face aux exigences de Bâle III et de Solvabilité II. Attendons donc de voir : si les banques sont six à répondre aux appels d’offres, avec des risques de dol au détriment des collectivités, je conviendrai que je vous ai fait une mauvaise réponse et qu’il est bon de définir un cahier des charges.
Je conclurai d’un mot : il faut, dans tous les domaines, choisir ce qui est positif pour soutenir les collaborateurs de Dexia, qui ont une tâche très difficile. À la Caisse des dépôts, nous nous sommes également efforcés d’être positifs en mobilisant tous nos réseaux pour distribuer les 5 milliards d’euros le plus vite possible et au plus près du terrain. Nous sommes également très positifs pour diffuser, avec nos partenaires de la joint venture conclue avec la Banque postale, une nouvelle culture pour une nouvelle banque, qui s’efforcera de récupérer une grande partie des 40 % de parts de marché que Dexia a pu avoir dans ses meilleurs moments.
M. le président. Monsieur de Romanet, je vous félicite de votre solidarité – personnelle et d’actionnaire – avec M. Mariani. Beaucoup de travail attend Dexia car, si la Caisse des dépôts et consignations a toujours su conserver sa réputation vis-à-vis des collectivités locales, il y a beaucoup à faire pour recréer les liens qui ont pu exister entre Dexia et ces dernières.
*
* *
ANNEXE 2 : EXEMPLES DE CONTRATS D’EMPRUNTS STRUCTURÉS
2.– Documents relatifs aux contrats de prêt souscrits auprès de Dexia par la ville de Sassenage
3.– Documents de travail adressés par Dexia à la ville de Trégastel
Ces documents peuvent être consultés au format PDF
1 () Proposition de résolution n° 3396, déposée le 5 mai 2011, et rapport n° 3464 du 25 mai 2011.
2 () Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale, juillet 2011, la Documentation française.
3 () Cour des comptes, Rapport public thématique du 13 juillet 2011 sur la gestion de la dette publique locale.
4 () Audition du 12 octobre 2011, séance de 18 heures 15.
5 () Ce financement prend essentiellement deux formes :
– les lignes de trésorerie constituent un droit de tirage permanent d’une durée courte (inférieure ou égale à un an) pour un montant plafond et une durée déterminés dans une convention passée avec une banque. Elles permettent à l’emprunteur de financer ses besoins ponctuels de trésorerie.
– les emprunts assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie (emprunts « revolving ») associent à la fois un financement à long terme et la couverture des besoins de trésorerie ponctuels. Ils sont principalement utilisés pour équilibrer en fin d’exercice les comptes et sont généralement remboursés pour partie en début d’exercice suivant pour que la collectivité retrouve sa gestion de trésorerie zéro. Comme le relève la Cour des comptes (p. 39 du rapport précité), ces contrats ont connu un fort développement et, « depuis la crise, ils servent de lignes de trésorerie car, du fait de l’ancienneté des contrats, leurs conditions financières sont moins onéreuses que les lignes classiques ».
6 () Le glossaire, annexé au présent rapport, définit chacun de ces éléments.
7 () Tel est d’ailleurs le parti pris par la direction générale des Collectivités locales, la direction générale du Trésor et la direction générale des Finances publiques dans la circulaire du 25 juin 2010 consacrée aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics (n° NOR IOCB1015077C).
8 () Ce terme de gestion comptable fait référence aux emplois et ressources à long terme : à l'actif, des immobilisations comme les terrains ou les bâtiments et, au passif, les capitaux propres et les dettes à plus d'un an.
9 () Audition du 2 novembre 2011, séance de 17 heures.
10 () Cette définition est empruntée à un manuel de référence : Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Paris : Dalloz, 2010, p. 1074.
11 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Picardie du 17 janvier 2011 sur la gestion de la commune de Compiègne, p. 10.
12 () Documents transmis à la commission d’enquête : Extrait de la délibération n° 2007.5.7.111 – Conseil municipal du 30 mai 2007.
13 () Par exemple, deux investisseurs peuvent décider de s’échanger tous les trois mois pendant sept ans la différence entre l’Euribor 3 mois et le taux de swap à dix ans prévalant au moment du fixing. Il s’agit alors d’un CMS 10 à sept ans. L’évaluation d’un instrument de ce type repose alors sur la détermination des taux forward 3 mois et dix ans sur toutes les périodes successives de trois mois sur toute la période jusqu’à maturité.
14 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Midi-Pyrénées du 22 septembre 2010 sur la gestion de la commune de Gourdon, p. 14.
15 () Audition du 2 novembre 2011, séance de 17 heures.
16 () Il s’agit du risque de voir les taux payeurs d’une indexation particulière évoluer en sens contraire de l’évolution de la courbe des taux domestiques.
17 () L’indice de la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA) est souvent utilisé pour déterminer le taux des swaps municipaux.
18 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Ile-de-France du 17 mai 2011 sur la gestion du département de la Seine-Saint-Denis, p. 73.
19 () On peut citer l’exemple de l’indice de la Deutsche Bank SMART, utilisé dans un swap souscrit en mai 2007 par la commune de Saint-Étienne (p.56 du rapport de la CRC précité).
20 () Article publié par l’Agefi du 13 mars 2008.
21 () Audition du 16 novembre 2011, séance de 18 heures 15.
22 () Rapport n° 2008-M-086-01 de l’inspection générale des finances, établi par M. Éric Gissler en février 2009. Non publié.
23 () Circulaire précitée de la direction générale des Collectivités locales, la direction générale du Trésor et la direction générale des Finances publiques.
24 () À titre d’exemple, un prêt à taux fixe ou variable simple est scoré entre 0 et 4 (profil « limité »), un prêt indexé sur le change entre 14 et 16 (profil « dynamique ») tandis qu’un snowball (non commercialisé) atteindrait théoriquement de 17 à 32 points.
25 () Audition du 2 novembre 2011, séance de 17 heures.
26 () Chiffres cités par M. Jacques Paquier, Financement des collectivités : l’innovation perpétuelle in La Gazette des communes, 8 novembre 2004, pp.20-21.
27 () Ce qui n’était pas sans risque pour les prêteurs intervenant sur ce marché, comme le souligne le rapport public de la Commission bancaire pour l’année 2001, pp.81-82.
28 () Délibération du comité syndical du 19 décembre 1996. Toutefois la sophistication de ces emprunts est passée sous silence dans le rapport d'observations définitives de la C.R.C. Île-de-France sur le SAN de Marne-la-Vallée - Val Maubuée du 14 octobre 2003.
29 () Le mot est de M. Olivier NYS, dans une tribune publiée dans la Gazette des communes du 16 octobre 2006, p.9.
30 () Là encore, le rapport d'observations définitives de la C.R.C. Centre sur la commune de Châteauroux du 15 juin 2006 se contente de présenter le montage.
31 () La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 a renforcé et étendu le support constitutionnel de la décentralisation mais c’est la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui a opéré de nouveaux et importants transferts de compétences et de moyens de l'État vers les collectivités locales.
32 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Rhône-Alpes sur la commune de Saint-Étienne du 30 novembre 2010, p.37 & 67 (tableau 12 de l’annexe).
33 () Audition du 21 septembre, séance de 15 heures.
34 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Rhône-Alpes sur la commune de Saint-Étienne du 30 novembre 2010, p.36.
35 () Audition du 5 octobre 2011, séance de 18 heures 45.
36 () Audition du 12 octobre 2011, séance de 18 heures 15, et chronique sur « les emprunts structurés contractés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » parue dans Gestion et finances publiques, n° 3-4, mars-avril 2011, p.249.
37 () Rapport d'observations définitives de la C.R.C. Champagne-Ardennes sur la communauté de communes de de la région de Bar-sur-Aube du 2 juillet 2009, p.12.
38 () Audition du 12 octobre 2011, séance de 17 heures.
39 () Audition du 6 juillet 2011, séance de 17 heures.
40 () Compte-rendu du conseil municipal de Saint-Étienne du 7 janvier 2008.
41 () Audition du 16 novembre 2011, séance de 19 heures 50.
42 () Ce chiffre a été repris par le ministre dans une interview au Figaro, le 8 juin 2011.
43 () Un recensement a toutefois été lancé en 2011 par les services de la DGFRIP et de la DGCL mais ses résultats – pour l’heure très parcellaires – sont en cours de fiabilisation (audition du 23 novembre 2011).
44 () Les données individuelles ont été rendues anonymes puis retraitées afin de figurer dans le présent rapport.
45 () S’agissant de la Caisse des dépôts, il s’agit généralement de taux variables du type [Taux du livret A + marge] et de durées longues (jusqu’à 40 ans).
46 () Avant swaps.
47 () Les données 2008 disponibles correspondent au stock d'emprunts structurés tels que décrits à l'époque, c'est à dire avant la charte Gissler. À l’époque, les nomenclatures internes des établissements de crédit incluaient comme "crédits structurés" des prêts à taux fixe ou indexés sur l’EURIBOR post-fixé (aujourd'hui cotés 1A) dans la mesure où ceux-ci étaient micro-couverts.
48 () Soit le taux d’intérêt moyen des emprunts structurés indexés sur la parité euro / franc suisse, pour un cours de change EUR/CHF=1,20.
49 () Pour dénombrer les clients, la commission d’enquête a dû raisonner établissement par établissement car les données transmises ne permettaient pas d’éliminer les doubles comptes : une même commune peut en effet avoir souscrit des emprunts auprès de plusieurs banques.
50 () Audition du 5 octobre 2011, séance de 16 heures 30.
51 () Audition du 15 novembre 2011, séance de 9 heures 30.
52 () Les filiales françaises de banques étrangères comme RBS et Depfa sont, en revanche, totalement absentes de ce segment de clientèle.
53 () Audition du 5 octobre 2011, séance de 18 heures 45.
54 () L’Union sociale de l’habitat regroupe cinq familles d’HLM. Les sociétés d’économie mixte n’en sont pas membres.
55 () Audition du 18 octobre 2011, séance de 9 heures.
56 () Fitch ratings, Rapport spécial : La dette structurée des collectivités locales : gestion active ou spéculation ? (juillet 2008).
57 () Rapport de la C.R.C. de Rhône-Alpes précité, p. 45.
58 () Audition du 16 novembre 2011, séance de 19 heures.
59 () Rapport de la C.R.C. d’Île-de-France précité, p.69.
60 () Audition du 12 octobre 2011, séance de 18 heures 15.
61 () Audition du 21 septembre 2011, à 15 heures et 16 heures.
62 () Audition du 5 octobre 2011, à 17 heures.
63 () Audition du 21 septembre 2011, à 16 heures.
64 () Audition du 21 septembre 2011, à 15 heures.
65 () Audition du 21 septembre 2011, à 16 heures 30.
66 () Audition du 12 octobre 2011, à18 heures 15.
67 () Audition du 6 juillet 2011, à 17 heures.
68 () Audition du 12 octobre 2011, à 18 heures 15.
69 () Audition du 21 septembre 2011, à 16 heures 30.
70 () Audition du 21 septembre 2011, à 16 heures.
71 () Audition du 6 juillet 2011, à 17 heures.
72 () Audition du 6 juillet 2011, à 17 heures.
73 () Audition du 21 septembre 2011, 15 heures
74 () Audition du 21 septembre 2011, à 15 heures.
75 () Audition du 5 octobre 2011.
76 () Audition du 5 octobre 2011.
77 () Audition du 5 octobre 2011.
78 () Audition du 5 octobre 2011.
79 () Audition du 5 octobre 2011.
80 () Audition du 5 octobre 2011.
81 () Audition du 5 octobre 2011.
82 () Audition du 18 octobre 2011.
83 () Audition du 18 octobre 2011.
84 () Audition du 18 octobre 2011
85 () Bundesverfassungsgericht, 22 mars 2011, affaire n° XI ZR 33/10.
86 () Jean-Philippe Lacour, Deutsche Bank épinglé en justice pour manquement au devoir de conseil, Les Échos, 23 mars 2011.
87 () Bruno Wertenschlag, Olivier Poindron, Elsa Sitruk et Stéphane Kourganoff, Emprunts toxiques : la banque gagne toujours, La Lettre du Cadre Territorial n° 429, 1er octobre 2011.
88 () Par exemple Michel Klopfer, consultant et Louis Renouard, magistrat des chambres régionales des comptes, « Les produits bancaires structurés, la Gazette du 22 octobre 2007.
89 () Rapport n° 2008-M-086-01 de l’inspection générale des finances, établi par M. Éric Gissler en février 2009. Non publié.
90 () Audition du 9 novembre 2011.
91 () Audition du 16 novembre 2011.
92 () Audition du 18 octobre 2011.
93 () Audition du 18 octobre 2011.
94 () Audition du 9 novembre 2011.
95 () Audition du 18 octobre 2011.
96 () Audition du 18 octobre 2011.
97 () Audition du 9 novembre 2011.
98 () Audition du 21 septembre 2011.
99 () Audition du 21 septembre 2011.
100 () Audition du 21 septembre 2011.
101 () Jacques Paquier, « Financement des collectivités ; l’innovation perpétuelle, La Gazette, 8 novembre 2004 ; Olivier Nys, « Emprunts : accepter une juste marge », 16 octobre 2006 ; Olivier Nys, « Les 10 commandements de la gestion de dette », Sandra de Pinho et Olivier Nys, la Lettre du financier territorial, décembre 2005 ou encore « Subprimes, Kerviel et moral hazard dans les collectivités », Olivier Nys, 2008.
102 () Audition du 12 octobre 2011.
103 () Audition du 12 octobre 2011.
104 () Audition du 12 octobre 2011.
105 () Audition du 12 octobre 2011.
106 () Audition du 12 octobre 2011.
107 () Audition du 21 septembre 2011.
108 () Rapport annuel de la Commission bancaire pour l’année 2002.
109 () Cour des comptes, Rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, juillet 2011.
110 () Union sociale pour l’habitat, Chiffres clés du logement social, septembre 2011
111 () Dexia Crédit local, note de conjoncture sur les finances hospitalières, avril 2011.
112 () Association d’étude pour l’agence de financement des collectivités territoriales, dossier de presse du 20 septembre 2011.
113 () Audition par la commission d’enquête de M. Augustin de Romanet, 29 novembre 2011.
114 () Les banques désertent le marché des collectivités locales, Les Échos, 1er août 2011.
115 () Cour des comptes, Rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, juillet 2011.
116 () La région Pays de la Loire a ainsi lancé une émission obligataire ouverte aux particuliers de la région en 2009.
117 () Audition par la commission d’enquête de M. Augustin de Romanet, 29 novembre 2011.
118 () Audition par la commission d’enquête de M. Augustin de Romanet, 29 novembre 2011.
119 () Audition par la commission d’enquête de M. Olivier Landel, 16 novembre 2011.
120 () Association d’étude pour l’agence de financement des collectivités territoriales, dossier de presse du 20 septembre 2011.
121 () Samuel-Frédéric Servière, Agence de financement des collectivités locales : La fausse bonne idée, Fondation iFRAP, 8 septembre 2011.
122 () Auditions des élus locaux par la commission d’enquête, 25 septembre et 5 octobre 2011.
123 () Décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
124 () L’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales prévoit un crédit de 140 heures par trimestre pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants.
125 () Articles L. 2121-29 du CGCT pour les communes, L. 3211-1 pour les départements et L. 4221-1 pour les régions.
126 () Circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
127 () La circulaire du 25 juin 2010 « déconseille » les emprunts suivants :
– Produits évoluant relativement à des indices relatifs aux matières premières, aux marchés d’actions ou à tout autre instrument incluant des actions ; à des indices propres à l’établissement de crédit, à des indices de crédits ou de défauts d’émetteurs obligataires, ou encore à la valeur de fonds ou à la performance de fonds ; à la valeur relative de devises quel que soit le nombre de monnaies concernées ; aux indices cotés sur les places financières hors des pays membres de l’OCDE ;
– Produits comportant une première phase de bonification d’intérêt (ou donnent lieu au versement d’une soulte) supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ;
– Produits libellés en devises étrangères ;
– Produits présentant des effets de structure cumulatifs.
128 () Audition de M. Christophe Faverjon, maire d’Unieux, le 5 octobre 2011.
129 () Article L. 313-3 du code de la consommation.
130 () Article L. 313-5 du même code.
131 () Article L. 313-1 et suivants du même code.
132 () Cour des comptes, Rapport public thématique sur la gestion de la dette publique locale, juillet 2011.
133 () Articles L. 2121-29 pour la commune, L. 3212-4 pour le département, L. 4221-1 pour la région, L. 5211-6 pour les établissements publics de coopération intercommunale.
134 () Tribunal administratif de Lille, 5 décembre 1989, Commune de Femès.
135 () L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales a repris ces dispositions : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8». Des dispositions similaires sont applicables aux départements (article L. 3312-1) et aux régions (article L. 4311-11).
136 () Instruction M14 applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, instruction M52 applicable aux départements, instruction M71 applicable aux régions, et instruction M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.
137 () Audition de M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace, mercredi 12 octobre 2011.
138 () Informations fournies annuellement à l’emprunteur par l’établissement préteur, en application du quatrième engagement de la Charte Gissler.
139 () Articles D. 3321-2 et D. 4321-2 du CGCT.
140 () Circulaire NOR IOCB1015077C du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
141 () Audition de M. Patrick Barbaste, premier conseiller à la CRC d’Alsace, mercredi 12 octobre 2011.
142 () Les emprunts actuellement souscrits et confiés au pôle d’assistance et de transaction pouvant être, a titre transitoire, exemptés de cette obligation, cf. III. C. 2 infra.
143 () Auditions des élus locaux par la commission d’enquête, 6 juillet et 21 septembre 2011.
144 () Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales pour les délégations consenties par les conseils municipaux, article L. 3211-2 pour celles applicables aux conseils généraux, article L. 4221-5 pour celles applicables aux conseils régionaux et article L. 5211-10 applicables au sein des établissements publics de coopération intercommunale.
145 () Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
146 () Article R. 26 du code électoral pour les élections municipales et cantonales, article L. 353 du même code pour les élections régionales.
147 () Article L. 6143-4 du code de la santé publique.
148 () Article L. 2131-2 pour les communes, article L. 3131-2 pour les départements, article L. 4141-2 pour les régions.
149 () Conseil d’État, 4 mars 1910, Thérond.
150 () Conseil d’État, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges.
151 () Tribunal des conflits, 12 janvier 1987, Ville d'Eaubonne c/GOBTP.
152 () Article L. 2122-22 du CGCT pour les communes, article L. 3211-2 pour les départements, article L. 4221-5 pour les régions et article L. 5211-10 pour les établissements publics de coopération intercommunale.
153 () Conseil d’État, 23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics (ATMMP) et autres.
154 () Déclaration de la Commission au considérant 13 et à l’article 18, point d) : « La Commission considère que les directives Marchés publics sont soumises aux obligations résultant pour la communauté de l'Accord sur les marchés publics, et interprétera donc ces directives d'une manière compatible avec cet accord. De ce fait, la Commission estime que le considérant 13 et l'article 18, point d), ne sauraient être interprétés comme excluant, entre autres, les marchés publics concernant les emprunts des pouvoirs adjudicateurs, notamment les collectivités locales, à l'exception de ceux faisant l'objet "de l'émission, de la vente et du transfert de titres ou autres instruments financiers". De plus, la Commission rappelle qu'en tout état de cause au cas où les directives ne trouvent pas à s'appliquer, comme par exemple en dessous des seuils, les règles et principes du traité doivent être respectés. Conformément à la jurisprudence de la Cour, leur respect implique une obligation de transparence qui consiste à garantir un degré de publicité adéquat permettant une ouverture des marchés à la concurrence. »
155 () Prévues par le 5° de l’article 3 du code des marchés publics du 1er août 2006.
156 () Audition par la commission d’enquête de M. Augustin de Romanet, 29 novembre 2011.
157 () cf. I. supra.
158 () Article 47 sexdecies du projet de loi de finances pour 2012, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 16 novembre2011, TA n° 7540.
159 () « Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »
160 () Notamment durant les travaux de la commission d’enquête sur le Crédit Lyonnais en 1994.
161 () cf. II. supra.
162 () Hormis un jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse, le 27 mars 2008, qui retiendrait pour le banquier une obligation d'information et de conseil précontractuelle lors de la souscription de contrats de swaps pour une société d'HLM , une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre de juin 2011 qui aurait rejeté la demande de la commune de Servian (Hérault) consistant à être autorisée à procéder au remboursement anticipé du capital restant dû de six prêts contractés entre avril 1994 et décembre 2005,ainsi qu’une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2011 par le Premier vice-président adjoint du TGI de Paris déboutant une assignation d’une banque pour obtenir le paiement à titre conservatoire des échéances dues par la ville de Saint-Étienne dans le cadre d’un contrat de swaps faisant l’objet d’un recours en annulation sur le fond, il existe peu de jurisprudence relative à ces emprunts.
163 () Auditions des élus locaux par la commission d’enquête, 6 juillet et 21 septembre 2011.
164 () Id.
165 () cf. supra II.
166 () Audition par la commission d’enquête de M. Augustin de Romanet, 29 novembre 2011.
167 () Par exemple, une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2011 par le Premier vice-président adjoint du TGI de Paris a débouté formulée par une banque pour obtenir le paiement à titre conservatoire des échéances dues par la ville de Saint-Étienne dans le cadre d’un contrat de swaps faisant l’objet d’un recours en annulation sur le fond, le juge en référé ayant justifié sa décision par le fait que « la légalité [du contrat] est aujourd’hui sérieusement contestée devant le juge du fond ».
168 () Le programme 122 de la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales comprend une ligne de crédits dénommée Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales, permettant d’accorder des subventions en faveur des collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles appelant un effort de solidarité nationale, telles que les catastrophes naturelles : les crédits spécifiquement destinés aux communes en difficulté financière représenteront 2,7 millions d’euros en 2012, selon les informations obtenues par le rapporteur pour avis de la commission des Lois de l’Assemblée nationale.
169 () Décision n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003 relative à la loi relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi : « le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ».
170 () cf. l’encadré relatif aux modalités de fixation du taux d’usure.
171 () Audition de M. Eric Gissler le mercredi 9 novembre 2011.
© Assemblée nationale
