______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 2008.
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l'article 145 du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
en conclusion des travaux d’une mission d’information constituée le 31 juillet 2007 (1),
sur « la politique de la France en Afrique »
Président
M. Jean-Louis CHRIST
Rapporteur
M. Jacques REMILLER
Députés
__________________________________________________________________
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page.
La mission d’information « Politique de la France en Afrique » est composée de : M. Jean-Louis Christ, Président, M. Jacques Remiller, Rapporteur, MM. Jean-Paul Bacquet, Patrick Balkany, Renaud Dutreil (jusqu’à la fin de son mandat de député), Serge Janquin, François Loncle, Mme Henriette Martinez, MM. Didier Mathus, Michel Terrot.
INTRODUCTION 5
I – LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE EN QUESTION 9
A.- UNE RELATION SINGULIÈRE MENACÉE D’ESSOUFFLEMENT 9
1) La difficile adaptation à la nouvelle donne internationale 10
2) Regards croisés : le constat d’un malentendu 11
B.- UNE PRÉSENCE FRANÇAISE EN RETRAIT 13
1) Des intérêts économiques en repli 13
2) Une politique française de coopération en « peau de chagrin » 18
C.- L’AFRIQUE, COURTISÉE, SE TOURNE VERS DES PARTENAIRES DIVERSIFIÉS 22
1) Le rôle ancien et croissant de l’Union européenne en faveur de la sécurité et du développement de l’Afrique 22
2) Le retour des Etats-Unis en Afrique 25
3) L’affirmation des puissances « émergentes » 28
II – L’AFRIQUE CHANGE 33
A.- L’AFRIQUE, TERRE DE DÉSÉQUILIBRES 34
1) Le continent de la jeunesse 34
2) Des pays en grande pauvreté 38
3) Un espace très vulnérable au choc climatique 43
B.- L’AFRIQUE EN MOUVEMENT 46
1) Moins de conflits, plus de démocratie 46
2) Des perspectives de croissance prometteuses 50
C.- L’AFRIQUE PREND SON DESTIN EN MAIN 53
1) L’instauration de mécanismes africains de résolution des conflits 53
2) Des efforts d’intégration fondés sur de nouveaux espaces de solidarité 56
III – L’AFRIQUE AUTREMENT : LE PARI FRANÇAIS DU PARTENARIAT 61
A.- UNE AMBITION PLEINEMENT ASSUMÉE : MAINTENIR LA PRÉSENCE DE LA FRANCE EN AFRIQUE 61
B.- UNE MÉTHODE : LE CHOIX DU PARTENARIAT 62
1) Instaurer des relations dynamiques de partenariat 63
2) Changer de style et de ton 64
3) Valoriser notre coopération multilatérale 67
C.- DES PRIORITÉS D’ACTION FONDÉES SUR L’INTÉRÊT MUTUEL DES PARTIES 69
1) Concrétiser les engagements du discours du Cap grâce à l’adoption d’une « feuille de route » 69
2) En matière de coopération, renforcer les moyens de l’aide bilatérale en faveur de l’éducation et de la formation 70
3) Sur le plan économique, soutenir la présence des entreprises françaises en Afrique ainsi que le développement des PME africaines 73
CONCLUSION 77
ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS 79
EXAMEN EN COMMISSION 83
ANNEXES 89
I. LISTE DES PERSONNALITÉS ENTENDUES PAR LA MISSION 91
II. LISTES DES PERSONNALITÉS RENCONTRÉES DANS LE CADRE DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS À L’ÉTRANGER 93
III. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA MISSION D’INFORMATION 95
Mesdames, Messieurs,
Evoquer les relations entre la France et l’Afrique, c’est entrer dans une histoire unique, à la fois tumultueuse et affective, prometteuse et frustrante. Malgré toutes ses vicissitudes, il y a de l’amour et de la grandeur dans cette relation, une attirance mutuelle qui mérite de résister aux changements du monde. Il y a l’espérance d’une humanité fraternelle, comprenant qu’il lui faut tisser avec ses propres différences des liens à toute épreuve. Il y a la guerre, la violence, le préjugé, la petitesse des hommes mais il y a aussi leur soif de paix, de culture, d’entraide et d’harmonie. Que de réactions avons-nous entendues, passionnées, agacées, voire désabusées ou, au contraire, enthousiastes et volontaristes ! En aucun cas, le couple que forment la France et l’Afrique ne peut laisser indifférent, ni dans le regard que l’on jette sur le passé, ni dans les espoirs que l’on peut nourrir pour l’avenir.
Il en est naturellement de même lorsqu’on aborde la politique de la France en Afrique. On y voit se profiler aussi bien la haute stature d’hommes d’Etats, d’entreprise et de culture que l’épouvantail de la « Françafrique ». Ce néologisme, inventé par le président ivoirien Houphouët-Boigny en 1973, décrit d’un mot les liens étroits et complexes unissant la France à ses anciennes colonies d’Afrique. Sa signification, là encore, est ambiguë. Proximité singulière ou proximité douteuse ? Le terme qui aurait pu évoquer une entente admirable, un métissage de peuples, une vision commune, a fini par symboliser la survivance de réseaux d’influence plus ou moins occultes, entretenus par la France en Afrique, voire d’une forme de néocolonialisme, et parfois même d’une complaisance pour des pratiques inacceptables, mêlant pouvoir, faveurs et argent.
Mais, alors que les réactions sur les relations franco-africaines restent vives, d’importantes mutations sont intervenues sur le continent africain, dont notre pays a tardé à prendre entièrement la mesure. L’Afrique, ces derniers temps, a plus bougé que le regard français sur l’Afrique. L’Afrique d’aujourd’hui connaît des transformations profondes que la plupart des grandes puissances du monde, en particulier les puissances émergentes, à commencer par la Chine et l’Inde, ont clairement identifiées. D’anciens conflits se sont résorbés d’une manière nouvelle tandis que l’Union africaine commence à jouer un rôle clé en matière de paix et de sécurité, attestant d’une volonté forte de prise en main, par les Africains eux-mêmes, des problèmes qui surgissent à l’échelle continentale ou régionale. Enfin, malgré de grandes disparités, l’Afrique connaît depuis quelques années une croissance économique soutenue, supérieure à la moyenne mondiale. De plus en plus nettement, l’esprit d’entreprise souffle sur l’Afrique, comme celui de la création artistique ou de la justice sociale. Pour autant, si l’Afrique est bel et bien en marche, le processus de démocratisation reste parfois lent. Le développement du continent s’en trouve en partie affecté, notamment aux plans de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, ne serait-ce que parce que l’aide au développement peut difficilement donner toute sa mesure dans un tel environnement.
Au-delà de ces transformations, l’Afrique se trouve aujourd’hui, en raison de la mondialisation, confrontée à des problèmes qui préoccupent l’ensemble de la communauté internationale, qu’il s’agisse de l’insécurité alimentaire mondiale, de la menace terroriste, des flux migratoires ou de la sécurisation des marchés et des approvisionnements, notamment énergétiques, mais qui ont sur le continent africain des conséquences démultipliées.
Malgré une présence ancienne en Afrique, la France a insuffisamment anticipé l’ampleur de ces évolutions et leurs conséquences. Alors que notre pays s’engageait progressivement dans un processus de retrait de la gestion des conflits africains au profit d’autres acteurs internationaux, dont l’Union européenne, il a, dans le même temps, enregistré un recul de son influence propre sur le continent. Ce recul n’est pas uniquement matériel, dénombrable en argent, troupes, enseignants ou migrants, il est aussi immatériel, il est aussi symbolique, politique et culturel.
Face à ces mutations profondes, et au risque considérable que représenterait pour la France un désamour durable avec l’Afrique, dans l’indifférence d’une opinion publique française repliée sur ses problèmes intérieurs, la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale ne pouvait rester silencieuse. L’Assemblée nationale, parce qu’elle représente le peuple français, est concernée au premier chef par le devenir d’une relation aussi vitale que celle qu’entretiennent la France et l’Afrique. L’objectif de la Mission d’information qu’elle a instituée en septembre dernier est de faire la part des choses, certes, mais aussi de réaffirmer une confiance et une volonté, et d’alerter l’opinion comme les pouvoirs publics sur le danger du désintérêt pour l’Afrique. Il est également de répondre aux critiques, fréquemment adressées au Parlement français, de rester à l’écart du débat sur les orientations d’une politique, la politique de la France en Afrique, où l’analyse critique, la transparence et l’audace sont plus que jamais nécessaires.
Enfin, à l’heure où une réflexion globale est engagée dans le cadre de la Revue générale des politiques publiques (RGPP) et du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, la commission des affaires étrangères entend apporter sa contribution sur le contenu de la réforme de notre politique en Afrique.
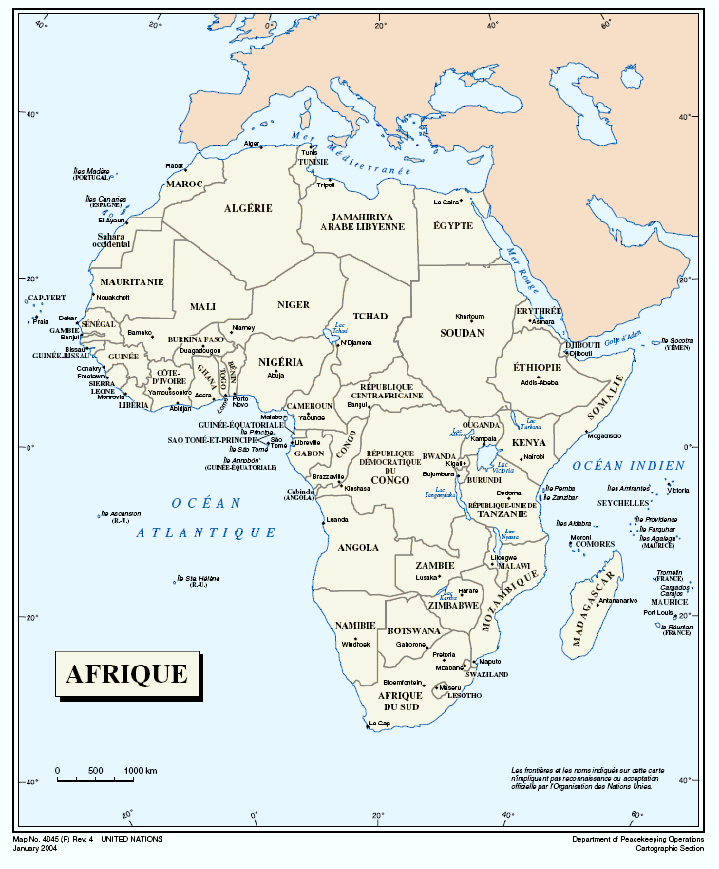
I – LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET L’AFRIQUE EN QUESTION
Les relations entre la France et ses partenaires africains se sont longtemps caractérisées par leur caractère ancien et étroit. Plusieurs signes montrent cependant qu’elles ont aujourd’hui tendance à s’affaiblir.
À l’occasion d’un déplacement en Afrique du Sud en février dernier, le président Nicolas Sarkozy dressait le constat suivant : « Mais en dépit de la profondeur et de l’ancienneté de ces liens, la relation de la France avec l’Afrique, particulièrement avec l’Afrique sub-saharienne, se distend. Le nombre de Français vivant en Afrique, les exportations et les investissements français vers l’Afrique ont baissé. Il en résulte que nos partenaires traditionnels en Afrique ont parfois le sentiment d’un abandon ou au minimum d’un désintérêt de la France à leur endroit. Alors cette relation est compliquée parce que s’y mêlent depuis toujours à la raison le sentiment et la passion, parce qu’elle est depuis toujours chargée d’une grande affectivité, mais aussi parce que cette relation est en décalage par rapport à ce que veulent les Africains et à ce que perçoivent les Français ».
A.- Une relation singulière menacée d’essoufflement
La nature des relations entre la France et l’Afrique est loin de laisser indifférent : certains dénoncent leur caractère ambigu, lié à des réflexes coloniaux encore très présents ; d’autres louent une relation particulière, à nulle autre comparable. De fait, une relation singulière lie la France à ses anciennes colonies d’Afrique, comme l’a souligné Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, devant les membres de la Mission (1) : « Nous y avons, nous Français, commis des crimes et multiplié les manquements, mais nous avons aussi cherché à y apporter – parfois avec maladresse – le meilleur de nous-mêmes. L’Afrique a versé son sang pour la France et, à cet égard, notre dette est immense ; cette dette est éternelle, tellement le sacrifice de tant d’Africains a contribué au cours des deux derniers conflits du siècle dernier, à préserver ce que nous sommes ».
En dépit de leur dimension unique, ces relations ont aujourd’hui perdu de leur intensité, laissant la place à une incompréhension mutuelle, nourrie d’un côté par une indifférence croissante, de l’autre par une certaine déception, voire un sentiment de rejet.
1) La difficile adaptation à la nouvelle donne internationale
Cette évolution est, en partie, la conséquence d’un environnement international profondément remanié depuis la fin de la Guerre froide ainsi que des choix politiques qui ont alors été faits, sans avoir été toujours pleinement assumés. L’effondrement de l’Union soviétique a, en effet, contribué à détourner l’attention de l’Afrique, jusqu’alors terrain d’affrontement indirect entre les deux blocs, tout en laissant espérer l’avènement d’une ère nouvelle dans les relations internationales. C’est dans ce contexte que le président François Mitterrand a prononcé, en juin 1990, le célèbre discours de La Baule définissant une nouvelle doctrine de conditionnalité démocratique, censée régir, à l’avenir, les relations entre la France et ses partenaires africains traditionnels. Cet effort pour fixer un cadre à ces relations n’a pas résisté à l’épreuve des faits ; pas plus que les tentatives qui ont suivi sous les divers gouvernements qui se sont succédé (« doctrine d’Abidjan » subordonnant l’aide française au respect des programmes d’ajustement structurel du FMI, avancée par le Premier ministre Edouard Balladur, ou doctrine du « ni - ni » - « ni ingérence, ni indifférence » - définie par le Premier ministre Lionel Jospin) (2).
La politique française en direction du continent africain a, en effet, régulièrement oscillé entre « (…) une politique de puissance (interventionnisme dans le pré carré, francophonie, soutien des pays africains à la France dans le cadre de l’ONU, utilisation des reliquats de réseaux de la Françafrique) et des relations normalisées (proximité moindre avec les pays francophones, européanisation et présence plus affirmée dans les plus grands marchés africains comme l’Afrique du Sud, le Nigeria ou l’Angola) » (3). Ces hésitations se sont traduites par certaines contradictions dans la mise en œuvre des orientations retenues, qui ont pu porter préjudice à l’image de la France en Afrique.
A cet égard, la France n’est sans doute pas non plus exempte de reproches qui, depuis les indépendances, a parfois trop longtemps soutenu au nom de la stabilité du continent, des régimes honnis de leurs peuples. Elle en paie peut-être aujourd’hui le prix.
Ainsi, renonçant à des interventions directes en Afrique, la France a fait le choix de « multilatéraliser » et de « régionaliser » la gestion des crises, en s’appuyant sur les décisions prises dans un cadre onusien, africain ou européen. Tel a été le cas, par exemple, en République démocratique du Congo où l’engagement de la France a pris la forme d’une participation à la force européenne « Artémis » qui s’est déployée en Ituri, en 2003, pour appuyer la Mission des Nations unies sur place. C’est toujours le cas aujourd’hui avec la participation de la France à la force européenne « Eufor » qui s’est déployée, en début d’année, pour protéger les populations et sécuriser l’acheminement de l’aide à l’Est du Tchad et au Nord-Est de la République centrafricaine. Parallèlement à ces engagements dans un cadre multilatéral, la France a mis en place, en 1997, un dispositif dit de « Renforcement des capacités africaines de maintien de la paix » (Recamp) destiné à appuyer les forces africaines dans leurs missions de maintien de la paix, en leur fournissant du matériel, de la formation et des exercices. Cette orientation, consistant à privilégier un cadre multilatéral d’intervention, n’a cependant pas été systématiquement suivie, suscitant de vives critiques quant à l’attitude jugée ambiguë de la France. Son implication dans la crise tchadienne, par exemple, lui a récemment été reprochée comme le signe de la persistance d’une politique d’ingérence. Il n’en reste pas moins que la France recourt désormais majoritairement aux principes d’africanisation et de mutualisation des efforts. Dans le même temps, elle entend reconsidérer la portée des accords de défense qui la lient, depuis les indépendances, à un certain nombre de partenaires africains ainsi que l’ampleur de sa présence militaire sur le continent (fermeture, en 1997, de la base de Bouar en République centrafricaine et diminution récente des effectifs de la force Licorne en Côte d’Ivoire). Cette tendance de fond marque la fin d’une époque dominée par la recherche de « zones d’influence » en Afrique au profit d’une approche multilatérale des relations franco-africaines.
2) Regards croisés : le constat d’un malentendu
L’évolution de la relation singulière entre la France et l’Afrique est également le fruit de modifications importantes dans les perceptions réciproques. Lors d’un déplacement de la Mission en Ethiopie, Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali, alors président de la Commission de l’Union africaine, a rappelé qu’en dépit des critiques qu’on pouvait lui adresser, la France avait régulièrement soutenu l’Afrique, « y compris pendant les mauvais jours » alors qu’elle faisait figure de continent délaissé. Cependant, la France a également déçu, du fait des contradictions de sa politique mais aussi d’interventions contestées, comme cela a été le cas au Rwanda, au moment du génocide. Aujourd’hui, « comme deux vieilles connaissances fatiguées l’une de l’autre, l’Afrique et la France ne se comprennent plus » (4). L’image de la France sur le continent s’est profondément dégradée tandis que l’opinion française, si elle manifeste ponctuellement des accès de compassion humanitaire, se désintéresse globalement de l’Afrique.
Ces changements dans les perceptions s’expliquent, en partie, par un changement de générations en Afrique, comme en France. Comme l’a souligné le journaliste Laurent d’Ersu devant la Mission (5) : « la génération précédente parlait de « communauté de destin » alors qu’aujourd’hui, il est davantage question de partenariat et de non ingérence ». A l’heure actuelle, la jeunesse de l’Afrique – plus de 60 % de la population africaine a moins de 25 ans – a une vision très différente de la France, développant ses dynamiques propres. Quant aux dirigeants ou hauts fonctionnaires africains, ils ont souvent fait leurs études ou une partie de leur carrière en dehors du monde francophone (6).
Au fil des années, une relation plus tendue s’est instaurée entre la France et ses partenaires africains traditionnels, autour de certains sujets de crispation. Tout d’abord, la présence militaire française en Afrique – 8 000 hommes au Tchad, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Sénégal et à Djibouti – est de plus en plus mal perçue : « les bases militaires françaises représentent des abcès de fixation dans la mesure où elles apparaissent comme le symbole d’une forme de permanence coloniale » (7). Cette présence militaire s’appuie en outre sur des accords de défense jugés opaques et obsolètes, dans la mesure où ils permettent des interventions selon des modalités largement laissées à l’appréciation de la France. Dans ce contexte, l’annonce faite par le président Nicolas Sarkozy, lors de son déplacement en Afrique du Sud, d’une renégociation de ces accords a été accueillie favorablement par une majorité d’observateurs. Ensuite, le soutien apporté par la France à certains régimes en place est contesté par une société civile africaine de plus en plus active et présente dans le débat public. Ces critiques sont relayées par des ONG françaises qui recommandent « d’abandonner la doctrine française de soutien aux régimes en place qui ne favorise pas les alternances politiques mais, au contraire, une réelle instabilité à plus ou moins long terme » (8). Enfin, certains choix politiques, en termes de politique migratoire notamment, « passent » mal, contribuant à élargir le fossé entre opinions publiques française et africaine.
Les réactions au discours prononcé par le président Nicolas Sarkozy à Dakar, en juillet 2007, attestent de cette incompréhension mutuelle. Car, tandis que l’opinion publique africaine manifeste un sentiment de rejet de la présence française sur le continent, l’opinion publique française témoigne d’une indifférence quasi-généralisée envers l’Afrique. Le sentiment qui paraît prévaloir en France est celui que « l’Afrique est un continent à la dérive et que la France a plus à y perdre qu’à y gagner » (9). En outre, « l’Afrique subsaharienne est désormais souvent perçue sous le prisme négatif du risque migratoire » (10). En ce qui concerne la communauté française en Afrique, elle tend à se réduire du fait du recours croissant à des cadres nationaux par les entreprises françaises ainsi qu’à la suite d’évènements particuliers comme ceux intervenus en Côte d’Ivoire en novembre 2004 (11). On estime aujourd’hui le nombre de ressortissants français en Afrique à environ 200 000 personnes, dont 100 000 binationaux. Près de la moitié de ces expatriés est établie en Afrique francophone (102 000 personnes en 2006 contre 140 500 en 1985) (12). Côté africain, un sentiment d’abandon, voire de trahison, se manifeste dans certains milieux. La consultation réalisée par le ministère des Affaires étrangères souligne ainsi que « chez les francophones les plus modérés, une impression d’être délaissés, voir de ne pas être payés en retour par une France en repli (immigration, visas, réduction de l’aide, traitement des anciens combattants) domine avec, pour corollaire, le risque réel que les jeunes générations se détournent de la France pour rejoindre de nouveaux partenaires ».
En définitive, tandis que la vision française de l’Afrique apparaît décalée par rapport aux réalités d’un continent en mouvement, l’image de notre pays en Afrique est une image brouillée, en grande partie du fait du manque de lisibilité de sa politique africaine. Ce « désamour » entre la France et l’Afrique s’inscrit dans un contexte par ailleurs marqué par un retrait progressif de la France sur le continent.
B.- Une présence française en retrait
La France dispose d’atouts importants en Afrique comme l’illustrent notamment une coopération bilatérale ancienne, un réseau étoffé de centres culturels et de lycées français ou encore la place de la francophonie dans un certain nombre de pays. Mais, en dépit de ces atouts, notre pays apparaît aujourd’hui en repli sur le continent africain, en raison de la concurrence accrue de nouveaux acteurs mais aussi d’une baisse des moyens qu’il consacre au maintien de cette présence polyvalente et multiforme. Au-delà des changements d’orientations politiques et de perceptions, le lien singulier qui unit la France à ses partenaires africains traditionnels se distend donc également dans les faits.
1) Des intérêts économiques en repli
Alors que l’Afrique représentait une part importante des échanges commerciaux de la France dans les années 50 – près de 40 % en 1957 –, elle n’occupe désormais plus qu’une place marginale – environ 2 % –, du fait notamment de la réorientation de la France vers l’espace européen. En outre, l’essentiel des échanges ne se réalise plus avec nos partenaires traditionnels francophones mais avec des pays comme le Nigeria et l’Afrique du Sud qui concentrent aujourd’hui la moitié des échanges français avec le continent.
L’évolution des relations économiques entre la France et l’Afrique
Depuis une vingtaine d’années, l’Afrique voit son importance dans le commerce extérieur français décroître ; c’est tout particulièrement vrai pour l’Afrique francophone, pourtant partenaire historique du capitalisme français. Si la France demeure le premier fournisseur du continent dans son ensemble elle n’est que son second client avec respectivement 15 % des importations du continent et 10 % de ses exportations (50 milliards de dollars en 2005).
« (…) Le poids de la zone franc dans le commerce extérieur français est tombé à seulement 1 % en 2006, alors que la France a absorbé à elle seule environ un quart des exportations de la zone. Maghreb compris, la part de l’Afrique dans les exportations françaises est passée de 8,7 % en 1970 à 5,6 % en 2006, et le continent a fourni cette dernière année 4,5 % des importations françaises. »
Les relations commerciales avec l’Afrique permettent à la France de dégager un excédent commercial confortable – elles contribuent à cet excédent pour 3,2 milliards d’euros en 2004, dont 1,8 milliard pour l’Afrique subsaharienne.
« (…) Le stock d’investissements directs français détenus par la France en Afrique est estimé à 4,9 milliards d’euros, soit 1,5 % des IDE français dans le monde et 4 % seulement des stocks d’investissements directs étrangers (IDE) en Afrique – la France vient en quatrième rang des investisseurs après la Grande-Bretagne (13 % du stock), les Etats-Unis (8 % du stock) et les Pays-Bas (5 % du stock). En revanche, les IDE français comptent pour 20 % du total des IDE réalisés dans la zone franc. Les trois quarts de ces investissements portent sur le Gabon, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Congo Brazzaville. Hors zone franc, les intérêts économiques en Afrique sont essentiellement miniers et pétroliers (Angola et Nigeria). »
Source : Philippe Hugon, « La politique économique de la France en Afrique. La fin des rentes coloniales ? », Politique africaine, n°105, mars 2007. Avec l’aimable autorisation de l’auteur
À l’heure actuelle, les entreprises françaises se désintéressent du continent africain, largement perçu comme un marché marginal par rapport à d’autres marchés, asiatiques notamment. Cette évolution est pour le moins paradoxale : les entrepreneurs français désertent, en effet, l’Afrique subsaharienne au moment où les opérateurs chinois et indiens y débarquent en force. Comme l’a indiqué Philippe Hugon devant les membres de la Mission (13), elle témoigne d’une « baisse d’attractivité pour l’Afrique qui semble s’expliquer par une image négative du continent dans le milieu des entrepreneurs français ainsi que par une vision qui tend à privilégier le court terme et un taux rapide de retour sur investissement ». Dans le prolongement de ce constat, Anthony Bouthelier, Président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN), observe que les investissements français actuellement réalisés en Afrique sont, dans la plupart des cas, le fait d’entreprises déjà implantées sur le continent : « en dehors du secteur des hydrocarbures, aucune entreprise non implantée en Afrique ne placera le continent en tête de ses diversifications géographiques, car il a une très mauvaise image. Les seules sociétés investissant en Afrique sont celles qui y sont déjà présentes, souvent depuis longtemps » (14).
Cette désaffection des entrepreneurs français s’explique également par la concurrence acharnée à laquelle ils sont désormais confrontés avec l’arrivée en force, sur les marchés africains, de nouveaux opérateurs en provenance des grands pays émergents d’Asie. Dans un récent ouvrage consacré à la « Chinafrique » (15), les journalistes Serge Michel et Michel Beuret ont mis en évidence le fait que le recul des entreprises françaises en Afrique se faisait, dans bien des cas, au bénéfice d’entreprises chinoises. Cette tendance se manifeste dans de nombreux secteurs comme le BTP – où les entrepreneurs chinois raflent d’importants contrats en affichant des prix de 30 à 50 % moins élevés que ceux de leurs concurrents français –, l’industrie de l’eau ou du bois. En réalité, les entreprises françaises ne font pas face à la concurrence d’autres entreprises, mais à celle de l’Etat chinois qui, par l’intermédiaire de contrats interétatiques, s’implante dans un pays avec des investisseurs à sa suite. Comme l’a souligné Stephen Decam, secrétaire général du CIAN, « cette configuration procure de grands avantages aux entreprises, notamment pour l’obtention d’autorisations publiques, comme ce fut récemment le cas au Gabon où la Chine a négocié avec les autorités locales un « fast track » pour l’accès au marché des médicaments. Aucune entreprise ne peut évidemment lutter contre un Etat » (16), qui négocie ses contrats en échange de licences d’exploitation de matières premières et ressources naturelles et les fait exécuter par sa main-d’œuvre expatriée. L’implantation massive de ces opérateurs asiatiques a pour conséquence une diminution de la présence économique française en Afrique qui se résume aujourd’hui à une vingtaine de moyens et grands groupes. En 2007, la Chine a ainsi dépassé la France en Afrique, avec un volume d’échanges s’élevant à 69 milliards de dollars contre 56 milliards pour la France (17).
Au-delà de cette concurrence accrue, certains observateurs considèrent que les difficultés économiques de la France en Afrique sont liées à la prépondérance de grandes entreprises et la faiblesse des investissements des PME (18). Ce déséquilibre est particulièrement net dans certains pays comme la Côte d’Ivoire où, à la suite des événements de novembre 2004, la présence de PME françaises s’est considérablement réduite. D’une manière générale, la présence économique française souffre de la disparition d’opérateurs intermédiaires français en Afrique, ce qui pose la question de l’adaptation du dispositif institutionnel de soutien aux entreprises françaises. À cet égard, la consultation réalisée, à l’automne 2007, par le Quai d’Orsay auprès de ses postes en Afrique a souligné la contradiction que représentait la diminution du réseau des missions économiques sur le continent avec le dynamisme africain. Ce constat inspirera les recommandations de la Mission, exposées dans la troisième partie du présent rapport.
Dernière évolution notable, l’intérêt de plus en plus marqué par les entrepreneurs français pour des pays africains situés hors du champ classique francophone. Cette évolution s’inscrit dans une tendance générale à la diversification des relations de la France avec les pays africains qu’ont récemment illustrée les déplacements du président Nicolas Sarkozy en Afrique du Sud et en Angola. Elle se manifeste par une présence croissante de grands groupes français dans des pays anglophones ou lusophones comme le Nigeria et l’Angola, par exemple où Total est le second producteur de pétrole. Comme le souligne Philippe Hugon (19), « hors zone France, les intérêts économiques en Afrique sont [en effet] essentiellement miniers et pétroliers ».
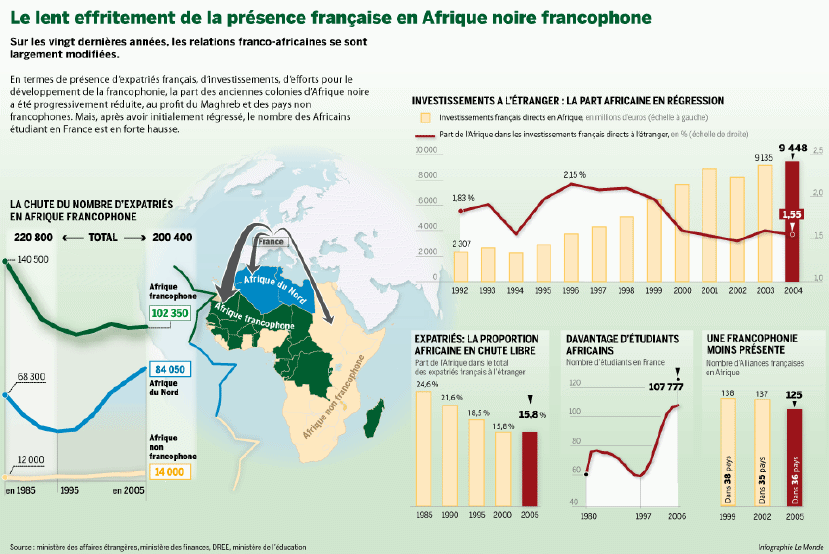
Source : infographie parue dans le journal Le Monde du 14 février 2007.
En définitive, les réorientations de la politique économique française en direction de l’Europe, mais aussi du reste du monde dans un contexte de multilatéralisme croissant, ont conduit les entreprises françaises à se détourner progressivement de l’Afrique. Mais ces grandes évolutions attachées à la mondialisation de l’économie ne sont pas les seules causes de ce désintérêt pour les marchés africains. D’autres raisons, plus spécifiques, peuvent être invoquées, en particulier la concurrence accrue de nouveaux opérateurs ainsi qu’une certaine frilosité des entrepreneurs français liée « à des situations de rente ainsi que par l’absence de volonté de prendre des risques » (20). Elles aboutissent à la situation paradoxale déjà soulignée de repli des intérêts économiques français en Afrique, à l’heure où le continent attise de fortes convoitises et représente des opportunités d’investissement ou de commercialisation très fortes.
2) Une politique française de coopération en « peau de chagrin »
La politique française de coopération a longtemps constitué un des instruments privilégiés de la politique de la France en Afrique. Les priorités qui lui sont assignées et les moyens qui lui sont consacrés constituent des indicateurs importants de l’implication de la France en faveur du continent africain. C’est la raison pour laquelle le dispositif institutionnel de pilotage de cette politique ainsi que les niveaux de l’aide publique au développement (APD) de la France ont retenu l’attention des membres de la Mission d’information.
Comme de nombreuses autres politiques publiques, la politique d’aide au développement a été profondément modifiée du fait la montée en puissance des engagements multilatéraux, notamment européens. Ainsi, le Fonds européen de développement (FED) occupe-t-il une place prépondérante dans l’aide française, dont il représente aujourd’hui près de 8 % du total. Si l’on y ajoute la contribution de notre pays au budget de l’Union européenne, on constate qu’environ 15 % de l’APD française (soit un montant de 1.885 millions de dollars en 2006) empruntent aujourd’hui le canal communautaire. Cette montée en puissance du volet multilatéral de l’aide française – de l’ordre de 7 % de progression annuelle de 1997 à 2007 – s’est accompagnée d’une diversification des objectifs mais aussi des « cibles » de l’aide au développement qui ne sont plus exclusivement les pays francophones d’Afrique subsaharienne.
Parallèlement à cette « multilatéralisation » croissante, la coopération bilatérale française a également connu des évolutions importantes. Sur le plan institutionnel, la réforme engagée en 1998 (21) s’est traduite par l’intégration des services de l’ancien ministère de la Coopération au sein du ministère des Affaires étrangères, la mise en place d’une coordination interministérielle via le Comité interministériel à la coopération internationale et du développement (CICID) et la désignation de l’Agence française de développement (AFD) comme « opérateur pivot ». Elle s’est accompagnée de la définition d’une « Zone de solidarité prioritaire » (ZSP) qui, intégrant des pays du Moyen-Orient, de la péninsule indochinoise, ou des Caraïbes et du Pacifique, n’est plus exclusivement africaine (22). Cette réforme de la coopération française s’est par ailleurs inscrite dans un contexte de réduction massive de l’assistance technique : le nombre d’experts français est, en effet, passé d’environ 23 000 au début des années 80 à près de 1 500 en 2007. Comme l’observe notre collègue Henriette Martinez, membre de la Mission d’information, dans son avis budgétaire sur les crédits de l’APD en 2008 (23) : « cette évolution traduit les mutations profondes des missions de l’assistance technique qui doivent s’adapter à de nouvelles situations (conception de politiques de développement en liaison avec des bailleurs de fonds multilatéraux, expertise sectorielle, etc.) et à de nouvelles modalités de mise en œuvre (assistance de courte et de moyenne durée, par exemple). Elle n’en soulève pas moins un certain nombre de questions sur la pérennité des actions engagées dans des pays où la France a traditionnellement une présence forte ».
En définitive, si la priorité africaine de la politique française de coopération continue d’être affirmée, elle n’apparaît plus aussi clairement dans son dispositif institutionnel, ni sur le terrain de l’aide. Dans le même temps, le choix d’une implication croissante dans les pays émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.) a été confirmé (24), ce qui soulève la question des moyens qui sont aujourd’hui effectivement consacrés à la coopération bilatérale française en Afrique subsaharienne.
De fait, si l’aide publique bilatérale représente aujourd’hui plus des deux tiers de l’aide totale de la France, sa structure et son volume ont été modifiés en profondeur au cours de ces dernières années. A l’heure actuelle, la prépondérance de l’aide bilatérale tient, en effet, en grande partie au poids important des opérations d’allègement de dettes ainsi que des dépenses « non programmables » ou d’origine extrabudgétaire, comme les dépenses d’écolage et d’aide aux réfugiés (25). Ainsi, si 70 % de l’aide française bilatérale ont été consacrés à l’Afrique (dont 58 % à l’Afrique subsaharienne) en 2006, cette évolution est essentiellement due à l’effet des volumes d’annulation de dette (26). Hors opérations de remise de dette, les quinze premiers bénéficiaires ne représentaient que 59 % de l’aide bilatérale allouable. Comme le relève le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE : « la conjonction d’un volume d’aide bilatérale programmable relativement limité et dispersé sur un nombre important de pays, ajouté à l’arrivée de nouveaux donateurs, fait que la France n’occupe plus la position clé qui était la sienne dans de nombreux pays africains (…) Si le fait que la France ne soit plus un partenaire bilatéral quasi exclusif permet d’assainir la relation partenariale, il est important que la France garde les moyens d’une stratégie ambitieuse d’appui à la lutte contre la pauvreté dans ces pays, où elle bénéficie d’un avantage comparatif lié à une relation historique à multiples facettes, incluant un effort de coopération de long terme » (27).
La part de l’Afrique dans l’aide publique mondiale au développement
La part de l’Afrique dans l’aide publique au développement (APD) totale est remontée à 41 % en 2006 – après un repli à 36 % en 1999. Ces flux croissants sont en grande partie imputables aux initiatives d’allégement de la dette et à l’aide d’urgence, qui ont représenté respectivement 23 % et 10 % du total de l’APD en 2006, triplant ainsi cette part depuis 2000. Résultat, l’APD totale à l’Afrique a augmenté, passant de 35,2 milliards de dollars en 2005 à 43,4 milliards en 2006.
L’essentiel de cette augmentation récente de l’APD à l’Afrique est à mettre au compte des allègements de dette et de l’aide d’urgence, alors que le montant des prêts et des dons à des programmes et à des projets est resté pratiquement inchangé en 2005. Les secteurs sociaux et la gouvernance ont bénéficié de près de 30 % de l’APD en 2005, alors que l’aide aux infrastructures économiques et aux secteurs de production en a représenté quelque 17 %, contre respectivement 36 % et 18 % en 2004. Reste à savoir si le montant de cette aide au développement de base continuera à progresser une fois tassée la hausse conjoncturelle liée aux allègements de dette et à l’aide d’urgence.
Les principaux bailleurs de l’Afrique sont la Commission européenne, la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, qui représentent ensemble 47 % de l’APD totale à la région. Viennent ensuite l’Allemagne, le Japon et les Pays-Bas.
Source : Perspectives économiques africaines 2008 – OCDE, Banque africaine de développement (BAD) et Commission économique pour l’Afrique des Nations unies (CEA).
Ces tendances structurelles sont d’autant plus préoccupantes que, d’une part, le volume de l’aide française recule en 2007 et que, d’autre part, la France est tenue par des engagements forts dont celui pris, avec les autres pays du G8 au sommet de Gleneagles (2005), d’augmenter l’aide de 50 milliards de dollars avant 2010 – pour la porter ainsi à 130 milliards de dollars – et d’en consacrer au moins la moitié à l’Afrique. Or, d’après les données préliminaires du CAD de l’OCDE, le volume de l’aide française s’établit à 9,94 milliards de dollars en 2007, contre 10,6 milliards en 2006. Ce recul se traduit par une baisse du ratio de l’APD sur le revenu national brut (RNB) de 0,47 % en 2006 à 0,39 % en 2007. Si la France est ainsi au premier rang des pays du G7, elle se situe en revanche au 11ème rang des pays du CAD, en deçà du niveau de l’effort moyen par pays estimé à 0,45 % (28). S’agissant de la promesse du G8 à l’Afrique, elle est aujourd’hui compromise comme le constate le rapport de l’Africa Progress Report (29) qui estime le déficit de financement de l’aide à environ 40 milliards de dollars. S’agissant de la France, l’organisation DATA (« Debt, Aids, Trade, Africa ») évalue le déficit à combler, par notre pays, pour respecter son engagement en faveur de l’Afrique, à 1,3 milliard d’euros en 2007 – 2008.
Au regard des orientations de la politique française de coopération et des engagements pris au niveau international en faveur de l’Afrique, la diminution de notre aide contribue à affaiblir la portée de la politique de la France sur le continent africain. Et ce d’autant qu’au même moment, de nouveaux acteurs s’affirment en Afrique, comme la Chine dont l’effort d’aide s’accroît progressivement. À cet égard, une dernière observation s’impose : l’aide française est principalement orientée vers des pays où nos intérêts économiques sont faibles alors qu’elle est quasi inexistante dans des pays comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud. Certains pays donateurs ont une approche radicalement opposée. A titre d’exemple, la coopération japonaise assure, par les octrois de prêts, la coordination entre les secteurs publics et privés et agit comme soutien financier au commerce et aux investissements directs extérieurs du Japon (30). Ainsi, « contrairement aux pays asiatiques nouveaux venus sur le continent, l’Etat français semble aujourd’hui moins que par le passé utiliser son APD en appui des intérêts commerciaux ou énergétiques de ses entreprises » (31). A défaut de parvenir à une meilleure coordination avec les grands pays émergents en Afrique, votre Rapporteur estime qu’il pourrait s’avérer utile de reconsidérer cette approche sans pour autant question de remettre en cause les engagements internationaux pris par la France aux côtés de ses pairs en faveur du déliement de l’aide publique au développement.
En définitive, malgré une présence ancienne et forte sur le continent africain, la France semble avoir davantage subi les changements qui y sont intervenus qu’elle ne les a anticipés et analysés dans le cadre d’une stratégie globale. Il en résulte un recul de la présence française sur le continent qu’accompagne une incertitude quant à la volonté de notre pays d’y maintenir une présence, compte tenu de la diminution des moyens qu’elle consacre à sa politique en direction de l’Afrique.
Au-delà de ce qui a pu être interprété comme des hésitations ou des contradictions, le principal reproche formulé à l’encontre de la France est de n’avoir pas su anticiper les évolutions qui sont intervenues sur le continent africain, en particulier son entrée dans la mondialisation. Ce défaut d’anticipation a été reconnu lors d’une consultation réalisée, à l’automne 2007, par le Quai d’Orsay auprès des 42 ambassadeurs français en poste en Afrique : « Loin de la pensée misérabiliste (…) les progrès accomplis par l’Afrique sont importants et largement sous-estimés par l’opinion et les observateurs ». Devant les membres de la Mission (32), le journaliste Antoine Glaser constatait, pour sa part, que « l’Afrique s’est trouvée de nouveaux partenaires, comme la Chine, tandis que la France adoptait une posture essentiellement défensive et réactive et se révélait incapable d’aller aux devants de la jeunesse africaine ». Et sa collègue Elise Colette, journaliste de Jeune Afrique, de conclure au cours du même échange : « (…) [il revient aujourd’hui à la France] de faire preuve de son attractivité par rapport à d’autres partenaires, comme les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. La situation a radicalement changé et notre pays doit faire des efforts : dans quelle autre partie du monde peut-il, en effet, se prévaloir d’une influence comparable à celle dont il dispose encore en Afrique ? ».
C.- L’Afrique, courtisée, se tourne vers des partenaires diversifiés
Après la fin de la Guerre froide, le continent africain, jusqu’alors terrain d’affrontement entre les deux blocs, a retrouvé une place géopolitique centrale, suscitant à nouveau l’intérêt de puissances comme les Etats-Unis, mais également celui de grands pays émergents comme la Chine, le Brésil ou l’Inde. L’Afrique oubliée est désormais devenue l’Afrique courtisée pour ses richesses énergétiques, ses matières premières et son potentiel de développement économique et commercial. L’affirmation de la présence de ces « nouveaux » acteurs, qui rejoignent l’Union européenne dans son partenariat de longue date avec le continent, modifie en profondeur les représentations sur l’Afrique et ses rapports avec le monde extérieur. Au-delà des interrogations qu’elle suscite, cette présence, en bousculant celle de partenaires traditionnels comme la France, crée une nouvelle donne dont il est indispensable de tirer les conséquences.
1) Le rôle ancien et croissant de l’Union européenne en faveur de la sécurité et du développement de l’Afrique
Après une période de relatif désengagement, l’Union européenne (UE) s’est progressivement affirmée comme un acteur important de la sécurité et du développement en Afrique. Elle entend aujourd’hui promouvoir une nouvelle relation avec l’Afrique, dépassant le lien traditionnel entre bailleurs de fonds et bénéficiaires de l’aide au développement. Cette approche repose sur une vision renouvelée du continent africain qui « prend la mesure de l’enjeu du voisinage géographique, dans un monde désormais globalisé » (33). Car, comme le souligne Nathalie Delapalme (34) « le continent africain est celui qui cumule le plus de facteurs de proximité avec le continent européen : la géographie, l’histoire, les langues, le mélange des peuples et des cultures. Ni le continent asiatique, ni l’Amérique latine ne peuvent se prévaloir d’une conjugaison aussi complète, même si différents facteurs y existent, à des degrés divers ».
C’est dans cette perspective que le Conseil européen a adopté, en décembre 2005, une « Stratégie de l’Union européenne pour l’Afrique » fondée sur l’idée que les enjeux africains (pression migratoire, risque sanitaire, enjeu environnemental, menace terroriste) s’imposent à tous et appellent une réponse coordonnée des Européens. Le document final adopté par le Conseil précise que « cette stratégie vise essentiellement à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et à promouvoir le développement durable, la sécurité et la bonne gouvernance en Afrique » (35). Fin 2007, cette vision globale a été précisée à l’occasion du sommet entre l’Union européenne et l’Afrique qui s’est tenu à Lisbonne, les 8 et 9 décembre 2007. Ce sommet s’est en effet conclu par l’adoption d’une « Stratégie conjointe UE – Afrique » - « à elle seule, l’évolution sémantique est fondamentale » (36) - reposant sur un plan d’action 2008-2010 et cinq partenariats dans des domaines d’intérêt commun : l’énergie, le changement climatique, les migrations, la mobilité et l’emploi, la gouvernance démocratique et, enfin, l’architecture politique et institutionnelle UE – Afrique.
Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de relations denses entre les deux continents à différents niveaux. L’Union européenne est notamment le premier partenaire commercial et le principal marché d’exportation pour une majorité de pays africains. En 2006, les importations de l’Union en provenance d’Afrique se sont élevées à 126 milliards d’euros et ses exportations à destination du continent à 93 milliards d’euros. L’Afrique fournit environ 9 % des importations de l’Union, dont la moitié est constituée de produits énergétiques, 23 % sont des biens manufacturés et 11 % des produits alimentaires et agricoles. Pour sa part, l’Afrique absorbe 8,3 % des exportations de l’Union, dont près de 80 % sont constitués de machines, de produits chimiques et de produits manufacturés.
En matière de développement, l’UE est le premier bailleur de fonds aux pays en développement avec près de 56 % - soit environ 44 milliards d’euros en 2006 - du total mondial de l’aide publique au développement (APD) (37). En 2005, l’Union a adopté, dans le cadre du « consensus européen pour le développement », un calendrier qui prévoit que les Etats membres devront consacrer 0,7 % de leur revenu national brut (RNB) à l’aide publique au développement d’ici 2015, avec un objectif collectif intermédiaire de 0,56 % d’ici 2010. Conformément à ces engagements, l’aide annuelle de l’UE doit doubler pour atteindre plus de 66 milliards d’euros en 2010 ; la moitié au moins de cet accroissement du volume d’aide doit être destinée à l’Afrique. D’ores et déjà, une part prépondérante de l’aide européenne au développement est consacrée aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – environ 40 % en 2006 –.
L’Union européenne est également un partenaire majeur du développement économique des pays africains à travers l’accord de Cotonou. Signé en 2000, cet accord vise à promouvoir et à accélérer le développement économique, social et culturel des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à contribuer à la paix et à la sécurité et à promouvoir un environnement politique stable et démocratique. Il repose sur cinq piliers interdépendants : le renforcement de la dimension politique des relations entre les États ACP et l’UE ; la promotion des approches participatives et l’ouverture à la société civile ; les stratégies de développement et une concentration sur l’objectif de la réduction de la pauvreté ; l’établissement d’un nouveau cadre de coopération économique et commerciale ; enfin, une réforme de la coopération financière. Les engagements pris dans le cadre de l’accord de Cotonou sont mis en oeuvre à travers le Fonds européen de développement (FED). Pour la période 2008 – 2013, le budget du 10ème FED s’élèvera à 22,682 milliards d’euros, soit 0,03 % du PIB européen.
Enfin, l’Union européenne est depuis quelques années très impliquée dans la résolution de certains conflits africains, comme en témoignent ses interventions en République démocratique du Congo (RDC) ainsi qu’au Tchad et en Centrafrique. L’objectif principal de l’Union est d’apporter un soutien au renforcement des capacités africaines de gestion des crises, notamment à travers la « Facilité européenne pour la paix en Afrique », créée en 2003 et dotée de plus de 300 millions d’euros (300 millions d’euros supplémentaires ont été débloqués pour la période 2008-2010). Cette facilité repose sur le principe de l’appropriation africaine. Elle appuie les opérations de maintien de la paix conduites par les pays africains ainsi que le renforcement des capacités de la structure de sécurité naissante de l’Union africaine (cf. infra). Plus de 435 millions d’euros ont ainsi été consacrés aux opérations de maintien de la paix de l’Union Africaine au Darfour (Soudan) par l’Union Européenne (Commission et aide bilatérale des Etats membres).
Par ailleurs, l’Union européenne a pris de nouvelles responsabilités en faveur de la sécurité en Afrique. C’est ainsi qu’en 2003, elle a conduit sa première opération à caractère militaire, l’opération Artémis, en République démocratique du Congo et qu’en 2006 elle est intervenue en soutien au processus électoral dans le pays (Eufor RD Congo). En janvier 2008, l’UE a lancé, dans le cadre sa politique de sécurité et de défense (PESD) l’opération Eufor Tchad/RCA qui s’est déployée à l’Est du Tchad et au Nord-Est de la République centrafricaine. Cette opération vise à soutenir la présence des Nations unies dans la région. Elle a plus particulièrement pour mission de contribuer à la protection des civils en danger, en particulier les réfugiés et les personnes déplacées, et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire en améliorant la sécurité dans la zone d’opérations. Le déploiement de cette force renforce ainsi l’engagement de l’Union européenne en soutien d’une solution à la crise du Darfour.
En définitive, l’Union européenne a progressivement renforcé la dimension politique du dialogue ancien qu’elle entretient avec l’Afrique. Cette orientation, qu’accompagnent les moyens importants que l’Union consacre au développement de l’Afrique, en fait un acteur majeur sur le continent.
2) Le retour des Etats-Unis en Afrique
Après s’être désengagés du continent africain à la fin de la Guerre froide, les Etats-Unis manifestent, depuis quelques années, un regain d’intérêt pour l’Afrique, qui s’est fortement accentué à la suite des événements du 11 septembre 2001. Cet intérêt renouvelé se traduit par un repositionnement stratégique sur le continent et une implication politique croissante, portant principalement sur la question des matières premières et le libre échange.
La politique américaine en Afrique se caractérise aujourd’hui par la prééminence d’intérêts sécuritaires, avec un objectif clairement affirmé de lutte contre le terrorisme. Elle est également marquée par une préoccupation forte de diversification et de sécurisation des approvisionnements énergétiques des Etats-Unis. Enfin, cette politique cherche à promouvoir la démocratie et le développement économique, tout en consacrant des moyens importants à l’éducation et à la santé, en particulier à la lutte contre les pandémies. De fait, l’aide totale des Etats-Unis à l’Afrique devrait atteindre 8,7 milliards de dollars d’ici 2010, soit le double de son montant de 2004 et un quadruplement depuis 2001 (38).
Cette implication plus forte des Etats-Unis en Afrique témoigne d’une volonté d’assurer la stabilité de la région afin d’empêcher l’apparition de foyers terroristes et de garantir la sécurité des approvisionnements américains en hydrocarbures. Les Etats-Unis importent, en effet, 15 % de leur pétrole d’Afrique (le Nigeria et l’Angola figurent parmi leurs dix principaux fournisseurs) et ce chiffre pourrait passer à 25 % d’ici 2015.
La place croissante qu’occupe désormais l’Afrique dans la vision stratégique américaine se manifeste par un certain nombre d’initiatives destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme comme l’initiative pan-Sahel (IPS), lancée en 2002, et relayée, en 2005, par l’« Initiative trans-saharienne contre le terrorisme » (TransSaharan Counterterrorism Partnership). Ce programme d’entraînement des forces militaires de neuf pays (39), doté de 100 millions de dollars par an jusqu’en 2010, a pour objectif d’aider à améliorer les capacités des forces de sécurité interne à contrôler les frontières et à lutter contre les activités illégales. Les Etats-Unis se sont, par ailleurs, implantés militairement à Djibouti où la mise en place, en 2002, du « Combined Joint Task Force – Horn of Africa » vise à combattre le terrorisme dans la région ainsi qu’à améliorer la sécurité dans les pays de la Corne de l’Afrique ainsi qu’en mer Rouge, dans le golfe d’Aden et dans l’océan indien. Dans le même esprit, un programme ciblant l’Afrique orientale (East African Counter Terrorism Program) a été mis sur pied en 2003.
Depuis l’échec de l’expédition en Somalie (1992 – 1993), les Américains sont, en effet, réticents à l’envoi de forces en Afrique et privilégient les programmes d’assistance militaire. L’objectif recherché est de limiter les interventions directes en cherchant des relais sur place et en privilégiant le recours à des solutions africaines. Dans cette perspective, un effort important de formation des militaires africains à la gestion des crises a été fourni, qui a concerné plus de 39 000 soldats africains de maintien de la paix depuis 2005 (40). Toutefois, la dispersion de ces efforts a conduit les Etats-Unis à rechercher une meilleure coordination de leurs activités militaires en Afrique. C’est ainsi que le président Georges W. Bush a approuvé, début 2007, la création d’un nouveau centre de commandement des Etats-Unis pour l’Afrique, l’Africom. Doté d’un important volet civil, le commandement Africom est appelé à orienter ses activités vers le maintien de la paix, les secours en cas de catastrophe naturelle et à concentrer ses efforts sur une aide humanitaire préventive. Au total, « la politique africaine des Etats-Unis peut se résumer ainsi : prévenir les conflits, éradiquer les cellules terroristes, exploiter les gisements pétroliers et gaziers, garantir la sécurité des routes maritimes (golfe d’Aden, mer Rouge, golfe de Guinée) et avoir accès à des bases avancées » (41).
Ces objectifs stratégiques s’accompagnent d’une aide au développement dont la finalité est de contribuer à réduire la pauvreté grâce à une croissance économique largement autonome. Dans cette perspective, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (African Growth and Opportunity Act − AGOA), adoptée en mai 2000, a été prorogée jusqu’en 2015. Le dispositif institué par cette loi s’adresse aux pays bénéficiaires de l’aide américaine qui progressent vers l’Etat de droit, une économie de marché et le libre-échange et qui mettent en œuvre des politiques économiques susceptibles de réduire la pauvreté. Les pays respectueux de ces principes de bonne gouvernance accèdent plus facilement aux marchés américains (42). Ce dispositif a été complété par une série de mesures destinées à soutenir le développement des marchés financiers ainsi que les échanges commerciaux et les investissements en Afrique (« Initiative en faveur du secteur financier africain » lancée en mai 2007 (43) et « Initiative en faveur de la compétitivité de l’Afrique dans le monde » dotée de 200 millions de dollars sur une période de 5 ans). Enfin, une trentaine de pays africains peuvent prétendre au « Fonds du millénaire » (Millenium Challenge Corporation), lancé en 2004, qui permet de financer des projets visant à aider les pays bénéficiaires à améliorer leur économie ainsi qu’à relever le niveau de vie de leur population. Là encore, la distribution de ces ressources est soumise au respect des principes suivants : une bonne administration publique, des investissements dans la santé et l’éducation et une politique économique libérale. À ce jour, la Société du Fonds du millénaire a conclu sept accords avec des Etats d’Afrique, pour un montant total de 2,4 milliards de dollars (44).
Au-delà de ces efforts destinés à stimuler la croissance économique en Afrique pour réduire la pauvreté, l’aide américaine se concentre sur la santé et l’éducation. Dans le domaine de la santé, les Etats-Unis mènent une politique offensive sur le terrain de la lutte contre les pandémies avec le lancement, en 2003, du Plan d’aide d’urgence à la lutte contre le Sida dans le monde (President’s Emergency Plan for AIDS relief – PEPFAR) et celui de l’« Initiative en faveur de la lutte contre le paludisme » en 2005. Le PEPFAR, destiné aux pays d’Afrique et des Caraïbes, est en effet doté de 15 milliards de dollars sur 5 ans et le fonds pour la prévention et le traitement du paludisme de 1,2 milliard de dollars sur la même durée. En matière d’éducation, une initiative spécifique a également été mise en place, qui prévoit un engagement de 600 millions de dollars sur 8 ans, en vue d’améliorer l’accès des Africains à une éducation fondamentale de qualité.
Ces initiatives en direction du continent africain attestent d’une nette réévaluation de la politique africaine des Etats-Unis. Par leur caractère multidimensionnel, elles démontrent que la stabilité politique, économique et militaire de l’Afrique est devenue un objectif stratégique de première importance non seulement pour lutter contre l’islamisme radical mais aussi pour sécuriser l’approvisionnement énergétique des Etats-Unis. Elles illustrent enfin le retour des Etats-Unis en Afrique, retour qui participe d’une nouvelle donne que, là encore, la France doit pleinement intégrer dans ses efforts de refondation de sa politique en direction du continent africain.
3) L’affirmation des puissances « émergentes »
Forum de coopération sino-africain, Sommet Inde – Afrique ou TICAD (45) : les rencontres au plus haut niveau entre dirigeants africains et responsables politiques des grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Japon, etc.) n’ont cessé de se multiplier au cours de ces dernières années. Ces rencontres dévoilent au grand jour l’influence croissante de nouveaux acteurs sur le continent africain, dont les objectifs et les méthodes d’intervention suscitent des réactions diverses. Aubaine pour certains, l’émergence de ces acteurs est dénoncée comme une nouvelle forme de pillage de l’Afrique, voire de néo-colonialisme, par d’autres. Dans tous les cas, elle soulève la question de l’articulation entre les différentes initiatives prises en direction du continent africain et de la nature du dialogue politique susceptible de se mettre en place.
Si certaines images, comme celle de la « Chinafrique » (46) par exemple, ont durablement marqué les esprits, les grands pays asiatiques désormais présents en Afrique ne sont, en réalité, pas des nouveaux venus sur le continent. La République populaire de Chine (RPC) s’est, en effet, impliquée politiquement en Afrique, dès avant les indépendances, avec la conférence des « non alignés » de Bandung, en 1955. L’aide aux mouvements de libération nationale, puis la coopération avec les Etats nouvellement indépendants, a permis à la Chine communiste de s’affirmer face à la prépondérance occidentale, de s’opposer à l’influence de l’Union Soviétique, et de faire échec à la concurrence de Taïwan. Pour sa part, l’Inde de Nehru a très tôt apporté son soutien aux mouvements indépendantistes tandis qu’en 1964, le gouvernement indien mettait en place un programme de coopération économique et technique (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) destiné à offrir une assistance à de nombreux pays du Tiers Monde (47). En outre, ces pays ont de fortes communautés nationales en Afrique, dont la présence est, dans certains cas, très ancienne (48). On estime aujourd’hui la communauté chinoise à environ 500 000 personnes (certaines estimations vont jusqu’à 700 000), dont près de 200 000 Chinois (ou Sud-africains d’origine chinoise) en Afrique du Sud. L’Inde bénéficie également de la présence d’une forte minorité indienne en Afrique du Sud (un million de personnes, soit près de 2 % de la population totale du pays), à l’île Maurice (720 000 personnes), au Kenya (100 000 personnes), ou encore en Tanzanie (90 000 personnes) (49).
Depuis la fin des années 90, les deux géants asiatiques manifestent un intérêt croissant pour l’Afrique, en particulier pour les matières premières (pétrole, or, cobalt, bois, uranium (50)) dont elle regorge, afin de soutenir leur croissance économique en forte expansion. Actuellement, l’Afrique représente 22 % des importations chinoises de pétrole (en provenance principalement du Soudan, de l’Angola et du Nigeria) et 20 % des importations pétrolières de l’Inde. Elle constitue également une source importante d’approvisionnements en minerais ainsi qu’en produits de base comme le bois, le cacao ou le coton.
Le continent africain représente un réservoir stratégique pour la fourniture d’hydrocarbures et de matières premières, mais il constitue également un débouché commercial essentiel pour l’économie de ces pays. A l’heure actuelle, l’Asie reçoit en effet 27 % des exportations africaines (trois fois plus qu’en 1990), ce qui est à peu près l’équivalent du niveau des exportations de l’Afrique à destination de ses deux partenaires commerciaux traditionnels que sont l’Europe (32 %) et les Etats-Unis (29 %). Parallèlement, les exportations asiatiques vers l’Afrique augmentent de 18 % par an, un taux de progression qu’elles ne connaissent nulle part ailleurs.
Une étude de l’OCDE (51) illustre le dynamisme exceptionnel qu’affichent les échanges de l’Afrique avec la Chine et l’Inde depuis 2000. A partir de cette date, les exportations africaines vers la Chine ont, en effet, progressé à un rythme annuel de 56 %. En 2004, elles portaient sur 11,4 milliards de dollars, soit un montant trois fois plus élevé qu’en 2000, correspondant à 6 % du total des exportations africaines dans le monde. Quant aux exportations de l’Afrique vers l’Inde, elles ont progressé de 10 % entre 2000 et 2004. Sur la même période, les taux de croissance annuels moyens des importations africaines en provenance de Chine et d’Inde (respectivement 33 % et 20 %) ont également été très dynamiques.
Le graphique ci-après illustre le dynamisme de ces échanges :
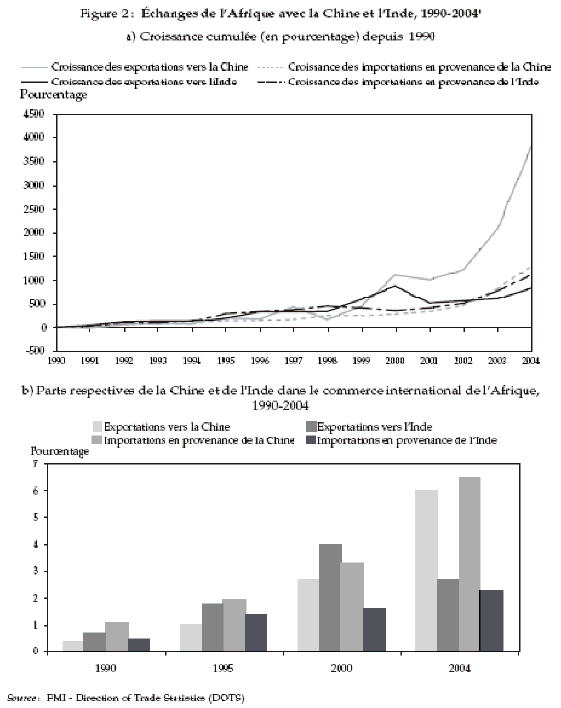
Source : OCDE, L’essor de la Chine et de l’Inde : quels enjeux pour l’Afrique ?, 2006.
Cette présence forte, qui s’est affirmée à un rythme extrêmement rapide, soulève un certain nombre d’interrogations, en particulier celle de son impact sur les perspectives de développement de l’Afrique. La Banque mondiale (52) a récemment constaté que les liens commerciaux, qui se développent entre les deux continents, présentent un déséquilibre majeur : les exportations africaines vers l’Asie ne représentent que 1,6 % de ce que les pays asiatiques achètent au reste du monde tandis que les achats de la Chine et de l’Inde en Afrique ne constituent que 13 % des exportations globales de ce continent. Certains observateurs s’inquiètent, par ailleurs, de la dépendance accrue des économies africaines à l’égard des industries de produits de base, qui ne favorise ni le recul de la pauvreté, ni les processus de diversification économique. En outre, le renforcement de la présence des géants asiatiques dans les pays dotés de ressources abondantes est de nature à accroître les rentes dont bénéficie l’élite qui contrôle l’accès aux ressources, au détriment des populations. L’exportation de la main-d’œuvre chinoise sur les chantiers africains s’avère également source de tensions, comme l’ont illustré les troubles en Angola (53). Enfin, en l’absence de normes environnementales rigoureuses et de moyens de les faire respecter, les industries extractives prélèvent un lourd tribut sur les écosystèmes, ce qui compromet les perspectives de développement durable du continent africain.
Acteurs économiques incontournables, les géants asiatiques se posent également en partenaires politiques de l’Afrique ainsi qu’en bailleurs d’aide. Le succès du sommet des chefs d’Etat sino-africains, qui a réuni à Pékin 41 chefs d’Etat et de gouvernement, les 4 et 5 novembre 2006, et la succession de visites de haut niveau de dirigeants chinois en Afrique confirment l’intérêt politique toujours plus marqué de la Chine pour le continent. Plusieurs initiatives ont été prises par les autorités chinoises afin d’affirmer cette dimension politique comme le lancement, en 2000, du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et la publication, en janvier 2006, du premier Livre blanc sur la politique de la Chine à l’égard de l’Afrique. La Chine participe également aux opérations de maintien de la paix (OMP) en République démocratique du Congo (RDC), au Libéria et au Soudan. Enfin, le pays devient un bailleur important de l’Afrique. Le « plan d’action de Beijing », lancé en novembre 2006 lors du FOCAC, prévoit un doublement du volume d’aide de la Chine aux pays africains d’ici 2009. En 2007, cette aide, composée de dons, prêts sans intérêts, prêts à conditions préférentielles, fonds à des sociétés communes à caractère coopératif pour des projets d’aide, d’une coopération scientifique et technologique et d’une assistance médicale, aurait atteint 625 millions de dollars (54).
L’Inde affiche également des ambitions politiques en Afrique, comme l’a démontré récemment le premier sommet Inde – Afrique qui s’est tenu, à New Delhi, les 8 et 9 avril 2008. Elle tente cependant de se démarquer de son puissant voisin, fréquemment perçu comme un prédateur, en insistant sur le nécessaire développement de l’Afrique dans la continuité de l’esprit de coopération du « mouvement des non alignés ». L’Inde a ainsi rejoint, en 2003, l’Afrique du Sud et le Brésil pour fonder le groupe IBSA destiné à définir des positions communes lors des négociations commerciales multilatérales (55). Sa présence en Afrique vise également à accroître son influence internationale et à mobiliser les pays de la région en sa faveur pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. L’Inde, qui contribue activement aux OMD des Nations unies, met également l’accent sur des actions de coopération à travers ses programmes Focus Africa, Team-9 et l’« initiative indienne de développement » (56) qui entend renforcer l’aide en empruntant sur les marchés pour étendre les prêts concessionnels à très faible taux d’intérêt.
Au-delà de leur dimension politique, les initiatives prises en direction de l’Afrique en matière d’aide soulèvent également la question de l’impact des concours de ces nouveaux bailleurs. Le risque existe en effet de voir saper les efforts visant à rendre soutenable la dette des pays les plus démunis et les plus tributaires de l’aide. Il a conduit les pays du G8 à proposer, lors de leur dernier sommet, l’instauration d’un dialogue régulier avec les grands donateurs émergents (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, etc.), sous l’appellation de « processus d’Heiligendam », afin de ne pas de nouveau faire basculer les pays bénéficiaires dans la spirale de la dette.
La Chine et l’Inde ne sont pas les seuls pays à s’intéresser de manière croissante à l’Afrique comme l’attestent les initiatives du Japon ou celles du Brésil dans la région. L’influence croissante de ces deux géants asiatiques met cependant clairement en évidence une nouvelle configuration des relations avec les pays africains que la France doit pleinement intégrer dans la redéfinition de sa politique africaine.
* * *
Avec le temps, la présence de la France en Afrique s’est estompée. Nos actions de coopération empruntent des canaux européens ou multilatéraux qui ne permettent plus d’identifier aussi clairement les actions de notre pays et notre aide bilatérale, même si elle représente les deux tiers de notre aide totale à l’Afrique, est de moins en moins visible sur le terrain. Comment percevoir en effet dans la vie quotidienne, pour des populations qui souffrent de pauvreté, les améliorations provenant des allègements ou des annulations de dette ?
Nos échanges économiques avec l’Afrique n’ont fait que décroître, même si nos investissements directs restent très importants dans les pays de la zone franc, et traduisent le fait que nous avons délaissé ce continent dont nous n’avons pas vu qu’il avait changé.
« Au sud du Sahara, les réalités sont disparates. Impossible de porter un regard unique sur un continent hétérogène.
Certains pays sont enlisés dans la souffrance : Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Soudan, etc. Voilà l’Afrique des drames. A quelques pas existe une Afrique du succès : Botswana, Mozambique, Lesotho, Ouganda, Maurice ou Cap-Vert ont tous su engendrer, ces quinze dernières années, une croissance par habitant et par an de 3 à 4 % ».
Kemal Dervis, administrateur du PNUD, et Jean-Michel Severino, directeur général de l’AFD, L’Express, 23 février 2006.
Continent confronté à une démographie galopante, déchiré par les conflits, victime d’une pauvreté endémique, ravagé par certaines pandémies comme le VIH/Sida : telles sont les images qui surgissent aussitôt lorsqu’on évoque la situation du continent africain. Ces exemples témoignent de la persistance d’une vision désabusée, voire désespérée, sur les perspectives de développement de l’Afrique.
Cette forme d’« afro-pessimisme » n’est, en réalité, pas nouvelle. Au lendemain des indépendances, l’agronome français, René Dumont, publiait ainsi un ouvrage intitulé : « L’Afrique noire est mal partie » (57). Plus récemment, Axelle Kabou posait, de manière volontairement provocatrice, la question de savoir « Et si l’Afrique refusait le développement ? » (58). En 2005, la « Commission pour l’Afrique » (59), instaurée par l’ancien Premier ministre Tony Blair dans la perspective du Sommet du G8 de Gleaneagles, observait ainsi que les images diffusées à la suite de la famine de 1984-1985 en Ethiopie avaient « fixé dans l’esprit du public le portrait d’un continent de désespoir et de dépendance ». Avant d’ajouter que « bien que de telles représentations correspondent toujours à la réalité, elles sont dans l’ensemble de plus en plus dépassées ». Cette vision pessimiste de l’Afrique est, en effet, partielle, voire décalée, pour deux raisons principales : d’une part, l’Afrique n’est pas une mais plurielle (60) ; d’autre part, comme l’ont souligné de nombreuses personnalités entendues par la Mission d’information, « le continent africain bouge vite et ne nous attend pas » (61).
De fait, la période récente semble se caractériser par le sentiment, de plus en plus partagé, que la situation en Afrique globalement s’améliore. Lors de son audition devant les membres de la Mission d’information (62), Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI et membre de la Commission pour l’Afrique, déclarait ainsi que : « L’Afrique change, plutôt pour le meilleur ; l’Afrique n’est pas ce qu’elle risquait de devenir : le continent oublié ». Des changements importants ont été amorcés ou sont désormais envisageables grâce notamment à « une nouvelle génération de leaders africains beaucoup plus conscients que leurs prédécesseurs des disciplines et de la continuité d’efforts nécessaires pour que le processus de développement s’amorce ».
Dans le même esprit, la Banque mondiale observe, à partir d’un sondage réalisé dans une dizaine de pays (63), que les Africains sont aujourd’hui convaincus d’être à l’heure des changements. De fait, différents indices vont dans le sens d’une lecture optimiste des évolutions que connaît l’Afrique depuis près d’une décennie : le recours de plus en plus fréquent à des élections démocratiques, une baisse globale de la conflictualité sur le continent ainsi qu’une croissance économique soutenue.
En dépit de ce sentiment d’amélioration, l’Afrique n’en reste pas moins confrontée à de graves difficultés, qu’atteste notamment le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La majorité des pays africains doit aujourd’hui faire face à la crise alimentaire, la pauvreté, les migrations, le risque terroriste ou encore les effets du changement climatique, qui déstabilisent fortement les sociétés et les économies africaines. Ces problèmes ne doivent cependant pas conduire à masquer les réalités d’un continent en mouvement, dont la France, malgré des liens anciens et étroits avec certains pays africains, a tardé à prendre pleinement la mesure.
A.- L’Afrique, terre de déséquilibres
1) Le continent de la jeunesse
Les questions de population sont étroitement liées à celles de développement et de croissance. C’est la raison pour laquelle les défis démographiques de l’Afrique, liés à la jeunesse de sa population, au rythme de sa croissance et à une transition démographique tardive et limitée, retiennent naturellement l’attention. De fait, entre 1990 et 2000, l’Afrique subsaharienne a connu un essor démographique fulgurant, avec une population multipliée par 7 en une décennie.
Comme l’a souligné Jean-Michel Severino, directeur général de l’Agence française de développement (AFD), devant les membres de la Mission, d’ici une quarantaine d’années, l’Europe aura, à ses portes, un ensemble démographique unique. La part de l’Afrique représentera alors entre 15 et 20 % de la population mondiale contre 10 % aujourd’hui. Selon les projections du Fonds des Nations Unies pour la population, à l’horizon 2050, la population africaine s’élèvera à environ 2 milliards de personnes ; en comparaison, la population de la Chine aura alors commencé sa décrue, du fait d’une transition négative, et devrait être à peine supérieure à 1,4 milliard d’habitants, dépassée par celle de l’Inde, qui s’approchera de 1,7 milliard.
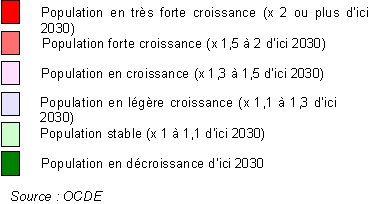
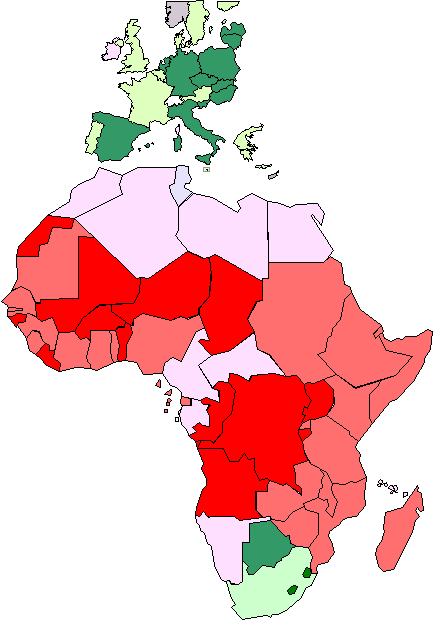
Cette croissance démographique exceptionnellement forte s’explique par un taux de fécondité le plus élevé au monde (5,5 enfants par femme en 2000 – 2005) et une mortalité en baisse, malgré une stabilisation à partir de la fin des années 80. Il résulte de ces évolutions que « les sociétés africaines auront à gérer, en moyenne, un doublement de leur population totale et un triplement de leur population urbaine entre 2000 et 2030 » (64). Entre 1950 et 2000, la population urbaine de l’Afrique a, en effet, été multipliée par 11, pour s’établir à 232 millions de personnes. Cette moyenne cache cependant des différences importantes entre la sous-région la moins urbanisée – l’Afrique de l’Est (27 %) – et la sous-région la plus urbanisée – l’Afrique australe (55 %) –. Si cette croissance urbaine tend aujourd’hui à se ralentir, l’Afrique n’en comprend pas moins 38 villes millionnaires dont la gestion soulève d’immenses problèmes en raison du manque d’infrastructures, de logements et de services urbains.
Parallèlement à ce phénomène d’urbanisation, la population rurale ne cesse de croître au point d’avoir doublé entre 1960 et 2000. L’explosion prévisible de la population urbaine d’ici 2050 s’accompagnera donc d’une forte densification de l’espace rural, y compris dans le Sahel. Cette croissance de la population rurale n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes, en particulier en matière de droits fonciers et d’utilisation des terres, comme l’illustrent les tensions actuelles dans la province soudanaise du Darfour ainsi qu’au Kenya. A une échelle plus globale, l’urbanisation accélérée de l’Afrique, conjuguée à la forte augmentation de la population rurale, contribue à l’accroissement de la densité moyenne en Afrique subsaharienne qui n’est plus une région sous-peuplée, comme cela pouvait être le cas en 1950.
Autre évolution notable, le rajeunissement considérable de la population qu’illustre le graphique ci-après. A l’heure actuelle, plus de la moitié de la population africaine a moins de 15 ans et les deux tiers ont moins de 25 ans, contre un peu moins d’un tiers en Europe. Cette évolution soulève la redoutable question de l’absorption de cette main-d’œuvre supplémentaire (entre 1995 et 2005, elle a augmenté de 29,8 %) sur un marché du travail, d’ores et déjà marqué par un taux de chômage élevé et une grande précarité (55 % des travailleurs africains vivent avec moins d’un dollar par jour).
![]()
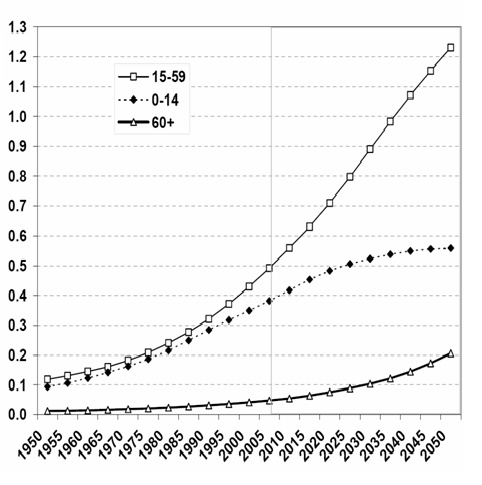
![]()
Enfin, l’essor démographique de l’Afrique a des répercussions importantes sur les migrations des populations. Comme l’a souligné M. Jean-Pierre Guengant, directeur de recherche à l’Institut de recherche sur le développement (IRD) devant la Mission d’information (65), le nombre de migrants subsahariens à l’intérieur de l’Afrique est estimé à 16 millions de personnes et celui de migrants résidant dans un pays de l’OCDE, à environ 4 millions de personnes, principalement aux Etats-Unis (930 000 personnes), au Royaume-Uni (812 000), en France (565 000), au Portugal (348 000) et au Canada (271 000). Au total, le nombre de migrants internationaux subsahariens représente environ 20 millions de personnes, soit 10 % du total des migrants internationaux dans le monde, un pourcentage proche des 12 % que représente l’Afrique dans la population mondiale. L’ouvrage collectif précité (66) sur les défis démographiques de l’Afrique souligne, par ailleurs, que l’Afrique subsaharienne constitue aujourd’hui plus une terre d’accueil que de départ, la Côte d’Ivoire (2,3 millions de personnes), le Ghana (1,5 million) et l’Afrique du Sud (1 million) étant les premiers pays de destination au niveau intra régional.
Les perspectives démographiques de l’Afrique à l’horizon 2050 se traduiront par une intensification de ces mobilités ainsi que par certaines tensions liées notamment au doublement attendu des arrivées sur les marchés du travail en Afrique subsaharienne (environ 14 millions par an au début des années 2000 et 27 millions au début des années 2030). Les récentes émeutes de la faim dans un grand nombre de pays africains, mais pas seulement, mettent également en lumière la nécessité de renforcer la priorité accordée aux politiques agricoles afin de parvenir à une révolution « doublement verte » en Afrique.
2) Des pays en grande pauvreté
Dans son rapport précédemment cité, la Commission pour l’Afrique présidée par M. Tony Blair relevait que si le monde est aujourd’hui inondé de richesse, il ne s’agit pas d’une richesse dont tout le monde profite : « En Afrique, des millions de gens vivent chaque jour dans la misère la plus noire et dans les conditions les plus sordides ». En dépit d’améliorations dans une série de paramètres fondamentaux du développement (croissance économique annuelle de plus de 5 % au cours des cinq dernières années, réduction des déséquilibres macroéconomiques grâce aux efforts d’allègement de la dette, etc.), l’Afrique reste en effet confrontée à un défi majeur : celui de l’extrême pauvreté.
– L’Afrique reste en retrait des objectifs du Millénaire pour le développement
A la suite de l’engagement pris en 2000, par la communauté internationale, de réduire de moitié la pauvreté dans le monde à l’horizon 2015, l’ampleur de ce défi peut être mesurée à travers le degré de réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Or, à mi-chemin entre leur adoption en l’an 2000 et 2015, l’Afrique subsaharienne ne paraît pas en voie d’atteindre ces objectifs. Un rapport des Nations unies (67) relève que, pour chacun des OMD, les retards accumulés par l’Afrique sont d’autant plus alarmants que d’autres régions du monde connaissent des avancées importantes.
D’après l’OCDE (68), l’Afrique subsaharienne est l’une région du monde où le nombre de pauvres a augmenté, en valeur absolue, au cours des dix dernières années. Dans le domaine de l’éducation primaire, par exemple, des progrès ont été réalisés, mais les difficultés augmentent avec le nombre d’enfants en âge scolaire. En 2007, l’Afrique subsaharienne comptait 348 millions d’enfants de moins de 14 ans et ils devraient être 403 millions en 2015. Un grand nombre de pays affichent un ratio supérieur à 90 % (Algérie, Cap Vert, Egypte, Madagascar, Maurice, Sao Tome et Principe, Tanzanie, Tunisie et Zambie), à l’inverse du Burkina Faso, de Djibouti, de l’Erythrée et de la République du Congo où le taux net de scolarisation est inférieur à 50 % en 2005. S’agissant de l’objectif de réduction de la mortalité infantile, beaucoup reste à faire dans la mesure où, sur la période 1990 – 2005, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans n’a été réduit que de 11 % contre 60 % en Afrique du Nord. En matière de santé maternelle, les résultats restent décevants. Du fait de la pénurie de soins médicaux, d’aide à l’accouchement et de personnel de santé, le pourcentage de pays paraissant en mesure de réduire des 3/4 la mortalité maternelle d’ici 2015 n’est que de 28,3 %. Autre exemple, les pays africains ne progressent guère vers l’objectif de réduction de moitié de la proportion d’êtres humains n’ayant pas un accès durable à une source d’eau améliorée : en 2004, cinq pays avaient atteint l’objectif et quinze étaient sur la bonne voie. Cela étant, les écarts entre villes et campagnes font que seuls l’Egypte, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie ont effectivement atteint l’objectif sur l’ensemble de leur territoire.
En définitive, si les bailleurs de fonds veulent que les pays africains atteignent les objectifs du Millénaire pour le développement, ils devront, selon l’OCDE, fournir davantage d’aide, rendre les allègements de dette consentis plus durables et opter pour des règles commerciales plus équitables. En 2006, l’aide publique au développement (APD) versée à l’Afrique a atteint 43,4 milliards de dollars dont 39,9 milliards sont allés à l’Afrique subsaharienne. Compte non tenu des allègements de dette, l’aide à l’Afrique entre 2005 et 2006 a progressé de 13 % mais de seulement 2 % pour l’Afrique subsaharienne. Nous sommes donc encore loin des engagements pris par les pays du G8, dont la France, au sommet de Gleneagles en juillet 2005, de doubler l’aide à l’Afrique d’ici 2010. Cela est d’autant plus regrettable que les effets récents de la crise alimentaire qui fait de nouveau basculer dans la grande pauvreté des centaines de millions de personnes qui en sortaient à peine exigeraient un effort redoublé. Les résolutions internationales relatives à l’amélioration de l’efficacité de l’aide au développement, comme celle prise lors de la conférence de Doha de novembre 2008 n’en prennent dans ces circonstances que plus de relief.
la crise alimentaire de 2007-2008 :
Des millions d’Africains acculés à la faim
par la hausse des prix.
La hausse mondiale des prix des denrées alimentaires a provoqué des ravages dans les pays en développement, et des milliers de pauvres ont été pris dans un arc de la faim qui s’est étiré de l’Égypte jusqu’au Zimbabwe en passant par le Cameroun et qui prend de l’ampleur.
Les chiffres sont accablants. En l’espace d’un mois, les prix à l’exportation du blé des États Unis se sont envolés pour passer de 375 à 425 dollars la tonne, et les prix du riz de Thaïlande sont passés de 365 à 475 dollars la tonne. Ces deux pays sont de gros exportateurs de céréales. D’après la FAO, sur les 36 pays aux prises avec une crise de sécurité alimentaire, 21 sont en Afrique. Selon le dernier rapport publié par la Banque mondiale sur la hausse des prix alimentaires, les prix mondiaux du blé ont augmenté de 181 % durant la période de 36 mois qui s’est écoulée jusqu’en février 2008, et les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté globalement de 83 %. Les pauvres consacrent en moyenne entre 50 et 75 % de leur revenu à l’achat de nourriture.
L’envolée des prix alimentaires a déclenché des émeutes dans plusieurs capitales africaines, ébranlant les autorités et entretenant plus que jamais les craintes malthusiennes.
Le phénomène s’explique par un ensemble complexe de facteurs aux effets plus alarmants que les dangers de l’explosion des taux de croissance démographique sans aucune mesure avec la capacité de production alimentaire dénoncés par Malthus au XVIIIème siècle. Le prix du baril de pétrole, qui s’est échangé jusqu’à 105 dollars, voire davantage, a constitué un facteur majeur en ce sens qu’il s’est répercuté sur une grande partie de l’économie agricole, en entraînant le renchérissement des prix tout au long de la chaîne de production et de distribution des produits alimentaires. La montée en puissance de l’agriculture destinée à la fabrication de biocarburants, qui utilise le maïs et la canne à sucre pour produire de l’éthanol et les cultures d’oléagineux pour produire de l’agro diesel, est tout aussi problématique. En outre, une sécheresse dévastatrice a décimé les récoltes dans la plupart des pays producteurs de blé, dans des pays aussi distants que l’Australie et le Kazakhstan, mettant à mal les disponibilités et provoquant des pénuries.
Quelques chiffres sur l’alimentation :
- 75 % des pauvres de la planète vivent dans des zones rurales : ils seraient 900 millions à subsister avec un dollar par jour. Ils vivent en majorité en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
- En Afrique, la demande de denrées alimentaires devrait représenter l’équivalent de 100 milliards de dollars d’ici 2015, c’est-à-dire deux fois plus qu’en 2000.
- L’Afrique subsaharienne est la seule région où les rendements des cultures vivrières ont diminué, et où les agriculteurs obtiennent des rendements équivalant au tiers seulement de ceux obtenus par leurs homologues asiatiques.
- La majorité des agriculteurs d’Afrique subsaharienne sont des femmes.
Source : Banque mondiale, 12 avril 2008.
– Le défaut des infrastructures premier obstacle à la croissance
Face au retard enregistré dans la réalisation des OMD, un constat s’impose : sans croissance économique, l’Afrique ne peut pas faire reculer la pauvreté de manière notable. Plusieurs facteurs sont susceptibles de contribuer à une croissance économique durable parmi lesquels une amélioration du climat des affaires, un soutien au secteur agricole ainsi qu’aux petites entreprises, etc. L’amélioration des infrastructures constitue également une priorité pour favoriser la croissance. L’état des routes, des voies ferrées, des infrastructures énergétiques ou rurales représente, en effet, un obstacle important au développement de nombreux pays. En 2005, la Commission pour l’Afrique estimait que, pour maintenir un taux de croissance de 7 %, l’Afrique devait consacrer, chaque année, 20 milliards de dollars supplémentaires aux investissements dans ce domaine ainsi qu’à la maintenance des équipements d’ici 2015.
D’autres réformes structurelles essentielles n’ont pas non plus été faites en temps utile. Dans cet ordre d’idées, Robert Zellick en présentant le Rapport sur le développement dans le monde en 2008 soulignait que l’agriculture et le monde rural avaient été négligés au cours de ces 20 dernières années et devaient de nouveau être au cœur des politiques de développement : La Banque mondiale précise que, « alors que 75 % de la population pauvre mondiale vit dans les espaces ruraux, seulement 4 % de l'aide publique au développement va à l'agriculture dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne, une région fortement tributaire de l'agriculture pour sa croissance, les dépenses publiques consacrées à l'agriculture ne représentent que 4 % des dépenses publiques totales et la charge fiscale reste relativement lourde dans ce secteur. » (69)
Dans son rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique subsaharienne en 2008 (70), le Fonds monétaire international (FMI) a récemment mis l’accent sur l’importance des déficiences des infrastructures dans le secteur de l’électricité. Une des conclusions de cette étude met en lumière un paradoxe insupportable : non seulement l’infrastructure énergétique de l’Afrique subsaharienne est peu développée comparée à celle des autres régions, mais l’alimentation en électricité est coûteuse et peu fiable.
De fait, avec 63 gigawatts (GW), la capacité de production totale des 48 pays d’Afrique subsaharienne est comparable à celle de l’Espagne. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, elle tombe à 28 GW, soit à peu près au même niveau que l’Argentine. En outre, la capacité de production de l’Afrique subsaharienne stagne depuis des années ; 25 % des centrales d’Afrique subsaharienne ne sont actuellement pas en état de fonctionnement. Les taux d’électrification sont également bas. Environ 24 % de la population d’Afrique subsaharienne accède à l’électricité, contre 40 % dans les autres pays à faible revenu. La consommation d’électricité en Afrique subsaharienne ne représente, hors Afrique du Sud, qu’environ 124 kilowattheures (kWh) par an, moins de 10 % de celle de la Chine.
Le rapport du FMI souligne, par ailleurs, que le manque de fiabilité de l’alimentation en électricité pèse sur le coût. Les entreprises manufacturières d’Afrique signalent que les coupures de courant représentent en moyenne 56 jours par an, ce qui leur coûte 5 – 6 % de leurs recettes. En outre, les systèmes d’électricité en Afrique, trop sollicités, sont devenus extrêmement vulnérables aux chocs sur l’offre, ce qui engendre une généralisation des coupures et des délestages. De fait, plus de 30 pays sur les 48 que compte l’Afrique subsaharienne ont subi de graves crises d’énergie au cours de ces dernières années. En définitive, les déficiences de l’infrastructure électrique freinent la croissance économique et réduisent la compétitivité. C’est la raison pour laquelle le FMI préconise de renforcer l’efficacité des compagnies d’électricité, d’accroître les capacités de production et de donner plus largement accès à l’énergie.
L’exemple du secteur de l’énergie illustre les graves problèmes d’infrastructures auxquels les pays d’Afrique subsaharienne doivent, pour la plupart, faire face. Ces difficultés représentent un véritable goulot d’étranglement qui entrave la croissance économique. L’ampleur des investissements nécessaires pour les surmonter illustre, là encore, que les défis de l’Afrique sont, en grande partie, des défis communs.
– Une insertion insuffisante dans le commerce mondial
Comme l’a souligné Philippe Hugon devant les membres de la Mission (71) : « si l’on privilégie une approche de haut en bas (« top-down »), l’Afrique apparaît marginalisée sur le plan économique. Le continent ne représente, en effet, que 1 % du PIB mondial pour 12 % de la population et n’attire que 3 % des investissements directs étrangers (IDE) ».
De fait, malgré une amélioration des performances enregistrées au niveau macroéconomique, l’Afrique est encore faiblement intégrée dans le marché mondial. Après avoir enregistré un net recul au cours de la précédente décennie (1990 – 2000), la part de l’Afrique dans le commerce mondial – qui avait chuté de 2,9 % à 2 % - est remontée à 2,3 % en 2006. Elle reste cependant marginale par rapport à la taille et aux potentialités du continent. Cette progression repose principalement sur les exportations africaines qui augmentent à un rythme plus rapide que les importations (à hauteur de 21 % contre 16 % pour les importations en 2006). L’Afrique conserve donc une balance commerciale excédentaire.
L’essor des exportations africaines est dû, pour l’essentiel, à l’explosion des prix du pétrole et des produits non manufacturés. En 2005, quatre des cinq plus grands exportateurs africains de biens étaient, en effet, des exportateurs de pétrole. D’après le Forum pour le partenariat avec l’Afrique (FPA) (72) : « à peine 13 pays africains ont été capables d’accroître la diversification de leurs exportations entre 2000 et 2005 – tous les autres pays ont soit stagné, soit reculé sur ce plan – et moins de 30 % des exportations d’Afrique subsaharienne comprennent des produits manufacturés, contre une moyenne de 70 % pour les autres pays en développement ».
Par ailleurs, le continent africain n’est pas le débouché principal des exportations africaines, ce qui témoigne de la faiblesse de l’intégration économique aux niveaux régional et sous-régional. Représentant moins de 10 % du commerce extérieur total du continent, le commerce intra régional entre pays africains demeure, en effet, inférieur à celui d’autres régions comme l’Amérique latine (près de 20 %) ou l’Asie (environ 40 %). Le principal partenaire commercial de l’Afrique reste l’Europe qui a absorbé 42,9 % des exportations africaines en 2005 et représentait la même année 47 % des importations du continent africain. Toutefois, les flux d’échanges évoluent rapidement comme l’atteste la forte croissance du commerce avec l’Asie – en particulier, avec la Chine – du fait, pour l’essentiel des exportations d’hydrocarbures et de produits primaires.
Le continent africain reste donc largement à l’écart des échanges commerciaux à l’échelle mondiale.
3) Un espace très vulnérable au choc climatique
Le changement climatique constitue un phénomène mondial, dont les effets précoces affectent dès à présent un grand nombre de pays et rappellent une évidence trop souvent négligée : l’interdépendance écologique des populations. Toutefois, si le phénomène est global, ses manifestations varient selon les différentes régions du monde. Le continent africain, en particulier, est confronté à un paradoxe insupportable : faiblement émetteur de gaz à effet de serre, il est cependant extrêmement vulnérable aux effets des changements climatiques.
Dans son dernier rapport sur le développement humain (73), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) fournit des éléments de comparaison permettant d’illustrer les fortes inégalités qui existent en matière de bilan carbone. Ainsi, alors qu’ils ne comptent que 15 % de la population mondiale, les pays riches sont responsables de 45 % des émissions de CO2. A l’inverse, l’Afrique subsaharienne accueille environ 11 % de la population mondiale mais ne représente que 2 % des émissions mondiales.
Un des paradoxes les plus difficiles lié au changement climatique est que la répartition des émissions actuelles de gaz à effet de serre correspond à une relation inversée entre le risque lié à ce phénomène et la responsabilité. Les pays en développement sont, en effet, plus vulnérables que les pays riches au changement climatique, et ce sont les pauvres qui sont le plus à la merci des incidences de plus en plus marquées de phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, sécheresses, tempêtes). Comme le souligne le PNUD, sur la période de 2000 – 2004, un habitant des pays en voie de développement sur 19 a été affecté par une catastrophe climatique. Le chiffre correspondant pour les pays de l’OCDE était d’un habitant sur 1 500 sur la même période. En 2005 par exemple, les sécheresses dans la Corne de l’Afrique et le sud du continent ont menacé les vies de plus de 14 millions de personnes dans un grand nombre de pays, de l’Ethiopie et du Kenya au Malawi et au Zimbabwe. Au cours de l’année suivante, la sécheresse a cédé la place à des inondations importantes dans la plupart de ces mêmes pays.
Les dérèglements du climat sont susceptibles d’avoir plusieurs types d’effets négatifs sur la production agricole notamment, mais aussi sur la situation nutritionnelle des populations ainsi que leur santé.
Dans le domaine de la santé par exemple, les changements climatiques risquent d’accroître l’incidence de maladies vectorielles comme le paludisme ou la dengue. A l’heure actuelle, le paludisme fait plus d’un million de victimes tous les ans, dont plus de 90 % en Afrique. 800 000 à 900 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année de cette maladie, ce qui en fait la 3ème cause de décès d’enfants dans le monde. Or, la hausse des températures liée à la variabilité croissante du climat est susceptible d’accroître la présence et l’élévation des populations de moustiques et de réduire de moitié leurs périodes d’incubation. D’ores et déjà, on assiste à l’apparition de nouveaux profils pathologiques dans de nombreuses régions. En Afrique de l’Est, par exemple, les inondations de 2007 ont créé de nouveaux sites de reproduction pour des vecteurs de maladies tels que les moustiques et déclenché des épidémies de la vallée du Rift et des niveaux croissants de paludisme.
Par ailleurs, comme l’a souligné M. Michel Camdessus devant les membres de la Mission (74) : « la modification du régime des précipitations lié au changement climatique aura des conséquences telles que la capacité de production alimentaire [en Afrique] pourrait se trouver réduite d’environ 50 % et 75 millions à 125 millions de personnes pourraient être obligées à la migration vers des zones plus hospitalières, côtières par exemple, mais aussi plus lointaines comme l’Europe ». L’Afrique subsaharienne est, en effet, une région très dépendante des précipitations, en particulier ses producteurs agricoles qui travaillent avec des ressources limitées, dans des environnements fragiles. Or, cette région est menacée par une augmentation de la surface des zones arides et semi-arides de 60 à 90 millions d’hectares qui risque de nuire considérablement aux systèmes agricoles non irrigués. Pour illustrer ce risque, le PNUD fait état d’une étude portant sur les implications potentielles, pour des zones non irriguées en Afrique subsaharienne, d’une augmentation de 2,9 °C de la température associée à une réduction de 4 % des précipitations à l’horizon 2060. Le résultat est une réduction des revenus par hectare de 25 % d’ici 2060, représentant, en prix de 2003, environ 26 milliards de dollars, soit un chiffre dépassant le montant de l’aide bilatérale à la région en 2005. De telles implications risquent d’être à l’origine d’épisodes d’insécurité alimentaire extrême, comme cela s’est déjà produit dans un certain nombre de pays comme le Cameroun, l’Egypte, la Côte d’Ivoire ou la Mauritanie. Elles sont également susceptibles d’accroître les tensions liées à l’accès aux terres, comme le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) l’a mis en évidence dans le cas du Soudan, et plus particulièrement de la région du Darfour (se reporter à l’encadré ci-après).
La dégradation environnementale,
source de tensions et de conflits au Soudan
Une nouvelle évaluation du pays, y compris la région du Darfour en proie à des troubles, indique que l’effritement rapide des services environnementaux dans plusieurs zones clés du pays constitue l’une des causes profondes à l’origine des décennies d’agitation sociale et de conflits.
Les questions les plus préoccupantes sont la dégradation des terres, la désertification et l’expansion du désert vers le sud, celui-ci ayant progressé de 100 km en moyenne au cours des quatre dernières décennies. Ces problèmes sont liés à divers facteurs, dont le surpâturage en sol fragile par un cheptel dont les effectifs ont connu une augmentation spectaculaire, passant de près de 27 millions d’animaux à environ 135 millions aujourd’hui.
Par ailleurs, on a de plus en plus de preuves témoignant d’un changement climatique régional à long terme dans plusieurs régions du pays. Ce fait est attesté par la diminution très irrégulière, mais marquée, des précipitations, qui est particulièrement évidente dans les Etats du Kordofan et du Darfour. Au Nord Darfour, par exemple, les précipitations ont diminué d’un tiers au cours des 80 dernières années. L’ampleur des changements climatiques relevés au Nord Darfour est sans précédent et ses impacts sont étroitement liés au conflit dans la région, car la désertification a considérablement aggravé les pressions sur les moyens de subsistance traditionnels qui reposent sur l’agriculture et l’élevage. En outre, les changements climatiques relevés au Nord Darfour risquent de réduire encore la production alimentaire en raison de la diminution des précipitations et de la variabilité accrue, en particulier dans la ceinture du Sahel. D’après l’évaluation post-conflit au Soudan, une baisse de près de 70 % du rendement des cultures est prévue dans les régions les plus vulnérables.
« La tragédie du Darfour n’est pas seulement la tragédie d’un pays d’Afrique, c’est une fenêtre sur le reste du monde qui met en évidence la manière dont des problèmes tels que l’épuisement incontrôlé des ressources naturelles, comme les sols et les forêts, conjugués à des impacts comme les changements climatiques, peuvent déstabiliser les communautés, voire même des nations entières » a conclu M. Achim Steiner, directeur exécutif du PNUE.
Source : PNUE, La dégradation environnementale, source de tension et de conflits au Soudan, juin 2007.
Au-delà de ces risques accrus de conflits, on s’attend également à ce que les changements climatiques réduisent encore les volumes et la qualité de l’eau dans les régions arides et semi-arides et portent atteinte aux systèmes écologiques et à leur biodiversité. De plus, l’élévation du niveau de la mer associée aux hausses de températures prévues pourrait déplacer des dizaines de millions de personnes vivant dans les zones de faible élévation, telles que le delta du Gange ou du Nil, et menacer l’existence même des petits États insulaires.
Ces quelques exemples viennent rappeler que « la question environnementale est une question de survie pour les populations les plus démunies d’Afrique » (75). Ils attestent des immenses défis auxquels la majorité des pays africains est confrontée mais qui se posent, en réalité, à la communauté internationale dans son entier, compte tenu de l’ampleur des conséquences des changements climatiques.
Du nouveau en Afrique. En intitulant ainsi l’un des chapitres de son rapport final, la Commission pour l’Afrique a souhaité mettre l’accent sur un certain nombre d’évolutions importantes qui se sont produites sur le continent africain depuis une décennie. Elle observait notamment que plus des deux tiers des pays d’Afrique subsaharienne avaient eu des élections multipartites – certaines plus libres et plus justes que d’autres – au cours des cinq années passées tandis que plusieurs changements de gouvernement s’étaient déroulés de manière démocratique et pacifique.
1) Moins de conflits, plus de démocratie
Depuis une dizaine d’années, l’Afrique enregistre des progrès importants en matière de stabilité politique et de démocratie. Des systèmes politiques pluralistes se sont progressivement implantés, débouchant sur des alternances politiques pacifiques dans plusieurs pays comme le Bénin, le Mali, le Sénégal, la Zambie ou encore le Ghana. La démocratie s’enracine peu à peu sur le continent africain qui voit se multiplier les consultations électorales et, par là même, se renforcer la capacité des citoyens à se faire entendre ou à exiger des comptes de leurs représentants. En dépit d’un regain de tensions observé dans certains pays – notamment au Kenya et au Zimbabwe – au cours de ces derniers mois, ce recours de plus en plus fréquent à des élections au suffrage universel pour légitimer les gouvernements constitue une tendance de long terme, tout à fait encourageante. L’objectif n’est désormais plus de se maintenir au pouvoir à tout prix mais de remporter les élections pour un deuxième mandat.
En 2007, 54 millions d’Africains ont ainsi participé aux 19 élections présidentielles et parlementaires qui ont eu lieu dans différents pays comme le Mali (réélection du président Amadou Toumani Touré), la Mauritanie (élection du président Sidi Ould Cheikh Abdallahi) ou la Sierra Leone (élection du président Ernest Bai Koroma) (76). En 2008, des élections importantes doivent se tenir en Angola (législatives), au Ghana et en Guinée (présidentielles) (77). Au total, une cinquantaine d’élections générales ont eu lieu en Afrique au cours de ces quatre dernières années, signe d’une tendance globale positive en dépit d’institutions démocratiques encore souvent fragiles. Le respect des droits civils et politiques reste, en effet, un sujet de préoccupations dans un grand nombre de pays d’Afrique subsaharienne, en particulier au cours de la période récente.
Certes les progrès ne se réalisent pas partout au même rythme et la tenue d’élections n’est-elle pas dans chaque cas la garantie d’un processus harmonieux du pays. Les violences intercommunautaires post-électorales qui ont éclaté au Kenya témoignent de la fragilité, parfois, du processus de démocratisation qui peut paradoxalement s’avérer être source de crise. De même le coup d’Etat militaire intervenu en République islamique de Mauritanie au cours de l’été 2008 prouve que les tenants des régimes autoritaires ne désarment pas facilement, malgré les souhaits sans ambiguïté des populations.
Pour timides qu’ils apparaissent parfois, les progrès démocratiques s’inscrivent néanmoins dans un contexte global de recul de l’instabilité politique sur le continent qu’il convient de saluer et que reflète la baisse du nombre de conflits nationaux en Afrique subsaharienne. Le graphique ci-après illustre cette tendance de fond qui s’est affirmée au cours de la décennie qui vient de s’écouler.
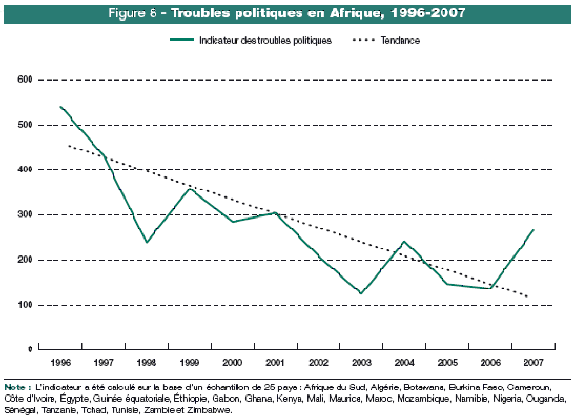
Source : OCDE, Perspectives économiques en Afrique 2007/2008, mai 2008.
Le continent africain a longtemps été un continent déchiré par de nombreux conflits de différente nature (conflits inter-étatiques, internes, ethniques, religieux, économiques). Sur les 75 à 80 conflits recensés depuis 1945, on dénombre une quarantaine de guerres civiles. Entre 1963 et 1998, pas moins de 26 conflits armés ont éclaté en Afrique, affectant 474 millions de personnes, soit 61 % de la population du continent (78). Au niveau sous-régional, 79 % de la population ont été touchés en Afrique orientale, 73 % en Afrique centrale, 64 % en Afrique occidentale, 51 % en Afrique du Nord et 29 % en Afrique australe.
En 2007, les organisations Oxfam International, RAIAL et Saferworld ont estimé à 284 milliards de dollars, le coût cumulé des guerres qui se sont déroulées sur le continent africain entre 1990 et 2005. D’après le rapport (79) de ces trois organisations, les pertes de l’Afrique dues aux guerres, guerres civiles et insurrections se sont élevées à environ 18 milliards de dollars par an. Ce chiffre, certainement sous-estimé selon les auteurs, comprend les coûts directs liés aux conflits tels que les coûts médicaux, les dépenses militaires, la destruction des infrastructures et les soins apportés aux personnes déplacées. Il inclut également les coûts indirects résultant d’opportunités perdues liées au ralentissement de l’activité économique, aux détournements de fonds, etc. Au total, ce montant de près de 300 milliards de dollars correspond approximativement à celui consacré à l’aide au développement sur la même période.
Dans un rapport (80) paru en octobre 2004, Kofi Annan, alors Secrétaire général des Nations unies, pouvait faire état d’une amélioration de la situation par rapport à son précédent bilan de 1998 où 14 pays de la région étaient en proie à des conflits armés ou guerres civiles, 11 vivaient des crises et troubles politiques graves et seuls 15 connaissaient une situation politique plus ou moins stable. En 2004, il constatait en revanche que seuls six pays africains pouvaient être considérés comme étant en proie à un conflit armé tandis que peu de pays étaient en définitive traversés par des crises politiques graves.
Toutefois, beaucoup reste à faire comme en témoignent aujourd’hui la catastrophe humanitaire du Darfour au Soudan, l’instabilité politique en Somalie, la situation au Tchad ou en République centrafricaine ou encore les problèmes de sécurité dans la région pétrolifère du delta, au Nigeria. De son côté, sur fonds de richesses naturelles et de convoitises multiples, la République démocratique du Congo reste le théâtre d’une guerre civile incessante, au bilan d’ores et déjà terrifiant. Par ailleurs, de graves tensions sont récemment apparues au Kenya, au Zimbabwe et en Afrique du Sud tandis que l’augmentation du prix des denrées alimentaires et, plus globalement du coût de la vie, a été à l’origine de troubles sociaux dans des pays traditionnellement stables comme le Sénégal, le Burkina Faso ou le Cameroun.
Dans ces conditions, l’Afrique reste le terrain privilégié des opérations de maintien de la paix de l’ONU. D’après l’OCDE (81), sur 17 opérations de maintien de la paix des Nations unies, huit sont déployées en Afrique et représentent pratiquement la moitié du budget des Nations unies pour préserver la paix dans le monde (environ 3,3 milliards de dollars sur un total de 6,8 milliards de dollars).
La carte ci-après sur la répartition des opérations de maintien de la paix fin 2007 illustre la prépondérance des opérations déployées en Afrique :
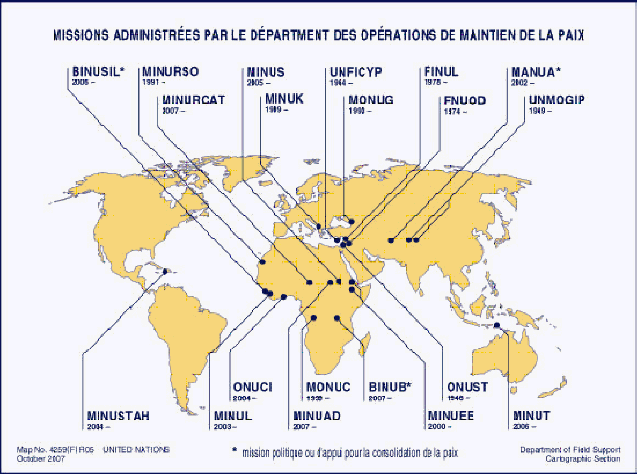
En dépit de cette vulnérabilité à la violence armée, d’importants progrès en matière de prévention et de gestion des conflits sont réalisés par les Africains eux-mêmes, grâce à l’implication d’organisations régionales et sous-régionales (cf. infra).
La majorité des pays d’Afrique subsaharienne se caractérise aujourd’hui par une stabilisation progressive, même quand ils sortent d’un conflit comme c’est le cas de l’Angola, du Liberia et du Mozambique. Après cinq années de guerre civile, la Côte d’Ivoire connaît une amélioration de sa situation intérieure à la suite de la signature de l’accord de Ouagadougou, le 4 mars 2007. L’ancien chef des rebelles, Guillaume Soro, est actuellement à la tête d’un gouvernement d’union nationale jusqu’aux prochaines élections qui devraient finalement se tenir dans le courant du premier semestre 2009, après avoir été plusieurs fois retardées.
Ces exemples montrent que l’Afrique a enregistré d’importants progrès dans la résolution de conflits par le dialogue, grâce notamment à l’essor des médiations africaines, comme cela sera évoqué ultérieurement.
2) Des perspectives de croissance prometteuses
Contrairement à une image trop souvent répandue, l’Afrique subsaharienne fait preuve de dynamisme économique. Sur le long terme, le continent connaît, en effet, sa croissance économique la plus forte depuis les années 70, avec des taux de croissance supérieurs à 5 % depuis cinq ans. Sur la même période, le revenu réel par habitant a progressé d’environ 3 % par an dans toutes les catégories de pays de la région (82).
Ces performances économiques sont le fruit de mesures d’annulation de la dette ainsi que des réformes engagées par la plupart des pays africains pour assainir leurs structures économiques et améliorer le contexte des affaires. Elles s’expliquent également par la baisse globale de la conflictualité ainsi que par les progrès enregistrés en matière de stabilité politique. Enfin, elles sont liées à la hausse des prix des produits de base ainsi qu’aux flux substantiels de financement extérieur.
En 2007, l’Afrique subsaharienne a affiché une croissance du PIB réel de 5,7 % tandis que le PIB par habitant a progressé de près de 3,7 %. D’après l’OCDE (83), cette croissance a été alimentée par la forte demande mondiale de matières premières, l’augmentation des investissements dans ce secteur et, dans la plupart des pays, des conditions météorologiques favorables pour l’agriculture. Cette moyenne masque cependant de forts écarts entre les pays exportateurs nets de pétrole – qui affichent une croissance supérieure à 6 % en 2006 et 2007 – et les autres pays africains, dont la croissance moyenne du PIB s’établit à 5 % en 2007 (contre 5,5 % en 2006).
Le tableau ci-après illustre ces écarts entre les différentes régions d’Afrique. Il permet aussi d’introduire le fait que la croissance affichée dans certains pays est fréquemment liée à l’accroissement des prix des matières premières exportées, ce dont bénéficient les pays concernés sans pour autant que les populations voient leur niveau de vie augmenter.
Taux de croissance par région d’Afrique (variation annuelle en pourcentage) | |||||
Région |
1999-2005 |
2006 |
2007 (e) |
2008 (p) |
2009 (p) |
Afrique du Nord |
4,2 |
5,6 |
5,3 |
6,2 |
6,2 |
Afrique de l’Ouest |
4,4 |
5,0 |
3,5 |
5,6 |
5,7 |
Afrique centrale |
5,3 |
3,4 |
4,1 |
5,1 |
4,4 |
Afrique de l’Est |
5,2 |
7,5 |
8,0 |
7,3 |
7,9 |
Afrique australe |
4,2 |
6,7 |
7,0 |
5,3 |
5,0 |
Total Afrique |
4,4 |
5,9 |
5,7 |
5,9 |
5,9 |
Pour mémoire : |
|||||
Pays exportateurs nets de pétrole |
4,7 |
6,2 |
6,4 |
6,8 |
6,2 |
Pays importateurs nets de pétrole |
4,1 |
5,5 |
5,0 |
4,9 |
5,5 |
Pays SANE (*) |
4,2 |
5,3 |
5,0 |
5,4 |
5,7 |
Autres pays |
4,7 |
6,6 |
6,7 |
6,5 |
6,1 |
(*) Afrique du Sud, Algérie, Nigeria, Egypte | |||||
Source : OCDE, Perspectives économiques en Afrique 2007/2008, mai 2008. | |||||
Ces bons résultats (84) pourraient se confirmer en 2008, avec un taux annuel moyen de croissance du PIB réel de 5,9 % pour l’ensemble du continent, en dépit d’un contexte moins favorable. Au-delà de ces prévisions à court terme, plusieurs projections à moyen et long termes tablent sur des perspectives de croissance durable. Lors de son audition (85), Jean-Michel Severino a précisé que de telles projections s’appuyaient notamment sur certaines tendances démographiques de fond comme l’augmentation de la population, qui contribue à une meilleure efficacité des politiques publiques (coût des équipements par habitant plus faible, populations plus faciles à atteindre, etc.) et l’urbanisation croissante du continent, source de gains de productivité. En outre, après vingt années de crise financière, la situation macroéconomique s’est globalement améliorée grâce à l’assainissement des finances publiques et des termes de l’échange plus favorables.
Toutefois, malgré ces perspectives prometteuses, d’importantes faiblesses subsistent. Tributaire de quelques produits de base, la moyenne élevée des taux de croissance atteints masque de fortes disparités de performance au sein de la région. En outre, cette croissance ne permet pas d’absorber tous les arrivants sur le marché du travail, en raison notamment de la forte expansion démographique. Enfin, comme l’a souligné Philippe Hugon devant les membres de la Mission (86), si le développement entraîne une augmentation du PIB, il génère également de fortes inégalités de revenus, à des niveaux proches de ceux atteints en Amérique latine, notamment au Brésil.
Les perspectives économiques de l’Afrique n’en restent pas moins prometteuses. Par rapport aux précédentes décennies, et en dépit des difficultés persistantes, la situation du continent s’améliore, les opérateurs d’autres pays y investissent massivement à un moment où la présence économique française enregistre un recul. Dans cet ordre d’idées, la stimulation d’activités génératrices d’emplois et de richesses, via l'APD notamment ou les politiques de développement solidaire, apparaît d’autant plus nécessaire qu’elle permettra aussi de contribuer à résoudre la question de l’immigration dont on a vu plus haut qu’elle est autant panafricaine (87) que dirigée vers les pays du Nord.
C.- L’Afrique prend son destin en main
Parallèlement aux évolutions démographiques, économiques et sociales qui viennent d’être évoquées et à l’entrée de l’Afrique dans la mondialisation, les pays africains eux-mêmes ont œuvré à l’élaboration d’un nouveau paysage institutionnel sur le continent, organisé autour de l’Union africaine (UA), de son programme du NEPAD, des communautés économiques régionales et d’une Banque africaine de développement renforcée.
1) L’instauration de mécanismes africains de résolution des conflits
Un des principaux changements intervenus en Afrique depuis le début de la décennie réside dans l’affirmation croissante du rôle de l’Union africaine qui a succédé, en 2002, à l’Organisation de l’unité africaine (OUA) instituée en 1963. Depuis sa création, l’organisation panafricaine s’est principalement affirmée dans le domaine de la paix et de la sécurité où elle cherche à s’imposer comme instance de règlement des crises africaines.
Cette ambition en matière de paix et de sécurité s’est traduite par l’adoption, au sommet de Durban de 2002, d’une « Architecture africaine de paix et de sécurité » qui conjugue action préventive et gestion des crises. La nouvelle architecture repose sur l’action du « Conseil de paix et de sécurité », composé de 15 Etats membres élus pour 2 ans (10 membres renouvelés début 2008) ou 3 ans (5 membres), qui a acquis, au fil des mois, une véritable autorité. Le Conseil a pour mandat de définir une politique africaine commune de défense et de sécurité, de prévenir et gérer les conflits mais aussi de proposer une médiation par l’intermédiaire d’un « groupe des Sages », institué en décembre 2007, dans le but de faciliter le dénouement des crises. Pour la gestion des crises, le Conseil de paix et de sécurité pourra, à l’avenir, s’appuyer sur la « Force africaine en attente » (FAA), constituée de cinq brigades régionales (88), qui doit en principe être opérationnelle en 2010. En matière de prévention et de planification, un « système continental de veille et d’alerte rapide » a été mis en place. L’objectif est de disposer d’un réseau de veille et de communication assurant, au profit des différents échelons, une information rapide, autonome et sécurisée sur les différents théâtres de crise en Afrique.
La structure de l’Union africaine
L’organisation de l’Union africaine s’inspire de celle de l’Union européenne.
La Conférence des chefs d’Etat est l’instance suprême de l’organisation. Elle se réunit au moins une fois par an, dont au moins une fois au siège de l’organisation (Addis-Abeba, Ethiopie). Le dernier sommet s’est tenu du 30 janvier au 2 février 2008.
La présidence de l’organisation est assurée par un Etat membre pour un mandat d’une année. À l’heure actuelle, l’UA est présidée par M. Jakaya Kikwete, Président de Tanzanie.
La présidence s’appuie sur un Conseil exécutif des ministres (essentiellement composé des ministres des affaires étrangères), des comités techniques spécialisés (ministres techniques) et d’un comité des représentants permanents (COREP) constitué des ambassadeurs accrédités à Addis-Abeba.
La Commission est l’instance permanente de l’Union africaine. Elle est composée d’un président (actuellement, M. Jean Ping, originaire du Gabon), d’un Vice-président et de huit commissaires : paix et sécurité, affaires politiques, infrastructures et énergie, affaires sociales, ressources humaines, sciences et technologies, commerce et industrie, économie rurale et agriculture, affaires économiques. Environ 500 personnes travaillent actuellement à la Commission.
Le Parlement panafricain, composé de 265 députés, a un rôle consultatif. Il se réunit deux fois par an (sessions de 10 jours seulement). Son siège est situé en Afrique du Sud.
Le Conseil économique, social et culturel (ECOSOCC), organe consultatif. L’un des enjeux est d’y faire représenter la diaspora africaine.
Des institutions judiciaires et de défense des droits de l’homme (Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, Cour de justice…) complètent le dispositif.
Source : ministère des Affaires étrangères – Ambassade de France en Ethiopie
Installé au printemps 2004, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA s’est montré actif dans le domaine des médiations (fin 2004, une médiation a été confiée au président sud-africain Thabo Mbeki dans le conflit ivoirien). Il a également rencontré certains succès au Togo, en 2005, en évitant une crise à la mort du président Eyadéma ou en intervenant en faveur de la reprise des processus démocratiques au Burundi et en République centrafricaine. En 2007, un certain nombre d’initiatives régionales ont été lancées sous les auspices de l’UA. En Somalie, une mission de maintien de la paix a été déployée pour garantir la stabilité et préparer le retrait des troupes éthiopiennes. Au Darfour, une mission mixte ONU – UA (la « force hybride ») remplace, depuis le 31 décembre 2007, la mission de l’Union africaine. Par ailleurs, des observateurs de l’UA sont déployés le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda ainsi qu’au Sud Soudan. Des officiers de liaison de l’UA, basés à Asmara (Erythrée) et Addis-Abeba (Ethiopie), participent au contrôle de la zone temporaire de sécurité entre les deux pays. Fin mars 2008, les troupes de l’UA ont débarqué sur l’île d’Anjouan, dans le cadre de l’opération « Démocratie aux Comores ».
Au-delà de ces initiatives de l’Union africaine, il faut également souligner l’importance croissante des médiations assurées par des personnalités ou des dirigeants africains, en vue de parvenir à une résolution des conflits par le dialogue et la concertation politiques. Tel a été le cas de la démarche de l’ancien Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, qui n’a pas ménagé ses efforts pour enrayer la montée des violences au Kenya, à la suite des élections présidentielles du 27 décembre 2007. Aujourd’hui, le pays s’est doté d’un gouvernement de coalition, après des semaines de fortes tensions et de violences qui ont fait près de 1.500 morts et 300 000 déplacés. Tel a également été le cas du président burkinabé, Blaise Compaoré, qui est parvenu, en mars 2007, à susciter la signature d’un accord entre le président ivoirien, Laurent Gbagbo, et le chef de la rébellion, Guillaume Soro, à l’origine de la formation d’un nouveau gouvernement. Cet accord prévoit la tenue d’élections présidentielles et doit permettre le retrait progressif de la communauté internationale de Côte d’Ivoire.
En dépit des avancées de l’Union africaine, des interrogations demeurent sur l’avenir de l’institution.
Un premier problème tient au fait que l’Union africaine n’a pas les moyens de ses ambitions : ses ressources sont insuffisantes, ses moyens humains sont, dans la plupart des cas, inadaptés et mal gérés et ses capacités techniques et administratives restent faibles. Ces difficultés de gestion, qui handicapent son action et mettent en péril sa crédibilité, ont motivé la mise en place d’un comité d’audit sur le fonctionnement interne de l’Union, qui a rendu ses conclusions mi-janvier 2008. Ces conclusions devraient être pour certaines prises en compte par la nouvelle Commission, mise en place lors du dernier sommet de l’UA qui s’est tenu, à Addis-Abeba, du 30 janvier au 2 février 2008.
Un second problème réside dans l’ambition qui est assignée à l’organisation. À cet égard, deux visions très différentes de l’intégration africaine se sont exprimées lors du sommet d’Accra de juillet 2007. D’une part, une approche « continentaliste », panafricaine, qui se réfère aux Etats-Unis d’Afrique et dont la Libye et le Sénégal sont les deux plus ardents défenseurs. D’autre part, une approche régionaliste ou « gradualiste » qui n’envisage pas de transfert de domaines de souveraineté vers l’échelon continental tant que les Etats n’auront pas progressé dans la voie de la bonne gouvernance et de la prospérité économique. Une réflexion sur ce thème a été engagée par un comité ministériel sur le gouvernement de l’Union mais les décisions dans ce domaine nécessiteront du temps.
Ces difficultés et hésitations ne doivent cependant pas conduire à négliger le rôle essentiel joué par l’Union africaine depuis sa création. Ses efforts en faveur de la résolution des crises attestent, en effet, d’une volonté ferme de trouver des solutions propres et de prendre résolument en main la destinée du continent africain.
2) Des efforts d’intégration fondés sur de nouveaux espaces de solidarité
Parmi les initiatives lancées à l’échelle du continent figure le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique – le NEPAD –, dont le document stratégique a été adopté en juillet 2001, à l’occasion du 37ème sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). L’objectif du NEPAD est d’offrir un cadre pour développer une nouvelle vision destinée à assurer la renaissance de l’Afrique. Dans cette perspective, les objectifs du NEPAD sont :
− d’éradiquer la pauvreté ;
− de placer les pays africains, individuellement et collectivement, sur la voie d’une croissance et d’un développement durables ;
− de mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique dans le contexte de la mondialisation et promouvoir son intégration complète et profitable à l’économie mondiale ;
− et, enfin, d’accélérer le renforcement des capacités des femmes afin de promouvoir leur rôle dans le développement socio-économique.
Dans le cadre du NEPAD, un mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a été adopté. Ce mécanisme consiste en un instrument de contrôle auquel les Etats membres de l’Union africaine se soumettent volontairement, en vue de s’assurer que les politiques et pratiques des Etats participants sont conformes aux valeurs, codes et normes convenus en matière de politique, économique et de gouvernance d’entreprise. Ce mécanisme d’autocontrôle facilite également le partage des expériences et le renforcement des pratiques optimales couronnées de succès, y compris l’identification des déficiences et l’évaluation des besoins de renforcement des capacités.
La participation au MAEP est ouverte à tous les Etats membres de l’Union africaine, mais l’adhésion est volontaire et n’est assujettie à aucune condition. À ce jour, 25 pays (89) ont accepté de participer au NEPAD. Le Ghana, le Kenya et le Rwanda sont les premiers à avoir parachevé l’exercice d’examen par les pairs. Compte tenu de l’intérêt de cette démarche, il a été entendu lors des différents sommets des G8 que l’aide serait concentrée en faveur des pays qui appliquent ce mécanisme, dans la transparence.
Par ailleurs, les pays africains se sont organisés au niveau régional ou sous-régional en communautés économiques. Il existe actuellement 14 organisations de ce type qui ont vocation à favoriser l’intégration économique au niveau régional. Nombreuses sont celles qui affichent également des objectifs politiques, ajoutés afin de prendre en compte les préoccupations croissantes liées à la sécurité et au maintien de la paix.
Au sein de ces organisations sous-régionales, on distingue :
− Deux organisations liées à la zone franc (Union économique et monétaire Ouest africaine - UEMOA - et Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale - CEMAC -) ;
− Deux instances qui incluent les Etats de la zone franc mais couvrent des zones plus larges (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest - CEDEAO - et Communauté économique des Etats d’Afrique centrale - CEEAC -) ;
− Trois communautés économiques qui constituent des marchés communs sous-régionaux (Marché commun d’Afrique orientale et australe - COMESA (90) -, EAC (91)), pouvant aller jusqu’à une union douanière (SACU (92))
− Les sept autres sont des organisations à vocation plus générale (Commission de l’océan indien - COI -, Communauté de développement d’Afrique australe - SADC (93) -, Union du Maghreb arabe - UMA -, l’Autorité intergouvernementale pour le développement - IGAD -, Conseil de l’entente, Union du Fleuve Mani - UFM -, Communauté des Etats Sahélo-Sahariens - CEN-SAD -).
Au cours de ces dernières années, ces organisations sous-régionales se sont affirmées en matière de prévention et de gestion des conflits africains, devenant des partenaires incontournables. C’est ainsi qu’en Afrique de l’Ouest, la CEDEAO est intervenue au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d’Ivoire avant que l’ONU ne prenne le relais. Si cette structure a jusqu’à présent surtout développé des activités liées aux questions de paix et de sécurité régionales, elle a également été désignée « point focal du NEPAD » pour l’Afrique de l’Ouest.
En matière de développement, ces organisations régionales ont pour objectif de remédier au morcellement qui dessert l’Afrique, notamment en termes de compétitivité économique. L’intégration régionale constitue l’une des voies les plus prometteuses pour permettre aux pays africains de tirer parti de la mondialisation. Elle est en effet susceptible de résoudre les problèmes de taille des marchés et d’isolement, en créant des zones de libre-échange.
À l’heure actuelle, il reste toutefois difficile d’avoir une vision claire dans cet enchevêtrement d’organisations. Certains Etats comme la République démocratique du Congo ou le Burundi sont, en effet, membres de trois, voire de quatre organisations différentes. Il en résulte une certaine confusion qui milite en faveur d’une plus grande coordination entre ces structures. Ces organisations jouent cependant un rôle important, en ce qu’elles manifestent une volonté d’intégration régionale et d’appropriation des questions de sécurité collective.
* * *
L’Afrique reste confrontée à de multiples risques de très grande ampleur qui menacent sa stabilité sociale et politique et ses perspectives de croissance.
Les crises alimentaires sont porteuses, on l’a vu avec le déclenchement des émeutes de la faim, de tensions sociales violentes amplifiées par de très fortes pressions foncières.
L’explosion démographique va s’accompagner de mouvements migratoires considérables à l’intérieur du continent, qui connaît avec l’urbanisation galopante un bouleversement des structures sociales, mais aussi vers les pays de la rive Sud de la Méditerranée. Enfin, les perturbations climatiques frappent l’Afrique avec beaucoup plus de dureté et entraînent un appauvrissement des sols et une désertification dont les conséquences sont dramatiques.
Mais, en dépit de ces menaces, l’Afrique offre des perspectives de croissance remarquables et s’ouvre à la mondialisation en développant ses échanges avec les nouveaux pays émergents.
Même si de nombreux conflits subsistent, même si les progrès de l’Etat de droit sont loin d’être définitifs et suffisants, ce qui n’est pas sans conséquence sur la croissance économique durable ni l’efficacité de l’aide au développement, l’Afrique offre néanmoins de plus en plus à ses partenaires un environnement politique juridiquement plus stable et plus démocratique qu’il convient de saluer et de soutenir.
L’Afrique a changé. Le regard de la France sur l’Afrique doit changer, en intégrant pleinement la portée des changements qui sont intervenus sur le continent, afin de parvenir à une relation franco-africaine apaisée et constructive.
III – L’AFRIQUE AUTREMENT : LE PARI FRANÇAIS DU PARTENARIAT
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès », Nelson Mandela.
Devant les membres de la Mission d’information (94), Michel Camdessus déclarait : « dans le monde d’aujourd’hui, dans ce contexte radicalement neuf des relations avec l’Afrique, il y a place pour une spécificité française à assurer ». Cette conviction est également celle des membres de la Mission.
La France a effectivement un rôle à jouer en Afrique, à condition toutefois d’opérer un « aggiornamento » de sa politique, d’en changer le style et les priorités. Certains changements importants ont été esquissés ; il convient aujourd’hui de les mener à leur terme et d’en tirer les enseignements. La politique de la France en Afrique a, en effet, trop souffert de choix partiellement assumés et des contradictions qui ont pu en résulter.
Il est également nécessaire d’aller plus loin, d’adopter une nouvelle démarche, à la fois plus pragmatique et respectueuse des différences. Une approche fondée sur le partenariat, dans le respect de l’intérêt mutuel des parties.
A.- Une ambition pleinement assumée : maintenir la présence de la France en Afrique
En dépit d’une présence ancienne sur le continent africain, la France a tardé à prendre la mesure des profondes transformations qui y sont intervenues depuis une quinzaine d’années. Pour continuer de jouer un rôle en Afrique et maintenir son rayonnement sur ce continent, elle doit conserver, tout en la faisant évoluer, une politique africaine qui lui est spécifique et s’inscrit dans une tradition désormais ancienne que les membres de la Mission d’information estiment devoir être maintenu dans son principe. Comme le soulignait l’ancien Ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, dans le rapport qu’il a remis au président de la République sur la place de la France dans la mondialisation, « la France a intérêt à garder une politique africaine. » (95).
Au-delà de son engagement européen, la France a intérêt à définir les éléments d’une stratégie propre, d’autant qu’elle dispose, du fait de ses relations anciennes et étroites, d’une expérience et d’un savoir-faire en Afrique qu’il importe de faire fructifier dans l’intérêt de tous, y compris de ses partenaires européens.
Cette politique doit être mieux définie et tenir compte du nouveau contexte international et géopolitique, et notamment du fait, comme cela a été précédemment évoqué, que l’Afrique est aujourd’hui le théâtre d’une concurrence acharnée pour l’accès à ses matières premières et elle représente un intérêt stratégique croissant.
Elle doit également obéir à un objectif simple et clair, afin de ne pas brouiller le message de la France à ses partenaires africains et courir, une nouvelle fois, le risque d’aboutir à une stratégie illisible. Cet objectif est de maintenir la présence de la France en Afrique en soutenant le développement du continent.
Énoncer cette ambition vise à mettre fin à la tentation d’un retrait d’Afrique qui reste forte, notamment dans l’opinion publique française, durablement marquée par l’image d’un continent perpétuellement en crise. Il s’agit également d’assumer pleinement nos intérêts, comme l’a déclaré le président Nicolas Sarkozy dans son discours du Cap prononcé le 28 février dernier : « Si la France veut refonder sa relation avec l’Afrique, la France doit commencer par reconnaître et assumer ses intérêts en Afrique ». Au-delà de la sécurité et de la stabilité du continent, la France a en effet des intérêts multiples en Afrique qui sont aussi bien politiques qu’économiques et culturels.
À l’heure où de nouveaux acteurs s’affirment sur le continent, il serait pour le moins paradoxal d’y renoncer, en dépit de la vive concurrence qu’ils doivent affronter. Car ils sont également autant d’atouts pour notre pays, comme pour les pays africains qui ont tout à gagner à une diversité de partenaires. Ils seront d’autant mieux défendus que la France saura mobiliser l’ensemble de ses atouts et de ses outils diplomatiques pour la promotion des idéaux qu’elle défend, sur le continent comme partout, en faveur de l’Etat de droit et de la gouvernance démocratique.
B.- Une méthode : le choix du partenariat
La nécessité d’adopter une approche et un style différents dans les relations franco-africaines ressort très clairement de tous les travaux et entretiens menés par les membres de la Mission. Le constat est unanime : il convient de substituer aux formes d’assistance qui ont prévalu jusqu’à présent de véritables relations partenariales, adaptées aux réalités non pas de l’Afrique, mais des mondes africains dans leur pluralité. Il est indispensable aussi d’ouvrir ces relations à de nouveaux acteurs de la société civile ainsi qu’au Parlement.
1) Instaurer des relations dynamiques de partenariat
La formule du partenariat tend aujourd’hui à largement se répandre comme l’illustrent les différentes initiatives prises pour appliquer de façon concrète la « stratégie conjointe », adoptée au sommet euro-africain de Lisbonne de décembre dernier (partenariats UE – Afrique pour la paix et la sécurité, sur la gouvernance démocratique et les droits de l’homme, sur les objectifs du Millénaire pour le développement, etc.). Pour autant, il ne faut pas se méprendre sur la portée de cette formule : alors que la définition d’une politique est unilatérale, le partenariat repose sur un dialogue entre égaux. Comme l’a précisé Michel Camdessus lors de son audition (96), le choix du partenariat est un choix exigeant : « il implique que votre partenaire (…) arrête lui-même ses propres choix et priorités. Il implique aussi la totale franchise de part et d’autre et l’acceptation du regard critique de l’autre sur nos politiques à son égard. Il implique un profond respect des exigences éthiques de l’autre, de sa culture, de ses traditions, y compris dans l’organisation de la vie collective ».
Instaurer des relations entre partenaires suppose également d’adapter nos outils traditionnels de coopération afin d’en subordonner l’utilisation à des objectifs déterminés conjointement. À cet égard, la proposition, formulée dans le cadre de la revue générale des politiques publiques (RGPP), de compléter l’indicateur de moyens de notre politique d’aide au développement, limité aux pays donateurs, par des indicateurs de résultats, impliquant les pays bénéficiaires, va dans le bon sens. Il est également nécessaire, comme le souligne la Commission du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, de s’assurer que le pilotage stratégique reste du ressort de l’autorité politique, et non de l’opérateur (97).
Faire le choix du partenariat ne consiste pas en une simple formule. Il s’agit au contraire d’adapter ses méthodes d’intervention afin de prendre en compte les priorités et intérêts spécifiques de chacun.
Dans ces conditions, inscrire les relations franco-africaines dans le cadre d’un partenariat unique ne paraît guère concevable. C’est pourquoi, votre Rapporteur suggère de définir des formes nouvelles de partenariats individualisés, définis au cas par cas, selon les pays concernés, qui n’empêchent pas toutefois de distinguer deux grandes catégories de pays : d’une part, les partenaires traditionnels de la France, avec lesquels notre pays a une langue en partage ; d’autre part, les puissances émergentes du continent africain, avec lesquels les échanges se sont amplifiés au cours de ces dernières années.
Dans le premier cas, la France proposerait, en fonction des priorités de chacun et des initiatives des autres bailleurs de fonds, en particulier l’Union européenne, de mettre l’accent sur des thèmes d’intérêt commun, comme l’éducation ou la santé qui constituent, selon votre Rapporteur, des champs d’intervention prioritaires. Cette orientation suppose que les moyens consacrés à la coopération bilatérale soient renforcés, dans la perspective notamment de l’épuisement prévisible des opérations d’allègement de dette.
Dans le second cas, l’objectif est de renforcer la présence française dans certains pays qui font aujourd’hui figure de puissances émergentes du continent africain comme le Nigeria, l’Ethiopie ou l’Afrique du Sud par exemple. Dans ces pays qui connaissent une croissance rapide, les actions seraient davantage orientées sur le soutien au développement économique, avec les moyens annoncés par le président de la République dans son discours du Cap (cf. infra).
Ces partenariats individualisés viseraient à mieux prendre en compte la situation de chacun de nos partenaires africains. Il s’agirait également de mettre davantage en cohérence les orientations de la coopération avec la présence d’intérêts français.
Choisir la voie du partenariat constitue une première étape importante, mais pas suffisante. Dans un grand nombre de cas, les différents interlocuteurs des membres de la Mission ont également insisté sur la nécessité de changer de style, en privilégiant notamment l’ouverture. Dans son rapport précité sur la place de la France dans la mondialisation, Hubert Védrine préconisait ainsi de « se mettre réellement à l’écoute des Africains » en instituant une commission bi partisane, chargée de recueillir les attentes des Africains à l’égard de la France et de l’Europe, puis « de reformuler clairement avec eux nos objectifs, notre stratégie, notre politique ». L’objectif est aujourd’hui de permettre une plus grande participation de la société civile et du Parlement dans la définition de la politique de la France en Afrique.
– L’accroissement du rôle du Parlement
Traditionnellement, la politique étrangère relève du domaine réservé du Chef de l’Etat et, jusqu’à présent, le Parlement n’a joué dans ce domaine qu’un rôle extrêmement marginal. La politique de la France en Afrique est, de ce fait, restée une prérogative élyséenne. Cette situation a été critiquée par certains parlementaires et associations ou ONG qui estiment que « le manque de transparence et de lisibilité de cette politique se double d’un déficit de démocratie, matérialisé notamment par la faiblesse du contrôle parlementaire sur l’aide publique au développement, sur les accords de coopération militaire, les interventions extérieures ainsi que les négociations internationales » (98).
Ce déséquilibre devrait désormais prendre fin. Dans son discours du Cap, le Président de la République Nicolas Sarkozy avait fait part de sa décision d’associer le Parlement français aux grandes orientations de la politique de la France en Afrique.
L’adoption de la loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Vème République vient de conforter le rôle du Parlement qui doit être plus largement et régulièrement informé et associé aux décisions de politique étrangère.
Le débat suivi d’un vote sur la situation en Afghanistan et le maintien de la présence militaire française marque incontestablement un tournant.
Il convient désormais de ne pas se limiter pour le Parlement à se prononcer seulement sur l’engagement dans la durée de nos forces sur des théâtres d’opérations extérieures.
Le Parlement doit aussi pouvoir faire des propositions et prendre des initiatives pour être mieux informé et contribuer de manière dynamique à la mise en place des actions de politique étrangère et plus particulièrement celles qui fondent la politique de la France en Afrique.
De nouvelles pratiques doivent s’instaurer, de nouveaux outils doivent être créés.
Un débat sur les orientations de la politique africaine de la France apparaît plus que jamais comme une nécessité. Le Parlement doit être clairement informé et consulté sur les fondements de l’intervention et les priorités de la France en Afrique.
Une évaluation régulière des politiques d’aide au développement au travers des actions menées par la France et des résultats obtenus pourrait ainsi être faite au cours d’un débat spécifique consacré à notre politique de coopération.
Ce débat pourrait s’appuyer sur les informations contenues dans un rapport remis tous les ans, par le Gouvernement, sur les réalisations de la politique conduite en Afrique, sur le modèle du rapport portant sur la contribution et la présence françaises au sein du Fonds mondial international (FMI) et de la Banque mondiale. Ce rapport comprendrait notamment un tableau retraçant l’état d’avancement de la renégociation des accords de défense ainsi qu’en annexe le contenu de ces accords, conformément aux annonces faites par le président de la République dans son discours du Cap, en février dernier.
Il conviendrait également de réfléchir au niveau parlementaire, à l’instar de ce qui existe avec la Grande Commission France/Russie, à la création d’une structure semblable France/Parlement Pan-Africain, afin d’échanger régulièrement sur les questions d’intérêt commun.
– L’ouverture à la société civile
La mondialisation s’est accompagnée d’une affirmation sans cesse croissante de la société civile qui s’est emparée de sujets traditionnellement réservés à la sphère des échanges interétatiques. On a ainsi vu des organisations non gouvernementales (ONG) s’intéresser à des problèmes généraux comme les questions commerciales, l’environnement ou l’aide au développement. Actuellement, la France se trouve dans une situation atypique s’agissant du montant de l’APD qui transite par les ONG françaises. On ne peut donc que souscrire aux propos du ministre de la coopération, M. Alain Joyandet, les 25 et 26 août 2008, lors des journées de la coopération internationale et du développement : « Je tiens enfin –c’est le 4ème chantier– à ce que les engagements pris au plus haut niveau vis-à-vis de la communauté des ONG soient respectés. Nous devons cesser cette « exception française » et nous rapprocher des standards de la plupart de nos partenaires, notamment au sein de l’UE. Avec moins de 1,5 % de notre APD qui transite par les ONG françaises, nous sommes loin de la norme OCDE avec 5 % en moyenne. Nous allons donc, dès 2009, augmenter cette part de notre APD via les ONG. L’objectif ambitieux que nous nous fixons est une augmentation totale de 50 % d’ici à la fin du quinquennat ».
Des associations africaines, relayées par des organisations françaises, se sont aussi mobilisées sur le thème des relations franco-africaines, exigeant une plus grande transparence de ces relations ainsi qu’une meilleure prise en compte des attentes des populations (99).
On pourrait ajouter à ces demandes, les attentes d’autres acteurs comme les entrepreneurs, dont l’avis est rarement pris en compte dans l’élaboration des priorités de la politique de coopération. Le président délégué du CIAN, Anthony Bouthelier, faisait ainsi observer que d’après une étude de l’IFRI, « la France est, parmi les grands acteurs en Afrique, le pays qui a la connexion la plus faible avec le monde de l’entreprise » (100).
Par conséquent, si la rénovation des relations franco-africaines doit passer par l’instauration de partenariats, ces partenariats doivent dépasser le cadre interétatique traditionnel et s’ouvrir à la société civile et aux entreprises. Dans son discours du Cap, le président Nicolas Sarkozy s’est prononcé en faveur de nouvelles modalités d’échanges dans le cadre des sommets France – Afrique, dont la finalité et le déroulement doivent être repensés, en lien notamment avec la tenue de sommets Europe – Afrique. Votre Rapporteur estime que la réforme de ces sommets pourrait ainsi intégrer une journée préparatoire d’échanges avec différents représentants de la société civile et du monde des entreprises, dont les résultats seraient ensuite intégrés par les chefs d’Etat et de gouvernement dans leur déclaration finale.
3) Valoriser notre coopération multilatérale
Comme le rappelle notamment Jean-Marc Châtaigner (101), « de par son histoire et son implication dans la construction de l’appareil européen de développement, la France a longtemps joué un rôle déterminant dans la philosophie et les axes d’intervention de l’Union européenne en Afrique ». Et si le cadre bilatéral doit rester un outil privilégié de la coopération entre la France et l’Afrique, notre pays intervient néanmoins de façon croissante dans un cadre multilatéral.
Il convient désormais, tout en maintenant la priorité aux actions bilatérales, de savoir mieux valoriser parallèlement celles que nous menons dans les cadres européen et onusien et votre rapporteur considère que notre pays doit repenser son implication en faveur de l’Afrique au niveau européen.
Devant les membres de la Mission (102), Jean-Christophe Belliard a mis l’accent sur le fait que « la connaissance intime que la France avait de l’Afrique ne se traduisait pas toujours au sein des structures de l’Union européenne, où le travail de consensus, en commun, à travers de multiples groupes de travail, tendait à limiter notre originalité et notre compétence (…) D’un côté, de plus en plus de dossiers sont gérés par l’Europe, qui dispose de moyens financiers considérables qu’elle ne parvient cependant pas à mobiliser dans leur intégralité. De l’autre, la connaissance des réalités de terrain et, plus généralement, le sens politique des choses manquait à Bruxelles ».
Dans ces conditions, votre rapporteur estime qu’il faut « investir » davantage les structures de l’Union européenne chargées des relations avec l’Afrique. Cette implication suppose de veiller, dans le respect de l’égale représentation de toutes les nationalités, à la présence d’experts français en nombre suffisant et à des postes de responsabilité. Elle suppose également de repenser la contribution de notre pays au partenariat de l’Europe avec l’Afrique afin que cette contribution ne soit pas perçue comme le prolongement de notre politique sur le continent africain. Enfin, la France doit contribuer à mieux faire connaître l’Afrique par ses partenaires européens, notamment les nouveaux Etats membres de l’Union européenne.
Certes, le rôle joué par notre pays reste important, comme l’illustre par exemple la reprise par l’Union européenne du concept français Recamp. Plus récemment, cette influence s’est encore manifestée avec le déploiement de la force « Eufor » au Tchad et en RCA, dont le principe a été activement soutenu par la France. Toutefois, il faut veiller à préserver cette influence, tout en partageant l’expérience acquise avec nos partenaires européens. En matière de paix et de sécurité, le cadre multilatéral garantit en effet la légitimité de l’action de la France sur le terrain, tout en mutualisant les risques d’enlisement ou de contagion des crises, notamment en cas d’intervention militaire, comme cela a été le cas en Côte d’Ivoire. Il permet également un partage des coûts d’intervention. À l’heure actuelle, les interventions militaires françaises sont ainsi menées strictement dans le cadre de mandats de l’Organisation des Nations unies (ONU). Elles tendent également de plus en plus souvent à s’inscrire dans un cadre européen, comme l’illustre le déploiement de la force européenne « Eufor » au Tchad et en République centrafricaine (RCA), activement soutenu par la France. Conformément à la résolution 1778 du Conseil de sécurité des Nations unies, cette opération militaire européenne a pour mission de contribuer à la protection des civils en danger, en particulier les réfugiés et les déplacés ; faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et les déplacements des personnels humanitaires et, enfin, contribuer à la protection des activités et des personnels des Nations unies sur place. Cette opération, qui mobilise 14 Etats membres sur le terrain, est la plus importante mission militaire de l’Union européenne en dehors du continent et sans assistance de l’OTAN.
Dans cet ordre d’idées, l’Union africaine joue désormais un rôle clé dans les questions politiques et sécuritaires du continent, comme l’a illustré son implication dans la recherche de solutions aux crises ivoirienne, burundaise ou soudanaise. Compte tenu de ce rôle, la France s’appuie aujourd’hui sur les décisions de l’UA pour justifier ses prises de positions et interventions sur le continent africain. C’est la raison pour laquelle la coopération française intègre une composante destinée à conforter la capacité des Africains à gérer leur propre sécurité collective. Elle soutient également l’intégration régionale en Afrique subsaharienne, en mettant l’accent sur des actions destinées à renforcer les capacités institutionnelles. Cette orientation doit être consolidée afin de favoriser la mise en place de relations de partenariat, reposant sur un dialogue entre égaux.
Plus généralement, en matière de développement, la démarche multilatérale permet de financer des projets de plus large ampleur, en matière d’infrastructures par exemple. A l’heure actuelle, la France consacre près du tiers de son APD totale à des programmes mis en œuvre par des organisations multilatérales, au plan européen comme au plan mondial. Il est donc également de sa responsabilité de s’impliquer davantage dans l’élaboration et le suivi de ces programmes.
En définitive, si les membres de la Mission d’information se prononcent clairement en faveur d’un renforcement des moyens de l’aide bilatérale française en direction de l’Afrique, cette position ne remet pas en cause la place de la coopération multilatérale. Il est cependant nécessaire de mieux exploiter les leviers d’action qu’offre le cadre multilatéral, afin de renforcer la portée du nouveau partenariat proposé avec l’Afrique.
C.- Des priorités d’action fondées sur l’intérêt mutuel des parties
Sur le fondement d’une ambition claire de maintien de l’influence française en Afrique et d’un style nouveau dans les relations franco-africaines, trois priorités paraissent aujourd’hui s’imposer. En premier lieu, reconsidérer les finalités et le contenu des instruments traditionnels de la politique africaine de la France, conformément aux engagements pris par le président de la République dans son discours du Cap. En second lieu, valoriser la relation singulière qui subsiste entre la France et ses partenaires africains dans le domaine de l’éducation et de la formation. Enfin, donner un nouveau souffle à notre présence économique sur le continent en accompagnant le développement du secteur privé africain et renforçant l’appui apporté aux entreprises françaises.
L’affichage de ces priorités n’est naturellement pas exclusif d’autres interventions urgentes rendues nécessaires du fait de l’actualité, comme cela est actuellement le cas dans le domaine de la sécurité alimentaire, par exemple. Il doit néanmoins contribuer à donner une lisibilité nouvelle à la politique de la France en Afrique, en fixant des lignes directrices claires.
1) Concrétiser les engagements du discours du Cap grâce à l’adoption d’une « feuille de route »
Votre Rapporteur rappelle que les travaux de la Mission d’information ont débuté en septembre 2007, c’est-à-dire avant que le président de la République ne prononce un discours important sur l’avenir des relations franco-africaines, au Cap (Afrique du Sud), en février 2008. Ce discours pose en effet les jalons d’une réforme de notre politique en Afrique, dont certains avaient été envisagés dans le cadre de la Mission : ainsi, la préservation – sous réserve de leur adaptation – des sommets France – Afrique, la renégociation des accords de défense et l’association du Parlement aux orientations de cette politique. Il vient par ailleurs mettre un terme au sentiment de confusion qui a longtemps prévalu entre les interventions du candidat Nicolas Sarkozy à Cotonou, en mai 2006, et celle du président de la République à Dakar, en juillet 2007. Ce discours comprend des engagements précis et s’attaque aux fondements et aux symboles de la présence française en Afrique, en évoquant :
− La publication et la renégociation des accords de défense qui lient la France à certains pays africains depuis leur accession à l’indépendance ;
− La révision de la présence militaire française en fonction de l’avancement de la construction d’un dispositif africain de sécurité collective (103);
− Le contrôle parlementaire sur les grandes orientations de la politique de la France en Afrique ;
− De nouvelles modalités d’échanges dans le cadre des sommets France – Afrique, dont la finalité et le déroulement seront adaptés ;
− Une coopération désormais ciblée sur l’accélération de la croissance économique en Afrique via le lancement d’une initiative de soutien à la croissance, mobilisant 2,5 milliards d’euros en 5 ans et destinée à financer, directement ou indirectement, 2 000 entreprises africaines, pour la création de 300 000 emplois (cf. infra).
Les orientations de ce discours prennent en compte les changements qu’a connus le continent africain ainsi que de la nécessité, pour notre pays, d’opérer un « aggiornamento » de sa politique africaine. La mise en œuvre de ces orientations traduira la détermination de notre pays à définir les nouvelles bases de sa politique à l’égard de l’Afrique. C’est la raison pour laquelle votre Rapporteur juge indispensable l’établissement d’une « feuille de route », comprenant un calendrier indicatif, afin de suivre l’état d’avancement de la réalisation de ces engagements. Le suivi du degré de réalisation de cette « feuille de route » serait évoqué lors du débat parlementaire sur la politique de la France en Afrique (cf. supra).
2) En matière de coopération, renforcer les moyens de l’aide bilatérale en faveur de l’éducation et de la formation
L’éducation est un domaine où la France a de réels atouts et avantages comparatifs à faire valoir, notamment dans les pays africains francophones. Afficher une priorité en faveur de l’éducation correspond, en outre, à l’un des huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Enfin, investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir.
Avec la santé, l’éducation constitue un préalable indispensable si l’on veut réussir et mener à bien une politique de développement. L’éducation doit être ici entendue au sens large et inclure également la formation professionnelle qui comprend la transmission d’un savoir-faire. Dans ce domaine, la France a des atouts et une expérience qu’elle doit faire fructifier à travers les projets de coopération qu’elle développe.
Cette orientation va de pair avec un renforcement de notre aide bilatérale dans les pays concernés. Il s’agit, en effet, d’enrayer le recul de la coopération dans le domaine de l’enseignement depuis quinze ans, qui fait sentir ses effets négatifs sur les générations montantes (104). Il s’agit également de répondre aux nombreux Africains francophones qui, selon nos différents postes diplomatiques en Afrique, éprouvent le sentiment d’être délaissés. Enfin, le rôle de la francophonie reste irremplaçable pour ceux qui veulent y voir, à la suite de Léopold Sédar Senghor, non pas une idéologie mais « un idéal qui anime des peuples en marche vers une solidarité de l’esprit ».
Cette priorité en faveur de l’éducation et de la formation suppose, d’une part, d’adapter l’offre française à de nouveaux besoins qui émergent ; d’autre part, de renforcer les moyens de notre aide bilatérale afin d’être effectivement en mesure de proposer une offre adaptée, tout en contribuant à la réalisation de l’OMD fixé en matière d’éducation.
Dans le secteur de l’éducation, notre action repose sur le réseau d’établissements de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) qui accueille aujourd’hui 34 000 élèves en Afrique subsaharienne – dont 18 000 sont français – répartis dans 105 lycées (105). Ce réseau, qui représente un véritable outil d’excellence pour la France à travers le monde, est aujourd’hui confronté à un problème de saturation de ses capacités d’accueil, du fait d’une croissance généralisée des effectifs. Dans le même temps, les moyens budgétaires alloués au fonctionnement de l’AEFE sont en baisse, l’Agence étant appelée à financer la croissance de son réseau d’établissements sur ressources propres.
Les membres de la Mission d’information estiment aujourd’hui nécessaire de renforcer le soutien public à l’AEFE afin que l’Agence puisse développer son réseau d’établissements en Afrique subsaharienne. Le deuxième souffle à la relation entre l’Afrique et la France que la Mission appelle vivement de ses vœux passera aussi, ne l’oublions pas, par le renforcement de la francophonie. Seul, naturellement, notre pays est à même de lui redonner l’impulsion nécessaire qui conditionnera sur le long terme l’influence de la France sur un continent aujourd’hui tenté par d’autres sirènes.
Un effort budgétaire supplémentaire est également nécessaire afin d’augmenter le nombre de bourses scolaires. Dans le même temps, il est indispensable de renforcer les moyens consacrés au soutien à l’enseignement primaire, en orientant davantage les actions de l’Agence française de développement (AFD) en faveur de ce secteur chaque fois que cela est possible, compte tenu des priorités fixées dans les Documents cadre de partenariat (DCP). En tout état de cause, une augmentation des crédits consacrés à la coopération bilatérale reste nécessaire afin de promouvoir cette politique. Dans un contexte de tassement de l’effort français d’APD, seule une loi de programmation budgétaire permettrait d’inverser la tendance actuelle, en délivrant un signal fort quant à la volonté de notre pays de s’engager résolument en faveur d’un partenariat renouvelé avec ses interlocuteurs africains.
S’agissant enfin de l’enseignement supérieur, votre Rapporteur constate que l’offre française de formation reste éloignée de certains besoins, en particulier ceux des entrepreneurs et de la sphère économique. Or, comme l’a indiqué Jean-Michel Severino aux membres de la Mission (106), « nous assistons [aujourd’hui] à un renversement de paramètres économiques qui va permettre aux énergies locales et à cet esprit d’entreprise de s’exprimer. Plusieurs communautés font, en effet, preuve de dynamisme, comme les Indiens en Afrique australe et orientale ou les Libanais en Afrique centrale et de l’ouest, et pourraient jouer un rôle équivalent à celui joué par les Chinois en Malaisie ou en Thaïlande. Certains groupes ethniques, comme les Bamiléké au Cameroun, participent également à la formation et au développement de cet esprit d’entreprise. Par ailleurs, de grandes entreprises émergent comme Ken-Gen (Kenya Cogénération) au Kenya dans le secteur énergétique. De même en Afrique de l’ouest, de grands opérateurs apparaissent, notamment dans le domaine des télécommunications, comme Sonatel au Sénégal ».
La France ne peut rester à l’égard de ces évolutions de fond qui contribuent au développement économique des pays africains. Cette dimension doit donc être intégrée dans l’offre française de formation proposée aux jeunes Africains. Dans cette perspective, votre Rapporteur juge nécessaire d’adapter cette offre, en encourageant notamment les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les Chambres de métiers (CM) à regrouper leurs moyens en vue de créer des « chambres consulaires » de formation d’entrepreneurs africains et de soutien à la formation professionnelle. Ces structures pourraient également être incitées à soutenir la création d’écoles de commerce africaines, sur le modèle des écoles supérieures françaises de commerce.
Par ailleurs, il est également nécessaire d’orienter davantage les étudiants africains qui viennent poursuivre leur formation en France vers des disciplines opérationnelles dans le monde des entreprises comme la gestion, le marketing, la finance, etc. Cette orientation suppose une plus grande sensibilisation de nos consulats en Afrique sur ces problématiques ainsi qu’une politique d’attribution des visas plus souple à l’égard de ces futurs entrepreneurs africains.
Enfin, la France ne peut rester à l’écart des efforts entrepris par ses partenaires pour rénover et étendre leur réseau d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. A cet égard, les membres de la Mission se félicitent de l’initiative du CNRS visant à créer une unité mixte de recherche internationale en Afrique de l’Ouest (107). Ce projet a pour objectif de favoriser les recherches dans le domaine des relations entre l’environnement, la santé et les sociétés, en associant, au sein d’un laboratoire commun, des chercheurs africains et français. Il s’agit, à terme, de promouvoir la mise en place, dans la région (principalement Burkina Faso, Mali et Sénégal), de politiques de développement durable plus performantes en matière d’environnement et de santé. Cet exemple montre que notre pays dispose d’une réelle capacité à développer des partenariats d’avenir dans le domaine de la recherche. Il nous faut donc aller de l’avant dans cette direction.
3) Sur le plan économique, soutenir la présence des entreprises françaises en Afrique ainsi que le développement des PME africaines
Le repli économique de la France en Afrique a fait l’objet d’un développement spécifique supra. Au terme d’une consultation de l’ensemble de nos postes diplomatiques en Afrique, il apparaît que, si les entreprises françaises ont tendance à favoriser un retour rapide sur investissement, elles constituent cependant « un socle solide pour saisir les occasions offertes par les nouveaux investissements sur un continent où il y a beaucoup à faire et rayonner à partir de leurs bases vers les pays africains les plus dynamiques ou encore délaissés (anglophones et lusophones) ».
Afin de soutenir cette dynamique, il nous faut tout d’abord reconsidérer notre dispositif public de soutien aux entreprises, dont les dimensions ont été considérablement réduites en Afrique subsaharienne. Comme cela a été évoqué précédemment, les effectifs des missions économiques ont fortement diminué tandis que l’opérateur Ubifrance est quasiment absent du continent, à l’exception des pays d’Afrique du Nord. Les membres de la Mission d’information ont, par ailleurs, appris avec consternation la fermeture de la mission économique française au Ghana, pays qui se caractérise pourtant par un fort dynamisme économique. Cette tendance est pour le moins paradoxale à l’heure où de nouveaux concurrents débarquent en force sur le continent africain, remportant avec succès de plus en plus de parts de marché. Il est aujourd’hui nécessaire d’inverser cette tendance en renforçant notre réseau des missions économiques en Afrique afin d’appuyer les projets des entreprises françaises, grands groupes comme PME (108). Il importe, par ailleurs, de pallier la disparition progressive d’opérateurs intermédiaires français en Afrique. Dans cette perspective, un système de parrainage avec les grandes entreprises présentes dans le pays, les missions économiques ou encore l’Agence française de développement (AFD) pourrait encourager l’arrivée de nouveaux opérateurs (109).
En termes de financement, l’objectif est de favoriser des partenariats innovants avec des fonds provenant de pays du Golfe, dans la mesure où ces derniers manifestent un intérêt croissant pour les marchés africains et apprécient le savoir-faire français. Cet intérêt croissant se manifeste dans des secteurs aussi divers que la téléphonie mobile (acquisition de Celtel – cf. infra – par le koweitien MTC), l’immobilier (réalisation de la future capitale sénégalaise confiée aux sociétés dubaïotes Damag et Limitless), la finance (constitution, fin 2004, du fonds saoudien « Kingdom Zephyr Africa », doté de 100 millions de dollars investis notamment dans des banques au Ghana et au Nigéria, ainsi que dans le groupe de télécommunications Sonatel) ou les médias (l’investissement de 25 millions de dollars nécessaire au lancement de CNBC Africa a été financé à 70 % par un consortium de Dubaï) (110). Dans ce contexte, la mise en place d’une plateforme commune visant à coordonner les projets des entreprises et banques françaises et les initiatives des fonds des pays du Golfe permettrait d’accroître substantiellement les investissements à destination de l’Afrique.
Enfin, il n’est pas illégitime de s’interroger sur les conséquences qu’aurait un retour partiel à l’octroi d’une aide liée dans un contexte où les coopérations chinoise, japonaise ou américaine appuient les intérêts commerciaux des entreprises nationales qui souhaitent s’implanter en Afrique.
Votre Rapporteur estime, par ailleurs, que la France doit être davantage présente dans les activités contribuant au développement économique de l’Afrique, en particulier les activités de capital-investissement qui viennent en soutien au développement du secteur privé africain. La période récente s’est, en effet, caractérisée par une forte diversification des financements en direction de l’Afrique. Devant les membres de la Mission (111), Philippe Hugon a recensé parmi ces nouvelles sources de financement « (…) les fondations privées, comme la Fondation Bill Gates, les banques islamiques et les fonds des pays pétroliers. Par ailleurs, avec plus de 3 milliards de réserves de change, les pays asiatiques émergents sont également devenus des gros financeurs. Enfin, les financements émanant des migrants représentent des sommes importantes, plus de deux fois le montant de l’aide publique au développement ».
Dans ce contexte, le développement du capital-investissement offre de réelles opportunités, avec des fonds récoltés qui ont atteint près de 2,3 milliards de dollars en 2006. À l’heure actuelle, la part de l’Afrique subsaharienne dans les fonds de capital-investissement destinés aux marchés émergents représente 7 % du total, soit un taux comparable aux autres régions émergentes (8 % en Amérique latine, 8 % au Moyen Orient/Afrique du Nord et 10 % en Europe de l’Est et centrale/Russie) (112). Le développement de cette activité favorise l’accès à des financements de long terme, reposant sur une association capital public – capital privé, via des agences de développement comme la Société néerlandaise pour le financement du développement (FMO), l’agence britannique CDC (Commonwealth Development Agency) ou la filiale française Proparco qui dépend de l’AFD (113). Soucieuses d’encourager l’activité dans le secteur privé, ces agences, soutenues par les gouvernements, constituent de bons garants des fonds d’investissement privés en Afrique. Cette association de capitaux est à l’origine d’une série de réussites commerciales – comme celle de Celtel, pionnier africain des télécommunications soutenu par le capital-investissement, racheté en 2006 pour un montant de 3,4 milliards de dollars – qui illustrent le lien entre capitaux privés, développement et lutte contre la pauvreté.
La France entend aujourd’hui renforcer sa participation à ces activités de capital-investissement, comme en témoigne l’« initiative pour la croissance économique en Afrique », annoncée par le président Nicolas Sarkozy lors de son déplacement en Afrique du Sud, en février dernier. Cette initiative vise à favoriser le développement des entreprises privées locales en accompagnant en particulier les PME qui sont souvent les plus génératrices d’emploi. Elle consiste à élargir leur accès au financement, en mettant à leur disposition des prêts, des garanties et en prenant des participations.
Dans cette perspective, trois axes ont été définis :
− La création d’un fonds d’investissement africain, doté de 250 millions d’euros, destiné à favoriser la croissance des PME africaines en leur apportant une ressource financière de long terme et un appui en matière de management. Il s’agit, à travers ce fonds, de prendre des participations dans des fonds d’investissement afin qu’ils en prennent à leur tour dans des entreprises ou des institutions de microfinance. L’objectif est de permettre l’émergence de gestionnaires de fonds locaux qui apporteront, en plus de leur soutien financier, un appui en termes de management, aux entreprises qu’ils soutiendront.
− La mise en place d’un nouveau fonds de garantie, également doté de 250 millions d’euros. Ce fonds de garantie doit permettre aux petites entreprises d’avoir accès au crédit bancaire et au capital en partageant le risque commercial avec les banques locales et en réduisant le risque pris par les investisseurs. Il devrait couvrir d’ici 5 ans plus de 750 millions d’euros d’encours de garantie. Ce fonds sera mis en place de façon progressive (les premiers pays concernés pourraient être Madagascar, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Mali, le Sénégal et le Ghana).
− Le doublement de l’activité de prêts et prise de participation de l’Agence française de développement (AFD) auprès du secteur privé africain qui atteindra 2 milliards d’euros au cours des cinq prochaines années. Ce doublement d’activité passera par une augmentation du capital de la filiale Proparco, qui triplera en 2008. Grâce à cette augmentation de capital, Proparco sera en mesure d’accompagner la croissance actuelle de l’Afrique en répondant à ses besoins de financement nouveaux, en particulier en matière de capital investissement et de financements longs dans les secteurs des infrastructures, des mines et des agro-industries. En engageant sur 5 ans plus de 2 milliards d’euros de prêts et de prises de participation au profit du secteur privé en Afrique, Proparco pourra catalyser ainsi 6 milliards d’investissements et créer ou maintenir 140 000 emplois.
En définitive, l’engagement financier de la France sur cette initiative portera sur un montant total de 2,5 milliards d’euros qui permettra de mobiliser 7,75 milliards d’euros grâce à l’effet d’entraînement des financements français sur d’autres investisseurs, y compris des investisseurs africains. Il devrait contribuer à soutenir 2 000 entreprises et à créer plus de 300 000 emplois.
Cette initiative en faveur de la croissance économique en Afrique témoigne d’une volonté forte de la France de réaffirmer sa présence sur le continent en participant à la mobilisation de ressources destinées à soutenir le développement du secteur privé africain.
L’objectif est de favoriser des activités génératrices d’emplois, grâce à l’apport de capitaux durables que favorise le capital-investissement. Il s’agit donc de contribuer tout autant à la croissance économique qu’au développement des pays concernés grâce à la mise en place d’activités pérennes et l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.
Aux termes de ses travaux, la Mission d’information a pris la mesure des transformations profondes qu’a connues l’Afrique au cours de la décennie ainsi que du retard de la France à les prendre en compte.
Aujourd’hui, quatre grandes crises – financière, alimentaire, énergétique et climatique – bouleversent les équilibres mondiaux et menacent les progrès réalisés sur le continent africain. L’Afrique est, par ailleurs, particulièrement vulnérable aux menaces qui concernent l’ensemble des pays, comme le terrorisme, les trafics illicites ou encore les flux migratoires. Face à ces défis, « il en va de l’intérêt général de la planète de réaliser l’énorme potentiel de croissance du continent africain » estime Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations unies, en introduction du rapport de l’Africa Progress Panel pour 2008 (114).
Et il en va évidemment de l’intérêt de la France et de la promotion des valeurs de la république. Telle est la conviction de la Mission d’information qui considère que notre pays doit maintenir une présence sur le continent. A cet égard, le lancement par Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie, de « huit chantiers» (115) témoigne de la volonté d’engager une nouvelle politique de coopération avec l’Afrique qui « bouge » et qui « entreprend ». Fondée sur le partenariat cette politique qui entend miser sur le développement économique de l’Afrique doit aussi comporter une dimension culturelle et éducative qui donne à la présence française sa spécificité.
Du fait de son histoire, la France dispose, en effet, de réels atouts en Afrique qu’elle doit valoriser là où elle est susceptible de faire la différence, par rapport à d’autres acteurs – comme les Etats-Unis ou la Chine – aujourd’hui très actifs dans cette région du monde. C’est la raison pour laquelle la Mission recommande de mettre l’accent sur une coopération bilatérale renforcée en matière d’éducation et de formation. L’éducation est, en effet, un domaine où la France a un réel avantage comparatif à faire valoir. En outre, investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir. Parallèlement, la Mission considère que la France ne peut rester à l’écart des efforts engagés en faveur du développement économique de l’Afrique. Ces dernières années ont, en effet, été marquées par un certain nombre de réussites qui témoignent du dynamisme des entrepreneurs africains, que la France doit soutenir. Dans le même temps, notre pays doit enrayer le repli de ses entreprises sur le continent, en recourant à des solutions innovantes de financement en mobilisant, par exemple, des fonds provenant des pays du Golfe.
Relance de la coopération et affirmation de la présence économique française en Afrique constituent donc les deux piliers du partenariat que la Mission d’information préconise pour appuyer le nouveau « pari » de la France en Afrique qu’elle appelle ardemment de ses vœux.
Notre pays continue de faire l’objet de fortes attentes de la part des Africains. Si l’Afrique demande à être regardée autrement dans ses relations avec ses partenaires économiques, il convient aussi que les actions de coopération et de développement que nous y menons ne soient pas exclusivement justifiées par des exigences de rentabilité.
La France doit continuer d’incarner et de défendre sur un plan politique les principes démocratiques d’égalité des chances, de respect des droits et libertés individuels, et de solidarité.
Sans le souci de préserver ces valeurs qui ne doivent pas cesser d’inspirer notre politique d’aide et de coopération, la France ne parviendra pas à refonder de façon durable la relation unique qui la lie avec l’Afrique.
ORIENTATIONS ET RECOMMANDATIONS
En partant du constat établi dans le rapport d’une Afrique qui change et d’une relation singulière avec la France menacée d’essoufflement, la Mission d’information a dégagé un certain nombre d’orientations et de propositions susceptibles de contribuer à une refondation de notre politique en direction du continent africain.
Orientations stratégiques
La France dispose de réels atouts en Afrique, qu’elle doit valoriser là où elle est susceptible de faire la différence par rapport à d’autres acteurs comme les Etats-Unis et la Chine.
La Mission d’information préconise donc d’afficher clairement l’objectif de maintenir la présence de la France en Afrique, en soutenant la stabilisation, le processus de démocratisation et le développement du continent. Dans cette perspective, la France doit recentrer les moyens dont elle dispose afin de renforcer l’efficacité mais aussi la visibilité de ses interventions.
Au-delà de ce recentrage, la France doit également adopter un style nouveau dans ses relations avec ses partenaires africains, en substituant aux formes d’intervention qui ont prévalu jusqu’alors des relations de partenariat, adaptées aux réalités non pas de l’Afrique, mais des mondes africains dans leur pluralité. Ces partenariats spécifiques concerneraient, d’une part, les partenaires traditionnels de la France avec lesquels notre pays a une langue en partage ; d’autre part, les puissances émergentes du continent africain. Ces relations de partenariat doivent, en outre, être des relations ouvertes à d’autres acteurs, en particulier le Parlement et la société civile.
Sur le fondement d’une ambition claire de maintien de la présence de la France en Afrique et d’un style nouveau dans les relations franco-africaines, plusieurs priorités s’imposent :
− Reconsidérer les finalités et le contenu des instruments traditionnels de notre politique en Afrique, conformément aux engagements pris par le Président de la République dans son discours du Cap ;
− Valoriser la relation singulière qui subsiste entre la France et ses partenaires africains dans le domaine de l’éducation et de la formation ;
− Donner un souffle nouveau à notre présence économique sur le continent, en accompagnant le développement du secteur privé africain et en renforçant l’appui apporté aux entreprises françaises.
- Soutenir les processus de démocratisation pour la généralisation d’Etats de droit.
Recommandations
Recommandation n°1 :
La Mission d’information suggère de définir des formes de partenariat spécifiques afin de mieux prendre en compte la situation de chacun de nos partenaires africains. Deux catégories de pays peuvent être distinguées : d’une part, les partenaires traditionnels de la France avec lesquels notre pays a une langue en partage ; d’autre part, les puissances émergentes du continent africain.
Dans le premier cas, la France proposerait, en fonction des priorités de chacun et des initiatives des autres bailleurs de fonds, de mettre l’accent sur des thèmes d’intérêt commun comme l’éducation.
Dans le second cas, l’objectif est de renforcer la présence française dans des pays à fort potentiel de croissance comme le Nigeria ou l’Afrique du Sud, où les actions engagées seraient davantage orientées sur le soutien au développement économique.
Recommandation n°2 :
La Mission souhaite un renforcement du rôle du Parlement français en matière de contrôle et de suivi de la politique de notre pays en Afrique.
A cette fin, elle propose l’organisation d’un débat annuel en commission sur les orientations de cette politique, en présence des ministres concernés. Ce débat pourrait s’appuyer sur les informations contenues dans un rapport, remis tous les ans par le Gouvernement, sur les réalisations de la politique conduite en Afrique, sur le modèle du rapport présenté au Parlement sur les activités du FMI et de la Banque mondiale, en application de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998.
Recommandation n°3 :
La Mission est également favorable à la création d’une commission interparlementaire « France – Parlement Pan-Africain » afin d’assurer un suivi des relations entre la France et ses partenaires africains.
Sur le modèle de la « grande commission France – Russie » qui a été mise en place à l’Assemblée nationale, cette commission permettra d’assurer un suivi, dans la durée, des relations entre la France et ses partenaires africains. Elle aura également pour objectif de consolider l’institution parlementaire à travers des discussions et échanges réguliers.
Recommandation n°4 :
La Mission estime que le nouveau partenariat entre la France et les pays africains doit dépasser le cadre interétatique traditionnel et s’ouvrir à la société civile ainsi qu’au monde des entreprises.
La réforme des sommets Afrique – France, évoquée par le président de la République dans son discours du Cap pourrait intégrer une journée préparatoire d’échanges avec différents représentants de la société civile et du monde des entreprises, dont les résultats seraient ensuite intégrés par les chefs d’Etat et de gouvernement dans leur déclaration finale.
Recommandation n°5 :
La Mission préconise d’exploiter pleinement les leviers d’action de la coopération multilatérale, qui occupe une place croissante dans les interventions de la France en faveur de la paix et de la sécurité ainsi qu’en faveur du développement de l’Afrique.
La France doit « investir » davantage les structures de l’Union européenne chargées des relations avec l’Afrique en veillant, dans le respect de l’égale représentation de toutes les nationalités, à la présence d’experts français en nombre suffisant et à des postes de responsabilité. Notre pays doit également contribuer à mieux faire connaître l’Afrique par ses partenaires européens, notamment les nouveaux Etats membres de l’Union européenne.
La France doit également poursuivre ses actions de soutien en faveur du renforcement des capacités de l’Union africaine ainsi que des communautés économiques sous-régionales.
Recommandation n°6 :
La Mission d’information suggère la définition claire d’une ligne dans laquelle s’inscrit la politique de la France en Afrique.
Ce discours pose en effet les jalons d’une réforme de la politique de la France en Afrique en évoquant la publication et la renégociation des accords de défense, la révision de la présence militaire française en fonction de l’avancement de la construction d’un dispositif africain de sécurité collective, de nouvelles modalités d’échanges dans le cadre des sommets Afrique – France, le contrôle parlementaire ainsi qu’une coopération ciblée sur l’accélération de la croissance économique en Afrique via le lancement d’une initiative de soutien à la croissance.
Le suivi du degré de réalisation de cette « feuille de route » serait évoqué lors du débat parlementaire sur la politique de la France en Afrique, proposé par la Mission d’information sur une base annuelle.
Recommandation n°7 :
En matière de coopération, la Mission recommande de renforcer les moyens de l’aide bilatérale en faveur de l’éducation et de la formation.
Cette priorité en faveur de l’éducation suppose de renforcer le soutien public à l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) afin que l’agence puisse développer son réseau d’établissements en Afrique subsaharienne. Dans le même temps, il est indispensable de renforcer les moyens consacrés au soutien de l’enseignement primaire, en orientant davantage les actions de l’Agence française de développement (AFD) en faveur de ce secteur chaque fois que cela est possible, compte tenu des priorités fixées dans les documents cadre de partenariat (DCP).
S’agissant enfin de l’enseignement supérieur, il faut adapter l’offre française de formation qui reste éloignée de certains besoins, en particulier ceux des entrepreneurs et de la sphère économique. La Mission préconise donc d’encourager les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les Chambres de métier (CM) à regrouper leurs moyens en vue de créer des « chambres consulaires » de formation d’entrepreneurs africains et de soutien à la formation professionnelle. Ces structures pourraient également être incitées à soutenir la création d’écoles de commerce africaines, sur le modèle des écoles supérieures françaises de commerce.
Par ailleurs, il est également nécessaire d’orienter davantage les étudiants africains qui viennent poursuivre leur formation en France vers des disciplines opérationnelles dans le monde des entreprises. Cette orientation suppose une plus grande sensibilisation de nos consulats en Afrique sur ces problématiques ainsi qu’une politique d’attribution des visas plus souple à l’égard de ces futurs entrepreneurs africains.
Recommandation n°8 :
En matière économique, la Mission estime nécessaire de soutenir la présence des entreprises françaises en Afrique ainsi que le développement des PME françaises.
Dans cette perspective, il importe de reconsidérer le dispositif public français de soutien aux entreprises (réseau des missions économiques), dont les dimensions ont été considérablement réduites en Afrique subsaharienne.
En termes de financement, l’objectif est de favoriser des partenariats innovants avec des fonds provenant de pays du Golfe, dans la mesure où ces derniers manifestent un intérêt croissant pour les marchés africains et apprécient le savoir-faire français.
Enfin, la France doit être davantage présente dans les activités contribuant au développement économique de l’Afrique, en particulier les activités de capital-investissement qui viennent en soutien au développement du secteur privé africain.
La commission examine le présent rapport d’information au cours de sa réunion du 17 décembre 2008.
Après l’exposé du président et du rapporteur, une discussion s’engage.
M. Jean-Marc Roubaud. L’Union africaine a été à juste titre évoquée dans le rapport, qui d’une façon générale va dans le bon sens lorsqu’il souligne le besoin d’un changement de ton et de style dans nos relations avec l’Afrique. Comment l’Union africaine perçoit-elle la mise en place de l’Union pour la Méditerranée ?
M. François Loncle. Je veux féliciter le Président et le Rapporteur de la mission pour leur travail considérable et leur rapport de qualité. J’observe, malicieusement, que, lorsque la commission des affaires étrangères confie les fonctions de président et de rapporteur d’une mission d’information respectivement à un membre du groupe SRC et à un membre du groupe UMP, ils travaillent toujours en parfaite intelligence ; en l’occurrence, ce sont deux membres du groupe UMP qui avaient été désignés et des dissensions sont apparues… Je ne commenterai pas le choix personnel fait par notre ancien collègue M. Renaud Dutreil et je salue la capacité qu’a eue M. Jacques Remiller à prendre le relais comme rapporteur.
Le constat dressé par la mission est le bon ; ses propositions sont intéressantes et notre groupe souscrit à la plupart d’entre elles. Mais on peine à dépasser l’ambiguïté fondamentale de l’influence respective dont peuvent disposer le Gouvernement et le Parlement dans les relations franco-africaines. L’exécutif a mené des actions éminemment critiquables : que l’on songe aux contradictions flagrantes qui ont eu pour protagonistes MM. Jean-Marie Bockel, Robert Bourgi et Omar Bongo ; que l’on songe également au décalage entre l’abominable discours de Dakar et le discours du Cap, prononcés par le Président de la République. Il est louable que le Parlement veuille infléchir la politique du Gouvernement mais celui-ci sait-il bien lui-même où il va ? Où est donc la rupture promise dans la politique de la France en Afrique ? Le groupe SRC, tout en souscrivant aux conclusions de la mission, y adjoindra sa propre contribution.
Le Président Axel Poniatowski. Les relations franco-africaines sont certes complexes et les actions critiquables ont été le fait de très nombreux gouvernements successifs.
M. François Loncle. Vous avez raison.
M. Jean-Pierre Dufau. Sans appartenir à la mission, j’ai suivi ses travaux avec attention et, au-delà même du contenu intéressant du rapport et des propositions qu’il formule, je veux saluer le ton employé et la hauteur de vue de la mission, dont beaucoup de responsables politiques devraient s’inspirer. Qui est « l’homme africain » ? Rien d’autre que l’homme qui vit en Afrique, ce berceau de l’humanité. Plutôt que de rôle de la France et de l’Europe en Afrique, je parlerais de responsabilité : l’histoire laisse des traces.
La mission a raison de mettre en valeur la notion de partenariat. J’ai personnellement eu l’occasion de constater que notre politique d’aide au développement était entravée par l’échec des accords de partenariat économique (APE) conclus dans le cadre de l’Accord de Cotonou, le blocage provenant de ce que les Européens imposent unilatéralement leurs vues, là où les Africains ont besoin de respect. Or, ce blocage ne fait qu’aggraver la pauvreté en Afrique.
Il est essentiel de distinguer les relations bilatérales des relations multilatérales. Dans le cadre bilatéral, la France porte une responsabilité propre. À ne pas allouer à sa coopération au développement les moyens financiers qui seraient nécessaires, elle risque de se trouver confrontée à des conséquences autrement plus coûteuses, en termes de sécurité par exemple. Dans le cadre multilatéral, il faut relancer les APE et la présidence française de l’Union européenne eût dû s’y atteler.
Gardons nous d’imposer aux pays d’Afrique, dans les réformes préconisées, un rythme trop rapide qui serait incompatible avec leurs intérêts : par exemple, une adhésion à l’OMC n’est pas envisageable sans consolidation économique interne préalable. Il n’existe pas de modèle unique de développement. Ceux qui prétendent le contraire sont mus par des intérêts propres, français ou européens, mais pas par ceux des Africains. Sans vouloir céder au pessimisme, il faut espérer que le berceau de l’humanité ne devienne pas son tombeau.
Le Président Axel Poniatowski. Je vous informe que le bureau de la commission a décidé hier de créer une mission d’information sur l’équilibre entre multilatéralisme et bilatéralisme en matière d’aide au développement, dont les travaux ne seront d’ailleurs pas limités au continent africain.
M. Michel Terrot. J’adresse mes félicitations au Président et au Rapporteur de la mission. La France n’a pas à renoncer à sa politique d’influence en Afrique, et le Président de la République a raison d’insister sur ce point à l’heure où les Chinois, les Américains ou les Britanniques consolident leurs propres positions. Il convient toutefois d’éviter toute dispersion de nos moyens d’aide bilatérale. J’estime que celle-ci doit se limiter à l’éducation et à la formation, qui participent de la défense de la francophonie, à l’heure où notre langue est malmenée en Afrique. C’est en revanche une erreur d’inclure dans notre aide bilatérale l’action sanitaire, qui relève, tout comme l’aide alimentaire, du multilatéral.
Relancer notre action bilatérale est une ardente obligation. Or nos postes diplomatiques en Afrique disposent de moyens sans cesse réduits pour ce faire ; cela justifierait la création d’une mission d’information ad hoc. J’approuve l’essentiel des conclusions du rapport, notamment en ce qu’elles tendent à redonner au bilatéralisme ses lettres de noblesse et à inciter les entreprises françaises à être davantage présentes en Afrique.
M. Jean-Paul Lecoq. Je participais hier à une rencontre avec des gouverneurs afghans, qui n’ont cessé de plaider pour le développement d’une démocratie proprement afghane. De même, je crois que la démocratie et l’économie africaines ne peuvent être conçues ailleurs qu’en Afrique ni imposées de l’extérieur, sur le mode de l’attitude de colon qu’entretient le Club de Paris en matière de rééchelonnement de dettes. L’accroissement des relations entre certains pays africains et l’Inde ou la Chine tient justement à l’attitude de ces dernières, qui ne cherchent pas à donner de leçons.
Nous avons eu, dans le cadre du débat budgétaire, des échanges qui concernaient l’Afrique, à propos de la présence française dans le monde, de l’enseignement français à l’étranger ou encore du format de notre réseau culturel. N’y a-t-il pas une contradiction entre la diminution des moyens budgétaires en cause et le souhait de renforcer les relations franco-africaines ?
Par ailleurs, la mission s’est-elle intéressée aux conséquences de la politique française en matière d’immigration sur nos relations avec l’Afrique ?
M. Dominique Souchet. Renforcer notre politique de coopération est une nécessité soulignée avec raison par le rapport. L’une des voies possibles consiste à mieux articuler la coopération décentralisée et la coopération bilatérale entre États : l’essor des cofinancements permettrait de renforcer la cohérence globale de l’aide allouée. Mais cela suppose d’augmenter les crédits de l’aide bilatérale au lieu de camoufler son insuffisance à l’abri de l’action de l’Union européenne.
Le Président Axel Poniatowski. Le recul de la présence des entreprises françaises en Afrique est préoccupant, et la proposition de la mission est bonne, qui consiste à créer, en marge des sommets France-Afrique, des journées consacrées aux entrepreneurs. Mais au-delà de ce qui ne peut être qu’une incitation et non une obligation, a-t-on une idée de la raison pour laquelle les entreprises françaises s’implantent moins sur ce continent ? N’est-ce pas une des conséquences d’un moindre interventionnisme étatique de la part de la France ?
M. Jaques Remiller, rapporteur. Je remercie l’ensemble de mes collègues pour leurs propos aimables.
En tant que rapporteur, j’ai travaillé dégagé de toute influence et sans pratiquer la langue de bois au sujet d’un continent que je connais bien pour y avoir effectué une partie de ma carrière professionnelle.
Contrairement à M. Dufau, je suis très optimiste sur l’avenir de l’Afrique. Les choses bougent sur ce continent qui a choisi de prendre son destin en main. Celui-ci lui appartient désormais, c’est le message que le rapport souhaite transmettre.
Si je partage l’ensemble des réflexions de nos collègues, je souhaite revenir sur plusieurs questions évoquées :
Ce rapport s’inscrit dans la logique du renforcement du rôle du Parlement en matière de politique étrangère prévu par la réforme constitutionnelle et par le discours du Cap pour l’Afrique. Dans ce cadre, j’espère que notre rapport fera date et que la proposition d’une commission interparlementaire entre Parlement français et Parlement panafricain retiendra l’attention.
Le lien entre l’Union pour la Méditerranée et l’Union africaine reste à préciser.
Il est essentiel de renforcer la francophonie afin de sauvegarder la langue française qui est attaquée de toutes parts. La disparition de notre langue annoncerait celle de la présence française en Afrique. A cet égard, la diminution des financements octroyés aux centres culturels français est préoccupante.
Si le renforcement de l’aide bilatérale est souhaitable de même que la renégociation des accords qui en découlent, la France doit au préalable définir clairement les contours nouveaux de sa politique en Afrique. La coopération décentralisée et son articulation avec la coopération nationale constituent également une piste de travail importante.
Parallèlement à la formation et l’éducation, la santé doit être un domaine d’action prioritaire en Afrique. J’ai souhaité que le rapport insiste sur ce point.
Le recul de la présence économique française est principalement dû au fait que les entreprises françaises peinent à s’adapter à la nouvelle donne économique en Afrique
M. Jean-Louis Christ, président. Je partage la passion du rapporteur pour l’Afrique. Je souhaite apporter des réponses sur deux points :
– sur l’Union pour la Méditerranée, M. Alpha Oumar Konaré, président de la commission de l’Union africaine nous a fait part des ses craintes de voir l’Afrique subsaharienne marginalisée par le projet d’Union pour la méditerranée alors que l’interlocuteur naturel de l’Union africaine est aujourd’hui l’Union européenne ;
– sur le recul des entreprises françaises en Afrique, le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) a mis en avant deux éléments d’explication : le premier tient à l’insécurité juridique qui règne en Afrique, le second réside dans l’attitude chinoise qui continue à pratiquer les aides liées qui faussent la concurrence en excluant les entreprises non chinoises. Je me permets de souligner également un handicap culturel : les entreprises anglo-saxonnes semblent mieux armées pour la compétition.
M. Jacques Remiller, rapporteur. En réponse à M. Lecoq, le sujet de l’immigration n’a pas été abordé dans le rapport car il mériterait une mission d’information à part entière.
M. Axel Poniatowski, président de la commission des affaires étrangères. Je vous remercie M. le président et M. le rapporteur et vous adresse mes félicitations pour la qualité de votre rapport.
La commission autorise, à l’unanimité, la publication du rapport d’information.
I. Liste des personnalités entendues par la Mission
Ministres
– M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire
– M. Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie
– Mme Rama Yade, secrétaire d’Etat chargée des affaires étrangères et des droits de l’homme
– Mme Brigitte Girardin, ancienne ministre chargée de la coopération et de la francophonie
– M. Jacques Godfrain, ancien ministre délégué à la coopération
Représentants des administrations concernées
– M. Jean-Christophe Belliard, conseiller « Afrique » de M. Javier Solana, Haut représentant de l’Union européenne pour la PESC
– Mme Maryse Bossière, directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
– Mme Nathalie Delapalme, inspectrice générale des Finances, coordinatrice de la Revue générale des politiques publiques (RGPP)
– Mme Caroline Dumas, directrice adjointe d’Afrique et de l’Océan indien au ministère des Affaires étrangères et européennes
– M. Bruno Joubert, conseiller diplomatique au Cabinet du Président de la République
– Mme Cécile Molinier, directrice du bureau de liaison du PNUD à Genève
– M. Jean-Christophe Rufin, ambassadeur de France au Sénégal
– M. Jean-Michel Severino, directeur général de l’Agence française de développement (AFD)
Représentants de la société civile
– M. Philippe Aubert, vice-président de l’association AGIRabcd
– M. Anthony Bouthelier, président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN)
– M. Justin Boum, président de l’association Aricha (association pour le retour sur investissement en capital humain en Afrique)
– M. Michel Camdessus, membre de « l’Africa Progress Panel » présidé par Kofi Annan, membre du conseil d’administration de la Fondation Chirac, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI)
– M. Thierry Chambolle, président de l’association AGIRabcd
– Mme Elise Colette, journaliste de Jeune Afrique
– M. Stephen Decam, secrétaire général du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN)
– M. Laurent d’Ersu, journaliste à La Croix
– M. Antoine Glaser, journaliste de La Lettre du Continent
– Mme Katia Herrgott, chargée de mission APD de Coordination SUD.
– M. Vincent Hugeux, journaliste de L’Express
– M. Amadou Kane, directeur de BNP Paribas Afrique
– M. Gilbert Maoundonodji, membre de la coalition tchadienne « publiez ce que vous payez »
– M. Jean Merckaert (CCFD), membre de la « plateforme citoyenne France – Afrique »
– M. Grégoire Niaudet (Secours Catholique), membre de la « plateforme citoyenne France – Afrique »
– Mme Martine Nourry, représentante du Comité de suivi de l’Appel à la paix et à la réconciliation nationale au Tchad
– M. Henri Rouillé d’Orfeuil, Président de Coordination SUD
– M. Fabrice Tarrit (Survie), membre de la « plateforme citoyenne France – Afrique »
– M. Nicolas Vercken (Oxfam), membre de la « plateforme citoyenne France – Afrique »
Chercheurs
– M. Gilles Boëtsch, président du conseil scientifique du CNRS
– M. Jean-Pierre Guegant, directeur de recherche à l’Institut de recherche sur le développement (IRD)
– M. Philippe Hugon, directeur de recherche à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRD)
– M. Gérard Prunier, chercheur au CNRS, spécialiste de la Corne de l’Afrique
Autres personnalités
– M. Jean-Lucien Bussa Tongba, député, vice-président de la commission économique et financière de l’Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
– M. Jérôme Kamate Lukundu, député, Assemblée nationale de la République démocratique du Congo
– M. Moïse Nyarugabo Muhizi, sénateur, président du groupe parlementaire RCD, Sénat de la République démocratique du Congo
– M. Mamadou Sangafowa, Directeur de cabinet du Ministre de l’agriculture de Côte d’Ivoire, membre de la direction du parti RDR en charge de l’identification
– M. Mass Walimba Katangira, président fondateur du Mouvement Mayi Mayi, responsable de la sensibilisation des mouvements armés étrangers au retour volontaire, consultant pour la Banque mondiale au titre du DDRRR, République démocratique du Congo
II. Listes des personnalités rencontrées
dans le cadre des déplacements effectués à l’étranger
Déplacement en Ethiopie
effectué par MM. Jean-Louis Christ, François Loncle et Michel Terrot,
du 15 au 18 janvier 2008
___
Représentants de l’ambassade de France
– M. Stéphane Gompertz, ambassadeur de France en Ethiopie
– Mme Sophie Moal-Makame, première conseillère
– M. Jérôme Bresson, deuxième conseiller, chargé du suivi de l’Union Africaine
– M. Dominique Gautier, deuxième conseiller, conseiller de presse
– M. Jamel Oubechou, conseiller de coopération et d’action culturelle
Membres du gouvernement éthiopien
– M. Mélès Zenawi, Premier ministre
– M. Seyoum Mesfin, ministre des Affaires étrangères
Représentants du Parlement
– M. Teshome Toga, Speaker de la chambre des Représentants des peuples (accompagné des présidents ou vice-présidents de six des treize commissions parlementaires de la chambre des Représentants)
Représentant de l’Union africaine
– M. Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union africaine, ancien président de la république du Mali
–
Autres personnalités
– Mme Gogalech Guebré, présidente de l’ONG KMG
– Le représentant du directeur de la planification stratégique et de la gestion des programmes de la Commission économique pour l’Afrique (CEA)
– Différents représentants d’organisations de la société civile, regroupées sous les auspices de « PANE » (Poverty Action Network Ethiopia)
– Différents représentants d’organisations non gouvernementales françaises (Action contre la faim, Médecins du Monde, Interaide, CIDR, Handicap international)
– Différents représentants de l’opposition : MM. Birtukan Medeksa et Temergen Zewdie (Union for Democracy and Justice), M. Lidetu Ayelew (EDUP – MEDHIN), Dr Beyene Petros (UEDF), M. Bulcha Demeksa, M. Merera Gudina
Déplacement au Ghana
effectué par MM. Jean-Louis Christ, Renaud Dutreil, Michel Terrot, Didier Mathus
du 4 au 6 juin 2008
___
Représentants de l’ambassade de France
– M. Pierre Jacquemot, Ambassadeur de France au Ghana
– Mme Evelyne Decorps, Première conseillère
Ministres et représentants du Président de la République
– M. Alhaji Aliu Mahama, Vice-président
– Mme Victoria Bright, Secrétaire d’Etat à la présidence de la République chargée des questions juridiques
– M. G. Gyan-Baffour, Secrétaire d’Etat, ministère des finances et de la planification économique
Représentants du Parlement
– M. Malik A. Yakubu, second deputy speaker et plusieurs membres de la commission des affaires étrangères
Experts
– Mme Anna Bossman, Commissaire, Commission des droits de l’homme et de la justice administrative
– M. Nat Amartfio, président du comité de l’Alliance française et ancien maire d’Accra
– Dr George Wiafe, doyen du département Oceanography & Fisheries, de l’université de Legon
– Pr Ayaa Kojo Armah, coordinateur du projet FSP régional (Proparco) – Université de Legon
– M. Tristan Fonlladosa, directeur de la Maison française
– Pr Eric Danquah, représentant du département de lettres de la Maison française
– M. Lucien Roux, directeur de l’Alliance française
– M. Filiberto Ceriani Sebregondi, chef de délégation de l’Union européenne au Ghana
Représentants des entreprises
– M. Osei-Boeh Ocansey, président du patronat ghanéen
– M. Chanel, conseiller du commerce extérieur
– M. Alain Bellissard, conseilleur du commerce extérieur
– M. Pelletier, conseiller du commerce extérieur
– M. Tranchepain, conseiller du commerce extérieur
III. Contributions des membres de la mission d’information
Contribution de Mme Henriette Martinez, députée des Hautes Alpes
Pour une coopération sanitaire renouvelée avec l’Afrique
Tous les experts internationaux et intervenants de terrain s'accordent aujourd'hui à reconnaître qu'il n'est plus de mise d’opposer développement économique et développement social, création d’entreprises et satisfaction des besoins de base, notamment en matière de santé et d'éducation. Ce constat a été clairement établi, il y a plus de dix ans, par les meilleurs économistes du monde réunis à la demande de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a directement inspiré la stratégie des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). La santé n’est pas un luxe que l’on s’offre une fois enrichi : elle est la condition même de tout développement économique et social.
La santé féminine.
Cette stratégie de développement orientée vers la santé repose notamment sur l’OMD 3 relatif à l’autonomisation des femmes. Alain Joyandet, secrétaire d’Etat à la coopération et à la francophonie, en posant comme une priorité de ses chantiers pour l'Afrique la valorisation du rôle des femmes et des filles, l’a clairement rappelé : « la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes est un vecteur incontournable de développement et de croissance ».
Les femmes sont, en effet, au centre de toutes les problématiques du développement. Leur rôle est majeur sur le plan familial comme sur le plan social. « Les femmes portent l'Afrique sur leur dos », selon le proverbe africain, précisément parce qu'elles assument l’ensemble des tâches ménagères et vivrières, en plus de leur fonction sociale première de procréation, sans toutefois avoir la maîtrise de leur fécondité. Nous sommes ici au cœur du problème que Mme Thoraya Obaïd, Directrice exécutive du FNUAP, résume ainsi : « quand une femme peut planifier sa famille elle peut planifier le reste de sa vie. »
Lors de la journée mondiale de la population, le 11 juillet 2008, qui avait pour thème « la planification est un droit, faisons-en une réalité », le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies a pu rappeler que, alors que la planification familiale permettrait à court terme de réduire d'un tiers la mortalité maternelle et infantile, 200 millions de femmes qui souhaiteraient avoir une contraception n'y ont pas accès.
D’une manière plus générale, les chiffres illustrent la tragédie que vivent les populations africaines sur le plan sanitaire. Ainsi, alors que la population d’Afrique subsaharienne ne représente que 12% de l’ensemble de la population mondiale, elle concentre :
• Les trois quarts des personnes infectées par le VIH et les deux tiers des nouvelles infections et des décès par sida,
• Plus de 50% des cas de paludisme, de mortalité maternelle et des avortements,
• un quart des décès par tuberculose.
En d’autres termes, dans des sociétés avant tout rurales, dans lesquelles le développement des agricultures vivrières est indispensable, la main d’œuvre est insuffisante pour assurer les récoltes. Lorsque les mères n’ont aucun moyen d’espacer les grossesses à répétition, que les filles aînées gardent les enfants au lieu d’être scolarisées, subissent les mariages précoces aux conséquences dramatiques en terme de santé, la moitié féminine de la population ne peut évidemment concourir au développement.
Or, comme l’explique très bien Jean-Pierre Guengant, directeur de l'IRD de Ouagadougou, ce sont les femmes pauvres qui n’ont pas accès au planning familial. La tradition n'explique pas tout, et les carences des systèmes de santé, dues au manque de volonté politique et aux difficultés budgétaires, en sont la principale cause. De telle sorte que, malgré une baisse globale de la natalité, les disparités restent grandes : ce sont en effet les pays les plus pauvres - dont 31 sur 34 se trouvent en Afrique subsaharienne – qui connaissent les taux de natalité les plus élevés avec 5,5 enfants par femme en moyenne qui entraîneront le doublement de la population de la région d’ici 30 ans.
Consécutivement, la croissance démographique quasi équivalente à la croissance économique en annule les effets et entrave le développement par habitant.
La mortalité infantile est certes en baisse. Mais sans diminution de la fertilité, de graves problèmes liés à la croissance démographique, en termes de sécurité alimentaire, d’approvisionnement en eau, d'équipements sanitaires et scolaires et de revenus par habitant persisteront. On assiste ainsi en Afrique au paradoxe de l’augmentation considérable et régulière des PIB nationaux coexistant avec la stagnation - voire la chute - non moins remarquable des PIB par habitant. Dans ces conditions, les ménages réduits à la survie ne peuvent épargner ni avoir les capacités d’emprunt et les possibilités d’investissement, qui en tous temps et en tous lieux, ont été à l’origine du développement. Or, le terreau de la paupérisation n’est évidemment pas le plus favorable au développement des entreprises, ni les carences sanitaires à celui de l'éducation…
L’aide internationale.
Sur un autre plan, il faut souligner que ni les bailleurs d’aide ni les pays africains n’ont rempli leurs engagements en matière de budgets affectés à la santé en général et à la santé reproductive en particulier.
En l’espèce, la France, comme la plupart des donateurs, a fait le choix du multilatéral. Il ne s'agit pas de le remettre en cause, mais d’y porter un regard attentif et surtout, de compléter les stratégies multilatérales axées principalement sur la lutte contre les grandes pandémies, par une politique bilatérale sanitaire active et innovante.
Des expériences réussies ont été conduites par la coopération française, qui font aujourd'hui référence. On peut ainsi évoquer la coopération triangulaire établie entre notre pays, la Tunise et le Niger dans la mise en œuvre du programme dit Kollo pour la santé maternelle et infantile, primé par le PNUD en décembre de cette année. De même, au Burkina Faso, le programme de santé maternelle « Aquasou », notamment au CMA du secteur 30 de Ouagadougou, au sein duquel le docteur Charlemagne Ouedraogo a récemment introduit des journées de réparation des mutilations génitales féminines, garantit désormais la prise en charge financière des soins obstétricaux. La coopération sanitaire des urologues français avec le service du professeur Ouattara de l'hôpital de Bamako pour la réparation des fistules obstétricales, et la formation des chirurgiens d'Afrique de l'Ouest est tout aussi remarquable, comme l’assistante technique de la France au Niger pour la mise en place de son programme national de santé grâce à l’expertise du docteur Hubert Balique.
En conséquence, à l’occasion de la nécessaire renégociation des DCP (documents cadre de partenariat) qui nous lient à nos partenaires africains, la gravité des problèmes sur le continent et la qualité de l’expertise française en la matière justifient que la thématique de la santé constitue la première priorité de la politique bilatérale de la France.
Dans le même esprit, notre pays pourrait également mettre au point, à l’instar de ce qui a été fait pour l’éducation, une procédure accélérée d’appui aux pays africains qui se doteraient d'une politique propre à atteindre au plus vite l’objectif - qu’ils se sont eux-mêmes fixé - de consacrer 15% de leurs ressources budgétaires à la santé. A ces pays, la France, comme l’ensemble des bailleurs, donnerait la priorité financière.
Dans le domaine de la santé comme dans tous les autres, le succès repose sur l’adaptation des systèmes et des procédures, et surtout des ressources humaines. Des réponses concrètes devront y être apportées en tirant les leçons de la réalité. En particulier, la question des conditions de travail et de vie minimales des professionnels de santé africains dans les zones rurales est cruciale. Il importe d'aider les nombreuses ONG qui ont fait la preuve de leur savoir-faire dans ce domaine pour que les populations reculées aient accès aux soins. En parallèle, dans les zones urbaines où un exercice privé est possible, l'AFD pourrait, par des prêts adaptés, permettre à des médecins libéraux de financer leur installation.
Avec pragmatisme, il conviendrait également de concentrer notre aide sur une formation de qualité d’agents de santé communautaires et, à un niveau supérieur, d’officiers de santé, tels qu’il en existe dans nombre de pays africains anglophones et lusophones. Vivant au sein des populations, travaillant sous le contrôle de diplômés qui bénéficieraient d'une aide pour s'installer dans les centres de santé, ils contribueraient à faire reculer de façon spectaculaire les pathologies qui accablent les populations africaines, comme ce fut le cas dans notre pays, ces dernières décennies, avant les succès de la médecine moderne.
Dans le même esprit, la France, dont l’expertise est reconnue, pourrait conseiller et soutenir les sociétés civiles africaines en matière de financement solidaire du risque maladie : des expériences positives existent, qu’il faut développer et généraliser.
La mise en œuvre de cette politique suppose, ici comme en d’autres domaines, la présence d’experts en développement, malheureusement de plus en plus rares. L’expérience de terrain reste une source de compétences inégalable et la France doit approfondir sa réflexion sur la relève de son expertise si elle entend poursuivre une coopération active et efficace avec l’Afrique.
Dans son rapport sur la santé en Afrique, l’OMS écrivait en 2006 : « Les pays africains ne pourront se développer, économiquement et socialement, que si la santé de leurs populations s’améliore nettement. On sait quelles sont les interventions sanitaires nécessaires dans la région. Tout le problème, pour les pays africains et leurs partenaires, consiste à les mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin, et le meilleur moyen d’y parvenir est de créer des systèmes de santé qui fonctionnent. »
Ainsi devons-nous établir une coopération sanitaire renouvelée avec l'Afrique, qui, à la définition d’objectifs de moyens devrait préférer en priorité l’obtention de résultats. Il convient pour ce faire d’adopter une démarche modeste mais résolue, adaptée aux situations locales, élaborée en partenariat avec les intéressés, intégrant les pratiques traditionnelles.
C'est à ce prix que l'Afrique pourra espérer atteindre les OMD, en particulier ceux relatifs à la santé et au genre, pour réunir les conditions d'un développement réellement durable.
Déclaration des 4 députés membres de la mission du groupe SRC
Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche de l’Assemblée nationale souhaitait la constitution d’une Mission d’information sur la politique de la France en Afrique. Il s’est donc félicité de sa constitution. Mais il a regretté d’avoir été écarté de son bureau. Les conclusions présentées par la Mission ont confirmé les réserves signalées à ce moment-là. Faute d’avoir eu le courage d’affronter la réalité des relations franco-africaines dans leur complexité et leurs contradictions, le travail d’auditions effectué par la Mission n’a pas été exploité comme il aurait pu l’être. Les interrogations d’hier restent celles d’aujourd’hui. Le groupe SRC a donc souhaité rappeler en conclusion de ce rapport les raisons qui rendaient nécessaire la constitution d’une Mission sur la politique africaine de la France. Il tient néanmoins à souligner la qualité du travail accompli par la mission, l’objectivité avec laquelle son président a conduit les travaux et l’intérêt des propositions formulées dans le rapport.
Les relations de la France avec l’Afrique portent la marque d’une histoire ambivalente. Les aléas de la colonisation et des indépendances, ayant maintenu un lien diplomatique, économique et culturel particulier, ont altéré la construction d’un rapport apaisé, équilibré et mutuellement profitable. Le bilan de plus d’un siècle de colonisation française et de quarante huit ans de coopération avec des Etats indépendants reste mitigé et discuté. Développement, démocratie, réduction des inégalités, construction d’Etats légitimes et efficaces, restent en 2008 trop souvent des sujets de débat plus que des réalisations concrètes.
A ces interrogations inscrites dans la durée sont venues s’en ajouter d’autres ces dernières années. La politique française à l’égard de l’Afrique a perdu cohérence et lisibilité. Entre discours de Dakar et du Cap, entre défense des intérêts économiques français, priorité donnée à la chasse aux immigrants africains et perpétuation affichée de la coopération, entre une conférence méditerranéenne qui paraît réduire le rapport à l’Afrique à sa frange nord, on peine à lire une politique répondant aux ambitions et au message d’ouverture vers les pays du sud que la France prétendait avec plus ou moins de bonheur transmettre jusque-là au continent africain. L’identité républicaine est menacée par les improvisations d’une diplomatie d’inspiration « cartiériste » et mercantiliste.
Un courant culturel et politique révisionniste de plus en plus influent a pris corps en France. Il tend à considérer que le mal développement est une affaire récente dont la responsabilité incombe aux seuls Africains, la colonisation ayant été une expérience positive. Les députés SRC ont critiqué comme étant sans fondement la proposition de loi adoptée par les élus de l’UMP prétendant réhabiliter la période coloniale. La page de cette loi a été heureusement tournée par le président Chirac. Mais le discours prononcé à Dakar le 26 juillet 2007 par le président Sarkozy en a relégitimé l’esprit.
Dans le quotidien « Libération », le 24 février 2006, Christophe Girard et Louis-Georges Tin ont illustré de façon spectaculaire et démonstrative, les raisons pour lesquelles la loi réhabilitant la colonisation adoptée le 23 février 2005 est une loi qui ne fait pas honneur à notre Assemblée et à notre pays. La parabole est la suivante : « Imaginons une famille tranquille vivant dans sa petite maison. Surviennent des soldats. Trucident le père, violent la mère, et les filles, battent les fils et les boutent hors de céans. Les soldats s’installent, se sentent chez eux. La mère est désormais la bonne. Ils réparent le toit, plantent des pétunias dans le jardin, des vignes dans les champs alentour, construisent des routes pour acheminer la marchandise vers la ville. Mais, vingt ans plus tard, les fils reviennent en force, portent secours à leur mère et à leurs sœurs et chassent les importuns hors de la maison natale. Comment disent les soldats-entrepreneurs. On nous chasse de chez nous ? Après tout ce que nous avons fait ? Notre rôle dans la maison n’était-il pas positif ? ».
2007 a également été marquée par une double rupture dans la relation franco-africaine. Une rupture quantitative. L’APD, l’aide publique au développement est entrée dans une phase déclinante. Cette aide a été orientée vers la recherche prioritaire du retour sur investissement, dimension légitime mais qui relève du commerce extérieur dont c’est la vocation, et non de la coopération. La rupture souhaitée par le chef de l’Etat a également été qualitative. La politique à l’égard de l’Afrique semble s’exercer désormais à partir d’une priorité sécuritaire. Le rapport à l’Afrique en effet relève aujourd’hui de la compétence préférentielle du ministre de l’identité nationale et de la lutte contre l’immigration. L’homme africain selon le président Nicolas Sarkozy, «n’a jamais l’idée de sortir de la répétition pour s’inventer un destin ». Paradoxalement ceux et celles qui voudraient venir en France pour « s’inventer un destin », étudier, participer à des rencontres sportives, travailler, se voient imposer un test ADN.
Quelle est la cohérence d’une politique, qui condamne « l’homme africain », et maintient paradoxalement une politique de coopération ? Quelle est la cohérence d’une politique qui prétend aider « l’homme africain » en réduisant les budgets d’aide au développement ? Quelle est la cohérence d’une politique qui se dit généreuse et conditionne sous couvert de co-développement le soutien budgétaire à l’acceptation de tests ADN ?
Le groupe SRC considère qu’il convient dans le rapport de la France avec l’Afrique d’éviter trois écueils, aujourd’hui trop présents : le paternalisme, le cynisme, et la tentation du retrait. La coopération française doit au plus tôt rompre avec un passé de donneur de leçon, avare de ses deniers, et trop souvent complice de responsables locaux prédateurs de leurs nationaux. Il lui faut refonder sa relation avec le continent noir. Elle doit le faire en repensant les logiques d’aide qui relèvent trop souvent de la charité internationale. La solidarité est une clef pour sortir du mal développement. Son objet n’est pas de satisfaire l’altruisme épisodique du sac de riz médiatisé par nos télévisions afin de compenser des carences émotionnelles. L’aide doit permettre aux peuples qui pour de multiples raisons,- la colonisation étant l’une d’entre elles-, ont manqué leur rencontre avec le développement, de se remettre dans le train du progrès économique et social.
Pour le groupe SRC l’esprit et les orientations de la nouvelle politique africaine de la France en rupture avec l’évolution engagée à La Baule marquent une inquiétante régression. Cette rupture conservatrice a des conséquences à long terme qui auraient du être prises en compte, identifiées, analysées et faire l’objet de recommandations circonstanciées. Le groupe SRC regrette que cela n’ait pas été le cas. Afin de pallier cette carence le parlement doit être à même de jouer un rôle plus dynamique. Il doit ajouter au contrôle traditionnel a posteriori de l’action du gouvernement une dimension diplomatique et de proposition.
En conséquence de quoi le groupe SRC propose que le rapport annuel remis avec retard par le gouvernement sur ses activités au sein des institutions internationales financières et de développement fasse l’objet d’un double rapport inscrit dans le calendrier budgétaire par les commissions des affaires étrangères et des finances.
Les députés du groupe SRC se félicitent que le rapport prenne en compte la nécessité de soumettre la politique de la France en Afrique au contrôle parlementaire et citoyen. Ils souhaitent en outre que la coopération au développement soit réellement destinée à la lutte contre la pauvreté et approuvent les priorités fixées par la mission s’agissant de l’éducation et de la santé. Ils demandent que la problématique des droits de l’homme parmi les conditions de la coopération ne s’efface pas devant des considérations de realpolitik. Ils estiment qu’une évaluation doit être menée pour conduire à un équilibre entre le cadre multilatéral et bilatéral. Les députés du groupe SRC considèrent enfin que la présence militaire doit être de plus en plus multilatéralisée et réellement transparente, c'est-à-dire encadrée par le parlement.
1 () Audition du 30 janvier 2008.
2 () Se reporter à « La fin du pacte colonial ? », rédaction de la revue Politique africaine, n°105, mars 2007.
3 () Alain Antil, « La politique africaine a besoin de lisibilité », La Tribune, 10 décembre 2007.
4 () Philippe Bernard, « L’image très dégradée de la France en Afrique », Le Monde, 26 avril 2008.
5 () Audition du 23 janvier 2008.
6 () Jean-Marc Châtaigner, « Principes et réalités de la politique africaine en France », Afrique contemporaine, n°220, 2006-4.
7 () Vincent Hugeux, journaliste de L’Express lors de l’audition du 23 janvier 2008.
8 () Audition de représentants d’ONG réunies au sein de la « plateforme citoyenne France – Afrique », 9 avril 2008.
9 () Collectif Capafrique, « Il faut à la France une nouvelle stratégie africaine », Le Figaro, 29 février 2008.
10 () Jean-Marc Châtaigner, art. cit.
11 () Se reporter au rapport d’information n°3694 de la mission parlementaire sur la situation des Français rapatriés de Côte d’Ivoire, présidée par M. Eric Raoult et dont le rapporteur était M. Jean-Luc Reitzer – 13 février 2007.
12 () Philippe Hugon, « La politique économique de la France en Afrique. La fin des rentes coloniales ? », Politique africaine, n°105, mars 2007.
13 () Audition du 14 mai 2008.
14 () Entretien avec Anthony Bouthelier, Commerce international, 30 avril 2007.
15 () Serge Michel et Michel Beuret, La Chinafrique – Pékin à la conquête du continent, Grasset, mai 2008.
16 () Audition du 30 avril 2008.
17 () Serge Michel et Michel Beuret, op. cit.
18 () Elise Colette, journaliste de Jeune Afrique, audition du 23 janvier 2008.
19 () Philippe Hugon, art. cit..
20 () Philippe Hugon, audition du 14 mai 2008.
21 () Se reporter notamment à l’article de Julien Meimon, « Que reste-t-il de la Coopération française ? », Politique africaine, n°105, mars 2007.
22 () A l’heure actuelle, la ZSP comprend 55 pays dont 43 en Afrique.
23 () Henriette Martinez, rapport n°189, 11 octobre 2007.
24 () Jean-Marc Châtaigner, art. cit.
25 () Audition d’Henri Rouillé d’Orfeuil, président de Coordination SUD, et de Katia Herrgott, chargée de mission APD de Coordination SUD – 16 avril 2008.
26 () Entre 2001 et 2006, le montant annuel des annulations de dette nettes a été multiplié par 7, passant de 366 millions à 2,7 milliards d’euros. Les estimations pour 2007 et 2008 s’élèvent à 1,3 milliard d’euros et 2,7 milliards d’euros respectivement.
27 () Comité d’aide au développement, OCDE, Examen des politiques et programmes de la France en matière de coopération pour le développement, mai 2008.
28 () Comité d’aide au développement, OCDE, ibid.
29 () Africa Progress Report, Le développement en Afrique : promesses et perspectives, juin 2008.
30 () Anne Androuais, « Japon et Afrique : la genèse de relations économiques », Afrique contemporaine, n°212, 2004-4.
31 () Philippe Hugon, art. cit.
32 () Audition du 23 janvier 2008.
33 () Nathalie Delapalme, « La relation Union européenne – Afrique : un partenariat stratégique », L’état de l’Union 2008, rapport Schuman sur l’Europe.
34 () Ibid.
35 () Conclusions des chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Conseil européen à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005.
36 () Nathalie Delapalme, art. cit.
37 () Cette aide provient principalement du budget de l’Union et du Fonds européen de développement (FED)
38 () L’aide bilatérale totale des Etats-Unis à l’Afrique a été multipliée par 2,8 entre 2000 et 2004 et l’aide à l’Afrique subsaharienne est passée de 1,580 milliards de dollars en 2000 à 3,636 milliards de dollars en 2004.
39 () Niger, Mali, Tchad, Mauritanie, Algérie, Maroc, Nigeria, Sénégal et Tunisie.
40 () Bureau des programmes d’information internationale du département d’Etat.
41 () Tanguy Struye de Swielande, « Washington redécouvre l’Afrique subsaharienne », Défense nationale et sécurité collective, mai 2008.
42 () En 2007, les exportations africaines aux Etats-Unis dans le cadre de l’AGOA se sont élevées à plus de 50 milliards de dollars, soit plus de six fois leur montant de 2001, première année entière d’application de cette loi. Au cours de cette période, les exportations américaines à destination de l’Afrique ont doublé, atteignant plus de 14 milliards de dollars.
43 () A l’issue de la tournée du président Bush en Afrique en février 2008 (Bénin, Ghana, Liberia, Rwanda et Tanzanie), 7 nouveaux fonds d’investissement verront le jour dans le cadre de cette initiative, mobilisant plus de 1,6 milliard de dollars.
44 () Lors de son dernier déplacement en Afrique, le président George W. Bush a signé un accord de 698 millions de dollars avec la Tanzanie, soit l’accord le plus important du Fonds du millénaire à ce jour.
45 () Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique. Le Sommet de la quatrième conférence (TICAD IV) s’est tenu du 28 au 30 mai 2008 à Yokohama, au Japon.
46 () Serge Michel et Michel Beuret, op. cit.
47 () François Lafargue, « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », Afrique contemporaine, n°219, 2006/3.
48 () A partir de 1870, l’Afrique du Sud a connu plusieurs vagues d’immigration en provenance de Chine tandis que les premiers ressortissants chinois à Maurice s’y sont installés dès 1920 (ils représentent aujourd’hui entre 2 et 3 % de la population mauricienne).
49 () François Lafargue, « La rivalité entre la Chine et l’Inde en Afrique australe », Afrique contemporaine, n°222, 2007/2.
50 () L’Afrique contient environ 30 % des réserves mondiales en minéraux, dont 40 % de l’or, 60 % du cobalt et 90 % du platine.
51 () OCDE, L’essor de la Chine et de l’Inde : quels enjeux pour l’Afrique ?, 2006.
52 () Banque mondiale (Harry G. Broadman), La Route de la soie en Afrique : nouvel horizon économique pour la Chine et l’Inde, septembre 2006.
53 () Serge Michel, « En Angola, son premier partenaire africain, la Chine essuie plusieurs revers », Le Monde, 23 mai 2008.
54 () OCDE, Perspectives économiques de l’Afrique 2007 / 2008. Ces Perspectives sont le fruit d’un projet conjoint de la Banque africaine de développement, du Centre de développement de l’OCDE et de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.
55 () François Lafargue, « L’Inde en Afrique : logiques et limites d’une politique », Afrique contemporaine, n°219, 2006/3.
56 () Jean-Michel Severino, « Les pays émergents entrent dans le cercle vertueux des nouveaux donateurs », Le Monde, 19 avril 2006.
57 () René Dumont, L’Afrique noire est mal partie, 1962.
58 () Axelle Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement ?, L’Harmattan, 1991.
59 () Notre intérêt commun, rapport de la Commission pour l’Afrique, mars 2005.
60 () Se reporter notamment à Cinquante Afrique, Claude Wauthier et Hervé Bourges, Le Seuil, 1979.
61 () Entretien avec Bruno Joubert, Conseiller diplomatique au Cabinet du Président de la République – 2 avril 2008.
62 () Audition du 30 janvier 2008.
63 () Ethiopie, Ghana, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda.
64 () Les principales évolutions, rappelées ci-après, sont extraites de l’ouvrage collectif : L’Afrique face à ses défis démographiques – un avenir incertain, paru en novembre 2007 aux éditions Karthala.
65 () Audition du 21 mai 2008.
66 () L’Afrique face à ses défis démographiques – un avenir incertain, Karthala, novembre 2007.
67 () L’Afrique et les objectifs du Millénaire pour le développement : le point en 2007.
68 () Perspectives économiques africaines 2008, OCDE, Banque africaine de développement et Commission économique pour l’Afrique des Nations unies, avec le soutien de la Commission européenne.
69 () Communiqué de presse n°:2008/080/DEC
70 () FMI, Perspectives économiques régionales – Afrique subsaharienne, avril 2008.
71 () Audition du 14 mai 2008.
72 () 9ème réunion du Forum pour le partenariat avec l’Afrique (FPA), Alger, 12-13 novembre 2007.
73 () PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008, La lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé.
74 () Audition du 30 janvier 2008.
75 () Philippe Hugon, audition du 14 mai 2008.
76 () OCDE, Perspectives économiques africaines 2008, op. cit..
77 () Celles prévues en Côte d’Ivoire pour 2008 seront vraisemblablement reportées au premier semestre 2009 mais le processus devrait néanmoins suivre son cours dans des délais raisonnables et dans des conditions normales.
78 () D’après le dossier de la Documentation française : « Maintien de la paix dans le monde : l’ONU et les acteurs régionaux ».
79 () Les milliards manquants de l’Afrique, rapport publié en octobre 2007.
80 () Rapport sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique, octobre 2004.
81 () OCDE, op. cit.
82 () Les organisations internationales distinguent généralement quatre catégories de pays en Afrique subsaharienne : les pays exportateurs de pétrole, les pays à revenu intermédiaire, les pays à faible revenu et les Etats fragiles.
83 () OCDE, Perspectives économiques en Afrique 2007/2008, op. cit.
84 () Votre rapporteur attire l’attention sur le fait que les données présentées dans ce tableau sont antérieures à la crise financière. Les estimations pour 2008 et, a fortiori, les projections pour 2009, doivent être prises avec prudence. Dans la mesure où elles reflètent une tendance d’ensemble, votre rapporteur a considéré utile de les laisser figurer dans son rapport, sous cette réserve.
85 () Audition du 21 novembre 2007.
86 () Audition du 14 mai 2008.
87 ()Cf. supra, A.- L’Afrique, terre de déséquilibres, p. 43.
88 () À l’heure actuelle, les trois régions les plus avancées sont la CEDEAO, la SADC et l’Afrique de l’Est avec la création d’un organisme ad hoc, l’EASBRICOM.
89 () Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan et Zambie.
90 () Common Market for Eastern and Southern Africa
91 () East African Community
92 () Southern Africa Customs Union
93 () Southern African Development Community
94 () Audition du 30 janvier 2008.
95 () Hubert Védrine, La France et la mondialisation, rapport remis au président de la République en septembre 2007.
96 () Audition du 30 janvier 2008.
97 () Audition par la commission des Affaires étrangères d’Alain Juppé, président de la Commission du Livre Blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, 18 juin 2008.
98 () Plateforme citoyenne France – Afrique, Livre blanc pour une politique de la France en Afrique responsable et transparente, L’Harmattan, 2007.
99 () Se reporter au Livre blanc précité, édité par la « Plateforme citoyenne France – Afrique », fin 2007.
100 () Audition du 30 avril 2008.
101 () Jean-Marc Châtaigner, art. cit.
102 () Audition du 9 janvier 2008.
103 () « La France n’a pas vocation à maintenir indéfiniment des forces armées en Afrique (…) »
104 () Synthèse de la consultation des postes diplomatiques sur le thème de la politique africaine de la France, janvier 2008.
105 () Audition de Maryse Bossière, directrice de l’AEFE – 14 mai 2008.
106 () Audition du 21 novembre 2007.
107 () Initiative présentée lors de l’audition de Gilles Boëtsch, 25 juin 2008.
108 () Audition de Nathalie Delapalme, 9 avril 2008.
109 () Proposition avancée par les représentants du CIAN devant la Mission d’information le 30 avril 2008.
110 () Michaël Cheylan, « Pour les pays du Golfe, l’Afrique ne se limite plus au Maghreb », Afrik.com, 28 juin 2007.
111 () Audition du 14 mai 2008.
112 () Thomas Dickinson, « Le capital-investissement : à la pointe des opportunités sous les cieux africains ? », Repères n°60, OCDE 2008.
113 () À l’origine du capital-risque en Afrique se trouvent également d’autres agences européennes de développement comme l’allemande DEG, la finlandaise Finnfund ou la norvégienne Nordfund ainsi que la Société financière internationale (SFI), filiale de la Banque mondiale. Se reporter à l’article d’Arnaud Lacordaire, « Faites vos jeux ! », Jeune Afrique, 31 octobre 2005.
114 () Le développement en Afrique : promesses et perspectives, rapport 2008 de l’Africa Progress Panel.
115 () Conférence de presse du 19 juin 2008 qui met notamment l’accent sur la relance des agricultures africaines, le rôle des femmes, le triplement des volontaires internationaux et l’augmentation du soutien financier aux ONG.
© Assemblée nationale